Assemblée nationale
27 janvier 1999
RAPPORT
DU GROUPE DE TRAVAIL SUR L’EFFICACITÉ DE LA
DÉPENSE PUBLIQUE ET LE CONTRÔLE PARLEMENTAIRE (1)
Président
M. Laurent FABIUS,
Rapporteur
M. Didier MIGAUD,
Députés.
——
TOME I
Rapport
(1) Ce groupe de travail est composé de :
M. Laurent FABIUS, président de l’Assemblée nationale, président,
M. Augustin BONREPAUX, président de la Commission des finances, vice-président,
M. Didier MIGAUD, rapporteur général de la Commission des finances,
rapporteur ; MM. Philippe AUBERGER, Dominique BAERT, Jacques BRUNHES, Gilles
CARREZ, Yves COCHET, Christian CUVILLIEZ, Laurent DOMINATI, Roger FRANZONI, Gérard FUCHS,
François GOULARD, Jean-Jacques JÉGOU, Pierre MÉHAIGNERIE, Michel SUCHOD.
SOMMAIRE
____
AVANT-PROPOS DU PRÉSIDENT
INTRODUCTION
PREMIÈRE PARTIE : LA PROBLÉMATIQUE BUDGÉTAIRE AUJOURD’HUI
I.- LA MAÎTRISE DE LA DÉPENSE PUBLIQUE : DOGME OU NÉCESSITÉ ?
A.- L’ÉVOLUTION DES DÉPENSES PUBLIQUES EN
FRANCE SUR LONGUE PÉRIODE ET LEURS EFFETS SUR L’ÉCONOMIE
1.- L’évolution au cours de la période
1949-1992
a) La dépense publique : une croissance qui reste forte
malgré un ralentissement récent
b) Le déficit budgétaire réapparaît avec la crise
2.- L’évolution postérieure
a) Une amélioration encore insuffisante des comptes
publics
b) Les prélèvements obligatoires : une notion dont il faut
bien apprécier la portée
c) Dépense publique et croissance : d’incontestables
interférences
B.- LA COMPARAISON INTERNATIONALE DES
DÉPENSES PUBLIQUES
1.- Les finances publiques dans l’Union
européenne
2.- Les dépenses publiques dans le monde
C.- RESTREINDRE L’ENDETTEMENT PUBLIC
SANS SE TROMPER DE CIBLE
1.- Les risques liés à l’endettement
public
2.- La limitation de l’endettement public passe par un
dosage fin entre maîtrise des dépenses et réforme de la fiscalité
II.- LA POURSUITE DE l’ASSAINISSEMENT DES FINANCES
PUBLIQUES DOIT ÊTRE ASSOCIÉE AU SOUTIEN À LA CROISSANCE
A.- PRIVILÉGIER LES DÉPENSES FAVORABLES À LA
CROISSANCE
B.- COORDONNER LES POLITIQUES BUDGÉTAIRES AU
SEIN DE L’UNION EUROPÉENNE POUR ASSURER LE SOUTIEN DE L’ACTIVITÉ
C.- PROGRAMMER LES DÉPENSES SUR PLUSIEURS ANNÉES ET
GÉNÉRALISER L’ÉVALUATION DES RÉSULTATS
1.- Les avantages d’une vision
pluriannuelle des dépenses
2.- L’évaluation doit devenir un outil d’aide à la
décision budgétaire
DEUXIÈME PARTIE : ACTUELLEMENT, LE PARLEMENT NE CONTRIBUE PAS
FORTEMENT À L’AMÉLIORATION DE L’EFFICACITÉ DE LA DÉPENSE PUBLIQUE
I.- BIEN QUE NOTRE PROCÉDURE BUDGÉTAIRE SOUFFRE D’UN MANQUE
DE TRANSPARENCE, LES PRÉROGATIVES DU PARLEMENT LUI PERMETTENT, EN THEORIE, D’AGIR
SUR LA DÉPENSE PUBLIQUE
A.- LA TRANSPARENCE DE NOTRE PROCÉDURE
BUDGÉTAIRE EST INSUFFISANTE
1.- Un manque de lisibilité constant
a) Des lacunes importantes
b) Certains progrès récents
2.- Une crédibilité parfois contestable
a) Un certain monopole d’expertise au profit du
Gouvernement
b) Une difficile révision du projet de loi de finances
3.- Une sincérité parfois sujette à caution
a) Des artifices de présentation
b) Un contrôle récent du Conseil constitutionnel
B.- LES PRÉROGATIVES DU
PARLEMENT LUI PERMETTENT, EN THÉORIEr, D’AGIR SUR LA DÉPENSE PUBLIQUE
1.- Des pouvoirs dont la réalité et
l’étendue prêtent à discussion
a) Des pouvoirs dont la portée n’est pas toujours
évaluée à sa juste valeur
b) Des effets pervers
2.- Une autorisation parlementaire souvent
contournée lors de l’exécution du budget
a) Une gestion des crédits budgétaires à la discrétion du
Gouvernement
b) Une pratique de la régulation budgétaire peu respectueuse des
prérogatives du Parlement
II.- MAIS, LE PARLEMENT N’A EU, JUSQUE LÀ, NI LA FERME
VOLONTÉ DE CONTRÔLER LA DÉPENSE PUBLIQUE, NI LES MOYENS D’EN ÉVALUER LES
PERFORMANCES
A.- LE PARLEMENT EST, THÉORIQUEMENT, EN MESURE
DE CONTRÔLER LA DÉPENSE PUBLIQUE
1.- Des pouvoirs étendus
a) Des attributions importantes
b) Une information abondante
c) L’assistance de la Cour des comptes
2.- Des pouvoirs sous-utilisés
a) Un bilan sévère
b) Une explication complexe
B.- LE PARLEMENT N’EST PAS, EN
REVANCHE, EN MESURE D’ÉVALUER L’EFFICACITÉ DE LA DÉPENSE PUBLIQUE
1.- Une pénurie d’instruments
a) Des notes d’impact largement insuffisante
b) Des simulations en matière fiscale rarissimes
c) Des rapports de contrôle encore trop confidentiels
d) Un Office d’évaluation des politiques publiques peu efficace
2.- Une indispensable évaluation de la
dépense publique
a) Des retards préoccupants
b) Un changement impératif
TROISIÈME PARTIE : LE PLEIN EXERCICE, PAR LE PARLEMENT, DE SA
FONCTION DE CONTRÔLE ET D’ÉVALUATION DES DÉPENSES PUBLIQUES RENDRA INDISPENSABLES
DES RÉFORMES PLUS PROFONDES TOUCHANT AU FONCTIONNEMENT MÊME DE L’ÉTAT
I.- LES RÉFORMES IMMÉDIATEMENT OPÉRATIONNELLES POUR UNE NOUVELLE
ORIENTATION DU RÔLE DU PARLEMENT
A.- DU CONTRÔLE À L’ÉVALUATION : DES
FONCTIONS PRIORITAIRES EXERCÉES PAR LA PLUPART DES PARLEMENTS ÉTRANGERS
1.- Distinguer contrôle et évaluation
2.- Les exemples étrangers
B.- RENFORCER LE CONTRÔLE DE
L’ASSEMBLÉE NATIONALE À TOUS LES STADES DE LA PROCÉDURE BUDGÉTAIRE
1.- Un débat contradictoire pour une
programmation pluriannuelle des finances publiques
2.- Un véritable contrôle de l’exécution des lois de
finances
3.- Le contrôle de l’emploi des crédits tout au long de
l’année
4.- Approfondir les liens avec la Cour des comptes
C.- INTRODUIRE ET SYSTÉMATISER
L’ÉVALUATION DE LA DÉPENSE PUBLIQUE À l’ASSEMBLÉE
1.- Les exemples d’évaluation à
l’Assemblée
2.- L’indispensable évaluation des services votés
3.- Les moyens pour agir
D.- UNE PLUS GRANDE VOLONTÉ DE DÉBAT
DÉMOCRATIQUE
1.- Améliorer la transparence
2.- Renforcer la démocratie
3.- Concevoir un nouveau rythme d’exercice du pouvoir
financier
II.- L’URGENCE DE LA RÉNOVATION DU FONCTIONNEMENT DE
L’ÉTAT
A.- LA RÉFORME INTROUVABLE ?
1.- Un état des lieux complet effectué en
1994
a) Achever la décentralisation
b) Renforcer le débat public et prévenir les difficultés
c) Légiférer avec mesure
2.- Une réforme en permanente gestation
3.- La politique patrimoniale de l’État au coeur de la
réforme
a) Prendre la mesure de l’insuffisance des informations
financières et comptables disponibles
b) Vers une modernisation de la comptabilité et une rénovation de la
gestion
B.- UNE PROCÉDURE BUDGÉTAIRE RÉNOVÉE, AU
SERVICE D’UNE ÉFFICACITÉ ACCRUE DE LA DÉPENSE PUBLIQUE
1.- Remédier au défaut de transparence de
notre procédure budgétaire
a) Renforcer la lisibilité des finances publiques
b) Améliorer la sincérité des comptes publics
2.- Améliorer les performances de la
dépense publique
a) Placer le Parlement au coeur du débat sur l’efficacité de
la dépense publique
b) Introduire une gestion plus souple de la dépense publique
3.- Rendre l’exécution budgétaire
plus respectueuse de l’autorisation délivrée par le Parlement
a) Tenir informé le Parlement de l’exécution du budget
b) Encadrer la mise en oeuvre des mesures de régulation budgétaire
RÉSUMÉ DES PROPOSITIONS
DÉCLARATIONS DE GROUPES POLITIQUES
LISTE DES PERSONNALITÉS ENTENDUES PAR LE GROUPE DE
TRAVAIL
ANNEXE : ÉLÉMENTS DE COMPARAISON ENTRE LES SYSTÈMES
BRITANNIQUES ET FRANÇAIS D’ÉVALUATION
Avant-propos du Président
En octobre dernier, j’ai souhaité constituer un groupe de
travail, composé de députés appartenant à tous les groupes politiques, pour aborder ce
qui m’apparaît comme l’un des grands chantiers des prochaines années :
l’efficacité de la dépense publique. Je les remercie très chaleureusement pour
leur participation assidue à nos travaux et pour la qualité de leurs réflexions. Je
tiens aussi à remercier vivement les personnalités que nous avons entendues. Elles ont
su nous faire partager leurs analyses stimulantes, parfois dérangeantes, et je crois que
notre groupe de travail aura su faire son miel de leurs analyses et propositions.
Il faut partir d’un constat simple : depuis trente ans,
la dépense publique n’a cessé d’augmenter. Doublement des dépenses de
l’Etat en francs constants, multiplication par cinq des dépenses locales,
multiplication par huit des dépenses de la sécurité sociale. Or, il n’est pas
certain – c’est même l’inverse ! – que l’argent public
soit toujours dépensé au mieux, et cela en dépit des contrôles qui peuvent être
exercés par le Parlement, par la Cour des comptes ou par les corps d’inspection.
Pour ne prendre qu’un exemple, le directeur de la Caisse nationale d’assurance
maladie n’estimait-il pas récemment qu’on pourrait économiser
100 milliards de francs sur les dépenses de santé, sans porter atteinte à la
qualité des soins ?
Les prélèvements obligatoires ont bien sûr suivi cette ascension des
dépenses. Ils atteignent aujourd’hui le niveau record de 46 % du PIB, quatre
points au-dessus de la moyenne de l’Union européenne. La libre circulation et
l’euro mettent désormais les Etats en concurrence et les exposent à des risques de
délocalisation, des capitaux et des entreprises, et donc à terme un risque de
paupérisation.
Face à une dépense publique qui a explosé, les pouvoirs
budgétaires du Parlement n’ont guère évolué, même si, grâce à la révision
constitutionnelle de 1996, celui-ci a obtenu un droit de regard sur les finances de la
Sécurité sociale, dont les crédits dépassent ceux du budget de l’Etat.
Pendant quatre mois, notre groupe de travail a exploré diverses pistes
pour essayer de répondre à une question qui apparaît centrale, alors que les ressources
publiques sont rares : " Comment dépenser mieux pour prélever
moins ? ". C’est une question qui préoccupe directement les
entreprises, qui procèdent de plus en plus à une évaluation qualité-prix des services
que leur offrent les Etats. C’est une question qui intéresse tout autant les
citoyens qui ont rarement le sentiment d’ " en avoir pour leur
argent ", c’est-à-dire de bénéficier de services à la mesure des
impôts qu’ils paient.
Nous avons, cela va de soi, auditionné aussi des représentants du
gouvernement. Celui-ci est bien conscient de l’enjeu et il a lui-même, par la bouche
de Dominique Strauss-Kahn et de Christian Sautter, avancé devant nous des propositions
allant dans le sens de nos préoccupations. Nous aurons, évidemment, besoin de lui pour
améliorer la situation.
*
* *
Une première conclusion à laquelle le groupe de travail est arrivé,
c’est que dépenser mieux suppose que les Assemblées contrôlent réellement
dépenses et recettes, ainsi que l’efficacité de celles-ci. Cela implique de placer
désormais l’évaluation et le contrôle au cœur de l’activité budgétaire
du Parlement. Je ne pense pas que cela viendra de l’Administration elle-même,
qui ne peut pas être juge et partie. Le Parlement, lui, dispose de la légitimité pour
faire respecter les articles XIII et XIV de la Déclaration des droits de l’Homme et
du Citoyen : " Tous les Citoyens ont le droit de constater, par
eux-mêmes ou leurs Représentants, la nécessité de la contribution publique… La
Société a le droit de demander compte à tout Agent public de son administration ".
· Dans cet esprit, une première
série de mesures que nous proposons dépend exclusivement du Parlement. Elle pourra et
devra être mise en œuvre, pour ce qui concerne l’Assemblée Nationale, dès les
prochaines semaines. Ces mesures s’inspirent en large partie de l’expérience
britannique, où une collaboration étroite entre le National Audit Office et la
Chambre des Communes a permis à cette dernière de retrouver un vrai pouvoir de contrôle
sur l’utilisation des fonds publics. La volonté du Premier Président de la Cour
des comptes d’appliquer pleinement l’article 47 de la Constitution ne peut
que nous inciter à aller dans ce sens.
Une mission d’évaluation et de contrôle (MEC) sera donc
constituée. Composée de membres de la commission des finances et élargie, en fonction
des sujets, aux rapporteurs pour avis des autres commissions, cette mission procédera à
des auditions chaque semaine, durant tout le premier semestre. Elle aura pour tâche à la
fois de préparer les auditions des responsables politiques et administratifs sur la
gestion de leurs crédits et de mener des investigations approfondies sur quatre ou cinq
politiques publiques.
Les auditions seront préparées, en liaison étroite avec la Cour
des comptes, par des missions de contrôle sur pièces et sur place. Les
investigations devront être menées dans un esprit non partisan. C’est
l’administration qu’il s’agit de contrôler, beaucoup plus que le
gouvernement. Dans ce contexte, la présidence de la mission sera exercée
conjointement par le président de la commission des finances et par un membre de l’opposition,
les travaux de la mission étant animés et coordonnés par le rapporteur général, qui
appartient traditionnellement à la majorité. De même, les contrôles sur pièces et sur
place seront désormais menés conjointement par un rapporteur spécial appartenant
à la majorité et par un rapporteur pour avis appartenant à l’opposition, ou
inversement. Les auditions de la mission seront publiques et retransmises
sur la chaîne de télévision parlementaire.
Nous souhaitons en outre qu’une séance de questions au
gouvernement soit consacrée, chaque mois, à l’examen d’une
politique publique, durant laquelle le ministre concerné sera, pendant une heure, soumis
à des questions ciblées.
La transformation de l’intitulé de la Commission des finances en
une Commission des finances, de l’économie, de l’évaluation et du contrôle
traduira, sur le plan réglementaire, l’élargissement de ses missions. Ses
capacités d’expertise seront renforcées, pour qu’elle puisse
véritablement dialoguer avec le gouvernement. Elle sera, en particulier, dotée
d’une banque de données budgétaires et financières lui permettant de
procéder à ses propres simulations.
Au-delà, ce sont toutes les commissions qui devront être étroitement
associées au travail d’évaluation et de contrôle, qui doit constituer le
préalable à une autorisation budgétaire éclairée.
Ÿ Une deuxième série de
mesures, touchant à l’organisation du débat budgétaire, vise à lui apporter les
améliorations indispensables et à redonner leur sens à l’autorisation de la
dépense publique et au consentement à l’impôt.
Nous proposons que le débat budgétaire soit désormais structuré
autour de deux temps forts, le premier au printemps, le second à l’automne.
De manière à privilégier la discussion des grandes orientations
économiques et financières, le débat d’orientations budgétaires devra
être préparé en amont par la commission des finances, qui devra pouvoir travailler sur
ses propres hypothèses. Le débat portera à la fois sur l’exécution du budget
précédent, sur les orientations envisagées par le gouvernement pour le prochain budget
et sur des projections triennales qui devront être régulièrement actualisées. Il
serait en effet anormal que les projections financières désormais soumises chaque année
par le Gouvernement à Bruxelles ne soient pas préalablement discutées et, pourquoi pas,
approuvées par le Parlement.
Le débat budgétaire devra rechercher une liaison plus forte
entre l’autorisation des crédits et le bon emploi qui en est fait. Le travail de
contrôle et d’évaluation réalisé par le Parlement au cours du premier semestre
prendra véritablement sa signification si la loi de règlement, qui solde le
budget de l’année précédente, est votée avant la loi de finances et si celle-ci
tire tous les enseignements des observations faites par le Parlement. De même, nous
demandons que l’examen de la loi de finances soit réaménagé pour mieux
dégager les grands choix budgétaires et mieux prendre en compte le travail des
commissions. L’examen de tel ou tel budget pourrait se dérouler au sein des
commissions saisies pour avis, en présence des ministres et de la presse, les travaux
étant publiés au Journal Officiel. Quant au débat en séance publique, avec votes, il
serait resserré pour permettre aux députés de se prononcer plus clairement sur les
grandes orientations de chaque politique publique, sans reproduire les débats qui auront
déjà eu lieu en commission. Des avancées en ce sens pourraient être menées rapidement
avec évaluation de leurs résultats.
*
* *
Notre groupe de travail est arrivé à une seconde conclusion :
un renforcement des missions d’évaluation et de contrôle exercées par le
Parlement peut et doit donner l’impulsion nécessaire à des transformations plus
profondes dans le fonctionnement de l’Etat qui achoppent depuis trop longtemps.
Priorité doit aller, selon nous, à l’amélioration de la transparence
et de la signification des comptes publics, par une transposition à l’Etat de
règles qui, le plus souvent, s’appliquent déjà à d’autres collectivités.
Ainsi, par souci d’accroître l’efficacité de la dépense publique et de
réduire les déficits, beaucoup d’entre nous souhaitent que soient désormais
distinguées d’une part les dépenses de fonctionnement et d’autre part
les dépenses d’investissement. Même si cette distinction est controversée,
le budget de l’Etat devrait à terme respecter un strict équilibre des recettes
et des dépenses de fonctionnement, comme c’est la règle en Allemagne pour le
budget fédéral et en France pour les budgets locaux.
L’information du Parlement devra être notablement améliorée par
la présentation d’une comptabilité patrimoniale et de comptes consolidés,
ainsi que par des projections à moyen terme des principaux postes budgétaires de
l’Etat. Il appartiendra à la Cour des comptes d’examiner la sincérité
des projets de loi de finances et des comptes annexés. Nous demandons que tout projet de
réforme fiscale soit désormais assorti d’une simulation et, comme Président
de l’Assemblée, j’y veillerai particulièrement.
La préoccupation de l’efficacité de la dépense publique devra
être davantage présente à tous les stades de la discussion parlementaire. Chaque projet
de loi devra être assorti d’une étude d’impact, précisant
l’adéquation entre les objectifs et les moyens à mettre en œuvre. Les crédits
budgétaires devront, à terme, être présentés et votés par programme et
assortis d’indicateurs de résultats, précis et chiffrés. Les parlementaires
doivent, dans la même logique, pouvoir procéder à des redéploiements de crédits.
A quoi sert-il en effet de s’appesantir sur 5 % de mesures nouvelles si
c’est pour adopter, en un seul vote et sans vraie discussion, 95 % de
" services votés " ?
L’autorisation parlementaire devra être non seulement mieux
éclairée, mais mieux respectée. Il ne nous paraît pas acceptable que les gouvernements
successifs puissent parfois dénaturer le budget que le Parlement vient d’adopter, à
peine sèche l’encre qui a servi à l’imprimer au Journal Officiel. Les
commissions des finances devront donc obtenir une information préalable sur les
opérations de régulation budgétaire et nous pensons qu’au-delà d’un
certain seuil, le dépôt d’une loi de finances rectificative devrait
s’imposer.
L’efficacité de la dépense publique suppose enfin que, au nom
même de la responsabilité qui est la leur, davantage de souplesse soit accordée aux
gestionnaires publics dans l’emploi des crédits, dès lors que le contrôle a
posteriori sera mieux assuré. L’idée est apparue convaincante, à cet effet, que
soit nommé dans chaque ministère un secrétaire général de l’administration,
chargé notamment d’établir et de suivre le plan stratégique des services.
*
* *
Nous sommes conscients que ces réformes, dont je viens de reprendre
ici seulement une partie, constituent un changement considérable, une sorte de
révolution maîtrisée. Elles nous paraissent nécessaires. Celles des réformes à
mettre en œuvre immédiatement, et qui dépendent de l’Assemblée Nationale,
seront appliquées dès la prochaine loi de finances. Les réformes qui sont souhaitées
pour le moyen terme – et dont certaines nécessitent une modification de
l’ordonnance organique du 2 janvier 1959 - seront préparées par une mission de
la Commission des Finances. Il serait bon qu’elles puissent être mises en
œuvre, après concertation avec le gouvernement et en liaison avec le Sénat. Elles
pourraient alors entrer en application – au fur et à mesure de leur adoption - avant
le terme normal de la présente législature.
*
* *
De quoi s’agit-il en définitive ? Il s’agit de
substituer à une logique de dépenses une logique de résultats. Il s’agit que
l’Administration rompe avec la tradition du toujours plus et qu’elle soit rendue
sans cesse plus attentive à l’efficacité de son action. Il s’agit de projeter
les données sur la moyenne ou la longue période et de ne pas être paralysé par le
court terme et l’annualité. Il s’agit que l’opposition puisse remplir sa
fonction essentielle au sein du Parlement. Il s’agit que le Parlement joue pleinement
son rôle en contrôlant réellement les dépenses publiques (budgétaires et sociales),
en discutant du fond des sujets et non de données chiffrées incompréhensibles – et
souvent faites pour l’être -, en disposant d’une vision complète et non
pas tronquée de la sphère publique pour arrêter ses choix et veiller à leur respect.
Bref, il s’agit d’améliorer l’efficacité de la dépense publique et, avec
ambition et pragmatisme, de revenir à la source de la légitimité parlementaire, tout en
l’adaptant aux données de la société moderne. Vaste programme ? Raison de
plus pour ne pas tarder.
RETOUR SOMMAIRE
INTRODUCTION
Historiquement - faut-il le rappeler ? - les Parlements sont nés,
puis se sont affirmés, comme les représentants des contribuables face à des exécutifs
dépensiers.
Le consentement à l’impôt, et son corollaire,
l’autorisation des dépenses, ont cependant changé de nature avec l’expansion
de la sphère publique.
La dépense publique, quand le souci de la contenir était le levain de
la démocratie, se limitait, pour l’essentiel, à financer le train de vie du
monarque, les caprices de ses favorites et la solde de ses gens d’armes...
Aujourd’hui, la dépense publique irrigue l’ensemble de la
Nation : les fonctions régaliennes pèsent désormais bien peu par rapport aux
interventions économiques et aux transferts sociaux, les finances publiques étant
devenues un instrument d’action structurelle, un moyen de redistribution essentiel à
la cohésion nationale, ainsi qu’un outil de réglage conjoncturel. D’où un
comportement quelque peu schizophrénique de l’ensemble de la société, prompte à
s’indigner contre les prélèvements, tout en appelant souvent de ses voeux le
développement de l’" Etat-Providence ".
Les parlementaires n’ont pas toujours échappé à cette
évolution, l’obtention de subventions restant encore, en elle-même, un critère
d’efficacité de l’élu auprès des électeurs.
Cependant, l’ouverture des frontières, le développement des
échanges, la mobilité accrue des facteurs de production, ainsi que le volume de la
dépense publique, qui représente, en France, plus de la moitié du produit intérieur
brut, doivent aujourd’hui conduire à une sorte de " révolution
culturelle ".
Même si ce qu’il est convenu d’appeler le poids des
prélèvements obligatoires ne peut être apprécié sans faire référence aux
contreparties offertes par les collectivités prélevantes, le niveau de ces
prélèvements et l’efficacité des administrations publiques en termes de qualité
de l’environnement économique, sont, en effet, devenus des critères souvent
déterminants des choix des agents économiques, dans une période marquée par la
mondialisation et les délocalisations.
Ainsi, la réduction du déficit et la diminution des prélèvements
obligatoires sont, aujourd’hui, des objectifs largement partagés.
La réduction du déficit est un impératif social, économique et,
au-delà, de bon sens. Le déficit est, en effet, générateur d’un endettement qui
conduit, dans une certaine mesure, à hypothéquer l’avenir, et, dans
l’immédiat, à prélever sur les revenus d’activité pour servir des
intérêts, c’est-à-dire, en fait, à favoriser la rente au détriment de ceux
- investisseurs, entrepreneurs et salariés - qui créent des richesses.
Quant à la nécessité de diminuer les prélèvements obligatoires,
elle prend en compte le poids désormais unanimement jugé excessif des impôts et des
charges.
Pour répondre à ces deux exigences, une voie est indispensable :
l’action sur la dépense.
Agir sur la dépense ne se réduit pas à de simples mesures
d’économie, et notre groupe de travail ne saurait être assimilé à quelque
" comité de la hache " appelant, de manière systématique, à des
coupes claires dans les dépenses publiques.
S’il faut certes se donner pour objectif, in fine, de
dépenser moins, il faut, pour y parvenir, s’efforcer de dépenser mieux afin de
répondre aux attentes du corps social.
Ce peut être un nouveau défi pour le Parlement, et le Président
Laurent Fabius nous a fort opportunément conviés à une réflexion au sein d’un
groupe de travail qu’il a animé, réunissant autour de lui et du Président de la
Commission des finances, des représentants des groupes politiques, le Rapporteur
général de la Commission des finances étant chargé de rapporter les conclusions de ces
travaux.
Un certain nombre de personnalités ont bien voulu nous faire part de
leurs expériences et de leurs réflexions. On trouvera, dans le tome II du présent
rapport, les comptes rendus de leurs interventions. Qu’ils soient ici remerciés
de leur précieuse contribution.
Nos travaux ont été particulièrement orientés en direction des
finances de l’Etat, celles sur lesquelles le Parlement – en dépit des
dysfonctionnements sur lesquels nous reviendrons – dispose de
l’information et des compétences les plus larges. Les finances sociales et locales
entrent également dans le champ de cette réflexion.
Le constat est unanime : les textes et les pratiques ont très
sensiblement limité, particulièrement en matière financière, le rôle du Parlement en
tant que décideur.
Cette évolution n’en rend que plus nécessaire une
réappropriation, par la représentation nationale, de son rôle de contrôleur,
qu’elle doit affiner et compléter, s’agissant de la dépense publique, par une
fonction d’évaluation.
" Nos concitoyens en ont-ils pour leur argent ? ",
telle est la question à laquelle il conviendra de s’efforcer de répondre
systématiquement dans le cadre d’une démarche doublement exigeante.
Tout d’abord, une telle démarche exigera de chaque parlementaire
une grande disponibilité temporelle et intellectuelle, ainsi que de l’audace. Les
pouvoirs de contrôle du Parlement, qui ne sont pas minces, restent, en effet, largement
virtuels. Le contrôle ne s’improvise pas, il se prépare et sa conduite demande un
fort investissement personnel. C’est notamment la raison pour laquelle, afin de
démultiplier les actions de contrôle, il est proposé de renforcer la capacité
d’intervention, en matière budgétaire, des commissions saisies pour avis.
Ensuite, cette démarche, pour porter tous ses fruits, exigera que
chaque parlementaire prenne sur soi, afin de dépasser les réflexes partisans. Les élus
de la majorité devront comprendre – et les gouvernements, comme d’ailleurs
la presse, devront admettre – que le constat argumenté de l’inefficacité
d’une politique, que la dénonciation d’un gaspillage, ne constituent pas une
remise en cause de la solidarité qui doit unir, dans notre système institutionnel, le
gouvernement et la majorité dont il procède. Aussi bien est-il proposé de renforcer, en
matière de contrôle et d’évaluation, les prérogatives des députés de
l’opposition.
Si les élus de la majorité réussissent à lever tabous et
inhibitions, corrélativement, ceux de l’opposition devront s’efforcer, dans cet
exercice, de considérer que, bien souvent, les errements qu’il convient de dénoncer
et de corriger ne mettent pas en cause la seule responsabilité gouvernementale, ni la
seule responsabilité du gouvernement du moment.
Par ailleurs – et ceci vaut pour la majorité comme pour
l’opposition –, porter un jugement sur l’efficacité d’une action
publique est un exercice d’une autre nature que celui consistant à se prononcer sur
le bien–fondé d’une politique.
Ce nouvel exercice de la fonction de contrôle sera expérimenté, dès
les prochaines semaines, au sein de la Commission des finances. Il nous invite, tous, à
l’effort.
On peut espérer que cette démarche de contrôle et d’évaluation
exercera un effet de levier pour déclencher d’autres réformes, plus profondes, pour
lesquelles notre groupe de travail s’est borné, à ce stade, à présenter quelques
pistes de réflexion.
Il s’agit de faire en sorte d’accroître l’efficacité
de la dépense, d’améliorer l’efficience de l’Etat, afin, qu’eu
égard à la qualité de la contrepartie, soit retrouvé le consentement du corps social
aux prélèvements opérés par les administrations, prélèvements, dont cet exercice
doit amplifier le nécessaire allégement.
Cette recherche de la meilleure adéquation entre les fins et les
moyens devrait permettre à la notion de finances publiques de renouer avec son
étymologie. Le mot finances ne vient-il pas de l’ancien français " finer ",
qui signifiait mener à fin, mener à bien ?
RETOUR SOMMAIRE
PREMIÈRE PARTIE
La problÉmatique budgÉtaire aujourd’hui
La maîtrise de la dépense publique est, à juste titre, devenue un
des éléments majeurs du discours politique. Pour autant, il n’y a pas de fatalité
à l’inefficacité de la dépense publique, mais l’efficacité de la dépense
doit être évaluée de façon permanente. Cette démarche doit être conduite
résolument, tout en acceptant l’idée que l’Etat doit aussi soutenir
l’activité économique et répondre aux attentes du corps social.
I.- la maÎtrise
de la dÉpense publique :
dogme ou nÉcessitÉ ?
Sous l’influence de l’œuvre de J.M. Keynes, qui avait
rejeté la vieille règle classique de l’équilibre budgétaire et préconisé la
compensation permanente entre les dépenses privées et les dépenses publiques, les
années cinquante à soixante-dix ont constitué l’âge d’or du
" réglage fin " (réel ou illusoire) de la conjoncture au moyen des
instruments budgétaires. C’était la politique dite du " deficit
spending ".
Les difficultés économiques qui sont apparues à la suite des deux
chocs pétroliers ont fait naître, dans le sillage de la théorie monétariste, de
nouveaux modes de régulation d’inspiration libérale (régulation par le contrôle
de la masse monétaire).
On a alors assisté, dans les années quatre-vingt, à la mise en
œuvre de politiques économiques déclarant écarter l’instrument budgétaire,
à l’exception notoire des Etats-Unis, où la relance économique a été réalisée
par des baisses massives d’impôts et le financement public d’un programme
militaire intense.
On peut se demander si aujourd’hui n’apparaissent pas les
prémices d’un mouvement inverse. Un large courant de la recherche économique, y
compris parmi les économistes libéraux, redécouvre que certaines dépenses publiques
peuvent stimuler la croissance. On peut citer, par exemple, les travaux sur la croissance
endogène, qui s’intéressent à nouveau au rôle de l’Etat dans
l’économie et à la nouvelle légitimité des finances publiques.
Quoi qu’il en soit et dans la mesure où, en France, une large
partie de la richesse nationale passe par les mains de la puissance publique, la
compétitivité de la nation est liée à l’efficacité de l’administration et
il est essentiel de tout faire pour renforcer celle-ci.
Ces premiers éléments invitent à retracer l’évolution de la
dépense publique dans son volume et dans sa structure, au cours des trente dernières
années, en France et dans les pays comparables, afin de mieux situer aujourd’hui le
problème du déficit budgétaire pour les Etats participant à l’euro.
A.- L’évolution
des dépenses publiques en France sur longue période et leurs effets sur l’économie
Même si l’établissement de corrélations est souvent malaisé,
l’évolution, sur longue période, ou plus récente, de la dépense publique, montre
que celle-ci ne doit ni être magnifiée, ni être a priori condamnée comme
inefficace.
1.- L’évolution au
cours de la période 1949-1992
Le Conseil économique et social, dans un rapport présenté par
M. Jacques Méraud () en 1994, a étudié, sur la période 1949 à
1992, les liens entre l’augmentation des dépenses publiques, la croissance et
l’inflation. Cette étude, comme les déclarations de M. Jacques Méraud devant
le groupe de travail le 22 octobre 1998, invitent à la prudence. En effet les
chiffres bruts brandis sans précaution peuvent conduire à de véritables contresens.
Afin de faciliter les comparaisons internationales, l’étude porte
sur les dépenses de l’ensemble des administrations publiques : Etat,
collectivités territoriales et organismes de sécurité sociale. L’ensemble de ces
dépenses représentait en France, en 1992, 53,5% du Produit intérieur brut (PIB).
a) La dépense publique : une croissance qui reste forte malgré
un ralentissement récent
Au cours de la période étudiée, il est constaté une réduction
régulière du taux moyen de croissance du volume (à prix constant) de la dépense
publique: ce taux de croissance était de 6,6% par an pour la période 1949-1962, de 3,7%
pour la période 1974-1983 et de 3% pour la période 1983-1992.
Mais le phénomène dominant, entre 1949 et 1992, est la progression
des dépenses des administrations publiques, exprimées en francs courants, plus rapide
que celle de la valeur du PIB. Le pourcentage des dépenses de l’ensemble des
administrations publiques dans le PIB est ainsi passé, entre 1949 et 1992, de 31% à
53,5%, ce qui traduit un accroissement de 0,5 point par an.
Cependant, comme le fait remarquer l’auteur du rapport, les
fluctuations et l’augmentation du pourcentage des dépenses des administrations
publiques dans le PIB sont plus accusées que les fluctuations correspondantes du volume
des dépenses de ces administrations, parce que ce pourcentage est évidemment influencé
par les fluctuations du PIB elles mêmes. Or, la croissance du PIB est allée
tendanciellement en ralentissant au cours de la période considérée, ce qui a eu pour
conséquence une augmentation de la part des dépenses des administrations publiques.
La sensibilité du pourcentage des dépenses publiques dans le PIB aux
fluctuations du PIB est accentuée par le fait que les administrations publiques se sont
efforcées, dans la mesure du possible, de compenser les fluctuations de la demande
privée. Cela est particulièrement net pour l’année 1975, où, à la suite du
premier choc pétrolier, le pourcentage des dépenses publiques dans le PIB a augmenté de
4,3 points. A l’inverse, lorsque le PIB a progressé de manière sensible, le
pourcentage des dépenses a ralenti sa montée : + 0,3 point par an de 1962
à 1974 et - 0,7 point par an de 1986 à 1989.
Il faut également préciser que la dépense des administrations
publiques centrales a progressé un peu moins vite que le PIB, alors que les dépenses des
administrations de sécurité sociale et des administrations publiques locales ont
progressé plus vite.
Entre 1949 et 1992, en valeur (c’est-à-dire non corrigées
de l’inflation), les dépenses définitives de l’Etat étaient multipliées par
91, et le PIB par 82 ; les dépenses de l’Etat passaient ainsi de 18,5% du
PIB en 1949 à 20,4% en 1992.
L’étude s’est également attachée à suivre
l’évolution des dépenses courantes du budget général (dépenses de
fonctionnement), qui ont progressé en moyenne de 4,0% par an, et celle des dépenses en
capital (dépenses d’investissement), qui ont connu une progression de 2,6% par an.
Le pourcentage de dépenses en capital dans le PIB est très inférieur à celui des
dépenses courantes et s’inscrit en baisse au cours de la période. Il est passé de
5,9% à 2,8% entre 1949 et 1992, alors que le pourcentage des dépenses courantes est
passé de 12,6% du PIB à 17,6%.
Parmi les dépenses courantes, les intérêts de la dette sont le poste
budgétaire qui a le plus progressé, essentiellement à partir de 1974 avec, entre 1974
et 1992, un taux d’accroissement de 13,3% par an. En 1992, ce poste représentait 13%
du total des dépenses définitives de l’Etat. Sa montée est due à
l’accroissement des déficits budgétaires au cours des années quatre-vingt et à la
forte hausse des taux d’intérêt intervenue pendant cette décennie.
Outre les intérêts de la dette, les deux postes de dépenses de
l’Etat qui se sont le plus accrus sont les prélèvements destinés aux Communautés
européennes et aux collectivités locales, mais leur comptabilisation, sous la forme de
prélèvements sur recettes, les exclut des dépenses du budget général.
Les caractéristiques de chacune des périodes prises en compte en
France en matière de croissance, d’inflation, de dépenses de l’Etat et de
dépenses de l’ensemble des administrations publiques sont résumées dans le tableau
ci-dessous extrait du rapport du Conseil économique et social :
(% par an) |
Période |
Croissance du PIB |
Hausse des prix |
Dépenses courantes de l’Etat |
Dépenses en capital de l’Etat |
Dépenses de l’ensemble des
administrations publiques |
1950-1959 |
+ 4,5 % |
+ 7,3 % |
+ 8 % |
+ 1,8 % |
- |
1960-1973 |
+ 5,6 % |
+ 4,9 % |
+ 3 % |
+ 5,2 % |
+ 4,8 % |
1974-1983 |
+ 2,3 % |
+ 11,0 % |
+ 4 % |
+ 1,2 % |
+ 3,8 % |
1984-1992 |
+ 2,3 % |
+ 4,0 % |
+ 1,2 % |
+ 2 % |
+ 2,9 % |
Source : Conseil économique et social, 1994.
Il est également intéressant de comparer l’évolution du
pourcentage des dépenses des différentes administrations publiques dans le PIB.
Le graphique ci-dessous montre qu’exprimée en pourcentage du PIB,
la dépense des administrations centrales a été assez fluctuante. On relève des
périodes de stabilité ou de quasi-stabilité : les années soixante (sauf 1967), la
période 1976-1980, les années 1984 et 1985 et, enfin, la période 1990-1992. La baisse a
été pratiquement continue de 1969 à 1974 et de 1986 à 1989. Enfin, la hausse a été
forte en 1967, 1975 et dans les années 1981-1982-1983. Au total le pourcentage des
dépenses des administrations centrales a oscillé entre 18 et 24% du PIB.
DÉPENSES DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES EN POURCENTAGE
DU PIB
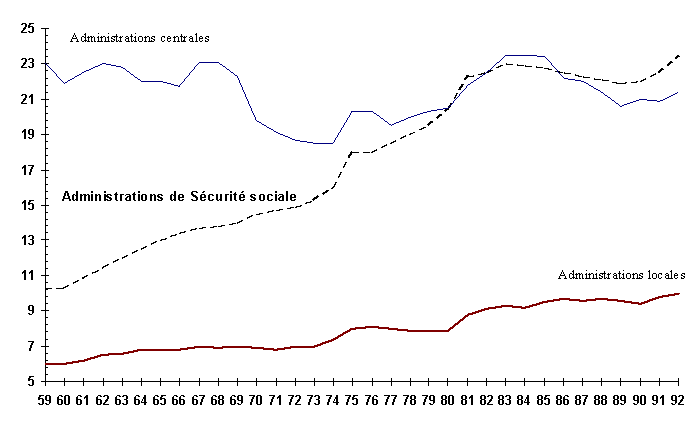
Source: INSEE, Comptes nationaux.
b) Le déficit budgétaire réapparaît avec la crise
Le déficit du budget de l’Etat est devenu, à compter de 1975,
une donnée permanente des comptes français. A l’inverse, au cours des dix années
qui avaient précédé le premier choc pétrolier, le budget de l’Etat avait été en
excédent à l’exception de trois années (1966, 1967, 1968). Notons qu’au cours
de la première moitié de la décennie 1970, le niveau de croissance général de
l’économie a été de 5,9% en moyenne et qu’il a chuté à -0,2% en 1975 par
rapport à 1974.
L’utilisation du budget de l’Etat dans une perspective
d’actions contracycliques, en 1975 comme plus tard en 1981, a buté sur la contrainte
extérieure et la contradiction, exacerbée par l’ouverture croissante de
l’économie, entre la relance intérieure et le fort ralentissement de
l’activité chez les principaux partenaires de la France. Cette réalité doit être
rappelée avant de constater l’effet limité de ces plans de relance sur le taux de
croissance globale de l’économie, alors même qu’ils se sont traduits par le
creusement du déficit extérieur et des déficits publics.
La période 1983-1990 a été marquée par un effort pour redresser les
finances de l’Etat, avec pour principaux objectifs la stabilité du franc par rapport
au Deutschemark et une croissance peu inflationniste. Ce redressement a été facilité
par la reprise économique amorcée en 1985 et accélérée par le
" contre-choc " pétrolier de 1986.
2.- L’évolution
postérieure
Si, entre 1985 et 1992, le déficit budgétaire a été progressivement
réduit, on a assisté à partir de 1991 à une forte détérioration des comptes publics,
malgré la montée des prélèvements obligatoires, mouvement qu’il a cependant été
possible de commencer à infléchir au cours de la période récente.
a) Une amélioration encore insuffisante des comptes publics
On s’appuiera sur le rapport sur l’évolution de
l’économie nationale et des finances publiques déposé par le Gouvernement en vue
du débat d’orientation budgétaire en mai 1996 et sur le rapport sur les comptes de
la Nation de 1997, établi par l’INSEE.
La période 1990-1994 a été marquée, en France, par une augmentation
des déficits publics de l’ordre de 4,2 points de PIB. Le besoin de financement des
administrations publiques était de 1,6% du PIB en 1990, il a atteint 5,7% en 1993 au
moment de la récession et 5,8% en 1994. Cette détérioration trouve son origine à la
fois dans un ralentissement marqué de la conjoncture et dans une orientation relativement
expansive de la politique budgétaire.
On comprend mieux le phénomène si, au-delà de la présentation des
déficits effectifs représentant le solde des comptes de l’Etat qui apparaît dans
les lois de finances, l’on tient compte du solde structurel () et du
solde primaire (). Le solde structurel peut également être qualifié de
solde actif ou " volontaire ".
Selon l’OCDE, la composante structurelle du solde effectif des administrations
publiques en France a évolué comme suit :
EVOLUTION DU SOLDE
STRUCTUREL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES
Excédent (+) ou déficit (-) en pourcentage
du PIB potentiel |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Prévisions |
1981 |
1982 |
1983 |
1984 |
1985 |
1986 |
1987 |
1988 |
1989 |
1990 |
1991 |
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
- 1,5 |
- 3,0 |
- 2,7 |
- 1,7 |
- 1,6 |
- 1,5 |
- 0,7 |
- 1,4 |
- 1,9 |
- 2,4 |
- 2,1 |
- 3,6 |
- 3,9 |
- 4,3 |
- 3,8 |
- 2,6 |
- 1,8 |
- 2,2 |
- 2,1 |
Source: Perspectives économiques de l’OCDE, juin
1998.
Le solde effectif primaire a, pour sa part, évolué comme suit :
EVOLUTION DU SOLDE
FINANCIER PRIMAIRE DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES
Excédent (+) ou déficit (-) en pourcentage
du PIB nominal |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Prévisions |
1981 |
1982 |
1983 |
1984 |
1985 |
1986 |
1987 |
1988 |
1989 |
1990 |
1991 |
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
- 0,7 |
- 1,6 |
- 1,4 |
- 0,9 |
- 0,8 |
- 0,6 |
0,3 |
0,5 |
1,0 |
0,8 |
0,5 |
- 1,1 |
- 2,6 |
- 2,3 |
- 1,4 |
- 0,4 |
0,4 |
0,2 |
0,5 |
Source: Perspectives économiques de l’OCDE, juin
1998.
Pour la première fois en France depuis 1991, le solde effectif primaire est devenu
excédentaire en 1997.
Selon l’OCDE, les réductions des déficits financiers effectifs
et structurels des administrations publiques ont été générales et de forte ampleur en
1997 dans tous les pays de l’Union européenne. Les politiques budgétaires
continueront de se resserrer en 1998, mais ces ajustements influenceraient moins
qu’en 1997 les perspectives d’avenir.
Le processus de réduction des déficits publics, engagé en 1995,
s’est poursuivi en 1997 (voir le tableau ci-dessous). Le besoin de financement des
administrations publiques a baissé de 80,4 milliards de francs (selon le système
européen de comptabilité nationale) pour atteindre 3,0% du PIB, la dette publique étant
restée constamment en dessous de la barre des 60% du PIB.
On rappellera cependant que l’audit des finances publiques
demandé à sa prise de fonctions par le Premier ministre et publié en juillet 1997,
prévoyait qu’en l’absence de mesures nouvelles et à conjoncture inchangée, le
déficit des administrations publiques aurait été compris entre 3,5 et 3,7% du PIB pour
1997.
CAPACITÉ (+) OU BESOIN(-) DE FINANCEMENT DES
ADMINISTRATIONS PUBLIQUES (1)
| |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
| En milliards de francs |
-401,5 |
-423,6 |
-372,2 |
-323,4 |
-243,0 |
| En % du PIB : |
|
|
|
|
|
| Administrations publiques |
-5,7 |
-5,8 |
-4,9 |
-4,1 |
-3,0 |
| Etat |
-4,6 |
-4,8 |
-4,1 |
-3,7 |
-3,3 |
| Organismes divers d’administration centrale |
0,3 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,7 |
| Administrations publiques locales |
-0,2 |
-0,2 |
-0,2 |
0,0 |
0,2 |
| Administrations de sécurité sociale |
-1,2 |
-0,8 |
-0,7 |
-0,6 |
-0,6 |
(1) Les chiffres de ce tableau sont établis selon le
système européen de comptabilité nationale dans sa version de 1979, conformément aux
dispositions prévues par le traité de Maastricht pour l’application des critères
de convergence.
Source: Comptes de la Nation, 1997.
Le déficit des administrations publiques s’est réduit en
1997. Le solde des organismes divers d’administration centrale a été
excédentaire de 45,8 milliards de francs. Cet excédent provient pour une grande
part de ce que se trouve classée parmi ces organismes l’unité chargée de gérer la
soulte de 37,5 milliards de francs versée par France Telecom.
Le besoin de financement des administrations publiques au sens des
comptes nationaux français s’est réduit, passant de 365,6 milliards de francs
en 1996 à 281,2 milliards de francs en 1997. Au sens des critères de Maastricht, le
ratio de déficit public a été de 3% du PIB après 4,1% en 1996. Cette amélioration est
due au redressement des comptes des administrations publiques centrales (Etat notamment)
et locales. Les dépenses de fonctionnement des administrations publiques (APU) se sont
modérément accrues : les salaires versés ont progressé de 2,4%, en partie à la
suite de la revalorisation de l’indice des traitements, mais surtout en raison des
effets de promotion (glissement-vieillesse-technicité, GVT).
Entre 1996 et 1997, le besoin de financement de l’Etat s’est
réduit de 30 milliards de francs et, dans le même temps, les dépenses de
l’Etat n’ont progressé que de 2%. Les recettes fiscales de l’ensemble des
APU ont sensiblement progressé (+ 7,2% après + 6,4%). Les recettes de
l’impôt sur le bénéfice des sociétés se sont accrues sous l’effet de la
majoration exceptionnelle de 15% de cet impôt pour les sociétés réalisant plus de
50 millions de chiffre d’affaires. Hors CSG, les impôts sur le revenu et le
patrimoine ont baissé de 0,6%. L’allégement du barème de l’impôt sur le
revenu a été modéré par l’effet en année pleine de la contribution pour le
remboursement de la dette sociale (CRDS). De son côté, avec une augmentation de son taux
et l’élargissement de son assiette, compensée par une baisse des cotisations
sociales, la CSG a fortement progressé (+ 60%). Les administrations publiques
locales ont dégagé une capacité de financement de 17,6 milliards de francs.
L’accélération des recettes fiscales s’est accompagnée d’une baisse
sensible de la charge d’intérêt consécutive à la baisse des taux.
Enfin, le besoin de financement de la sécurité sociale s’est
établi à 65,9 milliards de francs. Au total, le taux de prélèvements
obligatoires, nets des allégements de charges sociales prises en charge par l’Etat,
s’établit à 45,3% du PIB.
b) Les prélèvements obligatoires : une notion dont il faut
bien
apprécier la portée
On s’arrêtera quelques instants sur l’évolution des
prélèvements obligatoires.
Leur poids dans le PIB est passé de 35,1% en 1970 à 45,7% en 1996. A
cette date, ils s’élevaient à 3.593 milliards de francs, en augmentation de
5,3% par rapport à 1995. En 1997, le total des prélèvements obligatoires représentait
46,1% du PIB, il est passé à 45,9% en 1998 et devrait être ramené à 45,7% en 1999.
On observera que la part des prélèvements de l’Etat dans
l’ensemble des prélèvements obligatoires a fortement diminué depuis vingt-cinq
ans : elle n’en représente plus que le tiers en 1996, contre plus de la moitié
en 1970. Le mouvement de décentralisation engagé en 1981-1982 explique, pour une part,
ce phénomène.
Les trois tableaux ci-dessous offrent une vue synthétique de
l’évolution de ces prélèvements en France et à l’étranger, étant précisé
que des différences de conventions et de méthode expliquent les légères différences
constatées dans les données présentées par la Comptabilité nationale, l’OCDE et
Eurostat.
LES PRÉLÈVEMENTS
OBLIGATOIRES DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES EN FRANCE |
| |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
En milliards de francs |
|
|
|
|
Impôts après transferts de
recettes (1) |
1.842 |
1.935 |
2.043 |
2.190 |
Administrations publiques centrales |
1.163 |
1.231 |
1.238 |
1.290 |
dont Etat
|
1.078 |
1.142 |
1.196 |
1.241 |
Administrations publiques locales |
502 |
524 |
551 |
583 |
Administrations de Sécurité sociale |
86 |
99 |
174 |
229 |
Institutions de l’Union
européenne |
83 |
80 |
82 |
88 |
Cotisations sociales effectives |
1.414 |
1.479 |
1.551 |
1.558 |
Prélèvements obligatoires
effectifs |
3.256 |
3.413 |
3.594 |
3.748 |
Prélèvements obligatoires
effectifs nets des allégements de cotisations sociales (2) |
3.235
|
3.381
|
3.540
|
3.682
|
En % du produit intérieur brut |
|
|
|
|
Impôts après transferts de
recettes (1) |
24,9 |
25,2 |
26,0 |
26,9 |
Administrations publiques centrales |
15,7 |
16,1 |
15,7 |
15,8 |
dont Etat
|
14,6 |
14,9 |
15,2 |
15,3 |
Administrations publiques locales |
6,8 |
6,8 |
7,0 |
7,2 |
Administrations de Sécurité sociale |
1,3 |
1,3 |
2,2 |
2,8 |
Institutions de l’Union
européenne |
1,1 |
1,0 |
1,0 |
1,1 |
Cotisations sociales effectives |
19,1 |
19,3 |
19,7 |
19,2 |
Prélèvements obligatoires
effectifs |
44,1 |
44,5 |
45,7 |
46,1 |
Prélèvements obligatoires
effectifs nets des allégements de cotisations sociales (2) |
43,8
|
44,1
|
45,0
|
45,3
|
(1) Les transferts de recettes comportent notamment une
part des transferts de l’Etat aux collectivités locales et les versements de
l’Etat aux institutions de l’Union européenne.
|
(2) A partir de 1991, l’Etat a pris en charge des
cotisations dues par les employeurs. D’après les conventions retenues en
comptabilité nationale, les cotisations sociales effectives sont cependant maintenues au
même niveau, les allégements se traduisant par le versement par l’Etat d’une
subvention aux entreprises. Cette ligne indique le résultat qui serait obtenu si
l’on traitait ces prises en charge comme une baisse des prélèvements pesant sur les
entreprises.
|
Source : Comptes de
la Nation, 1997. |
RETOUR SOMMAIRE
COMPARAISON
INTERNATIONALE |
(en % du PIB) |
| |
1985 |
1995 |
| |
Taux de P.O. (1) |
Impôts |
Cotisations sociales |
Taux de P.O. (1) |
Impôts |
Cotisations sociales |
France |
44,5 |
25,2 |
19,3 |
44,5 |
25,2 |
19,3 |
Allemagne |
38,1 |
24,2 |
13,9 |
39,2 |
23,8 |
15,4 |
Royaume-Uni |
37,9 |
31,2 |
6,7 |
35,3 |
29,0 |
6,3 |
Suède |
50,0 |
37,5 |
12,5 |
49,7 |
35,2 |
14,5 |
Etats-Unis |
26,0 |
19,5 |
6,5 |
27,9 |
20,9 |
7,0 |
Japon |
27,6 |
19,3 |
8,3 |
28,5 |
18,1 |
10,4 |
(1) Prélèvements
obligatoires. |
Source : OCDE.
L’OCDE ne retient pas les mêmes conventions que la comptabilité nationale
française ou EUROSTAT, notamment pour les cotisations versées aux régimes de retraite. |
PRÉLÈVEMENTS
OBLIGATOIRES
DANS LES ETATS MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNE
(en % du PIB) |
| |
1980 |
1985 |
1990 |
1991 |
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
Europe des 15 |
38,6 |
40,5 |
40,8 |
41,4 |
41,9 |
42,1 |
41,9 |
42,1 |
42,6 |
42,6 |
Europe des 11 (1) |
38,5 |
40,3 |
40,5 |
41,4 |
42,2 |
42,8 |
42,4 |
42,4 |
42,8 |
43,2 |
Belgique |
44,2 |
47,2 |
44,3 |
44,3 |
44,5 |
45,2 |
46,3 |
46,1 |
46,2 |
46,6 |
Danemark |
45,6 |
49,1 |
49,7 |
49,9 |
50,2 |
51,3 |
53,1 |
52,7 |
53,5 |
53,1 |
Allemagne |
41,6 |
41,6 |
39,5 |
41,2 |
41,9 |
42,3 |
42,6 |
42,7 |
42,0 |
41,6 |
Grèce |
- |
- |
- |
- |
- |
33,0 |
33,7 |
34,1 |
33,9 |
- |
Espagne |
25,6 |
29,9 |
35,2 |
35,5 |
37,2 |
36,4 |
36,1 |
35,0 |
35,6 |
36,2 |
France |
41,7 |
44,5 |
43,7 |
44,0 |
43,7 |
44,1 |
44,2 |
44,7 |
46,0 |
46,3 |
Irlande |
34,7 |
38,9 |
35,5 |
35,9 |
36,1 |
36,0 |
36,7 |
34,4 |
34,3 |
34,1 |
Italie |
30,6 |
34,8 |
38,8 |
39,8 |
42,1 |
43,5 |
40,7 |
40,9 |
42,8 |
44,5 |
Luxembourg |
46,3 |
46,7 |
43,4 |
42,7 |
41,8 |
43,9 |
44,3 |
44,1 |
44,7 |
45,6 |
Pays-Bas |
46,0 |
45,5 |
45,1 |
47,5 |
47,4 |
48,2 |
46,1 |
45,1 |
44,9 |
45,9 |
Autriche |
41,0 |
43,0 |
41,3 |
41,8 |
43,1 |
44,0 |
42,8 |
43,0 |
44,2 |
44,9 |
Portugal |
25,5 |
29,3 |
32,3 |
33,6 |
35,9 |
34,7 |
35,1 |
35,9 |
37,1 |
37,9 |
Finlande |
36,9 |
40,9 |
45,4 |
46,8 |
46,8 |
45,5 |
47,6 |
46,3 |
48,2 |
47,5 |
Suède |
49,1 |
50,0 |
55,6 |
52,6 |
51,0 |
50,1 |
49,7 |
49,8 |
53,9 |
54,1 |
Royaume-Uni |
36,1 |
38,2 |
37,5 |
37,4 |
36,4 |
35,3 |
35,8 |
36,8 |
36,7 |
35,9 |
(1) Europe des 11 :
Allemagne, Belgique, Espagne, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Autriche,
Portugal et Finlande.
Source : Eurostat. |
On reviendra sur ce point dans la suite du rapport, mais indiquons dès
à présent qu’il convient de relativiser la portée des comparaisons
internationales relatives aux prélèvements obligatoires, car, pour une part, les
différences entre pays développés résultent du caractère public ou privé des
fonctions d’assurance retraites et maladies. En France, en Allemagne et en Suède,
les cotisations et les prestations sociales représentent environ 20% du PIB, contre 10%
seulement aux Etats-Unis. Or, lorsque l’on ajoute les contributions des employeurs
aux fonds de retraite privés (7% du PIB aux Etats-Unis) et les contributions des
salariés et des employeurs à l’assurance-maladie privée, l’essentiel de
l’écart entre les Etats-Unis et les pays européens disparaît.
Le poids des prélèvements obligatoires dépend évidemment de
l’arbitrage que fait un pays entre les besoins collectifs qui doivent être
socialisés et ceux qui doivent être satisfaits par le marché. Comme l’a indiqué
M. Louis Schweitzer devant le groupe de travail, le montant des prélèvements
obligatoires ne permet pas, par lui-même, de mesurer l’efficacité de l’Etat.
Si un pays décide que l’enseignement doit être financé par la dépense publique,
ce qui compte c’est la contrepartie obtenue et la qualité de l’enseignement au
regard de l’effort réalisé.
La meilleure comparaison n’est pas seulement celle des
prélèvements obligatoires d’un pays à un autre, mais celle qui s’efforce de
déterminer si, du point de vue de la satisfaction du besoin d’enseignement de
l’ensemble d’une population, le financement public apporte de meilleurs
résultats que le financement privé.
Pour compléter ce tour d’horizon, on trouvera ci-dessous un
tableau retraçant l’évolution récente de la dette des administrations publiques,
après avoir rappelé que la capacité de financement de l’Etat, comme des
administrations publiques dans leur ensemble, est négative depuis 1975. La charge des
intérêts a représenté 292 milliards de francs en 1997, marquant une baisse en valeur
de 1,5% par rapport à 1996. Cette baisse, obtenue malgré l’accroissement de
l’encours de la dette, résulte de la décrue des taux d’intérêt.
DETTE DES ADMINISTRATIONS
PUBLIQUES |
| |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
Dette brute consolidée (en MdF) |
3.572 |
4.021 |
4.359 |
4.699 |
En % du PIB |
48,5 |
52,7 |
55,7 |
58,1 |
Dette de l’Etat brute consolidée
(en Mdf) |
2.787 |
3.126 |
3.407 |
3.631 |
En % du PIB |
37,8 |
41,0 |
43,5 |
44,9 |
Source: Banque de France.
c) Dépense publique et croissance : d’incontestables
interférences
En définitive, il apparaît que, si le lien entre la dépense publique
et la croissance est incontestable, il est difficile de dire, sur une longue période,
lequel du déficit budgétaire ou du taux de croissance du PIB a le plus d’influence
sur l’autre. Ce qui a été constaté dans le rapport du Conseil économique et
social, c’est que plus la croissance du PIB a été forte, plus la progression des
dépenses budgétaires a été soutenue et inversement. C’est le sens de
l’intervention que M. Jacques Méraud a présentée devant le groupe de travail
et à laquelle on pourra se reporter. Selon lui, le lien entre la variation du volume des
dépenses de fonctionnement ou de consommation des administrations publiques et celle
concomitante du PIB, est pratiquement nul. En revanche, on trouve une liaison plus
forte entre les dépenses de transfert et la croissance.
L’évolution des déficits publics et des dettes publiques depuis
1992 paraît plus atypique. La détérioration très nette des déficits publics est
allée de pair avec, à la fois, un ralentissement marqué de la conjoncture et une
orientation relativement expansive de la politique budgétaire. Il faut sans doute
chercher l’explication du côté des taux d’endettement public, qui ont
énormément crû sous l’effet des diverses récessions depuis le premier choc
pétrolier. L’opinion sait qu’il faudra stabiliser la dette en augmentant les
impôts ou en contractant les dépenses et cela affecte les comportements de consommation
et d’épargne. Lors de la dernière récession, le comportement d’épargne des
ménages et des entreprises est ainsi devenu brutalement procyclique.
Ainsi que l’on va le voir, la comparaison internationale
n’apporte guère plus de certitudes, même si M. Jacques Méraud a constaté une
forte corrélation positive entre le taux de croissance et le volume des dépenses
publiques : plus les pays en cause ont connu une croissance forte de leurs dépenses
publiques, plus l’impact en terme de croissance du PIB a été stimulant.
Néanmoins, la stimulation budgétaire est tombée en disgrâce depuis
le début de la décennie. Elle ne répondrait plus aux attentes, malgré un contexte
d’inflation maîtrisée et de commerce extérieur florissant. Encore faut-il se
demander ce que seraient devenus, en France, l’activité et l’emploi sans les 4
ou 5 points de PIB injectés en moyenne chaque année par le déficit depuis 1992. Ne
faudrait-il pas tenter de rechercher la solution de ce problème sur le terrain de la
meilleure affectation possible des ressources. Par exemple, ne serait-il pas intéressant
de comparer l’efficacité, en termes de création d’emplois, des mesures de
réduction du coût du travail et de celles liées à la réduction du temps de
travail ?
B.-
La comparaison internationale des dépenses publiques
Les comparaisons internationales, à l’échelon européen ou
mondial, doivent être maniées avec précaution : la dépense publique doit être
jugée à l’aune de son efficacité, c’est-à-dire de l’ensemble de biens
et services qu’elle procure aux citoyens au sein d’une société donnée.
1.- Les finances publiques
dans l’Union européenne
Il a semblé intéressant d’aborder cette question pour
l’ensemble de l’Union européenne (Europe des Douze jusqu’en 1990, des
Quinze ensuite), où l’on a constaté un important creusement des déficits publics
au début de la présente décennie.
Les finances publiques des Etats européens étaient presque
équilibrées dans les années soixante et les déficits publics sont apparus avec la
récession du début des années soixante-dix. Le déficit public de
l’" Union européenne " est ainsi passé de 1,8% du PIB en
1972-73 à 5,8% en 1975. Il s’est stabilisé à 4% environ entre 1976 et 1980. Après
un nouveau creusement au début des années quatre-vingt, les déficits se sont réduits
tendanciellement entre 1981 et 1989 (2,9% en 1989). Après 1990, le déficit
s’accroît à nouveau fortement pour culminer en 1993 (6,3%) au creux de la
récession européenne. Depuis 1993, malgré une contraction généralisée des dépenses
publiques, le déficit s’est maintenu à un niveau élevé (4,2% en moyenne en 1996).
Il n’est passé en dessous de la barre de 3% qu’en 1997 (2,3% du PIB de
l’Union). La part des dépenses publiques dans le PIB est, parallèlement, passée de
52,4 % en 1993 à 48,7% en 1997.
Le tableau ci-dessous, établi par les services de la Commission
européenne à partir des données harmonisées d’Eurostat retrace l’évolution
des déficits publics en Europe et formule des prévisions jusqu’en 2000.
CAPACITÉ (+) OU BESOIN
(-) DE FINANCEMENT DES
ADMINISTRATIONS PUBLIQUES EN POURCENTAGE DU PIB |
| |
1970 |
1974 |
1986 |
1991 |
1996 |
|
|
1998 |
1999 |
2000 |
| |
- |
- |
- |
- |
- |
1996 |
1997 |
prévision de |
prévision de |
prévision de |
| |
1973 |
1985 |
1990 |
1995 |
2000 |
|
|
III-96 |
X-96 |
III-98 |
X-98 |
X-98 |
Belgique |
- 3,4 |
- 7,9 |
- 7,1 |
- 5,8 |
- 1,7 |
- 3,2 |
- 2,0 |
- 1,7 |
- 1,3 |
- 1,4 |
- 1,2 |
- 1,0 |
Danemark |
4,2 |
- 2,7 |
0,8 |
- 2,4 |
1,3 |
- 0,7 |
0,5 |
1,1 |
1,2 |
1,7 |
2,6 |
2,9 |
Allemagne * (a) |
0,2 |
- 2,8 |
- 1,5 |
- 2,9 |
- 2,6 |
- 3,4 |
- 2,7 |
- 2,5 |
- 2,6 |
- 2,2 |
- 2,2 |
- 2,2 |
Grèce |
- |
- |
- 12,4 |
- 11,7 |
- 3,6 |
- 7,5 |
- 4,0 |
- 2,2 |
- 2,4 |
- 2,0 |
- 2,1 |
- 1,9 |
Espagne |
0,4 |
- 2,8 |
- 4,0 |
- 5,8 |
- 2,5 |
- 4,7 |
- 2,6 |
- 2,2 |
- 2,1 |
- 1,9 |
- 1,6 |
- 1,3 |
France |
0,7 |
- 1,7 |
- 1,8 |
- 4,5 |
- 2,8 |
- 4,1 |
- 3,0 |
- 2,9 |
- 2,9 |
- 2,6 |
- 2,3 |
- 1,9 |
Irlande |
- 4,1 |
- 10,4 |
- 5,5 |
- 2,2 |
2,1 |
- 0,4 |
0,9 |
1,1 |
2,1 |
1,9 |
3,4 |
4,6 |
Italie |
- 5,4 |
- 9,6 |
- 10,9 |
- 9,2 |
- 3,3 |
- 6,7 |
- 2,7 |
- 2,5 |
- 2,6 |
- 2,0 |
- 2,3 |
- 2,0 |
Luxembourg |
2,7 |
1,9 |
- |
1,8 |
2,4 |
2,9 |
3,0 |
1,0 |
2,2 |
0,6 |
2,0 |
2,0 |
Pays-Bas (b) |
- 0,5 |
- 3,6 |
- 5,1 |
- 3,6 |
- 1,3 |
- 2,2 |
- 0,9 |
- 1,6 |
- 1,4 |
- 1,2 |
- 1,4 |
- 0,6 |
Autriche |
1,5 |
- 2,3 |
- 3,2 |
- 3,8 |
- 2,4 |
- 3,7 |
- 1,9 |
- 2,3 |
- 2,2 |
- 2,2 |
- 2,1 |
- 1,9 |
Portugal |
1,9 |
- 6,7 |
- 4,5 |
- 5,4 |
- 2,4 |
- 3,3 |
- 2,5 |
- 2,2 |
- 2,3 |
- 1,9 |
- 2,0 |
- 1,8 |
Finlande |
4,6 |
3,7 |
4,0 |
- 5,3 |
0,0 |
- 3,5 |
- 1,1 |
0,3 |
0,7 |
0,6 |
1,8 |
2,1 |
Suède |
4,5 |
- 1,7 |
3,2 |
- 7,7 |
0,1 |
- 3,5 |
- 0,8 |
0,5 |
0,9 |
0,9 |
1,4 |
2,3 |
Royaume-Uni |
0,1 |
- 3,6 |
- 0,7 |
- 5,8 |
- 1,4 |
- 4,7 |
- 2,1 |
- 0,6 |
- 0,1 |
- 0,3 |
0,1 |
- 0,2 |
EU-15 * |
- 0,3 |
- 3,7 |
- 3,3 |
- 5,1 |
- 2,2 |
- 4,2 |
- 2,3 |
- 1,9 |
- 1,8 |
- 1,6 |
- 1,4 |
- 1,2 |
EUR-11 ** |
- 0,7 |
- 3,9 |
- 4,1 |
- 4,9 |
- 2,5 |
- 4,1 |
- 2,5 |
- 2,4 |
- 2,3 |
- 2,0 |
- 1,9 |
- 1,7 |
USA |
- 0,8 |
- 2,3 |
- 2,9 |
- 3,5 |
0,9 |
- 1,2 |
0,1 |
0,1 |
1,4 |
0,6 |
2,0 |
2,4 |
Japon |
0,8 |
- 3,2 |
1,3 |
- 0,6 |
- 5,1 |
- 4,3 |
- 3,3 |
- 3,6 |
- 5,5 |
- 3,6 |
- 6,7 |
- 5,9 |
* L’Allemagne de l’Ouest jusqu’à 1990.
EU-15 et EUR-11 agrégé avec l’Allemagne de l’Ouest jusqu’à 1990.
Agrégation sans la Grèce jusqu’à 1985.
** Zone euro.
(a) Hors reprises de dettes et d’actifs liés à
l’unification par le gouvernement fédéral en 1995 (Treuhand, sociétés
immobilières est-allemandes et Deutsche Kreditbank), représentant un total de
227,5 milliards de Deutschemark.
(b) Hors dépenses exceptionnelles nettes liées à la réforme du
financement des sociétés de logement social en 1995, représentant un total de
32,84 milliards de florins.
Source : Commission européenne. |
L’accumulation des déficits des finances publiques
a entraîné un net accroissement de la dette publique des Etats membres de l’Union
européenne. Le ratio dette/PIB a commencé à augmenter sous l’effet des déficits
entre 1975 et 1980 et a subi une nouvelle hausse à partir de 1991 pour atteindre près de
60% du PIB de l’Union en 1997. Cette hausse de la dette publique s’est traduite
par une augmentation des charges de la dette (de 1,8% du PIB dans les années 1970 à 5,4%
en 1996).
Le tableau ci-dessous présente l’évolution de la dette publique dans sept pays
européens entre 1990 et 1995.
DETTE PUBLIQUE
(en % du PIB) |
| |
1990 |
1991 |
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
| France |
35,4 |
35,8 |
39,7 |
45,4 |
48,4 |
52,4 |
| Allemagne |
43,8 |
41,5 |
44,1 |
48,2 |
50,4 |
58,1 |
| Royaume-Uni |
35,3 |
35,7 |
41,9 |
48,5 |
50,3 |
54,0 |
| Italie |
98,0 |
101,4 |
108,5 |
119,4 |
125,6 |
124,8 |
| Pays-Bas |
78,8 |
78,8 |
79,4 |
81,1 |
77,6 |
79,0 |
| Belgique |
130,9 |
130,3 |
131,5 |
137,9 |
136,1 |
133,7 |
| Espagne |
45,1 |
45,8 |
48,4 |
60,5 |
63,1 |
65,7 |
Source: Eurostat (mai 1996).
Les grandes étapes qui viennent d’être rapidement retracées
sont en phase avec des contextes politico-économiques précis qu’il n’est pas
inutile de rappeler. Les années soixante-dix sont marquées par un consensus sur
l’utilisation du budget pour lutter contre la stagnation économique et ceci
s’est traduit par le creusement des déficits publics structurels. Entre 1976 et
1989, la lutte contre l’inflation devient prioritaire et, de surcroît, le fort
niveau des taux d’intérêt oblige les autorités budgétaires à réduire les
déficits primaires (hors charges d’intérêt de la dette) et les déficits
structurels se stabilisent autour de 1% du PIB. La période 1989-1991 voit le retour des
politiques budgétaires " actives " devant la nouvelle dégradation de
l’activité économique.
Mais, à partir de 1991, la situation devient paradoxale : le
solde public effectif reste fortement déficitaire (- 4,4 % en 1996) tandis que
le solde structurel primaire se redresse fortement (+ 4 % du PIB en 1996).
Ce paradoxe a été mis en évidence par une étude conjointe de
l’OFCE et du CEPII intitulée " UEM : quelle stratégie
macro-économique " (), qui évalue l’impact sur la
croissance en Europe des politiques budgétaires mises en oeuvre depuis 1991. Les auteurs
ont calculé " un indicateur d’effort budgétaire " pour chaque
Etat, utilisé ensuite pour simuler l’impact de cet effort sur la croissance. Selon
les conclusions de cette étude, " le taux de croissance de l’activité
est réduit partout en Europe dans les proportions correspondant aux efforts restrictifs
réalisés ". Dans tous les pays, la baisse de l’activité induite par
les mesures restrictives contrebalance les efforts initiaux. Le solde public ne peut donc
s’améliorer à hauteur des efforts précédemment consentis.
2.- Les dépenses publiques
dans le monde
Une comparaison internationale des dépenses publiques est présentée
dans l’étude précitée du Conseil économique et social conduite par
M. Jacques Méraud. Elle a été réalisée à partir de la publication par
l’OCDE d’informations internationales harmonisées sur les dépenses des
administrations publiques de 1960 à 1990. L’étude a établi un classement de 18
pays selon la part (en pourcentage) des dépenses publiques totales dans le PIB en 1960 et
en 1990. En 1960, la France occupait le deuxième rang de ce classement, derrière
l’Autriche, et, en 1990, elle n’occupait plus que le huitième rang, précédée
par trois pays scandinaves, les Pays-Bas, la Belgique, l’Italie et la Grèce,
l’Allemagne se trouvant alors en onzième position. Un seul pays est resté
d’une année à l’autre au bas du tableau, le Japon, qui est, en 1990, avec les
Etats-Unis, celui où les dépenses publiques, exprimées en pourcentage du PIB, sont les
plus modérées. On peut retenir également que, pour la variation de la part de ses
dépenses publiques dans le PIB entre 1960 et 1990, la France occupe le douzième rang.
Un autre classement comparatif est effectué, pour l’année 1990,
pour quatre composantes des dépenses publiques (consommation des administrations,
transferts sociaux, intérêts versés et subventions et, enfin, " formation
brute de capital fixe " c’est à dire les investissements publics et
l’aide publique à l’investissement) exprimées en pourcentage du PIB. La France
occupe le troisième rang en ce qui concerne les transferts sociaux, le huitième rang
pour les investissements sur fonds publics, le dixième rang pour la consommation des
administrations elles-mêmes et le douzième pour l’ensemble des intérêts versés
et des subventions économiques.
Les comparaisons internationales doivent être, en permanence,
éclairées par la prise en compte de la spécificité des dépenses publiques propres à
chaque pays. M. Jacques Méraud a ainsi mis en garde contre le risque qu’il y a
à comparer le poids des transferts sociaux effectués par les administrations publiques
en France, en Italie et en Allemagne. En Italie les transferts sociaux sont largement
remplacés par le travail au noir, l’économie souterraine se substituant aux revenus
de remplacement versés en France. Pour l’Allemagne, ce sont les mutuelles
d’entreprises qui financent une large part des transferts sociaux. On pourrait
ajouter le cas des Etats-Unis, où l’assurance maladie est, pour l’essentiel,
abandonnée au marché.
Il convient donc, à l’évidence, pour établir des comparaisons
pertinentes, de s’intéresser à la composition et à l’efficacité des
dépenses publiques.
Mais, à ce stade de l’analyse, il est possible de clarifier le
débat sur les véritables enjeux de la réduction de l’endettement public et sur les
fausses évidences à ce sujet.
C.-
Restreindre l’endettement public
sans se tromper de cible
On peut, tout d’abord, tenir pour acquis, à partir de la
démonstration de M. Jacques Méraud, que, si la croissance des dépenses publiques
en volume a beaucoup augmenté jusqu’en 1983, et plutôt plus en France que dans les
pays voisins, cette évolution doit être mise en regard d’une croissance plus forte
du PIB, la tendance s’inversant à partir de cette année 1983.
L’accroissement annuel moyen de la dépense publique a
d’ailleurs été relativement plus faible que précédemment au cours des années
récentes, marquées par des taux de croissance du PIB très ralentis.
Pour l’auteur, la relative faiblesse des taux de croissance du PIB
en France depuis le début des années 1980, comparés à ceux des autres pays européens,
ne serait donc pas la conséquence de charges publiques exacerbées et il faudrait trouver
d’autres explications à ce léger décalage avec les pays voisins.
Tout d’abord, il faut tenir compte du décalage entre le cycle de
croissance des pays anglo-saxons et celui de la plupart des pays européens. Mais surtout,
s’agissant de la France, on constate qu’elle affichait environ un demi point de
croissance de plus que ses partenaires, lorsqu’elle pratiquait une politique
monétaire plus expansive qu’eux, et un demi-point de moins, à partir du moment où
sa politique monétaire est devenue plus restrictive.
Cette corrélation positive entre croissance du PIB et augmentation des
dépenses publiques, qui laisse subsister une incertitude sur le point de savoir où est
la cause et où est l’effet, s’observe chez tous les partenaires de la France,
à condition que l’on veuille bien tenir compte du décalage entre les fluctuations
cycliques de la croissance, en particulier avec les Etats-Unis et le Royaume-Uni,
décalage qui rend les comparaisons difficiles sur des périodes courtes.
Un élément nouveau doit être pris en compte, si possible également
en évitant les interprétations dogmatiques : il s’agit du poids de la dette
publique, qui réduit considérablement la marge de manoeuvre budgétaire. Pour
l’ensemble des pays de l’OCDE, le rapport de la dette au PIB est, en effet,
passé de 41% en 1980 à 59% en 1990 et 72% en 1995.
Pour les pays de l’Union européenne, l’endettement public
est devenu pratiquement le seul moyen de financer le solde budgétaire depuis
l’entrée en vigueur du traité de Maastricht, qui interdit tout financement
monétaire direct du déficit public par les banques centrales.
En réalité, il existe un financement monétaire indirect du Trésor
par la banque centrale, puisque cette dernière peut et pourra toujours acheter des effets
publics sur le marché secondaire.
Néanmoins, ce taux d’endettement, qui oblige l’Etat à
emprunter pour rembourser les emprunts antérieurs, est porteur de risques et rend
nécessaire l’édiction de contraintes à l’endettement public et, partant, au
déficit budgétaire.
1.- Les risques liés à
l’endettement public
Le principal risque lié à l’endettement, qui doit être évalué
régulièrement et nécessite des mesures adaptées, est celui d’" effet
boule de neige " qui pourrait déboucher sur la non-solvabilité de l’Etat.
L’effet boule de neige est un processus d’explosion de la
dette publique qui se produit lorsque le taux d’intérêt de la dette est supérieur
au taux de croissance du PIB, ce qui entraîne une augmentation exponentielle du ratio
dette/PIB.
Il est généralement admis que lorsque le taux
d’intérêt (i) des emprunts publics reste inférieur au taux de
croissance (n) du PIB, le risque d’effet boule de neige n’existe pas et le
déficit primaire du budget de l’Etat est compatible avec une stabilisation du ratio
dette/PIB. Dans le cas contraire, une stabilisation de ce ratio requiert un budget
primaire de l’Etat excédentaire.
Le tableau de bord ci-dessous, extrait d’un article de
MM. Pierre Llau et Jacques Percebois (), exprime cette situation.
Contexte |
Situation budgétaire |
Effet boule de neige |
i<n
i>n |
Excédent primaire
Déficit primaire
Excédent primaire
Déficit primaire |
NON
NON
NON
OUI |
2.- La limitation de l’endettement public
passe par un dosage fin entre maîtrise des dépenses et réforme de la fiscalité
Pour contrecarrer l’effet boule de neige, l’Etat doit
s’efforcer de favoriser la croissance de façon à ce que le taux de croissance du
PIB reste supérieur aux taux d’intérêt. Mais il doit aussi s’efforcer de
faire apparaître un excédent du budget primaire, ce qui revient soit à accroître les
impôts, soit à réduire les dépenses. Cet excédent primaire devra être d’autant
plus fort que la dette publique aura atteint un niveau plus important, ce qui risque alors
de mettre en péril les dépenses productives de l’Etat, souvent réduites en
priorité.
Des contraintes ont été institutionnalisées en Europe, avec le
traité de Maastricht et l’adoption, par le Conseil européen d’Amsterdam les 16
et 17 juin 1997, du Pacte de stabilité et de croissance, qui laissent aux Etats membres
le choix des moyens pour atteindre les objectifs fixés.
Si une réorientation d’ensemble des prélèvements fiscaux vers
une fiscalité plus juste et plus efficace est nécessaire, il est exclu d’accroître
davantage la pression fiscale globale.
Pour être complet, on mentionnera l’étude de M. François
Bourguignon (), directeur d’études à l’Ecole des hautes
études, membre du Conseil d’analyse économique créé le 22 juillet 1997
auprès du Premier ministre. Cette étude relève que les prélèvements obligatoires ne
sont qu’en apparence plus forts en France qu’à l’étranger (30% aux
Etats-Unis), car, dans un cas, les prélèvements d’assurance maladie ou de retraite
sont obligatoires et donc pris en compte dans cet agrégat et, dans l’autre, ils ne
le sont pas. Si l’on exclut ces derniers prélèvements, les taux sont très voisins.
M. François Bourguignon s’attache à comparer le poids
macro-économique des divers circuits de redistribution dans quelques pays de l’OCDE
qu’il a choisis parmi ceux dont les taux de prélèvement obligatoires sont aux deux
extrêmes (Japon et Suède étant les plus éloignés de la moyenne). La France se situe,
avec l’Allemagne, à peu près au milieu du tableau comparatif. Mais cette
comparaison fait surtout ressortir le fait qu’en rapprochant les chiffres relatifs
aux différents prélèvements obligatoires, il se confirme que la plus grande partie de
l’écart entre les taux globaux de prélèvements obligatoires s’explique par la
couverture différente des systèmes d’assurance sociale. Plus précisément, une
grande partie des différences du taux de prélèvements obligatoires entre pays
s’explique par les parts différentes des secteurs publics et privés dans
l’assurance-vieillesse et l’assurance-maladie.
L’auteur tire de ces observations la conséquence que l’on ne
saurait se baser sur les taux de prélèvement obligatoire pour comparer la redistribution
qui peut avoir lieu à travers le circuit des assurances sociales dans divers pays. Etant
donné la similitude entre assurances privées et publiques, il n’exclut pas que des
pays ayant des taux de couverture sociale assez différents aboutissent néanmoins à une
redistribution équivalente.
D’ailleurs l’étude constate que les sommes redistribuées
des 50% des ménages les plus riches vers les 50% les plus pauvres représentent 5% du
revenu total des ménages en France contre 6% au Royaume-Uni ou 7% en Allemagne. Que la
France se situe plutôt vers le haut du classement international au regard du critère des
prélèvements obligatoires n’implique pas nécessairement qu’elle redistribue
plus que des pays qui se situent à un niveau inférieur, cela signifie avant tout,
qu’un certain nombre de fonctions d’assurance relèvent plus qu’ailleurs de
l’Etat ou des administrations de sécurité sociale et sont financées de façon
contributive et obligatoire sur les revenus d’activité.
M. François Bourguignon conclut qu’avec les mêmes
possibilités de redistribution que ses voisins, c’est à dire une pression fiscale
analogue, et avec une même demande sociale pour la redistribution, soit une distribution
comparable de revenus avant impôts et transferts sans contrepartie, les performances
redistributives de la France sont inférieures. Ce déficit de redistribution
s’explique, selon lui, par un faible pouvoir redistributif des transferts sans
contrepartie (RMI, allocations logement, aides aux parents isolés...) et surtout par la
place limitée faite à l’imposition progressive sur le revenu.
Si l’intensité redistributive n’est pas au niveau
souhaitable, il est cependant difficile de conclure qu’une marge subsiste en terme de
pression fiscale et sociale pesant sur la consommation et les facteurs de production.
Il n’existe donc pas de recette garantissant le succès d’un
ajustement budgétaire (par l’impôt ou par la réduction des dépenses), toutefois,
la problématique budgétaire aujourd’hui semble s’orienter, au sein de
l’Union européenne, vers un double consensus : résorber les déficits tout en
évitant l’effet négatif sur l’activité économique de politiques budgétaires
restrictives.
Nous tenterons de voir ci-après quels sont les principaux moteurs de
cette double obligation.
II.- lA PoursuiTE DE
l’assainissement des finances publiques DOIT ÊtRE ASSOCIÉE AU soutIEN À la
croissance
Le nécessaire assainissement des finances publiques doit être conduit
sans dogmatisme : il doit reposer sur une analyse de l’impact réel des
dépenses sur la croissance ; il doit s’effectuer en liaison avec nos
partenaires de l’Union européenne ; il doit prendre en compte une programmation
pluriannuelle des dépenses publiques ainsi qu’une évaluation généralisée des
résultats.
A.- Privilégier les dépenses favorables à la croissance
Les mécanismes exacts par lesquels transite le soutien à la
croissance restent à déterminer. De fait, certaines dépenses publiques ont pour effet
d’augmenter la capacité de production de l’économie ou contribuent à
accroître la productivité du secteur privé. Pour les keynésiens, la socialisation de
certains investissements (qui ne signifie pas a priori propriété étatique) par
l’utilisation du budget en capital, permettrait non seulement d’augmenter le
volume global d’investissements indispensable pour s’attaquer au noyau dur du
chômage, mais irait dans le sens de la réduction des incertitudes en favorisant une plus
grande stabilité de la conjoncture. Cet effet serait amplifié à l’échelle de
l’Europe, dont la croissance globale va dépendre essentiellement du dynamisme de sa
demande interne.
Le danger majeur des règles de discipline budgétaire vient de ce
qu’elles se focalisent sur le niveau du déficit et de la dette sans se préoccuper
de la structure des dépenses. Or, les récentes théories de la croissance endogène
soulignent avec force le rôle essentiel des dépenses publiques
" d’avenir ", dépenses d’éducation, de formation, de
recherche et d’infrastructure, dans le processus de croissance de long terme.
L’un des critères servant à délimiter le champ des interventions publiques doit
être l’obtention de rendements d’échelle croissants. A cet égard, les
dépenses effectuées par les pouvoirs publics sont à l’origine d’externalités
positives dont bénéficie la collectivité, et, en premier lieu, les entreprises, et qui
contribuent à renforcer la compétitivité générale du pays.
Dans cette perspective, la politique budgétaire peut contribuer à la
croissance.
Avant d’aborder la structure de la dépense publique en France, il
convient aussi de rappeler que le sens premier de la dépense publique est de couvrir les
dépenses que la collectivité a décidé de socialiser. Il s’agit donc de décider
quels droits seront effectivement garantis à tous.
Une autre mise au point est nécessaire : les dépenses publiques
ne peuvent sérieusement être regardées comme un immense " trou
noir ", absorbant, consommant et détruisant une partie des richesses créées
par les " forces vives du pays ".
Il s’agit donc de déterminer aussi finement et aussi
objectivement que possible l’utilité économique et sociale de chaque part de
richesse mise à la disposition de la collectivité.
L’ensemble des dépenses publiques représentait, en 1992, comme
on l’a vu, 53,5% du PIB. Mais il faut tout d’abord préciser que la moitié de
cette masse est constituée par des dépenses de transfert. Ce qui a été prélevé est
donc réinjecté dans l’économie par l’intermédiaire des administrations
publiques. Il est d’ailleurs établi que plus le taux de chômage s’élève et
plus la dépense publique de redistribution et d’action pour l’emploi augmente
également.
En comptabilité nationale, comme dans la classification établie par
l’OCDE, il existe trois grandes catégories de dépenses, les dépenses de
fonctionnement, qui incluent les dépenses de consommation des administrations et les
intérêts de la dette, les dépenses d’investissements et les dépenses de
transfert.
Toujours en 1992, parmi les 53,5% de dépenses publiques, la part de la
consommation des administrations était de 18,6% et la part des transferts de 26,2%.
Le concept de consommation recouvre les dépenses de personnel et les
dépenses de " consommation intermédiaire " c’est à dire les
achats de biens et de services par les administrations, mais également les dépenses
d’éducation, de recherche et de santé, qui devraient davantage être considérées
comme des investissements immatériels.
En ce qui concerne le budget de l’Etat, on retrouve la distinction
entre dépenses courantes, juridiquement qualifiées
d’" ordinaires " (de fonctionnement) et dépenses en capital
(d’investissement), les premières contribuant là aussi à financer
l’éducation ou la recherche. Certaines dépenses d’entretien des
infrastructures (routes, aéroports ...) figurent également dans les dépenses courantes,
alors que les dépenses d’amélioration du réseau de communication sont des
dépenses en capital, sans que la frontière entre les deux soit toujours très nette.
En 1992, selon le rapport précité du Conseil économique et social,
les dépenses courantes représentaient 86,1% du total du budget (17,6% du PIB) et les
dépenses en capital 13,9% du budget. Ces dernières sont passées de 5,9% du PIB en 1949
à 2,8% en 1992.
Un dernier élément d’information peut être utile, il concerne
la répartition des tâches entre les fonctionnaires.
Selon les estimations du mensuel " Alternatives
économiques " de décembre 1998, 78% des fonctionnaires de l’Etat et
des collectivités locales participent à la production de biens et de services, 5% à la
conception, à la mise en oeuvre et au contrôle des politiques publiques, et 17%
remplissent des fonctions de gestion et d’administration.
Entre 1980 et 1995, le nombre total de fonctionnaires (Poste et
télécommunications comprises) est passé de 4,6 à 5,3 millions, soit une hausse de
15%, la part de la fonction publique dans l’emploi global passant de 21 à 23,7%.
En 1995, les dépenses de personnel de l’ensemble des
administrations publiques ont représenté 14,4% du PIB.
On voit bien qu’au-delà des conflits idéologiques sur plus
d’Etat ou moins d’Etat, ce qui doit l’emporter, c’est la recherche de
l’efficacité de l’Etat, et que le coût de fonctionnement de l’Etat, comme
de l’ensemble des entreprises publiques, ne peut être jugé qu’au regard des
prestations offertes en contrepartie.
RETOUR SOMMAIRE
B.- Coordonner les politiques budgétaires au sein de l’Union
européenne pour assurer le soutien de l’activité
Depuis 1991, la croissance de l’économie européenne n’est
pas bloquée par des facteurs d’offre: l’inflation est basse, le solde
extérieur excédentaire, la situation des entreprises est globalement bonne et il
n’existe pas de tensions, bien au contraire, ni sur les capacités de production ni
sur le marché du travail. L’économie européenne a surtout souffert et souffre
encore, du manque de dynamisme de la demande.
Néanmoins, les pays européens restent tenus de réduire leur déficit
public, alors que les perspectives de croissance sont moins favorables.
Une stratégie macro-économique claire en Europe et des politiques
budgétaires coordonnées peuvent-elles sortir l’Union de ce dilemme et venir en aide
à la croissance ?
Selon le Pacte de stabilité adopté au Conseil européen
d’Amsterdam, les Etats participant à l’euro s’engagent à avoir, à moyen
terme, une situation budgétaire équilibrée ou excédentaire. Ils s’engagent à
présenter des programmes dans lesquels sont précisés les objectifs budgétaires, la
manière de les atteindre, et la sensibilité des prévisions aux hypothèses
sous-jacentes. Ces programmes sont pluriannuels, réactualisés et corrigés dès
qu’il existe un risque de déficit excessif, et ils sont rendus publics.
La Commission européenne devra établir un rapport dès que le
déficit public effectif ou prévu dépassera 3%. Ce dépassement sera considéré comme
exceptionnel s’il est consécutif à un événement inhabituel et indépendant de la
volonté de l’Etat ou si l’on constate une chute annuelle du PIB réel d’au
moins 2%.
La coordination des politiques macro-économiques au cours de la
troisième phase de l’UEM s’est trouvée au coeur des débats du Conseil
européen à Luxembourg en décembre 1997, mais aucune décision contraignante n’a
été adoptée en ce sens par le Conseil. La coordination continue de reposer sur la bonne
volonté des Etats. Elle reste à imaginer et à mettre en oeuvre.
Il va s’agir d’élaborer une combinaison satisfaisante
- ce que les anglo-saxons nomment un policy mix - entre une politique
monétaire unique et des politiques budgétaires décentralisées, mais soumises à des
normes de déficit.
Selon M. Pierre Jacquet, directeur-adjoint de l’IFRI (),
la période difficile sera celle pendant laquelle les déficits resteront très près de
la marge supérieure autorisée, parce que la marge de manoeuvre budgétaire sera très
faible. C’est pourquoi, " la négociation doit pendant cette période de
transition porter sur une interprétation collective de ce que veut dire la maîtrise
budgétaire: c’est, d’une part, veiller à la solvabilité de la dépense
publique bien plus que de respecter un objectif de déficit ou de dette publique ;
d’autre part, la coordination devrait consister à poser le problème de la
discipline budgétaire davantage en termes de budget global de la zone euro, plutôt
qu’une discipline décentralisée par pays ".
De ce point de vue, il faut se réjouir des conclusions du Conseil
informel de Pörtschach des 24 et 25 octobre 1998, au cours duquel un consensus s’est
dessiné pour considérer par principe que l’amortissement des dépenses publiques
d’investissement ne peut être imputé comme déficit et pour souhaiter que la
politique monétaire prenne en charge la stimulation de l’activité. L’objectif
commun clairement affirmé a été celui de la croissance et de l’emploi.
La baisse simultanée, le 4 décembre dernier, des taux directeurs des
banques centrales des onze pays de la zone euro est, à cet égard, très encourageante.
C.- Programmer les dépenses sur plusieurs années et généraliser
l’évaluation des résultats
Une approche renouvelée de la dépense publique doit reposer sur une
vision pluriannuelle et sur l’exigence permanente d’une évaluation de ses
résultats.
1.- Les avantages
d’une vision pluriannuelle des dépenses
Avoir une vision, au-delà d’un an, des processus économiques
contribuerait à rendre plus crédible l’affirmation selon laquelle les politiques
économiques sont de nature à permettre de combattre les plus graves dysfonctionnements
du moment, tel le chômage.
Un débat démocratique permet alors de faire le choix des objectifs
prioritaires à atteindre en plusieurs années et des moyens, en l’occurrence
budgétaires, à mettre en oeuvre pour y parvenir.
De surcroît, la capacité à prévoir les crédits nécessaires à la
mise en oeuvre d’un programme d’action qui va se dérouler sur plusieurs années
est probablement une source importante de rationalisation de la gestion et donc
d’économies.
N’importe quel plan de reconversion industrielle, de modernisation
d’un service public, de soutien à un secteur technologique ou encore la rénovation
des modes de rémunération des fonctionnaires, doit pouvoir se dérouler dans la durée,
en s’appuyant sur une solide évaluation des besoins financiers et la garantie que
les tranches de financement prévues seront respectées.
La souplesse de gestion et l’adaptation des moyens aux objectifs
qui en résultent et les contrôles réguliers, bien évidemment obligatoires, sont autant
de garanties d’une bonne gestion des fonds publics.
Cette logique de programmation, venant aussi souvent que possible se
substituer à une logique de projet à court terme, va incontestablement dans le sens de
la modernisation de l’Etat.
Un exemple est souvent cité, celui des plans
" objectifs-moyens " engagés par le ministère de l’équipement
à partir de 1985. Ces plans reposent sur une gestion planifiée des ressources humaines
définie au niveau déconcentré. Ils ont permis de passer d’une gestion de moyens à
une gestion par objectifs. Concrètement des accords d’évolution pluriannuelle des
effectifs ont été conclus avec le ministère du budget, prévoyant un recyclage des
économies réalisées au profit de crédits de fonctionnement ou d’investissement.
Mais il est paradoxal de constater que les mécanismes existant de
gestion pluriannuelle, tels que les contrats de plan ou les lois de programmation, qui
devraient être source de bonne gestion et d’économies, voient leur exécution
retardée pour des raisons de rigueur budgétaire à court terme.
Certes, les investissements d’infrastructures traditionnelles, qui
avaient initialement justifié les autorisations de programme ou contrats de plan, ne sont
plus, pour l’essentiel, supportés par l’Etat, mais par les collectivités
territoriales, qui réalisent désormais près des trois-quarts des investissements des
administrations publiques. Cependant, la programmation pluriannuelle pourrait retrouver
tout son intérêt pour des investissements immatériels tels que la recherche ou
l’enseignement.
Un autre secteur exige également une analyse prospective des besoins
et une gestion prévisionnelle, il s’agit de la gestion des ressources humaines de
l’Etat ; les politiques de recrutement, d’évolution des statuts, de
formation, doivent être programmées et leurs coûts évalués.
Il n’existait pas, en France, jusqu’à une date récente, de
projection de l’évolution des finances publiques à moyen terme. A cet égard, le
Pacte de stabilité et de croissance exige, pour chaque Etat de la zone euro, une
programmation triennale assurant la consolidation budgétaire. Il faut donc désormais
admettre la nécessité d’une programmation budgétaire pluriannuelle, au moins dans
ses grandes orientations.
La rigidité de l’approche annuelle de la dépense publique, outre
qu’elle est un facteur d’incertitude, se traduit, dans les administrations, en
raison de possibilités limitées de reporter les crédits de dépenses ordinaires ()
d’une année sur l’autre, par des comportements favorisant les gaspillages
consistant à engager en fin d’année tous les crédits disponibles, en dehors de
toute recherche d’efficacité.
La maîtrise des dépenses publiques exige d’assouplir ce carcan.
Une évolution dans ce sens est perceptible avec l’obligation
faite, comme on vient de le voir, par le Pacte de stabilité et de croissance, pour les
pays de la zone euro, de présenter des programmations triennales de leurs finances
publiques. Une ébauche de cette démarche a été réalisée le 23 décembre 1998
devant la Commission des finances de notre Assemblée : le ministre de
l’économie, des finances et de l’industrie et le secrétaire d’Etat au
budget sont venus présenter le programme pluriannuel des finances publiques d’ici à
2002. Il est certain que, pour l’avenir, une préparation plus en amont permettrait
de développer un débat contradictoire à la mesure d’un exercice aussi fondamental
que l’examen des grands choix économiques et financiers.
2.- L’évaluation
doit devenir un outil d’aide à la décision budgétaire
L’évaluation vise à énoncer, sur une politique ou un programme
spécifique, un jugement basé sur une information rigoureusement collectée et
débouchant sur une réelle connaissance d’un phénomène.
Il est possible de lui assigner différents objectifs : examiner
l’efficience d’une action, ou mesurer la productivité ou le rapport
coût/qualité d’un service, ou encore ce que les Britanniques appellent la
" value for money ", qui consiste à savoir si l’on peut
atteindre le même résultat à un coût moindre. L’évaluation peut également
s’intéresser aux conditions de mise en œuvre d’une politique, afin de
déterminer si les moyens utilisés sont adéquats.
Selon M. Jean-Claude Thœnig, président du Conseil scientifique de
l’évaluation (), l’utilisation de cet outil, en France,
n’est pas satisfaisante, bien qu’il existe de nombreux travaux
d’évaluation dans les ministères, par exemple dans le domaine de l’emploi ou
de l’éducation. Mais ces informations sont très peu utilisées au niveau national
et, surtout, elles se développent indépendamment de la préparation du budget.
M. Jean-Claude Thœnig cite l’exemple du " National
Audit Office " créé en 1983 au Royaume-Uni, chargé, pour le compte du
Parlement, d’examiner l’activité des départements ministériels et des
organismes publics sous l’angle de l’économie, de l’efficience et de
l’efficacité et qui élabore chaque année cinquante rapports de type value for
money.
En France, on constate une extrême centralisation, au plus haut niveau
de l’Etat, pour le lancement de programmes d’évaluation et, surtout, pour
l’utilisation des résultats. Il en résulte une très forte dépendance de
l’évaluation à l’égard des décideurs politiques gouvernementaux et de leur
plus ou moins grande sensibilité à cet outil. Or, il est indispensable qu’une
procédure d’évaluation puisse suivre son cours jusqu'à la diffusion des
résultats, sans possibilité pour les autorités publiques d’en interrompre le
cours.
La France est, sur ce terrain, un cas unique en Europe, malgré le
relatif succès rencontré par l’évaluation de plusieurs politiques (RMI,
informatisation, maîtrise de l’énergie, modernisation du ministère de
l’équipement). La loi quinquennale pour l’emploi prévoyait, dans son
article 82, une procédure spécifique d’évaluation qui aurait dû prendre la
forme d’un rapport à mi-parcours, adressé par le Gouvernement au Parlement. Une
commission mixte composée de six parlementaires et de six membres désignés par le
Gouvernement devait contribuer à l’élaboration de ce rapport. Or, le rapport,
publié en février 1997, n’a jamais été présenté au Parlement et encore moins
débattu.
Le lien entre la stratégie budgétaire et la demande
d’évaluation doit être toujours présent, même si les résultats
d’évaluation ne sont pas immédiatement traduisibles en termes de décision
budgétaire. Mais l’évaluation doit permettre également une meilleure connaissance
des réalités. On citera, de ce point de vue, une étude très instructive réalisée par
le Centre d’étude des revenus et des coûts (CERC) (), supprimé en
1994, qui rappelle que la productivité d’un service public se mesure en fonction du
degré de réalisation des objectifs qui lui sont assignés par les politiques publiques,
du degré de satisfaction des usagers et de la performance propre au service
(résultats/coûts). La mesure de la productivité globale d’un service ne doit pas
se limiter à la seule mesure de la productivité du travail, mais intégrer bien
d’autres gisements de productivité. Le CERC s’appuie sur des exemples concrets,
en particulier les caisses d’allocations familiales (CAF) et les unités forces du
ministère de la défense, où les gains de productivité importants (près de 4% en
moyenne d’une année par rapport à la précédente entre 1987 et 1990 pour les CAF)
ont été réalisés en agissant sur tous les produits (services rendus) et les moyens mis
en oeuvre pour produire (frais d’accueil, frais de publicité, démarchage auprès
des allocataires... pour les CAF).
De même que la productivité du travail n’est pas le seul
élément à prendre en compte pour évaluer la productivité d’un service de
l’Etat ou d’un service public, l’évaluation de ce service ne se résume
pas à sa productivité. Cette évaluation dépend des résultats par rapport aux
objectifs assignés aux politiques publiques par le Gouvernement et le Parlement et aux
missions assignées aux différents organismes. Les questions éclairées par
l’évaluation doivent donc être des questions pertinentes du point de vue des
grandes décisions publiques.
A côté des mécanismes de contrôle de la légalité des procédures
d’utilisation de l’argent public, il est urgent que le Parlement s’efforce
d’en évaluer les résultats, s’il souhaite peser davantage sur les choix
budgétaires et contrôler réellement l’action du Gouvernement. La concrétisation
de cette volonté devrait contribuer à résoudre certaines difficultés budgétaires et
même à renforcer, aux yeux de l’opinion, la légitimité de l’action publique,
grâce à la justification rationnelle des interventions et des dépenses collectives.
RETOUR SOMMAIRE
DEUXIÈME PARTIE
actuellement, LE PARLEMENT ne contribue pas fortement
À L’AMÉLIORATION DE L’EFFICACITÉ DE LA DÉPENSE PUBLIQUE
La Vème République marque, aux yeux de nos concitoyens, un
affaiblissement du pouvoir législatif, confronté à la puissance du pouvoir exécutif.
Cet affaiblissement serait particulièrement aigu en matière budgétaire et financière,
au point que certains ont évoqué " le déclin des pouvoirs financiers du
Parlement " ().
L’ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique
relative aux lois de finances régissant ces pouvoirs financiers a largement accompagné
cette évolution.
Il convient de rappeler que le texte fut, en effet, élaboré par la
direction du budget, au cours du dernier trimestre 1958, en dehors de toute concertation
avec la Commission des finances de l’Assemblée nationale, et ce contrairement aux
modalités d’élaboration du décret de 1956, puis promulgué par voie
d’ordonnance sur la base de l’article 92 de la Constitution, destiné à
permettre la mise en place des institutions.
L’ordonnance n’a, par la suite, fait l’objet que de deux
révisions d’importance mineure (), comme si elle était devenue une
sorte de " tabou ", comme l’a relevé M. Guy Carcassonne,
professeur de droit public, dans son intervention devant le groupe de travail.
Il est certes indéniable que l’ordonnance organique du
2 janvier 1959 a pour finalité de promouvoir une logique d’efficacité des
institutions de la Vème République, et ce au bénéfice du pouvoir exécutif. Doit-on
pour autant considérer que le Parlement en est réduit au rôle d’une simple chambre
d’enregistrement ? Un tel jugement mérite d’être nuancé, selon que le
Parlement exerce des fonctions de législation ou des fonctions de contrôle.
I.- Bien que
notre procÉdure budgétaire souffre d’UN MANQUE DE TRANSPARENCE, LES PRÉROGATIVES
DU PARLEMENT LUI PERMETTENT, en thÉorie,
D’AGIR SUR LA DÉPENSE PUBLIQUE
A.- LA
transparence DE NOTRE PROCédure budgétaire
est insuffisante
Pour exercer sa fonction de législateur, le Parlement dispose
d’une masse d’informations abondante, voire surabondante.
Comme le prescrit l’article 32 () de
l’ordonnance organique, le Parlement reçoit, parallèlement au dépôt du projet de
loi de finances, une série de documents d’origine gouvernementale, destinés à
éclairer la représentation nationale sur les choix de l’exécutif :
– rapport économique, social et financier, analysant
l’évolution économique internationale et explicitant les objectifs de la politique
gouvernementale ; ce rapport est assorti des comptes prévisionnels de la Nation,
lesquels récapitulent les hypothèses sur lesquelles repose le projet de loi de
finances ;
– des annexes explicatives, avec notamment " les
bleus budgétaires " présentant les crédits des différents ministères, des
budgets annexes et des comptes spéciaux du Trésor, et le fascicule des voies et moyens
détaillant les évaluations de recettes et présentant les résultats du contrôle
fiscal, ainsi que les dépenses fiscales ;
– des annexes générales : " les
jaunes " récapitulant la politique financière de l’Etat pour un secteur
ou un sujet précis, " les blancs ", qui présentaient, pour chaque
ministère, le coût des programmes et les objectifs assignés, ayant aujourd’hui
disparu.
Mais, comme le relève M. Jean-Pierre Lassale ()
" la véritable question est celle de l’utilité réelle de ces
documents : sont-ils exploitables et exploités, ou constituent-ils un alibi commode
pour un exécutif, certain en définitive de pouvoir imposer ses choix ? ".
Une analyse plus poussée des informations mises à la disposition du
Parlement souligne que leur lisibilité, leur crédibilité et leur sincérité sont, pour
le moins, susceptibles d’être améliorées ().
1.- Un manque de lisibilité constant
a) Des lacunes importantes
La plupart des personnes entendues par le groupe de travail ont
souligné le manque de lisibilité des informations transmises au Parlement.
- Il n’existe aucune présentation consolidée des comptes publics,
c’est-à-dire des comptes de l’Etat et de ses différents établissements
publics, des comptes des collectivités locales et des comptes sociaux.
Cette lacune a pour corollaire qu’il est difficile d’avoir
une vision consolidée des prélèvements obligatoires, alors que la fiscalité de
l’Etat et les prélèvements sociaux s’enchevêtrent chaque jour davantage.
- L’Etat ne fait l’objet d’aucun " bilan "
patrimonial et " hors bilan ".
Nos procédures budgétaires et comptables nous donnent, en effet, une
connaissance satisfaisante des flux de trésorerie, mais ne permettent pas
d’appréhender les opérations non dénouées (telles que les charges à payer ou les
produits à recevoir) et les charges futures (amortissements des investissements,
provisions pour charges à payer).
Par ailleurs, nos procédures comptables ne fournissent aucune
information sur le patrimoine de l’Etat (patrimoine immobilier, participations
des entreprises ou dans les organismes publics).
Enfin, le Parlement n’a pas de connaissance précise des
engagements à long terme – le " hors-bilan " – de
l’Etat. Ainsi, le Parlement n’est pas en mesure d’évaluer les engagements
de l’Etat sur les retraites des fonctionnaires, alors que ce poste de dépenses
devrait connaître une croissance importante au cours des prochaines années. De même, le
Parlement est dans l’incapacité, comme l’a relevé M. Jean Arthuis,
sénateur, ancien ministre de l’économie et des finances, dans son intervention
devant le groupe de travail, d’évaluer l’impact à long terme de la crise
financière du Crédit lyonnais sur les comptes de l’Etat ou d’apprécier la
portée des engagements de l’Etat s’agissant des dettes de la SNCF, par exemple.
Notons, également, que la " dette publique " ne prend pas en compte,
en l’absence de compatibilité patrimoniale, les garanties accordées par
l’Etat.
Précisons, enfin, que si la dette publique de l’Etat, définie au
sens strict par opposition au concept de " hors-bilan ", est
effectivement portée à la connaissance des parlementaires, cette notion soulève deux
difficultés. Le Parlement est, en effet, appelé, chaque année, à voter une
autorisation de principe de recours à l’emprunt, alors que l’article 31 de
l’ordonnance organique dispose que le projet de loi de finances de l’année doit
comporter une évaluation " des ressources d’emprunts et de trésorerie " ().
Par ailleurs, si les méthodes de gestion de la dette de l’Etat sont connues, les
opérations de gestion sur le marché de cette dette, telles qu’elles sont menées
par la direction du Trésor, en raison de leur caractère confidentiel, se caractérisent
par une profonde opacité. Notre collègue M. Philippe Auberger a ainsi fait
remarquer, au cours de l’une de ses interventions devant notre groupe de travail,
que : " [les parlementaires] ne disposent pas d’éléments
suffisants pour apprécier les méthodes de gestion de la dette publique utilisées.
Sont-elles adéquates, en fonction de l’évolution des taux d’intérêt ?
Cela correspond tout de même à une masse de dépenses importantes [...] ".
- Il n’existe, également, aucun bilan consolidé des entreprises
publiques.
Comme l’a rappelé M. Jean Arthuis, chaque entreprise publique
présente ses comptes, sans que l’Etat n’impose aucune règle de présentation.
Les informations transmises au Parlement ne donnent donc qu’une vision analytique de
chaque entreprise. Or, la publication d’un bilan consolidé des entreprises publiques
permettrait de savoir si l’Etat s’enrichit ou s’appauvrit du fait de ses
participations, si le résultat d’exploitation consolidé se solde par un bénéfice
ou par une perte, et si les entreprises publiques constatent ou non les dettes liées à
la retraite de leur personnel.
De manière plus générale, le Parlement dispose de peu
d’informations pertinentes s’agissant du secteur public, en raison de la
réticence de la direction du Trésor à les fournir : le compte d’affectation
des recettes de privatisation () ne présente, en recettes et en
dépenses, que des montants globaux. Il faut, à cet égard, toute la persévérance des
rapporteurs, spécial et général, pour obtenir des précisions sur la ventilation ()
de ces dotations par entreprise publique.
- Le Parlement ne dispose d’aucune vision globale et stratégique des
finances publiques françaises.
A défaut des éléments nécessaires, les débats en séance publique
s’intéressent très peu aux perspectives macro-économiques de l’économie
française ou à l’évolution de la charge consolidée de notre dette. Pourtant, de
telles discussions seraient on ne peut plus nécessaires, pour cerner les enjeux de nos
finances publiques. Or, le débat ne peut guère s’appuyer sur des données
incontestables, à défaut, par nature, d’être définitives. Ainsi certains
s’interrogent-ils sur la réalité de notre situation, comme M. Daniel Bouton,
ancien directeur du budget, qui a estimé, lors de son audition par le groupe de travail,
que " la situation consolidée des finances françaises [...] est
mauvaise et cela malgré la qualification obtenue aux critères de l’euro ".
- Les informations transmises à la représentation nationale restent
enfermées dans un cadre strictement annuel : jusqu’à l’expérience
précitée, menée à la fin de l’année dernière pour satisfaire aux exigences
résultant du Pacte de stabilité et de croissance, il n’existait aucune projection
pluriannuelle sur l’évolution de la fiscalité, des grandes catégories de dépenses
ou des fonctions collectives majeures.
Comme l’a expliqué, devant le groupe de travail, M. Jean
Picq, conseiller-maître à la Cour des comptes et auteur d’un rapport, en mai 1994,
sur l’Etat en France, intitulé " Servir une nation ouverte sur le monde ",
le Parlement peut être dans l’incapacité de repérer les sources d’explosion
de la dépense publique et d’évaluer les marges de manœuvre budgétaire.
- Les projets de budget, émiettés entre ministères et titres, souffrent
également d’un défaut de lisibilité et ne permettent pas d’apprécier les
efforts de l’Etat en faveur de telle ou telle politique.
M. Pierre Joxe, Premier président de la Cour des comptes, citait
ainsi, devant le groupe de travail, à titre d’illustration, l’exemple de la
formation professionnelle, dont il est à l’heure actuelle impossible de chiffrer
correctement les coûts.
b) Certains progrès récents
Afin de nuancer ce tableau assez pessimiste, il convient de
reconnaître que des efforts ont récemment été accomplis pour améliorer la lisibilité
de nos finances publiques.
t Une innovation :
la loi d’orientation quinquennale relative à la maîtrise des finances publiques du
24 janvier 1994
Rappelons que cette loi, adoptée dans le but de permettre le passage
à la monnaie unique, édictait des normes d’évolution des charges (stabilisation
des dépenses de l’Etat en francs constants) et fixait comme objectif de ramener le
déficit public à 2,5% du PIB en 1997, objectif par la suite décalé d’un an.
Un rapport sur les orientations budgétaires à moyen terme était
annexé à la loi. Mettant en évidence la nécessité de réduire les déficits publics,
ce rapport proposait de définir une stratégie. Les enjeux de la politique budgétaire
apparaissaient donc plus clairement.
Cette démarche doit être réitérée, compte tenu des contraintes
résultant, comme on l’a vu, du Pacte de stabilité et de croissance. A cette fin,
les Etats membres doivent présenter devant le Conseil de l’Union européenne des
perspectives d’évolution des dépenses publiques, de la dette publique et des
prélèvements obligatoires. M. Dominique Strauss-Kahn a évoqué, le 23 décembre
dernier, devant la Commission des finances de l’Assemblée nationale, ces
perspectives, tout en précisant qu’elles n’avaient pas vocation à se voir
traduire en dispositions législatives.
Notons, toutefois, que, si la démarche ainsi engagée est de nature à
préciser les enjeux de notre politique budgétaire, elle est restée, dans les deux cas,
très globale.
t Un débat
d’orientation budgétaire positif
- Une première expérience fut tentée, en avril 1990, avec
l’organisation d’un débat d’orientation budgétaire. Elle resurgit en mai
1996 et juin 1998, sans que cette formule soit cependant consacrée par les textes.
Théoriquement destiné à associer la représentation nationale à la
préparation du projet de loi de finances (), ce débat peut présenter un
intérêt majeur : il est l’occasion de donner une dimension globale et
stratégique aux discussions sur nos finances publiques.
- Il faut, à cet égard, évoquer l’initiative lancée par M. Jean
Arthuis, ministre de l’économie et des finances, en 1996. S’inspirant des
règles en vigueur pour les collectivités locales, il présenta le budget de l’Etat
en distinguant les dépenses de fonctionnement de celles d’investissement. Cette
distinction faisait ressortir que l’emprunt (529 milliards de francs) ne servait
à financer que pour une part modeste les investissements (179 milliards de francs),
le solde étant utilisé pour rembourser les emprunts du passé (241 milliards de
francs) et financer les dépenses courantes (109 milliards de francs) ().
Cette présentation était destinée, pour reprendre les propos tenus
par M. Jean Arthuis devant le groupe de travail, " à faire prendre
conscience à nos compatriotes de l’urgence et de la nécessité des réformes à
engager ". Effectivement, une telle présentation peut éclairer les enjeux
de nos finances publiques, et notamment le premier d’entre eux : réduire notre
dette publique, afin de retrouver des marges de manœuvre.
Cette initiative a donc permis, comme le souligne M. Jean Arthuis, de
" donner plus de signification et plus de lisibilité au budget, parce
qu’il n’y a pas de démocratie sans lisibilité, sans transparence et sans
contrôle ".
Votre Rapporteur soulignera que, même si la démarche engagée en 1996
n’était pas dénuée d’aspects politiques, il peut être utile de persévérer
dans cette présentation des dépenses de l’Etat, qui, sous réserve d’un
reclassement sérieux des dépenses de fonctionnement tenant compte de leur incidence
économique, permet de mettre en évidence que nos recettes de fonctionnement ne dégagent
aucune marge de manœuvre pour rembourser notre dette, obligeant la France à recourir
à l’emprunt.
Votre Rapporteur relève, sur ce point, qu’une présentation des
dépenses de l’Etat distinguant dépenses de fonctionnement et dépenses
d’investissement, en vue de prohiber le déficit de fonctionnement de l’Etat,
est sujette à controverses.
M. Daniel Bouton, ancien directeur du budget, a ainsi précisé,
au cours de son intervention devant le groupe de travail, que " s’agissant
des dépenses de l’Etat, la notion de dépense d’investissement n’a pas
véritablement de signification ", remettant ainsi en cause la distinction
opérée et a rappelé, s’agissant de la proposition de prohiber le déficit de
fonctionnement de l’Etat, que " le traité de Maastricht nous fournit un
bon cadre, c’est-à-dire que le 3% est un critère acceptable lorsque nous sommes en
bas de cycle et qu’il faut utiliser l’argent public pour faire marcher la pompe
de l’économie à condition que nous soyons en excédent primaire sur l’ensemble
de la loi de finances, c’est-à-dire que le total des dépenses soit inférieur au
total des recettes après défalcation de la charge de la dette ".
M. Louis Schweitzer, ancien directeur de cabinet du Premier
ministre, a également, au cours de son intervention, abondé en ce sens, faisant valoir
le caractère non pertinent d’une présentation des dépenses de l’Etat calquée
sur les règles en vigueur pour les collectivités locales. Il a ainsi souligné que
" l’organisation [des dépenses de l’Etat] à partir de la
distinction " dépenses d’investissement-dépenses de
fonctionnement " conduit à poser différemment le problème macro-économique
du déficit budgétaire. Dans une entreprise, l’on peut considérer légitime, si la
structure du bilan le permet, de financer l’investissement par emprunt, dans la
mesure où l’investissement rapporte l’argent nécessaire pour rembourser
l’emprunt. L’investissement de l’Etat, dans la généralité des cas,
génère plus de dépenses que de recettes, c’est-à-dire que, le plus souvent, un
investissement d’Etat peut avoir un effet économique général favorable, mais il ne
lui rapporte rien ; il conduira à des dépenses d’accompagnement de
l’investissement. Donc, du point de vue de l’équilibre budgétaire, il n’y
a, à mes yeux, pas lieu de traiter différemment les dépenses d’investissement et
celles de fonctionnement. Au contraire, des dépenses d’investissement peuvent, dans
certains cas, être plus négatives pour l’équilibre budgétaire que les dépenses
de fonctionnement, dans la mesure où elles génèrent des charges de façon durable ".
2.- Une crédibilité parfois contestable
Nos comptes publics peuvent souffrir d’un manque de crédibilité,
phénomène imputable à l’aléa inhérent aux prévisions économiques.
Rappelons que celles-ci sont élaborées sur la base des travaux de la
Commission des comptes de la Nation, publiés dans le cadre du rapport économique, social
et financier annexé au projet de loi de finances. Ces travaux débouchent sur des
prévisions économiques de court terme, élaborées grosso modo six mois avant que
le projet de loi de finances ne soit déposé.
Or, les hypothèses économiques retenues par le Gouvernement pour
construire son projet de budget font, traditionnellement, l’objet de critiques, il
est vrai plus ou moins justifiées.
Ainsi, le projet de loi de finances pour 1993 – on pourrait
en citer aussi d’autres – reposait sur une hypothèse de croissance du PIB
de 2,6%, débouchant sur un déficit de 165,4 milliards de francs. Le rapport de la
Cour des comptes sur l’exécution des lois de finances en vue du règlement du budget
de l’exercice 1993 précise que la croissance française a, en réalité, connu, en
1993, une récession de 1,0%, laquelle a débouché sur un solde d’exécution
négatif de 315,6 milliards de francs. De même, pour 1996, le Gouvernement tablait
sur une croissance du PIB de 2,8 % dans son projet de loi de finances initiale, alors
qu’elle ne s’est élevée, en réalité, qu’à 1,2 % ().
Ces exemples mettent en exergue deux difficultés.
a) Un certain monopole d’expertise au profit du Gouvernement
La première difficulté a trait à la pertinence des hypothèses
économiques retenues par le Gouvernement. Or, celui-ci bénéficie, d’une certaine
manière, d’un certain " monopole d’expertise ". Certes, le
Rapporteur général de la Commission des finances de l’Assemblée nationale
reproduit dans ses travaux, depuis 1988, les prévisions économiques des divers instituts
indépendants. Ceux-ci sont désormais entendus par la Commission des finances dès le
printemps. Par ailleurs, les députés ont accès aux travaux de la Commission des comptes
et des budgets économiques de la Nation. Enfin, la Commission des finances dispose de
crédits d’études pour faire réaliser des travaux économétriques. Il est à
observer qu’elle ne recourt que très épisodiquement et insuffisamment à cette
faculté ().
Mais, comme l’a relevé notre collègue M. Philippe Auberger,
Rapporteur général de la Commission des finances sous la précédente législature, ces
quelques initiatives restent sûrement insuffisantes pour permettre à notre Assemblée
d’apprécier le bien-fondé des hypothèses économiques du Gouvernement. Sans doute
conviendrait-il, comme le fit très justement remarquer notre collègue, de
s’interroger sur la manière dont " l’Assemblée et la Commission
des finances doivent s’insérer dans la réflexion économique et dans le système
d’information économique français ".
b) Une difficile révision du projet de loi de finances
La seconde difficulté a trait aux modalités de révision du projet de
loi de finances lors de son examen par le Parlement.
Pour reprendre l’exemple des projets de lois de finances pour 1993
et 1996, les hypothèses économiques retenues par le Gouvernement étaient contestées et
faisaient douter de la vraisemblance des données chiffrées qui en découlaient.
Mais, une refonte complète, en quelques semaines, à l’automne de
l’année n, du projet de loi de finances de l’année (n + 1), en vue d’une
meilleure adaptation à la conjoncture, s’apparente, il est vrai, à une
" mission impossible ". Cette difficulté pourrait être contournée
en construisant, dès le printemps de l’année n, diverses versions du projet de loi
de finances ou bien en ayant recours, le cas échéant, dès le printemps de l’année
(n + 1), à des collectifs budgétaires.
RETOUR SOMMAIRE
3.- Une sincérité parfois sujette à caution
Lors de son intervention, M. Jean Arthuis s’est inscrit en faux
contre l’" illusionnisme " affectant la rédaction de nos
comptes publics, qui permet au Gouvernement de jouer sur des artifices de présentation,
dans le but d’afficher un déficit public moindre ou d’échapper à
l’autorisation budgétaire du Parlement. C’est davantage l’ancien ministre
que le parlementaire actuel qui alors s’exprimait.
Rappelons, en effet, qu’en vertu des articles 2 et 16 de
l’ordonnance organique (), le budget de l’Etat doit retracer
" l’ensemble des ressources et des charges de l’Etat ".
Qu’en est-il dans la réalité ?
L’objet des développements ci-après n’est nullement de
retracer l’ensemble des artifices auxquels se livrent traditionnellement les
gouvernements successifs pour mettre en évidence une situation souvent plus apparente que
réelle. Une telle étude, pour être exhaustive, aurait nécessité des développements
qui nous auraient conduits au-delà des termes de la mission de notre groupe de travail.
Pour autant, il est possible de mettre en exergue les principales lacunes de la
présentation de nos comptes.
a) Des artifices de présentation
t En matière de
dépenses
On se bornera à citer les pratiques les plus courantes affectant la
sincérité des comptes publics.
- Notre comptabilité n’appréhende que des flux de trésorerie : selon
l’article 16 de l’ordonnance organique, une dépense n’est
comptabilisée comme telle qu’après visa de l’ordonnance ou du mandat par le
comptable assignataire. Ce système autorise donc de multiples artifices, puisqu’il
suffit de reporter des décaissements pour réduire, de manière factice, nos charges. Il
n’y a donc aucune prise en compte des droits constatés.
Cette lacune constitue un obstacle à la prise en compte des
opérations non dénouées et à celle des charges futures. En particulier, l’absence
de comptabilité en droits constatés ne permet pas d’introduire des provisions
pour charges à payer ou des amortissements des investissements, ce qui altère
également la présentation des comptes publics.
- Certains chapitres de crédits évaluatifs
, régis par l’article 9
de l’ordonnance organique, font traditionnellement l’objet de sous-évaluations
manifestes, quitte à enregistrer, en cours d’exécution, de dépassements qui
auraient souvent pu être évités ().
- Les phénomènes de débudgétisation permettent de réduire les charges de
l’Etat.
Un exemple célèbre, parce que censuré par le Conseil
constitutionnel, est l’article 34 du projet de loi de finances pour 1995. Cet
article envisageait de mettre à la charge d’un établissement public administratif,
le Fonds de solidarité vieillesse, les majorations de pensions accordées aux
fonctionnaires de l’Etat et aux exploitants agricoles en fonction du nombre de leurs
enfants.
La décision du Conseil constitutionnel () a limité,
depuis lors, le recours aux débudgétisations.
- La distinction opérée entre opérations de trésorerie et opérations budgétaires
permet de réduire artificiellement le solde d’exécution budgétaire.
Comme l’a souligné le Professeur Paul Amselek (),
deux catégories de dépenses échappent, par ce biais, au budget de l’Etat.
Il s’agit, en premier lieu, de la prise en charge par l’Etat
d’emprunts contractés par des organismes publics ou privés. Celle-ci ne devrait
nullement être considérée comme une opération de trésorerie, puisqu’il
s’agit " d’une dépense pure et simple de l’Etat "
[...] au même titre que " les dépenses correspondant aux subventions
accordées par lui pour couvrir les annuités d’emprunts de tiers ".
Rappelons, à cet égard, que la Cour des comptes a critiqué le traitement comptable de
la reprise par l’Etat de la dette de 110 milliards de francs de la sécurité
sociale, à compter du 1er janvier 1994. Cette opération, formellement régulière au
regard de l’ordonnance organique, a permis de substituer à un mécanisme
d’avances à court terme, traduit en dépenses et en recettes au budget de
l’Etat, un prêt à long terme, dont le montant n’apparaît pas dans le budget,
mais dont les annuités de remboursement sont inscrites en recettes, réduisant
d’autant le déficit budgétaire. Dans les deux cas, pourtant, la nature de la charge
de l’Etat reste identique.
M. Paul Amselek cite, en second lieu, les opérations par lesquelles
l’Etat règle ses créanciers " en leur remettant des obligations
payables à terme ou par annuités ". L’exemple le plus connu de ce
type d’opération fut la manière dont l’Etat remboursa, en 1993, aux
entreprises l’incidence de la suppression de la règle du décalage d’un mois en
matière de TVA : quelque 80 milliards de dépenses échappèrent alors au budget de
l’Etat.
- Le recours à la procédure de " prélèvement sur recettes "
pour verser la contribution de l’Etat au financement des dépenses des collectivités
locales et de l’Union européenne permet de ne pas inscrire en dépenses ces charges.
Rappelons, tout d’abord, que le prélèvement sur recettes, non
prévu par l’ordonnance organique, permet à l’Etat de céder à une tierce
personne une partie de ses recettes. Ce mécanisme est utilisé depuis 1969 pour verser la
contribution de la France au budget des Communautés européennes et pour participer aux
dépenses des collectivités locales. Par le biais de ce mécanisme, les sommes en jeu
apparaissent en déduction des recettes, mais non en charge, ce qui ne correspond pas,
dans bien des cas, à la réalité de l’opération.
Concrètement, les montants en cause sont considérables. Le
prélèvement sur recettes au profit des Communautés européennes est évalué, par la
loi de finances pour 1999, à 95 milliards de francs, tandis que ceux bénéficiant
aux collectivités locales se montent à 176 milliards de francs.
Dans les deux cas, ces sommes sont appelées à croître, compte tenu
du poids croissant de l’Union européenne et de l’approfondissement de la
décentralisation.
Bien que validé par le Conseil constitutionnel dès 1982 (),
ce mécanisme fait l’objet de critiques réitérées de la part de la Cour des
comptes. En effet, soit ces versements sont, en réalité, des recettes propres de
l’Union européenne et des collectivités locales, comme cela est probablement le cas
pour les recettes communautaires autres que la contribution assise sur le PNB, auquel cas
elles sont simplement perçues, puis rétrocédées par l’Etat, et doivent être
traitées en opérations de trésorerie ; soit il s’agit de versements de
l’Etat effectués au titre, d’une part, de contribution à une organisation
internationale et, d’autre part, de subventions, auquel cas les sommes en jeu
devraient être inscrites en dépenses au budget.
Soulignons, cependant, que cette évolution, pour fondée qu’elle
soit juridiquement, priverait - et c’est là le paradoxe - le Parlement de
moyens d’intervention : compte tenu de l’article 40 de la Constitution
relatif à la recevabilité financière des initiatives des membres du Parlement, ceux-ci
disposeraient de moyens d’intervention moindres si les prélèvements sur recettes
devaient être comptabilisés comme charges de l’Etat, matière où la compensation
n’est pas admise, à la différence de ce qui est admis pour les ressources,
lorsqu’une initiative parlementaire est coûteuse pour les finances publiques.
t En matière de
recettes
- Les erreurs de prévision concernant le taux de croissance économique peuvent conduire
à des surévaluations des recettes fiscales. Ce fut notamment le cas, on l’a
vu, lors de la préparation du projet de loi de finances pour 1993.
Ce fut également le cas en 1996 : dans son rapport (n° 934)
sur le projet de loi portant règlement définitif du budget de 1996, votre Rapporteur
relevait que les recettes fiscales nettes avaient été inférieures de
41,5 milliards de francs aux prévisions initiales, " ces moins-values
[n’étant pas surprenantes] compte tenu des modalités d’élaboration de la
prévision associée à la loi de finances initiale ", comme le soulignait,
à l’époque, la Cour des comptes ().
- L’affectation des recettes de privatisation a donné lieu à de vives
controverses jusqu’en 1995.
En effet, de 1992 à 1994, les modalités de comptabilisation des
recettes de privatisation ont varié d’une année sur l’autre ().
La Cour des comptes a critiqué, à de nombreuses reprises, l’affectation des
produits de privatisation d’entreprises publiques au financement des dépenses
courantes. Il n’en demeure pas moins que, jusqu’à la loi de finances
rectificative du 4 août 1995, qui a supprimé l’affectation de tout ou partie
des recettes de privatisation au budget général, le Gouvernement s’accordait de
larges marges de manœuvre.
- La procédure des fonds de concours permet, enfin, de faire échapper une masse
importante de recettes non fiscales à l’autorisation parlementaire et se traduit par
une sous-évaluation des recettes. Celles-ci, tout en transitant par le budget de
l’Etat, n’apparaissent pas dans le projet de loi de finances, et ce, alors même
qu’elles sont prises en compte, en interne, par l’administration.
Les fonds de concours, régis par l’article 19 de
l’ordonnance organique, constituent une procédure ancienne, dont l’origine
remonte à une loi du 6 juin 1843. Cette procédure permet, par dérogation à la
règle de non-affectation, de prendre en compte la participation de personnes morales ou
physiques (essentiellement les collectivités locales, les établissements publics et
l’Union européenne) au financement de dépenses d’intérêt général, des
crédits de même montant étant ouverts, en cours d’exercice, au budget du
ministère concerné. Soulignons que l’article 19 de l’ordonnance organique
permet, en outre, au ministre des finances, sur simple décret, " d’assimiler
le produit de certaines recettes non fiscales à des fonds de concours pour dépenses
d’intérêt public " ; ces fonds par assimilation représentent
une part prépondérante des fonds de concours.
Globalement, les fonds de concours représentent actuellement des
sommes conséquentes : 65,3 milliards de francs en 1995, 73,3 milliards de
francs en 1996 et 68,5 milliards de francs en 1997. Ils sont évalués à
65,3 milliards de francs pour 1998 ().
Des réformes substantielles sont heureusement intervenues, au fil des
années, pour rationaliser cette procédure () et améliorer
l’information des parlementaires.
A partir de 1985, un document, sous forme de fascicule vert, annexé au
projet de loi de finances, intitulé " Récapitulation générale des fonds
de concours par budget ", a permis de réduire l’opacité entourant les
fonds de concours, mais soulignons qu’il ne comportait aucune information de
synthèse. En 1994, un " état récapitulatif des crédits de fonds de
concours ", de couleur jaune, annexé au projet de loi de finances, a
succédé à ce document vert. Cet état récapitulatif, beaucoup plus clair, contient une
présentation d’ensemble des fonds de concours et une analyse globale par ministère.
Depuis le projet de loi de finances pour 1996, ce " jaune " fournit
aux parlementaires, non seulement les résultats de l’année (n–1) et les
prévisions de l’année (n), mais également une évaluation des fonds de concours
pour l’année (n+1), présentée par fascicule et par chapitre.
Par ailleurs, à la suite de la décision du Conseil constitutionnel du
30 décembre 1997 () sur le caractère irrégulier du rattachement de
ce qu’il est convenu d’appeler les " crédits
d’articles " par voie de fonds de concours au regard de
l’article 19 de l’ordonnance organique, il a été mis fin à cette
procédure. Rappelons, en effet, que celle-ci permettait d’ouvrir des crédits au
budget des services financiers, crédits () destinés, notamment, à
abonder les rémunérations des fonctionnaires du ministère des finances. Les
prélèvements ainsi opérés étaient abusivement assimilés à des fonds de concours,
puisque, s’agissant des crédits dits de l’article 5, ils étaient
alimentés par des recettes de nature fiscale, et, s’agissant des crédits dits de
l’article 6, l’acte générateur des prélèvements était une décision du
bénéficiaire. Malgré les critiques régulièrement présentées par les parlementaires
et par la Cour des comptes, il a fallu attendre le projet de loi de finances pour 1999
pour voir ces crédits d’articles rebudgétisés (). Au total, plus
de 11 milliards de francs ont été ainsi réintégrés au budget.
De même, à la suite d’une décision () de 1994
du Conseil constitutionnel fondée sur la notion de " charge par
nature ", le Gouvernement a procédé, à l’occasion du projet de loi de
finances pour 1999, à la réintégration, au sein du budget général, de près de
15 milliards de francs, essentiellement imputables à la rebudgétisation des
crédits, précédemment ouverts par voie de fonds de concours, afférents aux charges de
pension des fonctionnaires de La Poste.
Il n’en demeure pas moins que la situation n’est pas encore
satisfaisante :
– les fonds de concours ne font l’objet d’aucune
évaluation en loi de finances initiale, alors que, pour nombre d’entre eux, les
montants, stabilisés depuis plusieurs années, sont connus à l’avance et pris en
compte par l’administration ;
– le champ d’application de cette procédure demeure
excessif. L’affectation d’une recette à une dépense " est
évidemment incontestable lorsqu’on est en présence d’un véritable fonds de
concours, puisqu’il est nécessaire de respecter l’intention de la partie
versante. [...] L’affectation pourrait également se justifier
lorsqu’elle permet de rapprocher les recettes propres et les dépenses de tel ou tel
service de l’Etat ayant une activité quasi-commerciale " ().
Mais, ces exemples ne sont pas fréquents. La majeure partie des fonds
de concours reste constituée de recettes non fiscales, dont l’affectation n’a
pas de réelle justification. Cette procédure est d’autant plus choquante que
l’assimilation de recettes non fiscales relève du pouvoir discrétionnaire de
l’exécutif et de lui seul. Le Gouvernement est donc en mesure de faire échapper une
part non négligeable de recettes non fiscales à l’autorisation budgétaire du
Parlement, à la fois en termes de volume et en termes d’affectation. Ainsi, en 1997,
c’est-à-dire avant les reclassements opérés dans le cadre du projet de loi de
finances pour 1999, les fonds de concours par assimilation se montaient à
35,8 milliards de francs (). A cet égard, la Cour des comptes
observe, en particulier, dans son rapport sur l’exécution des lois de finances pour
l’année 1997, que le financement – fréquent – de
rémunérations par des fonds de concours " ne paraît pas conforme aux
règles [...], s’agissant de charges permanentes par nature "
(page 290).
b) Un contrôle récent du Conseil constitutionnel
Les artifices de présentation des projets de loi de finances sont donc
nombreux et soulèvent la question de la réalité et de la sincérité du déficit
budgétaire affiché en loi de finances initiale. Certes, la Cour des comptes relève,
chaque année, ce qu’elle considère comme des irrégularités. Mais, ses
observations, qui interviennent a posteriori, sont rarement suivies d’effets.
Il y a donc lieu de se féliciter du contrôle opéré, depuis quelques
années, par le Conseil constitutionnel, en matière de sincérité des lois de finances.
L’apparition, dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel, de
la notion de sincérité budgétaire est relativement récente : elle remonte à
1993.
Dans une décision du 21 juin 1993 (), le Conseil
constitutionnel examina au fond les arguments des auteurs de la saisine, tendant à
contester la sincérité des recettes de privatisation évaluées dans le projet de loi de
finances rectificative pour 1993, même si, in fine, il ne les retint pas.
Le 29 décembre 1994 (), il déclara contraire à
la Constitution, au nom du principe d’unité et d’universalité budgétaires,
l’article 34 de la loi de finances pour 1995, au motif que celui-ci opérait un
transfert de charges de l’Etat vers le Fonds de solidarité vieillesse, alors que
celles-ci constituaient des " charges permanentes [relevant] par nature "
du budget de l’Etat. Cette décision fut rendue au nom des principes d’unité et
d’universalité, mais, en réalité, la censure de la non-inscription au budget de
l’Etat de charges permanentes sanctionne également un défaut de sincérité.
Notons, par ailleurs, que le Conseil constitutionnel, dans cette décision, ne dénia
nullement au principe de sincérité, le rang de principe constitutionnel que les auteurs
de la saisine souhaitaient lui conférer, laissant entendre que la sincérité des lois de
finances constitue une exigence constitutionnelle.
Depuis 1993, le principe de sincérité budgétaire permet donc au
Conseil constitutionnel d’examiner la validité des prévisions de recettes (),
de contrôler les évaluations chiffrées des projets de loi de finances ()
ou encore de vérifier que les lois de finances ne font pas l’objet d’artifices
comptables.
Cette jurisprudence présente un intérêt majeur, celui de rendre
l’administration très prudente dans l’élaboration des projets de loi de
finances par crainte de la censure du juge constitutionnel. Mais, comme l’a noté
notre collègue M. Philippe Auberger, ce contrôle juridictionnel n’intervient
qu’a posteriori et les seules sanctions envisageables sont extrêmement
brutales, puisqu’elles ne peuvent conduire qu’à l’annulation des
dispositions incriminées, voire à celle de la loi de finances dans son ensemble,
obligeant par là même le Conseil constitutionnel à une extrême prudence.
Relevons, toutefois, que la récente décision précitée du Conseil
constitutionnel du 30 décembre 1997 relative aux fonds de concours, dans laquelle le
juge présenta au Gouvernement des recommandations, préfigure peut-être une évolution
de sa jurisprudence. Mais hormis cette avancée - récente -, il n’existe
à l’heure actuelle aucun contrôle juridictionnel exercé a priori sur la
sincérité des projets de loi de finances.
Au-delà de la question de la pertinence des données transmises au
Parlement, il convient de s’interroger sur la question suivante : à partir de
ces données imparfaites, le Parlement dispose-t-il des prérogatives nécessaires pour
infléchir les projets de loi de finances présentés par le Gouvernement ?
B.- les
prÉrogatives du parlement lui permettent, en thÉorie, d’agir sur la dÉpense
publique
L’article 47 de la Constitution énonce que " le
Parlement vote les projets de loi de finances ". Contrairement à la
situation prévalant sous les IIIème et IVème Républiques, il a vu son pouvoir
d’initiative singulièrement réduit, les discussions relatives à la loi de finances
devant maintenant s’engager sur la base du projet de loi gouvernemental. Comme
l’a souligné M. Guy Carcassonne, professeur de droit public, dans son intervention
devant le groupe de travail, cette situation n’est pas propre à la France :
" A peu près partout, et pour des raisons bien connues, c’est à
l’exécutif qu’il convient - dans l’usage qui est fait du budget comme
d’un instrument avant tout économique - de définir les grands équilibres, et
ensuite de veiller, dans toute la mesure du possible, à leur respect, le législateur
ayant alors beaucoup plus un rôle d’influence que décisif ". Votre
Rapporteur considère qu’il n’est pas anormal que l’initiative en matière
budgétaire relève d’abord du Gouvernement. Mais cela doit conduire le Parlement à
exercer plus fortement son pouvoir de contrôle. Votre Rapporteur reviendra plus loin sur
ce point.
De même, conforté par l’existence de mécanismes de
" parlementarisme rationalisé " (article 49, alinéa 3, de la
Constitution, vote bloqué, seconde délibération assortie d’un vote bloqué) et par
l’émergence, à partir de 1962, du fait majoritaire, c’est-à-dire d’une
majorité stable et homogène, le pouvoir exécutif apparaît, toutefois, tout puissant.
Aussi convient-il de s’interroger sur le point de savoir si l’autorisation
budgétaire ne devient pas trop formelle.
1.- Des pouvoirs dont la réalité et
l’étendue prêtent à discussion
En réalité, les prérogatives exercées par le Parlement en matière
financière et budgétaire ne sont pas aussi réduites que ne le laisserait supposer une
opinion très répandue.
a) Des pouvoirs dont la portée n’est pas toujours évaluée à
sa juste valeur
Sans revenir ici sur l’ensemble des dispositions de
l’ordonnance organique, il convient de souligner les " faux-semblants ",
pour reprendre l’expression du professeur Paul Amselek (), de
certaines d’entre elles.
t Un pouvoir
d’amendement limité, mais réel
Le pouvoir d’initiative du Parlement en matière budgétaire est
limité à ses seuls amendements. Or ceux-ci sont sévèrement encadrés.
L’article 40 de la Constitution dispose, en effet, que
" les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne
sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des
ressources publiques, soit la création ou l’aggravation d’une charge
publique ". L’ordonnance organique procède à l’application de ce
dispositif aux lois de finances, en prévoyant, dans son article 42 :
" aucun article additionnel, aucun amendement à un projet de loi de finances
ne peut être présenté, sauf s’il tend à supprimer ou à réduire effectivement
une dépense, à créer ou à accroître une recette ou à assurer le contrôle des
dépenses publiques. Tout article additionnel et tout amendement doit être motivé et
accompagné des développements des moyens qui le justifient. La disjonction des articles
additionnels ou amendements qui contreviennent aux dispositions du présent article est de
droit ".
Ces dispositions ont pour finalité d’éviter que les amendements
du Parlement ne dénaturent l’équilibre financier retenu par le Gouvernement.
Appliquées de manière stricte, elles auraient abouti à contraindre fortement le pouvoir
d’amendement des parlementaires. Une interprétation souple a donc été retenue, ce
qui laisse au pouvoir législatif une certaine marge de manœuvre pour modifier le
projet de loi de finances du Gouvernement.
- En matière de ressources, outre l’augmentation d’une ressource, les
parlementaires peuvent proposer la diminution d’une ressource, dès lors qu’ils
" gagent " cette réduction par la majoration, à due concurrence,
d’une autre ressource bénéficiant à la même catégorie de collectivités
publiques. Par ailleurs, la pratique a admis que les parlementaires pouvaient revoir à la
baisse les propositions d’augmentation de ressources présentées par le
Gouvernement, dans la mesure où la base de référence retenue par le juge de la
recevabilité sera, dans un tel cas, le droit existant et non pas le texte en discussion.
Ainsi, le Parlement conserve-t-il formellement un large pouvoir fiscal, conformément à
notre tradition institutionnelle.
- En matière de dépenses, en revanche, la compensation n’étant pas admise,
le Parlement ne se voit pas autorisé à prendre l’initiative d’une augmentation
d’une dépense.
Précisons, toutefois, que cette règle est en pratique, atténuée. La
logique majoritaire conduit, en effet, le Gouvernement à reprendre à son compte des
propositions d’amendements visant à accroître les dépenses publiques et qui
auraient donc été irrecevables sous la signature de députés, au regard de
l’article 40 de la Constitution.
Relevons que les parlementaires sont en mesure de présenter des
amendements de réduction de crédits, à condition toutefois que cette réduction soit
effective, motivée et que l’amendement en cause précise, dans son exposé des
motifs, le chapitre d’imputation. Soulignons, également, que si ces initiatives
devaient aboutir à dénaturer " les grandes lignes de l’équilibre
préalablement défini " (), elles seraient fragiles au
regard des dispositions de l’ordonnance organique, sauf à ce que les parlementaires
se soient préalablement prononcés, lors de l’examen de la première partie, en
faveur d’un amendement de réduction des plafonds des charges modifiant
l’équilibre général. Autrement dit, si des parlementaires entendent réduire
effectivement les dépenses publiques, ils sont habilités à le faire, mais dans le cadre
d’une stratégie prédéfinie tenant compte du niveau de l’équilibre général.
On observera que l’intervention, en amont, des parlementaires,
dans le cadre des réflexions menées en vue de la préparation de la loi de finances,
peut leur permettre d’exercer un rôle significatif. Votre Rapporteur en prendra pour
exemple la préparation du projet de loi de finances pour 1999 : le Gouvernement,
dès la fin de l’automne 1997, avait annoncé les trois grands axes des réformes
fiscales envisagées dans le cadre de ce projet de loi de finances : fiscalité
locale, fiscalité écologique, fiscalité du patrimoine ; la Commission des finances
a donc pu, avant l’été 1998, faire connaître son sentiment sur ces trois dossiers
dans le cadre de rapports d’information et ses observations ont alimenté la
réflexion gouvernementale ; plusieurs de ses propositions ont ainsi été prises en
compte dès l’élaboration du projet, ce qui a réduit d’autant la nécessité
de l’amender.
Le pouvoir d’initiative du Parlement n’est donc pas
négligeable. Comme le souligne le Professeur Paul Amselek () :
" Si l’initiative budgétaire du Parlement est limitée, elle est
limitée à l’essentiel : les Assemblées ont, en définitive, conservé intact
leur rôle originaire de protection des contribuables et de contrôle de "la
nécessité de la contribution publique" que leur a reconnu l’article 14 de la
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Elles peuvent réduire les
dépenses projetées par le Gouvernement, faire la chasse aux gaspillages ou aux
utilisations à mauvais escient des deniers publics ; elles peuvent refuser ou
diminuer les augmentations d’impôts que l’Exécutif sollicite, ou encore
apporter des améliorations au système fiscal existant tout en lui conservant le même
rendement. Ces pouvoirs revêtent à l’époque actuelle une importance accrue :
alors que l’Etat-Providence s’essouffle et est menacé d’apoplexie, et dans
les directions nouvelles tracées par l’Union européenne, l’heure n’est
plus aux dérapages démagogiques et aux initiatives d’alourdissement des charges
publiques et d’aggravation de la pression fiscale ou de l’endettement public et
du déficit budgétaire, mais à une gestion rigoureuse de ressources publiques désormais
limitées et à l’étroite surveillance de leur bon emploi. "
t Une globalisation des
votes finalement favorable à l’exercice du pouvoir d’autorisation
L’ordonnance organique du 2 janvier 1959 a considérablement
réduit le nombre de votes dont fait l’objet le projet de loi de finances.
Sur la base de l’article 41 de l’ordonnance
organique (), les évaluations de recettes font l’objet d’un
vote unique, lors de l’adoption de l’article d’équilibre, qui porte
approbation de l’état A récapitulant les recettes. S’agissant des dépenses,
les services votés font l’objet d’un vote unique pour le budget général,
d’un vote par budget annexe et d’un vote par catégorie de compte spécial du
Trésor ; les mesures nouvelles sont, en pratique, votées par ministère et par
titre pour le budget général et font l’objet d’un vote unique par budget
annexe et par catégorie de comptes spéciaux du Trésor.
- L’ordonnance organique, précédée dans cette démarche, sous la
Ivème République, par le décret-loi de 1956, a donc mis fin au vote par chapitre,
consacré sous la IIIème République par la loi du 16 septembre 1871 et devenu le
symbole de la nature démocratique du régime. Le nombre de votes est ainsi passé de
3.000 sous la IIIème République et 5.000 sous la IVème République à environ 120
sous la Vème République ().
Cette réduction drastique du nombre de votes a été interprétée, à
tort, comme le signe d’un affaiblissement des pouvoirs du Parlement. Il est vrai que,
pendant plus d’un siècle, la multiplication des votes était assimilée à un
approfondissement du contrôle parlementaire. En réalité, cette multiplication du nombre
de votes se traduisait par un examen pointilleux de la dépense publique, mais sans vue
d’ensemble, et débouchait souvent sur un enlisement des débats. En réduisant le
nombre de votes, l’ordonnance organique leur a, au contraire, donné une plus grande
signification politique.
- La réduction du nombre de votes prive-t-elle, par ailleurs, le Parlement de
tout droit de regard sur les sommes en jeu ? L’introduction d’un vote
unique sur 90% des crédits du budget général, les services votés, ne se traduit-elle
pas par un " référendum appliqué aux finances publiques ",
pour reprendre l’expression utilisée par René Pleven en 1959 ?
Il convient ici de lever un malentendu : les parlementaires sont,
juridiquement, en mesure de réviser, dans la limite de leur droit d’amendement, les
services votés, qui, contrairement à une idée reçue, n’ont, en droit, rien
d’intangible. Il leur suffit, pour cela, d’adopter une mesure nouvelle de
diminution de crédits, laquelle modifiera la dotation de tel ou tel chapitre. Il reste
que cette démarche est parfois délicate à engager.
De manière plus générale, la distinction opérée entre unité de
spécialisation et unité de vote, avec pour corollaire l’abandon du vote par
chapitre, ne fait pas obstacle au pouvoir de réformation du Parlement. Par le biais de
leur pouvoir d’amendement, les parlementaires peuvent proposer la diminution
effective du montant des crédits de chaque chapitre. La rationalisation de la procédure
de vote signifie uniquement qu’un tel examen n’intervient plus
systématiquement, mais uniquement sur initiative parlementaire.
Comme le résumait M. Dominique Strauss-Kahn, alors Président de la
Commission des finances de notre Assemblée, en 1989 (), " ce
système est finalement plus logique que le vote formel de tous les crédits chapitre par
chapitre. Si personne ne soulève de contestation, le Parlement se contente de voter les
crédits au niveau du titre ; il suffit de la volonté d’un seul parlementaire
pour que la chambre à laquelle il appartient soit appelée à voter au niveau du chapitre ".
Les pouvoirs budgétaires du Parlement ne sont donc pas juridiquement
aussi faibles qu’on le dit. En témoignent, par exemple, les modifications qui sont
apportées chaque année, depuis 1981, par la majorité sénatoriale, lorsqu’opposée
au Gouvernement, elle n’est pas tenue par la solidarité majoritaire qui caractérise
les décisions de l’Assemblée, au projet de loi de finances, ou encore les mesures
adoptées, chaque année, à l’initiative de l’Assemblée nationale, qui sont
loin d’être négligeables compte tenu des marges de manœuvre, elles-mêmes
limitées, dont dispose le Gouvernement.
Plus que les considérations juridiques, c’est la nécessaire
solidarité, dans notre système institutionnel qui reste parlementaire, entre la
majorité et le Gouvernement, qui explique, en grande partie, la nette insuffisance dans
l’utilisation de ces pouvoirs.
La situation présente est-elle pour autant
satisfaisante ? Au travers des réflexions de notre groupe de travail, il
ressort clairement que non, car les dispositions de l’ordonnance organique ont
engendré des effets pervers.
b) Des effets pervers
L’exercice, par le Parlement, de son pouvoir financier fait
apparaître plusieurs types de dysfonctionnement.
t Une attention trop
exclusive portée par le Parlement au domaine fiscal
Comme l’a souligné M. Daniel Bouton, ancien directeur du
budget, dans son intervention devant le groupe de travail, le Parlement dispose
" d’une influence certaine sur la fiscalité ". Il va donc
en jouer et modifier, à la marge, les dispositifs fiscaux.
Cette situation explique que, désormais, les parlementaires
concentrent l’essentiel de leurs travaux sur les aspects fiscaux du projet de loi de
finances, au détriment des aspects budgétaires ou de l’examen des problèmes
d’ensemble, et ce alors même que les dispositions fiscales pourraient parfaitement
faire l’objet d’une simple loi ordinaire.
Ce dysfonctionnement explique aussi, comme l’a souligné notre
collègue M. Jean-Jacques Jégou, que notre procédure budgétaire soit devenue
l’apanage d’un nombre réduit de spécialistes en mesure d’appréhender les
subtilités de notre droit fiscal.
Soulignons, enfin, que les marges de manœuvre reconnues au
Parlement en la matière, et donc sa volonté d’exercer ses prérogatives,
expliquent, sans doute, en partie, la complexité de notre législation fiscale,
complexité qui est aussi liée aux interactions entre l’administration et les
groupes de pression.
t Un examen des
dépenses dépourvu d’intérêt réel
L’introduction, contrairement à l’article 41 de
l’ordonnance organique, d’un vote des mesures nouvelles, non pas par titre et
par ministère, mais par ministère et par titre a fait prévaloir une logique sectorielle
lors de l’examen des crédits, au détriment d’un débat par type de dépenses.
Aussi, l’examen de la deuxième partie du projet de loi de
finances est-il devenu l’occasion, pour chaque ministre, de présenter la politique
menée dans son domaine de compétence et, pour les parlementaires, de prendre la parole
sur les différents aspects de la politique gouvernementale.
L’examen de la deuxième partie du projet de loi de finances a
perdu progressivement de sa pertinence. Comme l’a souligné M. Michel Prada,
ancien directeur, successivement, de la comptabilité publique et du budget, dans son
intervention devant le groupe de travail, " les discussions ministère par
ministère sont parfois des exercices de style, elles permettent certes une présentation
sectorielle de la politique ministérielle, mais ne donnent pas lieu à un examen très
approfondi de sa stratégie et mélangent un peu le regard sur le passé et celui sur le
futur ".
t Une logique tacite en
faveur de l’augmentation de la dépense publique
Les prérogatives reconnues au Parlement en matière de ressources
expliqueraient, selon M. Daniel Bouton " qu’en contrepartie de
cette balance de pouvoirs, il accepte depuis quarante ans de n’exercer qu’un
contrôle extrêmement faible sur les dépenses publiques. " Le
Professeur Jean-Pierre Lassale () évoque " une sorte de
consensus implicite, et peut-être inavoué [...] pour laisser à l’exécutif
et à l’administration une liberté d’action étendue ".
Or, M. Jean Picq, conseiller-maître à la Cour des comptes,
impute à " l’insuffisance du contrôle parlementaire "
l’incapacité de la France à réduire la dépense publique à hauteur des
performances réalisées par les autres Etats membres de l’Union européenne.
Plusieurs éléments d’explication rendent compte de cette
situation :
- la France " privilégie une logique budgétaire de dépenses au détriment
d’une logique comptable de résultats ", pour reprendre les propos de
M. Jean Picq. A aucun moment de l’examen de la deuxième partie du projet de loi
de finances, il n’est, en effet, envisagé d’évaluer les résultats des actions
menées et d’allouer, en conséquence, les crédits ;
- l’examen des dépenses par ministère a également pour effet pervers de favoriser
la croissance des dépenses. Celle-ci étant considérée, en France, comme
électoralement payante, ainsi que l’a exposé M. François de Closets,
journaliste, dans son intervention devant le groupe de travail, chaque ministre recherche
une augmentation de ses crédits budgétaires. " Un ministre influent [...]
reste toujours, pour les médias comme pour le Parlement, le ministre qui voit son budget
augmenter fortement ", a rappelé notre collègue M. Pierre
Méhaignerie. M. Michel Charasse a, également, abondé en ce sens, au cours de son
intervention devant notre groupe de travail, précisant que " pour les
parlementaires moyens et les lobbies de tous poils, un budget qui n’augmente pas est
un mauvais budget, alors qu’un budget qui augmente est un bon budget ! La
question de savoir ce que l’on fera avec l’argent du contribuable n’a
absolument aucune importante [...] " ;
- la distinction opérée entre services votés et mesures nouvelles
constitue, non
pas juridiquement, mais en fait, en raison de la pesanteur qu’elle exerce, un
obstacle à une appréciation de la dépense publique en fonction de son efficacité.
L’idée initiale pouvait certes sembler pertinente : les
parlementaires étaient appelés à concentrer leur attention sur les mesures nouvelles,
positives ou négatives, présentées par le Gouvernement, plutôt que de procéder,
chaque année, à un réexamen de la totalité des crédits alloués.
Ce mode de raisonnement apparaît peut-être plus adapté à une
période de croissance économique qu’à celle d’une appréciation de
l’efficacité de la dépense publique : la conception implicitement retenue a
été longtemps celle d’une croissance continue du budget, grâce à laquelle les
mesures nouvelles viennent chaque année s’ajouter aux précédentes.
Par ailleurs, et bien que des mesures nouvelles négatives permettent
la remise en cause de certaines dépenses, il y a, dans la distinction opérée entre
services votés et mesures nouvelles, une incitation à l’immobilisme. Comme l’a
souligné M. Pierre Joxe, Premier président de la Cour des comptes, dans son
intervention devant le groupe de travail, " on approuve par un vote unique
plus de 90% des dépenses du budget. Cela limite singulièrement la pertinence de la
discussion budgétaire, c’est-à-dire les variations par rapport à l’année
précédente et favorise l’immobilisme. La plus grande partie du budget est
reconduite d’année en année, sans examen ". Soulignons, à cet
égard, qu’au cours de ces dernières années, une seule tentative importante de
remise en cause des services votés a été tentée, lors de l’examen du projet de
loi de finances pour 1995, et ce, sans grand résultat, parce que se voulant trop
systématique.
- L’article 40 de la Constitution constitue un obstacle majeur à la remise en cause
de la dépense publique, dans la mesure où il prohibe la compensation entre charges.
Notre collègue M. Philippe Auberger a souligné, dans une intervention
au cours de nos travaux, que cette disposition interdisait au Parlement de procéder à
" une sorte d’exercice d’économie, comme le fait le Gouvernement
dans le cadre de la régulation budgétaire " et qu’un parlementaire
" n’a aucune possibilité d’envisager un redéploiement "
de crédits ou " de modifier une affectation de recettes à une dépense ".
Ces contraintes expliquent " la très faible mobilité possible des crédits
au niveau du vote de la loi de finances initiale ".
Notre collègue M. Gilles Carrez a rappelé, à cet égard, son
expérience en tant que Rapporteur spécial, de 1995 à 1997, du budget de
l’éducation nationale. Les modifications consensuelles souhaitées par les
administrations concernées se sont heurtées à la rigidité de l’article 40 de la
Constitution interdisant aux parlementaires de procéder à des redéploiements de
crédits.
S’il ressort de ce rapide tour d’horizon que le Parlement
dispose de prérogatives moins réduites qu’on ne le croit, il apparaît pertinent de
s’interroger sur le point de savoir si elles sont adaptées à notre époque. A
l’aube du vingt-et-unième siècle, doit-on régir nos finances publiques comme en
1959 ? Au terme de quarante années d’existence, l’ordonnance organique du
2 janvier 1959 ne nécessite-t-elle pas une révision en profondeur ?
Une telle démarche semble indispensable lorsque l’on se penche,
au-delà des prérogatives des parlementaires dans la confection du budget, sur les marges
de manœuvre dont dispose le Gouvernement pour s’écarter de l’autorisation
budgétaire votée par le Parlement.
2.- Une autorisation parlementaire souvent
contournée
lors de l’exécution du budget
Le Gouvernement dispose de prérogatives importantes, qui lui
permettent de modifier, en cours d’exécution, le montant et la nature des crédits
ouverts en loi de finances initiale.
Ces modifications peuvent intervenir, soit par voie législative, par
le biais de l’adoption d’un projet de loi de finances rectificative, soit par
voie réglementaire. Dans le premier cas, elles sont soumises à l’autorisation
budgétaire du Parlement ; dans le second, elles échappent au contrôle de la
représentation nationale.
- Or, une étude rapide des sommes en jeu souligne, comme le montre le tableau
ci-joint, qu’au cours des quinze dernières années, le pouvoir exécutif s’est
sensiblement écarté de l’autorisation budgétaire délivrée par le Parlement et
ce, sur le seul fondement de son pouvoir réglementaire, donc en dehors de tout contrôle,
si l’on tient compte du fait que l’examen des projets de loi de règlement ne
constitue qu’un exercice formel, au moins jusqu’à maintenant.
Ainsi, en 1996, les mouvements de crédits opérés par voie
réglementaire ont ouvert ou annulé, lorsqu’on totalise la valeur absolue des masses
déplacées, 223 milliards de francs (soit 9,7% des crédits initiaux) et procédé
au transfert, au virement ou à la répartition de 166 milliards de francs (soit 7,3%
des crédits initiaux) ().
BUDGET DE
L’ÉTAT :
MODIFICATIONS AU MONTANT DES CRÉDITS BRUTS |
Année |
Modifications opérées
par voie législative (a) |
Solde des modifications
opérées
par voie réglementaire (b) |
Total des
modifications |
| |
En milliards
de francs |
En % des
crédits initiaux |
En milliards
de francs |
En % des
crédits initiaux |
En % des
crédits votés |
En milliards
de francs |
En % des
crédits initiaux |
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997 |
+ 77,27 (c)
+ 30,30 (d)
+ 22,31
+ 48,05
+ 28,10
+ 61,99 (d)
+ 31,30
+ 52,57
+ 46,79
+ 53,36
+ 33,62
+ 56,76
+ 141,30 (d)
+ 46,32
+ 126,95 (d)
+ 47,86
+ 64,44 |
8,51
2,65
1,73
3,45
1,86
3,91
1,91
3,09
2,65
2,81
1,84
2,97
7,01
2,19
5,84
2,09
+ 2,75 |
+ 68,92
+ 54,74
+ 48,65
+ 67,96
+ 95,29
+ 88,49
+ 132,25
+ 104,98
+ 108,84
+ 125,43
+ 119,56
+ 124,45
+ 80,18
+ 125,53
+ 84,63
+ 130,84
+ 131,22 |
7,59
4,79
3,79
4,88
6,31
5,58
8,07
6,17
6,17
6,60
6,55
6,51
3,98
5,96
3,89
5,72
+ 5,59 |
7,00
4,66
3,72
4,72
6,20
5,38
7,92
5,98
6,01
6,42
6,43
6,32
3,72
5,83
3,68
5,60
+ 5,44 |
+ 146,19
+ 85,04
+ 70,96
+ 116,01
+ 123,39
+ 150,48
+ 163,55
+ 157,55
+ 155,63
+ 178,79
+ 153,18
+ 181,21
+ 221,48
+ 171,85
+ 211,58
+ 178,70
+ 195,66 |
16,10
7,44
5,52
8,33
8,17
9,49
9,98
9,26
8,82
9,41
8,39
9,48
11,00
8,15
9,73
7,81
+ 8,34 |
(a) Ouvertures de crédits
dans la quasi-totalité des cas.
(b) Y compris les rétablissements de crédits (16,96 milliards de
francs en 1996) et les annulations associées aux lois de finances rectificatives.
(c) 4 lois de finances rectificatives.
(d) 2 lois de finances rectificatives.
Source : Rapport n° 934, présenté par votre Rapporteur, en
qualité de Rapporteur général de la Commission des finances,
de l’économie générale et du plan, sur le projet de loi
(n° 587) portant règlement définitif du budget de 1996 et rapport de la Cour des
comptes sur l’exécution des lois de finances pour l’année 1997. |
- Les marges de manœuvre dont dispose l’exécutif, bien que
conformes, dans leur principe, à l’ordonnance organique, pourraient donc prêter à
critique en raison même de leur ampleur. Comme le soulignent les tableaux ci-joints, la
mise en œuvre des prérogatives du Gouvernement, notamment lorsqu’elles se
traduisent par le rattachement au budget de crédits par voie de fonds de concours ou par
des arrêtés d’annulation, représente, en effet, des sommes non négligeables. Sans
doute conviendrait-il, à cet égard, d’ouvrir un vaste chantier de réforme de
l’ordonnance organique, afin de contenir les prérogatives du pouvoir exécutif dans
des limites évitant la remise en cause du pouvoir et du vote du Parlement.
MODIFICATIONS APPORTÉES AU MONTANT DES CRÉDITS BRUTS
DU BUDGET DE L’ÉTAT
(en milliards de francs) |
| |
1990 |
1991 |
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 (a) |
Evolution 1997/1996 (en %) |
Crédits votés : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Loi de finances initiale |
1.899,93 |
1.825,66 |
1.912,23 |
2.013,01 |
2.106,94 |
2.174,47 |
2.288,02 |
2.346,28 |
+ 2,5 |
Loi(s) de finances rectificative(s) |
53,36 |
33,62 |
56,76 |
141,26 |
46,32 |
126,95 |
47,86 |
64,44 |
+ 34,6 |
A.- Total des crédits votés |
1.953,29 |
1.859,29 |
1.968,99 |
2.154,28 |
2.153,26 |
2.301,42 |
2.335,88 |
2.410,73 |
+ 3,2 |
| Modifications apportées au montant des crédits votés
: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Reports de la gestion précédente
|
62,39 |
60,44 |
56,39 |
53,22 |
61,07 |
54,68 |
67,75 |
69,80 |
+ 3,0 |
Décrets d’avances
|
3,74 |
1,50 |
14,78 |
5,00 |
7,24 |
0,60 |
17,73 |
12,84 |
– 27,6 |
Arrêtés d’annulations
|
- 14,67 |
- 19,16 |
- 23,5 |
- 65,46 |
- 29,21 |
- 54,11 |
- 46,00 |
- 36,77 |
– 20,1 |
Fonds de concours rattachés
|
47,87 |
57,14 |
59,85 |
64,07 |
63,38 |
65,27 |
73,31 |
68,53 |
– 6,5 |
Augmentations de crédits gagées par des ressources nouvelles
|
2,77 |
0,39 |
1,01 |
5,47 |
7,06 |
0,88(c) |
1,08 |
n.d. |
n.d. |
Solde
|
102,10 |
100,32 |
108,53 |
62,3 |
109,54 |
67,33 |
113,88 |
114,40 |
+ 0,5 |
Rétablissements de crédits
|
23,33 |
19,24 |
17,97 |
17,87 |
16,75 |
17,30 |
16,96 |
13,87 |
– 18,2 |
B.- Majoration totale du montant des crédits votés
|
125,43 |
119,56 |
125,45 |
80,18 |
126,29 |
84,63 |
130,84 |
128,27 |
– 2,0 |
C.- Total des crédits disponibles (b) |
2.078,72 |
1.978,85 |
2.095,22 |
2.234,46 |
2.279,55 |
2.386,05 |
2.466,72 |
2.533,99 |
+ 2,7 |
(a) Résultats provisoires
pour l’exercice 1997
(b) Crédits ouverts et rétablissements de crédits . C = A + B.
(c) Y compris 83,98 millions de francs de " mesures
diverses " (reprise de dotation aux amortissements du budget annexe de
l’aviation civile)
Source : Rapport n° 963, présenté par votre Rapporteur, en
qualité de Rapporteur général de la Commission des finances,
de l’économie générale et du plan, préalable au débat
d’orientation budgétaire pour 1999. |
BUDGET DE L’ÉTAT :
MASSES DÉPLACÉES PAR VOIE RÉGLEMENTAIRE (a)
(en % des crédits initiaux bruts) |
| |
1986 |
1987 |
1988 |
1989 |
1990 |
1991 |
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
A.- Majorations brutes des crédits
: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Reports de la gestion précédente
|
2,73 |
2,59 |
3,09 |
2,9 |
3,28 |
3,31 |
2,95 |
2,64 |
2,89 |
2,51 |
2,96 |
Décrets d’avances
|
0,03 |
0,44 |
0,28 |
0,4 |
0,2 |
0,0 |
0,77 |
0,24 |
0,34 |
0,03 |
0,77 |
Fonds de concours rattachés
|
2,97 |
2,99 |
2,45 |
2,4 |
2,52 |
3,13 |
3,13 |
3,25 |
3,0 |
3,0 |
3,20 |
Augmentations de crédits gagées par des ressources nouvelles
|
0,30 |
2,27 |
0,05 |
0,18 |
0,15 |
0,0 |
0,05 |
0,27 |
0,33 |
0,04(b) |
0,05 |
Rétablissements de crédits
|
0,90 |
0,85 |
0,82 |
0,88 |
1,23 |
1,05 |
0,94 |
0,88 |
0,79 |
0,80 |
0,74 |
Total |
6,95 |
9,15 |
6,69 |
6,78 |
7,38 |
7,59 |
7,85 |
7,23 |
7,35 |
6,38 |
7,73 |
B.- Annulations de crédits |
1,36 |
1,09 |
0,52 |
0,61 |
0,77 |
1,05 |
1,23 |
3,25 |
1,38 |
2,49 |
2,01 |
| C.- Variation totale du montant des crédits en cours
d’année (A + B) |
8,31 |
10,24 |
7,21 |
7,39 |
8,15 |
8,64 |
9,08 |
10,48 |
8,73 |
8,87 |
9,74 |
(a) Y compris
rétablissements de crédits.
(b) Y compris " mesures diverses " au budget annexe
de l’aviation civile.
Source : Rapport n° 934, présenté par votre Rapporteur, en
qualité de Rapporteur général de la Commission des finances,
de l’économie générale et du plan, sur le projet de loi (n° 587) portant
règlement définitif du budget de 1996. |
- En outre, votre Rapporteur souhaiterait souligner le caractère extrêmement
préoccupant, plus encore que les dispositions de l’ordonnance organique autorisant
ces diverses modifications, de l’usage que fait le Gouvernement de ces dispositions.
Ce sont, en effet, la pratique, plus que les règles juridiques, qui ont accru les marges
de manœuvre du Gouvernement. Compte tenu de l’ampleur des entorses
régulièrement dénoncées par la Cour des comptes, votre Rapporteur limitera son exposé
aux exemples les plus significatifs.
a) Une gestion des crédits budgétaires à la discrétion du
Gouvernement
Les gouvernements recourent, en effet, systématiquement, à diverses
techniques, qui leur permettent, en " contournant " les dispositions
de l’ordonnance organique, de s’écarter de l’autorisation budgétaire
délivrée par le Parlement.
t Les décrets
d’avance, véritables actes législatifs
L’article 11 de l’ordonnance organique ()
impose, pour recourir à des décrets d’avance, que soient réunies des conditions
d’urgence et que l’équilibre financier de la dernière loi de finances ne soit
pas affecté. Les sommes en jeu sont considérables, comme le montre le tableau ci-après.
Or, comme le relève régulièrement la Cour des comptes,
l’urgence alléguée par le Gouvernement n’est que rarement établie. Les
décrets d’avance servent bien souvent à couvrir des besoins prévisibles avant
même le vote de la loi de finances initiale, mais sous-évalués volontairement, afin de
respecter l’équilibre financier affiché par le Gouvernement en loi de finances
initiale. Ce caractère d’urgence est, d’ailleurs, singulièrement contestable
lorsque les crédits ouverts sont utilisés tardivement, voire ne sont pas utilisés.
Quant à l’équilibre financier, il n’est respecté que de
manière formelle, par le biais d’annulation de crédits prétendument sans emploi ou
de majoration de recettes budgétaires qui ne font l’objet d’aucune
justification de fond. Le tableau ci-après souligne, en effet, que des annulations de
crédits sont systématiquement associées aux ouvertures de crédits, prises sur décret
d’avance. A quelques exceptions près, les montants en jeu sont équivalents.
De manière plus précise, rappelons que votre Rapporteur a
souligné ()que le décret d’avance, du 31 mars 1995, avait
été " gagé par des économies de pure apparence ". De même,
le décret d’avance du 10 avril 1996 (), portant ouverture de
crédits à hauteur de 6,8 milliards de francs, a été gagé, pour partie, par
" la constatation de ressources non fiscales à hauteur de 2 milliards
de francs ", que le Rapporteur général de l’époque avait qualifiée
de " gage peu satisfaisant " ().
En réalité, les décrets d’avance tendent à devenir, comme le
relève le Président Philippe Séguin (), de " véritables
actes législatifs édictés par voie réglementaire, sans possibilité réelle de
sanction ultérieure. De telles pratiques procèdent, de la part de l’exécutif, non
seulement de la recherche bien naturelle de l’efficacité tranquille, mais aussi,
hélas, de la crainte du débat public ".
BUDGET GÉNÉRAL :
ÉVOLUTION DES OUVERTURES PAR DÉCRETS D’AVANCE ET DES ANNULATIONS ASSOCIÉES |
| |
Nombre de
|
Montants
(en millions de francs) |
Part dans les crédits
initiaux nets
(en %) |
| |
décrets d’avance |
Ouvertures |
Annulations
associées |
Solde |
Ouvertures |
Annulations |
Solde |
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998 |
2
2
1
–
2
–
1
3
2
2
2
1
2
1
2
1
2
2
2 |
3.496 285
2.150
–
3.780
–
630
7.284
4.362
5.073
2.803
1.500
14.781
5.000
7.245
600
17.731
12.836
6.037 |
610 –
250
–
2.781
–
530
5.219
2.733
6.573
3.743
– (a)
4.781
5.000
7.170 (c)
600
14.851 (d)
12.781
5.358 |
2.886 285
1.900
–
999
–
100
2.065
1.629
– 1.500
– 940
1.500
10.000 (b)
0
75 (c)
0
2.880 (e)
55 (f)
679 (g) |
0,67 0,05
0,27
–
0,4
–
0,06
0,69
0,40
0,44
0,23
0,12
1,12
0,36
0,50
0,04
1,14
0,81
0,38 |
0,12 –
0,03
–
0,3
–
0,05
0,5
0,25
0,57
0,31
–
0,36
0,36
0,49
0,04
0,95
0,81
0,33 |
0,55 0,05
0,24
–
0,1
–
0,01
0,19
0,15
– 0,13
0,08
0,12
0,76
0,00
0,01
0,00
0,19
0,00
0,04 |
(a) Indépendamment de
l’ouverture de crédits militaires par décret d’avance le 23 août, au titre de
l’opération Daguet, un arrêté du 9 mars 1991 a annulé 10.069 millions de francs,
soit 0,79% des crédits initiaux.
(b) L’équilibre du décret d’avance du 2 septembre 1992
a été assuré par les recettes de privatisation tirées de la cession de 2,3 % du
capital d’Elf-Aquitaine par l’ERAP (1,6 milliard de francs) et de
21,7 % du capital de Total par l’Etat (8,4 milliards de francs).
(c) L’équilibre du décret d’avance du 29 septembre
1994 a en outre été assuré par l’annulation de 75 millions de francs de
crédits sur le compte de prêts du FDES.
(d) Arrêtés d’annulation des 10 et 12 avril et du 26 septembre
1996.
(e) L’équilibre des décrets d’avance a en outre été
assuré par respectivement 2 milliards de francs et 870,04 millions de francs de
ressources non fiscales.
(f) L’équilibre des décrets d’avance a en outre été
assuré par une annulation de 55 millions de francs sur le compte de prêts du FDES.
(g) L’équilibre du décret d’avance du 21 août 1998 a
en outre été assuré par 679,2 millions de francs de ressources non fiscales.
Source : Rapport n° 1224, présenté par votre Rapporteur, en
qualité de Rapporteur général de la Commission des finances, de l’économie
générale et du plan, sur le projet de loi de finances rectificative pour 1998. |
t Un recours abusif au
crédit global
Les crédits globaux, régis par l’article 7 de l’ordonnance
organique (), visent à couvrir des dépenses dont l’objet ne peut
être déterminé lors du vote du projet de loi de finances. Ils concernent notamment les
dépenses éventuelles ou accidentelles.
Mais, en réalité, cette dérogation au principe de spécialité des
crédits est également " utilisée dans des cas où la répartition finale
était prévisible dès le vote de la loi de finances, à seule fin de réserver le plus
longtemps possible au ministre des finances la disposition des crédits " ().
Cette pratique est abusive lorsque le recours à la procédure des
crédits globaux tend à être utilisée, comme nous allons le voir ci-après, pour
régulariser rétroactivement des dépassements irréguliers de crédits limitatifs. Des
améliorations ont cependant été enregistrées, à cet égard, depuis une dizaine
d’années.
t Des dépassements
abusifs des crédits limitatifs
La notion de crédits limitatifs, de droit commun, implique qu’une
dépense ne peut être engagée que dans la limite du montant des crédits ouverts.
Or, jusqu’en 1992, date à laquelle ils étaient devenus une
pratique de gestion courante pour les crédits de rémunération des personnels (),
puis de nouveau en 1996 et 1997, l’administration a procédé, en cours
d’exercice, à des dépassements de crédits limitatifs, régularisés en loi de
finances rectificative.
Outre le fait qu’elle constitue une infraction aux dispositions de
l’ordonnance organique, en remettant en cause la nature même des crédits
limitatifs, cette dérive reflète " la manière pour le moins désinvolte " ()
dont les services anticipent l’autorisation budgétaire délivrée par le Parlement
et l’octroi de nouveaux crédits. Elle est même extrêmement dangereuse, puisque le
Parlement pourrait, au moins en théorie, refuser l’octroi des crédits
correspondants.
Par ailleurs, cette méthode de gestion prenait une tournure très
contestable, lorsque les dépassements de crédits limitatifs opérés sont couverts, de
manière rétroactive, par un arrêté de répartition sur crédit global, afin de
régulariser les dépassements observés préalablement au dépôt du projet de loi de
règlement. Comme le relevait, en effet, M. Jacques Magnet (),
conseiller-maître à la Cour des comptes, " l’ordonnance organique (article 35)
réserve au Parlement la facilité de couvrir, par une disposition de la loi de
règlement, les dépassements de crédits qu’il estimerait justifiés par des
circonstances de force majeure ; en s’absolvant elle-même,
l’administration méconnaît la distribution constitutionnelle des pouvoirs ".
t L’existence de
chapitres réservoirs
La pratique des " chapitres réservoirs " permet à
l’exécutif de " masquer l’objet ou le montant des dépenses
réelles " ().
Cette dérive a été rendue possible par la définition posée à la
notion de chapitre : celui-ci regroupe, en effet, des dépenses non seulement de
même nature (), mais également selon leur destination ().
Ce deuxième critère a favorisé la constitution de chapitres au contenu large,
qualifiés de " chapitres réservoirs ".
Une catégorie spécifique de chapitre réservoir pose singulièrement
problème : il s’agit du chapitre 31-94 du budget des charges communes,
relatif aux rémunérations de la fonction publique. Comme l’a dénoncé, au cours de
son intervention devant le groupe de travail, M. Daniel Bouton, ancien directeur du
budget, " la mécanique du 31-94 permet de supprimer toute intervention du
Parlement [en matière de politique salariale de la fonction publique] ", le
Gouvernement prélevant les sommes nécessaires sur le chapitre précité sans en
référer au Parlement.
Rappelons, ainsi, qu’un accord salarial a été signé en février
1998 entre le Gouvernement et les principales organisations syndicales (),
dont les effets, en année pleine, s’élèvent à 10,6 milliards de francs pour
1998 et 4,7 milliards de francs en 1999, soit, au total, pour ces deux années,
15,4 milliards de francs. A cet égard, la question se pose d’apprécier la
capacité, voire la légitimité, à engager les finances publiques d’un seul trait
de plume sans que le Parlement soit amené à se prononcer.
Ces quelques exemples ne constituent pas les seules atteintes portées
aux prérogatives du Parlement. Dans le contexte des réductions budgétaires que nous
connaissons, notamment depuis le début des années 1990, le Gouvernement n’a, en
réalité, que de faibles marges de manœuvre financières pour accroître, par le
biais des pratiques précédemment décrites, les crédits. Plus lourdes de conséquences
sont les opérations de régulation budgétaire destinées à annuler les crédits votés
par le Parlement.
b) Une pratique de la régulation budgétaire peu respectueuse
des prérogatives du Parlement
La régulation budgétaire pourrait se définir comme " [un
infléchissement] du rythme de la dépense budgétaire pour des motifs qui peuvent
tenir au réglage conjoncturel de la situation économique ou à la nécessité de
maîtriser la dépense publique " ().
- Elle prend, concrètement, la forme, soit, en fin d’année, de reports
de crédits, tirant la conséquence de la décision de retarder leur utilisation, soit, le
plus fréquemment, de gels de crédits, suivis de leur annulation, afin de gager des
mesures nouvelles décidées par le Gouvernement et non prévues en loi de finances
initiale ou de limiter volontairement les dépenses.
Ces annulations de crédits ont pris, au cours des dernières années,
des proportions importantes. Les sommes annulées par arrêtés se sont, ainsi, élevées,
en crédits bruts, aux montants suivants :
ANNULATIONS DE CRÉDITS
BRUTS DU BUDGET DE L’ETAT
(en milliards de francs) |
1990 |
1991 |
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
14,67 |
19,16 |
23,5 |
65,46 |
29,21 |
54,11 |
46,00 |
Source : Rapport
n° 963, présenté par votre Rapporteur, en qualité de
Rapporteur général de la Commission des finances, de l’économie
générale et du plan, préalable au débat d’orientation budgétaire pour 1999. |
Les annulations en montants nets, plus significatives, sont les
suivantes :
ANNULATIONS DE CRÉDITS
NETS DU BUDGET DE L’ETAT (a)
(en millions de francs) |
| |
1989 |
1990 |
1991 |
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
Budget général |
|
|
|
|
|
|
|
|
Dépenses ordinaires civiles nettes |
|
|
|
|
24.212,3 |
8.899,1 |
16.600,1 |
16.878,7 |
Dépenses ordinaires en capital |
|
|
|
|
2.583,9 |
2.744,2 |
4.644,7 |
5.620,0 |
Dépenses militaires ordinaires |
|
|
|
|
751,3 |
1.117,4 |
– |
– |
Dépenses militaires en capital |
|
|
|
|
9.010,9 |
– |
11.892,3 |
8.507,1 |
Total du budget général |
9.630,6 |
13.247,3 |
18.611,6 |
17.200,0 |
36.558,3 |
12.760,6 |
33.137,1 |
31.005,8 |
pour mémoire : crédits bruts |
9.730,6 |
13.347,3 |
18.611,6 |
23.000,0 |
59.968,3 |
29.061,6 |
43.157,1 |
40.205,8 |
Budgets annexes |
826,8 |
50,5 |
2,1 |
1,5 |
1,2 |
20,7 |
122,4 |
117,0 |
Comptes spéciaux du Trésor |
|
|
|
|
|
|
|
|
Comptes d’affectation spéciale |
– |
– |
141,5 |
500,0 |
– |
819,5 |
– |
5.510,0 |
Comptes de prêts |
190 |
1.273,7 |
400,6 |
– |
5.500,0 |
75,0 |
6.850,0 |
167,5 |
Comptes d’avances |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
3.980,0 |
– |
Total |
10.647,4 |
14.571,5 |
19.155,8 |
17.701,5 |
42.059,5 |
13.675,8 |
44.089,5 |
36.800,3 |
(a) Les documents de
récapitulation établis par la direction de la comptabilité publique à l’occasion
des projets de loi de règlement ne permettent pas, avant l’année 1993, de
décomposer les annulations de crédits nets effectuées sur le budget général en
fonction des catégories de dépenses.
Source : Rapport n° 934, présenté par votre Rapporteur, en
qualité de Rapporteur général de la Commission des finances,
de l’économie générale et du plan, sur le projet de loi (n° 587) portant
règlement définitif du budget de 1996. |
Précisons, toutefois, que les mesures de régulation budgétaire ne
concernent pas l’ensemble des crédits : " les rémunérations des
personnels, les dépenses liées à la solvabilité de l’Etat, les transferts sociaux
constitutifs de droits, les engagements internationaux,[...] et les services votés " ()
sont, par nature, exclus de la régulation budgétaire. Par ailleurs, le Gouvernement peut
exclure de toute mesure de régulation budgétaire les domaines qu’il juge
prioritaires.
- Le principe d’une annulation de crédits est, certes, fondé
juridiquement. Rappelons, en effet, que le Parlement vote des autorisations de dépenses,
lesquelles constituent des plafonds à ne pas dépasser, et non une obligation de
dépenser. Le Gouvernement est, par conséquent, habilité à ne pas utiliser la totalité
des crédits ouverts.
Par ailleurs, les incertitudes qui entourent les hypothèses
économiques retenues par le Gouvernement lors de l’élaboration du projet de loi de
finances, le caractère parfois approximatif des dotations budgétaires et les aléas de
la conjoncture imposent de donner au Gouvernement les moyens d’adapter, en cours
d’exécution, le budget voté. La régulation infra-annuelle des dépenses publiques
est donc une nécessité.
Pour autant, les modalités et les objectifs poursuivis par le biais de
la régulation budgétaire ne sont pas exempts de critiques.
t Une base juridique
inexistante
- Les opérations de régulation budgétaire reposent, juridiquement, sur
l’article 13 de l’ordonnance organique, lequel dispose que " tout
crédit qui devient sans objet en cours d’année peut être annulé par arrêté du
ministre des finances après accord du ministre intéressé ".
La Cour des comptes a eu, à maintes reprises, l’occasion de
préciser que les dispositions de l’article 13 de l’ordonnance organique ne
devaient être réservées qu’aux seuls crédits devenus sans objet,
c’est-à-dire aux crédits qu’" il est, par excès dans les
prévisions ou par survenance d’événements imprévus lors du vote de la loi de
finances initiale, impossible, et non seulement inopportun, d’utiliser, ou du moins
d’utiliser intégralement, aux dépenses en vue desquelles ils ont été ouverts,
l’annulation pour d’autres motifs devant être prononcée par une loi de
finances rectificative définissant un nouvel équilibre budgétaire " ().
Or, le caractère systématique et forfaitaire des annulations de
crédit, leur caractère répétitif (), le fait même que, parfois, ces
crédits prétendument sans emploi et donc, à ce titre, annulés soient ultérieurement
rétablis, soulignent que le Gouvernement, en ayant recours à l’article 13 de
l’ordonnance organique à des fins de maîtrise de l’équilibre budgétaire, se
livre à ce qui peut être assimilé à un détournement de procédure. Le Gouvernement ne
peut, en effet, estimer que des crédits sont devenus sans objet seulement parce
qu’il décide de ne pas les utiliser, à moins de considérer alors que
l’ensemble des crédits pour dépenses non obligatoires sont potentiellement des
crédits sans objet.
- En réalité, la régulation budgétaire, telle qu’elle est mise en
œuvre depuis le début des années 1980, sert, non pas à réguler l’exécution
budgétaire en fonction de la conjoncture, mais s’inscrit dans une politique de
redressement structurel de nos finances publiques, en vue de maintenir l’équilibre
budgétaire dans les limites préalablement définies par la loi de finances initiale. A
ce titre, la régulation budgétaire peut être considérée comme un instrument de
politique budgétaire à moyen terme.
Rappelons, brièvement, à cet égard, que la maîtrise du déficit
public est devenue un objectif à part entière de notre politique budgétaire.
L’obligation de satisfaire aux critères de convergence du traité sur l’Union
européenne a imposé, à la France comme aux autres Etats membres de l’Union
européenne, une politique de redressement des finances publiques. Or, compte tenu du
poids des marchés financiers internationaux, ce redressement passe désormais, non
seulement par l’affichage d’un déficit public respectant les normes édictées,
mais également par un suivi de l’exécution, afin de respecter l’équilibre
préalablement défini. A cet égard, force est de constater que la régulation
budgétaire, notamment lorsqu’elle passe par des normes forfaitaires de réduction
des crédits, s’est révélée un instrument d’une forte efficacité.
t Une autorisation
parlementaire contournée
Evoquant l’ampleur des prérogatives dont jouit le Gouvernement en
cours d’exécution pour gérer l’autorisation budgétaire délivrée par le
Parlement, le Professeur Guy Carcassonne, au cours de son intervention devant notre
groupe de travail, a jugé " qu’il y a quelque chose de parfaitement
indécent, non seulement à ce que, l’encre de la loi de finances étant à peine
sèche, elle soit déjà substantiellement modifiée, mais aussi à ce que, en cours
d’année, des sommes extrêmement significatives se promènent à travers des
virements, des transferts, des décrets d’avances ou des annulations. Il existe une
disproportion frappante entre le débat budgétaire, à l’occasion duquel peuvent se
nouer des conflits politiques, des débats très vifs sur l’affectation de un, deux
ou trois milliards de francs, et le fait que plus tard dans l’année, un trait de
plume et deux signatures permettront de déplacer cinq, dix ou vingt milliards de francs
au titre de la régulation budgétaire ".
- Il est, en effet, indéniable que les mesures de gel et d’annulation de
crédits décidées dans le cadre de la régulation budgétaire constituent une atteinte
aux prérogatives budgétaires du Parlement.
M. Daniel Bouton, ancien directeur du budget, relevait, à cet
égard, au cours de son intervention devant notre groupe de travail, que " la
loi qui est votée n’a pas vocation à être appliquée, en ce sens que la direction
du budget a déjà, sur instruction du Premier ministre, préparé le 1er décembre
le plan de régulation des crédits qui s’appliquera le 3 janvier, après la
promulgation ".
Le montant des sommes en cause revient à vider de sa substance le
contenu de l’autorisation budgétaire délivrée par le Parlement. Ce fut notamment
le cas en 1993, 1995 et 1996, où les annulations de crédits nets au budget général se
sont, respectivement, élevées à 36,5, 33,1 et 31 milliards de francs. Comme le
souligne le Président Philippe Séguin, " le caractère excessif de ces
méthodes, observé depuis plusieurs années et sous toutes les majorités, tend à vider
de leur contenu les autorisations initiales votées par le Parlement " ().
Pour sa part, M. Dominique Strauss-Kahn, ministre de
l’économie, des finances et de l’industrie, a indiqué, devant le groupe de
travail, qu’il n’avait pas procédé à de telles régulations.
Ces mesures d’annulation de crédits portent d’autant plus
atteinte aux prérogatives du Parlement qu’elles interviennent souvent peu de temps
après l’adoption définitive du projet de loi de finances. Rappelons ainsi, à titre
d’illustration, qu’en 1996, le ministre de l’économie, des finances et du
budget annonçait, dès le 26 février, un gel des crédits, pour chaque ministère,
de 15% () des crédits de dépenses ordinaires et de 25% des crédits de
paiements pour les autorisations de programmes ouvertes au titre de la loi de finances
initiale pour 1996. De telles décisions ne manquent pas de souligner le caractère
artificiel des projets de lois de finances votés par le Parlement.
Il n’est pas dans notre propos de remettre en cause la nécessité
d’ajustements des crédits en cours d’exécution, à des fins de maîtrise de
l’équilibre budgétaire. Mais, encore faudrait-il que ces exercices soient menés
par le pouvoir investi constitutionnellement de l’autorité budgétaire, à savoir le
Parlement. Les annulations de crédits décidées dans le cadre de la régulation
budgétaire ne correspondent pas à l’esprit de l’article 13 de
l’ordonnance organique et devrait donc relever de la compétence exclusive du
Parlement.
- Rappelons, à cet égard, que le Parlement disposait, jusqu’en 1981,
d’un droit de regard sur les mesures de régulation budgétaire.
Comme le relevait M. Alain Richard dans son rapport relatif au
projet de loi de finances rectificative pour 1991, les mesures de régulation ont
consisté, de 1959 à 1981, en un " article d’habilitation figurant dans
la loi de finances pour 1959 et autorisant le Gouvernement à déterminer un programme
d’économies par décret ".
Un article de régulation était donc voté, le Parlement habilitant le
Gouvernement à réaliser un certain volume d’économies, dont le montant ne pouvait
être inférieur à un certain niveau. L’article 16 de la loi de finances pour
1959 précisait que ce volume d’économies, fixé par décret, était déterminé par
une commission composée de représentants du Conseil d’Etat, de la Cour des comptes,
du ministre des finances, du ministre chargé de la réforme administrative et placé sous
l’autorité du Premier ministre.
Le Parlement obtint, par la suite, un droit de regard sur la nature de
ces économies. L’article 32 de la loi de finances pour 1969 prévoyait, en
effet, de soumettre à la ratification du Parlement, par une loi de finances
rectificative, la répartition par titre et par ministère de ces économies.
A partir de 1969 et jusqu’en 1981, un nouveau mécanisme de
régulation fut introduit, par le biais de fonds d’action conjoncturelle (FAC). Ces
derniers avaient une finalité radicalement distincte des actuels mécanismes de
régulation budgétaire, puisqu’il s’agissait, non pas de maîtriser la dépense
publique à des fins d’équilibre budgétaire, mais de prévoir, selon
l’évolution de la conjoncture, d’éventuelles dépenses supplémentaires. Il
est, toutefois, intéressant de noter que les procédures envisagées prévoyaient un
droit de regard du Parlement.
Cette procédure visait, en effet, à prévoir, en loi de finances
initiale, une enveloppe prévisionnelle de crédits destinés au financement
d’investissements. Les parlementaires étaient donc appelés à se prononcer sur le
principe et le montant global, réparti entre ministères, des sommes en jeu. En revanche,
l’engagement de ces sommes était laissé à l’appréciation du Gouvernement,
ainsi que leur répartition au sein de chaque ministère.
Compte tenu de ces expériences passées, il semblerait donc
envisageable d’introduire des mécanismes permettant de ne pas bafouer
l’autorisation budgétaire délivrée par le Parlement lors de la mise en œuvre
de mesures de régulation budgétaire.
Au-delà des atteintes portées aux prérogatives du Parlement, la
régulation budgétaire apparaît également critiquable au regard de ses conséquences
sur la gestion publique.
t Une gestion publique
remise en cause
L’incertitude entourant les dotations budgétaires dont pourront
disposer les gestionnaires perturbe, en effet, l’action administrative et provoque
des retards dans l’exécution.
Par ailleurs, le caractère étroit de l’assiette sur laquelle
pèsent les mesures de régulation budgétaire, ainsi que leur caractère forfaitaire et
uniforme, aboutissent à pénaliser des programmes parfois jugés prioritaires. Les
opérations d’investissement, ainsi celles relatives aux contrats de plan
Etat-régions, sont aussi particulièrement pénalisées.
Enfin, on peut s’interroger sur l’efficacité de ces mesures
de régulation. Les administrations cherchent, en effet, à se prémunir contre leurs
effets en réclamant des dotations qui excèdent leurs besoins réels. Mais surtout, une
logique de gestion à très court terme de l’équilibre budgétaire semble
s’être imposée, au détriment d’une vision globale et de moyen terme. Ainsi,
si la régulation budgétaire a permis de contenir les dépenses, elle semble avoir été
contre-productive en termes d’efficacité de la dépense publique. A cet égard, la
Cour des comptes () a estimé que le gel des crédits, décidé par la
lettre ministérielle du 26 février 1996, lequel était assorti de " l’interdiction
d’engager plus de la moitié des crédits avant la fin du premier semestre ",
contredisait, en raison de cet " échelonnement de la dépense ",
" toutes les dispositions en vigueur, dont celles issues du ministère du
budget, selon lesquelles les crédits doivent être délégués aux services
déconcentrés à hauteur de 80% avant la fin du premier trimestre. La segmentation des
engagements de crédits en deux périodes va à l’encontre de la politique de
déconcentration et de responsabilisation affichée avec constance depuis 1990. "
Les pouvoirs financiers du Parlement apparaissent, au total,
relativement limités dans l’exercice de ses fonctions de législateur, même
s’ils sont plus importants, sans doute, que l’opinion publique ou les
parlementaires eux-mêmes ne veulent le croire. Mais, rappelons, à cet égard, que la
logique de nos institutions repose sur une prééminence du pouvoir exécutif dans
l’élaboration des lois de finances. A la différence d’un régime
présidentiel, tel que celui des Etats-Unis, dans lequel le pouvoir législatif dispose
d’une véritable initiative financière, un régime parlementaire présuppose une
coopération organisée entre les pouvoirs exécutif et législatif. Sans doute cette
coopération laisse-t-elle, en France, une part excessive de prérogatives au
Gouvernement. Des réaménagements de notre procédure budgétaire sont donc nécessaires.
Mais, l’étude des seules prérogatives du Parlement en tant que
législateur ne permet pas d’appréhender, dans sa globalité, les pouvoirs de
celui-ci en matière budgétaire. En effet, au-delà du principe d’autorisation
budgétaire, l’une des fonctions majeures du Parlement est de contrôler
l’action du Gouvernement, à la fois sur le plan de sa régularité et de son
efficacité. Comme l’a fait très justement remarquer le Professeur Guy Carcassonne
dans son intervention devant le groupe de travail, on peut s’interroger sur le point
de savoir si, dans un régime moderne, où il est difficilement concevable que le
" Parlement fabrique une loi de finances de A à Z ", le rôle
des parlementaires en matière budgétaire n’est pas d’abord de contrôler la
dépense publique.
II.- Mais, le
parlement n’a eu, jusque lÀ, ni la ferme volontÉ de contrÔler la dÉpense
publique, ni les moyens d’en Évaluer les performances
Ce terme de contrôle est ambigu, car il recoupe, en réalité, deux
fonctions distinctes, comme l’a souligné, devant le groupe de travail, M. Loïc
Philip, professeur de droit public. Il renvoie, d’une part, à un exercice de suivi
des crédits budgétaires, afin de contrôler la régularité et l’effectivité de la
dépense publique. Il ouvre la voie, d’autre part, à un exercice d’évaluation
de la dépense publique, afin de déterminer si celle-ci a atteint les objectifs qui lui
étaient assignés et, dans l’affirmative, s’il est possible d’obtenir des
résultats identiques à un moindre coût.
Votre Rapporteur distinguera donc la capacité du Parlement, d’une
part, à contrôler la dépense publique et, d’autre part, à évaluer son
efficacité.
A.- le parlement
est, théoriquement, en mesure de contrôler la dépense publique
Le Parlement dispose de prérogatives extrêmement importantes en
matière de contrôle de la dépense publique, mais celles-ci sont peu utilisées.
1.- Des pouvoirs étendus
Ces prérogatives peuvent s’analyser sous trois angles
distincts : les parlementaires disposent d’attributions réelles, ils reçoivent
une masse d’informations abondante et ils peuvent bénéficier de l’assistance
de la Cour des comptes.
a) Des attributions importantes
t Les pouvoirs de
contrôle sur pièce et sur place des rapporteurs spéciaux
Au-delà du contrôle de l’activité gouvernementale, le Parlement
dispose, en matière budgétaire, de pouvoirs propres définis par l’ordonnance
n° 58-1374, du 30 décembre 1958, portant loi de finances pour 1959.
- L’article 164 () de l’ordonnance précitée
précise, en effet, que les rapporteurs spéciaux disposent, de façon permanente, de pouvoirs
de contrôle sur pièces et sur place pour suivre l’emploi des crédits du budget
ministériel dont ils ont la charge. Notons que seuls les rapporteurs spéciaux désignés
par la Commission des finances sont dotés de telles prérogatives, à l’exclusion
des rapporteurs pour avis des autres commissions, alors qu’une lecture moins étroite
de cet article aurait sans doute permis de conférer également ces prérogatives aux
rapporteurs pour avis. Une proposition sera faite en ce sens.
Ce même article précise également que les rapporteurs spéciaux
disposent, sur décision de la commission compétente, c’est-à-dire la Commission
des finances, de pouvoirs de contrôle sur pièces et sur place pour suivre la gestion des
entreprises nationales, des sociétés d’économie mixte et des sociétés ou
entreprises dans lesquelles l’Etat détient plus de 50% du capital.
Ces prérogatives permettent aux rapporteurs spéciaux de se déplacer
dans un ministère ou une entreprise publique pour contrôler des documents. Ils sont
autorisés à contrôler aussi bien la régularité que l’opportunité de
l’utilisation des crédits. Notons, par ailleurs, qu’à la différence d’un
rapporteur sur un texte législatif, désigné pour une période limitée, le rapporteur
spécial peut exercer ses pouvoirs de contrôle sur pièces et sur place tout au long de
l’année. Etant généralement reconduit d’une année sur l’autre, il est
en mesure de se spécialiser dans un domaine précis. Les pouvoirs de contrôle sur pièce
et sur place des rapporteurs spéciaux sont donc étendus et aussi importants que les
prérogatives dévolues aux magistrats de la Cour des comptes.
Soulignons, enfin, que ces pouvoirs revêtent une importance telle
qu’ils ont été transposés aux rapporteurs des commissions d’enquête.
Au-delà de ces pouvoirs de contrôle sur pièces et sur place, les
rapporteurs spéciaux peuvent également procéder à des auditions et présenter,
pratique de plus en plus fréquente, des rapports d’information devant la Commission
des finances, à la suite d’une modification de l’article 146 du Règlement
de l’Assemblée nationale intervenue en 1991.
- On observera que le Rapporteur général, seul à présenter, au nom de la
Commission des finances, des rapports sur les lois de finances rectificatives et les lois
de règlement, c’est-à-dire sur l’exécution des lois de finances, a,
naturellement, qualité pour exercer des pouvoirs de contrôle sur pièces et sur place
identiques à ceux des rapporteurs spéciaux, sur l’ensemble des ministères. Par
ailleurs, le Rapporteur général, sous le timbre duquel sont présentés les différents
rapports spéciaux annexés à son rapport général, a ainsi vocation, dans
le respect de l’autonomie d’expression des rapporteurs spéciaux, à coordonner
les activités de contrôle de ceux-ci.
t La participation des
députés et sénateurs à des organismes extra-parlementaires
Des parlementaires participent aux instances dirigeantes de dizaines
d’organismes extra-parlementaires : commission de surveillance de la Caisse des
dépôts et consignations, comité du Fonds d’aide et de coopération, comité des
finances locales, conseils d’administration des sociétés audiovisuelles du secteur
public, comité directeur du fonds d’investissement des départements
d’outre-mer (FIDOM), conseils de gestion de nombreux fonds gérés dans le cadre des
comptes spéciaux du Trésor...
Force est de constater que les parlementaires concernés utilisent peu
la faculté, ouverte par l’article 28 du Règlement, leur permettant de rendre
compte de leurs travaux, dans le cadre d’un rapport d’information.
t Les questions au
Gouvernement
Les parlementaires ont la possibilité d’interroger le
Gouvernement sur les matières budgétaires et financières dans le cadre traditionnel des
questions écrites ou orales au Gouvernement. Aucune séance de questions au Gouvernement
ne porte, cependant, de manière spécifique, sur la gestion de la dépense publique.
t Les commissions
d’enquête
L’article 6 de l’ordonnance n° 58-1100 du
17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires précise
que des commissions d’enquête peuvent être formées " pour recueillir
des éléments d’information soit sur des faits déterminés, soit sur la gestion de
services publics ou des entreprises nationales, en vue de soumettre leurs conclusions à
l’assemblée qui les a créées ".
Les rapporteurs des commissions d’enquête jouissent, en
application de ce texte, de pouvoirs étendus : " Les rapporteurs des
commissions d’enquête exercent leur mission sur pièces et sur place. Tous les
renseignements de nature à faciliter cette mission doivent leur être fournis. Ils sont
habilités à se faire communiquer tous documents de service, à l’exception de ceux
revêtant un caractère secret et concernant la défense nationale, les affaires
étrangères, la sécurité intérieure ou extérieure de l’Etat, et sous réserve du
respect du principe de la séparation de l’autorité judiciaire et des autres
pouvoirs ".
Soulignons également que toute personne dont la commission
d’enquête demande l’audition est tenue de déférer à cette convocation.
Enfin, les commissions permanentes peuvent demander de se voir
attribuer les prérogatives dévolues aux commissions d’enquête, pour une mission
déterminée et pour une durée n’excédant pas six mois ().
Cependant, comme l’a noté notre collègue M. Laurent
Dominati dans une intervention devant le groupe de travail, les travaux auxquels
aboutissent les commissions d’enquête parlementaires ne font pas l’objet
d’un suivi satisfaisant, aucun débat public n’étant organisé, de manière
systématique, sur les rapports qu’elles remettent.
b) Une information abondante
Dans le cadre de ses fonctions de contrôle de l’activité
gouvernementale, le Parlement est destinataire d’une masse abondante, voire
surabondante, d’informations.
t En cours
d’exécution
- L’article 164 de l’ordonnance n° 58-1374 du
30 décembre 1958 précitée énumère une longue liste de documents devant être
communiqués au Parlement tout au long de l’année.
Celle-ci comprend notamment le rapport établi par chaque contrôleur
financier sur l’exécution du budget du ministère dont il assume le contrôle.
- Le Parlement reçoit régulièrement des informations portant sur
l’exécution du budget et retraçant le niveau des recettes et des dépenses.
Depuis la mi-mars 1995, conformément à un engagement de
M. Nicolas Sarkozy, alors ministre du budget, le Parlement reçoit des statistiques
sur la situation de l’exécution du budget de l’Etat. Elles portent sur le
niveau des dépenses et l’encaissement des recettes. Cette publication est mensuelle
depuis octobre 1995.
En matière de dépenses, le Parlement est destinataire de la situation
des crédits du budget général (suivi mensuel des modifications apportées, en cours
d’année, aux crédits votés en loi de finance initiale) et de la situation des
dépenses du budget général (suivi mensuel de la consommation des crédits ouverts en
loi de finances initiale, par les lois de finances rectificatives et les actes
réglementaires). Ces informations sont, cependant, fournies avec un certain retard, alors
qu’il serait nécessaire d’y avoir accès de façon instantanée.
En matière de recettes, le Parlement dispose de la situation mensuelle
du recouvrement des recettes de l’Etat (relevé, pour chaque impôt, des rentrées
fiscales mensuelles), ainsi que de la situation résumée des opérations du Trésor
(SROT), publiée mensuellement. Indiquons, toutefois, que le relevé des rentrées
fiscales ne permet pas de suivre le recouvrement des recettes nettes, le Parlement ne
recevant pas d’informations détaillées sur les remboursements et dégrèvements.
Par ailleurs, la technicité des tableaux de la SROT rend leur utilisation quelque peu
malaisée.
Les informations ne manquent donc pas. On peut cependant, comme
l’a relevé M. Michel Prada, ancien directeur, successivement, de la comptabilité
publique et du budget, dans son intervention devant le groupe de travail,
s’interroger sur leur caractère exploitable. Selon lui, le ministère des finances
devrait " être en mesure de fournir des situations périodiques relativement
précises sur les différentes étapes de l’exécution budgétaire, aussi bien en
recettes qu’en dépenses ". Il est à noter, cependant, que les
assemblées ne peuvent accéder directement aux bases de données budgétaires et fiscales
du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie.
Par ailleurs, une référence trop systématique au secret fiscal peut
nuire à la bonne information du Parlement.
- Le dépôt au printemps, qui reste cependant exceptionnel, d’un projet
de loi de finances rectificative peut permettre aux parlementaires d’être informés
des modalités de mise en œuvre de l’autorisation budgétaire.
Le Conseil constitutionnel a, à cet égard, marqué son attachement à
l’exercice du pouvoir de contrôle du Parlement via les lois de finances
rectificatives. Ainsi, juge-t-il nécessaire le dépôt d’un projet de loi de
finances rectificative dès lors que les mesures d’exécution du budget prises par le
Gouvernement affectent les grandes lignes de l’équilibre économique et financier
définies par la loi de finances initiale ().
Dans la même décision, le Conseil constitutionnel a fait obligation
au Gouvernement non seulement de soumettre au Parlement, dans le cadre d’une loi de
finances rectificative, les décrets d’avances, mais aussi de lui communiquer les
arrêtés d’annulation des crédits, alors que l’ordonnance organique ne le
précise pas.
Rappelons, enfin, qu’à défaut du dépôt d’un projet de loi
de finances rectificative avant le 1er juin, l’article 38 de l’ordonnance
organique impose au Gouvernement d’adresser au Parlement, " au plus tard
à cette date, un rapport sur l’évolution de l’économie nationale et des
finances publiques ".
- Sur la base de l’article premier de l’ordonnance organique, qui
inclut, dans le domaine des lois de finances, les dispositions ayant pour objet
d’" organiser l’information et le contrôle du Parlement sur la
gestion des finances publiques ", le Parlement a fait obligation au
Gouvernement de le tenir informé des modalités de mise en œuvre du pouvoir
réglementaire en matière budgétaire et financière ().
- Les rapporteurs spéciaux de la Commission des finances disposent, outre les
pouvoirs de contrôle sur pièces et sur place décrits supra, de moyens
d’information spécifiques.
– L’article 164 de l’ordonnance n° 58-1374
précitée précise que, dans le cadre du suivi du budget ministériel dont ils ont la
charge, " tous les renseignements d’ordre financier et administratif de
nature à faciliter leur mission doivent leur être fournis. Réserve faite, d’une
part, des sujets de caractère secret concernant la défense nationale, les affaires
étrangères, la sécurité intérieure ou extérieure de l’Etat, d’autre part,
du principe de la séparation du pouvoir judiciaire et des autres pouvoirs, ils sont
habilités à se faire communiquer tous documents de service de quelque nature que ce
soit " (). On observera, à ce stade, que la lettre de ce
texte reste marquée par l’exclusivité de l’écrit qui caractérisait
l’époque de sa rédaction. L’évolution des moyens de communication doit
aujourd’hui conduire à s’interroger sur le sens qu’il faut donner à la
notion de " communication " de tels documents.
Ce même article prévoit également la transmission aux rapporteurs
spéciaux de la commission chargée suivre la gestion des entreprises publiques de
" tous documents de service, de quelque nature que ce soit, relatifs au
fonctionnement des entreprises, sociétés ou établissements soumis à leur contrôle ".
– Autre pièce maîtresse de l’information des
rapporteurs spéciaux : les questionnaires budgétaires. Près de 3.000 questions, au
total, sont adressées par les rapporteurs spéciaux, fin juin-début juillet, au ministre
chargé du budget, qui en assure la répartition entre les ministères. Les réponses
permettent d’analyser l’évolution des crédits et des dépenses votés
l’année précédente et d’établir un bilan de la politique gouvernementale
dans ses différents domaines d’application, ainsi que d’obtenir des
justifications sur les demandes de crédits présentées pour l’année suivante.
Cette méthode est également utilisée par les rapporteurs pour avis,
ce qui suppose, pour certaines administrations particulièrement sollicitées, une gestion
lourde, légitimant les observations récurrentes appelant à une coordination des
demandes des rapporteurs.
Votre Rapporteur relève que cette procédure fait l’objet de
certaines critiques en raison de la qualité inégale des réponses fournies aux
rapporteurs : celles-ci seraient en partie superficielles, manqueraient de sérieux,
seraient incomplètes... elles sont délivrées avec retard... quand elles ne sont pas,
purement et simplement, inexistantes.
- Enfin, de manière plus générale, toute commission permanente ou
spéciale, et donc la Commission des finances, peut " convoquer toute
personne dont elle estime l’audition nécessaire " ()
et obtenir, ainsi, les informations qu’elle souhaite sur la gestion des crédits.
t En fin
d’exécution
Une série de documents doivent obligatoirement accompagner le dépôt
du projet de loi de règlement.
Rappelons, que, d’après l’article 35 de l’ordonnance
organique, la loi de règlement a pour objet de constater " le montant
définitif des encaissements de recettes et des ordonnancements de dépenses se rapportant
à une même année ; le cas échéant, il ratifie les ouvertures de crédits par
décrets d’avances et approuve les dépassements de crédits résultant de
circonstances de force majeure ".
- Ce projet de loi doit être, selon l’article 36 de l’ordonnance
organique, accompagné d’annexes explicatives, présentant l’origine des
dépassements de crédits et la nature des pertes et profits. Ces annexes ne fournissent,
en revanche, aucune information à l’appui des demandes d’annulations de
crédits non consommés.
- Ce projet de loi est, par ailleurs, accompagné du compte général de
l’administration des finances, lequel retrace la balance générale des comptes de
l’Etat, l’état des recettes budgétaires et des dépenses budgétaires pour
chaque ministère. Depuis 1992, un rapport de présentation est joint à ce compte
général. Il présente notamment un bilan et un compte de résultats, un tableau
d’exécution des lois de finances de l’année et un tableau des différents
soldes dégagés par la comptabilité publique.
- Enfin, l’article 117 de la loi de finances pour 1991 a sensiblement
amélioré cette information, afin de pallier les conséquences du mouvement de
globalisation des crédits : le projet de loi de règlement doit être accompagné
" d’annexes explicatives qui retracent pour les chapitres du budget
général :
– d’une part, le montant des crédits par chapitre
détaillant les ouvertures par voie législative et les modifications
réglementaires ;
– d’autre part, le montant des dépenses constatées par
chapitre, article et paragraphe ".
On le voit, le Parlement n’est donc pas tenu dans l’ignorance
des modalités d’exécution des lois de finances, même si les informations fournies
peuvent être améliorées sur plusieurs points.
Ces informations sont, par ailleurs, appuyées par les différents
travaux de la Cour des comptes.
c) L’assistance de la Cour des comptes
En vertu de l’article 47 de la Constitution, " la
Cour des comptes assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de
l’exécution des lois de finances ".
Cette assistance prend différentes formes.
t Des rapports
exhaustifs et pertinents
- La Cour des comptes élabore, chaque année, un rapport public,
adressé au Président de la République et présenté au Parlement
(article L. 136-I du code des juridictions financières). Ce rapport permet de
porter à la connaissance du public les observations les plus exemplaires tirées de ses
travaux et de ceux des chambres régionales des comptes. Il comprend également les
réponses des administrations aux observations de la Cour des comptes.
Indiquons qu’à la suite d’une décision du conseil des
ministres, en date du 3 janvier 1991, les membres du Gouvernement sont désormais à
la disposition du Parlement pour être entendus sur les suites à donner aux observations
de la Cour des comptes. Cette procédure n’a jusqu’à présent jamais été
explicitement utilisée par les assemblées.
Notons également que le rapport public annuel de la Cour des comptes
ne donne lieu à aucun débat en séance publique.
- Le rapport annuel de la Cour des comptes sur l’exécution du budget,
institué en 1956, sert de base au contrôle parlementaire en cours d’exécution.
L’article L.O. 132-1 du code des juridictions financières prévoit, en effet, que
" la Cour des comptes établit un rapport sur chaque projet de loi de
règlement. Ce rapport est remis au Parlement, sitôt son arrêt par la Cour des comptes.
Il est ultérieurement annexé au projet de loi de règlement ".
Devant obligatoirement accompagner le projet de loi de règlement
déposé par le Gouvernement (article 36 de l’ordonnance organique), ce rapport
comprend une description de l’exécution de la loi de finances initiale et des
éventuelles lois de finances rectificatives, ainsi qu’une analyse critique de la
gestion de l’autorisation budgétaire délivrée par le Parlement, mettant notamment
en évidence les entorses constatées aux règles budgétaires. Il comprend également
désormais des monographies consacrées, soit à certaines catégories
d’interventions publiques, soit à certains ministères.
Des progrès importants ont été réalisés par la Cour dans le
domaine des délais de présentation de ce rapport d’exécution. Alors que celui-ci
devait être obligatoirement accompagné d’une déclaration générale de conformité
des comptes, destinée à vérifier leur cohérence - mais non leur
régularité -, et donc délivrée tardivement, l’article 19 de la loi du
6 novembre 1992, d’origine parlementaire, a permis de dissocier le rapport sur
l’exécution de la loi de finances de cette déclaration générale de conformité du
budget exécuté. Cette disposition, ainsi que l’accélération du processus de
reddition des comptes de l’Etat, ont permis d’accélérer sensiblement le
dépôt du rapport sur l’exécution. Il est donc, depuis 1993, à la disposition des
parlementaires avant l’ouverture de la discussion budgétaire () et
non plus, comme autrefois, au mois de décembre. Les parlementaires sont donc en mesure de
se prononcer sur le projet de loi de finances de l’année (n+1), au vu des résultats
de l’exercice (n-1).
- Depuis 1996, la Cour des comptes, utilisant les marges de manœuvre
offertes par l’accélération du processus de production des comptes de l’Etat,
présente une contribution au débat d’orientation budgétaire du printemps.
Cette contribution prend la forme d’un " rapport
préliminaire sur l’exécution des lois de finances " de l’année
(n-1).
- Depuis 1991, le rapport public annuel est accompagné de rapports
particuliers consacrés à des thèmes précis, la Cour des comptes ayant souhaité
développer ses activités d’information indépendamment du rapport public annuel.
Dans son intervention devant le groupe de travail, M. Pierre Joxe, Premier président
de la Cour, a ainsi cité les rapports de la Cour des comptes relatifs à la lutte contre
la toxicomanie, l’aide sociale, la politique en faveur des personnes handicapées, le
RMI... Des rapports relatifs à la fonction publique et au hors bilan de l’Etat sont
en cours d’élaboration.
- La Cour des comptes élabore enfin des rapports particuliers relatifs aux
entreprises nationales et aux sociétés d’économies mixtes. Ces rapports sont
transmis aux membres du Parlement désignés pour suivre ces questions (article
L. 135-3 du code des juridictions financières).
RETOUR SOMMAIRE
t Des réponses
possibles aux demandes d’enquête des parlementaires
- La Cour des comptes est habilitée à procéder à des enquêtes, à
la suite d’une demande présentée en ce sens par les commissions des finances ou des
commissions d’enquête du Parlement, " sur la gestion des services ou
organismes soumis à son contrôle, ainsi que des organismes et entreprises qu’elle
contrôle en vertu des articles L. 133-1 et L. 133-2 "
(article 132-4 du code des juridictions financières).
- Enfin, la Cour des comptes adresse, depuis 1975, une réponse écrite au
questionnaire élaboré par le Rapporteur général de la Commission des finances sur le
projet de loi de règlement. Son Premier président vient en présenter la teneur, chaque
année, lors de son audition par la Commission des finances, dans le cadre de la
préparation du débat sur ledit projet de loi.
Notons que cette procédure a été instituée de manière
conventionnelle.
t La transmission
récente de certaines des observations de la Cour
- L’article 135-5 du code des juridictions financières dispose que
" le premier président peut donner connaissance aux commissions des finances
et aux commissions d’enquête du Parlement des constatations et observations de la
Cour des comptes. Toutefois, les communications de la Cour aux ministres, auxquelles il
n’a pas été répondu sur le fond dans un délai de six mois, sont communiquées de
droit aux commissions des finances du Parlement " ().
- Cette disposition est entrée en vigueur à compter du début de
l’année 1996, mais ne reçoit pas encore une application totalement
satisfaisante : une dizaine de documents seulement ont été transmis dans ce cadre
depuis septembre 1996.
Rappelons, en effet, que dans le cadre de ses activités de contrôle
de gestion, la Cour des comptes émet des observations ou rédige des rapports destinés
à informer les autorités compétentes des fautes de gestion découvertes. Les
observations, non publiques, peuvent prendre différentes formes, en fonction de la
gravité des fautes commises : lettres des présidents de chambre, note du Parquet,
référés adressés par le Premier président au ministre concerné en cas
d’irrégularité grave.
Mais, le Président de la Commission des finances et le Rapporteur
général ne reçoivent pas systématiquement ces différents documents, notamment les
référés de la Cour des comptes. Dans son intervention devant le groupe de travail,
M. Pierre Joxe, Premier président de la Cour, a exclu qu’ils soient
destinataires de l’ensemble de ces travaux, faisant valoir que les magistrats de la
Cour ne disposeraient pas de la même liberté de critique si leurs conclusions devaient
être rendues publiques. Le devoir de réserve des rapporteurs parlementaires doit
cependant conduire à relativiser la portée de cette objection.
Manifestement, le Parlement est, potentiellement, un contrôleur
puissant. Mais, ces différents instruments de contrôle sont-ils effectivement utilisés
et permettent-ils réellement au Parlement d’exercer ses fonctions de
contrôle ? Par ailleurs, le Parlement a-t-il la volonté politique d’exercer
pleinement ses prérogatives ?
2.- Des pouvoirs sous-utilisés
Comme l’a souligné, au cours de nos travaux, M. Augustin
Bonrepaux, Président de la Commission des finances, " en réalité, il faut
bien le reconnaître, nous n’effectuons aucun contrôle. Après avoir voté le
budget, notre principale activité est de préparer le suivant ".
M. Michel Charasse a exprimé, au cours de son intervention devant le groupe de
travail, un sentiment analogue. Ces jugements sont, en très grande partie, partagés par
votre Rapporteur, en tant que Rapporteur général de la Commission des finances.
Le bilan est, en effet, sévère : le Parlement n’utilise que
très partiellement ses pouvoirs de contrôle.
a) Un bilan sévère
- Les rapporteurs spéciaux ne font usage que très rarement de leurs
pouvoirs de contrôle sur pièce et sur place, peut-être, comme l’a relevé
M. Pierre Joxe, Premier président de la Cour des comptes, lors de son audition par
le groupe de travail, parce qu’il n’est pas dans " l’esprit de
la loi " qu’un Rapporteur spécial se transforme en enquêteur. Il
n’y a donc que très rarement un suivi, tout au long de l’année, de
l’utilisation des crédits dont les rapporteurs spéciaux sont en charge.
Leurs éventuels travaux sont, en général, " sans
lendemain ", comme l’a fait observer devant notre groupe de travail le
Professeur Guy Carcassonne, et ne donnent pas lieu, lors de la discussion budgétaire, à
des échanges constructifs avec le Gouvernement, susceptibles de modifier
substantiellement le budget des ministères dont ils ont la charge.
De manière plus générale, les travaux des rapporteurs spéciaux ne
font l’objet d’aucune coordination, les rapporteurs généraux successifs
n’ayant pas réellement exercé les prérogatives résultant, comme on l’a vu,
du fait que les rapports spéciaux sont publiés sous leur timbre et l’examen de la
loi de règlement ayant été, jusqu’à maintenant, très formel. Les éventuelles
initiatives de contrôle s’effectuent donc en ordre dispersé ; les contrôles
restent ponctuels, les rapporteurs spéciaux se privant par là-même, d’aborder des
sujets transversaux ; aucune thématique de contrôle, susceptible de créer des
effets d’annonce et de synergie n’est définie.
- Hormis les projets de loi de finances rectificative de printemps, lesquels
traduisent souvent un infléchissement de la politique gouvernementale, l’examen du
collectif budgétaire à l’automne ne permet pas, en dépit des efforts entrepris
depuis une quinzaine d’années par la Commission des finances, de conduire un examen
approfondi de l’utilisation des crédits.
Déposés tardivement, examinés dans des délais trop brefs, les
projets de loi de finances rectificative font, en réalité, s’agissant de leur volet
dépenses, l’objet d’une simple ratification par le Parlement, maintes fois
dénoncée par la Cour des comptes. Les projets de loi de finances rectificative sont donc
plus un acte de régularisation des " ajustements " opérés ou
demandés par le Gouvernement, qu’une véritable autorisation budgétaire, à
caractère prévisionnel. Un projet de loi de finances rectificative d’automne pour
l’année n sert, en réalité, à compléter la loi de finances pour l’année
(n + 1), les crédits ouverts étant généralement consommés pendant la
période complémentaire ou reportés sur l’exercice suivant.
En raison de ce caractère tardif, le projet de loi de finances initial
pour l’année (n + 1) déposé par le Gouvernement en septembre de
l’année n ne prend donc pas en compte les mouvements de crédits intervenus au cours
de l’exercice. Les dotations initiales ont, par là-même, un caractère quelque peu
abstrait.
- Malgré des efforts récents pour renforcer les liens du Parlement avec
la Cour des comptes, leur coopération reste embryonnaire.
Les observations présentées par la Cour des comptes, notamment dans
le cadre de son rapport sur l’exécution du budget, ne sont pas suffisamment
exploitées : il n’y a ni suivi, ni utilisation systématique de ces
observations. Aucune suite n’est également donnée aux rapports spécifiques
qu’elle élabore. Par ailleurs, il n’existe aucune coordination des programmes
d’activités de ces deux organes.
A cet égard, M. Pierre Joxe, Premier président de la Cour,
s’est déclaré frappé de l’absence de débat public et contradictoire, en
France, sur les déficiences relevées par la Cour des comptes. Alors que les parlements
britannique et allemand organisent des réunions hebdomadaires avec des représentants de
l’organe financier de contrôle, celles-ci sont, en France, très épisodiques. Il
n’y a donc pas de véritable dialogue entre le Parlement et la Cour des comptes sur
les conclusions auxquelles celle-ci parvient, soit sur l’exécution du budget, soit
sur telle ou telle politique sectorielle.
- Hormis quelques exceptions (), l’examen du projet de
loi de règlement illustre l’absence de contrôle approfondi des dépenses
budgétaires par notre Assemblée.
Alors que cet examen devrait être l’un des temps forts de la vie
parlementaire, permettant de juger de l’action menée par le Gouvernement, il
s’effectue dans l’indifférence générale.
Déposé en décembre de l’année (n + 1), le projet de
loi de règlement du budget de l’année (n) n’est généralement examiné, au
plus tôt, qu’au printemps de l’année (n + 2). Les débats sont
formels, généralement expéditifs. Comme l’a souligné, lors de son audition, le
Professeur Guy Carcassonne, " nous vivons dans un mécanisme absolument
hallucinant, dans lequel l’Etat est la seule personne en France qui solde ses comptes
quand elle a le temps, quelques années plus tard, et de préférence de manière très
cavalière ". A la décharge des parlementaires, reconnaissons qu’il
est difficile de s’intéresser à un texte se contentant de retracer le passé et sur
lequel il n’existe, en fait, qu’un pouvoir d’amendement limité.
Pourtant, cette situation n’est pas irréversible. Rappelons, à
cet égard, que, sous la Restauration, l’examen du projet de loi de règlement
constituait l’un des temps forts de la vie parlementaire, les députés utilisant ce
texte pour porter un jugement politique sur la gestion du Gouvernement.
Comment expliquer l’inertie du Parlement en matière de contrôle
de la dépense publique ? Pourquoi n’utilise-t-il pas ses pouvoirs ?
b) Une explication complexe
Au vu des auditions menées par notre groupe de travail, l’absence
de contrôle de la dépense publique s’expliquerait par divers facteurs.
t Un phénomène
culturel et politique
- Contrairement à d’autres pays, notamment anglo-saxons, la dépense
publique a fait longtemps l’objet, dans son principe même, d’une approbation
- éventuellement tacite - de l’opinion publique. Comme l’a noté
M. Daniel Bouton, ancien directeur du budget, le lancement d’un projet
générateur de dépenses publiques ne donne pas lieu à de larges débats, quel que soit
son coût.
Comment le Parlement pourrait-il, dans ce contexte, renouant avec sa
vocation originelle, contribuer à contrôler la dépense publique, alors que, depuis le
développement de l’" Etat-Providence ", il a plutôt tendance à
chercher à abonder les crédits ?
- Le fonctionnement des institutions de la Vème République ne favorise
pas une telle évolution, voire y fait obstacle.
En effet, comme l’a relevé M. Pierre Joxe, " nos
institutions font [...] que l’opposition ne peut pas et que la majorité
n’ose pas contrôler ".
Le phénomène majoritaire place, à cet égard, la majorité dans une
position délicate. Ses critiques risquent d’être interprétées comme une remise en
cause de la politique gouvernementale. Comme le relève le Professeur Paul Amselek (),
" la classe politique française [n’a] pas réussi à trouver
jusqu’ici un juste équilibre entre les exigences raisonnables de discipline
majoritaire et la nécessité impérieuse pour le Parlement de remplir son rôle,
d’assumer les pouvoirs de contrôle qui lui sont reconnus, et de les assumer
d’ailleurs dans l’intérêt même du Gouvernement, dans son intérêt bien
compris ".
L’opposition, quant à elle, devrait pouvoir jouer un rôle plus
important en matière de contrôle, puisqu’elle ne peut guère peser directement sur
les décisions. Mais, elle n’a qu’un accès limité aux responsabilités :
sur les quarante-quatre rapporteurs spéciaux de la Commission des finances de notre
Assemblée, treize appartiennent à l’opposition. Le Professeur Guy Carcassonne a
ainsi estimé, devant notre groupe de travail, que : " la place faite à
l’opposition dans le système français est extrêmement insatisfaisante ".
Confrontées, en général, à l’obligation de jouer le rôle que
leur assignent les institutions - soutenir pour l’une, critiquer pour
l’autre -, majorité et opposition n’ont pas su créer les conditions
d’un dialogue sans conflit, que requiert, pourtant, l’exercice d’un
contrôle budgétaire moderne. Le Professeur Guy Carcassonne a cité, à cet égard,
l’exemple britannique : " La vivacité des discussions à la
Chambre des communes n’a rien à envier à ce qui se passe à l’Assemblée
nationale. Le niveau de conflit est extrêmement élevé. Simplement, il y a un
moment [lors de l’exercice des fonctions de contrôle] où l’on change de
registre [...] ". Notre Assemblée, elle, n’a jamais vraiment su
changer de registre.
Cette situation aboutit à une sorte de " consensus
implicite, et peut-être inavoué, pour laisser à l’exécutif et à
l’administration une liberté d’action étendue ", comme le met en
exergue le Professeur Jean-Pierre Lassalle (). Le Président Philippe
Séguin est même allé plus loin, déplorant que " Le Parlement lui-même,
hélas, accepte trop souvent un abandon de ses droits " ().
Enfin, force est bien de constater que, dans la tradition française,
le contrôle parlementaire dérange : il est parfois vécu, par le Gouvernement et
les administrations comme une sorte de " crime de lèse majesté ". Il
est à noter également que la presse ne manque pas de céder à la tentation de
présenter souvent comme un incident ou une difficulté politique ce qui relève de
l’exercice normal du pouvoir de contrôle.
Dans ce contexte politique, le caractère inadapté des moyens de
contrôle conduisait logiquement les parlementaires à ne pas y recourir.
t Des instruments de
contrôle inadaptés
Notre collègue M. Jean-Jacques Jégou a rappelé le caractère
" épuisant " de l’exercice de ses pouvoirs de contrôle
sur pièce et sur place, à l’époque où il était Rapporteur spécial en charge de
la formation professionnelle. M. Pierre Méhaignerie a, quant à lui, estimé
qu’il " faut vraiment faire preuve d’héroïsme "
pour qu’un rapporteur spécial s’engage dans la voie du contrôle.
Que peut faire, en effet, un parlementaire isolé, face à une
administration nécessairement plus nombreuse et toute puissante, qu’il ne connaît
pas toujours très bien ? Quelle peut être son incitation à utiliser ses pouvoirs
de contrôle sur pièce et sur place, sachant que ses " découvertes "
n’auront que de très faibles traductions effectives ? Rappelons, sur ce point,
que le projet de loi de finances rectificative est déposé trop tardivement pour
permettre des inflexions en cours d’exercice de la gestion des crédits. Quant au
projet de loi de règlement, il n’est assorti d’aucune réelle sanction. Cette
situation serait sans doute différente si la discussion sur les comptes de l’année
(n - 1) venait enrichir celle sur le projet de loi de finances de l’année
(n + 1), mais tel n’est pas le cas actuellement.
En réalité, les pouvoirs de contrôle sur pièce et sur place
s’apparentent davantage, en l’état actuel de leur usage, à
" l’arme atomique " : le pouvoir des parlementaires reste un
pouvoir de dissuasion, susceptible de prévenir les irrégularités, mais qui n’est
pas véritablement destiné à les déceler. Cette situation explique donc que les
parlementaires aient - ne nous le cachons pas - très peu de penchant pour le
contrôle sur pièce et sur place de la dépense publique, en dehors de quelques
initiatives qui, souvent, se veulent avant tout spectaculaires et médiatiques.
En l’état actuel de leurs prérogatives, les pouvoirs de
contrôle des parlementaires semblent donc davantage adaptés à des opérations ciblées.
Dès lors, un contrôle de la dépense publique exercé sur des sujets appréhendés de
manière globale et transversale requiert une profonde transformation des méthodes de
travail des parlementaires. Une telle réforme passe sans doute par une coopération
accrue avec la Cour des comptes.
Même s’il convient que le Parlement ait recours, pour le
contrôle, à une large palette de concours extérieurs, la voie d’une coopération
renforcée avec la Cour des comptes contribuerait à remédier aux défaillances
constatées, en conférant aux exercices de contrôle une objectivité et une continuité
qui lui font actuellement défaut. Votre Rapporteur a, cependant, conscience que les
modalités de fonctionnement, comme les rôles respectifs, du Parlement et de la Cour des
comptes, peuvent compliquer cet exercice de coopération, ce qui explique d’ailleurs
pour partie les faibles suites données aux travaux de la Cour des comptes par le
Parlement.
t Des relations
complexes avec la Cour des comptes
Comme l’a relevé le Professeur Guy Carcassonne, lors de son
audition par notre groupe, " les relations que le Parlement entretient avec
la Cour des comptes n’ont jamais été totalement satisfaisantes, même si chacun
sait qu’elles se sont plutôt améliorées ".
- Cet état de fait s’explique largement par des raisons historiques.
Contrairement à la situation britannique, la Cour des comptes n’a pas été créée
par et pour le Parlement, mais elle lui préexistait. Rappelons, en effet, que, lorsque le
Parlement eut recours, sous la Restauration, à la collaboration de la Cour des comptes
pour l’assister dans l’exercice des ses compétences financières, celle-ci
avait déjà cinq siècles d’existence. Alors que les Etats généraux, dont
l’origine remonte, comme pour la Cour des comptes, à 1302, cesseront de se réunir
à compter de 1614, la Cour des comptes n’a jamais vu, en revanche, son existence
remise en cause, à l’exception de la période 1791-1807 ; il est vrai que, au
moins jusqu’à la Révolution, son recrutement n’était guère exemplaire.
D’emblée, la Cour des comptes jouissait donc d’une tradition
d’indépendance, qui lui interdisait d’être un simple organe à la disposition
du Parlement. Sa raison d’être n’a donc jamais été d’assister la
représentation nationale, la Cour prenant soin de veiller scrupuleusement à sauvegarder
son indépendance à l’égard du pouvoir parlementaire. Elle poursuit,
d’ailleurs, actuellement dans cette logique, en ayant soin de déterminer en toute
autonomie son programme de travail. Cette volonté de la Cour des comptes d’affirmer
une nécessaire indépendance n’a donc pas toujours facilité les relations avec les
assemblées parlementaires en dépit de l’article 47 de la Constitution de 1958
prévoyant que la Cour " assiste " celles-ci, ce qui représente une
innovation importante par rapport aux précédentes constitutions.
- Des raisons plus techniques expliquent également les difficultés
auxquelles se heurte la volonté de renforcer la coopération entre ces deux institutions.
La Cour des comptes, est, en effet, une juridiction chargée,
notamment, de veiller à la régularité de l’exécution de nos finances publiques.
Pour sa part, le Parlement, investi de la légitimité démocratique, demeure une instance
politique, dont le jugement ne peut, légitimement, s’abstraire de tout point de vue
politique.
Par ailleurs, les horizons temporels de ces deux institutions sont
profondément différents. Le rythme des travaux de la Cour des comptes, lesquels reposent
sur une procédure contradictoire et minutieuse, ne correspond pas au souci de rapidité
qui caractérise la démarche des parlementaires. Ce décalage explique donc que la Cour
des comptes ne soit pas toujours disponible pour répondre à
" l’impatience " des parlementaires. Rappelons, toutefois, que la
Cour des comptes a accompli, au cours de ces dernières années, des progrès sensibles
pour raccourcir les délais de publication de ses travaux et que son actuel Premier
président a déclaré, à plusieurs reprises, souhaiter un renforcement de la
coopération entre l’institution qu’il préside et le Parlement.
Ces différents obstacles - historiques, politiques,
culturels - expliquent que le contrôle ne soit pas, en France, " un
acte naturel ", pour reprendre l’expression de M. Jean Arthuis,
ancien ministre de l’économie et des finances.
Le constat est identique en matière d’évaluation.
RETOUR SOMMAIRE
B.- le parlement
n’est pas, en revanche, en mesure d’évaluer l’efficacité de la dépense
publique
L’évaluation des politiques publiques ne doit pas être opposée
au contrôle de la dépense publique. Dans le premier cas, il s’agit d’estimer
l’efficacité des politiques publiques ; dans le second, il s’agit de
vérifier la régularité des opérations effectuées. Ces deux formes de contrôle sont
donc complémentaires l’une de l’autre, voire se renforcent.
Il est paradoxal de noter que, si le Parlement est doté de
prérogatives importantes en matière de contrôle, il apparaît, en revanche,
relativement dépourvu de capacités d’évaluation.
1.- Une pénurie d’instruments
Les instruments d’évaluation des politiques publiques recouvrent
partiellement ceux dont dispose le Parlement en matière de contrôle. Ceci est
particulièrement vrai des rapports élaborés par la Cour des comptes, notamment les
rapports spécifiques. Les critiques précédemment évoquées à l’encontre de
l’insuffisante exploitation de ces travaux par le Parlement sont donc également
pertinentes en matière d’évaluation.
Sans revenir, par conséquent, sur l’assistance que pourrait
apporter la Cour des comptes, il convient de prêter attention aux autres instruments
d’évaluation mis à la disposition du Parlement. Force est de constater que le
Parlement ne dispose, en la matière, que de très faibles capacités d’évaluation.
Cette pénurie d’instruments d’évaluation à la disposition
des assemblées parlementaires est d’autant plus préoccupante qu’elle est
imputable à des facteurs presque structurels, liés à l’incapacité de
l’administration française de se fixer des missions et de raisonner en termes
d’objectifs.
a) Des notes d’impact largement insuffisantes
Les parlementaires ne disposent encore que de peu de notes
d’impact, permettant d’évaluer a priori les effets administratifs,
juridiques, sociaux, économiques et budgétaires des mesures envisagées.
Rappelons, en effet, que les circulaires des 21 novembre 1995 et
18 mars 1996 relatives, respectivement, à l’expérimentation et à la
procédure de mise en oeuvre de l’étude d’impact ne prévoyaient pas la
généralisation de ce type d’étude. Les parlementaires ne bénéficiaient donc pas
systématiquement de cet instrument qui, s’il est de qualité, peut constituer une
aide précieuse à la décision, en leur permettant de légiférer à bon escient, en
ayant connaissance, pour reprendre les propos de M. Jean Arthuis au cours de son
intervention, de " la portée et des incidences des projets "
présentés. Cette lacune débouche, en particulier, sur le fait qu’il n’y a
aucune articulation entre les travaux normatifs des parlementaires et leurs implications
budgétaires.
Cette situation est d’autant plus regrettable que, comme l’a
souligné, devant le groupe de travail, M. Daniel Bouton, ancien directeur du budget,
l’article premier de l’ordonnance organique () prévoit,
théoriquement, qu’aucune mesure ne peut être adoptée sans que, préalablement, ses
conséquences financières n’aient été évaluées.
Indiquons, cependant, que cette situation sera, prochainement, appelée
à connaître une évolution : la circulaire du Premier ministre du 26 janvier
1998, a, en effet, pour objet de généraliser les études d’impact à
l’ensemble des projets de loi. De telles études seraient, en particulier, jointes
aux projets de lois de finances, pour " chaque article, exception faite des
articles portant prévisions de recettes ou ouvertures de crédits ". De
même, les projets de lois de financement de la sécurité sociale donneraient lieu à des
études d’impact pour les mesures particulières susceptibles d’y être
insérées.
b) Des simulations en matière fiscale rarissimes
Le Parlement ne dispose, en général, d’aucune simulation des
projets de réforme fiscale ou touchant aux prélèvements sociaux qui lui sont soumis.
Le Président Augustin Bonrepaux a rappelé, à cet égard, que
" [les parlementaires ont] débattu de la taxe professionnelle sans avoir pu
procéder aux simulations et investigations nécessaires ". Notre collègue
M. Pierre Méhaignerie, ancien Président de la Commission des finances, a, de même,
souligné le lourd handicap que représentait, pour le Parlement, l’absence de
simulation des projets de réforme fiscale : " un débat de grande
qualité s’est déroulé au sein du Gouvernement sur l’alternative "baisse
de la taxe professionnelle" ou "poursuite de l’allégement des charges
sociales sur les bas salaires", sans qu’il ne s’instaure au
Parlement ! ". Le Président Laurent Fabius, a relevé, à cet égard,
que " la simulation en matière d’impôt constitue un débat récurrent
qui progresse peu ".
Cette situation est d’autant plus préoccupante qu’à
supposer que de telles simulations existent, elles seraient fournies par le ministère des
finances, placé, par conséquent, dans la situation d’être à la fois juge et
partie. Autrement dit, le Parlement est totalement dépendant en matière de simulation,
ce qui explique qu’aucune réforme fiscale d’envergure ne soit conçue au sein
des assemblées parlementaires.
Pourtant, cette situation n’est pas irréversible. M. Michel
Charasse, sénateur, ancien ministre du budget, a, en effet, souligné, dans son
intervention devant le groupe de travail, qu’il serait tout à fait envisageable que
le Parlement ait accès aux bases de données fiscales générales du ministère des
finances et soit en mesure d’effectuer ses propres simulations. Cette évolution
serait d’autant plus pertinente qu’elle éviterait de voir le Parlement,
lorsqu’il est saisi, être confronté à des simulations dont les résultats peuvent
être aléatoires, voire très approximatifs, ce qui le place, de facto, dans
l’incapacité de prendre ses décisions en toute connaissance de cause.
c) Des rapports de contrôle encore trop confidentiels
Rappelons, en effet, que chaque ministère fait l’objet de
procédures d’audit, internes ou externes, et de rapports de contrôle par les corps
d’inspection, portant à la fois sur l’efficacité des politiques menées et sur
l’organisation et la gestion de ministères concernés. Or, aucune de ces analyses
n’est transmise au Parlement.
S’agissant des rapports d’audit, M. Pierre Méhaignerie
s’est interrogé sur le point de savoir s’il " serait possible [pour
les parlementaires], soit par les laboratoires universitaires, soit par les cabinets
d’expertise comptables ou les grands cabinets d’audit, d’avoir, pour le
Parlement et le Rapporteur de la Commission des finances, copie de ces audits et de ces
analyses [...] ? ".
Il en est de même pour les rapports élaborés par les corps de
contrôle ou d’inspection, qui ne sont pas transmis au Parlement.
Cette situation est doublement pénalisante. Elle prive, en effet, le
Parlement d’informations. Mais surtout, le secret excessif qui entoure ces rapports
d’évaluation et de contrôle explique, en grande partie, qu’il ne leur soit
souvent donné aucune suite.
Certes, il ne s’agit pas, pour notre groupe de travail, de
demander la diffusion publique de ces rapports. Comme l’a relevé M. Louis
Schweitzer, ancien directeur de cabinet du Premier ministre, cette demande, si elle
aboutissait, pourrait conduire à vider ces rapports de leur " substantifique
moelle " par crainte des retombées médiatiques.
Mais, en revanche, il semblerait nécessaire qu’ils soient
transmis au Parlement, en charge du contrôle du gouvernement et de l’administration,
dans le cadre d’une procédure garantissant le caractère confidentiel de ces
rapports. En effet, ainsi que l’a souligné, devant le groupe de travail,
M. Michel Charasse, sénateur, ancien ministre du budget, une certaine
confidentialité peut être nécessaire pour garantir l’efficacité du contrôle ou
de l’évaluation.
d) Un Office d’évaluation des politiques publiques peu efficace
- Institué par la loi n° 96-517 () du 14 juin
1996, l’Office parlementaire d’évaluation des politiques publiques traduisait
l’ambition du Parlement de se doter de moyens d’expertise autonomes vis-à-vis
du Gouvernement et d’entreprendre ses propres travaux d’évaluation.
Comme le relevait le Président Philippe Séguin (),
cet office devait permettre " d’effectuer des études que les services [des
Assemblées] ne peuvent spontanément pratiquer ", conférant ainsi
" une nouvelle dimension au dialogue naturel entre l’exécutif et le
législatif " et organisant, par là-même, un " pluralisme de
la réflexion sur les grands projets ou les grandes politiques publiques ".
A cette fin, il était prévu que l’Office, chargé de réaliser des études, serait
habilité " à faire appel à des personnes ou à des organismes choisis en
fonction de leurs compétences dans le domaine concerné ".
Observons, toutefois, que la création de l’Office résultait,
d’emblée, d’un compromis au sein du Parlement. Notre assemblée aurait, en
effet, souhaité instituer un office indépendant, calqué sur le modèle américain,
chargé de s’assurer du bon emploi des fonds publics. Le Sénat, en revanche, voulait
éviter la création d’une septième commission permanente, dont les compétences
transversales auraient conduit progressivement à dépouiller les autres commissions
permanentes de leurs attributions. Aussi, le compromis élaboré par les deux assemblées
a-t-il débouché sur la création d’un office rattaché, dans une certaine mesure,
aux commissions des finances (), conçu comme le bras séculier des
commissions permanentes () et dépourvu de pouvoir d’initiative.
- Pour autant, l’Office était doté, à sa naissance, de réels atouts.
Sa composition mixte () aurait, en effet, pu déboucher
sur une solidarité parlementaire, susceptible de transcender les liens unissant la
majorité au gouvernement, lesquels constituent, en France, comme l’a rappelé notre
collègue M. Laurent Dominati, un obstacle au contrôle des politiques publiques.
Par ailleurs, la faculté offerte à l’Office de réaliser, par le
biais d’évaluateurs professionnels, des études scientifiques et objectives, aurait
pu permettre d’ouvrir un véritable débat sur des sujets suffisamment fondamentaux
pour recueillir l’approbation des deux assemblées.
Relevons, enfin, que l’Office aurait pu déboucher sur une
transformation profonde de notre procédure budgétaire, en raison du caractère
pluriannuel de ses travaux et de ses compétences transversales. Comme le souligne
M. Pierre Avril (), " la procédure budgétaire a un peu
vieilli, [...] elle appelle une réflexion, et [...], sous ce rapport, un
organe de réflexion sera certainement utile, dans la mesure où il pourra traiter ces
questions ".
- Malheureusement, force est de constater que le bilan des travaux menés par
l’Office reste bien maigre au regard de ces ambitions.
Comme l’a noté M. Jean Arthuis, ancien ministre de
l’économie et des finances, dans son intervention devant le groupe de travail,
" [s’agissant de] l’Office parlementaire, je n’arrive pas à
croire que c’est un succès. Ce que nous avons fait là est dérisoire ".
Votre Rapporteur a lui-même qualifié, lors de ses interventions, cet organe de
" machin supplémentaire ", qui " ne sert à rien ".
Il est vrai, comme l’a relevé le Président Augustin Bonrepaux,
que l’Office n’a publié jusqu’à présent que deux rapports, le premier
sur la politique maritime et littorale de la France, présenté par M. Philippe
Marini le 6 mars dernier, le second sur l’efficacité des aides publiques en
faveur du cinéma français, publié par M. Jean Cluzel le 7 octobre dernier.
- Comment expliquer un tel dysfonctionnement ? Il semble que cet échec
soit imputable tant aux modalités de fonctionnement de l’Office qu’à la
définition de sa mission.
— Les modalités de fonctionnement de l’Office se
caractérisent, en effet, par leur lourdeur et leur instabilité, comme l’a souligné
le Président Augustin Bonrepaux au cours de son intervention dans le cadre du groupe de
travail.
A ce manque de souplesse des procédures de fonctionnement,
s’ajoute une instabilité et un manque d’identité de l’Office, imputable
à l’alternance annuelle des présidences, mais également au fait que les membres
désignés par chacune des commissions permanentes sont obligés, dès lors qu’ils
changent de commission, de démissionner de l’Office.
— Au-delà de ces modalités de fonctionnement, il convient
également de s’interroger sur la pertinence de la mission assignée à
l’Office.
Comme l’ont relevé certains intervenants, l’Office fait
double emploi avec les commissions permanentes, et notamment celle des finances, les
travaux de l’Office pouvant parfaitement être menés au sein des commissions
permanentes. Rappelons, en effet, que celles-ci disposent de moyens financiers leur
permettant de faire effectuer des travaux par des cabinets d’experts indépendants et
que les commissions des finances des deux assemblées sont habilitées à demander à la
Cour des comptes des enquêtes spécifiques. Il est, à cet égard, révélateur de
relever que l’Office ne dispose d’aucun instrument nouveau qui le distinguerait
des commissions permanentes (), ce qui souligne par là-même son
caractère redondant.
L’expertise délivrée par l’Office reste, en effet,
" isolée de la décision ", pour reprendre l’expression
de M. Pierre Avril (). Les travaux de l’Office ne peuvent donc
déboucher sur aucune décision concrète.
Relevons, enfin, que l’Office ne dispose d’aucune compétence
en matière de crédits budgétaires. En témoigne, à titre d’illustration,
l’absence de pouvoirs conférés à ses membres en matière de contrôle sur pièce
et sur place de l’emploi des crédits. Comment pourrait-il, dès lors, contribuer à
évaluer les politiques publiques dans une optique de réallocation des ressources ?
En réalité, tout se passe comme si les " parrains et
marraines " de l’Office avaient voulu créer l’organe pour créer
la fonction. Cette situation " a conduit à remplacer l’objectif par la
structure sans atteindre l’objectif ", pour reprendre les propos de M.
Pierre Méhaignerie.
2.- Une indispensable évaluation de la
dépense publique
Rappelons, en effet, que l’évaluation des politiques publiques
suppose que des objectifs soient, en la matière, fixés, afin d’établir si les
résultats sont atteints ou non, et que les coûts des mesures mises en oeuvre soient
connus afin de déterminer s’il est envisageable d’atteindre des résultats
identiques à un moindre coût.
a) Des retards préoccupants
- Or, sur ces deux points, l’administration française souffre de graves
retards.
Il n’existe, en effet, aucune culture en termes d’objectifs
et de missions au sein de notre administration. Celle-ci raisonne en termes de moyens
alloués, ou plus exactement de contraintes financières. Cela est notamment le cas pour
la gestion des effectifs de la fonction publique.
Corollaire de cette observation, il n’existe que très peu
d’indicateurs de résultats. Comme l’a noté, au cours de son audition,
M. Michel Prada, ancien directeur, successivement, de la comptabilité publique et du
budget, il faudrait, au contraire, pouvoir " mesurer les résultats par
mission, par service, et par nature de moyens, avec un dispositif qui associe aux données
financières des données physiques permettant d’avoir des mesures de résultat et de
productivité par rapport à des objectifs [...] ". En l’absence de
tels indicateurs, il est, à l’heure actuelle, impossible d’évaluer les
performances réalisées.
Par ailleurs, l’absence de comptabilité analytique empêche
d’évaluer le coût réel des mesures mises en oeuvre. M. Jean Picq,
conseiller-maître à la Cour des comptes, a estimé, lors de son audition par le groupe
de travail, que l’administration " ne s’intéresse jamais au coût ".
L’impossibilité de connaître le coût des services ou des mesures mises en oeuvre,
s’explique, notamment, par le fait que l’administration n’est toujours pas
vraiment dotée d’indicateurs de moyens.
Cette absence de connaissance des coûts et de mesure des résultats
explique que la France n’ait pas de culture de gestion, et encore moins de culture de
contrôle de gestion, c’est-à-dire " un compte rendu de l’usage
fait des deniers publics en termes d’objectifs, de coûts complets des actions et de
mesure de leur efficacité " (). Notre administration est,
en effet, ancrée dans une tradition juridique, laquelle se traduit par des contrôles
comptables de régularité, ce qui explique que notre administration reste réfractaire à
une logique d’audit.
M. Daniel Bouton, ancien directeur du budget, a fait observer,
devant le groupe de travail, que " lorsque nous regardons nos performances en
matière de gestion de dépenses publiques [...] ces performances sont [...] médiocres
sur les dix ou quinze dernières années. L’organisation de nos administrations est
archaïque et puissamment rigidifiée ".
- Ces retards se reflètent dans notre procédure budgétaire.
– Celle-ci ne donne pas lieu, en effet, de la part des
administrations, à ce que les anglo-saxons nomment un " reporting ",
c’est-à-dire à une réflexion stratégique, par grande fonction, permettant
d’examiner les résultats des objectifs assignés l’année précédente aux
politiques publiques, les nouveaux objectifs fixés et les moyens requis pour les
atteindre. Soulignons, sur ce point, qu’en Grande-Bretagne, en revanche, chaque
administration doit faire du " reporting " de ses activités au
Parlement. Mais, une telle évolution reste inenvisageable en France tant qu’il
n’existe ni comptabilité analytique, ni contrôle de gestion.
Conséquence de l’absence de débat par fonction ou par programme,
le projet de loi de finances reste un budget de moyens. " La
conception de la loi organique est celle d’un ²
budget de moyens ² dont la structure de
présentation et les règles d’exécution sont conçues en vue d’assurer
l’information précise du Parlement sur la nature et le montant des crédits
alloués, la régularité de forme et de fond dans leur utilisation et l’exercice
efficace des contrôles à tous les stades de la dépense " ().
Les dotations budgétaires ne sont donc pas appréciées en fonction de l’efficacité
des mesures proposées.
Dans la mesure où notre procédure budgétaire, enfermée dans une
logique de moyens, ne facilite pas une approche en termes de résultat et donc constitue
un obstacle à l’évaluation des politiques publiques, il convient de
s’interroger sur le point de savoir si l’ordonnance organique du 2 janvier
1959 ne nécessite pas une révision en profondeur, afin que les prévisions budgétaires
s’articulent autour d’objectifs.
– Afin de corroborer cette assertion, il convient de noter
que les initiatives prises par l’administration pour enrichir les modalités
actuelles de la discussion budgétaire d’éléments d’évaluation n’ont pas
abouti aux résultats escomptés.
Ainsi, les " blancs ", c’est-à-dire, les
documents budgétaires présentant les crédits de chaque ministère sous forme de
" budget de programme ", introduits à partir de 1978 dans le cadre de
la Rationalisation des choix budgétaires (RCB), n’ont-ils jamais débouché sur les
performances espérées.
Pourtant, il convient de souligner que ces documents correspondaient
exactement à la vision gestionnaire susceptible de déboucher sur une évaluation des
politiques publiques. Chaque budget de programme était subdivisé en groupes de
programmes, lesquels faisaient l’objet d’objectifs, d’indicateurs de coût
et d’indicateurs de moyens. Soulignons, toutefois, que les
" blancs " souffraient d’une lacune : l’absence
d’indicateurs de résultats.
La publication des blancs, progressivement tombée en désuétude, a
cessé à la suite de la réforme des documents budgétaires de 1996.
Pour expliquer cette évolution, il convient de souligner que les
blancs, introduits suite à une décision de la direction du budget, n’ont jamais
contribué à la préparation du projet de loi de finances, étant dépourvus
d’effets obligatoires. Leur seule fonction a donc été de servir de documents
d’information, et non de contribuer à la " rationalisation des choix
budgétaires " (RCB). Représentant une charge de travail importante pour les
ministères, ils étaient élaborés avec retard, souvent publiés après le vote du
budget et donc peu utilisés par les parlementaires, ce qui explique qu’ils soient
progressivement tombés en désuétude. Indiquons, enfin, que le projet de la RCB, visant
à déterminer de manière globale les missions et les moyens, relevait davantage de la
" mystique technocratique " que d’une vision pragmatique.
La réforme des annexes explicatives bleues, introduite à titre
expérimental en 1994 et mise en oeuvre dans le cadre de l’examen du projet de loi de
finances pour 1996, aurait dû permettre de combler les lacunes générées par la
disparition des blancs. Il n’en a rien été.
Certes, cette réforme a permis d’améliorer la lisibilité des
bleus : ces documents ont été allégés et simplifiés, afin de mettre en exergue
les grandeurs significatives, un certain nombre de données étant transférées dans des
bases de données accessibles par voie informatique. Mais, surtout, cette réforme
s’est traduite par l’introduction, à la place des
" actions " définies dans la cadre de la RCB,
" d’agrégats " regroupant les moyens affectés à une action,
destinés à permettre une analyse des politiques publiques en termes d’objectifs.
Soulignons, toutefois, que ces objectifs ne font pas l’objet de chiffrage. Ces
agrégats sont assortis d’indicateurs (moyens, activité). Il manque, en revanche,
des indicateurs de résultats, susceptibles de mesurer les performances réalisées.
Relevons que, si l’introduction des agrégats va dans le bon sens,
l’essentiel des données rassemblées dans les bleus reste ancré dans une vision
purement budgétaire de la dépense publique, contribuant ainsi à enfermer les débats
sur le projet de loi de finances dans une logique de moyens. Cette
" réformette " est donc largement insuffisante pour permettre au
Parlement d’exercer réellement sa fonction de contrôle de gestion a priori.
b) Un changement impératif
- Le redressement de nos finances publiques, la réduction de nos besoins de
financement, ainsi que l’ampleur atteinte par le niveau des prélèvements
obligatoires, imposent à la France de gérer " autrement " la
dépense publique.
Or, jusqu’à présent, la politique de maîtrise des finances
publiques n’a pas débouché sur une appréciation de la dépense publique en
fonction de son efficacité.
Elle s’est, en effet, traduite par des économies forfaitaires
imposées, via la régulation, aux ministères. Or, celles-ci semblent avoir
aujourd’hui atteint leurs limites. Comme l’a relevé M. Daniel Bouton,
ancien directeur du budget, devant notre groupe de travail, il n’est pas " possible
d’aller beaucoup plus loin dans les exercices de rognure [de la dépense
publique] année après année ". Mais, surtout, cette politique de
maîtrise de la dépense par des économies forfaitaires apparaît de plus en plus
contradictoire avec la recherche d’une efficacité accrue de l’argent public,
dès lors que les coupes opérées le sont de manière non sélective, c’est-à-dire
indépendamment de l’efficacité de la dépense visée, aboutissant ainsi à remettre
en cause les services rendus et à décourager les personnels concernés.
C’est pourquoi, il apparaît désormais indispensable de changer
les règles du jeu pour accomplir de réels progrès, comme l’ont fait unanimement
valoir les diverses personnalités entendues par le groupe de travail. Dans une période
de raréfaction de la dépense publique, il faut désormais obtenir des économies,
dégager des marges de manoeuvre et procéder à des réallocations de ressources sur la
base de l’efficacité de la dépense publique.
Il s’agit là d’une mission de longue haleine.
MM. Jacques Bonnet et Philippe Nasse indiquaient, en effet, dans leur audit des
finances publiques du 21 juillet 1997, que " concernant l’Etat, une
maîtrise prolongée de la dépense publique compatible avec le maintien ou
l’amélioration de l’efficacité des services impose, à notre avis, un
réexamen en profondeur des missions et de la législation qui gouvernent ses domaines et
ses modes d’intervention, ainsi que l’organisation même de ses services ".
Ce réexamen des missions assignées aux services publics passe par une
évaluation de l’efficacité de la dépense publique, afin de rendre compte de
l’usage des deniers publics, et par une politique de transparence, afin de débattre
des choix opérés.
- Le Parlement peut être en mesure de " servir de fer de
lance " à cette ambition, à condition, toutefois, qu’il se donne les
moyens d’évaluer la dépense publique.
Il suffit, pour s’en convaincre, de rappeler qu’en France, la
responsabilité de la réforme de l’Etat, laquelle repose sur le thème central de
l’appréciation de la dépense publique en fonction de son efficacité, varie au gré
de la composition des Gouvernements. Quant aux différents ministres, il leur est
politiquement difficile de s’engager dans la voie d’une telle appréciation de
la dépense publique, laquelle présuppose une redéfinition des moyens alloués à
l’administration dont ils sont en charge et des pouvoirs qu’elle exerce.
Or, comme l’a souligné devant le groupe de travail M. Michel
Prada, qui cumule la double expérience de directeur de la comptabilité publique, puis du
budget, " lorsque [les parlementaires] marquent de l’intérêt
pour [un] sujet, une dynamique se produit ; dans le cas contraire, il n’y
a aucun véritable contre pouvoir à la tendance de la technostructure à persévérer
dans son être et dans ses méthodes précédentes ". Le Parlement doit donc
" s’emparer " du thème de l’efficacité de la dépense
publique et exercer ainsi ses fonctions de contrôle.
Cette mission nécessite de profonds changements. Pour citer le
Professeur Loïc Philip, elle implique que " le Parlement admette que sa
mission a changé de nature, que son rôle n’est plus de faire des choix budgétaires
- ces choix en fait sont imposés et donc la discussion budgétaire a de moins en
moins de signification - mais d’être de plus en plus un
" vérificateur ", d’exercer une sorte d’audit à la fois
sur la transparence et la qualité des données financières de l’Etat et, peut-être
plus largement, des données financières publiques ".
En redevenant ce lieu de débat autour de la dépense publique, le
Parlement verra sa légitimité démocratique renforcée, puisqu’il apportera une
contribution aux exigences de transparence et de performance édictées par
l’article 15 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen :
" La société a le droit de demander compte à tout agent public de son
administration ".
RETOUR SOMMAIRE
TROISIEME PARTIE
le plein exercice, par le parlement, de sa fonction
de CONTRÔLE et d’ÉVALUATION des DÉPENSES publiques rendra indispensables dEs
rÉformes plus profondes touchant au fonctionnement même de l’État
Le Parlement peut jouer un rôle déterminant dans une démarche de
recherche d’une plus grande efficacité de la dépense publique.
Nombre de réformes, d’application immédiate, dépendent
largement de sa sphère propre. Il lui appartient donc de les rendre rapidement
effectives, afin de donner l’impulsion nécessaire au développement de réformes
exigeant un effort de maturation, dans la mesure où elles touchent au fonctionnement
même de l’Etat.
I.- Les rÉformes
immÉdiatement opÉrationnelles pour une nouvelle orientation du rÔle du parlement
Le contrôle budgétaire et l’évaluation de la dépense publique,
qui doivent être bien distingués, peuvent être rapidement amplifiés dans le cadre
d’une démarche privilégiant le développement du débat démocratique.
A.- Du contrôle à
l’évaluation : des fonctions prioritaires exercées par la plupart des
parlements étrangers
Il faut que le Parlement se réapproprie son pouvoir de contrôle
budgétaire et en améliore l’exercice, en lui associant un pouvoir
d’évaluation des résultats des dépenses publiques.
Deux temps forts doivent concrétiser le pouvoir financier qui
s’exerce à l’Assemblée nationale : la validation de la programmation
globale et pluriannuelle des dépenses et des recettes, la conduite d’un examen
approfondi et systématique de l’utilisation des crédits.
1.- Distinguer contrôle et évaluation
L’Assemblée nationale s’essouffle, un mois par an, dans un
examen, quelque peu illusoire, de la deuxième partie des lois de finances, alors
qu’elle dispose en fait, en matière de dépenses, d’une marge de manoeuvre des
plus limitée.
Elle doit reconquérir un véritable pouvoir de contrôle budgétaire,
exercé tout au long de la session annuelle, et privilégier cette activité.
Mais il faut aller plus loin et mettre en place des dispositifs
d’évaluation en distinguant bien les deux démarches.
L’évaluation se différencie des différentes formes de contrôle
et de l’audit organisationnel, par le type de point de vue adopté pour apprécier
l’action publique. Le contrôle et l’audit se réfèrent à des normes
internes au système analysé (règles comptables, juridiques ou normes
fonctionnelles), tandis que l’évaluation essaye d’appréhender d’un point
de vue principalement externe les effets et/ou la valeur de l’action
considérée.
Il faut également préciser que, contrairement à certaines formes
d’audit, l’évaluation n’a pas pour objet de porter un jugement sur la
manière dont les agents, y compris les responsables hiérarchiques, remplissent, à titre
individuel, leur mission.
On peut affiner cette distinction en reprenant les définitions
données par les textes applicables à l’une et l’autre activité.
La nature du contrôle qui incombe à la Cour des comptes ()
consiste, pour l’essentiel, à vérifier la régularité des recettes et des
dépenses retracées dans les comptabilités publiques et à s’assurer du bon emploi
des crédits, fonds et valeurs gérés par les services de l’Etat et les autres
personnes morales de droit public. Elle assure également la vérification des comptes et
de la gestion des entreprises publiques.
Si l’on se réfère aux dispositions sur le contrôle économique
et financier exercé par le Parlement (), qui confèrent des pouvoirs
spéciaux d’investigation aux membres du Parlement ayant la charge de présenter le
budget d’un département ministériel, on peut observer que ces contrôles portent
sur l’emploi des crédits inscrits au budget de ce département.
Le concept d’évaluation est, quant à lui, précisé dans un
décret () récent, qui vise à relancer et à améliorer
l’évaluation des politiques publiques dans un cadre interministériel. Il est
indiqué, à l’article premier, que l’évaluation d’une politique publique
a pour objet d’apprécier l’efficacité de cette politique en comparant ses
résultats aux objectifs qui lui sont assignés et aux moyens mis en oeuvre.
On remarquera que cette définition est sensiblement la même que celle
qui figurait dans le décret () de 1990, abrogé par le précédent, selon
laquelle l’évaluation a pour objet de rechercher si les moyens juridiques,
administratifs ou financiers mis en oeuvre permettent de produire les effets attendus de
cette politique et d’atteindre les objectifs qui lui sont assignés.
En mettant ces deux fonctions de contrôle et d’évaluation au
coeur de son activité budgétaire, le Parlement devrait être en mesure de faire reculer,
dès à présent, trois facteurs d’impuissance : le déficit de connaissance, le
déficit d’examen et l’autocensure.
Il doit pour cela renverser l’ordre de ses priorités dans la
procédure budgétaire et désigner comme moment fort du débat l’examen des
résultats des actions antérieures ou en cours et il doit se doter de nouveaux outils.
C’est ce que nous apprend la comparaison avec les parlements de
plusieurs grandes démocraties.
2.- Les exemples étrangers
On évoquera tout d’abord le dispositif mis en place aux États-Unis,
non comme un modèle, mais à titre d’exemple riche d’enseignement. Ce pays a
confié au General accounting office (GAO) la mission de développer une
activité d’évaluation. Le GAO est une agence du Congrès, qui a ainsi créé une
division spécifique (100 personnes dont 76 chercheurs) et occupe aujourd’hui en
matière d’évaluation une position sans équivalent dans le monde. Il intervient ex
ante lors de la formulation de la politique concernée, en cours d’exécution sur
le coût du programme et ex post pour juger des effets produits.
Ses évaluations ont un fort impact sur les décisions prises :
abandon du programme de développement de certains armements, réorientation des
réductions de crédits prévues par l’administration dans les budgets sociaux...
Ces succès tiennent à la position du GAO auprès du Congrès
américain : bien que disposant de la capacité juridique de s’autosaisir, il
réalise 95% de ses travaux à la demande de parlementaires.
Le travail du GAO, pôle dominant de l’évaluation situé en
dehors de l’exécutif, est complété par celui d’autres instances telles que
l’Office of management and budget, qui relève de l’exécutif et est
avant tout chargé de préparer et d’exécuter le budget, ainsi que trois agences
spécialisées sur lesquelles peuvent s’appuyer les deux chambres du Congrès :
le Congressional research service, qui réalise des études juridiques ;
l’Office of technology assessment, qui étudie l’impact des
nouvelles technologies ; le Congressional budget office, au service du
législateur pour la préparation du budget.
En Allemagne, le Parlement a joué un rôle important dans la
mise en place de dispositifs d’évaluation et, depuis 1970, de très nombreux votes
de lois et de programmes dans les domaines économique, social et éducatif ont été
assortis d’une obligation pour le gouvernement fédéral d’organiser une
évaluation de leur mise en oeuvre et des effets obtenus. La réalisation des travaux
d’évaluation est considérée comme une tâche spécifique qui ne peut être
accomplie, sauf dans les cas simples, par les institutions traditionnelles de contrôle ou
par les services de l’administration. L’initiative de l’évaluation est
généralement le fait du Parlement, mais elle peut également émaner de la Cour des
comptes ou de la Chancellerie, mais rarement du ministère chargé de la politique
concernée. Il n’est pas indifférent de noter que le fait que le Parlement a joué
un grand rôle dans ce processus peut expliquer que l’évaluation est peu appréciée
par l’administration fédérale, où elle est souvent confondue avec les contrôles
traditionnels. Contrairement à la France, où la démarche évaluative est totalement
centralisée au niveau de l’Etat, le système allemand pèche peut-être par un
manque de base légale et une approche un peu dispersée.
L’exemple le plus éclairant est certainement le système
britannique. Le développement de l’évaluation au Royaume-Uni s’est
produit sous une pression constante en faveur de réformes de la gestion publique qui
nécessitaient une attention plus soutenue à la fixation d’objectifs, à
l’amélioration du suivi des performances et à la mesure régulière des résultats.
Le motif principal de ces changements était le resserrement des budgets et le besoin
subséquent d’afficher des résultats, associé à la recherche d’une
amélioration continue des services publics. Le plus remarquable est peut-être que les
institutions centrales du gouvernement ne pilotent pas l’évaluation, qui est devenue
un mode de gestion décentralisée dans de très nombreux secteurs, un véritable outil
d’aide à la décision dont s’est également emparé le Parlement.
Le National audit office (NAO) a été créé en 1983 par
le National audit act, avec pour mission de renforcer le contrôle
parlementaire sur l’utilisation des fonds publics. Il est placé sous
l’autorité d’un " contrôleur et auditeur général " (CAG)
nommé par le Premier ministre sur proposition de la Chambre des communes. Avant cette
réforme, l’institution supérieure de contrôle avait une activité centrée sur
l’audit financier et le contrôle de régularité. Le NAO, organe indépendant, a un
mandat clair pour examiner l’activité des départements ministériels et des
organismes publics sous l’angle de l’économie, de l’efficience et de
l’efficacité. Chaque année, il transmet une cinquantaine de rapports de type value
for money au Parlement. Ce label regroupe les audits de performance, qui
allient contrôle du respect de la légalité et de la bonne gestion des organismes
publics, les examens spéciaux, qui sont des études plus courtes destinées à
analyser un dysfonctionnement particulier dans un système, les évaluations de
programmes, qui cherchent à apprécier dans quelle mesure une organisation ou
un programme a atteint ses objectifs qu’elles ont au préalable aidé à clarifier
(exemple : l’évaluation du programme national de maintenance des ponts). Ces
travaux se déroulent tout au long de l’année.
Le NAO travaille en étroite relation avec le Committee of public
accounts (PAC), Commission des comptes publics, qui fait partie des " Select
committees " de la Chambre des communes, lesquelles ont pour objet de
contrôler l’action du gouvernement et de l’administration ainsi que de gérer
l’organisation interne du parlement. C’est à cette commission que le NAO
présente ses rapports. Le choix des sujets et le contenu des rapports sont déterminés
par le CAG mais toujours en accord avec la commission. Cette dernière utilise les
rapports pour procéder à l’audition des responsables du ministère ou de
l’organisme contrôlé. Ces auditions sont publiques et se déroulent en
présence du CAG et de l’équipe du NAO qui a rédigé le rapport et qui aide le
président du PAC à préparer l’audition. Un rapport est ensuite publié par la
Commission des comptes publics, intégrant le rapport du NAO et les éléments recueillis
lors des auditions. Le rapport contient généralement des recommandations de réforme
auxquelles le gouvernement a l’obligation de répondre. Il n’appartient pas au
NAO, qui ne dispose pas d’un pouvoir de sanction, de porter une appréciation sur les
objectifs des politiques de l’Etat qu’il évalue. Les programmes gouvernementaux
relèvent du pouvoir politique et c’est au Parlement qu’il revient de les
discuter ou de les sanctionner. Il convient, à cet égard, d’observer qu’une
telle démarche exige un effort important, afin d’établir une distinction claire
entre le fait de mettre en cause la pertinence des objectifs d’une politique et celui
d’examiner l’efficacité des moyens choisis pour les atteindre.
C’est une dynamique de cette nature qu’il faudrait mettre en
place en France, où il faut, au moins autant que chez nos voisins, maîtriser la dépense
publique, en freiner la progression et la redéployer afin qu’elle ait la plus grande
efficacité économique possible. L’Assemblée nationale est loin d’être
totalement démunie pour entreprendre ce renversement de tendance, qui s’avère
possible sans bouleversement institutionnel majeur.
B.- Renforcer le
contrôle de l’Assemblée nationale à tous les stades de la procédure budgétaire
Le rôle du Parlement doit être clairement défini. Les choix
budgétaires et la préparation du budget relèvent de l’exécutif et il appartient
au Parlement de débattre des grands équilibres économiques et sociaux qui encadreront
les lois de finances et de contrôler la bonne gestion de la dépense publique et ses
résultats. Le Parlement doit donc lier étroitement les décisions budgétaires qui lui
sont soumises au résultat des contrôles et des études menées à son initiative. Il a
un rôle irremplaçable à jouer en matière de contrôle de la dépense budgétaire. Un
nombre d’initiatives limitées, mais mises en oeuvre avec détermination, devrait
permettre d’y parvenir. C’est incontestablement par de telles initiatives que le
Parlement retrouvera toute sa place et pourra jouer un rôle d’aiguillon en vue de la
poursuite de réformes plus profondes.
1.- Un débat contradictoire pour une programmation
pluriannuelle des finances publiques
L’Assemblée doit sortir de la contradiction actuelle qui consiste
à multiplier les votes sur des ensembles très fractionnés de crédits et à laisser
échapper l’essentiel. Elle doit désormais privilégier les grandes orientations
économiques et financières, d’une part, les comptes et les résultats, d’autre
part, par rapport au budget annuel lui même.
Le débat d’orientation budgétaire, tenu pour la première fois,
à l’initiative du Président Laurent Fabius, en avril 1990 et renouvelé en mai
1996, puis en juin 1998, constitue une innovation d’une grande importance, mais il
doit être l’occasion d’une plus grande transparence et d’un renforcement
de la capacité d’intervention du Parlement.
Ce débat doit permettre d’examiner les perspectives budgétaires
globales, dans le contexte d’une programmation triennale correspondant à
l’obligation fixée par le Pacte de stabilité et de croissance pour les Etats de la
zone euro.
Dans un premier temps, la Commission des finances examinerait, chaque
année, avant leur transmission aux instances communautaires, les perspectives
triennales des finances publiques, incluant l’ensemble des dépenses publiques
(Etat, sécurité sociale, collectivités locales).
Dans un second temps, le débat d’orientation budgétaire
proprement dit, au printemps, devrait porter sur les hypothèses économiques et les
prévisions de croissance du PIB à laquelle sont mécaniquement liées les principales
recettes de l’Etat. Mais le débat doit également porter sur la politique fiscale et
l’évolution des prélèvements obligatoires, ainsi que sur la politique de la
fonction publique.
A cette occasion, il devrait être possible de faire apparaître la
réalité des déficits et de l’emprunt, qui va bien au-delà de ce que permet de
constater l’article d’équilibre de la loi de finances initiale, puisque
l’emprunt doit aussi couvrir les besoins extrabudgétaires du Trésor.
C’est en tout cas ce que révèle le débat d’orientation
budgétaire qui a eu lieu en mai 1996. Pour alimenter ce débat, le gouvernement avait
dû, comme on l’a vu précédemment, fournir un rapport innovant sur plusieurs
points, notamment en établissant une distinction, pour définir les conditions de
l’équilibre, entre dépenses de fonctionnement et dépenses d’investissement.
Toutefois, la démonstration passant par la stigmatisation des
dépenses de fonctionnement trouve ses limites lorsque l’on rappelle qu’elles
intègrent les dépenses liées à la recherche, à l’éducation, à un certain
nombre de transferts sociaux (allocations non contributives) et les charges financières
de la dette elle-même. On pourra se reporter aux propos tenus, devant le groupe de
travail, par M. Daniel Bouton, ancien directeur du budget, et par M. Louis
Schweitzer, ancien directeur de cabinet du Premier ministre, qui considèrent, comme
beaucoup d’auteurs, que, s’agissant des dépenses de l’Etat, la notion de
dépense d’investissement n’a pas véritablement de signification. Cette
présentation, qui était restée relativement sommaire et artificielle, n’a pas
été reprise dans le rapport de même nature présenté par le Gouvernement pour le
débat d’orientation budgétaire du 9 juin 1998. Sous réserve d’un reclassement
approprié des dépenses, cette présentation, dont la vertu pédagogique ne doit pas
être sous-estimée, pourrait être reprise.
Pour être véritablement globale, l’approche devrait également
aborder le niveau des dépenses programmées pour la sécurité sociale et pour les
collectivités territoriales. On regrettera à cette occasion que la loi organique du 22
juillet 1996 relative au financement de la sécurité sociale, n’ait pas été
fusionnée avec l’ordonnance organique du 2 janvier 1959, ce qui aurait attesté une
volonté de vision globale des dépenses et de définition d’une politique
d’ensemble. Mais rien ne s’oppose à ce que, dans le cadre du débat
d’orientation budgétaire, soit effectué un examen général des finances locales,
nationales, sociales et européennes.
Ce débat doit être véritablement éclairé, contradictoire et
préparé en amont, en particulier au sein de la Commission des finances.
Il devra s’engager sur la base, au minimum, des documents
suivants :
– le rapport de la Cour des Comptes sur
l’exécution du budget de l’année précédente ;
– le rapport économique, social et financier
présenté par le gouvernement incluant les comptes prévisionnels de la Nation pour
l’année en cours et les années suivantes ;
– le programme triennal, éventuellement actualisé, de
finances publiques du gouvernement.
L’information économique et financière des parlementaires
pourrait être utilement complétée par des simulations effectuées sur telle ou
telle orientation fiscale ou financière, par les organismes, notamment publics, de
prévision (OFCE, INSEE, Commissariat général du Plan), commandées en temps utile par
la Commission des finances.
La préparation de ce débat donnerait lieu à des auditions par
la Commission des finances et notamment à celles du Premier président de la Cour des
comptes, du rapporteur du Conseil économique et social qui suit la conjoncture, du
gouverneur de la Banque de France, du ministre de l’économie et des finances et du
secrétaire d’Etat au budget, éventuellement du commissaire européen chargé des
affaires économiques et financières. L’organisation de tables rondes
d’experts économiques doit être systématisée par la Commission des finances,
comme elle l’a fait en vue du débat d’orientation budgétaire tenu en juin
1998.
2.- Un véritable contrôle de l’exécution des
lois de finances
Afin de redonner tout son sens à cet exercice, le projet de loi de
règlement devrait être déposé peu de temps après la communication, par la Cour des
comptes, de son rapport sur l’exécution des lois de finances qui serait présenté
au mois de mai/juin de l’année (n+1). Il est indispensable pour cela que
l’intégralité des comptes définitifs des ministères, nécessaires à
l’établissement de la déclaration générale de conformité qui accompagne le
projet de loi de règlement, soit remise beaucoup plus tôt à la Cour des comptes, comme
elle le réclame régulièrement. La période complémentaire d’exécution du budget,
qui s’est achevée, pour l’exécution du budget de 1997, le 7 février 1998,
devrait d’ailleurs être encore raccourcie.
Le rapport de la Cour des comptes devrait donner lieu, préalablement
à l’examen du projet de loi de règlement, à des auditions par la Commission des
finances plus nombreuses que c’est actuellement le cas, au minimum du Premier
président et des principaux magistrats qui ont participé à son établissement.
Mesurer l’écart entre la loi de finances initiale et le budget
finalement exécuté peut nourrir non seulement les débats relatifs à la loi de
règlement, mais surtout ceux concernant le projet de loi de finances initiale de
l’année à venir. L’interaction entre la loi exécutée et celle en
préparation est évidemment propre à enrichir la fonction de contrôle du Parlement et
facilitera une analyse approfondie de la politique budgétaire suivie. L’Assemblée
doit se mettre en situation de porter un jugement politique sur la réalité de la
dépense publique globale au regard des objectifs et des engagements budgétaires
pluriannuels.
Le vote du projet de loi de règlement de l’exercice n pourrait
donc, à terme, intervenir avant celui du projet de loi de finances pour l’année
(n + 2), ces deux textes pouvant d’ailleurs faire l’objet d’une
discussion générale commune.
3.- Le contrôle de l’emploi des crédits
tout au long de l’année
La Commission des finances doit s’efforcer de remplir de façon
plus approfondie son rôle de commission de contrôle de l’emploi des crédits tout
au long de l’année. Il lui suffit de mettre plus systématiquement en pratique les
textes existants, qui pourraient toutefois être légèrement améliorés.
Il faut rendre plus effectif le pouvoir des rapporteurs spéciaux, car
il est très peu exercé en raison de l’isolement dans lequel se trouvent ces
rapporteurs lorsqu’ils se risquent à entreprendre ce travail de longue haleine, avec
l’assistance d’un seul fonctionnaire parlementaire. Deux modifications doivent
être mise en oeuvre.
La première modification consisterait à compléter, à
l’occasion de la prochaine loi de finances, l’ordonnance du 30 décembre 1958,
afin d’étendre les pouvoirs des rapporteurs spéciaux aux rapporteurs pour avis
budgétaires des autres commissions permanentes. Rapporteur spécial et rapporteur pour
avis pourraient travailler conjointement sur chaque opération de contrôle.
L’isolement serait rompu par le caractère collectif de la démarche et la motivation
renforcée surtout si, comme il sera suggéré ci-après, dans une perspective de
renforcement de la transparence et de la démocratie, il était possible d’associer
un rapporteur spécial appartenant à la majorité et un rapporteur pour avis membre de
l’opposition ou l’inverse. Les rapporteurs spéciaux de la Commission des
finances auraient l’obligation de réaliser au moins deux contrôles de ce type par
an pour prétendre au renouvellement de leur désignation l’année suivante. La
coordination de l’ensemble de ces travaux par le Rapporteur général, susceptible,
le cas échéant, de prêter main forte aux contrôleurs, trouverait toute sa dimension
dans le rapport sur la loi de règlement.
En second lieu, les commissaires chargés du contrôle et le Rapporteur
général de la Commission des finances devraient préparer leurs démarches avec
l’aide des magistrats de la Cour des comptes investis des mêmes pouvoirs de
vérification sur pièces et sur place (art L. 111-3 du code des juridictions
financières) pour le contrôle de la gestion financière des services et des organismes
publics. Cette préparation consisterait, notamment, à éclairer les rapporteurs sur les
documents utiles à se procurer et le cas échéant sur leur interprétation. Une telle
démarche permettrait de concrétiser les dispositions de l’article 47 de la
Constitution, aux termes desquelles la Cour des comptes assiste le Parlement dans le
contrôle de l’exécution des lois de finances.
Pour impulser ces travaux, une mission d’évaluation et de
contrôle pourrait être créée, chaque année, au sein de la Commission des
finances.
Afin d’assurer l’association de l’opposition au
fonctionnement de cette mission, un membre de l’opposition s’en verrait confier
la co-présidence, aux côtés du Président de la Commission des finances,
l’animation et la coordination des travaux étant assurées par le Rapporteur
général.
La mission fixerait un calendrier d’auditions des fonctionnaires
responsables des grandes administrations, des directeurs d’établissements publics
et/ou des ministres concernés par les problèmes qui auront particulièrement retenu
l’attention des rapporteurs. Ces auditions se dérouleraient au rythme d’une par
semaine de janvier à juin, soit une vingtaine au total. Elles se situeraient dans le
cadre de l’article 5 bis de l’ordonnance du 17 novembre
1958 (). L’opposition serait associée à la préparation des
auditions hebdomadaires de la mission, qui seraient ouvertes aux autres membres de la
Commission des finances et aux rapporteurs pour avis des autres commissions.
Il faudra incontestablement faire preuve de volontarisme et de
pragmatisme pour lancer cette " machine ", mais, très vite, cette
démarche devrait produire des résultats et être ressentie comme indispensable au
travail du Parlement.
L’Assemblée nationale devra s’efforcer de faire passer
l’idée qu’elle exerce son pouvoir de contrôle dans l’intérêt même des
gestionnaires et que, si elle vise à réduire les dépenses inutiles, elle pourra aussi
s’incliner devant des services bien gérés et saluer les gains de productivité
réalisés.
Un moyen supplémentaire pourrait être prochainement opérationnel, il
s’agit de l’utilisation d’Internet.
Selon le récent rapport de M. Jean-Paul Baquiast ()
établi à la demande du ministre de la fonction publique, de la réforme de l’Etat
et de la décentralisation, le fonctionnement de l’Etat va être bousculé par la
société de l’information et l’obligation de transparence que véhicule la
" culture Internet ".
Il préconise la mise en ligne par l’administration de la
totalité des informations concernant les budgets, les dépenses, les subventions, les
effectifs... On ajoutera que pourraient également être diffusés par ce moyen, les
rapports des différents corps d’inspection et les études internes réalisées sur
la productivité dans l’administration et les organismes publics.
Est-il utopique d’imaginer un processus de dialogue critique entre
les commissaires rapporteurs et les responsables de l’administration, via
Internet ?
RETOUR SOMMAIRE
4.- Approfondir les liens avec la Cour des comptes
Les relations de la Cour des comptes avec le Parlement ont été
renforcées comme on l’a vu, en particulier avec l’article L. 132-4 du code
des juridictions financières.
Il ressort clairement de l’audition par le groupe de travail, du
Premier président de la Cour des comptes que les enquêtes prévues et dont la
réalisation est, en cas de demande, obligatoire pour la Cour, ne sont
qu’exceptionnellement demandées par la Commission des finances de l’Assemblée.
Ces enquêtes pourraient, en particulier, utilement éclairer les parlementaires sur la
sincérité des comptes de l’Etat et leur permettre de vérifier si les budgets
décrivent ou non l’ensemble des dépenses et des recettes de l’Etat ou encore
si les règles sur les marchés publics sont respectées.
L’article L. 135-5 du même code, relatif aux transmissions de
documents par la Cour des comptes, n’est pas encore, comme on l’a vu, appliqué
de façon satisfaisante, puisque les documents en cause ne sont transmis qu’avec
parcimonie à la Commission des finances.
Dans la perspective de la meilleure coopération appelée de ses voeux
par le Premier président de la Cour des comptes, il est souhaitable que le programme de
travail établi chaque année par la Cour, le soit désormais en coordination avec le
Parlement, qui devrait alors formuler ses demandes en matière d’enquêtes et
d’audits.
Mais l’Assemblée nationale, comme le font ses homologues
étrangers, doit aller au-delà de ces contrôles de régularité juridique et financière
des dépenses : elle doit s’intéresser à l’évaluation des politiques
publiques qui sous-tendent les dépenses autorisées et contrôlées. Il s’agit de
déterminer si les objectifs fixés ont été atteints ou sont en voie de l’être et
si les moyens mis en oeuvre sont adéquats.
C.- Introduire et
systématiser l’évaluation de la
dépense publique à l’Assemblée
Les parlementaires doivent se convaincre que, dans un environnement
budgétaire contraint, ils ont un rôle d’intérêt général essentiel à jouer, qui
consiste à s’assurer de la meilleure affectation possible des fonds publics.
Ne pouvant mesurer exactement les besoins des administrations pour
conduire les politiques engagées, les élus ont les plus grandes difficultés à trouver
les économies que l’Etat pourrait faire. Ils avancent à l’aveuglette, se
heurtant, à chaque tentative, à des intérêts puissants, légitimes ou non. C’est
pourquoi les choix doivent être éclairés de la façon la plus objective et la plus
transparente possible. Les parlementaires doivent savoir si, en mettant en cause des
dépenses votées l’année ou les années précédentes, ils compromettent un aspect
vital du fonctionnement de l’Etat ou pas.
L’opinion publique française est encore peu sensibilisée à
cette démarche évaluative propre à renforcer la compétitivité de l’ensemble du
pays et qui devrait échapper à toute approche partisane. Il appartient peut-être à ses
représentants d’ouvrir la voie. Il faut pour cela une ferme volonté de transparence
et de connaissance du réel, qui ne doit pas être confondue avec une accumulation
d’informations. Traquer la dépense inutile et la mauvaise gestion ou démanteler
l’empilement de structures ou de mesures injustifiées, ne sont pas des démarches
qui ont pour objet de mettre le Gouvernement en difficulté. Au contraire, dans certains
cas, elles peuvent l’aider à résoudre des problèmes et à rechercher le meilleur
fonctionnement possible de l’administration.
Comme il a été dit plus avant dans ce rapport, la dépense publique
ne vise pas, comme celle des entreprises, à dégager des profits, mais à satisfaire un
besoin d’intérêt général. Il faut donc intégrer cet objectif, à la définition
duquel le Parlement doit avoir participé en amont, à la démarche évaluative.
L’exercice peut s’avérer complexe, car il implique une analyse qualitative du
" produit ", il est néanmoins indispensable.
On s’en tiendra ici à l’évaluation de l’efficacité et
des résultats des dépenses de l’Etat, même s’il est de plus en plus difficile
de séparer les dépenses de l’ensemble des administrations publiques qui
s’influencent réciproquement.
1.- Les exemples d’évaluation à
l’Assemblée
Le besoin d’évaluation s’est exprimé jusqu’à présent
sous plusieurs formes restées inachevées.
Le suivi de l’exécution des lois, premier stade de
l’évaluation, a été pris en compte par la circulaire du Premier ministre du
1er juin 1990, qui prévoit qu’aucun projet de loi ne peut être soumis au
Conseil des ministres sans qu’un calendrier prévisionnel des décrets
d’application ne soit arrêté et que les dispositions essentielles de ces décrets
ne soient connues. Cette circulaire aurait dû faciliter le travail de vigilance du
Parlement mais son application est restée discrète ().
Certaines grandes lois ont prévu l’obligation, pour le
Gouvernement, de déposer un rapport d’évaluation afin de procéder aux adaptations
nécessaires, la reconduction du dispositif ou l’adoption d’une loi
complémentaire étant conditionnée par les résultats de l’évaluation. La loi du
1er décembre 1988 instituant le revenu minimum d’insertion allait même plus loin,
puisqu’elle formulait des exigences précises, en particulier sur le volet insertion
et la lutte contre l’exclusion. Mais la discussion parlementaire sur le
renouvellement de la loi en 1992 a très peu tenu compte des résultats transmis par la
Commission nationale d’évaluation du RMI.
On ne reviendra pas sur le sort réservé à l’évaluation à
mi-parcours prévue par la loi quinquennale relative au travail à l’emploi et à la
formation professionnelle, dont il a déjà été dit que le rapport de l’instance
d’évaluation, publié en février 1997, n’a jamais été présenté au
Parlement, alors que le Gouvernement y était tenu.
La prochaine illustration concernera la loi d’orientation et
d’incitation relative à la réduction du temps de travail, qui prévoit, en vue de
la préparation d’un deuxième texte, la présentation au Parlement du bilan des
accords sur les 35 heures avant la fin de l’année 1999.
Une autre approche concerne l’obligation d’assortir tous les
projets de loi, d’une étude d’impact juridique, économique et financier des
dispositions envisagées. Une circulaire du Premier ministre du 21 novembre 1995 relative
à l’expérimentation des études d’impact a fait l’objet d’un bilan
mitigé. Une nouvelle circulaire du Premier ministre, du 26 janvier 1998, visant au
même objet, s’est avérée nécessaire pour pérenniser la procédure tout en en
révisant les modalités. Tous les projets de loi, les projets d’ordonnance ainsi que
les projets de décrets en Conseil d’Etat qui ont un caractère réglementaire,
doivent être accompagnés d’une étude visant à évaluer a priori les effets
administratifs, juridiques, sociaux, économiques et budgétaires des mesures envisagées.
Il s’agit de s’assurer de manière probante que la totalité des conséquences a
été appréciée préalablement à la décision à venir et que les mesures proposées
sont les plus adaptées au but poursuivi. Si ces engagements sont tenus et que les
parlementaires peuvent disposer d’une telle étude, conçue non comme un rite mais
comme un véritable outil de réflexion, le travail d’examen et d’évaluation de
la loi en sera considérablement enrichi.
Enfin, il faut bien constater, comme l’a fait le Président de la
Commission des finances de l’Assemblée devant le groupe de travail, que l’Office
parlementaire d’évaluation des politiques publiques, créé par la loi du 14
juin 1996, s’est révélé inapte à répondre à l’attente des parlementaires.
Il est donc urgent que l’Assemblée nationale accède à une
véritable connaissance de la réalité des actions publiques. Plus
particulièrement elle doit se pencher sur l’évaluation des charges, des pratiques,
des besoins, des objectifs et des " productions " des services, et des
missions de l’Etat en général.
2.- L’indispensable évaluation des services
votés
Le Parlement, confronté au resserrement des budgets, doit se faire le
garant de l’amélioration continuelle de la gestion publique ; il en résultera
nécessairement une attention plus soutenue à la fixation des objectifs, à
l’amélioration des performances et à la possibilité de réaliser des économies.
Sa légitimité est d’autant plus grande à s’emparer de cette fonction que le
but ultime de l’évaluation est de renforcer la qualité et la sensibilité des
services publics aux besoins des usagers.
Les autorisations nouvelles de crédits absorbent aujourd’hui une
très grande part de l’énergie déployée lors des débats budgétaires. Il faut
inverser cette logique en concentrant l’activité des membres de la Commission des
finances et, au-delà, des autres commissions, sur l’examen de l’efficacité de
ce qui existe et qui représente entre 90 et 95% des crédits nets du budget général.
Seule cette démarche évaluative pourra redonner un sens aux décisions relatives à une
nouvelle activité, à une nouvelle structure, ou à un nouveau service.
Si, dans le cadre de l’adoption de la loi de finances initiale,
les dépenses du budget général font l’objet d’un vote unique en ce qui
concerne les services votés qui recouvrent des dépenses ordinaires et des dépenses en
capital - globalisation sans doute excessive -, la Commission des finances peut
tout à fait se donner les moyens d’évaluer les résultats de ces dépenses tout au
long de l’année.
Il s’agirait simplement de la mise en oeuvre de deux principes
définis par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et à ce
titre intégrés dans le bloc de constitutionnalité, rappelés par le Professeur Loïc
Philip devant le groupe de travail : les citoyens ou leurs représentants doivent
pouvoir constater la nécessité de la contribution publique et tout agent public
doit rendre compte de son administration.
La mission annuelle d’évaluation et de contrôle de la
Commission des finances examinera chaque année un certain nombre d’actions publiques
transversales en commençant par les plus coûteuses et les plus opaques dans leur
fonctionnement et leurs résultats, afin d’en mesurer l’efficacité.
Les pistes ne manquent pas. Le Professeur Loïc Philip a cité comme
objet d’étude prioritaire, les rémunérations dans la fonction publique et les
subventions aux entreprises publiques. M. Pierre Joxe considère, pour sa part, que
les programmes de lutte contre la toxicomanie, déjà abordés par la Cour des comptes, la
formation professionnelle, l’armement ou l’éducation nationale sont
prioritaires, et notre collègue M. Jean-Jacques Jégou souhaiterait tout
d’abord s’intéresser au fonctionnement du ministère chargé du budget. Notre
collègue M. Michel Suchod a suggéré, de son côté, d’évaluer
l’enseignement supérieur ou certains programmes militaires. Il faudrait aussi songer
aux aides publiques aux entreprises... Il ressort clairement des débats au sein du groupe
de travail qu’il ne sera pas difficile de définir chaque année quatre ou cinq
domaines d’exécution des services publics ou grandes fonctions collectives, pour
lesquels elle déclenchera des actions d’évaluation.
Il convient de distinguer cette démarche propre à la Commission des
finances et relevant de son initiative dans le but de nourrir la discussion budgétaire,
des évaluations prévues par certaines grandes lois ou des résultats de dispositions
législatives nouvelles au regard de l’impact qui en était attendu et dont la mise
en oeuvre appartient aux ministères, même si les résultats doivent être soumis au
Parlement.
Pour les services votés, il s’agira d’une évaluation ex
post ou portant sur l’exercice en cours, qui répond à des problèmes
méthodologiques différents de l’évaluation a priori.
La Commission des finances, par l’intermédiaire de sa mission
annuelle d’évaluation et de contrôle, doit devenir un commanditaire
d’évaluations, fonctionnant selon des modalités qui peuvent s’inspirer
du processus mis en place, au niveau interministériel, par le décret du 18 novembre
1998 relatif à l’évaluation des politiques publiques, susvisé. Le Conseil national
de l’évaluation, instance indépendante créée par le décret, assisté par le
Commissariat général du Plan propose, chaque année, au Premier ministre, un programme
d’évaluation des politiques publiques pour l’année suivante. Il examine
ensuite les rapports d’évaluation réalisés par différents opérateurs sous la
conduite d’une instance d’évaluation ad hoc et le rapport est publié
assorti de l’avis du conseil.
C’est une procédure de cette nature, aussi souple et efficace que
possible, qui doit être mise en oeuvre à l’Assemblée et pour laquelle les moyens
existent.
Pour chaque commande d’évaluation, devra être fixé un cahier
des charges à l’opérateur public ou privé choisi pour la réaliser, comprenant les
questions auxquelles il devra être répondu, les indicateurs de mesure souhaitables, les
modalités de mise en oeuvre de l’évaluation, les délais de réalisation, le coût
et les modalités de financement.
Les questions devront porter sur une ou plusieurs des qualités
exigées d’une bonne politique : la cohérence entre les différents objectifs
et entre les moyens juridiques, humains et financiers mis en oeuvre et ces
objectifs ; la réalisation des objectifs, au moyen de la comparaison entre la
situation initiale et l’évolution constatée ; l’efficacité,
c’est-à-dire la mesure des effets propres de la politique, qui peut souvent être
abordée par le biais de la question de savoir ce qui se serait passé en l’absence
de la politique concernée ; l’efficience, sous l’angle du rapport
coût-avantages ou coût-efficacité ; la pertinence, qui consiste à déterminer si
la politique mise en oeuvre est adaptée aux problèmes que l’on veut résoudre.
Les réponses aux questions fournies par les évaluateurs doivent être
aussi objectives et scientifiques que possible, dans le respect de règles de déontologie
qui existent pour ce type d’activité. La règle fondamentale d’une bonne
évaluation est que les chiffres et les faits qui servent de base aux conclusions des
évaluateurs ne soient pas contestables. Mais l’appréciation sur les objectifs des
politiques de l’Etat relève, en revanche, exclusivement du commanditaire.
La mission d’évaluation et de contrôle devra donc, non seulement
piloter les opérations d’évaluation en fixant, le cas échéant l’obligation
de fournir des rapports intermédiaires, mais débattre des résultats et procéder à
l’audition des évaluateurs et, éventuellement, des responsables des politiques
évaluées.
Il reste à déterminer selon quelles modalités sera remplie cette
fonction d’évaluation.
RETOUR SOMMAIRE
3.- Les moyens pour agir
Les fonctions d’évaluation qui viennent d’être décrites
sont de nature à assurer l’information de l’Assemblée pour lui permettre
d’exercer son contrôle sur la politique du gouvernement, dans les conditions
prévues par la Constitution. A ce titre elles entrent dans le champ d’application de
l’article 145 du Règlement de l’Assemblée nationale, relatif au rôle
d’information des commissions permanentes.
Des crédits spécifiques permettant le financement d’opérations
d’évaluation sont, d’ores et déjà, inscrits au budget de fonctionnement de
l’Assemblée nationale.
Si la mission d’évaluation et de contrôle doit jouer le rôle
d’instance d’évaluation et de commanditaire d’évaluation, on aura compris
qu’il ne lui revient évidemment pas de réaliser les évaluations elle-même.
Ce travail requiert le recours à des professionnels de
l’évaluation et l’implication, comme en Grande-Bretagne, de réseaux
d’expertise sectoriels regroupant des universitaires, des professionnels et aussi des
représentants de l’administration déjà chargés de l’évaluation de leurs
propres pratiques, est certainement la meilleure formule. Il serait utile, pour la mise en
oeuvre de ces opérations que notre Assemblée puisse disposer d’une étude sur le
réseau d’offre des opérateurs publics et privés exerçant en France, spécialisés
dans l’évaluation des politiques publiques.
Par ailleurs, la mission d’évaluation et de contrôle pourrait,
pour conduire ces actions, solliciter notamment l’assistance et le concours de la Cour
des comptes, particulièrement pour ce qui touche à la méthode.
La Cour de comptes est une juridiction financière et elle consacre,
comme l’a rappelé devant le groupe de travail son Premier président,
l’essentiel de son activité au contrôle de la régularité des opérations
décrites dans les comptabilités publiques. Toutefois, elle pratique, sur les
collectivités publiques de son ressort, des investigations qui correspondent à un
véritable audit de performance et pourrait sans aucun doute répondre, sur certains
dossiers particuliers, à des demandes de concours de la Commission des finances.
Le Commissariat général du Plan, et notamment son service de
l’évaluation, pourrait également être sollicité.
Compte tenu des besoins spécifiques de la Commission des finances et
de ses missions d’évaluation, le concours du Commissariat général du Plan pourrait
porter sur la préparation du cahier des charges y compris le questionnement, le choix des
opérateurs (cabinets privés ou universitaires) et l’aide au pilotage dans le suivi
très régulier des travaux de l’évaluateur.
Les rapports d’évaluation seraient débattus au sein de la
Commission des finances et complétés par l’audition des gestionnaires et, le cas
échéant, celle des représentants des usagers du service public concernés, selon des
modalités comparables au travail de contrôle, mais avec un objet distinct. Les
rapports complétés par les auditions seraient publiés. Ces travaux, étalés tout
au long de l’année, devraient considérablement enrichir la connaissance des
réalités des services publics et permettre au Parlement de sortir de l’autocensure
qu’il pratique actuellement à l’égard des services votés.
Il restera ensuite à valoriser les résultats obtenus,
normalement en les rendant publics - sous réserve, dans certains cas, de préserver
la confidentialité nécessaire à l’efficacité même de la démarche, ainsi que
l’a souligné, dans son intervention devant le groupe de travail, M. Michel
Charasse, sénateur - mais aussi en les rapprochant des décisions budgétaires à
prendre, par exemple par le vote d’une mesure nouvelle de diminution des crédits, ou
en prenant des initiatives telles que le dépôt d’une proposition de loi ou
l’audition d’un ministre. Quelque chose de vraiment nouveau se produira si les
députés utilisent la connaissance acquise des résultats d’une action politique
comme outil dans la discussion budgétaire, au nom de l’intérêt général
qu’ils représentent.
Enfin, en termes de moyens, il faut retenir la suggestion de
M. Michel Charasse qui considère que la Commission des finances doit pouvoir
accéder aux banques de données informatiques du ministère de l’économie des
finances et de l’industrie, ce qui permettrait le suivi, en temps réel ou presque,
des finances publiques. En tout état de cause, la Commission des finances doit se doter
d’une base de données budgétaires et financières lui permettant de procéder à
ses propres simulations, tant il est vrai que l’information est source de pouvoir.
D.- Une plus grande
volonté de débat démocratique
Le Parlement est le lieu privilégié où il peut être débattu de la
globalité de la dépense publique, où les limites à la tolérance fiscale des
contribuables peuvent s’exprimer et où peuvent se faire les grands arbitrages entre
les catégories de dépenses, la désignation des priorités économiques, mais aussi la
remise en cause des dépenses ou des actions inutiles.
Si les finances publiques donnent le sentiment d’être peu
maîtrisées, c’est en partie en raison de la dispersion des centres de décision, de
leur cloisonnement et de l’opacité de l’ensemble.
L’enchevêtrement des prélèvements et des financements rend
difficile, pour le citoyen, d’identifier les centres de responsabilité et accrédite
l’idée de l’impossibilité d’une régulation politique.
Le Parlement doit s’efforcer de faire progresser la réflexion
collective sur l’action de l’Etat - et, plus généralement, de la sphère
publique - et sur son coût, en développant sa propre capacité d’expertise
pour nourrir le débat public.
1.- Améliorer la transparence
Toutes les interventions de l’Assemblée nationale en matière de
dépense publique doivent être parfaitement lisibles, c’est pourquoi il ne faut pas
multiplier les organismes internes ou externes chargés des différentes actions et
choisir de concentrer les débats et les initiatives au sein des commissions, celles des
finances devant pouvoir s’appuyer sur l’expérience et les travaux des autres
commissions permanentes.
La principale décision en faveur de la transparence consisterait, pour
la Commission des finances à rendre publiques, sauf exception, les auditions
auxquelles elle procédera dans le cadre de ses missions d’évaluation et de
contrôle. L’ouverture à la presse et la retransmission par la chaîne
parlementaire des réunions hebdomadaires au cours desquelles se dérouleront ces
auditions sur des thèmes concernant de très près les rapports de l’Etat et des
citoyens ne manquera pas de relancer le débat démocratique et de rendre irréversible la
réforme de certains modes de gestion publique.
Il conviendra également de publier sous forme de rapports
d’information les résultats de ses actions de contrôle et les conclusions de ses
initiatives d’évaluation.
2.- Renforcer la démocratie
La garantie, grâce au contrôle effectué sous l’impulsion du
Parlement, de la meilleure affectation possible de la dépense publique est un instrument
fondamental de la démocratie, qui ne peut que rendre le plus grand service au
gouvernement, quel qu’il soit.
Cette démarche, pour être crédible et bénéficier d’une
certaine continuité dans le temps, doit faire l’objet d’un large consensus
parmi les parlementaires. Afin de donner toute son ampleur à cette nouvelle approche du
travail parlementaire et aussi de stimuler les initiatives, il serait souhaitable de renforcer,
à cette occasion, les droits de l’opposition.
La coprésidence, par un membre de l’opposition, de la
mission d’évaluation et de contrôle y contribuera.
Il peut, en outre, être facilement envisagé, au moins dans un premier
temps, sur certains budgets et afin de stimuler les actions de contrôle, de faire
collaborer un rapporteur spécial et un rapporteur pour avis, appartenant l’un à la
majorité, l’autre à l’opposition.
En outre, la Conférence des Présidents de l’Assemblée, qui
pourrait décider de consacrer une séance mensuelle de questions au Gouvernement à
l’examen d’une politique publique, à partir des travaux de la mission
d’évaluation et de contrôle et en soumettant le ou les ministres responsables à
une série de questions ciblées.
Enfin, ne pourrait-on envisager que le débat d’orientation
budgétaire soit conclu par le vote d’une loi d’orientation triennale fixant les
principales données financières de l’Etat ?
3.- Concevoir un nouveau rythme d’exercice du
pouvoir financier
Comme on l’a vu, la Commission des finances de l’Assemblée
nationale, doit désormais jouer pleinement son rôle de vérification de la qualité, de
la transparence et de l’efficacité des interventions financières de l’Etat.
Certains pourront regretter que n’ait pas été retenue la
proposition de créer une septième commission permanente spécialisée dans le contrôle
des comptes publics et dans l’évaluation des politiques publiques. L’autorité
dont jouit le Public accounts committee (PAC) au sein de la Chambre des communes
britannique peut en effet donner quelques regrets, étant cependant précisé qu’une
telle réforme nécessiterait de réviser l’article 43 de la Constitution, qui
limite à six, dans chaque assemblée, le nombre des commissions permanentes. Mais la
Commission des finances, sous l’impulsion de son Président et de son Rapporteur
général, dotée de moyens renforcés et appuyée sur l’expérience des rapporteurs
pour avis des autres commissions, doit pouvoir remplir un rôle comparable, si elle
concentre ses efforts sur les nouveaux temps forts de l’examen des finances
publiques.
Afin d’afficher clairement cette volonté, il est proposé de
demander à l’Assemblée, par la voie d’une résolution modifiant son
Règlement, le changement d’appellation de la Commission des finances, de
l’économie générale et du plan en Commission des finances, de
l’économie, du contrôle et de l’évaluation.
La Commission doit également adopter un nouveau calendrier de
travail annuel, rythmé par les deux nouvelles grandes phases du travail budgétaire
de l’Assemblée.
La première phase se déroulerait de janvier à juin et concernerait
le contrôle des comptes et l’évaluation des résultats d’un certain
nombre de politiques publiques, avec notamment les auditions nécessaires. Cette phase
se conclurait, à l’automne, par l’examen et le vote de la loi de règlement du
budget exécuté au cours de l’année précédente (n-1), éclairée par le rapport
de la Cour des comptes sur l’exécution des lois de finances, dans le cadre
d’une discussion commune avec le projet de loi de finances de l’année (n+1).
La seconde phase débuterait avec l’examen en commission de la programmation
triennale des finances publiques et se poursuivrait, en séance publique, par le débat
d’orientation budgétaire. Ce débat aurait été préparé en amont par la
Commission des finances sur la base des rapports et des simulations précédemment
évoqués et des auditions correspondantes. Cette phase s’achèverait par
l’examen et l’adoption de la loi de finances de l’année à venir, qui doit
être l’aboutissement de tous les travaux antérieurs.
L’examen des fascicules budgétaires se déroulerait au
sein des commissions saisies pour avis. Les débats auraient lieu en présence des
ministres et s’appuieraient sur les rapports des rapporteurs spéciaux et pour avis.
Ils seraient ouverts à la presse, nationale et régionale, et donneraient lieu à un
compte rendu au Journal officiel.
Une telle réforme, compte tenu du bouleversement qu’elle
entraîne des habitudes anciennes, peut être mise en œuvre de façon progressive.
Elle pourrait être engagée dès l’automne prochain, à titre expérimental, sur un
nombre limité de budgets.
Elle ne doit pas, non plus, se traduire par une réduction par rapport
au système actuel, de la possibilité, pour les députés, de questionner le
Gouvernement. Aussi pourrait-il être envisagé, outre les questions que les députés
posent oralement au ministre au cours de son audition par la commission saisie pour avis,
que, dans le cadre d’une organisation par groupe analogue à celle prévue pour la
séance publique, les députés puissent poser, à cette occasion, des questions
écrites au ministre concerné. Celui-ci aurait l’obligation de publier sa
réponse au plus tard au moment de la discussion de son budget en séance publique.
Le débat en séance publique, achevant cette deuxième phase, pourrait
être consacré à l’examen des articles de la première partie de la loi de
finances, puis des articles de la deuxième partie, et au vote des crédits, à
l’issue de débats plus resserrés privilégiant l’examen des politiques
publiques, de leurs orientations et de leur efficacité, débats dans lesquels
interviendraient les rapporteurs et un orateur par groupe. L’examen des éventuels
amendements se déroulerait selon les règles habituelles.
Ces évolutions souhaitables, si elles constituent un bouleversement
des habitudes et des mentalités, ne nécessitent que très peu de modifications du
Règlement de l’Assemblée et une unique réforme législative, celle étendant aux
rapporteurs pour avis les pouvoirs de contrôle des rapporteurs spéciaux.
Une forte volonté politique de la part de l’ensemble des
parlementaires, un peu d’audace et de disponibilité, devraient permettre de faire
apparaître le Parlement comme le véritable garant de la bonne gestion de la dépense
publique et de sa légitimité.
Limité, comme pratiquement tous les parlements étrangers, dans sa
participation à la confection de la loi de finances, le Parlement doit exercer tous ses
pouvoirs pour débattre des grands choix économiques et financiers, des domaines
d’intervention publique, et contrôler les résultats des dépenses. Si le Parlement
sait valoriser cette connaissance qu’il aura du fonctionnement des services publics,
il en résultera inévitablement un changement dans les comportements, notamment de
l’administration, vis à vis des recettes et des dépenses de l’Etat, comme cela
s’est passé dans de nombreux pays voisins.
Il est probable que cette impulsion contribuera à rendre inéluctable
la mise en chantier de réformes plus profondes, qui touchent au coeur même du
fonctionnement de l’Etat.
II.- l’urgence
de la rÉnovation
du fonctionnement de l’État
A.- La réforme introuvable ?
La réforme en profondeur du fonctionnement de l’Etat peut être
une source d’économie et il va de soi qu’elle ne saurait se résumer à la
seule question des effectifs de la fonction publique.
1.- Un état des lieux complet effectué en 1994
L’amélioration de l’efficacité de l’Etat français,
qui nécessite une meilleure définition de ses objectifs et la modernisation de ses
structures et de sa gestion, est à l’ordre du jour depuis de nombreuses années.
Dans cette perspective, le Premier ministre a confié le 8 novembre 1993 à une mission de
réflexion présidée par M Jean Picq, conseiller-maître à la Cour des comptes, le soin
de faire un bilan et des propositions.
Ce travail a donné lieu à la publication en mai 1994, d’un
rapport () très complet dont de nombreux aspects ont été repris devant
le groupe de travail par M. Jean Picq, qui a souligné que la mise en oeuvre de ses
propositions restait, pour l’essentiel, à faire.
On reviendra ici sur les principaux éléments des réformes
proposées, aux fortes répercussions en termes de maîtrise des dépenses publiques, pour
la mise en œuvre desquelles le Parlement pourrait jouer le rôle d’un aiguillon
puissant.
a) Achever la décentralisation
Trois aspects de la décentralisation doivent être rapidement
améliorés : en premier lieu, la confusion entre la décentralisation par matière
(l’urbanisme aux communes, les affaires sociales aux départements, la formation
professionnelle aux régions...) et la décentralisation par niveau (les collèges aux
départements, les lycées aux régions) ; ensuite, l’absence de délimitation
précise des compétences propres à chaque collectivité et, en conséquence, interdites
aux autres ; enfin, les mécanismes des finances locales, caractérisées par une
proportion excessive de dépenses financée par l’Etat, ce qui ne contribue pas à la
responsabilisation des acteurs locaux.
Ces trois éléments réunis expliquent l’enchevêtrement des
compétences, la multiplication des financements croisés et l’opacité générale du
fonctionnement du système. Ces cofinancements compliquent les procédures et favorisent
l’irresponsabilité, chaque partenaire renvoyant sur l’autre les raisons des
échecs et des dérapages financiers.
A ces défauts, s’ajoute le nombre excessif de niveaux
d’administration. Aucune des collectivités publiques ne paraît capable de résoudre
les problèmes d’aujourd’hui : la commune est souvent trop petite, le
département trop uniforme et la région rarement de taille européenne. La nécessaire
coopération intercommunale ou la mise en place de communautés urbaines ont encore des
effets limités et, en l’état, contribuent fréquemment un peu plus à compliquer
l’ensemble. Il y a, à l’évidence, un niveau de trop.
Le rapport de la " mission Picq " présentait trois
propositions de réformes qu’il estimait urgent d’engager :
– Légiférer sur les compétences locales, afin
de fixer de manière limitative les compétences de chaque collectivité publique, en
distinguant les compétences obligatoires et les compétences facultatives, le reste leur
étant interdit. La collaboration de différentes collectivités publiques devait, selon
le rapport, rester possible, mais encadrée dans des limites précises. Les
responsabilités de chacun devaient ainsi devenir plus claires pour les citoyens.
– Limiter les cofinancements : la clarification des
compétences devrait, selon M. Jean Picq, permettre de définir une collectivité
" chef de file " dans chaque domaine d’intervention publique. Les
différentes collectivités publiques devaient ainsi pouvoir déterminer au sein de chaque
région le programme des investissements selon une procédure contractuelle triennale
(Etat, régions, départements et principales communes), ce programme comportant la liste
des investissements jugés prioritaires localement.
– Expérimenter les politiques publiques : le rapport
présenté en 1994 appelait l’Etat à tirer avantage de l’existence de
collectivités locales entreprenantes pour engager autrement les nouvelles politiques
publiques. Moyennant quelques précautions juridiques, la décentralisation peut fournir
l’occasion d’expérimenter des programmes nouveaux avant de les généraliser.
L’expérimentation du revenu minimum d’insertion en Ille-et-Vilaine a permis
d’améliorer le projet avant son extension nationale. Un recours accru à
l’expérimentation permettrait de mieux prendre en compte la diversité des
situations sur le territoire et de d’éviter, quand c’est possible, une mise en
oeuvre uniforme des politiques publiques qui paraît de moins en moins adaptée
aujourd’hui.
Dans un ordre d’idée très proche, le rapport concluait que
l’Etat doit tirer toutes les conséquences qui découlent des transferts de
compétences effectués en direction de l’Union européenne au fur et à mesure
de leur réalisation.
Lorsque des compétences dans différents domaines d’action sont
ainsi transférées à l’échelon européen (la politique agricole, la politique
commerciale, l’environnement, la recherche, la monnaie, aujourd’hui, bientôt
l’immigration et la sécurité intérieure et probablement, un jour, la défense),
l’Etat doit réduire d’autant ses propres interventions et services de gestion
centraux et déconcentrés. Là encore, la juxtaposition des compétences est, selon M.
Jean Picq, source de confusion et de dépenses inutiles.
b) Renforcer le débat public et prévenir les difficultés
Gérer sous la pression des crises sociales ou économiques constitue
un sérieux reproche que l’on peut adresser à un Etat, car le coût d’une telle
approche est généralement considérable pour les finances publiques.
La complexité et la mobilité de la société rendent plus difficiles,
mais bien plus impératives que par le passé, l’analyse prospective et la démarche
prévisionnelle, qui devraient devenir des fonctions majeures de l’Etat.
Les moyens existent, mais ils mériteraient d’être ranimés.
Une communication du ministre de la fonction publique, de la réforme
de l’Etat et de la décentralisation, au Conseil des ministres le 5 novembre
1997, est encourageante ; elle préconise ainsi : " chaque
département ministériel devra se doter d’une mission de prospective et participer
à des programmes de recherche sur la gestion publique et diffuser leurs résultats ".
C’est en tout cas une première réponse aux propositions du rapport de M. Jean
Picq.
Il convient également de remobiliser dans cette démarche prospective
et d’anticipation, le Commissariat général du Plan qui, comme on l’a vu, est
par ailleurs investi de nouvelles tâches en matière d’évaluation.
Mais l’essentiel est de sortir ces analyses prospectives (études
démographiques, évolutions des différents secteurs économiques, mutations
industrielles, retombées de découvertes scientifiques, évolution du travail..) de
l’ombre et du secret dans lesquels on les tient trop souvent.
L’Etat doit organiser le débat public autour des résultats des
travaux des experts et des spécialistes, qui, sans remplacer la fonction centrale du
Parlement, pourraient prendre plus souvent la forme de Livres blancs, puisque ceux,
peu nombreux, qui ont été présentés en France, ont démontré leur impact (livres
blancs sur la défense et sur les retraites, par exemple).
Le Parlement doit évidemment trouver toute sa place dans cette
réflexion et c’est en particulier au moment du débat sur la programmation triennale
des finances publiques que ces études pourraient être exploitées.
Les objectifs fixés dans la programmation budgétaire seraient liés
aux besoins et aux prévisions mis en lumière par les débats. La discussion
parlementaire permettrait d’en discuter et surtout de
" sanctuariser " les objectifs et les engagements, de telle sorte que
les politiques appliquées ensuite puissent être jugées à l’aune de ceux-ci.
c) Légiférer avec mesure
L’inflation législative est unanimement dénoncée ; le
déficit d’évaluation de l’existant et de prise en compte des résultats
antérieurs en est une cause majeure.
Un progrès réel devrait être réalisé, si la généralisation des
études d’impact annoncée dans la circulaire du 26 janvier 1998, y compris pour les
lois de finances et les lois de financement de la sécurité sociale, se met en place de
façon satisfaisante.
Il appartient au Parlement de veiller au respect scrupuleux de
l’obligation de fournir ces études d’impact en annexe aux projets de loi et
surtout à la qualité de leur contenu, qui doit, notamment, éclairer le législateur sur
l’intérêt de modifier le droit existant et sur l’adéquation entre les
objectifs, quantifiés ou non, et les moyens proposés.
2.- Une réforme en permanente gestation
Comment passer des déclarations d’intention aux actes, telle est
l’interrogation qui s’impose, en particulier, depuis la parution du rapport sur
la réforme de l’Etat en 1994. Toutes les déclarations officielles s’en
inspirent, mais les mesures concrètes sont encore trop peu nombreuses.
Une première tentative avait été engagée avec la circulaire du
Premier ministre en date du 26 juillet 1995 relative à la préparation et à la mise en
oeuvre de la réforme de l’Etat et des services publics. La circulaire a été suivie
d’un décret (), modifié en 1998.
On se limitera ici aux aspects de la réforme en rapport direct avec
l’objet des réflexions du groupe de travail.
Le Premier ministre avait fixé, en 1995, cinq objectifs prioritaires
et il paraît utile de revenir sur trois d’entre eux : tout d’abord,
clarifier les missions de l’Etat par rapport à celles des autres acteurs publics et
à celles qui doivent relever du secteur privé (marché ou secteur associatif) ;
ensuite, réduire au maximum les tâches de gestion exercées au niveau central, pour les
transférer vers les services déconcentrés, et légiférer moins ; enfin, rénover la
gestion publique, ce qui implique la modernisation des procédures financières et des
règles de comptabilité publique, l’amélioration de la procédure budgétaire, avec
une meilleure information fournie au Parlement et une meilleure lisibilité de la dépense
publique, la publication trimestrielle de la situation des comptes de l’Etat et de la
sécurité sociale (ce qui a été réalisé) et la révision des modalités de la
régulation budgétaire.
La circulaire précisait également : " L’Etat
veillera à mieux gérer son patrimoine et à cette fin sera créé un organisme
chargé des affaires foncières et immobilières de l’Etat qui aura notamment pour
mission de mettre en place une véritable comptabilité patrimoniale de l’Etat ".
Le décret du 13 septembre 1995 avait créé, pour une durée de trois
ans, un comité interministériel pour la réforme de l’Etat et un commissariat à la
réforme de l’Etat.
Le 29 mai 1996, le comité interministériel a publié 105 orientations
et décisions dont le groupe de travail n’a pu que constater, tout au long des
auditions qu’il a réalisées, que la plupart en sont encore à l’état
d’ébauches ou de projets, en tout cas dans les secteurs qui nous occupent, et tout
particulièrement en ce qui concerne la modernisation des outils de connaissance du
patrimoine de l’Etat.
M. Jean Picq a sans doute raison lorsqu’il indique que
l’association du Parlement à ces réformes est la clé de la réussite. En tout cas,
on doit déplorer la cruelle absence du Parlement comme interlocuteur dans la phase de
préparation des orientations définies en 1995.
Le 5 novembre 1997, le ministre de la fonction publique, de la réforme
de l’Etat et de la décentralisation, a présenté en Conseil des ministres son
programme de réformes en indiquant qu’il fallait prendre en compte les mesures
adoptées au cours des dernières années, mais en changeant résolument de méthode.
Le décret du 8 juillet 1998 (), a remplacé le
commissariat à la réforme de l’Etat par une délégation interministérielle à
la réforme de l’Etat. Le comité interministériel pour la réforme de
l’Etat, chargé de fixer les orientations de la politique gouvernementale, a été
prorogé.
Un arrêté du Premier ministre, en date du 13 juillet 1998, met en
place les différentes missions dont est chargée la délégation interministérielle à
la réforme de l’Etat. Parmi ces missions figure celle qui vise à contribuer à
la rénovation des instruments et des méthodes de la gestion du patrimoine de
l’Etat.
Cet objectif, comme en 1995, figure en bonne place dans le programme de
réforme de l’Etat, au titre de la modernisation de la gestion publique.
Sous cette rubrique, le plan de réforme du 5 novembre 1997 prévoit
plusieurs domaines, qui doivent particulièrement retenir l’attention de
l’Assemblée nationale dans sa propre démarche rénovatrice.
L’amélioration de la gestion publique, pour laquelle, chaque
ministère devait, dans un délai de douze mois, présenter un plan pluriannuel de
réalisations, passe tout d’abord par l’établissement de contrats fixant
pour chaque ministère l’évolution de ses crédits de fonctionnement et de ses
effectifs sur plusieurs années.
Ensuite, il s’agit de poursuivre l’étude de la modernisation
du système budgétaire et comptable en vue d’une connaissance du coût complet
des services.
L’adaptation de la nomenclature budgétaire est nécessaire,
afin de regrouper les crédits autour des grandes politiques publiques et pour identifier
clairement les chapitres déconcentrés.
Un programme de modernisation de la gestion du patrimoine immobilier
de l’Etat est arrêté, afin d’améliorer la gestion du premier
propriétaire immobilier de France.
Enfin, l’Etat doit se doter d’un système de comptabilité
patrimoniale.
Avant d’examiner pour quelles raisons la politique patrimoniale de
l’Etat est un instrument indispensable à une gestion publique moderne et
respectueuse des intérêts des contribuables, votre Rapporteur suggère, afin de faire
jouer au Parlement son rôle dans ce vaste champ de réformes et d’éviter leur
enlisement, que la Commission des finances procède très prochainement à
l’audition du ministre de la fonction publique, de la réforme de l’Etat et de
la décentralisation ainsi que du délégué interministériel à la réforme de
l’Etat, afin de faire le point avec eux sur l’avancement de
ces différents chantiers, quatorze mois après leur lancement. Le sentiment est, en
effet, que les gouvernements successifs ont beaucoup glosé sur ces thèmes, mais que,
concrètement, peu de choses avancent.
3.- La politique patrimoniale de l’État au
coeur de la réforme
Il a été indiqué à plusieurs reprises, devant le groupe de travail,
que l’Etat ne serait pas en mesure de connaître précisément le montant réel de sa
dette ni le contenu et la valeur de ses actifs.
Il convient donc tout d’abord de répertorier le contenu et la
qualité des informations financières et comptables disponibles, avant de tracer quelques
pistes d’amélioration.
a) Prendre la mesure de l’insuffisance des informations
financières et comptables disponibles
L’impératif de maîtrise des finances publiques rend
indispensable une gestion plus performante du patrimoine de l’Etat, mais la première
difficulté apparaît lorsque l’on constate que sa consistance et sa valeur exacte ne
figurent dans aucun compte de la Nation.
Une évaluation de l’INSEE, réalisée en 1992, estime à
5.700 milliards de francs la valeur brute du patrimoine de l’ensemble des
administrations publiques. Toutefois cette évaluation, unique en son genre, exclut de
très nombreux biens difficilement estimables.
Le passif de l’Etat se décompose, pour sa part, en une dette
financière, négociable (obligations du Trésor, bons en comptes courants) ou non
négociable (bons du Trésor et emprunts à court terme, engagements de l’Etat), et
une dette non financière (correspondants du Trésor et créditeurs divers). Mais il faut
y ajouter la dette gérée pour le compte de tiers, comme c’est le cas des emprunts
de l’ancien budget annexe des postes et télécommunications.
Deux questions majeures sont aujourd’hui à prendre en
compte : une exigence de sincérité de la présentation de la situation financière
de l’Etat et une optimisation de la gestion de la dette. Cette double orientation ne
constitue pas seulement une priorité démocratique mais aussi économique, dans la mesure
où une part substantielle de la dette est négociée sur le marché mondial, de plus en
plus exigeant en matière d’informations et de transparence.
De surcroît, la sincérité de la présentation de la situation
financière des Etats membres de l’Union européenne est surveillée par les
institutions européennes, notamment en ce qui concerne la dette et le besoin de
financement annuel.
Enfin, ce besoin de transparence est apparu aux yeux de l’opinion
à l’occasion des pertes massives du Crédit lyonnais et des débats sur la reprise
de la dette de la SNCF.
Le règlement général de la comptabilité publique du 29 décembre
1962 assigne, outre la connaissance et le contrôle des opérations budgétaires et de
trésorerie, plusieurs finalités d’ordre patrimonial à la comptabilité publique,
comme la connaissance de la situation du patrimoine, le calcul du prix de revient, du
coût et du rendement des services. Mais, en réalité, la comptabilité de l’Etat
demeure essentiellement une comptabilité de caisse, au détriment de la logique
patrimoniale.
t Dépasser la
comptabilité de caisse
L’article 16 de l’ordonnance organique du 2 janvier 1959
oriente la comptabilité publique essentiellement vers la vérification de la conformité
de l’exécution du budget aux autorisations de dépenses contenues dans la loi de
finances. Toutefois, depuis 1970, une comptabilité patrimoniale a été mise en place,
qui permet de décrire, de façon cependant non exhaustive, des éléments de l’actif
et du passif de l’Etat (les participations financières, les immobilisations
corporelles et la dette principalement). Mais cette comptabilité patrimoniale est peu
fidèle et, surtout, découplée des enjeux budgétaires, elle n’a qu’une faible
portée opérationnelle.
t Une description des
postes d’actifs peu opérationnelle
Deux reproches principaux sont le plus souvent exprimés.
Les participations financières de l’Etat, telles qu’elles
sont retracées dans la comptabilité générale de l’Etat (CGE), sont réévaluées
annuellement en prenant en compte la situation nette comptable de l’entreprise au
prorata du pourcentage du capital détenu par l’Etat. La valeur retenue s’appuie
sur le dernier bilan connu de l’entreprise et il en résulte un décalage entre la
valeur de marché de la participation et celle purement comptable qui apparaît au bilan
de l’Etat. Ainsi, au moment de la privatisation de quatre grandes sociétés en 1993,
un écart positif de 25% entre leur valeur de marché et leur valeur au bilan de
l’Etat a été mis en évidence.
En second lieu, l’absence de consolidation des participations
financières ne permet pas de donner une vision économique globale du portefeuille de
l’Etat. De plus, certaines participations minoritaires et un grand nombre de
dotations ne sont pas comptabilisées.
Les immobilisations non financières ne sont pas beaucoup mieux
recensées. Aucun document ne réalise l’agrégation des biens immobiliers et de leur
valeur vénale, ni ne calcule les ratios d’entretien ou de maintenance.
t Une dette
sous-évaluée
La dette financière de l’Etat ne représente pas la totalité des
engagements de long terme de l’Etat.
Il existe de nombreuses charges de long terme dont l’Etat
s’acquitte en vertu d’obligations juridiques ou politiques qui ne sont pas
reprises en comptabilité. Il s’agit principalement des charges induites par le
régime des pensions des fonctionnaires de l’Etat, mais l’Etat garantit
également la dette de nombreux organismes. Ces engagements sont très partiellement
recensés dans les annexes hors bilan de l’Etat et n’apparaissent pas dans son
bilan.
La question n’est pas de demander à l’Etat, à l’instar
des entreprises, de provisionner toutes ses obligations, ne serait-ce que parce qu’il
garde la possibilité de revenir sur certaines d’entre elles en vertu de ses
prérogatives de puissance publique. Certaines formes de provisionnement ont cependant
été prévues par l’ordonnance de 1959, sous la forme de " chapitres
réservoirs " comme les " crédits pour dépenses éventuelles,
urgentes et imprévues ". Mais ces réserves, d’ampleur limitée, mises à
part, l’Etat pratique une politique de provisionnement minimal, alors que le
principe de sincérité budgétaire milite pour qu’apparaissent, à la lecture du
bilan de l’Etat, les causes d’éventuels déséquilibres futurs.
Il est, en l’état, difficile de connaître l’évolution
de la situation nette de l’Etat et de savoir dans quelle mesure ses dépenses
sont financées par l’impôt, les recettes non fiscales ou par la dette.
L’Etat ne s’intéresse pas beaucoup non plus à la rentabilité de ses actifs,
et les finances publiques sont jugées à l’aune des seuls ratios de la dette ou du
déficit rapportés au PIB.
b) Vers une modernisation de la comptabilité
et une rénovation de la gestion
Face à ce constat d’une politique patrimoniale de niveau
embryonnaire, les perspectives de réformes doivent s’orienter vers la modernisation
de la comptabilité et la rénovation de la gestion.
Au préalable, on constate une nouvelle fois que la règle de
l’annualité budgétaire, qui privilégie le court terme et incite à reporter le
plus tard possible, par exemple, les charges d’entretien des biens immobiliers, avec
les dégradations qui en résultent, ou le paiement des fournisseurs, ce qui peut
entraîner des agios extrêmement importants, rend difficile une politique patrimoniale
efficace.
La modernisation de la gestion des administrations nécessite que ces
dernières soit véritablement gérées, notamment au moyen de la définition
d’objectifs. Il convient donc d’organiser les ministères en ce sens, et on y
sera aidé en instituant, auprès de chaque ministre, un secrétaire général de
l’administration, chargé d’établir le plan stratégique des services et
des centres de responsabilité, de suivre les indicateurs de gestion, d’établir les
rapports annuels et de rendre compte au ministre.
Comme cela a été constaté à d’autres moments du rapport, le
moteur de la réforme doit consister à rapprocher les éléments d’information
que constituerait une comptabilité patrimoniale de l’Etat et les choix budgétaires
qu’elle devra éclairer. En effet, tant que les informations patrimoniales resteront
découplées du processus budgétaire, elles seront délaissées. En revanche,
l’adoption d’une comptabilité en " droits constatés ",
intégrant dans un même exercice budgétaire les dépenses dues mais non encore payées,
aura des répercussions capitales sur la lisibilité et la sincérité de l’ensemble.
Il en résultera nécessairement l’inscription
d’amortissements et de provisions, même à petite échelle, dans les projets de lois
de finances, ce qui renforcera l’approche pluriannuelle des engagements budgétaires
et permettra d’élargir l’horizon temporel du Parlement, mais aussi des
gestionnaires.
Comment opérer ce rapprochement ?
La programmation budgétaire triennale avec constitution d’un
" budget glissant " à l’intérieur de la période, souhaitée
par ailleurs, trouve, ici aussi, son plein intérêt. Mais une condition doit s’y
ajouter : cette prévision glissante devrait contenir les projections de
l’évolution mécanique sur trois ans, des charges et des recettes de l’Etat,
alors que de telles informations sont aujourd’hui limitées à l’usage interne
de la direction du budget. Il en irait ainsi, en particulier, pour toutes les mesures
nouvelles proposées.
Deux autres types d’informations devraient venir éclairer le
débat budgétaire, sous forme d’annexes par exemple.
Tout d’abord une information sur les engagements hors bilan.
Elle évaluerait de manière synthétique les engagements financiers, à législation
inchangée, et mettrait, le cas échéant, en évidence les risques de déséquilibres
financiers futurs.
Ces informations devraient concerner trois grandes rubriques : les
engagements sociaux, essentiellement les retraites, les engagements financiers (gestion de
la dette) et, enfin les garanties assurantielles (assurance en responsabilité de
l’Etat, assurance-crédit à l’exportation).
En second lieu une information sur les participations de l’Etat
est nécessaire. Il s’agirait de récapituler l’évolution en valeur de ces
participations, de recenser les engagements de l’Etat avec un bilan des
recapitalisations accordées et un plan indicatif des cessions et des recapitalisations
envisagées au cours des trois années à venir.
Une approche triennale des dépenses, le développement de la
comptabilité patrimoniale et la systématisation des contrôles et de l’évaluation
de la gestion publique devraient permettre de constituer une sorte de tableau de bord pour
les responsables des administrations et faire évoluer leur gestion.
Mais la dynamisation de la gestion mobilière et immobilière et le
développement des contrôles ne suffiront pas : conformément à ce qui a été
évoqué à plusieurs reprises devant le groupe de travail, il faut davantage intéresser
les fonctionnaires à agir dans le sens d’une meilleure gestion.
La contrepartie du renforcement des contrôles et des responsabilités
face aux résultats d’évaluation doit être une plus grande liberté d’action
pour les gestionnaires et la possibilité de tirer avantage des économies réalisées.
Un mécanisme d’intéressement budgétaire des grandes directions
ministérielles et des services déconcentrés doit être défini, sous forme de contrats
pluriannuels de programmation des dépenses. Cette logique de globalisation des
crédits de fonctionnement devrait même offrir des possibilités de redéploiements
des dépenses et de reports des crédits économisés sur des postes différents.
Mais leurs outils de gestion doivent également être rendus plus
efficaces par l’allégement des contraintes juridiques, en particulier celles
relatives à la gestion des biens immobiliers (possibilité de choix entre crédit-bail,
achat ou location de biens) et à la gestion des effectifs (choix des contrats,
redéploiements...).
Enfin, comme il a été également suggéré, notamment, par
M. Michel Bon, Président de France Télécom et ancien dirigeant de l’Agence
nationale pour l’emploi, des échanges d’expériences et de bonnes pratiques
entre les ministères mais aussi avec des administrations étrangères et même avec le
secteur privé, doivent être généralisés.
L’introduction de ces innovations, en particulier le passage à
une comptabilité en droits constatés, soulève de nombreux obstacles et nécessite des
modifications importantes de l’ordonnance organique. Il faudra sans doute procéder
par étape et encore une fois compter sur la mise en mouvement du Parlement dans ses
fonctions de contrôle et d’évaluation pour rendre indispensables ces réformes.
La réforme de l’État a notamment pour finalité de promouvoir
une efficacité accrue de la dépense publique. Elle ne doit donc pas être menée sans
aborder la question de la procédure budgétaire ; elle doit, à cet égard,
déboucher sur une profonde remise en cause de nos méthodes d’examen du projet de
loi de finances.
B.- Une
procédure budgétaire rénovée, au service d’une efficacité accrue de la dépense
publique
Notre procédure budgétaire souffre, en effet, comme on l’a vu,
de deux lacunes majeures.
D’abord, elle ne permet pas au Parlement de se prononcer sur les
enjeux stratégiques de nos finances publiques. Le Parlement n’appréhende pas, dans
sa globalité, la dépense publique et n’est pas en mesure de se prononcer sur ses
perspectives d’évolution. Il est, à cet égard, révélateur que les contraintes
pesant désormais sur les finances publiques françaises aient été introduites par le
biais des institutions communautaires, qu’il s’agisse de la discipline imposée
par le traité de Maastricht et par le Pacte de stabilité et de croissance, avec
l’élaboration de perspectives triennales d’évolution du déficit et de la
dette publique, ainsi que des prélèvements obligatoires.
Ensuite, notre procédure budgétaire ne permet pas d’appréhender
la dépense publique en termes d’efficacité. Elle reste enfermée dans une logique
privilégiant les dépenses, et non les résultats. Outre l’absence de lisibilité
des politiques publiques, il en résulte une déresponsabilisation des administrations,
qui, sous réserve de respecter les règles comptables, n’ont finalement guère de
compte à rendre quant à l’efficacité des dépenses effectuées. Or, la période
actuelle, marquée par la raréfaction des ressources publiques, impose de sortir de cette
logique, en " changeant les règles du jeu ".
C’est vers ces deux objectifs – appréhension des enjeux
stratégiques des finances publiques et évaluation de l’efficacité de la dépense
publique – que tendent les conclusions de notre groupe de travail relatives à
la réforme, à terme, de notre procédure budgétaire.
1.- Remédier au défaut de transparence de notre
procédure budgétaire
Afin de permettre au Parlement de se
" réapproprier " les finances publiques, il convient
d’améliorer sensiblement la transparence de notre procédure budgétaire. Cette
notion de transparence recouvre deux aspects : d’une part, la lisibilité des
finances publiques et, d’autre part, la sincérité des comptes publics.
a) Renforcer la lisibilité des finances publiques
Comme votre Rapporteur l’a précédemment souligné, le Parlement
reçoit une masse d’informations considérable de la part du Gouvernement et des
diverses institutions publiques. Toutefois, ces données ne permettent pas à la
représentation nationale d’appréhender les véritables enjeux inhérents à
l’évolution de nos finances publiques. Aussi, ces informations devraient-elles être
accompagnées de documents de synthèse, susceptibles de permettre au Parlement de se
prononcer, de manière pertinente, en intégrant les contraintes macro-financières
encadrant les politiques publiques.
t A l’occasion du
débat d’orientation budgétaire
- Une consolidation des comptes publics
– Il conviendrait, en premier lieu, que le Parlement puisse
disposer d’une présentation consolidée des comptes publics, c’est-à-dire
des comptes de l’Etat et de ses établissements publics, des comptes des
collectivités locales et des comptes sociaux.
Rappelons, en effet, que la prise en compte des seules dépenses de
l’Etat, comme le souligne le tableau ci-joint, ne permet plus de juger de la
réalité de la dépense publique. Les dépenses effectuées par les collectivités
locales ou via les comptes sociaux représentent une part croissante des
interventions de la sphère publique. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle
les institutions communautaires raisonnent désormais en termes de dépenses des
administrations publiques, et non plus simplement sur la seule base des dépenses de
l’Etat.
LA PART DES DÉPENSES
PUBLIQUES DANS LE PIB*
(en % du PIB) |
| |
1987 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
Etat |
22,1 |
21,9 |
21,4 |
21,4 |
21,1 |
Organismes divers d’administration
centrale |
3,3 |
4,0 |
4,1 |
3,6 |
3,4 |
Administrations publiques locales |
9,5 |
10,5 |
10,5 |
10,4 |
10,4 |
Administrations de sécurité sociale |
22,5 |
24,2 |
24,3 |
24,7 |
24,6 |
Administrations publiques (1) |
51,7 |
54,8 |
54,6 |
55,2 |
54,7 |
(1) Le total des
administrations publiques est supérieur à la somme de ses composantes en raison des
opérations de consolidation.
* Les dépenses publiques ne comprennent pas la 4ème ressource
(R 671), comptabilisée en déductions de recettes.
Source : Comptes de la Nation 1997, INSEE - Direction de la
Prévision - publiés dans " Les comptes des administrations publiques en
1997 ", n° 581 - avril 1998. |
Relevons, par ailleurs, que la dynamique des dépenses sociales est
telle qu’elle se traduit par un enchevêtrement croissant entre les prélèvements
sociaux et ceux opérés au profit de l’Etat. Cette situation impose, par
conséquent, de recourir également à une consolidation au niveau des prélèvements.
– En corollaire de cette exigence, le Parlement devrait être
destinataire d’un bilan et d’un hors-bilan de l’Etat et des entreprises
publiques, accompagné de projections à trois ou cinq ans, dès lors que les mesures
qu’appelle, à cet égard, la réforme de l’Etat permettront d’appréhender
les masses en jeu.
Ce document devrait permettre de mesurer les engagements à long terme
de l’Etat, notamment en matière de retraites de la fonction publique et de dette
publique, et d’évaluer les actifs de l’Etat, particulièrement dans le domaine
immobilier. Le Parlement disposerait ainsi d’une analyse globale et à long terme des
comptes de l’Etat lui permettant de prévoir les évolutions liées à ses
engagements à long terme, sur la base d’un débat transparent et démocratique.
Soulignons, également, la nécessité de mettre en oeuvre une approche
identique pour les entreprises publiques. Il est, à l’heure actuelle, impossible de
déterminer si l’Etat s’appauvrit ou s’enrichit du fait de ses
participations. Rappelons, à cet égard, que la loi portant diverses dispositions
d’ordre économique et financier de 1994 () prévoit, d’ores et
déjà, la publication des comptes consolidés des entreprises publiques, lesquels
comprennent leurs engagements hors bilan. Si quatre rapports ont déjà été déposés à
ce titre, ils ne permettent pas d’appréhender la situation d’ensemble des
entreprises publiques, car la consolidation est, pour l’essentiel, présentée
entreprise par entreprise, les informations globales restant insuffisamment développées.
- Des projections pluriannuelles des dépenses de l’Etat par fonction
Cette présentation des comptes publics devra être complétée par des
projections pluriannuelles, présentées par le Gouvernement au moment du débat
d’orientation budgétaire.
Cette démarche est, d’ores et déjà, engagée pour les
" grands soldes " de nos finances publiques. Les dispositions du Pacte
communautaire de stabilité et de croissance prévoient, en effet, que chaque Etat membre
présente, à ses partenaires, des projections triennales en matière de dette publique,
de déficit public et de prélèvements obligatoires.
Il conviendrait de compléter ces documents par des projections en
matière de dépenses et de recettes, afin de sortir du cadre strictement annuel de notre
procédure budgétaire. Celui-ci peut constituer, en effet, un obstacle à la lisibilité
des politiques publiques. Des projections pluriannuelles présenteraient, par ailleurs,
l’intérêt de permettre un débat sur le niveau de la dépense publique et les
moyens alloués aux grandes politiques.
A cette fin, ces projections devraient présenter des profils maxima de
dépense publique, détaillant les dépenses de l’Etat, les dépenses sociales et
celles des collectivités locales. Les dépenses de l’Etat seraient ensuite
ventilées par grandes fonctions, appelées, une fois la réforme de l’Etat devenue
effective, à être détaillées. Ces grandes fonctions évoqueraient, notamment, les
dépenses en faveur :
– des missions régaliennes de l’Etat ;
– de l’économie et de l’emploi ;
– de l’éducation ;
– de l’assistance et à la solidarité sociale ;
– de la protection de l’environnement.
Ces projections pourraient être effectuées soit à un horizon de cinq
ans, ce qui présenterait l’avantage de correspondre à la durée du mandat des
députés, soit à un horizon de trois ans, ce qui paraît plus réaliste, compte tenu de
la difficulté de l’exercice. Elles seraient glissantes, c’est-à-dire
révisables tous les ans, afin de ne pas imposer de carcan rigide au pilotage des finances
publiques.
Cet exercice serait également mis en oeuvre en matière de recettes,
pour chaque catégorie de prélèvement.
Votre Rapporteur soulignera, enfin, la faisabilité de ce projet. La
plupart des pays industrialisés ont, en effet, introduit, dans leur procédure
budgétaire, des projections pluriannuelles, qui leur permettent de
" piloter " à moyen terme leurs finances publiques. Ainsi, à titre
d’exemple, en Allemagne, les documents budgétaires sont complétés par un plan
financier, portant sur une durée de cinq ans, qui précise l’évolution des
dépenses publiques ventilées en une quarantaine de fonctions. La France souffre donc de
graves retards en matière de pluriannualité, qu’il conviendrait de combler au plus
vite.
-
Une présentation des dépenses de l’Etat distinguant dépenses
d’investissement et de fonctionnement
Les documents budgétaires transmis au Parlement ne permettent pas de
donner une dimension stratégique aux débats budgétaires. Les enjeux véritables
n’apparaissent pas.
En revanche, une présentation des comptes de l’Etat
s’inspirant des règles en vigueur pour les collectivités locales et distinguant les
dépenses d’investissement de celles de fonctionnement ferait très clairement
ressortir que les enjeux majeurs de la gestion de nos finances publiques résident dans la
réduction de notre dette publique. Rappelons, en effet, que la seule expérience tentée
en la matière, à savoir le débat d’orientation budgétaire de 1996, soulignait que
la France avait recours à l’emprunt pour financer ses dépenses de fonctionnement et
rembourser sa dette. Autrement dit, les ressources de long terme de l’Etat étaient,
pour l’essentiel, utilisées aux seules fins de " boucler les fins de
mois ". Tout en renouvelant ses précédentes observations sur la nécessité de
dépasser, en ce domaine, l’approche politiquement marquée retenue en 1996, votre
Rapporteur estime nécessaire que le débat puisse prendre en compte cette dimension.
Il importe, en effet, de souligner qu’une présentation des
dépenses de l’Etat selon un tel schéma pourrait permettre de mettre en lumière les
véritables enjeux de l’évolution de nos finances publiques.
Certes, cette approche devra être mise en oeuvre avec finesse. Il
convient, en effet, de prêter la plus grande attention au classement des dépenses,
notamment en matière d’éducation ou de recherche, afin de tenir compte de leurs
incidences économiques.
Sous cette réserve, votre Rapporteur appelle de ses voeux une présentation
des dépenses de l’Etat distinguant dépenses de fonctionnement et dépenses
d’investissement, afin de tendre, à terme, vers une section de fonctionnement en
équilibre, comme cela est la règle pour les collectivités locales ou en Allemagne.
Rappelons, en effet, sur ce point, que l’article 115 de la
loi fondamentale allemande restreint considérablement les possibilités de recours à
l’emprunt, dont " le produit ne peut dépasser le montant des crédits
d’investissement inscrit au budget ". Autrement dit, les ressources de
long terme ne peuvent financer que des dépenses à long terme (). Cette
disposition impose à l’administration allemande de présenter un budget de
fonctionnement en équilibre. Relevons, toutefois, que les responsabilités pesant sur la Bund
sont sensiblement moindres que celles relevant de l’Etat français, notamment en
matière d’éducation, en raison du rôle joué par les Länder.
L’ensemble de ces informations (comptes consolidés, projections
pluriannuelles, présentation des dépenses de l’Etat distinguant dépenses
d’investissement et de fonctionnement) devraient être transmises au Parlement lors
du débat d’orientation budgétaire du printemps.
Les assemblées seraient ainsi en mesure d’évoquer les enjeux
stratégiques liés à l’évolution de nos finances publiques.
t Au cours de la
procédure législative
Cette démarche prospective doit également, à terme, innerver
l’ensemble de la procédure législative.
Celle-ci souffre, en effet, en France, d’être déconnectée de
ses implications budgétaires, le Parlement n’ayant que peu d’éléments pour
évaluer le coût, non seulement pour l’économie, mais également pour le citoyen,
ou en matière environnementale, des lois adoptées.
C’est pourquoi, il convient d’assortir les projets de loi,
soit d’études d’impact pour les textes de nature législative, soit de simulations
lorsqu’il s’agit de projets de réforme fiscale ou touchant aux cotisations
sociales.
- A cette fin, les dispositions de la circulaire du 26 janvier 1998
relative à la généralisation des notes d’impact devront être mises en
oeuvre avec rigueur.
Rappelons que cette circulaire a pour objet " d’évaluer
a priori les effets administratifs, juridiques, sociaux, économiques et budgétaires des
moyens envisagés et de s’assurer, de manière probante, que la totalité de leurs
conséquences a été appréciée préalablement à la décision publique ".
Ces notes d’impact devraient notamment : " faire
le point précis de la législation ou de la réglementation applicable, afin de faire
précisément apparaître la portée des modifications apportées à l’état du droit
et leur adéquation aux objectifs poursuivis ", [...] " faire
apparaître l’impact des nouvelles normes au regard de l’objectif de
simplification administrative et notamment leurs conséquences en terme de formalités
incombant aux entreprises et aux autres catégories d’usagers ", [...]
" [présenter] une analyse globale des appels micro-économiques et
macro-économiques des mesures proposées ", précisant le coût
induit par ces mesures et leurs effets sur l’emploi, [...] " préciser
les conséquences budgétaires des nouvelles dispositions non seulement pour l’Etat,
mais également pour les collectivités locales, les établissements publics, les
entreprises publiques ou les comptes sociaux. ", [...] présenter un " bilan
coût-avantages [...] d’un point de vue quantitatif et qualitatif "
[...], ainsi que les principales mesures alternatives, et comporter, enfin, " un
dispositif de suivi d’évaluation de la mise en oeuvre du texte ". Ces
études d’impact seraient jointes, de manière systématique, à l’ensemble des
projets de loi transmis au Parlement.
Définies de manière ambitieuse, ces notes d’impact répondraient
aux voeux du Parlement. Encore faut-il que la circulaire précitée soit appliquée, et ce
de manière rigoureuse. Relevons, à cet égard, que notre assemblée n’a pour
l’instant noté qu’une concrétisation limitée de ce dispositif.
- Les projets de réforme concernant les prélèvements fiscaux et sociaux
devraient systématiquement faire l’objet de simulations.
Dans un premier temps, celles-ci seraient élaborées par le ministère
des finances, notre assemblée conservant la faculté d’effectuer une
contre-expertise avec ses moyens propres et, le cas échéant, en recourant à un
organisme extérieur. Rappelons, à cet égard, que chaque commission permanente dispose
des crédits budgétaires lui permettant de procéder à de telles études.
A terme, toutefois, il semble nécessaire que la Commission des
finances puisse se doter de ses propres programmes de simulations. A cette fin, il serait
souhaitable, d’une part, qu’elle puisse bénéficier d’un accès direct aux
bases de données fiscales globales du ministère des finances et, d’autre part, de
mettre en place les logiciels permettant, à partir de ces données, d’effectuer de
telles simulations.
Cet effort de transparence, assurant une lisibilité accrue de nos
finances publiques, ne saurait suffire, à lui seul, à redonner au Parlement le rôle qui
doit être le sien en matière budgétaire : il convient également de veiller à ce
que les données qui lui sont transmises soient correctement évaluées.
b) Améliorer la sincérité des comptes publics
La plupart des personnes auditionnées par notre groupe de travail ont
souligné les insuffisances de notre procédure budgétaire. Chaque gouvernement recourt,
en effet, à des degrés divers, à des artifices comptables, afin d’afficher un
déficit public moindre.
t L’indispensable
réforme de l’ordonnance organique
Il serait souhaitable d’introduire des règles strictes de
reddition des comptes publics s’imposant au Gouvernement. A cette fin, un vaste
chantier de réforme de l’ordonnance organique du 2 janvier 1959 est ouvert aux
parlementaires.
L’objet de notre groupe de travail n’était pas de chercher
à retracer, de manière exhaustive, les différents artifices auxquels recourent les
différents gouvernements. Aussi, votre Rapporteur n’abordera-t-il que les
principales lacunes inhérentes aux règles de présentation des comptes publics, telles
qu’elle ont été mises en exergue par les personnalités entendues par le groupe de
travail.
- Notre comptabilité publique enregistre, pour l’essentiel, comme on
l’a vu, des flux de trésorerie. Elle ne permet donc pas d’appréhender les
opérations qui ne sont pas encore dénouées ou les charges futures, liées aux
amortissements des investissements ou aux provisions pour charges à payer.
Aussi serait-il nécessaire d’introduire une comptabilité
d’exercice en droits constatés, rattachant charges et produits à
l’exercice du fait générateur ().
Indiquons, d’ailleurs, que cette réforme est inéluctable :
la directive SEC 1995, relative au nouveau système des comptes européens, vise à
rendre obligatoire, à partir de 1999, les calculs du besoin de financement des
administrations publiques en droits constatés, en sus des mécanismes de comptabilité de
caisse.
- Certaines dotations budgétaires font l’objet de sous-évaluations
chroniques, régulièrement dénoncées par la Cour des comptes. Ceci est notamment le cas
pour certains crédits évaluatifs. Aussi conviendrait-il d’évaluer plus
correctement les différentes dotations budgétaires.
- La distinction introduite entre dépenses budgétaires et
dépenses de trésorerie donne, également, lieu à des opérations visant à réduire
les charges prises en compte par le budget de l’Etat. Ce fut notamment le cas lorsque
l’Etat, prenant en charge une dette importante de 110 milliards de francs de la
sécurité sociale, transforma un mécanisme d’avances à court terme en un prêt à
long terme, dont le montant n’apparaissait pas dans le budget. Aussi conviendrait-il
d’engager une réflexion sur cette distinction, afin de définir avec davantage de
rigueur les opérations de trésorerie.
- En matière de recettes, l’une des critiques la plus fréquemment
émise concerne la procédure des fonds de concours. Les montants des principaux
fonds sont, en effet, connus à l’avance et pris en compte, en interne, par
l’administration dans ses évaluations de recettes. Il serait donc souhaitable que
les montants correspondants soient désormais inscrits en recettes, au moins pour les
fonds de concours supérieurs à 100 millions de francs.
- L’ensemble des ressources n’apparaît pas dans le projet de loi de
finances transmis au Parlement. Ainsi, contrairement aux dispositions de
l’article 31 de l’ordonnance organique, il ne comporte aucune évaluation
" des ressources d’emprunts et de trésorerie ", mais
simplement une autorisation de principe de recourir à l’emprunt. Le Parlement est
ainsi dans l’incapacité de se prononcer sur le niveau d’endettement réel de la
France. Aussi conviendrait-il d’inscrire en loi de finances initiale le montant des
emprunts envisagés, en assortissant ces indications d’informations concernant les
méthodes de gestion de la dette.
Cette réforme doit, non seulement, être mise en oeuvre, mais
également pouvoir faire l’objet de sanctions. L’une des lacunes majeures de
notre procédure budgétaire réside, en effet, dans le fait qu’aucun organe
indépendant ne se prononce, a priori, sur les projets gouvernementaux.
t La consultation
préalable de la Cour des comptes
Aussi conviendrait-il de prévoir qu’un organe impartial soit
saisi, ex-ante, du projet de loi de finances présenté par le Gouvernement. En
raison de ses compétences en matière de contrôle juridictionnel des comptes et de
contrôle administratif de la gestion publique, la Cour des comptes est, selon votre
Rapporteur, l’organe le plus compétent pour émettre un avis sur la sincérité des
projets de loi de finances du Gouvernement. Cette proposition a, d’ailleurs, été
avancée par M. Pierre Joxe, Premier président de la Cour des comptes, au cours de
ses auditions par notre groupe de travail.
La Cour serait ainsi amenée à se prononcer sur la sincérité des
données budgétaires présentées dans le projet de loi de finances.
Cette procédure, par sa seule existence, devrait suffire à prémunir
l’exécutif contre toute tentation de " manipulation " des
comptes publics. Le caractère préventif de la saisine de la Cour des comptes, chargée
d’évaluer ex-ante le projet de loi de finances du Gouvernement, devrait
pouvoir se traduire par une plus grande fiabilité des données présentées.
Au-delà de cette exigence de transparence accrue des finances
publiques, il convient de s’interroger sur les moyens mis à la disposition du
Parlement pour améliorer les performances de la dépense publique. Compte tenu de la
pesanteur qui caractérise notre procédure budgétaire, cet exercice appelle une
rénovation en profondeur de cette dernière.
2.- Améliorer les performances de la dépense
publique
Le niveau atteint par la dette publique, le poids des impôts et des
charges, la raréfaction progressive des ressources publiques et l’absence de marges
de manoeuvre budgétaires nous imposent de modifier la logique même de notre gestion
publique, en privilégiant une logique d’efficacité.
a) Placer le Parlement au coeur du débat sur l’efficacité
de la dépense publique
En raison de sa légitimité, le Parlement doit être au coeur de ce
processus d’évaluation de la dépense publique. Comme l’a souligné
M. Louis Schweitzer, lui seul est, en effet, en mesure d’exprimer, dans la
continuité, les points de vue des différentes forces politiques de notre pays. Pour
autant, cet exercice se révèle particulièrement complexe, tant notre procédure
budgétaire est éloignée d’une logique d’efficience de la dépense publique.
t Une logique
d’objectifs, de résultats et de contrôle
- En l’état actuel de ses modalités de fonctionnement, notre procédure
budgétaire semble, en effet, particulièrement inadaptée à un examen des moyens
alloués à l’Etat au regard de leur efficacité.
L’évaluation de l’efficacité de la dépense publique
suppose, en effet, que des objectifs soient fixés et que les résultats atteints soient
mesurables, afin de déterminer dans quelle mesure ces objectifs sont remplis et à quel
coût.
Or, notre procédure budgétaire reste enfermée dans une logique de
moyens, dispersés entre ministères et non pas répartis par fonction. Par ailleurs, si
les modalités d’examen du projet de loi de finances autorisent la remise en cause de
la dépense publique, la distinction opérée entre services votés et mesures nouvelles
constitue, non pas en droit, mais en fait, un obstacle majeur à cette remise en
cause : l’immobilisme est la règle, l’examen des services votés
l’exception.
L’adoption des services votés par ministère, et non plus
globalement, pourrait contribuer à casser cette logique.
- Cette logique a désormais atteint ses limites. Il semble, désormais,
difficile, compte tenu des économies déjà réalisées, d’aller plus loin dans cet
exercice mécanique. Ce sont donc véritablement les règles du jeu budgétaire qu’il
faut modifier, en réexaminant les missions assignées à l’administration, afin
d’allouer en conséquence les ressources publiques.
- Ce changement impose de fixer des objectifs à l’administration.
A cette fin, il convient de substituer, à terme, à la présentation
budgétaire actuelle par nature de charges ou par destination, une logique de
programmes et d’acteurs, soit au sein d’un ministère, soit au sein de
plusieurs d’entre eux lorsqu’il s’agit de politiques transversales.
Ces programmes feraient l’objet d’une structure
d’objectifs définis en début de législature, et sur lesquels le Parlement
serait appelé à se prononcer. Cette structure, objective et cohérente, comprendrait des
indicateurs de moyens, de résultats et d’objectifs, définis de manière
précise et chiffrée, et appelés à servir de référence au contrôle, a posteriori,
de l’efficacité de la dépense publique. Soulignons que seule une telle structure
est en mesure de déboucher sur le nécessaire triptyque " objectifs,
résultats, contrôle ", en substituant à une logique budgétaire de dépenses
une logique comptable de résultats.
Dès lors, en effet, l’administration serait plus fortement
soumise à une obligation de résultats et placée en situation de rendre compte de son
action, à la fois en termes de coût et de résultat.
Cette responsabilité devrait se traduire, chaque année, par un effort
de la part de l’administration pour rendre compte de son action (à l’image du
" reporting " anglo-saxon), à l’occasion de
l’examen, à l’automne, du projet de loi de finances pour l’année
suivante. Chaque administration présenterait à la représentation nationale un plan
stratégique récapitulant les résultats atteints l’année précédente, le
coût des mesures mises en oeuvre, les objectifs fixés pour l’année suivante,
assortis des moyens requis.
Le Parlement serait ainsi en mesure d’allouer les crédits
budgétaires en prenant en considération la performance des programmes, voire de les
octroyer en fonction d’une hiérarchisation des dépenses publiques.
Afin de permettre une telle évolution, il conviendrait,
s’agissant de la recevabilité financière des initiatives parlementaires,
d’admettre la compensation entre charges, comme c’est déjà le cas en matière
de ressources. Ainsi, il serait possible de " transférer " la
dépense là où elle paraît la plus efficace, à condition de rester dans le cadre
d’une enveloppe constante.
t Une démarche
progressive
- La poursuite de cet objectif constitue une démarche exigeante.
L’administration devra, davantage encore que ce n’est le cas, s’interroger
sur le coût de ses actions et rendre compte de ses résultats.
Par ailleurs, une telle réforme suppose, concrètement, que
l’administration se dote des moyens de mettre en oeuvre une
" budgétisation par objectif ". L’administration devra donc
introduire une comptabilité analytique, afin d’évaluer le coût des actions
entreprises, et se prêter à un contrôle de gestion, destiné à établir un bilan des
actions menées. Or, notre administration souffre, sur ces deux points, de graves retards.
M. Christian Sautter a indiqué, au cours de son intervention, qu’une logique
" objectifs - résultats - contrôle " était, d’ores et déjà,
appliquée en matière d’emploi-jeunes et de logements sociaux à construire. Mais,
ces exemples restent l’exception.
Autrement dit, cette logique d’évaluation permanente de la
dépense publique, qu’appellent de leurs voeux les membres de notre groupe de
travail, doit s’inscrire dans une logique de moyen terme : ce sera un processus
long et difficile.
- Pour y parvenir, il ne s’agit pas d’instaurer brutalement une
révolution dans l’organisation de notre administration. Une telle approche serait
totalement irréaliste et impraticable.
Seule une évolution progressive semble pertinente. Celle-ci serait
susceptible d’emprunter trois voies, de manière concomitante.
Le Gouvernement doit, en premier lieu, poursuivre, de manière plus
poussée, ses travaux de regroupement des dépenses publiques sous forme d’agrégats.
Ainsi, progressivement, les documents budgétaires transmis au Parlement, les
" bleus ", correspondront-ils mieux à une logique d’objectifs et
de résultats.
Par ailleurs, à l’occasion du lancement d’une nouvelle
politique ou de la réforme de l’une d’entre elles, l’exécutif devra
s’efforcer de présenter ses actions sous forme de programmes et de missions,
assortis d’indicateurs de moyens de résultats et d’objectifs.
Enfin, les travaux d’évaluation de la dépense publique que notre
Assemblée entend mettre en oeuvre au cours du premier semestre de chaque année,
devraient également se concrétiser par l’introduction d’une structure
d’objectifs, en coordination avec l’administration concernée.
Cette approche pragmatique devrait se traduire, dans un premier temps,
par la coexistence d’une présentation de la dépense publique sous forme de
programme et par ministère. A terme, il conviendra, sans doute, de ne retenir que la
seule approche par programme et par auteur, assortie d’une structure
d’objectifs.
b) Introduire une gestion plus souple de la dépense publique
En contrepartie des contraintes qui lui seront désormais assignées,
l’administration devrait disposer d’une plus grande autonomie de gestion. Des
efforts ont, d’ores et déjà, été menés en ce sens, avec l’instauration des
centres de responsabilité, par la circulaire du 23 février 1989, et des contrats de
service, par la circulaire du 26 juillet 1995. Ils doivent être poursuivis et
étendus à l’ensemble de l’administration, afin que celle-ci bénéficie
d’un budget global et, sur certains aspects, pluriannuel.
t Prévoir une
globalisation des crédits
La plupart des intervenants devant notre groupe de travail ont
souligné les inconvénients de l’excessive spécialisation des crédits
budgétaires. Elle fait obstacle à toute souplesse dans l’exécution des dépenses,
limite la marge de manoeuvre des ordonnateurs et laisse peu de place à l’initiative.
Dès lors que les services administratifs se verraient jugés sur les
résultats obtenus, il serait possible, au contraire, de déconcentrer et de globaliser
davantage les crédits () . Cette globalisation devra, notamment,
concerner les crédits de fonctionnement, y compris les crédits de personnel. Les
gestionnaires seront ainsi en mesure d’arbitrer entre les différentes catégories de
moyens, ce qui représenterait une avancée décisive, et d’introduire un
intéressement des services aux gains de productivité réalisés, ce qui devrait
constituer une incitation au changement.
t Développer une
approche pluriannuelle
Une approche pluriannuelle des crédits doit également être mise en
oeuvre, afin de donner aux gestionnaires des garanties quant aux moyens dont ils disposent
et conférer ainsi à leur action une visibilité dont ils sont actuellement dépourvus.
Cette approche pluriannuelle devrait, notamment, porter sur les
crédits de fonctionnement, et donc de personnel.
Cette mesure présenterait un autre intérêt majeur : celui
d’éviter les surconsommations de crédits observées en fin d’année, afin
d’épuiser les enveloppes budgétaires octroyées et obtenir leur reconduction. Une
gestion pluriannuelle des crédits de fonctionnement se traduira, au contraire, par leur
report automatique, supprimant ainsi ces effets pervers.
Les mécanismes actuellement retenus pour définir les autorisations de
programme pourraient être transposés aux crédits de fonctionnement. En tout état de
cause, il y aurait lieu de faciliter les reports de crédits.
Votre Rapporteur tient, toutefois, à rappeler que les marges de
manoeuvre offertes aux gestionnaires via la globalisation et la pluriannualité des
dotations budgétaires dont ils bénéficient, ne sont envisageables que si des objectifs
sont assignés aux services concernés et leurs résultats évalués. Autrement dit,
l’autonomie des gestionnaires doit être la contrepartie de leur plus grande
responsabilisation.
La rénovation de la procédure budgétaire et des règles de gestion
publique ne saurait suffire, à elle seule, à garantir une efficacité accrue de la
dépense publique. Encore faut-il, en effet, que les décisions de la représentation
nationale ne deviennent pas lettre morte une fois arrêtées.
3.- Rendre l’exécution budgétaire plus
respectueuse
de l’autorisation délivrée par le Parlement
Les marges de manœuvre extrêmement larges dont jouit, à cet
égard, le pouvoir exécutif en cours d’exécution suscitent de nombreuses
difficultés. Sans doute serait-il souhaitable d’engager à ce propos une ambitieuse
réforme de l’ordonnance organique, afin de contenir l’autonomie du Gouvernement
en matière d’exécution, dans le respect des nécessités liées aux exigences du
réglage conjoncturel.
A court terme, toutefois, deux séries de mesures devraient être mises
en œuvre, de manière consensuelle, afin de rendre l’exécution budgétaire plus
respectueuse de l’autorisation budgétaire délivrée par le Parlement.
a) Tenir informé le Parlement de l’exécution du budget
A cette fin, les Commissions des finances du Parlement pourraient,
régulièrement, procéder à l’audition du ministre chargé du budget sur
l’exécution de celui-ci.
Cette procédure informelle permettrait de faire le point sur les
résultats atteints par l’administration au regard des objectifs impartis, une fois
les réformes proposées par notre groupe de travail mises en œuvre.
Ces auditions présenteraient également l’intérêt
d’obtenir des informations précises et pertinentes sur le niveau de
l’équilibre budgétaire, lequel est aujourd’hui devenu un élément essentiel
de la conduite de la politique budgétaire. La représentation nationale serait ainsi
informée, au plus tôt, d’éventuels dérapages.
b) Encadrer la mise en oeuvre des mesures de régulation
budgétaire
La régulation budgétaire fait l’objet de vives critiques, en
raison des atteintes qu’elle porte aux prérogatives du Parlement, remettant en
partie en cause l’autorisation délivrée par le Parlement, et des difficultés
qu’elle suscite en matière de gestion publique, s’avérant parfois
contreproductive en termes d’efficacité.
Aussi conviendrait-il d’encadrer les pouvoirs de régulation
budgétaire du Gouvernement.
Notre groupe de travail n’a pas retenu des propositions visant à
prohiber toute mesure de régulation budgétaire, jugées irréalistes au regard des
contraintes pesant sur la gestion publique et des exigences communautaires en matière de
déficit.
Elle n’a pas non plus jugé totalement adaptée la suggestion
visant à créer un fonds de régulation budgétaire, sur le modèle du fonds
d’action conjoncturel (FAC) des années 1981 et 1982. Bien qu’une telle
procédure permette au Gouvernement de disposer de marges de manœuvre pour faire face
aux aléas de la conjoncture et ce, en respectant les prérogatives du Parlement, la
constitution de réserves ne semble plus adaptée au contexte actuel. Les expériences
passées montreraient plutôt qu’une telle procédure constitue, dans une certaine
mesure, une incitation à réaliser des dépenses supplémentaires. Or, tel n’est
évidemment pas notre objectif.
Afin de tenir compte du caractère d’urgence attaché à certaines
mesures de régulation, notamment lorsque des annulations de crédits ont pour objet de
gager des mesures nouvelles décidées par le Gouvernement, notre groupe de travail
demande à celui-ci de tenir informées les commissions des finances des deux assemblées
préalablement à toute mesure de régulation budgétaire, que celle-ci soit formelle ou
informelle.
Par ailleurs, il paraît souhaitable qu’au-delà d’un montant
très significatif - par exemple 10 milliards de francs - d’annulations
cumulées de crédits, voire de virements, au sein du budget général, soit rendu
obligatoire le dépôt d’un projet de loi de finances rectificative. On peut, en
effet, estimer qu’au-delà d’un tel montant, les modifications apportées à la
loi de finances initiale ne sauraient relever que du seul organe institutionnel investi de
l’autorité budgétaire, à savoir le Parlement.
Soulignons, enfin, que l’instauration de la session unique permet
de rejeter l’un des arguments généralement avancés à l’encontre de cette
proposition, le Gouvernement ayant fait valoir, dans le passé, que le rythme de travail
du Parlement ne correspondait pas au calendrier de l’exécution budgétaire.
*
* *
L’ensemble des mesures proposées constitue un changement
considérable.
Elles ne sauraient donc être toutes mises en œuvre
simultanément. A cet effet, les réformes de moyen terme seraient préparées par une
mission de la Commission des finances, avec l’aide des administrations compétentes,
et seraient mises en œuvre, en liaison avec le Gouvernement et le Sénat, au fur et
à mesure de leur adoption. Elles ont vocation, dans la mesure du possible, à
s’appliquer avant le terme de la présente législature.
Soulignons, enfin, que les mesures envisagées permettront au Parlement
de débattre, de nouveau, des choix fondamentaux, alors qu’actuellement, la décision
politique et les arbitrages budgétaires fondamentaux lui échappent largement. Notre
procédure budgétaire devrait ainsi retrouver une plus grande légitimité démocratique.
RÉSUMÉ DES PROPOSITIONS
Les réformes présentées ici sont inspirées par le souci d’une
meilleure efficacité de la dépense publique, efficacité indispensable en elle-même,
indispensable aussi si on veut limiter les prélèvements et les déficits. Elles
répondent à la volonté de mettre les fonctions de contrôle et d'évaluation au
cœur de l'activité budgétaire du Parlement.
Elles s'inspirent souvent d’exemples étrangers, en particulier de
l'expérience britannique qui a permis à la Chambre des Communes, en collaboration avec
le National Audit Office (N.A.O) créé en 1983, de renforcer son contrôle sur
l'utilisation des fonds publics.
Les propositions formulées partent de l’idée qu’un
renforcement des missions de contrôle et d’évaluation exercées par le Parlement,
notamment par ses commissions, peut donner l’impulsion nécessaire à des réformes
plus profondes touchant au fonctionnement même de l’Etat.
RETOUR SOMMAIRE
I - Les réformes à mettre en œuvre
immédiatement
1.1. Développer les activités de contrôle du Parlement
1.1.1.) contrôler l'emploi des crédits tout au long de
l'année
– créer chaque année, au sein de la Commission des
finances, une mission d’évaluation et de contrôle, chargée d’auditionner les
responsables politiques et administratifs sur la gestion de leurs crédits et de mener des
investigations approfondies sur quatre ou cinq politiques publiques. La mission établira
un calendrier de ses auditions, qui auront lieu chaque semaine durant tout le premier
semestre. Les auditions seront ouvertes aux membres de la Commission des finances et aux
rapporteurs pour avis des autres commissions ;
– étendre les pouvoirs de contrôle des rapporteurs
spéciaux de la Commission des finances aux rapporteurs pour avis des autres commissions.
Les contrôles sur pièces et sur place seront menés, autant que possible, conjointement
par les deux rapporteurs et coordonnés par le Rapporteur général. Ils donneront lieu à
un compte-rendu devant la commission. Le renouvellement des rapporteurs spéciaux dans
leurs fonctions sera subordonné à un minimum de deux contrôles sur pièces et sur place
par an.
1.1.2.) mieux contrôler l'exécution des lois de finances,
en avançant le vote de la loi de règlement à l'année N + 1.
L’accélération de l’arrêté des comptes et l’anticipation de la
déclaration de conformité doivent permettre à terme le vote de la loi de règlement
avant celui de la prochaine loi de finances, dans le cadre d’une discussion commune.
1.1.3.) resserrer les liens avec la Cour des comptes
– intégrer, autant que possible, les demandes du Parlement
dans le programme de travail établi annuellement par la Cour des comptes ;
– préparer les contrôles sur pièces et sur place des
rapporteurs budgétaires et les auditions de la mission d’évaluation et de contrôle
avec le concours des magistrats de la Cour des comptes ;
– appliquer pleinement l’article L. 132-4 du code des
juridictions financières, qui prescrit à la Cour de procéder aux enquêtes qui lui sont
demandées par les commissions des finances et de leur communiquer ses constatations et
observations.
1.2. Evaluer la dépense publique
1.2.1.) privilégier l'évaluation des services votés, qui
représentent plus de 90% du budget, plutôt que la seule discussion des mesures nouvelles
– mener un programme annuel d'évaluations, portant sur des
actions publiques transversales (exemples : programmes militaires, formation
professionnelle, aides aux entreprises, etc.). Ce programme portera chaque année sur
quatre ou cinq domaines. Il sera arrêté par la mission d’évaluation et de
contrôle ;
– fixer un cahier des charges à l'opérateur, public ou
privé, choisi pour conduire les évaluations ;
– débattre des résultats, en procédant à l'audition des
évaluateurs et des responsables des politiques évaluées.
1.2.2.) se donner des moyens efficaces pour agir
– tirer les enseignements des évaluations, par exemple par
l'audition d'un ministre, le vote d'une mesure nouvelle, le dépôt d'une proposition de
loi ;
– doter la Commission des finances d’une banque
informatique de données budgétaires et financières, lui permettant de procéder à des
simulations ;
– permettre l’accès direct de la Commission des
finances aux banques de données du ministère des finances.
Pour marquer sa volonté d’exercer pleinement ses attributions, la
Commission des finances, par modification du Règlement de l’Assemblée nationale,
s’appellera désormais Commission des finances, de l’économie, du contrôle et
de l’évaluation.
1.3. Renforcer le débat démocratique
1.3.1.) conduire les travaux de la mission d’évaluation
et de contrôle en toute transparence
– ouvrir à la presse les auditions de contrôle et
d'évaluation ;
– retransmettre les réunions hebdomadaires de la mission sur
la chaîne de télévision parlementaire ;
– publier les rapports d'évaluation, avec le compte rendu
des auditions et des débats auxquels ils auront donné lieu.
1.3.2.) élargir les droits de l’opposition
– confier à un membre de l’opposition la co-présidence
de la mission annuelle d’évaluation et de contrôle, aux côtés du Président de la
Commission des finances, l’animation et la coordination des travaux étant assurées
par le Rapporteur général ;
– associer l’opposition à la préparation des auditions
hebdomadaires de la mission ;
– dans le cadre des contrôles sur pièces et sur place,
faire collaborer un rapporteur spécial de la majorité et un rapporteur pour avis de
l'opposition (ou inversement).
1.3.3.) consacrer chaque mois une séance de questions au
gouvernement à l'examen d'une politique publique, en soumettant, pendant une heure,
le ministre concerné à une série de questions ciblées.
1.4. Rénover l’exercice du pouvoir financier
1.4.1.) privilégier la discussion des grandes orientations
économiques et financières
– examiner chaque année, en Commission de finances, avant
transmission à Bruxelles, les perspectives triennales des finances publiques, incluant
l’ensemble des dépenses publiques (Etat, sécurité sociale, collectivités
locales) ;
– organiser chaque année, en séance publique, un débat
d’orientation budgétaire, sur la base des rapports présentés par la Cour des
comptes (exécution de la loi de finances précédente) et le Gouvernement (rapport sur
les orientations budgétaires ; perspectives triennales des finances publiques).
Ne pourrait-on envisager que ce débat soit conclu par le vote
d’une loi d’orientation triennale des finances publiques ?
– mieux préparer ce débat en amont, en Commission des
finances, sur la base de simulations commandées à des organismes de prévision, ainsi
que d'auditions et de tables rondes d'experts.
1.4.2.) pratiquer un nouveau rythme d'exercice du pouvoir
financier, associant mieux les commissions et s'appuyant sur deux grandes phases de
travail
– La première phase sera consacrée, de janvier à juin, au
contrôle des comptes et à l'évaluation des politiques publiques et se conclura, à
l’automne, par le vote de la loi de règlement.
– La seconde phase débutera, en mai-juin, avec le débat
d’orientation budgétaire et s'achèvera, à l’automne, par le vote de la loi de
finances.
L'examen des fascicules budgétaires se déroulera au sein des
commissions saisies pour avis. Les débats auront lieu en présence des ministres et
s’appuieront sur les rapports des rapporteurs spéciaux et pour avis. Ils seront
ouverts à la presse, nationale et régionale, et donneront lieu à compte rendu au Journal
officiel. Une procédure de questions écrites permettra aux députés d’obtenir
réponse au plus tard le jour de la séance publique.
Le débat en séance publique se concentrera sur l'examen des articles
de la première partie de la loi de finances, puis des articles (rattachés ou non) de la
deuxième partie, et sur un examen resserré des crédits, privilégiant l’examen des
politiques publiques, leurs orientations et leur efficacité. Le débat en séance
publique sera ainsi l'aboutissement des travaux menés en amont, en commission.
RETOUR SOMMAIRE
II - LES RÉFORMES DE MOYEN TERME
Ces réformes, qui participent de la réforme de l’Etat,
nécessitent le plus souvent une modification des textes régissant l’organisation du
débat budgétaire, en particulier de l’ordonnance organique du 2 janvier 1959
relative aux lois de finances, et l’introduction dans la sphère publique de
méthodes plus modernes de gestion.
2.1. Améliorer la transparence et la signification des comptes
publics
2.1.1.) garantir la sincérité des informations budgétaires
– consulter la Cour des comptes sur les projets de loi de
finances et les comptes annexés, au regard de leur sincérité ;
– passer d’une comptabilité de trésorerie à une
comptabilité en droits constatés (obligation de rattachement à l’exercice, comme
pour les collectivités locales) ;
– mieux appliquer le principe d’universalité
budgétaire, en évaluant la totalité des recettes (fonds de concours par exemple) et des
dépenses (crédits évaluatifs, amortissements, provisions, etc.) ;
– inscrire en loi de finances le montant des emprunts
envisagés, en précisant les méthodes de gestion de la dette ;
– consolider les comptes de l’Etat, des établissements
publics et des entreprises publiques.
2.1.2.) renforcer l’information du Parlement
– établir chaque année, dans le cadre d’une
comptabilité patrimoniale, un bilan et un " hors-bilan " de
l’Etat, accompagnés de projections à trois ans, afin d’évaluer le patrimoine
de l’Etat et ses engagements à long terme (droits à pension, garanties,
etc.) ;
– accompagner le budget de perspectives d’évolution des
principaux postes (personnel, charges de la dette, etc.) à l’horizon de trois à
cinq ans ;
– assortir toute réforme touchant à la fiscalité ou aux
cotisations sociales de simulations ;
– présenter annuellement un plan stratégique par
ministère, exposant les résultats atteints l’année précédente par rapport aux
objectifs annoncés, ainsi que les objectifs fixés et les moyens requis pour
l’année suivante.
2.2. Centrer la discussion budgétaire sur l’efficacité de la
dépense publique
– adopter les services votés par ministère et non plus
globalement ;
– substituer à terme, à la présentation actuelle par
nature de charges ou par destination, une présentation des crédits par programme et par
acteur, permettant une évaluation a posteriori ;
– introduire des indicateurs de résultats et de moyens,
précis et chiffrés, pour les crédits de chaque programme, la structure d’objectifs
devant être présentée au Parlement en début de législature ;
– permettre des redéploiements de crédits, en autorisant
les parlementaires à opérer des compensations entre dépenses publiques, comme ils sont
autorisés à le faire en matière de ressources publiques ;
– distinguer entre les dépenses de fonctionnement et les
dépenses d’investissement. Parvenir à terme à un équilibre de la section de
fonctionnement, comme c’est la règle en Allemagne ou dans les collectivités
locales ;
– assortir les projets de loi d’une étude d’impact
de qualité, précisant l’adéquation entre les objectifs et les moyens mis en
œuvre.
2.3. Rendre l’exécution budgétaire plus respectueuse de
l’autorisation donnée par le Parlement
– fournir aux commissions des finances des deux Assemblées
une information préalable sur les opérations de régulation budgétaire ;
– au-delà d’un certain seuil d’annulations ou de
virements de crédits, rendre obligatoire le dépôt d’un projet de loi de finances
rectificative ;
– entendre régulièrement, en commission de finances, le
ministre chargé du budget sur l’exécution des recettes et des dépenses et sur les
résultats obtenus par rapport aux objectifs fixés.
2.4. Rendre la gestion publique plus souple et mieux contrôlable
2.4.1.) permettre aux gestionnaires davantage de souplesse dans
l’emploi des crédits
– globaliser les crédits de fonctionnement, dans le cadre
d’enveloppes réparties par programme et par acteur et non plus par nature de
crédits, à charge pour les gestionnaires de respecter leurs objectifs et d’en
rendre compte ;
– tendre vers une pluriannualité des dépenses de
fonctionnement et faciliter les reports de crédits, de manière à éviter les
gaspillages de fin d’année.
2.4.2.) moderniser les méthodes de gestion
– nommer auprès de chaque ministre un secrétaire général
de l’administration, chargé d’établir le plan stratégique des services et des
centres de responsabilité, de suivre les indicateurs de gestion, d’établir un
rapport annuel d’activité et de rendre compte au ministre ;
– tenir une comptabilité analytique permettant de connaître
avec précision le coût des services rendus ;
– introduire dans chaque administration et chaque
établissement public un contrôle de gestion, afin de passer d’une logique de
dépenses à une logique de résultats.
*
* *
L’ensemble de ces réformes constitue un changement considérable.
Les réformes à mettre en œuvre immédiatement seront appliquées dès la prochaine
loi de finances (loi de finances pour 2000). Les réformes de moyen terme seront
préparées par une mission de la Commission des finances, aidée par les administrations
compétentes, et elles seront mises en œuvre, en liaison avec le Sénat, au fur et à
mesure de leur adoption. Elles devront entrer en application avant le terme normal de la
présente législature (loi de finances pour 2002).
RETOUR SOMMAIRE
DÉCLARATIONS DE GROUPES
POLITIQUES
________
MM. Dominique Baert et Gérard Fuchs au nom du Groupe
socialiste
Groupe R.P.R.
Groupe U.D.F.
Groupe Démocratie Libérale
MM. Jacques Brunhes et Christian Cuvilliez
au nom du Groupe communiste
OBSERVATIONS DE MM. Dominique BAERT et Gérard
FUCHS AU NOM du Groupe socialiste
Constitué à l’initiative du Président de l’Assemblée
Nationale, le groupe de travail a situé sa réflexion dans un double cadre : prendre en
considération la nécessité de réductions et de réorientations de la dépense
publique, suivant des critères d’efficacité ; prendre acte que l’activité
budgétaire du Parlement ne permet pas, en l’état actuel de son fonctionnement, un
contrôle de l’efficience des dépenses et des recettes de l’Etat : ce contrôle
est pourtant partie intégrante de la légitimité démocratique du Parlement. Le groupe
de travail a procédé à de nombreuses auditions de personnalités ayant une expérience
dans le domaine du contrôle budgétaire et de l’évaluation, y compris des
représentants du Gouvernement (MM. les Ministres de l’économie et du budget), dont
certaines suggestions convergent avec les propositions formulées dans le rapport. Il a
également souhaité s’appuyer sur une analyse des systèmes étrangers, et en
particulier de l’exemple britannique, où une collaboration étroite entre le National
Audit Office et la Chambre des Communes a permis une amélioration du pouvoir de
contrôle exercé par le Parlement sur l’utilisation des fonds publics. Le groupe de
travail présente ses conclusions en deux étapes de réforme. Aucune modification
législative n’est nécessaire pour la mise en oeuvre des premières propositions,
dont nous rappelons ici les principales.
Proposition importante, sera créée au sein de la Commission des
finances, une mission d’évaluation et de contrôle, chargée d’auditionner
régulièrement les responsables politiques et administratifs sur la gestion de leurs
crédits, avec en particulier un objectif fonctionnel d’évaluation de quelques
grandes politiques publiques (quatre ou cinq par an). Les auditions auront lieu au cours
du premier semestre, qui sera consacré au contrôle et à l’évaluation, en
préalable à la phase de discussion et de vote du projet de loi de finances. Les moyens
à la disposition de cette mission seront tout d’abord les pouvoirs de contrôle des
rapporteurs spéciaux de la Commission des finances, qui seront étendus aux rapporteurs
pour avis des autres commissions, et une collaboration plus étroite avec la Cour des
comptes. Dans un premier temps il est clair qu’avant tout, les possibilités de
contrôle existantes auront à être mieux utilisées.
Sans être exhaustifs, tant les propositions du groupe sont nombreuses,
deux pistes d’action apparaissent particulièrement novatrices et stimulantes.
Le contrôle budgétaire doit d’abord être évaluatif : le groupe
privilégie, à juste titre, une évaluation de la dépense plutôt qu’un simple
contrôle. Comparer entre les objectifs des politiques, leur réalisation effective, et
les moyens mis en oeuvre : ce n’est peut-être pas une idée neuve, mais c’est
incontestablement une idée insuffisamment mise en oeuvre jusqu’à maintenant. Ce
doit devenir une priorité, car seule l’évaluation permettra d’orienter les
crédits vers les mesures les plus efficaces au moindre coût !
La réduction des dépenses publiques apparaît alors comme un
résultat de l’évaluation et non comme une finalité pour elle-même : et c’est
comme cela que le comprend le groupe socialiste.
Cette évaluation devra être large et sans exclusive : elle portera
bien sûr sur les mesures nouvelles, mais également sur les services votés (car ils
représentent 90% du budget !) à partir d’une approche transversale et fonctionnelle
des politiques publiques (ex. programmes militaires, formation professionnelle, aides aux
entreprises... )
D’autre part, le contrôle budgétaire doit être plus ouvert et
démocratique notamment via un élargissement des droits de l’opposition. Une
co-présidence de la mission d’évaluation et de contrôle, laquelle proposerait des
thèmes d’évaluation qui seraient retenus, serait confiée à un membre de
l’opposition ; de même qu’il est prévu de faire collaborer un rapporteur
spécial de la majorité et un rapporteur pour avis de l’opposition (ou inversement)
dans le cadre des contrôles sur pièces et sur place. Autant d’avancées
essentielles qui non seulement honoreraient notre vie démocratique, mais feraient
progresser incontestablement la réalité du contrôle parlementaire du budget de
l’Etat. Elles assureraient de surcroît la continuité et le suivi des évaluations
mises en oeuvre au-delà des alternances. Et cela, concomitamment avec une transparence
renforcée des travaux menés dans le cadre de la mission d’évaluation (ouverture à
la presse, retransmission télévisée).
Au-delà de ces propositions d’application immédiate, les
réformes envisagées pour le moyen terme participent d’un double objectif de
réforme de l’Etat et des méthodes de gestion des crédits au sein de
l’administration, et de renforcement des supports du contrôle exercé par le
Parlement (information, présentation clarifiée des comptes publics, comprenant en
particulier une comptabilité patrimoniale).
En se félicitant des travaux qui ont été menés, les représentants
du Groupe socialiste de l’Assemblée Nationale au sein du groupe de travail
soutiennent ces initiatives de modernisation et de renforcement du rôle de
l’Assemblée nationale dans l’exercice de son pouvoir budgétaire. La mutation
qui se dessine est d’importance, pour la réalité du travail parlementaire, et donc
pour notre démocratie. C’est pourquoi, le Groupe socialiste a la ferme volonté que
l’Etat puisse " dépenser mieux " pour " prélever
moins ".
Dominique Baert Gérard Fuchs
Député du Nord Député de Seine-Maritime
CONTRIBUTION DU GROUPE RPR
I.- sur les pouvoirs de contrôle et d’ÉVALUATION
DE LA DÉPENSE PUBLIQUE
Plusieurs propositions formulées par le groupe de travail
mériteraient d’être approfondies :
* Consolider la place du débat d’orientation
budgétaire grâce à une meilleure information de l’Assemblée nationale.
Le débat d’orientation budgétaire, institué en 1996,
pourrait à l’évidence être enrichi si les députés disposaient, lors de sa
préparation, d’informations plus étendues et plus diversifiées, émanant notamment
du Gouvernement, mais aussi de la Cour des comptes et d’organismes extérieurs.
* Développer l’évaluation des dépenses publiques
regroupées en " grandes actions publiques ".
Cette idée est à l’évidence intéressante, mais ne relève
pas de la nouveauté. Elle s’inspire largement, sinon quant aux moyens du moins quant
aux objectifs, des missions de l’Office parlementaire d’évaluation des
politiques publiques créé sous la précédente législature.
* Développer le principe d’auditions par la
Commission des finances de responsables administratifs et politiques.
* Améliorer la publicité faite aux débats de la
Commission des finances.
En revanche, une proposition appelle des remarques et nécessiterait
d’être précisée :
Il s’agit de celle concernant l’extension aux rapporteurs
pour avis des pouvoirs dévolus aux rapporteurs spéciaux. D’autant qu’il faut
compléter cette proposition par l’idée de les faire fonctionner en tandems,
l’un d’eux appartenant à la majorité, l’autre à l’opposition.
Tout d’abord, cette proposition ne précise pas les modalités de
répartition des postes de rapporteurs spéciaux entre la majorité et l’opposition.
A ce jour, le rôle de l’opposition reste mineur dans ce partage, celle-ci devant se
contenter d’un faible nombre de rapports spéciaux, représentant de surcroît une
part infime des dépenses publiques. A cet égard, il serait justifié de répartir les
différents rapports (nombre, poids des budgets) à la proportionnelle des groupes.
Par ailleurs, la proposition faite ne règle pas le cas où le
Gouvernement serait confronté à l’existence de plusieurs oppositions distinctes à
l’Assemblée.
Enfin, elle ne fait pas état des moyens qui pourraient être affectés
à l’exercice de ces nouvelles prérogatives.
II.- SUR LA PROCÉDURE D’EXAMEN DU PROJET DE LOI DE
FINANCES
La principale proposition de modification de la procédure
d’examen du projet de loi de finances faite par le Groupe de travail consisterait à
limiter à une simple explication de vote la discussion dans l’hémicycle des
fascicules budgétaires.
Par conséquent, le débat sur le projet de loi de finances se
focaliserait dans l’hémicycle sur les articles de la première partie, ainsi que sur
les articles rattachés ou non.
Une telle réforme n’est pas acceptable pour deux raisons
principales :
– Elle affaiblirait le caractère démocratique de
l’examen du projet de loi de finances, en privant de temps de parole dans
l’hémicycle un grand nombre de députés. Dans le cas du Groupe RPR et selon la
procédure actuelle, ce sont environ la moitié des membres du Groupe qui
s’inscrivent chaque année dans la discussion générale des fascicules ou sur les
questions. Elle déséquilibrerait de manière excessive les rôles respectifs des
différentes commissions dans ce débat, au profit d’une seule. Traditionnellement en
effet, l’examen des articles de la première partie et des articles non rattachés se
concentre entre les mains d’un nombre réduit de députés.
– Elle diminuerait la transparence de la procédure
d’examen du budget, dans la mesure où les fascicules budgétaires seraient examinés
par une commission ad hoc composée de la Commission des finances et des
commissions saisies pour avis, et non en séance publique dans l’hémicycle.
POSITION DU GROUPE UDF
Première observation : Le fil directeur de la réforme doit rester
centré sur l’efficacité de la dépense publique et sur le renforcement des moyens
du contrôle parlementaire. Cela passe notamment par le renforcement des liens entre la
Cour des comptes et la Commission des finances, par le suivi des mesures concrètes mises
en place par les administrations à la suite des observations édictées dans les
différents rapports de la Cour des comptes ou des missions de l’Inspection
générale, par une exigence de transparence encore accrue, par la généralisation
d’études d’impact des conséquences financières de tout projet gouvernemental.
Deuxième observation : Il est nécessaire que la réforme de la
procédure budgétaire se fasse par étapes. Elle devrait être expérimentée dans un
premier temps sur les budgets de quelques ministères seulement avant de se généraliser.
La réforme doit avoir pour objectif l’allégement de la procédure budgétaire pour
la rendre plus efficace et lisible. Ainsi, la phase des questions budgétaires en séance
publique pourrait utilement faire l’objet d’une procédure écrite où le
député déposerait auprès de la Commission compétente au moins une semaine avant, le
texte de sa question. La réponse serait remise le jour de l’examen du budget
concerné et publiée au Journal officiel.
Troisième observation : L’efficacité du contrôle ne sera
effective que si les droits de l’opposition sont renforcés, qu’il s’agisse
du choix des études de la " mission d’évaluation et de
contrôle " mais aussi de l’augmentation significative du nombre des
rapports spéciaux confiés à l’opposition.
En revanche la proposition formulée d’une coprésidence de la
" mission d’évaluation et de contrôle " semble secondaire.
Quatrième observation : Les contrôles sur pièces et sur place
doivent être réservés aux rapporteurs spéciaux associant autant que possible les
rapporteurs pour avis des autres commissions. En revanche, l’extension du contrôle
à tous les rapporteurs pour avis rendrait difficile les relations avec les
administrations compte tenu du nombre de rapporteurs.
CONTRIBUTION DU GROUPE DÉMOCRATIE LIBÉRALE
Le groupe Démocratie Libérale a jugé opportune l’initiative du
Président de l’Assemblée nationale, Laurent Fabius, de réunir les représentants
de tous les groupes parlementaires pour conduire une réflexion sur le contrôle
parlementaire et l’efficacité des dépenses publiques.
Chacun s’accorde à penser, en effet, que le contrôle
parlementaire a été impuissant à endiguer la progression continue et inquiétante des
dépenses publiques et corrélativement, celle des prélèvements obligatoires. Dans le
même temps, l’efficacité des services publics malgré leurs coûts croissants
apparaît tout à fait insatisfaisante.
Les auditions auxquelles le groupe de travail a procédé ont montré
un très large accord des personnalités entendues sur le diagnostic : la gestion
publique repose sur des principes et des méthodes aujourd’hui dépassés.
L’action publique ne se voit pas assigner d’objectifs clairs, ses résultats ne
donnent pas lieu à un examen périodique susceptible de remettre en cause les
orientations ou les choix.
Aussi, l’amélioration du contrôle parlementaire ne peut-elle
avoir de portée qu’au prix de profondes réformes en amont. Il apparaît
indispensable aujourd’hui de réformer notre organisation administrative et nos
finances publiques.
En premier lieu, il convient que l’Etat et tous les organismes
publics soient astreints à des obligations comptables aussi exigeantes que celles des
entreprises. On ne gère, ni ne juge une gestion sans une véritable comptabilité,
exhaustive et sincère, qui fait totalement défaut aujourd’hui. Les obligations
comptables, en particulier celles de présenter un bilan et un hors-bilan doivent donner
lieu à un contrôle externe confié à des commissaires aux comptes professionnels et
leur respect doit engager la responsabilité personnelle et pénale des agents.
En second lieu, les services publics doivent être organisés de sorte
que leurs objectifs soient clairement définis, objectifs sur lesquels leurs responsables
s’engagent. Un organisme indépendant du Gouvernement rattaché au Parlement, doit en
permanence apprécier les résultats obtenus, au regard des objectifs affichés. Le
contrôle de gestion utilisant une comptabilité analytique généralisée, doit être
systématique.
Ces conditions remplies, le contrôle parlementaire aurait les moyens
de s’exercer avec efficacité. L’examen de la loi de finances, qu’il
s’agisse de la loi de finances initiale ou de la loi de règlement, pourrait perdre
le caractère formel qui est aujourd’hui le sien, s’agissant de la partie
dépenses, et porter sur l’adéquation des moyens aux objectifs poursuivis.
Mais, en tout état de cause, il faudrait que le rôle de
l’opposition dans l’exercice de ce contrôle soit affirmé, car elle est
évidemment plus à même que la majorité d’être vigilante à l’égard de
l’action gouvernementale.
Ainsi, sans nier l’intérêt des travaux qui ont été conduits,
sans contester que les propositions du rapporteur général vont, dans l’ensemble,
dans le bon sens, le Groupe Démocratie Libérale estime que les mesures envisagées sont
insuffisantes, qu’elles ne sont pas de nature en elles-mêmes à corriger une
situation très dégradée.
Il relève aussi, que la volonté gouvernementale d’engager des
réformes améliorant la gestion publique fait totalement défaut. Dans ces conditions, il
ne peut qu’exprimer son profond scepticisme vis-à-vis de la portée du présent
rapport et des propositions qu’il contient.
OBSERVATIONS DE MM. JACQUES BRUNHES ET CHRISTIAN
CUVILLIEZ AU NOM DU GROUPE COMMUNISTE
Les réformes proposées par le groupe de travail traduisent un
changement significatif dans le sens du renforcement des droits du Parlement. Les
députés communistes qui ont toujours souhaité que l’Assemblée Nationale puisse
exercer un véritable pouvoir tant dans les orientations économiques du budget que dans
le suivi de son exécution approuvent cette démarche démocratique.
Le budget est un acte majeur de la politique nationale. Son annualité
reste un principe. En même temps l'action de l’Assemblée nationale doit être
sérieusement dépoussiérée d’un certain nombre de formalismes qui l’encadrent
depuis trop d’années.
Dans le cadre européen, le contrôle parlementaire doit répondre à
un véritable droit et non faire de l’Assemblée un instrument de mise en œuvre
du Pacte de stabilité pour peser à sens unique vers une réduction de la dépense
publique.
Les propositions du groupe de travail appellent les remarques suivantes
de notre part.
Contrôle du Parlement aux divers stades de la procédure
budgétaire.
t Le débat
d’orientation budgétaire de mai-juin doit faire l’objet d’un véritable
projet de loi fixant les grandes orientations et les hypothèses économiques à retenir,
les évaluations de ressources et de charges ainsi que les données de l’équilibre
financier.
Cette loi déterminant les grands axes de la loi de finances discutée
en octobre serait votée par le Parlement.
t Le parlementarisme
rationalisé a montré ses limites. L’article 40 de la Constitution doit être
révisé pour autoriser les amendements créant ou aggravant une charge publique sous
réserve qu’une ressource de substitution équivalente dans sa nature et son montant
soit créée.
Les amendements passibles de l’article 40 devraient en tout état
de cause pouvoir être discutés en séance.
Plusieurs mesures du groupe de travail sont excellentes comme rendre
identique les droits des rapporteurs spéciaux et des rapporteurs pour avis dans le suivi
du budget.
Il est important de renforcer les droits des députés. Il faudrait
permettre à chaque groupe de demander des études à l’INSEE, au Commissariat du
Plan, ou à un autre institut sur l’évaluation d’une question économique.
Chaque commission permanente, chaque groupe devrait pouvoir saisir la
Cour des Comptes pour une étude ou un contrôle.
Pour élaborer ses propositions, chaque groupe doit pouvoir obtenir des
ministères un chiffrage exact des mesures qu’il propose, notamment en matière
fiscale. Il doit avoir accès aux services d’expertise des ministères.
Les études d’impact devront être généralisées sur les projets
de loi et les propositions inscrites en séance publique. Assortir toute réforme fiscale
d’une simulation est également souhaitable, comme le suggère le groupe de travail.
Les propositions pour développer l’évaluation de la dépense
publique sont positives.
Pour assurer le débat démocratique.
Les réformes visant à renforcer les droits de l’opposition vont
également dans le bon sens.
Par contre, les députés communistes ne sont pas favorables au renvoi
en commission de l’examen des fascicules des budgets dépensiers. Pour pallier le
formalisme de certains débats, c’est la partie de la discussion portant sur des
questions-réponses et qui traite souvent de problèmes locaux qui pourrait être
remplacée par l’organisation au moins une fois par an d’une séance de la
commission compétente ouverte à la presse et au public et où le ministre répondrait à
des question ciblées.
Le débat et le vote en séance publique sur les différents budgets
doivent être maintenus. C’est important pour la démocratie.
S’agissant de la mise en œuvre du budget voté, la pratique
gouvernementale de procéder à des gels, des annulations ou des transferts de crédits
qui sont validés en fin d’année par la loi de finances rectificative donne
aujourd’hui au contrôle parlementaire un caractère formel.
Est donc décisive la proposition qu’au-delà d’un certain
seuil de régulation, soit rendue obligatoire en cours d’année la discussion
d’une loi de finances rectificative.
Si l’efficacité de la dépense publique est un objectif juste, il
ne saurait être seulement décliné en termes européens.
Le budget de l’Etat ne peut être assimilé à celui des
collectivités locales. Que les dépenses de fonctionnement soient toujours a priori
en équilibre ferait porter sur les seules dépenses d’investissement les problèmes
du déficit et pourrait compromettre la politique de croissance.
Enfin, le rôle actuel du Parlement sur le montant de la participation
de la France au budget de l’Union européenne n’est pas satisfaisante,
s’agissant d’un des premiers postes de la loi de finances (95 milliards pour
1999) qui conditionne la marge d’initiative sur les autres budgets. C’est
pourquoi la Commission des finances devrait être associée à la détermination de son
montant.
Si la mission de la Commission des finances est spécifique dans le
contrôle parlementaire, il ne faudrait pas que le rôle des autres commissions
permanentes se trouve amoindri dans la démarche nouvelle qui est engagée et dont
l’objet n’est pas seulement financier. C’est pourquoi toutes les
commissions devraient être mieux associées à la réforme.
Une dernière observation, aussi intéressantes que soient les
modifications proposées en matière financière, elles ne sauraient faire oublier que la
réforme première concerne le rôle et la place du Parlement dans les institutions
nationales.
Jacques BRUNHES Christian CUVILLIEZ
Liste des
personnalités entendues par le Groupe de travail
Le compte rendu de ces auditions est publié dans le Tome II du
présent rapport
M. François de CLOSETS, journaliste (22 octobre 1998)
M. Jacques MÉRAUD, membre honoraire du Conseil économique et
social (22 octobre 1998)
M. Jean-Claude THŒNIG, Président du Conseil scientifique de
l’évaluation (22 octobre 1998)
M. Guy CARCASSONNE, Professeur à l’Université de
Nanterre-Paris X (29 octobre 1998)
M. Laurent DOMINATI, député, Président de la mission
d’information commune sur les moyens d’information des parlements étrangers en
matière économique et sociale (septembre 1994-mai 1995) (29 octobre 1998)
M. Jean-Claude TRICHET, Gouverneur de la Banque de France (29
octobre 1998)
M. Michel PRADA, Président de la Commission des opérations de
bourse, ancien directeur de la comptabilité publique et du budget (5 novembre 1998)
M. Loïc PHILIP, Professeur à l’Université
d’Aix-Marseille (5 novembre 1998)
M. Philippe AUBERGER, député, ancien Rapporteur général de la
Commission des finances, de l’économie générale et du plan de l’Assemblée
nationale (1993-1997) (5 novembre 1998)
M. Jean ARTHUIS, sénateur, ancien ministre de l’économie et des
finances (19 novembre 1998)
M. René Barberye, Président du directoire du Centre national des
caisses d’épargne et de prévoyance (CENCEP), ancien directeur de la comptabilité
publique (19 novembre 1998)
M. Pierre JOXE, Premier président de la Cour des comptes
(24 novembre 1998)
M. Jean PICQ, conseiller-maître à la Cour des comptes, Président de
la mission sur les responsabilités et l’organisation de l’Etat (novembre
1993-mai 1994) (10 décembre 1998)
M. Augustin BONREPAUX, député, Président de la Commission des
finances, de l’économie générale et du plan de l’Assemblée nationale (10
décembre 1998)
M. Daniel BOUTON, Président de la Société générale, ancien
directeur du budget (10 décembre 1998)
M. Louis SCHWEITZER, Président de Renault, ancien directeur de cabinet
du Premier ministre (7 janvier 1999)
M. Michel CHARASSE, sénateur, ancien ministre du budget
(7 janvier 1999) ()
M. Michel BON, Président de France Télécom, ancien directeur de
l’Agence nationale pour l’emploi (ANPE) (7 janvier 1999)
M. Jacques DELORS, ancien ministre de l’économie et des
finances, ancien Président de la Commission européenne, Président de la Fondation Notre
Europe (13 janvier 1999)
Sir John BOURN, Contrôleur et Auditeur général du Royaume-Uni,
Président du National audit office (NAO) (13 janvier 1999)
M. Dominique Strauss-Kahn, ministre de l’économie, des
finances et de l’industrie, et M. Christian Sautter, secrétaire d’Etat au
budget (13 janvier 1999)
*
* *
RETOUR SOMMAIRE
ANNEXE
ELÉMENTS DE COMPARAISON ENTRE LES SYSTÈMES BRITANNIQUE ET FRANÇAIS
D’ÉVALUATION
Extraits des actes du colloque franco-britannique
organisé par le Conseil scientifique de l'évaluation, Paris, janvier 1998
l.- Observations générales
1.1. L'évaluation fait preuve d'une grande vitalité
en Grande-Bretagne. La pratique en est plus développée qu'en France et répartie à tous
les niveaux de l'administration et des services publics ; les moyens financiers et
humains qui lui sont consacrés sont plus importants (), et ses résultats
sont utilisés de manière plus systématique à des fins de gestion et de préparation
des décisions publiques. L'évaluation est diverse, dans ses objets (politiques,
programmes, activité des services et établissements publics, pratiques
professionnelles), ses modalités (combinaison d'expertise interne et de recours à
l'expertise externe) et ses finalités.
1.2. L'évaluation britannique se caractérise par
un grand pluralisme, tant au niveau des lieux d'expertise que des autorités passant
commande d'évaluation. La diversité des " clients " et des financeurs de
l'évaluation confère à celle-ci un caractère polycentrique (). Les
principaux lieux et acteurs de l'évaluation sont :
– le National Audit Office (équivalent britannique de
la Cour des Comptes) ;
– l’Audit Commission (organisme indépendant,
sans équivalent dans d'autres pays, qui évalue de manière totalement externe
l'efficience des services gérés par les collectivités locales) ;
– le Trésor (équivalent de la direction du Budget), qui
diffuse des normes méthodologiques pour le développement de l'évaluation ex-ante et
ex-post dans l'administration ;
– les organismes d'inspection ;
– les services d'études et de recherche dépendant de
l'administration ;
– certaines collectivités locales.
Par contraste, la conception française du pluralisme s'exprime
davantage dans les procédures d'évaluation elles-mêmes, notamment sous la forme de l’évaluation
partenariale (à l'exemple des évaluations menées dans le cadre des Contrats
de plan État-régions), à travers le mandat étendu confié à des comités de pilotage
pluralistes.
1.3. L'une des spécificités du modèle britannique
est l'implication dans le développement de l'évaluation de réseaux d'expertise
sectoriels regroupant des universitaires, des professionnels et l'administration. Dans des
domaines tels que la santé et l'éducation, les professionnels ont une longue tradition
d'évaluation de leurs propres pratiques.
1.4. L'utilisation des résultats des évaluations
à des fins budgétaires ou gestionnaires est beaucoup plus directe et systématique qu'en
France. L'évaluation a souvent pour client direct le financeur d'une action (ex -
Further Education Funding Council). Cette orientation budgétaire se traduit
notamment par le rôle du NAO à travers les audits de performance et autres value for
money studies. La Nouvelle gestion publique (New Public Management, réforme de
la gestion publique mise en oeuvre dans les années 80) s'est traduite par une plus grande
instrumentalisation de l'évaluation à des fins " managériales ". Il
serait cependant erroné de ramener l'évaluation britannique au concept de "value
for money ", et les évaluations présentées au cours du séminaire relèvent en
fait d'une large gamme de finalités (accountability, monitoring des actions
publiques, auto-formation des réseaux d'acteurs).
Le contraste demeure néanmoins fort avec les évaluations françaises
(qu'elles soient interministérielles, ministérielles ou régionales), qui n'abordent que
rarement la question de l'efficience des politiques et programmes publics, et sont
rarement utilisées pour préparer des décisions budgétaires.
1.5. En ce qui concerne les méthodes, le pluralisme
des démarches et des outils est la règle dans les deux pays. L'évaluation est
généralement considérée comme nécessitant la mise en oeuvre conjointe de méthodes
quantitatives et qualitatives. Les principales différences sont, d'une part,
l'utilisation plus systématique des approches comparatives en Grande-Bretagne. Bien
qu'ils ne soient pas aussi fréquemment mis en oeuvre qu'aux Etats-Unis, les protocoles
expérimentaux avec groupe de contrôle équivalents sont d'une pratique plus courante
qu'en France.
2.- Institutions et usages de l'évaluation au Royaume-Uni :
une vue d'ensemble
Christopher Pollitt
Professeur et co-directeur, Centre for the Evaluation of
Public Policy and Practice (CEPP),
Brunel University, Uxbridge.
2.1. Les institutions : hypothèses pour un débat
Puisque nous sommes ici pour discuter, je vais commencer par proposer
un schéma très simple afin de susciter le débat. En m'appuyant sur la théorie
contemporaine des organisations, je suggère que l'institutionnalisation de l'évaluation
dans le secteur public a été très différente selon les pays :
– aux Etats-Unis, l'évaluation s'est institutionnalisée
- principalement selon le modèle du marché ;
– en France, l'évaluation s'est institutionnalisée
principalement de manière hiérarchique ;
– au Royaume-Uni, l'évaluation s'est institutionnalisée
principalement sous la forme d'un ensemble de réseaux sectoriels.
Bien sûr, cette caractérisation est trop simple. Bien sûr, il y a
des éléments de hiérarchie, de marché et de réseau dans les communautés évaluatives
des trois pays considérés. Néanmoins, ces trois stéréotypes pourraient bien receler
une part d'utile vérité - et ont au moins l'intérêt de me fournir une grille pour
décrire l'évaluation au Royaume-Uni.
Quelques mots supplémentaires sont nécessaires avant de continuer à
raisonner sur la base des contrastes que je viens de suggérer. Aux Etats-Unis,
l'évaluation est depuis longtemps un commerce (business). De nombreuses firmes,
partenariats et centres universitaires existent et sont en compétition pour obtenir des
contrats des gouvernements et des organismes para-étatiques. L'évaluation est un service
à vendre et la réputation méthodologique est l'un des arguments de vente du "
produit ".
C'est à nos collègues français de dire comment les choses se passent
en France, mais j'ai été frappé par le passage suivant dans un article écrit en 1995,
intitulé " Évaluation à la française " :
" En France, l'évaluation a été institutionnalisée selon
des modalités qui sont typiques du style d'administration publique de ce pays.
L'évaluation s'est développée parce que son institutionnalisation a précédé son
application à des politiques concrètes " ().
Pour ce qui est du Royaume-Uni, il y a eu peu d'institutionnalisation
" descendante " (top-down). L'évaluation s'est plutôt bien développée
dans quelques secteurs, mais beaucoup moins dans d'autres, à travers des réseaux variés
mais sans noyau central unique et évident. Bien que l'argent circule, ce qui modifie
certainement les pratiques, il y a toujours pas mal de " confort "dans
cette situation, et on est encore loin d'avoir un marché concurrentiel pleinement
développé au sens américain. Je compléterai dans un instant cette description
sommaire, mais je dois d'abord préciser rapidement dans quel sens j'emploie les mots.
2.2. L'évaluation, une notion mouvante
Il y a des débats sans fin, à la fois au sein des institutions et
entre elles, quant au sens du terme " Evaluation ". Le Petit guide de
l'évaluation des politiques publiques de Conseil scientifique de l'évaluation ()
illustre très bien cela en rassemblant un certain nombre de définitions alternatives
très contrastées tirées de différentes sources françaises. Et il y a beaucoup
d'autres exemples - le guide du Trésor britannique de 1988 dit que l'évaluation ex-ante
devrait être appelée " appraisal " (),
et non évaluation (). La Commission Européenne, d'un autre côté,
appelle " évaluations " les analyses ex-ante, concomitantes et
ex-post(). Alors qu'un autre organisme européen, la Banque
européenne d'investissement, insiste sur le fait que seules les analyses ex-post peuvent
être qualifiées d'" évaluations ", les études concomitantes devant
être appelées " monitoring ". Un certain nombre de définitions
soulignent la nécessité pour l'évaluation d'être " objective " ou
" scientifique ", alors que d'autres insistent sur la dimension du
jugement. En contraste, quelques unes mettent l'accent sur les potentialités
" participatives " ou " partenariales " de
l'évaluation. Certaines soulignent que l'évaluation doit être
" externe ", alors que d'autres admettent l'évaluation
" interne " et même " l'auto-évaluation ".
Il n'y a pas " une seule bonne réponse " en face
de ces diverses possibilités - chaque définition est taillée en fonction de la
politique, des objectifs et des présupposés culturels de l'auteur institutionnel
concerné. Pour les besoins de ce séminaire, je vais adopter une approche large qui
inclut les études ex-ante, concomitantes et ex-post, et qui permet aussi à
l'évaluation d'avoir pour objet des politiques, des programmes, des institutions, ou
même des groupes d'individus. Je vais donc emprunter à un universitaire allemand une
définition de travail inclusive de l'évaluation :
" Les évaluations (...) ont pour but d'appliquer les
théories, méthodes et techniques des sciences sociales pour porter des jugements
relatifs à l'utilité, l'efficacité et la responsabilité dans les organisations
gouvernementales et non gouvernementales, dans le but de stimuler l'apprentissage
collectif " ().
2.3. Les objets de l'évaluation
Une autre source de variation - souvent négligée dans la
littérature académique - est la nature de l'objet type de l'évaluation.
Evaluer un programme (l'implantation d'industries de pointe dans les zones
défavorisées) est différent d'évaluer une institution particulière (est-ce que
telle école est performante ?), et les deux diffèrent de l'évaluation d'un process
(est-ce que les médecins font de bons diagnostics pour les douleurs abdominales ?).
Et évaluer une politique aux objectifs plus larges (par exemple, aider les
personnes défavorisées à vivre aussi normalement que possible) peut être encore
différent de tout cela. Du point de vue de l'évaluateur, l'objet de l'évaluation peut
avoir une influence significative sur le choix des méthodes, sur le type de relations
qu'il ou elle aura à gérer, ainsi que sur les publics auxquels devra s'adresser le
rapport final. Il me suffit de dire ici que des évaluations de tous ces différents types
sont pratiquées au Royaume-Uni. Certains organismes d'évaluation peuvent être
spécialisés dans l'évaluation de l'un ou l'autre de ces types d'objet, mais plusieurs
ont la volonté et la capacité d'évaluer des objets de différentes natures.
2.4. La configuration institutionnelle au Royaume-Uni
Il n'existe au Royaume-Uni aucune organisation ou autorité centrale et
dominante qui contrôle ou supervise l'ensemble des activités d'évaluation. Il n'y a pas
non plus un groupe de grandes et prestigieuses firmes d'évaluation dotées de moyens
importants telles que le Brookings Institute ou la RAND Corporation aux
Etats-Unis. Il se fait beaucoup d'évaluation, sous des formes très variées, mais elle
n'est pas orchestrée depuis un petit nombre de centres de décision. Une grande partie
est centrée sur un secteur particulier, bien que l'une des tendances les plus
intéressantes des cinq années passées ait été un développement des échanges
d'expériences entre secteurs (cross-sectoral learning) (la création de la
Société britannique d'évaluation en est l'un des symptômes).
Cela n'est pas du tout pour nier que l'évaluation a sa place dans les
institutions centrales au coeur de l'exécutif. L'initiative la plus spectaculaire a
probablement été le Central Policy Review Staff, créé par le Premier
Ministre Heath en 1970 et supprimé par le Premier Ministre Thatcher en 1983 ().
Depuis 1983 les Premiers ministres conservent leurs propres équipes d'analyse des
politiques au n° 10 Downing Street ; celles-ci mènent souvent dans des délais
brefs des évaluations de politiques publiques dans une perspective fortement politisée.
Les unités qui travaillent au sein du Cabinet Office conduisent aussi parfois des
examen de politiques (policy review) qui méritent d'être appelés évaluation.
Toutefois, ce genre d'activité de haut niveau est largement soustrait à l'examen du
public, et a tendance a s'adapter aux modes politiques, et en particulier aux
préférences du Premier ministre et du Gouvernement ().
Dans le secteur public, de temps en temps, le Trésor publie un guide
de l'évaluation. Ceci est spécialement important pour les organismes publics qui veulent
mener des évaluations à caractère économique (ils doivent généralement se conformer
à l'approche recommandée par le Trésor) mais le " Livre vert " (c'est le nom
du guide) peut très bien rester totalement inconnu des autres évaluateurs, même au sein
du gouvernement central.
De plus – comme nous le dirons sans doute d'autres
contributeurs à ce séminaire – des unités appartenant à certains ministères
(spécialement la santé, l'éducation et l'emploi, et la coopération) jouent un rôle
majeur en tant que commanditaires et pilotes de l'évaluation dans leurs domaines. Ils
sont au centre de réseaux complexes auxquels participent aussi bien des professionnels
que des universitaires, définissent des priorités sectorielles et, dans certains cas,
des " styles sectoriels " de pratique évaluative, et lancent
également des appels d'offres pour les évaluations qu'ils financent.
Il faut également mentionner le National Audit Office et
l'Audit Commission. Ces deux organismes conduisent d'importants programmes d'audits de
performance, dont au moins quelques uns entrent dans la définition de l'évaluation que
j'ai proposée il y a quelques instants (). Le NAO réalise environ
50 analyses d'efficience (value for money studies) chaque année pour le compte du
Parlement (). L’Audit Commission publie chaque année un plus
petit nombre d'études spéciales sur les gouvernements locaux et le National Health
Service ().
Par ailleurs, de manière partiellement ou totalement indépendante de
l'Etat central, beaucoup d'autres évaluations sont réalisées. De nombreuses autorités
locales possèdent leurs propres unités d'analyse des politiques et d'évaluation.
Certaines professions, spécialement la profession médicale et les enseignants, ont une
longue tradition d'évaluation de leurs propres pratiques, et les institutions
professionnelles concernées continuent d'encourager ce genre de travail, parfois en
concertation avec les départements ministériels, parfois de leur propre initiative ().
Par exemple, depuis 1989, l'audit médical des médecins hospitaliers et des
généralistes est exigé, et le collège des médecins a produit une somme importante de
conseils à l'intention de ses membres sur ce sujet. Au cours des cinq ou six dernières
années, le Gouvernement et la profession ont joint leurs efforts pour promouvoir une
conception de la pratique médicale fondée sur l'observation (a philosophy of
" evidence-based medecine "). Dans le domaine éducatif,
l'auto-évaluation des établissements scolaires a été très à la mode pendant quelque
temps au cours des années 80, et des études d'efficacité à plus grande échelle
ont continué à être menées avec des hauts et des bas depuis les années 70. Il
existe un vaste réseau d'évaluateurs dans le domaine de l'éducation, basé
principalement dans les universités et les instituts. Un développement notable au cours
de la dernière décennie a été l'intérêt croissant pour l'évaluation du milieu
professionnel des travailleurs sociaux.
Une grande variété de modèles et d'approches est utilisée dans ces
travaux. A une extrémité du spectre se trouve l'expérimentation clinique randomisée en
médecine - scientifique, quantitative, orientées vers l'identification des effets
et la mesure de l'efficacité. Des protocoles expérimentaux ou quasi-expérimentaux
peuvent également se rencontrer dans d'autres domaines - les programmes d'aide à la
création d'emplois, par exemple, ou dans le domaine de la prévention du crime ().
A l'autre extrémité du spectre, typiquement dans le champ de l'éducation, de la
formation permanente et de la garde des enfants, des groupes locaux et des institutions
pratiquent des formes d'auto-évaluation très participatives, principalement centrées
sur l'amélioration des processus, ou le développement des personnes ou des équipes.
L'éducation, l'apprentissage et l'emploi sont des domaines particulièrement
intéressants, parce qu'ils fournissent des objets qui se prêtent à la fois à la
recherche quantitative " dure " (hard edged) et à des
approches participatives et " développementales ".
2.5. L'évaluation et la Nouvelle gestion publique (New Public
Management, NPM)
L'évaluation est quelquefois considérée comme une simple composante
de la Nouvelle gestion publique. Dans cette perspective, l'évaluation est une phase d'un
processus cyclique de management rationnel (" planifier, réaliser,
examiner " comme le dit une célèbre maxime managériale). Il ne fait aucun
doute que, dans un certain nombre de pays - et tout particulièrement au Royaume-Uni,
les réformes de la gestion publique ont fait porter une attention plus soutenue à la
fixation des objectifs, l'amélioration du suivi des performances et l'évaluation
régulière (). L'un des motifs de ces changements est le resserrement des
budgets et le besoin subséquent d'afficher des " résultats ". Qui
plus est, quelques uns des systèmes les plus populaires pour améliorer la qualité et la
sensibilité aux besoins des usagers des services publics formulent la nécessité
d'analyser en détail les processus existants comme base d'une " amélioration
continue " (Total Quality Management, benchmarking, re-engineering) ().
Il en résulte que la pression continue en faveur des réformes de la
gestion publique a certainement aidé à promouvoir l'évaluation. De fait, au cours des
années 80, on peut observer que de plus en plus d'évaluations ont revêtu un caractère
managérial. Parallèlement, les firmes de conseil en management ont commencé à jouer un
rôle plus important dans les évaluations commanditées par le Gouvernement. Il est assez
intéressant d'observer que, bien que le NPM mette en avant la nécessité d'évaluer
comme faisant partie intégrante d'une bonne gestion, les réformes de la gestion publique
elles-mêmes ont souvent (et dans de nombreux pays) échappé à l'évaluation
systématique.
Ce serait pourtant une erreur que d'associer de manière trop exclusive
le récent développement de l'évaluation à la tendance
" managériale ". Comme on l'a indiqué plus haut, l'évaluation au
Royaume-Uni repose sur plusieurs types d'initiatives et revêt de nombreuses formes (en
fait, il ne serait pas trop hasardeux de considérer quelques uns des développements
intra-professionnels en matière d'évaluation comme des tentatives calculées de la part
des professionnels concernés pour prévenir le risque de se voir imposer des évaluations
de style managérial par le Gouvernement ou d'autres organismes financeurs). L'évaluation
a été influencée de manière significative par le NPM, mais elle a aussi sa propre
existence en dehors de l'idéologie managériale.
2.6. Remarques conclusives
Selon le tableau que j'ai essayé de brosser, les institutions
centrales du Gouvernement ne pilotent d'aucune manière l'évaluation au Royaume-Uni, bien
que leur influence soit importante. Il existe de nombreux centres d'expertise
indépendants, quoique probablement aucun dont la taille, les ressources et le
savoir-faire puisse rivaliser avec les institutions et corporations américaines les plus
renommées. La plupart des évaluations ont lieu au sein de réseaux sectoriels, bien que
les échéances d'expériences entre les secteurs paraissent se multiplier. Une grande
variété d'objets, d'approches et de méthodes coexistent.
Si cette description est acceptée comme approximativement exacte, nous
pouvons revenir à la question implicitement posée par la
" provocation " d'ouverture. Est-ce que les configurations
institutionnelles et le cadre culturel de l'évaluation sont, en France, semblables, ou
différents, de ce que l'on observe au Royaume-Uni ? Et s'ils sont différents,
quelles sont les causes sous-jacentes des caractéristiques spécifiques de l'évaluation
dans chacun des deux pays ?
3.- Le contrôle du bon usage des fonds public par le National
Audit Office
Sous sa forme et avec sa dénomination actuelle, le National Audit
Office a été créé en 1983 par le National Audit Act, avec pour
mission de renforcer le contrôle parlementaire sur l'utilisation des fonds publics.
Avant cette réforme, l’institution supérieure de contrôle (the
Exchequer and Audit Department) avait une activité centrée sur
l’audit financier et le contrôle de régularité. Le NAO a un mandat clair pour
examiner l’activité des départements ministériels et des organismes publics sous
l’angle de l’économie, de l’efficience et de l’efficacité. Chaque
année, le NAO transmet 50 rapports de type Value for money au Parlement britannique.
Extrait de l'intervention de David Goldsworthy
National Audit Office
3.1. Les différents types d'examen de type Value for money
" Ce que fait le National Audit Office sous le
label value for money peut être rangé dans la classification suivante :
– Les audits de performance - Typiquement, ils
examinent si une organisation, ou un aspect d'une organisation, fonctionne ou non de
manière efficiente. Les études de cette catégorie s'efforcent de fournir au Parlement
la garantie que l'organisation travaille de manière appropriée. De telles études
évaluent dans quelle mesure une organisation respecte ses propres règles ou se conforme
à un modèle de bonne gestion. Ils peuvent faire des recommandations en vue de
l'amélioration des procédures. Par exemple, une récente étude sur les opérations de
rénovation de la Corporation de développement Urbain de Leeds et Bristol a examiné
comment ces structures géraient la rénovation et fait des recommandations pour aider de
futures structures du même type à mener à bien une rénovation dans de meilleures
conditions ;
– Les examens spéciaux - Ce sont des études plus
courtes destinées à analyser un dysfonctionnement particulier dans un système. Parfois,
une telle étude permet d'identifier un problème qui pourrait survenir dans d'autres
circonstances. Par exemple, une étude sur la construction de la New British Library a
mis en évidence des dépassements massifs de coûts et de délais causés par un
contrôle de gestion insuffisant ;
– Les évaluations de programme - Ces opérations
cherchent à apprécier dans quelle mesure une organisation ou un programme atteint ses
objectifs. Parfois, de telles études prennent en compte la question du rapport
coût/efficacité et, quand les objectifs sont mal définis, elles aident à les
clarifier. Par exemple, l'évaluation du programme d'entretien des ponts de l'agence des
autoroutes a cherché à savoir si un programme national de maintenance des ponts
améliorait l'état des ponts, et si le programme était géré de manière
efficiente.
3.2. Value for money et évaluation
Une partie de la difficulté de comparer les études value for money
et l'évaluation réside dans l'élasticité des deux concepts. La courte littérature
sur ce sujet tend à établir de fausses dichotomies et de faux contrastes, comparant,
selon les préjugés des auteurs, des versions idéalisées de l'un avec les versions
opérationnelles de l'autre. Dans un tel scénario, les études value for money apparaissent
limitées parce qu'elles ne parviennent pas à fournir une mesure rigoureuse, sur une base
expérimentale, de l'efficacité d'un programme, et, d'un autre côté, les évaluations
formatives réalisées en interne ne répondent pas aux besoins des décideurs parce
qu'elles n'évaluent pas bien les coûts. En pratique, peu d'études traitent de tous les
aspects d'un programme et beaucoup de ce que l'on appelle évaluation est identique à ce
que l'on appelle value for money. Si l'évaluation est un terme valise englobant
toutes les formes d'examen qui cherchent à informer les décideurs au sujet de la raison
d'être ou de la valeur d'un projet, d'un programme, d'une politique ou d'un produit,
alors les études value for money constituent un sous-ensemble de
l'évaluation. Toutefois, ce sous-ensemble présente des caractéristiques spécifiques,
en relation avec le contexte dans lequel le National Audit Office intervient, la
manière dont il a cherché à remplir son mandat et le profil des compétences (the skill
mix) de son personnel ".
4.- L'évaluation des politiques et des pratiques dans le secteur
sanitaire et social
La responsabilité de l'évaluation dans le domaine sanitaire et
social incombe principalement au Ministère de la Santé, bien que d'autres acteurs
interviennent également (organismes de recherche, universités, fondations, etc.).
L'évaluation repose sur plusieurs types d'outils : les informations d'origine
managériale ou politique (management and political feedback), les suivis
statistiques, le suivi financier, les inspections et la recherche évaluative.
Extraits de l'intervention de Jenny Griffin,
Head of Policy Research Programme
Department of Health, London
4.1. Une exigence croissante d'évaluation
" Les départements ministériels sont soumis à de fortes
pressions pour évaluer leurs politiques, y compris des pressions du Trésor pour faire la
preuve de leur efficience (value for money and cost effectiveness), ainsi
qu'à une exigence croissante de la part du public pour que les décisions
gouvernementales, par exemple dans le domaine de la qualité de l'air, soient fondées sur
de solides évaluations scientifiques.
En Angleterre, tous les ministères dépensiers ont d'importants
programmes d'évaluation en cours de réalisation, et c'est aussi le cas pour le
Département de la Santé. Le programme d'évaluation du département de la santé couvre
l'ensemble du domaine de compétence du Secrétariat d'Etat à la santé [exercer la
tutelle du National Health Service, protéger et promouvoir globalement la santé de la
population, définir la stratégie et les politiques en matière de services sociaux (social
care services)]. Actuellement, les évaluations en cours sont les suivantes :
– des projets de recherche évaluative relatifs au Children
act (qui organise les soins pour les enfants en difficulté ou à risque) ;
– le Community Care Act (qui définit le cadre
législatif du soutien social aux personnes âgées fragiles et aux personnes
dépendantes) ;
– le Mental Health act (qui organise les services de
soin médical et de soutien pour les malades mentaux) ;
– la nouvelle stratégie d'organisation des services de
cancérologie ;
– toutes les initiatives prises pour renforcer les soins
primaires en Angleterre ;
– les stratégies de gestion des ressources humaines au sein
du NHS et des services sociaux ;
– la stratégie dite " Santé de la nation ", dans
le champ de la santé publique. "
4.2. L'organisation de la recherche évaluative
" La demande de recherche évaluative des Ministres de la
santé est importante. Ils considèrent que l'évaluation scientifiquement robuste va dans
leur propre intérêt. Les hauts fonctionnaires font des offres de financement de
recherche pour des évaluations qui correspondent à leurs exigences et à celles du
Ministre. Les priorités du programme de recherche sur les politiques, qui inclut
l'évaluation, sont fixées en tenant compte des critères suivants :
– les priorités ministérielles et l'adéquation aux
objectifs du département de la Santé ;
– l'ampleur et l'importance du problème en terme d'impact
présent ou potentiel sur l'état de santé ou les conditions de vie sociale ;
– la définition d'une stratégie précise pour introduire
les résultats de la recherche dans l'activité politique courante ou la formulation d'une
politique future ;
– les délais envisagés ;
– la faisabilité de la recherche ;
– le retour d'investissement attendu de la recherche ;
– la contribution possible d'autres budgets de recherche, par
exemple ceux d'organisations publiques non rattachées au ministère comme le Laboratoire
de la santé publique (Public Health Laboratory Service).
Un Comité de recherche ministériel, composé de hauts fonctionnaires
et de ministres fixe des priorités en utilisant ces critères. (...). Les cahiers des
charges [de la recherche évaluative] sont rédigés en étroite collaboration avec les
fonctionnaires en charge de politiques particulières, qui seront les utilisateurs de
l'évaluation. Le choix des contractants se fait sur la base d'un appel d'offres
concurrentiel et d'un examen par les pairs, et les comités d'appel d'offres sont souvent
constitués de membres de l'administration, des services et d'universitaires. Il est vital
que l'évaluation par un département ministériel soit considérée comme aussi ouverte
et indépendante que possible. Toutes les évaluations sont confiées à des organismes de
recherche universitaires (academic institutions). Aucune étude n'est réalisée en
interne ".
5.- L'évaluation dans le domaine de l'éducation
Le système éducatif britannique fait désormais l'objet d’un
ensemble très complet de procédures d’évaluation. Les évaluations dites "
systémiques ", les plus nombreuses et les plus importantes, sont réalisées par des
corps d'inspection coordonnés par l'Office for Standards in Education, dont les
pratiques du Further Education Funding Council (cf. ci-dessous) fournissent un
bon exemple. En outre, des activités ou projets pédagogiques particuliers qui
bénéficient du mécanisme dit Categorical funding mechanism font l'objet
d’évaluations particulières, soit "horizontales" (concernant un ensemble
de projets du même type), soit "verticales" (évaluation d’un seul
projet). Pour Murray Saunders, qui intervient en tant qu’évaluateur dans le cadre du
categorical Funding, le développement des procédures d’évaluation peut
être vu comme la manifestation d’une perte de confiance dans l’expertise des
professionnels de l’éducation.
5.1. L'évaluation et la crise de " l'autorité
professionnelle "
Murray Saunder,
Directeur du Centre for the Study of Education and training
Head of the Department of Educationnal Research
Lancaster University
" La croissance de l'activité d'évaluation dans le domaine
de l'éducation peut être vue comme participant d'une tendance plus générale à la
responsabilisation sur une base plus ouverte et plus objective (assertive) ainsi
qu'au contrôle de la manière dont les ressources sociales sont utilisées. Il est
intéressant de remarquer que cela reflète un changement dans l'équilibre du pouvoir au
détriment des détenteurs de l'expertise technique au profit de ceux qui contrôlent et
utilisent les ressources. Ce processus pourrait être qualifié d'hégémonie
consumériste, dans la mesure où les utilisateurs et les commanditaires se sont vu
reconnaître un droit de contrôle légitime plus étendu sur la qualité et la
spécification de l'expertise. D'où le fait que les utilisateurs attendent désormais
davantage de leurs droits légitimes et de leur pouvoir d'intervention dans un domaine qui
était autrefois considéré comme réservé à la décision fondée sur l'expertise.
Jusqu'ici, les "experts" ont bénéficié d'une sorte
d'immunité (behavioural immunity), qui s'exprime par un degré important
d'autonomie, justifiée (et acceptée par le public et les décideurs politiques) par la
conscience de leur "autorité professionnelle". Pour l'essentiel, cela équivaut
à un contrat implicite entre le commanditaire, l'usager, le client, etc., et l'expert. On
leur fait confiance pour fournir des résultats globalement acceptables, fondés sur
l'expertise, sans avoir besoin d'une régulation ou évaluation externe. Le concept de
"professionnel" dont on fait ici usage se réfère à un ensemble de valeurs
qui, en effet, équivalent à un contrat. Si un individu est considéré comme un
professionnel, cela signifie qu'il a intériorisé un ensemble de valeurs incluant des
principes de conduite qui lui confèrent une capacité d'autorégulation.
Les choses ont changé. L'évaluation est de plus en plus une activité
procéduralisée (a designated activity), menée par un nombre croissant
d'individus et d'organismes. Elle participe d'une crise générale de la légitimité de
l'expertise, particulièrement prononcée dans le contexte éducatif britannique. Il s'est
produit une rupture dans le contrat tacite qui caractérisait les rapports de
l’utilisateur et de l’expert. Les attentes du premier n’avaient pas
d’autres fondements que les valeurs collectives incorporées à l’idée
d’expert professionnel. L’évaluation et la responsabilisation par des
vérificateurs externes participent d’un nouveau fondement de la légitimité,
essentiellement coercitive et scientiste, c’est-à-dire fondée sur des critères
quasi-objectifs, sur la démonstration et les résultats davantage que sur la confiance.
Une fois que la confiance dans le professionnel s’affaiblit, quel autre moyen peut-on
mettre en oeuvre pour réguler la qualité d’un service ou d’une expertise que
la vérification " objective " ?
5.2. L'inspection au Further Education Funding Council
Le Further Education Funding Council a été crée en 1992. Il est
responsable de la répartition des fonds d’Etat (3 milliards de livres par an)
et de la qualité de l’enseignement pour l’ensemble du secteur de la Further
Education, qui comprend 450 collèges de secteur (établissements publics) qui
dispensent un enseignement qui va des dernières années de l’enseignement de base
(secondaire) à l’enseignement supérieur et professionnel. Ils reçoivent
environ 4 millions d’élèves chaque année, soit 68% de la population
scolarisée de 16 ans et plus. Le Council emploie 74 inspecteurs.
Extrait de l'intervention de Mark Griffiths
The Further Education Funding Council.
1. Les principes de l'inspection
" Les principes suivants guident toute l'activité
d'inspection :
– les inspections sont planifiées en concertation avec le
collège et tiennent compte de son organisation ;
– les objectifs et critères de succès que se donne
lui-même le collège, ainsi que le rapport établi en interne sur la qualité de
l'enseignement, sont pris en compte pour établir le contexte de l'évaluation ;
– le processus d'inspection inclut l'observation directe de
l'enseignement, la confrontation des performances du collège aux engagements pris dans sa
charte et l'évaluation de la stratégie du collège pour contrôler et améliorer sa
prestation.
2. Qualité et Standards
Le travail de l'inspection repose sur des jugements sur la qualité et
les standards. Les standards concernent prioritairement le niveau scolaire attendu et
effectivement atteint par les étudiants, ils peuvent être évalués en fonction des
points suivants :
– l'étendue et le niveau d'approfondissement de
l'enseignement, tel qu'ils ressortent des documents de cours ;
– les connaissances attendues des étudiants et les
compétences impliquées par les épreuves d'évaluation et questions d'examen ;
– les réponses des étudiants aux examens et autres formes
d'évaluation ;
– la rigueur manifestée dans la notation des épreuves
d'examen et autres évaluations ;
– le contrôle de la notation par des procédures internes et
externes.
Le concept de standard est relativement strict : atteindre des
standards élevés et un objectif ; atteindre des standards minimaux est une
obligation ; les standards sont mesurables et vérifiables et il est légitime de comparer
directement les standards atteints par des établissements menant aux mêmes
qualifications.
La qualité est interprétée en termes d'expérience des étudiants et
peut être évaluée en fonction des points suivants :
– les compétences manifestées dans le management des
tâches éducatives et d'enseignement ;
– le degré de réponse aux besoins des étudiants ;
– le soin avec lequel les étudiants sont orientés vers des
filières dans lesquelles ils ont des chances de réussir ;
– les conseils et le soutien intellectuel et éducatif fourni
aux étudiants ;
– les compétences académiques et pédagogiques manifestées
par les professeurs ;
– l'adéquation de l'environnement aux objectifs
d'enseignement ;
– la diversité et le caractère approprié des ressources
matérielles utilisées dans l'enseignement.
La qualité est plus floue que les standards ; atteindre une bonne
qualité est une aspiration ; la qualité, quoique non mesurable, peut être soumise
à un jugement professionnel et les comparaisons de qualité entre les institutions
doivent tenir compte des différences dans les missions et les valeurs ".
6.– L'évaluation au Ministère de l'intérieur (Home
Office)
Le Home Office est responsable de la justice criminelle, de
la police, de la prévention du crime, de la prévention de la toxicomanie, des prisons,
de la liberté surveillée, de l'immigration et des naturalisations. L’évaluation
dans les domaines considérés est le fait d'acteurs diversifiés, au sein de
l'administration (corps d'inspection, direction en charge de la recherche et des
statistiques, cellule de réflexion stratégique qui choisit et renseigne des indicateurs
de performance pour la Police), et à l'extérieur (Audit commission, National
Audit Office, Universités).
Extrait de l'intervention de Nick Tilley
Crime and Social Research Unit
The Nottingham Trent University, Nottingham
Les fonctions de l'évaluation :
" Les différentes formes de l'activité évaluative ont des
fonctions diverses et complémentaires :
– Contrôle : L'adage qui dit que "ce qui
est compté compte " (what gets counted counts) a quelque validité. Il ne
fait aucun doute que la fixation d'objectifs nationaux par le ministère de l'intérieur
et la mise en place d'indicateurs de performance pour en mesurer l'atteinte ont eu un
impact significatif sur les performances de la police. Le choix d'une batterie
d'indicateurs est un moyen de définir des priorités. En matière de police, par exemple,
l'utilisation d'un indicateur de récurrence des agressions a réussi à faire porter
l'attention des services sur cet enjeu. Les aspects de la performance qui ne sont pas pris
en compte par les indicateurs risquent d'être négligés ;
– Mettre en oeuvre la responsabilité : l'utilisation
de sommes importantes d'argent public requiert des mécanismes de responsabilité (accountability).
L’audit de l'activité des services du ministère de l'intérieur et des
organismes bénéficiaires de subventions répond pour partie au besoin de contrôler les
irrégularités. L'audit contribue également à l'évaluation de l'efficience et de
l'efficacité des services fournis ;
– Identifier et diffuser les bonnes pratiques, et
s'assurer de pratiques satisfaisantes : l'inspection de routine permet
d'identifier de "bonnes" (et de "mauvaises") pratiques, et de donner
des directives aux fournisseurs de service pour qu'ils emploient des moyens plus adaptés
en vue d'atteindre leurs objectifs ;
– Informer ceux qui conçoivent les politiques et
répartissent les crédits : les efforts réalisés par la Direction des
statistiques et de la recherche pour produire des évaluations approfondies et rigoureuses
des politiques et de programmes permettent d'identifier les types d'action efficaces. Il
s’agit de préparer les décisions concernant les politiques ou les programmes qui
ont un enjeu financier important ;
– Tirer des enseignements des innovations : le
système de justice criminelle doit faire face à d'épineux problèmes de pratique et de
fourniture de service. Le besoin existe de capitaliser au niveau national les
enseignements tirés des innovations locales, qu'il s'agisse de projets spéciaux ou de
modifications apportées aux schémas habituels de fonctionnement des services. Une partie
du travail de la Direction des statistiques et de la recherche (notamment à travers
l'Unité de développement de programmes) est consacrée à cette tâche, en particulier
pour ce qui concerne la réduction de la criminalité. La plus grande partie du
travail d 'évaluation du groupe de recherche sur la police y est consacrée, dans le
cadre du programme à long terme Police Operations Against Crime. Une grande
partie de l'évaluation interne aux services de police et de liberté surveillée a pour
but l'amélioration des pratiques ;
– Evaluations critiques de modèles de pratique : la
plus grande partie du travail d'évaluation conduit en interne fait l'objet d'une
publication et ceci permet l'exercice d'une certaine forme de responsabilité vis-à-vis
du public. Cependant, si cette évaluation est menée par les services du ministère ou
financée par lui (ou par toute autre agence gouvernementale), le risque existe qu'elle ne
soit pas perçue comme tout à fait indépendante. Les études d'évaluation réalisées
par les universités ou d'autres organismes de recherche indépendants (tels que le Policy
Studies Institute ou la Police Foundation) et financées par le Conseil pour
la recherche économique et sociale ou des fondations philanthropiques peuvent répondre
au besoin d'une évaluation encore moins suspecte de partialité".
7.- L'évaluation dans le domaine de la sécurité sociale
En matière de Sécurité sociale, tous les nouveaux programmes de
dépense font l'objet d’une évaluation ex-ante. Chaque évaluation est
réalisée sous la responsabilité des fonctionnaires chargés d’élaborer et de
mettre en oeuvre la politique. Pour les programmes importants, l’évaluation
s’intègre dans une procédure de management de projet. Dans tous les cas, le projet
d’évaluation est soumis au Trésor. Le recours à la technique de l’appel
d’offres pour sélectionner les équipes de recherche est systématique.
L’équipe de projet comprend un " research laison officer " qui
joue le rôle médiateur entre les équipes de recherche et leurs clients. Du point de vue
méthodologique, les évaluations reposent de plus en plus fréquemment sur la
réalisation d’une étude pilote, qui nécessite la mise en oeuvre expérimentale du
programme par un sous-ensemble de ses cibles potentielles. Pour autant, la réalisation
d’une évaluation suivant un véritable protocole expérimental se heurte à
d’importantes difficultés et demeure exceptionnelle.
7.1. L'éthique et les méthodes de la recherche
évaluative
Extrait de l'intervention de Peter Craig
Social research branch, Departement of Social Security
" La recherche évaluative au Département de la Sécurité
sociale utilise les méthodes de recherche habituelles (mainstream). La plupart des
évaluations, quelle que soit leur importance, reposent sur une combinaison d'enquête à
grande échelle (postales, par téléphone ou par entretien) et de recherche qualitative
à plus petite échelle, s'appuyant quelquefois sur l'analyse secondaire d'études
existantes ou de données administratives. Les échantillons sont souvent tirés des
fichiers de bénéficiaires, dont l'utilisation pour la recherche est prévue dans les
Social Security Acts. En pratique, les contraintes imposées à la diffusion de
l'information sont plus étroites que celles requises par la loi. La participation des
individus aux enquêtes, que l'échantillon soit ou non tiré à partir d'un fichier de
bénéficiaires, est fondée sur le principe du consentement éclairé. Dans le cas d'une
enquête par entretien avec un échantillon tiré des fichiers de bénéficiaires, par
exemple, les futurs éventuels enquêtés reçoivent une lettre d'information qui explique
le but de la recherche et l'identité du commanditaire, fournit des assurances de
confidentialité, et leur laisse la possibilité de refuser l'entretien avant de recevoir
la visite de l'enquêteur.
L'évaluation ayant à mesurer l'impact net d'une politique au bout
d'un certain temps de mise en oeuvre, une seule interrogation (a cross section survey) d'une
population cible est rarement adaptée. Les évaluations de grande ampleur nécessitent
une série d'interrogations étalées sur plusieurs années pour établir une base de
comparaison à partir de laquelle on peut ensuite observer les effets de la politique au
cours du temps. L'évaluation du 1995 Pension Act, par exemple, qui a introduit un
ensemble de modifications dans les pensions de retraite versées à divers titres (state,
occupationnal and personal pensions), a nécessité une série d'enquêtes auprès des
employeurs entre 1994 et 1998, des recherches qualitatives auprès des administrateurs des
organismes de retraite, des bénéficiaires et des professionnels impliqués dans le
contentieux les demandes de renseignements, ainsi que des enquêtes auprès des femmes et
des avocats concernés par la question des pensions de divorce. La recherche menée pour
l'évaluation du programme Jobseeker’s Allowance a nécessité des enquêtes
auprès de deux cohortes de demandeurs d'emploi, l'une tirée avant et l'autre après la
modification du dispositif. Chaque cohorte est interrogée deux fois à six mois
d'intervalle, de sorte que l'on peut comparer les effets des régimes pré et post JSA pour
des paramètres tels que la sortie du chômage ".
7.2. Le champ d'application des protocoles expérimentaux
Extrait de l'intervention de Robert Walker
Center for research in Social Policy
Loughborough-University
" Le champ d'application possible de l'expérimentation pour
la réalisation d'études pilotes dans le domaine des politiques de Sécurité sociale est
sévèrement limité. Non seulement les protocoles expérimentaux sont très difficiles à
mettre en oeuvre, mais les chances sont minces de les voir répondre aux besoins
d'évaluation qui apparaissent lors du développement de nouvelles politiques.
On peut attendre de l'expérimentation qu'elle fournisse des résultats
clairs seulement dans les situations où la politique est soit évidemment efficace, soit
un irrémédiable désastre. Même dans ces cas, les résultats peuvent très bien être
ambigus si l'environnement de la politique est complexe ou susceptible d'être affecté
par des changement exogènes, tels qu'une augmentation ou une chute de la demande finale.
Qui plus est, lorsqu'il y a un besoin d'évaluer des effets de système (system-wide
effects) ou des effets au niveau du comportement individuel, l'expérimentation n'a
pas grand chose à offrir. De plus, il n'est pas sûr que les résultats d'une étude
coût/bénéfice - que l'expérimentation seule permet - puissent être
agrégés au niveau national avec un degré de fiabilité suffisant. Si l'on ajoute à
cela que l'expérimentation est coûteuse et longue, il devient très difficile de
recommander que l'évaluation devienne un outil d'usage fréquent pour développer la
politique de Sécurité sociale.
Ceci ne conduit pas nécessairement à dire qu'il est impossible de
mener des études pilotes avant la mise en oeuvre généralisée d'une politique.
Toutefois, la réalisation d'études pilotes sera toujours difficile, il est peu
vraisemblable que les résultats seront définitifs et le risque inhérent à la décision
politique demeurera.
Par ailleurs, il n'est pas du tout certain que les études pilotes
doivent prendre la forme de protocole expérimentaux ou quasi-expérimentaux (qui se
heurtent à beaucoup des problèmes rencontrés dans l'expérimentation véritable). Il
est difficile de justifier le coût supplémentaire de l'expérimentation comparée à
d'autres approches. Dans bien des circonstances, il est vraisemblable que les protocoles
avec un seul groupe (N.D.T. : sans groupe témoin), tels que pratiqués dans les
études pilotes administratives, peuvent suffire pour produire l'information nécessaire
à l'évaluation prospective de la politique, à savoir répondre à des questions telles
que : "avec quel effet apparent ?" et "à quel coût
unitaire?". De plus, la compréhension peut être améliorée par le recours à une
forme ou l'autre d'évaluation " naturaliste "(realistic).
Il se peut que les études pilotes, quel que soit leur type, doivent
être considérées seulement comme une option de dernier recours. Il faut d'abord mettre
à contribution les recherches existantes pour aider à la formulation des objectifs de la
politique et pour développer des modèles relatifs à la manière dont une politique
particulière pourrait fonctionner. Ces modèles pourraient être testés en utilisant des
techniques pluralistes incluant le dialogue avec les responsables, les bénéficiaires
potentiels et les autres acteurs de la politique. Ces modèles, convenablement
spécifiés, pourraient alors être utilisés pour élaborer des modèles économétriques
qui pourraient être utilisés pour tester des variantes de la politique et mener des
analyses coût/bénéfice au niveau global. C'est seulement si des incertitudes
significatives demeurent à ce stade qu'il convient d'envisager une étude pilote. Et
même dans ce cas, on pourrait bien trouver des arguments pour de nouvelles recherches
fondées sur des méthodologies pluraliste ou naturaliste. La rapidité, le coût et le
besoin de comprendre peuvent contrebalancer l'espoir d'une mesure précise des résultats
".
RETOUR SOMMAIRE
© Assemblée nationale
|