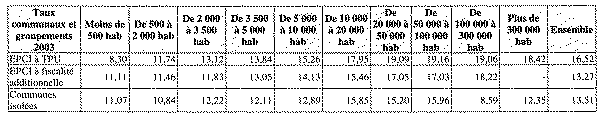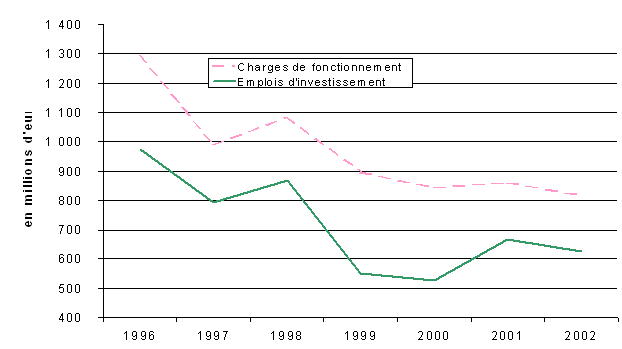Dès lors que ni les transferts de charges liés à l'acte II de la décentralisation, ni le désengagement de l'État n'expliquent, sinon pour une faible part, l'évolution de la fiscalité locale en 2005, il faut bien en chercher ailleurs les véritables causes. Ainsi que l'a remarqué M. Alain Guengant, « sur une période d'observation assez longue, une multitude de facteurs peut conduire à faire déraper la fiscalité [...]. Il en va tout autrement lorsque toutes les collectivités de même niveau, à la même heure, font évoluer leur fiscalité dans les mêmes proportions : il ne peut y avoir dans ce cas qu'un seul phénomène générateur. La question est de savoir s'il est d'ordre politique, économique ou autre ». La simultanéité apparente des décisions tient en fait à la stratégie de communication des régions et des départements, qui ont choisi de s'expliquer abondamment sur les responsabilités de l'État dans les hausses fiscales. Mais les budgets ont été adoptés aux dates habituelles, et l'éventail des pourcentages d'augmentations, même pour les régions, est très ouvert, en fonction de l'équation de chaque collectivité. S'il y a en pratique un faisceau de faits générateurs spécifiques à la hausse de la fiscalité locale en 2005, ainsi que l'ont révélé les investigations de votre Commission, ceux-ci sont bien des choix d'ordre politique et économique : le cycle électoral, les priorités de dépenses des collectivités territoriales et la stratégie financière de celles-ci, notamment en matière d'endettement et d'optimisation fiscale. Il n'a échappé à personne que, si les maires sont à mi-mandat, l'année 2004 a été marquée par le renouvellement des conseils régionaux et des conseils généraux pour la moitié de leurs élus, renouvellement qui, dans le cas des régions, s'est traduit par un profond changement des majorités politiques. De fait, la concomitance entre ces élections, la stabilité des taux de fiscalité locale maintenue en 2004, et leur envolée, dès l'année suivante, paraissent confirmer la valeur explicative de la notion de cycle électoral entre 2004 et 2005. 1.- Pertinence de la notion de cycle électoral La notion de cycle électoral en matière budgétaire et fiscale n'implique pas en elle-même de jugement de valeur. Il est normal qu'une majorité accédant au pouvoir engage des projets et ait besoin de les financer, que leur réalisation se déroule en milieu et en fin de mandat, avant qu'un certain retour à l'équilibre précède le rendez-vous suivant avec les électeurs. La préoccupation de votre Commission d'enquête est que ces phénomènes se réalisent dans la clarté et ne soient pas dissimulés aux électeurs. Les développements théoriques autour du cycle électoral ont distingué deux phases encadrant ce moment-clé pour les décideurs publics locaux que sont les élections : - d'abord, un cycle opportuniste s'observe lorsque, à l'approche des élections, la majorité en place augmente les engagements de la collectivité - pour améliorer la situation économique de celle-ci ou pour satisfaire telle ou telle fraction de l'électorat - ou marque une pause fiscale. Les deux tendances peuvent naturellement coexister. - ensuite, le cycle partisan est caractérisé lorsque l'arrivée d'une nouvelle majorité se traduit par l'application, immédiate ou plus tard dans le mandat, de son programme, ce qui, si les ressources de la collectivité ne sont pas suffisantes, entraîne la hausse de la fiscalité locale pour le financer, ou l'oblige à anticiper les moyens nécessaires à terme - à moins que la hausse ne soit justifiée par la nécessité de rattraper la stabilité fiscale de l'année électorale ou de solder le passif de la majorité précédente. En France, l'évolution des budgets des communes confirme empiriquement, de longue date, l'existence de cycles électoraux, ainsi que l'a constaté M. Dominique Hoorens, directeur des études de Dexia-Crédit local, au cours de son audition : « la fiscalité des communes et des groupements évolue en moyenne entre 0 % et 4 %. Elle est rythmée par des cycles électoraux assez marqués : on constate ainsi que les alourdissements de pression fiscale sont concentrés en début de mandat municipal. « Pour les départements, les statistiques ne permettent pas d'isoler un lien aussi fort avec le cycle électoral, les renouvellements ayant lieu de manière fractionnée. Les augmentations sont assez significatives, celles de 2002 et 2003 étant imputables à l'apparition de nouvelles charges, relatives aux SDIS ou à l'APA. En 2005, le taux de croissance de la pression fiscale des départements devrait encore avoisiner 4 %. « Les régions ne votent leurs taux que depuis 1989. Elles les ont fait augmenter en moyenne dans des proportions assez significatives - plus de 20 % la première année. Un rebond a été constaté juste après l'année du premier renouvellement, en 1993, et, pour 2005, nous prévoyons encore une augmentation moyenne de 20 %. Mais le dernier mandat constituait un contre-exemple : la fiscalité a été relativement étale entre 1997 et 2004 ». Les tableaux apportés par M. Dominique Hoorens à l'appui de son commentaire sont reproduits dans le tome III du présent rapport. En d'autres termes, la notion de cycle électoral se montre globalement pertinente pour les communes, mais moins pour les départements, notamment en raison de leur mode de renouvellement. L'effet du cycle n'a pas été encore systématiquement caractérisé pour les régions, du fait du manque de recul lié à la date récente de leur création. Mais le tournant des années 2003-2005 sera, à l'évidence, un jalon décisif dans l'arrivée à maturité des budgets régionaux. 2.- L'application de la théorie du cycle électoral aux comportements des décideurs locaux en 2004 et 2005 Dans une interview parue dans le Figaro du 11 janvier 2005, M. Philippe Laurent, interrogé sur la question de savoir si les hausses en début de mandat sont classiques, répondait que « c'est un phénomène qui était surtout sensible pour les communes, et qui semble nouveau pour les départements et les régions, probablement en raison de l'ampleur de l'alternance de mars 2004 ». En effet, tant le cycle opportuniste que le cycle partisan semblent avérés pour les régions et les départements en 2004 et 2005. Le cycle opportuniste s'observe à travers deux phénomènes : d'une part, la baisse ou la hausse modérée de la fiscalité dans la perspective de l'élection et, d'autre part, l'augmentation des dépenses de la collectivité en fin de mandat. · La modération fiscale pendant l'année préélectorale implique un rattrapage l'année suivant l'élection. Pour l'année 2004, année d'élection, l'analyse des budgets primitifs des départements et des régions montre que beaucoup d'entre eux ont fait le choix de la modération fiscale, surtout sensible d'ailleurs dans le cas des départements, après deux années de hausse. En effet, alors que l'ensemble de la fiscalité départementale avait augmenté de 3,5 % en 2002 et de 3,9 % en 2003, les taux ont été relevés en moyenne de 1,2 % en 2004, et 58 départements ne les ont pas augmentés. Quant aux régions, seules trois d'entre elles avaient augmenté ceux-ci en 2004, la hausse globale étant ainsi limitée à 0,4 %. Le département de la Vienne constitue un bon exemple de l'influence du cycle électoral sur l'évolution de la fiscalité locale. Lors de son audition, M. Jean-Yves Chamard, président de la Commission des finances du conseil général, a présenté la stratégie fiscale de son département. Alors que la Vienne était, en 2000, le département le moins fiscalisé de France, une passe difficile pour le Futuroscope ajoutée « aux surcoûts de l'APA, du SDIS et des 35 heures, nous amène à environ 20 millions d'euros par an de dépenses supplémentaires ou de moindres recettes. Or, 20 millions correspondent à 24 points de fiscalité », sachant naturellement que « plus la fiscalité est faible, plus le pourcentage doit être élevé pour récupérer un euro supplémentaire ». « Bref, il nous fallait relever les impôts de 24 %. Nous choisissons, et nous le déclarons publiquement, de le faire sur trois ans, en commençant par le tiers : 8 %, la différence étant financée par l'emprunt. [...] Mon idée, je ne l'ai pas caché à l'époque, était de faire trois fois 8 %. Mais en 2004, pour des raisons que je laisse à votre appréciation, j'ai été mis en minorité au sein de la majorité et je n'ai obtenu que 3 % - l'année 2004 n'était au demeurant pas totalement neutre à plusieurs égards. Cela nous a obligés, pour atteindre les 24 %, à relever les impôts de 13 % en 2005, ce que nous avons fait ». Ainsi, parce que le conseil général de la Vienne, en considération des élections cantonales de mars 2004, avait refusé d'augmenter les impôts de 8 % comme il était prévu en 2002, le lissage de la hausse sur trois années n'a plus été possible, d'où une chronique 8 % - 3 % - 13 % dont le profil heurté doit tout au calendrier électoral. De manière générale en 2005, la hausse des taux a pu être d'autant plus importante que les années précédentes ont été caractérisées par la stabilité ou la très faible progression des taux de fiscalité. Ainsi, en région Franche-Comté, le rapport de présentation du budget souligne que « les taux de la fiscalité régionale n'ont pas évolué depuis 2001, ayant ainsi généré une perte de produit résultant de la progression de l'inflation ». Dès lors, la nouvelle majorité estime nécessaire d'augmenter les taux de fiscalité, tant pour rattraper la hausse de l'inflation que pour dégager des ressources supplémentaires pour l'application de son programme. L'explication est peut-être facile ; elle est possible. · Le poids de l'héritage de la gestion précédente Une autre explication fréquemment invoquée par les nouvelles majorités, est le poids de l'héritage laissé par leurs prédécesseurs qui les contraint - généralement après un audit sur la question - à augmenter les impôts pour assumer des engagements non financés. Ainsi, le débat d'orientations budgétaires de la région Languedoc-Roussillon pour 2005 s'ouvre sur le constat que la précédente gestion se caractérise par « une fuite en avant préélectorale », En effet, « les engagements de la collectivité ont augmenté de 57% au cours de l'année préélectorale 2003 ». Par ailleurs, M. Thierry Camuzat, directeur général adjoint chargé des finances de la région, a déclaré, lors de son audition, que « nous avons tiré les conclusions de l'audit financier de la région réalisé par M. Michel Klopfer. Il établit à 297 millions d'euros le montant des autorisations de programmes engagées par l'ancien exécutif fin 2003 et non financées », concluant que « l'augmentation de la fiscalité est liée au besoin de financer les crédits de paiement pour honorer les engagements non financés de l'exécutif précédent ». Les éléments d'information fournis à votre Commission, tant par l'actuelle majorité que par le précédent président du conseil régional, M. Jacques Blanc, confirment ce dont on pouvait se douter d'emblée. Le thème de l'« héritage »16 traduit le changement de priorités lié à l'alternance, alors que les investissements et divers engagements juridiques font l'objet d'un financement pluriannuel. Ainsi, la nouvelle majorité accepte mal d'avoir à assumer certains des engagements antérieurs, tout en ayant à financer les projets pour lesquels elle s'est engagée devant les électeurs. Quant à l'équipe sortante, elle peut à bon droit faire valoir que son profil d'endettement lui aurait permis aisément de poursuivre le financement de sa politique sans majoration fiscale significative. Ce cas de figure a valeur d'exemple, même si, dans le contexte politique local, la verve des protagonistes donne au débat des dimensions hors normes, comme votre Commission d'enquête a pu en juger lors de son déplacement à Montpellier... S'il faut d'autres exemples, le président du conseil régional de Basse-Normandie, dans son rapport de présentation sur le budget 2005, invoque « le coût très élevé des décisions prises par ceux qui l'ont précédé », indiquant notamment que la moitié des crédits du budget pour 2005 résulte d'engagements pris par l'ancienne majorité. En matière de dépenses, une année post-électorale n'est jamais une « année zéro ». Les nouveaux exécutifs régionaux, pas toujours rompus aux raisonnements en autorisations de programme et crédits de paiements, ont pu en être surpris. De même, les orientations budgétaires pour 2005 de la région Franche-Comté expliquent que « la région doit honorer les engagements antérieurs qui ont un impact sur le budget 2005. L'accroissement du stock d'autorisations de programme sur la période 2001-2004 approche 62 millions d'euros (soit une hausse de près de 40 %. Un niveau élevé de crédits de paiement sera donc nécessaire dès à présent pour couvrir l'ensemble de ces programmes qui représentent environ deux tiers du budget régional en investissement ». Le même constat est fait en matière de fonctionnement : « concernant la politique de l'emploi, par exemple, 7 millions d'euros sont à absorber en 2005 pour assurer les paiements de l'ancien dispositif Contrat Régional Emploi Formation (CREF) ». · Les « artifices de présentation » du budget Cependant, l'invocation de l'héritage de l'ancienne majorité peut ouvrir la voie à bien des manipulations dans la présentation du budget. La frontière entre l'argumentation de bonne foi et une présentation habile, voire tendancieuse, peut être malaisée à tracer. Ainsi, le nouvel exécutif de la région Languedoc-Roussillon a, selon les mots de M. Georges Frêche le 19 avril à Montpellier, « entrepris l'examen systématique et le toilettage de tous les engagements juridiques pris par son prédécesseur au nom de la collectivité, redéployé les crédits de paiements dégagés pour financer la nouvelle politique du conseil régional et décidé d'une hausse de ses ressources pour budgéter les engagements non financés pris par l'ancien exécutif ». Soit. Le discours est recevable, même si l'ancien exécutif peut considérer les engagements bel et bien financés, à politique constante en matière d'emprunt. Mais M. Georges Frêche va plus loin : « l'augmentation pour l'exercice 2005 est uniquement due au report des engagements pris par mon prédécesseur en 2003 et début 2004 et dont il nous faut assumer le financement, puisqu'ils font droit sur le plan politique et réglementaire. Ils induisent un budget en augmentation de 40 %, qui s'établit à 742 millions, dont 142 millions correspondent à des crédits inscrits par mon prédécesseur et non financés ; ils sont couverts à hauteur de 88 millions par l'augmentation de la fiscalité et de 54 millions par recours à l'emprunt ». En d'autres termes, seuls les engagements de l'ancien exécutif seraient financés par la hausse des impôts locaux et par l'emprunt, les dépenses nouvelles l'étant exclusivement - et vertueusement - par des économies et des redéploiements. Il s'agit là d'une « coïncidence extraordinaire », pour reprendre les mots de M. Jean-Jacques Descamps. M. Georges Frêche a d'ailleurs fini par concéder que « le mode de présentation du budget ne relève pas d'une coïncidence mais d'une volonté politique [...]. C'est un artifice de présentation qui n'a aucune valeur légale ». Mme Ségolène Royal, présidente du conseil régional de Poitou-Charentes, a recouru au même « artifice » lors de la présentation d'un budget comportant de fortes hausses de fiscalité. Lors de son audition du 30 mars avec l'Association des régions de France, elle a ainsi déclaré avoir évalué à 25 millions d'euros le coût des transferts de charges imposés par l'État à sa région, transferts « que nous avons partiellement provisionnés pour 2005 par une augmentation de la fiscalité, à hauteur de 17 millions d'euros. Les mesures nouvelles, telles que la création de 660 emplois tremplins ou la gratuité des livres scolaires, ont été exclusivement financées par des redéploiements et des économies en dépenses de fonctionnement ». Là encore, le principe est simple. Il serait simpliste si les citoyens avaient en mains tous les éléments d'information budgétaire. Plus d'impôt ? La faute au prédécesseur ou à l'État. Nos actions nouvelles ? Le fruit d'une gestion économe. Ce genre de présentation induit les contribuables en erreur. Cependant, étant donné l'estime que M. Georges Frêche a montrée envers ses électeurs durant ses auditions du 19 avril, il est douteux qu'il s'arrête à ce genre de considérations. · L'augmentation des dépenses, assumée par les nouvelles majorités régionales La théorie du cycle partisan se fonde sur le constat qu'une nouvelle majorité arrivant aux affaires dans une collectivité a pour légitime ambition de répondre aux attentes de ceux qui l'ont élue et de mettre en œuvre son programme. De fait, les budgets primitifs des régions ont fortement augmenté en 2005, signe que des dépenses nouvelles se sont ajoutées ou vont s'ajouter aux interventions engagées par la majorité précédente, obligeant à dégager de nouvelles ressources pour leur financement. Ainsi que le déclare à juste titre M. Philippe Duron, nouveau président de la région Basse-Normandie dans le rapport de présentation du budget primitif pour 2005, « présenter le premier budget d'un mandat est toujours un exercice difficile car il faut concilier la nécessaire continuité de la collectivité territoriale avec les attentes dont sont porteurs les nouveaux élus ». De même, en vue du débat d'orientation budgétaire pour 2005 de la région Poitou-Charentes, Mme Ségolène Royal écrit : « le budget pour 2005 sera l'acte politique fondateur des nouvelles orientations, en dégageant des moyens pour financer les politiques de développement de la région que nous souhaitons mettre en œuvre ». Pour sa part, dans les orientations pour le budget de la région Bretagne, M. Jean-Yves Le Drian déclare que « le budget 2005 qui est le premier acte essentiel de la mandature nouvelle traduit le volontarisme politique. Il répond à la fois à une forte demande d'intervention publique et à la volonté d'honorer les engagements pris ». · 2005 : des augmentations de taux apparemment concentrées en début de mandat Ce qui apparaît moins légitime, c'est qu'une majorité régionale concentre au début de son mandat l'intégralité des hausses de fiscalité prévues au cours des prochaines années, en les mettant sur le compte de l'héritage. D'après M. Philippe Laurent, dans une interview donnée à la Lettre du cadre territorial (n° 292, mars 2005) : « il faut aussi être conscient d'un phénomène politique classique qui veut qu'on ait tendance à augmenter les impôts en début de mandat, à la fois pour se faire une cagnotte pour agir et parce qu'il vaut mieux augmenter au lendemain d'une élection qu'à la veille d'une élection ». De même, M. Robert Hertzog a observé : « point n'est besoin d'être agrégé de sciences politiques pour le comprendre qu'il est plus facile d'augmenter significativement les impôts en début de mandat, quitte à expliquer que c'est la faute des prédécesseurs... ». Cette explication par le cycle électoral permet un pronostic pour les prochaines années. Selon M. Philippe Laurent, « cette hausse de la fiscalité devrait d'ailleurs être plus limitée jusqu'à la fin des mandats en cours, d'abord parce que les augmentations sont généralement concentrées en début de mandat du fait du cycle électoral [...] mais aussi parce que la fiscalité des ménages, en certains endroits, a atteint ses limites, ». Ainsi, non seulement les hausses ont été concentrées en début de mandat, mais, dans bien des cas, elles ont été poussées à leur maximum, tant du point de vue légal que du point de vue économique. Cependant, nul mieux que M. Georges Frêche n'a illustré dans ses déclarations la pertinence de la notion de cycle électoral appliquée aux régions en 2005: « nous aurons haussé les impôts une fois en six ans, ensuite ce sera fini, les gens auront oublié et je serai probablement réélu. Ne vous figurez pas que le débat électoral va porter sur ces questions. [...] N'est-ce pas le b-a-ba de la politique ? Si j'ai été élu six fois maire de Montpellier, c'est parce qu'au lendemain de chaque élection j'entre en campagne pour la suivante. Deux ans d'impopularité, deux ans de calme, deux ans favorables avec des fleurs et des petits oiseaux, et vous êtes réélu : tout cela est d'une facilité déconcertante. Je vous le conseille ! Ce n'est pas avec des discussions sur le budget et la TIPP que vous influencez l'électeur, qui n'y comprend rien et qui s'en moque comme de l'an quarante ! ». On peut, au choix, sourire de l'humour ou frémir du cynisme. Est-il également utile de préciser que « cette hausse, pleinement assumée, a consisté à augmenter au maximum légal le taux de la taxe professionnelle » ? M. Jacques Blanc, ancien président de la région Languedoc-Roussillon, interrogé quelques minutes après par votre Rapporteur sur les causes de l'augmentation de la fiscalité régionale en 2005 a d'ailleurs répondu : « la cause est très simple. C'est une volonté politique, la volonté de se constituer un matelas pour faire ce qu'on a envie de faire ». De même, l'autre région qui s'est distinguée en 2005 par la hausse de ses taux de fiscalité, la Bourgogne, a écrit, dans sa réponse à la question de votre Commission d'enquête sur les perspectives en 2006 de ses ressources propres, qu'elle n'envisageait aucune augmentation de ses taux dans les prochaines années, l'évolution du produit fiscal ne reposant plus que sur la seule progression des bases. Ainsi, à l'instar de la région Languedoc-Roussillon, le nouvel exécutif de la région Bourgogne assume une stratégie délibérée de concentration de la hausse fiscale en début de mandat. En conclusion, la hausse des taux, ainsi que le remarque M. Philippe Laurent dans une interview parue dans le Figaro du 11 janvier 2005, « compte tenu des marges de manœuvre [aurait pu être] très progressive ». Mais, pour des raisons de tactique électorale, nombreux sont les exécutifs, notamment régionaux, qui ont choisi de la concentrer au début de leur mandat, c'est-à-dire en 2005. On comprend mieux, sous cet angle, l'active campagne de communication de ces exécutifs autour de leur budget et de leur fiscalité. Il reste que, même si « l'impôt, c'est la République », comme l'a défendu M. Georges Frêche, l'impôt n'est pas une fin en soi : en 2005, la flambée fiscale avait pour fonction de couvrir le dérapage des dépenses. B.- LE DYNAMISME DES DÉPENSES LOCALES EN 2005 Ainsi que l'a résumé M. Jean-François Copé lors de son audition du 14 juin 2005, « établi qu'il n'y a pas de lien entre les hausses de fiscalité régionale et la décentralisation - celle-ci vient tout juste de commencer, alors que les augmentations d'impôts se sont fait sentir dès cette année -, le fait est que si les taux augmentent, c'est bien parce que les dépenses augmentent. Lorsque l'on s'engage devant l'opinion publique à financer quantité de dépenses nouvelles dans le cadre d'une campagne électorale, chose parfaitement légitime et cohérente avec l'esprit de la démocratie et de la République, on est bien obligé d'appuyer sur le bouton des taux d'imposition, et c'est très exactement ce qui s'est passé ». Les choix budgétaires des collectivités territoriales, liés au cycle électoral, ont largement influencé leurs décisions d'augmenter la fiscalité. À ce propos, certains élus locaux, comme M. Martin Malvy, au nom de la région Midi-Pyrénées, ont souligné que, dans le questionnaire qui leur était adressé, « il n'est question que de la répartition et de l'évolution des dépenses régionales ». Or, ce ne serait pas là l'objet de votre Commission d'enquête qui ne devrait se préoccuper que des ressources des collectivités territoriales. Mais c'est oublier, ainsi que l'a rappelé M. Robert Hertzog le 8 mars 2005 « que l'important reste en définitive ce que l'on a fait avec l'argent [...] Aussi, bien que votre Commission se préoccupe des recettes et de la fiscalité, elle ne peut rester totalement indifférente à la manière dont celles-ci sont utilisées ». En effet, la question se pose de savoir si le surplus de recettes « servira [...] à financer des missions relevant du « cœur de métier » de la collectivité, ou [à] intervenir davantage dans le champ de compétences d'autres personnes publiques, collectivités territoriales ou État ? ». Or, l'examen des budgets locaux, éclairé par les réponses des collectivités elles-mêmes, révèle une hausse des dépenses « dans tous les compartiments du jeu », comme l'on dit en matière de rugby, sur les terres de M. Malvy. 1.- Le dérapage des frais généraux a) La croissance des dépenses de communication, de représentation et d'action internationale L'analyse des réponses aux questionnaires envoyés par votre Commission d'enquête aux régions et aux départements révèle une forte croissance des dépenses de relations publiques au sens large. Certainement utiles dans la perspective de promouvoir la collectivité à l'étranger, auprès des entreprises ou des citoyens, ces dépenses ne sauraient cependant croître aussi rapidement sans qu'on s'interroge sur le bien-fondé de telles augmentations dans certaines collectivités. Budgets des régions en 2005 : la promotion internationale et la communication (en millions d'euros)
Sources : Réponses au questionnaire des régions (Précision méthodologique : selon les collectivités, le calcul de l'évolution s'est fait par rapport au BP 2004 sinon, par rapport au CA 2004 selon l'information communiquée à votre Commission) Ce tableau traduit une évolution impressionnante des dépenses de communication, de réception et de représentation des régions en 2005, avec une hausse s'échelonnant de + 2% dans le Limousin à + 176% en Bourgogne. De plus, parmi les dix-sept régions qui ont renseigné cette catégorie de dépenses, la progression est supérieure à 25% pour dix d'entre elles, dont cinq qui affichent une hausse de plus de 50%. S'il est difficile, en l'absence d'un audit approfondi, de déterminer les raisons de telles augmentations, la hausse de 53% des dépenses de communication de la région Languedoc-Roussillon a été expliquée par M. Georges Frêche lors de son audition du 19 avril. Celui-ci a déclaré que, suite à son élection, « il a fallu refaire toutes les brochures. Je n'allais quand même pas distribuer celles de l'ancienne équipe ! Ensuite, nous avons créé un journal régional, Septimanie, qui est distribué à 1,2 million de foyers et financé, comme c'est normal, par le budget « communication » de la région ». N'est-il pas raisonnable de penser que dans d'autres régions également, les nouveaux exécutifs ont réédité toutes les brochures ou créé un nouveau journal régional, voire amélioré l'ancienne formule ? Par exemple, l'essentiel de la hausse des dépenses de communication de la région Haute-Normandie - 400 000 euros - résulte de la refonte du magazine « Ma région » qui passe d'un format petit tabloïd de 8 pages à un magazine de 16 pages, ainsi qu'à la parution de 10 numéros par an contre 6 auparavant. Quant à la région Picardie, qui a augmenté ses dépenses de 71,3 %, le rapport du président du conseil régional, M. Claude Gewerc, révèle que « en 2005, la politique de communication du conseil régional de Picardie sera profondément remaniée pour en faire un outil de démocratie participative et de développement durable ». Cette démocratie participative et de développement durable se traduira notamment, pour un montant de 230 400 euros, par la distribution d'objets promotionnels (stylos, mallettes, livres, T-shirts, coupes). On ne doute pas que ces objets soient biodégradables, dans le respect du pilier « environnement » du développement durable. Enfin, le rapport de présentation du budget de la région Bourgogne, qui détient le record d'augmentation des dépenses de communication et de représentation avec une hausse de 176 % en 2005, se caractérise par l'extrême sobriété de la présentation de sa sous-rubrique 0.202 « autres moyens généraux » dans laquelle les dépenses de communication et de représentation ne sont pas distinguées en tant que telles. Communiquer, certes, mais pas sur la communication. Ajoutons qu'il était loisible à la nouvelle majorité de ne pas conserver la politique, très économe des deniers publics, précédemment en vigueur. A contrario, il n'est pas anodin de constater que la région Alsace est l'une de celles qui augmentent le moins ses dépenses de communication et de représentation, en dépit de leur niveau fort modeste. En effet, ainsi que l'a déclaré M. Adrien Zeller, « nous essayons de cantonner les frais généraux dans des limites raisonnables. Cela vaut en particulier pour notre politique de communication, très ciblée, avec le bulletin sans doute le moins cher de France. Même si, cette année, du fait de la réalisation d'un film, à l'occasion de la fin de la construction de la maison de la région, le budget communication atteint 1,3 million d'euros, il reste relativement modeste ». De même, le Limousin qui se distingue en 2005 par une hausse de ses taux de 1,7 %, n'a quasiment pas augmenté ses dépenses de communication. Enfin, en ce qui concerne les actions européennes et internationales, il est difficile de distinguer une orientation claire de ces dépenses, le faible montant des sommes en jeu empêchant en tout état de cause que leur évolution ait un impact significatif sur les budgets et la fiscalité des régions. On relève cependant un quasi-quadruplement de ces dépenses pour la région Nord-Pas-de-Calais à 4,49 millions d'euros, contre environ 1,15 en compte administratif 2004. S'il est raisonnable de penser que l'intégralité des crédits votés ne sera pas dépensée, une telle augmentation suscite la curiosité. Votre Rapporteur a ainsi découvert, à la lecture du rapport de présentation du budget primitif pour 2005, que la région Nord-Pas-de-Calais conduit une politique internationale très ambitieuse puisqu'elle soutient des projets au Sénégal - notamment la mise en place d'un centre de formation au football -, au Mali, au Vietnam, au Maroc. La région a d'ailleurs mis en place une mission « relations internationales » dont l'objectif est de réfléchir « à ce que devrait être en 2005 et pour les années à venir la stratégie internationale d'une région du nord-est de l'Europe ». S'agissant des départements, l'analyse de l'évolution de leurs frais généraux ne permet pas de dégager aussi clairement une corrélation avec la hausse de la fiscalité. Certes, la Charente, qui a augmenté de 30,7% ses dépenses de communication à 0,885 million d'euros et de 42,3% ses dépenses au titre des actions européennes et internationales, se caractérise par une forte progression de sa fiscalité en 2005 ; en revanche, le département de la Vienne a diminué ses dépenses de communication, de réception et de représentation de 9,2% à 3,126 millions d'euros et ses dépenses au titre des actions européennes et internationales de 9,2% à 0,711 million d'euros - tout en augmentant le taux de ses taxes de 13% en 2005 : il s'agit pour ce département de deux volets complémentaires d'un plan de redressement. L'extrême diversité du montant des sommes engagées dans ces domaines empêche de tirer une conclusion générale de leur évolution. Ailleurs, la diminution de ce type de dépenses a contribué à stabiliser le taux des impôts. Ainsi le département des Alpes-Maritimes. Selon M. Christian Estrosi, président du conseil général, entendu par votre Commission le 26 mai 2005 : « une maîtrise des dépenses de fonctionnement passe par un volontarisme direct et concret. Ainsi, entre 2003 et 2004, les dépenses de communication et de réception ont diminué de plus de 1,7 million d'euros, passant de 6,4 à 4,6 millions d'euros ». Les dépenses de personnel des collectivités territoriales sont de valeur très inégale : alors que les régions sont encore - avant le transfert des TOS des lycées - des « administrations de missions », investies d'un rôle d'animation économique, les départements ont à gérer un personnel nombreux. Il en résulte une forte inertie budgétaire. · Départements : des administrations de gestion Dans les budgets départementaux, ainsi que l'a déclaré M. Claudy Lebreton, « le deuxième poste est la masse salariale, avec 187 200 fonctionnaires territoriaux titulaires et non titulaires ce qui représente une dépense de 5,1 milliards d'euros, soit 18% du total des dépenses de fonctionnement » selon les comptes administratifs des départements pour 2003. Avec de tels effectifs, une mesure comme le passage aux 35 heures joue évidemment à plein. Cependant, ainsi que l'a déclaré M. Brice Hortefeux, en 2005, « les dépenses de personnels [...] suivent une croissance encore soutenue - 7 % -, un peu supérieure à celle de 2004, qui était de 6 % ». Par ailleurs, comme pour les frais généraux, l'évolution des dépenses de personnel, autrement plus importantes il est vrai, ne détermine pas celle de la fiscalité en 2005. Ainsi, le département du Loir-et-Cher - qui a augmenté ses taux de 15% - n'enregistre-t-il qu'une hausse limitée de 4,8% de ses dépenses de personnel, alors même que ses dépenses de cabinet restent stables. Cependant, les départements qui n'ont pas augmenté leur fiscalité n'y sont généralement parvenus que grâce à la relative stabilité de leurs dépenses de personnel. · Régions : des administrations de missions ? Au contraire des départements, les dépenses de personnel des régions ne constituent qu'une faible part des dépenses courantes, 5,7%, les effectifs étant réduits par rapport à l'ensemble de la fonction publique territoriale (12 514 agents au 31 décembre 2002 contre 1,718 million pour l'ensemble de celle-ci). Cependant, leurs dépenses de personnel ont poursuivi en 2005, par rapport à 2004, une croissance soutenue, de 15,6 %, à 574 millions d'euros, le nombre d'agents devant atteindre 14 127 selon les inscriptions aux budgets 2005. Par ailleurs, on relève une forte croissance des dépenses de cabinet. Même si ces dépenses ne pèsent que très marginalement dans le budget des régions et des départements, il est intéressant d'observer qu'elles ont tout de même augmenté souvent plus rapidement que l'ensemble des dépenses de personnel elles-mêmes. Si la moitié seulement des régions a renseigné cet élément dans leur réponse au questionnaire, ce n'est peut-être pas seulement en raison de difficultés de nature technique : elles ont bien voulu en surmonter de plus délicates pour d'autres rubriques. En outre, les dépenses de cabinet progressent à un rythme s'échelonnant de + 3,8% en Île de France - où elles atteignent le niveau record de 2,2 millions d'euros - à + 118% en Bourgogne - où elles restent cependant à un faible niveau. Enfin, la région Haute-Normandie présente la double particularité d'avoir la plus faible dépense de cabinet et de ne pas l'augmenter en 2005. Budget des régions en 2005 : les frais de personnel et les dépenses de cabinet (en millions d'euros)
Les taux de croissance présentés ci-dessus sont fournis à titre indicatif pour les dépenses de personnel. Certaines régions ont présenté dans leur budget 2005 un rappel de leur budget 2004 dans la nouvelle nomenclature, ce qui a permis de calculer la croissance en 2005. Pour les autres régions, la DGCL s'est efforcée de retraduire les budgets primitifs 2004 en nomenclature M71 afin de procéder à des calculs d'évolution, mais cet exercice est bien sûr imparfait. Sources : DGCL (pour les dépenses de personnel, sauf la région Limousin) et réponses au questionnaire (pour les dépenses de cabinet). Cependant, on est en droit de s'étonner devant la hausse des dépenses de personnel qu'affichent certaines régions en 2005, notamment en région Languedoc-Roussillon où elle atteint 55 %, à 27,2 millions d'euros. Les dépenses de personnel s'élevaient à 17,7 millions d'euros dans le budget primitif 2004, mais à 21,5 millions d'euros en compte administratif 2004, ainsi que l'a déclaré M. Claude Cougnenc, directeur général des services, lors de son audition du 19 avril 2005. Il a par ailleurs indiqué que « nous sommes passés de 520 postes en mars 2004 à 517 en mars 2005, et il est prévu au budget de porter l'effectif à 580 postes fin 2005 », augmentation qui résulte en partie de l'intégration de personnel auparavant employé par des associations. Cependant, M. Richard Mallié s'est justement demandé « pourquoi la masse salariale augmente-t-elle de 30 % si les effectifs n'augmentent que de 20 % ? ». Ainsi que l'a déclaré M. Claude Cougnenc : « il y a plusieurs explications à l'augmentation du volume des dépenses de personnel. La première tient à la revalorisation, de 1,043 million à 1,778 million, du budget de formation pour le personnel de la région, étant donné les besoins induits par les nouvelles compétences transférées et la faiblesse du budget initial. La seconde est l'augmentation, conformément au cadre légal, négligé sous la précédente présidence, des prestations sociales servies au personnel ». M. Georges Frêche a précisé à ce propos que « des tickets restaurants d'une valeur faciale de 7 euros sont désormais proposés à l'ensemble des 520 employés au lieu que, comme par le passé, une centaine seulement ait accès à un restaurant particulier. Cela coûte plus cher, mais c'est plus efficace ». Par ailleurs, suite à l'élection de M. Georges Frêche à la présidence du conseil régional, la région Languedoc-Roussillon dispose désormais d'un encadrement à la hauteur... de son nouveau budget. En effet, à la question de votre Rapporteur sur le nombre des directeurs généraux adjoints sous la précédente majorité, M. Georges Frêche a répondu dans son style inimitable : « il y a avait un, il y a en a désormais six. Je divise pour mieux régner ». Cette attitude se reflète aussi dans le nombre des chefs de service régionaux. Il va de soi que ce « renforcement » est constaté hors effet des compétences transférées. Les décisions des collectivités territoriales en matière de personnel pèsent donc incontestablement sur leurs dépenses. Cependant, au-delà du cas particulier de la région Languedoc-Roussillon, la croissance des dépenses de personnel des régions et des départements est une problématique qui dépasse la seule année 2005. En effet, les collectivités territoriales connaissent depuis vingt ans une augmentation régulière et forte de leur personnel qui constitue incontestablement, sur le long terme, une cause d'évolution de la fiscalité locale, étudiée plus longuement dans la deuxième partie du présent rapport. Cependant, la forte croissance des dépenses de personnel peut sans conteste être expliquée par une cause spécifique à l'année 2005 : la croissance des interventions des départements et des régions, avec pour conséquence inéluctable une augmentation du nombre des personnels chargés de les mettre en œuvre. 2.- Le libre choix de dépenser plus On pardonnera à votre Rapporteur de rappeler cette évidence que les recettes servent à financer les dépenses et qu'en conséquence, la hausse de la fiscalité intervenue en 2005 s'est naturellement traduite par une forte augmentation des budgets des collectivités territoriales. Ainsi, les dépenses totales inscrites au budget primitif des régions de métropole s'élèvent en 2005 à 18,8 milliards d'euros, en croissance de 12,6 % par rapport à 2004. Quant aux budgets primitifs des départements, selon les premières tendances présentées par M. Brice Hortefeux lors de son audition du 15 juin 2005, « ils sont en augmentation sensible de 6 à 7 %, soit un rythme supérieur à celui des années précédentes », excepté en 2004, année où le montant global des dépenses des départements s'est élevé (hors opération de gestion active de la dette) à 52 milliards d'euros. S'agissant des régions, la forte croissance de leurs dépenses touche plus le fonctionnement (+ 13,8 %) l'investissement (+ 11,3 %). Dans les deux cas, cette évolution s'explique par une forte augmentation des interventions des régions dans le cadre de l'exercice de leurs compétences, enseignement, transport ferroviaire de voyageurs et surtout formation professionnelle et apprentissage. Quant aux départements, selon les déclarations de M. Brice Hortefeux, « trois postes expliquent à eux seuls la moitié de cette hausse : le RMI, l'APA et les charges de personnel ». Quant aux dépenses d'investissement, elles « devraient progresser moins rapidement cette année qu'en 2004 : 3 % environ contre 13 % ». Pour ce qui concerne le RMI et l'APA, on se reportera au B du I de la présente partie. De fait, le développement qui suit traitera principalement des régions, à partir de la distinction entre les dépenses obligatoires et les dépenses non obligatoires qui, dans les deux cas, regroupent des dépenses de fonctionnement et des dépenses d'investissement selon une présentation fonctionnelle. a) La distinction entre les dépenses obligatoires et les dépenses non obligatoires des collectivités territoriales L'article L. 1612-15 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) retient deux critères pour définir les dépenses obligatoires : « les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé ». · Les dépenses obligatoires des communes Les dépenses obligatoires des communes sont listées par l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales qui compte 32 rubriques. Le caractère non limitatif de cette liste est souligné par l'adverbe « notamment » qui introduit la liste. D'autres dispositions du CGCT et divers textes législatifs complètent cette liste. Une présentation synthétique permet de distinguer trois catégories de dépenses obligatoires pour les communes : - les dépenses relatives à des services publics non communaux, c'est-à-dire les dépenses d'intérêt national (ex : le cadastre, l'enseignement public et privé), ou départemental (ex : SDIS ou l'aide sociale) ; - les dépenses relatives à des services publics communaux, comme la rémunération des agents communaux, les frais de l'administration générale ou la police municipale ; - les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles, c'est-à-dire les dettes liquides et certaines qui, par exemple, proviennent des décisions des autorités communales ou le remboursement des emprunts. · Les dépenses obligatoires des départements La liste des dépenses obligatoires des départements est fixée à l'article L. 3321-1 du CGCT sous 21 rubriques. Cette liste ne saurait cependant être considérée comme exhaustive, le juge administratif qualifiant progressivement d'obligatoires de nouveaux types de dépenses. Néanmoins, leur liste peut être établie à tout moment. C'est ainsi que le président du conseil général de la Nièvre, M. Marcel Charmant, publie une présentation de son budget en distinguant dépenses obligatoires et non obligatoires. On y reviendra dans la troisième partie ci-après. Sont notamment obligatoires pour les départements les dépenses en matière d'administration générale, les collèges, le RMI, l'APA et les services d'incendie et de secours. · Les dépenses obligatoires des régions Les dépenses obligatoires des régions sont énumérées à l'article L. 4321-1 du CGCT sous neuf rubriques. En dehors des dépenses d'administration générale, les dépenses obligatoires des régions concernent les compétences qu'elles exercent exclusivement, comme les dépenses de formation professionnelle, les TER, ou les lycées. Outre leurs compétences obligatoires, les collectivités territoriales jouissent, depuis la loi du 2 mars 1982, d'une clause générale de compétence. L'article 1er de la loi du 7 janvier 1983 précise que « les communes, les départements et les régions règlent par leurs délibérations les affaires de leur compétence. Ils concourent avec l'État à l'administration et à l'aménagement du territoire, au développement économique, sanitaire, culturel et scientifique, ainsi qu'à la protection de l'environnement et à l'amélioration du cadre de vie ». Il résulte de ces dispositions que le champ ouvert à l'interventionnisme des collectivités territoriales est extrêmement vaste, si vaste que pour le cerner, il est préférable de s'appuyer sur la notion de dépenses interdites. Les dépenses interdites aux collectivités territoriales sont de deux sortes : d'une part les dépenses interdites par la loi (par exemple les dépenses relatives aux cultes) et les dépenses ne présentant pas un intérêt public local, c'est-à-dire présentant un intérêt privé, un intérêt relevant de la compétence exclusive d'une autre collectivité et enfin les dépenses étrangères à l'intérêt public local du fait de leur nature. Il convient donc d'analyser successivement l'évolution des dépenses des collectivités territoriales entrant dans leur champ de compétences obligatoires et celles situées hors de ce champ. Cependant, il faut être conscient que les collectivités territoriales font autant usage de leur autonomie lorsqu'elles décident d'accroître leurs dépenses dans le domaine de leurs compétences obligatoires que lorsqu'elles choisissent d'étendre leurs interventions au delà. b) La volonté de faire mieux et plus dans le domaine des compétences obligatoires Dans le domaine de leurs compétences obligatoires, M. Brice Hortefeux a observé, s'agissant des régions, que « les nouvelles équipes élues en 2004 ont décidé d'accroître leurs marges de manœuvre et de renforcer leurs possibilités d'intervention sur leurs principales compétences : ferroviaire, formation professionnelle et lycées. Ce ne sont donc pas les compétences nouvellement transférées en 2005 qui viennent accroître les budgets régionaux ». L'instruction budgétaire M71, entrée en vigueur en 2005 (sauf pour les régions Languedoc-Roussillon et Limousin et les régions d'outre-mer), permet désormais de procéder à une analyse fine des domaines d'intervention des régions. La ventilation fonctionnelle étant la même pour les dépenses de fonctionnement et les dépenses d'investissement, il est possible de chiffrer le montant total des dépenses prévues pour chaque grand poste. Le graphique suivant présente la répartition des dépenses par domaine, fonctionnement et investissement confondus, hors Languedoc-Roussillon et Limousin. 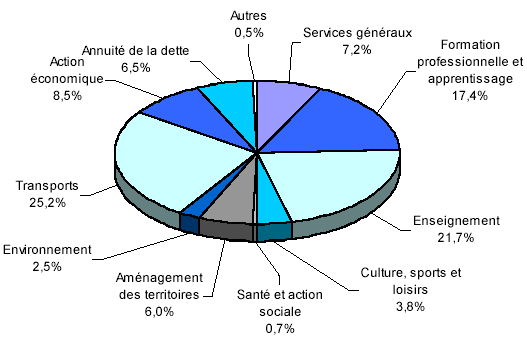 Parmi les compétences obligatoires, les trois principales nous retiendrons particulièrement : la formation professionnelle, l'enseignement et les transports. En raison du changement de nomenclature comptable, il n'est pas possible de procéder à des comparaisons entre les dépenses des budgets primitifs 2005 et 2004 sauf pour les dépenses de formation professionnelle et d'enseignement dont le périmètre n'a pas été modifié. L'analyse de l'évolution des dépenses au titre de ces compétences, qui représentent ensemble près de 40 % du total des budgets régionaux, permet d'éclairer les choix budgétaires des régions en 2005. Budgets des régions en 2005 : la formation professionnelle et l'enseignement
Source : DGCL · Régions : la formation professionnelle En matière de formation professionnelle et d'apprentissage, les régions détiennent, depuis le 1er juin 1983 une compétence de droit commun en matière de formation professionnelle continue et d'apprentissage. Cette compétence a été élargie par la loi quinquennale pour l'emploi du 20 décembre 1993 à la formation qualifiante et pré-qualifiante des jeunes de moins de 26 ans qui a pris effet le 1er juillet 1994. Par ailleurs, la loi « démocratie de proximité » a transféré aux régions la rémunération des employeurs d'apprentis. Son dispositif prévoyait un taux progressif de versement de 6 % en 2003, de 63 % en 2004 et de 97 % en 2005. Le montant total versé par les régions atteint ainsi 696 millions d'euros en 2005, financé par une dotation à due concurrence. Enfin, la loi du 13 août 2004 a renforcé et élargi le rôle des régions dans le domaine de la formation continue et de l'apprentissage. Ainsi que l'écrit la DGCL dans son analyse des budgets primitifs des régions en 2005, « les régions se sont appropriés cette compétence générale et ont décidé d'augmenter fortement les crédits en 2005. Le total des dépenses devrait atteindre 3 282 millions d'euros, en croissance de 18,6 % par rapport à 2004 et de 11 % si on neutralise les indemnités aux employeurs d'apprentis ». Les dépenses sont constituées pour l'essentiel de dépenses courantes, 3 113 millions d'euros en 2005, qui absorbent 31 % du total des dépenses de fonctionnement régionales. Ces dépenses concernent essentiellement les participations aux centres de formation professionnelle et la rémunération des stagiaires. Les crédits d'investissement restent logiquement en revanche très limités, avec 169 millions d'euros en 2005. Plus particulièrement, on constate la variété des choix des régions dans l'exercice de cette compétence. Si les dépenses de la région Centre n'ont augmenté que de 4 %, la région Bourgogne a augmenté les siennes de 86,7 % si bien qu'avec 70,7 euros par habitant, ses dépenses se situent désormais largement au dessus de la moyenne des régions de métropole - 54,7 euros. Ce niveau reflète, ainsi que le dit le rapport de présentation du budget primitif pour 2005 « la montée en puissance des mesures nouvelles initiées depuis avril 2004 » (emplois tremplins, 2 000 parcours pour l'emploi...). De même, si les problèmes de nomenclature budgétaire ont empêché la DGCL de renseigner l'évolution des dépenses de la région Languedoc-Roussillon en matière de formation professionnelle, les documents budgétaires révèlent que la région a voté un budget de formation professionnelle et d'apprentissage en hausse de 35 %, à 95,435 millions d'euros. Parmi de nombreuses mesures, la région a décidé de débloquer un million d'euros pour les aides individuelles aux projets n'entrant pas dans les programmes de formation de la région ou encore d'améliorer le système de défraiement forfaitaire des apprentis (5 millions d'euros). De plus, M. Christian Fina, directeur général adjoint chargé de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'éducation, a déclaré lors de son audition du 19 avril 2005 que « la politique d'achat de formations a été réorientée vers des actions qualifiantes, notamment dans l'industrie, qui coûtent beaucoup plus cher, ce qui induit un coût direct de 7,1 millions d'euros en 2005 ». S'agissant de l'enseignement, depuis le 1er janvier 1986, les régions ont compétence en matière d'équipements des lycées. Les crédits votés à ce titre par les régions de métropole atteignent 3 351 millions d'euros en 2005, ce qui représente 17,8 % de leur budget total. Les dépenses de fonctionnement pour les lycées ne représentent que 29 % de l'ensemble des crédits. Ces charges comportent les dépenses courantes des établissements, mais pas la rémunération des enseignants qui reste à la charge de l'État. Elles s'élèvent à 930 millions d'euros en 2005 et devraient progresser de 11,7 % par rapport à 2004. Ainsi que l'observe la DGCL, « la forte croissance des dépenses de fonctionnement des lycées résulte de nombreuses décisions nouvelles prises par les assemblées régionales, comme la gratuité progressive ou intégrale des manuels scolaires ». Cette mesure de gratuité constitue en effet une promesse électorale que les nouvelles majorités se sont empressées d'appliquer dès la rentrée 2004. Or, son coût est très élevé. Par exemple, en Languedoc-Roussillon, il est estimé à 6,5 millions d'euros, ce coût intégrant par ailleurs 6 495 tenues de travail et 5 000 boites d'outillage. En région Bourgogne, la gratuité des manuels scolaires prend la forme d'une dotation forfaitaire attribuée à chaque élève de première et de terminale pour un montant de 2,55 millions d'euros. De plus, 400 000 euros sont votés au titre de l'aide à l'équipement professionnel des élèves de première année de BEP et de CAP. Enfin, en région Poitou-Charentes, le coût de cette mesure est de 4,9 millions d'euros. Cependant, c'est encore l'investissement qui draine l'essentiel des crédits de cette compétence avec 2 421 millions d'euros prévus en 2005, en hausse de 8,5 % par rapport à 2004. Ces dépenses correspondent à la rénovation et la construction du patrimoine scolaire. Par exemple, la région Languedoc-Roussillon a lancé un programme d'investissement « 100 % avenir » se traduisant par la construction de 8 nouveaux lycées, dont trois avaient d'ailleurs été programmés par l'ancienne majorité, afin de répondre à l'accroissement du nombre des effectifs. Cela représente 123 millions d'euros en autorisations de programme et 650 000 euros en crédits de paiement. Par ailleurs, la région a lancé un vaste programme de rénovation des lycées pour 127,9 millions d'euros en AP et 6 millions en CP. Enfin, les lycées verront leurs équipements fonctionnels et pédagogiques complétés et renouvelés à hauteur de 16,5 millions d'euros en AP et 14 millions en CP. Enfin, il est intéressant d'observer que le montant des dépenses totales, en 2005, pour les lycées varie du simple au double selon les régions, de 36 euros à 80 euros par habitant, variations que n'expliquent pas uniquement les écarts démographiques. 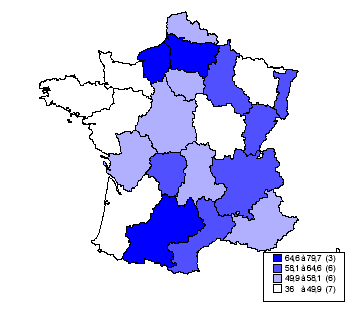 · Régions : les transports ferroviaires de voyageurs Enfin, dans le domaine des transports ferroviaires de voyageurs, la généralisation de la compétence des régions a été mise en œuvre le 1er janvier 2002. Conformément aux dispositions de la loi SRU du 13 décembre 2002, l'ensemble des régions métropolitaines, à l'exception de la Corse et de l'Ile-de-France, sont devenues les autorités organisatrices des services régionaux de voyageurs au 1er janvier 2002. Cette nouvelle compétence s'est traduite par des mouvements financiers très élevés : les dépenses prévues dans les budgets primitifs pour 2005 pour la régionalisation ferroviaires atteignent 2,64 milliards d'euros en augmentation de 12,9 % par rapport à 2004. Dans ce domaine, ce sont les dépenses d'investissement qui tirent les interventions des régions. Par exemple, en Languedoc-Roussillon, selon M. Gérard Blanc, directeur général adjoint chargé de la direction de l'action territoriale, de la direction des transports et des communications, de la direction de l'environnement et de la direction de la prospective de la région, « de 2005 à 2008, la région consacrera 78 millions au financement de matériels nouveaux ; 23,4 millions en CP sont inscrits à cette fin au budget 2005 ». Ces quelques exemples illustrent le dynamisme de l'investissement en 2005. Avec un montant de 8 695 millions d'euros de crédits votés, les dépenses d'investissement des régions (neutralisées des opérations de gestion active de dette) devraient progresser, rappelons-le, de 11,3% en 2005. Cette forte croissance concerne surtout les subventions d'équipement, et, dans une moindre mesure, l'investissement direct. Sur les régions, la DGCL indique : « S'agissant de l'investissement, les dépenses devraient s'élever à 851 millions d'euros de plus qu'en 2004 ; ce sont surtout les subventions d'équipement versées qui devraient augmenter le plus rapidement : plus 608 millions d'euros, soit + 14,1 %. Quant aux équipements d'enseignement, ils absorbent 300 millions d'euros de la croissance des dépenses d'investissement ». Le tableau suivant récapitule le montant et l'évolution de chaque catégorie de dépenses d'investissement. Crédits d'investissement des régions en 2005 (budgets primitifs)
Hors gestion active de la dette Source : DGCL De manière générale, ainsi que l'a déclaré M. Brice Hortefeux « les administrations publiques locales prennent une part prépondérante dans l'investissement public de la Nation : près de 70 % en 2003. Pour l'essentiel, il s'agit d'ailleurs d'investissements voulus par les collectivités territoriales et qui, chacun s'accordera à le reconnaître, ont un effet positif sur la croissance ». M. Jacques Pélissard a en outre rappelé que « un tableau intéressant dressé par la Fédération nationale des travaux publics fait apparaître que l'investissement public des collectivités territoriales a progressé, en 2004, de 6 %, tandis que celui des entreprises privées n'a augmenté que de 2 % et que celui de l'État a baissé de 8 % : c'est donc bien l'investissement public des collectivités territoriales qui a soutenu, en particulier, le marché du bâtiment et le niveau d'équipement du pays ». La note « Finances locales en France, grandes tendances 2004-2005 » publiée par Dexia estime d'ailleurs que l'investissement des collectivités territoriales s'élèverait à 44,6 milliards d'euros en 2005, soit une progression de 4,5 % par rapport à 2004. En conséquence, ainsi que l'a rappelé M. Alain Guengant, « elles se retrouvent à la tête d'un patrimoine considérable - 700 à 750 milliards d'euros, pour 100 milliards de dettes, autrement dit, s'il s'agissait d'entreprises, plus de 600 milliards d'euros de fonds propres - qui représente 80 % de l'équipement public de la France hors hôpitaux. Par comparaison, le patrimoine en équipement de l'État n'est évalué qu'à 150 milliards d'euros. Les collectivités territoriales apparaissent bien comme les aménageurs, en termes d'équipement public, du territoire national ». c) La volonté d'élargir le champ des interventions Chacun sait depuis Montesquieu que « c'est une expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser ; il va jusqu'à ce qu'il trouve des limites ». En écartant la notion d'abus et sans aucune intention malveillante, on pourrait transposer cette phrase aux collectivités territoriales qui, depuis que les lois de décentralisation leur ont attribué une compétence générale, tendent à élargir le champ de leurs interventions jusqu'à la limite ultime des dépenses interdites. Cet élargissement est d'ailleurs pleinement assumé par les responsables locaux qui n'hésitent pas, dans leurs documents budgétaires comme dans leurs dossiers de presse ou leurs déclarations, à mettre en avant l'ampleur de leurs interventions comme la preuve d'un meilleur service assuré au citoyen. M. Jean-Yves Le Drian, dans son rapport de présentation du budget primitif pour 2005 de la région Bretagne, déclare ainsi faire « une lecture volontariste des compétences régionales. Les onze missions régionales reposent d'abord sur le socle des compétences dévolues à la région, que la collectivité entend assumer pleinement. Elles reposent aussi sur une volonté nouvelle d'aller au-delà de ce que la loi prescrit strictement, dans la mesure où l'intervention régionale est attendue et susceptible d'apporte une dimension jusque là insuffisamment prise en compte. C'est ainsi que ce budget propose des objectifs nouveaux dans le cadre de nos compétences traditionnelles, mais va plus loin en ouvrant des champs d'intervention jusqu'alors inexplorés ». De même, M. Georges Frêche n'a pas simplement détaillé ses ambitions dans son rapport de présentation mais a clamé dans Le Monde du 20 février 2005 : « Nous augmentons de 76 % les crédits de la culture, de 58 % ceux du sport et de 40 % ceux du développement durable ». La seule lecture d'un budget primitif suffit d'ailleurs à édifier le lecteur peu averti qui croyait naïvement que les régions et les départements se contentaient d'exercer les compétences que la loi leur avait expressément attribuées. · La flambée des dépenses dites d'intérêt régional Les réponses aux questionnaires envoyés par votre Commission d'enquête aux régions révèlent que les dépenses d'intérêt régional, c'est-à-dire les dépenses des régions hors de leur champ de compétences obligatoires, connaissent une forte croissance en 2005. Le tableau ci-dessous se fonde sur les chiffres communiqués par les exécutifs régionaux, le calcul de l'évolution s'effectuant selon les cas par rapport aux montants du budget primitif pour 2004, lorsqu'ils étaient mentionnés ou, à défaut, du compte administratif 2004 sachant que certaines régions n'ont pas spécifié l'origine de leurs chiffres. Votre Rapporteur tient à préciser qu'il est conscient des limites de cet exercice de comparaison ainsi que des difficultés qu'ont pu rencontrer les régions dans l'extraction des chiffres de leur comptabilité ; mais il lui a semblé nécessaire, pour la bonne information de votre Commission d'enquête, de faire figurer ce tableau dans le présent rapport. DÉPENSES D'INTÉRÊT RÉGIONAL EN 2005 ET ÉVOLUTION PAR RAPPORT À 2004
Outre que ce tableau révèle l'extrême variété des priorités des régions, tant en termes de niveau d'intervention que d'évolution de celui-ci, il éclaire particulièrement les choix budgétaires des deux régions qui, en 2005, ont le plus augmenté leurs taux de fiscalité : le Languedoc-Roussillon et la Bourgogne. Ainsi, le budget de la région Languedoc-Roussillon a augmenté en 2005 de 211 millions d'euros pour s'établir à 765 millions d'euros, augmentation financée par une hausse de 79,4% du taux de sa taxe professionnelle et de sa taxe sur le foncier bâti. En conséquence, les interventions de la région connaissent une hausse vertigineuse de 42,7% en 2005. Pour M. Christian Bourquin, vice-président de la région Languedoc-Roussillon, entendu par votre Commission le 30 mars 2005, « M. Georges Frêche [...] a clairement dit à nos concitoyens que l'augmentation de l'impôt régional visait également à financer des opérations qui n'étaient pas assumées précédemment ». Il s'agit là d'un choix de la région qui, en 2005, a voulu faire un budget « 100% offensif » selon les mots de son président, et d'augmenter la fiscalité en conséquence, choix qu'il ne s'agit aucunement de juger ici. Parmi les dépenses mises en avant par la région Languedoc-Roussillon, l'endiguement du Rhône figure en bonne place. Pour M. Christian Bourquin, « nous nous devons, par exemple, même si le Rhône est un fleuve national, de pallier le désengagement de l'État pour que soient construites les digues qui doivent l'être et éviter ainsi un nouveau débordement dans le Gard. Le conseil régional a investi 9 millions d'euros, ce fut sa première décision [...]. On peut se demander quelles sont les compétences de l'État et celles de la région. On peut aussi se demander qui s'est désintéressé de l'aménagement du Rhône. Il faudra bien dire à nos concitoyens que l'État n'a pas assumé ses responsabilités ». La remarque mérite qu'on s'y arrête : il convient de se demander en l'occurrence si l'État n'a pas, au contraire, assumé ses responsabilités en ne finançant pas l'endiguement du Rhône et si la région n'a pas fait preuve de précipitation en lançant seule cet investissement. Ainsi que l'a déclaré M. Francis Idrac, préfet de la région Languedoc-Roussillon, « s'agissant de la protection contre les inondations, le problème ne s'est pas tant posé au niveau de la mobilisation des crédits, au niveau du CPER comme des fonds européens, qu'à celui de la maturation de projets prêts à être financés. Il est toujours très difficile et très long de mettre au point des projets arbitrant valablement entre l'amont et l'aval, la rive gauche et la rive droite. La philosophie de la protection elle-même a évolué, dans la mesure où l'on s'est rendu compte que la technique des digues était finalement le système de protection le plus meurtrier et qu'il convenait d'adopter une approche différente de gestion dynamique des crues. La protection contre les inondations appelle un effort considérable, que nous avons récemment chiffré à environ 700 millions d'euros. Mais c'est une problématique pour l'avenir ; les crédits disponibles, au niveau tant du CPER que des fonds européens, sont longtemps restés inemployés. Ainsi, la protection des basses plaines de l'Aude, à la suite des inondations de 1999, n'a toujours pas donné lieu à un projet faisant consensus ». En ce qui concerne la Bourgogne, l'interventionnisme est encore plus flagrant, dans la mesure où cette région se distingue par des progressions à trois chiffres de certaines de ses dépenses. Le rapport de présentation de M. François Patriat sur le budget 2005 révèle des initiatives aussi nombreuses que variées. Par exemple, « le cinéma fait l'objet d'une politique volontariste de la région » se traduisant notamment par la mise en place d'un fonds d'aide à la production cinématographique et audiovisuelle auquel est affecté 1,330 million d'euros. Dans le domaine du sport, la région soutient de nombreuses associations qui organisent des manifestations sportives, à hauteur de 2,3 millions d'euros, le montant total des dépenses dans ce domaine progressant de 167 % à 7,7 millions d'euros. Dans le domaine de la santé et de l'action sociale : « le conseil régional souhaite participer à la politique de santé aux côtés de l'État dont c'est une compétence régalienne et de l'assurance maladie dont c'est la mission ». Voilà ce qui est clairement assumé et entraîne une multiplication par plus de trois des dépenses. En matière d'environnement, « tous les dirigeants politiques ou économiques, tous les citoyens sont invités à agir pour un nouveau mode de développement durable. Le conseil régional de Bourgogne ne doit pas échapper à cette invitation. C'est pourquoi, en lien avec tous ses partenaires, il a pour volonté d'engager une action concrète dans ce domaine pour contribuer à l'effort planétaire en faveur de la préservation des ressources vitales tout en améliorant la qualité de vie des Bourguignons », ce qui se traduit par un quasi-triplement des crédits affectés à cette politique. Dans le domaine de l'emploi, la région a voté 2,609 millions d'euros en faveur de la création d'emplois tremplin, le montant des dépenses de la région dans ce domaine progressant de 296 % à 6,259 millions d'euros. Enfin, dans le domaine de la recherche, « la région affiche sa volonté de soutenir le développement de la recherche en finançant des allocations de recherche » pour un montant global de 1,981 million d'euros. Une région a d'ailleurs fait de son intervention au-delà de ses compétences obligatoires un choix politique clairement revendiqué : la région Nord-Pas-de-Calais. En effet, dans le n° 7 de son journal « L'information de la région Nord-Pas-de-Calais », publié en février 2005, le conseil régional a publié le tableau suivant sous le titre : « des choix volontaristes : politiques au-delà des compétences de la région ». 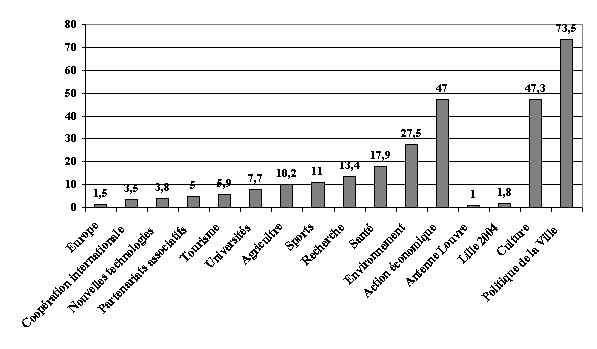 Le budget 2005 de la région s'élevant à 1,374 milliard d'euros, et ces dépenses au-delà des compétences obligatoires à 269 millions d'euros, ce sont donc près de 20 % de ses crédits que la région Nord-Pas-de-Calais consacre à des interventions en dehors de son champ de compétence, et ces dépenses sont évidemment en forte croissance. La croissance des interventions régionales dans tous les domaines semble d'ailleurs devenir le mètre étalon de la modernité et du dynamisme régional. Sont instructives de ce point de vue les déclarations du président de la région Bretagne, M. Jean-Yves Le Drian, dans son rapport pour le débat d'orientations budgétaires pour 2005. Rappelant le choix historique de la région pour un niveau d'intervention publique minimaliste, il estime que celui-ci « n'est pas à la hauteur des attentes exprimées envers la région », puisque le budget par habitant se situait au dernier rang des 22 régions en 2004 (240 € contre une moyenne de 280 €), tout comme les dépenses de fonctionnement interne (6 € contre 9 €). Et l'ancien indicateur de bonne gestion se trouve affecté d'un signe négatif : un budget économe devient la manifestation d'un retard par rapport à la moyenne nationale. M. Le Drian chiffre ce « nécessaire rattrapage » du budget régional, qui est une « contrainte supplémentaire » pesant sur le budget, à 129 millions d'euros, ce qui semble justifier par avance d'autres augmentations de la fiscalité régionale. Sans doute la Bretagne - encore l'une des régions les moins fiscalisées de France en 2005, a-t-elle également pour ambition de rattraper, dans le domaine de la pression fiscale comme dans les autres, la moyenne nationale. Il serait bon que les contribuables bretons en soient informés. Enfin, votre Rapporteur a décidé de regarder de plus près le cas de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur, en raison de son caractère illustratif, malgré son refus de répondre au questionnaire de votre Commission. Dans le rapport de présentation du budget primitif 2005, M. Michel Vauzelle écrit « il est cependant nécessaire d'augmenter la fiscalité locale, directe et indirecte, de 30% pour faire face aux transferts de charges imposés par l'État ». Cette « nécessité » se traduit par une hausse de 30,4% de la taxe sur le foncier bâti, de 30,2% pour la taxe sur le foncier non bâti et de 30,4% de la taxe professionnelle ainsi que par un produit supplémentaire de 40 millions d'euros pour les taxes directes et de 72 millions d'euros pour les taxes indirectes, soit un total de 112 millions d'euros. Or, ainsi que l'a remarqué M. Richard Mallié lors de l'audition de M. Michel Vauzelle avec l'Association des régions de France le 30 mars 2005, « la décision modificative n°1 votée par l'assemblée plénière le 18 mars 2005 précise les dépenses relatives à ces transferts. Pour l'année 2005, elles devraient s'élever à 23 millions d'euros, intégralement compensés par l'État comme le précise une annexe de la circulaire de la DGCL du 11 février 2005. Sur le site Internet du conseil régional de Provence-Alpes-Côte-d'Azur, je lis, ou du moins je lisais le 25 mars dernier : « d'ores et déjà, un montant de 6,724 millions d'euros a été adopté lors du vote du budget du 21 janvier 2005 concernant le transfert des compétences ». Compte tenu de vos choix politiques, comment allez vous employer ces 112 millions d'euros de recettes fiscales supplémentaires que vous allez demander au contribuable » ? M. Michel Vauzelle a déclaré que « le budget que nous avons présenté tient compte des contraintes nées du désengagement de l'État sur des points importants, notamment en ce qui concerne l'exécution des contrats de plan ». En répondant ainsi, il abandonne donc implicitement l'argument selon lequel la hausse de la fiscalité résulterait des transferts de compétences. De plus, il a fini par reconnaître, avec la retenue qui s'impose : « que cet impôt soit en partie destiné à financer une politique volontariste, je ne le nie pas [...]. Nous nous devons d'être soucieux de respecter les choix politiques qui ont été faits de manière claire par les citoyens de notre régions ». C'est ainsi qu'il a mis en avant la création de 230 emplois visant à assurer la sécurité dans les gares et les trains, ou la création d'antennes départementales afin de renforcer la démocratie de proximité. Et l'on retrouve ainsi le troisième mouvement de la « valse à trois temps ». M. Michel Vauzelle a donc repris à son tour le discours classique des responsables régionaux qu'avec un peu de poésie, votre Rapporteur a qualifié de « valse à trois temps ». Dans un premier temps, les régions ont quasi-unanimement dénoncé les transferts de l'acte II de la décentralisation comme cause principale de l'augmentation de leur fiscalité. Puis, dans un deuxième temps, cette argumentation ne tenant pas, elles ont mis en avant le coût du « désengagement de l'État », sans d'ailleurs clairement définir cette notion bien pratique. Enfin, parce que le « désengagement de l'État », à supposer même qu'il soit caractérisé, ne pourrait néanmoins expliquer une telle hausse, elles ont fini par accepter leur part de responsabilité dans l'augmentation des dépenses, en minimisant la charge de la rançon fiscale. L'extension générale du champ de compétences des collectivités territoriales n'est d'ailleurs pas propre aux régions. Les départements sont eux aussi concernés. Ainsi que l'a déclaré M. Claudy Lebreton : « les départements ont compétence obligatoire en matière de routes, de collèges, d'action sociale, de SDIS, et, dans ces domaines, ils sont seuls financeurs. À côté de l'exercice de ces compétences, ils définissent des politiques d'accompagnement au développement local, d'aménagement du territoire solidaire, notamment dans les domaines de l'éducation, de la culture, du sport, de la vie sociale. Ainsi, de très nombreuses réalisations ne verraient pas le jour sans la participation financière des collectivités, pourtant facultative, ou optionnelle ». Cependant, l'analyse des réponses au questionnaire envoyé aux départements, si elle démontre qu'effectivement, les départements ont élargi le champ d'intervention, ne révèle aucune rupture en 2005 par rapport à 2004, y compris dans les départements qui ont fortement augmenté leur fiscalité. · La stratégie de la région Alsace : maîtrise des dépenses, ciblage des interventions et choix pertinent de leurs modalités La justification de l'intervention des régions, comme des départements, en dehors de leurs compétences obligatoires, est (faut-il le rappeler) « la multiplication des désengagements de l'État », selon l'expression de M. Georges Frêche, qui les contraint à se substituer à lui dans des domaines aussi variés que la recherche, la culture, l'emploi ou l'action économique. Le retrait de l'Etat, par une sorte d'automatisme, déclencherait l'intervention des collectivités territoriales. Or, une région au moins a refusé de fonder son intervention sur le seul désengagement, réel ou supposé, de l'État : l'Alsace. Ainsi que l'a déclaré M. Adrien Zeller, « lorsqu'une association ou une commune nous a dit qu'elle avait moins de crédit d'État, nous nous sommes posé deux questions. Premièrement, y a-t-il un intérêt régional à intervenir ? Deuxièmement, le conseil régional est-il le mieux placé pour cela ? En d'autres termes, nous avons appliqué le principe de subsidiarité ». En effet, a-t-il rappelé, le danger qui guette les régions, c'est « l'accroissement des frais de fonctionnement ». En particulier, « L'Alsace est une petite région extrêmement sollicitée dans les domaines culturel, sportif ou environnemental, et nous devons être présents dans tout ce qui représente un intérêt pour la région, en évitant toutefois de nous occuper trop de ce qui ne nous regarde pas. À côté de nos missions fondamentales dans les domaines des transports, de l'éducation, de la formation professionnelle et maintenant du développement économique, nous avons décidé de nous efforcer de limiter à 2 % le taux de croissance de nos dépenses non obligatoires, dans les secteurs où nous n'avons pas de compétence explicite. [Ainsi, bien que] nous sommes souvent sollicités par des acteurs qui pensent que nous avons vocation à nous substituer, en tout ou partie, à l'État [,] nous décidons alors au cas par cas, en fonction de l'intérêt régional et des besoins réels ». De plus, s'agissant des subventions aux communes qui pèsent d'un poids important sur les budgets régionaux, M. Adrien Zeller a déclaré : « nous leur avons clairement annoncé que nous n'avons pas pour compétence générale de les soutenir. Nous n'intervenons à leur profit que sur des thèmes régionaux, pour financer des équipements culturels d'une certaine importance, des infrastructures permettant d'accomplir des économies d'énergie ou de produire des énergies renouvelables, pour valoriser le patrimoine, agir sur la trame verte ou en faveur de l'habitat ». Ainsi, les interventions de la région Alsace sont, selon M. Michel Thénault, préfet de la région, « assez bien ciblées autour de quatre priorités : les transports, la formation, l'économie et l'enseignement supérieur, la recherche et la technologie », ces interventions étant « toutes cohérentes avec la situation régionale ». L'Alsace a donc évité la tentation de tout faire dans tous les domaines, tentation à laquelle ont cédé un certain nombre de régions. De plus, elle n'a pas hésité à remettre en cause le calendrier de ses investissements. Ainsi que l'a déclaré M. Adrien Zeller lors de son audition du 30 mars 2005 : « dans la situation difficile qui est la leur, les collectivités locales sont contraintes de faire des choix. Pour sa part, l'Alsace a décidé d'étaler légèrement son programme de modernisation des lycées, qui se réalisera sur huit ans au lieu de six ». La même stratégie a été suivie par M. Christian Estrosi dans le département des Alpes-Maritimes : « Dès 2000, le choix a été fait de privilégier la politique d'investissement pour apporter des réponses concrètes aux difficultés quotidiennes des Azuréens et améliorer les conditions de développement des entreprises. De 2000 à 2003, le conseil général a investi 820 millions d'euros, soit une moyenne de 205 millions par an ; les réalisations se sont amplifiées pour atteindre 241 millions en 2003. Les chiffres sont supérieurs à la moyenne de la strate [...] En 2004, 273 millions ont été réalisés en investissement, avec en outre un taux d'exécution de 85 %, contre 77 % en 2003. Les crédits d'investissement inscrits au budget primitif 2005 atteignent le niveau sans précédent de 330 millions. Sur la base d'un audit réalisé par le cabinet Klopfer, une politique de planification et de contractualisation a été engagée. L'an passé, quatre grands programmes d'investissement ont donc été votés par l'assemblée départementale ». Pour le détail de ces programmes - construction de quinze collèges et six internats d'intégration, 110 chantiers routiers, construction d'un hôtel de police de 110 brigades de gendarmerie, contrat de plan avec quatre communautés d'agglomération - on se reportera au tome II du présent rapport. M. Christian Estrosi a conclu : « Grâce à cette politique de planification et de contractualisation, je sais exactement ce que je vais dépenser chaque année en investissement. Nous éviterons ainsi tout saupoudrage ». Enfin, même lorsqu'elle décide d'intervenir en dehors de ses compétences, par exemple pour mettre en œuvre une politique d'aide à l'achat des livres scolaires - politique qui a un coût élevé pour les régions - elle s'est attachée à choisir les modalités les plus adaptées tant à la finalité de celle-ci qu'à la réduction de son coût. Ainsi, « l'Alsace n'a pas adopté le principe de la gratuité des livres scolaires. Nous avons préféré accorder une prime de rentrée scolaire aux familles dont les ressources sont inférieures à la moyenne régionale, ce qui signifie que nous n'adressons pas de chèques aux familles aisées ou riches. On peut se demander quelle est la politique la plus sociale ». · Une forme atypique d'intervention : la suppression de la taxe sur les permis de conduire L'intervention des régions peut également prendre la forme de la diminution ou de la suppression d'une recette lorsque celle-ci s'inscrit dans le cadre d'une politique régionale. Ainsi, un grand nombre de régions ont décidé de diminuer, voire de supprimer complètement, la taxe sur les permis de conduire afin d'aider les jeunes, qui en sont les premiers redevables - ou leurs parents. C'est ainsi que la taxe sur le permis de conduire n'est plus prélevée que par cinq régions métropolitaines sur vingt-deux en 2005, après que les régions Auvergne, Midi-Pyrénées et Poitou-Charentes aient décidé à leur tour de la supprimer. Quant à celles qui la perçoivent encore, quatre n'ont pas touché à son tarif et une l'a divisé par deux. TAXE SUR LES PERMIS DE CONDUIRE EN 2005
Source : réponses au questionnaire et budgets primitifs des régions La région Midi-Pyrénées a justifié ainsi sa décision de supprimer la taxe en 2005 : « cet impôt, qui pesait réellement sur le budget des familles et des jeunes, est supprimé dans un souci de solidarité. La perte de produit sera compensée par l'augmentation du taux sur les cartes grises ». La région se prive ainsi d'une recette estimée à 2,3 millions d'euros dans le budget primitif pour 2004. De même, la région des Pays de la Loire a supprimé le 30 juin 2004 la taxe sur les permis de conduire dont le produit s'élevait à 2,5 millions d'euros. Certes, la taxe sur le permis de conduire ne constitue qu'une faible part des recettes fiscales des régions, mais, par équité, il convenait de mentionner que, dans un contexte de hausse générale des taux de fiscalité régionale, une taxe au moins aura vu son tarif diminuer, parfois jusqu'à zéro. Il est d'ailleurs à souligner que certaines régions sont moins fondées à se plaindre de la faiblesse de leur autonomie financière après avoir décidé volontairement de se priver d'une ressource fiscale. · La croissance des dépenses, obligatoires comme non obligatoires, exige une augmentation des ressources En conclusion, les dépenses hors compétences obligatoires ont fini par représenter une part importante des budgets locaux. Ainsi que l'a déclaré M. Charles Buttner, président du conseil général du Haut-Rhin, lors de son audition du 18 mai 2005 : « hors compétences obligatoires, il y a en premier lieu d'abord l'aide aux communes, pour les bâtiments publics, la voirie, etc. Je le dis très volontiers, car c'est un vrai enjeu au sein du projet départemental. Cela représente un peu plus de 100 millions d'euros sur un budget de 600 millions environ, soit un peu plus de 15 %, M. Chochoy pourra vous donner les chiffres exacts. S'ajoutent à cela les compétences en matière de développement économique, qui sont importantes, d'aide aux universités, qui sont importantes aussi. Au total, nous ne sommes pas loin, sinon du tiers, du moins du quart des dépenses ». M. Michel Chochoy, directeur général adjoint des services du département, a précisé : « le montant précis des dépenses hors compétences obligatoires s'élève à 145 millions en fonctionnement ». Ainsi, dans le cas d'un département dont la politique budgétaire est comparativement très modérée, les dépenses non obligatoires représentent le quart du budget. Dans le cas des régions, si l'on se fonde sur la répartition fonctionnelle des dépenses, on arrive à un total des dépenses non obligatoires de 21 % dès lors que l'on considère que ne sont pas juridiquement obligatoires les dépenses relatives à l'environnement, à l'aménagement des territoires, à la santé et à l'action sociale, à la culture, au sport et aux loisirs et à l'action économique. Certains ont même craint, à l'instar M. Georges Vincent, président du groupe démocratie et République du conseil général de l'Hérault le 19 avril 2005, que les collectivités territoriales diminuent leurs dépenses dans le domaine de leurs compétences obligatoires au profit de l'exercice des nouvelles compétences qu'elles se sont octroyées : « Le département intervient en effet hors de ses compétences dans un grand nombre de domaines. On peut parfois le comprendre, comme par exemple dans le domaine de l'enseignement élémentaire et préélémentaire, où les aides aux communes pour les créations de classes sont de l'ordre de 250 000 francs par classe, ce qui est une somme relativement importante, et appréciable pour les élus. Mais d'un autre côté, l'enveloppe du Fonds d'équipement des communes urbaines est insuffisante et mériterait d'être augmentée. Elle se rétrécit d'année en année, jusqu'à atteindre 397 000 euros cette année. Or, c'est quand même un élément important de l'amélioration du tissu urbain des communes et de la qualité de vie urbaine dans ces communes. D'un côté, le département accorde aux communes des aides hors de son champ de compétences, et de l'autre les aides du FECU sont insuffisantes. Le département intervient également dans les domaines sportif, culturel, économique, qui ne sont pas de sa compétence ». Or, cette crainte, malgré quelques réalisations locales, paraît vaine. En dépit d'une intervention croissante hors du champ de leurs compétences, les collectivités territoriales n'ont jamais abandonné leur « cœur de métier », les dépenses progressant régulièrement dans tous les domaines. Ainsi que l'a rappelé M. Jean-François Copé lors de son audition du 14 juin 2005, elles ont même progressé à un rythme tel que, « en 2004 est apparu un élément nouveau : pour la première fois depuis bien longtemps, les collectivités territoriales n'ont pas maintenu l'équilibre de leurs comptes. En clair, les comptes publics locaux sont tombés dans le rouge, affichant pour la première fois un déficit de 0,1 point de PIB. C'est là un élément nouveau pour les collectivités territoriales mais, hélas ! ancien pour l'État, qui ne saurait dans ce domaine leur donner de leçons. S'il tient incontestablement ses engagements quant aux transferts de compétences et aux transferts de ressources, son comportement dans ce domaine n'a rien de très glorieux. Reste que, pour la première fois depuis très longtemps, la forte augmentation des dépenses locales s'est traduite par un déficit des comptes des collectivités territoriales, qui de surcroît intervenait au cours d'une année relativement favorable sur le plan des conditions macro-économiques ». M. Brice Hortefeux a résumé la situation le 15 juin 2005 : « l'offre des services des collectivités territoriales augmente sous l'effet des transferts de compétences, mais aussi en fonction du choix éventuel des collectivités d'accroître leur niveau de service en allant au-delà de ce que faisait l'État ou en intervenant davantage sur leurs compétences générales ». En conséquence, les collectivités territoriales se sont donc trouvées dans l'obligation de dégager des ressources supplémentaires qu'elles ont essentiellement trouvées dans l'augmentation de leur fiscalité. C.- LA STRATÉGIE FINANCIÈRE DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 1.- L'arbitrage des collectivités territoriales entre emprunt et autofinancement a pesé sur l'évolution de la fiscalité locale Le dynamisme de l'investissement des collectivités territoriales, réel depuis quelques années, s'est donc poursuivi en 2005. Or, celles-ci disposent de deux moyens pour financer leurs dépenses d'investissement : par l'emprunt et par l'autofinancement, c'est-à-dire, principalement, par leur épargne. En effet, à la différence des dépenses de fonctionnement, l'exigence d'une couverture par des recettes de fonctionnement, parmi lesquelles le produit de la fiscalité, ne s'applique pas aux dépenses d'investissement. En conséquence, ainsi que l'a souligné M. Dominique Hoorens au cours de son audition du 9 mars 2005, « le choix stratégique entre fiscalité immédiate, par le biais de l'autofinancement, ou étalée dans le temps, par le biais de la dette, joue effectivement sur le niveau de pression fiscale ». De plus, les dernières années ont été marquées par une relative dégradation du taux d'épargne des départements et des régions, alors même que les dépenses de fonctionnement et d'investissement ont tendance à augmenter. Dès lors, certaines collectivités ont pu choisir d'affecter le surplus de recettes fiscales provenant de la hausse de leurs taux à la réduction du recours à l'emprunt et à la reconstitution de leur épargne. Ce choix stratégique, qui relève de leur libre administration, n'appelle en lui-même aucun jugement de valeur de la part de votre Commission d'enquête. Mais il est l'un des éléments explicatifs déterminants de l'évolution des impôts locaux en 2005. a) Bilan de la situation financière des collectivités territoriales à la veille de l'acte II de la décentralisation M. Brice Hortefeux a résumé le 15 juin 2005 pour la Commission la situation. A la veille de l'acte II de la décentralisation, « les finances locales pouvaient se prévaloir de fondements financiers solides [...]. Les premiers éléments disponibles pour l'année 2004 indiquent, d'une part, un tassement de l'épargne des collectivités sous l'effet incontestable d'une accélération des dépenses de personnels, et d'autre part la persistance d'un niveau élevé d'investissement : +7,2 % pour l'ensemble des collectivités. Cela se traduit à l'évidence par un besoin de financement pour l'ensemble des secteurs des administrations publiques locales et, du coup, par une légère augmentation de leur endettement. Encore faut-il relativiser ce phénomène qui intervient après huit années d'excédents : non seulement ce besoin est strictement lié à l'effort d'investissement [...] mais le recours à l'emprunt accompagne un autofinancement qui reste largement positif, à hauteur de 29,9 milliards d'euros. Ajoutons qu'il intervient dans un contexte financier reconnu comme favorable, les très faibles taux d'intérêt rendant l'endettement plus attractif. Les collectivités ont donc conservé des marges de manœuvre certaines en termes d'endettement. Enfin, le niveau de leur dette a très nettement diminué par rapport à ce qu'il était voici dix ans, rendant la charge de cette dette « soutenable » pour la plupart des collectivités ». La solidité de la situation financière des collectivités territoriales se reflète donc dans un endettement maîtrisé, quoiqu'en légère augmentation, et un autofinancement élevé, bien qu'en légère diminution. · Le poids de la dette des collectivités territoriales est soutenable Les collectivités territoriales ont globalement diminué leur recours à l'emprunt au cours des dernières années, ainsi que le montre le graphique suivant. Le reflux a été engagé, au milieu des années 1990, d'abord par les communes, instruites par l'exemple, puis par les départements et les régions. 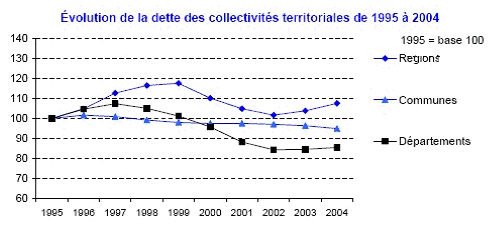 En 2004, selon les estimations de la Direction générale des collectivités locales, la dette totale des budgets principaux des régions (y compris les marchés d'entreprises de travaux publics) s'établit à 8,1 milliards d'euros. Elle était de 18,47 milliards d'euros pour ceux des départements et de 50,04 milliards d'euros pour ceux des communes. Le montant total de la dette des budgets principaux des collectivités territoriales atteint donc 76,61 milliards d'euros. Ainsi que l'a observé M. Dominique Schmitt : « le niveau de la dette des collectivités territoriales a très nettement diminué et la charge de la dette est devenue, pour la plupart, tout à fait supportable », résultat d'une politique de maîtrise de l'endettement mise en œuvre depuis la fin des années 90. DETTE DES BUDGETS PRINCIPAUX EN EUROS PAR HABITANT AU 1ER JANVIER
Source : DGCL De plus, pour M. Alain Guengant, entendu le 8 mars, les collectivités territoriales se trouvent « à la tête d'un patrimoine considérable - 700 à 750 milliards d'euros, pour 100 milliards de dettes, autrement dit, s'il s'agissait d'entreprises, plus de 600 milliards d'euros de fonds propres ». Les collectivités territoriales ont donc, globalement, une situation financière saine. On observe cependant des évolutions contrastées selon les catégories de collectivités territoriales. Si les communes connaissent une baisse régulière de leur endettement, l'encours de dette des départements, qui avait diminué de 18,6 % entre 1998 et 2002, connaît un début de remontée à partir de 2003. Plus significativement, l'endettement des régions, qui avait été réduit de 12,6 % entre 1998 et 2002 après une très forte augmentation au cours des années 1990, a repris sa progression depuis cette date : 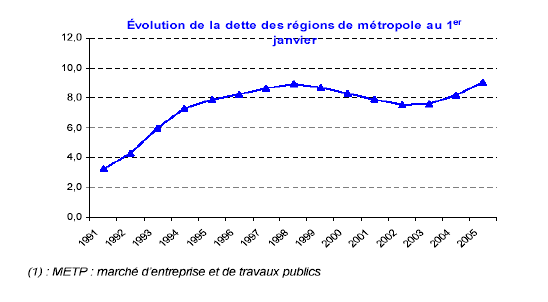 En 2005, les emprunts prévus par les régions de métropole au moment du vote de leur budget primitif s'établissent ainsi à 3 265 millions d'euros hors mouvements financiers liés à la gestion active de la dette, ce qui constitue une croissance de 19,1 % par rapport au budget primitif 2004. Cependant, comme l'a dit M. Robert Hertzog à votre Commission le 8 mars 2005 : « si la dette publique locale augmente à nouveau, c'est parce que l'investissement a redémarré, et elle ne me semble pas atteindre, pour l'instant, un niveau inquiétant ». À noter qu'en période de taux d'intérêt historiquement bas, un arbitrage favorable à l'emprunt est économiquement sain. En tout état de cause, cette croissance doit être interprétée avec une grande prudence. Ainsi que l'a observé M. Brice Hortefeux : « l'appel à l'emprunt, devenu au fil des ans une variable d'ajustement des budgets régionaux, est toujours surestimé par les prévisions. À l'inverse, les rentrées fiscales s'avèrent souvent meilleures que prévu et les investissements, pour des raisons différentes, souvent réalisés en partie seulement ». Le graphique suivant illustre bien cette pratique, en comparant les emprunts prévus au moment des budgets primitifs des régions et les emprunts effectivement souscrits. On observe que l'écart se creuse au fil des ans, ce qui permet de penser que les emprunts prévus en 2005 ne seront pas intégralement réalisés. 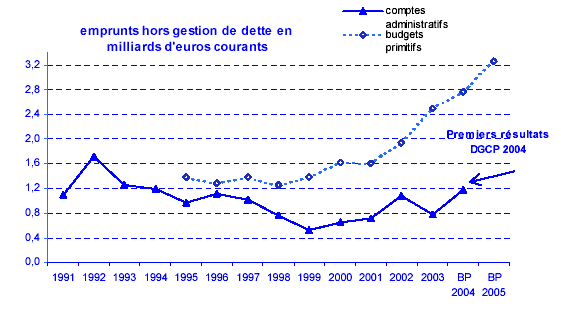 Cette pratique est également constatée pour les départements. M. Michel Buttner en a donné une illustration frappante le 18 mai, en signalant que, dans le Haut-Rhin, « le recours à l'emprunt est traditionnellement prévu à hauteur de 80 millions d'euros mais nous n'en avons réalisé que 30 millions en 2004 ». · Une épargne élevée, quoiqu'en légère diminution Plus encore que pour l'endettement, les collectivités territoriales présentent des situations contrastées en matière d'autofinancement, bien que celui-ci reste globalement à un niveau satisfaisant, à 29,9 milliards d'euros. Ainsi, la question de l'autofinancement n'est pas vraiment pertinente pour les communes, dont la capacité d'autofinancement a encore progressé en 2004 (+2,7 %), bien que la croissance se ralentisse. Éléments de gestion financière La capacité d'autofinancement d'une collectivité territoriale dépend de deux éléments : l'épargne dégagée sur la section de fonctionnement et les recettes d'investissement. La contribution de la section de fonctionnement au financement des investissements peut être appréhendée par la mesure de la capacité d'épargne dégagée par la collectivité sur sa section de fonctionnement. Elle s'apprécie à travers l'analyse des trois ratios de la chaîne d'épargne : - l'épargne de gestion, dégagée sur la gestion courante, représente la différence entre les recettes réelles de gestion et les dépenses réelles de fonctionnement avant paiement des intérêts de la dette ; - l'épargne brute correspond à la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement après paiement des intérêts de la dette (soit l'épargne de gestion moins les intérêts de la dette) ; - l'épargne nette correspond à l'épargne brute une fois déduite la dépense d'investissement prioritaire qu'est le remboursement du capital de la dette et les opérations liées au réaménagement de la dette. L'épargne nette représente la contribution de la section de fonctionnement au financement de la section d'investissement. La capacité d'autofinancement est calculée en ajoutant à l'épargne nette les ressources propres d'investissement qui sont composées, pour l'essentiel, du FCTVA et des remboursements de prêts et d'avances consenties à d'autres collectivités. Ces recettes dépendent donc directement des dépenses d'investissement réalisées au cours des exercices antérieurs et, pour les prêts, des échéanciers de remboursement qui s'y attachent. La capacité d'investissement avant emprunt détermine le montant total des investissements que la collectivité peut financer avant de recourir à l'emprunt. En revanche, la baisse de l'épargne des régions est particulièrement nette au cours des dernières années, ainsi que le montre le graphique suivant : 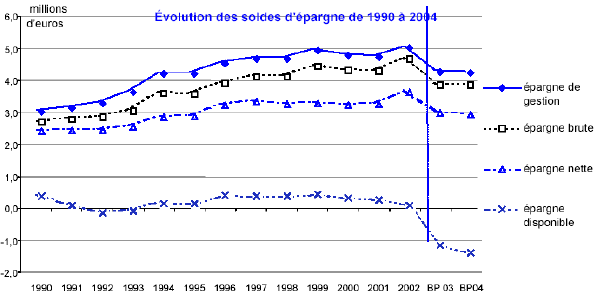 En effet, selon les chiffres de la Direction générale des collectivités locales, en 2004, les dépenses de gestion (dépenses de fonctionnement hors intérêts de la dette) ont augmenté sensiblement plus vite que les recettes de fonctionnement (11,3% contre 6,8%), ce qui induit une diminution de l'épargne de gestion de 1,9%. Malgré la stabilisation des intérêts de la dette, l'épargne brute diminue encore plus (-2,1%) et l'épargne nette baisse finalement de 4,4% pour atteindre un montant de 2,7 milliards d'euros, ce qui est insuffisant pour financer l'intégralité des investissements. Les départements ont eux aussi, connu une baisse de leur épargne brute au cours des dernières années, ainsi que le montre le graphique suivant : 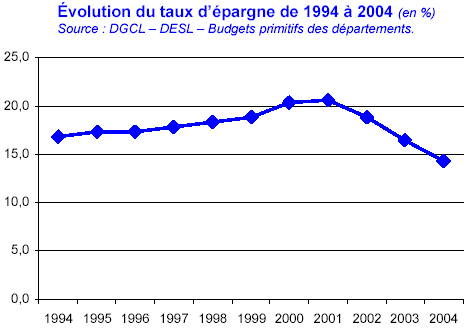 Cependant, globalement, la situation des départements est loin d'être mauvaise. Ainsi que l'a déclaré M. Claudy Lebreton durant son audition du 23 mars 2005, « le total de nos dépenses de fonctionnement selon les comptes administratifs 2003 s'élève à 28,7 milliards d'euros et le total de nos recettes de fonctionnement s'élève en 2003 à 37 milliards d'euros, dont 20,6 milliards d'euros de recettes fiscales. Cela signifie que les départements ont dégagé en 2003 une épargne brute de plus de 8 milliards d'euros, signe d'une gestion financière globalement saine ». De plus, les remboursements de dette diminuant régulièrement, les départements ont connu en 2004 une augmentation de leur épargne nette de 5,5 % à 3,7 milliards d'euros selon les estimations de la DGCL. Cependant, il est encore une fois difficile de tirer une conclusion générale, du fait des situations extrêmement contrastées des départements, comme le montre le tableau suivant : 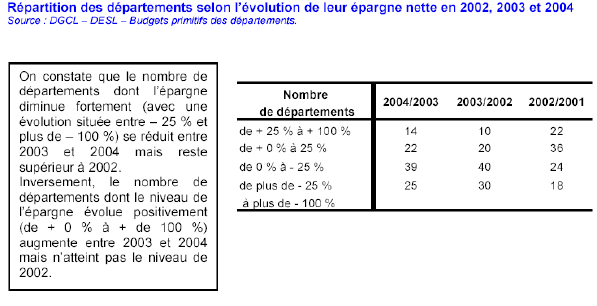 De manière générale, il convient de relativiser les conséquences de ce tassement de l'épargne des collectivités territoriales et de la reprise concomitante de leur endettement : - d'une part, cette reprise est strictement liée à l'effort d'investissement des collectivités territoriales, l'épargne restant positive à un niveau élevé ; - d'autre part, elle intervient dans un contexte financier favorable, puisque les taux d'intérêt très faibles rendent l'endettement plus attractif ; - enfin, ainsi qu'il a été dit, le niveau de la dette des collectivités territoriales, a très nettement diminué depuis quelques années, et la charge de la dette est soutenable pour la grande majorité d'entre elles. b) Les choix des collectivités territoriales en matière d'emprunt expliquent en partie l'évolution de leurs taux de fiscalité Sur longue période, les collectivités territoriales ont opéré des choix de financement variés pour leurs investissements. Certaines ont d'emblée privilégié le recours à l'emprunt, répartissant ainsi la charge entre les générations. D'autres ont choisi d'utiliser plutôt leur marge de manœuvre fiscale, limitant ainsi la charge de la dette, présente et à venir, mais faisant porter la charge du financement sur les contribuables actuels. Pour M. Dominique Schmitt, « ces variations n'obéissent à aucune logique spécifique ; elles tiennent seulement à des arbitrages entre endettement et fiscalité librement arrêtés par les collectivités territoriales » qui « utilisent à plein leur marge d'autonomie locale », a-t-il estimé le 10 mai 2005. Pour la période récente, M. Alain Guengant a néanmoins observé que « l'arbitrage des collectivités locales en faveur de l'autofinancement et la réduction de leur demande d'emprunt ont également pesé sur le taux de fiscalité ». En effet, « aux débuts de la décentralisation, 60 % de l'investissement local était couvert par l'emprunt ; nous n'en sommes plus aujourd'hui qu'à 30 ou 35 % ». Les investissements qui n'ont pas été financés l'emprunt l'ont été par l'autofinancement, et d'abord par la fiscalité, puisque les concours de l'État aux investissements sont demeurés proportionnellement constants. Cependant, afin d'apprécier dans quelle mesure l'arbitrage des collectivités territoriales au détriment de l'emprunt relève d'un libre choix, il est nécessaire de déterminer la situation financière de chacune d'entre elles au regard de la pression fiscale et de l'endettement. En effet, une collectivité fortement endettée n'aura pas la même possibilité de recourir à l'emprunt qu'une collectivité qui l'est faiblement, et aura plutôt tendance à privilégier le désendettement. Or, une telle étude n'est actuellement disponible que pour les régions. Elle est riche d'enseignements. Le graphique ci-dessous situe, en 2004, chaque région : - sur l'axe horizontal, par rapport à la valeur médiane de l'ensemble des régions en ce qui concerne la dette par habitant ; - sur l'axe vertical, par rapport à la valeur médiane de l'ensemble des régions en ce qui concerne les recettes fiscales en euros par habitant. 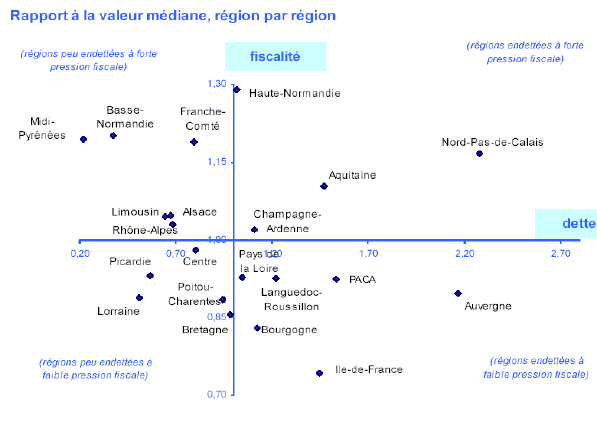 Il apparaît qu'une catégorie de régions avaient, en 2005, le choix libre de recourir à l'endettement plutôt qu'à la fiscalité pour le financement de leurs investissements : les régions peu endettées à faible pression fiscale. Parmi celles-ci, deux régions ont un comportement particulièrement significatif : la Bretagne et la région Centre. La région Bretagne, qui se caractérise par l'une des pressions fiscales les plus faibles du pays - avec le plus faible budget par habitant - a décidé de rééquilibrer sa stratégie financière au détriment de l'emprunt. En effet, ainsi que l'a fait valoir le président du conseil régional dans son rapport pour le débat d'orientations budgétaires pour 2005, « en l'absence d'une forte revalorisation des dotations de l'Etat ou d'une réforme profonde de la fiscalité locale donnant pleinement aux régions les moyens de leurs responsabilités, le conseil régional devra, dès 2005, recourir, soit à l'emprunt, soit à un appel supplémentaire à la fiscalité. [...] Pour ne pas poursuivre une stratégie de recours à l'emprunt, potentiellement très dangereuse, l'équilibre budgétaire devra être assuré par une augmentation de la fiscalité régionale ». En conséquence, la région précise dans sa réponse au questionnaire de notre Commission d'enquête que « la hausse des taux et tarifs de la fiscalité (31 millions d'euros) vient essentiellement compenser la baisse de l'emprunt (20 millions d'euros) ». La région Centre a, elle aussi, fait le choix délibéré d'une hausse de la fiscalité et d'un moindre recours à l'endettement. Dans son rapport de présentation du budget primitif de la région pour 2005, M. Michel Sapin, président du conseil régional, a confirmé qu'en « refusant de recourir de manière inconsidérée à l'emprunt, il devenait nécessaire d'agir sur les seules ressources dont nous avions la maîtrise : la fiscalité ». En conséquence, « l'augmentation de 18,6 % des dépenses d'investissement par rapport au BP 2004 se réalise avec un recours limité à l'emprunt », l'emprunt d'équilibre s'établissant à 79,8 millions d'euros contre 113 millions d'euros en 2004. Enfin, la région Languedoc-Roussillon, qui se caractérise par un endettement légèrement supérieur et une fiscalité légèrement inférieure à la valeur médiane de l'ensemble des régions, a choisi d'assurer le financement de ses investissements par la fiscalité plutôt que par l'emprunt. Ainsi que l'a déclaré, le 19 avril 2005 à Montpellier, M. Thierry Camuzat, directeur général adjoint chargé des finances de la région, « il a été décidé d'augmenter les taux de fiscalité au maximum puis d'en emprunter le solde », alors même qu'il reconnaît que « la région n'est pas particulièrement endettée ». M. Georges Frêche a admis pour sa part que « la région n'a pas voulu tout financer par l'emprunt, même si elle aurait pu le faire, et ainsi augmenter ses impôts beaucoup moins ». C'est pourquoi, selon M. Jacques Blanc, ancien président du conseil régional, « en 2005, avec une fiscalité normale et un emprunt normal, on pouvait faire face aux investissements générés par les autorisations de programme ». Et il conclut : « il fallait faire l'emprunt en totalité. [...] Ce n'était pas une charge supplémentaire, mais une gestion intelligente pour les investissements ». Par ailleurs, s'agissant de la région Franche-Comté, le rapport de présentation du budget primitif pour 2005 indique que « le choix proposé par la région en 2005 est d'ajuster les recettes par une augmentation de la fiscalité tout en diminuant le recours à l'emprunt afin d'assurer une gestion responsable de ses compétences et financer, à court, moyen et long terme, ses projets ». Quand bien même la région Franche-Comté se situait en 2004, sur le graphique, dans la catégorie des régions faiblement endettées à forte pression fiscale, elle a clairement fait le choix de la fiscalité au détriment de l'emprunt pour le financement de ses investissements. À l'inverse, deux régions peu endettées et disposant d'une fiscalité légèrement supérieure à la valeur médiane ont fait le choix de recourir à l'emprunt plutôt que d'augmenter les impôts régionaux : la région Rhône-Alpes et l'Alsace. Comme l'a précisé M. Jean-François Debat, vice-président du conseil régional de Rhône-Alpes, le 30 mars 2005, lors de l'audition de l'Assemblée des régions de France, « la région Rhône-Alpes était peu endettée, ce qui nous a permis d'augmenter très nettement notre recours à l'emprunt tout en le maintenant dans des limites acceptables ». L'emprunt de la région a augmenté de 130 millions d'euros en 2005 afin de faire face notamment à un très important programme d'investissement dans le domaine ferroviaire. Pour cette région, à la différence de certaines autres, la rationalité économique de la stratégie retenue apparaît de façon limpide. Quant à l'Alsace, c'est une région qui, selon M. Michel Thénault, préfet de la région, pouvait « jouer sur trois paramètres au moins : le recours à la fiscalité, le recours à l'emprunt mais aussi [...] une possible révision du calendrier de certains investissements ». Or, l'Alsace a fait le choix d'une hausse modeste de sa fiscalité et d'un recours important à l'emprunt, sans pour autant renoncer à ses investissements. Ainsi que l'a expliqué M. Adrien Zeller le 18 mai 2005, « notre région se caractérise par l'ampleur de ses projets, en particulier de ses grands projets comme les TGV, ce qui nécessite un effort considérable et se traduit par une augmentation temporaire de l'emprunt. Nous pratiquons une planification financière pluriannuelle, révisée chaque année, afin de savoir où nous allons. Nous avons choisi, sur la période dix ans en cours, de financer nos investissements lourds à hauteur des deux tiers par l'autofinancement et du tiers restant par l'emprunt, soit une augmentation de 100 millions d'euros par an ». Le niveau d'endettement est passé de 87 euros par habitant en 2002 à 167 euros par habitant en 2004 et devrait atteindre 397 euros en 2010, si l'on en croit le dernier débat d'orientations budgétaires. Certains pourraient s'effrayer d'une telle progression de l'endettement, et y voir la conséquence d'une mauvaise gestion, porteuse de risques financiers. Cependant, ce serait oublier deux choses, ainsi que l'a rappelé le préfet de région : d'une part « le recours à l'emprunt est inéluctable pour financer des investissements qui, à l'image du TGV à Strasbourg, finiront par rapporter, pour peu que l'on sache s'y prendre » et, d'autre part, que « pour la région, l'investissement forme une bosse, non un mille-feuille ». C'est pourquoi, fort de son expérience d'ancien Directeur général des collectivités locales, il ne doute pas que « dès 2012, sa capacité de désendettement sera revenue à des niveaux raisonnables ». Certains départements ont également recouru à l'endettement afin de financer leur programme d'investissement. Ainsi, le département des Alpes-Maritimes, dont les taux n'ont pas augmenté en 2005. Comme l'a fait valoir M. Christian Estrosi lors de son audition, le 26 mai 2005 : « pour l'avenir, sur la base d'un audit rétrospectif et prospectif, le conseil général inscrit ses dépenses dans un cadre clair et rigoureux. Le programme d'investissement de 2 milliards d'euros que j'ai signalé sera financé à hauteur de 750 millions par l'emprunt. La collectivité départementale approchera ainsi huit années de capacité de désendettement en 2010. Ce recours important à l'emprunt se justifie par un désendettement massif : la dette est passée de 600 à 50 millions d'euros, entre 1994 et 2004. La capacité de désendettement atteignait alors six mois. [...] Le recours à l'emprunt, accompagné d'une maîtrise des dépenses de fonctionnement, nous permettra de financer notre programme d'investissement 2004-2010 sans accroître le recours à la fiscalité ». Il est intéressant de constater de la sorte que trois collectivités territoriales qui ont peu ou pas augmenté leurs taux en 2005 ont défini une stratégie financière pluriannuelle pour le financement de leurs investissements, en intégrant l'emprunt parmi les choix de financement. En effet, non seulement la solvabilité d'une collectivité s'apprécie sur le long terme, mais elle n'est pas mise en danger par une augmentation temporaire de l'endettement. M. Gérard Burel, président du conseil général de l'Orne, a du reste témoigné le 10 mai 2005 de ce qu'un redressement financier courageux peut, en peu d'années, « sortir du rouge » une collectivité en situation critique : « pendant six ou huit mois, j'ai vraiment cru que je ne redresserais pas la situation, mais peu à peu les clignotants se sont remis au vert. Et en quatre ans, à ma grande surprise car je croyais que ce serait plus long, le département est revenu à meilleure fortune ». Les stratégies variées des régions en matière d'endettement et de fiscalité en 2005 ont naturellement bouleversé leurs positions respectives dans le graphique : 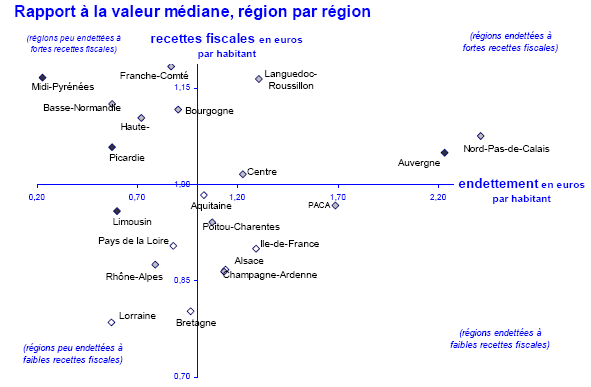 On observe ainsi que la Bourgogne, suite à la hausse de ses taux de 64,2 % - pour un produit voté en hausse de 68,4 % - se retrouve désormais dans de la catégorie des régions faiblement endettées à forte pression fiscale. La région Languedoc-Roussillon, qui a augmenté ses taux de 79,4 % pour un produit voté en hausse de 85,6 %, devient la deuxième région aux plus fortes recettes fiscales par habitant, ex-aequo avec Midi-Pyrénées, alors qu'elle se situait en 2004 en dessous de la valeur médiane. De même, le Limousin et la Picardie inversent leur position respective par rapport à la valeur médiane en matière de dette, le premier rejoignant les régions faiblement endettées à faible pression fiscale et la seconde les régions faiblement endettées à forte pression fiscale. Le choix de la région Aquitaine en faveur du désendettement apparaît clairement sur le graphique, puisqu'elle passe d'un rapport de 1,5 en termes de dette par habitant par rapport à la valeur médiane à quasiment la valeur médiane. Enfin, la région Alsace, située en 2004 dans la catégorie des régions faiblement endettée à forte pression fiscale intègre la catégorie exactement opposée des régions fortement endettées à faible pression fiscale. Ainsi que l'a observé M. Brice Hortefeux : « les collectivités ont pleinement joué de leur autonomie et de leur liberté de gestion. Pour mobiliser des ressources nouvelles, certaines préfèrent emprunter et répartir dans le temps la charge du financement ; d'autres choisissent la fiscalité et font porter l'effort sur le contribuable de l'année [...]. M. Alain Rousset a également reconnu : « De même qu'une entreprise peut, à un moment donné, choisir de faire appel aux fonds propres plutôt qu'à l'emprunt, elles ont choisi de financer leurs dépenses par une augmentation de leurs taux ». c) Les raisons de ce choix d'un recours limité à l'emprunt Il est souhaitable que les collectivités fortement endettées s'engagent ou poursuivent une stratégie de désendettement. De même, il est compréhensible qu'elles maintiennent un niveau élevé d'investissement par la hausse de leur fiscalité. Cependant, le refus de l'emprunt de la part de collectivités territoriales raisonnablement endettées conduit à s'interroger sur les raisons d'un tel comportement. En effet, « il est étonnant que les collectivités territoriales, dans ce contexte économique de baisse des taux, aient globalement réduit leur appel à l'endettement », comme l'a souligné M. Dominique Hoorens au cours de son audition. Il semblerait, selon M. Philippe Laurent, que « les élus locaux éprouvent une réticence générale à voir leur capacité d'épargne se dégrader ; c'est à partir de cet indicateur qu'ils mesurent la santé financière de leur collectivité. En effet, en matière de gestion publique locale, l'emprunt a mauvaise presse depuis les affaires d'Angoulême et de Briançon mais aussi en raison du poids de la dette de l'État ». De plus, « les agents territoriaux spécialisés dans les finances sont devenus très compétents, détiennent un savoir-faire et une expérience, pèsent auprès des élus mais ont une tendance peut-être excessive à la prudence. La fonction financière agit comme un frein. Ainsi, un accroissement des dépenses est généralement équilibré par une augmentation de la pression fiscale plutôt que par une diminution de la capacité d'épargne. La fonction financière semble guidée par un principe qui s'énoncerait de la façon suivante : la bonne gestion, c'est une épargne importante ». Cette cause de l'augmentation de la fiscalité locale, qui est structurelle, sera examinée plus longuement dans la deuxième partie du présent rapport. · La volonté de certaines collectivités territoriales d'augmenter leur taux d'épargne en 2005 Or, l'épargne des départements et des régions, si elle se situe à un niveau satisfaisant, est néanmoins en diminution. De plus, ces collectivités pourraient voir cette épargne diminuer encore sous l'influence de deux facteurs : - le premier résulterait de l'éventuel alourdissement du poids des charges transférées, lesquelles de manière générale, s'imputent sur la section de fonctionnement du budget des collectivités territoriales et réduisent mécaniquement leur épargne. Cet alourdissement est anticipé par nombre d'exécutifs locaux, qui pourraient décider de faire plus que l'État, sous l'effet notamment de la demande sociale ; - le second facteur tient au dynamisme des dépenses d'investissement, qui les obligent à dégager des ressources croissantes. Or, si elles recourent à l'emprunt, les annuités pèseront progressivement sur l'excédent de la section de fonctionnement et donc, à terme, sur le taux d'épargne, réduisant d'autant les marges de manœuvre pour les investissements futurs ; La préservation, voire l'augmentation du taux d'épargne, constituent donc, pour certaines collectivités, une priorité. Or, il existe trois manières d'améliorer ce taux : - comprimer les dépenses de fonctionnement, - diminuer le recours à l'emprunt (et, partant, le poids des annuités), - et enfin augmenter les recettes de fonctionnement. Les collectivités territoriales n'ayant, globalement, pas pu ou pas su maîtriser leurs dépenses de fonctionnement, la restauration du taux d'épargne passait par la hausse des impôts et par la diminution du recours à l'emprunt. Mais, comme les dépenses d'investissement augmentent et qu'il faut bien les financer, la diminution du recours à l'emprunt s'est traduite à son tour par une hausse supplémentaire de la fiscalité. Les cas de deux régions illustrent la mise en œuvre d'une telle stratégie. Ainsi, la région Centre. M. Michel Sapin a écrit dans le rapport de présentation du budget 2005 : « le choix a été fait d'augmenter la capacité d'autofinancement pour faire face aux investissements importants que nous devrons réaliser ». En 2005, poursuit-il « cet autofinancement atteindra un peu plus de 177,7 millions d'euros contre 147 millions d'euros lors de l'adoption du BP 2004 ». En effet, les recettes de gestion progressent par rapport à 2004 de 8,9%, beaucoup plus vite que des dépenses de gestion en hausse de 3,9%. Ainsi, l'épargne de gestion augmente de 20%, l'épargne brute et l'épargne nette progressant dans les mêmes proportions, les frais financiers étant contenus grâce au niveau bas des taux d'intérêt. Enfin, la progression de la fiscalité régionale en 2005 apportant une ressource supplémentaire de 44 millions d'euros, M. Michel Sapin considère que « cette ressource supplémentaire devra aussi, en grande partie du moins, le moment venu, nous aider à faire face à l'augmentation générale de nos charges que l'on doit craindre en 2007/2008 du fait des textes de décentralisation qui sont actuellement mis en œuvre ». De même, la stratégie de la région Bretagne a été clairement exposée par M. Jean-Yves Le Drian lors de l'audition du 15 juin 2005 : « pourquoi ai-je été amené à relever la pression fiscale de 15 % ? En raison de l'explosion de notre dette, essentiellement pour rétablir ma capacité nette d'épargne. J'ai ainsi diminué mon appel à l'emprunt sur mon budget 2005 ». En conséquence : « j'affecte l'essentiel de la ressource fiscale au rétablissement de l'épargne nette de la région, afin de corriger la situation que j'ai trouvée, où la dette avait été multipliée par trois ». En effet, « le président de région que je suis s'est trouvé confronté au problème du financement de cet endettement, alors même que l'épargne nette était passée de 47 % à 36 %. Devais-je continuer dans cette logique ou prendre des remèdes ? J'ai pris des remèdes, et la seule possibilité était de retrouver mon épargne nette. Tant et si bien qu'en 2005, j'emprunte moins que mon prédécesseur ». Enfin, interrogé par votre Rapporteur sur la question de savoir pourquoi l'Alsace n'avait augmenté ses taux que de 2 %, M. Alain Rousset, président du conseil régional d'Aquitaine, a répondu : « M. Adrien Zeller a choisi un autre rapport entre fiscalité et endettement que celui que nous avons choisi »,. En effet, comme il l'a écrit dans une lettre adressée au président de votre Commission en date du 8 avril 2005, « la poursuite de la politique de désendettement est dictée par des principes de précaution et de responsabilité » puisque « le service de la dette reste encore trop important [...], privant ainsi la région des marges de manœuvre correspondantes » Or, la région aura besoin de ces marges de manœuvre en 2007, « c'est-à-dire à un moment où la région devra dégager d'importants moyens pour honorer les engagements pris et pour ne pas faire échouer des projets d'investissement essentiels à l'attractivité du territoire Aquitain (bouchon ferroviaire de Bordeaux, grand contournement de Bordeaux, TGV sud Europe Atlantique, autoroute Bordeaux-Pau...). En conséquence, ainsi qu'il l'a reconnu lors de son audition, « l'augmentation de la fiscalité a été principalement due à l'impasse budgétaire où se trouvait la région et à son niveau d'endettement ». Exemple d'une stratégie de restauration de l'épargne: le département du Loir-et-Cher Le département du Loir-et-Cher, ayant voté une hausse uniforme de 15% dans son budget primitif, est l'un des départements qui ont le plus augmenté leurs taux de fiscalité en 2005. Cependant, cette augmentation s'inscrit dans une stratégie pluriannuelle qui vise à la restauration de la capacité d'épargne dégradée du département. Le débat d'orientations budgétaires pour 2005 révèle en effet que sur la base d'évaluations budgétaires prévisionnelles, reposant notamment sur l'hypothèse d'une stabilité des taux de fiscalité, l'autofinancement dégagé par la section de fonctionnement en 2005 serait de l'ordre de 19 millions d'euros, soit un niveau légèrement inférieur à celui du budget primitif pour 2004. Compte tenu de ce volume d'autofinancement, l'équilibre de la section d'investissement en 2005 nécessiterait un volume d'emprunt de plus de 43 millions d'euros (soit un financement de la section d'investissement hors amortissement de la dette à plus de 60 % par l'emprunt). Toujours sur ces bases, la capacité de désendettement du département qui devrait se situer fin 2004 à 3,4 années, durée déjà supérieure à la moyenne nationale, pourrait atteindre près de 7 ans à la fin de l'exercice 2005. De plus, le département doit faire face à la nécessité de réaliser un certain nombre d'investissements structurants, dans les domaines de la voirie et des collèges, en particulier, ainsi qu'à des sollicitations toujours plus importantes des communes. Il en résultera donc un montant d'investissements à réaliser plus important que dans l'hypothèse retenue dans le scénario théorique, ce qui est susceptible d'entraîner une dégradation plus importante encore de la situation financière. C'est pourquoi compte tenu de l'accroissement de charge que devra supporter le département, « le maintien de l'épargne passe nécessairement par un recours à la fiscalité directe ». Le Président du conseil général, M. Maurice Leroy, conclut « je serai donc amené à proposer dans le cadre du budget primitif 2005 une hausse des taux [...] qui devra permettre de ramener le financement des dépenses d'investissement par l'emprunt sous la barre des 50 % en terme d'inscription budgétaire. Un objectif qui permet de préserver à moyen terme l'équilibre des finances du département, en particulier notre capacité de désendettement ». · Le cas particulier de la région Poitou-Charentes Enfin, la région Poitou-Charentes mérite une attention particulière au regard de l'insistance de la présidente de son conseil régional à imputer aux transferts de charges décidés par l'État l'intégralité de la hausse de ses taux en 2005. Mme Ségolène Royal, lors de son audition avec l'Association des régions de France, le 30 mars 2005, a présenté les trois choix de la région Poitou-Charentes pour son budget 2005 : « le premier a été de maintenir, hors transferts de charges, le total des dépenses en 2005 au même niveau qu'en 2004, soit 484 millions d'euros. Cela signifie que toutes les dépenses nouvelles ont été financées par des économies ou des redéploiements ». Le deuxième « a été de réduire l'appel à l'emprunt ». Enfin, « le troisième choix a été de financer les transferts de charges décidées par le Gouvernement » sachant que « l'augmentation de 6 euros par habitant correspond, en effet, à l'euro près, à une augmentation des charges due aux transferts en provenance de l'État ». L'incohérence de l'argumentation apparaît immédiatement. En effet, si, à niveau de dépenses constant (hors transferts de charges), l'intégralité de la hausse de la fiscalité régionale a été absorbée par lesdits transferts, comment la région a-t-elle pu diminuer son emprunt dans de telles proportions, puisque celui-ci s'élève à 60 millions d'euros, en très forte diminution (- 36,64 %) par rapport au budget 2004 rectifié et « en dessous de la strate de référence 2003, soit 15,84% et au taux le plus bas depuis 2000 » ? 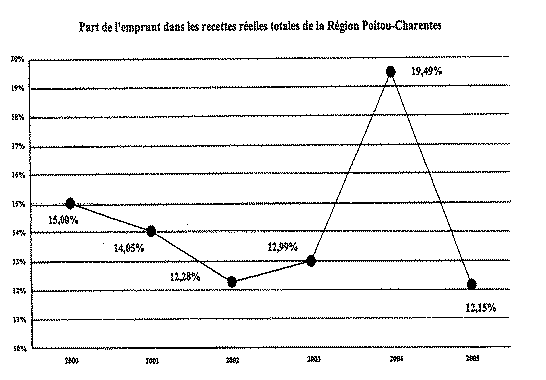 L'explication se trouve dans la réponse au questionnaire envoyé à la région par votre Commission d'enquête. On y découvre que les dotations de fonctionnement de l'État ont augmenté entre 2004 et 2005 de 23,258 millions d'euros - soit de 11,5 % - à 226,358 millions d'euros, les dotations d'investissement restant stables. Or, dans le même document, les transferts de charges décidés par l'Etat sont chiffrés à 25 millions d'euros - montant qui ne sera pas discuté ici. Si l'on suit le raisonnement Mme Ségolène Royal, la région Poitou-Charentes, qui a utilisé l'intégralité de la hausse de sa fiscalité pour financer les transferts de charges de l'État, a donc affecté la totalité de la hausse des dotations à la réduction de son emprunt. L'inverse est d'ailleurs possible, sachant que les dotations ou la fiscalité ne sont pas affectées spécifiquement à telle ou telle catégorie de dépenses. Ce qui est incontestable, et ce que revendique Mme Ségolène Royal, c'est que « le choix a été fait de réduire l'appel à l'emprunt », et que ce choix a été financé. Dès lors, on peut se demander, avec M. Jean-Yves Chamard, pourquoi « Mme Royal s'est répandue dans tous les journaux en expliquant que la forte augmentation de la fiscalité régionale [...] était en quelque sorte un « impôt Raffarin ». Pour le président de la commission des finances du conseil général de la Vienne, il n'y a pas de doute : « Mme Royal a voulu réduire la charge d'emprunt qu'elle considérait, à juste titre, trop élevée en la remplaçant par de la fiscalité ». Mais si tel était dès le départ l'objectif - tout à fait compréhensible - de la présidente du conseil régional, « mieux vaut faire savoir en toute transparence que trop d'emprunt, ce n'est pas bon pour l'avenir, a fortiori lorsque l'on craint l'éventualité de nouvelles dépenses, et que l'on a décidé de reporter une partie de l'effort sur la fiscalité afin d'alléger la charge d'emprunt, ce qui n'a rien d'absurde, plutôt que de faire croire n'importe quoi. Je suis vraiment très remonté contre cette présentation totalement biaisée, ainsi qu'en témoigne la comparaison entre les budgets régionaux 2004 et 2005. La décentralisation n'est pour rien là-dedans, si ce n'est à la marge ». d) Conclusion : la réduction de l'emprunt et la hausse de la fiscalité ont conduit à une amélioration des soldes d'épargne des régions en 2005 En conclusion, ainsi que l'a déclaré M. Brice Hortefeux : « la capacité d'épargne des régions est en nette amélioration en 2005, les dépenses augmentant un peu moins vite que les recettes de fonctionnement». Le choix des régions de restaurer leur épargne apparaît clairement dans le graphique suivant, qui est le prolongement de celui présenté plus haut : 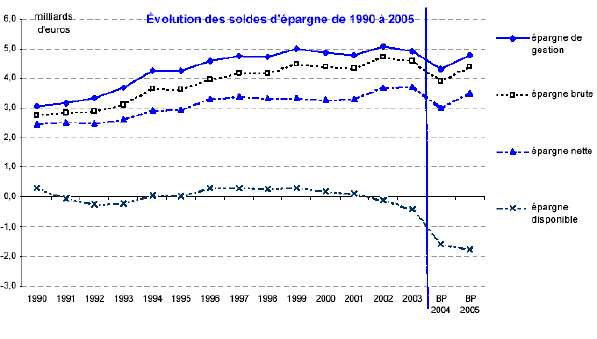 Par ailleurs, le tableau ci-après synthétise les conséquences du choix des régions en matière d'endettement et de fiscalité. 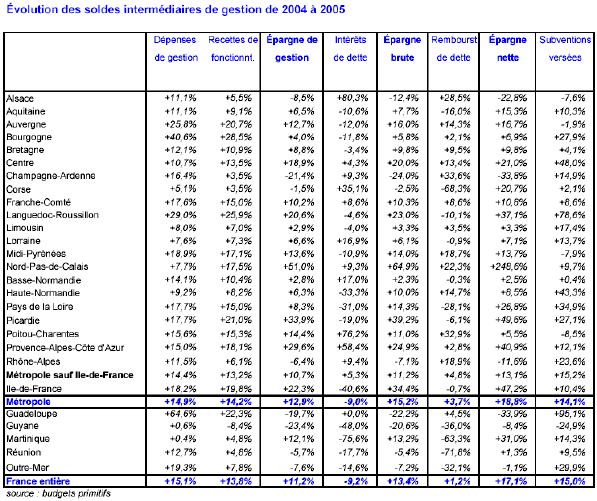 L'épargne nette des régions de métropole augmente globalement de 18,8 %. La région Alsace connaît une dégradation de son épargne nette de 22,8 % du fait de la faible hausse de ses recettes de fonctionnement et d'un recours accru à l'endettement. De même, les régions Champagne-Ardenne et Rhône-Alpes connaissent une baisse de leur épargne nette respectivement de 33,8 % et de 11,6 % pour les mêmes raisons. Inversement, la forte hausse de fiscalité décidée par la région Languedoc-Roussillon se traduit dans le solde de son épargne nette qui progresse de 37,1 %. Dans le cas de la région Île de France, la hausse de la fiscalité s'est ajoutée à la maîtrise de l'endettement, aboutissant à une augmentation spectaculaire de l'épargne nette de 47,2 %. A contrario, les choix de financement des départements sont également visibles à travers l'évolution de leur taux d'épargne. En 2005, ainsi que l'a déclaré M. Brice Hortefeux : « l'épargne nette découlant de ces prévisions de recettes et de dépenses [dans les budgets primitifs pour 2005] diminuerait légèrement : -1 %. Rappelons toutefois que les prévisions d'épargne des budgets primitifs s'avèrent souvent en deçà des réalisations». 2.- Des hausses opportunistes et de précaution a) La suppression envisagée de la part régionale de la taxe professionnelle a pu susciter des comportements opportunistes Sur décision du Président de la République, a été lancée une vaste réflexion sur la réforme de la taxe professionnelle menée par la commission présidée par M. Olivier Fouquet, aboutissant à un rapport dans lequel est notamment envisagée la suppression de la part régionale de la taxe professionnelle. Ainsi qu'il est écrit, « la réforme de la taxe professionnelle, notamment la mise en place d'un taux local encadré, peut être facilitée par une certaine spécialisation de la fiscalité locale, par ailleurs souhaitable à de nombreux égards. La commission a envisagé plusieurs scénarios. Elle en a retenu le dénominateur commun, qui est la suppression de la part régionale de la taxe professionnelle ». Les régions ont exprimé à maintes reprises, tant lors de l'audition de leurs représentants que dans leurs documents budgétaires, leur inquiétude face à la possible suppression de cette ressource dynamique. Cependant, sans attendre la décision finalement prise s'agissant de la réforme de la taxe professionnelle en général, et de sa part régionale en particulier, certaines ont cherché à anticiper les éventuelles conséquences budgétaires de celle-ci par une stratégie d'optimisation fiscale. En effet, toute diminution ou suppression d'une ressource des collectivités territoriales par décision de l'État doit être compensée par celui-ci. La suppression de la part régionale de la taxe professionnelle aurait donc pour conséquence le versement d'une compensation représentative du produit de taxe professionnelle perçu par chaque région antérieurement à cette suppression. Or, celle-ci se ferait naturellement à concurrence du montant des ressources supprimées. D'où la tentation pour la région de fixer ce montant de référence au niveau le plus élevé possible. Le directeur général des collectivités locales, M. Dominique Schmitt, a estimé sans ambages le 10 mai 2005 : « il y a évidemment eu des recherches d'effets d'aubaine, s'agissant de la taxe professionnelle ». En effet, selon M. Philippe Laurent, « de nombreux directeurs financiers ont fait le raisonnement suivant : dès lors qu'une ressource risque d'être figée au niveau atteint en 2005, il est logique que les régions se pressent d'accroître leur taux afin de maximiser leur produit et partant, le montant de leur compensation ultérieure ». M. Jean-Yves Le Drian, président du conseil régional de Bretagne, a confirmé le phénomène le 15 juin 2005 : « je me suis pour ma part demandé un moment si je n'allais pas augmenter davantage la fiscalité dans le seul but de me prémunir contre les risques d'une compensation de la taxe professionnelle ». En définitive, la hausse du taux de taxe professionnelle décidée par la région Bretagne a été relativement modeste comparée à celles votées par d'autres régions - 17,4 %, mais, a-t-il ajouté, « je sais que c'est ce qu'on fait certains de mes collègues ». Cette stratégie avait d'ailleurs été menée par certaines régions à la fin des années 90, en anticipation de la décision de suppression la part régionale de la taxe d'habitation. Ainsi que l'a écrit M. Didier Migaud dans son rapport sur la loi de finances rectificative du 13 juillet 200017 : « la base retenue pour le calcul de la compensation est le produit des rôles généraux de l'année 2000. On peut d'ailleurs se demander si certaines régions, ayant anticipé cette mesure parfois évoquée dans un passé récent, n'en ont pas profité pour augmenter fortement leur taux de taxe d'habitation pour 2000, sachant que la charge effective de cette hausse serait supportée, non par les contribuables, mais par l'État ». Le Nord-Pas-de-Calais a ainsi voté un taux de taxe d'habitation en hausse de 9,3% tandis que la hausse a atteint 15,2% en Lorraine et 19% en Provence-Alpes-Côte-d'Azur. A noter qu'une seule région avait, cette année là, baissé le taux de sa taxe d'habitation de 1,76% : la région Languedoc-Roussillon. Les conceptions ont bien changé entre temps. Or, M. Georges Frêche, qui a reproché à son prédécesseur « la pérennisation d'une compensation minimale de la taxe d'habitation, dont les taux ont été systématiquement baissé les années précédant la suppression de la part régionale », a augmenté le taux de la taxe professionnelle de 79,6 % en 2005. Il n'apparaît pas impertinent de déceler un lien entre les deux. D'ailleurs, à la question de votre Rapporteur sur le fait de savoir si cette hausse ne constituait pas une stratégie d'optimisation des ressources de la région, M. Georges Frêche a répondu que « cela a été l'un des éléments de la réflexion ». De son côté, M. Thierry Camuzat, directeur général adjoint chargé des finances de la région Languedoc-Roussillon, a très clairement reconnu que « compte tenu des projets de réformes qui pèsent sur les régions s'agissant notamment de la taxe professionnelle, il a été décidé de fixer au maximum possible le taux de la taxe professionnelle et, en application de la règle de liaison des taux, celui du foncier bâti au même niveau ». De même, M. François Patriat, président du conseil régional de Bourgogne, a indiqué lors de son audition que « depuis cinq ans maintenant, la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle et de la part régionale de la taxe d'habitation a été compensée sur une base très défavorable en Bourgogne », suite à la décision de la majorité précédente de pratiquer une politique de « blocage des impôts ». De fait, n'est-il pas permis de penser que la perspective d'une suppression de la part régionale de la taxe professionnelle a pesé dans sa décision d'augmenter de 74,6% le taux de sa taxe professionnelle ? b) L'impôt de précaution et d'anticipation Les collectivités territoriales, par la voix des représentants auditionnés par votre Commission d'enquête, ont largement fait part des incertitudes entourant les modalités des transferts de compétences à venir et en particulier les compensations qui leur seront accordées au titre de ceux-ci. Aux députés qui en auraient douté, il a été abondamment rappelé que « gouverner, c'est prévoir ». M. Martin Malvy écrit ainsi, dans son mémorandum en réponse au questionnaire de la Commission d'enquête, que « la région Midi-Pyrénées est extrêmement inquiète des conséquences à venir de la loi du 13 août 2004 [...], les expériences passées en matière de décentralisation ont suffisamment instruit les élus locaux quant aux modalités de calcul des dépenses transférées et quant à l'évolution du droit à compensation qui ne prend pas en compte les rattrapages qualitatifs et quantitatifs exigés par le citoyen local ». Le rapport du président Le Drian pour le débat d'orientations budgétaires de la région Bretagne note que « le budget 2005 se prépare dans un contexte de très profonde incertitude quant aux conditions des transferts de charges et de leur compensation au titre des lois de décentralisation ». Enfin, ainsi que l'a déclaré M. Louis de Broissia, président du conseil général de la Côte d'Or, « nous abordons l'acte II de la décentralisation avec le sentiment que nous avons beaucoup donné et que la prudence s'impose », surtout s'ils pensent comme M. Georges Frêche, que « avec ce gouvernement, le pire est toujours vrai »... Les collectivités territoriales craignent donc à la fois une compensation insuffisante des compétences transférées et une forte augmentation des dépenses résultant de ces transferts dans les années à venir. Elles ont pu également craindre la réforme de la taxe professionnelle. Or, n'est-il pas possible de penser que face à cette incertitude, réelle ou supposée, certaines collectivités territoriales ont jugé nécessaire, contrairement à M. Jean-Yves Le Drian, d'augmenter leur fiscalité par précaution, ce qui fait dire à M. Philippe Laurent que « l'une de causes de l'augmentation de la fiscalité est le fait que certains fonctionnaires territoriaux et élus locaux anticipent les difficultés de façon excessive, et ce phénomène ne peut être évalué qu'une fois le mal fait ». On retrouve ici l'influence de la fonction financière au sein des collectivités territoriales, dont on a observé qu'elle était croissante pour l'arbitrage entre emprunt et fiscalité pour le financement des investissements. Pour autant, ce sont les politiques qui décident des choix, quelle que soit la façon dont ils sont conseillés. Ainsi, Mme Ségolène Royal a-t-elle déclaré lors de l'audition de l'Association des régions de France : « j'ai provisionné des dépenses à venir correspondant à toute une série de charges nouvelles qui ne seront pas compensées ». Il est d'ailleurs permis de se demander, sachant l'état d'incertitude dans lequel les collectivités territoriales disent être tenues de la part de l'État, comment elle peut être aussi catégorique. Et d'ajouter : « nous nous sommes publiquement engagés à diminuer les impôts si l'État accorde les compensations qu'il doit nous accorder ». Si l'État compense intégralement les charges qu'il transfère à la région Poitou-Charentes, comme aux autres d'ailleurs, et que celle-ci diminue ses impôts, n'est-ce pas la preuve qu'il s'agissait d'une fiscalité de précaution, la région s'étant constitué un « matelas » au détriment des contribuables ? Pour M. Brice Hortefeux : « certains exécutifs considèrent que la constitution d'une réserve leur permet de faire face à la dérive de charges transférées, présentées tout à la fois comme inévitable et inéluctable. Je ne partage pas cette inquiétude, au moins pour trois raisons : - « première raison : la progression structurelle des recettes est intrinsèquement bonne. Indépendamment des ressources fiscales, destinées à compenser en 2005 les transferts, la fiscalité en général et les dotations augmentent plus vite que l'inflation ; - « deuxième raison : le pari - que prend le Gouvernement - d'une meilleure gestion à moyen terme des compétences transférées par l'État. C'était d'ailleurs bien, en matière de RMI, l'intention du législateur, qui souhaitait responsabiliser les départements dans leurs efforts d'insertion ; - « troisième raison : il appartient aux assemblées locales et à leurs exécutifs d'afficher et d'assumer leurs choix ». On peut également se demander dans quelle mesure une telle attitude de la part d'un décideur local est réellement responsable. En tout état de cause, elle n'avait rien d'inéluctable. Ainsi que l'a déclaré M. Marcel Charmant, président - socialiste - du conseil général de la Nièvre, « le plein effet des mesures de décentralisation et de transfert n'est pas encore complètement connu et les élus de la majorité [départementale] souhaitent y voir plus clair avant de procéder à des ajustements », quand bien même il se déclare inquiet quant à la compensation de l'allocation de compensation du handicap. M. Hervé Bramy, son collègue communiste de Seine-Saint-Denis, a insisté sur le fait que : « contrairement à d'autres collectivités territoriales, nous n'avons nullement voté une hausse des impôts par anticipation des transferts de charges à venir : routes nationales, personnels des DDE, agents, techniciens et ouvriers de service des collèges - alors que ce sont entre 30 et 50 millions d'euros selon les estimations qu'il nous faudrait intégrer dans le budget 2006. Au contraire, nous avons pratiqué la plus totale transparence tant auprès de la population que de l'ensemble des conseillers généraux, qui ont bénéficié, en temps utile, de l'ensemble des éléments d'appréciation ». Enfin, M. Michel Gaudy, vice-président du conseil général de l'Hérault : « l'Hérault n'a jamais augmenté la fiscalité de manière préventive mais toujours après avoir mesuré l'impact des mesures nouvelles mises à sa charge par l'État ». Il convient d'ailleurs de souligner la promptitude des élus départementaux, de toute tendance politique, à non seulement écarter dans leur cas particulier l'application de l'impôt de précaution mais également à en rejeter l'idée. Ainsi que l'a déclaré M. Brice Hortefeux : « les départements anticipent [...] une hausse des charges liées à leurs compétences principales - RMI et personnes âgées -, mais n'ont sans doute pas constitué autant de réserves de précaution que les régions ». À cette sage modération des exécutifs départementaux fait écho le silence des régions sur cette question sauf lorsque, à l'instar de la région Poitou-Charentes, elles reconnaissent avoir voté un impôt de précaution. * * * Au-delà de la polémique propre à l'année 2005, des sources profondes de la flambée fiscale apparaissent. Votre Commission a été conduite à s'interroger sur le fonctionnement d'un système dans lequel la responsabilité fiscale ne s'exerce plus et où chaque niveau de collectivité peut se défausser sur les autres de ses choix politiques. Il s'agira dans la deuxième partie d'identifier les phénomènes structurels par lesquels le système favorise la hausse fiscale. DEUXIÈME PARTIE : CAUSES ET CONSÉQUENCES STRUCTURELLES DE LA DÉRIVE DE LA FISCALITÉ LOCALE LES CHIFFRES CLEFS DES FINANCES LOCALES Les 36 782 communes, 18 504 organismes de coopération intercommunale (dont 2 455 à fiscalité propre), 100 départements et 26 régions constituent, avec les organismes divers d'administration locale, les administrations publiques locales (APUL) au sens de la comptabilité nationale. Leurs dépenses totales se sont élevées à 163 milliards d'euros en 2003 (soit 10,5 % du PIB), dont 48 milliards d'euros au titre des dépenses de personnel (1,72 million d'agents publics travaillent pour le compte des collectivités locales). À titre de comparaison, les dépenses de l'État étaient de 355 milliards d'euros. Leurs dépenses d'investissement ont été proches de 35 milliards d'euros, à comparer avec 8 milliards d'euros seulement pour l'État. Les communes représentaient 44 % des dépenses des collectivités territoriales, l'ensemble des groupements de coopération intercommunale 22 %, les départements 24 % et les régions 9 %. Leurs recettes comprennent le produit de la fiscalité locale (soit en 2004, 21 milliards d'euros de taxe professionnelle, 18,8 milliards d'euros de taxes foncières, 10,6 milliards d'euros de taxe d'habitation et 7,5 milliards d'euros de droits d'enregistrement) et l'ensemble des transferts en provenance de l'État (le montant total de 71,5 milliards d'euros comprenant notamment 36,7 milliards d'euros au titre de la DGF et 10,4 milliards d'euros correspondant à la prise en charge d'exonérations et de dégrèvements de fiscalité locale). Le taux de prélèvements obligatoires des APUL devrait être de 5,4 points de PIB en 2005 (y compris la part prise en charge par l'État), contre 16,2 % pour l'État et 20,6 % pour la sécurité sociale. En vingt ans, depuis le début des années 1980, leurs dépenses sont passées de 8 points de PIB à près de 11 points, 1/3 de cette augmentation étant le fait de la décentralisation et 2/3 résultant de la dynamique des dépenses. En 2004, pour la première fois depuis 1993, les APUL devraient être en déficit, avec un besoin de financement de 2,2 milliards d'euros (soit 0,1 point de PIB), couvert par un recours accru à l'emprunt (la dette publique des collectivités territoriales représentait déjà 105 milliards d'euros en 2003). Tout a déjà été dit et écrit sur l'organisation du système financier local. Pour autant, il ne serait pas concevable, dans le cadre d'un rapport analysant l'évolution de la fiscalité locale, de ne pas rappeler en quoi, de manière permanente, les structures du système institutionnel et fiscal français ont des conséquences fortes sur le taux de prélèvements obligatoires. Comme le rappelle M. Brice Hortefeux, ministre délégué aux collectivités territoriales, « les collectivités territoriales pèsent d'un poids croissant dans l'économie et augmentent logiquement la pression fiscale. Sur les 25 dernières années connues - de 1978 à 2003 -, la croissance des administrations publiques locales (APUL) a été en moyenne de 6,8 % par an, supérieure donc à celle de l'ensemble des administrations publiques - 6,3 % et 5,4 % pour l'État - et à la croissance du PIB : 5,2 %. Les dépenses des administrations publiques locales représentent un peu plus de 10 % du PIB en 2003 : 10,5 %, contre 9,8 % en 1998. » Le ministre délégué aux collectivités territoriales a clairement résumé les causes de cette augmentation des dépenses locales : « l'offre des services des collectivités territoriales augmente sous l'effet des transferts de compétences, mais aussi en fonction du choix éventuel des collectivités d'accroître leur niveau de service en allant au-delà de ce que faisait l'État ou en intervenant davantage sur leurs compétences générales. Les collectivités territoriales interviennent ainsi, et de manière croissante, dans des domaines où se manifeste une demande sociale importante et où s'expriment des besoins forts et précis : l'éducation, la formation professionnelle et l'aide sociale. » Cette augmentation des dépenses a pour conséquence systémique directe la hausse de la fiscalité locale. En 2004, les collectivités territoriales ont perçu, au titre seulement des quatre taxes directes locales, un montant de 53,5 milliards d'euros : 34,9 milliards d'euros pour les communes et leurs groupements, 15,4 milliards d'euros pour les départements et 3,2 milliards d'euros pour les régions. Le ministre délégué aux collectivités territoriales a présenté la synthèse des évolutions sur longue période : « d'après les comptes de la Nation, la part des impôts revenant aux administrations publiques locales - environ 5 % du PIB - est trois fois moins élevée que celle des impôts revenant à l'État. La part cumulée de l'État et des APUL est restée globalement stable au cours de ce dernier quart de siècle ; la hausse des prélèvements obligatoires tient en fait à la très forte progression des impôts revenant aux organismes sociaux. À l'intérieur de l'ensemble État+APUL, la part de ces dernières a d'abord régulièrement progressé, accompagnant une stabilisation, puis une diminution de la part de l'État : c'est la conséquence de la décentralisation des années 1980, certains transferts de compétences ayant été compensés par des transferts d'impôts : carte grise, vignette, etc. Puis la part des APUL s'est mise à diminuer à la suite des allégements fiscaux de la période 1999-2003, l'État compensant les pertes correspondantes pour les collectivités territoriales. Les modalités de compensation des récents transferts de compétences auront [...] pour effet d'augmenter dans les années à venir la part relative des APUL au détriment de celle de l'État, par l'effet mécanique de l'autonomie financière des collectivités territoriales. » Pour prendre la mesure d'ensemble de ces évolutions des finances et de la fiscalité locales, on se reportera au graphique n° 3 présenté devant votre Commission par M. Dominique Hoorens, qui figure dans le tome III du présent rapport. Celui-ci fait les mêmes analyses que le ministère de l'Intérieur : « on entend très souvent dire que les prélèvements obligatoires augmentent. Or qu'obtient-on en rapportant au PIB la somme des prélèvements levés par l'État et par les administrations publiques locales (APUL) ? Le résultat a légèrement baissé entre 1982 et 2003, puisqu'il est passé de 22,5 % à 20,7 % : le mouvement n'est certes pas énorme mais il n'y a pas eu de dérapage global, c'est un fait, alors que la part propre aux APUL est passée, en vingt ans, de 3,5 % à 5,1 %. [...] Le pendant des prélèvements obligatoires, ce sont les dépenses. Rapportées au PIB, celles de l'État enregistrent une légère inflexion à la baisse, tandis que celles des collectivités territoriales suivent un mouvement inverse, qui fut très notable au début de la première vague de décentralisation, puis s'est stabilisé et semble actuellement connaître un regain avec le début de la deuxième vague, pour atteindre 10,2 % du PIB en 2003. [...] Toutes les données présentées sur ce graphique sont calculées par référence au PIB, ce qui signifie donc bien, s'il y a stabilité relative, qu'elles augmentent de manière réelle, d'environ 4 % par an en moyenne. » Votre Commission a souhaité aller plus loin, en tentant de quantifier les différents facteurs de hausse des impôts locaux. M. Alain Guengant, directeur de recherche au CNRS, s'est livré à cet exercice, méthodologiquement très difficile, dans une étude des Sources de croissance du taux de prélèvement obligatoire des administrations publiques locales, qui figure dans le tome III du présent rapport. Selon les résultats de cette étude, « de 1978 à 2003, l'accroissement du taux de prélèvement des APUL provient pour un premier tiers environ de la croissance des frais de personnel, pour un deuxième tiers de l'augmentation des autres dépenses de fonctionnement, hors charges transférées, et enfin pour un dernier tiers de la progression des dépenses financières et d'investissement autofinancé. Les deux autres sources potentielles de variation du taux de prélèvement se neutralisent sur la période : la hausse induite par le financement des charges transférées est compensée par la baisse due à l'effet de levier favorable des dotations [y compris compensations des dégrèvements et exonérations par l'État] et autres recettes de fonctionnement. » Ces différentes causes structurelles d'augmentation des dépenses publiques locales - et donc des impôts locaux -, qu'elles soient institutionnelles, liées aux charges des collectivités elles-mêmes et inhérentes à leur mode de financement, ont des conséquences non négligeables, tant sur les ménages que sur les entreprises, qu'il vous est proposé d'analyser à la fin de cette partie du rapport. I.- UN SYSTÈME INSTITUTIONNEL LOCAL STRUCTURELLEMENT DÉPENSIER L'organisation institutionnelle du système local français est en elle-même, intrinsèquement, cause d'augmentation des dépenses et des impôts locaux. Cet aspect structurel, lié à la multiplicité des niveaux de collectivités territoriales, s'est encore accru avec le développement de l'intercommunalité. Qui est chargé de l'action économique ? de la culture ? de la protection de l'environnement ?... Toutes les collectivités, à des degrés divers ! Chacune intervient, à son niveau, en complément d'une autre institution. Outre qu'il est difficile de se repérer dans ce maquis institutionnel, il va de soi que la multiplication des compétences exercées par les collectivités territoriales, notamment après la mise en œuvre de la décentralisation en 1982, a été source d'augmentation des dépenses. Quant à l'État, il se contente de jouer un rôle d'observateur de toutes ces évolutions, au nom de la libre administration. 1.- La multiplication des acteurs locaux L'organisation administrative locale de la France se caractérise par une superposition des niveaux administratifs et un nombre très élevé de collectivités. Depuis l'acte I de la décentralisation, il existe trois niveaux de collectivités territoriales de plein exercice : la commune, le département et la région. À ces trois niveaux s'ajoutent les structures de coopération intercommunale. Les communes et départements disposent de budgets autonomes depuis la monarchie de Juillet. La création de nouvelles institutions autonomes (les régions en 1986, les intercommunalités, les pays) entraîne inévitablement un surcoût institutionnel : il s'agit de la notion, bien connue au sens de l'article 40 de la Constitution, de charge de gestion. Les nouvelles structures, quoiqu'elles fassent, et même si elles ne font rien, ont un coût réel de fonctionnement. Dans un article intitulé À la recherche d'une théorie du système financier public complexe18, le professeur Robert Hertzog a constaté que « la multiplicité des centres de pouvoir financier, c'est-à-dire des autorités ayant la liberté de décider de dépenses, a, par elle-même, des coûts immédiats provenant des appareils managériaux qu'il faut mettre en place. Elle génère aussi des surcoûts structurels provenant de la gestion de cette complexité : l'administration de l'administration prolifère sans rien produire que du papier, des normes, des réunions et une opacité croissante. » Le système local français n'est donc pas vraiment un exemple de « jardin à la française », selon l'image du ministre délégué aux collectivités territoriales : bien au contraire, tout le monde constate, pour la déplorer mais sans oser y toucher, une certaine confusion des compétences qui conduit à des financements croisés et à des doublons institutionnels. Les principes constitutionnellement garantis de libre administration et d'autonomie financière des collectivités territoriales se traduisent ainsi en pratique par la diversité des choix des 36 782 communes (autant que dans tout le reste de l'ancienne Union européenne à quinze, des 18 504 groupements intercommunaux (syndicats et communautés), 100 départements et 26 régions, soit plus de 50 000 acteurs. Il faut encore ajouter à ce rapide panorama institutionnel les 344 pays, initiés par la DATAR depuis la fin des années 1970 et reconnus par la loi du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. Ni échelon administratif, ni collectivité territoriale, le pays est un territoire présentant une cohésion géographique, culturelle, économique et sociale, dont les communes qui le composent élaborent un projet commun de développement, notamment en matière de services de proximité. Ce projet peut donner lieu à un contrat avec l'État et la région dans le cadre du volet territorial des contrats de plan État-régions19, donc à des financements et des dépenses supplémentaires. Comme l'a dit, avec un certain sens de la litote, M. Philippe Séguin, Premier président de la Cour des comptes, lors de son audition, le 21 juin 2005, par la Commission des finances de l'Assemblée nationale sur les résultats budgétaires 2004, « on ne saurait conclure de l'évolution observée depuis les lois de 1982 à une sous-administration territoriale de la France, et quelques ajustements équitablement répartis permettraient sans aucun doute d'aboutir à une situation plus raisonnable... » Pas plus que le Premier président, votre Commission n'est cependant apte à trancher aujourd'hui ce débat institutionnel récurrent. Il lui suffira de constater en quoi le système institutionnel est cause d'évolution de la fiscalité locale. a) La course à la subvention, cause d'illisibilité du système financier local et d'irresponsabilité des élus Votre Rapporteur s'inquiète des risques de gaspillages liés aux procédures de financement partagé pour de nouveaux équipements publics, qui résultent à la fois d'un trop grand nombre d'échelons territoriaux et de l'attribution à chacun d'entre eux d'une clause de compétence générale, c'est-à-dire d'une habilitation inconditionnelle à dépenser. Trop souvent, la pression fiscale locale se trouve ainsi indûment accrue dans l'opacité, source d'irresponsabilité. La stratification des différents échelons locaux et le coût qui en résulte nuisent à l'efficacité de la dépense publique et pèsent autant sur l'usager que sur le contribuable, local et national. Le professeur Robert Hertzog a décrit cette « course à la subvention » dans son article précité, À la recherche d'une théorie du système financier public complexe : l'« émiettement extravagant des structures publiques est un puissant facteur de gaspillage par doubles emplois, chevauchements de compétences, surenchère et compétition dans la dépense. Les riches dépensent sans évaluer avec une attention suffisante l'efficacité de l'opération et les moins riches utilisent leur entregent pour chercher des co-financeurs, que le nombre d'organismes existant permet presque toujours de trouver. » Lors de son audition par votre Commission, il a également mentionné « l'effet institutionnel et bien connu d'entraînement, qui fait que la moindre décision de financement du conseil général est généralement suivie par la communauté, puis par la région : bon nombre d'opérations arrivent ainsi à bénéficier de financements publics sans rapport avec leur utilité marginale. » Il y a en effet une tradition ancestrale de partenariat des départements avec les communes. M. Michel Mercier, président du conseil général du Rhône, a indiqué devant votre Commission avoir « conservé toute [son] action en direction des 293 communes du département, de la plus petite à la plus grande. Mais le département reste aussi une collectivité territoriale de plein exercice, avec une compétence générale, même s'il a des compétences particulières dans le domaine social. » M. Adrien Zeller, président du conseil régional d'Alsace, a aussi précisé que « la plupart des départements [...] ont instauré des barèmes de taux modulés très généraux pour l'ensemble des équipements municipaux. » Ces financements constituent, pour les collectivités bénéficiaires, une ressource parfois non négligeable. M. Marc Censi, président de l'Association des communautés de France, confirme l'existence d'un tel système pour le dénoncer avec vigueur : « la multiplication des acteurs locaux et l'incohérence des politiques menées sont un vrai problème. [...] La clause de compétence générale pose problème parce que chaque niveau de collectivité veut intervenir dans tous les domaines. S'il y a une économie à faire, [...] c'est dans l'imbroglio des compétences et la concurrence entre départements et régions. Les différents niveaux de collectivités sont mis en concurrence et chacun souhaite planter son drapeau sur les opérations locales. Ce système empêche les collectivités de réaliser des montages financiers cohérents. Il y a là une véritable gabegie que personne ne veut ni dénoncer, ni mesurer. [...] Les politiques territoriales sont fondées sur la clause générale de compétence pour tous les niveaux de collectivités, et sur la totale absence de hiérarchie ou de dépendance entre chacun de ces niveaux. Chacun peut donc faire n'importe quoi et tous les élus locaux savent très bien que l'on aboutit ainsi à une pagaille noire. » M. Pierre Méhaignerie, président de la Commission des finances de l'Assemblée nationale, a même constaté que « dans les grandes entreprises françaises, on a souvent recruté des diplômés des grandes écoles d'administration afin d'obtenir plus facilement toutes les subventions possibles. Aujourd'hui, certaines collectivités recrutent des personnes chargées de préparer des dossiers afin de bénéficier de tous les " arrosoirs " financiers. [...] Il y a des investissements qui ne se feraient pas s'ils n'étaient pas financés par des subventions à hauteur de 75 %, 80 %, voire 85 %. [...] Ces « arrosoirs » impliquent à chaque fois des demandes faites en multiples exemplaires. [...] Des centres culturels [...] reçoivent ainsi sept subventions différentes. Je ne suis pas sûr que cela soit de la bonne gestion. » Votre Rapporteur souscrit pleinement à cette appréciation. Il a donc été très attentif aux propositions formulées en vue d'une clarification : mettre en place la notion de collectivité chef de file, voire instaurer un plafond de subventions. Ces pistes sont évoquées au II.- A de la troisième partie ci-après. b) Le marché politique local de la dépense publique, cause d'augmentation de la pression fiscale Le problème institutionnel posé par la multiplication des acteurs locaux est renforcé par un effet d'entraînement politique, car les institutions locales ne sont pas désincarnées comme l'administration : il s'agit d'élus, et la problématique du pouvoir se pose en permanence. Comme l'a dit très bien M. Marc Censi, le système politique local « conduit à des choses impensables car les appartenances partisanes et les enjeux de pouvoir l'emportent trop souvent sur les stratégies de développement. » Ainsi que l'a rappelé le professeur Robert Hertzog, lors de son audition par votre Commission, « la multiplication des "entrepreneurs politiques", comme disent les politologues américains, entraîne ipso facto une multiplication des projets et des initiatives, que l'on ne saurait condamner en elle-même mais qui rend d'autant plus difficile l'arbitrage global, c'est-à-dire l'équilibre entre les finances publiques et l'économie, voire la société. En effet, si on multiplie les acteurs autonomes, que l'on peut présumer rationnels en ce qui concerne l'élaboration de leurs budgets propres, on n'est plus assuré de la rationalité du système dans son ensemble. Ce problème se retrouve dans tous les systèmes financiers complexes. » En effet, comme il le précise dans son article précité, À la recherche d'une théorie du système financier public complexe, tous ces entrepreneurs politiques locaux « ont des clientèles politiques à satisfaire et ont, chacun, d'excellents arguments pour augmenter la dépense afin de satisfaire des besoins, souvent légitimes, qui leur sont exposés par leurs partenaires. » Et le professeur Hertzog de poursuivre, devant votre Commission, sur cette notion de marché politique et institutionnel de la dépense publique locale, en ce qui concerne notamment les régions. Comme il s'agit des dernières collectivités de plein exercice créées au sein du système institutionnel local, elles ont besoin « d'affirmer leur place et leur pouvoir, sachant que celui-ci, à défaut d'être normatif - contrairement à certaines de leurs homologues étrangères, nos régions ne peuvent pas influer sur les politiques des autres acteurs par des lois ou des règlements -, ne peut que reposer sur l'instrument financier. D'où le sentiment d'assister à une course vers la taille financière critique, perçue comme un élément de pouvoir. [...] Un président de région peut-il raisonnablement supporter d'être financièrement plus petit qu'un de ses départements, voire qu'une communauté urbaine ? » Ce n'est sans doute pas le président du conseil régional d'Aquitaine, et président de l'Association des régions de France, qui dira le contraire. M. Alain Rousset se livrait ainsi à cette comparaison devant votre Commission : « mon collègue Martin Malvy [président du conseil régional de Midi-Pyrénées] et moi-même nous sommes rendus à Hambourg. Le président du Land - qui compte 1,5 million d'habitants, contre 6 millions dans l'ensemble Aquitaine-Midi-Pyrénées - va consacrer 80 millions d'euros par an à l'aide à l'innovation de ses PME. Nos deux régions ensemble ne sont pas capables de consentir la moitié de cet effort. Que font les régions françaises en matière de recherche et de transferts de technologies ? Selon une étude de l'Institut de la décentralisation, par rapport aux régions américaines, l'échelle est de un à sept. » Emporté par son élan, M. Alain Rousset oublie une différence institutionnelle de taille : la France n'est pas un État fédéral. L'article 1er de la Constitution affirme seulement, depuis la loi constitutionnelle du 28 mars 2003, que « son organisation est décentralisée ». M. Georges Frêche, président du conseil régional de Languedoc-Roussillon, se définissant comme un « jacobin décentralisateur », est pour une fois beaucoup plus mesuré en la matière : « je constate que l'on ne peut comparer les deux régions [Languedoc-Roussillon et Catalogne], puisqu'à population égale, notre budget, de huit à dix fois moindre que celui de la Catalogne, est ridicule. [...] Ils ont beaucoup plus de compétences, et leur budget est bien supérieur au nôtre. Aussi ne peut-on valablement nous comparer. » Un peu de modestie ferait du bien à tout le monde, et notamment au contribuable local, qui n'en demande pas tant et se trouve être la victime toute désignée des ambitions des autres ! On relèvera ainsi le caractère un peu présomptueux du terme, si souvent utilisé, de « président de région », alors qu'il s'agit de la présidence du conseil régional. Simple commodité de langage, dira-t-on, mais elle est significative. 2.- Les conséquences de l'acte I de la décentralisation En vingt ans, les collectivités territoriales ont hérité de nombreuses compétences qui étaient auparavant du ressort de l'État. La mise en œuvre de l'acte I de la décentralisation, à partir de 1983, a eu lieu dans un cadre garantissant une compensation financière plus qu'équitable pour les collectivités territoriales. Pour autant, on ne peut objectivement que constater, aujourd'hui, un fort décalage entre les ressources initialement transférées et les dépenses réelles engagées par les collectivités. Ce décalage a bien dû être financé par une augmentation des impôts locaux. M. Alain Guengant a tenté de quantifier ces éléments dans l'étude précitée des Sources de croissance du taux de prélèvement obligatoire des administrations publiques locales, qui figure dans le tome III du présent rapport. Selon les résultats de cette étude, « le financement des compétences transférées, y compris l'aide sociale départementale avant 1983, est à l'origine de 12,99 % de la hausse du produit des impôts [directs locaux] sur la période [1979-2003], dont 10,78 % attribuable à l'évolution des dépenses et 2,21 % à un effet de levier globalement défavorable des ressources transférées (dotations et impôts). [...] Ainsi, le solde net du financement des transferts de compétences en fonctionnement serait à l'origine d'une augmentation de 3,67 % du taux de prélèvement obligatoire des APUL, soit 10,03 % du total [de cette augmentation]. L'augmentation des dépenses contribue pour 3,33 % à l'élévation de la pression fiscale, alourdissement amplifié par un effet de levier défavorable des dotations transférées (DGD), à hauteur de 1,35 %, mais réduit par un effet de levier favorable des impôts transférés de - 1,00 %. » Pourquoi en est-on arrivé là ? L'État a bien joué le jeu, seulement les collectivités territoriales ont décidé, librement, de faire plus que l'État. a) Une compensation financière rigoureuse et équitable La compensation financière des transferts de compétences intervenus entre 1983 et 2003 s'est effectuée dans le cadre déterminé par la loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État. Le législateur avait déjà posé le principe selon lequel les transferts de compétences aux collectivités territoriales devaient donner lieu à une compensation financière concomitante, intégrale, dynamique et évolutive, sous la forme de transferts de fiscalité et de dotations budgétaires. Le montant du transfert de ressources destiné à compenser, pour la collectivité nouvellement compétente, l'accroissement de charges résultant des transferts de compétences devait être équivalent au montant de la dépense réalisée par l'État l'année précédant le transfert. Le droit à compensation a été actualisé annuellement par application du taux de progression de la dotation globale de fonctionnement (DGF) et, pour les dépenses d'investissement, du taux de progression de la formation brute du capital fixe. La compensation financière qui devait couvrir ce droit à compensation a été assurée par le transfert d'impôts d'État, et pour le solde, par des crédits budgétaires évoluant annuellement. Par ailleurs, un fonds de compensation de la fiscalité transférée (FCFT) a été instauré par la loi de finances pour 1997. Il s'agit d'un compte spécial du Trésor ayant vocation à accueillir, en son sein, le montant des écrêtements opérés sur la fiscalité transférée aux collectivités territoriales, lorsque cette fiscalité est supérieure au droit à compensation. Les crédits ainsi collectés sont reversés aux collectivités territoriales dont le montant des ressources fiscales transférées ne couvre que partiellement leur droit à compensation. Dans les faits, ce fonds ne concerne que les départements. Le nombre des départements contributeurs a évolué au gré des ajustements et des réformes fiscales ; ils sont aujourd'hui trois départements dits surfiscalisés (les Alpes-Maritimes, Paris et les Hauts-de-Seine), qui supportent un prélèvement total de 142,3 millions d'euros en 2004. Les transferts de compétences aux départements ont été financièrement compensés par l'attribution de deux impôts : les droits de mutation à titre onéreux (droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière) et la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, dite vignette automobile. On peut constater que l'évolution du produit réel de la fiscalité a été sensiblement plus favorable que l'évolution de la fiscalité indexée sur le taux de la DGF. Cet accroissement du produit fiscal des départements conjugue les effets base et taux et démontre que les départements ont su tirer parti de ces transferts de fiscalité pour faire face à leurs nouvelles charges. Plusieurs aménagements fiscaux ont cependant modifié le rendement de cette fiscalité affectée : ainsi notamment la réduction, à partir de 2000, du taux du droit d'enregistrement sur les ventes d'immeubles d'habitation à 3,6 % (alors qu'auparavant il pouvait varier jusqu'à 5 %) et l'exonération de vignette, à compter de 2001, pour les personnes physiques. Bien que financièrement compensées par abondement de la dotation générale de décentralisation (DGD), ces exonérations ont néanmoins privé les départements de recettes fortement dynamiques et ont surtout contribué à dégrader substantiellement leur taux d'autonomie financière. S'agissant plus particulièrement des dépenses d'investissement, la compensation financière a pris la forme, d'une part, de concours particuliers pour les ports maritimes de pêche et de commerce ainsi que pour les bibliothèques départementales de prêts et, d'autre part, d'une dotation spécifique pour les collèges, la dotation départementale d'équipement des collèges (DDEC). Les transferts de compétences aux régions en matière de formation professionnelle ont été financièrement compensés par l'attribution de la taxe sur les certificats d'immatriculation, dite carte grise. A l'instar des départements, le solde entre le produit indexé de la carte grise et le montant du droit à compensation a été compensé par l'attribution d'une dotation budgétaire. Les transferts de compétences intervenus dans les autres secteurs ont été compensés sous forme d'une attribution de DGD. S'agissant plus particulièrement des dépenses d'investissement, la compensation financière a pris la forme d'une dotation spécifique pour les lycées, la dotation régionale d'équipement scolaire (DRES). b) Des dépenses nouvelles allant bien au-delà des charges transférées Au-delà de ces principes, comment a été vécue sur le terrain la mise en œuvre de l'acte I de la décentralisation ? Comme l'a constaté M. Dominique Schmitt, directeur général des collectivités locales lors de son audition le 10 mai 2005, « les dépenses correspondant aux transferts de compétences ont, pour les régions, connu une progression assez sensible du fait de la montée en charge de leurs nouvelles compétences. Les dépenses de formation professionnelle continue et d'apprentissage ont crû à un rythme plus rapide que les dépenses liées aux lycées - dont le volume reste cependant supérieur mais dont la progression, très soutenue jusqu'en 1992, est depuis lors devenue très faible. » Cependant, M. Alain Guengant, directeur de recherche au CNRS, a rappelé devant votre Commission que « les dépenses associées à ces nouvelles compétences ont progressé nettement plus vite que les ressources - dotations ou impôts - transférées en contrepartie. D'où un effet de ciseaux qui a commencé à apparaître, non pas en 1982-1983, mais au début des années quatre-vingt-dix, et qui s'est, par la suite, considérablement amplifié. C'est dans cette période 1990-1993 que s'est clairement manifesté dans les départements l'effet de ciseaux entre le niveau des dépenses transférées et celui des ressources accordées en contrepartie. La manière dont les collectivités ont géré les compétences transférées a été incontestablement un facteur d'augmentation. » En effet, pour le professeur Robert Hertzog, « si les transferts de charges ont été jusqu'à présent compensés d'une manière généralement très correcte, la compensation n'a toutefois pas porté sur la totalité de la dépense effective, du fait que ce transfert s'est accompagné d'un besoin de rattrapage. [...] S'agissant des compensations des transferts de compétences, la Constitution a prévu un mode de calcul simple : ce sera autant que ce que l'État dépensait. Pour objectif qu'il soit, ce critère n'est pas satisfaisant : rien ne dit que l'État dépensait à un niveau optimal. L'expérience a montré qu'il fallait faire plus pour rattraper les inégalités territoriales. » On conviendra volontiers avec M. Dominique Hoorens, directeur des études et de la documentation de Dexia Crédit Local, qu'« il est un transfert dont le résultat n'est guère contesté par les Français : celui des lycées et des collèges, lesquels sont aujourd'hui dans un bien meilleur état qu'il y a vingt ans. L'État compense en versant aux collectivités territoriales l'équivalent de ce que lui coûtaient ces équipements, partant du principe qu'il envisageait de ne pas investir davantage. Si celles-ci décident de faire davantage, elles doivent payer car il serait intellectuellement compliqué - et même déresponsabilisant - de faire rembourser l'État. » Un certain nombre d'élus locaux, responsables de collectivités, ont parfaitement assumé devant votre Commission ce choix de faire plus. Ainsi M. Charles Buttner, président du conseil général du Haut-Rhin : « pour avoir vécu de très près l'acte I de la décentralisation, notamment celle des collèges, je tiens à souligner que la part de la DGF " collèges " représente aujourd'hui moins du septième de ce que le département y consacre, et que c'est à peu près la même chose partout, mais aussi qu'il y a aussi une satisfaction générale vis-à-vis du service public assuré par les départements. [...] À mon avis, les compétences transférées devront s'accompagner de mesures d'amélioration du service public. [...] Il y a différents niveaux de service. Je me souviens du temps où les collèges étaient de la responsabilité de l'État. Les structures y étaient parfois délabrées, les équipements inexistants, notamment pour les enseignements spécialisés, et cela sans que nous puissions interpeller un quelconque responsable. Nous étions bien obligés de nous accommoder de cette situation. Depuis que, le 1er janvier 1986, les collèges lui ont été transférés, le département du Haut-Rhin a d'abord décidé, dans les deux ans, la reconstruction d'un premier collège [...] après quoi il y a eu ensuite un plan pluriannuel d'investissement. » M. Jacques Blanc, ancien président du conseil régional de Languedoc-Roussillon, a fait le même constat lors de son audition par votre Commission : « je ne reviens pas sur l'influence de la décentralisation, sauf pour dire que ce sont les modalités financières de celle de 1982 qui ont entraîné la plus forte augmentation de charges. Pour les lycées, nous avons investi, entre 1986 et 2003, 1,5 milliard d'euros, alors que l'État ne nous a transféré que 250 millions d'euros. La DRES, dans le budget 2004, était de 16 millions d'euros pour plus de 80 millions d'investissements. » Pour M. Christian Estrosi, président du conseil général des Alpes-Maritimes, « la décentralisation coûte certes de l'argent [...], mais elle fait avancer la France : il suffit de comparer l'état actuel des établissements scolaires avec celui dans lequel ils se trouvaient avant leur livraison aux départements ou aux régions. Le jeu normal de la décentralisation, c'est que l'État compense à l'euro près les compétences transférées, puis que les collectivités prennent leur propre part de responsabilité sur le plus qu'elles peuvent apporter. » Les représentants de l'État entendus par votre Commission ont exactement la même analyse que les élus locaux. Ainsi, M. Michel Thénault, préfet de la région Alsace : « la décentralisation correspond au transfert de certaines compétences, avec les ressources afférentes à l'euro près. Mais elle ne peut pas se limiter à faire faire par d'autres, elle doit faire plus, peut-être mieux que ce que l'État faisait jusque-là ; le but profond est bien de prendre en compte des besoins auxquels l'État était incapable de répondre ou entre lesquels il lui était impossible d'arbitrer. Entre un lycée à Brive-la-Gaillarde et un autre à Molsheim, soit il n'en faisait aucun, soit il décidait lequel... Aujourd'hui, les deux sont faits. La satisfaction du besoin de service local a été nettement améliorée ; reconnaissons pourtant que la DGD était loin d'être à la hauteur... Malgré cela, aucun lycée en France n'est en ruine ; c'est donc bien la preuve que la décentralisation a permis de répondre à un besoin exprimé. » Les collectivités territoriales s'engagent ainsi désormais bien au-delà de ce que l'État faisait sur les compétences transférées ; elles doivent évidemment y consacrer des crédits supplémentaires, pris sur leur propre budget. On peut reprendre un exemple, exposé par M. Michel Thénault, préfet de la région Alsace : « lorsqu'elle décide d'investir sur un lycée, la région y installera le panneau solaire le plus approprié, la chaufferie au bois si possible, bref, tout un équipement 30 % plus cher, mais très performant, ce que jamais l'État n'aurait fait, sauf à récupérer une subvention de la région... ». M. Gérald Chaix, recteur de l'académie de Strasbourg, résume bien ce phénomène : « ce que fait la région ne peut pas, en l'occurrence, se comparer à ce que fait l'État, dans la mesure où elle ne se substitue pas à lui, mais traite le problème d'une autre façon. » L'exemple donné ne me semble pas être une juste approche : on dépense plus ; gérer autrement ne signifie pas pour autant occasionner plus de dépenses. Il est loisible aux collectivités d'être plus efficientes, c'est-à-dire de fournir des services à moindres coûts. Pour retracer l'esprit de la décentralisation, M. Alain Rousset, président de l'Association des régions de France, a estimé que « le service public a été amélioré, car la décentralisation, cela sert à l'amélioration du service rendu. » Pour autant, une amélioration du service rendu implique souvent une dépense, et donc un choix budgétaire de financement. La décentralisation ne peut pas être un alibi pour qu'une collectivité dise être obligée d'augmenter les impôts : c'est elle qui décide de le faire. Mais tout n'est pas possible, ni tout de suite, ni à 120 % : comme le soulignait à juste titre M. Adrien Zeller, président du conseil régional d'Alsace, « les régions sont contraintes de faire des choix. Pour sa part, l'Alsace a décidé d'étaler légèrement son programme de modernisation des lycées, qui se réalisera sur huit ans au lieu de six. » Faire ces choix, étaler ces dépenses nouvelles, aurait permis de limiter la pression fiscale induite par la mise en œuvre de l'acte I de la décentralisation. Il n'est pas certain que, dans l'enthousiasme des débuts, les différentes collectivités concernées aient voulu le faire, même en Alsace ! Les relations entre l'État et les collectivités territoriales ont été fondamentalement modifiées par la mise en œuvre de l'acte I de la décentralisation. Depuis 1982 en effet, la tutelle de l'État sur les différentes collectivités a été remplacée par un contrôle a posteriori de la légalité des actes des collectivités, et le pouvoir exécutif a été transféré aux présidents des conseils généraux et régionaux. Après le traumatisme vécu parfois au sein de ce qui s'appelait encore les services extérieurs de l'État, de nouveaux liens ont dû se créer. Il n'est cependant pas certain que l'équilibre actuel entre services de l'État et collectivités territoriales soit optimal en termes de régulation systémique, faute de vision stratégique globale sur les moyens d'assurer une régulation du système, tout en respectant l'autonomie de chacun. a) Une multiplicité de services de l'État en relation avec les collectivités territoriales Les collectivités territoriales sont certes très nombreuses, mais les services de l'État qui sont en relation avec elles ne le sont guère moins, ce qui ne facilite pas nécessairement une bonne coordination. L'échelon de base est toujours constitué par le préfet, seul titulaire de l'autorité de l'État sur le territoire qu'il administre. Il est localement le chef de l'ensemble des services déconcentrés de l'État. En plus de son rôle de garant du respect des lois, il a auprès des collectivités territoriales un rôle de conseil et de soutien. On peut d'ailleurs s'interroger sur la nature exacte de ce rôle qui peut aller jusqu'à une forme de cogestion avec le conseil général, organisant parfois une sorte de hiérarchie des collectivités territoriales. Il joue également un rôle important dans les relations contractuelles, accords et conventions qu'il établit au nom de l'État avec les collectivités locales. À ce titre notamment, il a un rôle central de négociateur des contrats de plans qui sont passés entre l'État et les régions. Le préfet n'exerce plus ni tutelle, ni contrôle d'opportunité, ni contrôle a priori sur les actes des collectivités territoriales. Le contrôle de légalité est désormais fondé sur trois principes : les actes des collectivités territoriales sont immédiatement exécutoires dès qu'ils ont été publiés ou notifiés ; le contrôle s'exerce a posteriori et ne porte que sur la légalité des actes, et non pas sur leur opportunité ; le représentant de l'État défère les actes qu'il estime illégaux au juge administratif, seul en mesure d'en prononcer l'annulation s'il y a lieu. Il porte sur un champ si large, au regard des moyens mobilisables, qu'un responsable important du corps préfectoral le qualifiait de « fausse monnaie ». Au niveau de l'administration centrale, les choses sont beaucoup plus complexes. Le ministère de rattachement des préfets, à savoir le ministère de l'intérieur, est bien évidemment le « tuteur » des collectivités. En son sein, la direction générale des collectivités locales (DGCL) a pour mission de définir les règles de fonctionnement et d'organisation des collectivités territoriales et de leurs groupements, de répartir les principaux concours financiers de l'État aux collectivités locales et de collecter et diffuser les données financières et statistiques relatives aux collectivités territoriales. La DGCL assure également le secrétariat de différents organismes de concertation comme le Comité des finances locales ou le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. Pour assurer un suivi des finances et de la fiscalité locales, la DGCL analyse les données provenant des budgets primitifs et des comptes administratifs. Ces données lui permettent de suivre les dépenses (prévues, puis réelles) correspondant à l'exercice des compétences transférées, ainsi que la recette correspondante. Elles figurent dans des publications statistiques, notamment le rapport annuel de l'Observatoire des finances locales, émanation du Comité des finances locales, présenté traditionnellement à la fin du mois de juin et destiné à faciliter la préparation du projet de loi de finances, pour les aspects touchant aux finances locales.. Les données statistiques tirées des budgets primitifs de l'année n sont diffusées entre juin et novembre de cette même année. Elles permettent d'appréhender les grandes tendances de l'évolution des finances locales, avec un certain retard donc. Les données statistiques tirées des comptes administratifs de l'année n sont diffusées en n+2 : en janvier pour les régions, mars pour les groupements de communes, juin pour les communes de plus de 10 000 habitants et août pour les départements. L'analyse des comptes des communes de moins de 10 000 habitants, très lourde du fait de leur nombre, est traditionnellement disponible à l'automne n+2. L'analyse de la fiscalité locale est conduite en trois temps : en juin, des éléments complets sur l'évolution des bases de fiscalité directe, ainsi que sur les taux pratiqués par les grandes collectivités ; en septembre ou octobre, une analyse complétée par les données portant sur le vote des taux des communes et de l'ensemble des EPCI à fiscalité propre ; au début de n+1, une publication détaillée sur les bases, taux, produits des quatre taxes locales et de la TEOM, par région, département, taille de commune et type d'intercommunalité d'appartenance. Le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie procède de son côté, avec son propre réseau (impôts, trésorerie), aux mêmes types d'analyses. La direction de la législation fiscale élabore les règles s'appliquant en matière de fiscalité locale. La sous-direction des finances publiques au sein de la Direction générale du Trésor et de la politique économique, en coordination avec la Direction du budget pour la synthèse, conduit les travaux concernant l'équation des finances publiques, les tendances d'impôt ou de déficit, qui concernent les collectivités territoriales. Elle évalue le compte des administrations publiques locales qui est notifié à l'Union européenne deux fois par an, début mars et début septembre. Elle s'appuie pour cela sur les échantillons et les analyses des budgets locaux qui ont été réalisés par la Direction générale de la comptabilité publique, dont la cinquième sous-direction suit spécifiquement le secteur public local. Elle analyse les comptes de gestion transmis par les comptables publics et publie des brochures d'information ; avec son soutien, l'ensemble des comptables publics jouent un rôle d'information et de conseil en matière de fiscalité directe locale envers les collectivités territoriales puisque, depuis le 1er janvier 2005, ils récupèrent auprès de la direction générale des impôts les informations relatives aux bases d'impôts locaux et les transmettent aux collectivités, en pouvant réaliser des simulations et des analyses financières individualisées. Enfin, la direction générale de l'INSEE élabore, a posteriori, les comptes nationaux. Les administrations publiques locales au sens de la comptabilité nationale En comptabilité nationale, le sous-secteur des administrations publiques locales (APUL) comprend les collectivités locales et les organismes divers d'administration locale (ODAL). Les comptes des APUL présentent des résultats différents de ceux qui sont obtenus pour les collectivités territoriales en termes de comptabilité publique (comptes de gestion ou comptes administratifs). Aux collectivités territoriales au sens constitutionnel du terme - à savoir les communes, départements et régions -, on adjoint l'ensemble des structures de coopération intercommunale pour constituer les collectivités locales. Cependant, certains syndicats (SIVU ou SIVOM) et régies sont classées dans la catégorie des sociétés non financières lorsque le produit de leurs ventes couvre plus de 50 % de leurs coûts de production. L'autre ensemble des APUL est constitué par les organismes divers d'administration locale (ODAL), lequel regroupe les autres établissements publics locaux (CCAS, caisses des écoles, SDIS), les établissements publics locaux d'enseignement, certains établissements publics nationaux (agences de l'eau, organismes consulaires, SAFER, STIF) et les écoles privées sous contrat. L'établissement du compte des APUL s'effectue par consolidation des mouvements entre collectivités : par exemple, les subventions que versent les régions aux communes sont neutralisées, alors qu'en comptabilité publique les flux financiers sont maintenus en dépenses des régions et en recettes des communes. De même, en comptabilité nationale, les mouvements de dette (emprunts nouveaux et remboursements de dette ancienne) ne sont pas retracés, alors qu'ils représentent une part élevée des budgets locaux (environ 10 % des recettes totales). Ce panorama rapide des services de l'État concernés par les collectivités territoriales complète le panorama institutionnel des collectivités elles-mêmes. Il n'est guère plus brillant : trop de services interviennent, les collectivités territoriales ont trop d'interlocuteurs, et ces relations complexes nuisent à une vision d'ensemble du système. Il s'agit bien évidemment d'une des causes du manque de régulation systémique : personne n'est en mesure d'assurer une ligne de conduite, car il n'y a pas de lieu de synthèse. b) Pas de pilote dans l'avion ! Les enjeux pour l'État des finances locales peuvent s'observer au travers du prisme du budget de l'État. En effet, le niveau élevé des concours financiers de l'État aux collectivités territoriales (ils représentent 20 % du budget) et leur progression rapide (supérieure en volume à la progression des dépenses de l'État) justifieraient un minimum de pilotage par l'État des finances locales, en tout cas de sa contribution à celles-ci. Il s'agirait notamment d'assurer la cohérence entre les finances locales et l'ensemble des finances publiques, et même plus largement l'économie quand on discute globalement de pression fiscale. Pour cela, une connaissance précise de la dynamique et des équilibres financiers internes des collectivités territoriales sont des préalables indispensables. L'État, en tant que contribuable local, et au-delà du strict exercice de compensation, assure globalement une part substantielle du financement des collectivités territoriales. Celle-ci peut-elle l'inciter à influer sur l'évolution des finances locales ? Le principe d'autonomie des collectivités territoriales le lui interdit-il ? M. Dominique Schmitt, directeur général des collectivités locales, est très clair : « nous sommes régis par le principe de libre administration des collectivités territoriales ; la DGCL n'a absolument aucun rôle de régulation. [...] Nous ne pouvons jouer que sur un élément : l'évolution des dotations aux collectivités territoriales. C'est le seul que l'État contrôle. [...] En l'absence de normes législatives sur la dépense, nous n'avons de moyens d'action potentiels que sur les dotations. Tout le reste relève de la libre administration des collectivités territoriales. Tout au plus pourrions-nous éventuellement jouer sur les règles de liens fiscaux entre les différentes taxes [et sur les dégrèvements,] mais nos marges sont très réduites. [Il n'y a] aucune réflexion structurée dans le cadre d'un objectif de régulation globale. » M. Brice Hortefeux, ministre délégué aux collectivités territoriales, répond encore plus brutalement : « l'État ne pilote pas les budgets locaux. [...] L'État fixe, en relation avec le Parlement, les montants des dotations et les règles de la fiscalité. N'attendez pas de l'État qu'il devienne un pilote qu'il entend ne pas être et qu'il ne veut plus être. » Il faut quand même bien mesurer l'ampleur des compensations financières versées par l'État en contrepartie des allégements d'impôt, sous forme soit de dégrèvements, soit de compensations d'exonération. Ainsi que l'a rappelé M. Alain Guengant, directeur de recherche au CNRS, lors de son audition par votre Commission, « si les concours de l'État aux collectivités territoriales ont considérablement augmenté dans les années quatre-vingt-dix, cette augmentation est uniquement imputable à l'accumulation des compensations venues en contrepartie des allégements des impôts locaux. [...] La question se pose de savoir comment ont été financées ces compensations. N'ont-elles pas contribué à creuser le déficit du budget de l'État ? » Pour le professeur Robert Hertzog, « notre système souffre d'un manque et peut-être d'une hypocrisie : un manque de régulateur, l'État ne jouant plus ce rôle, cependant que l'hypocrisie consiste à dire qu'il n'y a pas de régulateur dans le système local lui-même ; et comme il n'y a pas de hiérarchie entre régions, départements et communes, tout le monde peut faire la même chose. Peut-on raisonnablement tenir dans un système sans normes de gestion plus ou moins autoritairement fixées par l'État - le Gouvernement, mais le Parlement a lui aussi un certain pouvoir en la matière -, ni véritable procédure de concertation ? » Même vis-à-vis de l'extérieur, les collectivités territoriales peuvent prendre des positions inverses de celles, officielles, du gouvernement français. Ainsi, en ce qui concerne les négociations sur les perspectives financières 2007-2013 pour le budget de l'Union européenne, alors que la France demande, avec cinq autres pays contributeurs nets, la limitation de sa contribution au budget communautaire à 1 % de son revenu national brut (RNB), l'association des régions de France a fait savoir à la Commission européenne qu'elle soutient sa position, à savoir une participation à hauteur de 1,24 % du RNB, car elle espère ainsi disposer de plus de crédits, au titre des fonds structurels, pour les régions françaises. M. Marc Censi, président de l'Association des communautés de France, a aussi demandé, lors du congrès 2005 de l'Association pour la fondation des pays, que « si le budget européen est ramené à 1 % du PIB, comme le demande la France, contre 1,24 %, alors l'État devra redistribuer aux collectivités le manque à gagner. » Tout cela ne paraît guère sérieux et ne contribue pas à rationaliser le fonctionnement du système local français. Il y a bien, semble-t-il, un problème institutionnel qui dépasse le seul cadre des collectivités territoriales. Le Parlement et le Gouvernement, qui comptent bien des élus locaux, ne pourraient-ils plus aujourd'hui jouer leur rôle de directoire et de conseil de surveillance de la maison France ? B.- L'IMPACT DE L'INTERCOMMUNALITÉ La loi d'orientation relative à l'administration territoriale de la République du 6 février 1992 et celle du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, dite « loi Chevènement », ont lancé en France un mouvement de coopération intercommunale de grande ampleur. Face à la permanence d'un découpage communal émietté à l'extrême, la promotion de l'intercommunalité, en favorisant la mise en commun des moyens, devait permettre au secteur communal de fournir les services locaux à un meilleur niveau pour un moindre coût et renforcer la solidarité financière entre communes. Aujourd'hui, la couverture du territoire français par les structures intercommunales est en passe d'être achevée. Au 1er janvier 2005, 32 311 communes, rassemblant 52,2 millions d'habitants (84 % de la population), sont réunies au sein de 2 525 groupements. Le succès de l'intercommunalité est le résultat d'une politique d'incitation financière active menée par les pouvoirs publics. Il est aussi la conséquence d'un choix majeur de politique économique : l'attribution désormais automatique aux EPCI du pouvoir de lever l'impôt local. Cette autonomie fiscale intercommunale a suscité un débat public qui n'a pas encore été clairement tranché. En effet, alors que certains attendaient de la coopération intercommunale une réduction de la pression fiscale du secteur public communal (communes et intercommunalités), par le biais d'économies d'échelle résultant de la mise en commun des compétences communales, d'autres défendent désormais le point de vue contraire : la coopération intercommunale serait un facteur significatif d'augmentation des taux d'impôts locaux en France. Cependant, force est de constater que, passés les constats statistiques sommaires et les jugements plus ou moins intuitifs, l'évaluation de l'une des principales politiques publiques menées au sein du secteur local fait défaut. Dans le cadre de ses investigations sur les causes de l'évolution de la fiscalité locale, votre Commission d'enquête a souhaité contribuer à une clarification du débat sur l'impact de l'intercommunalité sur les finances locales, sans remettre en cause le bien-fondé et les avantages à attendre de la coopération intercommunale. 1.- Une inflation fiscale indiscutable a) L'impact de l'intercommunalité sur la dépense : l'incomplète substitution entre dépense communale et dépense intercommunale Selon la DGCL (Les finances des groupements de communes à fiscalité propre, 2003), les dépenses réalisées par les groupements de communes à fiscalité propre ont été multipliées par 3,9 entre 1993 et 2003, pour atteindre 22,9 milliards d'euros, soit 22,3 % du total du budget « communes + groupements », contre 8 % en 1993. 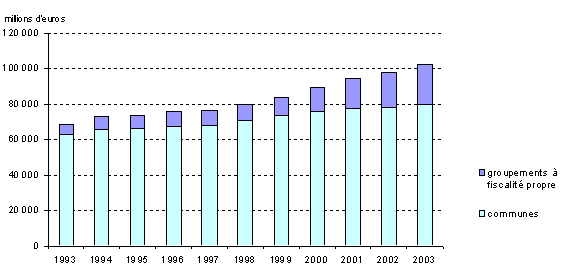 Audition du Directeur général des collectivités locales - 25 mai 2005 Audition du directeur général des collectivités locales - 25 mai 2005 Dépenses totales des communes Le graphique suivant retrace l'évolution comparative du budget des communes et de celui de l'ensemble des groupements de communes à fiscalité propre. 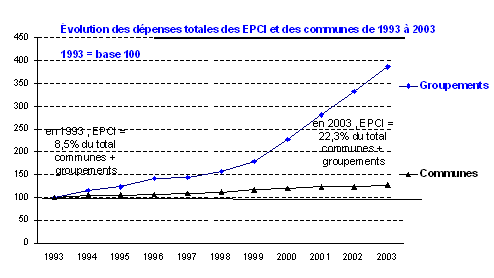 La forte croissance des dépenses des groupements à fiscalité propre observée depuis 2000 s'explique par la création des communautés d'agglomération et le passage à la taxe professionnelle unique (TPU) de nombreux groupements existants. La transformation de groupements en communautés d'agglomération, dotés de moyens plus importants et de compétences plus nombreuses, relance sensiblement l'activité de ces groupements. Cependant, le graphique montre clairement que l'accélération de l'accroissement des dépenses des groupements n'a pas été compensée par une diminution de celles des communes. La montée en puissance des intercommunalités ne s'est donc pas accompagnée d'un « effet de vases communicants » entre les deux niveaux d'administration. La DGCL fait généralement valoir que le volume budgétaire par habitant des communes membres d'EPCI à fiscalité propre est inférieur à celui des communes isolées. Ainsi, pour les communes de plus de 10 000 habitants de métropole en 2002, le volume budgétaire atteint 1 695 euros par habitant pour les communes n'appartenant pas à un groupement à fiscalité propre. Il est inférieur de 36 % pour les communes appartenant à une communauté urbaine 4 taxes et de 21 % pour les communes appartenant à une communauté de communes à TPU. Pour les communes de moins de 10 000 habitants en 2001, la tendance est identique. Celles appartenant à une communauté de communes 4 taxes présentent des budgets inférieurs de 20 % environ à ceux des communes n'appartenant à aucun groupement à fiscalité propre. 20 Cependant, dans une étude publiée en 2004 21, les professeurs Mathieu Leprince et Alain Guengant montrent que l'augmentation de la dépense intercommunale conduit, toutes choses étant égales par ailleurs, c'est-à-dire après neutralisation de l'influence des multiples facteurs explicatifs de la dépense communale, à une faible réduction voire à une augmentation de la dépense communale. Le graphique ci-joint met en évidence une rupture nette dans la progression des dépenses des communes à partir de 1992, rupture qui correspond à l'essor de l'intercommunalité. Le graphique montre que, sans l'intercommunalité, la progression des dépenses des communes aurait été beaucoup plus forte, puisqu'elle aurait suivi la tendance observée de 1975 à 1992, indiquée en pointillé. En revanche, il apparaît clairement que l'essor de l'intercommunalité s'accompagne d'un accroissement de la croissance tendancielle des dépenses cumulées des communes et des groupements. 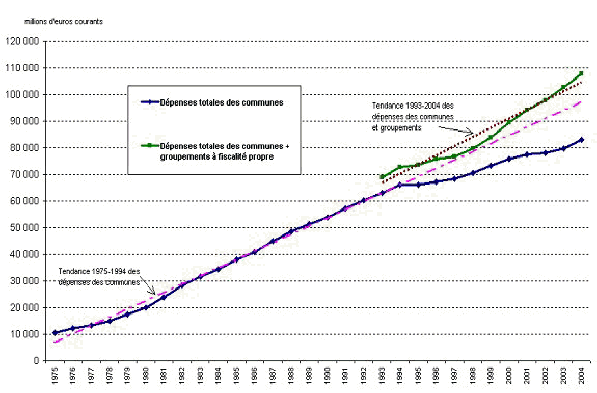 b) L'impact de l'intercommunalité sur la pression fiscale cumulée des communes et des intercommunalités L'essor de l'intercommunalité transforme en profondeur la répartition des recettes fiscales entre collectivités. En 1993, la fiscalité directe des groupements de communes représentait moins de 10 % de la fiscalité de l'ensemble du secteur communal. En 2003, c'est presque 30 % d'impôts qui sont prélevés directement par l'intercommunalité à fiscalité propre. Quant à son impact sur les taux cumulés de pression fiscale, si son évaluation n'est pas évidente, les études montrent clairement aujourd'hui que le développement de l'intercommunalité s'accompagne d'un alourdissement du fardeau fiscal. · Le développement de l'intercommunalité à fiscalité additionnelle s'est accompagné d'un alourdissement du poids des impôts locaux Le Conseil des impôts, dans son rapport de 1997 consacré à la taxe professionnelle, puis la Chambre régionale des comptes de Midi-Pyrénées, dans une enquête de 1998, ont tenté de montrer que le développement de la coopération intercommunale à fiscalité additionnelle n'a pas permis une maîtrise de la pression fiscale locale, alors qu'au contraire, la coopération intercommunale à TPU serait plus propice au maintien des taux d'impôts locaux. La méthode utilisée se bornait à identifier l'existence de taux d'impôts locaux cumulés, dans les communes membres d'un groupement à fiscalité propre, supérieurs aux taux d'impôts votés par les communes isolées. Or, l'évaluation des effets potentiels de l'intercommunalité sur les taux d'impôts locaux doit être menée en prenant en compte simultanément l'ensemble des déterminants potentiels de ces taux. Un premier travail rigoureux d'évaluation mené sur un échantillon représentatif de communes et de groupements à fiscalité additionnelle sur l'année 1997 a cependant permis de valider cette hypothèse22. L'analyse économétrique confirme que la pression fiscale communale est peu sensible aux variations de la pression fiscale intercommunale et ne diminue pas suffisamment pour compenser l'augmentation intercommunale. Il s'ensuit que la pression fiscale cumulée, communale et intercommunale, augmente quand l'intercommunalité à fiscalité additionnelle se développe. Toutes choses égales par ailleurs, les estimations économétriques indiquent qu'en moyenne, une hausse de 10 % du taux d'impôt intercommunal réduit de 1 % seulement le taux d'impôt communal voire même l'augmente dans les petites communes. C'est donc désormais un fait acquis : le développement de l'intercommunalité à fiscalité additionnelle s'est accompagné d'un alourdissement du poids des impôts locaux. · Les effets de la TPU sur la pression fiscale ne pourront être évalués que dans la durée Lors de son audition du 25 mai dernier, M. Dominique Schmitt, Directeur général des collectivités locales (DGCL) a indiqué que « si l'on essaie de voir ce que tout cela donne en termes de fiscalité, on constate que la pression fiscale des EPCI est restée relativement stable dans le temps. En particulier, la TPU ne semble pas être un facteur d'inflation fiscale. Les taux sont calculés automatiquement pour la première année d'exercice et ils sont par la suite rarement et peu relevés, même quand la possibilité est offerte par l'évolution du taux d'imposition « ménages » des communes. » Pour affirmer que « la TPU n'est pas un facteur d'inflation fiscale », la DGCL, dans un document intitulé Les finances des groupements de communes à fiscalité propre, 2003, s'appuie sur le tableau suivant qui récapitule les taux d'imposition à la taxe professionnelle observés chaque année sur chaque catégorie d'EPCI. 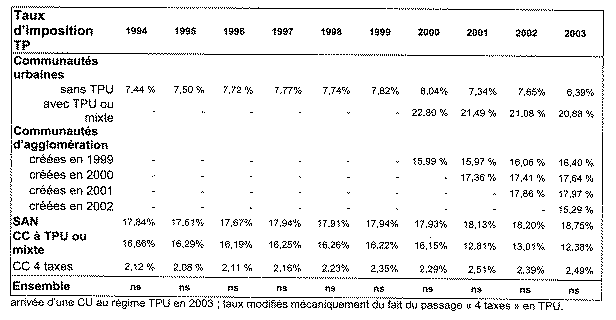 Cependant, le tableau ci-après montre que les taux de taxe professionnelle sont plus élevés dans les EPCI à TPU. DES TAUX SUPÉRIEURS DANS LES EPCI À TAXE PROFESSIONNELLE UNIQUE
Le tableau suivant distingue les modalités de fixation du taux de taxe professionnelle par les communes et groupements de communes disposant de ce pouvoir. MODALITÉS DE FIXATION DES TAUX DE TAXE PROFESSIONNELLE 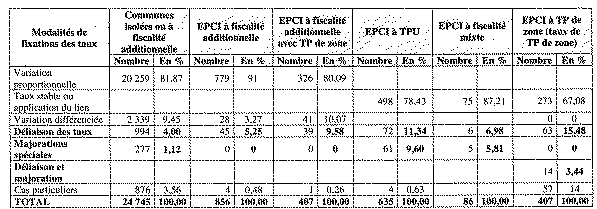 N.B. : La colonne « EPCI à fiscalité additionnelle avec TP de zone » vise les modalités de fixation du taux de TP additionnelle. Source : DGCL. Certes, une étude de la DGCL sur l'utilisation par 134 communautés à TPU de leurs facultés d'augmentation des taux de taxe professionnelle montre que les communautés qui avaient en 2003 la possibilité d'augmenter leur taux ne l'ont pas saisie systématiquement (dans moins d'un cas sur deux), néanmoins, le tableau qui précède montre que l'utilisation des dispositions dérogatoires aux règles de liaison entre les taux est liée à la spécialisation de l'impôt : 5,12 % des communes isolées ou en EPCI à fiscalité additionnelle ont mis en œuvre un dispositif dérogatoire, contre 20,94 % des EPCI à TPU sans fiscalité mixte. Un travail récent d'évaluation des effets de l'intercommunalité à TPU 23 suggère d'ailleurs que l'adoption par les groupements de la TPU ne modifie pas les tendances récentes d'évolution des dépenses locales et des taux d'imposition cumulés. Comme dans le cas de la fiscalité additionnelle, les comportements budgétaires des communes ne semblent pas tels que, en TPU, les dépenses locales se stabilisent. Cependant, il convient de nuancer ce résultat dans la mesure où nous manquons du recul nécessaire pour évaluer les effets de la TPU. L'étude précitée indique que « le résultat pourrait provenir de la nature dynamique de la TPU fondée sur le partage, non pas du montant, mais de la croissance de la taxe professionnelle entre le groupement et les communes membres. En conséquence les effets de la TPU n'apparaissent pas immédiatement mais s'accumulent graduellement dans le temps. Or, la création de la TPU est récente et seule la loi Chevènement de 1999 a réellement stimulé son développement. En d'autres termes, le changement serait encore trop récent pour déceler l'influence spécifique de la TPU sur les comportements de demande du bien communal. » · L'intercommunalité semble avoir entraîné une inflation de la fiscalité affectée M. Jean-Philippe Vachia, président de la Chambre régionale des comptes de Midi-Pyrénées, lors de son audition du 25 mai 2005 a souligné, à juste titre, les limites des statistiques nationales : « lorsque nous parlons de la pression fiscale des intercommunalités, deux précisions méthodologiques doivent rester présentes à notre esprit. La première est qu'il faut considérer l'évolution cumulée des impôts communaux et communautaires, que l'on soit en TPU ou en fiscalité additionnelle. La seconde, et c'est une manière de critique que nous faisons aux données statistiques nationales, est qu'il faut, afin de mesurer le poids financier réel de l'intercommunalité, considérer tous les services publics, c'est-à-dire tous les budgets annexes, la fiscalité spécialisée et les financements affectés : la taxe - et accessoirement la redevance - d'enlèvement des ordures ménagères, la redevance d'assainissement, le prix de l'eau, le versement transport. Si l'on prend tout cela en compte, force est de constater une tendance générale, que l'on pouvait déjà percevoir en 2003 et qui devrait s'accentuer dans les années à venir, à l'accroissement de la pression fiscale globale sur le contribuable-usager. » Le Directeur général de collectivités locales a d'ailleurs fait remarquer que « l'augmentation de la fiscalité directe est bien plus importante si l'on prend en compte la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Non seulement l'instauration de cette taxe et sa prise en charge par les groupements s'est développée dans le temps, mais la recette a progressé rapidement. ». Le tableau ci-après montre que, pour l'ensemble des structures de coopération intercommunale à fiscalité propre, cette taxe représentait 325 millions d'euros en 1995 (15 % du total) et qu'elle a atteint en 2003, 1 827 millions d'euros en 2003 sur un total prélevé de 3 675 millions, soit la moitié de la TEOM totale. ÉVOLUTION DU PRODUIT DE TEOM DE 1995 À 2003 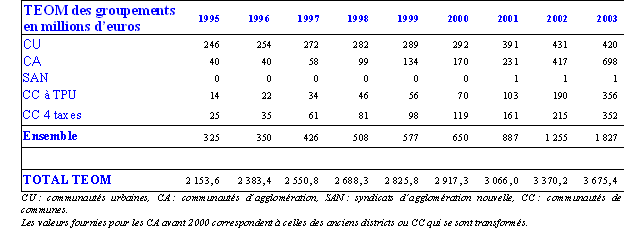 Audition du directeur général des collectivités locales-25 mai 2005 · La tentation croissante de recourir à la fiscalité mixte Si le recours à la fiscalité mixte reste marginal, M. Charles-Éric Lemaignen, Vice-président de l'ADCF chargé des affaires financières et fiscales et Président de la communauté d'agglomération d'Orléans Val-de-Loire, a indiqué, au cours de l'audition du 6 avril dernier, qu'un nombre croissant de groupements s'interroge sur l'opportunité de pratiquer une fiscalité mixte. « Très peu encore ont franchi le pas : 97 communautés de communes, 7 communautés d'agglomération, 4 communautés urbaines, parfois en se contentant de voter le principe sans voter de taux. C'est seulement une possibilité qu'elles se réservent. Mais le débat sur l'opportunité de passer à la fiscalité mixte devient récurrent dans certaines communautés. » En conclusion, l'argument de la neutralité de la coopération intercommunale sur les taux d'impôts locaux ne peut plus être utilisé. Cependant, en l'absence d'indicateurs de la qualité du service rendu, il n'est pas possible de quantifier la part de la croissance des dépenses dans le cadre intercommunal qui est due à l'amélioration du service et celle qui résulte de l'accroissement des coûts lié à l'empilement des structures et à l'existence de doublons. L'analyse de l'impact de l'intercommunalité ne peut dès lors qu'être partielle. a) L'intercommunalité élargit l'éventail des services publics proposés aux usagers. · D'une part, la montée en puissance des EPCI allège bien les dépenses communales mais les communes refusent d'être marginalisées sur le plan budgétaire. Elles maintiennent leurs ressources constantes pour redéployer leur action vers l'amélioration de la qualité des services publics restés de la compétence communale, ou par l'offre de nouveaux services publics non fournis en l'absence de coopération. M. Pascal Buchet, rapporteur général de la commission des finances et de la fiscalité locale de l'AMF et maire de Fontenay-aux-Roses, entendu le 3 mai 2005, a expliqué que, « si les charges transférées ne se traduisent pas toujours par une diminution des dépenses des communes, c'est que ces dernières utilisent trop souvent l'intercommunalité comme palliatif à la diminution de leurs marges de manœuvre, pour se décharger de certaines dépenses. C'est dommage car cela peut aller contre l'intérêt des intercommunalités. Je dois cependant dire que, maire depuis onze ans, je constate que les marges de manœuvre des communes ne cessent de se restreindre et que les capacités de choix des élus sont amputées. La tentation de se tourner vers l'intercommunalité pour élargir ses marges de manœuvre est donc tout à fait humaine. » Au cours de la même audition, M. Jacques Pélissard, Président de l'AMF, a pourtant souligné à juste titre que « l'intercommunalité n'a pas vocation à être une mise sous perfusion financière de communes exsangues. » · D'autre part, « le fait de se regrouper permet à des communes d'émerger à un niveau d'ambition qu'aucune n'aurait pu atteindre isolément » ainsi que l'a expliqué M. Marc Censi, président de l'ADCF, auditionné le 6 avril 2005. La coopération intercommunale offre en effet aux communes, souvent trop petites ou trop pauvres pour agir seules, un levier pour financer certains équipements et services importants, notamment sportifs ou culturels. À titre d'exemple, M. Georges Frêche, Président de la communauté d'agglomération de Montpellier, a indiqué que celle-ci mettait en place « un réseau de piscines et de médiathèques dans toutes les communes aux alentours de Montpellier, qu'elles étaient incapables de se payer. » Dans la mesure où le service public offert dans le cadre intercommunal n'était pas offert antérieurement par les communes isolées, la création d'un groupement ne peut pas induire une substitution entre la dépense communale et la dépense intercommunale et donc a fortiori une baisse du taux cumulé d'imposition. M. Jean-Philippe Vachia, chargé de coordonner une enquête conduite par la Cour des comptes et les chambres régionales des comptes sur l'intercommunalité, a expliqué, le 25 mai dernier, que les juridictions financières avaient « recherché des exemples d'économies d'échelle, de services améliorés, de mutualisation » : « Nous avons trouvé des exemples de réussites en la matière. Mais il y a une limite, liée au fait que la réorganisation des services au plan communautaire se traduit la plupart du temps par une amélioration de ces derniers et donc par des hausses de fiscalité. Par exemple, les habitants des communes se situant à la périphérie des communes centres bénéficient le plus souvent d'une mutation qualitative et quantitative du service de ramassage des ordures ménagères mais, parallèlement, ils subissent une augmentation de la fiscalité spécialisée, qui ne s'accompagne pas forcément d'une diminution corrélative de la fiscalité généraliste. Au final, le service est meilleur mais le coût est plus élevé. » C'est ce qui explique l'explosion de la TEOM dans le cadre intercommunal. Il convient cependant de souligner que les dépenses liées à l'amélioration de la qualité du service peuvent résulter de choix délibérés mais aussi de l'imposition de normes techniques plus sévères, notamment en matière de traitement des ordures ménagères. M. Jacques Pélissard, Président de l'Association des maires de France (AMF) a estimé que « les intercommunalités, du fait de la masse géographique et des capacités financières qu'elles représentent, sont (...) mieux à même de répondre à des besoins nouveaux exprimés par des population et cela peut amener à une plus grande intensité des investissements, mais ceux-ci sont légitimes dans la mesure où ils répondent à des attentes des populations. » « Le risque », comme l'a indiqué M. Alain Pichon, Président de la 4ème chambre de la Cour des comptes, le 25 mai dernier, « est que l'intercommunalité, qui est une structure beaucoup plus importante, souhaite se doter d'équipements plus volumineux, qui peuvent être disproportionnés, non pas au regard des exigences de la commune-centre, mais par rapport aux besoins et aux attentes des petites communes périphériques. À cet égard, la taille relative des communes membres est déterminante. Dans le cas d'une intercommunalité qui comprend une commune centre de 200 000 habitants, entourée de plusieurs communes de 50 000 ou 60 000 habitants, le système est beaucoup plus équilibré que si la commune centre compte 800 000 habitants et la deuxième commune la plus peuplée 20 000 seulement. » Plus une collectivité est peuplée, plus la gamme de services publics qu'elle offre est importante. L'intensité de l'effet d'accroissement global du niveau de service public induit par l'intercommunalité augmente donc avec la taille démographique du groupement. En zone rurale, l'effet serait faible, puisque les groupements restent en général trop petits pour fournir de grands équipements publics de proximité. Par conséquent, les taux cumulés augmentent davantage dans les petites communes appartenant aux grands EPCI. b) La gestion à deux niveaux, au lieu de favoriser l'apparition d'économies d'échelle, s'accompagne le plus souvent de doublons et d'une augmentation des coûts de structure administrative et de production des services M. Alain Guengant, directeur de recherche au CNRS, auditionné par votre Commission le 8 mars 2005, constate dans le surcroît de dépenses lié à l'intercommunalité « une déperdition non négligeable sous forme de charges de structure au niveau communautaire. Certains affirment que le bonus de DGF accordé par l'État, qui a fait le succès de la « loi Chevènement », a été pour moitié absorbé par des charges de structure supplémentaires. » · Ces charges de structure sont d'abord des charges de personnel. Dans une note fournie à votre Rapporteur, la Direction générale du trésor et de la politique économique (DGTPE) indique que la croissance de la masse salariale des collectivités territoriales s'est accélérée sur la période 1999-2004, passant de +4,6 % entre 1992 et 1998 à +5,7 % par an en moyenne entre 1999 et 2004 et que la moitié de cette accélération s'explique par le développement de l'intercommunalité et la mise en place de la réduction du temps de travail. Le développement de l'intercommunalité, qui s'est traduit par des transferts de personnels des communes aux groupements mais également par la création de nouveaux postes, aurait contribué au tiers de la progression de la masse salariale entre 1999 et 2004. M. Alain Pichon, entendu par votre Commission le 25 mai 2005 a constaté « une augmentation globale des effectifs et des dépenses consolidées de personnel. On constate en effet qu'il y eu un transfert a minima de personnels des communes membres vers la communauté et un recrutement de nouveaux personnels par cette dernière, ce qui peut se justifier par le fait qu'elle a justement été créée pour faire ce que ne faisaient pas les communes séparément, mais cela a forcément un coût. » Complétant ces observations, M. Jean-Philippe Vachia a fait remarquer que « la plupart des communautés urbaines ou d'agglomération récemment constituées, organismes nouveaux souhaitant s'affirmer, préfèrent souvent, plutôt que de « faire leur marché » en ressources humaines parmi le personnel des communes membres, recruter de nouveaux agents plus jeunes et plus qualifiés, en laissant les communes membres réaffecter les leurs à d'autres tâches, voire attendre qu'ils partent à la retraite, ce qui sera le cas d'un grand nombre d'entre eux d'ici cinq à dix ans. C'est plutôt cette stratégie qui a été choisie. Mais à l'arrivée, le coût additionnel n'est pas négligeable. » Au 1er janvier 2004, plus de 114 300 agents territoriaux, tous statuts confondus, ont été recensés dans les EPCI à fiscalité propre. Cet effectif moyen varie fortement selon le type de communauté : de 20 agents pour les communautés de communes à 246 pour les communautés d'agglomération et à 2204 pour les communautés urbaines. Près des trois quarts des agents sont titulaires de la fonction publique territoriale. Globalement, on observe un taux d'encadrement de niveaux A et B supérieur dans les communautés comparé à celui des collectivités territoriales. Il s'agit, respectivement de 11,4 % (niveau A) et de 15,1 % (niveau B) dans les EPCI, pour 8 % et 13 % dans l'ensemble des collectivités. Dans les communautés d'agglomération, ce taux d'encadrement est renforcé, puisqu'il est de 14 % pour les agents de catégorie A et de 16,5 % pour les agents de catégorie B 24. M. Pascal Buchet, rapporteur général de la commission des finances et de la fiscalité locale de l'AMF et maire de Fontenay-aux-Roses, entendu le 3 mai 2005, a expliqué que l'intercommunalité entraîne un alignement vers le haut des régimes statutaires et indemnitaires des personnels transférés à la communauté : « Quand des compétences sont transférées (...) et que des personnels basculent dans une intercommunalité, il y a un phénomène d'alignement par le haut : il y aura par exemple une généralisation des titularisations (...) au détriment des emplois aidés. L'opération a donc des répercussions financières mais se solde aussi par un bénéfice en termes de qualité de service. » LA « SPIRALE INFLATIONNISTE » DU TRANSFERT DES PERSONNELS « Le législateur a tenu à assurer un minimum de garanties aux agents transférés. La première de ces garanties concerne les avantages acquis prévus au 3ème alinéa de l'article 111 de la loi du 26 février 1984. L'article 64 de la loi du 12 juillet 1999 permet à l'organe délibérant de l'EPCI de maintenir à titre individuel aux agents issus des communes membres de l'EPCI les avantages collectivement acquis dont ils bénéficiaient. En effet, ces avantages ne peuvent plus être institués depuis l'entrée en vigueur de la loi de 1984, ce qui signifie qu'un agent qui quitte une collectivité qui avait instauré un tel avantage pour en rejoindre une autre qui n'a pas instauré le même, en perd automatiquement le bénéfice. Or, la plupart des EPCI à fiscalité propre (hormis les communautés urbaines de la première génération et les communautés issues des premiers districts) ont été créées après la loi de janvier 1984 et n'ont pu instaurer de tels avantages. L'article 64 de la loi Chevènement du 12 juillet 1999 visait donc à limiter l'effet dissuasif d'une mutation des agents communaux vers un EPCI. Le maintien des avantages acquis n'est nullement une obligation, simplement une faculté : c'est à l'organe délibérant de l'EPCI d'en décider. Autre disposition, plus impérative celle-là, la loi du 27 février 2002 prévoit expressément que les agents transférés conservent le bénéfice du régime indemnitaire de la commune lorsqu'il leur était plus favorable. (...) Le régime indemnitaire a été essentiellement employé dans les communautés pour compenser les inégalités générées entre les agents en raison du maintien des avantages acquis à ceux qui pouvaient y avoir droit. Il s'agit par exemple de compenser le treizième mois que certains n'avaient pas, par un niveau de primes mensuel plus élevé (...). Le transfert de personnel a donc un coût. Les avantages acquis, s'ils peuvent ne pas être maintenus puisque la loi Chevènement ne faisant de leur maintien qu'une simple faculté, il est rare de les voir supprimés lors du transfert. L'éventuelle compensation salariale par le régime indemnitaire pour les agents qui ne disposaient pas d'avantages acquis crée une dépense nouvelle à la charge de la communauté (qui ne peut être déduite de l'attribution de compensation). Il en va de même pour la nécessaire harmonisation des régimes indemnitaires des agents qui proviennent de communes différentes, et qui disposent de régimes indemnitaires différents. Cette harmonisation a le plus souvent été réalisée à la hausse, c'est-à-dire en reprenant le régime le plus favorable et en le généralisant à l'ensemble des agents. » · Aux dépenses de personnel, il convient d'ajouter les dépenses « somptuaires » des structures intercommunales : dépenses de locaux, de communication, indemnités des élus etc. Il s'agit globalement des dépenses engendrées par le « train de vie » des intercommunalités avec certains abus qu'il n'est pas possible de quantifier. Au cours de l'audition du 25 mai dernier, le Directeur général des collectivités locales a estimé qu'il avait pu « y avoir, çà et là, des abus » tout en précisant que « ce n'est certainement pas l'explication première de l'évolution des dépenses des communes et de l'intercommunalité. » M. Charles-Éric Lemaignen, au cours de l'audition du 6 avril dernier, a par ailleurs rappelé que « même si l'impact est assez dérisoire dans le budget, certaines communautés ont (...) eu une politique consistant à attribuer à chaque commune un vice-président, ce qui a pu entraîner ça et là une augmentation assez forte de l'effectif du bureau. » · Les redondances dans les structures administratives et l'exercice des compétences ont pu entraîner d'importants surcoûts. Il convient de rappeler que l'intercommunalité est fondée sur les principes de spécialité et d'exclusivité, ce qui suppose que les communes et les EPCI constituent deux niveaux de structures distincts, administrativement et fonctionnellement autonomes, où chacun exerce de son côté ses compétences avec ses propres moyens. Ces principes répondent au souci de ne pas voir l'apparition d'un nouvel échelon d'administration locale venir compliquer un paysage où les acteurs sont déjà nombreux et les chevauchements de compétence fréquents. Toutefois, ce système, satisfaisant pour l'esprit, s'est heurté aux réalités complexes du terrain où l'intervention conjointe des communes et de leurs EPCI est souvent légitime dans un domaine donné. Ainsi de la voirie, mais aussi de bien d'autres qui relèvent tant des équipements (structures culturelles et sportives...) que de l'animation (tourisme, action économique...). Il apparaît clairement aujourd'hui qu'un cloisonnement trop strict peut nuire à la cohérence de l'action locale et entraîner un dédoublement coûteux des services. Pour prendre en compte cette réalité, un premier assouplissement aux principes de spécialité et d'exclusivité a été introduit par la loi Chevènement en 1999 avec l'introduction de la notion d'intérêt communautaire. Celui-ci permet aux communes (ou au conseil communautaire dans le cas des communautés d'agglomération) de tracer une ligne de partage, au sein d'une même compétence, entre la partie de la compétence que l'on souhaite exercer au niveau de la communauté et celle que l'on désire au contraire conserver dans le champ d'action des communes. Cependant l'insuffisante définition de la notion d'intérêt communautaire a pu elle-même entraîner des redondances. M. Jean-Philippe Vachia a indiqué, au cours de l'audition précitée, que les juridictions des comptes ont observé « des cas d'intercommunalités dans lesquels l'intérêt communautaire a été insuffisamment défini, ce qui entraîne des doublons entre les projets des communes et ceux de la communauté. » Dans le souci de pousser à la définition de l'intérêt communautaire, la loi relative aux libertés et responsabilités locales a imposé un délai, soit 1 an à compter de la publication de la loi pour les EPCI existants, porté à 2 ans pour les nouveaux transferts de compétences. À défaut de définition dans ces délais, l'intégralité des compétences considérées est transférée à l'EPCI. Ces dispositions permettront de concrétiser la clarification des responsabilités entre l'EPCI et ses communes membres. La mutualisation peut être un outil efficace pour éviter le dédoublement des services. De nombreuses communautés se sont engagées avec leurs communes membres dans des démarches de mutualisation. Ces dernières peuvent être informelles : une communauté assiste ponctuellement ses communes membres ou inversement. La mutualisation peut aller jusqu'à la fusion des services d'une ou de plusieurs communes avec ceux de la communauté. Depuis 1972, la ville de Strasbourg n'a plus de services propres, ceux de la communauté urbaine étant affectés aux compétences communales et intercommunales. La loi du 13 août 2004 offre également un cadre juridique assoupli et rénové aux « services communs » ou « services partagés ». Les conditions de partage de services sont assouplies : communes et EPCI peuvent mettre à disposition leurs services (auparavant seuls les EPCI y étaient autorisés) dans un souci de bonne organisation. La loi consacre la possibilité de conclure des conventions entre les communautés de communes et leurs communes membres. Ces conventions portent sur la création ou la gestion de services ou d'équipements. Elles complètent les dispositions relatives au partage de services et répondent aux mêmes objectifs. M. Charles-Éric Lemaignen, au cours de l'audition précitée, a estimé que ces dispositions étaient de nature à limiter les doublons et partant les dépenses inutiles, « car si la communauté ne peut pas s'adresser facilement aux services communaux, elle créera ses propres services techniques d'agglomération, qui feront double emploi. » M. Jacques Pélissard, Président de l'AMF, a indiqué, au cours de l'audition du 3 mai 2005, qu'« après une période de balbutiement où la tentation naturelle a été d'organiser des doublons entre administrations intercommunales et municipales, une série de dispositions, avalisées par l'ensemble du bureau de l'AMF, ont été intégrées à la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, constituant son fameux titre IX : des outils existent désormais pour mettre sur pied des services partagés entre, d'une part, la communauté de communes ou la communauté d'agglomération et, d'autre part, les communes membres, notamment la ville centre, avec la possibilité de considérer les services rendus comme des prestations in-house, échappant au code des marchés publics. Nous croyons que cette novation juridique sur l'organisation de services partagés va permettre de mettre fin aux situations de doublons entre les administrations communautaires et les administrations municipales. Nous avons déjà pu le constater dans de nombreux cas. Cette administration commune, transversale des services entre communes membres (notamment la ville-centre) et intercommunalités a permis de réaliser des économies et limite le risque d'inflation fiscale. » · Enfin, M. Robert Hertzog, professeur à l'université de Strasbourg III, entendu le 8 mars dernier a expliqué qu'« il existe également des causes « institutionnelles » [d'augmentation de la fiscalité locale] dont on ne parle guère. La prolifération de nouvelles institutions entraîne deux sortes de charges supplémentaires. Non seulement la création d'une nouvelle entité provoque inévitablement, au moins dans un premier temps, un surcoût institutionnel assez facilement mesurable, quand bien même la nouvelle communauté peut utiliser en partie les moyens des communes existantes, mais surtout, la multiplication des « entrepreneurs politiques », comme disent les politologues américains, entraîne ipso facto une multiplication des projets et des initiatives, que l'on ne saurait condamner en elle-même mais qui rend d'autant plus difficile l'arbitrage global (...). » « À l'effet institutionnel d'entraînement (...) », a précisé M. Robert Hertzog, « est venu s'ajouter un effet politique, mais également de système, lié au besoin pour [les nouvelles institutions ] d'affirmer leur place et leur pouvoir, sachant que celui-ci, à défaut d'être normatif - contrairement à certaines de leurs homologues étrangères, nos régions ne peuvent pas influer sur les politiques des autres acteurs par des lois ou des règlements -, ne peut que reposer sur l'instrument financier. D'où le sentiment d'assister à une course vers la taille financière critique, perçue comme un élément de pouvoir. » Face à de tels comportements d'affirmation des groupements, les communes membres souhaitent, pour leur part, se donner les moyens de continuer d'« exister » en gardant, malgré les transferts vers l'intercommunalité, « une taille financière critique », ce qui entraîne un effet d'accumulation de la dépense. « Si l'intercommunalité crée des doublons de charges », c'est aussi parce que « dans la pratique, chaque commune conserve des antennes dans toutes les compétences, y compris celles qui ont été transférées, ce qui ne permet pas de concrétiser les économies d'échelle. », ainsi que l'a expliqué M. Michel Klopfer, consultant, à votre commission le 15 mars 2005. c) Le paysage de l'intercommunalité est encore trop compliqué Le Directeur général des collectivités locales, M. Dominique Schmitt, au cours de son audition du 25 mai, a indiqué que, parallèlement à la montée en charge de l'intercommunalité, « le dispositif s'est aussi considérablement simplifié : on compte 14 communautés urbaines, 162 communautés d'agglomération, 2 443 communautés de communes, les six syndicats d'agglomération nouvelle qui continuent à exister ayant vocation à intégrer des communautés d'agglomération. (...) Parallèlement au développement des EPCI fiscalité propre, [le nombre de SIVOM] a chuté de 2 472 en 1992 à environ 1 500 en 2005. La constitution des intercommunalités a permis de supprimer un certain nombre de SIVOM, leurs dépenses globales passant en dix ans de 2 231 millions de francs à 1 447 millions de francs. Cette réduction est perceptible aussi bien sur le fonctionnement que sur l'investissement (...). »
Audition du directeur général des collectivités locales - 25 mai 2005 Le diagramme précédent permet cependant de constater que la diminution des dépenses des SIVOM s'est ralentie entre 1999 et 2002. Au cours de la même audition, M. Dominique Schmitt a par ailleurs indiqué que la diminution du nombre de SIVU (qui est passé de 14 885 en 1999 à 13 500 en 2005) « a été moins marquée car le périmètre de la plupart d'entre eux était contraint par leur vocation spécifique, qu'il s'agisse du transport scolaire, de l'aménagement de berges ou de l'adduction d'eau. Il ne leur était donc pas facile de se fondre dans des EPCI dont les périmètres n'étaient pas nécessairement les mêmes. » Pour sa part, la Cour des comptes « a dû constater l'insuffisance de la simplification du paysage intercommunal », ainsi que l'a indiqué M. Jean-Philippe Vachia, Président de la Chambre régionale des comptes de Midi-Pyrénées au cours de l'audition du 25 mai dernier : « Tout d'abord, nous avons vérifié très attentivement si, dans tous les cas prévus par la loi, les syndicats ont bien été dissous, ou absorbés par les communautés. Dans l'ensemble, cela a été fait mais pas toujours de manière évidente. En effet, on constate souvent que des communautés de communes ont pris, par exemple, les compétences A, B, C, D, E et F, tandis qu'un syndicat intercommunal, SIVU ou SIVOM, conservait les compétences G et H, qui peuvent être des compétences assez voisines de celles de la communauté de communes, mais qui diffèrent en droit des compétences de la communauté de communes. Une myriade de SIVU et de SIVOM a ainsi été maintenue avec des compétences assez ténues. » M. Jean-Philippe Vachia a rappelé que « lorsqu'une communauté de communes se crée à partir d'un syndicat mais que certaines communes membres du syndicat ne sont pas membres de la communauté, le syndicat, par définition, survit, sous la forme d'un syndicat mixte. Nous assistons donc au développement de syndicats mixtes de différents types. Il peut y avoir de très gros syndicats mixtes au niveau des grandes agglomérations pour gérer le PDU ou le SCOT. Il y a également des syndicats mixtes de taille plus réduite, notamment en zone rurale. Certains sont des syndicats mixtes de syndicats mixtes, alors même que la création de telles structures est interdite par la loi et la jurisprudence. Nous en avons recensé un certain nombre. Ces syndicats mixtes de syndicats mixtes n'ont pas été créés ex nihilo, mais sont devenus des syndicats mixtes de second degré par l'effet du mécanisme de représentation-substitution. » « S'agissant de la création de syndicats mixtes, » a précisé M. Alain Pichon au cours de la même audition, « elle résulte souvent du fait que le périmètre des intercommunalités ne coïncidait pas avec l'histoire, ou avec les lois de la physique. Par exemple, l'histoire a pu faire qu'un réseau de transports urbains ne coïncide pas avec le périmètre d'une communauté. Dans ce cas, à moins de casser les lignes d'autobus, il faut créer en dehors de la communauté un syndicat mixte qui permette d'englober le périmètre du réseau de transports. S'agissant du service de l'eau et de l'assainissement, une intercommunalité peut être à cheval sur deux bassins versants. Il faut donc créer une structure supplémentaire pour gérer ce service dont le périmètre est déterminé par les lois de la physique. Il y a donc souvent un problème d'adéquation entre le périmètre de l'intercommunalité et l'héritage du passé ou les nécessités de la physique. » Notons que le périmètre cohérent de l'intercommunalité peut aussi ne pas coïncider avec « les lois de la politique ». M. Jean-Pierre Gorges a expliqué que « chez [lui], autour de la communauté d'agglomération qui est réduite à l'espace urbain, il y a trois communautés de communes qui se sont montées de manière défensive, parce que la couleur politique de l'agglomération n'était pas la même. On en arrive donc à des rapprochements fondés sur des critères de personnalité, au prix d'une multiplication des structures et des effectifs. » EXTRAIT DU RAPPORT D'OBSERVATIONS DÉFINITIVES N° 046/701 DU 31 DÉCEMBRE 2004 DE LA CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES DE LANGUEDOC-ROUSSILLON RELATIF AU SIVOM « La Communauté de communes du Pic Saint Loup a été créée par arrêté préfectoral du 7 novembre 2002. La plaquette de présentation de cette dernière, éditée en juin 1999, précisait que les compétences du SIVOM du Pic Saint Loup seraient « à terme transférées dans la communauté de communes. (...) Toutefois, dès à présent force est de constater qu'à défaut de la disparition à terme du syndicat, on assiste plutôt à une superposition de structures qui semble devoir se pérenniser (...). Le chevauchement des périmètres des 2 entités implique la transformation du SIVOM en syndicat mixte ainsi que la substitution de la communauté de communes à ses communes membres au sein du même syndicat. (...) Les deux entités continueront à coexister, le Syndicat n'étant toutefois doté que de compétences limitées. En réponse aux constats provisoires de la Chambre, qui relevait une coexistence du syndicat et de la Communauté dans plusieurs domaines de compétences, le Président du Syndicat a fait valoir la volonté affichée par les élus des deux entités « de transférer le plus de compétences possibles vers la communauté de communes ». (...) Il convient toutefois de remarquer que le SIVOM n'est pas appelé à se dégager de compétences (débroussaillage, balayeuses) qui ne concernent que certaines communes et ne peuvent, selon le Président du SIVOM être fiscalisées sur l'ensemble des contribuables. Interrogé dans le cadre de la procédure, le Préfet de l'Hérault a estimé qu'il paraîtrait logique que le Syndicat laisse place à la Communauté de communes même s'il est à craindre qu'il ne disparaisse pas du fait de l'intérêt, pour les élus, de pouvoir profiter de la plus grande souplesse qu'offre le syndicat par rapport à la communauté de communes pour le financement de certaines compétences. En effet, il est possible de moduler la participation financière des communes selon une clé de répartition, ce qui ne peut être le cas au niveau de la communauté de communes dont l'exercice des compétences est financé par la fiscalité. » Enfin, il convient de mentionner le problème posé par l'intercommunalité « d'aubaine ». Selon M. Jean-Philippe Vachia, il existe un certain nombre de « communautés de communes à qui l'on pourrait reprocher de n'être que des structures par trop ténues, des SIVOM rebaptisés « communautés de communes », avec un intérêt communautaire très limité. (...) Sans vouloir « épingler » des communautés en particulier, il y en a un certain nombre qui, principalement parce que l'intérêt communautaire n'a pas été défini ou l'a mal été, n'exercent pas les compétences qu'elles devraient exercer. D'autres, qui ont défini l'intérêt communautaire, n'exercent leurs compétences qu'a minima, sur le papier, en consacrant des années à élaborer des plans ou des projets sans passer aux réalisations. Il y a là un opportunisme financier ou fiscal certain. C'est le cas notamment des communautés de communes à TPU qui ont, sur le papier, les compétences nécessaires à l'obtention de la bonification de DGF, mais qui ne les exercent pas réellement. L'une d'elles a ainsi été sanctionnée par le retrait de cette bonification. » d) En fiscalité additionnelle, l'augmentation du niveau cumulé d'imposition pourrait résulter de la nature même du régime de coopération Le régime de la fiscalité additionnelle lui-même pourrait être l'un des facteurs de l'alourdissement des taux d'impôts locaux dans la mesure où il offre un environnement institutionnel et financier propice à des comportements de « défense » par les communes de leur poids budgétaire. En effet, avec le régime de la fiscalité additionnelle, aucune obligation légale de coordination des politiques fiscales communales et intercommunales n'est imposée. Les décisions de dépense des deux niveaux de gestion sont déconnectées, sans lien juridique contraignant. Le lien politique créé par la désignation des délégués communautaires par les conseils municipaux ne suffit manifestement pas à freiner l'accumulation de dépenses. e) Si la TPU a été conçue dans l'objectif de limiter l'inflation fiscale, sa complexité suscite de nombreuses interrogations quant à ses effets · La politique publique d'incitation au choix de la TPU postulait que ce régime fiscal constituait un dispositif de nature à garantir une forte substitution entre dépenses communales et communautaires, susceptible de contrer ou du moins d'atténuer fortement les tendances inflationnistes de la fiscalité additionnelle. Les organismes ayant opté pour la TPU reçoivent le total du produit de la taxe professionnelle prélevée sur le territoire communal et doivent en redistribuer à leurs communes membres la part non utilisée pour le financement des compétences transférées sous forme d'une attribution de compensation, montant calculé au moment du passage à la TPU. La TPU opère donc, via le calcul de l'attribution de compensation, une réduction des ressources communales en proportion du montant des dépenses transférées. Ainsi, le passage en TPU est neutre au plan budgétaire pour les communes, à condition évidemment que les charges transférées aient fait l'objet d'une juste évaluation. Le régime de la TPU est également conçu pour assurer une coordination contraignante des politiques fiscales des deux échelons superposés. L'adoption de la TPU suppose le plafonnement du premier taux voté par la communauté à hauteur de la moyenne des derniers taux votés par les communes. Enfin, les années suivantes, le taux d'imposition sur les entreprises voté par la communauté est lié à la moyenne des taux « ménages » votés par les communes. · Il s'ensuit que le système de la TPU est complexe et suscite de ce fait certaines interrogations quant à ses effets Entendu le 8 mars dernier, M. Alain Guengant, professeur à l'Université de Rennes I, expliquait à votre Commission que « la taxe professionnelle unique, en créant un rapport d'interdépendance très étroit entre communes et communauté, pose un problème de régulation du système. La TPU est certainement le système de fiscalité et de finances le plus complexe que l'on ait jamais construit, qu'il s'agisse de l'attribution de compensation, de la dotation de solidarité communautaire (DSC), des effets de transferts de charges, sans même parler de l'évaluation des charges transférées : si le législateur, par la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, a jugé nécessaire d'en réformer les critères, c'est bien qu'elle posait problème... » Dans un article intitulé « intercommunalité, une fiscalité maîtrisée ? »25 Matthieu Leprince rappelle qu'en TPU, les communes et la communauté font face à une succession de choix imbriqués dont la logique est la suivante : « Dans un premier temps, les communes arbitrent entre les différents types de communautés accessibles en fonction de leurs caractéristiques. Elles décident ainsi du régime juridique de coopération, donc notamment des compétences obligatoires et optionnelles à exercer en commun. C'est l'ensemble du projet communautaire qui se dessine dès cette étape. Dans un deuxième temps, la communauté à TPU constituée et les compétences choisies, la communauté doit procéder à un arbitrage spécifique au régime de la TPU : elle doit choisir le degré d'intégration du groupement. Autrement dit, elle doit décider dans quelle proportion des ressources disponibles (recettes fiscales et dotations de l'Etat principalement, moins l'attribution de compensation versée obligatoirement aux communes) sont affectées, soit à la production de services publics communautaires, soit au reversement de ces fonds vers les communes. C'est à ce stade qu'interviennent la définition de l'intérêt communautaire et la procédure d'évaluation du coût des dépenses transférées par les communes au groupement qui sont deux éléments centraux de la « mécanique » financière de la TPU qui est enclenchée. Dans un troisième temps, la communauté doit choisir la nature et les critères de reversement des fonds affectés aux communes. Elle doit alors décider de la nature plus ou moins redistributive de sa politique, notamment des critères de la dotation de solidarité communautaire (DSC), instrument central de mise en œuvre de cette solidarité. Mais des lois récentes ouvrent la voie à d'autres mécanismes d'aide communautaire aux communes notamment à travers le versement de fonds de concours dont l'intensité péréquatrice peut également varier. » Les évolutions constatées résultent de comportements propres à chaque groupement en matière d'évaluation des transferts de charges, de coordination plus ou moins étroite entre communes et communauté ou entre ville centre et communes périphériques, et en matière de définition de l'intérêt communautaire. Plus largement, c'est la qualité de la gouvernance des communautés qui détermine le succès de l'intercommunalité à TPU. Les auditions menées par votre Commission ont montré que certaines configurations en TPU recèlent des risques d'inflation fiscale ou de difficultés financières. ● L'imbrication étroite entre choix communaux et intercommunaux en matière de vote des taux pourrait avoir certains effets inflationnistes M. Charles-Éric Lemaignen, au cours de l'audition précitée, a indiqué qu'il avait « pu y avoir des pressions de certaines communes qui, lorsqu'elles ont augmenté leur fiscalité ménages, ont souhaité que l'agglomération profite de l'augmentation possible du taux de taxe professionnelle pour augmenter la DSC. Quantifier les conséquences de ce type de comportement, nous en sommes incapables, mais la tentation existe. Ont-elles résisté ? C'est difficile à mesurer. Dans ma communauté, des maires, ayant augmenté le taux de leurs impôts ménages, ont exigé que la communauté d'agglomération augmente le taux de la TPU. Nous ne l'avons pas fait. Ce raisonnement n'est pas illogique. » Au cours de la même audition, le président Augustin Bonrepaux relevait à juste titre que « quand vous avez un projet ou un service d'utilité locale, il vous faut des moyens. Et si vous voulez des moyens, il faut augmenter les impôts locaux. Et quand vous n'avez que la TPU, il faut augmenter la TPU. Vous êtes donc obligé de demander aux communes membres d'augmenter leurs impôts ménages pour pouvoir mener à bien votre projet. N'y a-t-il pas là une incitation à l'augmentation fiscale ? Si nous voulons être objectifs, il faudra faire état de tout cela dans notre rapport. » « Le fait que la taxe foncière sur les propriétés bâties permette également d'imposer les entreprises au niveau communal n'est pas étranger à sa montée en puissance dans les communes en TPU dont l'allocation de compensation est gelée », ainsi que l'explique M. Yves Fréville, sénateur d'Ille-et-Vilaine, dans un article publié dans la revue Pouvoirs Locaux26. M. Alain Guengant, au cours de l'audition précitée a indiqué que la plupart des collectivités pratiquent explicitement un arbitrage « qui consiste à jouer de la variation différenciée introduite par la loi de 1980 pour reporter les hausses de fiscalité directe sur les propriétaires en ménageant les occupants de logements. L'effet de ce report pratiquement systématique peut s'amplifier ponctuellement, en particulier dans les communes industrielles membres de communautés à taxe professionnelle unique, qui peuvent être tentées de se reconstituer une mini-taxe professionnelle à partir de la taxe foncière sur les propriétés bâties, dont le taux peut littéralement exploser lorsque 80 %, voire 90 % des bases sont des bases entreprises. » · Une mauvaise évaluation des charges communales transférées pourrait entraîner à terme des difficultés financières et un dérapage de la pression fiscale « Nous avons le sentiment que les différents transferts ne sont pas achevés » a expliqué M. Jean Philippe Vachia au cours de l'audition du 25 mai dernier. « Sur le papier, les intercommunalités ont toutes les compétences requises par leur statut, mais il est fréquent que l'intérêt communautaire ne soit pas défini, ou le soit insuffisamment, ce qui a un effet direct sur les transferts de charges, et donc d'actifs et de passifs. Dans les communautés à TPU, la recherche du consensus local a pu passer par l'adoption de stratégies qui n'étaient pas à l'avantage de la communauté, ce qui a eu pour effet de minimiser les charges qui lui étaient transférées. (...) Il est des cas où les charges transférées à la communauté ont été largement sous-estimées au départ, ce qui a conduit à surévaluer l'attribution de compensation reversée aux communes.(...) Ce phénomène peut avoir, à terme, des effets fâcheux. » « Quels sont les scénarios à risques ? » a déclaré M. Alain Pichon, au cours de la même audition. « Le cas, par exemple, d'une intercommunalité bâtie par regroupement de communes petites et moyennes, et où l'intercommunalité, notamment à TPU, a surtout fonctionné, les premières années, comme une sorte de pompe aspirante et refoulante, privilégiant l'aspect redistributif par rapport aux projets ou aux services intercommunaux. Cela peut s'expliquer par le fait qu'il faut se donner du temps pour monter des projets, pour définir l'intérêt communautaire. Mais avec le passage en TPU et les effets d'aubaine qui l'accompagnent, on a souvent cherché à rassurer toutes les communes membres, en redistribuant au maximum, l'intercommunalité conservant en fait très peu de moyens. Si des habitudes de ce type se prennent, le jour où il y aura un gros projet intercommunal à financer, soit le groupement se verra contraint de réduire la redistribution en faveur des communes pour garder plus d'argent au niveau intercommunal, soit il y aura un vrai risque de difficultés financières si la redistribution n'est pas ajustée à la baisse et qu'il faut néanmoins financer le projet. » « Mise à part une certaine communauté urbaine dont vous comprendrez que je ne veuille pas la nommer, » a complété M. Jean-Philippe Vachia, « la minorité de cas où nous avons observé des tensions financières sont des communautés qui avaient véritablement commencé à lancer de grands investissements mais où la redistribution avait été trop généreuse au départ. » La communauté de communes du Pic-Saint-Loup dont votre Commission a auditionné le président, M. Alain Poulet, le 19 avril dernier pourrait bien se trouver confrontée à une telle situation à court ou moyen terme. M. Alain Poulet a en effet expliqué que « l'attribution de compensation reversée aux communes est importante, supérieure même aux recettes de taxe professionnelle : 2,904 millions d'euros contre 2,668 millions d'euros. (...) Si la politique fiscale de la communauté de communes du Pic-Saint-Loup apparaît aujourd'hui comme très modérée, c'est certainement grâce à la prudence des élus, soucieux de la pression fiscale qui pèse sur les contribuables, mais aussi au fait qu'étant une communauté nouvelle, ayant un an d'existence sous sa forme actuelle, elle n'a encore réalisé aucun projet lourd et consommateur de crédits. Or des infrastructures manquent, notamment en matière sportive et culturelle, qui pourraient entraîner une tout autre situation fiscale si la communauté devait les assumer sans autres moyens que les siens. » En conclusion, comme l'a indiqué M. Jean-Philippe Vachia, au cours de l'audition précitée, il y a, en TPU, « tout un faisceau de critères » susceptibles « d'aboutir à des difficultés financières, ce qui nous fait dire que la logique profonde de la TPU, même si elle n'apparaît pas dans la lettre de la loi de 1999, repose sur la définition d'une stratégie financière et fiscale coordonnée entre la communauté et les communes membres, sans quoi l'on risque d'aboutir à de graves désillusions. » « Notre impression, » en conclut M. Jean-Philippe Vachia, « qui n'est qu'une impression, est que la montée en charge de l'intercommunalité n'est pas terminée. Il y aura des projets de grands équipements, la création de nouvelles zones d'activité ou d'aménagement...(...) Ce que nous craignons, mais nous manquons de recul, c'est que l'on assiste maintenant à une augmentation de la pression fiscale généraliste qui viendrait s'ajouter à celle de la fiscalité spécialisée.(...) Il faudra soit augmenter la TPU dans les limites fixées par la loi, soit recourir à une fiscalité mixte. » II.- L'ALOURDISSEMENT DES DÉPENSES À FINANCER Au-delà du fonctionnement du système institutionnel local, qui est intrinsèquement inflationniste, les collectivités territoriales ont un certain nombre de dépenses, obligatoires et non obligatoires, qu'elles doivent financer, là aussi par augmentation de la fiscalité locale. Ces dépenses sont soit subies, comme les 35 heures ou les normes techniques, soit volontaires, comme le choix de faire toujours plus sur des compétences facultatives, en réponse à la pression citoyenne ou par volonté politique délibérée. A.- TOUJOURS PLUS DE DÉPENSES LOCALES Y aurait-il un culte de la dépense publique au sein des collectivités territoriales ? On dépense pour investir, on dépense pour payer le fonctionnement et on dépense car on le croit utile. 1.- La dynamique de l'investissement public local et ses conséquences Pour prendre la mesure de la croissance des dépenses d'investissement des collectivités territoriales, on se reportera au graphique n° 6 présenté devant votre Commission par M. Dominique Hoorens, directeur des études et de la documentation de Dexia-Crédit Local, et qui figure en page 183 du tome III du présent rapport. a) Le moteur de l'investissement public en France Les administrations publiques locales prennent une part prépondérante dans l'investissement public de la Nation : près de 70 % en 2003 selon les chiffres fournis par le ministère de l'intérieur. Entre 1999 et 2004, les dépenses d'investissement des collectivités territoriales ont crû de 0,4 point de PIB, et ont porté principalement sur les transports urbains, la voierie, les réseaux d'assainissement et la construction de bâtiments publics. De ce fait, comme l'a rappelé M. Alain Guengant, directeur de recherche au CNRS, lors de son audition par votre commission, les collectivités territoriales « se retrouvent à la tête d'un patrimoine considérable - 700 à 750 milliards d'euros, pour 100 milliards de dettes, autrement dit, s'il s'agissait d'entreprises, plus de 600 milliards d'euros de fonds propres - qui représente 80 % de l'équipement public de la France hors hôpitaux. Par comparaison, le patrimoine en équipement de l'État n'est évalué qu'à 150 milliards d'euros. Les collectivités territoriales apparaissent bien comme les aménageurs, en termes d'équipement public, du territoire national. » M. Jacques Pélissard, président de l'Association des maires de France, a aussi souligné l'importance, en flux, de l'investissement public local aujourd'hui : « un tableau intéressant dressé par la Fédération nationale des travaux publics fait apparaître que l'investissement public des collectivités territoriales a progressé, en 2004, de 6 %, tandis que celui des entreprises privées n'a augmenté que de 2 % et que celui de l'État a baissé de 8 % : c'est donc bien l'investissement public des collectivités territoriales qui a soutenu, en particulier, le marché du bâtiment et le niveau d'équipement du pays. » Cela constitue un atout pour la France, et il s'agit bien d'une plus-value de la décentralisation. Pour autant, il est important pour votre Commission d'en mesurer les conséquences sur les impôts locaux. Les collectivités territoriales appliquent certes la « règle d'or » de l'équilibre budgétaire réel : elles n'empruntent que pour investir et remboursent sur leurs fonds propres. Mais il faut bien dégager une capacité d'autofinancement pour rembourser ces emprunts, et donc avoir recours au produit de la fiscalité. M. Alain Guengant a tenté de quantifier ces éléments dans son étude précitée des Sources de croissance du taux de prélèvement obligatoire des administrations publiques locales, qui figure dans le tome III du présent rapport. Selon les résultats de cette étude, « les dépenses d'investissement autofinancé représentent la seconde source de croissance [du produit des impôts directs locaux de 1979 à 2003] à hauteur de 30,90 %, dont 10,61 % induits par les remboursements d'emprunts, 2,94 % par les frais financiers et 17,35 % par l'épargne nette. [...] Les dépenses financières et d'investissement ont induit une hausse de 11,37 % du taux de prélèvement, soit 31,04 % de l'augmentation totale. La progression provient pour moitié de l'alourdissement des annuités d'emprunts, avec une hausse de 5,61 %, soit 15,33 %, et pour l'autre moitié de la croissance de l'épargne nette, avec 5,76 % soit 15,71 % de l'augmentation totale de la pression fiscale. » b) Les conséquences induites sur les budgets locaux Les dépenses d'investissement des collectivités territoriales permettent certes de financer des infrastructures, mais elles induisent aussi, indirectement, des dépenses de fonctionnement, pour entretenir et utiliser ces équipements. Ainsi que l'a rappelé le professeur Robert Hertzog, lors de son audition du 8 mars dernier par votre Commission, « contrairement aux entreprises, les personnes publiques, lorsqu'elles investissent, n'ont que des charges supplémentaires - charges d'emprunt et frais de fonctionnement induits - sans pouvoir espérer aucun revenu. [...] Il est assez rare, même dans des collectivités présentées comme à vocation économique, de réaliser des investissements producteurs de recettes. La bibliothèque construite par une communauté urbaine aura un coût et surtout générera des frais de fonctionnement énormes, tout comme un conservatoire ou un équipement sportif. » M. Roberto Schmidt, président de section à la Chambre régionale des comptes d'Alsace, fait grosso modo le même constat : « on devrait moins s'inquiéter du coût de l'investissement initial - qui peut s'amortir sur une longue période - que des charges de fonctionnement non maîtrisées que peuvent induire de telles installations. » L'étude précitée de M. Alain Guengant (Sources de croissance du taux de prélèvement obligatoire des administrations publiques locales) a également analysé l'effet d'induction de l'investissement sur le fonctionnement, qui serait la source première de l'alourdissement des charges courantes : « les modèles économétriques disponibles suggèrent un taux de récurrence de 0,28. En d'autres termes, 100 euros de nouveaux équipements (hors maintenance et renouvellement) induisent chaque année 28 euros supplémentaires de dépenses de personnel et de biens et services. » Il apparaît donc indispensable à votre Rapporteur de rentabiliser au maximum les équipements financés par les collectivités territoriales, en mettant en place des redevances et droits d'usage. Qui dit service public ne dit pas nécessairement gratuité : les services publics, eux aussi, doivent générer des ressources, pour améliorer leur propre qualité. Il s'agit d'une légitime alternative à l'augmentation de la fiscalité locale, plus responsabilisante car les utilisateurs sont les payeurs, à due proportion de leurs ressources bien entendu puisque, de manière générale depuis 199827, les tarifs des services publics locaux peuvent être modulés selon des critères sociaux. Plus largement, on regrettera la rareté et la pauvreté de l'analyse des retours sur investissement en termes de richesses et de ressources locales. Tel investissement engendre-t-il les ressources nouvelles qui permettront de le financer ? Cette interrogation est exceptionnelle. 2.- Le poids du personnel dans les dépenses de fonctionnement Selon les derniers chiffres publiés par le ministère de l'intérieur, il y avait au 31 décembre 2002 1,72 million d'agents au service des collectivités territoriales, dont 1,46 million relevant de la fonction publique territoriale. M. Dominique Hoorens, directeur des études et de la documentation de Dexia-Crédit local, a présenté devant votre Commission les évolutions de ce poste de dépense : « parmi les dépenses évolutives, le poste principal est celui des dépenses de personnel des collectivités territoriales, qui ont davantage augmenté que leurs autres dépenses. Elles devraient représenter 42 milliards d'euros en 2005 et participent à la tonicité de l'ensemble des dépenses, supérieure à la croissance du PIB. » Pour prendre la mesure d'ensemble du phénomène, on se reportera, dans le tome III du présent rapport, au graphique n° 5 présenté devant votre Commission par M. Dominique Hoorens. La masse salariale publique locale, qui représente plus du quart des dépenses totales des collectivités territoriales, explique 40 % de l'évolution totale des dépenses locales en point de PIB depuis 1980 (soit + 1,3 point de PIB). M. Alain Guengant a mis en relation les charges de personnel et l'évolution des impôts locaux, dans l'étude précitée des Sources de croissance du taux de prélèvement obligatoire des administrations publiques locales, également reproduite dans le tome III. Selon les résultats de cette étude, « sur la totalité de la période étudiée (1979-2003), 73,62 % de l'augmentation du produit des impôts locaux, hors impôts transférés, proviennent de la hausse des dépenses de fonctionnement, dont 38,25 % au titre des frais de personnel et 35,37 % au titre des autres dépenses de fonctionnement. [...] L'augmentation des dépenses de fonctionnement est à l'origine de 25,49 % de la hausse du taux de prélèvement, soit 69,60 % du total. La progression des dépenses de personnel contribue pour 13,16 %, soit 35,94 % de l'augmentation globale. L'impact des autres dépenses de fonctionnement contribue pour 12,33 %, soit 33,66 % de l'alourdissement total de la pression fiscale locale, hors impôts transférés. » Au-delà des facteurs généraux de hausse des dépenses de personnel dans les collectivités territoriales, il faut isoler en particulier les conséquences du passage aux 35 heures pour les budgets locaux. a) Une tendance lourde et inflexible Les dépenses liées à la fonction publique territoriale augmentent certes mécaniquement, comme toutes les dépenses de personnel, mais elles augmentent plus vite pour les collectivités territoriales que pour l'ensemble de la fonction publique. Comme l'a rappelé M. Dominique Schmitt, directeur général des collectivités locales, « la croissance des effectifs des collectivités territoriales est nettement supérieure à celle des effectifs de la fonction publique de l'État et à l'évolution moyenne de l'emploi en France. Entre 1981 et 2001, les effectifs ont crû de 38 % dans la fonction publique territoriale, de 15 % dans la fonction publique de l'État, de 28 % dans la fonction publique hospitalière, soit un total fonction publique de 23 %, alors que l'emploi n'a progressé d'une façon générale que de 13 % et la population active de 14 %. » Ces évolutions sont récapitulées dans le tableau suivant :
Champ : emploi public hors emplois aidés (champ de l'Observatoire de l'emploi public). Source : fichiers de paie des agents de l'État, enquête sur les collectivités territoriales, DADS (INSEE); enquête SAE et H80 (DREES). Les communes, qui restent le principal secteur employeur avec 1,2 million d'agents au total, sont particulièrement soumises aux effets de la croissance des frais de personnel, dont l'impact est d'autant plus élevé que la part du personnel dans leurs dépenses totales est sans commune mesure avec celle des départements et des régions. La part des frais de personnel dans les dépenses des communes s'établit en effet à 52,7 %, contre 15,7 % pour les départements et 6,7 % pour les régions. Elle croît avec la taille de la commune. Les effectifs ont également progressé sur les dernières années, accompagnant les transferts de compétences en direction des départements et des régions et le développement de l'intercommunalité à fiscalité propre. Considérés sur une dizaine d'années, les effectifs des collectivités territoriales font preuve d'une dynamique soutenue et continue, présente à tous les niveaux bien qu'à des degrés divers. Tout en portant sur des effectifs encore faibles, la croissance est la plus forte pour les régions (+ 7 % par an en moyenne sur 1993-2002). Elle est sensible, surtout dans la dernière période, pour les départements, dont les effectifs sont déjà bien plus importants. La croissance des effectifs des communes est plus mesurée, mais elle est continue et porte sur un effectif global qui représente encore plus de 70 % du total des collectivités territoriales. L'essentiel de la croissance se fait dans les groupements de communes, qui affichent un rythme annuel moyen de + 5,5 % sur la période, avec une accélération sensible depuis 1999. Les effectifs des collectivités locales de 1993 à 2002
Source : INSEE (Enquête annuelle au 31 décembre). M. Philippe Laurent, président-directeur général du cabinet Philippe Laurent Consultants, a évoqué quelques causes de ces augmentations : « les dépenses de personnel ont évolué du fait de l'application du statut de la fonction publique territoriale, et par là même, de la hausse des cotisations versées à la CNRACL, des créations de filières, des 35 heures ou encore de la mesure concernant le lundi de Pentecôte, qui coûte d'ailleurs 0,3 point d'impôt aux communes. L'éventuelle augmentation d'un point de l'indice de la fonction publique, dont la presse vient de se faire l'écho, se traduirait par un coût de l'ordre de 800 millions d'euros pour l'État et par 300 millions de dépenses supplémentaires pour les collectivités territoriales, dont 250 millions pour les seules communes, ce qui correspond pour ces dernières, à 20 millions d'euros près, à un point d'impôt. » Intervenant aussi devant votre Commission en tant que président de la Commission des finances et de la fiscalité locale de l'AMF, M. Philippe Laurent a aussi rappelé que « les compétences et la qualification des personnels tendent par ailleurs à s'améliorer, ce qui constitue un facteur de hausse des rémunérations. », au-delà de l'effet mécanique du GVT, compte tenu des nouvelles tâches prises en charge par les collectivités territoriales. Mme Fabienne Keller, maire de Strasbourg, a dressé un constat analogue devant votre Commission : « les collectivités territoriales sont soumises de façon automatique aux décisions de l'État, tant en ce qui concerne les évolutions statutaires, l'augmentation des traitements, que les mesures à caractère social - augmentation des contributions à la CNRACL, retraite additionnelle, contribution sociale pour les personnes âgées - ce qui entraîne, à effectif constant, une augmentation automatique de 2 % à 3 % par an, sans même compter le GVT, dont on peut considérer qu'il peut être en partie maîtrisé. Cela se traduit par un nombre à peu près équivalent de points supplémentaires de fiscalité sur les ménages, étant donné que la masse salariale représente [...] un peu plus de la moitié des dépenses de fonctionnement de la ville. » Des gains de productivité semblent difficiles à réaliser, structurellement parlant. Toujours pour Mme Fabienne Keller : « nos activités revêtent une dimension profondément humaine, qu'il s'agisse des 900 agents de la culture, comme les musiciens de l'orchestre, ou des travailleurs sociaux, de sorte que la notion de gains de productivité est à manier avec douceur. » M. Philippe Laurent évoque aussi la difficulté de faire mieux : « sur la partie personnel, à service rendu constant, beaucoup de collectivités ont accompli des progrès en matière de gestion dans les services comptables et administratifs. Cependant, les trois quarts du personnel pour les communes œuvrent sur le terrain, sur la voirie, dans les crèches, les écoles, les centres de loisir, etc. Il est difficile de réaliser des économies dans ce domaine car il s'agit de dépenses normées qui augmentent mécaniquement avec la croissance de la demande. » Pour autant, des actions permettant de maîtriser la progression des dépenses de personnel sont quand même possibles. Mme Fabienne Keller a ainsi expliqué que « les mesures prises pour contrôler la masse salariale concernent avant tout la gestion des effectifs. Ainsi, les services ont pour instruction de ne plus créer de postes sans en compenser l'équivalent, même lorsque l'ouverture d'équipements nouveaux nécessite de nouveaux emplois. Nous avons mis en place une gestion par objectifs, différencié le régime indemnitaire en fonction du niveau de responsabilité exercé - ce qui nous a valu une grève des éboueurs à Noël, mais nous avons tenu bon - et instauré progressivement des entretiens d'évaluation pour tous les agents, dans une collectivité qui en avait quelque peu perdu l'habitude. [...] Nous demandons que les nouveaux services soient assurés à effectif constant, ce qui suppose des remises en cause, des réorganisations. C'est ainsi que la nouvelle déchetterie fonctionne avec un horaire réduit de moitié par rapport à celui des autres déchetteries, mais qui permet de couvrir 95 % des besoins, par exemple en ouvrant le samedi matin, ou à des moments où les gens sont plus disponibles. Nous profitons des nouveaux projets pour mettre les fonctionnaires dans une démarche dynamique, qui permet au passage à certains d'entre eux, gagnés par la lassitude, d'évoluer dans leur emploi. » Qu'en est-il aussi de l'objectif de non remplacement d'un départ à la retraite sur deux dans la fonction publique ? M. Philippe Laurent, président-directeur général du cabinet Philippe Laurent Consultants, a présupposé « le remplacement, d'ici à dix ans, de 500 000 agents territoriaux en fin de carrière par des jeunes », comme si un remplacement de un pour un devait aller de soi au niveau local, alors que tel n'est plus le cas pour les fonctionnaires de l'État. Ce qui est possible au niveau central ne le serait pas aux niveaux décentralisés ? b) Les conséquences lourdes des 35 heures Si l'augmentation des traitements et des charges de personnel est une donnée constante de la fonction publique territoriale au cours des dernières années, on constate conjoncturellement une augmentation plus prononcée des frais de personnel en 2002, année de mise en œuvre des 35 heures, tous niveaux de collectivités territoriales confondus. Cette inflexion est sensible (+ 6,4 %, contre 5 % environ en moyenne annuelle sur les huit dernières années).
Ainsi qu'a déjà tenté de le démontrer la mission d'information commune créée par l'Assemblée nationale sur l'évaluation des conséquences économiques et sociales de la législation sur le temps de travail28, l'impact de l'aménagement-réduction du temps de travail sur la fiscalité locale reste cependant difficile à mesurer. On se réfèrera aux déclarations de M. Dominique Bur, directeur général des collectivités locales à l'époque, devant cette mission d'information, le 8 janvier 2004 : « les dépenses de personnel représentaient un peu plus de 30 milliards d'euros [en 2001]. Pour 2002, elles passent à près de 32 milliards d'euros, soit une progression de 5,9 % - + 1,77 milliard d'euros - soit une hausse sensiblement supérieure à celle des huit années précédentes, à savoir 4,6 %. [...] Dans les budgets primitifs pour 2003, les dépenses de personnel passent à 33,37 milliards d'euros, soit + 4,3 % et + 1,39 milliard d'euros. [...] Même si l'exercice est difficile puisque nous n'avons que des données globales, nous estimons qu'au moins un tiers de cet accroissement annuel a été généré par l'ARTT. [...] Une étude, réalisée par DEXIA - Crédit local de France avec le concours de l'Association des maires des grandes villes de France, a montré que, parmi les vingt villes qui ont répondu à l'enquête, l'accroissement de personnel lié à l'ARTT pouvait être chiffré à environ 1 % des effectifs. En extrapolant à l'ensemble des collectivités, cela donne 16 000 emplois supplémentaires, avec un coût moyen d'environ 520 millions d'euros. Si on le rapporte à l'augmentation constatée des frais de personnel, nous arrivons environ au tiers de l'accroissement annuel. » M. Dominique Schmitt, directeur général des collectivités locales, aboutit aux mêmes conclusions aujourd'hui avec plus de recul : « si l'augmentation des traitements et des charges de personnel est une donnée constante de la fonction publique territoriale au cours des dernières années, on constate conjoncturellement une augmentation plus prononcée des frais de personnel en 2002, année de mise en œuvre de la réduction du temps de travail (RTT), tous niveaux de collectivités territoriales confondus. La RTT avait été assez largement anticipée dans les grandes collectivités : au 31 décembre 2001, 40 % des communes de plus de 20 000 habitants, 30 % des conseils régionaux et généraux appliquaient d'ores et déjà les 35 heures, tant et si bien que l'entrée en vigueur effective de la RTT ne s'est pas traduite par un surcoût. Mais il n'en a pas été de même dans les petites communes, où la durée du travail était majoritairement restée à 39 heures. D'autres phénomènes ont dans le même temps affecté les charges salariales : ainsi en a-t-il été de la progression du point d'indice, relativement significative - 0,6 point au premier mars 2002, 0,7 au 1er décembre 2002, venus s'ajouter au 0,7 point du 1er décembre 2001 -, du protocole sur la résorption de l'emploi précaire, des effets du GVT, de l'augmentation du taux de cotisation à la CNRACL, du financement de l'intégration d'anciens emplois-jeunes dans la fonction publique territoriale, ou encore des recrutements pour faire face aux nouvelles compétences comme l'APA. Au regard de tous ces éléments, on pourrait considérer que l'impact financier de la RTT est, malgré tout, resté significatif, surtout en 2002 : il correspondrait au moins au tiers de l'accroissement annuel des dépenses de personnel durant les années 2002 et 2003. » Une évaluation très précise a été fournie à votre Commission par Mme Fabienne Keller, maire de Strasbourg. Pour l'administration unique de la ville et de la communauté urbaine de Strasbourg, dont les effectifs initiaux étaient de 5 996 agents, 200 recrutements ont été effectués en 2000 et 2001 du fait de la mise en place des 35 heures. Cet impact représente donc 3,3% de l'effectif, avec un coût en année pleine de 6,2 millions d'euros. Ces estimations, déjà significatives, n'intègrent cependant pas toutes les conséquences indirectes des 35 heures, dont le coût se répercute par exemple sur la masse salariale de tous les établissements sociaux et médico-sociaux, dont le fonctionnement est financé par des subventions des départements. Ainsi, M. Jean-Yves Chamard, président de la commission des finances du conseil général de la Vienne, a expliqué devant votre Commission avoir donné son « accord à une augmentation de 10 % de leur masse salariale, étalée sur trois ans. Quelques établissements ont été au-delà, d'où certains problèmes. [...] Les établissements sociaux sont en permanence à vous expliquer qu'il faut, en fait, beaucoup plus de personnel compte tenu du vieillissement, de ceci, de cela... Au conseil général, nous nous sommes arrêtés à 6 % ; mais, pour les établissements sociaux, nous sommes donc allés jusqu'à 10 %. Peut-être avons-nous été trop généreux... [...] Ce à quoi il faut ajouter l'augmentation de salaires des assistantes maternelles, dont il était impensable de réduire le temps de travail : une hausse sur trois ans de 5 %, puis 2 %, puis 2 % encore, négociée avec les syndicats. » Selon M. Philippe Laurent, « l'effet des 35 heures n'a pas été positif, car la RTT ne peut avoir aucun effet sur la productivité des services normés tels que les crèches, qui ont des heures d'ouverture précises et requièrent, en vertu de normes précises, un certain nombre de personnes par tranche de berceaux. » Mais la réponse n'est pas univoque. Ainsi, M. Gérard Burel, président du conseil général de l'Orne, a indiqué à votre Commission n'avoir embauché personne du fait des 35 heures, car « les fonctionnaires territoriaux ont su faire des progrès de productivité, que nous avons accompagnés par l'achat de matériels informatiques performants qui ont permis de supprimer des tâches répétitives. » Il va de soi - mieux vaut le rappeler car certains n'ont pas manqué de vouloir tracer des parallèles devant votre Commission - que la mise en place de la journée nationale de solidarité pour financer la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie a eu, sur les budgets locaux, un impact infime en comparaison avec celui des 35 heures. On se réfèrera avec profit aux précisions données par M. Brice Hortefeux, ministre délégué aux collectivités territoriales : « il est vrai qu'en contrepartie de cette journée travaillée non rémunérée, les employeurs territoriaux ont versé la contribution de 0,3 % de l'assiette des cotisations d'assurance maladie à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, installée voilà trois semaines. Rapporté à la masse salariale telle qu'elle apparaît dans les budgets primitifs, cela représente environ 100 millions d'euros, sans compter les frais de fonctionnement supplémentaires. Pourquoi ai-je donné ce chiffre ? Pour le comparer aux 35 milliards d'euros consacrés aux rémunérations par les collectivités... Cela donne un ordre de grandeur, et signifie tout simplement que chacun a dû supporter sa part de l'effort. » 3.- Le choix de dépenser : entre résignation et volontarisme Le professeur Robert Hertzog a bien rappelé, lors de son audition, que « nous ne disposons d'aucune étude scientifique définitive pour déterminer la source de la dépense dans une collectivité territoriale. D'autant qu'il existe une série de mythes dépensiers : le mythe du développement local, de l'interventionnisme économique local, à l'origine de combien de dépenses économiquement inutiles, et parfois de dépenses sociales socialement inutiles ! La disposition de ressources génère de la dépense. Dans un organisme émargeant à INTERREG, par exemple, on est porté à inventer des choses avec des organismes allemands et suisses dont, franchement, l'utilité ne saute pas toujours aux yeux. » Quand une dépense n'est pas obligatoire, quand elle n'est pas la conséquence du fonctionnement d'une structure, il y a bien un choix, discrétionnaire, de dépenser. Ce choix peut résulter directement de la volonté politique des élus locaux, il peut aussi, d'une manière ou d'une autre, être provoqué par les électeurs, administrés et usagers des services publics locaux. Pourquoi les élus se sentent-ils si souvent obligés de dépenser ? La proximité, corollaire de la démocratie locale, implique un contact plus direct et quotidien entre élus et électeurs. La pression sur les décideurs locaux est donc beaucoup plus forte qu'au niveau central, où elle est médiatisée au travers de la démocratie représentative, des groupes d'intérêt et du filtre de l'administration. Ainsi que l'a rappelé M. Philippe Laurent, lors de son audition du 15 mars 2005 en tant que président-directeur général du cabinet Philippe Laurent Consultants, « les exigences des populations ne cessent de croître en raison notamment du développement de la culture urbaine, c'est-à-dire de la diffusion dans les zones périurbaines et rurales de la demande de services qui n'existaient traditionnellement qu'en milieu urbain. Les services publics locaux sont de plus en plus amenés à remplacer la solidarité de voisinage, qui, sur certains territoires, est en train de disparaître. La généralisation du travail des femmes a également un impact direct sur les services liés à la petite enfance et, même si des moyens sont mis en œuvre, de manière périodique ou sporadique, par l'État ou les caisses d'allocations familiales, ce sont les communes qui agissent au premier chef. L'allongement de la durée de la vie et l'amélioration du niveau de formation, qui rend les administrés plus à même de formuler des critiques et de faire pression sur les élus, sont également des facteurs de hausse de la dépense locale. On constate en outre un repli sur les centres-villes et un essor de la périurbanisation qui accroît la taille des communes ; or il est presque scientifiquement démontré que les dépenses par habitant augmentent en fonction de la taille des communes. Ce phénomène n'est pas dû au gaspillage de l'argent public mais à la demande croissante de services publics locaux. » Ces exigences seraient liées à l'évolution de la structure de la population active. Ainsi, selon M. Pascal Buchet, rapporteur général de la commission des finances et de la fiscalité locale de l'Association des maires de France, « un pilier important de la croissance de la fiscalité, au-delà de l'aspect normatif, est le besoin en développement. Pour les crèches par exemple (qui ne sont à proprement parler la compétence obligatoire de personne), certains départements se désengagent. Or, compte tenu du taux d'activité féminine, il s'agit d'un très fort besoin émergent qui entraîne des coûts de personnel très importants. » Pour autant, choisir entre le recours à des assistantes maternelles, qui offrent pourtant la bonne réponse dans certains cas, et l'ouverture de places de crèche n'est pas neutre financièrement pour les collectivités. De très nombreux élus locaux ont décrit ou évoqué cette prétendue inéluctabilité de l'augmentation de la dépense provoquée par la pression citoyenne. Ainsi M. Joseph Spiegel, président du groupe socialiste au conseil général du Haut-Rhin : « je pense que toute compétence décentralisée entraînera une exigence de qualité de service différente. De deux choses l'une : soit on est sourd aux préoccupations des habitants, soit cette exigence se traduira par une augmentation des dépenses. » M. Bernard Cazeau, Président du conseil général de la Dordogne, s'estime contraint à faire des travaux de voierie « sous la pression notamment des revendications très fortes des populations ». De même, à propos de la mise en place de la nouvelle prestation de compensation du handicap, il rappelle « qu'il faut tenir compte de la demande citoyenne émanant des associations. » M. Jacques Pélissard, président de l'Association des maires de France, confirme lui aussi l'existence de cette pression citoyenne, lorsqu'il explique devant votre Commission que les investissements nouveaux réalisés par les structures intercommunales « sont légitimes dans la mesure où ils répondent à des attentes des populations. » On semble découvrir un sentiment d'impuissance chez les élus locaux, qui ne seraient pas armés pour résister. M. Marcel Charmant, président du conseil général de la Nièvre, constate que « si l'État a pu résister à la pression de la population et des élus, les conseils généraux et les conseils régionaux, eux, ne pourront pas se le permettre et seront contraints à entreprendre des travaux. » M. Maxime Camuzat, maire de Saint-Germain-du-Puy, estime ne vas avoir le choix : « quand les emplois-jeunes enseignant l'informatique dans les écoles sont supprimés, à quelle porte frappent les parents d'élèves et les enseignants ? À la porte de la mairie. Quand une association perd ses subventions de l'État, à qui s'adresse-t-elle ? Nous résistons mais, lorsque les demandes correspondent à des besoins réels, nous sommes obligés de céder » M. Alain Rousset, président de l'Association des régions de France, se demande, visiblement inquiet : « comment vais-je résister aux parents d'élèves qui vont venir me dire qu'il manque deux postes au lycée de Bazas ? Comment vais-je résister aux organisations syndicales ? [...] Je résisterai beaucoup plus difficilement [...] aux demandes des enseignants, des proviseurs, des parents d'élèves. [...] Pouvez-vous dire non à un chef d'entreprise qui vous dit que, s'il n'achète pas tel ou tel outillage, il perdra le marché des bords d'attaque des moteurs Pratt et Whitney dont il a le marché aux États-Unis ? [...] Que faire quand il y a un tel besoin ? » Pourquoi de telles réactions ? M. Gilles de Robien, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, a rappelé à juste titre devant votre Commission les propos de M. Jean-Pierre Raffarin, quand il était Premier ministre : « les élus municipaux, départementaux et régionaux éprouvent d'autant plus le désir de bien faire qu'ils sont " à portée de baffes des électeurs ". » Mais justement, là est le sens de la responsabilité politique des élus. En présence d'une attente ou d'une demande, la dépense publique correspondante n'est pas par nature ou par essence légitime : il faut arbitrer entre les différents intérêts en jeu, donc faire des choix, toujours difficiles. L'impôt de proximité n'est inéluctable que pour les résignés. Quels choix font les élus locaux ? En matière de dépenses, leur credo semble être plutôt : toujours plus ! Est-ce bien responsable ? Comme l'a expliqué M. Philippe Laurent lors de la même audition, les élus locaux veulent « aller au devant des attentes des administrés et fournir des services, notamment dans le domaine culturel, qui n'entrent pas strictement dans leur champ de compétences obligatoires. L'élu local refuse d'être un simple fonctionnaire : il souhaite fournir, par exemple, des places de crèche en nombre suffisant ou de nouvelles prestations culturelles, ces services étant dorénavant considérés comme des droits, en tout cas dans les grandes villes. [...] M. Philippe Laurent a aussi cité le cas des départements et des régions « qui craignent par ailleurs - mais ce n'est pas avéré - de devoir faire face à de nouveaux mouvements de restructuration de services publics, auquel cas, ils estiment qu'ils ne pourront faire autrement que d'accompagner les communes. » On ressent un effet cliquet très fort : toujours plus de dépenses, jamais moins ! Toujours selon M. Philippe Laurent, « les collectivités territoriales estiment de surcroît qu'elles doivent de plus en plus intervenir à la place de l'État sans aucune compensation. Le domaine de la police municipale, même si, de la part des communes, il y a eu une réelle volonté de mettre en place des polices municipales, constitue une illustration particulièrement évidente de ce dérapage. » Votre Rapporteur ne pense cependant pas que le « dérapage » provienne de l'État, mais des collectivités territoriales, qui veulent délibérément faire plus que l'État, et lui réclament alors - en raison du principe qui veut que l'État est responsable de tout, et notamment de la sécurité - une compensation qui n'a aucune raison d'être en l'espèce, car il ne s'agit aucunement d'un transfert de charges, contrairement à ce que laisse entendre M. Philippe Laurent. Celui-ci semble avoir anticipé cet argument, en affirmant devant votre Commission que « les polices municipales ont été mises en place par les communes pour faire mieux respecter les arrêtés municipaux et ont donné lieu à des dérives financières, mais comment isoler la part des dépenses relevant de la volonté politique de développer ce service et celle résultant de la nécessité de pallier les insuffisances de la police nationale ? » Comment surtout vouloir évaluer ces prétendues « insuffisances de la police nationale » ? Le Parlement vote un budget pour la sécurité, et le ministre de l'intérieur le met en œuvre. Les missions régaliennes de l'État sont donc correctement exercées, selon les décisions prises par les représentants du peuple. On peut vouloir faire plus au niveau local, mais il faut alors l'assumer en tant que tel, sans se défausser sur l'État. Comme l'a reconnu M. Jacques Pélissard, président de l'Association des maires de France, lors de son audition du 3 mai 2005, « les dépenses publiques locales subissent une pression à la hausse. Celle-ci est partiellement imputable aux décisions des élus locaux, qui assument leur vision de l'avenir de leur territoire en procédant à des investissements. » Mais, parmi les charges non voulues qui s'imposeraient aux élus, M. Jacques Pélissard cite « la nécessité, pour les collectivités, d'accompagner puis de prendre le relais de mesures mises en œuvre au niveau national, avec notamment les contrats aidés faisant suite aux emplois jeunes », alors qu'il s'agit d'un choix délibéré des élus de faire plus, ou plutôt de faire ce que l'État a délibérément décidé de ne plus faire, au motif qu'il estimait ces contrats aidés coûteux pour les finances publiques et inefficaces au titre de la politique de l'emploi. M. Adrien Zeller, Président du conseil régional d'Alsace, a d'ailleurs décidé, fort à propos, de faire beaucoup moins : « nous sommes souvent sollicités par des acteurs qui pensent que nous avons vocation à nous substituer, en tout ou partie, à l'État. Nous décidons alors au cas par cas, en fonction de l'intérêt régional et des besoins réels. [...] Lorsqu'une association ou une commune nous a dit qu'elle avait moins de crédits d'État, nous nous sommes posé deux questions. Premièrement, y a-t-il un intérêt régional à intervenir ? Deuxièmement, le conseil régional est-il le mieux placé pour cela ? En d'autres termes, nous avons appliqué le principe de subsidiarité. Par exemple, la région a décidé de ne pas intervenir pour remplacer l'emploi-jeune perdu par un club de sport. [...] Nous n'avons pas bâti de système global, du type emplois-tremplins. Nous avons fait preuve de sélectivité. » Voilà une véritable démarche responsable, qui ne considère pas l'augmentation de la dépense comme une fatalité. C'est un choix politique, assumé comme tel devant les électeurs, qui s'accompagne bien évidemment d'une modération concomitante de l'augmentation de la pression fiscale locale. CQFD. B.- LE POIDS CROISSANT DES NORMES TECHNIQUES SUR LE BUDGET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES Lors de son audition le 23 mars 2005, M. Claudy Lebreton a souligné que « les collectivités territoriales doivent faire face à un alourdissement de leurs charges qui résulte de décisions prises par l'État : contraintes environnementales en matière de traitement des déchets, normes de sécurité imposées aux établissements publics dont les collectivités territoriales ont la responsabilité... ». Bien entendu, ce qui est visé dans cette déclaration, ce ne sont pas les normes au sens juridique du terme, mais les normes techniques, qui se sont considérablement développées au cours des dernières années. Or, les collectivités territoriales sont susceptibles d'être confrontées à la question des normes chaque fois qu'elles ont en charge un ouvrage public, qu'il s'agisse de voirie, d'établissement scolaires, sociaux, de santé ou, d'une manière générale, d'équipements collectifs (notamment en matière d'assainissement ou de déchets). Parce qu'elles renchérissent le coût desdits ouvrages, les normes techniques constituent un facteur d'augmentation à long terme de leurs dépenses, d'autant que les collectivités territoriales sont rarement associées à leur élaboration. 1.- Des normes nombreuses, d'une portée juridique variée et coûteuses à appliquer pour les collectivités territoriales Ainsi que le rappelle un rapport d'information du Sénat29, « deux types de normes doivent être distinguées : les normes issues de textes législatifs ou réglementaires d'une part, les normes professionnelles, issues d'une démarche volontaire et établies par l'Association française de normalisation (AFNOR) d'autre part. À ces deux grandes catégories doivent être ajoutées les normes établies par les fédérations sportives ». Cependant, la distinction entre ces différentes catégories de normes, d'une portée juridique variable, a tendance à s'estomper. En effet, les élus sont conduits, notamment pour répondre à une demande sociale de sécurité, à s'entourer du plus grand nombre possible de garanties. Ils cherchent en conséquence à satisfaire à des normes et références techniques qui ne leur sont pas opposables en droit, alourdissant encore le coût de la mise aux normes de leurs équipements. a) Des normes nombreuses, d'une origine et d'une portée juridique variée Le développement considérable des normes repose essentiellement sur l'internationalisation du commerce et la standardisation des produits. Cependant, s'agissant du cas particulier des normes applicables aux collectivités territoriales, deux causes majeures sont à l'origine de leur renforcement : - d'une part, la demande sociale de réduction de l'incertitude en matière de sécurité. Le refus du risque conduit en effet à exiger l'élaboration de normes toujours plus nombreuses et précises, perçues comme autant de garanties contre les aléas techniques ; - d'autre part, les pouvoirs publics utilisent de plus en plus les normes pour fixer le détail des dispositions qu'ils arrêtent, notamment en matière de sécurité, d'environnement, de protection des travailleurs et des consommateurs. Ainsi qu'il est indiqué dans le rapport précité du Sénat, « le stock de normes établies par l'AFNOR - qui toutes ne concernent pas les collectivités locales - s'élève à 20 000 et s'enrichit de 1 800 normes nouvelles chaque année. 85 % des nouvelles normes de l'AFNOR ont une origine européenne ou internationale ». M. Jean Hyenne, directeur-adjoint de l'AFNOR, auditionné par votre Rapporteur le 24 mai 2005, a déclaré que le stock de normes s'élevait actuellement à 30 000, avec un flux d'environ 2 000 normes nouvelles par an. En l'espace de 5 ans, le stock de normes a donc augmenté de moitié. Par ailleurs, plus de 90 % de ce flux est constitué de normes professionnelles émanant de travaux tenus au niveau européen, principalement dans le cadre du Comité européen de normalisation (CEN), ou au plan international, au sein de l'International Standard Organisation (ISO). Cependant, seule une centaine de normes établies par l'AFNOR est rendue obligatoire dans un acte réglementaire. À côté de la normalisation professionnelle, les règlements techniques, pour leur part, sont déterminés au niveau communautaire ou national, et prennent la forme de directives, de lois ou de règlements. Enfin, à ces normes professionnelles et réglementaires s'ajoutent les normes édictées par les fédérations sportives. Selon M. Jacques Pélissard : « la règle est aujourd'hui la suivante : les fédérations sportives sont compétentes pour déterminer les normes qui sont en liaison directe avec la pratique du sport lui-même, comme la largeur du terrain ou l'intensité de son éclairage ; le nombre de places des gradins et l'espace consacré aux cabines des journalistes, en revanche, n'entrent pas dans leurs compétences. Certains points restent toutefois assez flous et méritent d'être clarifiés, concernant par exemple la surface des vestiaires ou le nombre des pommeaux de douche ». Non seulement les normes ont une origine variée, mais toutes n'ont pas les mêmes destinataires, ni la même valeur juridique. Les normes professionnelles, dont l'application est volontaire et contractuelle, concerne en effet bien plus leurs fournisseurs que les collectivités elles-mêmes. Ces normes ne revêtent d'ailleurs une valeur contraignante que dans la mesure où elles sont reprises par la réglementation. Aussi, les difficultés que soulèvent les élus locaux au sujet des normes sont-elles le plus souvent du ressort du pouvoir réglementaire, qui énonce le droit, et non de la normalisation en tant que telle. Dans le domaine de l'eau ou des déchets, par exemple, les seuils réglementaires prévus par les directives européennes et les mesures nationales ne proviennent pas de la normalisation. Cependant, les règlements des fédérations sportives comportent des prescriptions unilatérales qui s'imposent aux collectivités territoriales, dès lors que ces dernières souhaitent accueillir des compétitions d'un certain niveau. Cependant, les normes qui sont en principe facultatives peuvent acquérir un caratère plus ou moins contraignant. En effet, quelques sinistres médiatisés, à l'instar de celui des thermes de Barbotan, ont révélé que les élus pouvaient être mis en cause à titre personnel en cas de dommage, d'autant que les juridictions n'hésitent pas à se référer aux normes professionnelles pour déterminer les différentes responsabilités. Le code pénal prévoit ainsi plusieurs chefs de poursuite qui peuvent s'appliquer aux manquements aux normes. Les dispositions des articles 222-19 (atteintes involontaires à l'intégrité de la personne) et 221-6 (atteinte involontaire à la vie) répriment le manquement à l'obligation de sécurité et de prudence imposée par la loi ou les règlements, pris au sens large. Enfin, le délit de mise en danger délibérée de la vie d'autrui (article 121-3) sanctionne le fait d'exposer autrui au risque immédiat d'une atteinte physique grave, sans même qu'il y ait eu dommage effectif, par violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité imposée par la loi ou les règlements30 . En conséquence, et afin d'éviter une possible mise en cause pénale, les élus locaux sont conduits à respecter les normes professionnelles, notamment en matière de construction et de mise en sécurité des bâtiments, quand bien même celles-ci ne sont pas obligatoires en droit. b) Des normes de plus en plus coûteuses Ainsi qu'il est dit dans le rapport du Sénat précité, « si les normes les plus coûteuses pour les collectivités locales semblent d'origine législative ou réglementaire, notamment en matière d'environnement ou de sécurité, il n'existe néanmoins pas d'étude globale permettant d'évaluer précisément les conséquences financières des normes ». D'après un rapport de l'inspection générale de l'administration (IGA) publié en 200031, les chiffres disponibles sont soit sous-évalués, car ils ne prennent pas en compte le coût de l'entretien des équipements, soit surévalués car ils retiennent le coût global des équipements et pas seulement le surcoût lié aux normes. Ainsi que l'a observé M. Robert Hertzog : « Vous avez également posé la question du coût des procédures et des normes. Pensez-vous vraiment qu'on le connaisse réellement ? Je reste très perplexe à cet égard. Ce sont le plus souvent des coûts induits, très indirects, peu lisibles quand bien même ils sont incontestables, qu'il s'agisse des conséquences de la loi SRU, de la loi sur l'eau, des surcoûts liés aux nouvelles normes de construction, de traitement des ordures ménagères, etc. Comment les connaître exactement, alors que nous manquons cruellement d'études d'impact préalables et de simulations des conséquences financières de ces nouvelles normes ? ». En conséquence, « on ne peut que les mesurer collectivité par collectivité [...] mais on ne saurait les retrouver dans les statistiques globales. D'où la nécessité de s'en assurer très concrètement au niveau micro-collectivité territoriale ». Pour prendre des exemples tiré d'un rapport de la section du rapport et des études du Conseil d'État32 , le coût final d'une station d'épuration « aux normes de la directive de 1991 » pour la commune de Decize en Bourgogne (6 876 habitants) est de 5,7 millions de francs. Il atteint, pour la commune de Laon, dans l'Aisne (26 490 habitants), 63,3 millions de francs, pour le SIVOM de Metz (450 000 équivalents-habitants), 279 millions de francs et pour l'agglomération grenobloise (480 000 équivalents habitants) pas moins de 471 millions de francs. En effet, « les dépenses liées aux investissements environnementaux sont fortement concentrées sur les collectivités locales, notamment dans le secteur de l'eau et des déchets »33. Entre 1993 1995, les dépenses locales consacrées à l'assainissement de l'eau ont crû de 19,5 %, sans doute sous l'effet de la directive du conseil 91/271/CE du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduelles. De plus, toujours s'agissant de l'eau mais de sa distribution, ainsi que l'a déclaré M. Jacques Pélissard : « le coût total de la suppression de tous les réseaux en plomb, imposée par l'Union européenne, lorsque Mme Dominique Voynet était ministre, a alors été évalué à 50 milliards de francs. Toujours dans le domaine de l'environnement, la loi du 13 juillet 1992 relative à l'élimination des déchets, qui a transposé la directive 91/156/CE du 18 mars 1991 relative aux déchets a renforcé la réglementation en matière de traitement et de valorisation des déchets. Outre la mise en place d'une planification, autour de plans départementaux d'élimination des déchets, la loi a fixé de nouvelles exigences en matière de traitement et de valorisation des déchets, interdisant, à partir du 1er juillet 2002, la mise en décharge, sauf pour les déchets ultimes. Ainsi que le rappelle le rapport précité du Sénat, « l'investissement mis à la charge des collectivités territoriales était estimé, au moment de l'adoption de la loi, à 22 milliards de francs en 10 ans. Mais depuis, l'accroissement des exigences environnementales, s'agissant notamment de la réduction des émissions polluantes des installations d'incinération des déchets a sensiblement renchérit la facture : tenir l'objectif de 2002 demanderait aux collectivités d'investir 60 milliards de francs en 10 ans. 16 milliards de francs ayant déjà été engagés, l'effort à fournir reste considérable ». Ainsi, toujours selon le même rapport, « le coût de la collecte et du traitement des déchets ménager est globalement passé de 170 francs par habitant en 1990 à 300 francs en 1997, sous l'effet de l'augmentation de la quantité de déchets produites mais également du durcissement de la réglementation environnementale. On estime ainsi qu'une mise en décharge hors norme coûte entre 50 et 70 francs par tonne, alors qu'une mise en décharge aux normes revient à 250 à 300 francs par tonne ». Ces chiffres doivent cependant être relativisés, dans la mesure où les collectivités territoriales financent rarement seules ces investissements. Ceux-ci bénéficient généralement de financements extérieurs qui, par exemple pour les stations d'épuration, s'établissent le plus souvent à 40 % de subventions provenant de l'agence de l'eau et de 20 % de prêts sans intérêt. Cependant, 40 % de l'investissement n'en restent pas moins à la charge immédiate de la collectivité maître d'ouvrage, dépenses auquelle elle parfois du mal à faire face, surtout dans les communes rurales . Aux normes environnementales, désormais essentiellement d'origine européenne, s'ajoute le coût découlant des normes édictées par les fédérations sportives. Les exigences des fédérations sportives sont en effet parfois lourdes de conséquences pour les communes, mêmes les plus importantes. Par exemple, ainsi que l'a observé la mission d'évaluation et de contrôle de l'assemblée nationale, « le football professionnel concentre les problèmes les plus visibles, sinon les plus nombreux, généralement liés à l'édiction de normes relatives à l'éclairage des stades, l'entretien des pelouses et surtout la capacité des tribunes dans les stades [...] Ainsi peut-on évoquer l'exemple d'une commune de 8 500 habitants ayant déjà fait l'effort d'un taux d'équipement en bâtiment sportif équivalent à celui d'une commune de 20 000 habitants et dont la montée éventuelle du club de football en CFA 2 impliquerait de mettre aux normes le terrain sur une largeur de 68 mètre au lieu de 65 mètres, de prévoir la construction de tribunes assises avec ouverture d'un tunnel pour les joueurs et la pose d'un éclairage d'un montant total de 800 000 euros de modifier les vestiaires existants pour un coût de 662 400 euros, de répondre aux exigences en matière de vestiaires des officiels et de locaux annexes et de se doter d'un terrain de repli, lui aussi à des normes de dimensionnement et de sécurité nouvelles »34 . Un autre domaine dans lequel les normes se révèlent coûteuses pour les collectivités territoriales est la mise en sécurité des installations. Ainsi que le rappelle le rapport de l'IGA précité, « la direction générale des collectivités locales cite une estimation du total des investissements à réaliser de l'ordre de 30 milliards de francs s'agissant des équipements sportifs et de 40 milliards de francs en ce qui concerne les aires de jeux, sans que le surcoût de la mise aux normes puisse être isolé au sein de ces dépenses globales ». De plus, sur la base d'une étude de l'Observatoire national de sécurité dans les établissements scolaires35, la proportion des établissements nécessitant une mise aux normes va de 10 % en matière d'évacuation incendie à 20 % dans le cas des écoles maternelles confrontées à un problème de stockage excessif de matériaux combustibles. De surcroît, 25 % des bâtiments scolaires ne disposent pas d'une installation électrique conforme. Si des progrès sont régulièrement enregistrés dans les rapports annuels de l'observatoire, d'autres obligations ont été mises depuis à la charge des collectivités territoriales. En particulier, le coût des travaux obligatoires d'extraction de l'amiante est évalué à près de 2 milliards de francs. Enfin, la question des coûts prévisibles de la loi sur le handicap a été évoquée devant votre Commission. Selon M. Charles-Éric Lemaignen, vice-président de l'Association des communauté de France chargé des affaires financières et fiscales, lors de son audition du 6 avril 2005 : « aux termes de la loi sur le handicap, tous les transports publics devront être accessibles aux handicapés d'ici dix ans. Dans mon agglomération, nous avons mené une réflexion sur l'accessibilité des lignes fortes du réseau. Pour les trams, c'est fait. Pour le bus, cela représentera, rien que pour l'accessibilité des stations, un million d'euros pour chacune des cinq lignes fortes, à quoi il faut ajouter les adaptations nécessaires pour équiper les matériels de palettes, ainsi que la modification du service TPMR, transport des personnes à mobilité réduite, dont le coût par personne transportée est extrêmement élevé. Je ne suis pas certain que beaucoup d'agglomérations seront en mesure, dans dix ans, de respecter la loi... » Le coût de plus en plus élevé de ces normes se traduit évidemment, dans une proportion qu'il est toutefois impossible de chiffrer, par une élévation de la fiscalité, parfois indirectement pour financer la mise aux normes d'équipements publics, mais aussi directement, lorsqu'une taxe finance un service, comme la TEOM. Un exemple du premier cas a été donné par M. Thierry Camuzat, directeur général adjoint chargé des finances de la région Languedoc-Roussillon : « s'agissant des normes, nous possédons une piscine couverte. Or, ma commune se situe à la limite du territoire de la communauté d'agglomération. Des écoles et habitants de nombreuses communes non membres de la communauté d'agglomération utilisent donc notre piscine mais ce sont les citoyens de ma commune qui paient le déficit du centre nautique. Si une commission de sécurité devait donner un avis négatif concernant le centre nautique et exiger des travaux, je ne pourrais pas fermer le complexe, car imaginez le tollé que cela provoquerait. Je devrais donc accroître la fiscalité pesant sur les familles pour pouvoir financer une mise aux normes du centre nautique ». Quant à la TEOM, M. Charles-Éric Lemaignen, a déclaré : « si la taxe professionnelle n'a pas été inflationniste, en revanche, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères l'a été très fortement. Pourquoi ? Tout d'abord, parce que le taux de couverture des dépenses de collecte et de traitement des ordures ménagères par la TEOM est très variable d'une communauté à l'autre, et que beaucoup d'entre elles, face à la très forte pression à la hausse de ces dépenses, ont souhaité mieux les couvrir en accroissant le taux de la TEOM. En outre, la sévérité accrue des règles de mise aux normes a incontestablement conduit les collectivités, qu'il s'agisse des communes ou des communautés d'agglomération, à augmenter le taux de TEOM. Ainsi, la communauté d'agglomération que je préside est confrontée à des normes de traitement des fumées dans les usines de traitement des ordures ménagères. La construction du centre de traitement des fumées a coûté 9 millions d'euros. En fonctionnement, ce centre de traitement coûte un million d'euros par an à la communauté ». Enfin, le surcoût lié aux nouvelles normes peut peser sur l'usager par des augmentations significatives de tarifs, même s'il est difficile de les estimer précisément. Ainsi, en matière de traitement des déchets, toujours selon le rapport du conseil d'État, pour une agglomération comme celle de Caen, le coût des opérations de mise aux normes en 1993 d'une usine d'incinération importante, mise en service en 1973, s'est élevé à 67 millions de francs sur cinq ans, ce qui explique l'essentiel de la hausse tarifaire de 40 % intervenue entre 1994 et 1999. 2.- Les collectivités territoriales sont largement absentes du processus de normalisation et de réglementation technique L'analyse du processus de normalisation, tant pour les normes professionnelles que pour la réglementation technique, révèle que les collectivités territoriales en sont largement absentes, malgré quelques progrès récents. Pourtant, ainsi qu'il a été vu, l'adoption de normes peut être lourde de conséquences pour celles-ci. On arrive donc au paradoxe que souligne le rapport précité du Sénat : « le payeur final est absent de l'élaboration des règles qui sont à l'origine des coûts », cette absence pouvant d'ailleurs être considérée comme l'une des causes du coût des normes pour les collectivités territoriales. a) Le processus de normalisation Le processus de production de normes obéit à une logique technicienne exigeant des compétences spécialisées. Son organisation, qui reflètent les différents secteurs d'activité économique, est de fait verticale, qu'il s'agisse de la réglementation ou de la normalisation. · La réglementation organisée par les administrations techniques Ainsi que le rappelle le rapport précité de l'IGA, « l'élaboration des règles techniques par les services de l'État obéit à une division du travail qui s'opère entre les administrations techniques distinctes ». S'agissant des collectivités territoriales, celles-ci sont plus particulièrement concernées par la réglementation édictée par le ministère de l'intérieur (DGCL, direction de la défense et de la sécurité civile, direction des libertés publiques et des affaires juridiques), le ministère de l'environnement (direction de l'eau, direction de la prévention des pollutions et des risques), le ministère de la jeunesse et des sports (direction des sports). Nullement exhaustif, cet inventaire traduit la diversité des producteurs de règles techniques qui concernent les collectivités territoriales. Or, chaque administration a pour vocation au demeurant légitime de faire prévaloir les préoccupations de son secteur d'activité. Dès lors, des points de vue divergents peuvent exister entre les différentes services techniques qui ne sont pas toujours arbitrés en raison des cloisonnements administratifs. Ainsi que l'a remarqué M. Pierre Méhaignerie : « dans un système très verticalisé, chaque chef de bureau n'est attentif qu'à ce qui relève de sa compétence. Nous aboutissons à des additions de coûts qui deviennent insupportables pour le contribuable, national ou local ». Cependant, il convient de préciser que les positions divergentes des administrations sont arbitrées par la sous-direction de la normalisation, de la qualité et de la propriété industrielle du ministère de l'industrie. Celle-ci, après consultation du groupe interministériel des normes, prévu par le statut de la normalisation36 et composé des responsables ministériels pour les normes désignés par chaque ministère intéressé, définit la politique des pouvoirs publics en matière de normes et s'assure de la cohérence des actions des différents intervenants. · La normalisation professionnelle La normalisation repose, elle aussi, sur une organisation sectorielle. L'organigramme de l'AFNOR est fondé sur une séparation en grands secteurs d'activité économique. La prise en compte des différents intérêts en cause lors de l'élaboration des normes s'opèrent au sein des 26 bureaux de normalisation, chacun spécialisé dans un domaine, qui chapeautent 1 200 commissions de normalisation dans lesquelles interviennent au total près de 30 000 experts. À l'issue du processus, l'AFNOR homologue les normes françaises. Le Comité européen de normalisation est organisé selon un schéma voisin. Une douzaine de forums de discussion correspondent aux bureaux de normalisation français. Les normes sont élaborées par consensus par les experts issus des différents secteurs d'activité au sein de quelque 400 comités techniques. De fait, en France comme au niveau européen, la normalisation est une affaire de techniciens aux compétences extrêmement spécialisées. Cependant, l'État n'est nullement étranger à l'activité normalisatrice. Si les institutions de normalisation bénéficient d'une large délégation de prérogatives de puissance publique, le ministère chargé de l'industrie conserve la tutelle de l'AFNOR. b) La faible participation des collectivités locales à l'élaboration des normes Le point de vue des collectivités territoriales n'est pas vertical mais transversal, par rapport à l'organisation technicienne de production de normes, puisqu'il porte sur les secteurs d'activité les plus divers. De plus, l'intérêt des finances locales se fond souvent dans la masse des enjeux économiques sous-jacents à la normalisation. Beaucoup de normes sont en effet loin de ne s'appliquer qu'aux collectivités territoriales. De fait, il est difficile pour les collectivités territoriales à la fois de suivre le processus et de faire entendre leur voix en son sein. Ainsi que le note le rapport précité de l'IGA : « la dimension transversale, politique et financière de l'impact d'une règle technique pour les collectivités territoriales est insuffisamment prise en compte, faute souvent d'avoir été portée par un des participants au processus d'élaboration ». Cette faible association, qui se traduit par l'absence d'étude de l'impact financier des normes est l'une des causes du coût de celles-ci pour les collectivités territoriales. · L'insuffisante représentation des collectivités territoriales dans les instances de normalisation Dans le processus de normalisation, les faiblesses de la représentation des collectivités territoriales sont nombreuses, Sans doute le conseil d'administration de l'AFNOR fait-il place depuis 1996 à un représentant de l'AMF, mais sa légitimité peut-être contestée alors que la norme est déjà arrêtée, à l'instar de ce qui s'est produit en 1997 dans l'affaire emblématique de la norme d'hygiène des bacs à sable37 . De même, si un comité de concertation « normalisation et collectivités locales », présidé par M. Jean Auroux et regroupant des représentants des collectivités territoriales (AMF, ADF, ARF notamment), de l'État et de l'AFNOR, a été créé en 2000, son influence est encore limitée. De plus, cette faible représentation des collectivités territoriales au sein de l'AFNOR a pour conséquence que leurs positions ne sont pas relayées dans les instances internationales et européennes de normalisation. L'une des raisons majeures de cette sous-représentation des collectivités territoriales dans le processus de normalisation, ainsi que le note le rapport précité de l'IGA, tient au fait que « les domaines précis de la normalisation pour lesquels la spécificité des collectivités est incontestable ne sont pas connus des élus ». En effet, les élus doivent être capables d'identifier par eux-mêmes, au sein des 1 200 commissions de normalisation de l'AFNOR ou des 400 comités techniques du CEN, lesquels élaborent les normes qui leur sont applicables. De fait, seules « les collectivités territoriales de taille importante n'ont pas de réelle difficultés à connaître les normes qui leur sont applicables. Certes, les moyens financiers viennent à leur manquer parfois pour se mettre à niveau mais du moins disposent-elles du savoir-faire technique pour identifier, dans le champ des prescriptions techniques, celles qu'elles doivent appliquer. En réponse, beaucoup de grandes collectivités ont d'ores et déjà renforcer leurs services techniques et juridiques en intégrant la fonction de veille ». Connaissant les normes qui leur sont applicables, elles sont mieux à même de réagir lorsque de nouvelles normes sont en cours d'élaboration. Cette observation s'inscrit dans un débat plus large relatif à la taille critique des collectivités territoriales, et en particulier, des communes. Cependant, il faut aussi être conscient que les collectivités territoriales n'ont pas toutes les mêmes compétences, et celles-ci sont parfois éclatées entre plusieurs niveaux, nuisant ainsi à la cohérence de leur action dans le processus de normalisation. S'agissant de la procédure d'élaboration des règles techniques (et non plus des normes professionnelles), l'administration doit en principe consulter en amont les collectivités territoriales. Chaque ministère technique, dès lors qu'il est chef de file, se doit de procéder aux consultations utiles. Dans plusieurs secteurs sensibles, des organes de concertation ont même été institués dans ce but. Les collectivités territoriales sont ainsi représentées au comité national de l'eau, au conseil national du bruit, au conseil national des opérations funéraires ou encore à la commission nationale du sport de haut niveau38 . Cependant, ainsi que le note le rapport précité de l'IGA, « les représentants des collectivités locales ne sont pas systématiquement consultés par les services de l'Etat dès lors qu'aucune procédure n'est prévue par les textes ». L'entrée en vigueur du traité de Maastricht, en instaurant le comité des régions, composé de représentants des diverses collectivités régionales des Etats membres, les collectivités territoriales françaises y désignant 24 représentants, et en imposant la consultation préalable sur des projets de textes dans des cas qu'il énumère limitativement, a permis d'associer ces collectivités aux processus de décision à Bruxelles. Cependant, le même rapport note que « le comité des régions institué pour représenter les collectivités décentralisées n'a pas choisi de faire de la maîtrise de la prolifération des normes techniques imposées aux collectivités locales un axe fort de son action ». On observe d'ailleurs que la plupart des avis qu'il rend sur des sujets techniques, tels que la qualité des eaux ou l'évaluation des incidences sur l'environnement, penchent en faveur d'un renforcement de la réglementation. De plus, « le souci des finances locales apparaît rarement, s'effaçant devant des considérations de santé publique, de protection de l'environnement et des consommateurs ». · L'insuffisante prise en compte par l'État des préoccupations des collectivités territoriales Ainsi qu'il a été dit, ces intérêts ne sont pas univoques, et varient en fonction des niveaux de collectivités. De fait, ces intérêts sont difficiles à appréhender par l'administration de l'État, qui se heurte à des obstacles aussi divers que la représentativité des associations d'élus ou l'absence de méthode pour évaluer l'impact des normes nouvelles. Mais ces difficultés ne peuvent justifier que l'État abandonne à une logique purement technicienne le soin de fixer le niveau des charges imposées aux collectivités territoriales. Or, ainsi que l'indique le rapport précité de l'IGA, « au ministère de l'intérieur, la DGCL n'est pas la plus en pointe sur ce sujet qui touche pourtant le cœur des intérêts locaux. Faute de moyen, elle ne peut suivre l'ensemble des travaux du groupe interministériel. De fait, elle est peu présente dans les négociations. En conséquence, la voix du ministère de l'intérieur se confond le plus souvent avec celle de la direction de la défense et de la sécurité civiles, dont les préoccupations peuvent être en contradiction avec la position des collectivités locales et sont en tout état de cause très spécialisées. Paradoxalement, le ministère de l'intérieur revêt le rôle, en interministériel, d'une administration entièrement vouée à une logique technicienne et règlementaire. Il n'apparaît quasiment jamais comme le porteur de préoccupations locales ». Dès lors, faute d'une coordination des différentes positions des services au sein du ministère chargé des collectivités territoriales, la prise en compte des intérêts locaux dans la normalisation, déjà faible dans les discussions interministérielles, n'est plus assurée dans les négociations internationales. En matière de réglementation, l'administration a des difficultés à représenter les collectivités territoriales. La DGCL est certes plus présente à l'égard de la réglementation que de la normalisation. Il demeure que, comme le note le rapport de l'IGA, « face aux experts des administrations techniques, les administrateurs du ministère de l'intérieur ne disposent pas toujours de la compétence nécessaire. Quant aux techniciens, ils auront tendance à perdre de vue les enjeux généraux au profit de considérations purement techniques ». De manière plus générale, l'élaboration des normes ne fait l'objet, en France, mais également au niveau communautaire, d'aucune étude d'impact préalable en matière de coût. Ainsi que l'a rappelé M. Jacques Pélissard s'agissant de la mise aux normes des réseaux de distribution d'eau en plomb : « l'investissement est-il à la mesure des bénéfices sanitaires attendus ? L'analyse coût-avantages n'a jamais été effectuée. Le même constat pourrait être fait pour les normes en matière d'eau potable, d'emballages ou d'incinération ». C'est pourquoi M. Pierre Méhaignerie a estimé : « Les normes, c'est très bien, mais il y a un moment où il faut peser les avantages et les inconvénients. L'État doit réfléchir avant d'édicter ou d'homologuer de nouvelles normes ». Cependant, ainsi que l'a souligné M. Robert Hertzog, « certains pays se sont dotés de « budgets de normes » et l'OCDE a développé toute une méthodologie en la matière : l'État ne peut émettre de nouvelle norme que pour autant que celle-ci ne se traduise pas par une dépense supplémentaire excessive pour telle catégorie de personnes ou entreprises. Les normes environnementales aux États-Unis ont ainsi fait l'objet de calculs très précis. Ces études, même sans être scientifiquement très satisfaisantes, pourraient représenter, au moins sur le plan intellectuel, un progrès non négligeable pour le Parlement ». · La conséquence : des normes s'imposant sans concertation, ni étude d'impact financier En conséquence, non seulement les normes ne tiennent aucun compte des contraintes spécifiques pesant sur les collectivités territoriales, mais celles-ci sont mises devant le fait accompli. Ainsi que le remarque le rapport du Conseil d'Etat, à propos des normes techniques d'origine communautaire, « l'absence, en amont de leur adoption, de toute mesure des effets financiers des textes communautaires et de toute information préalable des collectivités territoriales sur leur discussion font que ces dernières sont mise devant le fait accompli ». Elles découvrent le plus souvent tardivement ces obligations, une fois qu'elles ont été transposées en droit français et ne mesurent l'impact financier qu'une fois l'investissement effectué, si bien que les plaintes des élus sont, dans la grande majorité des cas, formulées a posteriori, alors que la norme est déjà entrée en vigueur. Or, les dates d'entrée en vigueur de ces nouvelles normes sont fixées sans tenir compte de leur capacité à financer les investissements nécessaires. Elles présupposent que les collectivités territoriales, mais aussi l'État qui cofinance, seront, en toutes circonstances, capables de dégager les financements nécessaires et que les usagers pourront faire face aux éventuelles hausses de tarif qui en résulteront. Pour M. Pierre Méhaignerie, bien qu'il ait choisi des normes d'origine nationale, « l'exemple du SDIS est une caricature. Je suis heureux de ne pas avoir voté cette réforme proposée par le ministre de l'intérieur de l'époque. Elle portait en germe tous les excès actuels, le ministère décidant des normes et laissant les élus, et si possible les départements, en assumer la responsabilité financière ». Cependant, l'implication des collectivités territoriales dans le processus de normalisation et de réglementation ne va pas de soi, non seulement à cause de la complexité du processus mais également parce qu'elle demande un effort conséquent de leur part. En effet, ainsi que l'écrivait au début des années 90 les responsables du service des études et techniques locales de la DGCL : « cette implication nécessite sans attendre, de la part des collectivités locales, de gros efforts avant d'en recueillir les fruits : en matière de formation des hommes de dégagement de moyens de s'informer et suivre les travaux de normalisation, de coordination et de répartition des tâches entre les collectivités locales de façon à participer à toute la chaîne normative, de la définition des programmes et des stratégies à l'élaboration concrète des normes »39 . Ce constat ancien semble avoir fait son chemin puisque M. Jacques Pélissard a déclaré : « l'État mais aussi l'Association des maires de France et l'ensemble des collectivités territoriales doivent cesser d'attendre benoîtement que les normes s'appliquent et se montrer plus actifs là où ces normes sont produites, en particulier sur le terrain bruxellois ». 16 La Commission a été choquée de l'usage de ce mot par les fonctionnaires du Conseil régional. 17 Rapport A.N. n°2387, p. 243-244. 18 in : Constitution et finances publiques, Économica, 2005. 19 C'est le cas pour 225 pays. 20 Rapport de l'Observatoire des finances locales, 2004. 21 « Évaluation des effets des régimes de coopération intercommunale sur les dépenses publiques locales », Document de travail du CREM, 2004. 22 Matthieu Leprince, Superposition des niveaux de collectivités locales et comportements de dépenses publiques. Le cas de la coopération intercommunale en France. Thèse de doctorat en sciences économiques, dir. Alain Guengant, Université de Rennes I, 2001. 23 Alain Guengant et Matthieu Leprince, Évaluation des effets des régimes de coopération intercommunale sur les dépenses publiques locales, document de travail du CREM, Université de Rennes I, 2004. 24 Source : Ressources humaines intercommunales, ADCF, CNFPT, octobre 2004. 25 Matthieu Leprince, Pouvoirs locaux, n° 64 I/2005. 26 « Réforme des impôts-ménages : entre le nécessaire et le possible », Pouvoirs Locaux, n° 64 I/2005. 27 Cf. Conseil d'État, 29 décembre 1997, Commune de Gennevilliers et Commune de Nanterre : « eu égard à l'intérêt général qui s'attache à ce qu'[un] conservatoire de musique puisse être fréquenté par les élèves qui le souhaitent, sans distinction selon leurs possibilités financières, [un] conseil municipal [peut], sans méconnaître le principe d'égalité entre les usagers du service public, fixer des droits d'inscription différents selon les ressources des familles, dès lors notamment que les droits les plus élevés restent inférieurs au coût par élève du fonctionnement de l'école. » 28 cf. Rapport d'information de M. Hervé Novelli sur l'évaluation des conséquences économiques et sociales de la législation sur le temps de travail, n° 1544, déposé le 14 avril 2004. 29 Rapport d'information n° 166 (1999-2000) sur « la sécurité juridique des actes des collectivités locales et les conditions d'exercice des mandats locaux », présenté par M. Michel Mercier. 30 Il convient cependant de noter que la loi n°200-647 du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnels a apporté une nouvelle définition des infractions non intentionnelles qui limite les possibilités de mettre en cause les élus locaux. 31 « Les conséquences des normes techniques pour les collectivités locales », la Documentation française, 2000. 32 « Collectivités locales et obligations communautaires, étude du Conseil d'État, La documentation française, 2003 p. 38,39. 33 « Les coûts de la réglementation environnementale », David Litvan, Regards sur l'actualité, mai 1997, La Documentation française. 34 Rapport d'information n°2295 présenté par MM. Denis Merville et Henri Nayrou, députés, sur « les normes édictées par les fédérations et les ligues sportives », mai 2005. 35 Rapport annuel de l'observatoire national de la sécurité des établissements scolaires et d'enseignement supérieur, 1997. 36 Statut fixé par le décret n°84-74 du 26 janvier 1984 modifié. 37 Une norme avait été adoptée par l'AFNOR dans ce domaine suite à un processus de concertation avec le représentant des collectivités territoriales qui se trouvait être un ingénieur de la ville de Paris. Or, cette norme, qui était adaptée aux grandes villes disposant de la compétence technique et des moyens nécessaires, était complètement inappropriée pour les petites communes en raison de ses coûts de mise en œuvre. En conséquence, certaines communes ont protesté et préféré faire bétonner leurs bacs à sable... 38 Décrets respectifs n°65-749 du 3 septembre 1965 modifié, n°82-538 du 7 juin 1982, n°93-905 du 13 juillet 1993 et n°93-1034 du 31 août 1993. 39 « La normalisation européenne et les collectivités locales », Pierre Roussel et Claude Chaussoy, AJDA, 20 décembre 1991. © Assemblée nationale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||