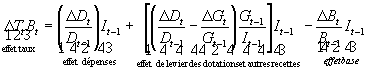La résolution créant la Commission d'enquête l'engage à apprécier « les conditions d'une responsabilité mieux assumée de l'ensemble des décideurs ». Les constatations faites permettent de porter une appréciation sur les pistes de réformes, à l'étude ou évoquées devant la Commission. Elles peuvent également inspirer des propositions. Quatre directions d'avenir peuvent être tracées, portant sur les réformes fiscales, sur le pilotage macroéconomique du système financier local, sur la mesure de la performance et sur quelques pistes de bonne gestion issues du témoignage de représentants de collectivités territoriales. A.- QUELLES RÉFORMES POUR LE SYSTÈME FISCAL LOCAL ? 1.- La difficile révision des valeurs locatives cadastrales « Les valeurs locatives sont-elles encore réformables ? Disons-le : plus le temps passe, plus la réforme devient impossible dans la mesure où les écarts entre les situations initiales et la situation actuelle ne font que s'amplifier. » a estimé M. Alain Guengant, directeur de recherche au CNRS et professeur à l'Université de Rennes 1, au cours de l'audition du 8 mars dernier. « Elle était déjà difficile en 1990, au point que le Parlement a plusieurs fois reporté sine die l'intégration des nouvelles valeurs cadastrales dans les rôles ; c'est encore plus vrai aujourd'hui, au point d'être devenu politiquement irréalisable compte tenu de l'amplification des transferts de charges. » « Nous n'avons toujours pas réussi à mettre en place la réforme des valeurs locatives. Serpent de mer, me dira-t-on ; encore faut-il en parler... » a déclaré M. Gilles Carrez, Président du Comité des finances locales, au cours de l'audition du 8 juin dernier. « Je me prends parfois à rêver à ce que nous aurions pu faire si, voilà quinze ans, plutôt que de chercher à faire « le grand soir », nous nous étions astreints chaque année, comme nous le faisons pour les immeubles neufs, à réviser les valeurs locatives à chaque mutation de propriété. Moyennant une « clause balai » prévoyant une révision obligatoire pour les immeubles n'ayant pas fait l'objet de mutation pendant tout ce temps, nous nous serions retrouvés au bout de dix ou quinze ans avec un système à peu près satisfaisant... Mais même cela, nous ne l'avons pas fait. » Faut-il renoncer définitivement à la révision des valeurs locatives ? Si le « grand soir » des valeurs locatives n'est certes plus à l'ordre du jour, quelques pistes sont envisageables pour moderniser ces valeurs et les rendre plus équitables. a) Les limites des opérations périodiques de révision générale Les valeurs locatives sur lesquelles sont assis en totalité ou en partie les impôts directs locaux sont actuellement déterminées en fonction de valeurs fixées en 1961 pour le foncier non bâti et en 1970 pour le foncier bâti et la taxe d'habitation. Des actualisations sont intervenues en 1970 pour le foncier non bâti et en 1980 pour l'ensemble des propriétés. Depuis 1981, seuls des coefficients nationaux annuels de revalorisation forfaitaire ont été appliqués. Ces coefficients ne reflètent évidemment pas de manière satisfaisante l'évolution des loyers, nécessairement différenciée au niveau. Dès lors, ces valeurs locatives sont très éloignées de la réalité du marché locatif immobilier. Cette inadaptation des bases est source d'iniquités. La loi du 30 juillet 1990 a fixé le principe d'une révision générale des valeurs locatives servant de base au calcul des impôts locaux, mais face à l'ampleur des transferts de charge entre contribuables induits par la révision, les nouvelles évaluations cadastrales n'ont pas été intégrées. Cependant, le besoin d'actualiser les valeurs locatives cadastrales fait l'objet d'un large consensus, dans une perspective de justice fiscale mais aussi de bonne allocation des ressources entre collectivités, car le potentiel fiscal, principal critère de répartition des dotations de l'État, est calculé sur la base des valeurs locatives. Il apparaît aujourd'hui que le choix consistant à effectuer périodiquement des révisions générales, nécessairement lourdes, a montré ses limites, alors que des opérations ponctuelles d'évaluation des logements neufs ou de réévaluations pilotées au niveau local par les communes et les services fiscaux interviennent régulièrement dans des conditions satisfaisantes. b) Quelques pistes envisageables Une première piste consisterait à donner aux collectivités territoriales la possibilité d'opter pour l'introduction des nouvelles bases issues de la révision de 1990, avec la possibilité d'en moduler les effets. La Commission pour l'avenir de la décentralisation, présidée par M. Pierre Mauroy, a proposé de transférer au maire la responsabilité de procéder ou non à la révision des valeurs locatives de sa commune. Les communes pourraient opter pour la mise en œuvre de la révision de 1990, avec la possibilité d'en moduler les effets en modifiant les secteurs d'évaluation et en appliquant des tarifs par secteurs locatifs moins élevés que ceux fixés dans le cadre de la révision. Une autre piste pourrait consister à renoncer définitivement à l'introduction de la révision de 1990, en mettant en place un nouveau dispositif de mise à jour permanente des bases de 1970 dont l'initiative incomberait à l'administration fiscale. Il s'agirait de donner à celle-ci les moyens d'une politique plus active de mise à jour des données. L'institution d'une obligation déclarative au titre des changements de caractéristiques physiques permettrait de mieux tenir compte des changements de caractéristiques physiques des locaux. Les propriétaires de locaux d'habitation pourraient être tenus d'effectuer de nouvelles déclarations descriptives des locaux, soit à l'occasion d'aménagements importants, soit lors des mutations. Comme l'a indiqué Mme Marie-Christine Lepetit, Directrice de la législation fiscale, au cours de l'audition du 26 mai dernier : « l'administration constate (...) qu'elle a trop rarement la possibilité d'obtenir un rafraîchissement des données permettant de mettre à jour les valeurs locatives. Mais le droit est ainsi : personne ne peut obliger un locataire ou propriétaire à déclarer les aménagements qu'il a réalisés, même lorsqu'il vend. De très nombreux travaux sont de nature à changer les valeurs locatives, mais sans pour autant déclencher juridiquement d'obligation de déclaration. (...) Une mise à jour plus au fil de l'eau, plus pertinente, plus partagée, plus transparente vis-à-vis des contribuables passe, de mon point de vue, par un système déclaratif enrichi - et donc des sujétions supplémentaires pour les contribuables. Mais sachant que nous partons à peu près de zéro, il doit être possible d'en faire un petit peu plus... » Une actualisation « au fil de l'eau » des valeurs locatives par l'administration fiscale permettrait à la fois de les moderniser et de les rendre plus équitables. Cependant, l'obsolescence des valeurs locatives n'est pas la source de tous les maux de la fiscalité locale. Comme l'a souligné la Directrice de la législation fiscale au cours de la même audition, si le niveau des impôts directs locaux est souvent jugé trop élevé eu égard aux facultés contributives de certains contribuables, on entend souvent dire : « C'est parce que les bases foncières ne sont pas bonnes ». « Les bases sont effectivement perfectibles, (...) mais je ne crois pas que la pierre philosophale soit à trouver dans une éventuelle future réforme des bases locales. Vous habitez un appartement pour lequel vous payez un loyer. Arrive un impôt une fois l'an. Si vous le trouvez très élevé au regard de votre loyer, disproportionné dans votre perception de ce que sont vos ressources et de ce que vous payez par ailleurs et que, par-dessus le marché, vous jugez que les services publics locaux ne fonctionnent pas, ce n'est pas en modifiant la valeur locative, en supprimant les quatre mètres carrés que vaut la baignoire et en ajoutant un coefficient d'environnement de 0,8 ou autre, bref en corrigeant cette « usine à gaz » pour la rendre plus claire, plus transparente et plus conforme aux valeurs actuelles, que l'on atténuera ce sentiment de disproportion ! La réponse n'est pas dans les valeurs locatives. Je ne dis pas qu'il ne faille pas les améliorer, mais cela ne réglera pas notre problème de montant et de niveau [des impôts]. » Entendu le 14 juin dernier par votre Commission d'enquête, M. Jean-François Copé, ministre délégué au budget et à la réforme de l'État, a indiqué, qu'il était d'accord, sur la nécessité de mettre à jour les valeurs locatives : « La situation actuelle est évidemment un scandale, avec des HLM dont la valeur locative est beaucoup plus élevée que celle d'un sympathique pavillon ! Le problème est de trouver ceux qui viendront avec moi pour assumer les transferts de charges, très lourds, qui donneront inévitablement lieu à des polémiques chez ceux qui y perdront, tandis que ceux qui y auront gagné ne diront rien. La seule solution est d'y aller très progressivement, comme on l'a fait pour la taxe professionnelle unique. Je suis en tout cas d'avis d'ouvrir ce chantier et je suis à votre disposition pour y travailler avec vous. » 2.- Quelle réforme pour la taxe professionnelle ? S'agissant de la réforme de la taxe professionnelle, votre Rapporteur a retenu deux grandes options principales. La première propose une réforme de l'assiette de l'impôt et reprend pour l'essentiel les conclusions du « rapport Fouquet ». La seconde cible le problème des entreprises dont la cotisation de taxe professionnelle dépasse le plafond théorique des 3,5 % de la valeur ajoutée. a) Une réforme dans la lignée des conclusions du « rapport Fouquet » : · Deux assiettes : valeur ajoutée et valeurs locatives foncières Deux objectifs sont au cœur de cette réforme : la modernisation de l'assiette conformément aux préconisations du « rapport Fouquet » destinée à rendre plus équitable la répartition de la charge de l'impôt entre les différents secteurs d'activité et un allégement « substantiel et permanent » de la charge fiscale des entreprises. Dans la mesure où les inconvénients du régime actuel sont essentiellement occasionnés par la taxation des équipements et biens mobiliers (EBM), la « commission Fouquet » propose la suppression de cet élément d'assiette. En revanche, elle propose de conserver l'élément de l'assiette constitué par la valeur locative foncière, qui assure un lien direct entre la localisation physique des entreprises et l'imposition. L'assiette mixte actuelle de la taxe professionnelle serait donc abandonnée. La taxe professionnelle serait remplacée par deux impositions distinctes : une imposition assise sur la valeur ajoutée, et une imposition assise sur les valeurs locatives foncières. Comme l'a expliqué Mme Marie-Christine Lepetit, Directrice de la législation fiscale, devant votre Commission le 26 mai dernier, « cet impôt pourrait respecter l'objectif économique de mieux répartir la charge contributive par catégories d'entreprises, tout en préservant des ressources stables et dynamiques pour les collectivités territoriales. Une manière d'y parvenir serait un panachage, permettant de conserver au futur impôt une assise foncière forte tout en ajoutant une part d'assiette sur un solde de gestion. Sur ce point particulier, plusieurs possibilités ont été évoquées ; M. Olivier Fouquet privilégiait plutôt la valeur ajoutée, après avoir comparé les avantages et les inconvénients des différentes formules possibles. » Afin de restaurer un lien fiscal fort entre territoires et entreprises, il est indispensable que la nouvelle assiette d'imposition soit entièrement localisable sur le territoire de chaque collectivité territoriale. La valeur ajoutée, qui est calculée au niveau de l'entreprise, serait donc répartie entre les différents établissements en fonction d'une clé de répartition simple définie par référence à des éléments représentatifs et localisés des facteurs de production tels que la valeur locative foncière et les effectifs. S'agissant des taux, la Commission a préconisé l'application d'un taux local d'imposition voté par les collectivités, ce qui leur permettrait de conserver la maîtrise du niveau de leurs ressources fiscales. Le taux de l'imposition assise sur la valeur ajoutée serait fixé par chaque collectivité dans les limites d'un taux plancher et d'un taux plafond, cette fourchette étant décidée au niveau national et fixée pour chaque niveau de collectivité. Cet encadrement national des taux d'imposition permettrait de limiter les écarts de taux entre territoires et éviterait l'apparition, localement, de situations de sur-imposition ou de sous-imposition. Pour la taxe assise sur la valeur locative foncière des entreprises, le taux actuel de la taxe professionnelle serait maintenu, et fixé par les collectivités selon les règles actuellement en vigueur. La commission a proposé d'étaler la mise en œuvre de la réforme sur une période de 10 ans pour lisser dans le temps la variation de la pression fiscale supportée d'une année sur l'autre par chaque entreprise. Les scénarios envisagés semblent plutôt prévoir une application complète de la réforme dès la première année, c'est-à-dire, en 2008 afin de permettre aux entreprises qui sont aujourd'hui surimposées de bénéficier tout de suite de l'allégement associé à la modernisation de l'assiette. · Deux impératifs : éviter les collectivités perdantes, alléger le prélèvement Pour les collectivités territoriales, une contrainte forte doit être respectée : chacune doit disposer après la réforme d'un montant de ressource équivalent, toutes choses égales par ailleurs, à celui dont elle disposait avant la réforme. Or, la mise en œuvre de la réforme se traduirait par des transferts de base imposable entre collectivités, principalement du fait du changement d'assiette, qui modifierait la répartition territoriale des bases imposables. Il conviendrait donc de mettre en place un mécanisme de compensation permettant de neutraliser les pertes de produit de toutes les collectivités perdantes. La neutralité budgétaire de la réforme pour les collectivités serait assurée de la façon suivante : - l'année de mise en place de la réforme, les collectivités fixent leur taux d'imposition locale d'activité en fonction du produit de l'année précédente. Si ce taux est inférieur à la limite inférieure de la fourchette, il est porté à cette limite ; s'il est supérieur, il est ramené à cette limite supérieure ; - les collectivités qui doivent appliquer la borne supérieure bénéficient d'une compensation de leurs pertes par recyclage des excédents prélevés sur les collectivités qui devront fixer leur taux à la borne inférieure. On voit bien en quoi ce mécanisme de compensation aboutit à « récompenser le vice, et à pénaliser la vertu ». Concrètement, les collectivités qui imposent le moins les entreprises seraient tenues d'augmenter leur prélèvement, le surcroît de recettes résultant de cette augmentation étant versé aux collectivités « surfiscalisées », tenues de ramener leur prélèvement au plafond. - les taux « plafond » et « plancher » seraient déterminés au niveau national de telle sorte que le montant des produits excédentaires soit équivalent au montant des produits à prélever. Dans le système actuel, l'État prend en charge 2 milliards d'euros de cotisation à la place des entreprises, essentiellement au titre du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée et sans tenir compte du dégrèvement des investissements nouveaux qui devrait coûter 2,8 milliards d'euros à l'État en 2007. Cet effort de l'État de 2,8 milliards d'euros pourrait être pérennisé. Dans un premier temps, le montant correspondant au coût total de la taxe professionnelle pour l'État en 2008 (4,8 milliards d'euros au total) pourrait être consacré au financement du dédommagement des perdants. Il pourrait, dans un second temps, bénéficier à l'ensemble des entreprises sous la forme d'un allégement général du produit de l'impôt. Les entreprises bénéficieraient ainsi d'un allégement global de 3,2 milliards d'euros de leur charge de taxe professionnelle entre 2004 et 2008. · Des effets secondaires dommageables Les principaux problèmes posés par cette réforme sont les suivants : - la réintroduction des salaires dans l'assiette de l'impôt par le biais de la valeur ajoutée pourrait pénaliser l'emploi, en tout cas c'est ce que les adversaires de la réforme ne manqueraient pas de critiquer. Cependant, comme il a été indiqué plus haut, la taxe professionnelle, quand bien même elle n'est plus assise sur les salaires, pénalise l'investissement mais aussi l'emploi à plus long terme. De plus, elle taxe déjà les salaires lorsque l'assiette valeur ajoutée se substitue à l'assiette traditionnelle ; - la complexité du mécanisme de « tunnellisation » des taux et les effets pervers, mentionnés plus haut, qu'il entraînerait ; - le grand nombre d'entreprises « perdantes » : 540 000 entreprises verraient leur cotisation augmenter de plus de 10 %. 400 000 entreprises risqueraient de voir leur cotisation augmenter de plus de 50 %. Dans ces conditions, il serait indispensable de garantir que la réforme ne peut avoir pour effet d'augmenter la charge fiscale acquittée par une entreprise de plus de 10 % et d'instaurer à cette fin un mécanisme de dégrèvement individualisé et dégressif (qui pourrait être mis en œuvre sur 10 ans) afin de lisser la hausse de cotisation induite par le changement d'assiette. Comme l'a expliqué M. Jean-François Copé, Ministre délégué au Budget et à la réforme de l'État, entendu le 14 juin dernier par votre Commission, « chacun doit être mis devant ses responsabilités. Il faut savoir ce que l'on veut. Depuis des années, on critique cet impôt. Nous proposons une solution : changer d'assiette. Si nous introduisions la valeur ajoutée pour 80 % -, 540 000 entreprises verraient leur cotisation augmenter de plus de 10 %. Cela fait beaucoup... d'autant qu'à chaque réforme de ce genre, ceux qui en bénéficient réagissent généralement assez peu alors que les autres sont furieux ! On pourrait compenser cette perte et imaginer un dégrèvement, en tout ou en partie, au-delà de 10 %. Mais la réglementation européenne interdit un dégrèvement pérenne ; il faut donc prévoir un rendez-vous périodique, d'ici à cinq, dix ou quinze ans, avec tous les problèmes que cela entraîne. » Compte tenu de ces éléments, le Ministre délégué au Budget et à la réforme de l'État a souligné à très juste titre que « Tout cela est assez complexe et ne peut se concevoir que dans une logique pleinement consensuelle. » Or, « la difficulté de cette réforme tient au fait que c'est un jeu à plusieurs acteurs : l'État, les entreprises, les collectivités territoriales. » b) La seconde catégorie d'options serait ciblée sur les entreprises qui acquittent une cotisation de taxe professionnelle supérieure à 3,5 % de leur valeur ajoutée Le plafonnement de la taxe professionnelle a pour objectif d'éviter que des entreprises supportent, du fait de l'importance de leur base imposable ou du niveau des taux locaux d'imposition, une charge fiscale excessive par rapport à leur valeur ajoutée. Comme il a été indiqué dans la deuxième partie ci-avant, ce dispositif est toutefois applicable dans la limite des taux pratiqués en 1995, l'accroissement des cotisations occasionné par les augmentations de taux intervenues depuis lors étant mis à la charge des entreprises. De ce fait, 41 % des entreprises plafonnées - soit 9,1 % du nombre total d'entreprises - subissent une imposition effective supérieure à 4 % de leur valeur ajoutée, pour un montant de cotisations excédant le plafond évalué à 1,1 milliard d'euros en 2003. On peut considérer que cette situation inéquitable constitue le premier problème posé par la taxe professionnelle actuellement et doit être réglée en priorité. Par conséquent, « Il y (...) a une autre option, » a indiqué M. Gilles Carrez, Président du Comité des finances locales, au cours de son audition le 8 juin dernier, « évoquée à maintes reprises et notamment par le Président Augustin Bonrepaux, qui part du principe suivant : le problème tient d'abord aux entreprises plafonnées, et particulièrement dans l'industrie. C'est ainsi que nos deux principaux constructeurs automobiles sont, du fait de leur chiffre d'affaires élevé, théoriquement plafonnés à 4 %. Or, ils paient une taxe professionnelle supérieure à ces 4 %, tout simplement parce que le dégrèvement a été gelé sur la base des taux de 1995 (...), depuis une réforme à laquelle nous avons été quelques-uns ici à participer, alors que le taux a pu sensiblement augmenter depuis. Le « cœur de cible » du problème posé n'est-il pas, précisément, les entreprises qui, manifestement, paient trop de taxe professionnelle par rapport à leur valeur ajoutée ? » Dans ces conditions, a estimé M. Jean-François Copé, au cours de l'audition précitée, « Il pourrait y avoir une [autre] option, qui consisterait à cibler la réforme sur les seules entreprises actuellement imposées au-delà de 3,5 % de leur valeur ajoutée - soit en abaissant le plafond, soit en « rafraîchissant » l'année de référence qui sert de calcul au plafonnement actuel en fonction de la valeur ajoutée. [La référence à] l'année 1995 est en effet un peu désuète. La situation des entreprises qui investissent en serait très significativement améliorée. Je tenais à réserver à votre Commission d'enquête la primeur de cette troisième option, dans laquelle je vois une piste intéressante. » Plusieurs propositions, faites notamment par l'Assemblée des départements de France (ADF), ont été avancées en vue de rétablir un plafonnement réel en fonction de la valeur ajoutée, en abaissant le plafond, en supprimant le gel des taux ou bien en actualisant l'année de référence. La suppression du gel des taux induirait un surcoût budgétaire de 1 075 millions d'euros pour l'État. Ce surcoût pourrait être compensé par un relèvement de 0,4 point du taux de la cotisation minimale en fonction de la valeur ajoutée qui passerait de 1,5 % à 1,9 %. L'opposition a présenté une proposition de loi tendant à supprimer la référence au taux de 1995 pour le calcul du dégrèvement, et à compenser le surcoût qui en résulte pour l'État par un relèvement du taux de la cotisation minimale. « Effectivement, » a indiqué le Président Augustin Bonrepaux, au cours de l'audition précitée de M. Jean-François Copé, « il se trouve que nous avions proposé cette (...) option à M. Alain Lambert en loi de finances, juste avant que le Président de la République annonce son intention de réformer la taxe professionnelle... ». Le rétablissement du plafonnement serait favorable aux entreprises du secteur industriel, dont la cotisation baisserait d'environ 0,5 milliard d'euros, tandis que la hausse de la cotisation minimale pèserait, pour moitié, sur les entreprises financières, et pour l'autre, sur les entreprises des secteurs du commerce et des services. Cependant, cette solution pérenniserait un dispositif d'une gestion complexe et conduirait à renforcer fortement la nationalisation de la taxe professionnelle ainsi que le rôle d'intermédiation financière joué par l'Etat, ce qui affaiblirait encore davantage le lien fiscal entre l'activité économique et les territoires. Surtout, « rétablir la vérité » pour [les] entreprises [qui acquittent une cotisation supérieure au plafond théorique de 3,5 % de la valeur ajoutée] ne conduit-il pas à donner une prime aux collectivités qui ont fortement augmenté leur taux depuis 1995 ? » a souligné le Président du Comité des finances locales au cours de l'audition précitée. Ainsi, avec le souci de ne pas récompenser les collectivités qui augmentent le plus leurs taux, M. Gilles Carrez, a proposé de mettre au point « un dispositif en deux articles, le premier disposant qu'aucune entreprise en France ne peut payer plus de 3,5 % de valeur ajoutée et le second qu'à partir du moment où une entreprise paie 3,5 % de sa valeur ajoutée, une augmentation de taux ne s'appliquera pas à l'établissement (...) d'ores et déjà plafonné ? De la sorte, le gisement fiscal constitué par cette entreprise serait rendu inexploitable. Nous introduirions ainsi un mécanisme de responsabilité, ce que nous avions essayé de faire, mais sans réussir, en 1995. » Aucune augmentation de taux votée par une collectivité territoriale ne s'appliquerait à une entreprise dont la charge de taxe professionnelle a atteint le plafond. La mise en œuvre d'un tel dispositif pourrait poser certaines difficultés techniques, dans le cas des entreprises comprenant plusieurs établissements, dans la mesure où la cotisation de taxe professionnelle est acquittée au niveau des établissements et que le plafonnement en fonction de la valeur ajoutée se calcule au niveau de l'entreprise. Ces difficultés ne devraient pas être insurmontables. Cependant, ce dispositif aurait le mérite de renforcer l'équité du système et la responsabilité des collectivités sans encourager des augmentations de taux opportunistes ni renforcer le rôle d'intermédiation financière joué par l'État. Enfin, il semble qu'il puisse faire l'objet d'un consensus plus large que la « réforme Fouquet ». 3.- Faut-il une plus grande spécialisation de la fiscalité locale ? La réflexion en la matière est évidemment très liée aux scénarios de réforme de la taxe professionnelle. « Simplification des structures et spécialisation fiscale : énorme débat, qui, lui aussi, a inspiré les colloques depuis toujours... », a soupiré M. Jean-François Copé, au cours de l'audition du 14 juin dernier. La « commission Fouquet » a estimé qu'un objectif supplémentaire pourrait donner du sens à la réforme de la taxe professionnelle : assurer une plus grande lisibilité au système fiscal en spécialisant les impôts locaux. Le rapport de la commission de réforme de la taxe professionnelle a examiné plusieurs scénarios de spécialisation, dans une fiche reproduite en page 159 du tome III du présent rapport. L'objectif serait qu'un seul pouvoir local s'exerce sur une assiette locale donnée, chaque collectivité devant bien sûr bénéficier d'une assiette fiscale suffisamment large pour empêcher tout risque financier lié à une assiette trop étroite, trop volatile ou trop spécialisée. Actuellement, les impôts locaux se répartissent de la façon suivante entre les différents niveaux de collectivités. Répartition du produit des impôts locaux en 2004 (en milliards d'euros)
Votre Rapporteur a retenu ici l'hypothèse qui consisterait à faire du foncier l'assiette de l'impôt communal et intercommunal. Seraient attribuées aux communes et EPCI la composante « valeur locative foncière » d'un nouvel impôt se substituant à la taxe professionnelle ─ en cas d'application du « scénario Fouquet » ─, l'intégralité des taxes foncières ainsi que la taxe d'habitation. La taxe professionnelle, ou, le cas échéant, la nouvelle imposition assise sur la « valeur ajoutée », serait attribuée aux départements et aux régions. SIMULATION DU SCÉNARIO DE SPÉCIALISATION ENVISAGÉ (SITUATION EN 2008, HORS CROISSANCE DE L'ASSIETTE) (en milliards d'euros)
Les avantages d'une telle réforme seraient les suivants : - le système fiscal serait rendu plus lisible pour le redevable ; - les collectivités seraient responsabilisées sur leur politique fiscale, les effets néfastes de la concurrence fiscale verticale fortement limités ; - le financement des communes et intercommunalités serait assuré par des impôts fonciers, ce qui est conforme à l'analyse économique sur le financement optimal des collectivités territoriales : ce sont en effet les services publics financés par les communes ou groupements intercommunaux qui sont les plus susceptibles d'être capitalisés dans la valeur des biens fonciers, dégageant une rente foncière que la fiscalité ne fait que « récupérer » ; - ce scénario permettrait d'éviter de localiser la valeur ajoutée au niveau communal et intercommunal, ce qui simplifie considérablement la réforme pour les entreprises et l'administration fiscale ; - enfin, il permettrait de réduire le besoin de péréquation entre communes et groupements à fiscalité propre. En effet, les écarts intercommunaux de potentiel fiscal sont principalement dus à la répartition des bases de taxe professionnelle. Le transfert de l'impôt sur la valeur ajoutée à un échelon de collectivité supérieur réduirait donc les écarts de potentiel entre communes et EPCI. Néanmoins, ce scénario présente plusieurs inconvénients : - il prive les départements de tout impôt foncier, alors qu'une partie des services publics qu'ils fournissent contribue à la valorisation des biens fonciers (les routes par exemple) ; - les ressources des départements deviendraient plus cycliques alors que les dépenses dont ils ont la charge évoluent en partie de manière contracyclique ; - le lien fiscal entre entreprises et communes ou EPCI serait distendu. Les EPCI seraient privés de la taxe professionnelle unique qui est aujourd'hui un moteur essentiel du développement de l'intercommunalité ; - enfin, comme tout scénario de spécialisation, il se traduirait par d'importants transferts, soit entre collectivités, soit, au sein d'une même collectivité, entre catégories de contribuables. M. Jean-François Copé, Ministre délégué au Budget et à la réforme de l'État a souligné, au cours de l'audition du 14 juin dernier, les problèmes que pose une telle réforme en insistant sur la difficulté de dégager un consensus sur la formule adaptée : « comment se traduirait la simplification ? Grosso modo, on donnerait l'impôt économique aux régions et aux départements, qui sinon n'auraient rien. On ne peut pas leur attribuer la taxe d'habitation : ce ne serait pas à l'échelle du problème. On laisserait les impôts ménages aux agglomérations et aux communes. Sinon, il n'y a pas de spécialisation : toutes les collectivités ne peuvent pas bénéficier de la TP. Il y a une contradiction fondamentale entre le fait de revendiquer une spécialisation fiscale et celui d'avoir créé la taxe professionnelle unique. La communauté d'agglomération à TPU est déjà un mouvement de spécialisation fiscale remarquable ; on n'imagine pas, alors que nous sommes en plein mouvement de concentration, devoir dire : « C'est fini, ce n'est plus la peine de continuer à faire vos schémas d'alignement de taux sur dix ans, on vous enlève la TPU pour donner toute la taxe professionnelle aux départements et aux régions. » Je le dis peut-être de manière provocante, mais ce sujet est très important et je cherche en gémissant quelle est la bonne formule... (...) « Le Président Augustin Bonrepaux s'inquiétait de mon avenir à l'idée que je me lance dans une réforme non consensuelle de la TP... C'est de la petite bière à côté de la question de savoir s'il faut spécialiser en l'enlevant aux départements ! Je le dis d'autant plus aisément que je suis, tout comme vous, malade de cette situation aberrante, unique en Europe, et totalement inadaptée à la réalité d'un pays moderne. Mais c'est ainsi... La loi Chevènement a malgré tout permis une réforme majeure de l'intercommunalité. L'agglomération, les communautés de communes, cela a tout de même du sens dans des territoires qui, sinon, seraient restés totalement isolés et en butte à une profonde crise d'identité. Il faut vivre avec, et voir comment faire prospérer la réforme. » S'agissant de la spécialisation, Mme Marie-Christine Lepetit, Directrice de la législation fiscale, a indiqué que « le sujet présente, en même temps que des inconvénients, certains avantages qui méritent d'être examinés. ». D'un côté, a-t-elle expliqué, « on ne peut qu'éprouver une forme de séduction intellectuelle à l'idée de clarifier la relation contribuable local-élu local en rendant plus univoque le lien entre un impôt et une collectivité. Par rapport au face-à-face et à l'élément de démocratie que comporte ce choix, il est plus satisfaisant de créer une forme de bijection - pardonnez-moi, je suis ingénieur de formation - que de se retrouver avec un impôt sur lequel quatre niveaux de collectivités votent des taux ou des morceaux de taux. (...) » « En même temps, » a-t-elle estimé, « en y regardant plus en détail, on voit bien naître toute une série de difficultés techniques. Pour commencer, cela fait deux réformes en une : c'est plus lourd, plus compliqué, plus coûteux. Ensuite, dans le choix des possibles, il n'est pas toujours très facile de mettre en regard un niveau de collectivité territoriale et une ressource qui « ressemble » à ses dépenses, pour employer un terme imagé. Et lorsqu'on est content du lien que l'on a cru organiser entre un niveau de collectivité et un impôt, on s'aperçoit souvent que l'on a organisé en même temps d'affreux transferts. « Supposons, par exemple, que l'on veuille faire remonter beaucoup d'impôt foncier au niveau du département, constatant que celui-ci assume un grand nombre de dépenses à caractère social et qu'il devrait bénéficier d'une ressource très stable, très liée aux ménages et aux éléments physiques présents. Mais ce faisant, on va remonter depuis les communes du foncier de toute nature - foncier bâti ou taxe d'habitation - en harmonisant de fait les taux, donc en créant des transferts. Chaque fois que l'on remonte de l'impôt existant d'un niveau local fin à un niveau un peu moins fin, mécaniquement on crée des transferts. C'est là une difficulté technique, mais également politique, parmi d'autres inconvénients relevés par le « rapport Fouquet ». (...) « Voyons plutôt ce que donnerait le contraire, c'est-à-dire en laissant le foncier au niveau communal - ce qui est validé par la théorie économique - et en construisant des impôts économiques aux niveaux départemental et régional. Cela fonctionne mieux au regard des problématiques de transfert comme au regard des impératifs de dynamique de l'impôt, par le fait qu'un département étant plus grand, il supportera mieux la conjoncture économique qu'une commune ou un ensemble de communes. Cela dit, est-il légitime qu'un département ou une région n'ait pratiquement que des impôts assis sur des soldes de gestion et très peu d'impôts « sécurisés », assis sur le foncier, par exemple ? (...) L'analyse précise montre que chaque schéma a ses avantages, mais également ses inconvénients. Aucune solution ne s'impose d'évidence, même si l'on s'aperçoit que certaines marcheraient plutôt mieux que d'autres. » « Traiter également de la spécialisation de l'impôt, » a estimé M. Gilles Carrez, au cours de l'audition précitée, « c'est effectivement conduire une deuxième réforme, autrement dit une opération extrêmement difficile. Ma conviction est que nous devons impérativement réduire le nombre d'échelons responsables en termes de vote de taux de taxe professionnelle.(...) Jamais nous ne parviendrons à une véritable responsabilisation avec un impôt éclaté entre six niveaux différents. Simplifier est devenu indispensable. La question reste de savoir s'il faut le faire en même temps que la réforme de l'assiette. Mon sentiment est qu'il faut rester prudents. La réforme de l'assiette est une affaire suffisamment difficile pour ne pas y ajouter une deuxième réforme au risque de nous conduire à un blocage généralisé. » « Ou alors, » a proposé M. Gilles Carrez, « on pourrait faire une réforme plus simple - du type de celle que j'envisageais en seconde option, en traitant d'abord du cas des entreprises situées au-delà du plafond théorique de valeur ajoutée -, ce qui permettrait peut-être de greffer dessus une simplification du paysage des bénéficiaires. » Une dernière hypothèse consisterait, à court terme, à proroger le dispositif de dégrèvement au titre des investissements nouveaux (DIN) ─ quitte à limiter la période de franchise ─, en attendant d'avoir trouvé le bon dispositif de réforme, combinant allégement des charges sur les entreprises, meilleure spécialisation des collectivités et donc limitation du transfert sur l'État. On se souvient que ce dégrèvement temporaire, prévu par la loi de soutien à la consommation et à l'investissement du 9 août 2004, a été prolongé de six mois, jusqu'au 31 décembre 2005, par l'article 100 de la loi de finances pour 2005. Dès lors qu'un délai de réflexion est encore nécessaire avant de procéder à la réforme de la taxe professionnelle, une nouvelle prolongation paraît nécessaire, sans doute pour une durée d'un an, afin d'assurer aux entreprises une visibilité satisfaisante dans leurs décisions d'investissement. Afin d'en limiter la charge budgétaire, soulignée à juste titre par M. Gilles Carrez, la période d'application du dégrèvement pourrait être ramenée de trois à deux ans. 4.- Quels ajustements pour l'intercommunalité ? a) Simplifier le paysage de l'intercommunalité : Afin de simplifier le paysage intercommunal et d'atténuer le phénomène d'empilement de structures lié à la prolifération des syndicats mixtes, « Il faudrait aller plus loin dans le processus d'absorption de ces syndicats », a estimé M. Jean-Philippe Vachia, président de la Chambre régionale des comptes de Midi-Pyrénées, au cours de l'audition du 25 mai dernier. « Il est probable, (...) » a indiqué M. Jean-Philippe Vachia, « qu'en zone rurale, ce phénomène est l'indice que les communautés de communes n'ont pas encore atteint une taille suffisante. Il faudrait encourager leur extension jusqu'à ce que leur périmètre coïncide avec celui des syndicats. Si une communauté de communes compétente en matière d'enlèvement et de traitement des ordures ménagères est obligée d'adhérer, pour la seule collecte, à un syndicat mixte de taille supérieure, c'est qu'il y a vraiment un problème de périmètre ! (...) En zone urbaine, on peut sans doute aller plus loin dans la fusion des périmètres : sans aller jusqu'à dire que les intercommunalités doivent forcément coïncider avec les aires urbaines au sens de l'INSEE, il n'est pas judicieux qu'il y ait un syndicat mixte pour le SCOT, un autre pour le PDU, etc. » b) Améliorer notre connaissance de l'intercommunalité : Les auditions menées par votre Commission d'enquête ont mis en évidence un défaut global d'évaluation et de suivi des effets de l'intercommunalité. Or, « Le prochain gros sinistre sera sûrement intercommunal. » a estimé M. Michel Klopfer, consultant, Président directeur général du cabinet Michel Klopfer. « En effet, toutes les communes, dépositaires de la légitimité politique, exigent de l'intercommunalité à laquelle elles adhèrent qu'elle se serre la ceinture pour arriver à faire passer leurs propres contingences, jusqu'au moment où elle explosera, comme ce fut le cas de bien des SEM. Mais cela ne se produira peut-être qu'au cours des années 2010. S'inquiéter du mode de fonctionnement entre communes et après l'adoption de la loi Chevènement de 1999, c'est un peu comme si l'on s'était penché, en 1988, sur les conséquences financières de la loi du 2 mars 1982 : personne ne se mobilise car il ne s'est encore rien passé de sérieux. » « Ce qui est (...) préoccupant, (...) » selon M. Alain Pichon, Président de la 4ème chambre de la Cour des comptes, entendu le 25 mai dernier, « c'est la difficulté d'appréhender la situation financière et patrimoniale globale de la territorialité couverte par l'intercommunalité, faute de pouvoir retraiter - je n'ose même pas dire consolider, car cela suppose des principes comptables qui ne sont pas encore en application - les données. Il faut bien reconnaître que les statistiques de l'État ne sont pas encore opérationnelles, tant du point de vue des délais que de celui des logiciels de traitement des comptes. Je ne suis donc pas sûr qu'à terme, si d'aventure l'intercommunalité de projet croissait et embellissait au point d'entraîner une dégradation de la situation financière des collectivités concernées, les réseaux d'alerte que constituent les préfets et les TPG seraient suffisamment opérationnels pour détecter à temps les difficultés qui pourraient se présenter ! C'est un risque dont il faut être conscient, et l'appareil d'État devrait faire un effort d'adaptation pour mieux suivre et accompagner cette évolution. » Par ailleurs, comme l'a rappelé à juste titre M. Dominique Schmitt, Directeur général des collectivités locales, au cours de son audition du 25 mai dernier, « plus vite l'intérêt communautaire sera défini, plus vite on aura une vision précise de la réalité de l'intercommunalité et de l'intégration des groupements, par rapport à des dispositifs d'aubaine destinés à capter des surcroîts de dotations. Mais je comprends aussi - c'est la raison pour laquelle le Gouvernement ne s'est pas opposé à l'amendement reportant d'une année la définition de l'intérêt communautaire qui aurait dû intervenir au plus tard cet été - qu'on puisse avoir intérêt à ne pas précipiter les choses si on a encore besoin d'un dialogue pour assurer la dynamique de l'intercommunalité et la qualité des relations de confiance entre les groupements et les communes membres. Nous avons donc répondu à M. Jacques Pélissard, président de l'Association des maires de France, que nous comprenions bien la nécessité de ce report. Mais on ne pourra pas aller au-delà d'un an, car il faut désormais absolument clarifier le concept d'intérêt communautaire. » Votre Rapporteur souscrit pleinement à cette analyse. c) Renforcer le contrôle de l'intercommunalité et sa responsabilité démocratique Le fait que les groupements à fiscalité propre soient autorisés à lever l'impôt, disposent de prérogatives grandissantes dans la vie locale et exercent fréquemment des compétences supérieures à celles des communes rend incontournable la question du contrôle démocratique qui doit s'exercer sur ces établissements. Même si la Constitution n'impose pas l'élection des représentants intercommunaux au suffrage universel direct et que le Gouvernement n'y est pas favorable, tant pour des raisons politiques liées au souci de préserver la légitimité des maires que pour des raisons plus techniques tenant au caractère inachevé de la carte intercommunale, des pressions en ce sens ne manqueront pas de s'exercer à l'avenir. « La question est délicate », a estimé M. Alain Pichon, Président de la 4ème chambre de la Cour des comptes, au cours de l'audition précitée. « Mon sentiment personnel est que, devant le succès de l'intercommunalité, et compte tenu du fait qu'elle est amenée à voter l'impôt, je ne vois pas comment on pourrait en rester durablement au statu quo actuel. On a évoqué le contribuable, qui paie un peu plus, l'usager qui s'y retrouve en termes de qualité et de quantité du service même s'il est un peu plus sollicité sur le plan fiscal, mais il n'en demeure pas moins que l'intercommunalité souffre d'un déficit de lisibilité démocratique, et que le citoyen ne s'identifie pas à elle. Si l'on faisait des sondages, sans doute serait-on surpris de constater que le citoyen ne connaît pas bien les responsables ni même les sigles de ces structures intercommunales. Faut-il faire élire ces responsables au suffrage universel direct pour obtenir une adhésion citoyenne plus forte à l'intercommunalité ou conserver le système actuel de désignation et de délégation par les conseils municipaux ? Je pense qu'il ne faut pas précipiter les choses, ce sera peut-être une prochaine étape, mais le véritable succès de l'intercommunalité passera nécessairement par une clarification vis-à-vis du citoyen. Qu'elle passe par une élection au suffrage universel direct ou par d'autres moyens, cette clarification sera incontournable. Mais cela pose évidemment la question du devenir des communes dans cette hypothèse. » Afin d'améliorer la gouvernance du couple commune-intercommunalité, il pourrait être envisagé de renforcer et de formaliser le rôle des conseils municipaux dans la surveillance et le contrôle de l'activité des établissements intercommunaux. Des mécanismes, tels que ceux mis en place au niveau européen afin de renforcer le contrôle par les parlements nationaux de la production normative communautaire, et d'assurer le respect du principe de subsidiarité en particulier, pourraient être adaptés et appliqués, mutatis mutandis, à l'entité territoriale que forment un groupement et ses communes membres. Afin « d'améliorer le dispositif de contrôle des communes et des élus communaux sur les intercommunalités », a indiqué le Directeur général des collectivités territoriales à votre Commission d'enquête le 25 mai dernier, « Nous sommes en train de regarder s'il serait possible d'appliquer un dispositif un peu semblable à celui qui est envisagé dans le projet de traité constitutionnel pour le contrôle exercé par les parlements nationaux sur l'Union européenne. » d) Interdire aux groupements à TPU d'avoir recours à la fiscalité mixte La fiscalité mixte consiste à conjuguer au niveau intercommunal le prélèvement spécialisé de la taxe professionnelle unique (TPU) avec celui d'un impôt-ménages additionnel qui s'ajoute d'une part à la TP intercommunale et d'autre part à l'impôt-ménages communal. La possibilité de lever la fiscalité mixte a été ouverte par l'article 86 de la loi du 12 juillet 1999 et se trouve désormais codifiée au II de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, qui indique que le principe de cette fiscalité ménages additionnelle à la TPU doit faire l'objet d'une délibération, à la majorité simple du conseil communautaire, avant le 1er janvier de l'année de son application. Comme l'explique M. Yann Le Meur, professeur associé à l'université de sciences économiques de Rennes I, dans un article récent consacré à la fiscalité mixte52, « le législateur a imaginé cette taxe complémentaire comme un financement d'appoint, en cas de difficultés passagères ou exceptionnelles que rencontrerait l'EPCI pour équilibrer un budget. Dans l'esprit du législateur, la taxe ménages ne saurait en effet entraîner une déspécialisation définitive de l'impôt local. Le débat parlementaire sur la fiscalité mixte avait opposé des élus locaux et les ministères des Finances et de l'Intérieur. Les premiers désiraient pouvoir répondre, en cas de besoin, à l'impossibilité d'augmenter suffisamment leur taux de TP, verrouillé par les taux ménages des communes du fait du lien entre les taux. Les seconds étaient soucieux de préserver la spécialisation fiscale et la logique systémique de substitution constitutive de la TPU - et souhaitaient contrer le lien fatal de cause à effet constaté dans le passé entre coopération et inflation fiscale. Faute de pouvoir, en 1999, empêcher l'option pour la fiscalité mixte, le législateur a prévu deux mesures limitant son application : - conformément à la nature passagère qu'on conférait à cette taxe, la loi ne lui a pas octroyé de caractère durable et l'a limitée à la durée du mandat ou à l durée restant à courir entre son application et la fin du mandat. À chaque renouvellement général des conseils municipaux, les élus (de la nouvelle ou de l'ancienne équipe) doivent donc la voter à leur tour pour la conserver durant le mandat à venir (...). - La mise en place de la fiscalité mixte interdit, sauf pour les communautés urbaines, toute augmentation du montant de la dotation de solidarité communautaire (DSC) par rapport à l'année précédente, ou toute instauration de DSC si elle n'existait pas auparavant. » Si le recours à la fiscalité mixte reste marginal, M. Charles-Éric Lemaignen, Vice-président de l'ADCF chargé des affaires financières et fiscales et Président de la communauté d'agglomération d'Orléans Val-de-Loire, a indiqué, au cours de l'audition du 6 avril dernier, qu'un nombre croissant de groupements s'interroge sur l'opportunité de pratiquer une fiscalité mixte. « Très peu encore ont franchi le pas : 97 communautés de communes, 7 communautés d'agglomération, 4 communautés urbaines, parfois en se contentant de voter le principe sans voter de taux. C'est seulement une possibilité qu'elles se réservent. Mais le débat sur l'opportunité de passer à la fiscalité mixte devient récurrent dans certaines communautés. » Or, « Notre impression, » a expliqué M. Jean-Philippe Vachia, au cours de l'audition précitée, « qui n'est qu'une impression, est que la montée en charge de l'intercommunalité n'est pas terminée. Il y aura des projets de grands équipements, la création de nouvelles zones d'activité ou d'aménagement... (...) Ce que nous craignons, mais nous manquons de recul, c'est que l'on assiste maintenant à une augmentation de la pression fiscale généraliste qui viendrait s'ajouter à celle de la fiscalité spécialisée.(...) Il faudra soit augmenter la TPU dans les limites fixées par la loi, soit recourir à une fiscalité mixte. » Votre Rapporteur serait favorable à ce que le recours à la fiscalité mixte soit interdit, dans la perspective de contrer cette potentielle dérive fiscale et dans la mesure où il estime que la spécialisation constitue l'un des arguments majeurs qui plaident en faveur de la TPU. Le recours à la fiscalité mixte lui paraît d'autant moins légitime que l'amorce de spécialisation qui découle du régime de la TPU a entraîné l'application de nouvelles règles de liens entre les taux de TPU et les impôts ménages communaux, mais aussi de nouveaux et notables assouplissements. Ainsi, depuis la loi de finances pour 2003, les EPCI bénéficient de la déliaison partielle des taux : ils peuvent augmenter leur taux de taxe professionnelle dans la limite d'une fois et demie l'augmentation du taux moyen pondéré de taxe d'habitation, ou, si elle est plus faible, du taux moyen pondéré des trois taxes ménages. Par ailleurs, ils peuvent faire application de la majoration spéciale du taux de taxe professionnelle, dès lors que le taux de taxe professionnelle est inférieur au taux moyen national de taxe professionnelle et que le taux moyen pondéré des taxes foncières et de la taxe d'habitation des communes membres est supérieur ou égal au taux moyen pondéré constaté l'année précédente pour ces taxes dans l'ensemble des communes au niveau national. Les conditions d'application de la majoration spéciale sont plus souples pour ces EPCI que pour les communes. Au surplus, ils peuvent cumuler majoration spéciale et augmentation du taux de taxe professionnelle supérieure à l'augmentation des taux des taxes ménages. Enfin, la loi de finances pour 2004 autorise les EPCI à mettre en réserve, sous certaines conditions, les hausses du taux de taxe professionnelle qui n'ont pas été appliquées. B.- QUEL PILOTAGE MACROÉCONOMIQUE POUR LES FINANCES LOCALES ? Avec des dépenses publiques atteignant 54,7 % du PIB, la France souffre à l'excès du poids de sa sphère publique - ce qui handicape la croissance de notre économie - et de la charge injustifiable que la dette publique fait peser sur les générations futures. Les ressources financières et humaines qui seraient dégagées par une concentration des moyens de la sphère publique sur ses missions irremplaçables apporteraient un supplément notable - au fil du temps - à la croissance et au dynamisme de l'économie. L'action sur ce terrain doit donc être générale, affectant l'État, les entreprises publiques, les organismes de sécurité sociale et les collectivités territoriales. Il s'agit bien ainsi de donner plus de pouvoir d'achat aux ménages et de renforcer la compétitivité des entreprises. Telle est la conviction exprimée devant votre Commission d'enquête par M. Pierre Méhaignerie, président de la Commission des finances de l'Assemblée nationale : « il convient de rappeler quel est le contexte économique et social actuel. Notre pays doit répondre à une double nécessité d'efficacité et de justice. L'efficacité exige la confiance des entreprises, la libération des initiatives, le développement des investissements. La justice doit s'entendre en termes de pouvoir d'achat et de réduction du chômage. Lors des dix prochaines années, même avec une croissance de l'ordre de 2 % à 3 % par an, nous savons que les deux tiers de cette croissance devront aller au financement des dépenses de vieillesse, de santé, au remboursement de la dette et à la réduction des déficits. À qui doit aller le dernier tiers ? Pour des raisons philosophiques et politiques, je pense qu'il doit aller essentiellement à ceux dont le salaire ne permet pas d'appartenir, comme ils l'espèrent, à la classe moyenne. Je pense surtout aux salariés du secteur privé. Partant de là, l'État comme les collectivités territoriales doivent s'imposer une meilleure maîtrise de leurs dépenses publiques et une amélioration de leur productivité. » L'OCDE fait le même constat : dans sa récente Étude économique de la France 2005, elle préconise une meilleure maîtrise des dépenses publiques. Selon ce rapport, publié le 16 juin 2005, « compte tenu des pressions grandissantes au niveau des dépenses liées au vieillissement, il est nécessaire de maîtriser étroitement les dépenses publiques directes, notamment par des réductions d'effectifs rendues possibles par le grand nombre de fonctionnaires partant actuellement à la retraite, et de limiter les dépenses concernant les salaires et les traitements. » Une autre raison justifie aussi de s'intéresser au cadrage macroéconomique des finances locales : le risque systémique. Il faut éviter que les déséquilibres financiers de collectivités territoriales importantes, dus à la progression continue et non maîtrisée de leurs dépenses alors que la limite de la pression fiscale aura été atteint, n'ait un effet de propagation à travers un risque systémique global, notamment via le secteur bancaire auprès duquel les collectivités s'endettent. Deux consultants ont fait part de leurs inquiétudes concordantes à ce sujet devant votre Commission : - M. Philippe Laurent : « le sujet de préoccupation le plus important, à nos yeux, est le suivant : les communes et communautés de communes semi-rurales doivent faire l'objet d'une attention particulière car si elles maintiennent le niveau de leurs services publics, elles risquent de voir leurs charges s'alourdir considérablement, notamment du fait des dépenses de personnel, alors que leur assiette fiscale se réduit » ; - M. Michel Klopfer : « si un cas de surendettement doit survenir avant la fin de la décennie, il touchera une grosse communauté et sa ville centre ; il y aura " du sang sur les murs ", car je crains l'attitude qu'adopteront les établissements prêteurs à l'égard de l'ensemble des collectivités du même profil. ». Interrogé par votre Rapporteur sur le sens de cette « prédiction », M. Jean-Philippe Vachia, président de la Chambre régionale des comptes de Midi-Pyrénées, a semblé confirmer ce point de vue : « dans le cas, en effet, d'une communauté de communes bâtie autour d'une ville dominante qui ne joue pas totalement le jeu des transferts et qui récupère l'essentiel des reversements, nous partageons d'une certaine façon cette crainte, sous certaines conditions. » Pour toutes ces raisons, il est absolument indispensable de mieux responsabiliser les décideurs, locaux et nationaux, en pesant avant tout sur le niveau de la dépense, pour maîtriser la croissance de la fiscalité locale. Pour M. Brice Hortefeux, ministre délégué aux collectivités territoriales, les ressorts d'une « gestion équilibrée des collectivités territoriales repose[nt] sur deux piliers. Le premier, c'est le sens de la responsabilité des élus, une responsabilité encore étendue et renforcée. Le second, c'est le contrôle de nos concitoyens, d'autant plus efficace que ceux-ci seront mieux informés ; ce qui pose naturellement la question de l'information de nos compatriotes. » 1.- Faire partager la culture de la maîtrise de la dépense publique Les dépenses des administrations publiques locales (APUL) représentent aujourd'hui, avec 169 milliards d'euros en 2004, plus de la moitié de celles du budget de l'État (288 milliards d'euros). Au total, le poids des dépenses locales dans la dépense publique atteint un niveau record de 20 %, alors qu'il n'était que de 18 % en 1990. Ainsi que l'a rappelé M. Dominique Hoorens, directeur des études et de la documentation de Dexia Crédit Local, lors de son audition par votre Commission, « rapportées au PIB, [les dépenses] de l'État enregistrent une légère inflexion à la baisse, tandis que celles des collectivités territoriales suivent un mouvement inverse, qui fut très notable au début de la première vague de décentralisation, puis s'est stabilisé et semble actuellement connaître un regain avec le début de la deuxième vague, pour atteindre 10,2 % du PIB en 2003. [Cela] signifie [...] qu'elles augmentent, de manière réelle, d'environ 4 % par an en moyenne. En schématisant, on constate donc que, depuis vingt ans, les dépenses des collectivités territoriales ont augmenté davantage que la croissance économique. » Il n'est plus possible de faire comme si de rien n'était. Comment rétablir un système de responsabilisation des élus au regard du lien entre la dépense et le niveau de pression fiscale ? Un effort de compréhension partagée des enjeux est d'abord indispensable. a) Les contraintes pesant sur les finances publiques En vertu du programme de stabilité des finances publiques, présenté à la Commission européenne par le Gouvernement français, l'ensemble des administrations publiques sont engagées à respecter des normes de progression de dépenses, lesquelles doivent permettre de respecter les critères de bonne gestion financière que sont les règles du pacte de stabilité et de croissance. Les années 2003-2004 marquent une inversion de tendance par rapport à la situation observée depuis les débuts de la décentralisation. Pour la première fois, l'épargne des collectivités territoriales ne progresse plus, et, comme l'investissement est maintenu, on constate un retour à la demande d'emprunt. Les collectivités territoriales se retrouvent donc face à un besoin de financement au sens des critères de Maastricht, et cette dégradation a été rapide. L'INSEE a communiqué à la Commission européenne, en mars 2005, son estimation du ratio de déficit public pour 2004, lequel s'élève à 3,7 % du PIB, contre 4,2 % en 2003. Cependant, parmi les différentes administrations publiques, on constate que les collectivités territoriales contribuent à détériorer le solde de 1,7 milliard d'euros, alors que le budget de l'Etat l'améliore de 10,8 milliards d'euros. Les composantes sont résumées dans le tableau suivant : 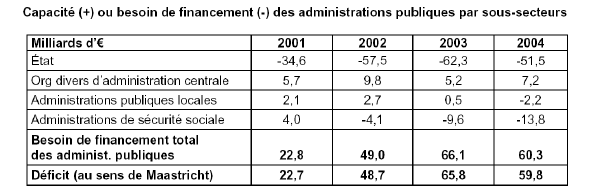 Source : INSEE. Ce résultat a été atteint, notamment, par une croissance du volume de l'ensemble de la dépense publique limitée à 2 %. Ce maintien du rythme global de croissance de la dépense publique recouvre cependant des situations contrastées : l'objectif de l'État de stabiliser sa dépense en volume a été atteint pour la deuxième année consécutive ; en revanche, la dépense locale a continué de croître à un rythme élevé (plus de 3,5 % en volume à champ constant), notamment en matière d'investissement, du fait de taux d'intérêt toujours bas, ce qui a amené les collectivités territoriales à enregistrer un déficit pour la première fois depuis 1995. Le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour 2005 propose une décomposition de la dépense publique par sous-secteurs des administrations publiques. Les principaux changements de périmètre, notamment le transfert aux départements du RMI en 2004, ont été neutralisés. Sur l'ensemble de la période 2003-2005, la contribution des dépenses des administrations centrales (État et ODAC) à l'évolution de la dépense publique est quasiment nulle. La contribution des administrations publiques locales, en revanche, serait de l'ordre du tiers. Les résultats sont présentés dans le tableau suivant : 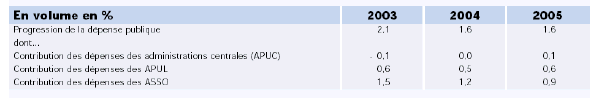 Source : rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances initiale pour 2005. Depuis dix ans, les dépenses locales ont crû en moyenne plus rapidement que la dépense publique globale (4,4 % par an en valeur, contre 4 % pour l'ensemble des administrations publiques). La dynamique des dépenses locales pèse sur l'évolution de la dépense publique globale : compte tenu du poids des collectivités locales dans la dépense publique (19 % en 2003), la contribution moyenne des administrations publiques locales (APUL) à la progression de la dépense publique a représenté 0,7 point par an en moyenne par an sur la décennie passée. 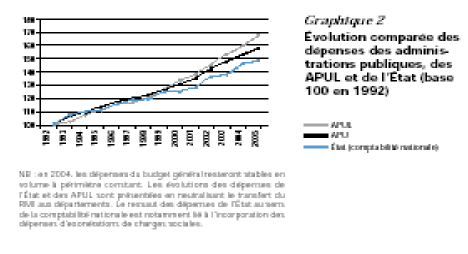 Source : rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour 2005. Les derniers transferts de compétences ne sont donc aucunement en cause. Selon les analyses les plus récentes de la direction générale du Trésor et de la politique économique, transmises à votre Rapporteur, sur la période 1993-1998, la dépense locale contribuait en moyenne à 17 % de la progression de la dépense publique, cette contribution atteignant une moyenne annuelle de près de 30 % entre 1999 et 2004, avec un pic de 42 % en 2004. Le principal facteur d'augmentation est la relance de l'investissement public local depuis 1999, avec une hausse de 6,9 % par an en moyenne entre 1999 et 2004 (soit + 0,4 point de PIB). Les travaux publics, portant principalement sur l'aménagement du territoire (voirie, transports urbains et réseaux d'assainissement), ont contribué pour près de la moitié à l'évolution de l'investissement. La construction de bâtiments publics (d'enseignement ou culturels) participe également fortement à la progression de l'investissement (plus du tiers de l'évolution). Enfin, l'achat de matériels informatiques constitue l'essentiel du reste de l'évolution des dépenses d'investissement, avec une progression annuelle moyenne de 12,6 % depuis 1999. L'OCDE, dans sa récente Étude économique de la France 2005, fait le même constat concernant les dépenses des collectivités territoriales : « la progression des dépenses de l'État a été moins rapide que celle des dépenses des collectivités locales. Cette situation ne résulte que partiellement du transfert par le gouvernement de certaines de ses responsabilités aux niveaux inférieurs d'administration, puisque l'on a également constaté une augmentation sous jacente des dépenses locales. » Tous ces éléments ont été fort bien résumés devant votre Commission par M. Jean-François Copé, Ministre délégué au Budget et à la réforme de l'État : « force est de constater que les dépenses des collectivités territoriales connaissent depuis ces dernières années une croissance considérable. Elles augmentent plus vite que celles de l'État, mais également plus vite que le PIB, même en raisonnant à périmètre de compétences constant. Leur rythme de croissance annuel en volume entre 1980 et 2004 est de 3,4 %, soit 1,3 point de plus que les dépenses de l'État sur la même période. Même à périmètre constant, le poids des collectivités territoriales est allé grandissant : 9,7 % en 2004. Du coup, pour financer ces dépenses en pleine augmentation, les collectivités n'hésitent plus à recourir dans des proportions très importantes à des hausses de la fiscalité locale. Ce risque n'a rien de virtuel : entre 2000 et 2004, toutes taxes et collectivités confondues, les produits ont augmenté de 10 % en moyenne. [...] En 2004 est apparu un élément nouveau : pour la première fois depuis bien longtemps, les collectivités territoriales n'ont pas maintenu l'équilibre de leurs comptes. En clair, les comptes publics locaux sont tombés dans le rouge, affichant pour la première fois un déficit de 0,1 point de PIB. [...]. Or, au moment où les collectivités accusaient un déficit, l'État a de son côté réduit le sien, améliorant ses comptes de 13 milliards d'euros, tout en assumant pleinement [...] ses responsabilités financières à leur égard. [...] S'il nous faut évoquer la situation financière des collectivités territoriales en constatant notamment une envolée sans précédent de la dette publique locale - qui atteint 112 milliards d'euros -, tout en parlant dans le même temps de modération fiscale, alors il faut clairement poser la question de la modération des dépenses publiques locales. Je le dis en conscience, tout en étant, comme membre du Gouvernement, très attentif au respect de la pleine autonomie des collectivités territoriales ; mais dans un contexte marqué par un effort significatif de l'État qui depuis trois ans maintient sa dépense publique en deçà de l'inflation - elle progresse de zéro en volume - il faut poser le problème de la maîtrise de la dépense, du côté des collectivités territoriales. » Pour l'instant, ces déclarations audacieuses semblent rester lettre morte. En effet, il est fort regrettable que le gouvernement n'en tire encore aucune conséquence pour l'avenir. Dans ses prévisions des finances publiques pour 2005 et 2006, élaborées en mars 2005, il se contente de constater que le niveau de déficit des administrations publiques locales se maintiendra au même niveau, avec une relative fatalité puisqu'aucun commentaire ou action prévisible n'est pas même esquissé. Il s'agirait alors du seul sous-secteur ne participant pas à l'amélioration de la situation des finances publiques :  Source : direction générale du Trésor et de la politique économique. b) La nécessaire prise en compte de ces contraintes par les collectivités territoriales Pourtant, des moyens d'action sont envisageables. M. Dominique Schmitt, Directeur général des collectivités locales, a présenté devant votre Commission les modes de régulation théoriquement possibles : « il convient de distinguer deux outils de régulation : la régulation par la ressource et la régulation par la dépense. La Grande-Bretagne a eu recours à la régulation par la ressource à la suite de la quasi-cessation de paiements de grandes cités comme Liverpool et Londres, de même que la Belgique, en raison des difficultés de ses provinces. Un tel système, qui ne peut emprunter que la voie législative, doit être utilisé avec la plus grande précaution. En France, il se heurterait au principe de libre administration des collectivités territoriales et à l'article 72 de la Constitution, ainsi qu'à la grande hétérogénéité de nos collectivités territoriales. « La régulation par la dépense paraît en revanche assez efficace. Elle n'a pas été prévue immédiatement par les premières lois de décentralisation, faute d'une présentation des documents budgétaires qui aurait permis un mécanisme de contrôle démocratique de la dépense. La loi ATR de 1992 a corrigé cela en introduisant dans le budget des communes de plus de 3 500 habitants une série d'indicateurs synthétiques qui font l'objet d'une analyse par la DGCL et par la Direction générale de la comptabilité publique, et qui permettent, par le jeu démocratique de l'opposition dans une collectivité territoriale, d'appréhender l'évolution de la dépense. [...] C'est donc sans doute sur cette piste de la régulation par la dépense qu'il convient aujourd'hui de travailler. » L'analyse de M. Schmitt n'épuise cependant pas le sujet. On pourrait réfléchir à introduire des mécanismes vertueux contribuant à modérer l'appétit de recettes, pour ce qui concerne les taux de la fiscalité locale. Trop longtemps, et encore partiellement aujourd'hui, l'augmentation des taux était d'autant plus tentante pour la collectivité que l'État en payait une partie. Pourquoi ne pas imaginer un schéma inverse, incitatif d'une tempérance globale ? Votre Rapporteur suggère que, sauf à rattraper un niveau de bases lorsque celles-ci auraient baissé, une part de l'augmentation des taux soit écrêtée par l'État, dans des conditions discutées par la « Conférence annuelle des finances publiques » (Cf. infra). Il faut aussi chercher des pistes du côté des dépenses. Selon le rapport Le sursaut : vers une nouvelle croissance pour la France, remis en octobre 2004 à M. Nicolas Sarkozy, alors ministre d'État, ministre de l'Économie, des finances et de l'industrie, par le groupe de travail présidé par M. Michel Camdessus, « il est de la première importance de rechercher en concertation avec des représentants des élus locaux et des organismes sociaux, une généralisation à l'ensemble de la sphère publique de la discipline financière et les efforts d'agilisation que l'État doit s'imposer. Il est clair, en effet, que si la dépense de l'État est, dans l'ensemble, maîtrisée, les années récentes ont vu les dépenses sociales et celles des collectivités locales littéralement exploser. Le pacte de stabilité et de croissance engage l'ensemble de la Nation. Or, aujourd'hui, l'ajustement qu'il impose est uniquement supporté par les dépenses de l'État, qui doivent compenser par leur réduction la forte hausse des autres dépenses publiques. Cette pratique va toucher très vite ses limites. » Le « rapport Camdessus » souhaite donc fort justement « mettre sous contrainte financière les dépenses des collectivités locales, lesquelles ont progressé à un rythme supérieur de 2 % au PIB sur les vingt dernières années. Compte tenu de ce dynamisme, une discipline budgétaire et financière ne peut plus les ignorer ». C'est pourquoi il propose de mettre en place, « à l'instar de pays voisins, un pacte de stabilité interne avec les collectivités locales, permettant d'avoir une stratégie nationale d'évolution des dépenses publiques plus globale. » Lors de son audition, le 21 juin 2005, par la Commission des finances de l'Assemblée nationale sur les résultats budgétaires 2004, M. Philippe Séguin, Premier président de la Cour des comptes, a lui aussi souligné qu'« il serait [...] aussi illusoire que stérile de ne faire porter [...] l'effort de maîtrise des dépenses que sur l'État, dès lors que son budget ne représente que 40 % de la dépense publique. Ainsi, [...] les dépenses des collectivités territoriales ont progressé, au cours des vingt dernières années, à un rythme supérieur à 2 % du PIB, sans qu'un objectif d'évolution ait été fixé a priori. Pour sortir de cette situation, il est indispensable de développer une concertation accrue, afin de mieux partager les responsabilités au sein des administrations publiques. D'une façon générale, une information partagée et de qualité sur les perspectives et les enjeux des finances publiques serait de nature à permettre des débats éclairés sur les choix qui restent à faire. » Votre Rapporteur souhaite qu'une réflexion approfondie soit menée à ce propos entre l'État et les collectivités territoriales. Cette régulation macroéconomique globale, pour être acceptée, ne peut être que concertée entre partenaires qui se respectent réciproquement. 2.- Mettre en place les moyens et les conditions d'une régulation systémique partagée Au-delà de la prise de conscience de la tendance lourde, au sens macroéconomique, d'augmentation de la dépenses publique locale, et de sa nécessaire maîtrise, un grand nombre de personnes auditionnées par votre Commission d'enquête ont estimé possible de mettre en place des mécanismes permettant, en associant État et collectivités territoriales, de mieux réguler l'ensemble des finances locales. Pour que cette régulation aboutisse, il faut rétablir des relations de confiance entre l'État et les collectivités territoriales. Au-delà, la réforme de l'État lui-même est aussi un corollaire indispensable. a) Créer des instances de concertation sur l'évolution des finances locales Des conférences financières inter-collectivités, organisées par les préfets et regroupant les « grands élus » au niveau de chaque région, pourraient constituer des lieux de concertation entre les principales collectivités territoriales du territoire, avec pour objectif une stabilisation globale des prélèvements fiscaux et une réorganisation des interventions de chacune d'entre elles. Votre Rapporteur avait déjà évoqué cette possibilité lors d'une audition de M. Jean-François Copé, alors ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, par la Commission des finances de l'Assemblée nationale le 25 janvier 2005 : « la révision de la LOLF pourrait fournir l'occasion d'instituer, dans chaque département, un conseil des prélèvements obligatoires, qui évoquerait à la fois ceux de l'État, ceux des collectivités territoriales et ceux des organismes de sécurité sociale. » Le ministre avait déjà fait sienne cette demande : « la fiscalité locale est un élément auquel le Gouvernement entend être très attentif, et les observatoires souhaités par M. Hervé Mariton devraient être créés dans les régions plutôt que dans les départements, car ce n'est pas tout à fait un hasard si la fiscalité régionale s'accroît de 2 % seulement en Alsace et de 50 % en Bourgogne. » Pour conclure un « pacte global » entre l'État et les collectivités territoriales, pourrait être réunie une conférence annuelle des finances publiques, où toutes les dépenses et recettes réciproques de l'État et des collectivités territoriales seraient mises sur la table. Le développement d'outils de pilotage centralisés des dépenses locales, comme l'institution d'une contrainte législative sur l'évolution des dépenses des collectivités territoriales, serait contraire à la Constitution. Aucune tutelle d'une collectivité, fût-ce l'État, sur une autre n'est envisageable. La concertation avec les collectivités territoriales est donc nécessaire. La mise en œuvre d'une telle concertation, avec chacune des 37 000 entités territoriales - non compris les structures intercommunales -, est matériellement impossible. On ne peut envisager de concertation approfondie sur les objectifs budgétaires qu'avec les collectivités d'une certaine taille, en particulier les 22 régions - qui bénéficient déjà d'une planification pluriannuelle de certaines de leurs dépenses établie conjointement avec l'État dans le cadre des contrats de plan -, les départements et les grandes agglomérations. Cette concertation pourrait notamment prendre la forme d'une conférence annuelle regroupant le Gouvernement, les commissions des finances des deux assemblées parlementaires et les principales instances de représentation des collectivités territoriales. Elle pourrait aboutir à d'éventuels accords politiques sur la stratégie nationale de finances publiques, reposant sur une maîtrise pérenne de la dépense. M. Jean-François Copé, Ministre délégué au Budget et à la réforme de l'État, a ainsi indiqué devant votre Commission d'enquête ne voir « que des avantages à l'organisation d'une conférence des finances locales réunissant tous les partenaires et qui serait l'occasion d'évoquer tous les sujets, sans tabou. [...] Ne pourrait-on pas, par exemple, solliciter les associations d'élus [et d'autres] structures - le Comité des finances locales ou le Parlement pourraient être des instances de débat - pour fixer d'une manière consensuelle une norme d'évolution des dépenses locales, non contraignante, mais qui servirait de point de référence, une manière de benchmarking pour montrer ceux qui dépensent beaucoup et ceux qui dépensent moins - en prenant évidemment en compte les réalités, les héritages, les situations géographiques, etc. » Bien entendu, et comme l'a rappelé M. Brice Hortefeux, Ministre délégué aux collectivités territoriales, « du côté des dépenses, le principe de libre administration paraît difficilement compatible avec la mise en place d'une norme d'évolution des budgets. » Il faut donc bien s'entendre sur le terme de « norme » : les dépenses des collectivités territoriales restent libres d'évoluer comme le décident les assemblées locales, mais si l'objectif d'évolution défini de manière consensuelle n'est pas respecté, l'État serait libre lui aussi de revoir son effort financier en faveur des collectivités. Tel est le sens d'une vraie liberté locale : une responsabilité pour les élus. D'une certaine façon, M. Jacques Pélissard, Président de l'Association des maires de France (AMF), a aussi esquissé une telle démarche lorsqu'il a été auditionné par votre commission : « nous demandons que des conférences annuelles soient organisées pour éclairer la complexité des rapports entre l'État et les collectivités territoriales. » Il visait notamment les décisions concernant la fonction publique : « il me semble possible d'associer les collectivités territoriales, départements, régions et communes, aux discussions salariales conduites jusqu'à présent en solitaire par le ministre de la fonction publique, quel que soit le gouvernement en place. » M. Pascal Buchet, rapporteur général de la commission des finances et de la fiscalité locale de l'AMF, a précisé cette demande : « il est nécessaire d'impliquer davantage les représentants des maires dans les discussions. C'est dans cet esprit que nous proposons l'organisation de conférences annuelles des finances publiques. Nous ne sommes pas qualifiés pour discuter de la pertinence des normes ou de l'évolution des salaires des fonctionnaires mais pour examiner, avec les représentants des pouvoirs publics, leurs conséquences financières et les moyens de les pallier. Actuellement, nous subissons sans pouvoir donner notre point de vue à aucun moment. Les collectivités territoriales doivent être associées davantage aux décisions de l'État. » La discussion des questions concernant l'évolution générale des rémunérations dans la fonction publique territoriale, subies de plein fouet par les collectivités, serait aussi un moyen de responsabiliser l'État, comme le souligne M. Pierre Méhaignerie, Président de la Commission des finances de l'Assemblée nationale : « Être vertueux, c'est aussi ne pas imposer des conventions collectives à tout bout de champ sans que les élus participent, du moins officiellement, à la négociation. Comme c'est agréable de dire oui aux organisations syndicales sans avoir à payer la facture ! » Ce dialogue pourrait très bien avoir lieu au sein du conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT), dont les missions devraient être étendues afin qu'il se prononce également sur les évolutions, décidées par voie réglementaire, de la valeur du point d'indice de la fonction publique. Cette solution technique n'épuise cependant pas le sujet. M. Jean-François Copé, Ministre délégué au Budget et à la réforme de l'État, a lui aussi pris l'exemple des évolutions salariales dans la fonction publique : « jusqu'à présent, jamais les collectivités territoriales, directement ou par le biais de leurs associations, n'ont été associées sur cette question. Je suis pour ma part tout à fait partisan de la poser ouvertement et d'associer d'une manière ou d'une autre les collectivités à la définition des évolutions salariales. » Pour autant, le Ministre délégué au Budget et à la réforme de l'État souhaite un véritable partenariat global : « cela doit être donnant-donnant et que cela suppose en même temps une réflexion sur la norme de dépenses publiques. L'un est lié à l'autre ; ou alors, on en reste aux mondanités. » Là encore, il faut une responsabilité partagée, sur des enjeux globaux et non sectoriels. Cette conférence annuelle des finances publiques pourrait aussi responsabiliser fiscalement les collectivités territoriales, en discutant de la réévaluation des bases des impôts directs locaux. Pourquoi la fixation des coefficients de revalorisation des valeurs locatives fait-elle l'objet, chaque année depuis 1981, d'une disposition de loi de finances - ou le plus souvent de loi de finances rectificative, donc connue très tard dans l'année par les collectivités -, parfois introduite par amendement parlementaire, sans concertation organisée préalable avec les collectivités territoriales, alors qu'il s'agit bien d'un des éléments centraux de leur stratégie fiscale ? Il serait souhaitable que cet élément d'évolution de la fiscalité locale soit discuté dans ce cadre, et ainsi affiché clairement et publiquement, pour qu'il ne soit pas masqué par les augmentations de taux, décidées ensuite librement par chaque collectivité, lesquelles se surajoutent à cette réévaluation. Les expériences de pactes internes de stabilité dans quelques pays européens Le respect des objectifs et engagements budgétaires pris par les gouvernements devant la Représentation nationale et au niveau communautaire dépend des performances budgétaires respectives des sous-secteurs des administrations publiques, généralement indépendants financièrement. En revanche, les coûts du non respect de ces objectifs et engagements sont de jure supportés par les gouvernements seuls. Au cours des années récentes, les pays membres de la zone euro ont donc reconsidéré les relations budgétaires entre les différents niveaux administratifs afin de mieux définir les responsabilités budgétaires. Allemagne La Constitution allemande permet que les Länder recourent à l'emprunt pour le financement d'un déficit, en vertu de leur autonomie financière. Chaque Land contrôle par ailleurs les finances des échelons infra-régionaux, notamment pour limiter leur endettement. En principe, les Länder suivent une règle d'or, qui veut que le financement par l'emprunt ne dépasse pas les dépenses d'investissement. Cette règle n'est cependant pas totalement contraignante, dans la mesure où la définition des dépenses d'investissements est très large et où l'application de la règle peut être assouplie dès qu'une détérioration sensible de la situation économique est déclarée. La Constitution prévoit enfin une solidarité entre administrations, si bien que l'intervention de l'administration centrale est prévue en cas de détresse financière. En mars 2002, le Bund, les Länder et les autorités locales se sont mis d'accord sur un pacte de stabilité interne visant à respecter les engagements européens. Il s'agit en fait d'un accord politique et non d'un système juridique contraignant, l'efficacité du dispositif reposant sur la « pression des pairs » et sur la publicité donnée aux conclusions du Conseil de planification financière53 . Ce dernier examine la compatibilité des perspectives budgétaires locales avec le pacte de stabilité et les raisons d'éventuels dérapages. Il émet des recommandations de nature à restaurer la discipline budgétaire. Cependant, le système allemand ne s'est pas révélé entièrement satisfaisant, car l'incitation des échelons locaux à prendre en compte la cible globale fixée pour l'ensemble des finances publiques reste limitée. Les travaux en cours d'une Commission spécifiquement créée dans ce but visent à améliorer l'architecture du pacte de stabilité interne. Espagne Dans le double but de lutter contre le niveau élevé d'endettement public et de respecter le pacte de stabilité, le gouvernement espagnol a fait adopter, en décembre 2001, la loi de stabilisation budgétaire, par laquelle l'État et l'ensemble des administrations publiques sont tenus de respecter un équilibre strict des comptes publics en fin d'exercice. L'Espagne a ainsi mis en place un dispositif original : dans le cadre d'une organisation institutionnelle fortement décentralisée, reposant sur une autonomie de gestion des collectivités locales consacrée dans la Constitution, la loi de décembre 2001 institue un outil puissant de pilotage des finances publiques intégrant les différents niveaux d'administrations publiques. Ce principe de déficit zéro s'applique à chaque entité publique. En cas de déficit exceptionnel d'une entité, un plan de remise à niveau est mis en œuvre, qui comprend notamment la possibilité de faire appel à l'emprunt sous le contrôle des instances nationales. Des dispositifs de contrôle et de sanctions sont prévus par la loi. Ainsi, le gouvernement central surveille le respect par les collectivités locales des dispositions de la loi. Il peut imposer des conditions au recours à l'endettement par les communautés autonomes. Le cas échéant, la charge des sanctions financières qui seraient infligées à l'Espagne en vertu des dispositions du traité et du pacte de stabilité pourrait être répartie, à due proportion, entre les autorités qui sont responsables des déficits. Source : rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour 2005. b) Renouer des relations de confiance entre l'État et les collectivités territoriales La réussite d'une telle démarche partagée nécessite cependant de rétablir les liens de confiance, parfois ternis, entre les collectivités territoriales et l'État. M. Philippe Laurent, président-directeur général du cabinet Philippe Laurent Consultants, a ainsi relevé l'existence, structurelle, d'« une certaine défiance vis-à-vis de l'État pour tout ce qui concerne les questions financières, due à de nombreuses raisons, désormais ancrées en profondeur, à tel point que cela devient un leitmotiv. En effet, plusieurs réformes annoncées, telles que la révision des valeurs locatives ou le projet de création d'une taxe départementale sur le revenu, n'ont pas abouti, et certains glosent même sur le fait que personne ne voulait vraiment de la réforme de la taxe professionnelle - nous verrons ce qu'il en sera puisque des textes sont en préparation à ce propos. Par ailleurs, les charges transférées n'ont pas été compensées intégralement et, parmi les élus locaux et les fonctionnaires territoriaux, rares sont ceux qui croient aux annonces gouvernementales récentes concernant l'APA ou le RMI ». Et celui-ci accuse même l'État de traiter les collectivités territoriales « avec une certaine insouciance - le terme n'est pas politiquement correct, mais c'est le bon. Les normes, les règlements, la suppression progressive de la part salaires de la taxe professionnelle, la réforme des SDIS, la hausse du point d'indice, les annonces systématiques de mesures clés en juillet ou en janvier, tout cela dénote l'absence d'une volonté déterminée de dialogue, quelle que soit la majorité nationale. » M. Robert Grossmann, Président de la communauté urbaine de Strasbourg, partage le même constat d'imprévisibilité de l'État sur un sujet précis : « la situation est plus complexe lorsqu'il s'agit de recettes attendues de l'État, car celui-ci change parfois la règle du jeu en cours de projet et sans avertissement. C'est un problème douloureux, que nous ne manquons jamais de souligner. Un exemple parlant en est le financement des transports en commun en site propre, dont l'État avait vivement incité les villes à se doter. Nous avons donc financé des études et établi toutes nos prévisions sur un certain volume de recettes fournies par l'État. Mais celui-ci a décidé, à l'échelon national, de rayer d'un trait de plume la ligne de crédits de 69 millions d'euros qu'il avait inscrite pour les tramways et n'en promet plus, à titre de compensation, que 25 millions, à charge pour les collectivités d'emprunter le reste [...] Cette attitude a été unanimement réprouvée par les présidents de communautés urbaines, toutes tendances confondues, entraînant une réponse prometteuse, mais intelligemment formulée de façon à ne pas être trop précise, par le ministre délégué au Budget. » M. Jean-François Copé, Ministre délégué au Budget et à la réforme de l'État, en est parfaitement conscient : « il est indispensable de nouer des relations de confiance entre l'État et les collectivités territoriales ; or le grand problème tient à la persistance d'une méfiance traditionnelle, de nombreux élus locaux, à quelque bord politique qu'ils appartiennent, se refusant à croire, avec force précédents fâcheux à l'appui, que l'État pourrait tenir ses engagements. » Telle est aussi la conviction exprimée le 11 mai dernier devant votre Commission d'enquête par M. Pierre Méhaignerie, Président de la Commission des finances de l'Assemblée nationale : « le débat politique entre l'État et les collectivités est totalement faussé. Les accusations de part et d'autre sont justifiées, mais elles sont partiales et partielles. Car c'est vrai que si l'État ne transfère pas les dotations, il a pris en charge un poids tellement important, à travers les dégrèvements et les exonérations, qu'il finance en partie les collectivités territoriales. [...] Il y a une attente de transparence et de lisibilité de la part de nos compatriotes, attente à laquelle nous ne répondons pas, du fait de la complexité du système. L'État est souvent accusé par les collectivités territoriales. Il a le devoir de répondre. » On ne peut donc que partager le constat, exprimé par M. Philippe Laurent, que « les collectivités territoriales ont besoin de lisibilité et de stabilité, et l'État, à cet égard, doit évidemment se montrer irréprochable », à condition qu'il soit de bonne foi et ne cache pas la volonté de recevoir toujours plus sans avoir de compte à rendre à qui que ce soit. À cette condition, et à cette condition seulement, un véritable partenariat financier entre l'État et les représentants des collectivités territoriales pourra alors s'engager. Comme le rappelle M. Brice Hortefeux, ministre délégué aux collectivités territoriales, « il y a en réalité deux manières de concevoir les relations financières [entre l'État et les collectivités territoriales]. La première - le mot pourra vous choquer, mais il résume ce que je pense -, c'est de les concevoir d'une manière " syndicale ", où des collectivités territoriales revendiquent en permanence et demandent à l'État de les subventionner systématiquement [...]. La deuxième, celle peut-être que nous pourrions retenir, c'est celle d'une responsabilité collective devant l'importance des charges publiques. » Dans ce cadre, il faut rappeler que l'État donne des gages sérieux aux collectivités territoriales. La reconduction du contrat de croissance et de solidarité en est un, de taille : tout en s'imposant de ne pas accroître en volume ses propres dépenses, l'État a respecté à l'euro près le pacte de croissance des dotations aux collectivités territoriales, dotations qui ont significativement augmenté : 60 milliards d'euros en 2004, dont 37 milliards d'euros pour la seule DGF. C'est là un effort substantiel, conformément à un engagement précis. En effet, le contrat de croissance et de solidarité, institué par l'article 57 de la loi de finances pour 1999, qui a lié l'État et les collectivités territoriales sur la période 1999-2003, a été prorogé en 2005 dans les mêmes conditions qu'en 2004. Ce contrat, contrairement au précédent pacte de solidarité, fait participer les collectivités locales aux fruits de la croissance puisque l'enveloppe de concours déterminée évolue chaque année comme le taux d'évolution des prix à la consommation hors tabac augmenté d'une fraction du PIB en volume, la part de PIB prise en compte dans l'indexation de l'enveloppe normée des concours de l'État étant de 33 % en 2005 (contre seulement 20 % en 1999 et 25 % en 2000). Compte tenu des hypothèses économiques retenues, le taux d'indexation du contrat de croissance et de solidarité est de 2,63 % en 2005. Les collectivités territoriales sont ainsi assurées d'une prévisibilité de ces concours sur la période du contrat. Pour l'avenir, M. Jean-François Copé, ministre délégué au budget et à la réforme de l'État, a proposé de moduler ce contrat en fonction d'engagements des collectivités territoriales : « on peut [...] s'interroger sur l'avenir du contrat de croissance pour l'indexation des dotations. Je comprends parfaitement que, du point de vue des élus locaux, le fait de toujours avoir la garantie d'une augmentation aussi significative des dotations soit une bonne chose. Mais je maintiens devant votre Commission que la question mérite que l'on y réfléchisse, alors que l'État tient ses engagements en versant des dotations très importantes et que, dans le même temps, les taux de fiscalité locale, tout comme les dépenses, augmentent de façon très significative. » M. Brice Hortefeux, ministre délégué aux collectivités territoriales, rappelle aussi au Parlement, lequel consent à l'impôt, l'importance de bien évaluer et soupeser ce versement de l'État aux collectivités territoriales : « 61 milliards d'euros, c'est 20 % des recettes de l'État qui ne font que transiter du contribuable national vers les collectivités territoriales. Chiffre colossal, qu'il convient de soupeser avec précision et raison lors de chaque loi de finances. » Il faut aussi insister sur une autre initiative - lourde pour l'État puisqu'elle représente 10 % de ses marges de manœuvre budgétaires - prise par le Gouvernement pour renouer des relations de confiance avec les collectivités territoriales. M. Jean-François Copé, ministre délégué au Budget et à la réforme de l'État, a ainsi rappelé devant votre Commission que « le Premier ministre Jean-Pierre Raffarin avait annoncé une compensation au titre de 2004 du différentiel constaté entre la TIPP affectée aux départements et les dépenses de RMI, actuellement évalué à environ 450 millions d'euros. Il faut y voir un gage que le Gouvernement a voulu donner aux élus locaux dans le souci d'établir des relations de confiance, et le geste est d'autant plus important qu'il n'était pas prévu à l'origine. » Dans un autre domaine enfin, il faut rappeler la décision prise fin 2004 par M. Jean-Pierre Raffarin, alors Premier ministre, de soumettre aux élus locaux toute nouvelle décision qui aurait pour effet de diminuer la présence d'un service public en milieu rural. Cette décision a été reprise à son compte par M. Nicolas Sarkozy, nouveau ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le 17 juin 2005 à Vitré : « je souhaite l'organisation d'une réelle concertation entre les élus locaux, les préfets et les représentants de tous les services publics existants. Dans l'attente de ces réunions, nous gelons le processus de restructuration, qui avait été précédemment engagé. » Comme le précise celui qui fut aussi ministre de l'économie et des finances, cette approche peut très bien se faire « sans augmentation budgétaire ». c) Que l'État, par sa réforme, montre l'exemple Au-delà, l'État se doit aussi de faire évoluer ses structures, les statuts de ses personnels et la réglementation qui s'applique, directement ou indirectement, aux collectivités territoriales. Ce mouvement de réforme de l'État, renforcé par le Gouvernement de M. Dominique de Villepin avec la réunion, sous la férule d'un même ministère délégué, de la réforme de l'État et du budget, doit bien évidemment aller de pair avec la mise en œuvre de l'acte II de la décentralisation. Un effort de réforme de l'État doit donc être entrepris. Comme le rappelait fort justement M. Alain Rousset, président de l'Association des régions de France au cours de l'audition du 30 mars dernier : « la France est le seul pays d'Europe où, dans la plus pure tradition jacobine, chacune des compétences des régions est doublonnée par les services de l'État. Ce mélange de décentralisation et de déconcentration a un coût, et complique le travail des collectivités territoriales. » Le 11 mai 2005, M. Pierre Méhaignerie posait la même exigence au niveau central : « Dans un système très verticalisé, chaque chef de bureau n'est attentif qu'à ce qui relève de sa compétence. Nous aboutissons à des additions de coûts qui deviennent insupportables pour le contribuable, national ou local. J'ajoute que moins il y aura de ministres, plus il sera possible de marquer une pause réglementaire. » Dans la perspective des prochains débats budgétaires, il faudra poser clairement la question des conséquences de la décentralisation sur l'évolution des emplois au sein de la fonction publique de l'État : des suppressions d'emplois en administration centrale, ou à tout le moins des redéploiements au profit des services déconcentrés, sont légitimes et souhaitables, notamment dans les ministères tels que l'éducation nationale ou l'équipement, particulièrement concernés par la mise en œuvre de l'acte II, ou l'emploi et la cohésion sociale, avec la mise en œuvre du « plan Borloo ». Le total des bureaux d'administration centrale concernés par la loi du 13 août 2004 dépasserait la soixantaine : il y a donc bien là un champ, non pas nécessairement de fermetures pures et simples, mais de regroupements et de restructurations de services, qui vont tout à fait dans le sens, et de la mise en œuvre de la LOLF, et de la réforme de l'État. La simplification des structures permettra également un allègement des procédures, au bénéfice en premier lieu des collectivités territoriales, mais au-delà aussi des citoyens. Sur cet aspect, la réforme de l'État aiguillonnée par la décentralisation, M. Robert Grossmann, Président de la Communauté urbaine de Strasbourg, a évoqué devant votre Commission un sujet précis, l'eau : « nous nous efforçons de respecter les normes, ce qui coûte très cher, et en face, du côté de l'Etat, nous avons affaire à cinq interlocuteurs, peut-être même plus : la DDASS, la DRASS, l'agence de bassin, l'ADEME, la DRIRE, la DDA, et j'allais oublier la DIREN. » Un regroupement des services de l'État s'adressant aux collectivités territoriales serait nécessaire, autour du sous-préfet dont le Premier ministre, M. Dominique de Villepin, a annoncé, dans son discours de politique générale devant l'Assemblée nationale, le 8 juin 2005, vouloir renforcer le rôle : « je souhaite [...] redéfinir la carte des arrondissements, et renforcer le rôle des sous-préfets : ils doivent être les premiers représentants de l'État dans tous les lieux de France qui sont aujourd'hui négligés, les quartiers urbains mal desservis, les régions isolées, les campagnes. » Le Parlement a aussi sa part de responsabilité dans la réforme de l'État, conformément au vœu du Président de l'Assemblée nationale, M. Jean-Louis Debré, de légiférer moins, mais mieux. Il ne faut pas que le législateur oublie de prendre en considération les conséquences des lois qu'il vote pour les collectivités territoriales. M. Robert Grossmann, Président de la Communauté urbaine de Strasbourg, a ainsi insisté sur : « la complexification et la judiciarisation de la vie publique [qui] sont devenues telles qu'on ne peut plus monter de projets comme il y a encore quelques années, que sur chaque projet il faut, à côté des ingénieurs et des techniciens qui se donnent à fond, des juristes pour détecter si tel texte, telle virgule est conforme à ce qu'attendent les tribunaux administratifs, sans quoi le projet risque de se heurter à des obstacles pour des raisons de forme, comme c'est arrivé récemment avec le tramway. Il faut simplifier ce maquis juridique. Quand nous évoquons le sujet avec nos avocats, ils nous disent : nous ne sommes pas le législateur, c'est lui qu'il faut interpeller ! Nous souhaitons un vrai toilettage de tous les codes : celui de l'urbanisme, celui des collectivités territoriales, pour que ce soit plus compréhensible par tout le monde. » Votre Rapporteur souhaite qu'à l'issue des travaux de cette Commission d'enquête, un groupe de travail, associant parlementaires et élus locaux, soit mis en place et travaille avec la Commission supérieure de codification afin de « toiletter » tous les textes ayant des conséquences, directes ou indirectes, sur les collectivités territoriales. En ce qui concerne les personnels enfin, Mme Fabienne Keller, maire de Strasbourg, a suggéré de créer plus de passerelles entre fonctions publiques d'État et territoriale : « les collectivités ont besoin de cadres de qualité. L'État en a beaucoup, alors qu'il a moins de compétences. Il y a peut-être des flux à encourager, des évolutions de carrière à valoriser plus qu'elles ne le sont actuellement, de meilleures synergies à assurer entre les niveaux de compétence, de façon à limiter les surcroîts de charges liés à la méconnaissance mutuelle ou à l'insuffisante optimisation de l'organisation institutionnelle. » d) La notion de collectivité chef de file comporte bien des inconvénients ; le plafonnement des subventions serait plus efficace Votre Rapporteur partage totalement le constat de M. Pierre Méhaignerie sur la superposition des niveaux d'intervention, conduisant à des empilements de subventions (cf. 2ème partie, I, A, 1, a). Il ne souhaite cependant pas soulever à nouveau le « serpent de mer » de l'organisation institutionnelle locale et de la suppression d'un échelon de collectivités, car cette piste serait aujourd'hui vaine et ne règlerait pas, comme par magie, tous les problèmes. M. Marc Censi, président de l'Association des communautés de France, a lui aussi indiqué devant votre Commission qu'il « ne croi[t] pas à la simplification, tant la matière est complexe. C'est une chimère que nous n'atteindrons jamais. » Votre Rapporteur ne croit pas beaucoup à la notion commode de chef de file. Celle-ci a l'avantage d'approcher la notion de répartition des compétences sans atteindre à sa rigueur ; elle porte une réelle intelligence de coopération. Mais comment définir clairement l'identité et le rôle des chefs de file ? Comment éviter de créer une hiérarchie, que nous ne voulons pas entre collectivités ? Comment pratiquer dans des conditions respectueuses du principe de subsidiarité : les communes, en particulier, n'ont pas pour seule vocation de s'occuper des missions dont personne d'autre n'aurait voulu. Une autre proposition, plus radicale, a été suggérée par M. Pierre Méhaignerie, président de la Commission des finances de l'Assemblée nationale. Elle consisterait à « instituer un taux de subvention maximal, qui ne pourra pas être dépassé, sauf peut-être pour les communes très pauvres. » Une telle limitation, intégrant nécessairement une dimension de péréquation et rationalisant l'exercice de l'autonomie des collectivités territoriales sans aucunement la remettre en cause, devrait faire l'objet d'une disposition législative générale. En favorisant l'émergence d'une subsidiarité entre les collectivités, ce serait un puissant facteur de modération de la dépense et de clarté des décisions. C.- MESURER LA PERFORMANCE DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES L'adoption, par le Parlement unanime, de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) ouvre une évolution majeure pour la gestion publique en France. Cette réforme de la procédure budgétaire vise en effet à atteindre trois objectifs fondamentaux : - améliorer la transparence des informations budgétaires pour redonner tout leur sens et leur portée à l'autorisation et au contrôle parlementaires de la dépense publique ; - afficher avec une plus grande clarté les choix stratégiques des finances publiques ; - confier une plus grande responsabilité aux gestionnaires publics, en orientant davantage les budgets vers les résultats. La LOLF représente ainsi, pour la gestion publique, une opportunité exceptionnelle de modernisation et de progrès. La mise en regard - dans chaque programme ministériel - des indicateurs d'objectifs et des moyens, doit permettre à la fois une décision éclairée du Parlement et un suivi des réalisations. Alors que la LOLF est en passe d'être transposée aux finances sociales (le projet de loi organique relative aux lois de financement de la sécurité sociale est encore en cours d'examen par le Parlement, mais devrait s'appliquer progressivement dès l'automne 2005), les finances locales ne peuvent rester à l'écart de ce mouvement. M. Jean-François Copé, ministre délégué au budget et à la réforme de l'État, a ainsi rappelé qu'« alors que cette année voit la mise en œuvre de la LOLF pour l'État, que de son côté la sécurité sociale se dote, également par une loi organique, d'instruments de modernisation de sa gestion, ne peut-on penser à adapter quelques principes de la LOLF à la gestion des collectivités territoriales ? » Comme on vient de le voir, au niveau local aussi, c'est un meilleur rapport coût/efficacité de la dépense - c'est-à-dire son efficience -qui est en jeu. Telle est la conviction exprimée devant votre Commission d'enquête par M. Pierre Méhaignerie, président de la Commission des finances de l'Assemblée nationale : « aujourd'hui, l'impératif industriel, l'attente d'emplois et de pouvoir d'achat doivent conduire les élus locaux, quelles que soient les difficultés, à rechercher toutes les voies possibles pour améliorer le rapport qualité/coût de leurs services. » Or, non seulement on manque aujourd'hui d'instruments pour évaluer le rapport coût/efficacité de la dépense locale, mais aussi la communication budgétaire des collectivités territoriales pourrait gagner en transparence. 1.- Une meilleure communication budgétaire pour plus de transparence et de démocratie locale a) De nombreux progrès ont déjà été réalisés La fin des années 1980 et le début des années 1990 ont été caractérisés, pour certaines collectivités territoriales (le cas de la ville d'Angoulême est topique), par des situations de sinistre financier qui tenaient beaucoup à une gestion hasardeuse, mais aussi au fait que l'État n'avait pas prévu la présentation de documents budgétaires consolidés retraçant la situation financière des collectivités et permettant au contrôle budgétaire (préfet, trésorier payeur général et, a posteriori, chambre régionale des comptes) de se prononcer de manière valable et rapide sur les évolutions budgétaires. Ainsi que l'a rappelé M. Michel Klopfer, président-directeur général du cabinet Michel Klopfer, en 1992, « on pouvait déjà accéder par Minitel aux comptes de n'importe quelle SA ou SARL de France ou de Navarre, mais certainement pas à ceux des collectivités publiques. » Un progrès a alors été accompli avec la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République, dite « ATR », qui a prévu la communication des comptes, la comptabilité des engagements ou la production d'annexes consolidées. Les nouvelles nomenclatures comptables fournissent également toute l'information financière souhaitable. M. Dominique Schmitt, Directeur général des collectivités locales, l'a rappelé durant son audition du 10 mai dernier : « le législateur a [...] prévu des annexes budgétaires très utiles quant à l'engagement budgétaire de la collectivité, en termes de garanties d'emprunt et d'état des concours financiers à des tiers. Il a également institué le débat d'orientations budgétaires qui est très important, en amont du vote du budget primitif, pour faire jouer cette régulation. J'ajoute que les nomenclatures comptables ont évolué, puisqu'on a cherché à les rapprocher des principes de la comptabilité générale, et elles intègrent une approche patrimoniale. » Pour résumer, toutes les communes de plus de 3 500 habitants doivent désormais produire, en annexe de leur compte administratif, une série d'indicateurs synthétiques qui retracent leur situation financière réelle. Ces indicateurs synthétiques font l'objet d'une exploitation statistique par l'État et d'une publication régulière (par la voie de la Documentation française et sur le site Internet du ministère de l'intérieur), ce qui permet aux citoyens et aux élus locaux eux-mêmes de procéder à une comparaison par strate particulièrement pertinente sur les grands déterminants du budget (niveau des dépenses réelles de fonctionnement, niveau de l'autofinancement courant, niveau de l'endettement). En outre, le budget est systématiquement accompagné d'annexes relatives aux engagements de la collectivité en termes de garanties d'emprunt, ainsi que les états de concours financiers à des tiers (sociétés d'économie mixte, associations,...). De plus, avec la tenue, en amont du vote du budget primitif, d'un débat sur les orientations budgétaires (DOB), les membres de l'assemblée délibérante comme les citoyens disposent d'un grand nombre d'éléments d'information, ce qui leur permet d'exercer un contrôle sur l'évolution budgétaire des collectivités territoriales. Enfin, parallèlement à ce travail réalisé dès 1992, les instructions budgétaires et comptables de l'ensemble des collectivités territoriales (M 14, M 52, M 71) ont été revues depuis 1997 pour favoriser une meilleure lecture et appréciation des budgets des collectivités concernées. On est peut-être allé un peu trop loin dans ce sens, un certain nombre de critiques ayant été émises sur la complexité des documents budgétaires, rendant leur lecture difficile - même pour les élus -, et sur la masse des documents demandés. Votre Rapporteur a également pu constater, au travers des réponses envoyées par les différentes collectivités territoriales sollicitées au questionnaire qu'il leur avait adressé, la très grande hétérogénéité des présentations budgétaires retenues par les exécutifs locaux, rendant très difficiles les comparaisons d'un budget à un autre dès que l'on s'écarte d'une vision strictement comptable ou des ratios traditionnels de structure financière. Un groupe de travail, présidé par le sénateur Jean-Claude Frécon, a ainsi été mis en place en 2003 par le Comité des finances locales pour réfléchir à une adaptation et à une simplification du cadre budgétaire et comptable des communes et de leurs établissements publics. Ce groupe de travail a rendu son rapport en décembre 2004, énonçant 26 propositions de simplification qui ont été examinées par le Comité des finances locales lors de sa séance du 1er mars 2005. S'agissant de l'objectif d'amélioration de la lisibilité des documents budgétaires, il a notamment été proposé de mettre en place une seule nomenclature croisée simplifiée - applicable pour toutes les communes quelle que soit leur taille -, de prévoir des présentations synthétiques permettant une vue d'ensemble du budget, de simplifier les annexes - en supprimant l'obligation d'annexer certains documents - et de mieux valoriser l'information relative au budget et à la situation financière des communes, notamment en réformant le suivi de l'état de la dette et en créant un état relatif à la gestion pluriannuelle. Un projet d'ordonnance et deux projets de décret faisant suite aux préconisations de ce rapport ont reçu un avis favorable du Comité des finances locales. Ces textes doivent être publiés prochainement, leur entrée en vigueur étant prévue au 1er janvier 2006 pour les communes et les départements, lesquels ont souhaité bénéficier d'une partie des avancées de la réforme de l'instruction M 14. Ils devraient également être transposés ultérieurement aux régions. Il s'agit d'une avancée certaine, qu'il faut saluer. Mais votre Rapporteur estime nécessaire d'aller au-delà de ces aspects, qui restent essentiellement techniques. La documentation mise à la disposition des élus devrait désormais être plus satisfaisante. C'est sur l'information des citoyens qu'il convient maintenant de faire porter l'effort. b) Plus de lisibilité et de transparence sont encore à rechercher Des progrès restent à accomplir en termes de transparence budgétaire des collectivités territoriales, dans trois domaines principalement : la consolidation des comptes entre communes et intercommunalités et sur un territoire plus large, une publicité beaucoup plus grande qu'aujourd'hui, le suivi des compétences obligatoires exercées par chaque collectivité. Tout d'abord, il importe d'assurer un meilleur suivi de l'ensemble que constituent communes et structures de coopération intercommunales, cause certaine d'augmentation de la fiscalité locale comme cela a été démontré dans la deuxième partie du présent rapport. La publication de comptes combinés communes-communautés apparaît tout à fait nécessaire aux yeux de votre Rapporteur, qui partage l'opinion exprimée devant votre Commission par M. Alain Pichon, président de la 4ème chambre de la Cour des comptes : « ce qui est plus préoccupant, [...] c'est la difficulté d'appréhender la situation financière et patrimoniale globale de la territorialité couverte par l'intercommunalité, faute de pouvoir retraiter [...] les données. [...] l'appareil d'État devrait faire un effort d'adaptation pour mieux suivre et accompagner cette évolution. » M. Jean-Philippe Vachia, président de la Chambre régionale des comptes de Midi-Pyrénées, estime aussi, d'un point de vue plus positif, que « la logique profonde de la TPU, même si elle n'apparaît pas dans la lettre de la loi de 1999, repose sur la définition d'une stratégie financière et fiscale coordonnée entre la communauté et les communes membres, sans quoi l'on risque d'aboutir à de graves désillusions. Il peut y avoir des pactes fiscaux, des pactes de redistribution, mais cela ne suffit pas : le pacte ne doit pas seulement porter sur le partage de la recette. [...] Des communautés en ont une, mais ce n'est pas une obligation, c'est seulement une recommandation de bonne gestion, même si c'est absolument indispensable. » Pour que cette coordination entre communes et communautés puisse effectivement se mettre en place, un préalable nécessaire est bien d'exiger des communes et des communautés à élaborer une documentation budgétaire combinée, à défaut d'être conjointe, et selon une présentation harmonisée au niveau national. M. Charles-Éric Lemaignen, vice-président de l'association des communautés de France chargé des affaires financières et fiscales, a rappelé que « la loi [ATR] de 1992 a [...] prévu de consolider seulement le budget des communes et les budgets annexes, pas celui des communes et celui de la communauté. Certaines communautés l'ont quand même fait. C'est donc tout à fait possible. Ce sont des comptabilités du même type, qui sont tout à fait consolidables. » M. Marc Censi, président de l'association des communautés de France, a confirmé devant votre Commission que cette approche est tout à fait possible : « s'agissant des comptes consolidés, il y a actuellement une initiative de l'administration fiscale, qui se traduit par de nombreuses expériences, notamment dans ma communauté d'agglomération [du Grand Rodez]. L'administration met en place un système de comptes consolidés de l'ensemble des collectivités - communes et intercommunalités. Ce système se met en place progressivement, et c'est la seule façon d'atteindre la vérité de la situation financière du couple communes-communauté. » Comme le rappelle aussi M. André Thomas, directeur général délégué des services de la ville et de la communauté urbaine de Strasbourg, « les quatorze communautés urbaines de France disposent d'outils agrégés de comparaison, mais surtout entre elles. » Il suffirait de prévoir leur publication, selon une présentation harmonisées qui serait élaborée en accord avec la direction générale des collectivités locales. Au-delà de cette amélioration de la présentation des comptes aux niveaux communal et intercommunal, on peut aussi songer à rendre plus transparents l'ensemble des budgets locaux sur un territoire donné, ce qui permettrait de présenter des éléments de comparaison standardisés, avec des analyses objectives pour faciliter les comparaisons. Si « comparer les chiffres disponibles de la dette par habitant de Paris et de Francfort ou de Barcelone n'a rigoureusement aucun sens, compte tenu des différences entre systèmes », comme l'a fort justement rappelé devant votre Commission M. Michel Klopfer, président-directeur général du cabinet Michel Klopfer, il faut aujourd'hui développer les analyses entre collectivités comparables au sein du système local français. La publication des données budgétaires et fiscales devrait donc s'accompagner de la présentation de moyennes par strates de collectivités équivalentes. Ainsi, le conseil économique et social d'Alsace a-t-il fait réaliser par des universitaires un Tableau de bord des finances locales en Alsace, qui présente sur sept ans les budgets de l'ensemble des collectivités de la région, l'évolution de leur dette et de la fiscalité locale. Ce tableau de bord se voulait une radiographie complète des finances des diverses collectivités territoriales de la région Alsace, jusque dans chacune des composantes de leurs budgets. Voilà un exemple à suivre. Ces éléments doivent faire l'objet d'une publicité accrue, pour que les citoyens et les élus puissent effectivement comparer l'action de leur collectivité avec celle des autres, et les moyens engagés. Telle est la proposition faite devant votre Commission par M. Pierre Méhaignerie, président de la Commission des finances de l'Assemblée nationale : « nous avons d'abord, à mon sens, un devoir de vérité, que ce soit en matière de lisibilité ou de transparence. La complexité est telle qu'elle rend illisibles pour l'électeur les responsabilités de chacun. Je souhaiterais que, par la voie des trésoreries générales ou par celle des chambres régionales des comptes, soit affiché un traitement harmonisé de l'évolution des dépenses, des taux, en précisant le potentiel financier des collectivités de plus de 10 000 habitants par rapport au potentiel financier moyen. Cet effort de transparence doit aussi conduire à indiquer l'évolution des dotations de l'État. [...] Dans les grands journaux d'information, les citoyens peuvent prendre connaissance des résultats des marchés publics. On pourrait, dans les mêmes conditions, rendre obligatoire la publication dans les grands quotidiens locaux d'information de l'évolution des impositions dans l'ensemble des collectivités territoriales de plus de 10 000 habitants, de façon que le citoyen voie plus clairement la responsabilité et l'engagement de chacune des collectivités. Cela impliquerait que soit également connu le potentiel financier de la commune par rapport à la moyenne du potentiel financier des communes ayant la même population, ainsi que l'évolution des dépenses de fonctionnement et d'investissement, sans oublier l'évolution des taux des différents impôts locaux. » À l'idée de votre Rapporteur de fournir, avec les avis d'impôts locaux, de telles informations comparatives - au-delà de l'évolution des taux appelés et comme cela se fait bien pour la déclaration d'impôt sur le revenu -, éléments qui permettraient d' « étalonner » la contribution de chacun, Mme Marie-Christine Lepetit, Directrice de la législation fiscale à la Direction générale des impôts, a répondu qu'« on peut l'imaginer, à l'exemple du document à caractère général joint à la déclaration d'impôts. La difficulté tient à ce que les finances des collectivités territoriales sont un sujet si complexe qu'il est très malaisé de se faire une religion au vu d'informations synthétiques. C'est un monde très divers qu'il est difficile de photographier de manière tout à la fois pertinente et synthétique. La richesse des rapports administratifs, qui collationnent les informations venant de 50 000 collectivités, donne parfois le tournis... Votre souci de mieux informer le contribuable est légitime, mais trouver le meilleur moyen d'y répondre n'est pas chose facile. » C'est pourquoi, au-delà des informations brutes que propose de présenter M. Pierre Méhaignerie, il faut aussi prévoir l'élaboration d'indicateurs, sur les parties recettes et dépenses des budgets locaux, plus harmonisés entre collectivités qu'aujourd'hui. Par ailleurs, il serait souhaitable de mieux identifier, au sein des budgets locaux, ce qui relève des compétences obligatoires et ce qui ressortit aux compétences facultatives exercées par les collectivités. En effet, les nomenclatures comptables sont parfois insuffisamment détaillées pour un suivi précis des dépenses correspondant aux compétences transférées, comme votre Rapporteur a pu le constater en analysant les budgets que lui ont communiqués les collectivités territoriales qu'il a interrogées. M. Dominique Schmitt, directeur général des collectivités locales, en convient parfaitement : « les nomenclatures comptables, parfois insuffisamment détaillées, ne permettent pas un suivi précis des dépenses correspondant aux compétences transférées. » Il n'est pas possible d'attendre l'analyse a posteriori, par le ministère de l'intérieur ou les chambres régionales des comptes, des comptes administratifs, notamment pour ce qui touche à la ventilation des dépenses par fonction. Ces données sont essentielles au débat budgétaire de la collectivité et doivent donc être disponibles, de manière harmonisée au niveau national, dès la présentation des budgets primitifs. Des réalisations concrètes, pratiques et très intelligentes du conseil général de la Nièvre, présentées par son président, M. Marcel Charmant, devant votre Commission, méritent d'être retenues : « les conseillers généraux de la Nièvre disposent, depuis l'an dernier, d'un tableau faisant apparaître, politique par politique, le coût des compétences obligatoires et le surcoût décidé par l'assemblée départementale. [...] Il faudrait mieux faire ressortir ce que coûte tel ou tel service. C'est pourquoi nous proposons aux Nivernais une présentation budgétaire un peu originale : les dépenses de fonctionnement de la machine administrative sont distinguées des enveloppes mises à la disposition de la Nièvre et des Nivernais, chacun pouvant ainsi voir ce que le département lui consacre. Un conseil de questure que j'ai créé, composé de conseillers de la majorité et de l'opposition, est arrivé aux conclusions suivantes : 86 % des moyens sont dépensés au profit des usagers et 14 % vont au fonctionnement de l'institution. Lors des réunions cantonales, nous organisons une exposition et nous remettons une brochure aux personnes présentes - car nous savons où finissent les papiers que reçoivent les gens dans leur foyer. Et c'est dans le même esprit que nous retransmettons par Internet les sessions du conseil général. » M. Jean-Yves Le Drian, président du conseil régional de Bretagne, a aussi refondu la présentation du budget de sa collectivité : il présente un budget simplifié, plus lisible, qui identifie les grands axes de l'action de la région, à travers les missions prioritaires choisies. Il est ainsi possible de mieux identifier les raisons réelles d'augmentation de la fiscalité qui a pu être décidée. Cette piste paraît très fructueuse. La distinction entre les dépenses obligatoires et celles résultant de l'initiative de chaque collectivité est tellement significative de ses orientations politiques qu'il convient de lui donner une portée juridique et de la sanctionner par un vote. Il sera donc souhaitable, dans les collectivités de plus de 3 500 habitants, de faire voter distinctement les budgets relatifs aux compétences obligatoires et les budgets portant sur des actions d'initiative locale. 2.- Des indicateurs de résultat dans un souci de bonne gestion L'amélioration de la transparence des budgets locaux peut être un but en soi, mais, bien plus, une véritable avancée de la démocratie locale pourra résulter d'une mise en synergie avec une nouvelle démarche de mesure de la performance des collectivités territoriales. a) Les modalités actuelles d'examen de la gestion des collectivités territoriales sont largement insuffisantes L'examen de la gestion des collectivités territoriales constitue une des missions des chambres régionales des comptes. En effet, en vertu de l'article L. 211-8 du code des juridictions financières, « la chambre régionale des comptes examine la gestion des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. [...] L'examen de la gestion porte sur la régularité des actes de gestion, sur l'économie des moyens mis en oeuvre et sur l'évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par l'assemblée délibérante ou par l'organe délibérant. L'opportunité de ces objectifs ne peut faire l'objet d'observations. » Comme l'a précisé M. Olivier Ortiz, président de la Chambre régionale des comptes d'Alsace, « les missions de la chambre régionale des comptes s'exercent essentiellement dans le cadre d'un contrôle financier a posteriori, ce qui explique le délai de traitement des exercices, mais la chambre a également l'occasion d'agir de manière un peu plus contemporaine dans le cadre du contrôle des actes budgétaires. Cette procédure, moins contrainte par les règles d'une pleine et totale contradiction, s'exerce dans un délai relativement bref et nous autorise à une parole relativement plus libre. Le contrôle des actes budgétaires est notamment l'occasion pour les chambres d'examiner certaines situations de tension, de constater les choix fiscaux arrêtés par les collectivités, de les analyser et de formuler des propositions, transmises sous forme d'avis aux intéressées et au représentant de l'État. » Ces interventions des chambres régionales des comptes, pourtant très limitées en pratique par les moyens de ces juridictions - qui ne leur permettent de réaliser de rapports sur la gestion des structures publiques locales qu'en moyenne tous les quatre à cinq ans pour les plus grandes collectivités -, ne sont pas allées sans des grincements de dents de la part des responsables des exécutifs des collectivités territoriales. Des tensions fortes entre élus locaux et juridictions financières sont ainsi apparues dans le courant des années 1990, et ont abouti à une définition plus précise de la notion de contrôle de gestion - laquelle ne doit pas porter sur l'opportunité des choix des collectivités - par la loi du 21 décembre 2001 relative aux chambres régionales des comptes et à la Cour des comptes. M. Olivier Ortiz, président de la Chambre régionale des comptes d'Alsace, a cependant constaté, ironie de l'histoire, qu'en fait « la loi du 21 décembre 2001 [...] a eu pour effet de donner une définition et un contenu à l'examen effectué par les chambres régionales des comptes sur la gestion des collectivités territoriales - ce qui, en fait d'innovation, a surtout abouti à conforter des pratiques existantes. » Une autre « déconvenue » en matière d'examen de la gestion des collectivités territoriales est intervenue lors de l'examen parlementaire de ce qui allait devenir la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. En effet, dans la perspective de la préparation de cette loi, le Premier ministre, M. Jean-Pierre Raffarin, avait confié à M. Gilles Carrez, rapporteur général de la Commission des finances de l'Assemblée nationale, le soin de rédiger un rapport sur l'évaluation des politiques locales. Ce rapport proposait la création d'un Conseil national des politiques publiques locales. L'article 92 du projet de loi54, qui reprenait cette proposition, a été supprimé à l'initiative du Sénat, au motif qu'il existerait déjà assez de structures chargées de l'évaluation des politiques locales (juridictions financières, cabinets de consultants mandatés par les collectivités locales, Comité des finances locales, Observatoire des finances locales, conseil économiques et sociaux régionaux, INSEE, direction générale des collectivités locales). Même si la création d'une nouvelle structure n'était pas nécessairement en elle-même une idée très séduisante, il pouvait quand même paraître souhaitable de se donner les moyens d'évaluer de manière méthodologiquement coordonnée toutes les politiques locales, qu'elles soient conduites par l'État ou par les collectivités territoriales. Il pouvait s'agir d'un contrepoint nécessaire à l'octroi de nouvelles compétences par l'acte II de la décentralisation. Dans la même perspective, le rapport d'information (n° 876) de notre collègue M. Georges Tron sur les organismes publics d'évaluation et de prospective économiques et sociales, réalisé dans le cadre de la mission d'évaluation et de contrôle (MEC) de votre Commission des finances en mai 2003, a proposé de créer un réseau d'instances régionales d'évaluation des politiques décentralisées, financées à la fois par l'État et les collectivités territoriales. Selon l'auteur de ce rapport, il est en effet indispensable de disposer d'une vue d'ensemble des politiques décentralisées et de leur impact, à l'heure de la nouvelle étape de la décentralisation. La cohérence de l'évaluation ne peut en effet être réalisée que par la remontée au niveau national des informations collectées, notamment pour pouvoir effectuer des comparaisons. À cet égard, votre Rapporteur estime que l'Observatoire des finances locales, créé au sein du Comité des finances locales, semble bien outillé pour remplir cette mission. Pourquoi toutes ces initiatives n'ont-elles pas abouties ? Qu'est-ce qui s'oppose à mettre en œuvre une véritable évaluation de la gestion des services publics locaux, dont on a pourtant pu constater le poids économique et financier croissant ? Il semble qu'il faille d'abord faire la part d'une certaine culture des élus locaux, rétive au contrôle, que les auditions de votre Commission d'enquête ont bien mise en évidence. Les divers consultants entendus ont pu le constater. Ainsi que l'a rappelé M. Dominique Hoorens, directeur des études et de la documentation de Dexia Crédit Local, « l'étendue et la qualité des services rendus à la population ont évidemment un impact sur les charges et par conséquent sur la fiscalité. [...] Les élus en sont seuls maîtres, à travers leur pouvoir d'apporter les réponses aux besoins de la population ». Pour M. Philippe Laurent, président-directeur général du cabinet Philippe Laurent Consultants, « la bonne gestion, notion au demeurant extrêmement subjective, n'est qu'un élément parmi d'autres du bilan des élus, et cet élément est loin d'être déterminant. » Les élus interrogés l'ont reconnu. M. Jacques Pélissard, président de l'Association des maires de France, a dénié à quiconque autre que les élus locaux et leurs électeurs le droit de juger de cette bonne gestion : « les élus locaux ne peuvent pas accepter la mise en cause de leur gestion. [...] Derrière ces critiques, il y a une opposition sous-jacente entre la gestion des collectivités territoriales et celle de l'État, qui serait soi-disant vertueuse et nous savons qu'elle ne l'est pas. Nous ne pouvons accepter ces critiques. En effet, elles ne tiennent pas compte du fait que l'évolution des dépenses publiques est largement dépendante des décisions de l'État. En second lieu, les collectivités ont largement démontré l'effet positif de leur implication pour l'économie nationale. » M. Marc Censi, président de l'Association des communautés de France, a tenu le même discours en réponse à une question de votre Rapporteur concernant la nécessité, pour les intercommunalités, de se consacrer principalement à la recherche d'une économie de moyens et de mutualisation des coûts, plutôt qu'à faire émerger de nouvelles ambitions : « vous touchez là à un jugement d'opportunité sur les politiques locales. Il appartient aux élus locaux, dans le cadre de leur mandat, de savoir si, dans la perspective du développement local, au sens durable du terme, c'est-à-dire social, économique, environnemental, ils doivent prendre des initiatives qui dépassent le strict équipement qu'ils auraient envisagé dans le cadre communal. [...] Il appartient aux élus locaux de dialoguer avec les contribuables, avec les usagers, avec les électeurs, pour savoir s'il faut se contenter d'une stricte mutualisation des moyens ou rechercher une stratégie de développement territorial. [...] Je me garderais, pour ma part, de porter un jugement sur les choix politiques de mes collègues. Si certains veulent se limiter à la stricte mutualisation des moyens dans le seul but d'aboutir à une meilleure gestion ou administration et à la recherche d'économies d'échelle, c'est leur droit, mais s'ils pensent que leur responsabilité politique est de dépasser la notion de gestion et d'administration et de faire du développement local, c'est leur droit aussi. [...] « Je crois que le souci de votre Commission de détecter si le système engendre des dépenses supplémentaires en tant que système est louable, et nous le partageons, mais dès lors que vous débordez sur un jugement d'opportunité des politiques locales, et notamment sur le choix des investissements, il y a une contradiction avec la lettre de la Constitution, qui consacre le principe de libre administration des collectivités territoriales. » M. Georges Frêche, président du conseil régional de Languedoc-Roussillon et de la communauté d'agglomération de Montpellier, a été encore plus direct : « rappelons-le puisque cela semble nécessaire, la Constitution dispose en son article 72 que « les collectivités s'administrent librement par des conseils élus ». Aussi vous répondrai-je avec la courtoisie due à l'institution que vous représentez, mais, sur le fond, je ne me reconnais de maîtres que le suffrage universel et le peuple souverain. [...] Dans le domaine de la qualité de gestion, je n'ai pas beaucoup de leçons à recevoir de qui que ce soit, fût-ce de gens mandatés par une institution [l'Assemblée nationale] à l'endroit de laquelle je porte grande révérence ». La fonction publique territoriale n'est guère en position d'apporter un contrepoids à des élus qui, de la sorte, acceptent mal de « recevoir des leçons ». Les fonctionnaires territoriaux, globalement, ne semblent pas toujours partager de culture gestionnaire. Ainsi que l'a rappelé M. Michel Klopfer, président-directeur général du cabinet Michel Klopfer, lors de son audition par votre Commission, « les collectivités n'ont pas de culture de gestion, de recherche du meilleur rapport qualité-coût ou d'achats : les étudiants de l'Institut national des études territoriales (INET) n'ont aucune envie de commencer leur future carrière de dirigeants comme acheteurs dans une grosse collectivité car ces postes ne sont pas valorisés, contrairement à ce qui se passe en entreprise. [...] Rares sont les initiatives tendant à abaisser le niveau de la demande, y compris dans des domaines où cela serait relativement commode. » Des progrès considérables ont pourtant été accomplis par les collectivités en ce qui concerne leur gestion financière dans le courant des années 1990. Comme l'a rappelé M. Philippe Laurent au cours de son audition du 15 mars dernier : « depuis une vingtaine d'années, nous avons pu observer une amélioration remarquable de la qualité et de l'autorité de la fonction financière dans l'administration publique territoriale. Les agents territoriaux spécialisés dans les finances sont devenus très compétents, détiennent un savoir-faire et une expérience, pèsent auprès des élus ». Du côté des dépenses, il faut donc aboutir à ce même niveau d'exigence, qui imprègne aujourd'hui véritablement le fonctionnement de l'administration d'État, notamment avec la mise en œuvre de la LOLF, laquelle responsabilise réellement les responsables des différentes administrations. Il s'agit donc bien d'une révolution culturelle de la gestion publique locale qu'appelle de ses vœux votre Rapporteur. b) Mettre en place des indicateurs de résultats autoconsentis par les collectivités territoriales Le processus de mesure de la performance de la gestion des collectivités territoriales est déjà en cours, mais il n'est ni généralisé, ni prégnant, ainsi que toutes les auditions réalisées par votre Commission ont permis de s'en persuader. Tel est du reste le sentiment exprimée par M. Pierre Méhaignerie, président de la Commission des finances de l'Assemblée nationale : « les collectivités territoriales restent dans une logique de moyens et non de performance. » M. Joseph Spiegel, président du groupe socialiste au conseil général du Haut-Rhin, a posé, le 18 mai, avec justesse la question des indicateurs : « sommes-nous en mesure, aujourd'hui, d'avoir une vraie démarche de projet, quand les questions que vous nous posez sont dénuées de tout indicateur ? Il aurait fallu commencer par proposer des indicateurs à la fois observables et comparables d'un département à l'autre. » En effet, comme l'a rappelé M. Dominique Hoorens, directeur des études et de la documentation de Dexia Crédit Local, lors de son audition du 9 mars par votre Commission, « les données d'ensemble ne permettent pas de rendre compte de la diversité des choix des 36 700 communes, des 18 000 groupements, 100 départements et 26 régions, soit plus de 50 000 acteurs. Or, les situations sont très diverses et cette diversité est difficile à illustrer. C'est sans doute un défaut de notre système de suivi, nous n'avons pas d'informations comparatives chiffrées sur le niveau des services rendus, leur étendue et leur qualité. » On ne part pas d'une table rase, heureusement. M. Olivier Ortiz, président de la Chambre régionale des comptes d'Alsace, a rappelé devant votre Commission que « les chambres régionales des comptes auraient tout intérêt à pouvoir identifier précisément des objectifs, des moyens et des résultats afin de dégager une série d'éléments mesurant l'économie, l'efficience, l'efficacité, en un mot la performance. Tout en appelant cette démarche de nos vœux, nous nous efforçons nous-mêmes de la traduire dans le déroulement de nos instructions et dans les observations que nous formulons à l'adresse des collectivités. « Force est de constater, au fil des années, dans les collectivités importantes, mais parfois dans de plus petites, une prise de conscience de ces préoccupations, avec notamment un développement sensible des procédures de contrôle interne, que nous nous attachons à articuler avec le contrôle externe que nous-mêmes effectuons. [...] Ces éléments de performance sont de plus en plus déterminants ; et si la LOLF a contraint l'État à s'engager dans cette démarche, celle-ci commence à se répandre dans les collectivités territoriales, et nous nous attachons à appuyer autant que nous le pouvons toutes les initiatives allant dans ce sens. » Ces prémices doivent être résolument confortés ; pour cela, il faut demander à toutes les collectivités territoriales d'une certaine taille de mettre en place une présentation de leurs budgets sous la forme de missions et programmes harmonisés au niveau national, et de définir elles-mêmes les indicateurs de résultats associés qu'elles cherchent à atteindre. L'évaluation de la performance et de l'efficacité de la dépense publique locale doit être le fait des assemblées délibérantes, comme elle l'est par le Parlement pour l'État. Elle doit être rendue publique, de manière harmonisée, afin que les contribuables locaux puissent exprimer leurs choix en toute connaissance de cause. Elle doit enfin s'articuler avec le rôle des chambres régionales des comptes qui, comme la Cour des comptes avec la LOLF, verront leur fonction de conseil aux collectivités renforcée et leur mission de contrôle a posteriori valorisée. Le choix d'indicateurs par chaque collectivité permettra une véritable appropriation active de cette démarche de performance et facilitera son adoption, compte tenu de la révolution culturelle à accomplir. Il ne risque pas d'aboutir à de multiples indicateurs non comparables entre collectivités, car chacune exerce en fait les mêmes compétences que les autres : il n'y a pas dix mille manières de conduire telle ou telle action, et un processus convergent se réalisera assez vite par la comparaison des pratiques réciproques, que facilitera encore la publicité qui devra être donnée à ces indicateurs. Il faudra également accompagner les collectivités dans la mise en place de ces indicateurs de performance. Nul besoin de créer de nouvelle structure à cet effet : on a vu le sort de récentes initiatives en la matière. Une direction de la réforme budgétaire au sein de la Direction générale des collectivités locales, sur le modèle de ce qui a été fait pour la mise en œuvre de la LOLF, serait sûrement très mal perçue par les élus locaux. Il semble à votre Rapporteur beaucoup plus opportun de s'appuyer sur l'expérience des juridictions financières, lesquelles sont parfaitement outillées pour cela. Il n'est que d'entendre M. Olivier Ortiz, président de la Chambre régionale des comptes d'Alsace, présenter devant votre Commission des pratiques déjà bien rôdées : « certains champs de l'action territoriale sont peut-être un peu plus difficiles à évaluer sur le plan des performances : la collectivité elle-même nous semble parfois avoir quelque mal à définir, non les objectifs, mais le référentiel qui lui permettra d'évaluer elle-même sa performance dans le domaine considéré. C'est du reste la raison pour laquelle nous nous efforçons, dans le cadre d'un dialogue avec la collectivité, de voir si elle-même est parvenue à mettre au point de tels outils et, à défaut, de bâtir quelques éléments de mesure que nous lui proposons de valider. [...] En plus des approches méthodologiques conduites dans le cadre du ressort de chaque chambre régionale des comptes, nous avons des structures de concertation interne, entre chambres régionales des comptes, mais aussi entre chambres régionales des comptes et Cour des comptes. Des travaux conjoints sont de plus fréquemment menés entre la Cour et les chambres, tant les politiques publiques sont de plus en plus imbriquées [...]. Certes, nous avons bien conscience que, dans des secteurs tels que le social, il pouvait être très difficile pour la collectivité d'élaborer elle-même des outils allant au-delà des seuls indicateurs d'activité ou procéduraux - nombre de dossiers, etc. Le dialogue qui s'établit avec nous dans le cadre de l'instruction a précisément pour objet de lui permettre de progresser dans ce domaine et d'être à même de valider l'appareil méthodologique sur lequel s'appuiera la chambre pour formuler ses observations. Si les chambres régionales des comptes n'ont pas formellement une mission de conseil au sens strict du terme, nous avons bien conscience que nos recommandations peuvent être utiles et accompagner une démarche qui, pour certaines collectivités, est déjà bien engagée. » M. Jean-François Copé, ministre délégué au budget et à la réforme de l'État, a déclaré devant votre Commission partager pleinement le souhait de mettre en œuvre cette démarche de transposition de la LOLF aux budgets locaux, au travers de la mise en place d'indicateurs de résultats. Il a en effet estimé qu'« il pourrait être très intéressant de mettre au point - à partir d'une certaine taille, évidemment, pas pour les petites communes - des indicateurs de performance. Autrement dit, sommes-nous capables d'imaginer une nomenclature permettant de prendre la mesure des politiques publiques locales, de l'argent engagé et des résultats obtenus, et en tirer des indicateurs à l'image de ce que nous faisons aujourd'hui pour l'État dans le cadre de la LOLF ? Nous sommes en train d'élaborer une batterie d'indicateurs très fournie, qui va du nombre de dossiers traités dans une préfecture ou un palais de justice jusqu'aux résultats de grandes politiques publiques - lutte contre l'illettrisme, contre la délinquance, etc. - en passant par le nombre de dossiers d'impôts traités grâce à la télédéclaration. Nous pourrions parfaitement décliner des indicateurs de performance similaires pour les collectivités territoriales et, à partir d'une certaine taille, ne plus parler seulement de section de fonctionnement et de section d'investissement, mais de missions et de programmes dans des domaines aussi essentiels que l'aide sociale, l'éducation, le développement économique, la sécurité, la formation professionnelle, autant de sujets sur lesquels il doit être possible de mesurer l'action conduite par les collectivités territoriales, comme on le fera pour l'État d'ici à quelque temps. » On se demandera seulement si, selon une approche somme toute assez « naturelle » venant d'un représentant de Bercy, la volonté de « décliner des indicateurs de performance similaires » ne s'apparente pas trop à une démarche un brin centralisatrice, avec un référentiel imposé par l'État aux collectivités territoriales. Ce n'est pas ainsi que votre Rapporteur conçoit la transposition de la LOLF aux finances locales : il faut créer les conditions d'une appropriation des nouveaux instruments proposés par les collectivités territoriales, sans les brusquer, en respectant leur autonomie de gestion. Qui dit présentation harmonisée, notamment des missions et des programmes - puisqu'il s'agit seulement de nomenclature budgétaire -, ne dit pas nécessairement élaboration d'indicateurs identiques pour tous. À chacun de choisir le sien, on comparera ensuite, et chacun se comparera aux autres. Aux yeux de votre Rapporteur, ce processus itératif paraît plus respectueux des libertés locales. D.- QUELQUES PISTES DE BONNE GESTION La mise en place d'indicateurs de résultats ne constitue en rien un gadget, ou une Nième information supplémentaire à joindre à des documents budgétaires déjà volumineux. Bien au contraire, il doit s'agir du support d'une véritable gestion dynamique des collectivités territoriales, de nature à optimiser la dépense publique locale, et donc de modérer la pression fiscale. Comme l'indique M. Charles Buttner, Président du conseil général du Haut-Rhin, « la maîtrise, ça ne consiste pas à en faire le moins possible, mais à trouver une évolution des ressources qui soit supportable à la fois par le contribuable et par l'économie, tout en permettant de fournir un service satisfaisant à la population. » Au cours de ses nombreuses auditions, votre Commission a eu l'occasion de rencontrer maints exemples de bonne gestion. Il serait à l'évidence judicieux d'adopter une démarche d'analyse comparative (« benchmarking ») au niveau local, ce que faciliterait grandement la mise en place d'indicateurs de performance. Un exemple de bonne méthode a été fourni par M. Jean-Yves Chamard, président de la commission des finances du conseil général de la Vienne : « depuis que l'exécutif est aux mains des élus, le département de la Vienne s'est fixé plusieurs critères en matière budgétaire : rechercher toujours le meilleur rapport qualité-prix, y compris en allant voir ailleurs s'il est possible de faire mieux. » Comme l'a souligné M. Jean-François Copé, ministre délégué au budget et à la réforme de l'État, « la décentralisation permettra également de comparer les collectivités entre elles, leur dynamisme, leurs initiatives, leur capacité à gérer les grands problèmes auxquelles elles sont confrontées. C'est là, du reste, qu'est tout l'intérêt de la fonction de patron d'une collectivité territoriale : le but n'est pas simplement d'avancer à l'ancienneté mais, lorsqu'on est maire d'une ville en difficulté, de la développer en allant chercher les entreprises et, pour un conseil général, de conduire une politique dynamique en matière d'insertion et d'aide sociale. » M. Philippe Laurent, président-directeur général du cabinet Philippe Laurent Consultants, explique ainsi qu'« il existe des pistes d'économies potentielles, déjà à l'œuvre dans beaucoup de collectivités. Les politiques d'achat se professionnalisent, avec des groupements de commandes, produisant des effets sur 20 % à 25 % des dépenses, ce qui ouvre des perspectives d'économies dans les villes moyennes. » Il faut aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin ! C'est pourquoi, en reprenant ce qu'il considère comme quelques bonnes idées exprimées tout au long des auditions des responsables locaux par votre commission, votre Rapporteur propose de les faire partager, pour que vive la démocratie locale. Une autre raison d'insister sur ces aspects tient au fait que l'étude sur les impacts financiers estimés de l'acte II de la décentralisation, commandée par l'association des départements de France au cabinet Ernst & Young, n'a aucunement tenu compte des impacts positifs de la décentralisation en matière d'optimisation de la dépense. Pourtant, comme le rappelle M. Brice Hortefeux, ministre délégué aux collectivités territoriales, « il faut faire confiance à la capacité de prise de responsabilité des élus. » La décentralisation doit bien être une chance à saisir pour mettre en œuvre une gestion plus efficace. Sans nullement vouloir donner de leçon à quiconque, seulement pour montrer ce qui est réalisable, voilà comment les collectivités territoriales pourraient s'y prendre pour faire mieux - et notamment mieux que l'État - sur certaines thématiques étudiées par votre Commission. 1.- En ce qui concerne les TER M. Bernard Sinou, directeur du transport public de la SNCF, a évoqué, lors de son audition, le peu d'implication des régions dans la gestion de leur compétence sur le transport ferroviaire de voyageurs, à de rares exceptions près, qui pourraient tenir lieu d'exemple. En ce qui concerne l'évolution de l'offre décidée par les régions tout d'abord : « les politiques des régions se diversifient : certaines ont procédé à une assez forte remise en cause de leur offre ferroviaire, d'autres se sont contentées d'ajustements à la marge de l'offre existante. On peut noter un mouvement non négligeable de transferts sur route d'offres ferroviaires dont la pertinence n'était pas des plus justifiées, compte tenu de leur coût. D'autres régions ont opté pour une remise à plat de la logique des dessertes, en supprimant certains arrêts afin de rendre les trains plus rapides et plus attractifs, par exemple en Rhône-Alpes. Des travaux ont parfois été mis en commun entre les transporteurs urbains et l'autorité régionale, comme en Midi-Pyrénées avec la réorganisation de l'étoile de Toulouse, où une nouvelle répartition des rôles a permis de mettre fin à la superposition de dessertes concurrentes. Je souhaite pour ma part que les futurs projets de service que nous monterons avec les autorités organisatrices permettent de progresser vers des remises en cause plus structurelles. Nous avons encore beaucoup à faire sur ce point, mais je n'en suis pas maître. Parmi les critères d'appréciation, on peut relever le nombre de voyageurs par train. Reste à savoir, et c'est un choix politique difficile mais majeur, jusqu'à combien de voyageurs par train la desserte doit être maintenue. C'est désormais un paramètre de plus en plus suivi par les régions. » En ce qui concerne les relations entre les régions, autorités organisatrices du transport ferroviaire, et la SNCF ensuite : « les progrès de productivité à offre constante sont par essence peu rapides, du fait des contraintes inhérentes à l'appareil de production existant. Cette dimension, si elle a fait l'objet d'un accompagnement permanent dans la plupart des régions, ne peut pas pour autant être considérée comme leur exigence première. Les régions se sont davantage attachées à améliorer la qualité du service et à développer l'offre, plutôt qu'à exiger une réduction des coûts de la SNCF. Je n'ai pas d'exemple à donner d'une politique de réduction des coûts demandés par l'autorité organisatrice dans la période passée, mais la question commence à se poser. Ainsi, la région Alsace a-t-elle demandé à reprendre la convention afin d'intégrer l'amélioration de la productivité parmi les engagements de la SNCF, ce qui devrait à terme influer sur le montant de la contribution de la région. » M. Adrien Zeller, président du conseil régional d'Alsace, a précisé ses intentions : « nous avons ensuite veillé à accroître la productivité générale du système. C'est une règle de conduite permanente. Le rapport coût/efficacité devient meilleur. » La même démarche a été suivie par la région Alsace en ce qui concerne la prévention des conflits sociaux à la SNCF : un avenant à la convention TER, qui va être mis en œuvre, prévoit un système de bonus-malus financier selon les services de substitution assurés en cas de conflit social interne, afin d'inciter le transporteur ferroviaire au respect de la convention. Des synergies sont possibles aussi en ce qui concerne les investissements sur les infrastructures du réseau ferroviaire. Des observations fort utiles pour les régions ont été formulées le 6 avril 2005 par M. Jean-Marie Bertrand, Directeur général de Réseau Ferré de France : « nous constatons aujourd'hui que le système de décentralisation, tel qu'il fonctionne, fait qu'il n'y a pas de lien direct entre la décision prise par les autorités organisatrices régionales d'étendre ou de restreindre le nombre et le volume des dessertes TER, d'une part, et les investissements en infrastructures, d'autre part. Ce qui est important pour nous, c'est d'arriver, en tant que gestionnaire d'infrastructures, à un système de décentralisation tel que l'on puisse se mettre d'accord avec les autorités organisatrices régionales sur une vision de l'évolution du réseau régional. Une région connaît les dessertes qu'elle veut développer, elle sait aussi que les coûts seront très élevés sur certaines lignes et qu'elle ne doit pas forcément placer l'effort sur ces lignes-là. D'où l'intérêt d'avoir une vision partagée, notamment sur les lignes à vocation essentiellement régionale, afin qu'il y ait cohérence entre la politique d'extension des dessertes voulue par l'autorité organisatrice et la politique d'entretien et de renouvellement du réseau conduite par le gestionnaire d'infrastructure. » 2.- En ce qui concerne les SDIS M. Michel Mercier, Président du conseil général du Rhône, a narré de manière très directe ses relations avec les syndicats de sapeurs-pompiers professionnels : « On se voit tous les deux mois, on fait le point. Je leur ai dit clairement : il n'y a pas un sou de plus, d'accord pour une indemnité cette année, mais alors pas d'embauches, et des heures supplémentaires pour les jeunes qui veulent en faire. Évidemment, tous ont choisi d'en faire.... [...] Ils avaient inventé un système de cycles, de 24 ou de 36 heures, et leur emploi du temps était fixé trois ans à l'avance. J'ai dit un jour au colonel, un excellent colonel d'ailleurs, le meilleur de France, qui a mis dix ans à devenir directeur parce qu'il avait les syndicats contre lui : " regardons les choses en face, on n'a pas besoin des pompiers de la même façon 24 heures sur 24. " J'ai fait faire un graphique, dont il ressortait que les pointes se situaient entre six heures et dix heures le matin, un petit peu à midi, de nouveau en fin d'après-midi, tandis qu'après 21 heures c'était très calme. J'ai donc supprimé les cycles de 24 et de 36 heures pour les remplacer par des cycles 12 heures, et j'ai dit : 1 600 heures pour tout le monde - 1 607 maintenant. Comme, pendant les vacances scolaires, il y a beaucoup moins d'accidents, on peut affecter les pompiers pendant 12 heures quand on en a besoin, et on les met en congé quand on en a moins besoin. La gestion est un peu compliquée, mais on économise de l'argent. Sinon, nous serions à bien plus de 90 millions d'euros. [...] Comme ils ne savaient pas quoi faire la nuit, ils avaient demandé des casernes avec des chambres individuelles privées, où il fallait bien qu'ils s'occupent... Ils habitent à Marseille, ou en Haute-Loire - qui est tout de même un pays de cocagne -, et ils venaient une fois par semaine à Lyon. Ils avaient leur maison là-bas et un appartement payé à Lyon. Maintenant, il n'y a plus que des chambres de garde : on ne va pas leur donner des chambres individuelles pour 12 heures. Grâce à cela, on a pu récupérer des appartements pour loger gratuitement 250 jeunes sapeurs-pompiers qui débutent dans le métier et qui ne gagnent pas assez. Même quand les choses sont très réglementées, on peut toujours réformer. Après, ils vont se plaindre à la direction de la défense et de la sécurité civiles place Beauvau, où les choses sont toujours gérées par un préfet et par beaucoup d'autres pompiers. Ils se gèrent eux-mêmes, mais on peut gérer aussi si on veut. Cela demande beaucoup d'implication, beaucoup de temps, et c'est parfois un peu rude. » M. Christian Galliard de Lavernée, Directeur de la défense et de la sécurité civiles au ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, n'a lui-même pas rejeté une telle approche lors de son audition par votre Commission : « il y a garde et garde car si, dans certains centres de secours, on compte deux ou trois appels par 24 heures, dans d'autres, le minimum de repos physiquement nécessaire est à peine envisageable. Tel est le cadre réglementaire national ; ensuite, les discussions sont à la discrétion des présidents des SDIS, et il leur est loisible de passer à d'autres cycles (12 heures, 9 heures ou 8 heures) que le cycle de 24 heures pour permettre, dans chaque caserne, une présence proportionnelle à l'activité. Il serait en effet absurde d'avoir un effectif constant à toute heure du jour ou de la nuit. Une étude récente que nous avons effectuée dans le domaine des transmissions a montré que la période active court de 8 heures du matin à 9 heures du soir, et que l'activité est très faible entre 11 heures du soir et 6 heures du matin. Voilà pourquoi de nombreux présidents de SDIS ont entamé un dialogue social - difficile - avec les syndicats de sapeurs-pompiers professionnels, tendant à instaurer, dans le cadre réglementaire, un système modulé. » Si sa gestion est décentralisée, l'APA est néanmoins une prestation sociale dont les modalités d'attribution sont identiques en tout point du territoire national. Cette égalité d'accès à la prestation empêche bien évidemment toute gestion dynamique du coût supporté par chaque département : c'est dans l'organisation du service gestionnaire que peut être améliorée l'efficacité. En revanche, des synergies sont possibles entre les différentes postes de l'aide sociale gérée par les départements, même si l'exercice est difficile. Ainsi que l'a décrit M. Michel Mercier, Président du conseil général du Rhône, « les associations d'aide à domicile sont un peu malthusiennes, on n'arrive pas à leur faire embaucher des gens qui sont au RMI, et qu'on pourrait pourtant former. Si bien qu'on donne de l'argent à des personnes âgées qui ne trouvent pas de services à acheter et qu'on leur en reprend donc une partie l'année suivante, tandis que d'un autre côté on verse des allocations à des gens qui n'ont pas de travail. Nous voudrions trouver des synergies entre les deux, mais ça ne marche pas. On voit là les limites du système associatif. Nous allons essayer de faire autrement si nous n'arrivons pas à les convaincre d'aller plus loin car, pour nous, c'est la clé. Si seulement on pouvait mettre 5 000 personnes, sur les 31 000 qui sont au RMI, en face des 18 000 personnes âgées qui cherchent quelqu'un pour s'occuper d'eux, ce serait déjà bien. C'est quelque chose de très important pour nous, et j'espère bien trouver un moyen, si possible avec les associations, sinon sans elles. S'il y a bien une chose qui ne se délocalisera jamais, ce sont les services à la personne. On répondrait à un vrai besoin, en créant de vrais emplois, de vraies entreprises, avec de vrais bénéfices, et peu de risques financiers. Et c'est peut-être le seul moyen, pour les départements, de sortir de la spirale de la dépense supplémentaire obligatoire. » M. Patrick Germain-Géraud, directeur de la solidarité départementale du conseil général de l'Hérault rejoint en pratique cette approche: « nous nous sommes attachés à former les allocataires du RMI qui avaient une appétence particulière pour les services de proximité, en commençant par un dispositif expérimental dans le Biterrois. Cela concerne à ce jour quelque 200 allocataires du RMI, nombre assez faible au regard du nombre total d'allocataires et des considérables efforts déployés, notamment en direction des employeurs. » Le pari qui a été engagé avec la décentralisation du RMI, et nous espérons qu'il s'agit d'un pari collectif, est que le fait de réunir dans une même main les volets « R » et le « I » du RMI, ─ à savoir le revenu et la politique d'insertion ─ est de nature à améliorer l'efficacité du dispositif. L'attribution de la responsabilité pleine et entière du pilotage de l'insertion aux conseils généraux, le cumul des compétences d'insertion et du service de l'allocation doivent inciter à un accompagnement plus étroit des allocataires. Les départements pourront utiliser tous les outils mis à leur disposition par la loi pour gérer le RMI de la façon la plus efficace possible. En matière de contrôle des allocataires, le président du conseil général a le pouvoir de prononcer toute mesure individuelle relative aux allocataires. Il lui revient donc, avec l'assistance des CAF et des MSA, de s'assurer que les contrôles adéquats sont bien réalisés et, si nécessaire, de donner des instructions pour qu'ils le soient. Le conseil général du Rhône a entrepris cette année une démarche de relance des allocataires qui n'avaient plus de contact avec les services d'insertion. 6 000 allocataires ont reçu une lettre recommandée les mettant en demeure de se présenter aux services, sous peine de suspension du versement de l'allocation. Après une deuxième relance, 800 allocataires ont fait l'objet d'une décision de suspension, intervenue le 1er mai. Bien entendu, au nom du principe de libre administration, M. Hervé Bramy, président du Conseil général de Seine-Saint-Denis entendu le 19 mai dernier, est fondé à considérer qu'il est « exclu qu'un conseil général à la fibre sociale comme le [sien] se lance dans une chasse aux allocataires du RMI. » Il n'est naturellement pas question de cela. Mais « avoir la fibre » ne dispense pas de gérer. C'est une amélioration du suivi individuel et de l'insertion qui est attendue de la décentralisation du RMI. Comme l'indique M. Michel Mercier dans le rapport qu'il a publié en mai 2005 dans le cadre de l'Observatoire de la décentralisation, « ce volet crucial du RMI est celui qui recèle le plus fort potentiel de « valeur ajoutée de proximité » que doit apporter la décentralisation. (...) En particulier, un effort doit être mené par chacun des départements pour que chaque allocataire dispose réellement d'un référent et d'un contrat d'insertion. Et un effort tout aussi conséquent doit être mené pour s'assurer que les référents rencontrent régulièrement toutes les personnes inscrites auprès de lui. » Entendu par votre Commission d'enquête le 10 mai dernier en tant que président du conseil général du Rhône, M. Michel Mercier a indiqué que les relances de son conseil général avaient surtout permis de renouer le lien entre les services d'insertion et plusieurs milliers de RMIstes. « Nous avons convoqué les gens, et certains nous ont dit : « je suis au RMI depuis quatre ans, ou depuis six ans, mais c'est la première fois que je vois quelqu'un, que quelqu'un s'occupe de savoir où on en est ». Mon but est qu'à la fin de l'année, chacun des 31 000 bénéficiaires ait un référent et un contrat d'insertion - je ne dis pas forcément un emploi. C'est une forme de respect. » En vue de l'insertion, les départements disposent de toutes les marges de manœuvre nécessaires pour optimiser l'emploi de leurs ressources, au service d'une stratégie qu'ils auront eux-mêmes définie, avec toute la pertinence que leur donne la proximité. Car les départements, en lien avec le service public de l'emploi, sont mieux à même de connaître précisément les allocataires et d'identifier les secteurs les plus susceptibles de leur offrir des perspectives d'emploi, dans le secteur marchand comme dans le secteur non marchand. L'analyse des comptes de gestion des départements pour 2004 permet de constater une forte progression de leurs dépenses d'insertion entre 2003 et 2004. Les dépenses nettes du volet insertion sont passées de 778 millions d'euros en 2003 à 861 millions d'euros en 2004. Les conseils généraux ont donc parfaitement compris qu'un effort supplémentaire d'insertion était de nature à déboucher sur un reflux de la charge du RMI. M. Michel Mercier a indiqué à votre Commission qu'il cherchait à établir des synergies entre l'APA et le RMI, en expliquant les difficultés auxquelles se heurte sa démarche : « les associations d'aide à domicile sont un peu malthusiennes, on n'arrive pas à leur faire embaucher des gens qui sont au RMI, et qu'on pourrait pourtant former. Si bien qu'on donne de l'argent à des personnes âgées qui ne trouvent pas de services à acheter et qu'on leur en reprend donc une partie l'année suivante, tandis que d'un autre côté on verse des allocations à des gens qui n'ont pas de travail. Nous voudrions trouver des synergies entre les deux, mais ça ne marche pas. On voit là les limites du système associatif. Nous allons essayer de faire autrement si nous n'arrivons pas à les convaincre d'aller plus loin car, pour nous, c'est la clé. » Quoi qu'il en soit, les initiatives du conseil général du Rhône correspondent tout à fait à la démarche qu'on peut attendre de la décentralisation. M. Hervé Bramy, Président du conseil général de Seine-Saint-Denis, a expliqué, quant à lui, au cours de son audition du 19 mai dernier, qu'il « prenait le taureau par les cornes » en signant « avec la SNCF et Véolia des conventions destinées à favoriser le recrutement d'allocataires du RMI, qui recevront une première formation grâce à l'enveloppe destinée à l'insertion. (...) ». « Je constate », a-t-il précisé, « que de nombreuses entreprises qui travaillent en Seine-Saint-Denis ont du mal à satisfaire leurs besoins en recrutement alors que nous avons 48 000 RMIstes, dont au moins un tiers devrait pouvoir retrouver immédiatement un emploi ». Au cours de son audition, le 25 mai 2005, M. Jean-Yves Chamard a expliqué que « le fait d'être plus proche du terrain peut inciter [le département] à une action plus volontariste. En voici un exemple : l'intérêt de tous, des bénéficiaires du RMI comme du département qui le verse, est qu'il y en ait le moins possible. Sans cesse à la recherche de méthodes innovantes pour essayer de remettre les RMIstes au travail, nous en avons trouvé une dans le Bordelais, dont nous avons racheté, si j'ose dire, les « droits d'auteur ». Elle consiste à rapprocher l'offre et la demande. Nous avons constitué quatre ou cinq équipes qui, dans tout le département, vont voir les entreprises pour réfléchir avec elles sur leurs besoins de main-d'œuvre avant de chercher, dans le vivier des bénéficiaires du RMI, les candidats à leur présenter. (...) Nous reprendrons cette méthode, en l'amplifiant, pour les emplois aidés, contrats d'avenir ou CI-RMA, encore peu développés. » Pour mettre en œuvre leur stratégie d'insertion, les départements disposent des instruments mis à leur disposition par le plan de cohésion sociale. Ils sont libres de l'organisation de l'insertion et peuvent décider librement s'en charger eux-mêmes ou de l'externaliser. Selon le Directeur général des affaires sociales, M. Jean-Jacques Tregoat, entendu le 25 mai 2005, la qualité des partenariats noués par les départements sera déterminante dans la réussite du dispositif. « Il s'agit d'abord du partenariat avec le service public de l'emploi, qui est un acteur incontournable de l'insertion professionnelle. Les départements sont cependant libres de recourir aux agents mis à disposition par l'ANPE ou de recruter leurs propres agents. (...) Il s'agit également des partenariats avec les communes et les intercommunalités, qui jouent souvent un rôle clé dans le développement économique et qui disposent de leurs propres outils d'insertion (CCAS, PLIE). » Votre Rapporteur souscrit à la proposition faite par M. Michel Mercier dans son rapport précité de créer un « forum des meilleures pratiques » (sous forme de rencontres régulières ou d'un espace Internet) qui permettrait aux départements d'échanger leurs méthodes et d'adopter les idées les plus efficaces au vu des expériences de chacun. M. Brice Hortefeux, ministre délégué aux collectivités territoriales, a bien rappelé quel était l'objectif de la décentralisation du RMI, à savoir « le pari - que prend le Gouvernement - d'une meilleure gestion à moyen terme des compétences transférées par l'État. C'était d'ailleurs bien, en matière de RMI, l'intention du législateur, qui souhaitait responsabiliser les départements dans leurs efforts d'insertion. Dans des collectivités se réclamant de la majorité - le Rhône, par exemple, avec Michel Mercier - comme de l'opposition - les Bouches-du-Rhône, avec M. Jean-Noël Guérini -, on observe des engagements tout à la fois fermes et efficaces quant à un meilleur contrôle qu'auparavant des conditions d'attribution et de gestion du RMI. » Comme le souligne le ministre délégué, les conseils généraux doivent prendre leurs responsabilités ; pour cela, il cite les propos d'un représentant des départements à la CCEC : « si le conseil général veut vraiment piloter une véritable politique de refondation sur l'insertion, il doit se repositionner, prendre le manche, travailler avec les autres. On ne peut pas transposer une politique qui a fonctionné pendant des années dans un autre monde et avec d'autres règles. » 5.- En ce qui concerne les TOS Mme Ségolène Royal a déclaré lors de son audition que « ces transferts de TOS transforment [la région] en collectivité gestionnaire, alors que nous n'avons pas le personnel nécessaire et que nous n'avons pas l'habitude ». Outre que le personnel support sera effectivement transféré aux collectivités territoriales et qu'une habitude s'acquiert, votre Rapporteur estime que ce transfert des personnels TOS, qui est une chance pour ceux-ci comme pour les élèves, le sera également pour le contribuable si tant est que les collectivités territoriales assument leurs responsabilités en matière de gestion. En effet, ainsi que l'a rappelé M. Gilles de Robien : « lorsque les moyens sont plus proches des élus locaux, la gestion est généralement plus fine, mieux adaptée et moins rigide [...]. Cette souplesse supplémentaire provient du regard de l'élu local et aussi de son désir de démontrer à la population que l'argent public est bien dépensé ». a) La question du temps de travail des TOS · Les dispositions de la « circulaire Lang » du 7 février 2002 M. Gilles de Robien a déclaré que : « la durée de travail des TOS est réglementairement de 1 607 heures, cette règle étant commune aux fonctions publiques d'État et territoriale ». Cependant, il a ajouté que la « circulaire Lang du 21 janvier 2002 apportait un certain nombre d'aménagements au principe afin de tenir compte des conditions particulières d'exercice de telle ou telle profession ». M. Gilles de Robien a présenté l'économie générale de cette circulaire55 : « la circulaire comptabilise comme temps de travail effectif les jours fériés légaux lorsqu'ils sont précédés ou suivis d'un jour travaillé par l'agent, d'une part, et une pause quotidienne de vingt minutes, d'autre part. Les congés annuels sont en outre calculés sur la base de neuf semaines ou quarante-cinq jours ouvrés, et le travail pendant les vacances des élèves ne peut excéder vingt-cinq jours par an. La journée de travail est organisée selon une amplitude maximale de onze heures, la durée hebdomadaire étant comprise entre 35 et 40 heures, avec une marge de fluctuation de 3 heures supplémentaires, et le temps de travail, lorsque les élèves sont présents, est réparti sur cinq jours par semaine. Il existe des équivalences pour les personnels ouvriers chargés de l'accueil logés : 1 730 heures par an et 43 heures par semaine pour les personnels en poste simple ; 1 910 heures et 48 heures pour chacun des personnels en poste double. Pour les personnels ouvriers chargés des fonctions de veilleur de nuit, l'amplitude peut aller jusqu'à la plage de vingt heures à sept heures, avec un repos hebdomadaire de 48 heures consécutives. En conclusion, la seule référence ayant force de règlement est la durée de 1 607 heures : c'est par conséquent la seule qui s'impose aux collectivités qui vont accueillir de nouveaux personnels. Comme toutes les circulaires, la « circulaire Lang » interprète les règlements, et c'est sur la base de cette interprétation que s'est stabilisé, depuis 2002, le dialogue social sur le thème éminemment sensible du temps de travail ». Tout cela conduit à un temps de travail très inférieur à la règle des 1 607 heures annuelles. · L'absence de connaissance précise du temps de travail des TOS Cependant, force est de constater que si les textes sont clairs, aucun des témoins auditionnés par votre commission, recteurs ou directeurs d'administration centrale, n'a été capable de répondre à la question du temps de travail effectif des personnels TOS. Par exemple, M. Dominique Antoine, Directeur des personnels, de la modernisation et de l'administration, a déclaré qu'il ne peut fournir le chiffre certain du nombre d'heures effectivement travaillées, puisque « le fait est que l'application de cette circulaire relève de l'échelon local. [...] Le recteur de toute académie connaît bien entendu les principes directeurs que je vous ai présentés, puisqu'il a connaissance de toutes les circulaires publiées au Bulletin officiel de l'éducation nationale. Il est vrai que le calendrier de travail, et donc de congé, est arrêté au sein de l'établissement scolaire. C'est en pratique le chef d'établissement, en vertu de son autorité fonctionnelle sur les agents et de son autorité hiérarchique, qui arrête ce calendrier de travail. Dans beaucoup d'établissements, les agents TOS sont réunis le lundi matin pour établir les feuilles de mission. Le tout est ensuite consolidé dans le cadre d'une gestion annualisée. Le recteur a donc raison d'ignorer le détail de la mise en œuvre des textes dans chaque établissement. Il va de soi qu'il connaît, en revanche, la réglementation en vigueur ». M. Gilles de Robien a confirmé ces propos en déclarant que « chaque chef d'établissement des 8 000 collèges et lycées applique la circulaire Lang avec loyauté, mais aussi avec une marge de manœuvre pour l'adapter aux circonstances particulières à chaque établissement ». On observera que M. Dominique Antoine a eu le mérite d'être complet, les recteurs auditionnés ayant été très elliptiques ou peu curieux. Cependant, même la durée de 1 607 heures, peut parfois faire l'objet d'interprétation au niveau local. Par exemple, dans le Haut Rhin, le temps de travail des TOS semble obéir à un régime différent de celui en vigueur dans les autres départements. Ainsi que l'a déclaré M. Michel Buttner, président du conseil général, « les miens font 1 580 heures, ou plutôt 1 575 heures par an, ils ont des semaines de 41 heures 30, il sont en totalité en congé du 13 juillet au 20 août, quand l'établissement est fermé, et partiellement pendant les petites vacances, avec des jours de permanence. Il faut enlever aux 1 600 heures nationales les deux jours du statut local, ce qui donne 1 580 heures ou 1 575, mais ils les font, en tout cas dans mes établissements ». · Les collectivités locales disposeront de marges de manœuvre pour accroître le temps de travail des personnels TOS Ainsi que l'a noté M. Charles de Courson le 11 mai 2005, « si l'on divise 1 607 heures par 143 jours d'ouverture des établissements, on arrive à 11 heures. Or personne ne travaille 11 heures par jour ouvré ». Quant au 20 jours qui sont effectivement travaillés pendant les vacances scolaires, non seulement les cantines ne fonctionnent pas, mais le grand nettoyage du début de l'été, qui est une pratique assez répandue dans les établissements scolaires, ne devrait pas prendre plus de deux jours. De plus, M. Jean-Pierre Gorges a fait remarquer le même jour que « pendant les vacances scolaires, en l'absence d'élèves et de professeurs, on ne nettoie pas les cours de récréation en permanence ». De fait, pour M. Jean-Yves Chamard : « j'ai l'impression que nous pourrions peut-être les faire travailler un peu plus qu'ils ne travaillent aujourd'hui ». Les marges de manœuvre des collectivités territoriales existent d'autant plus que, selon M. Dominique Antoine : « il est clair en tout cas que la circulaire Lang ne peut pas s'imposer aux collectivités ». En conséquence, ce qui leur est applicable, « c'est le régime de 1 607 heures ». Cependant, il reconnaît : « je ne suis pas convaincu que toutes les collectivités appliquent effectivement cette durée du travail. La question sera donc réglée au cas par cas, selon les collectivités ». Il relèvera donc de la responsabilité des collectivités territoriales de s'assurer que les personnels TOS travaillent effectivement 1 607 heures. Certains élus ont déjà arrêté leur politique s'agissant de leur temps de travail. Pour M. Michel Mercier, président du conseil général du Rhône : « les TOS ne sont pas une catégorie à part. Ce sont des fonctionnaires locaux. Dans une commune, le personnel de l'école fait le même nombre d'heures que les autres. On ne va pas créer des sous-catégories. Un des grands problèmes, c'est de donner à tout le monde le même statut et le même temps de travail. J'y suis arrivé, j'ai mis au moins dix ans, et ce n'est pas une nouvelle catégorie qui me fera changer. Tout le monde fera 1 607 heures ». Cependant, « on peut les répartir comme on veut, je suis ouvert sur les rythmes, il faut que les gens puissent prendre des vacances, mais les TOS travailleront le même nombre d'heures que les autres fonctionnaires ». Cependant, les collectivités territoriales pourront d'autant plus négocier un temps de travail effectif supplémentaire pour les personnels TOS que le régime indemnitaire des fonctionnaires territoriaux est plus favorable. Ainsi que l'a rappelé M. Dominique Antoine « les TOS sont caractérisés par un niveau de primes et d'indemnités qui est parmi les plus faibles de la fonction publique de l'Etat. [...] Sociologiquement, il est clair que dans l'esprit des TOS comme de l'institution, ces deux questions du temps de travail et du régime indemnitaire ont été, au fil des années, plus ou moins globalisées. J'appelle souvent sur ce point l'attention de mes interlocuteurs issus des collectivités territoriales, pour les inviter à tenir compte de ce fait. Dans le cadre de leur libre autonomie, ils pourront ou non prolonger ce principe, mais il est important de dire qu'à des salaires très modestes correspond un temps de travail conçu de manière souple ». Dès lors que temps de travail réduit et indemnités faibles vont de pair, les collectivités territoriales pourraient échanger des indemnités plus élevées contre un temps de travail allongé. Elles auraient d'autant plus intérêt à le faire que, comme l'a estimé M. Dominique Antoine, il est probable que les organisation syndicales auraient « le sentiment de ne pas perdre au change, parce que les régimes indemnitaires de beaucoup de collectivités sont bien meilleurs que ceux que nous pratiquons. S'il y a une charge supplémentaire en termes de temps de travail, elles considéreront qu'elle est compensée, dans beaucoup de cas, par les avantages indemnitaires ». Enfin, s'agissant des TOS agricoles et maritimes, au nombre d'environ 2 000, ils bénéficient actuellement d'un régime indemnitaire plus favorable que les agents des collèges et des lycées. Cependant, ainsi que l'a écrit Mme Marie-Josée Roig dans sa lettre précitée, « ces agents relèveront des mêmes cadres d'emplois spécifiques et aucune obligation légale n'imposera aux employeurs locaux de leur accorder un régime indemnitaire supérieur à celui qui servira de corps d'équivalence à l'Etat, et qui sera celui des trois corps auxquels appartiennent tous les agents TOS, sans distinguer selon qu'ils relèvent de tels établissements ou de tel autre ». b) La décentralisation des personnels TOS peut permettre aux collectivités territoriales d'exercer plus efficacement leur compétence · La gestion des personnels par la collectivité Les départements et les régions ont fait état de leur inquiétude face à l'arrivée de 93 000 nouveaux agents, dont la conséquence sera, surtout pour les régions, un très fort accroissement des effectifs dont elles ont la responsabilité. Cependant, plusieurs solutions sont envisageables afin de leur permettre de gérer au mieux ce transfert. Ainsi que l'a écrit Mme Marie-José Roig dans sa lettre précitée, les collectivités territoriales pourraient déléguer à une structure extérieure les tâches de gestion des TOS : « les régions comme les départements pourraient faire appel aux centres de gestion de la fonction publique territoriale par le biais d'une affiliation volontaire. Si, en l'état actuel du droit, une telle affiliation volontaire n'est possible que pour l'ensemble des personnels de la collectivité, une réflexion peut être engagée pour aménager ce dispositif et permettre aux régions qui le souhaitent de ne s'affilier que pour une partie de leurs personnels ». Pour M. Dominique Antoine, il serait également possible « de créer des syndicats mixtes qui permettent à plusieurs collectivités de mutualiser la gestion des TOS ». Sans aller aussi loin, une restructuration des services des collectivités doit leur permettre d'anticiper le transfert des personnels. Ainsi que l'a déclaré M. Christian Estrosi : « j'ai été amené à réorganiser mes services : j'ai transféré la direction des collèges à la direction des services techniques et j'ai créé une nouvelle direction de l'éducation, qui sera chargée de la gestion des TOS et de la politique d'accompagnement scolaire : voyages, livres, équipement informatique, etc. ». En anticipant le transfert des personnels TOS par l'adaptation de leurs structures administratives, les collectivités territoriales, renforcées par le transfert des agents supports, devraient pouvoir faire face dans de bonnes conditions à l'arrivée des personnels TOS. · Les collectivités territoriales peuvent améliorer la gestion de cette compétence en développant la polyvalence et la mutualisation des personnels, ainsi que l'externalisation de certaines tâches Pour M. Jean-Yves Chamard, il ne fait aucun doute que « à voir comment le système marche aujourd'hui, il doit y avoir des progrès de productivité possibles » permettant un meilleur exercice de leur compétence par les collectivités concernées. Outre l'accroissement du temps de travail effectif des personnels TOS qu'il reviendra à chaque collectivité de mettre en œuvre, si elle le souhaite, plusieurs possibilités s'offrent à elles, mais également aux chefs d'établissement, afin d'améliorer le service rendu aux élèves sans recourir à des recrutements supplémentaires. D'abord, le développement de la polyvalence des personnels doit permettre un meilleur exercice de leurs missions. En effet, ainsi que l'a déclaré M. Dominique Antoine, « environ deux tiers des agents sont des ouvriers d'entretien et d'accueil, qui n'ont pas de spécialité véritable. A peu près un quart des TOS sont des ouvriers professionnels, qui ont des spécialités de recrutement ». Cependant, même s'agissant de ces derniers, et en particulier des équipes qui travaillent en cuisine, « rien n'empêche un chef d'établissement, puisque ces spécialités ne sont que des spécialités de recrutement dans lesquelles les agents ne sont pas enfermés, de les faire travailler dans d'autres spécialités ». De plus, selon M. Dominique Antoine, une collectivité territoriale « sera libre de faire travailler dans un établissement scolaire un agent appartenant à un autre cadre d'emploi, mais elle ne pourra pas, de manière autoritaire, procéder à la démarche inverse ». En effet, le statut spécifique des TOS « confirme l'enracinement des TOS dans la communauté éducative » au point qu'une collectivité « ne sera pas fondée à extraire autoritairement un TOS qui ne le souhaiterait pas d'un établissement scolaire pour l'affecter à d'autres tâches ». Il s'agit là d'une contrainte lourde, limitant évidemment les marges d'efficacité espérées grâce à la décentralisation. Pour M. Jean-Yves Chamard, « ce sera donnant-donnant. Ils veulent garder leur statut spécifique ? Leurs primes seront elles aussi spécifiques. Mais si certains, au cas par cas, acceptent de devenir salariés du conseil général, c'est-à-dire de travailler ailleurs que dans les collèges lorsqu'il n'y a rien à y faire, nous pourrions leur proposer les mêmes primes que les autres agents du département ». Une souplesse dans l'emploi des personnels TOS est donc possible, reposant là encore sur le régime indemnitaire. Ensuite, pour M. Dominique Antoine, des gains de productivité pourraient découler de « la mutualisation inter-établissements, qui pourrait être plus poussée qu'elle ne l'est actuellement ». En effet, aujourd'hui, « la mutualisation se fait dans le cadre d'équipes mobiles d'ouvriers professionnels, les EMOP. Elles sont gérées par un établissement particulier, dit support, qui passe convention avec d'autres établissements pour organiser la mutualisation. La collectivité territoriale, depuis le vote de la loi de décentralisation, est compétente pour définir des politiques d'entretien des établissements. Elle devra d'ailleurs passer convention avec chacun des établissements pour indiquer lui indiquer quelles sont ses attentes et quels moyens elle met à sa disposition. Il sera également loisible aux collectivités de redistribuer des emplois, non pas pour les extraire des établissements, mais pour les faire passer d'un établissement à l'autre. Autrement dit, les collectivités ont en main des instruments de gestion puissants pour organiser une mutualisation plus développée ». De même, s'agissant de la formation des TOS, « pourquoi ne pas imaginer des regroupements. Si des actions de formation sont déjà mises en oeuvre pour des électriciens ou des chauffagistes, pourquoi ne pas y associer les TOS ? » Enfin, toujours selon M. Dominique Antoine, les collectivités territoriales auront la possibilité d'aménager « le degré et le mode d'intervention d'entreprises privées en complément des fonctionnaires. Cette complémentarité existe déjà, mais elle pourra être redéfinie par les collectivités. Je n'en dis pas plus. Je ne dis pas que la décentralisation organise la privatisation. Je dis que cette complémentarité sera nécessairement revue par les élus qui seront attentifs à l'exercice de leurs compétences ». Cette externalisation de certaines tâches a déjà été mise en œuvre en Alsace. Ainsi que l'a déclaré M. Adrien Zeller, « je connais, dans le Bas-Rhin, deux collèges dont la demi-pension est assurée par des prestataires privés, et cela fonctionne bien depuis vingt ans. De même, des fonctions comme l'entretien des ordinateurs ou la vérification des installations de chauffage et de climatisation sont déjà pour partie externalisées. Nous n'avons pas de plan prédéterminé mais nous réfléchissons au cas par cas, dans le respect des droits des personnes et de la qualité du service public, pour savoir s'il peut être parfois utile de créer, par exemple, des cuisines centrales ». De même, M. Michel Mercier, Président du conseil général du Rhône, a évoqué les possibilités de recourir à des sociétés privés dans le domaine de la restauration scolaire : « je vais passer des accords, notamment avec les communes rurales, afin que le restaurant scolaire fonctionne bien. Pareil si la commune fait appel à une société de restauration. Je vais essayer de faire jouer toutes les synergies locales. Le Rhône compte 1,6 million d'habitants, il y a des cantons de 4 000 habitants, des communes de 1 000 habitants qui ont un collège, il faut un restaurant scolaire, sans doute le même pour le collège et pour l'école, ce qui permettra en plus de réduire le hiatus pour l'élève de CM2 et celui de sixième. Nous avons ouvert des négociations. Le maire de Lyon a créé il y a plusieurs années une cuisine centrale gérée par des sociétés. Pour qu'il puisse bénéficier de meilleurs prix, je vais traiter avec lui. Je n'ai pas la même philosophie que lui sur tous les sujets, mais on peut tout de même s'entendre quand il s'agit du bien public... » c) Conclusion : les recrutements supplémentaires découleront des décisions - ou de l'absence de décisions - des collectivités territoriales et non d'une sous-dotation des collèges et des lycées en personnel TOS L'une des inquiétude récurrentes des collectivités territoriales serait le sous-effectif des collèges et des lycées en personnel TOS et la crainte des élus, tel M. Alain Rousset, de résister « difficilement, [...] aux demandes des enseignants, des proviseurs, des parents d'élèves. », avec les conséquences prévisibles en matière budgétaire. Cependant, ainsi que l'a affirmé M. Gilles de Robien, « aucune analyse des besoins dans l'absolu n'est actuellement disponible, même si des élus locaux émettent des estimations. Des barèmes de répartition font néanmoins apparaître des excédents et des déficits relatifs. J'imagine donc que, au moins dans un premier temps, avant de se lancer dans des recrutements, les nouveaux responsables s'efforceront d'optimiser les moyens transférés ». En effet, selon M. Jean-Yves Chamard, avant d'augmenter les effectifs des personnels TOS, « il faut commencer par mieux les utiliser ». Les gains de productivité, une organisation du travail plus souple et un temps de travail allongé permettraient sans aucun doute de ne pas recourir à des recrutements supplémentaires si bien que, selon lui, « il n'y a aucune raison de penser que les masses salariales seront à terme supérieures aux sommes que l'État transfère ». Il envisage seulement « une dépense supplémentaire d'encadrement, mais mieux vaut payer un cadre qui ait le punch nécessaire pour redonner tout simplement envie : il est tellement plus agréable de voir son établissement se rénover, avec de la peinture fraîche et des équipements bien entretenus, que de tenir un balai ! ». Le transfert des personnels TOS place donc les élus locaux devant leurs responsabilités. Ainsi que l'a rappelé M. Gérald Chaix, recteur de l'académie de Strasbourg : « libre au département d'augmenter ensuite la présence des TOS dans les collèges s'il le juge nécessaire : c'est un libre choix ; le contribuable étant un électeur, nul doute que le président du conseil général prendra sa décision en toute connaissance de cause ». Si les départements, comme les régions d'ailleurs, veulent recruter des personnels TOS supplémentaires, ils en sont libres, mais dans ce cas, ils n'ont aucun droit à réclamer une compensation à l'Etat pour ces recrutements. Si les collectivités veulent au contraire faire plus à partir des personnels actuels, cette décision relève désormais de leur responsabilité. * * * QUINZE CAUSES D'AUGMENTATION DES IMPÔTS LOCAUX EN 2005 La Commission d'enquête propose une typologie de causes d'augmentation ─ invoquées ou réelles ─ de la fiscalité locale : 1/ la décentralisation, cause que votre Commission d'enquête écarte pour l'essentiel ; 2/ le désengagement de l'État, à confronter à l'augmentation de l'effort financier de l'État sur les territoires ; 3/ la précaution, au cas où l'État ne respecterait pas la Constitution ; 4/ la sous-évaluation, qui amène à sous-évaluer rentrées fiscales et dotations à recevoir de l'État ; 5/ l'aubaine, lorsque les collectivités augmentent les taux de la taxe professionnelle en anticipation d'une réforme ; 6/ la pression citoyenne, ou la difficulté de dire non ; 7/ le choix politique d'engager telle ou telle dépense ; 8/ le cycle électoral, qui amène à les augmenter en début de mandat ; 9/ l'héritage, soit le passif, réel ou supposé, très cousin du cycle électoral ; 10/ la stratégie financière, arbitrage entre impôt et dette ; 11/ l'irresponsabilité du système, dans lequel l'État est le premier contribuable et où les autres collectivités cofinancent les dépenses ; 12/ l'accumulation des niveaux de décision, avec en particulier l'intercommunalité ; 13/ la contrainte normative, réglementaire ou technique ; 14/ l'absurde, lorsque la Présidente du conseil régional de Poitou-Charentes annonce assurer des personnels dont elle n'a pas la charge ; 15/ le déterminisme, parce qu'il serait de la nature de l'impôt d'augmenter. ... en espérant que la suite des événements n'en suggère pas d'autres. Le lecteur averti sera intéressé par le « protocole de mesure des sources de croissance des impôts et des taux d'imposition locaux », présenté par M. A. Guengant, tome III ci-après Le produit d'une taxe correspond à la multiplication d'une base d'imposition par un taux d'imposition : (1) ou L'équilibre du budget implique l'égalité des dépenses de fonctionnement complétée de l'épargne brute ( (2) soit encore d'une année sur l'autre, avec (3) La relation peut encore s'écrire après transformation : (4) 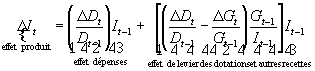 En combinant les équations (1) et (4), l'effet taux correspond par conséquent à : (5) et donc la variation stricto sensu du taux d'imposition d'une année à l'autre : (6) 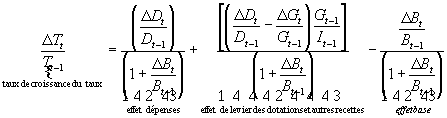 PROPOSITIONS DE LA COMMISSION D'ENQUÊTE A.- Pour un processus de décentralisation plus confiant 1. Améliorer la connaissance et l'évaluation des compétences avant leur transfert. 2. Évaluer les conséquences des décisions, législatives ou réglementaires, portant modification des conditions d'exercice des compétences. 3. Élaborer et publier les données annuelles, par région et par département, de l'effort territorial de l'État. B.- Pour un système fiscal local plus responsable 4. Mettre en place un nouveau dispositif de mise à jour permanente des bases de 1970 dont l'initiative incomberait à l'administration fiscale, sur déclaration des propriétaires de locaux d'habitation, soit à l'occasion d'aménagements importants, soit lors des mutations de biens immobiliers. 5. Assurer un fonctionnement plus actif des commissions communales des impôts directs. 6. Améliorer l'information des collectivités sur l'évaluation des bases. 7. Veiller, dans l'exercice du contrôle de légalité au strict respect de leurs compétences par les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). 8. Ne pas différer davantage la date limite de définition de l'intérêt communautaire. Encourager les EPCI à le définir au plus vite, et le plus précisément possible. 9. Améliorer le suivi, notamment statistique, de l'intercommunalité. 10. Renforcer et formaliser le rôle des conseils municipaux dans la surveillance et le contrôle de l'activité des EPCI. 11. Encourager l'unité des services entre EPCI et ville-centre. 12. Interdire le recours à la fiscalité mixte par les groupements à TPU. L'ajout d'une fiscalité ménages additionnelle à la TPU, encore peu développé, risque d'alourdir inconsidérément les prélèvements fiscaux sans exigence liée à l'intérêt communautaire. Or, les assouplissements récents de la TPU privent de justification la fiscalité ménages. Il convient aussi de protéger ce premier élément de spécialisation. 13. La réforme de la taxe professionnelle devra répondre aux enjeux suivants : a) alléger la charge des entreprises ; b) maintenir un lien territorial à l'impôt (sans que le territoire soit ici prédéfini) ; c) tendre à une meilleure spécialisation de l'impôt ; d) ne pas aggraver la charge de l'État comme contribuable local. Le « scénario Fouquet » paraissant aujourd'hui récusé, il ne semble pas sûr qu'une réforme définitive puisse être élaborée dès le projet de loi de finances pour 2006. C.- Pour un pilotage global des finances locales 14. Mettre en place une conférence annuelle des finances publiques, afin de rechercher, par la concertation, un « pacte global » entre l'État et les collectivités territoriales. Il définira en particulier les objectifs maxima globaux de dépenses et d'impôts, cohérents avec les engagements européens de la France figurant dans les programmes triennaux. Le contrat de croissance et de solidarité, qui fixe l'évolution de la DGF, pourrait être modulé en fonction du respect de ce pacte de stabilité interne. Il s'agit d'obtenir, mais nullement de manière autoritaire, la « généralisation à l'ensemble de la sphère publique de la discipline financière que l'État doit s'imposer », selon les termes du « rapport Camdessus » de 2004. La concertation est en effet la condition d'émergence d'un pacte de stabilité interne avec les collectivités territoriales, en respectant le principe de leur libre administration. 15. Plus spécifiquement, mettre en place des conférences annuelles thématiques, lieux de concertation en particulier sur l'évolution des traitements de la fonction publique ou sur la fixation des coefficients de revalorisation des valeurs locatives. 16. Mettre en place des conférences financières régionales, organisées par les préfets au niveau de chaque région, avec pour objectif une maîtrise globale des prélèvements fiscaux et une coordination entre les interventions des collectivités. 17. Introduire un déflateur d'impôt. Lorsque les bases de l'année N+1 seraient supérieures aux bases actualisées de l'année N, une proportion du produit supplémentaire (20%) lié à l'augmentation des taux irait à l'État. 18. Diminuer les taux de la cotisation de péréquation de la taxe professionnelle. 19. Édicter une disposition législative générale prévoyant des taux plafonds de subvention, taux discriminés à fin de péréquation. 20. Assigner à l'État un objectif de connaissance, de transparence et d'information préalable à tout transfert et au cours du processus, afin de restaurer des relations de confiance avec les collectivités territoriales. 21. Clarifier les rôles des ministères de l'intérieur et des finances dans la relation financière avec les collectivités territoriales en précisant les rôles en ce qui concerne le pilotage global, la politique fiscale, la gestion des transferts. 22. Expliciter la politique des finances locales de l'État, ses enjeux, ses objectifs au-delà de la seule mécanique des dotations. D.- Pour une obligation de performance 23. Prévoir, selon une présentation harmonisée, une obligation de publication de comptes consolidés des EPCI et des communes membres, qui serait l'expression d'une stratégie financière globale. 24. Rendre plus transparents l'ensemble des budgets locaux, par la publication de tableaux de bord régionaux standardisés, afin de présenter des éléments de comparaison entre collectivités, avec des analyses objectives pour faciliter les comparaisons. 25. Assurer la publication par les conférences financières régionales des principales données, présentées de façon homogène, des collectivités de leur ressort. 26. Mieux identifier, au sein des budgets locaux, ce qui relève des compétences obligatoires et ce qui ressort des compétences facultatives exercées par les collectivités. En effet, les nomenclatures comptables ne sont pas toujours assez détaillées pour un suivi précis, dès la prévision budgétaire, des dépenses correspondant à des surcoûts décidés par l'assemblée délibérante. 27. Prévoir, dans les communes de plus de 3 500 habitants, les départements et les régions, lors de l'adoption du budget, des votes distincts pour les compétences obligatoires et les compétences non obligatoires. 28. Mettre en place une présentation des budgets des collectivités territoriales d'une certaine taille sous la forme de missions et programmes, harmonisés au niveau national. 29. Mettre en place une mesure de la performance de la gestion des collectivités territoriales, en les obligeant, à partir d'une taille critique, à définir elles-mêmes des indicateurs de résultats associés à leurs objectifs budgétaires. Cette évaluation de l'efficacité de la dépense publique locale doit être le fait des assemblées délibérantes. Elle doit être rendu publique, de manière harmonisée, afin que les contribuables locaux puissent exprimer leurs choix en toute connaissance de cause. Elle doit enfin s'articuler avec le rôle des chambres régionales des comptes, qui verront leur fonction de conseil aux collectivités renforcée et leur mission de contrôle a posteriori valorisée. 30. Privilégier, lorsque c'est nécessaire, les redevances et droits d'usage plutôt qu'une augmentation des impôts locaux, afin de responsabiliser les usagers des services publics locaux. La Commission a examiné le présent rapport au cours de sa séance du 5 juillet 2005 et l'a adopté. Elle a ensuite décidé qu'il serait remis à M. le Président de l'Assemblée nationale afin d'être imprimé et distribué, conformément aux dispositions de l'article 143 du Règlement de l'Assemblée nationale. * * * EXPLICATIONS DE VOTE DU GROUPE SOCIALISTE (*) Confirmant les craintes exprimées dès l'annonce de la mise en place d'une Commission d'enquête sur la fiscalité locale, le groupe socialiste tient à marquer son désaccord total avec les positions exprimées dans le rapport à charge rédigé par Hervé Mariton. Ce rapport s'éloigne de l'objectivité indispensable au travail d'une Commission d'enquête. Le titre choisi par le Rapporteur prêterait à sourire, s'il n'était pas la preuve indéniable d'un parti pris qui s'apparente à un procès d'intention. Le Rapporteur n'a pas su ou voulu s'extraire de la polémique stérile et des raccourcis idéologiques. En dénonçant avec obstination la gestion des exécutifs d'un bord politique différent de celui de la majorité parlementaire, il illustre la volonté de cette dernière de mener un véritable « troisième tour » des élections régionales, après une défaite électorale historique. Alors que des questions essentielles en matière de contrôle des finances publiques à tous les niveaux, et de complémentarité et d'interdépendance dans l'action de ces administrations ont été mises en lumière lors des auditions, la majorité refuse d'en tenir compte, martelant un message aussi simpliste qu'irréaliste sur la nécessaire baisse de la fiscalité et de la dépense publique, quels que soient les besoins exprimés par les citoyens. Le groupe socialiste ne peut que regretter que l'on se soit ainsi éloigné du fond des débats et que les travaux menés par la Commission d'enquête, notamment les éléments objectifs fournis au fil des très nombreuses auditions, n'aient pas été pris en compte. Les conclusions du rapport étaient largement écrites avant même le début de ces travaux. Le Rapporteur a délibérément choisi de ne retenir des auditions que des citations tronquées qui nourrissent son dossier d'accusation, au besoin en distordant les expressions des uns et des autres. Malgré la très grande qualité des auditions d'élus locaux, d'experts et de consultants, que le groupe socialiste tient à souligner, le Rapporteur a essentiellement retenu les déclarations des responsables gouvernementaux et des services de l'État, qui représentent une vision unilatérale de la situation. À cet égard, le groupe socialiste dénonce avec la plus grande fermeté la manière dont sont considérés élus et fonctionnaires des collectivités dans ce rapport et il condamne les nombreuses mises en cause dont ils font l'objet. Si l'on veut bien les considérer avec objectivité, les travaux de la Commission (I) permettent pourtant de souligner l'aspect largement polémique et stérile de la démarche de la majorité (A), qui se fonde sur une hostilité profonde aux principes qui doivent inspirer une réelle volonté décentralisatrice (B). Cette hostilité explique que, conformément à l'analyse faite par les exécutifs locaux, leurs marges de manœuvre se trouvent de plus en plus réduites. Les hausses de fiscalité, qu'elles soient régionales ou départementales, doivent être mises en perspective (II) et trouvent bien leur origine dans des choix faits par l'État central, et non dans une quelconque « mauvaise gestion » (A). La décentralisation des déficits de l'État est une réalité, qui risque de s'amplifier dans les années à venir (B). I / Des travaux qui ont permis de souligner la volonté politicienne de la droite d'organiser une forme de « troisième tour » des élections régionales A/ Une démarche purement partisane qui ne peut être acceptée Si la forme du rapport peut étonner par sa violence, le fond des assertions du Rapporteur ne constitue guère une surprise. En effet, tout au long des travaux de la Commission, le caractère partisan du Rapporteur et sa volonté d'alimenter une prise de position idéologique auront été évidents. Ses prises de parole publiques l'attestent. Hervé Mariton déclarait ainsi dans le quotidien Les Échos, le 30 mars 2005, que son projet, dans le cadre des travaux de la Commission, était d'« éviter que l'explosion de la fiscalité régionale ne contamine d'autres niveaux de collectivités ». Le comportement particulièrement polémique du Rapporteur s'est clairement manifesté lors de l'audition des présidents d'exécutifs régionaux. En réalité, le seul objectif recherché par le Rapporteur et la majorité dans le cadre de la Commission d'enquête était d'accompagner une campagne de communication réductrice. Cette campagne était destinée à mettre en accusation les présidents de région nouvellement élus ou réélus en 2004. Le Président de l'UMP n'avait pas d'autre ambition. Il en a fait son principal cheval de bataille dès sa nomination. Il fallait en effet, et il faut toujours masquer l'échec retentissant de la politique menée depuis 3 ans, et tenter de détourner l'attention. Pour cela, la calomnie et la manipulation demeurent malheureusement les meilleures armes. À cet égard, le choix de la forme institutionnelle particulière qu'est la Commission d'enquête parlementaire reflétait sans doute largement la volonté de mise en accusation des élus locaux, sous une forme la plus « inquisitoriale » possible. On comprend que le décorum entourant une Commission d'enquête ait pu séduire la majorité. On peut regretter qu'il ait conduit à rejeter la formule d'une mission d'information, qui aurait sans doute offert plus de souplesse, et surtout un temps plus adapté - au-delà des 6 mois - permettant d'aborder le sujet dans tous ses aspects. Cette campagne a notamment pris la forme d'un « livre bleu » édité par l'UMP, dont il est étonnant de constater que le Rapporteur ne discute jamais la pertinence, à l'inverse des déclarations des élus de l'opposition nationale. Pourtant, s'agissant d'un document dénonçant les effets fiscaux d'une « mauvaise gestion » locale quelques mois à peine après l'élection des nouveaux exécutifs, il aurait sans doute été instructif d'en comparer les assertions et la réalité des faits. Deux messages étaient en réalité écrits avant même que la Commission ne commence ses travaux : - les exécutifs locaux dirigés par la gauche augmenteraient les impôts par pure opportunité et par un choix politique autonome ; - l'État, notamment dans le cadre de la décentralisation, n'y serait pour rien. Ces assertions sont évidemment fausses. Elles ont pourtant été incessamment répétées depuis plusieurs mois, notamment à l'occasion des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale. La volonté de « revanche politique » de la majorité y est apparue de façon éclatante56. Les réponses à ces questions ont été l'occasion d'attaques répétées contre les exécutifs locaux et contre l'opposition. Le Premier ministre, le 31 mars 2005, a été jusqu'à déclarer, en réaction à l'évocation de sa participation à la décision d'augmenter de 100 % les impôts régionaux quand il était vice-président d'un conseil régional : « À gauche, l'impôt a du goût ! À gauche, l'impôt a de la saveur ! À gauche, l'impôt sert à financer la démagogie ! ». Dans la même ligne, soulignons la question posée le 9 février 2005 par Christian Jeanjean, député UMP de l'Hérault, au sujet de la région Languedoc Roussillon : il dénonce une hausse « de 80 % » de la taxe professionnelle, chiffre fantaisiste comme le démontrent les documents fournis par le présent rapport, mais surtout « une hausse de près de 80 % de la taxe d'habitation »... alors que les régions ne perçoivent ni ne votent plus cette taxe depuis 2000 ! Ce que la ministre déléguée à l'intérieur, Marie-Josée Roig, ne se donnera jamais la peine de rappeler dans sa réponse, soulignant au contraire la justesse de l'analyse faite par le député auteur de la question... · Le rapport reprend les techniques éprouvées lors de cette campagne, et notamment la référence exclusive aux comparaisons entre taux d'imposition. La question de l'influence de la base des impôts locaux sur l'évolution des taux n'est jamais clairement abordée dans le rapport. Ceci est vrai pour l'étroitesse de la base des impôts régionaux. La fiscalité des régions représente 5 à 6 % des impôts locaux. Exprimer uniquement en taux des hausses de fiscalité a peu de sens, puisque là où une région doit augmenter de 20 % sa fiscalité pour parvenir à un produit donné, un département ne doit l'augmenter que de 4 %, et une commune de 2 %. Cette situation est malheureusement considérée par le Rapporteur non comme un fait indéniable, ce qu'elle est pourtant, mais au mieux comme une présentation trompeuse faite par les régions. Ceci est également le cas pour les variations très fortes existant entre collectivités appartenant à une même catégorie. Selon la richesse fiscale d'une région ou d'un département, une hausse d'un même pourcentage de l'imposition locale conduira pourtant à un produit très variable, et donc à une augmentation en numéraire par habitant également très fluctuante. Si dans le Loir-et-Cher, une hausse d'imposition de 15 % correspond à 37 euros d'augmentation par habitant, une hausse de 12 % en Poitou-Charentes correspond ainsi à 6 euros. Choisissant à dessein d'ignorer cette réalité, le rapport persiste à valider ses conclusions pré-écrites en se référant constamment aux seules hausses de taux, quand bien même ces références ne sont absolument pas significatives. Pourtant, comme l'a souligné lors de son audition Jean-Yves Chamard, président de la commission des finances du conseil général de la Vienne et député de la majorité, « plus la fiscalité est faible, plus le pourcentage doit être élevé pour récupérer un euro supplémentaire ». Cette déclaration n'est citée qu'incidemment, à l'appui d'un raisonnement visant à relativiser l'ampleur de la hausse de 13 % de la fiscalité de ce département - bien sûr dirigé par la majorité nationale. À l'inverse, la pertinence de ce raisonnement n'est jamais affirmée concernant la fiscalité régionale ! · Mobilisé entièrement par son dessein polémique, le rapporteur a largement ignoré son mandat, qui était de s'intéresser notamment à l'évolution sur le long terme des finances locales. Il est vrai que cette étude l'aurait contraint à reconnaître le poids des héritages de la gestion par la droite de plusieurs collectivités. L'observation de l'évolution sur une période plus large aurait pourtant permis de prendre en compte certaines réalités. Deux exemples, que le rapport évite bien sûr soigneusement de rappeler, peuvent être cités à cet égard. En 1989, alors que l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin était vice-président du Conseil régional de Poitou-Charentes dominé par la droite, les impositions ont été augmentées de plus de 100 %. De même, en 1994, le conseil régional de Rhône-Alpes, dont le Rapporteur de la Commission d'enquête était membre de la majorité de l'époque, avait décidé une hausse de 72 % de l'impôt régional. On comprend la discrétion du rapport sur ces faits. Plus globalement, l'analyse des chiffres de la fiscalité des régions entre 1992 et 1994 permet d'observer une hausse globale et conséquente des taux : + 50 % en Franche-Comté, + 29 % en Bretagne, + 50 % en Provence-Alpes-Côte-d'Azur, + 45 % en Languedoc-Roussillon. Parallèlement à la diversité des situations économiques et sociales dans les différentes collectivités, les « héritages » politiques sont pourtant un facteur important d'explication des variations et de l'ampleur de certaines hausses de fiscalité, notamment dans les régions. C'est particulièrement le cas pour les régions qui avaient été cogérées par des majorités rassemblant des élus de droite et d'extrême droite, ces alliances ayant été fondées sur une volonté de baisse des impositions au mépris des besoins réels des territoires. Ces choix ont des conséquences lourdes à très long terme, s'agissant notamment des compensations de l'État aux collectivités, après des suppressions d'impositions locales décidées par la loi. S'appliquant à des produits plus faibles, ces compensations s'avèrent structurellement sous-dimensionnées. Ces phénomènes ont été observés aussi bien dans la région Languedoc-Roussillon qu'en Picardie ou en Bourgogne. · Le Rapporteur met en avant, parmi les explications des hausses des impositions locales, celle reposant sur la théorie du cycle politique. En réalité, c'est une conception largement « asymétrique » de cette théorie à laquelle il a recours. Alors même qu'il fait de cette théorie le socle de son explication des hausses des taux décidées en 2005, ses enseignements, concernant le fait que les taux seront souvent baissés ou stabilisés durant les dernières années de mandat, il néglige de rappeler cette évidence que la conséquence logique de cette prudence en fin de mandat est souvent l'obligation dans laquelle se trouve les élus d'assurer une forme de rattrapage en début de mandat, sous peine de devoir remettre en cause de larges pans de l'action publique locale. Il en va de même de l'observation selon laquelle les investissements lourds, des dépenses engageant pour plusieurs années les collectivités mais qui peuvent avoir une forte portée « électorale », seront plus facilement décidés en fin de mandat. Le rappel de cette réalité par l'exécutif de la région Franche-Comté se trouve ponctué d'une conclusion dont le souci d'« objectivité » fait une nouvelle fois frémir : « L'explication est peut-être facile, elle est possible » (p. 126 du rapport) ! · C'est avec le même esprit partisan que le Rapporteur refuse la réalité du poids des engagements disproportionnés pris par certains exécutifs de droite dans les dernières années préélectorales. Confronté à la réalité de ces engagements, le rapporteur se contente de considérer que la difficulté à y faire face, qui explique pourtant la nécessité d'avoir recours à des moyens financiers supplémentaires, est liée au fait que « la nouvelle majorité accepte mal d'avoir à assumer certains des engagements antérieurs, tout en ayant à financer les projets pour lesquels elle s'est engagée devant les électeurs ». Une fois encore, il faut remarquer que, dans le cas de la région Languedoc-Roussillon, l'audit réalisé par l'un des experts auditionnés a chiffré à 297 millions d'euros le montant des autorisations de programmes engagées par l'ancien exécutif fin 2003 et non financées... Le peu d'importance accordé par le Rapporteur à de tels engagements, comparé à l'insistance avec laquelle il traite des 7,9 millions d'euros (au total) de dépenses d'action internationale et de communication de la même région à quelques pages d'intervalle, pourrait faire sourire s'il ne soulignait pas une nouvelle fois son esprit éminemment partisan. Pire, le Rapporteur a choisi, sur cette base, de mettre en cause la compétence des élus locaux en concluant que « les nouveaux exécutifs régionaux, pas toujours rompus aux raisonnements en autorisations de programme et crédits de paiements ont pu être surpris » (p. 127 du rapport) ! Au total, le Rapporteur s'en tient une nouvelle fois au matraquage de son message et conclut, quelques pages plus loin, avec l'objectivité et la mesure dont il sait faire preuve tout au long du rapport : « l'impôt n'est pas une fin en soi : en 2005, la flambée fiscale avait pour fonction de couvrir le dérapage des dépenses » (p. 131). · C'est dans l'analyse des dépenses des collectivités que le rapporteur dépasse les limites de ce qui peut être jugé comme acceptable en terme de présentation partisane. Ce qui, dans un registre purement politique, relèverait de la basse polémique pose, dans le cadre du rapport d'une Commission d'enquête ayant pour objet les collectivités locales, un réel problème de respect de élus locaux et de libre administration de ces collectivités. L'insistance et l'absence totale d'objectivité avec laquelle il met en avant les « frais de communication et de représentation » et les critiques qu'il adresse explicitement aux exécutifs sont indignes de sa fonction et ne peuvent être tolérées dans le cadre d'une Commission d'enquête de l'Assemblée nationale. Les remarques faites par le Rapporteur sur le nombre de pages des magazines édités par les régions, de même que celles visant la qualité des divers outils de communication, qui va même jusqu'à interroger le caractère biodégradable ou non des stylos ou t-shirts promotionnels, sont aussi risibles qu'inacceptables. Il faut rappeler que les dépenses inscrites au budget primitif des régions en 2005 s'élèvent pour la métropole à 18,8 milliards d'euros, en croissance de 12,6% par rapport à 2004. Il est significatif de constater que pour expliquer cette évolution, le Rapporteur choisit de se préoccuper d'un poste qui représente, d'après les tableaux fournis dans le rapport, un total de 100 millions d'euros (dont 72 millions pour les seules dépenses de représentation et de communication, selon les chiffres fournis en page 132), soit 0,5 % du total... Quel crédit accorder à cette théorie oiseuse sur les dépenses budgétivores des régions quand elle se fonde sur 0,5 % des dépenses globales ? Enfin, certaines insinuations ne peuvent être acceptées. Il en va ainsi de celles visant la qualité des réponses au questionnaire de la Commission d'enquête. Constatant que certains éléments du questionnaire n'étaient pas renseignés, le rapporteur déclare d'abord qu'une telle absence est « troublante » puis quelques pages plus loin « ce n'est peut-être pas seulement en raison de difficultés de nature technique : (les régions) ont bien voulu en surmonter de plus délicates pour d'autres rubriques » (p. 136). Ce propos n'étant étayé par aucun argument, il est inacceptable et révèle la dimension purement polémique et partisane du rapport. B / Le retour du fond antidécentralisateur de la droite Les élus socialistes pressentaient la volonté de manoeuvre politicienne de la droite et souhaitaient que les questions relatives aux finances locales puissent au contraire être traitées au fond et en toute transparence. Ils ont donc accepté de participer au travail de la Commission d'enquête, jugeant légitime sa mise en place dans le cadre notamment des principes constitutionnels fixant les compétences respectives du législateur et des collectivités locales. Malheureusement, les craintes exprimées d'une mise en cause de l'autonomie financière et de la libre administration des collectivités locales par la majorité se sont révélées fondées. A l'évidence, le libéralisme de la majorité, voire l'ultra-libéralisme ouvertement promu par le rapporteur, ne trouvent en effet jamais à s'exprimer en matière de respect de la liberté de décision des collectivités locales. À cet égard, les membres socialistes de la Commission d'enquête tiennent à souligner le caractère totalement inacceptable et injustifié des jugements émis durant les travaux et dans le rapport, notamment sur la bonne foi et la compétence des élus et des fonctionnaires territoriaux. Cette mise en cause est récurrente dans le rapport, et dessine une image intolérable des élus locaux, incapables de maîtriser leurs dépenses, par incompétence ou par démagogie. Le rapporteur, qui n'a de cesse de critiquer les élus locaux, s'en prend également aux fonctionnaires des collectivités. Il juge ainsi que « les fonctionnaires territoriaux, globalement, ne semblent pas toujours partager de culture gestionnaire » (p. 404). Ces exemples pourraient malheureusement être multipliés. Si nous devions ne retenir qu'un seul écart du rapporteur, nous mentionnerions un extrait des premières pages de la deuxième partie de son rapport consacrées aux causes « structurelles » des hausses d'impôt : « Un peu de modestie ferait du bien à tout le monde, et notamment au contribuable local, qui n'en demande pas tant et se trouve être la victime toute désignée des ambitions des autres ! On relèvera ainsi le caractère un peu présomptueux du terme, si souvent utilisé, de « président de région », alors qu'il s'agit de la présidence du conseil régional. Simple commodité de langage, dira-t-on, mais elle est significative ». · Les socialistes n'acceptent pas cette attaque en règle constante des responsables des collectivités locales. Cette charge est d'autant plus malvenue que, comme l'ont souligné abondamment les experts et consultants entendus par la commission, le secteur public local affiche des bons résultats financiers qui ont permis notamment à la France de se qualifier pour le passage à l'euro. Faut-il souligner que l'endettement des collectivités n'a cessé de diminuer dans la période où celui de l'État « explosait » littéralement ? Il est en effet piquant de constater avec quelle insistance le Rapporteur et la majorité font mine de s'inquiéter du besoin de financement de 0,1 point de PIB apparu en 2004 pour les administrations publiques locales ! D'une part l'apparition de ce besoin de financement est liée précisément à l'action de ce gouvernement. D'autre part l'inquiétude de la majorité est d'autant plus surprenante lorsque l'on compare ce chiffre aux 3,6 % de déficit public total, et surtout lorsque l'on prend en compte une dette publique totale qui aura augmenté de près de 8 points depuis 2002, la majorité ayant ici aussi remis en cause les engagements européens de la France de limiter l'endettement à moins de 60% du PIB. Cette polémique sert à alimenter l'image d'un État vertueux dont le gouvernement baisse les impôts qui se trouverait opposé à des collectivités irresponsables qui les augmentent. Elle est essentiellement destinée à préparer l'opinion publique à une « mise au pas » des collectivités, au mépris du principe de libre administration, au profit d'un modèle de « bonne gestion locale » défini par l'État. Le rapport reflète largement cette volonté de jugement des choix des collectivités locales. · Il est évident que la majorité a une idée arrêtée, quelle que soit la réalité de ses résultats en la matière, de ce que devrait être la gestion publique : toujours moins d'intervention publique, quelles que soient les demandes des citoyens, ce qui devrait permettre ou accompagner une baisse des prélèvements. Ainsi, le Rapporteur n'hésite pas à qualifier de façon explicitement négatives les orientations des gestions locales, dès lors qu'elles ne cadrent pas avec son orientation idéologique dogmatiquement libérale. Commentant les déclarations du Président de la région Bretagne constatant que le niveau d'intervention publique « n'est pas à la hauteur des attentes exprimées envers la région », il déclare ainsi « Et l'ancien indicateur de bonne gestion se trouve affecté d'un signe négatif : un budget économe devient la manifestation d'un retard par rapport à la moyenne nationale » (page 153). Ces jugements de valeur sont multiples et dessinent en creux quels auraient dû être selon la majorité, les « bons choix » des collectivités. L'exemple de la région Alsace est ainsi régulièrement cité. Le Rapporteur se félicite que, confrontée à un désengagement de l'État que le président de la Région a d'ailleurs admis sans le critiquer, celle-ci ait réagi avec parcimonie. Il passe à cet égard rapidement sur le fait que la région sollicite de façon régulière sa fiscalité, avec une hausse constante et appelée à se poursuivre dans les années à venir au moins égale à 2 % par an - à l'inverse des régions gérées en commun avec l'extrême droite, qui ont dû sous la pression des alliances politiques baisser chaque année le poids de leur fiscalité. La stratégie de la région Alsace consiste en effet à ne pas se substituer à l'État lorsque celui-ci se retire, sauf exceptions, et à remettre en cause son calendrier d'investissement. Elle est bien sûr citée en modèle. Cet exemple fournit deux enseignements : le désengagement et les difficultés financières accrues sont une réalité, reconnue par l'ensemble des élus locaux. Et la droite n'accepte pas la réponse consistant à tenter d'y faire face, conformément à la demande formulée par les citoyens. Le Rapporteur rejoint totalement le gouvernement qui, à plusieurs reprises, a exprimé son souhait d'un encadrement nouveau de l'autonomie des collectivités. On ne citera ainsi, tout en renvoyant à l'audition de Jean-François Copé, que les annonces du Ministre de l'économie Thierry Breton. Ce dernier a en effet une nouvelle fois expliqué que la situation de gestion des collectivités locales était « originale », ces dernières étant, selon lui, « complètement déconnectées des contraintes générales des finances publiques ». Son appel à la mise en place d'une « Conférence nationale des finances publiques » est l'aboutissement logique de la démarche d'encadrement des collectivités. · Une mention particulière doit être faite de l'attaque frontale de la majorité contre l'intercommunalité Sa vision d'une gestion publique qui ne doit viser qu'à la réduction des services publics rendus, des dépenses publiques et de prélèvements lui sert de référence quasi-exclusive dans sa critique de l'intercommunalité. Pour la majorité parlementaire, seule est concevable une substitution pure et simple des dépenses des structures intercommunales à celles des communes, et ceci au mépris de la demande des citoyens d'accès à des services supplémentaires, qui nécessite précisément la mise en communs des moyens. L'insistance avec laquelle ce thème a été abordé, l'incompréhension tenace de la majorité face au fait que les dépenses et la fiscalité communale ont continué à progresser, même si cela s'est fait à un rythme plus modéré que pour les communes restées à l'écart des intercommunalités, s'est exprimée lors de l'ensemble des auditions et se retrouve dans les critiques du Rapporteur. On ne peut que déplorer à cet égard que l'aveuglement idéologique de la majorité la conduise à critiquer avec autant d'insistance l'intercommunalité. II / Les critiques et les craintes émises par les exécutifs locaux se trouvent en réalité largement confirmées par les travaux de la Commission A/ La décentralisation des déficits est une réalité Les députés socialistes souhaitent une nouvelle fois insister sur un apport important des auditions, qui est d'avoir souligné la qualité de la gestion globale des collectivités. Les experts auditionnés ont souligné largement ses principaux caractères : endettement raisonnable, dépenses proportionnées à la demande des citoyens en matière de services publics, fiscalité raisonnée. Dans ce cadre, la responsabilité de l'État dans les évolutions récentes des finances locales est indiscutable, même si elle ne peut être réduite à la question précise de la « décentralisation » entendue simplement comme transfert de compétences. Le Rapporteur et la majorité tentent d'abuser l'opinion publique en exonérant l'État de toute responsabilité dès lors que les transferts de compétences seraient limités en 2005. Cette affirmation est trompeuse pour 3 raisons : - elle ignore les effets pour les collectivités du désengagement de l'État dans ses compétences propres ou partagées, - elle passe sous silence la question des contrats de plan, - elle relativise les enseignements inquiétants tirés des premiers transferts intervenus, notamment pour les départements. · En effet, la charge principale pesant sur les collectivités provient de la nécessité de combler le désengagement de l'État, qui s'inscrit dans un cadre beaucoup plus large que celui de la loi du 13 août 2004 sur les responsabilités locales. Contrairement à ce que tente de faire croire le rapporteur, l'intervention des collectivités locales en remplacement d'un Etat défaillant n'est pas liée à un choix politique autonome consistant à « aller contre » une volonté d'abandon de certaines politiques publiques jugées non prioritaires par une majorité politique au niveau national. Ceci est d'autant plus vrai que, comme l'ont fait observer les responsables locaux, et même si le rapporteur oublie totalement de le rappeler, la sollicitation des différents ministères est forte pour obtenir l'intervention complémentaire des collectivités pour accompagner les politiques nouvelles décidées par l'État. En réalité, l'État compte sur cette substitution, voire en est explicitement demandeur dans certains cas. L'audition de l'Association des régions de France est éloquente à ce sujet. L'État mendie auprès des régions leur participation au financement de ses compétences propres. C'est le cas notamment du TGV57 ou des universités. · Par ailleurs, dans le cadre des compétences croisées, à savoir celles assumées à la fois par les régions et l'État, hors contrats de plan, le désengagement de ce dernier est manifeste. Il est observé dans les domaines du développement économique, de l'aide aux entreprises et des transports publics (le cas du tramway de Bordeaux a été largement relayé par les médias). Jean-Paul HUCHON, Président de la région Île de France chiffre le désengagement de l'État, dans le seul cadre de ces compétences partagées, à 383,3 millions d'euros58. Même Adrien ZELLER, Président de la région Alsace, membre de la majorité nationale, consent à le reconnaître : « Il est vrai que les désengagements de l'État sont assez nombreux. Nous avons analysé la situation cas par cas, en ce qui concerne les crédits de matériel pédagogique, réduits des deux tiers, les parcs naturels, l'environnement... ». · Concernant les contrats de plan, les députés socialistes ne peuvent qu'une nouvelle fois dénoncer le manque d'objectivité et d'honnêteté de la présentation faite par le rapport de la réalité du retard dans l'exécution des engagements de l'État. Deux arguments principaux sont avancés par le Rapporteur pour nier tout effet à un retard qui pourrait, selon les rapports d'information parlementaires consacrés spécifiquement à cette question, atteindre jusqu'à 3 ans pour une durée initiale de 6 ans. D'abord une explication politicienne et sans portée, avec l'argument selon lequel les retards seraient dus au « surdimensionnement » des contrats de plan signés par le gouvernement de Lionel Jospin. L'aspect évidemment polémique et partial de cet argument suffit à l'écarter. On remarquera simplement en complément que l'opposition est totale entre les deux discours du gouvernement, qui fait mine d'un côté d'insister sur la nécessité de réaliser rapidement des grands travaux d'infrastructure, notamment en matière ferroviaire, afin de promouvoir des formes de transports alternatives à la route, et d'un autre côté se désengage massivement de ce domaine en accusant ses prédécesseurs d'avoir vu trop grand. S'agissant du volet routier, au rythme actuel de délégation des crédits, le taux d'exécution des contrats serait d'environ 54,7 % en 2005, et il faudra encore 3 ans supplémentaires, après 2006, pour achever la programmation. Concernant le volet ferroviaire, si toutes les dotations de l'État avaient été mobilisées - à savoir sans gel budgétaire - on atteindrait fin 2005 un taux de réalisation des contrats de l'ordre de 75 %... la réalité devrait être de 44 %. Ce volet connaîtra donc un retard de 6 ans, pour une durée initiale prévue de... 6 ans. Un décalage que le Rapporteur ose qualifier de « banal »59. Ce retard du volet ferroviaire encore plus important que celui du volet routier des contrats ne fait qu'aggraver le déséquilibre existant entre le ferroviaire et la route, entraînant des conséquences néfastes pour l'aménagement du territoire et l'environnement. Le financement par des contrats de plan État-Régions est censé être le plus équitable, chaque acteur contribuant pour la moitié. Actuellement, certaines régions participent à ces contrats à hauteur de 80 % contre 10 % pour l'État. Ensuite, l'idée selon laquelle les retards seraient en réalité une forme d'avance des collectivités sur le calendrier de l'État, qui n'auraient in fine aucune conséquence financière, fait bien peu de cas des observations de la Cour de Comptes sur les effets de ces retards et de la régulation budgétaire en matière d'investissement public. La Cour a ainsi rappelé à plusieurs reprises les conséquences en termes de surcoûts - intérêts moratoires, coûts liés aux arrêts et reprises de chantiers, coût pour les fournisseurs privés et cocontractants - de ces retards. · Enfin, si les premiers transferts restent limités en 2005, notamment au niveau des régions, les problèmes posés et observés pour leur compensation augurent mal de l'avenir. L'exemple le plus caricatural de l'approche du rapporteur est à rechercher dans son analyse des contrats d'avenir et du revenu minimum d'activité (RMA). Il fait de cette réforme décidée par le gouvernement, votée par la majorité contre l'avis de l'opposition et avec des vives critiques des collectivités concernées, un « outil optionnel » qui certes aurait un coût supérieur à l'ancien RMI pour les collectivités (de l'ordre de 25 à 30 % non compensés), mais dont celles-ci ne seraient en aucun cas tenues de se servir, ce qui est une analyse d'une hypocrisie rare60. Le Rapporteur répond une nouvelle fois à la commande politique que lui ont fait le gouvernement et la majorité : il fallait absolument justifier le fait que l'État avait refusé de compenser le surcoût de cette compétence. Mission accomplie : aucune compensation pour une compétence facultative. Cette conception est en tout point inacceptable. Il suffit d'imaginer la différence de traitement entre citoyens sur le territoire si elle était réellement mise en œuvre. Elle conduirait inévitablement à de grandes différences de traitement, notamment car les territoires les plus pauvres disposeraient de moyens d'interventions largement réduits, alors qu'ils sont bien souvent ceux sur lesquels les besoins sociaux sont les plus importants. · L'exemple du RMI suffit à illustrer le caractère trompeur du slogan, répété à l'envi par le Ministre délégué au Budget, selon lequel les transferts « seront compensés à l'euro prêt ». Les travaux de la Commission soulignent sans aucune ambiguïté un fait incontestable : si la compensation du transfert aux conseils généraux de la responsabilité de mise en œuvre du RMI avait respecté le cadre général fixé par la loi « responsabilités locales », la surcharge financière supportée par les départements aurait pesé dès 2004 sur leurs finances dans des proportions considérables. L'existence d'un écart de 450 millions au titre de l'année 2004 entre ressources et compétences transférées est désormais admise par tous. Il est vrai que l'insistance des députés socialistes et des élus locaux aura permis d'assurer l'insertion d'une « clause de revoyure » spécifique en la matière qui permettra, si le gouvernement tient ses engagements, de combler cet écart pour l'année 2004. Mais comme l'ont souligné les travaux de la Commission et comme l'ont abondamment rappelé le Rapporteur et le Ministre délégué au budget, cette intervention complémentaire de l'État était tout à fait exceptionnelle61. Et surtout, alors qu'un écart au moins aussi important est déjà constaté sur la première moitié de l'année suivante (2005), rien ne permet à ce jour d'affirmer qu'une même compensation pourra être accordée aux départements. Le Rapporteur conclut faiblement au sujet d'une éventuelle compensation intégrale des déficits envisagés pour 2005 et les années suivantes : « Votre Commission d'enquête a constaté qu'aucun arbitrage n'a été rendu sur ce sujet ». Les élus, en toute responsabilité, sont donc obligés de provisionner au vu de cette forte probabilité de déficits supplémentaires. La polémique qui entoure actuellement la décentralisation des services de transport en Ile-de-France illustre également la fausseté du slogan d'une compensation « à l'euro prêt ». Pour conclure cette analyse, on se reportera au rapport préliminaire sur l'exécution du budget 2004 réalisé par la Cour des Comptes. Celle-ci conclut ainsi que la dégradation des finances des collectivités est essentiellement due aux dépenses liées au RMI pour les départements, et aux subventions issues de la régionalisation du transport ferroviaire pour les régions62. Elle souligne que ces dépenses n'ont pas trouvé leur contrepartie dans des hausses des impôts locaux. · Concernant les régions, dès 2005, quelques nouvelles compétences (la formation des travailleurs sociaux, les aides aux étudiants des instituts de formation des travailleurs sociaux, les écoles et instituts de formation des professions paramédicales) leur ont été attribuées avec une visibilité financière quasi nulle. Aucune information émanant des services de l'État n'a été communiquée aux régions. Ces collectivités ont dû prendre en compte ces nouveaux transferts, sans connaître leur poids exact ni même la compensation de l'État les concernant63. Il faut rappeler ici que l'ensemble des exécutifs régionaux avaient pourtant adressé au gouvernement la demande pressante que puisse être organisé, comme cela avait été le cas sous la précédente législature, un audit contradictoire préalable permettant précisément aux régions de déterminer l'ampleur réelle des transferts auxquels elles seraient appelées à faire face, et le montant des compensations prévues. Faute d'avoir accédé à cette demande, le Gouvernement a choisi de laisser les régions dans un flou total et inquiétant, qui oblige chaque région à tenter, avec des grandes difficultés, un chiffrage préalable des besoins de financement qu'elle devra assumer. François PATRIAT, Président de la région Bourgogne chiffre ainsi le déficit de ces nouvelles compétences à 3 millions d'euros. · Plus globalement, la question du dynamisme très différent du coût des compétences et des moyens transférés doit être rappelée. Alors que le Rapporteur se contente essentiellement de retranscrire les déclarations de l'Etat et de ses services dans le cœur du rapport, il nous semble important de rappeler les déclarations des experts et consultants auditionnés par la commission. Comme le souligne le professeur Robert Hertzog, cité dans le rapport : « si les transferts de charges ont été jusqu'à présent compensés d'une manière généralement très correcte, la compensation n'a toutefois pas porté sur la totalité de la dépense effective, du fait que ce transfert s'est accompagné d'un besoin de rattrapage. [...] S'agissant des compensations des transferts de compétences, la Constitution a prévu un mode de calcul simple : ce sera autant que ce que l'État dépensait. Pour objectif qu'il soit, ce critère n'est pas satisfaisant : rien ne dit que l'État dépensait à un niveau optimal. L'expérience a montré qu'il fallait faire plus pour rattraper les inégalités territoriales. » B / Des craintes fortes pour l'avenir Arrêtons-nous sur l'évaluation des charges transférées aux collectivités locales. En vertu de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales, la Commission consultative sur l'évaluation des charges a été réformée. Composée de vingt-deux membres, 11 élus et 11 représentants de l'État, elle est chargée de contrôler la compensation financière allouée par l'État en contrepartie des transferts de compétences. Augustin BONREPAUX est l'un des vice-présidents de la section qui évalue plus spécifiquement les charges transférées aux départements et les recettes correspondantes. Les travaux de cette Commission sont essentiels pour déterminer avec exactitude le montant des charges transférées et celui des compensations proposées par l'État, ces dernières ne satisfaisant pas, à juste titre, les élus locaux. · Hervé MARITON affirme sans retenue et à plusieurs reprises que cette Commission consultative d'évaluation des charges aurait émis un avis favorable sur les règles de compensations d'ores et déjà émises. Il n'en est rien. Il suffit pour le constater de se reporter au rapport du président de cette commission, Jean-Pierre FOURCADE, à l'occasion d'un premier bilan établi en juin 2005. Ce bilan est éloquent : les élus ont formulé des exigences pour revoir les règles de compensation prévues jusqu'à présent s'agissant du RMI, du FSL64 (Fonds national du logement) et du Fonds d'aide au jeunes (FAJ)65. Ainsi, les élus ont unanimement demandé que l'année de référence pour calculer la compensation du RMI ne soit plus l'année 2003, mais l'année 2004 après abondement exceptionnel, ce qui nécessite l'arbitrage du Premier ministre. De même, ils ont demandé la mise en place d'un système d'alimentation régulière des départements, afin d'éviter les problèmes de trésorerie (le déficit de 450 millions d'euros de 2004 sera certes compensé, mais payé seulement en 2006). L'Etat a refusé d'accéder à cette demande. · Surtout, la question de l'évolution des moyens transférés en regard des charges ne peut être éludée. Elle impose de poser la question de l'évolution à long terme du rendement des impositions transférées. À cet égard, nous souhaitons une nouvelle fois nous inscrire en faux contre la présentation trompeuse faite jusqu'ici du « dynamisme » des impositions transférées. Il est vrai que, contrairement aux déclarations nombreuses du gouvernement jusqu'à ce jour, le Rapporteur choisit de qualifier de « fiable » et non de « dynamique » la taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP), dont une part sera transférée aux départements et aux régions en compensation des transferts. Les chiffres cités dans le rapport permettent de constater que les recouvrements de TIPP, qui n'ont progressé en réalité de façon dynamique qu'en raison des hausses de fiscalité décidées durant les années 1990, sont en baisse constante sur les 3 dernières années. On comprend dès lors que le rapporteur ait été contraint de ne pas retenir la notion de « dynamisme ». Mais on continuera de critiquer l'idée selon laquelle la TIPP serait un impôt permettant de faire face à long terme au coût inévitablement croissant des compétences transférées. Les élus pourront-ils être rassurés par les conclusions du Rapporteur selon lequel « Quel que soit le dynamisme de ces consommations, il importe de souligner que les départements bénéficient d'une garantie de ressources : ils sont assurés de percevoir chaque année un minimum égal au montant consacré par l'Etat au RMI en 2003, soit 4 941 millions d'euros »66. Cette garantie, dont il faut rappeler qu'elle ne fut acquise in extremis que grâce à la saisine par le groupe socialiste du Conseil Constitutionnel, s'avérera sans doute peu rassurante pour les élus locaux confrontés aux chiffres d'évolution de la TIPP et du nombre de bénéficiaires du RMI. Parallèlement, on ne peut être qu'inquiet face à l'impression d'improvisation laissée par le gouvernement concernant les éventuelles possibilités de vote des taux des impositions transférées par les collectivités. À l'inverse de l'image qu'elle avait souhaité se donner par le passé, la majorité a peu à peu abandonné le projet d'instauration d'une réelle autonomie fiscale des collectivités. Le vote du projet de loi organique sur l'autonomie financière avait illustré ce recul, en accordant aux produits d'impôts transférés sans possibilité de vote des taux le statut de ressources propres. Aujourd'hui, on constate que les projets du gouvernement concernant les - rares - impositions pour lesquelles les collectivités auraient dû disposer d'un pouvoir d'initiative en matière de vote des taux, restent très flous. En matière de TIPP, l'accord au niveau communautaire permettant d'offrir cette possibilité n'est toujours pas avéré, comme le rappelle le rapport. En matière de taxe sur les conventions d'assurance, dont les départements devaient à terme pouvoir faire varier le niveau, les déclarations de la directrice de la législation fiscale devant la Commission soulignent l'ampleur des difficultés qui sont peu à peu apparues en la matière et ne peuvent qu'inquiéter les représentants des collectivités. · À ces interrogations sur l'évolution et les marges laissées concernant les impositions transférées, s'ajoutent celles entourant les actuelles impositions locales et leur réforme. Durant les années récentes, les deux principales annonces de réformes des impositions locales ont en effet été faites de manière totalement inopinée, sans aucune concertation, par le chef de l'État. Cela a été le cas de la taxe professionnelle comme de la taxe sur le foncier non bâti. Or les projets du gouvernement sont entourés d'un flou total. Après avoir repoussé les propositions du groupe socialiste en matière de réforme de la taxe professionnelle pendant 2 ans, lancé une commission (Fouquet) qui a procédé à des travaux approfondis, et instauré un mécanisme « transitoire » de détaxation des investissements nouveaux dont le coût est supérieur à 1,5 milliard d'euros en année pleine, le gouvernement semble aujourd'hui se rallier à une réforme très proche dans l'esprit de celle portée initialement par les députés socialistes. À ceci prêt que là où les socialistes proposaient, pour un rendement total comparable, une réforme « autofinancée » (puisque le plafonnement de certaines entreprises en fonction de la valeur ajoutée aurait conduit à un relèvement de la cotisation minimale due par les entreprises les moins imposées), l'objectif central du gouvernement et de la majorité est d'alléger la charge totale des entreprises, même si cela doit restreindre drastiquement les marges de manœuvre déjà réduites des collectivités locales. · Le groupe socialiste regrette également profondément que les analyses du Président de l'ARF sur la nécessité d'assurer aux régions un meilleur lien entre les impositions affectées aux régions et ses compétences économiques n'aient pas été plus fortement prises en compte. Faute de précisions sur ce dispositif, le groupe socialiste ne peut que manifester son inquiétude face à un nouveau signe de la volonté de « reprise en main » des collectivités locales. Ce projet pourrait avoir des conséquences désastreuses pour les collectivités situées en zones rurales et industrielles, ainsi que pour les intercommunalités, dont la taxe professionnelle représente la ressource principale. Pour conclure ces réflexions consacrées à la question des marges de manœuvre financières laissées aux collectivités territoriales, le groupe socialiste souhaite dénoncer avec vigueur l'approche proposée de façon plus ou moins discrète par le Rapporteur et qui consiste à proposer la substitution de l'usager au contribuable. Cette proposition, traditionnelle dans la majorité, est lourde de menace quant au principe d'égalité des citoyens face au service public, au sein d'une même collectivité comme entre différents territoires. Elle nie la dimension d'équité, ainsi que celle de péréquation, car il est évident, même si le rapport final de la Commission d'enquête ignore très largement cette question, que les coûts de « production » des différents services publics peuvent être très divers selon les territoires. Il est curieux à cet égard que le modèle économique prôné par le Rapporteur - notamment quand il oppose à la gratuité des équipements pour les usagers, et donc à leur financement par l'impôt, la généralisation de la tarification à l'usager - n'ait en réalité été évoqué que par des représentants de la majorité au sein de la commission, alors que quasiment aucun des présidents d'exécutifs ou des experts auditionnés n'ont abordé ce sujet. La place qui lui est faite dans les propositions du rapporteur ne laisse donc pas de surprendre. On connaît la faveur du Rapporteur pour un modèle qui fait partie du bagage idéologique traditionnel de la droite la plus libérale. On ne peut accepter qu'il ait choisi d'en faire la promotion au nom d'une commission d'enquête dont les conclusions doivent viser l'objectivité. Conclusion Si l'on avait bien voulu s'en tenir au contenu des auditions et à la réalité des faits et des chiffres, les travaux de la Commission d'enquête auraient pu constituer une base de travail intéressante pour entamer une réflexion de fond sur l'évolution des finances et de la fiscalité locales. Ce travail n'a pu avoir lieu, du fait de la volonté de mise en cause systématique des élus locaux par la majorité nationale. Le groupe socialiste ne peut que déplorer ces attaques répétées contre la compétence et l'honnêteté de l'ensemble des élus et fonctionnaires territoriaux. La polémique a pris le pas sur la volonté de comprendre et d'analyser, pourtant mise en œuvre par la très grande majorité des personnes auditionnées. On se reportera donc avec profit aux comptes-rendus des auditions fournis par ce rapport, qui suggèrent quelques pistes de réforme profondes. À de nombreuses reprises, les travaux ont souligné les insuffisances du texte « responsabilités locales » du 13 août 2004. Ils auraient dû permettre de revenir sur les erreurs commises lors du vote de ce texte, notamment en matière de refus de procéder à une réelle clarification institutionnelle des compétences des différents niveaux de collectivités. Malgré le refus du gouvernement de s'interroger sur la nécessité d'une réforme visant à améliorer les mécanismes de péréquation, cette question demeure également centrale. La diversité des situations financières et fiscales constatées par le rapport le souligne à l'envi. On ne peut donc que déplorer une nouvelle fois que le rapporteur ait choisi d'ignorer largement, dans ses analyses comme dans ses préconisations, ce thème crucial, qui n'est abordé, de façon qui reste largement superficielle, qu'après 200 pages de son rapport. De même, la nécessité de plus en plus pressante d'entamer une réflexion d'ensemble sur la fiscalité locale, non pas pour se focaliser de façon caricaturale, comme le fait le Rapporteur, sur ces évolutions de très court terme, mais pour poser la question de son équité, de la répartition de la charge fiscale locale entre les ménages et les entreprises, sur l'ensemble du territoire, et sur les marges dont doivent disposer les collectivités pour assumer leurs responsabilité en la matière, n'a fait l'objet d'aucun développement. Au total, le groupe socialiste estime que les travaux de la Commission ont permis de confirmer largement l'analyse faite par les élus locaux des contraintes pesant sur leurs décisions fiscales : Les héritages des gestions précédentes sont souvent lourds, Les désengagements de l'État sont massifs, La mauvaise adéquation entre moyens et compétences transférés dans le cadre de la décentralisation, qui apparaît sur les premiers transferts réalisés, est une source d'inquiétude très forte pour l'avenir. Notre analyse est résumée dans les pages suivantes. Retour sur les causes d'augmentation des impôts locaux en 2005 Le Rapporteur ayant largement distordu, dans un sens polémique et partisan, les travaux de la Commission d'enquête, le groupe socialiste souhaite s'inscrire en faux contre ses conclusions. En reprenant la typologie des causes identifiées par le rapporteur de la Commission d'enquête et en excluant les propos les plus évidemment caricaturaux et polémiques, il convient d'y apporter les précisions et corrections suivantes : 1/ La Commission d'enquête ne peut écarter la réalité des effets de la décentralisation sur les finances des collectivités. Ceci est évident concernant le transfert du RMI aux départements. Comme l'ont souligné les travaux de la Commission avec insistance, si le gouvernement s'en était tenu au principe général retenu dans le cadre de la loi « Responsabilités locales », l'écart entre dépenses réelles et ressources transférées aurait atteint 450 millions en 2004, et un montant inéluctablement supérieur en 2005. La correction que le gouvernement, sous la pression notamment de la Commission d'enquête, a accepté d'apporter au titre de 2004, ne sera sans doute pas accordée au titre de 2005, et l'effet de ciseau ne pourra que se creuser. Concernant aussi bien les régions que les départements, les effets sur les finances locales seront certes différés, mais ne peuvent être ignorés. Contrairement aux affirmations embarrassées du Rapporteur, la TIPP n'est pas une imposition fiable, encore moins dynamique. Son produit ne progresse plus depuis plusieurs années. Quant à la possibilité pour les collectivités de voter les taux des impositions transférées, elle n'est pour l'heure avérée ni pour la TIPP, ni pour la taxe sur les conventions d'assurance. 2/ Conformément aux analyses faite dès l'origine par les exécutifs locaux, le désengagement de l'État est la principale cause des décisions d'augmentation de la fiscalité prises par les collectivités. Le niveau et l'éventuelle augmentation de l'effort financier de l'État dans les territoires restent à démontrer, l'ensemble des auditions ayant surtout mis en évidence l'absence d'informations précises à ce sujet, voire le refus des représentants de l'Etat de les fournir aux exécutifs locaux. En revanche, le non respect par l'État de ses engagements en matière de contrats de plan État-régions est avéré. Le retard pourrait atteindre 3 ans. Le seul argument avancé en la matière par le Rapporteur serait le prétendu « surdimensionnement » des engagements pris par le précédent gouvernement. Cette appréciation purement partisane est sans portée, compte tenu du fait que la relance des contrats et des investissements publics est unanimement demandée. Enfin, le rapport ignore la réalité de l'intervention des collectivités dans le domaine des responsabilités propres de l'État ou des compétences partagées, à la demande de celui-ci et en appui de ses politiques. Cette intervention n'est pas le fait d'un choix politique purement autonome. Il est avéré que le gouvernement n'a de cesse, notamment en matière sociale, de demander aux collectivités de participer à la mise en œuvre de ses actions pour élargir ses marges de manœuvres réduites par la contrainte budgétaire. Ceci est avéré aussi bien pour la diffusion des contrats aidés en matière de lutte contre le chômage, que pour la participation aux opérations de renouvellement urbain, les travaux liés aux trains à grande vitesse ou aux universités. 3/ Les collectivités ne sont pas dupes des garanties constitutionnelles mises en avant par l'État, ce qui peut expliquer qu'elles fassent preuve de précaution. La révision constitutionnelle du 28 mars 2003 n'a apporté aucune garantie en matière d'ajustement dynamique des recettes aux charges transférées, ou de compensation des créations de charges nouvelles. Comme l'a confirmé la loi organique relative à l'autonomie financière votée peu après, elle ne garantit en rien l'autonomie fiscale des collectivités, dont les ressources propres incluent des transferts de produits d'impôts sans possibilité de vote des taux. 4/ La réponse aux besoins exprimés par les citoyens ne peut être perçue comme une faiblesse de la part des élus locaux. Elle est la réponse à une demande politique et sociale bien souvent avivée par le désengagement de l'État. Le gouvernement ne peut prétendre se désengager des politiques sans que cela n'ait d'effet sur les choix politiques locaux. Les collectivités locales se voient bien souvent contraintes, politiquement au sens fort du terme, de prendre le relais d'un Etat qui se désengage. Plus largement, l'analyse du rapporteur trahit une conception négative de l'action publique, incapable notamment de reconnaître le rôle du service public, et qui vise le « toujours moins ». 5/ La possibilité de choix politique en matière de dépenses est une composante essentielle de la libre administration des collectivités, principe constitutionnel pour lequel la majorité n'a qu'un respect relatif. 6/ La théorie du cycle électoral peut éclairer certains choix, à la condition de ne pas être tronquée et sollicitée de manière abusivement partisane. Le Rapporteur ne retient qu'une chose de cette théorie : les augmentations de fiscalité auraient lieu en début de mandat. Toute aussi essentielle est pourtant la constatation d'un refus de solliciter cette fiscalité en fin de mandat, alors que les engagements non financés augmentent massivement. C'est pourtant le comportement qu'ont eu bon nombre d'exécutifs locaux dirigés par la droite en 2003 et 2004, comme le confirme la Cour des Comptes. Ce choix a contribué à fragiliser la situation financière des collectivités locales. 7/ L'héritage est lourd dans certaines collectivités L'héritage est d'abord politique. En particulier, les collectivités gérées par une coalition droite-extrême droite ont fondé leurs choix fiscaux sur la volonté d'une baisse ou d'une stagnation de la fiscalité, au mépris d'une gestion saine et de la réponse aux besoins réels. Ces choix idéologique ont d'ailleurs conduit à une compensation structurellement défavorable lors de la suppression de certaines impositions locales. Parallèlement, l'« héritage » doit être compris dans sa dimension territoriale : la diversité de situations économiques et sociales dont héritent les exécutifs explique les choix variables des collectivités. Cette diversité est d'ailleurs le meilleur démenti à la théorie d'une politique concertée de hausse de la fiscalité à des fins d'affichage politique, qui a pu être avancée par la majorité. 8/ La stratégie financière des collectivités évite la hausse de l'endettement La focalisation obsessionnelle du rapporteur et de la majorité sur la question des hausses de taux des impositions locales les conduit quasiment à reprocher aux collectivités leurs choix mesurés en matière d'endettement. L'explosion de la dette publique depuis 2002 - +8 points pour atteindre près de 65 % - devrait pourtant inspirer plus de prudence et d'humilité à la majorité en la matière. 9/ Les travaux de la Commission ont largement souligné les insuffisances de la loi du 13 août 2004 relative aux responsabilités locales. Il est piquant à cet égard de noter que le Rapporteur cite parmi les causes d'augmentation des impôts locaux aussi bien une « irresponsabilité du système », que l'empilement des niveaux de décisions, auxquels la loi n'a apporté aucune réponse malgré les suggestions faites notamment par les députés socialistes, ou encore les régimes d'édiction des normes, qui n'ont pas été réformés. Critiques de quelques propositions du Rapporteur · Le processus de décentralisation aurait pu être rendu plus confiant si l'État avait accédé à la demande simple formulée notamment par les exécutifs régionaux d'un audit sur les compétences transférées. Les travaux de la Commission et les propositions du Rapporteur prouvent à quel point cette demande était légitime. Sous la précédente législature, le gouvernement avait accepté cette démarche concernant le transfert des transports ferroviaires aux régions, ce qui a assuré, comme l'a souligné le président du Conseil régional d'Alsace, la qualité du dialogue entre l'État et les collectivités. Les gouvernements actuels ont refusé cet audit, ce qui n'a pu qu'accentuer la défiance des exécutifs locaux. · La volonté de renforcer le contrôle démocratique de l'activité des EPCI est une préoccupation constante des députés socialistes, qui ont de longue date défendu le principe d'une désignation de leurs exécutifs au suffrage universel direct. Tel n'est pas le souci du Rapporteur, qui propose au contraire de renforcer les contrôles bureaucratiques sur l'intercommunalité. · Les propositions en matière de taxe professionnelle illustrent une volonté de remise en cause de l'autonomie financière des collectivités territoriales qui ne peut être acceptée. Les députés socialistes membres de la Commission d'enquête ne peuvent une nouvelle fois que regretter la gestion catastrophique du projet de réforme de cet impôt par la majorité. Le refus de prendre en compte les propositions de réforme portées par le groupe socialiste, quelques jours à peine avant une annonce du Président de la République faite sans aucune concertation préalable, symbolise l'impréparation et le désordre qui ont présidé à ce projet. Après deux années de valse-hésitation, la mise en place d'une commission dont les conclusions semblent vouées à être délibérément ignorées, et le financement pour près de 1,5 milliard d'euros par an d'un allégement temporaire, il semble que le gouvernement et la majorité souhaitent s'inspirer de la proposition de réforme formulée dès 2003 par le groupe socialiste. Si cette proposition paraît appelée à constituer le socle de la réforme, les suggestions du Rapporteur consistant à encadrer très fortement l'autonomie des collectivités dans la fixation des taux, auxquelles le gouvernement semble sensible, sont inacceptables. Elle représente de plus une menace directe pour l'avenir de l'intercommunalité, dont la taxe professionnelle représente la principale ressource. · Les propositions d'introduction d'un « déflateur » d'impôt ou de fixation de taux plafond de subvention illustrent la volonté de remise en cause de l'autonomie des collectivités qui inspire la majorité, en opposition avec les principes même de la décentralisation. · Est également inacceptable, et sans aucun lien avec les travaux menés par la Commission, la proposition générale de substitution de l'usager au contribuable formulée par le rapporteur. Cette proposition est, à l'image du rapport, fondée sur une conception profondément partisane, hostile à l'action publique et à la volonté de solidarité, de redistribution et de péréquation. · Il est surprenant de constater que le Rapporteur n'émet aucune proposition en matière de réforme des impositions locales destinées à les rendre moins injustes. Aucune proposition ne vise à mieux proportionner ces impositions aux capacités contributives, et notamment au revenu des ménages. La seule préoccupation du rapporteur en matière de contribuable local, est d'assurer la baisse de la charge des collectivités, et la diminution globale des impositions, quels que soient les moyens et quel que soit l'effet d'un report de charge sur les « usagers », naturellement défavorable aux plus modestes d'entre eux. · Enfin, l'absence de toute proposition en matière de péréquation, sinon pour demander la diminution des taux de la cotisation de péréquation de la taxe professionnelle, doit être dénoncée. Les travaux de la Commission, et notamment les auditions des experts et consultants, ont démontré la diversité des situations financières « initiales » des collectivités, qui contraignent certaines collectivités « pauvres » à des efforts fiscaux démesurés en regard de ceux consentis par des collectivités mieux dotées, alors que leurs moyens d'action réels s'avèrent au final inversement proportionnels à leur effort fiscal. EXPLICATIONS DE VOTE DU GROUPE U.D.F. (*) La Commission d'enquête sur l'évolution de la fiscalité locale a permis un large échange entre tous les courants politiques sur les causes de la hausse de la dépense publique locale et de la pression fiscale locale. Tout d'abord, il convient de rappeler que la hausse de la dépense publique locale jusqu'en 2005 n'est pas liée à la décentralisation initiée par le Gouvernement Raffarin mais elle est partiellement liée à des mesures de décentralisation engagées par le Gouvernement Jospin, par exemple en matière d'APA, dont les coûts n'ont pas été couverts à due concurrence par des recettes nouvelles (4 milliards d'euros de coûts, 1,35 milliard d'euros de recettes). Cependant, les futurs transferts en matière de voirie nationale ou de politiques menées par l'État en faveur des personnes handicapées ou des SDIS vont contribuer à la hausse des dépenses. En deuxième lieu, l'UDF rappelle son attachement à l'autonomie fiscale et pas seulement financière des collectivités locales, car elle pense qu'une démocratie locale ne peut fonctionner que dans le respect du principe de responsabilité des élus devant leurs électeurs et que si l'assiette de l'impôt local est locale, et son taux fixé librement par l'exécutif local dans le cadre de règles fixées par la loi. Plus généralement, l'UDF regrette que l'on oublie trop facilement que dans une démocratie, ce sont les électeurs qui, in fine, jugent de l'adéquation entre le niveau des services publics et le niveau de la pression fiscale. Or, trop de mécanismes financiers initiés par l'État favorisent les collectivités dépensières au détriment de celles qui ont fait le choix de la modération de la dépense et de la pression fiscale. EXPLICATIONS DE VOTE DU GROUPE DES DÉPUTÉ-E-S Fait qui n'est pas habituel, le Groupe des député-e-s communistes et républicains s'est opposé dès le départ à la création de la présente Commission d'enquête. L'exposé des motifs présidant à sa création ne posait en effet pas le problème de manière saine et objective. Le débat s'est ouvert dans un climat de très vive polémique politique relative à l'augmentation de la fiscalité régionale peu propice à offrir des garanties d'objectivité. Nous avons souligné que la volonté de créer cette Commission était portée par le souci de détourner l'attention de nos concitoyens des problèmes et des difficultés attachés au désengagement de l'État vis-à-vis des collectivités et d'opérer une forme de « règlement de compte politique » après le basculement à gauche de la plupart des exécutifs régionaux. La lecture de ce rapport conforte cette appréciation. La première partie du texte, où est évoqué « le film des évènements », est une mise en scène en forme de réquisitoire qui réduit les enjeux de fiscalité locale au seul problème des régions. Le caractère réducteur du propos traduit un évident parti pris. Si l'on voulait évoquer des augmentations vraiment « explosives » de fiscalité et taxes locales, il eut été urgent et sans doute préférable de se pencher d'abord sur la question de l'augmentation de la TEOM ou encore du prix de l'eau, dont l'augmentation, dans un certain nombre de collectivités, vise parfois, nous le savons, à éponger une partie de la dette abyssale du groupe Vivendi. Toute cette mise en scène, où l'on ne retrouve que partiellement la teneur d'un certain nombre d'auditions, est précédée d'un avertissement signé du Rapporteur qui s'apparente à une déclaration politicienne et emploie un ton et des formules particulièrement choquantes à l'endroit des élus locaux. Des propos dont il faut souligner qui n'ont pas leur place dans un tel texte. C'est ainsi que le Rapporteur multiplie les accusations inadmissibles et graves à l'égard des élus (« on décide d'autant plus volontiers que d'autres paient »), les jugements sans nuances (« La France sur-administrée et sous-organisée »), les prises de position partisanes (« Jean-Pierre Raffarin a eu raison de relancer le mouvement de décentralisation »), les termes connotés (« dérives » ; « explosion ») et les procès d'intention (« L'augmentation de la fiscalité régionale en 2005 : l'argument ne pourrait-il servir à nouveau en 2006 pour la fiscalité départementale ?»). Les questions essentielles sont en revanche laissées de côté. Celle de savoir si les collectivités disposent effectivement des moyens financiers de faire face à leurs compétences et de répondre aux besoins et aux attentes de nos concitoyens. Celle encore des conséquences subies par les élus locaux du désengagement sans cesse croissant de l'État, qui s'est encore considérablement accru sur la dernière période. En 2002, le Gouvernement a clamé haut et fort sa volonté que l'État se recentre sur ses fonctions régaliennes et accorde donc la priorité à la Défense, la Police et la Justice. Ce choix a évidemment eu pour conséquence de reléguer au second plan d'autres missions. Beaucoup ont été décentralisées. De fait, un double transfert s'est opéré : l'un dans le cadre de la loi de décentralisation, qui pose la question du transfert des ressources correspondantes, l'autre, plus sournois, attaché à la diminution de dépenses utiles de l'État qui oblige souvent les collectivités à prendre le relais. C'est le cas notamment dans le domaine social, des services publics, des emplois aidés, des transports, etc. Si l'on souhaitait donc faire preuve de sérieux dans l'évaluation des enjeux de la fiscalité locale, il y aurait quatre points à prendre en compte. D'abord, s'interroger sur les choix politiques et financiers de l'État, qui ont une incidence très directe sur les finances de collectivités locales. Lorsque la fiscalité dérogatoire instituée par le Gouvernement prive l'État de 20% de ses recettes, cela pose inéluctablement un problème budgétaire qui ne peut pas ne pas avoir de répercussions locales. Satisfaire ensuite les attentes légitimes des élus locaux à disposer de recettes pérennes suffisantes garantissant une véritable autonomie de gestion et de décision. Poser l'exigence d'une répartition plus équitable des recettes, en tenant compte dans la détermination de l'impôt de la richesse effective, des revenus réels et de la création locale de richesses. Garantir enfin une plus grande transparence des choix opérés en matière fiscale, en associant davantage nos concitoyens au processus de décision en amont, car depuis plusieurs années, le grand absent du débat est bien le citoyen. Il serait temps de changer la donne. C'est à ce chantier que travaillent aujourd'hui les députés communistes en proposant une réforme d'ensemble des finances locales, s'attachant en premier lieu à moderniser la taxe professionnelle. L'exigence première est en effet d'élargir l'assiette de cet impôt et de prévoir dans ce cadre une taxation des actifs financiers des entreprises. Il est également indispensable de renforcer le rôle péréquateur de la dotation globale de fonctionnement, principal outil redistributif entre collectivités. Les députés communistes se veulent en outre porteurs d'exigences immédiates, largement en phase sur de nombreux points avec les demandes de la majorité des associations d'élus comme l'Association des Maires de France, l'Association des Régions de France, l'Association des Départements de France, etc. Nous jugeons ainsi indispensable de suspendre les transferts de charges liés à la loi de décentralisation et à procéder à leur évaluation, y compris relativement à leur pertinence, notamment afin de parvenir à une remise à niveau des dotations de l'État correspondant réellement aux charges transférées. Nous insistons en outre sur la nécessité de régulariser la DGF de 2004, y compris pour les communes et leurs groupements, en prenant en compte 100 % de la croissance du PIB et non seulement 50 % ou moins comme ce fut le cas les années précédentes. Dans le même esprit, nous croyons utile de prévoir le remboursement intégral de la TVA sur les investissements des collectivités et sur certaines dépenses de fonctionnement comme pour la réduction des taux d'emprunts et l'allègement des annuités sur certaines opérations ciblées. Nous nous prononçons en outre bien évidemment pour le maintien d'une taxe professionnelle attachée aux territoires calculée sur la valeur ajoutée et la valeur locative foncière, pour l'élargissement de son assiette, en intégrant un mécanisme de taxation des revenus financiers à hauteur de 0.5 %, et, d'une manière plus générale, pour une refonte globale de la fiscalité locale visant en particulier à garantir une répartition plus équitable de l'impôt entre l'ensemble des contribuables. Le groupe des députés communistes et républicains de l'Assemblée nationale a voté contre le rapport de M. Hervé Mariton, député UMP, car il est partiel et partial et qu'il débouche sur des propositions dont certaines sont contradictoires avec l'esprit même des lois de décentralisation. Ainsi lorsqu'il est proposé un « pilotage global » des finances des collectivités locales avec l'instauration de « Conférences nationales » pour organiser ce qu'il faut bien appeler une tutelle. Résolument attachés à l'autonomie de gestion des collectivités locales, il nous parait utile de rappeler donc pour finir que le seul juge des politiques fiscales des collectivités reste d'abord le citoyen et qu'il dispose pour l'éclairer des instruments d'évaluation pertinents que sont les Chambres régionales des comptes. * * * ____________________ N° 2436 - Rapport sur l'évolution de la fiscalité locale (Hervé Mariton) 52 Yann Le Meur, « La fiscalité mixte », Pouvoirs locaux, n° 64 I/2005. 53 Organisme composé des ministres fédéraux des Finances et du Commerce et du Travail, des ministres des Finances des Länder et des représentants des autorités locales. 54 « Il est créé un conseil national des politiques publiques locales. « Le conseil est composé de représentants des collectivités territoriales et de parlementaires, élus par leurs pairs, de représentants du Gouvernement et de personnalités qualifiées, dans des conditions définies par décret. Les représentants élus sont majoritaires au sein du conseil. Il est présidé par un élu désigné en son sein par le conseil. « Le conseil peut être saisi par les collectivités territoriales. Il peut également être saisi de demandes d'évaluation par le Gouvernement, l'Assemblée nationale ou le Sénat. « Les moyens nécessaires au fonctionnement du conseil et à la réalisation des évaluations sont financés par un prélèvement sur la dotation globale de fonctionnement, après avis du comité des finances locales. » 55 Publiée au Bulletin officiel de l'éducation nationale n°4 du 7 février 2002. (*) MM. Jean-Pierre Balligand, Augustin Bonrepaux, Pierre Bourguignon, Mme Claude Darciaux, MM. Bernard Derosier, René Dosière, Jean-Yves Le Drian, Pascal Terrasse. 56 En plus des questions visant les contrats de plan État-régions, on citera pêle-mêle la question de Dominique Richard, député UMP de Maine-et-Loire, dénonçant une hausse des impôts décidée « rue de Solférino », celle de Louis Giscard d'Estaing, député UMP du Puy-de-Dôme, dénonçant l'augmentation des impôts dans la région Auvergne, celle de Josiane Boyce, député UMP du Morbihan, à propos des choix fiscaux de la région Bretagne, celle de Jean Bardet, député UMP du Val d'Oise, (à propos de ?) et de Jean-Pierre Soisson, député UMP de l'Yonne, à propos de la Bourgogne. Dès la fin de l'année 2004, Pierre Méhaignerie, député de l'Ille-et-Vilaine, Michel Hunault, député UDF de Loire-Atlantique, et Christian Estrosi, député UMP des Alpes-Maritimes, avaient lancé une offensive préventive sur cette question.
57 Alain Rousset, Président de l'ARF « Il est d'ailleurs piquant de constater que l'État demande aux régions d'intervenir dans ses compétences propres. S'agissant des TGV, il leur demande par exemple de financer non seulement les études mais aussi les travaux. Il leur demande en outre de consentir aux autres collectivités territoriales les avances des crédits d'études et des crédits d'investissement. Il demande même à l'Aquitaine d'avancer les crédits européens, pour plusieurs millions d'euros. Sans cela, les dossiers ne progressent pas. Je crois que cela pose un problème de responsabilité. » 58 J-P Huchon « Je peux vous donner le détail projet par projet, tramway par tramway, échangeur par échangeur. Au niveau du contrat de plan routier, le désengagement de l'État porte sur 48 millions d'euros. Le préfet le reconnaît parfaitement. Il est venu devant nos commissions pour l'expliquer. Pour les transports collectifs, il y en a pour 252 millions d'euros. Le ministère des Solidarités s'est également retiré totalement d'un certain nombre d'actions, notamment celles concernant la lutte contre la toxicomanie : 20 millions d'euros. Le tourisme : 300.000 euros. L'environnement : 4,16 millions d'euros. En matière de formation, les stages d'insertion et de formation (SIF) et les stages d'accès à l'entreprise (SAE) sont immédiatement mis à la charge de la région Ile-de-France : 60 millions d'euros ». 59 Rapport d'information sur l'exécution des contrats de plan État-Régions et la consommation des crédits. 60 Selon les mots du Rapporteur :« Il ne s'agit pas d'une dépense obligatoire, et il est loisible aux départements d'organiser leur politique d'insertion comme ils l'entendent. Les conseil généraux sont en effet libres de recourir à leurs propres moyens, aux services de l'ANPE ou de tout autre opérateur de leur choix ». 61 1ère partie, p 72 « Dans la mesure où certains départements ont tendance à le considérer comme un dû, il importe de bien rappeler le caractère exceptionnel de cet engagement supplémentaire qui intervient en dehors de toute obligation légale ou constitutionnelle ». 62 Rapport préliminaire sur l'exécution des lois de finances pour l'année 2004, page 25 : « Les postes de dépenses qui croissent le plus vite sont les prestations et autres transferts (+16,6%), à cause du transfert aux départements de la charge du venu minimum d'insertion (5,4 Mds d'euros) et des subventions versées (11,6 Mds d'euros) notamment à la SNCF au titre de la régionalisation du transport ferroviaire de voyageurs et à la RATP au titre des transports en Ile-de-France. Les dépenses de fonctionnement, faute d'une norme d'évolution en volume, et les dépenses d'investissement augmentent également, respectivement, de près de 6% et de 7%, dans le prolongement de la tendance de l'année 2003 (+7%). Ces hausses n'ont pas été répercutées sur les taux d'imposition, les impôts locaux et les transferts courants entre administrations publiques progressant deux fois moins vite que les prestations et autres transferts ». 63 A. Rousset « Vous me demandez de chiffrer l'inquiétude. Cette inquiétude porte d'abord, cette année, sur le financement de la formation des personnels médicaux et paramédicaux. Je suis incapable, parce que les hôpitaux sont incapables de me le communiquer, de vous dire quel est le coût exact de la formation des infirmières. Je sais, en revanche, que l'augmentation des besoins en aides soignants, infirmières et personnels paramédicaux est impressionnante, et que l'État annonce que la compensation qu'il versera sera calculée sur la base de la moyenne des trois dernières années. Ce sera donc un cap assez difficile à passer. »
64 Rapport J-P. Fourcade concernant les vœux émis par les élus : « que la compensation dédiée aux départements en contrepartie du transfert des FSL soit basée sur le montant des dépenses exécutées au cours de la seule année 2004 et non sur la moyenne des dépenses de ces trois dernières années comme le prévoit la loi du 13 août 2004 (à l'instar de la méthode de compensation suivie pour la décentralisation du dispositif RMI) ». 65 Rapport J-P. Fourcade concernant les vœux émis par les élus « que soit remise en cause la méthode de calcul du droit à compensation fondée sur une moyenne de trois ans (conduisant à ne compensation définitive de 13,86 M€), dans la mesure où les dépenses constatées en 2004 ont fortement diminué. »
66 Rapport, page 66. (*) MM. Charles de Courson et Maurice Leroy. (*) M. Jean-Claude Sandrier. © Assemblée nationale |