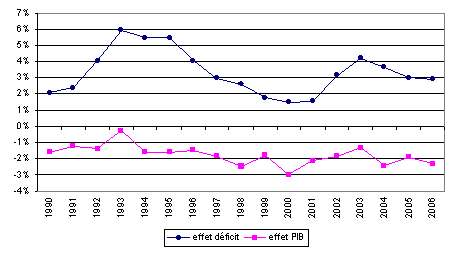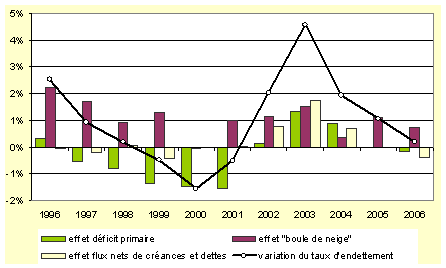Document mis en distribution le 13 février 2006 N° 2844 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 DOUZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 7 février 2006. RAPPORT FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES, DE L'ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU PLAN SUR LA PROPOSITION DE RÉSOLUTION (n° 2721) de MM. Hervé Morin, Charles de Courson et François Sauvadet et les membres du groupe UDF et apparentés, tendant à la création d'une commission d'enquête sur l'état réel des finances publiques de la France, PAR M. GILLES CARREZ Rapporteur général, Député -- Mesdames, Messieurs, Votre Commission des finances, de l'économie générale et du plan a été saisie d'une proposition de résolution n° 2721 présentée par MM. Hervé Morin, Charles de Courson et les membres du groupe UDF et apparentés, tendant à la création d'une commission d'enquête « sur l'état réel des finances publiques de la France ». Aux termes de l'article unique de la proposition, cette commission d'enquête aurait pour objet d' « évaluer le montant réel de la dette publique française, [d'] identifier les causes de cette situation et [de] définir les moyens aptes à résorber la dette publique de la France ». La recevabilité juridique de cette proposition de résolution ne fait pas difficulté. Deux conditions résultent des dispositions combinées de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires et des articles 140 et 141 du Règlement de l'Assemblée nationale. D'une part, la proposition doit déterminer avec précision soit les faits qui donnent lieu à enquête, soit les services publics ou les entreprises nationales dont la commission doit examiner la gestion. Quoique l'objet de la présente proposition soit vaste, on peut assez aisément considérer que la situation de nos finances publiques et, en particulier, de la dette publique constituent des « faits déterminés » au sens de l'ordonnance du 17 novembre 1958. D'autre part, les faits ayant motivé le dépôt de la proposition de résolution ne doivent pas faire l'objet de poursuites judiciaires. Par un courrier du 4 janvier 2006, le Garde des Sceaux a indiqué au Président de l'Assemblée nationale qu'aucune procédure n'est en cours sur les faits ayant motivé le dépôt de la proposition. En revanche, c'est sur le fond que la demande de création d'une commission d'enquête ne convainc guère. Non que les objectifs avancés par ses auteurs soient illégitimes : le Parlement doit effectivement être en mesure d'appréhender avec précision le niveau de la dette publique et les facteurs d'aggravation de l'endettement afin de pouvoir prendre, en toute connaissance de cause, les mesures d'assainissement adéquates. Force est cependant de constater que ces éléments sont aujourd'hui bien connus. Qu'elles émanent du ministère des finances, des deux assemblées parlementaires, de la Cour des comptes, de rapports remis au Gouvernement ou de travaux universitaires, les sources disponibles en la matière évoquent moins le vide que le trop-plein. La Conférence nationale des finances publiques tenue le 11 janvier dernier a, en outre, permis un état des lieux public et transparent. On voit mal, dès lors, l'intérêt que présenterait un rapport d'« enquête » confirmant un diagnostic déjà établi et prescrivant des remèdes par trop prévisibles. Selon les auteurs de la proposition de résolution, « trois questions méritent (...) d'être posées. Quelle est la vérité sur l'état des finances publiques de la France ? Pourquoi en est-on arrivé là ? Que faut-il faire pour rompre avec cette situation ? ». Ces trois questions peuvent trouver réponses sans nécessiter la réunion d'une commission d'enquête. I.- « QUELLE EST LA VÉRITÉ SUR L'ÉTAT DES FINANCES PUBLIQUES « Dire la vérité aux Français est notre premier devoir » écrivent à juste titre les auteurs de la proposition de résolution. Dans le domaine budgétaire et financier, le Gouvernement et le Parlement remplissent ce devoir chaque année lors de la discussion du projet de loi de finances et du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Pour 2006, et comme les année précédentes, le Conseil constitutionnel n'a d'ailleurs relevé aucun « défaut de sincérité » de la loi de financement de la sécurité sociale et de la loi de finances (décisions 2005-528 DC et 2005-530 DC des 15 et 29 décembre 2005). L'interrogation centrale de la proposition de résolution porte sur le niveau de la dette publique. Or, les chiffres sur ce sujet sont non seulement disponibles et aisément accessibles, mais aussi de plus en plus diffusés et médiatisés. C'est l'une des conséquences de la loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001 (LOLF), qui permet au législateur de se prononcer chaque année sur le tableau de financement de l'État et sur le plafond de variation nette de la dette négociable lors de l'examen de l'article d'équilibre de la loi de finances. C'est aussi l'un des mérites du rapport relatif à la dette publique établi par la commission présidée par M. Michel Pébereau remis en décembre 2005 (1). Au demeurant, la mission confiée à cette commission par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie (« mettre en évidence les conditions dans lesquelles la dette publique actuelle s'est constituée » ; « définir les orientations et les mesures nécessaires pour assurer le redressement de nos finances publiques et réduire leurs charges pour le futur » ; « proposer toutes mesures de nature à dégager des marges de manoeuvre nouvelles en appui des réformes que doit mettre en œuvre notre pays ») était très proche de celle qui serait assignée à la commission d'enquête dont la création est proposée. Qu'il s'agisse de la mesure de la dette publique ou du dynamisme de son évolution, les informations existantes ne manquent donc pas. Les chiffres officiels et définitifs les plus récents relatifs à la dette publique concernent l'année 2004. Le tableau ci-dessous les rappelle. LA DETTE PUBLIQUE EN 2004
Pour 2005 et 2006, les données issues des documents budgétaires associés au projet de loi de finances pour 2006 prévoient : - un ratio d'endettement public de 65,8% du PIB en 2005, soit environ 1.117 milliards d'euros ; - un ratio d'endettement public de 66% du PIB en 2006, soit environ 1.162 milliards d'euros. ENDETTEMENT PUBLIC 2004-2006
Sources : Rapport économique, social et financier joint au projet de loi de finances pour 2006 (tome 1) Ces éléments sont publics depuis le mois de septembre dernier. Ils avaient notamment été présentés dans le Rapport général sur le projet de loi de finances pour 2006, dont votre Rapporteur général se permet de reproduire un extrait ci-dessous :
Source : Gilles Carrez, Rapport général sur le projet de loi de finances pour 2006, n° 2568, octobre 2005, Tome 1 : « Exposé général », p. 64-66. Afin de faciliter l'appréhension des chiffres relatifs à l'endettement, plusieurs ratios à vocation pédagogique ont été avancés ces derniers mois. Ainsi, une dette publique de 1.100 milliards d'euros représente environ : - 17.700 euros par habitant ; - 32.000 euros par foyer fiscal ; - 40.000 euros par actif ; - 41.000 euros par ménage. En dépit de tous ces éléments, les auteurs de la proposition de résolution estiment que « ces chiffres ne représentent qu'une partie de la dette réelle » (qui serait « de l'ordre de 2.000 milliards d'euros »), accréditant ainsi l'idée d'une « dette cachée » que la commission d'enquête serait chargée de révéler aux Français. Une telle approche, qui entend inclure dans la dette certains engagements relatifs aux pensions des agents publics, est sans doute le résultat d'une lecture insuffisamment rigoureuse du rapport Pébereau précité. En dépit de certains commentaires trop rapides parus dans la presse à la fin de l'année dernière, le rapport Pébereau n'a révélé aucune dette cachée. Au contraire, il a clairement indiqué (s'il en était besoin) que « la France applique avec exactitude les règles comptables européennes applicables au secteur public, qui sont moins exigeantes que celles qui s'imposent au secteur privé » (2). En revanche - mais c'est une question différente - le rapport Pébereau a rappelé à juste titre que la seule notion de dette publique ne rend pas compte de l'état de nos finances publiques dans son ensemble : « le niveau de la dette financière des administrations publiques n'est qu'un élément dans l'appréciation de la situation des finances publiques » (3). D'une part, il importe également de tenir compte des organismes qui, un jour, pourraient être intégrés dans le champ des administrations publiques (cas, par exemple, de l'Entreprise minière et chimique en 2005) ou de ceux dont la dette pourrait être reprise - partiellement ou en totalité - par l'État (cas, par exemple, de la Caisse centrale de la Mutualité sociale agricole en 2005). La commission Pébereau a estimé que ces dettes, à la fois éventuelles et futures, représentaient entre 15 et 20 milliards d'euros. D'autre part, une juste appréciation de notre situation financière nécessite aussi de prendre en compte les engagements dits « hors bilan » de l'État, au premier rang desquels figurent les dépenses de retraites de ses agents (4). Le rapport expose deux méthodes de calcul de ces engagements, reproduites dans l'encadré ci-dessous.
Source : Commission présidée par M. Michel Pébereau, Rompre avec la facilité de la dette publique. Pour des finances publiques au service de notre croissance économique et de notre cohésion sociale, Les engagements hors bilan sont parfois assimilés à une « dette implicite ». Mais, en toute rigueur, il s'agit moins de dettes - s'il en avait la capacité financière, l'État serait d'ailleurs bien en peine de les « rembourser » - que de dépenses futures. À la différence d'autres dépenses à venir, ces engagements sont « certains au plan juridique, mais leur montant et leur date de dénouement sont déterminés par une série de paramètres exogènes » (5). Il est bien entendu indispensable de les évaluer aussi précisément que possible afin d'avoir une vision juste des finances publiques (ne serait-ce que parce que cet élément peut jouer dans la détermination par les prêteurs de la « prime de risque » qu'ils exigent de l'État emprunteur). La LOLF contribue d'ailleurs à une meilleure prise en compte de ces éléments, puisque le projet de loi de règlement du budget de 2006 devra être accompagné du Compte général de l'État, « successeur » du Compte général de l'administration des finances qui comportera une évaluation des engagements hors bilan. LES ENGAGEMENTS « HORS BILAN » DE L'ÉTAT L'information financière sur les comptes de l'État ne comprend pas, aujourd'hui, un document recensant les engagements dits « hors bilan », c'est-à-dire les informations qui, en comptabilité générale, sont jugées suffisamment significatives pour compléter et commenter celles données par le bilan et le compte de résultat. Le rapport de présentation du Compte général de l'administration des finances (CGAF) de l'année 2004 présente ces engagements en fonction des futures normes comptables qui entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2006 en application de la LOLF. Ces engagements sont certains au plan juridique, mais leur montant et leur date de dénouement sont déterminés par une série de paramètres exogènes. Deux catégories, destinées à s'enrichir dans la perspective du bilan d'ouverture, peuvent être distinguées : 1. Les engagements pris dans le cadre d'accords bien définis. Ces engagements couvrent trois catégories : a) La dette garantie, au sens de la loi du 23 décembre 1946. Elle regroupe les engagements de sociétés françaises, entreprises nationales, collectivités, établissements publics, organismes bancaires qui bénéficient de la garantie de l'État, c'est-à-dire ceux pour lesquels l'État s'est engagé, dans l'hypothèse d'une éventuelle défaillance du débiteur, à effectuer lui-même le règlement des intérêts ou le remboursement des échéances d'amortissement périodiques, prévues au contrat de prêt ou d'emprunt, ou encore à assurer les charges afférentes à un rééchelonnement de la dette (voire, dans certains cas très particuliers, une annulation). Son encours diminue fortement depuis dix ans, s'établissant à 24,8 milliards d'euros fin 2004 (dont 0,8 milliard d'euros en devises), à comparer aux 165 milliards d'euros de la fin 1990. b) Les garanties accordées par l'État à des établissements publics financiers ou à des opérateurs (publics ou privés) chargés pour son compte de missions d'intérêt général. Il s'agit principalement de l'engagement de l'État d'équilibrer les comptes de la Caisse Centrale de Réassurance (CCR), du compte « État » ouvert à la COFACE et des procédures de couvertures de risques par Natexis en faveur des exportations françaises. c) Les garanties de passif accordées dans le cadre d'opérations de cession ou de restructurations d'entreprises (pour l'essentiel publiques) ou de la protection de l'épargne. 2. Les engagements de retraite des fonctionnaires et agents publics relevant de régimes spéciaux. Les retraites des fonctionnaires et agents publics relevant de régimes spéciaux constituent une charge du budget général qui est compensée en partie par les contributions des agents (système de la retenue pour pension) et par des contributions « employeur ». Les droits à pension constituent une dette implicite. Les engagements au titre des retraites des fonctionnaires de l'État sont évalués à environ 890 milliards d'euros, soit environ 55% du PIB. Ce montant correspond, pour un taux d'actualisation de 2,5%, à la moyenne de deux scénarios différents quant au rythme des changements de comportements induits par la réforme du 21 août 2003. Source : Rapport de présentation du Compte général de l'administration des finances 2004, p. 33-37 et 119-124 (extraits). Pour autant, ces engagements ne constituent pas une dette que l'État devrait inscrire à son bilan. C'est à tort que l'exposé des motifs de la présente proposition indique que « selon les normes comptables internationales qui imposent de comptabiliser tous les engagements figurant en hors bilan, la France serait (...) endettée de plus de 2.000 milliards d'euros. La dette publique s'élèverait alors à 120% du PIB et non plus à 66% du PIB ». Le rapport Pébereau rappelle d'ailleurs que les normes comptables internationales (International financial reporting standards) ne prévoient la comptabilisation de ces engagements dans le bilan que pour les seules entreprises du secteur privé. À moins que ces normes soient modifiées à l'avenir, la France n'a donc pas de raison de retenir une approche plus contraignante, qui n'est pas partagée par les autres émetteurs souverains (6) et qui pourrait dès lors dégrader la qualité de sa signature. Il n'y a donc ni dette cachée, ni dette « réelle » à découvrir. Le montant de la dette publique étant en soi assez considérable, on voit mal l'intérêt qu'il y aurait à le « gonfler » artificiellement, au risque de l'alarmisme et au détriment de la rigueur des concepts. En outre, que l'on se saisisse du problème de nos finances publiques sous l'angle du déficit, de la dette ou des engagements hors bilan, l'agrégat retenu importe finalement beaucoup moins que les remèdes aptes à redresser la situation (cf. infra, III). II.- « POURQUOI EN EST-ON ARRIVÉ LÀ ? » La dette publique frappe au moins autant par son ampleur que par la rapidité de son aggravation. Les vingt-cinq dernières années ont en effet été les témoins d'une véritable « explosion » de l'endettement public. Augmentant de 6% par an en volume entre 1980 et 2004, le poids de la dette a triplé, passant de 21% à 64,7% du PIB. ÉVOLUTION DE LA DETTE PUBLIQUE (1978-2006) 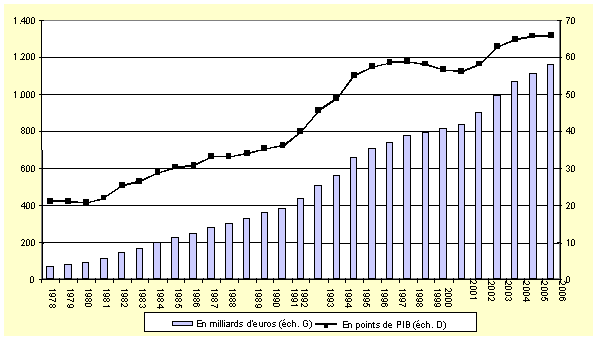 Sources : INSEE, Comptes nationaux (base 2000) et Rapport économique, social et financier joint Le graphique ci-dessus, qui présente cette évolution, met en évidence les deux grandes phases d'augmentation de la dette, entre 1981 et 1985 (de 21 à 30% du PIB) et entre 1991 et 1996 (de 36% à 58% du PIB). Dans ce contexte, après avoir longtemps été l'élève modèle de l'Europe, notre pays occupe désormais un rang peu enviable au palmarès de la vertu budgétaire : la dette publique française se situe à la cinquième plus mauvaise place de l'Union européenne, très proche de l'Allemagne (66,4% du PIB) mais encore loin derrière la Belgique (96%), l'Italie (106%) et la Grèce (110,5%). Cette comparaison est cependant trompeuse : la brusque croissance de l'endettement français ne correspond en effet pas à un choc économique comparable à la réunification allemande ; de même, elle contraste sensiblement avec les efforts d'assainissement budgétaire consentis par les États en queue de peloton (la Belgique et l'Italie ayant réussi à réduire leur endettement public de respectivement 38 et 18 points de PIB entre 1995 et 2004). Il n'est guère nécessaire de recourir à de complexes analyses pour identifier les causes de l'emballement de l'endettement public français. L'explication est évidente : depuis 1981, les administrations publiques n'ont jamais été capables de couvrir leurs dépenses par des recettes au moins équivalentes. Elles ont ainsi accusé de manière ininterrompue un besoin de financement se situant au mieux à 1,5% du PIB (en 2000) et, au pire, à 6% (en 1993) du PIB. ÉVOLUTION DES DÉFICITS PUBLICS DEPUIS 1978 (en pourcentage du PIB) 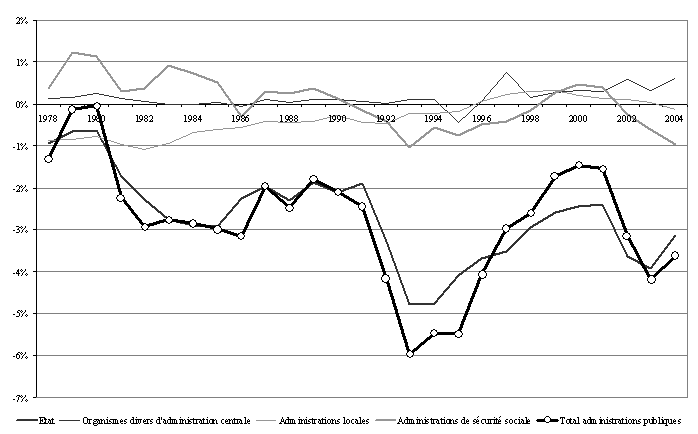 Source : INSEE, Comptes nationaux (base 1995 jusqu'en 1992 puis base 2000). En moyenne sur cette période, le déficit public s'est établi à 3,1% de la richesse nationale. Il n'est d'ailleurs guère indifférent de constater qu'à l'échelle de ce dernier quart de siècle, c'est l'État qui assume l'essentiel de la responsabilité de ces piètres performances, son déficit moyen s'établissant à 2,9% (contre un déficit moyen de 0,3% pour les collectivités territoriales et l'équilibre à long terme des finances sociales). Or, ce niveau de déficit est purement et simplement incompatible avec la maîtrise de nos finances publiques. En effet, la stabilisation de la dette publique à 60% du PIB impose de ne pas dépasser un niveau de déficit public supérieur à 2,3% du PIB (7). Au-delà, le poids de la dette s'accroît mécaniquement, inexorablement, et le service des intérêts grève une part toujours croissante des recettes disponibles. À cet égard, il est frappant de constater combien peu a été fait pour atteindre ce solde stabilisant, seules deux périodes d'exceptionnelle conjoncture économique (1988, 1998, 1999, 2000) permettant de le dépasser. SOLDE STABILISANT LA DETTE DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES ET SOLDE EFFECTIF (en points de PIB) 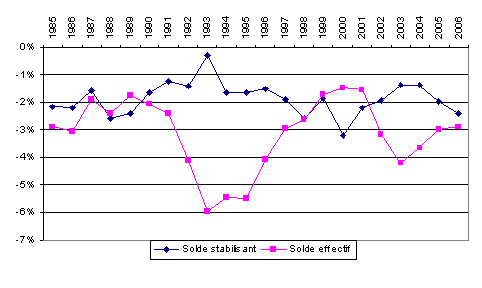 Pour la seule dette de l'État, le graphique ci-dessous - qui tient compte des premiers résultats de l'exécution 2005 (8) - montre que la situation est encore moins favorable : le solde stabilisant n'a été atteint que deux fois (en 1989 et 2000) depuis vingt ans. SOLDE STABILISANT LA DETTE DE L'ÉTAT ET SOLDE EFFECTIF (9) (en milliards d'euros) 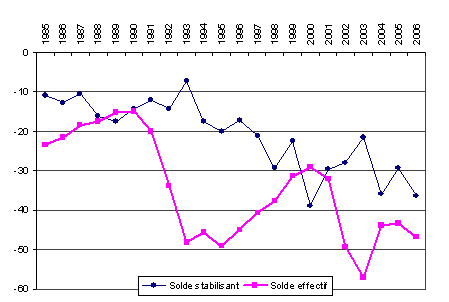 Or, cette situation résulte moins d'un brutal décrochage des ressources publiques (qui ont évolué en moyenne depuis 1981 au rythme substantiel de 2,3% en volume) que du maintien d'un taux d'accroissement des dépenses publiques de 3,1% par an en volume dépassant très largement un taux de croissance potentiel ramené depuis la fin des années 70 à 2/2 ½ % par an. ÉVOLUTION DE LA DÉPENSE PUBLIQUE EN VOLUME DEPUIS 1978 (en pourcentage) 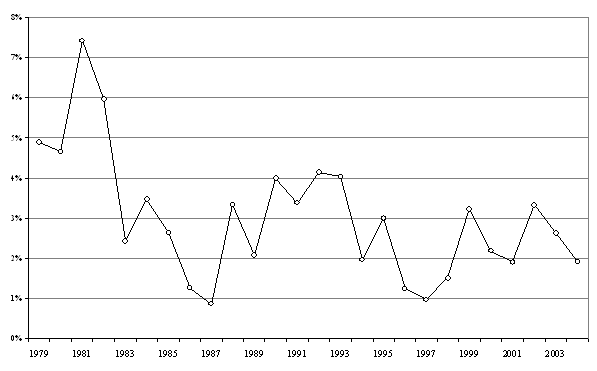 Source : INSEE, Comptes nationaux (base 1995 pour les données jusqu'en 1992 puis base 2000). Il faut d'ailleurs remarquer ici que le niveau des taux d'intérêt, pour avoir incontestablement accéléré le rythme de croissance de la dette publique au début des années 1990, n'a joué durant l'ensemble de la période étudiée qu'un rôle subsidiaire et ambivalent dans la perte de contrôle des finances publiques. Le maintien de taux d'intérêt réels supérieurs à 6% au tournant des années 1990, accroissant les frais financiers des administrations publiques de 77% entre 1989 et 1996, conjugué à une conjoncture économique exceptionnellement défavorable a évidemment joué un rôle décisif dans le quasi-doublement concomitant de la dette publique. Cependant, l'augmentation de la charge d'intérêt, évaluée à 20 milliards d'euros entre ces mêmes années, n'a représenté que 5% des 370 milliards d'euros (en euros courants) d'accroissement de la dette publique. En outre, force est de constater que depuis la fin des années 1990, le niveau des taux d'intérêt réel s'est fortement réduit jusqu'à l'étiage actuel de l'ordre de 2% sans que pour autant la stabilisation des frais financiers des administrations publiques (+ 4,4% entre 2002 et 2004 en euros constants) ne suffise à freiner l'endettement (qui a progressé de 18,5% durant la même période). Face au maintien d'un dynamisme élevé de la dépense publique, il est apparu dès 1984 impossible de relever le niveau des prélèvements obligatoires sans gravement compromettre le potentiel d'innovation, d'initiative et de croissance de l'économie. ÉVOLUTION DES PRÉLÈVEMENTS OBLIGATOIRES DEPUIS 1979 (en pourcentage du PIB) 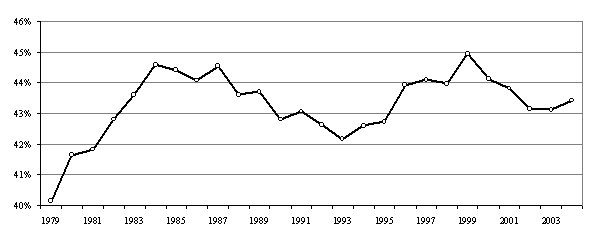 Source : INSEE, Comptes nationaux (base 1995 pour les données jusqu'en 1992 puis base 2000). Ce profond et durable déséquilibre entre les dépenses et les ressources publiques atteint aujourd'hui des proportions insoutenables : dans leur ensemble, les administrations publiques dépensent depuis 10 ans en moyenne 6% de plus que leurs ressources ; pour l'État, ce chiffre dépasse même 18%. TAUX DE COUVERTURE DES DÉPENSES PAR LES RECETTES DE L'ÉTAT 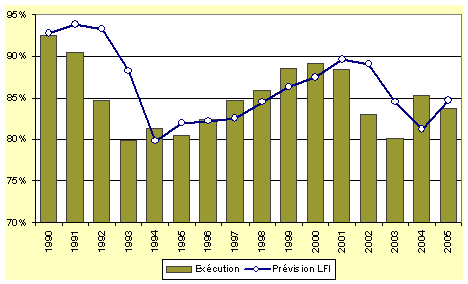 Source : Gilles Carrez, Rapport sur le projet de loi de règlement définitif du budget de 2004, n° 2546, octobre 2005, p. 29 (mis à jour de l'exécution 2005). Les causes de cette véritable préférence collective pour la dépense publique et pour l'endettement ont fait l'objet de très nombreuses analyses dont il n'est guère utile de faire ici la fastidieuse énumération (10). Les facteurs principaux sont largement connus : lourdeurs et incohérences de notre appareil administratif, accoutumance aux transferts sociaux et aux emplois publics ; aisance avec laquelle les administrations peuvent s'endetter, en particulier après l'apparition, grâce à l'euro, d'un marché obligataire très large et extrêmement liquide, situation de départ très favorable en termes d'endettement public qui a permis d'absorber de manière presque indolore, à la différence de nombreux États alors contraints à un ajustement budgétaire brutal, le choc des taux d'intérêt du début des années 1990, etc. Il est cependant une cause essentielle sur laquelle votre Rapporteur général est revenu avec constance : l'absence de réelle prise de conscience de la gravité de l'endettement public et son corollaire, une incapacité - exceptionnelle au niveau européen - à tirer partie des périodes de bonne conjoncture pour réaliser l'effort d'assainissement indispensable lorsqu'il est le plus aisé. Il n'est besoin de rappeler le contraste saisissant qui a opposé sur ce sujet entre 1997 et 2002 la France à tous ses partenaires européens (à l'exception de l'Allemagne). EFFORT DE CONSOLIDATION DE L'ENDETTEMENT PUBLIC (en pourcentage du PIB) 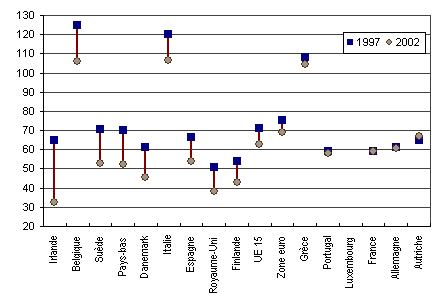 Source : Gilles Carrez, Rapport d'information sur les premiers éléments disponibles concernant l'exécution du budget en 2003, n° 1507, avril 2004. Comme le met en évidence le graphique ci-dessus, entre 1997 et 2002, en dépit d'une croissance économique supérieure à 3% en moyenne, l'endettement public français s'est révélé stable, tandis qu'il diminuait de 8,3 points de PIB dans l'UE à 15 (chiffre qui tend d'ailleurs à sous-estimer, compte tenu du poids conjugué de l'Allemagne et de la France dans les statistiques pondérées, la qualité et l'ampleur de l'assainissement structurel réalisé par les pays vertueux). Votre Rapporteur général a à cet égard mis en évidence à de nombreuses reprises (11) que l'application d'une règle de conduite budgétaire vertueuse mais modérée consistant en, d'une part, la stabilisation en volume des dépenses de l'État et, d'autre part, en l'absence de mise en œuvre de baisses d'impôt non financées par des réductions de crédits équivalentes entre 1997 et 2001 aurait permis d'atteindre l'équilibre du budget de l'État dès 2001, plaçant la dette sur une trajectoire de diminution à long terme. On n'a pas suffisamment profité des circonstances économiques favorables pour se désendetter. Ceci distingue fondamentalement la France des pays de niveau économique comparable, qui tous, à l'exception de l'Italie et du Japon, ont réussi à dégager un excédent budgétaire ces dix dernières années. La France, même en période de très forte croissance, n'a jamais fait mieux ces dernières années qu'un déficit de 1,4 % du PIB. C'est particulièrement vrai durant la deuxième moitié des années 1990 où l'on a à la fois augmenté les dépenses et diminué la part des prélèvements obligatoires dans le PIB plutôt que de profiter des circonstances pour améliorer le solde structurel. La part des prélèvements obligatoires dans le PIB a en effet été réduite entre 1999 et 2001. Si l'on avait profité des circonstances pour rechercher une répartition plus efficace des prélèvements obligatoires sans réduire le produit global des prélèvements, le solde des administrations publiques aurait été amélioré de 1,2 point de PIB en 2000 et de 1,0 point en 2001. En outre, en 2000, les dépenses publiques ont augmenté plus vite que la croissance potentielle, ce qui a aussi contribué à dégrader le solde des administrations publiques. Si ces choix n'avaient pas été faits, la dette n'aurait pas été en 2001 de 56,2 % du PIB mais de 53,6 %. Et si l'on avait voulu stabiliser la dette en montant, il aurait fallu, non seulement ne pas faire ces choix, mais faire des efforts supplémentaires en matière de dépenses, en profitant de la bonne conjoncture. En fait, lors des périodes d'amélioration de la situation économique, les suppléments de recettes inattendus sont rapidement considérés comme des « cagnottes », qui n'ont pas vocation à diminuer le déficit et à rembourser la dette, mais à être rendues aux citoyens, soit sous la forme de dépenses supplémentaires, soit par des baisses d'impôts. Le phénomène a été particulièrement fort en 2000, un an après l'apparition du terme de cagnotte dans les médias. C'est une année qui s'est achevée sur un déficit de l'État de 35 milliards d'euros, soit 12,4 % de ses recettes alors qu'il aurait pu être réduit de plusieurs milliards si le débat public sur la cagnotte n'avait pas conduit à consommer par des augmentations de dépenses et des diminutions de recettes les améliorations du solde budgétaire provoquées par la bonne conjoncture. La dette des administrations publiques s'est accrue de 21 milliards d'euros seulement, grâce à l'excédent global des autres administrations. Du fait de ces choix, les marges de manoeuvre des pouvoirs publics pour soutenir la croissance ont été limitées lorsque la conjoncture s'est retournée en 2001. Source : rapport de la commission présidée par M. Michel Pébereau, Rompre avec la facilité de la dette publique. Pour des finances publiques au service de notre croissance économique et de notre cohésion sociale, C'est d'ailleurs l'un des principaux mérites de l'actuelle majorité que d'avoir pleinement pris conscience de l'impossibilité de persévérer dans l'impasse de l'endettement public et de la nécessité de rompre avec la fatalité de la dépense. Cependant, mieux que dans d'interminables et vains débats sur les responsabilités du passé, c'est dans l'action et la responsabilité qu'elle a su trouver les premières et décisives réponses aux défis que porte la dette publique. III.- « QUE FAUT-IL FAIRE POUR ROMPRE AVEC CETTE SITUATION ? » Selon l'article unique de la proposition de résolution, une commission d'enquête serait nécessaire pour « définir les moyens aptes à résorber la dette publique de la France », comme s'il était urgent d'entamer un vaste travail de réflexion. C'est méconnaître le fait que les pouvoirs publics sont d'ores et déjà, depuis 2002, dans le temps de l'action. De surcroît, le Premier ministre a tout récemment décidé d'amplifier nos efforts, s'engageant à placer les finances publiques sur la voie de l'équilibre et à ramener l'endettement public à 60% du PIB à l'horizon 2010. La « stratégie renforcée de désendettement » du Gouvernement a été présentée lors de la Conférence nationale des finances publiques et précisée dans le programme de stabilité 2007-2009 (voir l'encadré ci-dessous).
Source : Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, Programme de stabilité 2007-2009. _ La stratégie budgétaire de l'actuelle majorité repose sur un constat : pour réduire le déficit (et donc l'endettement), le moyen le plus efficace - et dont les effets sont les plus durables - est la maîtrise la dépense publique. Se démarquant de la politique menée sous la XIe législature, la majorité a décidé de stabiliser les dépenses de l'État et de ralentir la progression des dépenses sociales. En particulier, les dépenses du budget général de l'État ont été stabilisées en volume, leur évolution épousant le rythme de l'inflation. En 2003, cette nouvelle « norme de dépense » a été très strictement tenue. Elle l'a aussi été en 2004, moyennant un accroissement des reports de crédits (contrariant ainsi le mouvement inverse engagé en 2002 et 2003). En 2005, elle a encore été respectée et les reports de crédits ont été fermement réduits. Selon les premiers résultats de l'exécution 2005, les dépenses nettes du budget général de l'État se sont établies à 288,4 milliards d'euros (hors remboursements et dégrèvements et hors recettes en atténuation des charges de la dette). Les reports de crédits « entrants » en 2006 ne dépasseraient pas 5 milliards d'euros (estimation provisoire), au lieu de 9,7 milliards d'euros l'année précédente. La « rupture » qu'appellent de leurs vœux les auteurs de la proposition de résolution a donc déjà été entamée. Toutefois, pour difficile qu'elle soit à tenir, la stabilisation en volume des dépenses de l'État ne produit ses effets que graduellement. La commission Pébereau écrit ainsi : « cette norme constitue une avancée incontestable. Mais même si elle était appliquée strictement et si la croissance économique était chaque année de 2 %, elle ne permettrait de stopper l'augmentation du ratio d'endettement qu'au bout de quatre ans. Et il faudrait attendre huit ans pour atteindre l'équilibre et neuf ans pour seulement retrouver notre niveau d'endettement actuel » (12). Dès le mois d'octobre dernier, conscient de la nécessité de renforcer la lutte contre le déficit et la dette, le Gouvernement a annoncé que la loi de finances pour 2006 serait la dernière à appliquer la règle du « zéro volume ». La deuxième étape dans la maîtrise de la dépense consiste désormais à passer d'une stabilisation en volume à une réduction en volume, afin de tendre à moyen terme vers le « zéro valeur » (c'est-à-dire à une stabilisation en euros courants). Plus précisément, lors de la Conférence nationale des finances publiques tenue le 11 janvier 2006, le Premier ministre s'est engagé à ce que, dans la loi de finances pour 2007, les dépenses de l'État progressent d'un point de moins que le taux d'inflation prévisionnel. Cette diminution de 1% en volume se traduirait par une économie de 2,7 milliards d'euros. En retenant la même prévision d'inflation que pour 2006 (1,8%), les dépenses n'augmenteraient donc que de 0,8% en valeur, c'est-à-dire de 2,1 milliards d'euros, à comparer aux 4,8 milliards d'euros qu'autoriserait la norme « zéro volume » et aux 4,9 milliards d'euros supplémentaires votés en loi de finances pour 2006. Après 2007, selon la programmation pluriannuelle des finances publiques (2007-2009), le rapprochement progressif vers le « zéro valeur » sera poursuivi : les dépenses de l'État diminueraient de 1,25% en volume en 2008, de 1,5% en volume en 2009 afin d'atteindre une stabilité en valeur en 2010. ÉVOLUTION PRÉVISIONNELLE DES DÉPENSES DU BUDGET GÉNÉRAL DE L'ÉTAT 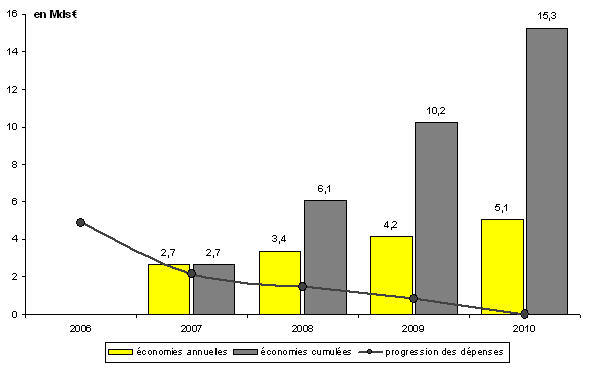 Hypothèse d'inflation annuelle = 1,8%. Cet engagement est particulièrement ambitieux : il consiste à dégager en quatre années environ 15 milliards d'euros d'économies de plus que ce que permettrait l'actuelle norme de dépense « zéro volume » (voir le graphique ci-dessus). Pour le tenir, la modernisation et la réforme de l'État - pour indispensables qu'elles soient - ne seront pas suffisantes. La majorité devra faire des choix clairs et procéder à des arbitrages difficiles entre maintien, réduction ou suppression de dépenses. Les efforts devront porter aussi bien sur certaines dépenses d'intervention que sur les dépenses de fonction publique (13) ou encore sur les crédits militaires. Une approche uniforme de la réduction des crédits n'étant ni possible ni souhaitable, c'est à une « revue des dépenses » qu'il faut se livrer, à l'image des pratiques suédoises (14), britanniques ou canadiennes. C'est pourquoi votre Rapporteur général soutient la démarche d'audits de modernisation lancés à l'automne dernier (17 audits ont été réalisés, suivis d'une deuxième vague de 20 audits engagés en janvier), tendant à réexaminer concrètement l'utilité et l'efficacité des dépenses de l'État. _ Une fois posé le principe du gel de la dépense, le rythme de l'assainissement budgétaire ne dépend plus que de l'évolution effective des ressources de l'État. Il serait pourtant illusoire de confondre, dans l'évolution des recettes en particulier fiscales, dont le caractère cyclique accentue dans des proportions souvent spectaculaires les évolutions de l'économie (15), la part du provisoire, c'est-à-dire les plus-values qui ont vocation à être strictement compensées par des moins-values tout aussi importantes en phase de ralentissement conjoncturel, et la part du permanent sur lequel doivent s'appuyer les efforts concrets de rétablissement des finances publiques. Votre Rapporteur général a à cet égard suggéré l'usage d'une règle de répartition des surplus fiscaux à la lumière de laquelle mesurer la qualité de la politique budgétaire.
Cette règle permet de mesurer la pleine crédibilité de la stratégie renforcée de désendettement définie par le Premier ministre, dès lors que celle-ci repose sur la préservation du socle de ressources des administrations publiques désormais adaptées aux contraintes et aux défis d'une économie moderne et ouverte. Il apparaît en effet que le respect des engagements de dépenses décrits plus haut conjugué à l'absence de baisses d'impôt qui ne soient pas financées par une réduction corrélative de crédits permettrait de réduire, de manière structurelle, le déficit de l'État de plus de 30 milliards d'euros d'ici 2010. SIMULATION D'ÉVOLUTION DU DÉFICIT DE L'ÉTAT (en milliards d'euros)
(a) Hypothèses retenues : taux de croissance de l'économie de 2,25% chaque année avec une inflation de 1,8% ; élasticité des recettes fiscales nettes au PIB de 1 ; évolution des recettes non fiscales égales à la croissance en valeur (soit 4% par an) ; accroissement des prélèvements sur recettes au rythme des dotations aux collectivités territoriales indexées (inflation + 1/3 de la croissance de l'année précédente). En outre, après l'impact en 2007 des baisses d'impôts décidées à ce jour (- 6,1 milliards d'euros de recettes fiscales), il est fait l'hypothèse de l'absence de nouveaux allégements fiscaux non financés par des baisses de dépenses équivalentes. (b) Hypothèses du programme de stabilité transmis aux autorités communautaires, voir plus haut. _ Bien entendu, l'effort de redressement, qui repose sur la maîtrise des dépenses, ne saurait se limiter à l'État. Pour aller vers l'équilibre des comptes publics en 2010, les efforts doivent être partagés entre les différents acteurs. L'un des mérites de la Conférence nationale des finances publiques est de l'avoir rappelé. Cette approche globale est d'autant plus nécessaire que les objectifs du programme de stabilité 2007-2009 sont plus ambitieux que ceux qui avaient été présentés au Parlement dans la programmation pluriannuelle associée au projet de loi de finances pour 2006 et présentée dans le Rapport économique, social et financier. En particulier, la part de la dette publique dans le PIB diminuerait dès 2007 même dans le scénario macro-économique « bas » (16). ÉVOLUTION PRÉVISIONNELLE DE LA DETTE PUBLIQUE (en points de PIB) 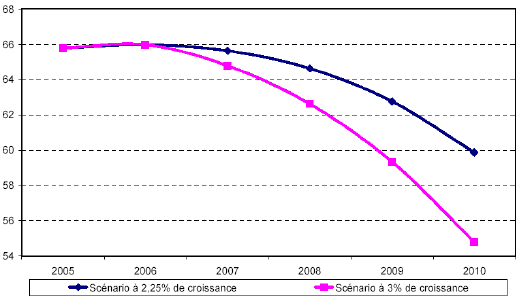 Source : Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, Programme de stabilité 2007-2009.
Pour parvenir à cet assainissement des finances publiques, les dépenses des collectivités territoriales devraient tendre vers une stabilisation en volume à l'horizon 2009, à l'image de ce que réalise l'État depuis le début de la législature. D'ici là, les dépenses locales connaîtraient une progression limitée à 0,5% en volume en moyenne. Quant aux dépenses sociales, elles devraient connaître un rythme annuel moyen de 1% en volume (2,5% en valeur) sur la période 2007-2009, sous l'effet notamment de la loi du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie, des mesures prises en loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 et de l'amélioration de la situation de l'emploi. En particulier, les dépenses d'assurance maladie encadrées par l'ONDAM ne progresseraient que de 2,2% en volume en moyenne. * * * La vérité des faits est connue, l'enchaînement qui a conduit à ce niveau d'endettement aussi. L'essentiel est dans l'action. Beaucoup a été fait en reprenant la maîtrise de la dépense publique. La perspective d'un retour à l'équilibre est désormais crédible. Les engagements pris doivent être tenus. EXAMEN EN COMMISSION Lors de sa séance du 7 février 2006, la Commission a examiné, sur le rapport de M. Gilles Carrez, Rapporteur général, la proposition de résolution de MM. Hervé Morin, Charles de Courson et les membres du groupe UDF et apparentés, tendant à la création d'une commission d'enquête sur l'état réel des finances publiques de la France (n° 2721). M. Charles de Courson a indiqué que si la dette de la France s'élèvera à 1.167 milliards d'euros à la fin de l'année 2006 selon les normes européennes (contre 1.104 milliards d'euros prévus à la fin de 2005), le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a admis que la dette « réelle » de la France serait de l'ordre de 2.000 milliards d'euros. La dette au sens de Maastricht ne prend pas en compte certains engagements relatifs aux pensions des trois catégories de fonctionnaires, des agents publics et des salariés relevant de régimes spéciaux. Ces engagements représentent plus de 900 milliards d'euros (450 milliards d'euros pour les agents de l'État et 450 milliards pour les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers). Selon les normes comptables internationales qui imposent de comptabiliser tous les engagements figurant en « hors bilan », la France serait endettée de plus de 2.000 milliards d'euros. La dette publique s'élèverait à 120% du PIB, et non plus à 66% du PIB. Face à ce constat, mais également parce que cette question de la dette publique ne doit pas rester le domaine réservé de groupes d'experts non élus, il convient d'instituer une commission d'enquête. Trois questions méritent d'être posées. Quelle est la vérité sur l'état des finances publiques de la France ? Pourquoi en est-on arrivé là ? Que faut-il faire pour rompre avec cette situation ? M. Jean-Pierre Gorges a approuvé M. Charles de Courson, regrettant également que les parlementaires, lorsqu'ils s'expriment sur la dette, ne soient pas écoutés comme le sont les experts. Votre Rapporteur général s'est opposé à cette proposition. Depuis de nombreuses années, les rapports généraux donnent une vision claire et précise de l'évolution des finances publiques de la France. Tous les chiffres du rapport Pébereau figurent dans les documents mis à la disposition du Parlement. Sur l'état de nos finances publiques, les chiffres sont connus de tous. La dette s'élève à plus de 1.100 milliards d'euros, montant auquel on pourrait éventuellement ajouter environ 20 milliards d'euros au titre de l'endettement d'organismes qui pourraient être intégrés, à terme, dans le champ des administrations publiques. Par ailleurs, 400 milliards d'euros correspondent aux engagements liés aux pensions des fonctionnaires de l'État. Ceux-ci ne constituent pas de l'endettement, mais des dépenses futures. Personne n'ignore les causes de l'accroissement de la dette : ce sont les déficits cumulés depuis le début des années 1980, découlant de la rupture de la croissance, des taux d'intérêt élevés et de l'incapacité des gouvernements successifs à réduire l'écart entre les dépenses et les recettes, écart qui s'établit à 18% en moyenne sur les vingt dernières années. Depuis 2002, la réponse a commencé à être apportée à la question de l'endettement. Pour la première fois, les dépenses de l'État sont durablement stabilisées en volume. De plus, lors de la Conférence nationale sur les finances publiques tenue le 11 janvier dernier, le Premier ministre a demandé aux ministres de préparer leur budget sur une hypothèse de diminution de leurs dépenses d'un point de moins que l'inflation et d'avancer des propositions précises sur le non-remplacement des départs à la retraite de fonctionnaires. L'évolution en volume des dépenses de sécurité sociale devrait être limitée à 1% de plus que l'inflation sur la période 2007-2009. Les dépenses des collectivités territoriales progresseraient, quant à elles, de 0,5% en volume en moyenne. La perspective est le retour à l'équilibre à l'horizon 2010. Si cette stratégie est appliquée, avec une croissance d'environ 2,5% par an, l'objectif n'est pas hors de portée. Au Danemark et en Suède, pays confrontés à une grave crise de leurs finances publiques au début des années 1990, des mesures radicales ont été prises avec succès. Preuve qu'il est possible d'agir contre le déficit et l'endettement. Tout est donc question de volonté politique. Dans cette perspective, le rôle de la Commission des finances et, au-delà, du Parlement, n'est pas tant de produire un rapport de plus sur un sujet maintes fois débattu que de surveiller l'application rigoureuse de la stratégie de retour à l'équilibre de nos finances publiques. M. Didier Migaud a fait valoir qu'il n'y aurait pas besoin d'une commission d'enquête si le Parlement et la Commission des finances jouaient leur rôle en matière de contrôle. Il est impératif que le Parlement français passe d'une culture de la soumission, voire de la démission, à une véritable culture du contrôle. Et afin que le contrôle soit effectif, il convient d'y associer l'opposition de façon plus systématique. Or, force est de constater qu'à l'exception de la Mission d'évaluation et de contrôle qui est coprésidée par un élu de l'opposition, cette dernière est absente de la quasi-totalité des instances de contrôle, ce phénomène étant amplifié lorsque la majorité politique à l'Assemblée nationale concorde avec celle du Sénat qui ne connaît pas d'alternance. Ce phénomène est caractéristique des institutions françaises, le débat sur la sincérité budgétaire étant propre à la France. Votre Rapporteur général a contesté cette analyse, la Commission Pébereau comptant, par exemple, un député socialiste et un député apparenté UDF. Le Président Pierre Méhaignerie a attiré l'attention sur les contradictions, voire la schizophrénie, de certains parlementaires ou groupes politiques qui protestent souvent simultanément contre la dégradation des comptes publics et l'insuffisance des crédits. La dépense publique demeure électoralement payante comme en témoigne l'attitude de nombreux élus locaux. La multiplication des contrôles n'éliminera pas cet élément structurant de la vie politique française. M. Didier Migaud a estimé que les divers rapports qui émanent de la Commission des finances n'offrent pas une vue exacte de la situation des finances publiques. Il n'y est question que de la politique de redressement des finances publiques de l'actuelle majorité, alors que le déficit a été systématiquement supérieur à 3% du PIB depuis 2002 avec un pic à 4% et alors même qu'il avait été ramené entre 2,4 et 2,6% du PIB en 2002. Un audit des comptes publics comme celui réalisé en 2002 par des magistrats de la Cour des comptes serait souhaitable. De façon générale, diverses contre-propositions pourraient être avancées afin de progresser vers plus de transparence. Il est désormais clairement établi que le contrôle est une question de volonté et non de moyens. Force est de constater que la volonté fait encore défaut à l'Assemblée nationale, alors que la culture de contrôle est déjà un peu plus ancrée au Sénat. Sur le fond, les propositions du Gouvernement afin de redresser les finances publiques paraissent hautement contestables et sa volonté de renvoyer à la prochaine législature la mise en œuvre de ces mesures ne laisse pas d'étonner. M. Charles de Courson a partagé l'analyse du Président Pierre Méhaignerie s'agissant de la résistance qu'opposent les ministères dépensiers mais aussi certains parlementaires à l'objectif de réduction de la dépense publique. Le ministre des finances a dû constater que la mise en œuvre de la loi organique relative aux lois de finances n'a pas modifié les comportements parfois syndicalistes des autres ministres. La commission d'enquête que le groupe UDF appelle de ses vœux n'aurait pas vocation à s'appesantir sur la partie descriptive. Sa mission essentielle serait de formuler des propositions et de porter un jugement sur la stratégie du Gouvernement. Elle pourrait notamment expliquer pourquoi les propositions récemment annoncées en matière de progression des dépenses locales ne sont pas tenables. Sur le plan institutionnel, elle démontrerait que la Commission des finances n'est pas une machine à entériner les décisions gouvernementales. M. Augustin Bonrepaux a jugé déraisonnable et contradictoire l'attitude du Gouvernement face aux recommandations de la Commission Pébereau. Cette commission estime souhaitable de donner un coup d'arrêt à la diminution des prélèvements obligatoires : le Gouvernement reprend cette analyse à son compte mais en renvoie la mise en œuvre à la prochaine législature. Cela n'est pas sérieux. Cette commission préconise une stabilisation des dotations aux collectivités territoriales en euros courants. Cette idée est effectivement reprise par le Gouvernement mais sans les contreparties exigées par la commission précitée : assurer la neutralité des transferts, ne pas imposer unilatéralement de nouvelles dépenses aux collectivités territoriales et assurer à ces dernières une plus grande maîtrise de leurs ressources et de leurs dépenses. La Commission a rejeté la proposition de résolution n° 2721. * * * ----------- N° 2844 - Rapport fait au nom de la commission des finances sur la proposition de résolution (n°2721) de MM. Hervé Morin, Charles de Courson et François Sauvadet et les membres du groupe UDF et apparentés, tendant à la création d'une commission d'enquête sur l'état réel des finances publiques de la France (M. Gilles Carrez) 1 () Commission présidée par M. Michel Pébereau, Rompre avec la facilité de la dette publique. Pour des finances publiques au service de notre croissance économique et de notre cohésion sociale, La documentation française, 2005. 2 () Rapport Pébereau précité p. 33-34. 3 () Rapport Pébereau précité p. 33. 4 () À rebours de l'exposé des motifs de la présente proposition de résolution, le rapport Pébereau précise en revanche que « ce raisonnement ne vaut ni pour le régime de retraite des fonctionnaires des collectivités territoriales, ni pour les régimes obligatoires du secteur privé, qui sont tous mutualisés » (p. 39). 5 () Rapport de présentation du Compte général de l'administration des finances 2004, p. 33. 6 () Au sein de l'OCDE, seuls quelques rares États - tels que le Canada et l'Australie - considèrent ce type d'engagements comme une véritable dette. 7 () Voir le rapport d'information (n° 2415) de votre Rapporteur général préalable au débat d'orientation budgétaire pour 2006, pages 31 à 37, qui éclaire la notion de solde stabilisant la dette. L'estimation d'un déficit stabilisant de 2,3% repose sur l'hypothèse raisonnablement optimiste d'une croissance potentielle évaluée à 2,25%, d'une inflation de 1,75% et d'un coût apparent de la dette de 4,5% en valeur. 8 () Tels qu'ils résultent de l'audition par votre Commission des finances du ministre délégué au budget et à la réforme de l'État, M. Jean-François Copé, le 24 janvier 2006. Pour 2006, les chiffres retenus sont issus des documents budgétaires associés au projet de loi de finances pour 2006. 9 () Voir le rapport n° 2415 précité. 10 () Voir notamment le rapport Pébereau précité. 11 () Notamment dans son rapport d'information sur les premiers éléments disponibles concernant l'exécution du budget en 2003, n° 1507, avril 2004, pages 15 à 18 ou dans son rapport général sur le projet de loi de finances pour 2006, n° 2568, octobre 2005, Tome 1 : « Exposé général », pages 7 à 14. 12 () Rapport Pébereau précité, p. 154. 13 () À propos de ces dernières, la commission Pébereau écrit notamment : « les recrutements continuent au même rythme que dans les années 1960. En effet, près de 95% des départs à la retraite au sein de l'État ont été compensés par des recrutements sur les cinq dernières années. Rien ne permet de penser que l'opportunité historique des départs massifs à la retraite dans les prochaines années des générations du baby boom sera véritablement saisie » (rapport précité, p. 108). 14 () Voir Pierre Méhaignerie, Gilles Carrez et Michel Bouvard, Une France plus attractive et plus juste : réflexion sur l'exemplarité suédoise, Rapport d'information n° 2621, novembre 2005. 15 () Voir en particulier le rapport de votre Rapporteur général relatif au projet de loi organique modifiant la loi organique relative aux lois de finances (n° 2001-692 du 1er août 2001), n° 1833, novembre 2004. 16 () Dans le scénario « bas » (2,25% de croissance par an de 2007 à 2009), le Rapport économique, social et financier joint au projet de loi de finances pour 2006 n'envisageait cette diminution qu'à compter de 2008. © Assemblée nationale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||