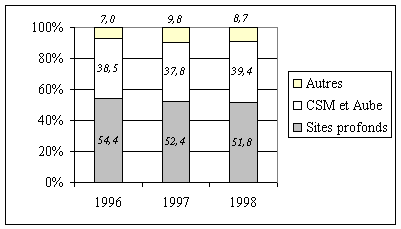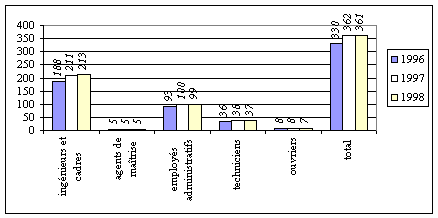LES CONSÉQUENCES DES INSTALLATIONS DE STOCKAGE L’urgence d’une rigueur et d’une exhaustivité accrues dans la gestion des déchets radioactifs *Chapitre 1 : la transposition de la directive européenne n°96/29 – problématique et état d’avancement *I – La problématique de la directive européenne n° 96/29 *1. La révision des normes par la CIPR n° 60 *1.1. Les résultats 1988 de l’UNSCEAR *1.1.1. La sensibilité et la précision accrue des résultats *1.1.2. La révision des doses reçues par les survivants *1.1.3. La nouvelle méthode de détermination du risque *1.2. Les nouvelles limites d’exposition de la CIPR n° 60 *1.2.1. Les choix de la CIPR en matière de coefficients de risque *1.2.2. La définition du niveau de risque acceptable *1.2.3. Le rôle central dévolu à l’optimisation *1.2.4. Les contraintes de dose ou limites individuelles *1.3. Les précisions de la CIPR n° 77 *2. Le débat sur les normes de la CIPR n° 60 *2.1. Les critiques contre l’irréalisme des normes de la CIPR *2.2. Les critiques contre le laxisme des normes de la CIPR *2.3. D’autres combats d’arrière-garde *2.4. Le rôle des autorités de radioprotection *3. Les points clés de la directive européenne n° 96/29 *3.1. Le contexte juridique de la directive *3.1.1. Le traité Euratom *3.1.2. Les sources des directives sur les normes de base *3.2. Les points clés de la directive n° 96/29 *3.2.1. Le champ couvert par la directive *3.2.2. Les principes de la radioprotection *3.2.3. L’exclusion de la radioactivité naturelle pour le public *3.2.4. Les nouvelles limites de doses d’exposition *3.2.5. Le concept de dose efficace pour chaque radionucléide *3.2.6. Les seuils d’exemption ou de libération *II – Etat d’avancement de la transposition *1. L’organisation mise en place pour la transposition *1.1. L’organisation institutionnelle *1.2. Le schéma juridique *2. Les décisions en suspens *2.1. Le débat sur la forme juridique des textes à adopter *2.1.1. Les aspects juridiques *2.1.2. Les aspects politiques *2.2. La nécessité d’une approche restrictive *2.2.1. Les limites d’exposition *2.2.2. Les seuils d’exemption *2.2.3. Les seuils de libération *2.2.4. La stratégie concentration/rétention contre la stratégie dilution/dispersion *Conclusion *Chapitre 2 : L’évolution souhaitable du dispositif de surveillance des conséquences des déchets nucléaires sur la santé publique *Introduction *I – Les potentialités de la nouvelle organisation française de sécurité sanitaire pour l’épidémiologie *1. L’organisation générale mise en place *1.1. L’architecture générale de la loi du 1er juillet 1998 *1.2. Les progrès attendus de la nouvelle organisation *1.3. L’annonce récente de la création d’une Agence de sécurité sanitaire de l’environnement *1.4. Le pragmatisme de la loi du 1er juillet 1998 *2. L’Institut de veille sanitaire (IVS) *2.1. Le Réseau national de Santé publique *2.2. L’approche épidémiologique des autres pays *2.3. Statut, missions et moyens de l’IVS *2.4. Les rapports de l’IVS avec les autres institutions de santé *2.5. L’IVS et les effets des rayonnements ionisants sur la santé *II – Les conditions du succès *1. Le nécessaire développement de l’épidémiologie *1.1. Les registres du cancer *1.1.1. Historique des registres du cancer en France *1.1.2. Le rapport Estève de 1996 sur les registres du cancer *1.1.3. La situation actuelle des registres du cancer *1.1.4. Les projets récents *1.2. Le programme cancer de l’IVS *1.3. Les autres études à mettre au point *2. La CNIL et l’identifiant unique *3. Le pluralisme de la recherche épidémiologique *Conclusion *Chapitre 3 : La participation des citoyens et des associations et le pluralisme de l’expertise *I – Les enquêtes publiques *1. La relative inefficacité des améliorations récentes de la procédure *2. Les modifications nécessaires de la procédure d’enquête publique *2.1. La question du commissaire-enquêteur et de la commission d’enquête *2.2. Le dossier mis à l’enquête *2.3. La réunion publique *II – Les Commissions locales d’information *1. Les enseignements de plus de vingt ans de travaux des commissions locales *1.1. Les disparités de structure et de fonctionnement *1.2. Des besoins communs *2. Les possibilités d’évolution *2.1. L’accès à l’information *2.2. Les moyens de financer des contre-expertises *2.3. L’insertion dans les procédures d’enquête publique *2.4. L’organisation des commissions locales d’information *III – Le Conseil supérieur de la sûreté et de l’information nucléaire *IV – Le pluralisme de l’expertise *Conclusion *Chapitre 4 : L’évolution souhaitable du dispositif de gestion des rejets et des déchets radioactifs *I – Les réalités concrètes de la gestion des déchets radioactifs *1. Une dimension temporelle hors normes *1.1. La nécessité de techniques pérennes *1.2. La nécessité d’organisations structurées et durables *2. La nécessité d’une cohérence globale *2.1. L’importance de spécifications et de conditionnements standardisés *2.2. L’indispensable harmonisation des projets *2.3. La nécessité de solutions coopératives *2.4. Une optimisation à faire sur le plan le plus large possible *2.5. Un service public unifié de gestion des déchets *II – La définition et le contrôle de la politique de gestion de déchets radioactifs *1. Les ministères compétents *1.1. La situation actuelle *1.2. Les possibilités d’évolution *1.2.1. L’implication du ministère chargé de la recherche *1.2.2. Le Comité interministériel de la sécurité nucléaire *2. Les structures administratives en charge des dossiers *2.1. Le contrôle de la sûreté : des moyens désormais à la hauteur des enjeux *2.1.1. L’évolution administrative de la sûreté *2.1.2. Des moyens satisfaisants *2.1.3. Le rôle de la DSIN dans la politique des déchets *2.1.4. Le rôle de l’IPSN, appui technique de la DSIN *2.2. L’action du ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement *2.2.1. Les domaines clés de l’action de la DPPR *2.2.2. Les progrès souhaitables *2.3. Le contrôle des sources radioactives à usage médical ou industriel *2.3.1. La place de la CIREA dans le dispositif de gestion des déchets radioactifs *2.3.2. Les améliorations possibles quant à la mission de la CIREA, sa place dans le dispositif institutionnel et les solutions qu’elle propose *2.4. L’indispensable renforcement des moyens de la radioprotection *2.4.1. Le BPRI et l’OPRI : l’évolution des moyens et des statuts *2.4.2. La répartition des tâches au sein de la sphère chargée de la radioprotection *2.4.3. Le renforcement des moyens propres de l’OPRI *2.5. L’opportunité discutable d’un rapprochement de la sûreté et de la radioprotection *2.6. L’externalisation impossible de la fixation de la norme et de la police en matière de sûreté et de radioprotection *3. Les procédures d’autorisation de rejet de radioéléments dans l’environnement *3.1. Le changement de procédure et de philosophie *3.1.1. Le régime des décrets de 1974 *3.1.2. Le décret n° 95-540 du 4 mai 1995 *3.1.3. La rigueur nouvelle des autorisations *3.2. La reprise des dossiers d’autorisation des rejets *III – La responsabilité des producteurs de déchets *1. Le principe de la responsabilité des exploitants *2. Les engagements financiers des exploitants *2.1. Les provisions financières effectuées par les exploitants *2.2. La nécessaire pérennité des fonds alloués au très long terme *2.3. Les dépenses annuelles de gestion des déchets radioactifs *3. Les dispositions à prendre par les exploitants pour diminuer les rejets et les déchets *IV – L’ANDRA : une mission à long terme qu’il faut refonder *1. Les textes législatifs et réglementaires relatifs à l’ANDRA et leur modification éventuelle *1.1. Les origines de l’ANDRA *1.2. Les dispositions de la loi du 30 décembre 1991 *1.3. Le décret d’application n° 92-1391 du 30 décembre 1992 de la loi du 30 décembre 1991 *1.4. Une spécialisation de fait *1.5. L’évolution possible et souhaitable de l’ANDRA *1.5.1. La réaffirmation du rôle de l’ANDRA *1.5.2. L’intégration de nouvelles fonctions de contrôle et de recherche *2. Les moyens financiers et humains de l’ANDRA *2.1. Les moyens humains *2.2. Les entreprises privées prestataires ou partenaires ? *2.3. Les moyens financiers de l’ANDRA *2.3.1. L’évolution de l’activité de l’ANDRA *2.3.2. La mise en place d’une subvention publique *2.4. La redevance sur les installations nucléaires de base *2.4.1. Le contexte actuel *2.4.2. Le contexte futur *3. Les services à proposer en urgence par l’ANDRA *Conclusion générale *PROPOSITIONS *Examen du rapport par l’Office *GROUPE de TRAVAIL *Personnalités rencontrées et visites *Troisième partie : L’évolution souhaitable de l’organisation juridique et institutionnelle L’urgence d’une rigueur et d’une exhaustivité accrues dans la gestion des déchets radioactifs Introduction Les conséquences des déchets radioactifs sur la santé publique et l’environnement, telles qu’on peut les estimer actuellement, sont selon toute probabilité limitées à court terme. Mais elles sont encore insuffisamment connues à long terme. Le diagnostic scientifique de l’impact des déchets radioactifs souffre donc de deux incertitudes qui ne peuvent être tenues pour négligeables. Ces restrictions justifient à elles seules une rigueur de plus en plus forte dans la gestion de ces derniers. Les nouvelles normes qui entreront en vigueur en 2000 après transposition de la directive européenne n° 96/29, correspondent de fait à une meilleure radioprotection. Mais, au-delà de limites d’exposition plus sévères qu’il faudra faire respecter dans la pratique , l’importance nouvelle donnée aux initiatives des exploitants en matière d’optimisation devra avoir comme contrepartie un renforcement des contrôles pratiqués par les autorités de radioprotection. Par ailleurs, de nouveaux outils de surveillance de la santé publique, en particulier l’Institut de Veille Sanitaire, ont été mis en place et devraient permettre une détection rapprochée des éventuels incidences des déchets radioactifs sur la santé publique. Encore faut-il, d’une part, que le chapitre des effets de la radioactivité artificielle ne soit pas placé au bas de la liste des priorités de santé publique et, d’autre part, que l’organisation du système institutionnel soit optimale grâce à une mise en concurrence réelle des équipes de recherche. Par ailleurs, une demande sociale forte s’exprime dans notre pays en faveur d’un réel contrôle de la qualité de l’environnement. La mise en place d’un cadre institutionnel adapté, conjuguant autorité et pluralisme de l’expertise, représente un défi pour les années à venir. De même, il convient que les citoyens soient non seulement associés mais partie prenante au fonctionnement du système de surveillance et de contrôle. La démocratie doit désormais aussi s’affirmer dans des domaines techniques jusqu’ici considérés comme réservés aux experts. Enfin, sans que soient minimisés les efforts conduits par chacun des exploitants nucléaire pour gérer dans son domaine d’activité ses propres déchets radioactifs, il apparaît clairement que le temps est venu de concevoir une organisation d’ensemble de la gestion des déchets. Le temps est venu pour que les structures nationales déjà existantes comme le CEA ou l’ANDRA se voient confier un rôle directeur non seulement dans le stockage des déchets radioactifs comme l’a fait la loi du 30 décembre 1991 pour les déchets de haute activité et à vie longue, mais aussi dans l’entreposage de toutes les catégories de déchets. Seule une telle décision préviendra la dissémination déjà en cours des déchets sur des sites multiples et offrira une solution pour le démantèlement des installations nucléaires dont les masses énormes de déchets se profilent à l’horizon. Chapitre 1 : la transposition de la directive européenne n°96/29 – problématique et état d’avancement I – La problématique de la directive européenne n° 96/29 En l’an 2000, la France devra faire entrer en vigueur de nouvelles limites de radioprotection qui résultent d’une directive de 1996 de l’Union européenne à adapter en droit interne. Ce changement a été impulsé en amont par une série de modifications introduites en premier lieu par l’UNSCEAR puis par la CIPR, dans le but d’améliorer la radioprotection des travailleurs du nucléaire et du public. L’objectif de l’UNSCEAR était d’intégrer de nouveaux résultats scientifiques dans l’appréciation des effets des rayonnements ionisants sur la santé. La CIPR, dont l’objectif de travail porte sur la protection des travailleurs et du public, entendait, pour sa part, traduire ces nouveaux résultats en termes de limites d’exposition et introduire un changement de philosophie tendant à renforcer le poids des impératifs de santé dans les prises de décision du nucléaire. La révision des normes de la CIPR selon sa publication de 1990 intitulée CIPR n° 60, est présentée par les différents commentateurs, soit comme un durcissement irréaliste des normes de radioprotection soit comme une avancée majeure dans ce domaine. M. Claude Birraux, député de Haute-Savoie, au nom de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, a longuement analysé dans son rapport de mars 1996 sur le contrôle de la sûreté et de la sécurité des installations nucléaires, les " fondements scientifiques de la révision des normes de radioprotection ". La CIPR n° 60, en tout état de cause, s’appuie sur les évaluations des risques élaborées par l’UNSCEAR dans son rapport de 1988. Il est nécessaire d’en exposer les principaux résultats avant d’examiner les recommandations de la CIPR proprement dites. L’UNSCEAR publie dans son rapport de 1988 une revue exhaustive des études épidémiologiques sur les risques de cancer associés aux expositions externes et internes aux rayonnements ionisants. La principale étude dont il est rendu compte, porte sur la mortalité pour cause de cancer et sur l’incidence de cette maladie jusqu’en 1987 chez les survivants de Hiroshima et de Nagasaki. Les résultats de cette étude ont permis d’estimer le risque sur la vie entière de mortalité par cancer à la suite d’une exposition à des radiations à faible transfert linéique d’énergie. Le premier nouveau résultat d’importance de l’UNSCEAR en 1988 est la mise en évidence d’un excès de risque significatif au plan statistique pour les doses comprises entre 0,2 et 0,5 Gray. En raison de l’effet mécanique de vieillissement de la cohorte des survivants de Hiroshima et de Nagasaki, un plus grand nombre de ceux-ci parviennent à un âge où les cancers radioinduits se déclarent. Il en résulte une puissance statistique accrue des études et la possibilité de mettre en évidence un excès de risque pour des doses faibles à propos desquelles il était impossible de conclure auparavant. A l’avenir et pour les mêmes raisons, le même phénomène de vieillissement permettra, selon toute vraisemblance, de mettre en évidence des excès de risque significatifs au-dessous de 0,2 Gray. Par ailleurs, la précision des coefficients de risque est améliorée puisque ceux-ci sont calculés pour 8 organes particuliers (sein, poumon, myélome multiple, ovaire, colon, œsophage, vessie, estomac). C’est par le calcul que les doses reçues par les survivants ont été établies, en particulier à partir des caractéristiques physiques des bombes atomiques lâchées sur Hiroshima et Nagasaki et à partir de la configuration des sites. Grâce à une intégration plus complète des différents paramètres d’exposition, ces calculs rétrospectifs se sont affinés au cours du temps. Les derniers résultats, publiés en 1986, se caractérisent par une réévaluation de la dose due au rayonnement gamma d’un facteur au moins égal à 5 pour Hiroshima, l’estimation restant inchangée pour Nagasaki. La dose due aux neutrons est quant à elle réduite d’un facteur 3 pour Nagasaki et d’un facteur 10 pour Hiroshima. Sur un plan méthodologique, par ailleurs, l’UNSCEAR utilise une nouvelle méthode pour la détermination du risque subi par une population exposée. Si les observations dont on dispose portent sur une cohorte qui n’est pas encore éteinte, il est très difficile de tirer des conclusions sur le risque subi par cette population, puisque, par définition, une partie du risque n’est pas encore exprimée. Ceci est bien évidemment le cas de la cohorte des survivants de Hiroshima et de Nagasaki. En conséquence, pour contourner cette difficulté qui s’effacera au décès du dernier survivant, l’UNSCEAR a réalisé une projection sur la vie entière en utilisant deux modèles. Le premier modèle est le modèle dit additif par lequel l’excès de risque demeure constant quel que soit l’âge atteint. Le deuxième modèle est le modèle dit multiplicatif, par lequel l’excès de risque croît avec l’âge atteint. Dans les deux modèles, un traitement particulier est réservé aux individus jeunes à la date des explosions atomiques. La combinaison de ces modèles permet de définir un intervalle de coefficients de risque. Cette démarche semble pertinente pour l’ensemble des observateurs, encore que le modèle multiplicatif ne propose en aucune façon une limite supérieure au risque estimé. Les résultats des coefficients de risque proposés par l’UNSCEAR pour des doses élevées, sont présentés dans le tableau suivant. Tableau 1 : Intervalles d’estimation de risque pour des doses élevées, par l’UNSCEAR (1988)
On peut, à définition comparable, comparer les résultats de 1988 de l’UNSCEAR, avec ceux de 1977. On note dans ce cas qu’il y a une multiplication par 1,8 du coefficient de risque, de 1977 à 1988. Une meilleure connaissance des conséquences des rayonnements ionisants sur la santé conduit donc à une réévaluation des risques. Des intervalles de risque sont aussi proposés dans la même étude pour des doses et des débits de dose faibles dont les effets sont moins importants par hypothèse. L’UNSCEAR propose à cet égard d’appliquer aux intervalles précédents, un facteur de réduction. Ce facteur de réduction du coefficient de risque sera compris entre 2 et 10, selon l’organe considéré, le niveau de la dose et la valeur du débit de dose. Depuis son rapport de 1988, l’UNSCEAR a pu étendre la période d’étude de mortalité des survivants de 1987 à 1990. Mais il n’est pas possible, pour le moment, de parfaire les résultats de 1988 sur le risque pour la vie entière. C’est pourquoi seuls ces derniers demeurent utilisables. Quoi qu’il en soit, rien de déterminant, en termes d’observations scientifiques, vient remettre en cause la portée des résultats de 1988. Les observations scientifiques contribuant à la formulation de la CIPR n° 60 peuvent donc toujours être considérées comme valables. Le travail de la CIPR prend appui sur les évaluations de risque de l’UNSCEAR et, dans la droite ligne de son objectif de radioprotection, suggère des limites de dose. Ces limites qui forment le point saillant des principales publications de la CIPR, ne doivent pas, néanmoins, occulter la philosophie qui sous-tend chaque grande série de recommandations de la CIPR, et en particulier, la publication n° 60 de 1990. On trouvera au tableau suivant un résumé des modifications des limites de doses survenues entre 1977 et 1990 dans les propositions de la CIPR. Tableau 2 : Evolution des limites de doses intervenues entre 1977 et 1990
Pour déterminer ces limites de doses, la CIPR a procédé en deux temps, d’une part en faisant un choix dans l’éventail de valeurs de coefficients de risque proposés par l’ UNSCEAR et d’autre part en adoptant de nouveaux principes en matière d’acceptabilité des risques. Ces limites ne peuvent, au demeurant, être affichées indépendamment du principe d’optimisation qui constitue leur cadre d’application. 1.2.1. Les choix de la CIPR en matière de coefficients de risque A partir d’une analyse critique des publications scientifiques les plus récentes, l’UNSCEAR, on l’a vu, a conclu en 1988 à différentes valeurs de coefficients de risque correspondant à des options méthodologiques distinctes. La CIPR a ainsi pu faire des choix, en privilégiant la plus grande prudence, pour retenir ses propres valeurs de coefficients de risque. C’est ainsi qu’en premier lieu la CIPR retient le modèle multiplicatif pour l’estimation du coefficient de risque à dose et débit de dose élevés. En second lieu, elle calcule le risque sur la vie entière en tenant des risques spécifiques à chaque classe d’âge. Enfin, en troisième lieu, elle adopte le facteur de réduction le plus faible, soit 2, pour le passage des doses élevées aux doses faibles. La deuxième étape de la démarche de la CIPR consiste, en complément au choix de ses propres coefficients de risque, à définir un niveau de risque acceptable. L’approche de la CIPR a complètement changé, à cet égard, entre 1977 et 1990. En effet, en 1977, la CIPR faisait référence aux niveaux de sécurité considérés comme les plus élevés dans l’industrie à cette date, à savoir une mortalité annuelle moyenne due aux risques professionnels inférieure ou égale à 10-4. La notion sous-jacente était donc celle de l’acceptabilité sociale du risque professionnel en milieu industriel. En conséquence, en 1977, une limite de dose de 50 mSv par an pour les travailleurs était choisie car elle correspondait dans les faits à une moyenne de 5 mSv par an et par travailleur, soit un risque annuel de cancer mortel de 10-4. En 1990, la CIPR décide d’abandonner son approche comparative par référence aux performances des industries les plus avancées, et s’attache à mettre en place une nouvelle notion, celle de l’acceptabilité du risque pour l’individu. Toute la démarche consiste à fixer d’une part une limite de dose au-dessus de laquelle le risque résiduel devient inacceptable pour la santé de l’individu exposé et d’autre part un niveau d’exposition optimisé en dessous duquel le risque est acceptable et correspond aux meilleurs pratiques d’une industrie nucléaire plaçant la radioprotection au coeur de ses préoccupations. Le schéma ci-dessous présente ces différents concepts. Figure 1 : Schéma de principe de l’acceptabilité du risque selon la CIPR n° 60
Au-dessus de la limite de dose, le risque résiduel est naturellement considéré comme inacceptable. Entre la limite de dose et le niveau d’exposition optimisé, le risque résiduel ne peut tout juste être considéré que comme tolérable. C’est seulement en dessous du niveau d’exposition optimisé que le risque résiduel est acceptable. Mais comment fixer le niveau de risque acceptable pour un individu ? Le raisonnement de la CIPR est le suivant. Le niveau antérieurement fixé pour les travailleurs était de 50 mSv par an. Ceci correspond à une dose efficace de 2,4 Sv pour la vie entière. La perte d’espérance de vie correspondante s’élève à 1,1 année. La probabilité de décès due aux rayonnements ionisants dépasserait 8 % même à un âge avancé. Ces conséquences seraient " jugés excessives pour des activités qui pour la plupart, sont récentes et de ce fait doivent être exemplaires ". En conséquence, la CIPR estime que la limite d’exposition adéquate pour les travailleurs est de 1 Sv sur la vie entière et de 20 mSv par an en moyenne sur 5 ans. S’agissant du public, la CIPR estimait en 1977, à la lumière des études sur l’acceptation des risques dans la vie courante, que " le niveau d’acceptabilité pour les risques fatals supportés par le public est d’un ordre de grandeur inférieur à celui déterminé pour les risques professionnels. Sur cette base, un risque compris dans une fourchette de 10-6 à 10-5 par an serait vraisemblablement acceptable par toute personne individuelle du public ". La CIPR fixait alors d’une part une dose limite de 5 mSv par an pour le groupe critique susceptible de recevoir l’équivalent de dose le plus élevé dans la population et d’autre part une dose limite de 1 mSv pour toute personne du public. En 1990, la CIPR n° 60 abandonne la notion de groupe critique, fait état d’une seule dose limite de 1 mSv par an, considérant au total comme acceptable ce dernier niveau qui, au demeurant, est du même ordre de grandeur que les fluctuations de la radioactivité naturelle. Comme cadre général d’application des limites de doses qu’elle publie, la CIPR systématise en 1990 le principe d’optimisation comme philosophie sous-jacente de toutes les activités nucléaires : " l’objectif général doit être d’assurer que le niveau des doses individuelles, le nombre des personnes exposées ainsi que la probabilité de subir des expositions quand ces dernières ne sont pas certaines, soient maintenues aussi bas qu’il est raisonnablement possible, compte tenu des facteurs économiques et sociaux ". En outre, la radioprotection devra faire partie intégrante des contraintes de conception d’une installation ou d’une activité : " le principe d’optimisation est essentiellement lié à la source et devrait d’abord être appliqué lorsqu’on est au stade de conception d’un projet ". Enfin, des risques d’inégalité entre les individus pourraient résulter du principe d’optimisation. La CIPR introduit donc la notion de contraintes de doses, correspondant à des restrictions sur la dose individuelle, qui ont une valeur générale et permanente, indépendamment du principe d’optimisation. Ces contraintes de doses sont en tout état de cause indispensables pour protéger les individus les plus exposés. Concrètement, pour l’exposition du public, la CIPR recommande le respect d’une contrainte de dose individuelle par source de 0,3 mSv/an. Un groupe critique peut en effet être exposé à plusieurs sources de rayonnements ionisants. Ce cas rare peut se produire, avec une probabilité faible pour une exposition à plus de deux sources. Il convient donc de prévoir une limite d’exposition par source – soit 0,3 mSv/an, de façon à être sûr que le total sera inférieur à la limite globale. On voit donc que dans ces conditions, la limite de 1 mSv/an perd de son importance. En 1998, la CIPR publie sous le numéro 77, un texte sur l’application du système de protection radiologique dessiné dans sa publication n°60 pour l’évacuation finale des déchets radioactifs. Ainsi qu’on l’a vu en première partie la définition des déchets donnée par la CIPR inclut les effluents liquides ou gazeux aussi bien que les matériaux solides. Deux stratégies existent pour l’évacuation finale des déchets : d’une part la dilution/dispersion, d’autre part la concentration/rétention. L’objectif principal de la politique de gestion des déchets radioactifs est la protection du public. La CIPR note que la stratégie de dilution/dispersion permet d’avoir l’assurance que les groupes critiques et donc a fortiori la population moyenne, sont protégés sous réserve de phénomènes de reconcentration dans l’environnement. La stratégie de concentration/rétention bénéfice des effets de la décroissance radioactive mais oblige à évaluer les expositions potentielles résultant par exemple d’intrusion ou de rupture des barrières de confinement. Rappelant ce qu’est une " pratique ", au sens de la CIPR n° 60, c’est-à-dire " une activité délibérée qui augmente le niveau d’exposition ambiant ", la CIPR, la CIPR 77 tire les conséquences du principe de justification pour la gestion des déchets radioactifs. En particulier, la gestion des déchets radioactifs ne peut être considérée comme une pratique spécifique et doit au contraire être rattachée à la pratique qui produit ces déchets. Le principe de justification doit en conséquence s’appliquer à l’ensemble. Ceci veut dire que dans la mesure où l’on modifie l’aval de la chaîne, le principe de justification oblige à une réévaluation globale. Concrètement, cela veut dire que tout changement dans le mode de gestion des déchets doit voir sa pertinence en matière de radioprotection analysée avec les opérations situées en amont. Une autre précision apportée par la CIPR n° 77 est sa recommandation de prudence dans l’utilisation des doses collectives, en raison des incertitudes affectant les prévisions de doses collectives pour des périodes de temps supérieures à plusieurs milliers d’années. En réalité, pour évaluer les effets de l’évacuation sur les générations futures par rapport aux effets d’une évacuation immédiate sur les groupes critiques, la CIPR conseille d’utiliser la méthode des détriments sanitaires en retenant comme critère d’évaluation les doses annuelles individuelles réelles ou potentielles. La publication n° 60 de la CIPR essuie, depuis sa parution, un ensemble de critiques, dénonçant son laxisme ou plus souvent son irréalisme. Ces critiques viennent de toute part, pour des motifs divers, à la fois de l’industrie et des milieux médicaux. Des combats d’arrière garde sont de surcroît engagés pour tenter de contrer l’inscription dans les réglementations européennes des dispositions de la directive n° 96/26 de l’Union européenne qui en reprend les principales dispositions. 2.1. Les critiques contre l’irréalisme des normes de la CIPR Les recommandations de la CIPR n° 60 concernant les travailleurs conduisent à une diminution de la limite annuelle moyenne de dose de 50 à 20 mSv pour les travailleurs. Cette limite est-elle aussi handicapante pour l’industrie que certains commentateurs veulent bien le souligner ? En réalité, comme l’a mis en évidence M. Claude Birraux dans son rapport sur le contrôle de la sûreté de mars 1996, il n’en est rien. Si la CIPR avait continué de prendre comme référence les niveaux de sûreté des industries les plus avancées, c’est en réalité à 10 mSv par an qu’il aurait fallu fixer la limite de dose au-dessus de laquelle le risque résiduel est inacceptable pour les travailleurs, puisque l’on a heureusement assisté à une forte diminution du taux d’accident du travail dans l’ensemble de l’industrie et en particulier dans les industries considérées comme les plus sûres. S’agissant de la limite d’exposition du public, les contempteurs de la CIPR n° 60 font valoir que l’abaissement de la limite de dose est absurde, compte tenu des niveaux de la radioactivité naturelle. A quoi l’on peut rétorquer en premier lieu que la limite de 1 mSv était déjà présente dans la CIPR n° 26 de 1977, comme on l’a vu précédemment. S’il existait une limite de 5 mSv, celle-ci ne s’appliquait en réalité qu’au groupe critique des individus les plus exposés. Autre critique : que signifie une limite de dose pour le public de 1 mSv par an, alors que la radioactivité naturelle est souvent décrite comme étant de l’ordre de 2,4 mSv par an ? En réalité, la réévaluation des coefficients de risque qui ressort des travaux de l’UNSCEAR est un fait établi et incontournable. La CIPR en tient compte comme elle devait le faire. Avec ces nouveaux coefficients, la probabilité de cancer mortel liée à une exposition de 1 mSv sur la vie entière est désormais de 4.10-3 selon les données de 1990 contre 10-3 selon les données de 1977. Pouvait-il y avoir en conséquence entre 1977 et 1990 une diminution de la limite de dose du public ? La réponse est non, bien évidemment. A cet égard, le principe d’optimisation doit entrer en jeu. La dose efficace moyenne délivrée par les rayonnements cosmiques est de 0,39 mSv/an ; celle délivrée par les rayonnements telluriques atteint 0,46 mSv/an, soit au total 0,85 mSv/an. La dose efficace annuelle, due aux radionucléides naturellement présents dans l’organisme, comme le potassium 40, est de l’ordre de 0,23 mSv/an. Hors le radon, le total atteint donc environ la limite de dose pour le public de 1mSv/an recommandée par la CIPR. La fixation par la CIPR n° 60 de la dose limite du public à 1 mSv/an a donc une conséquence précise, en vertu du principe d’optimisation. Un objectif en découle, parmi d’autres : il convient de limiter au maximum, à des coûts économiques et sociaux toutefois acceptables, la teneur de l’air et des eaux souterraines en radon. Réfutant les critiques d’irréalisme des normes de la CIPR n° 60, quelques observateurs dénoncent au contraire le laxisme qu’elle introduirait dans la radioprotection. Est-ce à dire que la CIPR n° 60 représente un recul par rapport aux préconisations antérieures ? A l’appui de ces dires, certains invoquent en premier lieu, l’abandon de la référence aux niveaux de risque des industries les plus sûres au profit d’un critère d’acceptabilité plus flou et en second lieu, la stabilité de la limite de dose du public, alors que le coefficient de risque a notoirement augmenté. Ces différentes critiques ne semblent pas, là non plus, pertinentes. La raison en est qu’un principe fondamental, le principe d’optimisation, est mis au centre de la radioprotection. Pour les expositions professionnelles, ce principe a une portée majeure puisqu’il se résume en la nécessité de définir des processus industriels et des procédures managériales intégrant l’impératif de minimisation des doses auxquelles les travailleurs peuvent être exposés. Pour les expositions du public, il a pour première conséquence que les pouvoirs publics ne peuvent plus se désintéresser de questions essentielles comme la dose d’exposition supplémentaire apportée par les installations nucléaires en leur voisinage puisque les populations sont déjà en moyenne à la limite supérieure de la dose acceptable. Il a pour deuxième conséquence que la question du radon dans les habitations par exemple ne peut plus être considérée comme négligeable. On voit donc que la CIPR n° 60 introduit bien un changement presque copernicien dans le domaine de la gestion des risques entraînés non seulement par la radioactivité artificielle mais aussi par la radioactivité naturelle. Depuis la fin de l’année 1998, le rythme des initiatives dilatoires s’accélère, au fur et à mesure que se rapproche l’échéance de mai 2000 pour l’entrée en vigueur de la directive européenne n° 96/29 qui, au demeurant, reprend les principales conclusions d’une publication, la CIPR n° 60, pourtant connues depuis 1990. Ces initiatives tentent d’exploiter l’article 32 du traité Euratom qui prévoit que " à la demande de la Commission ou d’un Etat membre, les normes de base peuvent être révisées ou complétées suivant la procédure définie à l’article 31 ". Parmi les principaux promoteurs de cette offensive perdue d’avance – la France est définitivement engagée vis-à-vis de l’Union européenne, sauf à déclencher une procédure lourde dont elle n’a pas la maîtrise –, il faut citer des sociétés savantes et des groupes de pression dont on ne sait trop pourquoi ils s’aventurent dans un tel combat d’arrière-garde. Les arguments utilisés ressortissent à deux types. La première catégorie correspond au souci de ne pas effrayer, par un abaissement de la limite d’exposition au-dessous de la dose correspondant à la radioactivité naturelle, une population qui ne saurait échapper à cette dernière et qui pourrait donc nourrir une grande inquiétude du fait de la révision des normes. Une telle sollicitude consistant à refuser au public une protection accrue sous le prétexte de ne pas l’inquiéter, est un schéma classique qui ne peut convaincre. La deuxième catégorie d’arguments correspond à la remise en cause de la courbe dose-effet sans seuil et à l’invocation du mythe du bienfait des faibles doses, c’est-à-dire de l’hormésis. Pas plus que la première catégorie d’arguments, ces considérations ne sauraient retenir l’attention, en raison sinon du principe de précaution, au moins de la nécessité généralisée de diminuer autant que faire se peut l’impact des activités anthropiques sur l’environnement et la santé publique. La nouvelle approche de la radioprotection que recommande la CIPR n° 60 ne peut être efficiente qu’à une condition au demeurant essentielle : la présence d’autorités de radioprotection fortes. Selon la phrase de M. Claude Birraux, " qu’il était simple le temps où l’autorité de radioprotection pouvait limiter son action à vérifier que les limites n’étaient pas dépassées ! Cet heureux temps n’est plus : la CIPR l’a fait s’envoler... ". Pour que le principe d’optimisation soit mis en jeu à tous les stades de la conception, de la réalisation et de l’exploitation, il faut en effet des institutions ayant une stature suffisante pour intervenir avec succès dans la réglementation et le contrôle, au même titre que les autorités de sûreté. Ceci devrait avoir une conséquence majeure dans l’organisation de la sûreté nucléaire et de la radioprotection en cours de définition en France. Non seulement il convient de renforcer l’expertise en radioprotection mais il faut aussi un échelon administratif de réglementation et de contrôle, y compris de coercition, aux pouvoirs étendus. 3. Les points clés de la directive européenne n° 96/29 La directive n°96/29 sur la radioprotection est prise en application du traité Euratom, comme les précédentes directives relatives aux normes de base. Rappelons que le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique (Euratom) indique dans son préambule que " l’énergie nucléaire constitue la ressource essentielle qui assurera le développement et le renouvellement des productions et permettra le progrès des œuvres de paix " mais qu’il est tout de même nécessaire " d’établir les conditions de sécurité qui écarteront les périls pour la vie et la santé des populations ". Parmi les missions qui lui sont dévolues par l’article 2 du traité, Euratom doit " établir des normes de sécurité uniformes pour la protection sanitaire de la population et des travailleurs et veiller à leur application". Tableau 3 : Article 30 du traité Euratom Des normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des radiations ionisantes sont instituées dans la Communauté. On entend par normes de base : a) les doses maxima admissibles avec une sécurité suffisante, b) les expositions et contaminations maxima admissibles, c) les principes fondamentaux de surveillance médicale des travailleurs. Selon l’article 33, " chaque Etat membre établit les dispositions législatives, réglementaires et administratives propres à assurer le respect des normes de base fixées (...) ". Deux autres articles présentent une grande importance en matière de répartition des pouvoirs entre les Etats membres et la Commission, dans le domaine de la protection sanitaire. Il s’agit en premier lieu de la responsabilité des mesures de la radioactivité dans l’environnement, visée à l’article 35. Tableau 4 : Article 35 du traité Euratom Chaque Etat membre établit les installations nécessaires pour effectuer le contrôle permanent du taux de la radioactivité de l’atmosphère, des eaux et du sol, ainsi que le contrôle du respect des normes de base. La Commission a le droit d’accéder à ces installations de contrôle ; elle peut en vérifier le fonctionnement et l’efficacité. Il s’agit par ailleurs de l’article 37 comportant obligation de déclaration des projets de rejets radioactifs dans l’environnement. Tableau 5 : Article 37 du traité Euratom Chaque Etat membre est tenu de fournir à la Commission les données générales de tout projet de rejet d’effluents radioactifs, sous n’importe quelle forme, permettant de déterminer si la mise en œuvre de ce projet est susceptible d’entraîner une contamination radioactive des eaux, du sol ou de l’espace aérien d’un autre Etat membre. La Commission, après consultation du groupe d’experts visé à l’article 31, émet son avis dans un délai de six mois.
Le traité Euratom dans son article 31 prévoit une procédure précise pour la fixation des normes de base. Tableau 6 : Article 31 du traité Euratom Les normes de base sont élaborées par la Commission, après avis d’un groupe de personnalités désignées par le Comité scientifique et technique parmi les experts scientifiques des Etats membres, notamment parmi les experts en matière de santé publique. La Commission demande, sur les normes de base ainsi élaborées, l’avis du Comité économique et social. Après consultation du Parlement européen, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission qui lui transmet les avis des Comités recueillis par elle, fixe les normes de base. Les normes sont élaborées par la Commission après le double avis d’experts désignés par le Comité scientifique et technique et du Comité économique et sociale. Mais elles sont fixées par le Conseil des ministres. Dans le processus d’élaboration des normes mais aussi dans le résultat terminal, l’influence de la CIPR dépasse de loin celle des instances consultatives dont l’intervention est prévue dans le traité. On trouvera au tableau suivant, les sources des directives sur les normes de base les plus récentes, sources qui sont les publications de la CIPR. Tableau 7 : correspondance des directives et des publications de la CIPR
Au demeurant, la directive n° 96/29 fait explicitement référence aux travaux de la CIPR dans un considérant selon lequel " du fait de l’évolution des connaissances scientifiques en matière de radioprotection, reflétée notamment par la recommandation n° 60 de la Commission internationale de protection, il convient de réviser les normes de base et d’établir un nouvel instrument juridique ". La portée de la directive n° 96/29 ne peut se réduire au changement des limites de doses d’exposition, aussi important soit-il. Cette directive introduit en effet des problématiques nouvelles tant aux plans scientifique que technique. L’une des particularités de la directive n° 96/29 est d’élargir considérablement le champ couvert par les directives précédentes n° 80/836 et 84/467. Au-delà de la radioprotection des travailleurs et du public dans le cadre d’activités utilisant des sources radioactives pour leurs propriétés, la nouvelle directive porte aussi sur certaines activités professionnelles exposant de façon non négligeable à des sources naturelles de rayonnement et sur les interventions en cas de situations d’urgence radiologique. Elle inclut le cas des travailleurs indépendants. La directive opère par ailleurs des distinctions plus nettes que les précédentes versions sur certains points importants. C’est ainsi le cas pour les sources naturelles de rayonnement qui sont traitées à part. C’est également le cas pour les notions d’entrée ou de sortie du système. La directive n° 96/29 réaffirme les principes de base auxquels doivent obéir les systèmes de protection radiologique applicables aux pratiques. Ces trois principes sont, comme on peut s’y attendre, conformes à ceux énoncés par la CIPR n° 60. Il s’agit en premier lieu du principe de justification de l’exposition, en vertu duquel toute nouvelle catégorie ou tout nouveau type de pratique entraînant une exposition à des rayonnements ionisants soient, avant leur première adoption ou leur première approbation, " justifiés par leurs avantages économiques, sociaux ou autres par rapport au détriment sanitaire qu’ils sont susceptibles de provoquer " (article 6). Ce principe est d’une portée considérable. Il ouvre en réalité le champ à toute contestation d’autorisations de rejets qui ne pourraient trouver une justification économique claire. Certes, le chiffrage du détriment sanitaire est complexe, en particulier en l’absence d’études épidémiologiques solides. Mais on peut considérer que ce principe renforce et traduit juridiquement le principe de précaution ainsi que le droit des générations présentes et futures à un environnement sain. Le deuxième principe est lui aussi fort important, comme l’ont amplement montré les réflexions de la CIPR n° 60 (voir plus haut). Il s’agit du principe d’optimisation. En réalité, la directive ne semble pas tirer avec autant de détails que la CIPR n° 60, toutes les conséquences de ce principe. L’optimisation est même considérée comme un contexte. L’alinéa a) du paragraphe 3 de l’article 6 indique en effet : " Chaque Etat membre veille, en outre, à ce que (...) dans le contexte de l’optimisation, toutes les expositions soient maintenues au niveau le plus faible raisonnablement possible, compte tenu des facteurs économiques et sociaux ". Le principe ALARA auquel il est implicitement fait référence est un principe qui guide évidemment les opérateurs du nucléaire. Mais, d’un point de vue juridique, l’expression " compte tenu des facteurs économiques et sociaux " n’a pas de contenu. Il semble donc difficile d’estimer qu’une disposition interne à une entreprise du secteur nucléaire contreviendrait au principe d’optimisation par référence à cette notion imprécise. En outre, la directive, par essence, laisse aux Etats membres le choix de la forme et des moyens pour atteindre le résultat prescrit. Logiquement, elle ne fournit donc aucune norme concernant l’organisation des institutions chargées de la radioprotection. L’esprit de la CIPR n° 60 ne trouve donc à ce niveau aucune traduction juridique. 3.2.3. L’exclusion de la radioactivité naturelle pour le public Dans son article 2, la directive n° 96/29 exclut de son champ d’application l’exposition au radon dans les habitations et le niveau naturel du rayonnement. De ce fait, les radionucléides contenus dans l’organisme humain, le rayonnement cosmique régnant au sol et l’exposition en surface aux radionucléides présents dans la croûte terrestre " non perturbée " ne sont pas pris en compte. Deux remarques doivent être faites à cet égard. La première est qu’une certaine imprécision est laissée pour ce qui est du rayonnement cosmique. En effet l’article 42 se penche sur la protection du personnel naviguant susceptible de subir une exposition supérieure à 1 mSv par an et appelle les entreprises à prendre des mesures de radioprotection appropriée. On pourrait donc considérer, reconnaissance étant faite de l’importance de ces rayons cosmiques, que la porte est ouverte à une prise en compte pour le public de ces rayonnements en altitude et en particulier dans les transports aériens. La deuxième remarque est qu’il paraît regrettable que des normes n’aient pas été fixées en ce qui concerne le radon pour les habitations. Ce sont les nouvelles limites de dose qui semblent constituer l’innovation majeure de la directive n° 96/29. Si d’autres changements importants sont également introduits par cette dernière, il faut néanmoins convenir que les nouvelles normes de base représentent une nouveauté. On trouvera au tableau suivant ces nouvelles valeurs. Tableau 8 : Limites de doses efficaces figurant dans la directive n° 96/29
Ainsi, par rapport aux directives antérieures n° 80/836 et 84/467, la directive n° 96/29diminue la limite de dose efficace pour les travailleurs exposés de 50 mSv par an à 100 mSv sur 5 années consécutives, à condition que la dose efficace ne dépasse pas 50 mSv au cours d’une année quelconque. Par ailleurs, pour autant qu’ils respectent la limite de 100 mSv sur 5 années consécutives, les Etats membres peuvent fixer une quantité annuelle. Dans ce cas, la limite de dose efficace serait de 20 mSv par an. Quant à la limite de dose efficace pour le public, elle passe de 5 mSv à 1 mSv par an. Toutefois, dans des circonstances particulières, une dose plus élevée peut être autorisée pendant une année quelconque, à condition que la moyenne sur 5 années consécutives ne dépasse pas 1 mSv par an. Compte tenu de la précision des indications données par la directive, il serait évidemment illusoire de spéculer sur une remise en cause des limites prescrites, d’autant que la possibilité de calculer les limites en valeurs moyennes permet une souplesse accrue dans la gestion des expositions. 3.2.5. Le concept de dose efficace pour chaque radionucléide Les normes de base sont traditionnellement exprimées en limites des doses d’exposition. Or ces valeurs ne sont pas mesurables directement. Il faut donc les traduire dans d’autres grandeurs qui puissent, elles, faire l’objet de mesures en vue des contrôles. La directive n° 80/836 résolvait cette question d’une manière aisément compréhensible et de surcroît très concrète. Des limites d’exposition externe étaient fixées pour le corps entier et la peau, et moyennant l’utilisation des facteurs de qualité des rayonnement, il était possible de comparer les mesures issues des dosimètres avec les limites de la réglementation. Pour les expositions internes, la directive prévoyait en premier lieu l’utilisation de limites secondaires, les limites d’incorporation annuelles pour les différents radioéléments. En second lieu, et pour faciliter encore le respect de la réglementation, des limites dérivées étaient proposées en termes de concentration des radioéléments, dans l’air, dans l’eau et dans les aliments. La nouvelle directive n° 96/29 rompt avec cette approche concrète. Elle donne en effet une place centrale et exclusive au concept de dose efficace. A cet effet, elle définit des valeurs des facteurs de pondération radiologique pour les rayonnements WR et des facteurs de pondération tissulaires WT. Bien entendu, la dose externe et la dose interne sont évaluées séparément. Pour le calcul de la dose externe, la directive prévoit la séquence suivante : énergie moyenne communiquée par le rayonnement ionisant u dose absorbée à l’organe u dose équivalente par intégration des effets des différents rayonnements u dose efficace par intégration des différents tissus ou organes. La directive recommande les valeurs des profondeurs dans le tissu ou l’organe auxquelles les estimations des énergies doivent être faites. Pour les expositions internes, la démarche proposée par la directive est nouvelle. Le principe est d’indiquer pour chaque radioélément les valeurs des doses efficaces engagées par unité d’incorporation exprimées en Sv/Bq que l’on multiplie ensuite aux incorporations exprimées en Bq qui représentent l’activité introduite dans le corps. Ceci vaut aussi bien pour l’ingestion que pour l’inhalation. Il faut remarquer que les valeurs des doses efficaces engagées sont données par groupe d’âge. En outre, la directive introduit pour chaque radioélément des facteurs de transit intestinal pour l’ingestion et des facteurs de rétention pulmonaire pour l’inhalation, facteurs eux aussi variables selon l’âge de l’individu. Si au plan scientifique cette approche est plus rigoureuse que la précédente, en revanche, elle est moins lisible. Ceci conduit la Commission à indiquer que des limites annuelles d’incorporation peuvent être, le cas échéant, dérivées par calcul des coefficients de dose et des limites de dose correspondantes. Deux mécanismes fondamentaux mais toutefois optionnels sont proposés par la directive n° 96/29. Il s’agit en premier lieu de la notion de seuils d’exemption et en second lieu de celle de seuils de libération. La directive propose au tableau 1 de son annexe I une liste de valeurs d’activités totales en Becquerels et d’activités massiques en kiloBecquerels par kilogramme pour différents radionucléides en dessous desquelles les Etats membres peuvent décider de supprimer l’obligation de déclaration. Le tableau suivant présente quelques valeurs pour des radionucléides significatifs. Tableau 9 : Seuils d’exemption pour différents radionucléides
Compte tenu du fait que l’exemption de déclaration peut porter sur un grand nombre de pratiques – production, traitement, détention, stockage, transport –, on conçoit que cette ouverture vers la banalisation de produits soit laissée à l’appréciation des Etats Membres. Les seuils de libération, quant à eux, sont une autre possibilité donnée par la directive aux Etats membres de fixer des valeurs en concentration d’activité et/ou en activité totale, auxquelles ou en dessous desquelles des substances radioactives soumises à l’obligation de déclaration ou d’autorisation peuvent être dispensées de se conformer aux exigences de la directive. La question des seuils de libération est particulièrement importante dans le cas des déchets nucléaires d’activité réduite, et en particulier pour les ferrailles ou les gravats générés par le démantèlement des installations nucléaires. Grâce à ce mécanisme, des matériaux pourraient être autorisés à quitter le circuit spécifique et étanche des matières nucléaires pour rentrer sur les marchés traditionnels. On conçoit bien que cette possibilité soit laissée à l’appréciation des Etats. En réalité, il se pourrait au contraire que les différences de politique mises en œuvre dans les différents Etats posent des problèmes de compatibilité insurmontables, dans la mesure où des matériaux banalisés dans un pays pourraient ultérieurement être transférés dans un autre pays n’appliquant pas de seuils de libération. Une telle difficulté devra probablement être tranchée au niveau communautaire. II – Etat d’avancement de la transposition Comme l’indiquent les traités de l’Union européenne, les directives arrêtées par le Conseil et la Commission, lient tout Etat membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens. On considèrera donc dans la suite d’une part l’organisation mise en place pour assurer la préparation des textes de transposition de la directive, d’autre part les résultats déjà obtenus et enfin les difficultés qui restent à résoudre. 1. L’organisation mise en place pour la transposition
Pour assurer la transposition de la directive n°96/29 du 13 mai 1996, un comité interministériel de transposition d’une trentaine de personnes a été mis en place le 19 décembre 1996 sous la direction conjointe de la Direction générale de la santé et de la Direction des relations du travail du ministère de l’emploi et de la solidarité. Le comité interministériel de transposition comprend les ministères suivants : industrie, environnement, transport, défense, agriculture, recherche, intérieur, économie. Il bénéficie également du concours de l’OPRI et de l’IPSN. Un groupe de pilotage comprenant un représentant de la DGS, de la DRT, de l’OPRI et d’IPSN est chargé de préparer les travaux du comité. Le secrétariat du comité interministériel est assuré par le Bureau de radioprotection de la Direction générale de la Santé. La directive n° 96/29 est apparue rapidement à l’administration française comme remettant en cause un nombre très important de textes. La solution d’une simple mise à jour a donc été écartée rapidement au profit d’une refonte complète de la réglementation. Des travaux du comité interministériel, il ressort que cinq textes devront être mis au point selon le schéma ci-après. Figure 2 : Architecture juridique des textes de transposition de la directive n°96/29
La solution jusqu’à présent retenue pour la forme juridique des différents textes est celle de cinq décrets. Le débat sur cette question est suffisamment important pour qu’on puisse encore le considérer comme ouvert. En concurrence avec l’idée de cinq décrets, se trouve l’hypothèse d’une loi établissant les principes de la protection contre les rayonnements, à laquelle renverraient quatre décrets d’application. Différents arguments juridiques forts appuient cette solution. Le premier est qu’en l’état actuel des choses, les textes actuels relatifs à la protection contre les rayonnements ionisants sont ancrés à la loi n° 61-842 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique, à la loi n° 64-1245 relative à la lutte contre la pollution des eaux et aux dispositions législatives des codes de la santé et du travail. Or cet ancrage est considéré fragile par de nombreux juristes. Par ailleurs, la directive n° 96/29 doit se traduire par des dispositions relatives aux travailleurs indépendants, qui sont du ressort de la loi. Certaines interdictions ou restrictions d’activité ne pourront également être édictées que par ce truchement. Bien évidemment, les modifications législatives nécessaires pourraient être incluses dans une loi de type DMOS. Mais on peut penser qu’une telle démarche manquerait de solennité et de visibilité. La date du 13 mai 2000 constitue, selon la directive, un butoir pour l’entrée en vigueur des dispositions législatives, réglementaires et administratives de transposition. Le recours à un texte législatif, avec ses délais incompressibles pourrait sembler contradictoire avec l’urgence qui caractérise désormais le dossier de transposition. En réalité, il conviendrait au contraire de tirer parti des projets actuels en matière nucléaire pour accélérer d’un coup deux processus. L’absence de texte législatif général sur le nucléaire a été une règle pendant de longues années en France, une situation à laquelle la loi n°91-1381du 30 décembre 1991 relative aux recherches sur la gestion des déchets radioactifs a heureusement mis fin. Une nouvelle étape doit être franchie avec l’examen début 2000 puis l’adoption du projet de loi relatif à la transparence en matière nucléaire, à la sûreté nucléaire et à la protection contre les rayonnements ionisants. Ce projet de loi est en cours de finalisation. Il pourrait être opportun d’y inclure les principes généraux de la protection contre les rayonnements ionisants tels qu’ils doivent être transcrits dans notre droit, à partir de la directive n° 96/29. L’engagement politique fort pris pour le texte relatif à la transparence pourrait accélérer un processus de transposition, dont certains ministères notent qu’il a une tendance fâcheuse à s’enliser. De surcroît, il serait incompréhensible sur un plan politique de demander au Parlement d’adopter un projet de loi sur la transparence en matière nucléaire, la sûreté nucléaire et la protection contre les rayonnements ionisants, alors qu’au même moment, des décisions fondamentales concernant les principes généraux de la radioprotection seraient prises par décret. La directive n° 96/29 donne certaines marges d’appréciation aux Etats pour la transcription de ses dispositions en droit interne. Il ne semble pas opportun de tirer parti de ces marges de manœuvre pour alléger les contraintes de radioprotection. Ainsi qu’il a été vu plus haut, la directive prévoit des limites annuelles de dose efficace, avec toutefois des possibilités de moyenner les doses réelles pour se conformer à la réglementation en cas d’événements particuliers. Pour le public, la limite d’exposition est de 1 mSv / an, avec la possibilité d’un dépassement sur une année, à condition que la moyenne annuelle sur 5 années ne dépasse pas 1 mSv. Il s’agit d’une complication inutile et au surplus démobilisatrice. Pour les travailleurs, la norme est fixée à 100 mSv sur 5 ans, à condition que la dose efficace ne dépasse pas 50 mSv au cours d’une année quelconque. Il paraît là aussi préférable et pour les mêmes raisons d’adopter une norme annuelle de 20 mSv à ne dépasser en aucun cas. La directive donne la possibilité par ailleurs aux Etats membres de calculer, en fonction des doses efficaces engagées qu’elle communique, des limites d’incorporation annuelles (LIA). Ces limites qui figuraient dans les directives précédentes 80/836 et 84/467, se sont révélées très commodes pour la radioprotection appliquée. Il est souhaitable que dans les textes de transposition figurent les limites dérivées recalculées en fonction des nouveaux résultats relatifs aux facteurs de pondération radiologique, de pondération tissulaire, de transit intestinal et de rétention pulmonaire. La directive prévoit par ailleurs pour la détermination des seuils d’exemption, des valeurs en activité totale exprimées en Becquerel ou bien des activités massiques exprimées en kiloBecquerel par kilogramme soit en Becquerel par gramme. Deux questions se posent à cet égard. Quelles sont les possibilités offertes par la directive ? Et au final, dans quelle mesure faut-il introduire des seuils d’exemption dans notre réglementation ? Le choix entre les deux indicateurs de l’activité totale et de l’activité massique est donné par la directive. En réalité, on voit bien qu’il est indispensable d’utiliser les deux et de conditionner l’exemption au respect des deux normes. Toute autre solution exposerait au risque majeur de dilution des matières radioactives, afin de passer sous le seuil d’exemption. En outre, la Commission dans un commentaire de la directive avait spécifié que l’exemption ne devait porter que sur des quantités inférieures à 1 tonne. Cette précision devrait être intégrée à toute réglementation. La directive fixe par ailleurs des seuils d’exemption par radioélément. Ceux-ci devront être fixés d’une manière telle qu’ils aboutissent à des contraintes plus fortes que celles découlant de la réglementation actuelle, quel que soit le scénario d’impact. La directive européenne donne également la possibilité aux Etats de prévoir un seuil de libération mais ne leur en donne pas l’obligation. Plusieurs options sont possibles. La première option est celle de l’introduction effective de seuils de libération. L’inconvénient majeur est que, dans la pratique, c’est aux producteurs de déchets qu’il reviendra de décider si des matériaux radioactifs peuvent être banalisés. On pourrait imaginer de mettre en place des contrôles assortis de fortes amendes en cas de non respect des seuils. Cette solution introduirait le risque de voir certains producteurs diluer leurs déchets afin de pouvoir les évacuer à moindres coûts en les banalisant. Face aux inconvénients et aux risques sanitaires de dilution et de dissémination de matériaux faiblement radioactifs, quel pourrait être l’avantage d’un système de libération ? Ce serait essentiellement de faciliter le recyclage. Mais le recyclage n’est pas automatiquement la meilleure des solutions en matière de gestion de déchets. Pour le ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement, " le recyclage est une référence trop absolue ". La raison en est que les études économiques de fond manquent cruellement en ce domaine. Les coûts du recyclage sont souvent sous-estimés. En particulier les études d’impact des toxiques, radioactifs ou chimiques, même pour les faibles quantités infinitésimales qui pourraient être présentes dans les matériaux recyclés, sont insuffisantes. Par ailleurs, il n’est pas sûr que l’économie de matières premières soit significative pour des déchets de type ferrailles ou gravats qui représenteront la plus grande part des déchets de très faible activité issus du démantèlement. Inversement, on manque aussi de références en matière de coûts de stockage à long terme, notamment pour les déchets TFA provenant du démantèlement. En tout état de cause, l’argument de l’intérêt économique du recyclage doit être écarté pour justifier la mise en place de seuils de libération dont l’impact psychologique serait vraisemblablement désastreux. La deuxième option ouverte la directive est celle du refus pur et simple de prévoir des seuils de libération. Cette solution est la bonne. Il convient de subordonner à une autorisation toute sortie de matériaux radioactifs à l’extérieur du périmètre des installations nucléaires. La responsabilité du producteur de déchets doit être entièrement conservée. Celui-ci doit avoir la charge de trouver un exutoire approprié. De plus, il doit assurer la traçabilité de ses déchets. Corrélativement, un stockage doit être prévu pour tous les types de déchets radioactifs, quel que soit leur activité, avec des filières de gestion mises en place pour chacun d’entre eux. 2.2.4. La stratégie concentration/rétention contre la stratégie dilution/dispersion La directive n° 96/29 traite des principes généraux de la protection contre les rayonnements ionisants et ne comprend pas de développements particuliers pour les déchets radioactifs. Toutefois, en raison de la politique de la Commission européenne fondée sur le traité Euratom et en raison de la CIPR n°77, il convient d’aborder la question fondamentale des avantages et des inconvénients respectifs de la stratégie dilution/dispersion et de la stratégie concentration/rétention et de prendre position sur cette question fondamentale pour l’avenir immédiat ou lointain. Ainsi que cela a été noté plus haut, l’article 35 du traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique (Euratom), confère à la Commission le droit d’accéder aux installations de contrôle de la radioactivité dans l’environnement et d’en vérifier le fonctionnement et l’efficacité. En vertu de l’article 37, les Etats membres sont tenus de fournir à la Commission les données générales de tout projet de rejet d’effluents radioactifs, permettant de déterminer si la mise en œuvre du projet est susceptible d’entraîner une contamination radioactive des eaux, du sol ou de l’espace aérien d’un autre Etat membre. Bien que les textes soient précis et ne donnent pas à la Commission des pouvoirs de contrôle direct, il faut noter une interprétation extensive de sa part des dispositions de protection sanitaire. Cette pression se matérialise par des recommandations qui ne sont certes pas contraignantes mais qui sont difficiles à contester sur un plan politique. Compte tenu de l’évolution des positions de l’Allemagne et de la Belgique, sans parler de la Suède, vis-à-vis du nucléaire, il serait irréaliste de penser que la pression de la Commission faiblisse dans les prochaines années, bien au contraire. Or, simultanément, il semble que, pour des raisons difficiles à percer, la CIPR, par certaines dispositions de sa publication n° 60 mais surtout par certains raisonnements de sa publication n° 77, introduise une certaine confusion dans les concepts opératoires de la protection contre les rayonnements ionisants et de ce fait donne l’impression que l’on peut baisser la garde dans le domaine de la radioprotection. Si la CIPR a raison de considérer les rejets comme des déchets, elle ne peut être approuvée quand elle dresse un parallélisme entre la dilution/dispersion et la concentration/rétention, fondé sur la notion d’exposition potentielle. La CIPR a raison de noter que le calcul de l’exposition potentielle est particulièrement difficile en matière de déchets radioactifs, comme on l’a vu plus haut, compte tenu du fait que les périodes à couvrir sont de plusieurs centaines, voire de milliers d’années. La commodité que souligne la CIPR de ne pas avoir à calculer d’exposition potentielle dans le cas des rejets, puisque l’on est censé connaître l’exposition du groupe critique, n’en est pas une en réalité. En effet, les processus de reconcentration dans l’environnement sont mal connus, de même que l’impact à long terme des faibles doses. Quant à la difficulté de calculer l’exposition potentielle en cas d’intrusion ou de rupture du confinement pour les déchets, elle est réelle mais elle ne tient pas compte de l’effectivité de la surveillance qui permet de réduire l’exposition réelle à des niveaux très bas. La notion d’exposition potentielle n’est donc pas, au total, une notion opérationnelle et rigoureuse. On ne peut comparer en effet un système clos de gestion des déchets avec un système ouvert qui érige la sortie, même après dilution, en moyen de fonctionnement. En réalité, la France a signé comme on l’a vu plus haut le 24 juillet 1998 l’accord de Sintra de concert avec les 14 autres pays signataires de la convention de Paris pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est (convention OSPAR). Il ne saurait y avoir d’alternative à la marche, déjà bien entamée, vers ce que l’on appelle communément les " rejets zéro ". La transposition de la directive oblige à l’évidence à des choix politiques. Il convient en conséquence d’y associer le Parlement. Par ailleurs, il est important que le présent rapport soit complété d’une part par une étude spécifique de la radioprotection des travailleurs du nucléaire, et, d’autre part, par une étude détaillée des conditions du démantèlement dans le domaine de la radioprotection. Chapitre 2 : L’évolution souhaitable du dispositif de surveillance des conséquences des déchets nucléaires sur la santé publique La création de l’Institut de Veille Sanitaire (IVS), en application de la loi de juillet 1998 sur la sécurité sanitaire, offre pour la première fois en France, la possibilité de conduire des études systématiques des effets des rayonnements ionisants artificiels sur la santé humaine, notamment autour des installations nucléaires, et en particulier autour des installations de stockage des déchets radioactifs. En réalité, les efforts consentis dans le domaine médical par le secteur nucléaire ont été depuis l’origine affectés en priorité à la protection des travailleurs du nucléaire. Certes, la France dispose depuis quelques années de registres du cancer. Mais il s’est agi d’initiatives louables, prises au niveau local pour palier les manques de l’Etat, et comme telles, manquant tout à la fois de moyens et de coordination. D’autres signes corroborent la faiblesse relative des préoccupations de santé, comme par exemple la disparité des moyens administratifs affectés d’une part au contrôle de la sûreté des installations nucléaires et d’autre part au contrôle de l’environnement et de la santé publique. L’absence d’une politique déterminée de suivi sanitaire des populations exposées aux rejets des installations nucléaires a même pu faire dire que les mesures effectuées dans l’environnement ont comme finalité première la surveillance du bon fonctionnement des installations. Or il semble que la France soit, dans le domaine des études épidémiologiques, à un moment stratégique où existent de réelles possibilités de progrès. En tout état de cause, un point doit être fait sur la situation de départ des moyens investis dans les études et la protection de la santé, en relation avec les installations nucléaires. On verra ensuite quels sont le statut, les missions et les moyens de l’IVS, ainsi que sa place dans le nouveau dispositif de santé. Dès lors, il sera possible d’estimer les conditions d’un progrès significatif des connaissances dans le domaine de la radioprotection et dans les mesures concrètes à modifier ou à prendre. I – Les potentialités de la nouvelle organisation française de sécurité sanitaire pour l’épidémiologie
La nouvelle organisation de la santé en France définie par la loi n°98-535 du 1er juillet 1998 constitue une avancée, dont on peut mesurer l’importance à propos de la surveillance des installations nucléaires, en particulier pour celle des installations de stockage des déchets nucléaires. La loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 définit une nouvelle organisation administrative tendant à renforcer la sécurité sanitaire des produits destinés à l’homme. Pour ce faire, une approche globale est adoptée, incluant la veille sanitaire et englobant également, à terme, l’environnement comme élément de la santé. L’Institut de veille sanitaire, créé à l’article 2, est un établissement public de l’Etat, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé. Sa mission (voir plus loin) est d’effectuer la surveillance de l’état de santé de la population, d’alerter les pouvoirs publics en cas de menace sur la santé publique et d’identifier les causes d’une modification de cet état de santé. L’Agence de sécurité sanitaire des produits de santé créée à l’article 6 est un établissement de l’Etat, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé. L’agence participe à l’application des lois et règlements relatifs aux médicaments, procède à l’évaluation des bénéfices et risques liés à leur utilisation, informe les associations de patients et les usagers sur les problèmes de sécurité sanitaire des produits de santé, contrôle la publicité sur ceux-ci et prend ou demande aux autorités compétentes de prendre les mesures de police sanitaire. L’Agence française de sécurité sanitaire des aliments créée par l’article 9 est un établissement public de l’Etat, placé sous la tutelle des ministres chargés de la santé, de l’agriculture et de la consommation. Sa mission est de contribuer à assurer la sécurité sanitaire dans le domaine de l’alimentation en évaluant les risques sanitaires et nutritionnels que peuvent présenter les aliments destinés à l’homme et aux animaux. La loi du 1er juillet 1998 crée enfin l’Etablissement français du sang, établissement public de l’Etat, chargé de gérer le service public transfusionnel dans le strict respect de l’éthique médicale. La loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 a pour objectif d’accroître la sécurité sanitaire dans notre pays, en s’appuyant sur un nouveau type d’organisation. Le principe de celle-ci est celui d’une décentralisation fonctionnelle, correspondant au souci de l’Etat de conférer l’autonomie administrative à plusieurs de ses activités. Plusieurs avantages en sont attendus. S’agissant de l’Agence de sécurité sanitaire des produits de santé, l’autonomie acquise permettra une gestion plus souple et le recrutement de spécialistes de haut niveau dans le cadre de contrats à durée limitée, tandis que des ressources pourront être tirées de la participation de l’industrie au financement de l’évaluation des médicaments. La création de l’Etablissement français du sang correspond, quant à elle, à la nécessaire reprise en main par l’Etat du service public transfusionnel après les fautes du système précédent. Mais la création des agences correspond aussi à la nécessité générale de séparer l’expertise de la décision, en recourrant à l’externalisation de l’expertise, celle-ci pouvant de surcroît s’approfondir avec davantage d’autonomie. En toute hypothèse, il est particulièrement utile de renforcer l’indépendance de l’expertise au travers de la création d’agences, alors que les conflits d’intérêt sont légion en matière de santé publique. L’administration qui conserve l’apanage des décisions lourdes se trouvera d’autant mieux protégée de l’influence des groupes de pression. 1.3. L’annonce récente de la création d’une Agence de sécurité sanitaire de l’environnement L’article 13 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 précise que " dans un délai de 6 mois suivant la date de promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité et la faisabilité de la création d’une Agence de sécurité sanitaire de l’environnement ". Le rapport de Mme Odette Grzegrzulka, Députée de l’Oise et de M. André Aschieri, Député des Alpes-maritimes, préconisait la création d’un tel organisme. Devant les Etats généraux de la santé, le Premier ministre, M. Lionel Jospin, a en conséquence annoncé le 30 juin 1999, la création de l’Agence Santé Environnement. Il faut noter le pragmatisme de l’approche adoptée par la loi du 1er juillet 1998 relative au " renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l’homme ". Selon l’article 3 de cette loi, le Gouvernement devait remettre au Parlement, dans un délai d’un an suivant la promulgation, un rapport ayant pour objet de proposer la restructuration des organismes de droit public propre à éviter une confusion des missions et la dispersion des moyens de la veille sanitaire. Par ailleurs, l’article 30 de la loi du 1er juillet 1998, prévoit qu’elle fera l’objet, " après évaluation de son application par le Gouvernement et par l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, d’un nouvel examen par le Parlement dans un délai maximum de cinq ans après son entrée en vigueur ". Les moyens sont donc donnés de jauger la réalité des progrès escomptés dans la veille sanitaire, après qu’une durée suffisante aura permis au nouveau système de se mettre en place et de fonctionner en régime permanent. L’Institut de Veille Sanitaire, successeur du Réseau national de santé publique, se voit aujourd’hui confier une tâche essentielle pour l’étude des conséquences des installations de stockage des déchets nucléaires sur la santé publique. Créé en 1992, le Réseau national de santé publique (RNSP) était un groupement d’intérêt public, ayant pour mission générale de développer et de coordonner la surveillance épidémiologique et l’investigation des phénomènes épidémiques ou d’urgence sanitaire. Son mode d’action privilégié était de fédérer des structures de recherche, des structures universitaires et des services de l’Etat, des observatoires généraux de la santé et des services d’épidémiologie des conseils généraux. Au-delà de la mise en commun des informations et du partage des tâches, il s’agissait aussi de séparer l’évaluation, dévolue au RNSP, et la décision, prérogative des pouvoirs publics. Des objectifs scientifiques ont également été assignés au RNSP, comme le renforcement du dispositif d’information sanitaire en santé environnementale, le développement d’une expertise sur l’évaluation et la gestion des risques en situation d’urgence ou de chronicité, le développement d’une recherche opérationnelle orientée vers la définition et la validation de critères sanitaires de décision en santé environnementale et la mise au point d’indicateurs de santé publique pouvant être corrélés avec des indicateurs d’environnement. L’activité du RNSP démarra véritablement en 1994, avec un budget atteignant une masse critique de 14 millions de francs lui permettant d’engager des actions fortes. Les acquis du RNSP furent assez importants pour que non seulement sa pérennité mais aussi son renforcement soient recherches au travers de sa transformation en Institut de Veille Sanitaire. L’exemple de l’efficacité en matière d’études épidémiologiques est donné par les pays scandinaves et par les pays anglo-saxons. Une étude des leucémies infantiles autour d’installations nucléaires telle que celle conduite dans le Nord-Cotentin y serait extrêmement facile. La transposition d’une telle étude dans le contexte de la Norvège – un cas hautement hypothétique puisque ce pays ne possède pas d’installations nucléaires – permet de mieux cerner les différences institutionnelles et au-delà, les disparités de référents culturels. Un fichier national des naissances existe en Norvège. Le repérage des individus dès leur naissance est donc possible. Un fichier des habitations permet par ailleurs d’enregistrer tous les déménagements. Un fichier national des cancers et des tumeurs est également disponible. Le croisement entre tous ces fichiers s’effectue avec un numéro d’identification individuel unique. Le cas de la Norvège n’est pas unique. Le Royaume-Uni donne un autre exemple d’efficacité avec ses " Small Area Health Statistic Units (SAHSU)", ou unités locales de statistiques sur la santé qui commencent à être mises en place dans ce pays. Ces unités listent les données géographiques, démographiques, sanitaires de la zone et y ajoutent les sources de pollution. Grâce à des outils informatiques, la détection de toute anomalie de santé est rapide et peut déboucher sur des enquêtes de terrain ciblées et rigoureuses. De par la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998, l’Institut de veille sanitaire est chargé 1° " d’effectuer la surveillance et l’observation permanente de l’état de santé de la population (...) " 2° " d’alerter les pouvoirs publics, notamment l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et l’Agence française de sécurité sanitaire des aliment, en cas de menaces pour la santé publique, quelle qu’en soit l’origine, et de leur recommander toute mesure ou action appropriée " 3° " de mener à bien toute action nécessaire pour identifier les causes d’une modification de l’état de santé de la population, notamment en situation d’urgence ". Les effectifs de l’Institut de veille sanitaire devraient augmenter de 30 personnes en 1999 pour atteindre une centaine de personnes à la fin de l’année, l’objectif étant fixé à 200 agents à la fin 2000. L’institut comprend 5 départements techniques. Le premier se consacre aux maladies transmissibles (surveillance, investigation, alerte). Le deuxième a pour mission la surveillance des risques environnementaux et professionnels. Le troisième se concentre sur les maladies chroniques et le suivi des grandes politiques de santé publique (cancer, maladies cardiovasculaires, maladies nutritionnelles, traumatismes accidentels et suicides). Le quatrième département est un département technique à qui est confié le développement de systèmes d’information et d’outils informatiques. Le cinquième département est celui des programmes européens, chargé en particulier de la coopération sur les maladies infectieuses et les effets de la pollution atmosphérique. Selon son directeur général, l’Institut de veille sanitaire peut être considéré comme une " tête de réseau disposant d’une masse critique d’expertise " et assurant la fédération d’opérateurs diversifiés par la standardisation et l’évaluation de l’information. Comment assurer à l’IVS un financement suffisant pour atteindre ses objectifs de suivi sanitaire des populations ? Différentes pistes existent. A court terme, la cohérence avec les nouveaux objectifs de prévention veut que la loi de financement de la sécurité sociale prévoie des crédits pour des études et recherches, en particulier dans le domaine de la veille sanitaire. Il serait également logique que la future écotaxe contribue au financement de l’IVS. 2.4. Les rapports de l’IVS avec les autres institutions de santé L’Institut de veille sanitaire n’est pas l’opérateur de tous les programmes et au contraire travaille avec une série d’administrations ou d’organismes divers que l’on peut classer en trois cercles. Le premier cercle est celui des services déconcentrés du ministère chargé de la santé, inspections de la santé, services d’ingénieurs sanitaires, cellules interrégionales d’épidémiologie. Le deuxième cercle est celui des organismes avec lesquels l’institut a signé des accords de partenariat – INSERM, Institut Pasteur, réseau Francim. Le troisième cercle comprend l’ensemble des professionnels de santé, médecins hospitaliers et médecins libéraux. Par ailleurs, l’Institut de veille sanitaire travaillera en étroite liaison avec les nouvelles agences sanitaires sur les aliments et les médicaments, et la future agence de sécurité sanitaire de l’environnement. L’objectif est de confronter, par exemple, les observations faites par l’IVS sur la morbidité liée à l’ingestion d’un aliment, avec les données sur la composition des produits consommés et les risques afférents. Pour l’étude des liens entre la santé et l’environnement, la future agence santé environnement collectera les données d’exposition des populations, les informations sur les dispositions de prévention. Ces données seront confrontées avec les observations de l’IVS afin de dégager d’éventuelles corrélations et de donner aux pouvoirs publics des éléments de décision. 2.5. L’IVS et les effets des rayonnements ionisants sur la santé L’expérience acquise par le Réseau national de santé publique et reprise par l’IVS correspond principalement aux maladies infectieuses et aux effets des polluants chimiques et de la pollution atmosphérique sur la santé. S’agissant des effets des rayonnements ionisants, " tout doit être inventé ". L’accent a longtemps été mis sur la métrologie des rejets et la mesure des doses reçues par les travailleurs. Il faut aujourd’hui s’attaquer à des questions difficiles comme, par exemple, la compréhension et l’identification des différents types d’exposition aux rayonnements ionisants. S’agissant des effets des rayonnements ionisants, leur temps de latence est généralement plus élevé que pour les polluants chimiques. En outre, la méthode épidémiologique se heurte souvent à des insuffisances de puissance statistique des observations qui empêchent de conclure sur le rôle causal d’un facteur de risque tout en ne permettant pas de l’exclure. En dépit de ces obstacles, l’Institut de veille sanitaire devra s’attacher à la demande sociale de veille sanitaire quant aux effets des rayonnements ionisants sur la santé. Il s’agira aussi de prendre en compte le cumul de doses chimiques et radioactives. Il faudra enfin mettre au point de nouvelles méthodes de recensement de données sur la mortalité mais aussi sur la morbidité. L’évaluation approfondie des conséquences de rejets et des déchets radioactifs sur la santé publique nécessite en France une approche épidémiologique ambitieuse, avec le développement non seulement d’outils modernes mais aussi d’une culture de santé publique où la connaissance des facteurs de déclenchement des maladies est considérée comme prioritaire. Les registres constituent un outil extrêmement précieux en épidémiologie. Selon l’arrêté de novembre 1995 relatif au Comité national des registres, " un registre est défini comme un recueil continu et exhaustif de données nominatives intéressant un ou plusieurs événements de santé dans une population géographiquement définie, à des fins de recherche et de santé publique, par une équipe ayant les compétences appropriées ". Après une phase de développement décentralisé et fondé sur des initiatives locales, il convient désormais d’homogénéiser et de multiplier ces registres. C’est en 1975 que le premier registre français du cancer est créé dans le Bas-Rhin sur la base d’initiatives locales. Cette création lance un mouvement qui s’amplifie rapidement. En 1986, un arrêté établit Comité National des Registres (CNR), placé sous la double tutelle des ministères chargé de la santé (Direction Générale de la Santé) et de la recherche (INSERM), dont la mission essentielle est de valoriser les données. En 1991, les responsables des registres français du cancer réseau prennent conscience de la nécessité de développer une étroite coopération. Le réseau FRANCIM est créé à cet effet. 1.1.2. Le rapport Estève de 1996 sur les registres du cancer En 1996, un groupe de réflexion créé par le comité national des registres du cancer (CNR) propose des orientations pour une politique d’évaluation, de création et de soutien éventuel des registres du cancer. Constitués au départ principalement à des fins de comparaisons internationales, puis reconnus comme utiles pour assurer une bonne gestion passive des données d’incidence, les registres du cancer sont finalement apparus comme des organismes de recherche épidémiologique à part entière dont la contribution à la lutte contre la maladie est essentielle. Le groupe de travail du CNR indique que la DGS ayant un rôle central dans la définition et la mise en place de la politique de santé ainsi que dans le contrôle et l’évaluation des actions menées, " elle doit, à ces fins, disposer d’un système performant et fiable d’information sur le cancer ". De même, les conseils généraux, qui sont chargés de la prévention, ont un intérêt majeur pour ce type d’information. Selon le groupe de travail, " dans le domaine de la connaissance des facteurs de risque et de protection, les registres du cancer sont bien placés pour entreprendre des recherches d’épidémiologique analytique ". Or la DGS a simultanément identifié les besoins. Parmi les facteurs de l’environnement, spécifiquement évalués par sa sous-direction de la veille sanitaire, " l’amiante et les autres fibres comme facteur de risque ‘non-professionnel’ du mésothéliome, les rayonnements ionisants et non ionisants, sont des domaines de recherche prioritaires ". Parmi les retards de la situation française, le groupe souligne qu’à la date du rapport, c’est-à-dire 1996, seuls 10 % de la population française étaient couverts par des registres généraux du cancer, avec au surplus une répartition géographique déséquilibrée. Les taux de couverture étaient à la même date de 22,4 % pour l’Allemagne, de 64,7 % pour de Royaume-Uni et de 100 % pour la Suède, le Danemark et la Finlande. Les auteurs du rapport préconisent en conclusion d’atteindre une couverture nationale suffisante par des registres généraux et d’expertiser certaines localisations ou groupes de localisation de cancer par des registres spécialisés. Dans quelle mesure ces recommandations ont-elles été suivies ? Au 1er mai 1998, on comptait 17 registres qualifiés, dont 11 registres généraux et 6 registres spécialisés du cancer, dont le registre national des leucémies de l’enfant. La qualification s’obtient après un avis favorable du Comité national des registres et du Comité consultatif sur le traitement de l’information en matière de recherche dans le domaine de la santé, et après autorisation de la Commission nationale informatique et libertés. Le degré supérieur de la reconnaissance pour un registre du cancer est celui de l’octroi d’une aide financière au fonctionnement par la DGS et l’INSERM. En contrepartie de cette aide financière, les registres concernés ont l’obligation de mettre à disposition des pouvoirs publics les données validées de l’année n-3 pour les registres généraux et n-2 pour les registres spécialisés. La situation au 1er mai 1998 des registres du cancer en France est résumée dans le tableau suivant. Tableau 10 : Les registres du cancer en France à la mi 1998
Le registre national des leucémies de l’enfant a été mis en place en janvier 1995, à l’unité 170 de l’INSERM. La collaboration avec les registres de cancers régionaux et départementaux permet aujourd’hui de couvrir environ 30 % du territoire. Grâce à des études rétrospectives, les données sont disponibles à partir de 1990, mais les périodes antérieures ne sont pas couvertes. Différentes initiatives ou projets ont été récemment lancés. Il faut citer le registre du cancer mis en place dans le Limousin récemment. L’Union régionale des médecins libéraux de Franche-Comté a par ailleurs soumis, en collaboration avec l’Université de Besançon, un projet d’étude épidémiologique sur les pathologies thyroïdiennes dans le cadre des conséquences de l’accident de Tchernobyl en Franche-Comté. Dans son rapport " rayonnements ionisants et santé ", le Professeur Alfred Spira note que " les rayonnements ionisants constituent le principal facteur de risque de cancer différencié de la thyroïde, et c’est le seul type histologique imputable aux rayonnements.(...) Pour l’ensemble de ces raisons, les cancers de la thyroïde devraient constituer l’un des éléments importants d’un système de surveillance épidémiologique des rayonnements ionisants. Des efforts devraient donc être entrepris dès à présent en vue de la constitution d’un registre national des cancers de la thyroïde ". Afin de mettre en place une vision globale de santé publique et d’accroître les moyens humains et financiers des registres du cancer, l’Institut de veille sanitaire doit mettre en place dans les prochaines années un programme " cancer " spécifique. Ce programme devra en premier lieu veiller à la cohérence du recueil d’information et évaluer au final la qualité de l’information produite. Il devra également rassembler, analyser et actualiser les connaissances sur les cancers, leurs causes et leurs évolutions et effectuer toutes études ou recherches nécessaires. Les registres du cancer, même perfectionnés et complétés, ainsi que les études épidémiologiques de validation, sont des outils indispensables mais ils ne concernent que la population extérieure aux installations nucléaires de base. En réalité, il faut une diversité d’outils et compléter les études conduites avec les registres, par un ensemble d’autres recherches relatives aux travailleurs du nucléaire. En premier lieu, une exploitation des données relatives aux agents statutaires d’EDF, de Cogema et du CEA pourrait être utile. Deux conditions sont néanmoins à remplir : il faudrait d’une part qu’un suivi post professionnel soit réalisé, par exemple par la médecine du travail, et, d’autre part, que la reconstitution des expositions des travailleurs soit possible sur la durée d’une carrière. En second lieu, la population des travailleurs de la sous-traitance et les travailleurs intérimaires sont également à étudier en détail, puisque la plus grande partie de l’exposition professionnelle lui est imposée. On peut toutefois s’attendre à des difficultés considérables pour reconstituer les dossiers médicaux et les profils d’exposition. La collaboration entre un organisme de recherche comme l’IPSN et la médecine du travail est ainsi à développer, avec l’aide des exploitants qui financent cette dernière. En toute hypothèse, une pression forte des pouvoirs publics devra s’exercer dans ce sens, tant il faudra bousculer les habitudes de pensée dans ce domaine. La culture médicale française est peu favorable au développement des études épidémiologiques, à l’évaluation et au suivi collectif des problèmes de santé. Le nombre de registres est encore insuffisant, et les moyens de ceux qui existent sont souvent insuffisants pour leur permettre de contribuer à la connaissance non seulement des cas mais aussi des facteurs en cause. En outre, certains verrous juridiques comme les contraintes d’accès à l’identifiant unique contribuent à accroître les difficultés des épidémiologistes dans l’utilisation des données nominatives. En l’occurrence, la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 en prévoyant que " l’institut (de veille sanitaire) accède, à sa demande, aux informations couvertes par le secret médical ou industriel dans des conditions préservant la confidentialité de des données à l’égard des tiers, définies par décret en Conseil d’Etat ", semble avoir apporté des solutions. On a vu précédemment que le programme " cancer " géré par l’Institut de veille sanitaire s’attachera à améliorer la qualité et la comparabilité des données. S’agissant de l’harmonisation des registres, ce programme devra éviter l’écueil d’une standardisation qui ne rencontrerait pas l’agrément des équipes fondatrices. De même, il serait nécessaire de ne pas contrecarrer les initiatives locales mais bien au contraire d’encourager, selon un mécanisme à déterminer, les projets proposés dans les régions. A cet égard, le refus d’apporter un soutien financier à différents projets comme celui d’un registre des cancers de la thyroïde en région Provence-Alpes-Côte d’Azur ou en Franche-Comté ne semble pas le signe d’une démarche pluraliste. Au vrai, ce dont il s’agit, c’est de développer en France une culture de santé publique. Comme l’écrit Marc Brodin, " si un des premiers épidémiologistes était français, c’est l’école anglaise qui a fait la trace. Les institutions médicales insulaires ont très vite inscrit ‘les responsabilités de santé publique’ comme une des responsabilités et des expressions de la médecine et des médecins. Les institutions médicales françaises ont prioritairement porté leur attention sur ‘la naissance de la clinique’ et l’exploration biologique ". Il convient aujourd’hui de développer l’enseignement de l’épidémiologie en tant que spécialité de fin d’études médicales, de susciter la création d’équipes dans les facultés de médecine, de poursuivre la montée en puissance des laboratoires d’organismes tels que l’IPSN où travaillent déjà 12 épidémiologistes. La pratique des appels d’offre doit être généralisée par l’Institut de veille sanitaire afin d’entretenir une saine concurrence entre les équipes de recherche et favoriser l’émergence de nouveaux centres de compétences. La prévention en matière sanitaire est enfin reconnue dans notre pays comme une priorité. En préface au rapport 1998 du Haut comité de la santé publique, M. Bernard Kouchner, secrétaire d’Etat à la Santé, écrivait : " Le Haut comité pointe (aussi) des zones d’ombre. Il convient de ne pas les éluder. En premier lieu, la faiblesse des actions de prévention au profit du tout curatif. C’est le malade qui domine dans notre système de soins. Pas le bien portant qui n’aspire pourtant qu’à le rester. La tendance doit s’inverser. Le système de prise en charge ne doit pas attendre que la maladie se déclare. Il doit la prévenir. Disons-le clairement, seule une évolution des mentalités, une révolution, y contribuera ". La France est en train de se doter enfin des instruments de surveillance de la sécurité sanitaire qui se trouvent déjà dans d’autres pays. L’action déterminée du Gouvernement correspond à une demande sociale de plus en plus forte, une demande au demeurant inscrite dans les traités de Maastricht et d’Amsterdam qui élargissent les compétences de l’Union européenne à la santé publique. Des discussions naîtront sans doute sur les priorités à donner en matière de veille sanitaire et de surveillance de l’environnement. A cet égard, les difficultés de l’épidémiologie relative aux effets des rayonnements ionisants s’ajouteront sans doute au poids objectif d’autres facteurs de risque pour faire passer au second rang l’étude des conséquences des rejets et des déchets nucléaires sur la santé publique. L’entrée en service des 4 réacteurs du palier N4 de Chooz B et de Civaux va encore faire croître en France la part du nucléaire dans la production d’électricité, pour sans doute dépasser les 80 % du total, à contre courant de l’évolution de tous les autres pays. Il ne saurait être admissible que l’importance des études épidémiologiques sur les rayonnements ionisants (et l’amiante) reconnue en son temps par la Direction générale de la santé ne se traduise pas concrètement par des programmes d’action prioritaires. En toute hypothèse, il devrait d’ores et déjà être décidé qu’une partie des recettes de la future écotaxe devrait être affectée à la surveillance sanitaire de la population et du territoire Chapitre 3 : La participation des citoyens et des associations et le pluralisme de l’expertise La participation du public aux processus de création d’installations nucléaires, ou d’installations classées pour la protection de l’environnement, ainsi qu’aux procédures d’autorisation de rejets, est un mouvement qui a commencé au début des années quatre-vingt et dont l’approfondissement est inéluctable car il correspond à une demande sociale. Les jalons réglementaires ou législatifs sont nombreux depuis le décret n°59-701 du 6 juin 1959 relatif aux enquêtes publiques. Il convient aujourd’hui d’examiner si les textes existants permettent une consultation efficace du public. Mais l’information du public peut s’effectuer également en continu, grâce aux commissions locales d’information. A ce propos également, il est possible de tirer les enseignements d’une expérience qui s’étale sur plusieurs années de fonctionnement pour certaines commissions. Les enquêtes publiques ont pour but de contrôler le caractère d’utilité publique d’un projet et de vérifier que l’opération envisagée a été conçue en toute connaissance de cause. Le déclenchement d’une enquête publique est prévu pour trente sept catégories d’aménagements, ouvrages ou travaux. La création et la modification substantielle des installations nucléaires de base font partie de cette liste, ainsi d’ailleurs que leurs rejets d’effluents radioactifs gazeux ou liquides, selon le décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 et le décret n° 95-540 du 4 mai 1995. En toute hypothèse, le dossier présentant les résultats de l’enquête publique fait partie du dossier transmis par le ministre chargé de l’électricité au Conseil d’Etat, à l’appui du projet de décret déclarant l’utilité publique des travaux relatifs à une installation nucléaire de base. La procédure d’enquête publique, établie par le décret n° 59-701 du 6 juin 1959 a été modernisée successivement par le décret n° 76-432 du 14 mai 1976 puis par la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 et ses décrets d’application. La loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement a par ailleurs complété le dispositif de consultation des populations, en offrant la possibilité d’un débat public en amont de l’enquête. En réalité, une série de difficultés pratiques de l’enquête publique, en n’étant toujours pas réglées, handicapent leur bon déroulement et contribuent à ce que cette procédure soit souvent de pure forme ou pire desserve l’idée même de consultation des populations concernées. 1. La relative inefficacité des améliorations récentes de la procédure L’organisation d’un débat public en préalable à une enquête publique est une possibilité nouvellement offerte par la loi. Toutefois, les contraintes dont elle est assortie augurent mal de son succès. Selon l’article 2 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement, un débat public peut être organisé sur les objectifs et les caractéristiques de projets d’aménagement d’intérêt national de l’Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des sociétés d’économie mixte qui présentent un fort enjeu socio-économique ou qui ont un impact significatif sur l’environnement. Parmi les opérations justiciables d’un débat public, on compte la création d’une installation nucléaire de base. Cette possibilité est toutefois restreinte au cas de la création d’un nouveau site de production nucléaire, ou à celui d’un nouveau site nucléaire, hors production électronucléaire correspondant à un investissement d’un coût supérieur à 2 milliards de francs. La procédure du débat public est quant à elle restrictive. C’est la Commission nationale du débat public créée par la loi qui l’organise. La saisine de la Commission peut émaner du ministre concerné par l’équipement conjointement avec le ministre chargé de l’environnement, ou bien des conseils régionaux, de 20 députés ou de 20 sénateurs concernés par le projet, ou bien des associations agréées de protection de l’environnement exerçant leur activité sur l’ensemble du territoire national. 2. Les modifications nécessaires de la procédure d’enquête publique 2.1. La question du commissaire-enquêteur et de la commission d’enquête Selon l’article 2 de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l’environnement, c’est le président du tribunal administratif ou son délégué qui désigne un commissaire-enquêteur ou les membres d’une commission d’enquête. Cette procédure a été explicité par le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l’application de la loi n° 83-630. Ce choix est capital pour la valeur de toute l’enquête et la crédibilité de la procédure. Ainsi que le confiait le directeur de la sûreté des installations nucléaires à votre Rapporteur, " l’un des problèmes majeurs, c’est l’élargissement du vivier des commissaires-enquêteurs ". Le dilemme compétence - indépendance est classique en la matière. Dans la directive du 14 mai 1976 relative à l’information du public et à l’organisation des enquêtes publiques, le Premier ministre soulignait que " sur les listes de commissaires-enquêteurs devraient figurer moins d’anciens fonctionnaires et davantage de personnes en activité. De même, il conviendrait de faire figurer sur ces listes des personnes qualifiées de par leurs études, leurs travaux ou leurs activités notamment au sein d’une association. " A l’inverse, l’indépendance a été privilégiée par la suite (décret n° 85-453 du 23 avril 1985 modifié par le décret n° 98-622 du 20 juillet 1998), dans la mesure où il est désormais institué que ne peuvent être désignées pour des fonctions de commissaire-enquêteur les personnes intéressées à l’opération soit à titre personnel, soit à titre des fonctions qu’elles exercent ou ont exercées depuis moins de cinq ans. Pour élargir avec efficacité les listes des experts qu’utilisent les présidents de tribunal administratif dans le cas des installations nucléaires, on pourrait imaginer que chacun des trois ministères chargés de l’industrie, de la santé et de l’environnement, établissent des listes et les communiquent aux présidents de tribunal administratif. En outre, pour les projets d’importance signalée, ceux-ci devraient opter en faveur de la création d’une une commission d’enquête de trois membres. La référence à cet égard pourrait être le montant de l’investissement. Mais l’importance que les pouvoirs publics accordent aux enquêtes publiques, doit aussi être marquée par une revalorisation substantielle de la rémunération des commissaires-enquêteurs. Les modalités de calcul de cette dernière sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement, de l’équipement, du budget et de l’intérieur. Sans atteindre les niveaux de rémunération des experts judiciaires, il est indispensable pour la qualité de la procédure de pouvoir attirer des experts dont la compétence soit comparable, sinon supérieure, à celles des ingénieurs des exploitants. La procédure actuelle prévoit qu’après vérification du dossier présenté par un exploitant nucléaire en vue d’obtenir une autorisation de rejets radioactifs, la DSIN met la demande à l’enquête publique. Il faut noter à cet égard que le dossier soumis au public n’est pas celui de la DSIN mais celui de l’exploitant. Une fois recueillies les remarques et critiques du public, la DSIN étudie l’ensemble du dossier de demande, à la lumière notamment des résultats de l’enquête. Dans la plupart des cas, la DSIN fait également réaliser des expertises par l’IPSN avant de prendre sa décision ultime. En définitive, le public ne connaîtra le dossier final qu’avec l’arrêté d’autorisation. Il serait préférable, à bien des égards, que ce soit le dossier ultime de la DSIN qui soit mis à l’enquête publique, de façon que les associations et la population soient à même de juger le dossier ultime. En outre, la possibilité de faire réaliser des expertises concurrentes de celles de l’IPSN devrait être offerte. Ceci ne correspond pas à l’opinion de la DSIN, qui souligne que dans un tel schéma, elle pourrait prendre des marges supérieures à ce qu’elles sont avec la procédure actuelle. Mais l’amélioration de la transparence du nucléaire suppose un tel changement de procédure. En réalité, il serait opportun d’insérer la Commission locale d’information dans la procédure de l’enquête publique (voir plus loin). Les textes relatifs à l’enquête publique prévoient qu’une réunion publique peut être organisée par le préfet, à la demande du commissaire-enquêteur ou du président de la commission d’enquête, qui, alors, ont la responsabilité conjointe des modalités de la réunion publique. La DSIN attache la plus grande importance aux modalités d’organisation et au bon déroulement des réunions publiques. Si ces efforts conduisent à une meilleure information du public et des associations, on ne peut que noter l’inévitable déséquilibre des débats, au détriment de ces dernières, dont, par hypothèse, les moyens d’étude et d’expertise reposent sur le bénévolat. Au total, il semble indispensable de revoir l’ensemble de la procédure d’enquête publique. En 1977, le Conseil général du Haut-Rhin crée la commission de surveillance de Fessenheim et donne ainsi le coup d’envoi d’une série d’initiatives tendant à améliorer l’information du public sur l’industrie nucléaire.² Fin 1998, 25 commissions locales étaient constituées autour d’installations nucléaires existantes, à quoi il fallait ajouter quatre instances locales relatives aux projets de laboratoires souterrains. Créées sur des bases à la fois diverses et souples, les commissions locales relatives aux installations nucléaires accomplissent des tâches d’ampleur variable. La confirmation et l’amplification de leur rôle sont demandés par des voix très diverses. En réalité, il convient de déterminer quelles sont les novations qui pourraient être réellement utiles. 1. Les enseignements de plus de vingt ans de travaux des commissions locales
Les commissions locales se caractérisent par une grande hétérogénéité, tant dans leur composition que dans leur fonctionnement. Un cadre général a certes été tracé par la circulaire du Premier ministre du 15 décembre 1981 " relative aux conditions de création et de fonctionnement de commissions locales d’information placées auprès des grands équipements énergétiques ". Il n’en demeure pas moins que les particularismes sont nombreux et souvent revendiqués par les commissions elles-mêmes. La commission locale de surveillance de Fessenheim a été créée en 1977 à l’initiative du Conseil général du Haut-Rhin et a lancé le mouvement de création d’autres commissions, sans toutefois imposer son modèle. En 1979, une commission d’information est établie pour la centrale de Saint Laurent des Eaux, et en 1981, la commission d’information de La Hague est constituée. Les résultats obtenus par ces trois commissions conduisent le Gouvernement à recommander leur généralisation, par une circulaire de M. Pierre Mauroy. Selon cette circulaire du Premier ministre en date du 15 décembre 1981, l’initiative de la création d’une commission locale d’information n’a pas à être imposée et revient au conseil général du département d’implantation d’un grand équipement énergétique. Le président et les membres de la commission sont désignés par le président du conseil général en liaison avec le préfet. Les élus (maires, conseillers généraux, parlementaires) disposent au minimum de la moitié des sièges. Les commissions sont régulièrement tenues au courant de l’état d’avancement des études, de la réalisation ou du fonctionnement des grands équipements. Pendant la période d’exploitation, le fonctionnement de la commission est pris en charge par les collectivités locales qui bénéficient des retombées économiques de l’équipement. L’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques a recommandé en décembre 1991 la systématisation et l’accroissement des moyens des commissions locales d’information. Une proposition de loi a été déposée dans ce sens par son rapporteur M. Claude Birraux. A la fin 1998, on comptait 20 commissions locales d’information (CLI) répondant au modèle de la circulaire Mauroy, une commission locale de surveillance pour Fessenheim, une commission spéciale et permanente d’information pour La Hague, une commission de surveillance pour le Centre de stockage de la Manche de l’ANDRA, une structure d’étude et d’information pour Valduc et une commission d’information pour le Tricastin (voir tableau ci-après). Tableau 11 : Liste des commissions d’information relatives aux installations nucléaires de base
Selon une étude du fonctionnement des Commissions locales d’information réalisée en 1996 à la demande de la DSIN par une équipe du CNRS d’Economie et Humanisme, les CLI s’identifient à l’un ou l’autre des cinq archétypes suivants : - la commission " fantôme " - la commission " dominée " par un acteur autoritaire - la commission " conflictuelle ", point de fixation de l’opposition au nucléaire - la commissions " conviviale ", lieu d’une meilleure information et de production d’une bonne image du nucléaire - la commission " impliquée ", partie prenante d’une politique de prévention et de meilleure insertion de l'industrie nucléaire dans l’environnement local. Cette typologie souligne à l’envie les disparités de fonctionnement des commissions locales, tant ce qui concerne le rythme de leur activité que pour leur mission réelle et leur mode de fonctionnement. Il faut à cet égard souligner la position spécifique de la commission locale de surveillance de Fessenheim, qui souhaite se distinguer du cadre de la circulaire Mauroy et a mis en place un réseau de mesure en continu de la radioactivité de l’air. Au début des années quatre-vingt dix, le ministère de l’industrie et le ministère de l’environnement ont proposé une aide financière incitative de 2,5 millions de francs par an pour l’ensemble des CLI. Une aide technique et logistique des DRIRE leur a également été proposée. Or, les crédits consommés n’ont été que de 1 011 664 F en 1997 et de 1 548 700 F en 1998. Les commissions locales sont pourtant toutes au courant de l’existence de ces subventions possibles, grâce à la Conférence nationale des présidents de commission locale d’information, qui se déroule chaque année. La raison de cette non-consommation par les CLI des crédits qui leur sont ouverts est en réalité leur manque de perspectives concrètes. Les actions d’information trouvent en effet rapidement une limite, celle de la saturation des populations qui peut d’ailleurs nuire à la crédibilité de la CLI. En tout état de cause, le véritable enjeu des CLI, c’est celui des contre-expertises, seules capables de renforcer leur légitimité par la mise en place d’une information véritablement contradictoire. Or, lors de la IXème Conférence nationale des présidents des commissions locales d’information, les participants ont clairement noté que les CLI doivent avoir " un œil critique et une certaine indépendance vis-à-vis des pouvoirs publics et des exploitants. La présence d’experts en leur sein doit leur donner une capacité de questionnement ". Les deux extrêmes pour une évolution possible des Commissions locales d’information seraient d’une part la continuation de la situation actuelle, avec sa grande hétérogénéité, ses réussites mais aussi ses échecs, et d’autre part, l’obligation qui pourrait être faite aux commissions existantes d’adopter une structure unique, avec des modes d’intervention imposés. A cet égard, la DSIN note que la liberté donnée par la circulaire Mauroy est positive, à condition que la présidence de la commission soit assurée avec efficacité. En toute hypothèse, il semble difficile de suppléer l’absence d’un animateur local et d’imposer la création et le fonctionnement d’une commission active dans un département où une demande sociale de transparence et de participation n’existerait pas. C’est pourquoi, en réalité, au-delà du changement éventuel de statut, ce qui paraît essentiel, c’est d’assurer, sur la base d’une démarche volontaire de leur part, un meilleur accès des commissions à l’information, de leur donner les moyens de déclencher des contre-expertises si elles le demandent, et enfin de les associer à la procédure des enquêtes publiques relatives aux installations nucléaires de base de leur ressort. La circulaire du Premier ministre du 15 décembre 1981 prévoit que " la commission pourra disposer de l’ensemble des informations et des études en provenance des exploitants ou des promoteurs du projet ainsi que des prescriptions qui leur sont notifiées par les administrations qui les contrôlent, à l’exclusion des secrets industriels et commerciaux et sous réserve des secrets de défense nationale et des impératifs de sécurité publique visant la prévention d’actes de malveillance ". Deux remarques doivent être faites à cet égard. La première est qu’une circulaire n’a pas de valeur réglementaire. D’où l’impossibilité pour une CLI de s’appuyer sur la circulaire pour réclamer des informations que l’exploitant répugnerait à lui livrer. La deuxième remarque est que la notion de secret industriel et commercial est extensive de même que celle d’impératif de sécurité publique. Le droit des CLI d’accéder à une information exhaustive sur les installations nucléaires de leur ressort doit donc être posé clairement par la loi, puisqu’un texte réglementaire n’aurait en la matière aucun support valable. Le droit d’accès à un financement pour des études complémentaires ou concurrentes de celles de l’exploitant et de l’administration doit être reconnu aux commissions locales d’information. Deux précisions devraient être apportées à une disposition générale en la matière. La première serait le plafonnement des concours annuels que chaque CLI pourrait obtenir. La deuxième concernerait la provenance du financement. A cet égard, le financement devrait être assuré à parité par la DSIN et par le conseil général du département concerné. En effet, d’une part une installation nucléaire de base a une portée et une utilité nationales et d’autre part, le département bénéfice de retombées économiques toujours importantes de ce type d’installation. Une expérience récente et au demeurant très positive, celle du groupe radioécologie Nord-Cotentin, souligne cruellement par opposition les insuffisances de la procédure d’enquête publique. En effet, ainsi qu’il a été vu dans la première partie du présent rapport, le groupe radioécologie a pour la première fois effectué dans le Nord-Cotentin une étude approfondie de l’impact sur la santé publique des rejets des installations nucléaires de la presqu’île. Ce groupe avait été constitué à l’initiative conjointe des ministres chargés de l’environnement et de la santé, afin de répondre aux inquiétudes locales quant au risque de leucémie autour du site de La Hague. En réalité, le groupe a réalisé l’étude d’impact contradictoire et approfondie qui devrait sous-tendre tout dossier de demande d’autorisation de rejets dans l’environnement. Quels ont été les moyens dévolus au groupe radioécologie Nord-Cotentin? Il n’est pas exagéré de dire que sans la prise en charge étroite du groupe par l’IPSN et sans une collaboration d’une ampleur considérable apportée sans contrepartie par les associations de protection de l’environnement, rien n’aurait été possible. Il découle de cette expérience très positive que les commissions locales devraient être incitées à développer en leur sein des groupes techniques, dotés de moyens de faire réaliser des expertises, et composés d’experts rémunérés en tant que tel, pour approfondir le dialogue avec les exploitants nucléaires. Les Commissions locales devraient contribuer étroitement non seulement à l’information du public mais aussi au contrôle et à l’amélioration de la sûreté et de la radioprotection. En réalité, c’est à une remise à plat du fonctionnement des CLI qu’il faudrait procéder. Il faudrait en particulier examiner la question de la présidence des CL et celles de leurs ressources qui pourraient provenir à parité du ou des conseils généraux et de la direction de la sûreté des installations nucléaires mais pas des exploitants. III – Le Conseil supérieur de la sûreté et de l’information nucléaire Le décret n° 73-278 du 13mars 1973 modifié par le décret n°87-137 du 2 mars 1987 a institué auprès du ministre chargé de l’industrie un Conseil supérieur de la sûreté et de l’information nucléaires (CSSIN). Le CSSIN peut être " consulté par le ministre chargé de l’industrie sur toutes questions importantes touchant à la sûreté nucléaire, ainsi qu’aux dispositions envisagées pour assurer une bonne information des populations sur la sûreté ainsi qu’en cas d’incident ou d’accident survenu dans une installation . Le Conseil adresse au ministre de l’industrie toutes recommandations qu’il juge utiles pour accroître l’efficacité de l’action d’ensemble poursuivie dans ces domaines ". Le Conseil supérieur n’a pas fonctionné jusqu’en 1981. A cette date, à la demande des syndicats et des associations, le CSSIN se saisit de la question des déchets, selon une démarche qui aboutira au rapport Castaing. En 1986, le Conseil supérieur s’adjoint la participation de journalistes et se saisit " de problèmes hors de son champ ". Le Conseil supérieur n’est pas relié organiquement aux Commissions locales d’information. Or il existe un besoin de coordination de l’action des CLI, ce besoin étant pris en charge par la Conférence annuelle des présidents de CLI organisée par la DSIN. Il pourrait être avantageux d’ajouter aux attributions du CSSIN l’information et la coordination des Commissions locales. La présence des présidents de CLI au sein du CSSIN s’imposerait naturellement. L’efficacité de l’action du Conseil dans ses missions actuelles n’en pourrait être que renforcée. En toute hypothèse, une réflexion approfondie et une concertation s’imposent avant de redéfinir le statut et la mission du CSSIN. Les conditions réglementaires du pluralisme en matière d’expertise existent d’ores et déjà. Le décret n° 76-480 du 24 mai 1976 fixant les modalités d’application de l’article 17 de la loi de finances rectificative pour 1975 relatif aux redevances auxquelles sont assujetties les installations nucléaires de base, prévoit explicitement dans son article 2 que les sommes provenant de cette redevance peuvent servir à rembourser " les dépenses occasionnées par l’exécution des analyses de sûreté confiées par convention au Commissariat à l’énergie atomique et éventuellement à d’autres établissements, organismes ou experts qualifiés, publics ou privés, en vue de l’examen technique des demandes présentées en application des articles 3 à 6 bis du décret du 11 décembre 1963 ". Il convient en conséquence de mettre au point une procédure d’agrément des associations de protection de l’environnement. Cet agrément devrait être accordé par deux au moins des ministères chargés de l’industrie, de la santé et de l’environnement, sur la base de la qualification des cadres de ces organismes et sur la base des travaux déjà réalisés sur une période de trois années. Cet agrément porterait sur une liste nominative de membres de l’organisme et serait donné pour une période de cinq années. Les associations agréées pourraient être sollicitées non seulement par la DSIN mais aussi par les Commissions locales d’information. Il serait vain à long terme, et injuste en toute hypothèse, de compter sur le seul engagement désintéressé des responsables d’associations pour assurer le pluralisme des analyses de sûreté et de radioprotection. Il serait vain et injuste de vouloir améliorer ainsi les performances des installations nucléaires au détriment de la vie personnelle de militants d’une cause d’intérêt général, la protection de la santé publique et de l’environnement. Une participation accrue du public aux procédures d’autorisation est de nature à produire des conséquences positives pour la santé publique et l’environnement. L’exhaustivité et la qualité de l’analyse peut être améliorée grâce à l’apport des associations. L’importance respective des différents objectifs, économique, sanitaire et environnemental, peut être mieux appréciée par les différents intervenants. La transparence conduit sans nul doute à une meilleure radioprotection grâce à la mise en œuvre de technologies de pointe qui n’auraient paru avoir d’utilité sans la révélation de la demande sociale qui s’exprime notamment par les associations de protection de l’environnement. Chapitre 4 : L’évolution souhaitable du dispositif de gestion des rejets et des déchets radioactifs A l’image de ces textes, les responsabilités sont elles aussi réparties entre un nombre important de responsables publics, tout en étant également assumées en première ligne par les producteurs de déchets eux-mêmes. Le temps est venu d’analyser l’organisation actuelle du système de gestion des déchets radioactifs, de vérifier les compétences attribuées par les textes et de renforcer la cohérence du dispositif, en évitant la mise à mal de structures qui fonctionnent d’une manière satisfaisante et en évitant aussi tout phénomène de " mille feuilles " législatif et réglementaire générateur de confusion et de démotivation. I – Les réalités concrètes de la gestion des déchets radioactifs Le problème du stockage des déchets radioactifs se pose sur des échelles de temps totalement inhabituelles. Il est en conséquence nécessaire de prévoir des solutions pérennes, non seulement sur le plan technique, mais aussi sur le plan institutionnel. Les contraintes techniques portent sur le confinement des déchets mais aussi sur le balisage et la surveillance des dépôts, le tout sur plusieurs milliers d’années dans le cas d’un centre de stockage définitif. A ces contraintes peuvent au surplus s’ajouter celles de la réversibilité, qui ne peut être réalisée qu’au prix d’une maintenance efficace sur longue période des équipements de manutention. Enfin, il reste à mettre au point des techniques de transmission à long terme de l’information sur les contenus et sur la localisation des centres d’entreposage ou de stockage. Mais la mise au point de toutes ces techniques ne servirait de rien si pour les véhiculer dans le temps, des organisations structurées et durables n’étaient pas en charge, et elles seules, des déchets radioactifs. Le cas de la décharge privée de Solérieux est exemplaire à cet égard. Par un arrêté préfectoral du 5 novembre 1975, une petite société de la Drôme est autorisée à installer et à exploiter, dans cette commune rurale, une décharge de classe 2, sans limite de durée, sur un terrain de 2 hectares et d’y stocker des ordures ménagères, des déblais et gravats, ainsi que des déchets industriels et commerciaux, à condition que ces matériaux ne soient ni toxiques ni inflammables. Au fur et à mesure du temps, cette décharge est mise à contribution par un nombre croissant d’industriels de la région qui bénéficient de coûts de transport inférieurs à ceux qu’entraînerait l’acheminement de leurs déchets vers des décharges plus sûres mais plus lointaines et de coûts de stockage très bas du fait du caractère sommaire des installations de Solérieux. Une accumulation de déchets de types très divers se produit sur cette décharge dont l’existence arrange bien du monde dans la région, y compris la préfecture de la Drôme qui y recourt en cas d’urgence. Cas particulier, Comurhex est autorisée officiellement en 1979, à mettre en décharge à Solérieux des fluorines (CaF2) provenant du process de fluoration de l’uranium en UF6, en amont de son enrichissement. L’arrêté préfectoral de 1997, qui prolonge l’autorisation initiale, spécifie que les traces d’uranium entachant les fluorines ne peuvent provenir que d’uranium naturel. Or il apparaît en juillet 1999 qu’en réalité une part des fluorines stockées à Solérieux contiennent des traces d’uranium de retraitement, en contravention avec l’autorisation préfectorale. Comprenant son erreur, Cogema, société mère de Comurhex, décide rapidement d’interrompre ses transports de fluorine. Mais l’analyse du dossier montre que l’entreprise, sans doute insuffisamment structurée, est incapable de révéler avec précision le contenu de sa décharge. Il semble au demeurant probable que divers déchets radioactifs justiciables de stockages spécialisés aient également été entreposés à Solérieux. Pire, l’exploitant, lassé par les visites, les expertises et l’intérêt soutenu des médias pour sa décharge, laisse entendre qu’il pourrait purement et simplement cesser son activité. En tout état de cause, la forme juridique de l’entreprise, une société en nom collectif, est synonyme d’une durée limitée. Cet exemple est certes celui d’une décharge ICPE et non d’une décharge INB. Mais il illustre jusqu’à la caricature les dangers à éviter pour les déchets radioactifs. Bien évidemment, les moyens et la pérennité des principaux exploitants nucléaires sont tout autre. Mais la durée à prendre en considération pour la gestion des déchets radioactifs étant de plusieurs centaines voire de milliers d’années, il est impératif d’adopter, dans tous les cas, y compris pour les déchets de très faible activité et les déchets miniers par exemple, les formes les plus pérennes d’organisation, à savoir des structures publiques. Le corollaire de cette nécessaire pérennité est que le recours à un financement au moins partiellement public ne devrait pas être systématiquement écarté. Pour l’instant, comme on le verra plus loin à propos de l’ANDRA, les exploitants prennent à leur charge la quasi-totalité du budget de cet établissement public. Cependant, la prise en compte du très long terme, bien au-delà des horizons de temps habituels, requiert le financement public, même si ses modalités restent à mettre au point. Alors que les producteurs de déchets radioactifs sont nombreux, et que les déchets radioactifs sont eux-mêmes multiples dans leur composition, leur concentration et leurs emballages, alors que les solutions transitoires mises au point par les exploitants nucléaires sont également nombreuses, il importe que le système de gestion actuel, au demeurant globalement performant dans le court terme, gagne la cohérence indispensable pour perdurer à l’échelle des siècles prochains. 2.1. L’importance de spécifications et de conditionnements standardisés Les déchets radioactifs sont très divers dans leurs contenus. On a vu précédemment la difficulté d’établir des classifications générales et durables des déchets, en faisant référence à leur contenu. Un autre motif de diversité est apporté par les conditionnements. Ceux-ci peuvent changer d’un exploitant à un autre et même d’une installation à une autre appartenant toutefois à un même exploitant. L’interface entre les opérateurs peut ainsi se révéler difficile et exiger des transferts inutiles et coûteux d’un type de conteneur à un autre. C’est le cas lorsque les dimensions des structures de transport ou d’entreposage sont différentes. Il est donc important que, sous l’autorité du responsable de l’entreposage ou du stockage final, un conditionnement définitif intervienne le plus en amont possible de la chaîne de traitement des déchets : la sûreté se fabrique en amont. La Commission nationale d’évaluation (CNE) note, dans son rapport n° 5 de juin 1999, que des divergences stratégiques semblent se dessiner entre EDF et le CEA, quant à la durée de l’entreposage qui pourrait précéder un éventuel stockage définitif. Selon les propres termes de la CNE, " EDF ne prend pas en considération une durée d’entreposage supérieure de 50 années (...) ". Au contraire, " le CEA a engagé un programme de recherche visant à établir des concepts d’entrepôts susceptibles d’être fonctionnels pendant 100 à 300 ans, période qui n’excède pas celle de surveillance des stockages de surface des déchets A et pendant laquelle la maîtrise des technologies nucléaires devrait être assurée ". Le foisonnement des projets n’est pas inutile dans une phase de recherche tous azimuts. On peut toutefois se poser deux questions sur la situation actuelle. La première est de savoir à quelle date il sera indispensable de trancher, dans la perspective du rendez-vous de 2006 fixé par la loi du 30 décembre 1991. La deuxième question est de savoir à quelle instance il reviendra de prendre des décisions techniques en la matière. Certes, il reviendra au Parlement d’assumer la responsabilité du choix entre les trois axes de la loi Bataille ou de la pondération entre les trois axes. Toutefois, des décisions plus techniques seront nécessaires pour réconcilier les visions des différents exploitants nucléaires. Cette tâche sera d’autant plus difficile que chacun des acteurs pourrait, grâce à une autonomie accrue obtenue par exemple suite à une privatisation partielle ou complète, être tenté d’adopter les solutions internes les plus adaptées à ses objectifs spécifiques, par exemple la minimisation des investissements à réaliser ou la maximisation du profit à court terme. Il peut sembler important, à cet égard, de rechercher au plus tôt une compatibilité et même une harmonisation des stratégies individuelles. Par ailleurs, les solutions mises en œuvre par les générateurs de déchets, dont la plupart sont justifiées économiquement et techniquement, peuvent dans certains cas fragiliser les éléments d’organisation pérenne du stockage et de l’entreposage. Plusieurs exemples tirés d’une actualité récente montrent que des contradictions d’objectifs peuvent remettre en cause les premiers éléments d’une organisation conçue pour le long terme. Ainsi l’incinérateur des déchets de Centraco entraînera une diminution des volumes à stocker, ce qui risque de fragiliser l’équilibre d’exploitation du centre de Soulaines. Il en est de même pour certains déchets technologiques en provenance de La Hague, dont les volumes diminuent d’année en année, ce qui, en soi, n’est pas une mauvaise chose mais entraîne une perte de recettes pour l’ANDRA. Il sera donc indispensable, à l’avenir, de mettre en place une tarification du stockage qui soit fonction de l’activité en Becquerel plutôt que du volume ou du tonnage, ce qui permettra de parvenir à un compromis dynamique entre concentration et dilution. Par ailleurs, le cas de la décharge ICPE de classe 2 de Solérieux montre que l’utilisation de ce type de décharge, en se plaçant à la limite de la réglementation ou en contravention avec elle, compromet des solutions techniques avancées infiniment plus sûres, comme celles de l’ANDRA. 2.4. Une optimisation à faire sur le plan le plus large possible La situation actuelle de la gestion des déchets radioactifs se caractérise sur un plan géographique par un grand nombre des sites d’entreposage, en raison de la responsabilité donnée aux producteurs de déchets de les prendre en charge, de les conditionner et de les entreposer tant que des exutoires centralisés ne sont pas mis à leur disposition. Cette réalité n’empêche pas que différentes questions soient posées. La première est la suivante : en terme de sûreté et de radioprotection, est-il préférable d’avoir un site central ou bien plusieurs sites différents de taille inférieure ? Au plan technique, la question ne peut probablement pas recevoir de réponse générique. En réalité, seuls des modèles prenant en compte la géologie des milieux, les mécanismes de dispersion et de transfert dans l’environnement et en particulier dans la biosphère pourraient apporter une réponse. En fait, pour déterminer l’optimum sites centralisés / sites répartis, il faut prendre en compte à la fois de des paramètres économiques et politiques. Mais au-delà d’une réflexion théorique difficile, il faut aussi prendre en compte la réalité. La situation actuelle est celle de sites répartis dans les installations des producteurs. Sera-t-elle indéfiniment réversible ? Autrement dit, une fois aménagés et utilisés des sites d’entreposage, sera-t-il toujours possible de reprendre les déchets qu’ils contiennent pour les réunir dans un site unique ? Les difficultés techniques et les coûts financiers que pourraient entraîner la reprise des déchets, leur manutention et leur transport ne doivent pas en l’occurrence être sous-estimées. La consolidation des sites répartis pourrait apparaître à l’avenir, au moins dans certains cas, plus avantageuse, en fonction de critères économiques voire sociaux, que l’exploitation d’un site unique. En tout état de cause, la géographie n’épuise pas le champ des questions à résoudre, et en particulier celle d’un centre de décision unique, responsable d’une politique nationale des déchets radioactifs. Le premier progrès nécessaire en matière de gestion des déchets est une identification aussi précise que possible des filières de génération de ces déchets. En complément, il est également nécessaire que tous les moyens existent pour caractériser ces déchets, pour les conditionner, pour les transporter et pour les entreposer - ou les stocker le cas échéant. Il semble par ailleurs indispensable qu’une réflexion soit conduite sur le statut des déchets. Si dans la plupart des cas, il n’y a pas d’ambiguïté sur les propriétaires de ceux-ci, en revanche certains objets singuliers, comme des aiguilles de radium ou des dispositifs à usage industriel, sont des objets abandonnés, aucune responsabilité ne pouvant plus être invoquée. Le CEA a mis en place dans ses installations de Saclay de l’INB 72, comme on l’a vu précédemment, un ensemble de dispositifs permettant l’entreposage de déchets radioactifs de toutes provenances et de toutes dimensions. Le service offert est particulièrement précieux pour les sources radioactives à usage médical ou industriel qui n’avaient pas d’exutoire, avant que cette possibilité soit mise sur pied. Le cheminement des demandes de prise en charge de tels déchets passe par l’OPRI ou l’ANDRA, qui en saisissent le CEA. Il paraît légitime que ce service rendu soit officialisé et mieux connu. Mais il ne saurait être une solution à long terme. Des progrès significatifs ont été faits par les producteurs de déchets radioactifs dans la prise de conscience de l’importance de la gestion des déchets radioactifs et dans la mise au point de stratégies de gestion de ceux-ci. Toutefois, " la somme des stratégies individuelles ne fait pas une stratégie nationale ". Il semble souhaitable désormais, pour marquer une nouvelle étape, de renforcer les institutions existantes en vue de créer un centre de décision unique qui impulse une politique centralisée de gestion des déchets. Il est même urgent de le faire sauf à compromettre toute possibilité de gestion cohérente des déchets. II – La définition et le contrôle de la politique de gestion de déchets radioactifs Comme on l’a constaté tout au long de la préparation du rapport, lors visites d’installations nucléaires, les exploitants nucléaires mettent chacun en œuvre des politiques internes de gestion de leurs déchets radioactifs, qui sont dans la plupart des cas satisfaisantes à court terme. Pour autant, il ne semble pas exister pour le moment une démarche d’ensemble à long terme pour les déchets radioactifs de faible et moyenne activité qui soit comparable à celle initialisée par la loi du 30 décembre 1991 pour les déchets de haute activité à vie longue. En l’occurrence, la nécessité d’une gestion centralisée ne veut pas obligatoirement dire qu’il faille parvenir à une centralisation physique de tous les déchets ou de tous les déchets de même type. Cela veut simplement dire qu’il est indispensable de parvenir à un plan d’ensemble à moyen et long terme de gestion des déchets de toutes catégories, cohérent, clairement affiché, connu et appliqué par tous les exploitants nucléaires. Par quelles autorités une telle politique nationale des déchets radioactifs peut-elle être définie et appliquée ? Les institutions compétentes sont étudiées dans la suite, différentes propositions étant faites pour en améliorer, le cas échéant, l’efficacité vis-à-vis de la gestion des déchets nucléaires. Selon les décrets n° 97-710 et n° 97-715 du 11 juin 1997, " l’élaboration et la mise en œuvre de la politique de sûreté nucléaire, y compris en ce qui concerne le transport des matières radioactives et fissiles à usage civil " sont des compétences exercées conjointement par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et par le ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement. Il n’entre pas dans l’objet du présent rapport de proposer une nouvelle organisation du contrôle de la sûreté nucléaire. C’est pourquoi on raisonne ici dans le cadre des institutions existantes. Compte tenu de la mission impartie à votre Rapporteur, les propositions qui suivent portent sur les moyens de dynamiser les institutions existantes. Deux évolutions semblent s’imposer, d’une part une plus grande implication du ministère de la recherche dans la politique de l’aval du cycle nucléaire, et d’autre part, la réactivation sous une forme légèrement modifiée du Comité interministériel de la sécurité nucléaire. En premier lieu, il faut souligner, comme on l’a fait dans la deuxième partie du rapport, que de nombreuses indéterminations scientifiques et techniques demeurent sur la question des déchets. Ces indéterminations touchent aussi bien la possibilité de transmuter certains déchets de haute activité à vie longue en déchets de durée de vie inférieure que l’efficacité à très long terme du confinement en couche géologique profonde, sans oublier les toxicités radiologique et chimique combinées et à long terme de nombreux éléments rejetés par les installations nucléaires. Ceci pourrait motiver qu’en matière de sûreté de l’aval du cycle nucléaire, les ministres de l’économie, des finances et de l’industrie d’une part, et de l’aménagement du territoire et de l’environnement d’autre part, partagent leur compétence avec le ministère de la recherche. Il s’agirait ainsi, au niveau des décrets d’attribution, de tirer la conséquence du fait que, concrètement, l’ANDRA est d’ores et déjà sous la tutelle des trois ministres. On peut se demander, par ailleurs, si le dispositif actuel ne manque pas d’un échelon qui aurait un poids politique suffisant pour définir une stratégie détaillée de gestion des déchets radioactifs et pour l’imposer aux acteurs du secteur. Or une institution existe, le Comité interministériel de la sécurité nucléaire, instauré par le décret n° 75-713 du 4 août 1975, qui pourrait être modifié et renforcé. Le Comité interministériel de la sécurité nucléaire créé par le décret n° 75-713 du 4 août 1975 comprend, ainsi que l’indique l’article 1er de ce dernier, " sous la présidence du Premier ministre, le ministre de la santé et de la famille, le ministre de l’intérieur, le ministre de la défense et le ministre de l’industrie ". Toutefois, " d’autres ministres peuvent siéger au Comité pour les questions relevant de leurs compétences ". Selon l’article 2, le Comité interministériel " coordonne les actions destinées à assurer la protection des personnes et des biens contre les dangers, nuisances et gênes de toute nature résultant de la création, du fonctionnement et de l’arrêt des installations nucléaires fixes ou mobiles, ainsi que de la conservation, du transport, de l’utilisation et de la transformation des substances radioactives naturelles ou artificielles ". Quelles sont les missions du Comité interministériel ? Elles sont très étendues et couvrent en particulier la question des rejets et des déchets. En effet, les missions du Comité s’étendent " à la protection des travailleurs et du public contre les rayonnements ionisants (...) ; au rejet des effluents radioactifs et non radioactifs liquides et gazeux (...) ; à la sûreté des installations nucléaires (...) ; au contrôle et à la sécurité des matières nucléaires pendant leur production, leur conservation, leur transport et leur utilisation, y compris les radioéléments et les déchets, en vue de protéger l’hygiène et la santé publique (...) ". L’article 3 du décret du 4 août 1975 prévoit l’intervention d’un secrétaire général du Comité interministériel, nommé par décret, et chargé de préparer les délibérations du Comité, de lui proposer les mesures nécessaires à l’accomplissement de sa mission et de suivre l’application des décisions prises. L’histoire du Comité interministériel sur la sécurité nucléaire montre une spécialisation de fait sur les domaines suivants : - la préparation de la position française en matière de sécurité nucléaire dans les relations internationales - la vérification des dispositions réglementaires régissant la sécurité des sites nucléaires civils et les matières nucléaires - l’organisation d’exercices de crise nationaux - la coordination des décisions prises en cas de situation accidentelle. Si la fin des années soixante-dix et les années quatre-vingt n’ont pas vu de controverse particulière entre les différents ministères chargés de la santé, de l’intérieur, de la défense et de l’industrie, à propos des questions nucléaires, la situation a désormais changé, avec la montée de la demande de protection de la santé et de l’environnement. Une réforme a minima pourrait consister à donner une nouvelle impulsion au Comité interministériel de la sécurité nucléaire. En premier lieu, sa dénomination serait modifié en " Comité interministériel de la sûreté nucléaire et de la radioprotection ". En deuxième lieu, le Comité interministériel, aujourd’hui à géométrie variable, comprendrait sous la présidence du Premier ministre, les ministres chargés de l’industrie, de la santé, de l’environnement, de la recherche, de la défense et de l’intérieur. Les attributions définies par le décret n° 75-713 du 4 août 1975 seraient intégralement reprises, avec toutefois un alinéa supplémentaire à l’énoncé des missions de l’article 2, à savoir que les missions du Comité s’étendent aussi " à la définition et au contrôle de la politique nationale des rejets et des déchets radioactifs ". Sans doute conviendrait-il également de prévoir un rythme régulier pour les réunions du Comité, afin de garantir qu’il se saisisse des questions essentielles relatives au secteur nucléaire en France. Enfin, le processus de nomination du secrétaire général du Comité, actuellement un décret, pourrait être solennisé afin de donner un poids accru à ce poste, par exemple par la procédure du décret en conseil des ministres. La coupure en deux entités distinctes de la régulation administrative du secteur nucléaire est aujourd’hui remise en question, même si une solution de remplacement s’avère difficile à mettre au point. Il reste que deux points d’accord existent : d’une part la radioprotection et la sûreté sont étroitement liées et d’autre part, la culture et les moyens de la radioprotection sont à renforcer d’urgence. 2.1. Le contrôle de la sûreté : des moyens désormais à la hauteur des enjeux Selon le décret n° 93-1272 du 1er décembre 1993, " la Direction de la sûreté des installations nucléaires (DSIN) est responsable de l’étude, de la définition et de la mise en œuvre de la politique en matière de sûreté nucléaire, ainsi que des problèmes qui s’y rattachent ". La DSIN a succédé au Service central de sûreté des installations nucléaires (SCSIN) lui-même créé par le décret n° 73-278 du 13 mars 1973. Rappelons que l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques a joué un rôle important dans le renforcement de l’administration chargée du contrôle de la sûreté, puisque aussi bien, son rapporteur, M. Claude Birraux, proposait, dans son premier rapport sur le contrôle de sûreté et de la sécurité des installations nucléaires : " le SCSIN est rattaché directement au ministre de l’industrie, en tant que nouvelle direction générale du ministère de l’industrie ". La structure de la DSIN comprend deux sous-directions fonctionnelles et quatre sous-directions opérationnelles. Parmi ces dernières, figure la 3ème sous-direction de la recherche, des déchets et du démantèlement. Par décision du 27 mars 1973, il a été créé auprès du SCSIN (DSIN) un groupe permanent d’experts chargé des installations destinées au stockage à long terme des déchets radioactifs. Plusieurs décisions du ministre de l’industrie précisent que les groupes permanents peuvent être consultés par le Directeur de la sûreté des installations nucléaires sur la réglementation technique relevant du domaine qui leur est confié et à tous les stades de la conception, de la construction et de l’exploitation d’une installation nucléaire de base. Au surplus, la consultation des groupes permanents est obligatoire lors de l’instruction de la demande d’autorisation d’une INB et de la préparation du décret d’autorisation. En 1984, le SCSIN comptait 21 agents de catégorie A et les DRIR 24 agents. En 1990, les effectifs s’élevaient respectivement à 22 et 44 agents, soit 65 ingénieurs et cadres. En décembre 1990, l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques demandait, par la voix de son rapporteur, Claude Birraux, que les effectifs du SCSIN soient doublés au terme d’un programme pluriannuel de 5 ans. En 1998, les effectifs atteignaient 165 ingénieurs et cadres. On peut en conséquence considérer que les recommandations de l’Office ont été suivies d’effet. Les ressources de la DSIN proviennent essentiellement des redevances instituées par la loi de finances rectificative n° 7561242 du 27 décembre 1975 et de son décret d’application n° 76-480 du 24 mai 1976. Grâce à ces redevances, la DSIN a disposé en 1998 d’un budget de 571,9 millions de francs. Les analyses et expertises de sûreté ainsi que les études représentent 81 % du total du produit des redevances, la rémunération des personnels et les moyens de fonctionnement correspondant à 19 % du total. L’organisation de la DSIN comprend, comme on l’a vu, une sous-direction " recherche, déchets, démantèlement ". L’importance croissante du problèmes des déchets à l’avenir conduit à recommander la création d’une sous-direction complémentaire, de façon à avoir une sous-direction " recherche " et une autre sous-direction " déchets et démantèlement ". Des créations de postes devraient être réalisées en conséquence. Si un effort supplémentaire, mais limité, doit être consenti pour la sûreté, c’est à un changement radical qu’il faut procéder pour la radioprotection. Selon le directeur de la sûreté des installations nucléaires, c’est bien la DSIN qui assume un rôle directeur dans la politique des déchets, tant pour ce qui concerne le transitoire que le long terme. C’est la DSIN qui oblige les producteurs à assumer leurs responsabilités dans la situation actuelle, en résolvant au cas par cas les problèmes qui se posent à eux, sans attendre la mise en place de centres de stockage ou d’entreposage centralisés ou partagés. En complément, pour le long terme, c’est la DSIN qui a lancé des groupes de travail sur des sujets spécifiques comme les déchets tritiés ou les rejets de carbone 14, afin de tenter de parvenir à des solutions collectives. Par ailleurs, les DRIRE ont la mission essentielle de contrôle sur place, en particulier pour les installations de stockage de déchets. On trouvera, à titre d’information, le nombre d’inspections portant sur les rejets et les déchets effectués en 1994 par les DRIRE. Tableau : Inspections des DRIRE portant sur les rejets et les déchets, en 1994
Selon l’article 1er de l’arrêté du 28 mai 1990, l’institut de protection et de sûreté nucléaire (IPSN), créé en 1976 en tant qu’institut au sein du Commissariat à l’énergie atomique, a pour mission " de réaliser les études, recherches et travaux de protection et de sûreté nucléaire qui lui sont confiés par les départements ministériels et organismes intéressés et de contribuer à la mise en œuvre des mesures arrêtées dans ce domaine, à la demande éventuelle des ministres chargés de leur exécution. L’institut fournit notamment, en matière de sûreté nucléaire, un appui technique direct au Service central de sûreté des installations nucléaires (...) ". Selon le même article, "dans le cadre de la mission fixée au CEA par le décret du 29 septembre 1970, l’IPSN effectue également des recherches ou travaux en matière de sûreté nucléaire, éventuellement pour le compte d’entreprises tierces ". Au total, les recettes de l’IPSN en 1998 étaient constituées à hauteur de 59,5 % de subventions de l’Etat, de 22,9 % du produit de sa convention avec la DSIN et de 17,6 % de ses contrats avec EDF, Cogema et autres clients. S’agissant de la répartition de ses activités, les programmes de recherche et d’expertise concernant la protection de l’Homme et des milieux et la radiobiologie représentaient 19,3 % de ses dépenses. Le budget de l’IPSN ne semble pas appeler de remarque particulière. La prise d’autonomie de l’IPSN par rapport au CEA, sous forme d’établissement public, permettrait sans doute une plus grande spécialisation sur les questions de sûreté et affirmerait encore l’autorité de l’IPSN dans ces domaines, à condition bien entendu de rendre encore plus rigoureuses les règles déontologiques de séparation des travaux menés pour la direction de la sûreté des installations nucléaires par rapport aux travaux conduits pour les exploitants. On peut souhaiter toutefois une meilleure inscription dans le programme général de recherche sur le stockage des déchets radioactifs, des travaux conduits par l’IPSN dans ce domaine (voir plus loin). 2.2. L’action du ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement En matière d’installations nucléaires de base, de rejets et de déchets radioactifs, l’action du ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement s’exerce par le biais d’une de ses directions, la Direction de la prévention des pollutions et des risques (DPPR) et par celui de la DSIN. Les développements qui suivent portent sur les responsabilités particulières de la DPPR. Deux domaines principaux sont du ressort de la DPPR, les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) qui peuvent recevoir des déchets faiblement radioactifs et les problèmes des petits producteurs de déchets radioactifs. On verra ensuite dans quelles mesures les structures devraient être complétées. L’action de la DPPR en matière des déchets radioactifs est fondée sur la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). Selon l’article 1er de cette loi, sont soumis au régime des ICPE " les usines, ateliers, dépôts, chantiers et d’une manière générale les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature et de l’environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments ". En fonction du type d’installation, de la nature et du volume des substances stockées, c’est-à-dire en fonction de la gravité des dangers ou des inconvénients que peut présenter leur exploitation, les ICPE sont soumises à un régime de déclaration ou d’autorisation (article 2 de la loi). L’autorisation est donnée par arrêté préfectoral, après enquête publique. La nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, inclut les cas de la préparation, de la fabrication, de la transformation, du conditionnement et du stockage de substances radioactives, sous forme de sources non scellées ou scellées. Des limites sont fixées en termes d’activités totales pour déterminer si le régime est celui de la déclaration ou de l’autorisation. Ces limites tiennent compte de la nature des radioéléments, selon leur groupe de toxicité. La loi du 19 juillet 1976 introduit un régime spécifique pour les ICPE. Parmi les dispositions les plus importantes, on peut citer la constitution de garanties financières, la définition éventuelle d’une durée maximale d’exploitation et d’un volume maximal de produits stockés ou extraits, et la mise en place de sanctions pénales et administratives en cas d’infraction. Le décret d’application n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié précise les modalités pratiques de ces dispositions. Pour la direction de la prévention des pollutions et des risques, il existe deux problèmes clé dans son domaine d’intervention. Le premier est celui des déchets miniers, dont on a vu qu’ils devaient faire l’objet de développement de techniques de confinement à très long terme et ne supposant pas d’interventions humaines. Le deuxième problème clé est celui des " petits producteurs " de déchets pour qui il est indispensable de monter une filière de récupération des déchets qui soit lisible et facile à utiliser. Par ailleurs, la DPPR souhaite clairement l’augmentation du nombre de ses inspecteurs des installations classées, une demande qui devrait pouvoir être satisfaite à la suite de l’augmentation significative des crédits du ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement dans le projet de loi de finances pour l’année 2000. 2.3. Le contrôle des sources radioactives à usage médical ou industriel La Commission interministérielle des radioéléments artificiels (CIREA), a pour mission de donner des avis sur l’emploi des radioéléments artificiels et des autorisations pour leur utilisation, mais elle a aussi la responsabilité du suivi des sources. Le rôle de la CIREA a déjà été examiné par l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, dans le rapport de M. Jean-Yves Le Déaut sur la gestion des déchets très faiblement radioactifs. Deux questions se posent quant au fonctionnement de la CIREA : d’une part l’extension éventuelle de sa mission et la continuité du rattachement administratif de ses services et d’autre part la clarification des exutoires qu’elle peut proposer pour les sources déclassées. 2.3.1. La place de la CIREA dans le dispositif de gestion des déchets radioactifs La commission interministérielle des radioéléments artificiels (CIREA) a été créée par la loi du 19 juillet 1952, sa composition et ses attributions ayant été précisées par le décret n° 54-475 du 3 mai 1954. Cette commission est chargée de donner son avis " sur les questions relatives aux radioéléments artificiels ". Selon l’article L. 634, " les détenteurs de radioéléments artificiels ou de produits en contenant ne pourront les utiliser que dans les conditions qui leur auront été fixées au moment de l’attribution ". Selon l’article L. 632, " la préparation, l’importation, l’exportation de radioéléments artificiels, sous quelque forme que ce soit, ne peuvent être effectuées que par le commissariat à l’énergie atomique ou les personnes physiques ou morales spécialement autorisées à cet effet (...) ". En application de ces deux articles, la CIREA assure un suivi complet des sources et produits radioactifs à usage médical ou industriel hors le cycle du combustible nucléaire. Au total, ce sont les opérations de fabrication, de vente, d’utilisation et ceci jusqu’à la reprise des sources hors d’usage ou ayant décru qui sont suivies en détail par la CIREA. La commission se réunit en séance plénière au moins deux fois par an, pour formuler ses avis et propositions sur toutes les questions d’ordre général que soulèvent l’élaboration et l’application de la réglementation relative aux radioéléments artificiels. Le secrétariat de la CIREA fournit quant à lui un travail extrêmement détaillé pour autoriser la fabrication, l’importation, la préparation, le transport, la vente, l’utilisation et la récupération des sources inutilisées. Ce sont le CEA et l’ISPN qui assurent, dans la pratique, les missions de la CIREA. 2.3.2. Les améliorations possibles quant à la mission de la CIREA, sa place dans le dispositif institutionnel et les solutions qu’elle propose La première modification, demandée dès 1992 par M. Jean-Yves Le Déaut, est que la mission de la CIREA porte sur les radioéléments artificiels et le radium, dont les usages médicaux sont analogues à ceux des radioéléments artificiels. Il faut aussi que la CIREA dispose de moyens d’inspection et de coercition pour faire respecter les conditions d’utilisation qu’elle impose. Par ailleurs, les liens sont multiples entre la CIREA et l’ANDRA, qui prend en charge, moyennant le recours aux moyens du CEA, le stockage des sources récupérées. Il paraît donc naturel, compte tenu par ailleurs de la similitude des statuts des personnels de l’ANDRA avec ceux du CEA, que l’ANDRA soit désormais l’institution dont dépendent les agents du secrétariat de la CIREA. Parallèlement, l’ANDRA devrait accélérer sa mise au point d’une solution propre pour les sources scellées ou non, en débarrassant le CEA d’une tâche de service public qu’il assume parfaitement à Saclay mais qui ne correspond nullement à ses missions. 2.4. L’indispensable renforcement des moyens de la radioprotection La radioprotection fait figure, sur le plan administratif, de parent pauvre, depuis que la sûreté a fait l’objet du développement exposé plus haut. Les échelons des administrations centrales ont certes été renforcés, ainsi que le " bras armé " de la radioprotection. Il n’en demeure pas moins que les moyens de la radioprotection et leur affectation que l’importance de leur contribution en amont des décisions, restent encore à renforcer d’une manière significative. 2.4.1. Le BPRI et l’OPRI : l’évolution des moyens et des statuts L’organisation administrative comprend en premier lieu le Bureau de protection contre les rayonnements ionisants (BPRI), appartenant à la sous-direction de la veille sanitaire de la Direction générale de la santé (DGS) du Secrétariat d’Etat à la santé. Le BPRI a été créé en 1995 et a vu ses moyens se développer lentement. Sa création est un écho tardif et atténué à la recommandation effectuée dès 1991 par l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, sur le rapport de M. Claude Birraux, de créer " une direction de plein exercice chargée de la radioprotection au ministère de la santé ". Certains experts avaient proposé que le BPRI soit commun à la DGS et à la Direction des relations du travail (DRT) mais il n’en a rien été. Le BPRI comprend en 1999 un chef de bureau, 6 cadres de catégorie A et 2 secrétaires. Ceci est à mettre en parallèle avec les 77 ingénieurs et cadres de la DSIN. Les décisions de doctrine et de réglementation sont de la responsabilité du BPRI, qui coopère, en tant que de besoin, avec la Direction des relations du travail. Ainsi qu’on le détaille plus loin, le BPRI, pour le compte du Secrétariat d’Etat à la santé, est cosignataire des autorisations de rejets. Pour autant, " la DGS a été exclue de la réflexion sur les déchets nucléaires ". La Direction générale de la santé s’attache par ailleurs à développer l’implication dans la radioprotection de ses services déconcentrés (DRASS et DDASS). En particulier, un programme de formation de ses inspecteurs est en cours. De même, la DGS entend développer les effectifs de ses services déconcentrés. Pour contrôler l’application de la réglementation en matière de radioprotection des travailleurs, de l’environnement et de la santé publique, le BPRI s’appuie sur l’Office de protection contre les rayonnements ionisants (OPRI). L’histoire de l’OPRI mérité elle aussi d’être contée. Ainsi que l’indiquait M. Franck Sérusclat, dans son rapport de 1990 sur la sécurité des installations nucléaires, au nom de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, le Service central de protection contre les rayonnements ionisants a été créé en 1956 au sein de l’Institut national d’hygiène, à l’occasion de la mise en exploitation du réacteur de Marcoule. Ses missions ont été définies par trois lois fondamentales : la loi du 2 août 1961 sur la pollution atmosphérique, la loi du 16 décembre 1964 sur la pollution des eaux et la loi du 25 juillet 1980 sur la protection des matières nucléaires et leurs textes d’application. Le SCPRI était un service technique des ministères de la santé et du travail et pouvait être considéré comme un démembrement de l’INSERM. M. Franck Sérusclat écrivait dans son rapport à propos du SCPRI : " cette indépendance a été constamment réaffirmée par le SCPRI. Le directeur du SCPRI est l’ordonnateur des dépenses du service, il n’existe aucune relation hiérarchique avec le directeur de l’INSERM et le conseil d’administration de l’INSERM n’a pas de compétence sur le SCPRI. Les conséquences de cette situation doivent être tirées. La transformation du SCPRI qui n’a aucun statut juridique clair et affirmé, en établissement public doté d’un conseil d’administration se prononçant sur les orientations générales du service et garantissant son indépendance pourrait être envisagée, de même que l’instauration d’une co-tutelle du ministère de la santé et du ministère de l’environnement ". Le Service central de protection contre les rayonnements ionisants (SCPRI), connaît enfin en 1994 un changement de statut pour devenir l’Office de protection contre les rayonnements ionisants (OPRI), en application du décret n° 94-604 du 19 juillet 1994. Selon l’article 1er du décret du 19 juillet 1994, l’OPRI est un établissement public de l’Etat à caractère administratif placé sous la tutelle conjoints du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du travail. Selon l’article 2, l’office " exerce les missions d’expertise, de surveillance et de contrôle propres à assurer la protection de la population contre les rayonnements ionisants ". En particulier, l’OPRI enregistre " les données relatives à l’exposition aux rayonnements ionisants ou à la radioactivité des personnes professionnellement exposées et de la population, et en assurant la centralisation, l’exploitation et la conservation de ces données ". L’OPRI contrôle également " les rejets d’effluents radioactifs gazeux et liquides en provenance des installations nucléaires de base ". Quels sont les réalités du travail accompli par l’OPRI et les moyens qui lui sont donnés ? La dosimétrie des 80 000 personnes employées par les exploitants nucléaires, des 13 500 travailleurs du domaine médical et des 35 000 personnes des autres activités utilisatrices de rayonnements ionisants est prise en charge par l’OPRI, ce qui conduit à l’analyse de 1 600 000 films par an. Il s’agit donc d’un travail considérable qui absorbe une grande part des forces de l’OPRI. Mais l’OPRI prend en charge d’autres missions. L’OPRI assure une surveillance générale de l’environnement et de l’exposition des populations, à partir de stations et de réseaux de prélèvements répartis sur l’ensemble du territoire. Pour la surveillance de l’air, l’OPRI effectue des mesures en continu avec le réseau " Teleray " et des dosimètres intégrateurs. Pour la surveillance des eaux, l’OPRI dispose du réseau " Hydrotéléray " et de stations de surveillance sur les principaux fleuves. Sont également surveillées la chaîne alimentaire, la flore terrestre, la faune et la flore aquatique. Dans ces activités systématiques, l’OPRI est toutefois souvent concurrencée par des réseaux ou des campagnes de mesure diligentées par les collectivités territoriales ou des associations de protection de l’environnement. Par ailleurs, l’OPRI se livre, depuis des années récentes, à des inspections des installations nucléaires de base. Par exemple en 1997, les centrales électronucléaires de Dampierre, de Flamanville, de Gravelines et de Civaux, ainsi que le centre de stockage ANDRA de l’Aube à Soulaines, ont fait l’objet d’inspections s’accompagnant d’opérations de mesure effectuées directement par l’OPRI, ce dernier s’appuyant sur les données fournies par les exploitants en régime permanent. L’ensemble des dépenses l’OPRI se sont élevées en 1998 à 78,4 millions de francs, dont 68,2 millions de francs de dépenses de fonctionnement et 10,2 millions de francs d’investissement. Les recettes ont atteint, en 1998, 101,8 millions de francs, dont 65,2 millions de francs de subventions (soit 64,1 %) et 29,6 millions de francs de ressources propres (soit 29,1 % du total). Les subventions proviennent essentiellement du ministère en charge de la santé (97 % des subventions) et du ministère du travail (3 % des subventions). Les ressources propres proviennent essentiellement de la dosimétrie. Les effectifs de l’OPRI s’élevaient à 178 personnes équivalents temps plein en 1998, dont 28,7 % d’ingénieurs et cadres de catégorie A. On ne saurait par ailleurs oublier le rôle de l’Institut de protection et de sûreté nucléaire (IPSN) dans la recherche et l’expertise en radioprotection. Sur un budget réalisé de 1,50 milliard de francs et des effectifs de 1252 agents, l’IPSN consacrait en 1998 19,3 % de son activité à des recherches et à des expertises sur la protection des milieux, la protection de l’Homme et la radiobiologie. 2.4.2. La répartition des tâches au sein de la sphère chargée de la radioprotection Une première question surgit à propos de l’organisation de la radioprotection. Il s’agit de la répartition réelle des tâches entre le BPRI, l’OPRI et l’IPSN. La deuxième question est évidemment celle de l’adéquation des moyens aux nécessités du contrôle de la sécurité des installations nucléaires. Sur le premier point, il faut signaler depuis 1995 la réintégration au sein de la DGS de la mission de conception de la réglementation et la responsabilité de l’application. Cette évolution est une bonne chose, de telles compétences ne pouvant revenir à un établissement public à caractère administratif. Bien sûr, selon l’article 2 du décret du 19 juillet 1994, l’OPRI " apporte son concours aux ministres chargés de la santé et du travail pour la préparation des lois, règlements, dispositions communautaires et accords internationaux relatifs à la radioprotection. Il peut proposer à ces ministres toute mesure de nature à améliorer la radioprotection ". Mais, selon la DGS, l’OPRI ne saurait être qu’un organisme chargé de la " métrologie ", tant pour les mesures sur le terrain que pour l’expertise dans ce domaine. Il serait pourtant souhaitable que l’OPRI mette en œuvre des pouvoirs de sanctions réels. En toile de fond des activités de l’OPRI, figure la question du pluralisme des mesures. Le pluralisme des mesures est demandé depuis 1991 par l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques. Dans son rapport pour 1991, M. Claude Birraux recommandait en effet que " le ministre de la santé soit directement chargé de mettre en place un réseau de laboratoires agréés pour les mesures de radioactivité dans l’environnement ". En fait, il faut faire preuve de réalisme sur cette question. Quels que soient les moyens supplémentaires qui pourraient être accordés à l’OPRI pour réaliser des mesures plus nombreuses et pour ainsi se substituer dans tous les cas aux exploitants, il resterait le doute provenant de l’unicité de la source. Il serait donc plus efficace, en termes de crédibilité, et plus économe, en termes financiers que la puissance publique accorde des subventions à des laboratoires agréés, que ce soit au niveau national ou au niveau local. Véritablement, le pluralisme des mesures reste toujours à officialiser et à organiser dans notre pays. S’agissant des recherches en matière de radioprotection, il est clair que l’OPRI n’a pas les moyens de rivaliser avec l’IPSN, de sorte que c’est cet institut qui est le seul moteur du progrès scientifique en France dans ce domaine. Cependant, il faut encore souligner que les recherches et l’expertise sur la radioprotection ne représentaient en 1996 que 21,4 % de l’activité totale de l’IPSN, soit environ 3 fois moins que les recherches et les expertises relatives à la sûreté. En dehors de la place réservée à chacune des institutions actuelles dans le futur système de contrôle de la sûreté et de la radioprotection, le renforcement de la recherche sur ce dernier domaine est une priorité absolue. Ainsi qu’on l’a vu, les moyens budgétaires de l’OPRI sont insuffisants et devraient être renforcés pour parvenir à une meilleure efficacité. Mais d’autres changements sont nécessaires, notamment en ce qui concerne le statut de l’OPRI, tel qu’il résulte du décret n ° 94-604 du 19 juillet 1994 relatif à sa création. Le budget de l’OPRI ne lui permet pas à l’évidence de mener à bien toutes les missions qui lui sont imparties. Ainsi, le nombre de ses inspecteurs chargés de contrôler sur place les dispositifs de radioprotection des exploitants nucléaires est actuellement de 4 personnes. Il convient donc de donner des moyens supplémentaires à l’OPRI. Quel pourrait en être le financement ? Comme on l’a vu précédemment, les ressources propres de l’OPRI en 1998 représentaient 29,1 % de ses recettes. L’activité dosimétrique est prédominante dans ces recettes, avec une part approchant les deux tiers. Les travaux réalisés pour EDF représentent près de vingt pour cent des recettes. En 1998, l’OPRI a vu ses recettes augmenter de 37,7 %. Mais cette augmentation n’est que d’apparence. En effet, les subventions ont augmenté de 53,2 %, en raison d’un versement par anticipation sur 1998 de recettes se rapportant à l’exercice 1999. En réalité, les subventions à l’OPRI n’ont augmenté, à conventions constantes, que de 7,5 %. Les recettes propres ont, quant à elles, augmenté de 38,5 %, en raison de réajustements de tarifs réalisés en 1997 et 1998. En définitive, il serait réaliste de programmer, pour les cinq prochaines années, un doublement des recettes propres s’accompagnant d’une augmentation de 50 % des subventions. Ainsi le niveau des 150 millions de francs de budget pourrait être atteint en 2005. Concurremment, des modifications réglementaires devraient être apportées au statut de l’OPRI dans le sens d’une amélioration de son efficacité. La première modification à effectuer concerne la mission impartie à cet organisme. Selon l’article 2 du décret du 19 juillet 1994, l’OPRI " participe à l’application des lois et règlements relatifs à la radioprotection, notamment : (...) en contrôlant les rejets d’effluents radioactifs gazeux et liquides en provenance des installations nucléaires de base ". La notion de participation reprise dans le décret tient compte du fait que l’OPRI s’en remet souvent au contrôle théorique de mesures faites par les exploitants eux-mêmes. Il semble donc préférable de préciser dans un nouvel alinéa du même article que " l’OPRI contrôle les rejets d’effluents radioactifs gazeux et liquides en provenance des installations nucléaires avec ses propres moyens de mesure et, après comparaison avec les mesures réalisées par les exploitants nucléaires, propose à ses ministres de tutelle toutes actions correctrices nécessaires au respect des autorisations et d’une manière générale à la protection de la santé publique et de l’environnement ". La deuxième modification qu’il est nécessaire d’apporter à l’OPRI découle de la responsabilité qui est la sienne d’effectuer des mesures dans l’environnement. Il semble nécessaire à cet égard de placer l’OPRI non seulement sous la tutelle de la santé et du travail comme actuellement, mais aussi sous celle de l’environnement. La troisième modification qu’il est nécessaire d’effectuer concerne le conseil d’administration. Celui-ci comprend en effet onze représentants de l’Etat et huit personnalités qualifiées nommés par les ministres chargé de l’industrie, de la recherche et du travail et trois représentants du personnel. Or l’on constate un très grand isolement de l’OPRI, non seulement sur la scène médiatique mais aussi vis-à-vis des milieux politiques et en particulier parlementaire. Il serait donc utile que, pour faire entrer à l’OPRI les préoccupations du public en matière de radioprotection, un député ou un sénateur soit désigné au sein du Conseil d’administration par l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, ainsi que c’est le cas pour l’ANDRA. Par ailleurs, une quatrième modification concernant le statut de l’OPRI devrait porter sur la possibilité que devrait avoir cet établissement public administratif de sous-traiter certaines de ses tâches à des organismes agréés par ses autorités de tutelle, ce qui n’est pas prévu pour l’instant. Le renforcement des contrôles sur place des rejets dans l’environnement, par exemple, ou bien le développement des films dosimétriques, pourraient en effet, dans certains cas, être confiés à des organismes publics ou privés agréés, agissant pour le compte de l’OPRI. Enfin, une cinquième changement devrait concerner le personnel de l’OPRI. En effet, cinq ans après la création de l’OPRI, le personnel n’a toujours pas de statut, ce qui paraît à la fois injuste et en contradiction totale avec l’importance de la mission de contrôle qu’exerce l’OPRI au service de la santé des travailleurs et de la santé publique. 2.5. L’opportunité discutable d’un rapprochement de la sûreté et de la radioprotection Le rapprochement éventuel de la sûreté et de la radioprotection est une question fréquemment débattue dans notre pays depuis quelques années. Ceci étant rappelé, faut-il modifier le paysage actuel des organismes du secteur ? Ainsi que l’a noté en juillet 1998, M. Jean-Yves Le Déaut, dans son rapport au Premier ministre sur " le système français de radioprotection, de contrôle et de sécurité nucléaire : la longue marche vers l’indépendance et la transparence ", huit rapports différents (parlementaires, IGAS, Cour des comptes, cabinet externe) avaient été consacrés à la mi-1998 à l’analyse du système de radioprotection en France et ont conclu à la faiblesse du dispositif. Parmi ses propositions de juillet 1998, M. Le Déaut met en avant la création d’une agence française de sûreté nucléaire et de radioprotection. Cette agence serait un établissement public à caractère industriel et commercial regroupant un IPSN rendu indépendant du CEA et l’OPRI. Or les vocations de l’IPSN, à savoir la recherche et l’expertise, ou de l’OPRI, c’est-à-dire la métrologie, sont très différentes. De plus, il semble que la Direction générale de la santé ne soit pas désireuse de diluer son outil de contrôle dans un établissement public de recherche dont ce ne serait pas la mission essentielle. Pour augmenter la prise en compte des impératifs de santé et de l’environnement dans la recherche nucléaire française, une solution pourrait être de placer l’OPRI comme institut de métrologie sous la tutelle non seulement de la santé et du travail comme actuellement mais aussi sous celle de l’environnement et de placer l’IPSN autonome sous une tutelle supplémentaire, celle du ministère chargé de la santé. Cette orientation trouverait naturellement à s’inscrire dans le décret de création de l’IPSN en tant qu’établissement public industriel et commercial. 2.6. L’externalisation impossible de la fixation de la norme et de la police en matière de sûreté et de radioprotection La responsabilité de la définition de la réglementation nucléaire et la responsabilité de la police dans le nucléaire (et donc la responsabilité de la sécurité du citoyen dans ce domaine) relèvent du Gouvernement. Le Conseil d’Etat l’a rappelé début 1999, à l’occasion de son examen de l’avant-projet de loi sur la transparence et la sûreté dans le nucléaire. Une analyse politique relative au contrôle de la sûreté et de la sécurité des installations nucléaires ne peut que conduire à la même conclusion que l’analyse juridique. De fait, il appartient en propre aux ministres en charge de l’industrie, de la santé et de l’environnement d’impulser, de définir et de contrôler l’ensemble des exploitants nucléaires et des opérateurs utilisant des produits radioactifs. En définitive, l’objectif de toute réforme des institutions dans ce domaine est d’améliorer, par la création seulement éventuelle d’une nouvelle institution, les conditions d’un compromis politique entre les objectifs de développement économique et de protection de la santé ainsi que de l’environnement. 3. Les procédures d’autorisation de rejet de radioéléments dans l’environnement Les années récentes ont vu un changement profond apporté aux procédures d’autorisation de rejets radioactifs, avec au surplus une série de modifications législatives et réglementaires de nature à permettre une remise à plat de l’ensemble des autorisations accordées dans le passé. Les progrès accomplis sont donc d’une grande importance, même si le réexamen de tous les dossiers d’autorisation va prendre du temps, c’est-à-dire quelques années. Quelques améliorations sont encore possibles et sont proposées dans la suite. Si un changement fondamental de procédure s’est produit avec le décret du 4 mai 1995, une évolution fondamentale s’est également produite en ce qui concerne les objectifs fixés aux exploitants nucléaires. Le régime des rejets d’effluents radioactifs gazeux provenant des installations nucléaires de base a été fixé de 1974 à 1995 par le décret n°74-945 du 6 novembre 1974. Celui des rejets d’effluents radioactifs liquides l’était par le décret n° 74-1181 du 31 décembre 1974. S’agissant des effluents gazeux, la demande d’autorisation de rejets était transmise au ministère de l’industrie qui l’adressait au ministère de la santé, lui-même sollicitant l’avis du SCPRI. Pour les effluents liquides, le dossier était également transmis au ministre chargé de la police des eaux et au ministre des transports dans le cas de rejets en mer. Pour la plupart des installations, la demande d’autorisation de rejets gazeux ou liquide était soumise à une enquête publique. Toutefois, les rejets provenant des installations autorisées avant la publication du décret du 6 novembre 1974 ne l’étaient pas. L’autorisation était accordée par arrêté conjoint des ministres de l’industrie et de la recherche, de la santé et de la qualité de la vie, avec dans le cas des rejets liquides la signature additionnelle du ministre chargé de la police des eaux et de celui des transports dans le cas de rejets en mer. Si les arrêtés d’autorisation de rejets étaient ainsi accordés au plan national, au contraire les autorisations de rejets d’effluents non radioactifs, c’est-à-dire chimiques, étaient octroyées par arrêté préfectoral. Selon les deux décrets précités, les conditions prévues dans l’autorisation étaient fixées pour une durée de trois ans. A l’expiration de ce délai, elles demeuraient applicables tant qu’elles n’étaient pas modifiées par le Gouvernement. Cette modification pouvait intervenir à tout moment, sous réserve d’un préavis d’un an, par arrêté interministériel pris dans les formes de l’arrêté d’autorisation. Les autorisations étaient fixées en quantités cumulées annuelles, globalement ou pour certains radionucléides. Néanmoins, selon l’article 5 de l’arrêté du 10 août 1976 relatif aux règles générales applicables à la fixation des limites et modalités de rejet des effluents radioactifs gazeux, " pour certains types d’installations, les modalités de ces rejets, notamment leur répartition dans le temps, les dispositifs d’évacuation, etc., peuvent être adaptés en fonction des caractéristiques de l’environnement. On pourra en particulier définir des valeurs maximales pour les activités volumiques ajoutées après dispersion dans le milieu récepteur ". Pour les rejets liquides, l’article 5 de l’arrêté du 10 août 1976 fixait également des limites d’activité volumique de l’eau d’un fleuve, consécutivement au fonctionnement de l’ensemble des centrales de puissance d’un bassin. Le texte fondamental qui modifie la procédure d’autorisation de rejets est le décret n° 95-540 du 4 mai 1995 relatif aux rejets d’effluents liquides et gazeux et aux prélèvements d’eau des installations nucléaires de base. Auparavant, la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau et son décret d’application n° 93-742 relatif aux procédures d’autorisation et de déclaration prévues par l’article 10 avaient modifié le régime d’autorisation des prélèvements d’eau et de rejets non radioactifs par les installations nucléaires de base. Ces autorisations, délivrées par arrêté préfectoral, étaient devenues limitées dans le temps. Par souci de simplification et de clarté, le décret n° 95-540 du 4 mai 1995 regroupe les autorisations interministérielles de rejets radioactifs et les autorisations préfectorales de prélèvements d’eau et de rejets non radioactifs. De surcroît, la Direction de la sûreté des installations nucléaires voit son importance renforcée dans le dispositif, puisqu’elle est chargée de l’instruction des demandes d’autorisation, pour le compte des ministères de l’industrie et de l’environnement. Dans tous les cas, selon l’article 11 du décret du 4 mai 1995, l’autorisation est accordée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l’industrie et de l’environnement. Selon la DSIN, il s’est produit depuis le milieu des années quatre-vingt dix un " renversement de doctrine " qui vient compléter les modifications réglementaires et en utiliser les marges de manœuvre. Le SCPRI fixait les autorisations de rejets en fonction de " seuils sanitaires ", en dessous desquels les rejets étaient considérés comme n’ayant pas de conséquences négatives sur la santé publique et l’environnement. En réalité, " il n’existait aucun fondement épidémiologique aux autorisations de rejets ". Moyennant quoi, en fonctionnement normal, les exploitants nucléaires pouvaient se targuer de ne rejeter qu’un pourcentage infime des autorisations, par exemple 1 % de ces dernières dans certains cas. La nouvelle doctrine relative aux niveaux des rejets radioactifs combine les principes ALARA et BAT, ce qui veut dire que, selon le directeur de la sûreté des installations nucléaires, " dès qu’un exploitant sait faire, on lui impose de le faire ". Les autorisations sont donc fixées en fonction de l’état de l’art, considéré sur un plan international, c’est-à-dire à un niveau proche des meilleures performances possibles. De sorte que, dès qu’un incident se produit, l’exploitant sort des autorisations données et donc doit déclarer à l’autorité de sûreté les difficultés qu’il rencontre et prendre des mesures conservatoires Ainsi que le précise le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 relatif à l’application de l’article 10 de la loi sur l’eau, les autorisations de prélèvement d’eau ou de rejets d’effluents liquides non radioactifs sont accordées par un arrêté préfectoral et pour une durée limitée fixée au cas par cas. Le décret du 4 mai 1995 ayant introduit une procédure commune d’autorisation pour les rejets radioactifs, les rejets non radioactifs et les prélèvements d’eau, l’arrivée à échéance des autorisations de prélèvements d’eau constitue le levier permettant de reprendre l’ensemble des dossiers d’une même installation nucléaire de base. Ainsi que l’a indiqué à votre Rapporteur le Directeur de la sûreté des installations nucléaires, la première application intégrale du décret du 4 mai 1995 a porté sur la centrale électronucléaire EDF de Saint Laurent des Eaux. En application des doctrines ALARA et BAT, les limites supérieures de rejet pour l’ensemble des radioéléments ont été divisées par 35, à l’exception des limites pour le carbone 14 et le tritium pour lesquels la réduction n’a été que d’un facteur 2. A la fin mai 1999, les dossiers des centrales électronucléaires de Saint Alban, de Dampierre, de Flamanville et de Paluel étaient en cours d’examen. Selon la DSIN, " ce qui nous guide c’est un arrêté qui tombe. Il faudra 5 ans pour tout repasser au peigne fin ". Il y a encore, en effet, des installations nucléaires de base qui fonctionnent encore grâce aux seules autorisations de l’ex-SCPRI. Deux observations peuvent être faites à cet égard. En premier lieu, les autorisation de rejets étaient données depuis 1974 par arrêté interministériel comportant la signature du ministre de l’industrie. Par ailleurs, il était possible sous le régime des décrets de 1974 de mettre fin à des autorisations de rejets mais cela nécessitait un préavis d’un an et un arrêté ministériel, une procédure à la fois plus lourde et plus conflictuelle que la procédure actuelle. Il reste que, de l’aveu même de la direction de la sûreté des installations nucléaires, les limites fixées pour certains radioéléments comme le carbone 14 et le tritium sont encore peu exigeantes, au motif que " le processus n’est pas facile pour EDF et encore moins pour le CEA ". On peut se demander à cet égard s’il suffit pour être à l’optimum que " les autorisations soient proches de ce que l’exploitant sait faire ". En tout état de cause, un objectif de principe doit désormais être fixé à l’ensemble des exploitants nucléaires, à savoir la marche vers le rejet zéro pour les radioéléments artificiels par conversion des rejets en déchets solides. A cet effet les autorisations de rejets doivent être données pour une durée limitée, sur la base des rejets réels et avec des objectifs de réduction programmée. Ce qui est mis en pratique dans les décharges de classe I, avec un traitement de tous les effluents et stockage sur place des polluants, doit également l’être pour les installations nucléaires. Un autre point fondamental est celui de l’arbitrage entre les rejets et les déchets solides. Selon la direction de la sûreté des installations nucléaires, " le rejet zéro n’est pas possible. Une installation n’a jamais de rejet zéro. Elle ne peut avoir que des rejets en dessous du seuil de mesure ". Il n’en demeure pas moins qu’un optimum est à trouver entre les rejets et les déchets solides, sachant qu’une diminution des rejets peut être obtenue avec une augmentation des déchets solides comme conséquence inévitable. Dans la mesure où les déchets correspondants sont gérables et n’atteignent pas des volumes dirimants, votre Rapporteur estime qu’il faut opter pour les déchets solides. En fait, il s’agit du débat entre dispersion et confinement, longtemps tranché en faveur de la dispersion. En tout état de cause, l’option de la dispersion paraît en contradiction de plus en plus forte avec la demande sociale. Mais pour que le confinement puisse être privilégié dans les faits, encore faut-il que l’opinion accepte des centres de stockage. S’ils sont assortis des garanties techniques suffisantes, cette acceptation ne devrait pas poser de problèmes insurmontables. III – La responsabilité des producteurs de déchets
Les exploitants générateurs de déchets radioactifs ont la responsabilité de la gestion de ces derniers. Ceci résulte de l’application à cette catégorie particulière de déchets, des dispositions de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l’élimination des déchets et à la récupération des matériaux. Selon l’article 2 de cette loi, " toute personne qui produit ou détient des déchets, dans des conditions de nature à produire des effets nocifs sur le sol, la flore et la faune, à dégrader les sites ou les paysages, à polluer l’air ou les eaux, à engendrer des bruits et des odeurs et d’une façon générale à porter atteinte à la santé de l’homme et à l’environnement, est tenue d’en assurer ou d’en faire assurer l’élimination conformément aux dispositions de la présente loi, dans des conditions propres à éviter lesdits effets. " Il s’agit d’une responsabilité permanente. Elle s’applique en particulier aux dispositions à prendre à court terme ou dans l’attente de solutions extérieures à l’entreprise. Ce principe est fondamental et fondateur de tout le système de gestion des déchets. Dans l’attente de la mise en place d’exutoires pour l’ensemble des catégories de déchets, les générateurs de déchets sont responsables de la gestion des déchets qu’ils produisent,. D’une manière générale, la doctrine du ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement est en effet qu’il n’existe pas de permis de polluer et qu’il n’existe pas non plus de limite sanitaire en dessous de laquelle un opérateur peut faire ce qu’il entend. En conséquence, tout producteur de déchets, en particulier radioactifs, doit élaborer un plan de gestion de ceux-ci, " du berceau à la tombe ", le communiquer aux administrations compétentes, appliquer la réglementation et se soumettre à des contrôles. Quel que soit le type de déchets, on ne commence pas par dire que ces obligations ne s’appliquent qu’au-dessus d’un certain seuil. Il n’existe pas de seuil d’exemption. Ces approches semblent progresser dans le nucléaire, certes difficilement, mais " cela se fait ". La Cour des comptes dans son rapport public pour 1998 a consacré une étude longue et fouillée aux provisions passées dans leurs comptes par les exploitants pour financer les dépenses futures de démantèlement de leurs installations et de gestion des déchets nucléaires. Si les principaux producteurs de déchets radioactifs sont des entreprises nationales dont on ne peut douter de l’engagement sur des objectifs collectifs comme la gestion des déchets, il semble nécessaire d’anticiper d’éventuels changements juridiques les concernant et pour tout dire, leur privatisation. 2.1. Les provisions financières effectuées par les exploitants Les dépenses de stockage des déchets radioactifs et de démantèlement des installations font l’objet de la plupart des exploitants nucléaires, de provisions annuelles, destinées à financer les dépenses correspondantes lorsque celles-ci se produiront. Le tableau ci-après fait la récapitulation au 31 décembre 1997 des provisions accumulées, qui, bien entendu, continueront de croître chaque année jusqu’à atteindre les montants des dépenses estimées. Tableau 12 : Provisions pour stockage des déchets et démantèlement faites par les principaux exploitants nucléaires au 31/12/1997
Les provisions faites par EDF pour les déchets nucléaires et le démantèlement ne représentent que la moitié du total des provisions que l’entreprise a passées dans ses comptes. Les autres provisions sont relatives au coût du retraitement futur des combustibles déchargés et à la prise en compte des défauts génériques. S’agissant du démantèlement, les provisions à fin 1997, pour les réacteurs électronucléaires, atteignaient 40 % du montant des dépenses estimées. Le CEA, pour sa part, n’a commencé que récemment (1993) à faire figurer dans ses états financiers les charges futures qui lui incombent. Les dépenses futures de stockage et de démantèlement sont inscrites dans ses engagements hors bilan. L’hypothèse implicite est que l’Etat fera face aux charges du CEA par des subventions budgétaires. La nécessité d’une programmation pluriannuelle est évidente là aussi. La Cogema, quant à elle, estimait au 31 décembre 1997 ses charges futures à 25,47 milliards de francs, dont elle avait provisionné comptablement à la même date 54 %. 2.2. La nécessaire pérennité des fonds alloués au très long terme Dans son rapport pour 1998, la Cour des comptes écrit à juste titre : " on ne peut pas inférer de l’inscription des provisions et, encore moins, de la présentation d’engagements hors bilan, que les ressources nécessaires seront disponibles lorsque les dépenses interviendront ". En toute hypothèse, il semble fondamental que soit mis en place un mécanisme assurant la pérennité des provisions passées pour la gestion future des déchets radioactifs et du démantèlement. La Cour des comptes estime en particulier qu’il convient d’isoler les fonds mis en réserve par les exploitants nucléaires, de façon à s’assurer de leur disponibilité le moment venu. Des dispositions allant dans ce sens doivent être adoptées d’autant plus rapidement que la pression de la concurrence sur le marché de l’électricité introduite par la directive européenne pourrait inciter EDF à faire passer au second plan les impératifs du long terme, sans parler des évolutions possibles du statut de l’établissement public. 2.3. Les dépenses annuelles de gestion des déchets radioactifs Le CEA met en œuvre depuis 1991 un plan pluriannuel d’assainissement et de gestion des déchets, dit Plan Lallement. Ce plan porte sur une vingtaine d’années et représente une dépense annuelle d’environ 600 millions de francs, dont 200 millions pour la seule gestion des déchets. Comment ces dépenses sont-elles financées ? La première phase de ce plan correspond à la période 1993-2000. Son financement est assuré dans le cadre d’une convention signée en août 1993 avec EDF et Cogema. Au-delà, rien ne semble prévu. La discordance entre la durée du plan d’assainissement et de gestion des déchets et la précarité de son financement ne peut qu’étonner. En fait, ceci n’est que le reflet de la situation générale qui est faite au CEA depuis la fin en 1997 de son contrat triennal d’objectifs. Depuis celle-ci, en effet, le CEA se trouve dépourvu d’une programmation à moyen terme de ses missions et de ses moyens, faute d’un accord entre les autorités de tutelle, alors que le temps de la recherche et du développement est un temps long. A l’évidence, il est indispensable que l’Etat définisse, au minimum à moyen terme, et de préférence à long terme, les missions du CEA et planifie sur la même durée ses ressources. En tout état de cause, il est indispensable qu’un financement pérenne soit prévu pour le plan d’assainissement et de gestion des déchets. 3. Les dispositions à prendre par les exploitants pour diminuer les rejets et les déchets La diminution par les exploitants de leurs rejets et de leurs déchets exigent de leur part différents types d’effort. La DSIN estime à cet égard que EDF n’a pas des équipes suffisamment nombreuses pour la mise au point de processus permettant de minimiser les rejets et l’exposition des travailleurs ainsi que pour effectuer les contrôles afférents. Il est par ailleurs symptomatique de constater que Cogema, dans sa nouvelle demande d’autorisation de rejets pour La Hague, ne s’engage pas sur des chiffres précis de réduction des rejets, se contentant d’indiquer que " l’impact dosimétrique des rejets restera inférieur à l’impact des rejets nominaux, c’est-à-dire 0,1 mSv/an ". Pour autant, Cogema connaît des possibilités de progrès. Ainsi, la réduction des rejets de ruthénium, un radioélément présent dans les effluents liquides, serait possible, selon l’entreprise, " moyennant un investissement de plusieurs centaines de millions de francs ". De même, il serait envisageable, de l’aveu même de Cogema, d’orienter préférentiellement dans les effluents liquides le carbone 14 et l’iode 129 présents actuellement dans les rejets gazeux. Si ces ouvertures sont faites par Cogema dans sa nouvelle demande d’autorisation de rejets, c’est qu’elles sont évidemment possibles et que d’autres existent sans doute aussi. S’agissant des rejets d’EDF, on a vu précédemment que la doctrine de la DSIN est d’imposer à l’exploitant de mettre en œuvre les techniques les plus performantes qu’il connaît. Ceci ne paraît pas constituer une approche satisfaisante. Il est au contraire de la responsabilité des pouvoirs publics de poser comme priorité une réduction toujours plus forte des rejets et d’impulser en conséquence les recherches adéquates, notamment à l’IPSN. On a vu précédemment que la mobilisation de l’IPSN sur des programmes de recherche et développement appliqués aux rejets et à la radioprotection semble ne représentaient en 1998 que moins de 20 % du total de ses dépenses de recherche. La subvention accordée par l’Etat et la convention liant la DSIN et l’IPSN constituent des leviers suffisants pour lancer des programmes de recherche additionnels sur la minimisation des rejets. En réalité, il faut placer la politique de réduction des rejets des installations nucléaires ainsi que la politique de gestion des déchets nucléaires au centre des préoccupations de tous les intervenants du secteur et exercer une pression constante et déterminée pour que chacun d’entre eux prenne des dispositions concrètes pour progresser dans cette voie. Etant constaté que les orientations générales de la politique des déchets radioactifs sont bien évidemment du ressort du Gouvernement, il reste la question, au demeurant fondamentale, de la mise en œuvre de cette politique. A cet égard, la place de l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs est, selon les textes, d’une importance capitale. Selon la loi n° 91-1381 du 30 décembre 1991, l’ANDRA se voit en effet dotée d’une responsabilité opérationnelle générale pour la gestion à long terme de l’ensemble des déchets radioactifs. Ainsi, l’article 13 de la loi énonce notamment que " cette agence est chargée des opérations de gestion à long terme des déchets radioactifs, et notamment (...) d’assurer la gestion des centres de stockage à long terme, soit directement, soit par l’intermédiaire de tiers agissant pour son compte (...) (et) de concevoir, d’implanter et de réaliser les nouveaux centres de stockage, compte tenu des perspectives à long terme de production et de gestion des déchets ". Il semble utile de revenir sur les phases successives de l’existence de l’ANDRA pour déterminer s’il est nécessaire d’envisager une modification de ses compétences et de son organisation, afin de faire progresser la gestion des déchets radioactifs dans notre pays. L’analyse des modifications successives du statut de l’ANDRA et un examen rapide de ses réalisations passées conduisent à envisager pour l’avenir deux options qu’il convient d’examiner en détail. Il pourrait en effet être opportun de réaffirmer la mission de l’ANDRA telle qu’elle ressort des textes existants, ou bien d’étendre sa mission par l’intégration de nouvelles fonctions, en particulier de recherche et de contrôle, voire de définition de la politique nationale de gestion des déchets. 1. Les textes législatifs et réglementaires relatifs à l’ANDRA et leur modification éventuelle Le texte de base relatif à l’ANDRA est bien entendu la loi n° 91-1381 du 30 décembre 1991 relative aux recherches sur la gestion des déchets radioactifs. Ce texte et le décret d’application correspondant ont défini la mission et les moyens de l’agence et fourni le cadre et l’inspiration des décisions prises dans le cadre de son activité. Il est toutefois nécessaire de rappeler les dispositions essentielles de l’arrêté initial de 1979, avant de tirer des conclusions sur d’éventuelles retouches à apporter au décret actuel. C’est en 1979 qu’est créée au sein du Commissariat à l’énergie atomique, une agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs. Selon l’article 2 de l’arrêté de création, l’agence est chargée, " conformément aux dispositions législatives et réglementaires et en application de la politique générale définie par le Gouvernement, des opérations de gestion à long terme des déchets radioactifs ". La loi du 30 décembre 1991 érige l’ANDRA en établissement public industriel et commercial, placé sous la tutelle des ministres de l’industrie, de la recherche et de l’environnement, sa mission générale restant toutefois la même. C’est à la demande expresse de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, que l’autonomie est donnée à une agence initialement dans le giron du CEA, et ceci contrairement à l’intention première du Gouvernement. L’octroi de l’autonomie répond à plusieurs objectifs. Dans le cadre d’un nouvel élan donné à la recherche de solutions à long terme pour les déchets radioactifs de haute activité à vie longue, il s’agit de disposer d’une structure spécialisée, aisément contrôlable et disposant d’une identité propre, indépendante de celle du CEA. Quelle est l’évolution des tâches détaillées confiées à l’ANDRA en 1991, par rapport à celles dévolues en 1979 ? En réalité, l’ANDRA indépendante reçoit globalement les mêmes, à cinq différences près. La première nouveauté introduite par la loi de 1991 est de souligner que la mission de conception, d’implantation et de réalisation de nouveaux centres de stockage qui continue d’incomber à l’ANDRA, doit explicitement tenir compte des perspectives à long terme de production et de gestion des déchets. L’arrêté de 1979 n’incluait ce point que sous forme d’incidente. La deuxième nouveauté est l’accent mis, dans les tâches de conception, d’implantation et de réalisation de nouveaux centres de stockage, sur " la réalisation et l’exploitation de laboratoires souterrains destinés à l’étude des formations géologiques profondes ". La troisième inflexion concerne les conditionnements. L’arrêté du 7 novembre 1979 indiquait que l’ANDRA était chargée " de promouvoir en concertation avec les producteurs de déchets des spécifications de conditionnement et de stockage avant leur évacuation vers les centres de stockage à long terme ". La loi de 1991, au contraire indique que l’ANDRA doit " définir en conformité avec les règles de sûreté, des spécifications de conditionnement et de stockage des déchets radioactifs ". Les responsabilités appartiennent donc à l’ANDRA qui définit les conditionnement et à la DSIN qui définit les règles de sûreté. Même si l’on ne peut concevoir que l’ANDRA ne se concerte pas avec les producteurs de déchets, la responsabilité et donc la décision ultime lui reviennent. Cette précision donnée par la loi n’est pas anodine. En effet, le conditionnement est un facteur essentiel de l’efficacité technique et économique de toute filière de traitement et de stockage de déchets. Le quatrième changement concerne la recherche. L’ANDRA devait, selon l’arrêté de 1979, " contribuer aux recherches, études et travaux concernant les procédés de gestion à long terme des déchets radioactifs ainsi que leur devenir ". La loi de 1991 précise que l’agence est désormais chargée notamment, " en coopération avec le Commissariat à l’énergie atomique, de participer à la définition et de contribuer aux programmes de recherche et développement concernant la gestion à long terme des déchets radioactifs ". La référence au CEA découle du fait que l’agence a désormais une personnalité juridique. S’agissant de la recherche, l’agence est associée à la définition des programmes et contribue à leur réalisation. Il s’agit là d’un rôle qui n’est ni directeur, ni exclusif, ni à la limite obligatoire. La cinquième innovation, essentielle, est la responsabilité donnée à l’ANDRA de conduire un inventaire annuel des déchets radioactifs se trouvant sur le territoire national. Une lecture possible de la loi de 1991 est de considérer que l’ANDRA est en définitive une agence d’impulsion dotée certes d’une compétence globale pour les déchets radioactifs de toute nature mais aussi d’une mission prioritaire, les laboratoires souterrains. Cette lecture, somme toute réductrice, est aussi, dans une certaine mesure, celle du principal décret d’application de la loi du 30 décembre 1991. 1.3. Le décret d’application n° 92-1391 du 30 décembre 1992 de la loi du 30 décembre 1991 Le décret d’application n° 92-1391 du 30 décembre 1992 de la loi précitée semble mettre l’accent, au moins sur un plan formel, sur la mission de l’ANDRA quant aux laboratoires souterrains. L’article 1er du décret rappelle en effet que " l’ANDRA exerce les compétences qui lui sont dévolues par l’article 13 de la loi susvisée. Elle présente chaque année à ses ministres de tutelle un rapport relatif aux travaux effectués ou à effectuer dans les laboratoires souterrains destinés à étudier l’aptitude de formations géologiques profondes à stocker des déchets radioactifs (…) ". Les missions générales et détaillées dévolues par la loi sont donc citées pour mémoire et l’accent est mis sur les laboratoires souterrains. Certains observateurs voudraient voir dans cette formulation une incitation directe donnée à l’ANDRA de porter la plus grande part de ses efforts sur cette question. Il est incontestable que les faits semblent leur donner raison. Que l’ANDRA ait donné, depuis l’octroi de son autonomie en 1991, une priorité de fait à la question des laboratoires souterrains et à celle des déchets de faible activité au détriment de ses autres missions, est une réalité difficilement contestable. L’examen des comptes de résultat de 1996, 1997 et 1998 le démontre clairement (voir figure suivante). Figure 3 : Répartition du chiffre d’affaires de l’ANDRA
Les ressources de l’ANDRA affectées à la recherche de sites pour les laboratoires en profondeur représentent de 1996 à 1998 plus de 50 % du total. Ceci résulte en réalité de nombreux facteurs. Parmi ceux-ci, on peut citer la pression des clients de l’ANDRA soucieux de voir avancer le projet le plus complexe et le plus long à mettre en œuvre, à savoir celui d’un stockage géologique pour les déchets de haute activité à vie longue. On peut également citer l’intérêt constant des pouvoirs publics et du Parlement pour ce sujet emblématique de la gestion des déchets radioactifs. Le deuxième thème privilégié par l’ANDRA est celui de l’arrêt de l’exploitation du Centre de stockage de la Manche, fin juin 1992 et la mise en service du Centre de stockage de Soulaines dans l’Aube. Le chiffre d’affaires pour les centres de stockage compte pour près de 40 %. Pour autant, la loi de 1991, qui fait autorité pour définir la mission de l’ANDRA, englobe bien la gestion à long terme de tous les déchets radioactifs, de haute, moyenne, faible ou très faible activité. Pour parvenir à une meilleure gestion des déchets de tous types, il est à l’évidence nécessaire d’accélérer le calendrier de réalisation de nombreux nouveaux équipements d’entreposage et de stockage partagés par l’ensemble des opérateurs du nucléaire. En conséquence, il faut tout à la fois réaffirmer le rôle de l’ANDRA et accroître ses moyens. Même si, juridiquement, une modification du décret n° 92-1391 du 30 décembre 1992 n’est pas obligatoire, votre Rapporteur estime toutefois utile que ce dernier soit modifié dans son article 1er. L’ajout d’une phrase et d’une précision dans cet article permettrait de rappeler voire de refonder la mission de l’ANDRA. Cette formulation pourrait être la suivante : "Article 1er : l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) exerce les compétences qui lui sont dévolues par l’article 13 de la loi du 3à décembre 1991 susvisée. L’ANDRA prend en conséquence toute mesure pour concevoir, réaliser, ou faire réaliser, exploiter et contrôler, des solutions opérationnelles de gestion à long terme de tout type de déchets radioactifs, en incluant l’entreposage de longue durée. En particulier, elle présente chaque année (…) ". 1.5.2. L’intégration de nouvelles fonctions de contrôle et de recherche L’ANDRA établit chaque année, sur une base déclarative, l’inventaire national des déchets radioactifs. L’agence répond ainsi à l’obligation qui lui est faite par l’article 13 de la loi du 30 décembre 1991. Toutefois, l’ANDRA, étant responsable de la publication de ces résultats, elle devrait se voir donner la possibilité de vérifier les déclarations des propriétaires de déchets, notamment pour ne pas être tenue pour responsable d’éventuelles inexactitudes. Au-delà de la question au demeurant fort importante de la connaissance des stocks actuels de déchets, la Commission nationale d’évaluation critique, avec raison, l’imprécision actuelle des prévisions des quantités de déchets à l’horizon 2020. Sa recommandation d’octobre 1998 montre l’ampleur du problème : " (la CNE) recommande également que les prévisions de production des colis de déchets destinés à un stockage soient rendues plus réalistes, plus cohérentes en évitant certains chiffres qui diffèrent selon les sources de données et qu’elles soient, pour le futur, argumentées ". La lettre de mission du nouveau Président de l’ANDRA comprend la réalisation d’un inventaire prospectif fiable sous les différentes hypothèses relatives à l’aval du cycle. Là aussi, il convient de donner à l’ANDRA un pouvoir permanent et institutionnalisé de mobilisation et de contrôle des équipes des exploitants afin de parvenir à des évaluations fiables. Au vrai, il s’agit que l’ANDRA soit dotée du pouvoir de contrôler les sites d’entreposage des déchets nucléaires de tous types, tout en restant elle-même contrôlée par la direction de la sûreté des installations nucléaires. Les travaux préparatoires de la loi du 30 décembre 1991, et notamment les débats parlementaires, ont montré par ailleurs que deux optiques existaient quant aux responsabilités de l’ANDRA en matière de recherche. La solution retenue confère à l’ANDRA, comme on l’a vu, la mission de participer à la définition des recherches et de contribuer à leur réalisation, sans lui donner un rôle directeur et les moyens en conséquence. Cette solution était raisonnable, lorsqu’elle a été prise, dans la mesure où l’ANDRA devait faire l’apprentissage de l’autonomie et mettre en place de nombreuses nouvelles structures. Il semble aujourd’hui que l’absence de moyens de recherche suffisants dans ce domaine stratégique entraîne des inconvénients et compromette l’affirmation pleine et entière de sa mission. A l’heure actuelle, l’agence se présente comme un " maître d’ouvrage scientifique ". L’ANDRA ne dispose pas de moyens de recherche propres comparables à ceux d’autres institutions du secteur, ce qui nuit à sa crédibilité. Elle est donc conduite à étendre sa politique de sous-traitance au domaine de la recherche. L’Office parlementaire s’est déjà fait l’avocat de la thèse d’un renforcement des capacités propres de recherche de l’ANDRA. Cette situation de l’ANDRA est en effet dommageable pour l’efficacité de l’ensemble du système actuel ou futur de gestion des déchets radioactifs. Un exemple le démontre. Une autre structure, l’IPSN, dotée elle de moyens de recherche autonomes, conduit des recherches fondamentales et voit ses recommandations ou ses résultats scientifiques bénéficier d’un écho et d’une crédibilité à laquelle l’ANDRA est bien en peine de répliquer, faute de moyens propres. D’où, non pas une saine concurrence, mais une impression de cacophonie sur les options de recherche. La question doit donc être posée de nouveau. Faut-il amplifier le rôle de l’ANDRA en matière de recherche ? La réponse proposée par votre Rapporteur est positive. Il faut que l’ANDRA, grâce à un abondement de son budget par un moyen discuté plus loin, étoffe ses équipes et ses équipements de recherche actuels. En contrepartie, la plus grande transparence serait exigée pour ses travaux de recherche. On pourrait aussi envisager de transférer à l’ANDRA les équipes de recherche du CEA et de l’IPSN travaillant sur la question des déchets. Dans cette hypothèse, il faudrait bien entendu, que l’IPSN garde un échelon d’expertise au service des autorités de sûreté. Alors que l’importance et l’urgence de solutions opérationnelles s’accroît pour un ensemble de déchets jugés jusqu’ici non prioritaires, comme, par exemple, les déchets de très faible activité et les déchets tritiés ou radifères, le renforcement des tous les moyens de l’ANDRA s’impose. Renforcer l’ANDRA signifie, bien évidemment, renforcer ses effectifs mais aussi rationaliser ses structures. Les effectifs de l’ANDRA totalisaient 361 agents en 1998. Les ingénieurs et cadres représentaient 58,8 % et les techniciens et les agents de maîtrise 28,8 % du total. L’augmentation des effectifs s’élève à 9,4 % entre 1996 et 1998, à mettre en rapport avec une diminution de 25,3 % de son chiffre d’affaires. Figure 4 : Evolution des effectifs de l’ANDRA
Quoi qu’il en soit, ce sont les structures internes de fonctionnement de l’agence qu’il semble primordial de modifier. Le décret n° 92-1391 du 30 décembre 1992 relatif à l’ANDRA établit en effet deux centres majeurs de pouvoir et de décision au sein de l’agence, qui sont d’une part le conseil d’administration et le directeur général. D’après l’article 5 du décret, " le conseil d’administration règle par ses délibérations les affaires de l’établissement ". Le terme " régler " est imprécis puisqu’il veut dire aussi bien dire, selon le Larousse, " assujettir à certaines règles ", que " décider d’une façon définitive ". La liste de points sur lequel doit délibérer le conseil comprend par ailleurs 13 items. Signalons par ailleurs que le président du conseil d’administration est certes nommé par décret mais que c’est le conseil en tant que tel qui a le pouvoir de décision. Les pouvoirs du directeur général sont définis par l’article 8, notamment dans ses 2ème et 3ème alinéas. Ainsi, " il prépare les décisions du conseil d’administration, met en œuvre ses décisions et lui rend compte de leur exécution. Il exerce la direction des services de l’agence et a, à ce titre, autorité sur le personnel ". En outre selon l’article 9 du décret, " l’agence est dotée d’un comité financier qui est consulté sur 1. les modalités et le niveau de tarification des prestations de l’ANDRA 2. les programmes d’investissement préparés sur une base pluriannuelle et sur leurs modalités de financement. (...) Le comité financier est présidé par le directeur général de l’agence (...) ". Le décret n° 92-1391 du 30 décembre 1992 prévoit un partage peu clair et inutilement compliqué entre le conseil d’administration et le directeur général. Or, dans des phases de développement, les organisations ont tout particulièrement besoin d’un organigramme clair, d’une unité de pouvoir et d’une identité qui ne peut être symbolisée et portée que par une seule personne. C’est pourquoi il semble opportun de transformer le poste de président du conseil d’administration en poste de président-directeur général, président du conseil d’administration, responsable devant ce dernier et détenteur de l’ensemble des pouvoirs visés aux articles 8 et 9. Un comité de direction présidé par le président-directeur général serait par ailleurs introduit pour rassembler l’ensemble des directeurs, technique, financier, etc. autour du président-directeur général. Pour de nombreuses tâches d’exploitation mais aussi de conception et de recherche, l’ANDRA fait appel à la sous-traitance. D’une manière générale, le recours à la sous-traitance est un gage de souplesse et semble adapté à la relative imprécision du plan de charge de l’agence pour les années à venir. On peut toutefois se demander si ce mode de fonctionnement, s’il devait se systématiser, serait compatible à long terme avec l’éthique d’un établissement public, établissement en charge de surcroît d’une mission de service public. Au-delà de cette question de statut, le régime souhaitable de fonctionnement de l’ANDRA doit être précisé dans la perspective d’une montée en charge rapide de son activité. L’ANDRA prévoit en effet de créer avec la société France Déchets du groupe Suez-Lyonnaise des Eaux, un groupement d’intérêt économique (GIE) pour la conception et l’exploitation d’un centre de stockage pour déchets de très faible activité (TFA). France Déchets se présente comme le leader européen du traitement des déchets industriels spéciaux. Quels seront les rôles respectifs des deux partenaires à 50-50 dans ce GIE intitulé Omega Tech ? L’ANDRA portera l’investissement de 130 millions de francs, financé par un prêt bonifié sans intérêt de l’Union européenne, l’amortissement du prêt étant ensuite refacturé au GIE. L’ANDRA fournira le terrain et le personnel et sera le maître d’œuvre du projet jusqu’à l’obtention de l’arrêté préfectoral. France Déchets assurera la commercialisation des services offerts par le nouveau centre, notamment auprès de l’industrie classique, du monde médical, et des organismes de la recherche et du développement, que l’ANDRA, centrée jusqu’ici sur les exploitants d’installations nucléaires de base, estime ne pas être mesure de contacter par ses propres moyens. Par ailleurs, France Déchets offrira en amont du stockage différentes prestations, dont la caractérisation des matériaux, le conditionnement in situ et le transport. L’objectif de France Déchets est de participer à la création, en France, d’une " vitrine " reproductible dans d’autres pays. L’objectif de l’ANDRA est également clair, celui de couvrir une clientèle de petits producteurs de déchets avec lesquels elle a encore peu l’habitude de travailler. Toutefois, la création d’un GIE ne s’impose pas, dans la mesure où France Déchets pourrait fournir ses services dans le cadre habituel de la sous-traitance, d’autant que les volumes à stocker, en provenance des " petits producteurs " seront résiduels par rapport à ceux produits en particulier par le démantèlement des installations nucléaires. En réalité, étant " chargée des opérations de gestion à long terme des déchets radioactifs " par la loi du 30 décembre 1991, l’ANDRA doit rester le pilote unique de ses activités, en contrepartie d’un élargissement de ses responsabilités et d’un renforcement de ses moyens. L’agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs a adopté depuis sa création en tant qu’établissement public, un mode de fonctionnement où la concertation avec les producteurs de déchets est si étroite qu’en simplifiant les choses, l’ANDRA pourrait être décrite comme une sorte de coopérative au service de ces derniers. La concertation et même l’intégration des besoins des exploitants nucléaires ne doivent pas être les seuls moteurs de l’ANDRA. Toutefois, il paraît désormais indispensable que la puissance publique marque l’importance du rôle de l’ANDRA en renforçant ses moyens financiers et, par-là, reconnaisse encore davantage l’importance de la question des déchets radioactifs. L’activité de l’ANDRA, telle qu’elle peut être retracée par ses comptes de résultat, connaît une baisse en décalage avec la montée de la demande sociale d’assainissement de la situation des déchets radioactifs en France. Le graphique suivant montre que sur chacun de ses trois grands secteurs d’activité – les sites profonds, les centres de stockage de la Manche et de l’Aube – son chiffre d’affaires est en baisse. Au total, la diminution d’activité atteint 25,3 % entre 1996 et 1998. Figure 5 : Evolution du chiffre d’affaires de l’ANDRA
En réalité, cette baisse d’activité peut avoir plusieurs origines. D’une part, elle peut provenir conjoncturellement d’une volonté moindre des producteurs d’engager des études à long terme, ce qui peut se traduire par un recul de leur engagement vis-à-vis de l’ANDRA qu’ils considèrent comme leur simple mandataire. Il peut également se faire que l’agence ait une capacité de réponse insuffisante par rapport aux attentes des générateurs de déchets. Enfin, l’évolution technique, le compactage des déchets, ou la mise en place de solutions transitoires en interne, peuvent être à la source d’une diminution des volumes des déchets expédiés au centre de stockage de l’Aube. Tous ces facteurs semblent pouvoir être invoqués, ce qui ne laisse pas d’inquiéter. La nécessité pour l’ANDRA d’accélérer son développement ressort nettement de la conférence de presse donnée par la DSIN début septembre 1999, au cours de laquelle il a été annoncée que " les opérateurs nucléaires français devront dès l’an prochain, commencer à rénover ou remplacer les sites de stockage de déchets radioactifs, qui, après plus de 20 ans d’exploitation, ne correspondent plus aux normes de sécurité ". Plus précisément, la DSIN ordonnait au CEA d’améliorer la sécurité ou de remplacer son site de stockage de Cadarache, à EDF de faire de même pour ses silos de Saint Laurent des Eaux et à Cogema de rénover ou supprimer trois de ses installations de stockage les plus anciennes à La Hague. Comme le rappelait simultanément la DSIN avec quelque embarras, l’ANDRA pilote pourtant un vaste programme de gestion de déchets radioactifs " qui est sur les rails depuis 1993 ". Dans le jeu complexe qui relie à l’heure actuelle l’ANDRA et les exploitants nucléaires, on peut comprendre que ces derniers, attachés en priorité à leur mission de production d’électricité, de services relatifs au cycle du combustible nucléaire ou bien encore focalisés sur la recherche, ne soient pas en situation d’impulser la préparation du long terme pour les déchets radioactifs. Il semble donc insuffisant de compter seulement sur les producteurs de déchets pour donner les moyens à l’ANDRA de jouer pleinement le rôle qui lui est assigné par la loi du 30 décembre 1991. En particulier, la préparation du long terme suppose des recherches d’une nature particulière, dont les retombées à court terme ne peuvent être que réduites. Par ailleurs, il est dans la nature de l’ANDRA de programmer son activité et son existence sur des durées de plusieurs centaines d’années. On peut d’ailleurs dire, en caricaturant les choses, que l’ANDRA pourrait être dans plusieurs siècles la seule institution survivante d’un secteur nucléaire disparu dans le courant du progrès technique. En tout état de cause, s’il faut conserver à tout prix l’étroite collaboration entre les exploitants nucléaires et l’agence, il paraît tout aussi nécessaire que l’agence voit son poids augmenter dans le secteur nucléaire et dans les négociations avec les exploitants. Dans cette perspective, la puissance publique doit marquer, d’une manière plus claire, l’importance de l’ANDRA pour l’assainissement de la gestion des déchets et en conséquence lui apporter en propre une subvention budgétaire. On a vu dans le passé comment l’Institut de protection et de sûreté nucléaire (IPSN) a progressivement accru son autonomie et son influence. L’IPSN a été créé au sein du Commissariat à l’énergie atomique par l’arrêté du 2 novembre 1976, afin " de réaliser les études, recherches et travaux de protection et de sûreté nucléaire qui lui sont confiés par les départements ministériels et organismes intéressés ". L’arrêté du 2 novembre 1976 prévoyait dans son article 6 que " les subventions de l’Etat affectées tant à l’institut qu’au financement des autres études, recherches et travaux de protection et de sûreté nucléaire menés par le C.E.A. au titre de sa mission propre sont arrêtés après avis du secrétaire général du comité interministériel de la sécurité nucléaires et individualisées par inscription à une ligne spéciale du budget du ministre de l’industrie et de la recherche ". Quatorze ans plus tard, dans son premier rapport sur le contrôle de la sûreté des installations nucléaires pour l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, M. Claude Birraux, député de Haute-Savoie, demandait " la création d’une ligne budgétaire individualisée dans les crédits du ministère de l’industrie, pour le financement du seul Institut de protection et de sûreté nucléaire ". Ce qui fut finalement réalisé et permit à l’IPSN d’engager une nouvelle phase de son activité. La même démarche doit être adoptée pour l’ANDRA. L’ANDRA devrait être dotée à l’avenir d’une ligne budgétaire individualisée dans les crédits du ministère de l’industrie et de celui de la recherche, afin de financer ses recherches propres. Comment pourrait être financée cette subvention nouvelle à l’ANDRA ? Par une augmentation de la redevance des installations nucléaires de base. Les installations nucléaires de base sont assujetties au paiement d’une redevance depuis 1975. Le mode de calcul de cette redevance, ainsi que sa destination sont sur le point de changer, le projet de loi de finances pour 2000 prévoyant différentes transformations. L’introduction d’une redevance pour les déchets nucléaires est discutée dans les deux contextes. La loi de finances rectificative n° 75-1242 du 27 décembre 1975 a assujetti les installations nucléaires de base au paiement d’une redevance annuelle. Le décret n° 76-480 du 24 mai 1976 modifié par le décret n° 82-577 du 29 juin 1982 prévoit à l’article 1er que " le ministre de l’industrie et de la recherche fixe le montant de la redevance dont l’exploitant est redevable et prescrit l’exécution de la recette ". En vertu de ces textes, les exploitants acquittent chaque années deux types de redevance : des redevances perçues au titre des actes de procédure réglementaires (demandes d’autorisation de création, autorisations réglementaires subséquentes) et des redevance annuelles. Les augmentations votées chaque année par le Parlement ont atteint 2 % en 1995, 0 % en 1996, 2,5 % en 1997 et 2,5 % en 1998. Un passage à 5 % du rythme d’augmentation annuelle pendant 5 ans du barème des redevances ne serait pas incompatible avec l’équilibre financier des exploitants nucléaires. Bien entendu, l’augmentation de la redevance porterait sur les quatre catégories d’INB, telles que les définit l’article 2 du décret n°636-1228 du 11 décembre 1963 modifié par le décret n° 73-405 du 27 mars 1973, art. 2, à l’exception des INB détenues par l’ANDRA. Par ailleurs, selon l’article 2 du décret du 24 mai 1976, " le produit des redevances auxquelles sont assujettis les exploitants des installations nucléaires de base est rattaché par voie de fonds de concours aux divers chapitres intéressés du ministère du budget. La répartition est effectuée par un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre de l’industrie. Les sommes ainsi perçues seront utilisées pour le remboursement des dépenses suivantes : (...) dépenses occasionnées par la réalisation d’études techniques en matière de sûreté nucléaire ". Il s’agirait donc de modifier les articles 1 et 2 du décret n° 76-480 du 24 mai 1976, en tirant la conséquence des décrets d’attribution de compétences des ministres de l’industrie, de l’environnement et de la recherche (voir plus haut). A l’article 1er, il serait indiqué que " les ministres de l’industrie, de la recherche et de l’environnement fixent le montant de la redevance dont l’exploitant est redevable et prescrivent l’exécution de la recette ". A l’article 2, la répartition serait effectuée par " un arrêté du ministre du budget et des ministres de l’industrie, de la recherche et de l’environnement ". Il est clair que ces nouvelles dispositions auraient pour conséquence de conforter voire de replacer le ministère de la recherche et celui de l’environnement dans le jeu des responsabilités relatives à la sûreté nucléaire. Alors que la sûreté nucléaire doit désormais être envisagés non seulement au quotidien mais aussi à très long terme, une telle évolution semble conforme non seulement à l’intérêt du secteur nucléaire dont l’avenir dépend de ses performances en matière de sûreté, mais aussi à la demande sociale et à l’intérêt national. S’agissant des installations nucléaires de base, l’article 24 du projet de loi de finances pour 2000 propose en premier lieu de supprimer les taxes liées aux actes de procédure les concernant, une seule taxe annuelle demeurant en vigueur. D’ailleurs, selon l’exposé des motifs, " les taux sont revus à la hausse afin de tenir compte, notamment, des coûts que représentent pour le budget de l’Etat, le changement de statut de l’IPSN, transformé en établissement public administratif indépendant du CEA, ainsi que la dotation accordée à l’Office de protection contre les rayonnements ionisants (OPRI). " Par ailleurs, le Gouvernement a engagé une régularisation des procédures de fonds de concours. En conséquence, le produit de la redevance, estimé à 829 millions de francs en 2000, sera considéré comme une recette du budget général. Dans ces conditions, il conviendrait de proposer une augmentation de 5 % des différents barèmes, à l’exception de ceux des installations nucléaires de base destinées au stockage définitif de substances radioactives, pour générer un surplus d’une quarantaine de millions de francs, destinées à financer une subvention publique à l’ANDRA. 3. Les services à proposer en urgence par l’ANDRA On a vu, tout au long des observations réalisées sur le terrain pour la préparation du présent rapport, que la gestion des déchets radioactifs est actuellement faite d’initiatives prises par les exploitants faute de solutions nationales répondant à leurs besoins de stockage et d’entreposage. A cet égard, on ne peut que regretter que l’ANDRA n’ait pas, en temps et en heure, entrepris de prendre à sa charge les problèmes urgents auxquels font face tant le CEA que Cogema et EDF, comme la loi du 30 décembre 1991 lui en faisait d’ailleurs l’obligation. Au reste, il n’entre pas dans la vocation du CEA de transformer un centre de recherche comme le centre de Cadarache en centre d’entreposage de déchets de très faible activité pour l’ensemble de ses installations. Il n’entre pas non plus dans les tâches de Cogema à La Hague d’accumuler des déchets dont certains pourraient être entreposés et même stockés ailleurs. En tout état de cause, il appartient à l’ANDRA de développer et de mettre en service dans les plus brefs délais, des installations de stockage de déchets de très faible activité, de prendre en charge les déchets radifères, les déchets graphite, les instruments déclassés. Il revient également à l’ANDRA de mettre au point et de lancer des solutions d’entreposage à long terme, tant pour les déchets de haute ou moyenne activité à vie longue que pour les combustibles irradiés. Dans cette perspective, l’ANDRA doit reprendre la maîtrise totale de ses projets et, en tant qu’établissement public seul assuré de la pérennité nécessaire à très long terme, s’affirmer comme le service public national de gestion de déchets radioactifs, que la population et les exploitants sont en droit d’attendre.
Conclusion générale
Dans le cadre de sa mission sur l’étude des conséquences des installations de stockage de déchets nucléaires sur la santé publique et l’environnement, et conformément aux méthodes de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, votre Rapporteur s’est efforcée non seulement de multiplier les visites sur le terrain et les entretiens avec les responsables du secteur mais aussi de dégager une vue d’ensemble et des propositions sur la question posée. Quelle est la situation actuelle en matière de déchets ? Sommes-nous à un moment charnière dans l’évolution de celle-ci ? Quel est le cadre dans lequel doit se placer désormais la gestion des déchets radioactifs ? Telles sont les trois principales interrogations auxquelles votre Rapporteur souhaite que l’Office parlementaire apporte une réponse. * La loi du 30 décembre 1991 relative aux recherches sur la gestion des déchets radioactifs a donné le coup d’envoi de travaux certes très importants mais qui se sont progressivement focalisés, dans la pratique, sur les déchets de haute ou moyenne activité. Il faut aujourd’hui engager une nouvelle étape. La France doit fournir un nouvel effort non seulement pour les autres types de déchets mais aussi pour améliorer d’une manière significative la gestion courante de ses déchets radioactifs. Si globalement les exploitants nucléaires s’acquittent de leur responsabilité de prise en charge de leurs déchets, force est de constater que d’une part les sites d’entreposage sont multiples et dispersés sur tout le territoire, que d’autre part les décisions des exploitants au demeurant tous publics privilégient souvent les impératifs de l’entreprise au dépends du secteur dans son ensemble, et qu’ainsi la concurrence nuit à la cohérence globale du système. En tout état de cause, les stratégies individuelles ne font pas une stratégie nationale. Simultanément, différentes catégories de déchets ne reçoivent toujours pas de solutions de stockage, alors que les volumes correspondants sont importants et que les situations d’attente ne peuvent que présenter une sûreté inférieure à celle de solutions spécifiquement adaptées à leur nature particulière. Le moment est-il venu de passer à une nouvelle phase de la politique des déchets radioactifs ? La réponse à cette question est positive, non seulement parce que l’amélioration de la sûreté est une quête permanente mais aussi parce que nous sommes à un moment charnière de l’évolution du secteur nucléaire. * Le premier changement est un changement de fond qu’il est nécessaire d’anticiper, quant aux souhaits de nos concitoyens. Dans le domaine particulier du nucléaire, les études d’opinion, tous secteurs et toutes activités confondus, montrent que les déchets nucléaires constituent une préoccupation figurant aux tous premiers rangs de la liste des risques redoutés par le public. Nos concitoyens sont de plus en plus nombreux et le seront toujours plus, à rechercher des modes de consommation, sinon des modes de vie, qui préservent les chances du futur et n’induisent pas des coûts de protection ou de restauration de l’environnement qui pourraient être évités grâce au choix de modes de production durables. Mais, par ailleurs, une directive européenne qu’il va nous falloir transposer en droit interne dans les tous prochains mois, vient fixer des limites d’exposition aux rayonnements ionisants plus contraignantes que par le passé. Ceci va nous obliger à diminuer l’exposition des travailleurs du nucléaire en améliorant les procédés industriels et à faire tendre rapidement vers zéro les rejets de radioéléments dans l’environnement, une exigence que pointe un récent accord international certes non encore ratifié mais qui trace la seule voie d’avenir envisageable. Il va nous falloir aussi mettre au point des sites d’entreposage performants et sûrs et les surveiller sans limitation de durée. Montée d’une demande sociale, rupture dans la réglementation, accélération dans les exigences internationales, tels sont les éléments qui font que nous sommes aujourd’hui à un moment charnière dans la gestion des déchets radioactifs. Quels sont les moyens dont nous disposons pour faire face à ces défis ? Notre organisation est-elle optimale et au-delà de l’organisation administrative, l’impulsion politique est-elle à la mesure des enjeux ? * Il ne s’agit pas ici de dévaloriser les efforts déployés d’une part par les administrations pour le contrôle de la sûreté ou pour la radioprotection des installations de stockage des déchets nucléaires et d’autre part par les exploitants pour gérer d’une manière responsable les déchets radioactifs générés par leur activité. Toutefois, il s’agit aujourd’hui de mettre en place une politique nationale des déchets mais aussi des rejets radioactifs, dans la plus grande transparence et la plus grande rigueur. L’élaboration et le contrôle d’une telle politique nationale font partie des responsabilités régaliennes du Gouvernement. Pour les voir s’accomplir, il faut une impulsion au plus niveau, celle du Premier ministre entouré de l’ensemble des ministres intéressés aux questions de sûreté et de radioprotection et informant régulièrement la représentation nationale sur les progrès accomplis. Il faut également des établissements publics spécialisés, comme l’OPRI, et l’ANDRA, renforcés dans leurs moyens d’intervention et dotés de nouveaux moyens de contrôle. Il faut enfin et surtout engager une recherche scientifique approfondie pour la minimisation rapide et drastique des rejets dans l’environnement, pour la réduction des volumes et de la toxicité des déchets radioactifs et pour l’amélioration du confinement des déchets ultimes, et pour placer ainsi le curseur des priorités au plus près des impératifs de protection de la santé publique et de l’environnement.
1ère proposition : Afin de préparer l’entrée en vigueur en 2020 des obligations de la convention OSPAR, l’attention des exploitants nucléaires est attirée sur l’avantage qu’ils trouveraient à intensifier leurs programmes de recherche et développement relatifs à une réduction de leurs rejets radioactifs à des niveaux proches de zéro pour les radioéléments artificiels et proches du niveau ambiant pour les radioéléments présents à l’état naturel. 2ème proposition : Afin d’inciter les exploitants nucléaires à ne pas prendre de retard dans les progrès à accomplir pour la réduction de leurs rejets, il serait judicieux que l’autorité de sûreté nucléaire étudie la possibilité d’une part de ne délivrer les autorisations de rejets radioactifs dans l’environnement que pour une durée limitée compatible avec une exploitation normale de l’installation, d’autre part de fixer leur niveau au voisinage des rejets réels et enfin, d’une manière générale, de fixer à chaque installation des objectifs de mise en conformité avec la déclaration de Sintra à l’horizon 2020, selon un calendrier qui serait rendu public. 3ème proposition : Il semble opportun d’introduire dans le futur projet de loi sur le contrôle de la sûreté et la transparence de l’information nucléaire une obligation de déclaration de détention de déchets radioactifs qui permettra à l’ANDRA d’améliorer sa connaissance des stocks existants dans le cadre de la réalisation de son inventaire national annuel.
4ème proposition : En prolongement de l’interdiction faite par la loi du 30 décembre 1991 de stocker en France des déchets radioactifs importés au-delà des délais techniques imposés par le retraitement, l’attention des exploitants et des pouvoirs publics est attirée sur l’intérêt qu’il y aurait de soumettre les contrats de retraitement à la condition d’un calendrier de retour ayant valeur d’engagement contractuel. 5ème proposition : Compte tenu de l’échelle de temps considérable sur laquelle le stockage des déchets et des résidus miniers doit être fait dans des conditions de sûreté et de radioprotection satisfaisantes, l’attention de l’autorité de sûreté et des exploitants est attirée sur l’avantage qu’il y aurait d’une part à conduire des études poussées sur la tenue à long terme de ces installations, notamment de traitement des eaux, et d’autre part à mettre en place des dispositifs et des procédures pérennes et pluralistes d’évaluation de leur sûreté. Il faudrait également que soient apportées des réponses précises à la question de la gestion à long terme de sites de stockage de résidus miniers, tant sur le plan de l’organisation que sur celui du financement.
2. Transposition de la directive européenne sur la radioprotection et déchets de très faible activité 6ème proposition : La possibilité ouverte par la directive européenne n° 96/29 sur la radioprotection d’introduire des seuils de libération pour les déchets radioactifs est un sujet encore débattu par les administrations. Si le concept de zonage des installations prôné par l’autorité de sûreté nucléaire permet d’isoler les déchets radioactifs des matériaux ordinaires et de sérier les grandes catégories de déchets, il semble toutefois nécessaire de préciser le niveau qui permettra de distinguer les matériaux contaminés de ceux qui ne le sont pas. Il est par ailleurs demandé à l’autorité de sûreté de définir avec précision les méthodes pratiques permettant d’assurer d’une part la traçabilité des matériaux issus du démantèlement des installations nucléaires et d’autre part l’information sur les lieux de transfert dans le domaine public.
7ème proposition : La directive européenne sur la radioprotection donnant la possibilité d’introduire des seuils d’exemption par radioélément, il est conseillé aux pouvoirs publics d’introduire dans la réglementation française une double condition d’activité totale et d’activité massique. 8ème proposition : S’agissant de l’addition intentionnelle de radioéléments dans des produits de consommation tels que définis par la directive européenne sur la radioprotection, il est conseillé aux pouvoirs publics de maintenir l’interdiction prévue par la réglementation actuelle. Par ailleurs tout ajout de substance radioactive doit impliquer que le public et les travailleurs en soient avertis. 9ème proposition : L’attention du ministère chargé de la santé est attirée sur l’intérêt qu’il y aurait à favoriser la constitution d’un registre national des cancers de la thyroïde et à consolider l’ensemble des registres du cancer. De même, il est suggéré à l’institut national de veille sanitaire (InVS) de placer dans ses priorités un programme d’action relatif aux effets des rayonnements ionisants. 10ème proposition : Afin d’améliorer le suivi de la santé des travailleurs du nucléaire et d’enrichir la connaissance sur les effets éventuels des faibles doses, il est proposé qu’un suivi épidémiologique, correspondant à la période d’activité et à la période post professionnelle, soit organisé non seulement pour les travailleurs statutaires du nucléaire mais aussi pour les travailleurs de la sous-traitance. 11ème proposition : Afin de mettre à parité les rôles respectifs de la radioprotection et de la sûreté nucléaire dans notre pays, il est proposé que le ministère de la santé soit associé à toutes les instances et procédures traitant des rejets et des déchets radioactifs. 12ème proposition : Afin d’améliorer la connaissance et la lisibilité de la situation actuelle et future des déchets radioactifs en France, il est proposé aux pouvoirs publics d’étudier la faisabilité d’un plan national de gestion des déchets radioactifs, faisant apparaître notamment les volumes en jeu ainsi que les responsabilités des différents exploitants nucléaires et fixant des objectifs intégrant les résultats des recherches conduites en application de la loi du 30 décembre 1991. A titre d’exemple, dans le cadre d’un tel plan, un calendrier assorti d’un plan de financement pourrait être élaboré pour la mise en place de filières adaptées à chaque catégorie de déchets faiblement radioactifs, la diversité des types de déchets faiblement radioactifs appelant en effet des solutions différenciées pour leur entreposage et leur stockage.
Examen du rapport par l’Office 1ère LECTURE 27 octobre 1999 L’office a examiné le rapport de Mme Michèle Rivasi, député, sur les conséquences des installations de stockage de déchets nucléaires sur la santé publique et l’environnement. Mme Michèle Rivasi, député, rapporteur, a indiqué que la réglementation relative aux déchets radioactifs et aux sites de stockage et d’entreposage nécessite d’être complétée et coordonnée, et que des solutions à long terme sont en attente, non seulement pour les déchets de moyenne ou haute activité pour lesquels la loi du 30 décembre 1991 a lancé un ensemble de recherches, mais aussi pour différents types de déchets de faible activité. Le rapporteur a ensuite rendu compte de ses missions sur le terrain, notamment sur les sites miniers de Bessines, au centre de stockage de l’Agence nationale de gestion des déchets radioactifs (ANDRA) à Soulaines, et dans les sites du Commissariat à l’énergie atomique (CEA) à Marcoule, Cadarache, Valduc et Saclay. Remerciant les exploitants nucléaires pour leur transparence, et soulignant que chacun d’entre eux assume ses responsabilités d’une manière satisfaisante, Mme Michèle Rivasi, député, rapporteur, a toutefois estimé qu’une meilleure cohérence doit être recherchée entre les initiatives des différents exploitants. Le rapporteur a attiré l’attention des membres de l’office sur les stocks de déchets accumulés dans les installations de la Compagnie générale des matières nucléaires (COGEMA) à La Hague, faute d’exutoire national pour les déchets issus du retraitement des combustibles français, et du fait de réexpéditions très insuffisantes des déchets issus du retraitement des combustibles étrangers. Elle a indiqué, qu’à son avis, la stratégie de concentration et de rétention des radioéléments, et donc la réduction des rejets, devaient être choisies résolument par les exploitants nucléaires. Insistant sur la nécessité de mettre en place rapidement un site de stockage de déchets à très faible activité, le rapporteur a également estimé que la France devrait renoncer à l’option ouverte par la directive européenne n° 96/29 d’introduire des seuils de libération pour les matériaux ou matières faiblement contaminés. Au total, Mme Michèle Rivasi, député, rapporteur, souhaite que, grâce à une impulsion politique forte, répondant à la demande sociale et aux engagements internationaux contenus dans la directive européenne et la convention pour la protection de l’environnement marin de l’Atlantique nord-est, dite convention OSPAR , la France s’engage résolument dans la voie de l’avenir pour son industrie nucléaire. M. Henri Revol, sénateur, président, après avoir souligné l’ampleur du travail d’analyse du rapporteur, a exprimé ses réserves sur les propositions soumises, et fait connaître que leurs formulations, sous forme de très nombreuses injonctions consistant à demander, avec précision et insistance, au pouvoir réglementaire de prendre des mesures dans son domaine d’attribution, n’étaient pas conformes à la mission de l’office. M. Robert Galley, député, a indiqué qu’il soutenait, à titre de mesure de précaution, l’objectif de réduction des rejets, tout en demandant des précisions plus poussées sur les connaissances actuelles en matière d’effets des rayonnements ionisants sur la santé, et en marquant sa surprise face au décalage existant entre le contenu analytique du rapport et le caractère abrupt des propositions. M. Yves Cochet, député, estimant nécessaire la relance de l’entreposage réversible des déchets nucléaires en sub-surface, a demandé, à propos du contrôle des stocks de déchets nucléaires, la mise au point d’un mécanisme permettant que le contrôleur soit indépendant du contrôlé. Il a fait connaître son accord global avec les propositions du rapporteur, à l’exception de celle sur la recherche, relative aux énergies renouvelables, qu’il souhaite voir conduite par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) plutôt que par le CEA. M. Jean-Yves Le Déaut, député, premier vice-président, a indiqué qu’il avait étudié longuement la question des déchets radifères dans son rapport de 1992 sur les déchets de très faible activité, et s’est demandé si des progrès avaient réellement été accomplis, depuis lors, sur cette question. Mme Michèle Rivasi, député, rapporteur, a alors répondu aux divers intervenants, en précisant les analyses qu’elle a faites de ces questions dans son étude. Prolongeant les débats, M. Claude Birraux, député, a approuvé la spécialisation du CEA dans le nucléaire, et a indiqué, à propos de l’ANDRA, qu’un exploitant ne pouvait être chargé d’une mission de contrôle. La Direction de la sûreté des installations nucléaires (DSIN) lui paraît avoir les moyens d’imposer ses vues aux exploitants nucléaires. Il a, par ailleurs, rappelé son travail d’enquête à propos des décharges du CEA en région parisienne, et a regretté que des auditions publiques et contradictoires ouvertes à la presse, indispensables à une réelle transparence du travail de l’office, n’aient pas été organisées par le rapporteur. Faisant valoir que le document soumis par le rapporteur exposait davantage ses propres vues que celles de l’office, M. Claude Gatignol, député, s’est également étonné que le texte ne produise pas, non plus, de relevés des auditions réalisées. Mme Michèle Rivasi, député, rapporteur, a souligné que, si le CEA connaît des difficultés budgétaires et un manque de perspectives, le principal enjeu est qu’une volonté politique s’exprime par des directives claires aux exploitants quant à la gestion de leurs rejets et de leurs déchets radioactifs. Relevant dans le rapport soumis à l’office des éléments intéressants, comme l’étude des rejets, des déchets étrangers ou des différents déchets spécifiques, M. Jean-Yves Le Déaut, député, premier vice-président, a souligné un décalage entre les propositions du rapporteur et ses conceptions personnelles. Or, l’adoption du rapport ferait, de ce dernier, la doctrine de l’office, dont le rôle est d’informer objectivement le Parlement sur les sujets dont il est saisi. Sur ce point, il a ajouté que si le corps du texte lui permettait de dire qu’il s’agissait d’un bon rapport, les propositions ne reflétaient ni ses propres conceptions sur de nombreux sujets -comme les seuils de libération, l’ANDRA ou l’Institut de protection et de sûreté nucléaires (IPSN)- ni celles de nombreux participants à la réunion, comme le montraient les débats. M. Henri Revol, sénateur, président, a alors estimé que des études complémentaires devaient être réalisées sur ces différents sujets, d’une grande importance pour l’avenir du nucléaire, en identifiant les contraintes scientifiques et technologiques, et en estimant les coûts des différentes solutions envisageables. Une discussion s’est ensuite engagée sur la méthode à suivre pour parvenir à cet approfondissement indispensable. M. Serge Poignant, député, a indiqué qu’une nouvelle saisine permettrait une discussion nouvelle. M. René Trégouët, sénateur, a fait observer l’importance de choisir une procédure non critiquable. A l’initiative de M. Henri Revol, sénateur, président, et de M. Jean-Yves Le Déaut, député, premier vice-président, la proposition de reporter la décision sur l’adoption du rapport, après des auditions publiques et contradictoires ouvertes à la presse, organisées par l’office et présidées par le rapporteur, sur les principales questions portant à discussion sur les déchets et les rejets radioactifs, a été adoptée par sept voix contre une. 2ème LECTURE mercredi 8 mars 2000 L’office a examiné en deuxième lecture le rapport et les propositions de Mme Michèle Rivasi, députée, sur les conséquences des installations de stockage de déchets nucléaires sur la santé publique et l’environnement. Mme Michèle Rivasi, députée, rapporteur, a rendu compte de l’audition publique du 10 février 2000 que l’Office lui avait demandé d’organiser afin de compléter son information sur les thèmes de la réduction des rejets et des déchets des installations nucléaires, ainsi que sur la transposition de la directive européenne n° 96/29 sur la radioprotection et les déchets de très faible activité. Au cours de cette audition publique, les engagements de la convention OSPAR ont été explicités, ainsi que les dispositions de la stratégie énoncée dans la déclaration de SINTRA. Les contraintes fixées à long terme par ces deux textes semblent être intégrées par les exploitants et les autorités de contrôle. S’agissant de la transposition de la directive européenne, si la DGS est en cours de réflexion sur certains points importants, la DSIN a exposé, pour sa part, des conceptions bien définies concernant le zonage des installations et la traçabilité des déchets issus du démantèlement. Par ailleurs, la nécessité de sites d’entreposage par filière pour les différents types de déchets très faiblement radioactifs n’a pas été démentie par les indications données par les exploitants, ainsi que l’obligation de prendre des dispositions pérennes pour les sites miniers et les sites de stockage des résidus miniers. Enfin, l’idée d’un plan national de gestion des déchets radioactifs n’a pas suscité d’objection lors de cette audition publique. Dans la discussion qui a suivi l’exposé liminaire de Mme Rivasi, M. Claude Gatignol, député, a fait remarquer que les rejets de l’usine de Cogema à La Hague ont connu des réductions très importantes, grâce à des efforts engagés de longue date. En réponse à une question de M. Jean Bizet, sénateur, sur la notion d’impact sanitaire zéro, Mme Michèle Rivasi a expliqué que la mesure d’un impact sanitaire est complexe et contestable, alors que celle des rejets ne prête ni à difficulté ni à confusion. M. Claude Gatignol, député, a regretté, pour sa part, que le rapport ne détaille pas suffisamment les enseignements des études réalisées par la Commission présidée par le professeur Souleau, qui ont apporté un démenti catégorique aux allégations du professeur Viel concernant l’impact sanitaire des rejets de l’usine de Cogema à La Hague. M. Henri Revol, sénateur, président, a ensuite invité Mme Rivasi à donner lecture de ses propositions. La deuxième proposition a été amendée, sur le point de la limitation de durée des autorisations de rejets, par la précision que cette limitation soit " compatible avec le fonctionnement normal des installations ". Sur la quatrième proposition relative au retour des déchets issus de retraitement de combustibles étrangers, il a été jugé préférable par les membres de l’Office d’attirer l’attention des " pouvoirs publics " plutôt que celle des " autorités de contrôle ". A la huitième proposition, les membres de l’Office ont précisé la notion de produits de consommation en faisant référence à la directive européenne n° 96/29 sur la radioprotection. A la dixième proposition relative à la connaissance des effets des faibles doses, il a été rajouté l’adjectif " éventuel ". Enfin, à la onzième proposition, les membres de l’Office ont jugé préférable que le ministère de la santé soit " associé " aux instances et procédures plutôt que " co-décisionnaire " dans celles-ci. M. Henri Revol, sénateur, président, a ensuite appelé les membres de l’Office à se prononcer sur le rapport et les propositions de Mme Rivasi. M. Claude Gatignol, député, a alors indiqué qu’il s’abstiendrait dans ce vote, en raison du fait que les positions relatées dans le rapport sur l’impact sanitaire des rejets de La Hague ne lui sont pas semblées suffisamment équilibrées. Le rapport a ensuite été adopté et sa publication autorisée.
M. Yves LENOIR Chef de projet à l’Ecole nationale supérieure des Mines de Paris Mme Monique SENÉ Présidente du Groupement des Scientifiques pour l’Information sur le Nucléaire (GSIEN) Mme Annie THEBAUD-MONY Directeur de Recherche, INSERM M. Jacques VARET Directeur, BRGM M. Jean-Claude ZERBIB Ingénieur en radioprotection
· Commission européenne Mme Suzanne FRIGREN, DG XI · Direction générale de la santé M. Yves COQUIN M. Jean-Luc GODET · DSIN M. André-Claude LACOSTE M. P. SAINT-RAYMOND M. CHAMBON · Direction du Travail M. Marc BOISNEL M. Francçois BRIANCEAU · Ministère de la recherche M. F. JACQ · Ministère de l’éducation nationale Professeur JF VIEL · IVS M. J. DRUCKER Professeur A. SPIRA M. M. JOUAN · IPSN Mme Annie SUGIER
· OPRI M. Jean-François LACRONIQUE · CEA M. N. CAMARCAT Pr. A. SYROTA M. SANDEVOIR M. GUILLAMOT M. BERTAILLES M. DUCOS M. DALVERNY · COGEMA M. JP LAURENT M. P. PRADEL M. JP PFIFFELMANN · ANDRA M. Yves LE BARS M. Yves KALUZNY M. E. BOISSAC · SITA-France M. GENESCO 2. Visites · Centres du CEA Cadarache Marcoule Saclay Valduc · Centres de COGEMA Bessines La Hague Comurhex
· Centre de l’ANDRA Centre de stockage de l’Aube (Soulaines) · Etats-Unis DOE – Hanford Site DOE – Yucca Mountain, Nevada DOE – Waste Isolation Pilot Plant (Carlsbad, New Mexico) EPA - Washington DOE - Washington NRC – Rockville 3. Audition publique · voir annexe_____________ N°2257.- Rapport de Mme Michèle Rivasi, déposé au nom de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, sur les conséquences des installations de stockage des déchets nucléaires sur la santé publique et l’environnement. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||