I. L’espace au cœur de la gÉopolitique mondiale
A. la multiplication des acteurs spatiaux : une course À l’espace
De 1957 à 2021, environ 12 000 objets ont été mis en orbite d’après de registre du Bureau des affaires spatiales de l’ONU (). En 2021, 8 000 satellites étaient encore en orbite dont environ 4 000 satellites américains, 1 600 russes, 600 chinois, 500 européens (dont 150 français), 220 japonais et 100 indiens.
Ces chiffres ne cessent d’augmenter. Selon Mme Isabelle Sourbès-Verger, chercheuse au CNRS, géographe et spécialiste des politiques spatiales : « Alors que de 1964 à 2014 le nombre d’objets lancés annuellement oscillait de quatre-vingts à cent cinquante satellites, les dernières années montrent une accélération croissante avec près de trois mille satellites lancés de 2017 à 2021 » (). On constate une véritable course à l’espace et cette dernière ne concerne pas seulement les États. Les activités spatiales dépendent en effet de plus en plus de l’initiative privée.
1. Des acteurs institutionnels plus ambitieux et plus nombreux
Pour Isabelle Sourbès-Verger, auditionnée par les rapporteurs, un État est qualifié de puissance spatiale stricto sensu lorsqu’il est autonome pour la fabrication et le lancement de ses satellites. Dix États et association d’États disposent aujourd’hui de ces capacités. Il s’agit par ordre chronologique de la Russie (en tant qu’héritière de l’Union soviétique), des États-Unis, du Japon, de la Chine, de l’Europe, de l’Inde et d’Israël avant les années 2000 puis de l’Iran, de la Corée du Nord et de la Corée du Sud.
Les pays peuvent aussi être classés en étudiant le contenu technologique des programmes spatiaux, ou plus simplement par le budget public dédié à l’espace. Les États-Unis se distinguent alors très nettement.
les budgets spatiaux dans le monde

Note : Les cercles représentent le montant du budget spatial du pays, en milliards de dollars ; les couleurs, la part du budget spatial dans le produit national brut (jaune : moins de 0,025 % ; vert clair de 0,04 % à 0,2 % ; vert foncé : plus de 0,2 %).
Source : Isabelle Sourbès-Verger.
a. Les États-Unis, une hyperpuissance spatiale
i. Une avance technologique et des moyens sans équivalent
Depuis le début de leur programme spatial dans les années 1950, les États-Unis dépensent chaque année plus de la moitié du budget spatial mondial (environ 50 milliards de dollars par an d’investissement). Le pays est ainsi devenu la première puissance spatiale, avec une avance technologique très nette sur ses compétiteurs.
Les institutions spatiales américaines les plus importantes sont d’une part, l’armée américaine (Département de la Défense, DoD en anglais) dont la Force spatiale des États-Unis (US Space Force) avec un budget d’environ 15 milliards de dollars en 2021 () et, d’autre part, la National Aeronautics and Space Administration (Administration nationale de l’aéronautique et de l’espace, NASA), dont les rapporteurs ont pu auditionner le représentant en Europe, Timothy Tawney. La NASA est une agence fédérale créée en 1958 qui est responsable d’une très grande partie du programme civil spatial américain, et qui disposait d’un budget annuel d’environ 23 milliards de dollars et employait environ 20 000 agents en 2021. Elle est leader dans la plupart des coopérations dans le domaine de la science et de l’exploration. Mondialement reconnue, elle contribue activement au soft power américain, c’est-à-dire à la capacité des États-Unis d’influencer et d’orienter les relations internationales en leur faveur, sans utiliser de moyens coercitifs (hard power).
Les États-Unis dominent le spatial, qu’il s’agisse des activités civiles, militaires, mais aussi désormais commerciales grâce aux entreprises du New Space. Dans chacun de ces domaines, les États-Unis possèdent des technologies de pointe. Ils disposent d’une très large gamme de lanceurs, avec par exemple :
- pour l’entreprise Northtrop Grumman, le lanceur léger Minotaur (charge utile de 500 à 1 700 kilogrammes en orbite basse) et le lanceur moyen Antares (8 tonnes en orbite basse) ;
- pour la société United Launch Alliance (ULA), le lanceur moyen Atlas V (8,2 à 18,9 tonnes en orbite basse, 4,7 à 8,9 tonnes en orbite géostationnaire) et le lanceur moyen à lourd Delta IV (11,4 à 28,8 tonnes en orbite basse ; 4,4 à 14,2 tonnes en orbite géostationnaire) ;
- ou encore pour SpaceX, les lanceurs moyen à lourd Falcon 9 et lourd Falcon Heavy (voire I. A. 2).
Le pays utilise plusieurs bases de lancement, dont les plus importantes sont le Centre Spatial Kennedy (NASA) et la base de Cap Canaveral (Space Force) en Floride, et la base Vandeberg (Space Force) en Californie.
Les États-Unis sont aussi leaders en matière de vol habité. Ils financent la majorité du programme de la Station spatiale internationale (International Space Station, ISS). Ils ont également été les premiers à mettre en service un véhicule spatial réutilisable, la Navette spatiale (Space Shuttle en anglais) (), utilisée de 1981 à 2011. Le programme a été stoppé du fait de deux accidents majeurs entraînant le décès de tout l’équipage d’astronautes (en 1986 avec la navette Challenger et en 2003 avec la navette Columbia), et du fait de coûts de fonctionnement et de remise en état de la navette exorbitants. En 2011, la puissance spatiale américaine a subi un déclassement majeur puisqu’elle a dû s’en remettre à la Russie pour convoyer des équipages vers l’ISS. Depuis 2020, c’est néanmoins l’entreprise SpaceX qui assure le transport de passagers vers l’ISS avec sa capsule Crew Dragon.
ii. Une nouvelle dynamique impulsée par l’administration de Donald Trump et reprise partiellement par celle de Joe Biden
Si les États-Unis souhaitent dominer l’espace depuis le début de l’ère spatiale, le mandat du président américain Donald Trump a apporté une nouvelle dynamique, notamment en relançant la course à la Lune après la tentative avortée de son prédécesseur G.W. Bush () et en réorganisant l’administration. Au mois de juin 2017, le National Space Council (NSpC) a été recréé pour mieux coordonner la politique spatiale américaine, avec à sa tête le vice-président américain Mike Pence.
Sept directives (Space Policy Directives – SPD) ont été adoptées par la Maison Blanche de 2017 à 2021, sous l’impulsion du vice-président. La première (SPD-1) portait sur le vol habité et l’exploration du système solaire en engageant les États-Unis à retourner sur la Lune, présentée comme une première étape avant Mars. La NASA a alors proposé un nouveau projet établissant une base lunaire en 2028, mais cette date était trop tardive selon Mike Pence. Le vice-président a fait simplifier et accélérer le programme en 2019 (). La nouvelle campagne lunaire, dénommée Artemis, devait envoyer des astronautes en 2024. Cette date a néanmoins été décalée d’au moins un an par la NASA en 2021.
Le programme Artemis
Le programme Artemis est un programme d’exploration habitée lancé en 2019 dont le coût dépasserait 30 milliards de dollars.
Son calendrier se compose de trois premières étapes :
- une mission non habitée autour de la Lune afin de tester le lanceur super-lourd Space Launch System (SLS) développé par la NASA depuis 2011 ainsi que le vaisseau spatial Orion développé depuis 2016 (Artemis-1) ;
- un premier vol habité autour de la Lune (Artemis-2) ;
- l’arrivée sur la Lune de deux astronautes (une femme et un homme), initialement prévue en 2024, pour un séjour d’environ une semaine (Artemis-3). Cette mission permettrait de lancer la construction d’une base habitée au pôle Sud, qui nécessitera plusieurs autres missions successives. Cette région suscite un fort intérêt au niveau scientifique et en raison de la présence très probable de ressources indispensables à une présence humaine permanente sur la Lune voire utiles pour la Terre, pouvant être exploitées in situ (voir partie I.B.3).
Le programme nécessitera la création d’une station spatiale habitée en orbite lunaire appelée Lunar Orbital Platform-Gateway (LOP-G) pour servir de relais entre la Terre et la Lune, ainsi qu’un vaisseau lunaire, le Human Landing System (HLS), qui transportera des astronautes de l’orbite lunaire à la surface de la Lune, et inversement.
La NASA coordonne le programme qui comprend des partenaires internationaux (voir la liste dans la partie II.A.1) et de nombreux acteurs privés. L’agence sous-traite une grande partie de la conception et de la production, dont l’alunisseur HLS confié à SpaceX (variante du vaisseau Starship).
Le calendrier, très serré, a dû être décalé. La mission Artemis-1 a été reportée au 12 février 2022 et Artemis-3 n’est pas prévue avant « au moins 2025 » selon la NASA. Ce retard résulte de difficultés techniques (retard dans le développement du lanceur SLS et du vaisseau Orion), financières (budget public alloué à la NASA insuffisant) et juridiques (litige entre l’entreprise Blue Origin et la NASA autour du choix de SpaceX pour l’alunisseur HLS).
Le programme Artemis témoigne de l’importance croissante des entreprises privées dans la politique spatiale américaine. Ces entreprises ont été à l’origine d’innovations majeures qui ont renforcé le leadership américain sur le spatial, y compris en matière commerciale. En 2020, les États-Unis captaient 70 % du marché des lancements commerciaux grâce à l’entreprise SpaceX.
Le programme Artemis a depuis été repris par l’administration Biden, même si l’exploration habitée a finalement été peu évoquée lors de la première réunion du NSpC organisée le 1er décembre 2021. Lors de cette réunion et dans un document publié au préalable (United States Priorities Framework), trois premières priorités ont plutôt été présentées : l’élaboration de normes de comportement dans l’espace, le renforcement de la place du spatial dans la lutte contre le changement climatique et le développement de la formation dans les sciences et les technologies afin de conserver le leadership américain en matière d’innovation ().
De plus, le 31 décembre 2021, la NASA a rendu publique la décision de la Maison Blanche d’étendre la durée d’exploitation de l’ISS de 2024 à 2030.
Enfin, le programme d’exploration robotique de Mars de la NASA se poursuit, éventuellement pour préparer ensuite une mission humaine. En 2022, la NASA participera ainsi à la mission ExoMars (ESA, Russie). Des missions privées vers Mars s’organisent également, dont un projet SpaceX de colonisation de la planète.
b. La Russie, une puissance en perte de vitesse
i. Une puissance héritée de l’URSS
La Russie a été la première puissance spatiale de l’histoire, avec la mise en orbite du premier satellite Spoutnik 1 en 1957, puis l’envoi du premier homme dans l’espace, Youri Gagarine, en 1961. La politique spatiale reste encore aujourd’hui un atout majeur de la politique russe, hérité de l’ère soviétique.
Comme le rappelait Isabelle Sourbès-Verger dans un article publié en 2017 : « La Russie détient incontestablement une place à part sur la scène spatiale internationale. Elle est l’une des premières puissances de ce club très fermé puisqu’elle maîtrise la gamme complète des missions, tant civiles que militaires. Certes, ses performances sont bien moindres que celles des États-Unis, en particulier pour les systèmes militaires, mais elle possède des créneaux de compétence uniques. » ()
Le pays a développé des compétences propres en matière de vol habité, dont bénéficie l’ISS depuis l’entrée de la Russie dans ce programme en 1993. De juillet 2011 à mai 2020 (mise en service de la capsule Crew Dragon par SpaceX), la Russie avait même l’exclusivité pour la relève des équipages.
Le pays a également développé une gamme complète de lanceurs, permettant de placer en orbite des charges légères (lanceurs Kosmos 3-M, Rockot, Strela et Start-1), moyennes (Soyouz) ou lourdes (Proton, qui peut lancer jusqu’à 22 tonnes en orbite basse et 4 tonnes en orbite géostationnaire) ; et Angara (voir infra). Ces lanceurs sont utilisés sur quatre bases de lancement : Baïkonour au Kazakhstan, la principale base de lancement pour les lancements civils ; et en Russie, Plessetsk, Kapoustine Iar et Vostotchny, inaugurée en 2016 pour réduire la dépendance envers le Kazakhstan.
Ces lanceurs ont longtemps été couronnés de succès à l’international. Des sociétés américano-russes et européano-russes ont assuré la commercialisation des Proton et des Soyouz respectivement. La Russie a ainsi lancé près de 250 satellites américains depuis le début de l’ère spatiale et a permis au Centre spatial guyanais (CSG) d’exploiter le lanceur Soyouz. À l’inverse, la Russie n’a quasiment jamais eu besoin de recourir à des lanceurs étrangers.
ii. Une vision stratégique hésitante et bouleversée par des difficultés économiques
Si le secteur spatial demeure une source de fierté pour la population russe, comme en témoignent le nom donné au vaccin russe contre le covid-19, « Spoutnik V », et le premier film de fiction tourné dans l’ISS en 2021, il est toutefois confronté à de nombreuses difficultés structurelles.
L’écosystème spatial russe s’est engagé dans une certaine modernisation, mais celle-ci reste insuffisante, que ce soit dans son organisation institutionnelle (notamment au sein de l’agence Roscosmos) et territoriale (), ou dans sa capacité à innover, y compris dans le secteur des lanceurs. Les contrôles qualité et les délais de production sont régulièrement mis en cause. La nouvelle gamme de lanceurs Angara a fait son lancement inaugural le 27 décembre 2021, avec sept ans de retard. De même, la mission lunaire Luna-25 qui devait être lancée en octobre 2021, a été reportée en 2022.
Cette situation résulte notamment d’un budget dédié au spatial insuffisant par rapport aux ambitions politiques de la Russie : ce budget, qui devait être initialement de 5 milliards de dollars par an sur la période 2016-2025, soit déjà un budget 10 fois plus faible qu’aux États-Unis et 2,5 fois plus faible qu’en Chine ou en Europe, a été réduit à la suite de difficultés économiques (). Il ne permet pas de financer l’ensemble des programmes spatiaux, et la situation devrait empirer avec la fin du monopole russe pour la desserte de l’ISS qui rapportait environ 80 millions de dollars par siège et la perte de parts de marché commerciales provoquée par la concurrence internationale accrue dans le domaine des lanceurs. Longtemps première puissance en termes de nombre de lancements, la Russie est désormais largement dépassée par les États-Unis et par la Chine.
Plus généralement, le pays manque de projet politique clair et constant pour le spatial, selon Isabelle Sourbès-Verger. Ce secteur reste perçu comme moins prioritaire que d’autres industries, telles que l’industrie des missiles. C’est finalement au travers d’un essai de test antisatellite que la Russie est apparue de manière significative sur la scène spatiale le 15 novembre 2021.
La stratégie spatiale russe semble balancer entre une orientation militaire plus engagée, ou le maintien des missions scientifiques majeures qui ont fait la puissance russe et ont contribué à son soft power, comme l’exploration spatiale lointaine. En l’absence d’un budget permettant de mener de front tous ces chantiers, les arbitrages politiques ne semblent jamais définitifs.
Bien que les derniers grands projets annoncés par la Russie (créer un vaisseau réutilisable, concevoir le lanceur super lourd Yenisei, déployer à 870 kilomètres d’altitude la méga constellation Sfera composée de 600 satellites de communication, relever des échantillons du sol de Vénus, créer une base lunaire avec la Chine, etc.) soient ambitieux, leur faisabilité reste plus qu’incertaine à une échelle de dix ans.
c. La Chine : une politique spatiale ambitieuse, avec ses caractéristiques propres
i. Un accès autonome à l’espace depuis plus de cinquante ans, contrôlé par l’armée
La Chine est considérée comme une puissance spatiale depuis le lancement en orbite de son premier satellite L’Orient est rouge 1 (Dong Fang Hong 1, DFH 1) par le lanceur Longue-Marche 1 le 24 avril 1970 ().
Plusieurs acteurs contribuent à la politique spatiale chinoise. Parmi les acteurs publics, figurent l’Agence spatiale nationale de Chine (CNSA en anglais), créée en 1993, qui exerce une mission de coordination et des activités diplomatiques, ainsi que son autorité de tutelle, l’Administration d’État pour la science, la technologie et l’industrie pour la défense nationale (SASTIND en anglais), sous le contrôle du ministère de l’industrie et des technologies de l’information (MITI) et du Conseil d’État (). L’Armée populaire de libération (APL) joue quant à elle un rôle central puisque le Département des systèmes spatiaux (DSS) de la Force de soutien stratégique (FSS) contrôle les centres de lancement, les centres de contrôle des satellites (en Chine notamment à Pékin et à Xi’an, en Argentine, au Kenya, en Namibie et au Pakistan) et les centres de surveillance de l’espace en mer (sept navires Yuanwang).
L’industrie spatiale chinoise est également importante. Ses acteurs principaux sont la China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC) et la China Aerospace Science and Industry Corporation (CASIC), contrôlés par le Conseil d’État par l’intermédiaire de la Commission pour l’administration et la supervision des actifs de l’État (SASAC) ().
ii. Des programmes spatiaux simultanés, tous ambitieux
L’ambition chinoise en matière spatiale a été renforcée sous la présidence de Xi Jinping. Le Livre blanc sur les activités spatiales de la Chine publié en décembre 2016 et portant sur la période 2017-2022 la décrit ainsi : « Explorer le cosmos, développer l’industrie spatiale et faire de la Chine une puissance spatiale est un rêve que nous poursuivons sans relâche ».
Cette ambition se traduit dans un budget public spatial annuel d’au moins 8 à 9 milliards de dollars en 2019 et en 2020 (), sans que les parts du civil, du militaire et de la recherche et développement ne puissent être distinguées.
La Chine a réalisé ces dernières années de grandes avancées, en multipliant le nombre de programmes spatiaux spécifiques. Pour Marc Julienne, responsable des activités Chine au Centre Asie de l’Institut français des relations internationales (IFRI), auditionné par les rapporteurs : « la Chine est, avec les États-Unis, la seule puissance à être en mesure de développer autant de programmes ambitieux simultanément. »
La Chine a tout d’abord amélioré son accès à l’espace. Le pays dispose de quatre bases de lancement (Jiuquan depuis 1958, Taiyuan depuis 1968, Xichang depuis 1984 et Wenchang depuis 2016, la mieux située, au sud de la Chine) et d’une large gamme de lanceurs Longue Marche (LM, ou CZ pour Changzheng en chinois), qui permet la mise en orbite de charges utiles légères ou lourdes sur toutes les orbites. Depuis 2019, le nouveau lanceur LM-5 peut même emporter des charges utiles de 25 tonnes en orbite basse et de 14 tonnes en orbite géostationnaire. Des projets de lanceur super lourd (LM-9) et de lanceur partiellement réutilisable (LM-8) sont également en cours. En 2019, avant la crise sanitaire, c’est la Chine qui a effectué le plus grand nombre de lancements au monde, avec 34 tirs dont 32 réussis. Pour leur part, la Russie a réalisé 25 tirs, les États-Unis 21 tirs (27 avec les 6 tirs réalisés par l’entreprise Rocket Lab depuis un port spatial néozélandais), l’Europe 6 tirs, l’Inde 6 tirs, l’Iran 3 tirs et le Japon 2 tirs.
La Chine a également lancé un programme de vol habité en 1992 et sa station spatiale baptisée Tiangong (Palais Céleste en mandarin ou Chinese Space Station en anglais, CSS) pourrait être opérationnelle d’ici la fin de l’année 2022 (). Si l’ISS devait arrêter prochainement son activité, ou devenir privée, la Chine serait alors le seul État à disposer d’un laboratoire scientifique permanent en orbite basse terrestre (300 à 450 kilomètres). La Chine démontre ainsi à nouveau ses capacités scientifiques et technologiques, tout en délivrant directement un message d’indépendance.
Le pays a également réussi cinq missions d’exploration de la Lune dans le cadre du programme Chang’e : lancement de deux sondes lunaires en 2007 et 2010 ; placement de deux astromobiles en 2013 et en 2019, en réussissant un alunissage sur la face cachée de la Lune, soit une première mondiale ; récupération d’échantillons lunaires en 2020. La Chine poursuivra ces missions d’exploration robotique (), et projette à moyen terme d’établir une base lunaire scientifique habitée, en coopération avec la Russie.
Enfin, depuis le mois de juillet 2020, la Chine réalise sa première mission d’exploration martienne, Tianwen-1 (). Cette mission lui permet de figurer parmi les puissances déjà présentes (États-Unis, Russie, Europe, Inde, Émirats Arabes Unis) et même d’être la seule avec les États-Unis à disposer d’un rover sur le sol martien bien que de moindre complexité.
Il est toutefois important de rappeler que si la Chine est de plus en plus active dans le domaine spatial, elle ne dispose pas encore des mêmes capacités technologiques que les États-Unis, en particulier dans le domaine militaire. Son budget est sensiblement similaire au budget cumulé de l’Union européenne, de ses États membres et de l’ESA.
d. L’Europe et le Japon : deux puissances technologiques qui excluent encore le vol habité
L’Europe et le Japon sont deux puissances spatiales reconnues pour leurs très grandes compétences technologiques, même si elles ont fait le choix de dépendre des États-Unis ou de la Russie pour le vol habité. Elles sont par exemple les seules puissances capables d’aller dans l’espace très lointain (ou « espace profond »), avec les États-Unis, ou de se poser sur des comètes et des astéroïdes. Néanmoins, ces deux puissances pourraient se faire distancer par les nouveaux acteurs du spatial.
i. L’Europe : une puissance spatiale incontestable mais dont l’organisation est fragmentée
La compétence spatiale est fragmentée en Europe, à la fois horizontalement – entre l’Agence spatiale européenne (European Space Agency, ESA) et l’Union européenne (UE) – et verticalement – entre ces organisations et leurs États membres ().
L’Europe spatiale est née véritablement en 1975 avec la création de l’ESA par onze États dont la France, même si elle avait été précédée par le Centre européen pour la construction de lanceurs d’engins spatiaux (CECLES ou ELDO en anglais) et l’Organisation européenne de recherches spatiales (ESRO), créées toutes les deux officiellement en 1964. En 2021, l’ESA réunissait vingt-deux États membres (), dont trois États non-membres de l’Union européenne (Norvège, Royaume-Uni, Suisse) et disposait d’un budget de 6,5 milliards d’euros, soit un budget supérieur au budget spatial public de la Russie. Cette organisation intergouvernementale, dont le siège se situe à Paris, planifie et coordonne les projets spatiaux de ses membres, en mobilisant des règles spécifiques telles que la règle du « retour géographique » (voir partie III). Elle est également chargée par ses États membres d’élaborer un programme spatial européen.
L’UE joue également un rôle croissant en matière spatiale depuis l’Acte unique européen de 1987, qui a introduit dans les traités un titre nouveau sur le Recherche et le Développement technologique, et surtout depuis le traité de Lisbonne, entré en vigueur en 2009, qui a, pour la première fois, doté l’UE d’une compétence en matière spatiale. Au fil des années, l’UE a créé plusieurs programmes spatiaux emblématiques, dont le système d’observation de la Terre Copernicus, le système de radionavigation par satellites Galileo et le Système européen de navigation par recouvrement géostationnaire (EGNOS). Depuis mai 2021, c’est l’Agence de l’Union européenne pour le programme spatial (EUSPA) qui est devenue responsable de la gestion opérationnelle de ces programmes, en lien avec la Commission européenne qui en est responsable politiquement, et de l’ESA, qui est responsable du développement scientifique et technologique de ces derniers. Elle sera aussi responsable à terme des nouveaux programmes de l’Union européenne, dont une initiative de surveillance de l’espace (Space Situational Awareness, SSA en anglais) et une initiative pour des télécommunications gouvernementales sécurisées par satellite (Govsatcom). Pour l’ensemble de ces programmes, l’UE s’est dotée d’un budget de 14,8 milliards d’euros sur la période 2021-2027.
Enfin, la politique spatiale européenne est également portée par les États européens eux-mêmes. Ces derniers contribuent tout d’abord aux budgets de l’ESA (obligatoire et facultatif) et au budget spatial de l’Union européenne – lorsqu’ils sont membres de l’une de ces organisations. Ils disposent également de leur propre politique spatiale nationale, avec des agences nationales dédiées. Les rapporteurs ont pu auditionner des représentants du Centre national d’études spatiales (CNES) français, dont son ancien président, M. Jean-Yves Le Gall, et son président actuel, M. Philippe Baptiste. Le CNES, qui propose et met en œuvre la politique spatiale de la France, disposait en 2021 d’environ 2 400 collaborateurs et d’un budget de 1,39 milliard d’euros, hors contribution à l’ESA, pour l’année 2022. Les agences allemande et italienne disposent également de budget important (1,7 milliard d’euros pour le Centre aérospatial allemand, le Deutsches Zentrum für Luft und Raumfahrt, DLR en 2021).
Au total, la chercheuse Isabelle Sourbès-Verger estime le budget européen à environ 13 milliards de dollars (11,5 milliards d’euros) en 2021, toutes sources de financement confondues (ESA, UE, nationales).
Malgré cette organisation complexe, souvent critiquée (voir partie III), les Européens ont su se doter de capacités spatiales importantes. L’ESA a développé ses propres lanceurs : Ariane depuis 1979 et Vega depuis 2012. Le lanceur lourd Ariane 5 sera prochainement remplacé par Ariane 6, et le lanceur Vega par Vega-C (voir partie III.A.1). Ces derniers sont exploités au Centre spatial guyanais (CSG) à Kourou, « le port spatial de l’Europe », que les rapporteurs ont pu visiter les 22 et 23 octobre 2021 (). À cette occasion, ils ont notamment auditionné la directrice du CSG, Mme Marie-Anne Clair, le directeur du Transport spatial de l’ESA, M. Daniel Neuenschwander et le directeur des lanceurs du CNES, M. Jean-Marc Astorg. Grâce aux lanceurs européens et au CSG, l’Europe dispose d’un accès autonome à l’espace.
Le Centre Spatial Guyanais (CSG)
Le CSG s’étend désormais sur 660 kilomètres carrés entre les communes de Kourou et de Sinnamary en Guyane (0,8 % du territoire de la Guyane).
Conçu en 1964 par le général de Gaulle pour renforcer la souveraineté nationale et utilisé de 1970 à 1976 pour le lanceur français Diamant, le CSG a rapidement accompagné le projet spatial européen avec le programme Ariane 1 dès 1973, concrétisé par un premier lancement en 1979. Son histoire est présentée en annexe n°3.
Le CSG dispose d’un atout indéniable pour les lancements : son emplacement géographique à une latitude seulement 5° au nord de l’équateur, qui permet de réduire les coûts des lancements (voir infographique ci-dessous), en utilisant notamment la force centrifuge de la Terre. Cet emplacement est bien plus compétitif économiquement que les bases de lancement américaines, chinoises et russes, situées bien plus au nord de l’équateur.
Au début de l’année 2022, quatre ensembles de lancement étaient en activité : celui du lanceur lourd Ariane 5 (ELA3), celui du futur lanceur Ariane 6 (ELA4) que les rapporteurs ont pu visiter, celui du lanceur intermédiaire Soyouz et celui du lanceur léger Vega et du futur lanceur Vega-C (ELV).
Comme le rappelait le député Lénaïck Adam dans un rapport (), le CSG joue un rôle clé pour le développement économique de la Guyane. Dans ce territoire, 450 entreprises et 4 600 emplois sont liés au spatial (soit 15 % du PIB de la région).
 infographie sur les atouts du CSG
infographie sur les atouts du CSG
Source : ESA, 2021.
Plus généralement, l’Europe a su également se doter d’une industrie spatiale de pointe, la deuxième au monde (avec un secteur générant entre 53 et 62 milliards d’euros de chiffres d’affaires en 2021). Selon la Commission européenne, un tiers des satellites mondiaux était fabriqué en Europe en 2021. Néanmoins, les moyens varient également fortement d’un pays à l’autre. La France, l’Allemagne et l’Italie sont les trois pays qui disposent du tissu industriel le plus développé. Surtout, l’Europe n’a pas encore pris complètement le virage du New Space, et marque un retard certain par rapport aux États-Unis sur les dernières technologies telles que les lanceurs réutilisables (voir partie I.A.2).
Enfin, l’Europe dispose de capacités d’exploration lointaine, qu’il s’agisse de l’étude des planètes lointaines ou de l’étude in situ de comètes, même si elle est de plus en plus concurrencée par la Chine dans le domaine de la science et de l’exploration.
ii. Le Japon : des technologies de pointe
Le Japon est considéré comme une puissance spatiale depuis le lancement en orbite du satellite Ohsumi par l’université de Tokyo en 1970. Si le secteur spatial japonais a été confronté dans le passé à des difficultés économiques (décennie 1991-2000) et constitutionnelles (restrictions sur les applications militaires jusqu’à la loi fondamentale sur l’espace en 2008), il bénéficie néanmoins d’une nouvelle impulsion politique depuis les années 2000.
Le budget public spatial japonais est d’environ 3,5 milliards d’euros en 2021, dont 1,6 milliard d’euros dédiés à l’Agence d’exploration aérospatiale japonaise (Japan Aerospace Exploration Agency, JAXA), créée en 2003 () et dont les rapporteurs ont pu auditionner le représentant à Paris. Ce budget doit permettre de réaliser les ambitions énoncées par le gouvernement. Le programme Space Industry Vision 2030 (« Vision pour l’industrie spatiale » en 2030), présenté en 2017, a pour objectif de doubler le volume de l’industrie spatiale japonaise d’ici 2030.
Le pays a déjà démontré ses capacités technologiques à de nombreuses reprises. Il dispose notamment d’une large gamme de satellites (géolocalisation, télédétection, navigation, météorologiques) et de plusieurs lanceurs, dont un lanceur léger, Epsilon, et un lanceur lourd, H-II, décliné en deux versions (H-IIA, utilisé majoritairement pour les lancements institutionnels japonais et H-IIB, utilisé exclusivement pour ravitailler l’ISS), qui dépendent de la base de lancement de Tanegashima. Bien qu’ils soient considérés comme chers au regard de la concurrence internationale (), ces lanceurs assurent une autonomie au pays. Par ailleurs, le Japon a démontré sa capacité à innover dans des technologies de pointe. Il a devancé la NASA en récupérant un échantillon d’astéroïde avec la sonde Hayabusa en 2005 et a su développer le prototype de voile solaire dès 2010 (mission Ikaros).
Le Japon continuera à participer à l’exploration spatiale au travers de plusieurs missions : imagerie spectroscopique par rayons X (XRISM) en 2022, exploration des lunes martiennes (Martian Moons eXploration, MMX) avec le CNES et le DLR en 2024, exploration du Soleil avec l’ESA (Solar-C) en 2026 et participation au projet lunaire de la NASA ().
e. Les autres nations du spatial : un cercle de plus en plus large
i. Les autres puissances spatiales
L’Inde a débuté son programme spatial dans les années 1960. Elle a créé l’Indian Space Research Organisation (ISRO, « Organisation indienne de recherche spatiale ») en 1969, que les rapporteurs ont pu auditionner. Cette agence est sous l’autorité du Département de l’Espace (Department of Space, DoS), qui dispose d’un budget d’environ 1,9 milliard de dollars pour l’année fiscale 2021-2022. L’ISRO concentre une très grande partie des activités spatiales du pays puisqu’en plus de concevoir les missions spatiales et d’assurer les lancements, elle conçoit et fabrique également les satellites, les lanceurs et leur propulsion.
L’Inde dispose de plusieurs lanceurs, dont le lanceur polyvalent PSLV (Polar Satellite Launch Vehicle) et le GSLV (Geosynchronous Satellite Launch Vehicle) qui assure la mise en orbite des satellites géostationnaires, et développe actuellement un lanceur léger, le SSLV (Small Satellite Launch Vehicle). Reconnue pour sa pratique du jugaad, l’innovation frugale, elle est devenue incontournable dans les lancements commerciaux en orbite basse à bas prix. Selon les chiffres fournis par l’ISRO, l’Inde a lancé 120 satellites indiens et 342 satellites pour d’autres États. L’Inde ne dispose toutefois pas de capacités de production suffisantes pour monter en puissance au niveau international.
L’Inde a longtemps développé le secteur spatial uniquement pour les applications civiles, en mobilisant à la fois ses ingénieurs et la coopération internationale, profitant de son statut de pays non aligné. Mais depuis les années 2000, les compétences acquises et la volonté de s’affirmer comme une grande puissance à l’échelle internationale ont poussé les autorités indiennes à développer des programmes plus ambitieux. L’Inde a ainsi lancé plusieurs missions d’exploration spatiale : sondes envoyées vers la Lune (Chandrayaan 1 en 2008 et Chandrayaan 2 en 2019), vers Mars (Mars Orbiter Mission (), aussi appelée Mangalyaan, en 2013), programme Gagayaan d’envoi d’un homme dans l’espace en 2022, projet de station spatiale en 2030. Désireuse de disposer d’un programme spatial autonome, « l’Inde est à un tournant de son histoire », selon les mots d’Isabelle Sourbès-Verger lors de son audition. Par ailleurs, très attachée depuis toujours au caractère civil de son activité spatiale, l’Inde témoigne sous le gouvernement du Premier Ministre Modi d’un intérêt nouveau pour le spatial militaire avec même l’affichage d’une capacité anti-satellite en 2019.
Le programme spatial israélien a quant à lui émergé dans les années 1980, à travers la création de l’agence spatiale israélienne (Israel Space Agency, ISA) en 1983 et le lancement de son premier satellite Ofek en 1988. Israël a développé un lanceur léger, le Shavit, à partir d’un missile balistique. Ce lanceur a également été dérivé en version commerciale, nommée LeoLink (LK), lancée depuis une base spatiale au Brésil (). Israël possède également un programme spatial scientifique, notamment incarné par la sonde lunaire Beresheet, qui devait alunir en 2019 mais s’est finalement écrasée sur la Lune après une perte de communication.
L’Iran possède également un programme spatial, amorcé au début de l’ère spatiale, mais qui a réellement pris son essor avec la création d’une agence dédiée (Iranian Space Agency, ISA) en 2004. Le pays a lancé de manière autonome son premier satellite, nommé Omid, en 2009. Il possède une gamme de quatre lanceurs légers (Safir, Simorgh, Qased et Zoljanah), principalement dérivés de missiles balistiques nord-coréens. Le programme spatial iranien est toutefois largement ralenti par les différentes sanctions internationales qui pèsent sur le pays (), notamment du fait des négociations autour du nucléaire militaire iranien et de son traité de non-prolifération, le JCPoA (Joint comprehensive plan of action, le plan d’action global commun, ou Accord de Vienne sur le nucléaire iranien). Malgré cela, le pays a lancé trois appareils à partir de son lanceur léger Simorgh le 30 décembre 2021.
Les deux Corée disposent également de capacités spatiales. La Corée du Nord, a réussi à placer en orbite deux satellites : Kwangmyongsong-3 et Kwangmyongsong-4, respectivement en 2012 et en 2016, même s’il s’agissait de petits satellites. Au mois d’octobre 2021, la Corée du Sud quant à elle a presque réussi à placer en orbite un satellite factice d’une tonne et demie depuis un nouveau lanceur (KSLV II ou « Nuri ») conçu intégralement par des entreprises sud-coréennes.
ii. Un accès à l’espace ouvert à d’autres nations : focus sur l’Afrique
Une quarantaine d’États dispose de programmes spatiaux nationaux et une centaine sont aujourd’hui propriétaires de satellites. Parmi ceux-ci, des États ont de vraies ambitions spatiales. C’est par exemple le cas de l’Argentine, du Brésil, des Émirats arabes unis (EAU) (), de la Thaïlande, de la Turquie () et de plusieurs pays africains.
Les rapporteurs ont choisi de faire un point plus spécifique sur le spatial en Afrique. Ils ont pu auditionner Sekou Ouedraogo, président de l’African Aeronautics & Space Organisation (AASO, Organisation africaine de l’aéronautique et de l’espace) ().
L’ère spatiale africaine a débuté en 1998 avec le lancement du satellite égyptien Nilesat 1 001 (conçu par Matra Marconi) par une fusée Ariane (). De 1998 au début de l’année 2021, 43 satellites africains ont été lancés, dont une majorité de petits satellites. Parmi les cinquante-quatre nations africaines, douze sont concernées : l’Afrique du Sud, l’Algérie, l’Angola, le Ghana, l’Égypte, l’Éthiopie, le Kenya, le Maroc, le Nigeria, le Rwanda, le Soudan et la Tunisie.
Des institutions nationales ont été créées dans plusieurs pays, dont souvent des agences spatiales. Les institutions les plus significatives ont été créées en Afrique du Sud (South Africa National Space Agency, SANSA), en Algérie (Agence spatiale algérienne, ASAL), en Angola (Bureau national de gestion du programme spatial, GGPEN), en Égypte (Egypt Space Agency), en Éthiopie (Ethiopian Space Science and Technology Institute, ESSTI), au Gabon (Agence Gabonaise d’Études et d’Observation Spatiale, AGEOS), au Ghana (Ghana Space Science and Technology Institute, GSSTI), au Kenya (Kenya Space Agency, KSA), au Maroc (Centre Royal de Télédétection Spatiale du Maroc, CRTS), au Nigeria (National Research and Development Agency, NASDRA), en Ouganda (mission du ministère de la Science), au Rwanda (Rwanda Space Agency, RSA) et au Zimbabwe (Zimbabwe National Geospatial and Space Agency, ZINGSA) ().
L’Afrique du Sud se distingue par sa longue expérience dans le spatial – elle collaborait avec les États-Unis dès les années 1960 – et par le budget consacré au secteur. En 2020, la SANSA était l’agence dotée du budget annuel le plus élevé du continent : 168 millions de dollars, auxquels devraient s’ajouter deux augmentations annoncées en 2020 (266 millions étalés sur quatre ans et 86,3 millions étalés sur dix ans). Les budgets des agences spatiales nigériane, algérienne et égyptienne suivent, avec respectivement 54, 50 et 40 millions de dollars la même année () (). Le Maroc, même s’il dispose d’un budget moins conséquent (2,3 millions de dollars en 2018) est aussi considéré comme un acteur important depuis le financement du satellite d’observation Mohammed VI, lancé en 2017 par une fusée Vega, pour un coût total de 500 millions d’euros.
Le budget spatial cumulé des agences spatiales africaines a plus que doublé en trois ans, passant de 238,12 millions de dollars en 2018 à 325,11 millions de dollars en 2019 et 503,12 en 2020 (410 millions d’euros). De plus, le montant de l’ensemble des investissements publics et privés qui était estimé à 7 milliards de dollars par an en 2018, pourrait dépasser 10 milliards de dollars par an en 2024 (8,9 milliards d’euros). Sur l’ensemble du continent, 8 500 personnes travaillent déjà dans le domaine spatial dont 6 500 dans des institutions et des centres de recherche et 2 000 dans le secteur privé.
L’ambition spatiale du continent s’est également traduite par l’adoption d’une Stratégie spatiale africaine et par la création d’une Agence spatiale africaine (AfSA) par l’Union africaine en janvier 2019 pour renforcer la coordination des politiques spatiales et développer les partenariats. Ses Statuts ont été signés par les chefs d’État et de gouvernement de cinquante-quatre pays, en s’inspirant de l’Agence spatiale européenne et en l’adaptant aux besoins africains. L’article 2 précise les missions de l’agence : « L’Agence spatiale africaine (AfSA) est instituée (…) en tant qu’organe de l’Union africaine chargé de promouvoir, conseiller, coordonner le développement et l’utilisation des sciences et des techniques spatiales en Afrique ; des réglementations connexes pour le bénéfice de l’Afrique et du monde, et de renforcer la coopération intra-africaine et internationale ». Cette agence sera basée au Caire, en Égypte.
2. Des entreprises qui bouleversent le paradigme spatial
a. Le New Space, une révolution industrielle américaine
i. Les acteurs privés sur le devant de la scène
Le New Space désigne un ensemble d’évolutions nées aux États-Unis qui marquent l’industrie spatiale depuis une dizaine d’années : multiplication des acteurs spatiaux et en particulier des start-up, innovations technologiques, financements nouveaux, baisse du coût de l’espace et extension du champ d’application des technologies spatiales.
Parmi les entreprises américaines les plus emblématiques de cette tendance, peuvent être citées :
- Space Exploration Technologies Corporation (SpaceX) créée en 2002 par Elon Musk, le fondateur de Tesla Motors, et qui comptait plus de 9 000 employés en 2021. La société conçoit, construit et commercialise le Falcon 9, un lanceur moyen ou lourd selon les versions, et le Falcon Heavy, le lanceur opérationnel le plus puissant au monde (la charge utile peut atteindre 64 tonnes en orbite basse, 27 tonnes en orbite géostationnaire) (), ainsi que les moteurs Merlin qui les propulsent. Au 31 décembre 2020, le Falcon 9 totalisait 102 succès sur 104 lancements depuis 2015 et le Falcon Heavy, 3 succès sur 3 lancements depuis 2018. En 2020, SpaceX a effectué 25 % des lancements mondiaux (26 tirs sur 104). Si l’entreprise était un pays, elle se placerait ainsi en deuxième position derrière la Chine (39 tirs soit 35 % du marché mondial) ().
Depuis 2012, SpaceX développe également le lanceur super lourd Starship (charge utile de 100 tonnes en orbite basse, 21 tonnes en orbite géostationnaire) composé d’un premier étage Super Heavy et d’un second étage Starship, et équipé de nouveaux moteurs dénommés Raptors. Ce lanceur serait utilisé pour les missions sur la Lune (atterrisseur lunaire) et sur Mars (projet de colonisation porté par l’entreprise), pour le tourisme spatial ainsi que pour des liaisons ultrarapides entre deux points de la Terre.
Enfin, la compagnie a développé et commercialisé le vaisseau spatial Dragon qui assure le transport cargo vers et depuis l’ISS depuis 2012, ainsi que le transport de passagers depuis 2020.
- Blue Origin, créée en 2000 par Jeff Bezos, fondateur d’Amazon, qui employait plus de 3 500 personnes en 2021. La société a développé le lanceur New Shepard pour les missions de tourisme spatial et de recherche (premier vol suborbital en 2015, première mission habitée en juillet 2021) et développe une nouvelle famille de lanceurs lourds réutilisables avec troisième étage optionnel, appelés New Glenn (jusqu’à 45 tonnes en orbite basse et 13 tonnes en orbite géostationnaire) et dont le premier vol est prévu en 2022.
Blue Origin est également motoriste : la société a développé les moteurs BE-3, BE-4 et BE-7 pour ses lanceurs et pour la propulsion du futur lanceur lourd Vulcan de l’entreprise United Launch Alliance (ULA).
Enfin, l’entreprise a proposé l’alunisseur Blue Moon à la NASA dans le cadre du programme Artemis, mais celui-ci n’a pas été retenu.
- Virgin Galactic (), créée en 2004 par Richard Branson et composée d’environ 1 000 salariés. Elle est spécialisée dans les vols touristiques et de recherche. Son premier vol habité a été réalisé en 2018 en utilisant l’avion spatial suborbital VSS Unity ().
- Rocket Lab, une société américaine d’origine néozélandaise, créée en 2006 et qui emploie environ 600 personnes. Après avoir conçu et commercialisé le micro-lanceur Electron (premier vol en 2017), elle développe actuellement le lanceur moyen Neutron (8 tonnes en orbite basse, premier vol prévu en 2024).
- Planet Labs, une entreprise qui exploite, fabrique et opère des nano-satellites d’observation de la Terre (200 satellites actifs en 2021).
Cette liste traduit l’arrivée des acteurs du monde numérique – les GAFAM (Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft) – dans le secteur spatial à partir des années 2000. Ils ont apporté des financements privés conséquents, des méthodes de travail issues du monde numérique, mais aussi un nouveau modèle commercial basé sur l’utilisation des données issues du spatial. L’innovation est pensée pour l’utilisateur final, qui doit pouvoir y accéder à un coût plus faible.
Enfin, le New Space se caractérise par la multiplication des projets de méga-constellations de petits satellites en orbite basse. La plupart de ces projets proposent de fournir un accès plus performant à Internet () : constellation Starlink de SpaceX (12 000 satellites, voire 40 000 à long terme) (), constellation Kuiper Systems d’Amazon (3 000), constellation de l’entreprise indo-britannique OneWeb (650), constellation Lightspeed de l’entreprise canadienne Telesat (300), constellation Guowang de la Chine (13 000), constellation Sfera de la Russie (640), projet de constellation européenne, etc. Les satellites sont alors envoyés par grappes par des lanceurs traditionnels ou par des micro-lanceurs.
La mise en place de ces constellations est très rapide, et celle de Starlink est la plus avancée. En effet, 33 lancements ont été dédiés à Starlink depuis mai 2019, portant la constellation de Starlink à un total de 1 890 satellites dont 1 731 étaient opérationnels à la fin de l’année 2021 (version 0.9 : 60 satellites lancés, 55 satellites désorbités ; version 1.0 : 1 678 satellites lancés, 79 satellites désorbités ; version v1.5 : 152 satellites lancés, 1 satellite désorbité) ().
En additionnant tous les projets de constellations, 40 000 à 75 000 satellites pourraient être envoyés en orbite basse dans la prochaine décennie. Même si tous les projets ne voient pas le jour, ces chiffres sont bien supérieurs aux 3 000 satellites qui étaient jusqu’à présent actifs autour de la planète, toutes orbites confondues.
ii. Des entreprises soutenues par le secteur public
L’émergence du New Space ne résulte pas seulement d’initiatives privées : elle a été fortement encouragée par une ouverture du secteur public et par des investissements publics dès les années 1990. Depuis la décennie 2010, le développement du secteur commercial est même devenu un élément majeur de la stratégie spatiale américaine, une tendance renforcée sous la présidence de Donald Trump. La deuxième Space Policy Directives (SPD-2) publiée le 24 mai 2018 avait par exemple pour objectif direct de soutenir le développement du secteur privé, en allégeant les réglementations () (licence unique accordée par le département des transports pour le lancement ou la rentrée atmosphérique d’un engin spatial commercial et obtention facilitée de cette licence, modifications des qualifications demandées par la NASA et le secrétaire à la défense, etc.), sous la coordination du département du commerce devenu responsable de la réglementation des vols spatiaux du secteur privé.
La NASA s’est également désengagée de certaines activités () et a laissé les entreprises prendre le relais à travers des contrats publics. La NASA ne développe par exemple plus qu’un seul lanceur, le SLS, présenté supra. Pour le transport de marchandises et d’équipages vers l’ISS, elle mobilise désormais SpaceX et Boeing.
De même, le DoD passe des contrats avec le secteur privé. Comme l’indique le CNES dans une note, « en 2020, SpaceX a remporté avec ses deux versions de Falcon en activité le programme « National Security Space Launch » (NSSL) aux côtés d’United Launch Alliance (ULA). Dans ce cadre, les deux sociétés vont se partager tous les lancements des missions spatiales de sécurité nationale du Pentagone prévus entre 2022 et 2027. SpaceX devrait récupérer 40 % de ces contrats, représentant environ 2,5 milliards de dollars pour une quinzaine de missions. La confiance engrangée auprès du Pentagone pourrait permettre à SpaceX de remporter des contrats au-delà du domaine spatial : l’U.S. Air Force a estimé que les techniques de production de son nouvel avion de combat du programme Next Generation Air Dominance ne sont maîtrisées que par le secteur commercial, et laisse donc la porte ouverte à SpaceX sur ce projet » ().
Ces contrats publics permettent ensuite aux entreprises d’être compétitives en réduisant leurs prix sur le marché commercial. En effet, lorsque la société SpaceX facture un lancement 100 millions de dollars à la NASA, elle le propose à 50 ou 60 millions de dollars sur le marché commercial (). Ces contrats s’accompagnent également de transferts de technologies de la NASA et du DoD.
C’est un modèle que l’on pourrait qualifier de « rentabilité à géométrie variable » qui permet aujourd’hui à une entreprise comme SpaceX d’amortir ses coûts grâce aux nombreux lancements institutionnels payés très cher par le contribuable américain. Les coûts fixes de l’entreprise sont alors couverts, ce qui permet ensuite de concurrencer les entreprises européennes comme Arianespace sur le marché des lanceurs, en proposant des prix qui n’ont besoin de couvrir que les coûts marginaux.
De plus, les entreprises bénéficient d’un écosystème juridique et financier américain favorable au développement d’une industrie spatiale nationale. Plusieurs lois et déclarations politiques américaines exigent par exemple que les lanceurs soient fabriqués aux États-Unis pour les missions institutionnelles ().
Enfin, en cas de difficulté, ces acteurs sont aidés par le secteur public car ils sont devenus trop stratégiques pour faire faillite (« too big to fail »). En 2008, la société SpaceX avait ainsi déjà été aidée par un contrat de douze lancements vers l’ISS, d’un montant de 1,6 milliard de dollars, alors qu’un seul de ses quatre essais de fusée Falcon avait été réussi. L’entreprise rencontrait d’ailleurs des difficultés financières, et ce contrat a sauvé l’entreprise de la faillite.
iii. Des innovations technologiques majeures
Le New Space est caractérisé par des innovations technologiques dites « de rupture » : réutilisation des équipements, miniaturisation des composants, motorisation électrique, impression 3D, moteurs réallumables etc. ; favorisées par la numérisation de l’économie (« big data », intelligence artificielle) mais aussi par des modes de pensée et d’organisation différents.
La réutilisation des lanceurs est envisagée par la NASA et l’industrie spatiale américaine depuis les années 1960. Réalisée entre 1981 et 2011 par la Navette spatiale américaine, cette opération n’était toutefois pas rentable d’un point de vue commercial. C’est finalement SpaceX qui a été la première entreprise capable de récupérer en douceur le premier étage d’un lanceur en 2015 et à le réutiliser en 2017, soit une véritable rupture technologique qui a beaucoup contribué à la réussite commerciale et à la réputation de SpaceX. Aujourd’hui, la réutilisation est devenue quasi systématique pour l’entreprise : en 2020, 81 % des lancements de Falcon 9 ont utilisé un premier étage ayant déjà volé (contre 27 % en 2017) et un premier étage a été utilisé à cinq reprises. La société commence également à récupérer les demi-coiffes des lanceurs Falcon 9 (9 avaient été récupérées au 31 décembre 2020).
En mars 2021, 3 lanceurs étaient réutilisables et commercialisés aux États-Unis (Falcon 9 et Falcon Heavy de Space X ; Electron de Rocket Lab) et on dénombrait huit projets en développement, dont cinq projets en phase d’essai (Dream Chaser de Sierra Nevada, New Shepard de Blue Origin, SpaceShip Two de Virgin Galactic, Space X Starship et X-37B de Boeing) et trois projets en phase d’étude (Neutron de Rocket Lab, New Glenn de Blue Origin et Vulcan de ULA). Les caractéristiques techniques de ces différents projets sont comparées en annexe n° 4. Certains utilisent un atterrissage vertical avec rallumage des moteurs (Falcon 9, Falcon Heavy, New Glenn, New Shepard, SpaceX Starship), d’autres un atterrissage horizontal comme un avion (Dream Chaser, SpaceShip Two, X-37B), un parachutage (Vulcan) ou une récupération par hélicoptère (Electron, Neutron) ().
Le développement des nanotechnologies et la miniaturisation des composants électroniques et mécaniques ont aussi permis de réduire la taille et la masse des satellites, et donc de réduire les coûts de lancement. De plus, depuis 2012, les satellites peuvent utiliser une propulsion électrique ce qui réduit de 40 % leur poids par rapport à un carburant chimique (ergol).
Comme le notait l’OPECST dans une note publiée en octobre 2019, les satellites de télécommunication ont également « gagné en flexibilité et sont maintenant reconfigurables grâce à des capacités embarquées de traitement et d’intelligence artificielle, pour s’adapter en temps réel aux demandes du marché, réajuster leurs missions au cours de leur existence, voire leur octroyer une seconde vie (). De ce fait, le modèle de satellites fabriqués sur mesure et à la demande devient obsolète et leur production peut être standardisée et accélérée (dix-huit mois au lieu de trois à cinq ans) pour un grand nombre d’entre eux » (). L’accélération de la cadence de production des satellites et de lancement résulte aussi d’une organisation industrielle très concentrée, sorte de méthode fordiste appliquée au spatial.
b. Une industrie spatiale française et européenne qui peine à se renouveler
i. Quatre grands industriels à la tête de l’industrie spatiale européenne
L’industrie spatiale européenne s’est restructurée au cours des années 2010. Un maître d’œuvre principal a tout d’abord émergé pour les lanceurs : ArianeGroup, alliance d’Airbus et du motoriste Safran et dont Arianespace est la filiale. Les rapporteurs ont pu auditionner Stéphane Israel, PDG d’Arianespace. La société Arianespace (détenue à 74 % par Arianegroup) est opérateur de lancement depuis le Centre Spatial Guyanais, c’est-à-dire qu’elle commercialise et fournit les services de lancement Ariane, Vega et Soyouz à ses clients institutionnels et commerciaux (). Arianegroup est chargée du développement et de l’intégration des lanceurs.
En parallèle, on dénombre trois maîtres d’œuvre concurrents pour les systèmes satellitaires, qui représentent eux aussi des fleurons de l’industrie européenne et dont les rapporteurs ont pu auditionner les représentants :
- Airbus Defence and Space (ADS), créée en 2014 par la fusion de plusieurs entités préexistantes. Au sein d’ADS, l’entité « Space Systems » conçoit et fabrique des satellites, des équipements pour les systèmes de télécommunications civils et militaires, pour l’observation de la Terre et pour les programmes scientifiques et de navigation. Son chiffre d’affaires était estimé à 3,8 milliards d’euros et elle regroupait 12 000 employés dans douze sites dans le monde (dont des sites en France, en Allemagne et en Espagne) en 2020. L’entreprise conçoit par exemple le module ESM (European Service Module) du vaisseau spatial Orion de la NASA qui est développé dans le cadre du projet Artemis de retour sur la Lune ;
- Thales Alenia Space (TAS), joint-venture entre l’entreprise française Thales (67 %) et l’entreprise italienne Leonardo (33 %) qui emploie environ 7 700 personnes (dont 4 500 en France). TAS réalise les mêmes activités qu’ADS et possède dix-huit sites dans le monde (dont des sites en France, en Allemagne, en Belgique, en Espagne, en Italie, en Pologne et au Royaume-Uni). Elle réalisait un chiffre d’affaires de 1,8 milliard d’euros en 2020 et a décroché un contrat de 3 milliards d’euros au début de l’année 2021 avec le groupe canadien Telesat pour construire une constellation de 298 satellites. Le 23 octobre 2021, les rapporteurs ont pu assister au lancement de deux satellites fabriqués par TAS : le satellite de communication militaire Syracuse 4a pour la direction générale de l’armement (DGA) et le satellite de télécommunications luxembourgeois SES-17 doté d’une charge utile entièrement numérique ;
- l’entreprise allemande OHB (Orbitale Hochtechnologie Bremen), qui n’a pas encore la même puissance industrielle qu’Airbus ou Thales (environ 3 000 employés et 1 milliard d’euros de chiffre d’affaires en 2019) et qui travaille aussi sur le secteur des lanceurs. Ses activités ne cessent d’augmenter et de se diversifier. OHB a notamment investi dans le projet de micro-lanceur allemand Rocket Factory Augsburg (RFA) One.
ii. Un « New Space » européen encore en développement
Les quatre grandes entreprises européennes du spatial se sont développées en suivant un modèle relativement traditionnel. Elles sont tout d’abord souvent issues du secteur aéronautique ou de défense et travaillent avec beaucoup de fournisseurs répartis dans toute l’Europe (dont des acteurs de taille moyenne comme Air Liquide et des plus petits fournisseurs). On constate une nette séparation entre la construction de satellites, les services de lancement puis les applications. Ces entreprises font partie de ce qui est parfois appelé ironiquement le « Old Space ».
La stratégie des autorités américaines pour soutenir le développement du New Space n’a pas encore été reprise par les acteurs publics européens. Les start-up européennes n’ont par exemple pas pu profiter des mêmes aides publiques que leurs concurrentes américaines, ce qui freine leur développement. Dans ce contexte, il est encore difficile de parler d’un « New Space européen ».
Néanmoins, de plus en plus de start-up sont créées chaque année en Europe dans le secteur spatial. Ces entreprises se spécialisent en règle générale dans un domaine en particulier, comme les micro-lanceurs, les nano-satellites, la propulsion, les applications terrestres ou les services spatiaux. Elles maîtrisent les dernières technologies, notamment grâce à des partenariats avec de grandes universités ou des agences spatiales nationales. Ces entreprises cherchent par ailleurs à s’établir comme des acteurs incontournables du secteur spatial européen. Par exemple, dix-neuf start-up françaises du secteur spatial ont créé le 7 mai 2021 l’Alliance New Space France () afin de fédérer leurs intérêts, faciliter les innovations et porter leur voix au niveau institutionnel.
Les rapporteurs ont eu l’opportunité d’auditionner ClearSpace, une start-up suisse emblématique de ce que pourrait devenir le New Space européen. Cette entreprise, qui a été créée avec l’appui de l’École polytechnique fédérale de Lausanne, a remporté un appel d’offres de l’ESA pour développer un service d’élimination de débris spatiaux. Elle a ainsi pu développer des technologies de pointe grâce aux financements de l’ESA et de ses pays membres. Le développement de ClearSpace est similaire à celui de SpaceX et des autres acteurs du New Space américain, et montre comment les acteurs publics européens peuvent utiliser leurs appels d’offres pour favoriser l’entreprenariat en Europe. C’est de cette manière que pourra s’ouvrir un véritable « New Space européen ».
c. Un développement inégal dans les autres pays
Dans les autres grandes nations spatiales, le développement d’une forme de New Space, apparaît encore limité. C’est notamment le cas en Russie, où l’industrie spatiale reste très endogène. Une nouvelle législation adoptée en 2020 (décret n° 298) pourrait toutefois encourager le développement du secteur privé en réduisant les contraintes administratives imposées jusqu’alors. De même, en Inde, un mouvement d’ouverture vers le secteur privé est en cours, mais se heurte à la position hégémonique de l’agence spatiale indienne, l’ISRO ().
En Chine, le terme New Space n’est pas utilisé mais plutôt celui de spatial commercial. Marc Julienne, auditionné par les rapporteurs, note l’émergence de nombreuses start-up privées ou semi-privées dans le secteur spatial chinois, que ce soit en matière de construction de lanceurs (China Rocket, Expace, LandSpace, LinkSpace, iSpace, OneSpace), de satellites (Chang Guang Satellite Technology, SpaceOK) ou de fourniture de services satellitaires. L’objectif recherché par les autorités est de stimuler l’innovation et de diversifier les canaux de financements. Toutefois, les activités de ces entreprises demeurent sous le contrôle du Parti communiste et dépendent encore de financements publics ().
Les autorités chinoises ayant besoin d’une intégration extrêmement forte du secteur spatial pour compenser le retard vis-à-vis des États-Unis, l’émergence de géants du spatial comme SpaceX ou Blue Origin, qui feraient concurrence aux entreprises d’État, n’est pas envisageable ().
B. Des enjeux nouveaux expliquent le bouleversement du paysage spatial international
1. L’espace est de plus en plus attractif pour les acteurs publics et privés
a. Un secteur plus accessible et plus performant
Outre les prix bas pratiqués par des pays comme l’Inde ou la Russie pour les lancements, c’est surtout l’émergence de nouveaux acteurs industriels ainsi que l’utilisation de technologies de rupture qui ont permis de réduire drastiquement les coûts de production des produits spatiaux et de mise en orbite. La réduction de ces coûts était d’ailleurs un élément clé de la stratégie de développement de ces acteurs.
Les industries spatiales américaine et européenne sont traditionnellement organisées autour de grands clients publics (la NASA et le DoD aux États-Unis) et de grands industriels fournisseurs, entourés de sous-traitants (). Dans ce modèle, les structures hiérarchiques sont souvent complexes et les coûts fixes importants. De plus, les acteurs se spécialisent chacun dans des activités différentes et peuvent même être situés dans des zones géographiques éloignées (). Ainsi, avec ce modèle, les coûts de production et de lancement sont importants. De plus, l’innovation n’est pas toujours encouragée, car la fiabilité devient une obsession, chaque fournisseur souhaitant garder sa place dans la chaîne, en produisant des produits sûrs.
Les acteurs du New Space ont apporté un nouveau modèle organisationnel, plus performant, dont l’exemple le plus poussé est SpaceX. La société utilise de nouvelles méthodes de management, issues de l’industrie digitale (espaces de travail ouverts, management horizontal, etc.). Surtout, elle a choisi un modèle d’intégration verticale qui lui permet de maîtriser l’ensemble de la chaîne de valeur et de diminuer le coût des produits et des services finaux. La société concentre en effet l’ensemble des activités spatiales possibles : de la production du satellite au lancement et à la fourniture de services aux usagers, et a pour objectif d’être la plus autonome possible sur chacune de ces activités. Enfin, elle réduit au maximum le nombre de sites de conception et de production. Ce modèle permet de supprimer une grande partie des coûts intermédiaires et d’assurer une meilleure coordination entre les différents sites industriels.
De plus, les entreprises du New Space se caractérisent par une certaine culture du risque, qui est encouragée par les appels d’offres publics et qui favorise l’innovation. Si le développement du lanceur Falcon 9 de SpaceX a été marqué par de nombreux échecs, la société les présente comme des enseignements indispensables au développement du produit final : le premier lanceur privé partiellement réutilisable et, contrairement à la Navette spatiale, rentable. Or, la récupération du premier étage du lanceur est sans doute l’innovation qui a eu le plus d’effet sur la réduction des coûts puisque cet étage représente environ 70 % du coût du lanceur. En le récupérant, l’entreprise peut réutiliser des composants techniques très onéreux, mais aussi gagner du temps pour le lancement suivant et donc augmenter le nombre de ses lancements et les revenus associés.
D’autres innovations telles que l’automatisation de la production, l’impression 3D, la miniaturisation des satellites voire leur standardisation et la construction à l’horizontale des fusées ont également réduit les coûts () et accéléré la cadence de production, ce qui permet de diminuer le prix final proposé au client. En parallèle, la réduction du poids des satellites – liée à leur miniaturisation et éventuellement à l’utilisation de la propulsion électrique – a également un vrai impact sur le coût de lancement.
Ainsi, ces différentes innovations ont permis de réduire drastiquement le coût d’accès à l’espace. Selon un article d’Éric André Martin pour l’IFRI publié en mars 2021 : « On estime que le coût d’envoi dans l’espace d’un kilo de fret par un lanceur conventionnel est resté stable entre 1970 et 2000, avec un peu plus de 18 000 dollars. Le coût pour une fusée Falcon 9 serait ramené à 2 600 dollars pour des lancements commerciaux en orbite basse » ().
Des acteurs qui n’auraient auparavant pas pu accéder à l’espace, peuvent désormais l’utiliser voire dans certains cas fabriquer eux-mêmes des engins spatiaux.
b. Un secteur toujours plus stratégique
i. Des infrastructures spatiales au cœur du monde numérique
L’ère digitale a permis non seulement d’améliorer la performance des satellites et des lanceurs (voir supra), mais aussi en parallèle de diversifier les utilisations de l’espace.
Premièrement, les satellites d’application () assurent des services devenus indispensables à tous et qui représentent donc des enjeux économiques très importants :
– la météorologie et l’observation de la Terre : les satellites profitent de leur position en orbite pour recueillir des données souvent beaucoup plus précises que les instruments terrestres. Le programme Copernicus de l’Union européenne produit par exemple des données d’observation de la Terre gratuitement, qui bénéficient à des secteurs d’activité très différents tels que la santé publique, les transports ou l’agriculture ;
– la navigation avec notamment le GPS (Global Positioning System) américain et Galileo de l’Union européenne. La Commission européenne estime que 7 % de l’économie de l’Union dépend des données transmises par Galileo pour son bon fonctionnement () ;
– les télécommunications, et notamment l’accès à Internet en haut débit partout dans le monde, un objectif porté par les différents projets de constellations évoqués supra, et qui répondrait à de nombreux domaines tels que l’Internet des objets ou le développement du cloud computing, c’est-à-dire la fourniture via Internet « d’un ensemble de services informatiques au travers de serveurs mis à disposition des clients » (OPECST) ().
Plus généralement, l’espace est devenu un maillon essentiel de l’économie de la donnée. Les infrastructures spatiales génèrent des millions de gigaoctets de données, souvent plus rapidement et plus précisément que les systèmes terrestres. Elle participe au phénomène de big data (données massives) ([62]). Or, l’amélioration constante des capacités de traitement des données rend possible leur utilisation voire leur commercialisation. Une fois traitées sur Terre, elles ont de multiples usages pour l’industrie, l’agriculture, le transport maritime, la météorologie, la gestion des ressources naturelles, la prévention et le suivi des risques naturels, etc. Les rapporteurs ont auditionné M. Christophe Vassal, le PDG de l’entreprise CLS qui fournit des solutions d’observation et de surveillance de la Terre depuis 1986 dans de nombreux domaines et pour des acteurs publics comme privés (suivi des surfaces vertes et des espèces sauvages, surveillance des bateaux de pêche, suivi des flottes terrestres, convois humanitaires). L’humanité devient de plus en plus dépendante des données spatiales.
Par ailleurs, l’économie spatiale pourrait se diversifier dans les décennies à venir. L’entreprise BlueOrigin développe actuellement le projet Orbital Reef, une station spatiale en orbite basse à usage commercial, scientifique et touristique qui serait mise à la disposition de clients privés et institutionnels à l’horizon 2030. Ce type de projet pourrait contribuer au développement de la production industrielle en orbite, profitant des avantages de l’apesanteur, notamment en matière médicale (). Enfin, les projets de tourisme spatial se multiplient (). L’année 2021 a été rythmée par les vols privés réalisés par les entreprises SpaceX, Blue Origin et Virgin Galactic. Bien qu’ayant des caractéristiques très différentes, ces vols ont en commun la présence de personnel non entraîné à bord, ce qui confirme la possibilité de rendre le vol spatial accessible à tout un chacun. Selon la banque d’investissement UBS, l’industrie du tourisme spatial aura une valeur de 4 milliards de dollars en 2030, soit une proportion faible mais non négligeable de l’industrie spatiale en général.
Au total, l’économie spatiale est évaluée par l’ONU à plus de 400 milliards de dollars dont 80 % d’activités commerciales (bureau des affaires spatiales, 2021) (). L’espace peut aujourd’hui être considéré comme la nouvelle frontière du développement technologique. En conséquence, le secteur attire des financements privés très importants, notamment via le capital-risque aux États-Unis.
ii. Un outil de développement
Les satellites, en particulier ceux qui permettent l’observation de la terre, la navigation ou les télécommunications, sont devenus essentiels pour le développement économique, social et environnemental d’un pays. Les applications spatiales semblent même avoir un effet multiplicateur sur ce développement. À titre d’exemple, l’ESA estime que le programme Galileo a eu un bénéfice économique de 62 milliards d’euros en 2020, pour un coût de 3,2 milliards d’euros, sur la période 2000-2020 ([66]).
Lors de son audition, M. Sékou Ouedraogo, président de l’African Aeronautics & Space Organisation (AASO), a démontré comment les infrastructures spatiales pourraient, à terme, répondre aux différents besoins socio-économiques du continent africain. L’utilisation de données satellitaires pourra, par exemple, aider à prévoir et prévenir les invasions de criquets, assurer la sécurité alimentaire en localisant les points d’eau ou en suivant l’état des cultures, ou lutter contre les épidémies de malaria en localisant plus précisément les zones à risque. Le spatial est ainsi un outil puissant pour contribuer au développement durable en Afrique. Le président du CNES a d’ailleurs souligné durant son audition que des partenariats émergeaient entre des acteurs du spatial et les agences de développement comme l’Agence française de développement (AFD) (voir également la partie IV. C. 1.).
De la même manière, Mme Isabelle Sourbès-Verger a partagé lors de son audition son analyse de la politique spatiale chinoise. Selon elle, cette politique n’a pas eu pour vocation première de faire de la Chine une puissance spatiale pouvant concurrencer les États-Unis, mais plutôt de répondre aux besoins internes en matière de développement.
Le spatial joue également un rôle clé dans les politiques publiques de lutte contre les dérèglements climatiques. Selon un rapport de l’OCDE publié en 2019, plus de la moitié des variables essentielles sur le climat repose sur des données recueillies par satellite (). Les satellites météorologiques et les satellites d’observation de la Terre communiquent, de manière fiable et actualisée, des informations essentielles pour la gestion des activités terrestres et maritimes ainsi pour les modèles d’évolution climatique. Les informations transmises par ces infrastructures permettent ensuite aux pouvoirs publics de concevoir des politiques adaptées. Dans ce contexte, un Observatoire spatial du climat a été créé en 2019 afin de procurer aux décideurs des données fiables et actualisées sur les dérèglements climatiques et leurs effets.
|
L’Observatoire spatial du climat
L’Observatoire spatial du climat (Space climate observatory, SCO) est un projet multilatéral à l’initiative du CNES, lancé officiellement le 17 juin 2019. À la fin de l’année 2021, il regroupait plus d’une trentaine d’agences spatiales ainsi que le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), le Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE) et le Bureau des affaires spatiales (BAS) de l’ONU. Ses membres se réunissent régulièrement à l’occasion de comités de pilotage. Le SCO peut également se décliner à l’échelle nationale : trois agences ont été mises en place en France, en Chine et au Mexique. Ces dernières sont chargées de faire le lien entre le SCO lui-même et les pouvoirs publics nationaux.
Le SCO a pour objectif de donner aux décideurs de tous les pays le même diagnostic fiable et actualisé sur l’état de la planète, à travers la mise à disposition de données scientifiques recueillies par satellite et la production d’indicateurs et de modèles. Ainsi, le SCO doit permettre d’indiquer avec précision l’impact des politiques publiques en matière de lutte contre les dérèglements climatiques.
Le principal enjeu pour l’avenir du SCO est d’apparaître comme un interlocuteur indispensable sur sa thématique. Cela passe par l’inclusion de nouveaux membres (notamment la NASA) et par la diffusion de ses services à des pays vulnérables, sans agence spatiale, principalement en Afrique et dans le Pacifique. La signature de la charte internationale du SCO en 2022 aidera à établir plus fermement l’organisation dans le paysage institutionnel mondial et à légitimer son action.
|
Les nombreuses utilisations du spatial sont résumées dans le schéma ci-dessous.
Les utiLIsations des technologies spatiales en 2021

Sources : Secrétariat général du Conseil de l’Union européenne à partir de données de la Commission européenne, de la Banque européenne d’investissement et du Parlement européen.
iii. Un enjeu de souveraineté
L’espace est un enjeu de souveraineté économique et industrielle. La dépendance envers les télécommunications et les données transmises par des satellites pour les différentes activités évoquées supra rend l’investissement dans le spatial indispensable.
Or, le secteur spatial offre une prime au premier entrant : les coûts fixes élevés et les risques de saturation de l’environnement spatial, notamment en orbite basse, récompensent les acteurs ayant investi en premier et proposant un service efficace. Ils bénéficient alors des meilleurs lieux, pour une technologie donnée. Dans ce contexte, la compétition est forte entre les acteurs – les États et les entreprises, aidées par les États – et extrêmement politique. Dans un article publié en octobre 2020, Mme Murielle Lafaye, responsable du pôle Intelligence économique du CNES, parlait du secteur spatial comme un des fronts de la « guerre économique » qui sévit entre les puissances mondiales : il est essentiel d’y investir afin de conserver ou d’acquérir une position économique dominante ().
L’espace est également indispensable en matière militaire – ce que démontrera la suite du rapport (I.B.2).
Au-delà de ces deux domaines – économique et militaire – l’espace est aussi un enjeu de soft power important. Les programmes d’exploration font rêver l’opinion publique et confèrent du prestige aux États qui en sont à l’origine. Le programme Apollo (1961-1972) a par exemple contribué à renforcer le statut de puissance des États-Unis pendant la guerre froide.
Enfin, il est important de noter que la souveraineté des États peut être menacée par des cyberattaques vers ou depuis l’espace. Les infrastructures terrestres sont concernées, tout comme les fréquences utilisées pour communiquer entre l’orbite et le sol et les satellites eux-mêmes.
La protection des infrastructures spatiales est donc absolument nécessaire pour conserver une réelle souveraineté en orbite comme sur Terre. En définitive, on peut dire que la souveraineté spatiale démarre sur Terre.
2. Une militarisation et une arsenalisation de l’espace
a. Un milieu incontournable pour les armées
i. Un milieu déjà perçu comme stratégique par les armées
L’utilisation de l’espace à des fins militaires n’est pas une chose nouvelle (). Elle n’a fait qu’augmenter depuis les premières transmissions d’images réalisées en 1960 par un satellite d’observation militaire américain. Les capacités spatiales sont mêmes devenues indispensables pour la veille stratégique et pour l’appui aux opérations militaires terrestres, aériennes et maritimes.
Si les articles 3 et 4 du traité de l’espace de 1967 précisent que l’usage de ce dernier doit se faire à des fins pacifiques, ils n’en interdisent pas pour autant les activités spatiales militaires. À l’article 4, les parties s’engagent seulement à ne pas mettre en orbite des armes de destruction massive et à ne pas militariser la Lune et les autres corps célestes.
Une distinction sémantique doit être faite entre la militarisation et l’arsenalisation de l’espace.
La militarisation concerne l’usage des moyens spatiaux dans un cadre militaire et a été pensée dès les débuts de la conquête spatiale. Pendant la guerre froide, les Américains et les Russes ont fait usage de satellites comme relais de communication militaire, de renseignement et de moyen de surveillance. Aujourd’hui, le développement des applications militaires dans l’espace comprend à la fois la surveillance de l’espace, l’observation (la constitution de données géographiques, le recueil de renseignements, l’appui aux opérations), l’écoute, les télécommunications, les systèmes spatiaux de positionnement-navigation-datation (en anglais positioning-navigation-timing, PNT), ainsi que des systèmes d’alerte anti-missile balistique et de détection d’explosion nucléaire.
L’arsenalisation de l’espace concerne le déploiement d’armes en orbite et est plus récente. Née pendant la guerre froide de la confrontation entre les deux blocs, elle a ensuite été mise en suspens avant de s’accroître à nouveau ces dernières années. Les moyens offensifs peuvent être classés ainsi : les capacités co-orbitales (Rendezvous and Proximity Operations – RPO), les capacités par ascension directe (la menace cinétique – Tir ASAT et ICBM), les armes à énergie dirigée (AED), les micro-ondes à haute intensité (High-power microwave - HPM), le laser ainsi que les moyens électroniques (brouilleurs de radiofréquence et cyberattaques).
Selon le général Mille, chef d’état-major de l’armée de l’Air et de l’Espace dans un article de presse publié en décembre 2021, « l’arsenalisation, qui correspond au développement de capacités militaires offensives et défensives espace/espace ou espace/terre s’est révélée lors du tir destructif d’un missile anti-satellitaire chinois en 2007 et a véritablement pris son essor au milieu des années 2010, à la faveur de la dégradation de l’environnement géostratégique mondial. » ()
ii. De nouvelles opportunités technologiques avec le New Space
La Stratégie spatiale de défense (SSD) française indique que les armées françaises « [devront] tirer parti des ruptures technologiques et d’usage du New Space. » ()
Les innovations issues du New Space couplées à l’évolution de l’« intelligence artificielle », décrites supra (partie I. A. 2.), repoussent les limites de l’utilisation traditionnelle du spatial. Le coût d’accès à l’espace a été réduit et les technologies sont devenues plus performantes, y compris en matière militaire. La SSD donne plusieurs exemples : « dans les prochaines années, le recours à des constellations de petits satellites permettra d’améliorer nos capacités militaires et notre résilience dans les domaines de l’observation, des télécommunications et de la surveillance spatiale. En aval, le traitement de la masse de données produites sera un enjeu majeur et seule son automatisation et le recours à l’intelligence artificielle permettront de tirer le meilleur parti des investissements consentis par le ministère au cours de la loi de programmation militaire (LPM). » ()
Le ministère des armées considère l’arrivée du New Space comme un complément bénéfique aux moyens déjà existants : il est ici question de « coexistence ». En effet, comme le précise la SSD : « Les usages et services que le New Space propose et promet doivent profiter aux armées, en complément des équipements détenus ou programmés. […] Il s’agit donc de capitaliser sur le meilleur de chaque approche, tout en préservant les exigences spécifiques du domaine militaire » ().
iii. Un théâtre des tensions internationales
Les sociétés et les armées sont devenues de plus en plus dépendantes des services spatiaux. Dans ce contexte, l’espace apparaît comme un lieu de compétition pour ses utilisations civiles et militaires, mais aussi pour le symbole qu’il représente en matière de souveraineté. Il peut alors participer à augmenter la conflictualité potentielle.
De plus, l’espace devient lui-même un lieu possible pour un conflit direct. La SSD () présente les différentes menaces qui peuvent peser sur les segments sol, les moyens de communication et spatiaux ou les parties logicielles associées () :
- les attaques cybernétiques, c’est-à-dire qui ciblent « les parties logicielles des différents segments des capacités spatiales » et peuvent parfois être irréversibles en rendant la charge utile voire le satellite entier inutilisable ;
- le brouillage électromagnétique qui « agit principalement sur les récepteurs de navigation (GPS/GALILEO) ou les récepteurs des communications satellitaires » ;
- le détournement des services en orbite, actuellement en développement pour apporter de nouveaux services spatiaux (réapprovisionnement en carburant, inspection, modification de la trajectoire, ajout de charges utiles, etc.). Détournés de leur objectif premier, ils pourraient « être utilisés en tant qu’effecteurs capables d’accoster, de s’amarrer, de capturer, de dégrader ou de déplacer un satellite » ;
- les menaces conventionnelles, c’est-à-dire « le sabotage, les actes malveillants sur les infrastructures terrestres [centres de contrôle au sol, radars, etc.] ou le ciblage des systèmes énergétiques ». L’objectif est de porter atteinte aux structures terrestres vitales pour mettre en péril les activités exo-atmosphériques ;
- les menaces cinétiques : « des capacités cinétiques antisatellites par missile depuis la surface ou les airs, ou par capacité co-orbitale ». Quatre puissances (États-Unis, Russie, Chine, Inde) ont montré qu’elles étaient en mesure de pouvoir réaliser des tirs balistiques pour atteindre et détruire des satellites en orbite. Le dernier tir antisatellite réalisé le 15 novembre 2021 est attribué à la Russie. La prolifération de débris spatiaux générée par ces tests inquiète très fortement les utilisateurs de l’orbite basse, et démontre que l’arsenalisation de l’espace est un sujet d’actualité et de préoccupation majeur pour les puissances spatiales.
Une sixième menace a été présentée aux rapporteurs par le Commandement de l’espace (CDE) en audition :
- les menaces à énergie dirigée de type laser ou micro-ondes à haute puissance (high-power microwaves, HPM) et les pulvérisateurs chimiques (chemical Sprayers) pouvant équiper des objets spatiaux actifs ou pouvant éventuellement être propulsés depuis la surface terrestre. L’objectif est d’aveugler, de brouiller et de perturber les senseurs et les capteurs.
De la destruction (missile antisatellite) à la neutralisation (brouillage de système de positionnement) ou au simple espionnage, les capacités des États ne cessent d’augmenter, dans un but défensif, mais aussi offensif.
Parmi les exemples les plus connus, figure le satellite de renseignement électromagnétique LUCH OLYMP (OLYMP-K) placé en orbite géostationnaire en 2014 par le ministère russe de la défense et par le service fédéral de sécurité (FSB). Le 7 septembre 2018, la ministre des armées Florence Parly a dénoncé la présence de ce satellite à proximité du satellite militaire franco-italien ATHENA-FIDUS (). Des activités similaires ont été observées sur les satellites américains INTELSAT 7, INTELSAT 905 et INTELSAT 901.
Au préalable, en 2017, d’autres satellites russes avaient déjà mené des activités suspectes en orbite basse : les satellites KOSMOS 2521 et KOSMOS 2523 avaient été expulsés d’un autre satellite, KOSMOS 2519. Ils ont ensuite réalisé des « manœuvres simulant une cible potentielle » avant de réintégrer le satellite dont ils avaient été propulsés ().
b. Une évolution de la doctrine et des moyens militaires déployés dans l’espace
i. Des doctrines militaires et des forces dédiées à l’espace
Conscients de l’importance du spatial en matière militaire, plusieurs pays ont développé des doctrines militaires spécifiques, et les ont accompagnées de forces dédiées. Les missions classées confidentielles réalisées par la navette américaine X-37 ont particulièrement inquiété Pékin et Moscou (). De même, les démonstrations chinoises et russes – dont des tirs antisatellites effectués en 2007 pour la Chine et en 2021 pour la Russie – encouragent elles aussi aujourd’hui l’escalade militaire.
La Russie a été la première puissance à prendre en compte les enjeux spatiaux dans sa doctrine militaire de 2010 (The Russian military doctrine), quasiment intégralement reprise en 2014. Officiellement, la Russie affirme considérer l’espace comme un domaine pacifique et s’oppose au développement et à l’utilisation d’armes dans l’espace. La tentative conjointe avec la Chine de soumettre un « traité sur la prévention du déploiement d’armes dans l’espace extra-atmosphérique, de la menace ou de l’emploi de la force contre des objets spatiaux » à la conférence des Nations unies sur le désarmement en atteste. Toutefois, les programmes et activités russes dans l’espace semblent prouver le contraire. Selon M. Jean-Jacques Ferrara rapporteur pour avis sur les crédits de la mission défense « préparation et emploi des forces : Air » du projet de loi de finances pour 2021 : « la Russie affiche ses intentions d’investir dans des dispositifs antisatellites co-orbital, avec une doctrine de réponse graduelle sur l’ensemble des tranches d’altitude, du sol aux satellites situés en orbite géostationnaire » ().
La réflexion du pays s’est accompagnée d’une restructuration des forces spatiales russes, qui a débuté en 2011. La dernière évolution date de 2015 avec la fusion de l’Armée de l’air russe (sigle VVS en russe) et de la Force aérospatiale de défense russe (VVKO) pour créer les Forces aérospatiales de défense russes (VKS). Cette branche de l’armée est divisée en trois services : l’armée de l’Air (VVS), la Force aérospatiale et la Force de défense antimissile (Aerospace and Missile Defense Force) et la Force spatiale (KV). Les missions de la Force spatiale russe sont la surveillance de l’espace, l’identification des menaces potentielles, la prévention des attaques depuis l’espace ainsi que la mise en orbite d’objets spatiaux civils et militaires.
De même, dès 2015, la Chine a publié un livre blanc intitulé La stratégie militaire de la Chine déclarant l’espace et le cyberespace comme très stratégiques, un constat repris ensuite dans le livre blanc La défense nationale de la Chine à l’ère nouvelle de 2019. L’organisation de l’Armée populaire de libération (APL) a aussi évolué en 2015 avec la création de la Force de soutien stratégique (FSS) qui fusionne deux domaines opérationnels : le spatial et le cyber.
Pour leur part, les États-Unis ont créé le 20 décembre 2019 la United States Space Force (USSF), soit le sixième corps de l’armée américaine. En août 2020, la Space Force a dévoilé sa première doctrine intitulée « La puissance spatiale – doctrine pour les forces spatiales » (Space Power – Doctrine for space forces) (), qui s’appuie sur des publications antérieures telles que la Joint Publication 3-14 Space Operations et la « Stratégie spatiale de défense » (Defense Space Strategy) du Pentagone, publiée en juin 2020 (). La doctrine spatiale américaine répond à trois objectifs : préserver la liberté d’action, permettre l’efficacité interarmées, et fournir des options indépendantes aux forces armées américaines. Elle décrit cinq compétences essentielles : la sécurité spatiale, la projection de puissance de combat, la mobilité et la logistique spatiales, la mobilité de l’information et la connaissance du domaine spatial.
Ces grandes puissances spatiales ne sont pas les seules à avoir mis en place des forces militaires dédiées à l’espace.
Le Royaume-Uni s’est doté d’une structure spécifique en avril 2021 (UK Space Command) et l’Allemagne en juillet 2021 (Weltraumkommando der Bundeswehr). Au mois de septembre 2021, pour accompagner la création de ces commandements militaires dédiés à l’espace, le Royaume-Uni a publié sa « Stratégie spatiale nationale » (National Space Strategy, NSS) et l’Allemagne « Les défis de la politique de sécurité dans l’espace : besoins d’action et recommandations pour l’Allemagne ».
En Italie, en 2019, le bureau général de l’espace (l’Ufficio Generale Spazio) a été créé et accompagné par la publication de la « Stratégie nationale de sécurité nationale pour l’espace ». Depuis juin 2020, un Commandement des opérations spatiales (Comando delle operazioni spaziali, COS) est opérationnel.
Pour sa part, la France, qui disposait depuis 2010 d’un Commandement interarmées de l’espace (CIE), s’est distinguée par un effort doctrinal particulièrement important depuis quatre ans (). La publication de la Revue stratégique de défense et de sécurité nationale en octobre 2017 a marqué un premier tournant en présentant l’espace extra-atmosphérique comme un milieu à part entière et comme une nouvelle zone de confrontation potentielle (). Le 13 juillet 2018, le président Emmanuel Macron a ensuite annoncé que l’espace représentait « un véritable enjeu de sécurité nationale » et demandé l’élaboration d’« une stratégie spatiale de défense » (). Le 25 juillet 2019, un an plus tard, le ministère des armées a donc publié la Stratégie spatiale de défense (SSD) à mettre en œuvre d’ici 2030. Florence Parly, la ministre des armées évoque en introduction « un nouveau front que nous devons défendre » (). Cette stratégie comprend une feuille de route comprenant quatre axes de travail : le renforcement de la doctrine spatiale française, l’adaptation de la gouvernance, le développement capacitaire et les ressources humaines.
|
La Stratégie spatiale de défense (SSD)
Le texte présente ensuite les deux objectifs de la France : répondre aux menaces dans de nouveaux contextes opérationnels en utilisant les cadres juridiques national et international, d’une part, et saisir les opportunités pour construire l’autonomie stratégique de la France, d’autre part. Ce dernier point nécessite selon le texte de « tirer parti des ruptures technologiques et d’usage du New Space », de « revisiter notre modèle industriel » et d’« élargir les coopérations au domaine des opérations dans l’espace », en l’ouvrant notamment à de nouveaux partenaires.
Enfin, pour réaliser ces objectifs, la SSD contient une feuille de route avec quatre axes majeurs :
- « affermir la doctrine spatiale de défense française » en l’articulant autour de quatre fonctions : le soutien aux capacités, la connaissance de la situation, l’appui aux opérations et l’action dans l’espace ;
- « adapter la gouvernance du spatial militaire aux ambitions » : modification de la chaîne de commandement avec la création d’un pilier spécifique à l’espace dans l’armée de l’air, regroupement des organismes du domaine spatial militaire, modification de la relation avec le CNES, utilisation de l’agence de l’innovation de défense ;
- « développer les capacités spatiales pour répondre aux ambitions » avec notamment une amélioration de la connaissance de l’environnement spatial (SSA), des mesures de protection actives et passives des satellites et l’acquisition d’« une véritable capacité d’action dans l’espace d’ici 2030 » ;
- « développer l’expertise spatiale dans la défense » en constituant un vivier d’experts et des parcours professionnels attractifs, grâce notamment à la création d’une académie de l’espace.
|
Pour servir cette stratégie, un Commandement de l’espace (CDE) a été annoncé par Emmanuel Macron le 13 juillet 2019 et créé le 3 septembre 2019. Le CDE est placé sous une double tutelle : sous l’autorité de l’armée de l’Air, qui est devenue « l’armée de l’Air et de l’Espace » pour les aspects organiques et sous l’autorité du chef d’état-major des armées (CEMA) pour les opérations et la politique spatiale. Il remplace le CIE, mais reste interarmées.
Les rapporteurs ont eu la chance de visiter le site de Balard et de pouvoir y auditionner plusieurs officiers, dont le général Friedling qui commande le CDE. Ils avaient également au préalable pris connaissance de l’avancée du transfert d’une grande partie des personnels du CDE à Toulouse (prévu en 2025), lors de la visite du site du Centre spatial toulousain.
|
Le Commandement de l’espace (CDE)
Le CDE a été créé le 3 septembre 2019. Il reçoit ses directives fonctionnelles (stratégie, coopérations, capacités) du chef d’état-major des armées (CEMA) et le chef d’état-major de l’armée de l’Air en exerce le commandement organique. Lorsqu’il mène des opérations spatiales militaires, il est placé sous l’autorité du CEMA et du Centre de planification et de conduite des opérations (CPCO).
Le CDE comprend une brigade aérienne des opérations spatiales (BAOS) qui a la charge de mettre en œuvre les opérations spatiales aériennes, une division coopérations européennes et internationales (DCEI), une division préparation de l’avenir (DPAV) qui participe à l’élaboration et à la mise en œuvre des stratégies d’acquisition des capacités spatiales, le bureau stratégie et politique spatiale et le bureau transformation qui suit et met en œuvre la montée en puissance du CDE. Les unités dépendant du CDE sont le Centre militaire d’observation par satellite (CMOS), le Centre opérationnel de surveillance militaire des objets spatiaux (COSMOS), le Centre de commandement et de contrôle des opérations spatiales (C3OS), le Laboratoire d’innovation spatiale (LISA) et l’Équipe de marque des programmes spatiaux (EMPS).
En 2021, le CDE rassemblait environ 290 personnes réparties sur quatre sites : Paris-Balard, Creil (CMOS), Lyon (COSMOS) et Toulouse. D’ici 2025, un centre opérationnel sera installé à Toulouse avec environ 350 effectifs sur les 470 que comprendra le CDE (). Il regroupera notamment les équipes du CMOS (120 personnes) et du COSMOS (35 personnes).
Avec une vocation interarmées, le CDE a notamment pour missions de contribuer aux travaux d’élaboration des plans d’opérations spatiales militaires conduits par l’état-major des armées ; de permettre une connaissance de la situation spatiale ; d’exercer le contrôle opérationnel des plateformes spatiales militaires ; de mettre en œuvre le centre de commandement et de contrôle des opérations spatiales.
|
En mars 2021, la France a mené le premier exercice militaire spatial de son histoire, dénommé « AsterX () », pendant une semaine. Cet exercice a consisté en la simulation d’une crise internationale, avec 18 scenarii différents (attaque sur un satellite français, débris spatiaux menaçant les populations civiles, brouillage des satellites de communication alliés par des adversaires, etc.) (). Un nouvel exercice AsterX sera mené au mois de mars 2022.
Enfin, en juillet 2021, la feuille de route « Maîtrise de l’Espace » a été présentée à la ministre des armées. La maîtrise de l’espace désigne alors l’ensemble des actions visant à conserver la liberté d’appréciation, d’accès et d’action dans ce milieu et à garantir le contrôle, la disponibilité, la sûreté et la sécurité des capacités nationales ou d’intérêt national pour préserver la fourniture des services spatiaux en appui des autorités gouvernementales et des opérations militaires. Elle couvre l’ensemble des capacités constitutives du système spatial militaire à l’horizon 2030-2040, c’est-à-dire l’ensemble des capacités spatiales accessibles au ministère quelles qu’en soient les modalités d’accès.
En parallèle, à la suite du tir ASAT russe du 15 novembre 2021, Josep Borell, le Haut représentant de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, a annoncé la publication prochaine d’une « nouvelle stratégie d’espace et de défense ».
ii. Une nouvelle ambition capacitaire
L’intérêt pour le spatial s’est traduit très concrètement dans la croissance des budgets dédiés à la défense spatiale depuis une décennie. Aux États-Unis par exemple, le Congrès a accordé 17,4 milliards de dollars de budget à la Space Force pour l’année 2022, soit une augmentation du budget de 13,1 % () par rapport à l’année 2021, alors même que le département de la défense (DoD) demandait une réduction de l’ensemble des effectifs de l’armée américaine pour l’année 2022. La Space Force verra quant à elle ses effectifs augmenter puisqu’ils passeront de 6 434 à 8 400 en 2022.
Pour la Chine, il est difficile de connaître le budget de défense précis alloué au spatial (). Toutefois, la très grande activité spatiale observée ne laisse pas de doute sur l’augmentation des moyens alloués.
En France la loi de programmation militaire (LPM) a alloué 3,6 milliards d’euros à la défense spatiale, puis 700 millions d’euros supplémentaires ont été ajoutés pour la mise en œuvre de la SSD.
Ces budgets ont permis de renforcer les capacités militaires. Celles-ci sont notamment visibles dans la carte ci-dessous. Des exemples seront ensuite donnés, même si de nombreux moyens sont classés secret-défense et ne peuvent donc pas être évalués précisément.
Les satellites militaires opérationnels en avril 2020

Source : Isabelle Sourbès-Verger ().
Les États-Unis, la Russie et la Chine ont tout d’abord développé des capacités militaires dans plusieurs domaines qui contribuent avant tout à la veille et à l’appui aux opérations :
- les systèmes spatiaux de PNT classiques duaux (GPS aux États-Unis, GLONASS en Russie et Beidou en Chine) et ceux dédiés aux forces militaires, des technologies qui permettent d’améliorer la connaissance du terrain, mais aussi une plus grande précision dans les interventions militaires. L’importance de ces systèmes PNT a conduit les États à créer des outils pour usurper, dégrader ou bloquer ceux de leurs adversaires ;
- les satellites de renseignement d’origine électromagnétique (ROEM) pour localiser, suivre et collecter des informations depuis l’espace. Les satellites américains NEMESIS, ORION et ELINT NOSS ont, par exemple, la charge du recueil de données électromagnétiques. Le satellite YAOGAN-32 serait aussi dévoué à cette tâche tout comme le LOTOS S1 russe ;
- les satellites de reconnaissance optique et de radars ISR (Intelligence (« renseignement »), Surveillance, and Reconnaissance) qui permettent d’appuyer les opérations terrestres. Les États-Unis disposent du KH-11, la Russie des BARS-M et la Chine du 3D ZY-3 ;
- les satellites de télécommunication militaire sécurisée. Les États-Unis ont développé le programme « Wideband Global SATCOM » et « MILSTAR » (Military Strategic and Tactical Relay), la Russie les satellites BLAGOVEST et la Chine aurait développé le SHEN TONG-2 ;
- les satellites d’alerte avancée pour détecter les tirs antisatellites (ASAT), de type missile balistique intercontinental (ICBM) et les explosions nucléaires. Les États-Unis disposent du programme « Defense Support Program » (DSP) prochainement remplacé par le « Space-Based Infrared System » (SBIRS), et la Russie des satellites TUNDRA. Des radars chinois prédestinés à la surveillance de l’espace sont dévolus à la détection de missiles balistiques ;
- la connaissance de la situation spatiale (SSA) qui repose sur des réseaux de radars et télescopes. La SSA permet d’établir un catalogue des objets spatiaux en orbite. La Russie dispose de capacités de connaissance de la situation spatiale très évoluées, juste derrière les États-Unis. Héritage de la guerre froide, ces capacités sont renouvelées depuis le début des années 2000. La Chine développe également rapidement des compétences dans le domaine.
Concernant l’Europe, la situation est particulière. À l’heure actuelle, il n’est pas possible de parler d’une puissance spatiale militaire, car l’Union européenne ne dispose pas en propre de moyens spatiaux militaires : elle dépend des financements et des stratégies de ses États membres. Plusieurs programmes spatiaux de l’Union européenne ou de l’ESA représentent toutefois un intérêt certain pour les armées : le système de PNT européen (Galileo), l’observation (Copernicus), la surveillance de l’espace (EU SST), le futur programme de télécommunications sécurisées (GOVSATCOM), les lanceurs européens (Ariane, Vega), etc.
|
Les moyens spatiaux français défensifs et d’appui aux opérations
– La loi de programmation militaire (LPM) 2019-2025 permettra à la France de disposer d’un programme de PNT autonome et souverain : le programme OMÉGA (opération de modernisation des équipements GNSS des armées). Si ce programme a débuté en 2018, il n’était pas encore opérationnel en 2021.
– Le programme Capacité de renseignement électromagnétique spatial (CERES) se compose de satellites de détection, de caractérisation et de localisation d’émissions électromagnétiques (radar et télécommunications). Trois satellites ont été lancés le 16 novembre 2021 pour la direction générale de l’armement (DGA). La LPM prévoit son remplacement par le programme de renseignements d’origine électromagnétique CELESTE en 2030.
– La France dispose aussi des satellites d’observation Hélios 2, qui seront progressivement remplacés dans le cadre du programme MUSIS par la constellation de trois satellites de composante spatiale optique (CSO) entre 2018 et 2022. Le programme IRIS remplacera les satellites CSO d’ici 2030.
– Le programme SYRACUSE IV (système de radiocommunication utilisant un satellite) est un système de télécommunication militaire dont le premier satellite, Syracuse 4a, a été mis en orbite le 24 octobre 2021. Les rapporteurs ont assisté à son lancement au CSG.
– Le système GRAVES (grand réseau adapté à la veille spatiale) permet de répertorier, détecter et suivre les objets spatiaux situés en orbite basse. Sa modernisation est une des priorités de la LPM. Son remplacement se fera entre 2023 et 2030. Le réseau de télescopes TAROT sera aussi modernisé durant cette période.
– Les radars SATAM qui permettent de trajectographier des objets d’importance stratégique élevée, seront également renouvelés.
Le remplacement des systèmes GRAVES et SATAM est prévu par programme ARES (action et résilience spatiale) qui a pour objectif de renforcer les capacités nationales dans les domaines de la surveillance spatiale (en consolidant la surveillance des orbites hautes), de la protection des actifs spatiaux et de préservation de la liberté d’action et d’accès à la zone extra-atmosphérique.
|
Pour un adversaire, les différentes capacités satellitaires évoquées supra représentent des cibles de choix puisqu’elles sont stratégiques pour les armées du pays attaqué, voire pour la société civile lorsqu’il s’agit de technologies duales. Leur arrêt, même momentané, pourrait déstabiliser voire paralyser l’ensemble de la chaîne de commandement, et mettre en péril la sécurité nationale du pays attaqué. Ainsi, pour protéger leurs actifs spatiaux et se préparer à l’éventualité d’un conflit dans l’espace extra-atmosphérique, les grandes puissances spatiales se sont équipées d’armes offensives potentiellement destructrices :
- les capacités par ascension directe c’est-à-dire les tirs antisatellites – tir ASAT et ICBM : les États-Unis (RIM-161), la Russie (PL-19 NUDOL), la Chine (DONG-NENG 3) et l’Inde (PDV MkII) ont acquis une maturité technologique suffisamment avancée pour détruire un satellite en orbite basse par l’intermédiaire d’un tir ASAT. Seules quatre puissances ont réalisé des tirs en orbite basse : les États-Unis en 1985 et en 2008, la Chine en 2007, la Russie en 2021 et l’Inde en 2019.
L’utilisation du tir ASAT comporte plusieurs limites. Il a tout d’abord un coût élevé (financier et en termes de débris spatiaux), est difficile à réaliser car toute cible en orbite est constamment en mouvement et ne peut pour l’instant atteindre que l’orbite basse. De plus, il ne peut attaquer qu’un satellite à la fois. Enfin, les systèmes d’alerte avancée peuvent détecter le départ du missile et le contrer par le biais des systèmes de défense anti-missile (de type ICBM). Dès lors, la puissance adverse peut identifier l’ennemi et répliquer rapidement ;
- les capacités co-orbitales (Rendezvous and Proximity Operations – RPO, Rendez-vous et opérations de proximité) c’est-à-dire des systèmes spatiaux capables de manœuvrer et d’interagir avec d’autres satellites, voire de les perturber ou de les détruire (y compris en ajoutant une charge explosive). Les États-Unis, la Chine et la Russie investissent massivement dans des projets de ce type ;
- les armes à énergie dirigée (AED), c’est-à-dire les micro-ondes à haute intensité (HPM) et le laser. Dès 2014, les États-Unis ont démontré leurs capacités à maîtriser la technologie laser en équipant l’US Navy de Laser Weapon System (LaWS). Par l’intermédiaire de son laser PERESVET, la Russie pourrait détruire des drones, aveugler des satellites et neutraliser des senseurs pour permettre des tirs ASAT. Enfin, malgré le manque de transparence de la Chine, de solides preuves attesteraient d’un effort de recherche dans les armes à énergie dirigée ;
- la guerre électronique, c’est-à-dire les brouilleurs de radiofréquence et les cyberattaques. Ce sont actuellement les moyens les plus utilisés par les puissances. Les États-Unis disposent par exemple du Counter Communications System Block 10,2, un système de contre-communication et la Russie du dispositif de brouillage R-330ZH qui permet de bloquer les communications et les transmissions GPS sur un rayon de 30 kilomètres.
La France développe des capacités de protection de ses intérêts dans l’espace, ce qu’elle qualifie de « défense active ». Elle se dote d’une capacité co-orbitale avec les deux satellites patrouilleurs YODA (yeux en orbite pour un démonstrateur agile) qui seront positionnés en orbite géostationnaire en 2023. Ils devront protéger les satellites français et alliés. Ils pourront être équipés de charge utile tels que des brouilleurs, des bras articulés, de l’armement à énergie dirigée. Une version améliorée de satellite patrouilleur sera mise en orbite en 2030.
La Russie et la Chine utilisent des moyens non cinétiques – qui sont moins facilement détectables, moins coûteux et souvent réversibles – mais aussi des moyens cinétiques, comme en attestent leurs tirs ASAT respectifs
Selon un rapport de la Secure World Foundation publié en 2021 (), les attaques les plus probables pourraient être de type électromagnétiques : brouillage de senseurs, éblouissement des capteurs par le biais d’attaques à énergie dirigée, piratage d’un terminal au sol (radars, centre de contrôle) afin de couper les liaisons entre les troupes et les actifs spatiaux.
Les moyens spatiaux militaires ou duaux des puissances spatiales sont résumés par le tableau suivant :
 Moyens militaires des puissances spatiales
Moyens militaires des puissances spatiales
Source : Secure World Foundation, 2021
3. À long terme : l’enjeu de l’exploitation des ressources spatiales
Si l’exploitation des ressources minières et de l’eau contenues dans les astéroïdes et la Lune pourrait avoir un grand potentiel économique à très long terme, il reste encore de nombreux défis à relever avant de l’envisager à grande échelle.
La prise de conscience de l’épuisement progressif des ressources terrestres de métaux et terres rares, l’anticipation de l’augmentation de leurs coûts, et leur aspect extrêmement sensible, voire stratégique pour certaines, rendent l’exploitation des ressources spatiales de plus en plus attractive. Des éléments comme le platine, l’or, le cobalt, le silicium ou le nickel, utilisés dans l’industrie, par exemple pour les microprocesseurs et les batteries, sont rares ou très difficiles d’accès, alors que la demande internationale augmente. De plus, leur exploitation terrestre est très polluante () et a des impacts négatifs sur le bien-être humain ().
Or, ces éléments rares et précieux se trouveraient en grandes quantités dans plusieurs centaines d’astéroïdes évoluant à proximité de la Terre appelés « astéroïdes géocroiseurs ». Les ressources contenues dans ces astéroïdes sont incomparables à celles des gisements terrestres : à titre d’exemple, les matériaux contenus dans l’astéroïde 3554 Amun représenteraient 20 000 milliards de dollars américains (). À très long terme, le potentiel économique de l’exploitation des ressources minérales des astéroïdes est donc immense.
En outre, l’exploitation de ressources spatiales pourrait contribuer au développement de nouvelles technologies sur Terre. Par exemple, des scientifiques estiment que l’utilisation d’Hélium-3, un isotope () d’hélium très rare sur Terre mais abondant sur la surface de la Lune, faciliterait grandement le développement de l’industrie de fusion nucléaire civile et donc procure l’espoir d’une source d’énergie électrique propre et presque infinie ().
Enfin, l’exploitation de l’eau contenue dans les corps célestes pourrait créer des « stations-service » spatiales qui fourniraient du carburant aux satellites, sondes et vaisseaux habités lancés en orbite ou dans le système solaire. En effet, l’eau est composée d’hydrogène et d’oxygène, les deux composants des carburants utilisés dans les moteurs spatiaux. Ainsi, en mettant en place des infrastructures capables de recueillir l’eau contenue dans les astéroïdes ou sur la Lune, puis de séparer ses molécules en oxygène et hydrogène, il serait possible de ravitailler les vaisseaux en carburant directement dans l’espace (). Les rapporteurs ont auditionné la société Air Liquide qui participe à plusieurs projets lunaires de ce type et dernièrement au projet EURO2MOON lancé par ADS. Il ne serait alors plus nécessaire de lancer en orbite le carburant nécessaire à l’ensemble d’une mission, ce qui réduirait le coût de lancement. À long terme, le déploiement d’une infrastructure de ravitaillement spatiale ouvrirait la voie à une exploration à plus large échelle du système solaire ().
Ces perspectives économiques et technologiques sont très attractives pour les industriels et les scientifiques, et la complexité technologique de ces missions exige pour les plus grandes puissances spatiales de s’y préparer dès maintenant. Néanmoins, l’exploitation des ressources spatiales se heurte à de nombreux défis d’ordre juridique, économique et même philosophique.
La première limite à l’exploitation commerciale des ressources spatiales concerne la propriété des corps célestes. Le Traité de l’espace, signé par l’ensemble des puissances spatiales en 1967, prévoit le principe de non-appropriation des corps célestes, mais laisse un vide juridique autour de l’exploitation des ressources tirées de ces objets. Les États choisissent alors leur interprétation du texte, voire l’imposent dans le cas des Accords Artemis (voir partie II. B. 2.a).
Les États-Unis ont unilatéralement résolu ce dilemme juridique dans le SPACE Act du 25 novembre 2015, en proclamant qu’un citoyen américain engagé dans l’exploitation commerciale d’une ressource spatiale a le droit de posséder, transporter, utiliser et vendre la ressource spatiale obtenue (). Le texte précise que ce principe est en accord avec le traité de l’espace, en déclarant que cette autorisation d’appropriation des ressources ne constitue pas une déclaration de la souveraineté des États-Unis sur un objet céleste (). Ainsi, les États-Unis – suivis par d’autres pays comme le Luxembourg en 2017, les Émirats arabes unis en 2019 ou le Japon en 2021 – ont proclamé dans leur législation nationale le droit à l’exploitation des ressources spatiales par des entités privées (). Ce droit a été renforcé par la signature des Accords Artemis par quinze pays (États-Unis, Royaume-Uni, Japon, Émirats arabes unis, Australie, Brésil, Canada, Israël, Italie, Luxembourg, Mexique, Nouvelle-Zélande, Ukraine, Pologne et Corée du Sud). Selon ces accords, l’appropriation des ressources d’un objet céleste ne contredit pas le principe de non-appropriation stipulé par le traité de l’espace. Pourtant, cette interprétation est en contradiction apparente avec l’esprit du traité de l’espace et ne fait pas l’unanimité parmi les puissances spatiales.
La France soutient une position intermédiaire : elle n’est pas fondamentalement opposée à l’exploitation des ressources spatiales mais elle souhaite que les négociations sur ce sujet se fassent au niveau de l’ONU. Ainsi, l’enjeu juridique de la propriété des ressources spatiales est encore âprement débattu, ce qui pose des limites légales sur l’exploitation de ces ressources au niveau international. Il est urgent de créer les conditions d’un débat international approfondi au plus haut niveau sur l’avenir du spatial, qui déterminera la manière dont l’humanité organisera ce nouveau territoire, et, à terme, l’exploitera.
Au-delà de ces contraintes juridiques se posent les questions de la faisabilité technique et de la viabilité économique de l’exploitation des ressources spatiales.
Les technologies nécessaires à l’extraction et au transport des ressources minières sur la Lune ou les astéroïdes sont encore au stade de concept, car les défis à relever sont nombreux. S’il est déjà possible de poser un satellite sur un astéroïde – comme l’ont fait la mission européenne Rosetta en 2014 et la mission japonaise Hayabusa-2 en 2018 –, l’exploitation commerciale des ressources spatiales nécessite de pouvoir freiner la rotation d’un astéroïde, de récolter ses ressources naturelles et de les envoyer sur Terre (). Les coûts de développement et de mise en œuvre d’un tel projet seraient immenses (). Ainsi, l’immense potentiel économique des ressources spatiales est conditionné au développement de technologies rendant leur exploitation viable d’un point de vue commercial. Or, l’état actuel des technologies ne le permet pas encore. Plusieurs entreprises cherchant à développer des solutions d’exploitation minière d’astéroïdes – par exemple Planetary Resources ou Deep Space Industry – ont fait faillite quelques années après leur création, faute de technologies suffisantes.
Enfin, l’exploitation des ressources spatiales pose un défi d’ordre philosophique : doit-on considérer l’espace comme un sanctuaire naturel à préserver ? On peut réaliser une comparaison avec la haute mer : parce qu’elle a longtemps été considérée comme disposant de ressources inépuisables, les textes internationaux n’établissaient aucune réglementation. La haute mer a donc subi des décennies de pêche intensive et de nombreuses ressources marines sont gravement menacées. Toutefois, des négociations sont actuellement en cours pour établir le premier traité international protégeant la biodiversité en haute mer (). Une dynamique similaire pourrait se mettre en place pour la préservation des ressources spatiales.
C. les dÉbris spatiaux, un risque majeur pour l’exploitation de L’ORBITE TERRESTRE
1. Plus de 300 millions de débris spatiaux en orbite
Le CNES répartit les objets spatiaux en trois catégories : les objets actifs manœuvrants (l’ISS, les satellites dotés de moteurs, etc.), les objets actifs non manœuvrants (sans propulsion) et les débris. Tout objet inactif en orbite est un débris spatial (ou « débris orbital »). Cette catégorie recouvre à la fois des objets encore « entiers » (morceaux de satellites ou satellites entiers, sangles, etc.) et des morceaux d’objets de toutes tailles.
Plusieurs événements peuvent provoquer des débris spatiaux :
- les lancements de satellites : d’une part, des débris peuvent être produits lors de la séparation des étages de lanceurs (boulons, vis, éclats de peinture, etc.), d’autre part, les étages supérieurs des lanceurs sont souvent abandonnés en orbite ;
- la dégradation naturelle des matériaux qui composent les satellites, notamment les peintures et les protections thermiques ;
- les explosions accidentelles de lanceurs et de satellites en orbite provoquées par des restes d’énergie (carburant, batterie) à bord de ces derniers ;
- l’absence de désorbitage des satellites en fin de vie, notamment pour les petits satellites sans propulsion ;
- les collisions (entre satellites, entre un satellite et un débris ou entre des débris), comme celle qui est intervenue en 2009 entre les satellites Iridium-33 et Kosmos-2251 et a créé plus de 1 400 débris de plus de 10 centimètres () ;
- l’utilisation de missiles antisatellites.
Le nombre de débris spatiaux créés par ces différents événements est difficile à évaluer avec précision, l’immense majorité des débris étant trop petits pour pouvoir être observés. Dans l’état actuel des technologies, on serait capable d’observer les objets de plus de cinq centimètres situés en orbite basse et ceux de plus d’un mètre situés en orbite géostationnaire ([107]). On estime qu’il y aurait, répartis sur toutes les orbites terrestres, environ 36 500 débris de plus de dix centimètres, 1 million de débris de plus d’un centimètre et 330 millions de débris de plus d’un millimètre (ESA, septembre 2021) (). La masse combinée des débris s’élève à environ 9 600 tonnes (ESA, septembre 2021) ().
Selon le dernier rapport annuel de l’ESA sur l’environnement spatial (ESA’s annual space environment report) publié au mois de mai 2021, les débris spatiaux se situent principalement sur les orbites terrestres les plus utilisées, soit l’orbite basse (en dessous de 2 000 kilomètres d’altitude) et l’orbite géostationnaire (36 000 kilomètres). En effet, 60 % des débris répertoriés se situent en orbite basse, 20 % en orbite géostationnaire et le reste dans les orbites intermédiaires, moins utilisées.
Or, même si les frottements avec l’atmosphère peuvent, à terme, faire retomber les débris situés en orbite basse sur la Terre, ce processus est souvent très long. Comme le démontre le graphique ci-dessous, il faut plus de cent ans pour qu’un débris situé à 800 kilomètres d’altitude, c’est-à-dire sur l’orbite la plus utilisée, retombe sur terre. À 1 000 kilomètres, plus de mille ans sont nécessaires.
 Temps moyen de retour naturel dans l’atmosphère d’un satellite
Temps moyen de retour naturel dans l’atmosphère d’un satellite
selon son orbite
Note : « years » signifie « années » ; « natural decay times » signifie « temps de retombée naturelle » ; « in orbit » signifie « en orbite » ; « re-entered » signifie « ayant effectué un retour dans l’atmosphère » ; « number of objects » signifie « nombre d’objets » ; « mean altitude » signifie « altitude moyenne ».
Source : Audition de M. Holger Krag, ESA.
2. Une augmentation exponentielle
Le lancement de la fusée soviétique R-7 Semiorka le 4 octobre 1957, plaçant le premier satellite Spoutnik en orbite, a inauguré le début de l’ère spatiale, mais aussi créé les premiers débris spatiaux puisque le dernier étage du lanceur et la coiffe conique sont restés en orbite après le lancement (). Depuis, le nombre de débris spatiaux a considérablement augmenté.
Les débris résultent tout d’abord des collisions entre les objets en orbite (notamment la collision entre les satellites Iridium-33 et Kosmos-2251 en 2009) et ce d’autant plus que la plupart des objets spatiaux sont situés en orbite basse, moins vaste que l’orbite géostationnaire. Ainsi, même si tous les lancements spatiaux étaient arrêtés, le nombre de débris spatiaux continuerait à augmenter automatiquement.
Cette hausse est aussi la conséquence de l’augmentation des activités spatiales, une tendance qui s’est accélérée avec les derniers projets de constellations de satellites placés sur l’orbite basse. De plus, la plupart des petits satellites envoyés en orbite basse sont aujourd’hui dépourvus de système de propulsion qui leur permettrait d’éviter une éventuelle collision ou de désorbiter en fin de mission.
Le graphique ci-dessous présente l’évolution du nombre d’objets par orbite. On remarque une augmentation constante mais relativement linéaire entre 1960 et 2007, suivie par une augmentation très rapide sur l’ensemble des orbites.
Évolution du nombre d’objets en orbite depuis 1957, par type d’orbite

Note : les sigles correspondent à l’orbite où se situent les débris : LEO : orbite basse ; MEO : orbite moyenne ; GEO : orbite géostationnaire ; HEO : orbites terrestres fortement excentrées ; MGO : orbites croisant les GEO et MEO ; LMO : orbites croisant les LEO et MEO ; GTO : orbite de transfert vers la GEO ; EGO : orbite géostationnaire excentrée ; NSO : orbite des satellites de navigation ; other : autres orbites.
Source : ESA’s annual space environment report, mai 2021.
Le graphique ci-dessous présente l’évolution de la masse d’objets en orbite depuis 1980. On remarque une augmentation forte mais relativement linéaire jusqu’au milieu des années 2000, suivie par une augmentation de plus en plus forte depuis.
 ÉVOLUTION DE LA MASSE D’OBJETS EN ORBITE DEPUIS 1980, PAR TYPE D’OBJET
ÉVOLUTION DE LA MASSE D’OBJETS EN ORBITE DEPUIS 1980, PAR TYPE D’OBJET
Note : les sigles correspondent au type d’objet dont sont issus les débris spatiaux. RM : objet lié à la mission du lanceur ; RD : débris de lanceur ; RF : débris issu de la fragmentation du lanceur ; RB : corps de lanceur ; PM : objet lié à ma mission de la charge utile ; PD : débris de charge utile ; PF : débris issu de la fragmentation de la charge utile ; PL : charge utile.
Source : ESA’s annual space environment report, mai 2021.
Enfin, les tirs antisatellites ont fait considérablement augmenter le nombre de débris en orbite depuis la fin de la décennie 2000. Le dernier en date est celui de la Russie, le 15 novembre 2021 (). Collectivement, ces tirs auraient produit plus de 10 000 débris en orbite.
3. Une menace pour la sécurité spatiale et terrestre
Les débris représentent une menace majeure pour la sécurité spatiale. Ils peuvent tout d’abord endommager un autre objet. En effet, leur énergie est extrêmement élevée : ils possèdent une vitesse de plus de 28 000 kilomètres par heure, quelle que soit leur masse. On estime ainsi que l’énergie d’une sphère d’aluminium d’un centimètre en orbite est équivalente à celle d’une voiture roulant à 130 kilomètres par heure sur Terre.
Ainsi, lorsqu’un débris percute un autre objet spatial, les conséquences sont souvent critiques. 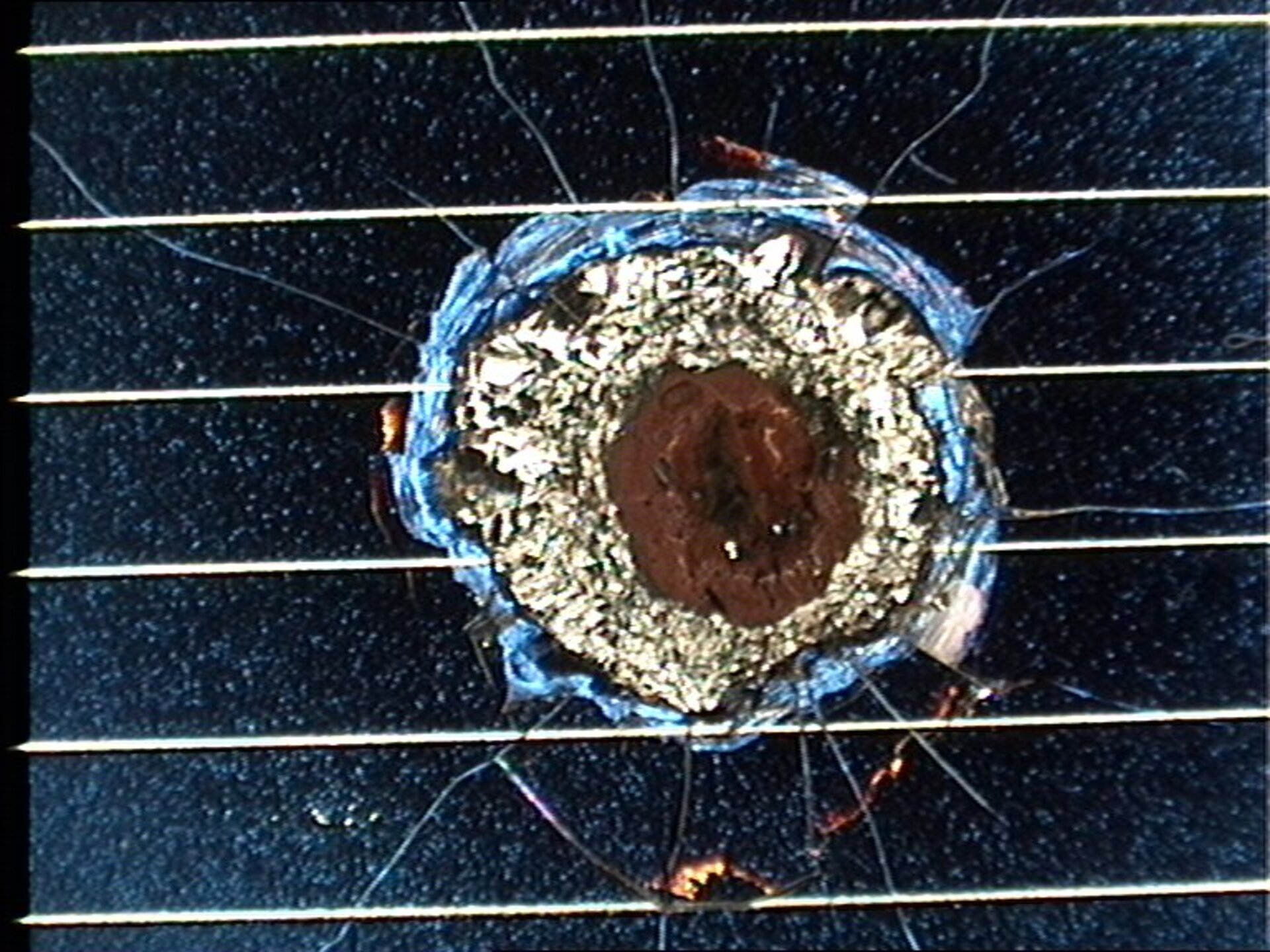 Un satellite peut par exemple devenir inutilisable parce qu’un de ses organes vitaux (réacteur, panneaux solaires, objectifs, radars, etc.) a été atteint par un débris, même petit.
Un satellite peut par exemple devenir inutilisable parce qu’un de ses organes vitaux (réacteur, panneaux solaires, objectifs, radars, etc.) a été atteint par un débris, même petit.
Les débris spatiaux pourraient menacer l’équipage et les infrastructures des stations spatiales. La Station spatiale internationale (ISS) est régulièrement touchée par de petits débris et sa trajectoire est de plus en plus souvent modifiée pour éviter de plus gros objets (). L’équipage est particulièrement vulnérable lorsqu’il réalise des travaux à l’extérieur de la station.
En limitant les activités spatiales, les débris spatiaux menacent aussi directement les activités terrestres qui en dépendent. Si un satellite devient inutilisable, ses opérateurs perdent des données précieuses, et le service rendu aux usagers s’arrête. Les activités civiles et militaires reposant sur les infrastructures spatiales, notamment dans le domaine de la communication et de la surveillance terrestre, sont donc particulièrement vulnérables.
Or, à terme, la multiplication des débris spatiaux risque de provoquer un phénomène de « collisions en cascades » qui rendrait l’exploitation de certaines orbites impossible. Cet effet a été popularisé sous le nom de syndrome de Kessler, du nom d’un des scientifiques de la NASA qui l’a théorisé en 1978.
|
Le syndrome de Kessler
Les scientifiques et consultants de la NASA Donald J. Kessler et Burton G. Cour-Palais () ont décrit en 1978 comment la multiplication des débris spatiaux pouvait créer une réaction en chaîne qui, à terme, rendrait certaines orbites inutilisables.
Le nombre de satellites en orbite augmentant, les chercheurs constatent que la probabilité de collision entre satellites croît également. La population de débris augmente donc en parallèle, car chaque collision entraîne la création de plusieurs débris. Or, la multiplication des débris spatiaux pourrait créer un effet de « collisions en cascade », où chaque collision en entraînerait d’autres.
Donald J. Kessler prédit ainsi l’existence d’un seuil de débris au-delà duquel les débris augmenteraient de manière exponentielle et finiraient par constituer une « ceinture » autour de la Terre sur certaines orbites. Ces orbites deviendraient inutilisables pendant plusieurs générations, le risque de collision étant trop élevé pour l’exploitation commerciale ou militaire.
Le syndrome de Kessler a été popularisé par le film Gravity d’Alfonso Cuarón, sorti en 2013.
|
Les orbites situées entre 800 et 1 400 kilomètres sont les plus à même de développer le syndrome de Kessler et de devenir inutilisables car elles concentrent le plus grand nombre d’objets spatiaux actifs et inactifs et ont une surface plus petite que les orbites plus élevées. L’humanité perdrait alors la capacité d’utiliser des infrastructures spatiales cruciales pour la recherche scientifique, les renseignements, les télécommunications, etc. situées sur ces orbites, mais aussi potentiellement pourrait perdre des capacités de lancement vers les orbites supérieures.
S’il est aujourd’hui impossible de savoir si le seuil critique de débris a été dépassé, il est certain que, sans action pour limiter la création de débris spatiaux, l’exploitation future de l’espace est en péril.
Enfin, dans une moindre mesure, les rentrées aléatoires des débris spatiaux dans l’atmosphère représentent aussi un risque pour la vie des populations au sol. En effet, bien que la plupart des débris qui atteignent l’atmosphère (vers 120 kilomètres d’altitude) soient vaporisés sous l’effet des températures très élevées et des frottements dus à l’entrée dans l’atmosphère qui les frappent, 10 à 20 % des débris retombent sur Terre (CNES, 2017). Néanmoins, dans la très grande majorité des cas, ils retombent dans l’océan ou dans des régions inhabitées, qui représentent 97 % de la surface terrestre. On recense à ce jour un seul incident, lorsqu’une Américaine a été touchée par un fragment de lanceur en 1997, sans conséquence.
4. Des technologies insuffisantes pour réduire l’impact des débris spatiaux
Deux méthodes sont aujourd’hui utilisées pour réduire l’impact des débris sur les infrastructures spatiales : le blindage et les manœuvres d’évitement.
Le blindage protège les modules vitaux d’un objet spatial des plus petits débris en leur ajoutant des couches de matériaux supplémentaires. Il pourrait être systématisé et amélioré pour mieux protéger les objets spatiaux, y compris pour les petits satellites.
Néanmoins, cette technologie n’est pas efficace pour les gros débris. Surtout, elle est difficile à développer et ajoute du poids lors du lancement, ce qui la rend très chère (). Dans ce contexte, le blindage est surtout utilisé pour les véhicules habités et pour les ravitailleurs de l’ISS.
Ainsi, les satellites et l’ISS utilisent un blindage alternatif, constitué d’une membrane de kevlar ou d’aluminium très fine située à une dizaine de centimètres de la paroi du satellite (). Cette membrane permet de dissiper l’impact sur une plus grande zone en vaporisant le débris avant qu’il n’atteigne la paroi du satellite à proprement parler. Cette technologie est efficace pour les débris de moins d’un centimètre. Néanmoins, elle est incapable d’arrêter les débris plus gros, car ils possèdent une énergie cinétique trop élevée.
L’évitement reste donc la méthode privilégiée pour les débris plus importants. Cette solution repose d’une part, sur une surveillance précise de l’espace, afin de connaître la position exacte des débris, et d’autre part, sur la manœuvrabilité des objets spatiaux pour éviter les collisions.
La surveillance de l’espace, effectuée au moyen de radars depuis la Terre est extrêmement complexe. Lorsque les radars au sol prédisent un risque de collision entre un débris et un satellite, une alerte est envoyée à l’opérateur du satellite. Celui-ci prend ensuite la décision de manœuvrer ou non son satellite, selon la probabilité d’impact mesurée. Les rapporteurs ont pu visiter le Centre d’orbitographie opérationnelle (COO) du CNES à Toulouse. Ce centre surveille en permanence les débris spatiaux pour permettre aux opérateurs de satellites d’éviter les collisions. Les rapporteurs ont également visité la salle de contrôle des satellites d’observation Pléiades Neo et AzALEO d’Airbus Defense and Space qui suit en permanence la trajectoire de ces satellites et la modifie si nécessaire.
Cette solution, bien qu’efficace, ne fonctionne que pour les débris que l’on peut surveiller depuis le sol. Or, les moyens de surveillance disponibles actuellement ne permettent pas de suivre les débris de moins de cinq centimètres, pourtant très nombreux.
De plus, seuls les satellites encore actifs et dotés d’un moyen de propulsion fonctionnel peuvent modifier leur trajectoire pour éviter un débris. Or, de nombreux satellites ne disposent pas de propulsion, notamment lorsqu’il s’agit de nanosatellites.
Enfin, l’évitement nécessite un partage d’information constant et fiable entre les opérateurs de satellites ainsi qu’une volonté commune d’éviter la collision. Or, en cas de risque de collision entre deux objets – et même si l’un des deux est un débris – il n’existe pas encore de code juridique international déterminant le responsable d’une éventuelle collision.
Ainsi, le 2 septembre 2019, ADM-Aeolus, un satellite météorologique de l’ESA, a dû manœuvrer pour éviter une collision avec un satellite de Starlink, après que l’entreprise SpaceX, propriétaire de ce dernier, a indiqué à l’ESA qu’elle ne comptait pas dévier son satellite. La responsabilité de la manœuvre a donc incombé à l’ESA, l’obligeant à utiliser du carburant, et donc à diminuer d’autant la durée de sa mission (). Cet épisode a choqué le milieu spatial du fait de l’intransigeance de SpaceX, et a démontré l’obsolescence du système de prévention des risques. Lorsque la probabilité d’une collision devient trop importante, l’opérateur de SSA (en l’occurrence, dans le cas d’ADM-Aeolus, l’armée américaine) prévient les deux propriétaires de satellites menacés, puis c’est par échange de messagerie électronique, entre opérateurs, que le sujet se règle et que chacun détermine ce qu’il devra faire avec son propre satellite.
Ces deux méthodes - le blindage et l’évitement – ne fonctionnent donc pas encore de manière optimale. Ces solutions sont complexes et coûtent cher. De plus, elles ne fonctionnent pas pour les débris de un à dix centimètres, trop gros pour le blindage des satellites mais trop petits pour être suivis depuis le sol et évités. Surtout, il n’existe pas encore de code juridique permettant de systématiser et de rationaliser ces mesures.
Plus fondamentalement, si ces techniques permettent d’atténuer les dommages sur les satellites et de diminuer le nombre de nouveaux débris potentiels créés, elles ne peuvent par nature pas réduire le stock de débris, un stock qui ne cesse par ailleurs d’augmenter. Une politique de retrait actif des débris existants (active debris removal, ou ADR), ou au moins des plus dangereux apparaît donc nécessaire. Selon l’ESA, il faudrait retirer entre six et huit gros débris par an afin de stabiliser la population de débris en orbite.
Il existe plusieurs projets de retrait actif des débris au niveau international. L’agence spatiale japonaise (JAXA) compte lancer le satellite ADRAS-J (Active Debris Removal by Astroscale-Japan) en 2023 afin de désorbiter un fragment de lanceur. Par ailleurs, la Chine a procédé au lancement d’un satellite dans le but de tester des « technologies de mitigation des débris spatiaux » le 24 octobre 2021. Ce satellite étant classifié, la communauté internationale ignore les technologies que la Chine utilise dans ce projet. Enfin, l’ESA finance le projet ADRIOS porté par la start-up suisse ClearSpace dont l’objectif est de désorbiter un morceau de lanceur Vega abandonné en 2013 et situé à une altitude entre 660 et 800 kilomètres. D’autres acteurs spatiaux comme les États-Unis ou la Russie ont également des projets en cours, mais ils semblent pour l’instant moins avancés que les projets japonais, européens et potentiellement chinois.
|
Le projet ADRIOS
Le projet Active Debris Removal – In Orbit Servicing (Suppression active des débris – maintenance en orbite, ou ADRIOS) a été lancé par l’ESA au conseil ministériel Space19+ de novembre 2019. Il s’agit d’un contrat de service de 86 millions d’euros passé avec un consortium avec plusieurs entreprises et institutions et dirigé par la start-up suisse ClearSpace.
Son objectif est le désorbitage d’un débris spatial appartenant à l’ESA à l’horizon 2025. L’ESA a choisi de désorbiter le « VESPA », l’étage supérieur d’une fusée Vega ayant décollé en 2013, dont la taille (2 mètres de diamètre) et le poids (112 kilogrammes) menacent les autres objets en orbite.
La technologie mise au point pour cette mission est celle d’un « satellite-éboueur », c’est-à-dire d’un satellite capable de s’approcher d’un débris spatial, de s’arrimer à lui avec des bras robotisés et de le faire redescendre dans l’atmosphère terrestre afin de le détruire.
|
Les différentes méthodes évoquées – le blindage, l’évitement, le retrait actif des débris – qui traitent les débris spatiaux déjà en orbite et les risques de collision, doivent encore être largement perfectionnées et renforcées, notamment parce qu’aujourd’hui, le retrait d’un seul débris est une opération nulle si l’étage du lanceur qui a servi à placer « le satellite éboueur » reste en orbite, comme c’est presque systématiquement le cas.
En parallèle, il est aussi indispensable d’éviter la création de nouveaux débris lors des lancements et au moment de la fin de vie des satellites. Le cadre juridique existant, présenté dans la partie II du rapport, est néanmoins lui aussi insuffisant.
Dans ce contexte, les débris constituent encore une menace majeure pour les activités spatiales. Le modèle actuel d’exploitation de l’espace ne semble pas soutenable.
II. une coopÉration limitÉe par certaines ambitions nationales
A. Une coopÉration internationale SINGULIÈre
1. Une coopération scientifique et technologique internationale très développée
a. Une multiplication des accords de coopération bilatérale
i. Les États-Unis
Les États-Unis ont su développer une coopération scientifique et technologique très riche au niveau international, qui renforce leur leadership. Leurs capacités de construction de satellites, de lancement ou encore de surveillance de l’espace, sont sans égales et intéressent de nombreux partenaires.
La NASA a développé un nombre très important de partenariats, présentés par la Mission pour la science et la technologie de l’ambassade de France aux États-Unis dans une note publiée le 7 juin 2021. Selon celle-ci, « au 1er janvier 2021, la NASA [entretenait] 672 coopérations (contre 713 au 1er janvier 2020) avec une très large palette de partenaires étrangers : 126 États et 6 organisations internationales (l’ESA, EUMETSAT, l’European Transonic Windtunnel GmbH (ETW), la Ligue Arabe, le Programme Nations Unies pour l’Environnement (PNUE) et l’Organisation Météorologique Internationale). » Parmi ces 672 accords, 367 sont qualifiés par la note de « spécifiques » et 303 de « génériques » ().
Les États impliqués dans une ou plusieurs coopérations avec la NASA sont présentés dans la carte ci-dessous. L’ESA et 16 États en entretiennent au moins 10. Ils représentent 68 % de l’ensemble des accords et sont colorés en jaune.
les États impliquÉs dans un ou plusieurs partenariats avec la nasa en 2021

Source : Mission pour la science et la technologie, ambassade de France aux États-Unis ().
Au début de l’année 2021, les partenaires qui disposaient du nombre le plus élevé d’accords avec la NASA étaient le Japon (72), la France (56), l’Allemagne (50), le Royaume-Uni (46), le Canada (34) et l’ESA (32). Les quatre principaux établissements impliqués étaient la JAXA (42), l’ESA (35), le CNES (25) et le DLR (23).
Sur les 56 accords passés par la NASA avec la France, 25 concernent le CNES, 31 des établissements de recherche et des universités, 6 le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), 3 l’Office National d’Études et de Recherches Aérospatiales (ONERA) et 1 le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA). Cette coopération franco-américaine porte surtout sur l’observation de la Terre (14 accords) et sur les sciences de l’Univers (27 accords dont 21 sur les études d’échantillons de poussières cosmiques, lunaires et de météorites tombées en Antarctique).
 thèmes des accords franco-américains
thèmes des accords franco-américains
Source : Mission pour la science et la technologie, ambassade de France aux États-Unis.
Parmi les partenariats avec l’ESA, il apparaît indispensable d’évoquer le James Webb Space Telescope (JWST). Les rapporteurs ont pu le voir au CSG deux mois avant son lancement sur Ariane 5, le 25 décembre 2021.
Le télescope spatial James Webb (JWST)
Le télescope spatial James Webb (JWST) a été lancé le 25 décembre 2021 par Ariane 5 au CSG. Il est le fruit d’une coopération entre la NASA, l’ESA et l’Agence spatiale canadienne (ASC) initiée en 2003 pour développer un successeur au télescope Hubble, mis en service en 1990. Une infographie de présentation du JWST et une infographie le comparant avec Hubble sont présentées en annexe n° 6.
Doté d’un budget total de 9,6 milliards de dollars (selon le NASA Financial Report de 2021), ce programme complexe et ambitieux a nécessité une grande coopération entre les scientifiques et les ingénieurs nord-américains et européens. En plus de fournir les infrastructures de lancement, l’ESA a notamment développé deux des quatre instruments de mesure du JWST et ses scientifiques sont impliqués dans l’ensemble des organes consultatifs du projet.
Le JWST embarque un télescope doté d’un miroir primaire de 6,5 mètres (soit plus de deux fois plus grand que celui du télescope Hubble) associé à quatre instruments de mesure conçus pour améliorer les capacités d’observation du télescope. L’ensemble de ces composants est protégé des radiations solaires pouvant fausser les mesures par un pare-soleil dépliable.
Le JWST sera placé au « point de Lagrange 2 » (), ce qui lui permettra d’effectuer des mesures sans être influencé par les fluctuations de température induites par des cycles orbitaux autour de la Terre.
En observant dans le spectre infrarouge, les instruments du JWST permettront aux scientifiques d’étudier, entre autres, les exoplanètes (), le cycle de vie des étoiles et la formation des premières structures complexes (étoiles, trous noirs et galaxies) dans l’univers primordial. L’objectif des observations réalisées par le JWST sera d’affiner le modèle cosmologique actuel et d’étudier la possibilité de vie extraterrestre sur les exoplanètes. Les données recueillies par le télescope seront accessibles aux scientifiques du monde entier.
Les opérations scientifiques menées via le JWST sont gérées par le Space Telescope Science Institute à Baltimore, dans le Maryland, qui est lui-même opéré par l’Association of Universities for Research in Astronomy. Cette instance regroupe toutes les demandes faites par la communauté scientifique des États en coopération sur ce projet, et sélectionne les projets sur lesquels le JWST sera amené à travailler ().
Chaque année de vie du JWST est appelée un « cycle » et les projets pour le « cycle 1 » ont été sélectionnés à la fin de l’année 2021.
Le JWST, lancé le 25 décembre, a réussi totalement à se déployer et a atteint son orbite à la fin du mois de janvier, mais il lui restera plusieurs mois de test et de calibrage avant son entrée en fonction, qui se fera à partir du mois de juin 2022.
Enfin, les Accords Artemis - rédigés par la NASA, le département d’État (Department of State ()) et le National Space Council - sont aujourd’hui devenus un outil majeur de la coopération spatiale américaine. S’il s’agit à proprement parler d’accords plurilatéraux, ils mettent en fait en œuvre un programme conçu par les Américains : le programme Artemis. Ils sont constitués d’un premier document qui rappelle des principes généraux (voir infra) (). Le 13 octobre 2020, huit pays les ont signés : l’Australie, le Canada, les Émirats arabes unis, l’Italie, le Luxembourg, le Royaume-Uni, le Japon et les États-Unis. Ils ont depuis été rejoints par le Brésil, la Corée du Sud, Israël, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, la Pologne et l’Ukraine. En novembre 2021, la France a annoncé son souhait de les signer. Initialement envisagée fin décembre 2021 en Guyane en marge du lancement du JWST, la cérémonie de signature a été reportée notamment en raison de la situation sanitaire. Elle pourrait être organisée au premier semestre 2022.
L’Agence spatiale européenne (ESA) est partenaire de plusieurs projets proposés par Artemis (notamment pour le Lunar Gateway) sans que chacun des États membres de l’ESA soit lui-même nécessairement signataire de ces accords.
Dans un document publié en 2020, la NASA indique : « Si la NASA dirige le programme Artemis, les partenariats internationaux joueront aussi un rôle clé dans le fait d’établir une présence durable et robuste sur la Lune tout en se préparant à mener une mission humaine historique sur Mars. (…) Les agences spatiales qui rejoignent la NASA dans le programme Artemis le feront en exécutant les accords bilatéraux Artemis. » () En effet, les Accords seront complétés par des accords bilatéraux pour mettre en œuvre des projets particuliers.
ii. La France
La France est elle aussi active à l’international. La coopération bilatérale se développe dans le cadre d’accords intergouvernementaux ou d’accords inter-agences ().
Si le CNES n’est pas le seul acteur français à mettre en œuvre des partenariats bilatéraux en matière spatiale – peuvent aussi être cités l’ONERA, le CNRS ou le CEA – il est de loin l’institution qui en entretient le plus, en tant qu’agence spatiale nationale. L’audition de M. Jean-Yves Le Gall, alors directeur du CNES, a été l’occasion de faire un point sur les accords internationaux du CNES.
Les partenariats internationaux du CNES prennent soit la forme de coopérations négociées avec d’autres agences dans un cadre bilatéral, soit celle d’un support à des consortia scientifiques qui soumettent des propositions à de grandes agences prescriptrices. L’ESA, EUMETSAT et la Communauté européenne sont alors des cadres naturels pour développer des missions inscrites dans des cadres programmatiques définis (Cosmic Vision, Earth Explorer, Copernicus…).
Mais, au-delà de l’Europe, le CNES entretient des relations avec 70 institutions publiques spatiales dans le monde entier. De 2015 à 2021, près de 159 accords ont été signés, et 120 accords étaient encore en vigueur au début de l’année 2021. Le schéma classique consiste en la signature d’un accord-cadre fixant les coopérations spatiales bilatérales avec l’agence spatiale du pays, suivi ensuite par la signature de différents arrangements de mise en œuvre sur des sujets spécifiques. Une partie de ces accords est également constituée de déclarations conjointes d’intérêts.
Les principaux partenaires du CNES sont les cinq grands acteurs spatiaux mondiaux : les États-Unis, le Japon, l’Inde, la Chine et la Russie. Ils représentent 60 % des accords entre 2018 et 2020 et se déclinent selon des axes différents : grandes missions très innovantes technologiquement avec les États-Unis, missions scientifiques d’étude du climat avec l’Inde et d’océanographique avec la Chine ; sciences, recherche et technologie ou lanceurs avec le Japon et la Russie. Les partenariats européens comptabilisent quant à eux 13 % des accords. Enfin, les nouveaux acteurs spatiaux en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie, occupent une place croissante (21 accords de 2015 à 2021). Le CNES coopère par exemple avec l’Afrique du Sud, les EAU, le Maroc et Singapour.
Ces accords ont un intérêt diplomatique certain tout en permettant de valoriser les compétences techniques et scientifiques de la France et d’assurer qu’elles suivent les dernières évolutions scientifiques. En outre, ils offrent parfois un effet de levier très important. Les rapporteurs ont eu l’opportunité de découvrir l’outil SuperCam placé à bord de la mission martienne Perseverance. La France a pu participer à cette mission avec une contribution de seulement 40 millions d’euros - alors que les États-Unis ont dépensé 2,4 milliards de dollars - et peut accéder aux résultats scientifiques de la mission.
La France est également à l’origine de la création de l’Observatoire spatial du climat (SCO, voir partie I. B. 1.).
iii. La Chine
La diplomatie spatiale chinoise s’est fortement développée depuis quelques années comme en témoigne la carte ci-dessous. Si la Chine ne peut pas coopérer avec les États-Unis, elle a su développer un nombre croissant de partenariats scientifiques et technologiques (construction de satellites, lancements), notamment en Asie, en Afrique et en Amérique latine.
Elle envisage par ailleurs sa station spatiale et son projet lunaire comme des outils de coopération internationale.
la diplomatie spatiale chinoise

Source : Isabelle Sourbès-Verger ().
Comme l’a expliqué Marc Julienne aux rapporteurs, la coopération internationale permet à la Chine de monter en gamme technologiquement en travaillant avec d’autres puissances spatiales – la Russie, l’Europe, la France, etc. – mais aussi de servir un objectif politique : présenter la Chine comme une puissance spatiale à l’initiative de coopérations. La Chine souhaite devenir un partenaire incontournable. De plus, ainsi que l’a rappelé Mme Isabelle Sourbès-Verger, puisque la Chine a été exclue de tout transfert de technologie américaine (voir partie II.A.1.c), elle est totalement autonome et libre de coopérer avec ses propres technologies avec tous les partenaires qui l’intéressent.
La Chine et la Russie ont signé récemment plusieurs accords de partenariat, dont un accord sur l’« alerte avancée » (détection d’un lancement de missile depuis l’espace) et un accord de coopération pour le développement d’une station internationale de recherche lunaire (International Lunar Research Station, ILRS), au mois de mars 2021 auquel l’ESA a annoncé s’intéresser. Au mois de juin 2021, ce dernier projet a été décliné en un plan.
iv. La Russie
La diplomatie spatiale russe, est traditionnellement très active, comme en atteste la carte ci-dessous sur la période 2015-2018. Pour l’Europe, elle se matérialise concrètement par la participation de la Russie à l’ISS ou encore par l’exploitation du lanceur Soyouz au CSG. Plus généralement, la Russie a réalisé de nombreux lancements européens et surtout américains.
la diplomatie spatiale RUSSE

Source : Isabelle Sourbès-Verger ()
La diplomatie spatiale russe est toutefois de plus en plus concurrencée, notamment par les États-Unis et par la Chine. Les prix et les capacités technologiques russes sont moins compétitifs que par le passé. De plus, les contrôles américains sur les transferts de haute technologie limitent certaines coopérations, notamment avec la Corée du Sud et le Japon, qui permettraient à la Russie de moderniser sa base industrielle ().
Consciente de ses faiblesses, la Russie se tourne aujourd’hui vers la Chine, avec un partenariat qui peut être vu comme complémentaire mais risque de se trouver assez rapidement déséquilibré compte tenu des différences d’ambitions respectives. Pour l’instant, les deux États ont un réel besoin d’échanges mutuels, notamment en termes de technologies, mais il existe un réel risque qu’à moyen terme, le partenariat ne soit déséquilibré en faveur de la Chine.
b. Des instances de coopération multilatérale depuis plus de soixante ans
La principale instance de coopération multilatérale sur le spatial est le Bureau des affaires spatiales (BAS) de l’Organisation des Nations unies (ONU), créé en 1958. Les rapporteurs ont pu auditionner Mme Simonetta di Pippo, sa directrice, qui le définit comme « le foyer du droit spatial passé, présent et futur » mais aussi comme « un intermédiaire et un fédérateur pour la communauté spatiale internationale ». Le BAS a en effet pour mission d’aider les États et la société civile à mettre en œuvre le droit onusien de l’espace et soutient des programmes qui permettent à des pays en développement d’accéder aux technologies spatiales. De plus, depuis 1962, il tient un registre des objets spatiaux lancés dans l’espace qui permet d’attribuer une responsabilité aux États concernés ().
Le Bureau des affaires spatiales (BAS) de l’ONU
Le BAS (United Nations Office for Outer Space Affairs, UNOOSA en anglais) fait partie de l’Office des Nations unies à Vienne (ONUV). Créé en 1958 pour assister le CUPEEA, son rôle s’est depuis élargi et il est devenu une entité autonome au sein du Secrétariat général des Nations unies en 2020 (circulaire ST/SGB/2020/1). Il rassemblait 95 États au début de l’année 2021.
En 2021, le BAS était doté d’un budget de 6,3 millions de dollars, dont 1,1 million provenant de ressources extrabudgétaires, et regroupait 35 personnes dont 23 agents permanents.
Le BAS comprend plusieurs entités :
– la Section des services au Comité et des affaires politiques et juridiques (CPLA en anglais), qui est chargée d’assurer le secrétariat du CUPEEA, d’organiser la réunion annuelle inter-agences UN-Space, et d’assister les États membres de l’ONU pour formuler et adopter des instruments internes en matière de droit spatial ;
– la Section des applications spatiales qui met en œuvre le Programme des applications techniques spatiales créé en 1968. Celui-ci propose des activités d’assistance et de coopération techniques aux États pour développer des capacités technologiques spatiales de base et pour tirer parti des applications spatiales pour atteindre les Objectifs de développement durable (ateliers de formation et séminaires avec le concours du pays hôte) et inclut des bourses et des programmes d’échanges universitaires ;
– le Programme des Nations unies pour l’exploitation de l’information d’origine spatiale aux fins de la gestion des catastrophes et des interventions d’urgence (UN-SPIDER), créé en 2006, qui organise sur sa thématique des séminaires et des missions de diagnostic et d’assistance pour les États intéressés. Ce programme comprend deux bureaux régionaux et est en grande partie financé par l’Allemagne, la Chine et l’Autriche. La France fournit et finance depuis octobre 2020 une « jeune experte associée » qui travaille également en parallèle sur l’Observatoire spatial du climat, que le BAS a rejoint ;
– le Comité international sur les systèmes mondiaux de navigation par satellite (ICG), créé en 2005 par les fournisseurs et utilisateurs de service de navigation, qui examine les questions techniques et opérationnelles relatives à la comptabilité et à l’interopérabilité des systèmes de navigation.
Le BAS travaille avec un large éventail d’acteurs : les gouvernements nationaux, les agences spatiales nationales et régionales, les autres entités onusiennes, les entreprises privées et la société civile.
Certains petits pays n’enregistrent pas le lancement de leur satellite auprès du BAS parce qu’ils n’en ont pas l’habitude et ne disposent parfois pas encore d’une agence spatiale. Compte tenu du nombre plus élevé de pays envoyant en orbite des objets spatiaux, le taux d’enregistrement des objets spatiaux a tendance à décroître. Le BAS a toutefois confirmé aux rapporteurs que les grands pays enregistrent leurs lancements, même s’ils prennent parfois quelques mois pour le faire.
Une des fonctions majeures du BAS est d’assurer le secrétariat du Comité des utilisations pacifiques de l’espace extra-atmosphériques (CUPEEA, Committee on the Peaceful Uses of Outer Space, COPUOS), qui se réunit annuellement. Le CUPEEA a été à l’origine de textes majeurs du droit de l’espace, dont les cinq grands traités (présentés infra), les résolutions sur les principes associés ou encore les lignes directrices sur la réduction des débris spatiaux (Space Debris Mitigation Guidelines) en 2007 et sur la soutenabilité à long terme des activités spatiales (Long-term Sustainability Guidelines) en 2019.
Le Comité des utilisations pacifiques de l’espace extra-atmosphériques (CUPEEA)
Le CUPEEA est un comité de l’ONU créé en 1958 en tant que comité ad hoc, devenu permanent en 1959. Depuis la fin de l’année 2021, il est composé de 100 membres.
Le CUPEEA se réunit chaque année, en juin, à Vienne, pour une session de dix jours, précédée par une session de chacun des deux sous-comités qui le composent : le « sous-comité scientifique et technique » (SCST – session de deux semaines en février) le « sous-comité juridique » (SCJ – réunion de deux semaines en avril) (). Chacun des deux sous-comités comprend lui-même plusieurs groupes de travail. Les présidences du Comité et des sous-comités durent deux ans et sont soumises à un principe de rotation entre les groupes régionaux.
Le CUPEEA exerce plusieurs missions :
– examiner la coopération internationale dans le domaine de l’espace extra-atmosphérique et discuter des questions d’actualité spatiale afin de s’assurer que le cadre juridique international de l’espace reste adapté aux besoins actuels et futurs ;
– contrôler le respect du cadre juridique international en matière spatiale ainsi que sa transposition dans le droit interne, et discuter des problèmes juridiques liés aux utilisations pacifique de l’espace extra-atmosphérique ;
– encourager la recherche et le partage de l’information concernant l’espace extra-atmosphérique.
Il transmet chaque année ses travaux à la Quatrième Commission de l’AGNU. Cette dernière se réunit à l’automne et adopte une résolution sur la coopération internationale en matière d’utilisations pacifiques de l’espace extra-atmosphérique.
Les décisions sont prises par consensus, ce qui donne un égal pouvoir de négociation à tous les États membres.
Les pays membres du CUPEEA étaient seulement 18 en 1958 () et 24 en 1959. Depuis, ce chiffre a régulièrement augmenté, avec une nette accélération depuis les années 2010. De nouveaux acteurs du spatial ont logiquement rejoint le CUPEEA, tels que la Tunisie en 2010, le Luxembourg en 2014, les EAU en 2015, la Nouvelle-Zélande en 2016 ou encore le Rwanda en 2019. Le CUPEEA compte désormais 100 membres ().
 Évolution de l’adhésion au CUPEEA de 1958 à 2020
Évolution de l’adhésion au CUPEEA de 1958 à 2020
Source : BAS.
En parallèle, la Première Commission de l’AGNU traite des questions de désarmement et de sécurité internationale, ce qui inclut les questions de militarisation de l’espace extra-atmosphérique. Cette Commission regroupe, entre autres, les travaux du Bureau des affaires de désarmement des Nations unies (UNODA), de la conférence du désarmement et de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA). Le 1er novembre 2021, la Première Commission a adopté cinq projets de résolution concernant la militarisation et l’arsenalisation de l’espace.
Ces textes doivent encore passer devant l’Assemblée générale des Nations unies puis devant le Conseil de sécurité avant de devenir des normes internationales. Il est intéressant de noter la ferme opposition de la France, du Royaume-Uni et des États-Unis au projet de résolution porté par la Chine et la Russie, intitulé Non-déploiement d’armes dans l’espace en premier. La France et ses alliés reprochent notamment au projet de résolution sa définition vague du concept d’« arme dans l’espace », qui selon son interprétation pouvait inclure l’ensemble des objets spatiaux. De la même manière, la Russie, l’Iran et la Chine se sont opposées à un projet de résolution porté par le Royaume-Uni et soutenu par l’Union européenne. Ces oppositions montrent que les rivalités géopolitiques influencent et parfois entravent les tentatives de coopération multilatérale et le pouvoir normatif de l’ONU sur les questions spatiales.
Le Comité inter-agences sur les débris spatiaux (IADC) est l’instance de coopération internationale la plus influente en termes de lutte contre les débris spatiaux. L’IADC est un forum international réunissant les treize plus grandes agences spatiales afin d’échanger des informations et faciliter la coopération sur les activités de recherche sur les débris spatiaux, d’examiner les progrès des activités de coopération en cours et d’identifier les options de réduction des débris. L’IADC n’a pas vocation à mettre en place des réglementations contraignantes mais propose des lignes directrices afin de réduire le nombre de débris en orbite.
D’autres comités tels que le Comité sur les satellites d’observation de la Terre (CEOS) et l’Organisation internationale de télécommunications par satellites (ITSO) doivent également être mentionnés en tant qu’instances de coopération multilatérale en matière spatiale.
En parallèle de ces institutions internationales directement liées au spatial, deux organisations sont aussi fondamentales pour appréhender les principales problématiques spatiales : l’Organisation internationale pour la standardisation (International Standard Organisation, ISO) et l’Union internationale des télécommunications (UIT). Elles travaillent en étroite collaboration afin d’établir légitimement des normes et des radiofréquences internationales.
L’Organisation internationale de normalisation (International Standard Organisation, ISO), une organisation non gouvernementale qui est représentée indirectement dans 165 États (), est partie prenante. Son comité technique ISO/TC 20 Aéronautique et espace tente d’établir des normes en matière spatiale.
L’UIT est quant à elle l’agence onusienne spécialisée dans les technologies de l’information et de la communication. Son secteur des radiocommunications (UIT-R) attribue les fréquences radioélectriques et des orbites de satellite et élabore les normes techniques qui assurent l’interconnexion des réseaux et des technologies.
Le secteur des radiocommunications de l’UIT (UIT-R)
Fondée en 1865 en vue de faciliter la connectivité internationale des réseaux de communication, l’UIT comprend désormais 193 États membres.
Le secteur des radiocommunications de l’UIT (UIT-R) traite plus spécifiquement de l’attribution internationale des fréquences radioélectriques et des orbites de satellite par la mise à jour d’un traité international, le Règlement des radiocommunications et le développement de normes techniques, les recommandations de l’UIT-R.
Le Règlement des radiocommunications et les normes édictées selon ce règlement ont pour objet d’organiser les demandes de chacun des acteurs et de respecter les équilibres entre chacun.
L’UIT n’est pas en relation directe avec un demandeur privé, ce sont les agences spatiales dédiées à cette tâche au sein des États membres qui font l’interface. L’UIT ne juge donc pas de la légitimité d’une demande : elle ne peut que vérifier le respect du cahier des charges présenté par un État membre, et indiquer si ce cahier des charges est contraire à une fréquence préalablement attribuée. Si la fréquence demandée est libre, l’UIT ne peut que l’attribuer. D’autre part, aucune sanction n’est prévue dans le cas où un acteur ne respecterait pas son engagement à utiliser la fréquence obtenue de l’UIT.
De ce fait, les fréquences, en tant que ressources naturelles limitées, mais fondamentales dans la gestion de l’infrastructure spatiale, sont attribuées uniquement en fonction de la demande, ce qui confère un très fort avantage à l’autorité qui demande en premier une fréquence. Or, le nombre d’objets connectés et de satellites en orbite augmentant de manière exponentielle, cette ressource se raréfie considérablement, ce qui renforce les tensions entre acteurs.
Les fréquences représentent donc un enjeu majeur en matière spatiale, même si cet enjeu est souvent méconnu du grand public. Il permet de comprendre la course de vitesse qui s’est engagée entre les acteurs des mégaconstellations afin d’occuper à la fois les orbites terrestres les plus pratiques, et d’utiliser les meilleures fréquences.
Le Comité mondial de la recherche spatiale (Committee on Space Research, COSPAR), dont le siège se situe à Paris dans les locaux du CNES et dont le directeur exécutif, M. Jean-Claude Worms, a pu être auditionné par les rapporteurs, est également un acteur important de la coopération multilatérale. Il joue le rôle de forum international pour promouvoir et débattre des questions liées à la recherche spatiale. Il fait également le lien avec l’ISO en apportant une expertise scientifique dans le cadre des débats entourant les réflexions et l’écriture des normes internationales.
Le Comité mondial de la recherche scientifique (COSPAR)
Créé en 1958 par le Conseil international des unions scientifiques (ICSU en anglais) (), il est la plus vieille des organisations scientifiques internationales consacrées uniquement à la recherche scientifique dans le domaine spatial. Il regroupe 45 pays membres, 13 unions scientifiques internationales () et plus de 11 000 associés (dont 600 associés français ou travaillant dans des organismes français), c’est-à-dire des scientifiques participant directement aux assemblées, symposiums, ateliers ou autres activités du COSPAR. Son budget est d’environ 1 million d’euros par an.
Le COSPAR traite des différents champs de la recherche spatiale à travers ses commissions scientifiques :
A. Surface, météorologie et climat terrestres,
B. Lune, planètes et petits corps du système solaire,
C. Hautes atmosphères de la Terre et des planètes,
D. Plasmas spatiaux du système solaire et magnétosphères planétaires,
E. Astrophysique depuis l’espace (étude des étoiles, des galaxies et de l’univers),
F. Sciences de la vie en relation avec l’espace,
G. Sciences des matériaux dans l’espace,
H. Physique fondamentale (lois de l’univers, structure et complexité).
En complément des commissions scientifiques, le COSPAR dispose de panels et de groupes de travail, permanents ou non, sur des thématiques situées à l’interface entre ces disciplines : dynamique des satellites, activités préjudiciables liées à l’utilisation de l’espace (débris, résidus chimiques des lancements, perturbations de l’environnement lunaire et martien par l’exploration), météorologie spatiale, protection planétaire, éducation et vulgarisation pour les écoles et le grand public, solutions innovantes, etc.
Un groupe de travail du COSPAR est également dédié à la mise en place d’une constellation COSPAR de petits satellites scientifiques, en commençant par l’étude de l’ionosphère (60 à 1 000 kilomètres d’altitude).
De même, la Fédération Internationale d’Astronautique (International Astronautical Federation, IAF), également basée à Paris, peut aussi être citée. Fondée en 1951, elle regroupait près de 407 membres de 71 pays différents en 2021. Elle organise notamment chaque année une grande conférence sur un sujet spatial (International Astronautical Congress). Elle est, elle aussi, composée de plusieurs commissions, administratives ou techniques. Parmi les commissions techniques figure par exemple une commission sur la gestion du trafic spatial (Space traffic management) depuis 2018.
L’IAF travaille en étroite collaboration avec d’autres institutions qui contribuent activement à la coopération internationale telles que l’Académie internationale d’astronautique (International Academy of Astronautics, IAA), basée en Suède, et l’Institut international de droit spatial (International Institute of Space Law, IISL).
Les différentes unions scientifiques internationales, dont l’Union géodésique et géophysique internationale (International Union of Geodesy and Geophysics, IUGG) ou l’Union astronomique internationale (International Astronomical Union, IAU), dont le siège est à Paris, jouent également un rôle important pour discuter des sujets spatiaux et définir des objectifs communs.
Enfin, des groupes informels d’États comme le G7 ou le G20 sont également devenus des lieux de discussion et de débat autour des enjeux spatiaux. Dans un communiqué commun publié le 13 juin 2021, les membres du G7 réunis à Carbis Bay au Royaume-Uni, ont ainsi déclaré « nous reconnaissons le danger croissant des débris spatiaux et la congestion croissante de l’orbite terrestre » et « nous convenons de renforcer nos efforts pour assurer l’utilisation durable de l’espace au profit et dans l’intérêt de tous les pays. Nous accueillons favorablement les Directives de durabilité à long terme des Nations unies et appelons les autres à se joindre à nous pour mettre en œuvre ces directives. » ()
c. Une coopération scientifique au service de la paix
i. Une coopération scientifique qui dépasse les tensions géopolitiques
L’histoire de l’exploitation et de l’exploration spatiale a été marquée par une tension permanente entre d’un côté, une vision stratégique et militaire, et de l’autre, une conception de l’espace comme vecteur de paix et de coopération entre les nations. Les premières étapes de la conquête spatiale étaient ainsi fermement inscrites dans une logique d’affrontement entre les deux superpuissances de la guerre froide : mis en orbite par des lanceurs dérivés de missiles intercontinentaux, eux-mêmes hérités des travaux menés par l’Allemagne nazie, les premiers satellites étaient avant tout des démonstrations de puissance.
Néanmoins, à la faveur de rapprochements diplomatiques entre les États-Unis et l’URSS, la vision de l’espace comme outil de coopération scientifique au service de la paix s’est imposée depuis les années 1960 (période dite de la « détente » entre les deux superpuissances).
Cette vision se retrouve très clairement dans les instances internationales gouvernant l’exploitation de l’espace. Ainsi, le Comité des utilisations pacifiques de l’espace extra-atmosphérique (CUPEEA) est créé par l’ONU dès 1958 avec, comme son nom l’indique, l’objectif de favoriser la coopération internationale pour les utilisations pacifiques de l’espace. Surtout, le traité de l’espace de 1967 stipule clairement que « tous les États parties au Traité utiliseront la Lune et les autres corps célestes exclusivement à des fins pacifiques ». L’ensemble des puissances spatiales ont accepté de collaborer afin d’utiliser l’espace à des fins pacifiques.
Selon M. Jean-Claude Worms, directeur exécutif du COSPAR, auditionné par les rapporteurs : « la raison d’être du COSPAR à sa création était d’offrir un cadre neutre au niveau politique aux scientifiques et, en particulier, de créer une tête de pont au moment de la Guerre froide, pour traiter de recherche spatiale et favoriser la coopération internationale. C’était donc une initiative d’acteurs de premier plan du spatial de l’époque, dont un bon nombre de Français, pour permettre aux chercheurs américains et soviétiques de pouvoir échanger dans un forum neutre sur les questions scientifiques. Ce rôle particulier a perduré jusqu’à la chute du mur de Berlin, et a ensuite dû évoluer pour englober la coopération entre toutes les nations ayant déjà, ou souhaitant développer, un accès à l’espace ». Le COSPAR a ainsi servi de plateforme favorisant la coopération scientifique internationale en matière spatiale, notamment en termes de recherche fondamentale.
Cette coopération est également apparente dans les programmes de vol habité et d’exploration spatiale depuis les années 1970. En 1975, une capsule Apollo et une capsule Soyouz se sont rencontrées en orbite (on évoquait alors un « rendez-vous » orbital), marquant un rapprochement historique entre l’URSS et les États-Unis. Cet événement n’a été rendu possible que par une grande coopération technique et opérationnelle entre Soviétiques et Américains, et a été largement relayé comme un message d’espoir et de paix entre les deux rivaux. Par ailleurs, de nombreux astronautes européens et américains ont été invités à séjourner dans la station spatiale Mir (« Paix » en russe) entre sa mise en service en 1986 et sa fin en 1999. La célèbre navette spatiale américaine a ainsi effectué plusieurs voyages vers Mir, soit une collaboration scientifique et technique unique entre les deux superpuissances.
Le projet de Station spatiale internationale (ISS) a également été un formidable vecteur de coopération scientifique internationale au service de la paix. Fruit de la collaboration entre l’ESA, la NASA, la JAXA, Roscosmos et l’Agence spatiale canadienne (ASC), l’ISS est la plus grande et la plus complexe structure jamais mise en orbite. Conçue pour accueillir jusqu’à sept personnes en même temps (), elle a hébergé des citoyens de dix nationalités différentes. Les passagers de l’ISS conduisent de nombreuses expériences scientifiques à visée pacifique. Le directeur technique de la NASA, David Miller, qualifiait en 2015 l’ISS d’« ONU spatiale » permettant aux scientifiques du monde entier de coopérer en dépit des différents conflits pouvant agiter la Terre.
Les recherches internationales autour des télescopes scientifiques, qu’ils soient spatiaux ou terrestres, sont également des exemples majeurs de coopération. Les organes scientifiques validant l’utilisation de Hubble, ou, demain, du JWST, pour un projet sont relativement éloignés des considérations géopolitiques. Les attributions sont faites par des scientifiques, pour faire avancer des domaines bien spécifiques de la science.
Fait remarquable, la coopération scientifique spatiale est en effet relativement peu affectée par les soubresauts géopolitiques mondiaux. La dimension pacifique de cette collaboration est probablement ce qui explique cette imperméabilité aux crises politiques internationales, ainsi que la dimension fondamentalement universelle de la recherche. L’espace est considéré par une majorité de scientifiques comme un sujet d’étude dépassant les rivalités nationales.
De plus, la méthode scientifique est par essence fondée sur la coopération et le partage de savoirs au-delà des frontières. En effet, la recherche n’est jamais isolée : un chercheur se base toujours sur les travaux de ses prédécesseurs, et ses théories et découvertes doivent toujours être validées par ses pairs afin d’être considérées comme valides. Ainsi, les colloques internationaux et les grandes revues scientifiques comme le Journal of Space science & Technology sont par nature des instruments de coopération internationale.
Enfin, le caractère exaltant de l’exploration spatiale ne doit pas être sous-estimé. Les conditions extrêmes auxquelles les missions spatiales font face sont autant de défis posés aux ingénieurs du monde entier. De plus, les missions spatiales ont contribué à apporter des réponses aux questions les plus fondamentales pour l’humanité : comment l’univers a-t-il été créé, d’où vient la vie, sommes-nous seuls dans l’univers, etc. Les réponses à ces questions sont si fondamentales qu’elles dépassent les différends entre les nations.
ii. Une limite : la marginalisation de la Chine
Néanmoins, la coopération scientifique internationale en matière spatiale est limitée par la marginalisation de la Chine, notamment du fait des États-Unis.
En avril 2011, le Congrès américain a voté l’« amendement Wolf » dans sa loi de finances. Cet amendement dispose qu’« aucun des fonds mis à disposition par [le Congrès] ne peut être utilisé par la NASA ou l’Office of Science and Technology Policy pour développer, concevoir, planifier, promulguer, mettre en œuvre ou exécuter une politique bilatérale, un programme, un ordre ou un contrat de quelque nature que ce soit afin de participer, collaborer ou exercer une action de coordination bilatérale de quelque manière que ce soit avec la Chine ou toute entreprise appartenant à la Chine, [sauf si une nouvelle loi n’autorise spécifiquement ces activités] » (). Si cet amendement n’interdit pas le partage de connaissances scientifiques, il interdit formellement leur application pratique dans le cadre de projets communs, sauf nouvel accord du Congrès, ce qui constitue une limite importante à la coopération scientifique avec la Chine ().
L’amendement Wolf ne fait qu’entériner légalement une politique de méfiance envers la Chine de la part des communautés scientifique et politique américaines. À titre d’exemple, l’agence spatiale chinoise (CNSA) est la seule des grandes agences spatiales à n’avoir pas participé à l’ISS.
De plus, les États-Unis ont une législation très stricte en matière d’exportation d’armes et de munitions (en anglais, International Traffic in Arms Regulations, ou ITAR). Ces règles ITAR s’appliquent aux technologies utilisées dans les lanceurs et satellites, et sont donc utilisées par les États-Unis pour restreindre les exportations de ces composants vers la Chine. Cela limite d’autant plus la coopération scientifique avec la Chine, car les ingénieurs et les scientifiques chinois n’ont qu’un accès très limité aux technologies américaines.
En dépit des règles ITAR et des réticences américaines, des agences spatiales comme le CNES ou Roscosmos continuent à développer des programmes de coopération scientifique avec la Chine. Néanmoins, la NASA étant tellement importante dans la coopération internationale, que la plupart des programmes de coopération sont, d’une manière ou d’une autre, liés à cet amendement Wolf et aux réglementations ITAR. C’est une des raisons qui expliquent que le nombre de programmes, par exemple de l’ESA ou du CNES avec la Chine, est relativement peu élevé.
2. Des formes de coopération militaire
La Stratégie spatiale de défense (SSD) préconise de travailler avec des partenaires « capables et volontaires », partageant une « vision commune des enjeux stratégiques du domaine » (). De fait, la France et ses alliés partagent une même analyse portant sur les risques liés à la militarisation et à l’arsenalisation de l’espace, décrits supra. Cette situation amène les partenaires à concevoir et à coordonner des actions conjointes (projets communs, échanges capacitaires).
La coopération s’établit tout d’abord dans un cadre bilatéral. La coopération franco-italienne a par exemple mené à la création du programme d’observation de la terre ORFEO (Optical and Radar Federated Earth Observation) pour un usage dual, civil et militaire. La composante optique (Pléiades) de ce programme est élaborée par le CNES tandis que l’Agence spatiale italienne (ASI) conçoit les radars (CosmoSkyMed). Dans le domaine strictement militaire, le programme HELIOS 2 (majoritairement français) vient compléter les infrastructures élaborées conjointement dans le cadre de l’observation de la terre. Dans le domaine des télécommunications spatiales, les projets Athena-FIDUS (satellite à usage dual) et SICRAL 2 (communication militaire sécurisée) respectivement lancés en février 2014 et en avril 2015 complètent les actifs spatiaux communs. Le traité du Quirinal signé le 26 novembre 2021 prévoit pour l’avenir un renforcement de la coopération franco-italienne : « Les parties renforcent leur coopération dans le domaine spatial en améliorant leur capacité à opérer conjointement dans l’espace à des fins de sécurité et de défense. Elles participent activement au développement d’une culture stratégique européenne dans ce domaine » (alinéa 5 de l’article 2 « sécurité et défense »).
La relation franco-allemande est avant tout basée sur l’observation et l’échange de données, même si elle se caractérise aussi par des échanges d’officiers entre les commandements de l’espace respectifs. La France partage ses données optiques par l’intermédiaire des satellites Helios (prochainement CSO) et l’Allemagne avec ses satellites radars SAR-Lupe (prochainement SARah). Toutefois, il faut noter que cette coopération n’a pas toujours été évidente. En novembre 2017, l’Allemagne a commandé deux satellites d’observation optique, en désaccord avec les accords de Schwerin, signés en 2002, qui partageaient les compétences de l’observation spatiale entre le développement de l’imagerie satellitaire optique pour la France et l’imagerie radar pour l’Allemagne afin d’éviter les doublons. Cela avait alors provoqué une crise diplomatique et le refroidissement de cette coopération.
Les deux pays continuent néanmoins à travailler ensemble. La coopération pourrait prochainement s’étendre dans les domaines de la surveillance (radars GRAVES pour la France et radars GESTRA pour l’Allemagne) et de l’observation. La mutualisation des actifs spatiaux et des ressources, notamment « autour d’un projet global de SSA européenne », pourrait amorcer cette dynamique.
La France multiplie aussi les coopérations spatiales militaires avec d’autres pays européens. La SSD prévoit à terme l’autonomie européenne et la création d’une industrie spatiale de défense européenne.
Au-delà de l’Europe, la coopération bilatérale passe également par un partenaire incontournable : les États-Unis. La France bénéficie des données recueillies par le système de surveillance de l’espace (SSA) américain Space Track. Elle a envoyé un officier d’échange au Space Command et recevra prochainement un officier américain au CDE. Cette relation s’est concrétisée le 13 février 2020 lorsque la France a intégré l’initiative Combined Space Operations (CSpO), regroupant les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, la Nouvelle-Zélande, l’Australie (les « Five Eyes ») et l’Allemagne. Ce forum multilatéral a pour objectif de garantir un usage « pacifique » et « responsable » de l’espace en renforçant la coopération et la coordination entre les sept nations. L’une des préoccupations de ce forum est la promotion de comportements responsables par la mise en place de normes, afin de préciser davantage certaines situations pouvant engendrer des malentendus, des escalades voire des conflits ().
Des coopérations ou des discussions bilatérales sont également en cours avec l’Australie, le Canada, les EAU, l’Inde et le Japon.
En renforçant leurs actifs spatiaux et leurs capacités à l’échelle nationale et collective, les nations développent et mutualisent leurs efforts pour faire face aux menaces, augmentant ainsi leur résilience. À terme, l’objectif est de conduire des opérations spatiales communes entre alliés (protection des intérêts spatiaux et nationaux, légitime défense dans le respect du droit international).
Afin de renforcer encore plus la coopération entre alliés et notamment l’interopérabilité entre la France et les États-Unis, l’OTAN a décidé d’implanter un nouveau centre d’excellence exclusivement dédié à l’espace à Toulouse, progressivement à partir de l’été 2021. Par ailleurs, dans le cadre du Memorandum of understanding CP 130 () signé en 2020, la France met à disposition ses actifs spatiaux (communications sécurisées) au service de l’OTAN ().
En parallèle, le traité de Lisbonne entré en vigueur en 2009 a fait de l’espace un domaine de compétence partagée entre l’UE et les États membres. À ce titre, la France participe à l’effort de défense par le biais de la coopération structurée permanente (CSP), dans les domaines des télécommunications, de radionavigation et de surveillance de l’espace. Toutefois, la coopération européenne spatiale est pour le moment limitée aux programmes « exclusivement civils » composés de « volets de sécurité » (COPERNICUS, GALILEO, EU SST et GOVSATCOM). De ce fait, les États membres développent leurs systèmes défensifs de façon autonome ou bilatérale. Dans ce contexte, la France souhaite inclure le volet spatial dans la politique de défense européenne.
Enfin, il est nécessaire de préciser que la convention constitutive de l’ESA ne lui permet pas pour le moment de développer des systèmes spatiaux dédiés à la défense.
B. Un Cadre juridique et une gouvernance contraints par les intérêts de certaines puissances
La compétition en matière spatiale ne s’exerce pas uniquement dans la course aux technologies, mais aussi dans la définition des normes qui encadrent les activités spatiales. Pourtant, le droit est plus que jamais indispensable pour assurer la durabilité de ces activités.
1. Des grands traités au « droit mou »
a. Les grands traités
i. Cinq traités conclus entre 1967 et 1979 structurent encore le droit de l’espace
Le droit spatial est récent. Si des travaux doctrinaux traitaient du droit international de l’espace extra-atmosphérique dès la première moitié du XXe siècle, ce sont les premiers lancements de satellites soviétiques et américains, respectivement en 1957 et en 1958, qui conduisirent les États à se pencher sur la conception de règles spécifiques. Leur intérêt universel apparu alors évident. Ainsi, ces règles furent élaborées dans le cadre onusien et non à travers des conférences interétatiques, comme cela pouvait être le cas pour d’autres sujets de droit international à l’époque. Elles bénéficièrent de la création du CUPEEA le 15 décembre 1958. Au final, seuls cinq grands textes définissent le droit international de l’espace extra-atmosphérique :
- le traité sur les principes régissant les activités des États en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes (dit « Traité de l’espace »), conclu le 27 janvier 1967 et entré en vigueur le 10 octobre 1967. Ce traité constitue en quelque sorte la « charte de l’espace », et reste encore aujourd’hui le traité le plus soutenu et le plus suivi par les puissances spatiales. C’est le traité qui est le plus consensuel. Il reprend la plupart des principes énoncés par la résolution adoptée le 13 décembre 1963 et a constitué un cadre général pour le développement du droit de l’espace. Il consacre le statut « d’envoyés de l’Humanité » des spationautes ;
- l’accord sur le sauvetage des spationautes, le retour des spationautes et la restitution des objets lancés dans l’espace extra-atmosphérique, conclu le 22 avril 1968 et entré en vigueur le 3 décembre 1968. Ce traité prévoit des mesures en cas de retombée d’objets spatiaux, habités ou non, sur Terre. Par ailleurs, il impose une obligation de secours et d’assistance aux spationautes dans l’espace extra-atmosphérique ;
- la convention sur la responsabilité internationale pour les dommages causés par des objets spatiaux (dite « convention sur la responsabilité »), conclue le 29 mars 1972 et entrée en vigueur le 1er septembre 1972. Elle impose aux États une forme de responsabilité internationale exorbitante par rapport au droit commun. Les États qui procèdent ou font procéder à un lancement, de même que ceux qui prêtent leur territoire ou leurs installations aux fins d’un lancement, sont solidairement tenus responsables du dommage qui pourrait être causé par l’objet spatial ou ses composants. Cette responsabilité est basée sur la faute lorsque le dommage est causé dans l’espace. Elle est absolue (sans faute) lorsque le dommage est causé à la surface de la Terre ou à un aéronef en vol ;
- la convention sur l’immatriculation des objets lancés dans l’espace extra-atmosphérique, conclue le 14 janvier 1975 et entrée en vigueur le 15 septembre 1976. Cette convention prévoit l’obligation pour l’État lançant un objet spatial d’immatriculer cet objet et de communiquer les informations relatives à son identification au secrétaire général des Nations unies. Un État conserve sous sa juridiction un objet immatriculé par lui ;
- l’accord régissant les activités des États sur la Lune et les autres corps célestes (dit « traité sur la Lune »), conclu le 18 décembre 1979 et entré en vigueur le 11 juillet 1984. Cet accord établit l’appartenance de la Lune et de tout corps céleste à l’intérieur du système solaire (excepté la Terre), et de leurs ressources naturelles, à la communauté internationale : ils « constituent le patrimoine commun de l’humanité ». « [Leur] surface et [leur] sous-sol ne peuvent être la propriété d’États, d’organisations internationales (…), d’organisations nationales (…) ou de personnes physiques. » (article 11) (). De plus, ils ne peuvent être utilisés qu’à des fins pacifiques (article 3).
Alors que les quatre premiers textes ont été signés par une centaine d’États, dont la totalité des puissances spatiales, l’accord de 1979 concernant la Lune n’a été signé que par vingt-deux États, dont dix-huit l’ont ratifié ou y ont adhéré après 1984 ([145]). La France est la seule puissance spatiale à avoir signé cet accord, mais elle ne l’a pas ratifié.
Ce cadre juridique, établi dans les années 1960 et 1970, a fixé plusieurs principes fondamentaux, encore en vigueur aujourd’hui :
- le principe de la liberté d’exploration et d’utilisation de l’espace (placement de satellites, accès à l’espace, recherche scientifique) qui se traduit notamment par un principe de liberté d’accès à l’espace pour les utilisations pacifiques (article 1 du traité de 1967) ;
- le principe de non-appropriation de l’espace et des corps célestes (article 2 du traité de 1967) qui ne contrevient pas au principe de maintien des droits de propriété privée sur les objets ou matériaux qui sont envoyés dans l’espace et sur les corps célestes (article 8) ;
- le principe de l’utilisation à des fins pacifiques de l’espace qui se déduit notamment de l’article 3 du traité de 1967 (conformité des activités spatiales au droit international dont la Charte des Nations unies « en vue de maintenir la paix et la sécurité internationales et de favoriser la coopération et la compréhension internationales ») et de l’article 4 qui prévoit une démilitarisation partielle de l’espace extra-atmosphérique (interdiction du placement d’armes de destruction massive dans l’espace et utilisation des corps célestes exclusivement à des fins pacifiques) ;
- un principe de responsabilité internationale qui se décompose entre un principe de responsabilité pesant sur les États des activités spatiales menées par eux ou leurs ressortissants impliquant une obligation d’autorisation et de surveillance continue de ces activités pour les États (article 6 du traité de 1967) et un principe de responsabilité pour dommage prévue par l’article 7 du traité de 1967 détaillé par la convention de 1972 mettant en place une responsabilité financière sans faute pour les États de lancement.
ii. Les autres sources du droit international
En complément des grands traités à vocation universelle, le droit international de l’espace se compose de plusieurs autres sources que l’on peut regrouper dans les catégories suivantes :
- des accords internationaux multilatéraux portant sur des programmes spécifiques tels que l’ accord intergouvernemental pour le développement et l’utilisation de la Station spatiale internationale (AIG ISS), conclu en 1988 et révisé en 1998 ;
- des accords bilatéraux entre États ou organisations internationales ;
- les traités fondateurs instituant des organisations internationales spécialisées ou actives dans le domaine des activités spatiales (convention constitutive de l’ESA de 1975 ; convention EUMETSAT ; constitution, convention et règlements de l’Union internationale des télécommunications, etc.) puis les accords régissant leur fonctionnement et leurs activités () ;
- le droit international général dans lequel s’inscrivent les traités relatifs à l’espace et qui peut par ailleurs s’appliquer dans l’espace extra-atmosphérique (principes généraux et Charte des Nations unies notamment).
Enfin, il convient de noter que les législations nationales, lorsqu’elles mettent en œuvre les dispositions des principaux traités de l’espace, peuvent être en partie considérées comme une source du droit international de l’espace.
b. Les dernières normes : du « droit mou »
Le droit international de l’espace ne passe toutefois plus aujourd’hui par de nouveaux grands traités internationaux contraignants. Les négociations à la CUPEEA et à la conférence du désarmement sont difficiles. Comme pour d’autres grands sujets du droit international, le multilatéralisme échoue face au retour de l’unilatéralisme. Il est toutefois important de noter que le multilatéralisme en matière spatial a toujours été très spécifique puisque seule une poignée d’États disposaient d’un véritable accès à l’espace lorsque le CUPEEA a été créé et les grands traités ratifiés.
Le droit international passe aujourd’hui surtout par de la soft law (ou droit mou ou souple, en français), c’est-à-dire par des règles ni obligatoires, ni contraignantes ; même si elles peuvent tout de même influencer les comportements.
Plusieurs résolutions de l’Assemblée générale des Nations unies (AGNU) sur le droit de l’espace, non contraignantes, ont été adoptées. Ces textes de droit dérivé jouent un rôle essentiel pour diffuser des principes et des pratiques, et pour normaliser la compréhension mondiale de certains aspects des traités. Plusieurs exemples peuvent être cités :
- les résolutions 1348 (XIII) adoptée le 12 décembre 1958 et 1472 A (XIV) adoptée en 1959 qui ont respectivement permis de créer le CUPEEA et d’en faire un organe permanent de l’ONU ;
- la résolution 1962 (XVIII) portant Déclaration des principes juridiques régissant les activités des États en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace extra-atmosphérique, adoptée le 13 décembre 1963. Il s’agit du texte à l’origine des principes consacrés quelques années plus tard par les traités internationaux ;
- la résolution 37/92 sur les Principes régissant l’utilisation par les États de satellites artificiels de la Terre aux fins de la télévision directe internationale, adoptée le 10 décembre 1982. Ces principes régissent les émissions de programmes de télévision qui peuvent être directement captés hors des frontières d’un État ;
- la résolution 41/65 sur les Principes sur la télédétection, adoptée le 3 décembre 1986. Ces principes s’appliquent aux activités d’observation active de la Terre, principalement à la détection de ressources naturelles ;
- la résolution 47/68 sur les Principes relatifs à l’utilisation de sources d’énergie nucléaire dans l’espace, adoptée le 14 décembre 1992. Ces principes édictent les précautions à prendre lors du lancement de sources d’énergie nucléaire dans l’espace ;
- la résolution 51/122 portant Déclaration sur la coopération internationale en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace au profit et dans l’intérêt de tous les États, compte tenu en particulier des besoins des pays en voie de développement, adoptée le 13 décembre 1996. Cette résolution présente un contenu plus politique. Elle réaffirme les principes fondamentaux du droit de l’espace ;
- la résolution 59/115 sur l’application de la notion d’État de lancement, adoptée le 10 décembre 2004. Cette résolution vise à harmoniser la mise en œuvre par les États de ce concept clé du droit de l’espace ;
- la résolution 62/101 portant recommandations visant à renforcer la pratique des États et des organisations internationales intergouvernementales concernant l’immatriculation des objets spatiaux, adoptée le 17 décembre 2007. Cette résolution vise à harmoniser et à rendre plus cohérentes les pratiques respectives des États en matière d’immatriculation d’objets spatiaux, conformément aux dispositions du Traité de l’Espace et de la Convention sur l’immatriculation de 1975 ;
- la résolution 68/74 portant recommandations sur les législations nationales relatives à l’exploration et l’utilisation pacifiques de l’espace extra-atmosphérique, adoptée le 11 décembre 2013. Cette résolution encourage les États à adopter des législations nationales qui transposent les traités internationaux et donnent des recommandations pour les mettre en œuvre.
D’autres textes non contraignants jouent également un rôle important. On peut à cet égard citer notamment les « lignes directrices » produites par le CUPEEA. Celles de 2019 portant sur la viabilité à long terme des activités spatiales (LTS guidelines) sont aujourd’hui une référence même si elles reconnaissent leur flexibilité. Elles ont pour but de « contribuer au développement de pratiques et de cadres de sécurité nationaux et internationaux pour la conduite des activités spatiales, tout en permettant une certaine souplesse dans l’adaptation de ces pratiques et cadres aux spécificités des pays » (). La résolution 74/82 de l’AGNU portant sur la coopération internationale touchant les utilisations pacifiques de l’espace adoptée le 13 décembre 2019 s’est ensuite « félicit[ée] de l’adoption par le Comité du préambule et des 21 lignes directrices aux fins de la viabilité à long terme des activités spatiales (…) [et a] not[é] que le Comité a encouragé les États et les organisations intergouvernementales internationales à prendre volontairement des mesures pour faire en sorte que ces lignes directrices soient appliquées dans toute la mesure possible et autant que faire se peut ».
De même, le COSPAR émet des recommandations en matière de protection planétaire (PP) c’est-à-dire sur les échanges biologiques impliqués par l’exploration du système solaire et son utilisation (), qui sont généralement suivies par les agences spatiales selon M. Jean-Claude Worms, le directeur exécutif du COSPAR auditionné par les rapporteurs. Selon lui, les normes proposées par le COSPAR pour la Lune sont considérées comme trop contraignantes par de nombreux acteurs et sont en train d’être assouplies.
Enfin, le comité technique ISO/TC 20, Aéronautique et espace, a élaboré de nombreuses normes internationales utilisées dans le cadre des objets et des véhicules spatiaux.
Ainsi ces textes qui composent un « droit mou » sont nécessaires : ils permettent de définir un référentiel commun, qui peut ensuite être décliné au niveau national. Toutefois, il ne peut pas, par nature, être suffisant : il doit être accompagné par des mesures plus contraignantes, défendues au plus haut niveau politique.
2. Un « dilemme du prisonnier » encouragé par certaines puissances spatiales
Le dilemme du prisonnier () caractérise une situation où l’on imagine deux personnes complices d’un même crime en interrogatoire, et où il leur est impossible de se parler. En l’absence d’information, les deux personnes finissent par se trahir mutuellement plutôt que de dire la vérité en espérant que l’autre fera de la même manière, car le coopérant a tout à perdre s’il joue franc jeu, tandis qu’il minimise individuellement sa perte s’il trahit l’autre. De ce fait, les deux se trahissent, créant le pire scénario pour eux, alors que deux réponses similaires maximiseraient leurs gains.
Cette métaphore traduit bien l’absence de confiance entre les acteurs internationaux du spatial et l’arrivée du risque d’un jeu « perdant-perdant », notamment avec l’épée de Damoclès des débris spatiaux en orbite basse.
a. Un impératif : réguler les nouvelles activités spatiales
Le droit international de l’espace se base sur un cadre juridique établi dans les premières décennies de l’ère spatiale. À l’époque, aucun satellite artificiel n’occupait l’espace. C’était principalement un lieu d’affrontement indirect entre les deux grandes puissances de la guerre froide, avec des technologies peu avancées. Or, la forte augmentation du nombre d’acteurs spatiaux – publics et privés –, la commercialisation croissante de l’espace et les profondes évolutions technologiques décrites dans la partie I de ce rapport présentent des questions pour lesquels les grands traités de l’espace et les premières résolutions de l’AGNU n’ont souvent aucune réponse, soit parce que la situation est nouvelle, soit parce qu’elle ne fait pas l’objet d’un consensus. Même si ces textes étaient ambitieux et se voulaient prospectifs il y a soixante ans, leur référentiel géopolitique et technologique est devenu obsolète. Par ailleurs, ces textes manquaient souvent de précisions. Ainsi, pour une question donnée, le cadre juridique est souvent inexistant, incertain, ou les deux. Clémentine Bories, professeure de droit public à l’université Toulouse Capitole parle ainsi de « trous noirs du droit international public » (). Les acteurs peuvent interpréter librement les silences ou les zones de flou de ce droit.
Parmi les domaines qui nécessiteraient un cadre juridique clair, le BAS de l’ONU a donné la liste suivante aux rapporteurs : « la réduction et l’élimination des débris spatiaux, la future présence humaine sur la Lune et potentiellement sur Mars, l’extraction de minéraux de la Lune et des astéroïdes, la protection planétaire, les moyens normalisés d’identification des satellites (similaires à ceux des navires et des avions), la connaissance fiable et accessible de la situation spatiale, la notification préalable au lancement en temps utile, la maintenance des satellites, des normes de sécurité communes pour les vols spatiaux habités et la prévention des hostilités actives. » Le manque d’encadrement des services en orbite pourrait également être ajouté à cette liste, tout comme le partage équitable des fréquences entre les opérateurs de satellites.
Les rapporteurs reviendront plus longuement sur les questions des débris spatiaux et des ressources spatiales.
L’augmentation très importante du nombre d’objets en orbite, notamment due à la mise en service de méga-constellations, présente un risque non négligeable de collision et de prolifération incontrôlée des débris spatiaux. Or, dans l’état actuel du droit international, tant que l’État d’origine de l’opérateur autorise le lancement, l’objet peut être mis en orbite et menacer les infrastructures spatiales des autres pays, y compris des installations critiques.
Comme présenté au chapitre C de la partie I du rapport, les débris spatiaux représentent une menace croissante. Leur prolifération augmente considérablement les risques de collision, mettant en danger les infrastructures spatiales et la vie des astronautes. À terme, on peut craindre une réaction en chaîne (syndrome de Kessler) qui rendrait certaines orbites inutilisables. Or, il n’existe pas à ce stade de réglementation internationale contraignante pour traiter ce sujet.
La responsabilité prévue dans les traités pourrait, avec une interprétation large, s’appliquer aux débris spatiaux. Par exemple, l’article 11 du Traité de l’espace dispose que « les États mèneront toutes leurs activités dans l’espace en tenant dûment compte des intérêts correspondants de tous les autres États partis au traité ». Si on considère que les débris spatiaux menacent les intérêts de l’ensemble des puissances spatiales, cet article pourrait s’appliquer aux débris spatiaux. Néanmoins, cette interprétation n’est pas universellement acceptée et ses termes restent flous. Cet article ne s’applique par ailleurs pas aux acteurs privés, donc reste limité dans son impact à l’ère du New Space. De la même manière, la « convention sur la responsabilité » de 1972 s’applique en théorie à la création de débris spatiaux. Toutefois, en cas de collision en orbite, il est nécessaire de prouver la faute d’un acteur afin de pouvoir appliquer les dispositions de ce traité (). Or, il est presque impossible de prouver qu’un acteur est responsable de la création de débris : la faute doit-elle incomber à l’opérateur, qui n’a pas su empêcher la collision ? Au fabricant du satellite, qui n’a pas inclus un système d’évitement des débris ? À l’État propriétaire de l’objet qui a créé le débris initial ? Aux autres institutions nationales qui n’ont pas pu fournir des données de SSA suffisamment précises ? Ces difficultés à prouver la faute limitent la portée de cette convention pour lutter contre la prolifération des débris spatiaux.
Enfin, le CUPEEA a adopté en 2007 les lignes directrices pour la réduction des débris spatiaux (Space Debris Mitigation Guidelines), écrites par le Comité inter-agences de coordination des débris spatiaux (IADC), suivies en 2019 par les lignes directrices pour la durabilité à long terme des activités spatiales (Guidelines for the Long-term Sustainability of Outer Space Activities). Néanmoins, ces lignes directrices n’étant pas contraignantes, les acteurs ne les respectant pas n’encourent aucune sanction.
De même, le cadre juridique encadrant l’exploitation des ressources spatiales n’est pas suffisamment clair. Le Traité de l’espace de 1967, impose le principe de non-appropriation des corps célestes. L’article 2 du traité dispose que « l’espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, ne peut faire l’objet d’appropriation nationale par proclamation de souveraineté, ni par voie d’utilisation ou d’occupation, ni par aucun autre moyen ». Si ce principe, repris également par le « traité sur la Lune » de 1979 (), est clair concernant l’appropriation souveraine d’un objet céleste, il laisse un vide juridique autour de l’exploitation des ressources tirées de ces objets. En effet, pour certains juristes, l’exploitation des ressources d’un objet céleste ne suppose pas nécessairement l’appropriation de l’objet en lui-même. D’autres juristes défendent l’opinion inverse, en se fondant sur la définition classique de la propriété : est propriétaire d’un objet celui qui en a l’usus, le fructus et l’abusus, ce qui inclut de fait l’appropriation de l’objet dont est issue la ressource. Dans ce contexte, les États choisissent leur interprétation du texte, voire imposent leur interprétation dans le cas des Accords Artemis (voir infra II.B.2.c).
Créer des normes encadrant l’exploitation des ressources spatiales demande de répondre à de grandes questions d’ordre à la fois économique et philosophique : doit-on considérer l’espace comme un bien commun ([153]) ? Quel cadre juridique imposer pour éviter un épuisement des ressources spatiales dans les décennies et siècles à venir, à mesure que leur exploitation augmentera ? Faut-il même en imposer un, étant donné que l’exploitation des ressources spatiales est peut-être nécessaire à l’exploration du système solaire et à la mise en place d’infrastructures sur la Lune et sur Mars ? Les réponses à ces questions doivent venir d’une discussion multilatérale entre les acteurs du spatial.
Ces exemples démontrent la nécessité d’établir des régulations voire des réglementations internationales pour les activités spatiales au XXIe siècle. Elles ne peuvent venir que de discussions multilatérales, même si celles-ci sont difficiles à réaliser dans un contexte international marqué par le retour de l’unilatéralisme et du bilatéralisme. De plus, certains États basent leur législation nationale sur leur intérêt à court terme, ce qui freine les efforts pour consolider le droit international de l’espace.
b. Des législations nationales centrées sur les intérêts nationaux à court terme
Le contexte international et juridique actuel favorise l’autoréglementation, souveraine (États) voire de la part des acteurs privés. Cette situation favorise de fait la loi du plus fort, celle de l’État ou de l’entreprise qui peut arriver en premier, ou qui peut déployer le plus de moyens pour parvenir à ses fins. C’est ce que de nombreux témoins appellent le « Far West » spatial.
L’article 6 du Traité de l’espace impose aux États la responsabilité de réguler les activités spatiales émergeant de leur sol. Ainsi, les États sont actuellement les seuls capables de réguler les nouvelles activités spatiales, ce qui contredit la notion d’espace comme bien commun de l’humanité et affaiblit le rôle des institutions multilatérales comme garantes de la pérennité de l’utilisation de l’espace.
Les États peuvent choisir d’établir des réglementations contraignantes. Pour les débris, ils peuvent par exemple mettre en place des normes de fabrication et des restrictions lors de l’obtention des licences de lancement. Mais d’un État à l’autre, les réglementations sont très inégales. La France s’est distinguée par son action dans le domaine avec la loi du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales (dite « LOS », n° 2008-518), suivie par un décret (n° 2009-643) et un arrêté du 31 mars 2011 dont la section 3 prévoit des règles de limitation des débris spatiaux et de prévention des risques de collision. Toutefois, ce cadre réglementaire apparaît encore insuffisant face au défi représenté par les débris spatiaux. Surtout, il ne concerne que la France. Les États-Unis, la Chine et la Russie, continuent à multiplier les lancements de satellites sans se préoccuper de la durabilité des activités spatiales.
Dans ce contexte, le secteur privé s’autorégule. Clémentine Bories décrit ainsi l’intervention des acteurs privés : « Des normativités privées pourraient venir enrichir le patchwork normatif. Lorsque l’entreprise américaine SpaceX fait part de son intention d’appliquer sur la planète Mars le droit de sa propre entreprise (« a set of self-governing principles »), elle prend acte des vides du droit international public actuel et propose un système auto-normateur qui rendrait certes sa complétude au droit, mais lui ferait perdre toute généralité. Dans l’ensemble, le développement de ces régulations complémentaires au système initial de droit international public étaye souvent utilement le droit de l’espace en faisant émerger des règles propres, adaptées à la volonté de leur(s) auteur(s), mais fait courir à la réglementation de l’espace un risque : celui du développement d’une constellation d’acteurs et de règles non articulées. Plus qu’un droit à la carte, un bric-à-brac pourrait se mettre en place au détriment de la construction d’un système juridique cohérent applicable aux corps célestes. » ()
Cette réflexion est très importante chez les acteurs du spatial américain. L’idée d’autorégulation est forte, d’une part du fait d’une culture politique et économique libérale très implantée, mais également parce que dans l’état actuel des choses, la moitié des satellites est américaine. Donc une régulation internationale signifierait en fait une régulation qui s’appliquerait majoritairement aux satellites américains, ce qui n’est pas envisageable pour eux.
Par conséquent, les États-Unis tentent depuis 2020, d’établir un droit international qu’ils maîtriseraient totalement dans le cadre d’accord contraignants. Cette nouveauté juridique est celle des Accords Artemis.
c. Les Accords Artemis : une redéfinition du droit international
Les Accords Artemis sont composés d’un document principal, signé par les États, dont le sous-titre est « les principes pour la coopération dans l’exploration civile et l’utilisation de la Lune, de Mars, des comètes et des astéroïdes pour des usages pacifiques ()». De fait, ils précisent les différents principes auxquels doivent se soumettre les parties (), avec souvent des références à des sources de droit multilatérales préexistantes.
Toutefois, ces accords choisissent en fait une interprétation très américaine du droit international en vigueur. À la section 10, le texte évoque notamment le traité de l’espace de 1967, ratifié par de nombreux pays dont les dont les États-Unis, mais prévoit « l’extraction et l’utilisation des ressources spatiales, y compris toute récupération à la surface ou au sous-sol de la Lune, de Mars, des comètes ou des astéroïdes », en estimant qu’elle peut « servir l’humanité en fournissant un soutien critique pour la sécurité et la durabilité des opérations ». Surtout, les « signataires affirment que l’extraction ne constitue pas en elle-même une appropriation au sens de l’article 2 du traité de l’espace () ».
Or, malgré cette affirmation, certains juristes considèrent que les Accords Artemis entrent bien en contradiction avec l’esprit initial de ce traité, tout comme ils entrent en contraction avec le traité sur la Lune et les autres corps célestes de 1979 (article 11) (). Ces traités prévoient en effet tous deux un principe de non-appropriation : la Lune et les autres corps célestes n’appartiennent à personne et ne peuvent donc pas faire l’objet d’un droit de propriété. Ils appartiennent à l’humanité toute entière (res communis).
Ainsi, selon une certaine interprétation stricte du traité de 1967, comme cela a déjà été évoqué supra (voir II. B. 2. a.), l’exploitation des ressources de ces corps célestes n’est pas possible sans décision commune puis redistribution des bénéfices à toute l’humanité. Pour d’autres, elle n’est pas directement précisée, ce qui laisse un espace de liberté. Le cadre juridique portant sur l’exploitation des ressources des corps célestes ne serait pas nécessairement aligné sur celui des corps célestes eux-mêmes.
Dans tous les cas, la situation peut être résumée par les mots de Clémentine Bories : « [les accords Artemis] vont à l’encontre la tradition multilatérale spatiale, et accentuent un tournant résolument plurilatéral derrière lequel d’aucuns verront surtout poindre un impérialisme déguisé, et dans lequel d’autres verront une technique de modification et d’évolution forcée des normes internationales reposant sur la création de précédents » ().
La Chine et la Russie se sont ainsi opposées publiquement à ces accords, même si cette position n’est peut-être définitive dans le cas de la Russie. De plus, la Chine et la Russie ont signé un traité de coopération visant à développer une station internationale de recherche lunaire (cf. supra, II.A.1.a.iv).
La France était jusqu’ici partagée entre une approche légaliste qui respecterait strictement le droit international, et son intérêt à être associée aux accords. Elle semble désormais s’orienter vers la seconde option. En effet, lors de sa venue en France le 11 novembre 2021, la vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris, a indiqué à la presse américaine que la France souhaitait rejoindre les Accords Artemis.
III. un soutien politique et économique encore insuffisant en EUrope face aux enjeux
Le spatial européen est aujourd’hui à un tournant de son histoire. Si les acteurs européens ne parviennent pas à se réunir pour innover davantage, leur dépendance envers les moyens spatiaux étrangers – notamment américains – continuera à s’accroître.
La France reste très impliquée sur la thématique, mais doit désormais convaincre les autres pays européens de suivre sa voie. Or, on constate encore un manque d’unité malgré plusieurs initiatives volontaristes, dont une réforme des institutions européennes en cours et un projet de constellation européenne.
A. une indÉpendance spatiale européenne menacée
L’Europe est autonome à de nombreux égards en matière spatiale : elle construit ses propres satellites et ses propres lanceurs, dispose d’un port spatial mondialement reconnu, propose des formations de haut niveau à ses ingénieurs, etc. Néanmoins, elle ne parvient pas encore à suivre le rythme imposé par les puissances américaine et chinoise.
1. Une industrie européenne compétente mais très concurrencée
Le New Space se caractérise par une accélération historique des cycles d’innovation, favorisée par des financements publics et privés très importants. Or, si les acteurs européens du spatial ont toujours su innover – comme en témoignent par exemple les parts de marché dans le monde des constructeurs de satellites de télécommunications européens (plus de 50 %) – ils manquent aujourd’hui de rapidité et se font de plus en plus distancer par les nouveaux acteurs cités supra (SpaceX, Blue Origin, etc.).
Les rapporteurs s’intéresseront plus spécifiquement à deux domaines : les lanceurs européens et l’enseignement supérieur.
a. Les lanceurs européens : innover pour survivre
Depuis les années 1970, le programme Ariane s’est caractérisé par des évolutions technologiques constantes. Le projet Ariane 6, décidé en 2014 et dont le premier lancement est prévu au second semestre de l’année 2022, le démontre à nouveau. Les méthodes de fabrication ont été simplifiées et les performances techniques augmentées. Les coûts de production ont été diminués de 40 %.
Néanmoins, les innovations proposées restent encore insuffisantes face aux technologies américaines, favorisées par des investissements et des contrats publics conséquents. Ainsi, si le programme Ariane 6 doit être soutenu par les puissances européennes pour garantir un accès autonome à l’espace, une nouvelle génération de lanceurs Ariane, plus performante (projet Ariane Next), doit aussi être lancée très rapidement et soutenue par des investissements européens conséquents.
Le programme Ariane 6
Le programme Ariane 6 a été décidé lors de la conférence ministérielle de l’ESA de décembre 2014 pour produire un lanceur flexible et abordable, mieux adapté aux nouvelles contraintes du marché des lancements. Piloté par ArianeGroup, il implique plus de 600 entreprises européennes, implantées dans treize pays. Son vol de qualification inaugural devrait avoir lieu au second semestre 2022. Plus d’une dizaine de lancements ont été commandés (chiffre de janvier 2022).
Ariane 6 est un lanceur de moyenne à forte puissance qui se déclinera en deux versions offrant une large variété de missions :
– Ariane 62, une version plus légère dotée de 2 boosters et qui pourra placer une charge utile de 10,3 tonnes en orbite basse, 6,6 tonnes en orbite héliosynchrone et 4,6 à 5 tonnes en orbite géostationnaire. Ariane 62 pourra alors remplacer le lanceur russe Soyouz au CSG ;
– Ariane 64, une version plus lourde dotée de 4 boosters qui pourra placer des charges utiles de 20,6 tonnes en orbite basse et 11,5 tonnes en orbite géostationnaire. Ariane 64, se place dans la succession d’Ariane 5 en permettant l’envoi de nombreux satellites en orbite basse pour de grandes constellations comme l’emport classique de deux satellites de télécommunication en orbite de transfert géostationnaire.
Les deux versions du lanceur proposent des solutions techniques innovantes, dont le moteur Vinci réallumable placé à l’étage supérieur et offrant une mise sur orbite plus précise, de nouveaux boosters (P120C), une construction à base de matériaux composites réduisant le poids total du lanceur ou encore la construction à l’horizontale qui permet de gagner en efficacité lors de la préparation au lancement. Ariane 6 décollera depuis le nouveau pas de tir du Centre Spatial Guyanais, ELA4, construit spécifiquement pour l’occasion. Les rapporteurs ont pu le visiter.
Malgré ces innovations importantes et une réduction des coûts de production estimée à 40 %, les prix proposés par Ariane 6 et la cadence de lancement resteront moins compétitifs que ceux de SpaceX, qui a pu baisser ses coûts grâce à son lanceur réutilisable, à son organisation industrielle innovante et à des contrats publics et privés nombreux (voir partie I.B.1).
Dans tous les cas, Ariane 5 et Ariane 6 bénéficient désormais d’un contexte plus favorable : l’augmentation des besoins de lancement à l’échelle mondiale, notamment pour les projets de constellation, privés et publics (projet Secure Connectivity (Connectivité sécurisée) de l’Union européenne, voir infra).
L’industrie européenne est également concurrencée dans le secteur des microlanceurs (objet spatial pesant de quelques dizaines de kilos à 500 kilogrammes) et des mini lanceurs, notamment par les États-Unis (Rocket Lab) et la Chine (Hyperbola-1, Jielong-1…).
En réponse, plusieurs projets nationaux ont émergé dans une forme de confusion qui a pu, dans un premier temps, desservir le spatial européen. Trois projets allemands ont notamment marqué l’actualité (Isar Aerospace, RFA One, Hylmpulse). ArianeGroup développe pour sa part son propre projet de minilanceur réutilisable, un projet dénommé « Maïa Space » qui doit être opérationnel en 2026. Ce lanceur sera fabriqué à Vernon dans l’Eure et pourra placer en orbite basse des satellites pesant plus lourd, entre 500 kilogrammes et 1 tonne (). Il bénéficiera des technologies testées dans le cadre du démonstrateur d’étage de fusée réutilisable Temis et du moteur réutilisable Prometheus.
Toutefois, selon M. Jean-Marc Astorg, directeur des lanceurs au CNES auditionné par les rapporteurs, ce marché est nécessairement limité. Seul un petit nombre d’acteurs pourra être viable commercialement. La plupart des lancements, même pour les petits satellites, sont et resteront captés par des lanceurs plus importants comme Ariane ou Vega.
Dans ce contexte, l’intérêt du développement de ces lanceurs est surtout d’explorer de nouvelles technologies. De plus, ils pourront représenter une source de revenus complémentaires pour les sites de lancement.
b. Repenser la filière aérospatiale dans l’enseignement supérieur pour mieux répondre aux besoins industriels
L’Europe dispose de formations de très grande qualité pour former des ingénieurs dans l’aérospatial. Les rapporteurs ont pu rencontrer à Toulouse M. Olivier Lesbre, le directeur général de la grande école ISAE-SUPAERO (), Mme Marie-Hélène Baroux, la directrice-adjointe, M. Nicolas Nohlier, directeur du Centre Spatial Universitaire de Toulouse (CSUT) () et des étudiants membres des associations Club Astre et Club CubeSat. Le pôle universitaire toulousain est reconnu à l’international pour son excellence : les ingénieurs qui y sont formés rejoignent ensuite rapidement les entreprises et institutions de l’aérospatial, ou deviennent entrepreneurs dans le domaine. D’autres universités européennes sont également reconnues, telles que l’Université de technologie de Delft (TU Delft) aux Pays-Bas ou l’Université Technique de Munich en Allemagne.
Des formations juridiques sont également indispensables. Les rapporteurs ont pu auditionner Maître Cécile Gaubert, avocate au Barreau de Paris spécialisée en droit des activités spatiales qui conseille les entreprises (construction contractuelle d’une activité) et réalise des études juridiques pour les entreprises (par exemple sur les risques juridiques d’un nouveau projet) et les agences spatiales nationales ou internationales (analyse des textes spatiaux). Ils ont également pu auditionner M. Philippe Achilleas, responsable du Master 2 Droit des activités spatiales et des télécommunications de l’Université Paris-Saclay, un master reconnu qui garantit une insertion professionnelle rapide à ses élèves. La demande des entreprises et des institutions pour embaucher des juristes sur ces thématiques est croissante.
La filière aérospatiale n’est toutefois pas encore suffisamment mise en valeur dans l’enseignement supérieur et manque encore souvent de moyens. Or, pour répondre à la concurrence imposée par les autres puissances spatiales, l’Europe doit former davantage de personnels spécialisés dans cette thématique. Une initiative en cours peut à cet égard être mentionnée et encouragée : la création d’une université généraliste, centrée sur le spatial et qui s’intitule la « European Space University for Earth and Humanity (UNIVERSEH) ». Cette université est un consortium de cinq universités européennes : l’Université fédérale Toulouse Midi-Pyrénées, l’Université du Luxembourg, l’Université de Luleå en Suède, l’université Heinrich-Heine-Universität de Düsseldorf en Allemagne et l’Université des sciences et des technologies AGH en Pologne.
2. Une dépendance envers les États-Unis pour la surveillance et l’exploration de l’espace
Les capacités de surveillance de l’espace et de suivi des débris spatiaux sont essentielles afin de prédire et d’éviter les collisions en orbite, mais aussi pour éviter toute menace militaire. Or, l’Europe dépend aujourd’hui encore trop souvent du système de surveillance de l’espace américain, de loin le plus précis au monde. Ce système repose sur des infrastructures radar et laser sur Terre et en orbite permettant d’établir un catalogue de plus de 27 000 objets de plus de cinq centimètres suivis quotidiennement.
La quasi-totalité des pays européens ainsi que l’ESA ont signé des accords bilatéraux pour avoir accès gratuitement à ce catalogue, ce qui n’incitait jusqu’ici pas les Européens à mettre en place un système souverain de surveillance de l’espace. Aujourd’hui, l’Europe possède trois systèmes de ce genre (), encore relativement peu développés et manquant de coordination.
L’Europe dépend également du partenaire américain pour le vol habité et pour l’exploration spatiale. Elle doit alors accepter la redéfinition américaine du droit de l’espace, présentée supra.
Plus généralement, l’Europe se place dans une situation de dépendance technologique envers les États-Unis.
B. un manque d’unité entre les pays européenS qui perdure malgré les changements institutionnels en cours
1. Une réorganisation institutionnelle amorcée
a. Une organisation institutionnelle morcelée
L’Europe spatiale s’est construite progressivement autour de trois grands types d’acteurs institutionnels : les États membres et plus spécifiquement, les agences spatiales nationales ; l’Agence spatiale européenne depuis 1975 (qui comprend vingt-deux États, dont la Norvège, le Royaume-Uni et la Suisse qui ne sont pas membres de l’Union européenne) et l’Union européenne depuis 1987 ().
L’Union européenne a ensuite vu son rôle renforcé dans les années 2000. Le 26 avril 2007, la Commission européenne a notamment publié une Communication sur la politique spatiale européenne (). Surtout, le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) instauré par le traité de Lisbonne () a changé de perspective. Le paragraphe 3 de l’article 4 du TFUE précise que l’Union européenne dispose directement d’une compétence en matière spatiale, même si elle la partage avec les États membres : « Dans les domaines de la recherche, du développement technologique et de l’espace, l’Union dispose d’une compétence pour mener des actions, notamment pour définir et mettre en œuvre des programmes, sans que l’exercice de cette compétence ne puisse avoir pour effet d’empêcher les États membres d’exercer la leur. » De plus, le paragraphe 1 de l’article 189 prévoit que « l’Union élabore une politique spatiale européenne. À cette fin, elle peut promouvoir des initiatives communes, soutenir la recherche et le développement technologique et coordonner les efforts nécessaires pour l’exploration et l’utilisation de l’espace ». Le paragraphe 2 précise toutefois : « Pour contribuer à la réalisation des objectifs fixés au paragraphe 1, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, établissent les mesures nécessaires, qui peuvent prendre la forme d’un programme spatial européen, à l’exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres. » L’idée n’est donc pas d’harmoniser, mais plutôt de créer un cadre juridique parallèle.
La première véritable Stratégie spatiale pour l’Europe a été publiée en octobre 2016. Selon Loïc Grard, professeur de droit public à l’université de Bordeaux, « la politique spatiale européenne se répartit [alors] entre les rôles dévolus à l’ESA (segment amont) et à l’Union (segment aval). Le segment amont couvre toutes les activités qui conduisent à la mise en œuvre d’infrastructures spatiales, y compris les travaux de recherche et développement, la construction de satellites et de lanceurs et le déploiement d’infrastructures spatiales. Le segment aval concerne toutes les activités commerciales qui reposent sur l’utilisation des données fournies par les infrastructures parmi lesquelles les services de diffusion, de communication, de navigation et d’observation de la Terre. »
Les relations entre l’Union européenne et l’ESA sont organisées autour d’un accord-cadre, adopté le 25 novembre 2003 par la Communauté européenne et entrée en vigueur en 2004. Pour Loïc Grard « cet accord fait office de partenariat stratégique entre l’offre (ESA) et la demande de systèmes spatiaux (UE) » (). De plus, un Conseil Espace, c’est-à-dire des réunions du Conseil de l’UE et du Conseil de l’ESA, contribue à la coordination interinstitutionnelle.
Les défauts de cette organisation spatiale européenne ont été présentés dans plusieurs rapports parlementaires, dont le rapport d’information sur la politique spatiale européenne des députés Aude Bono-Vandorme et Bernard Deflesselles, déposé par la commission des affaires européennes au mois de novembre 2018, qui appelait à une évolution de la gouvernance. Une réforme était d’ailleurs demandée par différents acteurs, qu’il s’agisse des institutions européennes et de l’ESA qui reconnaissaient elles-mêmes la nécessité d’améliorer la coordination, ou de plusieurs industriels. Certains industriels demandaient même une « restructuration radicale » du « modèle européen, éclaté et divisé » () car il ne permettrait pas de prendre rapidement des décisions importantes, notamment pour favoriser les innovations de rupture. Dans ce contexte, la réorganisation de la gouvernance spatiale européenne était attendue.
b. Une réorganisation en cours
Le 28 avril 2021, l’Union européenne a finalement adopté le règlement n° 2021/696 établissant le programme spatial de l’Union et l’Agence de l’Union européenne pour le programme spatial () qui donne les grandes orientations de sa politique spatiale pour la période 2021-2027. Il regroupe pour la première fois dans un seul texte l’ensemble des activités spatiales phares déjà existantes tout en prévoyant leur amélioration – Copernicus, Galileo et le Système européen de navigation par recouvrement géostationnaire (EGNOS) – et de nouveaux programmes : l’initiative de télécommunications gouvernementales par satellite (GOVSATCOM) et le programme de surveillance de la situation de l’espace (SSA). Le SSA comprend à la fois la surveillance et le suivi des objets spatiaux et la surveillance de la météorologie spatiale.
Le règlement n° 2021/696 prévoit également la création de l’Agence de l’Union européenne pour le programme spatial (EUSPA) dont le directeur exécutif, M. Rodrigo Da Costa, a été auditionné par les rapporteurs. L’EUSPA sera à terme responsable de tous les programmes spatiaux de l’Union, qu’il s’agisse des programmes déjà existants – qu’elle devra par ailleurs approfondir et renouveler – ou des nouveaux programmes.
L’Agence de l’Union européenne pour le programme spatial (EUSPA)
L’EUSPA a été officiellement lancée le 12 mai 2021. Le titre IX du règlement n° 2021/696 porte spécifiquement sur l’organisation de l’EUSPA. Il précise que cette agence est un organisme de l’Union dotée de la personnalité juridique (article 70) dont le siège est situé à Prague, en Tchéquie (article 71).
L’EUSPA remplace l’Agence européenne pour les systèmes mondiaux de navigation par satellite (GSA), qui gérait les programmes Galileo et EGNOS, et sera à terme responsable des autres programmes spatiaux de l’Union européenne.
La Commission a conclu une convention-cadre de partenariat financier avec l’Agence (articles 28) et l’ESA afin de définir « clairement les rôles, les responsabilités et les obligations de la Commission, de l’Agence et de l’ESA en ce qui concerne chaque composante du programme et les mécanismes de coordination et de contrôle nécessaires » (article 31). Celle-ci est entrée en vigueur le 23 juin 2021 (voir infra).
En parallèle, au début de l’année 2021, le commissaire Thierry Breton a également annoncé sa volonté de créer une nouvelle constellation européenne de satellites de télécommunication placés en orbite basse, dans le cadre d’un projet dénommé « initiative sur la connectivité spatiale sécurisée ». Ce projet devrait renforcer l’accès à Internet en haut débit pour tous les citoyens européens, mais aussi sécuriser les communications. Le projet comprendrait un volet stockage des données sur le sol européen.
c. Une répartition des rôles plus précise mais qui soulève encore des questions
La question de la gouvernance spatiale européenne n’a pas été réglée par le règlement n° 2021/696. Les articles 28, 29 et 30 prévoient une certaine répartition des tâches entre respectivement la Commission européenne, l’EUSPA et l’ESA. La Commission européenne finance les programmes et assure le pilotage stratégique (article 28), et l’ESA conçoit et développe les produits et services dans ses domaines d’expertise (article 30). Néanmoins, la répartition claire des rôles n’est toutefois pas assurée, et l’on peut craindre un risque de duplication de certaines tâches.
Le paragraphe 4 de l’article 28 dispose toutefois que : « La Commission conclut avec l’Agence et, tenant compte de l’accord-cadre 2004, avec l’ESA] une [convention-cadre de partenariat financier (CCPF)] () telle qu’elle est prévue à l’article 130 du règlement financier ». Celle-ci a été signée le 22 juin par les trois institutions. Cette convention précise à nouveau que l’Union est le donneur d’ordres, l’ESA l’architecte de la conception et l’EUSPA en charge de l’exploitation.
En parallèle, deux conventions de contribution ont également été signées : une première entre la Commission européenne et l’ESA relative à l’exécution du Programme spatial de l’Union et d’Horizon Europe, et une seconde entre l’EUSPA et l’ESA relative à l’exécution du programme spatial de l’Union, entrées en vigueur le 22 juin 2021.
Pour le juriste Loïc Grard, il existait avant la conclusion de la CCPF des « zones grises » non résolues :
- le maintien du principe du retour géographique (voir infra) sur lequel fonctionne l’ESA et plus généralement, la composition même de l’ESA avec des pays non-membres de l’Union européenne ;
- la question des lanceurs qui relève aujourd’hui de l’ESA mais est aussi indispensable pour assurer un accès autonome à l’espace promue par la nouvelle doctrine de l’Union européenne ;
- les « ambitions différentes » des deux entités. En effet, selon le juriste, « l’ESA a plutôt vocation à développer la recherche et (…) les technologies spatiales. Ses 2 200 salariés sont d’ailleurs majoritairement des scientifiques, des ingénieurs, des spécialistes des technologies de l’information… De son côté, l’UE veut s’imposer comme une véritable puissance spatiale, à la fois concurrent et partenaire des États-Unis, de la Chine et de la Russie. Elle agit plutôt comme un opérateur une fois l’infrastructure spatiale opérationnelle en place. Galileo illustre cette séparation des pouvoirs. L’ESA agit à la manière d’un prestataire technique pour le compte de l’UE en menant la sélection des industriels fabricants les satellites, en définissant l’architecture de la constellation… L’UE assure le service après-vente. » ()
Au cours de leurs auditions, les rapporteurs n’ont pas obtenu d’éléments certifiant que ces zones grises n’existaient plus désormais.
2. De nouvelles ambitions européennes, mais une enveloppe budgétaire européenne qui demeure insuffisante
a. Une prise de conscience de l’importance du spatial
L’Union européenne a récemment rehaussé ses ambitions spatiales, en comprenant l’importance de ce secteur pour la souveraineté européenne, et plus spécifiquement son rôle majeur dans l’économie. La politique spatiale européenne reste avant tout centrée sur l’économie : l’utilité de l’exploitation de l’espace est principalement jugée à l’aune des retombées économiques qu’elle procure. Il n’est ainsi pas anodin que le portefeuille du commissaire Thierry Breton comprenne à la fois le marché intérieur, l’industrie, le numérique et la politique spatiale et de défense de l’Union européenne.
Le 19 avril 2021 (), Manuel Heitor, ministre portugais des sciences, des technologies et de l’enseignement supérieur, résumait ainsi les motivations de l’Union européenne : « L’UE compte sur les activités spatiales en tant que facteurs de croissance économique durable et de sécurité. Grâce à notre nouveau programme spatial de l’UE, nous allons pouvoir rester compétitifs dans la nouvelle économie spatiale et préserver la souveraineté spatiale de l’UE. Ce programme stimulera notre reprise économique après la pandémie ainsi que notre transition vers un modèle économique vert et numérique. »
Cette prise de conscience se traduit concrètement dans l’augmentation du budget du programme spatial de l’Union européenne pour la période 2021-2027 : il a été fixé à 14,88 milliards d’euros en euros courants (13,2 milliards en prix 2018) ; même si la somme demandée par la Commission européenne était de 16 milliards d’euros en 2018. Ce montant représente 2,12 milliards d’euros en moyenne par an.
Sur ce nouveau budget, 9,02 milliards sont dédiés aux systèmes de navigation par satellite (Galileo, EGNOS), 5,2 milliards à l’observation de la Terre (Copernicus) et 440 millions à la sécurité (SSA, Govsatcom) (). On constate une nette augmentation par rapport aux programmations précédentes : 4,6 milliards d’euros pour la période 2007-2013 et 11,1 milliards d’euros pour la période 2014-2020. D’autres lignes du cadre financier pluriannuel (CFP) 2021-2027 peuvent également être mobilisées, notamment le cluster n° 4 « numérique, industrie et espace » (15,35 milliards d’euros) du pilier « problématiques mondiales et compétitivité industrielle européenne » du programme-cadre pour la recherche et l’innovation « Horizon Europe » et le Fonds européen de défense (8 milliards d’euros).
De plus, en janvier 2021, la Commission européenne a créé le fonds d’investissement Cassini, doté d’un à deux milliards d’euros, et consacré à l’entrepreneuriat et à l’innovation de rupture en matière spatiale. Ce fond doit couvrir tout le cycle d’innovation, c’est-à-dire de la simple idée à sa production industrielle.
En parallèle, le budget de l’ESA pour l’année 2021 était de 6,49 milliards d’euros, un budget qui a augmenté depuis plusieurs années (5,72 milliards en 2019 ; 4,1 milliards en 2014). Sa répartition par type d’activité est présentée en annexe n° 7. Les États membres sont le premier contributeur (67 %), suivis par l’Union européenne (26 %, 1,6 milliard d’euros), EumetSat (3 %) et les autres sources de revenus (4 %). Le premier contributeur étatique était la France (23,4 %, 1,065 milliard d’euros), suivie par l’Allemagne (21,3 %, 969 millions d’euros), l’Italie (13 %, 590 millions d’euros), le Royaume-Uni (9,2 %, 419 millions d’euros) et la Belgique (5,6 %, 256 millions d’euros) ().
L’évolution de ce budget dépendra de la réunion ministérielle de l’ESA en 2022. Pour sa part, l’Union européenne a annoncé qu’elle financerait l’ESA à hauteur de 9 milliards d’euros sur la période 2021-2027, soit environ 1,3 milliard d’euros par an.
b. Un budget qui reste insuffisant dans le contexte international actuel
Au total, en 2021, le budget public européen dédié au spatial, comprenant les contributions de l’Union européenne et de l’ESA, représentait environ 8,1 milliards d’euros. Il faut ensuite ajouter les budgets des agences spatiales nationales (notamment 1,26 milliard d’euros pour le CNES en 2021, hors contribution à l’ESA ; 1,7 milliard pour le DLR).
Si ce budget est important, il n’apparaît pas encore suffisant au regard des ambitions européennes. Les 500 millions d’euros dédiés à la sécurité ne permettront par exemple pas de créer la constellation de satellites souhaitée par Thierry Breton. Le Fonds européen de défense et le programme pour les communications quantiques pourront aussi être mobilisés, voire d’autres financements à préciser.
Le budget européen est actuellement le deuxième budget spatial au monde, devant la Chine (estimé), la Russie, le Japon et l’Inde. Néanmoins, il n’est pas certain que l’Europe conserve cette position longtemps compte tenu des ambitions exprimées par la Chine.
En outre, ce budget apparaît très faible en comparaison du budget public spatial américain : 40 milliards de dollars environ, soit 35 millions d’euros, alors même que la population américaine est moins nombreuse que la population européenne (330 millions de personnes en 2020, contre 450 millions dans l’Union européenne). Les États-Unis disposent également de capitaux privés très importants pour développer l’industrie spatiale. Dans ce contexte, l’écart avec les États-Unis continue à se creuser.
3. Une défense inégale du spatial selon les États européens
a. Un principe de préférence européenne difficile à mettre en œuvre
La déclaration relative à la phase d’exploitation des lanceurs Ariane, Vega et Soyouz au Centre spatial guyanais, adoptée à Paris le 30 mars 2007 et amendée le 4 décembre 2017 par dix-huit États membres de l’ESA dont la France, prévoit un principe non contraignant de préférence d’utilisation des lanceurs européens pour les missions institutionnelles. C’est l’analyse du député Lénaïck Adam, membre de la commission des affaires étrangères, dans son rapport sur le projet de loi qui autorisait l’approbation de cet accord, publié en septembre 2021 ().
Le paragraphe 8 de la section I prévoit en effet que les parties « tiennent compte » des lanceurs développés par l’ESA et du lanceur Soyouz exploité depuis le CSG et « examinent la compatibilité de leurs missions nationales avec l’utilisation des lanceurs lors de la définition et de l’exécution de leurs programmes nationaux », « (…) sauf si l’utilisation de ces lanceurs présente, par rapport à d’autres lanceurs ou moyens de transport spatiaux disponibles à l’époque envisagée, un désavantage déraisonnable sur le plan du coût, de la fiabilité ou de l’adéquation à la mission » (). Le paragraphe 9 ajoute que les parties s’accordent pour « apporter leur soutien collectif à la mise en place d’un cadre régissant les approvisionnements de services de lancement pour des programmes institutionnels européens et assurant à l’Europe une égalité des chances sur le marché mondial des services de lancement. » Ainsi, aucune véritable obligation ne pèse sur les parties.
L’article 5 du règlement n° 2021/696 autorise plus directement une forme de préférence européenne pour les services de lancement, même si celle-ci n’est pas directement nommée et reste légère puisque seul un « soutien » est mentionné. Il ne s’agit donc pas d’une préférence systématique ni même quasi systématique.
Règlement n° 2021/696
Article 5
1. Le programme [spatial de l’Union] soutient l’acquisition et l’agrégation de services de lancement pour les besoins du programme et, à leur demande, l’agrégation pour les États membres et les organisations internationales.
2. Dans le cadre de synergies avec d’autres programmes et instruments de financement de l’Union, et sans préjudice des activités de l’ASE dans le domaine de l’accès à l’espace, le programme peut également soutenir :
a) les adaptations, y compris les évolutions technologiques, des systèmes de lancement spatial nécessaires au lancement des satellites, dont des technologies de substitution et des systèmes innovants d’accès à l’espace, aux fins de la mise en œuvre des composantes du programme ;
b) les adaptations de l’infrastructure spatiale au sol, notamment les nouvelles évolutions, qui sont nécessaires à la mise en œuvre du programme.
Cet article répond au considérant n° 6 du règlement qui explique l’intérêt de disposer d’un accès autonome à l’espace, pour la liberté d’action, l’indépendance et la sécurité : « Afin d’atteindre les objectifs de liberté d’action, d’indépendance et de sécurité, il est essentiel que l’Union bénéficie d’un accès autonome à l’espace et puisse l’utiliser en toute sécurité. Il est donc indispensable que l’Union promeuve un accès autonome, fiable et économe en ressources à l’espace, en particulier en ce qui concerne les infrastructures et les technologies critiques, la sécurité publique et la sécurité de l’Union et de ses États membres. La Commission devrait donc avoir la possibilité de regrouper les services de lancement au niveau européen, tant pour ses propres besoins que pour ceux, à leur demande, d’autres entités, y compris les États membres, conformément à l’article 189, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Pour rester compétitive sur un marché en évolution rapide, il est également essentiel que l’Union continue d’avoir accès à des équipements d’infrastructures de lancement modernes, efficaces et flexibles et qu’elle bénéficie de systèmes de lancement appropriés. Par conséquent, sans préjudice des mesures prises par les États membres ou l’Agence spatiale européenne (ASE), le programme devrait pouvoir soutenir des adaptations de l’infrastructure spatiale au sol, y compris de nouvelles avancées, qui sont nécessaires à la mise en œuvre du programme et aux adaptations, y compris des avancées technologiques, aux systèmes de lancement spatial nécessaires au lancement des satellites, dont des technologies de substitution et des systèmes innovants, aux fins de la mise en œuvre des composantes du programme. »
Si ce principe de préférence européenne est effectivement indispensable, il faut désormais le mettre en œuvre concrètement. Or, de nombreux pays européens utilisent peu les lanceurs européens, même pour des missions institutionnelles. La carte ci-dessous, qui porte sur l’année 2019, en témoigne. La situation a depuis pu empirer, la concurrence internationale s’étant intensifiée.
Nationalité des satellites et de leur base de lancement en 2019

Source : Isabelle Sourbès-Verger ().
b. Des écarts d’ambitions entre les pays européens
La perception de l’importance du spatial varie fortement entre les pays européens, comme peuvent en témoigner les différences de budgets nationaux évoquées supra. La France est le pays le plus actif, suivi par l’Allemagne et l’Italie. Un deuxième cercle est composé de la Belgique, de l’Espagne, du Luxembourg et de la Suisse. Un troisième cercle peut être constitué de la Suède, de la Norvège et de l’Irlande. Les autres États européens, plus petits, perçoivent souvent moins l’importance de ce secteur pour leur économie, et plus généralement, pour leur souveraineté. En témoigne d’ailleurs l’habitude de certains États qui utilisent des lanceurs non européens pour leurs missions institutionnelles.
Enfin, la position du Royaume-Uni – membre de l’ESA mais non membre de l’Union européenne – pose question quant à la possibilité de définir une stratégie spatiale européenne commune et à la confiance mutuelle entre les acteurs sur la poursuite des programmes.
Mais même entre les pays les plus impliqués sur le spatial, des divergences ont pu apparaître. Les tensions sur l’avenir du programme Ariane 6 ont notamment été relevées entre la France et l’Allemagne. Finalement, à la suite d’un premier accord franco-allemand à la mi-juillet 2021, les États membres de l’ESA ont adopté à la mi-août 2021 une résolution dont les conclusions ont été publiées au début de mois de septembre. Cette décision stabilise l’exploitation d’Ariane 6 et de Vega-C à court terme. La demande de lancements institutionnels serait de quatre lanceurs Ariane 6 (trois Ariane 62 et deux Ariane 64) et deux Vega-C par an en moyenne.
De même, la question du développement de capacités de vol spatial habité ne fait pas consensus entre les États européens. Si Ariane 5 avait été pensée pour le vol habité avec le programme Hermès, l’Allemagne s’y opposait à l’époque. Aujourd’hui, un tel projet reste peu défendu à l’échelle européenne voire suscite des oppositions, y compris en France.
Surtout, cela a été présenté précédemment, les pays européens n’ont pas su définir de position commune dans le cadre des Accords Artemis.
En parallèle de ce manque de coordination et de vision stratégique commune, on constate également une dispersion des outils de production sur le territoire européen, favorisée aujourd’hui par la règle dite du « retour géographique ». Selon cette règle, définie à l’article IV de l’annexe n° 5 de la Convention de l’ESA, la contribution financière donnée par un État membre à l’ESA doit être redistribuée en proportion à ses industries sous la forme de l’attribution de contrats (). Pour certains acteurs, y compris des acteurs industriels, cette règle entraîne un saupoudrage des contrats et une duplication des savoir-faire dans plusieurs pays. Elle ralentit aussi la production industrielle en ralentissant l’attribution des contrats.
Les concurrences entre États au sein de l’Union européenne affectent également sa vitalité comme cela peut parfois être constaté entre la France et l’Allemagne qui ne partagent pas nécessairement les mêmes intérêts économiques, diplomatiques et stratégiques. Le plan de licenciement au sein d’ArianeGroup, ou, les changements de sites de production des moteurs d’Ariane 6 (du site de Vernon en France vers Ottobrunn en Allemagne), à la suite des derniers accords, témoignent de ces divergences d’intérêts, mais également de la précarité des installations industrielles qui sont parfois suspendues à des accords diplomatiques. Or, cela a des effets extrêmement concrets pour l’avenir des salariés, où qu’ils travaillent en Europe.
IV. Trois axes de Propositions pour de nouvelles stratégies spatiales française et euROPÉENnE
A. au niveau national : conSOLIDER nos ATOUTS et lancer une consultation nationale sur le spatial
1. Poursuivre l’augmentation du budget public dédié à l’espace
Le contexte décrit dans la partie I du rapport – une place croissante du spatial dans notre société et une concurrence internationale accrue – implique le maintien de l’effort financier engagé par l’État français.
Selon les chiffres disponibles en décembre 2021, le Centre national d’études spatiales (CNES) disposait pour l’année 2021 d’un budget propre de 1,329 milliard d’euros et d’un budget de 1,184 milliard d’euros pour la contribution française à l’ESA, soit 2,504 milliards d’euros au total. Pour l’année 2022, ces chiffres sont respectivement de 1,391 et 1,164 milliard d’euros, soit 2,555 milliards d’euros au total. Pour les fonds dédiés au CNES en 2022, 749 millions d’euros seront dédiés aux activités multilatérales (dont 472 millions d’euros proviennent du programme 193 recherche spatiale de la mission budgétaire recherche de la loi de finances initiale pour 2022 ; 150 millions d’euros du programme 146 équipement des forces de la mission défense et 119 millions d’euros du plan de relance pour le programme 191 recherche duale (civile et militaire)), 543 millions d’euros proviennent de ressources propres (programmes délégués : DGA, ESA, Eumetsat (), etc.), 55 millions d’euros du plan France Relance et 44 millions d’euros du Programme d’investissements d’avenir (PIA).
Le volet spatial du plan France 2030 devrait rajouter 1,5 milliard d’euros d’investissement sur plusieurs années. Les rapporteurs n’ont pas pu obtenir de détails sur la répartition définitive des crédits. En effet, au début de l’année 2022, ce plan était encore en cours de discussion entre l’État, BPI France et le CNES.
Dans tous les cas, les rapporteurs notent une tendance à la hausse du budget public dédié au spatial et appelle le gouvernement à la poursuivre.
Recommandation n° 1 : Préserver voire augmenter le budget public national dédié au spatial.
Pour améliorer l’information des citoyens et des parlementaires sur le spatial, les rapporteurs recommandent également d’améliorer la présentation des crédits dédiés au spatial. Ces derniers sont en effet répartis dans plusieurs missions budgétaires distinctes et dans plusieurs plans d’investissements nationaux. L’ensemble de ces crédits pourrait être présenté dans un même document, soit par exemple un document de politique transversale (DPT) « espace », communément appelé « orange ». Des DPT existent par exemple déjà pour le tourisme ou la politique maritime.
Recommandation n° 2 : Présenter l’ensemble des budgets spatiaux nationaux dans un document de politique transversale « espace ».
Le nouveau président du CNES, M. Philippe Baptiste, auditionné par les rapporteurs le 10 janvier 2022, a indiqué qu’il mobiliserait les crédits dédiés à son agence autour des quatre nouveaux « piliers stratégiques de la politique spatiale française » : la souveraineté nationale, la science, le climat et le renforcement de la compétitivité de la filière spatiale française. Ainsi le contrat d’objectifs et de performance (COP) entre le CNES et l’ESA pour la période 2021-2025 s’intitulera-t-il « Nouveaux espaces : souveraineté, climat, coopération scientifique et compétition économique, le spatial au cœur des grands enjeux de la décennie ».
Les nouvelles priorités de la politique spatiale française
Selon le nouveau président du CNES, la politique spatiale française suit désormais quatre objectifs stratégiques :
- la souveraineté nationale : mobiliser le CNES sur Ariane 6, préparer le futur en développant le réutilisable et en réduisant les coûts, accompagner la montée en puissance du spatial de la défense, jouer un rôle clé dans l’acquisition et le traitement des données spatiales ;
- la science : porter des missions ambitieuses, faire rayonner l’excellence française aux niveaux européen et international, animer la recherche scientifique spatiale et poursuivre les coopérations ;
- le climat avec, entre autres, le renforcement des programmes d’observation de la Terre et le développement de l’Observatoire Spatial du Climat (SCO en anglais) ;
- le renforcement de la compétitivité de la filière spatiale française : développer des technologies disruptives, de nouveaux modèles de partenariat et de co-investissement avec l’industrie, accompagner la transition d’une économie de l’infrastructure vers une économie de la donnée en faisant émerger de nouveaux usages et services.
Si ces quatre axes semblent en effet essentiels, les rapporteurs souhaitent qu’un axe dédié à la promotion de nouvelles normes internationales encadrant les activités spatiales soit ajouté. Ils développeront cet aspect dans la sous-partie C des propositions.
Les rapporteurs n’ont pas pu obtenir d’autres détails sur le COP, car celui-ci était encore en cours de discussion au début du mois de janvier 2022. Le président du CNES a, en revanche, présenté la réorganisation interne déjà initiée dans l’agence. Une direction de la stratégie a été créée ainsi qu’un secrétariat général pour regrouper les fonctions support et une direction Technique et Numérique qui s’articulera avec deux directions « projet », l’une pour les systèmes orbitaux et l’exploitation, l’autre pour le transport spatial.
Les rapporteurs s’interrogent aussi sur la possibilité de regrouper au sein d’un service unique l’ensemble des acteurs travaillant au CNES sur la sécurité des opérations spatiales, soit environ une cinquantaine de personnes. Au début de l’année 2022, elle était assurée par plusieurs bureaux distincts au sein du CNES : le service Sécurité des vols spatiaux, le bureau LOS des Lanceurs et le service Surveillance de l’espace (). Cette organisation est peu lisible pour les partenaires. Le CNES doit être identifié comme l’organisme français de régulation du trafic spatial, comme peut l’être la direction générale de l’aviation civile (DGAC) pour l’aéronautique.
Parmi les évolutions en cours au CNES figure surtout une profonde évolution des fonctions de l’agence. Elle compte financer davantage de projets innovants, quitte à déléguer une partie des activités qu’elle réalisait autrefois elle-même aux entreprises et notamment aux start-up.
2. Renforcer les efforts en faveur de l’innovation industrielle et de l’émergence des start-up
Le plan d’investissement France Relance 2030, annoncé par le président de la République, comprend un volet spatial (objectif 9). Les grandes lignes de celui-ci ont été présentées par M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie, des finances et de la relance, le 6 décembre 2021. Une enveloppe de 1,5 milliard d’euros sera consacrée au secteur spatial avec deux priorités : « rattraper le retard sur certains segments de marchés clés comme les lanceurs réutilisables ou les constellations, et investir dans les nouveaux usages ».
En parallèle, le plan prévoit également une enveloppe de 4 milliards d’euros de fonds propres pour investir dans les technologies d’avenir et répondre à la problématique du manque d’investisseurs privés en France, par rapport notamment aux États-Unis. Les entreprises du spatial pourraient bénéficier d’une partie de cette enveloppe.
Les efforts en faveur de l’innovation industrielle et de l’émergence de start-up dans le domaine aérospatial doivent continuer à être renforcés pour permettre à l’industrie aérospatiale française de rester compétitive. Ils doivent suivre trois axes : des transferts de compétences (notamment du CNES), de l’achat direct de produit ou de service pour que l’entreprise bénéficie d’un premier client et des investissements en fonds propres.
Recommandation n° 3 : Renforcer les dispositifs en faveur de l’innovation industrielle et de l’émergence de start-up dans le domaine aérospatial.
Dans le domaine des micro-lanceurs, la France doit rattraper le retard pris vis-à-vis d’autres pays. La France participera ainsi à la compétition européenne engagée.
Recommandation n° 4 : Financer très rapidement des projets de micro-lanceurs français pour rattraper le retard pris par la France.
En parallèle, une réflexion sur un plan pour une plus grande intégration verticale des processus de production dans l’industrie spatiale européenne – c’est-à-dire éventuellement un regroupement des grands acteurs du secteur, du satellite au lanceur (par exemple sous la forme de joint-ventures) – et sur la possibilité de produire plus rapidement et moins cher doit être menée, aux niveaux français mais aussi européen. Les entreprises résisteraient alors mieux à la concurrence imposée par les acteurs privés américains, et en particulier SpaceX.
Recommandation n° 5 : Mener une réflexion sur l’organisation industrielle française et européenne, afin de simplifier et d’automatiser les processus de production.
Enfin, en amont, il est également nécessaire de former davantage d’ingénieurs français et d’attirer les talents étrangers sur notre territoire. Les universités et grandes écoles françaises spécialisées dans l’aérospatial pourraient être plus soutenues par l’État, et ce d’autant plus qu’elles subissent la concurrence des universités étrangères, notamment américaines et allemandes (). Le CNES pourrait par exemple s’appuyer davantage sur l’ISAE-SUPAERO à l’international, en mettant en avant son offre de formation et à sa capacité à développer des formations chez les partenaires. De plus, certains projets des étudiants en aérospatial mériteraient de recevoir des financements plus conséquents, comme c’est par exemple souvent le cas dans les universités américaines () : microfusées et nano satellites étudiants, ballon-sonde, antennes au sol, projets d’exploration ou de simulations d’exploration (), etc. ; tout en veillant au caractère durable de ces projets pour ne pas polluer davantage les orbites. Enfin, un soutien plus important pourrait être apporté aux start-up aérospatiales créées par des étudiants et de jeunes professionnels.
Recommandation n° 6 : Renforcer les aides publiques destinées aux écoles et aux étudiants en aérospatial et mieux promouvoir leurs formations à l’international.
D’autre part, les métiers liés au spatial vont se multiplier et vont prendre des formes très diverses. La demande de spécialistes en assurance et en droit des activités spatiales va par exemple augmenter. À plus long terme, certains métiers qui existent sur Terre pourraient même être pratiqués dans l’espace dans le cadre d’une présence humaine durable sur certains corps célestes, comme la Lune ().
Par conséquent, la France et l’Europe doivent anticiper ces évolutions pour adapter les formations proposées dans l’enseignement supérieur, voire pour proposer de nouvelles filières.
Les formations en sciences humaines ne prennent pas encore suffisamment en compte les réflexions sur les activités spatiales, et il faudrait également intensifier les recherches sur les aspects éthiques, philosophiques, géographiques, historiques, géopolitiques, sociologiques, voire anthropologiques, de cette nouvelle ère spatiale. À ce titre, l’initiative « Objectif Lune » de l’ANRT est intéressante et aurait vocation à être bien plus connue.
Recommandation n° 7 : Anticiper les évolutions des métiers du spatial à long terme, en créant des formations adéquates, et ouvrir et soutenir la création de nouvelles filières universitaires liées au spatial, notamment dans les métiers de l’assurance et du droit des activités spatiales.
Recommandation n° 8 : Inscrire dans les programmes de géographie au lycée et à l’université les sujets spatiaux (enjeux géographiques et géopolitiques).
3. Inclure les citoyens et le Parlement dans la réflexion sur la politique spatiale française
Une réforme de la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales (LOS) apparaît nécessaire au regard des transformations majeures du contexte spatial depuis 2008. Le champ d’application de la loi pourrait par exemple être étendu à de nouvelles technologies et activités spatiales (services en orbite et vols suborbitaux, par exemple). La réglementation autour des débris spatiaux pourrait quant à elle encore être améliorée, même si elle ne doit pas placer les industriels français dans une situation de désavantage compétitif avec leurs concurrents étrangers. Plus généralement, cette loi serait l’occasion de redéfinir les régimes d’autorisation et d’immatriculation applicables aux opérations et activités spatiales ainsi que le régime de responsabilité. Les spécificités liées aux petits satellites pourraient être prises en compte et être différenciées des satellites de plus grande taille afin de travailler à une définition plus précise du régime de responsabilité.
Compte tenu des enjeux, les rapporteurs demandent un examen du ou des futurs textes au Parlement, dans les commissions et en séance publique. Le dernier grand débat parlementaire sur le spatial remonte à 2008, ce que regrettent les rapporteurs.
Le II de l’article 44 de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l’enseignement supérieur habilite le gouvernement, dans les conditions de l’article 38 de la Constitution, « à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire pour compléter et adapter les dispositions relatives aux activités et opérations spatiales et aux services qui y concourent, aux seules fins de garantir la protection des intérêts de la défense nationale, en précisant en particulier les conditions dans lesquelles l’État peut agir en qualité d’opérateur spatial ainsi que les règles de recueil et de diffusion des données d’origine spatiale, et favoriser aux mêmes fins la recherche et le développement en matière spatiale. » Le texte initial voté par l’Assemblée nationale prévoyait une autorisation beaucoup plus large, qui dépassait le cadre militaire. La commission mixte paritaire a finalement modifié le texte pour prendre davantage en compte l’importance du renouvellement de la LOS et plus généralement, des activités spatiales.
Recommandation n° 9 : Organiser un débat au Parlement sur le ou les textes qui remplaceront la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales (LOS).
En amont de ces discussions, il serait pertinent d’inclure les citoyens dans la réflexion sur la politique spatiale française. La France pourrait pour cela s’inspirer d’une initiative canadienne qui a duré cinq mois. Celle-ci a été présentée aux rapporteurs par M. Jean-Pierre Arseneault, délégué permanent du Canada à l’ESA.
La consultation publique de l’Agence spatiale canadienne
Du 26 octobre 2020 au 31 mars 2021, l’Agence Spatiale Canadienne (ASC) a consulté la population canadienne sur une thématique spécifique : « un cadre pour les activités d’exploration spatiale à venir », en utilisant Internet.
Elle a reçu 194 mémoires écrits de divers intervenants : des entreprises (dont celles de l’industrie spatiale et de l’industrie minière), le milieu universitaire et les experts, des organisations non gouvernementales mais aussi le grand public.
« Cinq thèmes clés sont ressortis des consultations » selon le rapport publié à l’issu () : « le rôle du Canada dans la gouvernance mondiale de l’espace », « actualiser le cadre réglementaire du Canada », « favoriser les possibilités économiques », « permettre l’utilisation des ressources spatiales [mais avec un cadre réglementaire clair pour assurer la viabilité à long terme de l’espace] » et « envisager les enjeux dans leur ensemble ».
Si l’initiative canadienne portait exclusivement sur l’exploration spatiale, la France pourrait quant à elle organiser une consultation plus large, qui pourrait servir à rédiger la nouvelle loi relative aux opérations spatiales et plus généralement, à définir la politique spatiale française. Cette consultation pourrait être organisée sur Internet.
Recommandation n° 10 : Lancer une consultation nationale sur le spatial.
Cette consultation doit s’accompagner d’une meilleure connaissance par les citoyens de l’espace et de ses enjeux. Le CNES a renforcé sa communication et Thomas Pesquet a contribué à populariser le vol spatial habité, et les enjeux plus généraux liés à l’espace. Toutefois, malgré ces initiatives, les enjeux géopolitiques, économiques et parfois scientifiques liés à l’espace, restent encore peu connus du grand public. Ainsi, une proposition du rapport sur la politique spatiale européenne présentée par les députés Joaquim Pueyo et Bernard Deflesselles le 12 juillet 2016 à la commission des affaires européennes, est reprise dans le présent rapport : « Intensifier les efforts de communication, de valorisation et de vulgarisation scientifique ».
Recommandation n° 11 : Intensifier les efforts de communication, de valorisation et de vulgarisation scientifique pour améliorer les connaissances sur l’espace, sur sa nature et sur son utilité pour la vie quotidienne.
Dans le cadre d’un travail de popularisation des enjeux du spatial, la création d’une « culture du risque spatial » – qui s’inspirerait de la « culture du risque » développée pour les industries dangereuses avec les salariés et les riverains – est très importante. En effet, l’espace étant un lieu d’une hostilité absolue pour les êtres humains et pour leurs machines, il convient d’améliorer la résilience des individus et des industries en cas de crise, pour mieux assurer leur sécurité.
À l’heure actuelle, un grand nombre d’applications personnelles ou professionnelles repose sur des satellites comme le positionnement (Galileo/GPS), la communication cryptée ou publique, les échanges commerciaux ou financiers et une partie (certes faible) du trafic Internet global. Or, la probabilité d’un accident déclenchant un syndrome de Kessler, d’une tempête solaire d’une intensité extrême, voire d’actes hostiles en orbite, n’est pas nulle.
Face à de tels risques, les technologies de l’économie spatiale doivent être repensées pour mieux résister. En parallèle, les sociétés doivent aussi apprendre à se réorganiser différemment, dès que cela est nécessaire ().
Recommandation n° 12 : Promouvoir une « culture du risque » dans l’économie spatiale et auprès des citoyens.
B. au niveau EUropéen : utiliser la présidence française de l’union européenne pour proposer une stratégie spatiale commune et préparer la prochaine conférence ministérielle de l’esa
La présidence française de l’Union européenne (PFUE) est une occasion unique pour préciser les contours de la nouvelle stratégie spatiale européenne et pour la rendre plus ambitieuse. Cette ambition devra ensuite continuer à être défendue dans tous les rendez-vous européens sur la thématique. Parmi ces rendez-vous figure le prochain conseil ministériel de l’ESA (CMIN), qui sera organisé les 22 et 23 novembre 2022 à Paris (). Un dialogue entre le CNES et ses tutelles est en cours pour les définir les orientations stratégiques de la France.
1. Accélérer les grands projets européens en cours, dont le projet de constellation européenne
La PFUE doit être utilisée pour accélérer les grands projets spatiaux européens, dans un contexte de concurrence internationale très forte et de risques pour la soutenabilité des activités spatiales.
Au début de l’année 2021, le programme spatial de la PFUE contenait trois axes principaux : « [définir] les contours du projet de constellation de connectivité sécurisée proposé par la Commission » ; « [œuvrer] au développement d’une vision commune au sein de l’Union en matière de gestion du trafic spatial » et « [lancer] une réflexion sur l’avenir de Copernicus et les évolutions stratégiques et environnementales qui façonneront les choix techniques et opérationnels nécessaires pour rester efficace d’ici à 2035 () ». Ces trois axes apparaissent essentiels pour les rapporteurs.
Le premier point, le projet de constellation européenne (« Connectivité sécurisée » ou Secure Connectivity en anglais) visant à permettre une connectivité sécurisée sur tout le continent européen (y compris dans les zones blanches actuelles) sera proposé par la Commission le 9 février 2022 (). Celle-ci espère pouvoir lancer des appels d’offres d’ici la fin de l’année, pour une mise en œuvre à l’horizon 2024.
Recommandation n° 13 : Accélérer la mise en œuvre des grands programmes spatiaux européens, dont le projet de constellation européenne.
Plus largement, les rapporteurs sont attentifs à l’ensemble de la chaîne de valeur de la donnée numérique, depuis sa production, à son traitement en passant par son stockage dans un cloud sécurisé et souverain. L’ambition stratégique d’une constellation européenne et indépendante ne vaut que si toute la chaîne des données numériques est sécurisée. À ce titre, ils souhaitent reprendre les inquiétudes de leurs collègues Alain David et Marion Lenne dans le rapport sur Les géants du numérique, présenté à la commission des affaires étrangères le 2 juin 2021, à propos notamment de la faiblesse de l’Union européenne sur ce secteur.
Plus généralement, la France doit promouvoir une hausse des crédits européens dédiés à l’espace. Elle doit notamment plaider pour une augmentation des commandes européennes institutionnelles pour la construction de satellites, les lancements européens () et l’économie de la donnée. Ces commandes de produits ou de services sont indispensables pour que les entreprises européennes mûrissent et deviennent plus compétitives. La France doit aussi défendre le financement de projets innovants, y compris parfois des projets au stade de « business model », comme cela a pu être le cas avec la start-up Clear Space.
Recommandation n° 14 : Plaider pour une augmentation du budget spatial européen pour augmenter le volume des commandes institutionnelles et financer des projets innovants.
Enfin, il apparaît nécessaire de moderniser le Centre Spatial Guyanais (CSG) pour continuer à attirer les clients institutionnels et privés. Le renouvellement des contrats de la base vers l’année 2024 pourrait être l’occasion d’engager une réflexion sur cette thématique. Les entreprises pourraient être sollicitées pour contribuer davantage au financement de nouvelles infrastructures et pour digitaliser le site. En contrepartie, elles auraient la garantie de pouvoir utiliser le site plusieurs années.
Recommandation n° 15 : Moderniser le Centre Spatial Guyanais en mobilisant des fonds publics et privés.
2. Faire émerger un droit européen des opérations spatiales reposant sur l’expérience française
Au sein de l’Union européenne, de nombreux types de droits nationaux des activités spatiales existent (Allemagne, Belgique, France, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, etc.). Ces droits sont disparates, non seulement sur leur champ d’application, mais aussi sur le fond du droit (lancement, opération en orbite, différences de procédures d’autorisations, divergences dans les références techniques ou dans la gestion des débris spatiaux, etc.). Il est donc impératif de créer une réglementation commune à l’échelle de l’Union européenne pour simplifier les processus et pour faire de l’Union une véritable puissance spatiale.
Or, la France est l’un des États pionniers en matière de droit des opérations spatiales avec la loi du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales (dite « LOS », n° 2008-518). Extrêmement précise et ambitieuse, cette loi est un outil de régulation et de respect de l’environnement très important. Mais les exigences demandées par la loi française grèvent la compétitivité des seules entreprises françaises qui y sont soumises et rendent plus difficile la concurrence avec les entreprises étrangères ().
Les rapporteurs plaident pour une transposition de la LOS en directive européenne afin de faire bénéficier l’Union européenne de ces orientations juridiques, et pour que ce droit forme la base commune de droit des opérations spatiales. In fine, le droit européen pourra servir de base pour les discussions internationales.
Recommandation n° 16 : Transposer la loi n° 2008-518 relative aux opérations spatiales (dite « LOS ») en directive européenne puis défendre le droit européen dans les instances internationales.
3. Proposer une stratégie spatiale commune en matière de sécurité et de défense
Le programme de la PFUE prévoit également que la France « contribuera également aux travaux pour doter l’Union d’une stratégie spatiale en matière de sécurité et de défense ainsi qu’à la feuille de route sur les technologies critiques et la réduction des dépendances stratégiques ». Dans un contexte de militarisation et d’arsenalisation de l’espace, il apparaît indispensable que l’Union européenne élabore rapidement une stratégie. La publication de la stratégie spatiale en matière de sécurité et de défense étant initialement prévue pour la fin de l’année 2023, les rapporteurs souhaiteraient une accélération des discussions.
La Commission européenne a prévu une communication sur la thématique le 9 février 2022.
Recommandation n° 17 : Définir une stratégie spatiale commune en matière de sécurité et de défense avant la fin de l’année 2022.
Au-delà de cette stratégie, l’Europe doit disposer d’une autonomie stratégique pour la surveillance des activités spatiales et le suivi des débris spatiaux, qui peuvent impacter ses activités civiles comme militaires.
Certains pays européens, dont la France et l’Allemagne, disposent de capacités propres de surveillance de l’espace, auxquelles s’ajoutent des dispositifs européens. Le programme European Union Space Surveillance and Tracking (EU SST) évalue notamment les risques de collision, suit les rentrées d’objets spatiaux dans l’atmosphère terrestre et détecte et caractérise les fragmentations en orbite. Ce programme doit intégrer de nouveaux États et être renforcé. Surtout, la base de données européenne créée il y a deux ans et qui partage chaque jour des milliers de mesures sur les objets spatiaux doit être consolidée. Les pays qui disposent de capacités de surveillance devraient partager davantage de données (). L’Europe doit aussi investir pour se doter de capteurs plus nombreux et plus performants pour détecter davantage d’objets spatiaux, notamment les débris les plus petits.
Recommandation n° 18 : Développer un système européen de surveillance des activités spatiales et de suivi des débris spatiaux autonome des États-Unis en encourageant le partage de données entre les États et en investissant dans de nouveaux équipements.
Une proposition similaire pourrait également être formulée pour l’action dans l’espace mais la politique de sécurité et de défense commune (PSDC) reste encore difficile à mettre en œuvre concrètement et la défense européenne continue à reposer avant tout sur les initiatives nationales, notamment françaises ().
4. Clarifier la répartition des rôles entre les États membres, l’Agence spatiale européenne et les institutions européennes
Le processus de décision est aujourd’hui alourdi par la complexité de la gouvernance spatiale en Europe, malgré les avancées notables des derniers textes européens. Le lancement et le déroulement des programmes se trouvent alors ralentis.
Les rapporteurs ne peuvent qu’espérer que le considérant 42 du règlement n° 2021/696 se réalise : « Une bonne gouvernance publique du programme requiert une répartition claire des responsabilités et des tâches entre les différentes entités concernées, afin d’éviter les chevauchements inutiles et de réduire les dépassements de coûts et les retards ».
D’autre part, les rapporteurs se questionnent quant au rôle du Royaume-Uni dans la politique spatiale européenne. Le Royaume-Uni reste membre de l’ESA alors qu’il a quitté l’Union européenne, ce qui crée une méfiance entre les acteurs et pose question quant à la continuité de l’engagement financier du Royaume-Uni sur certains programmes.
Recommandation n° 19 : Clarifier la répartition des tâches et des responsabilités entre les États membres, l’ESA et l’Union européenne (Commission européenne, Service européen pour l’action extérieure et EUSPA).
La PFUE et la prochaine conférence ministérielle de l’ESA doivent être l’occasion de traiter cette question.
5. Instaurer un véritable principe de préférence européenne contraignant pour l’utilisation des lanceurs européens
Les autres grandes puissances spatiales – les États-Unis, la Chine, le Japon, la Russie – favorisent leurs lanceurs nationaux, au moins pour les missions institutionnelles. Face à une concurrence faussée et pour préserver l’autonomie européenne, il apparaît indispensable d’inclure un principe de « préférence européenne » véritablement contraignant pour l’utilisation des lanceurs européens pour les missions institutionnelles dans les textes juridiques européens, qu’il s’agisse de l’ESA ou de l’Union européenne (un « Launch European Act » ()).
Recommandation n° 20 : Instaurer un principe de préférence européenne contraignant pour l’utilisation des lanceurs européens pour les missions institutionnelles des États membres de l’Union européenne et de l’ESA.
Au-delà de ce principe, il est également nécessaire d’engager une réflexion plus globale sur l’ensemble des mesures juridiques qui pourraient contribuer à la création de start-up ou à la consolidation des entreprises les plus stratégiques. Il apparaît par exemple pertinent de leur garantir l’accès aux marchés publics européens, comme c’est le cas aux États-Unis. Les députés Maud Gatel et Didier Quentin ont proposé dans leur rapport d’information sur l’autonomie stratégique de l’Union européenne, présenté à la commission des affaires étrangères le 2 juin 2021, d’« adopter dans les meilleurs délais, un « Small Business Act » européen » (proposition n° 12). De même, instaurer un « Buy European Act » pourrait être nécessaire. Ce type de mesures bénéficierait à l’ensemble des industries européennes, dont les industries critiques que constituent le spatial et le numérique.
6. Lancer un débat européen sur l’assouplissement de la règle du « retour géographique »
La règle du retour géographique, très rigide, complexifie et ralentit les programmes spatiaux européens. Certains acteurs ont démontré aux rapporteurs l’incohérence économique de cette règle, tout en maintenant l’idée de son importance diplomatique. Dans ce contexte, la France doit continuer à plaider pour une évolution de cette règle. Si une demande de changement radical a peu de chance d’aboutir, un appel pour une plus grande flexibilité apparaît indispensable.
La France peut au minimum demander que ce soit davantage utilisé le dispositif de « juste contribution » pour les futurs programmes spatiaux européens. Ce dispositif, déjà mis en œuvre dans des projets relatifs aux télécommunications tels que NEOSAT ou FLEXSAT, laisse le champ libre aux industriels pour s’organiser, le retour géographique évoluant au fil du projet. Il ajuste les contributions de chaque État au juste besoin dès les premières phases du programme, en parallèle de la constitution du consortium industriel.
Recommandation n° 21 : Proposer un assouplissement de la règle du « retour géographique » lors de la prochaine conférence ministérielle de l’ESA ou, à défaut, une utilisation plus large du dispositif de « juste contribution ».
Si la France sera probablement isolée sur cette thématique, comme elle l’a été par le passé, la conférence ministérielle de l’ESA doit malgré tout être l’occasion de proposer un modèle différent, plus performant.
7. Relancer la réflexion sur le vol habité
L’Europe a fait le choix de dépendre de la coopération internationale pour le vol habité, à la différence des États-Unis, de la Russie et la Chine. Priver l’Europe de cette capacité pose question dans un contexte où les projets en orbite basse et les projets d’exploration de la Lune et de Mars se multiplient.
Comme l’ont confirmé plusieurs personnes auditionnées, le vol habité présente un intérêt technologique mais aussi une dimension symbolique très forte. Il fait rêver le grand public comme les équipes scientifiques. Il assurerait une activité au CSG sur plusieurs années. Surtout, il devient aujourd’hui incontournable et l’Europe pourrait perdre de l’influence si elle n’est pas autonome sur ce sujet.
Lors de la conférence sur l’exploration spatiale (GLEX2021) organisée par la Fédération internationale d’astronautique (IAF) à Saint- Pétersbourg du 14 au 18 juin 2021, un groupe de travail mené par la direction des lanceurs du CNES a présenté une étude démontrant que l’Europe pourrait et devrait se doter d’un véhicule spatial habité pour l’orbite basse. Elle maîtrise déjà les technologies nécessaires pour le développer et Ariane 6 pourrait être adaptée pour le lancer depuis le CSG à Kourou ().
Le coût du développement, le temps nécessaire (jusqu’à huit ans selon l’étude) et la difficulté à rivaliser en termes de prix avec les capsules russes Soyouz et américaine Crew Dragon (SpaceX) représentent néanmoins des freins importants.
Dans tous les cas, compte tenu des enjeux, il apparaît nécessaire de débattre de la question lors de la prochaine conférence ministérielle de l’ESA organisée en novembre 2022.
Recommandation n° 22 : Débattre d’un éventuel programme de véhicule spatial habité européen lors de la prochaine réunion ministérielle de l’ESA.
*
Pour conclure ce volet spécifiquement européen des propositions du rapport, les rapporteurs souhaitent rappeler que si la présidence française doit constituer un nouvel élan pour le spatial européen, il ne pourra être efficace que s’il est repris par les autres États. Il apparaît en particulier fondamental que la France, en tant qu’État présidant le Conseil de l’Union européenne et ouvrant un nouveau « trio », c’est-à-dire un cycle de trois présidences, fasse le maximum pour impliquer dès à présent les deux États membres qui suivront la présidence française au second semestre 2022 et au premier semestre 2023, c’est-à-dire la République tchèque et la Suède. Ces deux pays sont également membres de l’ESA.
Recommandation n° 23 : Faire en sorte que la République tchèque et la Suède, qui sont les deux États qui composent le trio de présidence du Conseil de l’Union européenne jusqu’en juin 2023, soient constamment intégrées au travail de la France sur le spatial européen afin que ces sujets soient portés au plus haut niveau durant tout le trio de présidence.
C. au niveau multilatéral : œuvrer pour garantir à tous un accès À l’espace
Dans un contexte où l’espace devient un théâtre des tensions internationales, il est plus que jamais nécessaire de promouvoir le multilatéralisme.
1. Agir pour permettre à tous les États d’accéder à l’espace
Le spatial est devenu indispensable au développement dans toutes ses dimensions (économique, social, environnemental).
Ainsi, de grands acteurs internationaux du développement () commencent à intégrer les outils spatiaux dans leurs stratégies et leurs projets. L’Agence française de développement (AFD) a mis en œuvre plusieurs projets utilisant les données spatiales, par exemple pour le suivi des forêts tropicales (Afrique de l’Ouest et Centrale notamment), l’hydrologie (bassin du Congo) ou la compréhension des phénomènes d’érosion côtière à Saint-Louis du Sénégal. Elle a également créé un poste de coordinateur de la stratégie géospatiale à la fin de l’année 2021 (), au sein de sa direction des opérations. En outre, au début de l’année 2022, l’accord-cadre de partenariat entre le CNES et l’AFD sera renouvelé pour la période 2022-2023 et deviendra plus ambitieux (apports de 1,5 million d’euros en équivalent temps/hommes du CNES et de 150 000 euros de l’AFD). L’objectif est d’améliorer la qualité et l’efficacité des projets portés par l’AFD en incluant les données d’observation de la Terre recueillies par les satellites du CNES.
À l’avenir, l’aide publique au développement pourrait aussi contribuer à financer des satellites et des lancements. Comme l’a indiqué en audition la directrice du BAS, Mme Simonetta di Pippo, plus de la moitié des États membres de l’ONU n’ont jamais eu de satellite dans l’espace. Plus généralement, de nombreux pays ne disposent pas encore d’économie spatiale ou celle-ci émerge à peine.
Cette proposition doit être rapprochée de deux propositions du rapport sur les Géants du numérique présenté par M. Alain David et Mme Marion Lenne à la commission des affaires étrangères le 2 juin 2021 : « Faire du numérique un axe structurant de la coopération bilatérale française et européenne avec l’Afrique, afin de contribuer à la consolidation d’une souveraineté numérique africaine » (proposition n° 20) et « Œuvrer, en associant l’Agence française de développement, à l’émergence d’une réflexion commune avec nos partenaires européens et africains sur le développement des communs numériques » (proposition n° 21).
Elle doit aussi être associée aux efforts menés par notre agence spatiale nationale, le CNES, pour développer des partenariats avec des pays en développement. Le CNES doit absolument poursuivre cette politique.
Recommandation n° 24 : Utiliser l’aide publique au développement et les partenariats entre les agences spatiales pour permettre à tous les États candidats d’accéder à l’espace.
2. Proposer de nouvelles normes pour assurer la soutenabilité des activités spatiales
Pour assurer la pérennité des activités spatiales, la partie du II du rapport a démontré la nécessité d’établir plus de normes et de formes de régulation à l’échelle internationale.
Une meilleure gestion du trafic spatial (« Space traffic management » en anglais, STM) apparaît tout d’abord indispensable. Celle-ci passe par un système de surveillance de l’espace (voir les propositions supra), mais aussi par la réglementation. La stratégie menée par le CNES est d’encourager la création de normes internationales en utilisant un groupe de travail sur le STM au sein de l’European Cooperation for Space Standardization (ECSS) pour essayer d’internationaliser les normes présentes dans la réglementation française, mais aussi en travaillant sur les normes ISO. De plus, le CNES souhaite former un collectif de régulateurs pour discuter des exigences techniques de conception et des processus de délivrance des licences de vol, afin d’aboutir à des réglementations nationales équivalentes et à une reconnaissance mutuelle des autorisations.
Au-delà de ces initiatives indispensables, la France et l’Europe doivent être plus actives au CUPEEA sur cette thématique pour, à terme, créer un système de gestion internationale du trafic spatial. L’Union européenne doit préparer une position commune de ses États membres sur cette thématique pour pouvoir ensuite la défendre d’une même voix lors des négociations internationales. Elle semble aujourd’hui engagée à y parvenir.
Recommandation n° 25 : Renforcer toutes les initiatives européennes et internationales de la France en faveur d’une meilleure gestion du trafic spatial (Space Traffic Management, STM).
Recommandation n° 26 : Définir au préalable une position européenne commune sur ce sujet avant la fin de la PFUE.
Face à l’inflation du nombre de satellites, notamment en orbite basse, se pose la question des fréquences utilisées par les satellites afin de communiquer avec les installations terrestres.
L’Union Internationale des Télécommunications (UIT) est l’institution internationale qui valide les demandes faites par les instances nationales responsables des fréquences. Son mandat se limite à vérifier la compatibilité technique de la demande. Si une fréquence est disponible, elle ne peut que l’attribuer, sans pouvoir émettre d’avis sur le bien-fondé de la demande, ni sur l’équilibre international des différentes demandes en fonction des pays. L’UIT ne peut pas non plus sanctionner un acteur s’il utilise une fréquence différente de celle demandée. L’UIT est donc à la fois actrice et spectatrice de cette course aux constellations et, donc, aux meilleures fréquences.
Recommandation n° 27 : Repenser le rôle de l’Union Internationale des Télécommunications (UIT) pour construire une infrastructure de télécommunications spatiales plus durable et mieux partagée.
L’augmentation exponentielle du nombre de débris spatiaux, qui fait peser un risque sur l’exploitation des orbites terrestres, doit, elle aussi, être traitée spécifiquement par la communauté internationale. Le droit des activités spatiales actuellement en vigueur n’est pas équipé pour y répondre (voir partie II.B.2.a). Il n’existe tout d’abord pas de définition précise et unifiée des débris spatiaux, ce qui représente un obstacle majeur dans les discussions internationales sur le sujet.
De plus, le CUPEEA a élaboré des lignes directrices sur la viabilité à long terme des activités spatiales, mais celles-ci ne sont par nature pas contraignantes et ne sont donc pas encore suffisamment mises en œuvre par les États. Dans ce contexte, la France doit à la fois promouvoir leur application à l’échelle nationale et internationale, mais aussi aller plus loin en essayant de négocier un cadre juridique contraignant qui garantirait une utilisation durable des orbites terrestres.
Recommandation n° 28 : Négocier l’adoption d’une définition simple et unifiée des débris spatiaux par l’ONU.
Recommandation n° 29 : Négocier un traité international contraignant sur la limitation et la récupération des débris spatiaux au sein de l’ONU.
Un lien direct doit aujourd’hui être fait entre la soutenabilité des activités spatiales et l’arsenalisation de l’espace. Il apparaît nécessaire d’envisager une discussion sur la prolifération d’armes de très hautes technologies qu’il s’agirait d’interdire ou de limiter dès maintenant, au premier rang desquels les missiles antisatellites, qui forment une menace non pas seulement pour l’État visé, mais également pour la pérennité de l’orbite basse terrestre. La possibilité pour un État de rendre inutilisable cette dernière est un risque qui ne devrait pas être pris.
Recommandation n° 30 : Œuvrer à un traité d’interdiction des missiles ASAT et, plus largement, à une réflexion multilatérale autour de la militarisation et de l’arsenalisation de l’espace.
L’exploitation des ressources spatiales nécessite également un débat multilatéral. Un groupe de travail a été créé au sein du sous-comité juridique du CUPEEA. La France doit y être plus active, sans nécessairement suivre la doctrine américaine libérale sur l’exploitation des ressources imposée par les Accords Artemis.
L’Accord régissant les activités des États sur la Lune et les autres corps célestes de 1979, dit « traité de la Lune », qu’aucune puissance spatiale n’a ratifié est un échec diplomatique qu’il faut désormais dépasser. Les deux seules puissances à l’avoir signé, mais pas ratifié, sont la France et l’Inde. Ce traité doit être repris et renégocié au regard des nouveaux enjeux permis par les évolutions technologiques et des ambitions de chacune des puissances spatiales d’aujourd’hui. La question de l’exploitation des ressources lunaires devra être clarifiée.
Recommandation n° 31 : Utiliser le CUPEEA pour établir un régime juridique mondial sur l’exploitation des ressources spatiales.
Recommandation n° 32 : Envisager une révision du « Traité sur la Lune » de 1979 dans le cadre de cette nouvelle réflexion sur l’exploitation des ressources spatiales.
Pour accomplir ces différentes tâches, la France doit disposer d’équipes suffisantes. Il apparaît à cet égard indispensable de renforcer les équipes diplomatiques et les personnels du CNES affectés aux négociations internationales sur le droit de l’espace extra-atmosphérique. La Représentation permanente de la France auprès de l’Office des Nations unies et des organisations internationales à Vienne ne dispose pas d’un diplomate à temps complet. Or, cela semble être un minimum. De même, les équipes du CNES mobilisées pour le CUPEEA pourraient aussi être renforcées.
Au début de l’année 2021, la France mettait à disposition du Bureau des affaires spatiales de l’ONU une « jeune experte associée » pour la section UN-SPIDER et le SCO. La France doit aussi continuer à financer ce poste.
Recommandation n° 33 : Renforcer les équipes françaises qui participent aux négociations juridiques internationales sur le droit de l’espace extra-atmosphérique.
Pour conclure, les rapporteurs estiment que l’espace est un lieu très peu régulé, et que le droit des activités spatiales ne correspond plus aux dynamiques actuelles. L’espace forme, avec la mer – haute mer et fonds marins, et l’Antarctique – le triptyque des lieux non habités où le droit est du ressort de la communauté internationale, et où l’équilibre entre les différents usages de ces lieux se pose régulièrement.
La Convention des Nations unies sur le droit de la mer de Montego Bay de 1982, et son Tribunal international du droit de la mer, qui régule les différends entre les usagers, pourraient être des modèles à suivre. De même, le Traité sur l’Antarctique, si influent pour le droit de l’espace dans les années 1960 et 1970, avec son Secrétariat qui assiste les régulières réunions consultatives, pourrait également être au cœur de la création d’un nouveau mécanisme de la coopération spatiale internationale.
Par conséquent, les Nations unies pourraient relancer une dynamique de convention internationale visant à rebâtir un consensus mondial autour des usages de l’espace. La France, en tant qu’acteur majeur, et coopérant avec toutes les puissances spatiales du monde, pourrait être l’hôte d’un tel événement.
À plus long terme, il pourrait même utile de regrouper toutes les problématiques spatiales sous l’égide d’une seule institution internationale. Celle-ci assurait un traitement transversal des problématiques liées au spatial, gérerait les différends, actualiserait le droit, voire encadrerait la coopération internationale sur le suivi et la gestion des objets spatiaux (actifs ou sous forme de débris) et du trafic spatial.
Recommandation n° 34 : Organiser une conférence de haut niveau à Paris, en lien avec l’ONU, sur le thème des nouveaux enjeux spatiaux et de la coopération internationale.
N° 4991