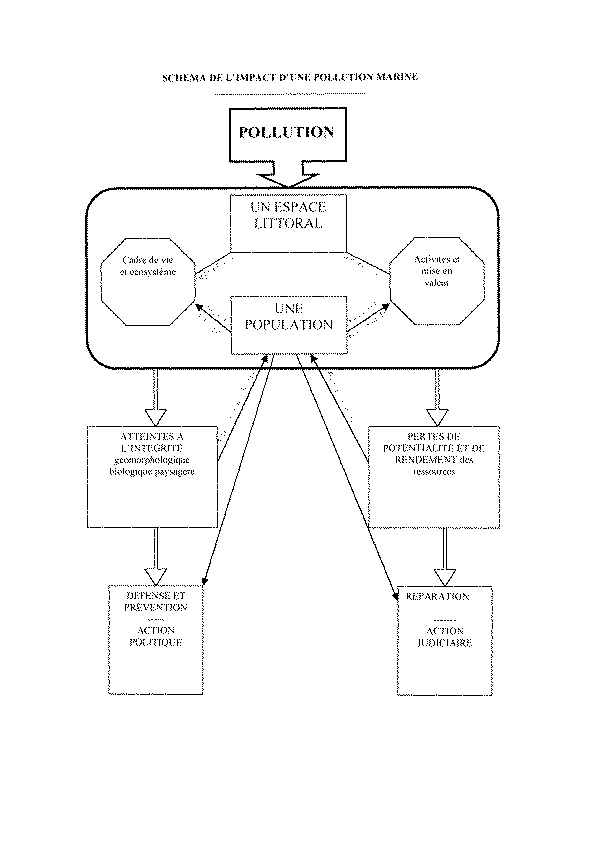Audition de M. Georges TOURRET,
directeur du Bureau enquêtes-accidents-mer,
et de M. Jean-Louis GUIBERT,
secrétaire général de l'Institut français de navigation,
auteurs d'une contribution provisoire au rapport d'enquête
sur le naufrage du navire-citerne Erika
(extrait du procès-verbal de la séance du 9 février 2000)
Présidence de M. Daniel PAUL, Président
MM. Georges TOURRET et Jean-Louis GUIBERT sont introduits.
M. le Président leur rappelle que les dispositions législatives relatives aux commissions d'enquête leur ont été communiquées. A l'invitation du Président, MM. Georges TOURRET et Jean-Louis GUIBERT prêtent serment.
M. Georges TOURRET : Dans un premier temps, il nous semble utile de vous rappeler aussi brièvement que possible la genèse du bureau « enquêtes accidents-mer », ses fonctions actuelles et le cadre dans lequel il travaille.
Depuis très longtemps, les ministres successifs en charge de la marine marchande avaient fait remarquer qu'il était devenu nécessaire d'avoir, au sein du ministère chargé des transports, une structure capable de leur donner, en cas d'accidents, un avis technique à la fois rapide et circonstancié. Cette structure devait revêtir un certain nombre de caractéristiques : être tout d'abord composée de techniciens ou de personnes expérimentées dans le secteur maritime et, d'autre part, présenter un certain degré d'indépendance par rapport à l'administration habituellement en charge de la mise en place des normes techniques concernant la navigation ainsi que de leur application et de leur contrôle. Cela fut fait au terme d'un processus relativement long dans un décret de 1981 relatif aux commissions d'enquête techniques et administratives qui en confiait la gestion à un bureau des enquêtes techniques et administratives après accident et autres événements de mer. Par commodité, nous avons pris l'habitude de le nommer B.E.A./mer sur le modèle de ce qui se fait depuis 1947 dans le secteur aérien avec le B.E.A./air, dont le fonctionnement a été considérablement rénové l'année dernière par l'adoption d'une loi précisant ses pouvoirs et ses modalités d'action, en application d'une convention internationale.
La base juridique du B.E.A./mer ne repose pas sur une convention internationale. En droit français, le texte à l'origine du B.E.A./mer est le décret du 20 janvier 1981. En droit international, c'est une simple résolution de l'O.M.I. du 27 novembre 1997, non obligatoire, mais recommandant aux États membres de mettre en place des enquêtes techniques pour tout accident et de le faire par le biais d'une structure permanente - ce qui fut fait par arrêté ministériel du 16 décembre 1997.
Le B.E.A./mer est composé d'un directeur et d'une petite équipe de permanents.
Le directeur est, par délégation du ministre, président de la commission permanente d'enquête sur les événements de mer, dont il désigne les membres en fonction des événements et par rapport aux caractéristiques de celle-ci.
Depuis sa création, le B.E.A./mer a conduit environ une soixantaine d'enquêtes techniques et administratives, certaines d'entre elles étant toujours en cours. L'Erika ne constitue que l'une de ces enquêtes, même si elle a retenu grande attention.
Le mécanisme d'enquête est le suivant : dès que le B.E.A./mer est informé de la survenance de l'événement, il diligente immédiatement une décision d'inscription à l'ordre du jour d'une formation
ad hoc de la commission permanente d'enquête et commence les travaux. Dans le cas de l'Erika, le C.R.O.S.S. a prévenu le B.E.A./mer de la survenance de l'événement le dimanche 12 décembre 1999 au matin, soit peu après la cassure. Immédiatement, nous avons commencé à rassembler les éléments nécessaires.
Le rassemblement des informations se conclut, du moins dans une première phase, par un rapport provisoire, remis au ministre. Dans le cas de l'Erika, alors que cela ne se pratiquait pas habituellement - mais rien ne l'interdisait, au contraire -, le ministre en charge des transports maritimes a décidé de rendre public le rapport provisoire. Il nous a demandé d'organiser une conférence de presse et de porter à la connaissance du public les conclusions provisoires auxquelles nous sommes parvenus. J'insiste sur le caractère provisoire de ces conclusions.
Le champ d'application et le domaine de compétences du B.E.A./mer concernent d'une part, l'ensemble des navires français, quel que soit leur type - les navires militaires exceptés -, auxquels il arriverait un accident où qu'ils soient dans le monde, d'autre part, tous les navires étrangers dans les eaux territoriales françaises, et enfin, par application des dispositions pertinentes de la résolution de l'O.M.I. précitée et de la convention internationale du droit de la mer, les navires étrangers susceptibles de provoquer une pollution du littoral français ou impliquant des ressortissants français, soit en tant que passagers, soit en tant que membres de l'équipage, soit pour toute autre raison, dans l'événement de mer en question. Lorsque le cas s'est posé au sujet de l'Erika, navire battant pavillon maltais en eaux internationales et sur lequel il n'y avait aucun ressortissant français, nous avons établi notre compétence non seulement sur la base du risque de pollution du littoral français, telle qu'elle est prévue par le décret de 1981, mais également sur celle de la nationalité de l'affréteur final, bien que l'affréteur direct ne soit pas une société de droit français.
Pour évoquer l'incident de l'Erika lui-même, il convient de scinder le problème. Lorsque nous avons pris connaissance de l'ensemble des premiers éléments, deux ou trois points nous ont interpellés.
Le premier groupe de questions concerne la propriété, les acteurs, les affréteurs du navire. Le deuxième, dont M. Guibert traitera à ma suite, concerne le navire lui-même. A quel type de navire avions-nous affaire ? Quel était son état ? Quelles étaient ses conditions d'armement ? Le troisième aspect, que traitera également M. Guibert, est le dernier voyage de l'Erika, la façon dont il s'est présenté, les comportements des différents acteurs.
M. le Rapporteur : Le prérapport fait apparaître des zones floues. Votre exposé portera-t-il à notre connaissance des éléments nouveaux ?
M. Georges TOURRET : Des éléments flous ont été éclaircis, d'autres le sont restés. Nous vous préciserons au cours de notre exposé ce qu'il en est aujourd'hui. Tous les jours qui passent, nous complétons nos renseignements et nos calculs. En conséquence, le rapport définitif intégrera des éléments nouveaux par rapport à ceux qui figurent dans le rapport provisoire, arrêté le 13 janvier, ainsi que par rapport à ceux que nous exposerons aujourd'hui en complément.
M. le Rapporteur : A quelle date rendrez-vous le rapport définitif ?
M. Georges TOURRET : Monsieur le ministre, j'ai été votre collaborateur ; je vous répondrai très franchement : nous le rendrons quand nous aurons fini !
Des incertitudes resteront pendantes un certain temps encore. Nous prendrons connaissance d'informations nouvelles au fur et à mesure que les sociétés de classification nous transmettront leurs dossiers. Par ailleurs, il est un point sur lequel nous ne maîtrisons pas le calendrier : l'état et l'exploration de l'épave, car l'objet du corpus delictis, encore que je n'aimerais pas que l'on emploie cette formule, est au fond de l'eau par 120 mètres. Son exploration pose de nombreux problèmes. Les mesures d'épaisseur de tôle sous l'eau ne sont pas simples ; l'examen de l'état de l'épave non plus. Par conséquent, un certain nombre d'incertitudes subsiste.
A quelle date rendrons-nous le rapport ? Dans quatre à six mois. Nous aimerions avoir fini cet été. La durée de nos enquêtes ne dépasse pas un an ; elle évolue entre six mois et un an. Il est rare que l'on puisse boucler une enquête en six mois, même lorsqu'il s'agit d'un modeste chalutier. Nous essayons de ne pas dépasser l'année. Nos collègues étrangers mettent quelquefois plus de temps que nous. L'enquête technique définitive sur l'Estonia
a duré trois ans. Dans le cas de l'Erika, nous rencontrons un problème relationnel avec l'Etat maltais qui, semblerait-il, procède à sa propre enquête sans pour autant nous avoir transmis pour l'heure toutes ses informations.
Revenons-en aux acteurs directement impliqués dans l'exploitation de l'Erika.
Les transports maritimes mettent en présence les acteurs principaux que sont un chargeur et un transporteur. En l'espèce, le chargeur a été assez facile à identifier dès le départ. La compagnie Total n'a pas hésité à reconnaître qu'elle était le chargeur de la marchandise, ni à nous donner des détails sur la marchandise et sur sa propre séquence d'affrètement, certes complexe, mais qui répond aux normes habituelles du marché des pétroles et des produits pétroliers plus spécialement.
De quel produit s'agissait-il ? D'un produit standard, le fioul n°2, qui est un bas de colonne de distillation dans l'industrie pétrolière. Il s'agit d'un résidu de distillation, non au sens de résidu tel qu'on pourrait l'entendre, mais un produit qui fait l'objet d'échanges internationaux importants, car il s'agit d'un produit fatal dans la production du pétrole qui n'est pas forcément consommé là où il est produit. Globalement, l'Europe du nord est plutôt excédentaire alors que l'Europe du sud est plutôt déficitaire, ce qui engendre des va-et-vient permanents de produits pétroliers. A cet égard, je rappelle qu'il ne s'agit pas de pétrole brut, mais d'un produit distillé. Un pétrole brut est une substance très complexe, dans laquelle entrent toutes sortes de molécules de divers hydrocarbures.
Le pétrole, une fois raffiné, se décompose globalement, en trois catégories : les gaz, qui donnent lieu à un transport maritime ou terrestre très spécialisé ; les produits que l'on appelle « blancs » - l'essence, le gazole -, produits très peu polluants, mais hautement dangereux à transporter et surtout très exigeants en termes de qualité de transport ; enfin, les produits « noirs », autrement dit les fiouls n° 1 - destinés à la propulsion des navires -, les fiouls n°2 - destinés globalement aux centrales électriques, encore moins exigeantes - , et les goudrons, dont l'utilisation est tout à fait particulière.
Nous avons donc affaire à un produit relativement polluant en l'absence d'évaporation naturelle ; en outre, il est collant. Il présente donc des caractéristiques physiques qui le rendent difficile à traiter. En revanche, sa dangerosité est relativement faible, en tout cas s'agissant de son transport puisqu'il n'est pas immédiatement combustible et qu'il est peu volatile. Par conséquent, il est plutôt moins exigeant en termes de qualité de transport, même si pour être pompé et transporté, il doit, comme tout « produit noir », être réchauffé. Autrement dit, les « produits noirs » doivent être transportés dans des navires disposant d'une capacité de réchauffage. Le fioul de l'Erika était transporté à la température de 55°-65° Celsius pour le pompage. Suivant les qualités du fioul, on doit régler la chaleur ambiante des cuves de façon plus ou moins élaborée pour simplement être en mesure de le pomper et de le traiter. Les raffineries du nord de l'Europe, en particulier celles de Dunkerque, sont fortement exportatrices, principalement à destination de l'Europe du sud, de ce produit. Elles sont exportatrices, car il n'existe pas d'usage local, dans la mesure où ce produit sert surtout à la production d'électricité alors que la zone nord est fortement productrice d'électricité par un autre moyen.
La société Total commercialise ce produit par l'intermédiaire de sa filiale internationale, Total Trading, installée nominalement aux Bahamas et gérée depuis Londres. C'est Total Trading qui a choisi l'affrètement de l'Erika, lequel s'est décidé sur le marché international au spot - c'est-à-dire pour un voyage - et sur la base d'un contrat de vente relativement original et assez responsable. La société Total n'a pas vendu son fioul « F.O.B. », elle ne l'a pas non plus vendu « C.A.F. », mais « D.D.U. », c'est-à-dire délivré à destination.
« F.O.B. » signifie que la vente s'effectue au départ du port, l'acheteur décidant d'assurer la responsabilité du transport. Il existe plusieurs modèles de vente à destination. Dans le cas qui nous occupe, il s'agissait d'une vente à destination, où l'expéditeur assurait le transport sous sa responsabilité. Entre les deux, le mode « C.A.F. » est très répandu dans le domaine maritime : c'est une vente au départ, mais dont le fret est traité par l'expéditeur pour le compte du destinataire, le transfert de propriété s'opérant au moment du port d'embarquement, bien que ce soit l'expéditeur qui a vendu la marchandise qui affrète le navire.
Dans le cas d'espèce, tout cela est juridiquement clair. Total a vendu à destination la marchandise qui lui appartenait à bord de l'Erika, le transfert de propriété ne devant se réaliser qu'au port d'arrivée. L'acheteur était Enel. La société Enel est une société d'Etat italienne, l'équivalent d'EDF et gros producteur d'électricité. La charte partie, c'est-à-dire le contrat d'affrètement, prévoyait un large éventail de destinations. En effet, elle prévoyait n'importe quel port d'ouest Méditerranée. Toutefois, le connaissement, ou bon de réception de la marchandise, prévoyait le port de Milazzo en Sicile ou celui de Livourne. Alternativement, les deux destinations furent affichées. Cela ne présentait guère d'importance, puisque, de toute façon, l'affréteur avait la possibilité de retenir, soit l'une, soit l'autre.
Une chose est sûre : la cargaison appartenait à Total. Le navire a été affrété par l'intermédiaire de deux courtiers : un courtier londonien et un courtier vénitien, donc italien, dont le nom sera repris dans le rapport définitif. Il était le courtier de l'armateur disposant du navire, comme c'est très souvent le cas. L'opération a donc mis en présence un courtier armateur et un courtier chargeur. L'examen de la charte parties et des connaissements de l'ensemble des dispositifs n'a pas appelé spécifiquement notre attention.
Au moment de l'événement, le navire avait un « armateur disposant », c'est-à-dire une personne qui en avait la responsabilité commerciale. Il s'agissait d'une société installée aux Bahamas : Selmont International, dont le siège réel d'exploitation se trouve à Lugano dans les locaux de son agent en Europe, la société Amarship, qui, elle, donnait les ordres.
Selmont lui-même a affrété le navire à temps à une entité sur laquelle nous n'avons pas encore pu mettre un nom de raison sociale, mais qui appartenait à la mouvance de M. Savarese, armateur napolitain, mais résidant à Londres. M. Savarese possédait l'Erika par l'intermédiaire de la société Tevere Shipping à Malte, laquelle société a semble-t-il deux actionnaires, deux personnes morales installées au Liberia, information que nous avons obtenue par la presse, mais qui n'est pas encore confirmée par les autorités maltaises.
Le groupe Savarese est complexe. Comme c'est souvent le cas en Italie ou en Europe, il s'appuie sur une dynastie familiale : M. Alberto Savarese, dont je ne connais pas tous les actifs, et M. Giuseppe Savarese, propriétaire direct - nous l'espérons du moins, car il se peut qu'il existe d'autres intermédiaires -, de trois autres navires-pétroliers, tous deux gérant une partie de l'entreprise dont ils sont les héritiers.
Ce montage nous a paru complexe, mais il est assez traditionnel dans la navigation pétrolière, surtout pour les bateaux de petite taille. A tort ou à raison, j'ai choisi - en l'occurrence, s'agissant d'un choix personnel, je l'assume - d'indiquer les noms des personnes en cause dans le rapport, même si j'emploie parfois le conditionnel, tout en indiquant que des interrogations se posent et qu'il convient de procéder à des vérifications. Il est apparu que deux des personnes citées dans le rapport provisoire ont formulé des objections sur son contenu au sujet de la propriété de l'Erika. Contrairement à ce qu'avaient fait savoir un certain nombre d'organes de presse londoniens, M. Vitiello a indiqué qu'il n'était en rien impliqué dans la propriété de ce navire. Quant à M. Savarese, après avoir indiqué qu'il était simplement agent de la société Tevere Shipping, propriétaire nominal, il a finalement reconnu le 21 janvier qu'il était le propriétaire effectif des structures financières assurant le portage de la propriété de l'Erika et de trois autres navires : le
Zagara, le Maria S et le Luigi S.
M. le Rapporteur : Tous sont sous pavillon maltais ?
M. Georges TOURRET : Tous les quatre, oui.
Une fois ces informations obtenues, il s'agissait de savoir qui exerçait réellement la gestion opérationnelle du navire, que nous appelons « la gestion nautique ».
Autrement dit, la gestion financière de l'ensemble était assurée par M. Savarese et ses entreprises, la gestion commerciale avait été déléguée à Selmont Amarship, armateur disposant situé à Lugano. Il restait à identifier l'intermédiaire, celui qui assurait la gestion nautique, ce qui comprend l'exploitation technique du navire, son entretien, ses réparations, l'installation de l'équipage à bord. En l'occurrence, il s'agit d'une entreprise installée à Ravenne, dont le propriétaire est M. Antonio Pollara et dont les deux actionnaires principaux sont, d'une part, la famille de M. Pollara, et d'autre part, M. Lucas Vitiello, précédemment cité, qui, effectivement, n'était pas armateur, mais copropriétaire du gestionnaire. Panship est un
ship manager, un gestionnaire nautique. La société existe depuis une dizaine d'années et détient principalement des pétroliers et des transporteurs de produits en gestion. Ils sont un certain nombre : les quatre précités, dans la mouvance de M. Giuseppe Savarese ; une demi-douzaine dans la mouvance personnelle de M. Lucas Vitiello, sous pavillon italien, et non maltais ; et d'autres navires de moindre importance. Globalement, telle que nous l'avons identifiée à ce jour, la flotte gérée par Panship représente une dizaine de navires.
Panship est un ship manager comme il en existe beaucoup, ce n'est pas un très grand
ship manager comme V Ships à Monaco, qui compte environ 350 navires, ou Walley à Hong-Kong et Acomarit à Genève. C'est un
ship manager de taille réduite - même si l'on ne peut parler d'artisanat - dont l'équipe, en l'occurrence, n'est pas forcément incompétente.
La position de Panship est très importante, car c'est le responsable au titre du code ISM, code de sécurité maritime qui prévoit comment doivent être gérés les problèmes de sécurité et pas seulement comment doivent être équipés les navires. Le code ISM présente en effet cette grande nouveauté : pour la première fois, on ne s'occupe pas uniquement de l'équipement du navire, mais également de l'application des procédures de mise en _uvre de la sécurité à bord d'un navire et à l'intérieur d'une compagnie bien déterminée.
Les pétroliers sont soumis au code ISM depuis 1998. De ce fait, les armateurs doivent bénéficier d'une certification ISM, à la fois pour chaque navire et pour la société de siège. C'est à ce titre que nous reviendrons sur le rôle du gestionnaire ISM en cas d'accident lors de l'évocation du dernier voyage de l'Erika.
Il reste un aspect sur lequel je suis sûr que vous souhaitez avoir quelques précisions : les membres de l'équipage. En effet, nous avons parlé des structures, mais
quid des marins ?
Ils ont été recrutés par l'intermédiaire du correspondant de Panship en Inde auprès d'une société, qui n'est pas une société de
ship management, mais une crewing agency, c'est-à-dire un fournisseur de main-d'_uvre, une agence de placement, un marchand d'hommes, selon la terminologie soit positive, soit défavorable que l'on souhaite lui donner. Il s'agit de Herald Marine, à Bombay, agence connue en Inde pour recruter des marins indiens.
L'opinion des ship managers sur les marins indiens, notamment ceux qui naviguent en international, est plutôt bonne. Ils sont considérés comme ayant une expérience de bonne qualité. Ce sont des personnes bien formées et techniquement au point.
Généralement, avec les Indiens il est possible de composer des équipages homogènes, ce qui n'est pas toujours possible avec les Philippins par exemple. L'Inde n'est pas seulement un pays fournisseur de main-d'_uvre non qualifiée, elle fournit également des cadres navigants de bonne qualité, ce à quoi ne sont pas encore arrivés les Philippines ou d'autres pays.
Sur cette base, les prix cités dans le rapport provisoire ont été confirmés. Aucun fait nouveau n'est à mentionner à ce sujet. Tout au plus dispose-t-on d'une meilleure connaissance du rôle des acteurs les uns par rapport aux autres.
Je vous propose, si vous en êtes d'accord, de répondre à vos questions sur cette première séquence relative aux acteurs avant de passer à celle concernant le navire.
M. le Président : Tout à fait.
M. le Rapporteur : Les bateaux des propriétaires réels ont-ils déjà été en infraction ? Étaient-ils connus de certaines autorités européennes et des autorités françaises en particulier ? L'Erika
est-il un cas particulier ?
M. Georges TOURRET : Les quatre navires réputés appartenir à M. Giuseppe Savarese ont tous été visités à de nombreuses reprises et trouvés déficients au même titre que l'Erika, ni plus ni moins, plutôt moins d'ailleurs : aucun problème de structure n'a été noté. M. Guibert y reviendra lorsqu'il abordera la question des navires, mais il est à préciser que les problèmes de structures sont difficiles à repérer dans le cadre des inspections, qu'elles soient le fait des services de l'Etat du port ou des services des affréteurs, et ce avec les techniques actuelles, ou du moins avec les procédures actuelles.
Ces navires ont défrayé la chronique plusieurs fois. Deux autres des navires appartenant à M. Savarese, semble-t-il, sont à l'heure actuelle bloqués pour le non-paiement de dettes anciennes au chantier de Bjiela au Monténégro : le
Luigi S et le Zagara. Le troisième, le
Maria S, est toujours bloqué, à notre connaissance à Augusta, à la demande des autorités maltaises, à la suite d'un conflit intervenu entre l'équipage se plaignant de ne pas être payé dans les temps nécessaires et à cause d'infractions relatives à la sécurité - ne concernant pas, semble-t-il, la structure -, repérées par le Rina agissant pour le compte des autorités maltaises et avec la participation d'un inspecteur maltais. Nous n'en connaissons que ce que nous en dit la presse internationale et nous n'avons pas eu d'informations ou de communications particulières des autorités maltaises couvrant l'ensemble des navires de Panship. A ma connaissance, à l'exception de ceux qui sont sous pavillon italien, tous les navires de Panship sont sous pavillon maltais. De toute façon, ils font tous l'objet de contrôles par la société de classification Rina.
M. le Rapporteur : Les navires de Panship étaient-ils suivis par Rina depuis toujours, ou depuis le même moment que l'Erika ?
M. Georges TOURRET : Panship a pour habitude de travailler avec le Rina. Lorsque l'Erika est passé sous gestion de Panship en 1998, il en est résulté un changement de société de classification.
M. le Rapporteur : Est-ce la raison du changement de société de classification ou en existe-t-il d'autres ?
M. Georges TOURRET : Tout le monde peut se poser la question de savoir s'il existait d'autres raisons, en pensant que le Rina aurait été moins exigeant que le Bureau Véritas (B.V.). Nous n'avons pas trouvé d'éléments nous permettant de confirmer un doute de cette nature. Nous avons simplement noté qu'était intervenu un changement de société de classification au moment d'un transfert de gestionnaire. Le navire était auparavant géré par la société Star Shipping, installée en Floride, aux Etats-Unis, même si elle était nominalement en place aux Bahamas. Le navire a également, un moment donné, été commercialement géré par M. Georges Economou de Drytank à Athènes. Depuis 1998, les choses étaient relativement clarifiées. Panship le gérait. Pourquoi avoir retenu le Rina ? C'était beaucoup plus commode, et cela fut fait à un moment où des réparations importantes étaient à effectuer dans le cadre d'une visite spéciale
(special survey). Ayant eu connaissance des deux dossiers de classification du Rina et du B. V., nous ne les avons pas jugés qualitativement très différents.
M. Gilbert LE BRIS : Pour participer actuellement à une mission d'information parlementaire sur le blanchiment de l'argent, je suis très sensible à ce thème. Nous ne pouvons pas, en l'occurrence, ne pas remarquer l'imbrication des différentes sociétés, et celle des lieux où elles sont implantées. Ce genre d'embrouillaminis dans lequel se trouvent les acteurs peut s'avérer propice à ce type de man_uvre.
Selon vous, à un moment ou à un autre, un soupçon de blanchiment d'argent par l'intermédiaire des propriétaires de navires, pourrait-il naître ?
M. Georges TOURRET : La commission que nous présidons, Jean-Louis Guibert et moi-même, est une commission technique. Si nous avions acquis un tel soupçon, nous aurions utilisé les dispositions applicables aux fonctionnaires et donc informé la cellule compétente du ministère des Finances ou le procureur de la République, aux termes des dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale. Vous noterez que nous ne l'avons pas fait, et ce pour deux raisons : le procureur de la République s'est saisi lui-même directement de cette affaire ; il nous a semblé bien mieux outillé que nous-mêmes, puisqu'il peut faire jouer les commissions rogatoires internationales pour explorer la question. Voilà pourquoi nous nous sommes concentrés sur la partie technique. Je ne puis vous cacher toutefois que vos collègues du Parlement italien viennent de décider la création d'une instance interne à leur institution sur les relations entre le blanchiment de l'argent et les activités de
shipping. Il est clair que la multiplicité des structures
offshore est l'une des caractéristiques tout à la fois du
shipping et de circuits de blanchiment financier. Mais le fait que les procédures soient les mêmes ne signifie pas forcément que l'on ait les mêmes m_urs. Nous nous sommes bien gardés d'entrer sur ce terrain, car c'est, aujourd'hui, celui de la justice.
M. François GOULARD : Je souhaiterais que vous précisiez un point d'ordre strictement juridique et non pas du tout personnel.
En tant que fonctionnaire, vous êtes, à la tête du B.E.A./mer, soumis à l'autorité hiérarchique de votre ministre. En d'autres termes, dans votre statut personnel, rien dans les textes, sur un plan juridique, n'assure votre indépendance. Vous avez le même statut que n'importe quel autre fonctionnaire de votre ministère.
M. Georges TOURRET : En effet, j'ai le même statut que n'importe quel autre fonctionnaire de mon ministère. Par contre, je n'ai pas le même âge.
M. François GOULARD : Ce n'est pas la question. Ma question est d'ordre purement juridique. Il est clair que vous êtes soumis à l'autorité hiérarchique du ministre.
M. Georges TOURRET : Effectivement. Cela dit, le décret du 20 janvier 1981 me donne la liberté de remettre un rapport en toute indépendance. Je n'ai ni reçu, ni sollicité d'instructions pour conduire l'enquête qui m'a permis de rassembler les informations nécessaires. Bien sûr, le ministre en charge des transports est une autorité hiérarchique qui peut s'exprimer, tout simplement parce que je ne suis pas magistrat. Nous n'occupons pas des sièges inamovibles. Une certaine autorité s'applique. Le fait que le service en question soit rattaché à une inspection générale, corps de contrôle, et non à une direction d'administration centrale, a paru présenter jusqu'ici une garantie suffisante de l'objectivité requise. Je suppose que, à un moment ou à un autre, il sera proposé au Parlement d'établir une loi concernant le B.E.A./mer comme il en fut établi une sur le B.E.A./air.
Les travaux auxquels nous avons fait référence jusqu'ici prévoient, dans l'alinéa d'un article que vous serez peut-être amené à voter, que « les enquêteurs ne sollicitent et ne reçoivent d'instructions d'aucune autorité que ce soit. »
Sur les soixante enquêtes que j'ai conduites jusqu'ici, je n'ai jamais ni sollicité ni reçu d'instructions quant à la mise au point des rapports que j'ai réalisés et remis. Je puis vous en dire autant au sujet du rapport annuel publié une fois par an dans le cadre du B.E.A./mer, dont la deuxième édition devrait sortir d'ici à quelques semaines.
M. Paul DHAILLE : Dans votre analyse de la situation financière, administrative et juridique de l'ensemble de ces structures, vous avez employé à plusieurs reprises le terme de « complexe ». On peut même penser que c'est opaque.
Si vous aviez à porter un jugement global sur le montage juridique, commercial et financier de l'exploitation de l'Erika, considéreriez-vous que c'est là une situation habituelle dans le domaine maritime, c'est-à-dire celle que connaît la majorité ou la plupart des navires qui naviguent à l'heure actuelle ou, selon vous, peut-on penser que ce cas précis est plus complexe ou plus inhabituel ou plus anormal que la situation moyenne des navires aujourd'hui ?
M. Georges TOURRET : La réponse que je vous ferai n'est pas seulement celle du directeur du B.E.A./mer, co-président de la commission d'enquête, mais celle d'un fonctionnaire qui travaille dans le secteur des affaires maritimes et que certains d'entre vous connaissent pour diverses raisons, notamment parce que j'ai été, à un moment ou un autre, leur collaborateur. Ma réponse est le fruit d'une expérience d'une trentaine d'années.
L'industrie maritime n'est pas une industrie différente des autres, même si elle s'exprime avec des navires et dans un lieu moins visible que les autres. Elle a été tentée de recourir, avec plus ou moins de vigueur selon les secteurs, à la sous-traitance d'un très grand nombre d'activités. Il existe encore des compagnies propriétaires de leurs navires, responsables de leur gestion technique et dont les marins sont les employés directs. Il y en a. Mais, notamment dans le secteur de la navigation à la demande, la règle habituelle - j'ignore si elle est normale ou non - consiste plutôt à démembrer la fonction armatoriale entre le gestionnaire financier, le gestionnaire commercial, le gestionnaire nautique et plusieurs intermédiaires, à divers niveaux, rendant parfois complexe l'analyse d'une situation de propriété. Ce n'est pas la première fois que nous rencontrons des situations aussi complexes et que nous butons sur la responsabilité réelle du propriétaire, parce que celui-ci se dissimule derrière plusieurs sociétés écrans. Comme aux 110 mètres haies, on saute une haie et puis une autre, ainsi de suite, jusqu'au moment où l'on trouve le nom du propriétaire. Parfois, on ne le trouve pas, car ce sont des actionnaires ou des fonds de pension qui possèdent collectivement le titre de propriété du navire.
L'évolution du vocabulaire est, à ce titre, révélatrice. Il y a encore quinze ans, sur les listes de situation des navires du Lloyd's publiées tous les jours, était indiqué « armateur » ; aujourd'hui, il est indiqué « correspondant ». Ce peut être le correspondant commercial parfois, ou le
ship manager, c'est-à-dire le gestionnaire nautique. Je me garderai bien de préciser si une telle situation est ou non anormale. Je dis simplement que c'est habituel dans un grand nombre de secteurs. Certes, certains secteurs y échappent. Le transport des passagers, par exemple, est assez peu concerné par de telles pratiques. Les grandes lignes régulières également.
Pour en revenir au secteur du transport pétrolier, quand, il y a trente ans, je suis entré dans l'administration des Affaires maritimes, les compagnies pétrolières pratiquaient la politique dite du « 40/40/20 » qui consistait à exploiter 40 % de navires en propriété. Total, Exxon, Shell, BP... : toutes s'y conformaient. Elles arboraient d'ailleurs leur logo sur la cheminée du navire. Les noms faisaient ainsi référence à la propriété : les bateaux s'appelaient
Esso-Picardie, Esso-Normandie, Amoco-Cadiz, Exxon-Valdez. Les personnes à bord étaient les employés directs de la société dont ils faisaient partie. En trente ans, la situation s'est grandement modifiée, dans la mesure où les grands majors pétroliers, en même temps qu'ils se dégageaient de la propriété directe des puits de pétrole - ou qu'on les en dégageait - se dégageaient de la flotte de transport pétrolier, pour diverses raisons. D'abord, parce que les obligations légales sont devenues moins contraignantes. A titre d'exemple, en France, la loi de 1992 est venue remplacer la loi de 1928 sur le transport pétrolier. L'obligation de détenir en propriété des navires correspondant à 66 % des tonnes/milles effectués a été remplacée par une obligation de détenir - pas forcément en propriété d'ailleurs - une flotte minimale. De ce fait, les fonctions, notamment dans le secteur pétrolier se sont considérablement démembrées entre différents acteurs. Plus on touche aux trafics internationaux, plus on rencontre ce type de navires.
Un autre phénomène semble être venu s'y ajouter. Globalement, au niveau mondial, le taux de renouvellement de la flotte pétrolière a connu une longue période de stagnation. De 1975 à 1985-1990, il n'y a pas eu de véritable renouvellement. La flotte est globalement vieillissante. Elle prend chaque année quelques mois d'âge moyen supplémentaire, un peu moins toutefois qu'il y a quelques années. En effet, nous avons connu des périodes où aucun navire n'était construit. La flotte prenait alors, en moyenne, un an supplémentaire tous les ans contre quelques mois à l'heure actuelle. Aujourd'hui, la flotte ne vieillit pas uniformément. Si elle vieillit pour le vrac, pour le grand vrac liquide, pour les grands pétroliers de brut, elle vieillit beaucoup moins pour les transports de produits blancs, lesquels sont très exigeants et pour lesquels un renouvellement de flotte non négligeable a été entrepris. Elle vieillit fortement pour les transporteurs de produits.
A l'heure actuelle, les contraintes sont telles que les produits les plus polluants - les produits « noirs » - sont transportés par les navires les plus anciens. Nous nous garderons bien d'affirmer que les navires les plus anciens sont les plus dangereux. Statistiquement, c'est vrai, mais ce n'est pas le cas pour chaque navire pris individuellement. C'est pourquoi nous n'avons pas fixé très précisément de barrière d'âge dans le rapport, car nous connaissons des navires anciens de très bonne qualité et d'autres, un peu moins vieux, moins présentables.
M. le Président : Ajoutons que ces vieux navires sont la plupart du temps déjà payés et qu'ils rapportent chaque fois qu'ils sont utilisés ?
M. Georges TOURRET : M. le Président, je n'en suis pas certain. Le prix des navires est un élément très difficile à déterminer.
M. le Rapporteur : Il est fonction de l'offre et de la demande.
M. Georges TOURRET : Un navire a toujours une valeur résiduelle : sa valeur de ferraille. Lorsque le marché atteint son point bas, on peut acquérir de bonnes unités à des coûts avoisinant le prix de la ferraille. En valeur d'achat d'occasion, le taux d'amortissement sera faible, puisque le prix de sortie sera le même que le prix de rentrée. L'annuité financière sera donc forte. En revanche, si le marché s'emballe, des navires de 15-16 ans d'âge seront achetés aussi chers qu'ils ont coûté à leur neuvage.
Prenons l'exemple de transporteurs de 275 000 tonnes, tels ceux que vous recevez dans votre circonscription à Antifer, M. le Président, ou ailleurs. Ils furent achetés aux alentours de 20 millions de dollars dans les années 1970-1975. Leur valeur est descendue à 4 millions de dollars dans les années 1985, puis remontée à 17 millions de dollars dans les années 1990 et redescend actuellement. Les difficultés de gestion des annuités financières sont relativement complexes. Peut-être est-ce la raison qui a poussé les pétroliers à se dégager d'une activité devenue, au fil des années, très aléatoire. Je ne puis vous indiquer si l'Erika était amorti. J'ignore le prix auquel il a été acquis, comment il a été exploité, et les crédits restant à honorer. Il y a quelques chances pour qu'il ait été amorti, mais je ne puis l'affirmer de façon automatique.
M. Jean-Pierre DUFAU : Nous sommes là au c_ur du problème concernant les acteurs et les décideurs. L'opacité qui entoure les acteurs, les donneurs d'ordres et les décideurs, est effectivement troublante. Telles sont les conclusions de votre rapport. Vous indiquez avec un bel euphémisme : « Dans l'état actuel des choses, la propriété réelle de l'Erika n'est donc pas publiquement revendiquée. »
M. Georges TOURRET : Elle l'est désormais.
M. Jean-Pierre DUFAU : Il n'empêche que l'ensemble du réseau tissé crée indubitablement le soupçon. Ma question porte sur les moyens d'investigation. Vous avez évoqué les commissions rogatoires internationales, mais quels sont les moyens d'aller véritablement au fond des investigations en ce domaine ? Par ailleurs, dans la mesure où le problème se pose à l'échelon du commerce international et non pas national ou européen, dans quelle direction pourrait-on agir pour essayer d'obtenir une plus grande transparence et revenir à des situations beaucoup plus lisibles comme cela était le cas lorsque les compagnies affrétaient elles-mêmes leurs propres navires ?
M. Georges TOURRET : Devant cet état de choses, et devant la nécessité pour l'affréteur d'avoir des garanties sur la qualité effective de son navire, nous avons suggéré aux compagnies pétrolières de reprendre une partie de la propriété des navires qu'elles utilisent. Nous l'avons, du reste, écrit en conclusion.
Votre première question dépasse les limites de mes compétences d'enquêteur technique, car elle interfère avec une demande globale d'une plus grande transparence, qui ne doit probablement pas concerner le seul
shipping, l'activité maritime, mais également d'autres activités de transactions internationales. Nous sommes obligés de constater l'existence d'un fait : les investissements et la propriété
offshore, c'est-à-dire dans certains pays que je ne qualifierai pas de « paradis fiscaux », car, d'une part, j'ignore leur fiscalité et, d'autre part, je ne suis pas en mesure de vous apporter une réponse sur ce sujet qui dépasse mes limites.
M. Bernard CAZENEUVE : Je poserai trois questions à M. Tourret.
La première concerne la manière dont fut constituée la commission d'enquête après l'accident. Vous avez indiqué que par les textes qui fondent vos missions et dès lors qu'un accident est constaté, vous avez la possibilité de constituer une commission d'enquête que vous présidez en désignant ses membres. Qui sont ces membres ? Quel est leur nombre et sur quels critères sont-ils désignés ?
Deuxièmement, vous avez précisé que, s'agissant de l'Erika, l'événement vous fut notifié à sept heures et que, dès huit heures, vous fûtes en mesure de rassembler un certain nombre d'éléments, ensuite portés au rapport provisoire remis au ministre. Qui vous transmet ces éléments et lorsque vous constituez la commission d'enquête quels sont vos pouvoirs et vos instruments d'investigation ? Quels types de moyens pouvez-vous diligenter ? Qui pouvez-vous envoyer sur place ? Comment pouvez-vous valider la fiabilité des éléments qui vous sont transmis, sur le fondement desquels vous élaborez vos recommandations ou vos rapports à destination du ministre ?
Ma troisième question est complémentaire des précédentes et porte sur les dispositifs financiers. Ne pensez-vous pas que le démembrement et la « financiarisation » de la fonction armatoriale ne rend pas plus difficiles les dispositifs de contrôle en diluant la responsabilité ? Comment le contrôle peut-il s'exercer dès lors que celui sur lequel le contrôle est censé s'exercer n'est même pas susceptible d'être identifié ?
M. Georges TOURRET : Les textes de 1981 ne nous donnent guère de choix pour la constitution de la commission permanente d'enquête sur les événements de mer. Elle doit être constituée par des personnes ayant exercé des compétences et des fonctions en matière de navigation et de sécurité de celle-ci. Comprenant des navigants, des juristes et des ingénieurs, le B.E.A./mer constitue en lui-même une petite équipe permanente qui représente le vivier naturel où les enquêteurs sont prélevés. En l'occurrence, il est vite apparu que nous disposons, au sein de l'équipe permanente, de quoi constituer la commission permanente d'enquête sur le naufrage de l'Erika,
à la condition de la compléter par des experts, ce que permet le décret de 1981.
Je suis statutairement, par l'arrêté du 16 décembre 1997, président de la commission d'enquête. Sur les affaires importantes, je désigne toujours un co-président. Pour la plupart des enquêtes de commerce, le co-président est M. Jean-Louis Guibert, administrateur général des Affaires maritimes, deuxième section. Il a été l'adjoint au préfet maritime de Brest. Il a exercé précédemment des fonctions à la Mission interministérielle de la mer. Il fut chef du bureau de la sécurité de la navigation et chef de centre de sécurité sur de grands navires. Il est capitaine au long cours et fut commandant de navire. Nous avions donc la compétence nécessaire. J'ai noté qu'un certain nombre d'associations nous ont fait remarquer que nous n'avions pas intégré d'officier de pont au sein de notre commission. Ce n'était pas tout à fait le cas.
Le rapporteur est traditionnellement pour toutes les commissions le secrétaire général du B.E.A./mer, M. Bernard Lion, juriste de l'équipe.
Par ailleurs, nous avons retenu un collège d'experts composé d'un chef mécanicien, chef mécanicien expert attitré du B.E.A./mer, M. Daniel Drevet, ayant exercé des fonctions de responsable en machines sur de très nombreux navires, de passagers comme à charges.
Nous avons retenu un ingénieur civil du génie maritime, M. Bernard Parizot, ancien directeur marine du Bureau Veritas.
Nous avons également désigné un deuxième capitaine comme expert auprès de la commission, le commandant Yves Halna du Frettay, directeur d'opérations à la compagnie Les Abeilles International. Nous avons passé un agrément avec Les Abeilles. M. du Frettay est actuellement à bord des navires travaillant, depuis le début des opérations, sur l'épave de l'Erika.
A préciser que nous ne nous sommes pas interdit de procéder à des consultations supplémentaires. Nous avons recueilli l'avis d'une demi-douzaine de commandants de navires pétroliers. A ce titre, nous pensions recourir à suffisamment de personnes compétentes.
Quant aux moyens, nous disposons de banques de données permanentes. En premier lieu, nous nous sommes renseignés sur les antécédents de l'Erika
en consultant entre autres le Lloyd's, les bases de données Sirenac, les précédentes inspections, afin de disposer du maximum d'éléments de base sur la carte d'identité du navire.
Sur votre question relative à l'opacité financière du dispositif, je ne puis vous en dire davantage que ce que j'ai déclaré tout à l'heure. Il est certain que je la ressens comme une gêne, mais ce n'est pas simplement cela. Sans doute touche-t-elle à la question des pratiques
offshore. A la limite, je suis probablement plus à votre écoute que vous à la mienne, tant le manque de transparence n'est pas un élément spécifique au
shipping. Il concerne bien d'autres mécanismes. L'homme du milieu maritime que je suis attend de votre commission qu'elle apporte un éclairage sur cette situation quelque peu complexe.
M. Serge POIGNANT : Monsieur Tourret, je souhaiterais vous poser une question technique. Vous avez écrit et affirmé dans le rapport provisoire que la cargaison de l'Erika
était un produit standard, du fioul n°2. Qu'est-ce qui a pu faire dire à certaines personnes qu'il aurait pu s'agir d'un résidu plutôt que d'un produit standard, au surplus présentant des caractéristiques cancérigènes, ce qui a d'ailleurs créé un syndrome chez les personnes intervenant dans le nettoyage ?
M. Georges TOURRET : Monsieur le député, nous réalisons une enquête sur le navire, non sur le produit. Je ne sais quoi répondre à votre question. Je pense qu'elle devra être posée à l'industrie pétrolière. Il n'en reste pas moins que je ne puis me désintéresser totalement de votre question en ma qualité d'enquêteur technique. Actuellement, circulent énormément de marchandises polluantes et dangereuses en mer. Elles ne se limitent pas aux seuls produits pétroliers ; leur transport s'effectue aussi, entre autres, par conteneurs. L'absence de traçabilité de certains produits est un élément préoccupant et handicapant pour des enquêteurs techniques ; cela dit, dans le cas d'espèce de l'Erika, nous ne nous sommes pas heurtés à trop de difficultés en ce domaine : le navire a chargé dans un seul port, pour un seul chargeur, à un seul appontement. En revanche, j'ignore le contenu des
sloptanks, c'est-à-dire les deux réservoirs situés à la partie arrière du navire et où sont déposés l'ensemble des résidus des précédentes cargaisons. Des précédentes cargaisons, nous n'avons pas trouvé de produits sortant de l'ordinaire : nous avons trouvé du fioul, du crude algérien, du crude tunisien, des bruts russes.
A priori, des indications obtenues nous n'avons pu tirer de conclusions. Mais, comme vous, nous étudierons avec attention les conclusions des laboratoires habilités.
M. Jean-Louis GUIBERT : Nous allons aborder les questions les plus techniques et donc les plus fastidieuses. Je vais en effet vous parler d'un navire sans plan, sans carte et sans schéma. Mais avant d'aller plus avant, je compléterai les réponses de M. Georges Tourret à la question de M. Poignant. Effectivement, un document a fait état d'un produit particulièrement dangereux. A dire vrai, il y eut beaucoup de « documents » dans cette affaire, vous l'avez tous noté ! Je pense que c'est pourquoi notre ministre nous a poussés à produire un rapport, peut-être un peu rapidement - c'est vrai, quelques éléments peuvent manquer -, mais nous espérions ainsi couper l'herbe sous les pieds à certaines hypothèses, idées, voire fantasmes. Malheureusement, nous n'avons pas très bien réussi l'exercice. Le rapport final tentera d'y parvenir. Cela dit, je suis convaincu que beaucoup de journalistes écriront toujours ce qu'ils ont envie de dire ou de faire lire dans leur journal, ce qui ne correspond pas forcément à la réalité.
Mon exposé traitera du navire, du dernier voyage, des causes de l'accident et surtout de l'évolution du dossier - il évolue sûrement, mais assez lentement. Je terminerai par les quelques propositions techniques auxquelles nous tenons le plus en l'état actuel des choses et surtout des propositions avancées par nombre de personnes. Il y a en effet un foisonnement d'idées, ce dont on ne peut que se réjouir ; certaines sont redondantes, d'autres sont bonnes, d'autres seraient certainement à écarter.
Le navire était un navire pré-Marpol, c'est-à-dire construit avec une simple coque, avant la convention de Marpol 1973-1978.
Il fut assemblé en 1975 dans un chantier japonais qui a construit un très grand nombre de navires de ce type. Polyvalent, il pouvait, soit transporter du brut, soit transporter des produits. C'est un bateau de 185 mètres, avec un port en lourd de 40 000 tonnes, tout à fait classique pour les navires de sa génération.
Un point essentiel est à connaître dans l'évolution de son existence technique : pré-Marpol, il avait treize citernes, toutes destinées à transporter du pétrole ou un produit gras. Ces citernes étaient enduites à l'époxy pour les protéger, mais elles étaient également protégées par le produit transporté. Lorsque l'on mettait de l'eau de mer pour le ballaster, cette eau de mer entrait, mais la protection par les résidus de pétrole empêchait les citernes de se corroder rapidement. Une telle conception présentait l'inconvénient que l'on ballastait dedans, avant de déballaster par la suite, opération qui, si le niveau de séparation entre l'eau de mer et le pétrole résiduel était dépassé, engendrait des pollutions de la mer par rejet de déballastage - et non dégazage. Dès 1990, on a séparé quatre citernes, bien qu'il ne soit pas astreint à de telles adaptations, deux à l'avant, bâbord et tribord - à gauche et à droite - et deux à l'arrière, bâbord et tribord, afin de transporter, soit du produit, soit du ballastage, de manière à gagner du temps, ce qui avait pour avantage de conserver la protection des citernes et également des produits gras de temps en temps.
La situation s'est aggravée en 1997, car, sur les quatre citernes, deux furent dédiées - les numéros 2 bâbord et tribord - uniquement à l'eau de mer pour le ballastage. Soit il y avait de l'eau de mer, soit rien du tout. Autrement dit, d'emblée, les protections d'origine, entretenues tant que l'on transportait des produits, ont eu tendance à s'abîmer et à disparaître progressivement. La rouille a foisonné, puisque ces capacités contenaient tantôt de l'eau de mer, tantôt une atmosphère saline. Si l'on ajoute à cela que le produit voisin des trois citernes qui entouraient le ballast était chauffé la plupart du temps aux environs de 50 à 65°Celsius, on avait là un effet thermique qui aggravait la condensation, donc la corrosion dans les hauts de citerne. C'est d'ailleurs ce que nous avons trouvé dans les dossiers.
Tel est l'historique du navire. Précédemment, on a parlé de
sistership : il en existait sept autres du même type. Nous avons immédiatement signalé par tous les moyens possibles aux propriétaires-armateurs des bateaux en question d'aller voir ce qui se passait dans cette partie des navires, dont tous les spécialistes savent qu'elle est difficile à entretenir et qu'elle se dégrade extrêmement rapidement.
Les contrôles effectués sur ces navires sont de quatre types.
Premièrement, la classification, réalisée par les sociétés de classification : elle consiste surtout à vérifier l'état de la structure, de la coque et des machines. Elle est fondée sur des règlements techniques édités par ces sociétés de classification, à peu près tous les mêmes, car la concurrence commerciale entre lesdites sociétés de classification est telle que l'on ne peut demander ni plus ni moins que le voisin ! D'où d'ailleurs l'apparition de ce que l'on appelle l'I.A.C.S., c'est-à-dire l'Association internationale des sociétés de classification, qui réunit les dix « meilleures » - les guillemets sont placées à dessein - et qui se prévaut d'un règlement harmonisé dans ce type de contrôles.
Le navire ayant été construit au Japon il a été suivi par le N.K.K., l'équivalent nippon du Bureau Veritas, dont nous n'avons rien à redire - il fait partie de l'I.A.C.S. Il est passé, pendant un temps, sous le contrôle de l'A.B.S., société américaine de classification qui fait également partie de l'I.A.C.S. Son suivi a été assuré par le Bureau Veritas de 1993 à 1998, Veritas qui appartient à I.A.C.S. Ensuite, c'est Rina, société italienne qui présente la particularité d'être à la fois une société de classification et l'instrument de l'Etat italien en matière de contrôle de sécurité, ce que nous appelons « le contrôle par l'Etat du pavillon du navire », qui a effectué les contrôles de classification et de certification de l'Erika. A noter que le RINA appartient également à l'IACS.
Depuis la création de l'I.A.C.S., il existe une procédure spécifique au transfert de classification, nommée « procédure Toca » (Transfert of class agreement), qui veut que la société de classification cédante, si j'ose dire, transmette l'ensemble du dossier à la société de classification prenante, celle-ci ayant à charge d'exécuter toutes les prescriptions demandées par la société cédante. La société prenante doit même attester de la réalisation des examens demandés par la société de classification cédante, ce qui constitue une forme de garantie dans le suivi du dossier d'une société de classification à une autre.
Dans le cadre de la classification, il existe trois sortes de visite. La plus importante est la visite spéciale, qui a lieu tous les 5 ans. Un bateau est classé pour une durée de 5 ans, une visite spéciale intervenant au début, une autre au bout de 5 ans. Entre les deux, une visite intermédiaire a lieu, qui se situe aux environs de 2 ans et demi. Des visites annuelles interviennent également. Mais il est clair que les visites les plus importantes sont celles de 5 ans. En l'occurrence, lorsque le navire est passé du Bureau Veritas à Rina, cette visite est intervenue au mois d'août alors que le transfert eut lieu au mois de juin, donc avec une prorogation des titres, jusqu'au moment où le bateau est passé au chantier pour réparation au vu des prescriptions du Rina.
Deuxième sorte de visite après la classification : la visite par l'Etat du pavillon. En France, il existe un service de sécurité des navires, dont on a beaucoup parlé, d'aucuns estimant qu'il ne compte pas suffisamment de moyens, ce qui est possible. Il assure lui-même des visites de mise en service des navires et des visites annuelles, mais sur des navires du pavillon. Ce même service n'existe pas à Malte.
Troisième catégorie de contrôle s'ajoutant à la classification et aux visites de l'Etat du pavillon : les visites
port state control, c'est-à-dire par l'Etat du port. Elles se réalisent dans le cadre des Mémorandums régionaux : le Mémorandum de Paris qui couvre pratiquement tous les pays d'Europe et, aujourd'hui, plusieurs autres Mémorandums, que ce soit au Japon, sur le continent américain ou ailleurs, qui réunissent plusieurs pays pour essayer d'harmoniser les contrôles et éviter les distorsions de trafic, autrement dit essayer de présenter un « front uni », comme les USA. J'insiste : la France ne peut adopter une loi telle que l'O.P.A. (Oil Pollution Act), la loi sur les pollutions par hydrocarbures adoptée aux Etats-Unis en 1990 pour régir ces contrôles. Presque tous les pétroliers qui se rendent aux Etats-Unis arrivent perpendiculairement à la côte ; les services américains peuvent s'assurer qu'ils sont en bon état et ne les laissent entrer qu'à cette condition. Au contraire en Europe, les navires ne rentrent pas directement dans le port, mais passent par nos côtes de la Manche pour se rendre à Rotterdam ou ailleurs. C'est une notion qu'il convient de prendre en compte parmi les idées qui peuvent prévaloir en ce domaine.
L'Erika a subi 7 visites en 3 ans, ce qui est plus que la moyenne, puisque, en général, le bateau n'en subit pas plus d'une tous les 6 mois. Les comptes rendus en notre possession, malheureusement assez lapidaires, donnaient généralement des informations portant sur des contrôles assez superficiels, assez documentaires, sur des points de détail. Des corrosions ayant été relevées, nous nous sommes aussitôt inquiétés. Manque de chance, elles concernaient les aménagements, pas du tout là où nous pensions les trouver, et n'étaient donc pas susceptibles de provoquer des raisons d'inquiétude. Ces visites ne se sont pas du tout attachées à la structure du navire. C'est un point important. J'ai noté qu'au Canada en particulier, les services canadiens réalisent souvent des visites d'inspection qui portent sur la structure du navire, notamment pour les
bulk carriers et les navires à double coque qui posent beaucoup de problèmes et qui en poseront encore bien davantage lorsqu'ils commenceront à vieillir.
La dernière catégorie de visites des navires de transport est constituée de visites privées, appelées
vetting, ce qui signifie « contrôle », qui sont réalisées par d'anciens officiers des compagnies pétrolières. Il s'agit de commandants, de seconds capitaines, qui, au sein d'un ensemble que l'on appelle « la base de données S.I.R.E. » réalisent des visites en vue d'affréter des navires. Un ou deux officiers passeront donc une journée, voire deux, sur un bateau pour savoir s'il peut être affrété. C'est particulièrement intéressant pour les navires vieillissants. C'était le cas de l'Erika. Il a été visité à sept reprises en un an. Les visites ont porté sur quatorze points. Les rapports de visite étaient assez complets et assez fouillés. Toutefois, une fois de plus, il s'est agi davantage de contrôles documentaires, de ce qui est apparent. Il n'y a eu aucun contrôle de structure à ces occasions. Sur ce point, j'apporterai un bémol : sur un navire citerne en exploitation, on ne peut quasiment visiter aucune structure, à commencer par les citernes elles-mêmes, pour des raisons de dégazage et de ballast, car l'on peut rencontrer des problèmes d'insuffisance de ventilation, voire éventuellement des fuites. C'est pourquoi nous indiquons dans le rapport provisoire qu'à chaque fois que la possibilité se présente, il faut se précipiter pour visiter ces structures, difficilement visitables. Voilà pour le navire.
L'avant-dernier voyage de l'Erika s'était terminé par un déchargement à La Corogne, au nord-ouest de l'Espagne. Il est remonté sur ballast, en ayant mis de l'eau dans les ballasts séparés, car il y avait très mauvais temps dans le golfe de Gascogne, ce qui était somme toute normal pour la saison, comme le savent tous les marins. Il est remonté par Ouessant, s'est rendu à Dunkerque, où il est resté du 7 au 12 décembre. Il a chargé 30 800 tonnes de produit, soit les trois quarts de sa capacité, puisqu'il s'agissait d'un 40 000 tonnes. Les citernes n'étaient pas toutes remplies, notamment sur la partie avant. Au cours de cette escale et du chargement, tous ceux qui l'ont observé - officiers de port, raffinerie - n'ont relevé aucun problème apparent. Se pose néanmoins la question de ses séquences de chargement, lesquelles jouent un rôle important sur la structure du navire. En effet, si l'on procède mal au chargement, comme pour les vraquiers, on peut avoir des problèmes de fatigue de la poutre navire. Or, nous ne disposons pas du plan de séquence de chargement : a-t-on commencé par la 1, la 2, la 3 ou la 4 ? Combien a-t-on chargé ?
Cela nous a conduits, dans le rapport provisoire, à demander le dépôt de ce plan par tout navire de transport, avant de quitter le port, afin de s'assurer - pour le moins
a posteriori - que là ne réside pas une des causes d'un accident. Cela étant, de ce que nous savons actuellement,
a priori, le chargement aurait été réalisé correctement, parce que, sur ces navires, il s'agit quasiment toujours des mêmes chargements. Un calculateur permet de s'assurer que l'on ne dépasse pas les limites de résistance de la poutre navire, en intégrant des données statistiques de mer et de temps, qui, en l'occurrence, ont, peut-être, été dépassées par la tempête particulièrement forte que le navire a rencontrée dans le golfe de Gascogne.
L'Erika est donc parti de Dunkerque le 8 décembre. Il a très rapidement trouvé du mauvais temps en mer. Il a doublé l'île d'Ouessant dans des conditions normales ; il a fait son compte rendu obligatoire, sans signaler d'avarie, ce qui est impératif dans le cadre du compte rendu. Cela paraît normal, puisque c'est le 11 décembre vers 12 heures 40, alors que le navire se trouvait au milieu du golfe de Gascogne, à mi-distance entre Ouessant et le Cap Finisterre espagnol, en un lieu où l'on ne peut rien faire d'autre pour un navire que de lui envoyer un bateau situé à proximité, en tout cas pas lui envoyer l'Abeille Flandre, car c'est beaucoup trop loin. Par ailleurs, un Super-Frelon n'a pas « les jambes » assez longues et envoyer un avion n'aurait pas servi à grand-chose. C'est un point qui fut évoqué. Il est à rappeler que nous nous situons là en plein milieu du golfe de Gascogne. Lors de la transat des Alizés en solitaire, toutes les personnes qui se retournent à cet endroit-là sont récupérées par des navires marchands et par aucun autre moyen.
M. le Président : Pourriez-vous nous donner une distance ?
M. Jean-Louis GUIBERT : 300 kilomètres d'Ouessant, 300 kilomètres de La Corogne. Vous avez la carte dans le rapport. Pour vous le situer, c'est le plus mauvais endroit.
M. Louis GUEDON : Et par rapport à Saint-Nazaire et Lorient ?
M. Jean-Louis GUIBERT : Le bateau ne pouvait rentrer à Lorient, car il avait un tirant d'eau trop fort. Lorsque le commandant a pris la décision et obtenu de son armement de faire route vers un port d'abri, il n'y avait que Donges qui pouvait correspondre à ses besoins eu égard à sa position. Il était route au 210, il était donc cap au suroît. Il affrontait un vent de suroît force 9 et des creux de 6 mètres. Il avait une houle résiduelle - ce terme étant un euphémisme en de pareilles circonstances - de la même grandeur, qu'il recevait par deux quarts tribord, c'est-à-dire 20 à 30 degrés sur la droite du bateau. Précisons qu'apparaît parfois un phénomène de vagues croisées- c'est-à-dire le cumul des vagues et de la houle - qui provoque des creux assez impressionnants. D'ailleurs, dans le livre de bord, on note que le navire tanguait « lourdement », lourdement signifiant que l'avant s'affale dans le creux suivant, avec des accélérations verticales importantes, une situation très éprouvante pour les navires.
M. Louis GUEDON : Quelle était la distance du navire par rapport à Donges ?
M. Jean-Louis GUIBERT : Environ 350 kilomètres.
M. Louis GUEDON : M. le secrétaire général, vous avez mis en exergue les difficultés météorologiques. Est-ce à dire que le bateau n'était plus man_uvrant et que le commandant n'avait plus la liberté de man_uvre pour regagner un port au nord, au sud ou à l'ouest ? Est-ce le but de votre exposé ?
M. Jean-Louis GUIBERT : Tout à fait. J'en arrive au point où l'événement initial se produit.
L'Erika se trouve au milieu du golfe de Gascogne. Tout à coup, une gîte commence à se déclencher sur tribord et le navire s'incline d'environ 10 degrés. Par ce temps-là, on peut s'inquiéter de ce genre de phénomène. Très rapidement, le commandant a fait contrôler par le second les capacités. Il fut noté une baisse de la capacité de la citerne n°3 pleine de fioul au profit, si j'ose dire, du ballast n° 2 qui était vide. Manifestement, une quantité importante de produit s'est déplacée sur la droite et a donc provoqué la gîte du navire. Ceci résulte forcément d'un effondrement, à tout le moins partiel, de la cloison longitudinale entre la citerne n° 3 et le ballast n° 2, puisqu'il s'agissait d'une cloison mitoyenne.
M. François GOULARD : Pardon de vous interrompre, mais il s'agit là d'un point crucial. La rupture partielle de la cloison ayant entraîné le transfert de fluide entre la citerne et le ballast, ne doit-elle pas être considérée de manière évidente, sur un pétrolier, comme une avarie majeure ?
M. Jean-Louis GUIBERT : C'est, en effet, une avarie majeure. On m'a indiqué que cela compromettait la stabilité du navire. J'ai même lu qu'il risquait de chavirer, ce qui eût été le cas si cela s'était étendu. Mais, en l'occurrence, la capacité vide était trop peu importante. Le navire n'était pas en danger
stricto sensu. Il s'agissait d'une avarie majeure, car elle était structurelle. A mon sens, elle a entraîné ensuite la déstructuration des autres éléments qui sont tous liés.
M. François GOULARD : Ma question va plus loin. La réaction du capitaine alors est de rétablir l'équilibre de son bateau par transferts entre ballasts, ce qui constitue une réponse immédiate, qui cependant ne résoud pas le problème de fond, qui est une rupture de cloison. Autrement dit, le comportement du capitaine est-il, à ce stade, à la hauteur de la gravité de la situation ou s'agit-il simplement d'une réponse immédiate ? Peut-on dire qu'il prend conscience de la gravité de la situation ?
M. Jean-Louis GUIBERT : Il prend conscience de la gravité de la situation. Donc, il faut qu'il redresse absolument son navire, ce qu'il peut réaliser en déballastant une quantité équivalente de poids en eau de mer du ballast n° 4 tribord. Le navire se redresse. C'est à ce moment-là seulement qu'il fait demi-tour : il met en fuite, puisqu'il va avoir de la mer de l'arrière. Procéder à la man_uvre avant eût été dangereux. Une fois cette man_uvre faite, le capitaine envoie son personnel vérifier sur le pont les ullages, c'est-à-dire les hauteurs dans les citernes. C'est là que l'on a la confirmation du transfert de cargaison et que l'on constate des fissures sur la partie avant du ballast n° 2, donc assez à l'avant du navire. Je le précise, car si cela avait été la section du milieu, cela expliquait plus rapidement la cassure ultérieure du navire. En l'occurrence, il s'agissait de cassures sur la partie avant. Le ballast était grandement fatigué du point de vue échantillonnage de pont et de structure. C'est un affaiblissement du côté tribord, lequel recevait des paquets de mer. Un paquet de mer représente une force de plusieurs tonnes. Lorsque cela tape au même endroit, cela fatigue, surtout si la structure en dessous commence à faiblir.
Ayant opéré cette man_uvre, le navire se retrouve droit. Il cherche un port de refuge. Manifestement, retourner à Brest n'est guère moins loin. Ce changement de cap l'expose mer de l'arrière : le navire travaille peut-être moins, mais il continue de tanguer énormément, ce qui fatigue grandement un bateau de ce type. Par ailleurs, pendant ce temps, dans le Nord le vent était passé de SW à NW. La répétition des mouvements fléchissants qui, une fois contractent le pont, une fois contractent le fond finira par le faire casser. Pour schématiser, c'est le coup du « fil de fer ».
Le commandant demande un port refuge. On lui indique Donges. Panship (M. Pollara) appelle un agent qui désigne lui-même un agent à Donges, lequel contacte la capitainerie. A cet égard, je signale que le capitaine de port n'a jamais dit non à quoi que ce soit.
Il y a un moment où, sur la route, le bateau fait cap inverse. Quand la décision est prise de venir sur Donges, il met le cap sur Donges. Pendant la nuit, parce que le temps a encore fraîchi - on aborde le plateau continental avec une remontée de la houle beaucoup plus forte qu'on ne le pense dans ces régions -, il revient plus au nord, cap au 50, et puis il faut bien prendre la route de Donges. C'est le moment où les déstructurations commencent à s'accélérer. Il n'est pas loin de 5-6 heures du matin. On voit le bordé de muraille du ballast n° 2 tribord qui est arraché. Inutile de vous dire que la déstructuration du navire était alors quasiment totale, que les cassures partirent par le fond au niveau sur la cloison au couple 66, c'est-à-dire entre le ballast n° 2 tribord et la citerne n° 3 tribord. Le découpage ne s'est pas opéré au rasoir, car l'on a constaté des coupures en biais sur les photos que l'on voit au fond de la mer. Le navire a cassé complètement en une heure, en se repliant autour du pont. Il ne restait dès lors qu'une solution : celle d'évacuer l'équipage, ce qui fut fait le plus rapidement possible par les hélicoptères de la marine nationale sous la coordination du C.R.O.S.S.
Une question a été posée sur la vitesse. Je voudrais préciser que la descente vers Ouessant, compte tenu des mesures réalisées entre les deux points G.P.S. - ce qui se fait de mieux - s'est effectuée à une vitesse de 6 n_uds environ. Le navire, dès qu'il a eu des problèmes, a ralenti. Il ne pouvait guère descendre en dessous des 6 n_uds. Prendre un cap plus direct aurait fatigué le navire en plein milieu du golfe de Gascogne. Pour soulager le plus le navire, il aurait fallu mettre le cap sur les Etats-Unis ! Je veux dire par là prendre toute la mer et la houle par bâbord. Il aurait fallu se rendre au large, option que, en tant que commandant, je n'aurais jamais prise. La seule décision à prendre consistait à rallier Donges. Le commandant a certainement pensé qu'il fallait y arriver le plus rapidement possible. Mais il n'a pas pour autant forcé l'allure. Le bateau était à 5,5 n_uds. Il n'a guère dépassé les 6 n_uds après Ouessant. Et encore ! Il me manque le point G.P.S. du retour en arrière. Cette vitesse a donc été évaluée et non mesurée.
Voilà pour la route et la chronologie des événements. Peut-être pouvons-nous répondre à quelques questions sur ce thème particulier dès à présent ?
M. Louis GUEDON : Le premier appel de détresse du commandant date du 11 décembre à 14 heures 08. Il fut démenti par la suite. Le C.R.O.S.S. d'Etel l'a signalé au préfet maritime à 17 heures 30 le même jour.
Compte tenu de la dangerosité de la cargaison et de l'état du navire, dont vous avez rappelé qu'il n'était pas de première jeunesse et au sujet duquel on éprouvait des doutes suite aux différents examens qui avaient révélé des problèmes de corrosion et dont on savait que certaines vérifications étaient superficielles, si ces éléments avaient été pris en compte aux premiers appels de détresse à 14 heures 08, le 11 décembre, afin de déterminer quel était véritablement l'état du navire, avait-il une chance de regagner un port, puisqu'il progressait à une vitesse de 6 n_uds à 300 kilomètres de Donges, port qui pouvait le recevoir. Existait-il une chance de mettre ce bateau à l'abri ?
M. Jean-Louis GUIBERT : Dès que le C.R.O.S.S. reçoit un appel de détresse, il mobilise tous les moyens pour porter assistance au navire en vue d'évacuer l'équipage. Eu égard à la position, il convenait de faire appel à tous les navires sur zone, en passant par Inmarsat, pour indiquer qu'un navire était en difficulté en tel point et qu'il convenait de lui porter assistance et sauver l'équipage. C'est ce qui aurait été fait, si l'Erika n'était pas passé en message de sécurité, donc de surveillance et non plus d'assistance immédiate, à peu près une demi-heure après. Ce qui a justifié ce retour en arrière de la part du commandant, c'est qu'il avait, selon lui, maîtrisé la situation de son navire et pris une route, ô combien plus confortable que celle avec la mer debout. Il est vrai qu'un commandant demande le moins possible d'assistance payante à la terre. Mais, en l'occurrence, dans l'esprit du commandant, la route qu'il prenait avait pour objet de s'abriter dans un port, ce qui, du reste, allait engendrer des frais énormes de port, de déroutement, etc. A mon sens, il a fait ce qu'il pouvait. Vu de la terre, dès lors que l'on passait du message « mayday » à celui de « pan », on descendait d'un cran et on était en veille. Les Super-Frelon ont été mobilisés à une heure au lieu de deux. Les dispositions étaient ainsi prises. Que dire d'une action depuis Brest par le préfet maritime ? On a parlé de l'Abeille.
Pourquoi ai-je insisté sur les 300 nautiques ? L'Abeille agit dans un rayon de 60 nautiques autour de Brest. Seul le préfet maritime peut décider de l'en faire sortir. Lorsque j'étais à Brest, nous l'avons fait sortir une fois - encore faisait-il beau temps. Nous avons eu une impasse, nous avons eu une chance exceptionnelle. Avec le temps qu'il faisait ce jour-là, jamais je n'aurais conseillé à mon préfet maritime d'envoyer l'Abeille au milieu du golfe de Gascogne. Que faisait-on le temps qu'il y arrive ? Le navire commençait à se détruire, ce que nous ignorions certes, mais envoyer l'Abeille
signifiait qu'il aurait remorqué un navire qui commençait à se casser par le milieu, ce qui a dû commencer avant 6 heures du matin, calculs qui nous font défaut à ce jour, mais que nous obtiendrons d'ici un à deux mois. A mon sens, l'Abeille eût été totalement inefficace.
M. François GOULARD : La question mérite que l'on s'y arrête un moment. On reçoit un appel de détresse d'un pétrolier, c'est-à-dire d'un navire qui doit retenir plus particulièrement l'attention. Il passe un « pan » peu de temps après. Quelle est, en l'occurrence, la réaction normale du C.R.O.S.S. qui reçoit le message ? Est-il normal qu'il ne s'inquiète pas plus qu'il ne l'a fait ? Si sa mission immédiate est de porter éventuellement assistance, s'il le peut, à l'équipage en cas de détresse, ne ressort-il pas de ses missions de s'interroger sur un message de détresse d'un pétrolier ? Ce n'est pas un événement anodin et dépasse éventuellement sa mission originelle qui est de porter assistance à l'équipage. Autrement dit, n'appartient-il pas au C.R.O.S.S. de donner l'alerte, de s'interroger sur le sort du navire, de recueillir des renseignements supplémentaires et de mettre en alerte toutes les autorités en mesure, le cas échéant, d'influer sur le cours des choses pour éviter une catastrophe, non seulement humaine, mais écologique ?
M. Jean-Louis GUIBERT : Tout à fait, sur la chronologie, nous disposons des messages du C.R.O.S.S. Il convient de rappeler que les messages passaient par lnmarsat C, c'est-à-dire en télex ; nous n'avions pas de liaison radio comme on peut en avoir avec Inmarsat A. Le bateau était trop loin pour pouvoir bénéficier de la V. H. F. C'est important, car, par radio, on échange très rapidement. En l'occurrence, il fallait avoir le temps d'envoyer le message télex. C'est automatique pour le
mayday, mais après, pour la discussion, il faut taper les messages. Sur une passerelle, avec vent force 9, le commandant ayant des soucis de structures et de ballast, devait, de surcroît, taper sur un écran pour envoyer un message. Le commandant, de sa passerelle, a fait le maximum dans ce domaine-là. Il avait déjà fait pas mal, ne serait-ce que parce que la cellule I.S.M. n'a pas fonctionné à terre et a insuffisamment pris en charge les événements. Le C.R.O.S.S. a automatiquement accusé réception du message de détresse. Ensuite, il a demandé confirmation. Le temps de la confirmation, le message était repassé au message « pan ». A partir de ce moment-là, une série de messages du C.R.O.S.S. furent échangés avec le navire sur ce qui se passait. Mais l'information arrivait au C.R.O.S.S. avec un certain décalage, car il fallait que le commandant rectifie la gîte. C'est seulement après l'avoir rectifiée et fait cap inverse qu'il a appelé le C.R.O.S.S., indiquant qu'il annulait son message de sécurité et qu'il ralliait Donges. Le C.R.O.S.S., en tant que représentant permanent du préfet maritime et coordonnant pour lui l'action de l'Etat en mer, du moins en matière de sauvetage, a rendu compte au Centre opérationnel de la Marine - C.O.M. -, à Brest, de ce qui se passait.
M. François GOULARD : En temps réel ?
M. Jean-Louis GUIBERT : En temps réel ou quasiment réel. Il a fallu attendre le soir pour disposer d'un message récapitulatif de tout ce qui avait été fait à bord, à savoir le déballastage afin de redresser le bateau, complété ensuite par la mise en communication du ballast n° 2 tribord, qui contenait du produit, avec le ballast n° 2 bâbord de manière à rééquilibrer le bateau. De plus, avant même l'arrivée de la nuit, l'équipage s'est aperçu d'une autre fuite sur le ballast n° 3 tribord. C'est dire la masse des informations que le capitaine avait à gérer seul - bien que l'équipage soit compétent - puisqu'il était seul en charge de la situation. Et je puis vous assurer qu'il l'a assumée « à l'ancienne ». Le commandant a tout pris en main et n'a rien délégué à qui que ce soit. Et l'ensemble des 26 membres d'équipage a été sauvé. Ce que j'ai entendu prouve qu'ils connaissaient leur métier et les pétroliers.
Le soir, donc, un message récapitulatif a mentionné les fêlures, qui, je le répète, n'étaient pas rédhibitoires, à l'avant de la citerne n° 1. Par conséquent, les autorités étaient prévenues. Le problème était de savoir ce qu'il fallait faire tant que le navire n'était pas plus proche de terre. Lorsqu'il s'est rapproché, les problèmes de structure se sont aggravés et le navire a fini par se casser. Le mettre sous remorque n'aurait qu'accéléré le processus si tant est que l'on ait tenté ce genre de man_uvre. On a évoqué l'hypothèse de l'intervention d'une équipe « évaluation-intervention ». Mais qu'aurait-elle fait ? Elle aurait constaté des problèmes sur le bateau, mais n'aurait pas pu se substituer à l'équipage ou le compléter sur ce point. Cette équipe est faite pour les navires à proximité de terre, notamment pour aider un équipage insuffisamment nombreux à passer la remorque afin de mettre le navire à l'abri.
Les trois autorités étaient prévenues : le C.R.O.S.S., le préfet maritime via son commandement opérationnel, et le port de Donges.
M. le Rapporteur : Selon vous, il n'y avait donc pas d'autre chose à faire ? A partir du moment où le dispositif de rupture est intervenu, la catastrophe était inévitable ?
M. Jean-Louis GUIBERT : La catastrophe était inévitable dès la veille, dès le début de la déstructuration, eu égard à la météorologie, car, même en faisant route sur Donges, le navire a encore beaucoup fatigué ; moins, certes, qu'en continuant au cap 210.
M. le Rapporteur : La catastrophe était-elle vraiment inévitable et irrattrapable, aucune assistance ne pouvant être dépêchée sur le bateau ? Autrement dit, il n'y avait rien d'autre à faire que ce qui fut fait ?
M. Jean-Louis GUIBERT : Vu de la passerelle ou du pont, oui. Personne n'a pu descendre dans les capacités pour essayer d'apprécier la situation. Il était impossible de savoir où l'on en était. Les gros navires modernes possèdent désormais des jauges de contrainte permettant de connaître la situation de la coque. Mais sur des navires, tel l'Erika, cela n'existe pas. Il n'y avait donc aucune connaissance de ce qui se passait à l'intérieur des cuves ; on pouvait simplement constater des changements de niveau dans les citernes.
M. Louis GUEDON : Nous avons tous reçu des informations par les personnes autorisées. Vous avez évoqué, monsieur le secrétaire général, la personnalité du commandant du port de Saint-Nazaire. Nous avons tous connaissance de ses dires. Il a expliqué que l'Erika ne pouvait être reçu à Donges, puisqu'il existait un risque de pollution de l'estuaire de la Loire et que la lutte contre un déversement de pétrole posait trop de problèmes dans un estuaire.
Alors que votre rapport semble dire le contraire, on est en droit de penser qu'entre l'appel de détresse lancé par le commandant de l'Erika
et le refus du commandant du port de Saint-Nazaire d'abriter le navire, refus qui n'est pas une affaire en l'air puisque le témoignage du commandant du port - qui l'a répété devant les médias - en atteste, le bateau a été désorienté lorsqu'il faisait route vers Donges à 6 n_uds et qu'il a été laissé à lui-même dans le golfe de Gascogne, puisqu'il se voyait interdire la route de Donges.
M. Jean-Louis GUIBERT : Sur ce point, je tiens à rétablir les faits. Nous avons eu connaissance de la communication avec le commandant du port, qui a accepté de recevoir le navire. A ce moment-là, il n'était encore question que d'une rémanence de l'affaire de la veille. Vous-même évoquez le deuxième message de détresse, celui envoyé le dimanche à 6 heures du matin. Or, à ce moment-là, le commandant du port a indiqué que, même si l'Erika
présentait une gîte et bien que ce ne soit pas facile, il pouvait l'accueillir au port. Il a simplement ajouté qu'en cas de fuites, il ne pourrait les contenir avec les barrages traditionnels posés autour d'un pétrolier, car les courants de marée étaient tels que le pétrole passerait par-dessus. Ce qui est vrai. On sait qu'avec 2,5 n_uds de courants, le pétrole n'est pas contenu dans les barrages portuaires. Le commandant du port n'a pas eu véritablement le temps de refuser à l'Erika
l'accès à Donges. Qu'aurait-on fait si le navire était parvenu jusqu'aux abords du littoral ? Peut-être l'aurait-on mis un peu plus à l'abri à terre en attendant que passe la tempête. En tout cas, le commandant du port n'a pas eu l'occasion de refuser.
M. Louis GUEDON : Au moins eût-on localisé le désastre.
M. Jean-Louis GUIBERT : Si l'on se reporte à l'endroit où le navire a connu de premières difficultés, au milieu du golfe de Gascogne, la pollution eut sévi de Penmarc'h jusqu'à Bayonne, voire sur les côtes espagnoles.
M. Jean-Michel MARCHAND : Je reviens à la chronologie.
J'ai été étonné des horaires indiqués. Vous venez de répondre en partie à mes interrogations. Je relève simplement qu'un appel de détresse est lancé à 14 heures 08 et qu'à 14 heures 18, seulement 10 minutes plus tard, le navire est partiellement redressé et, si j'en crois les données transcrites, le bateau passe de 10 à 5 degrés de gîte.
Je m'étonne donc de ce temps très court, alors que l'on met plus d'une heure pour déballaster. Techniquement, l'information est-elle incontestable ?
Vous m'avez déjà partiellement éclairé à ce sujet puisque vous avez par ailleurs indiqué que le capitaine avait fait tout ce qu'il fallait.
Sur un plan technique, il n'a pas été possible de se rendre sur place pour vérifier l'état des structures, ce que l'on peut aisément comprendre. Mais comment se fait-il qu'une telle vérification ne soit pas intervenue auparavant ? La vérification n'étant possible qu'après dégazage, ne peut-on en déduire la nécessité d'obliger les navires à dégazer au port, sinon de telles structures ne seraient jamais visitées ? C'est là une préconisation qui pourrait figurer parmi les recommandations que nous serons amenés à formuler.
M. Jean-Louis GUIBERT : C'est un point important, sur lequel nous allons revenir.
S'agissant de la chronologie des événements, je précise que j'ai travaillé sur le journal de bord - le journal passerelle -, dont nous avons eu la copie, et sur les messages. Sur ce dernier point, la corrélation des horaires relevés avec les faits peut parfois présenter des décalages de 3 ou 4 minutes. Vous me dites que passer du « mayday » au message « pan » a nécessité 22 minutes. Mais il ne s'agit là que d'un élément factuel. Etait-il bien raisonnable de le faire au bout de 20 minutes ? C'est difficile à dire. Mais le navire a fait cap inverse, ce qui modifie l'appréhension des choses, vue du navire.
S'agissant du contrôle, fond du problème puisque le navire a cassé, nous n'entrerons pas dans le détail des causes ni de leur analyse. Le problème a porté sur les structures du ballast, zone fragile de ces bateaux, qui se corrodent très vite. Il faut donc les surveiller le plus souvent possible.
La visite des 5 ans - special survey - a été réalisée par le Rina dès lors que le B.V. lui a transmis le dossier. Je travaille quelque peu sans filet, car nous commençons seulement à étudier ces dossiers, qui ne sont pas minces. J'en retire pour l'heure que le Rina, en juillet-août 1998, a procédé à une inspection totale du navire et des structures. Il a effectué des relevés d'échantillonnage conformément à une procédure élaborée au sein de l'Organisation maritime internationale, au titre évocateur de : « Visite renforcée des navires âgés ». Cet intitulé démontre que l'O.M.I. a bien pris en compte le vieillissement des navires pour augmenter les visites de sécurité. Nous disposons donc d'un relevé conforme, énorme, reprenant l'ensemble des relevés d'épaisseur, d'où ressortent des faiblesses dans les ballasts n° 2 qui avaient été signalées par les commandants ayant eu l'opportunité de les voir les rares fois où ils furent accessibles. Dans le cadre d'un arrêt technique de ce type, le navire est en cale sèche, tout est ouvert et ventilé ; il est possible de procéder à des investigations approfondies. Dans le chantier de Bjiela au Monténégro, des réparations ont semble-t-il été effectuées. Nous ne disposons pas de leur liste. Elles auraient consisté à remplacer des tôles sur le pont, corrodées davantage par le dessous que par le dessus, et à remplacer des renforts dans le haut du ballast : 7 furent remplacées au Monténégro après que 2 ou 3 l'aient été en 1997 sous la surveillance du Bureau Véritas. Par ailleurs, à peu près 50 % des renforts auraient également été remplacés. Les renforts sont les poutres sous-tendant les parois, les murailles, les ponts dans la partie haute.
Les réparations ont davantage porté sur la partie haute que sur la partie basse, la corrosion ayant été plus forte en partie haute.
En 1999, l'Erika a subi la visite annuelle de sa société de classification, à l'occasion de laquelle peu de problèmes furent signalés. En revanche, la visite de novembre 1999 nous a fortement intéressés. Souvent, en fonction des escales, les visites annuelles se font par tranches. Trois semaines avant l'accident, un inspecteur du Rina est descendu dans le ballast vraisemblablement à l'origine du naufrage avec un représentant de la société de gestion, Panship. Il a établi un rapport selon lequel il fallait, au cours du mois de janvier 2000, revenir dans ce ballast et reprendre des échantillonnages, ce qui laisse supposer qu'apparaissaient à nouveau des pertes d'épaisseur, qui, avant les remplacements, avaient atteint environ 25%, ce qui est très important sur des tôles de l'ordre de 10 millimètres. Par ailleurs, les corrosions des plafonds attaquent souvent les cordons de soudure. C'est dire que ce ne sont pas forcément les renforts qui lâchent, mais les soudures elles-mêmes. La poutre se trouve alors en porte-à-faux et la tôle de pont se trouve sans aucun raidisseur. C'est-à-dire qu'elle va travailler à la flexion, ce qui peut d'ailleurs expliquer les premières criques constatées sur le bateau.
Quid de la cadence des visites ? Sur ces bateaux, il est prévu des systèmes de ventilateurs et d'équipements permettant aux gens du bord de visiter ces capacités, car ce sont eux les mieux placés pour profiter d'une occasion. C'est ainsi que le commandant Krun Mathur et son prédécesseur avaient constaté une corrosion importante du ballast. Ils l'avaient signalée. Il y avait des paquets de rouille au fond, des boursouflures, des écailles de rouille. Des pertes de 25 % à 30 % sur les anodes du système cathodique qui jouent un rôle de protection, notamment lorsque le revêtement disparaît, avaient été relevées. Or, ce sont ces anodes qui suppléent et qui, en somme, absorbent une partie de l'effet électrolytique diminuant de ce fait la corrosion. Manifestement, le ballast était très atteint.
L'expert du Rina ayant indiqué, au mois de novembre, que la question devait être revue en janvier, cela signifiait que, avant d'arriver au port d'escale qui convenait le mieux en janvier, il fallait, vingt-quatre heures avant, arrêter toutes les dispositions nécessaires pour rendre la capacité visitable, et éventuellement stopper le navire. C'est un point extrêmement important : on peut demander et procéder à une inspection approfondie des ballasts, mais cela entraîne l'arrêt du navire pour une certaine durée.
M. Jean-Michel MARCHAND : Vous parlez d'arrêter le navire pour contrôler son état. Dans la plupart de nos ports, est-on en mesure d'effectuer les réparations ? Autrement dit, le navire n'est-il pas contraint, à un moment donné, même si l'on a constaté des défaillances, de reprendre la mer pour pouvoir être réparé ailleurs ? Ne peut-il pas, éventuellement, profiter de ce sursis pour se soustraire aux réparations nécessaires ?
M. Jean-Louis GUIBERT : Vous avez raison, mais cela intervient pour la classification comme pour les visites de l'Etat du port. Supposons qu'un inspecteur constate un élément irréparable dans un port belge. Je prends l'exemple de la Belgique à dessein, car il existe une méthode qui permet de détourner le Mémorandum de Paris : un bateau part de Hambourg ou de la Baltique avant de mettre le cap sur le continent américain. Le dernier port européen dans lequel il doit faire escale est Le Havre. A chaque port, il est demandé que les réparations soient faites au port suivant.
In fine, ces réparations doivent être réalisée dans le dernier port d'escale avant de traverser l'Atlantique, c'est-à-dire Le Havre, qui a la chance d'être bien outillé. Mais il est vrai que certains ports ne sont pas en mesure de faire les travaux. Autrement dit, si l'intervention du Rina avait eu lieu dans un port où l'on ne pouvait réparer, cela aurait voulu dire qu'il fallait envoyer le navire en question dans un port où il était possible de le réparer.
Un autre problème se pose également : celui de la capacité du chantier, en l'occurrence celui du Montenegro, dont nous avons appris l'existence du fait du naufrage de l'Erika. Il y a là un problème de surveillance des chantiers navals de réparation. Normalement, sur un chantier naval compétent, les représentants des sociétés de classification sont présents en permanence. Ils surveillent les travaux demandés par la société de classification ; ils certifient ensuite qu'ils ont bien été effectués. En l'occurrence, quelques zones restent encore floues.
M. le Rapporteur : Ces zones qui demeurent floues font-elles actuellement l'objet de vérifications de votre part ?
M. Jean-Louis GUIBERT : Nous procédons à ces vérifications du mieux possible, c'est-à-dire, pour le moment, sur la base des documents qui nous sont parvenus.
M. le Président : N'y a-t-il pas obligation pour un navire sujet à réparations de se rendre sur un chantier conforme ?
M. Jean-Louis GUIBERT : Il n'existe aucune obligation de ce genre. Il faut simplement que le chantier ait des soudeurs et des réserves de tôles permettant les réparations, ce qui se fait assez rare dans certaines régions.
M. le Président : Chacun peut donc s'installer comme réparateur de navire ?
M. Georges TOURRET : Non, pas tout à fait. Il existe une obligation d'homologation des soudeurs. Un des points en instance de vérification porte sur la présence ou non de soudeurs agréés et certifiés sur le chantier de Bjiela. Par ailleurs, il convient de déterminer si les inspecteurs des sociétés de classification étaient installés à demeure.
M. Jean-Louis GUIBERT : Cela étant, la certification de soudeurs agréés sur l'acier n'est pas difficile à obtenir. Je l'ai moi-même obtenue chez les Américains. C'est vous dire !
M. le Président : Il y en a, de la Pologne à la Grèce.
M. Jean-Louis GUIBERT : L'aluminium, en revanche, est beaucoup plus difficile à travailler. Le problème n'est pas tant celui de la compétence des soudeurs que celui de la surveillance permanente sur le chantier. C'est une donnée importante. Il faut que nous sachions s'il y avait quelqu'un ; ensuite, s'il s'agissait d'un expert du Rina, dédié à cette société de classification, et non d'un expert multicarte, qui ne vaut généralement pas grand-chose, car il représente tout le monde à la fois. On a souvent des surprises à ce sujet-là.
Mme Jacqueline LAZARD : Le nombre des arrêts techniques des navires diminue et la durée entre deux arrêts techniques est de plus en plus longue, même pour des compagnies françaises. Sans doute y aura-t-il lieu de faire une recommandation, voire de proposer une obligation sur le sujet, puisque l'état des structures peut seulement être évalué au cours des arrêts techniques.
M. Jean-Louis GUIBERT : Vous avez raison et il convient d'agir rapidement.
Il y a quinze jours, j'étais à Londres. Nous avons connu une attaque en règle de l'I.A.C.S., laquelle estimait que le rapport du B.E.A./mer ne voulait rien dire, qu'il s'agissait d'un rapport provisoire, que nous ne disposions d'aucune preuve. Certes, c'était de bonne guerre !
Ses représentants se sont réunis très rapidement et désormais, c'est à celui qui ira le plus vite. Que veulent-ils sinon garder la maîtrise de l'affaire, quitte - ce qu'ils proposent d'ores et déjà - à renforcer les mesures des visites améliorées au titre du vieillissement des navires ! Ils proposeront quelque chose. A nous d'être plus vigilants, puisque l'I.A.C.S. opère tout de même la classification et la certification d'une grande partie des navires qui passent par l'Europe. Il nous faut, au sein de l'Union européenne et de l'O.M.I., non pas les contrecarrer, mais vérifier que les textes sont appliqués, car le problème est bien celui-là. Il faut faire respecter les textes que l'on prend, sinon cela ne sert à rien.
Du côté des sociétés de classification, se posent des problèmes de qualification de personnel et de suivi. Ainsi que le souligne le rapport, il est un point essentiel à retenir : procéder seulement à des visites, pour la plupart documentaires ou de surface, est insuffisant. J'emploie les termes «de surface » à dessein. Le dessus d'un pont peut être parfaitement peint et être pourri en dessous. Tant que nous ne disposerons pas d'une culture du contrôle partagé, non seulement par les sociétés de classification, mais aussi par les services de l'Etat du port comptant des personnes formées qui « plongent », au sens propre du terme, dans les citernes, il est inutile de croire que les choses pourront s'améliorer de beaucoup.
Pour des États comme Malte, les choses sont bien plus simples. Les contrôles par l'Etat du pavillon n'existent pas et tout est délégué à la société de classification. Moyennant quoi, le Rina, après le B.V., opérait non seulement la classification telle que je viens de vous l'exposer, mais également la certification, à savoir la délivrance des titres internationaux. Ainsi, il n'est pas difficile d'être en règle, et effectivement, tous les titres de l'Erika
étaient impeccables, y compris le titre I.S.M. Si l'on s'arrête à ce type de contrôles, on n'assure qu'une partie du travail.
M. le Président : Les professionnels que vous êtes - non pas au regard de votre position au B.E.A./mer, mais plutôt en votre qualité de commandant - n'estiment-ils pas que tout pays admettant que son pavillon puisse être arboré par un navire devrait être obligé de mettre en place une administration maritime, sous peine d'être exclu de la communauté maritime, y compris des communautés politiques qui s'instituent par ailleurs ?
M. Jean-Louis GUIBERT : C'est une proposition, monsieur le Président.
M. le Président : Je l'avance.
M. Jean-Louis GUIBERT : En tant que politiques, vous le savez mieux que nous. Le problème est le suivant : jusqu'où peut-on aller à cet égard vis-à-vis des pavillons de complaisance, si l'on sait que la moitié de la flotte mondiale est sous pavillon de complaisance et qu'il existe des bons et des mauvais pavillons de complaisance ?
Il y a quelques années, lorsque M. Le Pensec est arrivé au ministère de la mer, il m'a demandé de faire la chasse aux pavillons de complaisance, ce à quoi je lui ai répondu de me permettre de la faire tout d'abord aux navires sous normes. Il m'a demandé quelle était la différence. Je lui ai répondu que, la veille, j'avais vu un navire français sous normes. Pour être une boutade, ma réponse n'en renvoyait pas moins à une réalité. C'est pourquoi je crois nécessaire d'appréhender le problème dans sa globalité.
Parmi les mesures pratiques, le rôle des sociétés de classification est extrêmement important. Il est concurrentiel. Il tient aux hommes, qui sont ce qu'ils sont. La plupart des experts du Bureau Veritas sont des hommes comme moi ou ayant, comme M. Drevet, ingénieur mécanicien, la même formation de marin assortie de compléments de formation. Est-ce suffisant ? C'est une première question.
Je crois qu'il faut surveiller de près les sociétés de classification. J'ai souvenir que, dans un décret de 1984 ou de 1987, avait été intégrée l'idée de mieux les contrôler. C'est une mesure que je crois nécessaire d'introduire au niveau international, sans quoi toute une partie nous échappera, surtout dans la mesure où elles sont de plus en plus souvent délégataires de pays incapables d'assumer leur responsabilité de contrôle.
Cela étant, en France, les sociétés de classification font à peu près correctement leur travail. Des dossiers que nous avons à connaître avec Georges Tourret, révèlent qu'une même société de classification est très sévère pour un navire battant pavillon français mais peut l'être moins pour un navire battant le pavillon d'un autre Etat. Il existe un double régime. Je ne porte pas une accusation. C'est un constat. Je dis qu'il faut aller très loin dans ce contrôle des sociétés de classification.
Il ne faut pas non plus laisser les sociétés de classification faire le double métier qui consiste à être à la fois classificateur et certificateur. C'est un progrès que nous pouvons obtenir, à faible coût.
Un dernier point est pour nous très important. L'un d'entre vous nous a d'ailleurs demandé comment nous obtenions nos informations. Nous les obtenons de façon laborieuse. Tout ce qui relève de la documentation proprement dite et du Lloyd's a été obtenu quarante-huit heures après l'accident, nous permettant ainsi de prendre beaucoup d'avance sur les autres commissions. Cela étant, nombre d'informations sont difficiles à obtenir, car nous n'avons pas de pouvoir judiciaire, une loi étant nécessaire pour cela. Par conséquent, nous peinons quelque peu.
Dans le cas présent comme dans beaucoup d'autres, le vrai dossier de sécurité n'est pas celui que détiennent les centres de sécurité de Concarneau ou de Lorient, mais celui de la société de classification. Il faut donc que les dossiers des sociétés de classification puissent être adressés immédiatement aux enquêteurs, quels qu'ils soient, dès lors qu'ils en ont fait la demande. En l'état actuel des choses, par « déontologie » - le terme est aimable -, l'I.A.C.S. refuse de communiquer ou de faire communiquer les dossiers des sociétés de classification. Pour ce faire, elle prétexte que lesdites sociétés travaillent pour l'armateur et que, par conséquent, seul l'armateur peut donner son aval. C'est la vieille école qui existe depuis 30 ans ! La nouvelle école s'y refuse au prétexte que la société de classification travaille pour l'Etat du pavillon et qu'il s'agit donc d'un problème de souveraineté ! Il a fallu que nous demandions nos informations à Malte. Nous n'avions guère l'air astucieux de demander aux autorités maltaises de bien vouloir nous communiquer les documents du Rina et du Bureau Veritas relatif à l'Erika. La transmission des dossiers des sociétés de classification aux enquêteurs sur les événements de mer accidentels constitue donc un sujet qui doit retenir votre attention.
M. Georges TOURRET : J'ajouterai que des États laxistes apparaissent tous les jours. Il y a peu, nous nous sommes trouvés confrontés à un navire battant pavillon géorgien dont les armateurs, soi-disant immatriculés en Bulgarie, étaient Syriens et domiciliés à Chypre. En l'occurrence, l'Etat du pavillon avait rajeuni le vraquier en question de 3 ans en lui délivrant un certificat qui le faisait paraître moins âgé que 30 ans alors qu'il en avait plus. La Georgie avait également donné délégation à une société de classification dont nous n'avions jamais entendu parler auparavant. Cela pour dire aussi que l'on voit régulièrement apparaître des sociétés de classification. Existent ainsi, en dehors des sociétés de classification de l'I.A.C.S., l'International Shipping register et, entre autres, l'Arabian Shipping register, dont j'ai vu une fois les papiers, qui a disparu et qui n'est immatriculé nulle part. On ne peut éluder une demande, que nous avons formulée par écrit dans notre rapport provisoire, à savoir que les affréteurs vérifient exactement à qui ils ont affaire et de quoi il s'agit lorsque des documents leur sont présentés.
M. Jean-Louis GUIBERT : Ce que vient de dire M. Georges Tourret est exact. Cependant, il n'y avait rien à apprendre du dossier de la société de classification bulgare, du moins pas grand-chose. En revanche, il me semble important de travailler dans le cadre de l'I.A.C.S., dont le domaine est à peu près circonscrit. Si nous y parvenons, les sociétés membres de l'I.A.C.S. sauront qu'en cas d'accident, l'Etat côtier exercera un contrôle latent sur leur sérieux via les enquêtes sur les événements de mer. L'Erika étant en eaux internationales, le B.E.A./mer ne pouvait diligenter une enquête que sur le fondement du risque de pollution des côtes françaises, et non sur celui de la non-assistance à personne en danger, qui n'avait aucune consistance juridique. En effet, on ne pouvait accuser le capitaine de mettre en danger son équipage, d'autant qu'il a très bien participé à son sauvetage. Les justifications de notre enquête sont donc très ténues. Certes, il était inconcevable de ne pas réagir, mais le dossier du Rina nous a été refusé, car nous n'agissions pas au nom de l'Etat du pavillon. L'Etat côtier doit se voir reconnaître le droit d'obtenir très rapidement les renseignements concernant un navire impliqué dans un événement de mer. Les sociétés de classification, du moins celles appartenant à l'I.A.C.S. - soit environ une dizaine -, sauront ainsi que de tels dossiers seront immédiatement intégrés dans des rapports d'enquête, ce qui serait nouveau au regard de la situation actuelle.
Mme Jacqueline LAZARD : Par votre expérience de commandant et la connaissance des faits relatifs à l'Erika, pouvez-vous affirmer aux membres de notre commission, qu'à votre sens, l'attitude du commandant a été logique, cohérente, en un mot professionnelle ?
M. Jean-Louis GUIBERT : Je ne puis que vous répéter ce que j'ai dit. Dans les mêmes conditions - c'est-à-dire avec un vent passant brutalement à force 9 et un pétrolier de 180 mètres qui prend de la gîte jusqu'à une dizaine de degrés par tribord -, je pense que j'aurais fait la même chose.
M. Jean de GAULLE : Vous auriez annulé votre message de détresse ?
M. Jean-Louis GUIBERT : Ayant réussi à pallier l'événement majeur constitué par la gîte, ayant redressé le navire et ayant la possibilité de me réfugier dans un port, certainement. Je serais peut-être resté en « mayday », puis en « pan » plus longtemps. Mais le message « pan » n'est que le fait de laisser les moyens de sauvetage en alerte. En plein milieu du golfe de Gascogne, je ne vois pas ce que j'aurais pu attendre de navires classiques, si ce n'est évacuer mon équipage.
M. François GOULARD : Je reviens sur le film des événements.
Vous indiquez qu'à 14 heures 55, est intervenu un échange en phonie entre l'Erika et le C.R.O.S.S., le seul de la période. Avez-vous eu accès à un enregistrement de cet échange ? Quelles conclusions en tirez-vous, notamment vous semble-t-il que les échanges ont permis de bien analyser la situation ?
Je souhaiterais également maintenant quelques précisions. Vous avez indiqué que le navire, faisant route vers Donges, marchait à 6 n_uds. Or, j'ai relevé que le rapport provisoire fait état de 9 n_uds. Pouvez-vous revenir sur cette différence, même si elle n'est pas considérable ?
M. Jean-Louis GUIBERT : Les informations du rapport reposent sur les données immédiatement portées à notre connaissance. Depuis, nous revoyons les éléments ayant trait aux diminutions d'allure.
M. François GOULARD : Quand il décide de faire route vers Donges, le commandant met le cap au 85, donc vers l'est à peu de chose près. Dans le courant de la nuit, il met beaucoup de nord dans son est et fait route au 50. Y a-t-il une explication rationnelle ?
M. Jean-Louis GUIBERT : Cela correspond à peu près à l'endroit où il « monte » sur le plateau continental. Bien qu'ayant la mer de l'arrière, il...
M. François GOULARD : Cela dit, il s'éloigne très sérieusement de son cap. C'est d'ailleurs pourquoi il a coulé au large de Belle-Ile.
M. Jean-Louis GUIBERT : Sur la carte annexée au rapport, vous noterez trois points G.P.S. : à 4 heures, 5 heures, 6 heures. Ces points se retrouvent sur la route. Il est revenu au 90.
M. François GOULARD : Oui, en fin de parcours.
M. Jean-Louis GUIBERT : Effectivement, je crois que la « montée » sur le plateau continental et les mouvements de plate-forme l'ont conduit à venir un peu plus au nord pour trouver une meilleure route. C'est quelque chose que l'on sent. Il faut être sur la passerelle pour sentir le moment où l'on est moins mal et où votre navire souffre le moins. Je pense donc que c'est ce qu'il a fait. Toutefois, on ne peut l'assurer. Après, il a fait cap sur Donges, mais il s'est arrêté avant.
Sur l'échange en phonie, nous disposons d'une bande enregistrée. Néanmoins, sur le plan juridique, les C.R.O.S.S. n'ont pas encore l'obligation d'enregistrer tous les messages. Je le précise car on m'a déjà posé la question.
Ce message est le seul qu'il y ait eu sur 21/82 en H.F. Le commandant a confirmé ce qu'il avait fait et qu'il avait vu les trois fissures sur le pont. La communication de mauvaise qualité s'est arrêtée là. En H.F., cela fonctionne assez mal.
M. Georges TOURRET : Il a répété que le navire était sous contrôle.
M. le Rapporteur : Serait-il possible que la commission d'enquête obtienne la liste des États du pavillon qui font appel aux sociétés de classification pour assurer leurs propres contrôles ? Vous indiquiez que les sociétés de classification, comme Rina, certifient parfois les normes de sécurité des navires à la place de l'Etat du pavillon, c'est pourquoi il serait intéressant que nous sachions exactement qui fait quoi dans certains pays.
M. Jean-Louis GUIBERT : Nous pourrions disposer de ces informations par l'O.M.I. Ceci étant, je ne suis pas sûr que l'on sache précisément les moyens que les États se sont donnés pour contrôler les sociétés de classification. J'insiste bien sur le fait que, en France, nous avons la possibilité de procéder avec eux à des visites, les visites mixtes associant des inspecteurs des Affaires maritimes et du Bureau Veritas constituant une méthode utile et efficace. A cette occasion, nous confrontons nos méthodes de travail. Par ailleurs, si un inspecteur peut détecter tout seul de la rouille et de la corrosion dans un ballast, sans échaffaudage, parce que le bateau est en exploitation, mon expérience me prouve que l'on n'est pas trop de deux ou de trois. D'ailleurs, nous proposons, qu'en cas de problème, outre l'expert de la société de classification du navire, un expert d'une autre société de classification du port où se trouve le navire et, si on en a les moyens, un inspecteur du service de sécurité du port soient en mesure d'effectuer conjointement les contrôles de sécurité qui s'imposent. On n'est jamais trop de deux ou de trois pour procéder à l'inspection et prendre la décision. C'est un élément nouveau dans notre culture.
M. René LEROUX : Je suis plus particulièrement touché par les conséquences de tout ce que vous nous dites. Je ne suis pas le seul au sein de cette commission d'enquête. Par conséquent, je souhaiterais savoir, compte tenu des conditions atmosphériques de cette fameuse nuit, à combien vous estimez le nombre de bateaux qui auraient pu subir les mêmes avaries.
M. Jean-Louis GUIBERT : 150 bateaux/jour passent à Ouessant. Au moins la moitié d'entre eux prend la route du fer, c'est-à-dire qu'ils suivent le trajet Ouessant-Finistère espagnol. Cela vous donne une idée approximative.
M. René LEROUX : Sont-ils tous dans le même état que l'Erika ?
M. Jean-Louis GUIBERT : Heureusement, non !
M. René LEROUX : Ne disposez-vous pas d'une estimation du nombre de bateaux qui nécessiteraient des travaux ?
M. Jean-Louis GUIBERT : Non. L'état de l'Erika comme celui d'autres navires est inhérent au marché des produits qu'ils transportent. C'est dire que des bateaux de ce type passent tous les jours au large d'Ouessant. Heureusement, ils ne présentent pas tous des fragilités dans leur structure et dieu merci il n'y a pas tous les jours un vent de force 9 ! Mais il est vrai que le risque est lié notamment au transport de produits noirs.
M. Georges TOURRET : Il n'y a pas de tempête dans le golfe de Gascogne qui ne comprenne pas dans son rayon d'action des navires marchands, parmi lesquels des navires chargés de produits polluants et dangereux.
M. Jean-Louis GUIBERT : Ces navires sont décomptés par le C.R.O.S.S.
M. François GOULARD : C'est un fort coup de vent, ce n'est même pas une tempête.
M. Jean-Louis GUIBERT : Avec un vent de force 9-10, de telles conditions météorologiques sont qualifiées de tempête. De toute façon, il s'agit d'une situation pour le moins inconfortable.
M. Pierre HERIAUD : Au terme du film qui vient de se dérouler, nous constatons que ce sont surtout les procédures en amont, c'est-à-dire préventives, qui feraient défaut, du moins n'existeraient-elles pas au niveau drastique et rigoureux qui semble nécessaire. Finalement, après le naufrage de l'Erika, tout aurait été fait en termes de procédures avec tous les opérateurs, là où ils étaient, et il n'y aurait rien à redire. Du moins, c'est un peu ce que j'en retiens personnellement. Est-ce aussi exact, selon vous ?
M. Jean-Louis GUIBERT : Vous avez raison, monsieur le député. Vous considérez que je vois les choses selon une certaine optique.
En tant que marin et surtout après avoir vu nombre de problèmes en ce domaine dans diverses fonctions, je suis persuadé que si l'on ne fait pas tout pour prévenir l'accident et pour prévenir la pollution qui en résulte, notre marge de man_uvre est très réduite par la suite. La lutte contre la marée noire est une image flagrante. Cela fait des années que de comité interministériel en comité interministériel, on améliore les stocks, les barrages, les produits, etc., et chaque pollution qui survient est différente de la précédente avec les pires difficultés pour la traiter. Autrement que par mer calme, avec un vent de force 1 ou 2, on ne sait pas mettre des barrages et récupérer du pétrole. Le problème c'est que l'opinion ne comprend pas que l'on en soit encore là. On a fait opérer des bateaux allemands, dédiés à ce type de lutte, qui coûtent très cher. Heureusement, ils ne servent pas très souvent. Ils n'ont pas mieux travaillé que les nôtres. Nous avons assisté le
Sea Empress, un navire sur la côte anglaise, avec les moyens stockés à Brest. L'utilisation de nos bateaux en eaux plus calmes a produit un rendement assez bon. Tout dépend du produit transporté.
D'ailleurs, les problèmes ont commencé avec l'annonce du CEDRE : il n'y aura pas de pollution, parce que ce produit-là restera là où il est.
En lui-même, le comportement du pétrole en eau de mer, selon la température, l'agitation de la mer, produit des effets variés. Habituellement, la mer agitée est favorable en cas de pollution, car cela fractionne les molécules et se produit alors une grande évaporation, de l'ordre de 50 à 60 % au cours des 4 ou 5 premiers jours. Manque de chance, le produit transporté par l'Erika était plus tenace. Le problème se repose à chaque fois de la même manière.
De ce que je dis, on peut retirer le sentiment que l'on n'a rien fait avant et peu de choses après. Mais un bateau n'est pas fait pour se casser.
J'en arrive au point final de notre étude et sur ce que nous proposons.
Une tendance consiste à penser qu'il faudrait arrêter de faire naviguer un bateau à 20 ou à 25 ans. Or, il existe des bateaux de 20 ou 25 ans en parfait état alors que d'autres, âgés de 5 ans, sont totalement pourris. J'en ai vu ! En revanche, il faut savoir que l'on a du mal à renouveler un bateau de 25 ans. Il faut peut-être alors envisager de le renouveler. Si l'on pose des limites drastiques, que se passera-t-il, comme pour toutes les limites ? M. Le Drian le sait parfaitement. Lorsque l'on parle de tonneaux de jauge brute ou de mètres, à chaque fois il existe une mesure perverse permettant de transgresser les limites. Si vous fixez un âge, la limite sera transgressée. Comment ? Pour l'exemple, arrêtons-la à 20 ans. Une visite spéciale d'une société de classification interviendra à 15 ans ; peut-être une visite intermédiaire moins lourde interviendra-t-elle à 17 ans et demi. Mais je suis prêt à parier que le bateau ne sera plus entretenu les deux dernières années. Le ballast de l'Erika s'est détérioré en quelques mois. D'où l'effet pervers des limites.
L'idée d'un diagnostic, fondé sur une visite technique « associative », pour déterminer la durée de vie d'un bateau, pour savoir s'il vaut encore les réparations et quelles réparations il lui faut pour durer un ou deux ans - avant de dire à l'armateur que dans deux ans c'est terminé - est un objectif, même s'il est difficile, qui mérite d'être étudié.
M. Léonce DEPREZ : Quelle est l'autorité internationale qui fixe les règles que doivent respecter armateur et affréteur ?
Quelle est l'autorité effective de l'O.M.I. ? En a-t-elle réellement une ? Ne pourrait-elle en acquérir une qui s'imposerait à tous les pays et à tous les navigants ?
M. Jean-Louis GUIBERT : Je laisserai Georges Tourret répondre à la première question. J'indiquerai simplement que le droit maritime régit les relations entre tous les tenants et aboutissants d'un navire et son exploitation.
Au sujet de l'O.M.I., d'aucuns diraient que c'est un « machin ». C'est un « machin » qui aujourd'hui réunit 150 pays. Une telle organisation internationale n'est donc pas très facile à gérer. Quant aux règles, il y en a presque trop. Les conventions, telle la convention SOLAS - Safety Of Life At Sea - est aujourd'hui, dans son édition de 1974, très élaborée sur le plan normatif. Il y a encore 30 ans, le contenu d'une convention était très léger, parce qu'il fallait la faire ratifier par les pays. Désormais, les conventions internationales, à l'image de SOLAS, comprennent des règles assez poussées, le problème étant de les faire appliquer. L'O.M.I. n'a pas de force de police, c'est-à-dire pas d'inspecteurs. Elle a mis en place un sous-comité auquel j'assistais récemment : le F.S.I.
- Flag State Implementation -, dont le sigle signifie en français « l'application des règles par l'Etat du pavillon ». Ce sous-comité essaye de faire le lien entre les règles édictées par l'O.M.I., c'est-à-dire par les 150 pays participants, et leur vérification par les Mémorandums. Pour schématiser, l'O.M.I. élabore des règles, et le sous-comité F.S.I. essaye d'accommoder ces règles avec leur contrôle, qui ne peut être assuré que par les Mémorandums. A l'origine, l'O.M.I. était contre le Mémorandum de Paris, parce qu'on lui retirait une partie de ses prérogatives. Aujourd'hui, une politique de Mémorandums régionaux a été favorisée un peu partout pour aider à l'application des règles. Nous connaissons donc une évolution. Pour conclure, sur l'O.M.I., je dirais que son utilité est avérée.
S'agissant des actions à envisager au niveau européen, ce à quoi vous pensez certainement M. le Député, les autorités de Bruxelles peuvent sans doute faire davantage sur le plan normatif. D'ores et déjà, l'Union européenne gère le Mémorandum de Paris. Aller plus loin suppose que des propositions soient formulées. Toutefois, sur un plan politique, il me semble que l'essentiel doit remonter à l'O.M.I. si nous voulons que la portée du contrôle soit internationale. Il ne s'agit pas tant de règles que de propositions sur le modèle de ce que je vous disais, par exemple, au sujet des sociétés de classification. Il faut les faire remonter via Bruxelles, parce que cela concerne l'I.A.C.S. au niveau européen. L'I.A.C.S. est agréée par l'Europe pour contrôler les navires, mais elle travaille également pour d'autres pays adhérant à l'O.M.I.
M. Léonce DEPREZ : L'O.M.I. figure-t-elle parmi les organisations spécialisées de l'O.N.U. ?
M. Jean-Louis GUIBERT : Oui, c'est un organe technique au même titre que la F.A.O. ou l'O.I.T.
M. Léonce DEPREZ : Tire-t-elle son autorité de l'O.N.U. ?
M. Jean-Louis GUIBERT : En effet, elle ne compte pas d'autorité politique : c'est un organe uniquement technique.
M. Georges TOURRET : Si je puis prolonger votre question, je demanderai : y a-t-il une police ? Une réglementation du comportement des affréteurs et, au-delà, des règles de comportement admises par tous les États pour le pavillon existent-elles ?
Une convention du droit de la mer, qui fut très longue à mettre au point, existe. Elle comporte des dispositions précises. Nous tirons nos pouvoirs en matière d'enquête sur les problèmes de pollution de ce texte. Cependant, nous butons sur deux ou trois obstacles.
Le premier c'est l'O.M.I. elle-même. Jean-Louis Guibert vous a décrit les limites de l'exercice technique, mais une autre limite apparaît quand on se pose la question de savoir qui sont les cotisants. Au fond, la communauté maritime internationale se répartit très schématiquement à l'heure actuelle en deux groupes d'Etats : ceux qui disposent des flottes, mais n'ont ni littoral, ni administration, et ceux qui possèdent un littoral et une administration, mais plus ou moins de flotte !
La concurrence faite par les premiers États - sans police et sans prise en compte des conséquences de leurs actes - aux seconds se répercute sur les marchés et ne permet plus aux pays développés de posséder des navires qui s'inscrivent dans un contexte de rentabilité suffisant. Cet écart s'éclaire d'exemples significatifs. Une convention internationale sur les conditions d'immatriculation des navires prévoit l'obligation d'un lien substantiel entre l'exploitation et l'Etat dans lequel le navire est immatriculé. Cette convention n'a été ratifiée par quasiment personne et n'est pas appliquée. Un premier butoir est donc opposé par la souveraineté des États.
Nous avons eu la curiosité de faire livrer dans nos bureaux la presse maltaise. Il nous paraissait intéressant de connaître la perception par les Maltais de l'enquête réalisée par le B.E.A./mer au sujet de l'Erika.
Il en ressort, pour schématiser, l'argumentation selon laquelle Malte est un Etat souverain et que son administration maritime, certes, n'a pas de moyens directs, mais délègue ses prérogatives à une soixantaine de sociétés de par le monde pour exercer, en ses lieux et place, les contrôles étatiques. Ici, je dois préciser que ces soixante sociétés sont souvent des sociétés de classification rémunérées par les armateurs. Est également avancé le fait que Malte délègue l'exercice de ses attributions d'Etat du pavillon à des sociétés européennes.
La tonalité générale de cette presse peut se résumer à ce que le pavillon maltais n'est en rien concerné par l'accident de l'Erika. En fait, la situation nous semble beaucoup plus complexe. La sécurité est un concept global qui recouvre plusieurs strates. La première est celle des contrôles devant être opérés par l'armateur lui-même. Dans le cas de l'Erika, on tombe sur un armateur « émietté ». La seconde est celle des sociétés de classification : c'est la plus importante, mais elle ne vaut que par la présence d'un vrai service technique au sein de la compagnie de navigation. La troisième est celle du contrôle étatique qui doit être le fait de l'Etat du pavillon. Le contrôle de l'Etat du port n'est, dans cette affaire-là, qu'un palliatif. Pourquoi serions-nous obligés d'entretenir aux frais du contribuable un corps d'inspecteurs et de garde côtes européens pour assurer les contrôles non opérés par les États du pavillon sur une activité somme toute bénéficiaire ? La presse maltaise a fait remarquer que le chiffre d'affaires de l'immatriculation des navires sous pavillon national avoisinait 600 millions de dollars, ce qui doit représenter la deuxième ou troisième activité de l'économie maltaise. Or, c'est une activité qui a parallèlement externalisé ses coûts ! Autrement dit, le pavillon maltais internalise ses recettes d'activité et externalise les coûts du contrôle.
M. Jean de GAULLE : En l'état actuel de nos débats, je voudrais revenir sur le film des événements pour lever quelques zones d'ombre.
Dans votre rapport, vous signalez que, le 11 décembre, à 12 heures 45, l'Erika est exposé à une gîte de 10 degrés avec un vent de force 9, ce qui n'est tout de même pas rien, et que le commandant commence à faire vider le ballast n° 4 avant de lancer un appel de détresse à 14 heures 08. Il nous est précisé que le déballastage prendra quasiment deux heures, de 13 heures 30 à 15 heures 30. Je vous rappelle le contexte : force 9 et creux de 6 mètres. Dans ce même rapport, il est précisé que, à 14 heures 34, le commandant, avant même la fin de son déballastage, annule son besoin d'assistance et son appel de détresse. Il nous est précisé qu'entre-temps, à 14 heures 15, il tente de joindre ses armateurs.
Ne trouvez-vous pas un peu surprenant qu'après avoir tenté de joindre l'un de ses armateurs, le commandant de l'Erika, avant même la fin du déballastage et avant que le constat des dégâts ait été dressé à 14 heures 30, annule son appel de détresse ? Ne trouvez-vous pas surprenant que le C.R.O.S.S. se contente d'un message lapidaire, en substance : « ne vous inquiétez pas, j'ai la maîtrise du bateau », avant même que le déballastage soit terminé et dans un contexte inchangé de force 9 ?
M. Jean-Louis GUIBERT : Si le passage « pan » - qui permet de rester sous surveillance avec la possibilité d'une aide plus rapide - a été produit un peu tôt, le fait déterminant est que le commandant annonce que le bateau commence à se redresser, ce qui fut fait relativement rapidement si l'on considère la capacité en cause de l'ordre de 500 tonnes. Il a mis 2 heures. Surtout, le demi-tour a changé l'appréciation psychologique des choses. Après avoir ramassé la mer de l'avant et avoir redressé son navire pour faire demi-tour sans danger, le commandant a jugé normal d'annuler son message de détresse et de prévenir le C.R.O.S.S. sur l'évolution de la situation. Il lui semblait tout aussi normal de chercher à joindre son armateur dans le même temps pour lui demander de désigner un port de refuge.
M. Georges TOURRET : Il n'y parvient d'ailleurs pas.
M. Jean-Louis GUIBERT : Après avoir fait demi-tour, il est tout à fait conscient de ne pas pouvoir retourner dans l'autre sens ; c'est tout à fait clair. Dès lors, la seule question est : où vais-je ?
M. François GOULARD : Il y a tout de même une vraie question. L'impact sur la gîte est fonction du transfert de charge d'une façon pratiquement proportionnelle. Ce n'est donc pas en une demi-heure que la situation se rétablit !
M. Jean de GAULLE : Si la situation allait si bien que cela et si le commandant avait une si bonne maîtrise de son bateau, pourquoi décide-t-il à 14 heures 34, soit 4 minutes après le constat des dégâts sur le pont de son bateau et au moment où il explique que tout va bien, de réduire la vitesse de son navire ?
M. Jean-Louis GUIBERT : A un moment, il lui était reproché d'aller trop vite ; ne lui reprochons pas maintenant de ne pas aller assez vite !
Il ne faut voir là qu'une mesure d'adaptation aux circonstances. Le rythme du tangage et du mouvement de plate-forme avait sans doute varié du fait des changements de cap. En fait, il a tenu compte des possibilités de changer de cap comme il l'a fait durant la nuit en venant, pour d'autres raisons, au 50 - chacun l'a noté - et à un moment il joue sur l'allure machine pour s'adapter à la fréquence des mouvements de plate-forme, sachant que la chose n'est pas aisée sur un navire de ce type. Ce n'est pas un car-ferry où l'on commande une telle opération depuis la passerelle et dans l'immédiat. Pour l'Erika, il faut passer par la machine, man_uvrer le cran de pétrole, ce qui n'est pas aussi simple.
M. Jean de GAULLE : Quelle est votre réponse sur l'attitude du C.R.O.S.S. qui prend acte que finalement les choses vont bien et de l'annulation du message de détresse ?
M. Jean-Louis GUIBERT : Pour avoir exercé des responsabilités vis-à-vis des C.R.O.S.S., je puis vous dire que par ce temps-là, ils ont tellement de problèmes un peu partout que si un « client » leur indique aller mieux et ne pas se porter trop mal - j'utilise l'expression à dessein -, ils se consacrent aux cas signalés comme les plus sérieux parmi les 50 ou 60 problèmes concomitants qui concernent tout aussi bien les planches à voile ou les voiliers.
M. François GOULARD : En décembre, vous ne trouvez pas de planche à voile dans ces zones-là.
M. Jean-Louis GUIBERT : Je vous garantis que si ! Vous en avez tout l'hiver.
M. Georges TOURRET : Chaque matin, parce que nous en sommes destinataires, nous lisons les messages de tous les C.R.O.S.S. Cela représente 25 à 30 messages quotidiens qui comprennent leur lot de « mayday », de « mayday » annulés, de « pan », de messages de « pan » transformés en « mayday », d'incidents se produisant sans « mayday » ni « pan » à l'avance. Finalement, dans un brouhaha de jour de tempête, il n'est pas anormal, par mesure de précaution, de lancer un message de détresse que l'on transforme par la suite. A la limite, le commandant dans cette affaire a agi avec un certain discernement pour ne pas sursaturer le C.R.O.S.S. par une demande d'aide qui ne lui semblait pas avoir lieu d'être à ce moment-là. Il connaît un problème, il réagit automatiquement en envoyant le
mayday, message qui se déclenche automatiquement - en appuyant sur un bouton et non en l'écrivant sur un écran. Dès que la situation lui paraît maîtrisable et que le processus de remise en état du navire revient à la norme, il fait le choix, à mon avis logique, d'annuler son état de détresse et de demander d'être mis sous examen en maintenant le signal « pan ». Il n'annulera ce signal « pan » que lorsqu'il aura achevé plus après l'ensemble de la rectification de son navire et qu'il se trouvera confronté à des avaries qui, aujourd'hui avec le recul, nous paraissent majeures, mais qui, à ses yeux, paraissent mineures. Les fissures en question telles qu'elles sont décrites s'étalent sur quelques centimètres et ne revêtent pas, selon lui, une importance capitale, car elles sont présentes sur le pont et non sur le bordé et parce qu'il n'y a pas de fuite d'huile à la mer. Les fissures lui apparaissent mineures. Je ne veux pas l'excuser...
M. Jean de GAULLE : Il y a tout de même une rupture de son ballast !
M. Georges TOURRET : Elle est interne.
M. François GOULARD : C'est tout de même la seule explication au passage du fluide de la citerne au ballast.
M. Jean-Louis GUIBERT : C'est tout a fait clair, mais il n'a pas dans cette situation l'appréhension que tout le reste va se détruire progressivement et rapidement. Il voit un passage et n'a pas d'éléments pour apprécier le reste. Il est facile
a posteriori de déclarer que les goussets se sont dessoudés, que les lisses se sont effondrées, que la cloison longitudinale s'est abattue, que la cloison transversale s'est mise à battre et n'a pas tenu non plus. De cet enchaînement, il n'a aucune idée.
M. Georges TOURRET : En revanche, si une cellule I.S.M. avait fonctionné réellement, si le commandant avait pu immédiatement joindre M. Pollara et ses adjoints, l'analyse aurait pu être faite de la façon suivante. Premièrement, la rupture de cloison s'est produite à un endroit qui n'avait pas été réparé au chantier de Bjiela au Monténégro. Deuxièmement, elle était liée ou non aux éléments sur lesquels le Rina avait demandé à Augusta une vérification supplémentaire des épaisseurs. Enfin - c'est un point dont nous avons clairement conscience, mais qui demande à être analysé dans le détail -, les fissures de pont sont intervenues dans un secteur qui avait été réparé. A cet endroit, les lisses de pont situées en dessous ont été changées à Bjiela
l'année précédente. Ces points ne figurent pas dans l'information globale du commandant qui, lui, est pris dans une tempête. C'est pour cela que les procédures I.S.M. ont été créées. Et c'est le premier accident majeur auquel nous sommes confrontés depuis l'entrée en vigueur du code I.S.M. Cela pose quand même un certain nombre de questions. Globalement, pour échanger des informations avec une cellule de crise à terre, il faut une radio pour communiquer. De plus, le bord est réduit à 26 personnes, ce qui sur un navire non automatisé est faible.
L'efficacité des procédures I.S.M. repose sur un suivi effectif depuis la terre et pas seulement sur la possibilité de joindre un homme sur son portable, de manière à ce que tous les éléments de dossier du navire soient accessibles rapidement. Là réside le vrai problème. Si les procédures I.S.M. avaient fonctionné, à la limite, c'est la cellule de crise constituée par l'armateur qui aurait dû prendre contact avec le C.R.O.S.S.
Le premier contact de M. Pollara avec les autorités maritimes françaises - je ne parle pas des agents commerciaux - date du dimanche matin à 7 heures 57 et il dure 8 minutes.
M. Jean-Louis GUIBERT : Le problème des dispositions du code I.S.M. va assez loin. J'ai été étonné d'apprendre à la lecture des textes, lourds et compliqués, que l'armateur doit donner au commandant des instructions sur la conduite à tenir par mauvais temps. Je n'ai jamais vu cela. Cela laisse rêveur. Toutefois, en, l'espèce, l'armateur n'avait pas donné de telles instructions. Au surplus, l'I.S.M., c'est du papier. Il y a un certificat et l'on trouve derrière ce que l'on trouve dans tout certificat.
M. Georges TOURRET : Un élément m'est apparu très choquant dans le cadre de la procédure I.S.M. engagée par M. Pollara. Pour organiser l'escale à Saint-Nazaire, M. Pollara donne au commandant Mathur, dont je rappelle que la bateau connaît des problèmes par un vent de force 9, le numéro de téléphone de l'agent à Port-de-Bouc et lui demande d'organiser l'escale. C'est finalement ce commandant, qui n'a à sa disposition qu'un télex, qui est confronté, seul, à la gestion d'une situation dégradée, dont il ne soupçonne pas l'ampleur. Quand les événements se précipitent et qu'il apparaît, au milieu de la nuit, que des fuites d'huile vont s'échapper en mer, la cellule I.S.M. donne au commandant le numéro de téléphone de la cellule d'urgence de Total à Paris. Le commandant appelle et tombe sur un répondeur. Autrement dit, le commandant de l'Erika
n'a pas reçu l'assistance terre de service, normalement constituée aux termes du code I.S.M.
A titre comparatif, je mentionnerai des événements que j'ai connus récemment sur des bateaux français. En ce qui concerne l'échouement du
Port-Racine de la société Van Ommeren, par exemple, la cellule I.S.M. a géré la situation ; elle a fonctionné.
M. François GOULARD : Vous déplorez l'absence d'assistance à terre, vous déplorez que le commandant de l'Erika ait été un homme seul pendant toute la suite des événements. C'est notre sentiment aussi. Cette assistance peut venir de son correspondant I.S.M., de son armateur, voire de Total. Je note que le commandant envoie ses messages Inmarsat C à Total à plusieurs reprises à partir du milieu de la nuit.
M. Georges TOURRET : Pas depuis le début, mais à partir du moment où il a le numéro.
M. François GOULARD : Cela signifie qu'une assistance depuis la terre vous paraît quand même revêtir une certaine utilité ?
M. Jean-Louis GUIBERT : Vous avez raison ; c'est fait pour cela. Mais l'assistance signifie décharger le commandant de tout ce qui n'est pas la conduite du navire dans l'état où il se trouvait, c'est-à-dire trouver le port de déroutement, etc.
M. François GOULARD : En cas de défaillance de l'armateur, les autorités maritimes ne peuvent-elles pas prendre le relais ? Nous connaissons la situation. Vous l'avez vous-mêmes décrite : il existe des pavillons de complaisance et des sociétés fantômes. Les autorités maritimes n'ont-elles pas un devoir de surveillance pour s'assurer que l'assistance, certes matérielle, mais bien utile, est donnée au capitaine ? N'ont-elles pas à se substituer à lui, par moments, pour l'encadrer, le rassurer et lui livrer des renseignements pratiques ?
M. Jean-Louis GUIBERT : Sur le plan nautique, on ne peut se substituer au capitaine. C'est un point important. En revanche, le C.R.O.S.S. a eu une conversation assez longue avec le port de Saint-Nazaire pour s'assurer que le bateau pouvait arriver jusqu'à Donges. Voilà le type d'assistance I.S.M. réalisée par le C.R.O.S.S. Cela répond en partie à votre question. Il en a été rendu compte au C.O.M. Le problème était alors que nous n'avions pas les moyens d'intervenir à ce moment-là. Nous ne pouvions guère faire davantage. D'ailleurs, le rôle de l'armateur tel qu'il aurait dû être rempli, était de s'assurer de l'agent et du capitaine de port et de ne pas laisser le capitaine s'en débrouiller seul. C'est tout ce qui était exigible de lui en l'occurrence.
M. Georges TOURRET : Supposons que le C.R.O.S.S. ait en sa possession la liste de la totalité des personnes désignées, selon la formulation I.S.M., de tous les navires de la planète, que se serait-il passé à 14 heures ? Le responsable du centre aurait appelé au téléphone l'armateur et n'aurait eu personne !
M. François GOULARD : Vous jugiez utile il y a un instant une coordination pour que l'armateur explique au capitaine l'existence de fissures à un endroit particulier.
M. Georges TOURRET : Mais, le problème, c'est que l'armateur n'était pas au bout du fil !
M. François GOULARD : En l'occurrence, qui était-ce ?
M. Georges TOURRET : Lorsque le commandant a essayé de prendre contact avec la personne désignée chez Panship, il a toujours échoué. Le contact n'a été établi avec la personne désignée qu'aux environs de 16 heures. Avant, il n'y est pas parvenu.
M. François GOULARD : Le commandant n'y est pas parvenu, mais c'est plus facile de le faire à terre que d'un bateau dépourvu de phonie.
M. le Président : A condition de savoir qui est derrière l'Erika.
M. Georges TOURRET : Le commandant savait très bien quelles personnes il devait appeler ; les noms de ces dernières figuraient dans les papiers du bateau. Il devait appeler le commandant Amitrano ou le commandant Pollara à Ravenne. Il n'y est pas parvenu faute de pouvoir utiliser Inmarsat A, celui-ci étant en panne. Lorsqu'il a pu utiliser le relais du
Nautic et du Seacrusader - pourvu lui, d'Inmarsat A en état de marche -, il n'a pas eu de contact. Le contact n'a été établi que très tardivement sur le portable de M. Pollara, dont la première réaction n'a été d'appeler ni le C.R.O.S.S. ni les autorités maritimes françaises, mais, selon ses déclarations dans la presse, M. Savarese pour l'informer du sort de son bateau. Il l'a trouvé sur des pistes de ski, ce qui n'est pas anormal un samedi d'hiver.
M. Pierre HERIAUD : Nous aurons sans doute au terme de notre mission a proposer des procédures sécuritaires assez fortes.
M. Tourret a expliqué que la sécurité se décline en trois catégories de contrôles successifs : celle de l'armateur, celle des sociétés de classification, celle des Etats du pavillon. Ne trouvez-vous pas que cela soit insuffisant ? Il ne faudrait pas que les contrôles qu'opérerait la France en cas d'accident ou de relâche dans un port soient substitutifs, mais complémentaires, car, en définitive, outre les accidents, un élément pernicieux s'attache au phénomène des marées noires : ce sont les dégazages au large des côtes, dans la mesure où, avant de reprendre la mer, les tankers pétroliers n'ont pas d'obligation de certificat de dégazage. Même si cela appelle des investissements dans les ports, des procédures rigoureuses doivent s'appliquer en amont. Autrement dit, aux trois niveaux de contrôles rappelés par M. Tourret, je pense qu'il conviendrait d'en ajouter un quatrième qui serait assuré par l'Etat côtier, qui peut subir les conséquences des accidents en mer. Que je sache, la localisation de l'Erika et de son produit n'a pas eu lieu à proximité de Malte !
M. Georges TOURRET : Vous évoquez les niveaux de contrôle liés aux responsabilités juridiques de certains acteurs. Le contrôle de l'Etat du port n'implique pas, juridiquement, la responsabilité de celui-ci.
M. Pierre HERIAUD : Je veux bien que l'on parle d'insuffisance de procédures en matière de prévention et non de responsabilité. Il suffit d'y remédier. Quand on constate qu'un navire prend la mer sans dégazage, lequel se fera éventuellement au large des côtes, en pleine mer, je considère comme totalement anormale une telle situation.
M. Jean-Louis GUIBERT : Ce n'est pas le cas de l'Erika. Il a ballasté à La Corogne, avant de parvenir au port de Dunkerque d'où il est reparti chargé. La question du ballastage passe essentiellement par la convention Marpol de 1973-1978, qui implique que les ports soient dotés d'installations à terre destinées à récupérer les résidus. Il en existe, mais encore insuffisamment. En outre, il convient de considérer les coûts que cela représente. Il est des pays où l'on rachète les résidus et d'autres où l'on fait payer très cher pour les récupérer, ce qui fausse le problème.
La réglementation prévoit également que les déballastages ne doivent pas être faits à la mer, sauf dans certaines zones, non spéciales, loin des côtes et selon certains pourcentages. L'observation à la mer est faite notamment par les avions des Douanes. Hier, j'ai lu un procès-verbal chez le procureur. Il concernait un bateau qui avait déballasté au large du cap Finisterre espagnol. On pouvait en observer la trace. Une procédure fut alors lancée. A signaler que les déballastages sont bien moins nombreux qu'autrefois. Il n'y en a guère qu'en cas d'accidents, certains profitant des circonstances pour déballaster.
M. Georges TOURRET : Monsieur le député, loin de moi la volonté de véhiculer l'idée ou le principe d'une absence de contrôle de l'Etat du port.
Dans le système actuel, l'Etat du pavillon doit être responsabilisé. Nous l'avons exprimé avec force. Nous avons proposé un mécanisme simple, « à cliquet ». Si nous arrivons à le faire prévaloir, même s'il peut sembler lointain, les choses ne se passeront pas comme avant. Il conviendrait que l'Etat côtier ou les États ayant intérêt à connaître les causes d'un événement de mer obtiennent la communication immédiate, sans restriction, de la totalité du dossier de sécurité des sociétés de classification, car c'est essentiel. Ensuite, il faudra bien bannir un certain nombre de ces sociétés de classification. Dans le cas d'espèce, ce n'est pas la question. Le Rina est une bonne société de classification. Néanmoins, ce n'est pas toujours le cas. Bien évidemment, lorsque nous abordons avec elles la question, ces mêmes sociétés objectent que ce n'est pas vrai. Mais, par notre expérience, nous avons la conviction qu'une société de classification qui vit avec, derrière elle, un Etat du pavillon capable de revenir sur ce qu'elle fait, n'adopte pas le même
modus operandi qu'une société de classification qui a délégation à la fois de l'armateur et de l'Etat du pavillon.
À cet égard, une police des règles de conduite se distinguant des sociétés de classification est importante.
Nous avons essuyé des refus de communication de dossiers de sociétés de classification sur d'autres affaires, où il y avait mort d'hommes.
Audition de M. Claude GRESSIER,
directeur des transports maritimes, des ports et du littoral
au ministère de l'Equipement, des transports et du logement
(extrait du procès-verbal de la séance du 15 février 2000)
Présidence de M. Daniel PAUL, Président.
M. Claude GRESSIER est introduit.
M. le Président lui rappelle que les dispositions législatives relatives aux commissions d'enquête lui ont été communiquées. A l'invitation du Président, M. Claude GRESSIER prête serment.
M. Claude GRESSIER : Pour que les choses soient claires, il faut sans doute que je resitue d'abord le cadre des responsabilités qui sont les miennes au sein du ministère. Je suis directeur du transport maritime, des ports et du littoral ; mes responsabilités concernent donc la tutelle de la flotte de commerce au sens économique du terme, c'est-à-dire tout ce qui a trait aux régimes d'immatriculation, aux aides sociales et fiscales, à la flotte de commerce, qu'il s'agisse des entreprises de transport de marchandises ou de transport de passagers.
Mon collègue Christian Serradji est chargé plus particulièrement de la sécurité maritime, c'est-à-dire des Centres de sécurité des navires répartis sur le territoire, des CROSS - centres opérationnels de sécurité et de sauvetage - et des Affaires maritimes.
Quant aux ports, j'en exerce la tutelle dans tous ses aspects
- sociaux, économiques ou réglementaires -, qu'il s'agisse des ports autonomes, des concessions aux chambres de commerce, des diverses professions portuaires, des ouvriers des ports ou des dockers.
Pour le littoral, ma responsabilité concerne, de façon générale, la gestion du domaine public maritime et sa mise en valeur. Cela va de la protection des lieux habités contre l'érosion marine, à la mise en valeur du littoral - sentiers du littoral et autres aménagements, y compris le problème de concession de plages - jusqu'au plan POLMAR.
Je m'occupe de la gestion des centres POLMAR terre
- POLMAR mer étant de la responsabilité des préfets maritimes - et suis donc chargé de la lutte contre les pollutions à partir de la terre. Nous gérons un certain nombre de centres opérationnels conservant des matériels, notamment des barrages, des bennes, des pompes Karcher et autres équipements destinés à lutter, à terre, contre la pollution.
Tel est donc le cadre de mes responsabilités.
Je commencerai par évoquer cet aspect POLMAR terre pour rappeler le déroulement des événements, à partir de mon point de vue, qui ont suivi le naufrage de l'Erika.
L'Erika a sombré le 12 décembre. Le 15 décembre, nous avons envoyé les premières consignes aux préfets des départements qui semblaient concernés, la Charente-Maritime, la Loire-Atlantique et la Vendée notamment. Nous ne savions pas encore que certaines nappes allaient dériver plus au nord. Nous avons mis en alerte des centres POLMAR afin qu'ils préparent tout leur matériel et commencent à demander aux transporteurs qu'ils connaissent de se mobiliser pour pouvoir acheminer dans les centres de stockage de proximité que les différents préfets leur désigneraient les barrages et les différents matériels - bennes et autres - nécessaires pour stocker les déchets de l'Erika, s'ils arrivaient jusqu'à la côte.
Ensuite, nous avons travaillé avec les préfets de régions et de départements, et notamment avec le préfet de la Charente-Maritime qui, au départ, avait été nommé préfet coordinateur par le Gouvernement. Ce dernier a rassemblé les demandes de barrages de ses collèges et, dès le 20 décembre, nous avons commencé à acheminer, de tous les centres POLMAR de France - non seulement ceux de Brest, Saint-Nazaire ou Le Verdon, mais aussi de Cherbourg, Dunkerque et, ultérieurement, Marseille - des barrages et des corps morts pour pré-positionner les barrages, lesquels doivent être placés essentiellement dans des endroits précis : à l'entrée de rivières, de ports, en protection de zones de conchyliculture non soumises à une grande houle et plus facilement protégeables, entre autres. Des pré-positionnements de barrages ont donc été effectués relativement rapidement en Vendée, en Loire-Atlantique, en Charente-Maritime. Puis ces différents barrages ont commencé à être posés.
Par ailleurs, peu de temps après, nous avons indiqué aux différents préfets des adresses de « grossistes » pour qu'ils puissent acquérir, sur les fonds POLMAR, le matériel consommable, à savoir cirés, bottes, pelles, etc. Nous avions de petits stocks, mais nous ne pouvons pas avoir des stocks considérables, d'autant que cela s'achète relativement facilement dans le commerce. Nous leur avons donc donné ces adresses afin qu'ils puissent acquérir ce matériel et le distribuer aux forces de sécurité civile et autres qui lutteraient et aideraient à éliminer les déchets de l'Erika.
Nous avons également réparti les pompes Karcher qui sont destinées essentiellement au nettoyage des rochers.
Que peut-on dire aujourd'hui à la lumière de ce qui a été réalisé ?
D'abord, comme tout le monde, nous avons suivi, au jour le jour, avec Météo France...
M. le Président : Je souhaiterais que nous nous arrêtions sur ce plan POLMAR terre.
M. le Rapporteur : M. le directeur, pourriez-vous nous dire rapidement et nous communiquer par la suite les moyens réels dont vous disposiez pour POLMAR terre de façon plus détaillée ?
Où étaient-ils positionnés et qu'aviez-vous comme matériel ?
Par ailleurs, est-il vrai que d'autres pays que le nôtre disposent de matériels plus sophistiqués pour enlever les nappes de pétrole ? Un article de Hervé Hamon, paru hier dans
Libération, indique que d'autres pays disposent de moyens techniques plus évolués et en plus grand nombre. Est-il exact que nous n'avons pas les matériels de haut niveau ?
Vous a-t-il manqué du matériel ? Avez-vous été en panne à un moment donné ?
Comment a-t-on pu faire une erreur aussi importante sur la météo ? Certes, la météo est une science de l'inexact, mais le positionnement de tous les matériels de POLMAR terre à certains endroits, pour devoir les rapatrier ensuite à d'autres en raison d'une prévision météo déficiente, ne manque pas de susciter des interrogations. Des experts, non des moindres, nous disent qu'aux Etats-Unis, par exemple, les mouvements de ce type sont prévus bien plus facilement, y compris aux Antilles françaises. Peut-être y a-t-il eu un malencontreux hasard, une succession malheureuse d'événements : sur ce sujet, je ne demande pas l'avis d'un spécialiste, mais celui de quelqu'un qui a vécu très concrètement les choses.
M. Claude GRESSIER : En métropole, nous disposons de huit centres de stockage. Quant aux matériels, nous avons 33 500 mètres de barrages de différents modèles, avec une grande proportion de barrages de haute mer ; 85 dispositifs de récupération (écrémeurs, barges récupératrices, etc.) ; 140 pompes ; 426 pompes à haute pression ; 261 groupes électrogènes, etc.
Le centre le plus important est celui de Brest. Puis nous avons les centres de Dunkerque, de Saint-Nazaire, de Cherbourg, du Havre, du Verdon, de Sète et celui de Marseille. Je pourrai vous communiquer le détail du type de barrages et des linéaires présents dans les différents centres.
Ces matériels sont-ils plus ou moins sophistiqués que ceux disponibles à l'étranger ?
Honnêtement, je ne saurai répondre à cette question. Nous avons des matériels assez diversifiés, des barrages, des pompes, des barges récupératrices, etc. Je ne sais pas, à ce stade, s'ils sont plus ou moins sophistiqués que ce qui peut exister à l'étranger en ce qui concerne la lutte à terre.
M. le Rapporteur : A terre, mais y compris les barrages et les barges récupératrices, qui sont mises en place en mer mais dépendent de POLMAR terre.
M. Claude GRESSIER : A la question de savoir si nous avons manqué de matériel, je puis apporter deux éléments de réponse.
D'une part, en ce qui concerne les barrages, nous avons constaté, compte tenu des fortes houles qui régnaient partout, que nous manquions de barrages de gros calibre, résistants à ce type de mer. Mais, suite à des exercices que nous avions faits auparavant, car nous en faisons régulièrement, nous avions subi la critique d'avoir des barrages trop lourds et de manquer de barrages plus légers permettant d'encercler ou de faire obstacle à une petite nappe pour la récupérer facilement ensuite. Cette fois, en raison de la houle assez forte, certains barrages n'ont pas tenu, et l'on nous a reproché de ne pas en avoir de suffisamment efficaces pour ce type de temps.
D'autre part, il y a eu - et c'est en soi une bonne chose, mais je pense que l'instruction POLMAR terre de 1997 n'avait pas été conçue dans cet esprit - un grand nombre de volontaires qui se sont présentés dans les communes pour nettoyer les plages. En fait, ces volontaires ont quelque peu manqué d'encadrement. Les préfets et les forces de sécurité civile ont été un peu débordés, surpris par l'ampleur de leur nombre.
De ce fait, nous avons manqué de lieux de stockage organisés, étanches, pour recueillir tous les déchets ramassés. Nous avons manqué en particulier de filmogène, ces films que l'on dépose à terre durant vingt-quatre ou quarante-huit heures pour rendre le sol étanche. Nous avons également manqué de cuves récupératrices en nombre suffisant à tous les endroits où des volontaires se sont présentés pour récupérer le fioul, mélangé au sable, de l'Erika. Cet aspect, à mon sens, a surpris tous les préfets et toutes les forces de sécurité civile mobilisées pour lutter à terre contre la pollution, et n'avait pas été suffisamment anticipé.
M. le Rapporteur : Des exercices POLMAR terre sont-ils organisés ? Dans le plan POLMAR terre de mon département, il était inscrit dans les documents qu'en cas de pollution, les déchets pétroliers devaient être déposés dans un certain nombre de carrières. Certes, la période de Noël n'est pas la meilleure, mais nous nous sommes aperçus le jour de Noël que sur les quatre sites éventuels, qui n'avaient pas été revus depuis cinq ou six ans, aucun n'était accessible. Il a donc fallu trouver en catastrophe d'autres lieux. Je demande donc s'il y a eu des exercices de répétition et de vérification de POLMAR terre. A quelles dates ? Ces exercices sont-ils obligatoires ?
Pour revenir sur les matériels, votre direction en a la charge. Une ligne budgétaire annuelle est ouverte à cet effet et un renouvellement permanent du matériel est effectué. Dans quelles conditions ? Etes-vous informé ou est-il diligenté un inventaire de l'état du matériel et, surtout, des nouveautés technologiques qui peuvent être mises en _uvre ? Je reviens là sur ma précédente question à laquelle vous n'avez pas encore répondu, car on entend dire qu'existent ailleurs des matériels plus sophistiqués. Est-ce vrai ?
La question reste en effet posée pour l'avenir. Quelles que soient les mesures de sécurité que l'on peut mettre en _uvre sur les pétroliers, une catastrophe est toujours possible. Le risque zéro n'existera jamais. Ces questions sont tout à fait pertinentes.
M. Claude GRESSIER : Je puis vous assurer que des exercices sont bien effectués. Nous disposons d'une ligne budgétaire pour financer l'entretien du matériel et les exercices. Nous insistons beaucoup auprès des services pour que ces exercices aient lieu. Je dois à la vérité dire qu'ils n'ont pas toujours lieu à la fréquence que nous souhaiterions.
Ils avaient eu lieu relativement récemment. Il me semble qu'un exercice a eu lieu en 1998 en Vendée, qui a montré que les choses étaient bien préparées. En Charente-Maritime, par contre, il n'y avait pas eu d'exercice depuis assez longtemps. Pour le Morbihan, je ne peux pas vous le dire de mémoire.
Donc, ces exercices sont bien prévus mais il s'est avéré parfois difficile de mobiliser les gens pour effectuer efficacement ces différents exercices.
M. François GOULARD : A propos des techniques de ramassage, de dépollution et de récupération des produits polluants, j'aimerais savoir si vous avez adressé des instructions techniques,
via les préfets, à tous ceux qui étaient chargés de la mise en _uvre de POLMAR terre ?
J'ai en effet eu sentiment, sur le terrain, que tous ceux qui étaient dans les différentes communes du littoral étaient assez démunis.
Il y a eu un début de polémique avec le ministère de l'Environnement quant aux techniques à mettre en _uvre. L'utilisation des pompes à haute pression que l'on appelle Karcher a été contestée. Aussi j'aimerais savoir, si vous avez une doctrine pour la dépollution, ce qu'elle est et si vous avez eu une coordination avec le ministère de l'Environnement pour vous mettre d'accord, entre administrations, sur les techniques à employer?
Par ailleurs, je fais part de mon étonnement quand je vous entends dire que vous ne saviez pas s'il existait des moyens plus élaborés que les nôtres dans d'autres pays. Cela signifie-t-il qu'il n'y a pas de contact, en temps normal en vue de préparer les crises, ne serait-ce qu'avec nos partenaires européens, pour faire le point des techniques existantes, alors que cela paraît une démarche assez naturelle au non-initié ?
M. Claude GRESSIER : Les techniques sont mises en _uvre sous le contrôle technique de deux organismes : le CETMEF, Centre d'études techniques maritimes et fluviales et le CEDRE, Centre de documentation, de recherche et d'expérimentation sur les pollutions accidentelles des eaux.
Le premier nous aide à gérer l'ensemble des centres de stocks POLMAR et adresse régulièrement des conseils aux services sur ce sujet. Le second nous a effectivement donné des conseils et des directives sur les bonnes techniques de dépollution et les précautions à prendre quant à ces techniques de dépollution à terre.
C'est donc par le biais du CETMEF et du CEDRE qu'il y a des contacts internationaux, car tous deux doivent se tenir informés des meilleures techniques existant, dans le monde entier, pour lutter contre la pollution et nous aider à donner des consignes aux forces de sécurité civile et aux préfets concernant les techniques et précautions à mettre en _uvre pour la dépollution.
M. François GOULARD : Quelles sont les relations avec le ministère de l'Environnement ?
M. Claude GRESSIER : Nous travaillons en accord avec le ministère de l'Environnement. Je ne peux pas dire que pour la mise en _uvre de ces techniques, nous ayons eu des critiques ou des suggestions particulières, ni dans un sens ni dans l'autre, de la part du ministère de l'Environnement.
M. Louis GUEDON : J'aimerais avoir une analyse critique de ces moyens car nous étions sur le terrain et nous ne pouvons pas nous contenter d'une énumération calme et sereine, faite dans les bureaux parisiens, pour dire que les choses vont comme elles vont ! Vous avez parlé des barrages. Nous avons eu deux sortes de barrages : les barrages gonflables, totalement inopérants, dont on se demande pourquoi ils sont encore utilisés, et les barrages pleins, de 0,70 mètre de profondeur, efficaces sauf par houle forte.
Quand on nous parle de barrages, je souhaiterais, si c'était possible, savoir si que nous disposions de matériels dépassés. Car nous avons été les témoins d'un exercice du plan POLMAR terre et quand on nous a donné les conclusions de cet exercice, tout « baignait dans l'huile »...(Sourires.). La marée pouvait venir, on l'attendait de pied ferme. Mais en phase opérationnelle, il n'y avait plus personne ! Nous ne pouvons pas nous contenter de ces explications.
Vous avez évoqué des méthodes. Nous, nous avons mis au point une méthode : le dragage par chalutage, par pélagiques, qui a donné les meilleurs effets puisqu'en deux coups de chalut, nous avions ramené 8 tonnes. Pour autant, cette méthode n'est pas du tout préconisée ou entendue. Quand nous avons voulu la généraliser sur les sites sédimentaux que sont nos plages, nous n'en avons pas eu l'autorisation, bien que nous soyons dans un département où le préfet a su mener les affaires avec une efficacité remarquable.
Vous avez aussi parlé des bénévoles, mais je suis désolé, ces bénévoles ne sont pas de votre fait. Vous ne pouvez pas vous attribuer les bénévoles dans le plan POLMAR car vous ne pouviez pas savoir quelle était la citoyenneté et le civisme des femmes et des hommes qui sont venus apporter leur concours. Cette chance a été l'alliée du plan POLMAR. Félicitons-nous du civisme de nos concitoyens, mais ne vous attribuez pas le bénéfice de cette générosité, qui ne peut être ni prévue ni codifiée. En effet, dans l'exercice du POLMAR terre, il n'y avait pas de bénévoles.
De plus, quand vous parlez des matériels utilisés par ces bénévoles, je me dois de préciser que ce sont les collectivités locales qui ont été les pourvoyeurs de ces matériels. Cela n'est pas à mettre à l'actif du plan POLMAR terre ! Les municipalités, les conseils généraux se sont mobilisés et ont acheté ce qui était nécessaire, l'ont distribué, ont organisé les repas des bénévoles, etc. Tout cela n'a jamais été pris en compte dans les exercices des plans POLMAR terre tels qu'on a pu les voir.
Pour conclure, j'aimerais que l'on sorte de l'étude d'un dossier telle qu'elle pourrait être faite dans un ministère. Replaçons-nous face à la mer, prenons nos bottes comme nous les avions il y a trois semaines et mettons-nous dans la peau des marins que nous sommes pour pouvoir être efficaces devant des cataclysmes qui ne se contentent pas de rapports BCBG faits dans un cabinet.
M. Claude GRESSIER : Je ne suis pas sûr de m'être attribué les bénévoles. J'ai simplement souligné ce défaut de l'instruction POLMAR de 1997 qui n'avait pas anticipé le fait qu'il y aurait de nombreux bénévoles, compte tenu de la sensibilité écologique de notre pays et des riverains de la mer. L'organisation et l'encadrement de ces bénévoles n'avaient pas été suffisamment prévus. Par la suite, des consignes, des recommandations, ont été données par le CEDRE, mais il est vrai que cela n'avait pas été bien anticipé dans l'instruction POLMAR de 1997.
Quant au chalutage, compte tenu de la viscosité du produit, dès la réunion que M. Gayssot et Mme Voynet ont tenue à Lann-Bihoué le 15 décembre, le directeur du CEDRE, M. Girin, a insisté sur le fait que, l'une des meilleures techniques de ramassage devrait être, justement, le chalutage, à condition que les conditions météorologiques et notamment de houle le permettent.
M. Louis GUEDON : Mais il y avait des navires en pêche à ce moment-là. Il ne faut pas nous faire croire que les navires ne naviguaient pas. La tempête n'a pas duré deux mois. Le 12 décembre, il y a eu le naufrage et c'est trois semaines après que le mazout est arrivé sur nos côtes. Pendant tout ce temps, nos navires étaient en pêche et sur les sites. Il ne faut pas dire que la houle empêchait le chalutage, car nous ne pouvons pas vous croire. Nos navires étaient en pêche !
M. Claude GRESSIER : La lutte en mer est sous la responsabilité des préfets maritimes. Je ne pense pas devoir me substituer à eux pour dire ce qui s'est fait ou ne s'est pas fait. J'ai cru comprendre que l'état de la mer était tel qu'il a été, semble-t-il, assez difficile de ramasser en mer les produits concernés. Mais vous interrogerez le préfet maritime à ce sujet.
En ce qui concerne les barrages, vous avez rejoint ce que j'avais dit. Nous avons, en effet, plusieurs types de barrages et, compte tenu de l'état de la houle, ce sont les barrages les plus lourds qui se sont révélés les plus efficaces. Et, je crois l'avoir déjà dit, nous avons sans doute un peu manqué de ce type de barrages lourds. Mais, je répète également que, dans d'autres circonstances, on nous a conseillé des barrages plus légers qui permettent d'isoler une petite nappe de façon très maniable, car les barrages lourds sont peu maniables et conçus pour rester fixes.
Pour l'avenir, l'une des questions que nous allons nous poser, après analyse de ce qui a été fait, quand nous réfléchirons au renouvellement de nos stocks de matériel, sera, compte tenu de la variété des produits qui risquent d'être déversés dans la mer et compte tenu des conditions météorologiques que l'on peut anticiper _ c'est tout de même par gros temps qu'il y a plus de risque de naufrage _ de déterminer quel type de barrage commander et stocker, sachant que le type de produit qui a été déversé en mer par l'Erika représente à peu près 2 % de toute la circulation des produits pétroliers à proximité de nos côtes. Cela n'excuse rien, mais il faut tout de même rappeler ces ordres de grandeur.
Les matériels, que nous ne possédons pas, qui auraient été utiles pour ce type de pollution sont des petites barges, éventuellement ouvrantes, permettant de faire une sorte de chalutage pour des nappes d'une petite ampleur, telles que celles qu'on a vu arriver une fois le produit disséminé dans la mer. Effectivement, nous ne possédons pas actuellement ce type de matériel.
M. le Rapporteur : Qui existe en Allemagne et dont on a beaucoup parlé.
M. Claude GRESSIER : Tout à fait.
M. Alain GOURIOU : L'expérience montre que les différentes marées noires correspondent à des produits pétroliers très différents qui nécessitent pratiquement des matériels spécifiques à chaque accident. Certains matériels sont inadaptés pour ramasser certains produits. L'acquisition de certains matériels après une marée noire ne garantit absolument pas qu'ils seront adaptés à la suivante. Nous risquons ainsi d'être toujours en retard d'une guerre.
Nous avons vu, sur la côte nord de la Bretagne, au moment du naufrage de l'Amoco-Cadiz, arriver un pétrole beaucoup plus léger, à la viscosité bien moins importante que celui de l'Erika. Les méthodes étaient alors parfaitement empiriques. Elles le demeurent. Il s'est avéré qu'à l'époque le matériel le mieux adapté n'appartenait pas du tout à la panoplie de POLMAR terre, il s'agissait de tonnes à lisier que les agriculteurs avaient mises à disposition des opérations de nettoyage. A ma connaissance, elles ne sont pas « labellisées » POLMAR terre, mais pour nettoyer de grands espaces avec un pétrole relativement « pompable », le remède s'était avéré presque miraculeux. Dans le cas de l'Erika, pas du tout. C'est du goudron très lourd qui arrive et les tonnes à lisier ne sont pas les mieux adaptées.
A mon sens, une enquête approfondie est nécessaire, d'une part, sur les différentes catégories d'hydrocarbures à risque et, d'autre part, après les différentes marées noires qui peuvent se passer dans le monde, sur les moyens les mieux adaptés à chaque produit, ce qui nous permettrait de gagner un temps considérable sans avoir à tester, à chaque fois, ce qui marche et ce qui ne marche pas.
La mise en place d'un barrage est une opération difficile et longue. Si ce barrage est inefficace, il faut le remplacer par un autre. Je m'étonne qu'après la dizaine de marées noires qui a touché nos côtes, nous en soyons encore réduits à un empirisme comme à la première.
M. Claude GRESSIER : Nous devons, bien sûr, nous adapter aux différentes catégories de risques mais comme je l'ai indiqué, nous connaissons les différentes catégories de carburants qui sont transportées au voisinage de nos côtes. Celui qui a été déversé par l'Erika représente un pourcentage relativement faible. Avant de commander du matériel nouveau - une bonne partie des barrages a été abîmée, plus d'ailleurs par les tempêtes des 25 et 27 décembre que par la marée noire -, nous allons essayer de tirer avec les gens de terrain les conséquences de la mise en _uvre des moyens dont ils disposaient. Puis, évidemment, avec le CEDRE et le CETMEF, nous mènerons une enquête sur les moyens qui sont le plus adaptés et ceux utilisés dans d'autres pays.
J'aimerais également faire une autre incidente à propos des barrages, notamment des barrages lourds que nous avons mis en place à certaines entrées de ports et de rivières ou pour protéger des exploitations conchylicoles. Ces barrages ont présenté l'inconvénient d'empêcher les pêcheurs de circuler. Nous avons été confrontés à un nombre important, notamment à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, de demandes d'ouvertures et de fermetures de barrages, ce qui a occasionné une série de difficultés. Cela nous a d'ailleurs conduits à avoir recours à une société privée, présente 24 heures sur 24, afin de pouvoir ouvrir le barrage à la demande pour ne pas perturber l'activité de la pêche.
Il faut savoir qu'un barrage lourd présente l'avantage d'être extrêmement efficace contre les pollutions qui peuvent entrer dans tel ou tel port ou estuaire et qu'a contrario, son ouverture ou sa fermeture demande plus de temps que celle d'un barrage léger.
C'est au regard de toutes ces contraintes que nous devons voir quel est le matériel le mieux adapté.
M. Dominique CAILLAUD : Je reste sur cette question des barrages pour évoquer une hypothèse qui paraissait poser un gros problème au port de Saint-Nazaire. Il semblerait qu'à marée descendante, il soit impossible d'empêcher une pollution maritime. Imaginons que l'Erika ait coulé un peu plus loin, vers l'entrée de l'estuaire de Saint-Nazaire, apparemment, nous n'aurions disposé d'aucun moyen pour empêcher une pollution de l'estuaire par les hydrocarbures.
Cela inquiétait beaucoup, la polémique ayant commencé sur l'autorisation délivrée ou non par le port de Saint-Nazaire, d'accepter le bateau avec des fuites. Mais la question reste entière : avons-nous les moyens de protéger de manière efficace un estuaire à marée descendante ou sommes-nous totalement dépendants de la marée et de la houle ?
Quant à la conception des barrages, à la fois protection et nasse, notamment pour les ports, il me semble qu'il faudrait arriver à avoir des systèmes d'ouverture un peu mieux adaptés afin d'éviter les problèmes évoqués à propos des bateaux. Dans l'attente de la marée noire, ces derniers ne pouvaient plus sortir. L'effet de nasse causé par le barrage n'est pas sans incidence économique quand on attend des jours et des jours l'arrivée de la nappe.
Ma dernière question reprend celle de notre rapporteur concernant les sites prévus pour le stockage. Je partage son étonnement de voir qu'il y avait encore 25 000 tonnes de l'Amoco-Cadiz
en stock à La Rochelle, alors que nous avions absolument besoin de ces capacités de stockage. N'existe-t-il pas un « service après-désastre » dans le plan POLMAR terre, pour vérifier le bon fonctionnement des moyens en cas de nouveau sinistre ? Devons-nous craindre que les stocks de l'Erika soient encore là dans vingt ans quand aura lieu la prochaine catastrophe ?
M. Claude GRESSIER : Pour répondre à votre première question, actuellement, pour un estuaire aussi vaste que celui de la Loire, nous ne disposons pas de barrages capables de résister aux courants de l'ampleur de ceux qui existent sur ce fleuve, à marée montante ou descendante. Il est exact que si le fioul était arrivé dans l'estuaire de la Loire, nous aurions eu une pollution très importante de l'estuaire et de ses rives.
M. Dominique CAILLAUD : A quelle distance pourrait-on stopper cette pollution, dans le meilleur des cas et des moyens techniques ? A Ancenis ? A Nantes ? A Nevers ?
M. Georges SARRE : Au mont Gerbier de Jonc !
M. Claude GRESSIER : Je ne peux pas répondre géographiquement exactement à cette question. Mais il est vrai que ce n'est pas facile avec les courants importants d'un grand estuaire. Nous pouvons protéger des petites rivières, et nous l'avons fait. C'est beaucoup plus difficile pour de grands fleuves comme la Loire.
En ce qui concerne les déchets de l'Amoco-Cadiz, il était prévu, et il est d'ailleurs toujours prévu, d'éliminer ce stockage. Une entreprise avait été désignée pour le faire mais, en cours de route, elle a fait faillite. Puis, l'affaire a traîné et les stocks sont malheureusement restés à La Rochelle dans ces cuves.
M. Michel HUNAULT : C'est incroyable !
M. Claude GRESSIER : Les déchets que nous avons actuellement sont tous destinés à être dirigés vers Donges où, normalement, la société Total Fina-Elf doit traiter l'intégralité de ces déchets, lesquels comportent un peu de fioul, une grand proportion de sable et des macro-déchets divers et variés.
Je pense que nous n'aurons pas la mauvaise surprise de les retrouver, comme ceux de l'Amoco-Cadiz, dans une cuve, à La Rochelle ou ailleurs.
Une question m'a été posée tout à l'heure sur la météo. Nous avons suivi au jour le jour les dérives de la nappe majeure, repérée par l'avion des douanes et en suivant les calculs de Météo France qui tenaient compte à la fois des vents et des courants, lesquels se sont révélés très puissants. Cette nappe a commencé à descendre vers le sud avant de remonter vers le nord pour toucher les côtes de Loire-Atlantique, du Morbihan et de Vendée.
En revanche, la pollution qui a touché le Finistère Sud est vraisemblablement due à des fuites de l'Erika précédant le naufrage et à des bouts de nappes qui n'avaient pas été repérés ou suivis par les avions des douanes. Nous avons tous été surpris par cette pollution qui est tout d'un coup arrivée...
Mme Jacqueline LAZARD : Le 23.
M. Claude GRESSIER : ...sur les côtes de Bretagne Sud
et qui résulte d'une mauvaise observation ou d'un mauvais repérage non pas de la nappe principale telle qu'elle a résulté de la cassure et du naufrage de l'Erika, mais des fuites qui ont eu lieu dans les heures précédant le naufrage.
M. Bernard CAZENEUVE : Mes questions portent sur trois problèmes : celui des matériels, celui de la structure administrative de gestion de ces crises et celui de la coordination interministérielle lorsque survient une pollution d'une telle ampleur.
Pour ce qui concerne les matériels et l'existence ou non de matériels plus performants, j'aimerais savoir quelles sont les instances au sein desquelles, de façon préventive, ces questions sont abordées. Quelles sont les instances de l'Union européenne où ces questions sont soulevées avant que les crises n'adviennent ? Etes-vous amenés à participer à ces réunions de concertation ? Quelle est leur fréquence ? Qui en prend l'initiative ? Quel est le fruit des réflexions de ces instances, si toutefois elles existent ?
On parle de pollution par les hydrocarbures, mais il y a 20 % du trafic mondial en matières dangereuses qui transitent au large de notre pays. Ces produits dangereux ne sont pas nécessairement des hydrocarbures. De quel matériel disposez-vous en cas de pollution qui ne serait pas due aux hydrocarbures ? Comment avez-vous prévu et anticipé ce type de crise ?
Ma question suivante porte sur la réforme de l'administration. Sous l'impulsion de Jean-Yves Le Drian il y a quelques années, il avait été envisagé de procéder à une fusion de la Direction de la flotte et de la Direction des ports, en vue de constituer une direction, dont je crois comprendre que vous en êtes le directeur aujourd'hui, qui devait avoir pour objectif principal de mettre l'accent sur la sécurité. Or, dans le libellé de votre direction - directeur des transports maritimes, des ports, du littoral au ministère de l'équipement - je ne vois pas apparaître la sécurité. Ma question est la suivante : quelle est la direction qui s'occupe de la sécurité au sein du ministère des transports ? Y en a-t-il une ? Et, s'il n'y en a pas, quelle est la sous-direction qui, sous votre responsabilité, s'occupe de cette question ? S'il n'y a pas de sous-direction, quel est le bureau, le service, l'agent qui traite de ces sujets-là ?
(Sourires.)
Plus généralement, pensez-vous que la réforme à laquelle il a été procédé -la fusion de la direction de la flotte et de la direction des ports - a, de ce point de vue, abouti à une amélioration du dispositif ? Que peut-on faire pour que le système soit plus performant ?
Enfin, je n'ai pas bien compris - sans doute est-ce parce que je n'étais pas, comme nombre de mes collègues ici présents, au c_ur de l'événement - comment s'est réalisée la coordination interministérielle du dispositif à partir du moment où le naufrage a été connu.
Dans d'autres expériences administratives concernant des événements intervenant à l'étranger, une cellule de crise était réunie au Quai d'Orsay, rassemblant l'ensemble des administrations, qui n'occultait d'ailleurs pas le pouvoir de l'ambassadeur.
Que se passe-t-il en administration centrale quand une crise de ce type se produit ? Qui prend l'initiative de réunir qui ? Qui participe au tour de table ? Quel est le mode de transmission des instructions de l'administration centrale aux autorités déconcentrées de l'Etat qui sont en charge de la coordination des moyens de l'Etat en mer lorsqu'une pollution de ce type arrive ? Quel est le dispositif de coordination interministériel et, au regard de votre expérience, était-il efficace ?
M. Claude GRESSIER : Les instances chargées de réfléchir et de conseiller sur les problèmes de matériels sont celles que j'ai citées précédemment, c'est-à-dire le CETMEF et le CEDRE. Au plan français, c'est tout à fait clair.
La Commission de l'Union Européenne, à ma connaissance, ne s'est jamais beaucoup préoccupée de ces problèmes. Il existe une personne à la direction de l'environnement qui met en rapport, éventuellement, les différents pays pour faire le
go-between, afin que les moyens des uns puissent aider les autres. Il s'agit, me semble-t-il, de M. Barisich qui exerce son activité plutôt dans le domaine de la lutte en mer.
Il existe, par ailleurs, la Convention de Bonn et les autres conventions sur l'aide intergouvernementale pour les luttes en mer contre les pollutions marines entre autres.
M. Bernard CAZENEUVE : Très concrètement, si une pollution intervenait sur le territoire du Président de notre commission - ce que je ne lui souhaite pas - il n'existe aucune disposition arrêtée conjointement par les Britanniques et les Français permettant la mise en commun de matériels appropriés à la lutte contre les pollutions constatées, en raison d'une absence de concertation entre les pays de l'Union en amont de l'émergence de ce type de difficulté ?
M. Claude GRESSIER : Ce n'est pas exact. Il existe les conventions de Bonn, de Lisbonne et de Barcelone, conventions intergouvernementales qui prévoient la coordination et la mise à disposition par tel ou tel Etat de ses moyens au profit de l'Etat touché par la pollution. Je veux dire que cela ne se fait pas dans le cadre de l'Union européenne, ce sont des conventions intergouvernementales, ou plus précisément multilatérales par zone maritime - Manche, Mer du Nord, Atlantique.
M. le Président : Envisage-t-on d'élargir ces accords multilatéraux et de faire en sorte qu'à Bruxelles quelqu'un s'occupe de piloter ces questions de sécurité en mer dans ce que certains appellent l'espace maritime européen, et veille à la mise en place des moyens nécessaires ? On a parlé de garde-côtes, moi, je ne dirais pas cela, mais des moyens, en tout cas, permettant de faire face.
M. Claude GRESSIER : Dans les propositions gouvernementales sur la sécurité maritime, ce type de propositions sera envisagée. Mais aujourd'hui, il n'existe que ces conventions multilatérales, indépendantes de l'Union européenne.
En ce qui concerne les produits dangereux autres que le pétrole
- il y en a une multitude -, pour ce qui est de la lutte à terre, POLMAR terre ne comporte pas pour l'heure de spécifications claires sur la façon de lutter contre ces produits, qui peuvent être extrêmement variés.
Quant à la question de l'organisation administrative, il y a eu, en 1997, la fusion de la direction de la flotte de commerce et de la direction des ports. La direction des ports était auparavant direction des ports et de la navigation maritime. En tant que telle, elle s'occupait de la signalisation maritime, ce qu'on appelait autrefois les phares et balises, des CROSS et des centres de sécurité des navires. Lors de la fusion, cet aspect sécurité maritime a été confié à la direction des affaires maritimes et des gens de mer, qui est dirigée par mon collègue Christian Serradji, que vous verrez prochainement. Il existe donc bien une direction qui s'occupe de sécurité maritime au sens large du terme, c'est-à-dire de la sécurité de la navigation et des navires - je ne parle pas de pollution.
M. le Rapporteur : Mais POLMAR terre dépend de vous ?
M. Claude GRESSIER : POLMAR terre dépend de moi en tant que littoral. POLMAR mer dépend du ministère de la Défense.
M. le Président : Tout POLMAR terre dépend de vous ?
M. Claude GRESSIER : Les matériels, seulement. L'organisation de POLMAR terre résulte d'une directive du Premier ministre de 1997, mise en _uvre par les préfets, avec la direction de la sécurité civile du ministère de l'Intérieur qui, là comme ailleurs en cas de catastrophe, joue son rôle général de coordination.
Moi, je suis fournisseur de matériels, je ne suis pas organisateur de POLMAR terre. L'organisateur local, c'est le préfet et, au plan général, c'est le ministère de l'Intérieur, notamment au travers de la direction de la sécurité civile.
La coordination interministérielle s'est faite de deux façons : une cellule de crise a été mise en place par le ministère de l'Intérieur, cellule permanente installée à la direction de la sécurité civile à Asnières ; de façon plus générale, une cellule de crise qui se réunissait régulièrement au cabinet du Premier ministre, d'une part, et au secrétariat général de la mer, d'autre part.
Voilà comment s'est faite la coordination interministérielle dans le domaine de la lutte contre la pollution, qu'il s'agisse de la mer ou de la terre.
M. le Rapporteur : Qui vous donne des ordres ? Le secrétaire général de la mer, le directeur de la sécurité civile, ou les deux ?
M. Claude GRESSIER : ... (Sourires.)
M. le Rapporteur : La question étant tout à fait importante, nous en reparlerons. Ce qui nous apparaît, c'est que le problème de la décision politique s'est posé dans cette période. Sauf le Premier ministre, nous n'avions pas le sentiment qu'un directeur de cabinet, par exemple, ait eu la capacité de décider tout seul et de donner des ordres à untel ou à untel.
Apparemment, théoriquement, le secrétaire général de la mer aurait dû pouvoir le faire, qui dépend du Premier ministre car on ne peut demander au Premier ministre de s'occuper en permanence de la mise en _uvre d'un plan.
Avez-vous senti des manques dans l'organisation, dans le dispositif, dans le fonctionnement ? Avez-vous eu des « coups de gueule » ?
M. Claude GRESSIER : Il y a eu nomination par le Premier ministre, mais je dirais que c'est essentiellement le fait du ministre de l'Intérieur, d'un préfet coordinateur. Le premier préfet coordinateur nommé était celui de la Charente-Maritime. Il s'est avéré par la suite que la pollution dérivait au nord. A ce moment-là, nous avons eu une difficulté non seulement de redéploiement des matériels, mais aussi de coordination, jusqu'au moment où le préfet de région de Rennes a été désigné comme préfet coordinateur pour la zone nord. À partir de ce moment, j'ai pu effectivement travailler avec lui et ses équipes sur le déploiement du matériel.
Tant qu'il n'avait pas été nommé, j'avais des problèmes de coordination, des préfets qui voulaient à eux seuls tout le matériel, bref, des problèmes de répartition un peu délicats. A partir du moment où le préfet de Rennes a été nommé en tant que préfet coordinateur, pour ce qui me concerne, en termes de matériels et de déploiement de ce matériel, il a été possible, si je puis dire, de « mettre les rames ».
Pour répondre à la question de savoir qui me donne des ordres, je dirai que ce sont ceux qui demandent les matériels. Je travaille donc essentiellement avec les préfets coordinateurs. C'est à eux, en liaison avec moi et leurs collègues, de faire les arbitrages. La difficulté est venue du fait que le préfet coordinateur désigné s'est révélé un petit peu loin. A partir du moment où un autre préfet coordinateur, celui de la région de Bretagne, a été désigné, le travail a été rendu plus facile.
M. Georges SARRE : Je souhaiterais intervenir sur la méthode. Je crois que M. Gressier n'avait pas terminé son exposé quand M. le rapporteur lui a posé une question à partir de laquelle l'incise s'est transformée en océan d'interventions.
Je voudrais donc savoir si M. Gressier avait terminé son exposé. En restons-nous seulement aux questions d'après naufrage ? Il est certes intéressant de parler des matériels, j'aurais d'ailleurs quelques questions à poser à M. le directeur à ce sujet, mais je voudrais savoir où nous en sommes dans cette audition car je souhaitais également poser des questions sur d'autres sujets.
Concernant les produits chimiques dangereux, vous avez l'air de dire qu'ils sont si nombreux que rien n'est prévu. C'est du moins ainsi que j'interprète votre réponse. Comme beaucoup de produits dangereux autres que le pétrole sont transportés, je dois dire que je suis franchement préoccupé, parce que cela arrivera bien un jour, ici ou ailleurs - on peut le craindre, en tout cas. Existe-t-il une nomenclature de ces produits dangereux ? Quels sont les matériels qui seraient disponibles et utilisables ?
Je suis bombardé, comme tous mes collègues, je suppose, d'e-mails
m'expliquant que ce pétrole de l'Erika se révèle être, après analyse, un produit particulièrement toxique, dangereux. Je tiens tout cela à disposition de la commission, mais je ne pense pas être le seul à bénéficier de ces informations. Vous-même, monsieur le directeur, avez-vous des informations particulières à ce sujet ? Est-ce une matière dangereuse, bien plus calamiteuse qu'on ne le dit et qu'on ne le croit ?
Compte tenu de l'empirisme, est-on en train d'expérimenter un certain nombre de matériels ? Comme nous avons des arrivages divers, variés mais fréquents, « profite-t-on » de cette situation pour étudier ce qu'il serait possible d'acheter, pour s'équiper pour la suite ?
Monsieur le Président, pour revenir sur cette question de méthode, je ne cherche pas à être déplaisant, mais à savoir si je dois poser tout de suite mes autres questions.
M. le Président : C'est toute la difficulté de l'exercice. Nous aurions pu en effet laisser M. Gressier faire l'intégralité de l'exposé sur une demi-heure et poser ensuite toutes les séries de questions. M. le Rapporteur a souhaité intervenir sur POLMAR terre et tout s'est enchaîné sur ce sujet même s'il est évident que nous avons d'autres points à évoquer. Je propose donc que nous continuions sur POLMAR et demandions à M. Gressier de revenir à une date ultérieure afin de poursuivre sur les autres aspects de ses responsabilités. Je pense que POLMAR est un sujet suffisamment important, qui pose suffisamment de questions, pour qu'on aille le plus possible au fond des choses. Je crois donc préférable, si les membres du bureau sont d'accord, que nous épuisions ce thème.
M. Georges SARRE : Je ne suis pas d'accord avec cette méthode. Je considère que POLMAR est effectivement un aspect extrêmement important, mais si l'on n'analyse pas les raisons et les causes pour lesquelles il y a eu ce naufrage, franchement...
M. le Président : Ce n'est pas le but aujourd'hui. La semaine dernière, nous avons reçu M. Tourret...
M. Georges SARRE : J'ai d'autres questions concernant les compétences de M. Gressier, que je souhaite poser.
M. le Rapporteur : Il reviendra.
M. le Président : On peut poser toutes les questions à tout le monde, il n'y aura aucune restriction. Mais, s'agissant des questions portant sur les raisons du naufrage, si certaines d'entre elles relèvent probablement de M. Gressier, je serais tenté de dire que ce que nous a indiqué M. Tourret la semaine dernière fournit aussi des éléments d'analyse importants et que ce que nous entendrons d'un certain nombre d'autres personnes auditionnées complétera cette information.
Quant à M. Gressier, compte tenu de l'étendue de ses responsabilités dans ce dossier, je suggère à nouveau que nous trouvions dans les semaines qui viennent un moment pour compléter cette audition.
M. Georges SARRE : M. le président, puis-je poser mes questions ?
M. le Président : Je vous en prie.
M Georges SARRE : M. le directeur, trois thèmes ont retenu mon attention. Le premier porte sur les risques de détournement de trafic, le deuxième sur la police portuaire et le troisième sur la flotte pétrolière française.
J'ai lu dans de nombreux journaux que les responsables portuaires en France font preuve de laxisme en matière de contrôle des navires pour éviter que les armateurs ne fuient les ports français et ne partent faire escale dans les ports voisins étrangers, moins contraignants. Or, s'il est vrai qu'il y a risque de détournement de trafic vers l'étranger des flux de marchandises diverses - par exemple, un conteneur acheminé par route ou par fer - en revanche, ces détournements, d'après ce que j'ai pu lire, sont impossibles pour les trafics de minerais et d'hydrocarbures.
Deux questions sur ce point : pouvez-vous confirmer que les trafics d'hydrocarbures, en entrée et en sortie des raffineries françaises, ne peuvent pas être détournés par les ports étrangers ? Si non, comment et dans quelles proportions ?
Le deuxième thème concerne la police portuaire. La presse a rapporté que la réglementation du transport des marchandises dangereuses, décidée en 1997, est effective depuis un an pour tous les modes et zones de transport sauf dans les ports soumis, dans ce domaine, à un quasi vide juridique depuis de nombreuses années. Monsieur le directeur, peut-on savoir quand cette réglementation sur les substances dangereuses dans les enceintes portuaires sera connue et appliquée ?
Concernant le blocage dans les ports, premièrement, les décisions d'immobilisation des navires dangereux prises par les inspecteurs des affaires maritimes doivent-elles, pour être exécutoires, être soumises aux autorités portuaires, c'est-à-dire aux directeurs et officiers de port ?
Deuxièmement, si tel est le cas, ne conviendrait-il pas qu'à l'exemple des Etats-Unis, les sanctions prises à l'encontre des navires en infraction dans les ports le soient exclusivement par les inspecteurs des affaires maritimes, comme c'est le cas chez les garde-côtes ?
Troisièmement, est-il normal que l'absence de preuve d'assurance des navires ou de leur cargaison n'entraîne pas l'interdiction d'escale ? Question complémentaire : pourrait-on avoir la liste des navires sanctionnés pour infraction dans nos différents ports et le nombre de jours d'immobilisation correspondants, depuis 1995 ?
Dernier thème : la flotte pétrolière française. De 1928 à 1992, toutes les sociétés pétrolières exerçant en France ont été obligées, par la loi, de détenir sous pavillon français une flotte correspondant à 66 % de leurs besoins de transport, pour des motifs de sécurité d'approvisionnement. Or la loi du 31 décembre 1992, imposée par les pétroliers, a abrogé cette disposition jugée trop contraignante pour la limiter aujourd'hui à un niveau symbolique de 5 % des besoins. Pour assurer la sécurité de nos approvisionnements en cas de crise, ne convient-il pas de renforcer les moyens mobilisables ?
De même qu'il existe une obligation de stock pétrolier pour tous de trois mois de réserve, ne faut-il pas disposer d'une flotte pétrolière mobilisable en cas de crise , comme c'est le cas aux Etats-Unis, susceptible de satisfaire 50 % de nos besoins nationaux ? Demande complémentaire : pourrait-on avoir communication de l'évolution depuis dix ans de la flotte pétrolière française par taille et par âge des navires, par compagnie et société pétrolière ainsi que la structure actuelle de nos approvisionnements en hydrocarbures par voie maritime en tonne/mille par compagnie pétrolière ? Je vous en remercie.
M. le Président : C'est un résumé qui vient d'être fait de l'ensemble du dossier de la commission d'enquête !
M. Michel HUNAULT : Ce sont les vraies questions !
M. le Président : Pour que les choses soient simples et comme il ne nous reste qu'un quart d'heure, j'aimerais que puisque nous avons commencé sur un thème, nous nous en tenions à ce thème.
M. Georges SARRE : Qui l'a décidé ? Quand et comment ?
M. le Président : A partir du moment où l'on a commencé sur le thème de POLMAR, il me semble que la meilleure méthodologie consisterait à épuiser le sujet.
M. Georges SARRE : Si nous sommes de trop, il faut nous le dire !
M. le Président : Personne n'est de trop !
M. Michel HUNAULT : J'exprimerai un regret sur la façon dont vous encadrez les débats, monsieur le président. Cette commission d'enquête a été créée à la suite d'une catastrophe. De vraies questions viennent d'être posées à notre invité, qui est le directeur des transports maritimes, des ports et du littoral. M. Cazeneuve a également posé des questions très précises dont nous attendons encore les réponses et M. Sarre pose une série de questions. Et vous dites que ce n'est pas le débat !
Si vous devez encadrer ainsi les questions, on peut s'interroger sur l'utilité de la présence de certains d'entre nous au sein de cette commission alors qu'il existe de vraies questions, que la population se pose, et que le transport des produits dangereux continue sans aucune réglementation depuis cette marée noire !
M. le Président : Lors de la dernière commission d'enquête que j'ai eu l'honneur de présider, je n'ai jamais rien encadré dans le sens que vous laissez entendre ! Je souhaite simplement, précisément pour que la personne auditionnée aille au bout de ses réponses, que nous puissions aussi aller au bout de nos questions.
M. Michel HUNAULT : Toutes les questions !
M. le Président : Bien sûr, toutes les questions ! Dans ce cas précis, s'il s'avère nécessaire de demander à M. le directeur de revenir, il reviendra. Aussi souvent qu'il le faudra.
Je m'inscris à l'opposé de ce que vous suggérez. Comme nous avions abordé le plan POLMAR terre, je souhaitais que nous en terminions avec ce volet. Mais si vous souhaitez poursuivre avec les questions posées par M. Sarre, je n'y vois aucun inconvénient.
M. Claude GRESSIER : En termes de protection du littoral, nous essayons d'empêcher des produits, pétroliers ou chimiques, d'arriver jusqu'à la côte, ou, du moins, dans les endroits les plus sensibles sur le plan écologique. Nous ne pouvons le faire qu'à l'aide de barrages ou de barges, comme je l'ai indiqué, qu'il s'agisse des produits chimiques ou pétroliers, à partir du moment où il y a déversement dans la mer de ce type de produit.
C'est autour de cela qu'ont été organisés les matériels POLMAR terre. Il peut y avoir, effectivement, d'autres produits chimiques. Il peut y avoir des produits chimiques dans les conteneurs. Le problème est plutôt alors d'essayer de repêcher le plus rapidement possible ce conteneur. Le problème est un peu différent de celui d'une nappe qui risque d'arriver au voisinage des côtes.
Les types de pollution peuvent être de natures très diverses. POLMAR terre a été conçu essentiellement pour empêcher des nappes d'arriver dans les zones les plus sensibles du littoral.
Quant à la toxicité du produit, à son caractère cancérigène éventuel, des laboratoires ont analysé ou vont analyser ce produit et juger des risques sur le plan de l'épidémiologie. Ce n'est pas ma spécialité et je ne saurais pas répondre à cette question.
Vous avez posé la question, monsieur le ministre, de savoir si nous en profitions pour expérimenter des matériels. Actuellement nous « expérimentons », si je puis dire, les matériels dont nous disposons et nous pouvons en tirer un certain nombre de conséquences. Nous n'avons pas d'autres matériels à expérimenter.
Par contre, nous commençons actuellement à tirer les leçons de ce qui a fonctionné et de ce qui n'a pas fonctionné pour orienter notre problématique de renouvellement du matériel, problématique urgente mais qui nous laisse un temps de réflexion. Urgente, en effet, parce qu'une grande partie des matériels a été détruite - par les tempêtes plus que par la pollution due à l'Erika - et nous devons donc reconstituer nos stocks avec une relative urgence, pour faire face dans un délai assez rapproché à une éventuelle nouvelle pollution. Mais cela ne nous empêche pas, pour une autre partie du matériel, de prendre le temps de la réflexion pour, une fois les leçons tirées de la catastrophe et des expériences étrangères, avoir des matériels mieux adaptés. Il s'agit de tenir compte des différentes catégories de produits transportés au voisinage des côtes françaises susceptibles de se répandre dans la mer, notamment en termes de produits pétroliers ou chimiques, qu'il s'agisse de pétrole brut ou de produits raffinés, puisque l'on transporte à la fois du pétrole brut vers nos raffineries et des produits raffinés - essence ou autres - à destination d'autres ports français ou étrangers.
En ce qui concerne les détournements de trafic, honnêtement, je ne crois pas que nos contrôleurs soient plus laxistes que les contrôleurs d'autres pays européens. Nous avons sans doute des centres de sécurité des navires avec des contrôleurs qui sont en nombre insuffisant. Le ministre lui-même l'a reconnu et a proposé de doubler leur nombre dans les deux ans qui viennent. Je ne pense pas qu'ils soient plus laxistes que d'autres dans l'Union européenne. J'en voudrais pour preuve la liste des navires immobilisés qui, d'ailleurs, figure sur le site Internet que nous avons en commun avec la direction des affaires maritimes et des gens de mer, sur lequel figurent nombre de navires immobilisés. Les autres pays ne l'affichent pas aussi clairement et, si nous établissons une comparaison en termes de nombre, nous ne pouvons pas dire que nos contrôleurs soient plus laxistes.
L'immobilisation des navires est demandée par les agents des affaires maritimes, qui font partie des centres de sécurité des navires. Ils la demandent à ceux qui sont chargés de la police portuaire, qui sont les officiers de port.
Votre question était de savoir si les officiers de port peuvent accepter ou refuser ? En principe, ils ne refusent jamais. Depuis le décret du 9 septembre 1999, nous avons modifié, entre autres éléments de ce décret qui en comporte beaucoup, une phrase du code des ports qui dispose désormais que les officiers de port interdisent la sortie des navires à la demande des agents des affaires maritimes, en utilisant le présent de l'indicatif valant obligation. Les officiers de port n'ont donc pas de marge de man_uvre, ils sont liés par la demande des inspecteurs des affaires maritimes.
Je pourrais vous donner ultérieurement le nombre de jours d'immobilisation depuis 1995, que je n'ai pas ici. Cependant ce nombre de jours d'immobilisation est une donnée un peu trompeuse parce qu'il s'agit de savoir si, entre-temps, le navire fait l'objet de réparations par l'armateur ou si celui-ci l'a abandonné, comme ce fut le cas du fameux
Kifangondo qui, abandonné par son armateur, n'a pas trouvé preneur et pour lequel il a fallu attendre cinq ou six enchères avant qu'il finisse par trouver un acquéreur qui engage les travaux nécessaires. Ce navire est resté quatre ans sur les quais du Havre. Le nombre de jours ne me paraît donc pas probant, mais nous pourrons évidemment répondre à une question sur le nombre de navires et ce qu'il en est advenu.
Concernant l'assurance, la réglementation internationale prévoit que doivent être assurés les navires transportant des produits pétroliers et chimiques. En revanche, il n'y a pas d'obligation d'assurance - et c'est une des réformes que nous envisageons - pour les navires classiques ne transportant pas de matières dangereuses. C'est assez répandu, mais ce n'est pas toujours le cas. Si je peux donner un exemple, il y a actuellement trois navires échoués sur les plages à côté de Port-la-Nouvelle, transportés sur le rivage à la suite des tempêtes de fin novembre de l'année dernière. L'un d'entre eux n'a pas d'assurance.
Actuellement, en ce qui concerne le pavillon français, la loi de 1992 prévoit que 5 % du tonnage de produits raffinés, déduction faite des produits exportés, doivent correspondre à la capacité d'une flotte sous pavillon français. Aujourd'hui, nous avons donc, sous pavillon français, quatorze navires qui appartiennent soit à la Compagnie nationale de navigation, soit à Green Tankers, compagnie norvégienne, soit à Euronav qui est maintenant sous capitaux belges, soit à Mobil.
Mobil est d'ailleurs la dernière société pétrolière possédant elle-même des navires ; les autres armateurs dont j'ai parlé, Euronav, Green Tankers ou la Compagnie nationale de navigation, pour remplir l'obligation légale qui leur est imposée par la loi de 1992, ont des chartes parties de long terme, mais pas de navires en propriété. Sur ces quatorze navires, un bon nombre sont malheureusement âgés et n'ont pas été renouvelés depuis longtemps, puisque neuf ont plus de vingt ans.
Nous envisageons d'accorder une priorité importante, tant pour les transports de produits bruts (VLCC), que pour ceux de produits raffinés - car nous avons aussi des navires hors obligation légale qui transportent des produits raffinés, dont un nombre non négligeable a également plus de vingt ans - dans l'enveloppe des GIE fiscaux mise en _uvre par le Gouvernement en 1998.
Actuellement, sur quatorze navires concernés pour les VLCC, neuf sont simple coque et auront, au cours des cinq ans à venir plus de vingt-cinq ans, deux autres sont simple coque et auront respectivement quatorze et quinze ans. Le coût total de renouvellement est de l'ordre de 4 milliards de francs. Avec le système des GIE fiscaux, le coût pour l'Etat serait de l'ordre du milliard, à étaler sur environ cinq ans.
Ensuite, nous avons les transporteurs de produits et les caboteurs pétroliers qui sont des navires de plus petite taille. Là, le coût pour l'Etat serait, au total sur cinq ans, de l'ordre de 400 millions de francs pour renouveler les plus âgés.
On peut se demander pourquoi les pétroliers n'ont pas renouvelé plus rapidement ces navires. C'est évidemment pour des raisons essentiellement économiques. Compte tenu de ce qu'ils estiment être le coût, qu'ils appellent le « surcoût », du pavillon français, cela les a conduit à ne pas se précipiter, c'est le moins qu'on puisse dire, pour renouveler rapidement cette flotte.
Il est vrai que les obligations qu'ils ont signées lors de la table ronde de jeudi dernier et les propositions que le Gouvernement français va soumettre à l'Organisation maritime internationale ainsi qu'à l'Union européenne entraînerons un renouvellement de cette flotte dans les années qui viennent, surtout si nous pouvons les aider en leur donnant une priorité dans le système du GIE fiscal, qui actuellement fonctionne assez bien.
Je ne pense pas avoir oublié de répondre à une question que vous m'avez posée.
M. Kofi YAMGNANE : Je voulais apporter deux remarques relatives aux questions posées par mes collègues, MM. Cazeneuve et Sarre, sur les produits dangereux transportés. Quand on est au CROSS-Corsen, en haut de la tour d'Ouessant, on voit des bateaux qui passent par dizaines. On les voit qui s'arrêtent et on leur demande ce qu'ils font là, immobilisés, ils vous répondent qu'ils n'ont rien. Alors, circulez !
L'amiral vous expliquera que pour l'Erika, cela s'était passé un peu comme ça : d'abord, ils l'ont vu immobile et lui ont demandé ce qu'il faisait là. Dans un premier temps, il a dit qu'il pensait avoir quelques difficultés et, dans un second, il leur a dit qu'il n'avait rien et qu'il repartait. Donc, il quitte le rail : pour eux, c'était terminé...
Alors quand il nous explique que, parmi tous ces navires, très peu en réalité transportent du pétrole... La plupart transportent des produits autrement plus dangereux ! Quand on entend dire que nous n'avons comme moyen de protection que des barrages, je me demande si un barrage arrête l'arsenic. Lorsque le produit se dilue dans l'eau, aucun barrage ne peut l'arrêter ! Si on n'a rien pour les éloigner un peu plus, on court de véritables risques.
M. Jean-Michel MARCHAND : Excusez-moi de revenir sur ce plan POLMAR terre. Si je vous ai bien compris, monsieur le directeur, vous êtes un fournisseur de matériel. Etre fournisseur de matériel, cela va-t-il jusqu'à la prise en charge des sites de stockage ? Vous nous avez parlé des quatre sites de stockage prévus dans le plan, mais vous n'avez pas du tout fait allusion aux sites intermédiaires. J'ai le sentiment, peut-être à tort, que les élus locaux, en particulier les maires du littoral, ont été abandonnés et ont dû trouver eux-mêmes des solutions, pour ne pas dire des palliatifs, afin de stocker - certes de façon provisoire, mais dans quelles conditions ! - les produits récupérés. Et j'acquiesce volontiers à ce propos à la remarque de mon collègue sur l'enthousiasme des bénévoles.
Je peux citer deux ou trois cas de ces stockages improvisés. On stocke, par exemple, dans une lande répertoriée comme site classé en raison de sa qualité écologique, ou auprès d'un ruisseau, ou encore dans une future zone artisanale à proximité d'habitations.
Aussi aurai-je deux questions à vous poser. Premièrement, dans le plan POLMAR, les stockages intermédiaires sont-ils prévus ? Si oui, pourquoi étaient-ils si peu judicieux, comme ce site sur lequel on est en train de faire des carottages pour savoir si le sol n'a pas été pollué en profondeur ? Même si nous ne savions pas exactement quand la nappe toucherait les côtes, nous avons eu le temps de nous préparer à cette éventualité.
Deuxièmement, en ce qui concerne la nécessaire dépollution de ces sites, maintenant, alors que l'on a transporté la pollution du rivage jusqu'à l'intérieur des terres, comment va-t-on procéder pour que les sites soient remis en état ?
Vu sous cet angle, vous comprenez combien il était important d'obtenir l'engagement de Total qu'il traiterait ces produits, surtout maintenant lorsqu'on sait ce que sont devenus ceux de l'Amoco-Cadiz.
M. Claude GRESSIER : Je reviens sur les déchets de l'Amoco-Cadiz
dont j'ai dit tout à l'heure qu'une partie, des résidus, stockés à la Rochelle, avait été confiée à une société qui avait fait faillite et était restée sur place. Mais il est vrai qu'une partie, c'est encore trop.
Des sites de stockage intermédiaires sont bien prévus dans les plans POLMAR des différents départements. Je peux vous citer, je les ai sous les yeux, les sites de ramassage en Vendée - le Puissaut à Saint-Hilaire, l'hippodrome à Saint-Jean de Mont, etc. Ces sites ont été prévus et ont été dotés très vite de bâches extrêmement résistantes. Ces sites ont donc été prévus. Certains sites l'ont mal été ? Peut-être mais, dans le plan POLMAR terre, ils sont prévus.
En revanche, compte tenu de l'afflux des bénévoles, il a fallu mettre à leur disposition très rapidement - ceci n'avait peut-être pas été suffisamment anticipé - des bennes ou des sites offrant encore plus de proximité que ces sites intermédiaires de stockage, afin qu'ils déposent tout de suite, après l'avoir ramassé, leur produit au voisinage immédiat des plages. Peut-être y a-t-il eu là une réactivité insuffisante pour la fourniture de bennes de capacité suffisante pour recueillir ces déchets, en temps réel, avant de les déposer ensuite sur les sites de stockage intermédiaire ou sur le site de Donges, où ces produits doivent être traités.
Mais des sites de stockage intermédiaire sont bien prévus dans les plans POLMAR terre des différents départements.
M. Jean-Michel MARCHAND : Vous avez bien compris ma question et je comprends votre réponse, sauf que force est de constater que ce plan ne correspond pas à la réalité de la catastrophe qui a touché nos côtes et à la nécessaire réactivité face à une catastrophe telle que celle-ci ! Si demain il nous arrivait la même chose, nous serions exactement dans la même situation, quel que soit l'endroit où la marée noire toucherait nos côtes.
Je me permets d'insister sur ce point et de faire remarquer à nouveau que les élus locaux ont bien été obligés de faire face à une situation qui n'avait été ni prévue, ni analysée, ni chiffrée.
M. Michel HUNAULT : Je voudrais revenir sur un point essentiel et si nous n'avons pas le temps de le traiter aujourd'hui, il faudra que M. le directeur revienne.
De vraies questions ont été posées, notamment par M. Sarre, sur les produits dangereux, reprises par nos collègues. Je voudrais donc savoir si M. le directeur des transports maritimes a des indications sur le transport des produits dangereux. Existe-t-il des informations sur ce qui est réellement transporté dans les navires ? J'aimerais savoir si cela dépend de votre sphère de compétence. Qu'y a-t-il dans les navires qui sont sous pavillon de complaisance ?
Qu'existe-t-il comme prévention ? Peut-on, demain, prévenir des catastrophes similaires à celle de l'Erika ?
On a dit que c'était du pétrole. Puis, à une question posée sur la dangerosité de ce pétrole au Premier ministre, qui s'est donné la peine de venir devant la Représentation nationale durant quatre heures et demie, nous nous sommes entendus répondre que « non, a priori », il ne présentait pas de danger. Depuis, dans toutes les académies, des circulaires invitent à ne plus envoyer les enfants au bord de la mer parce que c'est dangereux et les pompiers sur les plages de Loire-Atlantique sont maintenant masqués. Il semblerait qu'il soit dangereux de ramasser ce qui était jusque là présenté comme du pétrole.
C'est une vraie question. Notre commission d'enquête n'est pas là uniquement pour faire des constats, mais a aussi la responsabilité de faire des propositions et surtout de la prévention.
Ce n'est pas pour flatter notre collègue Georges Sarre qui a exercé des compétences ministérielles, mais sur la sécurité routière il a pris un certain nombre de décisions en vue de prévenir les accidents. Ces décisions sont aujourd'hui appliquées avec une certaine efficacité.
Il est vrai que des questions se posent et que notre commission d'enquête ne peut se contenter de ce qui est écrit dans la presse. Il faut que la Représentation nationale aille plus loin, pour savoir quelles sont les responsabilités et si l'on est sûr aujourd'hui, 16 février, que le transport des produits dangereux se fait dans la sécurité. Vous, monsieur le directeur, qui avez des responsabilités, êtes-vous vraiment au courant de ce qui se passe ?
Un des rôles de notre commission est aussi de faire des propositions, et je rappelle que dans quatre mois l'Union européenne sera présidée par la France.
M. le Président : Bien évidemment, la commission d'enquête a des propositions à faire. C'est son objet, en partant de certaines analyses.
M. le Rapporteur : Pour répondre à notre collègue Georges Sarre, j'ai cru comprendre que la commission d'enquête se poursuivait jusqu'au mois de juin et que nous aurions à aborder un ensemble de sujets. L'intérêt de la commission d'enquête, me semble-t-il, est d'aller jusqu'au bout de la discussion avec nos interlocuteurs et de ne pas laisser partir M. Gressier sans qu'il nous dise si le plan POLMAR terre marche ou pas.
Dans le champ de compétence de la commission d'enquête, il y a aussi, en matière de sécurité, l'application de ce plan à terre. En tant qu'élu côtier, j'ai la conviction, et je ne pense pas être le seul, que ce plan ne marche pas.
Une catastrophe de ce type pouvant se reproduire quelles que soient les précautions prises, car le risque nul n'existe pas, il faut également que nous fassions des propositions sur le plan POLMAR. Mais il faut aussi, en effet, faire des propositions sur tout le reste. Les questions qui ont été posées, nous les avons déjà posées et continuerons à les poser.
A mon avis, M. le président, étant donné l'ampleur des compétences de M. le directeur des transports maritimes, des ports et du littoral, il faudra qu'il revienne pour qu'on puisse approfondir certaines des questions qui viennent d'être abordées. Pour ma part, je suis prêt à poursuivre cette audition aussi longtemps que cela s'avèrera nécessaire pour aller au fond des choses.
M. Claude GRESSIER : Les navires transportant des produits dangereux doivent se signaler. Ils sont soumis à une obligation de signalement dès qu'ils arrivent dans les eaux territoriales et dans la Manche.
Lorsqu'ils arrivent dans un port, c'est la même chose. Une des prérogatives des officiers de port est de veiller au transport dans de bonnes conditions et, donc, au bon chargement et déchargement de ces produits dangereux. Il existe donc dans les ports et en mer une obligation de signalement des produits dangereux par les navires qui les transportent.
Cette obligation est généralement remplie par les transporteurs de vrac liquide. Je ne suis pas sûr que ce soit toujours fait lorsqu'un ou deux conteneurs parmi six mille boîtes transportent des produits dangereux. Lors du chargement dans le port, il est vérifié que la mise en place de conteneurs contenant des produits dangereux ou, éventuellement, des produits incompatibles - qui peuvent l'un avec l'autre produire des déflagrations ou avoir des résultats extrêmement dangereux - est faite de telle façon qu'aucune catastrophe ne puisse se produire.
Tout ce que je peux vous répondre, c'est qu'il existe bien une obligation de signalement complète dans les ports et une obligation de signalement, pour les transporteurs de produits dangereux, vis-à-vis des CROSS.
M. Louis GUEDON : Qui effectue le contrôle de ces déclarations, M. le directeur ?
M. Claude GRESSIER : Dans les ports, ce sont les officiers de port. Dans les CROSS, c'est une déclaration. Il n'y a pas de vérification, sauf s'ils arrivent dans un port déterminé.
M. Louis GUEDON : Pour reprendre la proposition de M. le Rapporteur, je dirai qu'il est nécessaire de faire des propositions constructives. Vous nous donnez une information positive : il y a une obligation de déclaration sur le rail d'Ouessant. Mais qui contrôle ces navires dans le cas où leurs déclarations seraient fantaisistes ? De quels moyens dispose-t-on pour éloigner ces navires ? A terre, la tâche paraît plus facile puisque les capitaines de port peuvent saisir les autorités et bloquer le bateau. Mais en mer ?
Avez-vous une réponse à cette question, M. le directeur ? Sinon, il faut mettre quelque chose en place.
M. Claude GRESSIER : Vous me demandez si l'on peut interdire à un navire...
M. Louis GUEDON : Vous avez dit que tout navire transportant des substances dangereuses avait le devoir de le signaler, c'est-à-dire que vous laissez cette déclaration à la bonne volonté du capitaine du navire. Mais les autorités maritimes françaises ont-elles les moyens de contrôler si les capitaines sont honnêtes dans leurs déclarations ?
Par ailleurs, si le navire présente un danger, de quels moyens disposons-nous, tant qu'il n'a pas encore coulé, pour l'éloigner des zones côtières et éviter les catastrophes ?
Nous ne pouvons nous en remettre à la seule bonne volonté des capitaines de déclarer qu'ils transportent des produits dangereux.
M. Claude GRESSIER : Il faudrait poser la question au préfet maritime. C'est lui qui est responsable de l'action de l'Etat en mer. A ce titre, lorsqu'il constate qu'un navire est en difficulté et transporte des produits susceptibles d'entraîner des pollutions graves, il peut lui enjoindre, d'une part, de faire cesser la pollution, et, d'autre part, de s'éloigner des côtes.
C'est une prérogative du préfet maritime, sous réserve, bien entendu de la sécurité de l'équipage.
Pour prendre un autre exemple que je connais mieux parce qu'il est portuaire et ressort totalement de mes compétences, je pense que vous avez entendu parler du
Junior M à Brest. C'est une illustration intéressante. Ce
Junior M allait de Saint-Pétersbourg au Maroc, transportant de l'ammonitrate en vrac, un produit dangereux qui, surtout en vrac, peut exploser. Dans les ports français, cet engrais n'est admis au chargement qu'en sacs. D'ailleurs, une bonne part des navires bloqués dans les ports sont justement des navires chargés d'ammonitrate car le produit étant relativement peu coûteux, les affréteurs affrètent véritablement des « poubelles », disons le mot.
Donc, ce Junior M se met à l'abri d'une tempête dans la baie de Saint-Brieuc. L'amiral demande qu'il soit admis au port de Saint-Malo. Refus du capitaine de port. Il demande qu'il soit accueilli au port de Brest. Refus du commandant de port.
Il finit par s'adresser à moi. Il était hors de question qu'il aille à Saint-Malo compte tenu de l'état du port, situé en pleine ville, après le passage d'une écluse, etc. Il nous restait deux solutions : soit nous le faisions remorquer au large et le coulions, soit nous le faisions entrer dans un port. L'amiral m'a fait remarquer que se posait la question de la sauvegarde de l'équipage et que les soutes risquaient de créer une pollution si le navire n'était pas coulé suffisamment au large. Le faire rentrer dans un port, entraînait un risque éventuel d'explosion.
Nous étions en hiver, il y avait peu de chances que le produit chauffe et explose. J'ai finalement pris la décision de le faire entrer au port de Brest. Après de longues et difficiles palabres avec l'armateur et le propriétaire de la cargaison, il a fini par être déchargé.
Nous sommes donc confrontés à des situations qui ne sont pas simples et dans lesquelles, entre une pollution en mer, la sauvegarde de l'équipage et un risque éventuel à terre, il faut peser les décisions.
M. Louis GUEDON : Je vous remercie, M. le directeur, mais vous ne répondez pas à la question posée par M. le Rapporteur, car l'ammonitrate est un produit organique dangereux sous trois conditions : quand ce produit est impur ; quand il est soumis à une hausse de température ; et quand il subit des chocs. Ce fut d'ailleurs la cause de la grande catastrophe de Brest en 1947 où, ces trois conditions étant réunies, un quartier de la ville a sauté.
Mais couler un navire chargé d'ammonitrate n'est pas dangereux puisque, dans l'eau il n'est plus ni polluant ni dangereux. C'est un sel qui se dissout, l'ammoniaque étant un produit volatil, ce n'est plus un produit polluant.
M. Claude GRESSIER : Mais les soutes sont polluantes. Le gasoil des soutes est polluant. Il allait au Maroc, ses soutes étaient pleines. Je n'ai pas dit que l'ammonitrate était polluant, mais le gasoil l'était. On aurait pu nous le reprocher.
M. le Président : Je propose que nous arrêtions là cette audition. Nous recevrons à nouveau M. Gressier pour une deuxième séance à une date à convenir.
M. le Rapporteur : M. le directeur, si nous pouvions avoir par écrit les informations qu'a demandées M. Georges Sarre tout à l'heure, cela permettrait d'avancer dans la réflexion.
Audition de M. Paul RONCIÈRE,
secrétaire général de la mer
(extrait du procès-verbal de la séance du 15 février 2000)
Présidence de M. Daniel PAUL, Président
M. Paul RONCIERE est introduit.
M. le Président lui rappelle que les dispositions législatives relatives aux commissions d'enquête lui ont été communiquées. A l'invitation du Président, M. Paul RONCIERE prête serment.
M. Paul RONCIERE : Je suis heureux d'être devant vous pour faire un point de situation sur les problèmes de sécurité maritime, puisque tels sont l'objet et la mission de votre Commission.
Sans doute n'est-il pas nécessaire de revenir sur une actualité qui est récente, si ce n'est que nous sommes tous bouleversés par ce nouveau drame sur le littoral atlantique.
Actuellement sont engagées des opérations de lutte contre la pollution, opérations menées à la fois à travers le plan POLMAR mer, qui a été déclenché dès que l'Erika s'est cassé en deux, et les plans POLMAR terre, soit un plan par département.
Le Gouvernement a été amené à prendre des mesures d'urgence et, au-delà, à annoncer des dispositions concernant la sécurité maritime. Je suis d'ailleurs arrivé avec un peu de retard car, à 16 heures 30, se tenait à Matignon, sous la présidence du Premier ministre, une réunion au cours de laquelle ont été adoptés trois Mémorandum français qui seront présentés respectivement à l'Union européenne, à la Commission de Bruxelles, à l'OMI et au FIPOL.
Je rappelle aussi que le 10 février dernier, le ministre de l'Equipement a réuni l'ensemble des acteurs du transport maritime et, qu'à l'occasion de cette réunion, a été adoptée - ce qui est novateur - une Charte de la sécurité maritime des transports pétroliers, dont les engagements, tout à fait nouveaux, vont précisément dans le sens de ce que nous souhaitons.
Le troisième volet, qui viendra ultérieurement, est d'ores et déjà programmé, puisque le 28 février prochain se tiendra à Nantes un Comité Interministériel d'Aménagement et de Développement du Territoire (CIADT) exceptionnel sur la réparation de l'ensemble des dommages, l'organisation des filières et les autres aspects économiques liés à la marée noire et à la tempête, et un Comité interministériel de la mer dont le seul objet sera la sécurité maritime, avec des annonces qui porteront sur des mesures nationales de sécurité maritime.
C'est dire que les problèmes soulevés à l'occasion de ce nouveau drame sont pris dans leur globalité et que le Gouvernement a le souci de répondre pleinement à l'ensemble des attentes de la population ainsi que des élus.
Je rappellerai maintenant très brièvement ce qu'est le Secrétariat général de la mer. C'est une instance qui a été créée en novembre 1995. Je rappelle que depuis 1981, il y avait eu des ministères de la mer et que, dans le gouvernement d'Alain Juppé, il n'y avait pas eu d'instance de cette nature, mais il existait toujours une Mission interministérielle de la mer, de dimension assez modeste : l'essentiel de sa mission était la coordination de l'action de l'Etat en mer.
Le Secrétariat général de la mer, créé en novembre 1995, a repris les compétences de cette Mission interministérielle, c'est-à-dire la coordination de l'action de l'Etat en mer et la préparation et le suivi des décisions du Comité interministériel de la mer. La Mission interministérielle de la mer avait été, quant à elle, créée en 1975, avant le drame de l'Amoco-Cadiz, à la suite du constat que nos moyens étaient mal coordonnés et extrêmement dispersés.
Trois principes ont conduit à ce choix : le premier est celui de l'unicité de l'espace maritime et donc, la nécessité d'avoir une opérabilité sur de grandes zones, par façade littorale ; le deuxième principe est l'unicité de la politique maritime ; le troisième est le recours à la coordination des administrations dotées de compétences spécifiques plutôt qu'à une politique inspirée du système des garde-côtes - que l'on cite toujours en
exemple -, système dans lequel une administration extrêmement puissante couvre tout un ensemble de compétences. Notre dispositif national n'est pas de cette nature.
Partant de ces trois principes, des outils ont été mis en place.
Le premier est le Comité interministériel de la mer qui, présidé par le Premier ministre, se prononce régulièrement sur des décisions touchant à la politique maritime de notre pays.
Le deuxième est le Secrétariat général de la mer. C'est un outil léger puisqu'il compte un secrétaire général, un secrétaire général adjoint proposé, conformément aux textes, par le ministre de la Défense - actuellement, ce secrétaire général adjoint est un amiral - et neuf chargés de mission. Cet outil a une double vocation. Il assure la coordination au niveau central de l'action de l'Etat en mer et prépare les décisions prises au niveau politique et veiller à leur exécution. Cette instance légère est placée auprès du Premier ministre, compte tenu de sa dimension interministérielle.
Le troisième outil est, pour la métropole, le préfet maritime - pour l'Outre-mer, le dispositif est un peu différent - qui est le représentant de l'Etat sur le littoral et qui est l'homme désigné pour assurer la coordination de l'action de l'Etat en mer, sur sa façade maritime.
Le sujet qui nous préoccupe est celui de la sécurité maritime. Je me permettrai de rappeler ce dont nous disposons, très rapidement car ce sont des aspects que vous devez connaître.
Depuis le drame de l'Amoco-Cadiz en 1978, puis, celui du
Tanio, de moindre importance, en 1980, nous avons connu une vingtaine d'années sans drame majeur sur nos côtes. C'est peut-être un miracle, mais pas tout à fait. Cela repose, je le crois et je tiens à insister là-dessus, sur les dispositifs mis en place, qui font preuve d'une efficacité certaine.
Le préfet maritime, je rappelle cet aspect juridique, dispose depuis une loi de 1976 prise en application d'une Convention internationale de 1969 sur l'intervention de l'Etat en haute mer, d'une arme juridique efficace qui est la mise en demeure. Elle lui permet chaque fois qu'il y a un risque d'accident, de mettre en demeure le commandant du bateau de prendre un certain nombre de dispositions. Il peut mettre aussi en demeure l'armateur. Parmi les outils juridiques, je citerai également la loi du 15 juillet 1994 relative aux modalités de l'exercice par l'Etat de ses pouvoirs de contrôle en mer, y compris en utilisant des moyens de contrainte quand cela s'avère vraiment nécessaire.
En dehors de ces instruments juridiques, nous disposons de divers autres outils : les Centres régionaux opérationnels de sécurité et de sauvetage, les CROSS, cinq en France plus deux sous-CROSS ; trois dispositifs de séparation de trafic et un dispositif particulier, récemment créé dans les Bouches de Bonifacio après le problème du
Fenes ; les obligations de signalement, qui reposent d'ailleurs sur des conventions internationales ; la mise en place de remorqueurs d'intervention en haute mer, un par façade maritime, en précisant que ces remorqueurs sont affrétés par le ministère de la Défense et mis à la disposition du préfet maritime et que, depuis juillet 1999, la Marine nationale a passé une nouvelle convention - cet aspect n'est pas très connu - avec la société
Les Abeilles, pour pouvoir disposer des remorqueurs portuaires en cas de nécessité.
Le préfet maritime dispose également d'une équipe d'évaluation et d'intervention qu'il peut déposer sur les bateaux pour aller voir ce qui se passe et apporter un soutien technique. Il existe tout un ensemble d'outils de sauvetage. Je me permets à cet égard de signaler le rôle essentiel des hélicoptères de la Marine nationale et, notamment, des
Super Frelons, avec, néanmoins, un problème qui n'est pas neutre, celui du vieillissement de cet outil et d'une disponibilité que je qualifierais peut-être d'insuffisante, sans oublier un ensemble d'équipements, aussi bien au niveau maritime qu'au niveau aérien, de lutte antipollution plus ou moins spécialisés avec, notamment, les deux avions POLMAR dont dispose la douane. Le dernier aspect, mais non le moindre dans notre dispositif, est l'existence du Centre de documentation, de recherche et d'expérimentations sur les pollutions accidentelles des eaux, le CEDRE, qui fait un travail absolument remarquable même s'il a pu être critiqué sur certains aspects relevant, me semble-t-il, plus de la communication.
En cas de difficulté, le plan POLMAR mer est donc engagé par le préfet maritime. Ce plan et son contenu sont définis par une instruction interministérielle récente, puisqu'elle a été signée en décembre 1997, à la suite d'une initiative du Secrétariat général de la mer de l'époque : en effet, c'est après une journée de réflexion sur le dispositif national de lutte contre les pollutions marines, qui s'est tenue à Paris le 29 janvier 1997, qu'a été revue et refondue cette instruction, après pratiquement une année de travail en interministériel, parce que c'est un sujet qui relève de l'interministériel.
A l'époque, je n'étais pas en fonction au secrétariat général mais j'en ai eu quelques échos : ce ne fut pas un travail simple que de mettre tout le monde d'accord. Parfois, il faut trouver le bon compromis.
Je rappelle aussi que chaque façade maritime a son plan POLMAR actualisé
- et nous veillons à son actualisation permanente. Je ne pourrais pas dire tout à fait de même des plans POLMAR terre. Je le dis parce que nous le constatons malheureusement. Il y a parfois des mises à jour qui tardent énormément. Dans ce domaine, il y a manifestement un toilettage d'urgence à engager.
Je signale également que le déclenchement du plan POLMAR permet d'engager le fonds d'intervention POLMAR, géré par le ministère de l'Aménagement du territoire et de l'environnement. Cela déclenche donc la mise en _uvre de crédits de l'Etat, ce fonds étant approvisionné au fur et à mesure des besoins exprimés à partir de la mise en _uvre des moyens. Vous avez pu voir très concrètement comment, pour l'Erika, ont été dégagés les crédits nécessaires.
Je termine cette présentation générale, qu'il me semblait utile de faire, pour parler de ce que nous vivons actuellement, car nous sommes dans le vif du sujet.
Comme moi, vous avez pu entendre parler de dysfonctionnements, de non-dit, de tergiversations, d'hésitations, d'improvisations, mots assez sévères que j'ai pu lire dans la presse. Je dois dire que si le dispositif du plan POLMAR mer nous paraît cohérent, par contre, il est incontestable que, confrontés à la réalité des situations de crise, il apparaît, mais c'est humain, que nous pouvons rencontrer de vraies difficultés. Je ne vous cacherai rien.
Sur l'accident lui-même, nous pouvons examiner la manière dont cela s'est déroulé et essayer de savoir si les interventions engagées l'ont été comme il convenait. Je noterai simplement de manière positive la réaction du CROSS Etel, puisque c'est lui qui a reçu les messages pour un navire qui était déjà très engagé dans le Golfe de Gascogne et qui avait passé Ouessant sans aucun problème après s'être signalé. C'est un navire disposant d'un
target factor de 13, c'est-à-dire un navire « convenable ». Les mauvais navires ont un c_fficient entre 40 et 50 ; celui-ci ne présentait donc pas
a priori de problème particulier. Le CROSS Etel a fait, à mes yeux, un bon travail. Le préfet maritime sera plus à même de vous en parler.
Le sauvetage en mer, quant à lui, a été conduit dans des conditions remarquables. L'intervention de l'Abeille Flandre
a été également tout à fait heureuse car s'il n'avait pas été possible de tirer la partie arrière du navire comme cela a été fait, puisqu'il y a douze kilomètres entre la partie avant et la partie arrière, les îles et la côte auraient été touchées beaucoup plus tôt.
Cela étant dit, nous étions dans des conditions particulièrement difficiles et, même si tous les ans nous faisons un exercice POLMAR mer par façade littorale, c'est généralement aux mois de mai, juin... J'ouvre ici une parenthèse pour dire que, malheureusement, les plans POLMAR terre font moins l'objet d'entraînements réels. Nous avions prévu, avant ce drame, lors d'une réunion interministérielle que j'avais organisée au Secrétariat général de la mer, de faire un exercice réel réunissant les plans POLMAR mer et POLMAR terre en l'an 2000, avec les financements idoines. Finalement, cet exercice n'a plus aucune raison d'être car, en matière d'exercices, nous sommes servis. Je ferme cette parenthèse.
Quand nous faisons ces exercices POLMAR mer, c'est donc dans des périodes où la météo est plutôt bonne. Nous mettons des barrages à l'eau, des pompes, et tout se passe bien. Malheureusement, la réalité n'est pas celle-là : tempête entre le 12 décembre et l'arrivée sur la côte le 24 décembre, avec trois jours et demi durant lesquels il a été possible aux bateaux pompeurs d'intervenir d'une manière plus ou moins efficace, mais en récupérant, pendant la période de jour - et nous sommes en hiver - 1 100 tonnes sur les 12 à 15 000 tonnes qui ont quitté le navire.
Par ailleurs, c'est un sinistre qui est situé à soixante-dix kilomètres des côtes, ce qui ne facilite pas les opérations. Pour l'intervention, c'est la première fois en France que nous avons un littoral touché sur 450 kilomètres. L'Amoco-Cadiz, qui avait déjà été dramatique, avait touché 180 kilomètres.
Il y a eu des erreurs d'appréciation, notamment, et chacun le sait, à partir des prévisions établies par les modèles utilisés pour calculer la dérive des nappes, qui avaient disparu sous l'eau - fioul n° 2. La seule expérience que nous avions - en dehors du
Tanio - est celle de l'Arago en 1990, au large de Madère. Pendant un mois, les Portugais ont désespérément cherché à savoir où était partie la nappe. Ils l'ont su quand elle est arrivée à Porto Santos ! La France avait, à cette époque, à la demande des Portugais, prêté les avions POLMAR équipés, en principe, pour repérer ces nappes. Le problème, c'est que quand elles sont entre deux eaux, il n'y a aucune irisation, donc, aucun moyen de repérage.
M. Louis GUÉDON : Non !
M. Paul RONCIERE : Je me permets d'insister sur ces aspects qui ne figurent peut-être pas dans les plans POLMAR mais qui soulèvent de réelles difficultés. Je vous donne ces éléments tels que je les connais. Ensuite, nous y reviendrons, si vous le souhaitez.
Donc, erreur d'appréciation sur la dérive du pétrole et, à partir de là, un positionnement des moyens POLMAR terre, qui était pour partie erroné puisque l'essentiel du dispositif se situait en Charente-Maritime et en Vendée.
Des outils, en mer, pour le pompage, qui se sont révélés, côté national, dans un premier temps inadaptés. Nous avons immédiatement fait jouer les accords internationaux... Vous verrez dans l'instruction POLMAR que le Secrétariat général de la mer est, en premier lieu, chargé de suivre la mise en _uvre des plans
- la définition de suivre est un peu courte, à mon avis - et, en deuxième lieu, chargé de faire jouer les accords internationaux de coopération des moyens.
Aussi, dès que le préfet maritime l'a demandé, l'accord de Bonn a été sollicité et nous avons affrété le
British Shield et l'Arca, navires effectivement beaucoup mieux adaptés à ce type de produit que les moyens dont nous disposions.
Nous avons également fait jouer un accord bilatéral France-Espagne qui avait été signé en novembre 1999, qui s'appelle le
Biscaye Plan. Les Espagnols ont envoyé sur zone deux drageurs équipés de barrages océaniques qui n'ont pas pu être utilisés en raison des conditions de mer.
Il y a aussi le problème que nous avons eu de gérer avec le FIPOL et ses experts (ITOPF) l'aspect lié à la notion d'« action raisonnable », avec le rappel que nous en faisions trop, que nous devions faire attention, de ne pas faire venir ceci, de ne pas faire venir cela. Mais cela, c'est le choix de l'Etat et non celui du FIPOL.
Autre faiblesse du dispositif qu'il convient de revoir : certaine impréparation à terre que je viens de signaler : le défaut d'exercices; les collectivités locales n'ont probablement pas été suffisamment préparées à l'organisation d'un dispositif de traitement sur les plages; le stockage des polluants s'est avéré assez défaillant. La communication a eu aussi ses faiblesses. Le principe pour POLMAR mer est qu'il n'existe qu'un seul « communicant », le préfet maritime. En fait, il y en a eu quelques autres. Cela a parfois conduit à avoir des messages discordants, pour ne pas dire inadaptés.
Il y a eu le problème des indemnisations, mal connues ou mal expliquées, il y a probablement les deux, avec des confusions entre le Fonds d'intervention POLMAR, qui est un fonds national pour lutter contre la pollution, les aides d'urgence de l'Etat, qui viennent pour aider soit les collectivités, soit les particuliers et les entreprises touchées, et le FIPOL.
Au niveau central, nous avons aussi eu des réactions à vitesse variable des différents ministères qui viennent en soutien du niveau local.
Ce premier bilan à chaud n'est pas terminé. Aujourd'hui et demain, le préfet maritime dresse un bilan de l'intervention des moyens placés sous son autorité sur l'accident et sur le pompage en mer. A partir des informations que nous recueillerons, il est certain qu'il nous faudra réexaminer un dispositif qui n'avait pas fonctionné concrètement depuis vingt ans.
J'aborderai maintenant le point essentiel, celui de la sécurité maritime. En la matière, il importe avant tout de prévenir les accidents. Je viens de présenter la manière dont on intervient pour traiter un accident- avec les défectuosités qu'il convient de reconnaître - mais ce qui importe, c'est d'avoir les bons outils pour prévenir les accidents et écarter, dans la mesure du possible, l'occurrence de ce genre de situations.
Le risque zéro n'existe pas. J'étais présent aux vingt ans d'anniversaire de l'Amoco-Cadiz
à Brest, où s'est tenu un colloque très intéressant. Cela avait été rappelé fortement, mais nous avons trop souvent tendance à l'oublier.
On parle toujours de navires sous-normes. Mais les accidents ne sont pas uniquement le fait de navires sous-normes. Le
Sea Empress n'est pas un affaire ancienne, elle date de 1996 au Pays de Galles : navire en bon état, qui rentrait dans un port, avec un pilote du port à bord ; pourtant, vous savez le drame qu'il y a eu. Les risques existent, il faut disposer des outils adéquats pour y faire face.
La préoccupation est donc de disposer d'un ensemble d'outils permettant de répondre à la préoccupation d'une meilleure sécurité maritime. Nous nous appuyons pour cela sur l'éventail des dispositifs internationaux. Le transport maritime est en effet soumis à un ensemble de conventions internationales. Sans entrer dans leur détail, qu'il s'agisse de la convention SOLAS sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, de la formation des équipages STCW, du code ISM, des conventions MARPOL, OPRC, etc. pour les pollutions, nous avons à notre disposition tous ces instruments internationaux dont la vocation et l'ambition sont d'éviter les accidents en mer.
Tous les ans, l'Organisation maritime internationale fait avancer cette réglementation. A côté des conventions qui ont une dimension obligatoire avec les difficultés qu'il y a parfois à les faire adopter parce que les Etats n'ont pas des intérêts convergents, il existe ce que l'on appelle les recueils de recommandations, qui n'ont pas de caractère obligatoire. C'est à ce niveau que l'Union européenne peut intervenir très efficacement pour donner valeur de directive à certaines de ces dispositions adoptées sous forme de recommandations par l'OMI. Je n'entre pas dans le détail de ce que fait l'Union européenne : de nombreuses directives sont déjà intervenues en ce sens.
Cependant, l'essentiel de ces dispositions repose sur ce que font les Etats du pavillon, puisque ce sont eux qui sont chargés de leur application. Nous tombons là sur le problème de la complaisance. Je ne vais pas développer cet aspect des choses, il est connu. Disons simplement que pavillon de libre immatriculation ne veut pas dire pavillon de complaisance et navire sous-normes, si ce n'est que l'on remarque tout de même une relation assez nette entre les trois. Les comportements sont inégaux d'un Etat à l'autre mais il y a des pratiques que nous ne pouvons pas admettre.
L'autre aspect, ce sont les limites du contrôle par l'Etat du port. Dans la mesure où l'Etat du pavillon n'assure pas la totalité des compétences qui sont les siennes, les Etats du port sont amenés, eux, à exercer un contrôle sur les navires qui arrivent dans leurs ports. C'est l'objet du Mémorandum de Paris.
Mais nous nous heurtons là à l'insuffisance des moyens dont disposent les centres de sécurité des navires, ce qui explique le doublement de ces moyens déjà annoncé par le Gouvernement pour être plus efficace et éviter que des navires qui ne soient pas en état de naviguer continuent à le faire. Il faut noter aussi que la répression des infractions n'est pas toujours facile, que les pratiques diffèrent d'Etat à Etat - nous souhaitons une harmonisation - et, ce qui n'est pas tout à fait innocent, qu'il y a un risque de délocalisation de certaines activités, d'où l'intérêt d'une démarche communautaire. C'est précisément une des orientations fortes du Mémorandum qui vient d'être arrêté par le Gouvernement et qui sera présenté à Bruxelles afin d'améliorer le dispositif au niveau communautaire. Cela n'interdit pas que nous fassions aussi tous les efforts au plan national.
Cela touche les navires, le facteur humain, la sécurité de la navigation et la surveillance. C'est sur toutes ces déclinaisons que nous devons être plus actifs et présents pour que soient renforcées les règles de sécurité maritime. Les mesures seront notamment destinées aux navires qui rentreront dans nos ports. Mais il y a aussi le transit. Or, nous savons bien qu'en raison de notre situation géographique, nous continuerons à connaître un important trafic de transit et, je le crains, à avoir encore des navires sous-normes qui se déplacent au large de nos côtes dans les eaux internationales ou en haute mer.
M. le Rapporteur : Quelques questions pour ouvrir la discussion.
Tout d'abord, je souhaiterais savoir si vous avez la responsabilité de POLMAR mer et POLMAR terre ou seulement celle de POLMAR mer. Si tel est le cas, comment s'opère l'articulation avec POLMAR terre ? Qui décide de quoi ? Et comment cela s'est-il passé ?
Ensuite, vous êtes placé auprès du Premier ministre, vos ordres doivent venir de lui, mais j'imagine qu'il a beaucoup à faire. Qui vous donne des ordres ? Quelqu'un du cabinet ? Ou n'en avez-vous pas ? Auquel cas, il vous faut, ce qui est tout à fait envisageable, apprécier les situations vous-même et, pour ce faire, de quelles informations disposez-vous ? De qui vous viennent-elles ?
Enfin, quand, après avoir apprécié la situation, vous donnez des ordres, êtes-vous obéi par les différentes administrations ?
A priori, vous êtes censé donner des ordres au préfet maritime, car, dans ces opérations, il ne dépend pas du ministre de la défense, mais de vous ?
Pourriez-vous nous éclairer sur ce thème et surtout nous dire très franchement si vous avez ressenti à un moment donné des difficultés dans la chaîne d'organisation ? Y a-t-il eu des engueulades - question que j'ai déjà posée à M. Gressier qui n'a pas répondu là-dessus mais, à mon avis, il a dû y en avoir ? Si oui, nous ne voulons pas savoir avec qui mais sur quels sujets. À quel moment les tensions se sont-elles manifestées ? Nous posons ces questions pour éviter que cela ne se reproduise ; il est malheureusement exact que le risque zéro n'existe pas, il faut cependant assurer une prévention maximum et, pour ce faire, comme vous le disiez, il s'agit de vérifier avant tout si l'appareil administratif et organisationnel de l'Etat est convenable.
Vous avez aussi évoqué les moyens techniques. Estimez-vous les moyens d'intervention suffisants ? Je pense notamment aux hélicoptères mais pourriez-vous préciser ? Aviez-vous, avant la crise, appelé l'attention, que ce soit vous, ou le préfet maritime, sur l'insuffisance des moyens en hélicoptères ? Aviez-vous reçu des réponses négatives ?
Les moyens nautiques, comme les remorqueurs, par exemple, sont-ils suffisants ? Ne faudrait-il pas, comme l'ont suggéré certains, identifier une ligne budgétaire spécifique consacrée, dans le budget de la défense, aux matériels de prévention pour éviter d'avoir à attendre le dernier arbitrage financier ?
Vous parliez également d'outils inadaptés pour le traitement de la pollution en mer. Pourriez-vous développer ? Nous avons fait appel à des bateaux étrangers, qui étaient nettement meilleurs. Pourquoi ? Compte-t-on y remédier ? Ne conviendrait-il pas de nous interroger sur notre incapacité sous-marine ? Un tel constat est-il fait aussi ailleurs, dans d'autres pays ? La France avait pourtant, me semble-t-il, des compétences assez fortes dans ce domaine. Cela signifie-t-il que celles-ci n'ont pas été exploitées ?
Observation complémentaire, qui rejoint une discussion que nous avons eue lors de l'audition précédente : les bateaux transportant des matières dangereuses ont l'obligation de se signaler à l'entrée du rail. Qu'est-ce qui permet de vérifier la bonne signalisation de ces bateaux ? La question a déjà été posée tout à l'heure et nous n'avons pas eu de réponse. L'Etat du port le fait-il à l'arrivée ? Existe-t-il une comparaison entre les informations données à l'entrée du rail et celles que l'on peut obtenir au niveau de l'Etat du port ? N'y a-t-il pas moyen de mieux articuler ces dispositions, avec un fichage des bateaux plus serré ?
M. Paul RONCIERE : Je vais prendre les questions dans l'ordre où elles ont été posées.
Pour ce qui est de la responsabilité de plans POLMAR terre et POLMAR mer, si vous prenez l'instruction interministérielle, il est précisé que les plans POLMAR mer sont élaborés par les préfets maritimes, en association avec un ensemble d'administrations. Ils doivent également associer les élus, les associations de pêcheurs. Le dispositif a été clairement défini.
De plus, les préfets de zones de défense sont impliqués dans l'élaboration des plans. Sur les façades, tout dépend du découpage, mais dans la conception même d'un plan POLMAR mer, on a le souci d'avoir cette interface terre-mer.
Pour les plans POLMAR terre, je vous l'ai dit, il faut reconnaître que nous avons un gros problème. L'instruction interministérielle de 1997 prévoyait, en effet, la mise à jour mais pas la mise à plat de ces plans. La mise à jour consiste simplement à apporter des modifications comme le changement des adresses des intervenants, l'ajout des nouveaux numéros de téléphone, etc. alors qu'il était nécessaire, du moins le pensions-nous, de revoir la conception même des plans POLMAR terre. Ce n'est pas qu'ils soient obligatoirement mauvais mais, par curiosité, j'ai sorti les plans POLMAR terre des cinq départements touchés par la pollution et je dois dire que certains ont une mise à jour relativement ancienne.
L'articulation entre POLMAR mer et POLMAR terre, en dehors du fait que le préfet de zone de défense est censé être le coordonnateur des documents, n'est probablement pas suffisamment travaillée dans notre dispositif actuel. Il est bien dit que dès que la pollution arrive sur la côte, le préfet maritime donne toutes les informations indispensables au préfet terrestre et qu'un officier de liaison est mis à la disposition de ce dernier pour assurer la liaison entre mer et terre. Dans l'affaire de l'Erika, le préfet maritime avait ainsi positionné deux petits navires, qui devaient servir de PC de liaison côté mer pour, le cas échéant, aller voir ce qui se passait.
Mais, dans cette affaire, il faut surtout savoir que nous n'avons pas vu arriver la nappe qui était sous l'eau et que nous l'attendions là où elle n'est pas arrivée. Quand elle a fini par arriver sur le Finistère sud, nous nous sommes d'abord demandés si ce n'était pas un dégazage. C'est dire où nous en étions ! Par ailleurs, nous n'avions pas, et n'avons d'ailleurs pas encore aujourd'hui, ce qui est difficile à faire comprendre, les moyens de savoir où se promènent les galettes avant qu'elles n'arrivent sur la plage.
C'est là qu'il nous faut évoquer l'incapacité de suivi d'une nappe sous-marine. Il y a eu un survol permanent de la zone avec les avions de surveillance maritime de la Marine nationale, les deux avions POLMAR des douanes, dont un avion qui vient d'être rééquipé avec des moyens extrêmement sophistiqués. Nous en attendions des miracles mais quand la nappe est sous l'eau, nous ne voyons rien du tout !
Nous avons commandé une étude pour savoir pourquoi le radar ne donne rien, pourquoi les infrarouges ne donnent rien, pourquoi le sonar ne donne rien. À la limite, il reste les plongeurs ! Certains ont été envoyés sur site. Quand des constats ont été faits à tel ou tel endroit, la Marine a envoyé des équipes de plongeurs. Ils n'ont rien vu. C'est un véritable problème. Les sous-mariniers nous ont dit : « Si l'on a des sous-marins, c'est précisément parce qu'on ne risque pas de les voir ! Si nous disposions d'outils permettant de repérer les sous-marins, nous n'aurions pas de sous-marins, ni de force stratégique ».
Nous faisons contrôler cet aspect qui nous parait extrêmement inquiétant parce que, quand une pollution disparaît pendant douze jours, voire un mois comme à Madère en 1990, cela pose vraiment problème. Le préfet maritime donne l'impression de ne pas être sérieux parce qu'il n'est pas en mesure de dire où la pollution arrivera ! Il en va de même des experts du CEDRE ou de Météo France.
Météo France avait trois modèles de dérive : un modèle anglais qui a été testé, qui s'est révélé être une catastrophe ; un modèle américain, également très mauvais ; et le français qui était le meilleur. Les experts de Météo France étaient si fiers de leur modèle que tous les jours sur Internet, vous aviez la position précise de l'endroit où était la nappe. Manque de chance : cela n'avait rien de scientifique !
Cela fait partie des expériences douloureuses. Nous pensons qu'il ne faut pas donner d'informations incertaines ou, si on le fait, il faut bien dire que ce sont des prévisions et ne pas laisser croire que l'on sait où est la nappe quand on ne le sait pas !
Quant à la responsabilité des plans POLMAR, je précise que pour le plan POLMAR mer, elle revient au préfet maritime sous l'autorité du secrétaire général de la mer et que pour le plan POLMAR terre elle dépend du préfet de chaque département, placé sous l'autorité du ministre de l'Intérieur.
Qui donne des ordres au secrétaire général de la mer ? Le secrétaire général de la mer est parfois quelque peu désespéré !... Soyons clair : ce n'est pas le Premier ministre qui prend le téléphone pour lui demander ce qu'il fait sur tel ou tel sujet. De ce côté, je ne suis pas très sollicité. Les sujets maritimes sont éclatés au niveau des membres du cabinet. Le cabinet du Premier ministre est organisé comme notre administration centrale, c'est-à-dire avec des gens dont les compétences sont cloisonnées. Nous avons donc un conseiller pour la pêche, un conseiller pour l'équipement, un conseiller à l'environnement, etc. Il n'y a pas de vision horizontale sur les problèmes de la mer.
Vous me direz que c'est précisément le rôle du secrétaire général de la mer que d'avoir cette vision horizontale. Ce qui me gêne un peu, c'est que nous sommes d'une certaine manière livrés à nous-mêmes. Nous prenons donc toutes les initiatives que nous espérons utiles et nécessaires en apportant la plus-value que nous pensons apporter dans le domaine de la politique maritime, mais nous ne sommes pas l'outil miracle qui permettrait de définir une politique maritime ou de sécurité maritime pour notre pays.
Quand nous avions un ministre de la mer, les rôles étaient plus clairs. D'ailleurs, à mon sens, la mission n'avait alors plus tellement de raison d'être. Mais, au moins il y avait un patron, qui pouvait utiliser cet outil de coordination.
Aujourd'hui, le problème est légèrement différent. Pour la coordination de l'action de l'Etat en mer au quotidien, nous nous fixons nous-mêmes, si je puis dire, notre « ordre de marche », ce sur quoi nous allons travailler. Ainsi, nous étions sur un certain nombre de pistes : les remorqueurs d'intervention en haute mer, l'analyse des risques et de l'évolution des risques, entre autres. Mais, pour répondre à votre question précise, il n'existe pas de directeur des opérations qui donne des ordres au secrétaire général de la mer.
D'où viennent nos informations ? Je dois avouer que, pour une large part, je vais à la pêche aux informations. Chaque administration centrale a sa propre logique et son esprit de chapelle. Pour obtenir des informations, même dans le cadre de POLMAR - je ne citerai pas de nom -, il m'est arrivé de téléphoner à un directeur d'une administration centrale pour lui demander un ensemble de fiches sur lesquelles il avait travaillé, qu'il n'a pas pu me donner, arguant que le ministre ne les avait pas validées. Je veux bien entendre ce genre de discours mais en travaillant de cette façon, je vois mal quelle coordination nous pouvons assurer ! Il y a une véritable difficulté qui tient au fait que notre rôle de coordination n'est pas totalement reconnu. Notre mission est d'établir un réseau avec tous nos correspondants naturels. Mais, selon la capacité de dialogue et de coopération de chacun, cela fonctionne plus ou moins bien.
Les informations ? Je le dis sur le ton de la plaisanterie mais j'en recueille énormément en lisant la presse spécialisée ! J'apprends par ce biais des éléments fort intéressants qui me permettent d'alimenter notre travail. Mais ce n'est pas satisfaisant.
M. le Rapporteur : Pouvez-vous donner un ordre au préfet maritime ?
M. Paul RONCIERE : Je peux donner un ordre au préfet maritime.
M. le Rapporteur : Sans passer par le cabinet du ministre de la Défense ?
M. Paul RONCIERE : Sans passer par le cabinet du ministre de la Défense. Mais le circuit est un peu plus compliqué dans la mesure où le Premier ministre doit intervenir, ce qui est normal car il faut que ce soit une autorité politique qui intervienne sur les décisions majeures, le secrétaire général de la mer étant un fonctionnaire.
Prenons l'exemple de l'affrètement de l'Arca. Nous avions fini de pomper et le préfet maritime se proposait de renvoyer l'Arca
aux Pays-Bas. Sur ce, le cabinet du Premier ministre, ayant appris cette intention par le biais du cabinet militaire, a fait savoir que cela ne lui paraissait pas du tout une bonne solution. L'Arca
a donc été maintenu plus longtemps que prévu, alors que les Hollandais le réclamaient pour le
bogue de l'an 2000. Nous l'avons conservé jusqu'au 31 décembre après-midi. Voilà l'exemple d'une décision qui ne vient pas du ministère de la Défense.
Dans l'exécution du plan POLMAR, le préfet maritime est placé sous l'autorité du secrétaire général de la mer. Toutes les informations remontent au cabinet du Premier ministre, où c'est plutôt le cabinet militaire qui les exploite. Il se trouve que le chef du cabinet militaire est actuellement un amiral, ce qui simplifie les choses. Il existe donc un contrôle du cabinet du Premier ministre dans l'exécution de ce qui touche à la mise en _uvre du plan POLMAR mer.
Quant à savoir si je suis obéi, je répondrai, que quand je demande au préfet maritime de prendre telle ou telle mesure, il peut soit me répondre qu'il le fait déjà - ce qui m'a déjà été répondu -, ou qu'une autre mesure lui paraît plus urgente, mais il obéit. C'est un militaire qui accepte l'autorité du secrétaire général de la mer, d'autant qu'à mes côtés, j'ai un amiral qui a une bonne expérience opérationnelle. C'est donc plus sous forme de conseils ou d'orientations que d'ordres écrits que nous travaillons. Je pense que cette façon de travailler n'est pas mauvaise.
A votre question sur les difficultés dans la chaîne d'organisation, tensions dans la gestion de crise, je répondrai que des tensions, nous en avons tous les jours. Nous avons aussi des explications, parfois un peu rudes, sur la manière dont les choses se déroulent, sur le fait que les décisions prises sont peut-être techniquement judicieuses, mais qu'il ne faut pas oublier que la population s'interroge et attend des explications suffisantes. Parfois, effectivement, mais c'est normal, les échanges sont un peu tendus entre les acteurs. Je parle là du plan POLMAR mer qui est celui que je suis au quotidien. Il est assez naturel que les appréciations ne soient pas toujours convergentes et que, de ce fait, nous puissions avoir des échanges un peu tendus lorsque la décision est prise, au niveau du cabinet du Premier ministre, d'engager telle ou telle action pour répondre à des attentes qui ne paraissent pas nécessairement les plus évidentes au préfet maritime qui a, lui, l'_il collé sur l'épave et ses risques.
Pour vous donner un exemple, hier étaient réunis à la préfecture maritime, deux comités d'experts, l'un pour examiner ce qui se passait sur l'épave à partir de tous les éléments recueillis, l'autre pour essayer de savoir ce qu'étaient ces arrivées d'hydrocarbures sur le littoral et comment les expliquer. Le préfet maritime a dit : « Je n'ai besoin d'aucune expertise, je sais ce qui se passe : il y a très peu de fuites sur l'épave et ce qui arrive sur le littoral, ce sont des reprises par le flux et le reflux. Pourquoi faire des expertises ? » Nous avons estimé qu'elles étaient nécessaires, et le cabinet du Premier ministre l'ayant demandé, il s'est exécuté. Cela fait partie des ajustements qui se font au quotidien entre l'échelon central et l'échelon opérationnel local.
Les moyens techniques sont-ils suffisants ? J'ai déjà commencé à répondre sur cet aspect. Sur les moyens de pompage en mer, nous n'avions pas les outils adaptés compte tenu de la nature du fioul. C'est du fioul n°2, la plus grande des cochonneries que l'on peut trouver, une espèce de chewing-gum et je rappelle qu'il représente moins de 5 % du trafic d'hydrocarbures.
Nous disposons d'outils qui, paraît-il, sont bien conçus pour les produits plus légers, comme par exemple le pétrole de l'Amoco-Cadiz, qui se serait d'ailleurs évaporé pour une bonne part si l'accident avait eu lieu à soixante-dix kilomètres en mer. Mais ce fioul n°2 ne s'évapore pas. Avec les 12 à 15 000 tonnes qui se sont déversées, nous en sommes actuellement à 120 000 tonnes de déchets. Nous sommes donc dans un rapport de 1 à 10 entre ce qui est en mer et ce qu'on retrouve à terre.
De ce point de vue, nos moyens sont insuffisants pour le traitement des hydrocarbures, tous les types d'hydrocarbures, par tous les temps. Incontestablement, il faut revoir le dispositif de traitement en mer. Heureusement, nous avons bénéficié de l'expérience des navires auxquels nous avons fait appel, qui ont prouvé que nous pouvions traiter cela.
Nous avons aussi un problème de couverture par les hélicoptères pour le sauvetage en mer. Actuellement, les
Super Frelons sont réservés uniquement aux missions de service public, parce qu'ils sont pratiquement en fin de course. Leur renouvellement par les NH90 est prévu en 2005. La question que je me suis permis de poser au ministre de la Défense concerne la période entre 2000 et 2005. En effet, de plus en plus souvent, nous faisons appel aux hélicoptères anglais. Ces derniers sont d'ailleurs venus dans le drame de l'Erika. Le
Super Frelon avait cinq minutes d'avance, c'est donc lui qui a mené l'opération, mais cinq minutes plus tard, c'étaient les Anglais qui sauvaient l'équipage. Là, effectivement, nous sommes un peu courts.
Les remorqueurs sont-ils suffisants ? Nous disposons de trois remorqueurs qui ont prouvé, depuis que nous les utilisons, les immenses services qu'ils peuvent rendre. J'ai la liste de tous les drames qui ont été évités par l'intervention des remorqueurs, et cette liste est parlante ! Mais les risques évoluent dans le temps. C'est la raison pour laquelle le Secrétariat général de la mer a engagé, sur demande du cabinet du Premier ministre, une réflexion qui porte, d'une part, sur l'évolution des risques et, d'autre part, sur les types de remorqueurs d'intervention en haute mer dont il conviendra que nous disposions demain.
Aujourd'hui, les Abeilles Flandre et Languedoc
sont encore en état de fonctionner. Un appel d'offres européen vient d'être lancé pour renouveler le contrat jusqu'en 2003. Nous nous plaçons pratiquement déjà dans la perspective de 2003 pour définir ce que devra être le futur cahier des charges. Ce travail est en cours et devrait, si cela est retenu, permettre d'améliorer le dispositif.
Mais se pose aussi le problème du nombre de ces remorqueurs, car quand un remorqueur est à Cherbourg, il lui faut du temps pour aller dans le Pas-de-Calais. Les Anglais affrètent un remorqueur à six mois. Nous devons donc trouver un dispositif qui fonctionne sur 365 jours dans le Pas-de-Calais. Cette question est examinée en perspective du prochain Comité interministériel de la mer. Le coût actuel d'affrètement des remorqueurs est de 53 millions de francs pour le ministère chargé de la Défense et lorsque nous disons aux responsables de la défense que le dispositif est un peu court, leur réaction est de dire, premièrement, que ce qui existe est bien et, deuxièmement, que, comme ils n'auront pas un sou pour payer cela et qu'il va leur falloir encore prendre sur leur substance,
a priori, ils ne sont pas enthousiastes.
Nous allons également faire le bilan du matériel de prévention. Nous avons constaté, par exemple, que les barrages pour la haute mer n'étaient pas en état de rendre d'énormes services. Par une mer qui dépasse 5, ils ne tiennent pas, même les barrages côtiers. Nous en avions disposé 30 kilomètres, les plans POLMAR terre désignent des zones sensibles où ces barrages doivent être positionnés. Mais par des mers un peu fortes
- malheureusement, c'est généralement en hiver dans les périodes de tempêtes que ces accidents se produisent - il existe un vrai problème.
Il faut donc que nous nous penchions sur l'ensemble des outils que nous mettons en _uvre au niveau national, en nous disant que ceux-ci doivent être de plus en plus conçus à une échelle européenne. J'ai fait allusion à l'accord de Bonn. C'est l'esprit dans lequel nous travaillons.
J'ouvre une petite parenthèse. Un rapport, rendu en 1992, portant sur le coût et le rendement des services publics s'intéressait au coût de l'action de l'Etat en mer. Les chiffres de ce rapport sont de 1989, ce coût s'élève à un milliard de francs. Les conclusions du rapport étaient que le rapport coût-efficacité de ce dispositif était très correct. D'après les premiers calculs que j'ai fait faire pour essayer de comparer, nous sommes toujours au même niveau de dépense. Je ferme cette parenthèse.
Il y a parfois des réveils douloureux dans la mesure où l'on se rend compte que certains outils ont sans doute vieilli et que nous n'avons pas toujours su anticiper ce qu'il convenait de mettre en place pour répondre à une situation comme celle que nous connaissons actuellement.
Les bateaux transportant des matières dangereuses ont l'obligation de se déclarer dans les zones de dispositif de séparation de trafic. C'est une obligation de déclaration de signalement, ce qu'on appelle aussi le « compte-rendu obligatoire ». Ces dispositions sont validées par l'Organisation maritime internationale.
Les CROSS, avec leurs moyens radars, repèrent tout le trafic et, dès lors qu'un bateau n'est pas signalé, il est en infraction. Cela arrive encore de temps à autre, mais le nombre d'infractions diminue régulièrement. Dans ce cas, nous saisissons l'Etat du pavillon pour demander que des sanctions soient prises à l'égard du bateau contrevenant.
Quant au contrôle de la bonne signalisation et au problème de la connaissance des bateaux qui rentrent dans les eaux européennes, ou plus exactement, dans les eaux territoriales et en zone économique exclusive, cet aspect est repris dans le Mémorandum que la France présente à l'Union européenne. Il s'agit de mettre en place un système d'obligation d'information pour tous les navires qui viendront dans les « eaux européennes », si je puis dire, car il n'existe pas réellement d'eaux communautaires.
Il s'agirait de l'obligation de signalement pour tous ceux qui rentrent dans les ports européens et tous ceux qui passent dans les eaux territoriales. Nous souhaiterions étendre cette obligation au-delà. Il s'agirait de connaître ceux qui passent au large de nos côtes - tous ne viennent pas dans les ports européens - et pouvoir soit interdire l'accès, soit tout du moins, puisque la navigation en mer est libre, surveiller les navires repérés comme étant sous-normes.
Je reviens au fichier qui est en train de se mettre en place, à l'initiative de la France, avec le soutien de la Commission européenne, le fichier EQUASIS. Sans entrer dans le détail, je dirai que ce dispositif sera extrêmement précieux et permettra d'améliorer fortement la connaissance des navires - leur état, leur âge, les contrôles dont ils ont fait l'objet, leur pavillon, la manière dont ils sont suivis - pour, à terme, avoir des navires plus sûrs.
Pour les navires citernes, vous avez vu que les armateurs et affréteurs français ont pris l'engagement d'avoir supprimé tout bateau simple coque à l'horizon 2008, avant les Américains puisque, pour eux, c'est à horizon 2010 et, pour l'OMI, 2015. Nous avons acté cette anticipation et nous souhaiterions que cette règle de bonne conduite au niveau national soit reprise par l'ensemble de nos partenaires européens, afin d'accélérer la mise hors de course de navires âgés, qui sont aussi les plus fragiles.
La flotte pétrolière mondiale ne cesse de vieillir, la flotte française pétrolière également. Ce matin, on me disait que les compagnies pétrolières françaises ont l'obligation d'avoir une capacité égale à 5 % de nos importations. Elles disposent donc d'un certain nombre de pétroliers sous pavillon national. Ceux-ci ne viennent pas dans les ports européens parce qu'ils sont un peu âgés ! Cela pose un véritable problème de fond, qui rejoint celui de l'état de la flotte pétrolière, celui du respect des normes qu'elle est censée respecter, celui de la classification. Quand vous savez que la société de classification de la Grèce, Etat de l'Union européenne, appartient à des armateurs, vous pouvez vous interroger sur l'indépendance de ladite société ! Je ne veux viser aucun pays pour ne pas créer de conflit diplomatique...Mais dans certains ports des Pays-Bas, on dit à un capitaine que son bateau est un peu juste, qu'il lui faut faire des travaux, mais qu'il dispose de quinze jours pour les faire. Nous savons bien ce que cela veut dire : cela signifie que le bateau n'est pas bloqué au port et qu'il peut aller ailleurs.
M. le Président : C'est ce que l'on appelle les relations commerciales !
M. Paul RONCIERE : Il y a là un ensemble de pratiques que je qualifierais « de complaisance » que nous devons bannir, au moins au niveau de l'Europe, si nous voulons écarter ce genre de difficultés. Evidemment, la référence est l'Oil Pollution Act. On dit que les Américains ont trouvé
le système. C'est un peu l'esprit, au moins pour le sérieux des navires, qui préside aux propositions françaises au niveau européen et de l'OMI.
M. François GOULARD : A entendre la description que vous faites du fonctionnement actuel des services chargés de la mer, il semble que le système appelle des réformes assez sérieuses. Vous avez évoqué le retour à un ministère de la mer qui puisse assurer une conduite politique d'ensemble de ces questions. Mais on s'aperçoit que la complexité administrative et l'intervention de multiples acteurs relevant de ministères différents est aussi une difficulté considérable pour l'action.
Ne pensez-vous pas qu'une organisation plus simple, un regroupement des moyens, serait une priorité de réforme pour l'action gouvernementale ? Pour citer un exemple, parmi tant d'autres, quand vous nous parlez des avions POLMAR, on peut se demander s'il faut vraiment que la douane intervienne dans ce genre d'affaires. Ne pourrait-on regrouper les moyens matériels au sein de certains services au lieu de les disperser, en temps normal comme en temps de crise ? Car nous savons très bien qu'en temps normal, toutes les questions maritimes sont extrêmement dispersées. Quel est votre sentiment sur ce premier point ?
Deuxième point, vous nous avez parlé des mesures que le Gouvernement préparait avec votre contribution afin d'accroître la sécurité maritime. La responsabilité civile en matière de pollution maritime est actuellement régie par une convention de 1969, sensiblement modifiée en 1992. Ne pensez-vous pas qu'il faudrait revenir sur l'exonération de responsabilité de l'affréteur, qui est le point fondamental de ce protocole de 1992 ? Au-delà des contrôles et des règles, qui pourront toujours être détournées, ne serait-il pas nécessaire de responsabiliser financièrement et juridiquement celui qui affrète, qui est toujours le plus solvable, car on sait bien que la solvabilité financière des armateurs est plus que sujette à caution ? Ne serait-ce pas là une direction majeure de réflexion pour que non seulement les règles existent mais qu'elles soient spontanément appliquées par des acteurs du trafic maritime qui auraient intérêt, matériellement, à le faire ?
M. Paul RONCIERE : Sur la question du ministère de la mer, ma réponse sera très prudente car c'est un choix de gouvernement. Dans certains gouvernements, il y a eu des ministères de la mer, dans d'autres, il y avait le Secrétariat général de la mer. Mais le Gouvernement actuel compte un ministre chargé de la mer - le Premier ministre lui a d'ailleurs confié le suivi d'un certain nombre de questions relatives à l'Erika - qui est le ministre de l'Equipement, des transports et du logement. Dans son décret d'attribution, il est dit que ce dernier est chargé de la mer, à l'exception de la pêche et des cultures marines, de la construction et de la réparation navale. Il y a donc en quelque sorte un ministre chargé de la mer, mais la réalité oblige à dire que, quand nous parlons de questions maritimes - je le vis tous les jours dans les réunions interministérielles -, nous avons au moins cinq ou six ministères majeurs impliqués.
Savoir quelle est la meilleure formule est une question qui a été débattue bien souvent. J'ai de nombreux rapports sur le sujet au secrétariat de la mer. Au-delà de l'aspect académique, c'est une question de fond.
En Europe, les ministres de la mer sont peu nombreux et, au niveau communautaire, l'on se rend compte que les responsabilités sont éclatées entre les différentes directions, directions des transports, de l'environnement, etc. La démarche est double : il y a l'idée d'une Agence européenne de la mer, lancée notamment par les Portugais, qui nous intéresse
a priori beaucoup. La question est en cours d'étude.
En matière de sécurité maritime, les Anglais, par exemple, ont réuni tous leurs moyens dans une agence. L'idée n'est sans doute pas mauvaise. Autant nous ne croyons pas au principe de la garde-côte qui répond à tous les besoins, je vous donne là un sentiment tout personnel...
M. le Président : C'est ce que nous vous demandons.
M. Paul RONCIERE : ... mais qui n'engage que moi - le débat reste ouvert....
M. Louis GUEDON : Chez les Américains, ce système marche très bien. Pourquoi pas chez nous ?
M. Paul RONCIERE : Chez les Américains, cette organisation regroupe d'autres administrations que les garde-côtes. Vous avez l'administration météo, l'US Navy, entre autres. En tout, ils ont cinq administrations maritimes, nous avons tendance à l'oublier. C'est une organisation d'une tout autre nature, pour partie militaire, qui compte 37 000 agents et 80 avions, 150 hélicoptères et je ne vous donne pas le nombre de navires !
M. Louis GUEDON : Les kilomètres de côtes ne sont pas les mêmes.
M. Paul RONCIERE : Le territoire n'est pas de la même dimension, certes, mais je veux dire que c'est une administration complète. Nous, nous partons d'un existant qui est le suivant : nous avons différentes administrations qui disposent de moyens pour agir en mer. Le choix qui a été fait, confirmé notamment lors des Comités interministériels de la mer précédents, est celui de cordonner ces moyens sous une autorité sans les fusionner, compte tenu de l'ensemble des problèmes que cela représente.
Je ne dis pas que ce débat est fermé. J'ai seulement donné une opinion très personnelle, qui n'engage que moi.
Le problème de l'inconvénient de la dispersion des moyens rejoint cette discussion. Par exemple, aujourd'hui, la direction des affaires maritimes et gens de mer du ministère de l'Equipement demande une grosse vedette d'intervention en Méditerranée, à l'image de l'Iris
dans l'Atlantique. Pourquoi pas ? Mais l'idée a été lancée sans qu'il y ait le début d'une concertation entre tous les partenaires. Nous avons la Marine nationale avec ses patrouilleurs de service public ; les Affaires maritimes souhaiteraient aussi avoir une grosse vedette pour aller en haute mer ; la Douane a ses propres vedettes ; la Gendarmerie également. C'est un problème. Les programmations des équipements au sein des différentes administrations ne sont jamais présentées au Secrétariat général de la mer, pour la raison très simple que nous ne rendons pas d'arbitrage politique, que nous sommes des techniciens. C'est assez fâcheux. On pourrait au moins nous demander si, sur le plan technique, cela nous paraît une bonne ou une mauvaise idée. Il y a encore quelques progrès à faire.
Pour ce qui est de la responsabilité civile en matière de pollution maritime et de la convention de 1969, refondue en 1992 : je pense que cette convention internationale est une bonne convention qui permet d'engager la responsabilité de l'armateur sans faute. Les choses sont simples : en cas de sinistre, automatiquement un assureur intervient. Ce sont les
P and I clubs. Ce dispositif doit être conservé.
Par contre, le dispositif d'indemnisation qui repose sur la convention FIPOL et qui s'appuie sur un système de mutualisation - tous ceux qui font du transport de pétrole payent, les bons comme les mauvais - nous paraît être un système déresponsabilisant. En conséquence, nous souhaitons responsabiliser. Vous lirez à ce sujet les propositions que le Gouvernement adresse à l'administrateur du FIPOL, ainsi qu'aux Etats membres qui gèrent le FIPOL, étant donné qu'il s'agit d'un accord intergouvernemental.
Les Canadiens ont trouvé un système assez original : ils ont, en plus du FIPOL, un fonds complémentaire alimenté à partir d'un certain nombre de critères. Pourquoi ne pas faire intervenir dans ces critères la notion de risque ? Lorsque des affréteurs, pour des raisons d'économie, affrètent des bateaux douteux, même s'ils sont bien classés en
target factor, il faut qu'ils engagent leur responsabilité. Il est trop facile de dire « Pollueurs, payeurs » - les Américains disent d'ailleurs « Pollueurs, nettoyeurs », cela va au-delà - alors que le système est un système de mutualisation.
Juridiquement, TotalFina était en droit de ne rien payer ! Ils se sont rendus compte qu'au-delà de la dimension juridique, il y a une dimension de morale politique. Mais cela n'a pas été simple. Ce résultat est celui d'une action de pression et l'opinion publique n'est pas indifférente. Le Premier ministre, comme vous le savez, est intervenu très activement auprès du PDG de TotalFina. TotalFina a pris la décision d'intervenir hors FIPOL, sur ses propres deniers. Cela a été confirmé lors du Comité exécutif du FIPOL qui s'est réuni aujourd'hui. La lettre de TotalFina est partie hier, annonçant que cette société prenait en charge, à hauteur de 700 millions, des dépenses liées au naufrage de l'Erika
et qu'elle se positionnait en dernier créancier vis-à-vis du FIPOL.
Le problème, au-delà d'Erika, est de trouver un système dans lequel les affréteurs puissent voir leur responsabilité engagée, ce qui n'est pas le cas actuellement.
M. Louis GUEDON : J'apprécie la qualité de cet entretien et la franchise de vos propos. Je serai aussi très franc avec vous, monsieur le secrétaire général.
M. Paul RONCIERE : Je vous en prie.
M. Louis GUEDON : Vous avez dit que le risque zéro n'existait pas, nous le savons tous ; les populations maritimes savent très bien que nous subissons tous les jours des naufrages. Par contre, s'agissant d'une catastrophe comme celle que nous avons connue, nous estimons qu'il y a une obligation de résultats, qui ne peut pas du tout mise être mise au crédit du plan POLMAR mer, lequel fait preuve d'une totale insuffisance de résultats. Il doit y avoir une obligation minimum de résultats, ce qui n'est pas le cas.
Je vais me permettre de reprendre des arguments que vous avez développés dans votre excellent exposé.
Vous avez parlé des collectivités locales en disant qu'il y avait eu un manque d'encadrement des bénévoles et une certaine méconnaissance du FIPOL. Je ne suis pas du tout de votre avis.
En ce qui concerne l'encadrement des bénévoles, je peux vous donner, sur de nombreux sites, les listes qui vous indiqueront le nom, l'adresse des bénévoles, les heures auxquelles ils ont travaillé, le matériel reçu, l'encadrement dont ils ont bénéficié, les repas qui leur ont été servis.
Et concernant le FIPOL, nous savons tous qu'il dispose de 1,2 milliard de francs. Nous avons tous pris des avocats et fait faire des constats d'huissiers pour que nos sites soient expertisés avant l'arrivée de la marée noire. Nous avons engagé des instances en justice, pour le cas où la partie amiable du FIPOL se montrerait réfractaire ou insuffisante.
Vous avez dit que les bateaux à simple coque ne posaient pas problème puisqu'en 2008, ils auraient tous des doubles coques et que nous serions alors en avance sur les Américains qui, eux, ne les auront qu'en 2010. Je veux bien mais, dans ce cas, ayons la même politique que les Américains. Vous mettiez en cause les garde-côtes mais ces derniers obligent tous les navires qui présentent des risques à se tenir à une distance en mer qui fait que les côtes américaines ne risquent plus rien. La fermeté du gouvernement américain à cet égard est exemplaire.
Comparons ce qui est comparable : si nous disposons de doubles coques avant eux, très bien, mais que va-t-on faire pendant les huit années à attendre, sachant justement que le risque zéro n'existe pas ? On n'admettra pas une autre catastrophe ! Vous avez rappelé que nous avions vécu vingt ans sans pollution. Pourtant, en découvrant que vingt ans après, aucune conclusion n'avait été tirée et qu'à La Rochelle, les cuves étaient encore pleines du mazout de l'Amoco-Cadiz, nous nous posons des questions sur les améliorations qui ont été apportées pendant ces vingt ans ! On ne peut accepter que vingt ans s'écoulent sans qu'aucune leçon ne soit tirée.
Vous avez dit que la loi de 1976 permettait la mise en demeure du commandant du navire et de l'armateur, et que la loi de 1994 permettait de procéder à des contrôles en mer. Nous, les professions maritimes, considérons que ces textes ne sont pas appliqués. Nous n'avons pas vu de mise en demeure.
Dans le cas de l'Erika, nous pouvons en parler ! L'appel de détresse a été lancé le 11 décembre à 14 h 08, le naufrage a eu lieu le 12 à 8 h 28, soit dix-huit heures après. Pendant ces dix-huit heures, il ne s'est rien passé. Vous dites que nous avons trois remorqueurs de haute mer ; aucun n'est intervenu au cours de ces dix-huit heures. Quel est le sens d'une mise en demeure qui pendant dix-huit heures n'a aucun effet ? J'aimerais savoir si elle a même eu lieu !
Quels sont la portée et le sens de la loi de 1994 sur le pouvoir de contrôle en mer sur des navires de cette qualité ?
Je reviens sur l'insuffisance de détection. Vous avez dit que ce mazout, qui représente moins de 5 % des cargaisons, échappait aux moyens d'investigation les plus sophistiqués. Mais, pour donner des exemples banals, dans le plan POLMAR mer, les mesures qui ont le mieux réussi ne sont pas les grandes mesures élaborées dans ce plan mais celles mises en place par les marins pêcheurs. Je pense en particulier au chalutage avec des pélagiques en face de la Vendée, grâce auquel en quelques heures, en deux chaluts seulement, ont pu être enlevées huit tonnes de fioul. Je m'étonne que les marins pêcheurs n'aient pas été autorisés à utiliser le filet maillant dérivant qui plonge à 50 ou 100 mètres, que l'on peut traîner. La Marine nationale n'était pas très favorable mais, en décrivant des cercles autour de l'épave, nous aurions pu capter les nappes qui étaient entre deux eaux ! Ce sont des mesures simples, de bon sens, que tout pêcheur vous recommanderait.
Alors, si les mesures du plan POLMAR n'ont pas été suffisantes, nous ne pouvons donner un quitus, en invoquant la fatalité. Vous avez dressé une liste exhaustive du matériel dont nous disposions, mais quels que soient les efforts faits, et je salue tous les sauveteurs qui ont été d'un dévouement à toute épreuve et qui ont droit à notre reconnaissance, nous estimons qu'il y a malgré tout une obligation de résultats.
M. Paul RONCIERE : Je comprends très bien que vous souhaitiez une obligation de résultats, mais...
M. Louis GUEDON : Nous la voulons et nous l'exigeons !
M. Paul RONCIERE : Je suis désolé mais je ne suis pas prêt à signer un plan POLMAR du style : « Compte tenu de la mise en _uvre de ce plan POLMAR, vous êtes garanti
à 100 %... »
M. Louis GUEDON : Je ne parle pas d'une garantie à 100 %, mais entre 0 et 100 %, il y a une marge de man_uvre !
M. Paul RONCIERE : Pour vous donner un exemple d'obligation de résultats, je citerai le traitement de l'épave de l'Erika. Nous avons une bombe à retardement sous l'eau et le Gouvernement, très légitimement, a le souci de trouver la solution avec TotalFina. Dans le contrat qui sera passé, nous inscrirons une obligation de résultats de 100 %. Cela ne s'est jamais vu, mais il faut clairement afficher l'objectif.
Pour ce qui est du traitement en mer d'une pollution comme celle que nous avons connue, je veux bien admettre que les 1100 tonnes récupérées sont insuffisantes par rapport aux 12 ou 15 000 tonnes déversées. Je veux bien admettre aussi que les moyens nationaux dont nous disposions n'étaient pas initialement adaptés pour traiter correctement ce type de pollution. Cependant, je crois honnête de dire que lorsqu'une partie essentielle de la nappe passe entre deux eaux et que l'on ne sait pas la repérer, malheureusement, elle arrive inévitablement à la côte.
Quant aux filets, il se trouve que j'étais à La Rochelle le jour où le préfet maritime a rencontré les pêcheurs de Vendée. Il était très satisfait de ces rencontres et s'est montré absolument prêt à faire appel à leurs services.
M. Louis GUEDON : En effet, j'y étais.
M. Paul RONCIERE : Les pêcheurs lui ont dit qu'ils étaient à ses ordres, et n'attendaient que d'être réquisitionnés. Manque de chance, nous ne savions pas où était cette nappe...
Je vous signale cependant que, depuis que le plan POLMAR est engagé, nous demandons aux pêcheurs de bien vouloir nous informer chaque fois que remontent des saletés de la mer et nous dire exactement l'endroit où ils les ont repérées. Or cela ne fonctionne pas très bien et, d'après ce que j'ai cru comprendre, ils ne tiennent pas trop à faire connaître leurs bases de pêche. Je ne sais pas si c'est un argument réel...
M. Louis GUEDON : Ce n'est pas bien de dire cela ! Monsieur le secrétaire général, vous laissez planer auprès de nos collègues le doute que les marins pêcheurs, pour protéger leurs zones de pêche feraient de la rétention sur les dangers !
Mais cela ne se passe pas comme ça. Les marins pêcheurs travaillent de deux manières : s'ils travaillent en pêche, vous vous heurterez au mutisme le plus complet et vous n'aurez aucun renseignement. Ils ont leur carte privée et personnelle, tout le monde le sait.
Mais si un navire de pêche est rigoureusement réquisitionné, avec un contrat liant le patron et les Affaires maritimes du quartier dont il dépend, contrat établi pour une durée donnée et pour lequel il recevra une indemnité, il quittera alors son mental de marin pêcheur préservant ses zones de pêche et deviendra un intervenant sur mer à la disposition de l'administration. Il vous tiendra alors un carnet de bord d'une grande fidélité. Il faut dire à nos collègues les choses telles qu'elles se passent.
M. Paul RONCIERE : Vous aurez sans doute l'occasion de rencontrer le préfet maritime. Sur la possibilité d'utiliser les filets maillants dérivants, je sais qu'il y avait un grand scepticisme. Peut-être à tort, je n'ai pas la qualification pour savoir si l'on pouvait ou non les utiliser. Mais compte tenu du fait que l'on n'arrivait pas à localiser les nappes et que, quand elles arrivent sur la côte, il est trop tard, les tirants d'eau étant tels que personne ne va récupérer le fioul dans deux ou trois mètres d'eau, manifestement, il y avait là un problème. Je le note, même si la réponse que je vous donne peut ne pas vous satisfaire.
M. Louis GUEDON : Je l'ai noté.
M. le Rapporteur : Cela a été dit par l'intervenant précédent, me semble-t-il.
M. Paul RONCIERE : Sur ce point, je ne me permets pas de porter de jugement.
M. Louis GUEDON : Excusez mon erreur.
M. Paul RONCIERE : Je vous en prie.
Sur le FIPOL, je crois savoir qu'un aspect n'était pas facile à faire comprendre, celui de la notion de dépenses raisonnables. A ce sujet, j'ai dit que les collectivités locales n'ont peut-être pas eu toutes les informations sur ce qu'on entend par ces termes de dépenses raisonnables ou non raisonnables. Il y avait peut-être une petite lacune, mais c'est du détail.
Ecarter les navires à risque de la côte est effectivement un souci majeur du Gouvernement. Je vous laisse le soin de regarder ses propositions en la matière. Nous souhaitons que cela ne se fasse pas simplement au large des côtes de France mais que ce soit une décision européenne.
Pour revenir sur les circonstances du naufrage, un
mayday a, en effet, été entendu par le CROSS Etel. Et il a été annulé, totalement annulé. Là, il y a un problème.
M. le Rapporteur : C'est tout le problème.
M. Paul RONCIERE : Je laisserai au préfet maritime le soin de répondre. La question posée était la suivante : dès lors qu'il y avait une mise en alerte, pourquoi le préfet maritime n'a-t-il pas déplacé son remorqueur de haute mer, qui était à Ouessant derrière le Stiff ?
Voici la réponse du commandant de l'Abeille Flandre, qui n'est pas celle du préfet maritime. Premièrement, il aurait été envisageable d'aller se pré-positionner non pas près d'Ouessant mais du côté de Morgat pour être plus proche en cas d'intervention, mais c'était avant que le navire ne fasse demi-tour et se dirige sur Donges. Compte tenu de l'endroit où il se trouvait, le temps d'intervention aurait été très long. Deuxièmement, ce jour-là, il y avait une grosse tempête et le remorqueur de haute mer a pour mission de surveiller le rail d'Ouessant où passent 300 à 400 navires par jour : or, un navire, le Maria K,
y était en difficulté. Le commandant de l'Abeille Flandre
estime donc que la décision du préfet maritime de le laisser positionné là où il était, compte tenu du défaut d'informations que nous avions sur ce qui se passait sur l'Erika, compte tenu de l'annulation du
mayday, était fondée.
Il faut savoir qu'à 14 h 30, le second capitaine est allé sur le pont de l'Erika
où il a constaté trois criques et trois boursouflures. Il y avait donc un problème sérieux. Les autorités françaises ne l'ont su qu'à 21 h 15.
Dernier point factuel, d'après le remorqueur, compte tenu de l'état du bateau, en voulant le remorquer, on l'aurait cassé en deux. Mais sur ce point, je ne peux réellement parler car je ne suis pas technicien des navires.
M. Louis GUEDON : Il y aura toujours un doute dans l'esprit des gens : n'y avait-il rien à faire ou aurait-on dû pour un bateau dans de cet état et avec sa cargaison, dès son premier appel de détresse, précéder les inquiétudes et imposer une obligation d'inspection ? Nous n'aurons jamais la réponse.
M. Paul RONCIERE : Il est vrai que le débat reste ouvert, monsieur le député. Je fais simplement référence au rapport provisoire du bureau enquêtes-accident, où un ensemble d'éléments très factuels expliquent la difficulté de la décision compte tenu des informations dont disposait le préfet maritime.
M. le Rapporteur : Il faudrait peut-être un remorqueur supplémentaire.
M. François CUILLANDRE : M. Goulard ayant déjà posé les questions que je souhaitais poser sur les responsabilités de l'armateur et l'affréteur, je ferai simplement quelques observations, non sur l'obligation de résultats, mais sur l'obligation de moyens de l'Etat.
Vous nous avez parlé de la vétusté de certains moyens d'intervention, notamment des
Super Frelons de la marine. A mon avis, la liste des insuffisances pourrait être bien plus longue. J'en ai noté, pour ma part, quelques unes. Où en est le remplacement de l'Abeille Flandre, que vous avez rapidement évoqué ? Vous avez été sous-préfet à Brest, vous connaissez le problème des hélicoptères de la protection civile - un seul à Quimper, aucun à Brest. Concernant les moyens de surveillance des dégazages _ car on parle de l'Erika
mais il faut savoir que l'essentiel du pétrole qui arrive à nos côtes est issu du dégazage sauvage en mer, même si certains dégazages sont autorisés au large des côtes _ de quels moyens disposez-vous pour ce contrôle ? Est-il prévu de les renforcer ?
En matière de vétusté, il faut aussi signaler les moyens de fonctionnement et d'investissement des « phares et balises ». On parle beaucoup de navires sous-normes, mais le baliseur de Brest, qui a enfin été mis à la retraite, avait plus de 70 ans et était largement sous-normes. Est-on prêt à mettre les moyens nécessaires pour assurer cette sécurité en mer ? Cette question s'adresse aussi aux parlementaires.
M. Paul RONCIERE : Le remplacement de l'Abeille Flandre est un sujet d'actualité, mais pas immédiat car l'appel d'offres pour le renouvellement des remorqueurs vient d'être lancé dans la perspective de 2003. Nous préférons faire appel à un armement national plutôt qu'à un armement sous autre pavillon, mais c'est un appel d'offres européen, aussi méfiance ! Après différentes études engagées, la consultation des préfets maritimes et des différents ministères, nous estimons que nous devons avoir à terme et assez rapidement un remorqueur d'intervention en haute mer plus rapide, plus man_uvrant, entre autres - nous avons établi la liste de nos besoins. C'est une décision que le Gouvernement sera amené à arrêter.
Le problème des hélicoptères se pose certes pour les
Super Frelons mais aussi pour les hélicoptères de la sécurité civile. Le centre hospitalier universitaire est à Brest ; compte tenu de la population du Nord Finistère, il se pose probablement un problème de positionnement d'hélicoptère. Sur ce point, je reste prudent parce qu'il y a toujours quelques rivalités entre le nord et le sud. Dans la mesure où il y en a deux, tout le monde sera content. Mais vous avez raison de dire qu'il ne faut pas simplement regarder le problème des hélicoptères de sauvetage qui vont en mer mais aussi celui de la desserte des côtes, sans oublier le sauvetage de proximité en période de baignade.
La surveillance des dégazages en mer est un problème global qui intéresse toutes nos côtes, pas seulement la côte atlantique. Des règles internationales sont arrêtées, notamment l'obligation de déballastage dans les ports. Encore convient-il qu'il y ait des stations de déballastage. Elles n'existent pas partout. Nous avons demandé que l'Europe, qui travaille sur le sujet, finisse par arrêter des règles communes. Nous serons d'autant mieux armés qu'effectivement, nous aurons les outils qui permettent aux bateaux de déballaster dans les ports d'accueil.
Le deuxième aspect est le repérage et la sanction : accords de Bonn. C'est une affaire que nous suivons de très près pour avoir le plus de moyens - nous essayons les moyens satellitaires qui nous donnent quelques retours intéressants - et des sanctions plus sévères. Mais sur ce point précis, se pose au niveau national la question de savoir s'il faut un tribunal spécialisé en la matière qui, comme en Angleterre, sanctionnerait vite et fort.
M. Louis GUEDON : Très bien !
M. Paul RONCIERE : Pour ce qui est des moyens des « phares et balises », nous étions effectivement arrivés à une situation qui n'était plus acceptable. Quand le ministre de l'Equipement, M. Gayssot, a constaté la situation, il a arrêté un certain nombre de dispositions qui se sont déjà traduites financièrement puisque, dans la loi de finances 2000 que vous avez votée, la construction d'un nouveau baliseur pour Brest est prévue. Mais c'est un plan de rattrapage énorme.
Puisque nous parlons de financement, il faut savoir que, sur une certaine période, les crédits du ministère de l'équipement se sont effondrés. Depuis 1997, il y a un réajustement en hausse. Un vrai plan de rattrapage s'impose donc.
M. Alain GOURIOU : La couverture par hélicoptère a été évoquée et elle est importante au niveau de la prévention et de l'intervention pour sauver les vies humaines, sinon pour tirer le navire d'un mauvais pas. Entre Cherbourg et Quimper, il n'y a pas d'autre base d'hélicoptères. Vous avez tous en mémoire l'accident survenu l'an dernier aux jeunes scouts au large de Perros-Guirec. Les problèmes en mer se passent en général dans des conditions météo mauvaises et l'on fait toujours des entraînements quand il fait beau. Le ciel est bleu, et tout le monde est content, on rentre en disant que ça marche ! Manque de chance, quand il faut intervenir, ce n'est pas du tout comme ça que les choses se passent ! Si vous faites intervenir l'hélicoptère de Quimper dans des conditions météo mauvaises, il ne passera pas les monts d'Arrée, ou difficilement, tant la visibilité est mauvaise. Et l'autre doit venir de Cherbourg ! J'aime autant vous dire que, quand vous êtes au large, vous avez intérêt à savoir nager ou à avoir des gilets de sauvetage efficaces !
Cette question a été soulevée en 1978. Cela fait vingt-deux ans ! La base d'hélicoptères a été proposée, la maintenance d'hélicoptères a été proposée - il y en a une à Lannion. Elle était d'autant mieux adaptée que les hélicoptères du Centre national d'études des Télécoms, qui ne sont pas évidemment équipés pour intervenir en mer, offraient des possibilités de maintenance. Nous attendons toujours cet hélicoptère.
Une question posée par M. Guédon m'a fait repenser à l'accident de l'Amoco-Cadiz, où les tergiversations à bord du navire ont été si longues et délicates entre le capitaine, l'armateur et l'affréteur que, lorsque l'on a enfin déclenché les moyens de sécurité, il était déjà trop tard. Si je reviens sur cette histoire de
mayday lancé, puis annulé, c'est pour me demander s'il ne serait pas possible, dès lors qu'un navire est considéré comme en difficulté, d'intervenir tout de suite, même préventivement. Après tout, s'il ne se passe rien, le bateau continue et le remorqueur rentre au port ; mais s'il y a quelque chose, les secours me paraissent se déclencher si tardivement qu'à chaque fois, on arrive trop tard.
Enfin, à propos des dégazages sauvages, on me dit que le coût de l'amende encourue éventuellement par un navire surpris en plein dégazage en mer est inférieur au coût du déballastage. Il a tout intérêt à payer l'amende !
M. Louis GUEDON : Très bien !
M. Paul RONCIERE : Il faut réexaminer le positionnement des hélicoptères. Actuellement, certaines zones sont particulièrement mal couvertes,
a contrario, d'autres le sont sans doute trop. Nous nous sommes rendu compte l'été dernier qu'il y avait sept hélicoptères de service public en Corse. Certes, il y a des feux de forêt, etc. Mais c'était à un point tel que nous avons fait revenir l'hélicoptère de la marine qui était prévu pour Ajaccio, parce que nous avons trouvé qu'ils étaient vraiment très nombreux.
Le plan de répartition des hélicoptères doit être revu. Donc, votre observation sur le fait que depuis 1978, vous ayez fait des propositions sans obtenir de réponse, illustre ce propos.
Intervention préventive, ce serait certainement bien. Mais une fois encore, je préfère ne pas porter de jugement sur la façon dont les choses se sont déroulées sur l'Erika compte tenu des éléments que nous connaissons parce que je rappelle que c'était un navire qui n'était pas classé comme étant un navire sous-norme. Il bénéficiait du code ISM, ce qui veut dire que le commandant, qui doit s'occuper de son navire, fait appel à une personne désignée par le code ISM pour être le correspondant entre l'armateur et les autorités à terre. Il a été très difficile au commandant d'accéder à cet organisme, qui s'appelle le
Panship. Il a fini par le joindre, mais celui-ci n'a pris aucune initiative pour prévenir les autorités françaises alors qu'il savait, lui, l'état du navire et les difficultés qu'il rencontrait.
Quand vous avez des classifications, qui sont des classifications « douteuses »
- nous entrons là sur un problème que nous n'avons pas évoqué mais qui est un problème de fond - on est extrêmement mal à l'aise.
Quand vous savez que le RINA est dans le club des bonnes sociétés de classification, vous pouvez vous demander ce qui se passe ailleurs. Je vous ai donné l'exemple de la Grèce, sur lequel je ne voudrais pas insister, pour vous dire qu'il y a du ménage à faire dans la maison.
Pour le dégazage, le vrai problème n'est pas que le coût de l'amende soit inférieur au coût du déballastage, c'est que, pratiquement, il n'y a aucune sanction. C'est encore mieux : cela ne coûte rien !
M. le Président : Ne pourrait-on pas imaginer que ces pétroliers ne puissent sortir du port sans avoir un certificat de dégazage ?
M. Paul RONCIERE : Mais les pétroliers ne sont pas les seuls concernés par le dégazage. Tous les bateaux le sont. Si un seul pays prend des mesures strictes, ce qui est souhaitable, on le félicitera mais cela signifiera aussi pour lui un détournement de trafic immédiat. Pour que le dispositif puisse fonctionner, il ne peut donc qu'être européen. Il faut que nous y allions tous ensemble.
Mme Jacqueline LAZARD : Ma question diffère de celles évoquées jusqu'à présent. Lorsque vous nous avez parlé des compétences du secrétariat général en matière de sécurité, vous avez parlé de l'état des navires, de la surveillance, mais aussi de l'aspect humain. Cela comprend-il la formation, les conditions de vie à bord ? Pourriez-vous nous en dire plus à ce sujet ?
M. Paul RONCIERE : Il est incontestable qu'actuellement, nous trouvons sur la mer des navires avec des équipages sous-payés, vivant dans des conditions d'hygiène et de travail lamentables, etc. Les règles minimales fixées par les conventions de l'OIT ne sont même pas respectées.
L'engagement qui a été pris en France dans la Charte des acteurs du transport, c'est que les navires ne respectant pas les règles de l'OMI ni celles de l'OIT pour les équipages, ne seront plus affrétés et ne rentreront plus dans les ports français. Nous souhaitons que cette charte nationale soit acceptée par l'ensemble de nos partenaires européens afin que tous adoptent une attitude identique. Mais, tant que nous n'aurons pas réglé cet aspect essentiel, nous n'aurons pas avancé.
Deux autres aspect de cette question touchent aux effectifs. Quand vous savez que sur l'Erika, il n'y a pas de radio...
M. Alain GOURIOU : Pardon ?
M. Paul RONCIERE : Non, il n'y a pas de radio, monsieur le député. Les messages maintenant, c'est automatique ! Vous n'avez plus personne pour s'occuper d'une radio ; il faut que vous soyez cuisinier, machiniste, et tout ! Les équipages sont extrêmement réduits. Et encore, sur l'Erika, ce n'était pas un équipage
a minima, il y avait vingt-six personnes, mais pas de radio.
Mme Jacqueline LAZARD : Cette absence de radio est vraie aussi sur des bateaux français battant pavillon des Kerguelen.
M. Paul RONCIERE : J'entends bien que quand on parle de faire le ménage chez les autres, encore faut-il le faire chez soi.
Puis il y a l'aspect que je qualifie de facteur humain qui est lié notamment au niveau de formation. Vous avez des diplômes de complaisance, car cela se vend : vous avez un diplôme d'officier qui n'existe pas mais s'achète ! Ce n'est pas sérieux. Il faut donc un véritable niveau de formation. Ce sont les normes STCW, sur lesquelles il reste beaucoup à faire.
Le facteur humain, c'est aussi le fait que vous avez des équipages cosmopolites. La règle veut que dans les navires de transport de matières dangereuses, tout le monde parle la même langue,
a priori l'anglais. Quand il y a cinq langues différentes et que les gens ne se comprennent pas, en cas de difficulté, cela peut être catastrophique.
Enfin, il y a l'ensemble des conditions sociales de travail qui ne peuvent être en dessous des normes de l'OIT. Il faut voir qu'à partir du moment où les Etats-Unis ont fait le ménage, pour partie, où l'Union européenne le fera également, ces navires continueront tout de même à naviguer et qu'il y aura probablement des transferts vers l'Amérique du Sud, l'Afrique, etc. Il faut donc probablement développer parallèlement un volet de coopération, dans le cadre de l'OMI pour, d'une part, mettre en place dans les Etats qui n'ont pas d'administration maritime alors qu'ils ont un pavillon, les outils et l'administration indispensables - car, même si notre administration présente quelques lacunes, elle a le mérite d'exister - et pour, d'autre part, faciliter sur le plan international, la formation de ces équipages. Il reste un travail extraordinaire à accomplir pour atteindre une situation plus satisfaisante que celle que nous constatons actuellement au niveau maritime, notamment si l'on prend pour base de comparaison le niveau de sécurité des transports aériens.
Audition du Vice-amiral d'escadre Yves NAQUET-RADIGUET,
préfet maritime de la région Atlantique
et commandant en chef pour l'Atlantique,
accompagné du commissaire général Yves MERLE
et de l'enseigne de vaisseau Aude de SAINT-CYR
(extrait du procès-verbal de la séance du 22 février 2000)
Présidence de M. Daniel PAUL, Président
Le Vice-amiral d'escadre Yves Naquet-Radiguet, le commissaire général Yves Merle et l'enseigne de vaisseau Aude de Saint-Cyr sont introduits.
M. le Président leur rappelle que les dispositions législatives relatives aux commissions d'enquête lui ont été communiquées. A l'invitation du Président, le Vice-amiral d'escadre Yves Naquet-Radiguet, le commissaire général Yves Merle et l'enseigne de vaisseau Aude de Saint-Cyr prêtent serment.
M. Yves NAQUET-RADIGUET : Monsieur le Président, Madame et Messieurs les Députés, je vous propose d'aborder dans l'ordre les trois domaines étudiés par votre Commission pour vous faire part d'un certain nombre de mes réflexions que j'éclairerai au moyen des enseignements qu'il me semble possible de tirer du naufrage de l'Erika, et surtout de la lutte antipollution qui a suivi.
Auparavant, permettez-moi de vous rappeler le rôle du préfet maritime tel qu'il est prévu dans le décret du 9 mars 1978. Ce décret pris quelques jours avant le naufrage de l'Amoco-Cadiz
met en place une organisation originale. Nombreuses sont les tâches qu'effectue l'Etat en mer. Cinq administrations sont plus particulièrement concernées : le ministère de l'Equipement, des transports et du logement ; le ministère de l'Agriculture et des pêches ; le ministère des Finances ; le ministère de l'Intérieur et bien sûr le ministère de la Défense, avec la Gendarmerie, la Gendarmerie maritime et la Marine, en charge de mettre en _uvre les moyens militaires de haute mer ou spécialisés dans le service public - car comme vous le savez, la Marine nationale assume au-delà de ses tâches militaires une mission de service public, à laquelle elle consacre chaque année environ 20 % de son activité. Je n'oublie pas dans cette liste, bien entendu, le ministère de l'Environnement.
L'originalité de cette organisation réside dans le fait que chaque administration programme, emploie et contrôle ses propres moyens navals ou aériens, nécessaires dans le cas de ses propres missions en mer.
Le préfet maritime est un préfet de la mer, dépositaire de l'autorité de l'Etat, délégué du Gouvernement et représentant direct du Premier ministre et de chacun des ministres. A ce titre, il a autorité de police administrative générale en mer. Il est investi d'une responsabilité générale dans tous les domaines où s'exerce l'action de l'Etat. Il coordonne l'action en mer des administrations concernées et, en tant que de besoin, la mise en _uvre de leurs moyens. C'est pour cela qu'il conduit les opérations de sauvetage, de lutte contre la pollution ou de maintien de l'ordre public.
La plupart d'entre vous êtes bien placés pour savoir que la façade atlantique est l'une des voies maritimes les plus fréquentées du monde. Plus de 150 bateaux empruntent chaque jour le dispositif de séparation de trafic d'Ouessant, soit un toutes les 10 minutes environ. Cela représente un volume de près de 1 million de tonnes de pétrole et de produits dangereux. Pendant près d'un tiers de l'année, les conditions climatiques y sont sévères. Il n'est sans doute pas inutile de rappeler que les côtes françaises sont placées sous les vents dominants, et qu'elles sont particulièrement vulnérables. L'accident de l'Erika vient s'ajouter à une liste d'accidents très graves et tristement célèbres qui sont survenus dans les dernières décennies.
En matière de prévention des accidents, le préfet maritime de l'Atlantique dispose d'un arsenal original de moyens : d'une part, un dispositif de séparation du trafic - véritable autoroute que les bâtiments suivent avec deux voies montantes et une voie descendante séparées par une bande de sécurité - qui est situé autour d'Ouessant, l'endroit le plus dangereux parce qu'il se situe à quelques dizaines de kilomètres seulement des côtes françaises ; d'autre part, un radar dont l'antenne se situe en haut d'une tour sur l'île d'Ouessant, à plus de 70 mètres d'altitude. Ce radar peut en permanence suivre les bâtiments situés dans le dispositif.
Avant d'aborder ce dispositif, tout navire transportant une cargaison dangereuse est tenu de s'annoncer, de préciser la nature de sa cargaison et d'indiquer ses problèmes éventuels. Chaque bâtiment est donc suivi dans le dispositif par les officiers du CROSS - Centre régional des opérations de sécurité et de sauvetage - Corsen, situé dans la petite ville du même nom. Toute anomalie est immédiatement détectée, que ce soit un bâtiment à contresens dans l'autoroute - ce qui arrive encore quoique très rarement -, ou que ce soit - plus fréquemment - un bâtiment en avarie de moteur ou de barre qui se met à dériver.
Le CROSS peut alors instantanément interroger le bateau, évaluer ses difficultés sur la base des informations qui lui sont transmises, et si celles-ci le rendent nécessaire, donner l'alerte. Si le préfet maritime considère que le bateau représente un danger grave et imminent pour la navigation ou l'environnement, il a la possibilité de mettre en demeure l'armateur et le commandant du bateau de faire cesser le danger, faute de quoi il prendra lui-même, aux risques et aux frais de l'armateur, les mesures qui s'imposent.
Le «bras armé» du préfet maritime est le remorqueur
Abeille Flandre, en alerte 365 jours par an, et extrêmement puissant. Il est placé auprès du navire en difficulté pour être prêt à lui passer une remorque. Auparavant, le préfet maritime aura eu la possibilité de mettre à bord, le plus souvent au moyen d'un hélicoptère, une équipe d'évaluation composée de mécaniciens et de spécialistes du remorquage susceptibles de donner un avis sur la nature de l'avarie et la capacité de l'équipage à la réparer.
En cas de besoin, et si le danger devient trop immédiat, le préfet maritime a le pouvoir d'ordonner, au besoin par la force, la prise de remorque qui permettra d'éloigner le danger vers le large ou de conduire le navire vers un refuge sûr.
Il serait injuste de nier que ce dispositif fonctionne. En vingt ans, le remorqueur
Abeille Flandre est intervenu 800 fois et a effectué plus de 200 missions d'assistance au profit de navires en difficulté majeure, parmi lesquels une bonne douzaine de pétroliers qui se seraient immanquablement échoués sur les côtes françaises, entraînant des pollutions dont l'Erika nous donne un triste exemple aujourd'hui.
Grâce à ce dispositif, au moins 2 millions de tonnes de pétrole n'ont pas souillé les côtes bretonnes.
Ainsi, dans la nuit du 11 au 12 décembre, nuit du naufrage, nous avons été sollicités à partir de 22 heures pour le sauvetage d'un bateau menaçant de s'échouer au large de Saint-Nazaire. Nous avons déroulé toute la procédure de mise en demeure de celui-ci - le
Maria K - et de réquisition d'un des remorqueurs portuaires. La situation ne s'est stabilisée que vers 6 heures du matin.
L'Erika a fait naufrage sans jamais avoir demandé assistance, sauf au dernier moment. Certes, le premier appel passé par courrier électronique indique une situation de détresse et il a été traité comme tel par le CROSS et le COM - Centre opérationnel de la marine -, mais comme ce message a été annulé 30 minutes plus tard et que, jusqu'au lendemain matin, le navire n'a cessé de nous communiquer des éléments rassurants, nous ne nous sommes pas inquiétés. Il naviguait à 9 noeuds dans le gros temps. Permettez-moi de vous résumer la situation telle que je l'ai ressentie à l'analyse de cet accident.
Sauf le 11 décembre, entre 14 heures 08 et 14 heures 34, si l'Erika s'est senti en danger il n'en a rien laissé paraître. Si l'on ajoute qu'il avait franchi la veille le dispositif de séparation de trafic d'Ouessant sans signaler le moindre problème, que son
target factor - nous reviendrons sur ce terme - pouvait être considéré comme très satisfaisant, on ne voit pas pourquoi nous n'aurions pas entériné le fait que le commandant avait repris la situation en main.
A la lumière du naufrage de l'Erika, et sans vouloir vous paraître provocateur, je vois au moins deux preuves de l'efficacité de l'organisation aujourd'hui en place et de l'état de préparation, de disponibilité ainsi que de réactivité de toutes les équipes qui la composent.
Je tiens tout d'abord à saluer l'efficacité des nombreux acteurs du sauvetage, certainement l'un des plus difficiles et sans doute l'un des plus dangereux de ces dernières années. Que l'on soit capable de sauver 26 personnes en mettant en _uvre 6 hélicoptères, dont 2 britanniques, en déroutant 3 bâtiments de commerce, en faisant appareiller 2 vedettes de la Société nationale de sauvetage en mer, de faire coordonner le tout par un
Atlantique, un dimanche à 6 heures du matin dans une météo calamiteuse, prouve l'état de préparation de tous, leur dévouement, leur maîtrise.
Je suis prêt à revenir sur cette véritable performance si vous le souhaitez, mais d'ores et déjà je ne peux laisser dire que le dispositif de sécurité maritime était réduit du fait de l'heure et de la date.
L'équipe de quart au Centre régional opérationnel de sécurité et de sauvetage, celle du Centre opérationnel de la marine, les bases aéronavales de Lanvéoc Poulmic et de Lann Bihoue ont réagi parfaitement et dans des délais minimaux. J'estime que leur performance n'a pas été suffisamment soulignée.
De la même façon, j'appelle votre attention sur l'exploit réalisé par l'Abeille Flandre
qui a pu établir une première liaison entre le remorqueur et l'épave en moins de 10 minutes. Le personnel hélitreuillé par
Super Frelon dans une mer démontée par des vents de plus de 100 kilomètres à l'heure - nous avions presque 60 n_uds de vent - a fait preuve d'un professionnalisme exceptionnel.
Si la tentative d'éloigner le danger vers le large ne s'est pas soldée par un succès, après un véritable combat qui a duré toute la nuit et la matinée du 13 décembre - le remorqueur se trouvant souvent en limite de puissance -, du moins a-t-elle empêché cette épave et ses quelque 10 000 tonnes de pétrole d'aller s'échouer et se briser sur Belle-Ile, avec les conséquences que l'on peut aisément imaginer pour l'île elle-même, comme pour le golfe du Morbihan.
Pour me résumer, le fait qu'un pétrolier s'ouvre en deux sans prévenir à une très grande distance du centre du dispositif de prévention où sont concentrés les secours, représente pour moi la preuve que le « risque zéro » n'existe pas.
Je reprends à mon compte la formule du Bureau d'enquêtes sur les événements de mer du ministère des Transports : en tout état de cause, dans la situation où il se trouvait, aucun moyen n'aurait empêché l'Erika de se briser !
Au moment où vous enquêtez sur la sécurité du transport maritime, je souhaite souligner le fait que si l'accident d'un pétrolier focalise notre attention, d'autres bâtiments pourraient nous poser également quelques difficultés. Je veux parler de ces porte-conteneurs dont la stabilité pourrait être mise en cause par les tempêtes du golfe de Gascogne, et qui, dans de telles conditions, risquent de perdre à la mer quelques-unes de ces boîtes dont nous ignorons le contenu, dont nul ne sait si elles seraient amenées à couler, à flotter, ou à flotter entre deux eaux.
Le danger que représentent ces conteneurs perdus pour la navigation et l'environnement est réel. Nous avons déjà connu dans le passé quelques accidents de ce genre. Un moyen de leur porter rapidement secours, quel que soit l'endroit où se produit l'accident, fait actuellement défaut : il n'a pas été possible, il y a quelques années, de mettre à la disposition du préfet maritime l'Abeille Supporter, ordinairement basée au centre d'essais des Landes, qui pourrait être disponible pendant au moins la moitié de l'année. Peut-être faut-il revoir ce point ? La possibilité de recourir aux moyens de secours espagnols, selon les termes du
Biscaye Plan que nous avons mis au point tout au long de 1999 et que j'ai signé quelques jours avant l'accident de l'Erika, rend le problème moins critique, mais laisse le nord du golfe de Gascogne très vulnérable.
Je souhaite enfin attirer votre attention sur un problème lancinant qui aurait pu être celui de l'Erika. Si le préfet maritime a le pouvoir de mettre en demeure un bateau représentant un danger, de le prendre en remorque si nécessaire, son pouvoir s'arrête au « trait de côte ». L'autorisation de le mettre à l'abri dépend du seul directeur de port, à défaut d'ordre contraire du préfet du département, voire de l'administration centrale en ce qui concerne les ports autonomes.
Nombreux sont les exemples de bateaux qui, n'ayant pu être accueillis dans un port, ont fini par sombrer, créant ainsi des pollutions sans doute plus graves et mettant en jeu la vie de leurs équipages. Je n'ai pas aujourd'hui la certitude que le port de Donges avait signifié à l'Erika une quelconque interdiction d'entrée, mais il est clair qu'au moment de l'accident le bateau continuait sa route sur Saint-Nazaire.
Si la cassure était intervenue quelques heures plus tard, on peut imaginer, en cas d'interdiction, qu'elle serait survenue alors que l'Erika était en train de tourner au large sans savoir où aller. Cette situation aurait mis l'Etat en très mauvaise position.
Que peut faire le préfet maritime s'il ne peut mener sa mise en demeure jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à un port de réparation ou au moins un port refuge ? Que peut faire le préfet maritime face à des situations semblables à celle qui s'est produite à Brest il y a quelques jours, où un bâtiment maltais, après avoir été piloté par un pilote du port de Brest, s'est vu refuser le droit de pénétrer dans le port, puis après une inspection du Centre de sécurité des navires, s'est vu refuser le droit de repartir ?
Il m'a été signalé que le sujet serait traité et tranché au cours du Comité interministériel de la mer de la semaine prochaine.
Augmenter le nombre de remorqueurs d'intervention le long de nos côtes et régler le problème de l'accueil des bâtiments en difficulté semblent des voies à explorer dans un cadre purement national en vue d'améliorer la sécurité maritime. Ceci clôt, Madame et Messieurs les députés, la première partie de mon exposé.
Le deuxième domaine qu'étudie votre Commission est hors du champ de mes responsabilités. Le contrôle des normes internationales des navires et des cargaisons est du ressort du ministère des Transports. Le préfet maritime n'intervient pas dans ce contrôle et l'élaboration des normes. Il n'en demeure pas moins que chaque fois qu'un bâtiment est en difficulté ou qu'il se signale comme transportant des produits dangereux à l'entrée du dispositif de séparation du trafic, le CROSS consulte le fichier européen SIRENAC tenu à jour dans le cadre du Mémorandum de Paris par les Affaires maritimes pour la France.
L'Erika était-il un «bateau poubelle» ? Rien ne permettait de le dire à l'époque. Son
target factor, c'est-à-dire la note attribuée par les fichiers SIRENAC, était de 12. Si l'on sait qu'un très bon bateau a un
target factor inférieur à 10 et que les «bateaux poubelles» ont des notes supérieures à 35 ou 40, on ne peut conclure avec certitude au mauvais état de l'Erika. Comment cette note a-t-elle été réellement attribuée ?
Je ne dispose pas de tous les éléments et le Bureau d'enquêtes sur les accidents semble sceptique. Nous n'avons au CROSS ou au COM aucun élément de jugement, si ce n'est que l'Erika avait un équipage exclusivement indien et, à ma connaissance, qualifié. D'après les déclarations du plongeur-sauveteur de la Marine nationale, la passerelle avait l'air en ordre. Le bateau avait un aspect meilleur que la moyenne des bâtiments sur lesquels il est habitué à opérer. L'équipage, aidé il est vrai par le plongeur, a été capable, dans une mer déchaînée, de mettre en _uvre un bateau de survie, de le faire démarrer et d'assurer une veille radio avec l'avion coordinateur.
J'aborde maintenant le domaine de la lutte antipollution. Je l'ai déclaré à Bayonne un mois avant l'accident : nous ne savons pas ramasser une nappe de pétrole en pleine mer !
Personne ne sait le faire. L'opinion générale des techniciens est que cette tâche est particulièrement difficile, voire impossible. L'instruction de 1997, signée du Premier ministre, précise d'ailleurs que « la récupération des hydrocarbures ou des produits toxiques déversés dans la mer sera toujours une entreprise difficile, aussi le Plan POLMAR doit-il prévoir des mesures qui pourront être engagées pour prévenir ces déversements dès que le risque d'un incident est connu. »
Cela explique que nous ayons donné la priorité pour nos moyens de lutte antipollution au matériel le mieux adapté à la majorité des cas prévisibles. On s'efforce d'éviter qu'un bâtiment ne vienne s'échouer sur les côtes, ou bien on se prépare à un accident du type d'une collision avec un pétrolier, ce pétrolier étant en mesure d'être confiné ou allégé. Il faut reconnaître que le cas du pétrolier qui s'ouvre en deux presque sans prévenir n'a pas été prévu.
Nous nous sommes retrouvés face à un cas particulièrement difficile : au moins 10 000 à 15 000 tonnes de fioul numéro 2, particulièrement collant et visqueux ; une tempête historique et une météo qui devait rester mauvaise presque trois semaines d'affilée ; une période de l'année, j'y insiste, peu propice à l'éclairement diurne - il faisait jour de 10 heures à 16 heures - ; une très grande distance de la terre, ce qui sous-entend une grande durée de trajet pour les nappes à travers le golfe de Gascogne sous l'effet conjugué des vents et des courants de marées particulièrement forts ; enfin, cinq départements concernés.
Dès le 13 décembre, il était clair dans nos esprits que ce pétrole, impossible à traiter par les dispersants compte tenu de sa viscosité, arriverait sur les côtes de France. Mais le modèle conjoint à Météo France et au CEDRE a été victime des très violentes tempêtes de la fin du mois de décembre, et l'arrivée prévue des premières nappes au niveau de l'île d'Yeu a été cruellement démentie par la pollution des plages du sud Finistère le 24 décembre, puis par la pollution majeure des côtes de Loire-Atlantique.
En fait, nous avons été desservis par deux éléments.
C'est très brutalement que les nappes surveillées ont changé de direction vers le nord et menacé les côtes de la Loire-Atlantique aux environs des 22 et 23 décembre. L'arrivée de ces nappes sur l'île d'Yeu avait été tellement médiatisée qu'il a été impossible de faire prendre conscience à l'opinion de ce changement de cible et de s'adapter à cette nouvelle situation. Les dispositions étaient prises beaucoup plus au sud : un préfet coordinateur était désigné à La Rochelle.
Par ailleurs, sans doute n'avons-nous pas réussi à prendre toute la mesure de la dispersion de ces nappes, de leur hypothétique plongée au cours des 12 jours de dérive sous l'effet de vents violents, de leur désagrégation sous l'effet des vagues. Reconnaissons-le, nous manquions d'expérience, et les modèles de Météo France étaient en cours de développement. Fallait-il alors leur donner une telle diffusion sans l'assortir d'un facteur d'incertitude ? Il est probable que non. Quoi qu'il en soit, je n'en avais pas la maîtrise.
Tout a été fait pour tenter de récupérer le maximum de produits en mer, selon une stratégie mise au point en commun avec les experts du CEDRE et de l'IFREMER.
Malgré l'aide des avions de la Douane qui ne nous a pas été mesurée, nos moyens de lutte étaient limités, même s'ils avaient déjà fait la preuve de leur efficacité dans d'autres occasions. Au titre des accords de Bonn, nous avons pris contact avec un expert de la Commission européenne qui nous a aidé à mobiliser les moyens disponibles.
Plusieurs bâtiments spécialisés dans la lutte contre les pollutions en mer tels que le néerlandais
Arca, le britannique British Shield, l'allemand
Neuwerk, nous ont rejoints, tandis que les Espagnols, dans le cadre du
Biscaye Plan, nous envoyaient sur zone 2 remorqueurs munis de barrages. L'Alcyon, puis l'Ailette, équipés des moyens antipollution les plus puissants dont nous n'étions pas sûrs qu'ils soient bien adaptés à ce produit particulier, ont été envoyés les premiers sur les lieux. Quelques heures d'essai dans des conditions météorologiques très difficiles ont démontré qu'il fallait changer de matériel. Des pompes
Foilex au débit beaucoup plus faible ont donc été montées sur nos bateaux. Du 19 au 23 décembre, dans un créneau de météo favorable, tous les bâtiments ont pu se mettre au travail.
Il est sans doute excessif de considérer aujourd'hui que l'Arca
- qui a récupéré à lui seul la même quantité de produit que tous les autres bâtiments -, constitue un référent idéal. Il serait aussi injuste de considérer que les moyens français ont été inefficaces puisqu'ils ont récupéré sensiblement autant de fioul en mer que leurs homologues étrangers.
Il faut signaler le rôle très important joué par le
commandant L'Herminier, un aviso de la Marine nationale, comme coordinateur de ces différents moyens sur zone. Il a joué ce rôle tout en s'efforçant d'améliorer par deux plongées sous les nappes, effectuées dans des conditions extrêmes, notre connaissance du comportement du produit. Ce comportement était un peu différent de celui étudié par le CEDRE dans son « polludrome ».
Quand une fois de plus, sous l'effet de la météo, le pompage a dû être stoppé, il est apparu que la fenêtre météo avait été bien utilisée. Tout ce qui pouvait être pompé l'avait été. Il était alors évident que de nombreuses nappes demeuraient trop petites pour pouvoir être pompées. L'arrivée des pollutions restantes sur les côtes de Vendée et de Charente-Maritime était inévitable et nous devions mettre en place une deuxième ligne de défense constituée par de petits bateaux coordonnés par 2 PC POLMAR mobiles, c'est-à-dire 2 bâtiments.
C'est le deuxième rideau que nous avons essayé de mettre en place dans les deux départements du sud, qui était censé mettre en _uvre des bâtiments de pêche réquisitionnés pour la circonstance, et des hélicoptères. L'Armée de l'air, contactée, avait mis ses hélicoptères de Cazeaux à notre disposition.
Des entraînements ont été conduits à La Rochelle et aux Sables d'Olonne. Une fois encore, la météo a empêché la mise en _uvre de ce système quand il aurait été utile. Quelques bateaux de pêche, remorqueurs de chaluts, ont été réquisitionnés mais les résultats ont été mitigés.
Notre système de récupération en pleine mer n'a pas fait la preuve d'une efficacité satisfaisante. Notre système de lutte près des côtes a été lui aussi très handicapé par le mauvais temps, et ses performances se sont révélées décevantes vis-à-vis du produit échappé des cuves de l'Erika. Lorsque la météo est redevenue bonne, au début de l'année 2000, il était trop tard. On peut sûrement, avec ce matériel, répandre des dispersants et sans doute pomper un fioul pas trop lourd ; mais on ne peut sûrement pas ramasser des boulettes compactes.
Il a été très difficile d'établir une coordination avec les très nombreuses autorités terrestres concernées. Un officier de liaison a été placé auprès des préfets coordinateurs. Un PC POLMAR a été installé à La Rochelle et un autre à Saint-Nazaire. Mais sans doute aurait-il fallu faire davantage.
J'en arrive à ma conclusion. Nous devons réviser notre jugement. À l'expérience le ramassage à terre de produits polluants est encore plus difficile, plus agressif pour l'environnement, plus aléatoire, et sans doute plus coûteux que le ramassage à la mer que l'on croyait impossible.
Nous avons prouvé, certes bien imparfaitement, qu'il était possible de ramasser des nappes de pétrole en mer, et nous avons bien mis en évidence l'importance de pouvoir les ramasser dans les délais les plus courts, avant qu'elles ne soient fragmentées, voire immergées. Nous avons besoin d'un bâtiment spécialisé, qui soit disponible sans délai et qui puisse travailler dans des conditions météorologiques très dures, face aux produits les plus difficiles.
Mesdames et Messieurs les parlementaires, j'arrive à la fin de mon exposé, et avant de me livrer à vos questions je vous propose une courte synthèse de ces différentes réflexions.
L'organisation de la sécurité maritime et des secours en mer fonctionne. Sans doute faut-il encore étendre son efficacité aux zones qui nous paraissaient moins vulnérables et plus éloignées de nos eaux territoriales.
Pour la première fois, une aide européenne a pu être sollicitée et les bâtiments ont obtenu des résultats inégalés jusqu'alors en matière de pompage à la mer. L'accident de l'Erika est là pour nous rappeler que le « risque zéro » n'existe pas et n'existera jamais !
Diminuer le nombre de bateaux hors normes au large des côtes françaises ne peut que diminuer le risque d'accidents. Par l'étendue de la pollution qu'elle risque d'engendrer, la menace représentée par une nappe d'hydrocarbures répandue au large est au moins aussi grave que celle d'une pollution beaucoup plus importante dont l'origine se situerait plus près de la côte. Il faut la combattre dès son apparition.
L'instruction POLMAR n'avait pas prévu que cinq départements pourraient être simultanément concernés par une pollution venant de la mer. Il était difficile de s'adapter dans l'urgence à ce cas extrême. L'ensemble que constituent les professionnels de la mer et les Affaires maritimes pourrait devenir l'interface dont nous avons besoin entre la mer et la terre. Il y a là une opportunité que nous devons organiser pour l'avenir.
M. le Rapporteur : Je vous remercie de votre exposé. Comme certains d'entre nous iront bientôt vous voir à Brest, l'occasion leur sera donc fournie de vous faire part de leurs interrogations.
Afin de faciliter l'intervention de mes collègues qui ne pourront pas se déplacer à Brest, je me limiterai aujourd'hui à quelques questions.
Pour revenir sur l'accident lui-même, si d'aventure le message de détresse avait été maintenu, vous auriez été inévitablement amené à intervenir le 11 décembre. Qu'auriez-vous fait ? Une intervention aurait-elle pu sauver l'Erika ?
Par ailleurs, avez-vous eu à déplorer, à un moment donné du naufrage, un manque de moyens d'intervention ; et si oui desquels ? On nous a dit qu'il manquait un hélicoptère ; avez-vous manqué de moyens d'intervention une fois le processus de sauvetage engagé ?
Vous avez déclaré tout à l'heure que nous ne savions pas traiter le pétrole en mer, et vous avez conclu en disant que la seule solution était de traiter le pétrole en mer. Cette contradiction suscite plusieurs interrogations : savez-vous pourquoi l'on ne sait pas traiter le pétrole en mer ; qui n'a pas fait ce travail ; pourquoi n'avons-nous pas réfléchi à cela ? Si l'on doit s'engager dans une démarche privilégiant le pompage en mer des produits polluants, quelles sont les mesures à prendre ? Vous avez évoqué le cas du navire néerlandais spécialisé, mais ce type de bateau suffit-il ? De même, s'il est désormais possible de lutter efficacement en mer contre les pollutions, comment expliquer les carences constatées tant dans les méthodes que dans les moyens mis en _uvre par la France ?
Enfin, qui vous donnait les ordres pendant la crise ? Est-ce que vous avez vous-même pris des décisions ? Avez-vous dû en référer à quelqu'un, et si oui à qui ? Est-ce au secrétaire général de la mer, est-ce au Cabinet du Premier ministre, est-ce au ministre de la Défense, ou à d'autres ? Avez-vous eu des problèmes pour faire exécuter vos ordres par les différentes administrations qui sont sous votre responsabilité, en tant que préfet maritime ?
M. Yves NAQUET-RADIGUET : Je voudrais insister sur un point. L'Erika
était, au moment du premier message de détresse, presque au milieu du golfe de Gascogne, soit en limite de portée des hélicoptères de sauvetage.
La première réaction que nous avons eue quand nous avons reçu ce message de détresse était de se dire : il faut que ce bateau se retourne pour se rapprocher de la Bretagne. Très vite, le problème a été résolu puisque le capitaine du pétrolier a annulé ce message de détresse et que le bateau est reparti cap au sud.
Qu'aurais-je fait si ce message de détresse n'avait pas été annulé ? J'aurais fait changer de cap le bateau pour le rapprocher des côtes et j'aurais très vite envoyé une équipe d'évaluation sur le navire. A ce moment-là, mon idée était de sauver l'équipage avant tout. J'aurais donc organisé le sauvetage de l'équipage. Je précise qu'une équipe d'évaluation n'est pas composée de spécialistes : c'est une équipe de mécaniciens appelés à aller voir en mer un bateau en panne, ou à préparer un éventuel remorquage. Ce ne sont pas des inspecteurs de coque ni des spécialistes des structures de navires.
Si je m'étais rendu compte de la gravité des événements et que le pétrolier avait commencé à s'ouvrir, il n'aurait pas été question de le remorquer. Je pense que je lui aurais demandé de se mettre mer de l'arrière pour qu'il soit moins sollicité, de ralentir car il allait trop vite, et je l'aurais mis en demeure de rejoindre un port d'accueil. S'il m'avait demandé du secours, c'est qu'il se serait trouvé en réelle difficulté : j'aurais donc essayé de le diriger vers un port refuge, en l'occurrence Saint-Nazaire.
A partir du moment où il n'était plus nécessaire de sauver l'équipage, il a fait ce que je lui aurais fait faire.
M. le Président : Votre intervention aurait tout de même accéléré le processus.
M. Yves NAQUET-RADIGUET : Peut-être, Monsieur le Président. Il s'écoule en effet 2 heures entre le message de détresse et l'annulation du message « PAN »,
deux heures de décalage avec cette alerte qu'il a reprise après. Il nous a annoncé vers 17 heures qu'il rejoignait un port refuge, à savoir Donges.
Je pense vraiment que je n'avais pas d'autres moyens que de lui dire de prendre la mer le mieux possible. Pour nous, marins militaires, la mer en travers de l'arrière est une mer qui roule mais qui ne sollicite pas trop les bateaux. En tout cas, il est sûr qu'il allait trop vite, mer de l'avant, et je pense que ma première réaction aurait été de le faire changer de route. Il recevait la mer pratiquement par 30 ou 40 degrés tribord sur l'avant et il prenait des chocs forts sur l'avant. Je l'aurais donc fait se dérouter pour qu'il subisse des chocs moins forts sur sa coque.
Ai-je manqué de moyens d'intervention ? Franchement non, car j'étais certes en limite mais en portée de l'hélicoptère
Super Frelon, à 150 ou 160 nautiques, c'est-à-dire la portée maximale. Nous envisagions, surtout s'il y avait 25 ou 30 personnes à sauver, que le sauvetage prenne un peu de temps. C'est pour cela que l'une des premières réactions du COM a été de dire qu'il fallait que l'Erika
se retourne pour se rapprocher des côtes. En effet, l'équipage de l'hélicoptère était en alerte à une heure et il y avait une bonne heure de trajet, ce qui faisait donc un délai de 2 heures avant de parvenir au pétrolier. S'il avait pu se retourner, l'hélicoptère aurait gagné 20 nautiques de trajet, ce qui était très important.
Au cours de l'intervention elle-même je n'ai pas manqué de moyens. Une fois de plus nous avons eu une très grande malchance avec cette avarie. Les moyens d'alerte ont décollé dans les temps prévus. Nous avions pris la décision, à partir de midi le samedi, de mettre les moyens en alerte à une heure, car il y avait très mauvais temps. Dans ces conditions, nous diminuions les temps d'alerte. L'équipage de l'Atlantique
était sur la base, ainsi que celui du Super Frelon.
Le Super Frelon a décollé après qu'un
Atlantique, qui est un avion de patrouille maritime, soit sur la verticale du bateau pour guider le
Super Frelon. A partir de là le sauvetage a commencé, car il fallait évacuer le bateau. Or, une panne de treuil s'est produite, ce qui est extrêmement rare, alors que le plongeur avait été mis sur le bateau et que 5 naufragés avaient été récupérés.
Nous avons alors renvoyé l'hélicoptère à Lanvéoc et nous avons demandé à la base de Lanvéoc de préparer un deuxième hélicoptère. Il y avait un deuxième
Super Frelon, mais il n'était pas disponible. A 6 heures du matin, la base a réussi à rendre disponible ce deuxième hélicoptère. C'est le même équipage qui est reparti avec un autre plongeur.
Pendant que l'on faisait ce changement d'hélicoptère, nous avions fait décoller un hélicoptère
Lynx, plus petit, qui a pu récupérer 6 personnes qu'il a déposées à Saint-Guénolé avant de se reposer à Lanvéoc.
Nous avions mis en alerte l'hélicoptère de La Rochelle, un
Dauphin qui est un excellent hélicoptère. Il a décollé dans les délais prévus, mais nous l'avons arrêté car nous avons vu qu'il était nécessaire qu'il commence par faire le plein à Lann Bihoué, ce qui constituait une perte de temps trop importante. Au moment où le premier hélicoptère a commencé à faire demi-tour à cause de sa panne, nous avons, selon les accords Manche plan, demandé aux Britanniques la mise en alerte et le décollage de 2 hélicoptères
Sea King. Ces 2 hélicoptères sont arrivés sur zone à peu près en même temps que le
Super Frelon. C'est le Super Frelon qui a fait le sauvetage, et les photos que nous avons vues à la télévision ont été prises par un
Sea King.
Comme il y avait entre 55 et 60 noeuds de vent, nous n'étions pas sûr de réussir l'hélitreuillage. Nous avons donc fait appareiller deux vedettes de la Société nationale de sauvetage en mer. Elles étaient presque arrivées jusqu'aux épaves au moment où le sauvetage était fini. Franchement, je ne crois pas avoir manqué de moyens pour le sauvetage.
Je vous l'ai dit tout à l'heure et il s'agit vraiment d'une conviction largement partagée : on ne sait pas ramasser une nappe de pétrole en mer. Pourquoi ? Parce que l'on se rend compte que le confinement de cette nappe est un problème, notamment par mauvais temps ; or, lorsqu'un accident arrive, il fait mauvais. Pour récupérer une nappe de fioul en mer, il faut la confiner, ce qui suppose la mise en place de barrages qui ne tiennent pas par mauvais temps en pleine mer. Nous avons essayé cette fois-ci et nous avons eu de gros déboires avec nos barrages.
En revanche, il existe maintenant une méthode. Les bateaux qui l'ont utilisée étaient très récents : le bateau allemand était neuf - c'était la première fois qu'il sortait - et le bateau hollandais avait un an. Le grand changement par rapport à nos méthodes est ce que l'on appelle le
Sweeping arm, c'est-à-dire un bras qui confine le pétrole, que l'on arrive alors à concentrer et à pomper. Ne disposant pas du matériel adapté à cette technique, nous ne pouvions pas la mettre en _uvre.
Nous nous étions effectivement focalisés sur le plus probable, c'est-à-dire l'accident en mer, notamment la collision traversière avec un autre bateau, ayant pour effet de provoquer l'ouverture de la soute d'un pétrolier. Dans un tel cas de figure, le problème est de confiner la cargaison échappée des cuves avec des barrages et de la pomper. On se met alors sous le vent et cela devient plus facile. Autrement dit, nous étions dans l'idée que l'on ne savait pas ramasser à la mer.
M. le Rapporteur : Etait-ce un postulat de départ ?
M. Yves NAQUET-RADIGUET : Absolument, c'était trop difficile. Les moyens étant limités, on a fait une optimisation afin que les moyens dont nous disposons soient les plus efficaces possible, dans le maximum de cas. Honnêtement, nous nous sommes trouvés confrontés au cas le pire, ce fioul numéro 2 dont personne ne peut se sortir, avec un très mauvais temps pendant 3 semaines, et des courants très forts.
Par ailleurs, l'une des solutions les plus faciles pour essayer de combattre une nappe à la mer s'appuie sur les dispersants. Nous savons les utiliser, mais nous ne pouvons pas le faire sur d'énormes quantités. De plus, les dispersants n'étaient pas efficaces sur le fioul numéro 2. J'ai beaucoup entendu dire que nos matériels n'étaient pas bons. Ils n'étaient tout simplement pas adaptés au problème.
Illustrons ce point, si vous le voulez bien, par l'affaire de ces fameux
Transrec.
Nous avons démarré avec les deux bâtiments de la Marine aux capacités les plus importantes, l'Alcyon
et l'Ailette, pour être schématique, avec 2 gros aspirateurs qui étaient censés pouvoir aspirer 250 mètres cubes à l'heure. Leur tête est plongée dans la nappe. Plus la nappe est confinée, plus leur action est efficace. Le résidu aspiré est alors stocké dans les soutes du bateau. Cette technique s'était révélée très efficace.
À titre d'exemple, j'y ai eu recours l'année dernière pour engager le pompage d'un bateau qui s'appelle le
Peter Siff et cela a donné de bons résultats. Ce système avait également été mis en _uvre par la France à l'étranger pour le
Sea Empress qui avait coulé dans un port anglais en 1997. Au moment du naufrage de l'Erika,
ce système nous paraissait être de loin le système le plus puissant.
Lorsqu'on a commencé à répertorier les bateaux qui pouvaient nous aider, j'ai décidé de ne pas recourir à un bateau norvégien privé dont la prestation coûtait extrêmement cher avant d'avoir vérifié qu'il était adapté à la situation. Dans l'équipe de mon PC POLMAR, il y avait des représentants du FIPOL qui estimaient son coût trop élevé. Ce bateau avait le même système que le
Transrec. C'est pourquoi j'avais besoin de connaître au préalable l'efficacité du système
Transrec, sous peine d'engager des dépenses avoisinant 650 000 francs par jour alors même que le FIPOL nous disait que ce n'était pas raisonnable. Si j'avais eu la certitude que ce gros bateau pourrait être efficace, nous y aurions eu recours.
C'est beaucoup pour cette raison que j'ai voulu tester les
Transrec. Certains de mes experts pensaient que cela pouvait marcher. Dès que l'on a vu que cela ne fonctionnait pas parce que le produit était trop visqueux, nous avons changé de matériel. Nous disposons d'un équipement que nous venions d'acheter, le
Foilex, dont le débit est beaucoup plus faible puisque qu'il est donné pour 80 mètres cubes/heure, alors que l'autre faisait 250 mètres cubes. Ce système
Foilex a fonctionné, en pompant directement dans la nappe sans pour autant la confiner.
L'expérience montre donc que le matériel est capable de pomper des polluants en mer. Certes, en France nous nous en tenions aux méthodes d'allégement des bateaux, de confinement d'un pétrolier présentant des fuites ; mais les bateaux équipés du
Sweeping harm sont très récents. Je pense tout de même que les systèmes français n'étaient pas suffisants. Donnés pour 80 mètres cubes/heure, ils ont seulement pompé quelques mètres cubes/heure à cause de la nature très dense de ce fioul numéro 2 qui bouche les tuyaux.
Qui m'a donné des ordres ? J'ai été très vite directement en liaison avec le Cabinet du Premier ministre. J'ai eu des contacts bi-quotidiens avec son Cabinet. Par ailleurs, mes adjoints ont pris contact avec le secrétaire général de la mer pour établir une liaison avec les Européens.
Toutefois, c'est M. Barisich, détaché de la direction de l'Environnement de la Commission européenne au sein du PC POLMAR, qui a favorisé une rapide mise à disposition des moyens des Etats-membres de la Communauté.
J'ai dirigé seul le début de la lutte, notamment la première partie de la lutte en mer. Même s'il s'agissait d'un combat que l'on savait très difficile, on se disait qu'il fallait le faire et que ce n'était pas parce qu'un mois auparavant on avait dit que l'on ne saurait pas le faire qu'il ne fallait rien tenter alors que nous avions 8 jours devant nous. Nous avons essayé, avec des résultats qui ne sont pas excellents. Pomper 1 100 mètres cubes ce n'est pas énorme, mais ce sont 11 000 ou 15 000 mètres cubes de déchets qui ne sont pas à ramasser maintenant. Surtout, pour la première fois, on ne peut plus dire que l'on ne sait pas le faire. Le premier jour où l'on a commencé à pomper, on a récupéré 50 mètres cubes. Je vous passe les sarcasmes de certains médias. Pourtant, nous étions ravis car nous avions administré la preuve que l'on peut y arriver.
J'insiste aussi sur le fait que nous avons disposé d'une fenêtre météo très courte pour nous permettre de pomper. Nous avons commencé avant même l'arrivée de l'Arca - dont je pense qu'il n'est pas idéal car il n'est pas assez gros - et des autres navires. Il faut pouvoir tenir par plus mauvais temps encore. Lorsque nous avons été obligés d'arrêter de pomper parce que la météo redevenait très mauvaise, il n'y avait plus de grande nappe en surface.
Peut-être aussi a-t-on, à ce moment précis, péché par optimisme en se disant qu'on avait pompé toutes les nappes. En réalité, il était déjà trop tard puisque beaucoup de nappes avaient disparu. Elles s'étaient morcelées et l'on a eu beaucoup de mal à les suivre.
Je crois que nous avons démontré qu'on ne doit plus se dire que l'on ne peut pas pomper des produits polluants à la mer. L'argumentation qui consistait à centrer notre dispositif et nos moyens sur le fait qu'il n'y aurait pas d'accidents, donc pas de nappe, et à affirmer - un peu cyniquement, j'en conviens - que l'on sait nettoyer les plages, n'est plus complètement pertinente. En fait, on faisait l'impasse sur la partie la plus difficile, en mer.
L'expérience me conduit à conclure qu'il est probablement plus difficile de ramasser des produits polluants à terre que de les ramasser à la mer, surtout dans les conditions actuelles de flux et de reflux.
M. François GOULARD : Je voudrais revenir sur les circonstances du naufrage ou plus exactement du premier appel de détresse lancé par l'Erika. Il a retiré son avis de détresse moins d'une demi-heure après l'avoir lancé.
À l'occasion de son mayday, il a transmis l'information selon laquelle il avait pris une gîte importante de 10 degrés. Or, la gîte est inquiétante pour un bâtiment de cette nature. Surtout l'explication de la prise de gîte d'un pétrolier est en principe une avarie assez sérieuse : il ne s'agit pas d'un déplacement comme dans un bâtiment qui transporterait des produits autres que des liquides ; cela ne peut venir a priori que de la rupture d'une cloison. On ne voit pas d'autre explication plausible à une prise de gîte importante et durable d'un pétrolier.
Malgré le retrait de l'avis de détresse de ce pétrolier, s'est-on organisé et les hommes ont-ils bien réagi face à cet événement ? Il est intéressant de savoir si la réaction de ceux qui ont entendu ce premier appel a été suffisante. Doit-on se contenter du retrait de l'avis de détresse du capitaine du bateau ? N'aurait-on pas pu en tirer la conclusion qu'il se passait quelque chose de grave et qu'il convenait de se renseigner davantage ? Ce n'est, naturellement, qu'une question.
Par ailleurs, concernant le repérage des nappes, vous avez dit lors de la réunion des élus concernés par le naufrage de l'Erika
à Matignon, en réponse à une question qui vous était posée par le Premier ministre, que vous ne saviez pas où étaient les nappes, ni si elles risquaient de toucher à nouveau nos côtes. Je m'interroge - mais je ne suis pas le seul - sur les moyens mis en _uvre et les capacités que l'on a à repérer des nappes de mazout à la mer, même partiellement immergées comme elles le sont, car des pilotes d'aéro-clubs nous disent qu'ils voient à peu près nettement ces nappes en mer, dans certaines conditions météorologiques.
Avez-vous utilisé tous les moyens de la Marine nationale, notamment les moyens sous-marins, qui auraient permis ou qui permettraient de repérer de telles nappes à la mer ? Il y a quand même un étonnement de la part du grand public face à l'incapacité dans laquelle vous avez déclaré être, de procéder à ce repérage.
Enfin, vous avez dit qu'après l'accident il y avait dans votre état-major un représentant du FIPOL, et que c'est sur les déclarations de ce représentant que vous aviez écarté le recours à un navire norvégien. J'aimerais savoir quels sont le statut et le rôle de ce représentant auprès de vous en cas de catastrophe.
M. Yves NAQUET-RADIGUET : Fallait-il se renseigner davantage ? Il me vient une hypothèse différente de celles que vous avez développées : celle de la fausse man_uvre. Lorsqu'un équipage se trompe en faisant un ballastage, le navire prend alors très vite de la gîte et le commandant s'inquiète. S'il reprend la man_uvre et que tout rentre dans l'ordre, il peut poursuivre sa route à une vitesse de 9 n_uds, indiquer aller à destination de Livourne et démentir son message de détresse en précisant que la situation est sous contrôle.
L'important est que le commandant nous ait remerciés de la rapidité avec laquelle nous avions réagi, car, dès l'émission du message de détresse, nous l'avons questionné. Il nous a dit être confronté à une gîte mais ne pas demander d'assistance immédiate. Une demi-heure après, il retirait son message de détresse après nous avoir remercié, précisant que la situation était sous contrôle, et que le navire poursuivait sa route en direction de Livourne. Nous avons plus pensé à la fausse man_uvre qu'au défaut de structure, notamment parce que dès qu'il y a eu la difficulté nous avons consulté le fichier SIRENAC. Le bateau avait un facteur 12, ce qui est une très bonne note ; ce n'était donc pas un bateau inquiétant pour nous. Evidemment, après coup, on peut se demander d'où vient ce 12.
Le seul à même de savoir ce qui se passe en mer sur un bateau est le commandant. Lorsque le commandant nous dit que tout va bien, je ne peux pas aller contre, d'autant que je ne dispose d'aucun moyen d'aller contre. A contrario, dans le dispositif de séparation du trafic d'Ouessant, le radar permet de voir le bateau qui s'arrête et qui commence à dériver. Si on le questionne, le commandant ne peut pas raconter d'histoires. De telles interventions se produisent plusieurs fois par jour. On demande à chaque fois ce qui se passe. En fonction des réponses du commandant, on décide de dépêcher sur zone l'Abeille Flandre. Si l'on se rend compte que le bateau continue à dériver, on le met en demeure. Mais l'Erika
nous ayant communiqué sa route et sa vitesse - il allait vers Livourne -, je ne pouvais pas lui dire qu'il représentait un danger pour les côtes françaises.
Le commandant ne nous a pas dit s'il avait vu les fissures mentionnées par le rapport provisoire du BEA/mer. Comme je l'ai dit à Monsieur le ministre, probablement aurions-nous réagi différemment si nous avions eu connaissance de ce paramètre, mais de toute façon nos moyens étaient limités pour intervenir. Nous nous sommes dit que le bateau avait eu un petit problème. Constatant qu'il était en train de regagner le Cap Finistère, nous avons prévenu le centre de secours espagnol de Madrid, en disant que l'Erika venait de nous signaler ce problème, mais nous n'avons pas du tout senti ce bateau en danger.
Je voudrais être très ferme sur ce que je vais dire car nous sommes là pour dire les choses : nous ne savons pas voir les nappes sous la mer, et si les pilotes d'aéro-clubs en sont capables, qu'ils nous les signalent, je ne demande que cela ! Certes, actuellement nous avons des sonars, et en matière de détection sous-marine nous n'avons de leçon à recevoir de personne. Cela va du sonar des frégates très modernes jusqu'aux sonars des petits bâtiments chasseurs de mines, en passant par des sonars multi-faisceaux des bâtiments hydrographiques, mais ces sonars ne sont pas faits pour détecter une nappe de pétrole. La question qui se pose est : où les envoyer ? Que l'on me dise où il y a une nappe sous-marine et je pourrai essayer de calibrer les sonars ! Lesquels marchent le mieux ? Je n'en sais rien. On ne voit pas sous l'eau, les pilotes d'aéro-clubs pas plus que les autres, ou alors par transparence. En dessous de quelques centimètres on ne voit pas, et certainement pas dans nos régions.
D'où vient ce qui arrive actuellement ? Qu'est-ce qui arrive encore ? On peut revenir sur l'action que je mène actuellement car vous avez posé cette question et je suis extrêmement touché par cela. Je pense, mais je peux me tromper car je n'ai pas de certitude, que c'est du flux et du reflux. En d'autres termes, il s'agit de ce qui n'a pas été ramassé : ce qui est arrivé une première fois, s'est alourdi avec du sable, a coulé - ce qui est la preuve que nous avons bien fait de ne pas couler les nappes comme certains nous l'avaient conseillé au début - et revient avec la marée ou le vent. Que faire contre cela ? C'est très près du bord et, avec les moyens de la Marine, je ne sais pas être efficace.
Il y a deux autres hypothèses. Cela peut provenir de l'épave qui fuirait. J'ai essayé de vous le dire, mais je sais qu'il est difficile de convaincre, quand bien même nous essayons de montrer les fuites à la télévision - et je suis prêt à les montrer à nouveau à ceux d'entre vous qui le souhaitent - : ce sont des fuites très peu importantes. On ne peut nier leur existence, mais cela se chiffre en litres, et non pas en tonnes. Ce n'est donc pas de cette origine que provient ce qui arrive sur les plages.
En outre il n'y a plus actuellement de fuites à proprement parler ; mais ne nous trompons pas, il y aura toujours des suintements qui remontent et qui font des irisations à la surface. Mettez un demi-litre d'essence dans la mer, vous verrez ce qui se passe. Je ne crois pas que ce qui arrive actuellement vienne de l'épave.
Cela dit, il faut le prouver parce que je peux me tromper. Aussi, j'ai fait revenir aujourd'hui l'Abeille Supporter avec le robot sous-marin qui va surveiller les épaves en permanence. Quand ce ne sera pas l'avant, ce sera l'arrière et vice-versa. Le dispositif sera prêt, le cas échéant, à boucher toute nouvelle fuite éventuelle.
Enfin, et c'est un essai car nous sommes désarmés face à ces nappes sous-marines, nous sommes en train de monter une noria qui va tourner en permanence autour de l'épave à quelques nautiques, soit une dizaine. Il s'agit de 3 bateaux, auxquels nous avons mis, une sorte de câblot blanc alourdi qui traîne jusqu'en bas, à 120 mètres de fond. Toutes les 2 heures on remonte, et on regarde si c'est toujours blanc. Depuis hier, le bout est toujours resté blanc. On va le faire sur une longue durée. Je crois que cela ne vient pas de l'épave, mais il faut faire attention et nous allons rester vigilants.
On a positionné également au-dessus de l'épave l'Ailette
qui est gréée en ramasseur de pollution. Mais ce qui sort actuellement de l'épave n'est pas de quantité suffisante pour être ramassé par les pompes de l'Ailette.
La dernière hypothèse réside dans l'extraordinaire dispersion dont nous n'avons pas su prendre la mesure : n'y a-t-il pas des nappes qui circulent encore en mer ? Là est la question.
M. le Rapporteur : Vous parlez des nappes initiales ?
M. Yves NAQUET-RADIGUET : Absolument, des nappes initiales. Hier, nous avons relancé une grande opération : 5 avions ont balayé le golfe de Gascogne du haut en bas et de l'est à l'ouest ; ils ont vu quelques petites choses mais rien d'important. Qu'est-ce que cela veut dire ? Y a-t-il des nappes initiales qui circulent encore en mer ou non ? Nous allons essayer de nous faire aider des pêcheurs, car ce sont eux qui sont peut-être une des clefs de notre organisation future en cas de catastrophe de ce genre. Certains nous signalent avoir ramassé des crabes avec des pattes noires. Encore faut-il qu'ils nous disent où ! De même, il faut que les pilotes d'avions, Monsieur le député, nous disent où ils voient les nappes. On s'y précipitera, on verra quels sont les sonars qui marchent bien, et on saura. Mais pour l'instant, je reconnais qu'on ne sait pas comment détecter une nappe de pétrole.
Les pêcheurs peuvent-ils le faire avec leur sonar à poissons ? Peut-être, je ne sais pas, mais il faut qu'il nous aident. Nous allons commencer une grande opération avec eux, mais ceux d'entre vous qui sont élus dans les départements côtiers le savent : nous avons la plus grande difficulté à ce qu'ils nous disent, déjà, qu'ils ont pris un crabe avec les pattes noires et, ensuite, où ils l'ont pris. On doit arriver à leur promettre l'anonymat total pour obtenir de précieux renseignements. Cela dit, nous avons quelques idées sur 3 ou 4 points et nous y avons actuellement déployé des chasseurs de mines, des plongeurs et des engins autopropulsés afin d'essayer de voir ces nappes. Néanmoins, je n'ai pas encore les résultats car l'opération a été enclenchée ce matin même.
Pour revenir sur la composition du PC POLMAR, je précise que le FIPOL n'avait pas de représentant. Par contre, l'International Tanker Owners Pollution Federation
(ITOPF), c'est-à-dire les assureurs, avaient dépêché des observateurs. Au PC POLMAR j'avais un délégué de la Compagnie Total, un représentant de l'ITOPF et de la Commission européenne et pratiquement un officier de liaison par pays participant à la lutte contre la pollution en mer, ainsi qu'en permanence, un représentant du CEDRE.
M. Gilbert LE BRIS : Essayons de tirer les conséquences de ce drame. Vous, préfet maritime, êtes dépositaire des responsabilités interministérielles qui vous sont confiées pour la sécurité en mer. Vous disposez pour cela des moyens traditionnels de la Marine nationale, avec sa polyvalence et l'intérêt que cela peut représenter, et des moyens civils. Vous avez mentionné d'ailleurs à quel point vous aviez trouvé dans l'Abeille Flandre
un allié utile, qui a notamment permis de faire que 2 millions de tonnes de pétrole, selon les chiffres que vous avez cités, ne souillent pas nos côtes durant ces dernières années. Sur la base de ces observations, j'ai trois questions à vous poser.
Ces bateaux, l'Abeille Flandre comme les autres, ont presque 20 ans. La technique a évolué depuis. Vous avez dit à un moment qu'ils étaient extrêmement puissants. C'est vrai, mais moins puissants que les bateaux que l'on fait maintenant, qui sont en liaison avec les plates-formes pétrolières, ou d'autres. Les risques aussi ont augmenté. Vous avez cité les boîtes des porte-conteneurs ; vous avez dit que le nord du golfe de Gascogne présentait une zone d'ombre dans la surveillance ; que là aussi il y avait des problèmes de rapidité. Par ailleurs, les navires à passagers se multiplient. Avez-vous l'impression qu'à l'heure actuelle l'on ait suffisamment de moyens et de capacités civiles d'intervention ? Faudrait-il une approche multinationale dans ce domaine ?
Ne serait-il pas utile d'identifier relativement clairement les moyens civils, à la fois dans la structure administrative et dans le budget qui leur serviraient ? A l'heure actuelle il y a une massification de l'ensemble des budgets et les priorités sont données au gré des volontés opérationnelles qui ne sont pas nécessairement toujours celles de la sécurité civile.
Enfin, vous avez abordé ce thème, une réflexion est-elle menée pour aller vers un effort accentué de surveillance et d'intervention, notamment par mauvais temps, non seulement dans les zones focales de danger - celle des abords d'Ouessant jusqu'au sortir du Pas-de-Calais entre autres -, mais aussi sans doute dans cette arrivée du golfe de Gascogne ? Quelles liaisons pourriez-vous avoir avec les autorités ibériques afin de permettre un suivi constant dans ce dernier secteur ?
M. Léonce DEPREZ : Vous avez déclaré que le « risque zéro » n'existe pas». On comprend bien ce que vous voulez dire, mais vous nous affirmez en même temps, vous qui avez la responsabilité de la solution à apporter, que « le cas du pétrolier qui s'ouvre en mer n'a pas été prévu ».
Je m'interroge et je vous interroge : comment, puisqu'il faut étudier tous les risques possibles, peut-on ne pas prévoir le cas d'un pétrolier qui s'ouvre en mer, alors que l'on sait que l'on autorise à tort des transporteurs très anciens à naviguer ? Comment pouvez-vous être surpris qu'un pétrolier s'ouvre en mer, alors que vous devez savoir que ces bateaux n'offrent plus la sécurité voulue ? J'avoue être étonné de votre remarque de non-prévision d'un cas qui apparaît, pour les profanes, assez banal. À partir du moment où circulent de vieux pétroliers qui ne sont peut-être pas suffisamment contrôlés, une pollution de la gravité de celle induite par le naufrage de l'Erika
peut se renouveler. D'ailleurs, vous nous l'avez laissé entendre en évoquant de nombreuses catastrophes évitées. Nous sommes sensibles à l'ardeur que vous mettez à défendre ceux qui vous entourent, cela dit, on se pose ces questions.
De même, j'ai du mal à comprendre pourquoi, comme vous l'avez dit, votre responsabilité se heurte à une certaine limite en mer. Comment les responsabilités s'interpénètrent-elles et se coordonnent-elles ? Qui est responsable au bout d'un certain moment, de l'évolution du problème ?
M. Edouard LANDRAIN : J'ai trois questions très courtes, militaires si j'ose dire.
Vous avez parlé des relations avec le port de Donges Saint-Nazaire. Il est né une certaine polémique sur les relations qu'ont pu avoir l'Erika, la préfecture maritime et le commandement du port. Pouvez-vous nous donner votre version de cette affaire, car la presse s'est fait largement l'écho d'incompréhensions pour ne pas dire plus ?
Vous avez dit que vous étiez dans l'incapacité de traiter le fioul en pleine mer tel qu'il se présentait. Si cela avait été une autre sorte de fioul, plus léger, la lutte contre la pollution en mer aurait-elle été plus performante ? Les systèmes qui étaient à votre disposition étaient-ils mieux adaptés à des fiouls de densité différente ?
La presse a fait état de sister-ships de l'Erika qui auraient eu des accidents comparables à celui qui nous intéresse aujourd'hui. Saviez-vous, ou avez-vous été mis au courant après, que ces bateaux présentaient une certaine dangerosité ?
M. Félix LEYZOUR : La marée noire que nous venons de connaître n'est pas la première. Je suis l'élu d'un département du nord de la Bretagne qui en a connu quelques-unes. Les accidents à la mer ne se déroulent jamais tout à fait de la même façon. Ils n'arrivent pas à la même distance des côtes, pas à la même distance des bases de départ des secours, pas dans les mêmes conditions météo et pas dans les mêmes conditions de mer. Mais dans la gestion de cette catastrophe, quels enseignements tirés des catastrophes précédentes vous ont été utiles dans les choix à faire au moment des interventions ? Quels sont les moyens dont on s'est doté depuis ces catastrophes majeures qui ont causé beaucoup de dégâts ?
Parallèlement à la mise en _uvre des moyens en mer pour essayer de ramasser le maximum de fioul, a-t-on dès le début incité à prendre rapidement des dispositions à la côte ? Malheureusement, quand il y a du fioul à la mer sous les vents d'ouest, il est toujours à prévoir que cela va arriver quelque part à la côte.
M. André ANGOT : A chaque fois qu'il y a un problème de pétrolier en mer, on nous dit que certains autres pétroliers en profitent pour faire des dégazages. Avez-vous pu repérer des dégazages illégaux en mer qui auraient pu venir ajouter un certain nombre de dégâts à ceux déjà causés par l'Erika ?
M. Paul DHAILLE : J'ai deux questions de portée générale. Vous nous avez dit qu'il y avait eu, au cours des 20 dernières années, environ 800 interventions pour avaries en mer, dont 200 majeures. Y a-t-il des statistiques du nombre d'avaries par nationalité de navires ? Quelles sont les natures de ces avaries ? Sur quels navires se produisent-elles plus régulièrement, est-ce sur des pétroliers, sur des porte-conteneurs ? A-t-on des statistiques annuelles du nombre et de la nature des avaries en fonction du type de navires sur lesquels elles se produisent ?
J'ai le sentiment que la situation de l'Erika était relativement habituelle, ce dont on peut être d'autant plus inquiet.
Par ailleurs, dans les zones industrielles à risque, à terre, il y a des plans particuliers d'intervention : en cas d'alerte, le directeur de l'usine perd très rapidement la direction des opérations au profit du préfet du département. Il semblerait qu'en mer le capitaine ait lancé un appel de détresse, puis qu'au bout d'une demi-heure il ait dit qu'il contrôlait la situation. Je comprends que l'on est en mer et pas à terre, et que le capitaine est seul maître à bord et seul juge de la situation, mais ne pensez-vous pas que, pour des navires transportant des matières dangereuses, dès le moment où il y a un appel de détresse, il faudrait que le capitaine perde la direction des opérations et qu'une procédure soit lancée, même si au bout d'une demi-heure les choses rentrent dans l'ordre ?
M. Jean de GAULLE : Il annule son appel 2 heures 17 minutes après.
M. Paul DHAILLE : Non, j'ai compris une demi-heure après en ce qui concerne le
mayday. Ne pourrait-il donc pas y avoir une procédure où il devrait confirmer, puisque l'on est en mer, que les choses vont bien ?
M. François CUILLANDRE : Vous avez parlé du rail d'Ouessant et de l'importance de ce système pour éviter des naufrages similaires à celui de l'Amoco-Cadiz ; celui-ci ne peut-il pas être amélioré ? Actuellement il y a 3 voies dans le rail, on a parlé d'un quatrième sens ; d'autres ont parlé de l'éloignement du rail par rapport à Ouessant ; on a également parlé d'une tour qui pourrait être mise en place à l'île de Sein : que pensez-vous de ces possibilités d'amélioration du système ?
Concernant le financement des moyens, Gilbert Le Bris évoquait l'âge avancé de l'Abeille Flandre : qu'en est-il de ses perspectives de remplacement ? Il y a eu dans les mois passés une série de polémiques suite à la fermeture programmée de Radio Conquet ; les CROSS ont-ils les moyens suffisants pour assurer leur mission, avec en filigrane le problème de la suppression du Service national ?
Par ailleurs, vous avez évoqué d'autres dangers que les pollutions par hydrocarbures, notamment les dangers venant des porte-conteneurs. Il y a aussi les pollutions des fûts toxiques qui naviguent en pontée sur les navires : dans des circonstances de tempête, ils passent facilement à la mer, séjournent un certain temps dans l'eau, et on ne connaît pas leur contenu.
M. Yves NAQUET-RADIGUET : Honnêtement, nous sommes actuellement satisfaits des
Abeilles. Je vous parle en employeur avec les nuances que cela implique par rapport au sentiment de l'équipage. Je dis que les
Abeilles d'aujourd'hui nous donnent plutôt satisfaction. Mais il est vrai que le remorquage de l'Erika, certes dans des conditions épouvantables, mais alors que le pétrolier contenait 30 000 tonnes, a placé l'Abeille Flandre
en limite de puissance.
Par ailleurs, quand l'Abeille a quitté Ouessant pour rejoindre l'Erika, il a eu la chance de développer sa vitesse maximale de 15 noeuds, soit 30 kilomètres/heure à peine, ce qui n'est pas beaucoup. Des remorqueurs plus puissants, plus rapides seraient probablement les bienvenus, mais nos remorqueurs, je parle surtout pour l'Abeille Flandre, naviguent relativement peu et sont, malgré leur âge de 20 ans, en très bon état - d'autant plus qu'ils sont bien entretenus. Je crois qu'il faut réfléchir à l'emploi de remorqueurs plus puissants et plus rapides. Quant aux propositions de porte-hélicoptères, d'hôpital qui nous ont été faites, j'avoue que je n'en éprouve pas le besoin.
En ce qui concerne le budget, même si j'ai passé quelques années à l'état-major de la Marine, je ne répondrai certainement pas à sa place. Je vous propose donc de lui poser directement la question.
Le suivi constant du trafic est à l'étude et en cours de réalisation. L'idée est que tous les centres de contrôle et de surveillance du Cap Finistère jusqu'à Jobourg, en passant par le dispositif de séparation du trafic d'Ouessant et les Casquets, soient reliés en réseau par ordinateurs. C'est en cours ; c'est l'affaire de quelques années.
M. le Président : De quelques années ?
M. Yves NAQUET-RADIGUET : Oui, de quelques années. J'ajoute que nous travaillons avec les Espagnols. Incontestablement, cela va se faire à l'horizon d'un petit nombre d'années.
M. le Président : Quels pays cela concerne-t-il ?
M. Yves NAQUET-RADIGUET : Cela concerne les Espagnols, les Français, et probablement les Belges et les Britanniques.
M. le Président : De combien d'années s'agit-il ?
M. Yves NAQUET-RADIGUET : Je pense que c'est peu d'années. C'est en cours. On est en train d'étudier cette question. On réalise petit à petit des choses. Il s'agit d'avoir des radars, notamment pour les dispositifs d'Ouessant et du Cap Finistère. Il s'agit également de relier entre eux des ordinateurs, et on sait le faire.
M. le Président : C'est la mise en place d'un dispositif européen ?
M. Yves NAQUET-RADIGUET : Tout à fait.
M. le Président : Cela pourrait-il compléter les accords de Bonn de 1994 ?
M. Yves NAQUET-RADIGUET : Je n'ai pas vraiment la réponse à votre question, mais je crois que oui. Actuellement, la France est partie au Manche plan qui est un accord de secours conclu avec les Britanniques. Favorisant une organisation des secours, cet accord nous a permis de bénéficier rapidement de l'aide britannique, en hélicoptères notamment, lors du naufrage de l'Erika.
De la même façon, le Biscaye plan, élaboré en 1999 entre la France et l'Espagne, conduit à une organisation du même ordre. Il y a également été fait appel lors du naufrage de l'Erika.
Ces plans convergent dans leurs principes et leurs objectifs. Nous nous orientons vers une liaison des différents centres de contrôle du trafic dans les dispositifs de séparation.
Comment ne pas avoir prévu le cas du pétrolier qui s'ouvre ? Vous avez raison, M. le Député, les cas ne sont pas rares. Vous avez d'ailleurs pu constater que 8 jours après l'Erika un pétrolier s'est ouvert en deux devant Istanbul, dans le détroit du Bosphore.
Malgré tout, avec des moyens un peu limités, nous avons été obligés d'optimiser notre système, c'est-à-dire de prévenir les accidents là où c'est le plus dangereux. La pointe de Bretagne est une zone maritime très exposée.
Si l'on en juge d'après les principales interventions de l'Abeille au cours des dernières années, c'est là où l'essentiel des problèmes maritimes sont constatés. C'est donc à cet endroit que l'on a concentré nos moyens d'intervention, et si quelque chose se passe très loin du côté de Penmarc'h, le dispositif s'avère moins étoffé. Il a fallu que l'on optimise nos moyens et lorsque l'on optimise, on ne peut pas tout faire. Nous avons essayé de nous préparer à ce qui a le maximum de chances de se produire.
Je crois que rien n'empêcherait un autre
Erika. Le vrai changement est là : nous pouvons nous retrouver avec une nappe de pétrole à l'eau et nous devons d'autant plus pouvoir la pomper que nous avons fait la preuve que nous pouvons le faire. C'est l'un des grands enseignements de cette crise. Nous ne pouvons plus nous contenter de cette espèce d'impasse, car on a conscience de la gravité des conséquences de nos choix et l'on se rend compte qu'on pourrait arriver à pomper. On n'a plus le droit de ne pas essayer de pomper une nappe à la mer.
L'interface entre la terre et la mer, est assez peu évoquée par le plan POLMAR. Là encore, il faut bien voir les choses. POLMAR prévoit le rapport d'un préfet maritime et d'un préfet. L'année dernière, j'ai mené un exercice à Trébeurden à la frontière des départements du Finistère et des Côtes d'Armor pour mettre en _uvre un PC POLMAR armé par 2 préfets. Nous considérions que c'était déjà une performance. On peut donc dire que le naufrage de l'Erika
nous a placés dans des conditions très difficiles. C'est pourquoi nous devons réfléchir à cette interface entre l'ensemble des professionnels de la mer et les Affaires maritimes. Cette interface nous aurait été utile dans la lutte contre la pollution de l'Erika. Or, nous n'avons probablement pas suffisamment su la mettre en _uvre cette fois-ci, vous avez raison.
Les relations entre la préfecture maritime et le port de Donges-Saint-Nazaire sont restées relativement succinctes lors de la gestion des difficultés rencontrées par l'Erika. Alors que nous étions dans la soirée en train de régler le problème du
Maria K qui dérivait à l'entrée de Saint-Nazaire, après l'avoir mis en demeure d'appeler un remorqueur. Le capitaine du port a déclaré, au détour d'une conversation téléphonique avec le CROSS au sujet du
Maria K, que si l'Erika avait des fuites, il ne le recueillerait pas. C'était la première fois que nous entendions parler de fuites. Constatant que le CROSS ne disposait pas des mêmes éléments d'appréciation de la situation, le capitaine du port de Donges a indiqué interroger le bateau tout en précisant que s'il s'avérait qu'il présentait des fuites, il l'empêcherait de rentrer dans le port.
Je n'ai jamais eu connaissance du résultat de cette démarche. Je ne sais pas si le commandant du port a interrogé ce bateau, s'il lui a donné un ordre, s'il l'a prévenu directement ou par l'intermédiaire de son armateur qu'il n'aurait pas le droit de rentrer. Ce dont je suis sûr c'est que, au moment de l'accident, l'Erika allait à 9 noeuds vers Saint-Nazaire.
M. Bernard CAZENEUVE : Avait-il le droit de refuser ?
M. Yves NAQUET-RADIGUET : Tout à fait, le capitaine du port a le droit de refuser.
Si le fioul avait été plus léger, il se serait évaporé et on aurait eu moins de difficultés qu'actuellement pour le récupérer tant en mer qu'à terre. Notre dispositif aurait sans conteste été plus performant. De surcroît, il aurait été plus facile de localiser le produit. S'agissant du fioul numéro 2, de l'Erika, entre le moment où un avion voyait quelque chose et celui où ralliait un bateau, il s'écoulait bien souvent une nuit entière : le lendemain le rendez-vous était raté. C'est l'énorme difficulté due au faible éclairement de cette période de l'année : il fait jour de 9 heures du matin à 17 heures. Si les conditions avaient été meilleures, je suis formel, nous aurions obtenu de meilleurs résultats.
Un sister-ship de l'Erika, le Santana III,
a récemment retenu l'attention. Autorisé à rentrer à Brest, mais pas dans le port, il n'avait plus le droit de sortir après inspection du Centre de sécurité des navires. Je l'ai lu dans la presse comme vous, mais je ne disposais d'aucun élément avant. Cependant, il s'agit là du domaine de la sécurité des navires qui concerne davantage la direction des affaires maritimes et des gens de mer au ministère des Transports.
Les enseignements tirés depuis l'Amoco-Cadiz
sont la mise en place du CROSS Corsen, celle du radar d'Ouessant et celle de la troisième voie rajoutée au dispositif de séparation du trafic qui existait avant. Cette troisième voie, décidée après le naufrage de l'Amoco-Cadiz, éloigne les pétroliers. Ainsi les pétroliers chargés qui montent du sud ont été repoussés aussi loin que possible de nos côtes, ce qui n'est pas sans provoquer une certaine gêne. C'est pourquoi beaucoup de demandes visent à simplifier à nouveau ce système. Je vous avoue qu'en tant que responsable de la sécurité dans ce dispositif, je ne suis pas très favorable au changement de sens. J'étudierai avec grande attention cette éventualité avec le ministère des Transports, mais je n'y suis pas favorable. Le problème est posé parce qu'un certain nombre de bateaux trouvent qu'on leur impose un détour pour passer dans ce dispositif, notamment les bateaux à passagers qui trouvent qu'on leur fait perdre une ou deux heures.
J'estimais que l'affaire était terminée depuis le 20 janvier, mais les arrivées successives de nappes de fioul me posent un problème à ce point aigu que j'ai réactivé les opérations POLMAR. Une opération « coup de poing » sur le rail, mettant en _uvre tous les avions de la Douane depuis 3 jours prend fin ce soir. Vous n'imaginez pas le nombre de dégazages qui ont été constatés ! Je précise que certains dégazages sont permis lorsque les navires se trouvent loin de la côte, à 150 nautiques de la côte. Cependant, je vous informe que, hier, 3 contrevenants ont été verbalisés par les douaniers. Pour l'anecdote, nous avons même eu l'impression que l'on nous demandait où était l'Erika pour venir dégazer dessus. Je n'en ai pas vraiment la preuve, mais j'en ai une certaine idée.
De mémoire, je ne saurai vous citer les statistiques concernant les avaries constatées sur les navires transportant des matières dangereuses ou polluantes. Toutefois, je dispose de ces statistiques dans mes dossiers. Tout au plus puis-je vous indiquer qu'il y a notamment beaucoup de pétroliers, de chalutiers, etc...
M. le Président : Je vous propose de nous les communiquer.
M. Yves NAQUET-RADIGUET : Tout à fait, je vous les enverrai.
Concernant les navires en détresse, pourrait-on lancer une procédure ? Il faut s'intéresser aux observations des CROSS. Le message de détresse est déclenché automatiquement : on appuie sur un bouton rouge et la position ainsi que la vitesse du navire sont précisées. A entendre les CROSS, il y a plusieurs centaines de messages de détresse par an. Beaucoup sont de fausses alertes : soit l'on a affaire à une panique, soit le bouton a été enfoncé par inadvertance. Dans le cas de l'Erika, nous avons demandé confirmation. Réception de notre message a été accusé par satellite, ce qui indiquait que le bateau naviguait encore à ce moment-là.
Pour en revenir au c_ur de la question, il me semble difficile d'imposer une procédure applicable dans les eaux internationales à un commandant attestant du bon comportement de son navire. Je ne mets en demeure que des bateaux qui représentent un danger immédiat pour nos côtes. Si l'on m'assure que tout va bien et que le navire repart à une vitesse de 9 n_uds, je ne vois pas bien quelle procédure faire jouer.
Les CROSS ont-ils des moyens suffisants ? L'un des grands changements du CROSS est la fin du service militaire. Beaucoup d'appelés et beaucoup d'officiers de la Marine marchande sous les drapeaux faisaient leur service dans les CROSS. C'est le ministère des Transports qui travaille sur cette question et qui engage des personnels civils pour faire face à cette situation nouvelle. Soixante postes ont été obtenus. Par ailleurs, nous-mêmes avons désarmé des sémaphores, libérant ainsi un vivier de personnels qualifiés susceptibles d'intégrer les CROSS. Si je ne vois pas d'énormes manques, je ne dirai sûrement pas que les CROSS sont pléthoriques.
M. Félix LEYZOUR : A-t-on suffisamment incité les gens à terre à se préparer au ramassage du fioul ?
M. Yves NAQUET-RADIGUET : Oui, mais malheureusement pas aux bons endroits. Je me suis déplacé avec le commissaire général Merle et avec d'autres personnes, avertissant qu'il fallait se préparer. Nous avons convoqué les pêcheurs. Nous avons également reçu des réponses très intéressantes de personnes de bonne volonté qui étaient prêtes à faire quelque chose. Malheureusement, le 24 décembre, le temps est redevenu mauvais et les petits bateaux n'ont pu effectuer des sorties. En outre, les hélicoptères ont été moins disponibles.
M. Louis GUEDON : Mon collègue Léonce Deprez avait posé une question à laquelle vous n'avez pas répondu. Vous avez dit que le « risque zéro » n'existe pas. Nous savons très bien que les drames de la mer ont, malheureusement, toujours existé et qu'ils existeront toujours. Nous comprenons bien que des navires connaîtront des naufrages.
Pour autant, lorsqu'il s'agit de navires qui transportent des cargaisons aussi dangereuses, mettant en péril l'économie de plusieurs départements au moins pour une année, peut-être pour plus longtemps - mais j'espère me tromper -, entendez-vous persister en disant que le « risque zéro » n'existe pas alors que vous nous avez expliqué que vous aviez le pouvoir de mettre en demeure le commandant ?
Vous avez évoqué les erreurs de manipulation, les fausses man_uvres dont on peut ne pas tenir compte dès lors que les inquiétudes sont apaisées par le commandant, mais de tels propos, quand on vous entend dire que le risque n'existe pas, attisent la colère de la population.
Votre propos englobe-t-il les navires d'une grande dangerosité ? Par ailleurs, pensez-vous, à la lumière des événements, que tous les bons choix aient été faits et les bons jugements portés, et que c'est sereinement que l'on puisse dire qu'il n'y avait pas autre chose à faire ?
M. Alain GOURIOU : La circulation maritime sur le rail est l'un de nos soucis majeurs. L'expérience montre que les côtes nord de la Bretagne ont déjà largement souffert d'accidents. Pensez-vous que pourrait être négocié ou mis en place un système avec nos voisins britanniques, qui consisterait, relativement à l'ouest du rail, à en interdire l'accès aux bateaux classés à risques ou aux bateaux notés de façon très négative sur la base de vos statistiques.
Par ailleurs, en cas de très mauvais temps dans la Manche, il me semble que nos moyens, quels qu'ils soient, sont relativement impuissants pour empêcher un navire en proie à des avaries graves de provoquer des drames. On voit que le rail dans une partie de son tracé a une largeur très faible, probablement de moins de 30 milles nautiques. Il semble, à cet endroit, que quelle que soit la rapidité des moyens d'intervention on ne puisse réellement pas empêcher le drame.
La solution n'est-elle pas à rechercher sur le plan international, afin d'éviter la navigation des navires, quel que soit leur pavillon, dont l'état est jugé réellement catastrophique, un peu comme on l'a fait pour la circulation routière en interdisant aux «poubelles» d'apparaître sur une route ?
Mme Jacqueline LAZARD : Je reviens sur le problème du dégazage. Vous avez parlé tout à l'heure d'opérations « coup de poing ». Lors de ces opérations, êtes-vous en mesure de savoir quels types de navires et quels pavillons sont en cause dans les infractions ?
Par ailleurs, vous avez dit au début de votre propos que les bateaux qui avaient une cargaison dangereuse devaient se signaler au CROSS lors du passage du rail. Cela dit, tous les navires sont-ils contrôlés lors du passage dans le rail ?
Enfin, vous n'avez pas répondu à la question posée par Monsieur François Cuillandre concernant l'intérêt qu'il y aurait à avoir un radar à l'île de Sein.
M. Jean-Michel MARCHAND : Je suis interloqué par deux informations que vous venez de nous donner et qui montrent les limites de nos moyens. Vous nous dites que personne n'a autorité sur un capitaine de port qui refuse de voir entrer un bateau.
M. le Rapporteur : Le directeur de port a autorité.
M. Jean-Michel MARCHAND : Lorsque le directeur de port décide de ne pas accepter un bateau, aucune autorité hiérarchiquement supérieure ne peut trancher ?
M. Yves NAQUET-RADIGUET : Si, le Premier ministre ou le ministre des Transports.
M. Jean-Michel MARCHAND : Mais personne n'a sollicité la décision du ministre des Transports dans le cas l'Erika, puisque ce bateau faisait route vers Donges alors que le commandant du port de Donges vous avait annoncé qu'il ne l'accepterait pas.
Vous venez de nous dire qu'au cours d'une communication téléphonique on vous annonce fortuitement que l'Erika aurait des fuites. Là encore, vous n'avez ni autorité, ni possibilité d'aller contrôler la véracité de cette information. Vous vous demandez si c'est bien fait par le commandant du port et vous n'obtenez pas de précisions sur ce point.
Je crois qu'il s'agit là de 2 éléments qui méritent que nous en tenions compte, non pas pour porter un jugement, mais pour modifier les moyens que nous aurions à mettre en _uvre dans des conditions identiques. Puisque des
sister-ships naviguent encore, il n'y a aucune raison que nous ne nous retrouvions pas dans la même situation à l'avenir.
M. Yves NAQUET-RADIGUET : Je suis désespéré de le dire, mais il serait irresponsable d'affirmer que le « risque zéro » n'existe pas. L'un des grands enseignements que je tire de cette crise est qu'il faut que nous sachions le traiter. Il m'apparaît plus grave de dire que le « risque zéro » n'existe pas et qu'il ne faut pas s'inquiéter. La fortune de mer existe et je crois qu'il faut que nous soyons capables d'y faire face. La réponse est là, le « risque zéro » n'existe pas et nous devons en tenir compte, ce que nous n'avons peut-être pas assez fait.
Le renvoi à l'ouest des bateaux à risques relève du domaine du droit international de la mer. Je pense que, s'ils s'entendent, les Européens ont beaucoup de possibilités pour au moins avoir du pouvoir sur les bateaux venant sur le continent, à l'image de ce qui se passe aux Etats-Unis.
Malheureusement, le problème ne se posera pas comme cela et je vais vous donner un exemple. Quel pouvoir aurons-nous sur un bateau qui part de Saint-Pétersbourg et qui va à Tanger, chargé de nitrate d'ammonium ? Cela dit, pourquoi pas, mais quel pouvoir et quel devoir aurons-nous vis-à-vis de lui s'il appelle au secours ?
C'est le cas du Junior M qui naviguait de Saint-Pétersbourg à Tanger. Il a été confronté à une grosse avarie et si nous ne l'avions pas récupéré il coulait en baie de Saint-Brieuc. Je veux bien que l'on maintienne les navires à risques à l'ouest, mais que fait-on quand ils appellent au secours ?
M. Alain GOURIOU : Même un bateau en excellent état peut avoir de graves difficultés. Il est de l'honneur de la Marine de venir en aide à un équipage en danger. Vous avez apporté une carte très éloquente sur les interventions effectuées par
Les Abeilles sur l'ouest de la Bretagne. Il est évident qu'il y a une prévention efficace, qui pourrait peut-être être renforcée dans le cadre d'un rapprochement entre les riverains de la Manche. Je pense que cette ouverture du rail est extrêmement périlleuse et nous réserve à coup sûr d'autres catastrophes. Quels que soient les moyens, on n'empêchera pas d'autres marées noires d'un bateau faisant naufrage entre Plymouth et la baie de Saint-Brieuc.
M. Yves NAQUET-RADIGUET : Je reconnais l'intérêt de votre proposition. L'endroit est très dangereux et si l'on peut arriver à éloigner les navires, c'est tant mieux. Je m'interroge toutefois sur la possibilité de le faire. Je souhaite qu'on le fasse. Quant à interdire le passage aux abords du Pas-de-Calais aux navires dangereux, cette proposition se heurte au droit international. Il faut que tous les Etats s'entendent. Il s'agit d'un sujet politique.
Pour en revenir au dégazage, l'opération coup de poing que j'ai mentionnée s'arrête cette nuit. Cela fait 3 jours que l'on maintient une permanence au-dessus du rail. Nous avons verbalisé au minimum 3 contrevenants, hier, dont nous avons les identités. Demain un rapport sera fait au Premier ministre, je pense que vous serez tenus au courant.
Il est très difficile de prendre quelqu'un sur le fait et de prouver sa responsabilité. Dans un dispositif de séparation du trafic, il est facile d'incriminer le bateau précédent. De plus, on dégaze le plus souvent de nuit de sorte qu'il est très délicat d'identifier le bateau fautif. Il faut réfléchir aux solutions à y apporter.
Le droit international fait obligation à tout bateau de se signaler aux CROSS
- ou équivalents - lorsqu'il entre dans un dispositif de séparation du trafic. Lorsqu'il transporte un produit dangereux ou polluant, il doit de surcroît indiquer la nature de sa cargaison. En ce cas, les CROSS y portent une attention toute particulière en contrôlant immédiatement son
target factor et en le suivant personnellement.
M. le Président : Tout bateau doit-il vraiment se signaler ?
M. Yves NAQUET-RADIGUET : Excusez-moi, j'ai fait un lapsus...
M. le Rapporteur : Si un porte-conteneurs lambda arrive devant Ouessant, il passe sans rien dire.
M. Yves NAQUET-RADIGUET : ... il a l'obligation d'être dans le bon sens, mais pour le reste j'ai fait un lapsus.
M. le Rapporteur : Excusez-moi, M. le Président, d'intervenir spontanément, mais je croyais bien me souvenir qu'en fait seuls les bateaux transportant des produits dangereux doivent se signaler en entrant dans le rail. Les autres entrent librement, même si les conteneurs sont mal ficelés et même s'ils transportent des produits dangereux.
M. Yves NAQUET-RADIGUET : Il existe tout de même un cas particulier : dans le Pas-de-Calais, où tout le monde se signale.
En ce qui concerne la mise en place d'un radar à l'île de Sein, pourquoi pas. Mais n'oubliez pas qu'un radar a une portée géométrique en fonction de sa hauteur. Vous contrôlerez réellement le trafic au large de l'île de Sein, si vous mettez une très grande tour comme celle d'Ouessant qui est à 70 mètres d'altitude. D'ailleurs, on a reporté cette fameuse voie supplémentaire montante, après le problème de l'Amoco-Cadiz, au plus loin que permettait le contrôle du radar. Je ne vois pas d'objection à la présence d'un autre radar sur l'île de Sein. Toutefois, il n'aurait pas permis de mieux suivre l'Erika.
J'ai évoqué le problème de l'autorité du port tout à l'heure. Je crois vraiment qu'il va être traité au prochain Comité interministériel de la mer. Je m'en réjouis parce que l'on se retrouve dans des positions impossibles. J'ai des exemples de bateaux à la remorque qui ont fini par couler parce que personne n'en voulait. Je souligne qu'il ne s'agit pas d'un problème français. Je comprends les réticences à accueillir des bateaux en mauvais état, susceptibles de rester le long d'un quai, de polluer ou d'être abandonnés. Cela me mettait toutefois dans une position très difficile. L'autorité compétente est le directeur des transports maritimes, des ports et du littoral, M. Gressier. C'est lui qui a fini par m'autoriser à placer le
Junior M dans le port de Brest. Je crois que le Premier ministre et le ministre des transports l'y avaient incité. Lui, trouve que c'est très dur. Pourquoi ne pas avoir immobilisé le
Junior M dans le port de Saint Brieuc ? Ce port l'avait refusé à cause de sa cargaison de nitrate d'ammonium et parce que le bateau présentait un état à tel point déplorable qu'il était en train de couler.
Dans le cas de l'Erika, nous découvrons le problème à 22 heures, heure à laquelle nous sommes informés que si l'Erika
a des fuites, le port lui refuse son accès. Le CROSS interroge alors l'Erika sur ce point précis. Des réponses rassurantes nous parviennent.
Deux messages relativement proches nous sont en effet envoyés. Le premier doit correspondre à l'obligation qu'a un bateau qui transporte des produits dangereux, qui s'approche à moins de 50 nautiques de nos côtes, de se signaler. C'est comme cela que nous recevons, vers 22 heures 50, un premier message un peu laconique qui fait état en substance, de fissures sur le pont et de la destination vers Donges.
Le second message est assez long. Il détaille ce qui s'est passé toute la journée et mentionne le problème rencontré, les fuites, les mesures de rétablissement du navire et la présence de fissures sur le pont principal bien que la coque semble intacte. Il indique également la destination de Donges et des mesures de surveillance permanente. Dans la nuit, nous avions décidé que, dès qu'il ferait jour, nous organiserions un vol d'Atlantique
pour repérer l'Erika, voir s'il y avait des fuites et prendre toute mesure conservatoire nécessaire. L'ayant interrogé à 3 heures 45 pour avoir sa position exacte, nous avons reçu un message aux termes duquel il était précisé que le navire faisait route vers Donges, cap au 95 avec une vitesse de 9 n_uds. On ne pouvait qu'en déduire qu'il n'avait pas de problème véritablement majeur. Si le capitaine de l'Erika
avait eu un sentiment contraire, il lui suffisait de nous avertir.
M. Edouard LANDRAIN : Vous nous avez parlé de radars de 70 mètres de haut avec des portées énormes. Vous ne nous avez pas parlé de la surveillance par satellites. On nous a dit, pendant la guerre du Golfe ou celle du Kosovo, qu'ils permettaient de lire une plaque minéralogique sur un véhicule. Pourquoi n'utilisez-vous pas les systèmes de navigation par satellites - GPS ou autres - pour contrôler les navires ?
M. Yves NAQUET-RADIGUET : Malheureusement, je ne suis pas un expert. Je crois qu'il est très difficile de surveiller un bateau à la mer avec un satellite. Un satellite défile ou bien il est fixe. Lorsqu'il est fixe, il est au-dessus de l'Equateur, et tourne à la même vitesse que celle de la Terre. On ne peut donc pas surveiller les mers de la France avec un équipement situé au-dessus de l'Equateur. Je crois sincèrement que surveiller la mer avec un satellite et trouver des bateaux n'est pas si facile que l'on pourrait le croire. Je suis d'accord, on peut lire des plaques minéralogiques grâce à des satellites. Mais les lit-on quand le véhicule est en mouvement ? Il est vrai que les satellites américains
Key Hole ont des pouvoirs séparateurs extraordinaires. Ce n'est pas pour cela qu'ils trouvent les bateaux à la mer. Il n'est pas si facile pour un satellite qui effectue plusieurs rotations de retrouver un bateau qui a bougé de son côté. Je sais qu'il y a des projets de surveillance de l'océan, notamment aux environs des ports. Je ne suis pas très compétent là-dessus, mais je ne crois pas que ce soit si évident. Cela viendra peut-être.
Audition de M. Christian SERRADJI,
directeur des affaires maritimes et des gens de mer
au ministère de l'Equipement, des transports et du logement,
accompagné de M. Pierre MITTON,
chef du bureau de contrôle des effectifs et des navires
(extrait du procès-verbal de la séance du 22 février 2000)
Présidence de M. Daniel PAUL, Président
MM. Christian Serradji et Pierre Mitton sont introduits.
M. le Président leur rappelle que les dispositions législatives relatives aux commissions d'enquête leur ont été communiquées. A l'invitation du Président, MM. Christian Serradji et Pierre Mitton prêtent serment.
M. Christian SERRADJI : Monsieur le Président, Madame et Messieurs les députés, c'est avec une certaine émotion que je viens devant une commission parlementaire pour un dossier de cette importance, d'autant que je suis en charge de la direction des Affaires maritimes et des gens de mer depuis 6 ans maintenant et que les problèmes auxquels nous avons été confrontés sont récurrents, à chaque débat parlementaire budgétaire. J'y reviendrai de façon constante.
Je pense qu'aujourd'hui je dois faire passer un certain nombre de messages forts, et je voudrais très simplement m'exprimer librement en homme responsable.
J'ai trois idées fortes à faire passer. Tout d'abord, en matière de sécurité maritime, l'action de la France ne peut se situer qu'au niveau international. Il n'y a pas de compétence nationale stricte qui soit indépendante du système international, et je crois qu'il est important de le dire.
Quatre acteurs internationaux jouent plus particulièrement un rôle majeur. Au premier rang d'entre eux se trouve l'OMI, qui est une institution spécialisée des Nations-Unies, avec 157 Etats-membres et un fonctionnement que je qualifierai d'efficace. Une trentaine de conventions ont été signées dans différents domaines par les membres de l'OMI. Je rappelle que ce sont les gouvernements qui prennent les décisions, et non pas l'OMI en tant que structure. Il faut un engagement conventionnel, donc contractuel, de chaque gouvernement, ce qui conduit dans le cadre de l'activité de l'OMI à la recherche du consensus maximum, ou d'un niveau minimum de désaccord. C'est pour cette raison qu'un certain nombre de résolutions ou de directives ont été prises par l'OMI dans un contexte que je qualifierai de long, très concertatif, et pas toujours très clair au moment des débats.
L'illustration type en est donnée par la convention STCW, signée en 1978. A peine était-elle ratifiée par tous les Etats-membres - mais non appliquée par la France en l'occurrence - , que cette STCW était, dès 1979, remise en cause pour déboucher sur la convention de 1995. Vous voyez le temps qu'il a fallu pour arriver à obtenir un accord !
Il me semble important d'apporter quelques précisions sur le parallèle parfois opéré entre l'OMI et l'OACI. Je crois nécessaire de rappeler les origines de ces deux organismes qui ne sont pas les mêmes et qui ne procèdent ni d'une même culture, ni du même objectif de départ. L'OMI est un club de grands pays marins d'origine anglo-saxonne, où il fait bon vivre et survivre. On monte à l'intérieur du système par ancienneté, et la France n'arrive jamais à obtenir des postes à responsabilité parce qu'elle n'y entretient pas de représentant permanent. C'est donc un club où il fait bon discuter, où l'on essaie des accords. Ce sont les pays les plus grands détenteurs de bateaux, c'est-à-dire les pavillons de complaisance qui ont progressivement pris le pouvoir au sein de l'OMI, ce qu'il est important de signaler.
Les décisions étant prises au sein de cette organisation internationale sur une base de consensus, les conventions y sont adoptées par petites touches successives et par programmation. Le concept de base de l'OMI est : « la liberté de naviguer d'abord ». Tout ce qui empêche cette liberté de navigation est proscrit, et ce n'est que par un « grignotage » progressif que l'on peut progressivement parvenir, par voie conventionnelle, à des réglementations applicables. Mais l'OMI ne contrôle pas leur application puisque ce sont les gouvernements qui s'engagent à appliquer les conventions qu'ils ont signées.
Il n'existe donc pas de système international de contrôle, à l'exception de la révision, en 1995, de la convention STCW, dans un contexte limité sur lequel je reviendrai si vous le souhaitez.
L'OACI procède de principes différents. Dès le départ, elle a été créée pour organiser et réglementer l'activité aérienne, laquelle faisait peur. Il fallait qu'un instrument qui volait atterrisse quelque part en faisant le moins de dégâts possible. Dès le début, l'OACI a été conçue et organisée avec la volonté absolue de parvenir à une réglementation contrôlée et contrôlable, ce qui n'est pas l'esprit de l'OMI.
Le deuxième acteur international d'importance auprès duquel nous pouvons intervenir est l'Union européenne, dont la compétence en matière de sécurité maritime est nouvelle. Ce n'est que dans le cadre du traité de Maastricht que l'on a développé une réflexion et une démarche en matière de sécurité du transport maritime.
Cet élément nouveau trouve sa base constructive en 1993, avec la communication de la Commission européenne intitulée « pour une politique commune » et qui met l'accent sur le principe de « quality shipping ». Cette politique initiée par M. Kinnock, ex-Commissaire européen en ce domaine, s'est traduite par la mise en _uvre d'une série de directives sur lesquelles nous pourrons vous fournir des éléments complémentaires.
Il est important de souligner quel rôle nous pouvons jouer par le biais de l'Europe. On peut en effet considérer que la Communauté européenne exerce une véritable compétence d'Etat du port, parce que les Etats membres s'organisent, harmonisent leur politique et la traduisent dans une directive qu'ils vont respecter et introduire dans leur cadre juridique national en tant qu'Etats du port.
C'est l'OMI qui organise l'Etat du pavillon. Là aussi, il y a une différence d'approche mais ce n'est pas gênant, parce que le plus important est la compétence de l'Etat du port. Dans le système du va-et-vient des bateaux, la compétence de l'Etat du port est une compétence forte, sur laquelle on peut jouer au maximum si l'on applique les normes et les règles qui ont été édictées par l'OMI, ce dernier point constituant un autre problème.
Le troisième acteur international de poids dans le secteur du transport maritime est l'AISM, association technique internationale sans but lucratif que la France a créée. Le siège en est à Saint-Germain en Laye. Il s'agit d'une association de signalisation maritime. Je rappelle qu'historiquement, la France était un des pays précurseurs dans ce domaine. Il est important de savoir que les technologies d'évolution du système des bouées doivent beaucoup à la France qui a mené une vraie politique en ce domaine. Troisième pays au monde dans ce secteur depuis des années, nous avons pourtant perdu toutes les responsabilités internationales, si ce n'est le siège de l'AISM qui est resté à Saint-Germain en Laye.
Les 200 membres de l'AISM proviennent de tous les pays. Il ne s'agit pas de gouvernants, mais d'acteurs de l'industrie maritime et de la signalisation maritime, qui élaborent bateaux et autres systèmes. Travaillant en étroite collaboration avec des instituts scientifiques énormes, ces membres sont à la base de toutes les évolutions technologiques modernes, à l'image du GPS et de toutes les techniques d'approche des navires qui sont un élément moderne de sécurité. Je reviendrai sur la question satellitaire.
Nous avons perdu un certain poids dans cette instance. Hélas, il en est advenu de même avec le Mémorandum de Paris dont nous avons été l'initiateur. Il s'agissait d'essayer de rendre les règles de l'OMI applicables par une organisation volontaire de 19 Etats, dont certains Etats du pavillon. Au lendemain du naufrage de
l'Amoco-Cadiz, la France a initié ce Mémorandum de Paris pour réglementer le système, tel qu'imaginé par l'OMI. Nous avons été très vite imités par le Mémorandum de Tokyo en 1993, et ensuite par les Mémorandums régionaux australien, africain, ou d'Amérique du sud. En mars 1998, la France a signé l'accord de Vancouver instaurant un lien entre les deux Mémorandums de Tokyo et de Paris, ce qui fera que dans environ 2 ans nous pourrons avoir des informations sur la totalité des navires en circulation.
Le Mémorandum de Paris instaure un contrôle harmonisé des navires qui font escale dans un port européen. Nous sommes dans le cadre de l'Etat du port. Nous sommes gestionnaires de la banque de données informatiques qui s'appelle SIRENAC, qui est gérée par l'un de mes services délocalisés, au centre administratif des Affaires maritimes de Saint-Malo. C'est à cause de cette expérience vécue que j'ai tenté, en avril 1998, de lancer EQUASIS sans moyens.
C'est dans le cadre du Mémorandum de Paris que les États signataires avaient pris comme objectif de contrôler au moins 25 % des navires s'arrêtant dans leurs ports. En faisant un calcul simple, les 19 pays européens contrôlant chacun 25 % des navires, l'ensemble des bateaux entrant dans les ports des Etats du Mémorandum doivent être contrôlés au moins une fois dans l'année. En effet, grâce à SIRENAC, tous les inspecteurs du port savent à quel moment a été contrôlé tel navire, et ce qui a été constaté. Dans le cas de l'Erika, nous savions que depuis 1996 il avait été contrôlé sept fois dans sept ports différents, dont aucun n'était français.
En France, environ 6 600 navires étrangers s'arrêtent dans nos ports. Environ 1 110 ont été inspectés en 1998 et 13,87 % en 1999, cette chute ayant été constante. J'y reviendrai. Voilà ce qu'est notre action au niveau international.
Le second message fort, que j'aimerais faire passer, ce soir, est que nous participons à des forums et que nous avons décidé de placer la dimension humaine au centre du dispositif d'une sécurité intégrée. C'est une démarche française assez constante, qui nous vaut d'être reconnus sur la scène internationale. Nous considérons effectivement que l'homme est partie prenante essentielle de toute politique de sécurité.
Quand on parle de l'OMI, des directives, et du Mémorandum de Paris, ce sont des normes techniques que l'on crée, que l'on invente. Je crois que l'on a fait le maximum, ce n'est pas la peine de chercher à faire plus en matière de normes. On peut améliorer des normes existantes ; on peut les peaufiner si on le souhaite. Mais dans un premier temps il faut que celles qui existent soient appliquées avec une certaine rigueur et une certaine constance.
Qu'est-ce que la France a fait pour cette dimension humaine ? Je voudrais que vous reteniez trois secteurs d'intervention majeurs.
Nous avons beaucoup travaillé sur la mise en place du code de gestion de la sécurité, c'est-à-dire le code ISM, qui met l'homme au coeur des enjeux de la sécurité, en éclairant son organisation, en déterminant les relations entre l'armateur et l'équipage parce qu'il y avait des ruptures totales entre les deux. On considère désormais que les marins, en tant que membres d'équipage mais aussi comme personnel d'encadrement, participent à la sécurité en travaillant sur le bateau et en ayant le sentiment que leur bateau est aussi leur instrument de travail. Ce sentiment les incite à veiller à sa valeur et à sa qualité normative.
Le deuxième élément sur lequel nous avons fortement travaillé est la convention STCW. Il est vrai que nous n'avons pas appliqué la convention STCW de 1978, parce que nous avions un concept « franco-français » dit de polyvalence. Ce concept était rejeté par tous les pays : c'est pourquoi la convention de 1978 parle de monovalence.
Les évolutions ultérieures et la qualité réputée de la formation française des marins ont fait qu'entre 1 200 et 1 500 marins français, tous secteurs confondus - exploitation et commandement - , travaillent sur des navires battant pavillon étranger. Je n'ai pas le chiffre précis - on est en train d'engager dans mon service toute une démarche d'enquête sur ce point - , mais on s'aperçoit que ces chiffres ne sont pas éloignés d'une certaine réalité. Je ne sais pas combien de capitaines, combien de marins sont concernés, mais on pourra vous fournir cela ultérieurement.
Jusqu'en 1995 nous avons défendu le concept de polyvalence. Nous avons été l'auteur du chapitre VII de la convention STCW de 1995 et nous constatons deux choses.
Tout d'abord, plusieurs pays parmi les plus opposés - notamment l'Allemagne et le Danemark - ont finalement rallié le concept de polyvalence. Le dossier qui a été déposé à l'OMI en août 1998 comporte des ressemblances assez fortes avec le dossier français. Par ailleurs, la France a ratifié STCW rapidement. Nous avons déposé notre dossier à la date voulue, c'est-à-dire le 1er août 1998 ; le décret français est sorti rapidement en mai 1999, et 25 arrêtés d'application ont été pris entre mai et octobre 1999.
Cela m'a conduit à engager une réforme des écoles de la Marine marchande, pas seulement dans la pédagogie mais dans l'organisation du système. Cela explique que parmi les propositions que l'on a pu faire, au niveau de l'Europe comme à celui de l'OMI, on a suggéré de créer un centre professionnel de sécurité maritime dans une des écoles de la Marine marchande.
Le troisième niveau où nous avons déployé une forte activité en faveur de la reconnaissance de la dimension humaine de la sécurité maritime est l'OIT. Lors de la dernière session maritime de l'OIT, c'est-à-dire en décembre 1996, la France a été le seul pays qui a eu le droit de parler au discours final pour défendre sa position sur les conventions OIT, créant un régime de durée du travail, une inspection du travail maritime, le repos compensateur et une série de conventions.
Pourquoi la France a-t-elle bénéficié de ce privilège ? Parce qu'en préparation à cette session, nous nous étions mis d'accord avec les deux collèges non gouvernementaux, c'est-à-dire les armateurs d'un côté et les syndicats de l'autre. Nous avons tenu le même langage dans toutes les commissions et dans tous les collèges, ce qui a fait que les propositions françaises ont été adoptées. Désormais, la France demande que ces conventions soient signées par les pays de la Communauté européenne, parce que c'est aller vers l'idée d'un certain niveau social, d'une harmonisation sociale de l'activité des marins sur les navires dits européens. Voilà ce que nous avons fait dans le domaine humain.
Un autre message important que je tiens à délivrer parce que la vérité m'y oblige, est que si la démarche que nous poursuivons se trouve accélérée par le naufrage de l'Erika, elle a été initiée dès 1997, sous l'impulsion de notre ministre actuel qui a fait de la sécurité dans le secteur des transports, notamment dans sa dimension maritime, l'une de ses priorités majeures.
Qu'est-ce qu'une priorité majeure ? Il faut que la France, dans les instances européennes, internationales mais aussi au regard de ses propres politiques internes, devienne un acteur permanent d'une sécurité renforcée.
Cela suppose, en premier lieu une plus grande coordination des actions. Nous avions une administration des Affaires maritimes qui travaillait « en kit », il y avait la direction de la flotte de commerce, la direction des ports, la direction des gens de mer, puis la pêche à côté.
La réforme de 1997 a regroupé sous la compétence de deux directions seulement la coordination des actions de l'Etat dans le secteur maritime. Tout ce qui touche au domaine économique relève désormais de la direction des transports, des ports et du littoral, sous l'autorité de Monsieur Gressier ; tout ce qui relève du régalien et de la vie des gens de mer est rattaché à la direction des Affaires maritimes et des gens de mer, dont j'ai la charge. Je m'occupe également du social et de la sécurité du secteur de la pêche qui, au titre économique, relève de la direction des pêches. Il y a donc une unité de responsabilité d'acteurs, ce qui facilite bien des choses.
Nous avons regroupé les responsabilités au niveau des services, de façon à rendre le système plus clair et plus fonctionnel autour du directeur départemental et du directeur régional, en supprimant le concept autonomiste des quartiers, que nous avons conservés mais avec une fonction différente.
En second lieu, nous avons également promu la collégialité dans les analyses et les décisions en matière de sécurité maritime. C'est un secteur très complexe, très diversifié, dont nous n'avons pas la maîtrise totale parce que l'essentiel se fait à l'étranger. Nous avons défendu une spécificité française dont nous présentons actuellement les avantages à d'autres pays : les commissions de sécurité.
Dans l'absolu, tout Etat du pavillon, peut effectivement, par le biais de ses inspecteurs, permettre à un bateau nouvellement construit ou réparé de naviguer après une inspection classique. Il peut aussi le faire par le biais d'une société de classification : c'est ce qui s'est passé avec l'Erika,
dont le suivi était assuré par le Rina. Le système français repose sur quelque chose de différent : la société de classification intervient sur ce qu'elle est capable de faire et sur ce que l'administration française n'est pas en mesure de faire, c'est-à-dire le contrôle du franc-bord. Le Bureau Véritas s'occupe de ce type de contrôles et classe les navires selon les règles de classification.
M. le Président : Pouvez-vous préciser ce qu'est le
« franc-bord » ?
M. Christian SERRADJI : C'est la partie la plus structurante du navire.
M. Pierre MITTON : Ce sont les éléments de sécurité qui permettent au navire d'avoir une bonne flottabilité et une bonne stabilité.
M. Christian SERRADJI : En France, des commissions de sécurité locales et nationale permettent, avec des armateurs, des professionnels et le Bureau Véritas, d'avoir une réflexion collective sur ce qui est constaté par les inspections des uns et des autres. Ce n'est qu'après l'accord de la commission de sécurité que le bateau a le droit de sortir et de naviguer.
Le concept de collégialité est un élément important pour qu'il n'y ait pas de décision individuelle et cachée en matière d'autorisation de navigation. Le bureau d'enquête sur les événements de mer, créé en 1997, est un instrument destiné à faire réfléchir les services et les commissions sur ce qui a pu être analysé ou corrigé à la suite de certains accidents.
En dernier lieu, le renforcement de l'action de prévention est un objectif important mais constitue en même temps notre plus grand point de faiblesse. Ce rôle est assumé par les centres de sécurité des navires. Au nombre de 15, ce sont de petits services répartis sur le littoral. Ils sont composés par des inspecteurs de sécurité qui remplissent deux types de fonctions : les contrôles des navires étrangers au titre de la compétence de l'Etat du port et les contrôles de tout bateau battant pavillon français au titre de la compétence de l'Etat du pavillon. Leur fonction va très loin. Par exemple, si un amateur éclairé et passionné construit son bateau en pleine Lozère, il téléphone là où il veut amarrer son navire - disons à Toulon - ; c'est alors le service de sécurité de Toulon qui va vérifier en Lozère si le bateau répond aux normes de sécurité. Tout cela est gratuit ; j'aimerais bien pouvoir le faire payer !
Ces précisions ont leur importance car elles vous donnent un ordre d'idée de la charge de travail des centres de sécurité des navires. Or, je n'ai que 54 inspecteurs de sécurité alors qu'il y a 67 postes budgétaires : j'ai donc 13 postes vacants. Je tiens à mettre ces chiffres en comparaison avec les 200 inspecteurs de sécurité anglais et les 160 inspecteurs espagnols. Si l'on double effectivement le nombre des inspecteurs des centres de sécurité des navires, je serai un homme heureux, mais encore insatisfait - cela va de soi.
La vérification de la conformité à la réglementation, la délivrance des certificats voilà à quoi se résume à peu près le rôle de ces centres de sécurité des navires. Nous avions, dans les années 1980-1982, 75 inspecteurs de sécurité ; nous avions recruté des contractuels, c'est-à-dire des anciens marins. Les évolutions statutaires et réglementaires de l'administration française, donc de la fonction publique, ont mis fin au recours aux contractuels, c'est-à-dire à ces anciens marins exerçant une deuxième carrière et touchant donc un deuxième salaire, ce qui posait problème. Désormais, nous sommes confrontés au recrutement d'inspecteurs sortant des écoles. Cela pose problème, mais je vous dirai quelles sont les solutions que nous suggérons et qui nous semblent y apporter une réponse intéressante.
Il me faut évoquer maintenant le rôle des CROSS, véritables instruments de prévision. Ils sont de la responsabilité du ministère de l'équipement et ont été créés au lendemain du naufrage de l'Amoco-Cadiz. Ils ont été développés grâce à un fort volontarisme politique des ministres concernés, mais sans moyens supplémentaires. Tout a été fait par redéploiement, que ce soient des moyens humains ou budgétaires.
Quand on sait que ces CROSS sont des usines technologiques avancées, en termes de radars, d'ordinateurs et autres équipements, vous imaginez la masse financière qu'il a fallu détacher des services classiques de l'administration de la mer pour les affecter à ces outils importants de stratégie de sécurité que sont les CROSS.
Le Président de la République a pris la décision de mettre fin au service militaire. 190 hommes du contingent remplissant leurs obligations nationales dans les CROSS permettaient d'assurer un service 24 heures sur 24. J'arrive à peine, de conférence budgétaire en conférence budgétaire, à obtenir que ces militaires du contingent soient remplacés par des personnels permanents. Je le fais par redéploiement interne de crédits et non pas par engagement de dépenses nouvelles. Suite au naufrage de l'Erika, j'atteindrai, je l'espère, le chiffre fatidique de 70 créations d'emplois dans tous les CROSS, y compris le CROSS Martinique que nous avons créé de toutes pièces il y a 3 ans pour respecter nos engagements internationaux, et le CROSS Réunion que je suis en train de créer pour remplir nos compétences internationales.
Se pose donc un énorme problème. Je rappelle que les CROSS font de 7.000 à 8.000 interventions l'an, globalement. Ils travaillent 24 heures sur 24. L'année dernière, ils ont secouru plus de 10.000 personnes, ils ont effectué plusieurs sauvetages. On déplore, en moyenne 30 personnes tuées sur l'année, marins et plaisanciers compris. Ce chiffre est encore énorme mais globalement, par rapport à la masse de ceux qui naviguent, on voit que les CROSS sont un outil d'une exceptionnelle qualité.
C'est le CROSS Etel que l'Erika a contacté en premier, le samedi. Moi-même, j'ai été averti une heure après qu'un pétrolier posait problème. Le lendemain, quand le commandant de l'Erika a relancé son
mayday à 6 heures du matin, j'en étais informé une heure après. Voilà ce que je voulais vous dire en matière de services et d'organisation.
Je vais terminer sur une anecdote concernant le balisage. Certains d'entre vous sont des élus du littoral. Vous avez notamment dû entendre parler du
Georges de Joly. J'évoque cet exemple à dessein, car j'ai pris la décision courageuse d'arrêter ce bateau. Je dis bien courageuse parce que le navire avait 73 ans d'âge : il nous avait été remis comme dommage de guerre en 1918. Or, il était cassé et aucun bureau expert ne pouvait m'assurer qu'en investissant 5 millions de francs pour réparer le moteur, le deuxième moteur n'allait pas lui aussi tomber en panne. De plus, on s'est rendu compte, comme dans le cas du
Verdon, que l'on pouvait facilement passer le pied à travers la coque. Par ailleurs, à Dunkerque stationne un bateau baliseur à peine plus jeune puisqu'il a 70 ans. Le plus jeune de tous les bateaux baliseurs de France est âgé de 37 ans !
Nous avions mis en place un plan de modernisation du balisage, engagé depuis 3 ans avec l'accord du secrétariat d'Etat au budget. Le remplacement du bateau du Havre sera effectué comme prévu - son successeur étant en fin de construction. Il n'en va pas de même pour le bâtiment de Dunkerque dont le renouvellement était pourtant programmé avant celui du
Georges de Joly. Mais en raison de la tempête, et compte tenu de la vétusté de ces navires, j'ai 4 bateaux de travaux qui ne peuvent plus faire le balisage, et 3 baliseurs qui sont arrêtés dans les ports.
Cela veut dire que sur le rail d'Ouessant, on fait appel aux équipements des Anglais pour nous aider parce que l'on n'a pas les moyens de faire notre propre travail. Je demande donc, dans le cadre du comité interministériel de la mer, que l'on accélère la mise à disposition des crédits budgétaires pour pouvoir mettre en construction les nouveaux bateaux dont nous avons besoin. Il s'agit d'un chantier de dix-huit mois. C'est un marché européen, mais malheureusement je ne suis pas assuré que cela se traitera avant la conférence budgétaire de mai 2000 consacrée à l'élaboration du projet de la loi de finances pour 2001.
En conclusion, quels sont les efforts à mener ? Tout d'abord, je crois qu'incontestablement l'on ne peut pas demander des améliorations au niveau de l'Europe comme au niveau international, si au niveau français on ne fait pas un effort significatif afin de se doter des moyens nécessaires pour avoir une politique cohérente en matière de sécurité maritime.
Cela fait des années que je tiens ce discours, et le naufrage de l'Erika prouve qu'il reste d'actualité. Il est temps que l'on prenne de vraies décisions dans ce domaine. Je demande donc plus de moyens humains et non par redéploiement. Je demande que l'on me permette de remplacer les radars du CROSS qui ont 25 ans d'âge, par des radars modernes. Je demande que l'on renforce la formation des inspecteurs de sécurité, en facilitant la transformation de l'école de Nantes en un centre professionnel de niveau européen, car on peut obtenir des moyens financiers de l'Europe si l'on réalise ce projet. Je demande que le CROSS Jobourg se transforme en un centre du trafic européen, parce qu'en termes de normes on peut obtenir de la part de l'OMI le signalement obligatoire de tout navire à 24 heures arrivant sur les côtes européennes, à condition d'avoir un suivi.
Je vous informe sur ce point que la démarche était lancée avant le naufrage de l'Erika. Nous avons réalisé une expérience, l'année dernière, entre les CROSS Gris-Nez , Jobourg et Corsen pour qu'en temps réel, les informations relatives à un navire qui se signalerait en Pas-de-Calais soient données aux trois CROSS en même temps.
Par ailleurs, nous avons passé un accord avec les Anglais : nous transmettons les mêmes informations à Douvres et les Anglais font la même chose. Le 14 décembre je suis allé signer à Madrid un accord avec les Espagnols pour que le système expérimenté avec eux au CROSS du Cap Finistère devienne une réalité. L'idée est qu'un bateau arrivant au nord se signale obligatoirement et que l'on puisse suivre son circuit de bout en bout.
Pourquoi ? Prenons l'exemple d'un bateau qui, au sud de l'Espagne se signale à Gibraltar : une fois qu'il quitte Gibraltar on ne sait pas où il va. Il peut aller vers l'Afrique ou vers l'Amérique ; on n'a plus de signalement.
Il n'y a pas de CROSS à Saint-Vincent. Nous demandons aux Portugais et aux Espagnols de faire un effort dans ce domaine pour qu'il y ait un suivi pour les bateaux qui contourneraient la côte et viendraient à se repérer au Finistère. Lorsque l'on visualise le captage des radars des CROSS existants, on constate qu'il faut développer ce circuit, ce qui suppose des radars plus puissants. En même temps, il faut en développer d'autres.
Puis, du Cap Finistère espagnol au Finistère français, vous avez un vide. Si le bateau suit la trajectoire la plus courte, il se signale au CROSS Corsen, et cela ne pose pas de problème. Mais un bateau venant d'Afrique peut très bien filer tout droit, ne pas se signaler, rejoindre la voie de l'Amérique du nord, et ne mentionner sa présence qu'au CROSS Jobourg. Il peut aussi ne pas se signaler du tout. C'est la faille du système actuel.
Au sein de la direction des Affaires maritimes et des gens de mer, nous travaillons depuis plusieurs mois sur l'idée d'une réflexion nouvelle en ce domaine, ce qui explique les expériences avec les Anglais et les Espagnols, et l'idée de faire du CROSS Jobourg un centre de trafic européen où toutes les données seraient rassemblées. Je suis heureux de vous dire que la démarche est plutôt reçue de façon positive, puisque la Commission européenne serait prête à financer la moitié du coût de l'opération, à charge pour la France de financer le reste. Les Anglais sont prêts à participer à l'étude pour mettre au point ce système parce qu'ils se sentent directement concernés, et j'ai rencontré il y a 10 jours les Norvégiens qui seraient prêts à faire le pendant du Cap Finistère et de Gibraltar dans le secteur du nord, ce qui nous assurerait un véritable circuit surveillé.
M. le Président : A quelle date la dernière étude de trafic en Manche remonte-t-elle ?
M. Christian SERRADJI : Elle remonte à 1977. Nous avions contacté Monsieur Lefèbvre pour qu'il nous fasse une nouvelle étude avant le naufrage de
l'Erika. Malheureusement elle se fera après l'accident de
l'Erika.
M. le Président : Il s'agit de l'étude du trafic ?
M. Christian SERRADJI : Oui. On dit que 600 bateaux/jour circulent dans le rail d'Ouessant, mais il s'agit de 600 bateaux/jour qui circulent dans tous les sens : on a donc un vrai problème.
Les captages radar de Jobourg et de Corsen sont limités et l'on peut très bien les contourner. Il y a des zones d'ombre que l'on ne peut plus accepter dans le secteur le plus fréquenté du monde. Même dans notre démarche nous n'avons pas la certitude que l'on pourra avoir les moyens techniques de suivre tout bateau potentiellement dangereux pour notre environnement littoral, sauf si l'on crée un nouveau système. Cela me paraît important.
Quoi qu'il en soit, il est clair que nos côtes sont à l'est et que le vent vient toujours d'ouest. Nous serons toujours confrontés à une certitude, à savoir qu'il n'y aura pas une sécurité absolue. Il ne faut pas mentir aux gens, un problème peut survenir à tout moment. Il ne peut pas y avoir un « zéro défaut » en ce domaine. Mais on peut mettre en place un système qui permette progressivement d'éviter au maximum le risque absolu.
M. le Rapporteur : Quel est l'apport d'EQUASIS par rapport à SIRENAC ? Quels sont les délais de sa mise en _uvre ? Quel est, à l'heure actuelle, le niveau d'adhésion à ce système au sein de l'Union européenne ?
Qui contrôle les normes sociales ou de qualification ? Est-ce que ce sont les contrôleurs qui sont en nombre insuffisant ? Cela se fait-il en même temps que les contrôles techniques des bateaux ? Les formes de contrôle sont-elles différentes ? Ces contrôles sont-ils aussi communiqués dans le cadre du Mémorandum de Paris ?
Vous avez dit qu'il y avait actuellement suffisamment de réglementations adaptées dans le cadre de l'OMI, que ce n'était pas la peine de continuer à se battre pour élaborer des conventions avancées en matière de sécurité du transport maritime et que si l'on appliquait les textes de l'OMI, l'on aurait déjà des normes de sécurité plus fortes. Vous confirmez bien cela ? Cela signifie-t-il que notre seule action est de faire en sorte que l'Europe applique les normes de l'OMI le mieux possible ?
M. Christian SERRADJI : Je vous laisserai une petite fiche à propos d'EQUASIS, et si vous le voulez, on pourra vous fournir une prestation sur ordinateur : la maquette est faite et a été présentée au niveau européen.
Je me trouvais à Bruxelles dans le cadre d'une réunion sur le
quality shipping, quand un chef du bureau de la Communauté me dit que ce serait bien si l'on pouvait faire mieux que SIRENAC.
Faire mieux, cela voudrait dire que l'on puisse obtenir les données techniques des contrôles faits par les
vetting, par les sociétés de classification, par les services et l'Etat du pavillon, alors que SIRENAC ne rassemble que les données recueillies par les services de l'Etat du port.
C'est ainsi que l'idée a été lancée. Dès le départ, l'opération est un partenariat paritaire entre la France et la Communauté européenne. La France a prêté ses hommes, ses cerveaux et des heures de travail à Saint-Malo et à Paris. La Communauté européenne a apporté 350.000 euros par an et s'est engagée à s'investir encore deux ou trois ans dans cette affaire. C'est un vrai partenariat qui s'est noué avec l'Europe ; c'est une opération conjointe. Je ne peux pas dire que ce soit une opération strictement française et que la Communauté européenne ne s'y soit pas intéressée.
Nous avons présenté la maquette à
mare forum le 29 juin 1999, à Amsterdam, devant les principaux responsables du secteur maritime du monde entier. La Communauté européenne a défendu le projet en indiquant qu'elle irait jusqu'au bout. Elle nous a facilité les dialogues pour obtenir l'accord de l'IACS - organisme de coordination des sociétés de classification - , des P. and I. Clubs, des assureurs, des chargeurs, etc...
Rassemblant toutes ces données, EQUASIS se présentera comme une banque de données Internet accessible à tous les inspecteurs en temps réel et résumant la vie d'un navire depuis sa sortie du chantier naval jusqu'à son dernier contrôle.
A l'intérieur, il y aura des passerelles - Gate ways - avec des numéros d'accès qui ne pourront être donnés qu'à ceux qui auront le droit d'accès parce qu'il y aura des informations confidentielles. Le système de transparence que va mettre en place EQUASIS va faire en sorte que ceux qui n'y figureront pas apparaîtront, par nature, douteux. La charge de la preuve s'en trouvera inversée : les inspecteurs s'intéresseront en priorité aux bateaux non répertoriés par EQUASIS. A l'inverse de SIRENAC, il y aura donc une organisation du contrôle des navires.
Nous avons signé le 10 décembre, à Bruxelles un accord de réalisation pour mai 2000. Le dossier a été présenté à l'OMI le 28 janvier. L'OMI s'est considérée comme concernée par EQUASIS et va y apporter son label international pour son développement. Les
coast guards américains, les Japonais, les Singapouriens, les Anglais et les Espagnols participeront à EQUASIS, feront partie de son comité de direction et, progressivement, contribueront à son financement.
Le directeur d'EQUASIS, c'est-à-dire la personne en charge de sa réalisation définitive est un Français, M. Philippe Marchand qui est l'ancien directeur départemental des Affaires maritimes de Saint-Malo et l'ancien directeur-adjoint du CAM.
En ce qui concerne les normes de l'OIT, lesquelles sont adoptées indépendamment de celles de l'OMI, nous avons cherché à obtenir des conventions qui soient claires dans le domaine du social, notamment en termes de durée du travail. J'insiste sur le niveau de protection de ces normes internationales qui est inférieur à celui de la législation sociale française, laquelle se trouve toujours un cran au-dessus dans ce domaine. Nous avons cherché à obtenir les textes juridiques nous permettant d'imposer un socle minimum au niveau européen à partir duquel on pourra aller plus loin.
Donnons un exemple : il n'y avait aucune législation en termes de durée du travail. Avec la convention OIT on peut, si elle est signée par tous les pays, commencer à raisonner sur la durée du travail maritime.
Par ailleurs, en vertu d'une convention, la France a pu créer une inspection maritime qui viendra conforter - le décret est paru en 1999 - ce qui était déjà fait par les inspecteurs de sécurité et par des inspecteurs du travail dûment formés. Cette inspection maritime exercera un double contrôle, portant autant sur le social que sur l'application de la norme technique.
Enfin, une réflexion sur les navires abandonnés a été menée. M. Jean-Claude Gayssot m'avait demandé de faire un rapport sur la problématique des marins abandonnés sur les navires épaves. Ce rapport a été rendu. Sachez que, depuis, nous avons suscité à l'OMI un groupe de travail mixte sur le problème des navires abandonnés, et que ce sont les propositions françaises qui font l'objet d'une étude internationale.
Ces propositions françaises portent notamment sur les problématiques de l'accueil des marins, de leur rapatriement, et de la mutualisation des coûts. Ces mesures doivent être prises au niveau international parce qu'au niveau français on ne peut pas le faire. Toutefois, il ne s'agit pas de modifier l'économie générale de la réglementation internationale en vigueur. L'essentiel est avant tout de l'appliquer. Pour cela, il faut continuer à bloquer les navires. En France, on en a bloqué 82 en 1999. Or quand on bloque des navires, il faut gérer deux situations. Il faut d'abord veiller à ce qu'ils ne gênent pas trop les ports parce que cela a des répercussions importantes sur l'attractivité des ports. Je crois néanmoins qu'au nom du principe du signalement obligatoire et de la vérification sévère de la qualité d'un navire, il faudra que l'on ait des ports refuges. Au nom de la sécurité je veux des ports refuges. Je suis clair et je dis bien
« je veux ».
Ensuite, je puis comprendre qu'économiquement cela pose un problème. Par conséquent, lorsque l'armateur ou l'Etat du pavillon ne respectent pas les règles internationales, il faut permettre à nos services de pouvoir racheter le navire, ou en tout cas de le vendre dans une procédure judiciaire accélérée : c'est le projet du rapport « navires abandonnés ». Il faut en même temps que l'on puisse s'occuper des marins, et ne pas laisser aux associations caritatives le soin de régler le problème comme on a été contraint de le faire pour le
Kifangondo. Sachez que je suis passible de la cour de discipline budgétaire parce que j'ai signé une subvention pour payer le salaire des marins et leur billet d'avion. Ce n'est pas normal !
Il y a là quelque chose à faire au niveau français. C'est un problème français qui pourra servir d'exemple pour obtenir des règles supplémentaires. Il est clair que beaucoup de navires sont bloqués dans nos ports parce que les marins ont compris qu'en France ils ont une écoute sociale beaucoup plus importante que dans d'autres pays. C'est le cas du
Santana II dont vous avez entendu parler, qui était bloqué à Bordeaux, que l'on a libéré, qui a été à nouveau bloqué à Brest - mais ce n'était pas pour la même raison.
M. Georges SARRE : M. le directeur, quels sont la nature et le montant des sanctions appliquées, notamment pour les navires naviguant à contresens dans le couloir de circulation du rail d'Ouessant ? Quels sont les moyens de repérage, d'identification des contrevenants dont disposent les Affaires maritimes ? Combien d'infractions ont-elles été constatées et sanctionnées en 1999 ?
Quels sont, d'une part, les montants des amendes encourues en cas d'infraction pour dégazage en mer, et, d'autre part, les coûts des opérations de dégazage sur installations appropriées dans les ports français ?
M. Christian SERRADJI : Je ne peux pas vous répondre sur cette question. Je ne sais pas, mais je peux trouver la réponse.
M. le Président : Vous pourriez éventuellement nous fournir une réponse écrite, avec des documents.
M. Georges SARRE : Est-il possible de préciser les points techniques suivants, ne serait-ce que par écrit ? Je comprends que vous ne puissiez pas nous apporter des éléments de réponse très précis immédiatement.
Pouvez-vous indiquer la différence de contenu des listes d'inspection des trois administrations maritimes des pays voisins que sont la Grande-Bretagne, les Pays-Bas, la France ?
Quel est l'état d'avancement du projet d'harmonisation européenne des critères contenus, et quelles sont les modalités d'inspection des navires en application du Mémorandum de Paris ?
Quel est le programme actuel de recrutement des 50 inspecteurs supplémentaires régulièrement annoncés depuis 1994 ?
Je souhaiterais que vous puissiez préciser les niveaux professionnels et catégoriels ainsi que leur origine pour les officiers expérimentés de Marine marchande ou les jeunes ingénieurs.
Concernant le rôle de l'OMI, je vous ai trouvé optimiste.
Concernant les exigences sociales, les armateurs s'engagent à ne recourir qu'à des sociétés de main-d'oeuvre respectant l'intégralité des conventions de l'OIT. Quel est le contenu précis des conventions concernées ? De même quels sont les cas d'intervention de l'inspection du travail maritime prévus par le paragraphe 2 de l'article 3 ?
L'article 4 prévoit un recours exclusif au pavillon des Etats ayant ratifié et appliquant effectivement les conventions de l'OMI et de l'OIT. Peut-on connaître la liste actuelle de ces pavillons et s'assurer de l'application effective ou non de ces conventions par Malte et Chypre ?
Je vous remets ces questions, M. le directeur, de manière à ce que vous puissiez apporter ultérieurement une réponse aux aspects les plus techniques.
M. Christian SERRADJI : Je ne dispose pas de tous les éléments ici. Je peux toujours répondre à certaines questions et je souhaite les traiter parce qu'elles posent un certain nombre de problèmes.
M. François GOULARD : Ma question est d'une nature et d'un style différents parce que je n'ai pas de sources d'informations administratives. Vous nous avez parlé de nombreux points touchant à la sécurité maritime, mais j'aimerais entendre votre analyse de l'affaire
Erika, puisque c'est de là que nous partons. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ? Quel est le maillon de contrôle qui a été déficient dans cette catastrophe ?
M. Christian SERRADJI : Très franchement, je ferai trois remarques sur ce qui n'aurait pas fonctionné. Je ne vais pas me substituer à M. Tourret, le directeur du bureau enquêtes accidents/mer.
Pour moi, le système n'a pas fonctionné parce que les inspections qui ont eu lieu les années ou les mois qui ont précédé n'ont pas été toutes répertoriées dans leur totalité. Si vous prenez le dossier SIRENAC, dont on peut vous fournir l'exemplaire concernant l'Erika, vous verrez que l'on y analyse les pays et les ports, où les contrôles ont eu lieu ainsi que ce qui a été constaté. Les informations y sont très succinctes, on sait que le bateau a été bloqué 2 jours pour faire telle et telle chose, mais on voit que très souvent, notamment à l'occasion de l'inspection russe, les défaillances relevées concernaient la pompe à gonfler les bouées ou ce genre de choses - même si je fais un peu d'ironie - et non d'éventuelles corrosions ou d'éventuels problèmes de structure.
M. François GOULARD : Est-ce volontaire ou non ?
M. Christian SERRADJI : Très honnêtement, je ne peux pas soupçonner la qualité des contrôles, même si je peux avoir quelques doutes.
Les dysfonctionnements résultent de ce que l'on ne s'est pas assuré de deux choses : la première étant que les contrôles aient réellement eu lieu, et dans l'affirmative, qu'ils aient été bien faits, la deuxième étant qu'ils aient été faits de la même façon dans tous les pays.
J'ai donné comme consigne à mes inspecteurs de sécurité - lourde responsabilité que j'accepte volontiers - que, s'ils n'avaient pas les moyens et le temps nécessaires pour faire une inspection sérieuse, ils ne la fassent pas. C'est ce qui s'est passé à Dunkerque.
M. François GOULARD : Pour l'Erika ?
M. Christian SERRADJI : Oui, à Dunkerque, l'Erika n'a pas été inspecté, l'inspecteur du centre de sécurité des navires a pris le dossier SIRENAC : il a vu que le bateau avait été contrôlé trois semaines plus tôt ; il s'est donc dit qu'il n'était pas la peine qu'il effectue un contrôle.
Le bateau avait été contrôlé en Russie.
Bien sûr, après coup, on a des doutes. On a repéré que certaines certifications avaient été accordées à des bateaux que l'on a vu souvent apparaître comme étant contrôlés et posant problème, ou à des bateaux bloqués. La société de classification Rina fait partie de celles qui attirent l'attention. Je ne dis pas qu'elle est la seule, mais je reconnais qu'elle retient notre vigilance. Si l'on devait avoir un effort à faire, ce serait sur la manière dont sont faits les contrôles et sur la qualité des références données par les inspecteurs.
Je suis donc demandeur de deux choses qui sont pour vous autant de réponses. Je souhaite tout d'abord la création d'un centre de formation de sécurité. J'ai demandé au secrétaire général de l'OMI de m'aider à une réflexion sur une convention STCW traitant plus particulièrement des inspecteurs de sécurité. J'ai passé des accords verbaux, mais j'espère que l'on pourra poursuivre. J'aurai besoin d'un grand soutien financier pour mon centre de sécurité, et ultérieurement pour les stages. Je suis également pour la création d'inspections conjointes franco-britanniques, franco-italiennes, franco-espagnoles où l'on apprend, par des échanges de fonctionnaires ainsi que par des travaux en commun, à harmoniser la façon de contrôler.
Il y a un autre élément de faiblesse du système : le contrôle des navires se fait au regard humain, il n'y a pas de technique pour sonder la coque, si ce n'est la mise du bateau en cale sèche, en chantier naval. Cela se fait tous les 5 ans et on va réduire les intervalles à 3 ans. Mais il faudra aussi placer les bateaux dans un chantier naval que l'on pourra vérifier. L'Erika a été, paraît-il, réparé au Monténégro. Mais on n'a rien vérifié. Il faudrait que l'on puisse contrôler ce que font les contrôleurs des sociétés de classification, car cela n'a pas fonctionné quelque part. Je sais que je suis irréaliste, mais je pense que c'est vers cela que l'on devrait aller. Il n'est pas possible qu'un Etat du pavillon abandonne la totalité de son pouvoir à une société de classification qui a un rapport d'entreprise privée, donc un rapport économique d'intérêt, avec l'armateur.
Je ne sais pas pourquoi l'Erika avait changé d'armateur et de société de classification. Visiblement, il a fallu longtemps pour identifier l'armateur, ce qui révèle une certaine opacité de sa gestion. Il me paraît néanmoins clair que la société de classification délivre des informations différenciées à l'armateur et à l'Etat du pavillon, ce qui place les services de l'Etat du port dans une situation délicate pour contrôler efficacement le bateau. C'est une des justifications d'EQUASIS.
M. le Président : Il ne faut pas non plus qu'EQUASIS nous prive de cette responsabilité nécessaire, que vous mettez en évidence, de l'Etat du pavillon.
M. Christian SERRADJI : Oui, c'est clair.
M. le Président : Tel que vous le présentez, EQUASIS pourrait dispenser Malte de mettre en place une administration en charge du contrôle des navires battant pavillon maltais.
M. Christian SERRADJI : Non, justement, Malte est persuadé d'assumer parfaitement son rôle d'Etat du pavillon.
M. René LEROUX : Il faudrait un autre pavillon, dans ce cas !
M. Christian SERRADJI : Toute ironie mise à part, les résultats du Mémorandum de Paris ne parlent pas vraiment en sa défaveur : Malte n'y fait pas partie des pires Etats du pavillon.
M. le Président : Malte n'est peut être pas le plus mauvais des Etats du pavillon, mais d'après les éléments que j'ai vus et qui étaient déjà pointés dans le rapport du Sénat de 1993, Malte faisait partie des Etats les moins sérieux en ce domaine.
M. Christian SERRADJI : M. le Président, je vous donne le tableau d'excellence, vous verrez que Malte ne fait pas partie des pires Etats du pavillon : c'est donc que le système n'est pas bon ! On devrait interdire qu'un pays qui n'a pas une administration capable d'assurer son propre contrôle ait des bateaux, mais si je dis cela je passe pour complètement fou parce qu'une telle proposition est contraire au droit international !
M. le Rapporteur : On peut empêcher que ces pays adhèrent à l'Union européenne.
M. le Président : Peut-on concevoir que, comme elle a pu le faire pour la peine de mort, la Communauté européenne exige que tout candidat à l'adhésion dispose d'une administration des Affaires maritimes capable d'assurer ses contrôles d'Etat du pavillon ? Ne pourrait-on pas dire que ne peut être membre de la Communauté européenne un Etat qui ne fait pas le nécessaire pour que son pavillon ne soit pas mis sur n'importe quelle poupe ?
Cela voudrait dire que Malte, Chypre, et la Turquie seraient confrontés à un sérieux dilemme. De la sorte, on pourrait exercer quelques moyens de coercition à l'égard de pays comme la Grèce, l'Estonie et un certain nombre d'autres pays. Je suis le parrain de l'Estonie, au sein de la Délégation parlementaire pour l'Union européenne, pour son entrée dans le marché commun. Croyez qu'à chaque fois que je rencontre l'Ambassadeur je lui en parle, et que je continuerai à le faire.
M. Christian SERRADJI : On peut toujours demander à l'Europe de poser cette condition pour intégrer certains pays, mais il faudra faire sortir de l'Union européenne ceux qui ne voudront pas se la voir appliquer. Vous aurez un énorme problème avec la Grèce.
M. le Président : ...qui est dominante à l'OMI.
M. Christian SERRADJI : Tout à fait. Malte, Chypre et Panama sont tout autant dominants à l'OMI dont le financement est assuré principalement par les pays qui ont le plus grand nombre de bateaux : 70 % du montant des cotisations est calculé en fonction du tonnage et les 30 % restant en fonction du positionnement du pays. Je ne pense pas que ce soit vers cela qu'il faudrait tendre, mais plutôt vers autre chose.
Par exemple, je ne pourrai pas empêcher que Malte se serve de ses bateaux pour développer une activité source de richesses. Par contre, je peux peut-être lui imposer, puisqu'il n'y existe pas d'administration maritime complète, l'obligation d'un contrôle conjoint avec les services du pays européen de son choix dans l'exercice de ses compétences d'Etat du pavillon, la société de classification ne pouvant plus être délégataire de cette compétence.
Si l'on pouvait mettre en place ce concept d'inspection conjointe, un petit pays comme Malte ou Chypre ne se sentirait pas placé en tutelle par les gros pays européens puisque ces derniers appliqueraient déjà des inspections conjointes de leurs services dans la pratique. C'est pour cela que je lie cette réponse au projet du centre de sécurité et de formation des inspecteurs aux standards STCW. Comme vous le voyez, j'essaie d'être cohérent dans ma réflexion.
Je réponds maintenant aux questions de M. le Ministre.
On peut vous transmettre le contenu des listes d'inspection des trois administrations maritimes des pays voisins. Ce sont à peu près les mêmes règles applicables ; on a beaucoup harmonisé entre nous. J'indique, au passage, que vous pourriez y ajouter les Espagnols.
Actuellement, nous sommes en train de réfléchir - c'est le projet dont je parlais - aux critères d'EQUASIS dont les inspecteurs devront se servir pour harmoniser un certain nombre de pratiques. Pour mettre les choses en place, il me semble indispensable de créer le centre de sécurité dont je vous ai précédemment parlé.
Le programme de recrutement des 50 inspecteurs supplémentaires régulièrement annoncé depuis 1994 n'a pas reçu de traduction concrète à ce jour. Comme je vous l'ai déjà indiqué, j'ai aujourd'hui 54 inspecteurs, 13 postes vacants, ce qui fait 67 postes budgétés. J'ai demandé, dans le cadre des 13 postes vacants, la possibilité de recruter 8 contractuels en 2000, qui me seront, je l'espère, accordés au comité interministériel de la mer.
Le ministère de l'économie et des finances propose de permettre le recrutement de 16 inspecteurs en 2001 et de 16 autres inspecteurs en 2002. Je rappelle que j'avais demandé la même chose au secrétariat d'Etat au budget l'année dernière. Avec M. Jean-Claude Gayssot, nous avons redéployé certains crédits du ministère de manière à ouvrir un concours exceptionnel de 8 postes. Ce concours était à base de titres professionnels : nous avons eu 2 admis sur 4 candidats.
Concernant les professeurs d'enseignement maritime, pour six postes offerts, j'ai trois candidats et un seul admis. Le métier n'attire pas et nous avons là un vrai problème ! Deux approches ont été faites à l'école de Nantes, qui m'avait valu, en d'autres temps, bien des problèmes. Nantes est un centre de formation des formateurs. Il faut former les enseignants au monde maritime. Ce centre va devenir européen puisque l'on reçoit des demandes de pays étrangers pour venir y former leurs enseignants.
Je vais créer le centre professionnel de sécurité, tous secteurs confondus, et j'ai mis à l'étude la création d'une classe préparatoire au concours administratif maritime parce que j'ai remarqué qu'à peu près 20 % des élèves formés dans nos écoles de Marine marchande ne deviennent pas marins dès leur sortie de l'école.
Je voudrais récupérer ces 20 % pour les attirer vers les métiers d'inspecteur et assimilés. Ils accepteraient un salaire minimal de 12.000 francs parce qu'ils sont jeunes étudiants, et nous les préparerions au concours tout en créant un vivier pour le contrôle des navires. Attractif, ce centre professionnel favoriserait une synergie des compétences, puisque les fonctionnaires en poste viendraient s'y former avec les plus jeunes ; cette synergie aurait également une dimension internationale, l'anglais devenant la langue obligatoire, y compris pour les fonctionnaires français. Voilà le projet de Nantes, et voyez la dimension qu'il prend. Je n'ai pas un centime, mais j'ai la foi !
M. Louis GUEDON : M. le directeur, il est très intéressant de vous écouter parce que l'on vous sent passionné par les problèmes de sécurité, et c'est rassurant dans les circonstances que nous connaissons.
Je voudrais mettre un terme à une boutade qui est lancée, que l'on voit intervenir dans les différentes auditions, et qui concerne le risque zéro.
Quand on explique « brut de décoffrage » que le risque zéro n'existe pas, on replonge dans le désespoir toutes les populations maritimes qui connaissent régulièrement des catastrophes économiques aussi graves que celle résultant du naufrage de l'Erika.
Ces populations connaissent bien le monde de la mer et savent très bien que les naufrages font partie de la vie de la mer. Elles savent qu'il n'y a pas de risque zéro pour les naufrages. Il y en a eu, il y en a, il y en aura toujours. En revanche quand on dit que le risque zéro n'existe pas lorsqu'il s'agit de navires en mauvais état, de navires qui portent des cargaisons dangereuses, de navires qui ne sont pas contrôlés, cela révolte, M. le directeur, les mieux pensantes des populations maritimes.
Quand, comme votre prédécesseur, on assène froidement cette boutade, l'administration semble alors manifester une totale désinvolture à l'endroit du citoyen. Un grave fossé se creuse ainsi entre l'administration et le citoyen. J'aimerais que l'on précise les choses de manière très claire quand on affirme avec assurance que le risque zéro n'existe pas.
M. Christian SERRADJI : M. le député, je tiens à m'excuser si j'ai donné l'impression d'avoir utilisé une formule par boutade. Mais en tant que responsable je ne dirai jamais que j'assure le risque zéro ! Je vais vous donner un exemple très précis. A la suite des mesures prises après le naufrage de l'Amoco-Cadiz, les autorités ont considéré qu'une telle catastrophe ne se reproduirait plus. Dans les batailles que mes collaborateurs et moi avons menées avec le ministère de l'économie et des finances, j'ai toujours dit que j'espérais que l'on n'aurait pas un jour à faire face un autre
Amoco-Cadiz. De temps en temps, par boutade, je disais que pour convaincre ceux qui ne voulaient pas m'entendre,
il faudrait que cela arrive.
On a tout de même diminué de 30 emplois mes effectifs d'inspecteurs de sécurité en 10 ans. On a diminué mes moyens budgétaires. La fin des réductions des effectifs de l'administration de la mer date de 1997. La remontée budgétaire date de 1998, et en fait il s'agit de redéploiements, non de crédits supplémentaires. On pourra faire toutes les réglementations que l'on voudra, si je n'ai pas les moyens de les faire respecter, si je n'ai pas les moyens de les contrôler, je ne peux pas assurer que les risques liés au transport maritime sont maîtrisés.
Ce problème est français, mais aussi international. Je pense que la France a le devoir d'abord de s'appliquer à elle-même les règles qu'elle voudrait voir appliquer par d'autres. Il me paraîtrait normal que la France commence à occuper des emplois et des postes à l'OMI, alors que l'on y affecte des fonctionnaires à disposition parce que l'on n'a pas les moyens de les placer en détachement.
Quand un poste s'ouvre, je suis obligé de me demander si je vais créer un poste dans un quartier français, ou si je vais affecter quelqu'un à Bruxelles, ou à l'OMI, et ce n'est pas normal. Nous sommes un pays maritime, mais nous sommes traités par des terriens !
M. Louis GUEDON : C'est très bien, c'est vrai.
M. Christian SERRADJI : Je suis désolé, ce n'était pas une boutade, c'est une grande inquiétude.
M. Jean-Michel MARCHAND : M. le directeur, nous sommes capables de comprendre votre enthousiasme et votre véhémence. Je ne veux pas revenir sur les questions que vous avez largement développées et qui me préoccupaient au plus haut point. Toutefois, le tableau que vous venez de nous tracer est particulièrement alarmant. Vous avez parlé de budget, mais vous avez aussi parlé de ressources humaines. Ce n'est pas uniquement un problème de budget puisque vous avez des postes vacants, c'est un problème de vivier, et c'est vraisemblablement lié au fait que l'on n'autorise plus les cadres de la Marine marchande à occuper un deuxième emploi. Je crois que c'est une vraie préoccupation.
Par ailleurs, force est de constater que l'annonce ministérielle de doublement des postes d'inspecteurs, à la vitesse où s'effectuent les recrutements, ne sera traduite dans les faits qu'en 2004 !
M. Christian SERRADJI : Ce n'est pas moi qui propose.
M. Jean-Michel MARCHAND : Je sais que ce n'est pas vous, M. le directeur. Le ministre des transports a fait une proposition fort intéressante, mais les services du ministère de l'économie et des finances ne suivent pas.
Vous nous inquiétez quand vous nous annoncez que vous disposez de 190 appelés du contingent qui vont être remplacés par 70 créations de postes budgétaires. La marge est énorme. Ne va-t-on pas être, demain, encore plus en difficulté qu'aujourd'hui ?
Ma véritable interrogation porte sur EQUASIS dont, je ne suis toujours pas convaincu de l'efficacité parfaite ou presque parfaite. L'Erika n'aurait-il pas pu tout de même passer au travers des mailles, ce système étant en place ? Si les règles sont draconiennes, et nous le souhaitons, les bateaux représentant un réel danger iront ailleurs. Peut-être les informations qui seront portées à la connaissance de tous ne seront-elles pas exemptes de doutes ? Je comprends ce que vous proposez, mais je reste sceptique sur l'efficacité totale de ce système.
M. Christian SERRADJI : Je vais être encore très franc. Je ne suis pas convaincu qu'EQUASIS sera d'une efficacité à 100 %. C'est la pratique qui nous permettra de le dire. L'objectif recherché et c'est là une vraie volonté, est de permettre à tout inspecteur, pour la première fois, de prendre connaissance de toutes les inspections faites au préalable, y compris par les sociétés de classification. C'est déjà un élément important : c'est ce que j'appelle la collégialité des analyses, et cela permettra de faire des analyses.
Il est également clair qu'il ne faudra pas se contenter de remplir un document : il faudra que l'administration puisse en tirer des conclusions, c'est-à-dire qu'en repérant tel navire, de telle nature, à tel moment, à telle période d'ancienneté, avec tel et tel problèmes, l'on puisse retrouver les bateaux présentant les mêmes caractéristiques et donc le même danger potentiel. On dit en effet que les quatre « petits frères » de l'Erika ont les mêmes problèmes. J'espère qu'EQUASIS nous permettra de disposer de ce type d'information plus rapidement. Il n'y aura plus de fuites d'informations puisque l'on saura qui est l'armateur. Il n'y a aura plus de fuites de la part des assureurs, de très bons assureurs assurant de très vilains bateaux et se cachant pour le faire. Il y aura plus de transparence, ce qui va tout de même un peu « nettoyer » le milieu.
Par ailleurs, je crois qu'il faut être très clair, M. le député : la qualité des informations données relèvera de la qualité des inspections. Pour qu'EQUASIS soit efficace, on doit l'être dans le choix des hommes, dans la façon dont on fera les inspections et dans la façon dont on va les contrôler. Je ne crois pas à un super système de contrôle du contrôle. Je crois à des contrôles conjoints parce que ce sont des pratiques. On réalise déjà des contrôles conjoints avec les Anglais sur les bateaux à passagers qui font la traversée de la Manche. On a appris nos métiers et découvert des choses.
C'est à partir de cette idée concrète que l'on s'est rendu compte que l'on pouvait améliorer notre façon d'inspecter et améliorer l'efficacité de nos contrôles.
Il y a une troisième réalité, mais celle-là ne sera que transitoire : les plus vieux bateaux du monde vont disparaître dans les 10 prochaines années. Il faudrait accélérer leur départ, mais on aura des bateaux neufs. Cela dit, je ne suis pas convaincu que même un bateau neuf ne casse pas.
M. Paul DHAILLE : Le Titanic a coulé.
M. Louis GUEDON : Et inversement, un très vieux bateau peut bien naviguer.
M. Christian SERRADJI : J'essaie de vous montrer qu'il est important que l'on fasse tout pour que les événements ne se reproduisent pas.
Vous disiez les citoyens se sentaient meurtris, c'est vrai. Je ne suis pas du littoral mais je suis allé voir sur le terrain comment on réagissait : c'est affreux !
M. Louis GUEDON : S'il se produisait un autre événement de mer comme celui de
l'Erika dans 6 mois, il y aurait une émeute à Paris !...
M. Christian SERRADJI : C'est vrai. Un pétrolier sombrant aujourd'hui et laissant échapper 12 000 tonnes de pétrole constituerait une catastrophe très mal vécue. Quoi qu'il en soit, c'est un traumatisme, c'est un viol du patrimoine.
M. Louis GUEDON : Tout cela pour des profits !
M. Christian SERRADJI : Tout à fait, mais là vous évoquez un autre problème.
Revenons à une chose très précise. Si l'on se place dans une démarche de suivi du trafic maritime, quel est le travail des vedettes des Affaires maritimes, relookées, de type
coast guards ? Il s'agit de faire de la surveillance, de la lutte antipollution en travaillant avec les pêcheurs et en étant organisés avec eux. On a vu nos vedettes agissant de concert avec les pêcheurs, essayer de bloquer avec une certaine efficacité les nappes de pétrole.
Ces vedettes sont chargées d'aller arrêter un bateau en pleine mer pour effectuer une vérification. Or, cela fait 3 ans que je demande que l'on me donne les moyens d'acheter 15 bateaux, ce qui n'est pas beaucoup. Chaque bateau coûte 4,5 millions de francs. Faites l'addition, ce n'est pas énorme. Il me faut 8 fonctionnaires pour faire marcher les bateaux. Avec M. Jean-Claude Gayssot on a pu redéployer pour la construction de 5 bateaux seulement !
Lorsque j'ai lancé l'idée de l'Iris
nous n'avions pas un sou. J'ai eu la chance de bénéficier d'un budget intelligent : j'avais obtenu 50 % de la somme de la Communauté européenne ; j'ai demandé les 50 % restants, on me les a avancés.
Il me faudrait un deuxième patrouilleur. On ne veut pas me donner l'argent, mais la Communauté européenne est prête à m'en payer la moitié. Donnez-moi 500 millions de francs et vous aurez vos
coast guards, soit un bateau par département. Je vous apporte les preuves chiffrées de ce que j'avance, c'est le dossier que j'ai remis à M. Jean-Claude Gayssot, sur lequel je me bats. Je ne suis pas un directeur qui n'est pas écouté. Je suis défendu, mais je ne suis pas entendu là où il le faudrait.
M. Paul DHAILLE : M. le directeur, votre intervention est intéressante parce qu'elle concerne l'Erika, et qu'elle est assez générale. C'est l'objectif de cette commission d'envisager tous les problèmes du transport maritime, en particulier celui des matières dangereuses.
Je n'ai pas la science de M. Sarre. Vous nous avez exposé ce qu'étaient l'OMI, le Mémorandum de Paris, l'AISM ; dans tous ces organismes on parle beaucoup de réglementation, mais on ne parle jamais ou presque jamais de contrôle, et presque jamais de sanctions. Dans ce domaine économique, il ne peut y avoir que des sanctions financières : y a-t-il un système de sanctions financières qui se met en place et qui soit reconnu par tout le monde ? Applique-t-on ce système de sanctions ?
J'aurais souhaité que vous développiez l'idée du blocage des bateaux dans les ports. Les capitaines de port, les ports autonomes ne tiennent pas particulièrement à ce que l'on bloque les bateaux. Se présentent en effet des problèmes économiques et sociaux, lorsqu'il faut vider le navire de sa cargaison, à plus forte raison s'il contient des produits dangereux. Peut-être pourriez-vous, M. le directeur, nous fournir une contribution écrite sur cette idée de port refuge.
Enfin, on évoque le transport des matières dangereuses. Sur terre, je sais ce qu'est une matière dangereuse. Dans le domaine maritime, estimez-vous que l'on ait la même définition des matières dangereuses ? Pensez-vous qu'il doive y avoir des normes supérieures pour les navires transportant des matières dangereuses ? Comment pourraient-elles être définies ?
M. Christian SERRADJI : Je suis contre la qualification de certains ports en ports refuge. Cela va à l'encontre d'une politique d'aménagement du territoire. Il ne faut pas qu'un port soit désigné comme port de refuge, susceptible de devenir une « poubelle ». Je ne peux pas le concevoir. En revanche, je considère que tout port est un refuge par nature : c'est un abri.
La sanction en cas de non conformité aux normes de sécurité existe, le Mémorandum de Paris est très clair sur ce point : il peut bloquer un navire pour l'obliger à faire les travaux immédiatement, sur place. Il peut également obliger un navire à aller, avec accord de l'armateur, au port d'attache de son choix, mais avec interdiction de transporter des matières ou de s'arrêter dans un autre port. Cela a été le cas du
Santana II qui était parti de Sète avec l'obligation d'aller dans un port de Grande-Bretagne. Il y a eu des problèmes sociaux et le navire s'est arrêté à Bordeaux ; vous en connaissez l'histoire. Les inspecteurs à tous les niveaux ont fait leur travail ; ils ont suivi le navire de bout en bout. Vous voyez donc bien qu'on a la possibilité de bloquer et de détourner tous les bateaux qui posent problème.
Par ailleurs, un bateau qui ne respecte pas les règles d'inspection et les exigences de réparation formulées par un inspecteur du Mémorandum de Paris peut être banni des ports des Etats membres. En janvier, les Espagnols nous ont transmis le nom d'un navire qui était banni des côtes espagnoles ; l'inspecteur espagnol demandait qu'il soit banni des ports européens. Nous avons appliqué la réglementation.
M. Paul DHAILLE : Pensez-vous que le système de sanction soit suffisant ? Pourrait-on imaginer des sanctions supplémentaires ?
M. Christian SERRADJI : Je suis favorable à ce que l'on imagine des sanctions financières, mais cela ne peut se faire que dans le cadre de la Communauté européenne. On pourrait, en effet, imaginer que, pour les navires s'arrêtant dans un port européen et ne respectant pas les règles, l'on puisse sanctionner l'armateur. C'est le propriétaire du bateau qui serait sanctionné.
Il y a un peu cette idée dans les propositions de M. Jean-Claude Gayssot sur l'extension de l'accès au FIPOL et la traçabilité. On peut aller plus loin en la matière.
Je vous rejoindrai sur cette idée d'un système de sanctions financières. Mais un pays ne peut pas le mettre en _uvre seul, au risque de provoquer un détournement de trafic au détriment de ses intérêts. Cela ne peut résulter que d'une décision de type communautaire. On peut envisager une décision de blocage d'un navire comme le font les
coast guards américains. Un patrouilleur comme l'Iris ou les vedettes des Affaires maritimes peuvent bloquer un navire. Ils l'ont déjà fait, mais cela suppose un peu plus d'outils, de moyens.
D'autres sanctions existent. Il suffirait de les appliquer et d'avoir un meilleur suivi. Par exemple, un bateau qui dégaze est sanctionné avec des amendes de 1 million de francs si on le repère. Il y a eu 17 infractions en 1999 dans ce domaine, repérées par le CROSS Corsen. Elles sont en instance judiciaire. On peut augmenter les sanctions sur ce point, mais souvent on ne sait pas qui a dégazé. On le saura mieux quand on aura mis en place le fameux suivi du trafic puisque l'on repérera le bateau et son trajet. Actuellement on pourrait vous faire une démonstration satellitaire. Les bateaux de pêche qui rentrent dans la zone de pêche ou qui en sortent sont repérés et identifiés par radar. Demain on pourra le faire sur tous les bateaux de commerce. L'évolution technologisque apportera des réponses progressives.
M. Aimé KERGUERIS : La communication entre les CROSS et la Préfecture maritime a-t-elle été satisfaisante, des annonces ayant été faites par la préfecture maritime, puis démenties ?
M. Christian SERRADJI : J'ai été très triste que l'efficacité de mes collaborateurs ait été mise en cause et je l'ai dit à qui de droit. Je suis toujours mécontent, et d'autant plus que cela s'est fait en public et que l'Etat doit parler d'une seule voix, notamment quand il y a ce genre de problème.
Je vais vous dire ce qu'il en est. Il existe un système que j'ai mis en place et qui fait que tout CROSS ayant un problème téléphone à mon chef de centre de CROSS à Paris, M. Babkine, lequel selon la procédure, appelle le sous-directeur de la sécurité maritime, M. Beaugrand qui m'appelle en final. S'il y a un mort, s'il va y avoir un gros problème, il faut saisir le cabinet du ministre. Si l'un de nous trois est absent, la chaîne passe au sommet. Nous sommes toujours avec le portable en prise directe.
Dans le cas de l'Erika, le 12 décembre à 11 heures 45, nos services ont reçu un coup de téléphone. A 12 heures 45, j'étais averti. Une heure après, on m'annonce qu'il n'y a plus de problème. Je demande au CROSS Etel de rester en éveil.
J'ai attendu jusqu'au dimanche matin, toute l'enquête l'a prouvé. L'Erika a émis son second
mayday à 6 heures. A 6 heures 45, on m'annonçait le problème et le préfet maritime était informé.
Le préfet maritime est responsable de la coordination de l'action de l'Etat en mer : c'est l'originalité française et c'est d'une grande efficacité. Il est là pour coordonner. Les services de l'Etat relèvent du responsable de la sécurité maritime.
Nous n'aurions peut-être pas eu les problèmes que l'on a rencontré sur la place publique si la simple règle que j'avais imposée à mes collaborateurs avait été également suivie par le préfet maritime, à savoir : pas de presse sans mon accord personnel.
Mme Jacqueline LAZARD : J'ai été ravie d'entendre tout à l'heure combien le facteur humain était important à vos yeux, en matière de sécurité maritime. Plusieurs questions ont été posées sur le problème des inspecteurs, mais je voudrais parler des marins.
Sur les navires il y a peut-être des problèmes qui commencent à se poser avec la baisse des effectifs, avec les conditions de travail, avec les équipages plus hétérogènes sur les navires de notre pavillon bis, et avec la rapidité des escales qui entraînent une plus grande fatigue des équipages. Les conditions de travail n'entraînent-elles pas une augmentation des risques ?
Vous avez dit au début de votre propos que la formation des marins français était l'une des meilleures, qu'elle était reconnue. Mais il se révèle que la formation pratique des marins sur les passerelles des navires ou dans les machines est de plus courte durée : le temps qu'ils passent en tant qu'élèves sur les bateaux est moins important. Je ne mets pas en doute la compétence, mais peut-être le manque d'expérience qui fait que l'on arrive à des situations quelquefois difficiles.
M. Christian SERRADJI : Sur la formation, la convention STCW crée une obligation de navigation dans des conditions réelles, et non plus en simulateur, d'une durée de 72 mois. C'est au bout de cette durée de navigation que les élèves pourront avoir leur fameux diplôme de capitaine de première classe ou de chef mécanicien. Il faut dire que les armateurs français n'avaient pas été très enthousiastes à leur offrir des postes. Lorsque je suis arrivé, j'ai posé comme principe qu'il n'y aurait pas de subvention s'ils n'étaient pas embauchés. Les armateurs ont fait un effort depuis, et ils réclament plus d'officiers. Je leur ai donné mon accord pour plus d'officiers, en exigeant pour contrepartie plus de stages et plus de prise en main, avec un contrat de qualification ou un contrat d'apprentissage. Il faut reconnaître qu'un énorme effort a été fait.
Le deuxième problème concerne les marins pêcheurs dans les lycées maritimes et aquacoles. Je me suis battu pour donner à l'AGEMA un statut public. On doit mettre un terme à ce discours tenu par beaucoup, selon lequel il faut en faire des chefs d'entreprise. Il faut d'abord en faire des marins. Ensuite seulement, ils seront chefs d'entreprise. Il faut mettre en place un système de formation qui leur permette d'avoir les deux dimensions. Les marins pêcheurs sont aujourd'hui ceux qui posent le plus de problèmes, en termes de sécurité.
Les marins pêcheurs ont des équipements mal adaptés ; ils poussent l'effort beaucoup trop loin en mer, et beaucoup trop longtemps. Les accidents que l'on voit sont malheureusement très souvent dus à la fatigue humaine et à la tension humaine. Sur les lycées maritimes aquacoles, il y a donc un énorme effort à faire pour maintenir un haut niveau de qualification maritime et un haut niveau de qualification en matière de sécurité. Après seulement viennent les autres considérations visant à en faire des chefs d'entreprise, comme le veut l'évolution de ce secteur.
Nous avons fait beaucoup d'efforts sur le CGO, le SMDSM (système mondial de détresse et de sauvetage en mer), tous ces problèmes et la lutte contre l'incendie. Il faudrait mieux les organiser. Il était temps que l'on arrête de faire de la formation des marins pêcheurs une rupture avec le vivier de la Marine marchande, aucun pêcheur ne venant dans la Marine marchande. Il est temps que l'on crée une filière professionnelle maritime unifiée. C'est une des raisons pour lesquelles je n'étais pas d'accord sur le transfert de l'AGEMA à l'Agriculture, parce que c'était briser cette filière professionnelle, technique, à mettre en place du niveau CAP jusqu'au niveau supérieur. J'avais obtenu un accord d'équivalences avec le CNAM pour que, lorsque l'on est officier de la Marine marchande, on soit aussi ingénieur du CNAM. Ces efforts créent des viviers attractifs et des carrières offertes à nos jeunes.
L'élément de sécurité doit être intégré dans la formation initiale et continue de nos marins, quel que soit leur secteur - ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent - . On ne peut le faire que si l'on crée une filière. Je suis très têtu car je crois avoir raison de réfléchir dans cette optique.
En ce qui concerne les effectifs, je crois, Mme la députée, que vous touchez un problème de fond, mais qui est très simple. En termes d'effectifs, la législation française est très claire et précise. En fonction du bateau il y a un effectif obligatoire. Il est scrupuleusement respecté seulement dans la mesure où on a la capacité de contrôler qu'il l'est effectivement, puisque, au nom d'une certaine liberté et du concept de responsabilité, il suffit que le patron dépose dans la boîte aux lettres, avant de partir, le rôle d'équipage. Mais entre le moment où il l'a déposée et l'arrivée au port, un membre d'équipage a pu tomber malade et être remplacé. Nous sommes alors confrontés à un vrai problème d'éducation et du sens de responsabilité. Là encore, je suis prudent quant à la réalité des effectifs tels qu'ils nous sont déclarés. Pour la Marine marchande, c'est plus sérieux.
L'autre problématique que vous soulevez est celle du pavillon bis. Que veut-on ? Veut-on défendre le pavillon français ? Il y a 210 bateaux qui battent pavillon français. Demain veut-on généraliser ce que M. Bolloré vient de faire en transférant 8 bateaux sous pavillon panaméen ? Il s'agit de 8 bateaux sur lesquels il n'y a plus que 4 Français membres d'équipage. Pour cette raison, je crois que le pavillon Kerguelen est à défendre - et peut-être à améliorer - car, pour le moment, il apporte 35 % d'emplois.
Je sais que les syndicats sont contre une telle proposition, mais tant qu'il n'y aura pas une harmonisation sociale et tant que l'on n'aura pas créé un pavillon européen, je crains que l'on ne soit obligé d'accepter un juste milieu, c'est-à-dire de défendre un certain niveau d'emplois français et d'accepter un niveau d'emplois étrangers, avec peut-être
- pourquoi pas ? - une qualification reconnue. N'oubliez pas que les Philippins ont une très bonne qualification.
M. le Rapporteur : Les Indiens aussi.
M. Christian SERRADJI : Tout à fait, et l'équipage de l'Erika était excellent.
On peut peut-être s'inspirer des Hollandais, qui ont carrément passé des accords avec les Philippins pour la formation et la gestion sociale des marins philippins sur leurs propres navires.
On est dans un système de forte concurrence. Essayons de défendre le maximum d'emplois français, et tâchons de préserver le maximum de bateaux. Je crois que nous aurons réussi demain cette reconquête, si le pavillon nouveau, sur lequel M. Jean-Claude Gayssot attend des propositions et sur lequel nous réfléchissons, arrive à associer en raison de sa réputation de qualité, non seulement des bateaux français d'armateurs français, mais aussi des armateurs d'origine étrangère. On créera de l'emploi français, alors qu'aujourd'hui on se vend à l'étranger. Il faut inverser la démarche.
M. René LEROUX : Je vous remercie de la franchise de vos réponses, je pense que tous mes collègues me rejoignent sur ce sujet.
Tout à l'heure vous avez parlé rapidement du secteur des phares et balises, notamment de l'état des bateaux. Je suis personnellement intervenu puisqu'étant à proximité de Saint-Nazaire, je suis directement touché par ce phénomène. Vous avez nommé tout à l'heure des bateaux qui avaient un certain nombre d'années. Il en est de même sur Saint-Nazaire, où stationne un bateau qui n'est pas très jeune et qui fait un excellent travail, même s'il est très fatigué. Je sais qu'un redéploiement est envisagé et je sais que vous êtes parfaitement au fait.
Je voudrais savoir dans quels délais vous estimez avoir la possibilité de remettre à niveau la totalité de ces bateaux. Vous me renverrez peut-être aux 500 millions de francs que vous avez demandés tout à l'heure, mais je demande quelques précisions car j'estime que le balisage est quelque chose d'important et contribue à la sécurité en mer.
Les pêcheurs de ma commune estiment que les contrôles avec vos vedettes maritimes sont beaucoup plus fréquents en direction du monde de la pêche qu'en direction du monde de la Marine marchande. Lorsqu'ils sont dans une zone interdite à la pêche, ils sont repérés immédiatement et la vedette est tout de suite à leur bord.
Je crois qu'il faudrait que vous fassiez un gros effort, notamment dans le domaine satellitaire, pour le repérage des bateaux de la Marine marchande. Vous avez parlé de la fatigue des marins pêcheurs, je vous rejoins complètement et je rejoins aussi Jacqueline Lazard. Il est vrai que les temps de repos sont de plus en plus courts, toutefois le nombre de jours de mer n'est pas aussi important que l'on a bien voulu le laisser croire à un certain moment.
Vous avez évoqué 1 million de francs pour les sanctions d'un dégazage, est-ce suffisant ? Vous n'avez pas la totalité des moyens, mais lorsque vous disposerez de vos systèmes de repérage, pourriez-vous identifier plus efficacement les navires recourant illégalement à cette pratique ?
M. le directeur, le projet de l'école de Nantes me paraît très intéressant, d'autant qu'il s'agit d'un projet européen. Je pense qu'une note sur ce projet ne nuirait pas à la qualité du rapport que nous pourrions faire.
M. le Rapporteur : Ce projet fera-t-il l'objet d'une décision lors du prochain comité interministériel de la mer ?
M. Christian SERRADJI : Le comité interministériel de la mer, va poser le principe d'une formation des inspecteurs. Le dossier de l'école de Nantes était lancé avant l'Erika, mais je peux vous le présenter. L'école de Nantes n'est pas la seule école concernée, il y a également l'école de Bordeaux et l'école de Marseille. Je présenterai le dossier dans sa globalité parce que la réforme est globale.
Pour en revenir aux questions de M. Leroux, je n'ai rien à dire sur la problématique des pêcheurs.
Pourquoi mes vedettes vont-elles contrôler les pêcheurs ? Il s'avère que dans la zone où vous êtes - et notamment dans la zone économique exclusive - nous avons d'énormes problèmes avec les Espagnols. La tendance actuelle est d'essayer de faire respecter, peut-être avec un peu de sévérité, la politique de la pêche plutôt que la politique de la Marine marchande.
M. René LEROUX : Les pêcheurs vont plus souvent au tribunal que les personnes de la Marine marchande. C'est important à souligner.
M. Christian SERRADJI : Oui, c'est vrai.
Nos interventions sur la Marine marchande n'auront d'efficacité que le jour où je pourrai affecter un inspecteur du travail sur mes vedettes. C'est cette mesure qui portera, parce que ce n'est pas la norme technique qui va servir. On le fait déjà au port.
Les règles internationales veulent que le contrôle des normes techniques se fasse au port et non pas sur le bateau en course, sauf demande du capitaine. En revanche lorsque l'inspection du travail sera présente dans nos vedettes, il suffira qu'un marin le réclame et on pourra arrêter un navire.
Il était prévu sur 8 ans, c'est-à-dire de 1998 à 2005, de changer tous les bateaux et toutes les bouées des phares et balises. Le coût de l'opération était de 500 millions de francs. Du fait de la tempête, 4 bateaux ont été brisés, le bateau du Verdon a été abimé, le
Georges de Joly n'est plus utilisable avant les délais initialement prévus pour son remplacement, et le bateau de Dunkerque survit. Je souhaite qu'il n'y ait pas de problèmes aux abords de Dunkerque et je suis obligé de demander aux Anglais de faire de temps en temps notre travail parce que notre bateau ne fonctionne plus. Par ailleurs, on loue un remorqueur anglais pendant 6 mois.
Personnellement, je trouve cela dommageable pour la réputation française.
La programmation de la construction d'un baliseur représente 6 mois de procédure juridique incontournable et 18 mois de construction. Le remplacement du
Georges de Joly ne se fera pas avant 2001-2002, celui du baliseur du Havre sera bientôt réalisé et celui du baliseur de Saint-Nazaire ne sera pas programmé tant que je n'aurai pas l'argent nécessaire.
S'il y avait un « divin Bercy », je demanderais qu'il me donne 500 millions de francs d'autorisations de programme et qu'il décale mes crédits de paiement sur 3 ans. J'engagerais alors tout de suite les marchés, ce que je ne peux pas faire tant que je ne dispose pas des autorisations de programme !.
Audition de M. Jacques LOISEAU,
président de l'Association française des capitaines de navires (AFCAN),
accompagné de M. Bertrand APPERRY
(extrait du procès-verbal de la séance du 23 février 2000)
Présidence de M. René LEROUX, Vice-président
MM. Jacques Loiseau et Bertrand Apperry sont introduits.
M. le Président leur rappelle que les dispositions législatives relatives aux commissions d'enquête leur ont été communiquées. A l'invitation du Président, MM. Jacques Loiseau et Bertrand Apperry prêtent serment.
M. Jacques LOISEAU : Monsieur le Président, Madame, Messieurs les députés, je ferai, dans un premier temps, une brève présentation de notre association.
Tout d'abord, sachez que je suis commandant de navire, que j'ai navigué pour plusieurs sociétés, mais presque toujours pour des armateurs français. J'ai été « prêté » par des sociétés françaises à des sociétés marocaines, ivoiriennes, sénégalaises. J'ai navigué 17 ans comme commandant, dont une dizaine d'années sous pavillon de complaisance avec différents équipages - coréens, croates, philippins, ivoiriens, sénégalais et espagnols. J'ai donc une bonne pratique de ce que l'on appelle les pavillons de complaisance, mais avec des armateurs français, et des
manning operators, sociétés fournissant les équipages.
Notre association réunit actuellement environ 350 capitaines, dont 150 naviguent toujours. Elle a été créée en 1979, après le naufrage de l'Amoco-Cadiz, pour lutter contre les lois qualifiées de « scélérates » par les capitaines parce qu'elles les rendaient responsables de toutes les pollutions et avaient institué des amendes exorbitantes eu égard aux revenus de ces derniers. Ces lois ont été modifiées : même si les capitaines peuvent toujours être désignés comme responsables des pollutions, la responsabilité peut également en incomber à l'armateur.
L'association n'a pas simplement pour but d'instaurer une solidarité entre les capitaines ; elle s'intéresse tout d'abord à la sécurité en mer. C'est la raison pour laquelle, depuis 1979, nous avons énormément travaillé sur les problèmes de sécurité et présenté des propositions. Nous n'avons pas toujours été entendus, mais le domaine maritime n'a pas non plus toujours retenu autant l'attention qu'en ce moment, naufrage de l'Erika
oblige.
Notre association est confédérée à l'IFSMA, la confédération internationale des associations de capitaines, qui réunit 7 000 à 8 000 capitaines. Nous sommes également confédérés à la CESMA, la confédération européenne - l'entité européenne étant, à nos yeux, indispensable pour nous faire entendre. Par ailleurs, nous faisons partie, en France, de la confédération des associations de la Marine marchande- laquelle réunit des associations de protection des brevets, des associations de pensionnés ainsi que des associations de chercheurs d'emplois.
M. Bertrand APPERRY : Monsieur le Président, Madame, Messieurs les députés, je suis capitaine au long cours, retraité depuis fin 1995 et adhérent de l'AFCAN depuis 1980. Après 33 ans de navigation dont 18 comme commandant de navires à passagers, je suis aujourd'hui expert maritime, spécialisé dans l'ISM.
Je mets donc en place, j'audite, j'évalue les systèmes de gestion de la sécurité des navires. En un mot, j'aide des armateurs français et étrangers à se mettre en conformité avec les obligations prévues par le Code ISM. En outre, je participe aux travaux de l'OMI sur ce sujet, au titre de conseiller de l'AFCAN pour la délégation française.
M. Jacques LOISEAU : Le naufrage de l'Erika
nous a appris un certain nombre de choses et a permis une prise de conscience accrue des questions de sécurité maritime en France.
Nous pensons sérieusement, depuis un certain temps, que la création d'un corps de garde-côtes civil européen serait très utile en matière de sécurité maritime ; le modèle américain, sous réserve de quelques aménagements à l'européenne, nous semble intéressant. Nous parlons d'un corps « civil », car l'on s'aperçoit, dans le traitement du naufrage de l'Erika
- mais il en va de même pour d'autres navires -, que la Marine nationale ne peut pas régler tous les problèmes, à plus forte raison lorsqu'ils concernent la Marine marchande. Ce corps civil pourrait réunir tous les experts nécessaires, notre métier étant extrêmement compliqué et varié. Ne nous faisons pas d'illusions, sa création ne pourrait pas intervenir avant une quinzaine d'années, mais sa dimension européenne ne serait pas dénuée d'avantages, notamment financiers.
Ce corps de garde-côtes pourrait, entre autres, labelliser les sociétés de classification et leur donner une note indépendante - car, actuellement, les sociétés de classification s'entendent entre elles et se cooptent par l'intermédiaire de l'IACS. Il s'agirait donc d'une solution pour avoir un point de vue extérieur de spécialiste.
Par ailleurs, il permettrait, en dehors des moyens techniques
employés pour le contrôle de la sécurité, le sauvetage et la lutte contre les pollutions- aviation et navires -, de réunir des moyens qui seraient mis à la disposition de toute l'Europe.
Nous y voyons également l'intérêt d'une unité d'approche dans les contrôles et dans la formation des contrôleurs, ainsi qu'un pouvoir de décision à très haut niveau - pouvoir de décision qui interviendrait dans les moments de crise. Nous savons tous qu'il existe des organismes payants qui viennent en aide aux navires en difficulté, mais l'on pourrait imaginer une entité indépendante et européenne de haut niveau prenant les décisions qui s'imposent en de telles circonstances.
Imaginons que l'Erika ne se soit pas brisé et qu'il n'ait pas coulé tout de suite : quelles décisions auraient dû être prises et par qui, comment désigner un port de refuge ? Je pense que l'on aurait hésité longtemps. Un corps de garde-côtes civil européen, disposant d'un pouvoir décisionnel important et composé de personnes spécialisées mais d'horizons divers et ayant une expérience des crises - ce qui nous manque - nous semble une bonne solution.
Enfin, ce corps de garde-côtes pourrait gérer EQUASIS, la base de données à laquelle nous croyons beaucoup. Nous pensons qu'elle apportera beaucoup plus de sérieux et de connaissances, et aidera, dans leurs prises de décision, tous les opérateurs des transports maritimes. Bien entendu, un certain nombre de paramètres supplémentaires devraient être ajoutés, notamment les particularités du navire.
L'armateur pourrait également être indiqué dans la base de données, mais nous savons tous qu'il peut être une société d'actionnaires, dont la mention présente finalement peu d'intérêt. C'est en fait l'opérateur qui est important et les renseignements le concernant devraient être intégrés à EQUASIS- moyens en ressource, activité, nombre de navires à gérer.
Il serait aussi intéressant de savoir si le navire appartient à une
single ship company et si l'affaire a un « marchand d'hommes » qui affecte l'équipage. Car c'est là le gros problème. Un équipage qui n'a aucun lien avec l'armateur ou le navire n'a aucun intérêt particulier à assurer un excellent entretien du navire : rien ne peut être fait de sérieux et de durable.
Nous avons en effet affaire à des marins qui sont un peu comme des « mercenaires » - ce qui n'a rien de péjoratif dans mon esprit - : ils sont employés à la tâche. Et je reviens là au statut du capitaine sur lequel repose toute la responsabilité alors qu'il n'a pratiquement aucun lien avec l'armateur - qu'il ne connaît même pas. Le commandant indien de l'Erika, Karun Mathur, a été mis en prison, alors qu'il ne connaissait pas l'armateur. Il avait seulement été en relation avec le
manning operator de Bombay qui l'avait recruté et l'exploitant du navire qu'il a découvert le jour où il a embarqué.
Notre fonction de capitaine n'a plus du tout le même sens qu'il y a quelques années. Je parle des capitaines étrangers, car il n'y a pratiquement plus de capitaines français à l'heure actuelle - vous connaissez le niveau de notre marine marchande ! C'est désolant, mais je ne vois pas comment les choses pourront évoluer, alors qu'il s'agit du point crucial de la sécurité maritime future. Il convient d'obliger les armateurs à disposer d'équipages fidèles leur appartenant.
En ce qui concerne les inspections du MOU - Mémorandum de Paris -, nous estimons qu'elles sont nécessaires et que les inspecteurs font très bien leur travail. Mais il ne faut pas leur demander des choses pour lesquelles ils ne sont pas compétents. Nous avons entendu parler de recherche et d'inspection des structures des navires. Or, à chacun son métier : nous ne pouvons demander aux inspecteurs du MOU d'inspecter la structure d'un pétrolier ! Il s'agit d'une tâche compliquée, technique et longue qui doit être réalisée par des spécialistes.
En France, le nombre de ces inspecteurs est insuffisant, ils n'ont pas le temps de tout faire, ne disposent pas du budget suffisant et l'on voudrait leur demander d'être disponibles 24 heures sur 24, tous les jours de la semaine, ce qui n'est pas possible ! C'est la raison pour laquelle un navire suivant une ligne régulière et accostant à un port français tous les week-ends a très peu de chances d'être contrôlé.
Le ministre de l'Equipement, des transports et du logement s'est engagé à doubler le nombre d'inspecteurs - par un recrutement de 150 inspecteurs sur 3 ans -, mais il ne faut pas se faire d'illusion : il faudra leur proposer autre chose qu'un salaire de misère ! Par ailleurs, il serait utile d'avoir recours à des professionnels - de nombreux inspecteurs viennent de la Marine nationale suite à la diminution de ses effectifs - ayant une bonne connaissance de la Marine marchande, sachant également qu'il est difficilement acceptable pour un marin de se faire contrôler par des personnes qui ne sont pas du métier.
Pourquoi ne pas avoir parfois recours, pour des vacations, à des experts issus de la Marine marchande : ex-commandants, ex-officiers ou ex-chefs mécaniciens ? Ça ne se fait jamais à l'heure actuelle !
S'agissant des sociétés de classification, nous n'avons pas grand-chose à dire, les experts de ces sociétés faisant très bien leur travail. Bien entendu, la façon de rémunérer ces sociétés est ce qu'elle est ; ce sont des sociétés privées qui vont être cotées en bourse.
Il convient aussi de rappeler que certains inspecteurs des sociétés de classification sont parfois gênés de constater un problème sur un navire. L'affaire de l'Erika
ne nous étonne absolument pas. Il n'est pas rare, lorsqu'un expert d'une société de classification juge que certaines tôles devraient être changées, que l'armateur fasse pression pour que les réparations soient reportées ; cette situation est courante.
Afin d'aider les sociétés de classification dans leurs inspections quadriennales ou quinquennales, l'on pourrait imaginer, lorsque les navires sont en arrêt technique et que l'on procède à leur reclassification, que le contrôle soit fait conjointement avec un expert du MOU ou d'une autre société de classification. Cela donnerait plus de crédibilité aux résultats de classification.
Il est souvent dit que 80 % des accidents sont dus à des erreurs humaines. C'est vrai, mais ce n'est pas le plus important car le facteur humain intervient aussi dans la fabrication et la conception des navires. Il convient donc avant tout de faire respecter les conventions existantes, telles que SOLAS,
STCW, le code ISM, qui seraient très efficaces si elles étaient appliquées.
Outre la fidélité des équipages, le gros problème actuel est l'utilisation et la fatigue de ces équipages. Or, des règlements concernant ce problème, auront du mal à s'appliquer dans l'Union européenne, car nos collègues européens sont assujettis à des réglementations du travail particulièrement pénibles.
Je prendrai l'exemple des Danois et des Norvégiens qui, pour pouvoir conserver leurs nationaux à bord des navires, réduisent de façon drastique les effectifs des équipages. Ils ont des caboteurs de 110 mètres de long avec 5 personnes à bord ! Des navires de mer au long cours dont l'équipage est composé de 7 ou 10 personnes, le capitaine et son second étant les deux seuls officiers faisant le quart - soit 12 heures de quart par jour auxquelles s'ajoute le travail quotidien ! Le capitaine et son second effectuent ainsi 90 heures de travail par semaine. Ces personnes ne dorment pas et lorsqu'il arrive un incident en mer, ce sont de véritables zombies qui accostent.
Il y a donc là quelque chose à changer, mais il faudra être très fort pour convaincre nos collègues danois ou norvégiens d'appliquer les réglementations de l'OIT. Le quart de nuit, par exemple, qui se faisait avec un officier et un matelot, a complètement été oublié alors qu'il s'agit d'une obligation internationale.
Je terminerai ce propos en vous disant un mot sur un problème de sécurité qui nous tient à c_ur - mais notre dossier est coincé à la préfecture maritime de Brest. Nous pensons que le rail d'Ouessant présente des dangers, en occasionnant des cisaillements avec des angles extrêmement faibles et dangereux dans le Golfe de Gascogne et en Manche. Or nous proposons depuis des années de revenir à un rail à 2 voies, comme cela se fait partout dans le monde. Les CROSS n'y sont pas favorables et y voient des difficultés sur les distances avec les radars. Je pense toutefois que ce sujet mérite qu'on s'y intéresse plus attentivement.
M. le Rapporteur : M. Loiseau, pensez-vous tout d'abord que la charte signée le 10 février au ministère de l'Equipement, des transports et du logement est applicable et permet une avancée ? Quel est le sentiment de l'AFCAN sur ce sujet puisque vous y avez contribué ?
Ensuite, je n'ai pas bien compris ce que vous vouliez modifier dans les modalités de réalisation des contrôles des sociétés de classification. Pouvez-vous nous dire si vous avez confiance en elles ? Les sociétés de classification membres de l'IACS - que vous avez vues fonctionner - sont-elles toutes crédibles ou sont-elles à qualité variable ?
Enfin, s'agissant des pétroliers, on a parlé du système européen de pétrolier E3 ; avez-vous un jugement sur celui-ci ? A votre avis, convient-il d'aboutir à des pétroliers d'une nouvelle génération ? Par ailleurs, la double coque est-elle un bon système ou est-ce simplement un protectionnisme déguisé des Américains ?
M. Jacques LOISEAU : Tout d'abord, je pense en effet que la table ronde organisée par M. le ministre de l'Equipement, des transports et du logement est une avancée importante, car elle a permis une prise de conscience des questions relatives à la sécurité maritime. Cependant, si cette réunion a été positive, elle reste franco-française, c'est-à-dire sans intérêt pratique ; en effet, la Marine marchande française - au 28e rang mondial - ne doit représenter que 3 % du trafic mondial. Toutes ces décisions n'auront d'intérêt véritable et effectif que lorsqu'elles seront transposées au niveau européen.
En ce qui concerne les sociétés de classification, je connais surtout - ayant toujours appartenu à des sociétés françaises - le Bureau Veritas et le Lloyd's Register of shipping. Cependant, j'ai toujours trouvé les inspecteurs des sociétés de classification de l'IACS compétents.
M. le Rapporteur : Les sociétés de qualification membres de l'IACS sont-elles toutes de qualité identique ? Le Rina, par exemple, est-il de même qualité que le Bureau Veritas ?
M. Jacques LOISEAU : Je le pense, oui ; les inspecteurs ont la même formation.
Bien sûr, les rapports humains que l'on instaure avec les inspecteurs des sociétés de classification sont très importants. Lorsque, en ma qualité de capitaine en activité, j'ai eu un problème de structure sur un navire transportant des produits chimiques, j'ai montré le navire à un inspecteur de la société de classification avec qui je m'entendais bien - car on finit par entretenir des rapports humains avec ces inspecteurs, ce qu'il est important de souligner.
En tant que commandants, nous sommes responsables des tenants et des aboutissants des décisions ; on ne peut pas arrêter un bateau du jour au lendemain. Tout un programme commercial est en jeu et la vie de la société en dépend.
Alors, il est vrai que, quelquefois, l'armateur « met la pression » sur l'inspecteur en le menaçant de changer de société de classification s'il arrête le bateau. Je sais que cela existe, car l'inspecteur qui avait contrôlé mon bateau en était un peu victime - certaines de ses décisions ayant été rejetées par Paris. En général, les réparations sont reportées de 3 ou 6 mois. Par ailleurs, l'inspecteur ne peut pas toujours affirmer que les réparations sont vitales.
M. le Rapporteur : Mais le Bureau Veritas et le Lloyd's ont les mêmes références. Les pratiques que vous décrivez ont-elles souvent cours ?
M. Jacques LOISEAU : En me basant sur mon expérience, je peux vous dire que je les ai vues une fois.
M. Bertrand APPERRY : Je connais également des cas où cela est arrivé. Mais en général, ce n'était pas au bénéfice de l'armateur. Au sein de l'IACS, il existe une charte qualité appliquée par les sociétés de classification.
M. le Rapporteur : Par Rina également ?
M. Bertrand APPERRY : Tout à fait. Rina n'est pas une mauvaise société de classification. Elle a des accords particuliers avec le Bureau Veritas et le Lloyd's et de nombreux inspecteurs du Rina sont formés à Londres par le Lloyd's
Register of shipping, dans le cadre de leurs accords internes. Cette société italienne n'est pas la plus mauvaise, même si elle n'est pas la meilleure non plus.
J'ajouterai que, pour nous, qui faisons le tour du monde, la qualité des expertises des sociétés de classification est parfois proportionnelle à la latitude. Je veux dire par là qu'il peut être plus intéressant - plus
soft - de passer une inspection près de l'Equateur que dans nos latitudes, les inspecteurs n'étant pas les mêmes. Tout cela est très subjectif. Un inspecteur est un homme avec des qualités et des défauts, ainsi qu'une formation.
Autre problème, on estime, à tort, qu'un inspecteur de société de classification est expert en tout ; or on ne peut pas être en même temps un grand expert de moteurs thermiques marins et un expert en coques. Et je ne pense pas que dans un port d'Afrique l'on trouve tous les inspecteurs nécessaires le jour où l'on en a besoin.
M. Jacques LOISEAU : En ce qui concerne votre question relative aux pétroliers, Monsieur le Rapporteur, nous pensons que le navire à double coque, imposé par les Etats-Unis, est un navire politique, médiatique ; il ne s'agit absolument pas de la panacée. Nous pensons même que dans l'avenir il y aura de gros ennuis avec ces bateaux qu'il conviendra de surveiller, particulièrement dans leur structure. En effet, la structure des tôles est inférieure à ce qu'elle aurait été sur un navire normal, et la rouille s'y développera à la même vitesse.
Bien entendu, nous croyons beaucoup aux capacités du E3, mais ce sont les Etats-Unis qui commandent ! Et tant qu'ils n'accepteront pas le E3, je ne vois pas de solution.
M. le Rapporteur : Votre association pense donc que la double coque est une manière, pour les Etats-Unis, de se protéger. Est-ce à dire que cela ne sert pas vraiment la sécurité du transport maritime mais empêche plutôt les bateaux non américains d'entrer aux Etats-Unis ?
M. Jacques LOISEAU : Pas réellement, puisque tous les constructeurs pétroliers, à l'heure actuelle, fabriquent des doubles coques afin justement de pouvoir entrer aux Etats-Unis, un marché incontournable. Le bateau à double coque a été imposé par les médias et rendu obligatoire par le Congrès américain, mais, techniquement, mes collègues spécialistes en la matière pensent que c'est une erreur.
Aujourd'hui, un grand nombre de pétroliers sont construits en Corée. Ils sont certes moins chers, mais on en a pour son argent. Dans 15 ans, il est probable que ces navires à double coque seront en plus mauvais état que l'Erika
ne l'était avant son naufrage.
M. Gilbert LE BRIS : M. Loiseau, j'ai bien retenu votre proposition d'un corps de garde-côtes civil européen qui correspondrait au système américain fédéral. S'agirait-il d'une structure inspirée de la gendarmerie nationale, c'est-à-dire rattachée au ministère de la Défense pour sa gestion administrative et ayant sa propre autonomie financière, ou d'une structure complètement autonome ? Dans ce dernier cas, j'aimerais savoir quelle serait la liaison possible avec la haute mer - le danger ne venant pas simplement des côtes -, car à l'heure actuelle seule la Marine nationale a une permanence avec une vision globale du théâtre d'opération sur la haute mer. Par ailleurs, comment envisager une permanence 365 jours par an et 24 heures sur 24 dans le cadre d'un corps civil ?
Mme Jacqueline LAZARD : M. Apperry, vous nous avez dit être expert maritime et spécialiste de l'ISM. L'Erika
est le premier naufrage après la mise en place de ce système ; pouvez-vous nous dire si toutes les mesures de prévention concernant ce pétrolier ont été prises ?
M. Jean-Pierre DUFAU : Ma question concerne également la création d'un corps de garde-côtes civil européen. Le problème qui se pose est de savoir qui commanderait hiérarchiquement ce corps et avec quelles responsabilités, ainsi que la marge éventuelle d'autonomie de ce corps. De quelle autorité politique, au sein de l'Europe, dépendrait-il ?
M. Louis GUEDON : M. Loiseau, vous avez un point de vue sur l'avenir de la Marine marchande, et je vous en remercie. Manifestement, depuis des décennies, la politique maritime de la France ne correspond pas à la grandeur de cette dernière : ce rang de 28e mondial n'était pas le sien il y a 40 ans.
Nous entendons, chaque semaine, des intervenants qui ont des formations, des responsabilités et des expériences très différentes. Bien que tous les points de vue que nous entendons sur les risques pétroliers soient d'un grand intérêt, je souhaiterais que l'on revienne sur votre opinion de personne autorisée, concernant le naufrage de l'Erika.
Estimez-vous que, selon le planning qui nous a été remis concernant les relations entre le commandant, le CROSS et la préfecture maritime, tout s'est déroulé de façon irréprochable, ou pouvions-nous envisager d'autres solutions ?
Par ailleurs, estimez-vous que le navire avait le temps matériel de gagner un abri pour éviter cette pollution qui met en péril l'économie des régions maritimes ?
M. Serge POIGNANT : M. Loiseau, ma question concerne également le corps de garde-côtes civil européen : comment ce corps se situerait-il par rapport au préfet maritime, et qui prendrait les décisions nécessaires au moment d'une crise ?
M. Jacques LOISEAU : Je suis malheureusement mal placé pour vous répondre, car je ne suis pas un spécialiste de l'organisation des administrations !
Le corps de garde-côtes civil européen est un vieux rêve ! Nous y avons beaucoup travaillé, notamment avec la Commission européenne. Il est vrai que cela demanderait un effort fabuleux pour pouvoir réunir toutes les administrations. En France, c'est absolument impossible : chacun tire de son côté. Les douaniers se baladent déjà avec des écussons sur leur poitrine où il est inscrit « garde-côtes » !
Les douaniers, donc, tirent d'un côté ; la Marine nationale, de l'autre ; certains inspecteurs des Affaires maritimes sont civils, d'autres militaires... Ne comptons pas sur la France pour y arriver. Un tel corps ne peut voir le jour que par l'Europe. Bien entendu, je ne vous donnerai pas la solution, tout cela me dépasse - je ne suis que commandant de navires ! Il vous appartient d'ailleurs davantage qu'à moi de trouver une solution. Vous en avez les moyens.
Pourquoi ce corps doit-il être civil et non militaire ? Parce que les militaires éprouvent des difficultés à s'adjoindre les compétences des civils, spécialistes de la gestion des crises. Or, chaque accident demande des spécialistes, lesquels ne se trouvent parfois que dans le civil.
M. Bertrand APPERRY : J'ajouterai que chaque contrôle doit être réalisé par un spécialiste. Je vous citerai un exemple.
Lorsque j'étais en activité, il m'est arrivé de faire une escale à
Corpus Christi, au Texas, avec un navire transportant du GPL - butane propane -, qui était suivi par l'ABS américain - American Bureau of Shipping. Nous sommes restés sur rade 48 heures en attendant la visite d'un capitaine des garde-côtes spécialiste du gaz - venu spécialement en hélicoptère - : il avait navigué 15 ans au long cours sur un gazier du même type. Le contrôle était donc tout ce qu'il y a de plus pertinent et efficace. Je me souviens avoir dit au commandant que les moyens dont disposent les Coast guards m'apparaissaient considérables. Il m'a répondu que le déplacement du capitaine des garde-côtes était à notre charge.
Je répondrai maintenant à la question de Mme Lazard concernant le code ISM - je vous remettrai d'ailleurs un document à ce sujet. Le code ISM est un outil international de prévention des accidents de mer. Il met en place, pour l'essentiel, une gestion des ressources humaines liée à la sécurité et à la prévention de la pollution. Dans ce but, il structure un programme de réduction des risques engendrés par les activités humaines dans la compagnie et à bord du navire. Tel est le code ISM, obligatoire pour les pétroliers depuis le 1er juillet 1998. L'Erika
était donc certifié ISM.
Nous savons qu'il a été certifié par le Rina, qui était également la société de classification - la classification du bateau étant différente de sa certification. Il nous reste à découvrir comment ont été réalisés les audits de certification.
L'OMI a mis en place ce code ISM avec des dates d'obligation ; des
warning ont été lancés par l'OMI, et tout le monde pensait qu'il s'agissait d'un moyen trouvé par la communauté internationale pour éradiquer les navires sous-normes. Tous les navires non conformes devaient partir à la ferraille.
Le 1er juillet 1998, tous les bateaux ont été certifiés ! D'où notre interrogation : les navires poubelles aussi ? Nous sommes donc assez sceptiques sur la valeur des certifications ISM. Je ne parle ni de la France, ni des Etats-Unis, ni de la Grande-Bretagne, ni de l'Allemagne ou de la Hollande qui ont leurs propres services assurant la certification ISM au sein de l'administration maritime, mais de tous les autres pavillons qui n'ont pas les mêmes moyens et qui ont délégué la certification ISM aux sociétés de classification.
C'est ce qui s'est passé pour l'Erika : le Rina a assuré la classification et la certification. Or nous sommes favorables à la séparation de ces deux fonctions. Il y a toujours - y compris dans la certification ISM - une relation de client/contrôleur entre la société de classification et l'armateur qui est assez délicate.
Quelles sont les solutions ? En tant que spécialiste ISM qui travaille sur ce sujet depuis plus de 5 ans, il me semble que l'une des solutions serait une meilleure formation des inspecteurs - pour la classification et pour l'ISM. On ne gère pas les ressources humaines à bord d'un navire comme l'on gère de la ferraille ou un moteur thermique. Or ce sont les mêmes inspecteurs qui effectuent ces visites dans le monde entier ! Pourquoi ? Parce que l'on a été très vite et que la formation n'a pas suivi.
Je suis l'un des premiers à demander à l'OMI que la formation des inspecteurs ISM intègre davantage la gestion du facteur humain. Les audits ne doivent pas être effectués comme des inspections ; or c'est ce qui se passe. J'ai ici le questionnaire du Rina relatif à la certification ISM de l'Erika : nous avons affaire le plus souvent à des inspections mettant notamment l'accent sur le contrôle de la pompe à incendie ou de l'extincteur. Ce n'est pas de la gestion de ressources humaines, encore moins un audit de la qualité et de la gestion du facteur humain.
M. le Président : Pouvez-vous nous remettre le questionnaire du Rina ?
M. Bertrand APPERRY : Bien entendu. Je vous remettrai également le questionnaire du Germanisher Lloyd's
comme cela vous pourrez comparer.
Dans le cadre de la gestion d'une situation de crise comme celle de l'Erika, il existe des organismes privés tels que le
Ship Emergency Response Service, - le SERS -, rattachés au Lloyd's
et au Bureau Veritas principalement, qui peuvent aider les capitaines. En effet, ces derniers, en pleine tempête, ne sont pas en mesure d'effectuer tous les calculs de stabilité. Ces services sont rendus 24 heures sur 24, moyennant finances
- c'est même assez cher -, et ils ont fait la preuve de leur efficacité.
Nous pourrions envisager que de tels services, avec une contribution européenne, s'intègrent dans un corps de garde-côtes civil européen.
Aux Etats-Unis, le SERS est obligatoire au titre de l'Oil pollution act de 1990, suite au naufrage de l'Exxon Valdez. En cas de problème, les commandants de pétroliers - qui ont passé un accord avec le Lloyd's
ou le Bureau Véritas - peuvent appeler le SERS et ils seront conseillés sur les mesures à prendre pour éviter que la situation d'urgence dans laquelle ils se trouvent ne s'aggrave.
M. Jacques LOISEAU : L'Erika n'a bénéficié d'aucun secours de la part de l'armateur et n'a demandé aucune aide extérieure.
Nous avons lu le rapport du BEA sur le naufrage de l'Erika. Nous avons un point de vue, mais nous ne disposons pas de tous les éléments pour juger - et il ne nous appartient pas de porter un jugement. Cependant, nous pensons qu'il n'y a rien à dire en ce qui concerne les relations qui ont été établies entre le commandant et le CROSS, compte tenu des moyens dont il disposait et de la distance.
Il convient de se mettre dans la peau d'un collègue étranger : comment aurions-nous réagi au milieu du golfe de Bengale? A qui nous serions-nous adressés ? Pour un commandant indien au milieu du trafic d'Ouessant, les personnels du CROSS ne sont que des personnes au bout d'une radio se trouvant dans une zone très restreinte.
Je précise qu'à bord de tous les navires se trouvent des documents - les SOPEP - indiquant les adresses et les numéros de téléphone indispensables pour pouvoir joindre les autorités dans la région où le navire se trouve. Il n'en a pas du tout été fait mention dans le rapport du BEA.
Ensuite, on pourrait toujours discuter sur les manoeuvres de notre collègue indien. Mais il est facile de le faire de notre fauteuil ! Nous pensons néanmoins qu'un certain nombre de choses n'ont pas fonctionné dans l'esprit du code ISM, ce qui prouve bien, une fois encore, que le fait que le commandant n'appartienne pas à la société n'est pas une bonne chose pour la sécurité.
M. Bertrand APPERRY : Le code ISM concerne la gestion de la prévention. Dans le cas du naufrage de l'Erika, le capitaine n'est pas exempt de toute erreur ou, du moins, de mauvaises évaluations des risques. Il commandait un navire ancien et il savait que la corrosion avait envahi les cloisons - l'inspecteur du Rina le lui avait dit. La société de classification avait décidé que le navire pouvait prendre la mer, mais le capitaine savait qu'il ne pouvait compter sur une fiabilité totale de son bateau.
Et il a eu à gérer une tempête avec un bateau qui n'était pas sûr à 100 %. Or nous savons ce qu'est une tempête de suroît à l'entrée de la Manche : ce sont des creux pouvant aller jusqu'à 6 mètres toutes les 15 secondes pendant 24 heures ! Le bateau fatigue - pour reprendre la terminologie usuelle du carnet de bord !
C'est là qu'intervient le code ISM. Selon ce code, une tempête est une situation d'urgence : des précautions doivent être prises ; les risques doivent être évalués. Je pense que le commandant Karun Mathur est, certes, un bon marin, mais un officier un peu jeune néanmoins pour affronter une telle situation d'urgence et insuffisamment formé pour gérer un tel risque. Je précise que c'est d'une attitude pro-active insuffisante dont je parle. Il a très bien su gérer la crise après. La commission du BEA ne parle pas non plus de prévention des risques - elle ne parle que de la gestion de la catastrophe.
M. le Rapporteur : Vous estimez donc que tout a été fait dans les règles à partir du moment où le commandant a donné l'alerte?
M. Jacques LOISEAU : Tout à fait. Mais je voudrais revenir sur l'histoire du port de Saint-Nazaire qui a refusé d'accueillir le bateau, juste pour dire que les positions de chacun ont été éclaircies. Je m'interroge néanmoins sur ce qu'il serait advenu si la coque du bateau ne s'était pas rompue.
M. Alain GOURIOU : En ce qui concerne les transports d'hydrocarbures, le commandant, dans une situation difficile, a-t-il réellement toute latitude pour prendre ses décisions ou est-il lié à une obligation d'en référer à son armateur ou à son affréteur avant de lancer un appel de détresse ou de solliciter de l'aide, notamment en vue d'un éventuel remorquage ?
M. Jacques LOISEAU : Cela dépend du caractère de chacun, des habitudes, des maisons. Mais l'appel au secours est une décision du commandant ; il n'a pas à en référer à son armateur. En revanche, la plupart des services liés à cette décision - comme le remorquage - sont payants, de sorte qu'il doit, dans ce cas, passer par son armateur.
J'insiste sur le fait que tous les opérateurs mettent en permanence la pression sur les capitaines de navires, en particulier lorsqu'il s'agit de porte-conteneurs. Ne serait-ce que pour respecter les horaires, on vit avec une montre dans le ventre, car si l'on arrive à une escale avec 2 heures de retard tout le programme à suivre en est bouleversé
- notamment pour les commerciaux qui sont dans les bureaux.
Traverser l'Atlantique avec des contraintes horaires cause énormément d'accidents et de casse sur les porte-conteneurs ; il y aura donc d'autres accidents de structure, non pas sur les pétroliers, mais sur les porte-conteneurs, ce qui peut être aussi grave !
M. Bertrand APPERRY : Nous ne savons pas si le capitaine de l'Erika a subi des pressions de la part de son armateur, mais l'histoire de l'Amoco-Cadiz
s'est peut-être répétée.
A la suite du naufrage de l'Amoco-Cadiz, l'OMI avait élaboré la résolution A443 précisant que les gouvernements devaient légiférer pour protéger le capitaine des réactions de son armateur suite à ses décisions concernant la sécurité et la prévention de la pollution - en d'autres termes, pour éviter que le capitaine ne soit renvoyé après l'arrivée à quai ou après l'échouement du bateau. Or, cette résolution n'a été prise en compte que par un pays : le Liberia !
J'ai interrogé officiellement l'administration française à ce sujet il y a déjà 2 ans. Or je n'ai jamais eu de réponse. Le fonctionnaire chargé de me répondre m'a officieusement déclaré ne pas avoir de réponse.
Il serait peut-être temps de revenir sur ce point et de prendre en compte cette résolution afin de protéger les capitaines qui prennent des décisions allant dans le sens de la sécurité et de la prévention des pollutions ! Nous ne savons pas ce que le capitaine Mathur et son armateur ont pu se dire avant le naufrage.
Audition de M. Francis VALLAT,
président de l'Institut français de la mer
(extrait du procès-verbal de la séance du 23 février 2000)
Présidence de M. René LEROUX, Vice-président
M. Francis Vallat est introduit.
M. le Président lui rappelle que les dispositions législatives relatives aux commissions d'enquête lui ont été communiquées. A l'invitation du Président, M. Francis Vallat prête serment.
M. Francis VALLAT : Mon introduction sera forcément brève dans la mesure où je pensais qu'il s'agissait exclusivement d'un jeu de questions et de réponses...
M. le Président : Cela peut se faire mais, étant donné vos déclarations, il serait peut-être bon que vous expliquiez le rôle que vous tenez aujourd'hui.
M. Francis VALLAT : Je suis intervenu principalement, comme vous le savez et comme vous l'avez rappelé, en tant que président de l'Institut français de la mer qui est une association d'utilité publique, et la seule de son genre qui regroupe aussi bien les cinq marines - Marine nationale, marine marchande, marine de pêche, marine de plaisance et marine de servitude portuaire - que des représentants de l'aquaculture ou de la protection du littoral, par exemple.
Mes propos, sans être forcément toujours justes - j'espère qu'ils le sont ; ils correspondent en tout cas à des convictions - non seulement sont des propos sincères mais ont aussi le mérite, compte tenu d'une part des différents intérêts que je représente, qui sont des intérêts parfois contradictoires ce qui m'oblige à faire preuve d'une grande prudence vis-à-vis de mes mandants, d'autre part des différentes sensibilités des métiers que je représente, de venir de quelqu'un qui se trouve contraint à l'objectivité maximale.
Malgré cette diversité, je tiens à vous dire que chacune des positions que j'ai pu prendre publiquement a été suivie unanimement par les divers représentants que je viens de citer. Ce n'est pas indifférent dans la mesure où vous avez pu constater, si vous en avez pris connaissance, que mes propos n'étaient pas lénifiants et que certains d'entre eux portaient sur des sujets pour lesquels les intérêts de départ étaient apparemment contradictoires.
Je crois pouvoir dire aujourd'hui - et nous avons encore réuni le conseil d'administration, il y a deux jours - que je parle au nom de tous ces intérêts, étant entendu que nous avons aussi la participation active à ce conseil du directeur des transports maritimes, des ports et du littoral, M. Gressier, et que doit nous rejoindre très bientôt le directeur de la sécurité maritime, M. Serradji.
Cette précision étant apportée, je me suis également beaucoup inspiré dans mes déclarations, non seulement de mes propres réactions, passées au filtre des intérêts que je représente, mais aussi de mon expérience puisque, pendant vingt-sept ans, j'ai été armateur pétrolier, fier de l'être et fier d'ailleurs d'avoir reçu certains d'entre vous à bord des navires dont je m'occupais.
Le sujet a déjà été largement débattu donc s'il y avait vraiment une nécessité de déclaration préliminaire elle porterait évidemment sur les questions de coordination des règles et d'application des sanctions, et pas seulement en cas d'accident ce qui justifierait d'ouvrir deux sous-chapitres.
Le premier aurait pour objet de déterminer s'il faut, ou non, intégrer la notion de faute moyennant probablement quelques nuances à apporter par rapport à des déclarations qui ont pu être faites publiquement par certains d'entre vous et sur l'esprit desquelles j'étais tout à fait d'accord, concernant notamment l'exemple américain.
Le second aurait trait à des sujets probablement un peu plus techniques : je crois qu'il faut quand même dire un mot de la double coque, se poser la question de savoir si la situation dans laquelle nous nous trouvons est irréversible, dresser un constat réaliste et, au-delà des accidents, parler des comportements criminels, non accidentels (de type dégazage en mer), que vous connaissez bien et qui sont révoltants.
Ces comportements sont insuffisamment contrôlés et, quand ils sont constatés, insuffisamment sanctionnés probablement du fait de la concurrence commerciale qui existe entre les Etats de l'Union. C'est un phénomène que chacun peut comprendre mais qui est de nature à pervertir certains comportements, y compris certains comportements des autorités, ce qui nous conduit à penser que la seule solution à ce niveau doit être de type européen.
Je crois que ce sont là les grands sujets qu'il faut couvrir, étant entendu qu'il en est un majeur qui apparaît en filigrane : je veux parler du problème du pavillon qui n'est, bien entendu, pas l'objet essentiel de cette commission. J'en suis tout à fait conscient mais je tiens à vous dire une chose qui vous fera probablement sourire : j'ai participé pendant plusieurs années au conseil d'administration de cet institut, j'ai été élu en novembre et le premier conseil que j'ai présidé, après les journées de Rennes sur la formation et l'emploi maritimes, s'est tenu, par les hasards du calendrier, une semaine après que j'ai eu à présider, à Marseille, une journée sur le transport pétrolier par voie maritime et une journée avant l'incident de l'Erika...Or, au cours de cette séance, il m'a fallu deux heures de débats, non pas pour imposer, mais pour obtenir l'accord unanime de l'Institut français de la mer pour que nos prochaines journées, les journées nationales de la mer qui se tiendront en octobre et novembre, portent sur le thème du pavillon national, ces journées portant pour titre « Un pavillon à quoi ça sert ? » et pour sous-titre « Pourquoi en France cela ne marche-t-il pas ? ».
Inutile de vous dire que, sur ce plan-là, l'aventure de l'Erika
qui nous navre tous, aussi compte tenu de la très forte proportion bretonne de notre conseil, peut être un mal dont sortira un bien car, en dépit de quelques voix discordantes prétendant que le pavillon est un peu « ringard » et que les choses ne se font plus comme cela, sur la défense du pavillon nous sommes rejoints par la totalité de la communauté maritime, d'une façon sincère ou non, ça n'est pas grave car comme le disait La Rochefoucauld « l'hypocrisie est un hommage que le vice rend à la vertu », mais en tout cas absolument forte.
M. le Rapporteur : Pour lancer le débat, M. Vallat, j'ai lu vos déclarations dans
Les Echos et je voudrais formuler deux interrogations de fond.
Premièrement, j'ai cru comprendre que, de votre point de vue, que l'OMI
- Organisation maritime internationale - a mis sur pied un dispositif réglementaire de qualité, tout le problème étant qu'on ne sait pas l'appliquer et qu'on ne l'applique pas alors qu'il serait de nature à améliorer la sécurité. Est-ce bien votre sentiment ?
Vous ajoutez que ces règles ne sont pas appliquées au niveau de l'Etat du pavillon, qu'il est un peu irréaliste de penser qu'elles le seront demain matin et que la seule solution qui nous reste est de les faire appliquer par l'Etat du port. Ces contrôles n'étant pas assez rigoureusement effectués, peut-être conviendrait-il de les renforcer, et si tel est le cas, comment ? J'aimerais connaître votre opinion sur ces différents points.
Deuxièmement, vous vous montrez un peu critique sur l'Oil Pollution Act, sans doute avec plus de connaissances que nous ne pouvons nous-mêmes en avoir. Notre jugement est probablement plus favorable à force d'entendre, depuis cette affaire de l'Erika, tout le monde prétendre que l'Oil Pollution Act
est une très bonne chose dont nous devrions nous doter alors que vous déclarez, vous, qu'il n'est pas si parfait : pourriez-vous développer un peu ce point de vue ?
J'aurai une dernière question d'un ordre tout à fait différent : puisque vous vous êtes occupé du
Tanio et que nous sommes aujourd'hui confrontés au problème précis de l'Erika, de par votre expérience, pouvez-vous établir des comparaisons entre les deux catastrophes ? C'est une question qui n'a rien à voir avec les deux premières. Elle est très technique et d'actualité mais votre expérience pourrait, en la matière, nous être très utile.
M. Francis VALLAT : Sur les règles de l'OMI, je pense qu'effectivement au total l'arsenal des règles existantes est de qualité exceptionnelle. Il devrait être complété sur un simple point qui est celui des navires anciens à propos desquels manquent quelques chapitres sur lesquels je vais probablement revenir .
Quoi qu'il en soit, même en leur état actuel, si les règles de l'OMI étaient respectées scrupuleusement et avec toutes les conditions que cela suppose, c'est-à-dire les contrôles et les sanctions nécessaires, on aurait beaucoup moins d'accidents ce qui ne veut pas dire que l'on atteindrait le risque zéro, vous le savez bien. Eric Tabarly, que j'ai eu l'honneur de bien connaître et qui venait chez moi de temps en temps, avait pour coutume de dire : « La mer, ça se respecte ! ». Quand il parlait d'Alain Colas, il disait de lui que c'était un grand homme et un homme courageux, mais qu'il ne respectait pas la mer car ses défis étaient trop fous, et Eric est disparu de ne pas avoir respecté la mer sur un point d'ailleurs qu'il savait - en conscience - ne pas vouloir respecter.
Mis à part cet appendice concernant les navires anciens, je pense que l'arsenal de l'OMI est tout à fait performant, que contrairement à une idée reçue - et qui nous sert parfois d'excuse dans nos pays où l'OMI sert de bouc émissaire -, les textes qui s'y font sont des textes qui sont initiés et conçus par des pays comme les nôtres, mais qui sont votés par l'ensemble des nations - même quand nous sommes minoritaires - pour une raison qui est bien simple : les Etats du pavillon qui ne font pas respecter les règles ne veulent surtout pas apparaître officiellement comme étant des gens qui les bafouent, ce qui les conduit à tout approuver, y compris les textes les plus durs.
C'est donc une idée fausse de penser que ce sont Malte, Chypre, Saint-Vincent-et-les-Grenadines et autres qui font les textes ou les défont : c'est bien nous qui les faisons et tout le monde les vote, mais le problème tient à leur application. Si je précise cela, c'est pour contrer une idée qui revient souvent et qui nous sert aussi un petit peu d'excuse.
Nous, les pays développés, les nations maritimes traditionnelles, sommes bien le pouvoir moteur et nos pays n'ont pas à rougir de ce qu'ils ont fait qui est un arsenal législatif international que je considère véritablement comme étant d'une qualité exceptionnelle.
Je pense que s'ajoute, au niveau de l'OMI - je suis bien conscient de ne pas dire que des choses qui plaisent - un problème qu'il est très important de reconnaître sur le plan du principe : tout texte unilatéral affaiblit un ensemble multilatéral et crée des confusions au travers desquelles les gens complaisants se faufilent pour passer au travers des mailles du filet. C'est une dimension importante au niveau du principe et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'on a conçu le MOU - Mémorandum de Paris - qui institue le contrôle par les Etats du port, (en rappelant que le contrôle des Etats du port est né de la faillite des Etats du pavillon : si les Etats du pavillon avaient fait leur travail, le contrôle des Etats du port serait superflu). De fait, les Etats du MOU sont là d'abord pour faire respecter les règles multilatérales de l'OMI.
Nos aînés ou les hommes de ma génération - je commence à vieillir - qui étaient alors aux commandes de l'Etat ou ailleurs et qui n'étaient pas plus imbéciles ni moins soucieux que nous, ont pris grand soin d'affirmer ce principe et les Etats du MOU se sont inscrits dans le cadre des conventions internationales en veillant à bien préciser qu'il fallait un contrôle très strict de celles-ci dans les ports, compte tenu du fait que les Etats du pavillon ne faisaient pas leur travail. Tout le problème tient au fait que, par manque de moyens et parfois de compétences, on s'est contenté du plus facile - mais c'était un point de départ et la France a joué un rôle moteur sur ce point, ce dont j'ai été très fier - de contrôler la régularité des papiers plutôt que la réalité à bord.
Je me souviens à cet égard de l'exemple d'un pétrolier, dont j'ai maintenant oublié le nom, mais dont le système de gaz inerte fonctionnait officiellement puisque tous les voyants lumineux du tableau électrique clignotaient comme ils devaient le faire à cela près qu'ils étaient alimentés séparément !
Comme n'importe quel professionnel vous le dira des règles l'OMI, ce sont bien nos pays qui en sont les pères et les autres pays les suivent, mais le problème qui reste posé est celui de leur respect et là, je suis effaré de lire parfois qu'il faudrait doter l'OMI de pouvoirs de police.
En effet, je considère qu'encore une fois c'est là une bonne façon de perdre du temps par irréalisme ! Sans que les organisations internationales soient systématiquement des « machins » ce sont quand même des machines lourdes : on sait tous les Etats très soucieux de leur souveraineté et nous avons déjà assez de mal à créer des forces pour intervenir, ici ou là, au nom de l'ONU - ce sont des forces de police qui ont des difficultés à intervenir, qui s'interposent mais avec de faibles moyens - pour ne pas penser raisonnable d'envisager de doter l'OMI d'une force mondiale quasiment militaire ou de contrôle. Cette perspective ne me paraît pas forcément irréaliste à terme, mais elle demandera des décennies pour être menée à bien.
Aujourd'hui, que se passe-t-il ? Nous avons des Etats du pavillon et des Etats du port qui, eux, ont une certaine souveraineté en mer et/ou sur leurs côtes - nous y reviendrons probablement tout à l'heure - qui est, soit individuelle, soit partagée à un niveau régional. Compte tenu des problèmes de compétition interétatique auxquels j'ai fait allusion précédemment, il est probable qu'au niveau des sanctions, les pouvoirs de police doivent résulter d'une harmonisation au niveau européen.
Pour la première fois, le Français moyen que je suis, a entendu à la télévision, peut-être comme vous l'avez fait vous-même, la commissaire européenne espagnole tenir un raisonnement que certains d'entre nous défendent depuis longtemps. Il consiste à dire qu'après tout et par comparaison avec l'attitude des USA - parce que l'Oil Pollution Act
contient, bien sûr, énormément de bonnes choses - l'Europe est la première puissance économique et commerciale du monde, que si nous nous unissons, aucun armateur international digne de ce nom ne peut penser se dispenser de commercer un jour ou l'autre avec nous et qu'il suffit donc d'avoir les mêmes règles et de les appliquer de façon égale dans nos ports pour que l'ensemble de la communauté armatoriale les respecte. C'est un raisonnement complètement juste que nous tenions - et Jean-Yves le Drian le confirmera - depuis déjà quelques années sans être entendus.
C'est un raisonnement absolument juste qui a été celui des Etats-Unis, puissance qui a imposé brutalement et efficacement ses règles à elle...
Une anecdote à ce sujet. Pour avoir fait partie, en tant que vice-président de l'Organisation mondiale des pétroliers - Intertanko -, des négociateurs qui se sont rendus au Congrès américain, je peux vous dire que nous avons eu une séance de travail avec les
U.S. Coast Guards, où nous avons fait valoir, dès le départ, de bons arguments, précisément sur la question des doubles coques. Les garde-côtes, qui ont d'ailleurs fait par la suite un travail absolument remarquable, avaient un pouvoir énorme dans cette élaboration des textes tout en se tenant à un cadre très strict qui résultait de l'Exxon Valdez puisque les hommes politiques, poussés par l'opinion, voulaient des mesures, non seulement rigoureuses mais encore visibles et surtout perceptibles par l'opinion publique, ce qui pouvait rendre certaines d'entre elles contestables, voire perverses.
Or, à un moment de cette réunion, alors que l'amiral qui commandait à l'époque la
Coast Guard, répondait plutôt avec gentillesse et efficacité à nos objections en arguant que, son pays étant le premier importateur mondial de produits pétroliers, aucun armateur pétrolier ne pouvait se dispenser de commercer un jour ou l'autre avec lui et que n'importe quel bateau empêché d'aller aux Etats-Unis perdrait de sa valeur de vente ce qui obligerait les armateurs à se doter des navires voulus par les Américains, son numéro deux, dont j'ai oublié le nom, a explosé, au grand dam de l'amiral qui le calmait, et a décrété: « Nous avons libéré le monde, nous sommes la première puissance du monde et vous ferez ce qu'on dit ! »
Je vous jure que c'est ainsi que les choses se sont passées et que l'amiral a dû intervenir tant cette réaction était gênante...
Donc, il n'y a pas de doute que si nous, Européens, le voulons - d'ailleurs dans l'esprit du MOU qui, comme vous le savez dépasse largement les frontières de l'Europe -, nous pouvons avoir les moyens d'imposer un bon contrôle des Etats du port, une bonne police faite par les Etats du port, au niveau régional plutôt qu'au niveau des Etats, et qui sera toujours supérieure à celle qui pourrait être faite par l'OMI dont ça n'est pas la mission et qui, à vue humaine, ne me paraît pas pouvoir disposer des moyens suffisants pour imposer une police mondiale.
En conséquence, il est très bien d'avoir de bonnes idées, mais si, au niveau de leur application, elles sont trop compliquées à mettre en oeuvre elles peuvent aussi servir
- et c'est une chose qui m'a toujours inquiété et que j'ai observée à plusieurs reprises dans le domaine maritime, comme dans la vie courante d'ailleurs - de paravent à ceux qui préfèrent s'en saisir au motif caché qu'elles sont irréalisables et qu'elles permettront de repousser le problème. Cet état d'esprit se retrouve chez bien des Etats du pavillon de l'OMI qui votent des textes très contraignants comme je le soulignais tout à l'heure.
Pour finir de répondre à votre question sur l'OMI, je pense que rajouter une couche de textes pour se faire plaisir, à chaque fois que se produit un accident, soit parce que l'on est homme politique et que l'on est responsable devant l'opinion publique, soit parce qu'on est bon professionnel et que l'on veut montrer qu'on soutient ce qu'il y a de plus dur, c'est aussi courir un danger énorme.
En effet, plus on accumule les textes, plus on crée un maquis. Or, plus le maquis est épais, plus les contrôles sont difficiles à exercer et plus les échappatoires se multiplient pour les moins bien intentionnés. Donc, la simplicité est très importante.
Au niveau de la seconde partie de votre question, sur l'agence européenne, les cinq présidents d'organismes maritimes français ont signé un papier sur le sujet mais des nuances sont apparues...
Certains voulaient une agence maritime européenne mais je leur ai opposé qu'il ne convenait pas de faire une bureaucratie de plus et qu'il était préférable de s'en tenir à une agence légère, ce qui nous a conduits à transiger sur une « agence opérationnelle ».
J'ai commis un ou deux articles où je soulignais que ce que les Américains avaient fait de remarquable, c'était de faire respecter les règles par les
Coast guards ce qui a d'ailleurs été perçu comme une demande de
Coast Guard européenne : je pense que, là aussi, il faut faire très attention parce les choses sont extrêmement compliquées et qu'il ne faudrait pas, non plus, que nos propositions servent de repoussoir.
L'organisme que serait l'Agence européenne ne m'intéresse pas moi, en tant que tel. Ce sont les moyens mis en _uvre qui comptent. Il y a des querelles entre administrations, entre pays - et j'ai rencontré, au cours des semaines passées, des hauts fonctionnaires français avec qui vous pouvez imaginer que je me suis longuement entretenu de tout cela - où se mélangent à la fois des défenses de boutiques et de bons arguments.
Par exemple, il ne faudrait probablement pas faire une agence européenne trop puissante parce que, les Anglo-saxons en ayant déjà une, elle « boufferait » l'agence française : je suis sensible à cet argument tout en notant que, là, on ne parle plus de sécurité.
En revanche, il est probablement vrai qu'il ne faut pas faire de
Coast Guard parce qu'elle poserait des problèmes qui sont trop compliqués à régler : il suffit de voir, chez nous, ceux qui se posent entre la gendarmerie et les douanes.
Il appartient aux politiques, donc à vous, de décider ce qu'il convient de faire tout en considérant qu'il y a deux dimensions très importantes : les choses doivent premièrement, se faire au niveau européen et deuxièmement, porter sur l'harmonisation des règles, de leur application, du contrôle de cette application, et enfin des sanctions (ainsi que sur le renforcement de ces dernières, y compris sur un plan pénal pour un certain nombre de délits). En effet, aussi longtemps que vous n'aurez pas mis un armateur en prison pour dégazage sauvage, aussi longtemps que vous n'aurez pas fait payer des amendes, non pas de 200 000 francs mais d'un million de francs, il y aura des dégazages sauvages...
Cela étant, il faut aussi balayer devant sa porte : l'Etat n'est pas tout à fait propre sur ce plan, notamment en raison de la concurrence entre les ports, etc.
Il y a donc nécessité d'une harmonisation européenne et je sais de quoi je parle quand je parle de dégazages puisque mes commandants avaient et ont toujours pour consigne de dénoncer les dégazages dont ils peuvent être témoins. Systématiquement, ils dénoncent même si ce n'est pas une position particulièrement confortable, ni toujours bien vue, mais je fermerai là la parenthèse sur les dégazages.
Au niveau de l'organisation et de l'harmonisation, je crois vraiment qu'elles ne peuvent se faire qu'au niveau européen. Les représentants de l'administration française sont d'accord sur l'objectif d'harmonisation des règles, de la façon de les appliquer et des sanctions mais il y a des querelles - et j'espère, bien que mon audition soit enregistrée, que mes propos ne seront pas colportés dans tous les ministères car je ne voudrais pas m'y faire que des ennemis encore que j'ai juré de dire la vérité et que c'est peut-être une occasion de faire bouger les choses - au nombre desquelles il convient de bien distinguer les querelles de boutiques des querelles de fond, ce qui prouve que la tâche ne sera pas forcément facile...
Sur cette base nous avons suggéré quelques idées concrètes sur lesquelles nous sommes tous d'accord - aussi bien les représentants des administrations avec qui j'ai eu l'occasion d'en parler que ceux d'autres intérêts privés, puisque j'ai conservé des amitiés avec Intertanko que j'ai contactée et que j'agis en totale transparence avec les autorités françaises - et qui sont très simples. On peut, par exemple, augmenter non seulement les effectifs des contrôleurs, mais aussi leur qualification (et qu'on ne vienne pas me dire que la France n'en a pas les moyens car doubler, voire quadrupler, le nombre des contrôleurs est tout à fait possible si on le veut). D'autant plus si on peut faire financer une partie de l'opération par l'Europe puisque tous les produits qui transitent dans nos ports sont destinés à l'Europe, on y arrivera d'autant mieux mais, pour moi, l'excuse financière ne tient pas. Si on veut le faire, on peut le faire.
Se pose ensuite la question de la qualification. En la matière, l'honnêteté des hauts fonctionnaires des « Affaires maritimes » n'est pas en cause mais force est de constater qu'ils ne sont pas toujours formés et, là, nous nous heurtons aux problèmes de statuts de la fonction publique, de contractualisation ou de non-contractualisation. J'ai passé, l'autre jour, une heure et demie à parler avec le chef d'état-major de la Marine sur la base d'une idée que nous avions eue dans le cadre de l'Institut français de la mer et dont j'ai rediscuté avec le directeur des gens de mer, et qui est la suivante : vous avez, dans la Marine, des gens qui partent en cours de carrière ou qui prennent leur retraite vers la cinquantaine, donc assez jeunes, et qui, pour avoir navigué sur les pétroliers de la Marine nationale, connaissent leur affaire aussi bien que les civils. Certains jeunes retraités de la Marine marchande qui habitent dans les ports pourraient aussi parfaitement travailler à la vacation, ce qui coûterait d'ailleurs moins cher que d'employer des personnels sur des postes permanents, mais on prétend que c'est impossible, ce qui est d'autant plus dommage que c'est là que se trouvent les compétences.
Il n'y a qu'à contractualiser avec tous ces gens qui habitent à Lorient, à Brest ou dans les ports pétroliers car ils seront ravis de gagner 300 F ou 400 F pour visiter les bâtiments. Outre que cela coûtera infiniment moins cher à la collectivité, les contrôles seront assurés par des gens qui, croyez-moi, connaissent les points sensibles des pétroliers.
On a donc proposé un certain nombre d'idées de ce genre dont une a été retenue, mais qui est d'ailleurs revenue par une autre source - c'est Clémenceau qui disait que la défaite est orpheline et que la victoire a plusieurs mères, mais peu importe car ce qui compte ce n'est pas tant la paternité de l'idée que le fait qu'elle soit retenue - et qui consiste à échanger les nationalités. L'idée, qui vous reviendra par la direction des gens de mer, est de constituer des équipes multinationales pour éviter les concurrences entre pays - on suggère par exemple de composer des équipes franco-italiennes - mais cela suppose de disposer d'encore plus de moyens. Nous avons donc proposé de procéder à un certain nombre d'échanges, non pas sur la totalité des équipes parce que ce serait trop compliqué à réaliser mais pas, non plus, sur un nombre trop restreint. On peut envisager, par exemple, que des Hollandais viennent au Havre pendant quelques semaines, voire deux ou trois mois, pendant que des Havrais exerceraient des contrôles à Rotterdam et ainsi de suite...
M. le Président : On vous a aussi interrogé sur votre expérience du
Tanio.
M. Francis VALLAT. Oui et également sur l'Oil Pollution Act mais je crois que je suis un peu long et je vais m'efforcer d'être plus concis dans les réponses.
De l'Oil Pollution Act, je dirai que c'est un texte qui a manifesté une volonté qui, en elle-même, était ce que les Américains qualifient un « deterrent » et là-dessus, ils ont complètement gagné. C'est quelque chose qui inquiète les armateurs troubles. C'est un texte qui est remarquable par sa cohérence, mais qui souffre toujours des trois défauts qu'il avait à sa naissance. Ils se voient assez peu en raison de la très nette amélioration de la non-pollution au large des côtes américaines (même si on oublie toujours de dire qu'elle s'inscrit dans un contexte général. Il serait, en effet, intéressant - mais je n'ai pas les chiffres - de comparer cette amélioration et celle du reste du monde, de façon à ne pas être dupes de ce qui est efficace et de ce qui ne l'est pas). Personnellement, je peux tout de même vous citer un certain nombre de pollutions qui, grâce à la double coque, ont été évitées aux Etats-Unis : je suis le premier à reconnaître qu'il en y a eu trois ou quatre dont celle causée il y a quelques années par un pétrolier B.P. (je crois) sur la côte Est, mais je vais y revenir...
Cette amélioration de la non-pollution s'est inscrite dans un contexte général et j'ai cité, dans certains articles, des chiffres qui sont absolument incontestables : parallèlement à une augmentation de 60 % du volume des cargaisons maritimes pétrolières, on a aussi enregistré une diminution de 60 % des pollutions, l'essentiel venant des dégazages. Il faut donc bien prêter attention au fait que ce phénomène s'est inscrit dans un contexte général.
Cela dit l'Oil Pollution Act présente à mon avis trois péchés et une qualité majeurs.
Le premier péché est d'avoir approuvé un seul système technique, à savoir le système de la double coque sur lequel je dirai un petit mot tout à l'heure ; le deuxième c'est d'avoir absolument voulu faire un système unilatéral qui soit imposé au reste du monde par les Etats-Unis (comme ils sont parvenus ensuite à le faire à l'OMI au niveau de la double coque) ; le troisième porte sur la question des responsabilités sur lesquelles je suis intervenu, mais dans un esprit vraiment très constructif, en envoyant un petit mot à M. Le Drian et en contactant le Mouvement des Citoyens parce que Georges Sarre et Jean-Pierre Chevènement avaient pris des positions publiques sur le sujet.
En effet, en ce qui concerne la responsabilité, le texte fédéral - je crois l'avoir expliqué clairement dans un article du Figaro en date du 2 février - a créé, pour la première fois dans l'histoire maritime, la non-responsabilité, de la cargaison, c'est-à-dire des compagnies pétrolières. Surtout ne l'invoquons pas et encore moins sur ce point-là, parce que, d'une part, on se trompe et que, d'autre part, ce faisant nous nous battons contre nous-mêmes.
Cela dit, la chose était tellement choquante et impraticable qu'un certain nombre d'Etats ont réagi et, aujourd'hui, ce sont cinq ou six Etats côtiers américains qui, dans le cadre de la loi fédérale américaine qui permet aux Etats de modifier la loi à condition de faire plus, ont introduit une responsabilité des compagnies pétrolières et de la cargaison. C'est le troisième défaut, étant entendu qu'il fausse toute la lecture du texte : il existe en effet toute une série de dispositions - si toutefois vous souhaitiez promouvoir un système qui est plutôt celui auquel je songe, au niveau français d'abord et européen ensuite, puisque nous avons la chance d'avoir bientôt une présidence française qui peut-être imposera un compromis - qui ne seraient pas applicables chez nous. Le texte américain a supprimé la responsabilité des compagnies pétrolières américaines, pour la simple raison que des millions de dollars ont été dépensés à Washington en lobbying par les dites compagnies pétrolières totalement échaudées par l'affaire de
l'Exxon Valdez et qui ont effectivement payé une facture aujourd'hui estimée à dix milliards de dollars, sans compter les pertes de chiffres d'affaires sur les deux années qui ont suivi l'accident.
La lecture du texte a été pervertie par le grand nombre de concepts et de clauses qui ont été créés pour contrebalancer cette non-responsabilité des compagnies pétrolières, d'où la création de la responsabilité illimitée des armateurs et (ça c'est excellent !) du concept, qui ne figure pas dans la loi mais qui est désigné sous la formule
« pierce the veil » qui signifie que l'on percera le voile, pour aller jusqu'au véritable armateur économique et le faire payer. C'est une démarche parfaitement cohérente, parce qu'il faut bien que quelqu'un verse ces sommes absolument énormes, que d'avoir créé cette responsabilité illimitée pour faute, ce que l'on oublie souvent de dire, y compris dans l'Oil Pollution Act. Il y a la caractérisation de la faute qui est un point auquel je tiens beaucoup.
En définitive, ce système est intenable : que les catastrophes se produisent aux Etats-Unis ou en France, personne ne peut s'exonérer de sa responsabilité, la preuve en est ce qui arrive à la compagnie Total qui assume des responsabilités qui sont supérieures à celles qui lui seraient imposées légalement. Là-dessus, il ne fait pas de doute que l'opinion publique et les politiques que vous êtes ont joué un rôle extraordinairement salubre à la suite des précédents événements même s'il faut avoir le courage de dire qu'il ne faut pas trop accabler les compagnies pétrolières. Nous sommes dans une situation qui s'est beaucoup améliorée mais un certain nombre d'Etats côtiers ont quand même jugé nécessaire de corriger l'Oil Pollution Act
sur ce point.
M. le Président : Tout cela est très intéressant mais pourriez-vous répondre sur le
Tanio avant que je ne passe la parole aux autres intervenants ?
M. Francis VALLAT : Je pense que les situations sont comparables mais je parle avec infiniment de prudence parce que je n'ai pas étudié le dossier de l'Erika.
D'après ce que j'en sais, je pense que les situations sont comparables : les deux épaves se trouvent en mer assez profonde - 90 mètres pour l'une, 110 ou 120 mètres pour l'autre - les trente mètres d'écart pouvant entraîner des différences au niveau de la colonne fixe puisque, pour le
Tanio, on réchauffait le fioul au moyen d'une colonne fixe avant de le pomper sur le pétrolier lui-même.
Globalement, je pense que les deux affaires sont tout à fait comparables et que l'opération de l'Erika peut être réussie de la même façon que celle du
Tanio.
J'ai néanmoins deux commentaires à formuler qui, à mes yeux, sont importants.
Premièrement, les sommes qui sont évoquées et qui s'inspirent de celles qu'a coûtées le
Tanio sont un peu extravagantes dans la mesure où le chantier du
Tanio - je n'ai pas eu le temps de revoir les dossiers - a été mobilisé plusieurs mois - au minimum six ou dix mois, je ne sais plus - en raison des tempêtes qui se sont succédées, alors que le temps de pompage effectif a été d'une semaine, en tout cas de moins de dix jours... Donc, même s'il y avait 6 000 tonnes dans le
Tanio et qu'il y en a plus dans l'Erika, avec un peu de chance au niveau de la météorologie, l'opération peut s'avérer beaucoup plus courte et moins onéreuse : la météo commandera s'il faut maintenir le chantier mobilisé, ce qui sera naturellement le cas à partir du moment où le pompage aura démarré. Il faut donc savoir que le temps de pompage effectif du
Tanio - la Comex ou Van Ommeren tankers pourront vous fournir les renseignements - n'a duré que quelques jours...
Je pense donc que le pompage peut marcher, qu'il est la meilleure solution sur le plan technique, la seule question que je me pose sans pouvoir y répondre faute d'en avoir la compétence technique étant l'opportunité d'y avoir recours. A l'époque, nous nous étions déjà posé la question avec les scientifiques. Nous ne nous étions pas plaints d'avoir à pomper le
Tanio : c'était un chantier exceptionnel sur le plan technique et un véritable défi. En outre, il est tellement bon, quand on prétend être un armateur pétrolier qui fait son travail et qu'on veut absolument être différencié des mauvais, d'être celui qui pompe et pas celui qui salit que nous étions absolument ravis de le faire.
Cela étant, je garde des discussions que nous avons eues avec des gens compétents, le souvenir que la décision prise à l'époque par Michel Rocard, je crois, était bonne sur le plan politique mais qu'elle ne se justifiait pas sur le plan technique. Est-ce vrai ou pas ? Je n'en sais rien. Pour deux raisons essentielles que l'on m'avait expliquées et qui sont peut-être fausses, mais que vous pourrez vérifier.
La première, c'est qu'il y a une période de quelques mois pendant laquelle, comme une éponge, le fioul - et d'après ce que je vois, il s'agit de résidus de fioul qui me paraissent être quand même, quoi que l'on en dise, relativement classiques mais je crois que nous allons avoir les résultats des analyses très bientôt et que nous allons donc être fixés - qui subit une pression de je ne sais combien de bars à 130 mètres, est pressé tout en créant encore des fuites, puis se durcit sous l'effet de la même pression et de la basse température au bout de quelques mois.
J'ai conservé, chez moi, à température ambiante, une bouteille de fioul provenant du
Tanio et je peux vous assurer qu'il est dur même s'il fait plus chaud que sous la mer. On peut donc certes se poser la question de savoir si, politiquement et psychologiquement, il est supportable qu'une telle masse de mazout, (même s'il n'y a plus de navire autour !) se trouve à proximité des côtes mais ce n'est pas la question technique qui est traitée.
En effet, le risque majeur auquel vous allez vous trouver confrontés, vous l'encourrez pendant le pompage car les moyens les plus compliqués à mettre en _uvre (sur le plan juridique de la responsabilité et sur les plans financier et technique) concernent le réchauffement du produit enfoui sous la mer qui, d'ici à quelques mois, sera probablement devenu très, très dur.
Je ne sais pas répondre à cette question, mais je trouve qu'elle vaut la peine d'être posée même si j'hésite à le faire publiquement par crainte de passer - et certains d'entre vous savent ici que je suis breton depuis quarante ans - pour quelqu'un qui prendrait à la légère cette menace. On court tellement de risques en faisant une déclaration publique sur ce sujet...
Je suis venu ici en pensant que je dirais absolument tout ce que je pense : j'ai bien précisé que je ne connaissais pas la réponse à cette question mais elle risque de sortir et comme la mer est plus forte que tout - j'ai fait référence à Tabarly tout à l'heure - je crois que, si pendant le pompage, il arrive quelque chose, tant vous, les hommes politiques, que nous, les professionnels, nous serons certainement considérés comme étant responsables pour ne pas avoir dénoncé les risques.
Aujourd'hui, nous sommes éventuellement responsables de ne rien faire et nous subissons une pression qui ne permet pas toujours l'objectivité, mais il ne faudrait pas, non plus, que nous soyons aussi responsables de ne pas avoir alerté sur les risques encourus durant la phase délicate de l'opération.
Le pompage du Tanio s'est bien déroulé mais nous n'avons été tranquilles que quand il a été terminé.
Sur l'OMI, pour ce qui touche aux questions de responsabilité, je crois qu'il serait plus efficace et plus rapide, d'autant que je voyais hier dans la presse que les Britanniques étaient soucieux d'obtenir un « co-leadership »
avec, ou contre, la France à ce propos, de monter significativement les seuils des responsabilités armatoriales, et aussi des chargeurs, qui existent aujourd'hui, notamment au sein du FIPOL - Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures. Personnellement, je pense que c'est une très bonne approche.
M. Edouard LANDRAIN : En vous écoutant, M. Vallat, j'ai entendu le procès des politiciens américains en tant qu'affréteurs et que législateurs. Vous nous avez dit que l'Oil Pollution Act est fait de telle façon que la société Total
ne serait pas du tout responsable selon les règles américaines...
M. Francis VALLAT : Légalement, non.
M. Edouard LANDRAIN : ...
et c'est d'ailleurs ce qui ressort de votre article du Figaro.
Vous nous avez dit également que la double coque, qui n'est sûrement pas la panacée, a été imposée pour des raisons psychologiques, sans doute, écologiques même, sous le coup d'une très forte pression américaine et, dans l'article que vous avez consacré à ce sujet - mais vous n'en avez pas parlé ici - vous citez une technique européenne, l'E3, dont j'aimerais que vous puissiez nous dire en quoi elle consiste et ce qu'il pourrait en advenir.
Pour terminer, je voudrais préciser que, sur la question des inspecteurs, vous avez totalement raison. Puisqu'on a résolu celle des enquêtes publiques en faisant appel à d'anciens fonctionnaires extrêmement compétents, qui font fort bien leur travail et pour un coût peu onéreux, on pourrait faire de même avec d'anciennes compétences liées à la mer et, en particulier, avec d'anciens pétroliers. Je voudrais, néanmoins, que vous précisiez comment l'Europe pourrait avoir une politique commune, globale, axée sur un certain nombre de règles de bon sens qui ne soit pas totalement opposée à ce que les textes américains apportent, de telle façon que nous ne soyons pas commercialement défavorisés.
M. Jean-Pierre DUFAU : Vos propos étaient tout à fait passionnants et, pour reprendre votre formule, il ne faudrait effectivement pas que les « querelles de boutiques » masquent le fond et qu'après avoir bien appréhendé la problématique du fond, on en revienne aux « querelles de boutiques » : je crois que c'est le risque !
Vous avez bien montré l'importance de la dimension européenne dans ce débat pour appréhender les différentes questions qui vous semblent majeures : celle des caractéristiques des navires sur laquelle je vais revenir, celle des pavillons, celle des certifications, classifications etc.
Incontestablement, donc, c'est au niveau de l'Europe que ces problèmes peuvent et doivent être appréhendés et vous avez, au passage, fait mention de l'imminence de la présidence française.
A partir de là, j'aimerais que vous puissiez aller encore un petit peu plus loin sur quelques préconisations, parce que notre commission a aussi pour vocation d'aller au-delà du naufrage de l'Erika pour en tirer des enseignements et s'orienter vers des propositions.
Enfin, je vous interrogerai sur un point précis : concernant la double coque et le E3 européen, nous avons pris acte de la décision américaine qui n'est pas sans me rappeler un peu le débat sur le
Concorde, qui avait eu lieu en son temps et pour d'autres raisons. Est-ce que la problématique de l'E3, qui semble avoir votre préférence, est complètement abandonnée ? Est-elle compatible avec le maintien de la double coque ? N'y a-t-il pas quelque chose qui reste à négocier pour ne pas jouer forcément un système contre l'autre mais introduire progressivement la concurrence ou la coexistence de ces deux types de navires et si oui, comment les négociations devraient-elles se dérouler et dans quel cadre pour, sans remettre forcément en cause la décision américaine, faire également entendre la voix de l'Europe et, peut-être, à terme, comparer les deux techniques ?
M. François GOULARD : J'aimerais, moi, que vous reveniez brièvement sur les questions de responsabilité que vous avez évoquées, certes, mais à propos de l'OPA et de la loi américaine. Je souhaiterais savoir si vous prônez une révision de la convention de 1969, rectifiée en 1992, sur la responsabilité civile en matière de pollution par les hydrocarbures. Etes-vous favorable à la responsabilisation de l'affréteur dans les conventions internationales et attendez-vous que la France et l'Europe prennent une position dans ce sens ?
M. Gilbert LE BRIS : Vous avez mentionné - et cela fait un peu partie de votre credo - que lorsque l'on rajoute des textes aux textes, on crée une espèce de maquis dans lequel se réfugient ceux qui ne veulent pas les appliquer et, en substance, vous nous avez dit que, finalement, les idées irréalisables évitaient de résoudre les problèmes.
A ce propos, je voulais vous poser une question concernant cette idée de travailler, au niveau européen, sur la pollution marine et les faits qui peuvent en résulter.
Sur la réglementation, bien évidemment, seule la force de l'Europe unie est de nature à résoudre un certain nombre de questions.
Bien sûr, on ne peut que souhaiter l'harmonisation des sanctions, mais c'est sur la prévention que je veux vous interroger : est-ce que, pour la prévention, c'est-à-dire, finalement, pour les moyens d'action à chaud, au moment de la crise, ce n'est pas de l'Etat riverain seul que peut relever la responsabilité, quitte à la fédérer après et est-ce qu'on n'a pas déjà, même si la chose n'est pas clairement identifiée, un embryon de garde-côtes en France ? Quels seraient, selon vous, les moyens de fédérer, par la suite, ces moyens nationaux pour parvenir à une solution plus européenne ?
M. Bernard CAZENEUVE : Ma question fera écho aux propos que vous avez tenus tout à l'heure concernant les relations entre les Etats-Unis, l'Europe et l'OMI.
Nous sommes dans une économie mondialisée et l'un des trafics qui illustrent le mieux cette mondialisation de l'économie, c'est le trafic maritime.
Nous savons que la mondialisation conduit parfois le droit à se faire l'écho des intérêts de telle ou telle puissance et vous avez évoqué précédemment, sous la forme d'une anecdote, la manière dont certaines puissances s'exprimaient sur des questions qui sont économiquement stratégiques.
Vous avez également indiqué que pour résister à une telle situation, il fallait que l'Europe se constitue comme une entité forte, capable, face aux Etats-Unis et au sein de l'OMI, de faire prévaloir ses intérêts.
J'aurai donc deux questions à vous poser sur ce point.
Premièrement, est-ce que tous les pays d'Europe ont la même vision de ce qu'est l'intérêt de l'Europe face aux Etats-Unis ? Sur plusieurs sujets qui n'ont rien à voir avec celui dont nous traitons aujourd'hui, nous avons pu constater qu'il y avait, à l'intérieur même de l'Europe, un certain nombre de pays qui regardaient les Etats-Unis avec les yeux de Chimène, pour des questions historiques ou tout simplement même parce que leurs intérêts étaient plus proches des intérêts américains que de ceux des autres pays de l'Union, et je pense notamment à la Grande-Bretagne.
Deuxièmement, est-ce que vous pensez qu'une bonne manière de se doter de dispositifs européens performants consisterait à instituer des dispositifs de contrôle qui soient totalement harmonisés avec, par exemple, la mise en place de garde-côtes européens ou, est-ce qu'au contraire, nous ne serions pas plus forts en améliorant, au niveau de chaque bassin maritime, la qualité des dispositifs existants ?
Vous avez évoqué l'OMI et « l'excellence de ses règles » selon votre propre expression : il y a de très bonnes règles de droit qui, dans le domaine de la prévention et de la répression des infractions, sont considérées comme étant de nature à répondre à la demande mais qui sont tout à fait inapplicables en raison de l'incapacité des Etats, sur des espaces qui sont multinationaux, à s'entendre au niveau de leur application. Ces règles excellentes auxquelles vous faisiez précédemment allusion, considérez-vous qu'elles sont, compte tenu de ces disparités, aujourd'hui applicables ?
M. le Président : J'ajouterai juste une toute petite question : avez-vous été témoin d'arrangements entre des sociétés de certification et des armateurs ?
M. Francis VALLAT : Oui. Il m'est arrivé d'acheter des navires d'occasion dont je considère qu'ils ne correspondaient pas à leur certification.
Cela étant, j'ai un correctif à apporter qui est à mes yeux très important et qui ressort de l'article des
Echos : les principales sociétés de classification ont senti passer le vent du boulet, il y a quelques années, et cela pour deux raisons cumulatives : d'une part, parce que sont arrivés au sein de certaines sociétés, des hommes qui avaient la volonté d'être des chevaliers blancs - y compris au Bureau Veritas - et qui ont eu énormément de crédit pour mener à bien leur tâche qui correspondait à une conviction personnelle ; d'autre part, parce que les sociétés de classification ont pris conscience qu'en perdant leur crédibilité elles perdraient tout.
Je dois dire, honnêtement, que je suis convaincu qu'il peut toujours y avoir un accident en mer - souvenez-vous de l'Amoco-Cadiz qui n'était pas vieux, de l'Olympic
Bravery qui était tout neuf ou encore de l'Exxon Valdez : moins de cinq ans, pavillon américain, le plus rigide du monde etc. - d'où, car cela ne diminue en rien la valeur de nos travaux mais au contraire l'accroît, la nécessité de se battre pour réduire au maximum le risque. De même, il peut y avoir des bavures au niveau des sociétés de classification. De même encore, il peut y en avoir au niveau du Parlement ou n'importe où puisqu'elles obéissent à une organisation humaine qui fonctionne avec des centaines ou des milliers d'individus et des gens qui, ayant une parcelle de pouvoir, peuvent être tentés d'en abuser.
Il y a un point sur lequel je tiens absolument à témoigner : parmi les sociétés de classification que je connais - il peut y en avoir d'autres mais je n'y crois pas beaucoup - je peux vous en citer qui subissent une véritable révolution culturelle qui est une révolution sincère... C'est quand même très important et c'est pourquoi il faut cesser de dire au public que rien ne se fait, car d'abord ce n'est pas vrai, ensuite, c'est réellement décourageant alors qu'il y a une amélioration.
Nous vivons ce drame épouvantable mais il y a une amélioration et je suis certain que, si les classifications douteuses existent encore - je vous donne ma parole d'honneur que je ne connais pas de cas récents chez les grandes alors que j'en connaissais dans le passé - elles sont beaucoup moins nombreuses.
Pour ce qui a trait à l'E3, nous avons perdu, sinon en totalité, du moins pour l'essentiel, dans la mesure où les Etats-Unis, conformément au raisonnement rappelé tout à l'heure et tenu par les gens que nous rencontrions au Congrès, ont pu imposer leurs normes techniques. Vous ne pouvez, en effet, pas avoir un armateur pétrolier international - et ce sont ceux qui nous intéressent et non pas les propriétaires de petits pétroliers de 2 000 tonnes dans un petit port indonésien - qui puisse acheter un navire en sachant qu'il n'ira pas aux Etats-Unis, premièrement parce que c'est une partie énorme du trafic, deuxièmement parce qu'un jour ou l'autre, il sera amené à vendre son navire et qu'il n'aura aucune valeur s'il ne peut pas aller aux Etats-Unis.
Le simple fait que les Etats-Unis imposent la double coque de façon pure et dure a entraîné une évolution du marché des navires double coque que vous connaissez et que j'ai rappelée dans certains articles : 5% en 1990, 27 % aujourd'hui et la moitié de la flotte mondiale d'ici à deux ans, selon un mouvement qui est irréversible.
La situation n'est pas forcément aussi dramatique que certains de mes articles pourraient le laisser entendre, mais ce que je dis c'est que nous aurons un jour, j'en suis sûr, un accident avec double coque qui sera plus dramatique qu'un accident avec simple coque, même s'il est vrai que la double coque évite tous ces risques de pollution à l'abord des ports, à petite vitesse, quand la double coque n'est pas crevée.
La principale raison de cette situation, oui monsieur, j'en témoigne absolument est que là-bas il ne s'est pas trouvé un homme politique pour oser dire que la double coque n'était pas mieux que la simple ou pour avoir le courage de dire que les choses étaient peut-être un peu plus compliquées.
Sur l'E3, nous avons donc perdu mais nous avons obtenu une victoire à la Pyrrhus en faisant reconnaître par l'OMI la bonne valeur des deux techniques : celle de la double coque, la seule à être reconnue encore aujourd'hui par les Etats-Unis, et celle de l'E3, considérée officiellement comme « équivalente », que je ne peux pas vous détailler aujourd'hui,
qui existe en fait depuis 1870 mais qui a été poussée par les chantiers européens et qui permet au navire d'être mis en configuration double coque en vidant la partie inférieure, pour aller aux Etats-Unis moyennant deux inconvénients. Premièrement, il perd 20 % de sa capacité de cargaison dans un marché hyper concurrentiel et, deuxièmement, les représentants des Etats-Unis - qui ont quand même senti le danger et dont j'ignore, tout en faisant partie de ceux qui les ont le plus fréquemment rencontrés, pourquoi ils sont bornés à ce point - ont été jusqu'à refuser d'admettre - et c'est pourquoi, sans sombrer dans la bande dessinée, ni dans la politique fiction, je suis enclin à penser que leur attitude est en partie anti-européenne - que l'E3 en configuration double coque pouvait être considéré comme un double coque, ce qui revient à le torpiller.
Un débat de la nature de celui qui s'est instauré à la suite du naufrage de l'Erika est une chance supplémentaire pour l'Europe, ne serait-ce qu'au niveau des principes et cela peut avoir quelques résultats si l'on considère qu'il y a encore des bateaux à construire, une partie de la flotte à renouveler - même si actuellement on enregistre un très fort mouvement dans ce sens, on est loin d'avoir renouvelé la flotte pétrolière mondiale - donc, pour les années à venir, je considère qu'il y a des perspectives.
Il est très facile de dire que l'Europe s'est déculottée, car l'Europe nous sert aussi beaucoup de bouc émissaire mais, sur ce plan-là, je pense qu'il n'y a pas doute et que si nous étions dans l'état d'esprit de Mme de Palacio qui s'exprimait l'autre jour, en voulant aller reparler de ce problème, l'issue du débat pourrait être différente.
Ce qu'il y a, c'est que les Etats-Unis savent que nous avons perdu une guerre très importante dans la mesure où un certain nombre de bateaux qui sont adaptés pour les Etats-Unis pourront venir en Europe alors qu'ils nous savent incapables de dire que nous fermons nos ports aux navires qui ne sont pas E3. Il y a donc un côté un peu irréversible et même si le combat est surtout de principe, il y a quelques armateurs qui ne vous le diront jamais. Il faut d'ailleurs se mettre à leur place : on ne peut pas demander à un armateur pétrolier de dire qu'il n'a pas le meilleur bateau du monde alors qu'il a dépensé des centaines de millions de dollars pour faire ce qu'il y avait de mieux par rapport aux réglementations existantes : c'est pourquoi, si vous questionnez un armateur pétrolier, il ne vous dira jamais vraiment que le double coque est plus dangereux, d'autant que le pire n'est pas toujours sûr et que dans certains cas, la double coque est un atout remarquable.
Personnellement, je pense que c'est le cas mais cela ne fait pas des bateaux double coque des bombes flottantes comme le sont de mauvais bateaux. Il n'en reste pas moins que les années qui passent accroissent le risque qu'ils le deviennent et que si un accident survient, ils peuvent être plus dangereux alors que, dans d'autres configurations, ils peuvent diminuer les possibilités d'accident.
Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question mais il s'agit un peu d'un combat perdu, ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas un combat qui vaille le coup d'être livré, au moins pour donner un coup de main aux armateurs qui ont envie de construire des E3. Je considère, moi, que les E3 sont une solution plus sûre, ce qui ne veut évidemment pas dire que la double coque soit une solution dramatique en toutes circonstances.
Vous m'avez interrogé sur les règles européennes par rapport aux USA.
En la matière, je dois avouer que si nous inscrivons nos pas dans ceux qui ont été lancés par la table ronde qui s'est tenue l'autre jour au ministère des transports, ce sera une bonne chose : en effet, outre les signataires - n'ont signé que les opérateurs français, c'est-à-dire les gens véritablement armateurs ou affréteurs - elle réunissait des délégations étrangères importantes, le président de l'IACS - International Association of Classification societies -, le président du FIPOL, le président des armateurs européens, et chacun a pu apporter sa contribution qui va être exploitée pendant la durée de la présidence française.
Je le dis d'autant plus sincèrement que, quinze jours avant son ouverture, j'étais furieux de savoir qu'elle allait s'ouvrir à quinze heures pour se terminer à dix-huit heures. En fait, un certain nombre de textes nous ont été distribués préalablement sur lesquels nous avons pu réellement travailler de telle sorte que, alors que j'étais sceptique au départ, je considère qu'est sorti de cette rencontre un geste fort et qu'au-delà, certaines directions ont été indiquées qui répondent à la question de savoir si nous, Européens, par rapport à ce qui existe aux Etats-Unis, nous ne sommes pas en train de prendre du retard.
En fait, la voie a été montrée et je pense que nous bénéficions d'un petit avantage en connaissant le calendrier américain ce qui nous permet, à nous, de nous adapter et non pas l'inverse... C'est un inconvénient par rapport au passé, mais par rapport aux mesures à prendre maintenant, c'est une donnée qui nous permet de garder les yeux ouverts.
Encore une fois, et comme toujours, on revient à cette question de la volonté européenne et je suis plutôt optimiste parce que je ne pensais pas qu'il sortirait des mesures aussi concrètes que celles qui sont sorties du code de bonne conduite. On peut m'objecter que, s'agissant d'une charte, elles n'ont pas force contraignante : certes, mais c'était bien la définition de l'exercice, dont la portée était connue dès le départ dans la mesure où un code de bonne conduite n'a pas pour vocation d'être contraignant.
Néanmoins, comme dans le milieu maritime tout se sait, je pense qu'au moins pour quelques mois encore, le milieu pétrolier, qui n'est d'ailleurs pas si mauvais qu'on le dit mais qui comporte encore quelques porcs - j'insiste sur l'orthographe du terme - va être sous les lumières et je pense qu'une charte d'une telle nature a une valeur au niveau, d'une part, pédagogique et, d'autre part, concret parce que les intéressés auront quand même du mal à ne pas respecter leur signature.
En outre, je pense que, si nous persistons dans cet esprit-là, nous aurons la possibilité de protéger l'Europe et les côtes européennes en répondant aux défis de la législation existant aux Etats-Unis en ayant recours, sinon aux mêmes moyens parce que, ainsi que je vous l'ai indiqué tout à l'heure, j'estime qu'il y a des erreurs dans l'Oil Pollution Act, du moins à des moyens aussi importants, et cela touche aux problèmes de responsabilité et de
Coast Guards naturellement, ou plutôt d'agence européenne.
Au niveau de l'OMI - je dirai juste un mot pour répondre à une question posée - il y a une forte responsabilité de nos pays. En effet, pourquoi acceptons-nous que des pays qui n'ont manifestement pas les moyens de respecter les conventions, les signent ? Est-ce les statuts de l'OMI qui l'imposent ? Je l'ignore mais vous n'entendez jamais aucune voix s'élever, ni de la Grande-Bretagne, ni de la France, ni de l'Allemagne, au moment où ces conventions sont signées ou quand vient le représentant de Malte ou, pire encore parce que ce n'est pas le pire, celui de Saint-Vincent-et-les-Grenadines ou de la Syrie, pour dire
- pardonnez-moi ma grossièreté - qu'ils se foutent de notre gueule !
Je pense qu'il y a une réponse qui peut être apportée à cette situation. Je l'ai évoquée dans l'article des
Echos et elle résulte de conversations que j'ai eues aussi bien en France ou en Europe que dans d'autres parties du monde. En effet, il y a une sorte de complexe des pays du nord par rapport aux pays du sud, qu'on peut comprendre et qui tient aux sources de revenus. Au nom de quoi en effet empêcher les pays pauvres de se constituer une cagnotte grâce aux taxes d'immatriculation ? Une fois de plus, on entre dans un domaine où les pays évolués ont une telle avance que tenir ce genre de langage équivaudrait à dire aux représentants des pays incriminés qu'on les maintient dans leur sous-développement.
C'est un point auquel je suis aussi particulièrement sensible - j'étais l'un des fondateurs de
Connaissance de l'Afrique quand j'étais étudiant et j'ai passé je ne sais combien de temps sur ce continent - mais il me semble que, si on le veut vraiment, c'est une question à laquelle on peut trouver des solutions.
Les principales critiques qui peuvent être formulées, c'est que les pays sous-développés ne disposent pas de suffisamment de moyens tant au niveau qualitatif que quantitatif.
En même temps, comme ces pays existent et qu'ils nous « bouffent » notre pavillon, nos revenus et notre puissance maritime avec tout ce qu'elle représente sur le plan social, économique ou autre, la solution intelligente ne consisterait-elle pas à faire en sorte que des pays comme les nôtres éduquent ces pays sur ce point, dans un contexte naturellement soigneusement organisé et non paternaliste, en les incitant à se regrouper ? Forcément cette démarche les authentifierait et leur donnerait plus de crédit mais, aujourd'hui, alors qu'ils n'en ont aucun, ils forment pourtant l'essentiel de la flotte mondiale... Il vaut donc mieux qu'ils aient plus de crédibilité et qu'ils en fassent un peu moins, d'autant qu'il ne me semble pas que le coût de telles formations serait prohibitif : c'est une piste...
Quoi qu'il en soit les Etats que nous sommes sont extraordinairement responsables sur ce plan, ne serait-ce qu'en raison de la culpabilité du silence et je peux vous dire que les armateurs rêveraient qu'il y ait une police et parfois des Etats plus courageux, y compris au niveau du langage, car c'est vraiment l'omerta qui règne.
Pour ce qui est des responsabilités des conventions de 1969 et de 1992, je pense n'avoir effectivement pas été assez clair tout à l'heure. Il existe dans ces conventions et dans les protocoles, des possibilités d'agir dans le cadre des conventions en montant les plafonds, étant entendu que ce ne serait pas « pour faire joli » : je crois qu'il est très important de s'inscrire dans ce cadre, ce qui n'empêche pas d'édicter une autre règle qui exigerait, par exemple, pour les pollutions pétrolières, que les armateurs prennent, par ailleurs, une assurance de 500 millions de dollars ou d'un milliard de dollars. Ce sont des assurances qui existent maintenant sur le marché et il serait quand même intéressant que le coût en soit partagé avec l'affréteur et que l'on étudie bien le principe de la coresponsabilité, du responsable de la cargaison et de l'armateur à tous les niveaux.
C'est une chose qui est pour moi essentielle : si nos grands-pères ont créé le système actuel au début du XIXème siècle, c'était pour permettre au transport maritime de perdurer : il fallait en effet tenir compte, non seulement de l'activité des corsaires, mais aussi du fait que le moindre naufrage conduisait à la ruine si bien que les marchands qui avaient des cargaisons à transporter finissaient par ne plus trouver d'armateurs.
L'esprit est toujours le même et la coresponsabilité de ce que l'on appelle « l'aventure maritime » doit être maintenue. Je pense que, dans le cadre des textes existants, monter les plafonds peut s'avérer suffisant mais à condition surtout de maintenir la notion de faute.
C'est là une question dont nous n'avons plus le temps de parler parce qu'elle justifierait un long débat mais je suis tout prêt à revenir sur le sujet. Il faut qu'un mauvais chirurgien fasse de la prison s'il a commis une faute volontaire ou s'il a opéré sous l'emprise de l'alcool, mais pas si son patient a été victime d'une embolie sur la table d'opération alors que l'intervention se déroulait merveilleusement bien : c'est le même système qui doit être appliqué et c'est pourquoi il faut être vigilant sur la notion de faute.
Par ailleurs, nous avons tous besoin du pétrole et, à un moment ou à un autre, il faut qu'il y ait une responsabilité de l'Etat du pavillon si le dommage atteint des milliards de milliards de dollars et ne peut pas être couvert. Pourquoi ? Pour une raison qui est simple et qui est aussi une raison de principe : les Etats du pavillon ont aussi une responsabilité qu'ils ne respectent absolument jamais. C'est peut-être l'occasion de les contraindre à la respecter mais, là aussi, pas de façon systématique, mais en cas de faute de l'Etat ce qui peut être un moyen de corriger les choses.
J'espère avoir répondu à votre question.
Je souscris à tout ce que vous avez dit concernant l'harmonisation des sanctions. Concernant la prévention, je pense qu'il est vrai que les Etats riverains sont naturellement les plus compétents et c'est bien dans ce sens que je disais tout à l'heure que la forme « du grand corps » qui chapeauterait tout cela ne m'intéresse pas : ce qui est le plus intéressant parce qu'indispensable c'est d'avoir une unité - et c'est pourquoi on a parlé d'une agence opérationnelle - qui veille à l'orchestration des choses (une fois que les législateurs, qu'ils soient européens ou nationaux, seront parvenus à l'harmonisation), et à l'application harmonisée des textes et des sanctions aussi par une sorte de contrôle des contrôleurs qu'évoquait l'autre jour le Premier ministre sur un autre plan.
Il me semblerait par ailleurs - mais c'est une question de bon sens et je n'ai pas de compétences en la matière d'autant que j'ai pu constater, à la suite d'une discussion avec le chef d'état-major de la Marine, qui a des idées absolument remarquables sur le sujet, que mes idées très simples n'étaient pas forcément adéquates - qu'un commandement unique, au moins par pays, serait le bienvenu. Que l'on arrête d'objecter qu'il y a les douanes, la gendarmerie ! J'ai conscience de mal répondre à votre question mais c'est parce que je n'ai pas les compétences suffisantes même si je crois avoir été à peu près clair au niveau du principe.
A l'échelle de l'Europe, ce qui compte surtout - j'ai du mal à percevoir la position des Etats d'Europe du sud mais je pense que l'Italie est plutôt favorable à la position française et que l'Espagne devrait la soutenir - c'est que les Allemands semblent avoir une véritable volonté politique contrairement aux Anglo-saxons, notamment les Britanniques, même s'ils sont, comme toujours, d'accord sur les principes.
Il reste à savoir si le tandem franco-allemand va être en mesure sur ce point d'entraîner le reste en sachant que, sur certains plans, les Anglo-saxons sont déjà mieux organisés que nous mais n'ont, néanmoins, pas réussi non plus à résoudre un problème dont je peux vous dire qu'il choque absolument tous les professionnels du maritime : je veux parler du refuge des navires blessés dans les ports. Aujourd'hui aucun navire endommagé, à plus forte raison quand il s'agit d'un pétrolier, ne trouve refuge dans un port.
Je peux, à ce sujet, vous raconter une anecdote qu'il m'a été donné de vivre : un navire dont j'étais directement responsable avait été blessé, vrillé après avoir été drossé par force 12 pendant deux kilomètres sur la côte : il était en très bon état et, de toute façon, il était chargé de super dont tout professionnel peut vous dire qu'il n'entraîne pas de pollution grave. En revanche, il se trouvait dans une situation extrêmement dangereuse et explosible. Nous avons réussi à le faire crocheter au petit matin et c'est là qu'a débuté la ronde des ports, et des ports français. Pas un port ne voulait accueillir ce bateau menacé d'explosion avec plus de trente hommes à son bord, et il a fallu que j'envoie un fax à un préfet l'accusant de non-assistance à personne en danger pour que le situation se débloque et qu'on me réponde d'un seul coup, que nous nous étions mal compris...
Le bateau a été reçu dans un port, inspecté, considéré comme perdu puis vendu à la casse et il est mort dix ans plus tard - ce qui prouve qu'il avait encore navigué dix ans - ciblé par un missile au Liban.
Je voulais souligner cette attitude des ports parce qu'elle est gravissime !
M. le Président : C'est un sujet qui a été évoqué hier ...
M. Francis VALLAT : Je sais que cette situation nous soucie énormément et sur le plan de la vie humaine et sur le plan de la pollution !
M. le Président : Nous avons évoqué l'aspect social des équipages qui sont à bord de ces bateaux qui souffrent d'avaries quand les ports ne peuvent pas ou ne veulent pas les accueillir...
M. Francis VALLAT : Oui, mais je savais bien que je ne pourrais pas parler du pavillon !
M. le Président : Allez-y ! Dites-nous quelques mots à ce sujet...
M. Francis VALLAT : Laissez-moi simplement dire que le débat sur le pavillon porte sur un concept qui est de plus en plus moderne, et non pas de plus en plus dépassé, aussi longtemps que l'Europe - et là c'est encore pire que les forces de police de l'OMI - ne sera pas capable d'avoir une flamme européenne. Il ne faut pas rêver. Ceux qui se sont occupés des dossiers peuvent en témoigner, avec l'échec du pavillon Euro et les positions totalement éloignées de l'Europe du nord et de l'Europe du sud...
L'affaire de l'Erika illustre parfaitement le fait qu'il s'agit d'un débat essentiel : vous connaissez, pour beaucoup d'entre vous, puisque les membres de cette commission s'intéressent aux choses de la mer, tous les avantages et les inconvénients du pavillon. Je voudrais simplement attirer l'attention sur un point en évoquant deux hommes, qu'il vaudrait mieux entendre que moi.
L'un, dont tout le monde parle - sans toujours bien le connaître d'ailleurs - en bien ou en mal et parfois à tort dans les deux cas, mais que j'ai, pour ma part, bien connu sur le plan maritime et qui est arrivé avec une volonté féroce de faire du maritime avec des Français, et de préférence des Bretons, est Vincent Bolloré qui, aujourd'hui, joue un jeu pur et dur en arguant de la simple raison que notre pays n'a pas de politique maritime.
L'autre, à qui personne ne demandait rien, en tout cas pas son pays, qui a d'ailleurs pris pour conseiller un Français et qui a plutôt une mentalité libérale, voire ultralibérale, est Lord Sterling qui a décidé de faire entrer cinquante navires sous pavillon britannique.
Le fossé qui existe entre leurs deux attitudes montre bien que le thème que nous avons retenu pour nos journées de l'Institut Français de la Mer et qui pose la question de savoir pourquoi le pavillon ne marche pas en France vaut véritablement la peine d'être étudié, d'autant que les seuils que nous sommes en passe d'atteindre me révoltent complètement.
En effet, l'avenir montrera demain que le monde maritime souffre principalement du manque de personnels qualifiés ainsi que de pays qualifiés pour les former et que la France risque « de perdre le manche » au moment où il sera stratégiquement capital de le conserver.
Il est impossible maintenant de rentrer dans le fond du débat mais les deux attitudes des hommes que je viens de citer, dont l'un fait entrer cinquante bateaux sous pavillon et l'autre sort les siens, sont l'illustration de positions différentes, dans deux pays qui sont pourtant, à bien des points de vue, dans une situation comparable.
M. le Président : Je crois que vous avez posé là un véritable problème.
Audition de M. Yves MANSILLON,
préfet de la région Bretagne, préfet du département d'Ille-et-Vilaine,
préfet de la zone de défense ouest,
coordinateur du plan POLMAR terre
(Procès-verbal de la séance du mardi 7 mars 2000)
Présidence de M. Daniel PAUL, Président
M. Yves Mansillon est introduit.
M. le Président lui rappelle que les dispositions législatives relatives aux commissions d'enquête lui ont été communiquées. A l'invitation du Président, M. Yves Mansillon prête serment.
M. Yves MANSILLON : Monsieur le Président, Madame, Messieurs les députés, pour répondre à votre demande, j'ai prévu d'articuler mon exposé en trois points. Tout d'abord, j'indiquerai en quoi et à quel titre je puis vous apporter des informations utiles sur l'objet de vos travaux. Ensuite, je vous dirai quel rôle j'ai concrètement joué en la matière. Enfin, je terminerai par quelques observations et suggestions tirées de cette expérience.
L'objet de vos travaux porte sur la sécurité du transport maritime, le contrôle des normes des navires et les moyens d'améliorer la lutte contre les pollutions. N'étant compétent ni
ès qualités, ni à titre personnel sur les deux premiers points, je n'ai donc pas prévu de les évoquer. C'est, à mon avis, plutôt sur le dernier point - les moyens d'améliorer la lutte contre les pollutions volontaires ou accidentelles - que vous souhaitez m'entendre.
Je précise immédiatement que je parlerai de la lutte contre les pollutions, non pas en mer - fonction qui relève du préfet maritime - mais à terre. C'est en effet en raison de la décision gouvernementale de me confier la coordination du plan POLMAR terre que vous m'avez convoqué.
La presse a souvent mentionné le rôle de coordinateur du préfet de la région Bretagne. En fait, la décision qui a formellement été prise par le ministre de l'intérieur indique précisément : « Le préfet de la zone de défense ouest - préfet d'Ille-et-Vilaine - prendra les dispositions utiles afin d'attribuer les moyens publics et privés nécessaires. Les préfets des départements concernés - Finistère, Morbihan, Loire-Atlantique et Vendée - sont chargés dans leur département de la direction des opérations de secours. »
C'est donc bien le préfet de zone de défense qui, en l'occurrence, est compétent. Cela va me conduire à rappeler brièvement ce qu'est le préfet de zone de défense - institution administrative qui n'est pas la plus connue -, et comment, en matière de plan POLMAR, se répartissent les tâches entre lui et les préfets des départements.
L'ordonnance de janvier 1959 relative à l'organisation générale de la défense prévoit une organisation territoriale fondée sur la coïncidence des structures civiles et militaires. Se trouvent donc, dans un même ressort, une région militaire - ou une circonscription militaire de défense selon les époques -, du côté militaire, et une zone de défense - avec à sa tête un préfet -, du côté civil.
Aux termes de l'ordonnance de 1959, le préfet de zone est « le haut fonctionnaire civil qui détient les pouvoirs nécessaires aux contrôles des efforts non-militaires prescrits en vue de la défense, au respect des priorités et à la réalisation des aides réciproques entre services civils et militaires, en vue de la défense civile et de la sécurité intérieure du territoire ».
Les pouvoirs du préfet de zone ont, par ailleurs, été complétés en application de la loi de juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile. Cette loi lui confie la charge de préparer les mesures de sauvegarde et de cordonner les moyens de secours publics en matière de sécurité civile.
De même qu'un préfet de département dispose, pour exercer sa mission, des services d'une préfecture et d'un secrétaire général de préfecture et que le préfet de région a auprès de lui un secrétaire général pour les affaires régionales, le préfet de zone est assisté par un collaborateur qui, dans sept zones sur neuf, a le grade de préfet : c'est le préfet délégué à la sécurité et à la défense. Le préfet de zone bénéficie également d'une structure relativement légère - en effectifs en tout cas - qui comporte deux organisations distinctes : d'une part, le secrétariat général de la zone de défense qui prépare les mesures de défense civile, et, d'autre part, l'état-major zonal de sécurité civile qui s'occupe de l'aspect sécurité civile.
Dans un bon nombre de zones, on a fusionné les deux structures en une seule par anticipation sur des textes que l'on nous annonce depuis au moins deux ans, de manière à avoir un service zonal de défense et de sécurité civile. Ce regroupement est maintenant assuré à tous les échelons hiérarchiques : c'est vrai depuis 15 ans maintenant dans les préfectures où l'on a fusionné le bureau de défense et les services de la sécurité civile en un SIDPC ; c'est également vrai depuis 3 ou 4 ans au niveau du ministère de l'intérieur où les fonctions de directeur de la sécurité civile et de haut fonctionnaire de défense sont assurées par une seule et même personne.
Ce service zonal est doté d'un centre inter-régional de coordination opérationnelle de la sécurité civile - le CIRCOSC - qui assure la veille opérationnelle 24 heures sur 24 dans une zone telle que celle de Rennes, et qui, de ce fait, recueille des informations sur les événements affectant ou susceptibles d'affecter la sécurité des populations, les répercute et prend un certain nombre de mesures. En période de crise, on constitue un centre opérationnel de défense zonal, un PC opérationnel.
Venons-en à la mise en _uvre des plans POLMAR terre. Il y a là des règles qui ne sont pas différentes de celles qui existent pour d'autres plans de secours, et qui ont été revues par une instruction du Premier ministre datant de décembre 1997 selon laquelle : « chaque préfet est chargé de la coordination des opérations de lutte contre la pollution dans son département, recevant pour cela les informations nécessaires du préfet maritime sur la pollution du milieu marin ».
Les actions directes de lutte contre la pollution sont menées par le maire dans le cadre de sa responsabilité de police générale. Mais dès que l'ampleur, la gravité de la pollution ou l'évolution de la situation l'exigent, le préfet de département prend la direction des opérations de secours.
Le préfet de zone de défense, quant à lui, intervient quand les moyens départementaux sont insuffisants. Dans son rôle de premier échelon de soutien des opérations, il recherche les moyens civils ou militaires nécessaires, d'abord dans la zone, puis, s'il ne les trouve pas, hors de la zone. Dans ce cas, soit il fait appel à la direction de la défense et de la sécurité civile au ministère de l'intérieur pour demander la constitution de colonnes mobiles de sapeurs pompiers venant d'autres zones de défense ou la mise à sa disposition des unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile, soit il s'adresse à l'autorité militaire pour obtenir des moyens militaires.
Il recherche donc les moyens, puis les répartit entre les départements en fonction des demandes, en essayant d'arbitrer et éventuellement en redéployant ces moyens lorsque cela est nécessaire.
Je souhaite à présent expliquer comment, concrètement, l'échelon zonal a joué son rôle depuis le 12 décembre. A cet égard, je distinguerai trois périodes.
La première qui va du 12 au 17 décembre s'apparente à d'une période de veille opérationnelle.
Le CIRCOSC a été alerté le dimanche matin, vers 11 heures, par un message téléphonique du centre opérationnel du service d'incendie et de secours du Finistère. Ce message indiquait en substance : « Navire en perdition, sauvetage de 26 hommes, cargaison de 30 000 tonnes, voire plus, qui pourrait s'écouler et atteindre la côte dans un délai d'une centaine d'heures ».
A partir de là, le CIRCOSC joue son rôle de recueil et de complément de l'information en vue de la répercuter vers le niveau national - la sécurité civile au ministère de l'intérieur - et vers les différents départements concernés. Il recherche des informations auprès de ceux qui peuvent en fournir, dont le service départemental d'incendie, le CROSS, le CEDRE, etc. Je n'ai pas cité la préfecture maritime, car nous n'avons pas pu la joindre pendant une demi-journée du fait de la saturation des communications.
Il est apparu que nous n'avons pas été alertés immédiatement, la préfecture de zone de défense ne figurant pas dans les organismes destinataires des messages dans le plan POLMAR mer, tel qu'il est rédigé : il s'agit là d'une suggestion sur laquelle je reviendrai. Le problème a été réglé après un contact entre le préfet délégué et un adjoint du préfet maritime qui nous a rendu destinataires de ces bulletins d'information, et nous avons affecté auprès de lui un officier de liaison qui nous transmettait l'information en continu.
Le CIRCOSC n'a pas seulement un rôle en matière d'information ; il a également un rôle de veille opérationnelle. Dès le mardi, nous avons commencé à adresser des demandes au Général commandant la circonscription militaire de défense de Rennes pour mettre en préalerte des éléments militaires d'intervention. Nous avons adressé une demande à la sécurité civile au niveau national pour prépositionner un détachement de l'unité d'intervention de la sécurité civile (UISC). Nous avons fait appel aux services départementaux de lutte contre l'incendie et de secours de la zone pour constituer des colonnes mobiles. Nous nous sommes également adressés aux régions voisines pour voir quels étaient les stocks de matériels POLMAR.
Nous ne sommes pas allés plus loin, car le l7 décembre s'est tenue à Lann Bihoué une réunion coprésidée par les ministres chargés de l'équipement et de l'environnement - et à laquelle participaient, entre autres, tous les préfets des départements côtiers et la zone de défense -, au cours de laquelle, il a été décidé, compte tenu des prévisions de dérive des nappes, de désigner le préfet de la Charente-Maritime comme coordinateur.
La deuxième période va du 18 au 28 décembre et correspond à la phase au cours de laquelle le préfet de la Charente-Maritime était chargé de coordonner les moyens.
Tout au long de cette période, la zone de défense ouest maintient son dispositif de veille et d'information, mais il s'agit d'une veille active : nous continuons donc à suivre le déroulement des événements. Ainsi, lorsque le 28 décembre, compte tenu de l'évolution de la pollution, je suis nommé coordinateur, le service zonal disposait déjà des éléments pour lui permettre d'accueillir ce transfert de responsabilité sans perte de temps.
La troisième étape démarre le 28 décembre, et nous sommes toujours dans cette phase.
Nous étions prêts intellectuellement, mais le travail devenait beaucoup plus important. Notre premier souci a donc été de nous renforcer, les effectifs propres au service zonal n'étant pas suffisants. Le CIRCOSC est composé d'une équipe d'officiers et de sous-officiers de sapeurs pompiers et d'appelés qui permettent d'assurer une permanence de 4 à 6 personnes le jour, et de 2 personnes la nuit. A ces effectifs est venue s'agréger la mission d'appui de la sécurité civile de la direction de la défense et de la sécurité civiles du ministère de l'intérieur. Cette équipe mobile - composée de 3 hommes ayant l'habitude de participer à des PC de crise -, qui était jusqu'alors en Charente-Maritime, est venue à Rennes.
Il convient d'ajouter à cette équipe, l'officier de liaison de la marine nationale, les 2 officiers de la circonscription militaire de défense, un représentant du CEDRE, un représentant de TotalFina et un représentant de l'équipement. Tous ont joué leur rôle. Par ailleurs, depuis cette date, 20 à 25 personnes sont réparties la journée en différentes cellules, comme pour un PC ORSEC classique.
Ce renfort était d'autant plus nécessaire que pendant une quinzaine de jours, à compter du lendemain de Noël, cette mission concernant la marée noire se doublait de la nécessité de traiter les suites de la tempête qui a touché une partie importante de la zone de défense. Nous avions donc une seconde équipe - un peu moins étoffée toutefois - qui s'occupait des conséquences de la tempête et des inondations.
Je rappelle quels étaient les objectifs de notre mission : recueillir les demandes de renfort des différents départements, aller rechercher les moyens humains et matériels nécessaires et les affecter dans les différents départements en assurant les arbitrages. En termes de renfort, nous avons eu en permanence entre 1 800 et 2 300 personnes durant toute cette période ; entre 1 000 et 1 350 militaires environ, 500 à 600 pompiers et les UISC.
D'autres missions ont été rajoutées à cette mission d'attribution des moyens. Dès le conseil des ministres du 29 décembre, le Gouvernement avait décidé de me confier l'élaboration d'un plan systématique de nettoyage avant le 10 janvier.
Ce plan systématique de nettoyage a été élaboré naturellement à partir des contributions des différentes préfectures. Je l'ai transmis au ministre de l'intérieur avant la date limite qui m'était fixée. Ce dernier l'a présenté dans ses grandes lignes à Lorient, le 17 janvier. Depuis lors, ce plan a été affiné et complété, notamment par des fiches individuelles pour chaque chantier qui décrivent les opérations à mener, les moyens nécessaires, et qui permettent d'assurer un suivi détaillé.
Au titre des autres missions qui nous ont été confiées, nous avons été chargés de répartir les emplois contractuels à durée déterminée que le ministère chargé de l'environnement, en accord avec le ministère chargé de l'emploi, avait décidé d'affecter pour recruter des postes d'encadrement dans les associations ou dans les collectivités. Nous devions également informer les autorités. Depuis le 19 janvier, à la suite d'une réunion interministérielle, il a été décidé de ne garder qu'une seule source d'information sur la lutte contre la pollution en mer et à terre. Par conséquent, le bulletin quotidien que je diffusais s'est enrichi, sur la base des données transmises par la préfecture maritime, d'une partie concernant la situation en mer. Depuis le 20 janvier, le bulletin en question a vu sa diffusion élargie aux acteurs économiques concernés, notamment les métiers de la pêche, de la conchyliculture, du tourisme, etc. Par ailleurs, il a été distribué à la presse afin de mieux répondre aux très nombreuses demandes que nous recevions.
Je ne développerai pas nos autres missions consistant en l'accueil d'observateurs étrangers, la coordination des chantiers confiés à TotalFina, et l'élaboration d'un protocole d'accord avec TotalFina - non pas sur le traitement de l'épave, mais sur le stockage et la destruction des produits pétroliers et des déchets souillés ramassés à terre.
Pour clore mon intervention, j'aimerais aborder les observations et les suggestions qui découlent d'un certain nombre de remarques que j'ai pu faire au cours de cet exposé. Elles portent sur trois points : le plan POLMAR, le découpage des zones de défense et la nécessité d'améliorer les connaissances sur certains points.
Premièrement, voici quelques suggestions concernant le plan POLMAR dans son ensemble, c'est-à-dire POLMAR mer, POLMAR terre et l'articulation entre les deux.
Tout d'abord, la préfecture de zone de défense doit absolument figurer dans la liste des organismes à informer systématiquement dès le début de la mise en _uvre du plan POLMAR mer. Je dirai même qu'avant le déclenchement du plan, il est utile que les échanges d'information entre la préfecture maritime et la préfecture de zone soient systématisés.
Au-delà de ces dispositions élémentaires, faut-il, comme cela a parfois été évoqué, fusionner les deux plans, mer et terre, sous l'autorité d'un seul responsable ? Pour ma part, je ne le pense pas, car chaque partie dans son contenu opérationnel a évidemment sa spécificité et exige des compétences bien particulières.
En revanche, il faut une plus grande harmonisation des deux plans, avec sûrement des parties communes, et une meilleure articulation, notamment en matière d'information, qui doit être permanente. Pour cela un dispositif simple consisterait à échanger dès le début des officiers de liaison entre les deux PC.
Autre problème, celui de la bande côtière. La situation n'est pas la même que pour le secours à naufragés où la ligne de partage est la bande des 300 mètres : les préfets de département interviennent dans les 300 mètres proches de la côte et le préfet maritime au delà de cette limite.
En matière de pollution, cette règle n'existe pas : le préfet maritime est compétent pour la mer et les préfets de département pour le domaine public maritime. Or, dans une bande côtière qu'il est difficile de définir, les moyens de la marine nationale ne peuvent pas intervenir - les profondeurs ne le permettant pas.
Il serait donc préférable que les préfets de département puissent agir, en relation bien entendu avec le préfet maritime - mais il y a un officier de liaison auprès d'eux - , avec le concours des Affaires maritimes, ainsi qu'en utilisant d'autres moyens, par exemple en requérant des bateaux de pêche qui pourraient mener plus facilement certaines opérations.
En ce qui concerne les plans POLMAR terre eux-mêmes, il y a également une nécessité de mieux les harmoniser, notamment en ce qui concerne la bande côtière.
Pour le contenu de chaque plan, il est apparu qu'il faudrait prévoir une plus grande prise en compte des aspects environnementaux, que ce soit en ce qui concerne les sites à protéger, ou au contraire les sites que l'on retiendrait comme lieux de stockage des produits ramassés. Cela s'est fait dans la pratique, mais il conviendrait de l'inscrire dans les plans révisés et de prévoir la présence, parmi les services représentés dans chaque PC opérationnel, de la direction régionale de l'environnement - DIREN. De fait, la DIREN a essayé de partager ses maigres effectifs pour être présente auprès de chaque préfet de département, mais il serait préférable d'institutionnaliser cette présence.
Il y a sûrement d'autres aménagements qui seront nécessaires, et afin de les déterminer, je prévois un travail de
debriefing avec les différentes préfectures de département dès que la période dans laquelle nous nous situons sera terminée et que l'on sera un peu moins occupés.
La seconde série de mes remarques porte sur le découpage des zones de défense.
L'expérience a montré que le découpage de la façade atlantique en trois portions, relevant de trois zones de défense différentes, n'était pas le meilleur moyen de faciliter la coordination entre les uns et les autres.
J'ajoute que le Gouvernement a d'ores et déjà décidé de remédier à cette situation en redécoupant les zones de défense de façon qu'il n'y en ait plus que deux qui couvrent le littoral atlantique.
Enfin, la dernière série d'observations que je formule s'appuie sur le constat que la marée noire a montré les limites et même les insuffisances de nos connaissances dans un certain nombre de domaines. J'en citerai deux.
Le premier concerne les caractéristiques et l'évolution des comportements dans le temps des différents types de produits pétroliers, une fois répandus en mer. Le CEDRE a été un instrument utile, mais il a des moyens limités. Il serait donc indispensable de le renforcer, comme le comité interministériel pour l'aménagement et le développement du territoire - CIADT - qui s'est déroulé à Nantes l'a d'ores et déjà prévu.
Le second porte sur l'appréciation des mouvements de la pollution. Il serait en effet indispensable d'avoir un modèle plus fiable de dérive d'une pollution en mer, en fonction à la fois de la météorologie et de la courantologie. Cela relèverait de Météo France, de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER) et du centre de documentation, de recherche et d'expérimentations sur les pollutions accidentelles des eaux (CEDRE).
Je n'ai pas besoin de rappeler les imperfections des modèles. L'un d'entre eux avait été abandonné rapidement, parce que l'on avait constaté que ses prévisions n'étaient pas corroborées par l'observation aérienne qui était réalisée 24 ou 48 heures après. Cependant, le modèle retenu, qui était meilleur, a néanmoins été insuffisant et l'on n'a suivi qu'une partie de la pollution, le reste étant vraisemblablement entre deux eaux.
L'orientation retenue par le CIADT de constituer un réseau de recherche en la matière pour coordonner toutes les compétences dans ce domaine est vraiment indispensable.
M. le Rapporteur : Monsieur le préfet, je vous poserai une série de questions, dont certaines pourront vous paraître un peu brutales.
Avez-vous eu des contacts avec le secrétariat général à la mer durant toute cette période ? Par ailleurs, lorsque des décisions devaient être prises, qui vous donnait les ordres ? Avez-vous été en conflit avec le préfet maritime, et si oui, qui arbitrait ? En fait, de qui dépendiez-vous pour l'ensemble de vos actions ?
Vous soulignez la nécessité d'une plus grande harmonie entre les plans POLMAR mer et POLMAR terre. A la lumière de votre propos, le seul point de distorsion était, apparemment, l'absence de liaison entre vos services et ceux de la préfecture maritime le premier jour. Avez-vous constaté d'autres éléments de distorsion entre ces deux plans ?
Par ailleurs, les niveaux de préparation de ces deux plans étaient-ils identiques ? Savez-vous si les plans POLMAR terre avaient été révisés dans les mois qui ont précédé le naufrage dans les différents départements ? Si oui, dans quels départements ? Bien entendu, si vous n'avez pas ces informations ici, vous pourrez nous les communiquer ultérieurement. Il m'a été indiqué que dans un département - mais peut être est-ce également le cas dans d'autres ? - les sites d'enfouissement préalablement répertoriés dans le plan POLMAR terre n'avaient pas été visités depuis plusieurs années, et qu'ils n'étaient plus valables pour certains d'entre eux. Avez-vous eu des problèmes d'activation de ce plan dans les départements ?
Convient-il de revoir le rôle du bénévolat dans le dispositif POLMAR terre ? En effet, les bénévoles n'ont-ils pas parfois constitué plus un handicap qu'un avantage ? Comment convient-il de gérer cette situation ?
Enfin, il existe un débat sur la qualité du fioul et sur sa toxicité ; or il faut que quelqu'un parle à ce sujet. Une note du centre antipoison de Rennes, en date du 21 décembre, révélait des résultats sur les analyses du fioul. Vous appartient-il d'informer l'opinion publique à ce sujet, car nous n'avons pas constaté une grande homogénéité en la matière et il y a eu des dégâts assez importants ?
M. Yves MANSILLON : Le préfet de zone, dans l'exercice de sa mission, travaille avec plusieurs autorités. Toute la préparation du plan systématique de nettoyage, c'est-à-dire l'évaluation des besoins en renfort et son suivi, est réalisé en relation principalement avec la direction de la sécurité civile du ministère de l'intérieur. Cependant, je suis également en relation avec le secrétariat général de la mer qui, lui, joue au niveau national le rôle de coordination des opérations pour la partie maritime.
Les choses ont pu, dans certains cas, se recouper, car il y avait une nécessité d'avoir des positions en harmonie. Je vous citerai deux ou trois exemples.
Ainsi, la réunion de présentation du mode de fonctionnement du FIPOL
à certains personnes a été organisée par le secrétariat général à la mer, mais j'y assistais avec les préfets de département.
De même, lorsque le ministre de l'équipement a voulu présenter les hypothèses envisagées pour le traitement de l'épave, et qu'il a voulu rassembler toutes les collectivités et les représentants des organismes sociaux et économiques qui reçoivent le bulletin d'information auquel je faisais référence tout à l'heure, il a chargé le secrétaire général de la mer d'organiser une réunion à Rennes, en relation avec moi.
Enfin, troisième exemple, nous avons eu le souci, dans la convention avec TotalFina pour le traitement des déchets, de ne pas inscrire de formules en contradiction avec les dispositions de la convention portant sur le traitement de l'épave. Cette dernière devant être élaborée par le secrétaire général à la mer, je lui ai soumis le projet de convention sur le traitement des déchets que j'avais préparé.
Tels sont les exemples d'articulation que je puis vous indiquer.
Sur certains points, des positions ont émané de Matignon. J'en indiquerai deux. La première me concerne directement, puisqu'il s'agit de la décision - que j'ai évoquée tout à l'heure - d'avoir une source d'information unique sur la lutte contre la pollution en mer et à terre.
La seconde concerne plus particulièrement le préfet maritime. Après les premières marées importantes du 24 et 25 janvier, nous avons vu, avec un décalage d'une huitaine de jours, de nouvelles arrivées de pollution sur le littoral. Ce phénomène s'est reproduit après les grandes marées du 20 au 25 février. J'ai alors proposé de ne pas attendre que ces pollutions arrivent sur le littoral en organisant une action de surveillance en mer et des actions de reconnaissance qui permettent de voir si des pollutions se déplacent entre l'épave et la côte ou entre deux eaux.
C'est ainsi qu'à partir du 20 ou 25 février, et en se fondant sur des instructions qui avaient été arrêtées à Matignon, la mise en _uvre des différents moyens maritimes pour tenter de détecter ces pollutions intermédiaires a été coordonnée.
Vous m'avez ensuite interrogé, Monsieur le député, sur les distorsions qui pouvaient exister entre les plans POLMAR mer et POLMAR terre. Il me semble vous avoir déjà répondu : il n'y a pas eu de problème particulier mis à part l'information qui ne nous est pas parvenue au début.
En ce qui concerne la révision des plans POLMAR, je ne peux pas vous dire exactement, ici, quels sont les plans des 14 départements de la zone dont j'ai la responsabilité qui ont été révisés depuis l'instruction du Premier ministre de décembre 1997. Certains départements ont, c'est certain, terminé ce travail de révision : le département de la Manche, dont le plan a servi de modèle à l'instruction de 1997, celui du Finistère ainsi qu'un ou deux autres.
Pour d'autres départements, le travail était commencé. Prenons l'exemple de l'Ille-et-Vilaine : nous avions commencé ce travail de révision fin 1998 et tenu quelques réunions début 1999. Nous avons eu ensuite d'autres priorités, concernant en particulier le bogue informatique de l'an 2000 pour lequel la petite équipe « sécurité civile défense » a dû laisser de côté le travail de mise à jour des plans départementaux POLMAR terre.
Cela étant dit, mais je ne voudrais pas avoir l'air de sous-estimer l'importance d'un plan, c'est souvent le travail préparatoire qui est le plus important. Il permet les échanges entre services, facilitant ainsi une meilleure connaissance de nos interlocuteurs le jour où l'on a à travailler ensemble en PC opérationnel. Le fait de ne pas avoir un plan formellement arrêté n'est pas nécessairement un handicap.
S'agissant du bénévolat, je ne pense pas que ce paramètre soit prévu dans aucun des plans départementaux. Il n'empêche qu'il y a eu un grand afflux de bénévoles qui a pu être précieux. Il a parfois pu constituer également une charge lourde à supporter : il n'y a rien de pire qu'une bonne volonté désordonnée !
L'afflux était tel, au cours des premiers jours, que bien souvent les maires ou les PC des préfectures ne pouvaient pas confier de mission à tout le monde ; les bénévoles avaient alors l'impression qu'on les négligeait, ou pire, qu'on les méprisait.
Certains départements ont très vite pris en compte cet élément, et ont mis en place, au PC préfecture ou au conseil général, une cellule d'accueil téléphonique pour organiser les missions. On demandait au maire de faire connaître les besoins et cette cellule servait d'intermédiaire.
Je vous citerai l'exemple de la Grande-Bretagne qui possède, à l'échelon intercommunal, des centres permanents d'accueil de bénévoles qui connectent les besoins et orientent les bonnes volontés. Voilà une formule qui pourrait être intégrée lors de la révision des plans POLMAR.
En ce qui concerne la toxicité du fioul, je vous rappellerai que dès la fin décembre 1999, la DDASS du Finistère et le préfet avaient diffusé les résultats du centre antipoison de Rennes auprès des PC avancés. Le CEDRE a remis à nos services toute une série de fiches réflexe, c'est-à-dire des recommandations sur la façon de traiter les produits, qui contenaient des indications sur la sécurité des intervenants.
Vers la mi-janvier 2000, le problème de la toxicité du fioul a resurgi. J'ai donc fait, à ce moment-là - le 19 janvier exactement -, un communiqué de presse que les médias, d'ailleurs, n'ont pas repris. Ce problème n'intéressait pas réellement, les questions étant diffuses, et la presse n'a pas publié ce communiqué. Elle n'a repris qu'une phrase faisant référence à l'avis d'un médecin qui avait été consulté localement.
C'est seulement après l'épisode assez polémique des analyses effectuées par le bureau d'étude Analytika que le problème a pris de l'ampleur et que l'on a dit et redit, mais en étant à ce moment-là assez mal entendu, ce qui avait été indiqué depuis le début.
M. le Rapporteur : Vous aviez donc le sentiment, par rapport à la note du 21 décembre et à votre deuxième communiqué, que le discours restait le même ?
M. Yves MANSILLON : Oui, tout à fait.
M. le Rapporteur : Vous n'avez pas eu d'informations différentes à porter à la connaissance du public entre le 21 décembre et aujourd'hui, en ce qui concerne la qualité du fioul ?
M. Yves MANSILLON : Non, aucune.
M. François GOULARD : Monsieur le préfet, je suis frappé par la différence qui existe entre la réaction de l'Etat suite à la catastrophe de l'Amoco-Cadiz, il y a plus de 20 ans, et celle postérieure au naufrage de l'Erika. En effet, les moyens dont dispose l'Etat aujourd'hui sont extrêmement différents de ceux qu'il avait en 1978. La décentralisation est passée par-là, ce qui veut dire, par exemple, que les moyens considérables d'une direction départementale de l'équipement sont aujourd'hui ceux du conseil général. De même, en ce qui concerne les moyens militaires, là où l'on mettait des dizaines de milliers d'hommes, vous n'avez plus qu'un millier d'hommes à votre disposition - ce qui ne fait pas beaucoup au kilomètre carré pour une pollution qui touche un linéaire de côtes infiniment plus important.
Il est assez symptomatique d'entendre M. le Rapporteur évoquer le bénévolat, que vous n'aviez pas évoqué vous-même. Vous n'avez pas parlé non plus, ou très peu, des collectivités locales.
Mon sentiment est que l'on a maintenu une apparence - en l'occurrence la responsabilité de l'Etat, le plan POLMAR et le rôle qui vous est dévolu par les textes -, alors que la réalité sur le terrain veut que les moyens ne soient pas toujours en votre possession. La situation a changé au regard des réactions du public ; ce phénomène qui était secondaire autrefois est devenu majeur. Prenez l'exemple des oiseaux mazoutés : sur un plan psychologique, c'est quelque chose d'énorme ; si l'on n'avait pas su recueillir et traiter ces oiseaux, je suis persuadé qu'il y aurait eu une réaction extrêmement vive de la part de l'opinion publique.
Or l'Etat n'avait pratiquement aucun moyen de faire face. Les représentants de l'Etat ont peut-être un ou deux fonctionnaires dans les services vétérinaires susceptibles d'agir, mais rien qui soit à l'échelle d'une telle catastrophe. En d'autres termes, j'ai l'impression que l'on n'a pas su adapter les moyens et la politique d'intervention à la réalité des risques et au contexte de telles catastrophes.
Je voudrais savoir quelle est votre réaction à cette présentation, certes schématique, mais tout de même partagée par de nombreux élus.
M. Yves MANSILLON : Monsieur le député, j'ai précisé, au début de mon propos, que je parlerai uniquement de ce qui dépend directement du niveau zonal, puisque c'est sur ce point que je peux vous faire part de mon expérience.
Par ailleurs, j'ai également rappelé que le premier échelon d'action était évidemment celui des communes. J'ai ainsi souligné le rôle des maires qui ont été les premiers à se mobiliser en utilisant tous les moyens mis à leur disposition - moyens municipaux, sapeurs pompiers et bénévoles.
En ce qui concerne les DDE, vous savez certainement qu'elles n'ont pas toutes été partagées : seules les DDE d'un tiers des départements sont partagées entre l'Etat et les départements. Pour le reste, c'est un service unique qui est, pour partie, à disposition du conseil général.
En revanche, j'adhère à vos propos concernant les moyens militaires. Dès que la réorganisation de la défense a été envisagée, les préfets, entre autres, ont évoqué le souci de voir se réduire une ressource tout à fait importante. Très souvent, le premier argument était celui de la proximité. Il y a 30 ans, il devait y avoir encore au moins un régiment par département. Aujourd'hui, compte tenu de la réduction du format de l'armée de terre, on en est loin.
Et cela n'est pas vrai seulement pour la proximité, c'est vrai aussi pour les effectifs globaux. L'importance des moyens disponibles pour ce que l'on appelle la projection intérieure a fait l'objet de débats depuis des années : ce sont quelques milliers d'hommes qui sont disponibles et, compte tenu des rotations nécessaires, nous avons bénéficié d'une part importante, notamment si l'on tient compte des effets de la tempête qu'il a fallu gérer dans le même temps.
M. Edouard LANDRAIN : Monsieur le préfet, je vous poserai trois questions.
Vous nous avez dit tout à l'heure qu'il vous a été impossible de joindre la préfecture maritime, pour cause de saturation dans les systèmes de communication. Cela est très étonnant à notre époque ! N'y avait-il pas, dans le plan de coordination terre-mer, une ligne directe entre le préfet maritime et le préfet de région - disposition nécessaire si ce n'est élémentaire ?
Ma deuxième question concerne la préparation des moyens de lutte contre les pollutions. Vous nous avez affirmé que les textes avaient été respectés, que les communes et les DDE avaient fait leur travail, et qu'il n'y avait plus de militaires. Nous en sommes conscients. Mais y a-t-il eu, dans le cadre d'une préparation éventuelle à une catastrophe, des simulations et des techniques proposées ? Les communes ont-elles été sensibilisées à ce qui pourrait arriver ? Avons-nous répertorié, par exemple, le nombre de bottes, de pelles qui pourraient être mises à disposition ? A-t-on prévu des réserves ?
Enfin, en ce qui concerne les sites d'enfouissement et les techniques utilisées, on a pu lire dans la presse que les techniques employées il y a 20 ans, notamment la chaux-vive, semblent être compatibles avec l'environnement ; avez-vous étudié et répertorié ces techniques ? Seront-elles de nouveau employées ou bien allez-vous, comme dans certains endroits, choisir des sites d'enfouissement au petit bonheur la chance dans des zones plus ou moins propices ?
M. Pierre HERIAUD : Monsieur le préfet, je souhaiterais parler de ce qui s'est passé concrètement dans la révision du plan POLMAR suite à la circulaire de 1997. Une réunion s'est tenue - à laquelle les représentants des maires ont été convoqués par accident sans doute ! -, où je me suis aperçu que rien n'était prévu pour les maires. Vous avez dit que les maires devaient être en première ligne, mais à la fin juillet, début août 1999, ce sont les services de l'Etat et les services départementaux de lutte contre l'incendie et de secours qui se trouvaient là, les maires n'ayant pas été intégrés. J'ai dû intervenir auprès du directeur du cabinet qui présidait cette réunion pour obtenir l'intégration des maires dans trois commissions chargées de recenser les sites, le patrimoine qu'il convenait de protéger, les ports, les plages, les criques et autres, de même que les cultures marines.
Or, et je l'ai dit ce jour-là, lorsqu'une catastrophe se produit, les maires sont en première ligne. Et nous avons pu observer, dans les PC avancés que nous avons montés à partir du 27 décembre, que les maires étaient bien en première ligne, et qu'ils étaient là avec leurs services techniques. Malheureusement, entre août et décembre, ils n'avaient pas eu le temps de travailler dans les commissions qui devaient recenser les sites ; d'où des erreurs commises sur des cultures marines - il aurait, par exemple, mieux valu remonter les huîtres qui étaient en mer plutôt que de les descendre. Aucune préparation n'était donc faite.
Aujourd'hui, suite aux abondements successifs - 120 puis 100 et 40 millions de francs pour le matériel, à nouveau 300 millions de francs récemment -, des moyens financiers sont disponibles. Mais les matériels n'arrivent pas ! Or pour des contraintes administratives diverses, je pense notamment aux rapports qui ont dû être établis pour savoir comment on allait procéder pour le nettoyage des côtes, nous ne disposons toujours pas du matériel nécessaire - Karcher et autres. Il semble que le matériel fourni - stocké depuis le naufrage de l'Amoco-Cadiz - était hors d'état de marche.
Vingt-cinq Karcher sont promis pour le sud Loire - je ne sais pas combien il y en a de prévu pour le nord -, 8 sont arrivés hier matin. Les services techniques et les mairies sont tout de même surpris de ce manque de préparation. Les marées de décembre sont allées atteindre, avec la tempête, les sommets des plus hauts rochers, les autres marées n'ont pas décollé ce mazout ; on aurait dû prévoir le matériel dont nous avons besoin aujourd'hui.
Les dispositifs des plans POLMAR terre des départements sont-ils supervisés par le préfet de la zone de défense, afin qu'il y ait une vision générale, une synthèse et que l'on insiste sur des points qui auraient dû être mieux préparés ?
M. Yves MANSILLON : Monsieur Landrain, je vous ai indiqué, effectivement, que nous avions eu des difficultés à joindre la préfecture maritime, mais je vous l'ai dit dans un souci d'honnêteté. Je n'ai pas dit que nous avions essayé en permanence, pendant des heures. Nous l'avons fait de façon discontinue.
Le centre opérationnel de la marine était évidemment, à ce moment-là, totalement concentré sur l'opération de sauvetage de l'équipage de l'Erika et les premières opérations d'urgence.
Un certain nombre de questions, Messieurs les députés, concernent ce que l'un d'entre vous a appelé des simulations. Comme tout plan de secours, les plans POLMAR donnent lieu périodiquement à des essais. Habituellement, une préfecture organise un à deux exercices par an, en alternant les exercices dits de « cadre » et ceux sur le terrain.
Etant donné qu'il existe 12 ou 15 plans de secours différents, il est évident qu'on ne les teste pas tous chaque année. Mais ce qui est important, c'est l'habitude de travailler avec les services. Une configuration ORSEC n'est pas fondamentalement différente selon qu'on traite des chutes de neiges considérables, une inondation ou un plan POLMAR : ce sont les mêmes mécanismes de coordination et de direction des services qui interviennent.
En revanche, en ce qui concerne les moyens matériels, ce que nous a dit M. Hériaud, à propos des matériels stockés et défaillants, prouve qu'il ne faut pas cultiver des modes de raisonnement qui ne sont plus de cette époque. La plupart des moyens sont des moyens fongibles que l'on peut trouver dans le commerce. On ne va pas faire des stocks de bottes ou de pelles ; ça n'aurait pas de sens ! Et pour les Karcher, ce n'est pas fondamentalement différent.
Evidemment, le problème est différent pour les moyens lourds
- tels que les machines à aspirer la pollution. Et c'est sans doute là qu'une mise en commun, ou en tout cas des accords d'échanges entre pays, pourraient se révéler utile. Par exemple, pour les cribleuses - appareils qui permettent de retirer la pollution enfouie dans le sable -, on a fait appel à des collectivités d'autres régions de France qui en disposaient et qui n'en avaient pas l'usage en cette saison. C'est d'ailleurs là que le rôle de coordination dans la recherche des moyens peut se révéler utile.
En ce qui concerne l'harmonisation des plans POLMAR, il s'agit en effet d'un travail qui n'a pas été fait et qui devra l'être. Les plans POLMAR étaient transmis à la zone de défense qui vérifiait que les règles essentielles étaient bien respectées, et que les procédures étaient bien exactes. Cependant, elle n'a pas eu ce souci d'harmoniser.
Quant aux sites d'enfouissement, il y a eu le souci, quelles que soient les dispositions à cet égard des plans POLMAR départementaux, de définir les points où seraient installés des sites de stockage provisoires- pour les définitifs, le problème est différent, car ce sont des sites industriels déjà équipés. Cet état des lieux des sites de stockage intermédiaires a toujours été revu par chaque préfet, en associant les compétences de la DRIRE et de la DIREN, pour être sûr de ne pas faire de bêtises en implantant une zone de stockage dans un site sensible écologiquement.
En tout état de cause, ces sites ne sont que provisoires et c'est l'entreprise TotalFina qui est chargée, en vertu de la convention que j'évoquais tout à l'heure, de récupérer le plus vite possible les produits dans ces sites et de les traiter. Il n'y aura pas de traitement sur place comme on l'a déjà fait, dans des conditions qui n'ont pas toutes été mauvaises, mais parfois un peu improvisées.
M. Louis GUEDON : Monsieur le préfet, nous avons bien compris quel était le fonctionnement des plans POLMAR terre et mer. Une des fonctions de cette commission d'enquête est de mieux comprendre les causes de ce naufrage afin d'éviter que de telles catastrophes se reproduisent.
Considérez-vous ce plan POLMAR comme parfait ? Sinon, quels sont, selon vous, les points faibles auxquels il convient de remédier, indépendamment, des défaillances que vous avez évoquées au sujet de l'harmonisation des procédures et de l'actualisation des sites de stockage des déchets ?
M. René LEROUX : Monsieur le préfet, je voudrais tout d'abord vous remercier d'avoir évoqué le rôle des maires. Comme l'a souligné mon collègue Pierre Hériaud, nous - maires concernés par la pollution de l'Erika - n'avons été appelés à participer aux réflexions qu'à partir du moment où l'on nous a signalé la catastrophe. Cependant, ce n'est pas parce que nous participions à ces réunions que nous avions les moyens de lutter efficacement contre la pollution ; nous n'avions que nos bonnes volontés, nos services, les élus et les bénévoles dans un premier temps.
Vous avez parfaitement rappelé le rôle que nous avons été amenés à tenir avec nos services : nous étions les coordinateurs sur le terrain et nous avons servi de remparts à l'envahissement des bénévoles - situation que nous avons eu du mal à gérer. Je me souviens avoir dû intervenir le 26 décembre pour évacuer les bénévoles en arrêtant leurs engins : ça n'était pas facile ! Aujourd'hui, la mobilisation est moins importante, il est même difficile de trouver des volontaires, alors que cette pollution revient régulièrement sur nos plages.
En ce qui concerne les procédures contentieuses, pouvez-vous nous confirmer que nous avons bien 3 ans pour déposer nos dossiers ?
Ensuite, vous avez parlé de repérage des nappes : à quoi servent ces repérages, alors que vous ne disposez d'aucun moyen pour les dévier ? Ces nappes arriveront à un moment ou à un autre sur la côte.
Par ailleurs, les réquisitions de bateaux de pêche sont-elles de votre ressort ou de celui du préfet maritime ? Quelle sera leur utilité ? En effet, j'ai l'exemple de bateaux qui se sont mobilisés pour prendre dans leur filet une nappe de pétrole qu'ils ont dû ensuite relâcher parce qu'il n'y avait personne pour récupérer la nappe dans la baie !
Vous avez également parlé de la prise en compte des aspects environnementaux. Je suis, bien entendu, d'accord avec vous, mais il s'agira - il y va de notre responsabilité à tous - de réaliser un grand travail de civisme : au départ, un grand nombre de bénévoles ont fait davantage de dégâts que de bien sur le littoral. J'ai un exemple précis concernant un sentier du littoral : en un après-midi, ils nous ont occasionné trois mois de travail de restauration.
En ce qui concerne le matériel nécessaire, je dois dire que je ne me vois pas acheter des pelles en prévision d'une prochaine opération de cette nature, car j'aurais beaucoup de mal à justifier cet achat et à l'intégrer dans mon budget ! En revanche, pour ce qui est des cribleuses, il est envisagé de faire venir des cribleuses fixes qui ont des tamis beaucoup plus fins, car actuellement, le produit passe au travers ! Aujourd'hui nous employons donc le système du lavage par la mer - que vous avez validé -, mais, bien entendu, l'on retrouve le produit sur les plages. Il conviendrait donc de nous doter en cribleuses fixes, voire d'évacuer le sable, mais alors qu'en fera-t-on ?
Enfin, j'ai entendu dire qu'il existait un produit qui pouvait dissoudre ce fioul, sans dommage pour l'environnement, avec un risque minime. Ce produit proviendrait d'une entreprise du nord de la France qui se fournirait en Amérique. Où en êtes-vous dans la validation de ce produit dont on nous a vanté les mérites ?
M. Kofi YAMGNANE : Monsieur le préfet, je voudrais pour ma part revenir sur le repérage des nappes. Voilà deux mois que cet accident s'est produit. Le haut des rochers est complètement pollué. J'aimerais donc savoir si vous avez le moyen de repérer les nappes qui arrivent - soit par l'observation, soit par des calculs ? Pouvez-vous déterminer leur trajectoire, leur vitesse et leur point d'impact sur les côtes ? Enfin, avons-nous les moyens de les intercepter avant qu'elles ne s'échouent sur la côte ?
M. Yves MANSILLON : Monsieur Guédon, en ce qui concerne l'efficacité du plan POLMAR, j'espère ne choquer personne, car aujourd'hui l'on entend beaucoup de critiques : sincèrement, je pense que le plan a bien fonctionné.
Depuis que j'exerce ce métier, j'ai connu de nombreux plans ORSEC ou équivalents, concernant soit une avalanche, soit des chutes de neiges abondantes, soit des inondations. Un plan ORSEC fonctionne toujours de la même façon. Pendant 3 ou 4 jours, tout le monde se bat et la mobilisation ne s'accompagne d'aucune critique, puis, le cinquième jour, l'on commence à poser des questions pour savoir qui est responsable. Naturellement, ce sont toujours les services de l'Etat qui sont pointés du doigt !
Nous n'avons pas vécu cela avec le plan POLMAR. Le travail s'est effectué pendant des semaines dans des conditions difficiles, mais il a été efficace. Replaçons-nous à la veille des grandes marées des 24 et 25 janvier : le travail avait bien avancé et nous étions confiants.
Pourquoi des critiques sont-elles actuellement formulées ? Ce n'est pas parce qu'on travaille moins bien, mais parce qu'il y a ce phénomène désespérant de l'afflux régulier, sans cesse renouvelé, de pollutions qui ne sont pas massives mais qui sont très dispersées.
En ce qui concerne les maires, certains d'entre vous m'avez entendu leur rendre hommage à Lorient ; le cadre étant différent, je n'ai pas éprouvé le besoin de le faire à nouveau ici. Mais il est évident que les maires ont effectué un travail considérable, et souvent avec des moyens limités.
Monsieur Leroux, je vous confirme que vous disposez d'un délai de 3 ans pour présenter vos demandes.
Pourquoi vouloir repérer les nappes et comment fait-on ? Nous utilisons, tout d'abord, l'observation aérienne, ainsi que des bateaux qui tournent dans différentes zones, dont certains d'entre eux sont équipés de sondes permettant de détecter des nappes évoluant entre deux eaux ou à quelques mètres sous l'eau.
Cette recherche est utile pour le cas où l'on trouverait des nappes suffisamment compactes pour pouvoir mettre en _uvre un procédé de pompage. Ce procédé, je le rappelle a été très efficace pendant les quelques jours de beau temps du début janvier. On n'avait jamais dans aucun pays réussi à pomper autant de fioul en une fois.
L'information a été, là aussi, un peu faussée, car les deux premiers jours, compte tenu de son caractère compact, le fioul obstruait les conduits des pompes. Mais ensuite nous avons eu du matériel adapté qui s'est révélé très efficace et n'a cessé de travailler que lorsque la tempête s'est déchaînée. Sachez donc que cette possibilité existe et que l'on peut le faire lorsque les conditions météorologiques sont favorables.
Il se trouve qu'aucun des systèmes de repérage mis en place - mais là je parle à la place du préfet maritime - n'a permis de détecter des nappes importantes. Ce sont donc bien le flux et le reflux existant dans la bande côtière très proche qui déposent la pollution au même endroit ou un peu plus loin, selon les courants. Or nous ne pouvons employer certains moyens - la Marine nationale ou le concours de pêcheurs - que si l'on découvre des nappes suffisamment compactes. Par ailleurs, si l'opération n'est pas conçue jusqu'à la fin, avec un point d'accueil et de stockage, il est évident que celle-ci ne peut pas être très efficace.
Enfin, je ne vois absolument pas de quoi vous voulez parler lorsque vous évoquez un produit miracle capable de dissoudre le fioul n° 2 sans dommage pour l'environnement !
M. René LEROUX : Les maires ont reçu une note, via les PC, provenant du concepteur et du fournisseur de ce produit.
M. Yves MANSILLON : Nous avons reçu, surtout dans les quinze premiers jours, de nombreuses propositions de toutes sortes ! Là aussi, les docteurs miracles sont un trait commun de tous les plans ORSEC ! Toutes ces propositions ont été envoyées au CEDRE pour examen et validation scientifique. Or ce produit ne me dit rien. Je vais me renseigner.
En ce qui concerne les cribleuses fixes, j'enregistre votre demande, car j'étais resté à la solution que j'ai évoquée.
M. le Rapporteur : Monsieur le préfet, très honnêtement, avez-vous manqué de moyens techniques et humains à un moment donné ?
Deuxièmement, ne pensez-vous pas que les collectivités territoriales devraient être intégrées complètement dans le système d'organisation des plans POLMAR terre - ce qui voudrait dire, bien entendu, que les maires acceptent l'autorité du coordinateur général ?
Enfin, que pensez-vous du CEDRE : sa structure et ses moyens sont-ils suffisants ?
M. Yves MANSILLON : En ce qui concerne les moyens humains, nous avons eu une petite inquiétude lorsqu'il a fallu transférer des effectifs pour lutter contre les conséquences de la tempête. Mais nous nous sommes, du fait des rotations en moyens civils, remis à niveau très rapidement. Par ailleurs, j'ai dû, début février, en appeler au plus haut niveau pour que l'engagement militaire soit maintenu à hauteur de 12 compagnies. Nous avons d'ailleurs eu, depuis lors, toujours plus que les 1 250 hommes prévus, puisque nous en avions en permanence 1 300 à 1 350.
S'agissant des moyens techniques, il est vrai que nous avons manqué de barrages, le temps que l'on en fasse venir d'autres régions. Cependant, je ne suis pas sûr que l'on aurait eu les moyens humains et navals de les mettre en place. Je ne suis toutefois pas catégorique car il s'agit d'une période que j'ai vécue moins directement.
Faut-il intégrer les collectivités locales dans les plans ? Oui, bien entendu. C'est indispensable, la commune étant le premier échelon d'action. D'ailleurs, la plupart des plans de secours font une place particulière aux collectivités locales. Le maire intervient, non pas en raison de la décentralisation, mais en raison de ses pouvoirs de police. Et il est, pour une part, sous l'autorité du préfet.
Enfin, j'ai trouvé le CEDRE très précieux. Les conseils qu'il a donnés, notamment en ce qui concerne les modes de traitement, ont été très utiles.
Audition de M. Marc CHEVALLIER, président,
et de M. Edouard BERLET, délégué général,
du Comité central des armateurs de France (CCAF)
(extrait du procès-verbal de la séance du 7 mars 2000)
Présidence de M. Daniel PAUL, Président
MM. Marc Chevallier et Edouard Berlet sont introduits.
M. le Président leur rappelle que les dispositions législatives relatives aux commissions d'enquête lui ont été communiquées. A l'invitation du Président, MM. Marc Chevallier et Edouard Berlet prêtent serment.
M. Marc CHEVALLIER : S'agit-il, M. le président, de discuter sur le dossier de l'Erika
ou sur celui de la sécurité maritime ?
M. le Président : Sur celui de la sécurité maritime, à moins que vous n'ayez des informations particulières sur le dossier de l'Erika.
M. Jean Yves LE DRIAN : En tout état de cause, votre point de vue sur l'Erika ne serait pas inutile.
M. Marc CHEVALLIER : Ce que je pourrais dire sur l'Erika, c'est que le prérapport de la commission d'enquête a été diligenté dans des délais assez brefs et qu'il nous paraît tout à fait bien présenté et bien fait.
Sur le fond, nous n'avons pas à prendre parti sur le résultat de l'enquête, mais il est clair qu'aujourd'hui le drame de l'Erika - parce qu'il s'agit bien d'un drame - fait apparaître dans notre système de réglementation et de contrôle de la réglementation - sur lequel je vais revenir - des insuffisances telles qu'il faut aujourd'hui rentrer dans le détail de la sécurité maritime pour essayer d'éviter à l'avenir des drames de cette importance.
Sur l'Erika lui-même, le fait qu'il ait été préalablement inspecté d'abord par le Bureau Veritas, ensuite par le RINA - Registro italiano navale - parce que Veritas n'en voulait plus, nous ouvre également les yeux sur un problème de fonctionnement et de transparence des sociétés de classification sur lequel, si vous le permettez, je reviendrai dans le cadre de la sécurité maritime.
Cela mis à part, le CCAF ne s'est pas prononcé sur le dossier de l'Erika en tant que tel puisque le rapport d'enquête est en cours et que les experts se sont déterminés : nous n'avons rien à ajouter par rapport à ce qu'ils ont dit !
Sur la sécurité maritime qui fait l'objet du débat, nous avons adopté une position claire dont je voudrais vous définir les grandes lignes.
Nous sommes partis du principe qu'il était inutile, aujourd'hui, de légiférer et de sortir de nouveaux textes mais qu'il fallait plutôt essayer - c'est en tout cas l'avis du CCAF - d'appliquer et de contrôler les règles de sécurité existantes. Elles sont nombreuses, elles sont très valables et le premier système qui va nous permettre de le faire, c'est le système EQUASIS qui est en train d'être mis en place.
Vous savez qu'il s'agit d'une banque de données qui permettra d'avoir une meilleure connaissance des navires, une meilleure information des affréteurs et un meilleur ciblage des possibilités de contrôle sur les navires à risques. Au travers de cette banque de données informatique, nous aurons accès à tout ce qu'il est possible de connaître sur le navire, son équipage, sa classe, son âge, ses certifications etc.
C'est là un élément qui me paraît très important. L'administrateur en chef, M. Marchand est chargé, à Saint-Malo, de sa mise en place au niveau national et je pense que, d'ici au début de l'été, le système pourra fonctionner.
Nous devrions également contrôler prioritairement des navires qui transportent des marchandises dangereuses et polluantes dans le cadre du contrôle de l'Etat du port. Vous savez que nous le faisons au niveau français, mais insuffisamment, puisque l'administration française ne dispose pas d'assez d'inspecteurs. Je crois pouvoir dire que nous avons inspecté, en 1999, 13 % des navires qui ont fait escale dans les ports français, l'objectif ayant été préalablement fixé à 30 %. Ce différentiel est considérable mais face à cette situation l'administration nous répond - et je crois qu'elle a raison - qu'elle n'a pas les moyens en personnels de se conformer à cet objectif. Pour être complet, il faut relever que, selon le Premier ministre, cinquante inspecteurs supplémentaires devraient être recrutés prochainement pour satisfaire aux contrôles de l'Etat du port.
J'ajoute - et nous sommes intervenus dernièrement avec Edouard Berlet sur ce sujet - que nous ne trouverons pas d'inspecteurs s'il s'agit de les rémunérer à 12 000 F ou 13 000 F par mois. Il faut absolument les rémunérer correctement pour avoir des gens de haut niveau, qualifiés, qui soient capables d'inspecter les bateaux étrangers ce qui suppose, au minimum, de parler couramment l'anglais et de savoir de quoi il est question, ce qui exige des formations d'un certain niveau. Si l'on veut embaucher ces contrôleurs, encore faut-il s'en donner les moyens...
Les contrôles devraient également être ciblés sur les navires battant pavillon d'un Etat qui n'a pas ratifié les conventions de l'OMI relatives à la sécurité des navires, notamment les conventions STCW. Il est important, compte tenu du fait que nous n'aurons pas, demain, la possibilité de contrôler tous les navires qui passent chez nous, de pouvoir au moins contrôler ceux qui font partie des navires dits les plus dangereux, puisque leur Etat de pavillon n'a pas signé les conventions internationales.
Enfin, il convient d'harmoniser les politiques et les pratiques de contrôle dans les pays de l'Union européenne. Nous avons plaidé en faveur d'un système de contrôle européen harmonisé - on a parlé de la création d'une commission européenne sur le sujet - pour définir des types de contrôles et, pourquoi pas, des formations communes de contrôleurs, en vue, éventuellement, de faire des échanges de contrôleurs : on peut imaginer que des contrôleurs hollandais viennent suivre des formations et effectuer des contrôles en France et qu'inversement des contrôleurs français puissent aller aux Pays-Bas.
A mon avis, ce qui est important, c'est de démarrer, dès à présent, une promotion de contrôleurs nationaux.
Il faut également renforcer l'efficacité des contrôles de structures en augmentant leur périodicité et nous pensons plus spécialement aux vieux navires dont on sait que, quand ils vieillissent, ils ont des problèmes : si je reviens à l'Erika, je dirai que c'est bien un problème de structure qui a provoqué sa fracture. Pour autant, soyons clairs : il aurait été double coque, il se serait quand même cassé et aurait aussi coulé.
Sur les bateaux pétroliers et les tankers de plus de vingt ans ce vieillissement des structures est un vrai problème puisqu'il faut savoir - et je l'expliquerai très schématiquement pour que vous compreniez - qu'il s'agit d'un problème d'usure de tôles, soit du fait du vieillissement et du contact avec l'eau salée, soit surtout du fait de l'électrolyse qui se crée entre des récipients qui sont chauffés - quand on transporte du pétrole, on chauffe la cargaison - et les ballasts qui sont remplis d'eau salée. Il y a un phénomène d'électrolyse important et il est donc indispensable de procéder à des radiographies de tôles. Si - je dis bien si - on avait radiographié l'Erika, on se serait aperçu qu'il présentait certainement de grosses faiblesses de structure.
Il faut donc impérativement rendre le système de suivi des structures de navires plus performant .
Certaines sociétés de classification ont fait en la matière de gros progrès et il conviendrait de dresser le bilan de ce qui se fait sur le plan technique pour qu'on prenne ce qu'il y a de mieux dans les sociétés de classification afin d'être en mesure, au moins à l'échelle européenne, d'exercer ces contrôles de façon rapide, le grand problème étant que nous n'aurons pas les moyens d'immobiliser les navires pour procéder aux inspections. Or, on sait que, pour faire une inspection des structures, il faut que le bateau soit dégazé, que les cuves et les ballasts soient vides et, très souvent, que le navire soit en bassin de carénage. Par conséquent, il faut disposer de moyens très adaptés pour intervenir rapidement.
En outre, sur le plan européen, il faudrait que nous puissions créer une commission d'étude sur les systèmes d'enregistrement des fatigues du navire, de ses avaries et de ses pannes.
Sur le plan de la classification, la garantie de la qualité des travaux des sociétés de classification est, à mon avis, déterminante : nous l'avons vu avec le RINA. Nous avons appris tout ce qui a été écrit et dit sur l'Erika et sans savoir exactement ce qu'il en est - j'ignore quelle sera la conclusion de l'enquête - je puis dire que toutes les sociétés de classification n'ont pas les mêmes niveaux, même si elles font partie de l'IACS (International association of classification societies). Certains pays refusent d'ailleurs les sociétés de classification de certains états.
A ce niveau, il y a certainement un cahier des charges à mettre en place : on pourrait imaginer un cahier des charges international qui serait élaboré sous l'égide de l'OMI pour établir les opérations de contrôles et les conditions de délégation aux sociétés de classification. C'est une mesure qui nous paraît assez fondamentale.
Il convient aussi de renforcer les procédures d'audit des ces organisations face à la directive européenne 94/57, car il nous semble également important de pouvoir mettre en place une procédure de contrôle des sociétés de classification. En définitive, aujourd'hui, les sociétés de classification sont payées par l'armateur qui est un client et elles ne sont contrôlées par personne. Il faut donc certainement que, sur le plan européen, on mette en place une procédure d'audit de ces organisations.
Il est essentiel, de surcroît, que les sociétés de classification s'engagent, quitte à ce qu'on les y oblige, à publier leur décision lorsqu'elles refusent un navire ou en modifient la notation.
Le Bureau Veritas, pour des raisons qui lui sont propres, et certainement valables, a refusé à l'armateur de l'Erika de poursuivre son exploitation commerciale et a exigé que le navire rallie un port pour y être réparé. L'armateur de l'Erika, comme c'était son droit, a décidé de changer de bureau de classification et est passé au RINA, moyennant quoi l'Erika a continué à naviguer.
Nous voulons que, dans un tel cas, la société de classification qui ne donne pas la notation ou qui change de classe ou de note, puisse motiver sa décision dans un système officiel européen de façon à ce que les autres sociétés de classification et l'ensemble des organismes de contrôle puissent être informés sur le sujet.
J'en arrive à la responsabilité du donneur d'ordre.
Contrairement à ce qui a été dit, nous ne voulons pas remettre en cause le principe actuel de responsabilité de l'armateur : l'armateur reste responsable de son transport, que les marchandises soient dangereuses ou polluantes, et il est évident que l'armateur doit conserver cette responsabilité. Néanmoins, nous souhaiterions qu'une participation, ou une responsabilité du donneur d'ordre sur le choix du navire soit mise en place. En d'autres termes, nous cherchons à éviter que des affréteurs affrètent des navires sous normes ou des « navires poubelles » .
Quel est le problème qui nous préoccupe aujourd'hui au niveau de la sécurité maritime ? C'est que le transport maritime est sous-rémunéré. Les pavillons nationaux ayant été incapables de défendre leurs positions respectives - les Américains ont ouvert la voie les premiers - nous en sommes arrivés à immatriculer des bateaux sous pavillon de complaisance.
La complaisance est une chose dont je ne veux pas parler aujourd'hui car elle est un peu hors sujet mais je précise quand même que, sous pavillon de complaisance, il y a de nombreux navires dans le monde qui sont de très bons navires, très bien armés, qui sont des bateaux récents et qui sont au « top niveau » : les bâtiments de la flotte chimiquière de nos amis scandinaves sont les meilleurs du monde et ils sont tous immatriculés au Liberia.
Sur la qualité des navires, il n'y a rien à dire.
En revanche, beaucoup de navires circulent dans le monde, sous pavillon de complaisance ou sous pavillon de petits États, qui ne sont pas du tout aux normes et qui sont les navires dits « poubelles ». Or, ce sont eux qui cassent le transport maritime et qui nous font une concurrence déloyale.
Il faut savoir que sur un petit caboteur, par exemple, nous dépensons environ 3 millions de francs par an d'entretien courant, comprenant les visites de classe, les passages de Veritas, les changements de pistons et que sais-je encore, alors que les Turcs, entre autres, - je ne veux incriminer personne - dépensent entre 300 000 et 500 000 F sur les mêmes navires... Il est évident qu'avec cet écart, quand nous sommes en concurrence sur un marché, on sait qui va l'emporter... Nous ne pouvons pas nous aligner parce que nous serions au-dessous de nos prix de revient.
Cela revient à dire que, pour les armateurs, le problème, c'est le coût d'exploitation. Or, plus ce coût est élevé, moins l'armateur est compétitif, ce qui explique qu'aujourd'hui, la concurrence que je qualifie de déloyale est faite par des armateurs qui arment des navires sous-normes, avec des équipages sous-payés, qui ne respectent pas les conventions internationales, qui ont des navires mal entretenus, mal classés ou classés par complaisance - la complaisance se retrouve à tous les niveaux - et c'est là-dessus qu'il faut se battre .
Si l'Europe décide d'appliquer les règles existantes et que les navires sont vraiment contrôlés, nous aurons la possibilité d'éliminer une partie des « bateaux-poubelles », car il faut savoir que ces navires ne peuvent pas se passer du trafic européen. Ils sont obligés, dans une exploitation normale, de venir en Europe. Par conséquent, si nous avons une solidarité européenne, nous allons pouvoir faire un grand pas en avant.
Pour ce qui est de la création de codes de bonne conduite entre donneurs d'ordre, armateurs et assureurs par grand type de trafic, vous savez que c'est un sujet qui m'est cher et dont j'ai parlé à plusieurs reprises. Je peux dire au passage qu'en France, nous avons institué un code de bonne conduite entre chargeurs, affréteurs et armateurs qui, dans bien des cas, fonctionne, et que nous avons fait des progrès considérables.
Il faudrait donc, sur ce plan, coordonner les actions entre les différents interlocuteurs au niveau de la sécurité, de manière qu'entre les affréteurs, les sociétés de classification, les assureurs corps/facultés du navire et les P and I Clubs, les gens puissent se parler, s'informer et que cette coordination permette d'arrêter un véritable objectif.
Il convient aussi d'homogénéiser pour les flottes concernées les règles de
vetting, visites effectuées par les clients à bord des bateaux - certaines sociétés comme Total, B.P, Shell, ayant leur propre service
vetting, les assurent elles-mêmes, d'autres les font faire par des organismes internationaux - afin qu'elles soient à peu près identiques pour tout le monde et que les armateurs soient contrôlés de façon assez homogène.
Pour ce qui a trait aux ports et aux CROSS (Centres opérationnels de surveillance et de sauvetage) nous considérons qu'il faut que les installations des ports soient en conformité les unes par rapport aux autres et que les terminaux portuaires aient des exigences de sécurité adaptées aux besoins des navires.
Il y a bien des ports en Europe qui, aujourd'hui, sont très en retard par rapport à d'autres : je pense aux pompages de terminaux en chimie et en pétrole qui sont peut-être moins sûrs que d'autres...
Par ailleurs, nous souhaiterions voir renforcées les obligations de signalisation dans les rails : on a beaucoup parlé du rail d'Ouessant en posant la question de savoir s'il était prudent d'être aussi près des côtes françaises. C'est une question mais il en est d'autres : nos radars sont-ils suffisamment puissants pour contrôler le rail Est et le rail Ouest ? Avons-nous les capacités de sanctionner et de vérifier tout ce qui se passe ? Disposons-nous de moyens de remorquage et de pilotage suffisants pour intervenir ? Ce sont autant de questions que nous posons.
Il faut, de toute façon renforcer la sécurité et par ailleurs développer des systèmes de contrôle à distance par les CROSS sur les navires et la marchandise, tel que le système transpondeur, par exemple.
Enfin, il faut définir, au niveau international, les conditions d'accueil des navires en difficulté dans certaines zones portuaires ou de navigation. Nous pensons en particulier au cas d'un bateau en détresse chargé d'une cargaison dangereuse dont personne ne voudrait. Or, cela a pu se produire ou pourrait se produire demain : que faisons-nous dans ce cas-là ? Qui prendra la décision de faire entrer le bateau dans le port du Havre s'il est dangereux pour ce port ? Qui prendra la décision de mettre un bateau à la côte plutôt que de le remorquer en haute mer, auquel cas on ouvre l'angle par rapport à la côte et on polluera beaucoup plus ?
Il convient aussi de développer la formation à la gestion de crise de l'ensemble des intervenants, que ce soit au niveau des pouvoirs publics, des ports, des armateurs ou des navigants. Nous avons touché du doigt l'absence de gestion de crise dans le cas de l'Erika. On sait que l'Erika avait satisfait au code ISM et pour nous, armateurs français, il est extrêmement étonnant d'apprendre que des armateurs de ce type puissent bénéficier de cette certification, car nous savons ce qu'est le code ISM et la gestion de crise qu'elle implique dans le cadre de ce qui nous est imposé.
Enfin, il convient, bien sûr, de renouveler la flotte pétrolière. Pour ce qui nous concerne, nous souhaiterions que cette dernière soit aidée et que nous puissions examiner, entre compagnies pétrolières et armateurs, les conditions de son renouvellement. On parle du GIE fiscal et je pense qu'il y a une accélération qui pourrait être envisagée.
Voilà, en quelques mots, quelle est la position des armateurs de France. Je répète, encore une fois, que ce qui nous paraît important c'est qu'en travaillant, en renforçant les normes de sécurité, et en appliquant les conventions à partir des principes OMI, nous pourrions, sans même légiférer par ailleurs, disposer des nombreux moyens qui sont à notre disposition pour renforcer les normes de sécurité et contrôler leur mise en _uvre.
Je crois également que c'est pour nous, armateurs français, l'occasion de remettre un petit peu d'ordre « dans la maison », concernant le trafic maritime européen parce qu'il s'agit de lutter sans relâche contre les bateaux que j'appelle « bateaux poubelles » ou « sous-normes ».
M. le Rapporteur : Je commencerai par une question de détail mais néanmoins importante : dans votre esprit, lorsqu'un navire est récusé par une société de classification, comme cela s'est produit pour l'Erika, les raisons du refus devraient être inscrites dans le système EQUASIS ?
M. Marc CHEVALLIER : Je crois qu'il faut une transparence totale sur la vie et la classe du bateau. Or, nous savons que ce n'est pas le cas aujourd'hui puisque les sociétés de classification n'ont pas à donner les registres du navire, sauf en cas de vente ou d'inspection particulière. Ce sont donc des éléments qui ne sont pas connus des tiers, sauf demande particulière pour une raison particulière.
Je crois que s'il y avait transparence totale sur le sujet, que ce soit grâce au système EQUASIS ou à un autre, l'ensemble des partenaires pourraient être informés sur le pourquoi de la chose.
M. le Rapporteur : Mais le système EQUASIS tel qu'il est mis en place actuellement n'intégrera pas ces éléments ?
M. Marc CHEVALLIER : Le système EQUASIS porte sur la transparence de la vie du bateau. Nous ne sommes pas aujourd'hui parvenus à la transparence des sociétés de classification.
M. le Rapporteur : C'est-à-dire que si le système EQUASIS existait, et si « M. Total » était d'une totale sincérité, de toute façon, il ne pourrait pas savoir que le navire
Erika est passé de Veritas à RINA ?
M. Marc CHEVALLIER : A mon avis, il doit pouvoir le savoir. En revanche je ne sais pas s'il connaîtra les raisons.
M. Edouard BERLET : Le système EQUASIS est en train de se mettre en place avec un nombre de partenaires limité, d'une part et, d'autre part, avec des sources d'information qui sont, pour l'essentiel, à ce stade, les données détenues par l'Etat du port. Je crois que le pari qu'on peut faire est que, progressivement, à la fois le nombre de partenaires à l'opération EQUASIS et les sources d'information disponibles vont s'accroître. Certaines données qui sont dans les sociétés de classification et qui figurent également dans certaines banques de données particulières, comme, par exemple, la banque de données SIRE sur les pétroliers, vont progressivement s'intégrer sous la pression, ou sous un quelconque autre motif d'ailleurs, à cette banque de données EQUASIS.
Je crois que l'objectif est effectivement que l'ensemble des sources d'informations disponibles sur l'ensemble des navires soient accessibles à la totalité des interlocuteurs, qu'ils soient publics ou privés : c'est bien l'objectif qu'il faut poursuivre.
M. Marc CHEVALLIER : J'insiste sur le pourquoi. Que l'on sache que l'armateur a changé de classification est une bonne chose, mais encore faut-il savoir pourquoi...
M. Edouard BERLET : Puisque que nous évoquons EQUASIS, il est un point important à souligner : la façon dont sont introduites les données dans le système. Il est évident qu'il faudra s'assurer que la structure qui aura la responsabilité d'introduire les informations dans le système soit une structure neutre, sans parti pris commercial. En effet, un propriétaire de navire risque très gros s'il n'a pas la certitude que l'information qui figure dans la banque de données est une information sûre. Il y a un moyen de lutte et de guerre commerciale qui est absolument colossal : c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier et auquel les opérateurs sont très sensibles.
A ce stade, je pense que la plupart des opérateurs, qu'ils soient affréteurs mais surtout armateurs, n'ont pas la totale certitude que l'on a bien un mécanisme de contrôle et de gestion du système EQUASIS qui répond à ces exigences. C'est un point important.
M. le Rapporteur : Pouvez-vous être plus précis ?
M. Edouard BERLET : Imaginons une information importante, quelle qu'en soit la nature, concernant un navire : si l'on n'a pas la certitude que cette information est effective, valable et réelle et qu'elle est introduite dans le système EQUASIS, cela signifie que l'on peut pénaliser un armateur, pénaliser un affréteur dans une décision d'affrètement.
Donc, je crois que l'avenir du système EQUASIS va dépendre beaucoup de la qualité de la structure de gestion du système...
M. le Rapporteur : Ma question visait plutôt à savoir pourquoi, aujourd'hui, il y avait des interrogations sur la fiabilité.
M. Edouard BERLET : C'est une interrogation normale dans la mesure où le système n'existe pas encore véritablement.
M. Marc CHEVALLIER : Tout simplement parce qu'il n'a pas encore démarré, ni fait ses preuves ! Le système, en tant que tel, ne suscite pas du tout d'inquiétudes, ni d'interrogations mais, aujourd'hui, il est en train de se mettre en route. Donc, effectivement, il faut savoir comment il va fonctionner, si la banque de données qu'il va sortir sera suffisamment fiable et si les éléments qu'elle fournira seront les mêmes pour tous les bateaux.
M. le Rapporteur : Qui doit gérer ce système EQUASIS qui doit normalement se mettre en place au printemps ?
M. Marc CHEVALLIER : C'est l'administration française, pour ce qui concerne la France.
M. le Rapporteur : Vous acceptez volontiers que l'administration française intervienne ; donc, si je comprends bien, votre interrogation porte sur les autres pays ?
M. Edouard BERLET : A ce stade, le système doit être cogéré par la Commission européenne et la France mais ce sera, en fait, la Commission européenne qui prendra progressivement le contrôle du système.
Cela étant, je me fais l'écho d'un certain nombre d'observations que l'on peut entendre sur le système : ce n'est pas une critique mais juste un souci de bon fonctionnement pour l'avenir. Tel était l'objet de ma remarque.
M. le Rapporteur : Vous avez mis l'accent
sur la nécessité - et plusieurs déclarations sont allées dans le même sens - d'exercer un contrôle sur les sociétés de classification, d'une part - ce qui est un vrai sujet - et sur les contrôleurs, d'autre part.
Comment envisagez-vous que soient effectués ces contrôles : par un organisme européen ? Par les Etats membres ? Quel dispositif peut-on mettre en place, ne serait-ce que sur les sociétés de classification, puisque s'agissant des contrôleurs on pourrait considérer qu'il y a des références communes ? Qui peut juger une société de classification ?
M. Marc CHEVALLIER : Il y a une organisation internationale, l'IACS, qui contrôle et regroupe les sociétés de classification...
M. le Rapporteur : Oui, mais RINA en faisait partie comme d'autres...
M. Marc CHEVALLIER :... et il lui appartient de proposer une formule d'audit. Vous savez, il est facile d'avoir un audit standard sur les sociétés de classification comme nous l'avons sur nos bateaux avec l'ISM, par exemple, ou avec les
vettings clients : il suffit de voir comment les bateaux sont classés, de vérifier la classe d'un pétrolier en cale sèche pour savoir comment opère l'expert du Veritas ou du RINA et, éventuellement, faire un contre-audit ou une classification parallèle pour savoir quelles sont les notes qui sont attribuées aux bateaux.
Il y a différentes formules, moi je n'en ai pas à vous proposer de but en blanc, mais il faut de toute façon, sur le plan européen en tout cas, avoir ce genre de procédures.
Je crois que nous avons une chance d'aboutir si nous travaillons au niveau européen. Il faut vraiment que nous misions sur la puissance européenne pour pouvoir faire avancer les choses !
Effectivement, les sociétés de classification sont mondiales et l'Europe ne peut certes pas tout faire toute seule, mais si déjà nous prenons des décisions sur le plan européen ce sera une avancée importante.
Les sociétés de classification en seront je crois assez d'accord parce qu'aujourd'hui, à la suite du drame de l'Erika, elles sont un peu montrées du doigt. Certains bateaux sont dans des classes dans lesquelles ils ne devraient peut-être pas être ; donc certaines sociétés de classification ne doivent pas se sentir très tranquilles sachant que ces bateaux naviguent avec des certificats de bonne classe. Donc, je ne suis pas certain que les sociétés de classification s'opposeraient à l'édiction de normes qui seraient au moins communes aux sociétés de l'IACS.
Cela veut peut-être dire que le RINA prendra des précautions plus importantes à l'avenir ou prêtera plus d'attention aux structures des navires. Cela ne me paraît pas un problème difficile à régler : il suffit que les techniciens définissent entre eux la façon d'auditer ces sociétés.
M. Edouard BERLET : Pour compléter la réponse de Marc Chevallier, j'ajouterai qu'il se trouve que la Commission européenne a proposé de modifier la directive sur les sociétés de classification, qui a été adoptée en 1994-1995, et qui prévoit une procédure de labellisation européenne des sociétés de classification, avec attribution, suspension, retrait du label. Ce qu'a proposé, il y a quelques jours, la Commission européenne, c'est d'améliorer ces procédures à la fois d'attribution, de suspension et de retrait de labels. C'est une proposition qui me semble aller dans la bonne direction puisque, dans l'application de la directive de 1994-1995, on a vu la Commission européenne prendre certaines décisions un peu laxistes, et attribuer son label à des sociétés de classification qui, manifestement, ne le méritaient pas et qui n'avaient pas, dans le milieu maritime, la réputation d'être de bonnes sociétés.
Le seul fait que la Commission durcisse un peu son texte va dans la bonne direction et je pense que cette proposition de modification de la directive sera, de toute évidence, adoptée par le Conseil transports dans les semaines qui viennent. Ce sera sans doute un des résultats finaux, au plan européen, de tout ce débat qui s'est instauré suite à l'affaire de l'Erika.
M. Marc CHEVALLIER : Savez-vous que l'on ne peut pas faire classer un bateau battant pavillon français au RINA ?
M. le Rapporteur : Non et par quelle décision ?
M. Marc CHEVALLIER : Il a le droit d'être classé au Veritas, au Lloyd's, au Germanisher Lloyd's, mais pas au RINA et cela par décision française. La France n'accepte pas le RINA !
M. Edouard BERLET : Vous avez deux situations différentes. En effet, outre le fait que certains Etats membres décident de reconnaître, ou pas, certaines sociétés de classification, on peut faire jouer cette procédure d'attribution ou de retrait de labels européens aux sociétés de classification que j'évoquais tout à l'heure. Ce sont deux mécanismes différents.
M. Marc CHEVALLIER : C'est ce qui veut dire que la France, aujourd'hui, n'accepte pas le RINA et je vais vous en donner un exemple : nous avons en tant qu'armateurs acheté deux bateaux en Italie au cours des trois dernières années - il s'agissait de navires classés RINA - mais le jour de la livraison en Italie, quand nous avons mis le pavillon français à bord, nous avons dû les faire classer par le Bureau Veritas.
M. le Président : A quand remonte cette décision ?
M. Marc CHEVALLIER : Je ne suis pas capable de vous répondre précisément mais cela remonte à loin...
M. le Rapporteur : J'aurai une dernière question : quelle nouveauté présente le code de bonne conduite qui a été signé par un certain nombre d'acteurs, dont vous-même, il y a peu de temps et qui, d'une certaine manière, a anticipé sur ce qui a été annoncé à Nantes et sur ce qui se prépare au niveau européen ? Quelle est l'avancée qui est, selon vous, la plus importante ?
M. Marc CHEVALLIER : Nous avons signé une charte sur la sécurité. Il ne s'agit pas d'un code de bonne conduite qui est un partenariat entre affréteurs et armateurs pour le choix des bateaux et pour le respect des règles maritimes et des clauses des conditions du transport...
M. le Rapporteur : Tout à fait !
M. Marc CHEVALLIER : La charte du ministre, M. Gayssot, porte sur la sécurité. Ce qu'il y a de nouveau, c'est que les compagnies pétrolières et les armateurs, bien sûr, plus l'AUTF (Association des utilisateurs de transport de fret) et l'UFIP (Union française de l'industrie du pétrole), ont pris un certain nombre d'engagements quant à l'âge des navires, à leur utilisation, au système de reclassification, à la fréquence des visites en cale sèche, aux doubles coques. La société de classification Veritas a déclaré qu'elle était d'accord pour la transparence.
C'est donc un ensemble de choses qui fait que, sur le plan français - là nous étions dans un débat franco-français -, les acteurs ont accepté d'intensifier leurs efforts en vue d'améliorer la sécurité maritime.
Maintenant, il faut qu'ils soient suivis par les autres car il ne s'agirait pas que seuls les pétroliers français s'interdisent d'avoir des bateaux non dotés d'une double coque en 2008, alors que les affréteurs belges ou hollandais continueraient à affréter des bateaux simple coque jusqu'en 2015. Sinon Total, ESSO ou B.P. ne seraient plus dans la compétition internationale, si tant est que l'on puisse considérer que les bateaux simple coque seront alors de vieux bateaux qui offriront des conditions de transport meilleur marché : on en revient toujours à la concurrence déloyale...
M. François GOULARD : Pourriez-vous revenir sur ce que vous avez dit très rapidement concernant la responsabilité du donneur d'ordre ?
J'ai cru comprendre que vous ne remettiez pas en cause la responsabilisé principale de l'armateur mais, comme vous avez néanmoins évoqué la responsabilité du donneur d'ordre, j'aimerais savoir dans quelles conditions elle peut jouer. En cas de non-respect d'un certain nombre de normes, pourrait-on envisager que la responsabilité de l'affréteur soit mise en cause ?
M. Marc CHEVALLIER : Je veux dire par là qu'il faut - mais c'est une opinion personnelle - que chaque acteur prenne sa part de responsabilité.
Je ne suis absolument pas favorable au transfert de la responsabilité de l'armateur, qui a la charge de la marchandise, qui la reçoit à bord de son bateau, qui doit la livrer du point A au point B : l'armateur reste responsable, c'est clair.
En revanche, lorsqu'un affréteur cible un transport « pas cher » avec un bateau dont il sait, pour avoir fait un
vetting, que l'état n'est pas satisfaisant, qu'il ne correspond pas aux règles internationales, que ledit bateau ne répond pas aux exigences des conventions internationales, que les règles de l'OMI, de l'OIT (Organisation internationale du travail) ou de STCW ne sont pas respectées, je considère qu'il prend une responsabilité en faisant travailler un navire qui est un navire sous-normes. C'est tout ce que je veux dire et je crois que c'est à ce niveau que l'affréteur doit avoir sa part de responsabilité.
M. François GOULARD : Cela implique une modification des règles internationales actuellement en vigueur ?
M. Marc CHEVALLIER : Je ne crois pas.
M. Edouard BERLET : Ce que nous voulons dire, c'est qu'il faut effectivement mieux responsabiliser les donneurs d'ordre, qu'ils soient affréteurs, chargeurs etc.
Cela peut se faire à travers la mise en place de codes de bonne conduite, de nature contractuelle et conventionnelle, entre les différents acteurs sur le marché sans pour autant qu'il faille à nouveau modifier la convention de 1969, modifiée en 1992, sur les responsabilités respectives de l'armateur et des affréteurs en cas de pollution, ce qui est un autre sujet. Cette action est donc possible sans modifier la réglementation internationale actuelle en matière de responsabilité.
Cela étant, on peut aussi ajouter qu'il serait peut-être bienvenu de réfléchir à la façon dont fonctionne actuellement la responsabilité des affréteurs, en particulier pétroliers, pour dédommagement en cas de catastrophe puisque c'est aujourd'hui le mécanisme du FIPOL - Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures - qui intervient selon un mécanisme de mutualisation qui ne prend pas du tout en compte le fait que le pétrolier incriminé soit responsable ou non.
On pourrait, pour simplifier, parfaitement imaginer un système de bonus-malus qui renforcerait la participation de ceux qui auraient été, dans les années précédentes, à l'origine d'une catastrophe : cela n'aurait rien de choquant mais cela supposerait, évidemment, une modification de la convention internationale qui a créé ce fonds international. Ce sont là deux sujets différents et Marc Chevallier parle, lui, d'une responsabilité conventionnelle contractuelle à travers des mécanismes d'accords qui permettent aux acteurs d'avoir des comportements plus responsables.
M. Marc CHEVALLIER : En matière de sécurité, ce qu'il faut éviter, c'est que les gens fassent n'importe quoi et il faut que l'affréteur, effectivement, adhère à ce code de bonne conduite.
Mme Jacqueline LAZARD : Vous avez tout à l'heure, fait référence à l'importance des structures des navires dans le cas de l'Erika et je crois effectivement qu'il s'agit d'un problème important. Pour autant, le contrôle ne peut intervenir, ou doit intervenir de préférence, lors des carénages puisque c'est à ce moment-là, surtout, que l'on peut voir et connaître quel est l'état des structures des navires. Or, il me semble savoir que les carénages sont moins fréquents que par le passé, ce qui conduit à une situation un peu ambiguë.
Par ailleurs, j'aimerais avoir votre sentiment sur le développement du système d'affrètement : les armateurs ont de moins en moins fréquemment des navires en propriété et ont recours à ce système de l'affrètement : n'y a-t-il pas, là aussi, un plus grand risque ? Même si vous avez déclaré qu'il y avait un code de bonne conduite, la tendance n'est-elle pas d'utiliser un navire plus ou moins performant et entretenu en fonction de la valeur de la marchandise à transporter ?
M. Marc CHEVALLIER : Concernant le problème des structures, il est vrai que pour inspecter correctement un navire, il faut le voir dans un bassin de carène, donc au moment de son carénage ou de ses travaux de reclasse, pour pouvoir faire des radiographies de tôles, se promener dans les doubles fonds, être sûr que le bateau a dégazé etc.
C'est dans ce but que, dans le cadre de l'élaboration de la charte de sécurité animée par le ministre, M. Gayssot, nous avons réduit les temps de visite et les durées des classifications sur les vieux navires. Il est évident qu'aujourd'hui on carène moins souvent les bateaux parce que les peintures et la technique ont fait des progrès, mais il est aussi évident que les navires sont de mieux en mieux contrôlés parce que les moyens de contrôle sont de plus en plus performants : on fait une échographie de tôle comme on en fait une d'un genou et on sait parfaitement si la tôle est valable, si elle est pourrie ou rouillée. On est même capable de mesurer son épaisseur à l'aide d'un seul appareil...
C'est dire que l'on a quand même les moyens de contrôler très sérieusement les navires, surtout si on les suit précocement dans le système EQUASIS. Le Bureau Veritas dispose d'un système
Veristar qu'il a mis au point, qui suit depuis son début la vie du navire et ses relevés, et qui permet à tout moment de vérifier quelles sont les incidences des flexions ou des contreflexions qu'il subit, de l'érosion de ses tôles etc.
Sans entrer dans un débat technique, je confirme qu'aujourd'hui, nous avons de plus en plus de moyens pour contrôler et que les progrès réalisés sont comparables à ceux qu'a faits la médecine. Par conséquent, je crois que nous serons de plus en plus rassurés quant à la qualité des contrôles de navires.
Ce n'est pas parce que les bateaux passent au bassin de carénage tous les vingt-quatre ou trente mois que cela pose un problème si les contrôles sont effectués dès le départ.
Pour ce qui est de votre seconde question, ne nous trompons pas : que l'on soit propriétaire ou exploitant d'un navire, de toute façon, aujourd'hui, les conventions internationales s'appliquent à l'armateur qui est l'armateur disposant. On peut donc avoir un navire en affrètement coque nue ou en affrètement à temps : dans ces deux cas, on devient alors armateur disposant et on a la responsabilité de l'équipage, de l'entretien, du paiement des loyers s'il y en a et de l'assurance du navire.
A ce titre, l'armateur disposant se substitue au propriétaire du navire - qui peut être tout simplement une banque - et prend des risques importants. Je ne pense donc pas qu'il y ait une dérive de ce côté-là.
Concernant la troisième question, il est évident que celui qui transporte des frets extrêmement pauvres - et on sait, par exemple, que le zinc il y a trois ans valait le fret moins 10, ce qui revient à dire que la cargaison ne valait pas le prix du fret - a tendance à chercher le bateau le moins cher possible : c'est vrai pour les céréales ce qui explique qu'il y ait, en Méditerranée, beaucoup de petits céréaliers affrétés, en fonction du produit, à des taux très bas. C'est là que nous retombons sur le scénario des navires sous-normes ou des navires poubelles.
M. Alain GOURIOU : Dans votre exposé, vous avez souligné à plusieurs reprises la nécessité d'accords ou de mesures prises ou à prendre au niveau européen. Tout le monde l'a bien compris. Il se trouve que la Communauté européenne est à géométrie variable puisque, partis à six, nous sommes arrivés à douze puis à quinze, pour peut-être finir à vingt-six, avec des pays dont les législations sont extrêmement différentes du nord au sud en particulier, certains pays européens ayant des politiques maritimes et des flottes très importantes comme les pays scandinaves, la Grèce, l'Italie, le Portugal ou la France.
Ne pensez-vous pas que beaucoup d'armateurs ou beaucoup d'affréteurs jouent précisément sur ce manque d'homogénéité de la législation européenne pour pérenniser un certain nombre de pratiques ? Par ailleurs, si l'on attend que l'ensemble des pays européens mettent en commun leur expérience pour imposer des cahiers des charges internationaux ou des mesures de contrôle très importantes, je crains que l'on ne doive attendre longtemps...
Au niveau de la législation française, selon vous, quelles seraient les mesures essentielles à prendre ?
Vous connaissez bien la flotte pétrolière : à quel pourcentage estimez-vous aujourd'hui les navires à risques qui entrent dans les ports français et, de manière plus générale, dans les ports européens ?
M. Marc CHEVALLIER : A la première question, j'aurais tendance à répondre que les conventions internationales et les moyens de contrôle existent aujourd'hui, c'est pourquoi j'ai pris la peine de dire dans mon exposé qu'il ne fallait surtout pas voter des lois supplémentaires mais simplement appliquer celles qui existent. Or, si l'on prend l'exemple du contrôle, malgré le Mémorandum de Paris, nous n'avons eu les moyens de contrôler, par la faute de la France, que 13 % des navires qui sont passés dans nos ports en 1999.
Ne serait-ce que sur ce plan, si nous nous dotions des moyens d'en contrôler 25 %, 30 %, voire 40 %, nous contrôlerions beaucoup plus !
Aujourd'hui, un bateau lituanien, un bateau russe, un bateau turc ou un bateau maltais qui passe dans un port français et qui se fait arrêter et bloquer, n'a rien à dire : cela arrive tous les jours, y compris avec des bateaux européens car il peut se trouver qu'un armateur ait des problèmes avec un groupe électrogène dont le démarrage automatique soit défectueux et qu'il se trouve bloqué, s'il est contrôlé, ce jour-là, par l'Etat du port...Ce n'est pas pour autant que l'armateur est un armateur de deuxième classe mais le bateau est contrôlé.
Donc, déjà, par rapport à ce qui existe aujourd'hui, des améliorations peuvent être apportées : aux Pays-Bas, à Rotterdam, les contrôles sont effectués sérieusement. J'ai voulu faire contrôler en France des bateaux concurrents, estimant qu'ils n'étaient pas en état de transporter des cargaisons riches et que la concurrence était vraiment déloyale : cela n'a jamais été possible, même s'ils étaient passés à plusieurs reprises à Bordeaux ou à Sète, car l'administration m'a invariablement répondu qu'elle n'avait pas d'inspecteurs, ni de contrôleurs, disponibles.
Sur ce plan, si la France avait les contrôleurs voulus et si l'Europe avait la volonté d'échanger des contrôleurs et de leur offrir une formation commune ce serait très bien. Sur le plan français, il y a certes des avancées considérables à faire, mais isolément, nous n'avons pas les moyens d'une politique de grande ampleur.
En outre, concernant ces bateaux européens auxquels vous faites allusion et qui naviguent un peu partout, j'ai rappelé tout à l'heure qu'ils étaient obligés de venir en Europe. Qu'ils soient turcs, lituaniens ou chypriotes, ils sont contraints de commercer avec l'Europe, donc ils prendront le risque du contrôle.
Il arrivera d'ailleurs un moment où ils seront de plus en plus difficiles à affréter parce que les affréteurs qui auront signé un code de bonne conduite ou donné leur accord pour adhérer à une charte, en affrétant des bateaux de deuxième zone courront eux-mêmes le risque, soit d'être montrés du doigt, soit de voir les bateaux bloqués ce qui rendra, pour les armateurs, leur exploitation impossible. Ils se verront donc bien dans l'obligation de les entretenir et de les mettre aux normes.
Vous avez raison de souligner, monsieur, la difficulté qu'il y aurait à légiférer. Il ne s'agit pas de légiférer mais de faire prendre conscience aux pays européens qu'ils ont intérêt à suivre cette dynamique pour protéger leur pavillon et leur flotte : aujourd'hui, bien que les Hollandais et les Allemands aient des flottes importantes, la flotte européenne se meurt parce qu'elle est concurrencée par les bateaux maltais, chypriotes, ou des bateaux de deuxième classe...
M. le Rapporteur : C'est un moyen de protection ?
M. Marc CHEVALLIER : Bien sûr, je suis convaincu et je peux le dire ici que la catastrophe de l'Erika peut nous permettre à nous, Européens, de faire un formidable pas en avant pour la défense du pavillon : M. Jospin a annoncé à Nantes, l'autre jour, qu'il allait prendre des mesures en faveur de la compétitivité du pavillon ; je suis persuadé que M. Gayssot est également très motivé sur le sujet - nous attendons impatiemment le mois d'avril ou le mois de mai pour en avoir confirmation - et je suis convaincu qu'il y a une prise de conscience collective. On n'a jamais autant parlé du transport maritime que depuis l'Erika, or dans un pays qui n'a pas de culture maritime...
M. le Rapporteur : Qui n'a plus de culture maritime...
M. Marc CHEVALLIER : ...pardon, qui n'a plus de culture maritime, c'est peut-être un moyen de rebondir !
M. Alain GOURIOU : Oui, mais combien de temps cela va-t-il durer ? Vous allez voir que, très vite, l'attention va se déplacer vers d'autres sujets d'actualité...
M. Marc CHEVALLIER : Je dis simplement que c'est un moyen pour les Européens de défendre leur potentialité maritime et leur flotte.
M. Alain GOURIOU : L'autre question visait à savoir à quel pourcentage vous estimiez le nombre d'Erika, transporteurs d'hydrocarbures qui naviguent aujourd'hui en Europe et qui constituent des risques potentiels.
M. Marc CHEVALLIER : Je suis incapable de vous répondre...
M. Alain GOURIOU : Un sur deux ?
M. Marc CHEVALLIER : Ah, non !
Pas du tout. J'aurais tendance à dire que c'est de l'ordre de 20 %.
M. René LEROUX : 20 % des navires sous pavillons français ?
M. Marc CHEVALLIER : Non pas du tout, 20 % des bateaux en général.
M. Alain GOURIOU : 20 % c'est déjà largement suffisant !
M. Edouard BERLET : Il existe un moyen relativement précis de le savoir : il suffit de prendre les statistiques de contrôle du Mémorandum de Paris qui donnent trimestre par trimestre, ou semestre par semestre, la liste des navires arrêtés par pavillon et je crois qu'en se livrant à un petit travail statistique, on devrait pouvoir approcher, même si ce n'est pas une méthode très précise, un taux de risque sur l'ensemble de la flotte.
Si vous me permettez, je voudrais apporter un complément de réponse aux questions posées sur les niveaux de responsabilité. C'est un sujet important. En fait, il y a trois niveaux de responsabilité possible : l'OMI, l'Union européenne et la France.
A notre sens, dans l'hypothèse où l'on voudrait édicter des règles nouvelles - on a dit que dans cette affaire il convenait prioritairement de contrôler et d'appliquer celles qui existent - il faudrait le faire au niveau de l'Organisation maritime internationale pour une raison simple : l'activité maritime est une activité mondiale et un armateur ne peut pas gérer un navire qui est appelé à aller à Singapour, à New York ou ailleurs s'il est confronté à des règles qui sont différentes selon qu'elles sont édictées en Europe ou aux Etats-Unis, par exemple. Il faut donc que les règles techniques, et les règles en général, soient édictées au niveau de l'OMI.
Cela signifie que, pour notre part, nous ne sommes pas d'accord avec la position française qui consiste à faire adopter un « Oil pollution act » (OPA) européen et donc à avoir un mécanisme de réglementation sur l'âge des navires, ou sur la double coque, qui soit défini au niveau européen. Cela doit se faire au niveau de l'OMI.
Par ailleurs, selon nous, c'est à Bruxelles et au niveau européen que l'on doit avoir une politique de contrôle, et non pas une politique réglementaire, qui soit précise pour faire en sorte d'aboutir à une homogénéité, comme nous l'avons dit, des pratiques de contrôle avec un durcissement des textes réglementaires existants en la matière. C'est ce qui va être fait avec la directive en cours de modification sur le contrôle de l'Etat du port et avec la directive en cours de modification sur les sociétés de classification. Je crois donc que la Commission européenne va dans le bon sens car, comme l'a dit Marc Chevallier, si nous avons une politique européenne harmonisée, les armateurs, ne pouvant pas se permettre de ne pas avoir accès aux ports européens, seront contraints d'appliquer correctement les règles, lesquelles auront été définies au niveau de l'OMI : c'est un point important.
Enfin, il est un troisième niveau, le niveau français. Comme c'est un petit niveau au plan maritime, nous ne devons pas trop lui en demander, faute de quoi nous risquons de pénaliser nos opérateurs, que ce soient les armateurs ou les ports. Si la France, de sa propre initiative - Dieu merci, elle ne l'a pas fait jusqu'à présent - décidait d'avoir une politique de contrôle unilatérale extrêmement dure et extrêmement différente de ce qui se fait dans les ports voisins, cela n'aurait qu'un effet : les armateurs abandonneraient le port du Havre - ce qui serait dommage - pour celui d'Anvers ou d'ailleurs. Nous nous autopénaliserions, pour une bonne raison certes, mais nous nous autopénaliserions.
Il est très important, à notre sens, d'avoir à l'esprit ce que peut faire chaque niveau de responsabilité.
M. Marc CHEVALLIER : J'ajouterai que la France va prendre la présidence européenne à compter du premier juillet et que c'est notre ministre qui va présider la Commission des ministres transports : sur ce plan, nous disposons d'un outil formidable pour faire passer certaines règles et je crois que, l'Europe étant quand même très sensible au sujet, nous devrions pouvoir avancer très vite.
M. Pierre HERIAUD : Je souhaiterais un complément d'information technique ou technologique sur le système EQUASIS.
Vous avez dit que, sans être la panacée, sa généralisation permettrait d'avoir des informations avec une totale transparence. Nous sommes donc là dans le cadre d'un système d'information, avec des sites de traitement et des réseaux de communication.
Ma question porte sur la sécurité de ce système de traitement des sites et de la transmission des informations. Pour les réseaux de transmission est-il envisagé d'avoir recours à la cryptologie et est-ce que les sites sont eux-mêmes protégés de manière à ce qu'il n'y ait pas d'intervention extérieure susceptible de modifier les données de base de vos fichiers ?
M. Marc CHEVALLIER : Je suis mal à l'aise pour vous répondre parce que je ne sais exactement, ni ce qui est prévu, ni la façon dont les choses vont se faire. Je sais que ce sujet a été évoqué par les différentes administrations. EQUASIS a été signé par un certain nombre de pays _ , y compris le Canada si ma mémoire est bonne...
M. Edouard BERLET : Oui et par Singapour, l'Espagne, la France, la Commission européenne. Il n'y a pas encore beaucoup de pays mais il y aura des réseaux d'information
M. Marc CHEVALLIER : Il y aura des réseaux d'information mais je suis incapable de vous répondre sur la sécurité de transmission de ces informations.
M. Edouard BERLET : Il n'en demeure pas moins que c'est une vraie question !
M. Marc CHEVALLIER : Je sais que l'administration en parle et qu'elle réfléchit à cette sécurisation.
M. le Président : Nous recevrons à une date qui n'est pas encore fixée un certain nombre de représentants du ministère : nous avons demandé à M. Gressier de revenir et ce sont des questions qui pourront probablement être posées à cette occasion...
M. Marc CHEVALLIER : Je crois que l'administration pourra vous répondre.
M. Louis GUEDON : Je souhaiterais obtenir une simple précision. Vous avez donné, l'un et l'autre, beaucoup d'explications sur l'OMI et le rôle qui doit être le sien pour établir des règles, sur l'Europe qui doit s'attacher aux contrôles - c'est un peu ce que j'ai cru comprendre - mais par trois fois, au cours de votre exposé, vous nous avez parlé de la responsabilité du donneur d'ordre dans l'affrètement, et du lien qui l'unissait à l'armateur qui doit rester responsable lorsqu'il a la certitude que le bâtiment n'est pas à la hauteur de ce que suppose sa cargaison. Vous nous avez également dit que l'affréteur et l'armateur devaient avoir, entre eux, un code de bonne conduite.
Vous nous avez ainsi laissé entendre que l'armateur n'avait pas tous les droits et que des responsabilités lui incombaient. Comme cela a été amplement rappelé au cours de la discussion, vous nous avez précisé qu'il était inutile de légiférer à nouveau mais qu'il convenait d'appliquer et de contrôler les règles de sécurité existantes.
Par rapport à tout ce débat, pour qu'il y ait ce lien sur lequel, par trois fois, vous avez insisté entre l'armateur et l'affréteur, est-ce que les textes existants, s'ils sont appliqués, permettent de responsabiliser l'affréteur qui refuserait d'assumer avec compétence les charges qui devraient être les siennes ?
M. Marc CHEVALLIER : Je crois qu'Edouard Berlet a déjà répondu à la question.
Sur le plan international, il n'est pas question - et je crois que l'on ne va pas changer les textes - de définir par réglementation la responsabilité de l'affréteur : il a une responsabilité sur sa marchandise et c'est l'armateur qui est responsable du transport. Cela ne changera pas, le seul point que nous évoquons est celui du code de bonne conduite qui fait que les affréteurs et les armateurs se mettent d'accord pour respecter certaines normes de sécurité ou certaines clauses et conditions du contrat de transport .
M. Louis GUEDON : Excusez-moi d'insister, mais je reformulerai ma question : le code de bonne conduite appartient-il aux textes réglementaires qui devraient être appliqués ou s'agit-il seulement d'une déontologie ? En d'autres termes, y a-t-il toujours ce risque de voir l'affréteur, s'il n'est pas obligé par les textes de respecter ce code de bonne conduite, reproduire les mêmes situations ?
M. Marc CHEVALLIER : Je confirme que
l'affréteur, aujourd'hui, a le droit d'affréter le bateau qu'il souhaite et continuera à en avoir le droit, sauf s'il a signé une charte de sécurité maritime qui pourrait devenir une charte européenne, s'interdisant par là d'affréter des bateaux qui n'auront pas une double coque à partir de 2008 etc. Pour le reste, nous n'avons aucun moyen, aujourd'hui, de dire à un affréteur : « Vous n'avez pas le droit d'affréter tel navire».
M. Louis GUEDON : Et sa responsabilité n'est pas engagée ?
M. Marc CHEVALLIER : Et sa responsabilité n'est pas engagée...
M. Paul DHAILLE : J'ai suivi avec attention ce que vous avez dit sur la nécessité du contrôle par l'Etat de toute une série de règles mais j'aimerais avoir une précision : quand vous dites que 13 % des navires ont été contrôlés, s'agit-il de 13 % des navires ou de 13 % des escales parce qu'un navire peut toucher un port français à plusieurs reprises et donc s'il a été contrôlé une fois, on peut penser que le contrôle vaut pour l'année en quelque sorte...
M. Marc CHEVALLIER : C'est 13 % des navires puisqu'il y a des navires qui font escale tous les deux jours en France...
M. Paul DHAILLE : Vous avez plaidé - et je vous suis assez - en faveur de contrôles européens. Peut-on envisager, à travers cela, s'il n'y a que 13 % des navires contrôlés - on pourrait espérer qu'en France il y en ait davantage - qu'on puisse, au niveau européen, mettre sur pied un contrôle qui, dès le moment où il serait effectué une fois dans un port européen, serait valable pour l'ensemble des pays d'Europe où le bateau pourrait faire escale durant l'année ? Autrement dit, souhaitez-vous qu'il y ait une espèce de contrôle européen qui soit défini et qui, effectué en Grèce, en France, dans les pays scandinaves ou en Allemagne, vaudrait pour l'ensemble de l'Europe ce qui permettrait que les navires soient beaucoup mieux contrôlés ?
Par ailleurs, j'en viens à une question qui me soucie beaucoup et à laquelle j'aimerais recevoir une réponse précise. Pour la première fois, on a parlé de l'assureur : comment se définit la prime d'assurance d'un navire et pourriez-vous me dire de manière très précise si, au cas où l'Erika aurait été un bateau neuf, sa prime d'assurance aurait été supérieure à celle qu'il a payée ? Je tiens à vous poser la question et je pense que je la poserai à d'autres reprises.
Enfin, nous sommes tous d'accord pour qu'il y ait des contrôles mais si le contrôle n'est pas satisfaisant on retient le navire. Or, on constate - et sur Le Havre on en a eu des preuves - que quand on retient un navire cela pose un certain nombre de problèmes financiers, cela pose un certain nombre de problèmes sociaux, cela pose un certain nombre de problèmes techniques. Votre organisation a-t-elle réfléchi à cette multitude de problèmes qu'il n'est pas toujours facile de résoudre dans un port donné et dans un port de l'Union européenne en particulier ?
M. Marc CHEVALLIER : Sur la question des contrôles, j'ai parlé d'harmonisation parce qu'effectivement, si nous arrivions à avoir des contrôleurs formés de la même façon et polyvalents, nous parviendrions à contrôler beaucoup plus de navires. On pourrait imaginer que, sur la base d'une formation identique, et sur des données de contrôle identiques, un bateau contrôlé à Rotterdam ne le serait pas huit jours après au Havre, parce que le contrôleur qui se présenterait au Havre verrait que le bateau aurait été contrôlé ou simplement parce que cela figurerait dans la banque de données...Ce serait un moyen de contrôler beaucoup plus de navires alors qu'aujourd'hui, c'est chaque Etat qui devrait contrôler 30 % des navires faisant escale dans son pays, au titre du contrôle de l'Etat du port.
Je reviendrai peut-être sur la responsabilité de l'Etat du pavillon que nous n'avons pas encore abordée.
En ce qui concerne les assurances, il faut savoir qu'elles sont de trois types : l'assurance corps du navire, qui assure la coque et les machines du navire ; l'assurance responsabilité civile transporteur, qui est en général entre les mains des
P and I clubs ; et l'assurance facultés, qui est l'assurance de la marchandise dont s'occupe ou ne s'occupe pas l'armateur selon les cas...
Pour répondre précisément à votre question, je dirai qu'il est évident que l'assureur corps assure un bien en fonction d'une valeur déterminée et déclarée : plus le bien assuré est élevé et plus l'assurance est chère, bien évidemment. Je peux donc répondre d'une façon précise que si l'Erika avait été neuf, il aurait valu 400 millions de francs, qu'il aurait été assuré pour 400 millions de francs. Dans ce cas précis, il était assuré pour 80 millions de francs, donc sa prime d'assurance concernant le corps du navire était moins importante parce qu'elle ne couvrait que 80 millions de francs et non pas 400 millions de francs. Cela vaut pour le corps.
Pour la responsabilité civile transporteur qui est tout autre chose, le
P and I qui calcule au tonnage son assurance, a certainement demandé beaucoup plus cher à l'armateur de l'Erika parce que son navire avait vingt-cinq ans et qu'il était dans un état moyen - sans préjuger de ce qui allait se passer - que si le bateau avait été neuf, auquel cas il aurait certainement eu une prime de responsabilité civile transporteur moins importante. Encore une fois, l'assureur prend son risque, détermine ce qu'il assure et évalue ses risques, en général d'ailleurs dans le cadre d'une flotte puisque l'Erika a des frères et s_urs...
A votre question je ne suis nullement gêné pour répondre : c'est une question de valeur assurée pour le corps et c'est une question d'âge du navire pour la responsabilité civile transporteur.
Après, vient la question de l'assurance de la marchandise. La marchandise qui appartenait à Total était-elle assurée, et si oui, par qui ? Et si elle était assurée, est-ce que l'assureur de la marchandise - en réalité Total s'auto-assure - aurait exigé une prime supérieure sur un bateau de vingt-cinq ans que sur un bateau de trois ou quatre ans ? Je suis sûr que oui, notamment en fonction des eaux dans lesquelles navigue le bateau et des dangers que présente la navigation.
M. Paul DHAILLE : Vous ne pouvez pas nous donner un ordre de grandeur de cette différence ?
M. Marc CHEVALLIER : Non, elle se mesure au cas par cas. Cela demanderait à être chiffré et supposerait tout un exercice. Je suis incapable de vous répondre.
M. Paul DHAILLE : Et sur tous les problèmes qui découlent du fait de retenir un navire dans un port, quel est votre sentiment ?
M. Marc CHEVALLIER : Les cas de bateaux retenus dans les ports sont quand même relativement rares. On a dit tout à l'heure qu'on considérait que peut-être 20 % de la flotte mondiale était sous-normes ou n'était pas en état de naviguer. Donc des bateaux retenus, il n'y en a pas énormément. Il y a des bateaux qui sont retenus ou arrêtés pour des problèmes d'équipage ce qui est encore autre chose : soit les équipages ne sont pas payés, soit ils ne sont pas normalement payés par les armateurs ce qui entraîne l'intervention des syndicats ou le refus de partir des marins...
Jusqu'à présent, le problème de la gestion de ces bateaux dans les ports ne s'est pas posé parce qu'ils ont été peu nombreux mais il pourrait effectivement se poser : j'avoue que nous n'avons pas réfléchi à ce problème parce qu'il y a beaucoup de quais en France et beaucoup de places pour les bateaux.
M. le Président : Pour poursuivre la question de M. Dhaille, si je comprends bien, M. le président, le propriétaire de l'Erika va toucher ou a déjà touché 80 millions de francs ?
M. Marc CHEVALLIER : C'est le chiffre que j'ai en tête mais sous toute réserve : je crois, pour l'avoir lu comme tout un chacun, que l'Erika était assuré pour 80 millions de francs.
M. le Président : Peu importe le chiffre...
M. Marc CHEVALLIER : Normalement, oui, pour la perte totale et à partir du moment où il n'y a pas eu faute de l'armateur...
M. le Président : Sauf que, quand même ce bateau s'est cassé en deux...
M. Marc CHEVALLIER : Le bateau a fait naufrage, c'est une perte totale. Il est assuré en perte totale et s'il n'y a pas une faute de l'armateur, l'assureur paye.
La responsabilité de l'armateur est exonérée de toute façon. S'il y avait eu une faute particulière, autrement dit, si l'armateur avait fait naviguer son bateau hors classe, sans certificat de classe, l'assurance n'aurait pas marché mais l'Erika est parti de Dunkerque avec tous ses papiers en ordre donc l'armateur a été payé ou le sera pour la valeur assurée.
M. Alain GOURIOU : Existe-t-il des bateaux qui naviguent sans assurance ?
M. Marc CHEVALLIER : Oui. Il y a des compagnies de navigation qui s'auto-assurent.
M. Edouard BERLET : Il n'y a pas d'obligation d'assurance.
M. Alain GOURIOU : Il n'y pas d'obligation d'assurance ?
M. Marc CHEVALLIER : Aucune ! En revanche, il n'y a pas d'armateur qui ne soit pas assuré en responsabilité civile transporteur ou du moins je n'en connais pas. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup d'armateurs qui fassent l'économie d'une responsabilité civile transporteur surtout s'ils transportent des produits dangereux...
M. Edouard BERLET : Je voudrais apporter simplement un complément de réponse à la première question qui a été posée concernant les taux de contrôle. Effectivement, le Mémorandum de Paris prévoit qu'il y a une obligation pour l'ensemble des pays de vérifier 25 % des escales dans les ports. Or, il se trouve, quand on regarde la façon dont cette norme est respectée, qu'aucun pays membre du Mémorandum de Paris ne respecte ce pourcentage : la France est à 13 %, d'autre pays sont à 18 % mais personne ne respecte ce taux.
Je me demande s'il ne conviendrait pas de revenir sur cette obligation qui est peut-être trop élevée et irréaliste et de faire en sorte de développer une politique qui soit une politique de ciblage des contrôles portant véritablement sur les navires réputés - passez-moi l'expression - sous-normes.
Pour ce faire, la banque de données EQUASIS devrait être d'un certain secours puisque, grâce à elle, on devrait être en mesure de repérer à l'avance les navires qui risquent de poser des difficultés, pour les contrôler en priorité. Je me demande s'il ne faudrait pas s'engager beaucoup plus largement sur la politique de contrôle en la ciblant davantage, en la reliant à la mise en place de la banque de données EQUASIS et en renonçant plus ou moins à ce taux de 25 % qui est sans doute excessif et qui ne correspond manifestement pas aux moyens que les différents Etats peuvent mettre en ligne pour exercer ces contrôles.
L'ambition de 1982 était peut-être un peu excessive et irréaliste et, sans doute, insuffisamment ciblée.
M. Edouard LANDRAIN : Je me projette un peu dans l'avenir : en 2008, il y aura obligation de tankers pétroliers à double coque et double fond. On nous dit que l'ensemble des chantiers mondiaux ont la capacité de construire environ cent navires par an et qu'il y en aurait 3 500 à changer. Mes questions seront simples : pensez-vous être en mesure de les changer relativement rapidement ? Quelles seront les incidences financières sur les armateurs, car tout cela aura un coût ? Sur combien de temps pensez-vous pouvoir lisser la dépense de manière à ne pas handicaper le système lui-même ? Ne pensez-vous pas que, s'il y a obligation de construire, il faudrait peut-être songer à réactiver un certain nombre de chantiers navals en Europe et en France en particulier ?
M. Marc CHEVALLIER : On touche au grand débat sur la compétitivité parce que, pour construire des bateaux, il faut avoir un pavillon compétitif et que pour avoir un pavillon compétitif, il faut se mettre aux normes au moins européennes ou internationales.
C'est un premier point.
Pour ce qui est de la capacité de construire, effectivement, si on envisage de reconstruire et de remplacer tout ce qui est assez ancien rapidement, on n'aura pas la capacité de le faire mais je pense que l'on peut procéder par paliers.
Il y a un vrai problème qui est un problème économique pour l'armateur : c'est peut-être un peu moins vrai aujourd'hui mais, hier, un pétrolier français avait besoin, pour s'amortir normalement sur douze ans, de 40 000 dollars par jour, alors que le marché était à 20 000 dollars. Par conséquent, si l'armateur français, propriétaire d'un seul navire voulait travailler dans ces conditions, il perdait 20 000 dollars par jour ce qui représentait - je le précise - 0,5 centime du litre à la pompe à essence. C'est-à-dire que cela correspondait au fait de passer le litre d'essence de 6,98 F à 6,985 F ce qui est une différence absolument ridicule par rapport au prix à la consommation...
Quoi qu'il en soit, la concurrence nous contraint à être au niveau du marché international. Or, ce niveau du marché international, nous devons pouvoir le redresser en exerçant plus de contrôles, ainsi que je l'ait dit tout à l'heure, et en essayant d'éliminer les bateaux-poubelles ou sous-normes mais ne nous faisons pas d'illusions : on ne va pas construire du jour au lendemain 1 500 ou 1000 pétroliers dans une année.
Ce n'est possible ni techniquement parce qu'il n'y a pas les chantiers, ni économiquement.
M. Edouard LANDRAIN : Vous estimez cela possible sur combien d'années ?
M. Marc CHEVALLIER : On a parlé de 2008 pour les doubles coques, les Etats-Unis se fixent 2010, l'Europe parlera peut-être de 2015 - je n'en sais rien mais on le lit. Lorsque l'on prévoit des changements de structures aussi importants, en général, ils s'opèrent sur une dizaine d'années.
M. Maxime BONO : Ma question est un peu liée à celle qui vient d'être posée. Vous avez décrit un processus, un code de bonne conduite, des contrôles des sociétés de classification, un contrôle de l'Etat du port en insistant sur la nécessité d'avoir un suivi précis de la qualité des structures.
Ma question est toute simple : vous parliez de l'électrolyse et de la nécessité d'aller dans les doubles fonds : est-ce qu'en fabriquant des doubles coques, si nous ne changeons pas nos procédures de vérification, nous ne sommes pas en train de fabriquer ce qui sera dans quinze ans des bombes à retardement ?
M. Marc CHEVALLIER : Pourquoi des bombes à retardement ?
M. Maxime BONO : Est-ce que les doubles coques ne sont pas plus difficiles à vérifier qu'un simple coque ? Si nous ne nous assurons pas d'un meilleur contrôle des structures, ne risquons-nous pas que ces bateaux qui, aujourd'hui, nous apparaissent plus sûrs, lorsqu'ils auront vieilli, ne deviennent au contraire plus difficiles à contrôler ? Est-ce que cela ne justifie pas une prise en compte très précise et une modification plus que jamais impérieuse de nos procédures ?
M. Marc CHEVALLIER : Vous avez parfaitement raison. Plus il y a de coques et plus il y a de tôles et donc plus les structures sont difficiles et longues à contrôler. Néanmoins, ainsi que je vous l'ai dit tout à l'heure, les possibilités de contrôles et les progrès techniques et électroniques font qu'on contrôle beaucoup plus facilement. Il n'en reste pas moins vrai que, dans un grand pétrolier à double coque, il y a des milliers et des milliers de mètres carrés à vérifier.
Il faut dire que nous avons fait des progrès considérables depuis vingt ans au niveau du revêtement des doubles fonds des navires et que les peintures actuelles font qu'ils souffrent beaucoup moins sur les bateaux récents que sur les bateaux anciens : de ce point de vue, on a une sécurité beaucoup plus importante par rapport aux phénomènes d'électrolyse et de détérioration des tôles que j'évoquais tout à l'heure.
M. René LEROUX : Je voulais juste vous poser une question qui est d'actualité puisque, il y a à peu près une quinzaine de jours, trente-neuf dégazages ont été dénombrés dans le rail d'Ouessant : vous, en votre qualité de président du Comité des armateurs, avez-vous connaissance de dégazages effectués par certains de vos capitaines et, si oui, quelles sanctions avez-vous prises à leur encontre ?
M. le Président : Vous avez juré de dire la vérité...
( Sourires.)
M. Marc CHEVALLIER : Je peux vous répondre sans aucune hésitation qu'aucun de mes capitaines n'a dégazé parce qu'ils savent ce qu'ils risquent. Vous savez qu'en droit français, en tout cas, un capitaine qui dégaze peut perdre son brevet, ce qui signifie qu'un commandant français surpris en train de dégazer perdrait son brevet, perdrait son travail et n'aurait plus le droit de naviguer. C'est un facteur important.
Ensuite, les gens sont, dans toutes les compagnies françaises, strictement formés et sensibilisés à ces problèmes parce que nous sommes ISO 9002, que le code ISM est en place, que les conduites du navire sont extrêmement suivies, contrôlées et je ne veux pas croire que des bateaux français dégazent aujourd'hui près des côtes. Je ne le crois pas !
M. le Président : Croyez-vous que ceux qui dégazent font partie des 20 % auxquels vous faisiez allusion tout à l'heure ?
M. Marc CHEVALLIER : Je me pose la question mais je ne suis pas certain que les navires sous-normes dégazent plus que les autres. Je crois que certains bateaux dégazent quand ils sortent des eaux territoriales et entrent dans les eaux internationales. Sans que ce soit à décharge des commandants de navire, il faut reconnaître que le système de dégazage des pétroliers est aujourd'hui extrêmement mal fait, dans les ports européens en particulier, et extrêmement onéreux. Mais de là à vous dire qui dégaze...
M. René LEROUX : Ce sont les autres ? ...
M. Marc CHEVALLIER : Réellement, je crois qu'ici, en France, les navigants français sont extrêmement sensibles à ces problèmes de pollution.
M. le Rapporteur : Ma question sort un peu du contenu de notre conversation mais elle peut avoir son importance pour l'avenir : comment marche le système des GIE fiscaux aujourd'hui ?
Sans parler de la comparaison quirats/GIE fiscal qui nous entraînerait sur un autre débat, imaginons que les dispositions que vous avez signées soient reprises par la Commission européenne, ce qui veut dire qu'il y aurait une accélération de la transformation d'un certain nombre de bateaux : il faudrait faire appel à un certain nombre de dispositions fiscales... Est-ce que ce système marche bien, beaucoup de dossiers sont-ils en attente, leur temps de traitement est-il convenable, est-ce un bureau de Bercy qui décide ou faut-il remonter au cabinet et suivre un chemin de croix pour obtenir les autorisations, ou est-ce que tout cela se passe dans la plus complète fluidité et dans une totale allégresse ?
Par ailleurs, serait-il possible que nous ayons des exemples des trois types d'assurances - parce que c'est une question extrêmement importante - en fonction de l'âge, de la cargaison pour nous permettre de bien comprendre les choses ?
Vous venez de dire que, dans les ports européens, le déballastage était mal fait et onéreux, pourriez-vous être plus précis sur ce qu'il serait possible de faire dans ce domaine ?
Enfin, je pense que nous pourrions aborder la question du pavillon dont vous comptiez parler.
M. Marc CHEVALLIER : Sur le plan du GIE fiscal, nous avons eu seize dossiers agréés en 1999. Nous pouvons donc considérer que le système marche correctement, sans que l'engouement soit comparable à celui suscité par les quirats, bien sûr, mais cela reste une formule intéressante pour les entreprises qui manquent de fonds propres et pour des investissements lourds. Il faut quand même savoir que nous sommes passés de 33 % sur les quirats avec l'obligation du pavillon pendant cinq ans, à 22% en GIE fiscal et l'obligation de pavillon pendant huit ans, ce qui veut dire que le surcoût du pavillon français pendant huit ans supprime complètement l'intérêt du GIE fiscal. Il demeure néanmoins un avantage considérable au niveau de l'effort financier au départ car il permet « de faire » sans en avoir ni les moyens financiers ni les fonds propres.
Nous avons une dizaine de dossiers en suspens aujourd'hui. Nous considérons que les choses se déroulent normalement. Le parcours est le suivant : un dossier est remis à la place Fontenoy, donc à la direction de la flotte qui l'examine et donne son feu vert et c'est Bercy qui décide, en accord parfois avec le ministère de l'Industrie sur certains gros dossiers, s'il donne ou non l'agrément.
La seule chose qui nous gêne beaucoup, c'est le système d'agrément au cas par cas. En effet, on ne peut pas bâtir de stratégie à long terme dans une compagnie, même si l'on considère avoir un bon dossier - ce que l'on sait très vite - et si les délais qui sont de deux à trois mois donc généralement respectés - il n'y a rien à dire de ce côté-là - quand on ignore si en 2001, 2002 ou par la suite on aura le même type d'agrément. Cette politique d'agrément est donc un inconvénient dans le cadre d'une politique d'entreprise.
Je vous fournirai bien volontiers des exemples de taux d'assurances en fonction de la valeur assurée et du type de navires étant entendu, si j'ai bien compris, que ceux qui vous intéressent sont ceux qui transportent des produits dangereux : il est évident que l'assurance d'un pétrolier est beaucoup plus onéreuse que celle d'un vraquier.
Concernant le dégazage, vous n'ignorez pas qu'il y a une obligation de dégazer les bateaux, de nettoyer les cuves qui ont contenu du pétrole non pas en mer mais dans des stations de traitement. Or, nous manquons de stations de traitement en Europe - on en a très peu en France : il y en a une au Havre et une à Lavéra - et nous rencontrons les pires difficultés pour trouver des ports qui en soient équipés. Les bateaux finissent donc par être chargés de produits de ballastage, d'eaux de déballastage, de produits de nettoyage dont ils ne peuvent pas se débarrasser, et quand ils peuvent s'en débarrasser, c'est hors de prix. D'où les dégazages sauvages et les rejets à la mer que l'armateur paye effectivement...
M. le Rapporteur : C'est hors de prix pour tout le monde mais les armateurs français le font...
M. Marc CHEVALLIER : Bien sûr que c'est hors de prix pour tout le monde! Le système est très mal fait et les capacités de réception de ces eaux de lavage sont totalement insuffisantes, aujourd'hui, en Europe. En France comme nous n'avons que les stations du Havre et de Lavéra, nous sommes obligés de transporter en permanence, sur des chimiquiers ou des pétroliers, des eaux de lavage dont nous ne savons que faire et qui alourdissent le bateau. C'est parce que les moyens font défaut que tant de bateaux trichent, ceci expliquant cela.
Maintenant, faut-il ou non, responsabiliser l'Etat du pavillon compte tenu du fait que certains pays autorisent l'armement de bateaux dans n'importe quelles conditions ?
Nous considérons, nous armateurs français, surtout compte tenu de notre législation française qui est extrêmement sévère en matière maritime, que c'est encore une concurrence déloyale que de voir des pays voisins accepter de coller un pavillon sur un navire en sortant une société écran située à Malte ou ailleurs, ce qui coûte 500 livres sterling ou 200 dollars...
Ne faudrait-il pas pousser un petit peu pour que les Etats du pavillon prennent aussi leurs responsabilités dans le cadre de l'armement de ces navires et de l'immatriculation de ces bateaux ?
M. le Président : Est-ce que cette question n'amène pas en même temps une réflexion sur l'organisation de l'OMI, parce que l'OMI fait la part belle à ces Etats et à un certain nombre de structures qui tournent autour ? Cela veut dire qu'à un certain moment, si nous poussons votre réflexion jusqu'au bout, c'est l'organisation même de l'OMI, son rôle, sa représentativité, qui sont mises sinon en cause, du moins en question.
Nous avons tous entendu le ministre - et pour ma part, je partage cette option - dire qu'il fallait envisager de rééquilibrer les pouvoirs de l'OMI en mettant face à ces Etats du pavillon les Etats de la côte qui n'en peuvent mais quand, brusquement, douze mille tonnes de pétrole arrivent sur leurs rochers ou sur leurs plages de sable fin...
M. Marc CHEVALLIER : Juridiquement, cela s'annonce compliqué.
M. le Président : Je ne dis pas le contraire mais il y a des tas de choses qui ne sont pas faciles à faire juridiquement et qu'il faudra pourtant bien faire un jour...
M. Edouard BERLET : On peut toujours imaginer un débat de ce type mais je crois qu'il sera quand même extrêmement difficile : il est vrai qu'il y a actuellement des déséquilibres dans la pondération des voix et dans la façon dont les Etats votent par rapport à leur situation dans l'OMI. Toutefois, concernant l'OMI, il y a, à mon avis, trois sujets : celui que vous venez d'évoquer ; la question de l'opportunité de la mise en place progressive de mécanismes de contrôles propres à l'OMI tels que ceux que l'on a, par exemple à l'OACI (Organisation de l'aviation civile internationale) en matière de contrôle de la circulation aérienne et enfin celle qui a été évoquée, de la responsabilité des Etats membres de l'OMI dans le respect des conventions qu'ils signent.
A mon sens, en termes d'efficacité, il est préférable de s'attaquer en priorité au troisième sujet et d'essayer de faire en sorte que les Etats qui signent et ratifient les conventions les appliquent correctement, quitte, peut-être à devoir imaginer des mécanismes de sanction, tels que contrôler prioritairement les navires des Etats qui n'auraient pas ratifié les conventions de l'OMI, le retrait de l'OMI - il faut peut-être faire preuve d'imagination - et à faire porter l'effort plus sur les Etats membres de l'OMI que sur l'organisation elle-même.
Dans un deuxième temps, je pense qu'il faut sans doute engager une réflexion sur la mise en place de contrôles propres à l'OMI mais cela supposerait qu'ils s'articulent correctement avec les moyens de contrôle existants dans les différents Etats, ce qui est une affaire difficile, sans même parler des moyens qu'elle implique : une telle démarche supposerait d'engager des moyens financiers absolument énormes. Est-ce un débat véritablement utile ?
Pour ce qui est du débat auquel vous avez fait allusion, il est extrêmement politique, de caractère diplomatique et va d'ailleurs au-delà du strict débat maritime puisqu'il touche peut-être au système de l'ONU en général.
Donc, à mon sens, il y a trois questions qui sont posées à l'OMI.
M. Marc CHEVALLIER : Dans ces Etats du pavillon de « deuxième zone », si j'ose m'exprimer ainsi, tout est confié à une classification et à un seul organisme : Malte a confié au RINA la totalité de la gestion de ses dossiers. Or, nous disons qu'il n'est pas normal, pour nous Français, qui avons une administration qui délivre un permis de navigation, une administration maritime, une société de classification et un autre organisme qui peut élaborer le code ISM, que d'un côté nous passions par trois étapes différentes et que, dans un autre Etat - pas très éloigné de la côte européenne : ce n'est pas le Liberia - on puisse tout mettre dans les mains d'une seule société. Il faudrait donc peut-être, dans le cadre du chapitre des sociétés de classification, ne pas permettre que les sociétés de classification prennent en charge le permis de navigation, la classe du navire et le code ISM.
M. Louis GUEDON : Je vais vous demander une simple précision : vous venez de faire un exposé sur l'importance de l'OMI mais premièrement, combien de pays appartiennent à l'OMI, deuxièmement, dans votre souci de voir, au sein de l'OMI, les règlements se structurer plus sérieusement, quelle chance avons-nous d'espérer que vos propositions ne soient pas des v_ux pieux mais puissent véritablement être appliquées ?
M. Edouard BERLET : Le nombre de pays appartenant est de l'ordre de cent cinquante. Pour ce qui est de la possibilité de faire adopter des règles nouvelles au sein de l'Organisation maritime internationale nous avons dit - et c'est un simple rappel - que nous ne considérions pas que c'était une priorité mais qu'il valait mieux appliquer et contrôler plus sérieusement les règlements existants.
Dans l'hypothèse où, par exemple, on voudrait raccourcir la date d'entrée en vigueur des doubles coques, nous pensons que la mesure doit être prise au niveau de l'OMI et non pas au niveau européen.
D'une façon générale, pour faire adopter une convention à l'OMI, il faut au moins cinq ans et autant de temps, ensuite, pour la faire ratifier ce qui fait entrer dans un processus de l'ordre d'une dizaine d'années entre le moment où est prise l'initiative et celui où la convention est ratifiée par suffisamment d'Etats pour entrer en application : cela vous donne une idée de la longueur du processus.
M. le Rapporteur : Cela veut-il dire que l'engagement pris sur les doubles coques en 2008 est illusoire, puisque vous nous dites que vous ne voulez pas que ce soit l'Union européenne qui lance la mesure mais l'OMI et qu'il faut à cette dernière dix ans pour mener à bien la démarche ?
M. Edouard BERLET : Je ne suis pas sûr que l'on ait effectivement tout à fait intégré, dans la proposition française, cette contrainte.
M. Pierre HERIAUD : C'est clair !
M. Edouard BERLET : J'exagère un tout petit peu car cela vaut pour des textes très classiques comme, par exemple, la saisie conservatoire du navire ou des choses qui n'ont pas de dimension politique, mais sur un sujet tel que celui de la double coque qui a une dimension politique beaucoup plus forte et qui s'inscrit dans un scénario dans lequel l'Union européenne proposerait...
M. le Président : Si tous les pays de l'Union européenne, sous la présidence française dans quelques semaines - puisque vous avez souligné vous-même qu'aucune compagnie de navigation ne pourrait se passer de Rotterdam, de Hambourg, de Felixstowe, d'Anvers, du Havre -...
M. Marc CHEVALLIER :... ce que je confirme.
M. le Président : ...s'accordaient à dire qu'ils ne voulaient plus, chez eux, à partir de 2008, que des navires à double coque en raison des dangers, de la pression démocratique et que sais-je encore...
M. Edouard BERLET : C'est un scénario qui ne risque pas de se produire parce que les premières réactions que nous avons, des administrations en tout cas, par rapport aux propositions françaises pour que Bruxelles prenne la décision d'interdire les simples coques à compter de 2008, prouvent qu'elles rencontrent en fait une opposition assez générale...
M. le Président : De qui ?
M. Edouard BERLET : D'après ce que j'ai compris, de l'ensemble des administrations nationales représentées : je n'ai pas parlé des ministres qui auront peut-être une vision politique différente, mais en tout cas la proposition rencontre une opposition assez générale des administrations, leur argument étant de dire - et nous y souscrivons - qu'il faut que ce type de questions soit traité au niveau de l'Organisation maritime internationale, de façon à éviter une segmentation...
M. le Président : Excusez-moi mais, lorsque les Etats-Unis ont dit qu'ils voulaient tel type de navires dans leurs eaux territoriales, on n'a pas dit qu'il y avait un dysfonctionnement international... Si, au niveau européen, nous allions plus loin que les Etats-Unis comme eux-mêmes sont allés plus loin que l'Europe il y a quelques années, pourquoi y aurait-il dysfonctionnement ?
M. Edouard BERLET : Parce qu'un armateur qui arme un navire au pétrole, un VLCC, a besoin d'aller avec son navire dans l'ensemble des pays du monde dans des conditions réglementaires homogènes, sans quoi certains marchés lui seront interdits pour cause de réglementation, ce qui reviendrait à dire qu'il lui faudrait armer des navires différents selon les marchés. En conséquence, l'armateur a intérêt a avoir une réglementation internationale homogène...
M. le Président : Ce n'est pas le cas aujourd'hui...
M. Edouard BERLET : Effectivement, et c'est malheureux. Je crois que les armateurs ne se sont jamais félicités du système de l'OPA.
Cela étant, mon pronostic dans cette affaire, c'est que, très vraisemblablement, au niveau de l'Union européenne interviendra une décision du Conseil transports qui demandera à l'OMI, dans le meilleur des cas, de se saisir de cette affaire : je crois que dans un tel scénario, qui me paraît le plus réaliste, le délai que j'évoquais - à savoir cinq ans pour signer et cinq ans pour ratifier - sera considérablement raccourci. Parce que le sujet est beaucoup plus important, le processus ira plus vite même si, malgré tout, la négociation d'une convention internationale demande du temps...
M. Marc CHEVALLIER : Encore faut-il savoir qu'un grand débat s'est instauré sur la double coque, sur le plan technique...
Mme Jacqueline LAZARD : Justement, quel est votre point de vue personnel sur la question ? La double coque est-elle, ou non, la panacée aux yeux des armateurs français ?
M. Marc CHEVALLIER : Si j'en crois les spécialistes français, non : en effet, si la double coque est intéressante en cas d'impact, d'échouement ou d'abordage dans la mesure où ils interviennent à vitesse lente, c'est-à-dire sans dépasser trois ou quatre n_uds, au-delà de cette vitesse, on a toutes les chances de crever la coque centrale et de se trouver confronté à un risque important d'explosion puisque l'on crée, dans le ballast, un mélange de pétrole et d'eau générateur de gaz susceptibles de produire des explosions.
Les Français avaient inventé, à Saint-Nazaire, le système
Eurêka qu'il faudrait peut-être réactualiser parce qu'il offre un compromis très intéressant sur le plan technique - c'est un peu compliqué d'en parler maintenant - dans la mesure où il s'agit aussi d'un double coque mais avec un double fond très important qui évite que le pétrole ne sorte en cas d'échouement. Malheureusement, il est plus cher que la double coque classique. Ce sujet mérite un grand débat, qu'il faudra ouvrir un jour ou l'autre parce qu'il faut avoir l'avis des spécialistes.
Audition de M. Guy GUERMEUR,
ancien député, président de la Commission d'enquête
de l'Assemblée nationale sur l'Amoco-Cadiz (1978)
(extrait du procès-verbal de la séance du 8 mars 2000)
Présidence de M. Daniel PAUL, Président
M. Guy Guermeur est introduit.
M. le Président lui rappelle que les dispositions législatives relatives aux commissions d'enquête lui ont été communiquées. A l'invitation du Président, M. Guy Guermeur prête serment.
M. Guy GUERMEUR : M. le président, madame, messieurs les députés, je suis très honoré de collaborer à vos travaux, et c'est bien volontiers que je vous ferai part des quelques remarques, inspirées par les derniers événements. Au-delà de ces événements, j'ai mené depuis une vingtaine d'années, une réflexion à la lumière des mesures qui ont été prises par les différents gouvernements, mais également à la lumière des risques nouveaux, apparus tout au long de ces deux dernières décennies. Il me semble utile de vous la faire partager.
Tout d'abord, je tiens à préciser que les idées que l'on entend exprimer, ici et là, selon lesquelles rien n'aurait été fait depuis 20 ans sont fausses. Beaucoup a été réalisé ; de nombreuses mesures ont été prises ; beaucoup d'énergie a été déployée et beaucoup de courage a été montré, notamment par les équipages qui sont en veille permanente à Cherbourg et à Ouessant. On ne peut pas dire que l'Etat soit resté inerte face aux nouveaux périls apparus avec les nouvelles techniques, l'accroissement du Produit Intérieur Brut dans tous les pays, l'évolution des échanges et l'intensification du trafic maritime.
Cependant, toute autosatisfaction, dans les pays les plus développés serait indécente. Durant les 5 à 10 ans qui ont suivi la publication des rapports des commissions d'enquête du Sénat et de l'Assemblée nationale, sur le naufrage de l'Amoco-Cadiz, de nombreuses dispositions juridiques ont été adoptées, telle la mise en place des « rails ». Des moyens plus lourds, exigeant des sacrifices financiers importants, ont également été mis en _uvre.
Cet effort d'investissement, ainsi que le silence sur ce qui se passait en mer après l'affaire du
Tanio, ont donné le sentiment à l'opinion publique et aux responsables politiques que les risques en haute mer étaient maîtrisés et qu'il suffisait, dorénavant, de gérer les moyens mis en place.
En réalité, les choses sont sensiblement différentes. Du fait de l'accroissement du trafic, et du fait de l'augmentation de la puissance des navires, une notion nouvelle doit être prise en compte : celle des « risques majeurs en évolution ». Il convient en effet de prendre conscience qu'au large de nos côtes, le trafic pétrolier représente plus du quart du trafic mondial. Par ailleurs 600 navires empruntent quotidiennement le passage est-ouest du rail d'Ouessant et croisent, pour l'essentiel, des bateaux à passagers très rapides et chargés, parfois, de plus de 2 000 personnes qui traversent la Manche dans un courant nord-sud.
Nous pouvons donc comparer ce trafic à des croisements d'autoroutes dont les passages à niveaux n'ont pas de barrières, avec des véhicules qui circulent de plus en plus vite et sans freins. Certes les radars existent ; la veille s'est renforcée ; les bateaux doivent se signaler. Mais il est évident qu'à tout instant une erreur humaine - origine de 80 % des événements de mer - peut être commise. Par conséquent, le simple fait de l'accroissement d'une part de la circulation maritime et d'autre part des vitesses crée un risque nouveau par son ampleur et par sa nature.
Depuis le naufrage de l'Erika, de nombreuses observations ont été faites, de nombreux jugements portés. On a parlé de pétrole, de produits polluants, de solidité des navires, de leur vieillissement et de leur capacité à résister au temps et aux collisions. En revanche, l'opinion ne semble pas s'être préoccupée de la sécurité du transport de passagers. Pourquoi ? Parce qu'évoquer le risque, pour la vie humaine, que prennent ces paquebots transportant 2 000 ou 2 500 personnes et croisant le trafic marchandise est-ouest, pourrait créer une psychose menaçante pour l'économie transmanche et conduire à des désaffections de trafics. Ce problème économique occulte donc le problème de sécurité.
Or il est clair que, parmi ces nouveaux risques, celui de la vie humaine est l'un des plus inquiétants. Je ne crois pas que l'on puisse, aujourd'hui, apporter la preuve qu'en cas de collision - telle que celle qui s'est produite il y a quelques mois à l'embouchure de la Tamise - les Etats riverains seraient en mesure d'organiser le sauvetage de plusieurs centaines de personnes avec les moyens actuels, tels que ceux de la France (SNSM, sécurité civile, Marine nationale). Il semble donc impensable que les responsables politiques, techniques et administratifs puissent faire l'impasse sur ce risque.
Les moyens invoqués qui seraient mis en _uvre dans une telle situation - par exemple, un autre navire à passagers appelé dans la zone pour secourir les naufragés - ne paraissent pas sérieux. Comment pourrait-on secourir des naufragés depuis une véritable muraille flottante ? Je ne doute pas de l'élan de solidarité qui se mettrait alors en place dans la population littorale, mais qui peut dire dans quelles conditions d'efficacité ce sauvetage aurait lieu de nuit, et par mauvais temps ? Il s'agit d'un élément de réflexion incontournable pour les décideurs.
J'ai peut-être trop insisté sur ce point, M. le président, mais il s'agit d'un problème de prévention relativement absent des débats actuels. J'ai cru utile de le signaler à votre commission d'enquête.
Un autre risque majeur est celui de la dimension des navires. A l'heure actuelle, des navires porte-conteneurs sont mis en construction qui transporteraient 10 000 boîtes. La dimension de ces navires, leur hauteur et leur prise au vent constituent autant de paramètres qui conduisent à s'interroger sur la capacité des moyens de remorquage à s'opposer à leur dérive et éviter leur échouement.
Bien entendu, lorsqu'un bateau dont la puissance est de 160 tonnes au croc passe une aussière au navire en difficulté, on peut penser que, si celui-ci se trouve dans le lit du vent, 160 tonnes de puissance suffiront. Mais on peut supposer aussi que diverses avaries - telle une barre bloquée par exemple - pourraient maintenir le navire en travers du vent ; et dans ce cas, la puissance pourrait être insuffisante.
Les évolutions techniques, la densité du trafic, la dimension des navires accroissent le risque, alors que les capacités d'intervention plafonnent au niveau atteint après l'Amoco-Cadiz
- ce qui est le cas aujourd'hui avec notre flotte de remorqueurs.
Au regard de ces faits, la puissance publique ne peut pas s'épargner une réflexion en profondeur sur l'adéquation de la capacité d'intervention à la croissance des risques.
Différents chapitres se présentent alors à la réflexion. Le premier s'inscrit dans une dimension internationale, et d'abord européenne. Nous ne sommes plus seuls ; nous faisons partie d'un ensemble solidaire où les politiques communes se multiplient, et nous pouvons penser que le moment est venu de prendre à bras-le-corps ce problème de la dimension européenne dans la lutte contre le risque majeur en haute mer.
Dans ce contexte, certains estiment qu'une garde-côtes européenne serait la solution idéale. J'ai pu moi-même le penser et partager ce sentiment avec mes collègues de la commission d'enquête que je présidais en 1978. Aujourd'hui, j'en suis moins sûr, notamment au regard des progrès réalisés chez lui par chacun des pays membres de l'Union européenne.
Tant qu'il n'existait rien, on pouvait imaginer un système européen harmonieux, construit de toutes pièces et aboutissant à une sorte d'action commune, comme c'est le cas dans un Etat fédéral tel que les Etats-Unis. Mais les pays européens sont allés chacun de son côté, avec son propre génie, ses propres réflexions. Je vois mal comment, sans bouleversement profond, l'on pourrait regrouper tous ces éléments, différents par leur nature, leur conception, leur mission, pour constituer un système européen intégré.
Que dire alors de ce qui se passera quand les pays candidats à l'Union européenne seront admis comme Etats membres ? Il me paraît difficile d'imaginer un système fédéré qui soit efficace et gérable. Je ne pense donc pas qu'une garde côtes soit la solution pour la communauté d'Etats qu'est l'Union européenne. Il n'y a là aucune considération idéologique en politique mais seulement un souci des réalités techniques.
En conséquence, il convient d'inscrire nos efforts dans une dimension nationale, mais en tentant d'harmoniser et de coordonner les efforts, les plans et les financements des différents pays européens. En effet, la dimension européenne ne peut être écartée.
A cet égard, je suis favorable à une structure de concertation, légère et permanente, qui offrirait un lieu de réflexion commune aux différents responsables européens. Cette institution constituerait une garantie de veille permanente, apte à informer et à renseigner les autorités ainsi que les organes de prévention et d'assistance de chaque pays de l'Union. L'Union européenne a un rôle important à jouer, notamment en matière de droit d'intervention en mer. Elle pourrait également favoriser l'utilisation rationnelle des moyens mis en place et financés par chacun des pays qui la composent. Il est évident que si l'on ignore l'Union européenne et que chaque pays s'engage dans un effort financier substantiel, créant ses propres moyens sans se soucier de ceux qui sont mis en place ailleurs, on assistera à des doublons et à des dépenses financières inconsidérées. Un minimum de concertation doit conduire à une redistribution des moyens, à des gains de productivité et à des innovations bienvenues.
Prenons l'exemple des deux rives de la Manche. Les Britanniques possèdent un système d'intervention qui ne fonctionne que l'été alors que le nôtre fonctionne toute l'année. La simple coordination de la mise en _uvre des moyens d'intervention de part et d'autre du « channel » pose des problèmes d'organisation. Qui doit prendre l'initiative des opérations ? Comment mettre les moyens en place ? Dans quel délai est-il possible d'intervenir ? Il faut reconnaître qu'à l'heure actuelle cette coopération n'est pas au point. Que dire alors des coopérations qui pourraient exister avec les pays nordiques !
Un gros effort de coordination doit être accepté au sein de l'Union européenne. Une implication de plus en plus grande de l'Europe, financièrement et techniquement, dans cette lutte contre les risques est souhaitable, sans que les quinze s'enferment dans l'alternative d'une garde-côtes fédérale.
En ce qui concerne les moyens à mettre en place, il convient de distinguer un certain nombre de chapitres. Les moyens juridiques ont été sensiblement améliorés après le naufrage de l'Amoco-Cadiz - notamment au début des années quatre-vingt -, mais il faut reconnaître que, depuis lors, c'est le
statu quo. Il serait nécessaire d'amener les différentes administrations de l'Etat, des régions, des départements à une réflexion productive sur leur rôle dans la prévention du risque maritime.
J'ai écrit, dans la note que j'avais adressée à votre commission, que la Marine nationale me paraissait être le service de l'Etat le plus indiqué pour appréhender l'ensemble de ces risques et mettre en _uvre les moyens d'y parer. Si j'ai proposé que, d'une part, l'intervention soit assurée par le ministère de la Défense - Marine nationale et préfet maritime - et que, d'autre part, la préparation des moyens et la logistique soient à la charge du ministère des Transports, c'est en tenant compte des missions assumées depuis l'Amoco-Cadiz. Car il ne fait aucun doute que la Marine nationale a remarquablement fait son travail durant ces 20 dernières années.
J'ai ici quelques chiffres concernant les missions de l'Abeille Flandre - basée à Brest et prépositionnée à Ouessant lorsque le temps menace. Entre le 14 septembre 1979 et le 7 mars 2000, ce remorqueur a effectué : 282 appareillages ou
stand by de navires marchands en avarie, dont 14 pétroliers et 6 transporteurs chimiques ; 194 escortes de navires en avarie, dont 20 pétroliers et 8 transporteurs chimiques ; 198 sauvetages de navires, dont 12 pétroliers ; 77 opérations diverses et 21 exercices. Telles sont les missions de l'Abeille Flandre qui n'ont fait l'objet d'aucune information - mais nous savons tous que l'on ne parle jamais des trains qui arrivent à l'heure !
Au vu de ces chiffres, on peut affirmer que le système créé en 1978, et qui reposait essentiellement sur l'intervention de la Marine nationale, a bien fonctionné. Mais doit-il perdurer, sans aucune modification ? Je ne le crois pas.
Dans la note que je m'étais permis de vous adresser en mars dernier, je n'écartais pas le maintien, à la Marine, de ces deux missions d'intervention de crise et d'ordonnateur des dépenses d'entretien et d'amortissement des moyens navals et aériens. Je livrerai aujourd'hui, devant vous, quelques réflexions qui se sont imposées après la rédaction de ce texte. La confusion sous la même casquette de l'intervenant, de l'auteur du financement et du concepteur est peut-être une conception inadéquate.
Nul ne peut sérieusement contester que la Marine nationale ait vocation à exercer l'autorité de l'Etat en mer, dans le cas de crise.
A contrario, des interventions multiples sous des commandements divers pourraient conduire à des erreurs de stratégie, de sauvetage voire à des désastres. Par ailleurs, le fait qu'un marin parle à des marins est une condition primordiale d'efficacité.
En revanche, le rôle confié à la Marine nationale - sur proposition de la commission d'enquête de 1978 - de préparer « le temps de crise », de mobiliser durant ce que j'appellerai le « temps de paix », de programmer les investissements et de veiller à la mise à niveau permanente des moyens les plus indiqués pour faire face aux risques, cette mission devrait être remise en question.
La Marine nationale est en effet confrontée à une donnée qui a échappé au pouvoir politique depuis 20 ans, ou n'a pas été suffisamment prise en considération. Je parle de la confusion des moyens budgétaires entre leur emploi « militaire » et leur emploi « civil ». Il ne fait aucun doute que la Marine nationale, qui a en charge les 3 remorqueurs - basés à Cherbourg, Brest et Toulon -, constate depuis 22 ans leur vieillissement. Dans le même temps, tous les observateurs - à commencer par le ministre de l'Equipement, des Transports et du Logement -, affirment à juste titre qu'un navire marchand de plus de 15 ans est justiciable d'un redoublement de précautions et de contrôles et qu'il est potentiellement dangereux. Or personne ne semble trouver surprenant que des remorqueurs de 22 ans - qui, par définition, ne sortent que lorsque le temps est mauvais et particulièrement éprouvant pour les navires - continuent à garantir la sécurité des passagers, des bateaux et du littoral !
On peut légitimement se poser la question de savoir pourquoi la Marine nationale considère que ces navires sont parfaits, qu'ils peuvent encore naviguer très longtemps et que le moyen terme est, pour eux, de 10 ou 15 ans, alors qu'ils sont utilisés dans des circonstances qui accélèrent leur processus de vieillissement par rapport aux navires marchands. La réponse est simple : il appartient à la Marine nationale de payer sur son budget de fonctionnement le complément de fret qui financera le renouvellement de ces remorqueurs. Comment pourrait-on reprocher à l'Etat-Major et à la Marine de consacrer toute son attention à préserver sa mission essentielle, la défense militaire de la Nation et donc de sauvegarder sa capacité budgétaire pour cette mission ?
Il semble donc malsain que la part de budget de la Marine nationale consacrée à la défense et celle qui est affectée à l'intervention en mer et au sauvetage soient confondues. A partir de ce constat, deux solutions se présentent : ou la Marine nationale continue de tout gérer mais avec un budget identifié par le Parlement pour chaque type de missions - proposition que j'avais présentée dans ma note -, ou la logistique et la préparation des actions de lutte contre les risques sont prises en charge par une administration civile sur un budget spécifique.
Dans ce cas, la configuration serait la suivante : une administration civile - par exemple celle du ministère de l'Equipement, des Transports et du Logement qui supporte déjà budgétairement la charge des CROSS, des Affaires maritimes, de la gendarmerie maritime, de la Marine marchande et des phares et balises - serait chargée de la préparation budgétaire et technique, alors que la Marine nationale aurait la responsabilité d'intervenir en mer et de mettre en _uvre ces instruments, en temps de crise. Cette solution aurait l'immense mérite de supprimer les objections au renouvellement, à l'extension et à la modernisation de la composante navale de la prévention et de l'assistance.
Vous me permettrez, M. le président - je suis conscient d'être un peu long -, de dire un mot sur ces remorqueurs qui sont « le Samu de la Mer ».
Trois remorqueurs sont aujourd'hui basés à Cherbourg, Brest et Toulon : le gouvernement a pris la décision d'en positionner un quatrième à Calais. Mais l'on sait très bien qu'entre la pointe de Penmarc'h et la côte espagnole s'étend une zone non couverte. Lorsqu'on envoie l'Abeille Flandre remorquer l'épave de l'Erika, on le fait à regret et, parfois, avec un certain retard car on expose, pendant ce temps, les parages de la Bretagne aux effets d'une forte tempête. On étend donc le champ d'intervention de ce moyen bien au-delà de sa mission originelle ! Il serait donc réaliste et prudent, dans la répartition des navires d'assistance et de sauvetage, d'en baser un cinquième dans le golfe de Gascogne.
Or c'est à la Marine nationale qu'il revient de financer un tel investissement, aussi fondamental, alors même qu'elle n'en a pas les moyens. On sait que le changement, à l'identique, sans aucune modification technique, des deux Abeilles positionnées à Cherbourg et à Brest ne pourrait même pas être financé par la Marine nationale.
A fortiori, est-il illusoire d'espérer la mise au niveau de la flottille de protection.
Deux éléments pourraient résoudre cette question : l'adoption d'une loi de programmation du sauvetage en mer sur cinq ans, avec une dépense programmée ; l'identification d'un budget spécifique, avec une ligne affectée à la prévention des risques en mer et à la lutte contre les pollutions. Cela permettrait une mise à niveau rapide des remorqueurs français.
Je ne m'étendrai pas sur les moyens pour lutter contre les pollutions, mais je pense que le choix d'un navire dépollueur - comme certains pays étrangers l'ont fait - n'est pas, à coup sûr, le meilleur choix. Il serait sans doute préférable de posséder plusieurs modules de lutte antipollution stockés tout au long des côtes européennes, chacun adapté à une circonstance particulière (lieu, produit, météo etc.), mobilisables très rapidement, que l'on pourrait embarquer sur une barge ou sur un navire et qui interviendraient rapidement sur une pollution parfaitement identifiée quant à ses composants.
Cette solution permettrait d'éviter les tâtonnements que l'on a connus après le naufrage de l'Erika, où l'on a commencé à pomper le pétrole au bout de plusieurs jours, alors que la nappe n'était plus rassemblée. On aurait pu, si les moyens mobilisés sur la fin des opérations de pompage avaient été mis en _uvre plus rapidement, recueillir 5 à 6 000 tonnes de fioul en mer. Ceci montre donc que l'idée d'un navire polyvalent ne permet pas nécessairement une action rapide et aussi efficace que des modules différenciés répartis le long du littoral.
En toute hypothèse le meilleur traitement de cette phase antipollution ne pourrait être conçu et mis en _uvre, sans une volonté de tous les Etats de l'Union européenne, de coopérer étroitement à la préparation et à l'action.
Je voudrais enfin vous livrer ma conviction quant à la forme de la décision qu'attend l'opinion publique pour juger de la cohérence et de la force de la volonté politique de l'Etat, après le naufrage de l'Erika
et la pollution du littoral atlantique.
Tout d'abord, la conception de la mission doit être globale et inclure, de l'amont à l'aval, la prévention, l'intervention et le traitement des conséquences du sinistre (lutte antipollution, indemnisation, sanctions etc.).
L'action de l'Etat en mer ne doit pas être la simple addition de mesures atomisées, prises par des administrations dispersées, au gré de leurs cultures et de leurs moyens.
La cohérence s'impose non seulement dans l'action mais dans la conception de la mission que l'Etat décide de se donner.
Une telle volonté doit s'accompagner d'une décision budgétaire forte, en importance de l'effort consenti, en rigueur dans l'affectation des crédits et en souci de la programmation pluriannuelle, permettant, seule, d'assurer, en continu l'adaptation des moyens au risque maritime.
Qu'il faille, dans cette intention, se préparer à quelques révolutions dans l'organisation administrative, nul ne peut en douter. La France qui va prendre la présidence de l'Union européenne, n'abordera pas cette responsabilité sans manifester avec force sa volonté d'imposer aux divers corporatismes la primauté de l'efficacité, par une soumission, de leur part, sans réserve, aux règles de la coordination.
Telles sont, M. le président, les réflexions que je souhaitais livrer à votre commission sur un sujet dont je ne me suis jamais vraiment distancié, depuis 1978.
M. le Rapporteur : En ce qui concerne la dimension européenne des interventions, vous avez parlé de la nécessité de coordonner les moyens existants - et non pas de créer un système fédéral.
Votre proposition, M. Guermeur, peut-elle s'accommoder de la proposition faite par le CCAF, la chambre syndicale des constructeurs de navires, et par l'Institut français de la mer, consistant en la création d'une agence maritime européenne qui pourrait regrouper la vocation dont vous parlez, celle du contrôle et celle de la coordination des différents moyens antipollutions ?
Deuxièmement, s'agissant de la force d'action de l'Etat en mer, et notamment des moyens de surveillance aérienne - les avions des Douanes en particulier -, pensez-vous qu'il faille les rattacher à la ligne budgétaire spécifique et identifiée dont vous préconisez la création ? Les avions des Douanes doivent-ils entrer dans le budget qui serait identifié et géré par le ministère de l'Equipement, des Transports du Logement ?
M. Guy GUERMEUR : Une agence européenne - quel que soit le terme employé -me paraît en effet nécessaire dès lors qu'elle permet une réflexion permanente entre les responsables des pays qui ont suivi des pistes différentes, parfois divergentes. De ce point de vue, cette agence, ou toute structure qui assurerait la coordination des réflexions, des essais, des tests en commun, est une bonne chose. Permanente, elle serait gérée par des responsables d'un niveau suffisamment élevé pour que la progression se fasse vers un système d'agence intégrée. C'est une donnée classique, dans la construction de l'Europe que l'on commence avec les sous-chefs de bureau et que l'on termine avec les ministres ; or, je crois qu'il faudrait pour cette agence là éviter l'échelon des sous-chefs de bureau.
Une structure qui irait plus loin et qui prétendrait conduire en commun une action européenne - telle que l'Eurocorps qui existe dans le domaine militaire - serait prématurée et irréaliste. Le système de garde-côtes des Etats-Unis, par exemple, qui sert de modèle dans la presse, est un système paré de toutes les vertus, mais adapté à un Etat fédéral. Je ne suis pas persuadé qu'il soit adaptable à une communauté d'Etats comme l'Union européenne - notamment lorsque les pays membres ont déjà avancé chacun de manière divergente et sont à des stades d'avancement très différents.
En ce qui concerne votre seconde interrogation, je dois dire que la question des douanes illustre bien le problème de la cohérence des structures administratives concernées par la sécurité du transport maritime. Et j'y porte quelque intérêt, ayant travaillé 15 ans dans cette administration. Il s'agit d'une administration dotée d'une personnalité extrêmement forte ; je doute donc que le pouvoir politique puisse, un jour, la détacher du ministère auquel elle appartient pour la rattacher à un autre ministère, quel qu'il soit.
La fonction des Douanes, qui ont été créées pour protéger l'économie nationale face à la concurrence étrangère, et, accessoirement pour exercer une fonction fiscale, s'est incroyablement amenuisée. Les Douanes, lorsqu'elles recherchent les traces de pétrole avec leurs avions, n'accomplissent pas une tâche fiscale ; il en va de même lorsqu'elles saisissent de la drogue. Je dirai même, M. le président, que lorsque les Douanes recouvrent les droits de douanes, elles n'interviennent pas fiscalement pour l'Etat, puisque les droits de douanes sont affectés au budget communautaire.
On peut donc dire que les Douanes, pour l'essentiel aujourd'hui, ont des missions qui ne correspondent pas à la raison pour laquelle elles ont été créées. La logique serait alors d'identifier clairement les tâches principales effectuées par les Douanes et de décider à quel ministère elles doivent être rattachées pour être efficacement accomplies.
On pourrait envisager qu'une force d'action de l'Etat en mer soit en mesure d'utiliser les moyens des douanes, leur structure de commandement, leur efficacité, leur présence sur le terrain, toutes leurs qualités qui présentent un avantage certain. Mais il ne faut pas se faire d'illusions, les douanes resteront attachées au ministère de l'Economie et des finances.
En revanche, il est possible d'affecter budgétairement des sommes pour des fonctions de prévention des risques en mer et de lutte antipollution. Il ne me paraît pas scandaleux que des moyens budgétaires soient affectés pour ces missions des douanes sur une ligne budgétaire du ministère de l'Équipement, des transports et du logement et non rattachés au ministère de l'Economie et des Finances. On peut effectivement penser que l'utilisation d'hélicoptères, d'avions de surveillance et d'appareils sophistiqués de détection de traces de pétrole par les Douanes ou par la Marine nationale soit financée par une ligne budgétaire relevant du ministère de l'Équipement, des transports et du logement, et par conséquent gérée par lui.
M. Louis GUEDON : M. Guermeur, vous avez insisté sur le fait que les douanes étaient une administration qui possédait une forte personnalité. Préalablement, vous avez rappelé qu'il existait un certain nombre de moyens qui relevaient d'autorités civiles diverses - les inspecteurs de sécurité, les CROSS, les Affaires maritimes, les phares et balises, la gendarmerie maritime. Ensuite, vous avez fait l'apologie du ministère de l'Équipement, des transports et du logement. Mais je ne vous ai jamais entendu proposer de placer tous ces moyens sous l'autorité d'une structure ayant en charge une politique de la mer, c'est-à-dire un secrétariat d'Etat à la mer. N'êtes-vous pas favorable à la création d'une telle structure spécifique capable de poursuivre une véritable politique de la mer ?
M. Guy GUERMEUR : Nous avons fait l'expérience, avant 1978, d'une situation où les administrations étaient dispersées et où les responsabilités n'étaient pas clairement définies.
Du temps où la liberté de circulation était la religion exclusive, tout le milieu maritime considérait que d'obliger un navire à passer dans un couloir, en dehors des chenaux balisés, était une aberration.
On peut penser que depuis lors, et personne ne le conteste, les choses ont été améliorées.
M. le député, vous me posez la question de savoir quelle serait la structure la plus indiquée pour un éventuel rattachement des administrations concernées. Il convient, me semble-t-il, de séparer la période de préparation - où s'effectue un travail d'état-major consistant à tester, regrouper et rendre les moyens interopérables avec ceux de nos partenaires - qui devrait être confiée à l'administration la plus apte, par sa culture et ses traditions, à faire travailler ensemble des administrations civiles différentes, et la période de l'action opérationnelle sur la zone du danger ou du sinistre qui devrait être confiée au ministère de la Défense - et plus particulièrement au préfet maritime - avec la maîtrise complète des moyens nécessaires.
Aujourd'hui, si un naufrage se produit en Manche par très mauvais temps, des bateaux arriveront spontanément sur zone, mais il est peu probable, étant donné le temps de préparation et de man_uvre nécessaire, qu'un navire militaire basé à Brest soit sur zone en moins de 10 heures, alors que les Abeilles ne demandent que trois quarts d'heures de préparation - qui peuvent être réduits à 30 minutes par la compétence des marins.
Il convient donc de doter les navires civils d'un poste de commandement intégral, afin que le commandement militaire n'ait pas à déplacer un bateau qui mettra un temps précieux pour arriver sur zone. Par ailleurs, il pourra, avec des moyens rapides tels que les hélicoptères - éventuellement par hélitreuillage -, déployer un état-major sur un navire préalablement doté de tous les équipements de communication et de conduite des opérations. De la sorte, la Marine nationale pourra intervenir dans les meilleures conditions possibles.
J'ai passé la journée d'hier avec le personnel de l'Abeille Flandre,
afin de recueillir son sentiment profond avant de venir devant vous. Il a insisté sur la nécessité de doter les remorqueurs de haute mer de ce poste de commandement permanent - notamment sur le bateau de sauvetage qui est le premier sur place - afin que la Marine nationale, en cas de crise, puisse commander l'ensemble des forces intervenant en mer.
Au fond, je crois qu'il faudrait distinguer le « temps de paix » et le « temps de guerre », si vous me permettez cette expression. En « temps de paix », le ministère de l'Équipement, des transports et du logement et les administrations intervenant en mer qui lui sont rattachées par une ligne budgétaire spécifique, doivent anticiper les accidents et créer les moyens d'y faire face. En « temps de guerre », il ne fait aucun doute que tous les moyens doivent être mis à la disposition de la Marine nationale qui doit avoir la maîtrise complète de leur commandement et de leur mise en _uvre.
S'agissant enfin de votre question relative à un ministère de la Mer, je fus, je crois, l'un des tous premiers à en recommander la création et à me réjouir de son institution. Plusieurs titulaires se sont succédés dans cette fonction, ce qui permet de mettre les personnes hors de cause. Reste la mesure de l'efficacité ; elle est discutable.
Les administrations demeurent attachées à leurs « maisons » ; elles en reçoivent les moyens - plus ou moins généreux.
Un ministère de la Mer n'a ni l'autorité politique, ni la légitimité historique, ni les moyens budgétaires qui lui permettraient d'asseoir son autorité : celle-ci ne peut être exercée que par le Premier ministre lui-même - ce qui est malcommode en pratique - ou par un ministère de première grandeur par son ancienneté, par l'importance de ses moyens budgétaires et par la reconnaissance de la compétence de ses corps constitués.
Hors de la Marine nationale, pour l'action d'engagement des forces de l'Etat en mer, il apparaît que le ministère de l'Equipement est le seul à remplir les conditions d'une mission générale et permanente d'organisation des voies et moyens nécessaires à la prévention du risque, à la réponse au sinistre et au traitement de ses conséquences.
Audition de MM. Pierre MAILLE et Michel GIRIN,
respectivement président et directeur
du Centre de documentation, de recherche et d'expérimentations
sur les pollutions accidentelles des eaux (CEDRE)
(extrait du procès-verbal de la séance du 8 mars 2000)
Présidence de M. Daniel PAUL, Président
MM. Pierre Maille et Michel Girin sont introduits.
M. le Président leur rappelle que les dispositions législatives relatives aux commissions d'enquête leur ont été communiquées. A l'invitation du Président, MM. Pierre Maille et Michel Girin prêtent serment.
M. Pierre MAILLE : Monsieur le président, madame, messieurs les députés, merci de nous recevoir ce matin. M. Michel Girin est le directeur du CEDRE, j'en suis moi-même le président. Nous avons prévu de commencer cette audition par une présentation du CEDRE.
M. Michel GIRIN : Le CEDRE est une structure petite et réactive avec un effectif de 36
- bientôt 37 personnes -, un budget opérationnel de 2,4 millions d'euros en moyenne sur les cinq dernières années, 60% de ce financement provenant de contrats publics et privés, les 40 % restants émanant de subventions.
Le CEDRE assume une fonction de recherche et de développement. Nous testons des produits, des équipements, des services techniques offerts par l'industrie. Nous proposons des améliorations destinées à conduire vers de nouvelles solutions, mais nous ne faisons pas de recherche fondamentale. Selon nos statuts, nous avons une fonction d'orientation, mais pas de réalisation de cette recherche, celle-ci s'effectuant dans des instituts plus puissants et plus organisés que nous.
Le CEDRE remplit également une mission de service public en situation d'urgence. Nous assurons en effet une permanence 24 heures sur 24 pour assister les autorités responsables de la lutte contre toute pollution accidentelle des eaux marines et continentales.
Dans ce cadre particulier, nous avons un rôle précis dans la mise en _uvre des plans POLMAR. Au niveau de la préparation, nous fournissons l'assistance nécessaire en matière de formation et d'expertise. Dans le plan POLMAR mer, nous sommes l'un des organismes techniques compétents pour intégrer l'état-major de lutte. Dans le plan POLMAR terre, les experts et les moyens du CEDRE doivent être mis à disposition du préfet en cas de pollution d'ampleur exceptionnelle.
Je précise que cette fonction recouvre également les eaux continentales et l'Outre-mer à travers la circulaire POLMAR, pour les départements et territoires d'Outre-mer, et la circulaire relative à la lutte contre les pollutions accidentelles dans les eaux intérieures. Compte tenu des missions qui nous sont dévolues, nous détenons une copie de tous les plans départementaux de lutte contre les pollutions accidentelles des eaux littorales ou des eaux intérieures.
Le dernier aspect de notre activité concerne le retour d'expérience qui doit être au service de tous, à travers des formations théoriques et pratiques, des animations d'exercices, des conférences, des manuels, des vidéos, un site Internet, des documents éducatifs, des sessions et une lettre d'information ainsi qu' un bulletin semestriel.
Nous assurons nos fonctions dans le cadre d'un réseau européen de partenariats et d'associations avec différents instituts et correspondants. C'est à ce titre que nous avons produit des rapports sur les accidents du
Haven, en 1991 - 144.000 tonnes de pétrole déversées dans le golfe de Gênes - de l'Aegean Sea, en 1992 - 80.000 tonnes déversées au large de La Corogne -, du
Braer, en 1993 - 85.000 tonnes de pétrole souillant les Shetlands -, et du
Sea Empress, 70.000 tonnes de pétrole déversées aux abords de Milford Haven. Ceci pour rappeler que des accidents d'une certaine importance continuent à se produire en Europe.
En année normale, la préparation à la lutte contre les pollutions des eaux représente une large part de l'activité du CEDRE. Nous formons 50 à 60 fonctionnaires issus de la Marine nationale, du corps des sapeurs pompiers, et des personnels civils des zones de défense. Nous participons aux deux exercices annuels POLMAR mer, POLMAR terre et eaux intérieures. Nous participons également à la mise à jour des plans POLMAR mer et des plans de lutte contre la pollution accidentelle des eaux intérieures.
Quatre à six plans sont mis ainsi à jour chaque année. Nous produisons enfin douze à quinze rapports contractuels d'expérimentation, d'études et de retour d'expérience.
En année normale, le CEDRE est néanmoins appelé à intervenir contre des pollutions. C'est ainsi que nous recevons 100 à 120 appels urgents qui concernent dans leur majorité des pollutions des eaux intérieures. On nous demande en général des informations techniques. Dix à quinze de ces accidents en moyenne, en France ou à l'étranger, conduisent à dépêcher du personnel sur le terrain. Leur implication est parfois lourde puisqu'elle nous mobilise plusieurs semaines, voire plusieurs mois.
Nous réalisons aussi une exploitation documentaire des retours d'expérience relatifs à des accidents survenus à l'étranger, auxquels nous n'avons pas participé et qui sont porteurs de leçons.
Bien évidemment, nous sommes la mémoire des accidents intervenus en France. A titre d'exemple, je mentionnerai le
Lyria, qui avait déversé 4.500 tonnes de pétrole brut à Toulon en 1993 ; le
Sherbro, qui avait perdu 88 conteneurs dans la Manche la même année ; le
Fenes qui avait perdu 2.650 tonnes de blé en Corse en 1996 ; le
Katja qui avait perdu 180 tonnes de fioul au Havre en 1997 ; le
Capetan Tzannis qui avait déversé 120 tonnes de fioul à Bayonne la même année ; et le
Peter Seaf dont le fioul a dû être pompé au large de l'île d'Ouessant en 1999. Le CEDRE est configuré à l'échelle de tels accidents.
Quand la pollution de l'Erika s'est déclarée, nous avons été directement impliqués. Avant l'arrivée à terre des premières nappes de fioul, nous avons rejoint les PC POLMAR en envoyant un ou plusieurs conseillers techniques au PC POLMAR mer dès le premier jour, puis dans chaque PC POLMAR terre dès activation du plan. Vous avez vu le nombre de PC à activer et le nombre de personnes dont nous disposons. Cela a posé évidemment problème, mais nous avons fourni l'assistance et les conseils aux PC POLMAR. Nous avons constitué l'interface entre la Marine nationale et Météo-France pour la prévision de dérive des plaques de polluant en mer, et nous produisons depuis une synthèse quotidienne pour les autorités.
Parallèlement, nous avons réalisé en laboratoire des tests et des analyses sur le produit afin de préciser son comportement et son évolution. En documentation, nous avons précisé nos données sur les accidents comparables et les moyens de lutte utilisés, et nous les avons communiquées aux PC POLMAR mer et POLMAR terre. En relationnel, nous avons recherché des soutiens chez nos partenaires étrangers, et ouvert des discussions techniques, parfois un peu tendues, avec les experts du FIPOL sur les solutions de lutte à utiliser.
Enfin, nous avons fait l'interface pour les stocks POLMAR et avons vérifié les données des plans POLMAR terre, dont la dernière mise à jour remontait à 1998 pour le Finistère, 1989 pour le Morbihan, 1999 pour la Vendée, 1984 pour Loire-Atlantique, et 1980 pour la Charente-Maritime.
A partir du moment où le produit polluant est parvenu sur les côtes, nous avons dû assumer notre mission de présence dans tous les PC POLMAR terre. Il y avait en permanence entre 8 et 12 personnes sur le terrain. De même, nous avons continué à produire nos synthèses techniques quotidiennes. Nous avons engagé des recherches de données complémentaires sur les accidents comparables parce qu'il y avait des détails techniques à affiner sur les moyens de lutte à utiliser face à des pollutions par du fioul lourd - susceptible de couler lorsqu'il a aggloméré du sable. En expérimentation, nous avons lancé des tests et qualifications de produits et matériels. Beaucoup de fabricants qui proposaient leurs produits aux PC POLMAR ne s'étaient pas faits référencer auprès du CEDRE. Il nous incombait d'évaluer la fiabilité de ces moyens en plus de nos autres missions.
La pollution induite par la cargaison de l'Erika nous a placés face à trois problèmes inévitables.
Le premier concerne les demandes d'information des autorités. Chacun voulait des informations plus vite, plus souvent, et plus personnalisées. Il nous est arrivé de faire 4 synthèses dans la journée pour différents services ; or, faire une synthèse toutes les 3 heures représenterait pour nous une lourde tâche.
Le déferlement médiatique a constitué un second problème. Qui d'autre que le CEDRE pouvait répondre aux questions techniques ? Nous avons constaté, après coup, que la préfecture maritime et les ministères renvoyaient les questions vers nous, n'ayant pas de réponse aux questions techniques qui leur étaient posées. Nous étions en permanence sur le front de la réponse aux médias.
Enfin, l'avalanche des inventeurs et fournisseurs a elle aussi été une difficulté permanente en de telles circonstances. Pendant plusieurs jours, on attendait la lutte en mer que l'on n'a pas vu démarrer de manière aussi satisfaisante que l'espéraient les médias et le public. De ce fait nous avons dû faire face à une multitude d'interventions, notamment de fournisseurs persuadés de détenir la solution et exigeant un traitement prioritaire et personnalisé de notre part. Si nous ne répondions pas dans l'heure à leurs propositions, celles-ci étaient immédiatement soumises aux médias et aux ministères, lesquels ministères nous rappelaient en nous demandant pourquoi nous n'utilisions pas de telles techniques. Face à tous ces problèmes, nous avons essayé de faire front et d'assurer notre mission, ce qui n'était pas très facile.
Tout ceci nous amène à constater deux évidences. Tout d'abord, le CEDRE n'est pas à l'échelle géographique - je dis géographique et non dimensionnelle - de cette pollution. Son effectif ne lui permet pas d'assurer sa mission auprès de tant de PC POLMAR en même temps.
Par ailleurs, le CEDRE n'est pas à l'échelle médiatique de cette pollution. Le travail qu'il a fait depuis 20 ans et sa capacité de répondre dans l'urgence n'ont pas été à la hauteur de l'attente du public et des médias. Il aurait fallu que nous répondions beaucoup plus vite et que nous ayons la solution, ce qui n'était malheureusement pas le cas et ne pouvait, en tout état de cause, l'être.
Ces deux évidences ne sont pas pour nous des surprises.
J'ai été personnellement affecté par les articles parus dans la presse selon lesquels nous avons fait « cocorico » au moment du colloque « 20 ans après l'Amoco-Cadiz », à Brest, en novembre 1998. Je rappellerai une phrase qui fait partie de la synthèse de ce colloque : « Nous savons que le risque est permanent et que nous n'avons pas de réponse parfaite à tout. Quoi que nous fassions pour prévenir l'accident, pour mieux nous préparer, pour mieux gérer la réponse, certains observateurs ne comprendront pas que nous ne puissions pas tout, d'autres critiqueront et viendront expliquer après coup ce que nous aurions dû faire ». C'est la sensation que nous avons eue dans cette situation.
M. Pierre MAILLE : Je précise que le CEDRE est une association créée sur la base de la loi de 1901. Au conseil d'administration, les ministres compétents sont représentés, tout comme les différentes collectivités - régions, départements, villes ; sont également représentées les industries pétrolière et chimique.
M. le Rapporteur : Je voudrais demander à M. Pierre Maille si le statut juridique du CEDRE lui paraît opportun ou bien s'il ne faut pas profiter de cette crise pour revoir tant ses effectifs que ses statuts. J'aimerais également savoir ce qu'il pense des dernières mesures annoncées par le gouvernement à l'occasion du comité interministériel pour l'aménagement et le développement du territoire (CIADT) qui s'est tenu à Nantes.
A M. Michel Girin, je souhaite poser une question sur la toxicité du fioul de l'Erika qui a fait l'objet d'un débat et continue à alimenter les polémiques. Le préfet de région que nous avons interrogé hier nous a déclaré que le discours des autorités sur la toxicité de ce fioul n'avait pas changé. Il y a pourtant un vrai problème médiatique là-dessus. Si la position officielle du centre antipoison de Rennes, datant du 21 décembre n'a pas évolué, elle n'a pas été entendue. Il y a eu de nombreuses déclarations à ce sujet, et le Premier ministre lui-même a dû s'en expliquer.
De même, comment expliquez-vous que nous n'ayons pas eu les moyens adéquats de pompage en mer ? De nombreux témoignages, y compris celui du préfet maritime, font état de carences importantes. Aviez-vous averti auparavant qu'il y avait là une impasse ? Il a fallu recourir à des moyens appartenant aux Pays-Bas. Maintenant, il vient d'être décidé d'en acquérir. Est-ce que l'alerte avait déjà été donnée ? Comment expliquer cette lacune?
Par ailleurs, vous avez rappelé les dates de réactivation des plans POLMAR terre. Vous est-il apparu qu'il y avait des manques dans POLMAR terre ? Pour notre part, nous en avons constaté un certain nombre, ne serait-ce que le fait que les lieux de stockage n'étaient pas tous bien identifiés et qu'il y a eu un peu de panique dans la gestion des situations, ce qui ne manque pas de nous interpeller face à la gravité des faits.
M. Pierre MAILLE : Sur la question du statut, je n'ai pas d'avis
a priori très arrêté, mais je crois que le statut n'est pas vraiment la question. La question est plutôt de savoir quelle est la volonté de l'ensemble des partenaires, des différents ministères concernés, des diverses institutions compétentes, pour se doter d'équipes de recherche et de prévention. Il s'agit de savoir quels moyens l'on veut ou l'on peut y consacrer. C'est un peu comme pour tous les sujets, quand il y a un accident, il y a de l'émotion et une forte pression qui font que l'on veut disposer maintenant des moyens que l'on aurait souhaité avoir avant l'accident. Quand le temps estompe ce souvenir, la préoccupation devient moins forte. Le CEDRE a été créé après l'Amoco-Cadiz, précisément parce qu'il y avait eu cet événement de mer. La question porte davantage sur les efforts que le conseil d'administration fait tous les ans pour vérifier que les moyens sont réunis, que l'on pourra payer le personnel et que les ministres consentiront à un effort suffisant.
Le statut associatif permet de fonctionner. Il offre suffisamment de souplesse. Mais un autre statut permettrait aussi de fonctionner. Là n'est donc pas le problème.
La question de la taille se pose, M. Girin l'a évoquée, mais là encore, tout dépend des missions que l'on veut confier à un organisme comme le CEDRE, à la fois avant et après l'accident. Lorsque la pollution arrive, comme cela a été le cas suite au naufrage de l'Erika sur 400 ou 500 kilomètres de côtes en touchant cinq départements, plusieurs régions, il devient difficile d'assurer une présence dans des PC divers, si l'on dispose d'un effectif de 35 personnes seulement.
C'est une situation exceptionnelle mais la solution ne se résume pas aux seuls effectifs du CEDRE. Comme vous le savez, le CEDRE fait de la formation auprès des personnels des directions de l'équipement et des sapeurs pompiers. Or ces derniers ne restent pas forcément en poste dans une région côtière exposée aux risques de pollution. Ils peuvent être affectés en Haute-Savoie parce que leur déroulement de carrière l'exige.
Par conséquent, il faudrait que l'administration puisse savoir où sont ces personnels, puisse les remobiliser en cas de besoin, afin de suppléer la petite taille de l'équipe du CEDRE, qui pourrait se consacrer à ses missions de formation ou de coordination sans être nécessairement présent sur tous les PC POLMAR.
Bien évidemment, nous souhaiterions avoir plus de moyens, et surtout, ne pas avoir à solliciter, tous les ans, tels ministères pour qu'ils poursuivent la mise à disposition d'agents, ni à se demander si la Marine nationale, dont le nombre d'appelés diminue, va continuer à apporter ses moyens au CEDRE. Le problème majeur est donc davantage la préconisation des moyens du CEDRE que son statut associatif.
Les mesures du récent CIADT qui s'est tenu à Nantes sont importantes. Nous sommes en train d'identifier les opportunités qui se présentent. Elles sont de diverses natures, soit en investissement - moyens d'analyse entre autres -, soit en fonctionnement - moyens supplémentaires de formation ou d'expérimentation.
Le budget d'un organisme comme le nôtre, évoqué tout à l'heure en euros, est de 15 à 16 millions de francs. Les moyens supplémentaires décidés lors du CIADT représentent un pourcentage d'évolution important du budget et devraient permettre au CEDRE d'être plus efficace sur l'expérimentation, la recherche en amont et la formation de personnels divers, sous réserve de ce que je disais précédemment, c'est-à-dire que les gens formés restent disponibles sur les territoires côtiers.
La question de la toxicité du pétrole ne relève pas des attributions ni des compétences du CEDRE.
M. le Rapporteur : Dans ce cas, c'est le métier de qui ?
M. Michel GIRIN : C'est une question effectivement très importante. Je peux vous répondre en vous disant qu'un hydrocarbure, quel qu'il soit, présente un certain niveau de toxicité. Quand vous remplissez le réservoir de votre voiture, vous êtes en présence de vapeurs d'hydrocarbures et on vous explique qu'il vaut mieux le faire en extérieur et non pas dans un lieu confiné. Tous les hydrocarbures en contact physique de longue durée présentent un danger pour l'homme. Tous font l'objet d'une fiche de sécurité. Tous les composants que l'on va trouver dans un hydrocarbure sont répertoriés dans cette fiche de sécurité. La toxicité est une question de durée et de conditions de contact. Les éléments que nous avons sur le produit transporté par l'Erika, nous conduisent à dire qu'une personne en présence de cet hydrocarbure dans un espace ouvert, sur une plage par exemple, ne court pas de danger par inhalation parce qu'il y a très peu de composants évaporables, très peu de composants légers dans ce produit. Une personne qui manipule l'hydrocarbure à mains nues pendant de longues journées prend des risques. Une personne qui manipule ce produit avec des gants mais qui va ensuite se laver les mains dans un diluant à base de benzène, comme nous avons vu faire sur des chantiers, prend plus de risques au cours du lavage de ses mains que dans l'opération même de lutte. Ce sont des pratiques simples que nous pouvons expliquer à tout le monde.
Au-delà, si nous voulons affiner l'information et nous poser des questions de toxicologie et d'épidémiologie à long terme, c'est une question qui dépasse notre niveau de compétence parce qu'elle entre dans le problème plus général de la sécurité des personnes qui travaillent en présence d'hydrocarbures. Si je me tourne vers les DDASS pour avoir l'information, je n'ai pas l'information. Je ne sais pas qui a la compétence, aujourd'hui, en France. Aux Etats-Unis, c'est la Food and Drug Administration. L'agence française de sécurité sanitaire et alimentaire (AFSSA) n'est pas compétente car on ne mange pas ce produit. L'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER) ne se préoccupe que des incidences d'un tel produit sur la faune ou la flore. Peut-être l'Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS) et les directions départementales des affaires sanitaires et sociales (DDASS) sont-ils plus concernés.
D'ailleurs nous retrouvons le même problème avec les producteurs de sel qui ne savent pas quelle structure de tutelle détermine s'ils peuvent produire du sel à partir de l'eau des régions touchées par la pollution de l'Erika.
Manifestement, le cloisonnement du système administratif français conduit à certaines zones d'ombre pour un problème aussi transversal. Il faut un jour que quelqu'un décide quelle structure doit prendre en charge ce type de problèmes.
M. le Rapporteur : Pensez-vous que c'est la non identification de celui qui est habilité à communiquer sur cette question, qui a provoqué les différentes variations d'interprétation sur le sujet ?
M. Michel GIRIN : Je suis persuadé que la connaissance existe dans le monde scientifique français. Le problème est plus l'identification de celui qui dispose de l'autorité pour s'exprimer que celui de la capacité scientifique.
Pour ce qui est de la lutte en mer, nous avons produit, en 1990, un rapport pour la Marine nationale qui s'intitule « état de l'art sur les techniques et moyens de lutte contre une pollution par produits très visqueux à solides ». Dans la conclusion de ce rapport, il est précisé que : « l'examen des techniques et moyens actuellement disponibles pour intervenir en mer face à une pollution accidentelle montre que, pour résoudre le problème particulier posé par les produits visqueux paraffiniques, il n'existe guère que des solutions limitées ou dont l'efficacité reste à vérifier ». A la fin du rapport, consacrée à l'évaluation de l'efficacité des différentes techniques, on peut également lire qu' : « une évaluation de leur efficacité en mer ouverte sur produits visqueux paraffiniques reste à faire, soit à l'occasion d'une pollution réelle, soit par le biais d'une expérimentation à grande échelle ».
Le problème de la lutte contre une pollution de fioul n°2 était déjà identifié par tous les pays chargés de la lutte antipollution. Tous ces pays savent que face à ce genre de pollution, les moyens dont nous disposons sont très limités. Ce n'est pas un problème facile. Il n'y a pas une solution évidente de bateau ou de machine que l'on va jeter à l'eau pour résoudre le problème. J'ai assisté à des présentations de projets de bateaux antipollution pour hydrocarbures visqueux construits par les plus grandes sociétés françaises d'ingénierie pétrolière, et j'ai été atterré par ce que j'ai vu. Il n'y a aucune solution vraiment satisfaisante parce que personne n'a la solution. C'est un problème très complexe.
M. le Rapporteur : Et le bateau hollandais ?
M. Michel GIRIN : Le bateau hollandais, l'Arca, qui a été le plus performant, a récupéré 400 tonnes de fioul. Si vous considérez son coût et que vous le comparez à celui des deux bateaux français qui, à eux deux, ont ramassé les deux tiers de la quantité de fioul qu'il a récupérée, en rapport coût/efficacité, vous arrivez à la conclusion qu'il vaudrait mieux avoir quatre bateaux à la française plutôt qu'un
Arca, et rassembler les capacités. Si vous considérez que l'Arca est plus performant sur ce fioul, posez-vous la question de savoir si, demain, il sera aussi efficace sur du pétrole brut.
L'Arca a été performant parce qu'il avait des bras courts et solides et qu'il a eu la chance de ne rien casser, ce qui n'a pas été le cas d'autres bateaux. Cela ne veut pas dire que ce bateau est la panacée. Je suis obligé de dire, en pur technicien, que ce n'est pas en achetant un
Arca que nous aurons la solution au problème la prochaine fois, parce que le problème sera différent : ce ne sera ni le même pétrole, ni les mêmes conditions de mer. De surcroît, si nous n'avons qu'un bateau, il sera peut-être en réparation le jour où nous en aurons besoin. Il n'existe donc pas de solution immédiate, évidente et simple.
M. Pierre MAILLE : Dans le prolongement de ce qui vient d'être dit sur les moyens d'intervention en mer, il faut sans doute penser à des engins polyvalents, à des bateaux qui accomplissent aussi une autre tâche, qui peuvent être équipés de moyens de récupération, qui peuvent éventuellement embarquer un conteneur avec des moyens d'intervention nécessaires, et qui seront répartis sur le littoral, plutôt que d'avoir un moyen identifié pour un type de pollution, qui sera positionné quelque part et pas forcément là où l'accident arrivera.
Il y a sans doute des réflexions à mener sur la polyvalence des engins avec les administrations maritimes, civiles et militaires.
M. François GOULARD : Je reviens sur les types de compétences que vous mettez en _uvre au CEDRE. La question du rapporteur sur la toxicité a montré que ce n'était pas forcément clair pour nous. Quels sont les types de compétences techniques et spécifiques que vous mettez en _uvre ? Quel est le niveau de vos personnels car, 35 personnes, c'est très peu ? Pour les compétences les plus élevées, quels sont leur niveau de formation et leur profil ? Avez-vous des chimistes, des spécialistes de la mécanique des fluides ?
Par ailleurs, quels sont les échanges techniques auxquels vous procédez avec les différentes administrations françaises compétentes ? J'ai été frappé tout à l'heure de vous entendre dire que les ministères ou la préfecture maritime ont systématiquement renvoyé vers vous toutes les questions, en particulier lorsqu'elles émanaient des médias, en période de crise. Mais en temps normal, avez-vous des interlocuteurs au sein des ministères chargés de l'environnement, de l'industrie, de l'équipement ? Avez-vous des relations permanentes avec des techniciens ? Avez-vous en face de vous des compétences techniques sur lesquels vous pouvez vous appuyer ?
Enfin, j'ai cru entendre tout à l'heure dans votre propos que vous aviez eu des relations « un peu tendues » avec le FIPOL sur la mise en _uvre de moyens techniques, au moment de la crise. Pouvez-vous être plus explicite sur les divergences d'appréciation ?
M. Pierre HERIAUD : J'ai entendu tout à l'heure, dans la présentation du rôle du CEDRE, s'agissant de l'élaboration et de la révision des plans POLMAR terre que, finalement, les informations dataient. J'ai entendu pour la Loire-Atlantique, 1984 ? Ne vous aurait-on pas informés de la réactivation du plan POLMAR terre de ce département à partir de juillet 1999 ?
Ma deuxième question complète celle de M. Goulard sur le budget du CEDRE, les recettes et les dépenses, les ressources et les emplois de votre secteur. Trente-cinq personnes sont budgétées dans vos dépenses, mais avez-vous des personnels mis à disposition par d'autres établissements - ministères ou administration -, qui ne seraient pas intégrés dans ce budget, ce qui arrive assez fréquemment ? Du côté de vos ressources, vous nous avez apporté quelques éléments, mais vous avez bien dit que l'équilibre de votre budget nécessitait des travaux faits pour des missions, des conventions passées avec le secteur public et le secteur privé. Quelle est l'importance des missions réalisées pour le compte du secteur privé ? Avez-vous passé des conventions avec des sociétés pétrolières, par exemple ?
M. Pierre MAILLE : L'effectif total du CEDRE est de 35 personnes, personnels mis à disposition par d'autres établissements inclus.
M. Michel GIRIN : Le CEDRE emploie 28 salariés. Nous sommes au courant des travaux de mise à niveau du plan. Je précise simplement que la nouvelle édition n'est pas encore sortie. C'est en cours de mise à jour. C'était très important et le fait qu'il ait été en cours de mise à jour a beaucoup aidé pour la lutte contre la pollution en Loire-Atlantique.
S'agissant du profil de notre personnel, celui-ci répond à des formations très diverses. Nous avons des ingénieurs, dont un ingénieur agronome. Je suis moi-même océanographe-biologiste. Nous avons également des géologues, des physiciens. Nous avons aussi un fonctionnaire du ministère de l'équipement et un fonctionnaire du ministère de l'environnement. Certains journaux ont dit que nous étions les pompiers de l'antipollution. Nous sommes des gens dont le métier est d'intervenir, au départ, pour fournir des conseils techniques et pratiques. Je prends mon exemple personnel : j'ai progressivement développé une compétence pratique approfondie dans le domaine de l'indemnisation et de la gestion des relations avec les organismes chargés d'indemniser. Ce n'était pas mon métier d'origine ! De même, il est arrivé à l'un de mes collègues, océanographe, d'être le porte-parole du CEDRE devant les médias. Chacun d'entre nous doit pouvoir répondre à des questions multiples dans de nombreux domaines différents. Tous les gens du CEDRE sont polyvalents et essayent de faire face à tout, dans la limite de leurs compétences, qui se résument à « comment lutter contre la pollution ». Nous n'allons pas jusqu'aux conséquences de la pollution.
Le CEDRE compte 20 ingénieurs et scientifiques et 15 personnels techniques et administratifs.
S'agissant de notre relation avec les administrations et les ministères, je vous ai apporté la liste des membres de notre conseil d'administration et de notre comité stratégique. Tous les gens avec lesquels nous avons des relations professionnelles importantes en situation de pollution, que ce soit la préfecture maritime, la Marine nationale, le ministère chargé de l'équipement et des transports, l'IFREMER, l'INERIS, l'Institut français du pétrole (IFP), sont à la fois membres de notre conseil d'administration et de notre comité stratégique. C'est à travers ce conseil d'administration et ce comité stratégique que les rencontres et les échanges se font régulièrement. Après, il appartient aux personnes présentes dans ces conseils de rediffuser les informations dans les structures qu'elles représentent. C'est peut-être dans cette rediffusion que tout se joue. En effet, quand le dossier est diffusé, l'ensemble du personnel de ces structures administratives ou professionnelles se trouve en relation directe avec nous.
Vous avez posé une question sur l'importance de nos travaux pour le compte du secteur privé. J'ai apporté ce que nous appelons le tableau de notre programmation technique annuelle, c'est-à-dire les contrats qui se discutent avec l'ensemble des membres de l'association du CEDRE. Y est indiquée la part apportée par les deux sociétés Elf et Total, respectivement 967.700 F et 576.210 F sur un total de 14 485 003 F pour 1998. Les chiffres sont à votre disposition. Ils figurent dans notre rapport annuel ; ils sont publics.
Concernant le FIPOL, le premier - qui n'est pas le seul - « cas tendu » a été le moment où le préfet maritime, sur notre conseil, a décidé de mobiliser des bateaux antipollution d'autres pays européens. C'est la logique, il faut être clair : on ne peut pas faire face à une pollution de cette ampleur avec ses propres bateaux antipollution. Lors d'une pollution à Milford Haven, en 1996, au Pays de Galles, un bateau français est allé lutter contre cette pollution, ce qui a constitué le meilleur exercice qu'il ait jamais fait. En exercice, on met 10 tonnes, au maximum, de produit en mer. Là, il s'est trouvé confronté à 70.000 tonnes de pétrole. Les matériels ainsi que l'équipage ont constaté la différence entre la réalité et l'exercice.
Il faut que le FIPOL soit intéressé par l'idée de nous apporter de l'aide et que le préfet maritime trouve bénéfice à utiliser cette aide. Nous avons apporté au préfet maritime toute la documentation que nous avions sur les bateaux de lutte contre les pollutions en mer et nous avons préconisé l'utilisation d'un certain nombre de bateaux. Quand le préfet a décidé d'engager ces bateaux, il a reçu une lettre du représentant du FIPOL lui disant : « Ces mesures sont déraisonnables. Les chances de réussir et de pomper en mer sont très faibles. Vous engagez de l'argent de manière indue ».
Le préfet maritime nous a demandé de répondre à ce représentant du FIPOL. Nous avons répondu très vertement que si les chances de pompage étaient effectivement faibles, il fallait quand même essayer pour minimiser la quantité de polluant devant arriver sur les plages. Le préfet maritime, sur la base de cet échange, a maintenu la décision et a engagé les bateaux hollandais et allemand. Le bateau allemand n'a pas fait grand chose, mais le bateau hollandais a effectué du bon travail.
M. le Président : Vous nous fournirez ces deux courriers .
M. Michel GIRIN : Avec plaisir.
M. François CUILLANDRE : Le CEDRE est une structure souple avec des moyens limités aux plans humain et financier, même si les dernières décisions du dernier CIADT vont pouvoir améliorer les choses. Ne peut-on pas imaginer une meilleure articulation avec des structures plus importantes ? Je pense notamment à IFREMER. Je me suis laissé dire que les relations étaient un peu tendues, notamment depuis le déménagement du CEDRE du site d'IFREMER vers le port de commerce.
M. Louis GUEDON : J'aimerais que vous apportiez deux précisions par rapport à votre intervention, M. le directeur.
La première concerne la communication, en raison de l'émoi qu'elle suscite dans les populations, sur le risque de cancer concernant le fioul de l'Erika. Dans les années 50, je me souviens qu'en matière de cancérologie trois théories prévalaient pour les tumeurs ou les hémopathies malignes: la théorie des mutants, la théorie virale, et la théorie chimique. Nous sommes là dans la théorie chimique. A l'époque, on ne se posait pas de problème, les toxicologues étaient les seuls compétents pour s'exprimer. Or, vous n'avez pas parlé de ces experts qui sont internationalement connus.
Depuis les années 50, les choses ont évolué. Les toxicologues ont toujours les responsabilités et les qualités qu'on leur reconnaît. Ils ont été concurrencés par une nouvelle spécialité que l'on appelle maintenant la cancérologie. Je n'ai pas entendu dans vos propos que la communication sur ce sujet, à l'endroit des populations, devrait être conférée à ces deux types de chercheurs, dont les publications internationales sont connues et qui ont seuls autorité pour s'exprimer.
La deuxième précision est relative aux bateaux de lutte contre la pollution en mer. Nous sommes maintenant à trois mois de l'événement, tout est retombé au point de vue des passions. Mais pendant l'événement, on a entendu les avis de personnalités autorisées totalement opposés à ce que vous venez de dire. Ces personnes sont venues nous dire que les bateaux français dont vous vantez les mérites par rapport aux bateaux étrangers étaient inefficaces et ne servaient à rien. Ils sont venus nous le dire sur le site. Aujourd'hui, vous en vantez les mérites. Nous avons constaté, nous qui étions sinistrés, que les navires français dont vous dites qu'ils sont maintenant formidables ont commencé à jouer un rôle après la venue en compétition des navires étrangers. En préalable, on est venu nous dire que le pompage était inutile et ne servait à rien.
Il est un peu difficile, quand on a vécu ces événements, d'entendre des propos inverses, à Paris, dans le calme d'un salon.
M. Michel GIRIN : Je souscris tout à fait à votre point de vue : c'est aux épidémiologistes de répondre et je préciserai que si vous allez sur notre site, vous verrez que la première personne à laquelle nous avons demandé un écrit sur ce sujet pour nous cautionner était le Professeur Baert du centre antipoison de Rennes, personne dont je respecte la compétence dans ce domaine. Il aurait fallu qu'une décision soit prise au niveau du PC POLMAR sur l'autorité habilitée à communiquer en matière d'épidémiologie et de risques pour la santé humaine, qu'on ne laisse pas les journalistes se précipiter sur toutes les personnes, y compris au CEDRE, qui ont tenté d'apporter des réponses avec ce qu'elles avaient.
M. Pierre MAILLE : IFREMER est membre du conseil d'administration du CEDRE et, à ce titre, est informé des études et des recherches menées. Historiquement, les directeurs d'IFREMER ont assuré des responsabilités au CEDRE. Jusqu'à l'installation du CEDRE dans ses nouveaux locaux, il existait une certaine proximité physique, puisque les installations du CEDRE se trouvaient à l'intérieur du campus d'IFREMER, à Brest. Le fait que le CEDRE se soit installé à un quart d'heure de ce site, dans ses propres locaux, n'a pas coupé ses liens avec IFREMER. Le site Internet est toujours le même. Bien entendu, les relations continuent. Mais peut-être que M. Girin peut expliquer la réalité de ces relations.
M. Michel GIRIN : IFREMER met deux personnes à notre disposition. Pour notre part, le fait de nous éloigner des locaux d'IFREMER ne correspondait pas à une quelconque rupture de nos relations, mais à une obligation technique. Il nous coûtait moins cher d'installer notre bâtiment là où se trouve notre plateau technique que de déplacer notre plateau technique là où était notre bâtiment. J'ajouterai que notre délégation Méditerranée reste sur le site d'IFREMER. Il n'y a aucune volonté d'éloignement. Toutefois je ne peux pas vous parler du point de vue d'autres personnes qui ont peut-être une vision différente des choses.
M. Louis GUEDON : Il ne fallait pas répondre !
M. Michel GIRIN : Nous nous sommes trouvés devant des journalistes nous disant que si nous ne répondions pas, ils considéraient que c'était un refus. Moi-même, je me suis retrouvé personnellement, à plusieurs reprises, dans cette situation où le journaliste nous disait : « Si vous ne répondez pas, j'écrirai quand même et avec ce que j'irai prendre ailleurs ».
Nous avons essayé de répondre en notre âme et conscience, mais nous sommes demandeurs d'une communication plus rigoureuse.
M. le Rapporteur : La position officielle sur la toxicologie a-t-elle évolué depuis le 21 décembre ?
M. Michel GIRIN : Non. Si vous relisez le texte du Pr Baert, on est toujours sur la même position.
M. le Président : Il s'agit de ce que les médias n'avaient pas repris à l'époque, et qu'ils ont repris depuis ?
M. Michel GIRIN : Si vous allez sur notre site, vous verrez que nous avons répondu à la toute dernière question posée par le laboratoire Analytika sur la viscosité du produit. Analytika a publié une norme AFNOR erronée, car ancienne et qui n'est plus valable.
S'agissant des bateaux de lutte contre la pollution en mer, je n'ai pas dit que les bateaux français étaient très efficaces. J'ai simplement estimé qu'à unités d'investissement égales, ils ont produit des résultats similaires à ceux des bateaux étrangers. Ils ont commencé à pomper le même jour. Ils n'ont pas été défaillants par rapport aux bateaux étrangers.
En revanche, tous les bateaux ont mis du temps à commencer à pomper parce que les conditions de mer ne leur permettaient pas d'aller sur le site. Les bateaux sont restés 3 jours à Brest.
M. Louis GUEDON : On est venu nous expliquer que ce n'était pas un problème de tempête. On est venu nous parler des pompes qui étaient totalement inadaptées et qu'il a fallu changer. Il faut dire les choses telles qu'elles se sont passées ! Il y a eu des problèmes techniques sur les pompes. Il ne faut pas nous parler de tempête quand on sait que le matériel était inadapté.
M. Michel GIRIN : Je vous répète ce que j'ai dit à la fin du colloque « 20 ans après l'Amoco-Cadiz » : je plaide co-responsable quant au choix du type de pompes, qui préconisait un système de pompage à grand débit dont nous pensions qu'il avait des chances de réussir. Nous pensions qu'avec ce genre de pompes, nous obtiendrions des résultats meilleurs qu'avec des pompes de plus petit débit. Nous avons peut-être commis l'erreur de suggérer à la Marine nationale de tenter l'opération avec une catégorie de pompes qu'il a fallu ensuite remplacer par une autre. Que celui qui n'a jamais essayé quelque chose en ayant pesé le pour et le contre de deux options me jette la première pierre. Mais cela n'a duré qu'une journée.
M. Louis GUEDON : M. le directeur, il ne faut pas hésiter à nous dire ce genre de choses !
M. Michel GIRIN : Si les bateaux qui viennent dans les eaux européennes avaient l'obligation de porter à bord une fiche technique du produit qu'ils transportent, nous pourrions gagner 3 à 4 jours dans les choix de techniques de lutte contre les pollutions en mer. Cela nous permettrait d'avoir les informations nécessaires sur la viscosité du produit et nous éviterait, ainsi, de perdre du temps dans la réalisation de tests.
M. le Rapporteur : Il faudrait nous préciser ce point.
M. Michel GIRIN : Le CEDRE fournit des fiches techniques antipollution aux bateaux français qui naviguent dans les eaux américaines. Ce sont des fiches sur le produit qu'ils transportent car, dans les eaux américaines, ils doivent être en mesure de faxer immédiatement l'information sur la nature du produit transporté et sur son émulsion. Cela permet ainsi aux autorités locales de savoir quel matériel leur est nécessaire. Si, dans le cas du naufrage de l'Erika, une telle fiche s'était trouvée à bord, nous n'aurions pas fait ce qui peut paraître aujourd'hui une erreur. Je suis demandeur parce que cette obligation existe pour les bateaux qui entrent dans les eaux américaines.
M. Gilbert LE BRIS : Vous dites que le CEDRE n'est pas à l'échelle géographique et médiatique d'un événement de l'ampleur de la pollution de nos côtes par la cargaison de l'Erika. On a pu effectivement constater l'inadéquation entre la théorie et la pratique, c'est-à-dire entre le discours du CEDRE selon lequel on doit ramasser les déchets polluants de telle façon et l'attitude des gens qui, les pieds dans le pétrole, veulent sauver des oiseaux et nettoyer la plage avec un enthousiasme parfois maladroit. Il y a un décalage entre les grandes espérances suscitées par la compétence technique du CEDRE et la réalité, sur le terrain, parfois différente.
Comment faire pour aboutir à une meilleure symbiose entre les préoccupations théoriques et les nécessités du terrain ? Des solutions, parfois frustes mais efficaces, peuvent-elles être mises en place ?
Ne faut-il pas aller vers un regroupement des moyens par secteur géographique ? Ne pensez-vous pas qu'il faudrait prépositionner en certains endroits du littoral français une annexe du CEDRE, des remorqueurs ou des bateaux capables d'intervenir sur la pollution, et des barrages flottants de manière à prévenir la pollution ? Ne doit-on pas envisager une nouvelle répartition géographique des moyens ?
De même, on a vu que les nappes ont disparu, puis réapparu. N'y a-t-il pas possibilité de marquer les nappes, dès l'origine, par coloration ou par des moyens magnétiques ?
La documentation, la recherche et l'expérimentation faisant partie de vos missions, avez-vous échafaudé les hypothèses les plus catastrophiques ?
Par ailleurs, on nous a indiqué que l'hypothèse de la rupture d'un navire en pleine mer, à une distance aussi grande de la côte que l'était l'Erika, n'avait jamais été étudiée. Autant on nous a assurés que les services français sont capables de gérer un navire qui arrive à la côte avec une pollution, circonstances à l'image de celles l'Amoco-Cadiz, autant il ne me semble pas devoir en être de même à une aussi grande distance de la côte. Le même raisonnement prévaut au sujet de la viscosité du fioul que contenait l'Erika. Les services sont compétents pour traiter des fiouls plus légers, mais pas des fiouls lourds, pour lesquels cela reste plus difficile.
Avez-vous donc travaillé sur une hypothèse aussi catastrophique que celle de l'Erika, quant au lieu, au phénomène même de la rupture du navire, voire même avec une explosion du carburant ?
De plus est-ce que la viscosité de carburants aussi lourds, avec une émulsion difficile, a été mise en équation dans une hypothèse travaillée ?
M. Michel GIRIN : Un accident assez similaire à celui de l'Erika s'est produit au Japon en 1997. Je suis personnellement intervenu sur les conséquences de cet accident. Vous en trouverez mention dans les lettres du CEDRE. On ne peut donc pas dire que le naufrage de l'Erika correspond à une situation dont on ne se savait pas qu'elle pouvait arriver. Il est arrivé quelque chose de similaire au
Nakhodka avec l'avantage que nous n'avons pas eu, comme les Japonais, l'avant du bateau qui a dérivé pour arriver sur un site touristique et l'arrière du bateau qui continue encore à fuir aujourd'hui par plusieurs centaines de mètres de fond.
L'accident de l'Erika est survenu avant que le CEDRE n'engage une réflexion approfondie sur les enseignements du naufrage du
Nakhodka et les moyens de faire face à un accident similaire. Chaque année, nous proposons à notre comité stratégique toute une gamme de sujets d'expérimentation et de recherche documentaire ; dans cette gamme, tout n'est pas retenu, pour des raisons budgétaires. L'étude d'un tel cas aurait vraisemblablement été avalisée par notre comité stratégique, dans un, deux ou cinq ans, en fonction de la sensibilité de ses membres ou de notre capacité à leur faire penser que cela pouvait arriver chez nous.
Je rappelle que nous sommes, au CEDRE, des conseillers qui avons pour mission d'attirer l'attention sur les risques potentiels et de chercher à anticiper. Il y a deux ans, un irradiateur de laboratoire a coulé au large des Açores. Quel plan et quelle organisation mettre en _uvre face à ce type de circonstances ? La réponse est : aucun. Nous avons proposé une réflexion sur un scénario identique dans les eaux françaises. La perspective que cela arrive étant mince, la recherche sur le sujet n'a pas été lancée. Je pourrais vous citer dix cas de pollutions susceptibles de se produire. Par exemple, il existe une étude très approfondie sur les munitions chimiques de la dernière guerre mondiale immergées en Baltique.
M. le Président : Si j'ai bien compris, le pétrole transporté par l'Erika représente 5 % des quantités d'hydrocarbures transportées dans le monde. C'est la raison pour laquelle la probabilité d'un accident avec ce type de pétrole n'avait pas été jugée suffisante pour justifier les recherches dont vous parlez ?
M. Michel GIRIN : Tout à fait. Il y a eu 4 accidents majeurs impliquant un déversement de plus de 70 000 tonnes de pétrole brut léger dans les eaux européennes. Jusqu'à présent, la grande crainte était celle d'un accident d'un pétrolier qui se casse avec 80.000 tonnes à bord. C'était le scénario le plus prévisible. Aujourd'hui, toute l'Europe va s'intéresser au scénario du
Nakhodka. Mais la seule chose dont nous avons pourtant la certitude est que le prochain incident sera différent. Toute la question est de savoir combien on veut dépenser pour étudier tous les scénarios possibles. Ce n'est qu'une question d'argent !
J'en reviens au décalage constaté entre sur la théorie et la pratique. Aujourd'hui, nous avons 10 personnes sur le terrain dans les PC. avancés. Aucun journaliste ne vient dire que cela ne marche pas. Aucun journaliste ne vient dire qu'il y a une distance entre ce que nous faisons et ce qui se passe sur le terrain. A partir du moment où la presse veut bien nous laisser le temps de travailler, nous pouvons effectuer notre mission. Le jour où la presse se précipite sur nous et où l'on apparaît en cravate, certains en déduisent que l'on se désintéresse de ce qui se passe sur le terrain. Croyez bien que je préfère être en blouson sur le terrain, mais il y a des jours où il faut que je sois dans la tenue où je suis aujourd'hui. Si l'on vient nous interroger dans un PC, on nous trouvera un peu distanciés de la personne du CEDRE qui s'active sur le terrain.
En fait, nous devrions répondre à la presse uniquement sur le terrain et, de préférence, en nous présentant les plus sales possible ! C'est une leçon que j'ai tirée de mon expérience personnelle !
S'agissant du secteur géographique, je tremble aujourd'hui quand je pense à la façon dont nous remplirions ce rôle, en cas d'accident en Méditerranée où nous ne disposons que d'une petite antenne.
Ce serait encore pire, s'il arrivait de nouveau un accident du type de la barge pétrolière qui a coulé en 1996 dans les Caraïbes, et qui a touché six pays différents de la région. Cette barge qui s'appelait « Vista Bella » n'a perdu que 1.000 tonnes de fioul, mais elle a touché six pays différents. En permanence des bateaux du style de celui qui s'est cassé ici passent dans les Caraïbes. Si je dois assurer une mission en Martinique ou en Guadeloupe, aujourd'hui, comment est-ce que je fais avec le personnel dont je dispose à Brest et que je dois déployer là-bas ?
Heureusement pour nous - malheureusement pour les gens du littoral - les accidents arrivent plus souvent sur la côte atlantique. Mais je dois bien admettre que nous ne sommes pas armés pour répondre efficacement à des accidents qui auraient lieu dans d'autres zones du littoral français.
M. Pierre MAILLE : Le problème de la pérennisation du recours à des gens formés par le CEDRE est à cet égard fondamental.
M. Michel GIRIN : Quant au marquage des nappes échappées de l'Erika, nous mettons actuellement en _uvre 20 bouées avec des balises qui sont connues et testées pour dériver en mer comme du fioul. Tous les jours, on lâche des bouées à partir de l'épave. La décision de les acheter a été prise il y a quinze jours. La même décision aurait pu être prise il y a 3 mois ou il y a un an.
Aujourd'hui on est capable de marquer un phoque avec une petite balise. On aurait pu techniquement mettre en place des mini-radeaux avec des mini-balises sur un certain nombre de nappes.
M. le Rapporteur : Il aurait fallu le faire tous les jours...
M. Michel GIRIN : Il s'agissait d'aller sur place et de marquer l'ensemble des nappes avec une multitude de balises. La balise coûte 3.000 francs l'unité. Si vous me demandez s'il est raisonnable d'avoir 200 balises comme celles-là, je vous répondrai par l'affirmative.
Cela n'aurait pas changé grand-chose dans la lutte elle-même, mais les balises nous auraient permis de contrôler l'évolution des nappes sur écran et en permanence. C'est un aspect médiatique et d'information vis-à-vis des gens qui sont à terre.
M. René LEROUX : M. Pierre Maille a parlé de la formation et du suivi de certains personnels par le CEDRE. Certains proviennent des DDE. Je voudrais vous demander si vous avez formé des personnes qui travaillent à la DRIRE (direction régionale de l'industrie, la recherche et l'environnement), car nous avons vu sur le terrain, pas forcément très rapidement et pas nécessairement avec les niveaux de compétence, des personnes qui avaient en charge des PC qui préconisaient des positions bien souvent différentes de celle du CEDRE. C'était difficile.
Par ailleurs, quelles sont vos relations aujourd'hui avec le FIPOL ? Il y a nécessité à engager des moyens complémentaires à ceux déjà engagés et relativement conséquents. Et je crois savoir que le FIPOL vous fait freiner des quatre fers quant au montant des investissements que vous préconisez dans la lutte contre la pollution de l'Erika.
Pouvez-vous nous le confirmer ?
Enfin, vous nous avez beaucoup parlé des médias. J'ai moi-même été confronté à cela. Les réponses que vous faites sont parfaitement justes. Il est tout à fait singulier d'être confronté à un journaliste qui veut entendre une réponse identique à l'idée qu'il se fait du problème. J'ai récemment participé à l'émission télévisée, « des racines et des ailes ». C'est une émission sérieuse. On a fait sentir le produit. Cela n'a pas été filmé et la journaliste a dit que cela ne l'intéressait pas. Elle m'a affirmé que le produit qui est arrivé sur Belle-Ile n'était pas tout à fait de la même nature que celui que nous avons reçu sur les plages de Loire-Atlantique. Il paraît qu'à Belle-Ile, les gens ont des malaises, présentent des maladies de peau. C'est en tout cas ce que les journalistes véhiculent ! Il y a ce grand épidémiologiste qui en a parlé, et finalement cela n'a jamais paru à travers les médias.
M. Paul DHAILLE : Nous parlons du naufrage de l'Erika, mais il peut y avoir d'autres pollutions. Avez-vous réalisé ou proposé des études sur des pollutions autres que par hydrocarbures et par produits chimiques ? Pourrait-on connaître la liste des études menées sur ces sujets ainsi que la liste des questions qui ont été posées et qui n'ont pas été suivies d'une étude ?
Vous avez déclaré que certaines sociétés pétrolières étaient membres de votre conseil d'administration. D'autres chargeurs interviennent-ils auprès du CEDRE sur d'autres types de pollution des eaux ? Je pense notamment à l'irradiation, qui peut être plus dangereuse qu'un certain nombre de pollutions. Y a-t-il, dans votre conseil d'administration, des compagnies d'assurance ou d'autres sociétés qui pourraient être intéressées par les moyens de combattre les pollutions en mer?
Enfin, la presse, me semble-t-il, a dénoncé la présence de la société TotalFina dans le financement de votre organisme. Mais comparés au chiffre d'affaires de n'importe quelle raffinerie, 900.000 F et 500.000 F de contributions financières, pour Elf et Total c'est une aumône ! Est-ce que l'on peut penser que ces compagnies pétrolières se donnent bonne conscience en vous octroyant ces quelques crédits ? Est-ce qu'elles subventionnent d'autres organisations ? Pouvez-vous avoir une idée approximative des sommes engagées dans l'étude des pollutions et de la lutte contre les pollutions par ces mêmes compagnies pétrolières ?
Ce qui me choque, ce n'est pas tellement que ces sociétés soient dans votre conseil d'administration, mais qu'elles y mettent aussi peu d'argent.
M. Bernard CAZENEUVE : Ma question concerne l'étendue des compétences du CEDRE au regard du type de pollution qu'il a à connaître. Le trafic maritime s'est considérablement mondialisé. 25 % du trafic mondial de matières dangereuses transitent au large de la Manche. Le risque de pollution par les hydrocarbures, s'il est réel, n'est pas le seul. Vos missions et vos investigations vont-elles au-delà des pollutions par hydrocarbures ?
J'ai le malheur d'être le député de la circonscription où se trouve l'usine de retraitement des déchets radioactifs de la Hague. Nous sommes censés pêcher des langoustes à huit têtes... Je connais bien la nature des contrôles qui s'imposent. Je constate qu'il n'y a pas eu un seul accident lié au développement de cette industrie nucléaire ou aux modes de transport utilisés pour ces produits. En revanche, il existe toute une série de contrôles concernant l'activité de ces industries, qui n'existent visiblement pas pour les secteurs susceptibles de causer les pollutions que vous avez à connaître.
Je voudrais revenir à la question de la toxicité du fioul transporté par l'Erika pour savoir si vous avez eu à formuler des propositions sur ces sujets. Pour ce qui concerne les activités nucléaires, l'Office de protection contre les rayonnements ionisants, rattaché au ministère de la Santé, effectue quotidiennement des centaines de contrôles sur toutes les installations radioactives, y compris sur les vecteurs de transport des produits nucléaires, dangereux ou non. Cet office de protection contre les rayonnements ionisants appuie également ses études sur des registres médicaux réalisés, soit par des services hospitaliers, soit part des professions libérales, et qui permettent d'avoir un ensemble de données épidémiologiques. Si je vous ai compris, il n'existe aucune étude épidémiologique, aucune banque de données sur l'impact d'une pollution par hydrocarbures et sur les dispositifs qui pourraient être mobilisés par les pouvoirs publics pour répondre à cette toxicité ?
Enfin, que s'est-il passé avec le ministère de l'environnement depuis le naufrage de l'Erika ?
M. Michel GIRIN : S'agissant de la formation réalisée par le CEDRE, je serai très bref. Interrogez le colonel Courtois, colonel de la zone de défense Ouest, pour vous rendre compte des difficultés qu'il a rencontrées pour mettre en place une cellule de lutte contre la pollution au niveau de la zone de défense. Ensuite, proposez-lui de faire une formation des personnels de la zone de défense au sujet des pollutions marines. Il se jettera dans vos bras en vous disant qu'il est enthousiaste et qu'il est prêt à le faire. Nous n'avons jamais pu organiser, faute de moyens financiers, une seule formation des personnels de la zone de défense sur les pollutions marines accidentelles. Le problème que nous avons rencontré est essentiellement le financement de cette formation.
En ce qui concerne le polluant arrivé sur Belle-Ile, n'oubliez pas que l'Erika contenait aussi son propre carburant. Il peut arriver à certains endroits des polluants différents. Toutes les analyses d'échantillons que nous avons eus en main correspondent à la cargaison de l'Erika. Cela ne veut pas dire que la totalité du polluant déversé provienne de cette même cargaison...
Le CEDRE joue un rôle d'expert pour le compte de l'Etat. Lors des réunions avec les représentants du FIPOL, nous nous livrons à des combats d'experts. Chacun exprime sa position. Notre position et celle des experts du FIPOL sont généralement assez divergentes. C'est normal puisque nous n'avons pas le même regard sur les choses. Eux ont le regard de l'argent ; nous avons le regard du résultat.
M. le Rapporteur : Qui arbitre ?
M. Michel GIRIN : Le décideur, c'est-à-dire le préfet. Mais le préfet, quand il arbitre, sait que s'il suit nos recommandations, il prend des risques financiers. S'il va dans le sens des experts du FIPOL, il s'expose à des risques de manifestations.
M. René LEROUX : Est-il vrai que certaines dépenses engagées par l'Etat ne seront pas prises en charge par le FIPOL ?
M. le Rapporteur : Existe-t-il un compte rendu des réunions d'experts autour des préfets concernés ?
M. Michel GIRIN : Nous avons un manuel de gestion de situations d'urgence en pollution qui explique qu'il appartient au gestionnaire de la crise de tenir des comptes rendus de toutes les réunions qui se tiennent. Les PC POLMAR mer et POLMAR terre ont des comptes rendus. Ces comptes rendus présentent davantage des prises de positions que des décisions.
M. René LEROUX : En l'occurrence, l'Etat abandonnera sa créance...
M. Michel GIRIN : L'Etat peut également se battre. Dans ce cas, nous serons avec lui pour nous battre. Le document que je vous communiquerai sur les bateaux de lutte contre la pollution montre bien que nous, experts, serons avec l'Etat pour nous battre et essayer d'obtenir du FIPOL qu'il se rallie à l'utilisation de moyens de lutte contre la pollution en mer. Les experts peuvent être démentis, d'un côté comme de l'autre. Nous espérons que notre position d'experts aidera l'Etat à défendre ses choix.
Les pollutions chimiques entrent dans notre domaine de compétences. Des entreprises chimiques, en particulier Rhône-Poulenc, sont représentées au sein de notre conseil d'administration. Comparez l'apport des pétroliers à celui des chimistes : mon souci est que les industries chimiques n'apportent aucune contribution financière au CEDRE aujourd'hui. Toutes les entreprises considèrent aujourd'hui que si un accident survient demain, il touchera un autre concurrent, et qu'elles n'ont donc pas à investir dans ce domaine.
Soyons clairs, la prévention des pollutions par produits chimiques accuse un retard de 10 ans par rapport aux mesures engagées par les compagnies pétrolières. J'aimerais qu'on essaie de rattraper ce retard avant qu'un accident se produise.
En ce qui concerne plus particulièrement la question des marchandises radioactives, je tiens à préciser que l'exemple que j'ai pris tout à l'heure ne concernait pas des produits irradiés, mais des irradiateurs de laboratoire, c'est-à-dire des appareils qui servent à radiographier. La France exporte chaque année 500 irradiateurs de laboratoires. Ils sont placés dans des conteneurs normaux avec leur petite cellule radioactive. Le conteneur n'est ni balisé, ni identifié, et part avec le reste de la cargaison.
D'un point de vue épidémiologique, un irradiateur de laboratoire au fond de l'eau, ne présente pas un grand danger. Mais s'il coule au milieu de la Manche, je peux vous garantir que le Gouvernement sera interpellé ! Il n'est pas nécessaire d'attendre cette extrémité pour prendre un certain nombre de dispositions au niveau français. On pourrait décider par exemple, quand on exporte un irradiateur de laboratoire, que le conteneur doit avoir une balise à bord. Cela nous éviterait en effet bien des soucis plus tard.
Le CEDRE ne possède pas de compétences en matière de radioactivité. Mais quand cet irradiateur a coulé au large des Açores, le ministère de l'Environnement nous a demandé où il se trouvait dans le bateau. C'était à nous de déterminer, ce qui n'était pas facile, s'il était dans la partie arrière du bateau - que l'on remorquait vers l'Espagne - ou dans sa partie avant - qui avait coulé.
M. le Président : Quelquefois on s'aperçoit qu'un conteneur, même lorsqu'il contient des marchandises dangereuses, est tombé juste avant que le bateau arrive à destination.
M. Michel GIRIN : Au niveau épidémiologique, je suis absolument d'accord sur le fait qu'il serait souhaitable de mener une réflexion approfondie sur le sujet. Cela existe au niveau de l'Académie des sciences américaine. Cela a été une base de départ pour lancer une réflexion au niveau européen. En résumé, si on veut le faire, on peut le faire.
Le ministère de l'Environnement recevait tous les jours notre synthèse. Nous avons répondu à ses multiples appels, et assisté à diverses réunions bilatérales. Comme avec tous les ministères qui se sont directement intéressé à cette pollution, des représentants du cabinet de la ministre de l'Environnement ainsi que des fonctionnaires, issus notamment de la direction de l'eau - qui était notre interlocuteur -.nous ont régulièrement contactés. Nous avons transmis au ministère de l'Environnement tout ce que nous savions, à chaque fois que nous le savions. Mon dernier contact avec ce ministère remonte à ce matin, au sujet des nouvelles nappes de fioul repérées.
Des compagnies pétrolières participent au budget du CEDRE, mais je suis d'accord avec M. Dhaille, elles pourraient participer davantage.
M. Paul DHAILLE : Est-ce que ces sociétés participent au financement d'autres organismes ?
M. Michel GIRIN : Elles participent au financement de tous les organismes similaires qui existent à travers le monde.
M. Paul DHAILLE : En France, vous êtes le seul organisme au budget duquel elles contribuent ?
M. Michel GIRIN : L'industrie pétrolière contribue au financement du CEDRE, de l'IFREMER, de l'IFP et également des autres grands instituts français par le biais de contacts portant sur des études et des analyses. Il en va de même à l'égard des organismes étrangers similaires. Financer l'amélioration des connaissances fait partie de la politique des compagnies pétrolières, ce qui n'est pas encore le cas dans l'industrie chimique. Cette dernière préférera financer la fondation Nicolas Hulot, par exemple. L'industrie pétrolière se soucie aujourd'hui des moyens de lutter contre les pollutions parce qu'elle se rend compte des effets d'une grande pollution. Elle doit donc faire des efforts pour améliorer la compétence qui existe.
M. Pierre MAILLE : Dans les pays étrangers, les compagnies pétrolières participent beaucoup plus au financement d'organismes similaires au CEDRE.
M. Paul DHAILLE : Et les compagnies d'assurance ?
M. Michel GIRIN : Notre comité stratégique comprend un assureur maritime, Skuld, qui est le seul assureur maritime réellement implanté en France. Il est entré l'année dernière pour voir comment l'assurance maritime pourrait s'intéresser à ce que fait le CEDRE, et comment elle pourrait intervenir pour faire en sorte que les choses se passent mieux dans une situation de crise. C'est une prise de contact toute récente et toute nouvelle.
M. Paul DHAILLE : Pouvez-vous nous dire si des études ont été réalisées sur le transport des produits irradiés ?
M. Michel GIRIN : Le CEDRE n'a mené aucune étude sur le transport de produits irradiés Le seul cas que je peux vous citer en connaissance de cause est celui où nous sommes intervenus dans une crise pour déterminer le lieu du conteneur. Mais il n'y a pas encore eu de décision d'engager quoi que ce soit sur les produits irradiés. Il y a encore deux ans, on nous disait que le transport des produits irradiés n'entrait pas dans le domaine de compétence du CEDRE : s'il arrivait quelque chose avec des produits irradiés, le CEDRE ne devrait être pas impliqué. Or quand l'événement est arrivé au large de l'Espagne, le ministère de l'Environnement nous a demandé de déterminer où se trouvait le conteneur en cause...
M. Pierre MAILLE : Par contre, des études ont été réalisées sur les colis dangereux.
M. Michel GIRIN : Elles concernent essentiellement les détonateurs et les produits dangereux comme les pesticides en sachets plastique, par exemple. En soi, ces colis ne sont pas dangereux, mais s'ils s'échouent sur les plages, ils peuvent constituer un vrai danger pour des populations qui se trouveraient à leur contact direct.
M. Vincent BURRONI : M. le directeur, vous avez dit tout à l'heure que vous auriez de grandes difficultés si une catastrophe arrivait en Méditerranée, compte tenu de l'implantation des principaux moyens du CEDRE sur la côte atlantique et du caractère limité de sa cellule en Méditerranée. En matière de prévention, quel est votre rôle exact de conseil technique ou d'aide à la décision concernant les équipements et les moyens à mettre en _uvre pour les plans POLMAR sur la côte méditerranéenne ? Au niveau des élus, on entend souvent dire, soit que les équipements existants sont inadaptés, soit qu'il y a manque de matériel. Je sais qu'une réunion est programmée dans les jours qui viennent avec le préfet des Bouches-du-Rhône par rapport à tout ce qui se produit et navigue dans le golfe de Fos au sein du port autonome de Marseille.
Pouvez-vous nous rassurer au niveau de la prévention des pollutions ? En effet, au niveau de la lutte contre les pollutions marines en Méditerranée, vous nous avez plutôt inquiétés.
Mme Jacqueline LAZARD : M. Girin, vous avez dit que vous fournissiez des documents d'information sur les produits pour les compagnies françaises appelées à partir dans les ports américains. Bien souvent, si vous aviez connaissance du produit transporté par les bateaux qui naviguent au large des côtes françaises, cela permettrait une plus grande rapidité d'exécution puisque vous n'auriez pas à réaliser de tests au préalable. Or il s'avère que les bateaux qui passent dans le rail d'Ouessant et qui transportent des matières dangereuses sont appelés à se signaler. Je suis étonnée qu'ils ne signalent pas le type de produit et qu'on ne puisse pas connaître la nature du produit transporté.
Par ailleurs, vous travaillez avec les armateurs français. Y a-t-il formation et information des personnels de direction des compagnies françaises de navigation, voire de leurs navigants eux-mêmes ?
M. Michel GIRIN : Si demain, un nouvel
Erika se produisait en Méditerranée, il faudrait très vite envoyer le maximum de matériels de la côte atlantique vers la Méditerranée. Il n'y a pas de quoi faire face à un naufrage similaire à celui de l'Erika
en Méditerranée. Il faudrait compter sur les stocks qui sont sur la côte atlantique.
Le rythme de renouvellement des matériels est relativement lent. Entre le moment où nous préconisons un matériel et celui où il arrive dans un stock POLMAR, il s'écoule 2 à 3 ans , parfois 5 ans. Ensuite, ce matériel reste 10 ans en stock, même si entre-temps on a trouvé qu'il y avait mieux. La durée d'existence d'un matériel dans un stock POLMAR est de 15 ans. C'est un peu long pour s'adapter à l'évolution de la technologie. J'aurais tort de vous rassurer sur ce point.
Pour la question posée par Mme Lazard, le bateau qui passe devant Ouessant va indiquer qu'il transporte du fioul, mais il ne communiquera ni le type, ni l'origine de ce fioul. En revanche, le bateau qui va aux Etats-Unis doit nous communiquer l'origine du fioul et ses composants. A partir de cela, nous élaborons une fiche technique. Si nous n'avons pas l'information, nous interrogeons le pétrolier producteur. De la sorte nous disposons, par exemple, de la viscosité du fioul, ce que nous n'avions pas quand le fioul est parti de chez Total dans le cas de l'Erika.
M. le Président : Est-ce que la France pourrait, à l'image de ce que font les Etats-Unis, demander des informations aussi précises sur les cargaisons ?
M. Michel GIRIN : Elle pourrait le demander pour les bateaux qui viennent dans nos ports. Mais 80 % de ce qui passe devant Ouessant ne va pas dans les ports français.
M. le Président : La France ne pourrait pas imposer un signalement de ce type dans nos eaux territoriales ?
M. Michel GIRIN : Non, car ces navires passent au large des eaux territoriales.
M. le Président : C'est donc au niveau européen que cette question doit être posée.
M. Michel GIRIN : Même les Turcs qui voient passer d'importantes quantités de marchandises dans le détroit du Bosphore, ne peuvent pas avoir d'exigences spécifiques sur l'identification et le signalement des produits transportés par les bateaux qui passent.
M. le Président : Hier soir, le comité central des armateurs français (CCAF) ne trouvait pas grand-chose à redire à l'idée que les Etats-Unis étaient un peu plus durs en matière de réglementation. Mais comme l'Europe montre des velléités de durcir elle aussi sa réglementation, le CCAF laissait entendre qu'il fallait favoriser l'adoption de dispositions internationales. J'observe néanmoins que les armateurs français s'accommodent de cette situation pour le moment.
M. Michel GIRIN : Est-ce que la couverture sociale que nous avons en Europe est identique à celle qui existe au Bangladesh ? Non, nous avons des règles plus prudentes et plus généreuses pour les personnes. Je pense que l'Europe pourrait faire preuve d'un certain pouvoir en décidant qu'elle impose aux bateaux qui viennent dans ses eaux certaines règles comparables à celles en vigueur aux Etats-Unis, ce qui serait toujours plus que les règles qui prévalent en la matière au Bangladesh.
Par ailleurs, j'ajouterai que l'indemnisation et la couverture auxquelles la France peut prétendre à travers le FIPOL sont les mêmes que celles du Bangladesh.
Je reprends l'exemple de la couverture sociale des Européens, supérieure à celle des pays en voie de développement : nous avons choisi, à travers le FIPOL, un système qui assure les pays en voie de développement d'une couverture en cas de dommages causés par des marins battant leur pavillon et recourant à des équipages de leur nationalité.
M. le Rapporteur : Avez-vous fait part de ces observations sur les fiches identificatrices des produits transportés à la Commission européenne ?
M. Michel GIRIN : Nous sommes membres du Comité consultatif sur la pollution par hydrocarbures - CCP. Nous sommes conseillers techniques et c'est un sujet qui a souvent été débattu en France.
Audition de M. Claude GRESSIER,
directeur des transports maritimes, des ports et du littoral,
au ministère de l'Équipement, des transports et du logement
(Procès-verbal de la séance du mardi 14 mars 2000)
Présidence de M. Louis GUEDON, Vice-président,
puis de M. Daniel PAUL, Président
M. Claude Gressier est introduit.
M. le Président lui rappelle que les dispositions législatives relatives aux commissions d'enquête lui ont été communiquées. A l'invitation du Président, M. Claude Gressier prête serment.
M. Claude GRESSIER : M. le président, madame et messieurs les députés, mon exposé liminaire se limitera aux aspects économiques du transport pétrolier. Je vous parlerai du transport pétrolier en général, de la flotte pétrolière française et également de l'attitude des compagnies pétrolières ainsi que de l'évolution de ce type de transport depuis un certain nombre d'années.
Actuellement, la flotte mondiale compte 7 030 pétroliers pour un tonnage de port en lourd de 289 millions de tonnes. Je précise sur ce dernier point que les tonnes de port en lourd sont une mesure de la capacité de transport des navires plus pertinente que les tonneaux de jauge brute pour le transport en vrac. Les tonneaux de jauge brute (tjb) correspondent au volume intérieur du navire : 1 tjb équivaut à 2,83 mètres cubes. Il s'agit d'un bon paramètre pour les navires de passagers. En revanche, il est plus intéressant de connaître la quantité de matière solide ou liquide qu'un vraquier peut transporter. C'est pour cette raison qu'il est préférable, dans leur cas, de se référer aux tonnes de port en lourd.
Le nombre total de pétroliers est à peu près le même que celui de 1975. En 1980, on comptait une centaine de navires supplémentaires - portant ainsi leur nombre total à 7 112 -, et le nombre de tonnes de port en lourd était de 339 millions.
De 339 millions nous sommes donc revenus à 289 millions de tonnes de port en lourd, du fait des contre-chocs pétroliers, des économies d'énergie subséquentes à ces chocs et du recours à d'autres énergies, notamment l'énergie nucléaire. Nous avons assisté ces dernières années - et ce point est important à souligner - à des variations des taux de fret maritime du pétrole, en fonction des chocs pétroliers, des contre-chocs et des politiques d'économie ou de substitution d'énergie plus ou moins importantes des différents pays du monde.
En 1980, la flotte française de pétroliers - je parle à la fois des Very Large Crude Carrier (VLCC), c'est-à-dire des transporteurs de brut, et des transporteurs de produits, c'est-à-dire des caboteurs et des transporteurs de produits raffinés - comptait 112 pétroliers. Une quarantaine d'entre eux étaient des transporteurs de brut, le reste étant des caboteurs et des transporteurs de produits raffinés. Aujourd'hui, la flotte française comporte 61 navires pétroliers, dont 15 transporteurs de brut et 46 caboteurs pétroliers. Ces chiffres recouvrent les navires sous pavillon métropolitain et ceux inscrits au registre de Kerguelen.
Depuis 1975-1980, les compagnies pétrolières se sont peu à peu désengagées du transport pétrolier. Auparavant, la plupart de ces compagnies possédaient une flotte de pétroliers soit directement, soit par l'intermédiaire d'une filiale. Elles s'en sont désengagées pour plusieurs raisons. La variation importante des taux de fret constitue sans doute le principal de ces motifs. Les compagnies pétrolières ont considéré, compte tenu de ces variations, qu'il était plus intéressant pour elles de procéder à des affrètements afin d'avoir une meilleure réaction par rapport au marché du transport tel qu'il se présentait.
Toutefois, le désengagement des compagnies pétrolières du transport pétrolier résulte également de leur volonté de se recentrer sur leur métier de base et d'atténuer leur responsabilité : à partir du moment où l'armateur est considéré comme entièrement responsable, elles ont préféré avoir recours à des armateurs indépendants plutôt que de faire ce travail elles-mêmes.
Les compagnies pétrolières ont donc eu recours à des pavillons de libre immatriculation ou de complaisance, à l'exception notable de deux grandes flottes pétrolières : celles d'Arabie Saoudite et d'Iran.
Le recours aux pavillons de libre immatriculation répond bien entendu à des soucis économiques qui laissent peu de place aux considérations de sécurité - car ces pavillons ne sont pas toujours suffisamment vigilants en termes de sécurité maritime - et incitent à rechercher de moindres coûts sociaux ou fiscaux.
En ce qui concerne le transport de pétrole brut en France, la loi de 1928 faisait obligation d'assurer ce transport sous pavillon français pour 66 % des tonnes-milles - tonnes multipliées par milles - importées. Cette loi a été respectée jusque dans les années quatre-vingt, avant qu'un certain nombre d'armateurs s'aperçoivent qu'elle était contraire à nos engagements communautaires et ne respectent plus cette législation.
La loi de 1992 a alors été adoptée. Elle comporte non pas des obligations de transport - qui seraient contraires à nos engagements communautaires -, mais des obligations de capacité : un pays a le droit d'avoir des capacités de transport sous pavillon national qu'il peut réquisitionner à tout moment en cas de nécessité.
Cette capacité de transport a été fixée, par décret, à 5,5 % des tonnages importés pour être raffinés, exportation déduite. Cela correspond à 50 % des tonnes-milles importées. Rapportée au volume des importations françaises de pétrole brut, cette capacité équivaut à celle fixée par la loi de 1928. En d'autres termes, cela correspond à 14 navires. Ces navires sont affrétés par les compagnies pétrolières à des groupes privés - à l'exception de la compagnie Mobil qui a conservé ses navires. Ces armateurs sont français ou étrangers : la Compagnie nationale de navigation, Euronav - dont un investisseur belge, M. Saveris, est présent au capital - ou Bergesen - à capitaux norvégiens - possèdent des navires sous pavillon français avec des équipes françaises de commandement à Paris.
En 1992, l'obligation de capacité a été assortie d'une permission de passer du registre métropolitain au registre des terres australes et antarctiques françaises - Kerguelen - créé en 1986.
Voici d'ailleurs le coût des registres et les coûts comparés, tels qu'on peut les estimer aujourd'hui.
Si l'on prend l'hypothèse d'un pétrolier ou d'un vraquier recourant à un équipage de 22 personnes, on peut considérer, bien que les coûts d'armement varient selon les armateurs, que la différence de coût entre un navire inscrit au registre des terres australes et antarctiques françaises (TAAF) et un navire sous pavillon de libre immatriculation avec un équipage étranger, est d'un peu moins de 1 000 à 1 500 dollars par jour.
Par ailleurs, la différence de coût d'exploitation entre un navire inscrit au registre métropolitain et un navire inscrit au registre des TAAF est de plus de 1 500 dollars. En d'autres termes, le différentiel de coûts entre un navire inscrit au registre métropolitain et un navire inscrit sur un registre étranger, peut être évalué à un peu plus de 2 500 dollars par jour, soit de 8 à 10 millions de francs par an. La différence de coût entre un navire inscrit au registre Kerguelen et un navire sous pavillon de libre immatriculation est, quant à elle, d'environ 3 millions de francs par an.
Ces chiffres doivent être rapportés aux taux d'affrètement. Le taux d'affrètement d'un pétrolier neuf, pour être équilibré, devra être de 45 000 dollars par jour. Les taux d'affrètement ont beaucoup varié - je l'ai dit - et sont même descendus jusqu'à 20 000 dollars par jour. Actuellement, ils se situent autour de 35 000 à 40 000 dollars par jour. Malheureusement, les taux d'affrètement des navires neufs sont à peu près les mêmes que ceux des navires anciens, ce qui pose un certain nombre de problèmes.
Nous pouvons considérer, en pourcentage, que le différentiel de coût d'un navire inscrit au registre Kerguelen par rapport à un navire de même catégorie battant pavillon de libre immatriculation représente 3 à 4 % du taux d'affrètement. En revanche, la différence entre un navire battant pavillon français et inscrit au registre métropolitain et le même navire battant pavillon de libre immatriculation se situe plutôt aux alentours de 7 %. Compte tenu des variations des taux de fret dont je vous ai parlé précédemment, ces différentiels ne sont pas négligeables.
Passons maintenant à la question de l'âge des navires. La flotte mondiale compte 800 pétroliers de plus de 100 000 tonnes, dont 350 ont plus de 20 ans. La flotte de VLCC - grands transporteurs de brut - est très âgée.
Si l'on se réfère plus précisément aux 61 navires pétroliers français, on constate un phénomène de vieillissement comparable à celui de la flotte mondiale. Ainsi, sur les 15 transporteurs de pétrole brut français, 8 bateaux ont plus de 23 ans, un navire a 19 ans et les autres ont moins de 7 ans. S'agissant des 38 caboteurs pétroliers français - j'ai mis de côté les navires stationnaires qui font du cabotage dans les DOM -, on compte 10 navires qui ont plus de 20 ans, 5 qui ont entre 15 et 19 ans, les autres ayant moins de 15 ans.
Du fait de l'âge important de la flotte française, le gouvernement a décidé lors du conseil interministériel de la mer qui s'est tenu à Nantes le 28 février dernier, de permettre à l'ensemble de la flotte pétrolière sous pavillon français d'être éligible au système des GIE fiscaux. L'objectif est de rénover une partie de cette flotte et de la rajeunir.
Le système des GIE fiscaux, mis en place en 1998 et qui a vraiment pris son essor en 1999, correspond à un coût fiscal de l'ordre de 25 % et présente un avantage pour l'armateur de l'ordre de 20 %. Je précise que le ministère de l'économie et des finances pensait que, compte tenu de l'obligation de capacité sous pavillon français prévue par la loi de 1992, il n'était pas utile de rendre les navires transporteurs de pétrole brut éligibles à ce système des GIE fiscaux.
Certains armateurs ont souligné que, du fait de l'âge élevé de la flotte, l'Oil pollution act pose des problèmes lorsque le propriétaire du navire est bien identifié et qu'il correspond à un GIE dont l'Etat fédéral américain peut invoquer la responsabilité illimitée.
L'Oil pollution act de 1990, qui pose des règles précises concernant à la fois l'âge des pétroliers et la responsabilité illimitée de l'armateur, a eu pour effet d'encourager la constitution de
single ship companies, c'est-à-dire des compagnies-écrans possédant un seul navire. Même si le phénomène existait auparavant, il s'est accentué pour détourner le principe de responsabilité illimitée prévu par l'Oil pollution act.
En application de la convention MARPOL, un certain nombre de pétroliers sous pavillon français vont sortir de la flotte dans les années qui viennent. Cette tendance a été renforcée par la charte signée en présence du ministre Jean-Claude Gayssot, il y a un mois. Tant les transporteurs de pétrole brut que les transporteurs de produits vont donc être renouvelés dans une proportion significative dans les années qui viennent.
Nous avons évalué le coût fiscal de ce renouvellement à environ 1 milliard de francs sur 5 ans pour les transporteurs de pétrole brut et à 500 millions de francs pour les transporteurs de produits.
M. le Rapporteur : M. le directeur, vous nous avez parlé uniquement des pétroliers. Disposez-vous d'indications particulières sur le transport des produits chimiques et le transport de matières nucléaires qui relèvent également du champ d'investigation de notre commission d'enquête ?
En ce qui concerne les registres d'immatriculation, j'ai l'impression que l'initiative norvégienne du Nis et l'initiative danoise du Dis ont donné, dans ces deux pays, des résultats assez spectaculaires. Votre direction pourra peut-être nous fournir des éléments à ce sujet. J'ai le sentiment que ces initiatives ont permis le développement de la flotte sous pavillons norvégien et danois. Je crois également qu'elles ont eu des répercussions bénéfiques pour l'emploi national, tout en attirant les personnels qualifiés d'autres nationalités sur les armements norvégiens et danois.
Si nous faisions de Kerguelen un registre fort, socialement garanti pour les personnels français et étrangers, et que nous accompagnions ce mouvement d'une communication forte, pourrions-nous aboutir à des résultats similaires à ceux du Nis et du Dis ? Ne s'agit-il pas d'un moyen de lutter contre l'insécurité ? Mais n'est-ce pas trop tard, lorsqu'on sait que le nombre de bateaux sous pavillon français, malgré les efforts des uns et des autres, continue à diminuer ? Bien évidemment, je vous demande votre sentiment personnel, ce qui n'engage en aucun cas votre ministère sur ce sujet.
Enfin, le système des GIE fiscaux est-il moins attractif que le quirat ? Pouvez-vous en évaluer le différentiel ? Est-ce, selon vous, la bonne formule ou en existe-t-il de meilleures ?
M. Claude GRESSIER : Je prends note de votre première question, M. le rapporteur, car je ne dispose pas ici de l'âge et des caractéristiques des chimiquiers et des transporteurs de matières nucléaires. Mais je vous ferai parvenir tous ces renseignements.
Cependant, sachez que des matières dangereuses sont également transportées dans les porte-conteneurs. Ils ont une obligation de signalement en vertu de la convention HAZMAT. Ils doivent, par ailleurs, obéir à certaines règles - ne pas mettre certains produits en contact par exemple. Je peux également vous indiquer que les chimiquiers et les transporteurs de matières nucléaires ont assez peu d'accidents.
Je répondrai d'abord à votre troisième question, puis je reviendrai au problème des registres. Le quirat avait un coût fiscal pour l'Etat de l'ordre de 35 % et un équivalent en subvention pour l'armateur de 25 à 30 %. Le GIE fiscal a un coût fiscal pour l'Etat de 25 % et un équivalent en subvention pour l'armateur de 20 %. Le différentiel est donc de l'ordre de 5 à 10 %. Même s'il est moins avantageux pour l'armateur, j'ai le sentiment que le système du GIE fiscal fonctionne.
La loi instaurant le quirat a été votée le 5 juillet 1996 et abrogée fin 1997. Pendant un an et demi, 23 navires de transport ont bénéficié du dispositif - dont 4 vraquiers secs, 5 pétroliers, 4 porte-conteneurs, 6 divers et 4 navires à passagers dont 3 ont été réalisés -, auxquels il convient d'ajouter 38 navires et vedettes de service - dont 19 Supply, petits navires desservant les plates-formes pétrolières, et 14 remorqueurs de la compagnie des Abeilles. Les quirats ont donc conduit à un investissement de 8 milliards de francs pour un coût fiscal de l'ordre de 2,8 milliards de francs.
Le GIE fiscal, voté en 1998, exige en contrepartie de l'avantage fiscal, que le navire soit inscrit au registre métropolitain ou à celui de Kerguelen pendant 8 ans. Quinze navires ont été agréés, dont 2 câbliers, 4 navires à passagers, 5 vraquiers et 4 porte-conteneurs. L'investissement total est de 3,6 milliards de francs pour un coût fiscal de 0,9 milliard de francs.
J'ai tendance à penser que 15 navires construits et immatriculés sous registre national - 13 si j'enlève les deux câbliers -, comparés aux 23 dûs aux quirats, ce n'est pas ridicule. J'ai le sentiment qu'il s'agit d'un mécanisme qui, même s'il est moins intéressant que les quirats pour les armateurs, est attractif, notamment par rapport aux mécanismes de même nature qui pourraient exister dans d'autres pays européens. Cependant, même s'il est compétitif, je suis tout à fait conscient que ce système ne répond pas à tous les besoins nécessaires au développement du pavillon français.
Bien entendu, ces propos n'ont pas de raison majeure d'être portés à la connaissance de la Commission européenne, les quirats n'ayant pas été notifiés, et le GIE étant un mécanisme de droit commun.
M. le Rapporteur : Le mécanisme quirataire avait tout de même été accepté par l'Union européenne.
Vous estimez donc que notre dispositif est aussi attractif que celui des autres pays européens. Mais qu'en est-il des dispositifs danois ou norvégien ?
M. Claude GRESSIER : Sur le plan de l'investissement, j'ai le sentiment que le GIE fiscal est l'un des dispositifs les plus compétitifs. Les Allemands avaient un système très compétitif, mais ils l'ont beaucoup atténué en raison de son coût fiscal très important.
M. le Rapporteur : Disposez-vous d'éléments de comparaison ?
M. Claude GRESSIER : Je peux les rechercher et vous les communiquer.
En ce qui concerne les registres d'immatriculation des navires, la combinaison du GIE fiscal et du remboursement de certaines charges, qui a été décidé lors du comité interministériel de la mer du 1er avril 1998, est un élément insuffisant pour un véritable développement des registres nationaux. Il faut reconnaître que la flotte française - mais nous y verrons plus clair à la fin de l'année 2000 car tous les navires quiratés ne sont pas encore entrés en flotte - reste quasiment stable depuis 5 ans à un niveau de 210 navires. On peut s'en réjouir et s'en inquiéter à la fois. En effet, cette flotte ne décroît plus, mais malgré la mise en _uvre de mécanismes tels que les quirats, elle n'a pas non plus augmenté. En fait, à chaque immatriculation d'un nouveau navire, un bateau déjà inscrit est sorti du registre national.
M. Paul DHAILLE : A combien peut-on estimer le renouvellement annuel de la flotte immatriculée sous pavillon français ? Combien de navires adhèrent à nos registres chaque année et combien en sortent ? Les navires sortants sont-il immatriculés ailleurs ou sont-ils mis à la casse ?
M. Claude GRESSIER : Un certain nombre de navires sortant du registre métropolitain ou de celui de Kerguelen sont placés sous d'autres pavillons, pour ensuite être vendus, voire mis à la casse plus tard.
Les mesures prises ne sont pas négligeables, puisqu'elles ont tout de même permis, malgré tout, un renouvellement de la flotte sous pavillon français : 36 navires sur 3 ans - l'année 1998 ayant été blanche -, ce n'est pas un chiffre ridicule si l'on tient compte du fait qu'un navire a une durée de vie de 20 à 25 ans. Je pense que l'on ira plus loin si l'on franchit un pas vers un registre plus performant.
Le mécanisme du GIE fiscal avantage plus les navires coûteux que les navires peu coûteux. Je veux dire par là que, lorsqu'un navire est coûteux, le surcoût de l'équipage, dont j'ai fait état tout à l'heure, est beaucoup plus faible par rapport à l'aide de l'équivalence en subvention de 20 % que pour un navire à faible prix, dont le différentiel est plus élevé même si l'équipage est moins important.
En ce qui concerne le registre Kerguelen, on pourrait tout d'abord se poser la question de savoir s'il faut le conserver ou s'il ne serait pas plus avantageux de mettre en place un registre métropolitain à tiroirs, traitant différemment notamment les ferries, dont les équipages doivent rester totalement français, et les autres activités de transport maritime pouvant recourir à une certaine proportion de main d'_uvre étrangère. Mais cette formule est probablement inconstitutionnelle. Même si la convention de Rome prévoit que l'on peut traiter de façon différente des marins de nationalités différentes sur un même bateau - suivant la législation de leur pays d'origine ou du pays de l'armateur notamment -, je ne pense pas que la Constitution française permette cela pour un navire inscrit au registre métropolitain.
La seule formule est donc celle que vous indiquiez : améliorer le registre Kerguelen. Il conviendrait tout d'abord de le rendre plus souple. Aujourd'hui, dans les faits, 35 % des marins des équipages des navires inscrits à ce registre doivent être français, ce qui est beaucoup pour des navires de petite taille. En effet, les avantages liés à la combinaison GIE fiscal-registre Kerguelen sont insuffisants pour des navires de petite taille, c'est à dire des bateaux de 20 000 à 30 000 tonnes de port lourd.
En revanche, pour des navires de 200 000 à 300 000 tonnes de port en lourd, on se situe dans des aides nettement plus importantes, au titre du GIE fiscal. La possibilité d'amortir un surcoût d'équipage est donc plus favorable.
Il nous appartient donc de rendre le registre Kerguelen plus souple, notamment pour les navires de petite taille, en n'étant plus aussi rigides quant à la part dans les équipages des marins français. Cela suppose de faire un pari avec les armateurs sur le développement de la flotte, et de convaincre les organisations syndicales que le développement de l'emploi y gagnera.
Par ailleurs, il convient d'introduire un corpus de règles applicable aux navires inscrits au registre Kerguelen, lequel permettrait de traiter les navires étrangers dans les conditions préconisées par l'Organisation internationale du travail (OIT), voire dans des conditions meilleures en ce qui concerne leur salaire de base, sans pour autant être totalement aligné sur les garanties qu'offre le droit du travail aux marins de nationalité française.
S'agissant du salaire de base, des accords sont en cours de négociation entre le Comité central des armateurs de France et les organisations syndicales au sujet du salaire minimum pour le personnel étranger travaillant sur les navires inscrits au registre des TAFF. Le niveau de ce salaire minimum devrait être supérieur aux planchers fixés par l'OIT.
En outre, développer la flotte sous pavillon français et maintenir les compétences suppose que l'ensemble des marins français, c'est-à-dire non seulement ceux qui naviguent, mais également ceux qui sont à terre et qui s'occupent du commandement des navires, soient pris en considération et associés aux décisions. Ce dernier point est extrêmement important, car nous avons besoin de capitaines au long cours, non seulement pour le pilotage, mais également pour commander les ports, pour travailler dans les compagnies de remorquage et pour effectuer les contrôles de l'Etat du port.
En résumé, la seule voie constitutionnelle qui puisse dynamiser le pavillon national passe par la négociation d'une revalorisation du statut des marins employés sur les navires inscrits au registre national en contrepartie d'une souplesse accrue dans leur management.
L'accompagnement économique de ces mesures passe par des initiatives plus ambitieuses que celles mises en avant par la Commission européenne en matière de remboursement des charges sociales. Actuellement, l'Etat rembourse certaines charges sociales supportées par les navires battant pavillon français et soumis à une forte concurrence internationale - ce qui représente un coût de l'ordre de 150 millions de francs par an. Jusqu'à présent, cette mesure ne concernait pas les navires qui naviguent entre la France continentale et la Corse ; ils y seront éligibles cette année. Si l'Etat décidait de rembourser d'autres charges telles que celles des ASSEDIC et les cotisations familiales, il supporterait un coût supplémentaire d'environ 160 millions de francs.
Il faut être conscient que le surcoût du registre Kerguelen par rapport aux registres internationaux n'est pas principalement imputable aux salaires. Il est surtout dû aux charges sociales et aux coefficients de relève, c'est-à-dire aux congés. En effet, le coefficient de relève des marins français est de 1,8 - c'est-à-dire qu'il faut 1,8 équipage pour faire tourner un bateau toute l'année -, contre 1,4 en moyenne dans les autres pays européens.
En France, les marins bénéficient de 22 jours de congés par mois d'embarquement, alors que les marins étrangers n'ont droit qu'à 8 jours - et parfois ces jours sont pris après une année complète, l'armateur faisant appel à un second équipage pendant la durée des congés du premier. J'insiste sur cet élément car il ne s'agit pas d'un paramètre négligeable, mais bien d'un facteur important de détermination du coût supporté par l'armateur.
Pour répondre de manière plus synthétique à votre question, M. le rapporteur, les seuls variables sur lesquelles il est possible de jouer pour promouvoir le pavillon français sont : la souplesse du registre de Kerguelen ; le nombre de marins français obligatoire à bord, qui peut être indexé sur la taille des navires ; les charges sociales.
Comme vous le savez, ce type de débat est actuellement en cours, puisque le ministre a demandé à deux inspecteurs généraux MM. Hamon et Dubois, d'établir un rapport qui sera rendu public dans les jours qui viennent De nombreuses discussions ont été menées avec les partenaires sociaux. Des propositions devraient être formulées au Comité interministériel de la mer du mois de mai.
J'ajouterai, de manière incidente, un point qui me paraît essentiel : Il est nécessaire de rendre les navires de croisière - ceux qui sont actuellement immatriculés à Wallis-et-Futuna et non les ferries - éligibles au registre des TAAF. Le dernier paquebot immatriculé à Wallis-et-Futuna, le
Mistral, a d'ailleurs donné lieu à des débats difficiles jusqu'à son inauguration par le Premier ministre.
M. Gilbert LE BRIS : Les pétroliers ne sont pas en principe des bateaux d'une grosse technologie. Leur construction peut donc tout à fait se faire hors de France. On perd ainsi le double effet traditionnel, c'est-à-dire l'effet armement et l'effet chantier. N'existe-t-il pas d'autres solutions pour aider à la construction de pétroliers sans passer par les GIE fiscaux ?
Par ailleurs, quelle est la position de la France en ce qui concerne le concept de pétrolier E3 ?
M. Claude GRESSIER : Malheureusement, M. le député, vous avez totalement raison : il n'y aucune chance qu'un pétrolier soit construit dans un chantier français ! Par ailleurs, cette probabilité est très faible en ce qui concerne les chantiers navals européens. Les vraquiers et les pétroliers sont des navires qui requièrent une technologie relativement simple - un grand pétrolier coûte actuellement 70 millions de dollars, ce qui n'est pas comparable avec le paquebot
Queen Mary qui vaut 4 milliards de francs la pièce !
En revanche, les navires à passagers et les navires de transport de marchandises qui requièrent une technologie avancée, dans des domaines divers, intéressent beaucoup les chantiers français - notamment les chantiers de l'Atlantique - et européens, lesquels possèdent les compétences nécessaires. Je veux, bien entendu, parler des chimiquiers, des gaziers, des dragues, des câbliers, des ferries et des remorqueurs qui sont autant de catégories de navires pour lesquels les chantiers navals français et européens maîtrisent les savoir-faire, les compétences et la productivité nécessaires.
En ce qui concerne le E3, il s'agit d'un navire plutôt à double pont qu'à double coque. Un navire à double coque présente des avantages importants à petite vitesse en cas de choc. En revanche, en cas de choc à grande vitesse, la double coque n'empêche pas la fuite du pétrole. Par ailleurs, entre les deux coques, il peut se produire des émanations de gaz pouvant provoquer des explosions.
Les chantiers navals français et la chambre syndicale des constructeurs de navires ont imaginé un excellent navire, rigide et à double pont. Malheureusement son coût est élevé, et c'est l'une des raisons pour lesquelles il n'a pas emporté, jusqu'ici, de conviction internationale. La solution serait peut-être d'y travailler avec certains de nos collègues européens, car mis en balance avec des catégories de navires moins sûres mais plus économiques, il y a fort à parier que le pétrolier E3 ne connaîtra pas un succès commercial.
M. Edouard LANDRAIN : M. le directeur, si j'ai bien compris, la flotte française de pétroliers est assez âgée. Il est donc nécessaire de la renouveler, d'autant que les normes nouvelles nous y obligent.
A votre avis, en combien de temps le stock mondial de pétroliers pourra-t-il être renouvelé ? Quelle est la capacité de l'ensemble des chantiers mondiaux ? Sera-t-elle suffisante ? On nous dit que les Américains voudraient imposer ce renouvellement en 10 ans : est-ce possible ?
En France, nous n'avons plus de chantiers capables de construire les pétroliers, nous nous adresserons donc à l'étranger. Quel est le coût du renouvellement de la flotte française et à combien se monteront les aides nécessaires ? En fonction du coût de ce renouvellement, ne serait-il pas plus intelligent de rouvrir certains chantiers que l'on vient à peine de fermer ?
M. Claude GRESSIER : En ce qui concerne les grands transporteurs de pétrole brut, 8 navires de plus de 23 ans sont à remplacer dans les 5 ans, compte tenu, d'une part, des dispositions de la convention MARPOL, et, d'autre part, des engagements pris avec la charte dont je vous ai parlé tout à l'heure. Si nous les aidons par le biais du GIE fiscal, le coût sera de 1 milliard de francs sur 5 ans. Pour les caboteurs et les transporteurs d'hydrocarbures plus petits, le coût serait de l'ordre de 500 millions de francs. Par conséquent, le renouvellement de la flotte pétrolière française présente un coût fiscal total de 1,5 milliard de francs sur 5 ans. A raison de 300 millions de francs par an, ce coût n'est pas démesuré.
La capacité des chantiers sera-t-elle suffisante ? Je pense que oui, car je ne suis pas sûr que toute la flotte mondiale doive nécessairement être remplacée. La destruction d'un certain nombre de navires anciens permettra peut-être aussi d'assainir le marché du transport maritime pétrolier.
Nous sommes revenus à une surcapacité moins forte que celle qui existait il y a quelques années. Toutefois, il existe encore quelques très gros navires de 450 000 tonnes qui, construits dans les années 1973-1976, ne nécessiteront pas d'être remplacés lorsqu'ils seront mis à la casse. Je crois donc qu'au plan mondial, la surcapacité est telle qu'il ne sera pas nécessaire de remplacer la totalité des navires hors d'âge dans les 5 à 7 ans à venir. De ce fait, les chantiers navals pétroliers sont en mesure de répondre aux besoins de renouvellement de certaines flottes, comme c'est le cas de la flotte française.
M. Edouard LANDRAIN : Même s'il existe une obligation d'avoir - en Europe comme aux Etats-Unis - des pétroliers plus sécurisés ?
M. Claude GRESSIER : Oui, tout à fait. Indépendamment des propositions françaises, la convention MARPOL - notamment dans ses annexes XIII F et XIII G - impose des obligations assez strictes telles que la double coque. Mais les échéances fixées sont un peu plus lointaines que ce que nous proposons aujourd'hui, ainsi que ce que prévoit aux Etats-Unis l'Oil pollution act et en France la charte de sécurité des transports pétroliers signée récemment au ministère de l'équipement, des transports et du logement. Quoi qu'il en soit tous ces pétroliers doivent disparaître selon les cas d'ici à 2015 - calendrier de la convention MARPOL - 2010 - calendrier de l'Oil pollution act - ou 2008 - calendrier proposé par la France au niveau européen. Or, d'ici là, les navires construits en 1973 auront disparu.
Mme Jacqueline LAZARD : M. le directeur, je voudrais que l'on revienne à la sécurité liée aux équipages, et donc aux pavillons. Vous nous avez dit qu'il était nécessaire, voire souhaitable, pour la compétitivité des armements et pour maintenir l'emploi, de rendre le registre Kerguelen plus souple.
Vous avez par ailleurs précisé que le surcoût était lié aux charges sociales et à la durée des congés des marins français - qui sont en majorité des officiers -, les marins étrangers restant quelquefois six mois à bord, voire un an, avant de se mettre en congé.
Ne prend-on pas un risque lorsqu'on a affaire à un personnel qui est sur le navire 24 heures sur 24 et qui ne prend aucun jour de repos ?
J'aimerais également évoquer l'autre problème lié à la volonté d'assouplir le registre Kerguelen. Celle-ci n'induit-elle pas la disparition, à terme, des marins français ?
M. Claude GRESSIER : Lorsque je vous ai parlé de l'assouplissement du registre Kerguelen, j'ai bien fait la distinction entre les petits et les gros navires. Compte tenu du GIE fiscal, je crois que l'on peut maintenir la compétitivité des gros navires battant pavillon français en conservant une partie plus importante de marins français. En revanche, cela me paraît extrêmement difficile pour les petits navires.
En ce qui concerne les risques liés au personnel étranger, il est vrai qu'il y a, sur ces navires, un corpus de règles sociales qui doit être instauré pour les marins étrangers. Il faut que l'ensemble des conventions de l'OIT soit ratifié par la France - ce qui n'est pas encore le cas puisque cinq ou six ne l'ont pas été - et appliqué sur les navires inscrits aussi bien au registre métropolitain qu'à celui des terres australes et antarctiques françaises.
Cela étant dit, il est vrai qu'aujourd'hui, notamment sur les pétroliers, les marins français bénéficient de 22 jours de repos par mois d'embarquement. La moyenne étant de 18 jours de repos par mois d'embarquement, cela aboutit à des surcoûts tout de même importants. Et je suis persuadé que l'on peut trouver, avec les personnels étrangers, des règles d'emploi qui leur permettent de se reposer, de prendre des congés, sans que cela coûte aussi cher que ce que coûtent aujourd'hui les marins français.
Cela induirait-il la disparition, à terme, des marins français ? Ce que vous dites n'est pas faux : les marins français sont en majorité des officiers. Je pense que l'on peut retrouver des marins compétents dans l'ensemble des domaines si l'on effectue une certaine différenciation entre les navires relativement petits - pour lesquels il convient de diminuer le pourcentage de marins français et d'accepter que ceux-ci occupent les fonctions d'officiers de tête - et les gros navires - où la proportion de marins français pourrait être relevée, compte tenu des avantages du GIE fiscal.
D'autre part, je crois que la profession des marins français pourra être préservée, si l'on arrive à placer ces personnels sur les navires de croisière que les chantiers navals nationaux réalisent. Actuellement, les chantiers de l'Atlantique construisent 15 navires de croisière par an environ, et nous n'arrivons pas à intégrer des marins français parmi le personnel. Sur le seul
Mistral, nous avons réussi à faire travailler 60 marins français ! C'est-à-dire dix fois plus que sur un navire moyen inscrit sur le registre Kerguelen !
Les marins français pourraient donc être plus nombreux dans les équipages des navires coûteux - vraquiers et chimiquiers enregistrés au registre Kerguelen où le GIE fiscal compense plus facilement leur surcoût - et dans les équipages des navires de croisière - qui, je le dis au passage, seront de plus en plus nombreux si l'on autorise les jeux à bord !
M. le Rapporteur : Nous allons recevoir
M. Fernand Bozzoni qui, si j'ai bien compris, a l'intention d'immatriculer ses pétroliers au Luxembourg et à d'autres registres après avoir longtemps milité en faveur du pavillon national. Par ailleurs, M. Vincent Bolloré, qui avait déclaré qu'il ne quitterait jamais le pavillon national, vient de le faire. Qu'en pensez-vous ?
M. Claude GRESSIER : Il s'agit de deux cas assez différents.
M. le Rapporteur : Le problème est que l'opinion publique ne saisit pas forcément cette différence.
M. Bolloré a joué les deux extrêmes. Il a été président du Comité central des armateurs de France, avant d'entretenir des relations plus tendues avec ce même comité. Ensuite, il a pris des options complètement différentes en ce qui concerne le pavillon de ses navires : il a considéré qu'il n'y avait pas de politique maritime en France et il a décidé de ne plus avoir affaire à qui que ce soit. Il n'a donc pas demandé le remboursement de ses charges sociales en raison des contreparties exigées en retour. Il n'a pas non plus demandé à bénéficier du GIE fiscal afin de ne pas être obligé de conserver le pavillon français pendant 8 ans.
Je considère ce genre d'attitude comme un signal d'alarme : si nous ne faisons rien, d'autres suivront. Or si notre pavillon n'est pas dépourvu d'atouts, ils ne sont pas suffisants. Je pense notamment aux problèmes des registres et de l'exploitation ainsi qu'à la compensation des charges sociales.
Nous avons réussi, depuis environ 5 ans, à maintenir la flotte sous pavillon français. Cependant, nous devons franchir un pas supplémentaire si nous ne voulons pas voir d'autres armements suivre l'exemple de M. Bolloré.
Bien entendu, nous ne devons pas céder au catastrophisme. Je peux vous citer des cas encourageants : le groupe CMA-CGM vient d'acquérir une série de porte-conteneurs, dont 4 grâce à un GIE fiscal et sous pavillon français. Ce groupe se développe de façon remarquable en possédant toujours une flotte française importante et un nombre de marins et d'officiers français non négligeable. Néanmoins, il nous faut prendre garde au signal émis par M. Bolloré car il est révélateur de la situation présente.
L'attitude de M. Fernand Bozzoni s'inscrit dans un contexte différent. M. Bozzoni a été traumatisé par les réactions brutales de TotalFina, suite au naufrage de l'Erika, au sujet de l'âge des navires pétroliers en circulation.
Avant que la charte des opérateurs du secteur ne soit discutée puis signée en présence du ministre, TotalFina a interprété à sa façon le problème de l'âge des navires. Au prétexte que certains navires de M. Fernand Bozzoni sont âgés, cette compagnie a, du jour au lendemain, refusé de continuer à y recourir en charte partie. Bien entendu M. Fernand Bozzoni
a d'autant plus mal vécu ce procédé que, non seulement il défendait le pavillon français, mais de surcroît il entretenait ses navires correctement.
Cela étant je ne désespère pas de le voir renouveler sa flotte en profitant des GIE fiscaux, comme son collègue de Bordeaux, Pétromarine, est en train de le faire au sujet de 2 transporteurs de produits.
Audition de MM. Roger PEREON, Président,
et Patrick PAYAN, secrétaire général,
de la Fédération française des pilotes maritimes
(extrait du procès-verbal de la séance du 15 mars 2000)
Présidence de M. Daniel Paul, Président
MM. Roger Péréon et Patrick Payan sont introduits.
M. le Président leur rappelle que les dispositions législatives relatives aux commissions d'enquête leur ont été communiquées. A l'invitation du Président, MM. Roger PEREON et Patrick PAYAN prêtent serment.
M. Roger PEREON : Madame et Messieurs les députés, les pilotes maritimes sont des acteurs indispensables du transport maritime fréquentant les ports français métropolitains et d'outre-mer.
Commissionnés par l'Etat, les pilotes fournissent une assistance pour la conduite des navires à l'entrée et à la sortie des ports, dans les ports, rades et eaux maritimes des fleuves et des canaux.
Leur mission première consiste à la fois à assurer la sécurité de la navigation, mais aussi la protection des installations portuaires et la protection de l'environnement.
En France, en Europe et pratiquement dans le monde entier, tous les navires - sauf les cas d'exemption prévus réglementairement - doivent faire appel aux pilotes dès qu'ils pénètrent dans la zone de pilotage obligatoire.
En France, les cas d'exemption répondent à des seuils de longueur puisque les navires d'une longueur inférieure à cinquante voire soixante-dix mètres sont exemptés de pilotage.
En sont également exemptés les navires dont le capitaine a obtenu une licence de capitaine-pilote après un examen et une fréquentation régulière du port. En ce cas, le pilote conserve le contrôle des opérations même s'il ne monte pas à bord.
Dans les faits, seuls les transbordeurs sont bénéficiaires de la licence.
Les pilotes, intervenants sur tous les navires, sont les seuls en mesure d'apprécier l'état de marche des bateaux qu'ils assistent. Comme ils ont tous une expérience éprouvée de la navigation du fait de leur carrière antérieure - tous les pilotes sont des capitaines au long cours ou des capitaines de première classe de la navigation maritime, recrutés par concours après dix à douze ans de navigation au large - ils peuvent juger d'un certain nombre d'éléments, en particulier de ceux influant sur la sécurité maritime.
Le plus important est que ce jugement s'effectue en toute indépendance. Le pilote n'est pas l'employé de l'armateur comme le capitaine, même si c'est l'armateur qui supporte les frais de pilotage dont l'assiette est le volume du navire et non la difficulté de la prestation.
Ce n'est que récemment que la participation active des pilotes dans le signalement des navires a été mise en _uvre.
Auparavant, l'obligation de rapport du pilote ne concernait que l'environnement extérieur, c'est-à-dire le balisage, l'état des fonds, les accidents ou incidents survenus en cours de navigation au pilotage.
La première directive européenne sur le sujet date de 1979, mais il a fallu attendre 1993, puis 1995, pour que le contrôle par l'Etat du port soit matérialisé.
Concernant le pilotage français, une modification du règlement général du pilotage, datant du 7 avril 1995, fait obligation au pilote, en plus de ses obligations de rapport antérieurement prévues, de rendre compte de « l'état du navire lorsqu'il présente un risque pour les personnes à bord, la cargaison, les autres navires, les installations portuaires ou l'environnement. »
Ce devoir de signalement a trouvé toute sa place dans le fonctionnement du système assurance-qualité - certification ISO 9002 - mis en _uvre depuis 1997 sous l'égide de la Fédération française des pilotes maritimes.
Nous disposons d'une source d'informations intéressante concernant les non-conformités rencontrées. Nous réalisons actuellement leur centralisation sur le site Internet de la Fédération française des pilotes maritimes - FFPM - et nous allons encourager l'extension du même système d'échange d'informations au niveau européen par l'intermédiaire de l'Association européenne des pilotes maritimes - EMPA - dont je suis l'actuel président.
Depuis 1995, nous avions tenté de mettre en place un tel système d'information entre pilotes européens à travers ce que nous avions appelé le RISAP ou
Reporting informations system among pilots.
La lourdeur du procédé technique - qui faisait appel à l'utilisation de fax entre stations - et la réticence du marin à l'écriture n'ont pas permis un bon fonctionnement de ce système. Si l'expérience française est concluante via Internet, nous allons relancer cette idée au niveau européen.
Les constatations effectuées par les pilotes au cours de leurs missions ne concernent que l'état apparent du navire, ses capacités de conduite et de man_uvre ainsi que la qualité des équipages, mais elles fournissent des indications intéressantes sur l'ensemble des aspects de la sécurité maritime.
Ce bref exposé sur le rôle du pilote a été centré sur le pilotage portuaire. Le pilotage hauturier français, qui est également membre de la Fédération française des pilotes maritimes, procède de la même mission de sécurité de la navigation mais n'est quasiment pas réglementé parce que n'ayant pas de caractère obligatoire.
Les pilotes, capitaines expérimentés, acteurs permanents de la sécurité maritime, sans être directement concernés par le naufrage de l'Erika
dans leur activité, ont tenu à mettre leur expérience à la disposition des pouvoirs publics et à faire des propositions pour améliorer la sécurité maritime et éviter le renouvellement de telles catastrophes dramatiques pour l'environnement. Ils en ont fait part à M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'Équipement, des transports et du logement avant la table ronde du 10 février, à laquelle nous n'avons pas été invités, ce que j'estime tout à fait logique.
Nous devons constater que depuis le courrier que nous lui avons adressé le 1er février, le Gouvernement a pris beaucoup d'engagements positifs dans le domaine de la sécurité du transport maritime pétrolier :
- le 10 février, signature de la charte de la sécurité maritime des transports pétroliers ;
- le 15 février, intervention du Premier ministre pour annoncer l'envoi d'un Mémorandum à l'Union européenne, à l'OMI - Organisation maritime internationale - et au FIPOL - Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures ;
- le 28 février, comité interministériel de la mer qui décide de nombreuses mesures visant à améliorer l'action de l'Etat en mer, à améliorer l'organisation du dispositif national d'interventions, et à apporter un soutien économique au pavillon français.
La Commission européenne a, elle aussi, lancé un programme d'actions pour les mois à venir. Nous nous réjouissons bien évidemment de cette prise de conscience et de ces mesures.
Nous pensons cependant que toutes ces mesures n'ont pas intégré cet élément majeur que représente le pilotage hauturier pour l'amélioration de la sécurité maritime dans les parages de la Manche, du Pas-de-Calais et de la Mer du nord.
L'exercice de cette activité au large, dans les eaux internationales, est fortement limité par l'absence de réglementation due au principe de liberté de circulation en mer.
Pourtant, la densité du trafic des navires transportant des marchandises dangereuses à proximité de nos côtes imposerait que l'on confie la navigation de ces navires à des spécialistes.
Le développement de cette activité apporterait une amélioration certaine, tant pour la sécurité de la navigation elle-même que pour les liaisons avec les autorités maritimes à terre et les centres régionaux opérationnels de sécurité et de sauvetage -CROSS.
La création d'une obligation de pilotage pour certains navires permettrait une meilleure organisation de cette activité au niveau européen et maintiendrait la présence française au sein de celle-ci. Actuellement, le pilotage hauturier français ne compte que 4 pilotes.
A ce jour, la réglementation concernant cette forme de pilotage repose sur la directive 79/115 CEE, qui n'est qu'une recommandation pour les navires battant pavillon des Etats membres d'avoir recours à des pilotes hauturiers européens. Elle repose également sur un décret du 2 mai 1979 qui crée le certificat de pilote hauturier, et sur un arrêté du 27 décembre 1979 qui fixe les modalités de cet examen.
Un renforcement de ces règles devient d'ailleurs urgent car la situation de la navigation dans le Pas-de-Calais est de plus en plus préoccupante : souvenons-nous de l'accident du 30 août 1999 entre le porte-conteneurs
Ever Decent et le paquebot Norvegian Dream où, sans nul doute des erreurs de navigation ont été commises.
Une autre de nos suggestions consiste en la création d'une équipe d'intervention immédiate pour l'évaluation des risques et l'aide à la prise de décision. Il s'agirait d'une équipe d'évaluation capable de dresser un diagnostic lorsqu'un navire, au large, donne des inquiétudes. Nous sommes conscients de la difficulté d'imposer cette mesure dans les eaux internationales. Peut-être est-il envisageable, lors du contrat d'affrètement, d'obliger l'armateur à se conformer aux décisions que prendrait le préfet maritime après avis de cette équipe d'intervention, cela au moins pour les navires qui font escale dans les ports français ? Les pilotes, qu'ils soient portuaires ou hauturiers, sont prêts à apporter leur compétence au sein d'une telle équipe.
L'accident de l'Erika démontre que, malheureusement, le transport maritime comporte des risques qui ne sont pas encore éradiqués. Les progrès techniques et la réglementation s'y emploient, mais les impératifs de sécurité et de rentabilité sont souvent contradictoires. Il nous semble évident que, s'agissant du transport de marchandises dangereuses pouvant avoir de graves conséquences, le maximum de précautions doivent être prises pour la sécurité des personnes et la protection de l'environnement.
Fort heureusement, le naufrage de l'Erika
n'a pas fait de victimes humaines. La sécurité a un coût. Il faut éviter que certains ne paient plus cher que d'autres le manquement aux règles de précaution indispensables au transport maritime.
M. le Rapporteur : Mes premières questions concernent le pilotage hauturier. Pouvez-vous nous dire où sont basés les 4 pilotes hauturiers français et dans quel cas ils interviennent ? Y-a-t-il une obligation de faire appel à eux dans certains cas ?
Vous dites qu'il conviendrait de faire intervenir les pilotes hauturiers de façon beaucoup plus systématique que ne le prévoit la directive de 1979, qui n'a effectivement qu'une valeur incitative. Pensez-vous qu'il doive y avoir obligation de faire appel à eux en Manche et en Mer du nord pour les bateaux transportant des substances dangereuses ? Si vous êtes d'accord avec cette mesure, la proposerez-vous en tant que président de la Fédération française des pilotes maritimes ou en tant que président de l'Association européenne des pilotes maritimes ? Quelles sont les initiatives possibles aujourd'hui pour créer un pilotage européen ?
Indépendamment du pilotage hauturier, pensez-vous, que la Manche et la Mer du nord puissent être saturées et qu'il soit nécessaire de réfléchir à cette possibilité ?
Ma dernière question a trait au pilotage portuaire et au devoir d'information : j'aimerais que vous nous précisiez si ce devoir de signalement des navires présentant des défectuosités est imposé par la directive de 1979 et si le réseau RISAP peut, ou non, être relié à EQUASIS.
M. Roger PEREON : Le pilotage hauturier est une activité tout à fait libre, tout à fait facultative et non réglementée.
Une directive européenne, parue en 1979, recommande aux navires battant pavillon des Etats membres de faire appel aux pilotes hauturiers.
Du côté français, un examen atteste le certificat de pilote hauturier. Il est impossible de se prévaloir du titre de pilote hauturier sans en avoir la certification. M. Payan qui est capitaine de première classe dans la navigation maritime et moi-même qui suis capitaine au long cours pouvons parfaitement aller au port du Havre offrir nos services à un capitaine de navire et accompagner des navires n'importe où en Manche et en Mer du nord. Toutefois, nous ne pouvons pas nous qualifier de pilotes hauturiers.
Il existe donc une grande liberté dans l'exercice de cette profession. Les pilotes hauturiers français qui sont des pilotes jeunes et qui ont suivi une formation très structurée, se trouvent confrontés à une concurrence qui n'est pas toujours loyale de la part d'autres pays, dans lesquels un certificat de pilote hauturier peut se conserver très longtemps sans besoin d'avoir une activité maritime importante.
Sans vouloir accuser aucun des collègues hauturiers étrangers, on sait que certains d'entre eux font, de temps à autre, du pilotage à la demande. Au Royaume-Uni, par exemple, des sociétés de travail intérimaires disposent d'un certain nombre de noms et font appel au premier qui se trouve sur leur liste. C'est donc une activité très peu réglementée.
M. le Président : Quel est le statut des 4 pilotes hauturiers en France ?
M. Roger PEREON : Leur siège social est à Dunkerque mais leur point d'embarquement et de débarquement est à Cherbourg, donc à l'entrée de la Manche. Ils embarquent sur des navires pour aller jusqu'à Hambourg et la limite constituée par une ligne qui va du Danemark à la Suède - la
Skaw Winga line - , car le pilotage hauturier est réglementé en Mer Baltique. En effet, il a été possible d'y instaurer la règle du port de départ, qui veut que le pilotage en Mer Baltique, mer fermée, soit exercé par le pilote de port qui a sorti le navire.
M. le Rapporteur : Et il va jusqu'où ?
M. Roger PEREON : Jusqu'au port de destination !
M. le Rapporteur : En Europe ?
M. Roger PEREON : Non, en Mer Baltique. Un pilote allemand peut ainsi embarquer à Lübeck pour aller à Tallinn, en Estonie.
M. le Rapporteur : Et s'il veut aller de Lübeck à Rotterdam ?
M. Roger PEREON : S'il va de Lübeck à Rotterdam en passant par la Mer Baltique et le Skagerrak, il naviguera jusqu'à la
Skaw Winga line où embarquera un nouveau pilote.
M. le Rapporteur : Et le bateau reprend son autonomie ?
M. Roger PEREON : Tout à fait !
M. le Président : Le recours à des pilotes constitue-t-il une obligation pour certaines compagnies ?
M. Roger PEREON : Les compagnies n'ont absolument aucune obligation en la matière !
M. le Président : Y en a-t-il cependant, parmi celles qui transportent des produits dangereux ou polluants, qui font systématiquement appel à des pilotes hauturiers ?
M. Roger PEREON : Les compagnies qui font systématiquement appel au pilotage hauturier sont des compagnies de porte-conteneurs, dont la compagnie
Ever green, la compagnie japonaise Mitsui OSK Line
et la compagnie Engine. En revanche, les navires pétroliers qui fonctionnent au " spot " c'est-à-dire à la demande, ne font pas régulièrement appel au pilotage hauturier.
Il est certain qu'en réclamant un renforcement du pilotage hauturier nous pensons plus aux navires transportant des marchandises et des cargaisons dangereuses. Ce sont eux qui devraient subir un début d'obligation...
M. le Rapporteur : J'en reviens à ma question de départ sur l'harmonisation européenne : si on devait créer un début d'obligation pour les navires transportant des matières dangereuses, comme vous le proposez, est-ce que les sociétés de pilotage seraient d'accord sur cet objectif et en mesure de répondre à la demande ?
M. Roger PEREON : Pour répondre à votre question, si vous le permettez, je changerai de casquette et je reprendrai ma casquette de président de l'Association européenne des pilotes maritimes.
Une demande de renforcement de la directive de 1979 a été déposée auprès de la Commission européenne pour aller dans le sens de ce que j'appelle « un début d'obligation », car il faut savoir que la Commission se montre très réticente par rapport à tout ce qui s'apparente à une contrainte... Nous avançons donc avec précaution !
Par ailleurs, nous essayons également de faire avancer le dossier au niveau de l'OMI, dont certaines des résolutions datant de 1981 - soit, environ de la même époque que la directive européenne de 1979 - recommandent de faire appel au pilotage hauturier en Mer Baltique, en Mer du nord et dans la Manche.
M. le Rapporteur : Pour recommander ou pour imposer le pilotage hauturier ?
M. Roger PEREON : De toute façon, l'OMI ne formule que des recommandations !
M. le Président : Ne pensez-vous pas, compte tenu des risques encourus, que les cinq pays qui bordent la Manche et la Mer du nord, à savoir le Royaume-Uni, la Belgique, les Pays-Bas, l'Allemagne et la France, du fait qu'ils sont déjà convenus par le passé d'un certain nombre d'accords, pourraient s'entendre, même si l'OMI ne fait que des recommandations et si des difficultés existent sans doute au sein de l'Union européenne en raison de son fonctionnement et même du fait que les puissance maritimes qui en sont membres n'ont probablement pas toutes intérêt à ce que des réglementations plus fortes puissent entrer en vigueur ?
Puisqu'aucun armateur au monde n'est en mesure d'éviter les ports de Hambourg, Rotterdam, Anvers, Felixstowe, Dunkerque et le Havre, pour m'en tenir à ceux-là, si les Etats du port décrétaient qu'ils refusaient de voir passer au large de leurs côtes des navires transportant des matières polluantes ou dangereuses sans pilote hauturier, ne serait-il pas possible d'arriver à un accord?
Si je comprends bien, c'est ainsi que les choses se sont mises en place au niveau de la Mer Baltique...
M. Roger PEREON : Oui, mais dans ce cas précis, il y a une règle d'équité dans la mesure où c'est la réglementation du port de départ qui prévaut.
Cette règle a été discutée : jusqu'en 1990, il existait une commission de pilotage hauturier, la
North Sea Pilotage Commission, où le directeur des phares et balises français de l'époque se montrait très actif .
Nous avons, nous aussi, essayé d'édicter cette règle du port de départ, mais si elle convenait parfaitement au Français et aux Allemands en raison de la présence des ports de Cherbourg et de Hambourg, elle ne convenait pas du tout aux Néerlandais, aux Belges et aux Britanniques.
Néanmoins, je pense qu'il faut reprendre le travail sur ce dossier et voir ce qu'il est possible de faire pour parvenir, au moins, à un accompagnement régulier de pilotage hauturier exercé par des hommes qualifiés.
M. le Rapporteur : Excusez-moi, mais vous n'avez pas répondu à toutes mes questions et vous avez omis notamment celle relative au trafic en Manche et en Mer du nord...
M. Roger PEREON : Pour ce qui est du trafic en Manche et en Mer du nord, je ne pense pas qu'il puisse croître encore beaucoup ! La tendance, en ce qui concerne le trafic international, va vers une diminution du nombre des escales des navires et, ce qui serait souhaitable, vers un développement du transport maritime à courtes distances pour désengorger le transport routier à l'intérieur de l'Europe. Il s'agirait alors de cabotage effectué par de petits navires qui ne présentent pas les mêmes risques que le transport de masse de pétrole.
M. le Rapporteur : L'Erika n'était pas un gros navire...
M. Roger PEREON : C'était quand même un bateau de 30 000 tonnes !
La directive de 1979 prévoyait un certain nombre de mesures pour les navires transportant des marchandises dangereuses ou polluantes à l'entrée ou à la sortie des ports. Elle ne comprenait pas encore le devoir de signalement pour le pilote et se limitait à la simple recommandation de faire appel à ses services lorsque le navire se présente à l'entrée d'un port.
C'est en 1993 - et je pense que le gouvernement français de l'époque a beaucoup poussé en ce sens - qu'est apparue la première directive sur le contrôle de l'Etat du port. Elle a introduit le devoir de signalement pour le pilote.
En 1995, la directive de 1993 qui ne concernait que le contrôle par l'Etat du port des navires transportant des cargaisons dangereuses, soit en vrac, soit en colis, a été étendue à l'ensemble des navires.
La directive de 1993 a été transcrite dans la réglementation française par le décret n° 2229 portant règlement général du pilotage pour que les pilotes français rendent compte de l'état du navire. Ce compte rendu est envoyé à la fois aux centres de sécurité, c'est-à-dire aux Affaires maritimes, et aux capitaineries de port.
C'est un processus qui fonctionne depuis 1995, mais je dois dire qu'avant la modification du décret, notre Fédération a dû se livrer à un énorme travail de persuasion auprès de nos collègues pilotes français qui se sentaient en quelque sorte liés à l'armateur, dans la mesure où c'est lui qui paye le pilotage. Ils ressentaient donc comme une délation le fait de signaler les navires en mauvais état.
Nous sommes parvenus à les convaincre qu'il en allait de l'intérêt général, de l'intérêt de la protection des installations portuaires françaises et de l'environnement. Nous avons mis également l'accent sur l'assistance à personnes en danger : personnellement, j'estime qu'un pilote qui aurait laissé partir un navire avec une baleinière crevée pourrait être accusé de non-assistance à personnes en danger.
C'est un système qui maintenant fonctionne bien ! Les rapports sont transmis depuis 1995.
Pour ce qui concerne le site Internet de notre Fédération, c'est notre démarche assurance-qualité qui nous amène, puisque nous disposons maintenant d'une base de données de non-conformité, à vouloir centraliser nos informations. Le système d'information entre les pilotes que nous aurions souhaité pouvoir mettre en place au niveau européen, en 1995, n'a pas fonctionné, probablement parce que nous nous y sommes mal pris. Toutefois, s'il fonctionne au niveau national, nous envisageons de l'étendre à l'Europe. Il est certain qu'il va dans le même sens qu'EQUASIS et que, sans la rendre publique, nous pouvons communiquer notre base de données aux autorités chargées du fichier général.
M. Pierre HERIAUD : J'aurais souhaité obtenir des précisions sur ce pilotage hauturier, qui ne compte que 4 professionnels en France.
A supposer qu'on impose, pour la navigation en Mer du nord, ce qui paraît hautement souhaitable pour la sécurité, l'application immédiate du système pratiqué en Mer Baltique, aurions-nous le nombre de pilotes suffisants, une formation suffisante et, si tel n'est pas le cas, dans quels délais pourrions-nous en disposer ?
M. Roger PEREON : Le recrutement des pilotes hauturiers s'effectue auprès des capitaines de navire ou des seconds capitaines. Il est certain que, là aussi, nous connaissons un début de pénurie tant au niveau français qu'au niveau européen. Je pense néanmoins que la situation pourrait s'améliorer en quelques années puisque la grosse pénurie s'est ressentie à l'entrée dans les écoles de la Marine marchande, dans les années quatre-vingt-sept à quatre-vingt-dix, quand les effectifs des promotions variaient de 37 à 80 élèves. Les dernières promotions atteignant 300 élèves, je pense que d'ici à quelques années, le vivier des officiers navigants va se renouveler.
M. Pierre HERIAUD: Approximativement, quel accroissement de coût entraînerait une telle mesure ?
M. Roger PEREON : Je dois dire que je ne l'ai pas évalué. Notre sentiment est que les transports de pétrole de masse doivent être bien encadrés, mais je ne dispose pas de statistiques en la matière !
M. le Président : Je connais un peu le problème des pilotes hauturiers, mais j'aimerais savoir comment les choses se passent lorsqu'un porte-conteneurs veut disposer d'un pilote hauturier. Il y a des pilotes hauturiers français, belges, anglais, néerlandais et je crois qu'il n'y a qu'un seul pilote hauturier allemand : je suppose que le navire ou l'armateur a le choix. Donc, si je puis dire, c'est le plus fort ou le moins cher qui l'emporte...
M. Roger PEREON : C'est généralement le moins cher !
M. le Président : Quel est le coût de la prestation des pilotes hauturiers ?
M. Roger PEREON : La facturation des pilotes hauturiers est fonction du nombre de miles parcourus et de la taille du navire, mais - je cite de mémoire - pour un pilotage hauturier entre Cherbourg et Hambourg il faut compter entre 5 000 et 6 000 francs !
M. le Président : Cela reste raisonnable !
M. le Rapporteur : Excusez-moi de vous interrompre, mais les compagnies qui font appel aux pilotes hauturiers obéissent à quels motifs ? Est-ce parce que leurs commandants ne sont pas assez expérimentés ? Pourtant, si je reprends votre exemple d'Ever green ,
c'est une compagnie qui emploie des gens qualifiés...
M. Roger PEREON : Il faut savoir que le capitaine du navire s'occupe de la navigation, bien sûr, mais également de toute les démarches commerciales du voyage. Or, les escales étant excessivement rapides dans les ports, un capitaine qui fait successivement escale au Havre, à Anvers et à Rotterdam peut profiter d'être en mer pour se reposer. S'il peut confier la navigation à un spécialiste, c'est toujours autant de gagné pour lui. L'armateur y trouve également son compte dans la mesure où il préfère garder son capitaine pour gérer l'escale à terre plutôt que de le fatiguer inutilement en mer, d'autant que le pilotage hauturier n'est finalement pas très onéreux !
M. le Rapporteur : Et vous pensez, qu'en ayant un pilotage hauturier systématique et organisé des bateaux transportant des matières dangereuses, on diminuerait considérablement les risques ?
M. Roger PEREON : Absolument !
M. le Rapporteur : Et votre association européenne y est tout à fait favorable ?
M. Roger PEREON : Oui, mais il est également certain qu'il faut dans ce cas, franchir un pas, à savoir créer un corps de pilotes européens !
M. le Rapporteur : Pas obligatoirement : on peut appliquer des normes européennes et avoir des corps de pilotes par pays qui soient coordonnés par une instance chargée d'éviter qu'une surenchère intervienne entre eux et qu'ils se livrent à une concurrence, y compris financière.
M. Roger PEREON : C'est vrai !
Mme. Jacqueline LAZARD : J'aurai, pour ma part, plusieurs petites observations à présenter.
Tout à l'heure, vous nous avez indiqué que vous aviez une participation active dans le signalement des navires. Or, on sait que les problèmes sont souvent liés à l'état des structures - cela a été le cas dans l'affaire de l'Erika,
comme probablement dans de nombreux autres accidents - et je pense que la présence d'un pilote à bord - je ne parle pas d'un pilote hauturier mais d'un pilote portuaire - ne permet pas d'avoir des renseignements sur ce point. En effet, compte tenu de la brièveté de cette présence à bord des pilotes, je ne pense pas, bien que vous ayez évoqué précédemment l'exemple d'une baleinière crevée, qu'elle soit suffisante pour témoigner d'autre chose que des aptitudes de l'équipage à naviguer et de l'état des appareils de navigation. Pour le reste, je doute fort que les pilotes aient le temps de procéder à une réelle vérification ! N'y a-t-il donc pas un manque en la matière ?
Par ailleurs, vous avez dit que vous aviez pour objectif d'assister le capitaine. Donc, en cas de problème, il n'y a pas de responsabilité du pilote : si le capitaine suit les recommandations du pilote, en tout état de cause, c'est lui qui reste responsable ! Si on mettait en place le pilotage hauturier, ne faudrait-il pas aussi, à ce moment-là, revoir les règles de la responsabilité des pilotes ? En effet, à quoi peut servir d'avoir des pilotes à bord s'ils n'ont pas de réelles responsabilités ?
Enfin, vous avez déclaré que les pilotes français étaient des hommes jeunes mais qu'ils devaient avoir 12 ans d'expérience du métier. Or, quand on sait le temps que prend, d'une part la formation des capitaines de première classe de la navigation maritime - puisque l'on ne forme plus de capitaines au long cours -, et d'autre part l'obtention du brevet complet - puisque le diplôme ne suffit pas pour pouvoir être pilote -, il est facile d'imaginer que cela conduit à un âge relativement avancé ...
M. le Rapporteur : Mais nous sommes tous jeunes !
(Rires.)
Mme Jacqueline LAZARD : Tant mieux, mais j'aimerais quand même connaître l'âge moyen des pilotes français !
En outre je voudrais savoir si les pilotes, qui sont admis sur concours, sont, comme les capitaines qui doivent revalider leur brevet tous les cinq ans, également tenus de revalider leurs qualifications ?
M. Roger PEREON : Vous avez tout à fait raison concernant l'appréciation sur l'état du navire effectuée par le pilote : il est certain qu'il ne peut pas juger de l'état des structures !
Notre estimation porte surtout sur les qualités man_uvrières, la qualité des équipages ainsi que sur l'aspect général du navire. Je dois dire que l'Erika
était, selon les derniers pilotes portuaires français qui l'ont piloté, un bon navire : un vieux navire, mais une bonne vieille machine qui man_uvrait bien et qui répondait bien !
M. le Président : Le pilote portuaire qui l'a sorti à Dunkerque n'avait rien observé de particulier ?
M. Roger PEREON : Non !
M. le Président : Est-ce qu'un pilote hauturier le menant de Dunkerque vers le rail d'Ouessant aurait senti quelque chose ?
M. Roger PEREON : Je pense que oui, de la même façon que le capitaine a senti quelque chose ! La différence, c'est que le capitaine a rendu compte à son armateur ou à son agent, alors que le pilote hauturier embarqué à bord aurait forcément rendu compte aux CROSS et aux services de sécurité.
M. le Président : Et que ce serait-il alors passé ?
M. Roger PEREON : Je pense qu'il y aurait eu intervention des services de l'Etat côtier !
Nous ne pouvons donc pas juger de tout, mais nous disposons d'un certain nombre d'éléments d'appréciation. C'est surtout notre indépendance qui, dans un exemple tel que celui de l'Erika,
permet de rendre compte !
Sur la responsabilité des pilotes, je dirai que la responsabilité du pilote portuaire est la même que celle du pilote hauturier puisqu'on a étendu le régime du premier au second. Notre devoir est de porter assistance au capitaine et d'en être le conseiller.
Il est à noter que la responsabilité pénale du pilote est totale : s'il arrive un accident, il est certain que le pilote coupable d'une négligence ou d'une faute passera au tribunal et sera, éventuellement, condamné alors que le capitaine pourra ne pas l'être. Tout dépend de l'appréciation de la justice.
En revanche, la responsabilité civile du pilote portuaire ou hauturier français n'intervient que dans sa relation avec l'armateur. Le pilote n'est pas responsable vis-à-vis des tiers mais seulement dans sa relation avec l'armateur qui, s'il prouve la faute du pilote, peut conduire ce dernier à se libérer de sa responsabilité par l'abandon d'un cautionnement : sa responsabilité est donc limitée et engagée uniquement vis-à-vis de l'armateur.
Il faut savoir que dans le domaine maritime, la limitation de responsabilité civile existe, y compris pour l'armateur. Si on augmente la responsabilité civile du pilote, il va s'assurer comme l'armateur ce qui va faire monter les prix et seules les assurances auront à y gagner !
Dans le cas d'un pilotage hauturier, on retrouve le même principe de responsabilité qui est un principe mondial puisque dans tous les ports du monde, les pilotes, en fonction de leur statut, bénéficient d'une limitation de responsabilité : là où les pilotes sont fonctionnaires, c'est l'Etat qui est responsable ; là où les pilotes sont des prestataires de services privés, la limitation de responsabilité joue.
Je tiens à préciser qu'à notre demande, le cautionnement des pilotes qui était de 30 000 F vient d'être réévalué : il est doublé depuis le 1er juillet 1999 parce que le pilote tient à avoir une matérialisation de sa responsabilité.
Pour en venir à votre dernière question, il faut savoir que pour devenir pilote français, il faut actuellement remplir quatre conditions : premièrement, avoir un brevet de commandement et être pratiquement commandant de 1ère classe de la Marine marchande dans la mesure où pour conseiller des capitaines il est préférable d'avoir la même qualification qu'eux ; deuxièmement, avoir à son actif 72 mois de navigation effective soit 10 à 12 ans si l'on inclut les congés ; troisièmement, avoir des aptitudes physiques particulières, puisqu'il est notamment obligatoire d'avoir une vision de 10/10èmes à chaque oeil ; quatrièmement, être âgé de moins de trente-cinq ans à la date du concours.
Toutes ces obligations réunies font que quelqu'un qui rentre dans une école de la Marine marchande à 18 ans peut se présenter au concours de pilotage 13 ans plus tard, donc à 31 ans, ce qui revient à dire qu'il lui reste 4 ans pour s'y préparer.
L'âge moyen des pilotes portuaires français doit actuellement se situer aux alentours de 50 ans mais nous sommes en période de renouvellement intensif puisqu'il y a eu un fort recrutement après la deuxième guerre mondiale, dans les années cinquante plus particulièrement, et également parce qu'une carrière de pilotage durant globalement 25 ans, un renouvellement des effectifs s'impose pour les années 2000.
Pour ce qui est de la revalidation des qualifications, disons que les brevets de capitaine au long cours, sont soumis à la même revalidation que ceux des Affaires maritimes. Au moment où cette mesure a été mise en _uvre par la convention STCW 95, nous nous sommes posés la question de savoir ce qu'il en était pour les pilotes et nous nous sommes aperçus qu'en France, nous n'avions rien pour revalider la qualification de pilote qui restait immuable pendant 25 ans. Nous nous sommes donc rapprochés de notre tutelle de l'époque pour voir comment procéder. C'est l'un des facteurs qui nous ont orientés vers la démarche assurance-qualité qui traite de toute la partie formation et qui prévoit un contrôle des connaissances.
Mme Jacqueline LAZARD : Puisque vous voyez des bateaux battant pavillon de tous ordres, pouvez-vous estimer le nombre de navires potentiellement dangereux sachant que, bien évidemment, je m'adresse là au président de la Fédération française des pilotes maritimes ?
M. Roger PEREON : C'est une évaluation difficile ! Ce que nous avons pu constater, c'est que, depuis une vingtaine d'années, il y a moins de navires sous-normes. La qualité des navires s'est quand même améliorée avec le contrôle de l'Etat du port et avec l'évolution des taux de fret, que ce soit à la baisse ou à la hausse. Disons qu'il y a toute une flotte de vieux navires sous-normes qui a disparu de la circulation !
Du côté des navires, je pense qu'on enregistre plutôt une amélioration. Il en va de même du côté des équipages. Les effets de la convention STCW 95 et de toutes les mesures prises au niveau de l'OMI se font sentir.
En revanche, nous déplorons actuellement la multiplicité des nationalités à bord des navires. Il est certain qu'avoir des membres d'équipage de trois ou quatre nationalités différentes, de religions différentes, de langes différentes, est source de problèmes.
M. le Rapporteur : Vous l'avez déjà senti à la man_uvre ?
M. Roger PEREON : Ah oui ! Absolument !
M. le Rapporteur : C'est une situation qui comporte des risques ?
M. Roger PEREON : Oui, ne serait-ce que le risque d'un défaut de communication entre le capitaine à la passerelle et l'officier ou le second sur le gaillard. Il y a parfois incompréhension et c'est très difficile : tous les ordres sont donnés en anglais, mais vous savez que l'anglais pratiqué par un Philippin et très différent de celui pratiqué par un Ecossais !
M. Louis GUEDON : Je voudrais revenir sur une question qu'a posée Mme Lazard et qui, pour moi, est importante parce que les personnalités que nous avons préalablement auditionnées ont tenu un propos un peu différent de celui que vous nous avez donné à entendre en préambule.
Vous nous avez dit très clairement que vous étiez favorable
" à la création d'une équipe d'intervention immédiate pour l'évaluation des risques " sur un navire en difficulté.
C'est une suggestion que j'avais faite à l'Assemblée nationale au cours d'une intervention qui faisait suite au drame de l'Erika et que j'ai renouvelée auprès d'une personne auditionnée dans les mêmes conditions que vous. Il m'avait alors été répondu - et je souligne que je partage votre point de vue - que je m'égarais sur une fausse piste parce que, si les conditions météorologiques étaient très mauvaises comme cela a été le cas pour l'Erika, ce collège d'experts délégués sur place aurait une efficacité nulle et non avenue.
J'avais pris cette réponse pour argent comptant même si elle ne m'avait pas satisfait mais, comme vous venez de rebondir sur le sujet, j'aimerais que vous puissiez me renseigner sur ce point.
Par ailleurs, je souhaiterais savoir s'il est possible d'espérer, dans le cadre de la réglementation européenne, que la Manche, compte tenu du trafic et du nombre de bateaux qui y circulent et qui ne cesse de croître - les intervenant précédents nous laissaient entendre que nous allions rapidement arriver à saturation avec les risques énormes que cela comporte notamment en raison du nombre des navires, de leur importance, et de leurs cargaisons - puisse, par le biais du pilotage hauturier qui est, de mon point de vue une notion très importante, être considérée comme le canal de Suez ?
M. le Président : Pour préciser la question de M. Guédon, dans quels autres endroits du monde se pratique le pilotage hauturier ?
M. Roger PEREON : Uniquement dans la grande barrière australienne.
M. le Président : Le pilotage hauturier est-il, là-bas, obligatoire ?
M. Roger PEREON : Non, il est également facultatif mais les navires y font beaucoup plus appel parce que, si vous me permettez l'expression, la grande barrière est " mal pavée " alors qu'en Manche c'est plutôt la densité du trafic qui doit être gérée.
En proposant de créer une équipe d'intervention, je ne suis pas sûr de détenir la vérité ...
M. Louis GUEDON : Personnellement, je partage votre point de vue !
M. Roger PEREON : C'est une idée qui nous est venue spontanément en évoquant le sujet avec M. Payan, mais elle va dans le même sens que la présence d'un pilote hauturier à bord : il est certain que dans un cas comme celui de l'Erika,
les difficultés ont commencé avant le naufrage.
Le capitaine, dans la mesure où il est lié à l'armateur, va garder le secret le plus longtemps possible ! Or, pouvoir diagnostiquer permet, sinon d'éviter l'accident, du moins de gagner du temps et de prendre des décisions de sauvegarde qui s'imposent.
M. Louis GUEDON : Mon commandant, je vous remercie de le dire parce que c'était tout à fait mon point de vue.
Le 17 décembre, j'avais fait une déclaration à l'Assemblée nationale dans laquelle j'estimais intéressante une proposition qui recoupait tout à fait celle que vous venez de faire. Différentes personnalités, précédemment, n'en ont pas tenu compte ou ont du moins laissé entendre qu'elle ne présentait pas d'intérêt ou qu'elle manquait de réalisme. Aucune d'entre elles n'avait été patron sur une passerelle ou n'avait eu la responsabilité d'un navire - et quand bien même cela avait pu être le cas, il ne s'était jamais agi d'une passerelle de navire susceptible de transporter des marchandises dangereuses.
Je vous remercie car votre position correspond tout à fait à ce que j'avais pressenti dès le départ.
M. Roger PEREON : Je dois dire qu'un tel projet sera sans doute très difficile à mettre en _uvre parce qu'on tombe très vite dans des eaux internationales où s'applique le droit de la mer.
M. le Rapporteur : Pas en Manche : la règle est de 200 milles !
M. Louis GUEDON : Les enjeux que nous constatons et les dégâts des accidents dont nous subissons encore les conséquences 4 mois plus tard nous commandent d'appréhender le problème et de ne pas nous laisser paralyser par les difficultés !
M. Roger PEREON : Mais, M. le député, j'ajoute que notre suggestion s'appuyait sur un exemple concret : celui d'un navire,
l'Alphastar, qui, transportant du minerai en Méditerranée, a commencé à se casser en pleine mer et a été abandonné par son équipage. La préfecture maritime de Méditerranée a décidé l'envoi d'une équipe d'intervention. Cette dernière a établi le diagnostic, fait remorquer le navire et l'a rentré à Fos en prenant le maximum de précautions ... Dans ce cas, le navire était abandonné, ce qui rendait bien sûr la chose légalement possible, mais il y a donc déjà eu intervention en pleine mer !
M. Louis GUEDON : Cette réponse est, de mon point de vue, fondamentale. Que pensez-vous de ma suggestion de considérer la Manche un peu comme le canal de Suez, à partir d'une réglementation européenne s'appuyant sur votre corps de pilotes hauturiers ?
M. Roger PEREON : Il faut aussi relativiser les choses : une proposition visant à rendre le pilotage hauturier obligatoire ne peut concerner que les navires transportant des marchandises dangereuses sans quoi cela deviendrait ingérable...
M. Louis GUEDON : Ce serait déjà ça !
M. le Rapporteur : Cela reviendrait à remettre en cause la qualité des commandants !
M. le Président : On ne met pas des agents de police à tous les carrefours ...
M. Roger PEREON : Heureusement !
M. Patrick PAYAN : Permettez-moi seulement d'apporter une précision supplémentaire à la réponse faite à Mme Lazard : il est exact que le pilote n'a pas capacité à apprécier la qualité technique des structures du navire, mais il faut savoir qu'il est le seul intervenant extérieur à pouvoir en apprécier le fonctionnement en état de marche !
Audition de MM. Alain GRILL, président,
et Fabrice THEOBALD, délégué général,
de la Chambre syndicale des constructeurs de navires
(extrait du procès-verbal de la séance du 15 mars 2000)
Présidence de M. Daniel PAUL, Président
MM. Alain Grill et Fabrice Theobald sont introduits.
M. le Président leur rappelle que les dispositions législatives relatives aux commissions d'enquête leur ont été communiquées. A l'invitation du Président, MM. Alain Grill et Fabrice Theobald prêtent serment.
M. Alain GRILL : Monsieur le président,
madame et messieurs les députés, c'est dans des conditions tout à fait exceptionnelles que notre chambre syndicale se présente devant vous. Mon propos liminaire va s'articuler en deux temps : le premier sera consacré à quelques considérations générales sur ce que nous avons déjà fait au plan syndical et professionnel ; le second aura trait aux suggestions que nous avons émises en tant que constructeurs français et européens pour augmenter la sécurité du transport maritime pétrolier. La seconde partie de mon exposé sera donc plutôt innovante par rapport à la première qui sera totalement factuelle.
Notre chambre syndicale a pensé, sur mon initiative, au début du mois de janvier, qu'à une situation exceptionnelle, il fallait répondre par une procédure exceptionnelle. J'ai donc pris ma plume pour proposer à plusieurs professions maritimes d'adresser une lettre, que nous avons signée, à tous les parlementaires français à Strasbourg.
Je crois qu'il n'y a pas de précédent en France : jamais les armateurs, les constructeurs, les autorités portuaires, les pêcheurs et aquaculteurs représentés par leurs syndicats patronaux n'ont signé une pareille lettre. Mon successeur à l'Institut français de la mer a bien voulu, lui aussi, y apposer sa signature.
Cette lettre porte la date du 17 janvier et si vous le permettez, M. le président, le délégué général va la distribuer bien que nombre d'entre vous, je le sais, en aient déjà eu connaissance !
Que disait, très sommairement, cette lettre aux parlementaires européens, dont je vous précise tout de suite qu'elle m'a valu de nombreuses réponses très encourageantes ? En substance, il y était indiqué qu'il faut traiter le problème de la prévention contre les pollutions accidentelles au niveau européen et qu'il faut sans doute envisager la création d'une Agence maritime pour coordonner les inspections, harmoniser les réglementations et - là, je m'adresse tout particulièrement à vous qui êtes député du Havre, M. le président - éviter que se constituent
volens nolens, des ports de complaisance, c'est-à-dire qu'il y ait des circuits de contrôle plus souples que d'autres !
Nous disions aussi, et je pense que personne n'en sera surpris, que l'Organisation maritime internationale dont le siège est à Londres, nous paraissait, certes très capable d'améliorer les choses sur le plan maritime mondial, mais très impuissante au niveau de ses moyens puisque cet organisme des Nations Unies n'a aucune capacité de contrainte. Autrement dit, les Etats membres des Nations Unies qui signent des conventions techniques, notamment de sécurité, ne sont nullement forcés de les appliquer ou peuvent le faire selon leur bon vouloir...
Par conséquent, ces quatre professions pensaient et continuent de penser que c'est au niveau de l'Europe qu'il faut traiter ce problème, et le traiter le plus vite possible ! Notre lettre a reçu, comme je l'ai dit, un écho très favorable. Je vous ferai grâce des très nombreuses réponses que nous avons reçues : le Parlement européen a voté dans la foulée deux résolutions très charpentées conduisant pratiquement aux mêmes conclusions et, pour en terminer avec cette introduction, je voudrais dire deux choses dont l'une est une évidence, ce dont je vous prie de m'excuser.
Tout d'abord, il est indéniable que ma profession et la profession européenne que j'ai représentée pendant plus de trois ans comme président européen ont tout intérêt à ce que les « navires-poubelles » soient évacués de la flotte mondiale. Ce n'est pas ici que je vais essayer de vendre des heures de travail, mais plus on sortira de bateaux de la flotte mondiale, plus le marché sera assaini nonobstant le fait que le marché des navires dits « simples », se trouve, hélas, en Asie... Nous ne sommes donc pas directement concernés par un renouvellement de la flotte mondiale. Nous pourrions seulement l'être indirectement dans la mesure où nos grands concurrents asiatiques - dont la Corée au premier chef -, ayant des pétroliers neufs à construire, se détourneraient du marché de la construction de navires sophistiqués sur lequel les Japonais commencent à nous concurrencer en se mettant ardemment à construire des paquebots...
L'autre point sur lequel je souhaite attirer votre attention porte sur une réflexion qui m'a été inspirée lorsque je présidais, en ma qualité de président de l'Institut français de la mer,
les journées de la mer au conseil régional de Rennes, en novembre 1999 - je vois d'ailleurs qu'il y a des députés bretons autour de la table que j'ai eu le plaisir de rencontrer là-bas. Le directeur des affaires maritimes et des gens de mer, qui avait bien voulu se déplacer pour la circonstance, déclara à la tribune qu'il avait les plus grandes difficultés à trouver des inspecteurs de la navigation et que les postes budgétés n'étaient pas pourvus. Comme c'est l'une des tâches de l'Institut français de la mer que d'essayer de relancer les vocations dans le domaine maritime et que, dans une affaire telle que celle de l'Erika,
le contrôle portuaire est un élément essentiel de ce que j'appellerai « le principe de la prévention », il m'a semblé que notre profession et d'autres professions maritimes devraient proposer à l'administration de faire exercer ce contrôle portuaire par d'anciens cadres retraités et capables, d'anciens navigants, d'anciens ingénieurs. Elle disposerait ainsi d'inspecteurs vacataires qui n'auraient pas toutes les caractéristiques de la fonction publique mais qui, payés sur honoraires, pourraient renforcer, le moment venu et le cas échéant dans tel ou tel port, les moyens de contrôle existants.
Je suis, pour ma part, comme j'ai été président des Chantiers de l'Atlantique pendant un certain nombre d'années, en train de rechercher des volontaires dans mes anciennes équipes et j'ai eu l'occasion, tout récemment, d'en parler au directeur des affaires maritimes et des gens de mer.
Cela étant, nous éprouvons en France, mais aussi en Europe, une incontestable difficulté à relancer les vocations maritimes. Dans tous les métiers de la mer, nous manquons de bras et de cerveaux.
Si vous le permettez, M. le président, je vais en venir à la seconde partie de mon exposé où nous allons, avec votre permission, nous projeter dans le futur.
L'approche des chantiers navals européens, puisque le projet que vous avez sous les yeux dans la plaquette qui vous a été distribuée remonte à l'année 1992, consistait à se demander s'il était possible d'améliorer la sécurité du transport maritime pétrolier et, si oui, à quel coût.
Le gouvernement américain, après l'affaire de
l'Exxon Valdez - et je ne peux que trouver ce précédent extrêmement heureux - a pris, dans des délais ultracourts et avec un vote unanime du Congrès des Etats-Unis, des dispositions concernant la conception future des pétroliers : schématiquement, il s'agissait du navire à double coque dont il est indiqué, en couleur sur les premières planches de notre plaquette, comment il se comporte en cas d'abordage et en cas d'échouement. C'est la solution américaine telle que le Congrès des Etats-Unis l'a votée dans ce qu'il est convenu d'appeler l'Oil Pollution Act
de 1990.
Cette double coque nous est apparue à nous, constructeurs européens - mais je vais y revenir - comme étant une protection insuffisante.
Nous nous sommes livrés à des calculs que vous retrouverez très schématisés dans notre documentation : à 3 n_uds, on crève la double coque ; si le navire fait 3 n_uds et vient s'échouer à cette vitesse sur les cailloux, il crève son double fond et par conséquent le pétrole est répandu.
Par ailleurs, ne serait-ce que dans l'entreprise que j'ai dirigée, on a jadis construit de très nombreux pétroliers, voire les plus grands au monde. Par conséquent, nous étions bien placés pour savoir combien il est difficile d'accéder à des espaces de dimensions aussi étroites : sur la quatrième planche, l'illustration en jaune démontre que la distance de 2 mètres entre chaque coque rend, pour un individu de ma corpulence - pour ne pas dire de mon âge -, toute vérification quasiment impossible. Or, le transport pétrolier présente cette caractéristique qu'il y a toujours des vapeurs d'hydrocarbures, qu'elles sont auto-explosives à des concentrations très faibles dans l'air - de l'ordre de 4 % - et que, par conséquent, le dégazage des espaces vides est un problème de sécurité majeur.
Il n'a pas été difficile de convaincre mes principaux collègues européens de l'époque, c'est-à-dire le groupe d'Etat italien Fincantieri, le groupe d'Etat espagnol Astilleros Españoles et deux chantiers allemands dont il ne reste qu'un aujourd'hui, l'autre ayant malheureusement disparu, de chercher à faire mieux que les navires à double coque tels qu'ils sont imposés par la législation américaine. Vous m'objecterez que mieux signifie plus cher : certes, et je vous renvoie, pour en trouver les détails financiers, au dos de la plaquette.
Nous sommes ainsi parvenus, au sein du groupement
Euroyards dont j'ai été l'animateur pendant plusieurs années, à réaliser le pétrolier E3, de conception européenne - puisque nous parlions de l'Europe tout à l'heure il me paraît très opportun de souligner ce point - et qui, au lieu de présenter une double coque à deux mètres d'intervalle, selon les prescriptions américaines, disposait d'une double coque à six mètres d'intervalle.
Nous avons effectué tous ensemble, nous vérifiant mutuellement, un certain nombre de calculs pour aboutir à la conclusion que si la sécurité à 100 % n'existe jamais, notre concept de navire à double coque résiste tout de même aux abordages et aux échouements à une vitesse de 7,5 n_uds.
Or, comme le problème des échouements - qui était celui de l'Exxon Valdez -
nous est apparu constituer un problème de sécurité majeur, nous avons ajouté à notre bateau un pont intermédiaire à 6 mètres au-dessus de la quille : ainsi, la hauteur de pétrole dans la cale est, en quelque sorte, double puisqu'elle se répartit au-dessus du pont intermédiaire et au-dessous.
Nous avons travaillé sur l'hypothèse d'un pétrolier de 280 000 tonnes, c'est-à-dire le bateau standard à deux millions de barils. La hauteur d'eau à l'extérieur étant en charge à 21 mètres, si le pont intermédiaire n'est pas percé, donc si l'échouement se fait à moins de 7 n_uds, la pression de l'eau est plus forte que la hauteur de pétrole sous pont intermédiaire. À ce moment-là - pardonnez-moi de dire que c'est l'oeuf de Christophe Colomb - la pression extérieure maintient à elle seule le pétrole à l'intérieur du navire !
Comme les bureaux d'études de Saint-Nazaire, ceux de Trieste, de Kiel et de Bilbao ne manquaient pas d'idées, le concept E3 a été amélioré en utilisant les espaces libres en abord entre les deux coques afin de pouvoir, si vraiment en cas d'échouement très grave on crevait le pont intermédiaire, faire en sorte de transvaser du pétrole et ainsi cantonner la hauteur de la cargaison de pétrole en cale au niveau de la mer pour arrêter assez vite le phénomène de rejet en mer.
Ce pétrolier, nous l'avons baptisé E3 : E comme européen, E comme économique parce nous avons quand même réfléchi aux données financières et E comme écologique. Nous étions peut-être très prétentieux, mais il a été très bien reçu à l'époque puisqu'il a obtenu le prix d'excellence, de mon temps, un tel prix était réservé au meilleur élève de la classe, mais je n'en dirai pas plus ! En effet, le prix Eurêka, prix européen, lui a été décerné à Oslo, capitale maritime, ce qui explique la présence du drapeau norvégien sur cette plaquette.
Hélas, il n'a pas fait beaucoup de petits puisqu'à ce jour, seuls mes collègues espagnols ont réussi à en construire un exemplaire. En effet, notre navire, plus sûr que les bateaux à double coque imposés par la législation américaine - qui constituaient déjà un progrès par rapport aux navires à simple coque -, coûtait naturellement un peu plus cher. Je vous demande de vous reporter au verso de la plaquette : vous y trouverez, dressée à la façon d'un armateur, la comparaison des coûts de transport pour un navire de 270 000 tonnes répondant soit à des spécifications basiques, soit aux normes du concept E3.
Comme pour tenir ce raisonnement, il fallait vraiment encadrer toutes les possibilités, nous avons pris un coût de construction européen, soit 110 millions d'euros, que nous avons mis en regard par rapport à un prix de construction asiatique qui est de l'ordre de 70 millions d'euros : la distance qui, sans aides, nous sépare des prix pratiqués sur le marché aujourd'hui est donc de 40 millions d'euros.
Nous avons ensuite considéré une hypothèse d'armement de notre navire conforme aux conditions européennes, ce qui veut dire que nous ne l'avons pas mis sous pavillon de complaisance et suppose donc un coût annuel d'équipage de 3 millions d'euros, soit trois fois plus que pour les bateaux armés selon des normes non européennes. Ce sont là évidemment des ordres de grandeur, mais nous en répondons.
Nous avons, en outre, prévu trente jours d'immobilisation au lieu de quinze pour bien entretenir le bâtiment et, de fil en aiguille, nous en sommes arrivés à la notion clé qu'est le coût de transport par baril : la différence, au baril, est de 0,8 euro entre la version standard et celle que nous avons retenue pour l'E3, ce qui rapporté au prix du litre d'essence est de l'ordre de 4 centimes.
Par conséquent, M. le président, ce projet a un coût indéniable car il correspond à un investissement nouveau et à des idées nouvelles. On repousse les conditions dans lesquelles un sinistre peut se produire - ce qui revient à dire que l'on éloigne le risque - mais tout cela a un coût. En tant que constructeurs de navires français, conscients d'être aussi constructeurs de navires européens, nous ne pouvons que souhaiter que notre idée suive son bonhomme de chemin et que les dispositions futures à prendre au niveau de l'Europe contiennent des dispositifs de promotion ainsi que des crédits de recherche complémentaires car, si nous avons appliqué nos idées à un grand bateau,
mutatis mutandis, elles peuvent également concerner des bateaux de moindre taille.
Si un chantier allemand a disparu, le dispositif
Euroyards, lui, existe toujours et l'innovation est là. Aidez-nous à améliorer la sécurité maritime du transport pétrolier !
M. le Président : Merci, M. le président. Je crois que votre requête correspond exactement à l'objet de la commission d'enquête, bien qu'il ne s'applique pas uniquement au transport pétrolier !
M. le Rapporteur : Merci de votre exposé qui me permet de rebondir sur deux ou trois sujets.
Premièrement, en raison de votre compétence et de votre expérience, pouvez-vous nous dire quel est, selon vous, l'âge limite d'un pétrolier « ancienne manière » - c'est-à-dire à simple coque - qui ne doit pas être dépassé pour assurer un maximum de sécurité, sachant bien évidemment que l'entretien est un élément important de la longévité des bateaux ?
Concernant les contrôles techniques qui sont opérés aujourd'hui, estimez-vous que les normes sur les bateaux à risques sont suffisantes ou qu'elles demanderaient, au contraire, à être révisées plus régulièrement ? Quel est votre avis sur les sociétés de classification qui, en Europe ou dans le monde, sont amenées à vérifier les structures des bateaux ?
Deuxièmement, pour en revenir au concept de l'E3, quel jugement portez-vous sur les intentions actuelles de la Commission européenne ? Nous étions à Bruxelles avant-hier et un certain nombre de dispositions doivent être proposées la semaine prochaine : sont-elles, à votre avis, suffisantes ou jugez-vous que l'interdiction des pétroliers à simple coque, même si elle n'exclut pas formellement la solution de l'E3, risque de généraliser le type de bateaux à la double coque selon les prescriptions américaines, au détriment du concept que vous défendez ?
M. Alain GRILL : Nous allons, avec Fabrice Théobald, tenter de répondre à ces questions qui sont, je dois le dire, capitales mais fort délicates...
Sur la longévité, Fabrice Théobald ajoutera des considérants qu'il a bien présents à l'esprit. Toutefois, je voudrais souligner que ce n'est parce qu'un navire est vieux qu'il est dangereux ! Il y a de vieux navires bien entretenus - comme vous l'avez d'ailleurs laissé entendre - qui sont tout à fait dignes de continuer à naviguer !
Cette remarque étant faite, nous ne pouvons argumenter que sur la base des statistiques. C'est sur les données statistiques concernant les sinistres des navires en fonction de leur âge que je vais demander à Fabrice Théobald de bien vouloir vous apporter plus de précisions.
M. Fabrice THEOBALD : Si vous le permettez, je vais encore distribuer quelques documents. L'un d'entre eux, illustre la fréquence des accidents en fonction de l'âge des navires. Il provient des statistiques des assureurs maritimes de Londres. Cette courbe montre bien que, statistiquement, les navires plus âgés ont plus d'accidents : c'est une réalité !
En d'autres termes, on ne peut pas dire qu'un navire vieux est nécessairement un navire sous-normes. En revanche, on peut dire que les navires sous-normes sont de vieux navires parce qu'effectivement, ils ont été mal entretenus. Voilà quelle est la logique. Le risque s'accroît avec l'âge du bateau et on sait très bien pourquoi. L'eau de mer étant corrosive, les tôles s'usent - c'est particulièrement vrai pour les accidents de structures - et deviennent plus fragiles. Par ailleurs, le métal se fatigue - ce qu'on oublie souvent - : en effet, outre l'épaisseur des tôles qui diminue après plusieurs cycles, l'acier perd ses qualités élastiques et devient cassant.
Par conséquent, l'âge du navire - et c'est particulièrement vrai pour les accidents de structures tels que celui de l'Erika - constitue un facteur de risque évident.
M. Alain GRILL : Avant d'en venir aux autres questions de M. Le Drian, j'aimerais enchaîner, si vous le permettez, sur la question concernant l'attitude de Bruxelles à propos du phénomène de vieillissement de la flotte mondiale.
Il nous faut, sur cette question, être très conscients que les autorités de Bruxelles sont aujourd'hui soumises à une très vive pression de la part du milieu armatorial et - pourquoi le cacher ? - des armateurs qui ont des flottes vieillottes pour ne pas dire vieilles, afin de l'empêcher de prendre des dispositions susceptibles d'éliminer ces navires trop précipitamment. Il y a, de toute façon, un problème de continuité qui se pose : on ne peut pas construire des bateaux neufs du jour au lendemain : cela prend de dix-huit mois à deux ans et s'ils étaient construits aujourd'hui, hélas - je dis bien hélas -, ils ne le seraient pas en Europe...
M. le Rapporteur : Même des E3 ?
M. Alain GRILL : Même des E3 ! Nous toucherions seulement des royalties, M. le rapporteur...
Il faut quand même penser à nous ! Si l'on doit, comme je l'ai entendu dire par un directeur de l'administration centrale, accélérer le processus de renouvellement de la flotte, grâce à des dispositifs fiscaux du type groupements d'intérêt économique, il faut tout de même veiller à ce que l'ouvrier ou l'ingénieur européen puisse en bénéficier et à ce que l'on ne nourrisse pas, après avoir fait des cadeaux énormes à la Corée avec les largesses du FMI, les chantiers coréens - du moins, pendant une certaine période...
Je suis de ceux qui pensent, et j'espère d'ailleurs que Fabrice Théobald est de mon avis, qu'il ne faut pas se cacher que les autorités de Bruxelles vont avoir une partie difficile à jouer parce que certains Etats membres de l'Union européenne ont des flottes importantes et sont sensibles à la pression que les armateurs peuvent exercer sur leurs pouvoirs publics. Ils vont donc veiller à ce que Bruxelles ne révolutionne pas les choses.
Nous constatons déjà au niveau professionnel, une tendance consistant à privilégier l'action de l'OMI sur celle des autorités européennes. Comme je suis un ancien joueur de rugby cela me rappelle ces moments où, quand nous ne savions pas quoi faire du ballon, nous donnions un grand coup de pied et tapions en touche, au risque d'ailleurs de perdre parfois la balle derrière les tribunes...(Sourires.)
Il faudrait donc sous la présidence française - mais il faudrait sans doute amorcer le mouvement sous la présidence portugaise - veiller à ce que ces pressions qui proviennent essentiellement des propriétaires de flottes anciennes soient contrebalancées par des pressions en sens inverse, notamment la pression de la France. Nous subissons avec difficulté les conséquences du naufrage de l'Erika, j'ai peine à imaginer ce qu'il adviendrait si une nouvelle catastrophe de ce genre se produisait...
M. Fabrice THEOBALD : Il faut que vous sachiez qu'une campagne de presse est actuellement conduite par ces milieux, notamment à travers le journal qui est un peu la référence dans le monde maritime, le
Lloyd's list, qui paraît en anglais et qui est très efficace. Pendant une semaine, ce dernier a publié chaque jour un article pour démolir la proposition de la Commission européenne qui vise à harmoniser le calendrier européen et le calendrier américain d'élimination des navires à simple coque.
Je ne prétends pas que cette proposition soit parfaite - nous vivons dans un monde maritime imparfait, notamment à cause de l'Oil Pollution Act
américain qui est pourtant incontournable. Dans ces conditions, la commissaire européenne, Mme Loyola de Palacio, avait parfaitement compris l'intérêt qu'il y a à harmoniser les calendriers de sortie de flotte pour que l'Europe ne soit plus ce qu'il faut bien reconnaître qu'elle est un peu aujourd'hui, à savoir la poubelle du monde, compte tenu des exigences plus contraignantes des Etats-Unis de par l'efficacité de leurs garde-côtes et leur législation.
Par ailleurs, il faut bien reconnaître que le contrôle de l'Etat du port tel qu'il est défini dans le Mémorandum de Tokyo est exercé plus efficacement que celui prévu par le Mémorandum de Paris, en grande partie d'ailleurs pour une raison géographique. En effet, tous les Etats de l'Asie du sud-est étant des îles ou des presqu'îles, il n'est pas possible d'y accéder par voie de terre. L'obligation de passer par un de leurs ports pour accéder à ces pays évite les détournements de trafic qui existent en Europe, où la France peut être desservie sans aucun problème par Barcelone, Gênes, Anvers et Rotterdam. Pour pénétrer sur le territoire du Japon, vous devez impérativement passer par un port japonais : c'est la géographie qui le veut. C'est pareil pour la Corée du sud, la Chine et de nombreux pays asiatiques.
En Europe, la concurrence portuaire fait toujours peser le soupçon que le port voisin n'exerce pas aussi bien le contrôle de l'Etat du port, d'où la proposition des professions en faveur d'une Agence maritime européenne insensible aux distorsions de concurrence.
L'Europe accueille un peu tout ce que les autres pays refusent. Il faut savoir que la proposition de Mme Loyola de Palacio est complètement battue en brèche par la presse et que la Commission européenne est effectivement sur la défensive.
M. Alain GRILL : Ce que vient de vous exposer Fabrice Théobald explique aussi, M. le rapporteur, tout l'intérêt que j'ai personnellement attaché à ce que le président du Comité des armateurs signe la lettre du 17 janvier, car cela témoigne, du côté de l'armement français, d'un réel désir de faire bouger les choses ! Je pense d'ailleurs que cette signature n'était pas facile à donner...
Vous nous avez également interrogés sur les contrôles et sur l'éventuelle insuffisance des normes. Pardonnez-moi de répondre en ingénieur que je suis.
Je pense que dans l'urgence dans laquelle nous nous trouvons, pour éviter que pareille catastrophe ne se reproduise, on ne peut pas faire tout en même temps ! On ne peut pas à la fois renforcer les normes et renforcer les contrôles ! Il faut commencer par ce qui est le plus urgent. Les normes étant certes perfectibles mais bien connues, le plus urgent est de renforcer les contrôles ce qui justifie la remarque que je faisais tout à l'heure au sujet des inspecteurs de la navigation.
Nous allons manquer d'ingénieurs ; nous allons manquer d'officiers ; nous allons manquer de directeurs de port. Il faut donc trouver, en France des palliatifs, des solutions intérimaires à cette carence de manière à ce que les contrôles de l'Etat du port soient effectifs. Dans le même temps - et nous en revenons à l'Europe -, il faut vérifier que le contrôle exercé à Rotterdam - et je cite ce port simplement pour faire image - soit de la même valeur, de la même profondeur, du même sérieux.
Je pense qu'au sein de la construction navale française, on peut trouver des volontaires. Il faut renforcer le contrôle de l'Etat du port. Si, par la suite une Agence maritime européenne est créée, on peut envisager de lui confier la tâche, avec des comités d'experts, de voir ce qui peut être amélioré du point de vue des normes existantes. Néanmoins, on commencerait déjà à appliquer les normes existantes que l'on éloignerait de nos côtes le risque de naufrages de navires du type de l'Erika.
Alors, il est vrai - M. Le Drian vous avez mille fois raison - que, chemin faisant, nous avons toutes les chances d'européaniser les exigences techniques américaines au sujet des bateaux à double coque. Ce faisant, nous avons aussi toutes les chances d'adopter, au niveau de l'Europe, par un souci d'homogénéité, les différentes règles d'exclusion en termes de dates, - 2010, 2015 etc... -, introduites par l'OPA américaine.
Si l'on adopte les mêmes dates que les Américains pour écarter de nos eaux les navires à simple coque ou sans ballasts séparés, les bateaux en question qui continueraient à naviguer n'auront pour autre potage que les eaux qui ne sont ni européennes, ni américaines. On voit bien que ce raisonnement est caricatural et qu'il faudrait une solution de caractère mondial. Mais ne rêvons pas et rappelons-nous que de telles mesures n'ont aucun pouvoir coercitif réglementaire puisqu'aucun gendarme mondial n'est là pour les faire appliquer !
Cela étant - et je ne voudrais pas que votre commission d'enquête se méprenne sur nos propos - ce n'est parce que nous avons conçu un navire techniquement plus sûr que nous considérons que ce qu'ont imposé les Américains n'était pas bien ! Les Américains ont apporté une réponse immédiate, dans les six mois qui ont suivi l'affaire de
l'Exxon Valdez avec une efficacité à laquelle je rends hommage, à une situation qui appelait une solution. Mieux vaut un navire à double coque répondant aux exigences américaines - à 3 n_uds on peut quand même espérer ne pas crever la double coque - que des navires à simple coque, bien sûr !
Il n'en reste pas moins que nous pensons, nous constructeurs, que la solution américaine qui a été adoptée avec une grande célérité est loin d'être parfaite. Le vieillissement d'un navire correspondant aux normes américaines comporte, en raison de la difficulté qu'il y a à entretenir l'espace entre les deux coques, des risques potentiels sérieux que nous avons essayé de repousser plus loin pour avoir un navire plus sûr !
M. Fabrice THEOBALD : L'ensemble du monde maritime est bien conscient de ces défauts mais, les Etats-Unis étant les Etats-Unis, les armateurs ont commandé aux chantiers navals des navires capables d'aller aux Etats-Unis. Ils n'ont pas commandé en fonction de la sécurité, mais en fonction des règles existantes !
M. Alain GRILL : Ce qu'il faut peut-être ajouter, c'est que, lorsque nous avons obtenu le prix d'excellence Eurêka pour E3, nous avons présenté notre navire à toutes les sociétés de classification et à l'administration américaine. Nous avons demandé à cette dernière si l'E3 lui convenait et si elle pouvait l'assimiler aux bateaux à double coque visés par l'OPA. Malheureusement, la réponse a été négative. Il ne s'agit pas d'un refus catégorique puisque l'administration américaine a admis d'assimiler l'E3 et de lui permettre d'entrer dans un port américain à la condition que l'espace situé sous le pont intermédiaire ne soit pas chargé en pétrole. Mais réduisant d'environ 10 % le port en lourd du navire, elle rendait ainsi son exploitation non rentable !
Je suis de ceux qui pensent, et le président Boissier qui est maintenant à la barre des Chantiers de l'Atlantique partage également cet avis, qu'une des tâches de l'Europe - sinon de la France - sera, à la suite de la catastrophe de l'Erika,
de faire accepter le pétrolier E3 par les autorités américaines, non seulement comme étant conforme aux prescriptions de l'OPA, mais également comme étant meilleur !
M. le Rapporteur : Ce point particulier n'est-il pas intégré dans les dispositions prévues par la Commission européenne qui vont normalement être adoptées par les commissaires européens cette semaine ? Nous avons compris, pour notre part, qu'il l'était et qu'il y avait équivalence dans les préconisations de la Commission européenne entre l'E3 - même s'il n'est pas nommément cité - et les navires à double coque.
M. Alain GRILL : Un traitement de la Commission européenne par équivalence n'est pas favorable à l'E3 parce qu'il est incontestablement meilleur, comme cette petite plaquette et ces quelques schémas vous le prouvent !
Il se trouve que j'ai échangé, M. le député, une correspondance avec Mme Lalis, directeur des transports maritimes auprès du commissaire européen chargé des transports, qui m'avait demandé pourquoi l'E3 n'avait pas encore été construit alors que nous en vantions les mérites. Je lui ai expliqué de la façon la plus claire et la plus percutante ce que je viens de vous dire, à savoir qu'il n'avait l'équivalence d'un navire à double coque aux yeux de l'administration américaine qu'à condition de ne pas être complètement chargé. Cette disposition doit être revue de manière à ce que ce type de bateau pourtant plus sûr et à terme moins dangereux soit effectivement le bateau de demain ou d'après-demain.
Monsieur le député, vous m'avez interrogé sur les sociétés de classification. Nous sommes des constructeurs et nous ne cotoyons les sociétés de classification que pour la construction des navires neufs. Nous n'avons pas d'appréciation particulière sur leur activité de classification pour la flotte en service. Nous obtenons la classification pour le navire neuf, ce qui est capital pour l'assurance du navire mais aussi pour l'armateur qui a ainsi la certification que le navire est conforme aux standards de la spécification.
Maintenant, il faut savoir que leur département « construction neuve » et leur département « flotte en service » sont cloisonnés et étanches, de même que la réparation et la construction navales sont des activités séparées et très différentes même si elles concernent toujours le navire. Dans leur activité pour l'entretien de la flotte en service, il est évident que les sociétés de classification obéissent toutes à un règlement librement établi, qu'elles sont toutes amenées à l'appliquer - sinon à quoi bon en avoir un ? - mais que ces règlements sont extraordinairement difficiles à interpréter. Je vais vous en donner un exemple. Personne n'a jamais su encore véritablement mesurer l'épaisseur d'une tôle. Où faut-il prendre la mesure ? En cinq points ? Que faut-il faire ? Or, l'épaisseur d'une tôle reste, comme l'a précisé tout à l'heure Fabrice Théobald, l'un des facteurs de la sécurité du navire. On peut voir l'état d'une tôle, mais de là à savoir si après un certain nombre d'années à la mer l'épaisseur de cette tôle reste suffisante pour garantir la rigidité du bateau et, si tel n'est pas le cas, à évaluer ce qui reste comme acier sain après que les chancres de la rouille soient passés par là...
Ce que je veux dire, c'est que le métier des sociétés de classification, lorsqu'il concerne la flotte en service, est un métier très difficile ! Cela étant, il y a société de classification et société de classification. Le jeu auquel se livrent un certain nombre de transporteurs, notamment pétroliers, qui consiste à « zapper » d'une société de classification à l'autre, est un jeu tellement courant que l'on ne peut pas ne pas penser qu'il est justifié par le fait que, quand les prescriptions d'une société de classification conduisent à des travaux trop importants, on va voir si une société de classification n'opterait pas pour un traitement plus favorable.
Les sociétés de classification « de notoriété mondiale », appelons-les comme cela, s'appliquent une police librement consentie qui fait que les règlements, la manière de les appliquer, les échanges éventuels entre inspecteurs vont toujours en s'améliorant. On peut se dire qu'il y cinq ou six grandes sociétés de classification mondiales qui constituent « le dessus du panier ». A côté de celles-là, il y en a effectivement d'autres de caractère plutôt national, qui pensent avant tout à faire du chiffre d'affaires. Cet objectif n'est pas, en soi, condamnable, mais il peut effectivement entraîner des attitudes du type de celles que je critiquais, à savoir prendre un client chez un concurrent en lui faisant valoir qu'on se montrerait moins exigeant à son égard.
M. Fabrice THEOBALD : J'ajouterai juste une précision. Vous avez vu, que figure parmi les documents que nous vous avons passés un communiqué de l'AWES - Association of West European Shipbuilders - ou Association des constructeurs de l'ouest européen. Au congrès de La Baule, cette association avait décidé de former un comité pour l'élimination des navires sous-normes. Il se trouve que nos collègues asiatiques, qu'ils soient Japonais ou Coréens, mais aussi nos collègues américains, ont fait de même.
Chaque année, nous nous rencontrons donc pour échanger nos expériences et nous tenir au courant de ce qui se fait dans les différentes zones géographiques. Or, suite à la réunion de l'année dernière qui s'est tenue à Washington, il nous est apparu que le Mémorandum de Tokyo publiait la liste des navires détenus suivant leur société de classification. Cela signifie que, par société de classification, il établit les taux de détention des navires retenus par l'Etat du port.
A l'époque je me suis étonné - et je m'en étais ouvert à M. Serradji, directeur des affaires maritimes et des gens de mer - que le Mémorandum de Paris ne publie pas cette liste. On m'avait répondu que parfois des navires étaient détenus pour des défauts qui n'étaient pas directement liés à la classification.
C'est vrai, mais de même que le président Grill a fait appel tout à l'heure au concept de prix d'excellence, je ferai appel à celui de mauvais élève : on a tous connu des mauvais élèves et nous savons que généralement ils sont mauvais en tout - le cancre qui excelle dans certaines matières reste très rare. Je dirai donc que, dans l'ensemble, les mauvais élèves ont les mauvaises sociétés de classification. Finalement, c'est une politique de l'armateur. Il y a des armateurs qui sont bons, qui essaient de faire ce qu'il faut, qui sont honnêtes. D'autres essaient de tricher ou sont pour le moins indifférents aux problèmes de sécurité !
Je possède, parce que mes collègues japonais me l'avaient fait parvenir, la liste établie par le Mémorandum de Tokyo qui fait bien apparaître en bas de page que les déficiences pour lesquelles les navires ont été arrêtés ne sont pas forcément liées à la société de classification. Il est quand même intéressant, si je prends un exemple au hasard, de voir que le Rina - Registro italiano navale -
a un pourcentage de détention de 15,45 %, donc supérieur - et même assez supérieur - à la moyenne qui est de 7,29 % !
M. le Président : C'est intéressant !
M. Fabrice THEOBALD : Voilà donc une suggestion d'amélioration de la police des sociétés de classification ! La
US Coast Guard américaine dresse, elle aussi, une liste comparable. Le registre italien y est mieux placé. Il faut dire néanmoins qu'il classe assez peu de navires dans cette zone.
Par ailleurs, les garde-côtes américains publient également une liste des pavillons cibles. Ce sont les pavillons qui peuvent s'attendre à être soumis à une visite parce qu'ils sont considérés comme mauvais à la suite de précédentes inspections. Tiens, Malte en fait partie !
(Sourires )
Il est à noter que, de temps en temps, certains Etats, sans doute vexés de figurer sur cette liste infamante, « font vinaigre » : c'est ainsi que l'Algérie, le Chili, le Brésil, l'Egypte, l'Inde et la Lituanie sont sortis de la liste en 1999 parce qu'ils ont fait des efforts et ont mis un peu d'ordre dans leur flotte.
M. Alain GRILL : Avons-nous répondu aux questions posées ?
M. le Rapporteur : Tout à fait, et cela me permet de rebondir sur deux ou trois points très précis avant que mes collègues n'interviennent.
Il serait utile que nous disposions des articles de la campagne de presse hostile menée par le
Lloyd's list contre les mesures imminentes de la Commission européenne. Toujours à ce sujet, puisque vous avez parlé de pays européens qui faisaient du lobbying contre les propositions de la Commission, il serait intéressant, si cela ne vous gêne pas, de nous éclairer davantage, bien que nous nous doutions de quels pays il s'agit.
L'Agence maritime européenne dont vous proposez la création aurait, c'est clair, une mission de contrôle. Mais, dans votre esprit, anticiperait-elle sur ce que pourrait être une mission de police en mer ? Serait-elle, par exemple, amenée à organiser les actions d'intervention, de prévention et de police en mer, qui sont aujourd'hui effectuées séparément par les différents Etats membres ?
Par rapport au concept de l'E3, n'y a-t-il pas moyen de remédier techniquement à l'opposition américaine sur l'absence de pétrole en dessous du double pont ? L'E3 peut-il, ou non, être modifié pour répondre aux exigences américaines ?
Enfin, vous évoquez beaucoup les problèmes d'échouage. Cependant, dans le cas de l'Erika,
nous avons été confrontés à l'exemple d'une coque qui se rompt en deux et donc d'une pollution en mer dans des conditions plus difficiles que celles des catastrophes antérieures. Est-ce que cette cassure de coque est un phénomène particulier pour un constructeur ?
M. Gilbert LE BRIS : L'E3 reste un navire un peu expérimental. J'aimerais savoir si des études du même ordre ont été conduites pour des navires transportant des substances difficiles ou dangereuses telles que les produits chimiques ou les gaz par exemple ?
Combien d'exemplaires de l'E3 ont-ils été construits ?
Le développement du E3 se heurte un peu aux mêmes difficultés que celles rencontrées par le Concorde avec les Etats-Unis. Si vous avez été relativement convaincants, semble-t-il, vis-à-vis de la Commission européenne au sujet de la création d'une Agence européenne de sécurité maritime puisque l'idée a été reprise par Mme de Palacio, les instances communautaires ne semblent pas partager votre vision des choses au sujet de l'E3 : le fait de s'aligner sur le calendrier des Etats-Unis pour l'élimination des navires à simple coque est la marque que, finalement, nous sommes à leur remorque dans cette affaire. N'y a-t-il pas moyen de reprendre la main en faisant ce qu'il est bien convenu d'appeler du chantage, quitte à refuser les navires à double coque en Europe tant que les pétroliers E3 ne seront pas acceptés aux Etats-Unis ?
M. Louis GUEDON : Par rapport à votre exposé, j'aimerais avoir une explication sur une formule qui est un peu polémique, en raison de ses aspects dogmatiques, depuis le naufrage de l'Erika
: je veux parler du risque zéro !
Quand on connaît la mer, on sait très bien que les naufrages ont existé bien avant l'Erika et qu'ils existeront bien après. Si on prend la formule à la lettre, il est évident qu'elle est erronée puisque le risque zéro n'existe pas ! Cela étant, vous m'avez troublé, et c'est la raison pour laquelle je me permets de vous poser la question, en disant qu'une catastrophe telle que le naufrage de l'Erika
était à ce point préjudiciable qu'un nouvel événement de mer de ce type serait extrêmement mal vécu par les Français.
A cet égard, j'ai trouvé dans vos propos une certaine solidarité par rapport aux populations de l'ouest de la France. Vous avez parlé de « poubelle de l'Europe » : nous qui sommes liés à la mer, qui en tirons les subsides nécessaires à notre existence - que ce soit le tourisme, la pêche, l'ostréiculture, la conchyliculture -, nous ne pouvons accepter de voir notre économie anéantie par un manque de contrôles et de normes, par la complaisance, par les gains de chacun, par la concurrence entre les pays et entre les constructeurs. La liste est longue de toutes ces questions liées à des notions d'argent et d'intérêt qui passent par pertes et profits la dimension sociale des populations maritimes.
Pouvons-nous, en nous tenant aux navires transportant des cargaisons susceptibles de produire les méfaits que nous connaissons et que nous ne voulons pas voir se reproduire, sinon prétendre atteindre le risque zéro, du moins y tendre de manière asymptotique à travers des normes et des contrôles ? C'est une question qui hante les esprits des hommes, des femmes et des populations qui vivent des produits de la mer dans l'ouest de la France.
M. Alain GRILL : Si vous me le permettez M. le président je commencerai par répondre à cette dernière question.
Je suis heureux que vous parliez, M. le député, de la solidarité des constructeurs de navires avec les populations touchées par la pollution de l'Erika. Cette solidarité était explicite dans la lettre du 17 janvier, cosignée par M. Alain Parres, président du Comité national des pêches et dont, pour ne rien vous cacher, je suis l'auteur.
N'oubliez pas qu'ayant été pendant dix ans président des Chantiers de l'Atlantique, les affaires de pollution me touchent directement. L'actuel président des Chantiers de l'Atlantique me disait que, lors des essais en mer du
Renaissance IV qui précédaient sa livraison à son armateur, le navire a malheureusement dû traverser une nappe de pétrole échappée des cuves de l'Erika.
Quand il est revenu au port, il a fallu le mettre en cale sèche pour laver intégralement ses _uvres vives, c'est-à-dire la partie immergée. Qui dit laver intégralement les _uvres vives, dit bien sûr des dépenses, mais aussi des effluents et des eaux sales qu'il faut éliminer en raison de leur caractère polluant.
Il ne peut pas ne pas y avoir de solidarité. Il faut qu'il y ait une solidarité européenne de manière à ce qu'il n'y ait pas la France et quelques pays en proue, en quelque sorte, qui courent le risque de pollution alors que les camarades derrière - je pense au Luxembourg, à l'Autriche etc. - n'en subiraient aucune conséquence. Il faut donc solidariser le risque et le traiter avec les moyens du moment, c'est-à-dire, non pas au niveau de chaque Etat membre, mais au niveau européen !
Le risque zéro, il n'existe, ni là, ni ailleurs. J'ai essayé en vous parlant de cet effort européen sur le concept de pétrolier E3, de vous montrer qu'on peut faire mieux que ce qui existe - c'est-à-dire ce à quoi renvoie la législation américaine -, et repousser ainsi le risque jusqu'à des accidents dont la survenance, si elle ne peut être exclue, reste exceptionnelle car, selon les termes des navigants, pour se mettre sur des cailloux à 7 n_uds, il faut vraiment le vouloir !
On peut toujours tendre vers le risque zéro - vous parlez d'asymptote, ce que je comprends tout à fait -, mais cela a un coût dont il faut voir s'il peut être supporté par le consommateur final. Nous avons essayé de vous démontrer à travers la petite plaquette d'information sur le pétrolier E3 que ce coût nous paraissait faible.
Cela me permet de passer à la question de M. le député Le Bris qui me demandait, en établissant un parallèle avec le Concorde, comment nous pourrions reprendre la main.
De mon point de vue, les compagnies pétrolières ont un grand rôle à jouer. Je ne me suis pas fait faute, tout comme Fabrice Théobald, de présenter ce projet à Total Fina et à l'ancienne direction des carburants du ministère de l'Industrie. Je pense que ce sont elles, beaucoup plus que nous, qui, à partir du moment où elles décréteront que notre projet est meilleur que le reste, créeront le mouvement. Cela étant, je ne jette pas, tant s'en faut, l'opprobre sur les bateaux à double coque aux standards américains : ils constituent un réel progrès par rapport à ce qui existe actuellement !
Nous n'avons pas conduit d'études particulières dans d'autres domaines et, en particulier, pour les navires transporteurs de produits chimiques. Mais cette idée, que j'ai appelée « l'oeuf de Christophe Colomb » tout à l'heure, si elle n'est pas brevetable, est transposable. Il faut d'abord la transposer à de petits bateaux. Il faut des moyens financiers pour mener ces études. Je rappelle que le travail conduit à propos de l'E3 par les cinq chantiers européens de départ, en 1992, avait été réalisé sur fonds propres et sans aide publique pour financer nos recherches.
Il faudrait donc que nous obtenions des crédits, soit au niveau national, soit au niveau européen, par l'intermédiaire de la direction de la recherche, pour étudier d'une façon communautaire d'autres types de navires pétroliers ou d'autres types de navires tout court. Une multitude de problèmes pourrait être envisagée dans le sillage du naufrage de l'Erika
- pardonnez-moi d'employer ce terme qui me déplaît -, notamment la question des conteneurs qui partent à la mer par défaut d'arrimage et que les Havrais voient parfois flotter. De tels conteneurs, s'ils contiennent des téléviseurs ne présentent pas un grand danger ; mais il peut en aller autrement lorsqu'ils contiennent des matières dangereuses...
Un seul E3 a été construit : il l'a été à Puerto Real par Astilleros Españoles pour le compte d'un armateur espagnol du nom de Tapias qui l'a revendu. Je crois savoir qu'il appartient aujourd'hui à Euronavale, et qu'il navigue sous le nom de
Bourgogne.
J'en reviens aux questions du rapporteur pour y répondre, en m'en excusant, dans l'ordre inverse de celui où il les a posées.
Lors du naufrage de l'Erika, le bateau s'est effectivement coupé en deux. Un ingénieur du génie maritime comme Fabrice Théobald ou comme moi-même ne peut pas ne pas avoir une idée personnelle sur les circonstances qui ont conduit à cela.
Fabrice Théobald a dit tout à l'heure que, soumises à des flexions alternées, les coques ont d'autant plus tendance à manquer d'élasticité et à se couper qu'elles sont minces. Ce qui s'est probablement passé, c'est que, ayant de la gîte et recevant la mer par le travers - puisque le navire allait, grosso modo, vers le sud, vers le cap Finistère -, le navire a man_uvré comme tout commandant apprend à le faire, c'est-à-dire qu'il s'est protégé par rapport à la mer en se mettant en fuite. Donc, il a pris la mer de l'arrière pour ne pas l'avoir en travers. Ce faisant, la houle arrivait de l'arrière. Compte tenu de la longueur d'onde de cette houle, le navire s'est trouvé tantôt avec son étrave sur une crête, son arrière sur une crête et son milieu en l'air ou avec une flottaison très basse ; tantôt avec son milieu sur une crête donc l'avant et l'arrière ne flottant pas ; tantôt sur deux crêtes avec une partie centrale non supportée par l'eau et subissant des efforts d'autant plus considérables que la coque du navire était usée.
Nous, M. le député, nous travaillons sur un navire neuf qui a deux coques, comme l'exige la réglementation américaine et, de surcroît, deux ponts, ce que n'exige pas la réglementation américaine. Les phénomènes de flexion alternée - cela peut faire l'objet d'une étude affinée - seront à coup sûr bien mieux maîtrisés par un bateau à double coque et
a fortiori à deux ponts que par un bateau à simple coque et à un seul pont !
Vous m'avez demandé comment remédier à l'opposition des Etats-Unis. J'ai tendance à répondre, comme je l'ai fait précédemment, que l'action des compagnies pétrolières sera déterminante à cet égard. Il suffit que deux ou trois compagnies pétrolières se décident à sauter le pas et à aller le plus près possible de l'asymptote, ne serait-ce que pour redorer leur blason pour lever les oppositions politiques, y compris aux Etats-Unis.
Maintenant l'Agence maritime européenne doit-elle faire office de garde-côtes européenne, même si vous n'avez pas utilisé ce terme ?
M. le Rapporteur : Je ne parle pas d'une garde-côtes européenne, mais de la coordination réelle des moyens. Je ne crois pas que, dans l'immédiat, on parvienne à avoir une compagnie de garde-côtes européenne car cela poserait des problèmes de postes et de souveraineté, ce qui me paraît assez compliqué. En revanche, ont peut avancer l'idée d'une coordination des moyens des Etats en mer avec une responsabilité politique globale, chacun conservant ses propres moyens tout en les mutualisant, ce qui serait déjà un pas important. Envisagez-vous que l'Agence européenne, si un bateau était en difficulté, puisse organiser les interventions, demander à tel Etat d'envoyer un remorqueur de haute mer, et à tel autre de mobiliser les moyens antipollution de sa marine militaire ?
M. Alain GRILL : Permettez-moi de vous répondre à titre personnel : le citoyen que je suis répond par l'affirmative ! Je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi il y a un contrôle aérien européen, qui d'ailleurs dans un certain nombre de cas de figure paralyse les transports aériens, et pourquoi ce n'est pas le cas dans le monde maritime. Là, ce n'est pas le président de la Chambre syndicale des constructeurs de navires qui répond, mais le citoyen - et le citoyen Théobald a peut-être une vision des choses tout à fait différente de celle de la Chambre syndicale des constructeurs de navires sur ce point.
Je me permets tout de même d'attirer votre attention sur un pas supplémentaire que nous avons franchi dans cette direction en tant que constructeurs. Si vous voulez bien vous reporter au communiqué de presse de l'AWES - qui réunit les constructeurs de l'Europe des Quinze plus ceux de la Norvège et de la Pologne -, vous verrez que nous n'avons pas eu de mal, même si nous étions encore une fois les initiateurs de la démarche, à faire adhérer nos homologues voisins à l'idée d'un contrôle européen. Dans le texte anglais qui était le texte d'origine, vous verrez même apparaître le terme
watchdog qui a été traduit par « gendarme ».
M. Fabrice THEOBALD : Nous n'avons pas osé le traduire par « chien de garde »...(Sourires.)
M. Alain GRILL : Tout cela pour vous dire qu'il existe, au niveau des constructeurs, une grande solidarité dans l'approche de ces problèmes. Je vous ai dit bien sûr - et je bats ma coulpe - que nous sommes tous intéressés à ce que le marché s'assainisse, à ce que la demande de navires neufs s'accroisse. Mais en disant cela, il ne faut pas oublier que les nouvelles commandes ont beaucoup plus de chances de favoriser les chantiers de Corée que les nôtres. Il y a une grande solidarité.
M. le Rapporteur : ... mais vous êtes constructeurs !
M. Alain GRILL : ... mais nous sommes constructeurs !
M. le Rapporteur : Un tel communiqué de la part de l'Association européenne des armateurs pourrait, sans vouloir minimiser l'intérêt de votre position, avoir encore plus de force.
M. Alain GRILL : C'est bien pourquoi je vous faisais remarquer tout à l'heure, M. le député, que M. Marc Chevallier avait signé la lettre du 17 janvier et qu'à cet égard il avait, à mes yeux, de grands mérites !
M. François CUILLANDRE : Vous nous avez longuement parlé de construction navale avec cet intéressant projet de l'E3, mais l'élu brestois que je suis aurait souhaité vous entendre évoquer l'entretien et la réparation navale.
Je relis une phrase qui figure dans l'un des documents qui nous ont été remis tout à l'heure : « Même si des navires anciens sont parfaitement entretenus, mais pas tous »
- mais pas tous ! - « il existe une corrélation évidente entre l'âge des navires et les naufrages... »
Les véhicules automobiles de plus de 5 ans je crois, ont l'obligation de passer au contrôle technique tous les 2 ans et, s'il révèle des déficiences, d'y remédier.
Ne peut-on imaginer de mettre en place un système un peu similaire pour les navires qui, passé un certain âge, ne sont effectivement pas forcément des navires poubelles, mais le deviennent s'ils sont mal entretenus ?
M. Fabrice THEOBALD : Cela peut s'envisager, mais qui contrôlera les contrôleurs ? Nous retombons dans le problème des sociétés de classification. A partir du moment où il y a des marchands de certificats, le problème se repose !
On peut imaginer de procéder à ce que l'on appelle « la visite spéciale » à intervalles plus rapprochés. En ce moment elle intervient tous les 2,5 ans pour les navires de plus de 20 ans et on pourrait penser à y procéder plus fréquemment.
Toutefois, il y a toujours une limite. Quelqu'un a demandé si les accidents de structures étaient exceptionnels : non, malheureusement ils se produisent - souvent on n'en entend pas parler parce qu'ils surviennent loin de la France. On doit toutefois se souvenir que le naufrage de
l'Erika n'est pas le premier accident résultant d'une rupture de la coque du bateau au large des côtes françaises. Je rappelle que le
Tanio était un navire qui sortait d'un chantier de réparation italien et dont on avait changé plusieurs dizaines de tonnes de tôle, de nouvelles tôles ayant été placées sur les points faibles. Comme, chaque fois que l'on renforce un point faible, la faiblesse se déplace, le navire a cassé à l'endroit où s'arrêtait la tôle neuve !
C'est-à-dire que, passé un certain âge, on ne peut plus rafistoler et qu'il vaut mieux construire un nouveau navire !
Cela étant, il y a effectivement des mesures à prendre pour améliorer la situation. Je ne sais pas si vous avez entendu les représentants du Bureau Veritas ?
M. le Président : Pas encore !
M. Fabrice THEOBALD : Ils vous diront mieux que nous les contrôles non destructifs qu'il peuvent faire à l'aide d'outils informatiques et vous parleront de Veristar. En fait, le problème est moins technique que politique, car il est le fait de ceux qui ne respectent pas les règles ou qui tentent d'y échapper.
M. Alain GRILL : Il faut reconnaître que l'on n'a rien inventé de plus corrosif que l'eau de mer !
M. François CUILLANDRE : Un bateau c'est de la tôle et des moteurs et l'Amoco-Cadiz
sortait des chantiers Astilleros Españoles...
M. Alain GRILL : Absolument ! Il en va de l'entretien d'une coque comme de celui d'un pantalon. Dans mes vertes années, j'avais une grand-mère qui cousait des pièces sur mon pantalon ou sur les coudes et le tissu lâchait, non pas là où elle les avait placées, mais avant ou après. Ce qui est vrai pour le tissu, l'est aussi pour l'acier, à ceci près que l'eau de mer est vraiment très corrosive et qu'on cherche à protéger tout cela avec de la peinture. On plaisante souvent en disant de certains navires qu'ils tiennent avec de la peinture, ce qui revient à dire que la tôle d'acier est tellement mince que seule la peinture donne l'impression qu'ils ont une coque continue.
Je n'ai pas répondu à la première des questions de M. le rapporteur concernant les campagnes de presse qui sont hostiles aux mesures envisagées par la Commission européenne. Il se trouve que j'ai donné à Fabrice Theobald un document en anglais qui en sera un exemple, mais nous pourrons vous en faire parvenir d'autres.
Ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont les organisations internationales et notamment la Chambre internationale des armateurs ainsi que le Syndicat européen des armateurs qui interviennent actuellement, alors que les Etats se montrent beaucoup plus discrets. Or, comme ces organisations sont toutes représentées à Bruxelles, elles ont effectivement une puissance de conviction qui est d'autant plus forte qu'il est très facile de faire valoir les problèmes afférents à une reconstitution de la flotte mondiale.
La chose ne se fera pas en un jour ; elle suppose des sorties ordonnées, donc des dispositions de caractère international très difficiles à mettre en place : on peut donc monter en épingle tout un tas de difficultés !
Il faut que d'autres professionnels du monde de la mer luttent, comme nous le faisons au niveau de la construction navale, pour que ce genre de commentaires ne soit pas dirimant, c'est-à-dire qu'il ne décourage pas les bonnes volontés bruxelloises et strasbourgeoises qui se sont déjà manifestées, et qu'il ne les empêche pas d'aller de l'avant.
M. Jacqueline LAZARD : Vous avez déclaré que les bateaux neufs aux normes de l'OPA étaient meilleurs que les bateaux à simple coque, tout en émettant des réserves sur lesquelles je ne reviendrai pas. Néanmoins, il est un point qui me pose problème, c'est la vitesse de 3 n_uds : un pétrolier est-il vraiment maniable à cette vitesse ? Si tel n'est pas le cas, cela plaide en faveur de l'E3 qui assure la résistance jusqu'à 7,5 n_uds... En effet, on sait que les accidents se produisent le plus souvent par gros temps quand les capitaines de navire choisissent plutôt de naviguer entre 6 et 7 n_uds.
M. Alain GRILL : J'aurais tendance à vous répondre qu'un bateau est maniable à 3 n_uds, mais il y a longtemps que je n'ai pas eu l'occasion de naviguer sur un pétrolier. Votre question est importante et vous permettrez que nous y réfléchissions plus avant. Effectivement, si on est obligé de ralentir pour éviter le risque des abordages et des échouements en courant un autre risque qui est celui de non-maniabilité, c'est de la fausse sécurité!
Pour le bateau E3, comme l'illustre la plaquette, nous avons prévu tout un tas de raffinements dont on pourrait dire que ce sont des options comme il en existe pour les voitures. Il s'agit, entre autres, d'un gouvernail en deux parties et d'un moteur auxiliaire qui permet, si le moteur principal ne fonctionnait plus, de faire rentrer le bateau dans un port à petite vitesse. Bref, nous avons prévu une quantité de dispositifs pour éviter que le navire ne perde sa man_uvrabilité. On pourrait d'ailleurs intégrer ces dispositifs aux navires à double coque standards de manière à ce qu'ils restent man_uvrants à faible vitesse parce qu'effectivement, par mauvaise mer, la navigation à faible vitesse est très difficile.
En tant que président de la Chambre syndicale des constructeurs de navires, et au nom du délégué général, je voudrais vous remercier du temps que vous nous avez consacré. Je voudrais que vous m'excusiez d'avoir fait, mais c'est mon péché mignon, un petit peu de commerce auprès de vous...
M. le Rapporteur : Nous ne sommes pas acheteurs ! ...
(Sourires)
M. Alain GRILL : Je parle du commerce des idées !
(Nouveaux sourires ) Mais je ne voyais pas d'autre façon de vous parler de l'E3 qu'en essayant de vous le vendre.
Je reprendrai maintenant la parole en tant que citoyen si vous le permettez, pour vous faire remarquer quelque chose qui m'est cher depuis très longtemps. Ayant été fonctionnaire à la Marine marchande, ayant été armateur, ayant été constructeur, ayant été ingénieur du Génie maritime et ayant connu les arsenaux, y compris ceux de Lorient, comme le sait bien M. Le Drian, je veux attirer votre attention sur l'émiettement de l'autorité de l'Etat français dès lors que sont en cause des questions maritimes.
Lorsque, ayant pris l'initiative de la lettre du 17 janvier, j'ai eu la bonne fortune de rassembler des gens aussi différents que les pêcheurs, les représentants des ports, les constructeurs et les armateurs, j'ai réalisé que toutes ces professions avaient cinq tuteurs. Ma réflexion, que je vais essayer de rendre aussi concise que possible, est la suivante : je me demande si la mer ne s'est pas vengée du peu d'importance que l'Etat français lui attache, à travers une structure administrative qui peine à régler les problèmes maritimes. M. le président, je vous saurai gré de bien vouloir mettre cette réflexion à mon compte et non pas à celui du président de la Chambre syndicale des constructeurs de navires.
Audition de MM. Martin HIRSCH, directeur général,
et Claude LAMBRE, responsable de l'unité d'évaluation des risques physico-chimiques de l'Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA)
M. Bernard TAILLIEZ, directeur du laboratoire ANALYTIKA,
M. Alain BAERT du Centre anti-poison de Rennes,
MM. Michel GIRIN, directeur, et Michel MARCHAND, du CEDRE,
M. Jean-François MINSTER,
président de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER),
MM. Daniel MOREL, directeur général,
et Alain FEUGIER, directeur chargé de l'environnement
à l'Institut français du pétrole (IFP)
MM. Georges LABROYE, directeur général,
et André CICOLELLA, ingénieur responsable de l'évaluation des risques sanitaires
à l'Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS)
MM. Alain COUTÉ, directeur du laboratoire de cryptogamie,
et Jean OUDOT,
du Muséum national d'histoire naturelle
(extrait du procès-verbal de la séance du mercredi 15 mars 2000)
Présidence de M. Daniel PAUL, Président
M. le Président : Mes chers collègues, après avoir réalisé, depuis le 20 janvier dernier, date de création de notre commission d'enquête, une vingtaine d'auditions à huis clos, nous poursuivons nos travaux en ouvrant exceptionnellement à la presse, l'audition de cet après-midi, organisée sur le thème de l'éventuelle toxicité du fioul de l'Erika.
Il nous a en effet semblé utile, devant la multiplicité des interrogations et des annonces concernant la dangerosité de ce produit, de tenter de faire le point de ce que l'on sait aujourd'hui, même si nous n'ignorons pas que des études sont encore en cours, par exemple dans le cadre de l'Institut de veille sanitaire.
Nous accueillons donc aujourd'hui les représentants de plusieurs organismes qui se sont penchés, à un titre ou à un autre, sur cette question.
(Le président cite les organismes présents.)
M. le Rapporteur : Messieurs, bien que n'étant pas spécialistes techniques du sujet, nous avons souhaité cette rencontre parce que nous sommes perplexes, comme nos concitoyens dont nous sommes les porte-parole.
Nous voudrions, dans le cadre de notre enquête, dont nous ne rendrons les conclusions qu'au mois de juillet, essayer de clarifier cette situation. Nous ne souhaitons pas tenir un débat technique, que nous ne serions peut-être pas en mesure de suivre, hormis quelques experts parmi nous, mais recueillir des informations permettant de nous éclairer.
En ma qualité de rapporteur, j'aurai trois questions. Tout d'abord, il s'agit de déterminer si tout le monde parle du même produit. S'agit-il bien du fioul lourd numéro 2 ou non, et quand et comment avez-vous effectué vos prélèvements ? En effet, il subsiste toujours un doute sur ce sujet.
Par ailleurs, la première communication officielle, nous semble-t-il, quant à la toxicité du fioul de l'Erika, serait celle du 21 décembre faite par le centre anti-poison de Rennes. Dites-nous s'il y a eu des antécédents à cette communication. Sinon, y a-t-il, de la part des autres laboratoires, des divergences de fond sur le contenu de cette communication du 21 décembre du centre anti-poison de Rennes, largement répandue par la suite ?
Le centre anti-poison de Rennes reste-t-il sur la même position que celle prise le 21 décembre ? Les autres laboratoires ont-ils une position différente de celle-ci ?
Je suggère, M. le président, que l'on commence par l'ordre chronologique de la première communication qui était celle, à ma connaissance, du centre anti-poison de Rennes du 21 décembre.
Quant à la troisième question, elle concerne les ramasseurs sur les plages. Le bénévole, l'employé municipal, le pompier ont-il pris, en aidant au ramassage des dégâts de l'Erika, plus de risques qu'un pompiste ? Comment devons-nous, nous, membres de la commission d'enquête parlementaire, comprendre des titres de journaux, différents dans leur philosophie, totalement contradictoires dans leur énoncé, indiquant « un danger réel, mais sans risque... » Si c'est un danger réel qui n'a pas de risque, qu'est-ce qu'un danger ? Dans un autre journal, le même jour, on peut lire « le fioul était bien cancérigène, mais le risque est infime... » Le caractère cancérigène est-il infime ?
Qu'en est-il exactement ? Comprenez que la population et notre commission, composée de nombreux élus du littoral, s'interrogent sur la contradiction entre le risque et le danger.
Ceci situe l'esprit dans lequel nous intervenons. Il n'est pas question, pour nous, de nous substituer aux procédures judiciaires, mais d'essayer d'éclairer l'opinion.
M. Alain BAERT : Le centre anti-poison de Rennes, auquel j'appartiens, a été contacté le 21 décembre, par le médecin inspecteur de la DDASS du Morbihan, sur demande de son préfet. La commande était d'envisager les mesures de protection qui seraient nécessaires à mettre en _uvre, dans l'hypothèse où le mazout de l'Erika arriverait sur les plages et qu'il y aurait nécessité de le ramasser.
Cette mission nous incombe de par les différents textes qui nous régissent puisque nous avons à donner, notamment en cas d'urgence comme le précise notre décret fondateur, face à une demande d'évaluation de risques, des avis et conseils pour toute substance pouvant entrer en contact avec l'homme, qu'elle soit de synthèse ou dispersée dans l'environnement. Par conséquent, cette mission était parfaitement du ressort du centre anti-poison.
Notre démarche a été d'identifier en premier lieu les dangers, c'est-à-dire essayer de nommer les affections, les maladies ou les lésions dont pourraient souffrir les personnes qui seraient exposées à ce mazout. Cela nécessite tout d'abord de définir par quelles voies ces personnes seront en contact. Classiquement, il existe trois voies : la voie digestive, si on l'ingère, la voie respiratoire si on l'inhale, et la voie cutanée si on est en contact avec le produit par la peau ou les muqueuses.
Partant de là, nous avons recherché, dans la littérature, chose que nous avions entreprise dès la connaissance du naufrage, en fonction des éléments connus à l'époque sur la nature de ce fioul, les lésions décrites, soit expérimentalement chez l'animal, soit dans les études de surveillance de populations, notamment de travailleurs.
Dès lors que l'on a pu identifier ces dangers, on distingue schématiquement les effets immédiats, que l'on dit aigus, des effets chroniques, liés à des expositions beaucoup plus longues. Ces effets peuvent également être distingués en des effets réversibles, c'est-à-dire qu'ils vont disparaître à l'arrêt de l'exposition, soit immédiatement, soit après quelque temps ou un traitement médical, et des effets irréversibles, qui conduisent à une altération d'une fonction de l'organisme ou d'un organe.
Dans le cas qui nous préoccupe, nous avions identifié les voies de pénétration. Des effets aigus par voie digestive nous paraissaient, sur le moment du ramassage, comme non-envisageables car il aurait fallu ingérer ce pétrole.
S'agissant de la voie respiratoire, les caractéristiques physico-chimiques, qui nous avaient été communiquées par le CEDRE et le LASEM* de Brest, le laboratoire d'analyse de la marine, montraient qu'il y avait une certaine proportion de composés volatils (benzènes, naphtalènes, etc.). Ces composés, dilués dans l'environnement et tenant compte que nous sommes au mois de décembre et qu'il fait froid, sont peu volatils. Par conséquent, on estimait que la concentration à laquelle seraient exposés les gens était très faible et ne risquait pas d'induire des effets sur la santé.
La voie, qui apparaissait essentielle et prédominante dans ces opérations de ramassage, soit à la main, soit avec des pelles, était la voie cutanée. C'est d'ailleurs celle qui est également prépondérante dans la pathologie professionnelle. Ceci concernait les données quant à l'identification des dangers.
Les effets aigus sont des effets irritants pour la peau, voire de photosensibilisation. En association avec le soleil, il se produit une aggravation des lésions. Toutefois, au mois de décembre, cette possibilité restait non envisageable.
Enfin, ce mazout contient effectivement une proportion non négligeable, voire très importante par rapport à d'autres produits habituellement manipulés, de composés qualifiés d'hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP). Ce nom chimique résulte de plusieurs cycles associés. Un certain nombre de HAP ont été identifiés comme étant cancérogènes, donc susceptibles d'induire le cancer par différentes voies de pénétration chez l'homme.
Lors de la première démarche, il s'agit donc de nommer les dangers. La deuxième démarche consiste à faire une évaluation du risque, c'est-à-dire pouvoir indiquer quantitativement la probabilité que ce danger survienne chez les gens, dès lors qu'ils seront exposés, mais cela ne reste qu'une probabilité. Autant le danger est une certitude -on est malade ou on ne l'est pas, on a une infection sur la peau ou pas - autant le risque reste, pour sa part, un concept de pari sur l'avenir, une probabilité.
On utilise souvent pour cela des modèles mathématiques d'extrapolation des données animales à l'homme. Comme l'a souligné secondairement le travail de l'INERIS, notamment pour la voie cutanée, il n'existe pas de modèle actuellement qui nous permette de faire cette évaluation, c'est-à-dire estimer la probabilité que le fait de mettre les mains dans le mazout, à plusieurs reprises, donnera une lésion, notamment chronique, puisque la lésion aiguë sera visible très rapidement. La lésion chronique, c'est-à-dire la cancérisation, se verra très tardivement.
C'est pourquoi, n'étant pas en mesure de faire une évaluation de ce risque, nous avons sauté cette étape pour faire une gestion du risque. Nous sommes partis du principe qu'en supprimant la voie d'exposition principale des ramasseurs à ce mazout, la question de l'évaluation du risque et des conséquences à long terme allait tomber d'elle-même. De plus, cela répondait parfaitement à la demande de notre confrère du Morbihan concernant des mesures de prescription pour les travailleurs.
Aussi nous avons insisté sur la pénétration cutanée, par conséquent la nécessité de porter des protections cutanées adaptées, notamment des bottes, cirés et gants résistant aux hydrocarbures, remontant suffisamment haut pour ne pas permettre le passage trop fréquent du pétrole sur les zones de friction que sont les poignets, les coudes, etc.
Ceci étant, il a bien fallu envisager que, comme tout système de protection, il puisse avoir temporairement ses failles : le mazout rentre sous les gants, les gants se percent... La réflexion que nous avons alors menée, en tenant compte des données de la littérature, certes animales, mais également de pathologie professionnelle, consiste, comme toute évaluation du risque en absence de certitude, en un jugement.
Nous avons également tenu compte du fait qu'un certain type de goudron, qui contient des hydrocarbures aromatiques polycycliques, est utilisé en thérapeutique humaine pour traiter les psoriasis depuis nombre d'années, c'est ce qu'on appelle le coaltar. Il existe un suivi de ces patients qui ont été traités, notamment par les dermatologues.
Il n'a pas été montré, dans ces suivis, d'excès de cancers, même si des cas particuliers ont pu être rapportés. Tenant compte de toutes ces données, nous avons estimé qu'avec un contact accidentel et épisodique, l'excès de risque restait dans les limites de la vie courante, en rappelant que la fréquence des cancers de la peau double actuellement tous les dix ans, pour d'autres facteurs qui ne sont pas chimiques. Ces prescriptions ont été données au médecin inspecteur de la DDASS du Morbihan. Elles ont également été transmises, pour information, au CEDRE.
M. le Rapporteur : De quel endroit provenaient les échantillons que vous avez analysés ? Avez-vous modifié votre jugement depuis ou été amené à analyser d'autres échantillons ?
M. Alain BAERT :
Nous n'avons jamais fait d'analyses parce que notre centre n'a pas cette mission, ni le plateau technique. Pour évaluer la situation, nous avons demandé des informations au CEDRE et reçu des chromatographies effectuées par le laboratoire de Brest Naval. Par ailleurs, selon notre habitude, nous avons contacté Total pour savoir ce que lui nous disait être dans la cargaison.
Depuis, à la lecture des différentes données publiées, notamment sur le site du CEDRE ou par l'Institut français du pétrole, nous ne voyons aucune raison de modifier notre jugement. Nous sommes tout à fait d'accord qu'il existe une augmentation de la concentration dans les échantillons en hydrocarbures cancérigènes, car un certain nombre de fractions, pour nous, s'évaporent. Par conséquent, le reste contient une proportion beaucoup plus importante d'hydrocarbures. Néanmoins, dans les problèmes de cancérogénèse, que le pourcentage soit de 50 % ou 90 %, ce n'est pas cela qui fera une différence, l'important étant la présence de substances cancérogènes.
M. le Rapporteur : Maintenez-vous toujours votre formule dans la limite de la vie courante ?
M. Alain BAERT : Oui.
M. Michel GIRIN : Le rôle du CEDRE, dans une telle situation, est de fournir aux autorités des conseils dans la lutte et d'apporter notre savoir, afin que cela soit utilisé le plus efficacement possible, au mieux des intérêts de cette lutte. Nous avons donc fourni au Dr Baert les documents et les éléments qu'il nous avait demandés. Nous avons reçu copie de sa note, qui nous a semblé tout à fait adaptée aux circonstances et à laquelle nous souscrivons en totalité.
Nous avons, par ailleurs, été contactés directement, le 24 décembre, par le préfet du Morbihan. Ce même jour, nous avons envoyé à toutes les préfectures de département et à la préfecture de zone de défense, un fax intitulé « Préconisations pour une intervention sur le fioul qui arrive sur le littoral ». Ce fax, ultérieurement mis sur notre site Internet, dès son ouverture, reprend les recommandations techniques pratiques telles que port de bottes, de cirés et gants indispensable.
J'ajoute un autre point important. Nous savons, par des naufrages précédents, que le problème réel, rencontré dans la lutte par les opérateurs, est un problème d'accidents du travail. C'est un problème de noyades - une noyade lors de la marée noire de l'Amoco -, de crises cardiaques - plusieurs crises cardiaques à l'époque de la lutte contre le
Nakhodka -, de chutes dans les rochers.
Notre personnel s'est rendu sur le terrain, dans des PC Polmar, muni de fiches de santé/sécurité des intervenants, insistant sur les problèmes de chutes, de brûlures, de blessures par chocs, de chutes dans l'eau, de poussières micro-particules, c'est-à-dire l'éventail d'accidents pouvant survenir sur des chantiers. En effet, le nettoyage est d'abord un chantier.
La partie cancérogène est une spéculation, tandis que la chute peut réellement se produire. Dans le cadre de cette lutte contre l'Erika, il y a une blessure grave par chute. Ce sont les problèmes auxquels nous avons été amenés à faire face et qu'il nous a fallu traiter.
Pour compléter les propos du Dr Baert : nous avons également, entre les mains, une réponse qu'il a fournie à notre chef d'équipe intervention, Michel Marchand. Ce dernier avait attiré son attention sur les dangers pouvant être présentés par le nettoyage des côtes à l'aide de Kärcher à haute pression, au moment où commençait le nettoyage avec ces appareils. Nous avons reçu du Dr Baert une réponse très complète qui a été mise sur notre site Internet.
M. le Rapporteur : Afin que nous comprenions bien la marche suivie, l'analyse menée au centre anti-poison concernait des préconisations par rapport à une identification du fioul transporté, lequel vous a été transmis par le CEDRE. Vous-même n'aviez pas manipulé ce produit pour l'analyser. En revanche, le CEDRE l'avait analysé.
M. Alain BAERT : Oui.
M. le Rapporteur : Votre évaluation s'est donc basée sur une fiche d'identification fournie par le CEDRE sur le fioul déjà identifié comme étant un fioul lourd numéro 2.
M. Michel GIRIN : Je pourrai vous communiquer ce tableau des échantillons que nous avons reçus et qui ont été analysés. Il s'agissait d'échantillons en provenance de la société Total, échantillons ramassés en mer par le navire de la marine nationale Ailette...
M. le Rapporteur : Quel jour ?
M. Michel GIRIN : Pour les échantillons raffinerie des Flandres, c'était le 12 décembre, pour les échantillons du BSHM Ailette le 16 décembre, pour les échantillons de l'ICO le 17 décembre, pour les échantillons en provenance de la ligue pour la protection des oiseaux venant de plumes souillées, le 18 décembre. Vous avez un assortiment de préleveurs, dans des conditions tout à fait différentes. Tous ces produits ont été analysés au LASEM et ont donné la même signature, celle du fioul de la cargaison de l'Erika.
M. le Rapporteur : Pour vous, il n'y a aucun doute sur ce point...
M. Michel GIRIN : Pour nous, il n'y a aucun doute. Je me tourne vers Michel Marchand qui est notre chimiste...
M. Michel MARCHAND : Sur l'identité du polluant, il semble y avoir un faisceau d'éléments convergents essentiellement sur les analyses pratiquées par l'Institut français du pétrole. Ce dernier a indiqué que les deux échantillons de référence Total, acheminés vers l'Institut français du pétrole, soit
via le CEDRE, par rapport à l'échantillon que nous avions reçu le jour même de l'accident, soit par l'intermédiaire de l'AFSSA, montraient que les analyses étaient identiques.
Par ailleurs, deux autres échantillons ont fait l'objet d'analyses, entre autres un échantillon prélevé le 22 décembre en mer et un échantillon de déchets se trouvant à Donges, sur le site de stockage des déchets. L'ensemble de ces analyses montre, selon la conclusion de l'Institut français du pétrole, que la nature même de l'échantillon représente du fioul numéro 2.
M. Daniel MOREL : L'Institut français du pétrole, qui est intervenu comme laboratoire d'expertise et de contre-expertise, dispose à la fois des méthodologies et des moyens d'analyse indispensables pour arriver à une caractérisation et une identification chimiques rigoureuses des produits.
Nous intervenons, mais ce n'est pas l'objet de la présente réunion, comme conseil du secrétariat général à la mer sur les opérations de récupération du pétrole qui reste dans l'épave.
Je vais énumérer précisément ce que nous avons été amenés à faire, et qui recoupe des éléments donnés précédemment par nos collègues. Nous avons fait trois types d'analyse. Tout d'abord, des analyses de la composition du fioul initial, sur deux échantillons :
- un échantillon qui nous a été envoyé par le CEDRE et que nous avons reçu le 28 décembre ;
- un échantillon qui nous a été envoyé par l'AFSSA et que nous avons reçu le 6 janvier 2000.
Nous avons ensuite procédé à des analyses du comportement au vieillissement pour le suivi dans le temps du produit, également sur deux échantillons : l'un prélevé en mer le 22 décembre, soit dix jours après le naufrage, par l'Ailette, le navire affrété par la marine nationale et équipé de récupérateurs ; l'autre prélevé sur le stockage des déchets à Donges, le 7 janvier 2000 et représentatif du produit arrivé sur la côte.
Nous avons réalisé un troisième type d'analyses, à savoir des analyses du transfert à l'eau des hydrocarbures contenus dans le fioul initial. Ce sont des résultats que nous avons envoyés à l'AFSSA le 26 janvier 2000. Nous avons envoyé un document final, le 8 mars.
Les résultats principaux de ces différents types d'analyses auxquels nous nous sommes livrés sont les suivants. Tout d'abord, nous avons obtenu des résultats identiques entre les deux échantillons de fioul initial, envoyés par le CEDRE et par l'AFSSA. Il s'agissait, sans aucun doute, d'une courbe de distillation classique d'un fioul
oil numéro 2. Nous nous sommes livrés à une analyse très détaillée, par famille, de ce produit qui est constitué de plusieurs coupes pétrolières bien identifiées dont 42 % d'aromatiques.
Dans la famille des aromatiques, nous avons procédé à l'analyse des hydrocarbures aromatiques polycycliques, en particulier des seize hydrocarbures aromatiques polycycliques de la liste de l'Agence de protection de l'environnement qui liste ces produits classés cancérogènes.
Nous avons recherché et identifié des marqueurs spécifiques, en particulier géochimiques, qui permettent de constituer la caractéristique du fioul initial. C'est bien cette signature qui nous a permis de tracer le fioul sur les deux échantillons que j'évoquais, l'un prélevé en mer par le navire Ailette et l'autre sur le stockage de déchets à Donges. Il s'agissait bien du même produit.
Pour ce qui concerne le reste des analyses, nous avons pu mettre en évidence une dissolution lente et faible des hydrocarbures et, pour ce qui touche à la question de l'inhalation, une évaporation relativement faible, puisque limitée à moins de 10 % de la masse de ces produits.
M. le Président : Je propose que l'IFREMER nous expose les conséquences qu'ils ont pu en tirer.
M. Jean-François MINSTER : L'IFREMER est un organisme de recherche, un EPIC
- établissement public industriel et commercial - qui travaille principalement sur les problèmes d'environnement du littoral et des ressources vivantes. Cette agence de moyens dispose d'outils d'intervention à la mer et gère des réseaux de surveillance, à la fois des pêches, des coquillages et du littoral. C'est dans ce cadre que l'IFREMER est intervenu sur l'ensemble du problème.
Dès la semaine du 20 au 24 décembre 1999, l'IFREMER a fait de lui-même des prélèvements sur les coquillages du Finistère-Sud à la Charente, à titre conservatoire, estimation du point zéro. Ces prélèvements, au départ, ne sont pas liés aux problèmes de santé des ramasseurs, mais à la toxicité éventuelle des coquillages et des pêches.
Depuis le début janvier, à la demande expresse du ministère de l'Agriculture et des pêches qui a été confirmée par écrit le 21 décembre 1999, les prélèvements ont été systématisés, avec une fréquence bimensuelle et mensuelle. Il s'agit d'un prélèvement tout le long de la côte, qui multiplie par quatre le réseau de surveillance habituel du littoral, en nombre de stations.
Les échantillons sont transmis au laboratoire de Rouen, à la demande du ministère de l'Agriculture et des Pêches, principalement pour des problèmes techniques, en raison de la capacité du laboratoire de Rouen, même si elle est saturée, et de la nécessité d'homogénéité de la qualité des mesures, suivant les mêmes protocoles.
De plus, l'IFREMER a choisi de s'attaquer à la caractérisation plus large des échantillons. Il faut en gros imaginer qu'il y a environ deux mille molécules dans le pétrole. Au-delà des hydrocarbures aromatiques polycycliques, d'autres molécules sont toxiques. L'IFREMER caractérise, sur dix points, plus de trois cents molécules mensuellement. Cela accompagne les mesures faites sur environ soixante-dix échantillons par le laboratoire de Rouen.
Ces résultats sont régulièrement transmis au ministère de l'Agriculture et des pêches, au directeur départemental des affaires maritimes et à l'AFSSA. L'IFREMER, ensuite, agit au large car, même si une grande partie du pétrole, la partie visible, est arrivée à la côte, il en reste néanmoins encore beaucoup en mer. Cette partie en mer, moins visible, peut parvenir à la côte ou, lors du réchauffement des eaux au printemps, continuer à dégazer et affecter les nourrisseries de poissons, voire les pêches.
En conséquence, l'IFREMER a organisé une série de campagnes, et le fera régulièrement tout au cours de l'année. Aujourd'hui, deux types de campagne ont principalement été faits : des campagnes à proximité de l'Erika, dans la colonne d'eau, et près du fond. Près du fond, la qualité de la campagne, en raison du mauvais temps et du matériel utilisé, ne permet pas bien de savoir ce qui se passe. En revanche, elle montre qu'il y a du pétrole dans la colonne d'eau, au large, dans des zones de pêche.
Lors d'un trait de chalut, le pétrole colle au chalut et peut éventuellement souiller les poissons. D'ailleurs, sur les criées, on trouve des poissons souillés, éliminés au fur et à mesure par les pêcheurs. Lors d'une campagne qui a eu lieu du 16 au 25 février en baie de Quiberon, de Vilaine, de Bourgneuf et dans l'estuaire de la Loire, il a été démontré que, sur les nourrisseries et le sable, il y a également du pétrole actuellement, dans des zones de développement des espèces.
Aujourd'hui, les pêches ne montrent pas d'effets significatifs sur les poissons, que ce soit du point de vue de l'odeur ou des affectations du poisson. Cependant, il faut se souvenir que le problème doit être envisagé sur le long terme. Lors des accidents précédents, les effets sur les poissons étaient souvent visibles plus de huit mois après l'accident. Il faut donc continuer la surveillance dans la durée, non seulement sur le littoral, mais aussi au large.
Par ailleurs, l'IFREMER, en tant que conseil, a participé aux travaux de l'AFSSA, en particulier à la réflexion sur le taux acceptable d'hydrocarbures aromatiques polycycliques dans les coquillages et au développement de tests olfactifs, plus simples que la mesure des hydrocarbures, sachant que ce n'est qu'un palliatif rapide et que cela nécessite, en tout état de cause, les mesures des hydrocarbures.
Il est frappant de constater que les tests olfactifs sont utiles pour les moules et les coques, mais pas pour les huîtres. De plus, le seuil de 0,5 microgramme par kilo de matières sèches de HAP total est particulièrement bas, car inférieur aux concentrations observées actuellement en bruit de fond dans un grand nombre de sites conchylicoles.
Actuellement, sept sites en Méditerranée et dix-neuf sites en Manche dépasseraient ce seuil. Par conséquent, l'IFREMER a alerté sur le problème d'attention à la différence entre la toxicité, la dose et le danger pour les consommateurs. En effet, il ne suffit pas d'avoir des coquillages affectés, il faut aussi en consommer de grosses quantités. Toute cette dialectique a été discutée à l'AFSSA, mais je laisse mes collègues experts débattre de cette question.
M. le Rapporteur : Pouvez-vous préciser cette affaire des dix-neuf sites de conchyliculture ? Cela signifie-t-il qu'aujourd'hui, dix-neuf sites, qui ne sont pas touchés par l'Erika, ont des taux supérieurs au taux...
M. Jean-François MINSTER : Oui, au taux seuil initialement préconisé et qui a été modifié justement sur la base de ce constat, probablement trop rigoureux dans le concept initial. Mes collègues vous expliqueront que tout un débat a lieu sur la toxicité et le risque.
M. le Rapporteur : C'est donc après la marée noire que l'on découvre que les sites sont toxiques...
M. Jean-François MINSTER : Non, ils sont surveillés depuis longtemps. Pour vous donner un exemple, il y a un an de cela, sur un des marchés, des huîtres ont été détectées comme contenant des concentrations de 1 000 microgrammes par kilo de HAP total. Une traçabilité a été faite à la suite de laquelle on s'est aperçu que les pêcheurs faisaient dégorger leurs huîtres dans des bacs goudronnés. Les pratiques habituelles peuvent être aussi nocives que la catastrophe de l'Erika.
M. le Rapporteur : Par conséquent, vous estimez qu'il n'y a pas sur la conchyliculture aujourd'hui, vu de l'IFREMER, de risques particuliers.
M. Jean-François MINSTER : Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit qu'il faut être prudent sur les seuils à déterminer pour interdire la vente et qu'il ne faut pas les prendre trop bas sur des principes de précaution extrêmes, compte tenu de ce qui existe au quotidien. Il faut bien les analyser.
Je voudrais également souligner que c'est malgré tout un problème dans la durée. En effet, même en mettant une huître polluée dans de l'eau pure, il lui faut six mois pour dégorger ses HAP. C'est donc un problème de toxicité qu'il faut surveiller dans la durée. Enfin, les molécules dissoutes dans l'eau de mer sont transportées par les courants. Ce n'est pas parce qu'un site, à une date donnée, n'a pas de grosses concentrations qu'ultérieurement, les grosses concentrations n'y parviendront pas, transportées par les courants.
Il convient d'analyser tout ce problème de fonctionnement marin, de toxicité et d'écotoxicité dans le système, et non pas seulement la chaîne finale, car le problème perdurera. Je voulais attirer votre attention sur cette dimension. Non seulement il faut faire attention aux difficultés éventuelles pour les ramasseurs, mais également aux ressources marines, que ce soit les poissons ou les coquillages, car ce problème va s'installer dans la durée.
M. Martin HIRSCH : L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments est un établissement public administratif dont l'une des missions est d'évaluer les risques alimentaires, en s'appuyant sur les personnels scientifiques de l'Agence et sur des comités d'experts qui peuvent appartenir à différents organismes de recherche ou d'enseignement.
L'Agence a été associée à la crise de l'Erika dès le 23 décembre, lorsque a été mise en place une coordination par réunion téléphonique, sous l'égide des autorités sanitaires, pour travailler entre les centres anti-poison, les DDASS et les différents organismes, et étudier les recommandations qui pouvaient être faites. Le 27 décembre, l'Agence a été saisie officiellement par les ministres d'une demande qui portait sur différents points, dans le cadre de la gestion de cette crise.
Les questions posées à l'Agence étaient les suivantes : « Afin de mener une surveillance adaptée à cette situation exceptionnelle, l'expertise de l'AFSSA est nécessaire en vue de connaître les risques que représente une telle pollution en matière de contamination des produits de la mer (céphalopodes, coquillages, crustacés, poissons,), à court, moyen et long terme. »
Le deuxième objet de la demande était de préciser les méthodes et techniques pour rechercher les molécules en cause. Quant au troisième, il était de recommander des valeurs permettant d'écarter de la consommation, des produits qui pouvaient s'avérer dangereux, sachant que l'on était dans un domaine pour lequel il n'existait pas, dans les contaminants possibles, de normes applicables pour les produits de la mer.
Dans ce cadre, nous avons été conduits à émettre quatre avis et recommandations entre le 6 janvier et le 6 février, lesquels se sont appuyés sur des travaux des comités de nos experts, auxquels ont été associés des experts d'autres organismes, tels que l'IFREMER et le CNRS.
A l'occasion de ces travaux, des administrations et des organismes concernés, tels que le CEDRE, l'IFP ou la société Total, ont pu être auditionnés. Les avis, rendus publics dès leur transmission, ont porté sur l'étude de différents points. Vous avez l'avis rendu public le 6 janvier, à une époque où on n'avait pas d'informations validées sur la composition exacte de la cargaison de l'Erika.
Nous avons alors pu raisonner sur deux types de données :
- les connaissances acquises sur cette catégorie de fioul, appelée fioul numéro 2 ;
- les connaissances générales sur la présence des substances toxiques dans ce genre de fioul, qu'il s'agisse des hydrocarbures aromatiques polycycliques mentionnés, des métaux lourds ou d'un certain nombre de substances de cette nature.
C'est sur ce fondement qu'a pu être rendue publique, à titre conservatoire, une recommandation d'interdiction d'un certain nombre d'activités pour éviter d'introduire, dans la chaîne alimentaire, des produits qui auraient pu se trouver dans des zones polluées. Par ailleurs, cela a permis de rappeler le caractère cancérogène des substances en cause, à partir d'une analyse préliminaire des premières connaissances que l'on pouvait avoir.
Au fur et à mesure des semaines, ces groupes de travail ont pu affiner leurs connaissances dès lors que des précisions sur la composition du pétrole ont été transmises par différents organismes, dont les laboratoires publics, et que les premiers résultats d'analyse, faits sur des échantillons de produits de la mer, ont pu être connus.
Nous avons recueilli les informations en matière de travaux expérimentaux, tant des organismes français, tels certains laboratoires du CNRS, que des laboratoires de pays européens, tels les laboratoires néerlandais qui ont beaucoup travaillé sur ces sujets. Ces laboratoires pouvaient nous communiquer des informations scientifiques importantes en vue de préciser et les risques et les recommandations.
Enfin, nous avons utilisé les informations dont nous pouvions disposer, à partir du réseau de surveillance précédemment cité par le directeur de l'IFREMER. Ce réseau permet de disposer de connaissances sur les niveaux de base, hors contexte d'une telle crise, d'imprégnation en hydrocarbures des produits de la mer, variables selon les différents points de la côte.
A partir de ces éléments, ont été émis plusieurs avis et recommandations dans la technique desquels je ne rentrerai pas. En revanche, M. Claude Lambré, qui est un expert en la matière, pourra vous apporter des compléments de réponse si vous le souhaitez. Les avis et recommandations que l'on a pu émettre ont concerné deux aspects :
- le suivi à court, moyen et long terme, à partir de traceurs biologiques, pour pouvoir, non seulement dans l'acmé de la crise, mais au fur et à mesure, continuer à suivre des traceurs directs ou indirects permettant de savoir quand on tendrait vers le retour à l'état normal ;
- les seuils que l'on pouvait recommander, connaissant leur toxicité, en fonction de la connaissance plus précise du pétrole.
Ceci a conduit à de premiers seuils stables proposés le 5 février 2000, à une époque où on disposait des résultats des analyses sur le pétrole et des travaux qui avaient été conduits. Parallèlement, les scientifiques de l'Agence ont été associés ou ont coordonné des travaux conduits avec différents laboratoires pour harmoniser les méthodes analytiques utilisées.
Cela a été le cas avec les laboratoires qui ont été chargés, par les pouvoirs publics, de mesurer au fur et à mesure les substances toxiques dans les produits de la mer, afin que les conditions de travail soient comparables et que l'on puisse veiller à la fiabilité des résultats.
M. le Président : Merci. La campagne médiatique, qui s'est développée depuis quelques jours, a remis en évidence un certain nombre de questions, de problèmes et de craintes vis-à-vis des manipulations faites par les intervenants sur les plages. J'aimerais donner maintenant la parole à l'INERIS, puisque ce sont les derniers qui sont intervenus dans cette campagne, ensuite au laboratoire Analytika, de façon à éclaircir les données sur cette question.
M. Georges LABROYE : L'INERIS, institut sous la tutelle du ministère de l'Aménagement du territoire et de l'Environnement, a pour mission d'évaluer et de prévenir les risques tant accidentels que chroniques, liés à l'activité industrielle, aux produits chimiques ou autres risques tels que géotechniques.
Dans ce cadre, l'INERIS a été saisi, le 11 février 2000, suite au débat sur la cancérogénicité des produits contenus dans l'Erika. Le ministère de l'Aménagement du territoire et de l'Environnement nous a demandé, en liaison avec les autres ministères, de faire une évaluation des risques de l'ensemble des opérations qui ont eu lieu sur les plages, que ce soit les opérations de nettoyage des plages, des oiseaux ou d'autres opérations faites principalement par les bénévoles, mais aussi tous les autres intervenants sur ces plages.
Nous sommes partis d'une analyse des substances qui se trouvaient, elles, sur la côte. Nous n'avons absolument pas étudié l'intérieur de la cargaison. En effet, dans une évaluation des risques, on s'attache principalement au produit en contact avec les personnes. Dans ce cadre, nous avons refait des analyses sur ces échantillons.
Je tiens à confirmer que, de ce point de vue, bien que nous n'ayons pas analysé le produit dans le bateau, nos résultats sont compatibles avec les autres résultats obtenus par les instituts cités précédemment, à cela près qu'il y a un peu moins de produits volatils, en particulier les naphtalènes, puisque nous avons fait les analyses des échantillons plus tardivement que ces autres instituts.
Je vais passer la parole à André Cicolella qui va vous donner un résumé des diverses évaluations faites.
M. André CICOLELLA : Nous avons appliqué la méthode de l'évaluation des risques telle qu'elle est préconisée par l'agence américaine de protection de l'environnement, à la fois dans les lignes directrices pour évaluer les dangers et l'exposition, et par rapport aux doses et aux concentrations de référence qui permettent de faire cette analyse de risque.
La différence entre danger et risque provient de ce référentiel. Ce dernier s'est imposé au niveau international, repris notamment par l'Union européenne dans les réglementations de 1993 et 1994, pour évaluer les risques pour les substances nouvelles et les substances existantes.
Ce référentiel décompose l'évaluation des risques en quatre phases. La première phase est l'identification des dangers, le danger étant la caractéristique intrinsèque d'une substance. Nous analysons telle substance en vue d'établir si elle est ou non cancérogène ou tératogène, en fonction de critères définis dans des lignes directrices.
La deuxième phase, qui concerne l'évaluation de la relation dose-effet, est extrêmement importante. Actuellement, s'agissant des substances cancérogènes de type génotoxique, c'est-à-dire qui agissent sur le génome ou l'ADN, le consensus scientifique est que l'on a une relation dose-effet sans seuil. Dès que vous avez un contact avec une molécule, le risque existe, même s'il est faible. Il est d'autant plus élevé que la dose et le temps d'exposition seront élevés. Des discussions scientifiques se font sur cette analyse, mais les agences fédérales américaines ou des autres pays ont accepté cette relation dose-effet.
Pour les effets non-cancérogènes, on considère qu'il y a un seuil d'effet, lequel est calculé, le plus généralement, à partir des données expérimentales obtenues chez l'animal. On applique un facteur de sécurité sur lequel il y a souvent des divergences, mais ce facteur de sécurité est d'au moins 100, pour extrapoler de l'animal à l'homme. On prend en considération le passage de l'animal à l'homme avec un facteur de sécurité de 10 et un facteur de sécurité de 10 supplémentaire pour tenir compte de la distribution au sein de l'espèce humaine. On peut ajouter d'autres facteurs de sécurité si on prend en considération la qualité des données. Parfois, si on n'a pas de seuil de non-effet chez l'animal, on aura un facteur de sécurité supplémentaire.
L'OMS recommande, par exemple, pour les effets tératogènes, un facteur de sécurité supplémentaire de 10. On peut aller jusqu'à un facteur de sécurité de 10 000. Ce facteur se situe entre 100 et 10 000, selon l'avis de l'évaluateur de risque qui fait ce choix de facteur de sécurité.
La troisième phase concerne l'évaluation de l'exposition. On va généralement procéder par scénarios d'exposition les plus vraisemblables, en prenant les hypothèses raisonnablement maximisantes, de façon à avoir dans les scénarios d'exposition, les situations extrêmes, mais qui restent vraisemblables. C'est ce que nous avons fait dans ce cas précis.
La quatrième phase consiste en la caractérisation des risques. On rassemble les données des trois premières phases et on essaie de donner une réponse sur l'importance du risque et l'incertitude autour du risque.
Sur ce cas précis, nous avons appliqué cette méthodologie. Dans un premier temps, pour évaluer le danger, il fallait faire des prélèvements. Nous avons analysé deux rejets, prélevés sur la plage de La Baule, le 15 février, dans lesquels nous avons environ 800 ppm d'hydrocarbures aromatiques polycycliques, notamment les plus cancérogènes, comme le benzo(a)pyrène ou le di-benzo anthracène.
Nous avons trouvé quelques milligrammes par kilo de composés organiques volatils, notamment du benzène, quelques centaines de ppm de métaux et une catégorie de substances pour laquelle on dispose des peu de données toxicologiques, à savoir la famille des thiophènes, proche des HAP. Nous avons cependant des inquiétudes par rapport à cette famille, dans la mesure où un certain nombre de ces substances sont mutagènes. Toutefois, nous ne disposons pas de suffisamment d'éléments pour pouvoir faire une évaluation des risques, en intégrant cette famille.
L'évaluation des risques a été faite principalement par rapport aux HAP et aux composés organiques volatils. Nous avons procédé tant à des mesures de terrain pour appréhender l'exposition qu'à des mesures pour évaluer la concentration en HAP dans les aérosols de Kärcher. Cette phase nous semblait particulièrement délicate dans les opérations de nettoyage.
Nous avons donc pu analyser et quantifier la concentration en équivalents benzo(a)pyrène. Les résultats sont d'environ 20 à 30 nanogrammes par mètre cube de benzo(a)pyrène dans ces opérations de nettoyage au Kärcher. Cela nous permet ensuite de faire une évaluation du risque par rapport à l'exposition par inhalation.
Nous avons fait des scénarios d'exposition cutanée qui correspondent à des scénarios vraisemblables de ramassage de rejets sur les plages, avec un contact cutané pouvant aller jusqu'à deux demi-surfaces de mains exposées. Nous avons également fait des essais en laboratoire, de façon à analyser les émissions provenant de ces rejets. La première série d'essais nous a permis de doser les composés organiques volatils, notamment le benzène. Une deuxième série nous a permis de doser les HAP volatils, de façon à estimer ce que pouvait être l'émission en composés volatils et en HAP provenant d'un vêtement de travail souillé.
A partir de tous ces éléments, nous avons pu construire des scénarios et évaluer les doses d'exposition. Les émissions provenant de ces rejets, en termes de composés organiques volatils, sont faibles. On trouve environ 100 microgrammes par mètre cube de benzène. Avec la dilution évidente sur le terrain, le risque lié au benzène est inférieur au risque acceptable.
Nous avons pris 10-5 comme risque acceptable, c'est-à-dire un cas pour cent mille. Cette notion est nécessaire, dans la mesure où on a évalué un risque cancérogène. Dès lors que nous n'avons pas de seuil zéro, il convient de fixer un seuil qui corresponde à ce risque acceptable. Actuellement, dans la réglementation française, nous avons un risque fixé à un pour cent mille, soit un décès supplémentaire pour cent mille personnes exposées pendant une vie entière fixée à 70 ans.
A titre de comparaison, le risque accident de la route est de 10-2, soit un décès sur cent personnes par accident de la route, sur une vie entière. Le risque accident du travail est d'environ 10-3. Cela donne une échelle de grandeur. Le risque considéré comme acceptable, donc négligeable, est de 10-5, soit une échelle de grandeur de un à mille, entre ce risque et le risque accident de la route. La fourchette de risque, concernant les effets du prion, se situe entre 10-2
et 10-6, soit une très vaste fourchette de risque, mais c'est la situation actuelle des connaissances.
Pour revenir sur l'exposition au benzène, dans une salle comme celle-ci, nous sommes à une concentration en benzène d'environ 10 à 15 microgrammes par mètre cube. Il y a plus de benzène dans cette salle que sur la plage de La Baule.
M. le Président : C'est peut-être une façon de représenter les choses, mais c'est important.
M. André CICOLELLA : C'est une comparaison importante. Un travail que nous avons fait par ailleurs montre que l'air intérieur est, en général, plus pollué en benzène que l'air extérieur.
M. le Rapporteur : Cela signifie que vous rejoignez le Dr Baert dans sa formule sur les limites de la vie courante.
M. André CICOLELLA : Pour le benzène, oui. Pour les HAP, les expositions urbaines, en zone rurale, sont de l'ordre du nanogramme par mètre cube de benzo(a)pyrène. Avec l'aérosol de Kärcher, on était à 20 à 30 nanogrammes de benzo(a)pyrène. Ceci nous fait dire qu'une exposition liée au Kärcher, pendant huit heures, pour des utilisateurs non protégés, commence à poser un problème de risque. On arrive dans la zone du risque non-négligeable.
Pour le cas considéré, c'est-à-dire les personnes exposées pendant cinq minutes lors des opérations de nettoyage des vêtements au Kärcher, le risque reste négligeable, du point de vue de l'exposition par inhalation.
Un autre élément d'exposition concerne l'exposition générale liée à la pénétration par voie cutanée du benzo(a)pyrène. C'est le seul HAP classé comme toxique sur la reproduction par l'Union européenne. En prenant un scénario d'exposition maximale lié à un contact cutané prolongé jusqu'à deux mois avec un rejet de fioul, on peut avoir une pénétration cutanée de benzo(a)pyrène suffisante pour déplacer l'indice de risque, qui est à 1, entre 3 et 30, selon les facteurs de sécurité que l'on va prendre.
On se trouve là, avec un risque pour la reproduction qui peut ne pas avoir été négligeable, sachant que les effets sur le développement embryofoetal sont à prendre en considération pour une période de risque minimale d'une journée. C'est la période critique définie par les lignes directrices de l'agence de protection de l'environnement des Etats-Unis pour les effets sur le développement embryofoetal. Cela étant, si ce risque n'est pas totalement négligeable, nous sommes tout de même dans la zone de préoccupation.
S'agissant des effets cancérogènes de type cutané, nous ne disposons pas de modèle d'extrapolation nous permettant de faire une quantification. C'est l'analyse du Dr Baert avec laquelle je suis entièrement d'accord. Nous avons donc pu estimer la dose, avec des scénarios maximaux, sans connaître précisément le pourcentage de HAP susceptibles d'être stockés dans la peau. N'ayant pas de modèle, nous ne pouvons actuellement répondre à la quantification.
Nous pouvons simplement indiquer - et c'est une évidence - que le temps d'exposition étant limité à quelques semaines au maximum, le risque est dans une zone négligeable et faible, pour des expositions de deux mois complets. Mais cette zone d'incertitude reste à quantifier.
La méthode de l'évaluation des risques permet d'analyser des effets non-cancérogènes chroniques, généralement de type irréversible, et des effets cancérogènes ou sur la reproduction. Elle ne permet pas de répondre à une évaluation des risques de type aigu.
C'est pourquoi nous avons, dans notre rapport, fait référence à trois études publiées récemment, notamment une étude japonaise faite après la catastrophe du
Nakhodka qui montre que, sur des populations qui avaient été exposées en moyenne quatre jours et demi, on relevait des symptômes de type irritations oculaires, de la gorge et de la peau, céphalées, nausées, pour 15 à 30 % de cette population. Cela correspond d'ailleurs aux observations qui ont commencé à être faites par le CHU de Nantes, lesquelles vont faire l'objet des investigations de l'INVS. Nous ne pouvons donc répondre autrement pour ce type d'effet.
En revanche, sur les effets de type irréversible, la réponse est que le risque de cancer, de façon générale, peut être considéré, du point de vue cutané, comme négligeable, avec une incertitude sur les expositions les plus importantes.
M. le Président : M. Cazeneuve, député de la Manche, m'a fait part de son impossibilité de demeurer parmi nous jusqu'à la fin de la séance. Je propose qu'il pose ses deux questions qui seront enregistrées et figureront au procès -verbal.
M. Bernard CAZENEUVE : Ma première question résulte d'une incompréhension de ma part, concernant notamment les interventions de l'IFREMER et de l'AFSSA. Je voudrais comprendre le lien qui existe entre le naufrage de l'Erika et l'augmentation des seuils en hydrocarbures contenus par un certain nombre de produits, qu'il s'agisse des huîtres, coquillages et autres.
Afin que l'on puisse établir un lien qui ait une fiabilité scientifique entre le naufrage de l'Erika et l'augmentation de ces seuils, il convient de disposer de suffisamment de mesures dans les heures qui ont précédé le naufrage, pendant et après. Dispose-t-on de cette série de mesures permettant d'établir ce lien et est-on en mesure aujourd'hui de dire, très clairement, la part d'augmentation de ces seuils imputable au naufrage ?
Par ailleurs, la politique du ministère de l'Environnement affirme la volonté de séparer très rigoureusement les missions d'exploitation et de contrôle lorsqu'il s'agit des pollutions. Pour les organismes qui se sont exprimés, notamment l'INERIS qui a pour seule tutelle ce ministère, existe-t-il des relations de nature contractuelle ou d'autre nature avec des exploitants pétroliers, notamment Total ?
M. le Président : Dans la discussion qui va faire suite aux deux derniers exposés, il conviendra également d'apporter des réponses aux questions de M. Cazeneuve.
M. Bernard TAILLIEZ : Je représente ici la seule entreprise privée qui s'est intéressée à cette affaire, à titre bénévole, depuis maintenant deux mois et demi. Notre approche de la question a été motivée par le fait que nous avons été surpris de n'entendre prononcer le mot cancérigène dans la presse, qu'à partir du 19 janvier, dans un article du Monde, qui rapportait des propos tenus par le laboratoire de cryptogamie du muséum national d'histoire naturelle, ici présent.
Nous vivons dans un pays où il aura fallu qu'un mois s'écoule avant que la nature cancérigène d'un dépôt côtier de plusieurs milliers de tonnes soit connue du public. La deuxième raison pour laquelle nous nous sommes intéressés à cette cargaison résultait du simple désir de vérifier si les rejets côtiers représentaient bien un fioul numéro 2, comme la cargaison était déclarée, ou autre chose.
Nous disposons d'éléments scientifiques qui permettent d'affirmer que l'Erika n'était pas chargé de fioul numéro 2. Cela suscite un silence pesant... mais c'est vrai. Je suis heureux de constater que l'INERIS mentionne, cet après-midi, sa connaissance d'une trentaine de molécules soufrées, à savoir les benzo-thiophènes, dont j'avais relevé l'absence dans le rapport de l'INERIS rendu public il y a quelques jours.
Nous vivons donc dans un pays où il aura fallu trois mois, jour pour jour, du 12 décembre au 12 mars, pour que soit connu, dans le détail, le caractère cancérigène et toxique.
M. le Rapporteur : Comme le débat a eu lieu, en grande partie, sur Internet, je me suis procuré vos déclarations. Les confirmez-vous ou les complétez-vous ? Vous dites : « J'ai obtenu mes échantillons grâce à un ami qui habite l'île de Groix. Je lui ai demandé de se munir de deux pots de confiture, de descendre sur la plage pour récupérer des échantillons de fioul. » Etes-vous sûr du fioul que vous avez récupéré et si ce n'est pas le même, avez-vous fait d'autres sondages ailleurs...
M. Bernard TAILLIEZ : Tout à fait.
M. le Rapporteur : Je souhaiterais clarifier la nature de ce fioul : est-ce du fioul numéro 2 ou non ? Le débat revient, puisque vous affirmez le contraire de vos collègues.
M. Georges LABROYE : Je répondrai tout de suite sur la question des thiophènes. Dans le rapport, ils sont cités, à quatre ou cinq endroits, dosés et non pas faits par similitude spectrale. Nous avons dosé plus de cinquante produits et si, effectivement, nous n'avons tenu compte, dans l'évaluation des risques, comme c'est la méthode générale américaine et européenne, que des seize HAP les plus toxiques, cela ne signifie pas que nous n'en avons pas analysé la totalité. Il vous suffit de consulter le rapport, sur notre site Internet, pour constater que les thiophènes sont bien cités dans la liste.
M. Martin HIRSCH : Je voudrais apporter une précision. J'ai sous les yeux, des coupures de presse qui datent du début janvier. On retrouve, tant dans l'AFP, le Monde, Ouest-France, le Parisien, un certain nombre de mentions à des rapports officiels sur le caractère cancérogène des substances contenues dans le pétrole. Ce mot était employé dans le premier avis de l'agence qui a été rendu public le 6 janvier 2000.
M. le Président : A quel moment ce caractère cancérogène a-t-il évoqué ?
M. Alain BAERT : Dès le 21 décembre. Dans ce courrier adressé à un de mes confrères médecins, spécialiste de santé publique, afin de lui faire comprendre ce pourquoi il faut se protéger, nous lui résumons le fait que, au regard des HAP, du temps de contact et de la durée, ces problématiques carcinogènes sont négligeables. Bien entendu, le mot « négligeable » doit être entendu en termes d'épidémiologie et non pas dans le sens que l'on ne s'en préoccupe pas.
M. le Rapporteur : A la limite de la vie courante, pour reprendre votre expression...
M. Alain BAERT : Tout à fait.
M. Paul DHAILLE : Je voudrais une précision et je m'adresse à l'IFP. La question est de savoir si les hydrocarbures sont tous cancérigènes ou si certains ne le sont pas.
M. le Président : En clair, si je laisse couler pendant de longues heures de l'essence sur ma main, je risque un cancer.
M. Alain FEUGIER : Je ne peux vous dire si vous risquez un cancer ou non. Néanmoins le pétrole est constitué d'un certain nombre de familles d'hydrocarbures, dont la famille des hydrocarbures aromatiques. Un certain nombre de ces composés ont, en effet, un caractère dit cancérogène, mais là encore, c'est la notion de danger et de risque. On a évoqué tout à l'heure le benzène. La quantité de benzène, qui a été mesurée en phase vapeur donc provenant du fioul, est très faible par rapport aux vapeurs de benzène que vous respirez quand vous faites un plein d'essence. Depuis le 1er janvier 2000, la spécification du benzène dans l'essence est passée de 5 % à 1 %. Mais nous sommes au niveau du pour cent dans le produit. Il faut donc relativiser.
M. Bernard TAILLIEZ : Oui, il faut se souvenir que l'Erika est chargé d'un résidu de distillation, c'est-à-dire de ce qui reste dans une colonne à distiller, dans lequel se sont concentrés tous les produits les plus toxiques du pétrole. On ne peut le comparer ni à du brut, ni à de l'essence.
M. Alain COUTÉ : Le muséum national d'histoire naturelle est un grand établissement à vocation d'enseignement et de recherche. Vingt-six laboratoires composent cet établissement. Le laboratoire de cryptogamie, dont j'ai la charge, a pour vocation l'étude des cryptogames, c'est-à-dire les algues, les champignons, les lichens et les mousses.
A ce titre, il est en contact avec de nombreux industriels et étudie notamment l'action des micro-organismes sur la dégradation de produits industriels, entre autres le pétrole. Une équipe du laboratoire travaille sur ce problème depuis 1973. Le professeur Oudot, expert en la matière et qui est à mes côtés, va vous exposer ses travaux.
Toutefois, avant de lui passer la parole, pour répondre à M. Tailliez, je voudrais indiquer que le laboratoire de cryptogamie n'a jamais fait état de l'aspect cancérogène du fioul de l'Erika parce que nous n'avons pas les compétences en ce domaine. Nous ne sommes pas à destination sanitaire.
M. Jean OUDOT : Les études menées au laboratoire de cryptogamie portent sur la biodégradation des hydrocarbures essentiellement, c'est-à-dire le devenir des hydrocarbures dans le milieu naturel.
A ce titre, nous travaillons depuis plusieurs dizaines d'années sur le sujet et c'est dans cette optique qu'ont été effectuées les analyses du fioul de l'Erika. Nous avons utilisé des échantillons du pétrole de l'Erika provenant du CEDRE et de la raffinerie de Donges, ainsi que des échantillons ramassés sur la côte par des correspondants du muséum.
Tous ces échantillons sont identiques et indiquent que l'on est toujours en présence du même pétrole de l'Erika. C'est dans l'optique de l'étude de la biodégradation de ce pétrole que ces analyses et caractérisations chimiques ont été effectuées. Les résultats confirment ce qui a été évoqué par ailleurs. Il s'agit bien d'un résidu de distillation auquel est ajoutée une fraction légère, un fluxant, formé de mono-aromatiques et de di-aromatiques.
Je ne me prononcerai pas sur la toxicité de ce pétrole. Nous avons simplement indiqué, dès le début de nos analyses, qu'il contenait des hydrocarbures aromatiques polycycliques et des aromatiques soufrés, c'est-à-dire les benzo-thiophènes dont on a parlé tout à l'heure, mais sans autre précision quant à l'éventuelle toxicité de ce produit, car ce n'est pas de notre domaine de compétence.
Sur cet aspect de toxicologie, je ne pourrai vous en dire beaucoup plus. Sur l'aspect biodégradation, on sait que c'est un produit très peu biodégradable, qui risque donc de persister longtemps dans l'environnement. En effet, la partie biodégradable de ce produit représente moins de 20 % de la totalité de la composition de ce produit.
M. Alain COUTÉ : Ces travaux ont été faits à l'initiative du laboratoire, sans avoir été télécommandés par divers organismes.
M. Edouard LANDRAIN : Je souhaiterais lever si possible et définitivement une ambiguïté. M. Tailliez a été relativement bref dans ses propos, mais ayant lu ses écrits, je demande s'il maintient, devant cette commission, son affirmation que le produit qu'il a analysé et qu'il pense être issu de l'Erika, n'est pas du fioul numéro 2. S'il maintient cette affirmation, sur quels fondements le fait-il ?
M. Bernard TAILLIEZ : Tout à fait, je maintiens cette affirmation. Le fioul numéro 2 répond à des spécifications qui font l'objet d'une norme. Par conséquent, lorsqu'on analyse la cargaison de l'Erika, on doit pouvoir relier les propriétés physiques et chimiques de cette cargaison avec le produit considéré comme fioul numéro 2. A moins que le ministère de l'Industrie ait accordé, pour charger ce bateau, une dérogation à la société Total Fina portant, par exemple, sur la viscosité et la teneur en fractions légères.
Toutefois, si une telle dérogation n'a pas été donnée par le ministère de l'Industrie à la société Total Fina, les mesures et les analyses que nous avons faites permettent de montrer que la cargaison de l'Erika n'est pas du fioul numéro 2. Ce dernier répond à des spécifications sur le plan de la viscosité qui ne sont pas remplies par les échantillons que l'on a pu se procurer. Le fioul numéro 2 doit répondre à certaines spécifications sur le plan des intervalles de distillation, ce qui n'est pas le cas des échantillons que nous avons analysés.
M. François GOULARD : Pour être plus précis, vous nous avez bien dit que vous n'avez pas analysé du produit chargé à Dunkerque dans l'Erika, mais un produit, ramassé par un de vos amis, sur la côte.
M. Bernard TAILLIEZ : Tout à fait.
M. François GOULARD : Comment pouvez-vous vous prononcer sur la viscosité du produit chargé ou sa composition ? Il est évident, pour tout le monde, que ce produit a été altéré par son séjour dans l'eau, par le temps, etc. Comment pouvez-vous tirer des conclusions de l'analyse d'un produit recueilli sur les côtes de Groix, plusieurs semaines après la catastrophe, alors que vous n'avez pas procédé à l'analyse du produit chargé ?
M. René LEROUX : Surtout pas vous-même !
M. Bernard TAILLIEZ : Je voudrais confirmer que le prélèvement effectué à Groix a bien été effectué dans des pots de confiture, dont on avait bien évidemment enlevé la confiture ! Ensuite, nous avons répété cette analyse sur un échantillon prélevé, sur l'initiative de l'hebdomadaire Paris Match, à la verticale de l'épave. Les résultats sont identiques à ceux que nous avions obtenus sur l'échantillon prélevé sur les côtes de Groix. Il se trouve que cet échantillonnage, effectué à la verticale de l'épave, a aussi été réalisé sous contrôle d'huissier.
M. le Président : Vous permettrez au béotien que je suis en ce domaine de solliciter de la part de vos confrères des autres organismes, leurs réactions quant aux problèmes de viscosité. Il ne s'agit pas d'opposer les structures ou les organismes les uns aux autres, mais de chercher sur cette question, en vue de notre rapport d'ici quelques mois, si elle n'est pas résolue d'ici là, un certain nombre de conclusions, en souhaitant qu'elles soient les plus pertinentes possibles.
M. Daniel MOREL : L'Institut français du pétrole a analysé des échantillons qui lui ont été fournis par le CEDRE et par l'AFSSA. Ce sont ces organismes qui connaissent la provenance des échantillons en question. Il n'y a aucun doute sur le fait qu'il s'agit bien de fioul numéro 2.
M. le Président : Une partie de ces échantillons a été fournie par la compagnie Total, provenant de sa raffinerie de Flandres.
M. Daniel MOREL : Nous avons analysé deux échantillons du fioul initial, l'un envoyé par le CEDRE et que nous avons reçu le 28 décembre, l'autre par l'AFSSA et reçu le 6 janvier. C'est maintenant à ces deux organismes de confirmer la provenance de ces échantillons.
M. Michel MARCHAND : Je voudrais apporter quelques éléments d'information quant au rapport du laboratoire Analytika qui conclut que, d'une part, le rejet de l'Erika est le résidu d'une opération de raffinage plus poussée conduite sur du fioul numéro 2 et, d'autre part, que l'Erika transportait des déchets industriels spéciaux et non pas du fioul numéro 2.
Le premier élément que je voudrais souligner est que l'échantillon de référence, analysé par le laboratoire Analytika, provenait de la raffinerie de Provence. Par conséquent, il n'est pas certain que la composition de cet échantillon dit fioul numéro 2 véritable soit analogue à celle du fioul numéro 2 de la raffinerie des Flandres.
Je rappelle la définition d'un fioul numéro 2, tirée d'une fiche de données de sécurité : « C'est un produit liquide issu de diverses fractions de raffinerie et sa composition est complexe et varie selon la provenance du pétrole brut. » C'est pourquoi lorsqu'on définit un fioul numéro 2, la norme AFNOR ne fait pas référence à une composition chimique, mais essaie de globaliser cette composition, au travers de certains paramètres essentiellement physiques.
La norme AFNOR indique par exemple, que la viscosité qui correspond à un paramètre qui est une résistance à l'écoulement, doit être « de plus de 110 centistockes à 50 degrés et inférieure à 40 centistokes à 100 degrés. » Le bulletin d'analyse, qui nous a été fourni par la société Total le premier jour de l'accident, indique que la valeur était de 554 centistokes, valeur confirmée au niveau du CEDRE à une valeur de 500. Quant à la valeur inférieure à 40 centistokes à 100 degrés, elle était, fournie par Total, de 38 centistokes.
D'autre part, une autre spécification est la teneur en soufre. La norme AFNOR indique qu'elle doit être inférieure à 4 %. Le bulletin d'analyse de Total donne 2,28 %. Nous sommes encore dans la norme AFNOR. Le pourcentage en eau doit être inférieur à 1,5 %. Il est là de 0,05 %. Enfin, nous avons le point éclair, qui représente une température à partir de laquelle le produit peut émettre des vapeurs inflammables. En fait, on globalise la teneur en fractions légères. Ce point éclair, d'après la norme AFNOR, doit être supérieur à 70 degrés. Le bulletin d'analyse du produit du fioul numéro 2 de Total est de 128 degrés.
Toutes les données de base, qui définissent le fioul numéro 2 selon la norme AFNOR d'août 1982, sont confirmées dans le bulletin d'analyse de Total.
M. Bernard TAILLIEZ : Bulletin d'analyse de Total !
M. Michel MARCHAND : Absolument. L'analyse, pratiquée par le laboratoire Analytika, a été de prendre un échantillon de fioul numéro 2 de la raffinerie de Provence, qui n'a pas forcément la même composition que le fioul provenant de la raffinerie de Dunkerque. La comparaison chimique de ces deux échantillons montre des différences très importantes, entre certains composés, qui sont des composés aromatiques comme le benzène ou le toluène, avec des concentrations variant d'un facteur dix à vingt fois inférieur.
C'est sur la base de cette différence que l'on arrive à la conclusion suivante : comme il y a des différences, on n'a pas affaire à un fioul numéro 2. Or ces différences sont simplement liées à un phénomène banal, qui est que ce fioul numéro 2, déversé en mer, a séjourné pendant quinze jours avant d'échouer sur la plage de Groix. Les fractions légères de benzène et de toluène ont diminué soit par phénomène d'évaporation, soit par phénomène de dissolution. Classiquement, c'est ce que l'on appelle le phénomène de vieillissement du pétrole.
Lors de la pollution de l'Amoco-Cadiz, sur les 223 000 tonnes de la cargaison, 40 % se sont évaporés dans l'atmosphère. Par conséquent, le phénomène d'une variation de composition est tout à fait banal.
M. Georges LABROYE : Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous n'avons pas analysé des échantillons provenant directement de la cargaison de l'Erika, mais des échantillons prélevés sur la côte. J'approuve ce qui a été dit précédemment. Il y a une évolution du produit, par vieillissement, qui perd ses produits volatils, sans compter que les prélèvements ont été effectués quinze jours ou trois semaines après le naufrage. Il n'y a donc pas d'incompatibilité.
Je répète que nous n'avons pas fait de mesures de viscosité ou autres paramètres physiques qui sont des caractéristiques essentielles des fiouls, parce que cela n'entrait pas dans l'étude qui nous était confiée : évaluer les risques que prenaient les bénévoles sur les plages.
M. Claude LAMBRE : Nous avons identifié, dès le départ, ce problème de la définition de ce que l'on appelle un fioul numéro 2. Dans les tout premiers avis, ce point était souligné. C'est la raison pour laquelle nous ne nous sommes pas arrêtés à la seule définition, nous avions également la définition qui vous en a été donnée.
Il était essentiel pour nous, en termes de réalisation d'une évaluation de risque, de savoir exactement ce à quoi les gens étaient exposés. Nous ne pouvions pas nous arrêter à la simple définition du produit. C'est pourquoi nous nous sommes procuré les analyses réalisées sur le stockage venant de Dunkerque et sur différents prélèvements.
Sur l'un des différents avis, nous avons listé les laboratoires qui ont travaillé et le type de prélèvements qui ont été faits. Le laboratoire du CNRS de Bordeaux a analysé un échantillon provenant du stock résiduel de Dunkerque, un échantillon prélevé en mer par l'Ailette et une dizaine d'échantillons prélevés sur la côte par ce laboratoire. Le laboratoire départemental d'analyse de la Drôme a analysé un échantillon du stock résiduel de Dunkerque. Le laboratoire municipal de Rouen a travaillé sur le stock résiduel de Dunkerque, des échantillons prélevés sur la côte par des personnels de ce laboratoire et un autre prélevé en mer par l'Ailette. Le laboratoire de Brest a analysé un échantillon du stock résiduel de Dunkerque et des échantillons prélevés sur la côte, également par des personnels de ce laboratoire. Enfin, le LASEM* de Brest a travaillé sur les échantillons fournis par Total.
Tous ont convergé pour dire que nous arrivions, aux écarts de mesure et aux phénomènes de vieillissement près, à quelque chose qui pouvait tout à fait correspondre à la définition du fioul numéro 2. Mais comme je vous l'ai dit, cette définition accepte néanmoins un certain nombre de variations.
En tout état de cause, l'important pour nous était, au-delà de la définition, de savoir ce qu'il y avait précisément dedans pour déterminer la toxicité du produit.
M. Bernard TAILLIEZ : En fait, les organismes n'avaient pas à répondre à cette question. Je suis d'ailleurs surpris que le CEDRE prenne position pour défendre Total sur la question de savoir s'il s'agit ou non de fioul numéro 2. C'est Total que cela concerne, et non pas le CEDRE, l'INERIS ou l'AFSSA.
Nous avons relevé des différences qui sont inexplicables par le phénomène de vieillissement. Lorsque cette hypothèse restait acceptable, c'est-à-dire sur les échantillons que nous avions prélevés à Groix, nous avions pris la peine à l'époque, sur notre site, de mentionner « si ce prélèvement est représentatif de la cargaison de l'Erika, alors... »
Depuis que nous avons effectué nos analyses sur ce prélèvement fait à la verticale de l'épave, nous sommes plus catégoriques, c'est-à-dire que nous affirmons que l'Erika n'était pas rempli de fioul numéro 2 répondant aux spécifications en vigueur, à moins que le ministère de l'Industrie ait accédé à une demande de Total concernant la modification des spécifications.
M. le Rapporteur : Je ne suis pas sûr que ce soit à nous de trancher sur ce point. Je voudrais rappeler à M. Tailliez qu'il a de plus indiqué, mais peut-être par un excès de langage, qu'il ne fallait plus considérer que c'était une opération de ramassage, mais de décontamination, et qu'il fallait donc opérer avec masque et combinaison. Vous l'avez écrit et cela a été repris par la presse.
Or, nous avons travaillé avec des gens qui ont passé beaucoup de temps à ramasser le pétrole. C'est pourquoi nous posons des questions et essayons de vérifier. Je suis très heureux de cette confrontation.
M. Félix LEYZOUR : Il semble y avoir des divergences sur les analyses du produit. J'aurais aimé savoir quel est le champ d'intervention habituel d'Analytika et sur quels types de produits vous travaillez généralement.
Ma deuxième question porte sur les personnes en contact avec des produits pétroliers. Des études statistiques ont-elles été menées, concernant les risques encourus par les populations d'intervenants dans le milieu du pétrole, des produits pétroliers et bitumineux ? En effet, un grand nombre de personnes travaillent dans ces milieux comme ceux de l'extraction, les raffineries, le transport, la mise en oeuvre de produits bitumineux sur les routes. Existe-t-il des statistiques faisant apparaître des risques ?
M. Bernard TAILLIEZ : Ce laboratoire, créé par mes soins en 1991, a pour vocation d'effectuer des investigations et des contrôles dans le domaine de la qualité et du respect de l'environnement. Nos clients sont les industriels, de manière générale, nos confrères qui ne sont pas équipés du type d'instrument dont nous disposons, les tribunaux. Par exemple, nous venons de terminer une investigation pour le compte du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence qui visait à confondre des gens qui ont falsifié du fioul domestique pour le faire passer pour du gazole.
M. Alain BAERT : Il existe, en effet, des études épidémiologiques de surveillance des travailleurs exposés, sachant que les personnes exposées aux hydrocarbures aromatiques polycycliques ne sont pas toutes dans l'industrie pétrolière. La fabrication de l'aluminium notamment est un grand fournisseur de données épidémiologiques.
En résumé, ces études confirment globalement que lorsqu'il y a des expositions à long terme - certaines études parlent de quarante ou cinquante ans - il existe la survenue d'un certain nombre de cancers qui sont du poumon, cutané et de la vessie principalement. Les trois sont parfaitement identifiés avec parfois, également, d'autres localisations aérodigestives. Les quelques études épidémiologiques qui ont quantifié montrent un excès de risque d'environ 2 %, voire 3 %, dans ces populations. Elles semblent toutes souligner la condition d'une exposition au long terme.
M. Michel GIRIN : Je voulais juste préciser que l'étude que nous avons faite sur la viscosité l'a été à la demande d'un site associatif et non pas d'une société quelconque dont on cite trop souvent le nom. Cela a rassuré ce site associatif qui nous en a remercié.
M. René LEROUX : Maire d'une commune du littoral et député de la circonscription de la Loire-Atlantique, qui a certainement été la plus touchée sur l'ensemble du littoral atlantique, je dois vous préciser que chaque matin sauf le mardi et le mercredi, depuis le 26 décembre, je tiens une réunion avec tous les bénévoles.
Inutile de vous préciser que je ne n'ai rien appris depuis le 26 décembre, suite à tous les rapports que vous avez pu, les uns et les autres, diffuser.
Au début, cela a été un moment d'enthousiasme, d'un grand élan de solidarité de la part de nombre de gens qui se sont immédiatement mobilisés pour nous aider à nettoyer les plages, ce de plus en période de vacances. Lorsque j'ai vu ces gens travailler à mains nues un produit d'hydrocarbure, nous avons immédiatement tenté de les équiper de gants, bottes et cirés. Cela a été une période difficile, mais j'ai interdit la présence des enfants, sans attendre les circulaires, et les chantiers le week-end, car ce n'était pas une visite de famille.
Je n'ai rien appris, suite au dernier rapport de l'INERIS, d'ailleurs très bien fait, et celui de RIVM dont j'ai pris connaissance et que j'ai largement diffusé auprès des bénévoles. Il ne faut pas oublier que, sur les plages, outre des bénévoles, travaillent des militaires, des pompiers... personnel qu'il faut considérer également dans cette tâche au quotidien.
Si j'avais voulu interdire à ces quarante-cinq bénévoles, encore présents à cette réunion le matin à 9 heures, d'aller sur les plages, je me serais fait conspuer. Nombre de personnes ont été choquées, dès lors que les élus ou d'autres ont pris des positions tendant à mettre le doute dans l'esprit. Peut-être n'avaient-ils pas été informés, dès le départ, de la nature du produit et ils se sont trouvés pris dans un système dans lequel ils n'auraient pas souhaité être.
Avez-vous, les uns et les autres, connaissance de symptômes ou de maladies ? En toute interrogation, chacun a toujours connaissance, mieux que l'autre, de phénomènes particuliers. Ainsi, sur une radio où je faisais une interview en direct, une dame précisait qu'avaient été recensés des militaires indisposés, présentant des signes cancérigènes...
Par ailleurs, quelle est la différence entre cancérigène et cancérogène ?
Nous avons connu, il y a quinze ou vingt ans, des dépôts de pétrole sur les plages. Maintenant, on pourrait dire que toute trace de pétrole retrouvée sur les plages provient de l'Erika. Aujourd'hui, on travaille avec des tamiseuses et beaucoup plus dans le détail. Par ailleurs, il y a peut-être moins de dégazages qu'à l'époque. Mais le produit que l'on recevait sur les plages n'est-il pas de la même nature que celui de l'Erika ?
Concernant le laboratoire Analytika, combien de personnes êtes-vous pour faire autant d'investigations et de communications ?
M. Alain BAERT : Pour répondre à votre première question, nous avons connaissance d'un certain nombre de symptômes qui rentrent dans le cadre des effets immédiats et aigus, essentiellement du type d'inconfort digestif et de troubles « neurologiques », c'est-à-dire sensations de vertiges, malaises, inconforts, voire irritations oculaires et au niveau des voies respiratoires supérieures qui deviennent, semble-t-il, plus présentes en fonction de la température.
Il existe une enquête rétrospective en cours, menée par l'institut national de la veille sanitaire, à l'aide d'un questionnaire auto-administré envoyé aux personnes ayant participé et dont les listes ont été fournies par les collectivités locales. Ce questionnaire, envoyé par la poste, est réexpédié dans une enveloppe T. Cette enquête a pour objet d'apprécier la fréquence des effets ressentis par les personnes qui ont travaillé un certain temps. Les seules mentions seront la nature de l'activité et le niveau de protection utilisé, mais sans la localisation géographique. Plus de trois mille questionnaires ont déjà été envoyés.
Nous savons, comme cela a été vu au cours d'autres événements, qu'un certain nombre de pathologies peuvent être induites par l'effet ressenti de la gravité de l'exposition. Ce sont des effets qu'il ne faudrait pas considérer comme psychosomatiques. Les gens les ressentent réellement, mais du fait de la connotation péjorative qu'ils ont de ce produit, ils le ressentent d'autant plus.
Nous dépistons actuellement, chez des professionnels pompiers, plus de cent effets secondaires qu'avec les médecins sapeurs-pompiers, nous essayons de documenter dans la chronologie.
S'agissant du terme cancérigène ou cancérogène, les deux termes sont équivalents. Ce sont des pathologies qui se développent toujours tardivement, malheureusement, et cela posera des problèmes éventuels de suivi. Un contact aujourd'hui avec un produit cancérigène probablement n'entraînera pas de symptômes visibles cliniquement palpables, avant cinq ou dix ans.
M. Bernard TAILLIEZ : Effectivement, nous employons un nombre de personnes qui n'a rien à voir avec les cinquante experts qui constituent l'AFSSA. Nous sommes trois personnes et demie.
Mme Jacqueline LAZARD : Tout à l'heure, le directeur de l'IFREMER a indiqué que les prélèvements faits avaient été transmis à un laboratoire de Rouen pour une meilleure homogénéité des analyses, car les protocoles, semble-t-il, ne sont pas tous les mêmes. Est-ce justement cette utilisation de protocoles différents qui amène à des résultats quelque peu divergents entre les différentes structures présentes ici ?
Par ailleurs, et je m'adresse plus particulièrement au Dr Baert, iriez-vous jusqu'à dire aujourd'hui, que l'exposition cutanée au produit est la plus risquée ? Quel problème se pose actuellement, notamment pour tous ceux qui ont travaillé dans les cliniques pour oiseaux ?
M. Jean-François MINSTER : Depuis plusieurs années, il y a, dans le cadre des réseaux de surveillance, ordinairement moins dense, des mesures de bruit de fond, y compris des mesures de la concentration totale des hydrocarbures. De plus, il y a un réseau dense de mesures élaboré entre le 20 et le 24 décembre, avec les échantillons ultérieurs qui ont servi à caractériser l'abondance relative des HAP et suivre l'évolution de la concentration totale.
Par exemple, au Croisic, le 24 décembre, on trouvait sur les moules 130 ppm d'hydrocarbures aromatiques totaux polycycliques qui sont passés, le 10 janvier, à 1 500. Ce sont des croissances très nettes, rapides, mais très hétérogènes. Sur les coques au même endroit, on ne relevait aucune augmentation. Comme c'est très hétérogène, cela oblige à une démarche de précaution.
Il convient de faire plus particulièrement attention dans le suivi des coquillages, car on va chercher des tendances à la croissance ou à la décroissance qui risquent d'être faibles ensuite. Il vaut mieux avoir un protocole bien défini et précis pour étudier les variations de quelque 10 %, pour savoir exactement où se situe la tendance. L'intérêt d'avoir une mesure homogène est totalement différent du besoin de caractérisation où le suivi à quelques pour cent près n'est pas essentiel.
M. Alain BAERT : D'une manière générale, l'exposition cutanée est la plus risquée. C'est celle qui a été parfaitement identifiée dès le début et qui a justifié les mesures de protection d'ordre général qui auraient dû « s'appliquer » également aux ramasseurs d'oiseaux, même si nous n'ignorons pas que cela pose des problèmes techniques pour ramasser un oiseau en état de détresse et de stress avec des gants pétroliers.
Cependant, dans l'activité de nettoyage des oiseaux, nous avons constaté, par rapport au scénario de celui à l'air libre sur la plage, que les bénévoles ont travaillé beaucoup plus longtemps, dans une atmosphère confinée et chaude sinon l'oiseau perd beaucoup de sa chaleur. La volatilisation des composés est alors beaucoup plus présente et peut devenir significative pour les composés volatils. D'autant que cette activité de ramassage et de traitement des oiseaux s'est effectuée, surtout dans les premiers temps de l'échouage du pétrole, avant même qu'il n'arrive sur les plages, à une période où la proportion de fractions volatiles, spontanément éliminées par le vieillissement du fioul, était plus faible que maintenant.
Il est très difficile, là encore, de pouvoir quantifier le risque parce que nous n'avons pas vraiment d'informations sur l'exposition à laquelle ils ont été soumis. De plus, les griffures d'oiseaux ont rompu partiellement la qualité de la barrière cutanée. Ce risque me parait plus important chez les ramasseurs d'oiseaux que chez les ramasseurs
lambda. Cependant, la durée réelle du contact et de l'activité ne me semble pas - mais c'est un jugement - rester dans l'inacceptable.
Pour reprendre les conclusions du rapport du RIVM, le risque, pour cet aspect, était acceptable. On change de terme, on ne parle plus de négligeable, mais d'acceptable. Ceci est mon avis d'expert, mais il est vrai que, pour les nettoyeurs d'oiseaux, le risque est certainement supérieur à celui des ramasseurs.
M. le Rapporteur : Le risque est négligeable pour le ramassage et acceptable pour les oiseaux...
M. Alain BAERT : Oui.
M. Pierre HERIAUD : Les experts ici présents ont, les uns et les autres, travaillé à partir d'une matière première, pour aboutir à des conclusions qui leur étaient demandées, mais leurs réponses diffèrent. Sans doute en matière d'analyse, y a-t-il des protocoles à respecter. Il eut été bon que la même matière soit donnée à tous, quoi que l'on puisse demander aux uns et aux autres.
En effet, le problème, toujours posé et non résolu, est de savoir ce que contenait l'Erika. Quand je dis résolu, cela signifie avoir une unanimité sur les analyses faites. La contre-épreuve est toujours possible. A ma connaissance, l'Erika fuit beaucoup trop. De la matière première pourrait donc être prise et remise à tous, afin que l'on détermine, une fois pour toutes, la nature de ce produit transporté par l'Erika.
M. Georges LABROYE : Sur ce thème, l'INERIS comme les autres instituts peut faire d'autres analyses. Le problème du vieillissement dans la mer se posera toujours. Il ne sera peut-être pas vieilli par évaporation sur la terre. Il faudra donc aussi extrapoler, mais nous sommes toujours prêts à faire des études comparatives. De plus, c'est une habitude très forte dans les instituts qui sont, comme les nôtres, agréés par le COFRAC ou aux bonnes pratiques de laboratoire. La pratique des essais interlaboratoires, très courante, nous permet d'étalonner les propres compétences des laboratoires. Nous sommes donc tout à fait partants pour procéder à ce type d'essais, si la communauté scientifique le décide.
S'agissant du point sur les oiseaux, il faut rappeler quelques éléments. Il existe un rapport complet sur ce thème sur notre site Internet. M. Cicolella ajoutera quelques précisions quant au problème des cancers cutanés. Certes, le rapport du RIVM, que nous avons également mis sur notre site Internet, conclut à ce type d'« acceptabilité », mais il me semble qu'il faut le relativiser.
M. André CICOLELLA : Nous n'avons pas repris les conclusions de nos collègues hollandais car le risque acceptable qu'ils ont utilisé est un risque à 10-4, soit un pour dix mille. C'était en contradiction avec ce qui avait été décidé en France pour d'autres risques, notamment le risque sols pollués, pour lequel le Conseil supérieur d'hygiène publique fixe la valeur limite environnementale du benzène à 10-5. La conclusion ici acceptable est faite par rapport à ce risque de 10-4.
Nous avons une grande incertitude sur le risque cutané, notamment pour les nettoyeurs d'oiseaux. Nous ne savons pas si l'usage des détergents a favorisé la pénétration des HAP pour ceux qui n'étaient pas protégés ou a pu, éventuellement, les protéger.
Nous avons eu une petite polémique avec la ligue de protection des oiseaux sur cette question, à la lecture des consignes qui avaient été données de travailler à mains nues pour des raisons de facilité, en particulier lors des opérations de lavage des oiseaux. Là une catégorie de personnes a pu être potentiellement surexposée, mais nous ne pouvons quantifier ce risque. Cela ne nous permet pas toutefois de dire que ce risque est négligeable.
Quant aux ramasseurs, ils ont été moins exposés puisqu'il n'y a pas eu de détériorations possibles de la peau par l'utilisation des détergents, ce qui est le cas dans les cliniques.
M. Claude LAMBRE : Je voudrais ajouter deux points. De même que l'INERIS a modifié quelque peu les évaluations de risque du RIVM, - il avait pris un risque acceptable à 10-4 - nous avions fait de même pour le risque alimentaire. Dans ce cadre, une étude du RIVM est en cours depuis un certain nombre d'années, sur laquelle nous avons travaillé, où ils prenaient également un risque à 10-4
que nous avons abaissé à 10-5.
Ensuite, concernant le problème des différences en termes de méthode, il convient de distinguer deux éléments :
- la méthodologie utilisée pour analyser le fioul lui-même. Pour ce faire, il n'existe pas quantité de méthodes, mais une seule, très nette ;
- les divergences en termes d'échantillons biologiques.
Une méthode a été proposée par l'IFREMER, que nous avons présentée et reprise dans le cadre de l'AFSSA. De plus, une étude est en cours de validation pour les laboratoires qui souhaitent participer à la réalisation des dosages. Les laboratoires se soumettent à cette enquête de validation pour attester de la validité de leurs résultats. Je voulais faire cette distinction entre dosage sur les échantillons de fioul et les échantillons biologiques.
M. Bernard TAILLIEZ : En ce qui concerne la validation de la dénomination de la cargaison de l'Erika - s'agit-il ou non de fioul numéro 2 - cela ne revient évidemment pas à un laboratoire comme l'INERIS dont le conseil d'administration inclut un membre de Total Fina. Ce n'est pas non plus au CEDRE ou à l'IFP que revient une conclusion aussi sensible, avec des implications politiques et judiciaires trop importantes.
M. Georges LABROYE : Nous n'avons pas de membre de Total Fina dans notre conseil d'administration. Je réponds également à la question précédente qui portait sur la part de nos activités pour Total. Je précise que, sur cette affaire, nous n'avons travaillé que pour le ministère de l'Environnement et pour personne d'autre. Qu'on ait fait un jour, une analyse pour une des sous-filiales de Total, de Fina ou d'Elf, ce n'est pas aberrant, mais c'est
epsilon, cela représente une part infinitésimale de nos recettes.
M. le Président : M. Tailliez, affirmer ici, après serment, qu'un organisme comme l'INERIS a, dans son conseil d'administration, un représentant de Total Fina...
M. Bernard TAILLIEZ : C'est l'information disponible sur le site de l'INERIS.
M. le Président : Ce n'est pas le débat, mais, autant on peut entendre une discussion, autant on peut entendre un certain nombre de divergences entre scientifiques, sur des analyses, des dispositifs, etc., autant s'agissant, cette fois, de la présence d'un représentant d'un organisme comme Total Fina dans le conseil d'administration de l'INERIS, ce qui est contesté, je dis que cela ne fait pas partie du sujet dont nous débattons aujourd'hui. En outre, cela jette un certain trouble.
M. Jean-François MINSTER : Je confirme la présentation de mon collègue de l'AFSSA quant à l'attention apportée sur l'analyse des échantillons biologiques et sur les démarches de discussions et d'affichage de procédure. C'est vraiment ainsi que c'est préparé.
M. Jean-Pierre DUFAU : Il ne faut pas s'enliser dans de faux débats. L'intérêt de cette commission d'enquête est de progresser et d'être capable ensuite de donner les informations les plus fiables possibles. La polémique n'a pas lieu d'être.
Sur les questions essentielles qui se posent, il y a parfois des interprétations différentes, voire divergentes, sur la nature du fioul qui est la base de la discussion. Ma première question est que ce problème pourra sans doute, comme cela a été confirmé par mon collègue, être « tranché » ultérieurement soit à partir des fuites de l'Erika, soit du pompage. Mais est-ce une vraie question désormais ou une question dépassée ? D'autant plus que ce qui importe, c'est moins la nature, dont on a vu que la définition n'était pas d'une rigueur à
epsilon près. Il ne s'agit pas de savoir si ce fioul s'appelle numéro 2 ou 3, mais les dangers et les risques qu'il présente.
En termes de vocabulaire, qui a son importance dans ce débat, j'ai été très attentif à la gradation faite entre la notion de danger et celle de risque. Quand ces informations sont livrées à l'opinion publique et médiatisées, chaque mot doit être bien pesé. Danger et risque ne sont pas des termes synonymes. Il faut donc les employer de la façon la plus efficace possible, pour la meilleure information du public.
Chaque fois, vous avez cru bon, mais c'était nécessaire, de qualifier cette notion de risque. Cela montre qu'il faut être très précis en la matière pour ne pas anormalement alarmer ou banaliser, les deux extrêmes étant excessifs.
Vous avez parlé de risque négligeable en ce qui concernait le ramassage. Pour nous, pour l'opinion politique et l'ensemble des personnes concernées, ce sont des choses aussi simples que ça qui sont importantes, au-delà de toutes les considérations et considérants scientifiques qui vous amènent à ces conclusions.
Vous avez évoqué un risque acceptable pour le nettoyage des oiseaux et autres. Il faut néanmoins se rappeler que cet élan des bénévoles, puis des professionnels, s'est produit à une époque où chacun a voulu s'en charger. On s'aperçoit que certaines initiatives spontanées n'ont pas été forcément du meilleur effet, et ceux qui pensaient être les plus qualifiés en la matière n'ont pas forcément pris les mêmes initiatives, si je prends le cas des oiseaux tel qu'il ressort.
Il faut être très prudent dans cette affaire et essayer d'en tirer des règles pour que l'approche de ces phénomènes soit faite non plus de façon passionnée et passionnelle, mais de façon la plus réfléchie et la plus raisonnée possible. Si on peut donner le pas à la raison sur la passion, nous aurons fait un grand progrès. Enfin, il n'empêche qu'une fois mis cela dans le cadre de la raison, on puisse effectuer cette tâche avec enthousiasme.
Pour conclure mon propos, je souhaite que le Dr Baert, à partir de ses conclusions sur les symptômes, le temps de latence ou de déclaration d'éventuelles maladies à caractère cancérigène de cinq ou dix ans, revienne sur ces questionnaires. Il serait intéressant que sur ces questionnaires remplis, sur quelques cas identifiés, on puisse avoir un suivi d'une durée de cinq ou dix ans, permettant de tirer davantage de conclusions. Je souhaite très fortement qu'un drame comme celui de l'Erika soit l'occasion de renforcer la cohésion nationale pour mieux traiter ces problèmes. C'est ce qui doit nous mobiliser et rien d'autre.
M. Alain BAERT : Vous soulevez un point important, sur lequel je ne pourrai malheureusement pas vous donner de réponses précises, qui est celui de la pertinence et de la faisabilité d'un suivi des gens qui sont intervenus.
En médecine, les suivis sont toujours des constats d'échec des médecins. Suivre quelqu'un signifie constater qu'à un moment donné, nous avons failli dans notre mesure de protection. Nous avons amputé une partie de nos possibilités thérapeutiques.
Par ailleurs, les effets que nous allons rechercher, en termes de chronicité, n'ont rien de spécifique à l'exposition au fioul. Il sera difficile de constater une lésion pour laquelle on ne pourra faire une relation formelle de causalité - je vous ai rappelé que les fréquences de ces cancers de la peau doublaient tous les dix ans, notamment des mélanomes qui sont des maladies ayant tendance à métastaser rapidement.
Enfin, les questionnaires envoyés sont strictement anonymes. Il ne sera pas possible d'identifier la personne qui a répondu, ni le lieu sur lequel elle est intervenue. Néanmoins, cette question, actuellement débattue au sein d'un groupe de travail, au niveau de la santé, sur la pertinence et la faisabilité d'un suivi médical - comment l'organiser et que rechercher -, sera notamment discutée vendredi, lors d'une réunion que nous tiendrons à la direction générale de la santé.
M. Serge POIGNANT : Nous avons tous saisi que l'appellation du fioul et sa qualité venaient plus de caractères physiques que chimiques. Restons donc sur l'aspect chimique puisque ce sont les substances chimiques qui peuvent être cancérogènes. Toutefois, dès lors qu'on a bien compris cette définition, quelle est la différence d'analyse, quantitativement et qualitativement parlant, entre INERIS, Analytika ?
On a évoqué de 800 à 1 000 ppm de moyenne hors endroit de prélèvement et de volatilité. Mais vous, monsieur Tailliez, obtenez-vous une composition très largement différente ? En effet, dès lors que l'on a les mêmes produits et les mêmes compositions, où est la différence dans la base de la toxicité ? Ensuite, la question est celle que vous posez fort justement, c'est-à-dire comment évaluer le risque. Mais le point de départ est bien la nature des produits cancérigènes, leur dose et leur concentration, le temps d'exposition, et l'exposition avec ou sans protection.
Dès lors qu'on cherche à répondre à ces questions, avec les mêmes types d'analyse en caractérisation chimique, je ne vois pas où est la différence. Au-delà de cette question, la remarque qui m'importe est de savoir comment maintenant, une fois établi que le risque était négligeable ou acceptable pour les nettoyeurs d'oiseaux, suivre spécifiquement l'épidémiologie. Mais je voudrais la réponse sur l'analyse chimique différente ou non du produit.
M. Michel MARCHAND : Je précise qu'avant cette réunion, j'ai revu les résultats des analyses de l'IFP sur les cinq molécules HAP qui avaient été sélectionnées par l'AFSSA. Je les ai comparés à ceux obtenus par le laboratoire du CNRS de Bordeaux qui travaille avec IFREMER. J'ai comparé ces données aux échantillons prélevés par Paris Match qui les a transmis à deux laboratoires indépendants. Nous évoluons souvent dans un débat où on veut opposer des laboratoires indépendants à des laboratoires institutionnels.
En ce qui concerne les résultats exprimés en ppm, c'est-à-dire en milligramme par kilo, des cinq HAP, ceux des laboratoires institutionnels se situent dans une fourchette qui varie entre 226 et 440 ppm. Ce n'est donc pas une variation très importante. En ce qui concerne les deux laboratoires indépendants, leurs valeurs sont quelque peu différentes : 445 pour l'un, ce qui rentre dans la fourchette des laboratoires institutionnels, et 713 pour l'autre.
Pour ma part, je ne vois aucun élément fondamentalement différent entre les résultats des divers laboratoires sur différents échantillons de produits qui évoluent relativement peu.
M. Bernard TAILLIEZ : Nous n'avons pas publié de mesures, mais nous les avons effectuées, et nous sommes tout à fait en accord avec les résultats de l'INERIS. Toutefois, s'agissant de la dangerosité et du caractère cancérigène de cette cargaison, l'INERIS ne peut se baser que sur la législation en vigueur qui porte sur seize HAP. Cette cargaison contient ces seize HAP, mais aussi d'autres HAP alkylés et des aromatiques polycycliques soufrés, dans des proportions importantes. Or on sait que tous ces produits appartiennent à la grande famille des composés aromatiques polycycliques qui sont tous, à des degrés divers, cancérogènes.
M. le Rapporteur : Acceptez-vous la formulation utilisée à plusieurs reprises par différents intervenants, sur la nature du risque négligeable pour les ramasseurs avec ou sans gants, et acceptable pour ceux qui s'occupaient des oiseaux, car il y a eu deux concepts autour de l'acceptabilité sans gant ? Il nous semble que c'est une formulation assez consensuelle des uns et des autres tout en admettant que c'est cancérigène, comme d'autres produits le sont. Acceptez-vous cela ou non ?
M. Bernard TAILLIEZ : Je l'accepte, mais je n'ai aucune compétence pour émettre une opinion sur le plan du risque.
M. le Rapporteur : Excusez-moi, vous avez dit autre chose, Monsieur. Nous sommes porteurs de l'intérêt général autant que faire se peut. Ayant eu aussi, pour ma part, à encadrer des bénévoles et des personnels mis à disposition, ces derniers ont lu que ce n'était pas une opération de ramassage, mais qu'il fallait opérer avec masque et combinaison. Pour un responsable, devant une telle information diffusée par vous-même alors que vous dites être d'accord sur la notion de risque, c'est gênant.
M. Bernard TAILLIEZ : J'ai mis en évidence la toxicité de ces produits, mais je me suis toujours bien gardé de mentionner quelque opinion que ce soit, concernant le risque. C'est l'affaire des toxicologues, et je suis chimiste.
M. Louis GUEDON : Nous avons bien compris que le débat sur le fioul numéro 2 est un débat qui n'intéresse personne, puisqu'il s'agit de mesures de viscosité, de soufre, d'eau et de température aux produits des vapeurs inflammables. On ne voit pas ce que ces constantes vont apporter en pathologie humaine. Par conséquent, cela n'apporte rien aux attentes du patient futur ou existant ainsi qu'aux gens inquiets. Nous allons donc évacuer cette identité.
Par ailleurs, on ne va pas développer, chez tous ces bénévoles, un syndrome psychosomatique en ne leur apportant pas de réponses et en restant dans le vague absolu que l'on entend ici. Il faut apporter une réponse. Quand vous consultez un biologiste pour un hémogramme, il doit vous dire si vous souffrez d'une hémopathie maligne ou non, et non que vous risquez peut-être de développer, dans les semaines prochaines, une hémopathie maligne. Vous l'avez ou vous ne l'avez pas. De même, si vous consultez votre chirurgien après des examens d'échographie et des scanners, il vous dira qu'il doit intervenir parce que vous avez une tumeur sur tel organe, et non qu'il est possible que peut-être, il y a risque... Nous avons besoin de réponses absolument certaines.
Il convient donc d'élaguer. Pour ce faire, nous avons compris qu'il y a trois modes d'intoxication : l'inhalation, l'ingestion et le contact avec l'épiderme ou les muqueuses. Personne n'a dégusté ce fioul, l'ingestion est donc à exclure du danger. J'ai moi-même été un bénévole. Pendant le travail, nous étions à 0,60 mètre des goudrons et, au repos, à 1,50 mètre. Aucun d'entre vous n'a pu nous donner la concentration par litre d'air que nous respirions, afin de savoir s'il y avait suffisamment de thiophènes ou autres qui auraient pu nous inquiéter. Ma conclusion en est qu'il n'y a pas de danger à partir de l'air respiré. Nous pouvons donc exclure le risque par inhalation.
Nous arrivons maintenant au risque par contact de l'épiderme ou des muqueuses. J'ai là entendu différentes choses. C'est la loi du tout ou rien : selon que vous êtes au contact avec un produit, vous pouvez développer un risque cancérogène dans le temps. On a évoqué les cancers de la peau provoquant des mélanomes qui étaient doublés par rapport à une certaine période de l'année. On a parlé de risque, de danger, d'acceptable, de négligeable.
A ce stade, on arrive maintenant en pathologie humaine, et chaque spécialiste du corps médical doit faire son examen de conscience et se demander s'il est l'interlocuteur compétent pour répondre à cette question.
L'une des premières tumeurs malignes connues provoquée par les produits toxiques fut le cancer des scrotums des ramoneurs, considéré comme étant la première tumeur chimique décrite. Maintenant, cela fait partie de l'histoire.
Ceci étant, la parole est maintenant au corps médical. La médecine légale, la médecine du travail, toutes sortes de spécialités, pour lesquelles on a suffisamment de recul, de statistiques, de publications, de suivis de dossier médical, doivent pouvoir indiquer, à partir des produits identifiés, dans quelles circonstances, quel est le devenir des individus mis au contact de ces produits.
Ont été évoquées tout à l'heure les personnes ayant à travailler les goudrons sur les routes qui contiennent des résidus de distillation. Il serait intéressant de connaître, parmi cette population qui, des années durant, a manipulé et respiré ce type de produit similaire à ceux qui nous préoccupent, le pourcentage de développement de tumeurs malignes et de comparer avec ceux de nos bénévoles qui ont passé plusieurs jours à ramasser le produit. Ce sont des réponses médicales que nous attendons.
M. Alain BAERT : Vous avez raison de rappeler la description, de 1770, de Percival Pott du cancer du scrotum chez les ramoneurs. C'est le premier cancer professionnel mis en relation avec les HAP qui nous préoccupent, mais dans des scénarios d'exposition qu'heureusement, le développement des sociétés a fait disparaître : en effet, on descendait des enfants de cinq ans dans les tuyaux et vingt ans après, ils avaient un cancer du scrotum.
Le problème essentiel est de tirer des données qui montrent qu'effectivement les expositions aux HAP peuvent, dans certaines conditions, donner des cancers chez l'homme et de les appliquer à nos ramasseurs sur les plages, dans un tel scénario qui réduit considérablement la durée d'exposition et qui ne nous permet pas d'apprécier le niveau réel d'exposition. Même si on peut le quantifier faible, c'est « à la louche ». On aimerait pouvoir être précis.
Nous ignorons actuellement, lorsqu'on étale du fioul sur une peau, la proportion qui passe dans l'organisme et celle qui reste dans la peau. Nous ne sommes donc pas en mesure de faire des extrapolations entre les données publiées et celles qui existent.
Je souligne également que l'on peut constater que l'ensemble de ces hydrocarbures, dans les classifications internationales, ne sont pas décrits comme cancérogènes certains. Cela signifie que le poids que l'on peut accorder à toutes les données n'a pas entraîné la certitude des gens qui font la classification. On reste dans un problème d'inconnues, alors qu'il faudra répondre à chacune des personnes qui nous interroge.
Pour l'instant, j'ai répondu à un certain nombre de personnes, mais au cas par cas, car cela doit se faire par un contact singulier entre le patient et son médecin, qui doit pouvoir interroger son patient sur ses pratiques, ses antécédents, afin d'être en mesure de donner une estimation la plus honnête possible.
M. Martin HIRSCH : Sur l'intervention visant à savoir les leçons à tirer d'une telle affaire en vue d'améliorer les choses, il convient de rappeler que plusieurs organismes, comme vous l'avez vu, ont été confrontés à la même problématique. Pour être en mesure de rendre des évaluations pertinentes aux pouvoirs publics et, en particulier, aux autorités sanitaires, il faut disposer, le plus rapidement possible, d'informations fiables, précises et complètes.
Peut-être serait-il opportun, pour le transport en telles quantités de matières dangereuses, de conserver un échantillon avant le départ d'un navire, et de le transmettre aux organismes qui auront à travailler dessus.
M. le Rapporteur : Tout à fait. Il serait même utile que vous nous l'écriviez.
M. Georges LABROYE : Les médecins ont largement la parole, y compris dans nos études, puisque tout ce qui a été dit s'y trouve repris. L'évaluation des risques fait appel à des équipes de médecins, médecins du travail, toxicologues, spécialistes d'animalerie ou médicaux, biologistes ou autres domaines
in vivo et in vitro. Nos études intègrent l'ensemble de ces aspects et n'ignorent pas la médecine clinique, sur laquelle nous nous appuyons.
M. André CICOLELLA : Ceci étant, l'évaluation des risques n'est pas un problème médical, mais une synthèse des données, des connaissances, au moyen de la méthodologie que j'ai exposée tout à l'heure, dont l'élément essentiel est la modélisation. Heureusement, l'espèce humaine n'est pas exposée au niveau d'exposition des animaux de laboratoire. La difficulté rencontrée est que l'on va extrapoler des résultats généralement obtenus sur vingt ou trente animaux, à une population beaucoup plus large.
Dans les données animales, les expositions sont d'environ 10 ou 20 microgrammes de benzo(a)pyrène par centimètre carré, sur plusieurs semaines ou mois. Elles suffisent à induire des tumeurs chez l'animal. Nous avons des données qui montrent qu'une exposition unique au benzo(a)pyrène suffit à induire des adduits à l'ADN, c'est-à-dire une liaison du benzo(a)pyrène à l'ADN. Des doses totales de benzo(a)pyrène d'environ quelques milligrammes suffisent à induire des tumeurs chez la souris.
Mais nous sommes incapables, actuellement, de dire quelle est la dose réelle. Nous avons une fourchette évidemment exagérée puisque l'on fait l'hypothèse maximale que l'ensemble du benzo(a)pyrène, présent dans les souillures, est passé dans la peau, sans pouvoir déterminer quel est le degré d'exagération. Ce travail scientifique n'ayant pas été mené jusqu'à présent, nous ne sommes pas en mesure de répondre. Je conçois que c'est frustrant pour vous, en tant que gestionnaire de risque, mais aussi pour nous, en tant qu'évaluateur de risque.
Nous avons une borne qui est en fait la durée d'exposition. Dans une liste des études épidémiologiques, une étude importante menée chez les ouvriers traitant le bois à la créosote, un ensemble de HAP, montre une augmentation de l'incidence du cancer cutané de la lèvre. L'exposition moyenne, au niveau atmosphérique, était entre 100 et 11 000 microgrammes par mètre cube. On peut supposer que l'exposition cutanée était de plusieurs centimètres carrés par jour, ce sur plusieurs années.
On sait que ce type d'exposition va induire des cancers cutanés, mais l'exposition des bénévoles ou des travailleurs sur les plages n'a pas été de plusieurs années. Ce n'est forcément pas un risque élevé.
M. Paul DHAILLE : Je dois dire au directeur du laboratoire d'Analytika que je suis étonné. Ayant été maire d'une commune, je sais que lorsqu'on fait une analyse d'eau potable, il y a un protocole scientifique. Je voudrais savoir quel protocole scientifique est suivi entre le prélèvement de l'échantillon, son transport et son analyse.
Je voudrais que les scientifiques ici présents me disent s'il y a un protocole scientifique à suivre dans ce cas et s'il l'a été. On peut envoyer un hélicoptère au-dessus de l'Erika et faire constater par huissier un prélèvement, toutefois ces méthodes ne m'apparaissent pas vraiment scientifiques.
Par ailleurs, député d'une circonscription qui comprend trois raffineries de pétrole, je vais peut-être passer pour quelqu'un qui a des intérêts dans l'affaire. Outre ceux qui ont été exposés, plusieurs centaines de personnes travaillent dans les raffineries. Si des bénévoles, exposés pendant quelques semaines, courent un risque très grave, qu'en est-il des travailleurs dans les raffineries ? Pouvons-nous nous dire que nous sommes en présence d'un danger du type de l'amiante...
(Réactions de M. Tailliez.)
M. Paul DHAILLE : Attendez, on en lit des pages entières dans la presse ! Vous comprendrez que, quand je rentre dans ma circonscription, les travailleurs du secteur pétrolier me posent la même question. Visiblement, cela n'avait ému personne auparavant. Peut-être estime-t-on le risque moins grand pour les travailleurs du secteur pétrolier que pour les ramasseurs.
Enfin, il nous a été dit que le risque le plus grave concernait les gens qui soignaient des oiseaux. Au risque de choquer, entre la vie d'un oiseau et la vie d'un être humain, je fais une différence. Quelqu'un peut-il me dire aujourd'hui qu'il aurait indiqué de laisser mourir les oiseaux car il y avait véritablement un risque important pour les hommes qui les soignaient ? C'est une prise de position simple. D'autant que j'ai le sentiment que ce n'était peut-être pas des espèces en voie de disparition.
Si les différents interlocuteurs ne peuvent répondre à toutes mes questions, qu'au moins ils m'indiquent le protocole scientifique qui a conduit au prélèvement, au transport et à l'analyse des échantillons.
M. François CUILLANDRE : Je reviens sur ce qu'il faut appeler une polémique entre Analytika et les autres intervenants. Sur l'idée de contre-enquête évoquée tout à l'heure, ne peut-on pas faire une contre-analyse sur les produits que vous avez reçus ? J'imagine que vous n'avez pas jeté vos pots de confiture à la décharge municipale et que vous pouvez encore les fournir...
Par ailleurs, quel serait - ce que vous dites de manière induite - l'intérêt recherché dans ce qui pourrait apparaître comme une vaste manipulation, associant les pouvoirs publics, Total, etc... et aboutissant à la situation qui a pu être décrite ? Je profite de l'occasion pour souligner qu'en ce qui me concerne, j'ai été quelque peu choqué par la mauvaise polémique faite sur le fonctionnement de l'INERIS.
A cet égard, vous avez eu tout à l'heure une phrase sibylline. Peut-être pourriez-vous préciser votre pensée, quant à la participation des pétroliers au conseil d'administration de Total. Ce n'est pas parce que l'organisme reçoit des financements du secteur des pétroliers qu'il ne fait pas preuve d'objectivité. Dans la même veine, ce n'est pas parce que la presse est financée, y compris par de la publicité de Total Fina, que l'on met en cause son objectivité.
On parle beaucoup de laboratoires indépendants pour évoquer les laboratoires privés et indépendants. De qui et de quoi le sont-ils ?
M. André CICOLELLA : Je voudrais apporter un élément d'information sur les effets en milieu professionnel. Il existe deux tableaux de maladies professionnelles, le 16 bis et le 36 bis. Le premier concerne les cancers de la peau, les cancers broncho-pulmonaires et les tumeurs de la vessie pour des travaux exposant aux goudrons de houille, donc aux HAP. Quant au second tableau, c'est l'équivalent pour les produits pétroliers.
Il est tout à fait possible de faire une évaluation de la relation dose-effet, à partir de ces expositions professionnelles. C'est ainsi que la valeur limite environnementale pour le benzène a été calculée, à partir d'une étude épidémiologique en milieu professionnel d'exposition au benzène. Ce travail sur les HAP, de l'ordre d'une année, n'a pas été fait, mais il pourrait l'être pour répondre à la fois aux préoccupations du type marée noire, mais plus largement du type professionnel.
M. Georges LABROYE : Je voudrais définitivement conclure sur cette question du conseil d'administration. L'établissement public INERIS a effectivement à son conseil d'administration des représentants tant de France Nature Environnement que des ministères, des unions professionnelles dont l'UFIP, mais pas de la société Total. Selon nos statuts, aucune société
intuite persona ne siège au conseil d'administration.
Parmi les 24 membres du conseil d'administration, la plupart représentent des ministères ou des associations. C'est déjà une garantie d'indépendance extrêmement forte, sans compter les membres du personnel élus de ce conseil d'administration.
M. Alain BAERT : Pour répondre à la question concernant tous ceux qui démazoutent, il s'agissait d'avoir la certitude qu'ils ne soient pas atteints et non pas d'évaluer un risque. Au départ, les gens veulent une réponse en termes de « oui » ou « non », et non pas « je risque... »
Dans la pathologie professionnelle, puisqu'il existe des tableaux des maladies professionnelles, on sait qu'un certain nombre de travaux et/ou d'expositions à des produits chimiques entraînent des effets secondaires sur la santé. L'hygiène au travail doit les réduire considérablement, voire les faire disparaître par des mesures préventives. Les ouvriers ont été informés de la nature du danger et sont donc à même de se protéger, avec de plus une sélection des personnes dans l'affectation aux postes et un suivi qui peut être annuel ou plus rapproché.
L'intérêt comporte une question de santé, mais il est également dépendant d'une pression sociale qui n'a pas toujours, à l'origine, des certitudes ou une réelle problématique scientifique. Cela peut être le cas actuellement. La difficulté rencontrée a été que l'on nous demandait des certitudes et que, par définition, les choses sont incertaines en science, notamment en santé. Les connaissances sur les substances chimiques doivent représenter cent certitudes pour six cent mille incertitudes, en termes d'effets sur l'homme.
S'agissant du mazout transporté par l'Erika, quels que soient les résultats des différents laboratoires, nous sommes très loin d'avoir la moindre certitude, mais nous sommes obligés, pour apporter des réponses aux questionnements légitimes des populations, de trouver la manière de baliser le mieux ces inconnues.
M. Alain FEUGIER : Concernant les protocoles analytiques, il faut de la rigueur sur toute la chaîne, dans le prélèvement et l'analyse. Tous les laboratoires reconnus pratiquent un protocole opératoire et analytique tout à fait rigoureux qui part des déterminations globales jusqu'aux caractérisations les plus détaillées possibles.
D'ailleurs ces laboratoires se rencontrent régulièrement pour confronter leurs protocoles analytiques afin de s'adapter aux nouveaux appareillages qui évoluent et d'avoir les procédures les mieux appropriées aux évolutions de la technologie. Pour la majorité des laboratoires, ce protocole est suivi. Il est rigoureux et le plus complet possible. Il se complète d'ailleurs avec la technologie des appareillages.
M. Bernard TAILLIEZ : En ce qui concerne le protocole, je n'ai jamais douté du fait que les laboratoires officiels appliquent cette rigueur nécessaire. Il n'y a aucune raison, de leur part, de douter du fait que la même rigueur est appliquée dans le cadre des analyses faites dans notre laboratoire.
En ce qui concerne la reproduction de ces analyses, nous les avons faites, une première fois, de manière bénévole, mais nous sommes prêts à les refaire moyennant finances.
S'agissant de notre indépendance, c'est un fait, nous n'avons de comptes à rendre à personne. On peut imaginer qu'un groupe aussi puissant et un lobby aussi important que celui des pétroliers puisse exercer des pressions sur des laboratoires, dans les conseils d'administration desquels ils figurent.
M. le Rapporteur : Je reprends les propos du président. Nous sommes dans une instance tout à fait solennelle de la République. Je vous demande de bien vérifier vos propos.
M. Jean-François MINSTER : Je vous remercie des questions que vous posez car elles nous interpellent. En ma qualité de président d'un des organismes publics de recherche en France, je voudrais réaffirmer que la recherche scientifique défend son indépendance, au-delà de ses instances et de ses tutelles, à partir de la validité scientifique et de l'intercomparaison mondiale des procédés et des résultats et non pas exclusivement par rapport à ses mandants et ses tutelles. C'est une garantie excellente et extrêmement efficace d'évaluation indépendante des études effectuées.
Par ailleurs, je préside un organisme qui a, dans son conseil d'administration, des représentants de l'UFIP et de cinq ministères de tutelle. Aucun d'entre eux, lors de conseils d'administration, ne m'a jamais donné d'instructions sur les méthodes employées, la qualité du travail, les méthodes d'évaluation. Ils nous demandent de répondre à des questions.
M. Michel GIRIN : Si la question difficile sur les oiseaux m'était posée en situation réelle, je demanderais au minimum une journée de réflexion et à consulter plusieurs collègues compétents avant de donner une réponse. Ainsi que cela est rapporté dans la lettre du CEDRE, la décision a été prise, au Danemark l'année dernière, de sacrifier les oiseaux.
M. le Rapporteur : Merci. Je vous propose d'arrêter là en vous remerciant de vous être déplacés pour cet échange qui était indispensable.
Audition du contre-amiral Yves LAGANE,
préfet maritime de la Manche et de la Mer du nord
(extrait du procès-verbal de la séance du 21 mars 2000)
Présidence de M. Daniel PAUL, Président
M. Yves LAGANE est introduit.
M. le Président lui rappelle que les dispositions législatives relatives aux commissions d'enquête lui ont été communiquées. A l'invitation du Président, M. Yves LAGANE prête serment.
M. Yves LAGANE : Je propose de vous présenter une analyse de notre organisation nationale pour maîtriser les risques liés à l'activité maritime.
Cette analyse est fondée sur l'expérience de dix-huit mois d'exercice de mes responsabilités de préfet maritime dans la Manche et la Mer du nord. Mais l'essentiel de mon activité de préfet maritime se concentre sur la zone Manche-Pas-de-Calais dont le littoral couvre les régions allant du Couesnon - le début de la Normandie - à la frontière belge.
Elle est également fondée sur une surveillance, une observation assez précise, au quotidien, de l'organisation de nos pays voisins, la Grande-Bretagne et la Belgique, avec lesquelles nous travaillons très régulièrement.
Dans un premier temps, je développerai la notion de risque lié à l'activité maritime dans ce théâtre très particulier que constituent la Manche et le Pas-de-Calais. Dans un deuxième temps, je livrerai une réflexion personnelle sur l'organisation et les moyens dont je dispose pour exercer mes activités de préfet maritime. Dans un troisième temps, en guise de conclusion, je vous proposerai deux enseignements et trois propositions.
Mon point de vue est sans doute légèrement différent de ce qui ressort du débat public dans le prolongement de l'affaire de l'Erika, qui a centré l'attention sur les problèmes de sécurité des navires, d'entretien des bateaux et de maîtrise de la mise en _uvre des bateaux. Il sera plus focalisé sur le risque d'accident et sur l'intervention à conduire en cas d'accident. Je précise que je ne parle, bien sûr, que de ma zone de responsabilité.
Premièrement donc : les risques en Manche-Pas-de-Calais.
Plusieurs éléments font du théâtre Manche-Pas-de-Calais l'un des théâtres les plus denses en activité au monde, notamment les activités de transport de matières dangereuses, qui sont une des caractéristiques principales de ce trafic. C'est exact mais, au titre de ces matières dangereuses, j'en citerai une qui n'est pas classée comme telle par la majorité des personnes : le transport de passagers.
C'est, pour moi, une matière dangereuse, précieuse en tout cas. Entre le Cotentin et le Pas-de-Calais, 70 000 personnes en moyenne traversent quotidiennement la Manche. Cela en fait une activité particulièrement sensible. C'est pourquoi j'ajouterai à tout ce que l'on évoque habituellement comme risques, celui lié au transport de passagers en très grand nombre.
L'autre caractéristique de ce théâtre qui intervient dans le risque est la densité et la diversité de l'activité. Les activités de transport de marchandises entre l'Atlantique et la Mer du nord et de passagers entre le continent et la Grande-Bretagne ne sont pas les seules. D'autres activités viennent interférer avec celles-ci.
L'activité de pêche est très importante car, comme par hasard, les endroits où vous avez le plus de poissons sont également ceux de plus grosse densité de trafic ! Deux zones sont particulièrement marquées : celle du nord-ouest du Cotentin et celle du sud du Pas-de-Calais. Deux cartes figurant dans les dossiers que je vous ai remis rendent bien compte de la densité du trafic à ces endroits.
Une autre activité est la navigation de plaisance. Moins importante qu'ailleurs, elle reste cependant significative, surtout en été.
L'activité d'exploitation du fond n'est pas négligeable non plus. De nombreuses exploitations des granulats marins ou de pose de câbles sous-marins au travers du détroit sont autant d'activités qui viennent interférer avec celles que je viens de citer.
Enfin, élément marginal mais non négligeable pour le préfet maritime de la Manche et de la Mer du nord, cette mer est bordée d'installations à caractère nucléaire qui, de temps à autre, nous amènent à conduire des opérations de maintien de l'ordre public.
J'en terminerai avec cette partie risque en insistant très légèrement sur les caractéristiques physiques de la région. Il s'agit d'un détroit, zone de passage resserré, comptant de nombreux hauts-fonds, soumis à des conditions de navigation difficiles, des conditions météorologiques souvent mauvaises ou de tempête, de forts courants et, pour couronner le tout, dans laquelle nous avons à gérer l'héritage des deux derniers conflits mondiaux, en l'occurrence plusieurs dizaines de milliers d'engins - bombes, munitions et mines - que nous trouvons encore très régulièrement dans les chaluts des pêcheurs ou sur le littoral, éléments non négligeables à prendre en compte dans l'activité du préfet maritime pour la Manche et Mer du nord.
Comment classer ces risques aujourd'hui ?
Cette estimation est très intuitive car je ne dispose pas de beaucoup de données pour la chiffrer. Je dirai qu'à 80 %, c'est le risque de collision entre deux bateaux. Ce risque est lié au facteur humain, c'est la capacité d'un officier de quart à deux heures du matin dans des conditions météorologiques difficiles de gérer une situation de proximité, c'est-à-dire d'éviter une collision dans des endroits où le trafic est très dense. C'est le principal risque perçu par le marin que je suis.
J'évaluerai ensuite à 15 % le risque lié à l'état des bateaux. Je n'ai pas de donnée précise, mais j'observe, soit en conduisant des opérations d'évaluation sur les bateaux, soit en regardant les résultats des analyses qui sont faites quand ces bateaux font escale, qu'un certain nombre de bateaux sont en très mauvais état. S'ils étaient des voitures, ils n'auraient certainement pas le droit de circuler sur notre réseau routier en France.
Les 5 % de risque restant sont liés à la difficulté sans cesse croissante de l'ensemble des acteurs qui pratiquent cette zone maritime à cohabiter. A mon avis, la densité d'acteurs risque fort de créer à l'avenir des problèmes de confrontations, d'affrontements entre les différents corps de métier qui chacun ont leurs objectifs et qui auront de plus en plus de mal à coexister. Il faudra que les Etats riverains interviennent de plus en plus souvent pour réglementer afin que ces gens puissent conduire leurs activités en paix.
Tel est donc mon classement des risques dans ces deux zones précises que sont la zone nord-ouest du Cotentin et la zone des approches sud du Pas-de-Calais.
Je compare souvent cette zone maritime à une grosse autoroute avec un trafic très dense de gros poids lourds, des croisements répétés sans feu rouge et, au milieu de tout cela, de temps en temps, un petit chantier qui vous oblige au détour et des tracteurs - les pêcheurs - qui suivent leur bonhomme de chemin, en toute indépendance, selon un tracé qui leur est propre, pas toujours facile à prévoir. Et il faut gérer tout cela !
Les priorités pour le préfet maritime pour la Manche-Pas-de-Calais sont les suivantes.
La première est le sauvetage des vies humaines. C'est la principale activité. Si je me réfère aux chiffres de l'année dernière, nous avons effectivement sauvé 1700 personnes qui se trouvaient dans des situations dangereuses, délicates, qui auraient pu se terminer de manière dramatique sans notre intervention.
La deuxième est l'assistance aux bateaux, dans une perspective clairement définie, c'est-à-dire l'assistance aux bateaux ayant des difficultés qui peuvent menacer à terme nos intérêts, pouvant avoir un accident ou s'échouer sur une côte et dont l'échouage pourrait avoir des conséquences dramatiques pour nos intérêts.
La troisième priorité est de faire en sorte que les gens respectent le « code de la route ».
La quatrième est, bien sûr, la prévention et la lutte contre la pollution.
La cinquième est le maintien de l'ordre public en mer,
en faisant en sorte que les acteurs cohabitent en paix.
La première des priorités conjoncturelles est d'organiser la cohabitation des activités de pêche et du transport maritime dans ces zones très denses, que sont la zone du nord-ouest du Cotentin et la zone des approches sud du Pas-de-Calais.
La deuxième est d'essayer d'obtenir, mais ce n'est pas de mon ressort, un traitement judiciaire plus dissuasif des nombreuses infractions que nous constatons aux règles de navigation.
La troisième est d'essayer de promouvoir un préavis de détection sur l'activité de transport maritime le plus loin possible, le plus large possible, c'est-à-dire « voir sur l'avant ». Je détecte actuellement les bateaux au moyen de mon CROSS de Jobourg, au nord-ouest du Cotentin, à une cinquantaine de nautiques. Plus on donnera du préavis sur cette capacité à surveiller et à faire en sorte que les bateaux se sentent surveillés et ne puissent pas en toute impunité faire n'importe quoi, plus le préfet maritime sera rassuré. Je pense à cet égard que les mesures engagées récemment vont dans le bon sens.
La quatrième est d'élaborer un plan de secours à naufragés. J'ai la responsabilité de deux plans d'urgence : le plan de secours à naufragés et le plan POLMAR mer. Je conduis actuellement un travail de re-élaboration du plan de secours à naufragés afin qu'il soit le plus cohérent possible et intègre à la fois la partie intervention mer et la partie interface mer-terre. Nous travaillons cela avec les deux zones de défense avec lesquelles j'ai la possibilité de travailler, la zone de défense Ouest et la zone de défense Nord, de manière à coordonner l'ensemble des activités de chaque préfet de département sous la coupe des zones de défense. Avoir dans un même document la partie intervention mer et la partie organisation de l'interface mer-terre est un élément très délicat.
Il conviendra de faire de même pour le plan POLMAR.
La cinquième priorité est, enfin, d'essayer de promouvoir une vision commune entre l'ensemble des pays qui bordent la Manche et la Mer du nord - Grande-Bretagne, Belgique et France - sur une politique de maîtrise des risques liés aux activités maritimes en Manche-Pas-de-Calais. Il n'y a pas de vision commune aujourd'hui sur ce sujet. Je reviendrai sur ce point dans ma dernière partie.
J'en arrive à la réflexion que je souhaitais vous soumettre sur l'organisation mise en _uvre et à la disposition du préfet maritime. Je la situerai par rapport à ce que je connais de l'organisation britannique. Je ne parle pas ici de sécurité des navires - ce n'est pas mon domaine puisque le contrôle de l'état des navires dépend très clairement du ministère des transports et ne relève pas de la responsabilité du préfet maritime. Concernant la sécurité de la navigation, qui est plus de mon domaine, je développerai deux points spécifiques : la surveillance de la circulation maritime et la gestion d'une intervention en cas d'accident.
La France a fait de gros efforts dans le domaine de la surveillance maritime. Il nous faut les poursuivre en coopération avec les Britanniques et les Belges quant à l'organisation des moyens pour la gestion d'une intervention lourde.
Dans l'organisation, le préfet maritime, avec ses responsabilités de police administrative générale, de réglementation, de mise en demeure des acteurs étrangers quels qu'ils soient, de prise de mesures conformes aux intérêts de la France, de coordination de l'ensemble des acteurs intervenant en mer - sécurité civile, administration des affaires maritimes, douanes, gendarmerie, société nationale de sauvetage en mer et, bien sûr, marine nationale - est un outil de décision superbe. De plus, le fait qu'il soit marin est un élément important.
Cet outil de prise de décision permanent, le préfet maritime, avec son petit centre d'opérations maritimes, les deux CROSS et l'arsenal réglementaire que l'on a mis à sa disposition, le considère comme un outil réactif et de très bonne qualité.
Si je le compare à celui des Britanniques, je constate que, progressivement, ces derniers sont en train de rejoindre notre organisation. L'analyse de deux accidents graves survenus en 1994 et en 1996 dans les Shetlands et au Pays de Galles, les a conduits à mettre en place un personnage, qu'ils appellent le
Secretary of State Representative (SOSREP), installé auprès de deux ministères. Selon l'événement en question, il est rattaché à tel ou tel ministère. Par exemple, en cas d'accident typiquement maritime, le ministère est celui des transports, de l'environnement et des régions ; en cas d'accident lié à une plate-forme
offshore, c'est le ministère de l'industrie.
Ce personnage que les Britanniques ont mis en place l'été dernier est celui qui se rapproche le plus aujourd'hui de ce qu'est un préfet maritime en France. Peu à peu, il en prend la dimension sans l'être tout à fait parce qu'il n'est désigné pour intervenir qu'en temps de crise. Il n'a pas la capacité d'action en continu, au quotidien, qu'a le préfet sur la gestion des cinq domaines que j'ai cités tout à l'heure, c'est-à-dire le sauvetage, l'assistance aux bateaux, la police de la navigation, le maintien de l'ordre public, la prévention et la lutte contre la pollution.
Je considère donc que notre outil est meilleur que celui des Britanniques. Or, ce que j'ai observé dans les autres pays européens me fait penser que les Britanniques sont les meilleurs. Qu'il s'agisse de la Belgique, de l'Allemagne, des Pays-Bas, que je connais moins, ou encore de l'Italie, il n'y a pas de discussion possible.
Après avoir parlé de l'organisation pour conduire l'action, j'en viens maintenant aux moyens. De manière synthétique, je distinguerai les moyens de prévention et ceux d'intervention.
Les moyens de prévention mis en _uvre aujourd'hui dans notre pays sont d'excellente qualité. Nous pouvons les développer, et il faudra le faire pour exercer une présence toujours plus forte auprès des acteurs maritimes sur la mer, mais les CROSS que nous avons mis en place, la capacité de surveiller et les moyens de patrouille dont nous disposons, qu'ils soient aériens ou maritimes, nous permettent de disposer d'un bon outil de prévention, qui est assorti d'un arsenal réglementaire efficace.
La seule difficulté du préfet maritime est l'outil de répression car il ne suffit pas de constater des infractions, encore faut-il les réprimer. Sur ce point, à mon avis, il y a quelque chose à conduire.
Si je compare cet aspect à l'organisation britannique, je dirai qu'aujourd'hui, nous sommes meilleurs dans le domaine de la surveillance de la mer et du contrôle continu de l'activité maritime. Les Britanniques n'ont qu'un centre de contrôle et de surveillance de la mer à Douvres, qui dépend directement de l'Agence des
Coast Guards, qui est une agence privée. C'est le seul. Sur la zone qui m'intéresse, Manche-Pas-de-Calais, ils n'ont pas d'autres moyens de savoir ce qui se passe en mer.
La situation est légèrement différente quand on passe aux moyens d'intervention.
L'intervention au quotidien, c'est-à-dire la disparition malheureusement trop fréquente d'un petit chalutier avec recherche de naufragés, la gestion d'un problème de maintien de l'ordre public, l'opération de mise en demeure d'un cargo qui ne veut pas dire qu'il est en difficulté et qu'il faut, peu à peu, en exerçant une pression de plus en plus forte, pousser dans ses retranchements pour l'obliger à admettre qu'il est en situation difficile, et la mise en demeure à partir du moment où l'on considère que son comportement commence à être dangereux pour nos intérêts, cette intervention au quotidien fonctionne bien, à ceci près que lorsqu'il faut intervenir avec des moyens un peu lourds transportés par hélicoptère, nous avons une excellente complémentarité avec les moyens belges et britanniques.
Je dispose de très bons hélicoptères de service public, des Dauphins. Ils sont parfaits pour 95 % de mon quotidien, mais dans 5 % des cas, j'ai recours quotidiennement
- et cela se passe très bien, de manière efficace - aux moyens belges ou britanniques qui sont les plus proches. Ils interviennent dans un délai tout à fait convenable dans la mesure où, en moins d'une heure, je peux avoir le concours d'un hélicoptère lourd britannique, plus proche de ma zone d'activité que ceux de Brest.
Pour ce qui est de la lutte contre la pollution, nous avons des moyens qui sont ce qu'ils sont... qui pourraient être améliorés. Au quotidien, j'ai les moyens de traitement d'une petite pollution, à partir de remorqueurs portuaires et de petits barrages. Ce sont des moyens pour faire face à la petite pollution chronique, la petite pollution volontaire, le déballastage ou le dégazage, que l'on rencontre encore trop souvent au large de nos côtes et que l'on est capable de traiter dans la plupart des cas.
Les Britanniques ne sont pas plus capables que nous de traiter ce type de pollution. Ils ont un moyen qui me semble important si jamais il y avait une pollution plus lourde, c'est la possibilité de disperser par moyen aérien des produits assez rapidement et sur une assez large surface. La France a opté pour une solution différente : la mise en place de moyens de récupération de produits polluants plus lourds. Mais, en toute franchise, à part les petits moyens auxquels je viens de me référer, je dispose de peu de moyens sur ma façade Manche-Pas-de-Calais.
En cas de risque majeur, nous ferons forcément une intervention dans le cadre de l'accord MANCHEPLAN. C'est le premier moyen à utiliser en la circonstance. Il s'agit d'un accord tout à fait clair de partage des moyens entre les Britanniques, les Français et les Belges qui fonctionne très bien. Pour ce qui est des moyens héliportés et des moyens de secours, on doit arriver à s'organiser.
Sans doute cette analyse n'a-t-elle pas été assez conduite en commun entre les Belges, les Britanniques et les Français mais, à mon avis, le risque majeur reste tout de même celui de la collision entre un transport de passagers de 2500 personnes et un pétrolier. Nous disposons de moyens nombreux et assez complémentaires entre la Belgique, la Grande-Bretagne et la France, mais je pense que nous ne pourrons pas faire de pari sur l'avenir et qu'il nous faut conduire une réflexion en commun pour s'assurer que l'organisation et les moyens mis en place sont aptes à gérer un tel événement.
La probabilité de risque est loin d'être nulle. Aujourd'hui, on a l'impression que, dans le Pas-de-Calais et la Manche, il n'y a pas de problème parce que l'on n'a pas eu d'accident comme ceux que l'on a malheureusement connus au large des côtes de Bretagne. Il faut sans doute attribuer cela à un renforcement de nos outils de contrôle et de surveillance et à tout ce qui a été déployé depuis une vingtaine d'années en matière de réglementation et d'exigences de plus en plus fortes sur le comportement des acteurs maritimes. Mais l'accident reste toujours possible.
J'ai deux CROSS, l'un à Jobourg, l'autre à Gris-Nez, juste sur les bords du Pas-de-Calais. Quand je vais à Gris-Nez, je constate que deux ou trois fois par semaine, on observe ce que l'on appelle en jargon de marin « des situations de proximité » c'est-à-dire que deux, trois ou cinq bateaux se trouvent dans des situations qui les obligent à man_uvrer en urgence pour s'éviter les uns les autres. Je ne suis pas capable de traduire cela en une probabilité de risque de collision, mais en voyant cela, je me dis que la collision n'est jamais très loin. Sans vouloir dramatiser ni faire peur, il est de mon devoir de vous confier ma perception de marin qui est que le risque est toujours présent dans cette zone, un risque de collision très particulier, et sérieux, puisqu'il peut impliquer un bateau de transport de passagers important et un bateau transportant une matière dangereuse.
L'été dernier a eu lieu une collision très grave qui, heureusement, n'a pas eu trop d'impact parce qu'elle n'a pas fait de morts. Elle s'est produite à la limite de la zone du préfet maritime pour la Manche et la Mer du nord, en zone britannique à l'ouvert de la Tamise, entre un paquebot qui transportait 2800 personnes et un porte-conteneurs. Heureusement, c'est le paquebot qui est entré dans le porte-conteneurs et non l'inverse. Cela aurait pu être dramatique. Les conditions météorologiques étaient parfaites, c'était la nuit, la visibilité était excellente ; rien ne pouvait expliquer cet accident. Il y avait même un pilote à bord de l'un des deux bateaux. Je raconte cela simplement pour illustrer le fait que ce risque est toujours présent.
L'intervention en cas d'accident majeur implique d'être capable de déployer dans des délais assez brefs, dans cette zone aux dimensions assez restreintes, des moyens de secours aux naufragés - la priorité - en grand nombre. Avec les bateaux présents et les moyens d'hélicoptères lourds dont nous disposons actuellement en Grande-Bretagne et en France, nous pouvons faire face, y compris en faisant venir des hélicoptères lourds de Brest.
Le deuxième moyen important concerne l'assistance aux bateaux. Nous nous retrouvons avec des bateaux en avarie. Il faut être capable de maîtriser leurs mouvements pour éviter qu'ils ne partent un peu partout. Il faut donc des moyens de remorquage. Je dois avouer que je me sens plus tranquille depuis que l'on a décidé, dans le cadre du dernier Comité interministériel pour la mer, de prolonger l'affrètement sur l'ensemble de l'année d'un remorqueur dans le Pas-de-Calais qui, jusqu'à maintenant, n'était affrété que six mois par le gouvernement britannique.
Le troisième type de moyens est le contrôle des sinistres à bord. L'été dernier, il a fallu six jours pour maîtriser l'incendie survenu sur le porte-conteneurs qui a fait l'objet de la collision. Ce type de sinistre doit être maîtrisé le plus vite possible car cela pourrait avoir des conséquences sur l'environnement. Nous disposons de moyens et je pense qu'il faut aussi conduire une réflexion commune entre les trois pays riverains de la Manche et du Pas-de-Calais pour qu'ils soient mis en cohérence.
Les derniers moyens qu'il serait nécessaire de mettre en _uvre assez rapidement et avec un faible préavis sont les moyens de confinement, puis de récupération, d'une éventuelle pollution. Pour l'heure, nous serions sans doute assez lents à réagir dans ce domaine. Je suis honnête.
M. le Président : C'est ce que nous vous demandons.
M. Yves LAGANE : Les mesures qui ont commencé à être prises par le Comité interministériel pour la mer afin de développer un nouveau moyen lourd de récupération de pollution me paraissent importantes.
En conclusion de cette comparaison entre les organisations britannique et française, je dirai pour être très synthétique, qu'aujourd'hui, l'organisation française est bonne, et même très bonne, pour la conduite de l'action du quotidien et pour tout ce qui est mise en _uvre de la prévention. Je pense qu'elle est meilleure que l'organisation britannique. Jusqu'à maintenant, nous avons plutôt privilégié la prévention et l'organisation de la conduite de l'intervention du quotidien à la mise en _uvre de moyens pour maîtriser des interventions lourdes.
C'est l'inverse chez les Britanniques : ils ont plus insisté sur les moyens d'interventions lourdes.
Il y a donc aujourd'hui une sorte de complémentarité de fait, car elle ne résulte d'aucune concertation entre les Britanniques et les Français, à ceci près que dans l'état actuel des choses, nous disposons de part et d'autre de la Manche d'assez peu de moyens de récupération et de confinement d'une pollution importante dans cette zone très sensible qu'est la Manche-Pas-de-Calais.
Je terminerai par deux enseignements et trois propositions.
La chaîne de commandement de conduite de l'action est, à mon sens, excellente.
Il existe une complémentarité de fait dans les moyens qu'il serait bon d'officialiser et de formaliser à partir d'une réflexion commune entre les Français, les Britanniques et les Belges.
Il conviendrait d'élargir le plus possible notre zone de surveillance. Sur ce point, je ne suis pas certain que nous soyons sur la même ligne que les Britanniques, mais, à mon sens, plus nous nous donnerons les moyens de contrôler les mouvements des acteurs de la zone Manche-Pas-de-Calais, donc de leur imposer des comportements qui soient conformes à ce que l'on attend d'eux, mieux cela sera. Ce que j'ai entendu dire des mesures qui sont engagées actuellement, en particulier par le ministère des transports, rassure le préfet maritime que je suis.
Il serait bon également de renforcer les sanctions, car nous avons un problème de poursuite des procédures. On verbalise bien, on constate bien les infractions, mais ensuite, comme je le disais récemment à M. le directeur des affaires maritimes et des gens de mer, un réel problème de crédibilité de notre action se pose, à partir du moment où nous avons de grandes difficultés à faire en sorte que les procédures aillent jusqu'à des sanctions.
M. le Rapporteur : Pouvez-vous nous dire s'il existe des répétitions du plan POLMAR ? Si oui, quand ont-elles eu lieu la dernière fois ? Avez-vous déjà mené des exercices concrets de coordination POLMAR mer et POLMAR terre sur votre zone de responsabilité ?
M. Yves LAGANE : La réponse à cette toute dernière question est non jusqu'à maintenant.
En ce qui concerne les exercices, ma réponse est positive. Nous les avons même faits en coordination et en coopération avec les Britanniques puisque le dernier exercice que nous avons conduit, si mes souvenirs sont exacts, a eu lieu au mois d'octobre dernier. Appelé Manche Ex, il s'agissait d'un exercice d'assistance à un pétrolier en avarie qui a amené les Britanniques, les sociétés pétrolières et la préfecture maritime à travailler en commun, mais nous n'avons joué que l'activité d'intervention maritime.
Pour ce qui est de l'interface mer-terre, je dois dire que depuis que j'ai pris mes fonctions, je me suis plus intéressé aux plans de secours à naufragés, auxquels j'ai donné une priorité, qu'au risque bateau. Mais, ce que nous faisons actuellement dans le cadre des plans de secours à naufragés doit être conduit de la même manière pour la partie POLMAR. La gestion de l'interface et la coordination entre l'action de terre et l'action de mer est un véritable problème que nous devons creuser.
M. le Rapporteur : Envisagez-vous de faire un exercice de ce type ? Nous nous sommes en effet rendu compte que dans l'affaire de l'Erika, il y avait eu quelques dysfonctionnements entre les plans POLMAR mer et POLMAR terre.
M. Yves LAGANE : Pour répondre franchement à votre question, je ne l'ai pas envisagé actuellement parce que je n'ai pas encore mené cette remise à jour du travail de planification POLMAR mer avec interface mer-terre. Ma priorité est un exercice que je suis en train de préparer pour les mois de mai ou de juin prochains dans les approches du Pas-de-Calais organisé autour de cette idée mais concernant le plan de secours à naufragés. Nous travaillons en commun avec la zone de défense, la sécurité civile, les sous-préfets et les autorités de la terre.
M. le Rapporteur : Le bilan de l'opération Manche Ex a-t-il été fait ?
M. Yves LAGANE : Nous avons un relevé de conclusions que je peux vous faire parvenir, qui est resté officieux parce que nous devions l'officialiser à la suite d'une réunion nécessitant la présence de l'opérateur pétrolier qui jouait avec nous, Total. Au moment où nous devions conduire cette réunion, Total a eu d'autres priorités. Nous avons eu du mal à conclure.
M. le Rapporteur : Vous avez dit à deux reprises à propos des relations avec les Britanniques qu'il fallait renforcer la complémentarité de moyens entre la France, la Belgique et la Grande-Bretagne. Estimez-vous que MANCHEPLAN ne suffit pas et qu'il faut renforcer certains aspects non pris en compte aujourd'hui ?
M. Yves LAGANE : MANCHEPLAN est un accord de coopération de moyens, élaboré à partir des acteurs de terrain, sous l'impulsion du Secrétariat général de la mer, et avec l'autorité centrale. Mais c'est une coopération de moyens. A aucun moment n'a été faite une analyse ou une appréciation de la menace réelle ou du risque réel que je viens d'évoquer en Manche-Pas-de-Calais. Il a simplement été décidé que les Britanniques disposaient de tels moyens, que les Français disposaient de tels autres et nous avons défini des zones de responsabilité en deçà desquelles untel est responsable de l'action avec l'assistance de l'autre, et réciproquement. Nous avons mis en place des procédures, des moyens de communiquer, des échanges très rapides de manière à pouvoir monter l'opération avec le concours de tous le plus vite possible, mais ce plan est le résultat d'un effort de coopération de mise en _uvre de moyens. Et il s'arrête là.
Quand je parle de travail en commun, je pense plus à une réflexion commune des autorités des trois pays riverains, pour apprécier le risque et étudier l'organisation d'une réelle complémentarité qui aujourd'hui, existe mais qui est aussi le fait du hasard. Il faudrait voir comment mieux maîtriser que ce que nous avons fait jusqu'à présent.
M. le Rapporteur : Pour l'instant, il n'y a que l'appel possible aux moyens des uns et des autres...
M. Yves LAGANE : Ça marche bien !
M. le Rapporteur : D'ailleurs, je crois que pour l'Erika, c'est ce qui s'est passé.
M. Yves LAGANE : Absolument.
M. le Rapporteur : Mais dans la gestion de la Manche et Mer du nord, il n'y a pas
de vision commune aujourd'hui ? Cela n'a jamais eu lieu ? Ni de la part des Britanniques ni de la part des Belges ?
M. Yves LAGANE : Non. Et je ne saurais pas l'expliquer.
M. le Rapporteur : Nous ne gérons pas la Manche et Mer du nord ensemble, nous nous envoyons des pompiers de secours ?
M. Yves LAGANE : C'est cela.
M. le Président : Est-ce que, malgré tout, vous rencontrez vos collègues de l'autre côté de l'eau ?
M. Yves LAGANE : Oui.
M. le Président : Officieusement ?
M. Yves LAGANE : Non, il y a des rencontres formelles ; mais ce sont des rencontres au niveau des opérateurs. Nous faisons, par exemple, l'analyse des interventions que nous avons à conduire réciproquement. Nous faisons du partage d'expériences mais l'analyse se fait entre gens qui conduisent l'action, c'est-à-dire essentiellement entre le chef des opérations de l'Agence des
Coast Guards britannique et mon adjoint chargé de l'action de l'État en mer. Ils se réunissent deux fois par an.
M. le Président : Pas à votre niveau ?
M. Yves LAGANE : A mon niveau, je n'avais pas de correspondant jusqu'à maintenant. Je vais provoquer de manière officieuse une réunion, dans quinze jours, avec le personnage dont je parlais tout à l'heure qui est créé depuis moins d'un an.
M. le Président : Est-il à Douvres ?
M. Yves LAGANE : Non, à Southampton. On l'appelle le
Secretary of State Representative (SOSREP). Il ne fait pas partie intégrante de l'Agence privée des
Coast Guards britanniques. Il est le représentant du secrétaire d'Etat à l'industrie et du secrétaire d'Etat aux transports, à l'environnement - ils ont associé les deux en Grande-Bretagne - et aux régions. Il vient d'être mis en place, je suis donc en train de démarrer une concertation que je souhaite régulière. Je pense qu'une concertation à plus haut niveau est nécessaire.
M. le Rapporteur : Pour avoir plus de précisions sur ce point : vous communiquez-vous des informations de repérage de bateaux entre ce qui correspond aux CROSS britanniques et les nôtres ?
M. Yves LAGANE : Leurs CROSS s'appellent des MRCC, des
Maritime rescue coordination centers. Ils communiquent entre eux par fax ou à la voix, mais il n'existe aucun système de transmission de données automatique entre ces centres, dont les équipements ont été développés indépendamment en Belgique, en France et en Grande-Bretagne. Il n'y a pas à ce jour de cohérence organisée entre ces outils.
Dans le Pas-de-Calais, il y a, à moins de 200 km les uns des autres, un centre à Douvres, un centre à Gris-Nez et un centre à Ostende. Ils communiquent et travaillent bien tous les jours, mais l'ensemble de cet outil n'a pas été développé dans le cadre d'une concertation commune entre les autorités françaises, belges et britanniques.
M. le Rapporteur : En gros, on ne gère pas la Manche et la Mer du nord ?
M. Yves LAGANE : On les gère chacun de son côté et, au bilan, on fait du bon travail au quotidien. Cependant, compte tenu de l'importance de cette mer intérieure européenne qui est un vecteur très important sur le plan économique - c'est la vision que j'en ai après dix-huit mois de responsabilité en tant que préfet maritime - il serait bon qu'il y ait une gestion commune ou, en tout cas, une appréciation commune du risque, d'une part, et des moyens pour maîtriser ce risque, d'autre part.
M. le Rapporteur : Dernier point sur les sanctions. Pour 1998, la brochure que vous publiez fait état de cinquante-cinq arrêtés préventifs pour exercer votre pouvoir de police administrative en mer. Ces arrêtés ont-ils été suivis de sanctions ? Pourrions-nous avoir le suivi sur une année, 1998 ou 1999 ? Car sans poursuites, il y a peu de crédibilité.
Estimez-vous, par ailleurs, nécessaire de renforcer légalement le dispositif répressif ? Les coûts des sanctions sont-ils trop faibles par rapport aux dégazages, ou autres ?
M. Yves LAGANE : Les arrêtés du préfet maritime ne sont pas les seuls à imposer des règles. Il y a surtout, en France, le code disciplinaire de la marine marchande et la réglementation de l'organisation maritime internationale qui s'impose à tous en mer. Celle-là est bonne. Les arrêtés du préfet maritime interviennent souvent sur des problèmes, tout à fait littoraux, de cohabitation entre les corps de métier, comme, par exemple, quand Greenpeace vient au large de La Hague. J'émets alors des arrêtés préfectoraux, mais ce n'est plus du tout du même ressort.
La principale difficulté est de faire en sorte que les sanctions, qui relèvent du code disciplinaire de la marine marchande, c'est-à-dire de l'application de la réglementation internationale pour prévenir les abordages en mer, qui est parfaitement claire et édictée par l'OMI, soient appliquées et suivies de procédures dissuasives. Aujourd'hui, nous constatons les infractions, et nous en constatons beaucoup. Je pourrai vous donner le chiffre exact pour l'année dernière.
En revanche, j'aurai beaucoup de difficultés à vous fournir la seconde donnée qui vous intéresse, car elle ne relève plus de ma responsabilité. Elle dépend soit du ministère de la justice, soit du ministère des transports qui, dans certains cas, peut réunir des tribunaux maritimes commerciaux dont la responsabilité sera de traiter l'affaire.
M. le Rapporteur : Confiez-nous vos propres résultats et nous vérifierons comment ces infractions ont été traitées.
M. le Président : A qui les transmettez-vous ?
M. Yves LAGANE : Ces sanctions sont transmises à l'administration des Affaires maritimes. Ce sont les directeurs départementaux, les services déconcentrés de l'administration des Affaires maritimes qui reçoivent les procès-verbaux, constatent l'infraction et, ensuite, doivent la traiter.
M. le Rapporteur : Nous pourrions tenter une expérience sur cette zone.
M. Bernard CAZENEUVE : Vous avez évoqué la densité du trafic et insisté sur le fait qu'il y avait non seulement du trafic de marchandises classiques, mais également du trafic de produits dangereux non pétroliers ainsi qu'un trafic très intense de passagers. Si demain, il devait y avoir une collision du type de celle que vous avez décrite tout à l'heure, qui s'est produite à l'entrée de la Tamise, de quels moyens disposeriez-vous très concrètement ? En l'absence de relations régulières et de dispositifs de contrôle en continu avec vos partenaires de la Manche et Mer du nord, êtes-vous en mesure de faire intervenir très rapidement sur zone des moyens autres que français pour faire face à des difficultés comme la collision entre un bateau transportant 2800 passagers et un porte-conteneurs ?
Avez-vous engagé avec vos collègues, ou l'Etat français a-t-il engagé une réflexion sur la mise à disposition des CROSS et des moyens publics de sécurité en mer, des nouvelles techniques de l'information et de la communication ? Qu'est-ce qui s'oppose techniquement aujourd'hui à ce que les CROSS, les préfectures maritimes, les administrations maritimes française, belge, britannique puissent en continu observer les mêmes données en utilisant les moyens techniques de communication les plus modernes qui permettraient d'avoir une surveillance plus fiable, en temps réel et simultanée, du trafic en Manche et de pouvoir mobiliser à tout moment des moyens communs ?
M. Yves LAGANE : Je réponds à votre première question sur les moyens dont nous disposons pour intervenir en cas d'accident grave, que je n'ai pas d'inquiétude quant à la capacité de mobiliser très rapidement de gros moyens français, belges et britanniques avec un très court préavis. Nous avons il y a quelque temps géré un accident, qui aurait pu être très grave, d'un ferry tombé en avarie complète d'énergie en sortant de Boulogne un jour de tempête, avec force 8. En sortant des passes, il tombe totalement en avarie. Il mouille en catastrophe et s'arrête à quelques mètres à peine des rochers.
Il a fallu organiser l'évacuation des passagers et la préparation de l'assistance du bateau. En vingt minutes, notre premier hélicoptère, français, basé au Touquet est intervenu et a procédé à l'évacuation de la trentaine de passagers. Moins d'une heure après, l'hélicoptère lourd britannique et le
Far Turbo, le remorqueur affrété par les Britanniques dans le Pas-de-Calais, étaient présents au large de Boulogne. C'était un événement d'intensité limitée, mais c'était tout de même un événement grave.
La capacité à mobiliser rapidement ne me préoccupe pas. Aujourd'hui, ma principale inquiétude est de pouvoir intervenir pour porter assistance aux naufragés. Cela dit, pour 2500 personnes, il faudrait mettre en _uvre beaucoup de moyens, mais le trafic étant assez dense dans ce secteur, nous disposons aussi de bateaux qui, en permanence, peuvent et ont même l'obligation d'intervenir. Avec les seuls moyens des Etats, je pense que nous serions aussi capables de le faire. Ce disant, je m'avance peut-être parce que je n'ai jamais vécu cela et j'espère bien ne pas le vivre. Nous sommes capables de faire beaucoup de choses - assistance au bateau, prise en compte des mouvements d'un bateau ayant perdu sa capacité à man_uvrer - avec les moyens français et britanniques disponibles sur place.
Nous avons également les moyens d'intervenir en cas d'incendie ou de sinistre sur un bateau. Avec les marins pompiers à Cherbourg et les pompiers spécialisés dans le Kent britannique, nous sommes capables là encore de mettre en _uvre des moyens assez importants.
Le point sensible reste le transport et l'acheminement de ces moyens. Cela impliquerait également des hélicoptères lourds. Nous en avons avec les Britanniques et les Belges, mais tout ce qui pourrait améliorer cet aspect est, à mon avis, bon à prendre. Je ne sais pas chiffrer aujourd'hui le besoin.
En fait, la principale préoccupation dans cette affaire serait d'être capable de confiner et de traiter le plus vite possible une pollution importante dans une zone qui est très étroite, qui peut donc conduire à une dispersion de produit polluant sur la côte. Aujourd'hui, que ce soit côté britannique, français ou belge, nous devons mener une réflexion en la matière.
Votre seconde question portait sur la compatibilité des moyens de surveillance de la mer belges, britanniques et français. En fait, aujourd'hui, rien n'empêche cette compatibilité, sinon peut-être une volonté et des objectifs différents. La préoccupation des Belges aujourd'hui est essentiellement de contrôler la circulation maritime à l'ouvert de ses longs chenaux qui accèdent aux ports. C'est donc d'obtenir un système cohérent de suivi de la circulation maritime entre la haute mer et les ports. C'est à la fois un problème de sécurité, mais aussi un problème de gestion commerciale de l'activité des ports.
Côté britannique, ils n'ont pas le même sentiment que nous de la menace qui vient de la mer. Je vais en parler avec le SOSREP
prochainement. Ils y sont moins sensibles que nous dans la mesure où ils sont au vent des risques dans la plupart des cas. Cette exigence de surveillance de la mer qui n'est pas aussi importante que la nôtre puisqu'ils n'ont développé qu'un seul centre de surveillance me fait dire qu'ils n'accordent pas la même priorité que nous à ce problème. Pour répondre clairement à votre question, on reste encore très « nationaux » dans l'analyse de ces problèmes, que l'on soit Britannique, Belge ou Français.
M. Edouard LANDRAIN : Vous avez parlé tout à l'heure de la Manche comme d'une autoroute, avec les difficultés d'une autoroute. Mais une autoroute est extrêmement surveillée, dotée de moyens de contrôle importants. De quels moyens disposez-vous ? Avez-vous des radars ? Bénéficiez-vous de l'aide des satellites pour suivre la marche des navires ? Cela est-il possible d'ailleurs ?
Le Channel est un endroit qui devrait obéir à une réglementation très particulière. Certains disent même que l'on devrait considérer cet espace maritime comme on considère un canal international, Panama ou autre. L'obligation d'avoir un pilote du Cap Lizard
jusqu'au Pas-de-Calais est-elle possible ou cela ne se réalisera-t-il jamais alors que cela permettrait une sécurité accrue ?
M. Gilbert LE BRIS : Vous parliez d'une autoroute, amiral. Avec trois tours de contrôle évidentes, celles du Corsen-Brest, Jobourg-Cherbourg, Gris-Nez-Boulogne presque à équidistance. La nature fait bien les choses. Souhaiteriez-vous qu'il y ait des déclarations d'entrée de certains bateaux sur cette autoroute ? Si oui, lesquels ? Que penseriez-vous d'un suivi desdits bateaux sur toute cette autoroute ? Cela vous permettrait-il de mieux cerner les risques potentiels ?
Vous êtes amené, pour la sécurité civile, à utiliser toute la panoplie des moyens militaires dont vous disposez, et vous puisez largement dedans ! Ne vous paraîtrait-il pas utile d'avoir une identification plus nette des moyens de la sécurité civile, de manière symbolique, au moins pour lui donner une meilleure visibilité, sans doute budgétaire mais aussi physique ? Ne conviendrait-il pas d'identifier tout ce qui est remorqueur, hélicoptère et autres moyens afin de leur donner une certaine autonomie, une caractéristique par rapport à la masse de ce que vous utilisez ?
L'expérience de votre collègue préfet maritime de Bretagne Atlantique ne peut pas ne pas vous avoir interrogé. A la lumière de cette expérience, pourriez-vous nous dire ce dont vous disposeriez si le même accident intervenait dans votre zone géographique ? De quels moyens souhaiteriez-vous disposer, en plus du commissaire pour les aspects juridiques ? D'un chargé de communication pour s'adresser aux différents médias qui sont très présents dans ces cas ? D'un capitaine de marine marchande pour vous expliquer les problèmes qui pourraient naître ? D'une personne des douanes ? Auriez-vous à votre disposition immédiatement tous les moyens pour réagir dans les meilleures conditions ?
M. Dominique DUPILET : Il se trouve que de la fenêtre de mon domicile, je surveille le détroit du Pas-de-Calais.
M. Yves LAGANE : Nous pourrons donc comparer nos expériences !
M. Dominique DUPILET : Je vous trouve très clair, mais très optimiste quant à la densité du trafic. Lorsque l'on parle d'incendie, vous dites qu'il y a des pompiers maritimes à Cherbourg. Mais entre Cherbourg et le détroit du Pas-de-Calais, il y a tout de même une certaine distance.
Vous parlez des moyens héliportés. Vous avez fait une allusion à un hélicoptère de service public au Touquet, qui est en fait des douanes...
M. Yves LAGANE : Non, de la Marine nationale !
M. Dominique DUPILET : Un petit hélicoptère...
M. Yves LAGANE : C'est tout de même un Dauphin !
M. Dominique DUPILET : Les premiers gros hélicoptères se trouvent au Havre ; entre Le Havre et le cap Gris-Nez, il y a aussi une certaine distance. On a l'impression qu'il faudrait aller chercher tous les moyens qui peuvent être mis en _uvre en cas d'accident grave dans le détroit du Pas-de-Calais chez les Britanniques, qui seraient les plus proches, les plus rapides, les plus efficaces ! Mais vous nous dites, en même temps, que tout cela est laissé au bon vouloir des Etats et qu'il n'y a pas d'officialisation de l'obligation d'intervention des uns et des autres.
Ne croyez-vous pas qu'il serait essentiel que des moyens supplémentaires français soient mis à la disposition du CROSS Gris-Nez afin de parer à toute difficulté susceptible de survenir dans le détroit du Pas-de-Calais ? Peut-être est-ce justement parce que c'est une autoroute et qu'elle est très réglementée qu'il n'y a pas eu d'accident, mais le nombre de navires de pêche qui naviguent dans ce détroit fait risquer l'accident régulièrement.
Quand s'est produit l'accident de l'Erika en Bretagne, les habitants du Pas-de-Calais sont venus nous voir pour nous demander quels moyens seraient à notre disposition si un tel accident survenait.
Tout d'abord, il faut bien dire que les maires n'ont aucune instruction. Ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire, bref, ils improviseraient. Ensuite, interrogés, les directeurs des Affaires maritimes répondent que, dans un tel cas, ils recevraient des instructions. Puis les sous-préfets, nous ont dit qu'il faudrait improviser.
Donc aujourd'hui, il n'y a pratiquement aucune directive envoyée aux principaux intéressés pour faire face à un accident tel que celui qui s'est produit en Bretagne.
M. Yves LAGANE : Pour ce qui est des moyens de surveillance de la mer et de contrôle du comportement des bateaux qui pratiquent cette zone sensible qu'est la Manche-Pas-de-Calais, les principaux moyens sont ceux de détection radar des deux CROSS, l'un au large du cap de La Hague et l'autre à côté de chez vous. Je dispose également de sémaphores, toute une chaîne d'unités qui appartiennent à la Marine nationale et qui disposent de radars aux portées plus faibles. J'ai également des patrouilleurs, des bateaux qui patrouillent la mer, qui sont là à la fois pour détecter, mais également pour exercer une pression sur le comportement des bateaux.
J'essaie donc en permanence - en tout cas, pendant les périodes de trafic les plus denses c'est-à-dire en semaine - d'avoir un patrouilleur présent dans le dispositif de séparation de trafic, entre l'autoroute qui est au nord-ouest du Cotentin et l'autre qui passe sous vos fenêtres.
Participent également à ces patrouilles les deux remorqueurs, le remorqueur
Abeille Languedoc qui est en permanence déployé au large du Cotentin et maintenant, partagé avec les Britanniques, le
Far Turbo pendant toute l'année.
Aujourd'hui, ces moyens me suffisent. Mais plus on augmentera la surface de la couverture radar, mieux ce sera. L'idéal serait d'obtenir entre le Cap Lizard et Corsen, une couverture radar complète. Pour cela il faut obtenir l'accord des Britanniques, et je ne suis pas certain que ces derniers nous suivent dans cette démarche. Ce serait pourtant utile. J'ai vu ce qui est en cours de développement actuellement au ministère des transports pour améliorer la capacité à détecter sur la mer, à mon avis, cela va dans le bon sens.
Le satellite. Très honnêtement, cette solution n'a pas été évoquée. Je ne sais si l'on est capable d'exploiter cette technique. Une piste en cours de développement fait l'objet d'un dossier étudié au sein de l'organisation maritime internationale, c'est l'obligation de mise en place de transpondeurs sur les bateaux. Ce sont de petits équipements type IFF, en jargon militaire, de petits émetteurs automatiques qui, quand ils sont interrogés par un radar, une station à terre ou un autre bateau, émettent automatiquement l'identification, la position, la route, la vitesse du bateau ainsi qu'éventuellement les caractéristiques de sa cargaison. Je pense que ce système est l'avenir.
Mais ce n'est pas totalement l'avenir parce que cela ne constituera pas une protection totale des Etats riverains. Si le bateau ne veut pas mettre son transpondeur en fonction, libre à lui et, à ce moment-là, nous perdrons l'initiative. Cela doit donc rester un élément complémentaire de dispositifs plus lourds, chers et difficiles à faire fonctionner parce que requérant beaucoup de personnels, comme les stations radars à terre, qui sont, de notre propre initiative et capacité, notre regard sur la mer.
Depuis l'été dernier, une réglementation particulière est imposée aux bateaux naviguant dans la Manche-Pas-de-Calais, tous ceux qui passent au large de Corsen et devant Gris-Nez ont l'obligation de s'identifier et d'annoncer leur passage...
Mme Jacqueline LAZARD : Pas tous, me semble-t-il !
M. Yves LAGANE : En effet, pas tous. Tous ceux de plus de 300 tonneaux, quel que soit le type de bateau, alors qu'auparavant ce n'était une obligation que pour les bateaux transportant des matières dangereuses.
A Corsen, cette obligation existe depuis deux ou trois ans. A Gris-Nez, depuis le 1er juillet dernier. Il y a une faille dans notre système : toute une partie du trafic qui arrive des Etats-Unis passe sous le Cap Lizard, rejoint notre zone sensible devant le Cotentin et n'a l'obligation de se signaler qu'à Gris-Nez. D'où cette initiative française proposée à l'OMI d'instaurer également l'obligation de déclaration en passant devant le CROSS Jobourg. Donc, une réglementation existe déjà et une démarche est en cours pour essayer de l'améliorer.
M. Edouard LANDRAIN : L'idée d'un accompagnement par pilote a-t-elle été évoquée ?
M. Yves LAGANE : Elle l'a été, mais auparavant il faudrait avoir un consensus entre les pays riverains de la Manche. Considérer que cette mer intérieure européenne peut être le domaine d'application d'un règlement qui soit européen, réponde à nos intérêts et soit plus contraignant que ceux élaborés par l'Organisation maritime internationale, demande au minimum un consensus entre les trois pays riverains de la Manche. Je ne suis pas convaincu que nous l'ayons.
Si nous sommes les seuls à le proposer et essayer de le faire passer auprès de l'OMI, il faudra agir avec beaucoup d'efficacité parce qu'il y a aussi derrière tout cela une diminution progressive de la liberté d'action du commandant, qui est responsable de la sécurité de son bateau. C'est un point de vue qu'il faudra arriver à imposer dans le monde maritime. J'y suis personnellement favorable mais, pour être réaliste, je pense que ce n'est pas d'application immédiate.
Pour ce qui est du suivi permanent des bateaux entre l'entrée dans une zone à définir entre le Cap Lizard et l'ouest de la Bretagne, jusqu'à leur passage dans le Pas-de-Calais, j'y suis très favorable. J'ai vu les plans d'équipement radar du ministère des transports, c'est ce vers quoi nous tendons progressivement. La démarche est assez volontariste. Quelques petits trous subsisteront, il sera difficile d'obtenir une couverture totale, mais tout ce qui va dans ce sens répond à l'attente du préfet maritime.
Concernant l'identification des moyens militaires en tant que contribution aux missions de service public, je vais essayer de ne pas être aussi optimiste que l'impression que je vous ai donnée. Il y a des lacunes, j'en ai évoqué une tout à l'heure, en particulier dans le domaine de la maîtrise et du traitement d'une pollution. Dans ce domaine, je suis clair, que l'on soit britannique, français ou belge, nous avons de petits moyens. Nous ne maîtriserons pas la situation. Nous serons sur la défensive compte tenu de l'étroitesse du domaine maritime et, donc, de la nécessaire rapidité de réaction.
Pour ce qui est des hélicoptères, deuxième point que vous avez évoqué, il est vrai qu'en France, nous n'avons pas d'hélicoptères lourds dans cette zone : les plus proches pour moi ne sont pas au Havre mais à Coxyde
en Belgique et à Southampton. Toute la question est de savoir si l'on cherche à organiser une complémentarité entre les moyens ou si l'on continue à travailler de façon autonome en essayant de développer chacun dans son coin les moyens pour parvenir à une maîtrise totale de la crise.
C'est une question d'approche et de politique à définir, qui n'est plus de mon ressort.
Concernant le soutien du préfet maritime pour gérer la crise, je n'ai pas cette capacité en permanence. C'est ma hantise. Le préfet maritime pour la Manche et Mer du nord est en même temps commandant de la Marine à Cherbourg ; mais la Marine à Cherbourg, ce sont de petits moyens de service public et un gros centre de formation à terre. C'est un tout petit état-major. Je n'ai donc pas la structure qui appuie le préfet maritime de Brest ou de Toulon.
Donc, pour gérer une crise de cette gravité, j'ai besoin de renforts mais ne suis pas convaincu d'en avoir besoin en permanence car ce serait très lourd.
J'ai cette petite compétence en communication, en gestion d'un accident grave en mer, mais il est évident que j'aurais besoin très rapidement, en quelques heures, de renforts pouvant venir de Brest ou de Paris. Je suis en train d'essayer de formaliser cette demande de manière à ce qu'ils puissent venir rapidement, « au claquement de doigts ».
Le préfet maritime a, jour et nuit, un téléphone dans sa poche. C'est très important parce que la structure est petite, très réactive mais par exemple, lors d'un événement comme celui qu'a géré mon collègue de Brest, il est fondamental de maîtriser la communication vis-à-vis du public de même que l'information vis-à-vis des autorités territoriales. Il convient de bien faire comprendre quelle est l'idée de man_uvre de manière à ce que tous tiennent le même langage, sans oublier, bien sûr, d'informer les autorités centrales. C'est un travail très difficile.
Je n'ai pas ces moyens en permanence, mais je m'organise pour pouvoir disposer de tels renforts dans un délai très bref.
J'ai cité les quatre actions à conduire pour essayer de maîtriser un accident grave de l'ampleur de celui qui est arrivé. Je ne veux pas dramatiser, cet accident n'a jamais eu lieu, mais je ne veux pas non plus l'occulter. Pour moi, en tant que marin, cet accident est une préoccupation omniprésente.
Pour le secours aux naufragés en grand nombre, nous disposons de moyens significatifs. Je ne peux pas affirmer toutefois que nous serions capables de maîtriser une situation avec 2500 ou 3000 naufragés.
Nous sommes aussi capables localement d'assister et de contrôler des bateaux ayant perdu leur liberté de man_uvre, depuis que nous avons ce remorqueur toute l'année.
Il nous est possible de maîtriser un incendie ou un sinistre à bord d'un bateau, en réunissant des moyens britanniques et des moyens français ; pour ces derniers cependant, j'utiliserai un moyen de transport léger au départ, qu'il me faudra ensuite renforcer avec des moyens lourds et, pour ce faire, j'aurai besoin de recourir aux hélicoptères britanniques et belges. Mais ces moyens sont significatifs, la question est de savoir si l'on décide de les développer en propre ou de renforcer une analyse commune entre pays riverains.
Enfin, pour le confinement et la maîtrise d'une pollution, je réponds clairement que nous n'avons pas de moyens. Nous nous donnons les moyens, nous en aurons mais aujourd'hui, avec un court préavis, dans cette zone spécifique qu'est le Pas-de-Calais, nous ne les avons pas.
M. Pierre HÉRIAUD : Après cette audition, notre sentiment est celui d'un manque de coordination. Vous nous avez dit qu'en prévention, la France est supérieure à la Grande-Bretagne et qu'en moyens de traitement des sinistres, ce serait l'inverse. Quel est donc le rôle des
Coast Guards et leur efficacité ? Serait-il opportun d'avoir un corps analogue en France ?
Mme Jacqueline LAZARD : Vous avez beaucoup insisté sur le trafic, tant sur sa densité que sur sa diversité. Etes-vous en mesure de connaître les principaux facteurs de risque de collision constatés par les CROSS ? S'agit-il d'erreurs de navigation, de problèmes de cohabitation avec les pêcheurs, de pannes ?
Par ailleurs, avez-vous connaissance des types de navires concernés par les risques ? S'agit-il surtout des navires de pêche ou de navires marchands ? Dans l'éventualité de navires marchands, avez-vous constaté plus de risques pour des bateaux battant pavillon de complaisance ?
M. Paul DHAILLE : Vous avez tout d'abord dit qu'il y avait parfois des incidents sur les navires et qu'après une première alerte, vous deviez pousser le capitaine dans ses retranchements pour qu'il avoue les difficultés auxquelles il était confronté. Puis vous avez indiqué que la mise en place d'un pilote sur chaque navire restreindrait la liberté du capitaine, seul maître à bord après Dieu ! Au risque de heurter, ne pourrait-on pas envisager, comme cela se passe à terre dans des zones industrielles, que dès lors qu'il y aurait un incident à bord, le capitaine perdrait le commandement de son navire au profit d'un pilote ? C'est ainsi que, quand il y a un incident dans une usine à risque sur une zone industrielle, le directeur de l'usine est dégagé de sa responsabilité et le préfet prend le commandement.
Par ailleurs, Cherbourg fait partie de votre juridiction. Des transports comme les pétroliers ou les chimiquiers sont fréquents, mais le transport de déchets nucléaires pourrait aussi entraîner des pollutions. Des règles s'appliquent-elles à ces navires ? Circulent-ils à tout moment ou en évitant les périodes d'affluence sur le rail afin d'éliminer toute possibilité d'accidents ?
A ce propos, les plans POLMAR prennent-ils en compte l'ensemble des conséquences qu'entraînerait une pollution causée par un navire transportant des déchets nucléaires ?
M. le Président : Amiral, il va de soi que certaines réponses peuvent nécessiter des éléments chiffrés, statistiques, que vous pouvez très bien nous faire parvenir ultérieurement.
M. Yves LAGANE : Les Coast Guards sont très efficaces. Ce sont des professionnels, des gens compétents.
J'ai indiqué, dans ma comparaison entre les deux organisations, que nous avions favorisé la prévention et l'organisation de la conduite de l'action quotidienne qui n'ont rien à envier à l'organisation britannique, alors que les Britanniques, en revanche
- c'est cela que j'appelle une complémentarité de fait - avaient plutôt privilégié sur l'intervention et l'action en cas d'accident plus grave.
M. Pierre HERIAUD : Comment se répartit leur rôle par rapport à la prévention et à l'action en cas de sinistres ?
M. Yves LAGANE : Ils sont responsables de la gestion et de la conduite du centre de surveillance maritime de Douvres, qui est le seul sur la zone Manche-Pas-de-Calais. Donc, dans le domaine de la prévention, ils n'ont pas la même capacité que nous à surveiller ce qui se passe en mer.
Dans le domaine de l'intervention, à mon avis, ils sont très bons.
M. Pierre HERIAUD : Mais leur activité n'est pas une activité uniquement préventive.
M. Yves LAGANE : La nôtre non plus. Nous aussi, nous intervenons au quotidien !
M. Pierre HERIAUD : On présente habituellement les
Coast Guards comme devant agir préventivement. Nous n'en avons pas, mais notre prévention est censée être meilleure ?
M. Yves LAGANE : J'estime que nous sommes plus efficaces parce que notre capacité de surveiller la mer est meilleure, entre les CROSS de Corsen, de Jobourg, de Gris-Nez et les moyens de patrouille que nous mettons en _uvre, plus importants que les leurs dans les zones de trafic.
M. le Rapporteur : De patrouille également ?
M. Yves LAGANE : De patrouille en permanence, je le pense, mais cela n'engage que moi et nécessiterait une vérification. Je peux le vérifier. Je vais évoquer ce sujet avec le SOSREP
prochainement.
Le principal risque aujourd'hui est, sans parler de l'erreur de navigation, sans doute le non-respect de la réglementation et l'erreur d'appréciation d'une situation dangereuse par l'officier de quart. Comme pour le conducteur routier, vous avez beau avoir un règlement, des policiers sur le bord de la route, vous êtes toujours soumis au risque de l'appréciation du chauffeur qui ne voit pas la voiture qui freine et qui entre en collision. Ce risque-là, je peux difficilement le maîtriser. C'est pour cela que, afin de prendre ce risque en compte, je cherche plus à mobiliser sur une politique de moyens d'intervention.
Le second risque sur lequel j'ai une possibilité d'action, et d'ailleurs j'agis, ce sont les pêcheurs, qui, malheureusement, travaillent souvent dans des zones de trafic dense. Il me revient donc de leur imposer des comportements conformes aux règles de navigation afin de ne pas gêner, comme cela leur est demandé par la réglementation internationale, le trafic qui passe dans ce dispositif de séparation de trafic.
La réglementation internationale ne leur interdit pas de pêcher dans ces endroits, mais signifie simplement qu'ils n'y sont plus prioritaires et ne doivent en aucun cas gêner le trafic. La difficulté est l'appréciation de la gêne, qui n'est pas toujours la même du point de vue du pêcheur et du point de vue du bateau marchand qui passe. C'est l'une de mes préoccupations aujourd'hui, et j'ai conduit une action avec des bateaux présents sur zone pour essayer de leur imposer des comportements plus conformes à ce que j'estime être favorable à la sécurité de navigation.
Les pannes de bateau existent ; en gros, sur un transit de vingt heures et sur 700 bateaux par jour, un bateau tombe en avarie tous les deux jours. C'est beaucoup, mais «en avarie » signifie que cela l'oblige à modifier son comportement et, le plus souvent, à s'arrêter ; cela ne signifie pas que ce soit une source importante d'accident. Ce que je redoute, c'est le bateau qui ne maîtrise pas ses mouvements et qui, peu à peu, dérive vers notre côte parce que l'on est sous le vent de la côte.
Je n'ai pas de statistiques indiquant que les bateaux sous pavillon de complaisance créent plus de situations délicates au plan de la navigation dans le dispositif de séparation de trafic que les autres.
C'est plutôt le pêcheur qui pose un problème important : il peut être à l'origine d'une situation délicate au point de vue sécurité de la navigation s'il oblige un bateau à se déplacer en mettant deux autres bateaux en situation de proximité. C'est une population très sympathique, mais qu'il convient de surveiller étroitement.
Vous avez évoqué la prise en charge et la responsabilité plus en amont de l'Etat en cas d'incident ou d'accident sur un bateau. Se pose là une question de principe importante. Aujourd'hui, c'est le commandant du bateau qui est responsable de la conduite de l'intervention et de l'appréciation de la situation de son bateau. Il est responsable également de décider du moment où, ne pouvant plus maîtriser par ses propres moyens, il doit faire appel à quelqu'un de l'extérieur...
M. Paul DHAILLE : Ce qui n'est pas le cas à terre.
M. Yves LAGANE : En effet, mais le problème, c'est que quand on est en haute mer, la réglementation du terrien n'intervient plus. La réglementation, c'est le droit international. Aujourd'hui, quand j'exerce sur le commandant du bateau et sur l'armateur un processus, que j'ai exposé tout à l'heure, de pressions de plus en plus fortes pour être le plus en amont possible de l'accident, en haute mer, c'est uniquement de « l'intoxication ». Il faut que je les harcèle, que je leur dise que je peux leur apporter une aide et que je les pousse à accorder leur autorisation.
A la limite, si le commandant me refuse l'envoi d'une équipe d'évaluation à son bord, il est tout à fait dans son droit. Je ne peux pas l'imposer. Je ne peux le faire que s'il est dans les eaux territoriales, dans la zone de souveraineté française. Dans les douze milles.
Je peux éventuellement faire une mise en demeure au-delà des douze milles lorsque selon mon appréciation de préfet maritime, j'estime que s'il laisse dériver la situation, dans quatre ou cinq heures, il y a un risque. Je peux alors lui imposer une équipe d'évaluation, qui prendra les affaires en main, lui imposer une prise en remorque et qu'à ses frais soient prises les dispositions que j'estime conformes aux intérêts de mon pays.
M. le Rapporteur : Dans la zone des 200 milles ?
M. Yves LAGANE : 200 milles, c'est beaucoup trop loin. Je ne sais même pas encore.qu'il est là. C'est quand je suis en mesure de le détecter, ou qu'il me dit quelque chose, que je peux mettre en place ces moyens.
M. le Rapporteur : L'intervention de ce type, au-delà des douze milles, est-elle fréquente ?
M. Yves LAGANE : Depuis que je suis préfet maritime, j'ai dû avoir une bonne douzaine d'interventions assez musclées de cette nature. L'une des raisons pour lesquelles j'ai toujours le téléphone sur moi est que la mise en demeure doit être exprimée par le préfet maritime. Il faut donc ma présence.
Il y a donc toute une part d'intoxication psychologique avant d'arriver à la mise en demeure. Je pourrais mettre en demeure systématiquement, mais si le risque n'est pas prouvé, l'armateur peut très bien se retourner contre le préfet maritime pour abus de droit ou non-respect de l'esprit de la loi et des outils mis à sa disposition.
Je travaille souvent avec British Nuclear Fuel,
la COGEMA et la société, Transnucléaire à laquelle ils sous-traitent le transport de matière nucléaire. Les bâtiments qui transportent des déchets nucléaires sont soumis à des exigences de sécurité très sévères en matière d'équipement, de comportement, de qualification du personnel. A mon avis - en outre, ce sont des Britanniques qui sont les transporteurs - ces règles dépassent largement ce que l'on impose actuellement à n'importe quel bateau dans le cadre de la réglementation internationale. Si cela vous intéresse, je peux essayer d'obtenir des éléments plus précis sur ce sujet.
Très honnêtement, dans ma préoccupation de préfet maritime, je ne peux pas dire que je ne prends pas ce risque en compte, mais il n'intervient pas en priorité.
Audition des commandants Jean-Pierre TANGUY,
directeur central de l'armement,
et Pierre JEANMAIRE, responsable technique navigation,
à la CMA CGM
(extrait du procès-verbal de la séance du 21 mars 2000)
Présidence de M. Daniel PAUL, Président
M. Jean-Pierre TANGUY : Avant de commencer, je précise que M. Jeanmaire et moi-même sommes des commandants de brevet CINM détachés à terre. Nous avons donc des responsabilités d'armement, mais également une longue expérience à la mer.
Je traiterai des différents chapitres qui font l'objet de cette audition.
Le premier concerne la sécurité du transport maritime de produits dangereux ou polluants. La compagnie à laquelle nous appartenons transporte des conteneurs. Nous sommes donc plus spécialisés dans ce type de transport. C'est la raison pour laquelle nous ne nous étendrons pas sur le problème des pétroliers dont nous ne sommes pas des experts. Pour nous, faire de la prévention, c'est essentiellement empêcher la chute de conteneurs à la mer et les accidents à bord, en particulier l'incendie.
M. le Président : Nous savons bien que CMA CGM s'occupe principalement de ce type de transport. Dans les produits polluants ou dangereux qui font l'objet de nos soins, il y a bien évidemment les vracs liquides, mais également tout ce qui se trouve dans les porte-conteneurs. Nous avons, par exemple, évoqué avec vos prédécesseurs un autre fret tout aussi dangereux, et probablement polluant, qui est celui de matières issues de La Hague. Certains minéraliers ou chimiquiers peuvent être tout aussi polluants ou dangereux. Vous voyez donc que nous essayons de tout envisager.
M. Jean-Pierre TANGUY : Tout à fait.
Pour sa part, la CMA CGM s'est dotée depuis plusieurs années d'un bureau des marchandises dangereuses qui suit l'évolution de la réglementation internationale et l'arrivée de nouveaux produits dangereux sur le marché. Il travaille en collaboration avec les responsables de lignes et avec les ship planers, c'est-à-dire les gens dont le rôle est de répartir la cargaison sur les navires. Ce bureau est donc chargé de l'application de la réglementation internationale et des procédures définies par la direction générale de la CMA CGM dans le cadre de l'ISM, l'International Safety Management.
La CMA CGM étudie également avec minutie les accidents qui se produisent chez les autres transporteurs, quelle que soit la nature des produits transportés. Cela est peut-être lié à notre histoire car, en fait, nous avons transporté toutes sortes de marchandises, du pétrole en passant par le gaz, sans oublier les déchets de La Hague ; je ne m'étends pas sur le sujet mais tout le monde se souviendra d'un bateau de la CGM, le flanc au-dessus de l'eau, qui avait été abordé dans les environs de Zeebrugge et qui avait à son bord des conteneurs faisant le trajet La Hague - ex-Union soviétique.
Bien que nous soyons plus spécialisés dans le transport de conteneurs, nous suivons ce qui se passe chez nos collègues pour en tirer des enseignements. Les accidents des pétroliers nous semblent tout à fait révélateurs : en effet, les accidents relatés dans les médias - notre métier fait que nous possédons une couverture mondiale et que nous ne nous arrêtons pas qu'aux accidents relatés dans la presse française - sont souvent liés à des erreurs de navigation, des ennuis techniques de propulsion ou des défauts de structure. Tous ces éléments peuvent toucher n'importe quel type de transport. Il s'agit, en fait, de problèmes liés à la compétence de l'équipage, à l'entretien technique, au suivi de la poutre-navire et à la conception du navire.
En ce qui concerne le contrôle des normes internationales des navires, j'ai relevé trois étapes.
La première est le contrôle par l'Etat du pavillon. La réglementation nationale est bien souvent calquée sur l'internationale - SOLAS, MARPOL et autres -, avec plus ou moins de bonheur. On peut se référer au fameux décret de 1987, qui n'est pas toujours très lisible.
J'insiste cependant sur un point : pour les aspects nécessitant des moyens importants, soit de technicité élevée, soit de calcul, l'Etat du pavillon délègue à une société de classification. C'est le cas pour les coques, les manuels d'assujettissement, entre autres. Je reviendrai plus tard sur cet aspect lorsque je parlerai des sociétés de classification.
La deuxième est le contrôle par l'Etat du port. Ce contrôle porte essentiellement sur la validité des documents. Or, les certificats concernant les principaux aspects des navires, c'est-à-dire la coque et la machine, sont eux-mêmes délivrés par les sociétés de classification.
La troisième est le contrôle par les sociétés de classification. Les principales sociétés de classification sont regroupées au sein de l'IACS, ce qui signifie que pour les éléments fondamentaux, le cadre technique est déjà fixé. Malgré cela, les sociétés de classification demeurent des entreprises commerciales. Loin de moi l'idée d'insinuer que les règles techniques des sociétés sont transgressées, mais, sous la pression de la concurrence entre sociétés elles-mêmes, ainsi qu'entre armateurs ou chantiers, la tendance, de plus en plus fréquente, est de se rapprocher sans cesse de la limite tolérée par le calcul. Or ce calcul ne répond qu'à un modèle mathématique. Les limites ainsi fixées peuvent donc être dépassées dans certains cas - cas de mer exceptionnelle ou de parages particuliers.
Je n'en donnerai que deux exemples. Celui du Sherbro
sera le premier. En étudiant ce cas, on s'aperçoit que de nombreux autres porte-conteneurs avaient perdu leur cargaison dans les mêmes parages. Le second se réfère à un dossier plus ancien, lorsqu'un cargo de la NCHP, qui n'existe plus, s'était plié sous l'effet de ce que nous appelons les coups de ballast à l'arrière du gaillard dans un parage bien connu de tous les marins, le Cap des aiguilles, où l'on rencontre sans doute les mers les plus fortes de la planète.
Peut-être conviendrait-il que les aspects fondamentaux de certains points de réglementation repris par l'OMI soient imposés à toutes les sociétés de classification, à l'instar de la réglementation sur les lignes de charge. Il faut bien noter cependant que cette réglementation doit être évolutive ; les lignes de charge en sont un parfait exemple.
M. le Président : Pardonnez-moi, mais que sont les lignes de charge ?
M. Jean-Pierre TANGUY : Les lignes de charge sont ces marques dessinées sur la coque, qui indiquent la ligne de flottaison, ce qui nous permet d'enfoncer plus ou moins le navire. Elles stipulent : hiver, été ; hiver, Atlantique Nord ou autre.
Entre parenthèses nous nous apercevons qu'avec le temps, ces lignes de charge, qui avaient été demandées au début du siècle par les assureurs parce que trop de bateaux « faisaient leur trou dans l'eau », bien qu'elles soient vraiment restées une réponse à un besoin de sécurité, n'ont plus maintenant leur plein effet. Il suffit pour s'en persuader de comparer les formes des coques et, surtout, la manière de transporter. Dans n'importe quel port, vous verrez la montagne de conteneurs posés au-dessus de la coque alors qu'autrefois ils étaient à l'intérieur. On prétend que tout cela doit être revu par l'OMI, mais cela prend du temps. Il faut donc de la souplesse dans l'application de toutes ces règles et surtout leur faire suivre l'évolution de la technique.
Pour ce qui est des cargaisons, le premier contrôle est celui de la déclaration des chargeurs. La CMA CGM accorde une attention particulière à ce point. Il faut que le chargeur qui met de la marchandise dangereuse dans un conteneur soit fiable ou que vous disposiez de procédures de vérification. Les entreprises de navigation doivent se doter de telles procédures. Cela peut tout simplement être contrôlé dans le cadre de l'ISM.
En complément de ces procédures, l'État du port doit se doter d'un corps d'inspecteurs qui contrôlent les cargaisons. C'est déjà le cas dans un certain nombre de ports, en particulier, dans le port de Rotterdam qui est à la pointe de ce genre de contrôle. En cas de doute, la structure spécialisée du transporteur doit être en mesure de justifier le chargement.
A notre avis, l'effet combiné de ces deux moyens suffit à assurer une sécurité maximale. L'inspecteur peut porter un jugement sur l'efficacité de la procédure qui est en amont.
Quant à l'amélioration de la lutte contre les pollutions volontaires ou accidentelles, à mon avis, la première phase doit être préventive. Il faut imposer aux navires, dès la construction, une capacité de décantation adaptée et d'un volume suffisant. Sur les porte-conteneurs, en dehors de la cargaison, les produits polluants sont les résidus de fioul ou autres produits équivalents. Il faut pouvoir décanter ces produits, séparer l'eau des résidus, ce qui permet ensuite de ne traiter que l'eau, qui est un peu sale, par des séparateurs adaptés.
Il faut également, et c'est très important, que soient mis à disposition des moyens de collecte appropriés dans les ports. Cela existe dans la réglementation internationale. Il existe même un procès-verbal à la disposition des commandants qui leur permet de signaler si ces moyens existent ou non. Je dois dire, pour en avoir rempli un certain nombre, que cette réglementation paraît être lettre morte.
Après la prévention, la lutte.
Il faudrait tout d'abord une organisation de détection placée sous une même autorité européenne, puisqu'à la mer, sauf en cas de flagrants délits tout à fait évidents, il est tout de même difficile de savoir qui est le pollueur. Il serait bon, ensuite, de créer un corps spécialisé lié à un centre de recherche. Il faudrait, enfin, des sanctions dissuasives.
M. le Rapporteur : Je poserai quelques questions sur la sécurité et reviendrai après sur la CMA CGM car notre problématique dépasse le seul aspect technique.
Vous arrive-t-il de vérifier le contenu que vous a indiqué le chargeur quand celui-ci ne vous paraît pas crédible ou s'il n'est pas un client habituel ?
Puis, le corps des inspecteurs vérifie lui aussi si ce que dit le chargeur est exact. Avec cet ensemble, vous estimez que les moyens de contrôle sont suffisants. Est-ce bien cela ?
M. Jean-Pierre TANGUY : Non. Le chargeur donne un produit, il ne vous donne pas un conteneur. Sinon, cela veut dire que la quantité à transporter est suffisante. Le premier point à vérifier est de savoir si le produit qu'il vous demande de transporter correspond bien à la description qu'il en fait.
Prenons un exemple : vous transportez un acide, la réglementation du code des marchandises dangereuses précise que cet acide doit être mis en bonbonnes de verre, puis emballé de telle façon. Ma première question sera de savoir si le chargeur conditionne bien le produit. Deux attitudes sont alors possibles : soit vous connaissez très bien le chargeur, qui vous a toujours livré les produits qu'il vous déclarait, et vous lui faites confiance ; soit c'est un chargeur nouveau, ou douteux, et votre agent
booker, celui qui reçoit le fret, doit mettre en place des procédures pour aller vérifier, de temps en temps, que ce qui est déclaré correspond bien à la réalité.
M. le Rapporteur : Vous ne le faites que pour les produits dangereux ?
M. Jean-Pierre TANGUY : Il me semble, mais je parle sous le contrôle de mon expert en la matière.
M. Pierre JEANMAIRE : En fait, nous ne le faisons pas que sur les produits dangereux. Nous le faisons par assurance interposée. En effet, lorsqu'un client vous déclare une marchandise, vous n'avez d'abord pas la certitude que la marchandise qu'il vous déclare correspond bien à ce qu'il met dans le conteneur. Sur des millions de conteneurs, il est évident que vous ne pouvez pas tout vérifier. Donc, il faut connaître le client pour savoir s'il est honnête et s'il vous déclare bien les marchandises dangereuses quand elles le sont, selon une appellation qui n'est pas commerciale mais qui correspond à celle du code des marchandises dangereuses, IMDG, code international établi par l'OMI.
Une vérification peut porter sur tous les conteneurs d'un bateau par sondages. La plupart du temps, dans certains ports, des experts payés par les assureurs travaillent avec la compagnie pour vérifier des conteneurs pris au hasard - cela peut donc être des conteneurs déclarés comme contenant des marchandises dangereuses ou des matières non dangereuses comme, par exemple, des chaussures. Ces conteneurs sont mis en zone sous douane et, avec le concours d'un commis douanier, les experts des assureurs ouvrent un conteneur et regardent si son contenu correspond bien à la déclaration. Et cela se passe uniquement sur le terminal du lieu de chargement du conteneur.
M. le Rapporteur : Outre la vérification que vous avez pu faire vous-même auprès du client, la douane et/ou l'assurance se mettent d'accord pour vérifier le contenu en fonction des déclarations que fait l'armateur sur le fret que l'on vous a déposé ?
M. Jean-Pierre TANGUY : Tout à fait. Il y a là un double intérêt. Dont celui du transporteur qui s'assure ainsi que la rémunération de son fret correspond bien à ce qui est chargé. A titre d'exemple, nous avons pendant des années transporté des « disques d'acier » qui étaient en fait des poêles Tefal. Cela change le prix du conteneur.
Nous avons également eu un incident sur un de nos porte-conteneurs qui fait les Antilles. On nous avait déclaré des fournitures scolaires. Il s'est avéré que c'était des panoplies de « petits chimistes » qui ont pris feu, au port heureusement, et ce fut sans gravité.
Ce sont des exemples concrets de fausses déclarations.
M. le Président : Lorsqu'un chargeur vous confie telle marchandise pour aller d'un endroit à un autre, c'est bien vous qui assurez l'organisation technique du transport de la marchandise, du fret dans les conteneurs ?
M. Jean-Pierre TANGUY : Cela dépend. Vous avez deux types de conteneurs. Des conteneurs
full container load : vous déposez le conteneur chez le client, qui le remplit, le ferme et met les scellés.
M. le Rapporteur : Vous ne disposez que du papier de déclaration.
M. Jean-Pierre TANGUY : Sauf à faire des vérifications comme l'a dit mon collègue.
Puis, il y a des conteneurs qui résultent d'un groupage, avec un certain nombre de marchandises sous hangar dans les ports et vous remplissez les conteneurs. C'est alors plus facile de vérifier ce que vous mettez dedans.
M. le Président : Le commandant est-il tenu de répondre à la demande de visite du représentant de l'assurance ? Pour les douanes, le problème ne se pose pas naturellement, mais pour les assureurs ?
M. Pierre JEANMAIRE : Le contrôle ne se passe pas à bord, il se passe sur le terminal même.
M. le Président : Y compris le contrôle par l'assurance ?
M. Pierre JEANMAIRE : Oui. Il y a un lien entre l'expert de l'assurance et ce que nous appelons le ship planer, c'est-à-dire la personne qui, dans le port, organise la mise à bord des conteneurs, les emplacements. Le
ship planer possède la liste des conteneurs qui comporte aussi le nom générique de la marchandise qu'ils contiennent. Nous communiquons cette liste à l'assureur qui va choisir de contrôler un nombre de conteneurs au hasard...
M. Jean-Pierre TANGUY : Ou plutôt la marchandise...
M. Pierre JEANMAIRE : Au hasard ou selon certains critères.
M. le Rapporteur : Lesquels ?
M. Pierre JEANMAIRE : Un nouveau client ; un conteneur qui coule alors qu'il est déclaré pour de la marchandise sèche ; un client qui se trouve sous l'_il attentif du transporteur parce que nous nous sommes rendu compte que certaines marchandises déclarées étaient de fausses déclarations. Petit à petit, ils sont surveillés.
M. le Rapporteur : Ensuite, parallèlement ou en même temps ou une fois sur l'autre, il y a l'inspection du port ?
M. Jean-Pierre TANGUY : Oui, mais c'est totalement différent. Je m'étais cantonné aux marchandises dangereuses. L'inspecteur du port vient pour sa part contrôler que votre plan de chargement correspond bien à la réglementation du code IMDG. Il s'intéresse donc à des conteneurs déjà chargés et libellés.
M. le Rapporteur : Il contrôle qu'ils sont bien en place, bien emboîtés ?
M. Jean-Pierre TANGUY : Lorsque nous rencontrons des inspecteurs de ce type, très entraînés, ils peuvent détecter des anomalies car ils disposent aussi de la description de ce que contient chaque conteneur. Ils établissent des comparaisons. Mon expérience personnelle me fait dire que ces inspecteurs posent des questions pertinentes et détectent des anomalies. Mais mon collègue qui a été
ship planer, qui est plus expert sur la partie terrestre, vous en parlerait mieux que moi. S'ils trouvent des anomalies, nous pouvons, par le biais de notre bureau des marchandises dangereuses, leur apporter les réponses souhaitées.
Il existe des règles extrêmement fines, précises. Par exemple, vous pouvez mettre des marchandises incompatibles dans un même conteneur, mais c'est fonction de la quantité : s'il s'agit de quelques kilos, ce n'est pas pareil que s'il y en a plus. C'est votre bureau spécialisé qui vous apportera la réponse ; le commandant n'est pas à même de le faire, à moins qu'il ait fait partie à une époque de ce fameux bureau.
Par expérience, j'ai constaté que la juxtaposition d'une bonne procédure de marchandises dangereuses chez un transporteur et d'une inspection compétente des services du port ou de l'Etat apporte une très haute sécurité. Les services des armateurs qui connaissent les contraintes de chaque port font en sorte que tout se passe bien et l'inspection du port, en posant les questions judicieuses, incite votre bureau des marchandises dangereuses à remplir sa tâche avec beaucoup d'exactitude parce qu'il sait qu'il peut être contrôlé. Cette dyade me paraît être très intéressante quant à la sécurité du transport de marchandises dangereuses.
M. le Rapporteur : Lorsque vous perdez un conteneur, son contenu est-il identifié ? Peut-on savoir automatiquement s'il s'agit de produits dangereux ?
M. Jean-Pierre TANGUY : Tout à fait.
M. Pierre JEANMAIRE : A bord, le commandant signe un manifeste des marchandises dangereuses. Celui-ci est remis à l'autorité du port de départ et, normalement, transmis à l'autorité du port suivant.
Sur ce manifeste, chaque numéro de conteneur est associé à son emplacement à bord, le nom de la marchandise ainsi que le code IMDG. Ensuite, avec le numéro du conteneur et sa position à bord de la liste des produits dangereux, le capitaine conserve à bord une copie de ce manifeste de déclaration de marchandises dangereuses sur laquelle figurent le nom chimique du produit, un numéro de téléphone d'urgence, le nom du chargeur, etc.
Voilà comment on repère les marchandises à bord. Le commandant est tenu d'afficher, à bord de son navire, un plan de disposition des conteneurs réputés dangereux, déclarés et manifestés comme tels. Si un navire perd des conteneurs, il peut tout de suite déterminer si parmi ceux-ci ou ceux en avarie, il y a effectivement des marchandises déclarées dangereuses et en connaître la nature ou le code.
M. le Rapporteur : Quand vous passez dans le rail, par exemple, à partir de quelle proportion de conteneurs dangereux, vous déclarez-vous dangereux ? Quand vous avez la moitié, le tiers ou le quart de votre cargaison en produits dangereux ?
M. Pierre JEANMAIRE : Bien que ce ne soit pas obligatoire,...
M. le Rapporteur : On nous a dit le contraire lors de l'audition précédente.
M. Pierre JEANMAIRE : Pour moi, il n'y a pas d'obligation, sauf pour les navires qui transportent des produits comme des hydrocarbures, etc.
M. le Rapporteur : Pour les hydrocarbures, nous sommes d'accord. Mais vous, par exemple, quand vous transportez des conteneurs de produits très sensibles, n'êtes-vous par obligés de vous identifier en rentrant sur le rail ?
MM. Jean-Pierre TANGUY : Nous nous identifions.
M. le Rapporteur : Mais vous ne dites pas ce que vous transportez ?
M. Pierre JEANMAIRE : Il nous est demandé si nous avons à bord des marchandises dangereuses. Le bateau détient en permanence la liste des produits dangereux et leur quantité. Il déclare donc les marchandises à son bord dites et réputées dangereuses.
M. le Rapporteur : Donc, vous vous déclarez ?
Vous disiez que nous n'étiez pas obligés de le faire.
M. Jean-Pierre TANGUY : Nous ne sommes pas obligés, mais nous pouvons le faire.
M. le Rapporteur : Un armement moins respectable que le vôtre peut très bien ne pas le déclarer ?
M. Jean-Pierre TANGUY : Oui, tout à fait.
Il existe partout des réglementations. Si vous allez à Melbourne, par exemple, avant d'entrer, vous devez déclarer si vous avez des explosifs ou pas. Les commandants connaissent les règles, savent qu'en tel endroit, ils doivent déclarer ceci ou cela, et ils déclarent ce qu'on leur demande.
Mais il faut bien avoir à l'esprit qu'un commandant revenant sur le rail d'Ouessant ne peut pas détailler l'ensemble de son chargement. Etant donné qu'il existe un registre sur lequel tout est inscrit, on peut toujours déclarer. Chacun a sa propre méthode certes, mais le commandant connaît parfaitement les produits dangereux qu'il transporte. Il peut soit en donner un résumé, en disant qu'il a tant de tonnes de telle classe, qu'il doit parler à un spécialiste, car je suppose qu'à l'autre bout des ondes, c'est un spécialiste qui écoute ; soit, si les autorités ne jugent pas intéressant d'être informées des produits dangereux à bord, il ne les déclare pas.
Mais dans d'autres zones que Ouessant comme, par exemple, entre la Corse et la Sardaigne, le commandant doit, en particulier, déclarer nos polluants marins. Ceci doit se faire avant de quitter le dernier port car il n'y pas beaucoup d'heures de mer avant d'y arriver.
M. Pierre JEANMAIRE : En règle générale, la réglementation portuaire de tout grand port demande
au commandant d'un bateau lors de sa déclaration d'entrée, c'est-à-dire à la réception de son message prévenant de son arrivée, de donner la liste des matières dangereuses qu'il détient à bord ainsi que leurs quantités. Tous les commandants l'ont prête, mais on peut passer Ouessant sans se manifester.
M. le Rapporteur : Sans se manifester ?
M. Jean-Pierre TANGUY : En tant que commandant de navire, on peut très bien, par temps de brume, passer Ouessant sans se manifester.
M. le Rapporteur : Et se retrouver au large de Cherbourg.
M. Pierre JEANMAIRE : Personne ne va vous appeler parce que la localisation est plus ou moins bonne et je ne pense pas que l'on dispose de moyens de reconnaissance pour repérer tous les navires. Donc, il y a forcément des bateaux qui passent au large d'Ouessant sans que cela se sache, ou plus exactement, on sait qu'un bateau est passé mais il n'est pas identifié. A mon sens, c'est le cas actuellement.
M. le Rapporteur : Mais êtes-vous obligés de le faire normalement ?
M. Pierre JEANMAIRE : Quand le centre d'Ouessant appelle, le bateau honnête répond, mais certains ne répondent pas. La preuve en est que Ouessant Trafic demande parfois à des commandants de notre compagnie de leur dire le nom du bateau qui est à côté de lui et qui ne se manifeste pas.
M. le Rapporteur : Tous ne le font pas, mais sont-ils tenus de le faire ?
M. Jean-Pierre TANGUY : Oui, mais tous ne le font pas.
M. le Président : On nous a dit tout à l'heure que deux textes prévoyaient l'obligation pour un navire de plus de 300 tonneaux de se signaler, quelles que soient la nature du fret et la nature du navire.
M. Jean-Pierre TANGUY : C'est possible mais, pour ma part, je n'en ai pas connaissance. Et mon collègue également. Peut-être sommes-nous restés trop longtemps à terre !
(Sourires.)
M. le Rapporteur : L'obligation s'applique au-dessus de 300 tonneaux.
M. Jean-Pierre TANGUY : 300 tonneaux, c'est vraiment le petit canot.
M. le Rapporteur : Vous ne le saviez pas ?
M. Jean-Pierre TANGUY : Non. Mais nous nous déclarons quand nous passons Ouessant.
M. le Président : Arrive-t-il que les autorités demandent au commandant d'un navire d'identifier pour eux le navire voisin qui ne s'est pas signalé ?
M. Jean-Pierre TANGUY : Oui, c'est fréquent.
Mme Jacqueline LAZARD : commandant, comme chacun sait, la CMA CGM utilise surtout des porte-conteneurs. Vous avez tout à l'heure parlé du saisissage des conteneurs. Comment est contrôlé ce saisissage ? Qui en a la responsabilité ? Intervenez-vous en tant qu'armement ?
Dans le cadre de la sécurité en mer, l'implication des équipages est importante. Votre compagnie assure-t-elle une formation des cadres navigants régulièrement ? De quel type de formation s'agit-il ?
Pensez-vous qu'il soit nécessaire d'aller vers le pilotage hauturier, comme c'est le cas dans le canal de Panama ou de Suez, pour des zones à risque comme le Pas-de-Calais et la Manche ?
Croyez-vous que la rapidité des escales, l'importance du trafic, la diminution des équipages sur les navires augmentent les risques ?
Voilà pour les questions d'ordre général, avant d'en venir à l'Erika puisque c'est cet accident qui est à l'origine de la mise en place de cette commission.
Lorsqu'il s'est trouvé en situation d'urgence, le commandant a probablement dû contacter son armateur. Je sais que dans votre compagnie, un commandant peut contacter l'armement à toute heure, sept jours sur sept, et que, conformément au code d'ISM, en cas d'ennui, une cellule de crise est mise en place. Pourriez-vous nous dire comment fonctionnerait cette cellule de crise ?
Ma dernière question s'adresse plus particulièrement au commandant Tanguy, qui aurait la responsabilité de la cellule de crise : qu'auriez-vous conseillé ? Aller à Saint-Nazaire, au large ou tout autre chose ?
M. Jean-Pierre TANGUY : J'étais sur le point de dire à M. Le Drian que nous nous efforcions de ne pas perdre de conteneurs à la mer mais, malheureusement, il y en a de plus en plus qui tombent à l'eau.
Dans le saisissage, la première phase est l'établissement du manuel d'assujettissement. Ce manuel est calculé par les sociétés de classification. Par dérogation, en France, c'est la Commission centrale de sécurité (CCS) qui délègue au Bureau Veritas ou autre en demandant de calculer le matériel de saisissage qu'il faut y mettre.
Ces calculs de forces, d'accélération et autres sont prévus pour rester dans un cadre de données. La société de classification édicte des règles : tant de mètres de stabilité ; donc, tant de force de rappel. S'il y en a plus, on sort du cadre. Cela dit, les calculs sont relativement larges et il faut des circonstances très exceptionnelles pour sortir du cadre. Malheureusement, à la mer, on trouve des circonstances exceptionnelles.
Ensuite, le matériel lui-même est fourni par les fabricants de matériel de saisissage. La société de classification, que ce soit pour un bateau neuf ou pour un remplacement de matériel de saisissage, dispose de toutes les données et vous mettez le matériel adapté, avec le nombre de barres qu'il faut, etc.
Le manuel de saisissage vous impose également une répartition des poids à bord, répartition en hauteur, bien évidemment, puisque dans l'autre sens, ce sont d'autres forces qui entrent en ligne de compte. Le commandant sait, baies par baies, ce qu'il peut mettre à bord ; il a les règles.
Si, par exemple, on a prévu en troisième plan un conteneur de 15 tonnes, qui ne les atteint pas, quelle charge peut-on mettre dessus pour le cas où il y aurait un conteneur plus lourd qui viendrait aussi ? Il faut bien reconnaître que tous ces manuels sont théoriques et la réalité ne coïncide pas exactement avec le manuel. C'est, malgré tout, un aspect bien étudié.
Il y a des facteurs que l'on n'imagine pas a priori : par exemple, la force du vent sur la pile de conteneurs, qui déforme la pile. Les conteneurs étant prévus pour un effort vertical, toute la pile peut s'effondrer même s'ils sont bien saisis par les barres. C'est ce qu'on appelle le
wind lashing - excusez ce terme anglais mais dans le vocabulaire maritime nous n'avons pas beaucoup de mots français. Le
wind lashing, ce sont les barres qui obligent la pile à rester verticale.
Vous avez également les efforts différents selon que l'on se trouve côté porte ou côté cloison du conteneur. Cela apparaît très bien dans les logiciels de calcul. Il y a une souplesse. C'est donc extrêmement complexe. Aujourd'hui, nous n'avons plus les marges de sécurité que nous avions dans le temps. Autrefois, on empilait les conteneurs les uns sur les autres. Nous avions de tels coefficients de sécurité, qui n'étaient même pas calculés, que cela ne posait aucun problème. Sur des navires comme les PCRP qui font la traversée de l'Atlantique vers les Antilles, que vous connaissez bien, les calculs démontrent que vous n'avez pas besoin de saisir vos conteneurs. Mais ces bateaux sont maintenant vieux d'au moins vingt ans et il y avait déjà à l'époque des barres de saisissage, parce que c'était la règle de l'époque. Trop n'a jamais manqué !
Voilà pour ce qui est des moyens mis à la disposition du bord.
Pour le saisissage sur les porte-conteneurs, il y a les
twistlocks, de petites têtes qui verrouillent la base du conteneurs, sur le pont, et des pièces qui évitent le ripage du conteneur. Car tout se déplace à la mer. Un conteneur n'est pas fixe ; il faut bien en être conscient. Donc, il existe maintenant des pièces qui servent de butée, le commandant Jeanmaire pourrait vous en dire très long à ce sujet, avec là aussi des risques d'effort qu'il faut contrôler parce que qui dit ripage et butée dit, forcément, effort latéral.
Le saisissage de la cargaison est effectué par des équipes spécialisées dans les ports, que l'on appelle des saisisseurs, sous la surveillance des membres de l'équipage. Cet aspect ne pose pas de véritable problème - les petites bagarres habituelles.
Dans une compagnie comme la CMA CGM , certes, je ne peux pas dire que ce soit respecté à cent pour cent car il y a des habitudes, mais les consignes sont que le commandant n'appareille pas avant d'avoir signé un bon de « bon saisissage ». Le commandant s'engage. Il déclare avoir constaté que tout était bien saisi et qu'il peut prendre la mer. S'il estime que la cargaison est mal saisie, soit on fait revenir les saisisseurs, soit les membres de l'équipage, si c'est peu de chose, peuvent le faire eux-mêmes.
La formation des cadres navigants est un long processus. En matière de sécurité, il n'existe pas de véritable formation spéciale. Les officiers sont des BAC + 5, avec un bagage mathématique suffisant pour évaluer les problèmes théoriques que cela pose. Il faut savoir jongler avec les vecteurs.
Ensuite, c'est l'expérience. En fait, vous ne pouvez pas savoir
a priori à quoi vous pouvez vous attendre. Je vais vous donner un exemple pour illustrer mon propos.
J'ai été chargé dans ma carrière de la construction d'un navire neuf. Avec mon collègue, second capitaine, puisque c'était un bateau qui faisait l'Australie, le Cap Horn, nous nous étions dit que pour ne pas prendre de risques pour le premier voyage, nous allions prévoir une stabilité de 1,50 m, la stabilité étant le couple de rappel. Mon collègue est parti et, dans les 40èmes rugissants et après, les barres de saisissage sautaient et tombaient à l'eau - nous n'avons pas perdu de conteneurs - mais elles tombaient parce que les forces de rappels étaient trop importantes. En voulant être trop prudents, en réalité, nous avions pris un risque. Par la suite et durant toute la vie du bateau, nous avons terminé avec seulement 60 cm de (_-a) - module de stabilité initiale transversale - et nous avons été tranquilles.
Mais cela demande un certain apprentissage.
Si je voulais rentrer dans les détails, il faudrait évoquer aussi les différentes formes de coques. Ces formes étaient nouvelles à l'époque. On les rencontre beaucoup maintenant. Ceux qui font du dériveur comprendront tout de suite ; c'est la forme du 420 : plus on gîte, plus on a une force de rappel importante. Cette force varie également en fonction de l'assiette du navire. Pendant des générations et des générations, on a calculé les éléments de stabilité du navire à assiette zéro. Or on s'aperçoit aujourd'hui qu'on peut avoir plus d'un mètre de différence selon que le navire est assiette zéro ou « sur le cul » comme on dit dans la marine. C'est l'expérience qui vous l'apprend, ce sont des éléments que le marin assimile peu à peu, qui ne nécessitent aucune formation spécifique.
M. Pierre JEANMAIRE : Il faut savoir que dans notre compagnie, les gens qui arrivent au grade de capitaine sont passés par un long processus. En général, on les a pris comme élèves dans une école, au Havre, à Marseille ou à Nantes actuellement. Sur notation, on les choisit comme lieutenants, puis, comme seconds. Enfin, ils seront capitaines.
Ils connaissent très bien les navires, que ce soient les habitudes de notre compagnie ou ce qui peut se passer à bord d'un bateau. Ils ne sont pas parachutés. Ce ne sont pas des gens que l'on sort d'un bureau de main d'_uvre pour les mettre comme commandant sur un bateau.
M. le Président : Ce que vous dites est valable pour les bateaux qui sont sous pavillon métropolitain. Si je prends les huit que vous commandez actuellement, une partie sera sous pavillon métropolitain et une autre sous pavillon non métropolitain. Qu'en sera-t-il des équipages et de ce que vous nous dites sur la qualification requise et le suivi dont vous parlez, année après année ?
M. Jean-Pierre TANGUY : Je vous répondrai très précisément puisque je suis à l'origine de ces règles.
Le pavillon, je suis désolé d'en décevoir certains, n'est pas un gage de bonne ou de mauvaise qualité. Ce sont les règles internes à la compagnie qui en sont le gage. Je confirme ce que dit mon collègue : nous prenons chaque année comme élèves de première année une vingtaine de jeunes, sélectionnés déjà sur une centaine de candidatures. Cinq seulement parviennent en fin de troisième année du cursus scolaire, avec lesquels nous prenons un engagement moral - uniquement moral - de leur donner la priorité sur des postes d'officier qui se libéreraient. Pour l'instant, nous les avons tous engagés.
Ensuite, effectivement, nous avons des règles de progression internes à la compagnie. Pour certains, on monte trop lentement.
Nous n'avons pas tout à fait les mêmes procédures, mais relativement analogues pour nos personnels étrangers.
Tout d'abord, ce n'est pas cosmopolite. Nous n'avons qu'une seule source de recrutement - cela peut être considéré comme sujet à défaut. Il s'agit de marins et d'officiers roumains, employés de la compagnie nationale roumaine qui n'a plus de bateau mais existe toujours et qui les détache chez nous. Il faut savoir que la majorité des lieutenants chez nous étaient des commandants dans leur pays qui ont effectivement commandé en Roumanie ou ailleurs.
Par ailleurs, nous sommes draconiens ; lorsqu'un commandant nous signale un officier pas compétent, selon ses propres critères, celui-ci est tout de suite débarqué et remplacé par un autre. Cela, sans aucune hésitation.
En ce qui concerne l'armement des navires, ce n'est pas parce que vous avez des navires battant pavillon étranger que vous ne mettez pas de Français à bord. A la CGM, avant la CMA CGM, nous avions des pétroliers de 300 000 tonnes, des licornes et autres, sous pavillon libérien, qui avaient un équipage cent pour cent français.
Quand, juste après la privatisation de la CMA CGM, il a été question de « déflaguer » quelques navires, on avait décidé de mettre un commandant et un chef mécanicien français à bord, quel que soit le reste de l'équipage. Cela ne s'est pas fait, mais c'est l'armateur qui a toutes les cartes en main. On parle toujours de critères financiers à propos des armateurs. Certes, c'est un élément important, mais la qualité et la fiabilité du transport sont également des critères financiers.
La CMA CGM, compagnie maintenant privée, gère par la Direction de l'Armement l'ensemble des éléments liés aux navires, c'est-à-dire non seulement les équipages sur les bateaux et l'entretien technique - puisque la direction de l'armement que je dirige est chargée des équipages et de l'entretien technique des bateaux - mais aussi la construction de bateaux neufs, ce qui permet d'avoir une vue d'ensemble. Cette direction de l'armement, même si elle a recruté des gens depuis la privatisation, reste quand même un noyau de l'ancienne CGM. Ce n'est pas par lubie de notre actionnaire, mais parce que nous avons là une expérience que nous n'avons pas voulu voir disparaître. Nous mettons même, au contraire, tout en _uvre pour la développer et la transmettre aux jeunes générations.
Pour n'en donner qu'un exemple, nous avons intégré un très brillant élément en construction neuve, auquel nous avons donné des responsabilités à l'âge de vingt-six ans. Il a construit les CMA CGM Utrillo et Matisse. C'est un élément extrêmement brillant, auquel nous transmettons notre savoir. C'est ainsi que l'on prépare l'avenir et que se construit un véritable armement.
Mme Jacqueline LAZARD : Une autre de mes questions portait sur les risques liés à la baisse des effectifs et aux escales rapides.
M. Jean-Pierre TANGUY : Le fait de passer « régime bis » a augmenté les effectifs sur les navires. De seize sur le navire dont je parlais tout à l'heure à cent pour cent français, nous sommes passés à une vingtaine de personnes à bord. Nous n'avons pas réduit les effectifs, au contraire.
Cela dit, la quantité des effectifs, si tant est qu'on ne dépasse pas ou que l'on ne tombe pas sous un seuil inférieur, car il faut rester extrêmement prudent, n'est pas forcément gage de qualité.
En ce qui concerne les escales rapides, aujourd'hui le marin qui embarque est un technicien ; il sait qu'il embarque pour deux à trois mois de service à la mer en permanence. Donc, mis à part pour le commandant si les escales sont successives, car il peut y avoir une accumulation de fatigue, pour les autres, qu'ils soient à la mer ou au port, les journées comportent toujours le même nombre d'heures de sommeil, d'heures de travail. Cela ne change rien du tout sauf peut-être pour le moral.
J'en viens au pilotage de haute mer. Je ne sais pas si le commandant Jeanmaire en a l'expérience, mais la mienne est extrêmement négative.
M. le Rapporteur : En Manche ? Ou ailleurs ?
M. Jean-Pierre TANGUY : A la CMA CGM, nous ne prenons pas de pilotes hauturiers. Nos équipages sont suffisamment compétents pour naviguer par eux-mêmes.
Il m'est arrivé, en fait, une fois, dans ma trop longue carrière de convoyage de navires, de voir sur la passerelle un pilote de haute mer. D'origine hollandaise, il nous menait du canal de Kiel au Havre. Ce pilote était strictement inutile : il avait fixé les règles à peine embarqué en disant que tout ce qui était anti-collision, man_uvres, suivi de route, ce n'était pas à lui mais à l'équipage de le faire. J'étais alors chef mécanicien mais je passais beaucoup de temps sur la passerelle, je m'interrogeais sur son utilité et le commandant était de mon avis. Il avait pris un pilote hauturier par prudence, nous aurions pu nous en passer.
Je suis très réservé, mais cela ne veut pas dire que d'autres ne soient pas d'une aide appréciable sur les passerelles.
M. Pierre JEANMAIRE : J'ai eu une expérience, j'ai navigué sur des pétroliers à la CGM. Nous faisions appel à des pilotes hauturiers parce que le rail de Mer du nord, pour les très gros pétroliers, ne pouvait être fréquenté qu'en son milieu. Les navires à grand tirant d'eau étaient fortement handicapés, ne pouvant même pas man_uvrer à certains endroits. Cela posait des problèmes de man_uvrabilité et d'application des règles en vigueur.
Je ne pense pas, pour ma part, que pour une compagnie qui possède un armement et un service technique, avec des bateaux en état, bien équipés, avec des cartes à bord corrigées et des équipements de navigation en état, le pilote apporte un plus dans le transit Cherbourg-Hambourg. Les officiers à la passerelle, dont je faisais partie, connaissaient bien le travail et, en fait, c'était nous qui continuions à man_uvrer le bateau.
En revanche, en discutant avec ces pilotes hauturiers, j'ai appris que parfois - et c'est sans doute vrai - certains armements font appel à ces pilotes pour faire un travail que ne seraient pas capables de faire les personnes à bord.
Il faut donc rester méfiant : ce n'est pas parce que vous avez à bord un pilote hauturier capable de mener un grand navire au travers du Pas-de-Calais et de la Mer du nord qu'il n'y a plus de problèmes. Il est certes compétent, mais quel est l'environnement autour de lui ? En cas de pépin, il ne peut pas tout faire seul et doit compter sur la compétence de l'équipage, ne serait-ce que pour la sécurité de ce dernier.
Il faut donc faire très attention à ce que des armateurs ne prennent pas des pilotes hauturiers uniquement pour pallier l'incompétence de l'équipage. Ainsi, on n'achète pas de cartes, on n'a pas d'instruction nautique, on ne se renseigne pas sur les arrivées des ports, les transits, etc. L'expérience que j'en ai est que le pilote hauturier était content de faire le voyage avec nous, mais que nous le transportions.
M. Jean-Pierre TANGUY : J'ai bien lu le rapport qui a été fait par la commission Tourret. Je n'ai rien à en dire, même si l'on ne peut s'empêcher de faire des remarques, en disant : « Tiens ! Il a fait ça ? Cela n'a fait qu'aggraver la situation ». Ce ne sont que des sentiments personnels. Cela étant, le rapport précise très justement que ce que le commandant a fait n'est pas parfait, mais que s'il avait fait autre chose, cela n'aurait peut-être pas été mieux. Il faut être prudent dans ses jugements.
Pour ce qui est de la cellule de crise, je vais laisser la parole au commandant Jeanmaire car, parmi toutes ses étiquettes, il est « Monsieur ISM », c'est-à-dire la personne désignée par l'entreprise comme responsable de la sécurité.
M. Pierre JEANMAIRE : Malheureusement, un armement maritime peut être confronté comme d'autres entreprises de transport à des cas graves, comme l'Erika. Cela arrive forcément. Il faut donc mettre en place des procédures.
Pour ce qui nous concerne, nous avons une ligne 24h/24h, comportant un répondeur horodateur, avec certaines sécurités d'appel s'il advenait que l'on ne puisse joindre cet appareil.
Normalement, un commandant qui se trouve dans le cas de l'Erika compose un numéro aboutissant à un répondeur horodateur, qui lui donne un certain nombre de renseignements : le nom du cadre de garde et des numéros de téléphone où il peut le joindre. Il peut éventuellement laisser un message comme quoi il a effectivement contacté un cadre de la compagnie.
C'est ainsi qu'assurant la permanence, on se retrouve directement en contact avec un commandant. Dans un cas comme celui de l'Erika, la personne qui aurait été de garde chez nous aurait été soit un commandant, soit l'ingénieur en chef du service technique. Il s'adresse donc à un cadre d'un niveau élevé et qui possède une compétence maritime. Lorsqu'un commandant me téléphone, étant moi-même commandant, je peux facilement me mettre à sa place. Je dois prendre une partie de son travail pour le dégager de certaines tâches, notamment administratives comme prévenir les autorités et les cadres de ma compagnie, ce qui lui permet de se consacrer à l'événement de mer auquel il doit faire face.
Cette cellule de crise sert donc déjà à alléger une partie de la tâche du commandant.
Dans un cas aussi grave, nous prévenons le directeur de l'armement, l'ingénieur en chef et un commercial s'il y a de la marchandise en jeu. Nous nous retrouvons au site du Havre, dans nos bureaux, et essayons de voir les renseignements que nous avons sur ce navire. Nous nous faisons donner des renseignements par le commandant. Nous lui donnons des numéros de téléphone, un fax ou un e-mail où il pourra nous joindre en permanence.
Le service technique prend en charge l'aspect technique de l'avarie. Pour ma part, je prends plutôt en charge tout ce qui concerne la sécurité, comme la stabilité. Je préviens les autorités maritimes, je vois ce qu'il y a lieu de faire, s'il faut dérouter le bateau, faire faire une réparation quelque part, demander des autorisations de préparations provisoires, des transferts vers un autre port, des autorisations d'entrées, etc.
Puis, en cas d'accidents aux personnes, nous prévenons le service de planification qui est capable de sortir une liste de l'équipage et des personnes à bord, qui s'occupe de prévenir le SAMU local ou, via Purpan, le CROSS Etel qui doit organiser les secours.
C'est donc ainsi que se met en place la cellule de crise. Pour ce qui est du cas précis de l'Erika, je n'étais pas directement confronté aux problèmes qu'a rencontrés le bateau, je n'ai donc pas réellement d'avis sur la question.
M. Jean-Pierre TANGUY : Bien que nous mettions en pratique ces procédures relativement souvent - toujours trop à notre goût, même si je ne parle pas de situations de crise importante, parce que, sur toute une flotte, il y a toujours un petit problème - nous disposons, en doublure de toutes les lignes téléphoniques dont M. Jeanmaire vous a parlé, de ce que nous appelons « la ligne rouge ». Le commandant dispose à bord d'une ligne de téléphone et de fax dédiée, qui arrive à une société de gardiennage dont les bureaux sont à Limoges - avec les technologies modernes, on peut faire ce que l'on veut. Cette société de gardiennage a des consignes permanentes ; elle a tous les numéros de téléphone des cadres responsables. Si le commandant s'adresse à elle pour demander quelque aide que ce soit, il doit impérativement le doubler d'un fax, afin d'éviter les canulars, ...
M. le Rapporteur : Que fait cette société de gardiennage ?
M. Jean-Pierre TANGUY : C'est une société de gardiennage normale, qui peut aussi garder des immeubles. C'est simplement une société de service qui retransmet un appel, qui est là en veille et sait qui contacter.
Par ailleurs, tous les commandants ont les numéros confidentiels de tous les cadres directement concernés.
Je ne vois aucun cas où, à quelque niveau que ce soit, nous n'ayons pas pu être contactés 365 jours sur 365 et vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Nous sommes absolument sûrs de nos procédures de ce point de vue.
Pour faire une comparaison avec ce qui s'est passé sur l'Erika, le commandant Jeanmaire l'a dit, je voudrais insister sur le fait que, d'une part, la personne chargée de la sécurité aurait pris en main ce qu'elle pouvait de la sécurité du navire, c'est-à-dire qu'elle aurait fait ses propres calculs, établi sa propre analyse et aurait pu donner des conseils au commandant, et d'autre part, le service technique aurait mis tout en _uvre pour contacter les chantiers, éventuellement des sociétés qui sont capables de faire un calcul rapide - Bureau Veritas ou autre.
On voit bien que le commandant n'a que deux choses à faire, qui ne sont pas des moindres : premièrement, gérer la situation au mieux à bord, car personne ne peut le remplacer pour ce qui est de la sécurité de son équipage et de son navire ; deuxièmement, répondre aux questions qu'on lui pose.
Sur ce dernier point, il ne faut pas oublier les circonstances dans lesquelles les commandants se trouvent. C'est une des difficultés du métier : quand un commandant ou un chef mécanicien vous appelle, il se trouve toujours dans des situations abracadabrantes, dans le mauvais temps, la nuit, entre autres, il a déjà essayé de résoudre lui-même le problème. S'il vous appelle, il est toujours angoissé. Il peut avoir énormément de mal à décrire ce qui se passe. Parfois, il ne songe même pas à donner le nom du bateau. Nous avons l'habitude, nous reconnaissons les voix, nous arrivons à faire le rapprochement, mais cela peut aller jusque-là. Nous devons donc calmer le jeu et obtenir une description aussi précise que possible de la situation. C'est une des difficultés de la partie terrestre. Ensuite, l'affaire suit son cours. Dieu merci, nous n'avons pas eu pour l'instant à gérer des situations du type de l'Erika, aussi extrêmes.
Mme Jacqueline LAZARD : Je fais encore appel aux spécialistes. A votre avis, un navire de la grandeur de ceux qui composent la flotte est-il maniable à trois n_uds ?
M. Pierre JEANMAIRE : Cela dépend totalement des conditions de temps et de mer.
M. Gilbert LE BRIS : N'êtes-vous pas inquiets de la course au gigantisme en matière de porte-conteneurs puisque de 3 000 à 5 000, on est en train d'évoquer des 10 000 boîtes ?
M. Jean-Pierre TANGUY : J'ai des projets de 18 000 dans mes tiroirs.
M. Gilbert LE BRIS : C'est encore mieux !
M. Jean-Pierre TANGUY : Cela ne veut pas dire qu'ils vont voir le jour !
M. Gilbert LE BRIS : C'est une course au gigantisme comme ce fut le cas pour les pétroliers à une époque, avec ce que cela implique en maniabilité, en remorqueurs nécessaires.
Cela ne vous inquiète-t-il pas, surtout après ce que vous nous avez dit des contraintes des conteneurs en général ? N'a-t-il jamais été envisagé de mettre des conditions particulières concernant certains conteneurs contenant des produits très dangereux, délicats à transporter ? Ne pourrait-on, par exemple pour les repérer, avoir des balises Argos sur ces conteneurs très spécifiques, qui ne doivent pas être perdus ?
M. Jean-Pierre TANGUY : Nous avons une procédure simple en la matière. Nous n'avons pas parlé de la procédure des marchandises dangereuses, mais il arrive que nous refusions de charger certaines marchandises dangereuses.
M. le Président : Oui, mais il faut bien les transporter.
M. Jean-Pierre TANGUY : Il faut bien les transporter, d'accord, mais c'est justement l'un des aspects du problème. Supposez que tous les transporteurs refusent de transporter ces marchandises, ne pensez-vous pas que cela pourrait contraindre certains chargeurs à faire des efforts de leur côté ?
M. le Président : Cela n'arrivera pas !
M. Jean-Pierre TANGUY : Bon. (Sourires.)
Nous faisons partie de ce que l'on appelle les majors, c'est-à-dire que nous avons l'habitude de travailler avec nos grands partenaires, européens ou autres, qu'il s'agisse de
Nedlloyd - P and O, Hapag, entre autres. J'ai travaillé avec eux durant toute ma carrière. Nous avons des procédures identiques et nous refusons tous, en même temps, les mêmes marchandises.
M. le Rapporteur : Quelles sont ces marchandises ?
M. Jean-Pierre TANGUY : Nous refusons les déchets parce qu'on n'est jamais sûr de la stabilité chimique des déchets. J'ai fait une intervention là-dessus ce matin, en prenant l'exemple de la peinture. Nous connaissons le n°IMCO (n° de codification international) de la peinture, mais si on ajoute du solvant dans cette peinture, savez-vous ce que cela devient ? Non, parce que le peintre qui a ajouté le solvant n'est pas allé voir le chimiste pour lui demander de requalifier ce produit.
Nous refusons donc, c'est un principe, de transporter toutes sortes de déchets.
Maintenant, si le déchet est identifié - il ne faut plus l'appeler déchet au sens IMDG du code -, il faut l'identifier dans la classe IMDG.
Je ne pense pas que l'on puisse mettre des balises sur ces conteneurs. Notre rôle n'est pas de récupérer ou de suivre les conteneurs, mais de ne pas les perdre.
M. le Rapporteur : Si un conteneur de produit très dangereux tombe à la mer, comment le repère-t-on ?
M. Jean-Pierre TANGUY : Vous ne le repérez plus !
M. le Président : Il y a, à ma connaissance, une entreprise en Bretagne qui a mis au point un dispositif qui permet de retrouver ces conteneurs.
M. Jean-Pierre TANGUY : Ces conteneurs, est-ce qu'ils flottent ? A quelle profondeur sont-ils ? Tout cela doit être pris en considération. Prenons l'exemple de bâtons de dynamite que nous avons eus sur nos côtes pendant un certain temps...
M. le Président : On nous a donné l'exemple de fûts d'uranium au large des Açores...
M. Jean-Pierre TANGUY : Nous ne sommes pas contre des solutions de ce type si elles existent. Mais il faudrait pouvoir les imposer.
M. Pierre JEANMAIRE : Premièrement, il faudrait que tout le monde soit à la même enseigne, que ce soit des règles internationales.
Deuxièmement, si le conteneur tombe par 3 000 mètres de fond, il me paraît très difficile d'aller le rechercher. En plus, au-delà de 100 mètres, il y a des risques de déformation et on peut imaginer que la marchandise subira déjà des dommages qui entraîneront une pollution. La solution serait que le conteneur reste à la surface et, donc, d'inventer un dispositif le rendant insubmersible. Actuellement, la réglementation internationale prévoit un étiquetage pouvant résister à un séjour de deux mois dans l'eau.
M. le Rapporteur : C'est une question que nous nous posons dans le cadre de notre mission. C'est une hypothèse d'école, mais ce sont toutes des hypothèses d'école : un porte-conteneurs transportant pour une part des boîtes avec des produits dangereux coule dans les mêmes conditions que l'Erika, par exemple, dans la Manche. Des conteneurs de produits très dangereux s'approchent des côtes, comment les repère-t-on ?
M. Jean-Pierre TANGUY : La seule solution aujourd'hui est de faire appel aux dragueurs de mines de la Marine nationale pour aller détecter les masses métalliques.
M. le Rapporteur : Si ce sont des masses métalliques !
M. Jean-Pierre TANGUY : Si ce sont des conteneurs, c'est le cas.
M. le Rapporteur : Oui. Mais nous avons eu le problème sur les nappes de pétrole que l'on n'arrivait plus à identifier. Ce n'est pas le sujet, mais une de nos interrogations est de savoir comment on n'est pas arrivé à évaluer le positionnement des nappes de pétrole.
M. Jean-Pierre TANGUY : Une nappe, c'est plus délicat à repérer qu'un conteneur, tout de même.
M. Pierre JEANMAIRE : Il faudrait, d'une part, définir quel type de marchandises rentrerait dans le cadre des marchandises très dangereuses et, d'autre part, pour éviter de les rechercher au fond, il faudrait qu'elles restent à la surface. Dans ce cas, il faut faire attention aux bateaux alentour. Il faudrait des moyens de signalisation lumineux, sonores ou électroniques, ce qui demanderait des conteneurs très spéciaux qui coûteraient forcément cher.
M. le Rapporteur : Hypothèse d'école : imaginez qu'un matin, la radio annonce qu'un porte-conteneurs - battant bien sûr un pavillon étranger, parce que cela ne peut pas être la CMA CGM, ils sont trop bien saisis ! - a coulé au large de la Bretagne, en pleine Manche et que trente boites chargées de déchets nucléaires arrivent sur nos côtes. Imaginez la panique. Et, entre nous, je ne suis pas sûr qu'on ait bien prévu ce risque, mais cela peut arriver. Comment fait-on ?
M. Jean-Pierre TANGUY : Nous allons tenter d'apporter quelque chose à votre hypothèse.
J'ai fait du transport de conteneurs d'uranium. Le conteneur lui même, les cylindres que l'on transportait étaient étudiés pour résister à des chocs importants comme la chute sur une dalle de béton de tant de hauteur, etc. Le conditionnement est étudié. Je passe la question des médias sur lesquels nous n'allons pas nous étendre. Je ne serais pas inquiet en tant que Breton si on me disait que c'est ce type de matériel que l'on va retrouver. Je serais bien plus inquiet pour d'autres, par exemple, des matières qui peuvent se mélanger à l'eau.
Mais je pense que l'on peut repérer ces fûts et, même s'ils arrivent à la côte, ils sont assez solides pour résister.
Je maintiens donc ma position. La vraie question est de savoir comment ne pas perdre de conteneurs. Sur ce point, il y a des choses à faire. Cela rejoint la question de M. Le Bris sur le gigantisme.
La majorité des modèles qui étaient vrais jusqu'à ces dernières années ont de moins en moins de valeur. Pendant de nombreuses années, on a construit des bateaux par extrapolation, en ajoutant quelques dizaines de mètres bout à bout. Aujourd'hui, on est arrivé à de telles tailles qu'il ne suffit pas d'ajouter quelques mètres. Je ne parle pas du chargement, je parle uniquement de la poutre-navire, c'est-à-dire du flotteur avant de mettre quelque chose dedans.
Le Bureau Veritas, par exemple, a développé un système qui s'appelle Veristar, de modélisation de la coque. Ils travaillent par ordinateur et peuvent détecter, avant même que le bateau ne soit construit, des anomalies. Ils l'ont déjà fait. Il y a certainement à creuser pour ce qui est de la sécurité ; non seulement la sécurité de la coque elle-même, mais aussi la sécurité de la machine.
Personnellement, j'ai vécu une situation particulière lors du deuxième voyage du navire dont je vous parlais tout à l'heure. Nous avions signalé à notre direction technique que, dans le mauvais temps, le moteur se déplaçait de dix centimètres par rapport à la cloison machine. Notre direction technique nous a répondu, à juste titre, que ce n'était pas le moteur qui se déplaçait par rapport à la cloison, mais la cloison par rapport au moteur. Nous avons coupé les tuyaux et avons mis des flexibles, car nous avions peur que les tuyaux cassent, et nous avons navigué comme cela pendant deux ans. Puis, au bout de deux ans, nous avons eu un grave ennui machine, nous sommes restés à la dérive au large de la Crête pendant 72 heures et nous sommes rentrés avec un cylindre en moins jusqu'à Marseille, où l'on a constaté des fissures incompréhensibles et inhabituelles sur le bâti moteur. Après une querelle d'experts qui dura un certain temps, on n'a jamais réussi à trouver la solution.
Avec le recul et avec les années, je suis persuadé que c'était pour partie dû au socle sur lequel était posé le moteur, qui n'était pas assez rigide et que les deux, moteur et cloison, bougeaient. Avec les puissances motrices extrêmement importantes que l'on mette actuellement sur les bateaux, un navire de 89 000 CV a eu par exemple, dès son démarrage après chantier, des problèmes de ce type, lié à des fondations du moteur trop souples. C'est un élément dont on ne parle pas, mais l'élément propulsif est fondamental.
Les futurs bateaux de la CMA CGM, de 6250 boîtes, seront équipés de moteurs de 93 000 CV. Pour information, je vous signale que le dernier directeur technique de la CGM disait que jamais il ne mettrait plus de 50 000 CV sur une même ligne d'arbre. Il n'est pas parti à la retraite depuis très longtemps, nous en sommes déjà au double et nous avons déjà des moteurs de 120 000 CV dans nos cartons. C'est cela le gigantisme. Cela peut donner effectivement matière à réflexion.
En ce qui concerne la man_uvrabilité, j'ai été commandant d'un navire qui était l'un des premiers gros porte-conteneurs conçu par les messageries maritimes, de 289 mètres de long. C'était un vrai sabot en man_uvre. Ses gouvernails étaient trop petits... Navire merveilleux à la mer, mais catastrophique en man_uvres.
Les bateaux modernes sont extrêmement faciles à man_uvrer. Lorsque vous montez sur un 5 000 boîtes, vous êtes étonnés de la comparaison avec ces bateaux, vieux de vingt-cinq ans seulement. Du point de vue de la man_uvrabilité, je n'ai pas de souci.
J'ai plutôt des soucis de tenue de la coque, de puissance motrice mise sur la ligne d'arbre. Il faut bien étudier les problèmes de paliers. Vous savez qu'un bateau
MAERSK (compagnie danoise de transport maritime, première mondiale) a été obligé de se faire remorquer du Japon il n'y a pas longtemps. Un palier moteur qui chauffe, cela peut arriver, mais c'est un vrai souci et l'on pourrait se poser la question de savoir s'il ne serait pas opportun d'imposer, au-delà d'une certaine taille, deux machines sur un navire. Cela représente un sérieux surcoût. Cela ne peut pas venir comme ça. Il n'y a que les USA qui pourraient se permettre de faire ce genre de chose mais, techniquement, il serait très intéressant de l'étudier.
Sur le bateau de 289 m de long à deux machines dont je vous parlais, j'ai eu des ennuis de ligne d'arbres, dans le détroit de Formose ; il est sécurisant d'avoir le 2ème moteur, même s'il ne vous mène très vite.
M. Pierre JEANMAIRE : Le gigantisme est aussi dans la hauteur. Vous avez maintenant de gros porte-conteneurs qui ont pratiquement autant de plans sur le pont que dans les cales. Dès que l'on est dans des conditions de vent relativement fort, le bateau constitue une voile fantastique. Jusqu'où ira-t-on ?
M. Jean-Pierre TANGUY : La tendance aujourd'hui, qui est irréversible, est de passer des conteneurs 8 pieds 6 pouces de haut, qui sont encore le standard, à ce que qu'on appelle le
high cube, 9 pieds 6 pouces. Cela veut dire que lorsque vous mettez sept plans en ponté, puisque c'est souvent la règle, vous êtes quasiment un plan plus haut que le standard qui a déterminé la construction du bateau.
Nous nous y intéressons déjà : nous avons demandé à des chantiers de nous coter des bateaux qui seraient prévus dès l'origine pour ce fameux
high cube. Nous ne dépasserons pas le standard, nous serons même plutôt en dessous.
Tous ces sujets de réflexion sont importants. Il faut bien voir qu'à l'échelon d'un pays comme la France, le savoir-faire est quasiment perdu. Si vous voulez poser des questions pertinentes et trouver des solutions pertinentes, il faut construire des navires. Nous construisons des paquebots, ce sont de magnifiques bateaux, mais je considère que notre génération voit la fin ; nous avions un acquis qui est en train de disparaître. C'est extrêmement grave non seulement pour les navigants, mais également pour nos collègues techniciens à terre et pour la société de classification,...
M. le Président : Parce que nous ne construisons pas de bateaux ?
M. Jean-Pierre TANGUY : Le Bureau Veritas fait des pieds et des mains pour être présent sur nos 6500 boîtes. Mais si la CMA CGM n'avait pas demandé au Bureau Veritas de suivre, ils auraient raté la marche des 6500 boîtes, et donc, la résolution des problèmes parce que la construction de tout navire engendre des problèmes à résoudre. 80 % de la flotte de porte-conteneurs actuelle, qui sillonnent les mers, est sous contrôle financier allemand. La société de classification allemande - qui n'est pas plus mauvaise qu'une autre, ce n'est pas le propos - suit la construction de tous ces bateaux et cela devient, de fait, un quasi monopole.
Pour ce projet des 6500 boîtes, nous sommes obligés de passer par les financements allemands, et nous sommes en train de nous bagarrer pour que le Bureau Veritas prenne le relais de
Germanischer Lloyd. Il se met dans les pas de
Germanischer Lloyd mais suivre les pas d'un autre est différent de suivre sa propre ligne.
Pour l'avenir, à moins de réfléchir dès maintenant à des solutions européennes et d'accepter qu'en matière de construction maritime, il y ait certains pays leader, il reste tout de même des questions à se poser.
M. le Rapporteur : Pourriez-vous nous dire, par écrit, quelles sont, à votre avis, les nouvelles garanties de sécurité qu'il faudrait mettre en _uvre pour les conteneurs ?
M. Jean-Pierre TANGUY : Volontiers.
Audition de M. Jean LABESCAT, directeur général,
et de M. Christian QUILLIVIC, directeur d'exploitation,
de la société Les Abeilles International
(extrait du procès-verbal de la séance du 22 mars 2000)
Présidence de M. Daniel PAUL, Président
MM. Jean LABESCAT et Christian QUILLIVIC sont introduits.
M. le Président leur rappelle que les dispositions législatives relatives aux commissions d'enquête leur ont été communiquées. A l'invitation du Président, MM. Jean LABESCAT et Christian QUILLIVIC prêtent serment.
M. Jean LABESCAT : Je commencerai par un très bref rappel de certains éléments essentiels de l'activité de l'Abeille Flandre et de notre société dans les premières vingt-quatre heures qui sont suivi le naufrage de l'Erika. Je continuerai en émettant quelques propos d'ordre plus général qui ont pour objectif de situer l'action de cette société, l'activité des remorqueurs de haute mer au service de la sécurité maritime et de la protection de nos littoraux.
En ce qui concerne les faits, l'Abeille Flandre a été informée du message de détresse lancé par l'Erika
à six heures du matin et a appareillé à six heures quarante, dans le cadre d'une procédure maintenant très rodée et qui lui a permis de prendre sans délai les dispositions nécessaires.
Le bateau s'est cassé à huit heures dix ; l'Abeille Flandre a été sur zone dès midi ; le temps était épouvantable et elle a pris en remorque la partie arrière à quatorze heures quarante, ce dimanche 12 décembre. Le lundi 13 décembre, la partie arrière a coulé à quatorze heures cinquante.
Il a pu être reproché à l'Abeille Flandre - notamment à plusieurs reprises à la télévision ou dans les journaux - d'avoir remorqué ou tenté de remorquer la partie arrière au large conformément à la mission qui, depuis vingt ans est la sienne, à savoir tout faire pour éviter qu'un navire ne vienne s'échouer. Si nous avions laissé dériver cette coque, il est clair, compte tenu du vent, compte tenu de l'état de la mer - la coque dérivait à près de trois n_uds - qu'elle allait droit sur Belle-Ile et il est aisé de pronostiquer que cette partie arrière se serait retrouvée à Belle-Ile avant qu'elle ne coule, c'est-à-dire vers dix heures du matin, le lendemain.
La pollution a eu essentiellement pour origine la rupture du bateau qui est intervenue à huit heures dix. C'est à ce moment-là que les dix, voire quinze mille tonnes, de pétrole brut se sont précipitées à la mer générant une pollution massive. Le fait que l'Abeille Flandre ait écarté la partie arrière est sans rapport avec la pollution qui a touché nos 400 kilomètres de littoral. La partie arrière ne fuyait pratiquement pas ou, en tout cas, de manière non-significative par rapport aux dix ou quinze mille tonnes de pétrole qui se sont trouvées libérées lors de la rupture du navire en deux.
Si je m'attarde sur ce fait, c'est parce qu'il m'a semblé que ceux qui pouvaient porter un tel jugement sur la décision du préfet maritime, comme sur la conduite de notre action pendant ces vingt-quatre heures, faisaient en quelque sorte table rase de vingt-cinq ans de réflexion, d'expériences et de continuité dans la décision politique qui a conduit, en 1978, à mettre en place de puissants moyens d'intervention en haute mer dont la mission a toujours été d'écarter tout navire de nos littoraux.
Prétendre que laisser la coque partir à la dérive, atterrir à Belle-Ile aurait conduit à une pollution de moindre amplitude c'est aller complètement à l'encontre de vingt-cinq ans d'expérience et de décisions politiques !
Quelles sont les réflexions qui sont les nôtres au sein de la société Les Abeilles International à la suite de cet événement majeur dont nous croyons qu'il aura un effet accélérateur sur un certain nombre de décisions en gestation comme l'avait eu, en son temps,
l'Amoco-Cadiz ?
Vous le savez, la sécurité maritime, l'intervention d'une société de sauvetage, les équipages qui se prêtent à ces missions ne se construisent pas dans l'instant ! Cette activité est tout à fait particulière dans le domaine maritime et il serait, une fois encore, illusoire de dire qu'elle peut être menée par des équipages non entraînés ou entreprise par des sociétés qui y verraient une opportunité de faire du
business.
Nous sommes un secteur à part, parce que dans ce domaine, rien ne se construit sans l'expérience, sans des relations entretenues à tous les niveaux avec chacun des maillons constitutifs de la chaîne de la sécurité maritime. Nous, Abeilles International et équipages des Abeilles, nous ne sommes que l'un des maillons de cette chaîne qui ne peut bien fonctionner que grâce aux connaissances réciproques de ses différentes composantes.
Rien ne se construit sans la patience, rien ne se construit sans la confiance réciproque et si j'insiste sur ce point c'est que, pour moi, sécurité maritime rime avec mission et donc avec un sens très élevé du devoir. On nous a confié la mission de protéger notre littoral. Cela fait vingt ans que nous sommes dévoués à cette cause et nous estimons donc, même s'il existe des sociétés qui exercent le même métier que nous - fort heureusement ! - et si nous faisons partie d'un réseau européen, que nous avons des devoirs mais également quelques droits !
Vous le savez, notre système repose sur un affrètement qui, tous les trois ans, est renégocié avec la Marine nationale qui est notre affréteur mais aussi notre donneur d'ordres, puisque le préfet maritime - et nous en sommes très heureux - met en action les Abeilles. Néanmoins, nous pensons qu'un opérateur ne peut remplir une telle mission dans les mêmes circonstances, sans y être impliqué lui-même de façon extrêmement significative et sans avoir réellement le souci de la tâche qui lui est confiée.
Au sein des sociétés européennes qui sont nos partenaires, au sein d'une association industrielle, nous entretenons des relations extrêmement serrées : aujourd'hui, je précise, pour votre information, que notre groupe remet au groupe TotalFina la réponse à l'appel d'offres lancé sur le pompage des parties arrière et avant de l'Erika. Nous avons réuni un groupe international de sociétés qui exercent le même métier que nous, la SMETAC et d'autres entreprises, ce qui n'a été possible que grâce aux relations que nous entretenons sur le plan européen avec ces sociétés de premier plan, ce qui prouve que nous sommes capables de mobiliser, quand il le faut, les moyens nécessaires aux missions qui sont les nôtres !
C'est un véritable métier que le nôtre. Il présente la particularité de compter peu d'opérateurs et de devoir s'exercer dans un contexte toujours hostile mais qui a ses propres règles de fonctionnement : la Lloyd's open form qui est une forme de contrat qui remonte à plus de cent ans. Toutes ces caractéristiques font de notre activité un métier tout à fait à part. Pour autant, il ne s'agit pas d'un métier de cow-boys, pas plus que de héros. Je tenais à apporter cet éclairage parce que les interventions de nos équipages dans des missions à haut risque, comme celle de l'Erika,
sont souvent associées à ces images erronées.
Nous ne pouvons faire notre travail et bien le faire que si nous avons derrière nous une structure organisée, des procédures rodées et des gens qui ont préparé l'événement. Les missions réussies ne sont le fruit ni du hasard, ni de la chance. Nous réussissons nos missions parce que derrière, une structure y a réfléchi, parce que des gens ont été mobilisés, parce que des industriels peuvent apporter les compléments de moyens et de ressources qui nous manquent. Nul ne peut tout prévoir, ni avoir dans ses stocks les moyens d'intervention pour faire face à tous les cas. Il serait illusoire de le croire.
En revanche, il faut avoir préparé à l'avance tout ce qui est mobilisable et qui peut s'avérer nécessaire y compris dans les cas les plus extraordinaires. Ne pensons pas que la sécurité maritime puisse être laissée à des initiatives hasardeuses. Qui dit sécurité maritime dit action réfléchie et inscrite dans la durée, dans laquelle l'industriel que nous sommes est prêt à faire son devoir d'industriel.
Nous ne pouvons pas, me semble-t-il, au moment où, pour nous, se pose le problème du renouvellement de nos navires nous satisfaire du système actuel. L'accomplissement de notre devoir d'entrepreneur devient très difficile dans cette optique qui ne nous accorde guère que trois ans à chaque renouvellement de contrat et qui n'ignore rien du jeu de la concurrence. Nous ne pouvons ignorer que tel ou tel autre peut proposer des moyens qui semblent satisfaire à la demande.
Tout cela nous met dans une position très inconfortable, qui nous fait même parfois douter du sérieux de l'objectif clairement affiché à savoir le renforcement de la sécurité maritime. Nous n'en sommes que l'un des maillons, mais la démarche originale et innovante adoptée par notre pays, en 1978, lorsqu'il a décidé de positionner des moyens dédiés à longueur d'année à cet objectif, doit perdurer. Il faudrait clairement admettre que dix années de plus doivent nous être accordées pour nous permettre d'aller de l'avant, de passer les commandes nécessaires au renouvellement de nos outils et disposer de matériels au goût du jour et adaptés aux menaces d'aujourd'hui.
Il est d'autres éléments que je me serais plu à souligner mais, si vous le voulez bien, je ne m'étendrai pas davantage pour pouvoir répondre à vos questions.
M. le Rapporteur : J'aimerais vous interroger sur deux sujets différents. Le premier concerne l'affaire de l'Erika elle-même, le second portera plus généralement sur la prévention et l'assistance.
Estimez-vous que l'annulation du premier message de détresse a fait perdre beaucoup de temps et a-t-elle eu une incidence sur l'issue des événements ?
Puisque l'Abeille a appareillé sur ordre du préfet maritime, pouvez-vous nous dire, s'il y avait eu un autre bateau en difficulté au même moment, entre Brest et Cherbourg par exemple, ce qui se serait passé ? Le problème ne s'est-il d'ailleurs pas posé puisque, d'après nos informations, il semble bien qu'il y ait eu hésitation ?...
Par ailleurs, et d'une manière générale, estimez-vous que le dispositif actuel d'assistance et de prévention est suffisant - quand je parle du dispositif, j'entends bien sûr tout le dispositif depuis la circulation dans le rail jusqu'aux moyens de prévention et d'intervention en passant par la réglementation - et, en dehors du fait que vous soyez le responsable de cette société, si tel n'est pas le cas, quelles sont, selon vous, les mesures à prendre pour le rendre plus performant ?
M. Jean LABESCAT : L'annulation du premier message de détresse est intervenue quelque vingt minutes, si ma mémoire est exacte, après le premier message lancé dans cette journée de samedi. Il est clair que cette annulation a,
ipso facto, ramené l'événement, vu de terre, à la dimension d'une fausse alerte. Il est tout à fait certain, surtout dans un contexte de week-end et sachant que ce type d'annulation est relativement fréquent, que de ce fait, un certain nombre d'actions n'ont pas été déclenchées immédiatement.
Il est toujours impossible de réécrire l'histoire mais, pour avoir réfléchi à cet événement, sachant qu'il s'est environ écoulé seize heures entre le moment où le capitaine de l'Erika a constaté une anomalie dans le comportement de son navire et celui où il a observé les premières déformations de son pont, j'ai tendance à penser que si l'Abeille Flandre avait été missionnée - nous allons mettre beaucoup de si - dès le samedi après-midi au lieu de l'être le dimanche matin, quand il n'y avait plus rien à faire pour éviter la catastrophe puisque le bateau s'est cassé avant qu'elle n'intervienne, les choses auraient été différentes. Ces seize heures durant lesquelles le navire a poursuivi sa route en prenant la mer du trois-quarts arrière, à une vitesse quand même relativement élevée, ont compté.
Si ce bateau avait été pris en remorque, le samedi vers dix-huit heures, heure à laquelle l'Abeille Flandre se serait probablement trouvée sur les lieux, si le premier message de détresse n'avait pas été interrompu, nous l'aurions « travaillé » autrement que ne l'a fait son capitaine. L'Abeille Flandre lui aurait fait faire, en quelque sorte, le bouchon : le bateau se serait comporté autrement et n'aurait pas pris la mer comme il l'a fait.
Encore une fois, il faut mettre beaucoup de conditionnels : je sais que la nature est parfois généreuse, que le métal dont est fait le navire peut avoir une souplesse extraordinaire, mais en tout cas, je n'exclus pas la possibilité d'avoir fait en sorte que le bateau ne se casse pas, car là est bien l'essentiel.
Ce qui compte, c'est que le bateau se soit cassé. Notre priorité fondamentale, à nous qui sommes habitués à ces missions et à ce contexte, est toujours de faire l'impossible pour que le polluant reste sur le navire. Le polluant doit rester sur le navire : il est aberrant de dire qu'on va choisir une zone du littoral dans laquelle on laissera le bateau dériver.
Il est des cas où l'Abeille Flandre est contrainte de conduire la navigation pour échouer le bateau dans une zone donnée. Cela s'est notamment produit avec le
Rosa M, un porte-conteneurs que nous avons volontairement échoué sur une plage à l'entrée de Cherbourg pour éviter qu'il ne coule ! Nous nous en sommes bien sortis : le bateau a été déséchoué après avoir étanché sa voie d'eau, mais très généralement , nous conduisons l'action pour éviter que le bateau ne se casse. En conséquence, dans la cas de l'Erika, nous aurions « pris le client » et nous aurions conduit l'opération en tenant le navire de telle sorte qu'il souffre le moins possible.
M. le Rapporteur : Vous auriez réussi ?
M. Jean LABESCAT : Je ne peux pas le dire !
M. le Rapporteur : Vous pensez que les chances de réussite étaient bonnes ? Vous auriez accompagné le bateau jusqu'à Saint-Nazaire ?
M. Jean LABESCAT : Nous aurions conduit l'opération comme elle demandait à être conduite. En dernier ressort, mon plan d'action personnel était de conduire le bateau, non pas à Saint-Nazaire, mais en baie de Douarnenez. Pourquoi ?
M. le Rapporteur : C'était votre idée après le deuxième appel ?
M. Jean LABESCAT : Comme vous le savez, l'action s'est portée uniquement sur la partie arrière. Si la partie arrière avait survécu, il se serait probablement passé trois à quatre jours avant que nous définissions entre nous tous, et bien sûr sous l'autorité du préfet maritime qui prend la décision ultime, un schéma d'intervention. Il aurait probablement consisté, non pas à conduire la partie arrière immédiatement dans un port tel que Saint-Nazaire qui est un port à risque puisque c'est une rivière et que la Loire a un courant très élevé, mais en baie de Douarnenez qui est la seule baie accessible de notre littoral. Nous aurions conduit une opération de transfert bord à bord de la cargaison sur un bateau que nous avions mobilisé dès le dimanche, puisque nous nous préoccupions déjà de savoir que faire du pétrole contenu dans la partie arrière. Nous aurions donc exécuté une opération de transfert dont je dirai qu'elle comporte des risques mais qu'elle est une opération de routine dont nous maîtrisons bien les différentes séquences.
M. le Rapporteur : Vous avez déjà fait cela ?
M. Jean LABESCAT : Peut-être pas très récemment, mais encore une fois n'oubliez pas que nous appartenons au groupe des sociétés qui pratiquent ce métier en Europe. Chaque fois que nous sentons que nos moyens sont insuffisants, nous n'hésitons pas à nous grouper et à faire venir des sociétés complémentaires des nôtres.
Nous aurions donc mené cette action sans complexes car nous avons l'habitude de fonctionner avec des gens qui font notre métier, qui ont notre culture et l'habitude de ces situations, avec qui nous avons des accords préétablis et avec qui nous entretenons de telles relations de confiance que, d'une petite structure, il est possible de passer à une organisation très significative en très peu de temps : en moins de vingt-quatre heures, nous savons déborder très largement le cadre de notre propre société parce que nous travaillons dans un contexte qui nous a imposé ce type de pratiques. Il est évident que nous n'avons pas de pétrolier dans notre flotte, mais nous savons où trouver le bateau susceptible de participer à une opération de transfert bord à bord.
M. le Rapporteur : C'est techniquement possible ?
M. Jean LABESCAT: C'est techniquement possible ! Des opérations de ce genre ont été conduites à plusieurs reprises ...Nous avons, de cette manière, déjà déchargé des pétroliers de 200 000 tonnes.
M. le Président : Mais pas dans la tempête ?
M. Jean LABESCAT : La tempête est toujours un phénomène de durée relativement courte. Nous avons tous en mémoire la fameuse tempête du mois de décembre mais
in fine elle n'a duré que quelques jours...
M. le Président : On nous a expliqué, à plusieurs reprises, que si les navires mis en _uvre n'avaient pas pu intervenir de façon efficace, c'était probablement parce qu'ils n'étaient pas tout à fait adaptés au type de pétrole qu'il fallait récupérer mais aussi parce qu'une tempête de nature un peu exceptionnelle a duré pendant suffisamment longtemps pour interdire un certain nombre d'opérations.
M. Jean LABESCAT : Je partage ce point de vue, mais c'est une chose de remorquer un bateau et c'en est une autre de ramasser à la surface de l'eau une espèce de fluide visqueux. Ce ne sont pas les même techniques qui sont mises en oeuvre.
En ce qui concerne le sauvetage, il faut quand même réaliser que, lorsque l'Abeille Flandre a pris la partie arrière, soit dans l'après-midi du dimanche, le vent était de force 6 à 7, il y avait des creux de sept à huit mètres et quarante n_uds de vent établis, alors que le lendemain, lorsque la partie arrière a coulé, le vent était passé à trente n_uds et les creux étaient passés à quatre ou cinq mètres ce qui est déjà une situation complètement différente et confirme ce que nous savons par expérience, à savoir que le très gros temps ne dure jamais éternellement !
Statistiquement, avec une plage de temps de quatre ou cinq jours - sauf à avoir une succession de dépressions qui s'enchaînent les unes aux autres ce qui peut aussi arriver - si le bateau avait survécu dans son ensemble, en menant les opérations de la façon la plus prudente possible et en faisant en sorte que le bateau prenne les lames en générant le moins de fatigue possible à bord, nous aurions eu une chance de pouvoir le conduire dans un lieu présentant le minimum de risques. Ce genre de décision relève toujours de compromis et j'imagine qu'il n'est jamais simple pour celui qui doit arbitrer in fine de la prendre, car on sait bien que si l'opération réussit il sera félicité mais que si elle rate c'est vers lui que remontera l'opprobre.
Notre métier nous enseigne une certaine humilité par rapport aux événements, par rapport aux forces de la nature. Rien n'est prévisible. Il faut constamment s'adapter et pour le faire avec la meilleure efficacité possible, il faut avoir réfléchi à un certain nombre de choses et avoir dans son arrière-cour un certain nombre de ressources, un certain nombre d'idées, un certain nombre d'équipements à mobiliser.
M. le Rapporteur : Pour transférer le fioul de l'Erika,
qui était de nature très particulière,
à un autre bateau, n'était-il pas nécessaire de le réchauffer ? Estimez-vous que l'on aurait pu remorquer tout le bateau, voire une partie du bateau ?
M. Jean LABESCAT : Je me contenterai de vous rappeler simplement que la partie arrière du
Tanio, lors de son naufrage en 1980, a survécu du fait du compartimentage du bateau qui était beaucoup plus serré que ne l'était celui de l'Erika. Nous l'avons promenée, à la remorque de l'Abeille Languedoc, pendant plus de quatre jours entre le moment où le bateau a été récupéré
in extremis sur le plateau des Minquiers et le moment où la partie arrière est entrée au port du Havre. Plus de quatre jours se sont écoulés pendant lesquels le temps s'est calmé, pendant lesquels l'enchaînement qui intervient dans les prises de décision a pu jouer son rôle normal, pendant lesquels un certain nombre de précautions et de dispositions ont été prises pour que le port du Havre prenne en charge la partie arrière du navire qui a pu ainsi y être déchargée.
Nous avions conduit le navire jusqu'à quai au Havre et, à ce moment-là, d'autres ont pris la situation en mains et se sont occupés de la partie arrière du
Tanio, qui était chargée d'un produit similaire à celui de l'Erika, à savoir du fioul numéro 2. Cette expérience antérieure m'a amené à penser qu'on aurait peut-être eu une chance de changer le cours des événements, mais encore une fois j'emploie le conditionnel, car dans ce métier nous ne sommes jamais sûrs ...
M. Gilbert LE BRIS : Je poursuivrai dans la même logique puisque ma question portera également sur les moyens qui seraient nécessaires dans le cadre de la prévention.
Vous avez dit qu'un affrètement de trois ans était insuffisant, ce qui peut se comprendre pour des raisons d'investissement et de mise en place. Quelle serait, selon vous, la durée d'affrètement pertinente ?
Quelle serait la répartition géographique souhaitable des moyens pour optimiser vos capacités d'intervention sur l'ensemble du littoral atlantique mais aussi méditerranéen ?
Nous avons noté que les risques augmentent mais que les moyens restent constants ce qui revient à dire que, finalement, le différentiel ne cesse de s'accroître dans ce domaine puisque les porte-conteneurs deviennent de plus en plus grands, que les bateaux de passagers tout comme les pétroliers deviennent de plus en plus grands, que la prise au vent devient de plus en plus forte : que faudrait-il prévoir, dans l'absolu et dans l'optimisation, comme moyens techniques à la fois en termes de capacité, de force, de vitesse, de traction ou autres pour répondre à ces nouveaux besoins ? Ces questions se rapprochent de celles du rapporteur et tournent autour de la prévention qu'il serait nécessaire de mettre en place à la lumière de l'expérience de l'Erika.
M. Jean LABESCAT : Votre question est un peu complémentaire de celle que vous posiez pour savoir ce qui se serait passé en cas de problèmes concomitants.
Pour nous, la concomitance est un vrai problème. Pour le préfet maritime
- dont je voudrais souligner au passage combien nous sommes heureux qu'il soit un marin, cette organisation nous satisfait pleinement sur le plan des relations et de la conduite des opérations dans la mesure où le dialogue est limpide entre le capitaine de l'Abeille Flandre et le préfet maritime puisque c'est un marin qui parle à un autre marin - c'est un terrible dilemme que d'avoir à décider s'il doit se priver de son moyen d'intervention qu'est l'Abeille Flandre, tout en sachant que durant 24 heures, voire 48 heures ou davantage, ce moyen sera dédié à une opération alors qu'une autre demande peut se manifester.
Lors de l'affaire de l'Erika, durant les 24 heures où l'Abeille Flandre a été connectée à la partie arrière du navire, une fausse alerte a été lancée : elle n'a pas perturbé le cours des événements ; mais nous avons connu des cas où le préfet maritime a arbitré en faveur d'un non-événement alors qu'un véritable événement se produisait.
Je rappellerai pour mémoire le cas du Jego Quéré chalutier de grande pêche qui a pris feu et pour lequel l'Abeille Flandre a été missionnée - il faisait un temps de chien - du côté de Lorient. Le préfet a arbitré estimant qu'à partir du moment où la vie humaine avait été épargnée et les équipages débarqués, il était préférable de garder l'Abeille Flandre en protection du littoral car il savait que s'il l'affectait à traiter le
Jego Quéré, il perdait la possibilité d'avoir recours à elle pour traiter un événement éventuellement plus grave, susceptible de se produire dans la zone d'Ouessant... Le
Jego Quéré a été à la côte. Il a fallu des mois pour traiter le problème de son épave, la sortir de la plage avant qu'elle ne coule quelque 600 mètres plus loin. Dans cette opération extrêmement difficile, nous avons été impliqués en sous-traitance de la DCN (direction des constructions navales) qui a traité le problème de l'épave.
Sans dévoiler de secret, il me semble même me souvenir que la présence de la DCN était liée au fait que le préfet maritime avait arbitré en faveur d'un non-événement, de façon d'ailleurs tout à fait raisonnable : toutes proportions gardées, le
Jego Quéré représentait un risque minimum par rapport à celui encouru avec un pétrolier de grande taille en difficulté dans les parages d'Ouessant.
Il existe une solution de secours qui est mise en _uvre actuellement quand l'Abeille Flandre est affectée à une opération. Pour être honnête, elle n'est valable que pour Brest où la marine dispose de deux petits navires : l'Ailette
et l'Alcyon que l'on a vus à la télévision lorsqu'ils traitaient le problème de la pollution en haute mer.
Ces bateaux ne font que soixante tonnes de traction au croc, alors que l'Abeille Flandre en fait cent soixante, mais il est une pratique courante qui veut, chaque fois que c'est possible, quand l'Abeille Flandre traite un navire en sauvetage, que
l'Ailette ou l'Alcyon, prenne le relais, soit mobilisé et mis en condition pour intervenir.
Sur Cherbourg, un pareil dispositif n'existe pas !
En Méditerranée par le même jeu que celui qui fait que l'Ailette
et l'Alcyon se substituent à l'Abeille Flandre, la
Carangue se substitue au navire d'intervention, le
Mérou. Ce sont des moyens qui constituent une demi-mesure parce que ces navires ne sont pas vraiment faits pour cela : ce sont des navires de transport à très grande plage arrière qui ne sont pas réellement adaptés à ce type de mission, mais mieux vaut encore les utiliser que ne rien avoir rien du tout ...
D'expérience, on peut dire que les distances qui séparent l'Abeille Flandre de l'Abeille Languedoc - l'une à Cherbourg, l'autre à Brest - sont toujours trop grandes. Nous sommes dans des échelles de navigation où le temps ne se compte pas en journées mais en heures ce qui est exceptionnel dans la Marine marchande et dans la navigation en général.
La Manche est une voie de passage, vous le savez, extrêmement occupée, mais où l'on progresse rapidement puisqu'on en franchit la moitié en douze heures de temps... Néanmoins, ce sont toujours des heures trop longues. Les cas où le bateau de Cherbourg a pu se substituer à celui de Brest sont extrêmement rares et si l'un de ces bateaux tombe, par exemple, en panne - ce qui est malheureusement toujours possible puisque ce sont en fin de compte des machines - la Marine n'a plus qu'un seul des deux bateaux. La tendance est alors de le positionner à peu près à mi-distance : c'est une solution qui ne satisfait personne, ni Brest, ni Cherbourg.
Ce problème de concomitance s'est également posé lorsque le
Frantz Hals s'est échoué sur la plage de Biarritz et qu'il a fallu avoir recours à l'Abeille Flandre qui a mis pour descendre presque 36 heures pendant lesquelles tout le dispositif d'Ouessant se trouvant dégarni, on est allé chercher un bateau d'une centaine de tonnes de traction.
Je vais maintenant répondre de façon plus spécifique à votre question des moyens : nous avons enregistré avec satisfaction le fait que l'Etat a souhaité prolonger l'affrètement du remorqueur anglais dans le Pas-de-Calais pendant les mois d'été, sachant que les Britanniques se satisfont depuis cinq ans d'une couverture uniquement hivernale. C'est une solution qui ne satisfaisait personne. On sait que, lorsqu'en plein mois d'août, l'année dernière, un navire de grande croisière le
Norvegian dream est entré en collision avec
l'Ever decent, un porte-conteneurs flambant neuf de six mille boites, causant son incendie, il n'y avait pas de remorqueur affecté au Pas-de-Calais ! Des accidents assez spectaculaires sont survenus dans la Manche, au mois de mai, et si nous étions sur les lieux avec l'Abeille Languedoc, il n'y avait personne du côté anglais !
Le gouvernement français a donc pris une décision à laquelle nous ne pouvons que nous rallier qui vise à faire en sorte que le remorqueur du Pas-de-Calais soit là maintenant en permanence. C'est une décision très sage. Le 26 décembre, nous sommes intervenus sur un navire transportant des voitures, tombé en panne de machine au large de Fécamp. L'Abeille Languedoc était positionnée, comme c'est son habitude, plutôt à l'ouest de Cherbourg où les dangers sont les plus imminents.
Elle a pris le transporteur de voitures en remorque à cinq heures du matin le lendemain en remontant à toute allure la Manche à la poursuite de ce navire qui dérivait à trois n_uds et elle l'a récupéré à quelques milles des bancs de sable, au large de Boulogne ! Le fait de disposer d'un remorqueur dans le Pas-de-Calais complète le dispositif de façon tout à fait efficace et je crois que c'est une sage décision.
En ce qui concerne notre société, elle est très préoccupée pour le golfe de Gascogne ! Je ne sais pour quelle raison, dans nos esprits à tous, il ne se passait rien de spectaculaire dans le golfe de Gascogne qui représente plus de 24 heures de mer, voire plus, pour un navire marchand qui va de Ouessant au Cap Finisterre. Or, voilà que l'Erika
nous rappelle qu'un navire marchand en plein milieu du golfe de Gascogne qui est connu pour être un lieu où l'on ramasse des coups de vent, où les bateaux fatiguent, peut générer, sinon une pollution massive - celle de l'Erika n'était que de 10 000 à 15 000 tonnes - du moins une pollution aux conséquences massives. Une pollution en plein golfe de Gascogne après une certaine dérive et par le jeu des courants et des vents peut mettre tout le littoral en situation très critique !
Le rayon normal d'action de l'Abeille Flandre est un cercle centré sur le phare d'Ouessant de soixante milles nautiques de rayon. Nous recevons souvent des appels de navires au-delà de ce rayon d'action : c'était vrai pour l'Erika.
Chaque cas est un cas d'espèce et, une fois encore, je crois que chaque arbitrage du préfet maritime est pour lui un cas de conscience, puisqu'il doit peser les risques de dépasser ce rayon d'action sachant que l'Abeille Flandre, du fait de sa vitesse relativement limitée, ne doit pas trop s'éloigner de son dispositif. Cette observation constituera un des éléments de réponse à votre question sur les paramètres techniques du navire d'intervention. Nous nous sommes rendus compte à l'évidence qu'il fallait doter nos navires d'une vitesse d'intervention supérieure pour répondre à ce souci d'élargir ce cercle normal d'intervention.
Quoi qu'il en soit, cela fait déjà un certain temps que nous plaidons pour que le fond du golfe de Gascogne, de Bordeaux à la frontière, soit doté d'un moyen significatif d'intervention en haute mer.
En effet, cette côte est dépourvue de tout abri naturel. Les vents poussent systématiquement les bateaux sur la côte qui est, pour une bonne part, faite de sable. Or, contrairement à ce que l'on pourrait penser, un fond de sable est tout aussi dangereux qu'un fond de roche : ce n'est qu'une affaire de temps mais, par le jeu normal des vagues et par expérience - nous savons tous qu'au bord de l'eau nos pieds s'enfoncent - en 24 heures de temps, un navire échoué sur une plage, se casse en deux. Tous les calculs montrent qu'un bateau n'est pas fait pour rester échoué. Quand on échoue un navire en cale sèche, on le fait en respectant certaines conditions de distribution de poids et sur des emplacements qui, dès la construction, ont été prévus pour cela. Que le fond soit de sable ou de roche, je dirais que le problème, pour nous sauveteurs, est pratiquement le même ! Il faut tout faire pour dégager le bateau le plus vite possible. Par conséquent, si nous perdons déjà douze heures ou plus, pour simplement mobiliser un moyen de traction significatif en ramenant l'Abeille de Brest au golfe de Gascogne, nous perdons un temps qui peut être décisif pour éviter une pollution massive.
Pour répondre à cette question spécifique, nous plaidons donc, et cela indépendamment de la société que nous représentons, mais simplement parce que nous voulons faire notre métier correctement à partir du moment où la compagnie Abeilles International est investie de la mission qui est la sienne, pour que le golfe de Gascogne soit l'objet de plus d'attention et soit doté, car il le mérite, d'un moyen dédié qui lui soit propre.
M. Louis GUEDON : Je voudrais vous remercier de votre intervention que chacun s'accordera sûrement à trouver excellente tant elle est empreinte de sincérité et tant votre argumentaire est partagé par les populations maritimes. Je voudrais vous dire, avant tout, que vous n'avez à nourrir aucune culpabilité : le monde de la mer a une très grande confiance dans les Abeilles, dans la qualité de leurs équipages et dans le travail qu'ils fournissent.
Vous nous avez donné une version importante des événements qui se sont déroulés le samedi et le dimanche par rapport à votre intervention.
Par ailleurs, vous nous avez indiqué que vingt-cinq ans de réflexion ne pouvaient pas être balayés par des critiques. Cette remarque est importante parce qu'elle est un peu en contradiction avec l'excellente qualité de votre exposé.
Vous avez ajouté que vous étiez satisfait que des marins parlent aux marins, mais il faut aussi rappeler que les victimes de ces situations sont aussi des marins : les populations maritimes connaissent la mer et on ne peut pas leur raconter n'importe quoi.
Nous avons entendu de très hautes autorités maritimes dire, le jeudi après-midi, qu'il n'y aurait pas de marée noire alors que le samedi matin la marée noire arrivait au Guilvinec ! Quand des marins entendent cela, ils n'ont pas confiance et il faut bien comprendre, si nous sommes parfaitement d'accord pour que des marins parlent aux marins, que les destinataires du message sont aussi des marins et comprennent les messages même quand leur réalisme et leur sincérité peuvent être mis en doute, ce qui n'est pas le cas de votre déposition.
Je voudrais souligner que vous avez laissé entendre que les choses auraient pu tourner autrement si le premier message de détresse n'avait été annulé par le commandant, ce qui de votre point de vue, arrive assez fréquemment, étant donné qu'un certain affolement sur la passerelle peut être repris en main par un commandant qui calme le jeu. Néanmoins, on sait maintenant que ce navire ne présentait pas toutes les garanties de contrôle, qu'il transportait une cargaison dangereuse et que son équipage pouvait être constitué de marins, certes compétents, mais pas forcément très familiarisés avec nos côtes et nos courants d'où ma question : lorsque l'on sait qu'un navire n'est pas de bonne qualité - et c'est le contrôle du port qui peut donner l'information - et qu'il transporte une cargaison dangereuse, ne devrait-on pas, sachant qu'il constitue un danger potentiel, après un premier appel de détresse, ne pas tenir compte de son annulation tant que l'on n'a pas été vérifier sur site ce qui se passe ?
M. André ANGOT : Je voudrais revenir rapidement sur la question précédente : à combien estimez-vous le nombre de remorqueurs supplémentaires nécessaires sur nos côtes ? En faudrait-il un de plus au Havre, un de plus à Nantes ou à Bordeaux et quels sont les besoins pour la Méditerranée? Il serait utile pour notre commission d'enquête, qui aura des propositions à faire, de pouvoir chiffrer le nombre de remorqueurs nécessaires sur nos côtes.
M. Paul DHAILLE : Ma question va dans le même sens que celle qui a été posée précédemment, mais je dois dire que j'attends avec impatience votre réponse parce que vous nous avez donné des informations un peu contradictoires.
Vous nous avez expliqué - et vous me reprendrez si j'interprète mal votre pensée - ce qui aurait peut-être pu être fait si, dès la première alerte, on avait envoyé sur site les moyens. Cela revient à dire qu'il est évident qu'à un moment ou à un autre, il faut - et j'entends bien que dans le monde de la mer tout le monde est libre et responsable, bien, beau, fort et intelligent - reprendre le commandement au capitaine et donc qu'il n'est plus maître à bord !
S'il a envoyé un message de détresse, il n'est plus maître à bord ; le commandement du navire doit donc passer à quelqu'un d'autre : à qui ? A priori au préfet maritime ! Si le navire n'est pas dans les eaux nationales mais internationales, c'est quand même une grande révolution ! J'ai posé la question à plusieurs intervenants devant cette commission : je ne vous donnerai pas leurs réponses car j'attends la vôtre...
Si dès le départ, on envoie sur site, cela signifie, ainsi que vous l'avez expliqué, que l'on dégarnit la défense et l'on revient à la question suivante : dans ce cas, combien faut-il de navires pour avoir une défense permanente de nos côtes et pour quel coût financier ?
En tant qu'élus nous sommes extrêmement sensibles au drame qui s'est déroulé, aux souffrances endurées par les populations mais nous savons bien qu'il y a des éléments financiers, que ce soit au niveau de l'Etat, des compagnies privées, ou des assurances qui doivent entrer en jeu.
Ma question principale vise donc à savoir si, à partir du moment où un message de détresse est envoyé - bien évidemment pas par n'importe quel navire mais par des navires qui transporteraient des matières dangereuses - on doit décharger le capitaine de son commandement jusqu'au moment où l'on aura déterminé s'il est en capacité de commander ou s'il convient de prendre d'autres moyens...
M. Léonce DEPREZ : Plus le temps passe, plus on entend les avis des autorités et plus je m'interroge sur la situation du Pas-de-Calais : je suis un peu effrayé de tous les risques qu'elle comporte notamment en raison de la circulation qui y est enregistrée. J'aurai donc deux questions.
Premièrement, si ce drame était survenu dans le Pas-de-Calais, que se serait-il passé ? Deuxièmement, j'ai noté votre observation sur le remorqueur, et j'avais déjà entendu dire qu'il était assez formidable que l'on en ait un. J'ai toutefois été un peu refroidi en apprenant qu'il était anglais ; je l'ai été plus encore quand on m'a dit qui allait avoir autorité sur le remorqueur car j'avais cru comprendre qu'elle serait partagée à 50/50 ce qui n'est pas un très bon rapport - je le tiens du monde de l'entreprise - car on ne sait jamais qui commande ; j'ai été enfin totalement refroidi quand j'ai su qu'il allait être ancré sur la côte anglaise.
Je sais bien qu'il ne s'agit pas de questions de frontières mais, très franchement, tout cela est fait davantage pour m'inquiéter que pour me rassurer et je me demande si, après ce drame - et ce sera peut-être un thème abordé par le rapporteur et le président - il ne conviendrait pas d'engager une nouvelle politique. En effet, j'ai bien compris que ce que nous avons vécu intensément avec
l'Erika, nous pouvons le revivre demain, après-demain, dix fois et dans des conditions beaucoup plus dramatiques encore dans certaines zones telles que le Pas-de-Calais !
Telles sont les questions auxquelles j'aimerais que vous-même, mais peut-être également le rapport, puissiez apporter des réponses.
M. François CUILLANDRE : Ma question est complémentaire de celle d'André Angot.
Vous nous avez décrit les insuffisances du dispositif actuel et je sais que vous avez le projet de renouveler une flotte qui commence à dater un peu avec des navires qui sont généralement soumis à de fortes tempêtes. La presse s'est fait l'écho de « navire-hôpital ». Pour la Commission, pouvez-vous préciser quel sont les avantages de ce projet et nous fournir éventuellement quelques précisions sur le surcoût qu'il entraînerait par rapport à un navire traditionnel ?
M. Jean LABESCAT : Je vais essayer d'embrasser l'ensemble des questions posées qui reflètent un certain nombre d'inquiétudes que je partage. Je vais m'efforcer d'être aussi concis que possible, aussi me pardonnerez-vous si je laisse dans l'ombre tel ou tel aspect de certaines questions.
Pour répondre à M. Guédon sur le problème du droit d'intervention, je dirai, à partir de certains critères qu'il conviendrait peut-être de resserrer davantage, qu'il faudrait aller au-delà d'une simple information laissée à la discrétion du commandant du navire. Si ma mémoire est exacte, il me semble que la loi de 1977 donne d'ores et déjà, et au-delà des eaux territoriales jusque dans la limite de 200 milles, la possibilité d'agir au préfet maritime.
La France a pris beaucoup d'avance, dans la foulée des désastres des années 70-80, sur le plan de la mise en place d'outils juridiques. Par conséquent, personnellement, je rejoins cette préoccupation et je milite, compte tenu des moyens dont nous disposons en hélicoptères, même si le rayon d'action de ces derniers est relativement limité, pour que le préfet maritime aille sur place ou se donne davantage de moyens de dépêcher une mission d'intervention afin de vérifier quelle est la situation. Je crois que cela va dans le bon sens et que, puisque l'outil juridique est là, il faudrait peut-être que les moyens suivent.
M. Louis GUEDON : C'est excellent ! Merci de votre réponse !
M. Jean LABESCAT : En ce qui concerne maintenant la distribution des moyens sur notre littoral, le dispositif qui va voir le jour le premier avril dans le Pas-de-Calais n'est pas satisfaisant. J'en connais déjà les limites de fonctionnement, mais je dois dire, une fois encore, que nous avons franchi un pas significatif : cela fait des années que nous plaidons pour la mise en place d'un moyen dans le Pas-de-Calais, car il nous faut douze heures, parfois davantage lorsque nous nous prenons le courant dans le nez, le vent dans le nez, pour remonter la Manche...
La côte du Pas-de-Calais, et particulièrement notre côte française, est le lieu de prédestination de toute épave flottante : les vents et les courants portent vers la côte. Nous allons mettre en place au premier avril cette espèce de remorqueur partagé entre Britanniques et Français. Je connais les limites du dispositif mais, de façon tout à fait heureuse, nous entretenons des relations privilégiées avec la compagnie de remorquage anglaise qui a passé contrat, car nous n'avons pas attendu cette signature pour organiser de concert une action commune en Manche.
En conséquence, pour ce qui nous concerne, nous ferons tout, dans la mesure où nous sommes associés à cette nouvelle aventure, pour que ce dispositif fonctionne, mais il est clair qu'un moyen partagé, au commandement partagé quand bien même il y aurait alternance, est une source d'ennuis et de retard dans les prises de décision : plus on met d'étages dans les processus de décision, plus on perd de temps.
Or, pour le Pas-de-Calais, il s'agit de raisonner en heures. Il faut deux heures pour aller à sec sur une plage lorsque l'on est dans le rail montant. Comme par hasard, ce rail montant est celui qui est de notre côté à croire que, nous Français, nous nous sommes donné des verges pour nous battre. Ajoutons que ce rail est sans nul doute plus chargé de polluants que le rail descendant qui, lui, est surtout fréquenté par des pétroliers vides.
M. le Rapporteur : La solution n'est pas satisfaisante en raison du double commandement ?
M. Jean LABESCAT : Clairement !
M. le Président : En même temps, n'est-il pas envisageable, compte tenu de ce canal que forment finalement la Manche et le Pas-de-Calais, compte tenu de la proximité des côtes anglaises et françaises, que les moyens soient communs ?
Le problème se pose d'un double système de décision ce qui est probablement regrettable, mais ne peut-on imaginer, au moment où l'on cherche à faire en sorte que des décisions concernant la sécurité maritime soient prises au niveau européen, que chacun aille sur site à trente ou quarante kilomètres - pardonnez-moi de parler en kilomètres pour la mer - avec un remorqueur du côté anglais et un remorqueur du côté français et belge ?
M. Jean LABESCAT : Pour répondre à cette question très précise, sachez que nous avons traité le
Kukawa, porte-conteneurs en flammes au milieu de la Manche, avec le
Farminara, qui est l'équivalent de l'Abeille Languedoc et l'Abeille Languedoc, elle-même. Nous avons donc déjà démontré que nous savions travailler ensemble, que les autorités savaient partager les moyens mis à leur disposition pour traiter un problème donné. Les moyens partagés sont une solution dont je dirai, à partir du moment où chaque moyen peut clairement être identifié à une chaîne de commandement, qu'elle va dans le sens normal !
Pour ce qui concerne notre littoral, je crois que le Pas-de-Calais, Cherbourg, Brest sont très correctement traités puisque les remorqueurs de Cherbourg et de Brest ont une puissance de traction de cent soixante tonnes. Bien sûr, on peut dire qu'un moyen nouveau permettrait aussi de franchir un pas sur le plan technique un surcroît de forces n'étant jamais superflu, nous le savons bien.
En revanche, pour ce qui est du golfe de Gascogne, il souffre d'un grave manque de moyens d'intervention efficaces. Les moyens dont nous disposons côté français sont de petits remorqueurs attachés à certains ports, tel celui de Saint-Nazaire...
M. Paul DHAILLE : M. le président, la réponse est intéressante, mais elle est partielle. Vous nous avez dit qu'effectivement, lorsque l'on envoie un navire sur zone, la défense côtière se trouve dégarnie. Or, vous nous signalez dans le même temps qu'il faudrait, lorsqu'un navire se trouve en difficulté, que le capitaine soit déchargé de son commandement et que l'on aille vérifier sur place, y compris dans la zone des 200 milles, ce qui veut dire, si votre suggestion était retenue par la Commission, que les sorties des navires se multiplieraient ... Il ne suffit pas de nous dire que la situation est correcte avec la législation actuelle : je vous redemande, compte tenu de ce que vous venez de nous dire, quelles seraient en quelque sorte les défenses à mettre en place pour faire fonctionner un système qui sera obligatoirement plus gourmand en matériel et en hommes.
M. le Rapporteur : Il y a les hélicoptères !
M. Paul DHAILLE : Non, puisque l'on nous dit qu'ils ne peuvent aller jusqu'au golfe de Gascogne par temps de tempête ! La réponse est intéressante mais incomplète !
M. Jean LABESCAT : Si vous le permettez, je vais poursuivre car je n'avais pas terminé mon exposé ! Sur la Manche, il y a aujourd'hui deux remorqueurs côté anglais et deux remorqueurs côté français. Nous mettons en service un autre remorqueur pour le Pas-de-Calais ce qui porte leur nombre à cinq pour traiter la Manche de Brest au Pas-de-Calais. Par le jeu des associations, des prêts, des combinaisons, je pense que, là, quand même, les moyens peuvent se substituer les uns aux autres et que disposer de cinq remorqueurs pour traiter cette zone améliorera clairement la situation !
Pour ce qui est de tout le sud de Brest, les moyens tant du côté espagnol que français sont très limités. Pour la France, ils sont de l'ordre de trente à quarante tonnes de traction et ce sont des moyens portuaires. Il y a, là, incontestablement un vide et, personnellement, je plaide pour la mise en place d'un moyen dédié de grande puissance qui soit basé quelque part entre Saint-Nazaire et Bayonne pour couvrir et protéger, en quelque sorte par un jeu de dominos successifs, le passage de Brest à Bayonne.
Pour ce qui est de la Méditerranée, l'Etat a fait, il y a deux ans, l'économie d'un remorqueur, ce qui explique que nous nous retrouvons avec un seul remorqueur dédié pour traiter la zone qui s'étend de la frontière espagnole à la frontière italienne. C'est insuffisant : les distances à franchir sont considérables et le remorqueur est, là, essentiellement missionné pour protéger tout l'Est, c'est-à-dire le dispositif corse, alors qu'au mois de décembre trois bateaux se sont échoués sur la plage de Port-la-Nouvelle : deux viennent d'être dégagés et nous traitons actuellement le troisième.
M. Christian QUILLIVIC : Sur le remorqueur d'intervention, je voudrais préciser que le projet est à l'étude depuis deux ans et que le document que je vous ai fait parvenir a donc été édité bien avant la catastrophe de l'Erika.
Ce que nous pouvons constater depuis vingt ans, en qualité de société d'assistance, c'est effectivement que lorsqu'un commandant envoie un message de détresse, même s'il l'annule par la suite, nous conservons toujours un doute sachant qu'il peut l'annuler parce qu'il maîtrise la situation mais aussi parce que son armateur lui aura dit de se débrouiller...
Le préfet maritime se trouve alors contraint de choisir entre faire partir l'Abeille pour vérifier pendant plusieurs heures le comportement du navire ou la garder pour couvrir tout risque éventuel à Ouessant.
En 1990, pendant l'hiver, à la suite de tempêtes successives, nous avons été amenés à faire d'innombrables sauvetages au large d'Ouessant et nous avons connu un cas de ce genre : le pétrolier
Béarn s'est trouvé en avarie totale au sud de l'Ile de Sein pendant qu'un gros porte-conteneurs, dans une situation analogue, dérivait sur Ouessant. Nous avons eu une chance inouïe puisque nous sommes parvenus à affréter un gros remorqueur qui, passant au large par hasard, a connecté le
Béarn en attendant que l'Abeille Flandre soit libérée.
Aussi, dans notre projet, nous avons tenu à mettre en valeur le fait que les futurs remorqueurs d'intervention devraient avoir le maximum de vitesse d'intervention pour un coût raisonnable, puisqu'il y a une échelle au-delà de laquelle on atteint des puissances gigantesques mais pour des coûts fantastiques.
Si vous prenez l'exemple du Tanio, il faut savoir qu'il se trouvait à mi-chemin entre Brest et Cherbourg au large de Perros-Guirrec. L'Abeille Flandre a connecté l'arrière du navire à vingt minutes d'un échouement sur les rochers. Autant vous dire que si la cargaison du
Tanio s'était répandue sur les rochers de Perros-Guirrec, cela aurait été une véritable catastrophe, ce qui explique notre souci de couvrir la zone située entre Brest et Cherbourg et de toujours assurer une vitesse d'intervention supérieure pour nous permettre d'arriver plus rapidement sur les lieux et faciliter le choix du préfet maritime.
Je voudrais encore ajouter, concernant le Pas-de-Calais, que, ainsi que certains d'entre vous le disaient à juste titre, les risques sont grands. Cela fait vingt ans que je suis aux Abeilles International ce qui m'a permis d'avoir la chance de déséchouer un navire tout neuf naufragé à la suite d'une erreur humaine qui n'a fait aucune victime, mais, pour moi, le risque majeur dans le Pas-de-Calais reste celui d'une collision entre un ferry chargé de passagers et un pétrolier montant ou descendant de 200 ou 250 mille tonnes. Ce risque, contrairement à ce que pensent certains, n'existe pas seulement l'hiver, mais aussi l'été en raison de la brume d'autant qu'à cette époque les ferries sont beaucoup plus chargés.
M. le Président : Le préfet maritime de Cherbourg que nous avons reçu hier soir, partageait votre inquiétude du fait des 70 000 personnes qui traversent la Manche dans un sens et de la centaine de bateaux qui croisent dans l'autre sens...
M. Vincent BURRONI : Je souhaiterais juste obtenir une précision par rapport à la Méditerranée. Vous nous avez dit que l'Etat avait fait l'économie d'un bâtiment et que les moyens étaient insuffisants : j'aimerais bien que vous nous fassiez des propositions plus précises et que vous me disiez si l'on peut espérer une réaffectation s'il y a de nouveaux moyens dédiés pour l'Atlantique ou un bâtiment nouveau et moderne et avec quelle capacité et quelles qualités ?
Mme Jacqueline LAZARD : Tout à l'heure, dans vos propos, monsieur, j'ai cru percevoir que la situation était particulière puisque le naufrage de l'Erika
est intervenu à la fin de la semaine : y aurait-il à craindre des difficultés plus importantes pour intervenir en fin de semaine ?
M. Jean LABESCAT : Je vais tenter de répondre le plus brièvement possible à l'ensemble des questions.
Pour répondre à ce souci de la vie humaine, nous pensons qu'un moyen d'intervention doit également avoir une capacité de récupération de naufragés aux normes actuelles.
M. Edouard LANDRAIN : Combien coûte un remorqueur ?
M. Jean LABESCAT : Nous avons un projet pour lequel 150 millions de francs sont suffisants. La vie humaine, pour nous, doit être traitée comme les entrepreneurs de pétrole le font avec leur navire de
stand by.
Je répondrai simplement à Mme Lazard que nous observons couramment qu'il est plus difficile, indépendamment des équipes humaines en place, de faire fonctionner des structures quand bien même elles sont dédiées, un samedi ou un dimanche. Personnellement, je ne vois pas de problème particulier, mais c'est un fait avéré qu'il est plus compliqué de mettre en _uvre des moyens en fin de semaine : il suffit de rappeler le temps qui a été nécessaire au capitaine de l'Erika pour joindre ses affréteurs, ses armateurs etc.
A M. Burroni, je dirai que je suis personnellement extrêmement alarmé de la situation en Méditerranée. Il y a un trafic de passagers considérable sur la Corse et même si le trafic marchand est moins important en face de Toulon et de Marseille qu'en Manche, il existe et il y a des zones - je parle de la Corse - qui sont inscrites au patrimoine universel.
Il y a deux ou trois ans, précisément du fait du manque de moyens affectés à ces dispositifs de protection, la marine a dû faire l'économie de l'un des deux remorqueurs d'intervention à cent cinquante tonnes de traction initialement prévus par les décrets. Aujourd'hui, nous ne disposons plus que d'un remorqueur de cent tonnes et nous jouons artificiellement par le biais d'un deuxième bateau qui n'est absolument pas conçu pour cela en disant que les deux bateaux font à eux deux cent cinquante tonnes de traction. Il n'est pas sérieux de continuer à fonctionner de la sorte et notre projet, dans la mesure où une volonté claire de faire notre devoir d'entrepreneurs s'y affirme, vise à mettre en place un moyen moderne qui satisfasse à l'ensemble des critères, adapté à cette zone particulière et à ces trafics particuliers afin de doter notre façade d'un système vraiment parfait !
Audition de M. Alphonse ARZEL,
maire de Ploudalmézeau et président du Syndicat mixte de protection
et de conservation du littoral nord-ouest de la Bretagne,
accompagné de M. Jean-Baptiste HENRY, coordinateur du syndicat
(extrait du procès-verbal de la séance du 22 mars 2000)
Présidence de M. Daniel PAUL, Président
MM. Alphonse ARZEL et Jean-Baptiste HENRY sont introduits.
M. le Président leur rappelle que les dispositions législatives relatives aux commissions d'enquête leur ont été communiquées. A l'invitation du Président, MM. Alphonse ARZEL et Jean-Baptiste HENRY prêtent serment.
M. Alphonse ARZEL : M. le président, nous sommes honorés d'être entendus par votre commission d'enquête, mais en tant qu'ancien parlementaire je suis un peu surpris car je pensais qu'elle s'apparentait à celle relative à
l'Amoco-Cadiz qui s'attachait à rechercher les responsabilités. Or votre commission s'intéresse davantage au transport maritime en général et aux améliorations à y apporter ce qui est un peu différent...
M. le Président : Vous n'ignorez pas qu'une enquête judiciaire est en cours et qu'une commission d'enquête parlementaire ne peut pas se substituer à cette enquête judiciaire ; nous avons donc préféré, en accord avec les autorités de l'Assemblée nationale, axer les travaux de la commission d'enquête sur la sécurité maritime en les résumant si je puis dire à la formule : « plus jamais ça ! ».
M. Alphonse ARZEL : Nous qui sommes ici quelques-uns à avoir vécu une aventure extraordinaire avec l'affaire de
l'Amoco, nous sommes heureux de venir devant vous porter témoignage de ce que nous avons pu faire, dire en même temps notre déception de devoir avouer avoir pendant tant d'années essayé de « faire bouger les choses » pour apporter plus de sécurité dans les transports maritimes de marchandises dangereuses et ne pas y être parvenus, même si des améliorations ont été apportées en l'espace de quelques années, telles que le radar implanté sur l'île d'Ouessant, la création du rail qui a permis une amélioration de la circulation, et la mise en service de remorqueurs de grande puissance.
Des décisions et des mesures ont donc été prises et des lois votées même si elles ne sont pas toujours appliquées, je pense notamment à celles relatives aux dégazages. Ces pratiques de dégazages sauvages nous irritent car si elles ne sont peut-être pas aussi polluantes qu'une vraie marée noire, telle que celle qui a fait suite au naufrage de
l'Erika, elles restent nocives. Les dégâts d'une marée noire sont visibles mais d'autres pollutions qui ne frappent pas autant l'opinion peuvent se produire.
Nous soutenons votre travail puisque l'affaire de
l'Erika pénalise, non seulement toute la côte atlantique mais aussi toute la région ouest de la France.
Nous avons eu l'occasion - Jean-Baptiste Henry en parlera tout à l'heure - de faire visiter les côtes bretonnes à des responsables de l'Alaska. Il faut en effet savoir que, depuis l'accident de
l'Exxon Valdez, nous entretenons des relations avec des Alaskiens qui ont eu également à connaître une marée noire en mars 1989. Dans notre procès, on peut regretter que cet accident se soit produit tant d'années après, car s'il était survenu plus tôt, le juge nous aurait sans doute prêté une oreille plus attentive mais on ne change pas le cours des choses. Si nous sommes là ce matin ce n'est pas pour évoquer des accidents à venir mais bien pour faire en sorte de les éviter...
Il y a beaucoup de pistes qui ont été soulevées. Pour ce qui nous concerne, nous avons créé une structure qui était surtout destinée à mener un procès et à faire payer les responsables de cette catastrophe. Le combat n'a pas été simple, puisqu'il a duré quatorze ans avant que nous n'obtenions gain de cause au terme d'une longue procédure.
J'ajouterai que la situation est actuellement favorable à une prise de conscience de tous ceux qui ont à traiter du transport maritime et à éviter les pollutions, mais que ce contexte ne durera pas. C'est pourquoi il faut frapper le fer tant qu'il est rouge sachant que l'émotion ne dure qu'un temps et que les dangers une fois éloignés sont oubliés. Les intérêts en jeu sont si importants qu'il est difficile de modifier le cours des choses mais nous avons des atouts et vous êtes là pour faire en sorte que les choses changent. C'est le souhait que nous formulons car nous nous sentons investis de la responsabilité de représenter la population de la côte ; les deux tiers de la population de notre grand ouest vivent en effet en bordure de mer. Il ne faut pas oublier ces populations et il y a, pour les porte-parole des citoyens que nous sommes, des propositions à envisager pour exiger une totale transparence dans ces affaires. Dans celle de
l'Erika, nous aimerions savoir comment les choses se sont déroulées et quelles sont les responsabilités.
M. Jean-Baptiste HENRY : M. le président, madame et messieurs les députés, je commencerai par faire trois ou quatre remarques d'ordre général sur le débat qui nous est proposé.
Premièrement, j'évoquerai le rééquilibrage nécessaire entre une politique de sécurité du transport maritime et une politique de sécurité du littoral et de l'environnement. Traditionnellement, c'est la sécurité et la viabilité du transport maritime qui a fait essentiellement l'objet de la politique des pouvoirs publics au niveau national et comme international. Or, depuis une trentaine d'années, à la suite du développement du trafic maritime et de la multiplication des accidents qui l'a accompagné, le problème de la sécurité du littoral et de l'environnement a commencé à influencer la politique des grands acteurs du commerce maritime, à savoir l'industrie du transport maritime et les Etats. Cela s'est traduit notamment par la mise en place de certaines conventions internationales, sur lesquelles je ne reviendrai pas, qui prennent en compte les pollutions et leurs répercussions et une plus grande importance des Etats du port par rapport à ceux du pavillon, mais plus encore - et c'est notre témoignage - par l'intervention d'une nouvelle catégorie d'acteurs qui veut influencer cette politique et intervenir dans le débat sur la sécurité du transport maritime, c'est-à-dire nous les riverains et plus généralement les gens de terre par rapport au monde un peu fermé de ceux que l'on appelle les gens de mer.
Tel est le fruit de notre expérience de Bretons du littoral nord-ouest de la Bretagne, à travers les réactions que nous avons enregistrées à la suite des huit marées noires que nous avons connues depuis une trentaine d'années et de la multiplication des accidents d'autres origines et plus encore des nombreuses alertes qui ont eu lieu sans heureusement se traduire par des accidents.
Nous avons réagi, d'une part à travers un procès comme l'a rappelé tout à l'heure le Président Arzel, le procès de
l'Amoco-Cadiz sur lequel je ne reviendrai pas mais qui nous a mobilisés de 1978 à 1992 et d'autre part dans le cadre d'une action que nous n'avons peut-être pas assez soulignée du point de vue de ses répercussions, je veux parler de la coopération internationale que nous avons initiée à l'occasion de l'affaire de
l'Amoco-Cadiz et poursuivie depuis.
Je veux surtout évoquer la coopération qui nous lie à l'Alaska qui a débuté en 1989 soit tout de suite après la catastrophe de
l'Exxon Valdez, que nous avons poursuivie ensuite et dont les derniers développements sont notre déplacement en mars 1999 en Alaska au moment où le pays tirait un bilan de la catastrophe dix ans après le naufrage de
l'Exxon Valdez, notre participation, en novembre dernier, à un colloque qui réunissait en Amérique du Nord, des citoyens qui s'occupent de problèmes de sécurité maritime et la venue en France, en janvier dernier, des Alaskiens à l'occasion de l'assemblée générale du syndicat mixte ce qui leur a permis de visiter le littoral touché par le catastrophe de
l'Erika.
De cette coopération et de notre expérience juridique nous avons retenu la nécessité d'avoir une représentation des riverains dans les instances chargées de la sécurité et du transport maritime. C'est l'objectif qu'a poursuivi l'Alaska à travers une organisation dont je serai amené à parler tout à l'heure, c'est aussi celui que nous cherchons à atteindre depuis cinq ou six ans. Nous avons invité à notre assemblée générale, il y a un an, un certain nombre de régions qui ont été touchées comme la nôtre par des pollutions maritimes : c'est notamment le cas du pays de Galles, du Devon, de l'Ecosse et de la Galice espagnole ainsi bien sûr que celui de l'Alaska. Nous avons également rencontré au cours de nos voyages aux Etats-Unis des représentants de la Russie qui connaît, elle aussi, à vrai dire pas mal de problèmes de pollution !
Il s'agit donc en quelque sorte d'exposer et de mettre en pratique le droit d'ingérence des citoyens, des riverains à propos d'une activité qui influe sur leur propre activité, leur espace de vie, leur espace d'existence et de travail et sur leur patrimoine qu'est l'environnement. Nous réclamons donc également un droit d'ingérence des riverains sur le secteur du transport maritime.
La catastrophe de l'Erika nous confirme la nécessité et l'urgence de cette intervention. L'innovation majeure que nous souhaitons, c'est qu'un nouvel acteur intervienne dans la réglementation. Nous proposons un modèle qui est celui que nous avons connu en Alaska et que je voudrais vous détailler un peu. Il a été créé par une loi, l'Oil Pollution Act qui a accompagné en 1990 les
hearings, les auditions auxquelles il a été procédé aux Etats-Unis après la catastrophe de
l'Exxon Valdez et dont je dois souligner qu'elles sont très différentes de celles que nous connaissons ici dans la mesure où elles sont publiques et où elles se déroulent sur le territoire des habitants concernés. J'ai eu moi-même l'occasion d'y participer lors d'un de mes déplacements en Alaska. Par l'Oil Pollution Act a donc été créée une représentativité des citoyens du littoral concerné par les problèmes de transport maritime, dont le littoral du Prince Williams Sound où aboutit le gros pipe-line qui traverse tout l'Alaska et qui achemine le pétrole venant du Grand nord vers les mers qui sont libres à peu près toute l'année des glaces.
Cette organisation s'appelle le RCAC - regional citizen advisory council. Elle réunit des représentants des collectivités locales, c'est-à-dire des communes américaines et des tribus indiennes puisqu'il s'agit d'un territoire encore habité par un certain nombre de tribus d'une part, d'autre part des représentants des organisations professionnelles du tourisme et de la pêche deux secteurs très importants pour l'économie du pays ainsi que les associations écologistes et des citoyens qui peuvent être volontaires pour participer à cette organisation.
Cette structure reçoit un financement par la loi. Il est actuellement d'environ 15 millions de francs et a permis à cette association d'embaucher une quinzaine d'experts qui délivrent un avis autonome sur l'objet de l'association qui est de contrôler - et c'est très intéressant et cadre parfaitement avec nos préoccupations d'aujourd'hui - ce que fait l'administration d'une part et l'industrie d'autre part dans le domaine de la sécurité et du transport maritime.
Il s'agit donc d'un organisme indépendant financièrement représentant les citoyens du littoral qui peut et doit intervenir et donner son avis sur les politiques de l'Etat d'Alaska, de l'Etat fédéral et de l'industrie pétrolière et du transport maritime.
Nous souhaitons que la loi française crée un organisme comparable notamment en Bretagne nord-ouest qui est la région à plus hauts risques - le nombre de pollutions le prouve - et qui a déjà une structure, le syndicat mixte, qui regroupe les parties au débat. En effet, à travers ce syndicat nous représentons non seulement les collectivités locales, les communes, les départements mais aussi avec les professions maritimes avec lesquelles nous avons passé contrat, c'est-à-dire les pêcheurs, les ostréiculteurs, les professions touristiques, commerçants, accastilleurs et j'en passe, de même que les associations écologiques puisque les deux grandes associations la LPO et la SEPNB - Société pour l'étude et la protection de la nature en Bretagne - qui agissent sur ce territoire sont associées à nos travaux depuis une vingtaine d'années.
Poser la question en termes de sécurité du littoral et en termes de sécurité de ses activités et de son patrimoine environnemental revient aussi - et je tiens à le souligner - à se réapproprier le débat et à le démocratiser, car lorsqu'on le pose en termes de transport maritime international, on reste un peu dépendant de ce que vont faire les autres et c'est souvent un alibi que de dire nous voulons bien faire telle ou telle chose, mais nos partenaires ne sont pas sur la même longueur d'onde que nous et ainsi de suite... A l'inverse, il s'agit que les pouvoirs publics traitent les problèmes français, il s'agit de notre politique de défense nationale même si elle est civile, car il est question de la protection de nos activités, de notre littoral, de ses citoyens ; c'est un problème qui nous concerne, seuls, et justifie que des mesures soient prises uniquement par notre pays.
Tel est donc le premier point que je voulais souligner et j'en arrive au deuxième point qui a trait au principe pollueur-payeur.
A l'encontre de l'opinion commune, je trouve que c'est un principe dangereux. En effet c'est accepter de faire de l'argent le seul critère de la lutte antipollution et admettre qu'il est seul dissuasif contre les pollueurs éventuels. Tout d'abord, il convient de se poser la question de savoir de quel pollueur il s'agit et à quel niveau. En effet, quand on compare ce qui se passe en France et ce qui se passe aux Etats-Unis - je peux vous donner quelques chiffres concernant
l'Exxon Valdez - on constate que les choses sont totalement différentes !
Il faut savoir que, par rapport à ce que va éventuellement payer Total, la compagnie
Exxon a payé 2 milliards de dollars de nettoyage, puis a été pénalisée par des amendes de 1 milliard de dollars - une amende civile de 900 millions de dollars et une amende pénale de 100 millions de dollars - enfin, elle est actuellement sous le coup d'un jugement de première instance, qui est toujours en appel, pour 360 millions de dollars de dommages économiques et 5 milliards de dollars de dommages punitifs. Faites le calcul, on aboutit à plus de 20 milliards de francs de conséquences financières pour Exxon à la suite du naufrage de
l'Exxon Valdez . Si vous les comparez aux 500 ou 600 millions de francs que Total s'est éventuellement engagé à payer vous verrez qu'il y a une marge assez forte.
Il s'agit donc de se poser la question de savoir jusqu'à quel niveau peut aller le pollueur et cela reste de notre responsabilité : on pourrait mettre des amendes comparables ; il existe des dommages punitifs et des amendes conséquentes qui peuvent jouer sur ce principe pollueur-payeur.
Pour autant, l'une des conclusions des travaux que nous menons depuis vingt ans montre que c'est non pas l'indemnisation qui prévaut mais la prévention et donc la responsabilisation. Vous me permettrez de me référer là à l'exemple du FIPOL dont on a beaucoup parlé à propos de
l'Erika. Le FIPOL mérite que l'on s'y arrête un peu et que l'on réfléchisse à sa réforme.
En effet la politique du FIPOL qui est menée dans le cadre international à travers la
Civil liability convention (CLC) met au premier plan l'indemnisation avec pour résultat - je voudrais le démontrer - de déresponsabiliser l'ensemble de l'industrie du transport maritime !
M. le Président : C'est sûr !
M. Jean-Baptiste HENRY : En effet on met l'accent sur le fonds d'indemnisation qui a augmenté jusqu'à 1,2 milliard de francs et on se propose de l'augmenter encore ; on pense que c'est uniquement par l'argent que l'on va résoudre le problème mais on passe généralement sous silence les conditions dans lesquelles s'est faite cette augmentation du fonds d'indemnisation et les règles qui le gouvernent. Je voudrais les rappeler parce qu'elles sont importantes.
La responsabilité de l'accident est centrée sur le propriétaire nominal du navire dont vous savez tous que, dans les conditions actuelles d'évolution des structures de l'industrie du transport maritime et notamment avec les pavillons de complaisance, avec la déstructuration à travers des sociétés dont l'une va gérer le bateau coque nue et l'autre le bateau affrété, une troisième l'assurance, une autre encore le personnel, il est déresponsabilisé en raison de la pulvérisation des responsabilités.
La responsabilité est limitée, sauf faute intentionnelle ou inexcusable. Là, je voudrais souligner une évolution. Jusqu'en 1992, c'est-à-dire jusqu'au nouveau FIPOL, - celui que nous avions connu au moment de
l'Amoco - il fallait prouver la faute lourde et je crains que le fait que nous ayons gagné contre Amoco n'ait eu des conséquences sur ce point. Entre nous soit dit, prouver une faute inexcusable ou une faute intentionnelle devient quasiment impossible surtout avec les lois qui régissent la question des preuves en droit français...
A ce propos, je signale que l'une des raisons principales de notre action aux Etats-Unis dans le procès Amoco tenait à cette question des preuves, puisque la justice américaine permet d'aller très loin dans le domaine des investigations.
Pour en revenir à mon propos, je dirai que nous assistons, à travers le FIPOL qui met l'accent sur l'indemnisation et sur son niveau, à une déresponsabilisation, à la fois des autres acteurs du transport maritime en se concentrant sur l'armateur nominal et des armateurs eux-mêmes puisqu'ils savent que, dans la plupart des cas, ils pourront dorénavant limiter leur responsabilité. On aboutit ainsi à une sorte de droit à acheter la pollution et la réforme qui, à mon avis, s'impose, devrait tendre à une responsabilisation qui est plus importante que l'indemnisation.
A cet égard, je voudrais reparler des riverains. Vous savez certainement que sont représentés au FIPOL les Etats, l'industrie du transport maritime, les armateurs, les chargeurs, les assureurs, et tous les acteurs du monde maritime, y compris les représentants de Greenpeace, à l'exception des riverains alors que cet organisme traite des questions d'indemnisation et de sécurité. Je trouve que là aussi, et c'est l'un des objectifs de l'organisation internationale que nous voudrions mettre en place, les victimes ou les victimes potentielles devraient être représentées au sein de cette organisation.
Il est une troisième raison pour laquelle le principe pollueur-payeur me paraît devoir faire l'objet de réserves, c'est qu'on fait comme si tous les dommages étaient indemnisables ce qui est loin d'être vrai ! Nos régions sont des régions de PME, de petites entreprises familiales qu'il est très difficile de dédommager complètement pour des dégâts de ce type d'autant qu'elles travaillent à partir d'une ressource naturelle qui, elle, n'est pas indemnisée. Il existe les effets de répercussion en chaîne qui font que, très vite, on arrive aux dommages indirects qui ne sont indemnisés ni par le FIPOL, ni par la justice française. Il y a aussi les dommages écologiques qui ne sont pas actuellement acceptés en terme d'indemnisation pas plus que les pertes d'aménités, à savoir les dérangements et perturbations causés par une marée noire, par exemple, ou l'image de marque et les effets de répétition. Il faut penser à l'effet de répétition sur la Bretagne de marées noires et de diverses pollutions et à leurs conséquences sur la confiance des investisseurs, par exemple pour une région qui risque de recevoir tous les trois ou quatre ans une marée noire ou de subir - dieu nous en préserve - les effets d'autres produits dangereux qui circulent sur la voie maritime qui longe nos côtes.
Je voudrais donc souligner que tous les dommages ne sont pas indemnisables et en guise de provocation, je voudrais savoir ce que vous diriez si on posait comme principe la formule : « violeur-payeur ». En effet, l'industrie maritime viole en quelque sorte le littoral, ses activités, ses habitants par les répercussions négatives qu'elle a.
J'en viens à ma conclusion : il y a selon moi trois rééquilibrages à opérer.
Premièrement, le rééquilibrage entre la sécurité du transport maritime et celle du littoral. C'est une action nationale qui doit le permettre : c'est notre politique de défense du territoire qui est en cause.
Deuxièmement, le rééquilibrage entre la prise en charge de sécurité du littoral par l'Etat et la possible participation des citoyens riverains et des collectivités locales aux décisions sur la gestion de ce littoral : rappelons que s'il y a bien un secteur qui n'a pas été touché par la décentralisation, c'est bien celui du littoral et de sa gestion.
Troisièmement, le rééquilibrage de la réparation qui n'est pas une seule question d'argent et qui implique de donner un moyen d'action aux victimes pour qu'elles se saisissent des problèmes de responsabilité, des risques et des conséquences du trafic.
Il s'agit donc non pas d'édicter de nouvelles réglementations mais essentiellement de « changer de point de vue » : en breton on dit « chanch penn d'ar vaz » prendre le bâton par un autre bout; c'est ce que nous proposons de faire. Les décisions dépendent de nous et permettent donc un débat démocratique en France et qui ne nécessite pas l'aval international !
M. le Président : C'est sans doute la première fois que le breton figure comme langue officielle du moins partielle d'une commission d'enquête !
(Rires )
M. le Rapporteur : Je voudrais faire simplement quelques observations car je connaissais la teneur des propos qui viennent d'être tenus et j'avoue souscrire à un certain nombre de conclusions. je voudrais poser deux questions à M. Henry et une à M. Arzel.
M. Henry, concernant le principe pollueur-payeur et plus globalement le FIPOL, est-ce que vous estimez que les propositions faites récemment par le ministre des transports sont, si bien sûr elles sont suivies d'effets, intéressantes et susceptibles de faire progresser la conception qu'on peut avoir de l'indemnisation ?
Par ailleurs, comment envisagez-vous au niveau international l'application du droit d'ingérence des collectivités concernées ? L'Oil Pollution Act est, en effet, rendu possible parce qu'il existe un dispositif particulier aux Etats-Unis : au niveau européen les choses sont différentes puisqu'il n'existe pas de réglementation unique aussi forte - peut-être y en aura-t-il un jour du fait de
l'Erika - et comment envisagez-vous la mise en oeuvre de cette disposition ? Passera-t-elle par une plus grande reconnaissance de la Conférence des régions périphériques maritimes (CRPM) au niveau international - cela peut être une hypothèse -, les Etats peuvent-ils prétendre à représenter les populations concernées, ce qui est le cas aujourd'hui mais reste manifestement insuffisant ? Comment voyez-vous la chose ?
M. Arzel vous avez dit, en commençant votre exposé, que beaucoup de choses avaient été faites depuis 1978 et que l'action menée alors a sans doute permis d'éviter d'autres catastrophes ; quel est votre sentiment sur les insuffisances majeures de l'action de l'Etat aujourd'hui en matière de prévention ?
M. Alphonse ARZEL : Je crois que ce qui manque chez nous, c'est un système de contrôle tel qu'il en existe dans d'autres pays.
Bien sûr, on a laissé entendre que l'on allait doubler le nombre de contrôleurs pour vérifier l'état des bâtiments, mais j'entendais hier un commandant de pétrolier ayant navigué pendant de longes années à travers le monde, dire à la radio qu'en Europe il y avait une très grande souplesse quant aux contrôles et que ces derniers étaient sans commune mesure avec ceux qu'effectuaient les
coast guards aux Etats-Unis. Si nous voulons apporter plus de sécurité il faut que ce problème soit réglé. Je ne sais pas même si un doublement du nombre des contrôleurs suffira, car il faut que les navigants sachent qu'ils doivent aussi répondre aux exigences relatives à l'entretien des navires.
Au cours de l'enquête concernant l'Amoco-Cadiz,
nous avons découvert la raison du naufrage. Il ne se serait pas produit si le gouvernail avait fonctionné correctement. Si le bateau avait été contrôlé alors qu'il se trouvait encore éloigné de nos côtes, il est vraisemblable que la catastrophe aurait été évitée... Il faut savoir qu'un tel bateau, une fois lancé en mer, chargé comme il l'était, avait besoin de cent kilomètres pour s'arrêter. Son commandant pensait qu'il était dans la bonne direction et qu'il lui suffisait d'aller en ligne droite pour atteindre l'Angleterre qui était son point de destination, mais c'était compter sans la tempête qui a tellement balloté le géant qu'il a fini par atterrir à Portsall, dans ma commune. Il est difficilement imaginable qu'un tel engin ait pu, avec la tempête, être ainsi drossé vers la côte, faute de gouvernail pour se diriger.
Pour répondre à votre question, il est vrai qu'il y a là un énorme travail à accomplir car nous pouvons rechercher un tas de solutions mais la meilleure reste la prévention qui consiste à faire en sorte que tous les moyens soient mis en _uvre pour empêcher les accidents.
Je sais que les choses se sont améliorées au niveau des remorqueurs mais il nous faut être attentifs aux besoins de ceux qui sont appelés à intervenir en cas de danger ; peut-être que, pris plus tôt, l'Erika ne se serait jamais fracturé en deux,
mais c'est un autre problème !
M. Jean-Baptiste HENRY : Je vais m'efforcer de répondre à vos questions, mais, en ce qui concerne la première, je dois avouer que je ne connais pas dans le détail les principales mesures proposées par le ministre des transports !
M. le Rapporteur : Il s'agit d'une augmentation du fonds, donc du montant de l'indemnisation, et surtout d'une articulation entre les cotisations, l'âge et la qualité des navires puisqu'un des aspects pernicieux du système actuel veut que chacun s'assure quel que soit le type de navire. Avec les nouvelles mesures, il y aurait une forme de responsabilisation du chargeur, la contribution étant proportionnelle à l'âge et à la qualité du bateau.
M. Jean-Baptiste HENRY : Pour moi, ainsi que j'ai tenté de le montrer au cours de mon exposé, l'essentiel c'est que le FIPOL serve à responsabiliser et non pas à indemniser. L'indemnisation vient au second plan et le problème principal demeure la prévention et la responsabilisation. Tout le problème consiste donc à définir comment assurer à travers un organisme international qui a pour bras séculier l'argent et l'indemnisation, une responsabilisation des acteurs du transport maritime. Au nombre de ces derniers, il y a les Etats qui ont leur responsabilité, par exemple au niveau des contrôleurs, des stations de dégazage, des investissements portuaires : il ne faut quand même pas éliminer la responsabilité des Etats ! C'est ce qui me paraît être le problème principal !
Pour ce qui a trait à votre seconde question sur la façon d'appliquer le droit d'ingérence, je distinguerai deux aspects. Premièrement, au plan national où au niveau de l'Etat et de son organisation, nous sommes libres d'intégrer ou non des représentants d'organisations ou de régions particulièrement soumises aux problèmes liés à l'insécurité du transport maritime telles que la Bretagne, dans les structures permettant de discuter du sujet à la fois au niveau national et international. Je suis peut-être naïf, mais pourquoi n'y aurait-il pas des représentants de la Bretagne ou de sa côte nord-ouest associés aux réunions traitant des problèmes de sécurité du transport maritime ? Pourquoi des représentants de ces régions n'assisteraient-ils pas les représentants français au niveau des assemblées générales du FIPOL ? Personnellement, je ne vois pas pourquoi cela ne pourrait pas se faire... Au plan national, nous pouvons faire ce que nous voulons en donnant une représentativité à un certain nombre de régions et je pense qu'il est possible de commencer par des régions qui se sont responsabilisées. En disant cela, je réponds un peu à votre question par rapport au CRPM. Le CRPM reste à un niveau assez général par rapport à une organisation comme le syndicat mixte qui regroupe vraiment les gens qui ont « les pieds dans l'eau » si j'ose dire, qui ont les pieds sur le littoral et qui sont directement concernés par les répercussions que peuvent avoir sur leur activité et leur environnement les problèmes du transport maritime.
Au niveau français, il appartient finalement aux politiques de décider s'ils intègrent ou non des représentants des littoraux concernés ; quant au niveau international, il est vrai que notre action au niveau du syndicat mixte a été aussi de nous responsabiliser et la coopération que nous avons engagée avec l'Alaska, les réunions que nous avons organisées avec d'autres régions également victimes de la pollution vont dans le sens d'une organisation internationale. Si nous parvenions à mettre sur pied une organisation des régions polluées, nous demanderions évidemment à intervenir au niveau des organismes internationaux pour les représenter.
M. le Président : Je vous propose d'aborder le commentaire du schéma que vous nous avez remis avant de passer aux questions des intervenants.
M Jean-Baptiste HENRY : J'ai fait ce schéma pour clarifier mes idées sur les rapports qu'entretiennent les habitants avec un littoral et les répercussions que peut avoir une pollution sur ce littoral.
On voit que la pollution arrive sur un espace littoral qui a globalement deux fonctions : une fonction cadre de vie, écosystème qui est le pays et une fonction lieu d'activité et de mise en valeur de ressources avec deux rapports différents entre les habitants et cet espace : des rapports d'appropriation pour ce qui est des activités et de mise en valeur et des rapports d'appartenance pour ce qui est du cadre de vie et du pays lui-même.
Avec cette distinction, cette population entretient également des rapports d'usage pour ce qui est du cadre de vie et des rapports marchands pour ce qui est de l'activité et de la mise en valeur des ressources. Que se passe-t-il en cas de pollution ? Une pollution se traduit, d'un côté par une perte de potentialités et de rendement des ressources, c'est-à-dire des dommages économiques qui touchent les moyens de vivre de cette population, mais d'un autre côté - et c'est ce que j'ai voulu souligner précédemment - elle induit des atteintes géomorphologiques animales, biologiques, paysagères du littoral qui sont une sorte de bouleversement de la vie littorale, - j'ai employé le mot viol - et une sorte d'annexion par une autre activité d'un territoire qui n'est pas le sien - et c'est là ce que j'appelle les raisons de vivre par rapport aux moyens de vivre !
Les solutions ne sont pas les mêmes dans les deux cas, ni bien sûr le rapport à la pollution : d'un côté, on est moins bien et de l'autre on a moins ! Par conséquent, les répercussions en termes d'action sont pour moi d'une part judiciaires par le biais d'une action en réparation des dommages et des pertes de potentialités et de ressources subies, la victoire devant se traduire par une restauration financière - et tout ce que nous avons observé à la suite du naufrage de l'Erika
le confirme -, d'autre part politiques par le biais d'une action de défense et de prévention, la victoire devant, cette fois, se traduire par un accroissement des droits de cette population.
Tels sont les deux points que j'ai voulu mettre en avant dans ce schéma qui me semble confirmé par toutes les manifestations, l'intérêt et l'émotion qui ont accompagné le naufrage de l'Erika,
tout le problème étant de faire en sorte que ces phénomènes ne soient pas seulement conjoncturels mais qu'ils soient organisés pour être permanents.
Mme Jacqueline LAZARD : Je voulais vous demander ce qu'il adviendrait du syndicat
Amoco, étant entendu que le syndicat mixte a été mis en place pour défendre les intérêts des collectivités locales et de la population. La procédure s'est terminée après une longue bataille ; envisagez-vous de maintenir la structure, quitte éventuellement à la modifier au niveau statutaire et si oui pour quoi faire ? S'agit-il de faire de la prévention - nous avons obtenu quelques éléments de réponse à travers les propos de M. Henry sur l'intérêt et la nécessité qu'il y aurait à ce que les riverains soient intégrés dans les structures de lutte - pour rester en état d'alerte et être immédiatement réactifs en cas de problème puisque l'on a noté la lenteur des procédures après le naufrage de l'Erika
ou encore de conseiller si de nouvelles catastrophes devaient survenir ? Quels seraient vos objectifs ?
M. Alphonse ARZEL : Les objectifs poursuivis à travers le syndicat mixte était de mener le procès contre les pollueurs. Il est vrai que lorsque tout a été terminé, nous avons décidé de modifier l'objet du syndicat mixte dont nous souhaitons qu'il continue pour mettre en place toutes les mesures que Jean-Baptiste Henry vient d'évoquer. Pour ce faire, il faut une structure et nous avons estimé que la structure d'un syndicat mixte est peut-être la plus adaptée pour mener de telles actions. En effet, comme vous le savez, si un syndicat mixte ne lève pas d'impôts directement, il reçoit les moyens de son financement par les collectivités adhérentes, ce qui nous a permis, lorsque nous nous trouvions en grande difficulté, de financer le procès de l'Amoco.
L'idée n'a pas jailli comme cela et il nous a fallu des années pour découvrir que la structure que nous avions mise en place au départ, qui reposait sur la loi 1901 et qui n'avait pas de moyens financiers, nous faisait dépendre de la générosité des uns ou des autres selon la formule « à votre bon c_ur messieurs dames ! » Ces structures qui s'appelaient à l'époque des comités de coordination et de vigilance portaient un beau nom mais sans moyens elles étaient vouées à l'échec !
Ce n'est que lorsque nous avons adopté la formule du système mixte, sur les conseils du ministre du budget de l'époque, Michel Charasse, à qui nous nous étions ouverts de nos difficultés, que nous avons pu aller de l'avant. Nous comptons dans ce syndicat 90 communes qui toutes ont été sinistrées au moment de l'affaire de l'Amoco plus deux départements et des membres associés.
Nous avons estimé qu'il fallait conserver cette structure. Maintenant, comme quelques-uns parmi vous devraient participer cet après-midi à la mise en place d'une structure nouvelle, nous observerons ce qui va se passer : si trois régions se mettent ensemble pour bâtir quelque chose cela nous intéresse. Nous avons fait modifier nos statuts en changeant l'objet du syndicat qui initialement devait permettre le bon déroulement de la procédure de l'Amoco, en précisant qu'il vise maintenant « à coordonner et à unir les moyens de chaque collectivité adhérente pour effectuer ou faire effectuer toutes études et recherches en vue d'apprécier les atteintes subies par le littoral, les riverains et leurs intérêts du fait des pollutions et d'autres risques liés à la circulation maritime afin de déterminer les travaux et actions nécessaires à la restauration, la remise en état et la réparation des dommages ».
Cela répond à votre question sur ce que nous allons faire ; mais de plus, nous allons « mettre en _uvre tous moyens légaux y compris les actions judiciaires tant en France qu'à l'étranger afin de déterminer les responsabilités des pollutions ou autres atteintes et d'obtenir l'indemnisation et la réparation des dommages subis ». Nous allons encore « agir en tout lieu nécessaire avec tout partenaire tant français qu'étranger pour la protection du littoral, des riverains et de leurs intérêts », nous fondant un peu en cela sur l'expérience des Alaskiens.
On nous reproche de faire de l'ingérence dans des affaires qui ne nous regardent pas. Nous pensons qu'au contraire c'est en agissant de la sorte que nous pouvons pousser le politique à prendre des mesures parce que, finalement, ce que nous attendons de vous, parlementaires, c'est que vous puissiez agir demain pour nous permettre d'atteindre nos objectifs. Nous sommes en quelque sorte la mouche du coche.
Puisque nous parlions tout à l'heure des relations avec les autres régions, j'ajouterai qu'il faut trouver le moyen de leur permettre de se retrouver. Quelqu'un a évoqué la CRPM, c'est une structure qui existe, mais, pour avoir participé à son lancement, j'avoue qu'elle semblait un peu importante compte tenu du fait que plus on s'éloigne du centre de nos intérêts plus ils sont difficiles à gérer. Il faudrait donc trouver une structure qui garde taille humaine ; c'est le cas de l'organisation que nous avons adoptée avec nos collègues, qu'ils soient écossais, gallois, alaskiens, espagnols ou même russes puisque nous avons découvert avec stupéfaction ce qui se passe en Russie. Nous avons besoin de faire connaître nos problèmes et de faire profiter les autres de notre expérience.
M. Edouard LANDRAIN : Je vais rester sur le thème que vient d'évoquer Alphonse Arzel : nous nous apercevons que l'exemple de l'Alaska est sans doute un bon exemple...
M. Alphonse ARZEL : Oui !
M. Edouard LANDRAIN : ... à la fois par la rigueur, la façon de traiter le problème et ses débouchés. L'Alaska est un Etat américain et jouit d'une certaine indépendance par rapport au système fédéral que nous n'avons pas en France et en Bretagne d'où ma question qui est simple : quelle a été la force de persuasion de l'Alaska vis-à-vis de l'Etat fédéral, après avoir utilisé les recours normaux quant à la pollution classique, pour obtenir un certain nombre de règles désormais applicables à l'ensemble du territoire américain moyennant quelques nuances ? J'aimerais savoir ce que cet exemple a pu vous apporter.
Par ailleurs, on se rend compte, surtout en ce qui concerne le territoire de la Manche, qu'il s'agit véritablement d'un territoire européen et que, même si les populations sont représentées, même si les provinces sont représentées, même si elles font preuve de tonicité, le problème nous dépasse et qu'un certain nombre de choses doivent être traitées à l'échelon européen. En conséquence, j'aimerais savoir quelles ont été vos relations à l'échelon européen : ont-elles pu déboucher sur un certain nombre de contestations, de règles communes allant vers une loi commune, avez-vous senti que des progrès se manifestaient à ce niveau ou au contraire que vous étiez perçus comme des indésirables et que l'Etat central aurait préféré que vous lui laissiez carte blanche dans les négociations ?
M. Alain GOURIOU : Je voudrais revenir sur un point que le président Arzel et M. Henry ont abordé pendant leur exposé, je veux parler de l'évolution en matière d'organisation du transport des hydrocarbures. Les exemples de l'Amoco-Cadiz
ou de l'Exxon Valdez illustrent la pratique qui avait cours il y a quelques années et qui consistait pour les grands industriels pétroliers à assurer le transport par une sorte d'intégration verticale depuis l'extraction jusqu'au raffinage en passant par le transport ce qui, incontestablement, ciblait et faisait apparaître les responsabilités en cas d'accident. Aujourd'hui, à l'évidence les grands trusts pétroliers internationaux n'assurent plus eux-mêmes ces transports : leur flotte pétrolière passe sous d'autres pavillons, d'autres systèmes de gestion, si bien que lorsque survient un accident comme celui de l'Erika,
on a toutes les peines du monde à déceler les responsabilités qui se sont « pulvérisées » pour reprendre le terme de M. Jean-Baptiste Henry.
Face à cette évolution qui a pour conséquence évidente de retirer les responsabilités des grands industriels pétroliers, ne pensez-vous pas que des solutions juridiques nationales et internationales s'imposent pour engager de manière importante la responsabilité des propriétaires de chargements d'hydrocarbures, c'est-à-dire les grands trusts ? En effet, on s'aperçoit au fil de nos auditions qu'il ne va pas être facile de désigner les responsables du naufrage de l'Erika
et surtout, ensuite, de les faire payer, puisqu'il apparaît aujourd'hui que la responsabilité de Total n'est pas juridiquement si évidente à prouver alors que dans le cas de
l'Amoco-Cadiz et de l'Exxon Valdez les responsabilités incombaient à des groupes industriels considérables qui, on l'a vu, ont payé ! Aujourd'hui, je ne suis plus certain que la compagnie Exxon serait amenée à payer des sommes aussi fabuleuses.
Enfin, vous avez cité le cas des Etats-Unis, en soulignant l'efficacité de leur système de
coast guards, il faut dire aussi que pour l'Amérique du Nord, on trouve trois partenaires - le Canada, les Etats-Unis et le Mexique - et qu'il est plus facile de s'arranger à trois qu'à quinze, voir plus, comme ce devrait être le cas pour la Manche.
Est-ce une solution complètement utopique que de proposer que ces transports d'hydrocarbures qui nous causent tellement de soucis soient purement et simplement interdits en Manche ? Ne peut-on pas envisager des terminaux pétroliers à l'entrée de la Manche, le pétrole circulant ensuite par terre, via pipe-lines vers sa destination finale ?
Je sais bien que M. le député du Havre n'y trouvera peut-être pas complètement son compte, mais je me demande, en raison du nombre d'incidents et d'accidents évités, si cela ne serait pas une solution de sagesse.
M. Alphonse ARZEL : Nous reconnaissons humblement que notre influence est quand même limitée et que ce n'est pas une petite structure comme la nôtre qui a pu faire tâche d'huile...
M. Alain GOURIOU : C'est le cas de le dire ...(Rires.)
M. Alphonse ARZEL : Cela étant, nous reconnaissons que nous n'avons peut-être pas su man_uvrer - je ne dirai pas godiller - pour aller vers Bruxelles. Nous n'avons peut-être pas assez tenu à mettre l'Europe au courant de ce que nous faisions : nous n'avons même sollicité aucune aide quand nous étions en grande difficulté pour financer notre procès, car nous étions sans doute trop braqués sur le résultat du procès qui était quand même exceptionnel. Mettez-vous à la place de ces élus qui ont décidé un jour qu'il fallait aller témoigner devant un juge à Chicago : certains maires qui n'avaient jamais pris l'avion ont décollé de Brest via Roissy pour Chicago qui est une ville qui n'est pas comparable aux nôtres. Quel stress pour tous ces élus d'autant qu'il se doublait encore du souci de bien défendre les intérêts de la commune sous peine de se voir sanctionner aux élections municipales !...(Rires.)
Vous riez mais c'était vraiment une situation difficile. Nous étions là pour les soutenir, mais nous reconnaissons que nous aurions pu faire autre chose et notamment nouer plus de contacts.
Maintenant nous souhaitons changer de direction et faire connaître un peu nos objectifs ! Quoi qu'il en soit, nous avons trouvé un écho favorable auprès de tous ceux que nous avons eu l'occasion de rencontrer. Lors de la commémoration du vingtième anniversaire de l'accident de l'Amoco-Cadiz,
nous avons invité les Alaskiens, car entre nous il est vrai qu'il y a eu immédiatement osmose d'autant que c'est nous qui leur avons soufflé ce qu'ils devaient faire... Ils ont réussi mais l'idée venait de nous et nous savons que si nous devions faire la même chose, ce serait certainement plus difficile !
Par ailleurs, il faut savoir que lorsque nous nous tournions vers tel ou tel responsable, nous nous heurtions parfois à des refus de collaboration au nom de l'ingérence. Les Britanniques du Devon, par exemple, parce qu'il y a des relations entre un district du Devon et la communauté de communes de ma région nous avaient invités à un colloque, mais au dernier moment il a été annulé du fait d'interventions de l'Etat qui a invoqué l'ingérence. Nous devons faire preuve de prudence et nous n'avons pas toujours pu nouer les contacts que nous aurions aimés parce que nous sentions que certains élus craignaient de faire des faux pas : il faut savoir que si nous nous plaignons de ne pas être suffisamment libres dans notre pays, nous vivons dans des conditions bien meilleures que nos voisins d'outre-Manche !
Nous aurions souhaité avoir plus de contacts mais nous sentons que nous pouvons y parvenir parce que partout se manifeste le souhait de pouvoir collaborer à un travail de prévention. Il faudra s'unir pour imposer plus de mesures en faveur de la prévention. Quand le pétrole part en mer c'est toujours par tempête et si le CEDRE (Centre de documentation, de recherches et d'expérimentation sur les pollutions accidentelles des eaux) de Brest a été critiqué, il faut reconnaître qu'il fait son possible avec les moyens qui sont les siens : la critique est facile mais les choses sont plus compliquées qu'il n'y paraît !
M. Jean-Baptiste HENRY : Sur le problème de l'Alaska, l'influence a été inverse de celle que vous évoquiez puisque c'est la politique générale des USA, de l'Etat fédéral, qui a permis de mettre en pratique le système qui fonctionne en Alaska et ce ne sont pas les réactions de l'Alaska qui ont influencé la politique de l'Etat fédéral. Pourquoi ? Pour deux raisons.
Premièrement, la catastrophe de l'Exxon Valdez
a suscité un émoi considérable, dont nous pouvons prendre ici la mesure avec celle de l'Erika,
dans l'opinion publique américaine : c'était vraiment la première grosse catastrophe que les Américains, qui s'intéressent essentiellement à ce qui se passe chez eux, enregistraient sur leur territoire. Pour la première fois, ils se trouvaient dans « le caca » si vous me permettez cette expression et ils ont réagi violemment, y compris par le biais de manifestations et d'autres actions publiques !
Deuxièmement, il est un élément qui n'a peut-être pas été suffisamment souligné, il ne faut pas oublier que l'Alaska est un pays producteur de pétrole et que le problème de l'époque, à la fin des années quatre-vingt, consistait à savoir si les Etats-Unis allaient mettre en exploitation de nouveaux territoires dans les zones vierges ou considérées comme hors d'atteinte de l'économie de l'extrême nord alaskien, au-delà du cercle polaire. Tel était donc l'enjeu avec la pression de l'ensemble l'industrie pétrolière et tout le problème de l'approvisionnement national et de sa sécurité était alors posé. C'est donc pour pouvoir favoriser l'exploitation de ces nouveaux territoires en produits pétroliers qu'il fallait donner des garanties à la population et aux écologistes en prenant le maximum de précautions, en intégrant de plus en plus la population dans les problèmes de sécurité.
Il faut bien prendre conscience qu'il y avait cet enjeu et c'est pourquoi il ne faut, ni diaboliser, ni encenser les Américains : il y avait simplement de très forts enjeux économiques qui se résumaient au problème de l'exploitation pétrolière du Grand nord. Telle sera ma réponse à votre première question !
Pour ce qui a trait à la seconde question, elle rejoint un problème également soulevé par Alain Gouriou, à savoir celui de la Manche. Je trouve que vous avez parfaitement raison de le poser comme tel. Il existe un détroit ou un couloir de navigation qui mérite une politique globale et non pas au coup par coup, au fur et à mesure que s'y multiplient les accidents. En effet, on aboutit ainsi à empiler des législations conjoncturelles qui sont fonction du type d'accidents survenus au fil des ans. Il faut, selon moi, conduire - peut-être votre commission pourrait-elle le suggérer - une étude du trafic en Manche, des gains qu'il apporte. Certains ensembles industriels vivent grâce à la facilité que représente la Manche pour le transport, certains pays vivent du trafic maritime en Manche, d'autres tels que nos régions n'en recueillent que les nuisances... Il faut d'abord dresser un bilan de la situation !
Ensuite, il faut faire une analyse des trafics et de leur évolution au moins sur trente ans pour définir l'enjeu actuel du trafic, son augmentation, ses risques - on sait pertinemment qu'il est de plus en plus dangereux - en fonction du type de produits qui y passent.
Enfin, il faut analyser les accidents et les alertes parce que je pense que l'on trouverait, à travers les statistiques, des périodes durant lesquelles ces accidents ou ces alarmes surviennent plus fréquemment, ce qui permettrait de définir les périodes à hauts risques. Ce genre d'étude serait plus utile qu'une politique conjoncturelle accident par accident. Pour répondre à la suggestion d'Alain Gouriou, il serait souhaitable de décider qu'à partir du moment où les vents atteignent une certaine force - je ne sais comment mettre la mesure en place même si elle est pratiquée en Alaska, il me semble à partir d'une force 6 ou 7 sur leur échelle - d'arrêter le trafic. Comme en Bretagne les accidents sont toujours survenus en cours de tempête, je pense qu'il serait bon d'établir des statistiques des accidents et des alarmes qu'il y a eu depuis vingt ans et en fonction des résultats de fermer le trafic ou, sans aller jusqu'à la proposition d'Alain Gouriou au vu de l'intérêt économique pour notre région, d'arrêter provisoirement le trafic en Manche, de prévoir des zones de repos - je pense à la baie de Douarnenez, à la baie de Brest - pour des arrêts provisoires d'activité.
M. le Président : Alain Gouriou va être interdit de séjour !
M. Alain GOURIOU : J'admets que mon propos était un peu provocateur, M. le président !
M. Jean-Baptiste HENRY : Pour aller dans son sens, je rappelle quand même que la désintégration du trafic pétrolier qui représente environ 45 % du trafic mondial est allée jusqu'à 60 % de bâtiments naviguant sous pavillon de complaisance contre quasiment 10 % dans les années soixante-dix.
M. Alain GOURIOU : Le désengagement des trusts pétroliers en matière de transport me paraît effectivement être une redoutable dérive dès lors qu'il s'agit de désigner des responsables.
M. Jean-Baptiste HENRY : Si je peux me permettre de rebondir sur cette remarque, ce sont les Etats qui ont permis ce genre de transferts. Il y a eu deux transferts : celui qui est le plus visible et qui s'est opéré vers les pavillons de complaisance et celui que vous indiquez qui est relatif au désengagement des pétroliers et plus encore au développement d'une flotte de transport qui n'a aucune tradition maritime. Il faudrait aussi regarder de temps en temps qui reçoit le trafic maritime mondial et à qui bénéficie le trafic pétrolier : on trouvera que ce sont les pays développés. Il faut évaluer nos responsabilités et les étudier avant de tout rejeter sur les pavillons de complaisance ou même sur l'industrie pétrolière.
M. Kofi YAMGNANE : Je voulais poser la question qui a été celle de notre collègue M. Landrain, mais je voudrais rebondir sur le sujet de l'harmonisation européenne. En effet, lorsque vous dites que la responsabilité est celle de l'Etat français, il reste à savoir comment agir au niveau européen. Interdire ou prévenir dans la limite des eaux territoriales françaises passe encore, mais les accidents surviennent la plupart du temps quand les bateaux sont déjà en dehors. Dans le cas où ils se trouvent dans des eaux territoriales européennes, comment parvenir à une articulation entre la réglementation nationale et la réglementation européenne ?
Par ailleurs, M. Arzel, quel rôle va jouer le syndicat mixte que vous avez créé maintenant que le procès pour l'Erika va débuter ? Est-ce qu'au titre des départements du Finistère et des Côtes d'Armor - en termes de solidarité puisque les Côtes d'Armor ne sont pas atteintes cette fois-ci - le syndicat va se porter partie civile ? Quelle va être sa position ?
M. Pierre HERIAUD : Mes observations vont être d'un tout autre ordre. Nous avons entendu des témoignages sur le résultat d'une action longue assortis de propositions d'intégration de nouveaux opérateurs dans la chaîne d'action notamment en prévoyant un droit d'ingérence des riverains.
Mes remarques qui sont d'ordre méthodologiques concernent votre schéma : je sais que la tendance est de tout systématiser mais partant du schéma de l'impact d'une pollution marine - il y a d'autres sortes de pollutions - vous regroupez dans un espace littoral une population et aussitôt une dichotomie apparaît entre ceux qui seraient les consommateurs et ceux qui seraient les producteurs. On aboutit ainsi à avoir d'un côté, en action politique, la défense et la prévention qui sont, il est vrai, l'aspect premier puisque c'est celui auquel nous nous attachons, et de l'autre côté, tout l'aspect économique avec pour solutions des actions judiciaires venant combler les pertes économiques.
La présentation est bonne, mais elle est peut-être - et vous me donnerez votre avis sur ce point - un peu simpliste. Pourquoi ? Parce que lorsque nous avons à légiférer sur un ensemble, il y a de plus en plus d'études d'impact mais on ne voit pas comment des études d'impact feraient autant de dichotomie entre ce qui est l'action consumériste et l'action de production. C'est beaucoup plus un ensemble d'interactions qui jouent de même qu'au sein de la population, on trouve intimement mêlés les gens de l'être et de l'avoir. Il ne faudrait pas aller trop loin dans de telles dichotomies idéologiques en quelque sorte.... Quel est votre sentiment sur cette question ?
M. François CUILLANDRE : En tant que vice-président du syndicat Amoco, je suis en parfait accord avec ce qu'Alphonse Arzel et Jean-Baptiste Henry ont pu dire sur le droit d'ingérence et sur la représentation des populations du littoral ainsi que sur le constat positif de l'expérience menée en Alaska.
Je voudrais rebondir sur la transposition de cette expérience sur notre continent dans la mesure où - et nous avons eu l'occasion d'en parler à plusieurs reprises - notre rapport au pétrole est totalement différent. Le gouvernement américain avait besoin de poursuivre l'exploitation pétrolière en Alaska, ce qui lui imposait de régler, y compris par la loi, les problèmes, mais les populations de l'ouest de la Bretagne qui voient passer les bateaux, et éventuellement leurs cargaisons, devant leurs côtes n'ont pas ce rapport humain et financier par rapport au pétrole, ce qui pose la question de savoir comment ces populations riveraines pourraient être entendues et associées.
M. Alphonse ARZEL : Nous avons des idées mais il faut les exploiter et on ne peut pas toujours décider de la façon dont nous allons travailler demain même si l'objectif reste tracé. Personnellement, j'attends de savoir ce que va faire la structure qui va être installée cet après-midi par les trois régions de l'Atlantique : la Bretagne, les Pays-de-Loire et le Poitou-Charentes. Nous devrons nous situer par rapport à une structure beaucoup plus large et différente, puisque c'est une association loi 1901 qui va être constituée.
Nous pourrons peut-être la faire bénéficier de notre expérience, mais il faut qu'elle reste proche du littoral et des habitants et qu'elle n'atteigne pas une taille telle qu'elle soit appelée un jour à se diluer jusqu'à sombrer dans l'oubli comme cela a été le cas des villes jumelées au niveau européen qui a duré deux ans : nous avons appris par expérience qu'il nous faut être pragmatiques dans la vie, que tout projet lancé doit conserver taille humaine si on veut le mener à bien.
Beaucoup de sujets méritent réflexion et ce n'est pas le modeste président qui peut apporter réponse à tout. Nous avons la grande chance d'avoir Jean-Baptiste Henry à nos côtés, mais peut-être que demain, au sein d'une structure différente, nous nous verrons obligés d'investir dans du personnel qualifié et des experts un peu comme l'ont fait les Alaskiens.
M. Kofi YAMGNANE : Vous pourrez toujours dire quel avocat ne pas prendre...
M. Alphonse ARZEL :. Je n'oserai jamais, car je ne veux pas me trouver de nouveau devant le tribunal !
M. le Rapporteur : Nous allons le recevoir : nous sommes très ouverts !
M. Alphonse ARZEL : Il vaudra mieux ne pas être là !
M. le Rapporteur : Il y aura un rapport !
M. Jean-Baptiste HENRY : Pour répondre à la question sur l'harmonisation des politiques nationale et européenne, je dirai que, lorsque je pose le problème en termes de sécurité du territoire, c'est précisément pour bien montrer que l'Etat peut avoir une politique tout à fait autonome s'il adopte ce point de vue et qu'il peut prendre un certain nombre de décisions concernant le trafic maritime.
Concernant les responsabilités de notre pays par rapport à la politique européenne, je vais reprendre une expression que j'avais déjà employée : je pense que l'on peut aussi prendre des mesures « unilatérales » et j'emploie volontiers l'image du cercle vertueux en opposition à celle du cercle vicieux. Le cercle vicieux consiste à dire que si l'on prend une décision, elle se traduira par des choses négatives et qu'il faut attendre que tout le monde se mette d'accord alors que je prétends qu'il y a des exemples vertueux où des décisions sont prises de façon positive et entraînent les autres dans ce sens. Qui dit, par exemple, si la France prenait une décision quant au renforcement des contrôles dans les ports, et si le trafic diminuait pendant quelques mois au profit de ports étrangers, que l'opinion publique des autres pays européens ne se rangerait pas de son côté ? A mon avis on peut parier sur ce cercle vertueux...
M. le Président : Je n'en suis pas sûr !
M. le Rapporteur : Moi non plus !
M. Jean-Baptiste HENRY : Ce n'est pas sûr mais je tiens le pari ! Vous demandez si le syndicat mixte se portera partie civile. Il se trouve que le syndicat mixte est en train de changer de statuts. Il est encore régi par les anciens statuts qui ne l'autorisent qu'à agir pour l'affaire de l'Amoco-Cadiz.
Donc, au niveau des statuts, il ne peut pas être partie civile dans le procès qui pourrait éventuellement avoir lieu concernant l'Erika.
A ce propos, je rappelle que le changement des statuts du syndicat suppose que chaque commune et chaque département délibèrent auparavant.
J'en profite pour souligner qu'il est, à mon avis, nécessaire qu'un procès s'ouvre sur les responsabilités pour les mettre au clair : c'est tout simplement un problème de catharsis, car nous ne pouvons pas rester dans l'ignorance de ce qui s'est réellement passé. Le fait de savoir est une bonne chose pour tout le monde et notamment pour les victimes.
J'en arrive aux questions de M. Hériaud. Je suis d'accord avec vous, pour dire que j'ai fait dans le schéma un effort de distinction pour montrer que les deux aspects du problème coexistent. J'ai établi cette séparation, non pas dans un but pratique mais intellectuel. Il faut tenir compte des deux composantes sans quoi, comment expliqueriez-vous, par exemple, qu'aujourd'hui il y ait tant de manifestations et d'émotion autour de l'Erika
et aussi peu autour de la tempête qui a causé beaucoup plus de dommages ? Si j'ai fait ce schéma, c'est pour bien montrer que tout cela se tient et qu'on ne peut pas seulement en rester aux problèmes économiques mais qu'il faut aussi tenir compte des autres problèmes soulevés à l'occasion de ce type de catastrophe. je suis donc d'accord avec vous et je fais amende honorable en précisant qu'il s'agit simplement d'un effort d'analyse.
M. Léonce DEPREZ : Economie, écologie : les deux se rejoignent !
M. Jean-Baptiste HENRY : Enfin, je reconnais avec François Cuillandre qui me demandait comment transposer l'expérience alaskienne que le contexte pétrolier est différent de même que le contexte institutionnel : malheureusement ou heureusement - chacun a son avis sur la question - la Bretagne n'est pas un Etat indépendant, au sens américain du terme!
M. le Président : Nous sommes ici garants de l'intégrité territoriale !
M. Jean-Baptiste HENRY : M. le président, je tiens à préciser que je parlais d'Etat au sens américain, c'est-à-dire d'Etat fédéral, ne voyez là aucune autre idée d'indépendance...
Les contraintes institutionnelles sont donc là ! Il n'en reste pas moins que l'on peut faire des expériences et je souhaite fortement que nous en tentions car nous avons montré nos responsabilités au syndicat mixte ; nous sommes vraiment représentatifs de l'ensemble des riverains, de la région la plus exposée aux risques maritimes. Nous avons une organisation qui est en train de se réformer, pourquoi ne la prendrait-on pas comme référence au sein des organismes qui vont être chargés de poser les problèmes de sécurité du transport maritime ? C'est tout ce que nous demandons et si d'autres régions, ensuite, ont la même expérience et s'organisent de la même façon, pourquoi ne pas les associer par itération ? C'est ainsi que je verrais personnellement se mettre en place une structure des régions victimes des pollutions maritimes par rapport à ces problèmes de sécurité du transport.
M. le Rapporteur : Une structure spécifique des régions victimes des pollutions maritimes ?
M. Jean-Baptiste HENRY : Oui à partir des responsabilités des uns et des autres et de leurs actions car nous avons réagi et il faut que les autres qui sont dans les mêmes situations le fassent aussi ...
M. le Rapporteur : C'est une question d'actualité et M. le président Arzel en parlait puisque, cet après-midi, les trois régions Bretagne, Pays-de-Loire et Poitou-Charentes vont se réunir en une structure dont on mesure encore assez mal le caractère opératoire. Est-elle de nature à répondre à vos préoccupations ou non ? C'est un point important.
M. Léonce DEPREZ : Il me paraît impensable de commencer à « charcuter » le littoral français car toutes les régions sont susceptibles d'être soumises à ce type de pollutions et je dirai que vers le Nord et notamment dans le Pas-de-Calais les conséquences économiques et écologiques en seraient plus dramatiques. Je comprends mal la composition d'une structure à trois régions : pourquoi l'arrêter là ? Il faut une politique globale du littoral français, de la mer et de ses relations avec la terre littorale !
Je pense que votre exposé, monsieur le directeur, a été très bon et je vous en félicite parce que des idées générales et des idées concrètes s'en sont dégagées, mais il faut surtout que vos propos inspirent ceux qui doivent traduire les bases d'une politique de la mer et de ses relations avec la terre avec des structures qui soient à l'échelle du littoral.
M. le Rapporteur : C'est une vraie question qui est posée et sur laquelle nous devrons faire des propositions !
M. le Président : Je pense même, au point où nous en sommes, même si mes convictions philosophiques pour ne pas dire politiques me poussent vers autre chose, que comme cela a été dit par un certain nombre de personnes, nous ne pourrons pas faire l'économie d'un rapprochement d'expériences, de volontés, de citoyenneté des deux côtés de la Manche : ce n'est pas possible ! Si la même affaire que celle de l'Erika
survenait entre - Le Havre et la Belgique ce sont les deux côtés qui se trouveraient touchés. Nous ne pouvons donc pas faire l'économie de mise en commun de moyens, de réflexions communes et d'actions communes dans le sens que vous avez décrit ce matin.
Attention donc à ne pas limiter le problème. Je comprends la position de la Bretagne, mais d'autres régions ressentent chaque matin quelques craintes : à nous de traduire la réflexion qui est la votre ! Je comprends que vous soyez les pieds dans le cambouis pour ne pas employer de terme plus trivial mais nous avons ici pour tâche d'essayer de donner une vision un peu plus large - non pas que la votre ne le soit pas puisque vous avez obtenu, au terme d'un combat de quinze ans des résultats remarquables, mais hélas elle ne suffit pas ...
M. Jean-Baptiste HENRY: Permettez-moi d'ajouter quelque chose à votre remarque, M. le président, qui concerne le problème du sens de la réaction et de l'action. Ce que notre action a mis en évidence, c'est que c'est précisément en partant de l'expérience de gens qui ont réagi que nous remontons aux problèmes généraux et je prétends que c'est un cheminement préférable à celui qui part de l'Etat pour appliquer telle ou telle mesure. C'est tout ce que j'ai voulu dire à travers mon exposé et les différentes interventions que j'ai pu faire en réponse à vos questions !
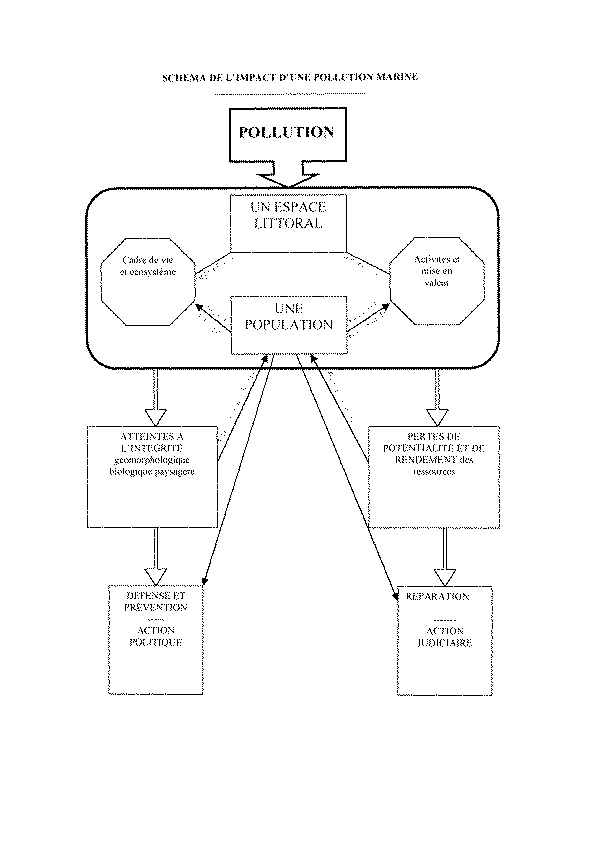
Audition de M. Jean-Pierre MANNIC,
directeur du CROSS d'Etel
(extrait du procès-verbal de la séance du 28 mars 2000)
Présidence de M. Daniel PAUL, Président
M. Jean-Pierre Mannic est introduit.
M. le Président lui rappelle que les dispositions législatives relatives aux commissions d'enquête lui ont été communiquées. A l'invitation du Président, M. Jean-Pierre Mannic prête serment.
M. Jean-Pierre MANNIC : Je n'ai pas préparé un exposé très structuré, préférant décrire le déroulement des événements au fil de nos échanges.
Je préciserai simplement que je suis administrateur en chef des affaires maritimes, directeur du CROSS d'Etel depuis deux ans, que j'ai été précédemment directeur du CROSS Jobourg et directeur départemental des Affaires maritimes, accessoirement capitaine de première classe de la navigation maritime. On peut dire que j'ai une expérience de navigant de dix ans entre les cours et ma carrière de navigant proprement dite.
Comme vous le savez probablement, le CROSS est un service civil spécialisé relevant du ministère de l'Equipement, des transports et du logement. Il est, pour un certain nombre de missions, mis à la disposition du préfet maritime, pour d'autres à la disposition du ministre de l'Agriculture et pour un certain nombre de missions propres, il est tout simplement mis au service des Affaires maritimes. C'est donc un service spécialisé des Affaires maritimes, qui dépend du ministère de l'Equipement et qui est mis à la disposition opérationnelle du préfet maritime.
La mission fondatrice des CROSS a été le sauvetage en mer, à savoir la coordination des moyens employés pour le sauvetage en mer, la réception des alertes et donc la gestion des opérations de sauvetage. Progressivement, sont venues se greffer d'autres missions au fur et à mesure de leur développement et de l'intérêt que l'on pouvait y trouver.
La première de ces missions a été une surveillance des pollutions - non pas dans l'esprit du plan POLMAR mais dans le but de recueillir des renseignements et des éléments concernant les pollutions et de constituer des dossiers qui permettent de poursuivre éventuellement les pollueurs devant la justice.
La deuxième s'est greffée progressivement au vu de l'intérêt que l'on a trouvé à, d'une part, mettre en place des dispositifs de séparation de trafic en Manche et, d'autre part, à en assurer le suivi, notamment en matière de respect des règles : il s'agit d'une mission de surveillance du trafic maritime qui s'exerce principalement dans les trois dispositifs de séparation de trafic de la Manche, du Pas-de-Calais (dispositif des Casquets) et d'Ouessant.
Il est une autre mission qui est une mission traditionnelle des Affaires maritimes, qui, évidemment, ne relève pas de la sécurité mais qu'il faut mentionner malgré tout, c'est la mission de contrôle des pêches puisque le CROSS Etel est un centre de contrôle des pêches ainsi que le centre français de contrôle des pêcheries, au sens communautaire du terme.
J'en arrive à la dernière mission qui n'est pas, non plus, négligeable : les CROSS sont des centres opérationnels permanents de transmission des Affaires maritimes. Ils assurent également le contrôle opérationnel des moyens nautiques des Affaires maritimes et les liaisons entre l'ensemble des autorités des services de l'Etat et autres et cela, vingt-quatre heures sur vingt-quatre.
Les centres fonctionnent avec du personnel civil et militaire. L'encadrement est assuré par des officiers des Affaires maritimes. Les personnels opérationnels sont, d'une part, des personnels de la Marine nationale détachés pour emploi ce qui signifie que, bien que supportés par le budget de l'Equipement et gérés par la Marine, nous en avons l'utilisation complète et, d'autre part, quelques personnels civils pour la maintenance et le secrétariat.
Depuis la fondation des CROSS et pour des raisons historiques, nous avons employé, bien entendu, du personnel provenant du service national. Avec la suspension du service national, nous passons dans une phase de professionnalisation, c'est-à-dire en fait de remplacement d'un certain nombre de ces appelés par des personnels de carrière.
Le CROSS a une compétence essentielle, officielle qui est d'ailleurs fixée par un décret en Conseil d'Etat : la représentation permanente du préfet maritime en matière de sauvetage. Il a donc une délégation permanente du préfet maritime qui n'est pas une délégation de type préfectoral au sens où on l'entend généralement dans les services extérieurs. C'est une délégation qui est beaucoup plus lourde dans la mesure où c'est un décret en Conseil d'Etat qui, à partir de 1983, est venu clarifier les rôles en matière de sauvetage en confiant au préfet maritime la responsabilité du sauvetage sur le plan régional.
En effet, avant cette date, le partage n'était pas toujours clair entre la Marine nationale et les Affaires maritimes. Le préfet maritime, au titre de ses attributions civiles a la responsabilité du sauvetage maritime et cette responsabilité est déléguée de manière permanente aux CROSS. Il y a cinq CROSS métropolitains et maintenant deux centres de coordination de sauvetage outre-mer : l'un aux Antilles, l'autre à la Réunion.
Voilà pour le cadre général mais je suis disposé à répondre à l'ensemble de vos questions.
Je veux bien vous résumer maintenant, parce que c'est quand même relativement long, l'ensemble des événements qui concernent le naufrage de l'Erika
tels que le CROSS les a vécus. Pour éviter de me tromper, j'ai préparé un document que je vous communiquerai. Il reprend tout simplement le texte d'un exposé que j'ai fait récemment à la Préfecture maritime dans le cadre d'un
debriefing avec les différents services de l'Etat : il rapporte la chronologie des événements tels que, je le répète, le CROSS les a vécus.
M. le Président : Pardonnez-moi mais, outre ce document, pourriez-vous nous communiquer les pièces ?
M. le Rapporteur : Est-ce le rapport exact ?
M. Jean-Pierre MANNIC : C'est très exactement une synthèse des éléments de journal de bord, des reprises d'enregistrement et de tout ce que la commission d'enquête judiciaire a saisi. Je ne suis plus en possession des pièces, notamment des enregistrements radio et téléphoniques.
M. le Rapporteur : C'est la synthèse ?
M. Jean-Pierre MANNIC : Oui et elle m'apparaît assez complète. Elle ne comporte pas la copie des messages de type télex qui ont pu être échangés, mais cette dernière figure
in extenso dans le rapport du BEA-mer.
Pour rappeler les événements, j'ai distingué deux parties : d'abord, ce qui s'est passé dans la journée du 11 décembre et dans la nuit du 11 au 12 décembre, ensuite, le sauvetage lui-même tel qu'il s'est déroulé le 12 décembre et dont il n'a pas été tellement fait état mis à part dans quelques coupures de presse.
Je précise que l'ensemble de mon récit est en heure alpha, c'est-à-dire en heure locale et non pas en heure T.U. - temps universel. Certains messages sont affichés en T.U. par les équipements mais pour des raisons de commodité et pour l'ensemble des opérations, nous avons choisi, dès le départ, de parler en heure locale qui est l'heure d'hiver, donc T.U. plus une heure.
Cette affaire a débuté à 14 h 08, le 11 décembre 1999. Le CROSS a reçu un message de détresse par un standard moderne et récent, via satellite que l'on appelle Inmarsat C - Inmarsat Charlie - qui provenait du pétrolier maltais
Erika qui était en position 46°29 N et 7°20 O, soit sensiblement dans le sud-ouest de la pointe du Raz, pour 140 milles nautiques ce qui fait
grosso modo 300 kilomètres.
Nous avons tenté d'assurer par message Inmarsat C le recoupement d'informations avec le navire. Nous avons infructueusement essayé de prendre contact par radio H.F. puis nous avons demandé au CROSS Corsen qui est mieux équipé pour ce type de relais en H.F, et qui est d'ailleurs la station officielle de veille H.F. de la fréquence de détresse, d'établir ce contact.
Le contact a finalement été établi entre temps en H.F. par Etel. Il n'était pas très bon et plutôt brouillé mais nous sommes, néanmoins, parvenus à joindre l'Erika, surtout d'ailleurs par Insmarsat C. L'ensemble des éléments dont nous disposons, compte tenu de la très mauvaise qualité des communications radio, a été réalisé par messages. L'avantage du message étant, bien entendu, qu'il laisse des traces sûres puisqu'il passe par France télécom et qu'aucun élément ne risque d'être perdu en cours de route.
Son inconvénient c'est que, lorsque l'on dialogue avec une messagerie, on n'a peut-être pas la même perception des choses que lorsqu'on a la personne, soit au bout d'un téléphone, soit au bout d'une radio : la voix humaine peut parfois amener à une communication plus directe, à creuser certaines choses, ce que ne permet pas le message
- mais c'est là une observation tout à fait personnelle.
Après que le contact a été établi entre le CROSS et l'Erika, le navire transmet à 14 h 34, un message, toujours par Inmarsat C. Il précise que le navire a une forte gîte, que le commandant est en train d'évaluer la situation, qu'il rappellera et qu'il ne demande plus d'assistance immédiate : on est ainsi passé d'une situation de détresse à 14 h 08, à une situation intéressante, certes, mais qui n'était plus une situation de détresse et surtout qui ne répondait plus à une demande d'assistance immédiate.
Le COM (Centre des opérations de la Marine) qui est, jusqu'à plus ample informé, le trait d'union avec la préfecture maritime pour transmission d'informations et demande de concours de moyens en sauvetage, vingt-quatre heures sur vingt-quatre
- comme le CROSS est le point de contact sauvetage vingt-quatre heures sur vingt-quatre - ce qui explique qu'il y ait un lien habituel entre eux - est prévenu à 14 h 38, et non je ne sais quand, comme certains journalistes ont cru bon de l'affirmer - vous m'excuserez cette parenthèse...
Un point de la situation de surface en navires de la Marine est établi. Comme il y a une inquiétude par rapport à ce qui se passe sur le bateau, l'officier de permanence du CROSS fait le tour, avec l'officier de permanence de la préfecture maritime, des moyens Marine disponibles au pas : on se demande qui est sur l'eau, qui serait capable d'intervenir en cas de besoin, à partir d'où et en combien de temps...
Les moyens aériens venaient d'ailleurs d'être passés en alerte à une heure : le point a été vérifié à ce moment-là. D'habitude, on compte plutôt deux heures mais, compte tenu du temps, le préfet maritime avait décidé de passer ses moyens d'intervention, c'est-à-dire
Super Frelon et Atlantique à une heure.
Un nouveau contact est établi avec l'Erika
en H.F., puis de nouveau par message Inmarsat Charlie à 15 h 15.
Le commandant de l'Erika remercie le CROSS de la promptitude de sa réaction - il est bien le seul d'ailleurs - et confirme qu'il a la situation sous contrôle. Il demande de conserver le message de détresse comme simple message de sécurité, ce qui est une procédure un peu inhabituelle compte tenu du fait que les messages de sécurité sont normalement plutôt réservés soit aux navires pour prévenir les autres navires d'un danger tel qu'un conteneur ou un tronc d'arbre qui flotte, soit aux CROSS pour le même type de messages ou des avis de coups de vent. Ce n'était donc pas une procédure très habituelle mais elle était tout de même assez claire. Je pense que le commandant cherchait surtout à effacer l'impression de détresse : comme il avait conscience d'avoir mis les choses en branle il avait peut-être trouvé là le moyen de dire que sa situation était rétablie.
Bien entendu, le COM Brest est tenu informé.
Il est alors environ 16h le samedi après-midi, et le lendemain matin à 6h , à une ou deux minutes près, nous avons reçu une rafale de messages de détresse.
A 17 h 25, l'Erika envoie au CROSS un nouvel Inmarsat C demandant d'annuler le message de sécurité, ce qui voulait dire, cette fois, qu'il n'y avait plus aucun élément particulier et annonce qu'il fait route vers un port de refuge ce qui était un élément nouveau par rapport à la situation précédente.
A 17 h 50, le CROSS demande à l'Erika, toujours par message Inmarsat - de préciser le port de refuge en question. Le navire répond à 18 h 05, qu'il s'agit de Donges, donc du port de Nantes-Saint-Nazaire, où il prévoit d'arriver à 18 h le dimanche, donc le lendemain. La situation en reste là jusqu'à vingt et une heures 15 : nous avons un navire qui a eu un problème, qui l'a rectifié et qui malgré tout préfère faire route vers un port de refuge.
A 21 h 15, l'officier de permanence du CROSS a un contact - d'ailleurs dans le cadre d'une autre affaire - avec le commandant du port autonome de Nantes Saint-Nazaire. A cette occasion, il apprend que le navire a signalé une forte gîte résiduelle, alors qu'il avait indiqué qu'il avait rétabli sa situation, et surtout des fuites.
M. le Rapporteur : Excusez-moi de vous interrompre mais vous avez appris cela par le commandant du port de Saint-Nazaire ?
M. Jean-Pierre MANNIC : C'est l'officier de permanence du CROSS qui a un contact avec le commandant du port autonome de Saint-Nazaire. La teneur du message a bien entendu été notée sur la main courante mais après nous avons réécouté les bandes des communications téléphoniques, notamment au moment de l'enquête judiciaire et nous avons les termes précis employés par le commandant du port de Saint-Nazaire.
A cette occasion, ce dernier apprend donc que le navire a une fuite. Le commandant de port estime difficile d'accueillir le navire compte tenu de ces fuites et de l'impossibilité de confiner une pollution dans l'estuaire de la Loire, ce qui est logique eu égard aux courants.
Il ne considère pas la gîte comme un problème majeur et reste surtout préoccupé par les problèmes de fuites et les éventuelles pollutions.
L'officier de permanence du CROSS en informe aussitôt le COM Brest à 21 h 20. C'est donc immédiatement dans la foulée de la communication que l'officier de permanence du CROSS tient informée la préfecture maritime.
Dans le même temps, compte tenu de ce fait nouveau qu'étaient les fuites, il envoie un message au navire en lui demandant de préciser sa situation.
L'Erika répond, d'une part, à 22 h 27, par un message en forme réglementaire que l'on appelle SURNAV, c'est-à-dire un message que tout navire transportant des marchandises dangereuses en vrac ou susceptibles de polluer, au terme d'un arrêté du préfet maritime, doit envoyer aux autorités françaises et en l'occurrence aux CROSS, un certain temps avant d'entrer dans les eaux territoriales.
Là, le message était parfaitement conforme à l'arrêté du préfet maritime. Nous avons été assez impressionnés de recevoir un message en bonne forme de l'Erika
mais nous avons en fait appris par la suite que c'était l'agent de l'Erika à Nantes qui lui avait fourni le modèle et indiqué la marche à suivre pour être en règle avec les autorités françaises.
Ce message fait état au chapitre des déficiences - puisque ces messages comportent une ligne « déficiences » - de fissures de la tôle du pont principal.
Tout de suite après, à 22 h 50, par un autre message Inmarsat C beaucoup plus complet, rédigé en anglais, et qui est celui que l'on retrouve dans le rapport du BEA-mer, il précise la nature des avaries : fuite interne entre citernes et fissure du pont principal au niveau de la citerne concernée par la fuite interne. Le message est donc, cette fois, plus descriptif. Il précise également qu'il a procédé à des transferts pour essayer de remédier à tout cela.
A la réception de ce message, le CROSS transmet à la préfecture maritime un message de synthèse avec la copie de l'ensemble des messages transmis et reçus de l'Erika depuis 21 h 15, puisqu'il s'agissait de messages nouveaux, et notamment bien entendu le message SURNAV et le compte rendu des avaries que l'Erika nous avait transmis, les éléments obtenus du port de Nantes, à savoir une synthèse de ce qu'avait dit le commandant de port, les coordonnées téléphoniques et fax de l'agent du navire - l'opérateur, PANSHIP, avait dû désigner un agent nantais, qui était si je ne me trompe Stockaloire, pour préparer l'escale du navire, commander le pilote, la place à quai etc - ainsi qu'un extrait du fichier SIRENAC, le fichier des navires contrôlés dans le cadre du Mémorandum de Paris, celui qui mentionnait le fameux
target factor de 12.
Tout cela a donc fait l'objet d'un message d'information très complet, très précis à la préfecture maritime qui a été transmis aux alentours de 23 h.
L'officier de permanence du CROSS, sachant qu'un navire avait des difficultés, a également demandé au personnel de quart de prendre un contact très régulier avec le navire pour s'assurer que sa situation ne s'aggravait pas, puisque les 26 personnes qu'il avait à son bord et le temps qu'il faisait rendaient le sauvetage difficile à mettre en place.
Aux environs de 4h, le chef de quart du CROSS Etel a envoyé une nouvelle demande d'informations à l'Erika et, à 4 h 06, l'Erika a envoyé un dernier message précisant sa position, sa route et sa vitesse. Donc à 4 h 06, le navire faisait route au 95, c'est-à-dire, grosso modo à l'Est, vers Donges et allait toujours à neuf n_uds ce qui montre qu'il s'agissait d'un navire qui n'était manifestement pas désemparé sur le plan de la machine et de la barre puisque cette vitesse, compte tenu du temps, est tout à fait conséquente.
Le seul commentaire du commandant, alors que l'on a su par la suite qu'à cette heure-là la situation était en train de se dégrader très sévèrement, a été la formule de politesse abrégée habituelle en anglais : best regards, ce qui veut dire salutations.
Dans la nuit, le CROSS a également repris un contact avec le COM pour évaluer la situation et voir les intentions de la préfecture maritime qui préparait pour le lever du jour un vol de reconnaissance pour s'assurer des fuites, des pollutions éventuelles et de l'état du navire ; mais ce vol n'a pas eu lieu car l'appel de détresse est arrivé nettement avant le lever du jour, puisqu'on était en décembre, et que l'appel de détresse est arrivé à six heures du matin.
J'en arrive à la deuxième phase et on passe à ce qui est la mission fondamentale, fondatrice du CROSS qui est la coordination du sauvetage.
A 6 heures, le CROSS reçoit un Mayday - en réalité il s'agissait d'une rafale de messages de détresse qui s'échelonnaient entre six heures moins trois ou quatre et 6 h 06 ou 6 h 07 Le chef de quart du CROSS a eu le temps de marquer 6 h mais, entre temps, il a récupéré des messages de partout à la fois, par Inmarsat C, automatique et manuel, par appels sélectifs numériques sur la radio qui nous sont parvenus de différents centres de coordination de sauvetage européens. Nous en avons reçu de nos collègues du CROSS La Garde, de nos collègues britanniques et je me demande même si nous n'en avons pas reçu des Grecs.
Nous avons donc reçu une série de retransmissions d'appels de détresse qui montrait qu'il n'y avait pas d'ambiguïté possible et il est bien évident que nous avons demandé tout de suite le décollage des moyens, notamment du
Super Frelon puisque, pour sauver un équipage, c'est encore lui le mieux adapté.
Compte tenu des difficultés et surtout des conditions météorologiques exécrables, nous avons également demandé à la SNSM (Société nationale de sauvetage en mer) de la pointe de Bretagne - Saint-Guénolé et Penmarc'h - qui a des canots de tout temps, de sortir, de façon à ce que si l'hélitreuillage s'avérait impossible, nous ayons au moins la possibilité de récupérer l'équipage par le biais plus traditionnel des canots de sauvetage qui a également fait ses preuves même s'il est un petit peu plus long.
Un avion de patrouille maritime Atlantique 2
de la base de Lann-Bihoué a assuré, quant à lui, une excellente coordination sur zone de tous ces moyens mais je ne m'étendrai pas sur ce sauvetage puisque c'est une partie qui s'est très heureusement enchaînée pour l'équipage et pour tout le monde.
Je préciserai simplement que nous avons eu un petit aléa de panne de treuil de l'hélicoptère français. Nous avons donc été conduits à faire très rapidement appel aux hélicoptères britanniques qui sont capables d'intervenir aussi vite que les hélicoptères français en Bretagne sud : cela peut paraître paradoxal mais il n'y a que deux heures de transit et surtout les hélicoptères britanniques viennent à deux hélicoptères lourds, l'un venant à la rescousse de l'autre, ce qui permet, en cas d'incident, de mener à bien l'opération.
Le seul élément marquant, c'est que les parties se sont séparées aux alentours de 8 h 21. Le treuil du
Super Frelon est tombé en panne à 8 h 24. On avait laissé le plongeur du
Super Frelon à bord de l'Erika et il a contribué par son sang-froid et son professionnalisme à considérablement améliorer et à organiser l'évacuation : compte tenu des risques de naufrage définitif de la partie arrière sur laquelle il restait un certain nombre de membres d'équipage, il a fait mettre une partie de l'équipage dans une des chaloupes de sauvetage qu'il est parvenu à mettre à l'eau dans des conditions convenables. Cette mesure aurait permis, en cas de naufrage définitif de la partie arrière avant le retour des hélicoptères ou l'arrivée de l'hélicoptère plus léger envoyé pour pallier la défaillance de l'hélicoptère lourd
Super Frelon, d'évacuer les personnes restées à bord.
De ce côté-là, l'opération s'est quand même bien déroulée : on a fait une noria entre Saint-Guénolé et le navire au moyen du petit hélicoptère et du
Super Frelon et, heureusement pour la fierté nationale, c'est le
Super Frelon qui, après un changement de machine, a achevé l'évacuation des derniers rescapés qui ont été débarqués à 11 h 30 à Lanvéoc.
Je ne m'étendrai pas sur tous les détails du sauvetage que j'ai consignés dans le document dont vous disposez.
Dans ce même document, j'avais également noté - mais ces commentaires n'engagent évidemment que moi-même - que pour l'événement, le CROSS avait doublé ses équipes, ce qui fait partie de la procédure normale : le CROSS dispose en permanence d'équipes de renfort pour traiter soit des événements graves, de type accidents de navires à passagers ou naufrages à nombreuses victimes, soit tout simplement des pointes d'activité estivale puisqu'il n'est pas rare d'avoir une dizaine, voire une quinzaine d'opérations concernant la navigation de plaisance pendant les opérations estivales ou les week-ends de printemps. Les équipes sont donc systématiquement doublées.
Bien que n'étant pas de permanence au sens de permanence opérationnelle de sauvetage, j'étais également présent sur le site pendant l'opération de sauvetage et il n'y a eu aucune difficulté à ce niveau : la coordination s'est bien déroulée et j'avoue que nous pouvons en tirer une certaine satisfaction.
Pour ce qui concerne les temps de ralliement vous trouverez quelques observations un peu techniques : elles concernent, pour une opération de ce type, les temps de ralliement français et britanniques tant nautiques qu'aériens.
Pour en venir aux commentaires, ce qui permettra d'introduire les questions, je trouve qu'il nous a manqué, en début d'après-midi du 11 décembre, une information sur les fissures. Je ne dis pas que cette information aurait changé quoi que ce soit, mais qu'elle nous a fait défaut. Qu'en aurait-il été si cette information était arrivée à la préfecture maritime en début d'après-midi ?
Je ne pense pas que l'on puisse refaire l'histoire mais je crois qu'une meilleure information sur l'état réel du navire aurait entraîné moins d'aléas sur le sauvetage.
Nous nous en sommes bien tirés à ce niveau, mais il aurait quand même été intéressant de mieux connaître la situation du navire pour ne pas nous retrouver à organiser un sauvetage auquel nous ne nous attendions quand même pas à six heures du matin : on est là pour y faire face, mais c'est tellement plus simple quand on peut prépositionner des moyens, les mettre en alerte et se faire un schéma d'intervention !
Quoi qu'il en soit on ne refait pas l'histoire.
Par ailleurs, il est un point intéressant sur lequel nous nous interrogeons les uns et les autres depuis deux ou trois mois : si le navire avait plus été sur le point de se casser ou avait décrit ses avaries en disant qu'il sentait qu'il n'allait pas terminer son voyage et qu'il se trouvait en situation très difficile, voire dangereuse, quelles étaient à 300 kilomètres de la côte française, les possibilités d'intervention juridiques et techniques ?
M. le Rapporteur : Merci, M. le directeur, de votre exposé. Je voudrais poser simplement deux questions qui rejoignent vos observations finales : dans le fait que vous ayez eu connaissance des fuites de manière fortuite, alors que le capitaine du port de Saint-Nazaire parlait du
Maria K, voyez-vous une faute du capitaine de l'Erika ?
Pouvez-vous tenter de répondre vous-même à votre seconde interrogation : si on avait découvert la fuite alors que le navire se trouvait à 300 kilomètres, quelle aurait été la meilleure démarche et qu'aurait-il été possible de faire ? Vous étant interrogé vous-même, avez-vous en tête une idée d'intervention notamment sur le plan technique et juridique ?
Le 11 décembre, vous étiez également préoccupé de la situation du
Maria K qui, si j'ai bien compris, était potentiellement dangereux ?
M. Jean-Pierre MANNIC : Oui, c'était un navire qui dérivait ou qui cherchait son mouillage dans une zone qui n'était pas évidente, parce que son hélice n'était pas assez immergée.
Je pense qu'il avait dû partir trop vite après une escale sans ballaster suffisamment. Nous avons donc dû attendre qu'il le fasse et, comme il y avait un vent très fort, il ne parvenait pas à étaler la mer et menaçait d'aller s'échouer sur un plateau ou sur un banc situé,
grosso modo, à l'entrée de l'estuaire de la Loire. Je n'ai plus exactement le lieu en tête mais je sais qu'il n'était pas très bon... Il s'agissait d'un vraquier lège si ma mémoire est bonne.
M. le Rapporteur : Donc pas polluant ?
M. Jean-Pierre MANNIC : Vous savez, un navire a toujours des soutes et d'ailleurs le préfet maritime l'avait, je crois, mis en demeure de faire cesser le danger potentiel qu'il représentait soit d'obstruction de chenal, soit d'échouage : il suffit d'une pointe de rocher pour crever très vite une soute ou un ballast et donc pour polluer.
M. le Rapporteur : Ma question visait à savoir s'il y avait d'autres cas de bateaux potentiellement dangereux au cours de cette journée hormis les deux dont il a été question et, au cas où le
Maria K se serait trouvé en grosse difficulté, s'il était possible de conduire deux opérations quasiment simultanées. D'une manière plus générale, estimez-vous que les moyens dont vous disposez aujourd'hui sont suffisants et que le remplacement de vos personnels à la suite de la fin du service national s'effectuera sans coupure ? Considérez-vous, par ailleurs, important de répondre positivement à la demande formulée par certains d'avoir un remorqueur supplémentaire en haute mer spécifiquement sur le golfe de Gascogne ?
M. Jean-Pierre MANNIC : Cela fait beaucoup de questions...
Sur le plan des personnels, nous avons réfléchi et j'ai personnellement eu un peu l'occasion de collaborer à la mise en place de ce plan de professionnalisation avec M. Serradji. Nous avons un plan 2001 qui semble - du moins je l'espère - cohérent quant au nombre et à la qualification du personnel. Après se posent les questions d'adaptation et de formation, mais elles relèvent de la gestion que nous allons traiter avec la Marine.
A partir du moment où les personnels dont nous disposons ne représentent pas le même coût, il s'agit qu'ils soient capables d'effectuer un travail de professionnels. Si tel est le cas, je pense que les CROSS seront bien armés, et sans doute encore mieux qu'ils ne peuvent l'être actuellement, pour affronter l'an 2001.
Sur la capacité à traiter plusieurs opérations, disons que l'opération du
Maria K était menée par la préfecture maritime, le CROSS étant un relais d'information et de transmission d'éléments : je crois qu'il faut bien voir que le CROSS a, en sauvetage, une responsabilité qui est pleine et entière, sauf si le préfet maritime décide de reprendre lui-même l'opération, tandis que dans les autres matières, il n'a pas de délégation particulière.
En fait, le CROSS est un outil à la disposition du préfet maritime ou des autorités des Affaires maritimes ou du ministère de l'Agriculture mais c'est essentiellement un relais information et le préfet maritime l'utilise comme il le souhaite, y compris en matière de pollution puisque, à ce niveau, le CROSS est amené, ne serait-ce que par son réseau radio, qui est bien développé sur la côte et de bonne qualité, à assurer un certain nombre d'opérations de relais.
En l'occurrence, pour le Maria K, je ne sais pas s'il n'a pas dû, tout simplement, lire la mise en demeure du préfet maritime pour que le capitaine l'intègre bien, ce qui arrive surtout lorsque l'on ne dispose pas de moyens de liaison faciles de type fax ou télex avec tel ou tel navire.
Le Maria K nous a mobilisés mais essentiellement au niveau du suivi de situation.
Pour ce qui est de l'affaire de l'Erika, l'appel de détresse était une opération CROSS mais ensuite il s'agissait du recueil de renseignements et je trouve que le CROSS s'est un peu acharné à trouver des renseignements sur ce navire dont on aurait pu penser qu'il était tout à fait anodin. C'est ainsi que les questions que nous avons posées au navire nous ont permis de savoir qu'il ne continuait pas sur le Cap Finisterre mais qu'ayant infléchi sa route, il avait décidé d'aller vers un port de refuge. D'ailleurs dès les premières minutes où l'information faisant état d'un port de refuge nous a été communiquée, l'officier de permanence a appelé Madrid en disant qu'il y avait un bateau qui semblait vouloir se réfugier en Espagne : le nom du port n'ayant pas été précisé, il aurait en effet parfaitement pu s'agir d'un port espagnol du fait de la proximité de la côte espagnole.
De la même façon, si le navire s'était cassé à cette distance, il est vraisemblable que ce sont à des moyens espagnols que nous aurions fait appel même si la zone se trouvait encore relever de la zone de compétence du sauvetage français.
Pour ce qui est de traiter plusieurs opérations, il nous est arrivé d'en traiter beaucoup plus : l'été, nous pouvons en traiter quinze à la fois, ce qui n'est pas exceptionnel. Dans ces cas-là, nous doublons, voire triplons s'il le faut les équipes de quart, nous prépositionnons davantage de personnel qu'en hiver, ce qui suppose naturellement une organisation du service assez rigoureuse, pour coller à la charge opérationnelle.
Notre souci est d'avoir toujours suffisamment de personnel pour faire face à la charge opérationnelle : nous pouvons avoir deux personnes la nuit mais jusqu'à sept ou huit personnes en plein après-midi, l'été, lorsque des opérations l'exigent, ce qui est une mesure de bon sens.
Pour ce qui est de la faute du capitaine, il est certain que nous aurions tous été très intéressés à connaître l'existence de ces fissures et les risques de cassure du navire au-delà d'une simple gîte, qui peut avoir trente-six raisons et dont le capitaine avait déclaré qu'il l'avait sous contrôle ce qui voulait dire qu'apparemment elle ne s'aggravait pas, qu'il la redressait et qu'elle ne repartait pas dans un mauvais sens.
M. le Président : Je comprends donc que vous avez appris l'existence de ces fissures, non pas directement par le commandant de l'Erika...
M. Jean-Pierre MANNIC : Tout à fait, c'est par l'intermédiaire du port de Nantes et pas par le capitaine.
M. le Président : Et par hasard ?
M. le Rapporteur : D'après nos informations c'est à l'occasion d'une conversation que vous avez eue à propos du
Maria K...
M. Jean-Pierre MANNIC : Voilà !
M. le Rapporteur : ... le capitaine du port de Saint-Nazaire ou son représentant vous ayant fait mention au passage de l'existence d'une fuite, ce qui vous aurait fait réagir ?
M. Jean-Pierre MANNIC : Puisque j'ai repris la transcription de la communication, il est plus facile que je vous la cite.
Le commandant du port de Saint-Nazaire dit : « j'en ai une petite autre pour vous derrière... ». L'officier de permanence répond : « allons-y on passe la première, celle du Maria K ». Ils déroulent l'affaire du
Maria K et le commandant du port de Nantes enchaîne : «
la deuxième affaire : j'ai un agent maritime qui m'a appelé pour un pétrolier qui s'appelle l'Erika »...
M. le Président : L'agent maritime ?
M. Jean-Pierre MANNIC : Oui, c'est l'agent maritime qui a appelé le port de Nantes pour demander l'escale.
Le CROSS Etel dit alors : « Oui, je vous ai envoyé un message d'ailleurs pour vous » ; il faut savoir que les informations que nous avons eues en cours d'après-midi ont également été retranscrites au port de Nantes, au BEA-mer et à la direction des Affaires maritimes et des gens de mer puisqu'il y avait une liste assez conséquente des destinataires compte tenu qu'elle se montait à environ une dizaine de personnes - ce à quoi le commandant de port répond : « Moi, j'ai juste eu un coup de téléphone d'un pétrolier qui serait en difficulté par 46°29 N et 7°18 O.
- « Oui ! On l'a eu, il nous a envoyé dans l'après-midi un message de détresse. Ensuite, il nous a recontactés en disant qu'il avait des problèmes de gîte ... Il ne demandait pas pour l'instant d'assistance. Après, nous sommes arrivés à le recontacter sur 21.82 et là il avait réussi à faire face... Il a du fioul à bord ?...
- « Oui 38.800 » dit le commandant du port de Nantes - allant en cela un peu au-delà de la réalité puisqu'il en transportait un peu moins, mais c'est logique puisque le bateau n'étant pas à destination du port de Nantes, le commandant n'avait pu que rattraper les renseignements en cours de route.
- « Oui, c'est cela normalement, il devait faire route d'après ce qu'il nous avait dit, vers Livourne en Italie, alors effectivement, il fait route sur Gibraltar...
- « Seulement son agent vient de m'appeler : c'est un pétrolier qui est affrété Total et Total demande à Donges de le prendre.
- « D'accord !
- « D'autre part, l'agent m'a parlé de fissures et si le bateau perd du fioul, moi, en Loire, je ne peux pas mettre de barrages avec le courant...
- « Ah... » dit l'Officier de permanence du CROSS Etel « ... il ne nous pas mentionné cela ! »
Après cet échange, le commandant du port de Nantes confirme : « c'est son agent qui m'a appelé tout à l'heure : il m'a dit qu'il a réussi à colmater ses fissures. En plus, si le bateau a de la gîte, mettre un bateau à quai pour le pomper n'est pas une petite affaire... » et le commandant de port ajoute: « donc s'il perd du fioul, c'est malheureusement pour Brest ! ». Le maître du CROSS Etel dit : « D'accord ! Ecoutez, quand j'aurai le COM, je vais les informer... ».
M. le Président : Et, selon vous, on ne peut pas considérer qu'il y a faute professionnelle du commandant ?
M. le Rapporteur : Le commandant a déjà informé l'agent qu'il y a fuite, mais n'en a pas tenu informé le CROSS ?
M. Jean-Pierre MANNIC : Le commandant, si on étudie la réglementation, devait être tenu de nous informer de ces fuites au moment du message SURNAV, c'est-à-dire du message qu'il envoie, si ma mémoire est bonne, lorsqu'il va rentrer dans les 50 milles, ce qu'il a fait réglementairement avant de rentrer dans les 50 milles. Autrement dit, il nous a rédigé un message faisant état de ses déficiences, qu'il nous a envoyé à 22 heures 27 et qui a été suivi, à 22 heures 50, d'une espèce de rapport complémentaire.
A 22 heures 27, le navire se trouvait encore loin de la côte et il était encore dans les conditions où il était temps, vu sa route, sa vitesse et la proximité des eaux territoriales, de nous adresser ce message SURNAV. Réglementairement, était-il auparavant dans les conditions de nous faire une déclaration ? Je ne le pense pas.
M. le Rapporteur : Au moment où il prévient son agent, était-il dans les eaux territoriales ?
M. Jean-Pierre MANNIC : Oh, non. Dans l'après-midi du samedi, par rapport à la pointe du Raz, il était encore à 160 milles. D'ailleurs, il ne s'est pas cassé, non plus, dans les eaux territoriales mais encore en haute mer. En revanche, il s'est cassé dans les 50 milles.
Il n'en reste pas moins qu'au moment du SURNAV, il était encore assez loin de la limite réglementaire où un navire à destination d'un port français ou des eaux territoriales françaises doit faire cette déclaration SURNAV conformément à l'arrêté commun des préfets maritimes/Manche-Mer du nord et Atlantique, puisque c'est un arrêté du préfet maritime qui impose cette déclaration.
M. le Rapporteur : En cas de danger quand on est dans les 200 milles, n'a-t-on pas le devoir de prévenir ? Je me pose la question...
M. Jean-Pierre MANNIC : Je ne le pense pas, mais je ne l'affirmerai pas non plus.
Cette obligation serait éventuellement issue de la Convention de Bruxelles sur le droit de la mer, mais c'est une question que je n'ai pas creusée et il appartiendrait plutôt à une division action de l'Etat en mer de la préfecture maritime de répondre à une question aussi pointue...
Je préfère ne pas m'avancer : je vous dirais bien qu'à ma connaissance non, et c'est d'ailleurs pareil pour les pouvoirs d'intervention d'office du préfet maritime, mais je ne m'avancerai pas sur ce terrain parce que je ne suis pas un juriste et que ces mises en demeure et ces interventions ne relèvent pas de la compétence du CROSS.
Si j'avais servi dans une préfecture maritime, dans une division action de l'Etat en mer, je serais totalement au fait des choses mais ce n'est pas le cas.
M. Aimé KERGUERIS : En naviguant au 15 par rapport au lieu où il était, le navire prenait la direction de Donges ?
M. Jean-Pierre MANNIC : A quel moment ?
Selon le capitaine - parce que là je vous parle du CROSS mais j'ai également lu le rapport d'enquête et les comptes rendus que le capitaine a pu faire à travers la presse - sous réserve de la véracité et de la fidélité de ses comptes rendus, il a dû faire route, je crois au 30 - ce sont des éléments qui me sont parvenus mais je ne peux pas les affirmer - pour, après son coup de gîte, aller vérifier l'état de son pont, de ses cargaisons et vraisemblablement pour prendre les niveaux des cuves.
M. Aimé KERGUERIS : Vous avez dit que le dimanche, à 4 h 06, il faisait route au 15...
M. Jean-Pierre MANNIC : Non, j'ai dit au 95.
M. Aimé KERGUERIS : Par ailleurs, l'idée d'interdire la circulation des bateaux contenant des marchandises dangereuses par vents d'une certaine force est-elle, selon vous, applicable ?
M. Jean-Pierre MANNIC : Personnellement, je pense que si l'Erika avait été en bon état, il aurait fait comme tous les bateaux du monde qui prennent ces routes par des temps souvent bien plus impressionnants - j'ai vu un pétrolier affronter des creux de dix-sept mètres - et qu'il ne se serait pas cassé. Un bateau de haute mer, sauf cas de cyclone qui est un phénomène météorologique qui préoccupe le marin, est fait pour affronter les conditions de tempête qui sont assez courantes au large de la Bretagne et du golfe de Gascogne.
On peut perdre des conteneurs mal saisis ou casser un bateau si on ne prend pas la précaution de réduire convenablement sa vitesse, notamment lorsque l'on fait face à la mer mais - je dis ce que je pense - je n'ai pas l'impression qu'un navire en bon état et bien conduit ne soit pas apte à affronter la mer...
Je ne parle pas d'un petit bateau de plaisance qui, lui, prend des risques - on l'a bien vu avec la minitransat - mais des bateaux de haute mer, qui sont certifiés haute mer, qui ont une cote haute mer et qui ne sont pas des bateaux pour les eaux intérieures.
M. Aimé KERGUERIS : Cette idée a été inspirée par comparaison avec la navigation aérienne. Pensez-vous qu'elle serait applicable compte tenu du fait que les catastrophes surviennent toujours dans les mêmes lieux ? Est-ce une idée farfelue ou une idée applicable et de nature à améliorer la sécurité ?
M. Jean-Pierre MANNIC : Je pense qu'un avion a la météo sur le terrain d'arrivée, sur le terrain de départ et que son vol n'étant pas très long, on peut admettre qu'au-delà de certains seuils, quand les conditions météorologiques rendent le vol dangereux, il ne décolle pas.
La météorologie maritime est une science qui, certes, a fait beaucoup de progrès mais qui n'est pas une science exacte et les délais de transit sont tels que je ne suis pas sûr qu'un navire qui partirait en toute bonne foi avec une couverture météorologique normale ne se retrouverait pas dans des conditions météorologiques détestables deux jours plus tard, la météorologie ayant évolué et lui-même se trouvant trop loin d'un port pour revenir rapidement.
Maintenant, on voit également des navires et notamment des petits navires
- tout dépend de la taille du navire : un navire de 30 000 tonnes, ce n'est pas un navire de 5 000 tonnes ou de 2 000 ou 1 600 tonnes - qui s'abritent. Nous voyons, parce que c'est nous qui gérons les autorisations de mouillage, les navires se mettre à l'abri notamment à Belle-Ile, Groix, et de l'autre côté, en baie de Saint-Brieuc, quand le temps est trop fort pour contourner la Bretagne. Les capitaines eux-mêmes, lorsqu'ils pensent ne pas pouvoir arriver à destination ou ne pas réussir à faire route puisque tout le problème du navire est de faire route contre la mer et le vent, préfèrent attendre une accalmie plutôt que de rester en mer à avancer à une vitesse très faible en consommant du combustible et éventuellement en prenant des risques.
Je vois assez mal appliquer une interdiction de navigation par mauvais temps.
M. François CUILLANDRE : Je serai très bref d'autant que mon intervention sera plus une observation qu'une question. Elle concerne le remplacement des personnels des CROSS sous service national.
Le site de radio Conquet a fermé ses portes il y a quelques jours et j'ai été saisi d'une demande des personnels sous statut France télécom pour qu'ils puissent poursuivre leur mission dans les CROSS.
Cela pose des problèmes statutaires mais ce sont des personnels qui sont formés, qui ont une expérience de plusieurs années et il serait quand même dommage de perdre ces acquis...
M. Jean-Pierre MANNIC : La fermeture des radios de stations maritimes a relevé d'une décision à la fois de nature politique et économique, liée au développement des moyens de communication modernes et notamment de Inmarsat, où France télécom a d'ailleurs des intérêts.
En effet, le volume des radiocommunications commerciales, ex télégrammes et téléphonie par radio avait chuté avec les mobiles, les mobiles satellite Global Star et GSM ce qui a conduit France télécom à se désengager de ses missions de service public.
Ces dernières, qui reviennent à l'Etat, ont alors été reprises par les CROSS, qui ont été dimensionnés à la fois sur le plan des équipements mais aussi sur celui des personnels, dans le cadre de la professionnalisation tout en sachant, bien entendu, que des obligations de veille de fréquences de détresse incombent à la France dans sa zone de couverture et de responsabilité sauvetage. Les deux CROSS qui sont officiellement chargés de la veille sécurité radiotéléphonique moyenne et haute fréquence ( MHF ), dont 21 82 kilohz qu'assurait auparavant Le Conquet radio, sont le CROSS Corsen et le CROSS La Garde en Méditerranée.
Il est bien évident que Le Conquet radio, du fait de la puissance de ses émetteurs, portait bien au-delà de ses zones de responsabilité. Le point le plus délicat reste celui des pêcheurs professionnels qui, ne parlant pas anglais, utilisaient Le Conquet radio comme station, y compris lorsqu'ils se trouvaient en mer d'Irlande ou en Ecosse. Il est bien évident que la station de Corsen peut parfois passer mais n'est pas dimensionnée pour assumer cent pour cent, ni même cinquante pour cent, du service dans cette zone, couverte par les stations radiotéléphoniques et les centres de coordination de sauvetage britanniques ou irlandais.
Le seul petit problème, c'est que les pêcheurs français ne parlent pas anglais ce qui, d'ailleurs, est contraire à toutes les règles puisque, lorsque l'on navigue en eaux internationales, on est censé parler un minimum d'anglais maritime : c'est valable pour les plaisanciers comme pour les marins de commerce dont on exige une connaissance minimale de l'anglais.
Le commandant Mathur de l'Erika était Indien mais il aurait été Grec, Espagnol, ou Chinois, le message aurait été rédigé en anglais. C'est la seule langue internationale exigée au niveau de l'OMI pour communiquer, que ce soit avec la terre, avec les centres de sauvetage ou entre navires.
M. François CUILLANDRE : Ma question visait à savoir s'il était possible de faire en sorte que les personnels volontaires soient réembauchés.
M. Jean-Pierre MANNIC : Je n'ai pas d'avis en la matière...
Dans la mesure où il y a un service à rendre, la décision prise par la direction des Affaires maritimes et des gens de mer a été de faire assurer ce service par du personnel opérationnel classique des CROSS. Maintenant, j'avoue que je ne peux pas avoir de point de vue sur la question.
M. Jean-Michel MARCHAND : Je voudrais revenir sur la responsabilité du capitaine. J'ai compris que vous nous avez dit que le capitaine a fait ce qu'il fallait faire dans le cadre de la réglementation existante, à savoir qu'il ne vous a pas fait passer le message parce qu'il ne se trouvait pas à la distance où il est obligé de le faire, mais qu'en revanche il en a informé son agent...
M. Jean-Pierre MANNIC : Il en a effectivement informé son agent : on l'a vu dans le rapport du BEA-mer.
M. Jean-Michel MARCHAND : J'ai noté les heures : à 22 h 27, il vous fait passer un message où il annonce des fissures de la tôle principale, message qu'il complète à 22 h 50 mais vous nous dites, monsieur, que le dernier message qui vous parvient à 4 h 06, où il indique sa position...
M. Jean-Pierre MANNIC : ... sa route et sa vitesse oui, ne comporte pas d'autres éléments sur ses avaries ou sur une aggravation de ses avaries.
Connaissant a posteriori la situation à ce moment-là puisqu'un minimum de rapports provisoires ont été établis dans le cadre de l'enquête, on aurait pu penser qu'il nous aurait avertis et dit : « attention les fuites s'aggravent ou j'ai ma tôle de pont, de bordée, de muraille qui commence à sortir ; je perds du fioul etc. »
M. Jean-Michel MARCHAND : On peut donc penser en vous écoutant qu'il n'a pas fourni toutes les informations qu'il possédait : considérez-vous qu'il y a une faute du capitaine ?
La question est la suivante. Vous nous dites que si vous aviez su qu'il était déjà en grande difficulté vous auriez pu etc. mais vos moyens étant déjà mobilisés à une heure, était-il possible de faire mieux ?
M. Jean-Pierre MANNIC : Même s'il n'y a pas de demande d'assistance au sens SOS ou
mayday tel qu'il nous en est parvenu à six heures, si nous sentons que la situation va s'aggraver - c'était à lui de nous le dire et d'apprécier sa situation - nous n'allons, bien sûr, pas envoyer un hélicoptère car si l'évacuation n'est pas immédiate il risque de « cramer » son potentiel et de devoir revenir.
En revanche, nous avons la chance d'avoir des avions de patrouille maritime qui tiennent une dizaine d'heures en l'air - ce sont eux dont je vous ai parlé tout à l'heure pour vous dire qu'ils ont assuré la coordination du sauvetage sur zone -, qui disposent de moyens de visée infrarouge et autres qui permettent quand même de jeter un _il, de détecter les fuites, et d'évaluer la situation du navire.
Les photos que nous avons vues à la télévision du bateau en train de se casser avec le pétrole qui jaillit vers huit heures du matin sont des films infrarouges puisque tout cela se déroulait encore de nuit.
Dans ces cas où l'on a un doute sur une situation, nous procédons comme nous l'avons fait pour un petit caboteur qui a failli chavirer quelques jours après et que nous avons ramené à Brest encore qu'il y avait, dans ce cas, une demande d'assistance assez pressante du capitaine ce qui faisait presque de notre opération un sauvetage : nous avons d'abord envoyé l'avion de patrouille maritime, ne serait-ce que pour guider l'hélicoptère qui, se trouvant à la limite de portée, ne peut pas se permettre de tourner en rond pour chercher le bateau. Le terrain doit lui être préparé par l'Atlantique
qui, lui, a de puissants moyens de communication, aussi bien avec nous qu'avec la Marine ce qui permet de faire une évaluation de la situation et de conduire le sauvetage dans de très bonnes conditions de coordination locale ce qui n'est pas toujours le cas. Pour les sauvetages côtiers nous avons des moyens VHF radio mais pour les sauvetages hauturiers tout se fait un peu à distance. En revanche, quand l'avion monte nous avons une communication radio avec lui ce qui rend les choses plus faciles.
M. Jean-Michel MARCHAND : M. le président, si vous le permettez j'ai encore une question qui porte effectivement sur les moyens : il y a eu une panne, certes, et on a fait appel aux moyens britanniques. Comment ces moyens britanniques qui fonctionnent par deux, si j'ai bien compris, peuvent-ils arriver sur zone en même temps que les nôtres et sont-ils globalement plus efficaces ?
M. Jean-Pierre MANNIC : C'est un problème de délai d'intervention. Actuellement, le dernier
Super Frelon de la Marine est à quatre heures d'intervention et l'hélicoptère d'alerte est à deux heures d'intervention. La plupart du temps ils décollent plus vite que cela, mais c'est un délai, nous a expliqué la Marine, qui est un délai maximum pour permettre l'entraînement des équipages et l'entretien des machines.
Les Britanniques, comme d'ailleurs les Espagnols, ont un système différent. Ils ont des équipages en plus grand nombre qui sont en alerte sur les bases et décollent, en général, en une quinzaine de minutes. Ils nous garantissent une demi-heure mais il faut compter entre cinq et quinze minutes. Les Espagnols nous garantissent également une demi-heure et ils s'y tiennent. Leur système est un peu différent puisqu'il s'agit d'hélicoptères civils affrétés comme l'étaient à une certaine époque les hélicoptères du service public français. Ils sont donc affrétés à des sociétés privées qui sont soumises à un cahier des charges qui garantit leur efficacité.
Ce qu'on perd en délai de route puisqu'il faut quand même venir de Grande-Bretagne, surtout en Bretagne sud, puisque pour la Bretagne nord ces interventions d'hélicoptères britanniques sont très courantes - ils n'ont que la Manche à traverser ce qui se fait très vite - on le gagne en délai de mise en _uvre : quand vous avez, d'un côté une heure et quart ou une heure et demie de mise en _uvre, et de l'autre un quart d'heure, vous gagnez une heure qui est presque suffisante pour faire le trajet - elle l'est certainement pour effectuer le transit en Bretagne nord et quasiment suffisante pour le transit en Bretagne sud.
M. Jean-Michel MARCHAND : Pour bien comprendre, lorsque vous dites que vos moyens sont à une heure...
M. Jean-Pierre MANNIC : ... je parle des moyens de la Marine parce qu'en fait, nous disposons des moyens d'une multitude d'organismes et d'administrations aussi bien français que britanniques...
M. Jean-Michel MARCHAND : Ces moyens sont à une heure mais il faut une heure quinze avant de décoller ?
M. Jean-Pierre MANNIC : Oui, quand ils sont à deux heures. Quand ils sont à une heure, il est clair que le personnel est sur la base et qu'il décolle en trente-cinq ou quarante minutes.
M. Jean-Michel MARCHAND : Ce qui équivaut au délai des Anglais ?
M. Jean-Pierre MANNIC : C'est plus que cela !
M. Louis GUEDON : Quand on écoute tous les responsables de l'administration française - et nous en avons vu beaucoup ici - ils nous expliquent le film des événements et le fonctionnement de nos associations maritimes : ils retracent le récit minute par minute d'une man_uvre qui donne le sentiment qu'elle s'est déroulée sans la moindre faute !
C'est l'impression que je ressens depuis deux mois en écoutant l'administration française.
Cela étant, il y a un divorce profond entre la relation des faits et le vécu des populations. D'ailleurs, d'autres spécialistes que ceux de l'administration emploient un tout autre langage. Il suffit de lire le rapport récent du Conseil économique et social, pour voir qu'il n'a pas du tout le même langage, qu'il est beaucoup plus proche de l'opinion exprimée par la population, qu'il est profondément critique, ce qui n'est pas votre cas et je le comprends parfaitement dans la mesure où vous êtes tenu à un devoir de réserve.
M. le Président : Il n'y a pas de devoir de réserve ici.
M. Louis GUEDON : Lorsque j'ai posé des questions à ce sujet, je me suis fait à plusieurs reprises « renvoyer dans mes buts ».
J'ai expliqué tout d'abord que je saluais le courage des sauveteurs que l'on ne remerciera jamais assez parce qu'ils ont été exemplaires mais ensuite j'ai expliqué que les naufrages ont existé bien avant
l'Erika, pendant l'Erika et qu'il y en aura toujours. Pour autant, je considère, pour ce qui est des bateaux en mauvais état qui transportent des cargaisons dangereuses, puisqu'on en est à évoquer la nature cancérogène du produit, que le risque zéro doit exister et qu'on ne doit pas les laisser naviguer comme ceux qui transportent du bois, de la ferraille ou des produits inertes ne présentant pas de dangers. On doit adopter une attitude différente à l'égard de ce type de navires et décider que le risque zéro doit être exigé, au même titre que pour un chirurgien qui, s'il commet une faute professionnelle, est condamné.
On entend toujours les mêmes choses, à savoir qu'en période de tempêtes il faut veiller partout et que si cela n'avait pas été le fioul de l'Erika, cela aurait été - et vous l'avez dit vous-même, monsieur l'administrateur - celui de certaines soutes qui serait venu inonder le rivage...
Je ne peux pas accepter un tel argument car les soutes d'un navire n'ont pas une capacité de 30 000 tonnes, donc s'il y a naufrage et si une marée noire provient de fioul destiné à la propulsion, je veux bien admettre qu'elle sera sûrement désagréable, mais vous m'accorderez que les dégâts seront bien moindres...
M. Jean-Pierre MANNIC : Oui, mais une centaine de tonnes sur une plage bien ciblée, ça fait des dégâts !
M. Louis GUEDON : Si vous me dites que cent tonnes de fioul font les mêmes dégâts sur 400 kilomètres que 30 000 tonnes, je veux bien : j'avais d'autres appréhensions mathématiques mais je peux me tromper... Si on doit considérer que cent tonnes et 30 000 tonnes, c'est pareil, je veux bien : je reprendrai des cours de mathématiques...
M. Jean-Pierre MANNIC : Je crois qu'effectivement, on ne peut pas accepter le moindre accident.
M. Louis GUEDON :... laissez-moi terminer : je ne vous ai pas interrompu, monsieur l'administrateur.
Par ailleurs, vous nous dites que le bateau étant à trois cents kilomètres, vous ne pouviez rien faire. Or, certaines personnes auditionnées ne partageaient pas du tout ce point de vue! C'étaient des personnes compétentes qui n'étaient pas de l'administration, qui tenaient un autre langage et qui disaient que si le problème avait été pris en amont avec une appréhension et une évaluation des risques qui auraient entraîné, au vu de la situation, une décision responsable, on aurait pu entrevoir le problème différemment. C'est ce que nous avons entendu ici.
Il y a donc deux langages différents selon que nos interlocuteurs appartiennent à une chapelle ou à l'autre : les adeptes de la première tiennent un langage uniforme - c'est celui que vous avez tenu avec beaucoup de loyauté - et les adeptes de la seconde ont un discours totalement différent.
Comme nous arrivons à un stade où nous devons nous faire une opinion, nous pressentons qu'une décision, certes difficile, dure, redoutable à arrêter, nous en sommes d'accord, devait être prise. Or, la décision a été prise et a conduit à ce que nous avons connu, c'est-à-dire à cet affreux résultat qui est un échec sur toute la ligne... Le plan POLMAR mer a été une pantalonnade : nous avons vu, chez moi, de hautes autorités maritimes venues nous dire le jeudi soir qu'on ne savait pas où était le pétrole, ni s'il y aurait une pollution alors que, vingt-quatre heures plus tard, il arrivait au Guilvinec : cela jette le doute sur beaucoup de choses...
Il y a des autorités qui, d'après la loi maritime, sont fondées à prendre toute disposition quand un danger en mer se fait sentir - c'est une loi - et ma question est la suivante : êtes-vous certain que le jugement a été le bon et que les décisions prises étaient de nature à nous mettre à l'abri, dès lors que l'on avait un navire en mauvais état, porteur d'une substance particulièrement dangereuse, ayant lancé un appel de détresse qui ensuite, c'est vrai, a été annulé par le commandant ? Peut-on valablement traiter le contrordre d'un commandant d'un navire ainsi chargé comme s'il l'était de billes de bois ou de matières non dangereuses ?
M. Jean de GAULLE : Je n'aurai, pour ma part, que deux questions très factuelles.
Pourriez-vous nous indiquer le contenu exact du premier contact en phonie qui a été établi entre le CROSS et le commandant de l'Erika, le 11 décembre à 14 h 55 ? Est-il possible d'en avoir copie ?
Toujours concernant la chronologie des événements, à quand remonte le premier contact entre le CROSS et la préfecture maritime ?
M. Jean-Pierre MANNIC : On a une transcription du message que, non pas le CROSS Etel, mais le CROSS Corsen a eu à ce moment-là avec l'Erika
puisqu'il a tenté, à notre demande, de joindre le navire que nous ne réussissions pas à contacter correctement en phonie.
Nous avons fini par y parvenir et ce qu'a simplement compris l'officier de permanence du CROSS Etel, c'est que le navire avait la situation sous contrôle. Comme cet officier n'était pas sûr de ce qu'il avait entendu - il vaut toujours mieux faire confirmer ce genre de messages - car la qualité de réception était épouvantablement crachotante, il a demandé une confirmation par message Inmarsat au navire
Erika : c'est comme cela que nous avons provoqué le message de 14 h 34.
M. Jean de GAULLE : Je croyais que les messages en phonie étaient enregistrés ? Il n'y a pas de bandes magnétiques ?
M. Jean-Pierre MANNIC : Sur Corsen, si, il y a une bande magnétique de la conversation de l'Erika.
Sur la bande du CROSS, - j'ai écouté la bande à Corsen - je crois reconnaître la voix de l'officier de permanence d'Etel mais sans plus car il y a un « crachouillis » innommable.
En revanche, nous avons entendu la conversation qu'avait eue l'Erika
avec le Fort George ce navire britannique mentionné par Antenne 2. Cet échange a effectivement également été enregistré par Corsen mais nous ne l'avons pas capté sur Etel étant donné la portée et la qualité de nos installations radio...
M. Jean de GAULLE : Je croyais que, ce 11 décembre, à 14 h 55, il y avait eu un contact en phonie sur la fréquence H.F. 21 82 entre l'Erika et le CROSS d'Etel ?
M. Jean-Pierre MANNIC : Oui : un nouveau contact a été établi avec l'Erika en H.F. et par message Inmarsat C.
M. Jean de GAULLE : Il n'y a pas de transcription de ces deux messages ?
M. Jean-Pierre MANNIC : Non. Pour la bonne raison que l'enregistrement en H.F. ne fonctionne pas correctement, nous n'avons pas, nous, de transcription de cette affaire-là.
M. le Rapporteur : Est-ce que vous estimez, dès lors que vous êtes obligés de passer sur Corsen dès que quelque chose se passe en golfe de Gascogne, que vos moyens techniques sont insuffisants ?
M. Jean-Pierre MANNIC : Oui, de toute façon, il y a un plan de remise à niveau de ces émetteurs, prévoyant notamment de récupérer l'ancienne station France télecom de Batz-sur-mer, du côté du Croisic.
M. le Rapporteur : Il faut faire la comparaison des moyens techniques entre Corsen et Etel...
M. Jean de GAULLE : M. le président, pardonnez-moi d'insister mais ma question n'est pas anodine parce que 14 h 55, c'est globalement une petite demi-heure après le constat de l'état du navire fait par le second du commandant qui mettait à jour la présence de fissures etc. Je repose bien ma question : une demi-heure après, alors que le commandant de l'Erika a donc parfaitement connaissance de l'état de son bateau - ce qui posait le problème de sa responsabilité - à partir du moment où le CROSS d'Etel est entré en contact par phonie avec l'Erika, est-ce qu'il n'y a eu aucun d'élément d'information sur l'état réel du navire ? Je vous pose à nouveau la question.
M. Jean-Pierre MANNIC : Non, non ...
M. Jean de GAULLE : Votre réponse est bien négative ?
M. Jean-Pierre MANNIC : A 14 h 55, nous parvient un appel de l'Erika sur 21 82
- effectivement la communication devait être là un petit peu plus audible - dont je n'ai malheureusement pas l'enregistrement mais la transcription littérale que je vous lis : «
Tout va bien à bord; la gîte de tribord est sous contrôle ; ne demande pas assistance ; va envoyer un message pour confirmer que tout va bien à bord ; 26 personnes à bord, cargaison fioul-oil : 23 946 mètres cubes - c'est ce que nous avions compris à l'époque - destination Livourne ».
Voilà la teneur de la communication de 14 h 55 qui est d'ailleurs suivie, à 15 h 15, du message que nous avons demandé à l'Erika qui nous précise que la situation est sous contrôle, dans ces termes : «
vessel and all crew members safe on bord, please cancel my detress alert and reconsider the message as safety message ; thanks for your prompt and timely reply ».
M. Jean de GAULLE : Et, M. le directeur, il n'est pas surprenant que l'Erika, environ une heure après son appel de détresse, explique au CROSS Etel que tout va bien ?
M. le Rapporteur : Mais il appelle son agent pour dire qu'il fuit...
M. Jean-Pierre MANNIC : Je ne dis pas que le commandant ait joué la transparence avec nous...
M. le Rapporteur : C'est l'agent qui le lui a interdit ?
M. Jean de GAULLE : Le CROSS Etel, lui, n'est pas surpris par ce changement d'attitude ? Il y a un message de détresse, et une heure après on explique que tout va bien.
M. Jean-Pierre MANNIC : Ce n'est pas la première affaire dans laquelle après une alerte, la situation repasse sous contrôle : ce n'est pas une situation exceptionnelle.
M. Aimé KERGUERIS : Peut-il prendre des contacts avec sa direction sans que vous le sachiez ?
M. Jean-Pierre MANNIC : Tout à fait ! Dans l'affaire de
l'Amoco-Cadiz, c'était plus ou moins Le Conquet radio qui avait fourni les informations parce qu'il n'y avait que cela comme moyen de communication ce qui n'est plus le cas avec les moyens modernes. Je crois même savoir que n'ayant pas d'Inmarsat A, c'est-à-dire de phonie téléphonique avec son agent, l'Erika
est repassé sur un navire de commerce sur zone - cela figure également dans le rapport du BEA-mer - pour demander un service comme on demanderait de se faire prêter un téléphone pour appeler...
M. Jean de GAULLE : Pardonnez-moi, mais je crois que vous n'avez pas répondu à ma seconde question sur le moment où a été prévenu le préfet maritime.
M. Jean-Pierre MANNIC : Très exactement à 14 h 38.
M. Jean de GAULLE : De quelle façon ?
M. Jean-Pierre MANNIC : Par téléphone. Le COM a enregistré.
M. Jean de GAULLE : Et là, quel a été le contenu de la conversation ?
M. Jean-Pierre MANNIC : Je ne l'ai pas relevé en détail. J'ai simplement cela : « Filocom Brest, OSEM prévenu ; pas de moyens Marine en golfe de Gascogne ; Super Frelon en alerte à une heure... ». L'officier de permanence face à un navire qui avait de la gîte, s'est demandé quels étaient les moyens disponibles. L'OSEM ayant répondu qu'il n'avait pas de moyens en golfe de Gascogne ce qui, vu le temps n'était pas étonnant, et la météorologie étant ce qu'elle était, le préfet maritime avait décidé de placer ses moyens à une heure. Comme, entre temps, l'officier de permanence s'est occupé de voir quelle était l'évolution de la situation, la communication suivante a été pour dire que le commandant déclarait avoir la situation sous contrôle.
M. le Président : Estimez-vous que l'insuffisance de moyens dont vous disposez au CROSS d'Etel - vous avez évoqué une programmation à venir - a pu avoir des incidences sur le déroulement des événements ?
M. Jean-Pierre MANNIC : A priori non. C'était moins confortable de travailler avec Corsen puisque c'est Corsen qui a assuré le relais et récupéré les informations, mais Corsen a eu une liaison qui, sans être extraordinaire, était nettement plus audible avec le navire.
Ce n'est pas la seule opération dans laquelle Corsen intervient ou interviendra comme relais d'information, mais c'est le rôle que jouait Le Conquet radio. Il y a encore quelques mois, c'est Le Conquet radio qui aurait eu le contact avec l'Erika et qui nous aurait retransmis les éléments d'information du capitaine.
M. le Président : Ne peut-on pas penser également que les moyens dont disposait l'Erika étaient éventuellement insuffisants en matière de transmission ?
M. Jean-Pierre MANNIC : La question s'était posée il n'y a pas très longtemps. Sur le plan réglementaire, il était « dans les clous » si je puis dire. Maintenant, il est vrai que l'on aurait pu imaginer un moyen de phonie moderne et non pas simplement la H.F. 21.82 dont la qualité de transmission dépend des conditions de propagation et peut être très bonne ou exécrable mais jamais excellente par rapport à des moyens de type Inmarsat Alpha ou M, c'est-à-dire des moyens de téléphone par satellite tout simplement, même s'il ne s'agit pas d'un téléphone portable mais d'une installation un peu plus sophistiquée. Nous avons d'ailleurs régulièrement par ce moyen d'excellentes communications avec des navires, ne serait-ce justement que pour lever les ambiguïtés sur certaines détresses, puisqu'avec le système automatique de détresse il y a quand même de nombreuses fausses alertes. Il est sûr que, par téléphone, il est parfois plus facile de poser des questions reconventionnelles en fonction des réponses du capitaine que lorsqu'on échange des messages.
M. Jean de GAULLE : Pardonnez ma question qui va vous paraître peut-être un peu naïve : lorsqu'un navire déclenche un signal de détresse, il n'y a pas, comme c'est le cas pour les avions, une boite noire ?
M. Jean-Pierre MANNIC : En plus d'un appel de détresse il existe ce que l'on appelle les « balises Sarsat Cospas », c'est-à-dire des balises de détresse automatiques dont sont d'ailleurs équipés les plaisanciers qui font de la navigation hauturière. Soit elles se décrochent d'elles-mêmes, soit il faut tourner un bouton selon qu'elles sont manuelles ou automatiques et l'indication de la détresse, qui passe par Toulouse, arrive au CROSS quelques minutes après, avec la position du navire.
Dans l'affaire de l'Erika il n'y a pas déclenchement de balises de détresse, mais un autre système qui est tout aussi réglementaire, qui fait partie du système mondial de détresse et de sécurité en mer - SMDSM - qui est une fonction détresse greffée, portée par l'Inmarsat. L'Inmarsat a accepté d'avoir une fonction détresse : on appuie sur un « bouton rouge » ce qui génère un message de détresse qui est couplé au positionneur GPS ce qui permet de connaître la position du navire, sa route, sa vitesse, d'être informé sur ce qui se passe, et de savoir si c'est l'opérateur qui l'a activé. Si l'opérateur a le temps, il peut ajouter l'objet et la nature de la détresse grâce à un petit menu très simple.
M. Jean de GAULLE : Il n'y a pas d'enregistrements de conversation ?
M. Jean-Pierre MANNIC : Non, c'est automatique et généré de type télex.
M. le Président : M. Guédon avait posé une question. Pouvez-vous nous la rappeler, M.Guédon ?
M. Louis GUEDON : J'avais dit qu'à un moment donné une décision avait été prise...
M. Jean-Pierre MANNIC : De quelle décision s'agit-il ? En fait, face à une non-demande d'assistance et à une absence de renseignements sur l'état réel du navire et sur l'évolution de la situation, nous ne pouvions, malheureusement, rien inventer...
M. Louis GUEDON : C'est votre point de vue !
M. Jean-Pierre MANNIC : Et c'est pourquoi j'aurais aimé, moi, je vous le répète, que le préfet maritime dispose, dans l'après-midi du samedi, d'une information plus précise, notamment sur le problème des fissures et des fuites.
Cela étant, on peut aussi se poser la question de savoir quoi faire dans ce cas : c'est une bonne question ! Que fait-on ? Nous sommes à 300 kilomètres de la côte, le navire est parfaitement maître de son destin et de sa situation ; il ne demande pas d'évacuation de l'équipage ce qui était quand même le fond de l'affaire au départ.
Ce sont 26 personnes qui doivent maintenant être chez elles et on peut quand même se dire que le système ne fonctionne pas si mal car nous aurions pu avoir à déplorer 26 morts même si cela, malheureusement, ne semble pas mériter autant de lignes que d'autres informations... Ces 26 personnes doivent quand même la vie au système mis en place par l'Etat français.
M. Louis GUEDON : Personne n'a mis en cause le sauvetage. Tout le monde s'est accordé à le juger remarquable !
M. Jean-Pierre MANNIC : Quand le navire se trouve à 300 kilomètres, primo, on ne peut pas y aller en hélicoptère...
M. Louis GUEDON : Il y a d'autres avis dont certains sont totalement opposés au vôtre. Je suis désolé, vous êtes un navigant respectable mais nous avons entendu d'autres navigants respectables nous dire totalement le contraire de ce que vous affirmez... Mettez-vous d'accord entre navigants !
M. Jean-Pierre MANNIC : Moi, je n'ai pas pris de décisions à la place du commandant Mathur et je n'ai pas eu à intervenir en la matière donc je peux en parler avec un peu de recul. Il y avait deux façons de voir les choses et j'ai entendu deux sons de cloche différents. En tant que navigant, j'ai tendance à dire que, peut-être, si le navire avait stoppé et mis doucement à la cape, il aurait survécu : ce n'est pas impossible et sans doute les experts pourraient-ils se prononcer là-dessus, mais il est une autre méthode qui consiste à prendre la fuite parce que c'est ce qui fait le moins souffrir le navire... Si vous connaissez une troisième solution, je suis preneur !
M. Louis GUEDON : Moi, monsieur, je ne connais pas de solution je suis un profane, un témoin : j'ai écouté des navigants qui sont expérimentés et qui ont des positions diamétralement opposées. Je ne suis qu'un profane mais je prends acte des désaccords entre les spécialistes.
M. Jean-Pierre MANNIC : Pour ma part, je ne vois pas de troisième voie sauf à éviter que le navire ne se trouve dans cet état, à cet endroit... C'est peut-être le fond du problème.
M. le Rapporteur : La question de M. Guédon visait à savoir quels sont les moyens d'accès au bateau s'il se trouve à 300 kilomètres. C'est le remorqueur de haute mer ?
M. Jean-Pierre MANNIC : Le problème du remorqueur de haute mer c'est qu'il n'aurait pas réussi à rattraper le bateau puisqu'il marchait à 9 n_uds et le remorqueur à 12. Il faut savoir que ce navire n'était pas en avarie de machine, ni de barre. Il avait sa pleine capacité de man_uvre : il faisait route. Un remorqueur de haute mer a été positionné à Brest et c'est une excellente mesure - nous avons tous en mémoire l'Amoco-Cadiz - que de le coupler à ce système de détection de situations anormales, mais ce remorqueur a quelle vocation ? Celle de remorquer les navires désemparés, en panne de machine, ce qui se voit régulièrement du côté d'Ouessant, ou en panne de barre, ce qui était le cas de l'Amoco-Cadiz, avec des pouvoirs d'intervention du préfet maritime qui permettent d'autorité d'écarter ces navires de la côte.
Voilà quel est le rôle d'un remorqueur de haute mer. Maintenant, le remorqueur de haute mer n'est pas, à mon avis, fait pour courir après un navire qui marche dix n_uds et qui se trouve à 300 kilomètres. Il l'aurait rattrapé en Italie...
M. le Rapporteur : Ce n'est pas ce que je veux dire. La fuite est constatée : où se trouve le bateau, à 160 kilomètres ?
M. Jean-Pierre MANNIC : Lorsque la fissure dans le pont a été constatée, il se trouvait à 300 kilomètres.
M. le Rapporteur : C'est bien ce que je pensais. Si le commandant avait déclaré la fissure, dont vous ne serez informés que beaucoup plus tard, aussitôt qu'il l'avait vue, on n'aurait pas demandé au remorqueur de haute mer de courir après le bateau...
Quels sont les moyens d'action qui étaient alors envisageables ? C'est sur ce point qu'intervient la divergence qu'évoquait M. Guédon. Certains intervenants disaient qu'il y avait la possibilité d'envoyer un équipage sur le navire par un remorqueur de haute mer, l'hélicoptère n'ayant pas une portée suffisante...
M. Jean-Pierre MANNIC : Peut-être, mais en sachant que pour rallier ce point, de Brest, il fallait compter, vu l'état de la mer, une vingtaine d'heures.
M. le Rapporteur : Et sans savoir, comme vous le disiez précédemment quels sont les pouvoirs juridiques dont on dispose...
M. Jean-Pierre MANNIC : Exactement ! Si le navire avait été désemparé ou en travers, on aurait décidé de lui envoyer le remorqueur pour essayer, au moins, de le maintenir à la lame. Mais là, ayant sa barre et sa machine, il pouvait se mettre à la cape et faire tête à la lame.
J'ai, moi aussi, recueilli des avis tout à fait divergents des commandants de pétrolier que j'ai interrogés : certains disent qu'il aurait mieux valu faire tête doucement à la lame, ce qui est effectivement plutôt mon point de vue, tandis que d'autres préconisent, au motif qu'un pétrolier souffre beaucoup quand il est face à la lame, de fuir et d'avoir la mer l'arrière, ce qui impose moins de contraintes.
Peut-être que les experts pourront se pencher sur la question et dire si la décision prise aura été déterminante et susceptible de faire évoluer la situation dans un sens ou dans un autre. Il y aura peut-être des simulations mais on ne fera jamais d'essais à la véritable échelle.
Pour ce qui est de moyens d'intervention, il en est un auquel on peut penser c'est toujours l'Atlantique 2
qui reste seul capable d'aller en moins d'une heure sur zone. Cela étant, il n'a pas d'autre capacité que de servir de relais de transmission.
Je suppose que si la fuite avait été déclarée, le préfet maritime aurait probablement envoyé l'Atlantique, qui aurait pu discuter avec le capitaine et lui demander comment il évaluait la situation et quelles étaient ses intentions. Peut-être, à ce moment-là, la préfecture maritime aurait-elle fait ce que n'a pas fait l'armateur, dans le cadre du code ISM, c'est-à-dire apporter une assistance sereine de la terre à un capitaine qui, en difficulté, s'est trouvé face à des numéros de téléphone et pratiquement à des répondeurs pour l'assister et qui, c'est vrai, n'a pas eu le réflexe de demander aux autorités, à défaut d'une réponse de son armateur, ce qu'elles pensaient de sa situation. Mais peut-être n'est-ce pas un réflexe habituel chez le capitaine d'un navire de ce type, dans le cadre d'un
management humain et d'un armement de ce type...
Audition de M. Philippe TREPANT,
président de l'Union française de l'industrie du pétrole (UFIP),
accompagné de M. Gérard GARDES,
directeur des transports et de la logistique,
et de Mme Marie-Noëlle MASSAL,
directeur des relations et affaires économiques
(extrait du procès-verbal de la séance du 28 mars 2000)
Présidence de M. Daniel PAUL, Président
MM. Philippe Trepant, Gérard Gardes et Mme Marie-Noëlle Massal sont introduits.
M. le Président leur rappelle que les dispositions législatives relatives aux commissions d'enquête lui ont été communiquées. A l'invitation du Président, MM. Philippe Trepant, Gérard Gardes et Mme Marie-Noëlle Massal prêtent serment.
M. Philippe TRÉPANT : madame, messieurs, je représente ici l'UFIP (Union française des industries du pétrole) et j'en suis également le président. Dans ce cadre, nous sommes en charge de la défense des intérêts des activités pétrolières en France. Nos adhérents sont les grandes sociétés pétrolières pour ce qui concerne leur activité française.
Elles étaient sept il y a deux ans. Leur nombre diminue étant donné les restructurations en cours. Nous sommes cinq aujourd'hui et quatre en fin d'année. Il s'agira donc de la société française Total-Elf-Fina, de Shell qui reste bien sûr la société anglo-hollandaise, de BP, la société anglaise et, enfin, d'Exxon qui sera issu de la fusion Exxon Mobil et qui sera la société américaine.
Nous nous occupons essentiellement des activités françaises de ces grands groupes. Ceci exclut les autres acteurs pétroliers que peuvent être, par exemple, les revendeurs indépendants ou les grandes surfaces.
L'industrie pétrolière en France, c'est essentiellement du raffinage-distribution et un peu d'exploration et de production de pétrole brut métropolitain.
Sur le plan du raffinage et de la distribution, nous raffinons environ 90 millions de tonnes qui correspondent aux besoins français en pétrole, c'est-à-dire, en gros, 40 % de la demande énergétique française, ceci dans treize raffineries. Nous distribuons ceci au travers de 17 000 points de vente.
En terme de production, nous produisons en gros 4 millions de tonnes d'hydrocarbures dont 1,5 million de pétrole, ce qui veut dire que la différence entre les 90 millions de tonnes de brut raffiné et le 1,5 million produit en France doit être importée. Nous importons donc le solde et même un peu plus car la France est une terre de transit pour quelques volumes de pétroles bruts, notamment à destination de l'Allemagne, pétroles qui sont importés par la région de Fos.
Cette situation de la France qui doit importer le pétrole qu'elle consomme est une situation assez générale dans le monde. Les grands pays consommateurs ne sont malheureusement pas, en général, les grands pays producteurs. C'était autrefois le cas des Etats-Unis mais ce n'est plus le cas aujourd'hui puisque même les Etats-Unis importent 50 % de leurs besoins.
Ces quantités de pétrole que consomme le monde doivent être, pour l'essentiel, acheminées, et elles doivent l'être par la voie maritime qui est la voie la plus appropriée.
Quelques chiffres : il se consomme dans le monde 3,5 milliards de tonnes de pétrole et il s'en transporte par voie maritime un peu plus de 1,5 milliard, plus 500 millions de tonnes de produits finis, ce qui correspond en gros à 2 milliards de tonnes de produits pétroliers, soit 40 % dans le contexte du transport maritime mondial, toutes marchandises confondues, puisque le trafic maritime mondial global est de 5 milliards de tonnes.
Un peu d'histoire : jusqu'au choc pétrolier de 1973, les activités pétrolières étaient intégrées, c'est-à-dire que les grandes compagnies pétrolières contrôlaient physiquement toutes les opérations, depuis la production jusqu'à la mise à la consommation dans les stations-services. Ceci comprenait toute la chaîne, y compris les transports maritimes.
Je rappelle les éléments de la chaîne : on extrait le pétrole du fond des puits, on le met dans les bateaux qui vont vers les raffineries, qui sont généralement proches des marchés consommateurs, puis on transporte le produit jusqu'à la station-service.
Tout ceci était intégré. Le choc pétrolier de 1973 a amené un découplage complet des activités car les sociétés ont été, à l'époque, soumises à des contraintes économiques relativement brutales dans la mesure où elles perdaient le contrôle de beaucoup de leurs champs de production.
On a donc vu le pétrole produit aller vers des destinations qui n'étaient pas nécessairement celles des raffineries auxquelles appartenait le groupe producteur, et ceci simplement afin de faire des économies de transport puisqu'une production en Indonésie, par exemple, allait à ce moment-là dans une raffinerie japonaise, et on préférait acheter du brut en Afrique plus proche, ou en Mer du Nord, (ce n'était pas le cas en 1973, cela l'a été un peu plus tard) pour l'amener à la raffinerie.
Ce découplage a fait que les bateaux transportaient plus souvent du brut qui n'était pas le vôtre, sur des lignes qui n'étaient pas non plus les vôtres. On a vu tout naturellement la chaîne pétrolière s'éclater entre les différents acteurs relativement spécialisés. On a donc vu se développer, dans le domaine du transport maritime, des flottes qui n'étaient plus contrôlées par les pétroliers jusqu'à la situation actuelle.
Ceci n'était naturellement pas sans poser des problèmes de contrôle, notamment de sécurité, car je voudrais rappeler que si le métier pétrolier est un métier très technique, c'est aussi et avant tout un métier de contrôle des risques.
Il est certain qu'il a fallu prendre des précautions quand on a commencé à affréter des bateaux appartenant à d'autres. C'est ainsi que l'industrie pétrolière, avec les armateurs ainsi qu'avec les sociétés de certification, a énormément innové au fil du temps, au cours des trente dernières années, en mettant en place des systèmes qui leur ont permis de contrôler que tout ceci se passait le mieux possible. Dans la plupart des cas, ces systèmes mis en place par les acteurs ont d'ailleurs ensuite été repris dans le cadre de l'OMI pour devenir la référence légale.
Ceci a concerné, en matière de sécurité, la prévention des risques, l'établissement de nombreuses normes en matière de prévention, puis des méthodes permettant de traiter les pollution en cas d'accident et, enfin, la réparation.
Pour ce qui concerne la prévention, nous avons mis en place un certain nombre de conventions dans le cadre de discussions qui ont été menées à l'origine, de façon souvent tripartite, entre les associations d'armateurs, l'association des sociétés de certification (I.A.C.S.), et les compagnies pétrolières qui intervenaient au travers de l'OCIMF, association regroupant une quarantaine de compagnies (de moins en moins étant donné les restructurations).
Je ne vais pas vous faire l'historique de tout ce qui a été fait. La dernière réalisation marquante est celle qui concerne la mise en place du système SIRE. C'est une base de données qui permet de mettre en commun l'ensemble des informations que collectent les sociétés pétrolières de façon à les aider à faire le choix des bateaux acceptables par rapport aux bateaux qui ne sont pas acceptables ; autrement dit, à séparer le bon grain de l'ivraie. Nous allons-y revenir.
Je ne vais pas m'étendre sur la partie traitement-dépollution. Les compagnies pétrolières, avec d'autres instituts, ont mis au point de nombreuses techniques qui permettent, en principe, de ramasser le pétrole répandu sur la mer. Il existe diverses méthodes : la foculation, le pompage, etc. Il faut être raisonnable, il faut disposer de ces méthodes mais, quand le pétrole est parti, c'est souvent dans des conditions de temps difficiles et on a beaucoup de difficultés à faire fonctionner les systèmes pointus que nous mettons en place. Il faut surtout éviter d'avoir des accidents.
Concernant la réparation des accidents, on s'est très rapidement aperçu que les procédures juridiques pour effectuer les recherches de responsabilité étaient très longues et que les victimes des accidents étaient finalement indemnisées après un nombre d'années trop important, d'où l'idée d'introduire, dans le système des fonds, un fonds du côté des armateurs qui s'appelle le fonds CLC, et un autre du côté des pétroliers qui s'appelle le fonds FIPOL, destinés à indemniser les gens, même si la faute n'était pas reconnue. Autrement dit, il s'agissait d'assurance responsabilité civile sans faute. Ces fonds rechercheront les véritables responsables si faute il y a et se feront indemniser plus tard, mais les gens situés sur le littoral et qui subissent la conséquence des pollutions ne doivent pas attendre trop longtemps que la justice soit rendue.
C'est pour vous dire que les acteurs du transport maritime pétrolier ont toujours été actifs au fil du temps pour mettre en place un certain nombre de novations et s'adapter aux exigences qui s'imposent à eux.
Ceci étant, je ne vous dirai pas que tout va bien. La preuve en est qu'il y a encore des désastres comme l'Erika et d'autres, et il y en aura malheureusement encore. Il faut qu'il y en ait le moins possible.
Nous avons fait notre investigation une fois de plus sur la situation, et notre diagnostic est aujourd'hui qu'il y a des réglementations en quantité importante pour régir toute cette sécurité, depuis la construction du bateau jusqu'à la gestion ou l'information des équipages mais force est de constater qu'il y a quand même des accidents et que des bateaux ne respectent pas les règles.
Notre diagnostic est de dire qu'il n'y a pas suffisamment de régulation. Cette insuffisance de régulation ne tient pas à une insuffisance des règles mais à une insuffisance de leur observation. En réalité, il y a inobservation des règles par une minorité d'acteurs peu scrupuleux et mal contrôlés.
Nous pensons qu'il est important que des dispositions soient prises pour que les règles soient respectées. C'est en principe, de la responsabilité des États du pavillon qui sont aujourd'hui, pour beaucoup, des pavillons de libre immatriculation, c'est-à-dire des pavillons de complaisance avec tout ce que ce mot sous-entend de médiocrité. Il ne faut pas faire le procès de tous les pavillons dits de complaisance mais il est certain que quelques États du pavillon n'ont pas, ou la volonté, ou les moyens d'appliquer les règles. C'est un fait et il faut vivre avec. C'est d'ailleurs pour cela que les pétroliers ont mis en place le fameux système SIRE.
Ceci étant constaté, nous disons que nous ne pouvons faire que du vetting, c'est-à-dire sélectionner et choisir un bateau selon les informations disponibles, puisqu'il y a carence des États du pavillon et que nous ne pouvons pas maîtriser l'ensemble, malgré les efforts faits par les opérateurs privés, puisque nous n'avons pas les pouvoirs de police que seul un État peut avoir. Il faut que les États du port prennent leurs responsabilités. Ce n'est pas une nouveauté et je ne ferai référence qu'au Mémorandum de 1982 par lequel les États du port ont décidé, dans la région européenne en allant jusqu'au Canada, de compenser la carence des États du pavillon en décidant de contrôler un bateau sur quatre dans les ports.
Force est de constater que ces contrôles dans les ports ne se font pas suffisamment puisque les statistiques qu'on connaît montrent que leur nombre ne s'établit pas à 25 % mais plutôt à 12 ou 13 % si je prends le cas de la France et un peu plus pour certains autres pays européens. On peut dire que ces contrôles ne sont pas faits très en profondeur.
Il y a aussi une concurrence entre les ports. Il y a des ports qui ne veulent pas trop rebuter les bateaux de venir.
Il y a là tout un ensemble d'éléments qui font que ces contrôles d'États du port ne sont pas efficaces.
Autre élément : les informations collectées par les États du port dans ces contrôles - pour ce qui concerne les pétroliers en tout cas - restent confidentielles. Nous n'en connaissons pas le contenu détaillé.
C'est donc un travail qui n'est pas fait suffisamment et le peu qui est fait n'est même pas utilisé positivement par les gens qui font le vetting et les choix. Il faut, selon nous, que les États du port prennent leur responsabilité et fassent finalement la police.
Un projet a d'ailleurs été lancé, surtout par la France, qui s'appelle le projet Equasis et qui est de nature à répondre, au moins en partie, à ce problème de repérage des bateaux dangereux en vue de les éliminer de la circulation.
Nous sommes naturellement en faveur de ce système. Nous sommes d'ailleurs prêts, dans le cadre de la charte de la sécurité que nous avons signée avec les autres partenaires et avec le ministre Gayssot, à apporter notre expérience du système SIRE parce qu'Equasis est finalement un système SIRE étendu.
Nous souhaiterions que le système Equasis aille plus loin que les simples éléments techniques et qu'il inclue également les données sociales puisqu'on sait très bien que la qualité des équipages est aussi importante pour la sécurité. Il faut un bon bateau mais il faut également des gens qui aient la formation et la capacité de bien gérer. Cela ne doit donc pas seulement couvrir les aspects techniques mais également les aspects sociaux.
Il est également important, selon nous, qu'Equasis débouche sur des éditions de listes noires - que seule la puissance publique peut faire - car, si on se partage des informations, nous ne pouvons pas publier des listes noires communes pour des raisons légales évidentes. Et chacun fait son propre vetting car nous aurions des problèmes vis-à-vis des lois concernant la concurrence si on le faisait ensemble.
La puissance publique pourrait donc également aller plus loin et établir des listes noires. Connaissant bien les bateaux, rien de plus facile à ce moment-là de demander aux bateaux de s'annoncer quand ils arrivent dans les eaux européennes et d'ordonner des feux verts ou des feux rouges : vous rentrez ou pas. Nous pensons que ceci est vraiment le c_ur du problème.
Il y a, bien sûr, d'autres voies d'amélioration. Il y a d'abord des améliorations qui concernent l'évolution des technologies et des réglementations générales permanentes. Il y a le débat du bateau à double fond, à double coque. Ce n'est même plus un débat puisque les Etats-Unis se sont lancés dans cette direction et qu'on ne voit pas très bien comment les armateurs pourraient ne pas suivre et ne pas adhérer à cette approche, même s'il y a des discussions techniques autour de ce concept. Les normes techniques doivent donc continuer à évoluer.
Un autre débat concerne la responsabilité, c'est-à-dire la réparation lorsqu'il y a eu, malgré les améliorations apportées, un accident. Je voudrais rappeler que les assurances des armateurs sont d'un montant élevé lorsque leur responsabilité est engagée. Ceci est peut-être à réviser. Les pétroliers peuvent également encourir des responsabilités civiles lorsqu'il y a faute si le produit était différent de ce qui a été annoncé.
Je voudrais aussi rappeler qu'il existe un système qui a fait ses preuves, c'est le système d'indemnisation pour la responsabilité civile sans faute dans le cadre du CLC et du FIPOL.
Il y a probablement des révisions à faire, compte tenu de l'augmentation de la sensibilité des gens à la protection de l'environnement, sur les montants d'indemnisation sans faute, et nous y adhérons puisque nous avons signé la charte qui le prévoit.
Dernier point : il y a la question qui est posée aussi assez fréquemment de la responsabilité environnementale qui est une responsabilité sans faute. Celle-ci est dans l'air du temps. Ce concept est en train de s'installer. Vous êtes mieux informés que moi de ce qui se fait au niveau européen en la matière. Je fais en particulier allusion à ce livre blanc du début février 2000 qui a été édité par la Communauté européenne. Il prévoit une réflexion et une réglementation générale sur le concept de responsabilité environnementale sans faute et, lorsqu'il sera au point, il s'appliquera naturellement à toutes les activités dangereuses pour l'environnement, y compris le transport maritime qui, par définition, peut porter atteinte à l'environnement comme on l'a bien vu récemment.
Voilà ce que je voulais vous dire d'entrée de jeu.
M. le Rapporteur : Plusieurs questions et d'abord une question technique pour que nos collègues soient tout à fait éclairés : comment le système SIRE est-il constitué et comment ferez-vous l'articulation entre SIRE et Equasis ? Mettrez-vous tout SIRE dans Equasis ? Y aura-t-il une technique complètement uniforme, à ce moment-là, pour vérifier la qualité des bateaux que vous choisirez ? Comment comptez-vous techniquement mettre en _uvre tous ces systèmes ?
Pouvez-vous aussi nous expliquer comment fonctionne le vetting ?
Sur le fond, le FIPOL peut indirectement apparaître, même si c'est un progrès par rapport à la situation antérieure, comme un droit à polluer et une espèce d'incitation à ne pas faire d'effort pour avoir des bateaux performants et sûrs puisque le FIPOL, c'est, de toute façon, une indemnisation de 1,2 milliard, quel que soit l'âge du bateau.
Nous avons le sentiment que, telles qu'elles sont aujourd'hui, les normes sont surtout insuffisantes. Je ne suis pas sûr que la somme de 1,2 milliard permettra de couvrir l'ensemble des dégâts constatés par la marée noire de l'Erika. D'autre part, vous payez la même chose quels que soient les efforts pour la qualité des bateaux. N'y a-t-il pas lieu de revoir les règles d'indemnisation du FIPOL ?
Enfin, dernière question : vous avez beaucoup insisté sur la responsabilité de l'État du port. Il se trouve que nous étions hier au Havre et nous avons essayé de le vérifier techniquement, concrètement, physiquement. Il apparaît qu'autant on peut aller vite pour faire des contrôles de bateaux sous pavillon français - que ce soit pavillon plein ou Kerguelen - parce qu'on connaît les normes, parce qu'on connaît les bateaux, parce que les contrôleurs reconnaissent l'histoire, autant la capacité de contrôle est faible sur les bateaux incertains, car il faudrait y passer un temps considérable
Nous sommes allés dans les ballasts voir exactement quelle était la tâche à entreprendre si on voulait vérifier la sécurité d'un bateau. On nous a indiqué des délais de contrôle extrêmement importants si on ne connaissait pas le bateau.
Voilà les questions qu'on se pose. Comment faire pour que l'État du port assure complètement la mission que vous demandez, puisque votre propos est de dire que l'État du port doit prendre ses responsabilités ? Cela demanderait beaucoup de temps et beaucoup de moyens.
N'y a-t-il pas nécessité de responsabiliser aussi davantage l'État du pavillon en imposant des règles beaucoup plus rigoureuses pour éviter ces insuffisances ? Parce que, même en y mettant un certain nombre de moyens, on voit bien le fossé considérable qui existe entre une volonté de faire et une capacité à faire.
M. le Président : Pour compléter la question de M. Le Drian, compte tenu des insuffisances que vous avez listées tout à l'heure, tant des États du pavillon que des États du port, pourquoi ne pas, dans ce cas, prendre l'initiative de shunter les compagnies où les bateaux arborent des pavillons à risque que vous connaissez bien, et vous en tenir à des pavillons métropolitains dûment connus, répertoriés, qui sont pour la plupart d'entre eux quand même bien connus ?
M. Philippe TRÉPANT : Je vais commencer par le vetting. Le vetting est l'opération qui consiste, au sein des société pétrolières, à déterminer, en fonction des informations connues sur un bateau, si celui-ci est acceptable ou non au regard des règles générales de l'OMI et souvent, en plus, au regard des règles internes de la société qui sont en général un peu plus strictes.
Ces services travaillent à partir des informations collectées dans la société, à partir de ce qu'on peut connaître également dans la presse, de tout ce qui est public, et aujourd'hui à partir de SIRE. Ces services sont, dans les sociétés pétrolières - du moins celles que je connais -, strictement séparés sur le plan de l'organisation, sur le plan de la notation des gens concernés (ceux qui font le travail), de ceux qui s'occupent ensuite de négocier les affrètements, de manière à ce qu'il n'y ait pas la tentation de jouer le prix de revient d'un transport sur un risque.
Les gens qui font du vetting sont des spécialistes, des techniciens, qui essaient, avec l'information dont ils disposent, de déterminer si ce bateau présente un risque inacceptable ou s'il peut être accepté. Les affréteurs, qui sont totalement séparés de ceux-ci, doivent ensuite trouver le meilleur bateau au sein de ceux autorisés par les vetteurs. Les deux fonctions sont complètement séparées et, dans les sociétés que j'ai connues, ces fonctions reportent à la direction générale. C'est un peu comme un service audit. Un service audit est évidemment totalement indépendant des services qui mènent les opérations commerciales et qu'ils sont censés contrôler. C'est ici rigoureusement la même chose.
Le vetting est donc une sélection technique, indépendamment de tous critères économiques.
Il est apparu que les informations ne sont pas suffisantes pour faire un vetting et une sélection efficace sans coopération large d'où le système SIRE que j'expliquais. Je ne vais pas y revenir, c'est quelque chose qui a été fait dans le club des pétroliers, les 40 sociétés de l'OCIMF, ce groupement de sociétés pétrolières qui s'occupent de problèmes maritimes. On a mis ensemble toutes les informations qu'on collecte et c'est ouvert à tous les membres du club. On enrichit l'information.
C'est là que je voudrais préciser ce que peut faire SIRE qui est un progrès substantiel par rapport au passé, mais qui n'est pas suffisant pour être véritablement efficace. Le système SIRE, comme je l'ai indiqué, n'a accès qu'aux informations qui sont ouvertes aux pétroliers.
Je voudrais insister sur d'autres contrôles, ceux-là beaucoup plus importants, qui ne sont d'ailleurs connus, ni des ports en général, ni de SIRE. Les sociétés de certification et de classification mènent ces investigations de manière approfondie. Leurs prestations sont définies d'une façon très précise dans le cadre des conventions de l'OMI (Organisation Maritime Internationale) et comprennent, pour les bateaux récents, une mise en cale sèche systématique tous les cinq ans, à quoi s'ajoute une inspection détaillée tous les ans du type de celle que vous citiez tout à l'heure, avec un examen du ballast, etc... mais sans mise en cale sèche, puis une inspection intermédiaire tous les deux ans et demi au lieu de la faire tous les cinq ans, consistant à arrêter le bateau plus longtemps encore, à le regarder dans tous ses détails, pour décider ensuite d'une éventuelle mise en cale sèche si besoin est.
Ces investigations sont extrêmement riches en informations, d'autant que la société qui fait ce travail a généralement participé à la construction et à l'ingénierie du bateau.
M. le Rapporteur : Est-ce la même en général ?
M. Philippe TRÉPANT : C'est la même société dans la pratique. Il y a des changements mais c'est très rare et, quand il y a changement, elle récupère tous les dossiers.
Lorsqu'interviennent des sociétés de classification sérieuses, dans pratiquement 80 % des cas, une mise en cale sèche intervient tous les deux ans et demi au-delà de quinze ans, parce que le bateau présente des points de rouille et qu'il faut aller les regarder. Nous avons décidé de systématiser ce type de contrôle dans le cadre de la fameuse charte de sécurité.
Toute ces informations précieuses détenues par les sociétés de classification et qui appartiennent à l'armateur ou à l'État du pavillon ne sont pas aujourd'hui accessibles de façon transparente et libre par les pétroliers pour alimenter SIRE. Elles ne sont d'ailleurs pas non plus accessibles aux États du port.
Ces informations sont également enrichies, au moins dans le cas des sociétés de classification sérieuses, par le recensement de tous les incidents qui surviennent sur le bateau, incidents que l'armateur doit déclarer à la société de classification selon le contrat. On s'aperçoit qu'il y a là un trésor d'informations.
Nous demandons que ces informations soient versées dans le fichier Equasis, en plus de celles que nous récoltons et que nous mettons à disposition d'Equasis, et en plus de celles que les États du port devraient également mettre dans Equasis. Dans ces conditions, on connaîtrait vraiment tout sur le bateau et il serait aisé de faire un vetting - officiel celui-ci - au niveau d'Equasis. Ceci pourrait sérieusement aider les compagnies pétrolières à éliminer les bateaux qui trichent.
Voilà l'articulation entre SIRE et le futur Equasis. Autrement dit, SIRE deviendrait un pourvoyeur d'informations d'Equasis, pour la part qui le concerne.
Mais Equasis, ou la réforme qui nous paraît nécessaire, ne doit pas se limiter à la mise en commun d'informations, elle doit déboucher sur un vetting officiel.
Elle doit également déboucher sur l'interdiction d'entrer dans les eaux territoriales, ce qui implique des obligations d'annonce de la part des bateaux avant de rentrer dans les eaux territoriales.
Vous vous rendez bien compte, d'une part, que l'exigence des informations au niveau de l'armateur et de sa société de classification, d'autre part, que l'exigence d'une annonce avant d'entrer dans les eaux territoriales et l'émission d'un refus si ce bateau est sur la liste noire d'Equasis ne peuvent pas être le fait des acteurs privés, même en club, car cela pose des problèmes légaux de toute nature. Par contre, une autorité publique, telle qu'une agence maritime européenne peut très bien le faire si les États européens le décident.
Je pense que cela répond à la question de l'articulation.
Vous disiez tout à l'heure, Monsieur Le Drian, qu'il faudrait agir sur l'État du pavillon. Oui, il faut essayer d'influencer l'État du pavillon pour qu'il respecte les engagements qu'il a pris dans le cadre de l'OMI mais on sait très bien qu'il y a des limites politiques qui font qu'on ne pourra pas aller au-delà parce que ce sont quand même des États libres.
Il faut effectivement favoriser tout ce qui peut faire pression sur certains de ces États. Certains sont candidats pour entrer dans l'Union européenne : il y a là des moyens assez faciles pour faire pression. Concernant d'autres pavillons, nous ne disposons pas d'arguments aussi évidents.
Je voudrais ajouter une remarque supplémentaire sur les États du pavillon. On a souvent, tout à fait injustement, assimilé dans la presse qualité du pavillon et risques des bateaux. La réalité n'est pas aussi simple. On peut être en présence d'États de pavillons sérieux où des armateurs trichent vis-à-vis de l'État du pavillon. D'autres Etats ne sont évidemment pas sérieux et encore certains États qui ne sont pas de complaisance, ne présentent pas les garanties souhaitables. On sait, année après année, que la Russie a des problèmes. J'ai beaucoup travaillé avec la Turquie et je voyais passer dans le détroit du Bosphore les bateaux russes. Je vous assure que, vu du pont, ce n'était pas brillant !
Il ne s'agit pas là d'États de complaisance, c'est encore un autre type de problème.
Ceci pour vous dire qu'il faut viser le bateau défectueux. Il n'y a pas de règles qui permettraient de les éliminer intellectuellement. Le bon et le mauvais se côtoient. Il faut absolument que chaque bateau soit suivi individuellement dans un système tel qu'Equasis et tel que je l'ai décrit. Si ceci est fait avec résolution, ces bateaux-là étant bannis d'Europe et déjà bannis des Etats-Unis, le marché réservé aux bateaux tricheurs sera très exigu. Que leur restera-t-il ? Il leur restera les côtes africaines... Autrement dit, il ne leur restera rien et ils disparaîtront.
C'était la réponse à la question sur l'État du pavillon et le pavillon à risque.
Vous avez posé une question sur le FIPOL. Le FIPOL a été créé, il y a 30 ans, en 1971. Les montants d'indemnisations se sont passablement développés. Ils s'élèvent aujourd'hui à 1,2 milliard. On dit que ce n'est pas suffisant. Tout cela pose, au fond, la question de ce que veulent les citoyens.
M. Louis GUÉDON : Très bonne réponse.
M. Philippe TRÉPANT : La pression est aujourd'hui énorme. Il y a donc fatalement un besoin d'indemnités. Autrement dit, il y a des choses qu'on considère comme étant des dommages, qui n'étaient pas considérés comme tels avant, et qu'il faut indemniser.
Le fonds a donc augmenté et il augmentera encore. Nous sommes d'ailleurs en faveur du réexamen de ce fonds.
Vous me disiez que ce fonds FIPOL est un encouragement à mal se conduire parce que la compagnie pétrolière qui est dans ce fonds sait qu'elle bénéficiera d'un club. Oui, d'accord, mais elle paiera au moins sa part.
Attention, on parle ici de la responsabilité sans faute. Le FIPOL intervient lorsqu'on n'est pas capable de déterminer que le pétrolier, l'armateur ou d'autres intervenants ont commis une faute, et ils sont rattrapés s'ils ont commis une faute. L'armateur doit aujourd'hui pouvoir garantir 1 milliard de dollars. C'est la responsabilité civile normale.
C'est pareil pour le pétrolier. Il a commis une faute s'il a mis, par exemple, du fuel lourd n° 2 contenant de l'essence et que cette essence a fait de la vapeur et a fait exploser le bateau alors qu'il l'avait déclaré comme étant un résidu. Le FIPOL se retournera vers le pétrolier dans ce cas-là.
Le FIPOL est un fonds qui permet d'intervenir lorsqu'il n'y a pas faute, autrement dit quand on ne peut rien reprocher au pétrolier. Le FIPOL intervient lorsqu'on ne peut pas établir l'existence d'une faute.
M. Louis GUÉDON : C'est formidable !
M. Philippe TRÉPANT : Sinon, s'il y a une faute du pétrolier, le FIPOL se retourne contre le pétrolier.
M. le Rapporteur : On en est bien conscient.
M. Philippe TRÉPANT : C'est souvent oublié.
Dans ce cas, le FIPOL fait l'avance.
L'idée qui a présidé à la création du FIPOL, c'est qu'il ne fallait pas que les gens sinistrés subissent une procédure de dix ou quinze ans, etc., mais si la compagnie a commis une faute, le FIPOL se retourne contre la compagnie. Cela prendra quinze ans et la compagnie paiera. Dans le cas présent, si l'enquête disait que Total a fait une faute, le FIPOL ferait payer Total. Voilà comment cela fonctionne.
En ayant bien cela en tête, la question est de savoir, en cas de faute, si l'avance faite par le FIPOL est suffisante ou non parce qu'il y a là un problème. A supposer qu'il y ait 5 milliards de dégâts et qu'il n'y ait que 1 milliard dans le fonds FIPOL, 4 milliards vont donc attendre au cas où Total serait responsable, à supposer qu'il le soit. C'est dans cet esprit que les acteurs sont d'accord pour dire qu'il faut réévaluer le FIPOL au même titre que la première tranche d'assurance sans faute pour les armateurs parce que ce fonds est aussi collectif, il s'agit là du CLC.
Afin de répondre à votre question, je ferai une dernière observation : si Total a fait une faute, il n'est absolument pas exonéré et, à supposer même qu'il le soit, ne pensez-vous pas, quand on voit ce qui se passe aujourd'hui pour Total, que le déficit d'image, de notoriété, l'impact probable sur les marchés financiers, constitue une pénalité considérable ? Je dirais même que c'est une pénalité un peu injuste s'il s'avère que Total n'a pas du tout commis de faute.
Le fait de risquer de rentrer dans un tel engrenage est hautement motivant pour être d'une extrême vigilance.
Je vais ici présenter un témoignage personnel : pour avoir passé vingt ans chez Mobil et dix ans chez Elf, et avoir eu à plusieurs reprises le département maritime dans les secteurs que j'ai dirigés, je peux vous assurer qu'on ne joue pas avec cela.
Ce n'est d'ailleurs pas seulement vrai dans le domaine maritime. Notre métier est un métier de gestion des risques, et la culture de ceux qui la font est avant tout de limiter les risques et de parler d'argent seulement après.
Le raffinage est très risqué. Sortir du pétrole du fond de la mer - maintenant à 1000 mètres de fond - est une opération encore bien plus risquée.
La gestion des risques est une chose que l'on fait et que l'on mène séparément des aspects économiques. C'est une tradition dans le métier.
M. Jean-Michel MARCHAND : Vous avez répondu à nombre de nos interrogations, mais tout de même ! Les systèmes SIRE et Equasis, décrits comme vous venez de le faire, paraissent parfaits. Or, force est de constater, comme vous l'avez dit vous-même, que c'est la mise en _uvre de la réglementation qui existe qui pose problème.
Je m'interroge, reprenant ce que vous venez de nous dire, sur le fait qu'on ne puisse pas exclure que les informations données soient incomplètes étant donné les carences actuellement constatées.
Je reprends l'exemple que vous venez de donner en disant que l'État du port ne vous communique pas d'informations. Vous avez même ajouté que les ports n'ont pas intérêt à ce que les contrôles soient particulièrement draconiens, sinon l'image et l'activité économique du port pourraient en subir des conséquences.
Les inspecteurs sont-ils sous la tutelle du commandant du port ou sont-ils indépendants ? S'ils sont indépendants - ce que nous souhaitons -, ils doivent pouvoir prendre en toute liberté un certain nombre de décisions et les communiquer. Vous ne devriez alors plus avoir les problèmes que nous venons de connaître en recoupant l'ensemble de ces informations.
J'ai compris aussi que vous sépariez le fait qu'on ait une liste de bateaux susceptibles d'être utilisés de celui, après, de les affréter. Or, il faut bien croire que l'Erika figurait sur vos listes, au moins sur la liste de l'entreprise Total.
Deuxième interrogation : ces bateaux sont bannis des eaux territoriales américaines. Par conséquent, ne se retrouvent-ils pas davantage sur les nôtres ? N'y a-t-il pas eu déplacement, sur cette planète, de ces bateaux qui ne peuvent plus travailler maintenant au niveau de l'Amérique du Nord ? N'y a-t-il pas des risques aggravés pour nos côtes ? En clair, les décisions que la France et l'Europe prendront demain ne devraient-elles pas être portées à un niveau supérieur, parce que ce sont après-demain les côtes asiatiques ou les côtes africaines qui en subiront les conséquences ?
Troisième chose : le droit à polluer a été évoqué à propos du FIPOL. On attend beaucoup de cette responsabilité environnementale sans faute. Je voudrais prendre une comparaison qui va peut-être vous paraître un peu osée, mais j'espère qu'on réfléchira dans ce sens au niveau de l'Europe : il y a encore beaucoup d'entreprises privées - souvent des grands groupes -, sur notre territoire, qui s'occupent des ordures ménagères et qui mettent en place des centres techniques d'enfouissement. Elles ont la responsabilité financière du suivi du site pendant trente ans et elles doivent provisionner de l'argent.
Voici ma proposition : sur les sites pollués, même sans faute, ne faudrait-il pas faire des provisions pour pouvoir suivre l'état de ces sites pendant une durée à déterminer ? La durée de trente ans n'est peut-être pas excessive.
M. René LEROUX : Vous n'ignorez pas, Monsieur le Président, que l'inquiétude des élus et des professionnels porte aujourd'hui sur les indemnisations, sans parler des particuliers qui ont subi des dégâts très importants.
Vous nous avez dit que quatre grands groupes alimentaient le fonds FIPOL. J'aimerais connaître tous les États qui participent à l'alimentation de ce fonds FIPOL, et comment se fait la cotisation à ce fonds. Vous pourriez certainement nous remettre des documents pour corroborer ou confirmer les propos que vous nous tenez.
C'est aujourd'hui un peu surréaliste. On les rencontrera certainement dans le cadre de notre enquête. Cela fait frémir de s'entendre dire aujourd'hui, dans les différentes réunions qu'on tient et selon les informations que nous recevons, qu'on indemnisera à hauteur de 30 ou 40 % parce qu'on ne pourra pas faire plus. Vous dites, en plus, qu'il y a possibilité d'abonder ce fonds.
Alors pouvez-vous, au titre de cette enquête, nous donner plus d'éléments concernant ce fonds FIPOL, la façon dont il fonctionne véritablement et qui prend les décisions. En êtes-vous un des acteurs à votre niveau ?
M. Philippe TRÉPANT : Vous avez parlé tout à l'heure des États du port et de leurs inspections. J'ai dit qu'il n'y avait pas d'accès à leurs informations. Pour être très précis, on sait quand un bateau est retenu par un port. On le sait et on le met dans la base SIRE. Par contre, on ne connaît pas le détail de ce qui a été vu.
M. Jean-Michel MARCHAND : Les carences actuellement constatées peuvent-elles très facilement se produire et le système d'information peut-il être plein de trous ?
M. Philippe TRÉPANT : Il est plein de trous aujourd'hui puisque, comme je l'indiquais, nous n'avons pas accès aux sources principales d'information. L'agence maritime européenne, si c'est elle qui est créée et si c'est elle qui doit s'occuper de la chose, aura l'autorité d'exiger que, de par la loi, toutes les informations disponibles lui soient communiquées. Nous aurons à ce moment-là couvert, en principe, toute l'information disponible et les mailles du filet se seront bien resserrées.
Il y a une chose sur laquelle je n'ai pas insisté dans mon exposé et que je me permets d'indiquer, c'est qu'il faut que les informations soient de qualité et exploitables.
M. Le Drian a fait tout à l'heure allusion au format, et c'est là que l'expérience SIRE peut être utile : nous avons mis en place, dans le cadre de l'industrie pétrolière, des formats, des espèces de check-list, qui permettent de comparer facilement et de parler le même langage, donc d'avoir une évaluation objective au cours des différents types de visites et d'investigations.
Je voudrais également insister : pour le bon fonctionnement d'un système tel qu'Equasis, il faut, en plus du format, qui permet la lisibilité, que l'information soit fiable, et ceci pose la question de la fiabilité des inspections, donc de la qualification des inspecteurs sur le plan du port, et de la qualification du personnel dans les industries pétrolières, mais ils connaissent en principe assez bien leur métier, ils tirent tout au moins le maximum de ce qu'ils peuvent voir pendant les temps de chargement et de déchargement.
Il y a surtout la qualification des sociétés de certification. Il existe aujourd'hui des systèmes qui garantissent une certaine qualité. Après ce qui a été dit à la suite d'Erika, il serait bon que les procédures d'agrément des sociétés soient vérifiées. On sait qu'il y a de grandes sociétés de certification de renom et qu'il y en a d'autres de second ordre, mais toutes ont des clients. Il faudrait, bien entendu, que ne soient acceptés dans les fameuses listes de bateaux qui ont le feu vert d'Equasis, que les bateaux inspectés par des certificateurs agréés.
M. le Président : J'entends bien ce que vous dites mais ce sont des constats que nous avons pu faire, que le gouvernement français a faits, que la Communauté européenne va sans doute confirmer. On espère en tout cas qu'elle va contrôler les sociétés de classification, etc.
Compte tenu des risques et du fait également que le FIPOL est constitué des sociétés pétrolières, ne pensez-vous pas qu'une mesure de précaution pourrait être prise par les sociétés pétrolières pour mettre à l'encan, premièrement, un certain nombre de navires de pavillons qui, à l'évidence, sont des pavillons connus comme étant « limite » et, deuxièmement, des sociétés de classification qui sont connues, elles aussi, comme étant « limite » ?
J'ai cru comprendre, au cours de certaines auditions, que le RINA n'était pas vécu par un certain nombre d'États du pavillon comme une société sérieuse en Europe. Or, je constate ici avec l'Erika, que c'est un pavillon maltais qui n'est pas vécu au plan mondial comme étant un pavillon exemplaire. J'ajoute qu'on a affaire à un propriétaire qui est obscur, c'est le moins qu'on puisse dire, et à une société de classification qui... Un interlocuteur, que nous avons eu ici à votre place, nous a dit qu'il ne travaillait jamais avec cette société. En plus des précautions qui devraient être prises par les États du pavillon et du port, ne devrait-on pas contrôler beaucoup plus qu'elles ne le sont probablement les sociétés de classification ? Sachant tout cela justement, pourquoi les sociétés pétrolières ne passent-elles pas par un verrouillage un peu plus important au sujet du choix des navires ?
M. Philippe TRÉPANT : Cette question est tout à fait pertinente. Vous dites un peu la même chose que ce que je dis au niveau des moyens. Vous dites qu'il faut vérifier la qualification, la qualité des informations, et finalement rassembler l'information pour ensuite éliminer, ou les mauvais pavillons, ou les mauvais bateaux, car je préfère parler des mauvais bateaux.
Mais, là où nous différons, c'est que vous dites que l'industrie pétrolière devrait collectivement s'organiser, parce que cela ne peut être que collectif. Comment, en effet, voulez-vous mettre à l'index quelqu'un si ce n'est pas fait collectivement ? Sinon vous arrivez toujours au même problème du vetting individuel avec un bateau, parce que ce n'est, tout de même, pas de la pure mathématique, ce n'est pas manichéen, ce n'est pas blanc ou noir. Un bateau sera considéré à la limite acceptable par l'un, et à la limite inacceptable par l'autre.
M. le Président : C'est déjà le cas.
M. Philippe TRÉPANT : Il faut qu'un bateau soit acceptable ou inacceptable et ce travail-là, si c'est à l'industrie pétrolière de l'assumer, ne peut être fait que collectivement et le faire collectivement se heurte à un nombre impressionnant de réglementations concernant la liberté du commerce, les lois de la concurrence, à l'OMC, à toutes ces choses-là, et on peut se trouver sous le coup d'un boycott parce que, vu sous un autre angle, ce serait refuser de faire du commerce avec quelqu'un. Des compagnies privées ne peuvent pas le faire. C'est d'ailleurs pour cela que SIRE ne donne que de l'information et pas d'évaluation. Chacun la fait pour soi.
Nous pensons que ce n'est pas suffisant et que seule la puissance publique est en mesure de prendre ce genre de mesure de bannissement. Il n'est pas possible de déléguer. On ne peut pas parler d'un pouvoir de police. Les pouvoirs de police ne peuvent pas être délégués à des acteurs privés. C'est en tout cas notre position.
Une question a été posée tout à l'heure sur le bannissement de l'Erika. Vous avez dit que l'Erika aurait été banni ailleurs. Je n'en sais rien du tout. Et je voudrais quand même rappeler que je reste très prudent à propos de l'Erika, je ne sais pas si le bateau était bon ou mauvais. Certes, il a coulé. Il y a beaucoup de rumeurs et, parmi les rumeurs, aucun scénario ne dit qu'une réparation était mal faite. C'est autre chose. Le bateau n'était donc pas pourri. C'est peut-être le cas, on ne sait pas, on verra. Je ne serai pas affirmatif de ce côté-là. Je ne sais pas si l'Erika aurait été accepté ou refusé dans d'autres eaux territoriales.
M. Jean-Michel MARCHAND : Les Américains n'acceptent plus que les doubles coques maintenant ?
M. Philippe TRÉPANT : Les Américains ont indiqué que tous les bateaux neufs entrant dans les eaux américaines seraient double coque. Les anciens continuent de circuler et la date limite de leur retrait définitif est 2015. Il y a deux dates, 2010 et 2015. Il y a pour l'instant des doubles coques et des simples coques. Les bateaux de moins de 5 000 tonnes seront exclus du dispositif pour de multiples raisons.
On n'en est pas encore là aujourd'hui. Il est vrai qu'à la différence de l'Europe, les Etats-Unis ont les
coast-guards, ce qui milite en faveur de notre thèse. Or, une telle organisation est difficile à instituer en Europe pour divers motifs.
Ces gens-là contrôlent extrêmement sérieusement les bateaux, c'est-à-dire qu'ils les contrôlent effectivement avant de rentrer dans les eaux et l'armateur qui se sent surveillé n'enverra pas son bateau dans cette direction.
Il y a un risque pour ceux qui ne sont pas organisés comme nous de voir les bateaux se présenter ici. Il y a, en plus, un risque plus important du fait de l'insuffisance de notre système de contrôle, tel que SIRE, ou des contrôles séparés qui ne travaillent pas ensemble.
C'est pourquoi il est primordial de créer cette agence européenne, de centraliser l'information et d'avoir une autorité de police centrale. Elle n'aura pas l'allure coast-guards car ce que je propose est un peu différent, mais il faut cette autorité, sinon le risque est de voir ces bateaux arriver chez nous.
Ils iront sur les côtes africaines. Les Africains n'ont pas les moyens que nous avons. On sait que les Japonais commencent également à s'organiser ainsi que l'Orient. Après avoir éliminé le Japon et ce qu'il y a autour, l'Europe et l'Amérique du Nord, il n'y aura plus de marché pour ces bateaux.
M. Jean-Michel MARCHAND : C'est en fait le marché qui régulera.
M. Philippe TRÉPANT : Il y avait une question concernant le FIPOL et le fonctionnement.
Je n'ai aucune autorité particulière au sein du FIPOL. Le FIPOL est géré par l'OMI avec ses représentations gouvernementales et est basé à Londres ; l'industrie pétrolière est représentée au sein de l'OCIMF. Ceci étant, j'entends comme vous les préoccupations de tous ceux qui voient la paperasse s'amonceler et qui aimeraient avoir de l'argent et être indemnisés tout de suite. Je comprends la position des gens qui sont impatients, mais c'est quand même un progrès par rapport à ce qu'on a connu il y a vingt-cinq ou trente ans, quand les procédures duraient plusieurs dizaines d'années.
Il faut réfléchir à l'amélioration des circuits administratifs, mais on ne peut pas échapper à l'administration.
On ne peut pas non plus tenir un guichet ouvert. Il faut constituer un dossier minimum, faute de quoi on risquerait de ne pas allouer les sommes, qui sont quand même importantes, à ceux qui en ont le besoin le plus urgent.
La question a été posée de savoir comment le FIPOL était approvisionné. C'est compliqué. Le FIPOL est constitué d'un ensemble d'États et qui ont ratifié la convention et qui appelle les fonds auprès des compagnies pétrolières. A la différence de ce qui a été fait aux Etats-Unis, c'est un fonds qui est appelé dès qu'il y a catastrophe. Le fonds constitué a comme différence avec le fonds appelé la constitution d'une immobilisation et la certitude d'avoir l'argent. C'est un club d'Etats et de compagnies pétrolières supposées financièrement solvables. L'historique montre que ce n'est malheureusement pas la première catastrophe.
Comment fonctionne ce fonds ? Lorsqu'une catastrophe comme celle-ci se produit, il y a appel de fonds immédiat qui se fait au prorata des volumes de brut importés par chaque société dans les différents pays membres du système. Total aura sa part à payer, Shell aura sa part à payer, etc.
M. Jean-Michel MARCHAND : Et qu'en est-il des sociétés qui opèrent au Japon ?
M. Philippe TRÉPANT : Les sociétés qui opèrent au Japon paieront également leur part au prorata de ce qu'elles auront importé au Japon puisque le Japon est adhérent au système FIPOL et que c'est un système mutuel.
M. René LEROUX : Je comprends que vous ne puissiez pas répondre à la place du FIPOL.
M. Philippe TRÉPANT : Je ne peux que vous dire ce que je sais sur le FIPOL.
Audition de M. Pierre GUSTIN,
directeur des assurances transports
de la Fédération française des sociétés d'assurances (FFSA)
(extrait du procès-verbal de la séance du 29 mars 2000)
Présidence de M. Daniel PAUL, Président
M. Pierre Gustin est introduit.
M. le Président lui rappelle que les dispositions législatives relatives aux commissions d'enquête lui ont été communiquées. A l'invitation du Président, M. Pierre Gustin prête serment.
M. Pierre GUSTIN : M. le président, mesdames, messieurs, je tiens tout d'abord à vous remercier de donner la parole aux assureurs maritimes dans le cadre de cette commission d'enquête. Historiquement, ils portent un intérêt tout particulier à la sécurité de la navigation et sont attachés à tout ce qui touche à la prévention.
Permettez-moi tout d'abord de rappeler que ce sont les périls de la mer qui ont fait découvrir aux hommes, dès l'Antiquité, la nécessité d'une assistance mutuelle, fondement du principe de solidarité de l'assurance. L'assurance maritime est la plus ancienne forme d'assurance. C'est elle qui a inventé le principe de transfert des risques qui a permis à bien des industriels, des commerçants, et des navigateurs, de jouer un rôle économique dans le développement de nos pays et de nos continents.
L'assurance maritime joue toujours un rôle très important en matière de sécurité financière dans les échanges internationaux. Elle a pour fonction principale de réparer les préjudices consécutifs à la réalisation d'un risque résultant d'un événement aléatoire. Avant cette audition, je me suis permis de transmettre à la commission un certain nombre de documents auxquels je vais me référer.
Dans un premier temps, je rappellerai le rôle des assureurs maritimes, tant en matière d'assurance des navires qu'en matière d'assurance des marchandises transportées. Je vous donnerai, comme vous le souhaitiez, quelques informations statistiques sur la sinistralité et, plus particulièrement, sur celles des pétroliers. Je rappellerai les mécanismes d'indemnisation. Vous avez dû entendre à plusieurs reprises des intervenants sur le problème des mécanismes des conventions internationales.
Dans un deuxième temps, je vous indiquerai quelles contributions les assureurs maritimes peuvent apporter à la prévention des risques et à l'amélioration de la sécurité des transports maritimes.
Quel est le rôle des assureurs maritimes ? On peut les classer en trois catégories. Tout d'abord, il y a l'assurance des navires eux-mêmes. Tout armateur a besoin, pour sa flotte ou son unité, d'assurer son navire contre le risque de perte ou d'avarie. Il s'agit de l'assurance dommages traditionnelle, ce sont des risques d'entreprises, sauf qu'ils ont un caractère essentiellement maritime et international par nature.
A qui s'adresse l'assurance des navires ? Il s'agit non seulement des corps de commerce, mais également des corps de pêche, l'activité fluviale, la plaisance, les risques offshore. Toute cette activité de l'assurance des navires, que dans notre jargon nous appelons l'assurance corps, entre dans un cadre juridique international. D'ailleurs, le législateur français en a largement tenu compte. Depuis Colbert avec sa fameuse ordonnance sur la marine marchande et la marine en général, on a reconnu le caractère international de l'assurance maritime.
En matière de capacité de marché, il est important de souligner que les assureurs du marché français ont toujours su donner aux armateurs des capacités suffisantes pour assurer leurs unités qui peuvent atteindre plusieurs centaines de millions de francs en valeur marchande. Par ailleurs, il faut souligner que, dans le domaine de l'assurance corps, les assureurs du marché français ont une excellente réputation de solvabilité et d'efficacité dans les garanties qu'ils offrent. Dans le document complémentaire que je me permettrai de remettre à la commission, vous pourrez constater que le marché français s'est largement internationalisé, et que les compagnies du marché français assurent un pourcentage important de la flotte mondiale, et pas simplement de la flotte française.
Cela étant, les assureurs maritimes sont soumis, comme les armateurs et tous les commerçants, à des pressions de la part de leurs assurés sur les taux et à la concurrence internationale. Mais ils ont toujours pratiqué, en matière d'assurance corps, une intense sélection des risques pour éviter justement de tomber dans le piège consistant à garantir des navires sous normes. Nous y reviendrons tout à l'heure.
Le deuxième volet de l'assurance maritime est l'assurance des cargaisons. Toutes les marchandises transportées, quel que soit le moyen de transport - non seulement maritime mais également aérien, fluvial ou terrestre - entrent dans le cadre de l'assurance transport. C'est une activité très importante puisque la France est un pays fortement exportateur et que les assureurs maritimes accompagnent les opérateurs du commerce extérieur en leur offrant des garanties adaptées à leurs besoins et à leurs risques.
Le troisième volet est l'assurance de la responsabilité des transporteurs maritimes, volet qui va nous intéresser plus particulièrement aujourd'hui. Traditionnellement, si l'assurance corps de navires est placée sur le marché des compagnies à prime fixe, le marché de la responsabilité des propriétaires de navires et des transporteurs maritimes est placé sur un marché qu'on appelle celui des mutuelles d'armateurs ou « P & I clubs
» (Protection and indemnity club). Ces associations existent depuis la fin du siècle dernier. Elles sont aujourd'hui essentiellement regroupées sur le marché de Londres. Environ 19 « P & I clubs » sont regroupés dans l'association « International group ». Ce sont des mutuelles parfaitement bien gérées, solvables, elles-mêmes réassurées, notamment auprès du marché traditionnel, ce qui leur permet d'offrir de larges capacités de souscription en matière de risques de pollution. Cela n'a pas empêché les assureurs à prime fixe d'offrir, à la demande des armateurs français, des possibilités de garantie de leur responsabilité. Actuellement, le marché français a une capacité, en matière d'assurance de responsabilité des propriétaires de navires, de 500 millions de francs par navire et par événement. Il est plus réduit en matière de risque de pollution par hydrocarbures, puisqu'il est pour l'instant de 50 à 100 millions de francs. Mais l'usage veut que ces risques soient toujours placés auprès des clubs P & I que je viens de présenter rapidement.
Je me permettrai de souligner que ces clubs P & I
ont réussi, à la suite du vote aux Etats-Unis de l'Oil Pollution act, en 1990, après la catastrophe de l'Exxon Valdez, à fournir la capacité suffisante prévue par ce texte qui peut atteindre un milliard de dollars par navire et par événement.
Que représente aujourd'hui, statistiquement, le marché français de l'assurance transport ? Le marché de l'assurance maritime proprement dit représente un chiffre d'affaires de l'ordre de 7,5 milliards de francs en 1999. Ces 7,5 milliards se répartissent à hauteur de 3,5 milliards pour l'assurance des navires proprement dits, et à hauteur de 4 milliards de francs pour l'assurance des marchandises transportées. Une grande partie de ce chiffre d'affaires est réalisé à l'international, pour les opérations d'exportation et d'importation de marchandises. En matière de corps de navires sur des flottes étrangères, nous avons également des placements importants de flottes étrangères sur le marché français. Officiellement, il y a une cinquantaine de compagnies d'assurance qui pratiquent plus particulièrement le risque maritime et transport, mais une douzaine de groupes, à la suite des restructurations enregistrées ces dernières années, représentent environ 85 % du chiffre d'affaires. C'est un marché assez concentré, assez spécialisé, compte tenu des spécificités du risque.
Que représente l'assurance maritime mondiale ? En 1998, environ 13 milliards de dollars. Le marché français occupe une place non négligeable dans ce contexte international puisqu'il se situe au 3e rang en matière d'assurance des navires avec une part de marché mondial d'environ 10 %, et au 4e en matière de marchandises transportées avec une part de marché mondial de l'ordre de 8,5 %. Vous retrouverez ces chiffres dans les documents que je vais vous transmettre. Les premiers marchés sont les marchés japonais, anglais, et américain.
M. le Rapporteur : Vous avez donné les chiffres du positionnement français sur l'assurance corps et l'assurance des marchandises. Qu'en est-il de l'assurance de la responsabilité ?
M. Pierre GUSTIN : Sur l'assurance de la responsabilité, les
P & I clubs représentent à peu près 90 % du marché mondial et la quasi-totalité du marché européen. Les armateurs français sont, à quelques exceptions près, assurés auprès des
P & I clubs pour l'assurance de leur responsabilité.
Quels sont les enseignements que les assureurs maritimes peuvent donner à la commission en matière de sinistralité ? Notamment, quelles sont les causes et origines des événements majeurs ou catastrophiques ? Traditionnellement, on constate dans nos statistiques ou dans les études réalisées que ce sont essentiellement les tempêtes, les abordages, les échouements ou les incendies qui sont la cause de pertes totales et de catastrophes maritimes. Quelle est leur origine ? Le plus souvent c'est l'erreur humaine : c'est le cas de la faute nautique. On peut citer le cas de l'Exxon Valdez. La panne de moteur ou l'avarie de gouvernail peut être à l'origine d'un événement catastrophique. La tempête, bien sûr : c'est le cas de l'Amoco-Cadiz
ou du Braer. La rupture de coque : c'est le cas de l'Erika. Cela peut être aussi le manque de qualification des équipages.
Les pétroliers ou navires spécialisés dans le transport de produits chimiques liquides ne sont pas les seules unités responsables de la pollution maritime. En plus de leurs soutes qui peuvent atteindre plusieurs milliers de tonnes, tous les navires sont susceptibles de transporter des marchandises dangereuses ou polluantes, y compris un certain nombre de transbordeurs qui peuvent embarquer plusieurs centaines de véhicules avec le carburant susceptible de provoquer une pollution. Plusieurs cas, notamment ces dernières années, de marchandises dangereuses en dehors du fait qu'elles sont classées purement polluantes, ont pu provoquer des incidents sur les côtes.
Pour spectaculaires et inquiétantes qu'elles soient, les pertes totales de pétroliers ne sont pas les plus nombreuses et concernent de nombreux navires lèges, c'est-à-dire sans cargaison à bord. Statistiquement, près de la moitié des incidents sur des pétroliers sont liés à des incendies ou explosions sur des navires lèges. Ce ne sont pas uniquement les navires « en activité ».
Quand on parle d'assurance maritime et de statistiques, il faut l'entendre au niveau mondial. Nous avons pu faire avec l'aide de notre organisation internationale, qui s'appelle l'IUMI (International Union of Marine Insurance), des statistiques sur les pertes de pétroliers sur la période allant de 1988 à 1998. Sur 1624 pertes totales de navires de commerce de plus de 500 tonneaux de jauge, nous avons enregistré 185 pertes totales de navires pétroliers. Ces 185 navires représentent 27 % du tonnage mondial - ce ne sont donc pas les pétroliers qui sont les plus souvent victimes de pertes totales - et environ 0,2, 0,3 % de la flotte mondiale, alors que la moyenne de tonnage perdu est plutôt à 0, 4, 0,5 %.
En ce qui concerne l'âge, facteur important dans les catastrophes maritimes, il est certain que plus de la moitié des pertes de pétroliers ont affecté des navires de plus de 25 ans d'âge. Malheureusement, cela n'a pas empêché des pétroliers beaucoup plus récents d'être aussi victimes de catastrophes maritimes.
M. le Rapporteur : Vous dites que les pétroliers ne représentent pas la plus grande catégorie des navires victimes de catastrophes. Quelle est la plus grande catégorie ?
M. Pierre GUSTIN : Les transporteurs de vrac, les vraquiers en général.
M. le Rapporteur : Vraquiers secs ou solides ?
M. Pierre GUSTIN : Les deux. Il y a eu récemment une catastrophe sur un bateau grec. Malheureusement, on a déploré la perte de 18 vies humaines. Visiblement, le navire avait aussi des défauts de structure. On en a peu parlé dans la grande presse, mais la presse spécialisée en a fait état.
M. René LEROUX : Il y a encore eu un incident grec cette nuit : 5 disparus.
M. Pierre GUSTIN : C'est encore le naufrage d'un vraquier.
Statistiquement, quelles sont les causes de pertes totales sur ces 185 navires ? Tout d'abord l'incendie et l'explosion, la tempête, l'échouement, l'abordage, et enfin, l'avarie de machine.
Il existe d'autres chiffres significatifs. En reprenant les états du « memoradum of understanding » (MOU) de Paris, d'octobre 1998 à mars 1999, le pavillon maltais a fait l'objet, au niveau du simple MOU de Paris, d'un arrêt de 7,34 % de sa flotte et de 104 saisies arrestations de navires. Alors que le pavillon chypriote, qui n'a pas non plus une très bonne réputation, n'a fait l'objet que de 94 arrestations de navires pour 5,87 % de sa flotte. A partir d'éléments statistiques, les assureurs maritimes peuvent avoir un certain nombre d'appréciations pour déterminer les facteurs d'aggravation de la sinistralité : il y a l'âge, la qualité de l'armateur, le pavillon, la société de classification. Dans ce domaine, nous avons aussi des sociétés de classification de complaisance. Il y a bien entendu la taille, le trafic, les conditions d'exploitation. Tous ces facteurs vont permettre aux assureurs d'apprécier les risques et de tirer un certain nombre de conclusions avant de donner leur garantie aux armateurs, ainsi qu'aux chargeurs, c'est-à-dire aux propriétaires de cargaisons.
Les mécanismes d'indemnisation interviennent à trois niveaux dans le domaine des catastrophes maritimes. C'est tout d'abord la perte du navire. Le navire est assuré auprès des sociétés à prime fixe. L'Erika était placé sur le marché italien et assuré par les assureurs de ce pays. Les assureurs avaient en main tous les éléments pour apprécier le risque.
M. le Rapporteur : A quelle hauteur l'Erika était-il assuré ?
M. Pierre GUSTIN : 80 millions de francs environ. La cargaison était assurée en partie sur le marché français par l'intermédiaire d'une société française, mais aussi auprès de la captive du groupe Total-Fina, elle-même réassurée auprès du marché national et international. La cargaison avait une valeur de 4 millions de dollars et était assurée pour tous les risques de perte pouvant survenir pendant le transport.
Enfin, en ce qui concerne l'assurance de la responsabilité de l'Erika, elle est placée auprès d'un
P & I club de l'International London group, qui est le
Steamship mutual underacting association des Bermudes, dont le siège social est aux Bermudes pour des raisons fiscales. C'est un
P & I club parfaitement solvable. Dans ce domaine, ce
P & I club remplira ses engagements, conformément aux mécanismes d'indemnisation prévus par les conventions internationales, par la convention CLC (Civil liability convention),
qui prévoit, par des mécanismes assez complexes, que le plafond de responsabilité auquel l'armateur est engagé, et donc son assureur
P & I club, s'élève à 81.113.163 F, le calcul se faisant en fonction du tonnage du navire et sur la base de la convention internationale ratifiée par la France.
C'est là qu'intervient un deuxième niveau : le FIPOL, mis en place dans le cadre d'une convention internationale, qui va pouvoir intervenir dans l'indemnisation de la catastrophe de l'Erika en complétant l'indemnisation prévue par la convention CLC, jusqu'à concurrence de 1,2 milliard de francs. Cette somme a le plus souvent été jugée insuffisante et a fait l'objet de demandes de réévaluation de la part d'un certain nombre d'instances, y compris au niveau européen.
Quelle est la contribution que les assureurs maritimes peuvent apporter à la prévention des risques et à la sécurité maritime ? Nous faisons un constat assez régulier en matière d'assurance maritime : les politiques de prévention sont davantage réactives que véritablement proactives. Il est important de rappeler que les assureurs en général ne se contentent pas de délivrer des garanties, d'indemniser des préjudices ou des pertes. Ils ont une préoccupation permanente : la prévention des risques et l'amélioration de la sécurité. Dans la branche maritime, cela se traduit à tous les niveaux, tant au niveau de la souscription des contrats qu'en dehors même de tout événement.
Comment fonctionne cette contribution permanente des assureurs maritimes à la prévention des risques et à la sécurité ? Tout d'abord, au niveau de la souscription des contrats, les assureurs veulent impérativement connaître et maîtriser le risque qu'ils assurent et sont amenés de plus en plus souvent à faire des visites de préassurance, c'est-à-dire à envoyer des experts pour vérifier la qualité d'un navire, en dehors même de tous les rapports qu'ils peuvent avoir émanant de sociétés de classification ou d'experts indépendants.
Ensuite, au niveau de leur police d'assurance, nous avons sur le marché français des contrats types mis en place par l'organisation professionnelle dans lesquels nous insérons automatiquement toutes les conditions prévues par la réglementation internationale ou les conventions internationales. C'est ainsi que nous exigeons, entre autres, que tous les navires concernés aient la certification ISM en matière de management. Les assureurs n'assurent pas automatiquement les navires dont l'âge est supérieur à 16 ans. Il est même prévu en matière d'assurance des marchandises transportées, l'application de surprimes si le navire sélectionné par le chargeur a plus de 16 ans d'âge.
Par ailleurs, nous exigeons également que les classifications soient faites auprès de sociétés notoirement connues et, dans toute la mesure du possible, membres de l'IACS. En cours de contrat, les assureurs se sont organisés pour avoir un suivi régulier des informations en provenance des MOU. Il n'y a pas seulement le MOU de Paris, mais également le MOU de Tokyo, le MOU Méditerranée. Ces informations permettent aux assureurs, en cours de contrat, d'intervenir pour suspendre la garantie ou exiger de l'armateur qu'il mette son navire en conformité avec les injonctions qui lui ont été données.
Nous avons également des liaisons avec les sociétés de classification qui nous informent systématiquement d'une suspension de classe, puisque, dans ce cas, l'assureur est en droit de suspendre sa garantie.
A la suite d'un événement, la première mission de l'assureur, si la garantie est acquise, est d'indemniser rapidement l'assuré. Il va également analyser le sinistre, alimenter sa base de données statistiques, et essayer d'en tirer des enseignements en matière de prévention pour éviter le caractère répétitif de certaines catégories de sinistres.
Parallèlement, les assureurs ont des actions permanentes. Nous avons mis en place, au niveau du marché français, des comités de liaison avec le Comité central des armateurs de France, avec les sociétés de classification, le Bureau Veritas en particulier. Nous apportons notre contribution aux travaux du Bureau enquête-accident-mer, créé il y a peu de temps et que nous avons vivement salué et encouragé. Nous participons également à un certain nombre de commissions nationales de sécurité. Nous avons, bien entendu, des contacts fréquents sur les thèmes de la prévention et de l'évolution des risques avec les chargeurs, les chantiers de construction. Depuis deux ans, nous entendons bien participer activement à la mise en place et au fonctionnement du projet Equasis, dont la commission a sûrement entendu parler.
Sur un plan plus général, nous participons, par l'intermédiaire du Comité maritime international, aux travaux de l'OMI, mais nous souhaiterions qu'il y ait une véritable instance internationale, où toutes les parties prenantes au transport maritime et à la sécurité du transport maritime puissent être présentes afin d'établir de véritables normes qui soient respectées. L'OMI fait un travail important que tout le monde salue de façon régulière. Mais la lenteur du droit international privé fait que, bien souvent, ces conventions internationales, par exemple, la convention HNS pour le transport de matières dangereuses, mettent un certain nombre d'années avant d'entrer en vigueur en raison de la nécessaire ratification par les États.
Nous souhaiterions également qu'il y ait, comme l'a souhaité dernièrement la Commission européenne, un renforcement du contrôle de l'Etat du port. Dans ce domaine, comme le font les Américains, une plus grande efficacité des garde-côtes et des services d'inspection serait de nature à limiter le nombre de navires inférieurs aux normes qui entreraient dans les eaux territoriales. Nous sommes d'ailleurs prêts à utiliser toutes les données des fichiers qui seraient mis en place, notamment au moment du renouvellement des contrats couvrant des navires, soit pour en renégocier les termes, soit pour retirer la garantie des assureurs, garantie qui ferait alors largement défaut aux armateurs qui ne pourraient a priori exploiter commercialement leurs navires.
Nous avons aussi parlé du transport de vrac, qui constitue pour nous un véritable souci. En effet, depuis une vingtaine d'années, à la suite de problèmes de méthodes de chargement ou de fatigue des structures, nous avons enregistré de nombreuses pertes totales avec des pollutions plus ou moins importantes, et avec, ce qui est beaucoup plus dramatique, des pertes de vies humaines.
Je voudrais insister sur un point rarement évoqué : le rôle important que jouent les sociétés d'assistance en mer. Nous pensons qu'il convient d'insister sur le rôle indispensable que jouent ces sociétés d'assistance et de remorquage qui, à plusieurs reprises ces dernières années, ont évité des catastrophes. Ne faudrait-il pas qu'il y ait une véritable politique au niveau européen dans ce domaine ?
Nous appuyons également sans réserve les actions des sociétés de classification qui ont décidé d'apporter plus de rigueur à leurs règles de classification et d'inspection des navires. Dans ce domaine, il est, nous semble-t-il, nécessaire de définir des règles internationales qui soient respectées par l'ensemble de la communauté maritime.
Enfin, sur le plan technique, on parle beaucoup du développement des doubles coques ou doubles fonds. Il est vrai que cette solution a été adoptée dans le cadre de l'Oil Pollution act. Elles visent à réduire, sinon à empêcher, le déversement d'hydrocarbures en mer. Mais il faudra veiller de près à ne pas remplacer ce mal par un autre mal, c'est-à-dire le risque d'explosion.
Voilà, M. le président, ce que je pouvais dire, très rapidement, en matière de contribution aux travaux que vous menez. Parfois certains de nos interlocuteurs nous disent : « Pourquoi ne pas prendre modèle sur ce qui existe en matière de sécurité aérienne, où il y a de véritables normes internationales homogènes, contraignantes, et sûres ? » La solution d'une assurance obligatoire n'est pas non plus satisfaisante. D'ailleurs, le ministère des transports français ne s'y est pas trompé : dans la charte sur la sécurité maritime des navires pétroliers, signée le 10 février de cette année, les opérateurs se sont engagés à souscrire auprès des compagnies présentant des garanties de sérieux et de solvabilité, l'assurance obligatoire risquant en effet d'entraîner une certaine déresponsabilisation et d'obliger les assureurs à donner des garanties à des navires indésirables.
M. le Rapporteur : Merci pour votre exposé, M. le directeur. J'ai quelques observations et quelques questions. Première question. Vous avez parlé de sociétés de classification de complaisance. Pouvez-vous reprendre votre propos et nous expliciter ce que vous entendez ? Vous avez évoqué la nécessité de normes internationales des sociétés de classification. Est-ce que des initiatives peuvent être prises à cet égard ? Comment voyez-vous l'application et la définition de ces normes ? Est-ce que les assureurs ont accès aux dossiers tenus par les sociétés de classification quand ils le souhaitent ? Est-ce que les clauses qui prévoient cet accès sont généralisées sur l'ensemble des contrats ou est-ce uniquement lorsque l'on a affaire à un assureur de qualité, et à une société de classification de qualité ?
Deuxième question. Vous avez évoqué la nécessité d'un renforcement des instances internationales, en ayant à l'égard de l'OMI des mots aimables, mais en constatant la lenteur de son fonctionnement. Pourriez-vous être plus explicite ?
Enfin, quel est votre avis sur l'Oil Pollution act et ses obligations ?
M. Pierre GUSTIN : En ce qui concerne les sociétés de classification, les assureurs maritimes, il y a une quinzaine d'années, ont été très critiques à leur égard, puisque l'aspect commercial semblait, pour certaines d'entre elles, l'emporter sur l'aspect technique. Pendant des années, on a constaté que tous les navires avaient la première classe dans les sociétés de classification. Quand on prenait les registres des sociétés de classification, on ne voyait aucun navire en deuxième ou troisième classe, tous les navires avaient la première classe. Cette interrogation des assureurs maritimes était corroborée par certaines sociétés de classification, et notamment le Bureau Veritas. C'est ainsi qu'a été créée l'IACS (Association internationale des sociétés de classification), qui a mis en place un certain nombre de normes pour définir les sociétés de classification qui pouvaient, techniquement, d'une façon aussi parfaite que possible remplir leur mission vis-à-vis des armateurs et des assureurs. Quand on dit qu'il existe des sociétés de classification de complaisance - je n'ai pas la liste sous les yeux mais nous pourrons vous la communiquer -, nous avons enregistré dans le monde environ 50 ou 55 sociétés de classification, alors que les sociétés membres de IACS ne sont qu'une dizaine. Dans beaucoup de pays, on délivre des licences ou des agréments à des sociétés qui peuvent donner la classification, telle qu'elle est prévue par les pratiques internationales, pour des navires de leur pays ou pour des navires tiers. Ces sociétés de classification dites de complaisance, les assureurs ne veulent pas en entendre parler et refusent généralement de donner une garantie d'assurance à des bateaux dont la société de classification n'est pas membre de l'IACS.
M. le Rapporteur : Ces bateaux naviguent sans assurance ?
M. Pierre GUSTIN : Ils peuvent naviguer avec une assurance, mais pas forcément avec une assurance du marché français ou d'un marché de premier ordre.
M. le Président : Une assurance européenne ?
M. le Rapporteur : Grecque, peut-être ? ...
M. Pierre GUSTIN : Peut-être.
M. le Rapporteur : Vous pouvez nous faire parvenir la liste des sociétés de classification existantes et non agréées par vous, avec lesquelles vous ne feriez jamais commerce. Vous est-il possible de nous adresser aussi, mais c'est peut-être plus difficile, la liste des assureurs maritimes qui font commerce avec des sociétés de classification de deuxième rang ?
M. Pierre GUSTIN : Cela me paraît difficile.
M. le Rapporteur : Mais cela existe en Europe ?
M. Pierre GUSTIN : Peut-être en Europe, en tout cas certainement dans d'autres pays du monde, en Asie ou dans d'autres pays « exotiques ». Au niveau du marché français, la politique que suivent depuis de nombreuses années les compagnies d'assurance consiste à ne donner des garanties qu'aux navires et aux marchandises sur des navires faisant l'objet d'une première cote dans une société de classification membre de l'IACS. C'est en toutes lettres dans les conditions générales des contrats. Il peut y avoir des exceptions, mais les assureurs font alors leur propre visite de préassurance. On ne peut pas dire que toutes les sociétés qui ne sont pas membres de l'IACS sont systématiquement à rejeter ou mauvaises. On peut néanmoins s'interroger sur certaines sociétés de classification.
M. le Rapporteur : Avez-vous votre propre corps d'inspecteurs ?
M. Pierre GUSTIN : Les compagnies d'assurance font appel à des experts indépendants, des anciens navigants qui ont une grande expérience à la mer et qui peuvent donc donner des avis techniques sur tel navire ou tel type de flotte.
M. le Rapporteur : Y a-t-il plusieurs experts indépendants en France ?
M. Pierre GUSTIN : Oui, et même au niveau européen.
M. le Président : Comment se passe une visite de préassurance ? Est-ce que les inspecteurs mandatés par la compagnie doivent prévenir à l'avance de leur arrivée ? Jusqu'où vont leurs droits d'inspection ? Peuvent-ils regarder l'intégralité de ce qu'ils souhaitent contrôler ?
M. Pierre GUSTIN : Je rappelle que nous sommes en matière d'assurance de risque d'entreprise et qu'il y a un véritable partenariat entre l'assureur et l'assuré ; à partir du moment où l'assuré a une certaine réticence à permettre à son assureur de visiter ou d'apprécier le risque, il y aura de la part de la compagnie d'assurance un certain recul quant à la volonté de délivrer une garantie. Dans la pratique, les conseillers techniques et les experts des assureurs vont sur les navires, vont visiter les flottes, ont accès à tout. Ils se mettent en « bleu de chauffe » et vont dans les cales. Ils n'ont pas la prétention de pouvoir visiter intégralement un navire en quelques jours, mais ce sont d'anciens navigants et ils ont l'_il.
M. le Président : J'ai cru comprendre que la cargaison de l'Erika a failli être assurée par une compagnie française.
M. Pierre GUSTIN : Je ne sais pas s'il a failli, mais en tout cas, il y a des
sister-ship de l'Erika. A notre connaissance, il y a 4 ou 5 bateaux équivalents construits par le même chantier japonais en 1975 et dans les années suivantes. Un
sister-ship de l'Erika est assuré sur le marché français et a fait l'objet, à la suite de l'événement, de visites complémentaires d'inspection (les assureurs voulaient vérifier s'il n'y avait pas les mêmes problèmes que sur l'Erika lui-même).
M. le Président : La visite de préassurance a eu lieu. Il y avait un accord de la société d'assurance, c'est ensuite que cela ne s'est pas fait.
M. Pierre GUSTIN : Je ne connais pas le détail, mais vous avez très vraisemblablement raison.
Pour répondre à votre question, sur l'accès aux livres des sociétés de classification, nous n'avons aucun problème en ce qui concerne le Bureau Veritas, car il existe un véritable partenariat entre les sociétés d'assurance et le Bureau Veritas en France. Il est parfois plus difficile, pour d'autres sociétés de classification, d'obtenir communication de l'ensemble des documents. Dans les conditions générales des polices, il est prévu que l'assuré doit fournir à l'assureur tous les éléments de nature à lui permettre d'apprécier le risque. Il y a,
a priori, rarement de difficultés pour obtenir ces documents. Cela peut être plus long si c'est une société de classification autre que le Bureau Veritas.
Votre deuxième question concernait le renforcement des instances internationales. Il est vrai que nous constatons, depuis pas mal d'années, à la fois des difficultés pour faire appliquer les conventions internationales ou les directives communautaires en la matière. L'OMI n'arrive pas, en matière maritime, aux mêmes résultats qu'en matière d'aviation. En matière d'aviation, on constate qu'il y a une volonté politique des Etats (peut-être parce qu'on touche davantage à la vie humaine qu'en matière maritime) pour que les conventions internationales soient rapidement appliquées et disposent de véritables normes adoptées et respectées par tous. Bien entendu, nous n'avons pas la solution. Le droit international public est assez complexe. Le mécanisme des ratifications, des signatures, des dépôts des instruments de ratification sont toujours très longs. Il y a peut-être dans ce domaine des initiatives qui peuvent être prises au niveau européen et qui feront accélérer la mise en place de telles normes internationales.
Mon propos n'est pas de dire qu'il faut réformer l'OMI, mais plutôt que l'OMI ne regroupe pas tous les acteurs du transport maritime. Si tous les acteurs étaient là, les solutions ne seraient pas pour autant plus simples ou plus rapides, mais il y a des interrogations de la part des assureurs et ils ne sont pas les seuls, sur la réelle efficacité de certaines instances internationales. C'est une critique constructive pour une réglementation renforcée et applicable.
Je vous rappelle que le Conseil économique et social, en France, à la suite de la catastrophe de l'Amoco-Cadiz, avait fait un certain nombre de suggestions. La Communauté européenne, il y a une dizaine d'années, avait lancé tout un programme de « safety at see ». A la suite d'un événement, il y a une réaction, puis quand l'effet médiatique s'estompe, on a l'impression que la volonté politique décroît. Nous sommes partisans, et nous ne sommes pas les seuls, d'une véritable batterie de normes internationales dans le domaine de la prévention.
M. le Rapporteur : Quelle est votre appréciation sur la partie assurance de l'Oil Pollution act ?
M. Pierre GUSTIN : Les Etats-Unis ont frappé haut et fort, à la suite de la catastrophe de l'Exxon Valdez, là aussi sous la pression de l'opinion publique. Les Etats-Unis sont un véritable continent avec une façade maritime particulièrement importante et avec une grande efficacité des « US cost-guards ». Le Parlement américain, sous la pression de l'opinion, a fait voter des dispositions qui font remonter les limites de responsabilité jusqu'à un milliard de dollars, et même en illimité s'il y a une faute personnelle de celui qui a provoqué la pollution. Les Américains, rappelons-le, ratifient rarement les conventions internationales maritimes. Ils ne sont pas parties à la convention CLC, au FIPOL. Ils font un peu bande à part dans ce domaine, mais ils montrent une certaine efficacité quant à la mise en place de normes ou de règles et surtout pour l'application de ces règles.
Au niveau de l'assurance, cette capacité d'un milliard de dollars n'est pas donnée par les sociétés d'assurance américaines, qui n'ont pas l'organisation et les capacités de les fournir, mais par le marché international à travers les
P & I clubs qui, par des mécanismes à plusieurs échelons de réassurance, sont parvenus à accorder ces plafonds importants, un milliard de dollars par navire et par événement, en matière de risque de pollution par hydrocarbures.
Je vous ai communiqué une note sur l'Oil Pollution act. Elle souligne le fait que certains Etats maritimes sont allés au-delà de la législation fédérale. Pour les armateurs qui vont toucher les côtes américaines, il faut suivre de très près les évolutions de la réglementation de chaque Etat, puisque, du jour au lendemain, il peut y avoir une disposition encore plus drastique tant au niveau technique qu'au niveau des plafonds de responsabilité.
M. Pierre HÉRIAUD : Malgré de telles expertises de préassurance, il peut y avoir des défaillances de l'expertise elle-même. Avez-vous des statistiques sur les sinistres intervenus malgré ces précautions et qui pourraient être imputables à une défaillance de cette expertise préassurance ?
D'une manière générale, ces expertises de préassurance diminuent et, de combien, le risque que vous prenez ?
M. Pierre GUSTIN : Il est très difficile de répondre à votre question sur le plan statistique. On sait que les événements de mer ou les accidents en général ont le plus souvent pour cause une erreur humaine : une faute nautique du capitaine ou une intervention malencontreuse d'un homme d'équipage ou d'un tiers. Les experts des assureurs ou des sociétés de classification ne sont pas, vous avez raison, infaillibles et peuvent eux-mêmes se tromper. Il ne faut pas négliger le fait qu'une grande partie des événements sont liés à la force des éléments difficilement maîtrisables. Les experts peuvent effectivement avoir une appréciation trop subjective du risque et mal apprécier, en quelques heures, la qualité d'un navire ou d'un chargement à bord d'un transporteur de vrac.
Je n'ai malheureusement pas de statistiques. Dire que tout est parfait à la suite d'une visite de préassurance reviendrait à supprimer le risque et donc inciter l'assuré à penser qu'il n'a pas besoin de souscrire un contrat d'assurance puisque l'expert a vu qu'il n'y avait aucun risque. Il y a toujours un aléa. C'est cet aléa que les assureurs veulent couvrir et c'est la raison pour laquelle ils sont tellement obnubilés par la prévention et par les enseignements qu'ils peuvent tirer d'un événement. Un point important doit être souligné, il existe une très large solidarité dans la profession, non seulement au niveau national, mais au niveau international, pour échanger des informations.
M. le Rapporteur : Sauf ceux qui travaillent avec des sociétés de classification « bidon » ?
M. Pierre GUSTIN : Bien sûr. Mais au niveau du marché à prime fixe, ou même des mutuelles d'armateurs, des échanges permanents d'informations se font aux niveaux national et international. Les assureurs maritimes ont tous les ans une conférence technique qui dure trois jours, où les assureurs et les experts viennent apporter une appréciation d'un certain nombre d'événements. La prochaine conférence se tient à Londres et abordera, parmi les sujets d'actualité, celui des bateaux de croisière - puisque c'est aussi une activité importante qui a tendance à se développer avec des risques, non seulement pour les armateurs mais pour les passagers transportés - et la question des suites de la catastrophe de l'Erika en liaison avec les mutuelles d'armateurs.
M. Pierre HÉRIAUD : Je voudrais me faire plus précis dans ma question sur le risque que vous prenez. En définitive, une expertise de préassurance est commandée par l'assureur afin de mieux mesurer le risque, voire à en prendre davantage. Au départ, il ne sait pas comment se situer et cela va jouer sur le niveau de la prime. Y a-t-il une façon de déterminer, en pourcentage, le risque supplémentaire pris qui doit être couvert par une variation de la prime d'assurance ?
M. Pierre GUSTIN : Deux facteurs interviennent : non seulement l'expertise de préassurance ou l'ensemble des informations données par l'armateur, mais aussi la statistique. Généralement, les assureurs demandent à un armateur la statistique de sa sinistralité sur cinq ans. A partir de cette analyse de la sinistralité sur cinq ans, ils vont pouvoir apprécier le risque qu'ils prennent et déterminer le taux de prime. Il n'y a pas de tarification de marché. Chaque compagnie, chaque groupe a sa propre politique de tarification, en liaison avec le courtier. A elle de convaincre un certain nombre de coassureurs de partager le risque avec elle sur une tarification basée à la fois sur les éléments objectifs donnés par l'armateur avant la souscription, la statistique et l'appréciation subjective que l'on va avoir du risque.
Mme Jacqueline LAZARD : Je reviens sur la prévisite. Faites-vous ces prévisites, uniquement quand il est question d'assurer des bateaux anciens ? Demandez-vous à connaître l'état des contrôles des navires, tous les ans ou tous les deux ans, pour réajuster éventuellement vos conditions d'assurance ? Vous avez donné les différents critères (âge du navire, qualité de l'armateur, société de classification) qui déterminent votre décision d'assurer. Est-ce que le type de navire, au départ, est une base qui sert de point d'ancrage pour les discussions concernant l'assurance ? Vous avez dit qu'après un accident de mer, votre rôle était bien entendu d'indemniser. Vous pourriez nous donner des informations sur la rapidité d'indemnisation. Vous avez également dit qu'il s'agissait d'analyser l'événement pour en tirer des conséquences. Est-ce pour faire de l'information, de la prévention ou est-ce pour réadapter vos primes d'assurance en fonction des problèmes posés ? Enfin, s'agissant de la non-obligation d'assurer un navire, vous avez dit tout à l'heure que si l'on refuse d'assurer un navire, on devrait voir diminuer le nombre de bateaux hors normes parce que les armateurs se sentiraient moins sécurisés. Ce n'est peut-être pas tout à fait logique.
M. Serge POIGNANT : Ma question porte sur la limite et la considération des dommages pris en compte après une catastrophe. En cas de mort d'homme, jusqu'où va l'indemnisation, la prise en compte des dommages ? En cas de pollution, est-ce la cargaison, le navire, puis le FIPOL ? Est-ce que ces éléments sont précis par rapport à la prise en considération des dommages ? Jusqu'où vont les assurances dans l'indemnisation et la prise en compte des dommages causés à la suite d'une catastrophe ?
M. René LEROUX : Vous avez rappelé que l'Erika
était assuré pour 80 millions de francs. Aujourd'hui, rien ne s'oppose à ce que cette somme soit versée au propriétaire du navire. Finalement, le propriétaire du navire n'est pas exempt d'une part de responsabilité dans la catastrophe qui s'est produite, et comme il n'y a pas eu de faute reconnue, il peut percevoir ses indemnités et nous laisser avec le pétrole sur nos plages et toutes les conséquences sur le littoral.
Le Conseil économique et social vient de publier une partie de son pré-rapport. J'entendais M. Fitermann en parler à la télévision ce matin. Il disait que l'on avait fini par identifier le propriétaire au bout d'un mois. Il s'agit d'une personne étrangère qui vivait à Londres et que l'on a réussi à joindre sur un portable. C'est effarant. J'espère que, dans les compagnies françaises d'assurance, on n'en est pas à connaître ce genre de situation. Vous n'ignorez pas non plus que ce monsieur était propriétaire d'une
world company, mais qu'il n'avait qu'un seul navire. Assurez-vous aussi ce type de société ?
M. Louis GUEDON : Je vais terminer la boucle des questions car c'est la conclusion de ce qui vient d'être dit. A partir des précisions apportées, l'important, ce sont nos concitoyens. Qu'advient-il des victimes qui n'ont pas été indemnisées pour la totalité des dommages qu'ils ont subis, dès lors qu'on a épuisé, de par les contrats, le plafond des sommes contractuelles qui lient tous ces braves gens que sont les assureurs, les armateurs, les affréteurs ? Il reste les victimes que nous sommes, nous, les citoyens.
M. Pierre GUSTIN : Je vais essayer de répondre dans l'ordre des questions et en les regroupant.
Sur la question des visites, si les assureurs demandent une visite de préassurance, c'est pour déterminer s'ils vont ou non assurer le navire, donner leur garantie, pas seulement à un navire mais aussi à une flotte. Ils ne se contentent pas de vérifier la qualité du navire, son exploitation, la liaison avec la société de classification, on va également étudier la qualité du management de l'équipage. Dans l'affaire de l'Erika, on a d'abord mis en cause l'équipage qui était d'origine indienne. Il y avait là un équipage homogène puisqu'ils étaient tous de la même nationalité. Il est arrivé, dans des sinistres maritimes, que la tragédie ait été aggravée par le fait qu'il y avait à bord plusieurs nationalités et que les membres de l'équipage ne comprenaient pas les ordres donnés par les officiers. Là aussi, c'est un critère qui va permettre aux assureurs d'apprécier le risque, soit en le refusant, soit en imposant un certain nombre de mesures avant de donner les garanties.
Bien entendu, il y a la possibilité de demander des surprimes. Nous sommes dans un marché de concurrence internationale et les assureurs, dans ces cas, refusent le plus souvent de garantir le risque. Je n'ai pas les chiffres mais en 1998, ce sont plusieurs milliers de navires présentés au marché français qui ont été refusés.
M. le Rapporteur : Où sont-ils allés ?
M. Pierre GUSTIN : Ailleurs. Mais ils n'ont pas été assurés par le marché français. Je réponds indirectement à une question posée sur la politique du marché français. Dans ce domaine, nous ne sommes pas les seuls. D'autres marchés le font aussi. Les sociétés qui opèrent sur le marché français en matière d'assurance corps ont généralement pour politique de refuser la garantie des navires inférieurs aux normes, même s'ils sont « attractifs » sur le plan de la prime ou du « prestige ».
S'agissant des types de navires, il est certain que la politique des assureurs ne va pas être la même sur l'appréciation du risque, quel que soit le navire. Nous parlions tout à l'heure des navires vraquiers. Cela fait un certain nombre d'années que nous avons une sinistralité importante en matière de transport de navires vraquiers. S'agissant des navires de croisière, les assureurs sont engagés pour des capitaux importants. Les magnifiques unités construites aux chantiers de l'Atlantique peuvent atteindre, en matière de risque purement dommages, 2,5 à 3 milliards de francs par navire. Il y a eu des incendies en cours de construction, ou d'autres des événements graves, et les assureurs restent très attentifs à ces risques. Chaque fois qu'un navire doit être livré, une commission nationale délivre l'agrément définitif à la mise en _uvre du navire, et l'association professionnelle des assureurs désigne généralement un technicien, pour participer aux travaux de cette commission.
S'agissant des accidents de mer et de la rapidité de l'indemnisation, je reviens sur une question que vous posiez sur le fait que l'on va indemniser plus rapidement le propriétaire du navire que les victimes. La politique respectée par le marché français est de verser l'indemnité dans les trente jours qui suivent le dépôt complet du dossier de réclamation, c'est-à-dire une fois les expertises terminées. Je ne sais pas si les assureurs de l'Erika ont indemnisé le propriétaire. Je n'ai pas eu d'informations particulières à ce sujet. Sur le marché français, il nous est arrivé à plusieurs reprises, en liaison avec le courtier et l'armateur, de retarder le paiement de l'indemnité dommage à l'armateur pour donner une priorité à l'indemnisation des victimes d'un événement, et notamment des marins.
M. René LEROUX : Connaissez-vous la compagnie qui a assuré l'Erika ?
M. Pierre GUSTIN : C'est une coassurance sur le marché italien, marché qui est tout à fait solvable. L'indemnisation se fera. L'armateur va être indemnisé pour la perte de son bien.
M. René LEROUX : Le propriétaire aussi.
M. Pierre GUSTIN : C'est le même. L'armateur est le propriétaire. Vous avez posé une question sur ces propriétaires de navire qui ont des « single ship companies » pour un certain nombre d'entre eux. On les appelle parfois les « Grecs de Londres » dans le jargon de la profession parce qu'ils sont installés à Londres. Un certain nombre d'armateurs n'ont qu'un seul navire, parfois très âgé, qui fait du
tramping, c'est-à-dire qu'ils vont faire des offres de service de port en port, proposant des taux de fret très compétitifs. Cela fait des années que la communauté maritime internationale, notamment par l'intermédiaire de la chambre de commerce internationale, essaie de sensibiliser les chargeurs sur les risques qu'ils prennent en faisant appel à ces
single ship companies, qui sont des armateurs dont le siège social est à Panama, le siège financier en Suisse, le siège administratif au Liechtenstein, etc.
M. René LEROUX : ...et toujours un seul homme !
M. Pierre GUSTIN : Et toujours un seul homme ou une seule famille. Ces armateurs sont rarement, pour ne pas dire jamais, assurés sur le marché français. Nous souhaitons, au contraire, privilégier les armateurs de lignes régulières. Nous avons toujours eu une politique d'étroite concertation avec le comité des armateurs et avec le marché français, et de soutien, tant en matière d'assurance de navires qu'en matière d'assurance de marchandises transportées, des armateurs de lignes régulières. Contrairement aux idées reçues, le pavillon panaméen ou le pavillon libérien n'est pas forcément un mauvais pavillon. L'aspect fiscal joue beaucoup. Tout le monde en « profite », même en France avec le pavillon Kerguelen. Nous poursuivons ces
single ship companies, ces mauvais armateurs qui vendent leur navire très facilement. Dans l'affaire de l'Erika, nous avons eu des difficultés avant de trouver l'armateur à La Valette, alors que le management était en Italie.
Quels sont les dommages pris en compte par les assureurs ? Il y a un contrat. En matière d'assurance corps, une valeur à gré fait l'objet d'un accord à la souscription. S'il y a une déclaration frauduleuse, la loi prévoit que l'indemnité sera revue. En ce qui concerne les marchandises transportées, c'est également en fonction de la valeur facture et de la valeur déclarée par l'assuré.
En revanche, en matière d'assurance de responsabilité, il y a les conventions internationales (CLC, FIPOL) qui plafonnent la responsabilité de l'armateur et qui, dans un certain nombre de cas, ne seront pas suffisantes pour indemniser tous les préjudices ou toutes les victimes d'une catastrophe.
Un mécanisme assez complexe est prévu dans le cadre des règles du FIPOL. Je rappellerai simplement que lorsque les tribunaux déterminent une faute inexcusable de la part de l'assuré et de l'armateur, ces limites de responsabilité ne s'appliquent plus. Dans certaines affaires américaines, en dehors du cas proprement dit de l'assurance, c'est l'assuré lui-même qui a été tenu de mettre la main à la poche pour compléter l'indemnisation des assureurs.
Je soulignerai au passage que le groupe Total a d'ores et déjà apporté une contribution financière, en dehors même de l'indemnisation FIPOL, puisqu'il va prendre en charge le pompage du produit et participer au financement du nettoyage des plages.
M. René LEROUX : Ils ont déjà commencé.
M. Pierre GUSTIN : Ces initiatives ont été prises avant même qu'on épuise le plafond
Erika. Toute la communauté maritime sera attentive pour constater si le plafond de l'Erika sera suffisant. Le FIPOL intervient à de nombreuses reprises. Il existe un rapport annuel du FIPOL et jusqu'à maintenant, les plafonds prévus par le FIPOL ont été suffisants pour indemniser. Il y a aussi tous les préjudices indirects qui sont très difficiles à déterminer.
M. Louis GUEDON : Nous touchons là le fond du problème. On peut certes remercier Total d'avoir pris quelques initiatives tout à fait légitimes, mais les préjudices vont être considérables. La dépréciation commerciale des sites touristiques est très importante. Ceci n'apparaît pas dans vos propos parce que ce n'est pas quantifiable, mais il y a une responsabilité. Depuis l'Amoco-Cadiz, à de nombreuses reprises, les mêmes sites nationaux ont été touchés. Il faut comprendre que l'on ne se contentera pas de contrats juridiques entre l'armateur, l'affréteur, l'assureur, limitant les choses, sinon ce sera la révolution. Ce sera vraiment se moquer des populations maritimes dont on se joue, depuis vingt ans, à travers des contrats juridiques qui bordent tout le monde. Il y a actuellement un déficit de commercialisation sur des régions qui ne vivent que du tourisme. A la fin de l'été, il y aura des règlements de comptes dans la rue ! Vous disiez tout à l'heure que l'opinion publique avait fait évoluer les choses. En démocratie, c'est l'opinion publique et le peuple qui fixent les règles du jeu. Nous en sommes là actuellement.
M. Pierre GUSTIN : Je tiens à dire que les assureurs ne se moquent absolument pas de l'opinion publique, bien au contraire. Malheureusement, nous n'avons pas les solutions immédiates à tous les problèmes. Il y a un cadre juridique international que nous essayons d'améliorer pour qu'il existe une solution assurantielle. Ce cadre juridique mérite que l'on s'implique et les assureurs veulent s'impliquer. Les assureurs sont prêts à apporter leur contribution à l'amélioration de la sécurité des transports maritimes. Une pollution maritime entraîne, comme on le sait, toute une série de sinistres ou de préjudices sur les côtes (commerciaux, écologiques, touristiques...) qui ont été largement étudiés et pour lesquels il y a des solutions à trouver. En l'occurrence, nous sommes au niveau du transport maritime international. Nous sommes dans le cadre de ces conventions internationales. Je me suis permis de dire que nous trouvions qu'elles n'allaient pas assez vite dans leur application et qu'elles pouvaient être améliorées.
Audition de M. Bernard ANNE,
directeur de la Division Marine,
et M. Luc GILLET,
directeur opérationnel de la Division Marine, du Bureau VERITAS
(extrait du procès-verbal de la séance du 29 mars 2000)
Présidence de M. Daniel PAUL, Président
MM. Bernard Anne et Luc Gillet sont introduits.
M. le Président leur rappelle que les dispositions législatives relatives aux commissions d'enquête leur ont été communiquées. A l'invitation du Président, MM. Bernard Anne et Luc Gillet prêtent serment.
M. Bernard ANNE : Nous avons prévu de vous présenter essentiellement le système de sécurité tel qu'il existe, afin de bien resituer le rôle des sociétés de classification, à l'intérieur de l'ensemble du système de sécurité maritime.
Je vais vous décrire rapidement le rôle des sociétés de classification et, en prenant cinq minutes de plus à la fin de l'exposé, Luc Gillet vous présentera un état de l'art en la matière, de manière très synthétique.
Tout d'abord deux types de règles existent dans le système de la sécurité maritime : des règles statutaires et des règles de classification. Les règles statutaires sont celles qui sont de la responsabilité des Etats et qui sont définies par des conventions internationales, qu'elles soient de l'OMI ou de l'OIT. Pour ces règles statutaires, le rôle des Etats du pavillon est primordial. Il consiste en l'adoption des règles et ensuite, la certification.
Les domaines de la réglementation statutaire sont les suivants : en premier lieu, la sauvegarde de la vie humaine en mer. Ce premier objet des règlements statutaires a donné lieu à des conventions internationales qui ont eu pour but principal de faire en sorte que les navires soient construits et équipés de manière suffisamment sûre, afin de préserver la vie des marins et des passagers.
Puis, au fil des années, est venue s'ajouter à ce domaine statutaire la protection de l'environnement à la suite de plusieurs catastrophes écologiques. La communauté internationale a pris la dimension du problème et décidé d'édicter un certain nombre de règles visant à améliorer la sauvegarde de l'environnement.
Les éléments couverts par le domaine statutaire sont les suivants :
- la construction et l'équipement du navire ;
- les aides à la navigation, c'est-à-dire tous les équipements que l'on peut trouver à bord d'une passerelle, mais également les cartes et autres systèmes ;
- l'effectif et la qualification des équipages ;
- la stabilité après avarie.
La construction de ces équipements sera, par ailleurs, traitée dans le cadre des sociétés de classification, les autorités du pavillon ayant très peu de moyens et n'ayant pas les compétences pour s'occuper de ces domaines.
Une autre compétence relevant des Etats est celle des contrôles. Les obligations des Etats sont les suivantes. Tout d'abord, ils doivent ratifier les conventions internationales. Il faut savoir que les Etats ne sont tenus d'appliquer ces conventions que lorsqu'ils les ont ratifiées. Toutes les conventions ne sont pas ratifiées par l'ensemble des Etats membres de l'OMI. On constate aussi que certains Etats peuvent ne pas appliquer ces réglementations internationales.
L'obligation de l'Etat est aussi d'adopter une législation interne qui transpose les conventions internationales dans les lois nationales, de telle manière qu'elles deviennent applicables juridiquement. Actuellement, nous avons aussi, par répercussion, une transposition dans un certain nombre de cas au niveau européen.
Les Etats doivent contrôler l'application des règles à bord des navires battant leur pavillon, ce qui les conduit à effectuer des inspections et à délivrer des certificats qui attestent de la conformité du navire aux règles internationales. Ils ont aussi à prendre des sanctions à l'égard des contrevenants.
Le rôle des sociétés de classification est complémentaire de celui des Etats et donc du domaine de la réglementation statutaire. Même si les sociétés de classification interviennent pour des missions statutaires pour le compte des Etats, c'est toujours sous couvert de ces derniers et, dans la majeure partie des cas, après des audits très sérieux menés par des Etats qui délèguent certaines de leurs prérogatives à ces sociétés de classification. Toutefois, la plupart des Etats gardent l'émission des certificats, hormis quelques pavillons qui donnent une délégation plus complète.
S'agissant de la classification des navires, je commencerai par les délégations à des sociétés de classification. Tout d'abord, nous avons le contrôle de la sécurité des navires et l'exécution des visites statutaires. Les navires ayant par vocation un champ d'action planétaire, il est clair qu'un Etat peut difficilement avoir des inspecteurs dans chacun des ports du monde pour vérifier l'état du navire ou intervenir à son bord.
C'est ce qui a conduit les Etats à déléguer un certain nombre de missions, notamment ces visites statutaires. Par exemple, lorsqu'un navire est au Japon, il est clair que, pour une escale de 24 heures, l'Etat du pavillon n'aura pas les moyens d'envoyer un inspecteur pour effectuer cette visite statutaire au Japon. C'est dans ce cadre que nous agissons. Ces visites font ensuite l'objet, dans le cas d'un certain nombre de pavillons sérieux, de confirmations par les Etats du pavillon lorsque le navire touche à nouveau les ports nationaux.
Dans d'autres cas, et cela peut aussi concerner des Etats dits sérieux, lorsque les navires touchent très rarement les ports nationaux - certains navires ne revenant pas dans les ports nationaux avant un an ou deux, voire plus - l'Etat du pavillon a alors tendance à se fier à la visite effectuée en son nom par délégation.
A l'issue de ces visites, des certificats sont délivrés. La délivrance des certificats se fait, là encore, dans une grande majorité des cas, par les Etats de pavillon, sur rapport fait par la société qui agit en son nom. Au vu de ce rapport, l'Etat du pavillon peut soit demander des compléments, des précisions ou une inspection complémentaire, soit délivrer le certificat, s'il est satisfait de l'ensemble.
La délégation est donc un contrat de confiance. Le Bureau Veritas a actuellement la délégation de cent vingt-cinq gouvernements dans le domaine maritime. Si on considère d'autres domaines comme l'aéronautique et autres, nous avons plus de six cents délégations au total. Ces cent vingt-cinq délégations maritimes couvrent la sécurité et la sauvegarde de la vie en mer, la SOLAS, le code ISM c'est-à-dire le code de gestion de la sécurité des navires, la prévention de la pollution, le franc bord et la jauge.
S'agissant de la France, tous ces certificats, sauf le franc bord, sont délivrés par l'autorité nationale, sur dossier présenté par la société de classification avec, très souvent, des commentaires, des demandes d'information et, éventuellement, des visites complémentaires.
La délégation est tout d'abord motivée par les compétences techniques des sociétés de classification. Il faut être capable de maintenir un corps vivant d'experts ayant le niveau de qualification requis. Au regard du niveau de la flotte française, on imagine mal que l'Etat français puisse disposer d'un nombre d'experts ayant un niveau de qualification qui permette de couvrir l'ensemble des domaines de la chose maritime. C'est l'une des raisons pour lesquelles les Etats s'appuient sur les sociétés de classification, tout en conservant le contrôle des opérations et de la décision.
Par ailleurs, il y a la difficulté de pouvoir disposer d'un réseau mondial d'experts qualifiés. On pourrait imaginer qu'à défaut d'avoir un réseau mondial, il y ait des accords entre Etats pour demander à certains d'entre eux d'agir au nom des uns et des autres. Toutefois, on tombe très vite sur des problèmes à la fois d'indépendance et de souveraineté qui font que cette solution n'a jamais été retenue. Il me semble d'ailleurs qu'elle serait très difficile à envisager, les Etats ayant des interprétations parfois très différentes d'une même convention internationale. Chaque Etat, quand il donne une délégation, en précise les termes d'application à la société de classification, en spécifiant bien son interprétation et dans quel domaine elle doit agir.
Lorsque certaines interprétations sont en contradiction ou trop en retrait par rapport à la convention internationale, il appartient aux Etats, sinon ils sont en défaut, de soumettre éventuellement des propositions d'amendements à l'OMI ou des demandes de précision.
Toujours dans ce même domaine, il est clair qu'il y a nécessité, pour les Etats qui justifient ce motif de délégation, d'assurer un suivi régulier des navires hors des ports nationaux. Si une administration doit être à bord d'un navire au minimum tous les ans, elle les voit parfois moins fréquemment, dans la mesure où a priori elle est centrée sur un pays. Il y a également la question du respect de souveraineté.
Cela explique pourquoi le Bureau Veritas est délégataire, dans bon nombre de cas, de gouvernements. Nous avons un effectif complet de huit cents experts, tous spécialistes de la chose maritime, que ce soit des architectes navals, des personnes ayant l'expérience de l'inspection sur le terrain, d'anciens chefs mécaniciens qui ont embarqué et ensuite rejoint le Bureau Veritas. Nous avons des experts dans tous les domaines, électricité, automatisation, structures etc. Parmi ces huit cents experts marine, nous avons un nombre de personnes qui couvrent l'ensemble des spécialités.
Ils sont répartis, en ce qui nous concerne, dans 420 centres d'inspection à travers le monde. Le total de notre effectif, en charge de l'ensemble des activités marines, est constitué de 1 300 personnes. Ceci fait qu'au-delà des huit cents experts qui sont essentiellement de terrain, nous avons un effectif d'environ cinq cents ingénieurs qui travaillent à des développements et des études complémentaires dans les techniques maritimes.
Ce rôle statutaire et ces missions confiées aux sociétés de classification ont été reconnus officiellement par l'OMI, dans le cadre de la convention SOLAS, par les amendements de 1995. C'est à partir des conventions de l'OMI que les différents Etats ont le droit de déléguer aux sociétés de classification.
L'autre volet concerne le rôle proprement dit de la société de classification et la classification. Historiquement, à la fin du 18e siècle et début du 19e, à la suite d'un certain nombre d'expéditions maritimes qui n'arrivaient pas à bon port, les compagnies d'assurance, qui existaient déjà, avaient imaginé un référentiel leur permettant d'avoir un jugement sur ce qu'elles assuraient. A l'époque, les navires étaient construits dans tous les pays du monde, sans aucun référentiel. Chacun construisait le navire comme bon lui semblait, avec son expérience propre et sans la moindre règle commune, alors qu'on retrouverait ce navire dans tous les pays du monde.
Les assureurs ont voulu se conforter dans leur choix et faire en sorte de n'assurer que des risques qu'ils estimaient supportables. Ils ont donc voulu qu'un référentiel soit constitué et, dans ce but, ont suscité la création des sociétés de classification. A l'époque, il s'agissait avant tout d'évaluer le risque pour la marchandise et le navire, beaucoup plus que la sauvegarde de la vie humaine en mer, qui a été l'objet de la convention SOLAS.
C'est de là que vient la différence entre la classification et le statutaire. Ceci étant, les deux domaines sont intimement liés car, dès lors qu'on édicte un référentiel pour la construction d'un navire, on fixe automatiquement des standards qui contribuent à la sécurité générale. C'est ainsi que, pas à pas, les deux domaines sont maintenant beaucoup plus intimement liés qu'ils ne l'étaient au départ.
Dans ce référentiel, il s'agit avant tout d'élaborer des règles contribuant à la sécurité des navires, en particulier dans le domaine de la construction des navires et leur conception, et de vérifier leurs applications au moyen de visites et d'inspections.
Ce domaine couvre la solidité générale de la coque, la conformité de la machine et des équipements aux règles de conception et d'utilisation. L'important, pour nous, est de bâtir ce référentiel qui touche tous les domaines, tant les navires en acier, les unités offshore, les bateaux de navigation intérieure que les engins sous-marins, les yachts, les engins rapides.
Chaque société de classification a ses propres référentiels, mais les plus importantes d'entre elles sont regroupées au sein d'une association internationale, l'IACS, dont le rôle est à la fois de garantir un niveau de qualité des sociétés de classification et d'assurer une cohérence entre les différents référentiels, de telle sorte qu'ils soient d'un niveau équivalent même si, sur certains points, ils diffèrent.
Les normes sont en constante amélioration. Nous publions périodiquement des éditions de règlements avec, cette année, un nouveau règlement qui contribuera, de façon renforcée, à la sécurité par la prise en compte des phénomènes de fatigue des matériaux. A la suite de différents phénomènes de contraintes, une tôle qui, au départ, était considérée comme ayant l'ensemble des caractéristiques nécessaires, diminue de résistance, même si l'épaisseur est toujours la même. C'est au niveau de la cristallographie qu'ont lieu ces décohésions entre les différents cristaux formant le métal.
Ces phénomènes, qui sont pris en compte dans les nouveaux règlements, étaient très mal connus il y a une vingtaine d'années. Au fil du temps et l'expérience et les travaux de recherche aidant, nous avons pu établir des règles qui ont un sens en ce qui concerne la fatigue des matériaux. Ce à quoi nous travaillons également dans ce règlement, qui sera mis en service en juillet 2000, c'est à l'amélioration des navires par une optimisation de leur maintenance.
C'est là un point important à souligner. On peut dépenser des sommes importantes en maintenance, mais sans faire ce qu'il faut aux endroits nécessaires. Il faut aider l'armateur à avoir une meilleure connaissance et une analyse plus fine de l'état de son navire, car n'oublions pas que c'est l'armateur qui est en charge de la maintenance du navire. Il est le seul à pouvoir l'être, pour la simple raison qu'il a en permanence à bord des personnels d'un bon niveau de compétence - tout au moins dans la majeure partie des cas -qui suivent le navire au jour au jour et peuvent détecter des débuts de défaillances lourdes.
Un autre point est à préciser. Dans le règlement de la société de classification, le certificat de classe qui est émis est relatif à l'instant de la visite. Dès lors qu'il y a un référentiel, on contrôle lors de la visite que le navire est conforme à ce référentiel et on en atteste par un certificat. Mais dans le contrat qui lie l'armateur et la société de classification, l'armateur a obligation de signaler tout point qui s'écarterait des conditions attestées par le certificat, c'est-à-dire qui s'écarterait du référentiel.
Si, pour une raison quelconque, survient une avarie, une détérioration ou autre, l'armateur est en faute s'il ne la signale pas à la société de classification. C'est extrêmement important dans le domaine de la sécurité. C'est basé sur une règle de sécurité. L'armateur doit le faire ; cela fait partie de son contrat. Si nous nous apercevons, à un moment donné, que l'armateur n'a pas respecté cette clause, nous refuserons de classer son navire, ce que nous pouvons faire même à titre rétroactif.
M. le Rapporteur : Cela vous est-il déjà arrivé ?
M. Bernard ANNE : Oui. Car il est absolument inacceptable que l'on nous cache quelque chose dans un contrat de confiance. Il est clair que, quand vous faites une visite à bord, vous voyez tout ce que vous pouvez voir, mais si quelqu'un sait quelque chose et ne vous le dit pas, il est en faute. Si on le découvre par la suite, on en tiendra compte dans notre appréciation du sérieux de l'armateur, et donc de la manière dont il a fait sa maintenance.
Pour nous, un armateur doit avant tout signaler tout écart au référentiel qu'il constaterait. Il nous reste ensuite à l'apprécier quand il le constate, et cela arrive assez fréquemment. Si un armateur nous informe qu'il rencontre tel et tel problème, nous allons, dans certains cas, juger s'il faut une réparation immédiate ou, au contraire, si c'est un problème mineur qui peut attendre le prochain arrêt technique, sans compromettre la solidité générale du navire.
Ce travail, qui doit être fait en commun par des professionnels de la mer, a jusqu'à maintenant, dans les traditions maritimes, toujours été respecté. Dans ma carrière maritime, j'ai toujours rencontré des gens sérieux qui connaissent la mer et ses dangers.
M. le Président : Avez-vous une expérience maritime vous-même ?
M. Bernard ANNE : Oui, je suis originaire des côtes bretonnes, donc j'ai une expérience personnelle au départ. Par ailleurs, je suis ingénieur du génie maritime. J'ai débuté à l'arsenal de Brest ; je suis ensuite entré à Gaz Océan société maritime, puis à la CGM, pour ensuite devenir vice-président et directeur général de la SNCM, société qui transporte des passagers entre la France continentale et la Corse ainsi que l'Afrique du Nord. Pendant mes dix années passées à la CGM, j'ai été responsable des programmes de navires neufs et construction. J'avais été également chargé, à une autre période, des opérations d'entretien. Je pense avoir acquis une certaine expérience en la matière.
Toutefois, je dois dire qu'au Bureau Veritas, je suis loin d'être l'exception puisque l'ensemble des ingénieurs du Bureau Veritas ont une formation maritime de base, spécialisée dans les techniques relatives à l'architecture navale, certains ayant parfois d'autres spécialités plus pointues en électricité, automatisation et autre. Une grande partie de nos inspecteurs, qui font les visites à bord des navires, ont mené une partie de leur carrière dans la marine marchandise.
Les opérations de classification concernent également les navires en construction. Le rôle doit être défini d'une manière claire. Celui qui construit et conçoit le navire, c'est le chantier. En revanche, dès lors que le navire est commandé pour être construit selon le règlement d'une société de classification, il doit être construit et conçu par le chantier dans le respect des règles de la société de classification, donc dans le respect du référentiel.
Pour ce faire, le chantier envoie ses plans à la société de classification pour vérification de la cohérence avec le référentiel. Ceci se fait tout au long de la construction pendant laquelle des experts de la société de classification sont sur le chantier pour suivre la construction et s'assurer que, tout au long de la construction, les différents commentaires qui ont pu être apportés pour faire respecter ce référentiel sont pris en compte. Cela part du dessin général jusqu'à l'ensemble des opérations de soudure, de constitution des blocs qui rentrent dans la constitution du navire.
Le deuxième aspect concerne les navires en service. De même qu'il y a un référentiel pour les navires en construction, nous avons un référentiel pour les navires en service qui définit les règles à appliquer et au-delà desquelles des remplacements impératifs sont à faire. Mais là encore, c'est l'armateur qui doit décider d'entretenir ses équipements. S'il a une pompe défaillante, il lui appartient de la remettre en ordre, dès qu'elle est défaillante.
Pour sa part, la société de classification va vérifier, au moment de la visite, que le navire est toujours conforme aux tolérances admises puisqu'il y a toujours des tolérances dans un référentiel. On vérifiera que l'on reste à l'intérieur de ces limites et si oui, le navire est reclassé. Sinon, la classe est suspendue ou retirée, jusqu'à ce que l'armateur ait remis le navire en état. Nous ne pouvons pas le contraindre à le remettre en état, mais seulement l'avertir que s'il n'est pas dans les limites, il n'est plus classé. C'est là notre rôle.
C'est un élément important quand on parle de navires en service et de problèmes de corrosion, ce dont on a beaucoup parlé dans le cas de l'Erika. Au travers de vos questions, j'apporterai quelques éclaircissements si vous le souhaitez. Le navire, au départ, est construit à la fois en tenant compte des caractéristiques du métal - l'effort global que doit subir la poutre navire avec des contraintes - comparées aux caractéristiques mécaniques limites du métal, c'est-à-dire les limites d'élasticité.
Au-delà de cette limite mécanique, nous avons un coefficient de sécurité au-delà duquel il y a une marge d'épaisseur dans l'échantillonnage prévu afin de permettre une certaine corrosion pendant la vie du navire. Quand ce seuil est atteint, il faut remplacer les tôles puisqu'un navire n'est jamais dans un état statique. Le navire va évoluer au cours de sa vie. Par conséquent, un navire tout neuf, tout comme une voiture, a droit à une réserve de vieillissement. Ensuite, dès lors qu'on atteint la marge de cette réserve, on tombe dans le coefficient de sécurité que l'on n'a pas le droit de dépasser. Il faut alors changer ou remplacer les équipements, les tôles et autres. Il faut garder à l'esprit qu'un navire, qui présente des phénomènes de corrosion, n'est pas forcément en mauvais état, pour autant qu'il reste à l'intérieur de la limite prévue initialement pour cette corrosion. On limite bien sûr les corrosions et les fréquences de remplacement de tôle avec des traitements appropriés des tôles (peinture et autres).
Le cycle de classification est de cinq ans. S'agissant des visites, nous avons ce qu'on appelle la visite annuelle. De même qu'elle existe pour le statutaire, elle existe pour la classe. Cette visite annuelle donne lieu à une inspection relativement rapide car elle se fait en escale commerciale du navire. On procède à l'aide d'une
check list d'éléments que l'on va vérifier, mais cette visite annuelle n'a pas la prétention d'être exhaustive. On vérifie que le navire, tel qu'il est, a été maintenu dans l'état qui correspond à son état de certification, donc conforme au référentiel, et que l'armateur n'a pas laissé se détériorer la situation sans nous le signaler.
La visite intermédiaire, entre la deuxième et troisième année, donne lieu à une inspection beaucoup plus approfondie du navire. Elle inclut soit un examen sous-marin de la coque par plongeurs, soit un passage au bassin, suivant le type de constatations faites. A cette occasion, des travaux de carénage sont effectués par l'armateur.
La visite spéciale, qu'on appelle la grande visite, se fait tous les cinq ans et permet d'examiner le navire beaucoup plus en détail, de telle manière qu'après cette visite, on lui redélivre un certificat qui correspond à un nouveau cycle de cinq ans.
Cette visite spéciale est extrêmement importante puisque c'est elle qui permet d'examiner dans le détail du navire. Ce cycle de cinq ans n'a pas été choisi au hasard. L'expérience acquise a montré que, jusqu'à cinq ans, le navire ne subissait pas de détériorations très marquées. En revanche, au-delà, on pourrait commencer à s'interroger. C'est pourquoi on a établi ce cycle de cinq ans.
Au-delà de ces visites, nous avons les visites occasionnelles souvent provoquées par l'armateur qui, dans le cadre de son contrat, va nous informer qu'il rencontre tel ou tel problème. Il nous demande alors de venir à bord pour lui dire si, compte tenu du problème rencontré, nous maintenons ou pas la classe. Si nous lui indiquons que nous ne maintenons pas la classe, l'armateur va immédiatement procéder à des réparations qui permettront, le cas échéant, de modifier notre position.
Dans d'autres cas, nous constaterons que cela ne met pas en cause la structure générale du navire, ni sa sécurité. Nous informons alors l'armateur qu'il a quelques mois pour faire ces réparations, voire qu'il peut les faire au prochain arrêt technique. Cela fait partie d'un jugement global. Nous avons en ce domaine des inspecteurs expérimentés, mais aussi des règles du jeu internes avec des notes d'information qui permettent de savoir quelle position prendre en fonction des constatations faites.
A la suite de ces différentes visites, nous délivrons des certificats de classification qui concernent la coque, la machine, les chaudières. Ces certificats peuvent avoir des visas, c'est-à-dire une remarque que l'on apportera, indiquant que tels travaux sont à faire dans les six mois. Le navire est conforme dans son ensemble, mais reste un point, sans forcément avoir un caractère d'urgence, pour lequel nous demandons que cela soit fait dans un délai de tant de mois.
A la différence d'autres sociétés de classification, toutes nos réserves sont mentionnées sur le certificat. Nous préférons avoir cette transparence pour que, lorsque l'armateur présente son certificat, y soient indiquées les réserves formulées par nous-mêmes. Le fait d'avoir cette transparence ne va pas pénaliser l'armateur car il ne faut pas en déduire que, par rapport à d'autres, son navire est mal entretenu. Ce serait faux de penser cela.
Il faut que chacun apprécie bien la situation et joue le jeu. Sinon cela pousserait à aller à l'encontre de cette transparence et à faire en sorte que les réserves soient adressées par courrier séparé, sans apparaître sur le certificat. Ce n'est pas ce que nous souhaitons, nous considérons que les réserves doivent apparaître sur le visa.
Il existe, dans le monde, une cinquantaine de bureaux ou de sociétés de classification. Dix d'entre elles, reconnues les plus sérieuses et les plus importantes, sont regroupées au sein d'une association, l'IACS (International Association of Classification Societies).
M. le Président : N'est-ce pas plutôt onze ?
M. Bernard ANNE : Vous avez tout à fait raison. Jusqu'à un passé récent, elles étaient au nombre de onze. Mais en 1998, nous avons exclu le
Polish Register of Shipping car il n'avait pas respecté les règles du jeu, en termes de système qualité.
M. le Président : Quand vous dites que vous avez exclu cette société de classification, cela signifie que les sociétés de classification participent à la procédure d'exclusion. C'est une forme d'autogestion.
M. Bernard ANNE : Dans son fonctionnement, l'IACS n'est constituée que des dix sociétés de classification qui en sont membres. Elle a un bureau, un secrétariat permanent et un conseil dans lequel chaque société de classification a un membre qui la représente. La présidence de ce conseil, qui tourne tous les ans, est assurée par un membre, issu d'une des dix sociétés de classification. Ce n'est pas en soi un organisme indépendant, mais une association qui regroupe ses dix membres.
M. le Président : Dans le règlement de l'IACS, il est écrit qu'un des membres de l'IACS peut être exclu par ses partenaires, à la suite des manques constatés dans ses modalités de fonctionnement ?
M. Bernard ANNE : Tout à fait. Il y a des critères à remplir pour devenir membre de l'IACS. Il faut avoir des moyens suffisants, l'un des critères est le tonnage et le nombre de navires. Si vous disposez de moyens conséquents, vous pouvez alors entretenir un nombre d'experts suffisants dans le monde entier, ce qui vous permet d'assurer un niveau de qualité et un service adéquats.
Par ailleurs, l'un des points les plus importants est un système de qualité, commun à l'ensemble des membres de l'IACS et qui doit être respecté. Dans le cas évoqué du
Polish Register of Shipping, à la suite de transferts de classe qu'il avait acceptés pour grossir rapidement afin probablement de ne pas être trop juste quant aux critères quantitatifs, le
Polish Register of Shipping n'a pas respecté les règles qui sont celles de l'IACS en matière de transfert.
Ces règles imposent, entre autres, que toutes les réserves mentionnées à l'encontre d'un navire par une société de classification soient effectuées et contrôlées par la société suivante de manière intégrale. Par exemple, si un navire quitte le Bureau Veritas avec des réserves mentionnées sur son certificat et des préconisations à effectuer lors du prochain arrêt technique, la société qui le prend n'a pas le droit de lever ces recommandations sans les avoir fait réaliser. Cela ne peut se faire que si la société qui perd le navire est d'accord pour dire que les recommandations ne sont pas indispensables, que les systèmes de sécurité sont corrects et qu'un délai peut être accordé.
Mais cela ne peut se faire qu'avec l'accord de la société que le navire quitte. C'est un moyen d'éviter des changements de classe dans le seul but de ne pas se soumettre aux exigences d'une des sociétés de classification.
Dans le cas de l'Erika, nous avions une simple recommandation, mais très importante, en ce qui concerne la coque, à savoir que le navire devait faire sa visite spéciale sans plus tarder, sans aucun délai et sans réutilisation commerciale. C'est pourquoi nous avions émis un certificat indiquant que l'Erika pouvait naviguer sur ballast, mais devait faire sa visite spéciale. Ce n'est pas dû à une quelconque prescience d'un problème potentiel ou autre, mais parce que le cycle de cinq ans est pour nous un garde-fou. On sait qu'au bout de cinq ans, des travaux sont à faire sur un navire, même si on ne sait pas exactement lesquels. Une inspection est nécessaire, et il est hors de question que quelqu'un puisse prolonger ce délai de cinq ans, uniquement en changeant de classe.
Nous avions recommandé que l'Erika soit sur ballast, lors de son arrêt technique, pour mener la visite spéciale. C'est d'ailleurs ce qui a été fait par la société qui a effectué cette visite spéciale, sous sa responsabilité, mais avec l'obligation de la faire faire entièrement. Or le schéma d'une visite spéciale est bien défini. En fait, il y a à revoir, entre autres, tout l'ensemble de la structure du navire, plus un certain nombre d'éléments de machines et autres. Tout ceci est bien défini au sein de l'IACS.
Dans les différents points de contrôle des sociétés de classification, il y a l'IACS dont le fonctionnement vient d'être évoqué. Ce sont les membres du conseil qui dirigent l'IACS, définissent ses règles et la manière dont on va opérer. Au travers de ce conseil de l'IACS, nous décidons de règles uniformes, sur le plan technique. Par exemple, on pourra décider qu'à compter de telle date, telle ou telle particularité de tous les navires devra être renforcée. Par conséquent, tout le monde devra inclure, dans son règlement, cette particularité. De même, s'il y a non-respect des règles du système de qualité, nous pouvons spécifiquement, au-delà de ce qui est prévu de manière régulière, déclencher des audits sur telle ou telle opération, menés par l'un des membres.
En résumé, les contrôles de certificat de classification sont faits à trois niveaux :
- par l'IACS, pour les dix membres de l'IACS, plus trois associés qui ne sont pas membres et qui sont le
Polish Register of Shipping, qui a perdu son statut de membre, l'Indian Register of Shipping et le
Croatian Register of Shipping ;
- la réglementation internationale qui a défini le contexte dans lequel les sociétés de classification interviennent ;
- la réglementation européenne, dans le cadre de directives.
Le système qualité a été mis en place en 1992, l'IACS elle-même étant bien antérieure. Ce système, basé sur les normes ISO 9000 et les règles de l'OMI, doit être audité tous les trois ans. Au-delà de cet audit, le conseil peut décider de mener des audits à n'importe quel moment.
S'agissant du contrôle des pavillons, certaines résolutions de l'OMI définissent la manière dont les organismes, agissant au nom de l'administration, peuvent être habilités, fixent des normes minimales pour être habilités et définissent un système de contrôle à mettre en place par l'Etat du pavillon.
On peut parfois s'interroger sur les normes minimales puisque cela conduit à avoir une cinquantaine de sociétés qui agissent en ce sens. Elles ne sont, en général, pas reconnues par les grandes nations maritimes.
La réglementation européenne, de ce point de vue, est un peu plus stricte puisque les règles européennes se réfèrent à des règles qui existaient dans les différents Etats pour agréer ces sociétés de classification. L'Europe a surtout cherché à les rendre homogènes, d'un pays à l'autre. Actuellement, les membres de l'IACS sont tous agréés par les Etats membres de l'Union européenne, mais avec un audit qui s'assure que tout est fait dans les normes.
Ces agréments, jusqu'à maintenant, sont donnés par l'Etat du pavillon qui propose à une société agréée de confirmer son agrément auprès de la Commission européenne à Bruxelles. Lorsqu'une société est agréée dans le cadre de la directive, elle est agréée par un Etat européen qui lui accorde l'agrément, mais qui ensuite en rend compte à la Commission européenne pour bien définir la manière dont cela a été fait et montrer que c'est conforme à la directive. Si ce n'était pas le cas, la décision pourrait être invalidée.
M. Gillet va maintenant vous présenter l'état de l'art sur ce que nous savons faire dans le contrôle des structures des navires. Cela aura son importance quand on abordera le cas de l'Erika.
C'est une démarche que nous avons préconisée pour le contrôle des navires les plus âgés en termes de structures. Je vous indique tout de suite que tout le monde n'est pas d'accord avec cela, car nous ne sommes pas nombreux, parmi les sociétés de classification, à avoir de tels systèmes facilement disponibles. Certains sont quelque peu hésitants à aller dans cette voie, mais c'est pour nous un outil, qui permettra pour le futur d'avoir une meilleure connaissance de la résistance d'ensemble du navire.
(Projection de diapositives.)
M. Luc GILLET : L'idée d'un système tel que celui que je vais vous présenter, VeriSTAR Hull, est de rassembler dans une seule base de données tous les éléments techniques concernant un navire, depuis sa conception, sa construction et sa maintenance en service, et de mettre à la disposition de l'armateur l'ensemble de ces données qui servent également à la société de classification.
Tout cela est possible, aujourd'hui, grâce au développement des techniques informatiques et des modèles de calculs que l'on fait sur ordinateur. L'idée est de partir d'une représentation la plus fidèle possible d'un navire existant, à partir d'un modèle numérique de calculs par éléments finis. Vous avez ici l'illustration d'un porte-conteneurs et de son modèle, tel qu'il est calculé, qui vous montre bien que l'on calcule le navire de façon la plus complète possible.
Ces systèmes ont l'avantage d'être très faciles à utiliser. On va, par exemple ici, à l'aide d'un système de couleurs, représenter une partie de la coque avec l'état des contraintes qu'elle subit, grâce à des codes de couleur lisibles. Dans ce cas particulier, plus on va de l'orange vers le rouge, plus le niveau de contrainte est élevé.
Un armateur qui possède un tel système peut ainsi avoir à tous moments, chez lui sur son ordinateur, une vue de son navire. Sur l'écran de son ordinateur, il peut voir l'état de son navire et accéder aux différents rapports techniques, mesures et calculs qui ont pu être faits à bord. En effet, en plus d'être un outil de calcul, cela permet de stocker des rapports techniques et des photos. Si l'armateur veut visualiser ces photos, il lui suffit de cliquer dessus et il y accède en grandeur réelle.
On peut également avoir tous les cas de chargement que le navire peut accepter, avec l'état du ballast et de tout ce qui doit être transporté à bord. Cela permet d'avoir, à tout instant, l'état du navire pour un cas de chargement donné, retrouver l'historique, les photos de telle et telle partie ou les rapports techniques qui ont pu être établis à la suite d'une intervention.
Tout cela est mis à la disposition de l'armateur ou de la société de classification par des moyens modernes, c'est-à-dire Internet ou CD Rom, l'idée étant de rendre disponibles très rapidement ces informations.
Pour vous montrer le fonctionnement de cet outil, je prendrai l'exemple d'un porte-conteneurs. Il s'agit ici d'un porte-conteneurs de quatre mille boites. Depuis longtemps, on sait quels sont les éléments critiques sur un porte-conteneurs, c'est-à-dire les éléments les plus sollicités qui doivent faire l'objet, pour la coque, d'une surveillance particulière. Ce sont ceux entourés en rouge. Néanmoins des systèmes comme VeriSTAR Hull permettent aujourd'hui d'aller beaucoup plus loin que la simple analyse de ces éléments critiques car on va générer un modèle complet du navire, en utilisant des moyens modernes qui nous permettent de le faire de façon très rapide et sophistiquée. Vous pouvez voir ici la génération automatique d'une partie du modèle. Ceci est le modèle complet tel qu'il est défini, une fois que toutes les données ont été rentrées.
On ne s'arrête pas au modèle d'ensemble, on va également modéliser tous les éléments critiques montrés tout à l'heure, avec des modèles beaucoup plus détaillés. Ensuite, on calcule le navire dans toutes les configurations réelles qu'il rencontre, c'est-à-dire de façon dynamique sur la houle. Il s'agit d'un calcul réel du navire complet sur houle, avec tous les éléments statiques et dynamiques que cela comporte, et non pas seulement l'application de règles plus ou moins empiriques ou théoriques.
En termes de sophistication des calculs, c'est ce que l'on fait de mieux aujourd'hui, l'important étant de retenir que l'on est en mesure de calculer tous les cas de chargement du navire et d'avoir une réelle visualisation des contraintes du navire dans ces différents cas de figure.
Ensuite, on peut analyser, dans le détail, en zoomant sur différentes zones. On voit ici, à l'intérieur de la structure, des éléments colorés en rouge car ce sont les éléments les plus sollicités. On va pouvoir regarder précisément les éléments qu'il faudra surveiller, puisque ce sont les éléments les plus critiques.
Ceci est une représentation dynamique du navire. Là encore les changements de couleurs correspondent aux changements de contraintes. Les déformations sont amplifiées pour les besoins de la démonstration. Ceci vous montre qu'il est possible de calculer l'ensemble du navire, de façon dynamique sur la houle, et de représenter des phénomènes relativement compliqués tels que la torsion d'un navire, élément très important sur les porte-conteneurs.
Toutefois, de tels outils permettent, aujourd'hui, de calculer les éléments de détail du navire, et notamment d'appréhender des problèmes beaucoup plus délicats qui sont les problèmes de fatigue, cette dernière donnant lieu à des fissures qui vont se propager et pouvant amener à la ruine des détails.
Ces systèmes contiennent des bibliothèques de détails qui permettent, automatiquement, de calculer tous les éléments critiques sur de tels navires. Ces calculs ont été faits de façon théorique, mais confirmés par des essais en grandeur réelle destinés à valider les modèles mathématiques.
A partir de ces calculs, on détermine des cartes d'éléments les plus critiques, les « hot spots » ou les points chauds, qui vont permettre à l'armateur d'établir son plan de maintenance. Ces cartographies d'éléments critiques et de zones fortement sollicitées sur le navire permettront à l'armateur, non seulement lors de la construction mais aussi pendant toute la durée de vie du navire, en fonction des différents cas de chargement, de connaître les usures et les remplacements de tôle auxquels il faudra procéder. A chaque fois, il pourra ressortir la carte des éléments les plus chargés et disposer d'éléments rationnels pour développer son plan de maintenance.
Ces cartes de détails donnent les éléments de contrainte, mais aussi permettent de prévoir les durées de vie en fatigue. Sur des pieds de cloison, par exemple, on obtient des durées de vie théoriques de cinquante ans. Sur d'autres détails, on obtient des durées de vie légèrement différentes. On va ainsi pouvoir apprécier, pour l'ensemble des détails du navire, la capacité de celui-ci à résister aux problèmes de fatigue sur une certaine période de temps. Les durées de vie que l'on donne ont surtout une valeur qualitative. Cela permet de comparer si un détail est meilleur qu'un autre, mais cela ne donne pas une valeur absolue de la vie du navire.
Ces illustrations, d'après le cas réel d'un grand pétrolier et de son carénage, vous montrent comment cela fonctionne pendant la vie du navire. L'idée est de repartir du dernier état connu du navire, avant le carénage, et de réétudier, pendant le carénage, les éléments critiques du navire en fonction du calcul précédent, pour constater, pendant l'arrêt en cale sèche, l'état réel du navire et décider alors, à partir de ces calculs, des remplacements nécessaires.
Cela se fait non seulement avec l'avis de l'expert de la société de classification, qui reste l'élément prépondérant, mais aussi à partir d'éléments de calculs qui correspondent à l'état du navire, au moment où les mesures d'épaisseur ont été effectuées, c'est-à-dire pendant son séjour en cale sèche. On peut retrouver l'historique et notamment reprendre des photos de détails, qui avaient été stockées auparavant, ou revenir stocker des photos de détails corrodés dans le but de pouvoir faire des inspections ultérieurement.
Le code de couleur permet de localiser les zones les plus sollicitées. En particulier, sur un détail d'une telle structure, on observe une petite zone rouge qui montre un niveau de contrainte excessif. On calcule des solutions de réparation, puis on recalcule l'ensemble du navire pour s'assurer que la zone rouge en question, par l'adjonction d'un gousset sur la partie droite, permet de faire disparaître ce niveau de contrainte excessif et de revenir à un état de contrainte acceptable pour le navire.
Ce type de calcul était possible auparavant ; on n'a pas inventé la méthodologie de calcul. Toutefois les moyens modernes de calcul permettent de le faire aujourd'hui très rapidement et d'avoir en permanence des bases de données du navire qui permettent de faire ces calculs et de prendre des décisions pendant l'arrêt du navire, ce qui était impossible auparavant pour des questions de délais.
M. le Président : C'est très intéressant. Cela rejoint un certain nombre d'hypothèses de travail pour les questions de maintenance, et non plus de réparation. On programme tout simplement la façon dont on peut se conduire aussi bien dans le domaine maritime que le bâtiment, les machines, etc... Pour appliquer ce genre de choses, cela implique un contrat à long terme avec une compagnie. Par ailleurs, cela signifie que vous êtes assuré du type de cargaison, des conditions de voyage du navire, de façon à savoir comment il réagit. Il ne réagira pas de la même manière selon qu'il est totalement chargé ou non, qu'il est fréquemment mis à contribution dans des mers en difficulté. Ce sont tous ces éléments que vous rentrez.
M. Bernard ANNE : Tout à fait.
M. le Président : Par ailleurs, vos concurrents, puisque vous avez développé cette proposition, en ont probablement d'autres. Procèdent-elles toutes de la même logique ou y a-t-il des différences significatives, et dans ce cas, lesquelles ?
M. Bernard ANNE : Tout d'abord, nos concurrents, comme vous les nommez...
M. le Président : Vos partenaires.
M. Bernard ANNE : Oui, parce que c'est plutôt dans cet esprit que cela fonctionne, même si parfois on préférerait classer tel navire à la place de l'autre. Tout d'abord, ce ne sont pas forcément des contrats à long terme puisque nous transférons des informations qui peuvent être reprises sur un autre système, moyennant des adaptations. Un armateur ne peut pas accepter d'être captif d'une société de classification pour le long terme.
M. le Président : Quelle est la durée du contrat ?
M. Bernard ANNE : Cela dépend de la durée de propriété du navire, dans une grande majorité des cas. Un armateur qui vend son navire au bout de six ans va le vendre à un autre armateur qui lui n'est peut-être pas habitué à travailler avec telle ou telle société de classification, mais préférera travailler avec celle avec laquelle il estime avoir les meilleurs liens, le meilleur service et le meilleur support.
M. le Président : Une compagnie sérieuse ou un pavillon métropolitain d'un grand pays à forte tradition maritime ont-ils plus tendance à avoir un contrat à long terme avec une société de classification, par rapport aux propriétaires de l'Erika, propriétaires d'un seul bateau, qui font du spot et qui peuvent éventuellement chercher à changer fréquemment de société de classification, sans prendre l'une des dix réputées meilleures ?
M. Bernard ANNE : Selon mon expérience maritime et d'armateur, on ne change pas de société de classification tous les ans. Tout d'abord, aucune société de classification ne l'accepterait. En général, les périodes sont de cinq ans, mais elles peuvent être, pour de multiples raisons, différentes. Par exemple, on ne peut empêcher, si cela semble sain, un armateur qui a une flotte de vingt navires, dont quinze sont classés par une société de classification, trois par une autre, de rationaliser les deux derniers. Tel autre peut choisir telle société de classification parce qu'elle est mieux implantée dans des pays qu'il dessert commercialement. Ce sera le cas de certaines sociétés de transport maritime par conteneurs.
Si l'armateur a fait classer son navire, au départ, par une société de classification qui a un réseau relativement limité en Europe du nord par exemple, il lui sera peut-être difficile de le faire suivre s'il va en Indonésie. Il choisira alors une société de classification plus appropriée, en termes de services, dans l'intérêt de la sécurité et du navire.
On ne peut pas en tirer une règle générale. Le fait que des navires changent souvent de propriétaires, qui changent eux-mêmes de sociétés de classification et ainsi de suite, ne signifie pas que ce ne soit pas sérieux et volontaire de la part de l'armateur, mais à tout le moins, cette discontinuité dans le suivi peut avoir des conséquences. C'est plus la discontinuité qui m'inquiète car cela peut parfois vouloir cacher une volonté.
L'important est la continuité, laquelle peut être obtenue soit en restant avec la même société de classification, soit avec des transferts d'informations importants entre sociétés de classification. C'est probablement sur ce point que les membres de l'IACS ont à faire des progrès. Même s'ils en ont déjà fait beaucoup, il en reste à faire, notamment par la constitution de telles bases de données.
Pour en revenir à la compatibilité entre les systèmes, certaines sociétés de classification, parmi les plus grandes au sein de l'IACS, ont des systèmes de même nature que le nôtre. Il nous reste à définir - et c'est ce que nous faisons actuellement - des standards d'échanges de données entre sociétés de classification pour justement être capables d'assurer cette continuité importante. Nous préparons des proformas de données d'information.
Cela fait partie d'une résolution prise par les membres de l'IACS. Cela avait commencé il y a quelques années, mais il me semble que la catastrophe de l'Erika a donné un coup d'accélération. Notre souhait est de pouvoir disposer d'une continuité de l'information entre les différents membres de l'IACS.
M. Luc GILLET : Pour revenir sur la partie plus technique de votre question, au-delà de l'intérêt immédiat pendant une réparation de pouvoir recalculer le navire en fonction de sa condition réelle, il s'agit de pouvoir stocker l'historique de toutes les réparations et des différents états du bateau pour retrouver, si besoin était, ce qui s'est passé et, en particulier, prédire les opérations de maintenance à effectuer.
Il s'agit également de pouvoir, le cas échéant, calculer de nouveaux cas de chargement qui n'avaient pas été prévus à l'origine et de voir la manière dont le navire réagit à ces différents cas.
M. Bernard ANNE : A chaque arrêt technique, lorsque des mesures d'épaisseur sont faites sur la structure, elles sont rentrées dans le système avec la nouvelle épaisseur de la tôle, pour pouvoir refaire un calcul qui tienne compte de la condition réelle.
M. Pierre HERIAUD : Nous avons entendu un exposé tout à fait intéressant sur le fonctionnement des sociétés de classification, leur rôle et leur importance, au nombre d'une cinquantaine dont une dizaine - les plus importantes - forme l'IACS. Ces sociétés ont un rôle de prévention et une force de proposition ainsi qu'on peut le voir en matière d'amélioration des normes. Toutefois, vous avez des besoins de connaissances plus générales de statistiques et de bases de données, ainsi que vous venez de nous l'indiquer.
J'aurai une question portant sur les bases de données. Nous sommes dans un univers extrêmement concurrentiel et la confidentialité de ces échanges de données me parait importante. Où en est-on en matière de cryptologie à ce niveau ? Quelle est la situation et quelles sont vos réflexions ?
S'agissant de l'estimation et de l'appréciation du « navire » par les sociétés de classification, l'écart type est-il très large ? Est-ce homogène ou non ? Quelle est votre appréciation et quelles pourraient être vos propositions ou vos desiderata à ce niveau ?
Enfin, nous avons eu l'occasion, dans des auditions précédentes, d'appréhender le rôle des experts des compagnies d'assurance en matière de préassurance. Quelles sont vos relations au niveau des 420 points que vous avez ici ou là, avec ces experts mandatés par les compagnies d'assurance pour l'expertise des navires ?
M. le Président : J'ajouterai une question qui reste dans le même cadre. Vous excluez une société qui n'est plus satisfaisante de votre groupe. L'Union européenne se propose de venir ajouter un contrôle des sociétés de classification sur ce point. Comment imaginez-vous ce contrôle supplémentaire ?
M. Bernard ANNE : La confidentialité est un point très important qu'il s'agit de bien comprendre dans le système des sociétés de classification. Tout d'abord, lorsque nous avons une délégation par un Etat du pavillon, nous n'avons aucune confidentialité vis-à-vis de cet Etat. Nous pouvons lui remettre l'ensemble de notre dossier de classification ainsi que toutes les informations sur le navire qui relève de lui. En effet, l'autorité du pavillon a toute autorité sur le navire et est en droit de savoir ce qui se passe à son bord. Par conséquent, quelle que soit notre confidentialité vis-à-vis de l'armateur, si l'Etat du pavillon nous demande une information sur le navire, nous devons la lui donner.
M. le Président : S'il la demande...
M. Bernard ANNE : Oui.
M. le Président : Prenons le cas de Malte. Ce pays donne son pavillon à des compagnies et admet qu'il soit porté par des navires qui, à l'évidence, ne méritent plus d'être sur la mer, du moins dans l'état où ils sont. Il faudrait qu'ils passent par une station-service de bonne qualité afin d'être réparés. Peut-on imaginer qu'à un certain moment, une société de classification a l'obligation d'avertir l'Etat, même s'il n'y a pas de demande de la part de l'Etat ?
M. Bernard ANNE : Je pense que c'est plus que cela. Nous n'avons pas le pouvoir d'attribuer le pavillon de Malte, par exemple, à un navire. Je voudrais préciser ce point. L'armateur va demander à s'immatriculer à Malte. Mais pour ce faire, Malte demandera que le navire soit en classe même si ce n'est pas forcément une obligation d'être classé en termes internationaux, encore que maintenant avec la dernière convention SOLAS et le dernier amendement 95 ceux qui ne l'étaient pas vont être obligés de l'être. Par ailleurs, les inspecteurs de Malte feront une visite pour donner le pavillon ou demander une visite de la part d'un délégataire, qui peut être une société de classification.
Cette visite va donner lieu à un rapport. Quand nous sommes concernés, nous donnons un rapport et un avis sur le navire à l'Etat du pavillon, dans le cas présent Malte. Si nous estimons que le navire est bien en classe, il aura ses certificats de classe.
En revanche, sur la partie statutaire pour laquelle on nous aura demandés de faire la visite en vue de l'autoriser à naviguer sous pavillon maltais, il est clair que nous émettrons un rapport à l'Etat de Malte dans lequel nous décrirons la situation du navire. Nous lui dirons s'il est conforme, parfaitement en règle en ce qui concerne son système d'extinction incendie, s'il dispose des équipements appropriés en ce qui concerne la sauvegarde de la vie humaine et les moyens d'évacuation. Ou encore nous lui dirons que nous avons relevé des défauts sur ces points et que, de ce fait, le navire n'est pas conforme.
C'est ensuite à l'Etat de Malte de décider de la suite à donner. L'Etat de Malte doit - et c'est ce qu'il fait à ma connaissance - réagir et indiquer qu'il n'autorise pas le navire à naviguer sous son pavillon, tant que telle réparation n'est pas faite ou telle disposition n'est pas prise. Ceci est la règle du jeu. Nous avons le devoir de faire un rapport, car il n'est pas question de ne pas informer l'Etat du pavillon sur la visite qu'il nous a demandé de faire en son nom. Étant délégataire, nous lui faisons un rapport.
Il en va de même quand nous travaillons pour le compte des autorités françaises. Dans bon nombre de cas, pour des approbations d'équipement ou autres, nous sommes délégués dans un cadre bien délimité qui décrit ce que nous devons faire au nom du gouvernement français et ce que nous devons lui rapporter. Dans ce rapport, figurent toutes les observations de nos experts.
En ce qui concerne la confidentialité, nous n'avons aucune confidentialité vis-à-vis de l'Etat du pavillon. S'agissant de la classe, nous devons la confidentialité à l'armateur parce qu'il peut y avoir, sur son navire, des éléments qui peuvent, dans son dossier, avoir un impact commercial. Certaines règles existent en la matière. De même si l'armateur vend son navire, c'est à l'acheteur de bien regarder ce qu'il achète et non pas à nous de lui dévoiler l'état du navire. En revanche, il doit être ou non en classe. C'est une question de confiance. Nous ne pouvons nous permettre de le déclarer en classe si, pour nous, il ne l'est pas. Nous perdrions toute crédibilité. La confiance est l'essence même du fonctionnement.
En plus de l'Etat du pavillon et l'armateur, d'autres acteurs peuvent souhaiter avoir accès aux dossiers : l'affréteur, l'assureur ou l'Etat côtier. Il est clair que nous n'avons pas le droit de divulguer ces informations à l'assureur, à l'affréteur ou à l'Etat côtier, sans l'autorisation de l'armateur ou de l'Etat du pavillon. Cela a posé problème au BEA-mer puis qu'il souhaitait qu'on lui donne des dossiers.
Nous lui avons indiqué que nous ne demandions pas mieux, mais qu'il lui fallait obtenir l'autorisation de l'Etat du pavillon, à défaut de celle de l'armateur. Cependant, l'armateur n'était peut-être pas enclin à donner une autorisation, il lui a donc fallu la demander à l'Etat du pavillon. Des relations internationales existent ainsi que les règles de l'OMI. L'Etat du pavillon est censé lui donner les dossiers.
Nous avions à l'époque, pour l'Erika, insisté auprès de l'Etat de Malte en indiquant qu'il devait nous autoriser à donner notre dossier au BEA-mer Nous avons, après nombre d'échanges et d'insistance, obtenu cette autorisation de l'Etat de Malte et avons alors remis le dossier au BEA-mer mais cela a pris une dizaine de jours.
Il serait si simple de définir, dans les conventions de l'OMI, une obligation de coopération entre l'Etat côtier, l'Etat du port et l'Etat du pavillon. Cela me semblerait tout naturel, mais ce n'est pas à nous de pouvoir l'imposer ou le faire. Nous devons être respectueux des règles fixées, sinon plus rien ne fonctionnerait correctement.
Ainsi que je l'avais déjà expliqué au BEA-mer, je ne m'imagine pas transmettre un dossier que j'ai établi au nom du gouvernement français, sans l'accord de ce dernier, à la suite de la demande d'un quelconque Etat. Cela me semble évident ; c'est une relation de confiance. Quand nous sommes délégués par un Etat, nous travaillons dans ce cadre et nous n'avons pas le droit d'agir en dehors de ce cadre.
De la même manière, le pavillon français, lorsqu'il délègue une activité, compte sur une confidentialité. Nous la respectons et nous ne pouvons pas, à une première demande, produire un document à un tiers. Il faut vraiment se donner les moyens et les instruments nécessaires si on veut rendre cette transparence plus forte.
C'est une demande de notre part parce que nous ne voulons pas être en porte-à-faux. Nous souhaitons que les règles du jeu soient claires.
M. Pierre HERIAUD : Je vous remercie de votre réponse. Pour ma part, je ne vois aucun problème dans les échanges de données et autres, entre le commanditaire, c'est-à-dire l'Etat ou l'armateur, vis-à-vis de la société de classification.
Nous avons déjà vu, notamment dans le cadre d'Equasis lors d'une précédente audition, que la multiplicité des sites informatiques - nous allons travailler de plus en plus sur des bases élargies pour des raisons évidentes - pose des problèmes de réception, de transmission et de stockage des données. Nous sommes dans un monde concurrentiel et, par conséquent, on va se retrouver avec des possibilités de piratage. Ma question portait sur la cryptologie nécessaire à ce niveau. Où en est votre réflexion et les applications éventuelles ?
M. Bernard ANNE : Pour notre part, l'armateur a accès à tous nos rapports de visite via Internet, avec une cryptologie de bon niveau de sécurité et une codification qui lui permet d'avoir seul accès au dossier de son navire. A des compagnies d'assurance qui souhaitaient avoir un accès facile aux dossiers, nous avons répondu que nous pouvions le faire, mais il convenait tout d'abord d'indiquer, dans leur police avec le client, que ce dernier les autorisait à avoir accès. Sur la foi de cette autorisation de l'armateur, nous leur donnons un code qui leur permet d'accéder aux dossiers. Il y a des possibilités d'accès protégé, mais notre rôle est aussi de faire en sorte qu'il y ait sécurité de l'information sur ce qui est considéré comme confidentiel. C'est ainsi que nous travaillons avec les assureurs pour l'accès aux dossiers.
C'est ainsi également que nous pouvons travailler avec d'autres, notamment les affréteurs. Que l'affréteur obtienne, dans son contrat d'affrètement, le même droit d'accès au dossier de la part de l'armateur, ne nous pose aucun problème. Dès lors que l'armateur nous y autorise, nous donnons un code d'accès à l'affréteur qui peut avoir accès total aux dossiers. C'est très facile à faire sur Internet, pour autant encore une fois que l'on respecte les règles de déontologie, ce qui me semble essentiel.
M. le Président : Ce cas de l'affréteur vous demandant accès vous est-il déjà arrivé ?
M. Bernard ANNE : Jusqu'à maintenant non. Mais les affréteurs demandent des attestations de classe dans lesquelles on met les réserves qui peuvent figurer sur le certificat. Jusqu'à maintenant, sauf cas très exceptionnels, j'ai rarement vu l'affréteur obtenir l'autorisation de son armateur d'avoir accès au dossier. Les accès au dossier qui sont donnés sont généralement en cas de vente, puisque l'acheteur peut demander à avoir accès au dossier de classe, auquel cas il y a une procédure d'accord de l'armateur, et auquel cas nous laissons l'accès au dossier à l'acheteur.
M. le Président : Se dirige-t-on de plus en plus vers cette demande de l'affréteur à son armateur ?
M. Bernard ANNE : Nous en avions discuté au moment de la charte avec le ministre des Transports. Si l'on veut une plus grande transparence, l'affréteur a la possibilité de l'imposer. En effet, si le marché est en faveur de l'affréteur, il peut imposer ce qu'il veut à l'armateur.
M. le Président : Le client est roi.
M. Bernard ANNE : Exactement. En revanche, si le marché est très défavorable pour l'affréteur, s'il est obligé de s'insérer dans ce marché alors qu'il y a pénurie de navires, cela réduirait son pouvoir car il sera quasiment obligé d'accepter le seul navire qu'il a trouvé pour pouvoir continuer à transporter son produit. Il faut trouver une règle d'équilibre.
Nous estimons que l'on doit pouvoir donner accès à l'information, voire des formes d'accès plus réduites, c'est-à-dire sans un accès total aux rapports. On peut aussi laisser cet accès complet à l'affréteur, sachant qu'il ira consulter ce qui l'intéresse. Il est toujours possible de le faire. Actuellement, par exemple, nous n'avons pas, dans notre système VeriSTAR Info, d'affréteurs ayant un accès direct. Cela peut être au cas par cas, mais c'est très rare. Si un armateur souhaite vraiment convaincre l'affréteur que son navire est un bon navire, il lui donnera peut-être cet accès. Mais là encore, nous suivrons la relation contractuelle qui sera établie entre l'affréteur et l'armateur.
M. le Président : Vous n'avez pas répondu à ma question concernant la manière dont vous vivez le fait que l'Union européenne va exercer un contrôle supplémentaire.
M. Bernard ANNE : Nous ne le vivons ni mieux ni moins bien, pour la simple raison que nous sommes habitués à travailler dans des systèmes de qualité avec des audits. Que l'Union européenne fasse un audit, pourquoi pas, elle en fait déjà. Cela n'est peut-être pas un fait très connu, mais nous avons été audités par l'Union européenne - conjointement d'ailleurs avec l'administration française puisque nous avions été agréés par l'administration française - et ensuite, au titre de cet agrément, considérés comme une organisation reconnue par la Commission européenne.
Il y a des audits de la Commission européenne, de même qu'il y a des audits de l'administration française. La Commission européenne ne souhaite pas tant contrôler davantage les sociétés de classification, à travers ces audits, qu'avoir des droits directs par transfert de compétence des Etats membres. Aujourd'hui, c'est l'Etat membre qui agrée et qui donne ensuite le dossier pour reconnaissance par Bruxelles. Toutefois, Bruxelles ne peut refuser si l'Etat membre a correctement fait le travail et si la société remplit tous les critères. Cet audit a plus pour objet d'éviter des traitements inéquitables.
M. le Président : Devant l'insuffisance d'un certain nombre d'Etats à accomplir différentes missions, l'un des palliatifs serait de transférer au niveau européen un certain nombre de ces missions.
M. Bernard ANNE : S'agissant des contrôles de sociétés de classification, je ne pense pas qu'il y ait grand-chose...
M. le Président : Le Rina est-il membre de l'IACS ?
M. Bernard ANNE : Oui, mais jusqu'à l'année dernière, il faisait quasiment partie de l'administration italienne. Le Rina était un établissement d'Etat, avec un rôle de service public en Italie, en ce domaine. On ne peut pas dire que le fait qu'il soit une société de classification change quoi que ce soit à ses relations avec son Etat, puisqu'il a été jusqu'à ce jour, directement sous le chapeau de l'Etat.
M. le Président : Les sociétés de classification, comme beaucoup d'autres entreprises, font l'objet d'un classement international qui n'est pas basé uniquement sur le chiffre d'affaires ou le nombre de clients, mais tient compte aussi de la qualité, avec tout ce que cela comporte sans doute d'aspects subjectifs. De ce point de vue, comment se placent Veritas et le Rina ?
M. Bernard ANNE : C'est une question quelque peu ardue car il va falloir trouver les référentiels. Actuellement, nous avons un système de réglementation internationale qui est à peu près cohérent, avec beaucoup de réglementations, le problème étant de savoir comment elles sont appliquées et la difficulté parfois de les appliquer, le fait que les Etats les ratifient ou pas.
Puis, dans l'application, il y aura le comportement à la fois des Etats de pavillon, de leurs délégataires et par ailleurs, pour la classe, des sociétés de classification. Tout ceci doit être bien intégré. Reste un acteur que l'on ne mentionne pas beaucoup qui est l'Etat du port.
Dans tout système réglementaire, il faut une police. L'Etat du pavillon et l'Etat du port sont les deux seuls à disposer d'un droit de police, les délégataires n'en ayant aucun. Nous n'avons pas le droit de retirer le pavillon d'un navire. Tout ce que nous pouvons faire est de dire que le navire est en classe ou non. Ensuite, il revient à l'Etat du pavillon de refuser le navire s'il n'est pas classé. Idem pour l'Etat du port.
Il est normal que nous ne puissions agir avec un pouvoir de police, car nous n'avons pas les instruments pour ce faire. En revanche, pour être efficace, nous souhaitons que les Etats du port puissent effectuer leurs contrôles et disposent des moyens pour le faire, car c'est vraiment aujourd'hui, de notre point de vue, le maillon le plus faible.
Quand les sociétés de classification travaillent pour les Etats en délégation, elles disposent des moyens techniques et autres. Par conséquent, le problème ne se situe pas à ce niveau, mais dans ce pouvoir de police qui est un pouvoir de constat effectif, puisque nous ne sommes pas en permanence à bord des navires. Nous délivrons un certificat qui atteste d'une conformité à notre référentiel au moment de la visite, mais nous ne pouvons pas ensuite savoir ce qui se passe.
Seul l'Etat du port, plus que d'autres, est en mesure de le savoir. J'avais demandé à Mme Lalis que dorénavant, nous puissions avoir copie intégrale des rapports d'inspecteurs des Etats du port, de telle manière qu'utilisant certaines dispositions de notre règlement, nous puissions dire à l'armateur qu'il ne nous avait pas signalé telle chose.
De deux choses l'une, soit il nous demande de venir à bord pour constater ce qu'il y a à faire et en quoi il est défaillant, et le cas échéant, on lui retire son certificat, soit nous suspendons la classe puisqu'il y a défaillance et rupture de contrat. Pour nous, c'est un point extrêmement important si l'on veut être efficace.
Le deuxième point est le fonctionnement du contrôle par l'Etat du port. Nous avons le Mémorandum de Paris (MOU) et celui de Tokyo, plus les garde-côtes américains qui ont un système particulier. Dans le cadre de l'Europe, il n'y a pas d'uniformisation, à la fois des procédures et des moyens, selon les pays. Tout le monde participe à ce système de contrôle du Mémorandum de Paris, mais chacun avec ses propres règles, sa propre autorité, son propre jugement, son propre classement, les points qui lui semblent importants et ceux qui lui semblent moins importants, et des crédibilités de rapport qui sont parfois sujettes à caution.
Certains sont néanmoins plus sérieux que d'autres. Dans le cadre du BEA-mer, s'agissant de l'Erika, nous avons relevé un rapport de contrôle par l'Etat du port mentionnant une corrosion d'une cloison. Tout le monde en a conclu que le bateau était très corrodé. Il l'était peut-être, je ne m'oppose pas à ce jugement. Mais cette cloison était une cloison de sanitaires, des emménagements, ce qui n'a absolument rien à voir avec la structure du navire. Il faut faire très attention sur la manière d'utiliser les rapports de contrôle par l'Etat du port.
Nous avons eu la curiosité de faire sortir un rapport complet et avons découvert alors ce que c'était. Pour nous, ce n'est pas un élément majeur de jugement d'appréciation. Nous en avons eu un autre qui avait été fait par un inspecteur en Norvège, lequel avait noté quelques petites défaillances. Pour bien juger de la crédibilité de cet inspecteur, il a mentionné ailleurs, dans son rapport, qu'il manquait les marques de franc bord à l'avant et l'arrière du navire. De telles marques n'existent ni à l'avant, ni à l'arrière du navire, elles sont au centre. Il a dû les confondre avec les lignes de tirant d'eau.
Au vu de tels rapports, on peut se dire qu'il y a beaucoup de travail à faire sur les interventions de l'Etat du port, qui nous sont nécessaires. Pour ma part, il ne s'agit pas de critiquer le contrôle par l'Etat du port, mais d'en avoir un qui soit sérieux, efficace et qui travaille en relation avec nous. Dès qu'il détecte une anomalie, nous souhaitons en être informés pour pouvoir réagir avec nos propres moyens. J'estime que c'est un maillon qui manque vraiment dans le système.
S'agissant des statistiques, les seuls qui ont, aujourd'hui, un système statistique à peu près efficace sont les Américains.
L'US Coast Guard a un système sérieux, qui comporte forcément parfois des points de défaillance, mais c'est le plus sérieux d'entre eux, avec des critères qui nous semblent fonctionner assez bien et surtout un système d'appel, ce dernier point étant très important.
Quand on arrête un navire, celui qui fait une inspection visuelle à bord du navire - comme c'est le cas de l'inspecteur de l'Etat du port - n'a pas forcément la connaissance complète du dossier. Il faut donc que nous soyons informés, que nous ayons les moyens de discuter avec lui pour indiquer pourquoi cela est fait ainsi et quelle est la situation.
A ce moment-là, s'il y a défaillance
in fine, nous dirons alors que cela ne va pas et que l'armateur doit faire les travaux nécessaires. L'appel est, en quelque sorte, le droit à la défense face à une mauvaise interprétation. Un navire bien peint donne bonne impression, et pourtant il n'est peut-être pas en bon état. C'est cette impression qu'il faut corriger dans certains cas. Dans d'autres cas, il est tellement évident que le navire est en mauvais état qu'il n'y a même pas lieu à en discuter.
Par exemple, on vous dit que, sur un pont, il y a une corrosion perforante à un endroit. Cela peut arriver sur un navire qui est à la mer depuis six mois. Pour autant, la structure n'est pas forcément en danger. C'est là qu'il faut avoir une appréciation technique, ce qui manque au
contrôle par l'Etat du port actuellement, lors des contrôles visuels trop rapides. De plus, ils n'ont pas toujours, selon les nationalités, les personnels qualifiés pour ce faire. Il y a pour nous un vrai problème à ce niveau. C'est vraiment un souhait car c'est le maillon faible de la chaîne pour arriver à travailler dans de bonnes conditions.
S'agissant des Américains, la classification est plutôt bien faite. Au niveau du MOU de Paris - je m'en suis déjà ouvert à Bruxelles - je considère qu'il n'y a pas de système d'appel. Quand on analyse les cas, les deux tiers sont des faux cas qui ne devraient pas avoir donné lieu à détention. En effet, on est dans des systèmes où le dommage est vraiment mineur, tel qu'il est constaté, et ne prend pas en compte l'impact réel. Quand on évoque parfois que c'est fait sur des critères de classe, en général cela ne concerne pas la classe.
Au travers de mes propos, il est important de considérer que le domaine de la classe est bien spécifique, de même que le domaine du statutaire. Il est difficile pour certains inspecteurs de l'Etat du port de faire la différence entre les deux. Nous aussi avons besoin de système d'appel pour être capable d'expliquer et de montrer ce qui est de la responsabilité de l'un et de l'autre, de telle manière que chacun puisse bien agir dans son domaine.
C'est là que j'ai tendance à dire que je fais confiance au système américain, tel qu'il est. Ce système, qui a démarré il y a quatre ans maintenant, a eu du mal à se roder puisque, au début, nous avons été pris par surprise, mais depuis que nous avons bien compris leur système, nous sommes dans une direction très saine.
Nous n'avons eu qu'une seule détention l'an dernier, mais nous venions d'un passé où la première année, comme nous ne connaissions pas les règles du jeu, nous en avons eu un nombre trop important. Ce nombre pèse encore, puisque ensuite la moyenne est faite sur trois ans. Cela nous a quelque peu gênés.
Le Rina, qui a beaucoup moins de navires aux Etats-Unis, est actuellement mieux placé que nous dans la matrice de la
Coast Guard, laquelle matrice tient compte en effet du type de navire. Si vous avez des pétroliers, comme ces derniers rentrent très peu dans les ports américains, vous aurez très peu d'inspections. Ils restent souvent hors des eaux intérieures. C'est déjà un type de navire exclu.
Les vraquiers sont par nature des navires plus sujets que d'autres à détention, car ce sont des navires qui souffrent et qui peuvent avoir des corrosions. Il se trouve que, dans notre flotte, nous avons plus en proportion de
vraquiers que d'autres, par rapport au Rina. Les navires à passagers connaissent, en général, peu de détention. Le Rina en a un certain nombre qui touchent les Etats-Unis. Cela joue donc favorablement, mais cela signifie aussi qu'ils font bien leur travail. Il ne faut pas non plus chercher à ne retenir que le négatif, il faut aussi retenir le positif.
Un autre facteur est l'âge du navire. Certaines sociétés de classification ont des flottes jeunes. Il est alors certain que les navires sont moins sujets, dans le système de ciblage, à vérification de la part de l'Etat du port et, donc à risque de détention. Mais cela pose un vrai problème. Doit-on systématiquement dire que l'on ne prend que des navires jeunes et envoyer les autres chez le voisin ? Ce n'est pas ainsi qu'on améliorera la sécurité. Or cela a été le cas longtemps, par exemple, des armateurs norvégiens qui commandaient les navires et qui, dès qu'ils atteignaient six ou sept ans, les revendaient, ce qui leur évitait de faire trop de maintenance.
Cette politique des armateurs norvégiens s'est quelque peu atténuée car les prix des navires ont été, à un moment donné, plus élevés. Il est certain qu'une société de classification qui a la chance d'avoir une flotte plus jeune, d'une certaine manière, ne prend pas sa part du fardeau et de la tâche globale qui est d'assurer la qualité de l'ensemble des navires en âge de naviguer.
C'est aussi un des critères qui va jouer dans la classification et qu'il faudrait pouvoir identifier. Un classement peut être un outil intéressant dès lors que l'on définit des critères qui tiennent compte de tous ces paramètres. Cela pourrait alors être significatif. Aujourd'hui, malheureusement, cela ne l'est pas encore vraiment.
M. Luc GILLET : Je voudrais apporter un complément de réponse et revenir à nos outils. Ce genre d'outil est particulièrement utile s'il est nourri d'informations le plus souvent possible et de façon la plus large possible. En particulier, on a intérêt à rentrer toutes les mesures d'épaisseur et toutes les informations qui peuvent nous provenir soit de l'armateur, soit d'autres examens faits par l'Etat du port ou autre.
Toute disposition qui viserait à séparer les choses et à ne laisser accessible à ces bases de données, qu'une partie des informations, dégraderait la connaissance globale que l'on a du navire et donc de l'utilisation que l'on pourrait faire de ces bases de données. C'est un point important, ajouté au fait que pour pouvoir maintenir de tels systèmes au plan technique, il faut des organisations relativement importantes. Il faut pouvoir bénéficier d'un grand nombre de navires. Ces outils sont accessibles à de grandes sociétés, et ne peuvent essaimer et se fragmenter de façon trop importante.
M. Bernard ANNE : Je voudrais revenir sur l'évaluation de la
Coast Guard pour vous donner une idée de la difficulté du problème. Les sept meilleures sociétés de classification, dont le Rina qui est bien placé, sont dans un mouchoir de poche, en termes de taux de détention aux Etats-Unis. Les chiffres, qui seront publiés en 2000 pour 1999, s'étaleront entre 0,2 ou 0,3 % et 0,8 %, c'est-à-dire que si vous avez un navire qui arrive avec un petit défaut, vous basculez complètement.
Cela signifie que l'ensemble de ces sociétés de classification, dans cette fourchette, sont considérées comme ayant un bon résultat. Nous sommes huit à être considérées comme telles, toutes membres de l'IACS par ailleurs. Pour notre part, nous devons être à 0,76 %, mais nous n'avons pas encore les chiffres officiels. Il faudra attendre les chiffres publiés par la
Coast Guard. Nous serons sixième ou septième à ce taux-là, mais avec tous les points que je vous ai mentionnés. En tenant compte de tout cela, cela signifie qu'un effort énorme a été fait aux Etats-Unis pour bien cerner les navires qui arrivent et tenir compte des navires les plus difficiles.
M. Pierre HERIAUD : Ce ratio est calculé sur trois ans.
M. Bernard ANNE : Oui, par conséquent on porte le poids des années pendant lesquelles nous n'avons pas été très méfiants dans la manière de faire. Il est important de le préciser. En revanche, ce système n'existe pas sur le Mémorandum de Paris, ni sur celui de Tokyo sur lequel il y a un cas assez amusant, dans le sens où le Rina s'était retrouvé le plus mauvais de la classe. En y regardant de plus près, parce qu'il avait eu une visite à l'entrée du port, on s'est aperçu que le navire n'était pas classé par le Rina et celui-ci est donc revenu le meilleur de la classe. C'est pour vous dire toute la difficulté de ces statistiques sur lesquelles il faudrait vraiment se pencher si on veut les rendre crédibles.
M. le Président : Un certain nombre de sociétés de classification se retrouvent partenaires d'Etats du pavillon ainsi que partenaires d'armateurs. Est-ce votre cas également ?
M. Bernard ANNE : Tout à fait. C'est le moyen d'avoir le meilleur niveau de qualité des navires. Cette question m'a également été posée au Conseil économique et social, et je crains de ne pas avoir réussi à le convaincre, ce dont je m'en veux. Quand on aborde les questions dans une enceinte avec peu de temps devant soi, il est parfois difficile de faire comprendre les choses.
Au travers des éléments que je vous ai exposés, le statutaire couvre, pour l'essentiel, toute la partie équipements de sécurité du navire. C'est là-dessus que porte la visite statutaire. Par ailleurs, vous avez la classe. Dès lors que vous mettez deux personnes différentes, chacune faisant une partie du travail, vous n'améliorez pas la cohérence d'ensemble. Il est préférable d'avoir une même personne, qui connaît bien l'ensemble du navire et l'ensemble des points faibles, pour pouvoir avoir la meilleure inspection possible. L'avantage est que cela augmente sa fréquence de passage à bord. Il y a donc cette question de continuité. A mon sens, c'est un avantage énorme.
Le deuxième point, mais qui n'est pas de même nature, est qu'il est difficile d'imaginer de faire autrement car ces domaines sont profondément imbriqués. Nous allons, par exemple, travailler pour l'administration française, lors de l'établissement du dossier de construction du navire, qui fait partie des certificats d'ensemble. Si nous ne pouvons pas à la fois travailler pour le gouvernement français et le navire, nous ne pourrons plus travailler du tout pour le gouvernement français pour ce navire-là. Cela signifie que quelqu'un d'autre qui doublera notre travail devra le faire.
On peut toujours vivre avec des systèmes peu cohérents, mais le plus important est la déperdition de l'information, de cohérence et de connaissance du navire qui en résultera. Par exemple, la question s'est posée pour le code ISM, consacré à la certification de la gestion des navires qui est très important si l'on veut améliorer la qualité du navire. Il s'agit dorénavant, dans le système ISM, lors de l'identification d'une défaillance d'organisation - l'organisation pouvant couvrir la maintenance - qu'elle soit traitée dès qu'elle est identifiée et qu'on ait la trace de son traitement. Il s'agit de bien inculquer une culture de qualité.
Pour l'ISM, on n'a pas fonctionné de la même manière. Cela a été considéré comme à part. Vous pouviez certifier un navire ISM sans pour autant le classer, ni faire le reste du statutaire. On se trouve dans un imbroglio dans lequel on ne sait plus qui est responsable de quoi
in fine. De ce fait, cela permet à certains armateurs de passer au travers. Je considère qu'il y a là quelque chose de plutôt négatif.
Certaines administrations, en ce qui concerne l'ISM, comme le pavillon norvégien, estiment qu'il faudrait revenir en arrière et au contraire, imposer que cela soit la même société de classification qui fasse l'ISM comme le reste, sur un même navire, c'est-à-dire ne pas multiplier les interlocuteurs. On peut le concevoir. En effet, plus vous multipliez le nombre de personnes ayant à faire un même travail, plus vous décrédibilisez l'information, plus vous créez des visions différentes et, au final, vous déresponsabilisez. Je considère qu'il y a plutôt avantage et intérêt, voire qu'il est indispensable d'avoir le même interlocuteur.
On n'imagine pas, en termes de responsabilités du navire, même s'il y a le contrôle par l'Etat du port, d'avoir deux Etats responsables du navire. Il n'y en a qu'un seul. De la même manière, quand quelqu'un intervient, il me semble préférable que ce soit le même.
Idem pour les systèmes de vetting. Ces systèmes, mis au point par les affréteurs, notamment s'agissant de cargaisons liquides, pétroliers et chimiques, ont été créés pour tenir compte d'éléments qui n'étaient pas couverts par la classe, ni par le statutaire, mais qui auraient pu être couverts aujourd'hui par l'ISM. Il s'agissait de voir si le navire, dans le cadre des opérations commerciales, avait les bonnes caractéristiques, par exemple pour le transport de produits chimiques, si les systèmes de pompage étaient bien ceux annoncés, si l'équipage avait la formation adéquate pour man_uvrer au terminal. Peu à peu, cela s'est étendu à différentes choses. Ils en ont alors profité pour examiner les rapports.
Dans le cas de l'Erika, le rapport de vetting indique que les ballasts et les peintures ont été faites, comme je l'ai lu dans le rapport du BEA, mais l'inspecteur du
vetting ne l'a pas constaté de visu. Il a repris soit ce qui était mentionné dans le rapport de la société de classification, soit ce qu'a déclaré le commandant. C'est là qu'il faut faire très attention sur l'apparence d'amélioration de qualité et de sécurité que donne la multiplicité des contrôles. Je préfère un contrôle confié à une seule et même personne, mais bien fait, et dont elle porte la responsabilité. On sait alors de quoi on parle, à qui on doit rapporter et ainsi de suite. Pour nous, ce serait plutôt une régression qu'un progrès.
Audition conjointe :
de la Fédération de l'équipement, des transports et des services (FO)
Syndicat de la Marine marchande représentée par M. Roger LE FLOCH,
de la Fédération des officiers de la Marine marchande (CGT)
représentée par M. Roland ANDRIEU, secrétaire général adjoint,
de la Fédération nationale des syndicats maritimes (CGT)
représentée par M. Robert BILIEN, secrétaire général,
du Syndicat national des cadres navigants de la Marine marchande (CGC)
représenté par le commandant André LATIL, secrétaire général adjoint,
du Syndicat national des personnels sédentaires
et navigants de la Marine marchande CFTC
représenté par M. François d'ABANCOURT, président d'honneur,
et le commandant Serge VÉRON, secrétaire général,
du Syndicat national et professionnel des officiers de la Marine marchande
représenté par M. René LUIGI, secrétaire général,
de l'Union maritime CFDT
représentée par M. Paul GOLAIN, animateur de la commission internationale,
et M. Joël JOUAULT
(extrait du procès-verbal de la séance du 4 avril 2000)
Présidence de M. Daniel PAUL, Président
Les représentants des syndicats des gens de mer sont introduits.
M. le Président leur rappelle que les dispositions législatives relatives aux commissions d'enquête leur ont été communiquées. A l'invitation du Président, les représentants des syndicats des gens de mer prêtent serment.
M. Roger LE FLOCH : M. le président, messieurs les députés, je suis capitaine au long cours, j'ai été commandant ou second capitaine sur différents types de navires. Je suis également chef d'un centre de sécurité des navires en Charente-Maritime, en charge du contrôle des navires ; je dois notamment sélectionner les navires dans le cadre du MOU (Mémorandum de Paris).
Le chef de centre est l'autorité compétente en vue de ces inspections pour les transports maritimes des produits dangereux et polluants sur tous les navires étrangers et français.
N'ayant pas préparé de discours, je suis à votre disposition pour répondre à vos questions.
M. Roland ANDRIEU : M. le président, nous sommes là pour tenter d'extirper ce mal effroyable que représentent à la fois les pavillons de complaisance et les navires sous-normes. Mais je ne crois pas que l'on liquidera ce type de problème d'un trait de plume. Il convient donc de prendre des mesures claires et nettes et de se donner les moyens de les appliquer, ce qui n'est le cas, actuellement, ni en France ni en Europe.
J'ai ici un ouvrage émanant de la Communauté européenne de 1979, dont je souhaiterais vous lire un court extrait : « Il convient de mettre fin de toute urgence à cette complaisance si l'on veut éviter à la communauté les plus grands dommages ». Or, si l'on compte le naufrage au large des côtes de Bonifacio, nous avons connu, depuis, neuf marées noires. Cela veut dire qu'il est indispensable de recruter des inspecteurs compétents et formés, des personnes qui ont déjà commandé un navire et qui seraient les représentants de la collectivité publique.
Actuellement, le corps d'inspection est composé de 60 inspecteurs, dont 7 vont partir en retraite ; il en faudrait au minimum 200. Un concours a été organisé récemment afin de recruter 8 inspecteurs, or seuls 4 candidats se sont présentés. Il existe donc, sans aucun doute, un problème de recrutement et de formation.
Nous sommes responsables de cette situation, les différents gouvernements n'ayant porté aucune attention particulière à ce problème. En ce qui me concerne, je me bats contre la complaisance depuis 40 ans. Mais la complaisance, ce n'est pas seulement la marée noire que l'on connaît actuellement, c'est aussi des coups de force dans les ports, notamment à Lorient et au Havre où l'on a fait venir des équipes armées pour chasser les marins qui réclamaient leur dû.
C'est aussi cela la complaisance : des personnes qui ne sont pas payées, qui vivent dans des conditions abominables et qui n'ont aucun statut, et des règles de navigation et de sécurité qui ne sont pas respectées.
M. Robert BILIEN : M. le président, messieurs les députés, le drame catastrophique que viennent de connaître à nouveau les côtes de notre pays avec le naufrage de l'Erika se produit régulièrement. Depuis l'Amoco-Cadiz, il y a plus de vingt ans, une douzaine de catastrophes ont souillé les côtes françaises. Il conviendrait d'y ajouter les multiples rejets en mer et les pertes fragmentées des conteneurs au large des côtes, car au-delà du naufrage des navires, il y a d'innombrables pollutions et incidents qui dégradent nos côtes et l'environnement de notre littoral.
Des rapports et des déclarations d'intention, il y en a eu et il y en aura encore ! Mais des actes, afin que cela ne se reproduise plus, il n'y en a pas. Les jours passant, les souvenirs ne doivent plus s'estomper comme par le passé. Bien au contraire, ils doivent être mis à profit pour trouver des voies réglementaire et législative pour une vraie politique de prévention. Il vous appartient, messieurs les députés, d'agir pour réglementer et assurer la sécurité du transport de produits dangereux, toxiques, polluants.
Il convient de mettre fin au choix des déréglementations qui aggravent les risques aussi bien dans les activités pétrolières que dans les activités concernant les marins et la manutention portuaire. La fédération des syndicats maritimes CGT considère qu'il y a des causes essentielles à ces drames, en particulier l'usage des pavillons de complaisance qui doit être banni des eaux territoriales françaises et européennes, car la plupart des navires en cause sont âgés, peu entretenus, et non conformes à la réglementation française.
Le naufrage de l'Erika ne relève pas du hasard. Il est la conséquence obligée, le résultat logique d'années de déréglementation et la traduction de cette dernière en termes de condition sociale, d'organisation et de concurrence dans le transport maritime en général, avec en particulier les pétroliers immatriculés dans des paradis fiscaux tels que Malte.
Si rien n'est fait, les prochaines années vont se traduire par un accroissement considérable des risques, notamment pour la France dont le littoral est particulièrement exposé. Il est urgent de prendre des mesures réelles et efficaces. Cela exige une lutte résolue contre les navires sous-normes et les pavillons de complaisance. Mais ne nous y trompons pas, le problème se situe d'abord dans les pays développés qui sont les principaux utilisateurs et bénéficiaires des registres maritimes au rabais, qu'ils se nomment registres bis ou pavillons de libre immatriculation.
Prendre des mesures efficaces, c'est retrouver une capacité d'intervention publique réelle, permettant notamment de réguler et de contrôler les activités maritimes de façon à favoriser le transport maritime de qualité qui intègre les coûts sociaux, de sécurité et d'environnement. Car le naufrage de l'Erika est aussi le résultat du recul et des insuffisances notoires de l'intervention publique. L'internationalisation de ces activités n'empêche nullement la France d'agir en propre, mais il est évident qu'elle doit mener simultanément une action résolue auprès de l'OMI et au niveau européen.
Les conditions de concurrence dans le transport, notamment pétrolier, déréglementées jusqu'à l'extrême, exercent des pressions inqualifiables sur le prix du transport et les conditions d'activité. Les armateurs s'adaptent en exploitant des marins sous payés, sans protection sociale. Il est temps que la France ouvre les yeux et qu'elle donne l'exemple. Notre transport de produits dangereux, toxiques et polluants doit être effectué sous pavillon français métropolitain.
L'abrogation de la loi de 1928 est scandaleuse, s'agissant des produits à risque, d'un secteur stratégique et d'activités globalement très profitables. Cette abrogation entraîne un engrenage régressif qui empêche toute issue favorable au transport de produits pétroliers sous pavillon français métropolitain s'il n'y a pas d'intervention ferme et énergique du législateur. L'examen des statistiques des sinistres en perte totale de janvier 1992 à juin 1999 pour la flotte des navires de 500 tonneaux et plus fait apparaître deux enseignements majeurs.
D'une part, les sinistres sont essentiellement le fait des navires âgés ; ainsi, 95 % des navires citernes sinistrés ont plus de 15 ans, et 78 % ont plus de 20 ans. D'autre part, ils sont préférentiellement dus au pavillon de complaisance. Pour l'ensemble des navires sinistrés, on trouve en tête et par ordre, Panama, Chypre, le Libéria, Malte et les Bahamas. Les données publiées par l'OMI pour l'année 1998 confirment totalement nos analyses : pour 287 sinistres répertoriés, on compte 107 sinistres avec perte totale du navire, dont 47 pour des causes de collision, les pertes de vies humaines atteignant le chiffre de 495.
Cela sans compter les graves préjudices directs - fermeture des zones de pêche ou de conchyliculture et matériels détruits -
et indirects - baisse des ventes et du cours des produits de la mer subie par les activités maritimes, et conséquences morales et financières inestimables pour les professionnels. Il convient d'y ajouter la dégradation de l'image pour les produits et activités de la zone côtière, ainsi que les dégâts écologiques, notamment sur les zones de frayère.
A eux seuls, sept pays d'immatriculation, Panama, Chypre, Bélize, Libéria, Malte, Saint-Vincent, les Grenadines et Bahamas, comptent pour 47 % des sinistres et des pertes totales en nombre. Les navires de ces pavillons sont particulièrement impliqués dans les collisions entre navires. Plus des trois quarts des sinistres concernent des navires de plus de 15 ans, qui sont à l'origine de l'essentiel des pertes de vies humaines et des cas graves de collisions.
La situation de la flotte mondiale et son évolution probable ouvrent donc des perspectives sombres en matière de sinistres : vieillissement de la flotte ; domination des pavillons de complaisance ; concurrence acharnée qui amène à économiser sur l'entretien des navires et sur le social ; pénurie qui entraîne l'emploi d'équipages mal formés, mal payés et hétérogènes ; poursuite de la délocalisation des activités productives qui accroît les trafics de matières dangereuses ; dégradation accélérée des flottes de certains pavillons. Autant de motifs d'inquiétude pour un pays comme la France dont le littoral est très exposé du fait de l'intensité du trafic maritime en Manche.
Ajoutons que si l'Union européenne et les pays européens du Mémorandum de Paris ne suivaient pas la France dans sa lutte contre les navires sous-normes, l'Europe risquerait de voir arriver dans ses eaux la plupart des navires dangereux rejetés des eaux américaines par les mesures d'expulsion prévues par l'Oil pollution act et par la rigueur des contrôles effectués par les coast guards.
Peut-on continuer à accepter que la concurrence maritime se fasse au prix de conditions sociales souvent intolérables pour les équipages concernés ? Est-il acceptable que les pays développés, et notamment européens, organisent eux-mêmes la concurrence fondée sur le
dumping social et fiscal ? Est-il normal de subventionner les transports maritimes français si cela ne s'accompagne pas de création d'emplois de qualité aux normes du premier registre national ?
La fédération nationale des syndicats maritimes CGT dit non, et a décidé de s'engager résolument contre ces pratiques en déposant une plainte au pénal avec constitution de partie civile. Il convient de mettre le social au centre de l'action pour regagner un transport de qualité, parce que la situation de beaucoup de marins est intolérable et qu'il est normal de garantir à tous les marins quels qu'ils soient et partout dans le monde des statuts sociaux de bon niveau. Mais cela se justifie également parce que la sécurité en mer et à bord d'un navire dépend étroitement de la capacité de l'équipage à assurer la navigation, les manoeuvres et les opérations commerciales, à interpréter les indications fournies par les instruments, à anticiper et à réagir correctement en cas d'incident.
Un navire n'est sûr que s'il est bien conçu, bien construit, bien entretenu et bien exploité. Au cours des dernières décennies de grands progrès ont été accomplis en matière d'instrument de navigation, de calculateur de chargement, d'automatisation. Paradoxalement, ils peuvent aggraver les risques dès lors qu'ils sont utilisés comme prétexte pour réduire les équipages, pour économiser sur la formation ou pour minimiser l'importance des transferts d'expériences.
L'éclatement de la fonction d'armateur, l'utilisation de sociétés de recrutement des équipages, l'instabilité et l'hétérogénéité des équipages, l'absence de suivi des navires, les chantages à l'emploi qui peuvent s'exercer sont des facteurs majeurs de risque ; on ne peut s'étonner que, sur certains navires, le b.a. ba du métier soit ignoré ou négligé. Pour en sortir, il faut donc que ce laisser-aller catastrophique pour nos populations passe non pas par l'abaissement des normes, afin d'être plus compétitifs, mais par la reconquête des transports sous pavillon français métropolitain et par un relèvement général des normes d'exploitation, de construction et d'entretien des navires.
Sait-on que le pavillon français métropolitain est le seul à être contrôlé tous les ans par les inspecteurs de navigation ? Sait-on que les navires sous pavillon de complaisance, sous immatriculation aux territoires antarctiques et arctiques français, ne le sont pas et peuvent y échapper s'il n'y a pas d'inspecteurs de navigation qui se préoccupent de réaliser ces contrôles ?
A ce stade de mon intervention, je voudrais insister pour que des décisions législatives énergiques soient prises afin d'éliminer les navires sous-normes et que les pavillons nationaux soient seuls utilisés pour ce genre de navigation. Mais pour cela, une intervention publique des élus de notre pays est nécessaire. Au-delà des mesures d'urgence afin de réparer les souillures de notre littoral, la prévention des sinistres de ce type est la priorité. Il n'existe pas de risque zéro en matière de catastrophes de ce genre, mais la réduction de ces éventualités est possible à condition de s'en donner les moyens.
Un autre élément, selon la fédération des syndicats maritimes CGT est indispensable : l'accroissement significatif du nombre des inspecteurs de navigation. Ils sont actuellement 60, alors qu'il en faudrait, comme dans certains pays de l'Union européenne, au moins 200. La CGT a entendu le Gouvernement annoncer le doublement du nombre des inspecteurs. Or les dispositions prises ne conduisent qu'à une augmentation de 21 ; c'est trop peu, il faut faire beaucoup plus et beaucoup plus vite.
Notre pays doit prendre toutes les dispositions pour que cela ne continue pas. La fédération des syndicats maritimes CGT insiste principalement sur deux priorités, d'une part, le transport de produits dangereux, toxiques et polluants sous pavillon français métropolitain afin d'éviter les tentatives d'exonération des responsabilités, d'autre part, l'accroissement significatif du nombre d'inspecteurs de navigation.
Telles sont à notre sens les mesures essentielles dont toute amélioration du transport maritime découle. Il conviendra, par ailleurs, de veiller à ce que l'Union européenne prenne enfin des dispositions pour assainir le transport maritime et ne cède pas à certains
lobbies d'armateurs de pétroliers, voire de sociétés de classification. La CGT insiste pour que les députés se préoccupent de cela et pèsent dans le bon sens à Bruxelles.
Lors de la table ronde du 10 février 2000, la CGT a fait de nombreuses propositions. Celles-ci sont contenues dans un document que je vous remets et qui doit être considéré comme partie intégrante de mon intervention.
La sensibilité à ces questions reste très forte. Gagner la prévention des sinistres maritimes est un défi et une responsabilité que vous devez assumer après des décennies de déréglementation. N'oublions pas que le pire est peut-être à venir, compte tenu de l'état actuel et des conditions d'exploitation de la flotte mondiale. Le sinistre maritime a donc un bel avenir à moins que vous n'y mettiez bon ordre. La CGT compte sur vous.
M. André LATIL : M. le président, je vous remercie d'avoir invité les représentants syndicaux à apporter leur contribution à la commission d'enquête. Le sujet est très vaste et, personnellement, j'avais noté une dizaine de points à traiter, mais je n'en traiterai que deux rapidement.
Premièrement, j'ai apprécié la table ronde organisée par M. Gayssot le 10 février dernier, qui s'est traduite par l'élaboration d'un document qui inspirera, je l'espère, fortement vos travaux. Il serait d'ailleurs souhaitable que ce document français se transforme en document européen.
Deuxièmement, il convient de noter que le naufrage de l'Erika a eu lieu au moment même où entraient en vigueur les certifications du code ISM ; ce qui veut dire que si ce navire avait réellement été contrôlé, il n'aurait jamais dû être certifié.
M. Bilien a insisté sur le fait que, si de nombreux rapports ont été élaborés, ils n'ont pas été suivis d'effets. M. le président, nous attendons de votre part que des lois soient votées en ce sens, des lois qui punissent non pas le capitaine, mais le capital.
M. François d'ABANCOURT : M. le président, la vocation de notre syndicat est de veiller aux intérêts des personnels, notamment navigants, de la profession. Je n'insisterai pas sur les problèmes techniques qui relèvent d'une certaine compétence, sauf en ce qu'ils ont une incidence sur les personnels en question.
Les divers intervenants ont brossé un tableau assez complet de la situation que nous pouvons faire nôtre. Tout le problème repose effectivement sur un manque de détermination des pouvoirs publics pour assainir la compétition dans les transports maritimes et éliminer les causes du système de la complaisance.
Les contrôles doivent s'appuyer sur des références techniques, mais il apparaît qu'actuellement les possibilités de contrôle sont notoirement insuffisantes ; il convient donc d'instaurer des systèmes de sanction qui soient dissuasifs. Diverses réunions ont eu lieu, dont la table ronde du 10 février, et une charte de la sécurité maritime des transports pétroliers a été signée. Nous pouvons nous référer également à l'avant-projet d'avis signé par M. Fiterman, en date du 10 mars 2000, qui comporte un certain nombre d'éléments pouvant constituer, à notre sens, des pistes de réflexion concrètes.
M. René LUIGI : M. le président, j'aurais souhaité fonder mon intervention sur quatre points principaux :
tout d'abord, l'Etat, national ou européen ; puis l'armateur, l'affréteur et le chargeur ; ensuite, le contrôle des navires, et enfin l'équipage. Mais peut-être y reviendrons-nous dans la partie de cette audition consacrée aux questions/réponses.
Nous pensons qu'il ne peut y avoir de véritable sécurité que dans la souveraineté de l'Etat - qu'il soit national ou européen. Son rôle est de contrôler la qualité des navires et des acteurs, ainsi que les zones d'accès ; il faut cesser de croire que les contrôles sévères des navires les éloigneraient de nos ports. En effet, je n'imagine pas un pétrolier qui doit ravitailler la raffinerie de Lavéra décharger à Barcelone ou Gênes !
Cependant, nous devons fixer notre attention non pas uniquement sur le transport pétrolier, mais sur l'ensemble des navires marchands, car 30 à 40 % d'entre eux transportent occasionnellement - et pour certains régulièrement -
des marchandises dangereuses ; il convient donc de les soumettre aux mêmes règles.
Le sacrifice de la sécurité sur l'autel du profit est devenu la règle en matière de transport maritime dans le monde, notamment pour ceux qui usent des paradis fiscaux : paradis fiscal qui est le bonheur pour eux et l'enfer pour les marins.
La réglementation internationale est complète et complexe, et les Etats doivent avoir la volonté de la faire appliquer. N'oublions pas que les règles édictées par l'OMI le sont à la majorité des tonnages; or, qui possède la majorité des tonnages dans le monde ? les pavillons de complaisance !
Nous espérons donc que votre commission présentera des propositions visant à faire adopter des lois plus sévères que la réglementation internationale, applicables non seulement en France, mais également - par extension -
en Europe. Il faudra d'ailleurs profiter de la présidence française pour faire avancer les choses en la matière.
M. Joël JOUAULT : M. le président, messieurs les députés, nous vous remercions de nous recevoir, non seulement en tant qu'organisation syndicale, mais également en tant que professionnels de la mer. En effet, des décisions sont souvent prises sans consultation des navigants qui vivent par la mer, élément naturel difficilement maîtrisable.
Le naufrage de l'Erika, auquel nous devions nous attendre, n'est pas un cas isolé. La course au « toujours moins cher » devait avoir cet effet en raison de la qualité du navire, et parfois des équipages. Malheureusement, il faut un accident pour que des mesures soient prises.
Cela a été le cas pour le Torrey Canyon
et l'Amoco-Cadiz, avec la création des CROSS, des remorqueurs de haute mer, du rail de navigation et du Mémorandum de Paris. En revanche, personne n'a remis en cause, de façon fondamentale, le pavillon de complaisance, véritable cancer de la marine marchande. Que dire, par ailleurs, du financement des navires ! Tout le monde sait ici que ce phénomène avait, et a, pour but de contourner les lois sociales et d'exploiter une main-d'oeuvre complètement déshéritée du tiers-monde.
Il convient de maîtriser tous les intervenants, de l'armateur à l'affréteur, de l'exploiteur au chargeur, et des sociétés de classification aux marchands d'hommes, pour que les taux de fret paient correctement toute la chaîne. Or ce n'est pas le cas aujourd'hui.
Des solutions existent. Outre le système Equasis, je pense à la mise en place d'une flotte de surveillance, aux amendes prononcées à la hauteur des dégâts occasionnés
- polluants ou non -, à l'harmonisation des équipages qualifiés, parlant et écrivant une langue commune, et rémunérés dans des conditions acceptables, à l'harmonisation des conditions sociales au niveau européen pour un cabotage européen. Certains armateurs ne sont pas clairs en la matière, notamment SOCATRA, PETROMARINE, TANKAFRICA, COPAMAR ou NAVALE FRANÇAISE.
La sécurité passe aussi par la relance des études des E3 et de la boîte noire. La mondialisation, contrairement à ce que certains déclarent, tire les conditions sociales vers le bas. Il convient d'inverser cette tendance avec des signes forts ; or en ce domaine, l'Europe peut être le moteur - nous jouerons, pour notre part, un rôle fort dans le monde maritime.
M. le Rapporteur : Messieurs, je vous poserai trois questions qui pourront faire l'objet de réponses de la part des uns et des autres.
Tout d'abord, estimez-vous que les conventions actuelles de l'OMI en matière sociale - je pense en particulier aux conventions STCW et 147 -
sont suffisantes ? Sinon, avez-vous proposé à l'OMI des améliorations et pouvez-vous nous en faire part ?
Ensuite, vous avez tous souligné la nécessaire dimension européenne pour mettre fin aux distorsions ; avez-vous mené des actions communes avec vos collègues européens à ce sujet auprès des instances européennes ?
Enfin, estimez-vous que les conclusions de la table ronde sont des bases correctes pour aboutir à une nouvelle réglementation ?
M. Paul GOLAIN : Il a été dit, lors de la table ronde, qu'un certain nombre de conventions seront ratifiées. Notre souci, pour le moment, est non pas de savoir si elles seront suffisantes, mais d'être certains qu'elles seront appliquées - car ce n'est pas le cas actuellement.
Par ailleurs, les propositions formulées par le groupe de travail Gilory ne doivent pas être mises au placard, car le rapport qui en est sorti est un rapport de qualité. Nous espérons même que la présidence française de l'Union, à partir du 1er juillet, s'en inspirera et sera un moteur pour aller plus loin sur ce sujet.
S'agissant de la table ronde du 10 février 2000, nous avons été choqués par certains propos relatifs aux mesures sociales : la sécurité ne doit pas être traitée sans prendre en considération le volet social. Or, il n'y a pas grand-chose dans ce domaine.
M. René LUIGI : En ce qui concerne la réglementation OMI, je vous l'ai dit tout à l'heure, il s'agit d'une question de volonté : les gouvernements doivent avoir la volonté de l'appliquer. Si la convention STCW, qui est une bonne disposition, était appliquée par tout le monde, nous arriverions à avoir quelque chose de tout à fait acceptable.
S'agissant de la table ronde du 10 février 2000, je n'aurai pas le temps ici de vous faire part de toutes nos réflexions. Cependant, lorsqu'on vous parle de la double coque comme de la panacée, je ne suis pas d'accord. Par ailleurs, les durées minimales entre deux contrôles en bassin, qui ont été avancées, sont encore trop longues.
Enfin, s'agissant des affréteurs qui s'engagent à accepter des navires de plus de 14 ans s'ils sont classés dans la même société de classification, je voudrais dire que cela n'est pas une preuve de bon état.
En résumé, les résultats de la table ronde sont un début, mais ne vont pas assez loin. En outre, les mesures qui seront prises devront s'appliquer non seulement en France mais également en Europe.
M. Roland ANDRIEU : En ce qui concerne votre troisième question, monsieur le rapporteur, il existe effectivement des relations entre les différentes organisations européennes. Mais chacune d'entre elles a un peu peur de ce qui va se passer dans son pays par rapport aux autres. Si l'on renforce, par exemple, la sécurité dans un seul pays européen, il est évident que les navires sous-normes iront se placer dans les autres ports européens.
Il est donc nécessaire que les gouvernements européens règlent ensemble ces problèmes. Car si les organisations en discutent entre elles, elles ne sont pas compétentes pour prendre des mesures législatives ; or elles constatent toutes que leur gouvernement est un peu frileux pour régler ces questions.
Je voudrais insister sur un point précis : le contrôle des navires ne s'effectue que sur les problèmes techniques et jamais sur les conditions sociales ; en effet, un contrôleur n'a pratiquement jamais le temps de contrôler l'application des normes OMI. Ce sont les organisations syndicales qui règlent les problèmes sociaux que peuvent rencontrer les navires mais jamais les Etats.
M. Roger LE FLOCH : La convention STCW 78 est en application, contrairement à la STCW 95 ; la liste blanche n'a pas encore été publiée, mais je crois savoir que la France n'en fait pas partie. Il y a donc un problème.
S'agissant de la convention 147 de l'OIT, si les contrôles sont effectués, comme l'a bien expliqué M. Andrieu, nous n'avons ni le temps ni les moyens de contrôler l'application des normes sociales. La convention 109, qui devait être ratifiée par tous les Etats et notamment par la France, permettrait, lors de nos interventions, de parfaire nos visites.
Récemment, j'ai effectué une visite du MOU - alors que je suis le seul inspecteur à la Rochelle -
au cours de laquelle j'ai fait remplacer le second capitaine et le deuxième lieutenant qui étaient totalement incompétents. Mais tous les inspecteurs n'ont pas forcément les compétences pour juger de celles d'un second capitaine et il n'est pas possible de retenir un bateau indûment. Il est donc indispensable que le contrôleur possède de grandes compétences, notamment nautiques.
Actuellement, nous butons sur deux difficultés : d'une part, le manque d'inspecteurs, et, d'autre part, la qualité de ces inspecteurs. Il ne suffit pas de nous promettre que l'on va recruter 100 inspecteurs, il convient de savoir lesquels ; si l'on ne recrute pas d'anciens navigants, on va dans le mur ! Sur les 60 inspecteurs, seuls 25 sont d'origine marchande, c'est-à-dire capables d'effectuer des contrôles.
M. le Rapporteur : Si nous avons compris la nécessité de renforcer le corps des inspecteurs, nous nous sommes également rendu compte de la difficulté d'en trouver même quand on ouvre des postes. Ne convient-il pas d'envisager, une fois la carrière de navigant achevée, de prolonger celle-ci dans le contrôle - les navigants étant seuls capables d'effectuer de bons contrôles ? Mais pour cela un accord syndical est nécessaire ; qu'en pensez-vous ?
M. Roger LE FLOCH : Ici, nous sommes tous d'accord. Mais vous savez qu'il y a des difficultés.
M. le Rapporteur : Et si le ministre des Transports décidait de créer 100 postes pour des personnes disposant d'une qualification très précise ? Vous le savez mieux que moi, les jeunes sortant des écoles ne sauront pas repérer le personnel navigant incompétent. Pour avoir cette capacité, il faut avoir déjà navigué, ce qui suppose un statut spécial pour cette catégorie de contrôleurs.
M. Roger LE FLOCH : Toutes les organisations syndicales ici présentes sont d'accord avec vous. Mais il se trouve que j'ai deux casquettes, or les organisations syndicales du ministère des transports de la mer, donc des affaires maritimes, notamment la CGT et FO, sont contre le recrutement de marins ; c'est historique. Ici, nous sommes tous conscients que s'il n'y a pas un vivier de marins qui entre dans la profession, on va dans le mur !
Les inspecteurs qui sont actuellement recrutés et nommés dans les centres de sécurité ont un bac+6 ou un bac+7, mais ne sont opérationnels que deux ans après. Etant donné qu'ils n'ont pas navigué six mois, ils n'entrent pas dans le cadre des inspecteurs de la sécurité du MOU -
seuls les anciens marins le sont en France, soit 25 personnes.
Je reviens à la question relative aux conventions. Je vous disais que la convention 109, qui nous permettrait d'effectuer des visites en matière sociale, n'est malheureusement pas ratifiée. Et le chef de centre de sécurité n'a pas les moyens de faire ce que j'ai fait récemment, c'est-à-dire de débarquer le second capitaine et le deuxième lieutenant pour incompétence. Je l'ai fait... au culot !
S'agissant de votre troisième question, il est évident que nos organisations syndicales n'ont pas de contacts avec les pays européens ; seuls les inspecteurs ITF (International Transport Workers Federation) en ont. Mais encore une fois, l'inspecteur ITF n'a pas vocation à arrêter un bateau ; seul l'inspecteur du MOU, le chef de centre, peut décider de l'arrêt d'un navire.
Pour ma part, je suis en contact permanent avec les gens de l'ITF ; c'est un surcroît de travail, mais c'est indispensable si l'on veut avancer. « Une équipe heureuse fait un bon bateau, un équipage malheureux fait un mauvais bateau...tout le monde le sait ».
En ce qui concerne les avancées de la table ronde, elles sont insuffisantes. On y a retrouvé exactement ce qui figure dans les rapports parlementaires de 1994. Ce qui manque en France, c'est une véritable volonté de créer un corps d'inspecteurs. Nous savons tous qu'il est impossible de créer un corps de garde-côtes européen, mais il conviendrait de créer un corps d'inspecteurs du MOU, c'est-à-dire un corps spécialisé faisant uniquement des visites du Mémorandum.
Il est inadmissible que des inspecteurs effectuant des visites de pétroliers de 300 000 tonnes le matin, inspectent l'après-midi un navire de plaisance de trois mètres cinquante ! C'est une aberration !
Nos collègues inspecteurs, qu'ils soient Allemands, Belges, Hollandais ou Anglais, ne s'occupent pas des navires de plaisance. Il n'y a qu'en France que les inspecteurs du MOU font également de la plaisance ! Il faut absolument que l'on en sorte, c'est une priorité ! Les chefs de centres doivent faire les visites des bateaux battant pavillon français ; or, tous les navires de plaisance battent pavillon français et il y en a un million en France, ce qui exclut que nous fassions les visites du MOU.
M. Roland ANDRIEU : Il est effectivement indispensable de recruter, mais sur quelles bases ? Comment allons-nous les rémunérer ? Car si nous recrutons des capitaines, des officiers, le problème du statut et de la rémunération se posera.
Par ailleurs, nous devrons recruter des formateurs pour former ces anciens navigants. L'école nationale de la marine marchande, par décision de M. le ministre, doit assurer cette formation ; mais où trouver les formateurs ? C'est le noeud gordien de tout ce qui va se passer : le contrôle et l'arrêt effectif des navires qui ne seront pas en conformité avec toutes les réglementations existantes.
M. André LATIL : En ce qui concerne les inspecteurs de navigation, j'ai toujours été partisan de prendre des commandants et des chefs mécaniciens - dont la retraite est à 55 ans -
à 50 ans et de les faire travailler jusqu'à 60 ans.
S'agissant de la charte de sécurité maritime, s'il est vrai qu'elle est insuffisante, il convient tout de même d'y aller progressivement, sinon nous nous mettrons les Grecs et les Anglais à dos et elle ne passera jamais au niveau européen !
M. Joël JOUAULT : Les conventions OMI, et notamment la STCW 95, entrent progressivement en application, et nous espérons qu'elles seront satisfaisantes. Mais il faut veiller à ce qu'il n'y ait pas une dérive vers une qualification moindre.
En ce qui concerne la convention OIT 147 et ses déclinaisons - car il ne suffit pas de s'intéresser seulement à l'inspection, elle comporte bien d'autres aspects -
, il y a un problème de fond. Je pense à l'instauration de minima pour les pays asiatiques qui sont tirés non pas vers le haut mais vers le bas ; il convient d'enrayer ce phénomène.
S'agissant de la dimension européenne, nous avons débattu, il y a quelques années, au niveau syndical, de la mise en place d'un pavillon Euro. Il s'agissait, tout d'abord, d'une harmonisation sociale européenne qui a ensuite été vidée d'une partie de son contenu pour ne concerner que quelques officiers ; puis, elle a fini par ne concerner que le commandant et son remplaçant, pour enfin être mise au placard. Il y a eu là un manque de volonté politique, ce qui a laissé place au développement des pavillons de complaisance.
En ce qui concerne la table ronde, un certain nombre de dispositions sont intéressantes ; cependant, il convient de se donner les moyens de les mettre en application et je crains qu'ils ne soient faibles. Par ailleurs, ces dispositions ne peuvent pas se limiter à la France et doivent être étendues au niveau européen. J'irai même plus loin, car le rail - sur la zone des 200 milles -
ne sert pas seulement à l'Europe, il sert également à des pays qui ne sont pas membres de l'Union européenne. La France doit se protéger, car ce sont pratiquement toujours ses côtes qui sont souillées.
M. le Président : La catastrophe qui s'est déroulée, il y a quelques mois, au large du Pays de Galles a tout de même « liquidé » les côtes galloises ; or on n'en a pratiquement pas parlé en France. De même que l'on ne parle pas de l'Erika en Grande-Bretagne. Et d'autres catastrophes ont eu lieu récemment, au large de la Turquie et au Japon. Le problème est aussi celui-ci : que faire pour que ces catastrophes sortent de leur contexte régional ?
M. Joël JOUAULT : Je parlais donc de l'Europe et du problème des conditions sociales. Il faut mettre en place une flotte européenne et des emplois européens. Un certain nombre de dispositions se trouvent dans la charte de sécurité maritime des transports pétroliers ; mais il faut aller plus loin et avoir une politique plus globale.
M. René LEROUX : Je suis un peu étonné de vous entendre dire que les navigants devraient arrêter leur carrière à 50 ans pour devenir inspecteurs jusqu'à 60 ans. Car cela veut dire qu'il faut attendre de devenir inspecteur pour être responsable d'un navire ! Monsieur Le Floch, lorsque vous étiez navigant étiez-vous incapable d'avoir un bon contrôle de votre navire ? Je sais conduire une voiture, et si je passe un jour inspecteur, je saurai toujours conduire une voiture !
M. Roger Le FLOCH : Le premier responsable de la sécurité des navires c'est le commandant : le code ISM donne aujourd'hui toutes les responsabilités au commandant. Mais jusque-là, un commandant ne pouvait rien faire sans l'aval de sa société. Le code ISM autorise désormais le commandant à agir pour le compte de l'armateur et à prendre soin à la fois du bateau et de l'équipage.
Lorsque je suis intervenu sur ce navire pour dire au commandant que le second capitaine et le deuxième lieutenant étaient incompétents, il ne m'a pas dit le contraire ! Mais tout le monde le sait bien, un commandant qui agit contre les intérêts de l'armateur se retrouve vite débarqué à son tour. Dans cette histoire, je suis même allé un peu loin, car aucun texte n'autorise un inspecteur de la sécurité des navires, dans le cadre du Mémorandum, à faire débarquer un membre de l'équipage incompétent.
Il faut savoir qu'il existe des « vrais faux brevets » de navigants : les brevets s'achètent dans les pays étrangers - notamment exotiques. Lorsque nous effectuons nos contrôles, certains marins nous en présentent. La convention STCW 95 permettra peut-être de détecter les fraudes ; mais pour cela il faudra être capable de déceler l'incompétence, et donc être un ancien navigant.
M. René LUIGI : M. Leroux a trouvé seul la réponse à sa question : il sait conduire, il est donc habilité à constater que je ne sais pas conduire s'il me pose des questions ! Le commandant est responsable, c'est vrai, mais l'inspecteur est là pour déceler ce qui ne va pas et prendre les décisions que le commandant ne peut pas prendre -
notamment si elles vont à l'encontre des intérêts de son armateur.
M. le Président : Vous êtes en train de décrire une situation extrêmement préoccupante et qui conduit à s'interroger sur le niveau de responsabilité des équipages sur un certain nombre de navires.
M. Roland ANDRIEU : Les équipages sont recrutés la plupart du temps
non pas par les armateurs, mais par des marchands d'hommes.
M. le Président : Peut-être convient-il d'envisager, dans le système Equasis ou parallèlement, un volet touchant à la formation, et par conséquent exclure les Etats qui ne forment pas leurs marins. Sauf, bien entendu, s'ils ont passé une convention avec un Etat autorisant l'envoi et la formation de leurs marins dans ce pays.
M. Paul GOLAIN : Si l'on reprend l'exemple de l'Erika, il est certain que l'équipage était compétent. Mais la plupart des équipages subissent une pression de la part des armateurs, notamment français. Récemment un commandant s'est fait débarquer parce qu'il avait refusé un plan de chargement. Ce genre de chose se passe même sous pavillon français.
M. le Président : De quel armateur s'agissait-il ?
M. Paul GOLAIN : La CGM.
M. René LUIGI : Les journées d'éducation maritime à Nantes, la semaine dernière, avaient pour objet l'internationalisation de la formation. Former les marins, d'accord, mais encore faut-il être certain du brevet qu'on leur délivre. Lorsque le brevet est délivré par la France, on peut supposer qu'il est de bonne qualité ; mais comment éviter que les brevets puissent être achetés à l'étranger ? La solution est d'exiger le professionnalisme de l'équipage, en mettant en place la culture de l'entreprise.
Moins l'équipage est important, plus il doit constituer un bloc. Quand les mouvements d'équipage sont tels qu'il n'y a aucune cohésion dans l'équipe, c'est « le bazar » à bord du navire. Pourquoi ne pas imposer la culture d'entreprise en exigeant, d'une part, un certificat de présence d'une durée déterminée - assez longue -
et, d'autre part, qu'un tiers de l'équipage ait au moins dix ans d'ancienneté dans le métier ?
M. le Rapporteur : Pourriez-vous nous faire parvenir des informations concernant les ventes de brevet ?
M. André LATIL: J'ai acheté mon brevet au Libéria ! Mon armateur qui est français, la CGM, m'a fait commander un pétrolier libérien. Cela lui a coûté 200 dollars.
M. le Président : Peut-être existait-il une équivalence avec votre brevet français ?
M. André LATIL : Oui, tout à fait ! Et la STCW 95 doit certifier toutes les écoles
dans le monde susceptibles de délivrer un diplôme. Mais cela n'empêche pas les faux brevets.
M. Paul GOLAIN : Nous sommes affiliés à la fédération des transports ITF, nous pourrons donc certainement obtenir des éléments. Mais je ne pense pas qu'il faille se focaliser sur les faux brevets ; les faux brevets vont avec les mauvais navires.
M. le Rapporteur : Ce sont ceux-là que l'on condamne !
M. Paul GOLAIN : Mais bien sûr ! Simplement une personne qui a son brevet ne va jamais accepter de naviguer sur une poubelle - sauf peut-être les marins du tiers-monde. Et je refuse d'ailleurs de mettre tout le monde dans le même sac en disant que tous ces marins sont des mauvais marins.
M. le Rapporteur : Le sujet, aujourd'hui, c'est le contrôle et l'application des normes ; or pour contrôler, il faut des personnes formées.
M. le Président : Je voudrais revenir sur la troisième question de M. le rapporteur concernant les contacts des organisations syndicales au niveau européen. Nous sommes tous d'accord pour dire que l'on peut voter les lois les plus contraignantes en France, cela n'empêchera pas un certain nombre de bateaux de circuler sur la Manche : jusqu'à preuve du contraire, la Manche n'est pas une mer intérieure interdite aux autres. Il convient donc de trouver une solution européenne.
Et ce n'est pas parce que le ministre des Affaires étrangères va la proposer à ses collègues européens qu'à partir du 1er juillet les pays européens vont l'adopter. Vous savez comme moi qu'il vaut mieux que la règle soit unanimiste ; or un pays tel que la Grèce n'est pas prêt à accepter que l'Europe adopte un certain nombre de dispositions contenues dans le document signé il y a quelques semaines au ministère des transports.
D'où la question que je me pose : ne peut-on pas envisager que les organisations syndicales européennes pèsent dans la période à venir, en se rassemblant et en lançant un cri d'alarme ? Le rapport de la commission d'enquête a aussi un rôle à jouer à cet égard.
Je ne vois pas pourquoi les Etats-Unis se seraient passés de l'OMI pour édicter des obligations, et pourquoi l'Europe se retrancherait derrière l'OMI. Chacun d'entre nous peut peser sur un certain nombre de choses : le Gouvernement, la commission d'enquête et les syndicats. Etes-vous prêts à peser de tout votre poids pour faire avancer les choses ?
Par ailleurs, ne pensez-vous pas qu'il faudrait réduire à l'OMI le poids
- actuellement prépondérant - des Etats du pavillon, afin qu'il y ait une représentation plus équitable des Etats côtiers et des Etats du port ?
M. René LUIGI : Bien entendu, mais de quelle manière ? Une voix par Etat, pourquoi pas ?
M. le Rapporteur : C'est le cas à l'ONU, dont dépend l'OMI.
M. Roland ANDRIEU : Nous allons rencontrer des difficultés avec nos collègues européens, non pas au niveau des syndicats, mais au niveau des Etats. Si l'on détaille la composition des navires de complaisance, les officiers sont en général formés, alors que les équipages ne le sont pas. Et si l'on interroge les pays européens, y compris la France, pour savoir comment cela se passe sous pavillons bis, nous allons rencontrer des difficultés, car je crains que ce ne soit la même chose. Si nous-mêmes, nous ne regardons pas ce qui se passe sous nos propres pavillons, parce qu'ils sont bis, et c'est vrai pour l'Angleterre, pour l'Allemagne, pour la France, pour pratiquement tous les pays d'Europe, chacun va essayer de se protéger de la règle générale...
M. Joël JOUAULT : Les officiers supérieurs apprécient d'avoir un équipage français. Mais les armateurs français sont en train de vouloir moduler les effectifs en fonction du tonnage du navire, de la valeur ajoutée, et d'un tas d'autres critères ; or là les officiers ne sont plus d'accord. Par exemple, le registre bis hollandais n'interdit plus rien : il autorise même l'armateur, s'il ne trouve pas de commandant, à en chercher un autre sur le marché de l'emploi mondial.
M. le Président : Sur cette question, n'est-il pas possible qu'il y ait une union syndicale au sein de la CES -
Confédération européenne des syndicats - à laquelle toutes vos fédérations sont adhérentes ? Dans une vie antérieure, j'ai réuni au Havre les organisations syndicales de marins de Grèce, d'Italie, d'Espagne, de France, de Grande-Bretagne, de Belgique et d'Allemagne ; et toutes, à l'époque, étaient tombées d'un accord sur un certain nombre de sujets. Il ne serait plus possible actuellement de peser de cette manière-là ?
M. Paul GOLAIN : Le travail est fait et il existe au sein de l'ETF (European Transport Worker's Federation) et de l'ITF. Dernièrement, dans le cadre de l'ITF, nous étions à Malte pour une conférence réunissant tous les syndicats européens. Actuellement, nous débattons au sein de l'ETF de la directive relative au cabotage européen. Or, même s'il existe des divergences syndicales, nous parlons d'une même voix sur ces sujets.
Mais le problème est de faire aboutir toutes ces propositions. Et là, chaque organisation syndicale se doit de faire du
lobbying auprès de son propre pays.
Je voudrais revenir sur les mesures positives adoptées par la table ronde et contenues dans le rapport Gilory, qui ont toutes été présentées au sein de l'ITF. L'ITF fait d'ailleurs du
lobbying auprès de ses adhérents pour que les conventions OMI et BIT soient ratifiées.
Nous espérons, que grâce à la présidence française de l'Union, les propositions issues de la table ronde et du rapport Gilory seront adoptées au niveau européen.
M. le Rapporteur : La conjonction du naufrage de l'Erika et de la présidence française à partir du 1er juillet 2000 est une opportunité pouvant permettre de faire avancer les choses en la matière. L'action de
lobbying dont vous parlez, c'est au semestre prochain qu'il faudra la mener.
M. Roger LE FLOCH : Il faut que la convention 109 soit ratifiée et intégrée à la 147 ; la convention 109 se substituera alors à l'ITF qui, à l'heure actuelle, n'a pas les moyens. Avec la convention 109, les contrôleurs du MOU auront toute latitude pour effectuer leurs visites.
M. André LATIL : Mon syndicat fait partie de la fédération des transports, et je peux essayer de faire passer le message. Je fais également partie de la fédération internationale des transports, je vois donc des marins étrangers auprès desquels je tenterai également de faire passer le message -
malheureusement, je ne vois ni Grecs ni Anglais.
M. Roland ANDRIEU : Dans le traité de Maastricht, l'article 7591C stipule que le Conseil établit les mesures permettant d'améliorer la sécurité des transports.
M. le Président : Vous parlez des Conseils des ministres auxquels participent les ministres grec, luxembourgeois, anglais ?
M. Roland ANDRIEU : Bien sûr, mais il y a la majorité qualifiée.
M. René LUIGI : Vous demandez, monsieur le président, monsieur le rapporteur, l'appui des organisations syndicales ; je trouve cette idée séduisante. Pour nous, il n'y a jamais eu de problèmes : lorsqu'une décision était adoptée concernant le monde maritime, nous faisions une intersyndicale solide.
M. le Président : Toutes les organisations syndicales ont signé un certain nombre de dispositions lors de la table ronde, et le Gouvernement a fait des propositions - en partie reprises par la Commission.
Mais la Commission n'a aucun pouvoir de décision ; c'est le Conseil des ministres qui décidera d'entériner ou non ces propositions. Cependant, notre rapport pourra représenter une pression supplémentaire ; par ailleurs, nous avons déjà rencontré un certain nombre de responsables à la Commission européenne, nous allons nous déplacer à Malte, à Londres, etc.
Je vous suggère donc, en tant qu'organisations syndicales, sans qu'il y ait nécessairement une intersyndicale, que vous pesiez de tout votre poids pour que les dispositions touchant à la sécurité maritime soient adoptées.
M. Joël JOUAULT : Je voudrais insister sur le problème du marchand d'hommes. Maintenant, les officiers fournissent des équipages entiers - du commandant au dernier matelot -
et traitent avec le gérant du navire et non plus avec l'armateur ou l'exploitant du navire. La fidélisation du personnel sur un navire est très importante. Mais le marchand d'hommes est un maillon de la chaîne qui est tout à fait inadmissible.
M. Roger LE FLOCH : Le code ISM est actuellement la panacée, tout au moins pour les navires qui y sont soumis depuis le mois de juillet 1998 : pétroliers, ferries, chimiquiers et vraquiers. Mais il ne faut pas oublier qu'en février 2002, tous les navires de plus de 500 tonneaux seront soumis au code ISM. On peut donc d'ores et déjà se poser de nombreuses questions.
Je prendrai un exemple concret : l'IACS, l'Association internationale des sociétés de classification, avait préconisé que les sociétés de classification délivrant les classes aux navires ne soient pas celles qui délivrent les DOC - les attestations de conformité -
et les SMC - les certificats de gestion et de sécurité des navires.
Or il se trouve qu'il n'existe aucune déontologie à ce sujet, ni au niveau français ni au niveau européen. Et celle de l'IACS n'ayant pas été appliquée, les sociétés de classification sont de ce fait juge et partie et osent nous dire, lorsque nous visitons les bateaux : « Nous ne gérons pas l'équipage, c'est le rôle du marchand d'hommes". Or le paragraphe 6 du code ISM traite du personnel géré par la compagnie et les auditeurs des sociétés de classification s'assurent de l'application de ce paragraphe. Il y a donc un problème très grave, qui va aller en s'amplifiant.
Mais la solution pourrait être simple : il suffirait de dire, par exemple, que la Lloyd's délivre les certificats de classe et le Germanischer Lloyd fait les audits.
M. le Rapporteur : Avez-vous l'occasion de faire des visites du MOU en Charente-Maritime ?
M. Roger LE FLOCH : Bien sûr, je devrais visiter 200 navires par an, mais l'année dernière je n'en ai fait aucune ! Cette année, j'en ai déjà fait quatre, car un chimiquier de 16 000 tonnes s'est échoué à 500 mètres de la plage en face de Chatelaillon. Je n'interviens donc que lorsqu'il y a une catastrophe et non pas systématiquement comme cela est prévu. Mais il faut dire que je suis seul habilité à faire du MOU ! Je vais, heureusement, bientôt être accompagné de deux inspecteurs que je vais former pendant deux ans.
M. Jean-Pierre DUFAU: Nous venons de faire le tour des problèmes que vous vivez, concrètement, tous les jours. A ce titre, votre expérience est particulière et irremplaçable.
M. le président vous a déjà invités à nous faire parvenir les documents que vous jugerez utiles pour la commission, mais je voudrais que vous nous communiquiez également une note sur les deux éléments suivants.
Premièrement, la situation en France : les problèmes liés au contrôle de sécurité, au sens large du terme, des navires et des installations ; les rapports entre armateurs, affréteurs, marchands d'hommes, etc., l'équipage et les perspectives vers lesquelles il faudrait tendre, en sachant qu'il y aura de gros problèmes à résoudre, notamment dans le temps. Il y a ce qui est souhaitable dans le moyen et le long terme, mais il y a aussi un immédiat à gérer : que peut-on faire pour les cinq ans à venir ?
Second élément : peut-on faire la même chose au niveau de l'Union européenne ? Peut-on rédiger le livre blanc « minimum » qui nous permettrait d'appréhender les mêmes thèmes à l'échelle européenne, afin que la commission puisse croiser cette analyse française et la perspective européenne, ce qui pourrait permettre, à l'occasion de la présidence française, d'avancer ? Nous avons là une opportunité pour agir dans ce domaine et aller beaucoup plus en profondeur dans ce dossier, afin que des progrès sensibles soient réalisés dans l'ensemble des secteurs que vous avez évoqués.
M. Roger LE FLOCH : Je peux déjà vous laisser l'exposé des problèmes « franco - français » que j'avais préparé et qui est assez complet. Nous n'avons pas abordé la question du transport des produits dangereux et polluants ; et le pétrole n'est pas le seul produit dangereux. Le code IMDG - le code des produits dangereux - n'est pas encore appliqué dans tous les pays ; il est donc vain de vouloir prétendre surveiller les matières dangereuses sur les navires, quand aucun texte ne nous permet de le faire sérieusement.
En matière de pollution, je pourrais vous parler des
slop, les eaux sales des pétroliers,
et des sludge, les eaux boueuses des cargos ; je peux vous assurer que les armateurs disent au chef mécanicien de se débrouiller pour débarquer dans les ports les moins chers. Si les résidus reçus à terre l'étaient gratuitement, il n'y aurait pas de pollutions de cet ordre. Car non seulement c'est cher, mais tous les ports ne sont pas munis de réceptacles.
M. René LEROUX : Avez-vous déjà dégazé en mer ?
M. René LUIGI : Mais bien sûr !
M. Roger LE FLOCH : Je n'ai jamais dégazé près des côtes bretonnes - je suis Breton ! - mais j'ai dégazé en pleine mer, en plein milieu de l'Atlantique et du Pacifique.
M. René LEROUX : Combien y a-t-il de ports actuellement en France qui peuvent faire dégazer les bateaux correctement et en peu de temps ?
M. le Président : Deux ports sont équipés pour cela : Marseille et Le Havre.
M. Roland ANDRIEU: Il y a bien d'autres rejets à la mer : ainsi j'ai assisté pendant dix jours, avec une compagnie de navigation française, à des rejets de déchets radioactifs.
Audition de Maître Christian HUGLO, avocat
(extrait du procès-verbal de la séance du 5 avril 2000)
Présidence de M. Daniel PAUL, Président
Maître Christian Huglo est introduit.
M. le Président lui rappelle que les dispositions législatives relatives aux commissions d'enquête lui ont été communiquées. A l'invitation du Président, Maître Christian Huglo prête serment.
Maître Christian HUGLO : Monsieur le président, madame et messieurs les députés, je vous remercie de m'avoir convoqué devant votre commission d'enquête. Vous savez que je ne suis qu'un modeste praticien. J'ai hélas connu beaucoup de marées noires, et je n'en suis pas tellement fier. Je peux peut-être vous être utile au travers des différentes expériences des procédures que j'ai pu mener depuis 1976.
Je me suis intéressé au droit maritime dans les années 1973-1976, lors de l'affaire de Montedison, pour la Corse contre l'Italie. J'avais rassemblé les villes de Nice et Marseille ainsi que la Corse, afin d'intenter un procès pour pollution. A cette époque
- l'anecdote est assez intéressante -, les gouvernements français et italien avaient indiqué qu'il n'y avait aucune raison de droit pour empêcher la pollution dans la mer Méditerranée. J'ai été très soutenu, à cette époque, par M. Virgile Barel - auquel je rends hommage -, député assez remarquable et tout à fait intéressé par ces questions de la mer. Nous avons monté un procès. Nous avons démontré, en Italie, en saisissant les navires de Montedison, qu'il était possible d'avoir une juridiction sur la mer. La question essentielle, en matière de droit maritime, était effectivement d'assurer une juridiction sur la mer internationale. Cette affaire a permis d'offrir une victoire importante à la Corse, Marseille et Nice, contre une pollution de la mer Méditerranée qui était tout à fait importante à cette époque et qui a donné lieu à des conventions internationales par la suite.
J'ai commencé à travailler sur le sujet de cette façon. Je ne suis pas un spécialiste de droit maritime, mais plutôt un spécialiste de droit public. Ces différentes affaires m'ont valu d'être engagé par la Bretagne, à partir de 1976, dans plusieurs procès pour marée noire.
J'ai connu plusieurs dossiers : l'affaire du
Gino et du Teamcastor (1979), deux navires qui se sont heurtés au large de la Bretagne - il me semble d'ailleurs que le
carbon black du Gino est toujours au fond de la mer - ; l'affaire du
Boelhen, pétrolier naufragé au large de l'île de Sein en octobre 1976 ; l'affaire de l'Olympic Bravery
(février 1976) dans laquelle nous nous sommes tous demandés s'il ne s'agissait pas d'un acte de baraterie, c'est-à-dire un acte de destruction volontaire du pétrolier - je ne sais pas ce qu'il en est advenu car il n'y a pas eu de suite judiciaire dans cette affaire particulière.
Dans ces deux dernières affaires, j'ai mené des expertises au tribunal administratif pour le Comité local des pêches et la SEPNB - Société pour l'étude et la protection de la nature en Bretagne -, afin d'obtenir les éléments de circonstances et de reconstituer les faits. Il s'agissait d'affaires extrêmement difficiles à régler du point de vue financier car il y avait peu de couverture en vue d'indemnisations à l'époque. C'est au cours des affaires de l'Amoco-Cadiz et du
Tanio que j'ai pu avoir des contacts avec les assureurs de ces navires, et obtenir des indemnités que certains jugent relativement faibles dans les deux cas. Mais elles étaient tout juste couvertes par la Convention de 1969.
Je me suis ensuite occupé de l'affaire
Amoco-Cadiz, aux Etats-Unis, pendant quatorze ans. C'est un procès que j'ai conçu et mené avec la Bretagne et avec l'Etat, dans des conditions particulièrement difficiles. Je vous livrerai un élément important sur les commissions d'enquête parlementaires de 1978, l'Etat français et le procès de Chicago. Je suis tout à fait partisan du secret professionnel, - il est évident que je ne peux que le respecter -, mais il faut savoir que l'Etat français a failli perdre son procès dans l'affaire de l'Amoco-Cadiz, à cause des commissions d'enquête parlementaires. En effet, la publication de certaines informations dans leurs travaux était contraire aux procédures de
discovery en vigueur devant les juridictions américaines. L'Etat français a été condamné à de sévères amendes et il a failli être débouté de son procès. Cet exemple me permettra de faire une observation sur les difficultés de conduire des procès à l'étranger dans des circonstances assez particulières.
L'affaire de l'Amoco-Cadiz est extrêmement importante. Selon moi, elle a rétabli ce que j'appelle la « réalité ». Tout ce qui est sécurité maritime est régi par le droit des transports maritimes. Ce n'est pas le navire qui pollue, mais toujours sa cargaison. Dès lors que le produit arrive sur le littoral, à mon avis, on change de droit. Le Pr. du Pontavice, grand spécialiste de droit maritime qui a conçu ce procès avec nous pour l'Etat français - on peut, à cet égard, lui rendre hommage, car c'est vraiment lui qui a eu l'intuition de la possibilité d'un procès aux Etats-Unis pour défendre les intérêts français - a souvent commenté la décision des juridictions américaines en rappelant que la victoire des Bretons et de l'Etat français aux Etats-Unis était celle du droit de l'environnement sur le droit maritime.
Encore une fois, ce n'est pas le navire qui pollue, mais sa cargaison. Une fois que le dommage est au littoral, il faut se référer à un droit applicable et acceptable. Dans le cas contraire, on se heurte à de grandes déconvenues.
L'affaire de l'Amoco-Cadiz a été réglée par un procès, dont on peut tirer plusieurs enseignements.
Tout d'abord, il est possible de faire un procès à l'étranger et de rechercher les responsables devant n'importe quelle juridiction. Les pollueurs ne sont pas à l'abri. Il était très important de rechercher les responsabilités économiques derrière les pavillons de complaisance. C'est là que réside la grande victoire de la décision du 17 avril 1984 sur la responsabilité dans laquelle le juge fédéral Mc-Garr a déclaré que la maison-mère
Standard Oil of Indiana était responsable des actes de ses filiales, tant en ce qui concerne la conception du navire, qu'en ce qui concerne sa gestion. Je vous donnerai des détails sur les raisons d'être de la condamnation du chargeur aux Etats-Unis.
Ensuite, s'agissant des dommages, nous avons connu beaucoup de difficultés sur des problèmes de preuves. Tout ce que nous avions gagné sur la première partie dans la procédure de
discovery contre la compagnie Amoco, s'est retourné contre l'Etat et contre nous dans la deuxième partie, pour des raisons propres au système américain. Celui-ci n'accepte que la preuve par témoin et non la preuve par document ou par expertise. Si vous déposez par témoignage et que vous n'êtes pas la personne qui a vu les éléments du dommage, votre témoignage n'est pas recevable. Petit détail : la plupart des fonctionnaires qui avaient monté les dossiers pour l'Etat français et l'Agence judiciaire du Trésor dans l'affaire de l'Amoco-Cadiz, en 1978-1980, n'étaient plus en fonction en 1986. Par conséquent, ils ne pouvaient pas déposer devant le tribunal de Chicago. De la même façon, les maires bretons qui avaient élaboré les dossiers et qui étaient sur le terrain, de mars à juin 1978, n'avaient pas forcément été réélus. Eux non plus ne pouvaient pas témoigner à Chicago.
Ces raisons de procédure expliquent le niveau des indemnités obtenues qui est, somme toute, plutôt honorable puisque Amoco a été condamnée à verser 1,4 milliard de francs alors que les commissions d'enquête parlementaires de 1978 estimaient le préjudice à 400 millions de francs.
J'ai cependant le sentiment que la victoire de l'Amoco-Cadiz s'est retournée contre nous en 1992, lorsque la convention de Bruxelles a admis un certain nombre d'exceptions sur la focalisation des responsabilités. En effet, lors de l'affaire de l'Amoco-Cadiz, nous
nous sommes trouvés confrontés à l'obstacle de l'article 3, paragraphe 4, de la Convention de 1969, lequel prévoit les exonérations de responsabilité pour les personnes autres que les propriétaires. A présent, avec cette convention de Bruxelles, il est pratiquement impossible de rééditer le même exploit.
Certes, la convention CLC nous gênait pour faire le procès à Chicago. Toutefois, nous avons été jugés, non pas sur la base de la convention de 1969, mais sur la base du droit américain. La convention de 1969, pourtant internationale, ne nous était pas opposable comme droit international public, mais comme loi française puisqu'elle avait été transcrite dans notre législation. Comme c'est le droit américain de la responsabilité qui compte, nous avons fait appliquer le droit américain. On ne peut donc pas dire, dans l'affaire de l'Amoco-Cadiz, que l'application de la Convention de 1969 s'imposait.
Grâce à la procédure américaine, nous avons pu réaliser l'exploit d'atteindre la réalité économique derrière les pavillons de complaisance. Il s'agit, à mes yeux, d'un point très important.
L'affaire du Tanio est selon moi à la fois assez positive et décevante. Le naufrage de ce bateau remonte au 7 mars 1980 : 30 000 tonnes de pétrole se sont répandues en mer et tout est arrivé essentiellement sur les Côtes-du-Nord. Nous avons réveillé les mêmes comités de coordination avec M. Josselin et avec différents élus. Nous avons élaboré les dossiers, un à un, avec le FIPOL. Nous avons réussi à négocier avec le FIPOL. Nous n'avions pas besoin de faire de procès. En effet, la Convention de Bruxelles de 1971 était en vigueur.
Je garde un assez mauvais souvenir de notre négociation avec le FIPOL qui, dossier par dossier, hôtel par hôtel, commune par commune, ressemblait à une négociation de « marchands de tapis ». Nous n'avons obtenu que 62 % des indemnités auxquelles nous avions droit, parce qu'il n'y avait pas assez d'argent mobilisable.
L'affaire du Tanio est assez terrible du point de vue financier. Elle a rapporté de l'argent à la République française- 360 millions de francs -, aux communes - 40 millions de francs -, et aux personnes privées - 8 millions de francs. Bien sûr, de tels montants n'étaient pas négligeables par rapport à la jurisprudence initiale. Il faut savoir que dans le passé, on n'indemnisait jamais. En effet, en vertu du droit des hydrocarbures, pendant des années, aux Etats-Unis et en France, on n'indemnisait que le dommage causé par le contact physique avec le pétrole et non pas le dommage économique. Sur le plan du résultat, le niveau d'indemnisation obtenu à la suite du naufrage du
Tanio n'est pas si mauvais. Néanmoins, le FIPOL a une doctrine extrêmement restrictive sur le remboursement des frais et sur celui des dommages économiques et écologiques.
S'il a fallu 14 ans pour faire le procès de Chicago et obtenir 1,4 milliard de francs pour la République française, le secteur privé et le secteur public, il nous a quand même fallu 6 ans, dans le système d'indemnisation institutionnel du FIPOL, pour obtenir 62 % du montant total du préjudice ! Certains faits se passent de commentaires.
Je me suis occupé des affaires de l'Amazone
et du Haven, pour le parc national de Port-Cros où j'ai négocié avec le FIPOL dans des conditions difficiles. Nous avions un dossier très solide avec des dommages écologiques, économiques, à 600 000 ou 700 000 francs pour cet établissement public. Je n'ai pas voulu me lancer dans un procès éternel. Nous avons transigé avec le directeur du FIPOL à 330 000 francs. Dans le cadre d'un procès, j'aurais peut-être eu davantage mes chances. D'ailleurs, nos amis italiens impliqués dans l'affaire ont poursuivi l'instance et ont réussi, parce qu'ils invoquaient une loi italienne sur les dommages écologiques, à obtenir un peu plus d'argent que nous-mêmes. Quand on se trouve en situation de victime, on est un peu sous la dépendance du FIPOL.
Je profite de ma présence ici pour vous dire mes inquiétudes au sujet de l'affaire de l'Erika. Dans ce cas précis, Corinne Lepage et moi-même représentons environ une cinquantaine de communes et 2 000 ou 3 000 personnes. Nous sommes plusieurs avocats et différentes procédures sont en cours, notamment devant les tribunaux de l'ordre judiciaire, pour les expertises maritimes, au pénal, et devant le FIPOL. Je crains très franchement que nous ayons beaucoup de difficultés à payer tout le monde.
Le fonds correspondant à la responsabilité du propriétaire du navire, tel que prévu par la Convention de Bruxelles est de l'ordre de 80 millions de francs. Il vient d'être déposé auprès du tribunal de commerce de Nantes par le propriétaire du bateau. Le délai expirait le 24 avril. Si les victimes n'engagent pas de poursuites contre le propriétaire de l'Erika
dans ce délai d'un mois qui lui est imparti pour déposer le fonds de 80 millions de francs, cela veut dire qu'elles acceptent ce fonds et qu'elles ne contestent pas la limitation de responsabilité du propriétaire du navire. Les victimes doivent casser le plafond de limitation de responsabilité et démontrer la faute personnelle du propriétaire. Or, c'est tout un exploit que de démontrer la faute personnelle du propriétaire !
Il existe deux critères pour établir le lien du propriétaire avec le mauvais entretien du navire. Il faut prouver que le propriétaire avait connaissance d'un certain nombre d'éléments et de surcroît qu'il avait un pouvoir direct sur le fonctionnement du bateau.
Par exemple, si le capitaine commet une faute nautique à lui tout seul - fait une erreur de navigation -, ce n'est pas la faute du propriétaire. Mais si le propriétaire engage un mauvais équipage, alors la faute lui incombe. Si le propriétaire fait naviguer un navire qui n'est pas navigable, c'est également de sa faute. La victime doit cependant le démontrer par expertise.
Nous sommes actuellement obligés de le faire par l'intermédiaire des expertises du tribunal de Dunkerque, où se trouve un collège de 5 experts dont certains sont experts près la Cour de Cassation. Nous nous promenons en Europe pour essayer de démontrer les fautes et le fait que le navire n'était pas en bon état. Avant d'arriver à quoi que ce soit, nous rencontrerons de nombreuses difficultés. Tout le monde va se tourner vers le FIPOL qui dispose de 1,2 milliard de francs.
Selon les premières estimations, l'Etat français va être un grand créancier, ce qui est tout à fait légitime parce que l'Etat dépense toujours des sommes considérables dans ce genre de circonstances. Cela se chiffrera probablement en centaines de millions.
S'agissant du pompage de la cargaison de l'Erika, je vous renvoie au passé. J'ai l'expérience du pompage de la cargaison du
Tanio. Il est très difficile de pomper dans la mer. Les devis pour le marché d'appel d'offres du
Tanio s'élevaient à 46 millions de francs et la facture finale était de 286 millions de francs. Je souhaite bien du plaisir aux entreprises chargées du pompage de la cargaison de l'Erika et je m'interroge sur l'addition financière qui va en ressortir. Certes, la compagnie Total Fina a indiqué, si j'ai bien compris, qu'elle en assumerait financièrement une partie.
M. le Président : Elle en financerait la totalité.
Maître Christian HUGLO : Dans ce cas, elle sera peut-être tentée de demander autre chose. Je vous indique d'ailleurs qu'elle est très active dans les procédures civiles engagées. Si Total Fina peut se faire payer, elle prendra peut-être le coût du pompage à sa charge, mais je n'ai pas encore vu de renonciation de Total Fina au fonds du FIPOL. J'attends toujours qu'on me montre un papier selon lequel cette compagnie pétrolière abandonnerait son droit aux indemnités du FIPOL.
J'ai entendu des déclarations des autorités de l'Etat français et de celles du FIPOL et je voudrais bien voir un écrit de renonciation de Total Fina à son droit à indemnisation. Techniquement, c'est une affaire très difficile. La somme de 1,2 milliard de francs est disponible. Juridiquement, le FIPOL a le devoir d'accueillir des réclamations pendant 3 ans, soit jusqu'en 2003. D'ici là, toute personne qui aura subi un dommage peut réclamer. Normalement, les répartitions se font au marc le franc. Dans l'affaire du
Tanio, la répartition s'est faite au marc le franc : nous avons défini une masse, nous avons regardé ce qui était disponible, et nous avons calculé un pourcentage d'indemnisation pour tous. De cette façon, nous sommes arrivés à 62 % du montant du préjudice. Je crains que dans le cas de l'Erika, il n'y ait pas indemnisation à 100 % des personnes qui ont subi des pertes.
Pour les communes fortement exposées, le préjudice se situe actuellement entre 5 et 15 millions de francs. Les dépenses sont considérables. Je lisais ce matin que dans certains endroits, notamment de la côte Atlantique, on a rouvert l'ostréiculture et la pêche. Les dommages sont tout à fait considérables. Total Fina a peut-être renoncé sur le papier, encore que je connais bien ses avocats et que je sais comment se passe un procès de ce genre, mais si tout le monde se présente, croyez-moi, il n'y aura pas assez d'argent pour indemniser.
Nous n'avons pas encore fait d'expertise sur les dommages. Je pense que l'Etat a droit à des dédommagements importants. Autant j'étais « maritimiste » par adoption il y a quelque temps, autant en tant que juriste, je suis profondément choqué par le système du droit maritime. En effet, je le trouve complètement inadapté. On est dans une autre logique et il faut le dire : on est dans une logique de dommages causés par une cargaison et non pas dans une logique classique d'un dommage causé par un navire. C'est tout à fait autre chose !
Il est tout à fait anormal que les bénévoles doivent nettoyer, que les élus doivent retrousser leurs manches. Comme pour les affaires du
Tanio et de l'Amoco-Cadiz, je vais faire compter le temps passé par les élus pour superviser la lutte contre la pollution de l'Erika comme rémunération d'ingénieur des travaux publics. Il n'y a aucune raison que ce cadeau soit fait aux pollueurs. Nous avions plaidé cette affaire à Chicago et, malheureusement, la jurisprudence de la Cour de Cassation s'est retournée deux mois après le procès. Nous n'avons pas pu obtenir la rémunération des bénévoles. Juridiquement, le bénévolat est un service qui se fait dans l'intérêt de l'auteur du dommage et l'auteur du dommage doit le rembourser. Je vous assure que je ne ferai pas de cadeau sur ce genre de questions.
Avant de venir, j'ai lu attentivement le rapport du Commissaire européen en charge des transports, Mme Loyola de Palacio. Il est très intéressant. Elle formule des propositions au Conseil des ministres européens tout en réservant un accueil favorable aux propositions françaises, que j'appuie complètement parce que des points importants y sont abordés par le ministre des Transports, sur la sécurité et sur les sociétés de classification. Mme Loyola de Palacio propose au Conseil des ministres européens de dépasser la Convention de Bruxelles de 1969, à travers un système de sécurité responsabilisant le propriétaire de la cargaison. Elle propose, en fait, de doubler le système de la Convention de Bruxelles de 1969 et de mettre à disposition, dans l'avenir, une somme d'un milliard d'euros, soit 6 milliards de francs.
C'est tout à fait révolutionnaire, au sens strict du terme, du point de vue juridique. Cela mérite d'être encouragé. On ne peut pas laisser des populations littorales, des gens dont l'activité est étroitement liée au milieu marin, dans un tel marasme. Je vous avoue que je n'aime pas l'exploitation médiatique - vous ne m'avez d'ailleurs pas beaucoup vu - de la détresse de ces gens. L'assistance des victimes qui se posent beaucoup de questions sur ce qu'elles peuvent faire ou pas, est beaucoup plus difficile qu'elle ne l'était suite au naufrage de l'Amoco-Cadiz. Dans l'affaire de l'Amoco-Cadiz, il y a eu une mobilisation extraordinaire des Bretons, toutes tendances politiques confondues. On n'a pas eu de mal à animer une population pour la faire se battre à l'étranger. Même si les difficultés du procès ont été énormes, l'exploit a été réalisé. Il était difficile de rassembler des milliers de personnes pour attaquer une seule société, qui plus est à l'étranger.
Or, dans l'affaire de l'Erika, vous trouvez des gens qui ont des intérêts divers. Les victimes ne sont pas unies, ce qui profitera aux pollueurs et aux personnes qui doivent payer. Chacun est libre de se défendre, mais certaines choses m'ont choqué. Les gens demandent la désignation de responsables. Ils voudraient vraiment que le droit change. Or, quand vous leur donnez des formulaires du FIPOL à remplir, ils quittent la salle sans les prendre. C'est stupéfiant ! Il y a un système d'indemnisation, de mutualisation du risque qui devrait être facile à mettre à contribution, mais finalement, ce n'est pas ce qui intéresse les gens. Il existe un mouvement de fond, que je regarde comme observateur, de gens qui tirent à droite et à gauche. Des signes sont attendus dans le sens d'un changement du droit, d'où l'intérêt de votre commission d'enquête parlementaire.
Pardonnez-moi ce discours franc, mais tout à fait sincère.
M. le Président : Intéressant en tout cas.
M. le Rapporteur : Comment imaginez-vous que l'on puisse changer le dispositif du FIPOL ? On voit bien les lacunes du système. Vous avez insisté sur le fait que le FIPOL ne payait qu'à contrec_ur et avec beaucoup de difficulté. Est-ce qu'un système différent peut être envisagé pour assurer immédiatement le remboursement des préjudices ? Il y a, en effet, un besoin financier immédiat qui se fait sentir.
Deuxièmement, sur cette affaire de l'Erika, comment imaginez-vous que l'on puisse établir, globalement, un diagnostic du préjudice financier sur la totalité de la côte Atlantique ? C'est une question que l'on se pose dans l'association créée récemment entre les régions des Pays de Loire, de la Bretagne et de Poitou Charentes. Il faudra bien dépasser le préjudice de chacune des communes prises individuellement pour se poser globalement le problème du préjudice écologique, économique, d'image, de l'ensemble de la zone concernée. Existe-t-il des moyens juridiques et techniques d'effectuer une telle évaluation globale ?
Maître Christian HUGLO : Je vais rebondir sur votre première question. Vous avez parlé du FIPOL et du système d'indemnisation des pollutions par hydrocarbures. En ma qualité d'enseignant du droit de l'environnement, je considère que le principe de la responsabilité civile a une double valeur : il a non seulement une valeur réparatrice car la personne à la source du dommage doit être condamnée et désignée par les tribunaux pour réaliser la compensation financière, mais également une valeur pédagogique. En effet, quand vous êtes dans un système de mutualisation du risque, les différents acteurs n'ont plus qu'à attendre que cela passe et le FIPOL fait le travail pour les responsables. Dans les cas de catastrophes naturelles, la mise en _uvre de la solidarité nationale et l'attribution de sommes considérables aux victimes ne font pas l'objet de contestations. Cependant, cette solidarité nationale n'incite pas les principaux acteurs à conduire les plans de risque imposant aux communes de prendre les différentes dispositions nécessaires et aux constructeurs de prendre les précautions nécessaires. On sait que l'indemnité va arriver.
Le système du FIPOL est un système de confort escamoteur de la responsabilité. Voilà ce que j'en pense sur le fond des choses.
Dans l'affaire Amoco-Cadiz, quand on a poursuivi
Standard Oil of India, la compagnie a été gênée de voir son organisation démontée, à tel point qu'elle l'a réorganisée avec son système de contrôle. Cette action s'est révélée utile. Je signale au passage que le
Haven, navire qui a sombré en Méditerranée, est un bateau s_ur de l'Amoco-Cadiz.
Le FIPOL ne connaît pas ce qu'on appelle les demandes urgentes. Il n'existe pas de quelconques facilités pour obtenir des demandes d'urgence en référé. Le FIPOL est une administration qui a ses bureaux à Londres. Les gens du FIPOL ne sont pas pressés et travaillent selon des règles très précises. Leur problème est de rendre la mobilisation de l'argent et le paiement des victimes les plus tardifs possibles. Ce n'est pas une logique judiciaire contradictoire, mais une logique de bureaux : vous discutez avec une compagnie d'assurance. Si vous voulez améliorer le système du FIPOL, il faudrait en modifier le règlement de manière à permettre de mener une procédure. À l'heure actuelle, c'est la plus totale discrétion sur les indemnisations.
Le fonctionnement du FIPOL présente deux problèmes : premièrement, ses responsables partagent des dommages et vous ne savez pas pourquoi ; deuxièmement, les indemnités parviennent très tard aux victimes, beaucoup plus tard que vous ne le pensez en tout cas. Pour le
Haven, j'ai dû transiger quatre ou cinq ans plus tard. Avec un référé, je fais aussi bien !
Dans le système du FIPOL, il n'y a ni procédure d'urgence, ni procédure contradictoire, ce qui est très gênant.
S'agissant de l'évaluation globale du préjudice, Corinne Lepage et moi-même sommes avocats de la région Poitou-Charentes et nous coordonnons étroitement nos travaux - ce qui n'est pas le cas de tous les avocats choisis par les régions - avec des avocats de Loire-Atlantique et de Rennes. Nous avons rencontré les régions, les départements, et nous avons mis un plan au point. Nous avons d'ailleurs proposé une méthode de travail qui n'a pas été acceptée par la totalité des avocats. Un d'entre eux est actuellement en retrait, il s'agit de Maître Alexandre Varaut.
M. René LEROUX : C'est l'avocat de la Loire Atlantique.
Maître Christian HUGLO : Oui, mais d'après ce que je comprends, la région Loire-Atlantique aime bien Maître Pittard, excellent avocat de droit public. Or, Maître Varaut ne veut pas se couler dans le moule global. Nous sommes prêts à mener un certain nombre d'actions en commun, à nous coordonner, mais Maître Varaut préfère rester à la lisière. Il ne paraît pas vouloir et ne souhaite pas adopter la même stratégie que nous-mêmes, à savoir Maître
Pittard, Maître Druais et Corinne Lepage. Un seul d'entre nous n'est pas d'accord et le mécanisme est bloqué. Nous devons cependant quand même avancer.
Je n'ai pas déclenché les expertises, et ceci pour deux raisons.
Premièrement, je ne voulais pas d'une expertise menée par les experts du tribunal des Sables-d'Olonne. Je trouve que c'est une erreur d'avoir intenté un procès devant le tribunal de grande instance des Sables d'Olonne qui, me semble-t-il, n'a pas nécessairement vocation à s'occuper de la Loire-Atlantique ou du Morbihan. J'aurais préféré demander une expertise au tribunal administratif, tribunal interdépartemental, avec un collège d'experts, et dégager exactement les 14 catégories de dommages que nous avions dégagées lors de l'affaire de l'Amoco-Cadiz. Deuxièmement, j'attends que les choses se stabilisent pour harmoniser les demandes. Il faut que Maître Varaut accepte d'arrêter son procès aux Sables-d'Olonne, ce qui n'est pas évident. J'avais proposé de prendre les experts des Sables-d'Olonne pour les intégrer dans la procédure au tribunal administratif de Nantes. Cela me paraît plus sage et c'est le moment pour le faire. Il faut attendre que le préjudice soit un peu consolidé et que l'on y voit un peu plus clair.
Le FIPOL nous a dit que si nous faisions des expertises, il ne payerait pas. C'est extraordinaire ! Afin d'aider les gens au mieux, j'ai conseillé aux collectivités locales d'essayer de se faire payer le plus vite possible, là où c'était possible. L'Etat a mis de l'argent à disposition des collectivités publiques qui seront remboursées sur factures. Mais pour aller plus loin avec le FIPOL, il faut constituer un dossier suivant des canons particuliers. Il faut également se mettre d'accord sur l'évaluation de certains coûts tels que la rémunération des employés municipaux, le temps dépensé par les maires. Or, les personnels du FIPOL ne veulent pas d'expertise. Ils attendent que l'expertise judiciaire soit terminée pour payer.
Etant pris dans un dilemme, nous avons donc coupé les dossiers en deux : tout ce qui concerne les dépenses directes, les factures, est présenté de façon incontestable ; et tout ce qui concerne l'appréciation des dommages sera présenté de façon harmonisée par la suite.
Ma réserve stratégique personnelle est de garder pour la suite les demandes d'indemnisation des dommages écologiques, des dommages de restauration, et des dommages pour l'image de marque, dans l'hypothèse où nous serions obligés de faire un procès civil aux assurances anglaises devant le tribunal de commerce de Nantes. Cela ne s'avère pas très facile. Les assurances anglaises voient très bien arriver les choses. Elles entendent invoquer la faute inexcusable de l'assuré. On va disposer de 1,2 milliard de francs du FIPOL, mais pour obtenir des fonds de la part des assureurs, ce ne sera pas évident. Par ailleurs, ne cherchons pas trop d'argent du côté des sociétés de classification, même si elles ont commis des fautes incontestables dans cette affaire.
Je précise au passage qu'il y a une grande similitude entre l'affaire du
Tanio et celle de l'Erika. Le Tanio était un pétrolier qui appartenait à Elf et qui a été revendu à une société malgache dans un état épouvantable, réparé dans les mêmes chantiers italiens. J'ai consulté le dossier avant de venir ici : vous trouvez les mêmes problèmes. Dans l'affaire du
Tanio, nous avons réussi à obtenir un supplément d'indemnité parce que nous avons transigé avec les assurances anglaises.
Pourrons-nous, dans le cas du naufrage de l'Erika, pousser le procès jusqu'au bout ? Peut-être obtiendrons-nous quelque chose des assurances anglaises, dont je précise qu'elles ne sont pas les assurances des sociétés de classification. Je crains que nous ne puissions tirer plus de 30 ou 40 millions de francs du côté des sociétés de classification. Je pense qu'il est possible de mettre en cause la responsabilité du RINA, mais probablement pas celle du Bureau Veritas. Pour ce qui concerne l'American Bureau of Shipping, nous n'en savons rien. Le plus vraisemblable serait la mise en cause du RINA, mais son assurance n'est pas très forte : en cas de sinistre industriel, sa police d'assurance est assez faible. Il va falloir se battre !
M. Louis GUEDON : J'aimerais obtenir une simple précision. Vous nous avez dit que dans le droit maritime, on avait coutume de se retourner vers l'armateur, considérant que la pollution était de la responsabilité du bateau. Les faits venant d'évoluer, on s'aperçoit que les dommages ne sont pas liés au bateau lui-même, mais véritablement à la cargaison qu'il transporte. Par conséquent, le propriétaire de la cargaison ne peut rester étranger à ce type de sinistre.
Vous avez également expliqué que vous étiez profondément inquiet sur le montant de 1,2 milliard de francs disponible au FIPOL, puisque cette somme serait bien inférieure à l'évaluation provisoire que vous faisiez du sinistre.
Ma question est donc la suivante : a-t-on des chances de pouvoir se retourner vers ce responsable que vous mettez en évidence, c'est-à-dire le propriétaire de la cargaison ?
Maître Christian HUGLO : Je n'ai pas de ranc_ur contre Total Fina, cela m'est complètement indifférent. Du point de vue du droit français, la chose est d'une simplicité absolue. En effet, il existe un arrêt Geiger du Conseil d'Etat, qui date du 18 novembre 1998. En interprétant l'article 3 de la loi de 1975, cet arrêt a donné le pouvoir au maire, en tant qu'autorité de police, de prendre des dispositions pour faire évacuer des déchets sur son territoire. En matière d'environnement, la police spéciale appartient au préfet. Mais là, le Conseil d'Etat a considéré que l'article 3 de la loi précitée, qui dispose que « toute personne qui abandonne des déchets peut être mise en demeure par l'autorité de police de les évacuer ; à défaut, il y aura consignation des sommes », concerne également les navires. Quand j'ai vu cet arrêt que j'ai commenté, je me suis dit qu'on allait l'appliquer à l'affaire de l'Erika. J'ai donc suggéré aux différents maires de la Loire-Atlantique de prendre des arrêtés municipaux, qui permettraient, après la première mise en demeure, de demander au responsable des déchets - dans ce cas, sans contestation possible, la société Total Fina -, de consigner une somme d'argent. Après cela, on suggérera d'émettre des titres de perception et de recouvrement. Cela avait d'ailleurs été dit par le doyen Vedel dans l'affaire
Amoco-Cadiz. Il m'avait dit : « C'est tout de même dommage que nous ne soyons pas en France parce que vos communes prenaient des dispositions à titre exécutoire et elles en recouvraient le financement sur le pollueur. » Cela m'est resté en mémoire et je me suis dit que si un jour il y avait la possibilité d'agir dans ce sens en France, on le ferait. Il faut une base légale, or elle existe : c'est la loi de 1975.
Pourquoi cette loi est-elle applicable ? Un décret du 15 mai 1997 a transcrit une directive européenne sur les déchets. Il y est écrit, dans le tableau « déchets dangereux » que « sont des déchets dangereux : les hydrocarbures accidentellement répandus. » Or, la cargaison de l'Erika
est constituée d'hydrocarbures et le naufrage du navire les a accidentellement répandus dans la mer. La directive de 1975, concomitante à la loi, ne distingue pas le propriétaire et le détenteur de déchets. En effet, la défense de Total Fina consistera à dire que ce n'est pas la compagnie qui a répandu les déchets, mais le propriétaire de l'Erika. Or, c'est faux : le responsable de l'évacuation des déchets est le détenteur de la cargaison, même s'il en a confié le transport à quelqu'un par voie conventionnelle.
M. le Rapporteur : Mais Total Fina n'était pas propriétaire de la cargaison au moment de l'accident...
Maître Christian HUGLO : La compagnie n'était pas propriétaire de la cargaison, mais elle est détenteur des déchets, au sens matériel du terme. Une fois que les hydrocarbures sont arrivés sur la plage, ils appartiennent à Total Fina qui doit les évacuer.
M. René LEROUX : Vous considérez donc que le fioul souillant nos plages est un déchet ?
Maître Christian HUGLO : C'est un déchet par désignation de la loi. Je ne suis pas dans la controverse déchet / fioul lourd. Je n'ai aucun élément pour le dire et j'ai horreur d'affirmer des choses que je ne sais pas. J'ai quelques idées à ce sujet, mais j'attends les expertises. Je trouve que la polémique, qui n'est pas prouvée, est déplacée et inintéressante. Mais pour faire fonctionner la loi, c'est imparable : je n'ai qu'un critère formel à appliquer, celui de la directive européenne selon laquelle ce sont des hydrocarbures accidentellement répandus. Si on regarde la philosophie de la réforme, on constate qu'elle va exactement dans votre sens. Mme Loyola de Palacio réclame l'application du Livre blanc de la Commission européenne sur la responsabilité environnement, et le retour au principe « pollueur payeur » sur ces questions.
Dans l'état actuel des choses, je peux vous dire que les préfets n'ont pas déféré les arrêtés des maires au tribunal administratif.
M. René LEROUX : De toute façon, tous les maires n'en ont pas pris.
Maître Christian HUGLO : Ils ne sont, en effet, pas obligés de les prendre, mais il n'y a pas eu de déféré préfectoral, ce qui semble être une bonne chose. Devant le tribunal administratif de Nantes, nous avons formulé la demande d'un référé injonction : nous avons demandé au tribunal la possibilité d'envoyer des injonctions à Total Fina pour reprendre l'ensemble des déchets qui restent sur les plages, et les déchets stockés à côté.
Je dois vous dire très franchement que j'ai téléphoné vingt fois à l'avocat de Total Fina en lui disant que j'attendais que la compagnie fasse un geste pour les communes. Il ne s'est rien passé et les représentants de Total Fina se promènent dans les communes en proposant de l'argent à droite et à gauche, sans offrir de services. Moi, je ne veux pas d'argent ; je veux que la compagnie pétrolière fasse son travail. Si elle accepte d'engager un nettoyage fin pour les vacances de Pâques et les grandes vacances, un travail immense restera à faire. Les communes ont besoin d'argent.
Je vais voir ce que va dire le tribunal administratif de Nantes sur l'injonction. Il risque de me répondre qu'une collectivité publique n'a pas besoin d'adresser d'injonction, conformément à la jurisprudence « préfet de l'Eure ». Si tel est le cas, j'avancerai mon dossier. Il faut une réparation effective, en fonction du droit des déchets.
Nous avons trouvé là un biais juridique, celui du droit de l'environnement, qu'il faut appliquer en toute sérénité.
M. le Rapporteur : Et non plus le droit maritime ?
Maître Christian HUGLO : Non, parce que le déchet est sur la plage, qu'il nous appartient à tous, et qu'il doit être géré pour ce qu'il est.
M. François GOULARD : S'agissant des victimes, pensez-vous qu'il y a un terrain intéressant dans la mise en cause de la responsabilité de l'Etat ?
M. Pierre HERIAUD : Nous avons entendu l'exposé d'une personne très expérimentée. Personnellement, j'ai le sentiment que nous envisageons le problème, non pas en partant du général vers le particulier, mais en l'abordant sous l'angle de la somme des points particuliers. Il me semble qu'il est difficile d'avoir une vision générale. J'aimerais connaître la méthode que vous employez pour recenser et estimer l'ensemble des préjudices. Sont actuellement concernés : les particuliers, les entreprises, les communes, l'Etat, les départements et les régions. Dans la mesure où tout le monde intervient, il y a un phénomène de cascade. Or aujourd'hui, des communes ont déposé, ont émis des factures, ont été remboursées pour partie. Des sommes sont connues au niveau de l'Etat, mais à charge pour lui de se retourner éventuellement comme victime pour aboutir à une indemnisation par le FIPOL, si les fonds sont suffisants. J'aimerais donc connaître aujourd'hui la méthode avec laquelle vous avancez, et l'état, pas à pas, de la procédure suivie avec les estimations des différents dommages.
M. François CUILLANDRE : Dans votre propos introductif, vous avez évoqué les risques de la commission d'enquête parlementaire sur le procès de l'Amoco-Cadiz. Pourriez-vous expliciter davantage ?
Deuxièmement, en votre qualité de praticien du droit, vous connaissez le procès de l'Amoco-Cadiz ; pour ma part, je le connais un peu également. Ce procès a selon moi été marqué par trois aspects : sa complexité, sa longueur, et son coût. Ce procès est une victoire du pot de terre contre le pot de fer. Toutefois, ce n'est pas une victoire financière, en tout cas pas pour le syndicat mixte de protection et de conservation du littoral nord-ouest de la Bretagne, et ceci à deux niveaux : celui des indemnités obtenues au regard des indemnités demandées et celui des indemnités obtenues au regard du coût du procès. Seul le geste de l'Etat,
in fine, a permis au syndicat mixte d'indemniser les communes sinistrées. J'aurais souhaité avoir votre avis sur le sujet. Par ailleurs, n'existe-t-il pas le même risque pour l'affaire de l'Erika ?
M. André ANGOT : La presse a évoqué un protocole d'accord qui aurait été conclu entre le Gouvernement et la société Total Fina, selon lequel pour le pompage du fioul qui reste dans les deux parties du bateau, il y aurait une obligation de moyens et non de résultats. Compte tenu des grandes difficultés à pomper ce fioul qui va devoir être réchauffé, ne risque-t-on pas de voir la société Total Fina abandonner ce pompage ? Sachant que, dans cette hypothèse, il resterait une grande quantité de fioul dans l'épave qui, au fur et à mesure de la dégradation des restes du navire, risquerait de remonter à la surface, existe-t-il une possibilité d'indemnisation si ce fioul devait s'échouer sur les côtes plusieurs années après le naufrage ?
M. René LEROUX : Vous avez interpellé les maires touchés par cette catastrophe quand vous avez dit que les victimes ne sont pas unies. J'aimerais que vous précisiez votre pensée. Comme vous l'avez fort bien expliqué, lors de la catastrophe de l'Amoco-Cadiz, un syndicat mixte avait été créé. Il est vrai que nous n'en sommes pas là, mais il y a une telle superposition de création d'associations départementales, régionales, inter-régionales, qu'au bout d'un moment, nous, les maires, craignons d'être finalement les victimes de tout. A l'issue de cette affaire, tout le monde va toucher des indemnités avant les communes qui n'auront rien, alors que comme vous l'avez dit tout à l'heure, les maires devraient être indemnisés tels des ingénieurs sur le terrain.
Comme je l'ai dit au département et à la région, je suis très inquiet. Mais quand vous dites que les victimes ne sont pas unies, en comparaison de l'affaire de l'Amoco-Cadiz, je suis encore beaucoup plus inquiet.
Mme Jacqueline LAZARD : Je voudrais poser une question très courte. Dans votre propos, vous avez parlé des risques ou du danger qu'avait fait courir l'enquête parlementaire, au moment du procès de l'Amoco-Cadiz. Pouvez-vous préciser votre propos ?
Maître Christian HUGLO : Dans l'affaire de l'Amoco-Cadiz, nous avons gagné grâce à la procédure de
discovery. Quand vous faites un procès aux Etats-Unis, ce n'est pas comme en France, où vous délivrez une assignation et où vous communiquez des pièces. Aux Etats-Unis, c'est la procédure de
discovery, et cela commence par des questionnaires : vous envoyez à la partie adverse 2 000, 3 000, 5 000 questions. La personne est obligée d'y répondre. A partir de cette procédure de découverte sur questions, si vous ne répondez pas, le juge fait injonction, et des amendes tombent. Vous établissez ensuite une liste de personnes que vous entendez déposer.
Après cela, il y a la découverte sur documents, et tout le monde est obligé de fournir les documents. Nous avons pu connaître la fuite de l'Amoco-Cadiz grâce au bordereau de consommation de liquide hydraulique : il consommait dix fois plus que la normale et nous en avons déduit qu'il y avait un mauvais entretien. C'est donc grâce à la procédure de
discovery que nous avons gagné.
Il y avait cependant, de la part de la compagnie Amoco, une forte demande qui nous a mis en difficulté pendant un certain temps. Selon les défenseurs d'Amoco, il y avait une faute de l'Etat français et deux enquêtes parlementaires, celles de l'Assemblée nationale et du Sénat, avaient des éléments là-dessus. L'Amiral a été décoré le jour de l'accident de l'Amoco-Cadiz. Personne n'a pris la responsabilité d'intervenir, ce qui était vrai. Par conséquent, la partie adverse a engagé une action reconventionnelle. Les Américains, d'une offensivité que vous ne pouvez pas imaginer, ont exigé du juge la production de deux choses. La première, complètement stupide pour nous, en droit français, était le rapport du conseil des ministres du 17 mars 1978. Tout le monde sait qu'au conseil des ministres, il n'y a pas de compte rendu. Ils ont fait des procédures pour tenter de l'obtenir. La seconde était non pas le rapport imprimé des commissions d'enquête parlementaires, mais les dépositions des officiers, en particulier des officiers de Marine nationale qui établissaient un certain flottement dans les ordres. J'ai défendu la France et la Bretagne, mais nous n'avons pas été très brillants à cette époque précise parce que c'était la première fois que cela arrivait. L'Etat invoquait l'ordonnance du 17 novembre 1958. Il s'est trouvé un professeur de droit que je ne nommerai pas, et qui a d'ailleurs failli être poursuivi, pour dire que le secret demandé aux personnes sur les travaux non publics d'une commission d'enquête n'avait aucune valeur ; c'était inadmissible. C'est au vu de cette consultation que le juge a rendu une ordonnance. Il a donné à l'Etat français une amende de l'ordre de 300 000 dollars. La consultation d'un professeur de droit selon lequel on pouvait découvrir les dépositions des personnes ayant été entendues devant une commission d'enquête parlementaire a coûté très cher à la République française.
M. François CUILLANDRE : Est-ce que c'était un professeur de droit français ?
Maître Christian HUGLO : Oui. Ce n'était pas très bien. Le décret-loi de 1936 a interdit à un professeur de droit de consulter contre l'Etat, et surtout dans un procès à l'étranger. C'est un des risques des procédures et on ne peut pas toujours tout prévoir.
S'agissant de la responsabilité de l'Etat, elle existe dans les différentes affaires, mais elle est tellement difficile à mettre en _uvre que les victimes n'auraient aucune chance en la recherchant. Heureusement, le juge Mc-Garr, à Chicago, ne s'y est pas trompé. Il a recherché la cause première en raisonnant de la sorte : « ce navire a un gouvernail mal entretenu et qui fuit ; l'équipage ne respectait pas le manuel ; la cause première est effectivement que ce bateau est tombé en panne. »
Nous allons raisonner de la même manière dans l'affaire de l'Erika. Nous allons dire que la cause première est que ce navire aurait dû être réparé beaucoup plus vite, qu'on l'a laissé partir avec des tôles en faiblesse, alors qu'il aurait dû être mis en révision pour refaire un certain nombre de choses. Telle est la cause première.
Quand on analyse les causes des accidents, je suis frappé de constater le plus souvent un retard d'intervention. Nous savons que des efforts extraordinaires ont été faits à Ouessant, mais le danger est tellement fort qu'il faut avoir des gens en permanence. Dans la chronologie de l'Erika, 24 heures ont été perdues. Les personnes ont été sauvées le lendemain, mais on a tardé à ramasser l'épave et la partie arrière. Lors du naufrage du
Tanio, les Abeilles ont remorqué la partie arrière du navire qui contenait pas mal de pétrole, et ils l'ont ramenée au Havre. Dans le cas présent, ils sont arrivés un peu tard sur zone.
La responsabilité de l'Etat est la prévention et la préparation de la lutte contre les pollutions. Par rapport à la causalité, il faut être clair, c'est une responsabilité de seconde zone. En toute hypothèse, je vois très mal un tribunal administratif accueillir une action des victimes reposant sur la mise en cause de la responsabilité de l'Etat. Il faudrait admettre la théorie du risque auprès d'une région ou une faute lourde. C'est difficile à faire et on entraînerait les gens sur une mauvaise voie. Je pense que ce n'est pas aux contribuables de payer, mais aux pollueurs. La philosophie de ma réponse est celle-là.
En ce qui concerne l'expertise des préjudices, j'ai apporté ce que j'avais monté dans le dossier de l'Amoco-Cadiz. Nous avons des idées très précises des réclamations que l'on peut formuler pour les personnes publiques et les personnes privées. J'ai déjà les rapports des tribunaux administratifs. Au sein d'une commission de cinq personnes, nous avons travaillé pendant des mois pour monter les dossiers de dommages.
Je peux vous dire rapidement tout ce que l'on peut essayer de réclamer intelligemment pour les personnes publiques : rémunération du personnel communal, rémunération des volontaires et du travail des élus, travaux sur les ports et les ouvrages publics correspondants, routes faites, routes à faire, programmes de rétablissement du littoral, retards d'investissements, perte d'image de marque. En son temps, j'ai fait condamner la Montedison à 500 000 francs de dommages et intérêts pour atteinte à l'image de marque de la Corse. Il y a eu d'autres décisions sur ce point.
Il est assez difficile d'obtenir réparation de la perte de jouissance des habitants : en effet, en droit administratif, il existe une théorie selon laquelle lorsqu'un ouvrage public n'est pas disponible, la commune a droit à une indemnisation pour perte de jouissance. Par exemple, un constructeur doit vous livrer un stade, le stade n'est pas prêt à temps, et la commune ne peut pas le mettre à la disposition des habitants. Des indemnités sont prévues dans la jurisprudence du Conseil d'Etat. Ce n'est pas extraordinaire, mais on peut le demander.
Les pertes écologiques définitives sont très difficiles à demander. Cela concerne simplement des programmes de restauration. C'est ce que nous avions demandé dans l'affaire de l'Amoco-Cadiz, mais cela n'a pas été retenu par le juge qui nous a répliqué, en substance, que de toutes façons, la mer réparera. Ce n'était pas une réponse. Il y avait quand même un trouble de jouissance et un trouble à terme.
Enfin, les opérations de repeuplement peuvent faire l'objet de dédommagements pour les collectivités publiques.
Voilà ce que l'on peut demander pour les personnes publiques.
S'agissant des personnes privées, ce sont des pertes économiques. L'évaluation doit être faite en perte de chiffre d'affaires et non pas en perte de bénéfice. C'est le drame du FIPOL.
M. René LEROUX : C'est par rapport à l'excédent brut d'exploitation que le FIPOL calcule l'indemnité due.
Maître Christian HUGLO : Absolument.
J'ai effectivement indiqué que les victimes ne sont pas unies. Une première réunion inter-régionale assez positive a eu lieu. On nous a demandé un rapport que j'ai rédigé. Nous attendons des réactions. Je crois comprendre que les régions seraient assez prêtes à aider les collectivités locales à financer les expertises dommages, c'est-à-dire à prendre à leur charge les expertises dommages des communes pour chiffrer leur préjudice. En effet, il faut faire ces expertises au tribunal administratif avec un collège d'experts. Cela représente un coût important.
Nous ne les avons pas encore lancées pour deux raisons. Tout d'abord, parce que le FIPOL nous disait que si l'on faisait des expertises, les dommages directs ne seraient pas payés. Ensuite, j'attendais que le préjudice soit un peu consolidé. Nous allons pouvoir commencer à le faire après les vacances de Pâques. C'est une question de coordination d'avocats.
J'en reviens à la question de M. Cuillandre au sujet de l'affaire de l'Amoco-Cadiz. Dans cette affaire, nous avons été très audacieux ! Nous n'avions que 15 millions de francs de factures payées par les communes et non par l'Etat. Il s'agit du dossier préparé par un ancien fonctionnaire du Conseil général des Côtes du nord, Monsieur Gaspaillard. Le reste était payé par l'Etat. Le syndicat mixte a quand même touché 230 millions de francs grâce aux intérêts. J'aurais souhaité beaucoup plus, mais tout nous a été cassé par le juge qui a totalement refusé de prendre en considération le préjudice écologique et le programme de rétablissement des lieux, avec des expériences de repeuplement, élaboré par la faculté de Brest. Le juge a considéré que de toutes façons, la mer réparera. C'était terminé.
En fait, nous avons été très desservis dans la deuxième partie du procès, par la procédure de
discovery. Malheureusement, les témoignages des élus se sont effondrés un à un pour les raisons que je vous ai déjà exposées.
Pour terminer, j'aborderai la question des dommages. Le délai de 3 ans court à partir du moment de l'apparition du dommage. Il s'agit d'une exigence classique en droit de l'environnement. La prescription ne court qu'à partir du moment où le dommage est apparu objectivement. C'est une réponse strictement juridique, mais qui permet un accès aux mécanismes prévus par la Convention portant création du Fonds.
M. le Rapporteur : A propos du FIPOL, il y a un point sur lequel je souhaiterais avoir votre avis d'expert. Comment est apprécié le « caractère raisonnable » des mesures de remise en état auxquelles est subordonnée l'indemnisation ? Dans les textes du FIPOL, il est fait mention de ce « caractère raisonnable » dont la définition apparaît assez subjective.
Maître Christian HUGLO : Un article de doctrine a été écrit dans la revue du commerce international par M. Jacobsson et l'un de ses assistants. Cet article résume la doctrine du FIPOL qui apparaît clairement comme une doctrine anglo-saxonne assez réaliste en apparence. Là où les responsables du FIPOL sont très malins, c'est qu'en réalité, ils négocient commune par commune, personne par personne. Le caractère raisonnable, c'est ce qu'ils apprécient eux-mêmes quand cela leur fait plaisir ! C'est aussi simple que cela.
M. le Rapporteur : Peut-on contester les critères retenus par le FIPOL ?
Maître Christian HUGLO : On ne peut pas les contester devant un tribunal. Nous avions pensé contester les choix du FIPOL devant une juridiction londonienne puisqu'il a son siège à Londres. Juridiquement, c'est tout à fait possible, mais allons-nous nous engager dans une procédure de ce genre ?
La meilleure réponse possible est une négociation uniforme. Croyez-moi, je travaillerai sur ces questions, car c'est mon grand souci. C'est une question de volonté des élus. Les élus doivent imposer aux avocats qu'ils ne fassent pas cavalier seul. Nous sommes là pour rendre service et pas pour faire la une des médias, ce qui n'est pas notre vocation. Les élus doivent exiger de leurs avocats qu'ils leur rendent des comptes comme je l'ai fait tous les trois mois environ pendant 10 ans devant l'assemblée générale du syndicat mixte de protection et de conservation du littoral nord-ouest de la Bretagne. Si vous avez besoin du concours du Bâtonnier de Paris sur cette question, je peux vous dire qu'il vous aidera très volontiers.
Audition de M. Jean-Pierre PAGE,
directeur du
Lloyd's Register of Shipping pour la France
(extrait du procès-verbal de la séance du mercredi 5 avril 2000)
Présidence de M. Daniel PAUL, Président
M. Jean-Pierre Page est introduit.
M. le Président lui rappelle que les dispositions législatives relatives aux commissions d'enquête lui ont été communiquées. A l'invitation du Président, M. Jean-Pierre Page prête serment.
M. Jean-Pierre PAGE : M. le président, madame, messieurs les députés, je suis entendu en tant que directeur pour la France du Lloyd's Register of Shipping sur le sujet de la sécurité du transport maritime de produits polluants et de matières dangereuses. J'expliciterai donc le rôle des sociétés de classification dans ce domaine.
Pour comprendre la situation et la position actuelles des sociétés de classification, il est important, me semble-t-il, de faire quelques rappels historiques.
Les sociétés de classification, du moins pour les plus importantes d'entre elles, sont assez anciennes. La date officielle de la constitution de la plus ancienne d'entre elles, le Lloyd's Register of Shipping, est 1760. Les autres grandes sociétés de classification ont toutes été créées dans les premières années du XIXème siècle : le Bureau Veritas en 1828 et la société japonaise NKK en 1869.
Les sociétés de classification ont toutes été crées sous l'impulsion des assureurs maritimes. Le développement du commerce maritime international, qui, à l'époque était d'ailleurs plutôt local qu'international, s'est traduit par l'accroissement de la taille des navires et des quantités des marchandises transportées. Grâce aux sociétés de classification, les assureurs pouvaient ainsi disposer de référentiels, en quelque sorte, de la qualité et de la fiabilité des navires qu'ils assuraient.
Les sociétés de classification ont imaginé et conçu un système d'inspection et de visite des navires qui leur permettait de délivrer des cotes attestant le degré de confiance pouvant être accordé aux navires. A l'origine, ces cotes, assez complexes, couvraient la coque des bateaux. Elles s'intéressaient également à la qualité de leur voilure et à un certain nombre d'autres éléments, en particulier la qualité des capitaines - qui, à l'époque, étaient d'ailleurs assez souvent les armateurs - ainsi que celle des équipages.
Le système, assez vite apprécié, s'est développé puisqu'il répondait à des besoins. Néanmoins, pour que la crédibilité de ces cotes soit la plus grande possible, la nécessité de constituer une sorte de référentiel est apparue très rapidement pour que ces certificats soient les plus homogènes, objectifs et crédibles possible.
Le XIXème siècle et le début du XXème siècle - même encore actuellement, bien sûr - ont été témoins d'évolutions tout à fait fondamentales en matière de transport maritime sur les plans technique et juridique.
Sur le plan technique, les navires ont constamment et considérablement évolué : les coques en bois sont devenues des coques en acier et la propulsion à voile a fait place à la propulsion à vapeur.
Sur le plan juridique, le XIXème siècle s'est caractérisé, dans le domaine maritime, par une économie ultralibérale et de très faibles interventions étatiques, pour ne pas dire aucune. Néanmoins, le développement de cette activité industrielle que devenait le transport maritime international a conduit les Etats à réfléchir à leur rôle et à l'importance que prenait cet essor. Dans le courant et à la fin du XIXème siècle, ont donc eu lieu des tentatives de concertation entre les grands Etats maritimes. Je ne cite qu'un seul exemple parce qu'il me paraît assez significatif : la France et la Grande-Bretagne, qui étaient pourtant des rivaux assez francs dans le domaine du transport maritime, se réunissaient et avaient tenté, à la fin du XIXème siècle, d'élaborer des règles, en particulier pour éviter les collisions dans la Manche.
Le véritable déclenchement de la prise de conscience de la nécessité d'intervention des grandes puissances fut, selon moi mais aussi selon nombre de mes collègues, la catastrophe du
Titanic en 1912. Très médiatisée déjà à l'époque, cette catastrophe affectait le transport transatlantique qui était en plein développement. A la suite de la catastrophe du
Titanic donc, en 1914 précisément - date qui n'était peut-être pas extrêmement bien choisie ! -, s'est tenue une conférence internationale qui a débouché sur la première convention maritime internationale, et la plus importante à mon avis : la fameuse convention SOLAS,
Safety Of Life At Sea.
Ce processus, entamé au tout début du XXème siècle, s'est développé entre les deux guerres. Un certain nombre de textes internationaux visaient une coopération et une concertation plus grandes entre les Etats maritimes, en particulier dans deux domaines : le sauvetage en mer et les radiocommunications. Je crois qu'il faut y voir, là aussi, les conséquences du naufrage du
Titanic, qui provoqua en l'occurrence un effet psychologique important débouchant sur une prise de conscience des manques et des faiblesses dans ces deux domaines.
Dans le cadre du sujet qui nous préoccupe, le tournant le plus important a été marqué par la création, en 1948, d'un organisme de l'ONU : l'organisation maritime consultative internationale. Celle-ci est devenue, en 1982, l'organisation maritime internationale, organe délibératif des Nations Unies, plus communément dénommée IMO sur le plan international (ou OMI en français).
Toujours dans le domaine de la sécurité maritime, la contribution la plus importante de l'OMI est l'élaboration de conventions internationales. Déposés par l'OMI, ces instruments juridiques doivent être ratifiés par des Etats, et ce dans le respect d'un double critère : le nombre de pays signataires et le tonnage maritime représenté par ces Etats.
M. le Président : Je me permets de vous interrompre pour vous signaler que dans le cadre des auditions auxquelles nous avons déjà procédé, nous avons notamment reçu vos collègues d'une autre société de classification. Nous disposons donc déjà de beaucoup des éléments que vous évoquez. Pourriez-vous passer plus précisément à l'actualité ?
M. Jean-Pierre PAGE : En vous priant de m'excuser, je vais tenter de répondre à votre souhait de concision.
A l'heure actuelle, les sociétés de classification les plus importantes, au nombre d'une dizaine, voire d'une quinzaine, classent quasiment 90 % du tonnage mondial et environ 60 % du nombre de navires dans le monde. Elles sont un des acteurs essentiels de la chaîne de la sécurité dans le domaine du transport maritime aux côtés de l'OMI, des Etats qui réalisent le contrôle du pavillon, des ports qui facilitent le contrôle par l'Etat du port, bien entendu des assureurs, bien évidemment des armateurs, ainsi que des grands organismes technico-commerciaux tels INTERTANKO, l'association des pétroliers, et la BIMCO, l'association des navires transporteurs de vrac. Je précise que ce quinté n'est pas du tout dans l'ordre !
(Sourires)
La sécurité est l'affaire de tous les intervenants, chacun dans son propre rôle et sa propre fonction. Mes collègues d'autres sociétés de classification que vous avez auditionnés ont certainement insisté sur le double rôle que jouent actuellement celles-ci. Leur fonction est de délivrer des certificats qui attestent la qualité d'un navire à un instant donné, conformément au référentiel qui est le règlement de la société. Elles ont également un rôle de certification, en recevant délégation par les Etats du pavillon de la charge de vérifier l'observation et l'observance des conventions internationales par les navires. Telle est la raison pour laquelle j'avais commencé mon exposé en insistant sur le rôle des conventions internationales.
J'ai résumé aussi brièvement que possible mon exposé, mais je vous remettrai mes notes.
M. le Rapporteur : Un certain nombre d'informations que vous nous avez données, monsieur le directeur, nous ont déjà été communiquées par d'autres interlocuteurs. C'est pourquoi nous vous avons invité à raccourcir votre propos, ce dont nous nous excusons.
Mes questions sont assez simples.
Imaginons que je veuille, personnellement, créer une société de classification demain matin. Je réunis le capital suffisant et je prétends avoir la qualification. Qui m'agrée ?
M. Jean-Pierre PAGE : Tout d'abord, vous n'aurez pas besoin de beaucoup de capital. Les sociétés de classification sont des sociétés de service et elles ont toutes une très faible surface financière. A cet égard, vous n'aurez donc pas trop de soucis à vous faire.
Ensuite, qui vous agrée ?
M. le Rapporteur : Personne ? Je peux la créer tout seul ?
M. Jean-Pierre PAGE : Vous pouvez effectivement la créer tout seul, mais il vous faut trouver du personnel qualifié.
M. le Rapporteur : Personne ne viendra vérifier la qualité de mon personnel ?
M. Jean-Pierre PAGE : Si, car pour réussir, il vous faudra faire la preuve de la qualité de vos équipages, si je puis dire.
M. le Rapporteur : De mon personnel ?
M. Jean-Pierre PAGE : Tout à fait ! Une première action consisterait à vous rapprocher de l'IACS, l'association internationale des sociétés de classification. La reconnaissance par l'IACS, qui n'est pas obligatoire, est tout de même une pièce d'identité ; disons un bon viatique !
Mais pour ce faire, il vous faudra du temps parce que l'IACS retient un certain nombre de critères, parmi lesquels l'ancienneté, avant d'admettre une société de classification en son sein. De mémoire, l'IACS ne reconnaît ou ne peut reconnaître que des sociétés de classification ayant plus de trente ans d'expérience, référence à laquelle s'ajoutent notamment la qualification des équipes et le nombre de navires classés.
M. le Président : Par conséquent, pendant trente ans, une société de classification qui prétend obtenir la reconnaissance de l'IACS peut fonctionner sans cette reconnaissance ?
M. Jean-Pierre PAGE : Certaines, même importantes, fonctionnent sans être membres de l'IACS.
M. le Rapporteur : Et elles sont moins chères ?
M. Jean-Pierre PAGE : Je crois que le coût n'a rien à voir avec l'appartenance ou non à l'IACS.
M. le Rapporteur : Mais objectivement, elles sont moins chères ? Interviennent-elles sur le marché français ? Quelle est la part du Lloyd's Register of Shipping sur le marché français ?
M. Jean-Pierre PAGE : Très faible ! Le marché français est complètement dominé par le Bureau Veritas : le Bureau Veritas classe 90 % de la flotte française et le Lloyd's Register of Shipping 90 % des 10 % restants ! L'American Bureau of Shipping classe également un peu de la flotte française. Toutefois, il ne s'agit pas uniquement d'une question de tarifs mais d'une question...
M. le Rapporteur : De qualité ?
M. Jean-Pierre PAGE : Non plus, parce que ce ne serait pas gentil pour nous !
(Sourires.)
M. le Rapporteur : Tel n'était pas le sens de ma réplique ! Je pensais au fait que vous ne soyez que deux sur le marché français.
M. Jean-Pierre PAGE : Sur le marché français, en effet.
Le choix de la classification est assez difficile à comprendre. D'abord, le coût de la classification est très faible dans un bilan d'opérations et d'exploitation d'un navire. Je ne connais pas ou je ne connais plus très bien les comptes d'armateurs, mais la classification doit représenter un pourcentage infime du coût total des opérations d'exploitation du navire. Le choix de la société de classification est d'abord celui de l'armateur. Il peut la quitter quand il le souhaite et pour des raisons qu'il n'a pas à donner.
S'agissant du Bureau Veritas, il s'agit, d'abord, d'une société de classification de tout premier rang, considérée sur le marché français comme la société nationale. Les documents sont rédigés en français et l'on y parle en français. Des raisons de facilité expliquent donc sa position. Pour ces mêmes raisons, l'American Bureau of Shipping est très présent aux Etats-Unis, le Det Norske Veritas l'est dans l'armement norvégien et la société de classification japonaise, dont la taille est tout à fait comparable à la nôtre, classe également 90 % de la flotte japonaise. Un certain nationalisme s'exprime dans le choix de la société de classification.
M. le Président : Toujours au sujet des sociétés de classification, vous parliez d'une surface financière relativement réduite.
M. Jean-Pierre PAGE : En effet.
M. le Président : Du moins, une capitalisation importante n'est pas une nécessité. En cas d'erreurs ou de fautes d'une société de classification, comment cela se passe-t-il ? Reprenons l'exemple de M. Le Drian. Ce dernier s'est installé. Il a trouvé ses premiers clients dans les deux cadres que vous citiez tout à l'heure : accord avec un Etat du pavillon et avec un armement. Un accident survient. Quelles assurances sont obligatoires ou pas ? A quel niveau ? De ce point de vue, comment cela se passe-t-il ?
M. Jean-Pierre PAGE : Je crois que les sociétés de classification prennent des assurances civiles, mais ne sachant pas, je ne peux pas vous répondre à ce sujet.
M. le Président : Y a-t-il une obligation d'être assuré pour les sociétés de classification ?
M. Jean-Pierre PAGE : Je ne le crois pas.
M. le Président : Dans le cadre de l'exemple pris tout à l'heure par M. le rapporteur, on peut très bien s'installer sans expérience dans le domaine maritime et sans obligation d'obtenir l'accord d'autorités quelconques. Ensuite, il faut trouver un armement. Or, on ne pourra pas obtenir un des armements importants dont vous parliez tout à l'heure, c'est-à-dire un armement appartenant à des pays traditionnellement maritimes, en Europe de l'ouest en particulier. Ceux-ci sont souvent contrôlés par des sociétés de classification nationales, ou quasiment telles en tout cas. On se tournera donc vers un armement qui souhaite probablement des agréments faciles, sans obligation d'assurance et sans obligation d'une surface financière permettant de faire face aux accidents éventuels, n'est-ce pas ?
(M. Page acquiesce.)
Par conséquent, le jour où l'accident survient, la ou les victimes peuvent donc se retrouver devant des situations extrêmement difficiles. Certes, le tableau est noir...
M. Jean-Pierre PAGE : Noir, en effet !
M. le Président : ... mais au-delà des 10 sociétés de classification qui se reconnaissent dans l'IACS ou que l'IACS reconnaît, j'ai le sentiment qu'il en existe beaucoup plus qui ne font pas partie de l'IACS.
M. Jean-Pierre PAGE : J'ai lu un jour, sans jamais en avoir eu la liste, qu'il existait une quarantaine de sociétés de classification. Je n'ai jamais eu confirmation de ce chiffre.
M. le Président : Vous confirmez donc, même s'il ne s'agit pas d'un rapport de 10 sur 40, qu'il existe plus de sociétés à l'extérieur qu'à l'intérieur de l'IACS ?
M. Jean-Pierre PAGE : Des sociétés de classification locales, en effet, mais je ne les connais pas.
M. Paul DHAILLE : Je souhaite vous poser une première question, du reste récurrente pour mes collègues et je m'en excuse auprès d'eux. Vous avez retracé l'évolution historique des sociétés de classification. Il est clair que ce qui était la marine du début du siècle, même celle des années quarante et cinquante, n'est plus celle d'aujourd'hui. Bien sûr, les navires ont évolué, mais les cargaisons ont connu la même tendance. Je suis certain que la pollution d'un navire transportant du charbon était terrible, même s'il perdait sa cargaison. Avec les hydrocarbures, les produits chimiques et les déchets nucléaires, les risques se sont accrus. Par conséquent, les critères de classification ont-ils évolué au sein de votre société de classification en fonction de l'évolution des cargaisons ?
Ma seconde question prolonge ce qui a été dit précédemment. Dans l'industrie et les services, on constate une labélisation qualité ISO 9002 d'un certain nombre de sociétés. Existe-t-il une procédure « qualité » dans les sociétés de classification ou une reconnaissance officielle de ces dernières en fonction de cette exigence, c'est-à-dire un agrément au titre des normes ISO 9002 ou autres ?
M. Jean-Pierre PAGE : Les règlements des sociétés de classification, pour ce qui concerne la partie « coque » du navire, prennent en compte la nocivité et la dangerosité des produits transportés. Pour les produits chimiques, les sociétés de classification donnent leur avis sur la capacité de transport des navires et sur les caractéristiques de la coque devant transporter de tels produits. Les sociétés de classification ont donc pu évoluer en fonction des produits transportés.
M. Paul DHAILLE : Continuent-elles à évoluer, vu le transport, par exemple, de conteneurs qui passent d'ailleurs parfois par-dessus bord - c'est pourquoi on en retrouve à la mer - et le transport des déchets nucléaires aujourd'hui ?
M. Jean-Pierre PAGE : L'évolution des sociétés de classification est constante en raison, d'une part, de l'évolution précisément de la nature des produits transportés qu'intègrent leurs budgets de recherche et de développement dont elles sont toutes dotées, et, d'autre part, de leur expérience liée à l'inspection des navires ou à leurs relations avec les armateurs.
En ce qui concerne l'assurance qualité, je reviens une nouvelle fois à l'IACS qui, pour accepter ses membres et les conserver en son sein, a mis au point un système interne de contrôle de la qualité. Ses membres font donc l'objet d'un audit triennal suivant les normes de l'ISO que vous citez. Cet audit est mis à plat tous les trois ans. Un membre a perdu sa qualification voilà quelques années.
M. le Président : Lequel ?
M. Jean-Pierre PAGE : Dois-je le dire ?
M. le Président : Oui.
M. Jean-Pierre PAGE : Il s'agit du Registre Polonais.
M. Jean-Michel MARCHAND : Beaucoup de choses ont été dites à la suite des questions de M. le rapporteur et de M. le président, mais pas tout !
Vous venez de nous dire que vous ne connaissiez pas un certain nombre de sociétés de classification. En réponse à notre collègue Paul Dhaille, vous dites que toutes ont des programmes de recherche pour s'adapter aux modes de transport. Au nom de la cohérence, je m'interroge : quand vous dites « toutes » , s'agit-il uniquement de celles qui sont membres de l'IACS ? Il ne peut d'ailleurs s'agir de toutes les sociétés de classification puisque la majorité d'entre elles sont extérieures à l'IACS, mais telle n'est pas ma question et j'y viens.
Avec cet accident de l'Erika, les sociétés de classification, quelles qu'elles soient, viennent de prendre un grand coup, si j'ose m'exprimer ainsi, par rapport à leur image. Sachez-le ! Le public et les élus ne font pas, pour le moment, la différence entre l'une ou l'autre. Par conséquent, comment allez-vous, vous, sociétés réunies au sein de l'IACS et considérées comme étant sérieuses...
M. le Président : « Faire le ménage ! »
M. Jean-Michel MARCHAND... « faire le ménage », en effet, ou demander qu'il y ait au dessus de vous un agrément pour ne conserver que celles qui font un travail correct ? A vous écouter, j'ai bien compris que n'importe qui peut s'installer - même moi qui n'y connais strictement rien ! -, et trouver effectivement des clients dans certaines parties du monde pour classer des bateaux. On pourrait espérer que les accidents, l'Erika n'étant malheureusement pas le premier, puissent servir à l'amélioration de certaines conditions. Or on n'a pas le sentiment que, dans ce cadre, des progrès puissent intervenir.
M. Jean-Pierre PAGE : Je crains que le schéma proposé par le rapporteur ne donne à la commission une idée quelque peu faussée de la classification. Moi-même, j'ai peut-être pu vous susciter un sentiment similaire. Le schéma que vous avez choisi est certes figuratif mais assez irréaliste. Je vois mal quelqu'un avoir l'intention et l'initiative de monter une société de classification, même si les barrières ne sont pas tellement nombreuses.
M. le Rapporteur : Le problème principal est celui de la labélisation des sociétés de classification. J'ai pris un exemple à l'absurde, car je n'ai pas du tout l'intention de créer une société de classification, ce qui est d'ailleurs préférable pour la sécurité du transport maritime international !
(Sourires.)
En revanche, nous nous interrogeons sur la facilité pour un certain nombre de sociétés de classification de ne pas être membres de l'IACS, d'être présentes sur le marché international et d'obtenir, dans un certain nombre de pays, des marchés auprès d'armateurs et d'être les délégataires de la certification pour tel ou tel Etat. Nous pensons donc qu'il convient, au niveau international, de « faire le ménage »,- pour reprendre l'expression de M. le président -, parmi les sociétés de classification, même si
a priori le Lloyd's Register of Shipping n'est pas concerné.
M. le Président : Ce n'est pas, en effet, le Lloyd's Register of Shipping qui est en cause.
M. Paul DHAILLE : Monsieur le directeur, vous êtes ici dans une situation un peu difficile parce que vous êtes responsable d'une société de classification dont chacun pense ici qu'elle est sérieuse. Cependant, dans votre profession, il existe visiblement à la fois des gens sérieux et reconnus et quelques « brebis galeuses ». Par ailleurs, ce qui frappe les membres de la commission d'enquête, c'est l'absence de règles bien établies dans l'exercice de l'activité de classification des navires. Tout a l'air de se passer à l'amiable et d'avoir entraîné vers le bas, dans le cadre d'une mondialisation favorisant les pavillons de complaisance, toutes les structures techniques, administratives et juridiques.
Monsieur le président, si vous me permettez de faire cette réflexion devant une personne auditionnée, j'ai l'impression que le monde maritime est resté, au titre de l'organisation et des règles juridiques qui le régissent, presque quelques dizaines d'années en arrière. En d'autres termes, on considère que c'est encore un monde de grande liberté et que toute une partie des choses doit rester dans un domaine de grande liberté que personne ne contrôle trop, pas même l'OMI dont les rapports internationaux ne sont pas obligatoirement suivis ni très contraignants.
Or pour nous, se pose un vrai problème dans ce domaine de la classification. Nous ne vous demandons ni de justifier votre position, ni de défendre ceux qui sont plus mauvais, mais nous souhaiterions tout de même avancer dans ce domaine.
M. Jean-Pierre PAGE : Tout d'abord, je sais, sans avoir cependant les conventions et les textes précis en tête, que l'OMI exerce sinon un certain agrément, pour reprendre votre vocabulaire, du moins un certain contrôle sur les sociétés de classification.
Ensuite, c'est curieux, mais étant dans le
business, si je puis dire - car il ne s'agit pas d'un
business -, j'ai exactement l'impression inverse de la vôtre.
M. le Président : Vous avez ce sentiment parce que vous travaillez dans une société inscrite à l'IACS, mondialement connue, la plus ancienne au monde puisqu'elle a été créée en 1760. La société de classification que vous représentez fait donc partie de cet ensemble - disons-le même si cela n'engage que moi - « sérieux ».
M. Jean-Pierre PAGE : C'est vraisemblablement la raison pour laquelle je suis pris à contre-pied par vos questions. Nous avons l'impression, nous mais aussi nos collègues du DNV et du BV avec qui j'en parle, de vivre dans un environnement de plus en plus « censeur ».
M. le Président : A l'évidence, il ne l'est pas assez puisque le RINA, pourtant membre de l'IACS, laisse passer un bateau comme l'Erika. Qu'en est-il donc des autres sociétés de classification qui ne sont pas membres de l'IACS ?
M. Jean-Pierre PAGE : Je me refuse à parler de l'Erika parce que nous n'avons jamais classé ce navire. Je ne peux donc pas du tout porter un jugement sur une société de classification collègue. De plus, bien que tel ne soit sans doute pas le thème du débat, on ne sait pas encore exactement quelles ont été, sinon les responsabilités, du moins les actions du RINA dans cet accident. Je n'en dirai pas plus.
M. le Président : Vous seriez le seul dans ce cas-là !
(Sourires.)
M. Jean-Pierre PAGE : Je n'ai pas du tout de mandat pour m'avancer sur ce terrain.
Il est vrai, et vous avez certainement raison, que du fait de notre appartenance à de grandes sociétés de classification moi et mes collègues auxquels je faisais référence, nous avons, nous, le sentiment d'être de plus en plus contrôlés. A ce titre, il serait intéressant pour vous d'auditionner un représentant de l'IACS.
M. le Président : Nous allons rencontrer des représentants de l'IACS à Londres.
M. Jean-Pierre PAGE : En fait, le sujet qui est abordé là est celui de l'image de marque des sociétés de classification.
M. le Président : Je vous résume notre problème. Un certain nombre de navires circulent sur les mers, en particulier au large, à proximité des côtes françaises. Or même si les compagnies nationales, réputées telles en tout cas, les grandes compagnies, ne sont pas exemptes de tout reproche - que ce soit sur le plan technique des navires, sur le plan social des marins avec tous les problèmes de fonctionnement à bord, que ce soit au niveau du contrôle de ces navires dans les Etats du port ou au niveau du contrôle de ces navires dans les Etats du pavillon -, on s'aperçoit que beaucoup de pays qui ont des pavillons n'ont aucune administration maritime. Certains n'ont même pas de côte ! En d'autres termes, l'activité maritime est devenue après tout une activité comme une autre, ce qui pose tout de même problème. Personnellement, quand je vois des pavillons luxembourgeois dans la baie de Seine, cela m'interpelle ! Mais il en est ainsi de bien d'autres pavillons !
En même temps, il y a des gens autour de ces navires qui sont, entre autres, les sociétés de classification : ces dernières certifient les bateaux pour l'Etat du pavillon et les classent pour l'armateur c'est-à-dire qu'elles sont juge et partie. En fait, elles sont aux deux bouts de l'opération. C'est ce que l'on nous a dit. C'est pourquoi nous comptons proposer de rompre cette relation en dissociant le choix de la société de classification pour la classification de celui de la société de classification pour la certification.
M. Jean-Pierre PAGE : Vous faites là le lien entre ce que l'on appelle, nous, la classification et le statutaire...
M. le Président : Voilà.
M. Jean-Pierre PAGE... et vous proposez de rompre ce lien ?
M. le Président : Il ne faut pas que ce soit la même société de classification, qui fasse ces deux opérations. Si la société de classification que nous avons envisagée tout à l'heure - et c'est une opération très théorique - est constituée de la manière que nous avons considérée, et si je suis l'armateur, je « m'arrange » : je m'installe aux îles Caïmans et la société de classification s'installe dans les îles voisines. Ainsi, l'affaire est bouclée ! Or des navires classés et certifiés selon ce type de montage circulent !
Notre travail n'est pas de penser ou d'imaginer que toutes les sociétés de classification fonctionnent selon le même modèle, bien évidemment. Toutefois, il s'agit de prendre en compte un certain nombre de considérations : majoritairement, les sociétés de classification ne sont pas affiliées à l'IACS ; tous les contrôles ne sont sans doute pas réalisés pour leur interdire l'exercice de leurs activités dès lors qu'elles ne satisfont pas à un certain nombre d'obligations ; les contrôles ne sont pas suffisants pour interdire aux navires ainsi classés l'accès à un certain nombre d'eaux territoriales et de ports, pas plus qu'il n'est possible d'interdire le transport d'un certain nombre de marchandises.
Si ces navires transportaient, comme au temps des galions, de l'or et de l'argent, la situation serait moins grave. Mais dès lors qu'il s'agit de produits polluants et dangereux, la situation devient plus gênante, d'autant plus qu'ils ne sont pas seuls sur les mers.
Qu'auriez-vous fait avec l'Erika ? Comment auriez-vous procédé si l'armateur avait demandé au Lloyd's Register of Shipping de devenir sa société de classification ?
M. Jean-Pierre PAGE : En venant de la société de classification qui classait le bateau ?
M. le Président : Oui.
M. Jean-Pierre PAGE : D'abord, on applique les règles de l'IACS, c'est-à-dire que l'on est destinataire des exigences posées par la société de classification précédente pour les reprendre à notre compte. Ensuite, on fait une inspection du navire.
M. le Président : Comment ?
M. Jean-Pierre PAGE : Avec nos inspecteurs.
M. le Président : Combien en avez-vous en France ?
M. Jean-Pierre PAGE : D'abord, l'Erika ne serait pas nécessairement venu en France.
M. le Président : D'accord ! Le navire aurait pu être classé ailleurs.
M. Jean-Pierre PAGE : Tout à fait.
A l'heure actuelle, le Lloyd's Register of Shipping doit compter dans le monde 1 500 ou 1 600 inspecteurs. Si l'Erika était venu au Havre, par exemple, j'aurais envoyé mes inspecteurs du Havre l'inspecter.
M. le Président : Comment recrutez-vous ces inspecteurs, ceux qui sont en France ? Sont-ils des anciens officiers de la marine marchande ?
M. Jean-Pierre PAGE : L'un d'entre eux est un ancien de Navale et tous les autres viennent de la marine marchande. Nous avons la chance, en France, de bénéficier d'une formation que je considère comme étant excellente et qui repose sur la polyvalence. Les inspecteurs que l'on recrute ont été à la fois commandant et chef.
M. Jean-Michel MARCHAND : Vous avez dit : « mes inspecteurs ». Cela signifie-t-il que l'inspection a lieu avec plusieurs inspecteurs en même temps ?
M. Jean-Pierre PAGE : Cela dépend du type de navire et du sentiment que l'on peut avoir du bateau. Cependant, sur les gros navires, de type pétrolier ou
bulk, qui requièrent tout de même des attentions plus particulières et surtout au moment des visites de cinq ans, dites visites spéciales, on peut y affecter deux ou trois inspecteurs, ne serait-ce que pour des raisons de fatigue parce que l'effort physique consistant à monter et descendre est assez éprouvant.
Pour répondre à votre question, monsieur le président, le Lloyd's Register of Shipping doit avoir en France une dizaine d'inspecteurs marine, sans compter ceux qui s'occupent de constructions neuves, lesquels sont des gens à part.
M. Gilbert LE BRIS : Depuis les assignats, on dit que la mauvaise monnaie chasse la bonne. Depuis l'Erika, on risque de dire aussi que les mauvaises sociétés de classification chassent les bonnes, c'est-à-dire qu'elles leur posent une multitude de problèmes.
Je suis quelque peu surpris de voir que vous ne semblez pas abonder dans le sens qu'il faut mettre de l'ordre parmi les sociétés de classification existantes. Pourtant, le traumatisme subi à la suite du naufrage de l'Erika est peut-être l'occasion de procéder à une mise à plat et de reconstruire.
Après cette première remarque, n'estimez-vous pas que l'OMI n'a pas suffisamment de pouvoirs ? Plaideriez-vous pour un renforcement sérieux des pouvoirs de l'OMI ?
M. Paul DHAILLE : Je souhaite poser deux questions très courtes.
Si j'ai bien compris, vous ne classez que 9 % de la flotte française. Avez-vous connaissance d'armateurs qui auraient quitté des sociétés de classification, en particulier la vôtre, pour en rejoindre d'autres, plus souples ou moins exigeantes ?
Par ailleurs, serions-nous en mesure de connaître la répartition des armateurs par société de classification ? En particulier, pourrions-nous savoir si certains armateurs ou certains pavillons s'adressent plus spécialement à telle société de classification ou à telle autre ? Puisque l'on connaît certainement celles qui sont sérieuses - du moins on s'en doute -, par déduction, on saurait quelles sont les autres.
Mme Jacqueline LAZARD : D'abord, quelle est la fréquence des inspections faites par votre société de classification sur les navires ? Nous avons parlé tout à l'heure de contrôles complets, tous les cinq ans. Outre le contrôle de départ lorsque vous acceptez éventuellement de classer le navire, qu'en est-il après ?
Ensuite, vous avez parlé tout à l'heure de la polyvalence de vos inspecteurs en précisant qu'ils avaient exercé le métier de chef et de commandant. Dès lors,
quid du contrôle qu'ils peuvent opérer sur tous les appareils de radio à bord, sachant qu'ils n'ont pas reçu cette formation ?
Enfin, en dehors de l'aspect physique du navire et de tous ses appareils de fonctionnement dont les machines et appareils de navigation, avez-vous un droit de regard sur les équipages, c'est-à-dire sur la façon dont ils sont choisis, sur leurs compétences et leur qualité ?
M. Jean-Pierre PAGE : A la suite d'une première remarque, M. Le Bris m'interroge sur l'OMI qui, à mon avis, n'a aucun pouvoir. L'OMI crée des conventions internationales qui sont ratifiées et appliquées par les Etats. Voilà plusieurs années, j'ai moi-même participé à des travaux de commissions de l'OMI. Je me souviens que l'OMI se plaignait du fait que ses conventions n'étaient pas ratifiées assez vite, et qu'elle perdait le contrôle de leur application, l'Etat du pavillon en devenant de fait le responsable. A titre tout à fait personnel, je ne pense pas que l'OMI cherche à prendre des pouvoirs de contrôle excédant les fonctions qu'elle exerce déjà.
Pourquoi un armateur quitte le Lloyd's Register of Shipping ? Très souvent, il ne nous le dit pas ! C'est son droit le plus strict de quitter le Lloyd's Register of Shipping pour aller ailleurs ou de quitter le BV pour rejoindre le Lloyd's Register of Shipping.
M. Paul DHAILLE : Le problème n'est pas tant qu'il quitte le BV pour aller au Lloyd's Register of Shipping que d'aller ailleurs sans que l'on sache où !
M. Jean-Pierre PAGE : Je suis désolé, mais je ne peux pas répondre à ce type de question. Je suis très heureux d'être au Lloyd's Register of Shipping. Je travaille dans une société que je considère comme étant excellente au niveau de sa qualité et de ses contrôles et je n'ai aucune expérience en matière d'autres sociétés de classification. Si les armateurs veulent aller ailleurs, c'est leur choix. Telle est leur liberté ! Là, il n'y a pas de contrôle !
M. le Président : Existe-t-il une fréquence de ces mouvements de transfert de classe des navires entre sociétés de classification ?
M. Jean-Pierre PAGE : Il est fondamental, me semble-t-il, que vous rencontriez les représentants de l'IACS parce que je crains - c'est sans doute l'empreinte du traumatisme de l'Erika - que vous vous fassiez une idée assez fausse des sociétés de classification.
M. le Président : Je ne le crois pas ! Mais il s'agit d'un autre problème.
M. Jean-Pierre PAGE : Je ne suis pas l'IACS et je ne la défends pas, mais...
M. le Président : Compte tenu de votre expérience en tant que responsable du Lloyd's Register of Shipping sur la France, pouvez-vous nous dire si s'opèrent des transferts de classe de navires sur les 90 % des 10 % que laisse le Bureau Veritas ?
M. Jean-Pierre PAGE : Je connais très peu de mouvements.
M. le Président : Ce milieu est donc très stable ?
M. Jean-Pierre PAGE : Oui. Ces mouvements ne se résument pas en ces termes :
« Je quitte le Lloyd's Register of Shipping, le BV ou le Norske pour aller me classer chez « tartempion » parce que je vais payer dix fois moins cher ! » Cela peut arriver, mais je suis convaincu que c'est une erreur de penser que cette situation serait assez fréquente parce que dans ce cas, nous ne serions pas confrontés à un
Erika, mais à cent !
M. le Président : Dans ce cas, pourrions-nous dire que même en dehors de la France, il y a une certaine stabilité dans les relations ou les liens qui unissent les navires - je ne parle même pas des armements ou des Etats du pavillon - et les sociétés de classification ?
M. Jean-Pierre PAGE : Il y a une grande stabilité, ne serait-ce que pour des raisons essentiellement pratiques. Lorsqu'un navire est classé par une société de classification, il a des dossiers et même si nous travaillons tous de la même façon, nous n'avons pas tout à fait les mêmes procédures, notamment en ce qui concerne l'enregistrement et l'émission des rapports. Les intéressés sont donc habitués à travailler avec une classe.
Les changements de classification que, moi, j'ai pu connaître - que ce soit dans un sens ou dans l'autre -, sont très souvent liés à un changement d'armateur. Les navires se vendent et s'achètent et certains armateurs aiment bien travailler avec telle ou telle société de classification. Je ne dis pas qu'un armateur choisit systématiquement la même société de classification pour classer toute sa flotte, mais on ne peut nier que des liens d'histoire se tissent entre les armateurs et les sociétés de classification.
Je ne peux donc pas vous dire pourquoi un armateur quitte le Lloyd's Register of Shipping, mais quand c'est le cas, je le regrette !
(Sourires.)
Des statistiques d'armements classés ont certainement été réalisées et vous permettraient de savoir plus précisément la répartition des armateurs par société de classification. En France, le Lloyd's Register of Shipping, classe certains navires de M. Dreyfus. Il en a classé pendant longtemps chez Worms. En revanche, il ne classe rien, sinon une petite unité, à la CMA-CGM. Il a classé des navires appartenant à Van Ommeren qui a acquis des constructions neuves classées désormais par le BV. En revanche, le Lloyd's Register of Shipping garde toute l'assurance qualité chez eux. Le Lloyd's Register of Shipping classe également des navires de PETROMER, mais il ne classe pas ceux de la SOCATRA. Je précise que la société de classification que je représente classe le voilier « Le Ponant ».
Prenons le problème à l'envers ! Les sociétés de classification ont certaines spécificités. Par exemple, le Lloyd's Register of Shipping classe actuellement la grande majorité des paquebots et, traditionnellement, les méthaniers. En revanche, les porte-conteneurs sont essentiellement classés par le Germanisher Lloyd parce que le trafic conteneurs a été beaucoup - même s'il est moins maintenant - entre les mains des armateurs allemands, lesquels se classent toujours chez GL par tradition. Certaines habitudes sont ainsi prises.
M. le Président : Et les pétroliers ?
M. Jean-Pierre PAGE : Les pétroliers sont essentiellement classés par le Lloyd's Register of Shipping et par le NKK japonais, parce qu'une flotte pétrolière importante est construite au Japon avec des armements japonais. Beaucoup de pétroliers sont également classés par l'American Bureau of Shipping parce que les pavillons du genre Panama sont plus ou moins contrôlés par les Américains, lesquels choisissent l'ABS.
S'agissant de la fréquence des visites : outre la visite spéciale tous les cinq ans pour laquelle le navire, en cale sèche, fait l'objet d'une inspection intérieure et extérieure, des visites annuelles permettent de faire le tour du bateau pour voir ce qui se passe. Il faut bien savoir, mais peut-être l'avez-vous appris par mes collègues que vous avez auditionnés, que nous ne pouvons intervenir à bord que sur demande de l'armateur. Nous ne pouvons pas monter à bord pour inspecter le navire parce que l'on pense qu'il y a un problème. Il s'agit d'une différence majeure avec le contrôle de l'Etat du port, les inspecteurs montant alors à bord, ce qui est, à mon avis, très complémentaire de notre démarche. En ce qui concerne le pays dont je m'occupe, je me félicite personnellement des relations qui existent entre les administrateurs chargés des contrôles portuaires et nos inspecteurs. Nous nous rendons des services complémentaires et mutuels. Si un inspecteur du port, en montant à bord, décèle un problème, il attire notre attention, ce qui se fait régulièrement.
En ce qui concerne la formation radio, certains de nos inspecteurs ont leur brevet. Quand ce n'est pas le cas, nous faisons appel à des spécialistes de radio maritime que nous agréons.
Quant au personnel, nous ne le couvrons pas du tout. C'est le choix de l'armateur. Cela étant, la convention STCW a mis un ordre certain dans ce domaine. Par ailleurs de plus en plus de contrôles de personnels sont opérés.
Si vous me le permettez, je souhaite vous livrer encore quelques réflexions.
Je crois me rendre parfaitement compte de l'état d'esprit de votre commission d'enquête et je peux vous dire que plus cela va, plus je suis heureux d'être au Lloyd's Register of Shipping! Ne disposant pas des statistiques, j'ignore le nombre de sociétés de classification, en dehors des plus grandes sociétés qui, je le répète, classent 90 % ou 92 % de la flotte mondiale. Si vous faites le référentiel au regard du nombre de navires, la proportion n'est pas la même. Beaucoup de petits navires, que l'on voit moins ou que l'on ne voit pas et qui assurent des trafics locaux, ne sont pas classés par les grandes sociétés de classification. Peut-être cette considération peut-elle éclairer votre philosophie de la classification ?
Par ailleurs, on prête beaucoup plus à la classification que ce qu'elle peut faire et que ce qu'elle fait. Dans la classification proprement dite, nous ne nous « intéressons » qu'à l'aspect structurel de la coque - donc à son étanchéité, à sa solidité et à sa résistance -, aux appareils propulsifs principaux, donc à la propulsion, et aux appareils auxiliaires principaux - c'est-à-dire à la fourniture d'énergie électrique et au gouvernail -, bref à tout ce qui peut mettre en danger la sécurité du navire et de l'environnement. Nous ne sommes pas des armateurs. Nous ne sommes pas des chantiers constructeurs ni des chantiers réparateurs.
M. le Président : Vous n'intervenez pas et vous ne contrôlez pas de chantiers réparateurs ?
M. Jean-Pierre PAGE : Absolument pas ! Nous contrôlons ce qu'ils font quand ils interviennent sur les navires dont nous avons la charge.
M. le Président : C'est ce que je voulais dire !
M. Jean-Pierre PAGE : Oui, nous contrôlons ce qu'ils font. Si un trou est décelé dans la coque, ils ne peuvent pas faire n'importe quoi et n'importe comment !
M. le Président : Vous vous rendez sur place lorsque le bateau est dans un chantier de réparation ?
M. Jean-Pierre PAGE : Tout à fait ! Nos inspecteurs interviennent.
M. le Président : Vous contrôlez donc le travail qui y a été fait...
M. Jean-Pierre PAGE : Nous contrôlons non pas les chantiers mais le travail qui y est fait et qui est relatif à nos responsabilités.
M. le Président : Vous est-il possible de vous opposer au choix d'un armateur ou d'un armement qui choisirait un chantier qui n'est pas certifié ISO 9002 pour réparer un navire que vous classez ?
M. Jean-Pierre PAGE : Absolument pas ! Nous n'intervenons pas dans le choix du chantier.
M. le Président : Même si le chantier n'est pas certifié ISO 9002 ?
M. Jean-Pierre PAGE : Une multitude de chantiers ne sont pas certifiés ISO 9002 !
M. le Président : Pour en revenir à l'Erika, précisément la réparation a eu lieu dans un chantier qui n'était pas certifié ISO 9002.
M. Jean-Pierre PAGE : Je vous crois parfaitement.
M. le Président : C'est donc probablement aussi l'une des raisons pour lesquelles un certain nombre de doutes subsistent.
Vous n'intervenez donc pas auprès de l'armement pour lui faire remarquer que le chantier dans lequel il fait réparer son navire suite à une de vos remarques n'est pas agréé ?
M. Jean-Pierre PAGE : M. le président, cela ne m'est personnellement jamais arrivé.
M. le Président : Le Lloyd's Register of Shipping est un organisme sérieux qui a des armements sérieux !
Mme Jacqueline LAZARD : Voilà !
(sourires)