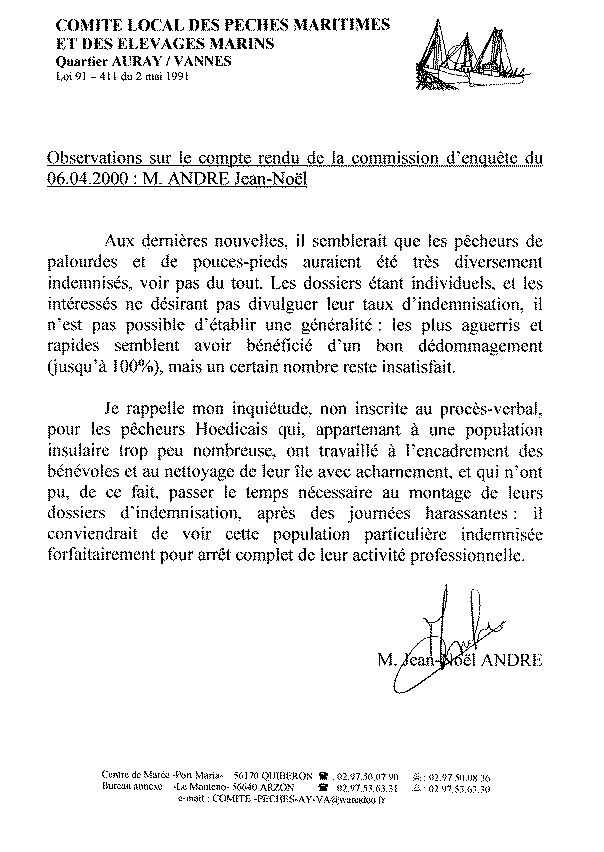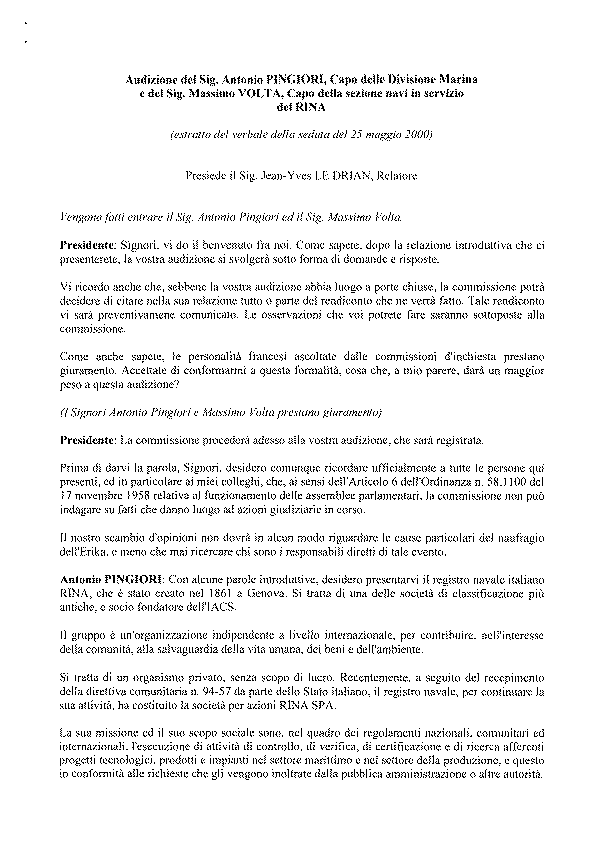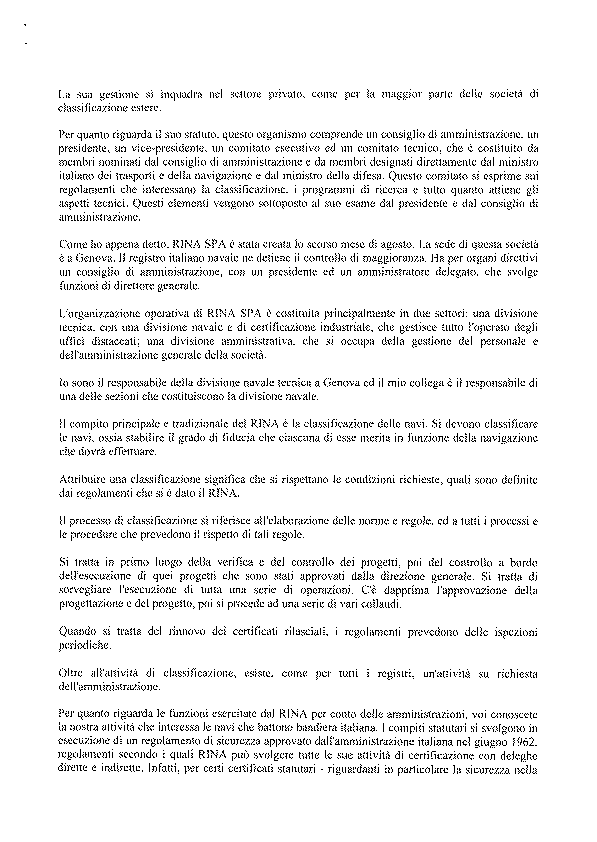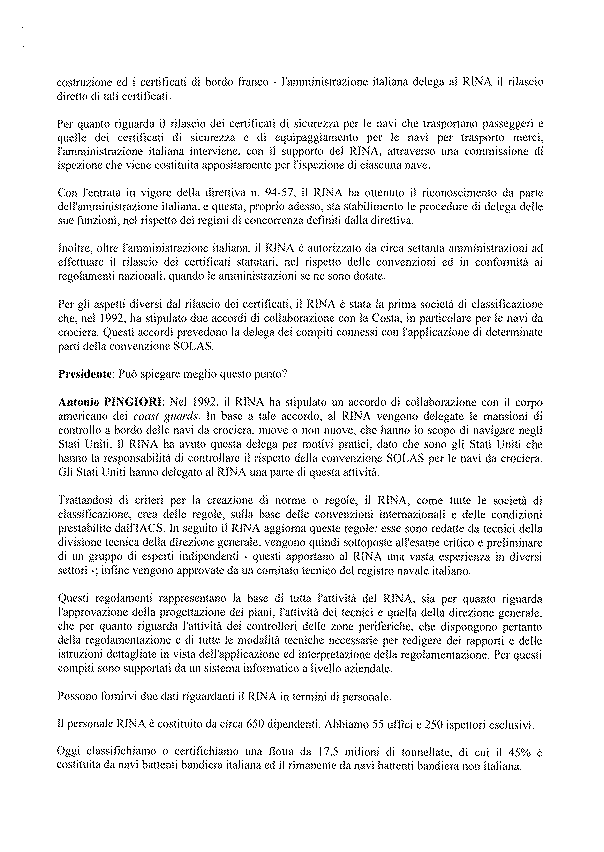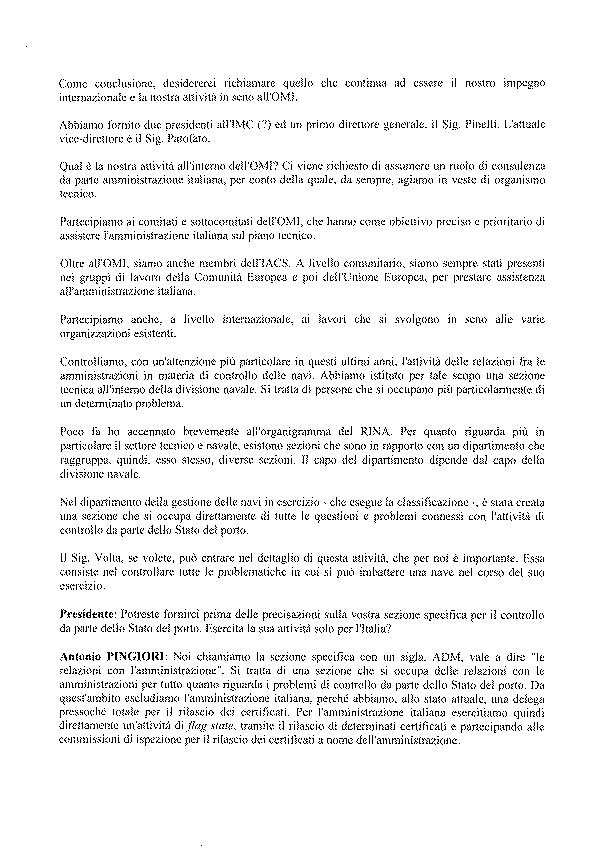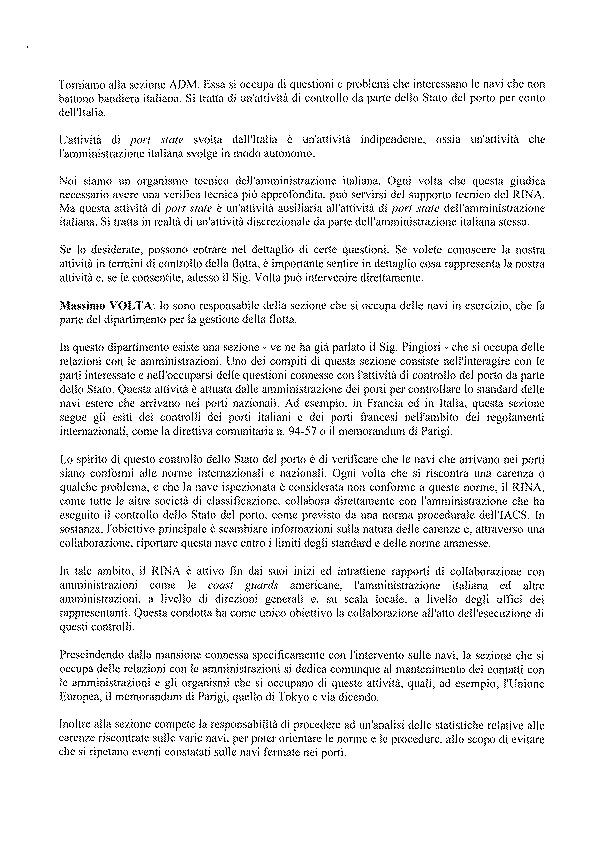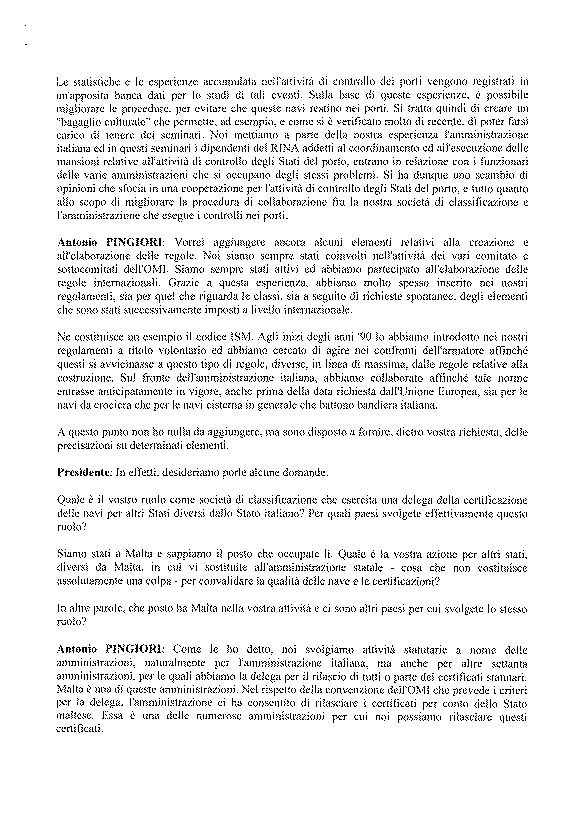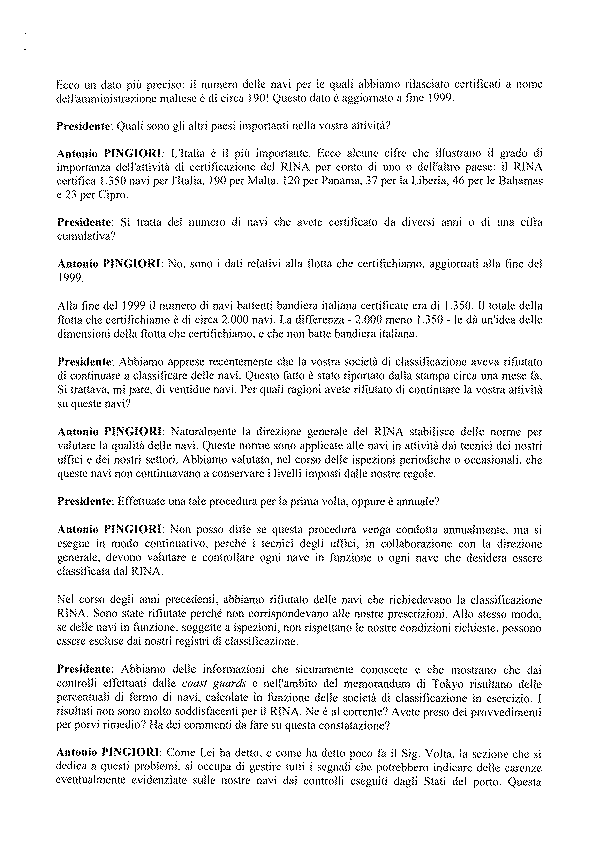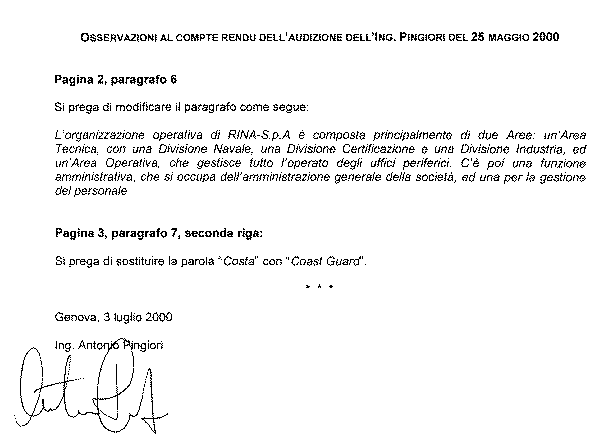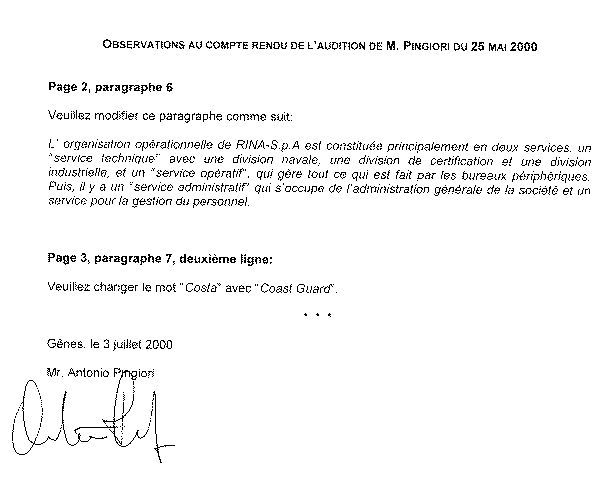Audition de M. Jean-Yves BANNET,
maire de Locmaria Belle-Ile et président du district de Belle-Ile,
M. Jacques FRAISSE, maire de Saint-Hilaire-de-Riez,
M. Loïc LE MEUR, maire de Ploemeur,
M. Loïc PROVOST, adjoint au maire de Batz-sur-Mer,
M. Dominique YVON, maire de l'île de Groix
(extrait du procès-verbal de la séance du 6 avril 2000 à Lorient)
Présidence de M. Daniel PAUL, Président.
MM. Jean-Yves Bannet, Jacques Fraisse, Loïc Le Meur, Loïc Provost, Dominique Yvon, sont introduits.
M. le Président leur rappelle que les dispositions législatives relatives aux commissions d'enquête leur ont été communiquées. A l'invitation du Président, les témoins prêtent serment.
M. Dominique YVON : Je suis le maire de l'île de Groix. L'île de Groix, comme d'autres communes, a été touchée par la marée noire à partir du 24 décembre dernier. Notre commune qui compte 2.300 habitants hors saison, fait 14 kilomètres carrés, avec un linéaire de côtes polluées d'environ 15 kilomètres, comportant beaucoup de criques et de falaises. Tout cela pour montrer la petitesse de la commune.
En ce qui concerne les dépenses occasionnées par la marée noire, la commune dispose d'un budget relativement peu important. Dans la majorité des cas, elle a donc fait payer directement les interventions dans le cadre du plan POLMAR. Depuis le 26 décembre, nous avons en charge entre 100 et 120 militaires que nous nourrissons trois fois par jour, que nous logeons. Nous n'avions pas les moyens de payer les différents frais.
Les frais que la commune a directement payés concernent les heures supplémentaires des personnels communaux et le personnel que nous avons été obligés d'embaucher pour accueillir les militaires et leur préparer les repas, etc.
Enfin, la commune a été mise dans l'obligation d'acheter du matériel pour nettoyer les plages ; je tiens à votre disposition les détails et les chiffres.
M. Jean-Yves BANNET : Je suis adjoint au maire de Belle-Île et président du district de Belle-Île. Je ne reprendrai pas ce que vient de dire mon collègue. Nous sommes des insulaires et nous connaissons quasiment les mêmes difficultés, sauf que Belle-Île est un peu plus grande avec 60 km². On peut parler de 3.000 tonnes extraites à ce jour, dont 1.500 sont évacuées par les soins de l'entreprise TotalFinaElf. Le coût global jusqu'à présent est de 4,2 millions de francs pour 3.000 tonnes, soit 1.400 F la tonne. Voilà donc le prix d'une tonne de déchets évacués de Belle-Île, depuis le moment où elle est récupérée sur la plage ou en fond de crique, jusqu'au moment où elle arrive à Donges.
Nous avons des militaires, la sécurité civile et un régiment d'artillerie, ainsi que de nombreux bénévoles. Il faut tenir compte de l'alimentation, de l'hébergement, du transport, du café, de la casse du petit matériel, de diverses dépenses, qui représentent un total de 3.926.370,79 F, soit près de 4 millions de francs. Pour ce qui est des quatre communes, pour le matériel et le personnel, le coût s'élève à 300.000 francs ; la somme totale est alors de 4,2 millions de francs. A ce jour, le montant remboursé est de 1,3 million de francs !
J'ose espérer que le remboursement de cette différence entre 4,2 millions de francs et 1,3 million de francs ne tardera pas trop, car nous pourrions nous trouver en difficulté. Nous avions un peu de trésorerie ce qui nous a permis de voir venir, mais il ne faudrait pas prolonger. C'est notre inquiétude.
En outre, qui prendra ces frais en charge : POLMAR ou FIPOL ? Nous préférerions POLMAR. Mais c'est une autre interrogation.
M. Loïc LE MEUR : Je suis maire de Ploemeur. Notre commune compte 17 kilomètres de côte, 14 plages et criques : toutes ont été touchées. Les moyens mis en _uvre par la commune consistent dans l'accompagnement de bénévoles, à l'origine, puis dans l'accompagnement et la logistique de compagnies de militaires affectés à Ploemeur depuis un mois et demi.
Les coûts globaux - hors remise en état des sites puisque nous avons des devis pour 1,2 million de francs pour les mois à venir - reprenant l'assistance communale tant en main d'_uvre qu'en matériel roulant, ont été évalués et chiffrés à 2.832.000 F, dont pris en compte au titre du plan POLMAR terre 617.000 F. Il reste à charge de la commune 2.215.000 F déjà payés.
Comme mon collègue de Belle-Île, je m'interroge sur ce remboursement dans la mesure où les communes touchées doivent prendre en charge ces dépenses. Avec les dépenses de personnel communal, qui constituent 50 % du total, nous arrivons à 1.058.000 F ; on ne prend en compte au titre du plan POLMAR terre que les heures supplémentaires du personnel et non les heures normales.
Je m'interroge : avons-nous agi au titre de notre pouvoir de police administrative communale ou dans le cadre du déclenchement du plan POLMAR, sous l'autorité du préfet, tout simplement au titre du pouvoir déconcentré de l'Etat ?
En effet, les textes de décembre 1997 précisent clairement que la mise en _uvre du plan POLMAR terre est attribuée au préfet et celui-ci, dans le cadre du déclenchement du plan POLMAR, peut disposer des moyens communaux.
Si tel était le cas, nous pourrions demander non pas un remboursement au plan POLMAR, mais bien des avances parce que les sommes commencent à être importantes, et ce n'est pas fini : les chantiers lourds de nettoyage se poursuivront encore au moins pendant deux à trois mois. Heureusement que notre trésorerie est saine.
Nous sommes inquiets face au remboursement du FIPOL, surtout quand on sait qu'il remet en question les taux horaires de coût de personnel alors que notre statut de fonction publique est connu. Pour le matériel roulant, nous prenons des délibérations qui permettent de clarifier nettement le coût horaire du matériel mis à disposition. Il a été placé sous l'autorité de l'Etat au titre du premier PC POLMAR avancé, installé au Fort Bloqué.
On pourrait s'interroger sur une demande de remboursement de ces sommes-là non pas au FIPOL mais à l'Etat, à charge pour l'Etat de les récupérer auprès du FIPOL.
M. Jacques FRAISSE : Je suis maire de St-Hilaire-de-Riez, en Vendée. Notre commune dispose de 14 kilomètres de plages, dont 3 kilomètres de corniche rocheuse vendéenne, site classé national depuis 1929. Je n'ai pas eu de gros problèmes : l'efficacité du préfet et du sous-préfet a fait que le nettoyage lourd a été pris en charge directement.
Actuellement, voici les problèmes : la dépollution de la corniche doit être prise en charge par TotalFinaElf ; avec les cabinets d'avocats et de nombreuses communes, nous avons notifié à TotalFinaElf un arrêté selon la loi sur les déchets le mettant en demeure d'enlever ces déchets. TotalFinaElf nous demande de retirer cet arrêté sous peine de retarder le nettoyage à titre de sanction.
Deuxième élément : comme mes collègues, nous avons un problème d'heures supplémentaires, prises en charge par le préfet, autour d'un million de francs. Actuellement, nous n'avons plus de bénévoles en raison des dangers potentiels. Nous devons donc engager des personnes selon « le plan Jospin ». Nous percevons 98.000 F de subvention de la région pour six emplois, non assumés à 100 %. Or, il nous faudra pratiquement passer nos plages au tamis. Le camion de location et le matériel seront à notre charge pendant deux ou trois mois, ce que j'estime à environ 1 million de francs.
M. Loïc PROVOST : Je suis adjoint au maire de Batz-sur-Mer, autre commune ayant une côte rocheuse de 7 km, avec aussi plusieurs plages située près de La Baule, importantes pour l'économie touristique.
Au niveau de la sous-préfecture, la prise en charge a été très rapide. Dès les premiers jours, les factures ont transité rapidement. L'avance de la commune est chiffrée à 2,3 millions de francs : 300.000 F directement au titre de la commune et deux millions de francs par rapport à l'aide apportée par d'autres communes.
Une particularité n'a pas été résolue : la ville de Nantes, dans le cadre d'un partenariat, a envoyé une cinquantaine de personnes pendant deux mois, ce qui représente pour elle un coût de 1,5 million de francs. Nous souhaiterions que Nantes puisse être indemnisée de cette somme, même si elle n'a pas subi de préjudice direct, car elle a apporté une aide importante.
Au même titre, des petites communes, comme St Lyphard, St Joachim et une ou deux autres, dès les premiers jours nous ont mis à disposition du matériel roulant et du personnel qui nous ont beaucoup aidés alors que le matériel manquait. Je tenais à signaler cette particularité par rapport aux villes.
Nous avons la possibilité d'embaucher 43 personnes via l'Etat ; actuellement, une trentaine est déjà embauchée, mais nous devons effectuer l'avance de trésorerie : pour une petite commune, cet élément pourrait nous poser des problèmes dans le cas d'un retard de remboursement. D'après mes informations, en effet, les salaires seraient payés d'abord par les communes, puis remboursés ultérieurement.
J'ignore si c'est le lieu, car le préjudice ne touche pas seulement notre commune, mais j'aimerais relever un élément : nous avons des marais salants : sans doute, ne fonctionneront-ils pas cet été et c'est toute la profession qui sera sinistrée. La décision de fermeture n'est pas encore prise. Pour une partie de la profession, ce ne serait pas trop pénible car une coopérative fonctionne, mais notre commune en particulier compte beaucoup d'indépendants que la fermeture des marais placera dans une situation catastrophique. Indépendants, ils ne disposent quasiment pas de stock, surtout les plus jeunes. Cela entraînera une situation très difficile au plan économique pour la commune. Je le souligne, car si le préfet devait annoncer la fermeture temporaire des marais, il serait intéressant qu'il puisse présenter en parallèle des plans d'aide à ces paludiers en difficulté.
M. Dominique YVON : J'ai omis de vous fournir les chiffres : le coût global des dépenses engendrées s'élève à 2,1 millions de francs. Les dépenses prises directement en charge par la commune, sous réserve de remboursement par le plan POLMAR et le FIPOL, seront de 610.000 F, somme totale investie jusqu'à présent par la commune.
Un autre problème, non chiffrable aujourd'hui mais important pour nos petites communes à 80 % touristiques, est le déficit d'image et le déficit de fréquentation que nous connaissons déjà. Nous sommes en période de vacances scolaires de la région parisienne et nous percevons déjà un creux sensible pour cette première semaine. C'est difficile à chiffrer. Les commerçants et artisans de l'île sont inquiets quant à la saison qui démarre.
M. le Rapporteur : Pour prendre un exemple, avez-vous une idée des réservations pour l'été ?
M. Dominique YVON : Pour ces réservations estivales, l'Office du tourisme commence à recevoir davantage d'appels téléphoniques. La baisse actuelle doit avoisiner les 25 % à 30 %. Bien sûr, rien ne dit que la situation sera identique en juillet. La situation actuelle montre néanmoins une baisse de fréquentation assez sensible en cette période.
M. le Rapporteur : Sans vouloir revenir sur chaque intervention, j'ai cependant quelques questions pour les cinq communes représentées, l'essentiel pour nous aujourd'hui concernant les mécanismes d'indemnisation.
Premièrement, avez-vous tous eu des contacts avec TotalFinaElf, comme ce fut le cas pour un des maires présents ? Si oui, comment se manifestent l'intervention et l'aide de TotalFinaElf pour votre commune ? Disposez-vous de chiffres ? Si oui, lesquels ? Quelles sont vos relations ?
Dans le cadre de l'indemnisation, nous recevons TotalFinaElf cet après-midi.
Deuxièmement, avez-vous eu des relations avec le FIPOL ? Avez-vous essayé de vous faire rembourser déjà par le FIPOL ? Quelle est votre positionnement ?
Troisièmement, certains d'entre vous ont donné un différentiel entre un chiffre de dépenses engagées et un chiffre de dépenses remboursées. Sans donner les chiffres, pourriez-vous tous les cinq nous donner les deux lignes - engagements financiers et remboursements, déjà effectués ou en attente - et nous les fournir à nouveau actualisés pour le rapport de juin ? Pourrez-vous alors nous communiquer les dépenses non couvertes et la raison du refus ? Nous vous saurions gré de nous adresser cela dans les meilleurs délais. Ensuite, nous ferons le point à la fin de notre période d'enquête pour vérifier comment les choses se passent dans vos cinq communes.
Quatrièmement, le préjudice : normalement, la couverture du préjudice doit être prise en charge par le FIPOL. Comment percevez-vous le diagnostic sur le préjudice commercial, d'hôtellerie et d'image ? Avez-vous déjà réfléchi à la manière de le calculer ?
M. René LEROUX : Je veux remercier nos collègues maires d'avoir fait ce déplacement ; je suis aussi maire et particulièrement touché par cette marée noire. Je remercie particulièrement mon collègue de Batz-sur-Mer d'avoir souligné l'importance que revêt pour nous l'activité conchylicole et salicole. C'est une grosse interrogation. On se charge aujourd'hui de trouver les meilleures solutions possibles et nous avons interrogé le sous-préfet de St Nazaire sur l'accord du FIPOL.
Je voudrais lui poser une question : il nous a dit avoir recruté 43 personnes sous convention Etat, mais aussi avoir la possibilité d'en recruter sous convention Conseil général. Pour autant que je sache, les personnes que nos recrutons sous convention Etat sont prises directement en charge par l'Etat : il n'y aura donc pas d'avance de fonds de la part des collectivités. J'aimerais que nous soyons d'accord sur ce point avec la sous-préfecture de St Nazaire : il me semble que c'est dans ce sens que nous nous dirigeons.
M. Pierre HERIAUD : Bien que nous soyons sur le sujet de l'indemnisation, j'ai entendu tout à l'heure des problèmes de responsabilité. Quelle était la connaissance que vous, les maires, aviez de l'organisation et du fonctionnement du plan POLMAR terre ? Aviez-vous été associés à sa révision puisque la plupart de ces plans étaient en révision ? Saviez-vous ce que vous aviez à faire et quelles étaient vos responsabilités immédiates en cas de déclenchement de ce plan ?
M. Dominique YVON : Sur les contacts que nous avions avec la société TotalFinaElf : en tant que maire, j'ai pris contact avec la direction générale de TotalFinaElf dès le 27 décembre pour lui demander d'étudier un contrat de partenariat entre la commune de Groix et cette société. Huit jours après, nous avons reçu une réponse favorable.
Depuis la fin du mois de décembre, TotalFinaElf a mis à la disposition de la commune deux sociétés privées, chargées du gros nettoyage. Ils utilisent 13 personnes sur l'île, qui travaillent en permanence avec de gros moyens. Certaines criques étaient endommagées et il fallait descendre en rappel. C'est donc TotalFinaElf qui a pris en charge une grande partie de ce nettoyage. Les travailleurs sont toujours à l'ouvrage avec les Karcher pour le nettoyage fin.
Quant à la dernière question sur ce que nous avions à faire dans le cadre du plan POLMAR, j'avoue qu'a priori nous ne disposions pas de beaucoup d'informations : nous nous sommes débrouillés avec les moyens du bord, c'est-à-dire avec des pelles et des seaux. Surtout pendant les vacances de Noël, entre le 24 décembre et le 5 janvier, les maires ont eu des périodes de blues intense, sans moyens et submergés par les arrivées constantes de fioul.
Pour le FIPOL, je n'ai eu aucun contact personnel. Nous avons eu une ou deux réunions à la préfecture. On nous a laissé entendre que les taux d'indemnisation n'étaient pas connus, que le montant de 1,2 milliard de francs serait certainement très insuffisant. Nous aurons des factures directes d'heures travaillées à présenter au FIPOL. Chez nous, elles s'élèvent à un peu plus de 100.000 F, ce qui est relativement modeste. Si nous devons faire une croix dessus, nous le ferons. Mais nous n'avons eu aucun contact avec le FIPOL pour l'instant.
M. le Rapporteur : Quel est le montant estimé de la participation de TotalFinaElf ?
M. Dominique YVON : Ils en sont pour l'instant à plusieurs centaines de milliers de francs, voire un million de francs.
M. le Rapporteur : Et ce montant n'est pas intégré dans les 2,1 millions de francs ?
M. Dominique YVON : Non, ils ont 13 ou 14 personnes qui travaillent depuis un bon moment ; ils ont acheté du matériel, des Karcher, un véhicule pour aller partout sans abîmer la nature, un « quad ». Ils doivent en être au moins à un million de francs.
M. René LEROUX : Pour vous donner un chiffre : le nettoyage des enrochements du port de pêche de La Turballe a coûté à la société TotalFinaElf 2,5 millions de francs à ce jour.
M. Jean-Yves BANNET : Pour répondre à la question de savoir si nous étions au courant du dispositif POLMAR, je dis non, mais nous avons appris vite, largement aussi vite que les services de l'Etat, tous en même temps ; nous sommes presque devenus des spécialistes et je crois que nous nous y connaissons aujourd'hui. C'est un premier point.
Pour TotalFinaElf, j'ai eu, au téléphone, le président Desmaret très tôt. Un de mes concitoyens en est un ami de jeunesse : suite à un contact, M. Desmaret a répondu qu'il allait intervenir. Ce fut le cas, mais avec retard. Nous l'avons constaté pour le nettoyage et pour l'évacuation des déchets : nous en sommes à 1500 tonnes sur 3000 en raison de divers problèmes compréhensibles. Actuellement, TotalFinaElf paie environ 40 personnes sur Belle-Île.
Nous avons fait l'acquisition de huit appareils de nettoyage, fournis par TotalFinaElf : le coût total est de 400.000 F.
M. le Rapporteur : Pourriez-vous chiffrer complètement ce que TotalFinaElf consacre à Belle-Île ?
M. Jean-Yves BANNET : C'est très difficile, mais il s'agit d'une grosse somme. Nous essaierons d'avoir des renseignements, mais ce n'est pas facile avec eux.
Je pense qu'il s'agit d'une somme importante, compte tenu des chantiers entrepris qui exigent environ 40 personnes d'entreprises spécialisées. TotalFinaElf est bien présent.
M. le Rapporteur : Avez-vous l'impression que TotalFinaElf joue le jeu ?
M. Jean-Yves BANNET : Certainement, TotalFinaElf a joué le jeu chez nous. Nous demandons toujours plus, vous savez ce que c'est ! TotalFinaElf : peut mieux faire, à continuer !
Pour ce qui concerne l'hôtellerie et la restauration, la baisse du chiffre de réservation approche les 30 % pour l'été, davantage pour Pâques. Nos hôteliers et restaurateurs vivent une très grande inquiétude. Nous sommes en liaison avec le FIPOL ; on parle de 1,2 milliard de francs disponibles mais on ignore ce que cela représente ; on craint qu'il n'y en ait pas assez.
On apprend ensuite que les Anglais décideront du pourcentage de remboursement, ce qui fait trembler tout le monde : ils décideraient de combien nous serons remboursés ! Nos hôteliers et restaurateurs sont inquiets : ils craignent pour l'image. Ce n'est pas TotalFinaElf qui la réparera. Qui ? Certainement pas le FIPOL qui a autre chose à faire. Il faudra réparer un jour : nous sommes tous conscients de la difficulté.
M. le Rapporteur : Concernant les relations avec le FIPOL ?
M. Jean-Yves BANNET : Avant-hier, une de mes collaboratrices appelle le bureau du FIPOL à Lorient. Son compte rendu : « Je ne sais pas s'ils parlent comme nous : on ne comprend rien à ce qu'ils disent ». Ils ne savent pas ou ne veulent pas communiquer.
M. Loïc LE MEUR : Je ne connaissais pas le plan POLMAR. Nous avons eu la chance sur la commune d'avoir le premier PC POLMAR avancé. Les services de l'Etat, avec les moyens dont ils disposaient, vu que tout avait été descendu en Vendée, ont été particulièrement performants sur nos trois communes traitées depuis ce PC : Guidel, Ploemeur et Larmor-Plage. Leur efficacité était remarquable et nous nous sommes mis sous les ordres du PC POLMAR avancé, avec tous les moyens à notre disposition. J'ai lu récemment la circulaire de décembre 1997 que je ne connaissais pas.
TotalFinaElf n'intervient donc pas sur ma commune. Dans le courant du mois de janvier, j'ai rencontré un représentant de la mission Atlantique de TotalFinaElf. Il m'a dit que la société nous aiderait si nous avions besoin d'eux et il m'a remis sa carte. Lorsque nous avons eu besoin de matériel de nettoyage de galets, je l'ai appelé : aucune réponse, zéro, aucun moyen. Nous nous sommes débrouillés seuls. Comme la cellule POLMAR ne disposait pas encore des moyens financiers, la commune a loué du matériel extérieur, dont des bétonnières pour nettoyer les galets.
A titre anecdotique, nous avions besoin de produits pour décrocher les galets. Par hasard, il s'agit de produits de TotalFinaElf. Nous avons été contraints de les acheter : TotalFinaElf ne nous les livrait pas. Après, la situation s'est résolue.
Sur les relations avec le FIPOL : le 28 février, nous avons déposé en mains propres un dossier pour un montant de 1,4 million de francs, relatif à des dépenses communales, tant en main-d'_uvre qu'en matériel mis à disposition entre le 20 décembre - recueil des oiseaux mazoutés, puis le 24 décembre au matin lorsque nous avons été atteints - jusqu'à la fin janvier. Je n'ai même pas reçu un accusé de réception du FIPOL.
En revanche, j'ai obtenu des informations par la préfecture et par le biais d'un autre collègue maire, qui avait déposé un dossier quasiment à la même période, et qui a rencontré un représentant du FIPOL peu après parce qu'il s'interrogeait sur le coût du personnel, sur le taux du matériel, etc.
Etant sous statut de la fonction publique, par rapport au grade, le taux horaire du personnel est parfaitement connu même si le taux horaire du matériel mis à disposition peut être remis en question. Pour l'instant, j'attends et je n'ai toujours pas de réponse.
Tout à l'heure, j'ai oublié de mentionner que nous avons 60 contrats à durée déterminée (CDD), sous convention d'Etat. La logistique est assurée par la commune et, fort heureusement, par la communauté d'agglomérations du Pays de Lorient. Sans elle, nous aurions eu d'énormes difficultés : pour nos sept communes touchées du Pays de Lorient, elle a acquis pour 1,5 million de francs de matériel de nettoyage que nous n'étions pas capables de payer à cause des autres débours financiers. Heureusement que nous avons eu l'appui de la collectivité intercommunale, mais la commune doit assurer une partie de la logistique destinée à ces CDD sous convention d'Etat.
Le préjudice économique est difficile à évaluer. Ma commune double sa population l'été : elle passe de 19.200 habitants à 40 ou 42.000. Nous faisons souvent nos constats en octobre : ils sont évalués par les consommations d'eau, les déchets ménagers, etc.
Nous manquons aujourd'hui d'un outil d'évaluation de l'activité économique. A l'échelle des communes touristiques, il n'existe pas d'observatoire du tourisme et de la fréquentation touristique sur nos communes. L'évaluation est très difficile. Nous disposerons de chiffres à la fin de l'année. J'ai fait un premier tour : nous avons 9 campings sur ma commune, dont un ouvert toute l'année, avec des moyens importants, qui a constaté une chute d'au moins 50 % de ses réservations pour l'été.
M. le Rapporteur : Sur votre commune, envisagez-vous une méthode d'évaluation ou êtes-vous dans l'impossibilité de répondre à cette question ?
M. Loïc LE MEUR : Aujourd'hui, il est impossible de répondre. Ce ne sera possible que sur la fréquentation à la fin de l'été et à partir d'évaluations. En outre, c'est une activité saisonnière : comment évaluer quand la direction du tourisme dit que, pour un lit touristique déclaré, il y en a au moins un autre dans la famille ou chez les amis ? Ce phénomène est marquant en Bretagne. Tout cela génère de l'activité économique, à travers les commerces.
Or, vous savez la difficulté à connaître le chiffre d'affaires d'un supermarché. Le gérant refuse de le transmettre. Pour un lit touristique déclaré, nous pourrons savoir le préjudice en automne, mais pas pour les autres lits touristiques. La Bretagne repose sur des vacances familiales : la famille et les amis constituent le lieu d'hébergement et nous ne le mesurerons pas. Notre indicateur de fréquentation réside surtout dans la consommation d'eau en fonction de la saison.
M. Jacques FRAISSE : S'agissant du plan POLMAR, je n'ai pas eu de problème : la nappe oscillant entre l'île d'Yeu et la côte vendéenne, nous avons eu le temps de nous organiser. Le préfet était présent sans arrêt. Nous sommes le deuxième lieu d'accueil de colonies de vacances en France et nous n'avons donc pas eu de problème pour loger les pompiers, les gendarmes, etc. Nous avons ainsi eu le temps de nous mettre au courant. Une pollution a atteint la corniche classée ; deux heures après, le préfet était sur place pour vérifier les dégâts.
En ce qui concerne les rapports avec le FIPOL, nous venons d'envoyer notre première note, d'un montant de 900.000 F. Elle correspond à ce que nous disions auparavant : personnel communal, location de matériel, plus les repas et boissons des bénévoles.
Quant à nos relations avec TotalFinaElf, nous savons que la corniche vendéenne, où des nappes sont en train de flotter, viendra en dernier. Nous l'acceptons, car nos collègues des îles, comme Belle-îlle et d'autres, sont plus touchés. La corniche vendéenne n'est pas trop atteinte et ce n'est pas un problème de passer en dernier. J'espère qu'ils ne nous feront pas un « chantage » par rapport à l'arrêté !
Sur la proposition de M. Labbé, représentant TotalFinaElf en Vendée nous venons de commander une cribleuse par marché négocié pour 535.000 F TTC. Nous recevons 30 % du Conseil général, 30 % de la Région et TotalFinaElf nous propose 30 %. Nous hésitons : faut-il ou non accepter ?
M. le Rapporteur : Vos relations ne sont pas donc pas bonnes ?
M. Jacques FRAISSE : Notre avocat, Me Lepage, nous dit qu'il ne faut pas trop négocier.
M. le Rapporteur : Vous n'avez donc pas eu d'intervention lourde de TotalFinaElf dans votre commune, comme à Groix ou Belle-île ?
M. Jacques FRAISSE : La société interviendra sur la corniche. Pour nous, la saison risque d'être catastrophique. Nous passons normalement de 9.000 habitants à plus de 150.000 en été. Avec St Jean-de-Monts, nous sommes la première ville de Vendée en été. Nous avons la deuxième capacité de France en hôtels de tourisme, après Argelès, et 48 campings.
Grâce aux indicateurs actuels et à ceux que nous mettrons en place - taxe professionnelle des entreprises, taxe de séjour, tonnage des ordures ménagères - nous pourrons mesurer l'impact sur la fréquentation touristique. Mais nous savons que nous avons au moins 40 % d'échappement des taxes de séjour dans les campings.
La solution ne viendra pas par les panneaux et indications qu'on nous demande de placer sur toutes les plages indiquant « Plage polluée mais nettoyée. Attention au goudron : allez voir le pharmacien ou les pompiers. » On nous demande de placer dans les offices de tourisme, les campings, les hôtels, des papillons expliquant que, si quelqu'un a un peu de goudron sur les pieds, il convient d'aller voir un médecin. Je suis médecin : c'est de la folie. J'ai envie de placer des panneaux : « Tout ce que vous risquez, c'est d'avoir un peu de goudron, facile à nettoyer ».
Nos premiers indices sont fournis par les colonies de vacances en provenance d'Argenteuil, de Nanterre qui nous envoient ordinairement 600 gamins par été. Aujourd'hui, ils nous demandent de nous positionner par rapport aux risques. Que vais-je répondre à ces maires ? Bien sûr, je ne vais pas mentir : j'essaierai d'expliquer la situation, mais j'ignore quelle sera leur réaction. Nous risquons donc une baisse de fréquentation très importante. Selon les indications des offices de tourisme s'agissant des réservations, la baisse devrait se situer entre 10 et 30 % pour le moment.
M. Loïc PROVOST : Sur le plan POLMAR, quant à savoir si nous étions préparés, je n'ai pas une très bonne réponse et il vaudrait mieux voir la question avec le maire. Nous n'en avons pas discuté. J'ai l'impression que tout a relativement bien fonctionné sur notre commune grâce à la présence du sous-préfet qui a pu mettre en place une réunion d'organisation dès le dimanche soir. J'ajoute que la commune a pris les devants, sans attendre que tout se fasse tout seul. Ensuite, le PC a poursuivi.
Au niveau de la commune, je considère donc que nous avons été efficaces rapidement, que nous avons travaillé vite, proprement, en veillant à ne pas repolluer, ce qui était le problème des premières semaines. Au début, il fallait tout nettoyer, donc on repolluait le sol. Voilà pour le Plan POLMAR.
Pour le FIPOL, nous n'avons pas de dossier engagé parce que les intérêts de la commune sont défendus par le cabinet Huglo-Lepage. Nous nous interrogeons quant à savoir si nous continuons la procédure engagée sur son conseil ou si nous demandons une indemnisation directe au FIPOL.
Sur les relations avec TotalFinaElf : elles existent, mais elles sont ténues. La société est intervenue au début pour prendre en charge directement des factures. Nous ne l'avons pas souhaité. Concrètement, une dizaine ou une quinzaine de membres de leur personnel interviennent sur le site de Saint Michel, qui est passé à la télévision le premier soir, site très visité. Cela reste un petit chantier : 150 personnes travaillent sur l'ensemble de la commune, pour 7 kilomètres de côtes, mais eux interviennent à dix ou quinze sur une centaine de mètres de rochers seulement. Leur intervention est très ponctuelle.
Pour les préjudices, je ne rappellerai pas tout ce qu'ont dit les collègues. Je voudrais insister sur quelque chose d'incalculable : les préjudices subis par les gens qui ne pourront pas travailler la saison. Notre commune est touristique ; toutes les personnes qui vivent sur place et qui arrivent à boucler l'année grâce à 6 ou 7 mois de salaire auront de grosses difficultés à le faire avec deux mois d'activité seulement. Les communes auront à y faire face plus tard. Ce préjudice sera difficilement évaluable mais il existera bel et bien.
Si les restaurateurs, hôtelleries de plein air et commerçants pourront isoler un préjudice net et précis par rapport au chiffre d'affaires, ils ne pourront pas mettre en avant l'absence des deux personnes habituellement embauchées.
M. le Rapporteur : Vous n'avez pas imaginé un processus d'identification du préjudice ?
M. Loïc PROVOST : Nous avons réfléchi mais, pour l'instant, nous n'avons pas encore trouvé de moyen. C'est vrai que les 48 postes débloqués par l'Etat permettent actuellement de pallier cette situation. Provisoirement, on a pris des gens du coin qui auraient du mal à trouver du travail en saison. Ce sera un préjudice que nous verrons sans doute au niveau du CCAS. Beaucoup de gens habitent dans le coin et ne s'en sortent que par quelques mois de travail dans l'année.
M. François GOULARD : J'aimerais revenir sur les relations avec la société TotalFinaElf, en particulier pour demander à M. Fraisse de nous donner des précisions sur ses relations avec cette société. Vous avez évoqué tout à l'heure, vous fondant sur la loi de 1975, la mise en demeure adressée aux détenteurs des déchets de bien vouloir les ramasser. Elle est destinée à engager ensuite la responsabilité de cette société.
Vous avez laissé entendre que vous auriez subi des pressions de la part de cette société qui aurait menacé de ne pas réaliser les travaux qu'elle envisageait de conduire sur le territoire de votre commune. Dans quels termes cela a-t-il été exprimé ? Cette affaire me paraît grave : le mot « chantage » a été prononcé, même s'il était placé oralement entre guillemets. Pouvez-vous être plus précis sur les termes utilisés ?
M. Gilbert LE BRIS : En tant que maires, nous sommes tous soumis, par l'intermédiaire des préfets, à une obligation d'information sur l'état des plages. Qui dit information dit risque de contentieux supplémentaire : cet élément m'amène à vous poser la question de savoir si vous avez envisagé d'augmenter vos polices d'assurance et, surtout, si vous avez songé à demander au FIPOL ou au fonds POLMAR de les payer pour vous ?
M. Jean-Michel MARCHAND : Je reviens sur les relations avec Totalfina Elf. En vous écoutant, j'ai eu le sentiment qu'il existerait deux poids, deux mesures. TotalFinaElf intervient à certains endroits, avec des relations très contractualisées, presque amicales. Dans d'autres endroits, TotalFinaElf n'est pas du tout présent et, finalement, on entend des menaces de sa part. Est-ce simplement une impression, parce que nous n'avons qu'un petit échantillon des maires, ou est-ce une réalité ? Cette menace pèse-t-elle parce que vous avez pris un arrêté, M. le maire ? La réponse ne pourrait-elle pas être une cohésion entre tous les maires de faire le choix que tout le monde prenne cet arrêté ? J'émets ici un simple avis, bien entendu.
Je suis étonné que TotalFinaElf se comporte de cette manière. Derrière tout cela, il doit y avoir la volonté, non pas de réparer le préjudice, mais de créer des différences, voire des divergences entre les diverses collectivités. Comme rien ne se fait sans intention, ce doit être pour en retirer des bénéfices plus tard.
Ma deuxième question concerne aussi ce que vous avez dit, M. Fraisse : vous n'avez plus de bénévoles. Pour vous aider, il reste soit des militaires soit des pompiers, soit des partenariats d'autres communes. Vous avez encore de ces gens mis à disposition par d'autres communes ?
M. Loïc PROVOST : Cela se termine aussi.
M. Jean-Michel MARCHAND : Ainsi, dans les semaines qui viennent, le travail ne pourra se poursuivre qu'avec peu de bras. Concernant ces bénévoles, l'inquiétude est grande à cause de la toxicité du produit et des risques à moyen terme ou long terme de cette toxicité. Les avertissements qu'il vous a été demandé d'afficher participent-ils du principe de précaution ? Comment pourrez-vous les gérer ? En plus, j'ai bien entendu que votre commune accueillait de nombreux enfants ou des jeunes. C'est aussi un problème qui ne peut être géré que globalement ; il faut une vraie cohésion.
M. Louis GUEDON : Faisant partie de la catégorie des maires auditionnés, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'ils ont dit, mais on ne peut pas aborder tous les aspects du dossier en quelques minutes. Je voudrais donc apporter un complément d'information à la Commission.
Je suis d'accord avec ce qu'ont dit mes collègues : ils ont fait le point sur les réactions immédiates et ont souligné l'urgence et la nécessité de faire en sorte que les plages retrouvent leur propreté.
A présent, avec les difficultés de remboursement des uns et des autres, avec les relations avec le FIPOL ou TotalFinaElf - je n'ai aucune relation avec l'un ou l'autre, contrairement à Jacques Fraisse -, le problème est de sauvegarder l'équilibre économique de nos régions, désormais menacé, mais dans des proportions difficiles à évaluer. Dans ce domaine, l'affaire est claire : on ira au besoin au contentieux. Cela a été dit en début de réunion : nous disposons de trois ans pour monter les dossiers. Nous ne pouvons pas ne pas tenir compte des déficits d'images, évalués maintenant à travers les sondages que nous faisons tous auprès de tous les professionnels - hôteliers, meublés, campings... Mais ce ne sont que des sondages : à la fin de l'année, lors du bilan, nous pourrons calculer le déficit et demander des réparations.
La crainte est que le 1,2 milliard de francs du FIPOL soit insuffisant pour réparer ce déficit.
Un autre aspect a été évoqué par l'adjoint au maire de Batz-sur- Mer : indépendamment du déficit des entreprises, les pertes immédiates de certains emplois saisonniers pèseront lourdement sur les ressources de certaines familles. Cela fera partie du bilan du nombre d'emplois saisonniers que chaque commune aura perdu pendant ces trois ans au regard du nombre d'emplois saisonniers dont elle bénéficiait avant. Ce dossier sera difficile à gérer.
Concernant les bénévoles, sur les zones rocheuses, vu que les rivages sédimentaires sont déjà complètement nettoyés, l'application du plan POLMAR par le préfet de Vendée a été remarquable. Mais il nous a toujours interdit de faire travailler des bénévoles sur les côtes rocheuses compte tenu des risques. Actuellement, dans le cadre du plan POLMAR a été lancé un appel d'offres, dont les résultats devraient être connus fin avril, pour faire en sorte que des entreprises spécialisées procèdent au nettoyage des côtes rocheuses.
M. le Président : Je rappelle que la conversation pourra se poursuivre à l'issue de notre réunion quand elle ne concerne pas l'indemnisation à proprement parler.
M. Aimé KERGUERIS : Je voudrais demander aux trois maires si on leur a demandé à un moment donné de ne pas se porter partie civile, car cela aurait risqué de gêner la procédure d'indemnisation devant le FIPOL ou TotalFinaElf. En tout cas, quelle a été la réaction du FIPOL ou de TotalFinaElf ?
Mme Jacqueline LAZARD : S'agissant du remboursement lié aux heures de travail d'employés municipaux requis du fait de la mise en place du plan POLMAR, ce travail était sous la responsabilité du préfet. Avez-vous interrogé à ce sujet les services préfectoraux sur la possibilité d'une prise en charge des heures normales et supplémentaires par l'Etat ?
M. Loïc LE MEUR : Nous travaillons depuis deux jours avec notre avocat, un expert en ces domaines. C'est lui qui nous a amenés à cette réflexion. J'ai interrogé et j'ai transmis une petite note au directeur de cabinet du préfet, avec lequel nous entretenons d'excellentes relations. Dans ce département, cela marche très bien et nous pouvons nous parler très rapidement. Je lui ai soumis ce matin cette question. C'est à suivre.
Nous a-t-on demandé de ne pas nous porter partie civile ? Non, je n'ai jamais été interrogé sur ce point. Nous sommes restés avec notre conseil. Nous travaillons avec lui depuis un certain temps et nous n'avons pas voulu entrer dans des procédures contentieuses. C'est pourquoi nous avons déposé un dossier auprès du FIPOL très rapidement, sans chercher d'autre voie juridique. Je ne mesure pas les enjeux à mon échelle. Nous avons préféré prendre nos précautions en envoyant nos dossiers. Nous verrons après. Maintenant, l'analyse est un peu différente en fonction de l'étude de la situation.
Sur les polices d'assurance, nous n'avons pris qu'une seule mesure, celle d'élargir notre responsabilité à la présence des bénévoles. C'est l'inquiétude que nous pouvions avoir.
Sur les principes de précaution, nous avons quelques inquiétudes aujourd'hui : on nous demande de poser des panneaux sur les 14 plages et criques de ma commune, classées en catégorie 3 par rapport à la circulaire. J'avoue que j'ai demandé immédiatement le passage de la DDASS parce que je ne voulais pas les poser. Devant la contrainte, puisque d'autres collègues ont décidés de les poser et que des groupes ont créé une telle psychose médiatique, je suis forcé de les poser. Ce sera fait cet après-midi car nous ne pouvons pas rester isolés.
J'ai testé le texte qu'il est prévu d'afficher à des acteurs économiques : il n'y a pas pire que de dire que ce produit peut dégager des allergies, que les principaux effets qui se produisent sont des irritations...
M. le Président : M. le maire, comme cette campagne médiatique nous interpellait, nous avons réuni en présence de la presse l'ensemble des laboratoires publics et privé - privé étant relatif au laboratoire Analytika - de façon à faire le point sur cette question. Tout en restant prudent, sans être moi-même scientifique, je dois dire que l'hypothèse de dangers très importants que laissaient planer certaines informations s'est pour le moins dégonflée au cours de cette audition.
M. Loïc LE MEUR : M. le président, j'ai eu écho de cette réunion, très rassurante pour nous. A mon sens, ce texte redonne une nouvelle inquiétude : il est ridicule de le retrouver présent sur toutes les plages. Mais puisque certains les ont placés, nous sommes contraints de suivre.
Un comité anti-marée noire, non situé dans ce département, a téléphoné la semaine dernière à la mairie de Ploemeur pour dire qu'il s'attachait à vouloir déposer plainte contre les maires qui encadraient les bénévoles. Le texte qui nous est imposé provient de la Direction générale de la santé, par l'intermédiaire du préfet, mais ce n'est pas un arrêté préfectoral. Les maires doivent donc apposer ces panneaux sur leurs plages à leur initiative. Nous prenons donc de plein fouet la responsabilité de la pose de ce panneau.
M. Jacques FRAISSE : Sur le problème TotalFinaElf : je veux retirer les mots « menace » et « chantage » en parlant plutôt d'un amical conseil. Avec le représentant de TotalFinaElf, nous avons parlé de ces arrêtés et de ces notifications visant à l'enlèvement des déchets. Il m'a dit qu'il n'y avait en Vendée que trois communes qui avaient suivi cette voie : La Tranche, Noirmoutier et Jard-sur-Mer, je crois.
C'est un autre cabinet d'avocats que celui que nous avons choisi qui a conseillé cette procédure. Le représentant de TotalFinaElf a dit que nous avions intérêt à collaborer pour que les plages soient vite nettoyées ; en cas de plaintes, d'arrêtés et de notifications fondées sur la loi sur les déchets, leurs avocats seraient obligés de les déférer devant le tribunal administratif. Leur défense serait de dire que le plan POLMAR donne tout pouvoir au préfet et retire au maire ses pouvoirs habituels de police. Le maire n'est plus fondé à édicter des arrêtés contre TotalFinaElf : c'est l'affaire du préfet. Voilà ce que serait leur mode de défense.
Il a ajouté que si leurs avocats devaient réagir ainsi, cela retarderait le chantier. Voilà comment les choses se sont passées ; c'était donc plus enrobé. Le mot « chantage » serait grave.
D'autre part, par rapport à ces demandes d'affichages et à la question des assurances, j'ai demandé à mon secrétaire général : que faisons-nous ? Nous assurons-nous ? Y a-t-il possibilité de nous assurer ? S'agissant des panneaux, j'ai aussi hésité ; mais le sous-préfet a pris le soin, samedi dernier, de téléphoner à tous les maires de Vendée pour leur expliquer que c'était pour se protéger : ils éviteraient toute possibilité de recours contre nous. Faut-il alors s'assurer de manière supplémentaire ? Je ne le sais pas.
M. Loïc PROVOST : Sur les relations avec TotalFinaElf, j'ai l'impression
- je pèse mes mots -, qu'il y a de « bonnes » communes et de « mauvaises » communes et que les bonnes auront plus de choses que les mauvaises.
M. le Rapporteur : Il faut être une île pour être bonne commune ?
M. Loïc PROVOST : Non, pas du tout, mais nous avons senti à travers nos relations avec eux que, si l'on collaborait, ce serait plus facile de recevoir du matériel ou de l'aide.
M. le Président : Que signifie votre expression « si l'on collaborait » ? Soyez précis parce que vous êtes sous serment et que ce sont des choses importantes : qu'entendez-vous par là ?
M. Loïc PROVOST : Oui, mais il n'y a pas d'écrits : les choses se passent oralement, lors d'une visite.
M. le Président : Il ne faut pas que la commune mette TotalFinaElf en accusation ?
M. Loïc PROVOST : Je ne sais pas. C'est au maire de le préciser. Mais quand quelqu'un vient pour proposer de payer les factures, on a jugé que ce n'était pas forcément la meilleure base pour avancer. Donc... C'est un sentiment que j'exprime, que nous partageons.
M. le Rapporteur : C'est le même sentiment que votre maire ?
M. Loïc PROVOST : Je pense que oui.
Concernant les bénévoles nous n'en avons presque plus mais heureusement nous sommes aidés énormément par des Lorrains, des travailleurs des houillères, qui sont en préretraite à 45 ans et qui sont une trentaine chaque semaine à nous aider. Actuellement, pour 120 personnes affectées au nettoyage sur la commune et 6 km de côte au total, 100 mètres de côte sont nettoyés par semaine de travail. Faites le calcul !
M. Jean-Michel MARCHAND: Ces mineurs sont-ils considérés comme bénévoles ou sont-ils mis à la disposition de la commune par un organisme ou une collectivité ?
M. Loïc PROVOST : Ils sont mis à disposition par les houillères puisqu'ils sont salariés en préretraite dans le cadre d'un plan de fermeture de mine. Ils sont âgés de plus de 45 ans.
Actuellement le rythme de travail est lent. Le maire est à Nantes aujourd'hui pour demander des moyens supplémentaires. Car si l'on peut se satisfaire que La Baule et Pornichet soient ouverts, ce qui est positif, chez nous, au rythme actuel des travaux, nous en sommes au point de nous demander si ce sera ouvert pour juillet et août. Il faut multiplier les moyens par deux ou trois. Sinon, selon le planning, nous ne serons pas prêts pour le mois de juillet. Imaginez la situation : nous craignons le pire.
S'agissant des assurances, nous avons renforcé notre contrat pour les bénévoles. Depuis quelques jours, toutes nos côtes et nos plages sont interdites à la circulation et cette mesure est signalée par des affiches.
M. Jacques FRAISSE : J'ai oublié de répondre à une question : j'ai arrêté tout chantier bénévole, de même que le personnel communal s'est arrêté durant 48 heures, quand a été avancée cette notion de dangerosité cancérigène. J'ai demandé des instructions au préfet. Nous avons revu le personnel communal : nous avons dégonflé l'information et ils ont été volontaires pour reprendre le travail. Je n'ai pas voulu l'imposer.
Le problème avec les bénévoles, c'est que, pour respecter les règles de sécurité imposées, il faut porter un masque. Les compagnies d'assurances acceptent de couvrir ce risque, mais on ne sait jamais quant à la possibilité de gens travaillant sans masque, par manque de discipline. Nous ne voulons pas prendre une telle responsabilité, bien que je sois certain qu'ils ne risquent rien.
Audition de M. Jean-Noël ANDRÉ,
président du Comité des pêches de Vannes-Auray,
M. Jean-Marc BARREY, président du Comité des pêches de Lorient,
M. Alain DRÉANO, secrétaire général de la section régionale
conchylicole de Bretagne sud,
M. Jean-Marc RIO, président du Comité des pêches de La Turballe,
M. Jacques SOURBIER,
président de la section régionale conchylicole des Pays de la Loire
(extrait du procès-verbal de la séance du 6 avril 2000 à Lorient)
Présidence de M. Daniel PAUL, Président
MM. Jean-Noël André, Louis Ferrero, Jean-Marc Barrey, Alain Dréano, Jean-Marc Rio et Jacques Sourbier sont introduits.
M. le Président leur rappelle que les dispositions législatives relatives aux commissions d'enquête leur ont été communiquées. A l'invitation du Président, MM. Jean-Noël André, Louis Ferrero, Jean-Marc Barrey, Alain Dréano, Jean-Marc Rio et Jacques Sourbier prêtent serment.
M. Jean-Marc BARREY : M. le président, notre rôle est de vous dire comment les indemnisations se sont opérées. De la rapidité, il y en a eu ; de l'efficacité, beaucoup moins, notamment de la part du FIPOL. La différence était grande entre les déclarations, voire les prétentions du FIPOL par rapport aux réalités sur le terrain. Beaucoup de publicité, de déclarations via les médias, la télévision ; une mise en place rapide du bureau d'indemnisation à Lorient, tout cela s'est fait en moins d'un mois.
Mais, lorsque les gens directement atteints ont frappé à la porte de ce bureau « d'indemnisation » de Lorient, ils se sont aperçus qu'ils se heurtaient à un mur : d'une part, ce n'est pas un bureau FIPOL mais un simple relais, pour ne pas dire un bureau écran. C'est notre conviction et nous sommes ici pour dire la vérité.
Il y a en fait deux bureaux écrans, qui sont d'une part le bureau d'indemnisation à Lorient, qui commence par filtrer, et une société d'expertise, dite COFREPECHE, située à Brest, à qui on renvoie la responsabilité en disant aux gens que l'expert en réfère au bureau d'indemnisation de Lorient qui lui-même en réfère ensuite à Londres.
Bref, un délai extrêmement long, des difficultés énormes, des dossiers imprécis, des informations erronées de la part de ces gens qui donnent les instructions. On ne conseille pas ceux qui déposent les dossiers de façon transparente et efficace. Donc, une efficacité nulle, beaucoup d'effets médiatiques, et les conchyliculteurs, les pêcheurs à pied, entre autres, qui ont vécu un premier trimestre 2 000 effroyable.
M. Jean-Noël ANDRE : M. le président, pour 98 % de la flotte, nos navires sont de petits bateaux, en majorité de moins de 12 mètres. Nous sommes donc « scotchés » dans les eaux sales depuis le début. Les dossiers ont été déposées pour l'indemnisation du matériel souillé et pour les deux pêcheries fermées.
Aujourd'hui, face au FIPOL, on bute sur la question du manque à gagner dans des dossiers déjà montés et déposés depuis le début du mois de février. Voilà donc deux mois que cela dure. Les pêcheurs sont très inquiets et commencent à grogner. En tant que responsable, j'essaie de les calmer, de leur laisser espérer un dédommagement rapide, mais je suis aussi inquiet : je ne sais pas où l'on va avec le FIPOL. C'est très difficile à supporter en tant qu'élu.
Une autre question concerne nos marins : ils s'inquiètent sur le devenir du trafic maritime, en particulier des pétroliers. Ils demandent qu'au départ de chaque port, les pétroliers aient dégazé et soient en possession d'une fiche de partance, après une visite en bonne et due forme, de façon à éviter ces profiteurs de catastrophe que l'on observe aujourd'hui sur nos côtes.
Nous avons beaucoup de pression avec nos pêcheurs, ils sont prêts à démarrer. J'espère pouvoir les maintenir.
M. Jean-Marc RIO : Je suis président du Comité local des pêches de La Turballe, qui n'ont subi aucune perte d'exploitation. Les pertes subies consistent uniquement en matériel souillé quand la marée noire est passée par-dessus les jetées alors que le matériel était stocké sur les quais. Ces dossiers ont été montés par le groupement de gestion et par le port de La Turballe, qui avait énormément de matériel stocké en caisses (palettes et tout ce qu'il fallait pour la prochaine campagne).
Ces dossiers ont été déposés en temps et en heure au FIPOL. Nous avons rencontré des problèmes quand le FIPOL nous a dit qu'il fallait déposer des dossiers avec factures. Nous les avons données.
Or, ils ne prennent les factures qu'à hauteur de 70 % avant d'appliquer un taux de vétusté. Là, cela ne passe plus. Un chalut coûte 100 ou 200 000 F. Une prise en compte à 70 %, plus 3 ou 4 ans d'usage pour des matériels qui ne peuvent pas être remis à l'eau, nécessitant automatiquement le rachat de nouveau matériel, ne pourra satisfaire les intéressés quand ils recevront la confirmation écrite de ce qui leur a été annoncé verbalement. Tout le monde tourne en rond autour du problème.
Quand on demande des nouvelles, on nous renvoie de bureau en bureau ; personne ne nous répond ou le fait de manière évasive. Un jour, les dossiers sont à Londres, un jour, ils sont à l'étude. Si quelqu'un pouvait nous renseigner le plus vite possible, cela calmerait les esprits sur la côte.
M. Jacques SOURBIER : Je suis responsable conchylicole de la section régionale centre-ouest. Ma zone de compétence concerne essentiellement les Pays de la Loire et, plus au sud, la Charente-Maritime, mon collègue étant représentant de la région Bretagne sud.
Contrairement à ce qui a été dit, nous n'avons pas été atteints au niveau des productions ni au niveau des cycles de production pour les années à venir. Mais nous avons subi un très fort préjudice commercial qui s'étend à l'ensemble de la filière conchylicole et qui déborde largement des zones géographiques touchées par la marée noire. En ce premier trimestre 2000, les chiffres d'affaires des entreprises ont été touchés dans un ordre de grandeur de 30 % à 60 % selon les entreprises.
Une perte d'activité, une perte de chiffre d'affaires sont un manque à gagner considérable, d'autant que, les exercices comptables étant clos en juin, cette période de l'année constitue en réalité, la consolidation, voire le résultat net de l'entreprise. C'est donc une mise en difficulté évidente de la filière conchylicole et des entreprises de nos régions.
La procédure d'indemnisation est plus ou moins complexe selon les régions : en Pays de Loire, un dispositif régional, dans un premier temps, a permis aux ostréiculteurs de bénéficier d'avances sur les indemnisations du FIPOL, au travers d'aides consenties par la région. De la même manière, l'ensemble de la filière doit bénéficier des aides exceptionnelles mises en place par l'Etat et pour lesquelles nous instruisons des dossiers.
Cela n'enlève en rien l'obligation pour le FIPOL de nous indemniser correctement in fine. Cela permet aux entreprises d'espérer un soutien en trésorerie avec une certaine efficacité par rapport à ce que le FIPOL est en mesure de faire. Si nous n'avions que le FIPOL aujourd'hui - je rejoins les propos de mes collègues de la pêche - pour faire fonctionner nos entreprises, vous auriez l'ensemble d'une filière économique sur les bras. Nous ne bénéficions d'aucune avance au niveau du FIPOL pour faire fonctionner nos entreprises. Avec le préjudice que nous subissons, si nous n'étions pas soutenus par ailleurs, nous ne pourrions pas passer la fin de saison.
Cette procédure FIPOL concerne tout le monde ici. Dans la mesure où notre structure professionnelle est en place avec des moyens humains et le soutien de la région, nous avons entamé une négociation sur la meilleure manière de procéder pour présenter des documents comme preuves du préjudice.
Nous avons rencontré à Lorient le FIPOL accompagné des représentants de la région des Pays de la Loire, et de l'Etat. Nous étions sortis de réunion avec le sentiment que nous pouvions avoir une attitude et des méthodes d'investigation raisonnables, selon la terminologie des représentants du FIPOL.
Néanmoins, lorsque nous leur avons soumis le compte rendu de cette réunion, nous avons obtenu une fin de non-recevoir : ils ne reconnaissaient pas la teneur des propos qu'ils nous avaient tenus la veille.
Cette incertitude a perduré une quinzaine de jours aux termes desquels ils se sont réunis et ont finalement convenu que nos propositions sur la manière de procéder pour l'instruction des dossiers était recevable. Quinze jours après cette affirmation téléphonique, pour laquelle j'avais demandé confirmation écrite, il s'est avéré que, sur le terrain, au-delà de la méthode convenable que nous avions mise en place, les experts - soit de COFREPECHE soit d'autres sociétés d'expertise - exigeaient beaucoup plus, au point que ces demandes n'étaient ni recevables, ni même exécutables.
Nous avions convenu, par exemple, que le principe d'indemnisation était basé sur la perte du chiffre d'affaires sur l'année en cours par comparaison avec l'année antérieure ; nous devions fournir les résultats d'exploitation des trois années antérieures de l'entreprise. Cette méthode avait été acceptée de manière à disposer d'éléments de comparaison globaux. Sur le terrain, les experts réclamaient non seulement ces documents, mais encore une évaluation des stocks à l'instant du sinistre, ce qui est impensable dans notre profession : je mets au défi dix experts de réaliser ce type d'expertise sur le terrain. Ils le savent mais l'exigent malgré tout.
Nous avons réussi à passer cet écueil. Ensuite, ils nous ont demandé le détail des ventes des trois années antérieures. Chaque professionnel devait apporter ses livres comptables ! Cela tenait plus du contrôle fiscal que d'un calcul d'indemnisation. C'était inapplicable. On remarquait clairement une volonté de bloquer le système.
J'ai moi-même voulu vérifier ce point de détail quand j'ai appris leurs exigences : je me suis permis de les appeler. Au téléphone, on m'a dit : « C'est une erreur d'appréciation. Nous sommes désolés. Sur les dossiers, il n'y a pas de problème : c'est bien ce que nous avons dit précédemment ». Or, je viens d'apprendre ce matin que d'autres personnes ont subi le même type d'investigation et sont soumises aux mêmes contraintes.
Il existe manifestement un double langage au sein du FIPOL qui me contrarie énormément. Nous avons l'impression d'un double jeu, une façon de faire patienter. Apparemment, il y a un jeu attentiste de la part du FIPOL qui bloque toute la démarche.
Encore ce matin au téléphone, nous avons demandé à quel moment nous pouvions espérer être indemnisés : « Le règlement interviendra bientôt ». C'est un langage qu'on nous a déjà tenu il y a quinze jours et qu'on nous tiendra dans deux semaines encore. Nous sommes en phase d'incertitude totale. Sur le terrain, la pression monte énormément. Dans les semaines qui viennent, s'il n'y a pas une prise de position tangible du FIPOL, je crains des actions violentes sur le terrain.
Autre observation : le FIPOL ne paie pas ; pour la base professionnelle, le FIPOL ce sont les pétroliers. Bien sûr, il y a des Etats et des gouvernements, mais les pétroliers cotisent aussi dans cette affaire. En fait, le FIPOL dessert ses propres clients en offrant une image négative aux personnes susceptibles d'être indemnisées. Aujourd'hui, quand on dit que le FIPOL ne paie pas, les gens disent qu'ils vont aller casser Total.
Il serait temps de mettre la pression où il faut la mettre pour que les clients du FIPOL ne soient pas contrariés par leur propre assureur. Ceci dit en aparté, mais c'est quand même assez important.
M. le Rapporteur : Je crois que ce n'est pas du tout en aparté, car vous vous exprimez devant toute la presse et c'est enregistré.
M. Jacques SOURBIER : Ce n'est en tout cas pas le sujet principal.
Voilà donc où nous en sommes. Nous espérons maintenant que le montant des indemnisations sera connu le plus vite possible. Pour la filière conchylicole, les dossiers sont instruits par un système unique entre nos deux régions et 250 dossiers ont été déposés auprès du FIPOL. Pour l'instant, il ne s'agit que de la présentation du préjudice pour les mois de janvier et février. Nous présentons actuellement de nouveaux dossiers pour la période de février à mars.
Nous souhaitons que les indemnisations se fassent rapidement. Mais nous ne savons pas si le montant sera arrêté rapidement et si un taux d'avance en découlera immédiatement comme annoncé depuis le début. Voilà l'enjeu. Nous ne pouvons pas nous satisfaire, comme le fait le FIPOL, de ce que veulent bien faire les régions et l'Etat, dans l'attente des bonnes dispositions du FIPOL. J'ai l'impression que le FIPOL joue un jeu subtil : « Des gens s'occupent de nos indemnisations à notre place ; laissons-les faire et nous verrons ce qui se passera. »
M. Alain DREANO : Je suis secrétaire général de la section régionale conchylicole de Bretagne sud. Je compléterai ce qu'a dit M. Sourbier, puisque nous sommes sur la même longueur d'ondes, à quelques nuances près. Dans le secteur du sud Bretagne, c'est-à-dire principalement le Morbihan et le sud Finistère, la lenteur de l'indemnisation de la part du FIPOL commence à peser lourdement sur les entreprises. Cela entraîne des risques soulignés par des exploitants, sur la santé de leur trésorerie. Du fait de la persistance des charges fixes, on commence à parler d'éventuels licenciements ou de baisse d'activité au niveau des salariés.
La question est de savoir qui prendra en charge ce coût supplémentaire au plan social. Le FIPOL le pourra-t-il ? On l'a interrogé et on attend sa réponse. En tout cas, c'est une vraie question compte tenu de la lenteur des indemnisations en cours.
Par ailleurs, le dispositif complémentaire mis en place par l'Etat et les régions fonctionne bien concernant les Pays de la Loire. Dans notre secteur, ce dispositif n'est pas opérationnel vu que la circulaire de l'Etat avait prévu son intervention uniquement pour les zones qui faisaient l'objet d'une fermeture administrative. Or, le Morbihan et le sud Finistère étaient exclus de ce champ d'application. Ainsi, aujourd'hui, sur l'ensemble des dossiers en cours d'instruction auprès du FIPOL, nous n'avons aucune avance sur indemnisation à l'instar de ce qui s'est passé dans les Pays de la Loire. La trésorerie de nos entreprises est grandement fragilisée par cette attente du dispositif mis en place par l'Etat.
Début mars, nous avons eu, à grands renforts d'annonces de presse, une prévision d'extension de l'application du dispositif de l'Etat, mais il a fallu attendre le 31 mars pour en voir arriver les effets réels, encore limités et ne convenant pas totalement à la réalité des besoins.
Il convient de souligner que, compte tenu de la lenteur de l'indemnisation du FIPOL et de la mise en _uvre des procédures, une intervention conjointe ou complémentaire de l'Etat ou des collectivités locales devient indispensable en cas de préjudice de ce type. Le dispositif mis en place dans les Pays de la Loire permet de soulager les entreprises de façon relativement efficace. Malgré le préjudice, les charges fixes des entreprises courent et, tant que l'indemnisation n'intervient pas, elles remettent en cause le devenir de ces entreprises.
M. le Rapporteur : Une question un peu naïve aux cinq représentants : connaissez-vous quelqu'un qui ait été indemnisé par le FIPOL ? Pourriez-vous nous en parler ?
Deuxièmement, quel est le rôle exact de COFREPECHE dans les procédures d'expertise ?
Troisièmement, les deux sections conchylicoles de Bretagne sud et des Pays de Loire pourraient-elles nous fournir un document comparatif des différentiels d'aides et avances ? En Pays de Loire, c'est un mécanisme Etat/région en attendant le FIPOL, essentiellement parce que la collecte y a été interdite. Ce n'est pas le cas du Morbihan parce que la collecte n'y a pas été interdite. Dans le Morbihan, pas d'avances du tout : on attend le FIPOL.
Peut-être n'aurons-nous pas le temps de tout dire aujourd'hui, mais une note à ce sujet nous intéresserait.
Ensuite, par rapport aux premières interventions, comment jugez-vous le mécanisme d'indemnisation de l'Etat s'agissant de la pêche ?
M. Jean-Marc BARREY : Oui, effectivement, quelques personnes ont pu toucher, après pas mal de remue-ménage face aux annonces du FIPOL et à leur soi-disant efficacité et rapidité. Les gens se sont manifestés et, fin février, quinze à vingt personnes, notamment des pêcheurs à pied, avaient reçu une semaine d'indemnisation, soit environ 2 000 F correspondant à la première semaine de janvier. Ce sont, à ma connaissance, les seuls qui ont été indemnisés. Quelques pêcheurs de pouces-pieds également ont eu une avance. Mais Jean-Marc Rio en parlera mieux que moi et vous indiquera les sommes.
En ce qui concerne le rôle de COFREPECHE : quand les gens viennent déposer leur dossier au bureau d'indemnisation de Lorient, on leur pose des questions mais on ne les aide pas pour leur dire s'ils répondent bien ou non à la question. Le bureau se réserve le droit de dire qu'il n'est qu'une boîte aux lettres et que l'expert de COFREPECHE jugera. On en arrive donc à penser à un gain de temps délibérément voulu. En effet, ces gens devraient être aidés au démarrage et au montage du dossier : le bureau d'indemnisation pourrait leur indiquer directement quelles erreurs ne pas commettre pour éviter ces navettes entre Lorient, COFREPECHE Brest, retour à Lorient et, éventuellement, Londres.
La dernière question concernait l'intervention de l'Etat. Elle est reçue comme un soulagement : le ministère de l'Agriculture et de la Pêche, voyant les gens s'impatienter, a décidé que, puisque le FIPOL ne faisait pas assez vite, il allait lui-même prendre les dossiers en charge et les indemniser provisoirement à hauteur de 50 % de ce qu'ils peuvent prétendre du FIPOL. Ce fut particulièrement apprécié par les gens indemnisables. Cependant, il sera peut-être difficile de savoir qui a touché et comment. A partir de là, le FIPOL pourrait conclure que ce n'est plus la peine de se casser la tête : l'Etat commence à indemniser en partie ! Le FIPOL mettra la pédale douce.
Premièrement, l'opération a été très bien vue des gens qui attendaient une indemnisation et très rapide. Deuxièmement, cela aura peut-être un effet négatif parce que le FIPOL traînera davantage les pieds.
Par ailleurs, certains se demandent, dès lors que le ministère de l'Agriculture et de la Pêche a pris cette option, pourquoi cela n'avait pas été fait depuis le début : que l'administration d'Etat, en l'occurrence les Affaires maritimes, traite directement les dossiers et se retourne ensuite vers le FIPOL. Même si les gens critiquent facilement l'administration française, aujourd'hui, dans ce cas de figure, 90 % seraient en faveur de cette solution : l'administration indemniserait et se retournerait ensuite contre le FIPOL.
M. Jean-Noël ANDRE : A Vannes-Auray, les premiers de nos marins indemnisés par le FIPOL appartenaient à des pêcheries fermées : la palourde ou le pouce-pied ; c'est logique. Aujourd'hui, ils sont conscients que cela s'est bien passé. Chez nous, ils ont été entièrement indemnisés par le FIPOL, à charge pour eux de déposer un nouveau dossier. Ils ne se plaignent pas pour l'instant.
Les gens qui ont eu du matériel souillé par le mazout bénéficient d'une avance de trésorerie par l'Etat. De ce côté-là, les gens sont calmés. Il semble légitime que leurs filets soient remboursés. Malheureusement, dans les coopératives, les factures doivent être acquittées. Les marins qui n'ont pas l'argent sont bien embêtés pour obtenir des facture déjà acquittées. C'est une difficulté.
Le troisième problème, c'est le manque à gagner. En tant que président, au moment de la catastrophe, j'ai dit aux gars qu'il fallait travailler sérieusement du fait que du mazout allait arriver sur nos côtes et attendre avant de mettre les casiers et les filets à l'eau. Certains marins l'ont fait. Malheureusement, la compensation pour ce manque à gagner n'arrive pas : nous sommes à la fin avril et il manque de l'argent dans la bourse. C'est une grosse inquiétude. Pour mes marins, j'aurais aimé que l'Etat, même s'il a fait ce qu'il devait faire, prenne cela entièrement en compte et qu'il se retourne ensuite contre le FIPOL. Nous aurions été plus rassurés et cela aurait contribué à généraliser les comportements responsables. A ce jour, c'est le noir complet ; on ne sait pas où l'on va et cela devient grave.
M. le Rapporteur : Les pêcheurs de pouces-pieds ont été indemnisés complètement en fonction de ce qu'ils demandaient ? N'y a-t-il pas eu un pourcentage ?
M. Jean-Noël ANDRE : Oui, les pêcheurs de pouces-pieds ont été indemnisés en fonction de ce qu'ils demandaient, du moins ceux qui ont rempli les dossiers, comme il se doit. Il n'y a pas eu de pourcentage.
M. Jean-Marc RIO : Comme La Turballe n'avait pas de perte d'exploitation et qu'il n'y avait que du matériel sali, nous avons déposé les 25 dossiers, mais nous n'avons toujours aucune réponse. Personne n'a été réglé d'un seul centime. Nous attendons pour voir comment nous y prendre.
M. Alain DREANO : Concernant COFREPECHE : dans le domaine de la conchyliculture, c'est un avis d'expertise sur les dossiers déposés par les conchyliculteurs sur base de références standards ou d'éléments de comparaison si possible. Or, les entreprises ont des systèmes d'exploitation et de commercialisation tellement différents d'un secteur à l'autre qu'il est difficile de définir des standards. Ainsi, lorsque nous nous étions vus, nous avions lourdement insisté sur le fait qu'il s'agirait d'une instruction au cas par cas et qu'il était difficile d'avoir une approche globale systématique des dossiers conchylicoles.
Pour les aides, je passerai la parole à M. Sourbier sachant que, dans les Pays de la Loire, les trois dispositifs sont articulés entre le FIPOL, l'Etat et la région. Je compléterai par rapport à ce qui se passe dans le Morbihan et dans le sud Finistère.
M. Jacques SOURBIER : Dans notre secteur, personne n'a été indemnisé à ce jour. Le FIPOL a simplement approché quelques professionnels qui n'étaient pas passés par nos structures pour déposer un dossier. Ce fait les empêche de bénéficier des aides et des soutiens de la région. Tous ceux qui avaient déposé des dossiers directement au FIPOL se sont vu rabattre sérieusement leurs prétentions. Certaines personnes avaient présenté des dossiers de l'ordre de 800.000 F et les ont vu ramenés à hauteur de 40.000 F parce que les preuves apportées ne convenaient pas aux experts du FIPOL, ces gens étant hors filière professionnelle.
M. le Rapporteur : Dans la filière, vous ne connaissez personne qui a été indemnisé ?
M. Jacques SOURBIER : Ce sont simplement des demandes de la part du FIPOL vers ces gens : « acceptez-vous ce nouveau montant d'indemnisation ? » Il ne s'agissait pas de donner un chèque pour indemnisation. Nous sommes très loin du compte pour l'instant.
Je connais un autre cabinet - le cabinet Thomas - de La Rochelle qui agit en tant qu'expert pour le FIPOL.
Pour les aides régionales, en Pays de la Loire, nous bénéficions d'un système d'avances de la région qui permet d'anticiper des avances du FIPOL que nous attendons toujours. Ensuite, nous avons les aides de l'Etat qui consistent en un dispositif à trois niveaux.
Les avances remboursables sont plafonnées à 200 000 F sachant qu'elles s'appliquent sur 50 % du montant d'indemnisation demandé au FIPOL. Ce critère fonctionne à une condition précisée en préambule, qui fait que nous sommes bénéficiaires et pas la Bretagne : n'en bénéficieront que les professionnels qui ont connu tout ou partie des fermetures sur leur zone de production. La Vendée et la Loire-Atlantique ont vu une partie de leur zone de production fermée. De ce fait, nous entrons dans le dispositif et nous pouvons bénéficier d'un dispositif d'allégement de charges sociales. Comme la Bretagne n'a pas bénéficié de la première mesure, elle ne peut pas bénéficier de la seconde. C'est un effet en chaîne.
Une troisième mesure, indépendante, s'applique également aux zones fermées : il s'agit d'un allégement des charges financières. Elle ne s'applique pas dans les autres régions, qui ont pourtant subi le même préjudice commercial, que ce soit l'Ille-et-Vilaine, le Finistère ou le Morbihan, voire au-delà.
Tout cela a fait l'objet de négociations avec le ministère concerné et auxquelles j'ai participé avec le président national. Le dispositif mis en place a fait l'objet de tractations très douloureuses. Nous avons manifesté devant le ministère des Transports et ces mesures en sont les effets. Mais, sur le terrain, ces mesures étatiques ont du mal à être mises en _uvre parce que les enveloppes attribuées à l'échelon départemental ne sont pas toujours suffisantes. Des annonces nationales ont été faites au niveau ministériel et même au niveau du Premier ministre. Des enveloppes semblent disponibles mais, concrètement, nous ignorons où sont passés ces montants.
M. le Rapporteur : Avez-vous des cas où des gens n'ont pas pu être indemnisés ?
M. Jacques SOURBIER : Nous sommes dans la phase d'instruction des dossiers. Aujourd'hui, des indemnisations sont obtenues. J'ai pu le constater tant en Loire-Atlantique qu'en Vendée : ces dossiers sont instruits et envoyés pour paiement. Aujourd'hui, personne n'a encore reçu d'argent. Le gros problème, ce n'est pas tellement que nous ne recevions pas d'avance, mais de connaître la hauteur du futur montant. Aujourd'hui, selon les enveloppes fermées telles qu'elles sont constituées dans certains départements, dans certains cas, notamment d'allégement de charges financières, si les gens sont au maximum du dispositif, trente entreprises pourront en bénéficier et pas les autres. Cela créera des difficultés.
Nous ne sommes pas convenablement aidés ! Nous avons demandé à la direction des pêches de revoir ces enveloppes et de réaliser des effets de bascule pour atteindre des seuils normaux. Tout cela fait partie de négociations permanentes avec le ministère et la direction. Tout ne s'est pas mis en place de manière très simple. Même si l'intention de l'Etat et du Premier ministre, que j'avais rencontré à l'époque, était de dire que les choses iraient plus vite que d'habitude, on constate une lenteur dans le dispositif. Aller vite pour ce type de mesure n'est peut-être pas la méthode qui convient d'ailleurs ; aller vite et bien n'est pas toujours évident.
Des efforts sont fournis de tous les côtés, mais il y a eu retard au départ, faute de prise de conscience suffisante quant à l'impact du préjudice subi. On a d'abord pensé que c'était circonscrit à quelques régions conchylicoles touchées par la marée noire. Le vrai problème est que cela a déteint sur la filière pêche, de façon assez faible heureusement, mais cela aurait pu être plus grave.
Voilà où nous en sommes et voilà pourquoi je souscris à la demande de la Bretagne d'être mieux prise en compte.
M. Alain DREANO : Les entreprises de Bretagne sud, pour la partie Morbihan et sud Finistère, n'ont reçu aucune forme d'indemnisation autre que l'indemnisation FIPOL. Depuis le 31 mars, on peut bénéficier de l'avance sur le dispositif FIPOL par l'Etat, mais les deux autres mesures - allégement des charges sociales et allégement des charges financières - n'y sont pas applicables.
Par ailleurs, la mise en _uvre des dispositifs avec l'Etat prend appui sur le dossier FIPOL tout en retenant des repères dans le temps qui ne sont pas identiques. Pour le FIPOL, on prend les trois dernières années et, pour certaines mesures de l'Etat, c'est l'année précédente. Une distorsion apparaît dans l'approche et l'instruction des dossiers, ce qui n'est pas toujours facile à gérer.
Mon dernier point se rapportera à la situation des entreprises de Bretagne sud. Aujourd'hui, de grosses entreprises ont des charges fixes supérieures à 200.000 F par mois. Or, le dispositif d'avances sur l'indemnisation du FIPOL est plafonné à 200 000 F par entreprise. Le seuil des besoins exprimés par les entreprises sera vite atteint, au risque d'aggraver la situation.
M. le Président : Nous passons aux questions : elles pourront être collectives ou adressées en particulier à l'un d'entre vous.
M. Gilbert LE BRIS : Deux questions à l'ensemble de nos invités. Sur la question du préjudice direct subi, comme les filets souillés ou la fermeture de parcs, nous avons entendu vos avis. J'aimerais vous interroger sur les préjudices indirects, c'est-à-dire les atteintes à l'image de marque. Les gens ne savent pas spécialement où ont été pêchés les poissons bretons. L'image de marque de l'ostréiculture et de la conchyliculture sera également atteinte à travers la catastrophe.
Je doute que cela soit réalisable, mais avez-vous, d'une part, mis en place des éléments de mesure de ce préjudice indirect et, d'autre part, avez-vous eu des assurances d'une indemnisation de ce préjudice indirect ou d'une restauration de l'image de marque, par un biais quelconque ?
Deuxième question : j'ai cru comprendre que TotalFina avait fait un geste à l'égard des pêcheurs concernant le prix du litre de gazole. De quoi s'agit-il exactement et quelles sont les conditions de cette aide ?
M. François GOULARD : Les organisations que vous représentez ont-elles procédé à des chiffrages des pertes subies ?
M. Jean-Michel MARCHAND : Deux remarques : je suis étonné que vous ne nous ayez pas communiqué de chiffres, ne serait-ce qu'en ordre de grandeur, tant des préjudices directs qu'indirects.
Ma deuxième remarque portera sur vos réflexions, M. Sourbier. D'après vous, le FIPOL a approché divers professionnels qui n'étaient pas inscrits dans vos organisations professionnelles. Ce sont pourtant de vrais professionnels si j'ai bien compris. Le FIPOL aurait essayé d'obtenir un accord sur une indemnisation à 60 % en-dessous de la valeur du dossier déclaré. C'est une tentative qui risque de faire jurisprudence : il y a un véritable danger.
Je voulais souligner que les deux régions se trouvent dans des situations différentes. Étant de la région Pays de la Loire, je comprends que la Bretagne souffre de la différence de traitement entre régions ayant très rapidement proposé des indemnisations.
M. le Rapporteur : C'est partiellement corrigé.
M. Alain DREANO : C'est vrai que la situation est différente selon les zones touchées quant aux avances remboursables. Si je lie les deux remarques, vous serez aussi inquiets sur la hauteur à laquelle le FIPOL envisage d'indemniser.
M. Louis GUEDON : Vous avez manifesté à l'unisson un vif mécontentement à l'endroit du FIPOL. Ce n'est pas une découverte pour nous : s'agissant d'un processus d'assurance, nous savons qu'une compagnie n'est jamais encline à délier les cordons de sa bourse.
Nous avions anticipé ce que vous vouliez nous dire. Avant que le process soit en route, des réunions sur le terrain nous ont montré qu'il convenait de rester vigilants quant au FIPOL. Nous vous avions conseillé, d'abord, de vous grouper en organisations de producteurs ou de professionnels et, ensuite, de prendre le concours de juristes qualifiés ou d'avocats. Vous rencontrez aujourd'hui des difficultés que nous pressentions.
Avez-vous utilisé, choisi et pris les conseils que nous vous proposions de prendre à Noël ? Devant ces difficultés, quel rôle jouent ces conseils qui doivent vous aider dans le labyrinthe et le parcours du combattant que vous connaissez ?
Mme Jacqueline LAZARD : Deux questions courtes à MM. Sourbier et Rio.
Vous nous avez parlé d'une perte de 30 à 50 % évaluée sur le chiffre d'affaires de la plupart des entreprises. La Bretagne se situe-t-elle dans la même moyenne ? Ou bien le fait de ne pas avoir fermé les pêcheries a-t-il malgré tout entraîné des effets plus positifs ?
Ma deuxième question concerne les avances faites sur les pertes d'exploitation, à hauteur de 50 %. Sur quelle base, ces avances de l'Etat sont-elles accordées ? Le système vous semble-t-il appliqué correctement ? N'existe-t-il pas de difficulté à évaluer le chiffre précédent ?
M. Jacques SOURBIER : Sur la restauration de l'image de marque, nous avons pensé immédiatement à ce problème sachant que nous avions subi un préjudice direct commercial, mais pas en production, et les années à venir sont pourvues en stocks.
En conséquence, notre image subira une influence négative : les consommateurs se sont détournés temporairement du produit. Pour les rassurer, dès que la crise se sera estompée, il conviendra de revenir sur le marché par une communication dynamique. Pour ce faire, des moyens financiers sont indispensables. Le FIPOL reconnaît le préjudice indirect mais, comme il est difficile de chiffrer aujourd'hui la totalité des préjudices, compte tenu des effets de cumul à chaque mois, nous ne pouvons pas arrêter les compteurs. Par rapport au FIPOL, pour estimer l'ampleur du préjudice, il faudra arriver à des conclusions. Dès les conclusions acquises, nous pourrons nous adresser au FIPOL pour présenter le chiffrage de notre préjudice d'image.
Nous nous employons à mettre en _uvre un plan de communication avec nos partenaires habituels, régionaux et départementaux. Nous leur avons déjà adressé un plan de communication pour notre région afin de pouvoir, dès la fin de cette année, rassurer les consommateurs et réaliser une action dynamique. Voilà sur le plan régional.
Au niveau national, nous avons une mise en _uvre d'une communication plus générique, la filière étant concernée dans sa totalité. Nous avons bénéficié là d'aides de l'Etat : leurs montants ne sont pas encore arrêtés. On assiste à des valses-hésitations entre négociateurs. A cet égard, il serait opportun que les parlementaires puissent réagir pour stabiliser les choses.
Des annonces de moyens financiers considérables nous ont été faites par OFIMER et nous nous apercevons aujourd'hui que l'enveloppe n'est pas attribuée aux seuls conchyliculteurs mais qu'elle doit être partagée. Pourtant, notre préjudice ne se partagera pas. Il conviendrait plutôt de rallonger les enveloppes ou d'en créer de nouvelles à mettre à disposition d'autres filières, si nécessaire. Voilà où nous en sommes.
Concernant la communication, des actions seront organisées à tous les niveaux, tant national que régional.
Cela étant dit, comment se faire indemniser par le FIPOL après ? La question est judicieuse mais je n'ai pas encore osé entamer cette procédure. Malheureusement, nous n'en sommes pas encore là.
S'agissant de communication, mes collègues de Bretagne avec qui j'en ai discuté, et moi-même sommes en négociation avec un représentant de TotalFina. Une annonce sera faite quant à une participation de TotalFina dans une communication en faveur de la conchyliculture ; communication à portée régionale, pour les Pays de la Loire au moins. Nous sentons aujourd'hui une volonté de la société de participer au soutien de nos professions. Je n'ai pas d'affirmation nette, mais des négociations sont en cours à ce sujet.
Sur le chiffrage des pertes : j'ai déjà expliqué les difficultés d'agir aujourd'hui.
Pour répondre à la question de Mme Lazard, nous subissons des pertes de l'ordre de 30 à 50 %. Actuellement, nous n'avons pas de chiffrage particulier à vous présenter. Nous devons attendre.
Pour les avances sur perte d'exploitation, les dispositifs fonctionnent relativement bien. L'intérêt de la formulation que nous avons adoptée, c'est que toute la procédure s'effectue au travers des organes professionnels pour que l'instruction des dossiers se déroule correctement. Certains ont pensé aller plus vite en réagissant eux-mêmes auprès du FIPOL. Il s'avère qu'ils n'avaient pas la manière de procéder.
En tant que professionnels, c'est notre rôle d'entrer en contact avec le FIPOL pour valider la manière de procéder. Une structure représentative qui entre en relation avec le FIPOL permet de reconnaître la procédure pour l'ensemble de l'activité et d'éviter tout retard pour les membres. Ceux qui sont passés par la structure professionnelle ont pu bénéficier de la bonne manière de procéder auprès du FIPOL. Grâce à la mise en place de dispositifs d'aide étatique, c'était une manière d'instruire systématiquement tous les dossiers destinés tant au FIPOL qu'à l'Etat ou à la région. C'était une concentration des moyens pour répondre à toutes ces demandes. Une personne qui passait par le circuit professionnel n'avait qu'un dossier à déposer. Ceux qui sont allés uniquement vers le FIPOL sont tout surpris de ne pas être pris en compte par la région ou par l'Etat. Il a fallu uniformiser et rationaliser la démarche.
M. Alain DREANO : Au niveau des plans de communication, nous devrons agir de la même manière que nos collègues de Vendée, avec une inquiétude : le plan de communication n'aura de réel effet que lorsque nous aurons des certitudes quant au devenir de ce qui reste théoriquement dans les cuves de l'Erika. Compte tenu des enjeux, on se verrait mal engager autant de moyens si de nouvelles nappes nous étaient annoncées sur le littoral. C'est le préalable en la matière.
Pour le chiffrage, actuellement pour la Bretagne sud, d'après un état que j'ai réalisé ce matin, nous pouvons considérer un préjudice établi à la date d'aujourd'hui aux environs de 7,2 millions de francs qui recouvrent une cinquantaine de dossiers déposés auprès du FIPOL par notre intermédiaire, via la section régionale. Certains exploitants ont déposé en direct des dossiers auprès du FIPOL, mais nous ne disposons pas de leurs montants.
M. le Rapporteur : Vous allez déposer les mêmes auprès de l'Etat à partir du moment où la circulaire sera élargie ?
M. Alain DREANO : Le fait d'avoir travaillé en concertation avec nos collègues de Vendée nous a permis d'élaborer les dossiers selon la même méthodologie. Ainsi, d'ores et déjà, tous les dossiers passés par les sections régionales sont transmis en bonne et due forme, avec l'ensemble des pièces nécessaires, auprès de la direction départementale des Affaires maritimes. Les Affaires maritimes sont déjà en possession des dossiers prêts à l'instruction : cela devrait nous permettre de gagner du temps. Nous attendions le feu vert administratif pour l'ouverture du dispositif de l'Etat.
Au total, 250 dossiers seront déposés en tout entre les deux régions. Je crois avoir fait le tour des questions.
M. Jean-Marc RIO : Quant à la question de savoir si nous avons pris un avocat, je suis surpris, M. Guédon. Nous ne l'avons pas fait à La Turballe pour la bonne raison qu'on nous avait dit que nous disposions de trois ans pour ester en justice. En revanche, nous avons fait constater par huissiers et experts maritimes le soir même et le lendemain matin. Les dossiers ont été montés en collaboration avec le groupement de gestion pour ce qui concerne les filets et l'expertise maritime. Pour la criée, c'est aussi avec l'expert maritime. Actuellement, nous n'avons donc pas pris d'avocat. Faut-il le faire ? Nous verrons.
Concernant le prix du carburant accordé par TotalFina, cela relève d'un arrangement avec les coopératives, puisque c'est la coopération maritime qui a discuté avec eux. Cela a dû nous rapporter 50 F par m3, soit cinq centimes par litre. Par contre, je ne sais pas si les ports ravitaillés par des concurrents de TotalFina ont perçu les mêmes avantages. Cela m'étonnerait.
M. Jean-Noël ANDRÉ : En ce qui concerne le carburant, nous n'avons pas de nouvelles ; nous ignorons s'il a baissé ou non. J'aimerais l'apprendre.
L'impact sur la pêcherie est d'environ 30 % de chiffre d'affaires en moins depuis le début de l'année, pour ceux qui ont pu travailler.
Par ailleurs, nous n'avons pas pris d'avocat. Les gens ont été raisonnables et ont agi à l'amiable. C'était à l'ordre du jour au début de la crise.
M. Louis GUEDON : Contacter un avocat ne veut pas dire que vous entamerez une procédure : il permet de défendre vos dossiers à l'amiable avant d'entrer en contentieux.
M. Jean-Noël ANDRÉ : Bien entendu. Etant au début du mois d'avril, il vaut mieux ne pas brûler les étapes et attendre quelque temps avant d'entamer une autre procédure. C'est la politique que nous avons appliquée chez nous, à La Turballe.
M. Jean-Marc BARREY : Je répondrai brièvement à la question de M. Le Bris sur le préjudice direct ou indirect. Nous avons constitué un public raisonnable, notamment les pêcheurs. L'objet de l'action des pêcheurs n'était pas de salir la profession en ramenant des produits qui auraient pu être pollués : cela aurait attiré une fois de plus la médiatisation et entraîné un effet dévastateur sur le marché. Les professionnels responsables que nous sommes ont plutôt prêché l'inverse auprès de nos mandants en leur disant de ne pas se rendre dans les zones à risques, de ne pas ramener des produits douteux, qui susciteraient une critique dont pâtirait l'ensemble des produits de la pêche, y compris le poisson pêché à des milliers de kilomètres de nos côtes.
Ce préjudice subi par les marins qui ont décidé de ne pas prendre le risque de pêcher des produits malsains ne se mesure pas. Même si on leur remboursait des produits pollués éventuellement ramenés, ils ont opté pour la solution de ne pas se rendre dans les zones à risque : l'ensemble de la profession en aurait pris un coup. L'effet aurait été bien pire que l'indemnisation du pollué. A la limite, l'effet indirect ne pourrait se mesurer que sur un mois comparable de l'année précédente. Et encore : quand on connaît les fluctuations de la pêche, cela reste très difficile.
Voilà pour l'effet indirect sur la pêche. Nous avons eu affaire à des gens raisonnables car, selon les chiffres de la production, les cours sont restés relativement stables. Ils auraient pu être autrement catastrophiques en agissant différemment.
Deuxième question : l'effet du gazole sur la négociation ne vaut que pour les coopératives dépendantes de la coopération maritime, d'une part. D'autre part, la ristourne de cinq centimes sur un prix qui a doublé en un an ne sera pas très perceptible. D'autant plus que, depuis le sommet de l'OPEP à Vienne, les prix redescendent : ce matin, il était à 1,51 F. Je pense donc que la mesure des cinq centimes est surtout médiatique. Nous verrons si TotalFina maintiendra cette diminution du prix lorsque nous retrouverons des prix que nous estimons normaux.
Sur l'efficacité et la rapidité des indemnisations par l'Etat sur certains dossiers, les Affaires maritimes ont été très claires : elles ont demandé que les dossiers qui leur parviendraient pour la mise en _uvre des mesures liées à la circulaire Glavany soient identiques à ceux du FIPOL. Les dossiers sont donc identiques. La procédure est rapide : des commissions se réunissent entre huit et dix jours et un dossier de ce type peut être réglé dans les quinze jours, trois semaines, via les Affaires maritimes, par le règlement OFIMER. Cela prouve une certaine efficacité. Si cela avait pu être appliqué dès le départ, nous n'en serions peut-être pas là aujourd'hui.
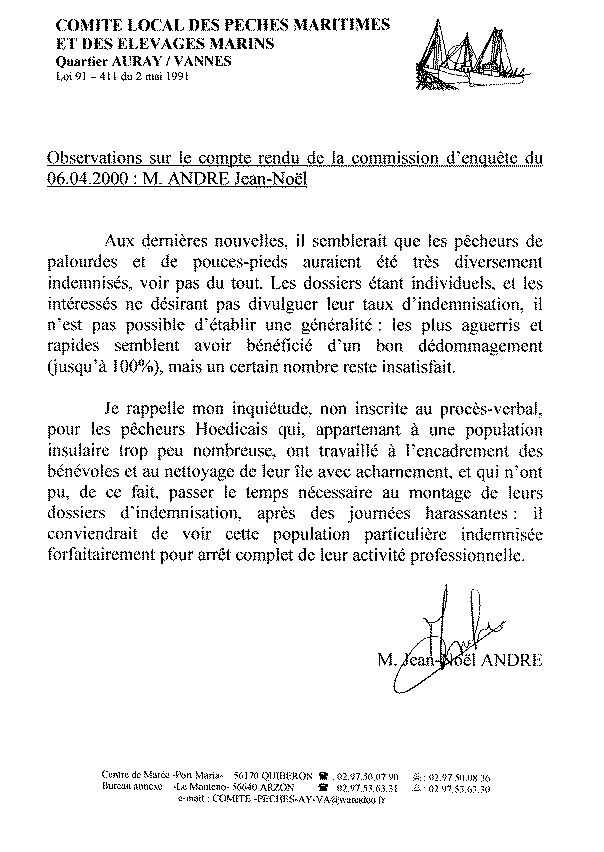
Audition de Mme Marie-Christiane BOISSY, présidente
du Comité régional du tourisme des Pays de la Loire,
accompagnée de M. Hervé LEMOINE, directeur,
et de M. François VERTADIER,
directeur du Comité régional du tourisme de Bretagne
(extrait du procès-verbal de la séance du 6 avril 2000 à Lorient)
Présidence de M. Daniel PAUL, Président
Mme Marie-Christiane Boissy, M. Hervé Lemoine et M. François Vertadier sont introduits.
M. le Président leur rappelle que les dispositions législatives relatives aux commissions d'enquête leur ont été communiquées. A l'invitation du Président, Mme Marie-Christiane Boissy, M. Hervé Lemoine et M. François Vertadier prêtent serment.
M. François VERTADIER : J'ai réuni quelques données sur l'évolution de la fréquentation touristique. Il faut être prudent sur les chiffres réunis à la suite de la marée noire : nous aurons des chiffres plus fiables à partir du 14 avril. Dès aujourd'hui, nous avons réalisé des enquêtes, dont une approfondie avec l'Observatoire régional du tourisme en Bretagne, concernant les locations meublées dont les réservations commencent en décembre et janvier. On connaît donc beaucoup plus facilement la situation en meublé qu'en hôtellerie. Le meublé représente 36,1 % de l'hébergement marchand en Bretagne.
S'agissant de l'évolution de la fréquentation touristique en Bretagne après la marée noire, une chute très sensible de fréquentation touristique est prévue pour la réservation dans les meublés. Elle concerne tout le littoral touché par la marée noire et, contrairement à ce que l'on aurait pu penser, peu de transferts se réalisent sur la partie bretonne de la Manche.
A l'évidence, c'est l'ensemble de la Bretagne qui est pénalisé, avec quelques nuances. Si une chute de fréquentation importante se fait sentir sur le littoral sud, on peut penser que le littoral de l'Ille-et-Vilaine et des Côtes d'Armor s'en sortiront à peu près correctement. Pour le Finistère, l'ensemble du département est touché par une baisse sensible des réservations.
J'ai préparé une carte sur les zones les plus touchées. On peut y voir nettement que les tâches noires correspondent aux endroits où la marée noire s'est déposée.
M. le Président : On en voit dans la baie de Saint-Brieuc : elle n'a pas pourtant pas été polluée par le pétrole.
M. François VERTADIER : On remarque quelques modestes petits points noirs en dehors des zones de pollution. Le littoral sud - Finistère et Morbihan - est évidemment le plus touché, d'autant que cette partie du littoral représente le plus fort parc immobilier. On peut donc envisager une chute globale de réservation pour l'été entre deux et six semaines par maison, selon les endroits. On a noté aussi pour les maisons une chute d'environ 50 % des demandes d'information.
Cela dit, il convient d'être prudent. Le décalage dans la réservation peut avoir plusieurs causes. Mais on sait que l'essentiel du phénomène est dû à la marée noire.
Concernant les gîtes de France souvent situés à l'intérieur des terres, la chute de réservation atteint 15 à 20 % dans le Morbihan et 8 % dans le Finistère. En ce qui concerne les résidences de tourisme, des chiffres précis nous indiquent une baisse de réservation qui tourne autour de 20 à 25 %, avec des transferts très nets sur la Méditerranée, le Massif central et l'Aquitaine. Les villages de vacances enregistrent des baisses de 40 à 50 % dans les zones les plus polluées. Ce sont eux qui ont le plus souffert.
Pour la clientèle étrangère, nous n'avons pas les chiffres complets mais nous savons que nous subissons une chute très importante s'agissant de la clientèle allemande. Comme j'ai l'habitude de fournir des données sérieuses, je ne vous donnerai pas d'éléments quantitatifs avant le 15 avril. En ce qui concerne l'Angleterre, qui représente 46,6 % des nuitées étrangères en Bretagne, la chute des réservations atteint 18 %.
Par extrapolation, avec toutes les réserves que l'on peut émettre, on peut noter une baisse de fréquentation d'environ 18 % pour la clientèle française en Bretagne. Pour la clientèle étrangère, une baisse de fréquentation et de réservation de 29 % doit être attendue, ce qui peut nous permettre d'avancer une moyenne de baisse de 20 % environ pour l'ensemble de la Bretagne. Je rappelle toutes les réserves sur ces chiffres, les plus sérieux possible.
M. le Rapporteur : Notre venue ici aujourd'hui porte essentiellement sur les problèmes d'indemnisation. Ma question est de savoir comment vous constituez les dossiers potentiels d'indemnisation. En constituez-vous parce que vous considérez que cela fait partie de votre mission ? Sinon, qui le fait ou qui pourrait le faire ?
D'après toutes les auditions que nous avons eues depuis ce matin et par ailleurs, il apparaît bien que le point le plus sensible est l'évaluation du préjudice dans le domaine touristique. En même temps, il nous semble qu'il ne faut pas laisser ce préjudice sans compensation. Avez-vous déjà suggéré une méthode pour évaluer ce préjudice ? Comment concevez-vous sa mise en _uvre pour permettre les indemnisations ?
M. François VERTADIER : En ce qui concerne le Comité régional du tourisme(CRT) de Bretagne, je serai clair : il n'a pas reçu mandat du département ou du Conseil régional pour s'occuper du dossier d'indemnisation. A ma connaissance, en Bretagne, ce sont soit les services des chambres de commerce, dont certaines s'en occupent activement, soit les services administratifs par l'intermédiaire de la délégation régionale au tourisme, c'est-à-dire le service extérieur du secrétariat d'Etat au tourisme en Bretagne, qui interviennent en la matière.
Par contre, avec l'Observatoire régional du tourisme, nous nous attachons à mesurer, de la façon la plus fiable possible, le préjudice subi globalement au niveau de la fréquentation bretonne. Nous n'intervenons pas au niveau de l'entreprise individuelle.
M. le Rapporteur : A quelle période l'Observatoire pourra-t-il donner des résultats d'évaluation ?
M. François VERTADIER : Nous disposons de bases qui commencent à devenir intéressantes et nous devrions pouvoir donner des chiffres fiables à partir du 14 avril. Mais nous savons qu'ils évolueront en permanence.
En revanche, le rôle du CRT auquel on s'attelle depuis plusieurs mois déjà est la promotion commerciale du tourisme. Nous mettons tout en _uvre pour réagir et sauver ce qui peut l'être.
M. le Rapporteur : Estimez-vous que la campagne de promotion que le Comité régional du tourisme engagera pourrait faire l'objet d'une indemnisation au titre du préjudice ?
M. François VERTADIER : Nous l'espérons.
M. le Rapporteur : Vous déposerez un dossier auprès du FIPOL ?
M. François VERTADIER : Nous sommes en contact sur ce sujet avec le conseiller régional responsable. Quant aux services du Conseil général, ils nous ont dit de ne rien faire sans eux et d'attendre leurs instructions afin d'éviter des rangs dispersés. Mais à l'évidence, tant la Bretagne que nos collègues des Pays de la Loire espèrent bien être indemnisés sur l'ensemble des frais de campagne.
M. le Rapporteur : A combien sont estimés les frais de campagne de promotion pour la région de Bretagne ? Par ailleurs, les fonds annoncés par l'Etat servent-ils à abonder les campagnes de promotion des divers comités régionaux ? Ou bien arrivent-ils en plus et en parallèle ?
M. François VERTADIER : Nous pouvons avoir plusieurs types de calcul : les sommes engagées par le Comité régional du tourisme à partir du budget normal pour la communication touristique tournent autour de 15 à 20 millions de francs par an. Cette année, nous avons engagé quelques crédits complémentaires. En outre, nous avons reçu le soutien du secrétariat d'Etat au Tourisme et de Maison de la France, qui engagent en faveur de la Bretagne une campagne à hauteur de 9 à 10 millions de francs, dont une partie grâce à de l'argent en provenance de TotalFinaElf.
L'indemnisation en matière de communication peut être de deux types : nous pourrions demander à être indemnisés pour les sommes engagées cette année, mais le plus intéressant serait de tenir compte du préjudice global dû à la baisse de fréquentation en Bretagne. Et je ne parle pas du préjudice d'image, considérable, surtout pour la Bretagne.
Une parenthèse : cette année, que ce soit pour l'Île d'Yeu ou pour la baie d'Audierne, voyez la presse internationale : il s'agit toujours de la Bretagne et des Bretons ! Nous pâtissons cette fois de la renommée médiatique de la Bretagne : nous subissons tous les déficits d'image dans cette affaire.
Il serait donc plus intéressant d'essayer d'obtenir une indemnisation proportionnelle au préjudice subi au niveau de la fréquentation touristique. Avec un chiffre d'affaires du tourisme en Bretagne qui tourne autour de 20 milliards de francs et une baisse de fréquentation de 20 %, vous imaginez les sommes en jeu.
M. le Rapporteur : L'office d'évaluation d'observation touristique vous paraît-il un organisme totalement fiable et opposable dans ses chiffres ?
M. François VERTADIER : Cet organisme a été mis en place par le Conseil régional et l'Etat au titre du précédent contrat de plan. Unanimement en Bretagne, il est salué pour le sérieux de son travail, la fiabilité et la prudence de ses chiffres. Il est reconnu par l'INSEE comme un partenaire fiable. Je pense donc que ses travaux sont éventuellement opposables.
M. François GOULARD : Vous avez dit que vous n'aviez pas pour mission d'aider les professionnels à préparer des dossiers d'indemnisation. Néanmoins, à votre connaissance, les professionnels du tourisme ont-ils commencé à constituer leurs dossiers, ont-ils pris des contacts avec le FIPOL ? Si oui, quel est le résultat de ces contacts ? Quel est le climat dans lequel se sont déroulées les premières discussions entre professionnels du tourisme qui n'ont pas constaté l'intégralité des préjudices, en principe quasiment certains ? Quel a été le résultat de ces contacts avec le FIPOL ?
M. François VERTADIER : Pour le Morbihan, je ne sais pas. Pour le Finistère, la chambre de commerce de Quimper a mis en place un service pour aider l'ensemble des professionnels à monter les dossiers d'indemnisation du FIPOL. La mise au point des dossiers doit être en cours et je pense que c'est pareil dans le Morbihan. Pour ce qui est de la constitution des dossiers, tout se passe bien. Sur les contacts avec le FIPOL, je n'en sais rien.
Mme Marie-Christiane BOISSY : Pour les Pays de la Loire, le problème est peut-être légèrement différent. La Loire-Atlantique a été la plus touchée, le nord de la Vendée également. Je rappelle deux ou trois chiffres : les Pays de la Loire comptent 450 kilomètres de littoral et le tourisme représente 20 milliards de francs dans l'économie de la région, 50 000 emplois saisonniers et 35 000 emplois permanents. Vous constatez donc que c'est très important pour nous : l'Erika nous a touchés de plein fouet, particulièrement la Loire-Atlantique et la Vendée.
Deux sujets nous préoccupent pour l'instant : la reconquête de l'image touristique et le déficit des réservations.
La reconquête de l'image touristique s'est concrétisée par un premier travail, avec Maison de la France, pour la grande campagne internationale et nationale, mise en place avec eux, puisque nous nous sommes impliqués dans son élaboration. La campagne devrait donner envie de rejoindre les côtes atlantiques puisque nous allons communiquer sur l'air, qui est resté tonique.
Ensuite, il y aussi les campagnes des Pays de la Loire. Au point de vue budgétaire, notre budget habituel de campagne de communication est de dix millions de francs ; cette fois, le président Fillon a débloqué 6,5 millions de francs complémentaires, qui nous permettront de réaliser une bonne campagne régionale. En effet, il faut que les cinq départements s'y retrouvent.
Lors d'événements de ce type, on parle du littoral, mais l'intérieur des deux départements touchés - Loire-Atlantique et Vendée - sera aussi concerné par la chute de fréquentation. Quand une famille, client le plus fréquent, vient sur le littoral parce qu'elle a choisi des vacances sur l'océan, s'il fait un peu moins beau ou parce qu'elle veut voir autre chose, elle gagne l'intérieur des terres. Les gens y assistent à de grands événements, ils voient des spectacles, des jardins, du patrimoine. Un déficit de clientèle sur le littoral se répercute sur l'intérieur.
Le déficit de réservation est différent parce que les deux départements ont été touchés différemment. Dans les deux départements, l'hôtellerie de plein air a été la plus touchée : outre la marée noire, nous avons eu droit à la tempête. En Loire-Atlantique, pour l'instant, au 31 mars, la baisse des réservations est évaluée à 32 % et la baisse du chiffre d'affaires à 36 %. Les hôtels et restaurants évaluent leur manque à gagner entre 25 et 30 %.
En Vendée, l'île de Noirmoutier a été touchée ainsi que le nord du département. Je pense que M. le député-maire des Sables-d'Olonne sera d'accord pour dire que le sud a été moins touché : nous pouvons dire maintenant que nos plages sont propres. Moi-même, je suis élue aux Sables-d'Olonne. J'ai rencontré le maire d'une commune à une quinzaine de kilomètres au sud des Sables : il possède un complexe particulier de vacances où les réservations se sont maintenues à 100 %. Mais, pour le reste, on retrouve le même déficit de réservations.
Concernant les dossiers, pour la Loire-Atlantique, la CCI, le Conseil général et les syndicats se sont occupés des dossiers FIPOL. Quant à nous, en Vendée, c'est le Comité départemental du tourisme (CDT).
M. le Rapporteur : Dans le cadre de vos responsabilités, connaissez-vous des hôteliers ou des restaurateurs déjà indemnisés ?
Mme Marie-Christiane BOISSY : Non, en général, tous les professionnels se demandent quand ils seront indemnisés et ont hâte de l'être. Ils se demandent ce que le FIPOL et l'Etat vont faire.
M. le Rapporteur : Connaissez-vous des entreprises d'hôtellerie ou de restauration qui sont déjà en grosse difficulté du fait du non-versement des arrhes ?
Mme Marie-Christiane BOISSY : Bien sûr.
M. le Rapporteur : A votre connaissance, les dispositions sur des prêts à taux zéro ou à taux réduit, de la BDPME, par exemple, ont-elles été mises en _uvre dans le domaine de l'entreprise touristique ? Si ce n'est pas de votre compétence, nous poserons la question aux chambres de commerce.
Mme Marie-Christiane BOISSY : Je préfère passer la parole à Hervé Lemoine, le directeur. Globalement, les professionnels que j'ai rencontrés sont inquiets : ils ont des difficultés financières et ont hâte de savoir où ils en sont et quand vous leur donnerez satisfaction.
M. Hervé LEMOINE : J'ai une information complémentaire sur ce sujet. Nous faisions un point ce matin avec nos collègues de Loire-Atlantique et de Vendée : la Loire-Atlantique aurait à ce jour deux professionnels indemnisés - l'un au Pouliguen, l'autre à Batz-sur-Mer - deux cafetiers-restaurateurs indemnisés à hauteur de 200.000 F.
M. le Rapporteur : Pourriez-vous nous transmettre cette information, en indiquant le montant de la demande, les justificatifs et le pourcentage de couverture par le FIPOL ?
M. Hervé LEMOINE : Tout à fait. Ma seconde information concerne la Vendée. Le Comité départemental du tourisme organise une structure de montage des dossiers d'indemnisation FIPOL. Aujourd'hui, aucun professionnel du tourisme n'a présenté de dossier complet. Ils ont seulement présenté des lettres d'intention ; il y en a 250. Aujourd'hui, ces entreprises ne sont pas capables d'évaluer le préjudice ou la perte d'activité ou de chiffre d'affaires, mais elles se sont déjà fait reconnaître auprès du FIPOL comme susceptibles de demander une indemnisation.
Cette procédure est intéressante. En effet, on se signale en amont et on constitue le dossier dès qu'on obtient les premiers bilans.
M. le Président : Comment cela se passe-t-il pour des organismes de vacances dont le siège social est situé en dehors de votre région, mais qui sont des partenaires importants ? Je pense à des organisations de tourisme social, en particulier, qui réservent des centaines, voire des milliers de lits sur les deux régions que nous évoquons. Doivent-elles faire elles-mêmes les demandes, établir des dossiers au titre du FIPOL ou bien est-ce vous, localement ?
M. Hervé LEMOINE : Je n'ai pas de réponse.
M. Louis GUEDON : M. le directeur, c'est forcément l'organisme qui subit une perte de profit qui devra monter ce dossier. S'agissant d'un organisme de vacances qui relève de la CCI, par exemple, ils monteront eux-mêmes leur dossier de déficit, comme le boucher du coin ou le restaurateur.
M. Hervé LEMOINE : Le comité régional de tourisme n'instruit pas de dossier. Je ne peux pas répondre précisément à cette question.
M. le Président : Mais tout à l'heure, vous disiez que c'était le comité départemental en Vendée, après avoir parlé de la Chambre de commerce.
M. Hervé LEMOINE : J'espère qu'ils le feront, oui.
M. Louis GUEDON : Je réponds à la question du président : des mesures ont été prises. Dans des réunions préparatoires aux dossiers de dédommagement de la marée noire, il a été convenu que chaque structure professionnelle devait s'organiser pour présenter ses dossiers et les soutenir. Pour les entreprises qui ne rentraient pas dans des systèmes d'organisation départementale, comme une entreprise dont le siège social est situé à Paris, les mairies que ces entreprises ont l'habitude de fréquenter se mettent à leur disposition pour les aider et être le relais pour monter les dossiers. Les communes seront donc le relais pour les cas isolés qui n'entrent pas dans les structures générales professionnelles.
M. le Président : Pour revenir sur le dossier qui nous préoccupe, ensuite, ce sont le CDT de Vendée et la CCI de la Loire-Atlantique qui centralisent les dossiers, qui vérifient que ces dossiers sont bien établis et qui les soutiennent auprès du FIPOL. C'est bien cela ?
M. Hervé LEMOINE : Tout à fait. La Loire-Atlantique a trois interlocuteurs : le Conseil général, les syndicats professionnels et la Chambre de commerce.
M. le Rapporteur : Existe-t-il un mécanisme transitoire pour les hôteliers et les professions du tourisme, selon vos informations, destiné à faire des avances d'anticipation sur ce que versera le FIPOL, comme cela se passe dans les milieux de la pêche ?
M. Hervé LEMOINE : A ma connaissance, non.
M. le Rapporteur : Donc une entreprise d'hôtellerie récente, qui assurerait son printemps grâce aux arrhes, peut se trouver en dépôt de bilan alors qu'elle pourrait bénéficier du FIPOL dans un an ? Il n'y vraiment pas de fonds intermédiaire ?
M. Hervé LEMOINE : Non. La seule garantie est que le Conseil régional des Pays de la Loire s'est porté garant auprès des banques pour permettre à certaines entreprises de demander des prêts relais ou à court terme.
M. le Rapporteur : Comment cela se passe-t-il ? C'est vous qui instruisez ?
M. Hervé LEMOINE : Non, c'est la région à travers ses services financiers. Une cellule de crise a été montée au sein du Conseil régional : elle traite tous les problèmes financiers et environnementaux.
M. le Rapporteur : La vérification s'effectue en fonction de divers paramètres ?
M. Hervé LEMOINE : Je l'espère.
M. le Rapporteur : Ils donnent la garantie d'un emprunt auprès des banques. Cela permet d'éviter certains dépôts de bilan. Nous devrions demander au Conseil Régional comment fonctionne le dispositif.
C'est une anticipation sur un remboursement intégral FIPOL ? Ils font cela sur la moitié du préjudice ? Vous ne savez pas ? C'est le cas pour la pêche.
Mme Marie-Christiane BOISSY : Pour l'hôtellerie de plein air, la région aide à hauteur de 50 % pour les mobile homes. L'hôtellerie de plein air a été très touchée : dans la région de Saint Jean-de-Monts, Notre-Dame-de-Monts connaît la plus grande concentration de campings et la région s'est engagée à aider.
M. le Rapporteur : En avance sur l'indemnisation du FIPOL et à hauteur de 50 % du chiffre d'affaires constaté l'année précédente ?
Mme Marie-Christiane BOISSY : Non, pour l'achat de nouveaux mobile homes, pour l'investissement.
Si vous le souhaitez, nous pouvons demander à la région de vous envoyer tous les documents qui sont en rapport avec les indemnisations.
M. Jean-Michel MARCHAND : A vous écouter, on a le sentiment d'une certaine désorganisation au niveau du montage des dossiers et d'une absence de fédération de ces dossiers par un organisme qui chapeauterait la CCI en Loire-Atlantique, par exemple. Je vous le dis parce qu'au cours des auditions, nous avons bien remarqué que les tentations étaient fortes - ne parlons pas de tentatives -, soit du FIPOL soit de TotalFina, de créer des brèches. N'êtes-vous pas préoccupé par ce risque ? N'y a-t-il pas de risques à voir traiter des dossiers différemment en un point ou en un autre ? Évidemment, le dossier le moins bien traité risquerait de faire jurisprudence pour les autres. C'est ma première question.
Ma deuxième question vient d'être posée par notre rapporteur : elle concerne les moyens intermédiaires. Nous comprenons que, momentanément, vous ne pouvez pas déposer un dossier complet étant donné que vous ne disposez pas des chiffres du manque à gagner sur l'ensemble de la saison. Je suis quand même surpris que vous ne puissiez pas évaluer une fourchette d'après une saison touristique précédente. Ce serait un premier point posé pour assurer l'avenir.
Dernière question, un peu tendancieuse : certains d'entre vous ont-ils été approchés de façon individuelle par TotalFina pour contracter quelque opération ? On constate que cela se fait par ailleurs.
Mme Marie-Christiane BOISSY : Ah bon ! je ne suis pas au courant du tout ! Si cela se pratique, on pourrait peut-être les rencontrer pour leur demander des fonds supplémentaires.
Mme Jacqueline LAZARD : Ma question rejoint celle de mon collègue quant à la difficulté qui me semble apparaître du fait ce n'est pas la même institution qui gère tous les dossiers.
Ma deuxième question est la suivante : M. le directeur, vous avez dit qu'aucun dossier n'avait été déposé, sauf deux, parce qu'ils ne sont pas encore complets. Malgré tout, avez-vous une idée du nombre de personnes qui se sont signalées ? En effet, en amont, vous avez conseillé de se signaler. Est-ce bien vous, le CRT, qui engagez les professionnels à se signaler ? Vu qu'on dispose de trois ans pour monter les dossiers, pensez-vous intéressant de se manifester en amont pour pouvoir être éligible ultérieurement ?
Mme Marie-Christiane BOISSY : Je passerai la parole à Hervé Lemoine, mais sur l'organisation, devant un événement qui s'est passé dans l'urgence, je pense que les départements ont réagi à leur manière : pour la Vendée, c'est le CDT qui s'est chargé des professionnels avec lesquels il a réalisé un gros travail. L'urgence a mené à de tels comportements.
M. Hervé LEMOINE : Pour ma part, je ne pense pas qu'il y ait eu désorganisation. Aujourd'hui, certaines corporations se sont très bien structurées. L'hôtellerie de plein air, au travers de son syndicat, gère complètement le dossier de A à Z. Ils sont très actifs. A mon avis, ils réagiront très bientôt, après les vacances de Pâques.
Le second syndicat est celui des professionnels de l'hôtellerie et de la restauration. Il concentre aussi l'information, aide au montage des dossiers ; ce sont des professionnels organisés. Dans cette désorganisation que vous évoquiez, il manque le particulier, le propriétaire d'un meublé qui veut le louer : il n'est pas encadré, à part quelques syndicats qui pourraient éventuellement constituer certains dossiers. Comment le particulier montera-t-il son dossier, comment prétendra-t-il à l'indemnisation ? Ce problème m'inquiète. Il faudrait régler cette question.
Aujourd'hui, il est trop tôt pour donner des chiffres. Le 14 avril, une première copie de l'Observatoire régional du tourisme sortira disant que nous avons mis en place un Observatoire ponctuel de crise en Bretagne et en Pays de la Loire. Nous allons interroger tous les secteurs professionnels du secteur touristique : des agences immobilières, des hôteliers, des restaurateurs, des campings. Ces questionnaires sont partis aujourd'hui et nous reviendront à la mi-avril, sachant qu'au début de mai, l'Observatoire national du tourisme consolidera tout cela et devra transmettre au FIPOL ces informations qui serviront de base de référence.
Mme Marie-Christiane BOISSY : Au début mai, elles seront plus ajustées : les vacances de Pâques nous permettront de voir. Les gens ont réfléchi, ils viennent observer. Sur le littoral, chez nous, nous avons l'impression que les gens viennent se renseigner et que les vacances de Pâques amèneront des familles. Il sera plus facile d'affiner le pourcentage de déficit, en espérant le faire décroître.
M. Hervé LEMOINE : Les estimations les plus pessimistes annoncent moins 30 % sur les zones les plus touchées : Loire-Atlantique et nord Vendée. Les plus optimistes, dans les zones très éloignées du sud Vendée, tablent sur moins 10 % de fréquentation sur l'ensemble de la saison. C'est à prendre avec précaution : du 15 juillet au 15 août, on ne trouvera pas de place ; on refuse habituellement de la clientèle à cette période. Nous aurons refusé moins de monde mais nos structures seront complètes et saturées.
M. le Président : C'est très important, car cela veut dire que, malgré la marée noire, vous aurez des sites touristiques complets pendant cette saison ?
Mme Marie-Christiane BOISSY : C'est seulement une petite tranche de la saison : entre le 14 juillet et le 15 août.
M. Hervé LEMOINE : Cette très haute saison où nous sommes en refus de clientèle est proportionnellement très faible. Chez nous, la saison commence maintenant, début avril. C'est aujourd'hui que notre déficit de fréquentation est énorme.
M. le Président : Mon constat : dès à présent, vous sentez ce déficit !
M. Hervé LEMOINE : C'est clair et constaté. Certains cafetiers ou restaurateurs travaillent principalement le week-end ; au Croisic ou à Pornic, ils font zéro couvert aujourd'hui. On peut donc déjà constater une baisse d'activité, de chiffre d'affaires et de fréquentation.
Audition de M. Merri JACQUEMIN,
responsable du bureau FIPOL et de Steamship Mutual à Lorient
(extrait du procès-verbal de la séance du 6 avril 2000 à Lorient)
Présidence de M. Daniel PAUL, Président.
M. Merri Jacquemin est introduit.
M. le Président lui rappelle que les dispositions législatives relatives aux commissions d'enquête lui ont été communiquées. A l'invitation du Président, M. Merri Jacquemin prête serment.
M. Merri JACQUEMIN : Avant tout, je voudrais apporter quelques précisions. Vous m'avez qualifié de représentant du FIPOL. Je ne suis pas le représentant du FIPOL, mais simplement le responsable du bureau des demandes d'indemnisation de Lorient, installé en commun par le FIPOL et Steamship Mutual, assureur du navire en responsabilité civile.
Je voudrais parler d'abord de dispositions générales qui ne concernent pas uniquement l'Erika mais qui s'appliquent lors de sinistres, de naufrages de pétroliers transportant des hydrocarbures lourds, dits persistants puisqu'ils ne disparaissent pas spontanément et créent des marées noires, ce qui fut le cas de l'Erika.
Ces catastrophes donnent droit à une indemnisation qui a été prévue par deux conventions internationales de 1992, auxquelles la France participe.
La première convention concerne la responsabilité civile : elle prévoit une responsabilité objective, c'est-à-dire automatique, du propriétaire du navire. Celui-ci est en droit de limiter sa responsabilité à hauteur d'un montant calculé en fonction du tonnage du navire. En ce qui concerne le sinistre de l'Erika, ce montant s'élève à 9,2 millions de droits de tirages spéciaux (DTS), soit la contre-valeur en francs français d'environ 84 millions de francs.
Selon la seconde convention internationale, il a été porté création du Fonds international d'indemnisation de 1992 pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, c'est-à-dire le « FIPOL 1992 », organisation intergouvernementale à laquelle appartiennent de nombreux États, dont la France.
Cette organisation est entièrement gérée par les gouvernements des États membres et - cela mérite d'être souligné - l'industrie pétrolière ne participe pas aux décisions adoptées par cette organisation.
Le FIPOL 1992 a pour mission de relayer l'indemnisation disponible au titre de la responsabilité civile du propriétaire pour permettre une indemnisation plus complète des victimes. Son engagement est cependant lui-même limité à 135 millions de DTS, soit aujourd'hui environ 1,2 milliard de francs, incluant la somme mise au compte de l'assureur couvrant la responsabilité civile. Les montants en francs dépendent des taux de change, mais c'est à peu près cela.
Il me paraît utile de préciser que le FIPOL est financé par des contributions prélevées sur certains types d'hydrocarbures transportés, précisément les pétroles bruts et fuel-oil lourds, contributions acquittées par les industries pétrolières destinataires.
Les gouvernements des Etats membres du FIPOL ont défini les critères généraux d'indemnisation qui ont été reproduits dans le « manuel sur les demandes d'indemnisation », que je tiens à votre disposition, publié par le FIPOL en juin 1988. Ils peuvent être résumés de la manière suivante :
- toute dépense/toute perte doit avoir été effectivement encourue ;
- toute dépense doit se rapporter à des mesures jugées raisonnables et justifiables ;
- les dépenses/les pertes ou les dommages encourus par un demandeur ne sont recevables que si et dans la mesure où ils peuvent être considérés comme ayant été causés par la pollution. Il doit donc y avoir un lien de causalité entre, d'une part, les dépenses/les pertes ou les dommages visés par la demande et, d'autre part, la pollution résultant du déversement ;
- un demandeur n'a le droit à réparation que s'il a subi un préjudice économique quantifiable ;
- un demandeur doit prouver le montant de sa perte ou de son dommage en produisant des documents ou d'autres preuves appropriées.
Les gouvernements des États membres du FIPOL ont décidé qu'il était essentiel d'arriver à une application uniforme des critères d'indemnisation dans tous les États membres.
Les demandeurs doivent être traités sur un pied d'égalité afin de permettre aux derniers venus dans la liste des demandeurs de recevoir une indemnisation dans les mêmes proportions que ceux ayant présenté leurs demandes plus tôt.
La politique du FIPOL est, depuis 22 ans, de régler les demandes à l'amiable. Il convient de noter qu'au cours des années, le FIPOL a été amené à intervenir dans 105 sinistres. Dans la grande majorité de ces sinistres, les demandes ont été réglées à l'amiable et c'est dans le cas de sept d'entre eux seulement que les demandeurs ont choisi d'intenter une action en justice.
Chaque demandeur conserve en tout état de cause son droit de saisir la justice de son pays pendant un délai de trois années après la survenance du dommage.
Enfin, une disposition qui facilite le traitement des préjudices continus, dont on a beaucoup eu à connaître au bureau : quand un préjudice intervient de façon continue ou discontinue sur une période longue, le demandeur peut tout à fait formuler de nouvelles demandes pour une période ultérieure à celle de sa première ou de sa précédente demande.
Par exemple, concernant les pêcheurs d'anatifes, en particulier pour le Morbihan, la pêche est fermée depuis le 7 janvier. On a donc pu déjà régler des dossiers au titre de la période de janvier. Les gens déposent de nouveau une demande puisque le dommage continue : la pêche est toujours fermée et ils subissent toujours un préjudice. Ainsi, ils posent des demandes successives, ce qui permet d'accélérer les premiers paiements.
Après avoir brossé le paysage général, j'en arrive aux missions spécifiques du bureau de Lorient.
Devant l'étendue de la pollution causée par le naufrage de l'Erika, le 12 décembre 1999, et du grand nombre de demandes d'indemnisation qui pouvaient être attendues à la suite du sinistre, le P&I Club Steamship Mutual, assureur en responsabilité civile du propriétaire du navire, et le FIPOL ont entrepris d'ouvrir en commun dans la zone sinistrée un bureau local des demandes d'indemnisation pour faciliter et accélérer le traitement des réclamations à venir.
Toujours en association avec les clubs - les assureurs en responsabilité civile des navires, souvent anglais ou scandinaves -, le FIPOL avait précédemment établi des bureaux locaux pour cinq ou six pollutions majeures survenues dans d'autres États membres. Le bureau commun de Lorient n'est donc pas une première.
Il a ouvert ses portes au public le 12 janvier 2000, soit un mois exactement après la survenance du sinistre.
Bien sûr, il a fallu équiper les locaux retenus en mobilier, matériel et moyens de communication. Il a surgi ex nihilo, car au 31 décembre, il n'était pas encore décidé de son implantation à Lorient ni de m'en confier la responsabilité. Il a fallu faire vite pour l'équiper de matériels et moyens de communication, pour mettre en place un effectif adapté de personnel suffisamment compétent : ce n'est pas facile lorsque l'on ne sait pas ce qui arrivera, combien de demandes, à quel rythme. Nous avons dû faire preuve de beaucoup d'imagination pour ouvrir dès le 12 janvier.
Devant l'impossibilité de tout copier, il fallait également mettre en place des procédures, traduire et adapter des documents et formulaires, dont certains compliqués. Grâce à l'aide du Steamship Mutual et du FIPOL, tant en moyens financiers et en expérience qu'en personnel, détaché de Londres, la structure de Lorient est devenue pleinement opérationnelle dans les jours qui ont suivi et les premiers chèques d'indemnisation ont pu être remis aux victimes le 21 février 2000.
Quelles sont ses missions ? Sans avoir vraiment le temps de regarder la télévision ou d'écouter les médias, j'entends diverses accusations. Il convient donc que je définisse clairement les missions du bureau de Lorient.
Le bureau des demandes d'indemnisation a reçu les missions suivantes :
- accueillir et renseigner les victimes de préjudices : particuliers, entreprises, associations et toute autre personne de droit public ou privé ;
- fournir à ces victimes les formulaires appropriés pour faire valoir leurs droits. Ces formulaires doivent être appropriés, car un dommage subi par un pêcheur d'anatifes n'a rien à voir avoir un dommage d'hôtelier ou de restaurateur : les formulaires sont adaptés aux métiers ;
- aider, si nécessaire, ces victimes à remplir les formulaires de demande d'indemnisation. Ils ne sont pas très simples, car un minimum de renseignements sont nécessaires ;
- tenir un registre de toutes les demandes reçues, leur attribuer un numéro d'ordre chronologique et en accuser réception au demandeur ;
- s'assurer que les documents et pièces fournies à l'appui des demandes ont bien été joints ; sinon demander les pièces nécessaires à l'évaluation du préjudice encouru. Certains formulaires nous parviennent parfois sans pièce à l'appui : c'est forcément perdu d'avance ;
- transmettre sans délai ces demandes aux experts appropriés choisis par le Steamship Mutual et le FIPOL pour l'évaluation de chaque demande ;
- réclamer au demandeur toutes les pièces complémentaires que les experts jugeront nécessaires et les leur transmettre dès réception. Les experts évaluateurs sont parfois un peu courts en pièces et cernent difficilement la nature et l'importance du préjudice ; dans ce cas, ils nous demandent de contacter le demandeur pour solliciter d'autres pièces, comme une licence de pêche, des relevés, des pièces qui, curieusement, manquent ;
Ensuite, les experts se prononcent après étude de toutes les pièces, évaluent la demande par rapport à ce qui est réclamé et par rapport à leurs connaissances et leur expérience : ils sont spécialisés en tourisme, en choses de la mer (conchyliculture, pêche, récolte de coquillages, etc.), en généralités, comme des dommages survenus aux bateaux de plaisance, aux propriétés de bord de mer et aussi aux communes au titre d'opérations de nettoyage : certaines communes ont fait valoir des demandes au titre de la pollution par la marée noire.
Dès réception du rapport des experts, le bureau transmet l'ensemble des documents constituant la demande au Steamship Mutual et au FIPOL à Londres avec un formulaire de demande d'approbation du montant retenu, en y ajoutant des commentaires, le cas échéant.
A la réception de la décision du Steamship Mutual et du FIPOL quant au montant arrêté, nous informons le demandeur et recueillons son accord ou son refus. On ne peut rien payer sans l'accord des deux parties : il s'agit bien d'une démarche commune.
En cas d'accord du demandeur, il est procédé aussitôt que possible au paiement de la somme convenue, contre signature d'un reçu valant quittance subrogative. Si le demandeur est pressé, nous l'invitons à venir retirer son chèque ; sinon nous lui envoyons la quittance, qu'il nous renvoie signée pour que nous puissions lui faire parvenir le chèque avec un des trois exemplaires de la quittance.
Enfin, après ses missions ponctuelles auprès de demandeurs, le bureau a les missions générales suivantes :
- tenir à jour le compte des fonds mis à sa disposition et rendre compte régulièrement. Ces fonds sont par essence appelés à disparaître et il convient de les regarnir régulièrement ;
- adapter ses effectifs et ses moyens à la demande, de sorte que le déroulement des procédures reste fluide ;
- faire toutes les diligences nécessaires pour accélérer le règlement d'un dossier en cas d'urgence. Nous respectons la notion d'urgence pour les cas de personnes subissant des préjudices difficiles à supporter économiquement - gens modestes ou entreprises. S'ils nous sollicitent, nous avons la possibilité de demander un accord partiel rapide, un hardship payment, un paiement d'urgence ;
- enfin, rendre compte de tous les événements de nature à affecter le bon fonctionnement du bureau ou le suivi des demandes d'indemnisation.
Cette liste n'est pas limitative des initiatives à prendre. En effet, notre petite structure est susceptible de s'adapter en fonction des instructions de nos mandants. C'est sur le terrain, au besoin, que l'on découvre au fur et à mesure ce qui doit être fait. Quand la pollution s'est produite, personne ne savait ce qui se passerait, où elle allait aboutir, qui serait touché, etc. Moi-même, j'ai découvert des métiers dont je ne soupçonnais pas l'existence.
En revanche, et pour qu'aucune ambiguïté ne puisse subsister, je préciserai que le bureau de Lorient n'a pas reçu pour mission de se prononcer sur la recevabilité de la demande. Nous recevons toutes les demandes et nous ne formulons aucune opinion sur leur recevabilité.
M. le Président : Vous êtes une boîte aux lettres ?
M. Merri JACQUEMIN : J'en reparlerai : cette boîte aux lettres fait quand même des chèques.
Le bureau n'a pas non plus reçu pour mission :
- d'effectuer lui-même des expertises ou des évaluations ;
- de prendre la moindre décision quant au montant de l'indemnisation à payer.
Le bureau n'a donc reçu qu'une mission de gestion administrative des demandes d'indemnisation. C'est une gestion administrative centralisée : dans le schéma de fonctionnement, tout sort de chez nous, tout revient chez nous et nous gardons toutes les archives qui ont trait aux indemnisations passées, en cours ou à venir.
Naturellement, cette procédure prend un certain temps. Malgré toute notre bonne volonté, le règlement des demandes ne peut s'effectuer immédiatement.
En effet, l'évaluation, qui ne relève pas de notre responsabilité, prend du temps, surtout pour des métiers peu ou mal connus. Dans l'hypothèse où le montant maximum pour indemniser les victimes ne suffirait pas à répondre à 100 % de la totalité des demandes, il convient dès à présent de veiller à traiter toutes les demandes sur un pied d'égalité, sinon il y aurait un risque de voir les demandeurs qui ont présenté leurs réclamations en premier recevoir une indemnisation supérieure en pourcentage à celle de ceux s'étant présentés plus tardivement.
Ainsi, par exemple, les professionnels du tourisme ont actuellement de grandes craintes, comme tout le monde, sur la qualité de la saison à venir. Bien évidemment, ils ne peuvent pas présenter aujourd'hui de demande puisque, pour la plupart, ils n'ont encore subi aucun dommage : ils pourront présenter des demandes plus tard, soit une seule en fin de saison, soit plusieurs au cours de la saison, à chaque fois qu'ils le jugeront bon.
Sur cette façon d'examiner les demandes, que certains trouvent trop lente, il reste à dire qu'il faut être prudent et qu'en allant trop vite, le bureau et/ou les autres intervenants risqueraient de commettre des erreurs qui pourraient se révéler préjudiciables aux demandeurs ultérieurs. C'est une règle que je crois avoir bien comprise et qu'il me paraît juste d'appliquer.
Je terminerai sur la situation actuelle du processus d'indemnisation.
A la date du 5 avril 2000, hier midi, le bureau des demandes d'indemnisation a reçu 777 demandes et 131 demandes complémentaires pour un montant de 63.674.225 F. Les demandes complémentaires concernent des sinistres déjà en cours de traitement : la pêche est toujours fermée et il faut introduire une demande à fin février, puis à fin mars. Le bureau a également reçu 1.268 lettres d'intention, émanant pour la plupart du secteur du tourisme.
Enfin, hier à midi, 102 demandes avaient été payées, en tout ou en partie, pour un montant total de 1.178.650 F.
Les paiements autorisés mais non encore effectués, en cours ou en attente du retour de l'accord ou du reçu du demandeur, étaient hier au nombre de 20 pour un montant de 519 382 F. Avec ces chiffres indicatifs, j'ai terminé mon exposé liminaire.
M. le Rapporteur : Votre exposé nous a permis de relever les principales questions que l'on se pose depuis ce matin.
Je commence par un constat : vous vous présentez comme l'administrateur local de décisions qui ne sont pas prises par vous. Je constate que le naufrage a eu lieu le 12 décembre ; nous sommes en avril. Le fonds dont dispose l'ensemble s'élève à 1,2 milliard, dont un million de francs est dépensé aujourd'hui.
M. Merri JACQUEMIN : Et il n'y a que 65 millions de francs de demandes.
M. le Rapporteur : C'est le premier constat : la situation est un peu paradoxale.
Pouvez-vous nous préciser de qui proviennent les 777 demandes à l'heure actuelle ? Vous avez dit que les lettres d'intention provenaient surtout du secteur du tourisme ? De qui proviennent les lettres ? De personnes qui ont été indemnisées, les heureux bénéficiaires du 1.175.000 F, auxquels il faudrait rajouter 519 000 F de dettes ?
Mais nous pourrions considérer les autorisés comme bénéficiaires, comme si c'était fait. Cela n'empêche pas l'ampleur de la différence entre les 1,2 milliard et le million. Sur quel taux par rapport à leur demande initiale le versement s'est-il fait ?
Puisque c'est Londres qui décide du montant et du taux, à votre connaissance, le taux payé correspond-il à celui défini par l'expert ? Vous nous avez confié ne pas être à même de déterminer le pourcentage, de définir « l'économiquement qualitatif ». La recommandation des experts est-elle suivie par Londres pour le versement de la somme et pour le pourcentage ?
Enfin, dernière question pour l'instant : avez-vous un avis personnel sur le concept de « dépense raisonnable et justifiable » ? On peut comprendre justifiable ; raisonnable, c'est plus complexe. Avez-vous un avis personnel sur le concept de raisonnable, qui paraît parfois incompréhensible ?
M. Merri JACQUEMIN : De qui proviennent les demandes ? C'est varié : des statistiques sont envoyées chaque jour à l'agence judiciaire du Trésor. J'aurais dû les amener.
Je peux définir les grandes masses. Les demandes du début ont été essentiellement d'origine maritime : pêcheurs à pied, pêcheurs d'anatifes, bateaux de pêche. Les ostréiculteurs ne sont apparus que depuis une quinzaine de jours : je crois qu'ils devaient se mettre d'accord avec leur organisation de producteurs pour monter des dossiers plus uniformisés, plus coordonnés. En appréciant « à vue de nez », cela représente 60 %. Il y a des demandes de nettoyage (demandes de type 1) : il s'agit essentiellement de collectivités locales et de quelques particuliers dont les maisons ont été envahies par le pétrole. Plus quelques demandes en provenance du secteur du tourisme, mais très peu : les établissements qui restent ouverts toute l'année ont déjà des pertes à faire valoir, mais je ne sais pas s'ils les ont subies.
La deuxième question porte sur le taux payé par rapport à la demande initiale. C'est une question très vaste, car il y a déjà l'évaluation de l'expert : il définit le montant recevable de la demande de façon raisonnée, motivée, selon lui, car il ne commande pas le système. Ce montant correspond parfois à la totalité de la demande, mais parfois il est très différent.
Beaucoup de difficultés naissent du fait que, pour de mêmes métiers en de mêmes endroits et pour de mêmes périodes, les demandes varient du simple au décuple. Qu'est-ce que cela signifie ? Où est la vérité ? C'est vrai qu'une grande partie du travail des experts doit consister en la recherche de la vérité. Ces demandes étant intermédiaires puisque le dommage se poursuit (pour les pêcheurs à pied notamment), elles ont été payées à 100 % du montant évalué, pour la plupart et même, je crois, pour la totalité des demandes, sauf à vérifier.
M. le Rapporteur : Sur la base du rapport d'évaluation de l'expert ?
M. Merri JACQUEMIN : Certainement.
M. le Rapporteur : Donc le FIPOL paie rubis sur l'ongle ?
M. Merri JACQUEMIN : Londres paie, ainsi que le Steamship Mutual. Je veux absolument me débarrasser de cette image FIPOL, mais on y revient toujours !
M. le Rapporteur : Selon les rapports d'experts ? Rubis sur l'ongle d'après les chiffres du rapport d'expert dans tous les cas ?
M. Merri JACQUEMIN : A priori. Je pourrais me tromper mais globalement, oui. Les bureaux de Londres suivent l'avis des experts.
M. le Rapporteur : Il n'y a donc pas d'affichage de pourcentage. Je complète ma question : vous avez dit qu'on ne sait pas trop si l'on aura assez d'argent pour payer tout le monde à la fin et qu'il faut faire preuve de précaution.
L'expert ne fait pas preuve de précaution : il présente un rapport indiquant que la demande est juste et qu'il convient de payer. Actuellement, les sommes engagées ne sont pas très fortes mais, à un moment donné, les collectivités vont déposer leurs dossiers, comme c'est déjà fait en partie. Le tourisme va aussi présenter ses réclamations et nous risquons de rencontrer quelques difficultés. Si vous me dites payer en fonction du rapport d'experts, il n'y a pas de pourcentage.
M. Merri JACQUEMIN : Actuellement, les demandes sont intérimaires : les gens ont la possibilité de déposer plusieurs dossiers successifs. Nous n'en sommes qu'aux premières demandes. Elles ont vraisemblablement été acceptées puisque je constate qu'elles sont payées au niveau de leur valeur évaluée.
S'agissant du concept de dépense raisonnable, c'est à l'expert de l'évaluer au cas par cas, c'est la politique de l'organisation. Ce mot revient souvent dans le document que je vous laisserai. Je n'ai pas à me prononcer sur l'opportunité et la signification de l'expression, mais ce manuel du traitement des demandes d'indemnisation a été mis au point par les gouvernements des États membres. Pour moi, raisonnable, c'est la raison, c'est ni trop ni trop peu.
M. le Rapporteur : La raison, c'est l'expert ? En fonction de votre propre expérience récente, la réponse est bien que c'est l'expert ?
M. Merri JACQUEMIN : L'expert tente d'évaluer une demande d'une façon raisonnable ; j'imagine que c'est cela.
M. le Président : Ce matin, on nous a parlé d'un taux de vétusté...
M. Merri JACQUEMIN : A juste titre, M. le président !
M. le Président : ...concernant les filets de pêche.
M. Merri JACQUEMIN : Oui, pour les filets de pêche également. Le taux de vétusté est susceptible d'être appliqué à tous les remboursements d'événements, comme une pollution par marée noire, ou à n'importe quel remboursement d'assurance. C'est une pratique commune.
M. le Président : Donc, dans ce cas, vous vous alignez sur les pratiques traditionnelles des assurances ?
M. Merri JACQUEMIN : On pourrait le dire : les experts s'alignent sur les pratiques communes.
M. François GOULARD : Je voudrais revenir sur la question du rapporteur. Dans la mesure où le FIPOL ou l'assureur commencent à payer actuellement des montants modiques, on voit mal comment le principe que vous avez énoncé d'égalité des demandeurs peut être respecté : la contradiction me paraît évidente.
En effet, si l'on paie à 100 % les premières demandes et si l'on dépasse le montant total prévu pour les indemnisations, à un moment, on réduira ce taux pour l'annuler en définitive. Il y a une contradiction entre la pratique et le principe d'égalité de tous les demandeurs tel que vous l'avez affiché.
Un exemple : en matière de dépôt de bilan, nous savons que l'égalité des demandeurs ou de certaines catégories de créanciers fait qu'il faut attendre la fin des déclarations pour connaître le pourcentage servi au moment de la liquidation.
Plus particulièrement, un demandeur éventuel s'appelle l'Etat. Le gouvernement a annoncé qu'il passerait en dernier rang, qu'il attendrait que toutes les autres demandes aient été présentées avant de faire la sienne. Si l'on applique ce principe d'égalité des demandeurs, peu importe le moment où la demande est présentée : il n'y a pas de raison de servir plus mal quelqu'un qui s'est présenté à la fin du délai de trois ans et quelqu'un qui s'est présenté au tout début. En fonction des informations que vous détenez, pouvez-vous m'éclairer sur ce point ? C'est très important.
Mme Jacqueline LAZARD : Quelques questions pratiques, notamment sur les missions du bureau de Lorient : accueillir, renseigner et fournir les formulaires dont vous avez dit qu'ils n'étaient pas simples. Ne faites-vous que fournir les formulaires ou bien aidez-vous à les compléter, à renseigner sur la façon de les compléter puisqu'ils ne sont pas très simples ?
Vous avez dit aussi que vous aviez pour obligation d'accuser réception des dossiers transmis : est-ce fait systématiquement ?
D'autre part, on vous transmet les dossiers, l'expert les traite et les renvoie avant que vous ne les fassiez parvenir à Londres. C'est vrai que tout cela prend du temps, un temps important avant l'indemnisation. Je trouve que c'est en contradiction avec l'installation d'un bureau dont l'objectif était d'être au plus près et d'éviter toute lenteur dans le règlement des dossiers. Je voudrais votre avis sur ce constat.
Dernière question : comme vous dites être le responsable du bureau d'indemnisation de Lorient et non quelqu'un en prise directe avec le FIPOL, aviez-vous déjà effectué ce genre de travail avant ? Cette question est un peu plus personnelle.
M. Jean-Michel MARCHAND : Je ne vais pas vous poser des questions bien différentes. J'ai noté, dans le premier volet sur lequel vient de vous interroger ma collègue, les missions du bureau de Lorient. Vous nous avez dit que vous deviez aider les victimes à remplir les formulaires et, trois phrases plus loin, faire compléter les dossiers quand ils reviennent des experts. Cela signifie que vous n'avez pas bien aidé à les remplir ?
M. Merri JACQUEMIN : Je n'ai pas dit cela.
M. Jean-Michel MARCHAND : Si, si. Je l'ai noté mot par mot. A un moment donné, vous ne remplissez pas le service pour lequel sans doute ce bureau a été ouvert. C'est la question que je vous pose : remplissez-vous le service pour lequel ce bureau a été ouvert auprès des demandeurs ?
La seconde interrogation reprend celle qui vous a déjà été formulée : si ce sont les experts qui évaluent l'indemnité, comment pourra-t-on rester dans une enveloppe préétablie ? Je peux poser la question de façon un peu insidieuse : les experts ont-ils toute l'indépendance souhaitée pour évaluer les dossiers qui leur sont proposés ?
M. le Président : J'ajoute une ou deux questions. Y a-t-il possibilité d'appel à la suite des propositions de remboursement ?
Deuxièmement, je suppose que l'appel entraîne certaines procédures : a-t-on une expérience, dans ce domaine, sur le poids que peut avoir le FIPOL face à un appel ? En outre, ces experts dont il est beaucoup question, entre le bureau de Lorient et le FIPOL à Londres, l'un qui reçoit les dossiers et l'autre qui décide, où sont-ils ? Ces experts se trouvent-ils aussi à Londres ou dans la région de manière à se rendre sur place pour vérification ? Jugent-ils seulement sur pièces ? Se déplacent-ils ? De quel type d'experts s'agit-il ?
M. Merri JACQUEMIN : Je vais répondre dans le désordre en commençant par M. le président. Les experts se trouvent en France, tous. Certains dans le Finistère, puisqu'il y en a dans chaque département concerné. Ils ne sont pas à Londres.
Ils ne se rendent pas toujours sur place. Cela dépend de la nature des dommages : s'il y a des constatations à effectuer, ils se rendent sur place. Prenons l'exemple d'une mévente d'huîtres : il n'y a rien à constater si ce n'est le chiffre d'affaires en baisse. Effectivement, ils peuvent raisonnablement traiter sur dossier puisqu'on ne demande pas de fournir les huîtres en question qui n'ont pas été vendues. C'est vraiment du cas par cas. Pour examiner une maison souillée, l'expert ira sur place, sauf si le dossier photographique est suffisant. Si le dommage n'est pas trop important, les experts ne vont pas se déplacer. Mais des experts se sont rendus à Belle-Île et dans d'autres îles pour constater que des filets étaient bien souillés. Cela pour répondre à votre question.
Vous m'avez parlé d'appel ensuite, qu'entendez-vous par là ?
M. le Président : J'ai rempli un dossier, je vous le transmets, il parvient aux experts, il vous revient pour être remis au FIPOL et on me répond que je serai indemnisé d'une somme qui ne me satisfait pas. Concrètement, si je conteste, est-ce que je touche malgré tout cette indemnité ? Puis-je encore espérer voir un complément me parvenir après examen ? Ou bien ma contestation remet-elle en cause le premier versement susceptible d'intervenir ?
Y a-t-il de la part du FIPOL, de la part des experts, de la part du bureau, éventuellement, une forme de pression sur les demandeurs, incitant à ne pas faire appel, à ne pas pousser les demandes plus loin, en fonction d'objectifs à atteindre de ne pas dépasser cette somme de 1,2 milliard, d'être prudent dans les indemnisations afin de faire face à toute éventualité ?
M. Merri JACQUEMIN : Je comprends bien vos questions et je vais essayer d'y répondre.
M. le Président : Une question accessoire : qui paie les experts ? Est-ce pris sur les 1,2 milliard ou en plus ?
M. Merri JACQUEMIN : Non, les frais de fonctionnement de l'administration des sinistres, en général, c'est-à-dire du bureau, des experts et les frais internes des opérateurs tels que le FIPOL et l'ITOPF sont complètement en dehors de ce montant-là.
Concernant l'appel, ce n'est pas tout à fait un appel. Tout à l'heure, j'ai dit que chaque victime conserve en tout état de cause, satisfait ou non, le droit de s'adresser à la justice. Que se passe-t-il quand les gens ne sont pas satisfaits ? Ce n'est pas très fréquent. Ils peuvent tout à fait apporter de nouvelles pièces. S'ils ne sont pas satisfaits, c'est que l'expert a jugé, soit d'après ce qu'il a vu soit d'après les pièces, que le dommage valait telle indemnisation selon lui. S'ils ne sont pas satisfaits, c'est qu'ils disposent d'autres pièces, non jointes à leur dossier, pour faire valoir leur indemnisation.
Concernant la pêche de certains produits, pour de mêmes pêches, aux mêmes endroits, pour de mêmes périodes, avec des produits de même prix, les demandes vont du simple au décuple. Certains sont peut-être très au-delà de la vérité et d'autres bien en deçà de la vérité. Il existe encore d'autres phénomènes particuliers à certaines pêches qui jouent aussi dans le système.
Vous m'avez également demandé si le bureau, les experts, l'assureur et, enfin, le FIPOL chercheraient à réduire la demande et à faire pression sur les demandeurs pour économiser de l'argent. En ce qui concerne le bureau, il est certain que non. Franchement, je pense que cela ne doit pas être vrai : il est quasiment évident que tous les fonds seront dépensés et je ne vois pas quel intérêt pourrait gouverner ce type de réaction.
En additionnant toutes les demandes qui arriveront, encore inconnues surtout s'agissant du tourisme, plus le droit de l'Etat français à présenter une demande pour tous les fonds qu'il a avancés, plus le même droit que conserve néanmoins TotalFina qui a dit vouloir avancer les fonds et en obtenir remboursement à partir du moment où il sera subrogé dans certains droits concernant, par exemple, le pompage du navire, nous sommes sûrs aujourd'hui qu'en additionnant tout cela, l'ensemble des fonds sera dépensé et qu'il n'y a aucune raison de vouloir faire des économies.
L'argent a été changé à la date du 15 ou du 16 février, converti en francs français par décision du comité exécutif. Je sais que l'on entend beaucoup parler de cette accusation que le bureau, bouc émissaire de tous les mécontentements, tenterait de réduire les demandes. Pas du tout.
Au contraire, quand les gens ne sont pas contents, nous leur demandons de fournir d'autres pièces. Nous n'avons d'autre pouvoir que d'essayer de leur faire produire des pièces qui feraient changer l'opinion des experts.
Pour revenir à la question de l'indépendance des experts, je n'ai pas de réponse : ce n'est pas moi qui les ai nommés. J'imagine qu'ils sont indépendants. Je ne sais pas qui les nomme : je suppose qu'ils ont été choisis par Steamship Mutual et le FIPOL, en commun. En tout cas, ce n'est pas le bureau : le bureau envoie les dossiers aux experts appropriés, choisis par le Steamship et le FIPOL. J'en connais quelques-uns : il serait difficile de les taxer de partialité.
M. Jean-Michel MARCHAND : Et qui les paie ?
M. Merri JACQUEMIN : J'ai répondu que je ne savais pas : ce n'est ni le bureau, ni les victimes. Toute cette gestion du sinistre dépend des fonds du FIPOL, mais n'est pas déduite de la somme disponible. Ai-je répondu à vos questions ?
M. Jean-Michel MARCHAND : Oui, dans la mesure où vous savez ou vous ne savez pas.
M. Merri JACQUEMIN : Mme Lazard m'a demandé l'utilité du bureau. Elle a dit que le temps écoulé avant que les demandes soient payées était très important. Je peux poser la même question : que veut dire important par rapport à raisonnable ?
Mme Jacqueline LAZARD : Le temps est trop long : vous avez des délais très longs, semble-t-il, plus de cinq semaines.
M. Merri JACQUEMIN : Semble-t-il, madame. Nous avons payé les premiers dossiers le 21 février et nous en payons depuis lors. Cela fait cinq semaines entre le 12 janvier et le 21 février.
Il est évident qu'il y a un plus grand nombre de dossiers déposés que de dossiers payés : il arrive tous les jours des demandes et leur nombre augmente. Nous travaillons sur les premiers dossiers en les prenant dans l'ordre. C'est vrai que le temps est toujours trop long pour ceux qui attendent.
Au sein du bureau, nous sommes quatre dedans et un à l'extérieur, c'est-à-dire que, comme le bureau est excentré géographiquement, nous avons préféré garder une personne à la disposition des collectivités publiques et privées.
M. le Président : Estimez-vous être assez nombreux ?
M. Merri JACQUEMIN : Je me pose la question et j'envisage d'engager une personne en plus. Il convient d'identifier les goulots d'étranglement ; c'est une partie de mon travail. J'hésite pour l'instant : je ne suis pas certain que d'être plus nombreux accélérerait les règlements. Si j'en étais sûr, je le ferais, car j'ai toute possibilité d'engager du personnel administratif supplémentaire sans devoir en référer à qui que ce soit. C'est la seule décision qui relève de ma responsabilité.
Madame, vous m'avez demandé si nous renseignions les gens pour remplir les formulaires. Je vous ai dit que nous le faisions : c'est notifié dans nos missions : « Si nécessaire, aider ces victimes à remplir leur demande d'indemnisation » . Nous le faisons à la fois à Lorient et par le biais de notre itinérant.
M. Merri JACQUEMIN : Sur la position de l'Etat, je ne peux pas répondre. Ce que j'ai entendu, comme tout le monde, c'est que l'Etat français se mettrait en avant-dernier. Je l'ai entendu le 15 février. Que signifie se mettre en avant-dernier ? Deux façons de le faire : on peut se mettre en avant-dernier s'il reste quelque chose, comme l'a prévu TotalFina. La société ne demande pas à être incluse dans le partage si le fonds est dépensé. Pour l'Etat français, la position m'a semblé plus ambiguë : ils sont en avant-dernier sans préciser si c'est après tout le monde. Je n'ai pas participé à ces discussions.
M. Goulard m'a parlé de la difficulté de respecter le principe d'égalité. Je me suis posé la question depuis le début. La réalité, c'est que 100 % des demandes que nous payons sont des demandes provisoires : les dommages n'ont pas cessé. Il y a peut-être une part d'estimation qui ne dépend pas de moi : si le dommage dure trois mois et que nous payons un mois à 100 %, cela ne représente que 33 % du dommage possible ; dans ces conditions, nous pouvons raisonnablement les payer à 100 %.
C'est encore une supputation de ma part, car je ne suis que le responsable du bureau et pas du FIPOL. Vous verrez M. Jacobson la semaine prochaine : il a certainement des idées sur ces problèmes.
Ai-je répondu à toutes les questions ?
M. Jean-Michel MARCHAND : Une remarque : j'apprécie vos supputations, monsieur, mais vous venez de dire quelque chose d'extraordinaire : nous remboursons des dommages à 100 % parce que nous pensons que cela ne fera que 33 % en fin de course.
M. Merri JACQUEMIN : Cela pourrait ne faire que 33 %.
M. Jean-Michel MARCHAND : Vous avez été interrogé sur la position de TotalFina et de l'Etat français, TotalFina en dernière position et l'Etat en avant-dernière. Seront-ils inclus ou pas dans le partage ? Vous l'avez dit.
M. Merri JACQUEMIN : Si je l'ai dit, vous me permettrez de rectifier : je crois avoir dit que TotalFina avait déclaré clairement, urbi et orbi, publiquement, qu'ils avanceraient des fonds - fonds du pompage, fonds d'aide au nettoyage, matériel - et qu'ils feraient une réclamation s'il restait de l'argent. Cela veut bien dire rester en dernière position et ne pas participer au partage.
J'ai dit également qu'en ce qui concerne l'Etat français, je n'avais pas d'opinion.
M. le Rapporteur : A partir du moment où, en loi de finances rectificative, on inscrit en nouvelles dépenses une somme correspondant aux engagements pris par le gouvernement, à mon avis, cela veut dire que c'est la dernière position.
M. le Président : J'ai cru comprendre que quelques fonds étaient prévus pour faire face aux événements de la fin 1999.
Mme Jacqueline LAZARD : J'avais posé une question que j'avais qualifiée de plus personnelle : avez-vous déjà exercé cette profession précédemment ?
M. Merri JACQUEMIN : La gestion de sinistres n'est pas mon métier premier. Je suis courtier maritime, pour quelques semaines encore. J'ai de profondes racines dans le maritime. C'est vrai qu'une catastrophe de pétrolier touche au maritime. Mais ce que je fais n'est pas un métier très technique à vrai dire.
Audition de M. Jacques de NAUROIS,
directeur des relations institutionnelles,
et de M. Pierre GUYONNET,
directeur de la mission Littoral Atlantique,
du groupe TotalFinaElf
(extrait du procès-verbal de la séance du 6 avril 2000 à Lorient)
Présidence de M. Daniel PAUL, Président
MM. Jacques de Naurois et Pierre Guyonnet sont introduits.
M. le Président leur rappelle que les dispositions législatives relatives aux commissions d'enquête lui ont été communiquées. A l'invitation du Président, MM. Jacques de Naurois et Pierre Guyonnet prêtent serment.
M. Jacques de NAUROIS : Je m'exprimerai en deux parties : je commencerai par dire dans quel cadre nos interventions s'effectuent et Pierre Guyonnet reviendra plus en détail sur lesdites interventions.
Deux dispositifs ont été mis en place. Le premier est un dispositif dans le cadre de la lutte contre la pollution, c'est-à-dire du plan POLMAR ; le plan POLMAR étant du ressort et sous l'autorité des préfets, nos activités dans ce cadre s'exercent sous l'autorité et la coordination des autorités préfectorales. Le second dispositif se situe dans le cadre de l'indemnisation des victimes - sujet principal de notre audition de ce jour - et donc du FIPOL.
L'intervention de TotalFina s'insère dans le cadre réglementaire du plan POLMAR. Quelle fut notre philosophie dans cette affaire ? Les engagements que nous avons pris, nous avons essayé de les prendre dans des domaines où nous estimions pouvoir apporter une plus-value par rapport au cadre dans lequel l'Etat agissait déjà.
C'est ainsi que nous menons, d'une part, des actions d'un type assez délimité - pompage et traitement des déchets - qui sont des travaux d'ingénieurs, de caractère technique, pour lesquels nous pensons que notre société peut apporter une plus-value par rapport à la seule action de l'Etat. Nous intervenons selon des protocoles précis qui définissent nos relations avec l'Etat.
D'autre part, nous menons diverses actions que je qualifierai de support par rapport à l'activité du plan POLMAR terre et qui sont définies de manière souple avec les préfets en charge du plan POLMAR. Que faisons-nous ? Nous prenons en charge des chantiers de pollution relativement difficiles ; nous mettons à disposition des matériels, des quads, des grues, des cribleuses, du matériel de nettoyage divers ; nous faisons des apports en matière de logistique pour des chantiers POLMAR, à travers des mises à disposition de navires, d'hélicoptères, de matériels divers de transport de ce type ; nous nous occupons de transport de déchets vers les sites de stockage lourd et nous avons pris en charge un certain nombre de chantiers de dépollution de terrains qui ont accueilli des sites de stockage intermédiaire.
Enfin, nous avons trois autres types d'actions qui se situent en marge du plan POLMAR. Nous sommes en train de constituer un fonds d'actions pour la mer de 50 millions de francs, de manière à contribuer à la restauration de sites écologiques sur le long terme. Nous participons pour 30 millions de francs à une campagne de restauration d'image organisée par le secrétariat d'Etat au Tourisme. Et nous avons signé récemment une convention de modération de prix avec le secteur de la pêche, particulièrement touché.
Ces différentes actions sont reprises sur ce document, ainsi que la manière dont elles se situent par rapport au plan POLMAR. (cf. annexe 1)
Vous voyez sur le tableau, d'une part, la manière dont ces actions se situent par rapport aux actions de l'Etat aussi bien dans le cadre du plan POLMAR terre que dans le cadre du plan POLMAR mer ; d'autre part, une estimation des montants des engagements de notre groupe dans les différents types d'actions dont je vous ai fait mention tout à l'heure.
On estime, pour le moment, que le montant total de notre engagement est supérieur à 700 millions de francs. Il faut aussi noter que les parties élimination des déchets et traitement des cargaisons ne sont que des estimations puisque les opérations ne sont pas terminées.
Indemnisation des victimes : il s'agit du cadre défini par la convention internationale de 1992, à l'origine de la création du FIPOL, organisation gouvernementale qui, dans le cas du naufrage de l'Erika, permet de dégager un fonds d'un montant d'environ 1,2 milliard de francs. Ce fonds fonctionne indépendamment de toute question de responsabilité.
Notre action se situe en supplément des dispositifs d'indemnisation du FIPOL. En effet, TotalFinaElf, notre groupe, souhaite que l'intégralité des fonds FIPOL, comme je l'ai dit 1,2 milliard de francs, serve à l'indemnisation des préjudices économiques subis par la société civile. Cela signifie que, pour les actions qu'il a prises en charge, le groupe ne demandera pas d'indemnisation au FIPOL. Cela définit notre mode de relations avec le FIPOL. Si vous le permettez, je passe la parole à Pierre Guyonnet qui reviendra plus en détail sur les diverses actions que nous avons entreprises et sur lesquelles nous travaillons actuellement.
M. Pierre GUYONNET : Nous disposons de quelques planches sur lesquelles je m'appuierai pour mon exposé. Je reprendrai d'abord nos actions principales : les chantiers spécifiques et les fournitures de matériel que nous apportons aux organisations POLMAR ; ensuite, l'élimination des déchets ; enfin, le traitement de la cargaison.
Pour les chantiers de nettoyage, sur la carte (cf. annexe n°2), vous voyez que nous intervenons sur tous les départements touchés par la marée noire à l'intérieur du plan POLMAR. Nous n'intervenons qu'en complément des moyens engagés par l'Etat au titre du plan POLMAR, sans vouloir prétendre réaliser la majeure partie des travaux.
Nous utilisons des procédés techniques et des moyens validés par les scientifiques du CEDRE, par les PC POLMAR ; ce sont eux qui fixent les priorités pour décider d'un chantier ou d'un autre. Cela se décide avec les PC POLMAR. On commence le travail en faisant l'inventaire, en établissant un cahier des charges approuvé par les experts. En général, concernant notre mode de travail, comme TotalFinaElf ne dispose pas de personnel capable de mener ces travaux de dépollution, nous travaillons avec des sous-traitants que nous supervisons. Nous avons utilisé de nombreuses personnes employées habituellement dans les dépôts ou dans les raffineries qui viennent nous aider pour un temps afin de superviser les chantiers de dépollution.
Très souvent, les chantiers qui nous sont confiés sont difficiles. Ils demandent des moyens particuliers, parfois de l'expertise. Certains chantiers ont nécessité l'emploi d'hélicoptères. Pour superviser ce genre d'opérations, nous avons fait appel à des groupes de chez nous qui avaient l'habitude d'effectuer des forages dans des endroits isolés pour lesquels des hélicoptères sont indispensables ; il ne s'agit pas d'utiliser ce genre d'engins n'importe comment, car cela peut s'avérer très dangereux. En fin de chantier, comme il existe un cahier des charges, nous avons une signature d'une bonne fin de chantier. Quelques chantiers sont déjà terminés.
Sur cette planche (cf. annexe n°2), une majorité de chantiers engagés et, en jaune, quelques chantiers en projet : La Bernerie n'est plus en projet puisqu'il a été démarré la semaine dernière. En revanche, la corniche de Sion reste en projet parce que nous avons quelques discussions avec les directions régionales de l'environnement (DIREN) et avec le CEDRE. Cette zone étant très fragile sur le plan écologique, on ne peut pas agir de façon trop violente.
Pour ce qui est de l'élimination des déchets, un graphique
(cf. annexe n°3) montre l'échelle du temps mise à jour au 31 mars et l'échelle des tonnes. Juste avant la mise en service d'Arceau, nous en étions à 140 000 tonnes. Tout en haut, nous sommes à 200 000 tonnes. Avec la mise en service d'Arceau 2, à proximité immédiate de Donges, une capacité de stockage d'environ 200 000 tonnes a été créée ; nous ne pensons pas avoir cette quantité.
En revanche, la place nous sera précieuse quand nous commencerons le traitement des déchets eux-mêmes ; nous aurons besoin d'effectuer du tri, de composer des tas, d'installer des usines et des ateliers de traitement des déchets. Actuellement, nous en sommes à 140 000 tonnes et nous pensons que cela pourrait aller jusqu'à 160 000 tonnes.
Pour ces sites, nous disposons d'autorisations d'exploitation de l'administration et un protocole est en cours de mise au point avec le préfet Thuau. Ce protocole classique nous charge bien sûr de faire ce travail, non seulement de stockage lourd des déchets, mais aussi de leur élimination.
Le document suivant (cf. annexe n°4) indique le planning que nous nous sommes fixé. Nous sommes prêts à lancer l'appel d'offres : la ligne verticale montre où nous en sommes. Cet appel d'offres se fera sur trois lots : le lot de Frossay, le lot de Donges et le lot d'Arceau 1 ; comme Arceau 2 vient de s'ouvrir, il ne contient pas grand-chose : il fera l'objet d'un appel d'offres ultérieur complémentaire. Avec trois lots, nous laisserons aux entreprises ou groupements d'entreprises un mois de délai de réponse et nous passerons les contrats en début juin.
Des entreprises ou des particuliers ou des groupements d'entreprises se sont manifestés en nombre et nous avons déjà reçu une centaine des propositions. Elles ont fait l'objet d'une préqualification que nous sommes en train de finaliser avant l'envoi des appels d'offres.
Bien sûr, la mission de ces entreprises sera d'éliminer totalement les déchets, de les recycler. Il ne s'agit pas de faire des tas dans un coin ; il ne s'agit pas non plus de passer un contrat et de ne pas vérifier les réalisations des entreprises ; nous contrôlerons l'élimination complète et saine des déchets, à la satisfaction des autorités de l'Etat qui nous superviseront : DIREN et DRIRE (directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement). La durée du traitement des 160 000 tonnes est prévue jusqu'à la fin 2001, donc 18 mois. Nous nous donnerons encore six mois, jusqu'à mi-2002, pour remettre en état tous les sites utilisés pour stocker les déchets lourds.
Concernant les types de traitements, nous essayons autant que possible de recycler les coproduits, en particulier nous essayerons de récupérer tous les fiouls plutôt que de les brûler. Nous pensons que nous sommes dans la bonne voie en prenant cette option de traitement écologique raisonnable.
A titre d'exemple, le fioul récupéré en mer au moment du naufrage a été envoyé à la raffinerie de Donges, stocké dans des réservoirs à fioul, réchauffé et traité ; il est recyclé et servira à produire de l'électricité et du chauffage pour la raffinerie. Nous tenterons d'agir de la même façon avec tous nos déchets, à l'exception de tout ce qui est domestique - bottes, casques, gants - qu'il faudra absolument incinérer.
Voilà pour la partie du traitement des déchets.
Pour le traitement de la cargaison, le planning qui vous est présenté (cf. annexe n°5) montre que les opérations devraient se dérouler de mi-avril à fin septembre. Ce fut la base de toute l'activité et de la préparation que nous avons eues. Nous voulions que la totalité de la belle saison soit consacrée aux opérations en mer. En décembre, lorsque nous avons travaillé dans cette partie de l'Atlantique, nous nous sommes aperçus qu'il était excessivement difficile de travailler en hiver, que les moyens mis en _uvre étaient inopérants ou souffraient énormément de la mer, voire ne pouvaient pas rester en mer. Nous nous sommes alors attachés à ce que toute la préparation du projet - qui n'est pas classique - s'effectue durant l'hiver de sorte que tout soit prêt pour la belle saison.
Le protocole a été signé le 26 janvier. Il a été largement diffusé. Nous avions déjà commencé les reconnaissances de l'épave et, en même temps, le colmatage des fuites. En parallèle de ces activités, d'autres équipes ont travaillé en bureau d'études pour étudier les cas de base, le pompage, préparer l'appel d'offres, tout cela en accord avec le secrétaire général de la mer qui, sous l'autorité du ministre chargé des Transports, a constitué un comité de pilotage interministériel d'une douzaine de membres, soutenu par un collège d'experts de 9 membres. Tout ce que nous faisons leur est soumis au fur et à mesure pour accord.
Nous avions lancé des appels d'offres à quatre entrepreneurs ; à ce jour, nous avons reçu des offres de deux groupements ; nous sommes en train de les examiner. La semaine prochaine, nous aurons une série de réunions avec le comité de pilotage et le collège d'experts pour leur présenter nos recommandations quant au choix de l'entrepreneur. Nous devrions suivre exactement ce programme des opérations.
Voici (cf. annexe n° 6), à titre d'exemple, un plan de l'épave avant ; elle est retournée au fond de la mer par 120 mètres de fond, à l'envers ; la partie hachurée correspond à l'endroit de la rupture. Un certain nombre de fuites ont été colmatées. Parfois, ce sont des endroits très difficiles, car la tôle avait été soit pliée soit arrachée. Il a fallu s'y prendre à plusieurs reprises. La Marine nationale est toujours sur le site et veille à ce qu'il n'y ait pas de déclaration de fuite qui ne soit pas immédiatement notée pour pouvoir être immédiatement colmatée.
Voici (cf. annexes n° 7 et 8) le schéma de pompage et ce à quoi pourrait ressembler l'opération de pompage elle-même. Avec des moyens en surface très certainement à positionnement dynamique pour avoir une plus grande facilité : nous sommes dans l'Atlantique et ce n'est pas parce que nous travaillerons en été que ce sera la Côte d'Azur ou les côtes africaines ! Nous risquons des coups de tabac et nous devons prévoir des moyens qui, d'une part, résistent bien et, d'autre part, puissent être démobilisés et remobilisés très rapidement. Avec des systèmes avec ancrage, nous compromettrions gravement nos chances de réussite. Nous utiliserons plutôt des moyens à positionnement dynamique, au moins pour les bateaux de travail. Nous utiliserons plusieurs de ces bateaux : au moins deux engins, l'un nous permettant de préparer l'épave, de percer les trous dans les coques, d'installer les flexibles et l'autre bateau sera dédié au pompage lui-même.
Nous sommes en train de réaliser un pilote à la raffinerie de Normandie, au CERT, qui sera visitable dès la fin de la semaine prochaine. Vous serez les bienvenus pour le visiter.
S'agissant du coût, le graphique (cf. annexe n° 1) donne une estimation de 400 millions de francs ; en fait, nous ne sommes pas encore certains que cela ne coûtera que 400 millions de francs. Nous attendons les résultats des offres. En outre, nous savons que travailler en mer peut engendrer des périodes de stand-by impossibles à mesurer ; pour la dernière opération qui concernait le Marianos, sur lequel nous avions effectué des colmatages et des surveys sous-marins, nous avons subi 140 % de stand-by. C'est plus que ce à quoi on s'attendait. Mais ce bateau était suffisamment solide dans la mer et bien équipé pour obtenir de bons résultats techniques ; seul le portefeuille a souffert.
Je suis prêt à répondre à vos questions.
M. le Rapporteur : Cette journée d'auditions est centrée sur les problèmes d'indemnisation. Mes questions porteront donc surtout sur ce point et nous aborderons les autres sujets lorsque nous entendrons le président de votre groupe. Ainsi, si nous avons bien compris, vous n'émargerez pas au FIPOL ?
M. Jacques de NAUROIS : Vous avez bien compris.
M. le Rapporteur : En aucun cas de figure, TotalFinaElf ne déposera de dossier au FIPOL ?
M. Jacques de NAUROIS : Le seul cas de figure dans lequel nous pourrions envisager de remettre un dossier au FIPOL serait celui dans lequel l'ensemble des indemnisations de la société civile, plus l'indemnisation de l'Etat serait inférieur à 1,2 milliard de francs. S'il restait encore de l'argent au pot, une fois toutes les indemnisations attribuées, nous serions tentés et nous déposerions des dossiers pour le solde. Mais nous sommes dans un cas de figure tout à fait théorique.
M. le Rapporteur : Merci. Il valait mieux que cela soit dit deux fois plutôt qu'une.
Sur le reste, concernant vos interventions ponctuelles sur le nettoyage des côtes, pour lever toute ambiguïté, les chantiers que vous avez engagés, vous les avez décidés en fonction de discussions avec les autorités préfectorales ou avec les maires ?
Vous est-il arrivé de refuser un chantier chez un maire parce qu'il menaçait de vous faire un procès ? Pour être encore plus clair, avez-vous dit à des maires : « N'allez pas chez l'avocat et je vous mets des moyens. Si vous allez chez l'avocat, je n'en mets pas » ? Est-ce arrivé, à votre connaissance ? Ou bien votre logique est-elle différente ?
M. Pierre GUYONNET : Avant de parler de l'intervention des avocats, toute récente, nous avons travaillé plusieurs mois dans le cadre du plan POLMAR. Nous ne travaillons sur un chantier que si le PC POLMAR, nous dit : « C'est une priorité ; pourriez-vous le prendre ? » C'est avec le PC POLMAR que nous établissons les priorités.
Ensuite, nous discutons avec les scientifiques, puis avec les maires. De temps en temps, les maires font pression sur nous pour tel ou tel chantier. Mais nous ne pouvons pas le faire en dehors du plan POLMAR. Comme nous avons des représentants à Rennes, il nous est arrivé de demander au PC POLMAR s'il voulait bien regarder tel endroit où l'on semblait angoissé de ne pas voir démarrer de chantier. Mais nous ne le démarrons que si nous réussissons à influencer le PC POLMAR. Ce n'est pas la voie normale, mais cela arrive.
Pour les communes dans lesquelles il y a un différend juridique, plusieurs cas peuvent se présenter. Lorsque nous avons déjà un chantier ouvert sur une commune et que la commune prend un arrêté municipal nous enjoignant d'enlever les déchets, au titre de la loi sur les déchets, dans ce cas, si les choses ne vont pas plus loin, nous n'entreprenons pas d'action juridique et nous ne contre-attaquons pas immédiatement. Nous travaillons dans le cadre du plan POLMAR et nous continuons dans ce cadre. Quelqu'un disait : « Les juristes aboient, la caravane passe » !...
En revanche, si nous n'avons pas engagé de chantier sur une commune et qu'un arrêté municipal est pris, nous ne démarrerons pas le chantier. S'il était démarré, nous continuerions puisque nous serions sous POLMAR ; sinon, nous ne le démarrerions pas.
M. le Rapporteur : Cela vous est-il arrivé souvent ?
M. Pierre GUYONNET : Très peu souvent, un cas ou deux. Par contre, ce qui est souvent arrivé, c'est que des chantiers soient déjà démarrés, qu'un arrêté municipal soit pris et que nous continuions à travailler. Nous avons connu entre cinq et dix cas de ce type.
Mais nous avons aussi reçu maintenant un certain nombre de référés. Autant nous n'entamions pas d'action en justice quand il y avait seulement un arrêté municipal, autant nous sommes obligés de répondre à un référé. En y répondant, malheureusement, nous sommes dans l'obligation de faire aussi appel de l'arrêté pour le contrer.
M. le Rapporteur : Quand il y a concomitance des deux ?
M. Pierre GUYONNET : Oui, oui. Ce fut toujours un référé pour nous enjoindre d'appliquer l'arrêté. Dans ce cas, sur le plan juridique, nous sommes obligés de contre-attaquer, de faire valoir notre position. Quand des chantiers ont démarré sous POLMAR, nous poursuivons sous POLMAR même si nous avons un arrêté doublé d'un référé : les maires doivent apprécier que leurs plages soient propres le plus rapidement possible et nous essayons de les aider.
M. François GOULARD : Je veux revenir sur cette loi de 1975 et ces fameux arrêtés. N'y a-t-il pas une certaine contradiction ? Vous dites que si un maire prend un arrêté de mise en demeure de retirer les déchets, vous n'ouvrirez pas de chantier. Donc, c'est précisément ce que l'arrêté municipal vous demande : nettoyer. Au cas où le chantier est déjà ouvert, on peut penser que vous avez satisfait à la demande du maire puisque vous êtes en train de nettoyer les déchets sur la côte.
Par ailleurs, si vous êtes en mesure de le faire - car je suppose que vos services juridiques se sont penchés sur ce problème - quelle est votre analyse de l'application de la loi de 1975 ? Contestez-vous fondamentalement l'application de cette loi au cas présent ? Dans l'affirmative, pouvez-vous nous dire sur quels arguments ?
Sur la question du FIPOL, je ne mets pas en doute votre déclaration, d'ailleurs déjà faite par le président de votre société ; néanmoins le FIPOL a un principe d'égalité de traitement de ceux qui présentent des demandes de remboursement. Or, le délai qui s'ouvre est long puisqu'il couvre trois ans. A priori, on ne sait pas ce que feront les divers acteurs concernés.
Ma question sera précise : au-delà des déclarations faites aujourd'hui et auparavant, avez-vous notifié au FIPOL cette position de votre société ? Ce n'est pas sans intérêt en fonction de ce que je viens de rappeler.
M. le Rapporteur : Pour compléter, par rapport à la loi de 1975 et aux problèmes juridiques, me trompé-je en analysant votre position de la manière suivante : vous êtes prêts à toute solution à l'amiable avec quiconque en engageant des moyens financiers non négligeables que vous n'imputerez pas au FIPOL ; mais, si l'on vous cherche sur le terrain juridique, ce sera à la justice de trancher ?
M. Jean-Michel MARCHAND : N'auriez-vous pas la tentation de revenir à vos premières déclarations et de dire que ces déchets ne sont pas les vôtres, dès qu'un arrêté est pris ?
Deuxième question, complètement à l'opposé, car nous parlons du traitement des déchets et des souillures. Vous annoncez 50 millions de francs pour réparer les dégâts causés à l'environnement : ces 50 millions de francs resteront-ils sous votre autorité ou seront-ils confiés à un organisme indépendant ? Je vais vous dire pourquoi : manifestement, il y aura des recours ; or, à en croire la jurisprudence de l'Amoco-Cadiz, les demandes en ce domaine ont été balayées par la justice américaine.
M. Pierre GUYONNET : Comme vous l'avez noté, nous ne sommes pas des juristes mais nous ferons une réponse préliminaire et approximative. Vous me disiez que nous avions une attitude quelque peu bizarre...
M. François GOULARD : C'était une question !...
M. Pierre GUYONNET : Il faut voir le libellé de ces arrêtés : ils nous demandent de venir chercher les déchets qui nous appartiennent ; mais ces déchets ne nous appartiennent pas. Nous ne sommes pas tentés de revenir à notre position ancienne ; notre position est claire et les juristes pourront l'expliquer mieux que moi : nous avons expédié un produit, transporté dans un bateau qui a été confié à un armateur et il y a eu un accident en mer. Nous sommes producteurs de produits et pas de déchets.
M. le Rapporteur : Nous reviendrons sûrement sur ce point.
M. Pierre GUYONNET : Certainement, parce que c'est le c_ur du débat.
M. le Rapporteur : Nous ne pouvons pas l'aborder aujourd'hui.
M. François GOULARD : Dommage, d'autant que les maires nous en en ont parlé ce matin. C'est au c_ur des préoccupations locales.
M. Pierre GUYONNET : Nous sommes clairement en opposition juridique avec certains maires. Pas avec tous.
Cela dit, les 50 millions de francs ne sont pas loin d'être dépensés ; en fait, nous avons déjà engagé plus de 50 millions de francs.
M. Jacques de NAUROIS : M. le député parlait de la fondation pour la mer. Dans tout le processus FIPOL, tout est fait pour la compensation du préjudice économique ; rien pour ce qui concerne les préjudices écologiques. Nous nous sommes donc dit qu'il serait intelligent de faire quelque chose, même si ce n'est pas complet, dans le domaine des préjudices écologiques.
Nous avons annoncé la création d'une fondation dans laquelle nous injecterons 10 millions de francs par an, sur cinq ans, pour travailler sur ce genre de sujet. L'intention est de le faire avec des acteurs scientifiques, politiques, des milieux locaux et de ne pas le faire tout seul. Mais, sans pour autant agir dans notre coin, stricto sensu, nous conserverons le contrôle des opérations,. Nous travaillerons avec une fondation dotée de ces fonds pour financer des programmes de recherche, des programmes d'action, etc. Nous sommes en phase de constitution du bureau qui pilotera cette fondation.
Dans ce domaine, nous avons déjà la fondation Total qui travaille sur des problèmes d'équilibre marin et qui a une certaine expérience. C'est donc une extension de cette fondation qui sera appliquée au problème du littoral.
Quant au FIPOL, nous lui avons notifié officiellement notre position : elle est actée dans des rapports de réunions du FIPOL, datant de février.
Annexe 1
Annexe 2
Annexe 3
Annexe 4
Annexe 5
Annexe 6
Annexe 7
Annexe 8
Audition de M. Pierre KARSENTI,
président du Conseil des chargeurs maritimes français (CCMF)
de l'Association des utilisateurs de transport de fret (AUTF),
M. Jacques BLANCHARD,
chargé de mission, responsable du transport maritime,
à la délégation aux approvisionnements de Gaz de France,
et de M. Bertrand MANGIN,
responsable qualité-sécurité chez Gazocéan Armement
(extrait du procès-verbal de la séance du 19 avril 2000)
Présidence de M. Daniel PAUL, Président
MM. Pierre Karsenti, Jacques Blanchard et Bertrand Mangin sont introduits.
M. le Président leur rappelle que les dispositions législatives relatives aux commissions d'enquête leur ont été communiquées. A l'invitation du Président MM. Pierre Karsenti, Jacques Blanchard et Bertrand Mangin prêtent serment.
M. Pierre KARSENTI : M. le président, madame et messieurs les députés, en tant que président du conseil des chargeurs maritimes français, je tiens à vous préciser que la fonction de chargeur a pour caractéristique de ne pas être un métier. Par ailleurs, je suis directeur adjoint du transport maritime du groupe Elf.
La situation née du naufrage de l'Erika est, pour les chargeurs, singulière et extrêmement inconfortable.
Elle est singulière, car dans l'organisation des contrôles exercés dans le transport maritime, les chargeurs sont exclus : un navire est contrôlé d'abord par son amateur, puis par l'Etat du pavillon, ensuite, par une société de classification, et enfin par les autorités du port.
Cela étant dit, les chargeurs sont financièrement responsables. Dans le cas précis du naufrage de l'Erika, dossier qui est loin d'être clos, il semble que l'armateur, qui est le premier concerné par l'accident de son navire, ne devra rien payer, que la mutuelle des armateurs devra payer 80 millions de francs, que le FIPOL indemnisera à hauteur de 1,2 milliard de francs et que le chargeur en cause s'engagera à verser, sur une base volontaire, 600 ou 700 millions de francs. En d'autres termes, les chargeurs, dont on dénonce l'irresponsabilité, supportent 95 % de la facture - hors dépenses de l'Etat -, alors que l'armateur, premier responsable, ne paie pratiquement rien. Et pourtant, aujourd'hui, le nom le plus cité - et pas en bien -, c'est celui du chargeur de l'Erika.
Cette situation est donc très inconfortable - il existe une dichotomie entre ce que font les chargeurs et la perception qu'en ont la société et les pouvoirs publics -, ennuyeuse - car ce n'est pas sain - et dangereuse - car les chargeurs pétroliers sont des deep pocket. Et pour d'autres trafics de marchandises polluantes - je rappelle à cet égard que la convention HNS n'est toujours pas ratifiée -, il sera difficile de demander aux chargeurs de contribuer à d'éventuelles réparations. Le sujet n'est donc pas simple et mériterait d'être revu.
Le conseil des chargeurs maritimes préconise la transparence et le contrôle technique des navires. Nous ne pensons pas qu'il s'agit d'une voie sans issue, au contraire. J'ai relevé, dans le Mémorandum qui a été transmis par le gouvernement français à l'Union européenne, une idée qui m'a semblé intéressante et qui consiste à avoir accès aux dossiers techniques des navires transportant des marchandises polluantes et/ou dangereuses. Il me semble, en effet, qu'il serait efficace d'instituer l'obligation, par l'intermédiaire de l'OMI ou de l'Union européenne, pour les navires qui doivent accoster dans un port européen, de tenir à la disposition des autorités de l'Etat du port les dossiers des sociétés de classification les concernant, de manière à éviter une duplication des dossiers techniques des bateaux qui n'apporte pas toujours une véritable valeur ajoutée par rapport aux dossiers des sociétés de classification. Cela me paraît tout à fait faisable à l'heure actuelle.
Nous avons bien vu, avec le naufrage de l'Erika, que c'est grâce à la pression de l'opinion publique française que les autorités maltaises ont accepté de demander au Bureau Véritas de communiquer le dossier du bateau. Légalement, les autorités françaises n'avaient pas la possibilité de réclamer ce dossier. Cela n'est pas normal, comme il n'est pas normal que le RINA n'ait rendu publique son enquête que récemment et n'ait pas communiqué le dossier de l'Erika aux autorités françaises.
Il est indispensable que l'Europe s'organise pour pouvoir traiter ce type de problèmes, car il ne faut pas attendre du système EQUASIS plus qu'il ne peut donner. Il faut éviter de crouler sous les papiers et disposer des informations utiles. J'irai même plus loin en disant que les affréteurs devraient, eux aussi, avoir accès à ces dossiers. En effet, ces derniers ont un certain nombre de capacités techniques - des systèmes dits de vetting - , et les dossiers des sociétés de classification seraient susceptibles de les intéresser.
Une partie de la discussion porte, aujourd'hui, sur la manière de contrôler les sociétés de classification : plutôt que de faire des cahiers des charges, il serait peut-être plus intelligent de donner la possibilité aux Etats d'aller inspecter les navires. L'inspection des navires donne bien souvent une idée assez juste du travail des sociétés de classification. La France dispose d'une opportunité pour faire avancer ce dossier à l'occasion de sa présidence de l'Union européenne.
En ce qui concerne le volet financier, je l'ai dit tout à l'heure, il y a tout de même quelque chose de malsain dans l'organisation actuelle de la convention CLC et du FIPOL, puisque les armateurs n'ont aucune responsabilité financière - ils ne paient environ que 5 % des frais occasionnés par un accident. Par ailleurs, il n'y a aucun rapport entre le volume de la cargaison du navire et la taille de la pollution. Il me semble donc qu'il n'est plus logique de lier la responsabilité de l'armateur à la taille du navire comme le fait la convention CLC.
Il serait nécessaire de rétablir une certaine parité, dans les conséquences financières, entre les chargeurs et les armateurs. L'armateur en cause devrait pouvoir, comme cela se fait aux Etats-Unis, posséder un COFR, un certificat de responsabilité financière précisant que l'assurance pourra jouer jusqu'au montant qui correspond à la taille du navire. Ce système est d'autant plus envisageable que les Clubs P&I proposent aux armateurs des couvertures pouvant aller jusqu'à un milliard de dollars pour les problèmes de responsabilité civile. Ainsi la couverture exigée pour les armateurs dont les navires accostent aux Etats-Unis est de 1 milliard de dollars, alors que la couverture obligatoire pour les bateaux venant en Europe est de seulement 80 millions de francs : c'est tout de même inéquitable !
En ce qui concerne la double coque et la disparition des navires à simple coque, je dirai que tout cela est possible et qu'il me semble nécessaire de faire l'économie d'une guerre des normes. Il serait en effet plus simple de reprendre les critères imposés par les Américains et de les appliquer. La disparition des bateaux à simple coque pour 2010 - qu'ils prévoient pour 2000 - et la généralisation des navires à double coque avec des protective location d'ici 2015 ne me paraissent pas être une mauvaise mesure. En outre, le transport maritime est organisé de telle manière que les Etats-Unis et l'Europe sont très liés. Lorsqu'un navire part du Golfe Persique chargé de pétrole brut, il a deux destinations possibles : les Etats-Unis ou l'Europe. Par conséquent, l'application des mêmes normes pour les navires à destination des Etats-Unis et de l'Europe me paraît répondre à un souci de simplicité.
En conclusion, je dirai qu'une catastrophe telle que le naufrage de l'Erika ne doit pas se reproduire. Votre commission a la possibilité de faire avancer les choses, car elle aura un réel impact. Aujourd'hui, le système qui prévaut est un système dans lequel l'inefficacité est presque organisée, ce qui n'est pas sain. Nous le voyons avec l'affaire de l'Erika, tous les acteurs du transport maritime sont mis en cause. Le secteur du transport maritime a des progrès à faire et il ne doit pas rater l'occasion qui lui est donnée de les faire.
M. Jacques BLANCHARD : M. le président, madame et messieurs les députés, en tant que responsable du transport maritime de Gaz de France, je souhaite vous éclairer sur la spécificité du transport maritime du gaz naturel liquéfié, la commission ayant décidé d'enquêter sur tous les produits dangereux ou polluants.
Le méthane est transporté par navire sous forme liquéfiée à moins 160 degrés sous pression atmosphérique ; on utilise donc des navires très spécialisés. La flotte mondiale des méthaniers ne représente à fin 1999 que 113 navires. Le trafic commercial a commencé pour la France en 1964 avec le Jules Verne - ce bateau prototype construit pour Gaz de France est toujours en exploitation. Il s'agit de navires très spécialisés, connus de tous ; aussi la profession n'est pas confrontée au problème des affrètements SPOT que l'on rencontre pour les pétroliers. Très peu de méthaniers sont disponibles sur le marché puisqu'ils sont presque tous attachés à des contrats d'affrètement de long terme. Par ailleurs, la plupart des méthaniers sont dédiés à des lignes bien définies : on n'a donc pas une totale fluidité du marché du transport GNL.
Les méthaniers sont de gros navires - pour 80 % d'entre eux -, les plus petits ayant une capacité de 19 000 mètres cubes alors que celle des plus gros est de 138 000 mètres cubes, soit environ 69 000 t de port en lourd. En outre, 40 % de la flotte mondiale a plus de 20 ans.
Des études de longévité ont été réalisées par plusieurs sociétés, notamment Shell et le Lloyd's Register of Shipping qui ont démontré la viabilité de ces bateaux jusqu'à 40 ans. Gaz de France exploite un navire récent de 2 ans et cinq navires dans la tranche d'âge de 20 à 30 ans, et ce sans aucune inquiétude.
Le trafic mondial est le suivant : on dénombre, pour 1999, 2 127 voyages de méthaniers et 10,4 millions de milles nautiques parcourus. Gaz de France importe principalement du gaz sous une forme FOB, c'est-à-dire que l'établissement est responsable du transport maritime : plus de 8 millions de tonnes proviennent de l'Algérie ; le terminal de Montoir-de-Bretagne reçoit également 0,4 million de tonnes en provenance du Nigeria - mais achetées sur la base de contrat CIF et transportées par d'autres navires - et 2,8 millions de tonnes de gaz en provenance de Nigéria - en vertu d'un contrat d'échange passé avec la société italienne ENEL.
Les navires de taille moyenne de la flotte contrôlée par Gaz de France font environ 200 escales par an dans le sud de la France, à Fos-sur-mer, près de Marseille. Les grands méthaniers venant d'Algérie font 60 escales par an à Montoir-de-Bretagne, près de Saint-Nazaire, et ceux qui viennent du Nigéria en font une cinquantaine. En outre, deux bateaux tournent sur la ligne Algérie Belgique et passent donc à proximité des côtes françaises.
Quelles sont les particularités des méthaniers ? Le fait de transporter une cargaison à moins 160 degrés oblige à l'isoler complètement du reste de la structure du navire, sinon l'acier ne tiendrait pas. Les méthaniers ont tous une double coque, que ce soit les techniques « à sphères » développées par les Norvégiens (Moss Rosenberg), et aujourd'hui par les Japonais, ou les techniques « membranes » développées par les Français (Gaztransport & Technigaz filiale à 40 % de Gaz de France). Les ballasts sont très importants et contribuent à protéger le bateau en cas d'abordage, ce que l'expérience a confirmé. Le méthane est un produit non agressif pour les structures, la cuve est en aluminium pour la technique Moss Rosenberg et les membranes sont en inox ou en invar pour les techniques Gaztransport & Techniquigaz. La faible masse volumique du produit conduit à un niveau de contrainte sur le bateau très faible - et les cargaisons sont extrêmement bien réparties.
S'agissant de l'exploitation des bateaux, le fait qu'il s'agisse de lignes régulières facilite leur inspection par l'armateur ou l'affréteur. Gaz de France affrète 6 méthaniers et est armateur ou co-armateur de trois d'entre eux. Gaz de Francce utilise des navires qui ont encore la chance de posséder un pavillon national et un équipage national : 3 bateaux sous pavillon français, 2 sous pavillon italien et un sous pavillon algérien. L'homogénéité des équipages facilite la qualité de la prestation.
Les statistiques d'accidents dans la profession répertoriées par le SIGTTO (Society of International Gas Tanker & Terminal Operators Ltd) sont excellentes : sur les 14 dernières années, on ne compte que 27 accidents ou incidents enregistrés et aucun navire n'a été perdu. Le plus grave des accidents a été celui d'un méthanier qui s'est échoué devant Gibraltar, mais sans conséquences autres que les dommages matériels, la cargaison ayant été protégée grâce à la double coque et à son isolation. Enfin, il y a eu très peu de collisions.
En ce qui concerne le produit lui-même, le gaz naturel liquéfié (GNL) est essentiellement constitué de méthane. S'il arrive un jour en contact avec l'eau, nous aurons affaire à un choc que l'on appelle une « transition rapide de phase », c'est-à-dire une vaporisation très rapide du GNL qui provoque elle-même une onde de surpression. Cependant, il s'agit d'un gaz non polluant et il n'y aurait aucun dommage pour les eaux autre que le choc thermique et l'onde de surpression associée. Le gaz resterait au niveau de l'eau pendant très peu de temps, puis s'élèverait dans l'atmosphère dès qu'il aurait atteint une température de - 120 degrés, température à laquelle il est plus léger que l'air.
La seule pollution possible et limitée est celle contribuant à la destruction de la couche d'ozone du fait de l'évacuation du méthane à l'atmosphère. Mais si l'on considère la pollution globale mondiale due aux émanations de méthane, un gros méthanier qui lâcherait l'ensemble de sa cargaison dans l'atmosphère correspondrait à 1/10 millième de la pollution mondiale de méthane, ou 2 % des émanations françaises. Les effets sont donc limités. Enfin, si le gaz s'enflammait, l'impact sur la couche d'ozone serait divisé par dix.
M. Bertrand MANGIN : M. le président, madame et messieurs les députés, avant de devenir responsable qualité-sécurité chez GAZOCEAN, j'ai suivi une carrière d'officier de la marine marchande française qui m'a amenée aux fonctions de commandant ; à ce titre j'ai commandé tous les types de GPLiers dans le monde. Je vais donc compléter les propos de M. Blanchard en vous présentant les caractéristiques du transport maritime de GPL.
Pour l'essentiel, le GPL se présente sous la forme d'un mélange de butane et de propane, mais il est essentiellement transporté sous forme, soit de butane, soit de propane. Il existe une autre catégorie de gaz, que l'on peut difficilement associer au terme GPL : les gaz chimiques, tels que le propylène ou le chlorure de vinyle, qui sont utilisés dans l'industrie chimique pour la fabrication des plastiques ou des engrais, comme l'ammoniac. Par rapport au trafic général du GPL, le trafic de ces gaz est marginal.
Le GPL est un produit qui est transporté dans un état liquide, de la même façon que le méthane, mais à une température nettement plus élevée. La température la plus basse est de - 42 degrés pour le propane, à l'exception de l'éthylène, gaz chimique, qui est transporté à - 104 degrés. Le butane, quant à lui, se transporte, soit à la température ambiante, soit aux alentours de - 5 degrés.
Les problèmes de fractures dues à la différence importante de température entre la structure du navire et le produit qui serait amené à s'écouler ne sont pas comparables aux problèmes que peut poser le gaz naturel : on ne constate pas, à - 42 degrés, des fractures importantes de la structure du navire.
Au même titre que le gaz naturel, il s'agit pour l'essentiel de gaz non toxiques. La pollution ne concerne pas directement la couche d'ozone, sachant que la plupart de ces gaz sont, à l'état gazeux, plus lourds que l'air - le butane est deux fois plus lourd que l'air ; le propane une fois et demie ; seul l'éthylène est très légèrement plus léger que l'air. Ces gaz vont donc peu s'élever dans l'atmosphère, mais ils vont se diluer rapidement et donc participer à l'effet de serre au même titre que d'autres gaz ; cependant, leur impact sur l'environnement reste limité.
Le problème majeur de ces produits, c'est leur inflammabilité. Le butane peut s'enflammer dans l'air s'il est dans une proportion comprise entre 1,5 et 9 %. Au-delà de ces limites, soit le gaz est trop riche - ce qui est le cas lorsqu'il est transporté dans les cuves du navire, puisqu'il n'y a pas d'air -, soit il est libéré dans l'atmosphère et lorsqu'il tombe en dessous du 1,5 % fatidique le risque d'inflammation n'existe plus. Les nuages de gaz répandus dans l'atmosphère ont donc une conséquence limitée du fait de cette dilution rapide du gaz. Les incendies qui peuvent se déclencher sur des gaziers finissent par s'apparenter à des feux d'hydrocarbures classiques.
En ce qui concerne les navires transportant ce type de produits, à la différence du gaz naturel, le marché s'apparente plus au marché pétrolier. Il y a très peu de navires dédiés pour travailler entre deux terminaux. La règle générale, c'est soit le contrat SPOT, soit le contrat d'approvisionnement.
Il existe environ 1 000 GPliers dans le monde, contre 7 000 pétroliers. Ces navires sont beaucoup plus petits ; les plus gros - environ 80 - ont une capacité de transport de 45 000 tonnes, 80 000 mètres cubes pour 230 mètres de long, et représentent plus de la moitié, en volume, de la capacité de transport de la flotte. L'essentiel des navires sont petits, puisque 50 % des GPliers ont une contenance de moins de 5 000 mètres cubes - donc moins de 1 500 tonnes.
Au niveau de la conception technique de ces navires et du mode de transport des cargaisons, la double coque, notamment latérale, s'avère utile même si elle n'est pas systématique. Ce sont pour la plupart des navires à double fond - ce qui les protège des risques d'échouage -, la cargaison est transportée dans des cuves séparées de la structure ; pour le transport des cargaisons à haute pression, allant parfois jusqu'à 18 bars, les cuves sont très épaisses - jusqu'à 20 millimètres d'épaisseur. Le problème de corrosion des cuves est très limité, et le fait qu'elles soient posées dans les cales des navires facilite leur inspection. L'atmosphère de ces cales est tenue à un point de rosée très bas de manière à limiter toute corrosion.
S'agissant des flux de marchandise dans le monde, 45 millions de tonnes de GPL sont échangés chaque année, à comparer avec les 1,8 milliard de tonnes du pétrole. Les flux à destination de l'Europe représentent 10 millions de tonnes de GPL, contre 500 millions de tonnes de pétrole, et ceux qui concernent la France s'élèvent à 2,6 millions de tonnes de GPL, contre 100 millions de tonnes.
En France, plus de la moitié de ces mouvements affectent le complexe de Fos, pour 1,5 million de tonnes. C'est là que se trouve le plus gros stockage : 300 000 mètres cubes. A Rouen, ce sont 1 million de tonnes, et au Havre 0,5 million de tonnes de pétrole.
En ce qui concerne la sécurité de ce mode de transport, la réglementation applicable au niveau international - c'est-à-dire les textes de l'OMI - est la même que celle qui est applicable pour l'ensemble des navires : SOLAS, MARPOL, Lignes de charge, STCW 95, règlements des sociétés de classification. Il convient toutefois d'y ajouter des règlements particuliers, notamment l'IGC, code international reconnu par l'OMI, concernant la conception des navires gaziers très spécialisés. On peut également ajouter certains aspects de la convention SOLAS, traitant du transport de marchandises dangereuses, du code IMDG concernant les matières dangereuses et de la convention STCW 95 concernant les standards de formation et de qualification des équipages.
Au niveau national, il existe des règlements locaux comme ceux des US Coast Guards, ou, en France, l'obligation de compte rendu SURNAV, et le rail de séparation du trafic d'Ouessant, les navires dangereux devant passer plus loin que les autres. Il existe également des réglementations au niveau des ports qui vont jouer sur la sécurité des mouvements du navire à l'intérieur des ports, en privilégiant les mouvements du gazier par rapport aux autres navires, en y affectant un nombre plus important de remorqueurs et en limitant ses mouvements en fonction de la météo. Enfin, il y aussi des règlements au niveau des terminaux de réception eux-mêmes.
Comme vous pouvez le constater, les navires gaziers sont très réglementés. Il convient d'ajouter, à tous ces règlements, les normes ou les standards de l'industrie, les guides de bonnes pratiques qui sont des références importantes pour l'industrie du transport du GPL. Ces guides de bonnes pratiques sont notamment édictées par un organisme international, le SIGTTO, dont l'objectif est la sécurité et la fiabilité du transport du gaz naturel. Ma société fait partie de cet organisme depuis sa création et a toujours contribué activement à ses travaux. Le Chemical Distribution Institute traite quant à lui un peu plus précisément des navires transporteurs de gaz chimiques : le CDI qui est une émanation du BSI - British Standard Institute. Les chargeurs ont également des exigences particulières.
Je terminerai mon propos en vous exposant notre point de vue sur l'armement maritime de ces navires et la sécurité.
S'agissant de l'entretien des GPLiers, la corrosion y est beaucoup plus facile à contrôler, car on accède aisément à toutes les parties de la structure et des cuves du bateau, l'intérieur des cuves n'étant toutefois pas exposé au risque de corrosion. Cette industrie se donne les moyens d'entretenir ses navires, mais la concurrence est peut-être moins forte que sur d'autres segments du transport maritime. Ces navires coûtent relativement cher. Les taux de fret sont plus élevés. L'industrie est plus récente et a toujours cherché à se garantir une fiabilité qui va de pair avec la sécurité.
Au même titre que pour la conception des navires, nous avons affaire à une exploitation spécialisée qui nous a amenés à développer des procédures particulières, à employer du personnel qualifié, à avoir une approche tournée vers la responsabilité des opérateurs - depuis le terrain jusque dans les armements - et un mode de fonctionnement spécialisé. Les marins qui naviguent sur des gaziers sont plus spécialisés que ceux qui naviguent sur des porte-conteneurs.
La gestion des risques a été prise en compte, au niveau international, avec le code ISM, mais elle existait auparavant au niveau des armements de gaziers. Le code ISM a permis de formaliser certaines procédures, mais cette politique de recherche de la qualité de la sécurité a toujours été un objectif important.
Les statistiques des accidents sont bonnes : il y a 3 ou 4 accidents ou incidents par centaine de bateaux et par an. Les pertes totales représentent moins de 0,7 pour mille bateaux par an et concernent pour l'essentiel de très petits navires.
La gestion des situations de crise est un aspect que l'on traite avec un maximum de soin, dans le cadre du code ISM. Nous possédons une organisation qui nous permet d'être rapidement en contact avec les intervenants nécessaires dans ce genre de situation et d'être à l'écoute en temps réel si un problème survient à bord du navire.
Nous disposons, avec l'aide des sociétés de classification, de systèmes qui nous permettent d'obtenir une expertise en temps réel de la résistance de la structure et de la stabilité du navire, suite à une avarie. Il y a quelques mois, nous avons réalisé une simulation d'abordage sur l'un de nos navires avec le système SERS - Ship Emergency Response Service - du Lloyd's Register of Shipping ; ce service a très bien fonctionné. Cela nous a permis de tester les capacités du Lloyd's Register of Shipping à répondre en situation de crise.
Si j'avais une suggestion à vous faire, ce serait de généraliser le recours à ce type de services, sachant que techniquement cela ne pose aucune difficulté particulière et que le coût n'est pas très élevé - 5 000 à 6 000 francs par an et par bateau, auxquels il convient de rajouter l'investissement initial pour que la société de classification puisse numériser l'ensemble des plans nécessaires pour pratiquer une expertise en situation de crise.
M. le Rapporteur : M. Mangin, pouvez-nous nous préciser la dimension de GAZOCEAN ARMEMENT en indiquant son nombre de bateaux et de marins ? Par ailleurs, les tests, dont vous venez de nous parler, me semblent intéressants. Pouvez-vous nous faire parvenir une notre précise à ce sujet ?
M. Bertrand MANGIN : GAZOCEAN ARMEMENT est l'une des plus anciennes sociétés du monde spécialisées dans le transport maritime du gaz. Nous gérons actuellement de 6 navires : 2 méthaniers et 4 GPliers - un cinquième GPLier va rentrer en flotte à la fin du mois de juin. Nous sommes, en France, le leader sur ce segment.
Trois de nos bateaux sont sous pavillon Kerguelen ; les 3 autres sont sous pavillon français métropolitain, libérien et panaméen. Nous employons des équipages français et étrangers, l'effectif moyen étant de 25 marins par bateau. Sous pavillon français, les marins sont des nationaux ; sous pavillon Kerguelen les marins sont français - pour 35 % d'entre eux - et roumains. Pour un autre bateau, nous avons quelques Philippins et nous employons, sous pavillon libérien, un équipage entièrement letton.
M. le Président : Les équipages des bateaux sous pavillon Kerguelen sont-ils homogènes ?
M. Bertrand MANGIN : Les officiers sont français et les équipages roumains ; l'homogénéité est donc de bonne qualité. Les Roumains ont une culture qui se rapproche de la nôtre. Par ailleurs, nous avons une politique de fidélisation du personnel : même si le personnel étranger ne travaille pas aux mêmes conditions que le personnel français, certains marins étrangers sont chez nous depuis le début. Nous tournons toujours avec les mêmes équipages.
M. le Rapporteur : Qui recrute les marins roumains et lettons?
M. Bertrand MANGIN : Nous avons une agence de recrutement en Roumanie - pour des raisons de politique de société - et une autre en Lettonie. Nous contrôlons l'équipage, le choix du personnel, les rotations, les rythmes d'embarquement et les affectations de fonction comme s'il s'agissait de personnels français.
En ce qui concerne le personnel letton, qui navigue sur un bateau entièrement letton, nous avons une stabilité remarquable des effectifs. Les marins travaillent sur un rythme de cinq mois de navigation cinq mois de repos ; deux équipages se remplacent tous les cinq mois, avec une excellente régularité depuis cinq ou six ans.
M. le Rapporteur : Estimez-vous que vos partenaires et concurrents portent une attention aussi prononcée que GAZOCEAN ARMEMENT sur la qualité des navires qu'ils utilisent ? Autrement dit, la flotte mondiale de GPLiers est-elle une flotte de qualité ?
M. Bertrand MANGIN : Pour l'essentiel, oui. Les acteurs principaux partagent notre approche de la gestion des bateaux. Les grands armements ont une politique comparable à ce que je viens de vous exposer. Les écarts que vous pourrez constater sont relativement marginaux.
M. le Rapporteur : Quel est l'âge des bateaux de votre société ?
M. Bertrand MANGIN : Nous avons un bateau qui a un an, deux qui ont une vingtaine d'années, un bateau de dix ans ; plus de la moitié de la flotte a moins de quinze ans, à l'image de la flotte mondiale de GPLiers. Au niveau de la longévité, nous avons la même approche que celle qu'a exprimée M. Blanchard. Ce sont des navires qui vieillissent bien au niveau de la cargaison et qui permettent un très bon suivi de la structure. Les structures sont beaucoup moins sollicitées que celles d'un certain nombre de navires ; les cargaisons sont plus légères ; les constructions plus solides et les bateaux plus petits. Ces bateaux peuvent vivre longtemps en très bon état.
M. le Rapporteur : Avez-vous déjà transporté des gaz polluants ?
M. Bertrand MANGIN : Oui, au cours de ma carrière j'ai transporté du chlorure de vinyle et de l'ammoniac sur des bateaux de GAZOCEAN. Mais depuis quelques années nous n'avons quasiment pas transporté ce type de produits.
M. le Président : Pour quelle raison avez-vous cessé d'en transporter ?
M. Bertrand MANGIN : Nous gérons des navires pour le compte d'armateurs ; nous ne sommes donc pas maîtres de l'aspect commercial de notre activité. Cet aspect commercial est géré par les armateurs et les affréteurs, qui, en l'occurrence, sont les mêmes.
M. le Rapporteur : Qui sont-ils ?
M. Bertrand MANGIN : Nous travaillons pour Gaz de France - qui est armateur et affréteur -, GEOGAS, société basée en Suisse et fondée par l'ancien président de GAZOCEAN - qui est aussi à la fois armateur et affréteur -, et pour un armateur allemand qui possède une filiale affrétant des navires. Ensuite, les affréteurs proposent les navires aux chargeurs.
S'agissant du test que l'on a effectué il y a quelques mois, le Lloyd's Register of Shipping, la société de classification anglaise, propose un service qui s'appelle Ship Emergency Response Service - SERS. Elle n'est pas la seule à proposer ce type de service, le Bureau Véritas le propose également, mais elle est leader sur ce segment du marché.
Ce service ne nécessite pas que le bateau soit classé au Lloyd's Register of Shipping ou à la société de classification qui le propose. Pour mettre en place ce service, la société de classification a besoin de posséder toutes les données techniques nécessaires, notamment tous les plans de structure du navire, pour pouvoir alimenter son programme de calcul. Nous payons un abonnement annuel - somme assez modique -, pour bénéficier de ce service qui nous permet, 24 heures sur 24, d'avoir en quelques dizaines de minutes, au vu d'un rapport que le bord va fournir directement au SERS du Lloyd's, le résultat des calculs d'après l'avarie constatée.
Les officiers du navire possèdent tous les éléments pour effectuer les calculs de contrainte et de stabilité du bateau à l'état intact, mais ils ont assez peu d'éléments pour traiter les cas d'avarie. Les quelques types d'avarie auxquels ils peuvent se référer - envahissement de telle cale par exemple -, sont assez limités. En situation de crise, les officiers n'ont ni le temps ni les moyens de calcul nécessaires à bord ; en revanche, ces calculs peuvent être faits rapidement à terre. Le SERS va donc communiquer rapidement le résultat de ses calculs et nous donner des pistes pour résoudre le problème.
Nous avons effectué un exercice récent avec l'un de nos bateaux et le SERS du Lloyd's Register of Shipping. En l'occurrence, nous n'avons pas pris un cas de figure complexe puisque nous avons choisi le cas d'un abordage au niveau de la cuve n°1 d'un navire possédant quatre cuves, un envahissement du compartiment de la cale et une brèche assez importante dans le bordé. Le Lloyd's nous a répondu en une dizaine de minutes, pour nous dire si la structure du navire était susceptible de dépasser les contraintes admissibles - ce qui n'était pas le cas en l'espèce -, quels étaient l'état des tirants d'eau, le niveau de l'assiette et l'importance de la gîte du navire ; par ailleurs, on voulait savoir si la cuve elle-même, vu la poussée hydrostatique de l'envahissement de la cale, était susceptible de subir des contraintes telles qu'il y ait des déformations au niveau du pont.
M. le Rapporteur : Pouvez-vous nous envoyer une note sur cette expérience ?
M. Bertrand MANGIN : Oui, bien entendu.
M. Le Rapporteur : Existe-t-il une association des sociétés de transport de gaz maritime au niveau mondial ?
M. Bertrand MANGIN : Il s'agit du SIGTTO.
M. le Rapporteur : M. Karsenti, vous avez fait état du malaise des chargeurs. On parle beaucoup de la responsabilisation encore plus grande des chargeurs sur la garantie du transport, les incitant ainsi à s'associer avec des armateurs de bonne qualité. On se réfère pour cela à ce qui a été fait aux Etats-Unis après l'accident de l'Exxon-Valdez. Quel est votre sentiment sur ce débat ? Vous parliez de transparence, comment pourrait-on conduire les chargeurs à être plus responsables du choix technique des bateaux ?
Par ailleurs, il est dans l'air du temps d'augmenter la contribution du FIPOL au dédommagement de ce type de sinistres. Pensez-vous que l'uniformité de la participation des chargeurs au FIPOL quels que soient la qualité et l'âge du bateau, soit une bonne chose ?
Enfin, quelles sont vos relations avec les sociétés de classification ? Ne pensez-vous pas que pour faire en sorte que la responsabilisation des chargeurs soit plus forte et plus garantie, il serait souhaitable d'instituer des relations plus structurées avec les sociétés de classification ?
M. Pierre KARSENTI : La responsabilité est en effet tout le problème. Les grandes sociétés pétrolières ne sont pas prêtes à constituer leur propre flotte dans le domaine du transport maritime, notamment pour des raisons d'organisation. Le marché du transport maritime de pétrole brut est organisé de telle sorte que lorsqu'une cargaison est chargée en Afrique ou dans le Golfe Persique, l'affréteur se garde la possibilité, pour des raisons de valorisation du pétrole brut qu'il a acheté, de la décharger en Europe, aux Etats-Unis ou en Asie.
Le système du découplage en vigueur depuis vingt ans, qui veut que l'intégration de la chaîne pétrolière - qui va de la recherche de pétrole jusqu'à la station service - ait explosé en 1974/1978 lors des chocs pétroliers, et le développement du trading, font que nous ne transportons plus nos cargaisons. Autrement dit les grandes sociétés pétrolières, même si elles avaient des flottes, les mettraient à disposition d'autrui mais ne les utiliseraient pas. Les présidents des sociétés pétrolières ne voient donc aucun intérêt à investir dans un domaine qui ne leur profitera pas puisque leurs sociétés chargent du pétrole sans même savoir s'il est destiné à leurs raffineries ou à la vente à d'autres compagnies. De plus, il ne s'agit pas de leur métier de base.
Vous me parlez de ce qui a été fait aux Etats-Unis, mais là-bas les responsables sont non pas les chargeurs, mais les armateurs. Si Exxon a payé pour le naufrage de l'Exxon-Valdez, c'est parce que le bateau lui appartenait : la compagnie a payé non pas en tant que propriétaire de la cargaison, mais en tant qu'armateur. Cependant il est vrai que depuis l'Oil Pollution Act de 1990, on ne sait plus vraiment qui sont les parties responsables puisque la loi mentionne les « opérateurs » du navire sans pour autant en donner une définition précise. Il peut s'agir d'un propriétaire armateur, mais comme on l'a vu à travers l'évolution du système et dans l'affaire de l'Erika, le mot « armateur » ne veut plus rien dire dans le secteur pétrolier ; il existe un propriétaire de la coque, mais une personne peut effectuer un affrètement coque nue, une autre un affrètement time charter pour mettre un équipage, une quatrième assurer le suivi du navire, et une dernière s'occuper de la fonction commerciale. Dans ces conditions, qui est l'armateur ? C'est une vraie question à laquelle nous souhaiterions avoir une réponse !
Lorsque je disais tout à l'heure que l'organisation actuelle du secteur du transport maritime ne nous convient pas parce que son inefficacité est organisée, je pourrais dire a contrario qu'elle est faite pour que ça marche d'une certaine manière ! Lorsque cinq personnes remplissent la fonction d'un armateur, cela ne peut pas nous satisfaire.
Du côté américain, cette responsabilisation n'est pas mauvaise dans la mesure où ils ont, avec le système de COFR, obligé l'armateur à posséder des fonds disponibles. Les Américains ont également mis en place une responsabilité environnementaliste et exigent que les responsables d'une pollution « remboursent l'environnement ». Mais je crois qu'ils sont en train d'abandonner cette idée, car ils ont dépensé des centaines de millions de dollars pour savoir qui devait rembourser, combien valait une plage ou un morceau de rocher. Cela pose un vrai problème : on rembourse qui et comment évaluer les dommages écologiques ?
M. le Rapporteur : La loutre vaut 80 000 francs !
M. Pierre KARSENTI : Il ne sert à rien de créer des systèmes qui n'ont pas de sens. Il convient de prendre des mesures constructives qui soient efficaces. Nous pouvons utiliser le système américain pour ce qu'il a d'intéressant, mais laissons de côté les voies qu'il a empruntées et qui ne riment à rien.
S'agissant de l'augmentation du FIPOL, elle est inévitable. Est-ce que cela servira ? Je n'en sais rien ! Je suis frappé de la facilité avec laquelle les milliards volent dans toutes ces affaires ; on ne sait d'ailleurs plus s'il s'agit de milliards de francs, de dollars, de lires, d'euros... Cela n'est pas sain.
Les Américains ont mis en place un fonds d'un milliard de dollars financé par les importations de pétrole brut, du coup nous voulons que le FIPOL soit alimenté par un milliard d'euros. Je pense néanmoins que la mise à disposition des sommes appelle à la dépense : si nous disposons d'un milliard d'euros, il sera vite épuisé et après nous en voudrons, 5, puis 10 et il n'y aura plus jamais de fin.
M. le Rapporteur : Il faut pourtant rembourser le préjudice, et cela dépassera les 1,2 milliard de francs disponible.
M. Pierre KARSENTI : Certes. Les Américains sont tout de même revenus de ce système. Si l'on commence à défiler la bobine, tout le monde va se plaindre : un touriste pourra porter plainte parce qu'il voulait aller passer ses vacances dans la zone géographique touchée au moment du naufrage ! Les Américains s'amusent à ce jeu ; les cabinets d'avocats se rémunèrent de cette façon, on peut effectivement procéder de la même manière en France.
M. le Rapporteur : Par cet exemple, vous poussez votre raisonnement à l'extrême !
M. Pierre KARSENTI : Certes, mais cet extrême existe. Sans doute le plafond du FIPOL sera-t-il porté à un milliard d'euros. Il me semblerait toutefois plus intéressant d'instituer une égalité entre les armateurs et les chargeurs et de responsabiliser davantage les armateurs.
Je voudrais ouvrir une parenthèse, car vous avez dû recevoir des armateurs et entendre à cette occasion que les chargeurs ne voulaient pas payer le prix de la sécurité. Cela n'a aucun sens. Je vais vous donner trois chiffres. Vous savez que nous travaillons en world scale, c'est-à-dire avec un barème pour les transports de pétrole brut.
Le barème initial de 100 pour les transports de pétrole brut sur les bateaux de 80 000 tonnes qui naviguent en mer du nord, était fixé à 80 il y a un an, à 200 il y a deux mois, et atteint 140 aujourd'hui. Alors, lorsqu'on dit que les chargeurs ne veulent pas payer la sécurité, je réponds que cela n'a aucun sens. La sécurité a-t-elle été plus garantie quand le barème était à 200 que quand il était à 80, je n'en suis pas certain ; les équipages ont-ils été mieux payés et mieux formés lorsque le barème était à 200 que quand il était à 80, je n'en suis pas certain.
Je crois donc que l'on confond le prix et le coût. Or les chargeurs ne sont pas responsables des coûts ; nous sommes confrontés à un marché - celui du transport maritime international - qui donne un prix. Nous souhaitons que les institutions internationales fassent en sorte que le coût de la sécurité figure bien dans les coûts de transport. Et les chargeurs sont prêts à payer ce coût-là.
M. le Rapporteur : Avec le naufrage de l'Erika, l'image de Total Fina est écornée et cela a un coût.
M. Pierre KARSENTI : Bien sûr, mais je vais vous donner l'âge de certains bateaux qui ont fait naufrage : l'Exxon-Valdez avait cinq ans ; l'Amoco-Cadiz, quatre ; le Braer en avait trois. Ces bateaux n'étaient pas épouvantables. On ne peut pas demander aux chargeurs d'aller vérifier si dans le tarif qu'on leur propose, le coût de la sécurité a été pris en compte.
Je ferai deux comparaisons. Tout d'abord, avant de prendre l'autobus, vérifiez-vous l'état des freins sous le châssis et faites-vous conduire le chauffeur pendant 2 ou 3 kilomètres pour voir s'il conduit bien ? De même, lorsque vous achetez 2 kilogrammes de tomates, nous assurez-vous que les gens qui les ont ramassés n'ont pas été exploités ?
M. le Rapporteur : Certes, mais si j'apprends que l'un des bus de la compagnie que j'envisage d'utiliser a subi un grave accident, je change de compagnie.
M. Pierre KARSENTI : Le problème du transport maritime de pétrole brut, c'est qu'il n'y a plus de grands armateurs. Ceux qui restent, nous les prenons de préférence, vous vous en doutez bien ! Mais lorsqu'on va sur un marché et que l'on a besoin d'un bateau à affréter à telle date, on nous présente 10 bateaux dont on ne sait pas à qui ils appartiennent - du fait des single ship compagnies et des sociétés écrans. La traçabilité, dont on dit qu'elle est extrêmement difficile à mettre en place, on nous demande de la faire tous seuls !
M. le Président : J'ai tout de même le sentiment que dans chaque compagnie pétrolière, il y a quelques personnes très qualifiées et issues souvent de la marine marchande dont le rôle est de veiller, de surveiller, de suivre les différents navires. Il n'y a tout de même pas des centaines d'Erika sur les mers du globe.
M. Pierre KARSENTI : Si, si.
M. le Président : Il n'y a tout de même pas des centaines de navires comme l'Erika susceptibles de transporter du fioul numéro 2, entre Dunkerque et l'Italie !
M. Pierre KARSENTI : Si, M. le président, il y en a des centaines.
M. le Président : Dans ce cas là, le rôle de ces personnes issues de la marine marchande est de tenir la liste noire des navires et des armements à éviter. Si tel n'est pas leur travail, à quoi servent-elles ?
M. Pierre KARSENTI : Je crains que l'état que vous avancez ne soit dépassé, M. le président. Dans la flotte pétrolière, nous n'en sommes plus à choisir entre les blancs et les noirs. Les mauvais navires ont été éliminés depuis très longtemps. Je vous rappelle que l'Erika était doté de tous les certificats.
M. le Président : D'autres compagnies ont révélé qu'elles n'auraient jamais pris l'Erika, qui figurait sur leur liste noire.
M. Pierre KARSENTI : En effet, ces propos ont été tenus. Mais savez-vous que la presse anglo-saxonne relate que les compagnies anglo-saxonnes ne feraient plus d'acceptation de navires. Elles se contenteraient maintenant de dire « nous n'avons plus de questions à formuler sur votre navire ». Et les armateurs ont compris que cette formulation, un peu étrange, voulait dire que les navires concernés sont bons. Cette attitude des compagnies anglo-saxonnes leur permettrait d'éviter d'éventuels problèmes juridiques.
Si l'on veut aller vers la diabolisation du chargeur, on y arrivera. C'est vous qui êtes la représentation nationale. Mais j'essaie de faire _uvre utile. Et si vous prenez les statistiques des mémoranda de Paris et de Tokyo, le nombre de pétroliers arrêtés est infime.
M. le Rapporteur : Parce que les contrôles sont insuffisants !
M. Pierre KARSENTI : Non, M. le rapporteur. Les contrôles de l'Etat du port sont effectués non pas par les Etats mais par les chargeurs. Pourquoi voulez-vous que les inspecteurs de l'Etat du port, qui ne sont pas assez nombreux et qui ont beaucoup de travail, aillent contrôler les pétroliers alors que nous le faisons ? Ils nous font confiance et ils ont raison. Cela ne se dit pas, mais il s'agit des faits.
Les navires vraiment très mauvais ne sont plus utilisés. Nous avons aujourd'hui affaire à des navires intermédiaires : des navires tels que l'Erika qui ne sont pas mauvais de façon évidente, mais qui se révèlent pas bons à un moment donné. Il est très difficile pour nous de produire beaucoup d'efforts pour une productivité pas toujours significative. La réalité aujourd'hui, c'est qu'un événement comme le naufrage de l'Erika n'est pas acceptable. Tout le reste n'est que statistiques ou littérature.
En ce qui concerne les sociétés de classification, nous serions intéressés d'avoir accès à leurs dossiers, car cela nous permettrait de compléter notre système de vetting de manière efficace. Malheureusement, on nous l'interdit.
M. Le Rapporteur : Le système EQUASIS ne vous le permettra pas ?
M. Pierre KARSENTI : Tout dépendra de ce l'on mettra dans EQUASIS. Les chargeurs fournissent la partie la plus avancée d'EQUASIS, puisque le système SIRE fonctionne. Mais l'ordinateur ne rend que ce que vous lui avez donné ! Il ne faut donc pas voir dans ce système la solution à tous les problèmes.
La preuve, l'Erika était acceptable pour certaines compagnies pétrolières et pas par d'autres. Quand un navire n'est acceptable par personne, l'affaire est simple, mais si sur quatre inspections, une est mauvaise, la deuxième est bonne, et les deux autres sont moyennes, il n'est pas évident de déterminer la qualité du navire. Or ce sont ces navires qui ne sont pas évidemment mauvais qui posent le plus de problèmes.
Audition de M. Fernand BOZZONI,
gérant de la Société d'armement et de transport (SOCATRA)
(extrait du procès-verbal de la séance du 19 avril 2000)
Présidence de M. Daniel PAUL, Président.
M. Fernand Bozzoni est introduit.
M. le Président lui rappelle que les dispositions législatives relatives aux commissions d'enquête lui ont été communiquées. A l'invitation du Président, M. Fernand Bozzoni prête serment.
M. Fernand BOZZONI : Monsieur le président, messieurs les députés, mon exposé introductif sera bref, car s'agissant d'un événement aussi important que le naufrage de l'Erika, il est nécessaire de prendre un certain recul.
Je ne ferai qu'exprimer des regrets. En tant que professionnel du transport maritime pétrolier, je regrette d'avoir assisté à l'agitation qui a eu lieu depuis le naufrage, et je déplore le manque de recul des personnes qui se sont exprimées ; cela n'est pas favorable à la recherche de solutions efficaces.
L'on peut cependant, d'ores et déjà, tirer quelques enseignements sur les comportements, afin d'éviter qu'une telle catastrophe ne se reproduise.
Que pouvons-nous constater : le naufrage d'un bateau - d'un certain âge - qui transportait du fioul. On a cédé un peu trop vite à mon sens, aux pressions de la rue : les vieux bateaux, la société de classification et Totalfina ont tous été condamnés. La première question que je me pose est de savoir ce qui se serait passé si au lieu et place de Total on avait eu affaire à une société exotique de trading. Les comportements de l'affréteur n'auraient pas été les mêmes ; je ne pense pas que celui-ci aurait contribué à la réparation des dégâts à hauteur de 700 millions de francs ! En l'occurrence, on avait la compagnie pétrolière sous la main, la deep pocket, et l'on a tapé dessus. C'est facile mais cela ne résout pas le problème.
Il a également été dit que la société de classification n'avait pas fait son travail correctement et que le navire était trop vieux. Or je ne pense pas que l'on puisse raisonner en ces termes ; le problème est beaucoup plus vaste, certaines questions fondamentales ne sont pas encore résolues aujourd'hui, parce qu'elles sont complexes - je pense notamment au contrôle des navires. Personne n'a évoqué tous les progrès réalisés depuis dix ans en matière de sécurité du transport maritime, en général, et du transport pétrolier en particulier ; tout le monde a été condamné à la même enseigne.
Personnellement, j'ai énormément souffert du naufrage de l'Erika : du jour au lendemain, une grande société pétrolière française m'a signifié, oralement, que quatre de mes bateaux, âgés de plus de 25 ans - des petits bateaux français de 5 000 tonnes avec du personne français à bord transportant non pas du fioul mais des produits blancs -, étaient « black listés ». Or il s'agit de bateaux que cette société pétrolière utilise depuis plus de 25 ans et qu'elle connaît parfaitement !
Si tous les bateaux d'un certain âge doivent partir à la ferraille, on va s'éclairer à la bougie ! Et il est tout à fait anormal de ne pas faire la distinction entre les bateaux : les petits, les gros, les bateaux transportant des produits blancs, ceux transportant du produit noir, les bateaux français, etc... La cerise sur le gâteau a tout de même été la lettre que M. Gayssot a envoyée aux présidents des compagnies pétrolières françaises, leur recommandant de ne pas affréter des bateaux de plus de 20 ans, alors que ce sont ses services qui délivrent les permis de navigation pour mes bateaux français - et armés avec du personnel français - âgés de plus de 20 ans ! Du jour au lendemain, je me suis retrouvé avec quatre bateaux inactifs... A ce niveau, on fait fausse route.
Il faut attendre d'avoir tous les éléments à notre disposition pour tirer les enseignements du naufrage de l'Erika. Mais pour le moment, il ne s'agit que de conjectures, nous ne connaissons pas les véritables causes de l'accident. Je suis en train de lire le rapport du RINA, qui est très intéressant. Il est certes galvaudé - il ne correspond pas à ce que l'opinion publique attendait - mais il y a des vérités qui fâchent.
On connaît d'autres catastrophes qui restent partiellement inexpliquées. Le RINA apporte un éclairage inattendu, nouveau sur le naufrage de l'Erika, étayé par un solide raisonnement ; il montre aussi que les choses ne sont pas aussi simples que cela.
Une des mesures positives mises en avant aujourd'hui, c'est la question de l'âge : on veut interdire les bateaux de plus de 15 ans. Je regrette ce type de « systématisme » qui ne résoudra pas les vrais problèmes, car supprimer les navires de plus de 15 ans n'empêchera pas les poubelles de 10 ans de circuler !
Cependant, des réflexions doivent être menées, notamment sur la responsabilisation des Etats du pavillon, certains Etats accordant leur pavillon à n'importe qui. J'ai appelé cela de la « prostitution pavillonnaire » Et comme nombre d'entre eux ne possèdent pas un corps national d'inspecteurs suffisant, ils délèguent le contrôle de la sécurité à la société de classification qui, souvent, classe le bateau ; la société de classification devient alors juge et partie, ce qui pose un vrai problème.
Il serait donc nécessaire, sur un plan légal, de responsabiliser les Etats qui accordent leur pavillon. Il conviendrait également de séparer la fonction de classification du bateau de celle du contrôle de la sécurité, à l'intérieur des sociétés de classification - qui sont, ne l'oublions pas, des sociétés commerciales, pour les Etats qui ne possèdent pas de corps d'inspection. voire d'aller plus loin en interdisant aux sociétés de classification d'exercer ces deux fonctions pour un même navire. Il s'agirait là d'une première mesure de moralisation.
Par ailleurs, il faudrait mettre en place un contrôle des sociétés de classification qui puisse s'effectuer dans des conditions techniquement valables. Je m'explique : actuellement, l'Etat du pavillon délègue un certain nombre de contrôles à une société de classification. Lors des arrêts techniques, nous avons affaire non pas au représentant de l'Etat du pavillon - que l'on ne voit que pour la visite annuelle qui se déroule à flot -, mais à l'inspecteur de la société de classification. Le représentant de l'Etat devrait être présent lors des arrêts techniques afin de discuter avec l'inspecteur de la classe.
Cela étant dit, imposer le contrôle des sociétés de classification ne se fera pas d'un coup de baguette magique, car le problème de la formation des inspecteurs va se poser. On ne trouverait pas, à l'heure actuelle, suffisamment de contrôleurs d'inspecteurs.
Par ailleurs, les visites et les inspections dans l'Etat du port s'effectuent à flot. Je ne sais pas si vous êtes souvent entrés dans les ballasts d'un pétrolier, mais même si vous avez une vague idée de leur état général, rien ne vous dit qu'une soudure ne va pas casser sur une tôle de bordée. En matière de contrôle de coque, les inspecteurs procèdent un peu comme les experts-comptables, c'est-à-dire par sondages. L'expert-comptable certifie les comptes, mais il le fait par sondage, il ne dit pas qu'il a vu tous les comptes.
Quoiqu'il en soit, statistiquement, un accident tel que celui de l'Erika est rarissime, car il est impossible qu'un bateau se casse en deux comme cela.
M. le Rapporteur : Il y a deux ans, au Japon, le Nakhodka s'est également cassé en deux. Or ce navire avait été construit dans les années 70 dans le même chantier naval que l'Erika. Au cours de nos entretiens à Londres, des interlocuteurs nous ont parlé de la même préoccupation de renforcement de la coque sur l'axe central.
M. Fernand BOZZONI : Les réparations coûtent tellement cher que l'armateur ne répare pas !
M. le Président : S'il ne répare pas, il faut l'obliger à ne plus utiliser le navire.
M. Fernand BOZZONI : Il n'obtiendra plus ses certificats de classe et ne pourra donc plus naviguer. Bien entendu, tout dépend de celui qui l'affrète, mais il ne pourra plus rentrer dans une raffinerie.
M. le Rapporteur : Selon vous, le problème majeur à régler concerne les sociétés de classification.
M. Fernand BOZZONI : Je dirai plutôt qu'il concerne les contrôles. Car je puis vous affirmer que depuis dix ans des progrès considérables ont été réalisés en matière de sécurité - le code ISM, la SCTW 95, la généralisation des vettings. Il faut tout de même que vous sachiez que nous sommes perpétuellement en inspection ! Nos bateaux sont obligatoirement « vettés » par toutes les grandes compagnies pétrolières qui délivrent des certificats de vetting valables six mois - pour l'instant, car cela va changer. Comme il faut être certifié par une dizaine de compagnies, cela représente jusqu'à 24 inspections par an ! auxquelles il convient d'ajouter les inspections de classe, des assureurs, des inspecteurs de l'Etat du port et de ceux du pavillon !
M. le Rapporteur : Cela se passe ainsi parce que vos navires sont français ?
M. Fernand BOZZONI : Non, cela ne dépend pas du pavillon.
M. le Rapporteur : Et vous proposez un contrôle supplémentaire !
M. Fernand BOZZONI : Il y a trop de contrôles et ils ne sont pas assez clairs. Les compagnies pétrolières ont toutes créé leur service de vetting, car il faut bien comprendre que Shell ne peut pas faire confiance à Esso, etc. Ces inspections de vetting se font à flot et sont axées sur des questions de sécurité, de maintenance, c'est-à-dire que ces contrôles ne sont traités ni par la société de classification ni par SOLAS.
Je vous donne un exemple. Les compagnies pétrolières ont demandé que des alarmes de température sur les arbres de pompes soient systématiquement installées sur les pompes de cargaison. En effet, lorsqu'on décharge de l'essence, si un arbre chauffe il met le feu au bateau. Or une telle mesure de sécurité n'est requise ni par la classe ni par SOLAS. Les compagnies pétrolières demandent donc des mesures supplémentaires ayant trait notamment à la sécurité, à la maintenance et au mode de gestion et d'entretien des bateaux par l'armateur.
Il convient également de savoir que des audits de nos bureaux sont effectués : les compagnies Shell, Elf, Total sont venues dans nos bureaux pour voir comment nous étions organisés.
M. le Rapporteur : Combien avez-vous de bateaux ?
M. Fernand BOZZONI : Nous avons treize bateaux, dont le volume varie entre 1 000 à 45 000 tonnes ; nous avons également en gestion un VLCC de la Shell de 280 000 tonnes.
Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller chez un armateur afin d'étudier la façon dont il est organisé. Je suis persuadé que cela vous aiderait à comprendre tout ce que nous avons à traiter quotidiennement.
M. le Rapporteur : M. Bozzoni, vous êtes tout de même un cas particulier. Vous êtes un armateur français, votre compagnie est une compagnie familiale, elle possède peu de navires qui sont bien identifiés et organisés. Honnêtement, ce n'était pas le cas de l'Erika.
M. Fernand BOZZONI : Je ne suis pas d'accord, j'aurais pu posséder l'Erika. Et si la cause première de son naufrage est une cassure de soudure suite aux réparations réalisées dans le chantier de Monténégro, c'est un accident qui aurait pu m'arriver. Si j'ai bien compris la thèse du RINA, la coque de l'Erika avait été percée pour effectuer des réparations sur les cloisons. Il suffit, au moment où l'on referme les ouvertures réalisées dans la coque, qu'une soudure soit mal faite pour qu'au bout d'un certain temps elle casse ; et là, c'est la théorie des dominos, car ça casse où ça ne devrait pas casser.
M. le Président : Lorsque vous faites réparer l'un de vos navires, je suppose que vous contrôlez les compétences du chantier auquel vous faites appel.
M. Fernand BOZZONI : Les chantiers ont tous une réputation : bonne ou mauvaise. Cela étant dit, les ouvriers des chantiers devraient tous savoir faire une soudure. Par ailleurs, notre ingénieur d'armement est sur place pour vérifier le travail avec le chef mécanicien. Sans oublier que chaque fois que la coque est touchée, il convient de prévenir la société de classification, qui envoie son inspecteur vérifier que le travail est bien effectué ; or cet inspecteur local connaît mieux que tout le monde la valeur du chantier. Si ces règles ont été respectées pour l'Erika, je suppose que l'inspecteur du RINA était présent lors des réparations et qu'il connaissait la valeur du chantier. Mais je ne sais pas combien de centaines de mètres de soudure ont été réalisées, ni comment la soudure a été contrôlée.
M. le Président : J'ai vu comment procédait la société Stolt Nilsen, pour vérifier les soudures sur un chimiquier en construction. Eh bien quand on veut, on peut ! Chaque soudure était vérifiée une par une, notamment avec un Kleneex : si le Kleneex accrochait, la soudure était à refaire. Pour réaliser ces soudures, les responsables du chantier ont fait venir des soudeurs qualifiés de Pologne et de Hongrie - la France ne possédant plus de soudeurs compétents.
M. Fernand BOZZONI : Il s'agit de soudures spécifiques, un chimiquier possédant des citernes en acier inoxydable. En outre, on peut se demander s'il ne s'agissait pas d'un excès de zèle, qui a d'ailleurs été fatal au chantier en question !
M. le Président : Ce que je voulais dire, c'est que lorsqu'on a la volonté de réaliser des contrôles, on le peut. Par ailleurs, on a toujours la possibilité de confier la construction ou la réparation d'un navire à un chantier qualifié.
M. le Rapporteur : Monsieur Bozzoni, si je vous ai bien compris, vous suggérez de simplifier les contrôles tout en les renforçant.
M. Fernand BOZZONI : Tout à fait, cela nous faciliterait la tâche. Mais je ne me fais pas d'illusion, les compagnies pétrolières continueront à réaliser leur propre vetting. Cependant, j'ai eu l'occasion de constater que certains inspecteurs de vetting n'étaient pas du tout compétents. C'est la raison pour laquelle il serait très dangereux d'ouvrir le fichier SIRE à tout le monde, car on y trouvera des absurdités. Il faut être sûr de la qualité de l'information qui y sera rapportée.
M. le Rapporteur : Le système EQUASIS ne devra donc pas être ouvert à tout le monde.
M. Fernand BOZZONI : Non, ou alors il faudra être sûr des informations.
M. le Rapporteur : Ce qui veut dire que les contrôleurs devront être contrôlés.
M. Fernand BOZZONI : Actuellement, je n'ai pas accès au fichier SIRE, je ne peux donc pas me défendre ; c'est la porte ouverte à tous les abus. Je ne dis pas qu'il conviendrait d'instaurer une commission d'appel, mais les armateurs devraient pouvoir expliquer leurs actes.
Parmi les éléments qu'un inspecteur constate et relève à bord, certains sont largement discutables. Des inspecteurs de vetting pétroliers peuvent nous demander certaines choses concernant la maintenance ou la façon de conduire un bateau sur lesquelles nous ne sommes pas d'accord. Et si l'on ne peut pas s'expliquer, cela peut nous porter préjudice : au vu de ce qu'ils liront, les affréteurs ne choisiront pas nos bateaux. Il convient donc d'être extrêmement précis.
Nous n'avons pas encore abordé la question de la double coque. C'est la mode, tout le monde veut des navires double coque. Cependant, ces navires n'ont pas 10 ans, nous n'avons pas de recul pour apprécier leur solidité. Lorsqu'ils vont commencer à sauter comme des bouchons de champagne, on changera d'avis ! Et cela va arriver ! De la corrosion va apparaître sur les plafonds des ballasts, des fuites vont se produire. Et à ce moment-là on s'apercevra que la double coque n'est pas la solution. Il n'y a pas de solution miracle...
M. le Rapporteur : ... sauf la qualité du contrôle.
M. Fernand BOZZONI : Mais je vous assure que l'on a déjà réalisé d'énormes progrès au cours de ces dix dernières années. En outre, les sociétés de classification sont en train de mettre en place des outils informatiques qui aideront les armateurs à prendre des décisions sur ce qu'il faut réparer ou non, comment le faire et si cela vaut le coup ou non. Actuellement, l'on met en place une surveillance quasi permanente des coques.
M. le Rapporteur : Certes, mais cela vaut-il pour le « Bozzoni » de Saint-Pétersbourg ?
M. Fernand BOZZONI : Ce n'est pas vrai pour tous les « Bozzoni ».
M. le Rapporteur : Des progrès ont donc été réalisés, mais pas pour tous les « Bozzoni » ; alors comment peut-on les contrôler quand ils traversent la Manche - puisqu'ils ne s'arrêtent pas dans l'Etat du port ?
M. Fernand BOZZONI : Il y aucune possibilité, c'est vrai. Cependant, étant donné que ces navires naviguent sous pavillon de complaisance, il serait peut-être possible, au niveau de l'OMI, de mettre en cause les Etats. Quand vous accordez un pavillon, vous donnez votre nationalité ; il s'agit d'un acte qui devrait engager les Etats davantage qu'ils ne le sont aujourd'hui. Je ne dis pas que cela est facile, mais il s'agit d'une piste qu'il conviendrait d'étudier.
S'agissant du contrôle, il existe deux façons de l'envisager : soit au niveau de l'OMI, soit au niveau européen - ce dernier me semblant plus efficace. La création d'un corps européen de contrôleurs serait une bonne chose, un peu comme les garde-côtes américains.
M. le Rapporteur : Avec des contrôles en mer ?
M. Fernand BOZZONI : Non, ce ne serait pas possible. Les garde-côtes américains contrôlent les navires entrant dans les eaux territoriales ; ils ne peuvent entrer dans le port que lorsqu'ils ont passé la pré-visite. Et tout le monde les craint ! S'il vous manque une carte, c'est 1 000 dollars d'amende. C'est incontestablement ce modèle.
Par ailleurs, il faudrait plus de transparence et de collaboration, entre les contrôleurs et les sociétés de classification,.
M. Louis GUEDON : Monsieur Bozzoni, dans la première partie de votre exposé, vous avez évoqué des regrets. Vous avez également parlé des pressions de l'opinion publique. Or nous sommes en démocratie, c'est donc le peuple qui a raison et non les armateurs ou les industriels. Par conséquent, s'il y a un désaveu du peuple sur des actes des industriels, ces derniers peuvent se poser des questions. En outre, je m'étonne, étant donné qu'il y a eu six naufrages au même endroit avec des conséquences économiques très graves, que vous ayez des regrets sur le fait que l'opinion publique s'émeuve encore et s'exprime.
J'aurais aimé entendre, de la part des professionnels du transport maritime, les mêmes propos que ceux qui sont tenus par les professions de santé. Vous êtes amenés à connaître un nouveau processus, car vous transportez des cargaisons dangereuses. Dans les professions de santé, lorsqu'un accident se produit, le responsable est non seulement celui qui a dispensé le médicament, mais également celui qui l'a prescrit, celui qui la fabriqué et même celui qui a élaboré le principe actif qui est entré dans la composition du produit. Toute une chaîne de responsabilités est ainsi soumise à des contrôles permanents intransigeants. Et s'il y a une faille, on enlève à l'intéressé le droit d'exercer, même s'il a fait dix ans d'étude.
J'aimerais savoir si vous maintenez vos regrets, sachant que l'opinion publique a le droit d'exister, et les régions touchées de ne pas perdre leurs métiers et leur économie, ce qui est le cas actuellement.
M. Fernand BOZZONI : Au risque de vous décevoir, monsieur le député, je maintiens mes regrets. Et je vais vous dire pourquoi. Bien évidemment, je n'ai rien contre la démocratie ; ce que je voulais faire observer, lorsque je disais que j'avais des regrets, c'est qu'il existe, dans le transport maritime, un environnement juridique et des conventions internationales précises qui ont été ratifiées par la France. Or après la réaction de l'opinion publique qui est tout à fait légitime, on a tiré un trait sur ce cadre juridique. Qu'il convienne de le modifier, je suis d'accord, mais ce n'est pas à chaud que l'on doit faire fi de la loi et de l'environnement légal. Je regrette également que l'on ait passé sous silence les progrès réalisés au cours de ces dix dernières années en matière de sécurité maritime.
Et qu'en est-il des marins français qui naviguaient sur mes bateaux qui ont été « black listés » du jour au lendemain ? Ont-ils mérité le le sort qu'ils ont subi ? Je ne le pense pas. Les populations ont été victimes, je le reconnais, mes marins aussi. Cette condamnation brutale d'un bateau, parce qu'il a plus de 25 ans, n'est pas légitime, notamment lorsque l'Etat français nous délivre un permis de navigation. Il faut que les choses avancent, il faut des propositions mais ne pas être aussi brutal et aussi sectaire.
M. le Rapporteur : Je voudrais vous demander une dernière chose, qui n'a que peu de rapport avec l'Erika. Nous souhaitons, dans notre rapport, faire des propositions pour améliorer la politique maritime de la France. Nous aimerions donc connaître votre sentiment sur les mesures d'aide annoncées, sur celles déjà existantes et sur celles qui sont envisageables ; sont-elles de nature à renforcer l'armement français ? Selon vous, quelles mesures faudrait-il prendre pour qu'il puisse tenir une place plus importante ? Moraliser et sécuriser le transport maritime passent par l'existence d'armements de moyenne taille qui puissent être souples. Pourriez-vous nous faire une note précise sur le sujet ?
M. Fernand BOZZONI : J'ai lu avec beaucoup d'intérêt le rapport Hamon-Dubois et j'y ai relevé une remarque très intéressante : la tâche est tellement énorme que l'on finit par douter des chances de réussite.
En fait, pour réussir il faudrait des armateurs ; or, en France, il n'y en a pas. Comment expliquez-vous le fait que le premier chantier du monde de construction de paquebots de luxe soit à Saint-Nazaire et qu'aucun armateur français n'en exploite ?
M. Louis GUEDON : Nous en connaissons la raison, alors ne nous faites pas croire que vous ne la connaissez pas !
M. Fernand BOZZONI : La seule raison à mes yeux est qu'il n'y a pas assez d'armateurs français. Les compagnies inscrites au Comité central des armateurs de France ne sont pas forcément des armateurs ! Etre armateur, c'est une aventure maritime, cela demande beaucoup d'imagination, de souplesse, il convient d'être moderne et dynamique. Je serais le premier intéressé à ce qu'il y ait 200 armateurs en France.
M. le Président : Combien y en a-t-il ?
M. Fernand BOZZONI : En matière de transport pétrolier, Il y a l'ancien Van Ommeren qui est maintenant un conglomérat - Hollande, Suède, Norvège - et qui possède 50 navires avec une filiale française qui doit compter 9 ou 10 bateaux, Fouquet-Sacop qui possède 4 ou 5 bateaux en Méditerranée, Petromarine, dont les navires sont surtout en Afrique, Services et Transport qui est bien ciblé sur des petits bateaux, c'est tout il y a vingt caboteurs.
En tant que président de la section cabotage du Comité central des armateurs de France, j'ai reçu, avec deux collègues, une délégation d'armateurs japonais ; ils étaient 40 et représentaient une partie des armateurs au cabotage japonais, c'est-à-dire 3 000 bateaux ! Nous étions 3 et nous leur avons dit : « Eh bien nous, nous représentons 23 bateaux ! » Certes le Japon est un cas particulier, mais tout de même ! Ils n'ont le droit de construire un nouveau bateau pour le cabotage que s'ils en mettent un à la ferraille.
M. le Président : Tous vos navires étaient sous pavillon métropolitain ; sous quel pavillon sont-ils, maintenant ?
M. Fernand BOZZONI : J'ai désarmé le dernier navire qui était sous pavillon français, car, comme je vous l'ai expliqué, il a été condamné par l'âge. Les autres sont sous pavillon Kerguelen, Saint-Vincent et les Grenadines, et Luxembourg.
M. le Président : Combien avez-vous de marins français ?
M. Fernand BOZZONI : Environ quatre-vingts, dont deux sur un navire battant pavillon luxembourgeois. Je vais vous faire part d'une expérience que je suis en train de mener - sous pavillon luxembourgeois, car je ne pourrais pas le faire sous pavillon Kerguelen. Je mets aux commandes une équipe composée d'un commandant et d'un commandant adjoint et tout le reste de l'équipage ce sont des malgaches francophones que je forme moi-même, à Madagascar. Nous travaillons avec l'école maritime de Mahajanga depuis des années, nous envoyons des commandants et des chefs mécaniciens qui font office de formateurs. Nous avons ainsi un équipage homogène et fidélisé sur nos bateaux, je veux former mes hommes et tout le monde doit parler le même langage. J'ai mis un commandant et un commandant adjoint car je voudrais séparer les deux fonctions suivantes : l'exploitation commerciale du bateau et l'entretien. J'estime en effet que l'entretien doit être réalisé par une équipe qui est à terre alors que la conduite intéresse les personnes à bord. Je demande simplement à cette équipe - commandant et commandant adjoint - d'organiser le travail.
Je veux casser la barrière qui existe entre le pont et la machine. Comme dans une usine, je veux qu'il y ait un président et un directeur général, et les services derrière. Je suis donc en train de mener cette expérience, et je dois dire que les intéressés la jugent plutôt favorablement. J'en ferai part à l'administration lorsque j'aurai terminé, mais il y a peut-être là une idée à exploiter. D'autant qu'elle va dans le sens de l'amélioration de la sécurité : je responsabilise beaucoup plus l'équipe qui reste à terre pour garantir la sécurité du navire, car elle change moins souvent que les commandants et les chefs mécaniciens qui tournent. Prenons l'exemple de l'aviation civile : lorsqu'un avion atterrit, le pilote et le copilote descendent de l'avion pendant que les équipes de terre se préparent à procéder à son entretien. Il n'appartient pas au pilote d'entretenir son avion !
Entretien du Rapporteur avec MM. George GREENWOOD, chairman,
D.J.L. WATKINS, secretary and executive officer
de International Group of P&I Clubs
Christopher HAVERF, director de P&I Clubs - West of London
Ian WHITE, directeur,
et Clément LAVIGNE, biologiste marine,
d'International Tanker Owner Pollution Federation (ITOPF)
(extrait du procès-verbal de la séance du 19 avril 2000)
MM. George Greenwood, Christopher Haverf, Clément Lavigne, D.J.L. Watkins et Ian White sont introduits.
M. le Rapporteur : Messieurs, je voulais vous dire, en commençant cette audition, que j'ai été désolé de la brièveté de l'entretien que nous avons eu à Londres, mais notre emploi du temps était très chargé - trop sans doute. Je souhaiterais donc que nous puissions revenir sur l'action des P&I Clubs et votre manière d'appréhender la situation, après quoi je vous interrogerai éventuellement plus en détail.
M. George GREENWOOD : Lors de notre réunion de la semaine dernière, nous avons répondu aux questions initialement posées et je crois que les réponses apportées vous ont satisfaits. Nous avons expliqué que les P&I Clubs achètent de la réassurance ce qui est fondamental, car tout ce qui relève de la tarification dépend de l'évaluation du risque par les souscripteurs. Par conséquent, toute évolution de la situation aura obligatoirement une incidence sur la tarification comme cela est apparu dans les réponses qui vous ont été faites.
Il est important de noter que cela ne concerne pas la seule tarification mais aussi le niveau de la couverture disponible. En effet, le fait d'acheter aujourd'hui l'équivalent d'un milliard de francs de réassurance ne signifie pas qu'il sera possible de faire de même d'ici à un an, quand la situation aura évolué...
Pour ce qui a trait à la première question de votre liste, avez-vous besoin d'un complément d'information ?
M. le Rapporteur : Ce qui me paraît le plus important, c'est l'articulation entre les P&I Clubs et le FIPOL. Je n'ai pas bien compris à la fois la situation actuelle et votre position par rapport au souhait de la France d'augmenter la couverture FIPOL et le montant de l'indemnisation par sinistre.
M. George GREENWOOD : Je vais laisser à Ian White le soin de vous répondre car il a une expérience pratique des liens qu'entretiennent le FIPOL et les P&I Clubs.
M. Ian WHITE : Il est sans doute important de rappeler que la responsabilité et tout ce qui touche à l'indemnisation relèvent d'un système à deux niveaux : d'abord, celui de la responsabilité directe qui est, en fait, celle de l'armateur, ensuite, celui de la couverture supplémentaire grâce au FIPOL.
Il faut savoir que les deux piliers de ce système sont étroitement liés car, pour que le système fonctionne, il est nécessaire que les parties, qui vont verser les indemnités et les compensations, travaillent en collaboration.
D'emblée, il faut donc préciser que le groupe international des P&I Clubs d'une part, et le FIPOL d'autre part, ont signé un protocole d'accord, en vertu duquel sont prévus un partage rapide des informations, un recours, dans la mesure du possible, aux même experts, ainsi qu'un traitement rapide et commun des sinistres.
M. Clément LAVIGNE : Permettez-moi d'ajouter un petit commentaire. Il est important effectivement de savoir qu'il s'agit d'un système à deux niveaux, le premier étant celui de la CLC sur la responsabilité civile qui est assuré par les P & I Clubs et financé par les armateurs, le second étant celui du FIPOL ou de la convention du fonds qui est, lui, financé par les chargeurs.
M. Ian WHITE : D'un point de vue pratique, la coopération est très importante parce que, si les experts recrutés étaient différents et le sinistre considéré comme deux accidents séparés par les deux parties, il serait beaucoup plus difficile pour le plaignant d'obtenir satisfaction.
Je voudrais ajouter que, dans le cas de l'Erika, le P&I club concerné et le FIPOL ont décidé de travailler en étroite collaboration et ont établi un bureau commun afin que les demandes d'indemnisation soient adressées à un interlocuteur unique.
Je veux dire par là que, pour que le système tout en étant à deux niveaux fonctionne, il faut qu'il existe entre ces derniers une très étroite entente.
M. George GREENWOOD : Il convient également de préciser que le protocole d'accord que nous avons signé avec le FIPOL n'a strictement rien à voir avec la convention.
M. le Rapporteur : Avec la CLC ?
M. Clément LAVIGNE : Avec les deux conventions existantes : il s'agit d'un protocole indépendant.
M. le Rapporteur : Quand a-t-il été signé ?
M. Christopher HAVERF : Il y a sept ou huit ans.
M. le Rapporteur : Il s'agit, en fait, d'une convention de coopération technique ?
M. Christopher HAVERF : Absolument !
M. George GREENWOOD : Ce protocole n'a rien à voir avec les conventions. Nous l'avons rédigé volontairement avec le FIPOL. Il est totalement indépendant. En théorie, nous pourrions décider d'assumer nos responsabilités tout à fait séparément, c'est-à-dire faire face aux demandes de remboursement qui nous incombent, sans nous occuper de ce qui se passe côté FIPOL. Pour autant, en trente ans, nous avons développé une coopération et pris conscience qu'il allait de l'intérêt des personnes demandant à être indemnisées d'avoir un bureau unique et un seul interlocuteur.
M. Ian WHITE : J'aimerais revenir sur une question qui nous est souvent posée à propos des méthodes utilisées par le FIPOL pour traiter les réclamations et demandes d'indemnisation. Certaines sont considérées comme raisonnables, comme recevables, d'autres non, ce qui nous amène à déterminer des catégories sur lesquelles il convient sans doute de dire quelques mots.
M. le Rapporteur : Vous serait-il possible d'approfondir un peu ce concept de « raisonnable » ?
M. Ian WHITE : C'est précisément le point que je souhaitais éclaircir. Le FIPOL existe depuis trente ans et ce sont les gouvernements, qui sont, en fait, les parties à la convention du fonds, qui ont établi un certain nombre de règlements et d'orientations concernant la couverture des demandes d'indemnisation.
Il faut savoir que ces grandes orientations sont publiées par le FIPOL pour assurer une uniformité, une homogénéité, du système du fonds. Cela revient à dire qu'une demande d'indemnisation émanant du Japon, devra recevoir le même accueil que celle émanant de la France, du Royaume-Uni ou du Danemark. Il faut que le système puisse fonctionner comme une organisation mutuelle, ce qui suppose donc qu'il y ait une cohérence au sein du FIPOL.
C'est là un point très important à souligner car les demandes de remboursement qui sont discutées par le FIPOL le sont en fait avec tous les gouvernements : par exemple, lors de la discussion d'un cas survenu au Japon, les questions difficiles qui peuvent être soulevées par la délégation française ou britannique doivent normalement recevoir le même traitement ! Finalement, ce sont, au sein du FIPOL, les gouvernements qui sont responsables de l'élaboration de ces grandes lignes directrices qui déterminent l'admissibilité ou la non-admissibilité des demandes d'indemnisation. J'ajoute que ce sont aussi les gouvernements qui décident d'interroger les autorités responsables du lieu où s'est produit le sinistre.
Il est donc important de retenir que c'est un ensemble de règles homogènes qui s'appliquent toujours, partout, et non pas une règle mise en place pour traiter d'un cas particulier.
M. Watkins vient de me rappeler un exemple remontant à la fin des années quatre-vingt qui illustre parfaitement mon propos. Une méthode particulière avait cours dans l'ex-Union soviétique pour calculer le montant des indemnisations : ce système voulait que l'on calcule le nombre de litres d'eau de mer contaminés par la pollution due à un déversement d'hydrocarbures, puis que l'on établisse une certaine valeur, fixée en roubles, par litre d'eau afin de déterminer le montant de l'indemnisation réclamée. Les délégations du FIPOL n'ont évidemment pas accepté cette méthode de calcul théorique de l'indemnisation due...
M. le Rapporteur : Mais en aucun cas cela ne dépassait le montant forfaitaire de 1,2 milliard de francs ?
M. Ian WHITE : Si j'ai pris cet exemple, ce n'est pas pour évoquer un montant particulier. Qu'il y ait eu ou non, dépassement de plafond importe peu : ce qui est intéressant c'est que la délégation du FIPOL a opposé une fin de non-recevoir à cette méthode de calcul des indemnisations, qu'elle se conforme à de grandes lignes directrices pour ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Cet exemple illustre bien l'uniformité du système !
M. le Rapporteur : Mais, vous, les P&I Clubs, êtes, en fait, exclus de la discussion sur l'attribution des fonds FIPOL ?
M. D.J.L. WATKINS : Oui, mais ces règles existent et nous les suivons à notre niveau.
M. le Rapporteur : Ma question concernait peut-être plus M. Jacobsson mais comme vous êtes liés et qu'en droit français ce concept de recevabilité n'est pas très clair, je me suis permis de vous demander ce que vous entendiez par des demandes « raisonnables ».
M. Ian WHITE : La manière la plus simple de l'expliquer est encore de dire que nous essayons simplement de trouver la solution la plus appropriée, celle qui, au vu des circonstances particulières, se justifie parfaitement au plan technique. Nous avons maintenant une expérience de trente ans en matière de nettoyage de la pollution par hydrocarbures et il convient simplement d'appliquer la meilleure technique, la meilleure technologie, avec la plus grande efficacité possible pour atteindre ce fameux résultat « raisonnable ».
M. George GREENWOOD : Il est encore un point que j'aimerais souligner concernant le contexte juridique dans lequel opère le FIPOL.
Les représentants des différents gouvernements présents au FIPOL sont issus de traditions juridiques différentes et ils ont peut-être aussi, compte tenu de leur bagage et de leur éducation juridique, des idées un peu différentes de ce qui peut être considéré comme étant raisonnable ou comme ne l'étant pas.
Toujours à propos de ce concept, il faut savoir que cette notion, au sein du FIPOL, résulte d'une sorte de mélange, de consensus ou de compromis entre tous les gouvernements : il est essentiel, par exemple, que la délégation japonaise ait foi dans les normes édictées et que ces dernières reçoivent également un écho très favorable des autres délégations par rapport au code civil et à la tradition juridique qui sont les leurs.
Cela suppose un compromis que le FIPOL s'efforce d'atteindre à travers cette solution « raisonnable ».
M. Ian WHITE : Précisément, notre organisation, l'ITOPF, sert souvent de référence au FIPOL ou aux P&I Clubs parce que nous avons notre mot à dire sur ce qui peut servir cette uniformité, sur ce qui constitue la meilleure solution au plan technique, compte tenu des circonstances particulières. Évidemment, ce n'est pas un système manichéen et il ne s'agit pas de dire que telle ou telle chose est entièrement raisonnable ou déraisonnable. Il faut une souplesse, une marge de man_uvre.
Ainsi, il y a vingt ans, le Royaume-Uni, a connu une très importante pollution par hydrocarbures et la seule technique dont le gouvernement britannique disposait, à l'époque, était le recours aux produits chimiques dont tous les experts et techniciens rassemblés s'accordaient à dire qu'ils étaient inefficaces.
Malgré tout, le gouvernement, pour satisfaire l'opinion publique et prouver qu'il s'attelait au nettoyage, a persisté à utiliser ces produits pendant vingt jours, moyennant, ainsi que vous pouvez l'imaginer, un coût très important.
Nous avons considéré qu'au plan technique cette solution inefficace n'était nullement raisonnable et que le gouvernement britannique s'était livré à un exercice de relations publiques. Quand nous parlons de solution « raisonnable », nous tentons d'empêcher les gens de gaspiller des sommes phénoménales dans des techniques qui, de toute façon, ne portent pas leurs fruits d'autant qu'il faut savoir que les fonds ainsi dépensés ne sont pas, par la suite, reversés à ceux qui présentent des demandes d'indemnisation, notamment la communauté des pêcheurs. Dans le cas que je viens d'évoquer, le Royaume-Uni n'a pas obtenu d'indemnisation pour l'emploi de ces produits chimiques dont nous avons considéré qu'ils correspondaient à un véritable gaspillage.
J'en viens au mot de la fin : le recours à des produits chimiques, surtout en grande quantité quand bien même la preuve de leur efficacité pour nettoyer les dégâts dus aux hydrocarbures serait apportée, peut entraîner des dommages pour l'environnement. Aussi, dans certaines circonstances et dans certaines parties du monde, nous sommes farouchement opposés à leur utilisation, notamment lorsqu'elle risque de porter préjudice aux activités de pêches.
En résumé et pour en revenir à cette notion de « raisonnable » - cela renvoie au début de mon propos - nous essayons, en fait, de trouver la meilleure réponse technique possible, vu les circonstances.
M. le Rapporteur : Nous avons reçu, ce matin, dans le cadre des auditions de la commission, un petit chargeur pétrolier français qui nous faisait observer une contradiction très lourde et qui m'a frappé.
Dans l'affaire de l'Erika, l'armateur va toucher le prix de son bateau, soit 80 millions de francs, les P&I Clubs vont payer, en son nom, 60 millions de francs et tout le reste sera pris en charge par l'affréteur. Puisque le FIPOL, l'affréteur, va payer près de 1,2 milliard de francs, Total peut-être un milliard de francs pour sa propre image - nous en sommes actuellement à 700 ou 800 millions de francs mais on peut avancer la somme d'un milliard de francs - l'Etat français, entre un milliard et 1,5 milliard de francs qu'il ne pourra pas se faire rembourser par le FIPOL, étant donné l'étendue prévisible du préjudice touristique et sachant qu'il a annoncé qu'il se présenterait le dernier, on peut en déduire que les armateurs sont les hommes les plus heureux du monde...
M. George GREENWOOD : Sans parler de l'Erika, ni chercher à savoir si les sommes dépassent ou non la limite, je vous propose de voir comment le système est actuellement construit. La première chose qu'il ne faut pas perdre de vue c'est que ce système n'est pas fondé sur la notion de culpabilité ou de faute : c'est un système coopératif et nous veillons à ce que la personne qui émet une demande d'indemnisation soit effectivement indemnisée.
M. le Rapporteur : Cela vaut pour le FIPOL ?
M. George GREENWOOD : C'est également vrai pour les armateurs et les P&I Clubs ! Toutes les conventions internationales, qu'il s'agisse de la convention internationale sur la pollution ou de celles portant sur tous les autres types de responsabilités associées au transport maritime, se fondent sur le tonnage. Il est important de savoir que c'est une tradition établie de longue date puisqu'elle remonte au début du siècle dernier : c'est un système que nous utilisons depuis très longtemps pour évaluer les responsabilités des armateurs et qui n'est donc pas spécifique aux P&I Clubs. Si l'on recense les sinistres qui, survenus au cours des trente dernières années, ont généré des pollutions par hydrocarbures, on s'aperçoit que, justement, ce sont les grands navires qui payent le plus...
M. le Rapporteur : Vous voulez dire qui cotisent le plus ?
M. George GREENWOOD : Les grands navires payent plus car leur limite de responsabilité est beaucoup plus importante que celle des petits navires : c'est un point qui est entériné dans les conventions et qui correspond à ce que l'on appelle un « barème glissant ». Par conséquent, un grand navire qui n'aurait commis aucune faute paierait beaucoup plus du seul fait de sa taille. Dans le cas présent, on peut très bien considérer qu'il s'agit d'un petit navire et qu'en plus l'armateur est en faute, mais ce n'est pas du tout ce qui nous inquiète ou ce qui nous intéresse : le système vise à indemniser en cas de demande d'indemnisation. On constate qu'au cours des trente dernières années, les armateurs ont plus payé et fait face aux demandes de remboursement que les affréteurs car, dans la plupart des cas, les plafonds ne sont pas dépassés.
M. le Rapporteur : Vous avez des statistiques sur le fait que les remboursements en cas de pollution n'ont pas dépassé le montant de l'assurance des armateurs ?
M. George GREENWOOD : La limite supérieure pour les grands navires est très importante puisqu'elle s'élève à 90 millions de dollars !
M. le Rapporteur : Il vaut donc mieux être pollué par un gros bateau...
M. George GREENWOOD : En réalité, cela n'a pas d'incidence sur le montant disponible mais sur sa répartition entre les P&I Clubs et le FIPOL.
M. le Rapporteur : J'aimerais des exemples, et c'est intéressant !
M. Ian WHITE : Je peux vous montrer une représentation graphique du phénomène avec les francs français en ordonnée et la taille des pétroliers en abscisse : on voit bien que plus le navire est gros et plus l'armateur et son assurance doivent payer, même si le montant total reste le même.
M. le Rapporteur : Nous nous interrogeons sur le point de savoir si le critère de poids et de taille est le bon et s'il n'est pas déresponsabilisant dans la mesure où n'interviennent ni la qualité, ni l'âge du bateau. Vous-mêmes, intervenez-vous par rapport au ratio âge-qualité ? Si tel n'est pas le cas, le système est déresponsabilisant car le FIPOL et la CLC peuvent alors apparaître comme une garantie pour un droit de pollution...
M. Christopher HAVERF : Les P&I Clubs examinent l'état et l'âge du navire de façon très circonspecte avant d'accepter de l'assurer. Néanmoins, ils préfèrent s'en tenir à la notion de stricte responsabilité et de paiement indépendamment de la notion de faute afin d'assurer assez rapidement une indemnisation à ceux qui en ont fait la demande. Autrement, il faudrait ouvrir une enquête à la suite du sinistre ce qui prendrait beaucoup de temps et retarderait d'autant le remboursement des personnes ayant demandé à être indemnisées.
Je suis d'accord pour dire que, dans le cas de l'Erika, un certain nombre de questions se posent en ce qui concerne notamment les contrôles de qualité, la classification, les inspections etc. Tout cela est vrai mais, encore une fois, il ne faut pas que cela se retourne précisément contre ceux qui ont demandé à être indemnisés, et nuise aux armateurs et aux affréteurs.
M. George GREENWOOD : Il serait peut-être utile de citer des exemples illustrant les conséquences de l'application d'un système fondé sur une responsabilité pour faute. Dans certains cas, des personnes demandant à être indemnisées ont essayé de poursuivre les armateurs en dehors du territoire couvert par le FIPOL et de la convention. Il y a notamment le fameux cas de l'Amoco-Cadiz, que vous connaissez tous, où les plaignants se sont rendus devant les tribunaux américains, ce qui a pris dix ans...
M. le Rapporteur : Plus que cela !
M. George GREENWOOD : Quatorze ans...
M. le Rapporteur : Même vingt ans pour finir !
M. George GREENWOOD : C'est possible !
Il est un second cas très connu, celui du Tanio, qui, lui, n'est pas un contre exemple puisque, dans le cas d'une pollution d'un navire de dimension relativement modeste, il n'a fallu que deux ans pour régler toute l'affaire, et cela précisément parce que le système n'était pas fondé sur la responsabilité pour faute, ce qui a permis à ceux qui avaient demandé à être indemnisés de l'être et très rapidement.
Vous avez évoqué le fait qu'il fallait éviter d'être déresponsabilisant pour les armateurs susceptibles d'être tenus pour responsables d'une pollution accidentelle, cela nous incite à réfléchir à la manière d'améliorer notre système pour éviter que de tels dommages ne se reproduisent à l'avenir.
Ainsi que nous l'avons déjà expliqué dans les documents que nous vous avons soumis, nous ne pensons pas qu'il soit bon d'augmenter les montants des fonds disponibles à des fins d'indemnisation. Nous estimons qu'il faut augmenter les fonds disponibles de la CLC et du FIPOL mais, pour ce qui est des petits navires en mauvais état, nous pensons qu'il est préférable de faire appel à d'autres méthodes et d'aborder la question sous d'autres aspects.
M. le Rapporteur : C'est-à-dire ?
M. George GREENWOOD : Nous sommes tout à fait ouverts à toutes les idées susceptibles de nous aider à faire mieux fonctionner les sociétés de classification, à améliorer le contrôle des Etats portuaires. Il s'agit là d'actions ciblées, qui peuvent nous aider à réduire le nombre de cas de pollution accidentelle par des navires qui ne seraient pas aux normes. En revanche, nous ne pensons pas qu'augmenter les fonds d'indemnisation de 300, 400 ou 500 millions de dollars puisse nous aider à remédier à des situations de ce type.
M. Clément LAVIGNE : Il convient peut-être de préciser que M. Greenwood parle des fonds de responsabilité individuelle des navires.
Si on augmentait la responsabilité individuelle d'un navire, cette dernière pourrait toujours être assurée. Cette mesure n'inciterait donc pas à éviter le recours à des navires de mauvaise qualité. M. Greenwood estime que le problème ne porte pas tant sur les montants disponibles sous CLC et FIPOL que sur d'autres facteurs responsabilisants en termes de pénalités financières.
M. George GREENWOOD : Pour être encore plus précis, il est permis de se poser une autre question : pourquoi faut-il que ce soit les cargaisons les plus polluantes - en l'occurrence, il s'agit des hydrocarbures lourds - qui soient acheminées par les bateaux en plus mauvais état ? C'est ce genre de questions qu'il convient de se poser pour éviter à l'avenir toute pollution accidentelle comme celle de l'Erika. C'est sur ce type de problématique qu'il faut mettre l'accent.
M. le Rapporteur : Quel genre de réponses y apporter ? Ce bateau présentait toutes les garanties de classification et le RINA - Registro Italiano Navale - vient de publier son rapport en disant qu'il avait accompli son travail.
M. George GREENWOOD : Nous venons d'évoquer l'Erika : je ne pense pas qu'il faille examiner un cas spécifique en détail mais considérer plutôt qu'il convient d'améliorer le fonctionnement des sociétés de classification. C'est d'ailleurs une idée tout à fait admise par l'IACS (Association internationale des sociétés de classification) qui est l'organisme de tutelle de toutes les autres. L'IACS vient d'ailleurs de remettre un rapport indiquant les voies et moyens pour perfectionner le système. Pour notre part, nous pouvons examiner les changements à apporter à nos règles communes pour introduire plus de transparence et nous permettre d'être mieux à même de comprendre les différents aspects du processus de classification.
En outre, les responsables du contrôle des Etats portuaires, et les sociétés de classification elles-mêmes peuvent également apporter leur pierre à l'édifice en vue d'améliorer le processus : des progrès sont possibles, surtout si nous bénéficions de l'appui des gouvernements.
Je peux citer l'exemple d'une démarche spécifique qui est de nature à améliorer les choses - sans revenir sur le cas de l'Erika, c'est sans doute une leçon que nous en avons tirée. Il existe, en effet, une mesure technique très importante à laquelle procède l'IACS en examinant l'état des navires qui consiste à évaluer très précisément les dégâts dus à la rouille, c'est-à-dire la perte d'acier du navire et, grâce à des ultrasons, à mesurer l'épaisseur du métal de la structure du navire.
Cependant, il y a des sociétés de classification de l'IACS qui permettent aux armateurs d'avoir recours à des techniciens extérieurs pour effectuer ces mesures, dans de nombreux cas, ce ne sont pas les sociétés de classification mais l'armateur qui a recours au service d'une société tierce qui soumet, ensuite, ses résultats à la société de classification.
L'IACS dans son rapport, suggère - et on peut d'ailleurs se demander pourquoi cela n'a pas été fait avant - que toutes les mesures d'épaisseur du métal effectuées par ultrasons soient surveillées par un technicien appartenant à la société de classification.
Je ne peux pas me prononcer sur le cas de l'Erika car j'ignore si les mesures par cette méthode d'ultrasons ont été bien effectuées, si l'épaisseur de l'acier a eu une importance dans l'affaire mais, pour les vieux navires, il convient de s'assurer que la procédure a correctement été suivie. J'estime que cette suggestion qui figure dans le rapport de l'IACS constitue vraiment un pas en avant, car c'est en revenant sur des normes techniques et en vérifiant que les sociétés de classification exercent une surveillance que nous parviendrons à progresser.
Bien sûr, nous ne sommes pas techniciens et nous devons faire confiance aux sociétés de classification pour apporter ces réponses techniques. Nous ne prétendons pas connaître, ni détenir tous les moyens pour améliorer le système mais nous savons qu'il peut être amélioré et qu'il doit l'être.
M. le Rapporteur : En réalité, les armateurs pouvaient, dans certains cas, faire venir des techniciens à leurs propres frais ce qui rendait le diagnostic litigieux mais ce sont les mêmes armateurs qui payent les sociétés de classification et on nous a dit que des certificats de complaisance sont délivrés moyennant, éventuellement, des dessous de table.
Nous étions, hier à Marseille où nous avons discuté avec un commandant italien qui a reconnu très franchement que cela arrivait. Dans ces conditions, ne faudrait-il pas créer une instance de contrôle des sociétés de classification, une espèce de lieu d'appel du diagnostic de la société de classification ? Vous êtes-vous déjà, vous-même, posé cette question ?
M. George GREENWOOD : La Commission européenne, elle-même, peut déjà contrôler les sociétés de classification. Il existe même une directive lui permettant d'exercer ce pouvoir, qui est actuellement en train d'être renforcée !
M. D.J.L. WATKINS : Il est important de rappeler aussi que l'IACS vient très récemment, puisque cela ne date que de deux ans, de mettre en place, pour surveiller ses normes de qualité un comité où sont invités des intervenants de différentes industries et de différents secteurs. Nous avons pris une participation active à ces réunions et nous avons vraiment l'espoir que le travail de ce comité aura un impact sur le fonctionnement des sociétés de classification.
M. George GREENWOOD : On peut également aborder ce problème des sociétés de classification par un autre biais.
En effet, il faut savoir qu'actuellement, dans les contrats qui lient les armateurs et les sociétés de classification, ces dernières spécifient qu'elles ne sont pas responsables, ou alors vraiment pour un montant infime, en cas de négligence de leur part au cours d'une enquête de classification. Nous avons déclaré haut et fort que c'était là un point qu'il s'agissait d'examiner de très près !
M. le Rapporteur : Ah oui ! Je ne savais pas cela...
M. George GREENWWOD : Nous ne voulons pas pousser à la faillite les sociétés de classification dont nous savons que beaucoup s'acquittent, et s'acquittent bien, d'une tâche très difficile : toutes les sociétés de classification ne sont pas corrompues ; ce sont quelques cas isolés qui posent problème. Les sociétés de classification se montrent très préoccupées de cette question de la responsabilité or, pour ce qui nous concerne, nous souhaiterions qu'elles soient tenues pour responsables. En effet, souvent, c'est, non pas la société de classification qui est responsable dans l'absolu, mais une personne qui travaille en son sein. Il faut donc que cet individu puisse se dire: « si je commets une erreur, on pourra poursuivre l'ensemble de ma société et lui demander une indemnisation importante, donc je dois faire attention ! » Ce raisonnement qui est le nôtre vise à encourager celui qui travaille pour la société à se montrer très attentif lors de l'enquête.
M. le Rapporteur : Je suis désolé car mon emploi du temps m'oblige à interrompre nos travaux mais je suis ravi que nous ayons pu aller plus au fond des choses.
M. Christopher HAVERF : Si des questions supplémentaires vous venaient à l'esprit, n'hésitez surtout pas à nous en faire part.
M. Clément LAVIGNE : Avant de nous séparer, je précise que l'ITOPF avait produit un document que nous vous avions remis uniquement en anglais. Comme il traite de nombreux points dont nous avons discuté aujourd'hui, nous allons vous en faire parvenir la traduction.
Audition de M. Dominique RAIN,
responsable transports à l'Union des industries chimiques,
et de M. Denis TUAL,
directeur du transport maritime d'Ato-Fina
(extrait du procès-verbal de la séance du 2 mai 2000)
Présidence de M. Jean-Yves LE DRIAN, Rapporteur
MM. Dominique Rain et Denis Tual sont introduits.
M. le Président leur rappelle que les dispositions législatives relatives aux commissions d'enquête leur ont été communiquées. A l'invitation du Président, MM. Dominique Rain et Denis Tual prêtent serment.
M. Dominique RAIN : Monsieur le président, madame et messieurs les députés, l'Union des industries chimiques est l'organisation professionnelle de notre secteur.
Elle regroupe, à travers ses chambres régionales et ses syndicats sectoriels, environ 1000 entreprises, soit 235 000 personnes qui sont rattachées à la convention collective de la chimie : 165 000 directement et 65 000 via des syndicats associés qui correspondent à ce que l'on appelle en général « la parachimie ».
Pour en venir au transport maritime qui est l'objet de notre audition, je voudrais préciser que, selon les chiffres officiels, la valeur des exportations de notre secteur a été, en 1999, de 264 milliards de francs. Celle des importations a atteint 211 milliards de francs, ce qui correspond donc à une balance commerciale excédentaire de plus de 53 milliards de francs.
De ces chiffres, en intégrant le cabotage intraeuropéen, on peut déduire que la valeur des produits chimiques, ayant pour destination finale ou pour origine la France et qui ont été transportés par mer - je précise que cela ne signifie pas qu'ils sont passés par des ports français -, s'élève à environ 160 milliards de francs.
Une première analyse aurait pu laisser penser que notre secteur industriel était extérieur au champ d'investigation de votre enquête. En effet, les accidents maritimes que nous avons connus durant les cinquante dernières années, et dont les conséquences ont été dramatiques pour les côtes françaises, ont été des accidents de navires-citernes de produits pétroliers et, plus précisément, de produits pétroliers rémanents donc de pétrole brut et de fioul.
C'est ainsi qu'à la table ronde présidée par le ministre de l'équipement, des transports et du logement seuls les chargeurs de l'industrie pétrolière étaient présents et que les mesures prises ne concernaient que leur secteur.
Toutefois, vous vous êtes interrogés à plusieurs reprises sur la sécurité d'autres transports que celui des produits pétroliers.
Il est vrai que les produits chimiques transportés sont souvent - mais pas exclusivement - des marchandises dangereuses qui présentent les risques chimiques bien connus - incendie-explosion, toxicité, corrosivité - et, beaucoup plus rarement, en quantité minime, des produits pouvant entraîner une pollution importante.
A ce stade, on peut dire que les problèmes de sécurité dans le transport maritime des produits chimiques se posent surtout dans les ports puisque s'y concentrent les risques chimiques précités, relativement localisés, notamment pour ce qui concerne les produits d'importation quand les spécifications ne sont pas respectées.
Pour que cet exposé soit plus concret, je vais maintenant passer la parole à mon collègue, M. Denis Tual, qui pourra vous parler de son expérience en entreprise.
M. Denis TUAL : Je suis responsable des transports maritimes, non plus d'Elf Atochem mais d'Ato-Fina, nouvelle appellation qui fait suite à la fusion Total-Elf intervenue il y a quelques jours : Total Fina Elf est notre maison-mère et la partie chimie répond au nom d'Ato-Fina depuis le 17 avril.
Je souhaiterais décrire brièvement quelle est la demande à satisfaire quand on parle de transport maritime concernant les produits chimiques et, pour ce faire, je commencerai par exposer la grande diversité des produits en jeu.
Cette diversité dans les produits chimiques joue sur les volumes transportés puisque nous pouvons aussi bien parler d'exportation ou de transport de lots unitaires - qui sont inférieurs au kilogramme quand il s'agit de produits transportés en conteneurs maritimes de groupage - que de lots pouvant atteindre 35 000 tonnes.
Par rapport aux produits pétroliers, ces 35 000 tonnes représenteront une taille maximale compte tenu du fait que les dimensions classiques des navires proposés pour transporter de la chimie en liquide sont d'une taille du même ordre.
La diversité s'applique donc aux volumes mais aussi à la présentation des produits qui peuvent aussi bien être des gaz que des liquides ou des solides.
Cette diversité s'observe également dans les industries concernées, que ce soit au niveau des clients ou des fournisseurs. Sur les 1000 adhérents de la parachimie dont M. Rain parlait tout à l'heure, certains produisent de la peinture, d'autres du caoutchouc, d'autres des chimies différentes, car il y a une grande variété d'intervenants qui peuvent être considérés comme producteurs ou utilisateurs de produits chimiques.
Cette diversité intervient aussi au niveau de la dangerosité des produits. Comme les risques sont beaucoup plus des risques de corrosion, d'explosion ou de toxicité que des risques de pollution rémanente ou visuelle, ils pèsent davantage sur l'interface portuaire que sur l'environnement. Par ailleurs, certains produits de cette liste ne présentent, quant à eux, aucun risque puisqu'il s'agit de compatibles alimentaires.
Vous pouvez donc mesurer la grande variété des produits auxquels nous avons affaire.
Une des caractéristiques des produits transportés par voie maritime est leur sensibilité à la contamination.
Pour garantir une qualité totale au client et respecter l'intégrité du produit, nous nous devons d'assurer que le produit ne souffre aucune contamination. Alors que nous parlons du transport de plusieurs milliers de tonnes, quelques PPM - parties par millions - de contamination, c'est-à-dire des traces de contamination, peuvent suffire à remettre totalement en cause l'intégrité du produit et le rendre impropre à la consommation.
C'est la raison pour laquelle, dans le secteur de la chimie, l'attention est en permanence focalisée sur le respect des spécifications du produit, tant lors de son chargement que pendant son voyage ou à son arrivée. Cette préoccupation explique les contraintes très sévères et très caractérisées qui sont imposées à la flotte chimique.
Nous avons besoin d'une offre de transport qui reflète cette grande diversité des produits.
Nous envisageons donc le transport de produits chimiques aussi bien par lignes régulières - lorsqu'il s'agit de conteneurs secs qui peuvent charger des fûts, des sacs ou de petits emballages de n'importe quel type -, que par affrètement vrac dans des navires-citernes - qui peuvent aller du petit navire de 2 000 ou 3 000 tonnes jusqu'au navire de 40 000 tonnes au maximum pour les transports parcellaires.
Pour ne parler, dans un premier temps, que de la ligne régulière, je préciserai qu'une grande partie des produits chimiques sont transportés dans des conteneurs qui répondent à la réglementation internationale du code IMDG - réglementation du transport maritime de marchandises dangereuses. Grâce à un système conteneurisé qui a évolué tout au long des dernières années, les conteneurs sont devenus traçables. Nous pouvons ainsi, à chaque moment, par des systèmes de traçabilité savoir où se trouve le conteneur de produits chimiques, quand bien même nous avons - du fait de la très grande organisation du monde des armateurs - du mal à identifier le navire sur lequel il a été embarqué.
Autant nous savons précisément avec quelle compagnie nous allons travailler, autant l'actuel système des consortiums ou des conférences place un écran complet entre le chargeur et le navire
Nous essayons - et je pense que nombre de vos collègues se penchent sur ces dossiers -, via d'autres instances de chargeurs, de faire condamner ce système « conférenciel » qui est aujourd'hui le seul cartel autorisé au monde et qui constitue un frein à la pleine connaissance et à la pleine transparence de la qualité des navires utilisés.
Le transport de vrac bénéficie de beaucoup plus de transparence. Dès qu'il s'agit de transporter en vrac, quatre types de navires sont proposés :
- les parcel tankers qui prendront des lots pouvant aller de 200 tonnes à 5 000 tonnes, ce sont des navires variant entre 2 000 et 40 000 tonnes, tout à fait différents de leurs homologues de même taille du transport pétrolier puisqu'un navire de 40 000 tonnes peut compter une cinquantaine de cuves différentes, chacune étant reliée par une ligne particulière ;
- les navires spécialisés gaziers : ils sont capables de charger à très froide température ou à très forte pression, tels les méthaniers ou les éthyléniers ;
- les product chimical tankers : ils pourront être utilisés pour le transport de la chimie très simple de type méthanol et se situent à la marge entre le transport pétrolier et celui de produits propres selon qu'ils transportent des naphtas et autres essences ou de la chimie ;
- la flotte de produits secs qui se compose de petits vraquiers dont la taille approche généralement les 4 000 ou 5 000 tonnes : ils peuvent être aussi bien des céréaliers que des charbonniers, qui peuvent transporter des phosphates, des nitrates ou des engrais qui, eux aussi, seront baptisés « produits chimiques ».
Le nombre de navires est assez réduit : pour les seuls navires chimiques, donc les navires uniquement liquides et gaziers, on peut avancer le chiffre de 1 700. Nous savons que 70 % environ de cette flotte est contrôlée par quatre armateurs de très grande taille qui travaillent sur des métiers très techniques du fait des caractéristiques de ces produits chimiques.
M. le Président : De qui s'agit-il ?
M. Denis TUAL : Les quatre sociétés les plus importantes sont Stolt-Nielsen, Jo Tankers, Tokyo marine, et Odfjell Tankers qui vient de fusionner avec Sea Chem. Ce sont donc maintenant quatre groupes, au lieu de cinq, comme c'était le cas il y a quelques mois, qui se partagent 70 % du marché.
Ces navires sont des navires sophistiqués qui doivent répondre à toutes les contraintes qu'imposent les produits chimiques, spécialement en matière de lutte contre la contamination. Pour cela, ils doivent être multicuves, pouvoir se rincer très facilement et supporter des inertages et des azotages, autant d'obligations assez fortes.
Généralement, ce sont des navires à revêtement inox dont la structure elle-même garantit une solidité beaucoup plus importante que celle des navires-citernes pétroliers.
Ils représentent des investissements très importants puisque la construction d'un parcel tanker de 35 000 tonnes comportant une cinquantaine de cuves coûte à peu près 80 millions de dollars, soit le prix d'un VLCC de 300 000 tonnes !
La sophistication des navires constitue en elle-même une barrière très importante pour les armateurs. Cette caractéristique explique que l'on ne trouve pas, dans la chimie, de petits armateurs et que le marché se concentre dans les mains de quelques-uns.
Le voyage type d'un parcel tanker de ce tonnage consiste à acheminer dans une cinquantaine de cuves, une vingtaine, voire une trentaine de produits différents confiés par une dizaine de chargeurs différents, avec une dizaine de ports de chargement et autant de ports de déchargement, ce qui impose à l'armateur de disposer d'un réseau mondial.
Pour effectuer un voyage type, l'armateur doit trouver une multitude de chargeurs et de produits, ce qui constitue une seconde barrière à l'entrée sur ce marché pour les armateurs.
L'armateur purement régional qui voudra faire de la chimie avec un seul navire aura bien du mal à trouver preneur. On peut donc dire que le marché est limité par une barrière à la fois humaine et capitalistique.
Du fait du récent développement de la chimie, la flotte chimiquière est beaucoup plus jeune que la flotte pétrolière puisque seulement 20 % de ses navires ont plus de vingt ans et que 20 % d'entre eux, suite à l'important programme d'investissement mis en place ces dernières années, ont moins de cinq ans.
On travaille, là, sur des contraintes et dans un monde un peu différents, l'exception pouvant être le transport des produits chimiques secs tels que les phosphates et nitrates, par exemple.
M. le Président : Si j'ai bien compris sur les 1700 bateaux que compte la flotte chimiquière, seuls 20 % ont plus de vingt ans ?
M. Denis TUAL : Exactement !
M. Dominique RAIN : Nous tenons ces informations du grand courtier maritime Barry Rogliano Salles : nous ne les avons pas inventées !
M. Denis TUAL : Ce chiffre de 1700 navires ne concerne que les bâtiments transportant des produits liquides et des gaz, mais on connaît moins la flotte plus vieille qui transporte des produits solides : je pense notamment aux phosphates qui sont acheminés sur des transporteurs de produits secs ou de clinkers, à l'image des minéraliers ou autres.
Cette flotte est plus ancienne et ne présente pas ce caractère de technicité avancée qu'imposent les produits précédents. C'est d'ailleurs une flotte beaucoup moins contrôlable parce que plus diversifiée.
Voilà donc ce qu'il en est de la présentation rapide des contraintes inhérentes aux produits eux-mêmes et de la flotte qui est à notre disposition.
Je vais maintenant passer la parole à M. Rain qui vous entretiendra de l'attitude générale des chargeurs chimiques en France et en Europe et des mesures prises pour garantir la sécurité des navires que nous affrétons.
M. Dominique RAIN : Pour ne pas abuser de votre patience, je voudrais juste, sous forme de conclusion, vous dire que l'industrie chimique a, en tant qu'industrie, pris conscience depuis de nombreuses années qu'elle ne pouvait poursuivre ses activités qu'en adoptant une attitude responsable.
Tel est l'objet de « l'engagement de progrès de l'industrie chimique », connu sous la formule anglo-saxonne de « responsible care ». Il prévoit l'engagement volontaire, par le biais d'une charte librement signée par les entreprises, d'apporter une contribution au développement durable, non seulement par des progrès dans l'industrie chimique et par une amélioration constante de l'hygiène et de la sécurité de l'environnement dans nos usines, mais aussi par une politique de gestion responsable des produits ainsi que par une politique active tant interne qu'externe.
Au-delà des mots, comment, me direz-vous, se concrétise ce discours au niveau du transport maritime ?
Nous avons décliné cet engagement au niveau du transport maritime depuis une dizaine d'années, en l'articulant autour de deux axes.
Premièrement, pour ce qui concerne les navires-citernes consacrés au transport des liquides et des gaz tels que définis précédemment par M. Tual, la CEFIC - Confédération européenne de l'industrie chimique - a créé, dès les années quatre-vingt-dix le CDI - Chemical Distribution Institute -, d'origine anglo-saxonne.
Cet organisme a pour vocation, sur la base de règles communes, de faire inspecter les navires par des inspecteurs indépendants qu'il forme spécialement à cette fin. Leurs rapports d'inspection sont à la libre disposition des membres du CDI. C'est quand même, là, une formule un peu différente de celle qui existe chez nos collègues - dont nous ne dirons pas de mal compte tenu du fait que, par ailleurs, ils sont nos actionnaires.
M. Denis TUAL : Ce Chimical Distribution Institute, qui se compose aujourd'hui de 33 membres, soit de toutes les grandes sociétés chimiques mondiales, a été fondé par 13 sociétés européennes, dont Elf Atochem, en 1994.
M. Dominique RAIN : S'agissant toujours du transport maritime, le SQAS cargo - Safety Quality Assessment System - a été créé dans les années 1995 et suivantes pour évaluer le système cargo. Il s'intéresse à la sécurité et à la protection de l'environnement pour les conteneurs, étant entendu qu'il ne s'attache, en fait, qu'au transport d'approche, aux cosignataires, aux transitaires et aux sociétés de manutention et qu'il laisse de côté, pour les raisons précédemment évoquées par M. Tual, le problème du navire.
En effet, si nous choisissons l'armateur, nous ne choisissons pas le navire : c'est comme cela et, aussi longtemps que les règles ne changeront pas et que les articles 85 et 86 du traité de Rome seront ce qu'ils sont, nous n'y pourrons pas grand-chose !
Deuxièmement, l'Union des industries chimiques a signé une convention avec le CEDRE - centre de documentation, de recherche et d'expérimentation -, dont les personnels, présents en permanence allient une haute compétence technique à une bonne maîtrise de l'anglais, chose assez rare en France. Par cette convention, le CEDRE, en raison de ses compétences et de son organisation, est considéré comme le pivot français du réseau européen de l'industrie chimique en cas d'accident de transport, étant précisé que ne sont pas uniquement visés les accidents de transport maritime mais également et plus particulièrement les accidents terrestres.
Notre brochure sur ce Responsible Care est là pour vous prouver que nous avons vraiment travaillé ce sujet, non pas spécifiquement pour le transport maritime, mais dans tous les domaines touchant à l'hygiène, à la sécurité et à l'environnement. Je vous en laisserai un exemplaire.
Je voudrais ajouter que le transport de produits chimiques s'intègre dans un marché mondial et se trouve, par là-même, soumis aux règles mondiales élaborées dans le cadre de l'OMI. Il existe une universalité à laquelle nous ne pouvons prétendre nous soustraire.
De son côté, la France se montre légitimement préoccupée par la protection de ses côtes et la sécurité de ses ports.
Parallèlement, une concurrence sévère s'exerce entre les ports européens. Dans ces conditions, la sécurité et le contrôle dans les ports français, quel que soit leur régime administratif - qu'il s'agisse de ports autonomes ou de ports d'intérêt national -, doivent être appliqués de manière indépendante par rapport à l'autorité gestionnaire. C'est du moins ma conviction personnelle.
M. le Président : Nous allons revenir sur ce point !
M. Dominique RAIN : Par ailleurs, la France a conquis une position importante dans le commerce international puisqu'elle y occupe la quatrième place, avec une balance largement excédentaire - comme nous venons de le voir, elle est de 53 milliards de francs rien que pour la chimie -, ce qui est l'_uvre des industriels français et de leurs personnels.
Simultanément, non seulement le transport maritime sous pavillon français s'est réduit à la portion congrue, mais pas un groupe à capitaux français ne figure parmi les grands armateurs mondiaux, même s'il se trouve que le secteur de la chimie est l'un des rares à avoir conservé un armateur national, en l'occurrence la Navale !
Sans vouloir aucun mal à l'armement français, force est de constater qu'il y a une disproportion considérable, ce qui m'amène à dire qu'il ne faut pas se tromper d'alliés.
Les pouvoirs publics français doivent défendre les chargeurs, c'est-à-dire les industriels et les emplois qu'ils génèrent. Pour ce qui est des armateurs, ils peuvent faire confiance aux grands pays armatoriaux et à leurs alliés !
Sauf à tourner autour du pot, je ne peux pas terminer sans reconnaître qu'il existe bien des problèmes de responsabilité et d'indemnisation et dire ce que nous en pensons.
Il est un principe auquel on fait souvent référence : celui du « pollueur-payeur ». Au niveau des principes, tout le monde est d'accord, mais encore faut-il bien identifier qui se cache derrière chaque mot !
Il nous apparaît probable qu'est pollueur celui qui a la gestion opérationnelle du transport. C'est le premier responsable et c'est sur lui que doit reposer, non seulement la responsabilité, mais également la charge de l'indemnisation. S'il faut fixer des plafonds, ces derniers doivent être les plus élevés possible, ne serait-ce que pour responsabiliser l'ensemble du système, c'est-à-dire l'armateur et son assureur par le biais de la prime d'assurance, et, par là-même, son chargeur qui in fine payera toujours. En effet, sans lui, il n'y aurait pas de transport, car le secteur du transport maritime ne vit que parce qu'il y a des chargeurs pour le payer et des gens qui y trouvent un intérêt : on ne transporte pas pour le plaisir de transporter !
Il faut donc que la responsabilité repose pour l'essentiel sur la personne qui assume la gestion opérationnelle du transport. S'il doit y avoir une mutualisation, il convient qu'elle s'opère à un niveau de plafond très élevé. D'ailleurs, nos amis Américains, qui font preuve d'un certain sens pratique et concret, ont parfaitement compris, pour ce qui concerne leur politique intérieure - car ce n'est pas toujours le cas lorsqu'ils votent dans le cadre de l'OMI - ce qu'ils devaient faire.
M. le Président : Merci pour cet exposé. Je vous prie d'excuser l'absence du président de cette commission d'enquête, M. Paul, qu'en ma qualité de rapporteur et en l'absence des membres du bureau, je supplée aujourd'hui.
J'ai été très intéressé par vos propos et j'aimerais pouvoir vous poser quelques questions complémentaires avant de céder la parole à ceux de mes collègues qui souhaiteront intervenir.
D'abord, en ce qui concerne la méthode, si j'ai bien compris l'UIC est un regroupement d'industriels ?
M. Dominique RAIN : C'est un syndicat professionnel.
M. le Président : L'UIC n'a donc pas directement de pouvoir d'intervention et d'action auprès des armateurs ? Elle n'intervient pas dans une quelconque politique du transport maritime : elle ne fait que comptabiliser, constater et inciter ?
Puisque vous êtes intervenus sur le sujet dans votre exposé liminaire, je crois bon de préciser que nous considérons que notre mission porte sur l'ensemble des produits dangereux ou polluants et non pas uniquement sur le pétrole !
M. Dominique RAIN : C'est bien parce que c'est ainsi que nous l'avons compris que nous avons levé le doigt et demandé à être entendus.
M. Le Président : Effectivement, et d'ailleurs, demain, nous auditionnerons des responsables de la COGEMA.
J'aimerais donc savoir quelle est la relation entre l'UIC et ses mandants, précisément sur ce problème du transport maritime.
M. Dominique RAIN : L'UIC n'est, malgré tout, que l'expression de ses mandants et, pour mener une politique dans un domaine donné, il faut agir au niveau de l'organisation professionnelle.
Pour être clair, je dirai que cela doit se faire un peu au niveau de l'organisation professionnelle nationale et souvent au niveau de l'organisation professionnelle européenne, car vous pouvez noter que sur les trois exemples que j'ai cités, deux se situaient au niveau européen, contre un seul - plus modeste du reste - au niveau français.
Les sociétés travaillant en même temps dans différents pays européens, c'est quand même dans le cadre de l'organisation professionnelle adéquate qu'un certain nombre de ces principes d'« engagement de progrès » et de responsible care sont déclinés. En effet, comme des problèmes de concurrence se posent entre les adhérents, c'est à ce niveau que des choses peuvent se faire ou se font !
M. Denis TUAL : La généralisation des bonnes pratiques, l'élaboration de meilleures pratiques sont développées chez les uns et diffusées chez les autres de façon à éviter tout groupement pour des problèmes de concurrence.
L'UIC pour la France et la CEFIC pour l'Europe servent vraiment de catalyseurs à la mise en _uvre de ces bonnes pratiques ou d'autres initiatives.
M. le Président : Pouvez-vous revenir plus en détail sur la charte des bonnes pratiques à laquelle vous avez fait référence précédemment ?
M. Dominique RAIN : Il y a plusieurs choses que je vais détailler car dans mon souci de brièveté j'ai peut-être été un peu confus.
Quand je parlais de charte, je faisais référence à l'« engagement de progrès » qui n'est pas propre au seul transport maritime - même si ce dernier y est inclus -, et qui concerne plus globalement le secteur chimique au niveau mondial. Cet « engagement de progrès » se décline en neuf principes directeurs que l'on appelle chez nous des principes HSE - hygiène-sécurité-environnement -, et qui portent aussi bien sur la vie industrielle que sur la vie des produits. S'il est bon d'élaborer des produits le plus proprement possible, encore faut-il donner naissance à des produits qui, de leur conception à leur destruction, seront les mieux adaptés à leurs objectifs et les plus favorables à l'environnement !
M. le Président : Il s'agit donc d'une charte globale d'engagement signée par l'ensemble des entreprises du secteur ?
M. Dominique RAIN : L'engagement de progrès a été signé par toutes les grosses entreprises et par quasiment toutes les entreprises de plus de 100 personnes.
M. le Président : Par l'intermédiaire de l'UIC ?
M. Dominique RAIN : Il a été signé à l'UIC !
M. Denis TUAL : Puisque vous parlez de charte de bonnes pratiques, il faut savoir qu'il en existe une pour les chargeurs européens.
Elle a été éditée, en 1998, par l'Association européenne des chargeurs - l'European Shippers'Council - pour les chargeurs, chimiques ou autres, et les utilisateurs de moyens de transport maritime. C'est un code de bonne conduite pour le transport maritime qui a été signé par un grand nombre de chargeurs européens, en liaison avec la Commission européenne.
M. le Président : C'est un document dont je découvre l'existence. Vous l'avez à votre disposition ?
M. Denis TUAL : J'ai apporté une base de présentation ainsi qu'un document sur le CDI que je vais vous remettre.
Ce code de bonne conduite renvoie en fait aux discussions qui ont actuellement lieu au sein de la Commission européenne dans le cadre de la campagne, lancée, il y a quelques années, en faveur du quality shipping, par le commissaire des transports.
Les chargeurs et les industriels ont été parmi les premiers à répondre à cet appel en signant cette charte de bonne conduite dont vous avez un exemplaire et qui présente le minimum d'engagements auxquels doit se soumettre un chargeur avant d'affréter un navire.
Ce document a été conçu sous l'égide de l'European Shippers' Council qui s'est trouvé chargé par la Commission, qui manifestait un vif intérêt à la chose, d'inciter les autres professions à entreprendre une démarche similaire. Pour l'instant, les choses en sont là et seuls les chargeurs industriels ont pu signer ce code de bonne conduite. Il faut attendre pour savoir si l'exemple sera suivi par d'autres.
M. le Président : A qui pensez-vous ?
M. Denis TUAL : Aux armateurs, aux sociétés de classification, aux « surveyors », aux courtiers, à tous ceux qui sont impliqués dans une opération maritime d'affrètement.
M. le Président : Je vais encore vous poser quelques questions auxquelles vous pourrez répondre globalement pour laisser à mes collègues le temps d'intervenir à leur tour.
Sur le transport maritime de produits chimiques en vrac, vous paraissez - sans doute à juste raison - assez fiers de votre action en matière de sécurité. Vous confiez des produits aux quatre ou cinq armateurs dont vous dites qu'ils se partagent le marché. Quel type de pavillon battent leurs navires ?
M. Denis TUAL : Ces armateurs pratiquent la libre immatriculation de leurs bateaux.
M. le Président : Y a-t-il, chez Ato-Fina, quelqu'un pour vérifier, sur le transport de produits en vrac, si les produits sont bien embarqués, et si le bateau est de qualité ?
M. Denis TUAL : Oui, cela se fait sans arrêt ! Dans nos procédures, nous pratiquons de façon permanente le vetting.
Quatre ou cinq armateurs détiennent 70 % du marché ; les 30% qui restent sont plus morcelés entre divers armateurs dont certains peuvent être français.
Les grands transporteurs de produits chimiques sont surtout d'origine norvégienne - comme le corroborent quasiment tous les noms que j'ai cités tout à l'heure - et ils se sont alliés, pour la plupart, à des capitaux américains. Les pavillons de leurs bateaux sont, le plus souvent, des pavillons de libre immatriculation. C'est ainsi que Stolt-Nielsen qui est le plus gros transporteur de produits chimiques au monde a de nombreux navires ...
M. le Président : ...sous pavillon norvégien bis ?
M. Denis TUAL : Non ! Les bateaux du groupe sont fréquemment immatriculés au Liberia, aux îles Marshall ou aux îles Caïman.
Avant chaque affrètement, nous envoyons à l'armateur un questionnaire - il en existe un pour les liquides, un pour les gaz et un pour les solides - qui couvre une quarantaine de points de façon à connaître tout le « pedigree » du navire, y compris la nationalité de son équipage, le nom et les références de l'armateur - armateur propriétaire, armateur exploitant et armateur disposant - ainsi que son pavillon dont je précise qu'il n'est pas pour nous un critère d'élimination.
M. le Président : Vous avez raison : les réponses au questionnaire sont plus parlantes !
M. Denis TUAL : Effectivement, puisqu'on demande quelle est la société de classification du navire, quel est le P&I Club, pour quel montant le bateau est assuré, quelle est la nationalité de l'équipage - nous préférerons un équipage entièrement philippin à un équipage mixte -, quelles sont les dernières cargaisons transportées, quel est l'historique de « l'accidentologie » du navire etc. L'armateur doit donc répondre à une quarantaine de questions assez précises.
Si le pavillon vient corroborer des doutes nés des mauvaises réponses, il deviendra un facteur aggravant. Néanmoins, il faut savoir que la grande majorité de la flotte que nous utilisons est immatriculée au Liberia, aux Bahamas ou, très souvent, à Panama.
Dans la flotte chimiquière, de nombreux bateaux battent encore pavillon norvégien. Certains battent pavillon italien ou même français, car il reste quelques très bonnes sociétés françaises de transport de produits chimiques : je pense notamment à Tank Africa, Navale française ou Fouquet Sacop qui sont sous pavillon bis français, c'est-à-dire immatriculés au registre Kerguelen.
Nous recourons donc à une multitude de pavillons. Mais avant toute décision, nous envoyons ce questionnaire pour connaître l'identité complète du navire utilisé.
M. le Président : Vous est-il arrivé de refuser des bateaux et pour quelles raisons ?
M. Denis TUAL : Cela nous arrive sans arrêt !
M. le Président : Qu'entendez-vous par « sans arrêt » et pour quelles raisons ?
M. Denis TUAL : Chez Ato-Fina, les refus sont liés à des règles d'âge et à la nature du produit transporté. Tous nos produits sont différents suivant la classification MARPOL : certains produits plus corrosifs ou plus toxiques auront une classification plus exigeante que la soude caustique que nous utilisons tous pour nettoyer nos éviers et qui est compatible avec l'huile et le vin. On peut donc avoir des critères différents selon les produits.
Nous retenons des critères d'âge et des critères de détention par les Etats du port puisque, avant chaque affrètement, nous consultons sur Internet - malheureusement, avec un mois et demi ou deux mois de décalage - la liste des détentions des années précédentes.
Par ailleurs, nous avons recours au CDI qui opère, pour le compte de tous les chargeurs chimistes, une inspection reconnue, effectuée par des agents agréés et entraînés.
De la sorte, au lieu de faire visiter le navire pendant son escale commerciale par 15 inspecteurs - l'un d'Ato-Fina, l'autre de Shell chimie, l'autre encore de Dow chemical... -, les 33 membres du CDI s'en remettent à un corps d'inspecteurs en qui ils ont confiance.
M. le Président : Le CDI dispose d'un corps d'inspecteurs spécialisés dans tous les ports ?
M. Denis TUAL : Non, il compte 57 inspecteurs dans le monde dont 40 doivent être basés en Europe. Il s'agit uniquement d'inspecteurs indépendants, agréés CDI à la suite d'une formation, qui sont d'anciens navigants - soit capitaines au long cours, soit chefs mécaniciens - de la flotte consacrée à la chimie ou aux gaz. Ils ont suivi des cours et leur agrément est renouvelé chaque année.
Ils procèdent à l'inspection qui comprend une série de quelque 1 500 questions regroupées dans un manuel spécifique selon qu'il s'agit d'un transporteur de produits chimiques ou de gaz.
Les réponses apportées sont ensuite disponibles sur une base de données CDI que les membres de la CEFIC peuvent consulter sur Internet.
Ainsi, par exemple, si on me propose aujourd'hui un navire, je peux vérifier s'il a fait l'objet d'une inspection CDI. Si tel n'est pas le cas, je peux la provoquer : à la demande d'Ato-Fina, un inspecteur se rendra à la prochaine escale du navire pour y procéder.
M. le Président : A la prochaine escale du bateau que vous n'avez pas encore retenu ?
M. Denis TUAL : Exactement, que cette escale se fasse à Singapour ou ailleurs, l'inspecteur se rendra sur les lieux et procédera à l'inspection.
Tout cela à un coût et c'est pourquoi nous payons un abonnement au CDI en début d'année. C'est également la raison pour laquelle nous repayons pour chaque inspection de navire et chaque rapport émis, y compris quand l'inspection à eu lieu à la demande d'un collègue d'une autre société chimique.
Ensuite, nous regardons sur la liste du Mémorandum de Paris si le navire a été détenu, ou non, et, ainsi, nous disposons d'un certain nombre d'informations pour nous déterminer.
M. le Président : Pouvez-vous nous dire combien de bateaux Ato-Fina a refusés au cours de l'année 1999 ?
M. Denis TUAL : Dire un par semaine serait peut-être excessif, mais c'est de cet ordre de grandeur.
M. Dominique RAIN : Il se trouve que j'ai été amené, dans ma carrière, à travailler dans le négoce et l'industrie avant d'exercer des responsabilités au sein de l'organisation professionnelle. Je connais donc un certain nombre de négociants dont plusieurs sont venus se plaindre au motif qu'ils ne comprenaient pas pourquoi on leur avait refusé tel bateau de transport de méthanol à tel endroit, arguant que d'autres l'avaient accepté.
J'ai donc la preuve, ne serait-ce qu'en raison de ces plaintes, qu'il y a des refus sur le marché.
M. Denis TUAL : Nous nous montrons aussi stricts sur les navires non contrôlés. En effet, même quand notre partie commerciale fait une vente FOB - free on board - où nous aurons juste à mettre le produit à disposition, il nous arrive de refuser les bateaux : mes équipes ont refusé, ce matin, un navire qui venait charger pour nous du produit, à Lavéra, et qui nous était proposé FOB par un trader .
Il en va de même pour les achats CIF - cost, insurance and freight. Nous nous donnons le droit de refuser de charger un navire s'il ne nous plaît pas et tous les membres du CDI adoptent a priori la même attitude.
M. le Président : A la différence du secteur pétrolier, vous mettez en _uvre, en quelque sorte un système de vetting collectif à l'échelle européenne ?
M. Denis TUAL : Oui !
M. le Président : Vous parlez, là, au nom d'Ato-Fina mais vos collègues français procèdent-ils de la même manière ?
M. Denis TUAL : Oui, pour la majorité d'entre eux ! Nous constituons maintenant avec Ato-Fina, le cinquième groupe chimiste mondial. En France, il y a le groupe Rhodia mais il recourt beaucoup aux conteneurs et très peu au vrac maritime, car il a peu de volume sur ce type de produits transportés.
En revanche les groupes tels que Dow chemical, ICI, Shell chimie et autres, eux aussi membres du CDI, procèdent comme nous.
Les industriels du secteur chimique, n'ayant jamais eu de flotte propre, un groupe comme Ato-Fina n'a pas d'anciens navigants, donc pas d'inspecteurs !
M. le Président : Mais vous avez créé votre propre corps d'inspecteurs à une échelle commune...
M. Denis TUAL : Voilà ! Il est européen, commun à la profession et indépendant !
M. Dominique DUPILET : Vous avez précisé que les risques - principalement les risques d'explosion - étaient les plus grands lors des escales des navires dans les ports.
Quels sont les rapports que vous entretenez avec les autorités portuaires ? Une formation particulière est-elle dispensée, notamment aux pompiers maritimes? Contribuez-vous à développer la sécurité ou laissez-vous aux armateurs le soin de régler ce problème, ce qui serait étonnant sachant que vous êtes les seuls à savoir la composition des produits transportés ?
M. Dominique RAIN : Il existe en France, normalement, un règlement national portuaire et des règlements locaux portuaires qui sont destinés à régler ce genre de problèmes. La capitainerie du port est le bras séculier chargé de les faire appliquer.
Le problème est que ces règlements nécessitent d'être à jour, ce qui - comme vous le savez sans doute - n'a pas toujours été le cas, et d'être bien adaptés à la situation, ce qui est d'abord - permettez-moi de vous le dire - un problème administratif.
Nous sommes intervenus à de très nombreuses reprises - soyons clairs - dans le cadre d'importations de produits chimiques solides transportés, en vrac, c'est-à-dire des engrais - ammonitrates ou nitrates d'ammonium selon le côté où l'on se place -, pour dire que les choses étaient faites sans totalement respecter l'ensemble des règles de sécurité.
Le problème n'est pas complètement résolu à ce jour, puisque d'aucuns se préoccupent de la sécurité du transport et donc du navire mais ne se soucient de la conformité du produit aux règles qu'à son arrivée - une fois qu'il a été déchargé - et prennent de surcroît plusieurs mois pour régler le problème.
M. Edouard LANDRAIN : Ma question s'adresse à M. Tual.
Monsieur, vous avez dit que, concernant les conteneurs, vous aviez beaucoup de difficultés, pour les lignes régulières, à identifier le navire transporteur. Pourriez-vous nous apporter des précisions sur ce point ? Ignorez-vous sur quel bateau et sur quelle partie du bateau se trouvent les conteneurs ?
M. Denis TUAL : Nous savons très exactement où se trouvent les conteneurs une fois qu'ils ont été embarqués. Mais le système des conférences ou des consortiums fait que cinq ou six armateurs peuvent se mettre ensemble et offrir un service commun. Par conséquent, si vous travaillez avec la société Maersk Sealand, vos produits pourront être embarqués sur le prochain navire en partance qui sera un navire de Lykes, de K.line ou de tout autre partenaire sur cette association.
En fait, les armateurs forment des associations, mettent les navires dans un pool d'exploitation et, alors que vous pouvez imaginer que vos produits voyageront sur le Sealand explorer, ils peuvent très bien partir sur le Likes adventure.
Ce n'est qu'une fois les produits embarqués, que vous saurez exactement le nom du navire de transport et que vous pourrez suivre le cheminement des conteneurs.
M. Edouard LANDRAIN : En cas d'incident, on peut vous interroger ?
M. Denis TUAL : On peut exactement savoir où se trouvent les produits. Mais un navire qui embarque 4 000 boîtes, n'aura que 300 conteneurs de produits chimiques les autres contenant des jouets, des chemises ou que sais-je encore.
On ne pourra suivre les conteneurs transportant nos produits qu'une fois qu'ils seront à bord. Mais, avant l'embarquement, l'armateur peut retarder l'acheminement si son navire est trop plein. Cela fonctionne comme l'autobus : on ne sait rien de la qualité du véhicule dans lequel on monte.
M. le Président : Vous ne pouvez pas vérifier la qualité du bateau qui embarque votre produit ?
M. Denis TUAL : Non, de même que, lorsque vous montez dans un train, vous faites confiance aux pouvoirs publics, sans vérifier la qualité du matériel qui vous transporte. Tout comme pour les voyages en chemin de fer ou en autobus, il y a un contrat d'adhésion !
M. le Président : Vous disiez tout à l'heure ne pas être d'accord avec ce système ?
M. Dominique RAIN : Non, nous ne sommes pas d'accord avec ces pratiques qui s'appuient sur les articles 85 et 86 du traité de Rome.
M. le Président : Vous souhaiteriez connaître la qualité du bateau sur lequel vous embarquez vos produits ?
M. Dominique RAIN : Nous aimerions avoir un contact bilatéral et être sûrs, quand nous signons avec quelqu'un, que ce sera bien lui l'exécuteur du contrat et pas un autre. Cela éviterait aussi quelques ententes qui ne sont pas, non plus, très favorables - puisqu'il faut appeler un chat un chat -, parce qu'elles entraînent également des ententes sur les prix.
Mme. Jacqueline LAZARD : Vous venez précisément de répondre à la question que je voulais poser ...
M. Jean-Pierre DUFAU : Si je résume votre propos, vous aimeriez choisir et l'armateur et le navire ?
M. Dominique RAIN : Tout à fait : vous ne pouvez pas mieux me résumer !
M. Denis TUAL : L'important pour un industriel est de contrôler son transport et de ne laisser ce soin ni à un trader, ni à un client, ni à un fournisseur étranger. Il faut que le chargeur français puisse contrôler le transport aussi bien pour des raisons de qualité - il choisira, à cet effet, son armateur et son vecteur logistique, le navire -, que pour des raisons de massification et de marketing - il pourra, en massifiant ses flux, avoir des taux plus intéressants et, en connaissant les armateurs, savoir quels sont les flux de ses concurrents.
Il faut donc faire en sorte que les industriels puissent contrôler le transport et non pas les pousser à se dire : « je vends à la porte de mon usine en fermant les yeux sur le reste. »
M. Jean-Pierre DUFAU : Quelque chose m'a sans doute échappé car je n'ai pas bien compris comment vous pouvez choisir l'armateur et pas le navire et faire inspecter ensuite ce même navire par le CDI ?
M. Denis TUAL : Le CDI n'intervient que sur le vrac liquide ou gaz. Pour les conteneurs, le SQAS cargo surveille le déroulement des choses au départ et à l'arrivée, mais il ne s'occupe pas du navire.
M. Jean-Pierre DUFAU : Vous avez, par ailleurs, évoqué rapidement les problèmes de rinçage. J'aimerais en savoir un peu plus sur la technique et le déroulement de ces opérations. Sont-elles contrôlées et peut-on, ou non, parler de rinçages sauvages ?
M. Denis TUAL : Les qualités de pompage font qu'une cuve entière de ces chimiquiers peut être vidée, à quelques litres près, grâce à des systèmes de siphon. Le risque de pollution de la cargaison suivante nous fait obligation de trouver la meilleure technique possible de pompage !
M. Jean-Pierre DUFAU : Soit, mais après le pompage, vous effectuez bien un rinçage ?
M. Denis TUAL : Contrairement aux structures des navires-citernes, les chimiquiers ont des parois complètement lisses et les structures sont à l'extérieur ce qui correspond presque naturellement à de la double enveloppe : il y a, d'une part, la coque avec ses structures intérieures et, d'autre part, les structures extérieures de la cuve et la cuve dont les murs sont plus lisses que ceux de la pièce dans laquelle nous nous trouvons. Il n'y a pas même une poutre qui permettrait au produit de se nicher dans un coin.
Le système se limite à quelques serpentins de réchauffage, quelques serpentins de nettoyage, des tuyauteries qui montent et qui descendent et à des jets rotatifs qui nettoient en profondeur.
Avant de recharger, il est procédé à une inspection visuelle du produit pendant laquelle, très souvent, on fait même descendre les marins dans les cuves.
M. Jean-Pierre DUFAU : Chaque rinçage est contrôlé dans le port ?
M. Denis TUAL : Chaque rinçage est contrôlé. Il peut se faire au large ou dans le port mais toujours avec obligation, puisque les navires répondent aux normes MARPOL, de conserver dans des tanks spécifiques ce que l'on appelle les « slops », soit de très petites quantités. Ces slops sont ensuite retraités à terre, soit par les installations portuaires, comme c'est le cas dans certains ports français, soit par des industriels spécialisés puisqu'il y a quelques industriels capables de stocker les matières chimiques et sont spécialisés dans le traitement de ces résidus.
Mme. Jacqueline LAZARD : Le système paraît idéal et vous nous montrez qu'il y a là une sécurité qui n'existe pas au niveau du pétrole.
M. Jean-Pierre DUFAU : Vous nous brossez, en effet, un tableau que je ne qualifierais pas d'idyllique mais dont je dirais qu'il montre bien l'importance des précautions prises en matière de sécurité et d'organisation.
Pour ce qui concerne les produits secs, vous avez précisé que les navires étaient un peu plus anciens ce qui me conduit à vous poser cette dernière question : connaissez-vous, de par le monde, des exemples de pollution chimique ?
M. Dominique RAIN : Je pensais bien que vous me poseriez la question ! Soyons clairs : le dernier grand accident de navire chimique s'est quand même produit dans le port de Brest et, si ma mémoire est bonne, il a fait 29 victimes en 1947.
M. Edouard LANDRAIN : Il s'agissait de l'Ocean liberty !
M. Dominique RAIN : Exactement !
Il faut donc appeler un chat un chat : c'était bien un bateau de produits secs chargé, en l'occurrence, de nitrates d'ammonium. Je dois avouer que, malheureusement, nous ne sommes toujours pas très à l'aise aujourd'hui par rapport à cet accident qui s'est produit il y a plus de cinquante ans !
Actuellement, un tel navire ne nous viendrait sans doute pas des Etats-Unis mais plus probablement de Lituanie, d'Estonie ou de pays de ce genre qui exportent ce que nous appelons, à l'arrivée, des « ammonitrates » parce qu'ils sont destinés à l'agriculture mais qui sont souvent des nitrates plus ou moins explosifs. La quantité des produits est attestée par un simple système déclaratif.
Le trait est peut-être un peu grossi et je ne voudrais surtout pas que vous pensiez que cela correspond à des attitudes malthusiennes de l'industrie chimique.
Vous avez bien senti que nous étions très largement ouverts sur le monde - nous avons plus de 50 milliards de francs d'excédent de commerce extérieur -, et mon propos ne vise pas à défendre des pratiques malthusiennes de l'industrie chimique, bien au contraire ! Ce n'est nullement notre mentalité.
Il n'empêche que la France était un pays équilibré en matière d'engrais, plus exactement d'azote, et qu'aujourd'hui la moitié de l'azote nécessaire à son agriculture est importée, soit sous forme d'ammoniac, soit sous forme d'engrais et d'ammonitrates. Certains navires transportant ces produits sont dans un triste état comme vous avez sans doute pu le constater à Lorient ou à Brest.
M. Jean-Pierre DUFAU : Est-ce un secteur qui, sur le plan de l'économie d'abord et des transports ensuite, est en phase de développement ou de régression ?
M. Dominique RAIN : On ne peut pas dire que ce secteur soit en régression. Globalement, la France, dont la consommation d'engrais était équilibrée, doit importer aujourd'hui 50 % de ces produits. C'est un secteur où les importations se développent et qui devient une contrepartie commerciale avec un certain nombre de pays que j'ai cités tout à l'heure.
M. Edouard LANDRAIN : Ma question sera très simple : votre optimisme tient-il au fait qu'il n'y a que quatre ou cinq gros transporteurs susceptibles de transporter des produits chimiques à l'échelle mondiale ? En d'autres termes, cette hyperspécialisation constitue-t-elle, à vos yeux, une totale garantie ?
M. Denis TUAL : Sans être une garantie totale, je pense que c'est une garantie importante, dans la mesure où le transport nécessite une formation des personnels aux types de produits qu'ils prennent en charge.
M. Edouard LANDRAIN : Finalement, le monopole est une garantie ?
M. Dominique RAIN : Dans la mesure où il y a quatre armateurs, on ne peut pas parler de monopole.
M. Edouard LANDRAIN : C'est vrai mais, si j'ai bien compris, ils s'arrangent quand même un peu entre eux.
M. Jean-Pierre DUFAU : C'est un monopole diversifié !
M. Denis TUAL : Il faut savoir que beaucoup de ces transporteurs sont des cousins fâchés à mort ! Les groupes Jo Tankers et Odfjell sont des familles de cousins fondateurs qui, selon leurs propres dires, ne se réconcilieront jamais : voilà ce qu'il en est pour la petite histoire !
Plus sérieusement, le fait que 70 % de la flotte soit entre les mains de quatre armateurs peut être un peu ennuyeux, mais les autres 30 % de la flotte appartiennent à des gens sérieux que nous connaissons de visu : nous n'irons pas confier des produits dangereux à quelqu'un que nous n'avons pas vu, dont nous n'avons pas rencontré les experts en produits dangereux, dont nous ne sommes pas certains qu'il ait reçu, compris et analysé nos fiches de données de sécurité des produits ! C'est tout cela qui constitue une garantie.
Dire que la situation du transport maritime de produits chimiques est idyllique est peut-être excessif, mais nous avons le souci d'avoir affaire à des transporteurs qui sachent traiter les produits compliqués que nous leur confions.
Les ammonitrates étant des produits simples, nous faisons appel à des gens qui font du transport simple et c'est bien là qu'est le danger ! Pour le reste de la chimie - le gaz et le liquide -, les risques sont moindres même si nous ne sommes pas à l'abri d'un accident compte tenu du fait que le CDI, en dépit de ses nombreuses vertus, n'ira pas surveiller la structure des coques.
De nombreux aspects de la question relèvent de la responsabilité des Etats, des sociétés de classification, des armateurs. C'est à l'armateur qu'il appartient de dire que c'est parce que son bateau est sérieux et solide qu'il le met sur le marché !
M. le Président : J'aurai une dernière question à vous poser.
À quel moment et pour quelles raisons le CDI a-t-il été créé ? Puisque vous faites preuve d'une telle confiance en vos armateurs, une telle initiative n'était-elle pas superfétatoire ?
Par ailleurs, avez-vous dernièrement refusé des bateaux appartenant aux armements privilégiés avec lesquels vous travaillez ou vos refus ne concernent-ils que les 30 % du marché non contrôlés par les grands groupes?
M. Denis TUAL : Le CDI a été créé en 1994, notamment parce que tous les industriels avaient déjà, plus ou moins, un système de vetting et que nous considérions qu'un armateur confronté à la visite de plusieurs inspecteurs pendant une même escale ne fait pas bien son travail.
Nous avons décidé de mettre nos moyens en commun et d'optimiser ainsi les coûts : il est sûrement plus avantageux pour nous d'avoir recours au CDI qu'à deux ou trois personnes employées à temps plein, pour ne pas parler des frais de déplacement qui viennent encore alourdir la note quand il faut procéder à une inspection à l'autre bout de l'Europe ou du monde. C'est dans cet esprit que nous avons créé ce corps.
Il nous est arrivé, par exemple, de refuser des navires de Stolt-Nielsen ou de ses partenaires qui ne nous agréaient pas. Mais c'est assez rare parce que, même si nous nous informons précisément sur le navire, le seul nom de Stolt-Nielsen nous met déjà largement en confiance. Nous prêtons davantage d'attention au pavillon et à l'identité de l'armateur qu'au pavillon du navire !
Audition de représentants des collectifs « marée noire »
du littoral atlantique
(extrait du procès-verbal de la séance du 2 mai 2000)
Présidence de M. Jean-Yves LE DRIAN, Rapporteur
MM. Laurent Ferrero, Nicolas Garnier, Gwénael Hédan, Jean-Claude Hervé, Mme Javette Lebesque et M. Pascal Tosatto sont introduits.
M. le Président leur rappelle que les dispositions législatives relatives aux commissions d'enquête leur ont été communiquées. A l'invitation du Président, MM. Laurent Ferrero, Nicolas Garnier, Gwénael Hédan, Jean-Claude Hervé, Mme Javette Lebesque et M. Pascal Tosatto prêtent serment.
M. Jean-Claude HERVE : En premier lieu, je vais très rapidement vous présenter la délégation : Javette Lebesque, du collectif de Vannes, Gwénael Hedan, paludier à Guérande, Pascal Tosatto, ostréiculteur à La Bernerie, Laurent Ferrero, du collectif de Nantes, Nicolas Garnier, saunier à Noirmoutier, Jean-Claude Hervé, du collectif de Nantes.
Ces collectifs ont été constitués spontanément, dans l'émotion suscitée par la catastrophe de l'Erika. Afin de pouvoir intervenir de façon coordonnée et efficace auprès des pouvoirs publics et des différents interlocuteurs, nous avons décidé de travailler en coordination et élaboré des positions communes qui figurent dans les documents que nous vous remettons. Parmi ceux-ci vous trouverez un texte qui a été lu à Mme Dominique Voynet lors de sa venue à Vannes et le Mémorandum, qui regroupe les propositions émanant des collectifs et qui a été remis à M. Lionel Jospin lors du CIADT et du CIMER qui se sont tenus à Nantes fin février.
Ce dossier comprend également deux textes plus récents, dont un élaboré par le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Bretagne. Je tiens à préciser que ce comité régional des pêches, avec lequel nous travaillons en étroite coordination, ne fait pas partie des collectifs, mais nous a accompagnés dans toutes nos démarches. Il continue de nous accorder sa confiance et à nous apporter son entière collaboration.
Les collectifs réunissent, dans un même ensemble, des citoyens, des organisations humanitaires, citoyennes, environnementales, syndicales et professionnelles ainsi qu'un certain nombre de partis politiques. Le collectif est une structure extrêmement large et lourde à gérer, mais cette diversité d'approche permet d'être en prise sur la réalité et de recueillir un avis qui reflète autant que faire se peut l'opinion des populations du littoral. Chaque collectif a son autonomie et, de ce fait, parfois son expression propre. Pour autant, nous faisons notre possible pour essayer de parler d'une seule voix ; ainsi, les documents qui vous sont remis ont recueilli l'accord des différents collectifs.
Très brièvement, je souhaiterais faire le point des mesures qu'il nous semble nécessaire de mettre en _uvre, lorsqu'une catastrophe de la nature de celle de l'Erika se produit.
Il conviendrait de pouvoir délimiter très rapidement la zone contaminée et d'appliquer, dans ladite zone, des mesures de précaution. Cela signifie que, dans le même temps où on interdit des activités professionnelles liées à la mer, on prévoit la possibilité de rémunérer les professionnels qui se retrouvent ainsi privés de leur travail pendant la durée de la pollution. Ce qui se passe actuellement, dans le cadre de la catastrophe de l'Erika, est lourd d'enseignement. On peut constater que l'absence de délimitation d'une zone où il y a effectivement un problème a porté préjudice à l'ensemble des professions de la mer, même dans des zones ne présentant aucune pollution. Les pêcheurs du Nord-Finistère ou les ostréiculteurs de Marennes, d'Arcachon ou de Cancale sont pénalisés, alors qu'il ne se passe rien chez eux.
Selon nos premiers constats, il faudrait aussi éviter d'avoir recours de nouveau à des bénévoles, surtout lorsqu'ils sont utilisés sans encadrement et sans suivi sanitaire. Même s'il est normal que des citoyens participent à ce travail, il est anormal de les laisser seuls, et sans encadrement comme cela a été le cas.
En ce qui concerne les moyens de prévention, nous estimons qu'il devrait y en avoir de disponibles sur l'ensemble du littoral. Enfin, il conviendrait d'appliquer le principe de transparence et de vérité et d'organiser, à intervalles réguliers, des exercices pour les élus ou les collectivités de bord de mer, afin qu'ils connaissent les directives à mettre en _uvre. On peut également envisager l'utilisation de moyens modernes d'accès de la société civile à différentes informations qui peuvent être utiles dans un tel cas.
Dans nos propositions, figure une remise à plat de l'ensemble des plans de protection, qu'il s'agisse du plan POLMAR mer ou POLMAR terre, et une remise en chantier de toutes les chaînes de commandement qui ont pu exister, de façon à éviter les cafouillages constatés.
Afin de réparer les dommages liés à la reconstitution de l'environnement, il faut envisager d'instaurer des amendes très lourdes pour les destructions du patrimoine et des ressources du patrimoine maritime, des espèces protégées, ou des réserves halieutiques.
Si l'on veut pouvoir mesurer à l'avenir l'impact des pollutions et envisager un retour à la situation antérieure, il faut également qu'il existe un état initial, dressé à l'aide d'études, des littoraux atlantique et méditerranéen. De ce point de vue, ce que pourront vous dire nos collègues paludiers et sauniers sont des éléments très importants.
Il nous semble aussi que les côtes doivent être mieux surveillées. Cela signifie qu'il est nécessaire de modifier un certain nombre de choses, peut-être de créer un corps de garde-côtes, disposer de navires de haute mer, d'hélicoptères, d'avions. Les ports doivent être équipés pour organiser les dégazages, de même que les raffineries ou les môles, où viennent accoster les pétroliers, doivent être équipés en vue de récupérer les déchets, ce qui n'est pas le cas partout.
Il faut envisager des mesures de renouvellement de la flotte maritime et, en ce qui concerne l'état des navires, une évaluation des procédures de contrôle. Il faut qu'il y ait évaluation - c'est une vieille règle de l'Etat - car, si les fonctionnaires des Finances ont parfois des traitements plus importants que d'autres, c'est aussi parce qu'ils ont des responsabilités liées à la collectivité. Dans le domaine du contrôle des transports maritimes, le contrôleur qui exerce un travail extrêmement difficile et pénible, voire dangereux, doit être rémunéré à la hauteur de sa responsabilité.
S'agissant des procédures, certains professionnels nous ont indiqué qu'il était anormal que le bateau soit soumis à l'examen d'un seul contrôleur et qu'il devrait y avoir des contrôles en doublette. Certains avis de professionnels vont en ce sens, mais c'est à eux qu'il revient de décider de ces procédures. Nous n'avons pas vocation, en tant que collectifs, à faire des propositions sur de telles procédures.
Notre proposition majeure consiste à demander un changement de la réglementation et de la législation afin de rendre responsable de tout ce qui peut arriver le donneur d'ordres. Une mesure analogue a été prise dans le bâtiment et les travaux publics et, de l'avis général, depuis sa mise en place, le nombre des accidents a diminué et la responsabilisation de l'ensemble de la chaîne est plus marquée. Il faut aller dans le même sens en ce qui concerne le transport maritime, c'est-à-dire rendre responsable le propriétaire de la marchandise.
M. le Président : Le propriétaire de la marchandise peut changer en cours de route.
M. Jean-Claude HERVE : Il nous semble que c'est une des façons de limiter les risques. D'autres propositions ont été exprimées, mais elles ne semblent pas très fiables. Ce sont donc celles que nous avons retenues et exprimées à Mme de Palacio et à tous les intervenants que nous avons rencontrés et que nous rencontrerons dans les mois qui viennent.
De plus, nous constatons qu'un certain nombre de propositions, faites par le Conseil économique et social (CES) recouvrent très largement les nôtres.
M. Laurent FERRERO : La coordination des collectifs est à l'origine de la manifestation qui a réuni, à Nantes le 5 février, 30 000 personnes. Nous avons depuis organisé d'autres manifestations certes moins importantes, mais l'objectif n'est pas tant de renouveler une telle manifestation de masse que de continuer de montrer nos préoccupations.
Ainsi que cela est indiqué sur les autocollants qui figurent dans le dossier nous avons deux axes de propositions. Tout d'abord, la responsabilité environnementale nous semble être la perspective la plus importante. Nous estimons que le meilleur moyen d'obtenir de celui qui décide de mettre en circulation un produit dangereux qu'il s'assure des conditions de ce transport est de le rendre responsable de sa cargaison. En effet, le rapport de force entre les parties dans un contrat de transport est déséquilibré. Il est clair que les pétroliers, comme Total, Elf ou d'autres, ont la possibilité d'imposer des conditions de prix au détriment des conditions de sécurité. Jean-Claude Hervé évoquait la responsabilité du maître d'ouvrage dans le bâtiment. C'est un ensemble de règles en ce sens qui sont importantes à mettre en _uvre. Nous avons prévu d'organiser des journées internationales d'études, au mois de septembre ou octobre, pour débattre avec des personnalités compétentes en ce domaine.
Le second axe concerne le nécessaire contrôle citoyen. Au-delà de l'objectif qui consiste à faire payer Total car nous considérons qu'il ne revient pas aux contribuables de financer les conséquences de cette catastrophe, nous avons une préoccupation au regard de la responsabilité environnementale. Nous estimons important que les citoyens aient une attitude de vigilance et qu'ils interpellent, si besoin est, l'ensemble des institutions et des acteurs qui peuvent être concernés. Nous voulons obtenir des actes et cela suppose que nous ayons des informations.
Avec les moyens modernes actuels, il est possible de connaître, par exemple, pour la circulation des bateaux en Manche, le nombre de navires qui passent, les navires contrôlés, les défauts relevés par rapport à la réglementation et l'état de ces navires, et de porter ces informations à la connaissance du public.
Le CES évoque un rempart de papier. Beaucoup de choses ont été faites et écrites, mais lors de la catastrophe, ces informations se sont révélées peu disponibles. Il faudrait qu'elles le soient à travers un système d'informations informatisé et pertinent, qui devrait également intégrer des modélisations d'atterrissage des produits toxiques qui peuvent être répandus en mer.
Météo-France s'est révélé incapable de prévoir l'atterrissage des nappes. Cette grande institution doit se donner des moyens de modélisation, - elle possède déjà les moyens de calcul - afin de délimiter plus précisément, dès le début, les zones concernées par la pollution. Pour que ce système ne reste pas lettre morte, on peut imaginer une certification qualité, comme en entreprise. Il existe des organismes certificateurs au niveau national, tels que l'Association française d'assurance qualité (AFAQ), et au niveau européen. Pourquoi ne pas envisager que ces procédures soient testées par un tiers extérieur qui puisse garantir leur performance ?
En conclusion, les capacités techniques d'intervention sur cette pollution notamment pour le pompage des nappes se sont révélées largement insuffisantes. Il nous semble important qu'au niveau européen, ces moyens existent, et peut-être seraient-ils plus facilement mis en _uvre si, dès le départ de la cargaison, on en connaissait la nature. Au-delà de la certification qualité, l'instauration d'une traçabilité permettrait de connaître la nature des produits transportés par tous les bateaux qui circulent au large. Enfin, s'agissant de la décontamination des plages, des roches et des fonds, nous manquons de moyens efficaces pour la mener à bien.
M. François GOULARD : Vous avez écrit, dans votre dossier, que les compagnies pétrolières, étant responsables, devaient payer. C'est un sentiment qu'on peut partager sur un plan moral, mais il faut aussi considérer le droit, car nous sommes dans un Etat de droit, avec des règles nationales et internationales. S'il s'avère que Total ne peut être condamné à payer les conséquences de la marée noire, considérez-vous que l'Etat doit intervenir ? En d'autres termes, si les procédures d'indemnisation à l'amiable du type FIPOL et les procédures judiciaires engagées par les uns et les autres contre Total n'aboutissent pas, estimez-vous que de telles catastrophes relèvent de la solidarité nationale ?
Vous avez parlé des bénévoles, de leur mauvais encadrement au départ et de la nécessité de faire faire des exercices aux élus. Les élus sont-ils selon vous les interlocuteurs naturels des bénévoles dans de telles circonstances ? Comment voyez-vous l'articulation du rôle des bénévoles, des élus et des services de l'Etat qui, dans les textes, sont les responsables de l'intervention ? Les plans POLMAR, en effet, relèvent de la responsabilité de l'Etat.
M. Jean-Claude HERVE : Les maires se sont trouvés en charge de PC de commandement, souvent sans aucune instruction. Ils ont fait comme ils ont pu. Il ne s'agit pas de désigner du doigt les uns ou les autres, mais de constater que des défaillances ont pu être relevées à ce niveau et que l'information dans une situation imprévue a mal fonctionné. C'est cette impréparation qu'il faut briser.
Il nous semble que les technologies modernes permettent une meilleure transparence et la mise à disposition du public d'une information sur les mesures à suivre dans tel ou tel cas. Une des leçons que l'on peut tirer de la catastrophe de l'Erika, est de pouvoir changer les procédures d'information et d'encadrement, et de revoir les procédures de commandement. En effet, on a laissé les bonnes volontés agir comme elles ont cru bon devoir le faire, sans qu'elles aient nécessairement la compétence ou l'information, et qu'elles sachent éviter les pièges.
S'agissant de l'intervention de l'Etat, nous souhaitons qu'il joue un rôle de relais. Au-delà, le problème est d'une autre nature, puisqu'il s'agit d'un système où le coût du transport des marchandises doit être le plus bas possible. Avec les pavillons de complaisance et la complaisance de façon générale, on arrive aux limites de ce système où l'on fait prendre des risques considérables à la planète pour gagner quelques sous. Nous disons précisément qu'il faut arrêter ce système. La loi n'est pas rétroactive, et les jugements seront ce qu'ils sont.
Nous ne sommes pas dans cette logique puisque nous sommes un collectif citoyen. Pour l'ensemble des habitants du littoral, il semble évident que la responsabilité incombe à Total, et nous entendons bien utiliser tous les moyens, à disposition des citoyens, pour faire en sorte que Total finance largement au-delà des engagements, quels que soient les résultats des recours juridiques ou des pressions de l'Etat. Nous estimons que l'Etat doit faire pression car il n'est pas normal de faire transporter des produits d'une telle dangerosité dans de telles conditions. C'est à la justice maintenant de démêler cette affaire, mais pour notre part, nous avons une démarche citoyenne par rapport à cela.
Mme Javette LEBESQUE : Il faut, dans la réponse donnée à M. Goulard, dissocier deux éléments. En ce qui concerne la pollution provoquée par l'Erika, nous considérons que Total doit payer ; mais nous nous interrogeons aussi sur le point de savoir si les procédures actuelles vont permettre à Total d'assumer.
Cependant, il faut aussi considérer l'avenir. La leçon de l'Erika doit permettre de légiférer, ce que vous êtes les mieux à même de faire ; Dans cette perspective, il nous semble que la puissance publique doit disposer de la maîtrise complète des contrôles. Il est exclu pour l'avenir que le contrôle soit confié à des contrôleurs privés, dépendant de la compagnie qui va les payer ou les employer. La puissance publique française, voire européenne et dans le cadre de l'OMI, doit être non seulement responsable de l'ensemble des contrôles, mais aussi de la maîtrise dans la recherche de la réparation. Cela ne signifie pas que la puissance publique doit payer. Il ne suffit pas de dire que l'affréteur est totalement responsable, car le commandant d'un bateau peut aussi faire une erreur.
Un texte de loi n'est pas une chose figée. Néanmoins, celui qui fait transporter un produit dangereux par bateau doit s'assurer et faire la preuve qu'il s'est assuré que le transport de ce produit dangereux peut se faire sans problème. Dès lors qu'il ne peut le prouver, il est totalement responsable.
M. Laurent FERRERO : Le problème actuel auquel doit faire face M. Desmarest est plus un problème d'image qu'un problème qui engage l'avenir de la société Total. Notre action a pour but de créer un rapport de force, comme Total sait l'établir avec les armateurs pour faire baisser les prix. Nous voulons obtenir, par la mobilisation de l'opinion, une contribution la plus grande possible, voire totale, de cette compagnie pétrolière.
S'agissant des bénévoles, on ne peut poser en principe leur intervention sur des produits dangereux lors de telles catastrophes.
M. Serge POIGNANT : J'ai parcouru vos propositions et vos souhaits, en particulier la critique des pavillons de complaisance. Etes-vous favorable à la formule des garde-côtes ?
Au-delà des bénévoles, estimez-vous aujourd'hui que les moyens ont été et sont suffisants ? Par rapport aux indemnisations, notamment avec le FIPOL, estimez-vous que les choses vont suffisamment vite, car il nous a été indiqué que les dossiers ne sont pas présentés assez rapidement ? Dans votre Mémorandum, qui date de février, vous indiquiez qu'il y avait toujours des fuites. Est-ce toujours le cas et sur quelles bases vous fondez-vous ?
Enfin, vous dites être favorable au pompage le plus rapide possible de l'Erika, avec un contrôle citoyen. Qu'entendez-vous exactement par cela ?
M. Edouard LANDRAIN : A la page 3 de votre Mémorandum, vous faites un constat extrêmement sévère : « (...) les services de l'Etat ont fait montre d'inefficacité, d'impréparation et d'opacité... » J'aimerais savoir sur quels éléments vous vous fondez pour faire un tel constat, quelques mois seulement après la catastrophe, alors que toutes les explications ne sont peut-être pas encore données.
M. Alain GOURIOU : Je voudrais reprendre l'argumentation qu'avait commencé à exposer M. Goulard. Dans deux catastrophes précédentes - l'Amoco-Cadiz sur la Bretagne-Nord en 1978 et l'Exxon Valdez sur les côtes de l'Alaska quelque temps plus tard - les responsabilités ont été plus faciles à établir, car le propriétaire de la cargaison était également le transporteur. La compagnie pétrolière Amoco a été condamnée par la justice à indemniser les dégâts ; la compagnie Exxon a été condamnée par la justice américaine.
Dans le cas présent, les choses sont moins claires. Il apparaît à l'évidence que, depuis les deux catastrophes précitées, les pétroliers - responsables des cargaisons - sous-traitent le transport, y compris aux Etats-Unis, afin d'éviter leur mise cause en cas d'accident.
Votre collectif s'est-il déjà porté partie civile sur le plan judiciaire et auprès de quelle instance ? Sinon, avez-vous l'intention de le faire, soit en tant que partie propre, soit en association avec les collectivités locales - régions, départements, syndicats, intercollectivités ?
Mme Jacqueline LAZARD : Dans votre propos liminaire, vous avez souligné la nécessité de délimiter la zone contaminée lors d'une catastrophe considérant qu'il pouvait y avoir des conséquences pour des professionnels hors de cette zone. J'ai cru comprendre que vous disiez qu'il serait nécessaire d'indemniser les pertes d'exploitation de ces professionnels hors zone.
M. Jean-Claude HERVE : Les pertes d'exploitation des professionnels hors zone ne sont comptabilisées nulle part, c'est le marché qui fait baisser les prix. C'est un système totalement pernicieux. En fait, nous proposions, afin de limiter l'effet sur les professionnels de la mer, que la zone présentant un problème soit clairement délimitée, de façon à ce que l'activité continue sur la zone qui ne présente aucun problème. Il ne faut pas que nous nous retrouvions dans l'obligation de faire des publicités pour dire que nos poissons viennent d'Espagne !
M. le Président : Je voudrais rebondir sur ce point car je trouve le concept intéressant. Vous estimez que, lors d'une catastrophe, une communication très forte doit être faite sur la zone touchée, ce qui présente l'inconvénient de désigner des sinistrés. Toutefois il faut le faire publiquement afin d'éviter que d'autres soient sinistrés, alors qu'ils sont hors de la zone touchée. Cela entraîne, pour la collectivité, un manque à gagner considérable.
M. Jean-Claude HERVE : C'est très exactement ce que nous avons dit sur la notion de transparence et de vérité : il faut dire où se situe exactement la zone touchée par la pollution et les problèmes qui existent dans cette zone, tout en indiquant, dans le même temps, que partout ailleurs, la situation est normale. De ce point de vue, l'exemple des marais salants pourrait être instructif.
Les collectifs, pour l'instant, ne se sont pas portés partie civile. Nous allons nous adresser aux élus du littoral, dans les prochains jours, pour leur proposer, comme cela s'est passé sur la côte Finistère-Nord, une démarche commune sur ce sujet. C'est en cours. Il n'est pas exclu qu'au terme des discussions avec les élus et les instances départementales, régionales ou autres, il y ait des constitutions de partie civile ou modification des instances. Pour l'instant, il n'y a rien.
M. Gwénaël HEDAN : Je suis paludier à Guérande et, sur la question des moyens, je peux vous faire part de mon point de vue pour cette partie du littoral. Les militaires ont beaucoup travaillé et ont été courageux car les conditions météo n'étaient pas faciles. En fait, j'ai constaté qu'une équipe de militaires arrive sur le terrain et travaille quinze jours. Le marais salant n'est pas pollué, mais la lagune qui borde le marais salant, que l'on appelle le trait, est une zone que les ostréiculteurs et les paludiers connaissent très bien, mais pas les militaires. Tous les quinze jours, il faut réexpliquer le phénomène des marées, des sables mouvants et des courants, car ce ne sont jamais les mêmes équipes qui reviennent. Le travail n'est pas fait de façon satisfaisante à cause de ces changements.
Au niveau de l'aide apportée aux paludiers pour gérer la crise, le préfet a mis en place, à notre demande, un comité de suivi de la pollution composé du CEDRE, de l'IFREMER, de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS), des paludiers, de l'ITOPF - International tanker owners pollution federation, qui travaille pour le compte du FIPOL - et un laboratoire, le LPTC de l'université de Bordeaux. Nous considérons que les moyens financiers et autres ne sont pas suffisants. Par exemple, le laboratoire de Bordeaux, qui travaille pour nous, n'est toujours pas payé. Personne ne veut le payer et on ne sait pas qui va le payer. Le FIPOL a demandé des analyses au laboratoire de Bordeaux, mais pour son propre compte, et nous n'aurons pas les résultats puisque c'est le FIPOL qui paie. Nous trouvons cela totalement inadmissible.
M. Nicolas GARNIER : Je voudrais ajouter quelques mots sur la question du financement. Nous avons eu un exemple en commission de suivi à Noirmoutier, laquelle commission devait diligenter des analyses de suivi de contamination dans l'eau de mer. 35 millions de francs avaient été débloqués pour le suivi écotoxicologique lors du CIADT, cependant la direction départementale de l'Agriculture interrogée, m'a répondu que le CIADT concerne l'investissement et que ce que nous demandions relevait du fonctionnement.
Cela signifie que nous en sommes à mégoter pour quelques analyses alors que l'on sait à quel point il est difficile de faire des analyses représentatives d'échantillons d'eau de mer, milieu très hétérogène et sujet à de fortes variations. Il faut mettre le maximum en ce moment sur le suivi écotoxicologique. Nous avons donc besoin de dépenses de fonctionnement et non d'investissement.
M. le Président : Je voudrais dire quelques mots sur ce point et, en même temps, informer mes collègues de la commission de prochaines échéances. Je voudrais d'abord rappeler au collectif que nous avons tenu une journée entière sur l'indemnisation. Par ailleurs, en accord avec le président, j'ai demandé à Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat au budget, de venir devant la commission, vers la fin de ses travaux, afin de faire le point sur l'ensemble des engagements pris par le gouvernement et d'examiner les diverses affectations des sommes annoncées.
Nous avons également rencontré le FIPOL non seulement à Lorient, mais M. Jacobsson lui-même pendant une séance de travail à Londres. Si vous disposez d'exemples spécifiques qui montrent des dysfonctionnements dans les remboursements, vous pouvez nous les communiquer par écrit. Nous referons un point sur l'indemnisation à la fin des travaux de notre commission.
M. Gwénael HEDAN : Nous n'en sommes pas encore au stade des indemnisations, qui viendra plus tard. Actuellement, nous nous attachons principalement à éviter de polluer le marais salant.
M. Pascal TOSATTO : J'étais vendeur de mon affaire d'huîtres depuis l'automne. Un acheteur risquait d'apparaître au lendemain des fêtes de fin d'année, lorsque les gens se sont refait une santé financière. Au lieu de voir arriver un acheteur, j'ai vu arriver des nappes de mazout. Mon dossier n'est pas recevable au FIPOL et je ne suis pas le seul dans ce cas.
En interrogeant les cabinets anglais qui devraient prendre le relais, on peut regretter que l'Etat ne soit pas centralisateur des dossiers, conseilleur et garant. Ces cabinets anglais n'ont jamais traité de cas de personnes qui vendaient leur établissement.
Les ostréiculteurs s'inquiètent : un tiers de la population ostréicole se demande s'il est en train ou non d'empoisonner ses clients ; un autre tiers attend les réactions du premier tiers. Quant au troisième, peut-être regroupe-t-il ceux qui sont à l'abri des ennuis financiers ou de morale.
M. le Président : Nous avons reçu le président de la confédération conchylicole de Bretagne-Pays de Loire. Je voudrais qu'on s'attache à la mission propre des collectifs marée noire.
M. Pascal TOSATTO : Par rapport aux garde-côtes, la Bretagne en prend « plein le nez ». Il faudrait lui donner des moyens régionaux lui permettant de veiller à ce que les eaux soient respectées.
M. le Président : Le problème posé par l'Erika n'a pas été vraiment celui-là.
M. Nicolas GARNIER : Je voudrais revenir sur la délimitation des zones. Nous avons deux sites de production de sel par la technique artisanale du marais salant, dont les principaux sont Guérande, Noirmoutier et l'île de Ré, cette dernière ayant été très peu touchée. Guérande a été principalement touché et Noirmoutier, qui se situe à 45 km à vol de mouette au sud, un peu moins, mais suffisamment pour que, dans l'esprit du grand public, pour lequel les deux sites sont associés, il y ait maintenant une confusion, une imprécision et une ambiguïté. Cela se traduit par un doute généralisé concernant le produit sel des marais salants.
Heureusement que les guérandais ont pris la décision d'appliquer le principe de précaution, à la majorité des producteurs, c'est-à-dire de ne pas faire de récolte cette année. A Noirmoutier, nous sommes dans une situation très difficile, car inverse. Les structures professionnelles et les services techniques de l'Etat ont pris le parti de nous demander, à nous producteurs qui voulons appliquer également le principe de précaution, de prouver que l'eau était contaminée, alors que nous leur demandions de prouver que l'eau n'était pas contaminée.
Nous sommes devant cette problématique depuis plus d'un mois. Un arrêté préfectoral a été pris en Vendée, il y a un mois, qui autorise les prises d'eau, moyennant certaines prescriptions spéciales qui nous semblent imprécises, ambiguës et inapplicables. L'expérience des derniers jours l'a bien prouvé. Le protocole de suivi, que nous sommes censés valider malgré nous, est absolument inapplicable. Des prises d'eau ont été faites récemment dans lesquelles ont été retrouvées des boulettes de fioul, alors qu'aucun protocole de surveillance ni de précaution n'avait été mis en place. Nous en sommes à quelques-uns à décider de ne pas produire cette année car tous nos clients nous le demandent. Nous savons que nous prenons une décision protégeant sur le long terme l'image du produit et nous sommes en train de devenir des boucs émissaires, à l'échelle locale, car on nous accuse de mettre en péril l'image du produit, en appliquant le principe de précaution. Nous sommes dans une situation très grave, du point de vue de l'ordre public, car nous sommes amenés à subir les conséquences physiques et matérielles des positions que nous avons prises. Cette situation est, en fait, le résultat d'un manque de décision ferme concernant le zonage, l'évaluation du risque et les problèmes de seuil.
M. Michel HUNAULT : Je souhaiterais apporter une précision. Vous avez indiqué que vous alliez intervenir auprès des élus afin qu'ils s'organisent. Au niveau des pays de la Loire, cela a déjà été fait sous l'autorité du président de la région. Une cellule a été mise en place, avec un conseil commun, en relation avec les représentants des différents départements de la région des pays de la Loire.
M. Gwénael HEDAN : Je voudrais faire un bref historique des actions entreprises sur le marais de Guérande, à la suite de la pollution. Dès l'arrivée des plaques de mazout, nous avons installé nos barrages filtrants en paille, puisqu'on ne disposait encore ni de pelleteuses, ni d'autorisations pour construire des barrages en terre, ni de moyens financiers. Ensuite, dans les semaines qui ont suivi, nous avons pu mettre en place des barrages de terre qui protégeaient l'entrée des marais salants. Nous avons donc fermé l'entrée des étiers. A la suite de la construction de ces barrages, nous nous sommes interrogés sur la façon de les gérer et sur l'autorité susceptible de nous signifier le moment de les ouvrir et de les fermer.
Nous avons obtenu un arrêté préfectoral interdisant la prise d'eau de mer. Suite à cet arrêté, le 3 mars 2000, et à notre demande, un comité de suivi scientifique a été mis en place qui réunissait des scientifiques et des administrations pour procéder à des analyses et à la mise en place d'un protocole d'analyse : un constat visuel de présence ou non de pétrole, une analyse de la fraction dissoute des hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l'eau, et une analyse des particules sédimentaires en suspension dans l'eau.
Ces analyses font actuellement l'objet d'interprétations par les scientifiques, lesquelles sont soumises à un comité de suivi présidé par le préfet et dans lequel siègent la DDASS, l'IFREMER, le CEDRE et les paludiers. Ce comité de suivi est censé nous aider à prendre la bonne décision quant au moment d'ouvrir les barrages. On s'aperçoit que, de toute façon, la pollution est toujours présente. Il y a encore eu de nouvelles arrivées la semaine dernière, suite à un coup de vent. Dès que survient un coup de vent, on constate une remise en suspension des particules argileuses qui sont en fait des vecteurs de la pollution, car les HAP se fixent sur ces particules.
Une analyse peut être bonne un jour et très mauvaise deux jours plus tard, car un coup de vent a eu lieu entre-temps. La prise de décision est donc très difficile. Le préfet a donc demandé à la direction générale de la santé de saisir l'Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA) pour fixer un seuil de pollution acceptable pour pouvoir faire du sel.
L'AFSSA a fait une étude et ses conclusions ont été qu'on ne pouvait fixer de seuil pour alimenter les marais salants en eau de mer pour faire du sel. L'AFSSA partait du principe que l'eau de mer est d'abord un milieu naturel soumis aux normes environnementales. Mais l'eau de mer constitue aussi pour les paludiers une matière première. On ne sait pas non plus comment se comportera le polluant en entrant dans les marais salants du fait de l'évaporation et de la concentration de l'irisation qui peut empêcher certaines bactéries de fonctionner convenablement. C'est un phénomène relativement complexe.
L'AFSSA a indiqué qu'elle ne pouvait pas fixer de seuil. Le préfet n'ayant pas de seuil pour prendre la décision d'ouvrir ou de fermer les barrages, la DDASS de Loire Atlantique a renouvelé sa demande à la direction générale de la santé, laquelle n'a pas tenu compte de l'avis de l'AFSSA et a fixé un seuil de manière très contestable, puisque l'IFREMER et le CEDRE le contestent, à savoir un seuil de 200 nanogrammes par litre des seize HAP. Ces HAP servent à analyser l'eau pour voir si elle est contaminée ou pas. L'IFREMER et le CEDRE ne sont pas d'accord avec ce seuil de 200 nanogrammes. De leur point de vue, avant l'Erika, il y avait environ 10 à 15 nanogrammes par litre. Ceci fait qu'actuellement, en mettant en place un système de filtration sur les marais salants, censé empêcher la pollution en dessous de 200 nanogrammes, on légalise la pollution, c'est-à-dire que si on suit l'avis de la DDASS, on peut polluer les marais.
M. le Président : C'est un sujet très important, nous l'avons constaté à plusieurs reprises, lors de différentes auditions. Nous avons été amenés à faire une audition générale de la commission, avec l'ensemble des laboratoires sur la toxicité du produit lui-même. L'exemple que vous venez de citer pourrait-il faire l'objet d'une note écrite à la commission ?
M. Gwénael HEDAN : Tout à fait.
M. Jean-Claude HERVE : De la même façon, si on peut éventuellement obtenir des notes de scientifiques venant à l'appui de nos propos, nous essayerons de vous les faire parvenir, si bien évidemment cela rentre dans le cadre de votre activité.
M. le Président : Tout à fait.
M. Jean-Claude HERVE : Je voudrais répondre très rapidement aux propos de M. Landrain quant au jugement sur l'inefficacité, l'impréparation et l'opacité. Ce sont certes des termes sévères, mais c'est aussi ce que nous avons constaté. Si on considère que les ostréiculteurs de la ria d'Etel ont été obligés d'acheter eux-mêmes un barrage flottant pour pouvoir protéger l'entrée de la ria, que les bateaux qui étaient chargés...
M. le Président : C'est la faute de la météo.
M. Jean-Claude HERVE : Peut-être mais pas seulement. Les bateaux, chargés de mettre en place les barrages, étaient incapables d'affronter une mer un peu formée. Il y a quand même là une réelle impréparation, un réel manque de moyens, et une vraie inefficacité. Quant à l'opacité, c'est tout le délai qu'il a fallu avant de connaître la vraie nature de la cargaison.
Quand l'Erika est parti, des prélèvements de la cargaison devaient être remis au réceptionnaire de la marchandise. On connaissait donc la nature du produit livré. Même si le délai est long pour produire des analyses, l'opacité a néanmoins été réelle. Pour nous, c'est un fait tout à fait contestable et il faut impérativement changer les méthodes.
En matière de pollution, si on veut qu'un principe de précaution se mette en place, il faut une transparence totale, y compris en matière sanitaire. Quand le responsable de l'INERIS dit qu'il ne sait pas, qu'il n'existe pas de documents ou d'études sur le sujet, il faut avoir le courage de le dire. La transparence doit aller jusqu'au bout, y compris dans l'affirmation ou la reconnaissance de ce que l'on ne sait pas.
M. Nicolas GARNIER : Récemment, nous avons eu l'occasion, grâce à l'obligeance de M. le sous-préfet de Vendée, de participer aux réunions techniques concernant la prise de décision d'ouverture ou non des écluses. Les documents techniques, que nous avons reçus, nous sont parvenus par les soins de l'ITOPF, qui sont les conseilleurs techniques du FIPOL. Ils ont été les seuls à diligenter les premières prises d'échantillons et ont fait en sorte d'écarter le laboratoire de Bordeaux en ne lui envoyant pas les échantillons qui devaient normalement faire l'objet d'une contre-analyse. Au final, les premières analyses ont été faites par un laboratoire de Norvège, choisi uniquement par l'ITOPF.
Le problème des indemnisations et celui de l'évaluation de l'impact sont liés car l'ITOPF s'immisce dans l'évaluation de l'impact en amont des problèmes, pour pouvoir influer sur les résultats et prouver qu'éventuellement, les pollutions portuaires et touristiques sont prépondérantes par rapport à la pollution provenant du naufrage.
Les professionnels sont incompétents pour affronter des juristes et des techniciens - qui souvent parlent anglais - et ne sont pas préparés à maîtriser cette situation. De leur côté, les services techniques de l'Etat ne possèdent pas non plus les compétences requises dans les domaines scientifiques qui leur sont soumis.
Par exemple, le responsable de la Direction Départementale de l'Equipement (DDE) « cellule qualité des eaux du littoral » m'a affirmé que le naphtalène, qui est un hydrocarbure aromatique polycyclique léger, donc très soluble dans l'eau, ne serait pas présent dans le sel parce que le naphtalène est, je le cite : « Comme l'antimites, cela s'évapore ». Il ne me l'a pas écrit. Pourtant, les taux relevés dans les analyses étaient très importants en naphtalène. Un fonctionnaire de l'Etat, qui appartient à un service technique de l'Etat, m'a affirmé une chose qu'il est incapable de prouver.
Comment nous, les sauniers, qui essayons de nous renseigner depuis trois mois pour faire une licence de chimie organique en accéléré, (rires) pouvons-nous être capables de réfuter l'autorité de services techniques de l'Etat qui prennent de telles positions, au cours d'une réunion à la sous-préfecture, destinée à prendre la décision d'ouvrir les écluses pour alimenter 1 200 hectares de marais salants, avec les impacts environnementaux et économiques que l'on connaît ?
C'est pourquoi nous demandons, avec les Guérandais, une réponse claire. Par précaution, interdisons, dans les départements de Vendée et de Loire-Atlantique, les prises d'eau pour le marais salant et prenons la responsabilité, en matière d'indemnisations, de cette décision qui est une réponse claire pour une activité, qui est au centre de l'image touristique régionale et de l'image à long terme de cette région.
M. Jean-Claude HERVE : Vous nous avez demandé si les moyens étaient suffisants. Une réponse négative a été donnée par le CES, il en est de même pour les indemnisations du FIPOL.
M. le Président : Vous avez de la chance de le savoir. Nous en revenons et nous ne le savons pas. Disons les choses telles qu'elles sont aujourd'hui ; il y a 1,2 milliard disponible et il a été dépensé 2,5 millions. Vous ne pouvez donc pas dire qu'il n'y a pas suffisamment d'argent, le problème étant de savoir comment il sera distribué. C'est une de nos préoccupations de voir que quatre mois après la catastrophe, seuls 2,5 millions de francs ont été dépensés.
M. Jean-Claude HERVE : Justement, le système du FIPOL nous préoccupe car c'est une assurance et un droit de polluer. La responsabilité du donneur d'ordre, que nous souhaitons est une façon d'aller à l'encontre de ce droit. Nous souhaitons que celui qui engage quelque chose prenne les précautions nécessaires.
En matière de prévention, il faut aussi s'interroger sur la nécessité de transporter certains produits dangereux par voie maritime. On peut essayer de limiter le volume des produits dangereux transportés par voie de mer, quand cela n'est pas nécessaire. Il nous a été rapporté, par un certain nombre de professionnels, que beaucoup de cargaisons croisaient au large de la Bretagne car les bateaux ne voulaient pas entrer dans les ports français pour livrer la cargaison, par crainte des contrôles. Il y a non seulement un problème national, mais aussi européen, de concurrence et de différence des contrôles entre les différents ports.
Les produits dangereux vont aux Pays-Bas et reviennent ensuite par la route, en direction de Marseille ou du sud de la France. Le problème doit être considéré non seulement à l'échelle nationale, mais aussi communautaire, car il concerne plusieurs pays européens. Selon différentes enquêtes, les deux pays de la communauté essentiellement victimes des pollutions maritimes sont l'Angleterre et la France. La majorité des bateaux qui polluent ou qui naviguent dans les eaux ne vont ni en France ni en Angleterre. Il y a là un problème de responsabilisation et d'harmonisation des pratiques qui nous semble extrêmement important.
Bien que cela ait été dit tout à l'heure, j'insiste de nouveau sur la nécessité de garde-côtes. Dans l'entretien que nous avons eu avec Mme de Palacio, il a été avancé l'idée que la complexité des systèmes de protection des côtes des différents pays était telle qu'elle doutait de la possibilité d'avancer au niveau européen. On peut aussi réfléchir sur le système français tel qu'il existe, avec ses divisions, son fractionnement et ses dysfonctionnements et voir comment il serait possible de mettre en _uvre un système de garde-côtes qui soit efficace à l'échelle nationale.
Mme Javette LEBESQUE : Je souhaiterais apporter un complément de réponse à M. Landrain, tiré de l'étude que le directeur de la NOAA a présentée à Lorient il y a deux mois. Si on veut pouvoir considérer que le « plus jamais ça » n'est pas un simple raccourci verbal, il faut que toute la partie prévention puisse être étendue au maximum, c'est-à-dire y compris prévoir que cela peut se reproduire et avoir des personnels formés et aptes à une réponse immédiate, chose que nous n'avons pas dans notre fonctionnement portuaire ou littoral.
C'est le sens des quelques mots que vous pointiez dans le paragraphe du Mémorandum. Il ne s'agit pas de dire que M. Untel a mal fait son travail, mais qu'il n'y a pas, pour l'instant, les conditions d'une réponse immédiate, correcte et qui permette d'atténuer les causes telles qu'on a pu les vivre.
M. Pascal TOSATTO : Du fait de l'improvisation, du manque de matériel et de préparation, il résulte que l'on se retrouve avec 150 000 tonnes de déchets non triés. Il va falloir rapidement songer à en faire quelque chose, sinon, comme dans le cas de l'Amoco, on aura encore, dans vingt ans, des centaines de milliers de tonnes qui auront peut-être été dissimulées, comme c'est le cas actuellement.
Audition de M. Philippe PRADEL,
directeur-adjoint de la branche combustibles
et recyclage de la COGEMA,
accompagné de Mme Catherine TISSOT-COLLE,
directeur général adjoint de TRANSNUCLEAIRE
(extrait du procès-verbal de la séance du 3 mai 2000)
Présidence de M. Louis GUEDON, Vice-président.
M. Philippe Pradel et Mme Catherine Tissot-Colle sont introduits.
M. le Président leur rappelle que les dispositions législatives relatives aux commissions d'enquête leur ont été communiquées. A l'invitation du Président, M. Philippe Pradel et Mme Catherine Tissot-Colle prêtent serment.
M. le Président : Nous sommes heureux d'accueillir M. Philippe Pradel, directeur adjoint de la branche combustibles et recyclage de la COGEMA, qui est accompagné de Mme Christine Gallot, directeur des relations internationales et des affaires publiques, et Mme Catherine Tissot-Colle, directeur général adjoint de TRANSNUCLEAIRE.
Je vous donne la parole pour un exposé introductif, à la suite duquel nous vous poserons quelques questions.
M. Philippe PRADEL : Avant de commencer cet exposé, permettez-moi de parler rapidement des sociétés que nous représentons.
COGEMA est l'industriel français du cycle du combustible nucléaire. TRANSNUCLEAIRE est une filiale à 100 % de COGEMA dont la fonction essentielle est d'assurer les transports maritimes, terrestres et aériens de matières nucléaires pour le compte de COGEMA mais aussi pour d'autres industriels de l'électronucléaire.
Je vais décrire tout d'abord le cycle du combustible nucléaire, les différentes matières de chacune des étapes et les modalités selon lesquelles elles sont transportées.
Le cycle du combustible nucléaire commence par les lignes d'uranium à partir desquelles sont extraits des concentrés miniers d'uranium transportés principalement sous forme de ce que l'on appelle le Yellow Cake dénommé ainsi parce qu'il est de couleur jaune et qu'il contient à 90 % de l'uranium.
Ensuite, nombreuses sont les étapes chimiques de préparation de cet uranium avant fabrication du combustible nucléaire, et ce sous différentes formes chimiques, principalement des formes fluorées, telles que tétrafluorure ou hexafluorure d'uranium.
L'amont du cycle nucléaire, étape précédant la fabrication du combustible nucléaire, se caractérise principalement par des quantités de matières faibles mais tout de même supérieures à celles du reste du cycle. Telle est l'une des caractéristiques du nucléaire : les quantités de matières sont extrêmement faibles pour une production d'énergie donnée. Pour vous donner un ordre de grandeur, elles sont un million de fois plus faibles que lorsque l'on utilise, par exemple, du pétrole ou du gaz. La même énergie est produite avec un gramme de matières nucléaires et avec une tonne de combustibles fossiles.
Lorsque nous parlerons tout à l'heure plus en détail des transports, il faut bien avoir présent à l'esprit que les quantités sont extrêmement faibles. De ce fait, le nombre de transports est peu important et les conditions associées peuvent être précises s'agissant de transports très spécifiques.
Suit l'étape de la fabrication du combustible nucléaire, c'est-à-dire des éléments qui entrent dans les centrales nucléaires pour produire le courant électrique.
L'aval du cycle est l'étape postérieure à la production d'électricité dans les réacteurs nucléaires. Le combustible usé doit être pris en charge pour être « retraité ». Le retraitement est réalisé aujourd'hui dans toutes les industries modernes. Il consiste à trier les différents composants restant dans ce combustible usé pour assurer, d'une part, le recyclage de ce qui est recyclable et, d'autre part, le conditionnement sous forme de déchets ultimes des matières réellement non révisables.
A ce titre, des transports du combustible usé lui-même qui contient une quantité importante de radioactivité, même si elle est très faible du point de vue massique, interviennent. Après retraitement, c'est-à-dire après séparation des produits recyclables, est effectué le transport des matières recyclables en vue de leur utilisation pour fabriquer de nouveaux combustibles, ainsi que des déchets ultimes sous forme de déchets « vitrifiés », c'est-à-dire bloqués dans une matrice de verre ayant des caractéristiques d'inaltérabilité, au sens commun du terme.
En amont du cycle, les quantités sont faibles mais relativement significatives. A titre d'exemple, la quantité d'uranium extraite annuellement sur l'ensemble de la planète - et pas seulement pour le compte de COGEMA - est de l'ordre de 30 000 tonnes. Toute cette quantité n'est pas transportée par bateau ou par avion, bien entendu. Une partie de ces minerais est utilisée localement si une industrie nucléaire est implantée dans le pays d'extraction. Par ailleurs, les minerais d'uranium, matières relativement peu toxiques et peu radiotoxiques, se transportent de manière assez conventionnelle par rapport aux matières à risque, en général.
J'insiste sur une spécificité des transports de matières radioactives, celle des transports de l'aval du cycle, c'est-à-dire après irradiation en réacteur. Compte tenu des quantités de radioactivité importantes et donc d'une radiotoxicité importante, des caractéristiques bien particulières de protection et de sécurité s'imposent non seulement pour les transports mais aussi pour d'autres manipulations.
Citons quelques exemples pour les différents transports issus de l'aval du cycle.
Le premier est celui du combustible usé. Le combustible sortant de réacteurs doit être acheminé vers une usine de retraitement, il n'en existe qu'en France, en Angleterre et au Japon, plus en ex-Union Soviétique, en Russie et au Kazakhstan, d'où la nécessité d'acheminer ces combustibles par voie terrestre ou maritime vers ces usines de traitement. Une première classe de transports concerne donc les combustibles usés.
Après séparation des matières en vue du recyclage de 96 % à 97 % de la matière sous forme d'uranium, de plutonium ou de combustible recyclé, les 3 % de matières de combustible usé non utilisés sont mis sous forme de déchets vitrifiés. Ceux-ci doivent également être transportés vers le pays d'origine et au sein de celui-ci vers l'installation dédiée d'entreposage ou de stockage définitif. Tels sont les différents transports de matières à assurer en aval du cycle.
Ces transports sont assurés par voie terrestre ou maritime. Pour ce qui concerne l'Europe continentale, ils sont assurés en l'occurrence par voie ferrée. En revanche, s'agissant des pays du Sud-Est Asiatique, principalement du Japon, avec lesquels nous avons beaucoup de relations, les transports de combustibles usés ou les transports en retour des matières recyclées ou des déchets ultimes sont effectués par voie maritime.
Le premier transport est celui du combustible usé. Plusieurs années après, les produits reviennent sous la forme que j'ai décrite tout à l'heure.
Le transport du combustible usé est une activité relativement ancienne puisque, depuis plus de trente ans, nous avons des liaisons régulières avec le Japon mais en très petit nombre. Seules quelques unités de transport de combustibles usés par an partent des différentes centrales japonaises vers le port de Cherbourg à proximité duquel se situe l'usine de traitement de ces combustibles usés de La Hague.
Citons un autre cas particulier plus récent dont vous avez sans doute entendu parler l'année dernière : les réacteurs de recherche. En matière de nucléaire, outre les installations de production d'électricité et d'électronucléaire utilisées par le Japon, il faut aussi prendre en considération les installations de recherche à vocation médicale pour la production de radio-isotopes en médecine nucléaire ou scientifique en recherche pure. Ainsi, nous avons effectué l'année dernière un premier transport maritime en provenance d'Australie de combustibles usés du réacteur de recherche australien.
L'élément le plus important en termes de transport est celui du combustible recyclé à partir des matières issues ou récupérées du combustible usé, dit combustible Mox dans un langage quelque peu technique. Celui-ci, fabriqué après tri, est livré aux mêmes clients.
Etant donné qu'il contient du plutonium, ce combustible est soumis pour son transport à des exigences en matière de protection physique, c'est-à-dire de non-risque de détournement de ces matières. Le premier transport de ce type a été effectué vers le Japon en 1999. Il s'agissait d'un transport expérimental. Pour donner un ordre de grandeur de ce type de transport par rapport à d'autres pour les années à venir, un seul bateau partant de Cherbourg pour le Japon charge à bord l'équivalent énergétique de vingt-cinq tankers de 200 000 tonnes. Je précise qu'il s'agit non pas d'un tanker mais d'un bateau d'une centaine de mètres de long. Par conséquent, un seul bateau partant de Cherbourg vers le Japon transporte en son sein, sous forme de combustibles, l'énergie potentielle, si je puis dire, qui sera produite dans les réacteurs, équivalente à celle de vingt-cinq tankers de 200 000 tonnes. Tel est l'ordre de grandeur à la fois des volumes et du nombre de transports effectués.
Le deuxième type de transport en retour, après le combustible usé et le combustible recyclé, concerne les déchets ultimes sous forme de déchets vitrifiés conditionnés dans une matrice de verre d'une dimension d'un peu plus d'un mètre de hauteur, qui leur assure une grande stabilité. Cinq transports en retour par voie maritime ont été effectués depuis 1995 vers le Japon qui est le seul pays concerné. Aujourd'hui, nous sommes au régime équilibré de ces retours par rapport aux transports allers, soit un ou deux transports par an correspondant aux programmes commerciaux que nous avons avec le Japon. Il s'agit d'un nombre très restreint. Tels sont les ordres de grandeurs en termes de masse et de nombre de transports des matières.
La sécurité de ces différents transports est assurée dans des conditions très analogues à celles appliquées en matière de sûreté nucléaire en général. Le principe, fondé sur la défense en profondeur, consiste, à la manière des camps retranchés de Jules César pourvus de plusieurs lignes de défense les unes derrière les autres, à mettre des barrières successives entre la matière dangereuse, c'est-à-dire la matière nucléaire, et l'extérieur. L'objectif est de se protéger a priori de deux risques : un risque de dispersion des matières radioactives, notamment dans l'environnement, et un risque d'exposition directe du personnel aux rayonnements. Tels sont les deux grands thèmes visés par la sécurité et la sûreté nucléaires.
La sécurité et la sûreté de ces installations et de ces transports, qu'ils soient maritimes ou terrestres, sont garanties par que l'on appelle le « colis », c'est-à-dire l'enveloppe qui entoure la matière nucléaire, son emballage. La matière nucléaire n'est pas mise à nu, si je puis dire, dans une installation, un cargo ou un bateau. Il s'agit d'une caractéristique très particulière et très importante des transports de matières nucléaires. Les fonctions de ce colis tendent à respecter les deux principes que je viens d'énoncer : non-dispersion des matières radioactives et protection par rapport aux rayonnements ionisants. Par ailleurs, des dispositions spécifiques concernent la manutention de ces colis, leur chargement et déchargement à quai, par exemple. Je n'y reviens pas puisque tel n'est pas vraiment le sujet, mais ces fonctions sont, bien évidemment, importantes.
Par ailleurs, comme dans toutes les installations nucléaires, une organisation est prévue pour gérer les situations exceptionnelles de crise avec des entraînements sous forme d'exercices annuels.
Je reviens sur ces notions de défense en profondeur et de barrières les unes derrières les autres, si je puis dire, avant d'accéder à la matière nucléaire, le tout étant mis dans un vecteur de transport, en l'occurrence un bateau.
Sont transportées par voie maritime des matières stables, non sous formes liquides, dans un conditionnement adapté. Des types d'emballage spécialement étudiés et faisant l'objet de contraintes fixées réglementairement sont prévus à cet effet. Le transport est assuré par des navires, soit dédiés, soit spécialement affrétés.
Les emballages assurent les fonctions principales de sûreté pour le transport, c'est-à-dire le confinement de la matière transportée, y compris en situation accidentelle ou incidentelle. Un blindage contre le rayonnement assure une protection contre les radiations. Il s'agit d'emballages lourds, en général sous forme de cylindres d'une importante épaisseur d'acier de vingt ou vingt-cinq centimètres. Ils assurent, bien entendu, la protection contre les rayonnements mais ils présentent aussi, de ce fait, des caractéristiques mécaniques en cas d'incident ou de problème. Ils sont en effet capables de résister à une multitude d'agressions, de type incendie ou immersion à grande profondeur, tout en gardant leur intégrité.
Incidemment, un problème est particulier au nucléaire : le maintien de la sous-criticité dans le cadre de transports de matières fissiles. Cette considération rejoint ce que j'indiquais tout à l'heure à propos du transport de matières susceptibles de provoquer une réaction en chaîne. La géométrie des différents éléments est étudiée pour qu'en aucun cas, même à la suite d'introduction d'eau ou d'un incendie, l'ensemble du contenu du colis puisse atteindre la criticité, c'est-à-dire le début d'une réaction en chaîne. Il s'agit là réellement d'une particularité très forte du nucléaire.
M. le Rapporteur : Vos derniers propos concernent tant le combustible usé que les déchets ultimes ?
M. Philippe PRADEL : Oui !
M. le Rapporteur : Par conséquent, tout type de transport, n'est-ce pas ? (M. Pradel acquiesce.)
M. Philippe PRADEL : Ces emballages spécifiques sont utilisés tant pour les déchets vitrifiés que pour les combustibles usés. Les principes sont sensiblement les mêmes, ainsi que leur gabarit, mises à part quelques spécificités internes. Ils sont relativement standardisés pour les installations d'expédition et de réception afin de pouvoir les manipuler et les ouvrir pour en sortir et y entrer les combustibles ou les déchets vitrifiés. A titre d'information, un château chargé pèse environ 110 ou 120 tonnes. Sa longueur est de l'ordre de quatre mètres cinquante ou cinq mètres de long et son diamètre environ de deux mètres. Sa masse est importante, sachant que c'est la masse de la protection - et non celle du contenu - qui fait celle de l'objet.
M. le Président : De combien de couches ou d'étages le château est-il constitué ?
M. Philippe PRADEL : Dans le cas des déchets vitrifiés, il est constitué de sept conteneurs par tranche sur quatre étages, ce qui représente au total vingt-huit conteneurs. Dans le cas du combustible Mox, recyclé et livré en retour aux clients, le château est moins standardisé parce que les réacteurs ont chacun leur mode de combustibles. Certains en sont constitués de huit, mais il peut y en avoir davantage.
Mme Catherine TISSOT-COLLE : Les emballages utilisés pour le Mox sont, en général, identiques extérieurement à ceux utilisés pour les combustibles usés. Seuls les paniers intérieurs sont différents parce que vous avez, d'un côté, un combustible neuf et, de l'autre, un combustible irradié. Les caractéristiques physiques sont donc différentes, mais il s'agit basiquement du même produit qui répond aux mêmes normes AIEA et qui présente les mêmes caractéristiques de sûreté.
M. Philippe PRADEL : Les emballages utilisés se caractérisent par leur épaisseur de protection biologique qui assure aussi une forte mécanique à l'ensemble, ainsi que par plusieurs niveaux d'ouverture et de fermeture de bouchons par des joints étanches - a minima deux - vissés ou soudés, qui assurent plusieurs barrières de confinement de la matière interne par rapport à l'extérieur.
M. le Rapporteur : Il n'y a donc aucune radioactivité extérieure ?
M. Philippe PRADEL : Si à l'extérieur, vous n'avez aucune sortie de radioactivité, en revanche, vous pouvez avoir du rayonnement qui est, lui « matériel » mais qui est maintenu à un niveau bas pour le personnel qui travaille autour de l'installation.
Toujours en ce qui concerne la sûreté et la sécurité de ce type de transport, quel est le type de navire utilisé et à quelle réglementation répond-il ?
En matière de transport, les réglementations, relativement complexes, sont internationales, en tout cas émises par des structures essentiellement issues de l'OMI parmi lesquelles deux principales intéressent notre activité : d'une part, l'Agence internationale de l'énergie atomique qui émet un certain nombre de recommandations sur différents sujets, en particulier celui des transports ; d'autre part, l'OMI, l'Organisation maritime internationale qui a émis en 1993 le recueil INF, Irradiated nuclear fuel, concernant notamment les combustibles usés, le plutonium et les déchets à haute radioactivité.
Ce recueil, transcrit en droit national français en 1996, prévoit trois classes principales - INF 1, 2 et 3 - de navires utilisables en fonction de la quantité et de la nature des matières transportées. La classe la plus restrictive, la classe 3, permet le transport des plus grandes quantités de matières. Ce recueil prévoit également les caractéristiques particulières de ces navires en matière d'architecture, donc des coques et de la stabilité, de la protection contre l'incendie et de matériels spécifiques de radioprotection qui sont la spécificité nucléaire. Le personnel à bord doit être protégé et formé à la radioprotection. Par ailleurs, il prévoit un plan d'urgence à bord, c'est-à-dire un entraînement des équipages en cas d'incendie ou d'avarie en cours de transport.
Distinguons deux types de navires : d'une part, les navires dédiés dont l'usage exclusif est le transport des matières nucléaires. Ces navires sont actuellement la propriété d'une filiale commune à COGEMA et à certains autres partenaires, japonais et anglais. Cette société PNTL - Pacific Nuclear Transport Limited - effectue les transports entre le Japon, d'une part, et la France et l'Angleterre, d'autre part. En termes techniques, ces bateaux d'une centaine de mètres de long, se caractérisent par des systèmes sophistiqués de navigation et de radionavigation, une structure de coque bien définie, en l'occurrence de double coque s'agissant des bateaux INF 3, et la redondance de l'ensemble des moyens de conduite - gouvernails et motorisation - afin de prévenir une défaillance unique d'un moteur. A bord, sont transportés entre seize et vingt châteaux selon la structure de ces bateaux.
Ces bateaux qui naviguent maintenant depuis plus d'une trentaine d'années font l'objet de programmes d'entretien et de maintenance. Ils sont éventuellement renouvelés au fil de leur usage. Ils effectuent deux, voire trois rotations sur le Japon par an - pas plus -, sachant que la durée du transport entre le continent européen et le Japon est de l'ordre de deux mois, selon la route choisie.
Le second type de navires utilisés pour des transports non pas moins outillés mais moins dédiés ou moins réguliers sont les navires spécialement affrétés. Ils répondent également aux normes INF et, en général, INF 2.
M. le Rapporteur : Je me permets de vous interrompre de crainte d'oublier de vous poser cette question : est-ce TRANSNUCLEAIRE qui affrète PNTL ?
Mme Catherine TISSOT-COLLE :C'est effectivement TRANSNUCLEAIRE qui agit, en général, comme sous-traitant de COGEMA et qui affrète PNTL.
M. le Rapporteur : Soit PNTL...
TRANSNUCLEAIRE qui agit, en général, comme sous-traitant de COGEMA et qui affrète PNTL.
M. Philippe PRADEL : Vous abordez là une des règles dont j'avais l'intention de parler dans le cours de mon exposé. La responsabilité, non pas civile classique du transport maritime mais nucléaire du transport, incombe à l'expéditeur. Il est parfois possible, par contrat, de transférer cette responsabilité de l'expéditeur au destinataire. Par conséquent, l'expéditeur est responsable et, par dérogation, le destinataire par une mise en commun. La structure responsable en matière nucléaire est nécessairement ce que l'on appelle un exploitant nucléaire. Tel est le principe de base intangible, d'ordre réglementaire.
M. le Rapporteur : C'est donc l'expéditeur qui est responsable de tout ce qui peut arriver sur le bateau ?
M. Philippe PRADEL : L'expéditeur est responsable des éventuels dommages résultant d'un incident nucléaire et non pas d'une collision, par exemple.
M. le Rapporteur : Sa responsabilité ne concerne pas le bateau lui-même ?
M. Philippe PRADEL : L'expéditeur est clairement responsable des conséquences nucléaires d'un éventuel incident ou accident.
M. le Président : L'expéditeur est donc nécessairement responsable des conséquences d'une pollution liée à la cargaison ?
M. Philippe PRADEL : D'une pollution nucléaire, bien entendu, sachant que l'expéditeur est nécessairement une société nucléaire que l'on appelle dans notre langage un exploitant nucléaire. En l'occurrence, il s'agit le plus souvent pour COGEMA de TRANSNUCLEAIRE. Les Japonais et les Anglais ont aussi des sociétés dédiées dont le métier...
M. le Rapporteur : Je me permets de vous interrompre une nouvelle fois, avec l'autorisation de M. le Président.
M. le Président : Tout à fait ! Ce point est important.
M. le Rapporteur : Cette responsabilisation de l'expéditeur est une originalité dans le droit maritime. S'agit-il d'une pratique de COGEMA ? Ou est-ce codifié au sein du club des nucléaires maritimes de l'OMI au titre du code auquel vous avez fait allusion tout à l'heure ?
M. Philippe PRADEL : A ma connaissance, mais nous vous donnerons des précisions juridiques exactes, c'est l'AIEA qui a émis ce type de recommandation, laquelle est appliquée par chacun des pays...
M. le Président : Pas nombreux !
M. Philippe PRADEL... qui sont quasiment tous membres de l'AIEA. En revanche, je ne suis pas certain que cette responsabilité soit rappelée en tant que telle dans le code INF.
M. le Rapporteur : Vos collègues japonais et britanniques ont-ils le même système de responsabilisation ?
M. Philippe PRADEL : Ils appliquent également la responsabilité de l'expéditeur.
M. Paul DHAILLE : Allez-vous nous parler des équipages...
M. Philippe PRADEL : J'en ai dit un mot tout à l'heure en parlant de la formation, mais je peux en parler plus en détail.
M. Paul DHAILLE... sur les navires dédiés et affrétés afin d'apprécier la nuance, et ce à tous les niveaux ?
M. le Rapporteur : Cette question pourrait faire l'objet d'une réponse à l'issue de cet exposé.
M. Philippe PRADEL : Ces navires respectent les codes suivant leur catégorie et les exigences particulières y afférentes, selon qu'ils sont à double coque ou non, par exemple.
Evoquons la question de la réglementation que nous avons déjà esquissée.
Les transports de matières nucléaires par voie maritime sont strictement réglementés et contrôlés par les institutions de l'ONU, que sont l'AIEA et l'OMI.
M. Jean-Michel MARCHAND : Me permettez-vous de vous interrompre, monsieur Pradel ?
M. Philippe PRADEL : Je vous en prie.
M. le Président : La parole est à M. Marchand, avec l'autorisation de M. Pradel.
M. Jean-Michel MARCHAND : Dans le prolongement de la question posée par mon collègue, M. Dhaille, je souhaiterais que l'on revienne sur les notions de « dédié » et « affrété », notamment sur cette dernière à peine évoquée, pour bien saisir la nuance et la différence en ce qui concerne les équipements du bateau.
Mme Catherine TISSOT-COLLE : Cela ne change rien !
M. Philippe PRADEL : Les navires dédiés, qui sont la propriété d'une société nucléaire que nous avons en commun avec les Japonais et les Anglais, effectuent des transports réguliers de combustibles usés à l'aller, c'est-à-dire entre la France et le Japon, et de combustibles Mox ou de déchets vitrifiés au retour, donc entre le Japon et la France.
Pour les transports moins routiniers, nous faisons appel à des navires affrétés. L'exemple type est celui du transport de combustible australien dont je vous ai parlé tout à l'heure. Nous avons recouru à un navire affrété. Il appartient à un armateur et il respecte les mêmes conditions techniques, mais il peut avoir d'autres usages que le transport de matières nucléaires.
M. Alain GOURIOU : Faites-vous vérifier leurs normes techniques ?
M. Philippe PRADEL : Absolument ! Il s'agit d'un « certificat ». Ces navires font l'objet d'un agrément INF 1, 2 ou 3.
M. le Président : L'agrément est le même entre un navire dédié et un navire affrété ?
Mme Catherine TISSOT-COLLE : Tout à fait ! Cela n'a rien à voir !
M. le Rapporteur : C'est un problème de propriété !
Mme Catherine TISSOT-COLLE : Les systèmes d'usage sont différents, mais les navires répondent exactement aux mêmes normes.
M. le Président : Les caractéristiques des navires sont les mêmes ?
Mme Catherine TISSOT-COLLE : Les mêmes ! Les contraintes sur les navires sont liées à la nature des matières transportées et donc à la réglementation qui s'y applique.
S'il s'agit de matières de l'amont du cycle, s'appliquent un certain nombre de contraintes réglementaires, de spécifications techniques que l'on doit respecter. Par conséquent, on vérifie que les navires que l'on affrète y répondent.
S'il s'agit de matières de l'aval du cycle, s'appliquent d'autres caractéristiques.
Cependant, le fait que ce bateau soit utilisé uniquement pour nous ou à d'autres fins n'a aucune influence sur les spécifications techniques qu'il doit respecter.
M. le Président : On peut penser qu'un navire dédié a les caractéristiques pour les produits à la fois en amont et en aval du cycle ?
Mme Catherine TISSOT-COLLE : Qui peut le plus, peut le moins, peut-on dire ! Mais les contraintes sont plus importantes sur les matières de l'aval du cycle parce qu'elles ont plus de radioactivité.
M. Philippe PRADEL : Les navires dédiés sont tous, à ma connaissance, sauf erreur de ma part, du type INF 3, c'est-à-dire les plus contraints réglementairement. Ils assurent les transports notamment de combustibles usés.
Mme Catherine TISSOT-COLLE : Dans l'amont du cycle, certains transports concernent des matières assez peu radioactives. Par conséquent, si tous les transports que nous effectuons obéissent à la réglementation, il est toutefois possible, dans ce cas, de recourir à des navires...
M. le Rapporteur : De pluriactivité !
Mme Catherine TISSOT-COLLE... plus ordinaires et qui peuvent être utilisés par d'autres affréteurs à d'autres fins.
M. Paul DHAILLE : Dans tous les cas, c'est toujours l'expéditeur qui est responsable ?
M. Philippe PRADEL : Dans tous les cas de transport de matières nucléaires, qu'elles soient de l'aval, en petites ou grandes quantités, la responsabilité nucléaire incombe toujours à l'expéditeur, exploitant nucléaire.
M. le Président : De quand date cette responsabilité qui est celle de l'affréteur en cas d'ionisation du produit à la suite d'une catastrophe ? Avez-vous été considéré comme responsables depuis le début ?
M. Philippe PRADEL : L'ONU, puis l'AIEA ont commencé à rédiger des réglementations en matière de transport de matières nucléaires dès l'après-guerre, dans les années 50.
M. le Président : Dès que cette industrie s'est développée, votre responsabilité a été associée à votre transport ?
M. Philippe PRADEL : Tout à fait !
M. le Président : Dès le début ?
M. Philippe PRADEL : Dès l'origine du transport de ces matières nouvelles et très spécifiques.
Mme Catherine TISSOT-COLLE : En fait, le système de responsabilité des transports nucléaires est décalqué du système de responsabilité nucléaire pour les installations nucléaires. Telle est la logique ! Il s'agit d'une logique non pas « transport » mais nucléaire.
M. le Rapporteur : Nous reviendrons sur ce point fort intéressant à l'issue de votre exposé.
M. Philippe PRADEL : L'AIEA émet des règlements de transport de matières radioactives et l'OMI des codes et des recueils, dont l'IMDG et l'INF, qui sont transcrits en droit français. Certains pays appliquent l'INF sans même l'avoir transcrit dans leur droit national. La France l'appliquait avant même de l'avoir transcrit dans son droit en 1996.
M. le Rapporteur : L'IMDG ?
Mme Catherine TISSOT-COLLE : L'INF pour les matières de l'aval du cycle.
M. Philippe PRADEL : Outre les réglementations internationales qui sont, par nature, celles du transport maritime, des organismes sont également chargés de la réglementation en France. Avant 1997, était concerné le ministère des transports avec les structures dédiées. Depuis 1997, ces missions ont été rassemblées auprès de l'autorité de sûreté, la direction de la sûreté des installations nucléaires (DSIN), qui dépend des ministères de l'industrie et de l'environnement. Cette direction est chargée de contrôler les équipements de transport maritime ou terrestre et de participer à l'élaboration de la réglementation nationale.
Cette modification du système, assez récente, visait à parvenir à une situation homogène en matière de nucléaire, qu'il s'agisse du transport ou des installations, et ce sous le contrôle d'une autorité de sûreté unique, la DSIN, sur l'ensemble des activités nucléaires françaises.
Pour conclure cet exposé introductif, j'examinerai les incidents et les accidents et leur classement dans ce que l'on appelle une échelle de gravité.
En matière de réacteurs ou d'installations nucléaires fixes, il existe une échelle internationale qui permet de communiquer en cas d'incident sur le réacteur « x » ou directement sur l'installation COGEMA. L'incident est classé de niveau 0, 1, 2, 3 jusqu'à 7. Cette échelle internationale est presque utilisée par tous les pays, en tout cas très strictement en France. Depuis 1999, elle a été étendue aux incidents de transport, ce qui est la conséquence logique du point précédent puisque je disais que la DSIN était chargée également de la sûreté des transports.
Cette échelle de gravité, dite INES, International Nuclear Events Scale, comporte donc sept niveaux. Le niveau 0 ne concerne pas un incident. Etant donné que quelque chose qui n'était pas prévu s'est passé, l'événement est néanmoins déclaré bien qu'il soit sans aucune conséquence d'aucune nature en termes de barrières de confinement et de sûreté. Il permet d'alimenter le retour d'expériences des exploitants.
Outre le niveau 0, cette échelle décrit la gradation des incidents, de l'anomalie à l'incident grave, et des accidents, de l'accident simple à l'accident majeur. En matière électronucléaire, l'accident de niveau 7 bien connu est celui de Tchernobyl. En matière de transport, étant donné que les matières sont confinées, nous ne pouvons pas imaginer atteindre un tel niveau.
Cette échelle présente, en particulier, l'intérêt d'être appliquée en temps réel mais aussi de reconstituer les incidents passés et de les classer sur cette échelle, pour en donner l'ordre de grandeur.
Deux incidents ont été relativement connus ces dernières années.
En 1997, un navire, le Carla, qui n'était pas du tout dans notre environnement mais qui transportait des sources radioactives à usage médical, a coulé dans les Caraïbes à 4 000 ou 5 000 mètres de profondeur. Les types de protection étaient les mêmes, c'est-à-dire des sources scellées avec des enveloppes. Il a donc été procédé à une analyse de l'impact potentiel de cet incident. Le colis est supposé être au fond de la mer, mais il ne se passe rien puisqu'il est étanche. Il n'y a jamais d'urgence en la matière. En revanche, si ce colis est laissé au fond de la mer, il peut se dégrader et, progressivement, l'ensemble de la matière nucléaire peut se diluer dans l'océan. Cette analyse a révélé un niveau d'impact nul, d'autant plus qu'il s'agissait de sources médicales, donc pas d'une importance extrême. Moyennant quoi, la décision a été prise par les autorités en question - la France n'était pour rien dans cette affaire - de laisser ce colis au fond de la mer compte tenu d'un impact nul.
Le second exemple qui nous concerne plus directement date de 1984. Un navire, le Montlouis, avait coulé à quelques kilomètres des côtes de Dunkerque avec en son sein plusieurs conteneurs d'uranium. L'analyse a conclu à l'absence de danger immédiat en matière nucléaire, compte tenu du confinement garanti par les emballages. Mais étant donné que ces colis étaient déposés à une faible profondeur de la mer et à proximité des côtes, il a été décidé d'aller rechercher les colis. Ceux-ci ont été récupérés et ramenés à terre dans les deux ou trois semaines suivantes, compte tenu de l'absence d'urgence radiologique et de leur étanchéité.
L'incident du Carla a été classé de niveau 3, ce qui correspond à un incident grave compte tenu d'un impact nul contrairement à l'accident dont l'impact potentiel possible sur le public ou l'environnement est non négligeable. Il a été néanmoins classé au plus haut niveau des incidents.
L'incident du Montlouis a été classé rétroactivement, c'est-à-dire l'année dernière, en niveau 2.
Cette échelle, aujourd'hui à l'essai puisqu'elle a été étendue aux incidents de transport en 1999, permettra d'avoir une communication peut-être plus compréhensible sur la nature des différents incidents susceptibles de se produire sur les transports, qu'ils soient d'ailleurs maritimes ou terrestres.
Tels sont les éléments que je souhaitais vous livrer en guise d'introduction.
Mme Catherine TISSOT-COLLE : Permettez-moi, monsieur le président, d'apporter un complément d'information concernant les emballages.
Pour être certain que ceux-ci répondent aux exigences présentées par Philippe Pradel, ils doivent, avant d'être agréés, c'est-à-dire avant de pouvoir être utilisés dans un pays, subir une série de tests de chute, d'immersion et de résistance à l'incendie dont les caractéristiques ont été prévues également par l'AIEA. Cela permet, en amont, de garantir que les emballages utilisés ne nous trahiront pas et sont bien conformes à la réglementation.
M. le Président : En résumé, le risque zéro en matière de naufrage n'existe pas, quelles que soient les précautions d'usage, de surveillance et de technologies qui sont l'objet des soins de ceux qui arment ces navires. En cas de naufrage, la cargaison tombe au fond de l'eau, sans toutefois présenter de risques immédiats dans l'échéance de quelques mois, compte tenu des emballages dans lesquels sont transportés les combustibles. Après étude, deux décisions peuvent être prises : soit les colis sont à des milliers de mètres de fond et l'irradiation future n'étant pas problématique, on ne doit pas aller les chercher ; soit les colis se trouvent à quelques centaines de mètres de fond et, dans ce cas, après on met les moyens pour aller les rechercher.
Mme Catherine TISSOT-COLLE : Exactement !
M. Philippe PRADEL : Tout à fait et sans urgence, comme vous l'avez indiqué.
Des études - non pas réelles mais de simulation d'accidents - ont été réalisées dans le cadre des transports avec le Japon. Les Japonais ont voulu envisager les différents cas susceptibles de se poser, tels celui du bateau coulé dans les eaux territoriales ou au large. Par conséquent, nous disposons déjà de l'analyse prévisionnelle de l'accident qui permet de prendre la bonne décision sans avoir à engager des études longues en amont. Cela fait partie des dossiers d'analyse préliminaire de risques, selon la dénomination qui leur est accordée dans notre jargon.
M. le Président : M. le Rapporteur souhaite vous poser un certain nombre de questions.
M. le Rapporteur : Je souhaite en effet vous poser quatre questions.
En premier lieu, la cargaison est-elle assurée et comment ?
M. Philippe PRADEL : Vaste question à laquelle je réponds sur plusieurs plans.
M. le Rapporteur : Du bateau ?
M. Philippe PRADEL : Du bateau !
M. le Rapporteur : D'accord, mais je parle de l'assurance de la cargaison !
M. Philippe PRADEL... s'agissant de la responsabilité nucléaire de ce que l'on peut appeler la cargaison...
M. le Rapporteur : Toutes choses égales par ailleurs, M. Desmarest assure aussi son pétrole ! Enfin, les chargeurs assurent leur propre cargaison.
M. Philippe PRADEL : La cargaison, en tant que valeur de la cargaison, n'est pas assurée.
M. le Rapporteur : Non ?
M. Philippe PRADEL : Non !
M. le Rapporteur : Et en tant que risque potentiel ?
M. Philippe PRADEL : Bien entendu, et ce dans le cadre de conventions internationales quelque peu complexes dont je n'ai effectivement pas parlé. Il s'agit notamment des conventions de Paris, Bruxelles et Vienne. Il existe une multitude de conventions auxquelles différents pays sont membres ou pas et qui couvrent les dommages jusqu'à certains niveaux. La France est membre des conventions de Paris et de Bruxelles, mais des pays « clients » relèvent d'une autre convention dont les seuils ne sont pas les mêmes mais le principe est globalement identique. Il s'agit donc de régimes conventionnels.
M. le Rapporteur : Pourriez-vous nous faire une note sur ce point ? Qui vous assure et comment ? Quel est le niveau de mutualisation ?
M. Philippe PRADEL : Je ne dispose pas dans mon dossier d'une note spécifiquement détaillée, mais nous pouvons vous adresser un résumé en deux pages.
M. le Rapporteur : Je vous en remercie, car il s'agit d'un de nos sujets de prédilection.
M. Philippe PRADEL : Nous vous communiquerons une note à ce sujet.
M. le Rapporteur : Pour ce qui vous concerne mais aussi les autres, du moins ce que vous savez sur les autres !
M. Alain GOURIOU : Et ce quel que soit le type de bateau, dédié ou affrété.
M. Philippe PRADEL : Bien entendu ! J'espère d'ailleurs avoir été clair en expliquant qu'il s'agissait d'une différence d'usage et non pas de technique ou d'assurance.
M. le Rapporteur : En deuxième lieu, vous avez évoqué deux sinistres. Les avez-vous cités parce qu'il s'agit d'exemples spectaculaires, forts ? Ou d'autres sinistres se sont-ils produits dans l'histoire ?
M. Philippe PRADEL : Je les ai cités comme étant les deux plus importants exemples en matière maritime. Cela étant, sur le port de Cherbourg, s'est produit en 1991 un incident de manutention. A l'occasion d'une opération de déchargement du bateau sur le quai, le pont a dévissé. L'incident a été rétroactivement classé en niveau 1, mais sans conséquence en tant que telle, même sur le colis. Cet exemple, le troisième, est le dernier que j'ai présent à l'esprit dans le domaine maritime.
M. le Rapporteur : Même pour ce qui concerne vos collègues japonais et britanniques ?
Mme Catherine TISSOT-COLLE : Y compris les Japonais et les Anglais !
M. Philippe PRADEL : Je les inclus ! Quand je parle de transports entre le Japon et l'Europe, il s'agit d'un seul type de transport, les Français et les Anglais étant ensemble. Quand un navire part du Japon pour aller à Cherbourg ou à Barrow, au nord de Manchester, le trajet est le même. Dans un sens, les Français et les Anglais sont réceptionnaires uniques et le Japon est expéditeur unique, et réciproquement dans le sens inverse.
M. le Rapporteur : Mais il existe d'autres transports nucléaires dans le monde que ceux auxquels vous faites allusion ?
Mme Catherine TISSOT-COLLE : Certes, mais à notre connaissance, aucun autre incident ne s'est produit.
M. le Rapporteur : Par conséquent, s'il existe d'autres transports, d'autres incidents ne se sont pas produits ?
Mme Catherine TISSOT-COLLE : Non, du moins à notre connaissance.
M. Philippe PRADEL : Nous pouvons le vérifier en faisant une enquête plus détaillée, mais je ne le crois pas non plus. En revanche, d'autres incidents se sont produits dans le domaine des transports terrestres ou autres.
M. le Rapporteur : Je me doute, mais seul le transport maritime nous préoccupe. Le transport terrestre fera l'objet d'une autre commission d'enquête !
Je reviens sur le problème de la responsabilité. Vous avez affirmé la responsabilité de l'expéditeur. Il s'agit d'une figure juridique que l'on ne retrouve pas ailleurs. Nous serions intéressés de savoir, peut-être pas aujourd'hui, comment historiquement nous en sommes venus à ce concept qui n'est pas le concept historique du maritime, n'est-ce pas ?
Mme Catherine TISSOT-COLLE : Absolument !
M. Philippe PRADEL : Tout à fait !
M. le Rapporteur : J'ai cru comprendre que l'on était parvenu à appliquer juridiquement ce concept sur le transport maritime à partir de la filière nucléaire, n'est-ce pas ? Pourrions-nous cependant en avoir un rappel historique ?
Dès lors, en ce qui concerne toujours le transport maritime, comment les autres pays appliquent-ils ce concept ? Est-il ou non reconnu comme tel par l'OMI et, dans l'affirmative, depuis quelle date ? Vous n'en étiez pas certain tout à l'heure et vous vous interrogiez à ce sujet. J'aimerais en avoir la réponse, même si ce n'est pas dans l'immédiat.
Si j'ai bien compris, les Britanniques et les Japonais font de même. (M. Pradel et Mme Tissot-Colle acquiescent.) Tout transport maritime nucléaire est donc bien aujourd'hui de la responsabilité de l'expéditeur.
Mme Catherine TISSOT-COLLE : C'est certain !
M. Philippe PRADEL : Avec toutefois la dérogation que je mentionnais, c'est-à-dire que l'on peut, conventionnellement ou contractuellement, la « basculer » de l'expéditeur sur le réceptionnaire.
M. le Rapporteur : Peu importe puisque, à la limite, c'est la même chose !
M. Philippe PRADEL : La même !
M. le Rapporteur : Ce point me paraît très important.
M. le Président : Vous nous avez expliqué tout à l'heure qu'en amont de la filière, vous aviez les sels d'uranium, les fluorures et, en aval, le plutonium et des résidus.
Parmi les matières radioactives, d'autres composants sont-ils transportés par voie maritime ? Ou est-ce l'essentiel des produits transportés ?
M. Philippe PRADEL : L'essentiel est tout ce qui concourt au cycle du combustible nucléaire. Une autre catégorie de matières nucléaires, illustrée par l'exemple du Carla que je citais, est transportée : il s'agit de tout ce qui gravite autour de la médecine et de la science nucléaires. Ce type de transport n'est pas le métier de base de la COGEMA, si je puis dire, mais c'est la deuxième catégorie des matières nucléaires transportées dans le monde. Certes, elles représentent des quantités beaucoup plus faibles que les matières que je vous ai décrites, mais elles existent tout de même. L'accident du Carla concernait précisément des sources à usage médicale.
M. Jean-Michel MARCHAND : Je comprends bien que votre responsabilité est liée à la cargaison, mais les trois accidents que vous avez relatés concernent des bateaux.
Quelles ont été les causes de ces accidents ? La catégorisation des bateaux est-elle concernée ? Quelles sont les responsabilités ou pas des équipages ? Par voie de conséquence, quelles sont les décisions que vous avez été conduits à prendre dans le choix de vos bateaux ?
Je suppose que les bateaux dédiés sont spécifiquement conçus et que les équipages sont particulièrement entraînés à de telles manutentions. En revanche, les bateaux affrétés n'appartiennent pas aux filiales de vos sociétés. Par conséquent, comment les choisissez-vous ? J'ai bien entendu que les caractéristiques techniques devaient être les mêmes. Précisément, les bateaux qui ont eu des accidents avaient-ils ces caractéristiques techniques ?
M. Philippe PRADEL : Les deux accidents du Carla et du Montlouis concernaient des transports de matières classifiées et faiblement radioactives par des bateaux ni dédiés ni affrétés. Il s'agissait d'un transport plus commun de matières à risque au titre d'autres réglementations.
S'agissant de la formation des équipages, les contraintes sont identiques, qu'il s'agisse de bateaux dédiés ou affrétés. L'équipage est composé d'une certaine façon. En vertu d'un pourcentage fixé, environ la moitié de celui-ci est nécessairement de la nationalité du pavillon, le pavillon étant français dans le cadre des transports français, ou britannique dans le cadre des transports britanniques.
Il existe donc un certain nombre de règles de ce type, ainsi que de formation de l'équipage, notamment en matière de radioprotection pour les officiers. Ces règles sont les mêmes sur les bateaux dédiés et affrétés pour les transports dont je vous ai parlé et qui sont les plus spécifiques de notre activité. Les bateaux accidentés que j'ai mentionnés transportaient des matières dangereuses classiques, si je puis dire.
Mme Catherine TISSOT-COLLE : Monsieur Marchand, en fait, c'est la loi du pavillon qui détermine notamment la nationalité des équipages...
M. Jean-Michel MARCHAND : C'est bien le problème !
Mme Catherine TISSOT-COLLE... et ce directement.
M. Jean-Michel MARCHAND : Je vous remercie de cette réponse, car vous ne nous aviez pas précisé cet aspect.
M. Philippe PRADEL : Je ne vous avais effectivement pas précisé cet aspect pavillonnaire.
Mme Jacqueline LAZARD : La formation des équipages est respectée en fonction du pavillon, mais je suppose qu'une formation spécifique est dispensée pour le transport nucléaire.
Mme Catherine TISSOT-COLLE : Absolument !
M. Philippe PRADEL : Tout à fait !
Mme Jacqueline LAZARD : Est-elle dispensée sous votre contrôle ?
M. Philippe PRADEL : Sous notre contrôle, en effet.
Mme Catherine TISSOT-COLLE : Les bateaux dédiés de la compagnie PNTL sont de pavillon britannique, constitués d'équipages 100 % britanniques qui ne font que cela. Il sont, par ailleurs, numériquement plus nombreux que ceux que l'on trouve sur la moyenne des bateaux de transport de matières dangereuses.
Mme Jacqueline LAZARD : Pour les bateaux dédiés ?
Mme Catherine TISSOT-COLLE : Oui !
M. le Président : Et affrétés ?
Mme Catherine TISSOT-COLLE : Non ! Cela dépend du bateau affrété. On affrète en particulier un bateau qui est sous pavillon français des TAFF et, dans ce cas, une partie de l'équipage doit être de nationalité française. Sur le bateau que l'on utilise, en général, le Bouguenais, le nombre de marins français est plus important que celui exigé par la réglementation et tous les marins appelés à s'approcher de la cargaison ont une formation particulière en radioprotection.
M. le Rapporteur : Ce sont donc, en fait, toujours les mêmes ?
Mme Catherine TISSOT-COLLE : Oui ! Et nous veillons à une pérennité des équipages.
M. le Président : Pour en terminer sur cette question, madame, soyons clairs : pour le transport des produits nucléaires, vous excluez les pavillons de complaisance du transport de ce type de produit ?
M. Philippe PRADEL : Pour les produits de l'aval !
Mme Catherine TISSOT-COLLE : Absolument, pour ce qui concerne les produits de l'aval du cycle !
M. le Président : Pas pour les produits de l'amont ?
La règle générale serait que pour les transports de ces produits dangereux à vocation nucléaire, les pavillons de complaisance soient proscrits, n'est-ce pas ?
M. Philippe PRADEL : Il s'agit d'une règle en tant que telle sur l'aval du cycle et sans doute une règle d'usage sur l'amont dont les produits sont également soumis à une réglementation correspondant à leur niveau de risque.
Mme Jacqueline LAZARD : Madame, vous avez dit tout à l'heure que vous vérifiez l'état des bateaux affrétés et que vous vous assureriez qu'ils respectaient bien les normes. Avez-vous votre propre corps d'inspecteurs ?
M. Philippe PRADEL : Outre la délivrance du certificat accordée par les autorités internationales, la DSIN, autorité de sûreté de l'Etat ou de la nation française, est chargée de ce type de contrôle et de vérification de papiers, de certificats, d'agréments...
M. Alain GOURIOU : L'Erika avait aussi des papiers !
M. Philippe PRADE :... et elle fait des visites dans les ports français, au sens d'inspection du terme.
M. Alain GOURIOU : A défaut d'être complètement tranquillisé, j'ai été un peu rassuré par l'exposé de toutes les normes qui nous ont été définies, mais il est vrai qu'un accident est toujours possible.
Je souhaite poser deux questions.
La première a trait à la précédente : les autres responsables, c'est-à-dire les Britanniques et les Japonais, utilisent-ils les mêmes normes que celles que vous-mêmes appliquez, en particulier dans le cas de l'affrètement des bateaux, pavillons de complaisance compris ?
M. Philippe PRADEL : La réponse est clairement oui !
Mme Catherine TISSOT-COLLE : Entre le Japon et l'Europe, le transport n'est assuré que par les bateaux que l'on a décrits et qui sont des navires spécialement utilisés à cette fin.
M. Alain GOURIOU : Imaginons tout de même le pire, même sur un excellent bateau avec un équipage parfait, en l'occurrence un typhon, un incendie, l'avarie de deux gouvernails dont celui de secours. Avez-vous en portefeuille, si je puis dire, un plan de mesures applicables immédiatement en cas d'accident que vous qualifieriez de majeur, d'après l'échelle de gravité ?
Imaginons l'impossible, le cas d'un navire qui s'échoue sur les côtes de l'Atlantique, de la Manche ou de la Méditerranée. Quelles sont les mesures que vous envisagez ou que vous avez prévues d'appliquer dans l'immédiat, c'est-à-dire dans les heures qui suivent un accident éventuel ?
M. Philippe PRADEL : Pour ce qui concerne l'avarie ou l'incendie, s'applique le plan d'urgence à bord auquel les équipages sont formés. Si l'exécution de ce plan d'urgence à bord n'a pas suffi et que le bateau est, soit échoué sur une côte, soit coulé, s'applique le plan de secours qui fait l'objet d'entraînements annuels avec les équipes concernées. Je rappelle cependant le principe de base selon lequel il n'y a pas urgence.
Le plan d'urgence à bord s'applique pour éteindre par exemple immédiatement un incendie. Vous décrivez là un accident dit majeur non pas au sens de l'échelle de gravité que j'évoquais compte tenu de l'absence de conséquence à l'instant donné mais en termes de naufrage, le bateau ayant coulé par exemple. Il n'y a pas d'urgence parce que la sécurité, la sûreté, le confinement sont assurés non pas par le bateau mais par l'enveloppe du colis.
En cas d'échouage d'un navire sur une côte, par exemple, nous avons les matériels disponibles pour aller récupérer les colis qui, par définition, ne sont pas atteints et les remettre sur la voie publique, si je puis dire.
M. Alain GOURIOU : Ces matériels sont à Cherbourg ?
M. Philippe PRADEL : Principalement en Angleterre, mais nous en avons aussi en France.
Mme Catherine TISSOT-COLLE : Depuis quelques années, a été conçu un système de portique mobile, surtout utilisable en cas d'accident terrestre et non pas en mer. Ce portique peut être acheminé n'importe où et monté en une dizaine de jours. Il permet de récupérer dans des configurations géographiques compliquées des emballages de ce type. Nous aurions donc largement le temps, en configuration terrestre, de mettre en place ce genre d'appareil en cas d'échouage sur les côtes, ce qui paraît assez peu probable.
M. le Rapporteur : Mais toujours possible !
M. Philippe PRADEL : Tout à fait, mais encore une fois, s'il y a urgence à bord, il n'y a pas d'urgence en cas extrême. Si un navire s'échoue ou coule, comme c'était le cas du Montlouis, c'est-à-dire à proximité des côtes, en fond peu important, on a le temps d'aller rechercher les objets et les matériels sont disponibles ou prêts à être assemblés pour pratiquer l'opération elle-même, et ce sans urgence temporelle.
M. Alain GOURIOU : Avez-vous en propre ces moyens spécifiques sans avoir à faire appel à la Marine nationale ou à des compagnies spécialisées d'intervention ?
M. Philippe PRADEL : Tout à fait ! Des moyens basés principalement en Angleterre, sauf erreur de ma part, puisque les Français, les Anglais et les Japonais sont associés, sont disponibles à tout moment. Il existe donc des moyens dédiés, ce qui ne nous empêche pas éventuellement de faire appel à la Marine nationale pour obtenir des moyens supplémentaires.
Mme Catherine TISSOT-COLLE : En guise de précision complémentaire, nous avons mis en place depuis quelques années un système de suivi en temps réel de tous nos transports, y compris par voie maritime. TRANSNUCLEAIRE dispose d'une salle dédiée avec un système de suivi GPS-INMARSAT, si bien que l'on sait où sont tous nos transports, qu'il s'agisse des camions, des wagons ou des bateaux. En cas d'anomalie sur un transport, on le détecte et on le voit immédiatement.
Le même système existe en Angleterre, comme l'indiquait Philippe Pradel, pour les bateaux de la compagnie PNTL qui vont ou reviennent du Japon. Un centre de suivi fonctionne en permanence. Il s'agit là non pas d'une exigence réglementaire, mais d'un outil dont nous nous sommes dotés parce que nous avons pensé qu'il était utile et important. Les bateaux eux-mêmes, en particulier les bateaux PNTL, ont un système de sonar équipé de piles au lithium d'une durée de sept ans, si bien que s'ils coulaient, nous aurions leur position.
M. Alain GOURIOU : Si le navire coule à 3 000 mètres de fond, il n'est pas certain que le système fonctionne !
M. Catherine TISSOT-COLLE : Si, il fonctionne jusqu'à 6 000 mètres de profondeur.
M. Alain GOURIOU : Encore faut-il aller le chercher à 6 000 mètres de profondeur !
Mme Catherine TISSOT-COLLE : Nous parlons en termes d'information...
M . Philippe PRADEL : Et de positionnement ! Le bateau donne sa position jusqu'à 6 000 mètres de fond.
M. le Président : Pour prolonger la question posée par M. Gouriou, il est vraisemblable que, dans le cadre de l'ensemble de la chaîne industrielle de ces produits, il y ait des sous-traitants. Sont-ils soumis à des contrôles ? Puisqu'ils manipulent des produits dont la dangerosité est connue, comment sont-ils suivis pour assurer une surveillance analogue à celle que connaît l'industrie primitive, la grosse industrie ?
Mme Catherine TISSOT-COLLE : Dans le cadre du groupe COGEMA, nous avons des sociétés de roulage qui sont certes des sous-traitants mais qui, faisant partie du groupe, sont sous contrôle. Tous les transports par camion que nous effectuons en France sont assurés par ces sociétés de roulage. L'une, dénommée Lemaréchal et située à proximité de Cherbourg, effectue les transports routiers entre La Hague et le port et La Hague et le terminal ferroviaire. Une autre, installée dans le sud-est de la France, travaille pour le compte des usines ou des centrales implantées là-bas.
M. le Président : C'est vous qui en assurez l'inspection et le contrôle ?
Mme Catherine TISSOT-COLLE : Oui !
M. le Président : Vous disiez que 30 000 tonnes étaient annuellement produits dans le monde.
M. Philippe PRADEL : En matière de minerais d'uranium.
M. le Président : Nous sommes bien d'accord !
A partir de ce chiffre global, peut-on savoir quel est le tonnage qui est acheminé vers la France ou qui en part après un traitement ?
Ensuite, quels sont les axes d'acheminement de ces différents produits ? En particulier, quel est le tonnage qui voisine les côtes françaises, avec la sensibilité de ces régions pour les raisons que vous comprenez ?
M. Philippe PRADEL : Nous vous confirmerons les chiffres que je vous communique de mémoire et que je cite en termes d'ordre de grandeur.
Sur ces 30 000 tonnes, la consommation nationale en France d'uranium est de l'ordre de 7 000 tonnes. Il s'agit donc d'une part importante parce que notre parc nucléaire est important. Cela étant, notre industrie étant aussi exportatrice, l'ordre de grandeur des matières traitées en uranium en France doit être de l'ordre de 12 000 ou 14 000 tonnes. La France couvre, bien entendu, ses besoins nationaux mais l'industrie exportatrice rend également des services à d'autres pays européens ou au Japon.
Les modes d'acheminement ne sont pas tous assurés par bateaux. Nous n'avons quasiment plus en France de mines d'uranium, mais il reste des mines européennes, principalement dans l'Est de l'Europe. Le reste est canadien - et le transport maritime est assuré par une société canadienne - ou africain. Les transports avec l'Afrique sont également effectués par bateau.
Nous pourrons vous communiquer les chiffres exacts concernant la proportion d'acheminement d'uranium par voies maritime et terrestre. De mémoire, le transport doit être assuré pour deux tiers par voie maritime et, pour un tiers, par voie terrestre.
Mme Catherine TISSOT-COLLE : Pour les matières de l'aval du cycle, c'est-à-dire les matières les plus radioactives, le nombre de transports est très faible. Seuls un ou deux transports de résidus vitrifiés sont effectués par an. Les combustibles Mox feront l'objet, en régime de croisière auquel nous ne sommes pas encore parvenus, d'environ deux transports par an, plus les transports de combustibles usés à destination de COGEMA La Hague.
M. le Président : Le nombre de transports se compte toujours sur les doigts d'une main !
Mme Catherine TISSOT-COLLE : En effet, puisque moins de dix transports par an sont effectués.
M. Alain GOURIOU : Finalement, toute la production tiendrait dans un seul navire !
Mme Catherine TISSOT-COLLE : Pas tout à fait !
M. Alain GOURIOU : Pour 14 000 tonnes ?
M. Philippe PRADEL : Pour la production d'uranium, oui ! Si elle provenait d'une mine unique, elle pourrait faire l'objet d'un transport dans un seul navire qui ne serait d'ailleurs pas gigantesque ! Mais dans la pratique, interviennent tout de même d'autres considérations ! (Sourires.)
Mme Jacqueline LAZARD : Vous avez insisté sur l'importance de la prévention en matière d'emballage. Ma question est donc très simple : où ces emballages sont-ils fabriqués ?
M. Philippe PRADEL : Il existe plusieurs fabricants, notamment en France. S'agissant de la France, la conception, l'activité d'ingénierie, les vérifications et les tests sont assurés essentiellement par COGEMA et TRANSNUCLEAIRE.
En termes de fabrication et chaudronnerie, il est fait appel, en général, à des sociétés françaises mais aussi allemandes et japonaises.
Mme Catherine TISSOT-COLLE : Nous avons pu également en faire fabriquer aux Etats-Unis mais toujours sous notre contrôle. Cela fait partie de nos responsabilités pas directement de transport mais d'ingénieur des emballages.
Il est important de noter que pour pouvoir être utilisé dans un pays, un emballage doit avoir été agréé par les autorités dudit pays. Imaginez un emballage conçu en France, fabriqué en Europe sous contrôle d'une société française, pour pouvoir circuler en France, il doit être agréé par les autorités françaises. Si cet emballage contient des matières japonaises et doit être expédié au Japon, il devra être également agréé par les autorités japonaises.
Par conséquent, chaque emballage est agréé par différentes autorités indépendantes, lesquelles n'ont pas le moindre intérêt à être complaisantes puisqu'elles seront conduites à voir transiter cet emballage sur leur territoire.
M. le Rapporteur : Le tout doit tout de même bien être soumis à une norme internationale ?
Mme Catherine TISSOT-COLLE : Le tout répond effectivement à la même norme internationale, mais chaque autorité de sûreté assure sa propre analyse du dossier de sûreté et vérifie que l'emballage est conforme.
M. Jean-Michel MARCHAND : Si j'ai bien compris, en termes de transport, il convient de distinguer trois sortes de produit : d'abord, les produits en amont, peu radioactifs ; ensuite, les produits en aval du cycle, très radioactifs, ceux liés à l'industrie nucléaire française, dont vous avez la responsabilité ; enfin, les produits médicaux dont nous avons peu parlé sans doute parce que vous n'en avez pas la responsabilité. Ces derniers sont transportés comme n'importe quel autre produit certes dangereux et polluant mais sans les précautions que vous nous avez expliquées...
Mme Catherine TISSOT-COLLE : Non !
M. Jean-Michel MARCHAND : ... ou répondent-ils aux mêmes normes de précaution et sous la responsabilité de qui ?
M. Philippe PRADEL : Les « émetteurs » de normes sont les mêmes, c'est-à-dire l'AIEA et l'OMI. Toutefois, ces produits médicaux répondent à des exigences moins strictes.
Mme Catherine TISSOT-COLLE : Ils sont moins radioactifs.
M. Jean-Michel MARCHAND : Pourquoi les exigences sont-elles moins strictes ?
M. Philippe PRADEL : Notamment, parce que leur activité est plus faible. Les règles sont fondées notamment sur des bornes d'activité et de donneurs.
Toutefois, le principe est le même. Vous ne transportez pas une source médicale en vrac. Elle est nécessairement emballée dans un colis qui répond à certaines spécificités. Celles-ci ne sont pas nécessairement aussi drastiques que celles que je vous ai décrites, mais elles existent et elles sont également réglementaires. Tel était le cas du Carla. Les sources médicales que ce navire transportait étaient non pas à nu ni en vrac, mais dans un colis spécifié.
M. Jean-Michel MARCHAND : A qui incombent les responsabilités ? Aux propriétaires de ces déchets ?
M. Philippe PRADEL : Je ne préfère pas vous répondre sur ce point.
M. le Rapporteur : Il serait intéressant de savoir si cela relève de la même logique.
M. Catherine TISSOT-COLLE : Je pense pouvoir vous répondre par l'affirmative, mais il conviendrait de le vérifier.
M. Philippe PRADEL : De mémoire, tous les transports nucléaires sont de la responsabilité de l'émetteur. En principe, telle est la règle ! Mais nous le vérifierons pour ce qui concerne les sources médicales.
M. le Rapporteur : Pourriez-vous le vérifier pour nous ?
M. Philippe PRADEL : Tout à fait !
M. le Rapporteur : Sur l'aspect médical, la logique de responsabilisation est-elle la même ?
M. Philippe PRADEL : Tel n'est pas notre métier, mais il nous est possible de le savoir.
Audition de M. Hugues du ROURET,
président de Shell France,
accompagné du commandant Alain CHENU
et de M. Jan KOPERNICKI, vice-président de
Shell international trading & shipping company limited (STASCO)
(extrait du procès-verbal de la séance du 9 mai 2000)
Présidence de M. Daniel PAUL, Président
MM. Hugues du Rouret, Jan Kopernicki et Alain Chenu sont introduits.
M. le Président leur rappelle que les dispositions législatives relatives aux commissions d'enquête leur ont été communiquées. A l'invitation du Président, MM. Hugues du Rouret, Jan Kopernicki et Alain Chenu prêtent serment.
M. Hugues du ROURET : M. le président, madame, messieurs les députés, nous avons eu la chance d'écouter l'allocution de M. le Premier ministre pour la présidence française de l'Union européenne. Nous avons vu, avec intérêt, que la sécurité maritime figurait en bonne place dans le programme de travail présenté par le Premier ministre, et c'est une bonne chose.
Je vous propose de dire quelques mots sur l'organisation de Royal Dutch Shell, de Shell en France, et des mouvements d'hydrocarbures liés à notre activité. Je vous dirai également comment nous appliquons la charte signée avec M. Jean-Claude Gayssot, et les difficultés que nous rencontrons dans sa mise en _uvre.
Je demanderai enfin à M. Kopernicki de vous expliquer comment le groupe Royal Dutch Shell, depuis des décades, opère dans la sélection et le choix des navires que nous utilisons.
M. Kopernicki est à la fois vice-président de la division des transports maritimes du groupe Royal Dutch Shell, et membre du comité exécutif de l'OCIMF - Oil Companies International Marine Forum -, organisation mondiale des transports maritimes des sociétés pétrolières. M. Kopernicki fera le point de ses discussions avec le comité exécutif de l'OCIMF, la Commission européenne, et même différents gouvernements.
Naviguent chaque jour pour Royal Dutch Shell à peu près 140 navires pétroliers. Vingt et un sont de pleine propriété ; 16 sont affrétés en coque nue ; 28 sont affrétés à temps ; et 75 sont affrétés au voyage. Ceci représente 4,7 % de la flotte mondiale. Les compagnies Exxon Mobil, BP Amoco et Royal Dutch Shell représentent à elles trois 15 % du transport maritime mondial.
Par ailleurs, Royal Dutch Shell utilise 21 bateaux spécialisés dans le transport du gaz liquide, ce qui représente 20 % de la flotte mondiale. En France, Shell a trois sites industriels importants.
Le plus important, situé dans la zone de Berre l'Etang, est un très grand complexe pétrochimique, probablement le plus grand groupe industriel de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. En industrie lourde, nous sommes le plus grand investisseur, en 1999 et en 2000, à travers le développement de nouvelles usines de polyoléfines. Ce sont des premières mondiales. Ce développement se fait par une joint-venture avec le groupe BASF.
Autre pôle industriel important, le complexe de Petit-Couronne se situe en Normandie. C'est le complexe de raffinage le plus proche de Paris quand on vient de la mer, et c'est un site que nous spécialisons dans une approche européenne, en fabrication de bitumes - jusqu'à un million de tonnes - et d'huiles de base.
Ces deux pôles de Berre et de Petit-Couronne, sont des sites où l'on importe des matières premières, où l'on fabrique des produits, et où l'on en exporte une grande partie.
Le troisième site est celui de la raffinerie de Reichstett, en Alsace, que nous possédons à 65 %. C'est un site que nous opérons, mais dont l'approvisionnement en brut vient du port de Fos, acheminé par pipe-lines, et qui a une desserte locale. Les ajustements par rapport aux demandes du marché se font par des barges sur le Rhin. J'indique à ce propos que les barges sont aussi un des éléments du problème de la sécurité maritime.
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement nous a appelés à une réunion, au mois de février, pour essayer de développer les actes de précaution, afin d'éviter, autant que faire se peut, des accidents du type de l'Erika. Nous avons mis en _uvre l'application de cette charte, mais je reconnais que nous avons quelques difficultés sur les dispositions qui concernent le pavillon.
En effet, la charte interdit d'affréter des navires qui battent certains pavillons tels que le pavillon des îles Marshall ou celui du Koweït, qui n'a pourtant que des bateaux neufs. Cela peut causer un important préjudice de compétitivité par rapport à nos activités.
Comment ceci se traduit-il sur Le Havre-Antifer ? En 1999, 37 navires transportant du pétrole brut y sont entrés. Nous y avons réceptionné 166 navires de produits et expédié 265 navires de spécialités, transportant en particulier des huiles de base et des bitumes, qui constituent un pôle important du groupe Royal Dutch Shell en Europe. Nous avons ainsi spécialisé cette raffinerie et fermé des capacités dans les raffineries de Heaven et de Pernis.
Dans le cas de Lavéra-Berre, nous avons réceptionné 131 navires d'importation de pétrole brut, non seulement pour le complexe de Berre, mais aussi pour la raffinerie de Reichstett ; mais dans ce dernier cas nous agissions également pour le compte de nos partenaires dans cette raffinerie, à savoir les groupes Total Fina Elf, BP et Mobil.
Au premier trimestre, sur Le Havre-Antifer, les mouvements de bateaux ont concerné 9 navires de transport de pétrole brut, 31 navires de produits, et 56 navires d'exportation de produits. Au cours de la même période, sur Berre, les mouvements ont concerné 41 navires de transport de pétrole brut, 39 navires d'expédition de produits - nous fabriquons des produits chimiques extrêmement pointus - et 25 navires de différentes matières importées.
Vous voyez donc bien que nous sommes concernés par les accidents potentiels dans le transport maritime.
Dans notre politique de développement européen, nous avons trois sites industriels extrêmement importants. Nous y investissons et ils exportent, si l'on se réfère à l'exemple de Berre, plus de la moitié de leur production.
Comment s'organise ce transport maritime ?
Je vais passer la parole à M. Jan Kopernicki, vice-président mondial de la branche shipping de Shell, et acteur de notre groupe dans les discussions en cours avec la Commission, voire même avec des gouvernements européens.
M. Jan KOPERNICKI : Je vais essayer de vous donner une idée de l'organisation internationale maritime de Shell. Notre siège mondial, composé de 120 personnes, se situe à Londres. Nous disposons d'une quarantaine d'inspecteurs à travers le monde, qui travaillent à l'inspection des navires. De plus, dans chaque pays où il existe des investissements maritimes, nous recourons à environ 60 experts maritimes qui complètent notre dispositif de protection maritime au niveau mondial.
Cela nous donne d'excellents renseignements sur l'état des navires, notamment grâce aux recherches du système SIRE, auxquelles s'ajoutent nos inspections de terminaux. Nous recevons en permanence de nouvelles informations sur lesquelles nous pouvons baser notre décision de prendre ou non un navire.
Le choix d'affréter ou non un bateau est une décision professionnelle. Dans le groupe Shell, nous distinguons la partie maritime et la partie trading. Cette division de responsabilités est un principe très ancien. Ma décision sur un navire est la décision finale. Il n'y a pas de question commerciale qui entre en ligne de compte.
Cette décision dépend de nombreux paramètres. L'armateur compte pour beaucoup dans le choix, surtout si nous le connaissons. Nous passons en revue le sérieux et la gestion de la société de l'armateur. Il ne faut pas oublier les aspects de l'équipage, du management, du training. C'est ce que les Américains appellent le « software » de la situation. Nous ne voulons pas qu'un navire que nous affrétons ait le moindre problème.
Nous regardons le profil de la flotte de l'armateur, son histoire opérationnelle, ses résultats en nous basant sur les inspections des navires de sa flotte. Nous sommes très attentifs à la classification du navire. En cas de changement de classification, nous sommes vigilants, car il arrive que, quand certains armateurs ont des problèmes, ils cherchent une autre société de classification qu'ils persuadent de délivrer des certificats.
Le pavillon est important mais pas prédominant. Dans cette industrie où les finances et les impositions fiscales jouent un grand rôle, nous constatons aujourd'hui que des sociétés, bien qu'excellentes, choisissent les pavillons pour des raisons financières. Par conséquent de nombreux paramètres sont pris en considération.
Nous avons une équipe professionnelle à Londres, des spécialistes à travers le monde, et nous inspectons des navires quotidiennement. Nous tenons compte de toutes les informations qui arrivent à Londres ainsi que de celles en provenance des US Coast Guards, ou d'autres systèmes de contrôles par les États du port dans un souci de sécurité environnementale. Nos décisions ne correspondent pas nécessairement à nos intérêts commerciaux et nous refusons des navires tous les jours.
M. Hugues du ROURET : M. le président, M. Kopernicki vient d'expliquer le processus conduisant à la décision de prendre ou de ne pas prendre un bateau, surtout en affrètement au voyage. Ce processus de décision intègre une grille de onze paramètres.
L'un des paramètres, basé sur le Mémorandum de Paris, impose aux gouvernements européens de contribuer eux-aussi à la sécurité du transport maritime en faisant des inspections avec leurs propres inspecteurs. J'ai eu l'occasion de souligner à M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement que la France, très exposée avec ses côtes, est le pays qui a le moins appliqué ce Mémorandum. Les Pays-Bas et le Royaume-Uni respectent, au minimum, le quota de 25 % d'inspections de navires qui viennent dans leurs ports.
Le problème de la sécurité des navires étant très complexe, il est intéressant de comparer l'avis d'un agent de l'Etat du port avec celui d'un agent du groupe Royal Dutch Shell. Malheureusement, en France, à peine 5 ou 6 % des bateaux ont été inspectés.
Monsieur Jean-Claude Gayssot a répondu qu'il était conscient de ce problème et qu'il procéderait à une augmentation des effectifs de surveillance. Nous lui avons d'ailleurs proposé, s'il le souhaitait, d'accueillir dans notre groupe un certain nombre de ces nouveaux inspecteurs. Dans le contexte international qui est celui du transport maritime, nous pourrions leur montrer comment nous travaillons et leur apporter ainsi une formation complémentaire.
M. Jan KOPERNICKI : Nous cherchons des solutions internationales et surtout pratiques, compte tenu du grand nombre de lois et de règlements applicables. Comme M. du Rouret l'a indiqué, une grande opportunité s'offre à la Communauté européenne pour faire progresser la réglementation dans les ports. On peut se référer au modèle des Etats-Unis, où les US Coast Guards connaissent un grand succès avec leurs programmes d'inspection dans les ports et avant l'entrée dans les ports. Cela a permis d'éliminer un certain nombre de bateaux à risque.
Nous sommes soucieux du problème des sociétés de classification. Il n'est pas acceptable qu'un armateur puisse changer facilement de société de classification. Aussi, nous demandons que le transfert de classe soit davantage réglementé.
On parle beaucoup de l'âge des navires, ou des échéances pour qu'ils soient tous à double coque. Il nous faut trouver un calendrier international. Effectivement, s'il y a des dates différentes pour chaque région du monde, la situation ne sera pas facile à gérer pour les compagnies pétrolières dont l'activité est fortement liée au transport maritime.
Nous travaillons avec l'OMI, pour relever le plafond des fonds prévus par le système de la convention CLC. J'étais à Tokyo, il y a deux semaines, et j'ai réussi à persuader les Japonais de permettre cette augmentation du niveau des plafonds, qu'ils essayaient de bloquer jusque-là. C'est enfin fait, et nous espérons que cette mesure sera discutée par le comité juridique de l'OMI, au mois d'octobre 2000.
M. Hugues du ROURET : Voici résumés les grands points de réflexion et de discussion que nous avons, soit avec la Commission européenne, soit au niveau international.
M. Kopernicki a convaincu les autorités japonaises d'augmenter les plafonds des fonds d'assurances, en cas d'accident. Il les a également convaincues de l'intérêt d'une réglementation des procédures de changement de classe. Les sociétés de classification sont des sociétés commerciales et certaines sont meilleures que d'autres. Si un armateur a un problème avec une société de classification sérieuse, il aura tendance à monter une structure internationale, capitalistique, et à changer la propriété du bateau. La société de classification perdant du terrain au niveau de son chiffre d'affaires, aura tendance à être un peu plus flexible. C'est exactement ce qu'il faut éviter. Il existe un foisonnement de règlements internationaux qui doivent être appliqués par tous.
Le point sur le contrôle d'inspection dans les ports est aussi très important.
M. le Rapporteur : S'agissant de la flotte pétrolière utilisée par Royal Dutch Shell - je ne parle pas de la flotte du gaz liquide - pourriez-vous nous dire sous quel pavillon elle est immatriculée ? Auparavant, avez-vous eu plus de 26 navires en pleine propriété ? Si oui, pourrions-nous avoir ultérieurement quelques informations sur l'évolution de la propriété pleine du groupe à l'égard de la flotte utilisée, ainsi que sur son évolution dans le temps ? Quelles sont les raisons qui vous ont amenés à sortir de votre patrimoine une partie de la flotte que vous possédiez ? A partir de quelle date cela s'est-il fait ?
Deuxièmement, la qualité de la société de classification fait-elle partie des critères de choix dans vos décisions ? N'acceptez-vous que certaines sociétés de classification et en rejetez-vous d'autres ? Par exemple, choisissez-vous celles qui sont inscrites à l'IACS ? Vous arrive-t-il d'en prendre qui n'y sont pas inscrites ? Est-ce que certaines sociétés de classification membres de l'IACS sont suspectes à vos yeux ? En résumé, avez-vous une politique à l'égard des sociétés de classification ?
Vous disiez tout à l'heure qu'il existe une distinction très nette entre la décision maritime et le trading au sein du groupe Shell. Pourriez-vous commenter davantage ce point ? Quand il vous arrive d'être en conflit, avez-vous totalement les mains libres, quelles que soient les conséquences ? Quel pourcentage de bateaux vous arrive-t-il de rejeter annuellement ? Avez-vous des exemples précis ? Quelles en sont les conséquences ? Est-ce que ces bateaux vont voir ailleurs ?
Par ailleurs, avez-vous une politique aussi rigoureuse vis-à-vis du software ? Vous arrive-t-il de refuser des sociétés intermédiaires, pour manque de sérieux ou de rigueur sur le management des bateaux ?
Vous avez fait état de la qualité de votre vetting au travers de vos experts dans le monde. La navigation chimique a créé un outil, le Chemical Distribution Institute, qui mutualise les vetting des entreprises du secteur chimique. Cela permet, semble-t-il, une plus grande qualité du dispositif et une plus grande autonomie par rapport aux acteurs. L'organisation du transport pétrolier international, l'OCIMF, a-t-elle envisagé de mutualiser le vetting ? Est-ce que cela pourrait être une solution de complémentarité vis-à-vis d'Etats du pavillon qui ne font pas toujours leur travail, et d'Etats du port qui ne le font pas totalement non plus ?
Enfin, je n'ai pas bien compris l'observation que vous avez faite sur l'impossibilité d'appliquer la charte de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement, sur le problème du pavillon. Je ne vois pas le point qui pourrait gêner.
M. Hugues du ROURET : Je propose que M. Kopernicki réponde sur la première question de l'évolution de la flotte pétrolière de notre groupe. Je pourrai donner un aperçu sur le passé de la société maritime Shell, en France.
S'agissant de l'évolution de la flotte pétrolière, il faut ajouter les 16 bateaux affrétés coque nue aux 21 possédés en propre. Que l'on soit propriétaire du bateau ou que l'on affrète un navire coque nue à long terme, c'est comme s'il y avait deux propriétés. Shell dispose donc d'une flotte de 37 pétroliers, et en affrète 75 autres au voyage.
M. Jan KOPERNICKI : La plupart de nos navires sont sous le pavillon de l'île de Man. Pour des raisons financières, 6 navires sont sous pavillon du Liberia. Ils sont affrétés coque nue par un opérateur dont le système de finances exigeait un pavillon libérien. Mais les contrôles et le standard de qualité sont les mêmes que pour les autres navires.
Beaucoup de raisons stratégiques ont présidé à l'évolution de notre flotte. Il fut un temps où l'on pensait que la propriété de la flotte était centrale et stratégique. Aujourd'hui, nous pensons qu'il existe suffisamment de navires indépendants pour soutenir notre activité. Cela rend moins indispensable le fait de posséder une grande flotte.
Nous avons fait de mauvais choix d'investissement sur les grands navires. C'est en effet un grand risque que d'acheter un navire de 70 millions de dollars, avec un délai de construction de deux ans, et un amortissement de sept à dix ans au minimum.
Nous avons décidé de faire appel au marché du transport maritime, plutôt que de miser sur des investissements dont on ne peut prédire actuellement la rentabilité.
M. le Rapporteur : La raison principale de l'évolution de votre flotte est-elle l'investissement que cela représente ?
M. Jan KOPERNICKI : C'est une des raisons.
M. Hugues du ROURET : Nous sommes un acheteur très important de pétrole brut aux pays arabes. Quand le Koweït a décidé de développer une flotte de tankers, de très grande qualité, un conflit d'intérêt s'est fait jour. Les Koweitiens conditionnent souvent certains achats de pétrole brut à l'utilisation de leur flotte pour l'acheminement du produit. Ces bateaux doivent évidemment remplir la matrice du processus de décision, ce qui en général ne pose aucune difficulté.
Il y a des années, nous contrôlions en France une société très importante : la société maritime Shell, qui a eu jusqu'à 21 tankers. De règlement en règlement, cette société s'est trouvée confrontée, dans le domaine du transport maritime, à des coûts qui n'étaient absolument plus compétitifs. Cela nous a amenés à vendre certains de ses tankers à notre flotte, sous pavillon hollandais ou sous pavillon britannique, île de Man. Quand j'étais responsable au Moyen-Orient, j'ai moi-même acheté un navire à SMS pour en faire une plate-forme de production de pétrole.
Il ne faut pas s'étonner, si les gouvernements, quels qu'ils soient, ne se sont pas assez préoccupés du fait que la France est un grand pays maritime. Aujourd'hui, nous le payons : nous devons nous trouver au 28e rang mondial des flottes.
M. Jan KOPERNICKI : Votre deuxième question est de savoir si nous employons toutes les sociétés de classification. Nous considérons que le système IACS ne fonctionne pas. Leur conseil exige que toutes les décisions soient prises à l'unanimité. Il est très difficile pour les instances de parvenir à prendre des décisions parce qu'elles sont toujours bloquées.
Nous examinons les sociétés de classification individuellement et non en fonction de leur appartenance à IACS. Il est vrai que la plupart des navires que nous affrétons sont suivis par les sociétés membres de l'IACS. Malgré tout, aujourd'hui, l'IACS n'est pas tellement importante pour nous. Il est vrai que c'est la route vers l'OMI car ses membres jouent un rôle d'expertise auprès de cette organisation, mais leur système ne fonctionne pas très bien.
M. Hugues du ROURET : Nous sommes donc sélectifs dans l'utilisation de nos sociétés de classification.
M. Jan KOPERNICKI : Et nous contrôlons chaque société de classification de façon individuelle.
M. le Président : Vous touchez là un point essentiel. Pouvez-vous préciser votre pensée quand vous dites que l'IACS ne fonctionne pas bien ?
M. Jan KOPERNICKI : La discussion avec l'IACS sur le transfert de classe n'est pas nouvelle. L'IACS nous a toujours dit qu'elle avait des systèmes de contrôle, et que si un de ses membres bénéficiait d'un transfert de classe, il devait s'assurer que l'ensemble des documents soient complets et que les travaux demandés sur le navire avant le transfert soient réalisés. Cependant, à l'évidence, cela ne fonctionne pas. Ce transfert de classe est un sujet très important.
M. le Rapporteur : C'est l'un des sujets majeurs de notre enquête.
M. Jan KOPERNICKI : Nous recherchons un système dans lequel nous pourrions avoir confiance dans les sociétés de classification, qu'elles appartiennent à l'IACS ou non, avec lesquelles nous faisons notre affrètement. En cas de transfert de classe, les travaux doivent être entièrement réalisés et l'armateur ne doit pas avoir recours à un transfert de classe dans le but d'éviter les nécessaires réparations de son navire.
Dans notre système, c'est automatique : si un navire change de classe, l'autorisation d'affréter ce navire est immédiatement annulée.
M. le Rapporteur : Vous voulez dire que si un bateau change de classe, votre position est de ne plus l'affréter dans l'immédiat ?
M. Jan KOPERNICKI : Notre expert doit revoir le navire et éventuellement faire une nouvelle inspection. Avec certaines sociétés - le Lloyd's Register of Shipping ou l'American Bureau of Shipping par exemple -, la discussion sera très brève. Mais avec d'autres, nous serons amenés à nous poser des questions. Par exemple, pourquoi tel armateur change-t-il subitement de société de classification ? Quelles sont ses motivations ?
M. Hugues du ROURET : L'autre point que vous avez souligné, et qui est en fonctionnement dans notre groupe depuis des années, concerne le fait de distinguer la responsabilité d'affréter ou pas un bateau, de l'action de trading, c'est-à-dire d'achat et de vente de produits.
Dans notre groupe, il existe des règles extrêmement fixes qui peuvent amener M. Kopernicki à refuser un bateau. L'application se fait ensuite avec le commandant Chenu, qui a la responsabilité de mise en _uvre pour les côtes européennes.
Depuis le début de l'année, nous avons dû refuser des bateaux, qui venaient, par exemple, sur le complexe de Berre, pour exporter certains de nos produits, tels que des fiouls lourds. La décision revient à la fois à la division du transport maritime dirigée par M. Kopernicki et au commandant Chenu, qui m'alertent éventuellement. Il arrive qu'ayant refusé un bateau, le commercial nous oppose le coût d'une telle décision, soit environ 1,5 million de francs dus au stockage du produit dans l'attente d'un bateau accepté par la division du transport maritime.
M. le Rapporteur : In fine, est-ce vous qui arbitrez les conflits d'intérêt ?
M. Hugues du ROURET : Si le coût est important, je n'arbitre pas. Si le commandant Chenu a un doute, il clarifie avec sa ligne. Des instructions très précises ont encore été mises à jour, suite à la réunion au ministère des transports. Pour ma part, je renforce simplement la position des affréteurs sur la position commerciale.
Sur Berre par exemple, nous sommes actuellement gênés pour importer certaines catégories de pétrole brut. Il existe un peu plus de 800 qualités de pétrole brut, et lorsque l'on veut optimiser un outil par rapport aux produits que l'on veut fabriquer, on doit essayer de trouver le mélange de pétroles bruts le plus économique. C'est d'autant plus important sur le terminal de Berre, principalement constitué d'unités pétrochimiques, et sur la raffinerie de Petit-Couronne, qui a besoin de pétroles bruts d'une certaine qualité puisque l'outil est spécialisé sur des fabrications de bitumes et d'huiles de base.
Nous avons encore des difficultés. Il arrive parfois que nous ne puissions pas acheter, en termes commerciaux, le pétrole brut optimum, car nous savons que le bateau qui le transporte sera refusé par la branche shipping. A ce moment-là, nous changeons de qualité de pétrole pour avoir le bateau qui convient, ou bien nous différons un approvisionnement.
Il s'agit donc vraiment d'une décision séparée : le dernier mot revient à la division shipping et non pas à la division commerciale.
M. le Rapporteur : Il serait intéressant que vous nous communiquiez une note sur ce processus de décision, avec des exemples de rejets de bateaux.
M. Hugues du ROURET : Nous pourrions vous faire une note qui détaille la matrice des onze paramètres de décision. Un de ces paramètres est le contrôle par l'État du port.
M. le Rapporteur : Ce type de décision se situe-t-il pour le groupe Shell au niveau mondial, avec des répercussions dans chacun des pôles géographiques de développement ? L'exemple que vous venez de donner sur le terminal de Berre relève-t-il d'une instruction de la direction mondiale ?
M. Alain CHENU : Absolument. Il s'agit d'un double mécanisme. Il existe un niveau de décision sur la base de données des navires et de toute façon l'acceptation du terminal. Le dernier mot appartient à la base de données, à Londres. S'il y a une décision négative au niveau d'un terminal, elle est irréversible. Cela rejoint votre question sur le CDI et autres mutualisations. Nous avons des professionnels issus du milieu de la marine, dont je fais partie, ayant une expérience de terrain. Ils supervisent les opérations et font du vetting, de l'inspection. Il peut s'agir soit d'inspections complètes que l'on partage - les inspections SIRE -, soit d'inspections de terminaux. S'il y a un incident opérationnel dans un terminal, l'information est remontée à Londres.
C'est la raison pour laquelle nous tenons absolument à conserver cette expertise professionnelle, et à être certains qu'elle ne se dilue pas dans quelque chose de plus vaste. Nous participons donc à des ensembles d'information mutuels - tel que le système SIRE en l'occurrence -, mais nous avons également notre propre expertise que nous tenons absolument à conserver.
M. le Président : Quelque chose m'échappe car vous parliez de navires arrivés à Berre et que vous avez refusés.
M. Alain CHENU : Il s'agissait d'un refus avant transaction.
M. Hugues du ROURET : Prenons un exemple plus concret. Vous vous trouvez avec une demande un peu moins forte des bases de la pétrochimie. Vous êtes donc obligé de changer l'outil de raffinage qui prépare les bases pour un cracker, lequel prépare lui-même les bases pour des usines pétrochimiques.
L'optimum est de disposer d'un certain pétrole brut, mais vous avez un changement dans la demande. Vous êtes alors obligé d'ajuster votre mélange d'hydrocarbures bruts à l'entrée. Si vous recherchez le produit brut optimum, la décision commerciale va le trouver sur le marché de pétrole brut. Elle indique alors qu'elle dispose de telle qualité de pétrole brut que tel bateau peut acheminer dans dix jours.
La branche shipping peut refuser ce bateau. A ce moment-là, soit vous trouvez un bateau que la division du transport maritime accepte, soit vous changez la qualité de produit que vous allez importer. Ceci se fait au niveau des cargaisons et je vous ai indiqué le nombre de mouvements des bateaux.
En complément de ces fabrications, nous importons des produits tels que les bases et nous exportons des produits fabriqués. Là encore, on peut rater une optimisation économique, c'est l'exemple d'une surproduction de fioul lourd sur la raffinerie de Berre. Après avoir conclu un marché avec ENEL, il fallait un bateau. Nous l'avons trouvé, mais ce bateau a été contrôlé par notre division shipping qui n'en a pas voulu. Nous avons donc stocké un peu plus, jusqu'à ce que nous trouvions un bateau sur lequel il n'y avait pas de veto.
S'agissant de la politique software, vous demandez quel est le poids attaché à la qualité - plus qu'à la nationalité - de l'équipage.
M. Jan KOPERNICKI : Le management de l'équipage est également un élément clé à nos yeux. Notre intérêt réside dans la totalité des paramètres humains : le management, le training, l'équipage, les officiers. Nous faisons une inspection sur les navires et nous procédons à une inspection de management au bureau de la société armatoriale.
M. le Rapporteur : Vous déplacez-vous dans les sociétés qui gèrent les navires ?
M. Jan KOPERNICKI : Une équipe de mon bureau visite ces sociétés d'après un index de risques. Nous laissons s'écouler de larges délais lorsque nous inspectons les armateurs que nous connaissons bien et qui ont des pratiques solides. S'agissant de ceux pour lesquels des problèmes peuvent se poser, les visites sont plus rapprochées. Il nous est souvent arrivé de refuser des sociétés de management de bateaux.
M. le Rapporteur : Vous est-il arrivé de prendre un bateau, puis, constatant que la société de management n'était pas bonne, de revenir sur votre décision, non pas pour sa mauvaise qualité, mais uniquement parce que sa gestion n'est pas performante ?
M. Jan KOPERNICKI : L'inspection des navires affrétés à temps s'effectue toujours avant le contrat.
M. le Rapporteur : Cet aspect fait-il partie des onze critères pris en compte dans le choix des navires ?
M. Jan KOPERNICKI : Oui, bien entendu. Par conséquent, l'hypothèse que vous avez évoquée ne peut pas se produire.
M. Hugues du ROURET : Une autre question concernait notre qualité de vetting. Nous devrons vous fournir la grille des paramètres du processus de décision.
Faisant un parallèle avec le secteur de la chimie, vous souhaitiez savoir dans quelles mesures nous serions prêts à faire une sorte de « black list » pour échanger nos expériences entre principaux transporteurs. Ce problème s'était déjà posé après le naufrage de l'Amoco-Cadiz.
Nous entrons là dans une situation de droit international un peu difficile. Il faut trouver le moyen d'établir ce « black listing », tout en respectant les règles de compétition.
M. Kopernicki va vous expliquer l'état des discussions concernant ce point précis au niveau de l'OCIMF.
M. Jan KOPERNICKI : Notre premier outil est la base de données SIRE. La législation sur la concurrence pose un problème. SIRE est un échange d'informations sans opinions. Elle regroupe un ensemble de rapports d'informations standardisés.
J'attire votre attention sur le fait que le questionnaire d'inspection du système SIRE ne pose qu'une seule interrogation au sujet des structures des navires. Il est difficile pour un inspecteur qui visite un bateau dans un port, d'entrer dans ses citernes. C'est la raison pour laquelle le débat sur le système de classification est si important. L'inspecteur des compagnies pétrolières lit les certificats des sociétés de classification, mais il ne peut pas vérifier l'information, notamment sur l'architecture du navire.
Nous nous intéressons désormais à l'architecture des navires. Nous demandons un droit de regard sur les informations de la société de classification de l'armateur. Nous avons écrit à tous nos armateurs afin qu'ils nous autorisent à regarder les rapports de leurs sociétés de classification.
M. le Rapporteur : Depuis quand l'avez-vous fait ? Depuis le naufrage de l'Erika ?
M. Jan KOPERNICKI : Tout à fait. Notre système évolue constamment et il est difficile de cerner tous les aspects de ce problème. Je ne pense pas qu'il existe aujourd'hui une opportunité en faveur d'un système commun de vetting. Les sociétés ont toutes des priorités différentes. Chez nous, l'environnement est la première des priorités.
M. le Rapporteur : Pensez-vous que ce n'est pas le cas des autres sociétés ?
M. Jan KOPERNICKI : Je ne sais pas.
M. le Rapporteur : Est-ce un plus commercial ?
M. Jan KOPERNICKI : Je ne sais pas, je vous décris simplement ce que nous faisons chez nous. Je préfère que mon inspecteur voie un navire, même si je suis très intéressé par les résultats des autres inspections. Mon intérêt sera d'avantage porté sur les résultats négatifs que positifs. Pour la compagnie Shell, il est hors de question d'envisager un accident.
La base de données SIRE est un système d'informations très abouti. Au sein de l'OCIMF, nous sommes prêts à faciliter l'accès aux informations du système SIRE - en utilisant par exemple le système EQUASIS en Europe - et à les donner aux autorités des ports et des gouvernements, partout dans le monde.
M. le Président : Êtes-vous favorable à ce que les informations du système SIRE soient intégralement communiquées à EQUASIS ?
M. Jan KOPERNICKI : Oui. C'est plus un problème technique que politique. Il est dans l'intérêt de tous que les autorités, dans les ports, puissent bénéficier des informations des rapports SIRE.
Ensuite, nous cherchons à élargir le système, afin d'y intégrer de nouveaux éléments pour le rendre plus compréhensible.
M. Hugues du ROURET : Vous aviez une autre question concernant le pavillon. Nous avons eu une longue discussion, lors de la réunion avec M. Jean-Claude Gayssot, sur l'article 4 de la charte du 10 février dernier.
Dans la première proposition qui nous a été faite, il n'était question que de recourir à des navires battant pavillon des États de l'Union européenne. Nous avons considéré qu'il s'agit là d'une formulation trop restrictive. Par exemple, la Norvège, grand producteur de gaz et de pétrole brut, ne fait pas partie de l'Union européenne, mais appartient à l'espace économique européen.
Nous sommes donc passés à une formulation se référant aux pavillons de l'espace économique européen et aux Etats ayant ratifié et appliquant effectivement les conventions de l'OMI et de l'OIT. Or, certains Etats très sérieux n'ont pas signé ces conventions : par exemple, le Koweït, qui a une flotte neuve, ou les îles Marshall.
M. le Président : Pourquoi ne les signent-ils pas ?
M. Alain CHENU : Lors de la discussion sur la charte, il y a eu une surestimation du nombre d'Etats qui signent les conventions de l'OIT. Si l'on prend tous les pavillons, convention par convention, on s'aperçoit que des Etats et des pavillons très sérieux n'ont jamais ratifié ces conventions. La dernière convention n'est même pas ratifiée par la France. La toute dernière convention est signée par quatre Etats.
Le problème est que peu d'Etats signent les conventions de l'OIT, et notamment de grands acteurs maritimes comme Singapour, Panama, Koweït, les îles Marshall.
M. Jan KOPERNICKI : Nous ne sommes pas autorisés à prendre un navire sous pavillon singapourien, bien que les contrôles par l'administration du pavillon soient d'un niveau identique à ceux effectués en Europe ou aux États-Unis.
M. le Président : Vous disiez tout à l'heure que vous mettiez les problèmes de sécurité et d'environnement en tête de vos priorités. Ne pensez-vous pas qu'il serait souhaitable de faire pression sur les Etats qui veulent entrer dans la Communauté européenne mais qui n'appliquent pas un certain nombre de prérogatives d'Etats du pavillon, afin qu'ils adhèrent aux conventions internationales ?
M. Jan KOPERNICKI : Ces ratifications prenant toujours du temps, la solution serait peut-être de donner un délai d'observation à ces pays, sans refuser leurs bons navires, auxquels le seul reproche que l'on fait porte sur le pavillon. Notre intérêt est d'utiliser les navires de la meilleure qualité.
Mme Jacqueline LAZARD : Compte tenu de ce vous venez de nous dire sur les précautions que vous prenez pour l'utilisation des navires, auriez-vous pu affréter l'Erika ?
M. Jan KOPERNICKI : Non.
M. Hugues du ROURET : Nous avons pris la décision de ne pas l'affréter depuis une inspection que nos inspecteurs ont faite en février 1999.
M. le Rapporteur : Vous l'aviez affrété en 1997.
M. Hugues du ROURET : Il ne faut pas qu'il y ait de confusion. Ce bateau avait fait l'objet d'un jugement interne à Shell. L'Erika a été affrété par Shell en décembre 1997. Il a été inspecté par Shell en février 1998 et jugé « acceptable ». A la suite d'une escale en Norvège en mai 1998 le navire a été déclassé de « suitable » à « terminal use only », c'est-à-dire dans la catégorie « non affrétable ».
M. Jan KOPERNICKI : Cette permission au terminal est un sujet qui interpelle tout le monde. Même dans le cas d'un navire ayant la permission d'approcher un terminal, au moment où un affréteur pense pouvoir l'affréter, il ne peut pas le faire. Comme la question se pose de savoir si ce navire peut approcher notre terminal, nous faisons une inspection ou une revue du navire : ce n'est pas une permission, car il y a encore une inspection.
Depuis l'Erika, nous pensons abandonner ce système d'évaluation au terminal qui provoque beaucoup de confusion en termes de communication. Nous avons également abandonné notre lettre de permission car nous avons constaté que les armateurs utilisaient nos lettres comme des licences. Notre lettre ne donnera dorénavant aucune assurance que le navire peut être affrété par Shell. Dès que nous pensons affréter un navire, nous faisons une revue des catégories de navires de très haute qualité. Il y a un système de listes.
C'est un sujet compliqué comprenant plusieurs aspects, mais il est évident que nous ne voulons pas que les armateurs utilisent notre inspection comme une licence.
M. le Président : L'Erika avait bien une lettre d'acceptation ?
M. Jan KOPERNICKI : Non. L'Erika a été inspecté en février 1999. A la suite de cette inspection, l'affrètement de l'Erika par Shell, seul, a été refusé. La permission d'approcher un terminal était accordée, à la condition que le navire soit à nouveau inspecté.
M. le Président : Pourriez-vous nous communiquer cette lettre de non-admission ?
M. Jan KOPERNICKI :Absolument.
M. Hugues du ROURET : Cette lettre figurait dans le rapport de MM. Georges Tourret et Jean-Louis Guibert, mais de façon partielle.
M. Gilbert LE BRIS : J'ai deux questions qui s'adressent à vous, mais qui pourraient également s'adresser à d'autres affréteurs.
Vous limitez de plus en plus l'affrètement à long terme au minimum nécessaire. Vous procédez de plus en plus à des contrats « à temps ». L'effet induit est une incertitude pour les armateurs, puisqu'ils n'ont plus la garantie d'avoir des chiffres d'affaires lissés dans le temps. Cela provoque chez eux des tentatives de réduire les frais techniques ou de maintenance.
N'avez-vous pas l'impression qu'il y a là un cercle vicieux, du fait non seulement que vous rendez les armateurs de plus en plus incertains, et que vous devez également les contrôler davantage ?
Par ailleurs, vous avez parlé du Mémorandum de Paris et du contrôle par les États du port. Vous avez évoqué l'aspect quantitatif, en disant que la France ne faisait pas beaucoup de contrôles, mais vous n'avez pas parlé de l'aspect qualitatif.
Je voudrais savoir si tous les pays font preuve de la même sévérité dans le contrôle. En effet, plus le pays est laxiste au niveau du contrôle, plus il a de chances de voir des bateaux venir, ne serait-ce que pour obtenir un certificat de complaisance qui leur permettra d'aller dans d'autres ports européens. Pouvez-vous nous dire quelle est votre expérience, dans le domaine de la différence qualitative des contrôles des États du port ?
M. Jan KOPERNICKI : Cette question illustre bien l'importance d'une solution soit régionale, soit internationale. Il n'est pas dans l'intérêt des populations qu'un État européen dont le système est moins solide que celui d'un autre, permette à un navire de faire du transport dans la Communauté européenne. Nous avons une expérience qualitative dans le domaine des contrôles. C'est la raison pour laquelle, à l'OCIMF, nous continuons à privilégier l'importance des inspections par les États du port. C'est un sujet très important, qui ne concerne pas uniquement la France ou la Hollande, mais bien tout le monde.
M. Hugues du ROURET : Le Mémorandum de Paris a fixé un quota sur les bateaux qui escalent dans un Etat. Il faut d'abord respecter le quota, et le faire d'un point de vue qualitatif. Cela n'empêchera pas une compagnie pétrolière, telle que la nôtre, d'avoir dans sa banque de données, un jugement plus ou moins positif sur le contrôle de certains Etats. Si nous avons un doute, nous serons d'avantage incités à vérifier la qualité des bateaux.
M. Jan KOPERNICKI : Le port de Rotterdam a un système nommé « Green Award », ou récompense verte : si un navire inspecté se révèle d'une très bonne qualité, on lui donne un pavillon vert, et les coûts de port se trouvent abaissés pour une année. En l'occurrence, il y a un geste commercial pour la qualité et les armateurs y sont très sensibles. Les autres ports, en Europe, pourraient faire la même chose.
Nous sommes également armateurs, et nous avons ce même problème des fluctuations du marché. Le marché, aujourd'hui, pour les VLCC est à presque 100 points du world scale. En novembre, c'était 40 ou 50, donc beaucoup moins. Les armateurs ont le choix d'entrer ou non dans ce système. Ils évoluent dans différents aspects de l'activité. Les grands armateurs sont dans le pétrole, les navires de voitures : ils ont un portfolio diversifié. Nous sommes sensibles à leur position, mais ils ont choisi d'entrer dans ce système.
M. le Président : La compagnie Shell a-t-elle déjà été confrontée à un accident ?
M. Hugues du ROURET : Oui. Ce n'est malheureusement pas en renforçant toujours l'ensemble des paramètres de prise de décision, que l'on évitera tout accident. Nous avons eu des accidents limités. Nous avons eu l'accident, important à l'époque, de la cargaison de l'Amoco-Cadiz. Dans cette opération, la responsabilité était clairement celle de l'armateur.
Nous faisons évidemment tout pour éviter des accidents.
La question a été posée de savoir si nous étions sensibles à l'environnement. Vous avez peut-être entendu parler de la plate-forme Brent Spar. Quand nous n'en avons plus eu l'utilisation, il a été décidé de couler cette plate-forme, en plein accord avec le gouvernement britannique et toutes les associations environnementalistes britanniques, y compris l'association des pêcheurs britanniques qui avait identifié avec nous l'endroit où il était préférable de couler cette plate-forme. Il y a eu de fortes réactions de la part de mouvements du type Greenpeace, surtout en Allemagne et au Danemark, et nous avons eu du mal à gérer cette situation. Nous avons finalement décidé de ne pas saborder cette plate-forme, près des mers des Shetlands, dans une fosse identifiée avec les pêcheurs. Cela nous a valu les reproches du gouvernement britannique et de la presse, qui nous a traités de tous les noms.
Peut-être à cause de Brent Spar, avons-nous été victimes des mouvements d'opinion, tout à fait légitimes, qui se préoccupent de l'environnement et de ce qu'on laisse aux générations futures ?
Depuis deux ans, nous avons mis en place une politique de développement durable. Nous nous engageons à réaliser non seulement un rapport financier de nos activités, mais aussi un rapport plus sociétal que social. Nous allons produire le prochain rapport dans quelques jours.
Nous sommes extrêmement préoccupés par ces problèmes d'environnement. Mais ce n'est pas à cause de l'Erika que la fonction shipping a été dissociée de la fonction marchande. Cela fait des années que nous pensions à distinguer ces deux activités, surtout dans ce marché très compétitif, où l'on incite nos collaborateurs à atteindre des objectifs de performance.
M. le Rapporteur : Vous avez fait référence à des dispositions nouvelles que vous avez prises à la suite de l'Erika. Son naufrage a-t-il entraîné dans votre management des décisions supplémentaires, ou a-t-il conforté ce que vous faisiez déjà ?
M. Jan KOPERNICKI : Nous avions déjà pris des décisions, en 1999. C'est un processus en évolution. Chaque année, il y a plus ou moins de changements, de nouvelles idées. Notre système est vivant. L'an dernier, nous avons envisagé de faire plus d'inspections du système de management des armateurs. Nous avons également eu une discussion interne au sujet de la structure des navires. Cette discussion a porté sur les grands navires, et sur nos préoccupations au sujet de cet acier haute résistance, aujourd'hui utilisé pour les navires neufs.
Suite au naufrage de l'Erika, cette discussion s'est accélérée. Nous avons maintenant une équipe d'architectes navals, qui nous assistent en examinant les informations structurelles des navires. Nous avons demandé aux armateurs la possibilité de voir tous les détails structurels. Nous attendions des sociétés de classification qu'elles fassent ce travail. Cependant, l'expérience nous a montré que certaines de ces sociétés ne remplissaient pas leur rôle. C'est un problème très sérieux car les inspections que mes inspecteurs réalisent pendant 8 à 10 heures sur chaque navire dans un port, ne peuvent être effectuées que sur ce qui est visible, c'est-à-dire sans entrer dans les citernes.
Ces certificats délivrés par les sociétés de classification sont donc fondamentaux pour nous. Nous devons avoir confiance dans leur système. Il est indispensable pour la Shell, pour l'OCIMF, de trouver une logique qui fonctionne avec les sociétés de classification. Il faudrait peut-être les rendre responsables, en cas d'accident dû à une structure du bateau. D'ailleurs, certaines sociétés de classification commencent à envisager une assurance P&I. Il peut s'agir d'une bonne idée
M. le Président : Nous vous remercions de nous avoir apporté toutes ces précisions. Nous vous demandons de nous faire parvenir, dès que possible, les éléments écrits dont vous nous avez parlé. Nous approchons en effet de la phase de rédaction du rapport, et donc d'analyse des différentes données.
M. Hugues du ROURET : Nous vous communiquerons la liste de tous les paramètres et la façon dont ils sont utilisés.
M. le Président : Et la lettre de non-admission de l'Erika.
Audition de M. Thierry DESMAREST,
président-directeur général,
et de M. Bertrand THOUILIN,
directeur des transports maritimes,
du groupe TotalFinaElf
accompagnés de MM. Jacques de NAUROIS,
directeur des relations institutionnelles,
Pierre GUYONNET, directeur de la mission Littoral-Atlantique,
et de Mme Isabelle GAILDRAUD,
responsable de la mission Littoral-Atlantique
(extrait du procès-verbal de la séance du 9 mai 2000)
Présidence de M. Daniel PAUL, Président
MM. Thierry Desmarest, Bertrand Thouilin, Jacques de Naurois, Pierre Guyonnet et Mme Isabelle Gaildraud sont introduits.
M. le Président leur rappelle que les dispositions législatives relatives aux commissions d'enquête leur ont été communiquées. A l'invitation du Président, MM. Thierry Desmarest, Bertrand Thouilin, Jacques de Naurois, Pierre Guyonnet et Mme Isabelle Gaildraud prêtent serment.
M. Thierry DESMAREST : M. le président, mesdames, messieurs les députés, en introduction à notre audition, je souhaite restituer dans leur contexte les circonstances qui ont présidé à l'accident de l'Erika, en traitant d'une manière générale du fonctionnement du marché du transport pétrolier par voie maritime. Nous verrons ensuite rapidement, car ce point a fait l'objet d'une audition par votre commission d'enquête, les actions concrètes prises par notre groupe pour remédier aux pollutions créées par ce naufrage. Puis, M. Thouilin, directeur des transports maritimes du groupe TotalFinaElf, reviendra plus en détail sur la description de la chaîne du transport maritime, nos procédures internes de sélection, et la manière dont, à notre avis, il est possible et souhaitable, de faire évoluer la sécurité dans ce domaine du transport maritime pétrolier.
Le monde pétrolier s'est profondément modifié ces vingt dernières années du point de vue de la géographie de la production et de la consommation. Les sources se sont diversifiées : l'importance relative du Moyen-Orient, en tant que source de production, a diminué au profit de nouveaux horizons comme l'Afrique, l'Asie du sud-est, l'Amérique latine ou la mer du nord.
Les grandes zones d'importation se sont également multipliées. Même dans les marchés matures où la consommation stagne, la part des importations croît : c'est le cas en particulier aux États-Unis. Mais ce sont les marchés émergents qui tirent aujourd'hui la croissance de la consommation pétrolière, et des pays autrefois autarciques, comme la Chine et l'Inde, deviennent des importateurs significatifs.
En conséquence, les flux de transports sont devenus plus instables et se sont beaucoup diversifiés. Si bien qu'il est devenu plus rare aujourd'hui pour une compagnie de traiter son propre pétrole brut dans ses raffineries. Cette instabilité et cette diversité des flux de produits ont créé la nécessité pour des compagnies comme la nôtre de faire de plus en plus appel pour leurs transports à des navires dont elles n'assurent pas le contrôle direct. Pourquoi ? Parce qu'il est en effet de plus en plus difficile dans ce contexte de pouvoir espérer avoir un navire que l'on contrôle pour charger en date et lieu une cargaison dont la destination n'est souvent connue que tardivement.
Il s'est donc développé un marché de transports SPOT extrêmement actif, où les opérateurs font appel à un transporteur pour un voyage bien déterminé entre un port de chargement et un port de déchargement, eux-mêmes déterminés à une période précise. Dans le même temps, les conditions d'exercice de la profession d'armateur se sont significativement dégradées.
Si les flux se sont diversifiés, les routes, elles, se sont en effet plutôt raccourcies. La mer du Nord est proche de l'Europe, l'Indonésie du Japon, l'Amérique latine de l'Amérique du Nord, et le canal de Suez est accessible à des navires de plus grande taille. Les principales sources nouvelles d'approvisionnement qui se sont développées sont relativement proches des marchés d'importation. La demande de transport n'a donc pas suivi la croissance de la demande de pétrole. Il en est résulté un excédent structurel de navires qui a fortement pesé sur la rentabilité des opérations de transport elle-même. Nous avons tous encore à l'esprit les images des pétroliers à la chaîne dans les fjords de Norvège.
On assiste, par voie de conséquence, à un vieillissement préoccupant de la flotte mondiale et l'on voit des pratiques d'exploitation dégradées se développer chez certains opérateurs. Dans le même temps, les grands groupes ont eu des besoins de financement croissants dans leurs activités d'exploration-production, et il en est résulté une désaffection relative pour cette activité de transport. Cette désaffection est d'ailleurs différente suivant les groupes, M. Thouilin vous montrera tout à l'heure que notre groupe, en la matière, a suivi une politique équilibrée.
Le secteur du transport subit actuellement encore cette crise. Cela se manifeste en particulier par l'insuffisance de la surface financière de la plupart des opérateurs et la limitation des moyens financiers qui permettent à la fois l'amélioration des pratiques et le renouvellement nécessaire de l'outil.
Pour assurer leur transport dans des conditions de sécurité satisfaisantes, les compagnies - dont la nôtre - ont toutes édicté des règles d'affrètement strictes basées sur un système d'informations commun dénommé SIRE. Ce système est nourri par les informations disponibles provenant, soit des armateurs eux-mêmes, soit des sociétés de classification, soit des enquêtes de qualité réalisées par le personnel des compagnies dont c'est la tâche. C'est ce que l'on appelle le vetting, mais ce système ne fonctionne que si les informations qui le constituent sont fiables.
Pour améliorer la transparence et la fiabilité des opérations effectuées par les armateurs, l'Organisation maritime internationale (OMI) a mis en place un système de certification de la qualité des transporteurs et des navires, le code ISM ; les sociétés de certification qui garantissent l'intégrité des structures des navires se sont, elles, de leur côté, regroupées pour les plus sérieuses d'entre elles au sein d'une association dénommée IACS. Leurs classifications sont à la base de la confiance que nous pouvons avoir dans nos propres procédures internes de vetting.
Les Etats, aux termes de la convention de Paris de 1992, s'engageaient également à apporter leur pierre à l'ouvrage en créant des corps d'inspecteurs chargés de vérifier la qualité des navires touchant les ports des signataires. Tel est le cadre général dans lequel le groupe TotalFinaElf exerce ses activités de transport.
Conformément à nos principes généraux de fonctionnement qui interdisent de donner la prééminence aux considérations économiques sur la sécurité des opérations, ne sont acceptables pour l'affrètement que les navires qui ont au préalable passé les contrôles du vetting TotalFinaElf, qui sont gérés par une société certifiée ISM et qui sont certifiés par une société de classification appartenant à l'IACS.
L'accident de l'Erika montre malheureusement que ce qui a été fait est insuffisant et qu'il faut aujourd'hui aller plus loin. Nous assistons actuellement à la perte de confiance à la fois de l'opinion publique, du monde politique et des opérateurs eux-mêmes dans la capacité du système de transport à gérer ces opérations de manière sûre. Les statistiques ont beau montrer que malgré ces conditions défavorables les fréquences d'accidents sont stables à un niveau bas - ils ont même diminué sur la moyenne période -, nous savons bien qu'il n'est pas possible de s'en contenter et que nous devons collectivement trouver les moyens de faire des avancées significatives dans ce domaine. Nous participerons pleinement aux actions qui seront engagées en liaison avec le gouvernement français et la Commission européenne.
Progresser dans la sécurité veut dire qu'il faut s'attaquer simultanément à tous les maillons de la chaîne. Pour les affréteurs, cela veut dire revoir les conditions du vetting et utiliser leur force d'utilisateurs des navires pour faire évoluer les pratiques. Nous avons déjà progressé dans ces domaines. Pour les armateurs, il faut revoir les conditions de certification de leurs opérations pour donner à leurs clients les garanties nécessaires qu'ils sont en droit d'exiger avec la transparence et les contrôles nécessaires à la crédibilité de leur garantie. Pour les sociétés de classification, il en est de même.
Il faut aussi favoriser l'émergence de grandes compagnies d'armement dont la surface financière sera la garante de conditions d'opérations saines, transparentes et pérennes sur le long terme, c'est-à-dire assurant la modernisation et le progrès technologique de l'outil, en vue d'une sécurité améliorée dans des conditions de compétitivité acceptables. Pour les Etats, dont la France qui aura un rôle important à jouer en la matière en prenant prochainement la présidence de l'Union européenne, il s'agira d'assurer un environnement économique et réglementaire qui permettra aux opérateurs de progresser dans cette voie.
A cet égard, les fonctions de contrôle qui sont l'apanage des Etats doivent être renforcées et rendues plus efficaces. Tel est le chantier qui nous attend tous. La tâche est difficile, car les acteurs sont multiples, opérant à l'échelle mondiale, impliquant donc de multiples organismes et des Etats ayant des intérêts naturellement divergents. Notre groupe est déterminé à jouer un rôle positif et j'espère efficace en la matière.
A plus court terme, la priorité est d'assurer efficacement et rapidement la remédiation contre la pollution côtière qui atteint le littoral atlantique. La réglementation existante donne cette responsabilité à l'Etat à travers le dispositif POLMAR. Par le biais du FIPOL, la communauté des raffineurs apporte une contribution financière importante qu'il faudrait bien se garder de trop désavouer car elle assure aux victimes une couverture de leur préjudice, indépendamment de toute responsabilité juridique dont nous savons tous combien elle est lente, difficile et aléatoire à établir.
Pour ce qui est du cas de l'Erika, notre groupe, ses dirigeants et tout son personnel ont profondément conscience d'être l'un des maillons d'une chaîne qui a failli, et tous en acceptent les conséquences et les responsabilités. Nous avons ainsi pris directement en charge, dans le cadre légal du plan POLMAR, un certain nombre d'actions : le pompage de l'épave, le traitement des déchets rassemblés sur des sites voisins de la raffinerie de Donges, des opérations de nettoyage sur des sites difficiles nécessitant des moyens appropriés et, à travers la création d'une fondation pour la mer, la participation à la restauration d'équilibres écologiques dégradés.
Nous avons aussi accepté de ne pas présenter à l'indemnisation du FIPOL les dépenses correspondantes, estimées aujourd'hui à 850 millions de francs, tant que les préjudices subis par la société civile et l'Etat n'auront pas été intégralement couverts.
Cet accident a créé des préjudices importants pour les populations du littoral atlantique que nous regrettons profondément. Il fut aussi l'occasion de montrer un immense élan de solidarité et de conscience à travers toute la société française. Je veux aussi ici rendre hommage à tous ceux et celles qui ont _uvré sans compter dans des conditions difficiles, qu'ils soient bénévoles, militaires ou agents de l'Etat ou des collectivités locales, afin que les conséquences de cet accident soient résorbées le plus rapidement possible. La tâche n'est pas terminée, tous s'y emploient encore avec courage et détermination. Soyez assurés que nous continuerons à participer activement à cette tâche.
Je passe maintenant la parole à M. Thouilin qui va entrer dans les détails de ce qui peut constituer une base pour l'amélioration, dans le futur, de la sécurité dans les transports pétroliers.
M. Bertrand THOUILIN : M. le président, mesdames et messieurs les députés, les négociants et affréteurs pétroliers constituent une profession mal connue, et toute tentative de lever un coin du voile me paraît bienvenue. C'est la raison pour laquelle je remercie la commission d'enquête de nous donner l'occasion de préciser notre rôle dans l'affaire de l'Erika. J'examinerai d'abord la place que les négociants - les traders - et les affréteurs pétroliers occupent dans la chaîne du transport, puis comment ces intervenants contribuent, me semble-t-il, à améliorer la qualité des services maritimes.
Tout comme il existe une chaîne du transport qui va du chargeur au destinataire, en passant par les affréteurs, les courtiers, les autorités portuaires, les armateurs, les assureurs, il existe aussi une chaîne de la sécurité dans laquelle chacun a son rôle à jouer et où chacun doit assumer ses responsabilités. Il s'agit à chaque fois d'un rôle bien spécifique, bien déterminé, et souvent très technique. Or, pour dire les choses très simplement, depuis des années, face aux défaillances de certains maillons de la chaîne, la tendance a été non pas de s'attaquer aux problèmes de fond et à remédier aux défaillances constatées, mais très souvent de reporter la responsabilité sur des maillons voisins qui paraissaient plus solides. On a créé de ce fait une confusion générale sans régler aucun des problèmes posés par la sécurité dans l'ensemble de la chaîne.
Je prendrai quelques exemples. Face aux défaillances de l'Etat du pavillon, on a mis en place un mécanisme de contrôle par l'Etat du port. De ce fait, on a donc ajouté un nouveau maillon à la chaîne de sécurité. Mais l'on se rend compte aujourd'hui que ce système a ses propres limites, et que le problème de fond n'a pas été réglé pour autant.
Face aux défaillances des propriétaires de navires, on a mis en place un système de certification des opérateurs, que l'on appelle le code ISM. Là encore, l'accident de l'Erika vient de montrer les limites de ce nouveau maillon dans la chaîne de sécurité.
Face aux défaillances des sociétés de classification qui sont au c_ur du dossier, on parle aujourd'hui de créer un nouvel organisme de contrôle de ces sociétés. De mon point de vue, le problème de fond ne sera pas réglé tant que les sociétés de classification ne seront pas directement responsables de leurs fautes ou de leurs négligences à l'égard des tiers.
Enfin, face aux défaillances des armateurs, il y a aujourd'hui une tendance très nette à faire glisser la responsabilité sur les chargeurs ou les affréteurs. Il est évident, notamment pour l'industrie pétrolière, que ces derniers ont un rôle à jouer et une responsabilité à assumer en matière de sécurité. Pour autant, il serait faux et extrêmement dangereux de croire qu'une canalisation des responsabilités sur les seuls affréteurs aurait un effet significatif sur l'amélioration de la sécurité.
Je crois que l'on ne pourra rien faire en matière d'amélioration de la sécurité maritime et d'indemnisation des victimes d'accidents tant que l'on ne partira pas des deux principes de base suivants : d'une part, la sécurité des transports est une chaîne comportant de nombreux maillons, et où chacun doit assumer ses responsabilités de manière stricte et entière sans pouvoir les reporter sur d'autres acteurs ; d'autre part, les victimes d'un accident n'ont pas à chercher qui est le responsable à l'intérieur de la chaîne. Elles ont droit à une réparation sûre, fondée sur des principes objectifs et débarrassés de toute recherche de responsabilité. Ce but ne peut être atteint que par des mécanismes d'indemnisation collectifs, tels que ceux mis en place par les conventions internationales de 1992.
Je tiens à préciser qu'avant de rejoindre le groupe TotalFinaElf, j'ai travaillé pendant 15 ans chez un armateur. J'ai donc une culture armatoriale forte, et je suis convaincu que la sécurité des opérations de transport dépend d'un juste équilibre des droits et obligations entre transporteurs et affréteurs. Par ailleurs, je suis moi-même Breton, originaire de Trébeurden dans les Côtes-d'Armor ; je n'ai donc pas besoin d'insister beaucoup sur le fait que dans cette affaire je me suis senti solidaire et proche des populations touchées.
Le commerce international des produits pétroliers est aujourd'hui effectué par deux types de négociants différents : des traders indépendants d'une part, et des traders intégrés au sein de sociétés pétrolières, d'autre part. La stratégie de ces intervenants en matière de transport est assez différenciée. Schématiquement, on peut considérer que les traders intégrés ont une politique d'affrètement plus active, plus structurée, qu'ils cherchent, dans la mesure du possible, à contrôler l'exécution de leurs transports, alors que les traders indépendants n'apparaissent que de manière occasionnelle et sporadique sur le marché.
Cela est important à deux titres. L'affrètement pétrolier n'est pas l'apanage des grandes sociétés. Il existe à côté des grands groupes pétroliers comme le nôtre, une myriade d'autres sociétés indépendantes qui affrètent des navires et qui sont propriétaires de cargaisons en cours de transport. Par ailleurs, la politique des chargeurs en matière de transport peut évoluer. Il faudrait prendre garde à cet égard au fait qu'un changement fondamental des règles et de la répartition des responsabilités dans la chaîne pourrait inciter les chargeurs les plus importants à se retirer de l'ensemble des opérations au profit de sociétés indépendantes, manifestement moins exposées, mais moins solides financièrement.
L'affaire de l'Erika montre que le groupe TotalFinaElf, même s'il n'est plus directement armateur, a bien une politique de transport. Nous avons en effet vendu cette cargaison sur une base ex-ship, c'est-à-dire que nous nous sommes engagés, à l'égard de notre importateur italien, non seulement à lui fournir le produit, mais également à le transporter jusqu'à destination et à conserver la propriété et les risques liés à la marchandise jusqu'à la livraison finale.
Pour l'exécution de cette opération, notre trader a donc fait appel à notre service affrètement basé à Londres en lui indiquant les dates de disponibilité du produit à la raffinerie de Dunkerque. A partir de là, la manière dont travaille un affréteur pétrolier est somme toute relativement simple. Il regarde tout d'abord si nous n'avons pas dans notre flotte contrôlée, c'est-à-dire affrétée à temps, un navire disponible aux dates souhaitées. Ce n'était pas le cas en l'espèce. Il lui faut dès lors s'adresser au marché SPOT, c'est-à-dire au marché de l'affrètement au voyage. Pour ce faire, il dispose de sa propre connaissance de ce marché ainsi que des services d'un courtier dont le rôle est de suivre le marché des frets et de mettre en contact transporteurs et affréteurs.
En général, l'affréteur cherche à « travailler » plusieurs navires à la fois, mais tout dépend, évidemment, du nombre d'unités disponibles dans la zone géographique concernée et des contraintes liées aux dates de chargement. En l'occurrence, le choix était extrêmement limité pour des raisons qui tiennent essentiellement à l'offre de transports disponibles pour le fioul lourd ; nous nous sommes donc rapidement intéressés à l'Erika.
Il faut bien comprendre, à ce stade, que les discussions sur le taux de fret sont largement indépendantes de l'âge ou du pavillon du navire. Le marché SPOT est fondé uniquement sur l'offre et la demande de transport, c'est-à-dire que le taux de fret sera essentiellement le résultat du rapport entre le nombre de navires disponibles et le nombre de cargaisons à enlever. En vérité le taux de fret aurait été sensiblement le même pour n'importe quel type de navire. Il est donc faux de dire que les compagnies pétrolières cherchent à économiser sur les coûts de transport en affrétant des navires de mauvaise qualité : le prix du marché est le même pour tous.
S'agissant de l'Erika, les choses étaient simples. Nous avions une cargaison à acheminer en Méditerranée, et l'armateur, qui venait de livrer une cargaison en Atlantique, souhaitait ramener son navire en Méditerranée. L'opération était donc parfaitement logique, et je puis vous assurer que la rémunération prévue au contrat pour l'armateur était parfaitement correcte. Néanmoins, nous avons dans notre groupe une règle fondamentale découlant d'une instruction extrêmement précise de la direction générale, selon laquelle on ne peut pas affréter un navire au sein du groupe sans avoir reçu au préalable l'accord d'un service technique spécialisé chargé de contrôler la qualité du tonnage utilisé et sa conformité aux règles de sécurité. Il s'agit de ce que nous appelons dans notre jargon le vetting.
Ni le droit international, ni la législation communautaire, ni le droit français n'imposent une quelconque obligation aux affréteurs en matière de contrôle des navires. C'est à l'armateur lui-même, responsable de la gestion nautique du navire, de veiller à ce que celui-ci soit conforme aux normes internationales en matière de sécurité, de protection de l'environnement et de conditions de vie et de travail à bord.
Le transport pétrolier, et dans une certaine mesure le transport de produits chimiques, sont les seuls domaines dans lesquels les chargeurs ont regroupé leurs moyens et leurs efforts pour mettre en place un système commun d'inspection et de contrôle des navires. Il s'agit d'une démarche totalement volontaire qui témoigne bien du fait que les affréteurs sont conscients de leur responsabilité en matière de sécurité. En l'occurrence, nos procédures internes ont été respectées.
L'affréteur en charge du dossier de l'Erika a bien consulté, fin novembre 1999, avant de conclure le contrat, la base de données informatique dans laquelle figurait le statut du navire déterminé par notre service vetting, et c'est seulement après avoir obtenu une réponse positive qu'il a conclu l'affrètement.
Je vous dirai maintenant quelques mots sur la politique globale de sécurité maritime du groupe TotalFinaElf.
La contribution provisoire à l'enquête technique sur le naufrage de l'Erika du BEA-mer recommande aux groupes pétroliers français d'assurer à nouveau sous le pavillon national la propriété directe, l'armement ou l'exploitation d'une part majoritaire de leur flotte. Comme vient de vous l'expliquer le président Desmarest, l'évolution économique des marchés pétroliers après la grande crise des années soixante-dix a conduit, à partir du milieu des années quatre-vingt, la quasi-totalité des sociétés pétrolières à se retirer de l'exploitation directe de navires.
Je voudrais simplement ajouter ici qu'il n'y a pas a priori de corrélation évidente entre la fréquence des pollutions et la propriété directe des navires par les sociétés pétrolières. N'oublions pas que l'Amoco-Cadiz et l'Exxon Valdez appartenaient à des compagnies pétrolières. Les statistiques indiquent même que le retrait des sociétés pétrolières de l'exploitation directe de navires a coïncidé avec une baisse des pollutions. Depuis le milieu des années quatre-vingt, alors que la part des armateurs indépendants dans le transport pétrolier devenait nettement prépondérante, le nombre de pollutions a baissé, selon l'organisme INTERTANKO, de 60 %.
Le groupe TotalFinaElf ne s'est d'ailleurs pas désintéressé de la propriété maritime. Nous sommes aujourd'hui copropriétaire avec la société Services et Transports du Havre de trois navires de produits de 40 000 tonnes, immatriculés sous pavillon français. Par ailleurs, nous avions, en octobre 1997, déposé une demande d'agrément pour l'achat de deux VLCC dans le cadre de la loi du 5 juillet 1996 sur le financement quirataire. Bien entendu, nous sommes toujours près à examiner, en collaboration avec les armateurs français, tout nouveau projet permettant à la fois de renouveler la flotte pétrolière sous pavillon français dans de bonnes conditions de financement, et d'exploiter cette flotte sur le marché international dans de bonnes conditions de compétitivité.
Mais plus que la propriété et l'armement direct, je crois que c'est l'affrètement à temps qui est aujourd'hui le moyen le plus approprié à la disposition des compagnies pétrolières pour soutenir la politique d'investissement des armateurs et contrôler la qualité des navires. Il permet en effet d'installer dans la durée une véritable relation de partenariat avec des armateurs et autorise l'affréteur à suivre de plus près la maintenance de la flotte. Pour autant, il est clair que toutes les cargaisons ne peuvent pas être transportées par des navires affrétés à temps. Ce type de contrat est bien adapté aux approvisionnements réguliers, mais ne permet pas de répondre aux besoins ponctuels du marché SPOT. Cela est particulièrement vrai dans le domaine des produits raffinés - essence, gazole ou fioul - où les transactions sont nombreuses et rapides : ayant besoin de trouver un moyen de transport dans des délais extrêmement courts, le chargeur doit donc faire appel au marché de l'affrètement au voyage pour retenir le navire disponible aux meilleures dates.
Depuis plusieurs années, le groupe TotalFinaElf a développé une politique très active en matière d'affrètement à temps. Il contrôle en permanence une flotte composée d'une quarantaine de navires depuis la fusion avec Elf - une trentaine auparavant -, ce qui en fait l'un des acteurs les plus importants sur ce marché. Pour 100 navires qui travaillent en permanence pour le compte du groupe TotalFinaElf, 60 sont affrétés au SPOT et 40 à temps, ce qui est un ratio extrêmement élevé.
Avant même sa fusion avec Elf, TotalFina était le plus gros affréteur à temps de navires pétroliers sous pavillon français. Ainsi, au moment du naufrage de l'Erika, la flotte comprenait 8 navires appartenant à quatre armateurs différents pour un tonnage global supérieur à un million de tonnes de jauge brute. Par ailleurs, un rajeunissement considérable de cette flotte avait été entrepris en 1999, indépendamment de l'Erika. Ainsi, l'Autan et le Borée, deux gros pétroliers de 300 000 tonnes de plus de 20 ans, ont été remplacés par le Luxembourg et l'Algarve, tous deux construits en 1999. Nous avons pris deux autres navires, l'Ardenne, sous pavillon français et construit en 1997, et le Brabant, sous pavillon luxembourgeois et construit en 1998.
Enfin, postérieurement à la charte signée sous l'impulsion du ministre des transports, M. Jean-Claude Gayssot, nous avons restitué à son armateur notre dernier navire de plus de 20 ans et nous l'avons remplacé par un navire neuf de 300 000 tonnes que nous avons réceptionné le week-end dernier - il doit entrer en exploitation cette semaine et sera bientôt au Havre. De même, la flotte sous pavillon international pour le transport de produits raffinés est importante et jeune. L'Isère et la Seine sont de 1999 ; le Montebello de 1997 ; le Betty Knutsen de 1999.
Ces navires sont en général présents sur les marchés européens. Notre politique est de privilégier systématiquement leur utilisation directe par le groupe pour le transport de nos propres cargaisons. En 1999, 54 % du pétrole brut nécessaire à l'approvisionnement de nos raffineries européennes ont été transportés sur des navires contrôlés par le groupe par des contrats d'affrètement à temps. Et ce ratio s'élève même à 65 % si l'on raisonne non pas en tonnes transportées mais en tonnes-milles, c'est-à-dire en tenant compte de la distance parcourue. Ce sont des ratios extrêmement élevés dans le milieu pétrolier. Toutefois, l'ampleur et la diversité de nos activités font que le recours à l'affrètement au voyage, comme ce fut le cas pour l'Erika, sera toujours une nécessité.
En matière d'affrètement au voyage, il est impossible d'aligner, dans le domaine des contrôles de la sécurité et de la qualité, les conditions des affrètements au voyage sur celle des affrètements à temps. La rapidité des transactions fait que l'affréteur au voyage ne peut pas inspecter lui-même physiquement le navire avant son affrètement. Le plus souvent, le navire est en mer quand le contrat se négocie. L'affréteur doit donc inspecter par anticipation les navires susceptibles d'être loués ultérieurement et procéder ensuite par échange de rapports d'inspection avec les autres pétroliers au sein d'une base de données commune à tous les affréteurs, et que l'on appelle le système SIRE. Par ailleurs, l'affréteur au voyage n'a pas la possibilité de suivre les arrêts techniques des navires. L'affréteur ne peut donc pas contrôler le travail réalisé par la société de classification et doit se contenter des certificats émis par celle-ci. Il est particulièrement démuni pour tout ce qui concerne la vérification des structures des navires - états des citernes et des ballasts par exemple -, qui ne sont pas accessibles lors des inspections.
Demander aux affréteurs au voyage de renforcer le contrôle des structures est matériellement impossible. Les espaces cargaisons et les ballasts sont, dans la plupart des cas, interdits d'accès pendant les opérations commerciales pour des raisons de sécurité. D'ailleurs, les contrôles de structures sont fondamentalement de la responsabilité de l'armateur et de la société de classification, lors des arrêts techniques et des visites spéciales. Il s'agit ici d'un aspect fondamental du sujet. Il existe un dossier technique sur le navire qui est de la responsabilité de la société de classification - et il ne peut guère, à mon avis, en être autrement.
Ces suivis techniques sont longs et complexes et doivent être réalisés par des experts. Transférer cette activité sur les inspecteurs mandatés par les chargeurs qui sont d'anciens navigants et non des experts en construction navale serait extrêmement dangereux.
Je terminerai cet exposé en vous indiquant la méthode que nous employons pour inspecter les navires.
Même s'ils ne peuvent pas tout contrôler, et notamment pas les structures internes du navire, les inspecteurs mandatés par les compagnies pétrolières voient tout de même beaucoup de choses. Comme l'a justement relevé le rapport du BEA-mer, chaque inspection dure en moyenne une dizaine d'heures et est menée par des contrôleurs compétents et expérimentés : ce sont souvent d'anciens commandants au pétrole, ce qui était le cas pour l'inspecteur de TotalFina qui a inspecté l'Erika. Le formulaire utilisé, dénommé Vessel inspection questionnaire, comprend 400 questions touchant à peu près tous les aspects du navire, depuis les certificats et la documentation à bord, jusqu'au management de l'équipage, la navigation, le management de la sécurité, la prévention de la pollution, le système de gaz inerte, etc.
S'agissant de l'état des structures et de l'état des citernes et des ballasts, le guide d'inspection précise que la visite des citernes ne doit être entreprise que s'il existe une possibilité de le faire en toute sécurité. Ce qui est relativement difficile en pratique. Dans ce domaine, il s'agit donc surtout d'une vérification documentaire basée sur les certificats de la société de classification qui se trouvent à bord et qui concernent essentiellement le programme renforcé des structures mis en place par une résolution de l'OMI, en novembre 1993.
En dehors de l'inspection proprement dite, chaque compagnie a des critères d'acceptation des navires. Pour ce qui concerne le groupe TotalFinaElf, leur nombre s'élève à une soixantaine, en complément de l'inspection effectuée par nos experts. Ces critères sont extrêmement variés : le navire doit être parfaitement conforme aux standards fixés par les conventions internationales de l'OMI ; le navire doit être classé par une société de classification membre de l'IACS ; tous les certificats de classe doivent être exempts de réserve ; tous les documents relatifs au programme renforcé d'inspection des structures et à la dernière visite spéciale du navire doivent être à bord ; tous les éléments relatifs à la stabilité du navire doivent être approuvés par la société de classification et se trouver à bord ; les intervalles entre les arrêts techniques ne doivent pas excéder trente mois ; le navire doit être couvert par un P&I Club de tout premier rang, membre de l'International Group of P&I Clubs ; le bord doit être en possession d'instructions complètes de l'armateur en matière de sécurité et de protection de l'environnement ; le navire ainsi que l'armateur doivent avoir une certification ISM ; enfin, le navire doit être assuré à hauteur de 700 millions de dollars pour les dommages de pollution, et l'armateur doit être membre de l'ITOPF. Je précise que toutes ces conditions étaient réunies par l'Erika.
M. Thierry DESMAREST : Nous avons le sentiment que nous avons agi, s'agissant de l'affrètement de l'Erika, en professionnels respectant des procédures établies en vue d'obtenir la meilleure sécurité possible, même si, à l'expérience, cela s'avère insuffisant. Nous avons également l'impression, sans préjuger des résultats des enquêtes en cours, que la défaillance principale à l'origine de la catastrophe se situe dans les conditions d'intervention de la société de classification.
Il est clair que lorsque nous affrétons au voyage un bateau pour lequel nous ne pouvons pas inspecter les structures, nous devons avoir une grande confiance dans la qualité du travail réalisé par la société de classification. Or, malheureusement, les circonstances montrent que l'on avait beau avoir un bon certificat, la visite quinquennale avait beau remonter à 18 mois, le travail de la société de classification n'avait pas décelé les difficultés de structures de l'Erika. L'efficacité des acteurs doit donc être améliorée dans ce domaine.
M. le Président : Messieurs, je vous remercie.
M. le Rapporteur : M. Desmarest, je n'ai pas bien compris vos explications concernant le vetting. Pouvez-vous revenir sur ce point et nous préciser comment fonctionne votre vetting ? Avez-vous des personnels propres et combien ? Par ailleurs, êtes-vous satisfait du dispositif actuel ?
S'agissant de l'Erika, à quel moment vos soixante critères d'acception ont-ils été appliqués ? Par ailleurs, votre vetting concerne-t-il aussi la gestion nautique du navire, le management, et pas seulement le niveau de qualité du bateau ?
M. Thierry DESMAREST : Le service vetting est un service interne au groupe TotalFinaElf : des collaborateurs de la direction des transports maritimes sont chargés de cette activité de vetting qui s'étend également à la gestion nautique. Nous n'affrétons que des bateaux qui ont l'habilitation ISM.
M. Bertrand THOUILIN : Nous avons un service vetting basé à Paris et qui regroupe en permanence quatre inspecteurs, tous anciens navigants au pétrole. Nos conditions de recrutement sont assez strictes, puisqu'ils doivent avoir navigué au moins cinq ans au pétrole, dont deux ans à des postes de management, c'est-à-dire de commandant, second capitaine, chef mécanicien ou second mécanicien. Nous employons, en outre, un inspecteur en Belgique, un à Marseille, un dans la région du Havre et un dernier à Rotterdam. Ces inspecteurs travaillent exclusivement pour le groupe TotalFinaElf.
Leur travail comporte deux tâches essentielles. D'une part, ils inspectent eux-mêmes les navires ; nous ne souhaitons pas que nos inspecteurs soient uniquement des gestionnaires de bases de données, ils se déplacent donc en permanence sur les bateaux. D'autre part, ils gèrent une base de données dans laquelle sont inclus tous les renseignements sur les pétroliers que nous utilisons ou que nous sommes susceptibles d'utiliser.
Cette base de données ne se limite pas au système SIRE. Nous avons notre propre retour d'expériences que nous stockons, nous sommes abonnés à des bases d'information, comme le Lloyd's casualties qui donne en permanence des nouvelles sur les navires qui ont connu des avaries. Nous suivons les statistiques du Mémorandum de Paris et la liste des navires détenus. Mais surtout, nous nous servons de la base de données SIRE, base de données commune à l'ensemble des affréteurs et qui est le produit commun de l'ensemble des 26 sociétés membres de l'OCIMF. Nous participons au groupe de travail, à la taskforce, du système SIRE qui est l'outil essentiel de notre contrôle.
Les vérifications sont décrites dans le manuel que je vous ai indiqué. Vous nous demandez si notre vetting porte également sur la gestion nautique. Il faut être précis à ce sujet, car il s'agit d'un terme juridique lourd de sens. La gestion nautique, c'est la conduite du navire ; or la conduite du navire est de la responsabilité de son commandant, et de personne d'autre. Nous nous contentons de vérifier que le navire possède bien son certificat ISM et que son armateur-gérant est bien en possession du document of compliance qui prouve qu'il possède, lui aussi, la certification ISM.
Je rappellerai d'ailleurs que, logiquement, le certificat ISM aurait dû éliminer tout besoin de vérification des navires par les affréteurs. Quand le code ISM a été publié en 1998, j'ai rencontré de nombreux armateurs qui m'ont demandé pourquoi l'on continuait à inspecter les navires ; ils nous reprochaient de leur faire perdre du temps et de l'argent. Selon eux, la preuve de la certification ISM pour leur navire et pour leur organisation à terre devait nous suffire. Et M. Francis Vallat, que vous avez rencontré au Havre la semaine dernière, était l'un des grands avocats de cette idée selon laquelle le code ISM aurait dû mettre un terme au vetting.
M. le Rapporteur : La certification ISM de Panship a bien été délivrée par le RINA ?
M. Bertrand THOUILIN : Tout à fait.
M. le Rapporteur : C'est donc bien le RINA qui a délivré la certification ISM ainsi que la certification de l'Erika. Le récent changement de société de classification concernant ce bateau n'a choqué personne ?
M. Bertrand THOUILIN : Ce changement a eu lieu un an et demi avant que nous l'affrétions. Le fait que la certification ISM soit donnée par la même société de classification que celle qui suit le bateau par ailleurs est malheureusement une pratique courante. Et il s'agit d'une pratique que j'ai toujours trouvée choquante.
La France est l'un des rares pays où l'administration a pris ses responsabilités en refusant de déléguer la certification ISM à une quelconque société de classification et en l'assurant elle-même. Mais la France est une exception. Une des propositions que nous avions faites après le naufrage de l'Erika allait justement dans le sens d'une séparation du rôle de certificateur ISM de celui de la classification du navire.
Mme Jacqueline LAZARD : M. le président-directeur général, les conséquences de la catastrophe de l'Erika sur la côte atlantique sont importantes. Le pompage des cuves de l'Erika va bientôt commencer ; vous donnez-vous une obligation de résultat ?
M. Thierry DESMAREST : Le pompage des cuves de l'Erika n'est pas une opération simple. Les deux épaves sont à 120 et 130 mètres de profondeur, et sont situées dans une zone qui, du point de vue océano-météorologique, n'est pas une zone facile. En outre, le produit est sans aucun doute, de tous les produits pétroliers, le plus difficile à pomper : il faut tenir compte de la température de la mer - de 10 ou 11 degrés - et, par conséquent, de la très forte viscosité du produit qui en résulte.
Nous avons donc cherché le schéma nous permettant d'être les plus efficaces possible. Nous n'avons pas lésiné sur les moyens. Nous avons même révisé notre estimation du coût du pompage de 400 à 500 millions de francs. Nous allons mettre en place un dispositif qui comportera 6 bateaux - 3 à positionnement dynamique et 3 autres bateaux de logistique - et un hélicoptère, afin de nous donner tous les moyens pour réussir cette opération rapidement, c'est-à-dire entre juin et septembre.
Par rapport aux schémas utilisés dans le passé, il était difficile d'envisager le même que celui qui a été utilisé pour le Tanio, puisqu'il a fallu 18 mois pour récupérer une quantité nettement inférieure à celle qui se trouve dans les cuves de l'Erika ; cela nous aurait conduits à travailler pendant une longue période et donc pendant les mois d'hiver, dans une zone difficile.
Nous avons donc mobilisé de gros moyens afin de nous donner toutes les chances de succès. Nous sommes confiants, tout en sachant qu'il ne s'agit pas d'une opération facile. Aussi, dans le même temps, nous nous entourons du maximum de précautions afin d'éviter toute pollution supplémentaire. S'il s'avérait qu'au mois de septembre les résultats sont insuffisants, nous envisagerons la meilleure tactique pour poursuivre l'opération - peut-être suspendre l'opération et la reprendre dans une autre période de beau temps. Il faut savoir qu'en hiver, il est probable que l'ensemble des matériels et des personnels seraient en attente pendant 80 à 90 % du temps, ce qui serait sans doute faire courir des risques excessifs. Disons néanmoins que tout a été organisé pour que l'on ait le maximum de chances de succès.
M. François GOULARD : M. le président-directeur général, je voudrais revenir sur une notion que vous avez abordée dans votre propos introductif, à savoir la notion de responsabilité, notion qui a un sens juridique précis. Vous avez reconnu avoir une responsabilité dans ces questions de sécurité maritime en évoquant les dépenses que vous avez engagées pour le nettoyage des côtes et le pompage des cuves de l'épave. M. Thouilin a, quant à lui, évoqué la notion de responsabilité en parlant du vetting et des contrôles que vous opérez de manière directe ou indirecte pour assurer la sécurité.
D'un point de vue général, les pétroliers ont mis en place un dispositif, avec l'accord des gouvernements, que je qualifierais de « responsabilité partielle » avec la création du FIPOL, puisqu'il s'agit d'une responsabilité limitée au montant du fonds, lequel est de 1,2 milliard de francs. Or il est possible, voire probable, que la totalité du préjudice, sous toutes ses formes, dépassera les fonds disponibles sur ce fonds FIPOL. Dans ces conditions, il est permis de s'interroger sur la possibilité pour les victimes d'être indemnisées correctement et donc sur la possibilité de mettre en jeu la responsabilité des acteurs. La question est complexe, vous avez évoqué une chaîne de responsabilité dans laquelle il y avait eu des défaillances.
La question que je voudrais vous poser est la suivante : n'y a-t-il pas lieu, aujourd'hui, de reposer dans son ensemble et à un niveau international, cette question de la responsabilité dans le transport de ces matières pétrolières qui présentent des risques, car aujourd'hui la couverture des préjudices n'est pas convenablement assurée ?
Je voudrais par ailleurs connaître votre position sur un point plus particulier concernant une loi française, la loi sur les déchets. Cette loi a été invoquée par les avocats d'un certain nombre de collectivités pour vous demander, soit de procéder vous-mêmes à la récupération des déchets laissés par l'Erika sur les côtes, soit, à défaut, d'en supporter la charge. J'avais déjà posé la question à Lorient, mais les représentants de votre groupe avaient réservé leur réponse. Quel est votre sentiment sur la mise en jeu de cette loi, qui est un moyen pour les victimes d'être indemnisées, ou du moins de voir le préjudice réparé ?
Enfin, vous avez parlé de la sécurité maritime, du transport pétrolier d'une façon générale, pour l'ensemble des produits, alors que ceux-ci sont très divers. L'Erika transportait un produit bien spécial, le fioul n° 2, qui présente des particularités physiques et dont le transport est particulier. Il existe en effet des risques spécifiques, notamment parce que ce produit est transporté à chaud, et que la présence de sources de chaleur dans un navire, avec des ballasts qui sont alternativement remplis d'eau de mer ou vides, entraîne une accélération incontestable de la corrosion.
Toutes ces particularités m'amènent à vous demander - et je ne conteste nullement votre souci de la sécurité - si vous ne pensez pas qu'il y a eu une insuffisance de réponses à ce risque, en sachant que quel que soit le respect formel des règles, il ne fallait pas être très grand clerc pour imaginer que de tels bateaux, avec un âge aussi avancé et un management tel qu'on le sait, allaient, un jour ou l'autre, provoquer un accident ?
M. Thierry DESMAREST : Les différents produits pétroliers présentent chacun des problèmes spécifiques. Le transport de l'essence ne comporte pas de grands risques de pollution, puisqu'en cas d'accident l'essentiel du produit s'évapore, mais parallèlement les risques d'explosion sont importants et constituent une menace pour la vie de l'équipage.
Le transport de fioul lourd n'est pas négligeable. Je vous rappelle qu'il y a une vingtaine d'années, avant que le programme nucléaire soit aussi important, la production des raffineries françaises était composée de plus d'un tiers du fioul lourd ou fioul n° 2. Il est vrai que ce fioul provoque des problèmes particuliers en cas de corrosion importante, mais nous devons prendre en considération tous les problèmes de sécurité que posent les différents produits, y compris le butane et le propane.
Le problème particulier auquel nous sommes confrontés avec le fioul lourd, c'est que l'offre de bateaux pour transporter ce type de produits est en général une offre de bateaux anciens. En effet, les armateurs n'aiment pas transporter dans leurs bateaux modernes du fioul n° 2 qui est un produit particulièrement sale, car pour affecter ensuite de tels bateaux au transport des produits blancs, ils devront faire des rinçages pendant plusieurs voyages.
Cela dit, la réputation de l'Erika n'était pas celle qu'on lui attribue aujourd'hui. Vous avez sans doute lu dans le rapport d'enquête du BEA-mer que ce bateau était considéré comme étant correctement entretenu et qu'il n'avait pas mauvaise allure, même si, bien entendu, cela ne suffit pas pour garantir l'intégrité des structures. Et l'on en revient là au problème de la confiance que l'on peut avoir dans la société de classification qui est la seule à même de procéder aux vérifications des structures.
En ce qui concerne les problèmes de responsabilité, en termes juridiques, un tel événement de mer met en cause la responsabilité de l'armateur. Mais, compte tenu des conséquences qu'un naufrage pétrolier peut représenter, une convention intergouvernementale permet un mécanisme d'indemnisation à hauteur de 200 millions de dollars. Jusqu'à présent, il n'y a jamais eu de problème de plafond, et je ne sais pas aujourd'hui s'il y en aura, dans la mesure où nous acceptons de prendre en charge l'ensemble des opérations - pompage, récupération des déchets, travaux de nettoyage - pour un montant actuellement évalué à 850 millions de francs qui ne s'imputera pas sur le fonds. En fait, nous ne serons indemnisés que s'il reste des fonds après l'indemnisation de toutes les victimes - personnes privées et professionnels, collectivités locales, Etat, etc. -, et les chances que nous le soyons me paraissent assez faibles. De même, l'Etat ayant accepté d'apparaître à l'avant-dernière place - devant nous - dans la liste de ceux qui peuvent prétendre à une indemnisation du FIPOL, il est difficile de dire aujourd'hui si la réparation des préjudices économiques dépassera ou non le plafond.
J'ajoute que nous avons indiqué que nous étions favorables à une remontée substantielle des engagements financiers, aussi bien au niveau des assureurs qu'au niveau du FIPOL. Il n'y a pas de raison pour qu'on limite à un niveau aussi bas la responsabilité des assureurs de l'armateur, l'assurance étant inférieure à 80 millions de francs pour un bateau de cette taille. Des clubs d'assureurs peuvent parfaitement mettre en place, pour des bateaux de la taille de l'Erika, une assurance avec un plafond de 100 ou 200 millions de dollars.
Par ailleurs, TotalFinaElf paie environ 10 % des appels de fonds lancés par le FIPOL, mais nous sommes tout à fait d'accord pour que l'on double ou que l'on triple le plafond d'intervention du FIPOL.
M. le Rapporteur : M. le président-directeur général, dans votre exposé introductif, vous avez parlé d'une chaîne globale de responsabilités qui a failli, et c'est bien le moment de parler de ce problème central dont le cas de l'Erika n'est qu'une illustration criante.
Nous avons reçu les industriels du recyclage des matières nucléaires. Dans ce secteur, la responsabilité du propriétaire des matières transportées, donc de l'affréteur, est totale. Ce principe a amené les responsables à prendre des mesures de sécurité extrêmement importantes. Nous avons également découvert que l'affréteur de produits chimiques a une grande part de responsabilité en cas de problème lors de leur transport.
Alors il est vrai que le pétrole a une autre histoire et que le marché est beaucoup plus compétitif. Il n'empêche que la question de la redéfinition des responsabilités se pose, ce qui entraînerait une clarification de la filière - qui est assez opaque - et peut-être une responsabilisation plus grande des affréteurs. En effet, le FIPOL ne pénalise pas ceux qui affrètent des bateaux de mauvaise qualité, très âgés ou certifiés par des sociétés de classification plus ou moins sérieuses.
M. Thierry DESMAREST : M. le rapporteur, j'attire votre attention sur le fait qu'il convient tout de même de faire attention, dans les évolutions, à ne pas déresponsabiliser l'armateur. C'est l'armateur qui assure la gestion nautique de son bateau et c'est le commandant du bateau qui est derrière les manettes. Je serais favorable à une évolution du système qui relève les plafonds de responsabilité de façon très substantielle, aussi bien du côté de l'armateur - et il en tirera les conséquences au niveau de ses assureurs, qui eux-mêmes seront plus sévères pour les bateaux assurés - que du côté de l'industrie pétrolière.
D'aucuns disent qu'à partir du moment où tout cela est mutualisé, plus personne n'y fait attention. Tout d'abord, je pense que l'on ne traite pas les problèmes de sécurité de cette façon, et, ensuite, si l'on poussait cette logique jusqu'à son extrémité, on interdirait aux personnes de s'assurer.
M. le Rapporteur : Vous ne payez pas le même prix pour assurer une voiture ancienne que pour assurer une voiture neuve ! Au FIPOL, les apports des compagnies pétrolières sont à peu près identiques quel que soit l'état des bateaux qu'elles affrètent.
M. Thierry DESMAREST : Je serais assez favorable à l'instauration d'un système de bonus-malus dans le fonctionnement du FIPOL. Ce serait une manière de prélever plus fortement sur ceux qui présentent une sinistralité plus importante.
M. Bertrand THOUILIN : Il convient tout de même de rappeler aujourd'hui que si le coût de la pollution de l'Erika était de 2 milliards de francs, il pèserait pour 96 % sur l'industrie pétrolière et pour 4 % seulement sur l'armateur. Le système est aujourd'hui déséquilibré et extrêmement favorable aux armateurs. Et les P&I Clubs le savent très bien : ils ont toujours mis le risque de pollution à part. Ils couvrent des tas de choses, du coût des clandestins à bord jusqu'au dommage à la cargaison, alors que le risque pollution a été soigneusement mis de côté depuis l'Amoco-Cadiz, voire même avant.
Ils ont d'abord offert une garantie limitée à 500 millions de dollars, puis elle est montée à 700 millions et, depuis le 1er février 2000, à 1 milliard de dollars. Assez curieusement, l'Erika était assuré pour 700 millions de dollars, et si le système CLC FIPOL ne s'était pas appliqué, on aurait peut-être pu avoir accès à cet argent tout de suite.
Il y a donc un marché de l'assurance qui couvre déjà le risque de pollution. Aujourd'hui, chaque armateur a une couverture de 1 milliard de dollars par navire. Il n'y a donc pas grand-chose à faire pour essayer de mettre le droit en conformité avec les faits puisque la couverture des armateurs existe. Par ailleurs, le système FIPOL pose, aujourd'hui, un problème de montant. C'est en fait la première fois, mais comme le protocole de 1992 vient simplement d'entrer en vigueur, c'est une fois de trop.
Il convient de bien distinguer le problème du montant de celui du principe. Quel a été, au départ, le fondement du FIPOL, et pourquoi le France s'est-elle battue pour que ce système existe ? C'est précisément pour que toutes les victimes aient droit à une indemnisation, quel que soit le propriétaire de la cargaison, c'est-à-dire quelles que soient les responsabilités dans la chaîne. Le fondement du système, c'est la sécurité pour les victimes, la certitude d'être indemnisées.
Le système, de ce point de vue, est parfait. Le taux d'impayés au FIPOL est l'un des plus bas du monde et l'un des meilleurs dans le système onusien. Il s'agit donc d'un bon système. Mais il y a un vrai problème de montant et un vrai problème de déséquilibre entre les armateurs et l'industrie pétrolière.
La France, dans le domaine de la pollution pétrolière et de la prévention des risques de pollution, est considérée comme l'un des pays les plus avancés du monde. Parce que nous avons eu des expériences douloureuses dans le passé et parce que l'administration française au niveau du FIPOL, au niveau de l'OMI, s'est battue pour que le système existe. En France, nous possédons un dispositif très sophistiqué, qui est celui du plan POLMAR.
Nous avons considéré que la loi sur les déchets qui visait à faire supporter l'enlèvement des déchets par le groupe TotalFinaElf était contraire au dispositif du plan POLMAR, qui précise très clairement que cet enlèvement relève de l'autorité de l'Etat. Dès lors qu'un plan d'urgence - plans POLMAR ou ORSEC par exemple - est mis en place, les maires sont dépossédés de leurs compétences et sont sous contrôle de ce plan. Pour notre part, nous avons inscrit notre intervention dans le cadre du plan POLMAR depuis le début : nous nous sommes mis à la disposition des autorités désignées par le plan POLMAR et toutes les actions que nous avons menées sur le littoral l'ont été dans le cadre de ce plan.
En outre, nous considérons aussi qu'en matière de pollution pétrolière, certaines conventions internationales - la convention CLC et la convention FIPOL - canalisent la responsabilité sur un certain nombre d'opérateurs, et notamment sur le propriétaire du navire. La loi sur les déchets de 1975, qui est postérieure à la ratification des conventions CLC et FIPOL, ne doit pas primer sur ces traités internationaux. Je suis persuadé qu'en matière de pollution par hydrocarbures, la loi sur les déchets ne s'applique pas, car il existe un texte international qui prime sur la loi de 1975.
Enfin, dernier point, la loi de 1975 pose des problèmes de qualification juridique : la société TotalFinaElf est-elle productrice de déchets ? Ce n'est pas évident, car elle est productrice d'une marchandise loyale et marchande qui devient un déchet à la suite d'un accident. Est-elle détentrice des déchets ? Ce sont des interrogations que je me pose.
Pour résumer, les deux aspects fondamentaux de notre attitude sont que, d'une part, nous pensons que le plan POLMAR a été institué pour répondre à ce genre de situation et nous entendons répondre et coopérer avec les autorités du plan POLMAR, et, d'autre part, il existe un système composé de deux conventions internationales qui priment sur la loi de 1975 sur les déchets.
M. Louis GUEDON : M. le président-directeur général, vous insistez sur le plan POLMAR, et je vous en remercie. Actuellement, une enquête est menée auprès des maires pour savoir ce qu'ils en pensent. Il n'est pas certain qu'à l'issue de cette enquête, vous puissiez vous abriter en toute sérénité derrière les modalités du plan POLMAR.
Par ailleurs, vous avez évoqué, dans votre exposé liminaire, la hiérarchie des contrôles, et le fait que la chaîne ait failli, ce qui veut dire que cela ne fonctionne pas suffisamment bien. S'agissant de la prévention routière, l'on considère qu'il vaut mieux « prévenir que guérir ». En l'espèce, on estime que ce n'est pas une bonne politique de considérer que les assurances sont là pour dédommager les victimes et leurs familles : une politique responsable, sociale et humanitaire, consiste à faire en sorte de diminuer le nombre d'accidents de la route.
Le problème qui préoccupe notre commission d'enquête est un peu comparable, puisque le transport maritime concerne des matières inertes - céréales, minerais, tissus, bois, épices - et en cas d'accident, on ne peut que déplorer le naufrage, la perte des marchandises, et au pire la mort de l'équipage ; mais il s'agit d'un drame de la mer, et il y en a toujours eu.
Dans le cas précis du naufrage de l'Erika, il ne s'agit plus d'un drame de la mer, car l'on se trouve devant des conséquences très graves concernant quatre départements français. Or nous ne voulons plus revoir cela. Je reprends donc les paroles du rapporteur, avec qui je suis tout à fait d'accord, dans la mesure où les substances transportées sont dangereuses : vous ne pouvez pas vous abriter derrière un arbre qui cache la forêt, même si votre argument est juridique, car il ne tiendra pas longtemps devant la pression de l'opinion publique.
Cette commission d'enquête a pour vocation de présenter des suggestions afin que de telles catastrophes ne se renouvellent pas, je vous repose la question : les propriétaires des produits dangereux pour les hommes et l'environnement ne doivent-ils pas être déclarés responsables, d'autant qu'ils disposent des moyens financiers nécessaires pour traiter ce problème ? En d'autres termes, ne faut-il pas aligner le régime de la responsabilité en cas d'accident pétrolier sur ceux en vigueur pour les transports de produits chimiques et radioactifs ?
M. Thierry DESMAREST : Je suis tout à fait d'accord avec vous, M. le député : il vaut mieux prévenir que dédommager. Et nous sommes décidés à avoir une approche constructive pour renforcer le caractère préventif. Nous avons renforcé, dans les jours qui ont suivi le naufrage, nos procédures de sélection des navires ; nous avons signé la charte de M. Jean-Claude Gayssot qui reprend un certain nombre de nos propositions ; nous sommes partisans d'avoir un système de contrôle de qualité des sociétés de classification, afin que l'on puisse avoir vraiment confiance dans leur travail.
Et lorsque nous parlons d'un organisme de contrôle des sociétés de classification, nous songeons à un organisme européen ayant le droit de refuser l'agrément aux sociétés de classification qui ne présenteraient pas les qualités requises pour être considérées comme sérieuses. Si nous voulons faire bouger le système, il est en effet indispensable d'établir des sanctions.
En ce qui concerne la responsabilité totale de l'affréteur, je vous ai déjà répondu : nous pensons qu'il ne faut pas déresponsabiliser l'armateur. En revanche, nous sommes favorables à une forte augmentation de la prise en charge par l'industrie pétrolière des conséquences des accidents, et à la responsabilisation de chaque acteur par un système de bonus-malus au niveau du FIPOL.
Quant à l'efficacité du mécanisme de remboursement du FIPOL, il s'agit d'une convention entre gouvernements. En notre qualité d'industriel, nous n'avons aucun pouvoir sur la rapidité des remboursements. Ce sont les représentants des Etats qui dirigent le FIPOL : c'est à eux qu'il appartient d'exiger une accélération du processus.
M. le Président : Etes-vous favorable à la proposition du gouvernement français de porter à 1 milliard d'euros le plafond du montant de l'indemnisation par le FIPOL ?
M. Thierry DESMAREST : Je n'y suis pas défavorable - c'est d'ailleurs le montant en vigueur aux Etats-Unis -, mais il faudrait que l'on assigne une responsabilité de l'ordre de 300 millions de dollars aux armateurs qui peuvent parfaitement s'assurer pour de tels montants. Cela veut dire qu'il y aurait un certain contrôle au niveau des sociétés d'assurance et la mise en place d'un système de bonus-malus à l'égard des armateurs et de leur sinistralité. L'industrie pétrolière supporterait la part la plus importante, avec 700 millions de dollars.
M. Louis GUEDON : Il est bien évident que s'il y a une faute de navigation, la responsabilité de l'armateur est totale.
M. Thierry DESMAREST : On ne peut tout de même pas le dégager de toute responsabilité quand il n'entretient pas son bateau !
M. Louis GUÉDON : C'est évident M. le président directeur général. Un tel cas de figure relève de la faute de navigation car la navigation englobe l'entretien du matériel autant que sa mise en _uvre.
M. Alain GOURIOU : M. Thouilin, en tant que député de la circonscription dans laquelle est située Trébeurben, je puis vous dire que les retombées économiques du naufrage de l'Erika ne sont pas nulles. En matière touristique et en termes d'image, c'est tout le littoral de la Manche et de l'Atlantique qui est atteint. Mais on fera le bilan en temps utile.
Je voudrais revenir sur le problème de l'affrètement. Nous avons auditionné d'autres industriels du secteur pétrolier qui nous ont exposé leur manière de voir les choses et les garanties qu'ils exigeaient lorsqu'ils choisissaient un navire. Il se trouve qu'un de ces industriels a récusé l'Erika, considérant que ce bateau ne présentait pas les garanties nécessaires pour un transport de carburant.
Le groupe TotalFinaElf a-t-il le souci, sachant que ce fioul n° 2 est transporté par des navires anciens, de prendre le minimum de garanties quant aux bateaux affrétés ? Étiez-vous informés que l'Erika avait déjà été récusé par d'autres affréteurs ?
M. Thierry DESMAREST : Quand nous avons pris la décision d'affréter l'Erika, l'armateur nous avait indiqué qu'il avait reçu des lettres d'acceptation de quatre autres compagnies pétrolières internationales figurant parmi les dix premières mondiales. Il venait d'ailleurs de faire un voyage pour la compagnie espagnole Repsol, et détenait des lettres d'acceptation d'Exxon, de Texaco et de Shell.
J'insisterai sur le problème de Shell, car cette société fait, a posteriori, des distinguos subtils. Nous disposions d'une copie de la liste des compagnies qui avaient envoyé une lettre d'acceptation à l'armateur, mais pas du détail des termes de cette acceptation. Or, dans la lettre de Shell, il était précisé que l'Erika était bon pour charger dans les terminaux de cette compagnie, mais que la société se réservait le droit de le refuser pour charger pour son propre compte.
Nous qui produisons du fioul dans une raffinerie, nous avons du mal à comprendre comment un bateau peut être bon pour charger ce fioul pour le compte de quelqu'un d'autre, et être mauvais si c'est pour notre propre compte ! Soit le bateau est bon, soit il ne l'est pas. Il est facile de faire des commentaires une fois que l'accident s'est produit, et il ne faut pas trop faire de sémantique en cette matière. L'Erika n'avait pas mauvaise réputation. Plusieurs grandes compagnies pétrolières avaient envoyé des lettres d'acceptation et, de l'aveu de tous ceux qui ont accédé au bateau, y compris les sauveteurs, il avait une allure extérieure satisfaisante. Simplement le problème de ses structures n'a pas été décelé par les contrôles.
Et je dois vous dire que ce problème d'intégrité des structures, déjà difficile à présent, sera un problème de plus en plus important. En effet, les bateaux à double coque constituent un progrès pour un certain nombre de risques - en particulier pour les risques d'échouage et de collision -, mais ils constituent une complication pour les problèmes d'intégrité des structures car des points de corrosion peuvent se développer entre les deux coques à des endroits particulièrement peu accessibles. Il conviendra donc de renforcer les contrôles de l'intégrité des structures et du développement de la corrosion.
M. René LEROUX : M. Desmarest, en tant que maire particulièrement touché par la pollution, je vais sortir du cadre de la commission d'enquête pour vous poser des questions plus terre à terre sur la dépollution. Vous nous avez fait part de votre compassion face au traumatisme que nous vivons au quotidien sur le littoral et vous avancez un chiffre de 850 millions de francs. Pouvez-vous nous donner le détail de cette somme, afin que l'on ait une idée du montant qui intéresse directement le littoral ? En termes d'image, ne serait-il pas préférable que vous engagiez plus de moyens en direction des collectivités et des professionnels pour les aider, au quotidien, dans la reconquête des espaces naturels ?
Mes collègues ont, tout à l'heure, parlé de responsabilité. A partir du moment où, considérant que vous aviez un devoir moral, vous vous êtes engagés à financer certaines opérations de nettoyage du littoral, je ne sais pas dans quelle mesure la commission d'enquête peut concevoir que votre responsabilité juridique n'est pas engagée, même si, au jour d'aujourd'hui, elle n'est pas avérée.
Vous avez donc débloqué la somme de 850 millions de francs, avec l'aide, certainement, d'un réseau d'actionnaires très proches de vous. Quelle est la réaction de l'ensemble des actionnaires du groupe TotalFinaElf aujourd'hui ? Ne pensez-vous pas qu'ils pourraient abandonner une part de leurs dividendes au titre de cette image et essayer de vous conforter dans la décision que vous avez prise en renforçant les fonds financiers que vous avez débloqués ?
Enfin, s'agissant d'un fioul n° 2, qui représente un très faible pourcentage de votre activité, envisagez-vous de ne plus le transporter ?
M. Thierry DESMAREST : Malheureusement, nous n'avons pas d'autre solution que de transporter le fioul n° 2 produit par nos raffineries ! Son principal usage est la production d'électricité. La France s'est dotée d'un programme nucléaire qui a sensiblement réduit notre activité dans ce domaine. Nous avons donc investi dans les raffineries pour limiter la production de fioul, mais il existe encore des productions importantes que l'on doit exporter puisqu'elles n'ont pas de débouché en France ; on ne peut donc pas se dispenser de le transporter.
En ce qui concerne les 850 millions de francs que nous engageons, ils se répartissent de la manière suivante : 500 millions de francs serviront au pompage des cuves du navire ; 200 millions de francs sont prévus pour la collecte des 150 000 tonnes de déchets à partir des dépôts secondaires pour les amener sur les dépôts primaires - qui sont pratiquement tous situés à Donges -, et le traitement de ces déchets ; 30 millions de francs financeront en partie une campagne de promotion de l'image du littoral atlantique ; 70 millions de francs - soit 20 millions de plus que prévu initialement - sont affectés au paiement de travaux de nettoyage du littoral ; enfin, nous participerons au programme de restauration des équilibres écologiques pour 50 millions de francs. Le total s'élève donc à 850 millions de francs, sans compter le coût du personnel mis à disposition : 70 personnes, dont 50 à temps plein, travaillent sur l'encadrement de ces différentes opérations.
Il s'agit d'un engagement important, et lorsque je rencontre les actionnaires de TotalFinaElf, les réactions sont extrêmement variables. Certaines personnes se demandent pourquoi nous dépensons tant d'argent alors que nous ne sommes juridiquement pas responsables ; d'autres pensent, au contraire, qu'il est important, pour notre image, de s'investir dans la restauration de l'environnement du littoral.
Nous sommes la première entreprise française à la suite de la fusion de TotalFina avec Elf. Nous avons affiché des objectifs de préservation de l'environnement, avec notamment une fondation qui a travaillé sur le thème de la biodiversité marine et terrestre. Le thème de la préservation de l'environnement est donc un thème que l'on essaie de traiter depuis longtemps et nous continuerons notre action pour la restauration de l'environnement et des équilibres écologiques. Si cela s'avère nécessaire pour parvenir à des résultats satisfaisants pour le littoral, nous n'hésiterons pas à augmenter notre contribution financière aux opérations en cours.
M. Léonce DEPREZ : M. Thouilin, vous nous avez dit - et nous l'avons parfaitement compris - que la sécurité des transports maritimes est une chaîne comprenant de nombreux maillons. Mais il est évident que le maillon TotalFina est fondamental.
M. le président-directeur général, au moment du naufrage, l'opinion publique, justement, n'a pas perçu TotalFina comme assumant son rôle de maillon de la chaîne. Vous avez donc dû réviser votre position ; aujourd'hui, vous nous dites d'ailleurs que juridiquement vous n'êtes pas responsable, mais que moralement vous ne pouvez pas ne pas intervenir. Il n'y a donc pas concordance entre votre premier propos et celui de M. Thouilin. Le malaise qui s'est développé dans l'opinion publique est venu de votre déclaration.
M. Thouilin, j'ai été frappé par la déclaration d'un préfet qui disait : « Nous avions tout prévu, sauf qu'un bateau se casse en deux ». L'aviez-vous prévu, vous, en affrétant l'Erika ?
Enfin, que ce serait-il passé si l'Erika s'était cassé en deux dans le Pas-de-Calais ? Le moment n'est-il pas venu de penser au transport par une autre voie que celles qui présentent autant de risques ?
M. Jean-Michel MARCHAND : M. le président-directeur général, je voudrais revenir sur trois points, et partir de la phrase que vous avez prononcée : un maillon d'une chaîne qui a failli. La construction est parfaite : est-ce la chaîne qui a failli, ou est-ce un maillon, et dans ce cas, lequel ?
Je ne comprends pas pourquoi, après avoir remarqué des dysfonctionnements dans les informations qui vous sont données par les sociétés de classification, vous n'avez pas été interloqué par ces informations. Vous avez bien dû constater que certaines informations ne correspondaient pas à la réalité ; et vos inspecteurs peuvent aller vérifier un certain nombre de choses. Un bateau ne doit pas se casser au cours d'un voyage !
Deuxième point, je ne partage pas votre opinion quant à votre définition du mot « déchet », car pour les personnes qui les subissent et qui les ramassent, ce sont bien des déchets. Je comprends bien la bagarre juridique que vous allez mener et j'en attends des réponses. D'ailleurs, j'aimerais savoir comment vous allez traiter ces déchets et où allez-vous le faire ; car s'il faut les transporter, quel moyen allez-vous utiliser ?
Vous connaissez parfaitement le fioul n° 2, qui est la première étape de la distillation. Vous connaissez ses caractéristiques chimiques et donc sa toxicité. Comment se fait-il que vous n'ayez pas été le premier à informer les populations, et en particulier tous les bénévoles ? Car même si les maires ont fourni des équipements spécifiques, on a tout de même laissé des personnes ramasser ces déchets.
Enfin, je voulais revenir sur le thème de l'indemnisation des personnes, dont je précise au passage que je ne vois pas pourquoi elle serait limitée à 1,2 milliard de francs ! Mais vous avez déjà répondu à ma question en indiquant que l'assurance du bateau était mise à contribution et que les assureurs des armateurs doivent pouvoir être davantage impliqués à l'avenir.
M. Edouard LANDRAIN : M. le président-directeur général, j'apprécie le fait que vous ayez pris sans attendre un certain nombre de règles, d'obligations, de nouveaux critères pour obliger vos transporteurs armateurs à prendre le maximum de précautions. Ma question est simple : les armateurs ont-ils eux aussi, en contrecoup, des exigences à votre égard quant aux délais et aux coûts ? En résumé, subissez-vous des mesures de rétorsion de la part des transporteurs ?
M. Thierry DESMAREST : Depuis l'accident de l'Erika, nous constatons une montée des taux de fret qui n'est pas négligeable. Cette montée est liée à deux phénomènes : d'une part, la croissance de la demande de pétrole est relativement forte depuis un an, et, d'autre part, les affréteurs sont de plus en plus réticents à affréter les bateaux les plus anciens. La demande concerne donc surtout les bateaux récents, ce qui fait monter les taux de fret. Les armateurs exigent, par conséquent, des conditions plus rémunératrices depuis quelque temps.
M. Edouard LANDRAIN : Cela veut-il dire que pour le futur, les nouvelles règles étant établies, il faudra prendre en compte le phénomène que vous connaissez actuellement ?
M. Thierry DESMAREST : Nous avons constaté que dans des domaines où la réglementation a évolué, il y a eu une relance de la construction navale. Du fait de la législation américaine sur les bateaux à double coque, la moitié des grands pétroliers - de plus de 100 000 tonnes - a moins de dix ans. Pour les bateaux plus petits, la proportion d'unités de moins de dix ans n'est que d'un quart. Les choses bougent sur ce plan ; raison de plus pour amplifier le mouvement.
S'agissant de la toxicité du produit, sachez que nous avons envoyé la fiche descriptive du produit aux pouvoirs publics dans les jours qui ont suivi le naufrage et avant l'arrivée des premières nappes de polluant sur les plages. En outre, des analyses de contrôle à partir d'échantillons prélevés au chargement ont également été envoyées. Vous avez déjà auditionné des experts : ils vous ont certainement expliqué qu'il faut des expositions très prolongées pour que de véritables problèmes de toxicité se posent.
Il est vrai, M. le député, qu'un bateau n'est pas fait pour se casser en deux ! Cela étant dit, il convient de savoir que dans un pétrolier il y a des masses qu'il faut répartir de telle manière que selon que le pétrolier se trouve en haut d'une vague ou dans un creux il n'y ait pas d'efforts excessifs qui remettent en cause la sécurité du bateau. Et de ce point de vue, je puis vous assurer que le plan de chargement avait été fait de manière correcte et n'exposait pas le bateau à des répartitions de masses déséquilibrées qui auraient créé des risques de rupture. La rupture doit donc avoir une autre cause, notamment liée à des phénomènes de corrosion.
Vous demandez également pourquoi nous n'avions pas été alertés contre les insuffisances du RINA. Il existe déjà un mécanisme de sélection parmi les sociétés de classification, et le RINA fait partie des sociétés de classification dites de premier rang. Alors peut-être que parmi ces sociétés, de classification de premier rang, certaines ne méritent pas ce classement et qu'il faudrait faire le ménage.
En ce qui concerne les déchets, nous avons lancé un appel d'offres à une dizaine d'entreprises présélectionnées ; on devrait avoir les réponses la semaine prochaine. Différentes filières sont envisagées, mais celle qui paraît a priori primer consisterait à effectuer des traitements physico-chimiques des déchets. Ces traitements pourraient être réalisés dans la région de Donges, ce qui éviterait les problèmes de transport.
M. Bertrand THOUILIN : Je voudrais, pour ma part, revenir sur les propos de M. Deprez qui évoqué un changement de discours. Je ne suis pas de cet avis, car nous avons dit dès le début que ce navire avait été inspecté dans le cadre d'un système de contrôle préalable. Nous avons toujours considéré que nous étions l'un des maillons de la chaîne, mais que notre intervention avait ses propres limites. Et si nous avons rempli nos obligations de manière diligente et responsable, cela n'a pas empêché le navire de se casser.
Dès le début, nous avons parlé non pas en chargeur qui aurait nié toute responsabilité, mais en chargeur qui a affrété ce navire en suivant une procédure interne de contrôle et de sélection.
Bien entendu, nous n'avions pas prévu que ce bateau allait se casser. Je vous rappelle qu'il avait subi un arrêt technique important, puisqu'il était resté cinq semaines en chantier de réparation, moins d'un an et demi auparavant. Il n'est donc pas normal, alors qu'il devait rester - grâce à ce contrôle - en exploitation cinq années de plus, que ce bateau se casse moins de deux ans après cet arrêt ! Il y a bien quelque chose qui ne fonctionne pas dans le système, quelque chose que nous, affréteurs, nous ne contrôlons pas et que nous ne pourrons jamais contrôler. Le problème de l'Erika est un problème de structures, ce qui veut dire qu'aucun inspecteur extérieur - mêmes ceux du Mémorandum de Paris ou des Affaires maritimes - ne pouvait le voir. C'est un problème de mesure d'épaisseur, d'études de la corrosion, lesquelles sont effectuées par les sociétés de classification.
En ce qui concerne les risques dans le Pas-de-Calais, il y a eu récemment une collision importante entre un navire à passagers - le Norvegian Dream - et un porte-conteneurs - l'Ever Decent. Les risques de pollution sont effectivement extrêmement importants dans cette zone, mais je voudrais attirer votre attention sur le fait que le risque de pollution par produits chimiques en conteneurs - dans cette même zone - est certainement un dossier tout aussi, sinon plus important.
Cela étant dit, je ne vois pas comment l'on pourrait changer les routes maritimes : il y a une succession de grands ports - Dunkerque, Anvers, Rotterdam -, et la seule autre route possible serait de passer par les Shetlands, ce qui serait un énorme détour. C'est toutefois la route qu'empruntent les bateaux transportant le pétrole norvégien.
M. le Président : M. le président-directeur général, vous avez commencé à mettre le doigt dans l'engrenage en prenant en charge un certain nombre de coûts. Cela veut dire, pour une large part de l'opinion publique, que vous avez des responsabilités. Et si vous aviez tout pris en charge ? Et si vous aviez déclaré, dès le mois de décembre : « TotalFinaElf est une grande société qui aspire à un positionnement international très fort, qui aspire également à être très forte dans le développement durable, dans la protection de l'environnement, et donc, au-delà de ce que le FIPOL prendra en charge, nous compléterons afin que les habitants du littoral ouest atlantique n'aient pas à souffrir » ?
Vous auriez ainsi fait une opération publicitaire à l'échelle internationale qui vous aurait coûté relativement peu d'argent, d'autant que vos résultats sur l'exercice passé montrent la très bonne santé de votre société. Une partie de vos actionnaires n'auraient peut-être pas été d'accord, mais d'autres sociétés, non confrontées au même type de problème, ont eu cette réaction : faire d'une catastrophe une opération positive.
Actuellement, vous cumulez tous les inconvénients. Vous allez payer, et si le pompage ne donne pas de bons résultats, on vous en tiendra pour responsable. Même en payant, on vous accusera de ne pas payer assez.
M. Thierry DESMAREST : Je vous rappellerai, M. le président, que je ne suis pas le propriétaire des fonds de l'entreprise ! Je ne peux donc pas de mon propre chef décider de faire un chèque en blanc, alors que notre responsabilité juridique n'est pas engagée. Nous avons néanmoins essayé de trouver une solution pour aider les victimes de cette pollution.
Les premiers jours, les experts pensaient que cette pollution allait être très limitée ; c'est aussi la raison pour laquelle nos déclarations des premiers jours peuvent, aujourd'hui, ne pas apparaître en ligne avec l'ampleur du problème.
Nous avons pris un engagement important, concernant la récupération des déchets, la restauration de l'environnement, car lorsqu'on est l'une des plus grandes entreprises françaises, au-delà d'une simple approche de responsabilité juridique, il est normal de vivre en bonne intelligence avec l'ensemble des communautés concernées et de montrer sa solidarité face à ceux qui souffrent depuis maintenant plusieurs mois. Nous essaierons, dans toute la mesure du possible, de garder des relations de confiance avec les collectivités territoriales et les élus, même s'il y a des jours où, poussés par les avocats, cela n'est pas simple.
M. le Rapporteur : Avez-vous affrété, depuis le naufrage de l'Erika, des bateaux classés par le RINA ?
M. Thierry DESMAREST : Oui, mais le moins possible. C'est inévitable, notamment quand on a une raffinerie en Italie. Mais nous le faisons en réalisant de nombreux contrôles croisés pour essayer de s'entourer du maximum de sécurité. Cependant, il est évident que lorsque nous avons le choix entre un bateau classé par le RINA et un autre bateau classé par une autre société de classification membre de l'IACS, nous prenons le second bateau.
M. le Rapporteur : Quand a eu lieu votre dernier vetting sur l'Erika ?
M. Bertrand THOUILIN : L'Erika est sorti du Monténégro en août 1998, et notre vetting a eu lieu en novembre 1998. Ce vetting a été effectué selon les procédures en vigueur, c'est-à-dire qu'il a eu lieu au port et que notre inspecteur de Marseille a suivi le guide que je vous ai remis. Par ailleurs, d'autres grandes sociétés - Shell, Texaco - ont ensuite procédé à leur propre vetting en utilisant le même questionnaire.
M. le Rapporteur : RINA a également certifié que Panship était conforme aux prescriptions du code ISM. Il est indiqué, dans ce code, qu'il faut un soutien approprié à terre. Or, nous avons pu constater, selon le déroulement des événements, que ce soutien était tout à fait inapproprié. Vous êtes-vous substitués à Panship afin de pallier cette absence de soutien au commandant de l'Erika ?
M. Bertrand THOUILIN : Effectivement, le code ISM prévoit des procédures extrêmement strictes en cas d'événements de cette importance, notamment dans la communication entre le bord et la terre, et ensuite dans la mise en place de cellules de crise. A ma connaissance, Panship n'a jamais armé de cellule de crise, ce que nous, en revanche, avons fait dès le 12 décembre à 9 heures du matin. Nous sommes ensuite assez vite montés en puissance avec une cellule de crise composée d'une quarantaine de personnes.
Nous n'avons pas eu de contact direct avec Panship après l'accident, leurs avocats et leurs assureurs leur ayant conseillé de ne pas nous parler. Nous avons donc eu des contacts avec l'armateur via le P&I Club, ce qui n'était pas très simple.
M. le Rapporteur : J'ai cru comprendre que, pendant le naufrage, vous vous étiez substitués à Panship.
M. Bertrand THOUILIN : Nos chartes concernant l'affrètement contiennent une clause qui précise que l'armateur, en cas de problème, doit prévenir l'affréteur. C'est ce qui s'est passé.
M. le Rapporteur : Parce qu'il n'y avait pas de réponse de la part de Panship ?
M. Bertrand THOUILIN : Ce n'est pas la version qui nous a été donnée. Le commandant était en contact avec le responsable de Panship, et il nous a prévenus.
M. le Rapporteur : Nous souhaiterions également connaître l'âge moyen de vos bateaux affrétés à temps ou au voyage sur les trois dernières années. Par ailleurs, certains de vos bateaux ont-ils été arrêtés au cours de ces trois dernières années ?
M. Bertrand THOUILIN : A ma connaissance, non.
M. le Rapporteur : Enfin, dernière remarque, le président-directeur général parlait de la chaîne de responsabilité complexe et de la confusion générale qui s'en dégageait. Comme alternative à cette confusion générale, vous n'avez proposé que l'augmentation du fonds du FIPOL et la responsabilité plus grande des armateurs. Nous souhaiterions connaître vos idées sur une plus grande transparence de l'ensemble du processus, car on a un sentiment d'opacité qui induit inévitablement toutes les interprétations.
M. Thierry DESMAREST : Je vous propose de vous envoyer un résumé de nos propositions pour l'amélioration de la sécurité maritime. Nous n'avons pas, en effet, parlé du resserrement des visites techniques pour les bateaux anciens, des règles plus strictes pour les bateaux de plus de 15 ans, du fait de ne pas recourir à des bateaux de plus de 80 000 tonnes de plus de 20 ans - ce qui va au-delà de la charte de M. Jean-Claude Gayssot. Nous vous ferons également part des différentes idées sur lesquelles nous travaillons avec les services de la Commission européenne et le ministère des transports.
Audition de M. Michel de FABIANI,
président de BP France,
accompagné de M. Christian PARMENTIER,
directeur des approvisionnements et de la logistique
(extrait du procès-verbal de la séance du 23 mai 2000)
Présidence de M. Jean-Yves LE DRIAN, Rapporteur.
MM. Michel de Fabiani et Christian Parmentier sont introduits.
M. le Président leur rappelle que les dispositions législatives relatives aux commissions d'enquête leur ont été communiquées. A l'invitation du Président, MM. Michel de Fabiani et Christian Parmentier prêtent serment.
M. Michel de FABIANI : M. le président, messieurs les députés, la sécurité du transport maritime a fait l'objet d'une grande attention dans notre groupe, comme d'ailleurs, je crois, dans tous les groupes pétroliers.
La politique du Group BP Amoco en matière de sécurité maritime, à laquelle la filiale BP. France que je préside souscrit parfaitement comme toutes les autres filiales, est définie dans le cadre du groupe par une entité en charge de l'ensemble des problèmes de transport maritime : BP Shipping.
Cette politique s'inscrit dans le cadre plus général des politiques H.S.E
- hygiène, sécurité, environnement -, sachant que BP a pour ambition affichée d'opérer sans conséquences sur l'environnement et de tendre vers le « zéro accident, zéro dommage ».
A sa demande, nous avons remis une note résumant notre politique en ce domaine au ministre de l'équipement, des transports et du logement, le 21 janvier 2000.
Je me contenterai d'en relever quelques éléments compte tenu du fait que je me propose, à la fin de cette audition, de mettre à la disposition des membres de la commission un certain nombre de documents reprenant le détail des procédures qui y étaient décrites ; un dossier que nous avons élaboré en interne - aussi bien à l'intention du personnel que du public - sur la politique de sécurité en faveur de l'environnement de BP-Amoco Shipping, entité en charge de ces opérations pour l'ensemble du groupe ; le communiqué de presse que nous avons publié à l'issue de la table ronde ainsi que la lettre que nous avons adressée, ensuite, à M. Jean-Claude Gayssot.
Nous aspirons - ce n'est qu'une aspiration, l'accident étant toujours possible - à tendre vers le « zéro accident, zéro pollution, zéro dommage à l'environnement », grâce à cette politique qui s'applique en premier lieu, mais pas exclusivement, au transport maritime de nos produits.
Pour ce qui concerne ce secteur, notre démarche est essentiellement et prioritairement fondée sur la prévention et la sélection des navires. Nous dotons ces derniers d'équipages qualifiés, étant entendu - même si je parle à la première personne du pluriel - que nous agissons par délégation puisque notre flotte ne se compose que pour partie de navires qui nous appartiennent en propre et que nous utilisons fréquemment les navires de sociétés extérieures.
La procédure utilisée en interne, que nous désignons sous le terme anglo-saxon de « vetting » et qui peut se traduire en français par « validation », est un processus qui est en amélioration constante.
Le groupe BP Amoco qui est la résultante de la fusion intervenue l'année dernière entre BP et Amoco a repris la politique de ces deux groupes - l'année dernière, nous avons reconfirmé toutes nos politiques et notamment la politique shipping. Cette politique s'appuie avant tout sur des normes de sécurité que nous considérons être parmi les plus exigeantes de la profession. Elle comprend un certain nombre de procédures qui reposent essentiellement sur la sélection des navires, aussi bien pour les affrètements à terme que pour les affrètements SPOT, et qui s'appliquent aux navires mais également aux barges - notamment fluviales - qui assurent des transports d'un volume moindre, ainsi qu'aux audits des terminaux portuaires et fluviaux sur lesquels nous opérons.
Nous n'établissons pas de distinction au niveau de la procédure de vetting ou des exigences requises entre notre flotte propre et les affrètements à tiers pour la bonne raison que ces derniers concernent la majeure partie de nos opérations maritimes.
Il s'agit d'une procédure interne et il appartient, je crois, à chaque groupe de définir la sienne.
Pour résumer, les critères de la procédure de sélection sont les suivants : le carnet de santé du navire où se trouvent les données physiques, le dernier bilan de l'état du bâtiment mais aussi son historique avec les inspections, les incidents, les réparations dont il a pu être l'objet ; les informations concernant l'armateur et les équipages, notamment leur formation ; les informations concernant le pavillon qu'il s'agisse de ses modifications ou de ses évolutions au gré des différents propriétaires etc.
Dans la note dont je vous ai parlé, vous trouverez une description de la procédure avec une douzaine d'opérations successives qui déterminent la décision du service shipping de retenir, ou de ne pas retenir, un bateau, que ce soit pour une opération SPOT ou à terme.
Il convient de bien noter que, dans cet ensemble de critères, les aspects les plus délicats sont les aspects humains, c'est-à-dire, la connaissance que l'on a du propriétaire et du capitaine du navire ainsi que l'ensemble des informations que l'on peut obtenir sur la façon dont le bâtiment, son équipage, son capitaine, son propriétaire se sont comportés.
Nous travaillons donc essentiellement sur ces informations, complétées par les inspections qui sont réalisées par nos propres inspecteurs dans les principaux endroits où s'effectuent des opérations. Je reviendrai par la suite sur ces procédures en vous donnant quelques exemples.
En amont, on distingue un certain nombre de niveaux de contrôle qui correspondent à ce qu'on appelle dans le vocabulaire maritime :
- l'Etat du pavillon : tout ce qui touche à la réglementation et à l'administration au niveau national, pour lequel nous nous fondons bien sûr sur les pratiques des différents Etats ;
- l'Etat du port : tout ce qui concerne l'inspection réalisée par les inspecteurs de port, inspection dans la qualité dépend du niveau de formation et d'expérience des inspecteurs ;
- les sociétés de classification, qui nous garantissent l'intégrité structurale.
C'est sur cette triple base que nous effectuons, par la suite, notre propre procédure de vetting qui nous concerne directement et au terme de laquelle nous prenons la décision, qui est une décision de société, d'affréter ou de ne pas affréter un bateau.
En étudiant les incidents qui se produisent, on constate qu'une bonne partie d'entre eux ont eu une origine humaine et sont le fait d'erreurs soit d'appréciation, soit de fonctionnement. Les statistiques que nous avons consultées prouvent que la majeure partie des incidents ont pour origine les hommes et les procédures et c'est pourquoi les équipages, le capitaine et la façon dont la bateau est géré sont des paramètres essentiels.
Les éléments plus administratifs ou techniques ne sont pas permanents : ce n'est pas tous les jours qu'un bateau est inspecté en cale sèche et nous disposons donc d'un certain nombre d'informations de caractère périodique, étant entendu qu'il est surtout important de savoir ce qui se passe dans l'intervalle et de s'assurer que tous les incidents sont bien signalés, que les équipages sont bien formés lors de leur renouvellement et ainsi de suite.
C'est là, selon moi, que se situe la part de l'information à la fois la plus importante et la plus difficile à appréhender puisqu'elle n'est que la résultante de renseignements que nous obtenons par des canaux transversaux et bien naturellement par nos propres inspections.
Tel est le processus dont je répète qu'il est en amélioration continue : en effet, nous avons bien vu qu'au fil des temps, les bateaux de plus de vingt ans, par exemple, ont été soumis à un certain nombre de contrôles qui ne leur étaient pas imposés antérieurement ; la charte française et les propositions européennes envisagent maintenant d'y contraindre les navires âgés de plus de quinze ans.
Notre groupe a connu, dans le passé, un certain nombre d'incidents. D'après mes informations, le dernier en date remonte à 1993 ce qui ne nous empêche pas d'être réalistes et de considérer que l'accident, soit d'origine humaine, soit d'origine technique, est toujours possible même si le second, dû à des défauts de structures ou autres, devrait être probablement plus facile à éviter que le premier.
Il en va d'un navire comme d'une automobile ou d'un camion. Un véhicule aura beau être neuf, récemment révisé, bien équipé, conduit par un chauffeur très bien formé et respectueux des règles de conduite : toutes proportions gardées, je ne garantirai pas qu'il n'aura pas d'accident. Nous ne faisons d'ailleurs pas de différence entre un élément de sécurité majeur et mineur et c'est pourquoi nous nous montrons par exemple très stricts quant au port de la ceinture de sécurité par nos chauffeurs routiers.
J'estime que la politique de sécurité d'un groupe passe, bien sûr, par les procédures que je viens de décrire mais plus encore par la stricte observation aussi bien des règles de détail que des règles plus importantes : si l'on commence à établir une hiérarchie entre ce qui est bénin et plus grave, on ouvre, pour les hommes qui sont essentiels dans toutes ces opérations, des possibilités de négligence. C'est pourquoi il nous faut être extrêmement rigoureux.
Il est clair que, sans y être impliqués, nous sous sommes sentis, dès le premier jour, concernés par l'accident qui a donné lieu à la création de votre commission d'enquête. Pour montrer l'importance que nous attachions à la sécurité dans notre groupe, nous avons constitué - et Christian Parmentier peut en témoigner puisqu'il est la cheville ouvrière de cette initiative - une cellule de crise au niveau du groupe et à l'échelle nationale.
Nous avons, en effet, considéré qu'un tel accident aurait pu nous arriver. D'ailleurs, pour être tout à fait honnête, je dois avouer qu'en prenant connaissance des premières informations qui faisaient état d'un bateau parti de Dunkerque où nous avons une raffinerie, j'ai pensé qu'il pouvait s'agir de l'un des nôtres.
Nous avons constitué une cellule de crise, non pour cette raison, puisque j'ai tout de suite téléphoné à Dunkerque où l'on m'a rassuré, mais parce que nous avons estimé qu'au-delà du cas d'espèce, nous n'étions pas à l'abri de ce genre d'accident.
Nos procédures de crise comprennent un certain nombre d'exercices auxquels nous nous livrons régulièrement sur ces accidents dont nous savons, même s'ils ne sont pas survenus depuis longtemps, qu'ils peuvent toujours se produire.
Nous avons participé à la table ronde organisée par le ministre de l'équipement, des transports et du logement, M. Jean-Claude Gayssot, et signé la charte dans un esprit très clair ! Pour nous, ce document comprend des mesures conservatoires qui s'imposaient dans un moment de crise et d'émotion particulièrement forte.
Nous nous sommes aperçus depuis, parce que nous n'en avions pas mesuré toutes les incidences, que cette charte pose plusieurs problèmes pratiques : par exemple, nous avions oublié que les bateaux de moins de 5 000 tonnes pour le cabotage n'étaient pas concernés par certains engagements de la Charte, que les bateaux GPL, dont le risque pollution est nul, étaient visés par la charte alors qu'il est en réalité très difficile de les suivre, pour ne pas parler de tous les produits non pétroliers au sens strict.
Bref, dans notre esprit, cette charte - et je crois que nous en sommes là - doit maintenant remonter au niveau européen car, même si on peut aspirer à ce qu'elle soit mondiale, il faut, pour parvenir à une amélioration réelle et continue, qu'au moins au niveau des Etats-Unis et de l'Europe, - champs d'action de nombreuses grandes sociétés internationales -, les attitudes, les critères et les approches soient identiques, aussi bien dans le contenu que dans le timing.
Il serait en effet à la fois illogique et difficile de créer des ségrégations au sein d'une flotte de caractère international. C'est la raison pour laquelle nous avons soutenu la démarche qui consistait à porter les demandes au niveau européen pour que le problème y soit pris en main, comme la Commission européenne est en train de le proposer en préconisant un certain nombre de mesures.
Il est clair que nous soutenons, sinon mot à mot du moins dans leur ensemble, les propositions présentées à l'échelon européen. Nous pouvons émettre quelques réserves - plus de pratique que de principe - sur la panacée des « double coque » dont il n'est pas sûr qu'elle réponde à toutes les situations, étant entendu que pour les gros bateaux elle constitue un élément de sécurité dont il est bon qu'il soit pris en compte.
Cependant, il faut, en la matière, que les horizons soient identiques de façon à obtenir une homogénéité de timing pour les Etats-Unis et l'Europe, où sont concentrés les pouvoirs de décision de sociétés telles que les nôtres.
A cela vient s'ajouter toute une série de mesures sur les inspecteurs des ports, sur l'accès aux bases de données, sur le contrôle des sociétés de classification et de leurs transferts, sur l'histoire des bateaux et le relevé de leurs incidents, mesures auxquelles nous souscrivons totalement et qui, la plupart du temps, rejoignent d'ailleurs l'action que nous menons au sein de notre Groupe.
Il n'y a donc aucune raison pour que nous ne souhaitions pas leur extension, d'autant que le vrai problème est de s'assurer que les acteurs majeurs - qui ne sont pas uniquement les sociétés pétrolières même si la tendance est de ne regarder que le produit et d'en déduire, s'il est pétrolier, qu'elles sont seules concernées - adoptent tous, au moins en Europe et aux Etats-Unis, une attitude homogène à tous les niveaux de la chaîne et appliquent les procédures.
Nous émettons quelques réserves toutefois sur l'idée d'augmenter les responsabilités au niveau européen, parce que nous ne pensons pas, en tant que groupe international, qu'il soit bon qu'un pays ou une zone régionale spécifique impose des surcoûts ou des obligations financières particulières. Cette affaire de sécurité ne relève, en effet, pas tant des financements que de la prévention, donc des attitudes, des procédures ainsi que du contrôle et de l'application desdites procédures.
Voilà ce que je tenais à dire en préambule.
M. le Président : Pour revenir à la dernière partie de votre intervention, vous vous dites défavorable à la mise en place d'un dispositif financier spécifique à une zone, mais favorable aux propositions élaborées actuellement, tant par le gouvernement français que par la Commission européenne, qui, a priori, intègrent l'augmentation des participations des compagnies pétrolières au FIPOL. Or, on s'aperçoit que le montant de l'indemnisation prévue par catastrophe risque d'exploser et il serait inconvenant de penser que le contribuable doive faire l'appoint comme ce sera vraisemblablement le cas dans l'affaire de l'Erika, même s'il est encore un peu tôt pour le dire.
Dans ces conditions, votre société est-elle favorable à l'augmentation des plafonds du FIPOL auquel inévitablement, vous êtes amenés à contribuer, étant précisé qu'il ne s'agit pas d'un dispositif régional puisqu'il concerne tout le monde sauf les Etats-Unis ?
A propos de vos procédures de vetting, vous avez déclaré que vous étiez aussi vigilants pour vos transports en propre que pour les transports affrétés : vous serait-il possible de préciser d'une part, quelle proportion de transports en propre vous conservez ; quel stock de bateaux vous pensez maintenir ; si vous êtes, ou non, en sortie de flotte progressive ? D'autre part, sachant qu'il existe deux types d'affrètements - les affrètements quasi permanents pour les bateaux dédiés et les affrètements au coup par coup qui sont ceux qui présentent le plus de problèmes -, pouvez-vous nous dire si la vigilance dont vous faites état s'exerce avec autant de rigueur sur les affrètements non dédiés ? Comme nous l'avons demandé à vos collègues, nous serions aussi très intéressés de savoir quelle est, au niveau de votre compagnie, pour ce qui concerne la France, la part de ces trois modes de transport - transport en propre, affrètement à temps et affrètement au voyage.
M. Michel de FABIANI : Pour ce qui concerne le FIPOL, il est évident que les niveaux FIPOL ayant été fixés il y a un certain nombre d'années, nous considérons qu'il faut regarder s'ils sont toujours adaptés.
Dans la mesure où il s'agit du FIPOL et où une éventuelle augmentation des contributions s'applique à tout le monde, cela ne pose pas de problèmes. Dans mon intervention, je parlais de taxations, d'impositions ou de contributions spécifiques à une région ce qui est bien différent du FIPOL auquel, comme tout le monde, nous contribuons, et dont nous considérons que les normes, si elles n'étaient plus adaptées, devraient être révisées.
Sur le vetting, je confirme qu'une partie de la flotte, qui correspond à environ 20 % des besoins de transports du groupe BP-Amoco, est en propriété et en gestion directes. Je ne parle pas de la France en particulier mais du groupe dans son ensemble.
M. le Président : Vous pourriez nous faire parvenir la répartition globale et française ?
M. Michel de FABIANI : Bien sûr, mais je vous situe un ordre de grandeur en précisant d'ailleurs que, cette année, nous remplaçons quatre VLCC par des navires à double coque, ce qui correspond à une étape importante, programmée de longue date, du renouvellement de notre flotte.
Je crois que nous n'avons pas, dans l'immédiat, l'intention de modifier cet équilibre car nous sommes d'avis que notre capacité de transport en propre nous permet de maîtriser la connaissance de toute la chaîne
Concernant les chiffres sur la partie SPOT et dédié, nous vous les ferons parvenir...
M. le Président : Oui, ce serait intéressant parce que nous les avons demandés également à vos collègues et qu'ils laissent apparaître que c'est dans les transports à la commande que les risques sont les plus grands.
M. Michel de FABIANI : Nous vous fournirons donc les informations à ce sujet.
Nous ne faisons effectivement pas de différence entre les systèmes d'affrètement dans la mesure où nous partons du principe que peu importent le propriétaire et l'aspect juridique de la gestion des bateaux : seules comptent les conditions de transport.
Nous envisageons la question sous l'angle suivant : le bateau avec son équipage et tout ce qui tourne autour transporte, à un moment donné, un produit BP-Amoco et il faut - car ce n'est pas une affaire de montage de société, ni un problème juridique ou autre - que les deux - c'est-à-dire le bateau et l'équipage - répondent à nos normes. Nous n'établissons donc aucune différence.
D'ailleurs cette approche ne s'applique pas uniquement au transport maritime ; nous procédons exactement de la même manière pour l'affrètement des camions.
Des accidents de la route, nous en enregistrons en France et ils constituent d'ailleurs mon principal souci, le pire des scénarios étant qu'un camion transportant du carburant en provoque un sur l'autoroute un week-end du 14 juillet... C'est vraiment un souci permanent.
Pour limiter les risques, nous imposons à nos contractants les normes que nous observons en interne. Il n'y a pas de différence et c'est cette mentalité qu'il faut parvenir à faire passer car, comme vous le disiez, ce n'est pas parce qu'il s'agit d'affrètements au voyage qu'il faut faire preuve de moins d'exigence que pour les affrètements à temps ; j'irai même jusqu'à dire que l'attention devrait presque être inversement proportionnelle à la durée de l'affrètement.
M. le Président : C'est ce qu'il faudrait !
M. Michel de FABIANI : Il faut adopter la même conduite : telle est notre position.
M. le Président : Vos normes sont les douze points que vous évoquiez précédemment ?
M. Michel de FABIANI : Absolument. Elles sont détaillés dans la lettre et elles vont de la réputation de l'armateur jusqu'aux changements de société de classification en passant par l'audit de l'armateur, l'inspection du navire, le rapport SIRE, le rapport d'escale, le rapport d'affrètement, le changement de pavillon, les marchés, l'historique des accidents et les changements d'équipage et de capitaine.
M. le Président : Ce sont éventuellement des critères de refus ?
M. Michel de FABIANI : Oui, ils peuvent motiver un refus.
M. le Président : A titre d'exemple, auriez-vous, pour le trafic français, des indications à nous donner sur le nombre de bateaux que vous avez refusés au cours de l'exercice 1999, sur les sociétés de classification qui les avaient acceptés et sur les raisons qui ont motivé votre décision ?
M. Michel de FABIANI : Nous pourrons vous communiquer ces informations mais, d'ores et déjà, je peux vous donner des chiffres plus généraux sur le groupe qui ont trait aux inspections auxquelles nous procédons nous-mêmes : le taux de refus peut atteindre, selon les années, un tiers ou la moitié des bâtiments inspectés, étant bien précisé que ces chiffres incluent les inspections sur les affrètements SPOT et que, lorsque nous inspectons un bateau nous-mêmes, c'est soit parce qu'il a un certain nombre d'années, soit parce que nous avons un doute quant à sa fiabilité ce qui explique que le taux de refus soit assez élevé.
M. le Président : C'est un taux de refus par rapport au nombre d'inspections effectuées ?
M. Michel de FABIANI : Exactement ! En revanche, dans des conditions normales de vetting le taux de refus tourne aux alentours de 15%. Ce sont donc des normes différentes, ce qui n'est d'ailleurs pas neutre.
M. le Président : Une note sur le sujet ainsi que sur les sociétés de classification des bateaux repoussés nous intéresserait.
M. Christian PARMENTIER : Il nous sera plus facile de vous fournir ces données au niveau du groupe qu'au niveau spécifiquement français.
M. Michel de FABIANI : Effectivement, parce nous ne travaillons pas particulièrement au niveau français et que notre base shipping n'est pas en France.
M. le Président : Cela suffira !
Avez-vous un pavillon privilégié et sous quel registre est immatriculée la partie française de votre flotte ?
M. Christian PARMENTIER : Les deux navires qui sont actuellement sous contrat de durée pour satisfaire à l'obligation de capacité de transport, au titre de la loi de 1992, sont sous pavillon Kerguelen.
Ces deux navires qui vont bientôt avoir 25 ans, le Once et le Chaumont, sont sur le point d'être remplacés par deux unités très modernes de 300 000 tonnes chacune, qui représentent le dernier cri en matière de technologie maritime. Le transfert de ces deux navires devrait intervenir entre le mois de juillet et la fin de l'année 2000.
M. Michel de FABIANI : Concernant les pavillons, notre groupe n'entend pas dénoncer certains pavillons plus que d'autres car toutes les statistiques que j'ai pu consulter semblent indiquer qu'il n'y a pas de pavillon miracle.
M. le Président : Il existe quand même des différences assez importantes, y compris entre les pavillons de complaisance...
M. Michel de FABIANI : Il est certain qu'il en existe déjà une entre d'une part le pavillon américain et le pavillon britannique et d'autre part entre les pavillons des Bahamas ou du Liberia et certains pavillons européens. Ce sont des points qu'il faut garder en mémoire pour ne pas créer une espèce de ségrégation a priori.
M. le Président. La commission d'enquête a bien intégré ces données, mais il n'empêche qu'il y a, entre les pavillons dits « de complaisance », énormément de variations, ce dont la commission d'enquête a également pris bonne note : s'il est exact que le pavillon libérien peut soutenir la comparaison avec un certain nombre de pavillons nationaux de bon niveau, d'autres, tels que celui de Belize, de Saint-Vincent et Grenadines ou même ceux de certains pays de l'Est, peuvent être beaucoup moins bons.
M. Michel de FABIANI : Sans doute.
M. le Président. Il serait donc intéressant pour nous d'avoir la proportion d'appels aux différents pavillons, dont nous avons d'ailleurs rencontrés un certain nombre de responsables...
Par ailleurs, nous croyons savoir que vous avez mis en place des procédures spécifiques pour le trafic dans les détroits du Bosphore et des Dardanelles : est-ce une fausse information ?
M. Christian PARMENTIER : Je n'ai pas d'information sur ce point.
M. Michel de FABIANI : La seule chose que je peux dire, c'est que nous appliquons les procédures habituelles. Excepté cela, seules pourraient intervenir des limitations de taille de bateau mais, à ma connaissance, il n'est pas prévu de suppléments aux procédures. Nous allons vérifier l'information, car nous ne sommes pas directement concernés, Christian Parmentier et moi-même.
M. le Président : Le système pratiqué pour le transport des produits chimiques qui consiste à mutualiser les moyens financiers et techniques du vetting vous paraît-il être applicable aux produits pétroliers ou relever d'une sorte de secret d'entreprise ?
Dans le secteur de la chimie, sans vouloir établir une corrélation entre les deux observations, les normes sont les mêmes pour tous et les accidents sont moins nombreux.
M. Michel de FABIANI : Je ne suis pas en mesure de répondre d'emblée à cette question parce que nous ne nous la sommes pas posée dans ces termes mais je dirai que, s'il faut un minimum de principes communs, il faut aussi laisser aux groupes qui veulent faire plus la possibilité de le faire car c'est un facteur de stimulation.
M. le Président : C'est dans ce sens que je parlais de « secret d'entreprise » ou d'image d'entreprise.
M. Michel de FABIANI : Oui, mais il y a une différence entre le secret de fabrication
- formule mystérieuse comme en ont certaines sociétés -, qui n'est pas dévoilé, et le fait de « faire plus » et de le faire savoir. Je pencherai davantage pour la seconde possibilité car je crois que le progrès dans ce domaine, soit fait suite à un accident qui crée une prise de conscience - si nous remontons à vingt ou trente ans, il est indéniable qu'en créant la surprise, les accidents ont suscité un regain d'intérêt ou une prise de conscience -, soit tient au fait qu'en de nombreux domaines, certaines sociétés n'attendent pas la réglementation pour agir au-delà.
Cet aspect de stimulation est sans doute ce qu'il faut préserver. La mutualisation est une bonne chose si tous les mutualistes sont du même niveau.
M. le Président : Et vous pensez que ce n'est pas le cas de vos collègues ?
M. Michel de FABIANI : Je pense effectivement que le domaine pétrolier international regroupe des acteurs très différents.
M. le Président : Vous pouvez préciser votre pensée sans citer de noms ?
M. Michel de FABIANI : Je ne veux pas citer de noms, mais dire simplement qu'il est clair que certains groupes pétroliers ont la réputation d'être très stricts.
M. le Président : Vous en faites partie ?
M. Michel de FABIANI : Nous avons la prétention d'en faire partie. Je crois que d'autres groupes pétroliers ont, soit aucune réputation, ce qui est neutre, soit la réputation d'être moins stricts que d'autres. C'est une chose qui se dit et qui est connue dans la profession.
M. le Président : Le seul problème, c'est que tous les responsables de groupes que nous avons auditionnés se disent très performants dans ce domaine. Il faut croire que nous n'avons pas rencontrés les mauvais.
M. René LEROUX : Sans doute !
M. Michel de FABIANI : J'en reviens au facteur humain. Il est facile d'avoir des procédures mais ce n'est pas à leur niveau que se fait le test. Le vrai test réside dans la capacité de refus des bateaux, quand le trader a une opération possible et que le responsable du shipping la repousse. C'est là qu'est la vérité parce que le shipping a le dernier mot sur le trading.
M. Le Président : Ce sont les 15 % de refus que vous avez mentionnés précédemment ?
M. Michel de FABIANI : Voilà ! Nous avons nous-mêmes pris récemment la décision - et nous en discutions encore hier entre nous - de faire en sorte que personne ne puisse s'opposer au responsable du service shipping, ce qui revient à dire que pas même le président d'une filiale ne peut outrepasser la décision du service shipping.
M. le Président : Les autres compagnies que nous avons auditionnées font de même.
M. Michel de FABIANI : Ce que je peux dire, c'est que le problème tient encore une fois à l'application stricte de la décision de l'individu, en l'occurrence, notre inspecteur de port qui se trouve à Lavéra ou à Fos : c'est là que se situe le point important parce que, honnêtement, ce n'est pas tous les jours qu'un président de société se trouve en situation de pouvoir outrepasser la décision du shipping et, à la limite, j'espère que ce n'est jamais le cas.
En revanche, c'est au quotidien que le service shipping doit suivre la procédure et se prononcer sur l'acceptation ou la non-acceptation d'un bateau.
Je vais vous citer un exemple très simple. Nous avons récemment fait appel à un bateau qui a chargé environ 20 000 tonnes de fioul lourd à Lavéra et qui répondait à la procédure de vetting, compte tenu du fait qu'il n'avait pas eu d'incidents, qu'il avait subi une inspection favorable etc.
Lors du chargement, notre inspecteur a décelé une petite anomalie dans l'analyse de produits. Il aurait parfaitement pu considérer qu'il avait fait son travail, mais comme quelque chose l'inquiétait et qu'il n'était pas satisfait, il a poussé ses investigations, comme il en a le pouvoir - contre le commercial et le trader -, y compris si l'opération est sur le point de se faire et que le bateau est prêt à partir, comme c'était le cas. Il a donc demandé une inspection supplémentaire qui a révélé que le navire avait probablement subi un petit choc, qui avait pu se produire la veille ou juste avant son arrivée, et il a refusé d'autoriser la poursuite du chargement de ce bateau.
Ce qui est important, c'est que quelqu'un d'un niveau de professionnalisme très élevé puisse à n'importe quel niveau, parce qu'il est dans la chaîne shipping, avoir ce pouvoir de décision.
L'affaire va même plus loin puisqu'en fait le chargement du bateau ayant commencé, il a fallu le stopper et décharger le navire ce qui suppose un coût financier.
Tout cela pour dire qu'il ne sert à rien d'avoir les meilleures procédures du monde, si vous n'avez pas les meilleurs hommes du monde ou que ces derniers ne sont pas capables de prendre sur eux le poids de la procédure. Personnellement, je préfère une société où un inspecteur est capable de dire non. J'ajoute que l'épisode que je viens de vous raconter nous été rapporté après coup et qu'on ne nous a pas demandé de trancher : personne n'a eu à intervenir puisque l'inspecteur a dit « non, nous ne le prenons pas ! », point final.
M. le Président : Cela s'est produit après le naufrage de l'Erika ?
M. Michel de FABIANI : Oui.
M. le Président : Les choses se seraient déroulées de la même manière avant ?
M. Michel de FABIANI : Tout à fait !
M. le Président : Le cas s'était déjà produit ?
M. Michel de FABIANI : Cela était arrivé !
M. Christian PARMENTIER : Pour revenir très précisément à votre question sur la mutualisation du vetting, je voudrais ajouter que lorsque ces procédures de validation ont été développées par les compagnies pétrolières, il y a de cela un vingtaine d'années, l'obsession était d'être accusés par les armateurs de collusion et donc d'infraction aux lois de la concurrence.
C'est la raison pour laquelle ce qui a été mutualisé, c'est l'échange d'informations sur les visites des navires à travers la fameuse base de données SIRE, qui est commune à l'ensemble des compagnies pétrolières.
Pour autant, le principe avait été retenu, pour ne pas risquer des sanctions pour infraction aux règles de la concurrence, de s'abstenir d'indiquer les jugements que chaque société porte à partir d'éléments extérieurs et objectifs sur les diverses certifications qu'a, ou n'a pas, le navire et sur l'état du bateau.
Par conséquent, franchir une étape par rapport au niveau actuel suppose aussi de bien tirer au clair ce qu'il est possible ou interdit de faire par rapport aux règles de la concurrence.
M. Michel de FABIANI : Il est évident qu'il est difficile de mettre au ban un navire car s'il appartient à BP de décider de le refuser, une autre société peut parfaitement, sur la base des mêmes données, l'accepter : c'est bien là qu'est tout le problème du risque !
M. Christian PARMENTIER : Qu'une coalition de sociétés décrète que tel armateur et ses navires ne sont pas bons peut aussi être considéré comme une façon d'exclure certains opérateurs du marché. Toutefois, on peut imaginer des schémas avec des garanties d'indépendance, mais cela suppose de prendre en compte un certain nombre d'éléments.
M. le Président : C'est une histoire différente de celle de la chimie !
M. Pierre HERIAUD : J'aimerais compléter la question de notre rapporteur sur l'éventuelle augmentation du plafond du FIPOL.
Vous vous êtes placés dans le strict cadre de la concurrence en disant qu'à partir du moment où ce relèvement s'appliquerait à tout le monde, il ne pose pas de problèmes particuliers. Or, comme actuellement tout le monde n'est pas membre du FIPOL, cette éventualité peut-elle entraîner des distorsions de concurrence ?
Par ailleurs, vous avez longuement parlé, à juste titre d'ailleurs, me semble-t-il, des risques de pollution terrestres liés au transport routier : dans ce cadre, avez-vous eu des accidents ayant provoqué des pollutions ? Avez-vous été amenés, en tant que responsables, à réparer des dégâts et disposez-vous d'une cellule permanente d'évaluation des dommages causés, de procédures spécifiques et d'équipes pluridisciplinaires ?
M. Michel de FABIANI : En ce qui concerne le FIPOL, je souscris à vos observations.
Nous adhérons au FIPOL et nous acceptons le niveau de contribution appliqué aux participants. Cela étant, nous sommes bien conscients qu'un groupe comme le nôtre supporte certainement, d'un point de vue global - compte tenu de sa politique de sécurité pour l'environnement, d'hygiène et de santé -, des surcoûts par rapport à d'autres sociétés internationales : c'est une évidence mais cela fait partie de la façon dont nous conduisons nos opérations.
M. le Président : Vous dites avoir des surcoûts en raison des normes de sécurité qui sont les vôtres ?
M. Michel de FABIANI : Oui, mais c'est le coût du professionnalisme et ce n'est pas un problème ! Ce qui nous gênerait davantage, ce sont des surcoûts régionaux qui créeraient une distorsion à l'intérieur du groupe, ou des surcoûts qui pénaliseraient des acteurs opérant dans une certaine partie du monde.
M. Pierre HERIAUD : Vous avez insisté tout à l'heure sur l'importance de la coordination et de l'homogénéité des politiques sur des zones étendues et vous avez cité les zones américaine et européenne. Sans parler des autres zones, règne-t-il, entre ces deux-là, une harmonie parfaite par rapport au FIPOL ?
M. Michel de FABIANI : Je faisais référence aux Etats-Unis et à l'Europe par rapport aux normes techniques : je pensais aux normes concernant les navires ou aux normes de procédure.
En ce qui concerne les responsabilités, on sait pertinemment que la réglementation américaine, y compris dans son esprit, est différente de la réglementation européenne ce qui rend plus difficile une « normalisation ».
Toutefois, tout ce qui peut tendre à des normes communes est effectivement souhaitable même si je sais que, notamment en matière de responsabilité, des divergences apparaissent entre la conception américaine et la conception européenne et que le seul fait d'influencer ces façons de voir dépasse le pouvoir des opérateurs privés.
Pour ce qui est du transport routier, nous avons des cellules de crise à tous les niveaux. La cellule de crise étant, par définition, une équipe pluridisciplinaire, je réponds affirmativement à votre question.
Sur l'évaluation des dommages, je dirai que nous procédons plus au cas par cas. Nous avons, en effet, déploré des accidents et c'est pourquoi j'y faisais référence précédemment. Je pense notamment à l'un d'entre eux qui s'est produit sur une autoroute desservant le sud-ouest, non pas le 14 juillet mais le 15 août, et qui a provoqué des dégâts humains d'abord et matériels ensuite : sans être responsables au sens juridique du terme, puisqu'une voiture zigzaguant sur la chaussée en était la cause, nous avons assumé notre part financière. Je n'ai plus le souvenir exact du détail de cette affaire, car elle remonte à deux ans.
M. Christian PARMENTIER : D'une façon générale, en cas d'incidents, la directive qui est inculquée aux membres des cellules d'urgence et qui fait partie de leur formation consiste à accepter, si besoin est, le principe d'une participation financière pour contribuer à pallier les conséquences d'un accident, à nettoyer les pollutions qui s'ensuivent et à indemniser les dommages matériels et humains sans se préoccuper des problèmes de responsabilité.
En d'autres termes, l'idée est d'agir le plus rapidement possible de façon curative, sachant que dans un délai indéterminé les tribunaux seront amenés à déterminer de façon très savante l'échelle des responsabilités des uns et des autres. Nous avons donc pour principe d'agir sans nous préoccuper de savoir si notre intervention sera interprétée comme un aveu de responsabilité. Nous obéissons avant tout à un principe d'action curative.
M. Pierre HERIAUD : Vous avez répondu à ma question, mais elle était peut-être un peu trop globale et pas assez circonscrite dans le temps et l'espace. Puisque vous transportez des liquides qui en cas d'accident sont susceptibles de fuir - notamment par les courants d'évacuation que sont, entre autres, les rivières -, avez-vous été à l'origine de dégâts concernant l'environnement ou la pisciculture ? De même, bien avant que les tribunaux ne se réunissent, disposez-vous vous-mêmes d'une cellule d'évaluation des dommages ?
M. Michel de FABIANI : Je peux vous répondre par un exemple qui est celui des cuves des stations-service, dont nous procédons régulièrement à l'inspection, notamment quand elles sont proches de rivières comme la Seine, par exemple.
Il va de soi que, s'il y a dommage, il faut le soigner. Mais nous privilégions l'évaluation préventive. Si nous changeons actuellement un certain nombre de cuves des stations-service, ce n'est pas parce que nous y sommes obligés mais parce que nous considérons, compte tenu d'un risque éventuel de fuites à proximité de certaines rivières dont la Seine, que nous devons le faire plus à titre préventif que curatif.
M. René LEROUX : Vous n'ignorez pas que l'Erika a quelques « petits frères » dont l'un, selon un hebdomadaire paru la semaine dernière, navigue encore - et dans nos eaux, de surcroît -, d'où ma question : avez-vous affrété l'Erika ou l'un de ses frères ?
Vous avez évoqué la construction de deux navires dont la mise en service doit intervenir avant la fin de l'année : s'agit-il de navires à double coque et, si oui, à quelles normes ? Je suppose qu'il s'agit des normes américaines car je ne crois pas que votre société ait adopté le système français ou européen E3.
Enfin, le pavillon de Malte vous fait-il peur ?
M. Michel de FABIANI : La dernière fois que nous avons eu recours à l'Erika, c'était en mai 1999 dans le cadre du groupe. Suite à un rapport d'escale négatif dans l'une de nos raffineries, très exactement en Espagne, nous avons décidé de faire procéder, par nos propres inspecteurs, à une inspection préalable qui nous a conduits, en novembre 1999, à décider de ne plus retenir ce bateau sur nos listes.
M. le Président : Il s'agissait des listes du groupe ou des listes BP France ?
M. Michel de FABIANI : Des listes du groupe : nous n'avons pas de listes spécifiques BP. France !
M. René LEROUX : Dans ce cas, vous n'avez pas eu l'idée d'aviser la société de classification ?
M. Michel de FABIANI : Nos rapports d'inspection ont figuré sur la base SIRE. Le rapport de la base SIRE est un rapport technique qui signale un certain nombre d'événements et qui se contente, sans préciser que BP ne prend plus ce bateau, de rapporter ce qui a été constaté. Il se trouve que ce rapport a été produit fin novembre 1999.
M. le Président : Pouvez-vous nous faire parvenir le rapport qui a été intégré à la base SIRE ?
M. Michel de FABIANI : Oui, nous vous ferons parvenir ce que nous avons fait figurer sur la base SIRE.
M. René LEROUX : Et les anomalies que vous avez relevées sur ce bateau ?
M. Michel de FABIANI : Tout à fait.
M. le Président : Ces réflexions sont intéressantes et il serait bon d'adresser la même demande à Shell.
M. Michel de FABIANI : Oui car, à ma connaissance, nous n'étions pas les seuls à avoir pris la décision de ne plus affréter l'Erika.
M. le Président : Nous ferons la demande à Shell pour que les choses soient claires.
Par ailleurs, si c'est possible, pourriez-vous nous communiquer les éléments de votre réflexion interne sur le refus d'affréter l'Erika qui n'ont pas figuré sur SIRE ?
M. Michel de FABIANI : Nous ferons tout notre possible pour vous fournir ces informations !
Maintenant, en ce qui concerne les bateaux « frères de l'Erika » comme vous les appelez, notre position est de ne condamner a priori ni des bateaux, ni des pavillons. En l'espèce, il s'agit du pavillon de Malte et il nous est arrivé d'utiliser des bateaux avec cette immatriculation, mais nous allons vérifier la chose.
Nous ne cherchons pas à condamner a priori un pavillon et nous nous intéressons davantage au bateau ou à l'armateur.
M. Christian PARMENTIER : C'est l'armateur qui est vraiment le pivot de notre approche en la matière.
M. Michel de FABIANI : Pour ce qui est des « bateaux frères », s'ils répondent à tous nos critères, nous les utiliserons. Un grand débat s'est instauré, au moment de la charte signée au ministère des transports, sur le fait de ne plus utiliser les bateaux âgés de plus de quinze ou vingt ans. Or, pour ce qui nous concerne, nous ne voyons aucune raison de prendre une telle mesure : nous utilisons actuellement des bateaux de vingt-trois ou vingt-quatre ans pour nos approvisionnements de pétrole brut en France : ce sont des bateaux sur lesquels nous avons les informations nécessaires. Nous ne pensons pas qu'il y ait des critères simples qui permettent d'exclure.
Cette réponse est valable pour les bateaux semblables à l'Erika, à partir du moment où ils respectent bien les procédures, où ils font l'objet d'inspections, où ils sont mis en cale sèche etc.
M. René LEROUX : Vous dites que vous prenez des bateaux de vingt-trois et vingt-quatre ans s'ils correspondent à vos critères, mais ces critères vont-ils jusqu'à l'analyse de l'épaisseur de la coque ?
M. Christian PARMENTIER : Nous avons en affrètement de durée, depuis plusieurs années, deux VLCC qui servent à garantir notre obligation de capacité de transport et qui doivent être remplacés par deux unités modernes. Lors de leur mise en cale sèche, ces deux bâtiments vieux de vingt-quatre ans font régulièrement l'objet d'inspections d'épaisseur de coque par les sociétés de classification.
M. René LEROUX : Vous dites bien que ce sont les sociétés de classification qui opèrent ces vérifications : ce n'est donc pas vous ?
M. Christian PARMENTIER : Les analyses de structures ne sont pas faites par les affréteurs !
M. René LEROUX : C'est bien ce que je voulais entendre : aujourd'hui, vous ne vérifiez pas vous-mêmes l'épaisseur des coques et vous pouvez donc affréter un frère jumeau de l'Erika, dont les cuves sont certes propres, mais dont la tôle aura 5 mm d'épaisseur.
M. Michel de FABIANI : Il faut que le rapport de classification comporte le résultat de toutes les analyses !
M. René LEROUX : Le rapport de la société de classification concernant l'Erika était bon !
M. Christian PARMENTIER : Il n'était peut-être pas aussi bon que cela puisque trois défauts majeurs ont été identifiés à l'inspection de novembre.
M. Michel de FABIANI : Nous vous donnerons les motivations de notre décision du mois de novembre.
M. Christian PARMENTIER : Ce qui est sûr, c'est que le rapport d'escale négatif ne peut pas porter sur l'épaisseur de la coque, mais sur une anomalie observable par les opérateurs de la raffinerie...
J'en profite pour dire que l'analyse pragmatique n'a rien de théorique puisque cela fait vingt ans que nous nous essayons à faire ce screening des bateaux pour détecter les derniers mauvais navires qui ont échappé au filtre des critères imposés par les Etats du pavillon, par les Etats du port, par les sociétés de classification. Nous intervenons en dernier recours pour procéder à un ultime « tamisage » afin d'identifier les bateaux qui seraient passés entre les mailles du filet.
Nous sommes très pragmatiques dans cette approche. Sachant que nous ne procédons aux inspections des navires que lors de leurs escales, car il n'est pas question d'interrompre les opérations commerciales, nous savons bien que ces inspections ne peuvent pas être structurales.
Par conséquent, la philosophie qui s'est imposée a consisté à dire que le critère déterminant était l'armateur et, à travers lui, son style de gestion, ses objectifs de société et sa rigueur dans la maintenance. Ce sont ces éléments qui, à long terme, sont déterminants pour la qualité d'un bateau. On peut être certain qu'un bateau acheté par un bon armateur, répondra en quelques mois au standard habituel de sa flotte.
Nous procédons donc à cette analyse « multicritères » en douze points, mais en la centrant fortement autour de l'armateur et de sa volonté d'avoir une flotte d'un certain standard.
Maintenant, il est vrai qu'il y a souvent coïncidence entre un armateur et un pavillon. On constate, en effet, que les armateurs ne dispersent pas leurs navires au gré des pavillons et qu'ils ne disposent pas d'autant de pavillons que de navires. Très souvent un armateur est fidèle à un ou deux pavillons et c'est là où les choses se recoupent quelque peu.
Il n'en reste pas moins que, dans nos analyses, c'est l'armateur et non pas le pavillon qui est essentiel. Il se trouve que les bons armateurs ont plutôt des navires qui relèvent de tel et tel pavillon, y compris de pavillons non européens.
M. André ANGOT : Vous nous avez expliqué que votre politique d'affrètement est assez rigoureuse, mais avez-vous des assurances que les bateaux ne dégazent pas après leur passage dans vos installations ?
M. Christian PARMENTIER : Depuis un an ou dix-huit mois, je ne me souviens pas très bien, nous exigeons des garanties contre les dégazages en mer. Nous n'acceptons désormais que des navires à ballasts séparés, car ce que l'on nomme à tort « dégazage » correspond en fait à un relâchement dans les eaux internationales, ou autrefois dans les eaux portuaires, des eaux de ballast qui, passées par les cuves de cargaison, se sont trouvées mélangées aux produits pétroliers. Aujourd'hui, nous interdisons l'affrètement de navires, y compris en excellente condition, s'ils n'ont pas de ballasts séparés.
M. le Président : Depuis quand ?
M. Christian PARMENTIER : Depuis un an ou un an et demi : je peux le vérifier.
M. Michel de FABIANI : Certaines de nos réponses peuvent vous paraître hésitantes ou imprécises quant aux dates, mais il faut bien voir qu'en France nous avons délégué la gestion de la partie shipping, à BP Shipping.
M. le Président : Qui se trouve où ?
M. Michel de FABIANI : A Londres. Tout passe par ses responsables : quand ils agissent, c'est pour notre compte et nous leur faisons entièrement confiance en matière de décision.
Nous avons, bien sûr, des inspecteurs locaux qui surveillent le chargement, qui vérifient les papiers etc. Mais la décision de principe est prise au niveau mondial dans la mesure où, le transport maritime étant un transport international, nous considérons qu'il est impossible d'avoir des jugements différents selon les pays.
M. le Président : Mais un inspecteur de Lavéra peut toujours prendre la responsabilité de refuser un bateau ?
M. Michel de FABIANI : Tout à fait : il peut toujours faire plus, mais il ne pourra jamais outrepasser un refus de BP Shipping.
M. le Président : Avant de conclure, si vous le voulez bien, je vous poserai encore deux séries de questions.
Premièrement, je vais rebondir sur vos propos précédents : votre discours se tiendrait s'il n'y avait pas les single ship companies.
Il nous apparaît, a priori, qu'en ayant affaire à un armateur structuré, surtout pour des groupes comme les vôtres et surtout pour la nature de produits que vous transportez, la clarification peut être meilleure. Partagez-vous ce sentiment : que pensez-vous des armateurs qui recourent au procédé juridique des single ship companies et faites-vous fréquemment appel à eux ?
Deuxièmement, le développement de la recherche pétrolière dans le Caucase - aux Etats-Unis, nous avons appris que les cartes publiées laissaient entrevoir d'importantes perspectives au Kazakhstan -, auquel j'ignore si vous êtes associés...
M. Christian PARMENTIER : Nous sommes très directement impliqués en Azerbaïdjan, pas au Kazakhstan.
M. le Président : Peu importe: c'est dans le même secteur !
Le développement de l'exploitation pétrolière dans cette zone risque donc d'aboutir dans les vingt ans à venir à un accroissement du trafic pétrolier en Méditerranée : partagez-vous ce jugement et considérez-vous qu'en Méditerranée les normes de sécurité extérieures à votre responsabilité - c'est-à-dire les zones de traversée, les contrôles, les moyens de lutte contre la pollution - sont aujourd'hui suffisantes ?
De gros efforts ont été réalisés en Manche - même s'il reste beaucoup à faire - mais, sans dévoiler les conclusions de cette commission d'enquête, il nous a semblé, sans même prendre en considération les perspectives d'accroissement de trafic dont je viens de faire état, qu'il y a de sérieux manques en Méditerranée. Si une catastrophe y survenait, elle serait beaucoup plus grave que si elle se produisait en Manche, en Mer du nord ou dans l'océan Atlantique : est-ce aussi votre opinion ?
M. Michel de FABIANI : L'exploitation des champs pétrolifères de la zone caspienne renvoie, il est vrai, au problème des pipe-lines turcs qui aboutiront en Méditerranée. Elle provoquera effectivement, un accroissement du trafic mais, en toute honnêteté, j'ignore s'il s'agira d'un accroissement global : il faut voir à quel approvisionnement il se substituera. Je n'ai pas d'informations même si nous pouvons tenter d'en recueillir et de vous les transmettre afin que vous puissiez savoir si ce trafic sera important et s'il viendra s'ajouter ou se substituer à un autre.
Ce qui est vrai c'est que la zone du nord est une zone où les pays riverains sont relativement homogènes et où l'on peut penser que les procédures le sont aussi.
A l'inverse, les pays riverains de la zone Méditerranée ne sont nullement homogènes : certains appartiennent à l'Union européenne, d'autres ont posé leur candidature pour y entrer - et je crois important d'ailleurs qu'au moment de l'examen de ces candidatures, les points dont nous avons parlé s'intègrent aux objectifs d'adhésion -, d'autres n'y participent en rien. Il reste donc à savoir comment les différents pavillons et surtout les différents ports vont se comporter.
Si nous prenons l'exemple européen, nous voyons clairement que le niveau des inspecteurs de port et leur densité ne sont pas identiques actuellement dans tous les pays d'Europe et que si le gouvernement français a pris des mesures pour renforcer leur effectif au niveau national, c'est probablement parce que cela répondait à une nécessité.
Je ne peux donc pas dire que la Méditerranée est un monde homogène au niveau maritime, mais je ne sais pas répondre à la question de savoir s'il faut s'attendre à un accroissement brut ou à un remplacement de trafic.
M. le Président : Si vous pouviez nous le dire, cela nous éclairerait.
M. Michel de FABIANI : Nous vous donnerons notre point de vue sur la question !
Concernant les inspecteurs de port, il faut savoir qu'au nombre des mesures dont nous avons discuté avec le gouvernement français, il en est une qui me semble intéressante : il est très bien d'augmenter le nombre des inspecteurs de port mais il convient aussi de s'assurer de leur formation pratique.
C'est la raison pour laquelle nous avons écrit un courrier, auquel il a été donné une réponse positive, proposant d'aider à cette formation pratique. En effet, il ne suffit pas de doubler, voire de tripler, le nombre des inspecteurs français de port, l'essentiel reste qu'ils soient compétents, qualifiés, informés de la façon dont les choses se passent, non seulement dans les ports, mais aussi dans les sociétés. Nous sommes tout à fait disposés à apporter notre aide en ce domaine.
Encore une fois, il ne s'agit pas d'une question financière, mais d'une question pratique qui consiste à savoir comment mettre les gens en situation et les placer face à leurs responsabilités.
M. le Président : Et sur les compagnies gérant un bateau unique ?
M. Christian PARMENTIER : Il est fréquent qu'une structure coiffe les bateaux appartenant à une entité légale spécifique, mais il y a deux cas de figure. Soit une société de gestion regroupe la gestion de l'ensemble de ces bateaux : il est alors clair pour les gens de BP Shipping qu'ils ont, au sein de ladite société, des interlocuteurs bien identifiés et que la gestion de ces navires appartenant à ces armateurs propriétaires d'un bateau unique est bien maîtrisée, auquel cas la relation est identique à celle que nous entretenons avec un armateur standard propriétaire de plusieurs navires et il est possible d'envisager un affrètement. Soit il est difficile de savoir à qui parler, de trouver un correspondant, auquel cas la relation s'établit sur des liens suffisamment distendus pour justifier un refus catégorique du bateau au titre de l'analyse multicritères qui définit les probabilités de risque.
M. Michel de FABIANI: Appelons les choses par leur nom, la single ship company peut être un montage juridico-fiscal de la même façon qu'il existe des filiales, des joint ventures ou autres, mais ce n'est pas un problème car, alors, elle fait partie d'un groupe. En revanche, si la gestion d'un seul navire est concentrée sur un enchevêtrement de compagnies dédiées exclusivement à cet objet, cela mérite un examen attentif.
M. le Président : Quand vous avez affrété l'Erika, le bateau se trouvait déjà dans cette situation ?
M. Michel de FABIANI : C'est vrai !
M. le Président : Le bateau était géré par une cascade de sociétés créées dans ce seul but et vous l'avez pris ?...
M. Michel de FABIANI : En mai 1999, oui : nous l'avons pris !
M. le Président : Je comprends la logique que vous développez, mais dans ce cas précis, il y a une contradiction. Vous avez fini par refuser le bateau, mais pas pour cette raison.
M. Michel de FABIANI : Si le bateau est bon, il n'y a pas de raison de le rejeter uniquement pour une question de montage juridique.
M. le Président : Excepté la raison que vous venez de mentionner, à savoir qu'un bateau dont la gestion repose sur un enchevêtrement de compagnies vouées exclusivement à cette fin est suspect.
M. Michel de FABIANI : Il peut l'être.
M. Christian PARMENTIER : S'il est géré par une société dédiée à cet objet et qu'on ne parvient pas à établir un contact avec un gestionnaire, c'est là qu'il y a problème.
M. le Président : C'était le cas pour l'Erika : vous ne saviez pas à qui vous parliez.
M. Christian PARMENTIER : Si, puisqu'il y avait une single ship company, mais aussi un opérateur en relation avec BP Shipping.
Quand on regarde les critères de la charte signée le 10 février dernier par l'ensemble des opérateurs français du secteur pétrolier au ministère des transports, on s'aperçoit que le seul mauvais point de l'Erika tenait au fait que le navire avait changé de société de classification depuis moins de deux ans : c'était la seule anomalie objective par rapport à la charte. Pour le reste, l'Erika présentait un problème d'ordre structurel sur lequel seule la société de classification pouvait fournir des éléments.
M. le Président : Certes, mais il me semble bien, y compris au moment où vous l'affrétiez, que ce bateau relevait d'une single ship company au plein sens de la formule.
M. Michel de FABIANI : Nous vous confirmons que nous avions des relations avec un représentant de l'armateur.
Audition de Mme Florence PARLY,
secrétaire d'Etat au Budget
(extrait du procès-verbal de la séance du 23 mai 2000 )
Présidence de M. Louis GUEDON, Vice-président
Mme Florence Parly est introduite.
M. le Président lui rappelle que les dispositions législatives relatives aux commissions d'enquête lui ont été communiquées. A l'invitation du Président, Mme Florence Parly prête serment.
Mme Florence PARLY : M. le président, M. le rapporteur, madame, messieurs les députés, mon intervention sera brève et se limitera à une présentation du rôle du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie face à la marée noire provoquée par le naufrage de l'Erika.
Le ministère des Finances a exercé trois fonctions : il a d'abord participé à la lutte contre la pollution ; il a ensuite contribué à la mise en place des financements nécessaires ; enfin, il a joué un rôle important dans les relations que la France entretient avec le FIPOL.
Premièrement, le ministère a participé à la lutte contre la pollution par le biais de la direction générale des douanes et des droits indirects, chargée de cette mission. Un comité interministériel de la mer de 1984 a confié à l'administration des douanes la mise en _uvre des moyens aériens de télédétection des pollutions maritimes. Pour ce faire, la douane s'est équipée depuis 1988 d'un avion dit POLMAR 1, spécialement aménagé pour lutter contre la pollution en mer ; en 1994, ce dispositif a été complété par un deuxième avion dit POLMAR 2, qui est venu renforcer les moyens de la douane.
Le plan POLMAR a été déclenché le 12 décembre 1999. Dès cette date, les moyens aériens de télédétection de la douane ont été mis à la disposition du préfet maritime. Le 13 décembre, nous avons décidé de positionner à Lorient le deuxième avion de télédétection qui était initialement basé à Hyères. Ces deux avions ont réalisé à ce jour 160 heures de mission aérienne pour effectuer le repérage des nappes d'hydrocarbures issues de l'Erika. Dix équipages de quatre personnes se sont relayés successivement pour réaliser ces missions.
Pour tirer les premières leçons de la marée noire provoquée par l'Erika, un projet douanes-POLMAR a été adopté et la première mesure concerne la remise à niveau des équipements de télédétection de l'avion POLMAR 2. Par ailleurs, il a également été décidé d'acquérir un troisième avion du même type ; le principe de cette acquisition a été acté et son coût est d'environ 30 millions de francs. En outre, un certain nombre d'actions, ont été prévues à ce titre, notamment en matière de formation.
Enfin, je rappellerai qu'en dehors des périodes de crise, les douanes contribuent au titre de ses missions permanentes à la recherche et à la constatation des rejets illicites commis par les navires ; elles le font avec d'autres administrations, telles que la marine et la gendarmerie.
Deuxièmement, le ministère a contribué à la mise en place des financements nécessaires à la lutte contre les conséquences de la marée noire.
Il existe un fonds POLMAR qui finance les dépenses de nettoyage des côtes ; ce fonds est localisé sur le budget du ministère de l'environnement, c'est le chapitre 57-10. Nous avons abondé ce chapitre par plusieurs décrets de dépenses accidentelles, le premier abondement ayant eu lieu dès le 28 décembre 1999. Cette mécanique d'abondement à partir du budget des charges communes, chapitre des dépenses accidentelles, nous a permis de ne jamais être en situation de rupture de financement.
A ce jour, nous avons mis en place 320 millions de francs en faveur du plan POLMAR terre. Deux cents millions de francs supplémentaires sont prévus dans le collectif de printemps et sont inscrits sur le chapitre 37-95, le chapitre des dépenses accidentelles, sur le budget des charges communes - c'est sans doute la raison pour laquelle ils ne sont pas immédiatement visibles.
Aujourd'hui, le ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement estime que des moyens supplémentaires seront nécessaires pour le fonds POLMAR d'ici à la fin de l'année, et, bien entendu, si cela se confirme, nous pourrons faire face à ces nouveaux besoins grâce à la provision pour dépenses accidentelles qui va être ainsi rechargée au sein du budget des charges communes, dans le cadre du collectif qui est en cours d'examen.
En ce qui concerne les dépenses éligibles au fonds POLMAR, leur liste a été établie par une circulaire du Premier ministre, mais celle-ci va faire l'objet d'une actualisation, un certain nombre de problèmes d'application s'étant présentés. Cette actualisation permettra d'inclure de manière explicite dans les dépenses éligibles au fonds POLMAR, les actions de nettoyage, la location de matériels, le traitement des oiseaux, ainsi que le recrutement de personnels en CDD, dont l'annonce avait été faite par le Premier ministre lors du CIAT de Nantes. Le TPG de la région Bretagne s'est vu confié une mission générale de suivi de la consommation de ces crédits.
Troisièmement, les relations avec le FIPOL. C'est la direction des affaires juridiques du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie qui est chargé, sous l'autorité du ministère des affaires étrangères, de conduire la délégation française auprès du FIPOL.
Le Gouvernement n'est pas resté inactif face au FIPOL, puisque nous avons organisé, d'abord début janvier puis le 23 mars dernier, à Paris, une série d'entretiens avec M. Jacobsson, l'administrateur du FIPOL, et le club des assureurs de l'Erika, afin de résoudre notamment les problèmes de procédure et de paiement. Ma collègue Dominique Voynet a fait part à M. Jacobsson du mécontentement de la France.
Nous avons demandé au FIPOL de ne pas retenir de taux d'indemnisation tant qu'une évaluation sérieuse des sinistres n'avait pas été achevée. Or toute la difficulté tient au secteur du tourisme, très sinistré ; par conséquent, face à un chiffre qui avait été cité de manière hasardeuse dans la presse et faisant état d'une dizaine de milliards de francs de sinistre, nous avons décidé, en accord avec le FIPOL et ma collègue Michelle Demessine, de mettre en place une mission de l'inspection générale des finances qui, en liaison avec l'observatoire du tourisme, va évaluer la réalité des conséquences de la marée noire sur le secteur du tourisme. Cette mission a démarré et devrait rendre ses conclusions au mois de juin.
Tant que ce travail n'est pas achevé, il est très difficile d'effectuer une évaluation crédible de l'impact de la marée noire sur la fréquentation touristique de l'été.
Nous avons également pris l'initiative de proposer une réforme du FIPOL autour de trois axes principaux. Le premier concerne le plafond d'indemnisation lui-même que nous souhaitons voir relever de 1,2 milliard de francs à 1 milliard d'euros. Le deuxième axe consiste à inclure, dans les dommages susceptibles d'être pris en charge par le FIPOL, les dommages à l'environnement. Le troisième axe, enfin, consiste à faire en sorte qu'à l'avenir on tienne compte, pour le calcul des contributions des compagnies pétrolières au FIPOL, du type de navire qui sera utilisé afin que les compagnies utilisant des navires qui n'assurent pas une garantie en termes de sécurité de transport se voient pénaliser par rapport aux compagnies qui recourent à des navires offrant les garanties de sécurité requises.
Bien entendu, tout cela suppose une renégociation des conventions du FIPOL ; de ce point de vue, nous avons accueilli très positivement la proposition du Royaume-Uni d'augmenter le plafond dans le cadre des couvertures actuelles. Il s'agit d'un premier pas que nous soutenons, mais qui n'est pas suffisant. Par ailleurs, des discussions sont en cours au niveau communautaire pour faire en sorte que, dans l'attente de la renégociation des conventions FIPOL, une première mise en _uvre de ces dispositifs puisse se faire dans un cadre strictement européen.
M. le Rapporteur : Madame la secrétaire d'Etat, pouvez-vous nous apporter des précisions sur la consommation des 320 millions de crédits inscrits - qu'ont-ils couvert ? Car l'une des difficultés que nous avons constatées, c'est justement la non-connaissance de l'utilisation des crédits inscrits. Par ailleurs, des préfets vous ont-ils fait part de difficultés de paiement, c'est-à-dire d'une indisponibilité de l'argent ?
Mme Florence PARLY : Sur l'ensemble des crédits affectés au plan POLMAR, 320 millions ont été délégués ; « délégués » ne veut pas dire nécessairement consommés. Il m'est impossible, aujourd'hui, de vous fournir un chiffre exact, ce que je puis néanmoins vous indiquer, c'est que ces crédits ont été largement consommés.
En revanche, nous n'avons pas eu d'informations selon lesquelles il y aurait eu rupture ou risque de rupture dans la mise en _uvre des paiements. Et nous pensons que l'abondement prévu dans le cadre du collectif qui est en cours de discussion devrait arriver à temps pour justement éviter toute rupture.
M. le Rapporteur : En ce qui concerne le FIPOL, vous lui avez demandé de ne pas retenir de taux d'indemnisation tant qu'une évaluation sérieuse des sinistres n'avait pas été achevée. Nous avons également rencontré M. Jacobsson, et, selon nos informations, le remboursement se faisait intégralement, mais au compte-gouttes.
Il va falloir fixer un taux et chacun attend l'évaluation finale. Mais pendant cette période intermédiaire, certaines professions rencontrent des difficultés, notamment les professions du tourisme.
Le Gouvernement avait annoncé que la BDPME allait faire des prêts à taux zéro, tout comme la Caisse des dépôts et consignations ; selon nos informations, ce dispositif n'a pas été mis en place, ce qui entraîne des difficultés réelles, car il y a un manque à gagner important. Avez-vous des informations à ce sujet ?
Mme Florence PARLY : Vous soulevez là une vraie question ; en effet, le taux d'indemnisation du FIPOL n'est toujours pas fixé de manière définitive. Il devrait l'être au début du mois de juillet. Nous venons de mettre au point le dispositif qui était attendu et qui consiste à faire faire, par la BDPME, des avances de trésorerie dans l'attente de l'indemnisation par le FIPOL.
Le dispositif, qui sera opérationnel dans quelques jours, se présente de la manière suivante : la Banque du Développement des PME (BDPME) consentira des avances au taux de 1,5 % l'an. Ces avances sont calculées sur la base d'une assiette que nous avons évaluée à 50 % de l'indemnisation du FIPOL que nous pouvons aujourd'hui anticiper. Tant que nous ne connaissons pas ce taux, nous ne voulons pas risquer, par une évaluation excessive, de procéder à des avances qui s'avéreraient supérieures au niveau de l'indemnisation définitive qui serait assurée par le FIPOL.
Ce dispositif est acté dans ses principes. Il reste à mettre au point la convention de manière précise avec la BDPME ; par conséquent, d'ici à la fin du mois de mai, ce dispositif devrait être opérationnel pour les personnes intéressées.
M. Le Rapporteur : Quelles sont les raisons qui expliquent l'importance du retard ? La demande était, dès le départ, très forte, et des entreprises sont contraintes de déposer le bilan.
Mme Florence PARLY : La raison principale est que nous attendions les expertises du FIPOL, et que celles-ci sont extrêmement longues à venir. Le problème ne tient ni à la BDPME ni aux services de l'Etat ; il tient au FIPOL lui-même qui distille ses rapports d'expertise selon un rythme qui lui est propre. C'est la raison pour laquelle nous avons pris cette mesure, afin d'éviter d'accroître le retard, et donc les difficultés de ceux qui ont besoin de ces aides.
M. Pierre HERIAUD : Madame la secrétaire d'Etat, me référant aux chiffres que vous avez donnés, j'en étais à 560 millions de francs au lieu de 520 ; n'y aurait-il pas 40 millions pour du matériel qui seraient venus s'ajouter ?
Si 320 millions de francs sont actuellement délégués, les situations sur le terrain sont très diverses. Ces sommes sont imputées à des remboursements, des compensations de prises en charge des dispositifs militaires, sapeurs pompiers et autres, et à des travaux réalisés par des entreprises, en l'occurrence réquisitionnées. Or, à la fin du mois d'avril, les entreprises qui avaient été réquisitionnées sur le secteur sud de la Loire-Atlantique n'avaient toujours pas été réglées des travaux qu'elles ont réalisés depuis le début du mois de janvier 2000.
Les PC, sous la conduite des sapeurs pompiers, devaient viser ce qui était directement pris en charge par ces entreprises et l'adresser aux trésoreries générales. Parallèlement à cette procédure, il y en avait une seconde, car la maîtrise d'_uvre des travaux de nettoyage était sous la conduite des Ponts et Chaussées, donc de la DDE ; or il semble que dans cette dernière procédure des lenteurs ont abouti au fait que les entreprises ne sont toujours réglées.
Je souhaiterais donc connaître quelle a été la consommation de ces 320 millions de francs de crédits délégués, tout ce qui a été affecté à des compensations de prestations d'autres ministères et en même temps à la rémunération des services réalisés par les entreprises réquisitionnées.
Mme Florence PARLY : S'agissant des 40 millions de francs auxquels vous faisiez allusion, ils relèvent du plan POLMAR mer ; ils sont venus s'ajouter, en quelque sorte, aux 320 millions de francs qui relèvent, eux, du plan POLMAR terre.
En ce qui concerne la consommation des crédits, je fournirai les chiffres qui ont été demandés par M. le rapporteur, en essayant de distinguer ce qui relève de l'indemnisation des entreprises elles-mêmes des autres formes d'indemnisation. C'est sans doute une des leçons à tirer de cette catastrophe - nous n'avons pas de remontées d'informations qui indiqueraient l'existence de retard concernant l'indemnisation des entreprises et des collectivités locales. Il importe donc que cette vérification soit faite de manière précise.
M. Pierre HERIAUD : Les collectivités locales, pour partie, ont été remboursées de certaines dépenses dans un délai qui n'a pas dépassé un mois. Je parle uniquement des entreprises pour lesquelles la procédure, semble-t-il, doit être différente.
Mme Florence PARLY : Nous allons vérifier ce point car les entreprises et les collectivités locales étaient prioritaires dans le processus d'indemnisation.
M. René LEROUX : Madame la secrétaire d'Etat, je souhaiterais prolonger les propos que vient de tenir mon collègue Pierre Hériaud, car les entreprises, en effet, n'ont toujours pas été remboursées. Je suis intervenu à plusieurs reprises auprès du TPG de Loire-Atlantique pour lui signaler que de nombreuses entreprises souffraient de ce retard. En revanche, je confirme que les collectivités locales ont été réglées dans un délai très court.
Cette difficulté pour les entreprises est d'autant plus pénible quand on conteste, par exemple, l'achat d'une caisse à outils ; en effet, lorsqu'on demande deux caisses à outils d'une valeur de 500 francs, on nous répond qu'en achetant deux caisses on aura deux clés de 10, alors qu'une seule suffirait ! Voilà ce que nous répondent les gens de vos services.
Je dois reconnaître, en revanche, qu'avec le préfet nous avons débloqué un certain nombre de situations ; vous connaissez tous les procédures des marchés publics : lorsqu'on dépasse un certain montant, il faut remettre en cause... Or il se trouve qu'il n'y avait qu'un seul fournisseur pour un type de matériels bien précis. Donc, outre le fait que la Cour des comptes peut contester le bien-fondé des engagements de factures, nous devons fournir des justificatifs. Il est très pénible de voir que 300 ou 400 personnes peuvent ne pas travailler parce qu'il leur manque un petit joint de l'hydronettoyeur ! J'aimerais donc, là aussi, que vous insistiez auprès des TPG afin qu'ils fassent diligence pour le règlement des factures.
Lorsque nous nous étions rencontrés à Matignon, madame la secrétaire d'Etat, je vous avais demandé quelles étaient vos intentions concernant les banques. Vous m'aviez répondu que vous rencontriez, le lendemain ou le surlendemain, le directeur du Trésor. Or je suis intervenu plusieurs fois auprès des banques et des directions départementales pour débloquer des dossiers - demande de remboursement d'échéance de prêts ou d'autorisation de découverts de 6 000 ou 9 000 francs -, qui me répondaient qu'elles n'avaient aucune instruction - notamment la BNP et le Crédit Agricole.
Enfin, j'aimerais connaître le montant qui sera mis à la disposition des paludiers de Guérande.
Mme Florence PARLY : L'indemnisation prévue pour les paludiers de Guérande s'élève à 3 millions de francs.
En ce qui concerne les banques, vous m'apprenez qu'aucune suite n'a été donnée après que le directeur du Trésor ait réuni les banques ; par conséquent, je me propose de vérifier ce point et de vous fournir des éléments de réponse.
M. Pierre HERIAUD : Je voudrais revenir sur les crédits d'avance accordés par la BDPME ; 1,5 %, il y a une bonification de facto. Est-il envisagé de prendre en charge cette bonification dans le cadre des mesures arrêtées ?
Mme Florence PARLY : C'est la Caisse des dépôts qui assurera le financement du 1,5 % ; cela se retrouvera in fine dans les comptes de l'Etat car il viendra minorer le reversement que pratique la Caisse des dépôts en faveur de l'Etat. Nous sommes dans un processus où les bonifications d'intérêts en termes de dépenses ouvertes au budget de l'Etat sont de moins en moins importantes ; là, nous avions un canal commode qui permettait d'arriver au même résultat.
M. Pierre HERIAUD : Nous n'aurons pas le montant exact.
Mme Florence PARLY : Il me sera facile de vous le fournir, a posteriori, lorsque nous aurons mis en place le dispositif.
M. Jean-Michel MARCHAND : Mes collègues ont largement abordé les problèmes concernant les dommages économiques, mais nous n'avons pas encore abordé l'indemnisation des dommages écologiques, alors que, sur ce sujet, nous travaillons sur du plus long terme. Pouvez-vous évoquer cette question ?
Vous nous avez parlé de la réforme du FIPOL et annoncé trois mesures : le relèvement du plafond de l'indemnisation à 1 milliard d'euros, le fait d'inclure les dommages à l'environnement, et, enfin, une participation selon le type de navire. Cela signifierait que les navires ne disposant pas des qualités requises paieraient plus cher ; mais cela veut dire aussi qu'ils seraient autorisés à naviguer. Or ce que nous souhaitons, justement, c'est qu'ils ne soient plus autorisés à naviguer ! Pouvez-vous nous apporter des précisions à ce sujet ?
Mme Florence PARLY : S'agissant des aides consenties au titre de la reconstitution du cadre écologique, elles s'élèvent à 300 millions de francs - pour ce qui concerne l'Etat - auxquelles il convient d'ajouter les engagements pris par Totalfina qui comprennent une contribution de 50 millions de francs pour le nettoyage des côtes et le sauvetage des oiseaux, de 200 millions de francs pour le traitement des déchets recueillis et de 80 millions de francs pour la restauration des équilibres écologiques.
Bien entendu, nous partageons tout à fait votre point de vue selon lequel il importe avant tout de mettre en place des réglementations interdisant, dans nos eaux, la circulation de navires présentant des dangers pour la sécurité, notamment en matière de transport d'hydrocarbures.
Simplement, nous voulons éviter que le système de contribution financière actuellement en vigueur au FIPOL ne déresponsabilise les compagnies pétrolières ; aujourd'hui, le système de mutualisation des risques est déresponsabilisant. L'indication que je vous ai donnée tout à l'heure est au stade de la réflexion. Il n'est pas impossible que, si nous sommes en mesure de mettre en place des réglementations plus contraignantes, en termes de circulation des navires, le mécanisme de sanctions financières que nous envisageons soit moins utile, ou puisse prendre une forme différente.
Je comprends votre observation, monsieur le député, mais il n'est pas dans nos intentions de favoriser par un mécanisme de sanctions à rebours un abondement facile du FIPOL en incitant le recours à des navires dangereux. Notre priorité est donc bien d'agir au niveau des réglementations - mon collègue Jean-Claude Gayssot serait d'ailleurs mieux habilité pour en parler que moi -, mais en complément de cette première approche, il nous paraissait utile d'envisager une réforme du mécanisme des contributions financières.
M. Jean-Michel MARCHAND : Ces contributions doivent être totalement dissuasives ; leur montant doit être tel que les armateurs ne puissent plus être en mesure de les assumer. Cependant, j'y vois tout de même un inconvénient : travaillant sur la contrainte financière, ces bateaux seront déplacés ailleurs. On ne manquera pas d'interroger votre collègue Jean-Claude Gayssot pour que la réglementation puisse interdire à ces bateaux de naviguer.
Mme Florence PARLY : Bien évidemment, dans notre esprit, si un mécanisme différent de contributions financières venait à être adopté dans le cadre du FIPOL, la pénalisation devra être considérable. Il ne s'agit pas de fixer des coefficients de pondération qui varieraient de quelques pour-cent par rapport au degré de sécurité que présenteraient les navires ; il s'agirait véritablement de rendre l'utilisation des navires peu sûrs tout à fait pénalisante.
Il est un peu délicat pour moi, à ce stade des discussions, de vous donner des ordres de grandeur dans la mesure où il ne s'agit encore que de pistes de réflexion.
M. Michel HUNAULT : Madame la secrétaire d'Etat, nous avons reçu M. Desmarest qui nous a fait le même cours de droit que devant le conseil régional des Pays-de-la-Loire en distinguant la responsabilité de l'armateur et celle de l'affréteur.
Le Gouvernement a annoncé un certain nombre de mesures depuis cette catastrophe au titre de la solidarité nationale. L'Etat entend-il récupérer ces sommes en se constituant partie civile ?
Mme Florence PARLY : Oui, l'Etat se constituera partie civile. Par ailleurs, Totalfina Elf se présentera en créancier de dernier rang par rapport aux indemnisations du FIPOL, et l'Etat s'est placé en avant-dernière position.
M. Michel HUNAULT : Je me réjouis de cette réponse, mais je ne parlais pas du FIPOL. L'Etat se constituera-t-il partie civile dans le cadre de la procédure qui déterminera la responsabilité de cette catastrophe écologique et économique ?
Si l'Etat se constitue bien partie civile, il serait intéressant de le faire en coordination avec un certain nombre de collectivités locales.
Mme Florence PARLY : Bien entendu, la coordination me paraît de bon aloi. Il me semble que cela avait été le cas au moment de la catastrophe de l'Amoco-Cadiz.
M. le Rapporteur : Au moment de la publication du rapport, nous vous demanderons de nous communiquer les chiffres exacts, par département, des dépenses et des engagements, ainsi que le moment où les dépenses ont été engagées.
Enfin, je souhaiterais savoir s'il appartient à votre administration de suivre le FIPOL - sinon, qui en a la responsabilité ? Il existe en effet des interrogations sur la manière dont le FIPOL travaille, et au moment de la catastrophe nous avons pu constater un certain nombre de dysfonctionnements de l'Etat.
Par ailleurs, le Premier ministre et le ministre des transports ont pris des engagements, notamment l'augmentation sensible d'inspecteurs des navires et le renouvellement de la flotte de dragage des affaires maritimes ; les financements de ces mesures sont-ils déjà prévus - dans l'affirmative, pouvez-vous nous les communiquer ?
Mme Florence PARLY : Il existe bien une instance qui assure le suivi du FIPOL ; le ministère des affaires étrangères est en quelque sorte le chef de file de la France au FIPOL, mais, concrètement, le suivi technique est assuré au sein du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie par l'agent judiciaire du trésor. Il n'y a donc pas d'ambiguïté sur la responsabilité du service technique en charge du suivi du FIPOL.
Vous avez abordé le sujet des inspecteurs du transport maritime. Cette question a été réglée dans le cadre du collectif de printemps. La mesure relative à la flotte de dragage, les baliseurs, ne figure pas dans le collectif, mais il s'agit d'un sujet dont nous allons discuter prochainement avec Jean-Claude Gayssot dans le cadre de la préparation du budget pour 2 001. Cependant, il me semble que cette décision avait été prise dans le collectif.
Audition de M. Olivier MOCH, directeur général adjoint,
et de M. Philippe DANDIN, chef du service prévisions marines,
de MÉTÉO France
(extrait du procès-verbal de la séance du 24 mai 2000)
Présidence de M. Jean-Yves Le Drian, Rapporteur
MM. Olivier Moch et Philippe Dandin sont introduits.
M. le Président leur rappelle que les dispositions législatives relatives aux commissions d'enquête leur ont été communiquées. A l'invitation du Président, MM. Olivier Moch et Philippe Dandin prêtent serment.
M. Olivier MOCH : Je vous remercie de consacrer un peu de votre temps à Météo-France dont je vous présente très brièvement l'activité dans le domaine maritime.
Etant donné que la science météorologique progresse considérablement, il est important d'en tirer absolument parti dans les procédures de sécurité en mer.
Météo-France, créé sous la forme d'un établissement public à caractère administratif en 1993, compte 3 700 personnes. Parmi les missions qui lui ont été confiées, citons celle de la sécurité des personnes et des biens. Il s'agit de surveiller l'atmosphère et l'océan superficiel, d'en prévoir les évolutions et d'exercer les attributions de l'Etat en matière de sécurité météorologique des personnes et des biens. Citons également sa mission de soutien à la Marine nationale.
Les ressources de Météo-France représentent environ 2 milliards de francs dont 60 %, financés par le contribuable, sont donc consacrés par l'Etat à une mission, d'une part, de sécurité et, d'autre part, de défense nationale. Tels sont les deux piliers de notre activité outre celle exercée également dans le domaine de l'environnement. Les 40 % restants sont financés, non pas par le contribuable, mais par des clients spécifiques parmi lesquels j'inclus le monde de l'aéronautique.
La météorologie et l'océanographie ont beaucoup progressé ces derniers temps. Sciences jumelles, elles assurent actuellement leur jonction.
La météorologie opérationnelle, liée tant aux observations faites de par le monde entier qu'à la modélisation de l'atmosphère, existe depuis plusieurs décennies. Nous assistons actuellement à la naissance de l'océanographie opérationnelle. Il est vrai que l'observation de l'océan faisait l'objet de recherches et de campagnes de mesures lesquelles n'avaient pas jusqu'à présent un caractère régulier, répétitif et routinier. J'attire votre attention sur le fait qu'un certain nombre d'éléments et de phénomènes physiques à l'échelle planétaire sont en cours de découverte. Par exemple, El Niño, phénomène physique absolument majeur sur la planète, correspond à des déplacements d'eau chaude dans le Pacifique sur une surface équivalant à la taille de l'Amérique du Nord, par exemple. Ces phénomènes ont été bien décrits récemment, c'est-à-dire voilà vingt ou vingt-cinq ans par les satellites qui ont permis d'observer les températures de surface de la mer. Sans parler de la prévision, ce qui se passe en profondeur a été compris voilà seulement quelques années. Ces phénomènes géophysiques considérables à l'échelle de la planète ont été bien décrits récemment.
L'océan et l'atmosphère interagissent en permanence. Nous observons la jonction de l'océanographie et de la météorologie.
Comment travaillons-nous en météorologie ?
Comme je l'indiquais, la météorologie est « fille » de la Marine. Une Commission d'enquête, sans doute semblable à la vôtre, a étudié voilà 140 ans le naufrage de la flotte franco-britannique en mer Noire. A cette époque, Le Verrier, chargé de l'enquête par Napoléon III, a fait remarquer que cette tempête avait d'abord balayé l'Europe et que par des stations d'observation, il eût été possible de prévoir la tempête et donc de se prémunir contre ses effets. Par conséquent, la météorologie est, par nature, internationale. L'atmosphère « se moque » des frontières ! Pour faire de la météorologie, nous avons besoin d'observations et nous faisons des calculs. Nous connaissons les équations de la mécanique des fluides. Nous savons donc ce qui se passe à un instant donné. Par exemple, cette nuit, à minuit, heure universelle, le monde entier a fait des observations qui ont été transmises notamment à Météo-France. A Toulouse, nous avons pris une photographie de ce qui se passait et nous calculons la suite.
J'attire donc votre attention sur un élément nouveau en météorologie : nous travaillons sur le globe entier. Le temps qu'il fera à Paris dans deux ou trois heures dépend de celui qu'il fait en cet instant à Rouen ou à Versailles. Mais le temps qu'il fera à Paris dans cinq jours dépend de ce qui se passe aujourd'hui au Chili et en Chine. Nous ne pouvons donc prévoir le temps à Paris que si nous observons ce qui se passe sur l'ensemble de la planète. Il s'agit donc d'un travail collectif. Les services météorologiques sont à la fois tous partenaires et concurrents, la prévision marine étant devenu un sous-produit de la prévision du temps à Paris. Pour faire de la prévision du temps à Paris, nous avons dans nos calculateurs au passage l'information couvrant le Chili et le c_ur de l'Atlantique.
Sans entrer dans le détail, sachant que je suis prêt à répondre à vos questions, je cite un exemple significatif. Une information couvrant la Malaisie et l'Indonésie nous a été demandée voilà quelques années par le Gouvernement, lors des incendies de forêts majeurs en Indonésie. La sécurité civile et Météo-France ont aidé à cette époque le Gouvernement malaysien à prévoir les conséquences de cette affaire, en observant notamment les vents et les pluies en Malaisie. Nous avons ainsi fait tourner un modèle local à une échelle d'une vingtaine de kilomètres sur ces pays de la zone. Nous avons donc été capables de faire ce zoom sur cette partie du monde en quelques heures, en fait en moins de temps qu'il n'en a fallu à notre expert pour se rendre à Kuala-Lumpur.
Nous avons donc une capacité d'analyse complète du globe par nature parce que nous en avons besoin pour faire de la prévision, ne serait-ce que sur la métropole et les DOM-TOM. Nous avons aussi la possibilité de faire un zoom sur n'importe quel point du monde.
Nous publions maintenant des indicateurs de fiabilité pour présenter au public et aux responsables gouvernementaux l'évolution de nos prévisions. En une quinzaine d'années, nous avons gagné deux jours de prévision. En fait, la prévision faite pour les cinq jours prochains, en l'occurrence jeudi, vendredi, samedi, dimanche et lundi puisque nous sommes aujourd'hui mercredi, a la même valeur que celle faite à seulement trois jours voilà une quinzaine ou une vingtaine d'années. Nous disposons au total de cinq indicateurs précis. Je n'entre pas dans les détails, sauf si vous souhaitiez des compléments d'information.
J'évoque maintenant notre activité dans le domaine de l'océan.
Nous commençons à comprendre l'océan qui, contrairement à une idée répandue, est non pas plat mais ondulé de bosses et de creux dont la différence n'est que de quelques centimètres. Nous savons désormais les observer par satellite et les prévoir. De ces bosses et de ces creux de quelques centimètres sur la surface de l'océan, nous pouvons déduire la situation des courants à la fois en surface et en profondeur. Pour vous faire partager une impression qui, personnellement, me frappe beaucoup, sachez que nous observons la surface des océans avec des satellites qui « orbitent » à 1 300 kilomètres d'altitude, lesquels permettent de mesurer l'altitude de l'océan à deux ou trois centimètres près et, à partir de ces légères différences de hauteur, nous en déduisons les courants en profondeur.
Tels sont les développements auxquels nous sommes parvenus avec le point complémentaire que j'évoquais au début de mon exposé : la naissance de l'océanographie opérationnelle. Ces activités d'observation, réalisées jusqu'à présent de façon ponctuelle dans le cadre de la recherche, sont devenues régulières.
Notre première activité en termes de sécurité concerne la prévision marine. Il s'agit d'une information sur l'état de la mer, destinée aux marins, telle que le vent force 12 éventuellement annoncé sur France-Inter le matin selon cette fameuse échelle de Beaufort. Notre connaissance est maintenant assez approfondie. Puisque nous travaillons sur l'ensemble du monde pour la raison que j'ai mentionnée tout à l'heure, notre information est relativement élaborée. Outre la force du vent qui est une caractéristique essentielle pour les marins, nous disposons d'une information sur les différentes houles, c'est-à-dire les mouvements de la mer et les vagues dus aux vents venant de très loin. Ces houles peuvent être nombreuses et croisées. Nous pouvons annoncer une houle en provenance du nord-ouest avec telle hauteur de vagues, telle longueur d'onde, c'est-à-dire telle distance entre les deux crêtes, et telle ou telle direction. Aux houles croisées s'ajoute la mer du vent locale, c'est-à-dire celle induite par le vent local. Ces informations sont importantes parce que les différents types de bateau réagissent différemment selon l'intervalle entre deux crêtes, par exemple.
Par conséquent, nous sommes quasiment capables de faire du « sur mesure » pour les bateaux. De fait, à l'occasion de grandes courses transocéaniques, nous pouvons, pour deux voiliers naviguant dans des zones similaires, fournir des informations différenciées parce que tel type de bateau résiste bien à telle longueur d'onde de houle ou supporte plus ou moins bien tel type de houle croisée. Nous pouvons, bien entendu, également le faire à des échelles plus réduites, voire sur de petites mers intérieures telles que la Méditerranée ou la Caspienne.
Cette activité de prévision marine, qui dépend d'ailleurs de Philippe Dandin, est organisée au niveau tant national que mondial.
Au niveau national, cette activité, qui consiste à publier des bulletins sur les zones « rivage », « côte », « large » et « grand-large », bénéficie du concours de la DAMGM, la Direction des affaires maritimes et des gens de mer, qui s'occupe de la diffusion de l'information. Une batterie de systèmes radio ou télex permet de transmettre de l'information aux capitaines, en anglais et en français, dans certaines zones.
Au niveau mondial, cette activité est également organisée, sachant que l'océan est partagé sur le globe en un certain nombre de zones. Celles dans lesquelles s'exerce notre responsabilité pleine et entière s'étendent de Brest jusqu'à Pointe-Noire et en Méditerranée occidentale. Nous exerçons également une activité de soutien, notamment dans les zones dites VII B et VIII C. Avec La Réunion, la France s'est vu confier par la collectivité « maritime » internationale la responsabilité de la protection de tout le sud-ouest de l'océan Indien contre les cyclones tropicaux.
Cette organisation de l'océan dans sa totalité étant assurée, il s'agit de veiller à insérer complètement les progrès de la science dans ce schéma.
La première activité concerne donc les bulletins de prévision marine.
Le deuxième domaine dans lequel nous travaillons est la prévision de dérive de nappes ou d'épaves en surface, point qui vous intéresse sans doute particulièrement.
Citons l'exemple du porte-conteneurs le Sherbro qui, dans la Manche, au point 49°45 N, avait perdu des conteneurs qu'il convenait de retrouver avant qu'ils ne s'ouvrent et ne créent des dégâts. Or une information est manquante, si j'ose dire, dans cette affaire : la prise au vent. Plus le conteneur est immergé, moins il a de prise au vent, information dont nous ne disposons pas au début puisque nous ne savons pas dans quel état se trouve le conteneur. Par conséquent, immédiatement informées de l'incident, les équipes de Toulouse font tourner un modèle de calcul de dérive avec des simulations de positions possibles établies de 1 à 9 en fonction de l'immersion dudit conteneur. Bien entendu, le modèle prend en compte les courants de marée illustrés par un mouvement sinusoïdal. Comme je l'indiquais, plus le conteneur est immergé, moins il a de prise au vent et moins il dérive. Ces prévisions de dérive permettent précisément aux avions de récupérer plus rapidement les objets perdus en mer.
Je vous ai cité l'exemple d'un conteneur mais la prévision opérationnelle est également destinée à la recherche de bateaux naufragés, ce qui s'est malheureusement produit dans de nombreux cas. La mise en _uvre de cet outil prévisionnel peut permettre aux CROSS de disposer d'informations pour la recherche notamment d'épaves ou de naufragés.
Un autre exemple est celui de l'Erika puisque ces modèles sont également utilisés dans le cas de dérive de nappes de pollution. Une fois repérée au fond de l'eau, l'épave est illustrée sur nos cartes, ainsi que le trajet global des nappes qui sont, d'abord, descendues vers le sud et, ensuite, remontées vers le nord, et le trajet de bouées météorologiques mouillées très rapidement par Météo-France pour s'assurer que les nappes d'hydrocarbures ne dérivaient pas. Le modèle de diffusion est dénommé Mothy, Modèle océanique de transport d'hydrocarbures.
Quel a été le fonctionnement de cette prévision dans le cas de l'Erika ?
Des observations étaient faites sous la coordination du préfet maritime. Le CEDRE envoyait régulièrement des informations synthétisées à Météo-France sous forme d'un ou deux points qui schématisaient la nappe. Puis, nous faisions le calcul ultérieur. Le type de modèle utilisé a défini notamment la prévision à deux jours de l'arrivée des nappes de pétrole sur les côtes françaises, en l'occurrence la situation au 26 décembre au matin. Il permet également d'envisager ce qu'il serait advenu si une épave avait fui lentement en mer.
J'insiste sur le fait que ces modèles, mis en _uvre en 1994, sont relativement récents et que les procédures actuelles de lutte contre la pollution ne tiennent pas compte véritablement de l'existence de ce type de modèles désormais disponibles. Or il nous paraît important que les procédures de défense et de sécurité soient désormais adaptées pour prendre en compte l'existence de ces modèles. Les trajets de la bouée qui ont été observés en temps réel dans le cas de l'Erika permettent de disposer d'une information et d'affirmer la véracité de ces modèles.
Ce type de modèle peut être mis en _uvre 24 heures sur 24 et cette activité est organisée au niveau tant national qu'international. Il est d'ailleurs paradoxal que l'expertise de Météo-France dans ces domaines soit d'abord connue au niveau international avant d'être prise en compte dans les procédures nationales.
M. le Président : Excusez-moi, mais je ne comprends pas.
M. Olivier MOCH : J'illustre mon propos par un autre exemple. Dans le cas de rejets d'effluents radioactifs dans l'atmosphère suite à un incident intervenu dans une centrale nucléaire, les responsabilités de Météo-France au niveau international ont été définies par l'Agence internationale pour l'énergie atomique et par l'Organisation météorologique mondiale. Une tâche a été confiée à Météo-France avant même que les procédures nationales de calcul n'aient été organisées.
Sans entrer dans le détail, je signale également que la France est responsable d'une activité liée au SIUPM.
M. Philippe DANDIN : Il s'agit du système d'intervention d'urgence en cas de pollution marine. Les services météorologiques couvrent des zones de responsabilité prédéfinies.
M. Olivier MOCH : En cas d'incident d'un pétrolier au large du Maroc, nous savons ce que nous devons faire et nous exerçons notre activité. Ces cellules de crise sont activées en quelques dizaines de minutes dans notre centre de Toulouse, sans difficulté majeure.
Le troisième type d'activité que je mentionne brièvement a trait aux surcotes. Lorsqu'une dépression arrive brutalement, une sorte d'aspiration fait lever le niveau de la mer, ce qui est particulièrement net dans le cas d'un cyclone. Par exemple, lors du passage du cyclone Hugo en Guadeloupe, nous avions observé, d'un côté, une surcote et, de l'autre, une décote. Bien entendu, ce type de modèle peut également être utilisé en métropole. En outre, nous pouvons développer des activités de type statistique, c'est-à-dire considérer tous les cyclones qui se sont produits dans le passé pour tenter de reconstituer les zones plus ou moins sensibles, une sorte de couloir d'une zone le long de la côte, susceptible de connaître des surcotes importantes.
La modélisation de la tempête du 27 décembre dernier fait apparaître des surcotes importantes au large de l'estuaire de la Gironde. Dans le cadre de la recherche scientifique, pour des raisons compréhensibles, il nous est demandé de modéliser et de prévoir encore plus près des côtes, voire à l'intérieur des côtes et au sein de l'estuaire de la Gironde. Nous travaillons donc actuellement sur des problèmes physiques complexes avec des spécialistes d'autres domaines.
Quels sont les axes de progrès ?
Le premier concerne les observations. Pour progresser, nous avons besoin de disposer d'une densité d'observations météorologiques en mer plus importante. Les services météorologiques européens, très proches les uns des autres, se sont regroupés pour un certain nombre d'activités. Par exemple, nous avons organisé toute l'activité satellitaire météorologique de manière commune, au sein de l'Agence EUMETSAT. Nous mettons en place la même organisation pour les observations, en particulier l'observation des océans puisqu'il s'agit d'un besoin collectif. Nous mettons également en place ce que nous appelons dans notre jargon l'observation « adaptative », visant à savoir ce qu'il est nécessaire de mesurer à telle ou telle période s'avérant particulièrement importante, ainsi que l'information satellitaire.
S'agissant de la météorologie pour les océans, nous devons progresser dans trois domaines.
Le premier est celui de l'observation des océans in situ, c'est-à-dire une observation régulière, opérationnelle en profondeur des océans, qui s'organise actuellement au niveau mondial. Nous espérons que l'Europe, et en l'occurrence, la France y prendront une part pleine et entière.
Le deuxième est l'observation spatiale, c'est-à-dire l'observation des océans par le haut, notamment l'altimétrie océanique dont je vous ai parlé tout à l'heure et qui est une composante essentielle. Dans ce domaine, la France occupe une position de pointe puisque le satellite Topex-Poséidon et son successeur Jason sont des joint-ventures franco-américaines. Il s'agit maintenant - et c'est tout l'objet du débat sur le futur satellite Jason 2 - de passer à la phase opérationnelle, c'est-à-dire de faire de l'observation régulière.
Le troisième, en cours d'élaboration en France, est le projet de modélisation fine de l'océan dans sa totalité, à l'instar de ce qui est fait pour l'atmosphère. Il s'agit de l'important projet MERCATOR que nous développons avec cinq autres organismes essentiels en océanographie dont l'IFREMER, l'IRD et le SHOM.
En modélisation, nous progressons également dans la création de modèles à aire limitée, visant à développer les effets de zoom dans tel ou tel domaine et le sur mesure. Nous souhaitons aussi progresser dans le domaine de la chimie, l'une des questions essentielles en matière de pollution par les hydrocarbures étant de connaître les évolutions chimiques.
Dans le domaine international, nous progressons également, le problème important étant de parvenir à insérer Météo-France dans les procédures nationales de sécurité en mer pour tirer pleinement parti des progrès actuels. Pour l'instant, la procédure POLMAR confère un rôle essentiel au préfet maritime et un rôle d'expertise au CEDRE. En revanche, Météo-France, qui intervient pourtant en tant qu'expert possible du CEDRE en deuxième ou troisième position, n'y est même pas mentionné. Il est impératif de progresser, car Météo-France peut apporter un input. Il s'agit donc d'être certain que toutes les connaissances et l'expertise de Météo-France puissent être mises sur la table, mais aussi de le faire participer plus directement à la cellule de crise pour mieux organiser l'observation de l'évolution des nappes d'hydrocarbures en mer. Une question est essentielle, celle de l'organisation des plans de vol pour constater la situation des nappes d'hydrocarbures.
Dans le cas de l'Erika, Météo-France disposait d'une information synthétique fournie chaque jour par le CEDRE et communiquant un ou deux points de localisation des nappes d'hydrocarbures. Ensuite, il nous était demandé de calculer la dérive de ces nappes. En revanche, nous ne savions pas si des nappes n'avaient pas affecté d'autres zones extérieures. En d'autres termes, nous ne savions pas si l'avion n'avait pas été voir ou s'il n'avait pas pu voir ou si la mer était vraiment vierge. Nous ne savions pas s'il n'y avait pas de pétrole, si l'on n'avait pas été voir ou si l'on n'avait pas pu voir quelque chose.
Le dernier axe sur lequel il est important de progresser est la systématisation du travail du Bureau enquêtes-accidents/mer. Depuis plusieurs décennies, le monde aéronautique, quels que soient les incidents ou les accidents aériens qui se sont produits, mène des enquêtes approfondies sur tous les tenants et aboutissants, ce qui a permis de progresser. Lorsqu'un petit avion se pose et qu'un pneu explose à l'atterrissage, l'enquête systématique est lancée. C'est aujourd'hui le cas pour l'ensemble des accidents mais aussi des incidents. Même les cas de figure qui ne révèlent aucun incident sont étudiés. Voilà ce qui a finalement permis au fil des années de faire progresser considérablement la sécurité dans le domaine aéronautique.
Tels sont, monsieur le Président, les quelques éléments de réflexion que je souhaitais d'emblée développer.
M. le Président : J'aimerais vous interroger sur un point particulier.
Vous nous avez présenté la carte de l'évolution de la dérive des nappes d'hydrocarbures, en date du 26 décembre.
M. Olivier MOCH : Prévue pour le 26 décembre.
M. le Président : La prévision d'évolution de dérive des nappes que vous aviez envisagée n'a pas correspondu à ce qui s'est passé. Nous serons donc conduits à vous demander les mêmes cartes aux périodes antérieures à cette date.
D'une part, la dérive n'a donc pas été celle qui a été prévue par Météo-France d'après ce que nous avons constaté. Un certain nombre d'élus, membres de cette Commission, étaient directement en activité à ce moment-là, si je puis dire.
D'autre part, cette information a été diffusée non seulement par les services officiels, mais aussi sur Internet.
Par conséquent, quelle est votre opinion sur ces problèmes ? Quelles en sont les raisons ? Qui a donné l'autorisation de diffuser ces informations ?
Cette diffusion a induit dans l'opinion, d'après ce que nous avons, nous élus, constaté, des perturbations assez importantes qui ne devraient pas se reproduire. Notre rôle consiste non pas à faire le procès de l'événement - d'autres instances en sont chargées - mais à tirer les conséquences de l'événement pour l'avenir. C'est d'ailleurs pourquoi nous souhaitions vous auditionner.
Comment se fait-il que des informations non fiables - pour des raisons que vous nous expliquerez certainement - ont pu être diffusées et provoquer de telles perturbations ? Elles ont valu au préfet de zone de concentrer tous ses efforts sur un département, alors que la marée noire est arrivée sur un autre. Cette situation a généré des dysfonctionnements importants en termes de secours et de mise en _uvre des moyens de nettoyage.
M. Olivier MOCH : Votre question comporte deux parties très distinctes.
La première concerne les erreurs de prévisions. De notre avis de scientifiques et d'experts, il n'y a aucun doute sur le fait que les nappes de pétrole observées en mer sont celles qui sont arrivées dans le sud. Les nappes qui ont été annoncées à Météo-France ont donné lieu à des calculs de dérive, lesquels ont été validés par les faits.
M. le Président : Je m'excuse, mais je ne suis pas d'accord : autant que je m'en souvienne - mais mes collègues de ce secteur sont mieux informés que moi - rien n'est allé à l'Ile-d'Yeu ! On attendait ces nappes sur l'Ile-d'Yeu qui, la veille de Noël, était sur le pied de guerre, alors que nous, les élus ici présents, nous nous préparions à passer le réveillon. Or nous l'avons plutôt passé dehors. Telle est la réalité des faits ! C'est pourquoi je souhaite avoir les cartes. Rien n'est allé à l'Ile-d'Yeu !
M. Olivier MOCH : J'aurais dû être plus explicite dans ma réponse, car nous ne prétendons pas que nos modèles sont précis à quelques kilomètres près au sein de la zone sud.
Ce que je voulais dire, c'est qu'une partie du pétrole a dérivé vers le Finistère et le Morbihan, donc au nord et tout à fait en dehors de la zone annoncée. Nous pensons que ce pétrole n'a pas pu venir et n'est pas venu des nappes de pétrole observées en mer. Ce pétrole, qui était à l'origine plus au nord, n'a pas pu être observé parce que le temps était extrêmement mauvais. Les avions n'ont pas pu voir. Peut-être une partie de ce pétrole était-elle même sous l'eau.
En tout cas, monsieur le Président, le pétrole qui est arrivé sur les côtes tout à fait au nord et qui correspond à cette déconvenue complète des procédures de protection ne vient pas - nos spécialistes et nos experts sont formels et clairs à cet égard - des zones...
M. le Président : Identifiées par le CEDRE ?
M. Olivier MOCH :...identifiées et, en tout cas, transmises à Météo-France.
Toutefois, nous n'allons pas jusqu'à dire qu'au sein de la zone sud, nous sommes capables à 2 milles ou 3 milles nautiques près de faire des prévisions. Notre travail en météorologie consiste à faire une prévision générale et à donner une zone d'impact et, ensuite, à affiner l'affaire au fur et à mesure de l'évolution des observations.
Si vous le souhaitez, monsieur le Président, nous sommes en mesure de vous présenter une hypothèse qui est celle que nous avons faite, selon laquelle l'Erika aurait commencé à fuir faiblement avant son naufrage. Vous pouvez vous poser la question de savoir quand l'Erika a commencé à déverser du pétrole. Si vous faites tourner le même modèle Mothy sur une hypothèse de lâché quand l'Erika était plus au nord puisque, avant de sombrer, le navire a suivi un trajet nord-sud, vous constatez a posteriori que ces nappes de pétrole arrivent exactement en temps et en heure sur le Finistère et le Morbihan.
M. Louis GUEDON : A posteriori...
M. Olivier MOCH : Oui.
M. le Président : Hypothèse intéressante ! L'avez-vous remise au Bureau enquêtes-accidents/mer ?
M. Olivier MOCH : Ces documents sont à la disposition, d'une part, du BEA et, d'autre part, de la justice.
Je vais laisser le soin à Philippe Dandin de vous décrire le trajet de nappes polluantes qui auraient pu être relâchées par l'Erika avant qu'il ne se brise.
Philippe DANDIN : D'après ce qui figure dans le rapport d'enquête du BEA, l'Erika a passé le CROSS Corsen quarante-huit heures avant sa cassure qui survient au sud de Penmarc'h. Il faisait route au 210° vers le cap Finisterre. L'hypothèse est fondée sur une fuite d'hydrocarbures. Dans notre système Mothy, nous faisons donc sortir du pétrole de demi-heure en demi-heure. Le point terminal est le point de rebroussement du pétrolier.
A l'examen détaillé de cette animation visuelle, le scénario d'arrivée à la côte est tout à fait réaliste par rapport aux observations d'arrivée de pétrole, d'abord, à Penmarc'h, ensuite, dans la zone des Glénans et, enfin, dans le sud de la Bretagne.
Cette hypothèse de travail a été faite à partir du modèle après avoir validé les qualités et les défauts de ce dernier. Nous en mesurons donc l'incertitude. Je précise que cette hypothèse a été faite avec un modèle à plus basse résolution que celui utilisé en opérationnel, parce qu'il a fallu couvrir un très large domaine. En d'autres termes, la précision de la taille des mailles du modèle est un peu moins fine, ce qui ne modifie cependant en rien la qualité de la simulation.
Par conséquent, le scénario d'arrivée sur les côtes de Bretagne sud est tout à fait pertinent par rapport aux observations. Nous n'avons eu vent de cette hypothèse qu'après la sortie de la crise, c'est-à-dire le 24 décembre au matin quand du pétrole nous a été annoncé à deux encablures de Belle-Ile, ce qui était tout à fait surprenant pour nous qui suivions l'évolution de la dérive du pétrole.
Olivier MOCH : Indépendamment de cette hypothèse, si j'ose dire, nous sommes absolument convaincus que les nappes de pétrole qui ont été observées et qui ont été signalées ne peuvent pas être celles qui sont arrivées sur le Finistère et le Morbihan.
M. le Président : Cela signifie donc qu'il y aurait eu un défaut d'observation ou d'information pour vous permettre d'évaluer la dérive des nappes ?
M. Olivier MOCH : Nous avons travaillé sur une certaine information, c'est-à-dire que nous avons calculé des dérives à partir d'une information synthétisée par le CEDRE. Nous pensons que cette information a été relativement précise, avec les caractéristiques habituelles de météorologistes, c'est-à-dire qu'elles sont affinées avec l'évolution du temps.
En revanche, nous pensons que d'autres nappes de pétrole n'ont pas pu être observées ou qu'elles n'ont pas, en tout cas, été signalées plus au nord ; si bien que le message, selon lequel si d'autres nappes de pétrole se trouvent ailleurs, elles s'échoueront ailleurs, a manqué. Nous en venons là aux affaires de communication auxquelles vous faisiez allusion, monsieur le Président.
M. le Président : Pour en revenir à la communication, était-il logique que vous diffusiez partout ces informations selon lesquelles il fallait s'attendre, pour l'utilisateur moyen du Net, à un Noël noir sur l'Ile-d'Yeu ?
M. Olivier MOCH : La communication dépend du préfet maritime, en l'occurrence du responsable de la cellule.
M. Louis GUEDON : Pas du tout !
M. le Président : M. Guédon, je propose que M. Moch achève sa réponse avant de vous donner la parole.
Veuillez poursuivre, M. Moch.
M. Olivier MOCH : Dans ce type d'affaires, il y a des exemples où, en raison d'un black-out total de l'Etat, aucune information n'a circulé ; dans d'autres, les services de l'Etat ont fourni dans le désordre des informations parfois contradictoires. En tout cas, il s'agit surtout de coordonner le message afin que l'information donnée soit cohérente.
Au cours de cette période, des quantités de médias se sont adressées à Météo-France pour avoir de l'information, soit sur le trajet des nappes de pétrole, soit sur les simples méthodes selon lesquelles nous travaillions. A Toulouse, des journalistes venaient quasiment camper devant le centre !
Nous avons demandé par écrit au préfet maritime ce que nous pouvions faire, lequel nous a autorisés à diffuser une information sur ce dont nous disposions, en lui laissant un préavis d'une heure sur la teneur de celle-ci. C'est donc avec l'accord de ce dernier que nous avons décidé de mettre en place ces serveurs sur lesquels nous avons fourni de l'information sur la dérive estimée des nappes signalées. Il est vrai qu'un accent a absolument manqué sur le fait qu'il s'agissait uniquement de la dérive prévue des nappes signalées.
Telles sont les conditions dans lesquelles la diffusion de l'information a été décidée et organisée.
M. Louis GUEDON : Dans votre exposé, vous mettez en exergue les méthodes scientifiques de Météo-France et, de ce point de vue, je suis tout à fait d'accord avec vous. Météo-France est certainement une avancée scientifique très importante par rapport à ce qui était observé autrefois par les anciennes frégates météo qui étaient basées à La Rochelle et dont l'une sert d'ailleurs maintenant de musée pour les touristes.
Cela étant, puisque vous abordez à juste titre un problème scientifique, précisément le domaine scientifique est fait de doutes, de curiosité et de modestie et l'on connaît parfois un échec. Il n'y aurait pas, me semble-t-il, de déshonneur à reconnaître que dans l'affaire de l'Erika, vous avez connu l'échec complet.
En premier lieu, vous avez parlé à plusieurs reprises du préfet maritime. Nous l'avons vu faire la tournée des popotes pour essayer de nous remonter le moral. Il est venu rencontrer tout le monde de la mer dans mon département, le jeudi, à dix-sept heures, alors que les nappes de pétrole touchaient le rivage dans la nuit du vendredi au samedi. Il nous a dit qu'il ne comprenait pas du tout où était le pétrole, que Météo-France avait donné des informations que lui ne vérifiait pas et qui n'étaient pas vérifiées par ces navires qui étaient en surface. Tel a été le message qu'il nous a donné et dont j'ai été témoin.
Par conséquent, il y a un total divorce entre les propos tenus par le préfet maritime en réunion officielle trente-six heures avant l'arrivée du pétrole sur la côte et ce que vous lui faites dire aujourd'hui ici, en cette fin du mois de mai.
En deuxième lieu, nous ne pouvons pas accepter que vous nous apportiez des explications a posteriori, en d'autre termes que vous refassiez la bataille d'Austerlitz quand elle est finie ! On vous demande de prévoir et d'anticiper l'événement et non pas de dire quelle est la maladie quand le malade est mort !
En troisième lieu, tous les vieux marins, qui ont une grande expérience de la courantologie sur le littoral de Vendée, étaient totalement en désaccord avec vos informations. L'habitude des naufrages, de la dérive des éléments dormants, de celle malheureusement des corps de naufragés, de l'arrivée sur la côte des nappes en raison de la courantologie était totalement opposée à vos informations, et ils ont eu raison !
Puisque nous parlions de l'Ile-d'Yeu, le maire qui est un capitaine côtier a toujours expliqué qu'il ne croyait pas du tout à ce que vous aviez prévu sur l'Ile-d'Yeu qui, cher Président, a manifestement bien célébré le réveillon. Ils n'ont pas cru en ce que disait Météo-France, qui leur annonçait une île envahie par le pétrole le lendemain matin.
Par conséquent, dans le domaine scientifique, il faut savoir reconnaître les réussites, lesquelles sont nombreuses, mais aussi parfois les échecs. En l'occurrence, tel fut le cas ! Il s'agit d'en tenir compte, car pendant trois semaines, c'est-à-dire entre le naufrage de l'Erika et l'arrivée des nappes sur les côtes, ce fut une « choucroute » extraordinaire avec des effets médiatiques considérables, qui s'est soldée par un échec total. Reconnaissons-le avec humilité pour faire progresser la science.
M. Olivier MOCH : Nous nous accordons à reconnaître que la science est faite de doute et d'humilité, mais je souhaite insister sur un point.
M. Louis GUEDON : Heureusement !
M. Olivier MOCH : Les modèles de dérive n'existaient pas voilà quelques années et quand bien même auraient-ils existé, il n'y avait pas de données pour les alimenter en temps réel, ce que nous sommes aujourd'hui capables de faire en n'importe quel point du monde. De surcroît, il s'agit de les utiliser.
Par conséquent, l'approche qui consisterait à dire que tout n'est pas parfait, que ce modèle n'est ni utilisable ni disponible dans l'avenir pour les procédures en raison des difficultés majeures rencontrées, et donc qui consisterait à jeter le bébé avec l'eau du bain, serait dangereuse.
Le préfet maritime vous a dit qu'il ne savait pas où se situaient les nappes de pétrole. Tel était bien le problème ! Pour pouvoir faire le calcul de la dérive et prévoir où les nappes échoueraient, il aurait fallu disposer précisément d'une information plus complète sur l'état présent des nappes de pétrole.
M. Louis GUEDON : Je me permets de vous interrompre pour préciser ce que j'ai voulu dire.
Lorsque par modestie le préfet maritime explique qu'il ne sait pas où sont les nappes de pétrole, cela signifie qu'il ne comprend pas comment Météo-France, dans la presse ou sur les chaînes de télévision, peut décrire au centimètre près leur localisation. Or c'est bien ce que l'on a vécu pendant les trois semaines. Alors que Météo-France annonçait où se situaient ces nappes au centimètre près, le préfet maritime nous disait et c'est lui qui avait raison : « Je ne sais pas ce qu'ils font parce que je ne sais pas où est le pétrole ! »
M. Olivier MOCH : Dans la pratique, je vous ai expliqué comment nous travaillions. A partir de l'information sur les nappes de pétrole observées et synthétisées sous forme de deux ou trois points, qui nous a été fournie par le CEDRE au jour le jour, Météo-France a procédé à des calculs.
Par conséquent, l'élément sur lequel nous devons progresser pour des accidents futurs concerne précisément cette systématisation de l'observation. Les modèles dont j'ai parlé progressent et sont utilisables. Il ne faut surtout pas les considérer comme étant inutiles et les rejeter.
En revanche, il est certain que pour les utiliser, nous avons besoin de disposer de données d'observation. Nous ne pouvons calculer la dérive d'une nappe de pétrole que si nous en connaissons la présence à un instant donné.
M. Louis GUEDON : Il ne faut cependant pas dire qu'elle existe si vous ne savez pas qu'elle existe !
Mme Jacqueline LAZARD : Dans le prolongement des propos tenus par mon collègue mais sans aller tout à fait dans le même sens, je souhaite parler aussi du bon sens des marins.
Dans mon secteur, celui de Penmarc'h, les marins, qui connaissent aussi très bien la courantologie, ont dit que ces nappes qui s'étaient échouées provenaient du pétrolier non pas après sa cassure mais obligatoirement avant, ce qui signifie qu'il avait fui avant de se briser. Cela conforte ce que vous nous avez dit. Il est vrai que l'on peut faire confiance au bon sens des marins. Des nappes qui n'ont peut-être pas pu être observées se sont obligatoirement échappées avant que le pétrolier se casse, d'où ma question.
Vous avez dit que ces nappes n'avaient pas été observées ou signalées. Si elles n'ont pas été observées, il s'agit d'un fait, mais si elles l'ont été sans être signalées, il s'agirait alors d'une erreur grave.
Météo-France dispose-t-il de moyens opérationnels supérieurs à ceux du CEDRE ? Dans l'affirmative, il serait fondamental que vous soyez immédiatement inclus parmi les acteurs du plan POLMAR.
M. Olivier MOCH : Les moyens d'observation, en l'occurrence le survol de la zone par des avions des Douanes, dépendent non pas du CEDRE mais du préfet maritime. Par conséquent, les moyens d'observation ne sont à la disposition ni de Météo-France ni directement du CEDRE.
L'expertise du CEDRE est claire, avérée et importante dans une multitude de domaines, tels que la chimie et la caractérisation des nappes de pétrole. Par exemple, la densité du pétrole est un élément tout à fait indispensable pour faire tourner les modèles dont je vous ai parlé et pour faire des simulations de la dérive en mer.
Aucun conflit, aucune difficulté n'entrave les relations entre le CEDRE et Météo-France, qui doit cependant être plus directement impliqué dans les cellules de crise. Nous pensons également qu'il convient d'organiser de manière plus rationnelle l'observation en mer.
Quant au bon sens des marins, nous reconnaissons que ces derniers connaissent bien les océans. Nous remarquons cependant qu'ils utilisent en permanence des bulletins météorologiques, c'est-à-dire les informations fournies par Météo-France.
M. Louis GUEDON : Cela n'a rien à voir ! Les marins apprécient vivement les services que vous leur rendez et ils reconnaissent de toute évidence le bien-fondé de votre travail, notamment lorsque Météo-France annonce une tempête ou une dépression. Ils vous en sont reconnaissants. Il s'agit d'un progrès considérable, comme vous l'avez dit et comme je l'ai moi-même confirmé, par rapport au travail réalisé autrefois par les frégates météo.
Météo-France a voulu entrer dans une spécialité, la courantologie. Nous sommes loin de la surveillance de l'océan Indien ou des responsabilités que vous assumez jusqu'au milieu de l'Afrique. Nous avions une courantologie à définir. Or sur cette spécificité qui n'a rien à voir avec les renseignements météorologiques dont ils vous sont reconnaissants, force est de reconnaître leur désaccord et leur supériorité.
M. Olivier MOCH : Je m'en tiens à ce que j'ai indiqué. Les calculs de dérive progressent et l'erreur consisterait à ne pas insérer cette compétence grandissante dans les systèmes de sécurité. Il est clair cependant que nous ne sommes absolument pas capables à 5 milles près de faire un calcul au milieu de deux zones d'îles.
M. Jean-Michel MARCHAND : Monsieur le directeur, ce que j'entends me semble grave de conséquences. Certes, ce n'est pas le lieu de porter un jugement, mais vous nous dites que les nappes qui vous ont été signalées ont échoué là où vous l'aviez prévu.
M. Olivier MOCH : Quasiment !
M. Jean-Michel MARCHAND : L'incertitude scientifique...
M. Olivier MOCH : Normale...
M. Jean-Michel MARCHAND : Normale, en effet.
Vous nous dites également que si les nappes se sont échouées là où elles n'étaient pas attendues, c'est parce qu'elles étaient situées ailleurs. On utilise les mêmes calculs et on détermine de quel endroit elles sont parties.
Cela voudrait dire que le capitaine pourrait avoir de vraies responsabilités parce qu'il n'a pas signalé que son bateau fuyait, alors que c'était le cas depuis longtemps, d'après vos calculs.
Par ailleurs, l'information selon laquelle le fioul serait passé dans un ballast à la suite d'une rupture de cloison interne serait fausse.
Il s'agit donc de mesurer toutes ces conséquences.
En outre, étant donné que l'on sait à quel moment l'Erika s'est cassé en deux, il eût été intéressant que vous nous montriez des simulations, car c'est bien de ce point de rupture que les nappes se sont répandues à la mer.
Ma seconde question prolonge celle posée par Mme Lazard. Puisque vous nous avez présenté une carte illustrant les creux et les bosses de l'océan, vous disposez donc de moyens pour observer de façon très précise la surface de l'océan.
Ces moyens peuvent-ils être utilisés pour pouvoir détecter des nappes de pétrole ? Dans l'affirmative, pourquoi ne pas les avoir utilisés ? Etiez-vous subordonnés aux informations qui vous étaient fournies par le CEDRE ? Si c'est le cas, c'est lourd de conséquences !
M. Olivier MOCH : En réponse à la question concernant les simulations, nous sommes, bien entendu, à la disposition de toute autorité qui souhaiterait nous demander des simulations complémentaires, fondées sur telle ou telle hypothèse. Si votre commission d'enquête ou la justice nous demande de faire tourner ce type de modèle sur telle ou telle hypothèse, il est tout à fait clair que nous répondrons à cette attente. Nous sommes là pour cela !
Par ailleurs, je n'ai pas porté d'accusations précises ou définitives. J'ai simplement affirmé ici que les nappes qui sont arrivées dans le nord ne sont pas celles qui ont été observées et signalées dans le sud. C'est tout ce que j'ai dit !
En ce qui concerne la question des observations, la carte que je vous ai présentée était une carte de prévisions, illustrant nos capacités de modélisation de l'état de la mer à venir.
Actuellement, nous assistons à la naissance de l'océanographie opérationnelle qui nous permettra de disposer d'informations continues sur l'océan. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Nous ne disposons que d'observations faites par tel ou tel satellite de temps en temps, couvrant telle ou telle période.
Par ailleurs, la plupart des satellites qui couvrent l'océan ne donnent pas d'informations en cas de présence de nuages. On ne voit pas sous la couche nuageuse. La période durant laquelle s'est produit le drame de l'Erika était caractérisée par un mauvais temps et une couverture nuageuse importante. Nous n'avons pas pu utiliser ces sources.
Il est vrai que la recherche s'oriente vers la possibilité, à partir d'informations télédétectées par satellite, par hélicoptère ou par avion, d'observer une mer plus calme, en fait une mer d'huile au milieu d'un océan plus déchaîné. Le tout est du domaine de la construction de l'océanographie opérationnelle dont je parlais.
M. le Président : Je souhaite vous poser deux autres questions.
La première, très précise, porte sur l'hypothèse que vient de soulever M. Marchand et que vous avez évoquée, selon laquelle le bateau aurait fui largement avant la cassure.
Etes-vous en mesure de nous donner quasiment l'heure à laquelle il aurait commencé à fuir, d'après votre modélisation ? Normalement oui, n'est-ce pas ?
M. Olivier MOCH : Non, monsieur le Président. Nous pouvons travailler dans l'autre sens, si je puis dire. Nous modulons toutes les contraintes d'humilité et de doute qui caractérisent la recherche et que l'on évoquait tout à l'heure. Si l'on nous demande de faire tourner nos modèles sur telle ou telle hypothèse, nous le ferons et nous dirons : « Voilà où il est plus vraisemblable que cette nappe de pétrole atteigne la côte ».
M. le Président : Quant à la carte illustrant la dérive probable du pétrole qui aurait fui...
M. Olivier MOCH : Monsieur le Président, je n'ai pas été jusque-là. J'ai dit que si le pétrole avait fui, voici la trajectoire que cette fuite aurait prise.
M. le Président : Oui, et vous constatez que c'est là qu'il arrive !
M. Jean-Michel MARCHAND : Le modèle que vous faites tourner à partir d'une nappe repérée et communiquée vous permet, dites-vous, de déterminer à quelques milles d'erreur près l'endroit où les nappes vont s'échouer mais ne fonctionne pas en sens inverse.
M. Olivier MOCH : Nous avons d'abord travaillé sur ce sujet dans le domaine aérien. Dans le domaine nucléaire, par exemple, une question qui nous est posée est de savoir d'où peut provenir telle ou telle pollution radioactive observée.
Dans le traité sur le contrôle des expériences nucléaires atmosphériques, dont je n'ai pas en mémoire la dénomination exacte, sont prévues quatre procédures de contrôle. L'une d'entre elles est une procédure de contrôle météorologique, mise en _uvre notamment par Météo-France. S'il est souhaité observer tel ou tel type de radioélément à tel endroit, il est demandé à Météo-France, au niveau international, de faire des calculs rétrotrajectoires pour tenter de savoir d'où peut provenir telle ou telle pollution radioactive.
M. le Président : Cela donne des résultats ?
M. Olivier MOCH : Dans le domaine aérien, oui ! En marine, la situation est moins simple, mais je vais laisser le soin à M. Dandin de vous en parler.
M. Philippe DANDIN : La rétrodérive pose les mêmes problèmes qu'en atmosphère : certaines choses s'inversent et d'autres pas. Dans l'océan, il y a donc une diffusion. C'est pourquoi à partir d'un point initial, les nappes se dispersent et le « nuage » de points que l'on donne illustre une zone de probabilité de présence. En rétrodérive, la diffusion sera la même.
Nous avons mis en place cette rétrodérive après la crise, à la demande du CEDRE à cause des problèmes de recollecte de pétrole à la côte qui n'avait pas été nettoyé. En particulier, sur l'Ile Dumet, dans le fond de la baie de Quiberon, 800 tonnes de pétrole n'ont pas pu être nettoyés avant les grandes marées suivantes de fin janvier. Une grande partie de ce pétrole a été recollectée par la mer et, peu de temps après, nous en avons vu arriver dans toute la baie de Quiberon, sur la Presqu'Ile de Rhuys, l'Ile de Houat et l'Ile de Hoëdic. Nous avons donc mis en place le système et nous avons fait des simulations de rétrodérive.
M. Olivier MOCH : Je souhaite néanmoins souligner une différence. Dans le cas aérien dont nous parlons, celui d'une expérience nucléaire prohibée ou d'une fuite de centrale nucléaire, il s'agit, lorsque l'on cherche à retrouver l'origine, d'une source ponctuelle.
Dans le cas précis que nous évoquons là, il s'agit de sources en mouvement. Il existe donc plusieurs solutions possibles en rétrotrajectoire et le problème est beaucoup plus compliqué.
M. Philippe DANDIN : Le pétrole qui est arrivé sur la côte du Croisic provenait bien de la zone de l'accident où l'épave s'était cassée en deux.
M. le Président : Je vous prie de m'excuser de revenir sur la fuite qui se serait produite avant le naufrage. Je raisonne peut-être de manière un peu simpliste, mais tel est notre travail.
Si le bateau a fui avant le naufrage au point figurant en haut de votre carte, ce que celle-ci tend à démontrer...
M. Olivier MOCH : Je n'ai pas dit cela, monsieur le Président.
M. le Président : Non, vous ne l'avez pas dit, mais soyons clairs ! Vous ne vous expliquez l'arrivée de pétrole sur la zone du Morbihan et du Finistère sud, dites-vous, que parce que le bateau commence à fuir beaucoup plus tôt.
M. Olivier MOCH : Je ne l'explique pas.
M. le Président : Du moins, vous ne savez pas l'expliquer autrement !
M. Olivier MOCH : Je dis que les nappes du sud ne sont pas celles qui sont remontées au nord.
M. le Président : Cela peut aller très loin, car cela veut dire que le bateau a commencé à fuir avant le naufrage, au point que j'indiquais sur la carte. Par voie de conséquence, la responsabilité du capitaine est directement engagée.
Nous pouvons savoir à quelle heure il était là-bas. Or il n'a indiqué qu'il était en difficulté qu'après et, dans un deuxième temps, il annule son message de détresse : le bateau n'est plus en difficulté et il ne demande plus de secours.
Cela signifie que si des secours avaient été envoyés au moment où les premières fuites se sont produites, la suite se serait peut-être passée totalement différemment.
Je divague peut-être dans mon raisonnement et je tiens ces propos entre parenthèses, mais il peut s'agir d'une hypothèse.
M. Pierre HERIAUD : Une telle hypothèse serait lourde de conséquences ! Il s'agirait d'un élément majeur pour l'affaire.
M. Louis GUEDON : Cela recoupe certaines auditions !
M. le Président : J'ai bien compris votre explication et je vous ai bien entendu exprimer votre extrême prudence.
Je comprends mieux également pourquoi des explications différentes ont été données et pourquoi le pétrole n'a pas atteint l'Ile-d'Yeu puisque ce n'était pas le même. Mais nous en tirons beaucoup de conséquences. (Assentiment.)
M. Olivier MOCH : Je me permettrai de compliquer encore davantage le débat, monsieur le Président, en faisant part d'un troisième élément qui nous a été demandé seulement pendant quelques-unes des journées qui ont suivi le sinistre : l'hypothèse de fuite des épaves reposant au fond de la mer. En effet, nous pouvons également faire des calculs sur des fuites hypothétiques, en tout cas à partir des épaves qui reposent au fond de la mer.
D'un côté, on nous invite à prendre une multitude de précautions avec ces modèles qui ne sont peut-être pas bons dans l'état actuel de la science et, de l'autre, la tentation est permanente de les utiliser pour tester telle ou telle hypothèse en continu. Tel est le paradoxe !
M. le Président : Dans la suite logique, il n'est sans doute pas opportun que cela soit rendu public en période de crise. Telle est ma critique essentielle !
Que le préfet maritime garde ces informations pour lui pour toute décision à mettre en _uvre, soit ! Quant à leur diffusion sur le Net, je me pose la question !
Ma deuxième observation, liée à la précédente, porte sur l'organisation. Météo-France n'est qu'associé au préfet maritime en période de crise. Ne serait-il pas souhaitable que vous soyez directement impliqués dans le processus ?
M. Olivier MOCH : Pour l'instant, monsieur le Président, nous ne sommes même pas associés au préfet maritime. Nous sommes associés au CEDRE qui est, lui-même, un expert du préfet.
Nous pensons effectivement - et c'est aussi l'avis du CEDRE pour être tout à fait franc - que compte tenu d'une compétence que l'on peut certes critiquer mais qui est grandissante, il serait important que Météo-France soit impliqué plus directement aux côtés du préfet maritime.
M. le Président : Quelles sont vos relations avec les services de météorologie de la Marine nationale ?
M. Olivier MOCH : Comme je l'ai indiqué très brièvement en préambule, Météo-France est en charge de la météorologie pour les armées. Des ingénieurs de chez nous encadrent les équipes de météorologistes militaires.
M. le Président : En fait, il n'y a pas deux services.
M. Olivier MOCH : C'est cela. Les météorologistes militaires de la Marine, de l'Aéronautique et de l'armée de Terre sont encadrés par des ingénieurs de Météo-France.
Mme Jacqueline LAZARD : Ma question est d'ordre technique.
Malgré les satellites, Météo-France utilise-t-il toujours les informations qui peuvent leur être données par les bateaux ? Je veux parler des informations établies par les marins lors des quarts ou de celles fournies par les techniciens météo qui font partir des ballons des bateaux.
M. Olivier MOCH : Je réponds en deux points.
Les océans étant des déserts météorologiques, nous avons absolument besoin d'informations. Certes, nous progressons dans le domaine satellitaire, mais nous avons toujours besoin de données au sol. Par conséquent, nous disposons toujours de navires météorologiques sélectionnés qui font des observations et qui nous les communiquent.
La question complémentaire est celle de l'automatisation : sera-t-il possible ou pas d'envoyer ces ballons automatiquement ? L'évolution tend à une automatisation de l'observation sur les navires et non pas à la disparition de cette observation au sol, qui demeure essentielle pour nous.
M. Philippe DANDIN : Cette observation est toujours très importante et essentielle pour nous. Par exemple, il arrive que parmi les Bretons qui pêchent en mer d'Irlande, une observation faite en mer par un patron pêcheur déclenche toute une chaîne d'alerte chez nous parce que les satellites et les modèles n'ont rien vu.
M. Olivier MOCH : Un des progrès de la météorologie dont je parlais est celui de l'observation adaptative. Nous connaissons aujourd'hui les zones les plus importantes à observer pour avoir une information sur la métropole, par exemple. Nous pouvons vouloir aujourd'hui densifier les observations dans telle zone au large du Canada parce que l'information est particulièrement importante.
M. le Président : En raison des pouvoirs de la Commission, je vous demande de bien vouloir nous adresser les copies des échanges de courriers que vous avez entretenus avec le préfet maritime et dont vous avez fait état, lorsque vous sollicitiez son autorisation de diffuser l'information.
Par ailleurs, je souhaite que vous nous adressiez les copies des simulations essentielles que vous avez faites sur la période, y compris celle de la dérive à partir de la fuite en marche dont nous venons de parler.
M. Olivier MOCH : Je précise que cette dernière n'a pas été faite pendant la période.
M. le Président : Nous sommes bien d'accord, mais j'imagine que vous avez dû, vous aussi, vous poser la question, en constatant que la nappe annoncée à tel endroit est arrivée là où vous ne l'aviez pas du tout prévu. Je suppose que c'est bien ce que vous vous êtes dit.
Par ailleurs, aujourd'hui, vous devez penser dans votre for intérieur que, scientifiquement, honnêtement et déontologiquement parlant, il n'existe pas d'autre solution : le navire a fui avant ! Du moins, vous ne parvenez pas à trouver d'autres explications.
Je ne dis pas que vous en êtes certain. Mais intellectuellement, vous vous dites qu'en raison de l'état de la science, de vos informations et de votre technicité, vous ne parvenez pas à comprendre comment cela a pu se passer, sinon ainsi. Telle est hypothèse, la seule, devez-vous vous dire, sans jurer cependant que c'est la bonne.
M. Olivier MOCH : Les experts de Météo-France et les marins qui connaissent parfaitement bien la mer, c'est-à-dire ces experts dont nous avons parlé tout à l'heure...
M. le Président : Mme Lazard remarquait d'ailleurs que leurs propos confortaient les vôtres.
M. Olivier MOCH :...disent que ce qui est arrivé au nord n'a pas pu provenir de ce qui a été observé au sud.
M. le Président : Cet élément est très important parce qu'il remet en cause nombre des auditions auxquelles nous avons procédé.
En fonction de l'heure des premières arrivées de pétrole sur les côtes du Finistère sud et du Morbihan, pouvez-vous identifier la période au cours de laquelle le pétrole a commencé à fuir de l'Erika ?
M. Olivier MOCH : Il sera difficile de répondre à cette question et de raisonner en termes de rétrotrajectoire.
En revanche, comme le démontre le schéma dont vous avez eu connaissance et sur lequel des couleurs différentes correspondent à des heures différentes de relâchés de pétrole, il est possible, tout en prenant en compte les limites nécessaires du modèle dont nous parlions, de dire que le pétrole relâché à tel endroit au passage du bateau aurait eu telle dérive.
A la limite, nous pouvons cloisonner le parcours de l'Erika et déterminer les conséquences du relâché du pétrole à condition de connaître la trajectoire et son timing exact. Si du pétrole a été relâché à tel moment, nous pouvons définir la trajectoire probable qu'il aurait eue.
Si en guise d'hypothèse de travail, vous nous dites que du pétrole a été relâché à telle heure par le bateau à tel endroit, nous pouvons essayer de calculer sa dérive avec le modèle dont je parlais. En termes de rétrojectoire, c'est beaucoup plus difficile à calculer.
M. le Président : Vous le pouvez si l'on connaît son heure de passage. Vous, vous ne la connaissez pas ?
M. Olivier MOCH : Si, les calculs ont été faits.
M. Philippe DANDIN : Nous avons fait les calculs avant de disposer du rapport du BEA-mer et, ensuite, nous les avons « calés » en prenant en compte les données figurant dans ledit rapport. Mais nous savions que le bateau était passé dans le rail d'Ouessant quarante-huit heures avant et quelle était sa vitesse de navigation.
M. Olivier MOCH : Précisons également qu'il s'agit de la simulation directe et non de la rétrotrajectoire.
M. Philippe DANDIN : En rétrotrajectoire, nous pouvons partir de Penmarc'h et vérifier que dans le nuage de points obtenu en rétrodérive, il y a une cohérence avec les heures de passage des bateaux, mais cela ne sera jamais une vérité absolue.
Il est essentiel de voir que le modèle Mothy n'est pas du domaine du credo. Nous avons de nouveau vérifié et validé tout ce que nous avions fait pendant la crise et nous en mesurons les incertitudes.
M. Olivier MOCH : Pour répondre précisément à votre question, monsieur le Président, il me paraît extrêmement difficile de savoir à quelle heure le bateau aurait commencé éventuellement à relâcher du pétrole. Deux points successifs sur la trajectoire pourraient donner les mêmes conséquences au sol. Il n'existe donc pas de solution unique à la rétrotrajectoire.
M. Pierre HERIAUD : Ce n'est pas univoque.
M. Olivier MOCH : Voilà.
M. le Président : D'accord, mais tout de même... !
M. Olivier MOCH : Notre travail a consisté à considérer la trajectoire de l'Erika et à supposer qu'il ait fui le long de sa trajectoire. Nous avons représenté ces fuites par des couleurs différentes selon les heures de passage. Ces différentes trajectoires possibles sont exprimées.
M. le Président : D'après le rapport du BEA-mer, à un moment donné, il est proposé à l'Erika un secours et il le refuse parce qu'il n'en a plus besoin.
M. Pierre HERIAUD : Cela explique aussi certaines anomalies.
M. le Président : Je pense qu'il devait déjà fuir pas mal à ce moment-là et qu'il devait le savoir.
M. Pierre HERIAUD : Evidemment.
M. le Président : Je compte sur vous, monsieur le directeur, pour nous adresser les copies des documents dont je vous ai parlé tout à l'heure.
M. Olivier MOCH : Bien entendu, monsieur le Président.
M. René LEROUX : Compte tenu de tout ce que vous nous avez présenté dans le détail, s'agissant notamment des mouvements de la mer, pouvez-vous nous dire aujourd'hui, à nous maires et députés de la côte, si nous allons encore « recevoir » du pétrole ? Je vous pose la question, car les plages de Loire-Atlantique ont encore été affectées ce matin même.
Le dispositif en place voilà quelques mois ne l'est plus de la même manière aujourd'hui, sauf pour ce qui concerne la surveillance assurée en permanence autour de l'épave de l'Erika. Or d'après des observations qui sont faites par des plaisanciers ou des pêcheurs et qui nous sont rapportées, des nappes dériveraient encore autour des îles, en l'occurrence au large de l'Ile Dumet. Disposeriez-vous d'observations à ce sujet ? Je vous pose la question, sachant qu'il existe toujours un plus malin qui sait plus de choses que les autres !
M. Olivier MOCH : Comme je l'ai indiqué tout à l'heure, pour l'instant, nous n'avons même pas accès aux informations d'observations.
M. René LEROUX : C'est bien ce que je pensais !
M. Olivier MOCH : Nous n'avons eu qu'une information synthétique, donnée par le CEDRE pendant la période.
J'en profite pour signaler que ces modèles marins ne sont plus directement applicables lorsque l'on est à quelques encablures de la côte. S'agissant des modèles de surcote, j'ai souligné moi-même que la surcote qui nous avait été demandée pour la centrale du Blayais est un problème scientifiquement très différent de celui de la surcote sur la côte landaise, par exemple.
Entretien du rapporteur avec
M. Philippe LOUIS-DREYFUS,
président-directeur général de la Société LOUIS DREYFUS Armateurs,
accompagné de M. André MAIRE, conseiller du président
(extrait du procès-verbal de la séance du 25 mai 2000)
MM. Philippe Louis-Dreyfus et André Maire sont introduits.
M. le Rapporteur leur rappelle que les dispositions législatives relatives aux commissions d'enquête leur ont été communiquées. A l'invitation du rapporteur, MM. Philippe Louis-Dreyfus et André Maire prêtent serment.
M. le Rapporteur : Je tenais à m'entretenir avec vous de l'ensemble des problèmes de sécurité maritime afin de savoir comment vous les gérez dans votre armement. Je souhaite également connaître votre point de vue sur le dispositif français d'aide à l'armement et ses possibilités de renforcement.
M. Philippe LOUIS-DREYFUS : Je ne suis pas personnellement un très grand technicien de l'armement ! C'est la raison pour laquelle je suis accompagné de mon ami et collègue André Maire, conseiller du président, présent depuis de nombreuses années dans le groupe Louis-Dreyfus, comme naviguant puis au siège de la société. Pour ma part, j'ai repris l'armement Louis-Dreyfus en 1997. Sur les deux sujets techniques que vous souhaitez aborder, M. Maire vous apportera toutes les prévisions utiles. J'interviendrai davantage sur les aspects plus généraux et sur la politique en faveur de la marine marchande française.
M. le Rapporteur : Pourriez-vous, dans un premier temps rappeler la situation de votre groupe, son état en matière d'armement et son potentiel de navires. D'une manière générale, quelle est la stratégie de votre groupe ? Nous parlerons ensuite des problèmes de sécurité.
M. Philippe LOUIS-DREYFUS : Le groupe Louis-Dreyfus est un groupe français qui a 150 ans d'existence. C'est une société privée gérée par la même famille depuis cinq générations. En termes de volume et historiquement, c'est une affaire de négoce international, l'armement maritime est devenu sa deuxième activité voici déjà près d'une centaine d'années, à la fin du siècle du dernier.
Le groupe gère une flotte de quarante navires, plus deux qui sont actuellement en construction. Peut-être avez-vous lu dans la presse il y a quelques jours que nous faisions cette opération en association avec Alcatel.
Depuis une cinquantaine d'années, il y a toujours eu en permanence entre huit et douze, treize ou quatorze navires sous pavillon français.
M. le Rapporteur : Combien sont sous pavillon français aujourd'hui ?
M. Philippe LOUIS-DREYFUS : Treize !
M. le Rapporteur : Sous pavillon métropolitain ou pavillon Kerguelen ?
M. Philippe LOUIS-DREYFUS : Il y a un méthanier géré en partenariat avec Gaz de France, qui assure l'approvisionnement de la France en gaz algérien sous pavillon métropolitain. Les autres sont sous pavillon Kerguelen. Nous utilisons également les autres pavillons qui sont souvent des pavillons « opérationnels », brésilien, argentin, indonésien, turc et britannique.
M. André MAIRE : Ces opérations se font en fonction des joint venture et des partenariats que l'on peut avoir ! Nous avons enfin quelques pavillons « économiques ».
M. le Rapporteur : En fonction de quels critères choisissez vous vos pavillons opérationnels ou économiques ?
M. Philippe LOUIS-DREYFUS : Les pavillons non français - Indonésie, Brésil et autres s'expliquent parce qu'il existait - c'est de moins en moins vrai - des avantages compétitifs à avoir ce pavillon, voire même des obligations. Si l'on veut travailler en Argentine ou au Brésil, pays où le groupe s'est implanté et est actif depuis années, si l'on veut y faire de l'armement, si l'on veut bénéficier des trafics « protégés », les pays appliquant des dispositions de protection du pavillon que la France n'a jamais appliquées, il fallait avoir leur pavillon. Je ne parle pas uniquement de la navigation côtière mais je pense aussi à l'approvisionnement de matières premières ! C'est aussi le cas de l'Indonésie où beaucoup de trafics et de transports maritimes sont réservés aux armements et pavillons locaux. Cela n'est pas vrai en France et ne le sera plus en Europe, comme vous le savez.
Quelle a été notre stratégie ? Nous sommes français ! mais nous avons été armateur espagnol, armateur italien, armateur portugais. Nous ne le sommes plus, toujours pour les mêmes raisons, à savoir les avantages compétitifs octroyés aux armements nationaux. Le seul pays où nous restons armateur est la Grande-Bretagne pour des raisons liées à une grande fidélité à l'égard de ce pays.
M. le Rapporteur : Combien avez-vous de bateaux sous pavillon britannique ?
M. Philippe LOUIS-DREYFUS: Un de nos bateaux est contrôlé par une société britannique mais il n'est même pas aujourd'hui sous pavillon britannique !
M. André MAIRE : Il est sous pavillon panaméen.
M. le Rapporteur : Si je comprends bien, vous êtes sous les pavillons nationaux quand il y a un partenariat spécifique. Vous êtes généralement joint venture sur tous ces pavillons là ! En dehors des pavillons économiques sur lesquels nous allons revenir, sur les pavillons nationaux que vous avez cités - Brésil, Argentine, Indonésie, voire Grande-Bretagne - vous n'y allez que lorsqu'il y a un partenariat financier pour la propriété du navire ?
M. Philippe LOUIS-DREYFUS : Dans les faits, aujourd'hui, Brésil, oui ! Indonésie, oui ! Turquie, oui ! Grande-Bretagne, non ... C'est un cas un peu particulier qui n'a aucun rapport avec l'objet de la commission. Pour la Grande-Bretagne, il faut dire que mon père, Compagnon de la Libération, a passé quatre ans en Angleterre pendant la guerre et de ce fait il y a une certaine tradition et une certaine fidélité à ce pays ! C'est un élément qui n'a rien à voir avec le transport maritime : nous garderons toujours un pavillon britannique pour ces raisons.
M. le Rapporteur : Cela concerne combien de bateaux, en dehors des pavillons économiques sur lesquels nous allons revenir ?
M. Philippe LOUIS-DREYFUS: J'ai cité les treize français !
M. André MAIRE : Au Brésil, il y en a six et en Turquie il doit y en avoir trois. En Indonésie, il y a deux vrais bateaux et des grues flottantes, puisque nous avons une activité de chargements en pleine mer très importante.
M. Philippe LOUIS-DREYFUS : J'ai intégré les grues flottantes dans le compte des quarante-deux bateaux que j'ai cités. Ce ne sont pas vraiment des bateaux mais se sont des grues flottantes mobiles, avec moteur et équipage à bord !
M. André MAIRE : En Argentine, nous n'en avons plus pour l'instant mais nous sommes toujours dans ce pays. Au Brésil, il y en a six. Avec la Turquie et l'Indonésie, c'est une quinzaine de bateaux qui sont sous des contrôles nationaux, autres que français.
M. le Rapporteur : Pour les pavillons économiques, quelle est la répartition ?
M. André MAIRE : Pour les autres pavillons, c'est une question de coût ! Le choix n'est pas forcément lié à des partenariats. Certes, il y a eu des partenariats off shore, certains partenaires ne veulent pas venir en France. Le choix des pavillons économiques tient à une question de coût, notamment dans l'activité de vrac sec.
M. Philippe LOUIS-DREYFUS : Votre question portait sur le point de savoir si les bateaux étaient panaméens ou libériens.
M. le Rapporteur : Le reste, c'est Panama !
M. Philippe LOUIS-DREYFUS : Oui, le reste, c'est Panama !
M. le Rapporteur : Cela veut dire une vingtaine sous pavillon panaméen !
M. Philippe LOUIS-DREYFUS : Non pas une vingtaine ; dans les investissements nationaux, les Argentins admettent volontiers le pavillon panaméen. Il en est de même en Angleterre et en Indonésie. Les bateaux peuvent donc être dans des « cellules nationales » mais avec des pavillons panaméens.
M. le Rapporteur : Vous pouvez me faire parvenir l'état actuel de votre flotte et les caractéristiques de vos principales activités.
Est-ce qu'il y a une réflexion stratégique du groupe sur le fait de choisir plutôt Panama que Liberia ? Et plutôt Panama que Malte ? Ou est-ce la tradition qui veut que vous preniez Panama ?
M. Philippe LOUIS-DREYFUS : Je suis à la tête du groupe depuis 1997. En tout état de cause le Panama et le Liberia sont comparables. Il n'y a pas d'avantages spécifiques. Ce sont souvent les banques qui préfèrent le Panama au Liberia. En tout état de cause, l'idée de choisir Malte et Chypre ne nous a jamais effleurés.
Une grande partie de la flotte mondiale est panaméenne ou libérienne. Beaucoup de pays dans le monde dont une grande partie de la flotte contrôlée par les Etats-Unis est sous pavillon panaméen et surtout libérien. Cela n'empêche pas que ces navires sont tout à fait récents et parfaitement bien gérés. C'est le cas aussi de nos bateaux qui sont gérés par nos services techniques et par notre armement à Paris, exactement de la même façon, selon les mêmes critères, avec le même soin et la même surveillance que les navires sous pavillon français.
M. André MAIRE :... Pour les formalités nous n'avons pas de difficultés avec les autorités du Panama, la tâche est très facile ! Pour nous, il s'agit uniquement d'une question de coût dans la sécurité ! Nous ne voulons pas avoir des pavillons un peu exotiques comme Wallis et Futuna. Nous voulons un pavillon reconnu.
M. le Rapporteur : Wallis et Futuna n'est pas exotique ! C'est un pavillon sérieux ! De même que le Vanuatu : c'est un pavillon très sérieux et c'est d'ailleurs un pavillon français ! C'est un pavillon TAAF bis. C'est comme Kerguelen ! Je suis désolé de vous le dire ! Vous pensiez sans doute aux îles Grenadines ....
M. André MAIRE : Ou Saint-Vincent ! Mais tout cela ne nous intéresse pas ! Pour nous, l'intérêt, c'est un coût mesuré et un pays reconnu internationalement. Le pavillon panaméen est connu et reconnu partout. La majorité des pavillons de complaisance, c'est Panama...
M. Philippe LOUIS-DREYFUS : Les pavillons de « libre immatriculation » !
M. André MAIRE : Ils sont connus aux Etats-Unis et un peu partout ! Nous avons démarré ainsi avec Panama...
M. le Rapporteur : Historiquement !
M. André MAIRE : Historiquement, nous avons commencé avec Hong Kong. Pourquoi ? C'était encore le Commonwealth, nous avions des officiers anglais, le pavillon était reconnu et le niveau de sécurité était équivalent à celui des navires anglais. Par ailleurs, nous y avions un partenaire armateur local. Le statut de Hong Kong ayant changé, nous avons recherché un autre pavillon d'accueil nous permettant d'opérer nos navires de libre immatriculation dans des conditions identiques à celles de Hong Kong, de manière à pouvoir maintenir les charges d'équipages à un niveau international dans une activité comme le transport de vrac sec entièrement soumis à une concurrence pure et dure.
M. le Rapporteur : Est-ce que vous savez qu'actuellement, dans le tableau de la qualité du pavillon, le Panama est dans les mauvais élèves ?
M. André MAIRE : C'est possible ! Si vous le dites, vous avez certainement raison !
M. le Rapporteur : Au niveau de la sécurité, sujet qui nous intéresse beaucoup, en pourcentage de bateaux retenus !
M. Philippe LOUIS-DREYFUS : En pourcentage de problèmes par rapport à la flotte ou en nombre d'événements et d'incidents ?
M. le Rapporteur : En pourcentage d'infractions et de retenues dans les ports au titre du Mémorandum de Paris, Panama est dans les mauvais élèves. Liberia et Malte commencent à devenir de bons élèves. Autrement dit aujourd'hui, la sécurité est plus sûre sur un bateau libérien ! Par contre les bateaux panaméens sont très mauvais. Je vous le dis parce que je vais le dire publiquement. Votre flotte de libre immatriculation est donc immatriculée dans un mauvais pavillon, ou du moins réputé comme tel, en matière de sécurité !
M. Philippe LOUIS-DREYFUS : C'est très intéressant !
M. André MAIRE : Pour ma part, je fais attention aux pourcentages et je me méfie beaucoup des statistiques. Est-ce que ce n'est pas parce qu'il y a plus de bateaux panaméens ...
M. Philippe LOUIS-DREYFUS : Il doit y avoir des pavillons nationaux de la CEI ou de pays souverains qui doivent avoir des statistiques bien plus mauvaises.
M. le Rapporteur : Cela dit, Panama se tient plutôt mal ! Nous avons vu des pays qui avaient mauvaise réputation comme Malte ou le Liberia ! Ils sont aujourd'hui à un niveau de qualité qui est proche des niveaux de qualité et de contrôle en Europe. Par contre, ce n'est pas le cas de Panama.
M. André MAIRE : Pour nous, il s'agit de rechercher la baisse du coût des équipages. Que ce soit le pavillon Liberia ou Panama, nous agissons en matière de sécurité. Nous pouvons passer demain matin sous pavillon du Liberia et cela ne nous pose aucun problème. Ce n'est pas la recherche d'un pavillon plus qu'un autre.
M. le Rapporteur : Le problème des coûts est important mais celui de la sécurité l'est aussi et il le deviendra de plus en plus. Inévitablement, il y aura suspicion à l'égard d'armements inscrits sur des pavillons dont le contrôle de l'Etat du pavillon n'est pas très sérieux, ce qui est le cas de Panama. Je sais bien que l'essentiel de votre flotte ne porte pas sur des matières polluantes ou dangereuses mis à part le méthanier. Vous êtes plutôt dans le vrac sec.
M. Philippe LOUIS-DREYFUS :Nous sommes armateurs ! Cela veut dire que nous cherchons à gagner de l'argent par ce métier mais aussi que nous gérons des navires, des équipages, des usines flottantes. Nous avons pour ce faire un service technique relativement important...
M. le Rapporteur : Combien de personnes ?
M. Philippe LOUIS-DREYFUS : Entre 25 et 30 personnes ! Il faut y inclure les 5 ou 6 responsables des relations humaines qui s'occupent de nos marins à bord. Autrement dit 25 personnes du service technique sont des ingénieurs, des GM, des anciens officiers-commandants, chefs mécaniciens...
M. le Rapporteur : Le recrutement se fait essentiellement parmi les anciens navigants.
M. Philippe LOUIS-DREYFUS : Beaucoup comme cela ! Mais il y a aussi les acheteurs de matières et de matériels qui ne sont pas, eux, forcément des anciens navigants. La responsabilité de suivre l'état technique de la flotte est confiée en grande majorité à d'anciens navigants.
M. le Rapporteur : Ils sont basés où ?
M. Philippe LOUIS-DREYFUS : A nos bureaux, à Paris !
M. le Rapporteur : Ils se déplacent ?
M. Philippe LOUIS-DREYFUS : Ils se déplacent énormément ! Ils vont voir les bateaux en permanence, sans attendre qu'ils viennent en France.
Nous faisons suivre l'ensemble de ces navires et de ces grues flottantes, où qu'ils soient, par ces équipes implantées à Paris. Ce sont des salariés stables ! Nous ne faisons pas appel à des services extérieurs pour suivre nos navires. Par rapport à la flotte, cela fait un pour trois ou quatre.
M. André MAIRE : En général, il y a un super intendant et un ingénieur d'armement pour trois ou quatre bateaux. Cela dépend des bateaux et de la facilité d'entretien. Le chef du service technique est lui-même couvert par un patron d'armement. Nous ne sous-traitons rien pour ce qui concerne l'armement, ni la maintenance ni l'équipage !
M. Philippe LOUIS-DREYFUS: Au contraire, nous gérons des navires pour d'autres. Les super-intendants dont je parlais ont des navires affectés indépendamment du pavillon. Ils peuvent avoir un Panaméen, un Français, un Brésilien, etc.
Accolé à ce système d'armement, nous avons une cellule sécurité mise en place quand je suis arrivé. Nous sommes ISO 9002 et ISM depuis 1996-1997.
Nous avons été ISO 9002 avant d'être ISM puisque nous avions d'abord commencé par cette démarche !
M. André MAIRE : Il y a un grand tronc commun entre les deux démarches !
M. Philippe LOUIS-DREYFUS: Nous avons été dans les premiers à l'être en France...
M. le Rapporteur : Sur l'ensemble de l'armement ?
M. André MAIRE : La partie armement des navires était ISO 9002 avant que l'ISM ne soit obligatoire ! Nous avons commencé à l'époque et nous avons continué.... Les certifications sont arrivées en 1998...
M. Philippe LOUIS-DREYFUS : La personne qui a constitué avec son équipe la cellule qui a été l'élément de base vis-à-vis de Veritas pour les certifications ISM et ISO est aujourd'hui responsable assurance - qualité. Les salariés suivent l'ensemble des problèmes de sécurité en dehors de ce qui est fait par les services techniques.
M. André MAIRE : Ils rapportent directement à la Direction générale...
M. le Rapporteur : Combien de personnes y a-t-il dans cette cellule ?
M. André MAIRE : Deux !
M. le Rapporteur : Avez-vous la même société de classification sur l'ensemble de vos bateaux ? Sont-elles différentes ? Comment les choisissez-vous ?
M. Philippe LOUIS-DREYFUS : Nous en avons deux : Bureau Veritas en large partie et le Lloyd's register.
M. le Rapporteur : Y compris sur les bateaux que vous immatriculez à Panama ?
M. André MAIRE : Absolument !
M. Philippe LOUIS-DREYFUS : Nous ne faisons aucune différence dans la façon de gérer techniquement la sécurité pour les navires français, les TAAF, et les autres !
M. André MAIRE : Nous sommes on line en permanence ! Nous avons un service d'astreinte avec nos navires vingt-quatre heures sur vingt-quatre : une personne peut toujours être contactée !
Tous les soirs, les responsables des cellules partent avec une mallette sécurité qui contient deux portables, des dossiers de consignes de sécurité, des listes de téléphones, etc. Dans nos locaux, nous avons un bureau réservé à la cellule de crise avec 10 lignes de téléphone pour pallier aux encombrements et un téléphone rouge. Bref, nous avons tout un système d'astreinte 24 h/24. L'astreinte peut être à trois niveaux. Ce sont tous des super intendants qualifiés qui peuvent répondre immédiatement. Si le problème les dépasse, il existe un deuxième niveau... Ils appellent des responsables, comme le patron du service technique ou le patron de l'armement. Eventuellement, il y a un troisième niveau qui fait appel au Président, en cas de grave accident par exemple. Mais nous sommes en permanence en liaison avec les bateaux vingt-quatre heures sur vingt-quatre et le dispositif qui fonctionne depuis plus de deux ans déjà marche très bien.
M. le Rapporteur : Depuis que vous avez mis en place le dispositif ISM ?
M. André MAIRE : Nous l'avions déjà !
M. le Rapporteur : Recrutez-vous le personnel directement ou passez-vous par des sociétés spécialisées ?
M. André MAIRE : Pour les officiers, le recrutement relève de notre directeur des relations humaines de la division maritime. Il y a une DRH dans le groupe Louis-Dreyfus à Paris et une DRH spécifique pour les officiers navigants.
M. le Rapporteur : Quel est le pourcentage d'officiers français et d'officiers étrangers ?
M. André MAIRE : En général se sont des Anglais ou bien maintenant des Croates. Nous avons pris des équipages croates complets, avec les officiers. Ce sont toujours des gens qui ont été soumis à des entretiens, qui ont de l'expérience.
M. le Rapporteur : Vous avez votre propre système de sélection ?
M. André MAIRE : Oui, tout à fait !
M. le Rapporteur : Et pour les équipages ?
M. André MAIRE : Nous passons souvent par des sociétés de main d'_uvre.
M. Philippe LOUIS-DREYFUS : Pour nos navires Kerguelen - TAAF, nous avons fait le choix d'officiers français avec un équipage non français.
M. le Rapporteur : Ma question concerne indirectement la sécurité : comment faites-vous pour recruter vos équipages ? Vous avez donc des organismes spécialisés que vous validez sans doute parce qu'il y a beaucoup de monde sur le marché, avec des gens plus ou moins sérieux...
M. André MAIRE : Nous les validons !
M. le Rapporteur : Vous les connaissez et vous les faites contrôler?
M. André MAIRE : Oui ! Le DRH et le capitaine d'armement vont les voir, les connaissent. Ils viennent chez nous ! A l'origine, quand on a fait les pavillons Kerguelen, c'était un armateur turc qui nous fournissait l'équipage. Au départ, dans les pavillons Kerguelen, nous avons donc mis des marins turcs. Nous avions fait le choix de prendre des équipages européens et non asiatiques. Nous étions en association avec des Turcs à qui nous avions demandé de nous fournir des équipages. Maintenant, il n'est plus évident de trouver des marins en Turquie. Nous avons finalement pris d'autres équipages. Mais nous les sélectionnons !
M. Philippe LOUIS-DREYFUS : Nous avons déjà changé plusieurs fois d'agence parce que nous n'étions pas satisfaits. Nous travaillons aujourd'hui avec des gens à peu près convenables qui nous donnent un bon service.
M. André MAIRE : Mais certains marins philippins nous sont encore fournis par un ancien partenaire avec qui nous avions des relations armatoriales. Nous avions des navires en copropriété. Nous n'en avons plus ! Mais l'intéressé, toujours armateur, a une dizaine de navires et il continue à nous fournir des marins à la demande. Ce n'est pas uniquement une société de main d'_uvre. Il est vrai qu'aujourd'hui, nous avons deux ou trois équipages croates qui sont très bons, fournis par une agence spécialisée croate...
M. le Rapporteur : Vous faites vérifier le niveau de qualité du marin par une équipe spécialisée. Ou la qualité de l'agence ?
M. André MAIRE : Oui !
M. le Rapporteur : Vous est-il arrivé de changer d'agence pour des raisons de qualité de l'équipage ?
M. André MAIRE : Bien sûr ! Ce sont les commandants qui nous disent ce qu'ils en pensent. Ainsi, nous avons un suivi des organismes qui nous fournissent les marins. Quand on connaît le prix d'un bateau neuf, on ne va pas s'amuser à mettre n'importe qui sur les bateaux, à 45 millions de dollars l'unité ! De même, nous n'avons pas du tout intérêt à avoir des bateaux qui se dégradent rapidement !
L'âge de notre flotte - et je ne parle pas des trois bateaux sur la Turquie - pour les bateaux de 170 000 tonnes qui font du vrac doit être de trois ou quatre ans. Pas plus ! L'année dernière, nous avions quatre navires polonais et le plus vieux datait de 1993.
M. Philippe LOUIS-DREYFUS : Les bateaux sismiques sont récents aussi, même s'ils ont été transformés. Le navire neuf a été fabriqué à Saint-Nazaire. Les autres ont été remodelés et transformés ; la coque est ancienne mais la transformation a été faite il y a deux ans. C'est le cas principalement des vraquiers qui constitue notre activité principale.
M. le Rapporteur : Votre assureur vérifie-t-il la qualité de votre équipage ?
M. André MAIRE : Je ne pense pas que les assureurs le fassent. Les Clubs, eux, font souvent des visites sur les bateaux. C'est le cas pour P&I.
M. le Rapporteur : Est-il arrivé à P&I de faire des visites de vérification de la qualité du personnel ?
M. Philippe LOUIS-DREYFUS : Non, P&I veille à l'aspect technique et à la sécurité !
M. André MAIRE : Nous avons des procédures qui ne sont pas obligatoires. Nous les faisons parce que nous ne voulons pas avoir de pépins du type Erika. Nous avons par exemple un système de computer avec le Lloyd's register ! Tous nos gros navires, chargés ou sur ballast, et qui peuvent faire l'objet d'un accident, d'un échouage, d'un abordage, sont modélisés. Tous nos éléments hydrostatiques sont rentrés dans les ordinateurs, avec un modem, ce qui permet de faire tous les calculs de coque, à tout moment. Ce système est accessible vingt-quatre heures sur vingt-quatre.
Ensuite, quand un navire appareille pour un voyage de plus de trois jours, nous recevons l'état des poids. Cela fait partie des papiers qui sont mis en possession du commandant qui peut dire ainsi qu'il a, par exemple : 1 000 tonnes de soude dans un ballast, 5 000 tonnes de minerai dans la cale 1, 6 700 tonnes dans la cale 2, etc. On connaît ainsi exactement l'état des poids et la fatigue du bateau. De même, en fonction des mouvements de ballast qui vont être faits à la mer, le commandant sait si le navire reste dans ses contraintes de fatigue.
S'il arrive un « pépin » une voie d'eau par exemple, on peut entrer immédiatement en contact avec le système de calcul, voir qu'il y a 4000 tonnes dans le ballast tribord n°2. Et dire ce qu'il faut faire....
M. le Rapporteur : Qui le leur dit ?
M. André MAIRE : C'est la cellule de crise qui communique directement au centre de calcul... Immédiatement, le Lloyd's register va nous dire : « Faites ceci, faites cela... » Des conseils sont donnés pour prendre éventuellement des marges avec la ruine de la structure, s'il y a eu un abordage ou autre. C'est quelque chose que nous faisons sur tous nos gros navires... Nous savons entrer dans ce système qui, de notre point de vue, est très important. Ainsi, quoi qu'il arrive, vous ne prenez pas les mauvaises décisions. Du moins, nous avons un appui logistique qui va nous permettre de conclure dans tel ou tel sens !
M. Philippe LOUIS-DREYFUS : Ce ne sont pas des décisions prises par hasard ou dans un moment d'affolement et de crise !
M. le Rapporteur : Vous pourriez nous faire une petite note là-dessus d'une page ?
M. André MAIRE : Je la ferai moi-même...
M. Philippe LOUIS-DREYFUS : Nous serions volontiers venus avec notre responsable qualité mais il est au Japon sur un bateau.
M. André MAIRE : Nos commandants remplissent un questionnaire et ils le renvoient au siège qui l'envoie immédiatement au centre de calcul en cas de pépin ! C'est là une des mesures que nous prenons sur nos gros bateaux.
Par ailleurs, nous sommes également entrés aux Etats-Unis dans le système des pétroliers, c'est-à-dire que nous avons un représentant local pour la pollution qui est en liaison avec une société spécialisée dans le contrôle. Bien que cela ne soit pas obligatoire, tous nos navires sont dans le système.
M. le Rapporteur : C'est obligatoire aux Etats-Unis !
M. André MAIRE : Pour les pétroliers ! Nous n'avons pas de pétroliers ! Tous nos navires de vrac sont entrés dans le système.
M. Philippe LOUIS-DREYFUS : Un bateau de vrac a quelques milliers de tonnes de soute.
M. André MAIRE : Un bateau de vrac peut aborder un pétrolier et il peut être responsable. Nous avons donc adopté le système pétrolier.
M. le Rapporteur : Vous trouvez que c'est un bon système ?
M. André MAIRE : Nous, nous le pensons car il y a cette concentration de pouvoirs.... Les Coast Guards n'ont qu'un interlocuteur. Tout est planifié ! S'il y a un problème, on sait qui s'engage ! Le seul interlocuteur des Coast Guards est sur place ; il a des contrats avec les sociétés qui ont des équipements... En tout cas, c'est un bon système de centralisation et tous les intervenants ne vont pas dans tous les sens ! Nous avons des exercices réguliers avec eux dans le cadre de la prévention !
Je ne pense pas qu'on puisse faire beaucoup mieux ! Il faut bien comprendre qu'avec des bateaux de 40 ou 50 millions de dollars on ne peut pas se permettre n'importe quoi, les laisser s'arrêter quelques jours dans un port parce qu'il manque tel ou tel matériel, un extincteur par exemple ! Nos super intendants vont sur les bateaux très régulièrement ; ils passent plus de six mois en voyage. Nous avons des contrôles permanents. Chaque fois qu'il y a un pépin des formulaires sont remplis puis envoyés à terre et analysés. Ils font l'objet de publicité sur tous les navires pour bien faire comprendre ce qui est arrivé sur tel ou tel navire...
M. Philippe LOUIS-DREYFUS : Il y a un traitement de l'expérience de tous les incidents qui dérogent à la procédure habituelle ou à la situation normale et il fait l'objet d'une grande diffusion.
M. André MAIRE : Cela fonctionne bien ! Dès qu'un marin glisse sur le pont et se casse un bras, cela fait l'objet un rapport d'accident. Cela revient au siège chez le responsable assurance-qualité qui est indépendant du système d'armement et de l'entretien... Il informe le responsable de l'entretien de ce qui est arrivé et il lui demande quelle mesure il compte prendre. Il avertit, le cas échéant, la Direction générale en indiquant qu'il y a un problème et qu'il considère que le service entretien ne prend pas les mesures nécessaires en matière de sécurité.
Il y a donc tout un système qui fonctionne assez bien, avec des réunions de direction régulières, des rapports d'accident. Je pourrais vous montrer nos manuels, c'est-à-dire trois gros bouquins... Nous allons au-delà de l'ISM. C'est un peu comme sur les avions où l'on dit aux passagers qu'il faut attacher les ceintures ! Nous pensons qu'il est bien d'avoir des rappels en ce qui concerne toute la vie du bord. Pour le mouillage, par exemple et ce n'est pas dans l'ISM, nous avons des procédures rappelant ce qu'il faut faire pour bien agir. Nous avons également des procédures en ce qui concerne le minimum de pièces de rechange, les corrections de cartes, etc. Nous avons eu du mal à mettre tout cela en place, mais maintenant tout est bien rodé.
M. Philippe LOUIS-DREYFUS : Ce n'est pas toujours bien accepté. Moi-même, quand je suis arrivé, les procédures mises en place pour l'ISM et pour l'ISO 9002 me paraissaient extrêmement lourdes, avec une énorme perte de temps et de papier ! J'ai toujours en partie le même point de vue mais cela a quand même eu un impact. En tout cas, cela nous a permis une réflexion interne sur les procédures à suivre, sur des actions que l'on faisait bien ou que l'on faisait mal. Cela nous a permis sans doute d'être beaucoup plus performants en matière de sécurité et de qualité qu'antérieurement. Ces procédures nous ont apporté beaucoup, même si au départ on pouvait les considérer comme une espèce d'usine à gaz.
Par contre, il y a beaucoup de procédures excessives et dont on pourrait se passer. Mais inversement, comme le disait André Maire, on a rajouté délibérément de notre propre fait un certain nombre de contrôles qui nous paraissaient indispensables.
M. André MAIRE : La sécurité, c'est un état d'esprit ! Quand j'étais commandant, un capitaine qui s'arrêtait, pour cause d'avarie ou d'incident n'était pas forcément un bon commandant. Il ne fallait pas arrêter le bateau ! Il ne fallait pas dire qu'il y avait un problème... Ces procédures ISM et toute cette démarche vers la qualité font qu'aujourd'hui les commandants se sentent libres de dire : « J'ai un pépin sur mon bateau... Avant d'appareiller, je vais réparer ! » Il y a trente ans, ce n'était pas le cas... On disait « On verra cela au retour... » Aujourd'hui, vous ne trouvez plus un commandant qui, s'il y un ballast « crevé », acceptera de partir... Il dira qu'il faut appeler un chantier... De même, vous ne trouverez plus beaucoup de commandants qui acceptent de jeter des déchets à la mer.
M. le Rapporteur : Chez vous ! Il y en a ailleurs...
M. André MAIRE : Sûrement, mais l'ISM n'est en place que depuis 3 ans et il faut du temps pour imprégner les esprits. Il est d'ailleurs vraisemblable que certaines sociétés ont acheté leurs manuels sans faire une véritable démarche. En ce qui nous concerne, nous y avons mis le temps, cela n'a pas été facile notamment la première année. Au total, cela nous a pris près de 3 ans mais nous pensons que nos procédures sont bien en place au point qu'on nous a déjà demandé de les vendre.
Certes, il y a toujours des bateaux un peu bizarres, avec à la base simple acquisition d'une coque, puis revente et plus-value. La démarche ISM fait que la sécurité devient de plus en plus essentielle pour les commandants. Avant les commandants disaient au super intendant qui venaient à bord qu'il y avait tel ou tel pépin. Le super intendant faisait ce qu'il voulait ! Aujourd'hui, les commandants ne le disent même plus au super intendant. Cela vient directement à la sécurité ou à Paris par des notes, par des formulaires. Même les super intendants ne peuvent plus dire au commandant, comme ils le faisaient antérieurement, « On verra plus tard pour ce problème... » C'est dire qu'il s'installe une atmosphère de sécurité. Un commandant n'estime plus être un mauvais commandant parce qu'il a attendu deux jours avant de partir ! En tout cas chez nous un tel état d'esprit est en place. Plus aucun commandant n'hésite à dire qu'il ne part pas pour telle ou telle raison. Les commandants se sentent concernés, ils savent qu'ils sont responsables et que la sécurité est devenue une question très importante.
M. Philippe LOUIS-DREYFUS : En tant que président, je me réjouis que cela se passe ainsi ! Les commandants sont responsables et je le suis en dernier ressort, ce qui est tout à fait normal.
M. André MAIRE : Les commandants se concertent et l'état d'esprit change !
M. le Rapporteur : Vous avez eu le label ISO 9002 en raison de ce dispositif de sécurité particulier ?
M. André MAIRE : Le label ISO 9002 fait partie des audits que nous avons passés avec succès ! Avant d'être ISM, on était ISO 9002. Comme on avait prévu que l'ISM allait sortir, nous avons considéré qu'avec ISO 9002, 80 % du travail serait fait. .
M. le Rapporteur : Avez-vous des observations sur la politique française en matière d'encouragement au shipping ?
M. Philippe LOUIS-DREYFUS : On peut faire la jonction avec les questions de sécurité ! Vous avez parlé des grecs ou des armements qui n'ont pas forcément les mêmes conditions de sécurité. Certains de ces armateurs là, au demeurant très sympathiques, font très bien leur boulot. Ils sont en concurrence avec nous sur les mêmes trafics, sur les mêmes dossiers, sur les mêmes appels d'offres, sur les mêmes affréteurs, internationaux, français ou pas. Par définition, de par la loi de l'économie, ils sont a priori moins chers parce qu'ils n'ont pas les contraintes que nous nous imposons...
M. le Rapporteur : Ils ne s'imposent pas les mêmes contraintes !
M. Philippe LOUIS-DREYFUS : Non, ils ne s'imposent pas les mêmes contraintes ; ils n'ont pas les mêmes bateaux ; ils n'ont pas les mêmes équipages. Nous sommes en concurrence : le marché maritime qui est le nôtre, en particulier celui du vrac sec, est un marché complètement compétitif. Les affréteurs, quels qu'ils soient, - je ne citerai pas de nom, d'autant que c'est un fait global et mondial - iront toujours au moins cher dans 99 % des cas, et ce quoi qu'ils puissent dire en public officiellement, sur leur volonté de privilégier l'armateur de qualité et les bateaux en bon état. Ce « moins cher » peut être quelquefois un armement de très bonne qualité et quelquefois un armement, un navire, un assureur, une banque de moins bonne qualité. C'est souvent avec eux qu'il y a des problèmes et des catastrophes. Quand on est un armateur sérieux, on n'est jamais à l'abri d'un problème.
C'est un métier difficile et compliqué, avec la mer et les intempéries en plus. On ne peut pas tout régler, mais, étant donné la façon dont les grands armements sérieux font leur boulot, il y a moins de chances d'avoir des ennuis.
Pour des raisons diverses, nous sommes très attachés à l'armement français, au pavillon français, pour faire le métier de base qui est encore le nôtre : le transport de vrac. C'est un marché complètement concurrentiel et compétitif. C'est un peu humiliant de demander de l'aide mais il s'agit simplement d'être placé au niveau où sont les autres. Nous faisons la même course avec des handicaps. Nous partons pour le même marathon mais avec un sac de vingt-cinq kilos sur le dos. Ce sont les charges sociales excessives, d'abord et surtout. Mais il y a beaucoup d'autres choses qui pourraient être faites. On va sans doute un jour manquer de personnel. On commence déjà à en manquer dans la flotte française. Les officiers français sont de très grande qualité - ils sont souvent à bac plus quatre ou cinq - mais ils ont tendance à aller ailleurs ; dans l'industrie ou dans les activités para maritimes où on les paye beaucoup mieux. Nous sommes quant à nous soumis à des contraintes liées à la concurrence internationale. Il faut donc que l'on soit aidé, soit par une baisse des charges soit par des subventions. Mais je préfère que l'on nous retire un poids du dos plutôt que de nous donner de l'EPO...
Il faut aussi, si on le peut, s'orienter vers une défiscalisation des salaires des marins et des officiers. Tout le monde ne partage pas mon point de vue selon lequel une telle mesure devrait être mise en avant de façon prioritaire pour attirer des personnels et les garder. Il faudrait que cette mesure de défiscalisation bénéficie uniquement - et c'est là que je me différencie des autres - aux personnes concernées, à savoir les navigants. Certains disent que cela devrait profiter aussi à l'armement. Je ne partage pas ce point de vue ! Je considère que c'est une mesure destinée à attirer et maintenir des gens de qualité dont nous allons avoir besoin. Nous avons toujours une dizaine ou une douzaine de bateaux, je souhaite continuer à maintenir ce pavillon et même le développer. Si nous avons pu garder un pavillon français, c'est parce que nous avons les autres bateaux sous un autre pavillon...
M. André MAIRE :Cela permet en effet de « péréquer » un peu !
M. Philippe LOUIS-DREYFUS : Aujourd'hui, en matière de vrac, nous essayons de maintenir le pavillon français mais nous avons aussi d'autres activités plus sophistiquées, à plus de valeur ajoutée ! Ce sont les navires sismiques, les bateaux Alcatel, poseurs de câbles ou de maintenance, ce qui justifie le surcoût des pavillons européens, notamment français. Pour un appel d'offre international d'Alcatel, il y a eu une douzaine d'armements en lice Nous nous sommes bagarré contre les Norvégiens et les Anglo-américains qui n'avaient pas les mêmes contraintes que nous. Sur des affaires de ce type, le handicap est plus faible et on peut, à la limite, l'assumer. Mais pour le transport de vrac, qui restera une activité de base pour nous, nous retirer les handicaps dont j'ai parlé est une question de vie et de mort. Il faut que l'on nous aide avec des mesures qui sont à l'étude aujourd'hui, compte tenu de la décroissance de la flotte. Nous sommes un des derniers armements français de taille internationale à être véritablement en butte à la concurrence internationale complète, car les autres armements sont des armements de ligne ! Nous sommes les seuls à être sur un marché complètement classique et ouvert, celui du vrac international . Il est difficile de se maintenir ! Il faut avoir le c_ur bien accroché et avoir envie de le faire. Ce qui est notre cas et nous le prouvons.
Avec les aides telles que les quirats ou les GIE aujourd'hui ....
M. le Rapporteur : Que pensez-vous des GIE ? Les utilisez-vous ?
M. Philippe LOUIS-DREYFUS : Oui ! Les bateaux Alcatel seront construits dans le cadre du GIE. Cela nous a permis d'être tout juste compétitifs ! Il est indéniable que s'ils avaient été maintenus, les quirats auraient permis un développement de la flotte française. Les GIE vont peut-être aider à son maintien au niveau actuel, notoirement insuffisant, vu la vocation maritime de la France avec le nombre de kilomètres de côtes et son importance en tant qu'exportateur. Elle a besoin pour exporter, pour fabriquer des Airbus et des TGV, d'importer du minerai et du charbon; c'est aussi une nécessité pour la stratégie et pour l'indépendance militaire et économique du pays. Je le pense profondément et ce ne sont pas de simples paroles de circonstance pour essayer d'obtenir du « fric ».
M. le Rapporteur : Je souhaite que vous puissiez me faire parvenir ces documents dès que vous le pourrez et peut-être aussi la liste de la flotte avec le type de bateaux, la plaquette de présentation, le dispositif de sécurité...
M. André MAIRE : Je souhaite préciser ce que j'ai dit tout à l'heure à propos de l'utilisation du pavillon panaméen pour une réduction des coûts. Nous ne recherchons pas une réduction des coûts à tout prix ! Le problème est posé par rapport au pavillon français. Je veux quand même dire que toute notre flotte est ITF.
M. Philippe LOUIS-DREYFUS : Nous payons nos équipages ITF certainement le double ou 50 à 60 % de plus que certains armements français qui font appel au même pavillon. Je ne citerai pas de nom.
M. le Rapporteur : Parlant du Liberia et de Panama, je vous provoquais un peu parce que j'ai les chiffres ! Nous venons de voir le Liberia la semaine dernière, mais c'est un peu particulier car c'est en fait un armement américain : le siège, l'organisation du Liberia est à Washington. C'est une entreprise !
M. André MAIRE : On les connaît ! On a eu quelques bateaux sous le Liberia.
M. le Rapporteur : Telles sont les statistiques aujourd'hui et ce point est assez frappant. On a pu voir les Maltais...Comme ils sont « plombés » par l'Erika, ils font des efforts très importants. De plus, il y a la perspective de leur entrée dans l'Union européenne, qui est conditionnée par les efforts sur la sécurité.
M. André MAIRE : La réduction des coûts est une vraie question. Nous recherchons la réduction du coût de l'équipage par rapport aux coûts français. Mais nous n'avons pas d'équipage qui ne soit pas ITF et tous nos navires sont entrés à l'ITF. D'ailleurs, les personnels ne travaillent pas bien s'ils sont sous-payés, il faut qu'ils soient payés au moins au niveau de leur pays et un peu mieux même, en dollars. Nous ne poursuivons pas la recherche de la réduction des coûts à tout prix.
M. Philippe LOUIS-DREYFUS : Le même bateau pavillon de libre circulation ou pavillon TAAF c'est 50 % de plus et par rapport au pavillon français, c'est presque le double.
M. le Rapporteur : Vous êtes le seul armement français à être complètement sur le marché international. Il serait intéressant que vous puissiez me donner les éléments de comparaison 1999 pour un bateau de même type car nous avons ces éléments d'une manière trop globale.
M. André MAIRE : Les coûts d'équipage sont différents. L'entretien et l'assurance, sont comparables. Nous ferons une décomposition des coûts. Par contre, vous aurez chez nous des bateaux avec sept officiers. C'est dire que des navires peuvent avoir un différentiel plus grand que celui que l'on vous donnera !
M. le Rapporteur : Combien de vraquiers avez-vous en Kerguelen ? Pourquoi les laissez vous ainsi sur Kerguelen ?
M. André MAIRE : : Nous avons 7 navires vraquiers plus 2 navires polyvalents et les navires sismiques, cela doit en faire 15 au total.
M. le Rapporteur : Normalement, vous mettez vos vraquiers sous pavillon international ?
M. Philippe LOUIS-DREYFUS : Absolument !
M. le Rapporteur : Sauf quand il y a des aides qui vous obligent à les maintenir pendant un certain temps !
M. Philippe LOUIS-DREYFUS : Nous avons sept ou huit vraquiers sous pavillon TAAF.
M. André MAIRE : Nous vous enverrons les éléments souhaités, avec un tableau de comparaison de deux navires identiques.
M. Philippe LOUIS-DREYFUS : L'Erika est un accident que l'on regrette profondément mais il est certainement porteur de beaucoup d'espoirs pour les armements sérieux.
M. le Rapporteur : Tout à fait !
M. Philippe LOUIS-DREYFUS : Il ne s'agit pas de dire merci à l'Erika !
M. le Rapporteur : La catastrophe de l'Amoco-Cadiz avait déjà entraîné un certain nombre de mesures non négligeables. Si elles n'avaient pas été prises, nous aurions eu certainement d'autres catastrophes. Je pense aux problèmes de circulation en Manche. Il faut que l'Erika fasse le reste !
M. Philippe LOUIS-DREYFUS : Il y a de gros efforts à faire en matière de réglementation, au niveau de l'armement, au niveau de l'administration. Votre idée d'une centralisation au niveau français ou européen paraît excellente. Il y a aussi peut-être des efforts à faire au niveau des affréteurs pour les inciter à faire appel à des armements sérieux et pas forcément moins chers.
M. le Rapporteur : Vous êtes donc favorables à la responsabilisation des affréteurs !
M. Philippe LOUIS-DREYFUS : Les amener à affréter des navires de qualité me paraît bien et c'est ce que nous faisons dans notre groupe qui est aussi affréteur. Nous avons une affaire de négoce et nous affrétons des bateaux de céréales et des pétroliers. Nous avons des mesures internes et un vetting interne qui nous amènent à faire que les différents affréteurs du groupe choisissent des navires selon des critères bien déterminés.
M. le Rapporteur : Le vetting interne du groupe est différent pour cette partie du service technique de la partie armement du groupe ?
M. Philippe LOUIS-DREYFUS : Nous affrétons près de 2000 bateaux par an. L'année dernière, nous étions le premier affréteur mondial. Nous avons Cargill et les grands pétroliers.
M. le Rapporteur : Vous avez une équipe de vetting ?
M. Philippe LOUIS-DREYFUS: La procédure de vetting a été mise en place avec l'appui, le conseil, l'expérience de nos équipes armement, bien entendu : l'âge du navire, la classe, le changement de propriétaire, le changement de classe entrent en ligne de compte. ...
M. le Rapporteur : Je suis désolé de ne pas avoir abordé cette question là avant et je me suis trop centré en fait sur votre métier d'armateur et pas suffisamment sur votre métier d'affréteur.
M. Philippe LOUIS-DREYFUS : Cela vaudrait la peine d'en parler !
M. André MAIRE : Le problème de l'affréteur, c'est qu'il ne peut pas voir tous les bateaux ! Mais au moins, comme disent les Anglais, il faut qu'il fasse un peu diligence et qu'il fasse un minimum de vérifications ! Il peut au moins poser des questions à l'armateur et considérer qu'il y a certaines procédures à suivre. Il peut vérifier qu'il soit assuré, qu'il soit dans un Club. Il doit savoir si le bateau a été vendu la semaine précédente, par exemple...
M. le Rapporteur : Au niveau des affréteurs, nous avons reçu les grands pétroliers !
M. Philippe LOUIS-DREYFUS : Nous sommes un des plus grands affréteurs mondiaux mais la plupart des affrètements se font par Londres, par les Etats-Unis, par Singapour...
M. le Rapporteur : Le problème n'est pas celui de l'armement et de l'affrètement français mais celui de la circulation. Une partie de vos bateaux affrétés passent en Manche.
M. André MAIRE : Nous avons une chance en matière de pétrole : nous avons un goulot d'étranglement pour nos bateaux. Nous ne chargeons notre pétrole qu'à la raffinerie car nous avons une raffinerie ! Tous les pétroliers que nous affrétons viennent et sont visités. Nos personnels sont en train de remettre au point une sorte de questionnaire.
M. le Rapporteur : Nous vous interrogerons peut-être en complément sur cette question. Il serait intéressant que nous ayons plus d'informations sur votre système de vetting affréteur.
M. André MAIRE : Nous sommes en train de refaire notre questionnaire d'affrètement et il est bien avancé !
M. Philippe LOUIS-DREYFUS : Nous le remettons à plat, en liaison avec Electricité de France, dans la cadre du négoce électricité. EDF nous a demandé de suivre cette question d'assez près puisque cette activité conduit à affréter beaucoup de navires, pour le fioul, pour le charbon, pour le pétrole aussi. Nous travaillons sur cette question. Quand il sera fini, nous vous le transmettrons, sachant que c'est en principe un document interne et confidentiel.
Audition de M. Antonio PINGIORI, chef de la division marine,
et de M. Massimo VOLTA, chef de la section navires en service,
du RINA
(extrait du procès-verbal de la séance du 25 mai 2000)
Présidence de M. Jean-Yves LE DRIAN, Rapporteur
MM. Antonio Pingiori et Massimo Volta sont introduits.
M. le Président : Messieurs, je vous souhaite la bienvenue parmi nous. Comme vous le savez, après l'exposé introductif que vous nous présenterez, votre audition se déroulera sous forme de questions et de réponses.
Je vous rappelle également que, bien que votre audition se déroule à huis clos, la commission pourra décider de citer dans son rapport tout ou partie du compte rendu qui en sera fait. Ce compte rendu vous sera préalablement communiqué. Les observations que vous pourriez faire seront soumises à la commission.
Comme vous le savez aussi, les personnalités françaises entendues par les commissions d'enquête prêtent serment. Acceptez-vous de vous conformer à cette formalité, ce qui à mon sens donnerait d'autant plus de poids à cette audition ?
(MM. Antonio Pingiori et Massimo Volta prêtent serment).
M. le Président : La commission va procéder maintenant à votre audition qui fait l'objet d'un enregistrement.
Avant de vous donner la parole, Messieurs, je souhaite toutefois rappeler solennellement à l'ensemble des personnes ici présentes, et notamment à mes collègues, qu'en application de l'article 6 de l'ordonnance n° 58.1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, la commission ne peut enquêter sur des faits donnant lieu à des poursuites judiciaires en cours.
Nos échanges ne devront donc en aucune manière porter sur les causes particulières du naufrage de l'Erika et moins encore rechercher quels sont les responsables directs de cet événement.
M. Antonio PINGIORI : En quelques mots d'introduction, je souhaite vous présenter le registre italien naval, RINA, qui a été créé en 1861 à Gênes. Il est l'une des sociétés de classification les plus anciennes et membre fondateur de l'IACS.
Le groupe est une organisation indépendante, agissant au niveau international afin de contribuer, dans l'intérêt de la communauté, à la sauvegarde de la vie de l'homme, des biens et de l'environnement.
C'est un organisme privé, sans but lucratif. Récemment, à la suite de la transcription de la directive communautaire n°94-57 par l'Etat italien, le registre italien naval, pour poursuivre son activité, a constitué la société par actions RINA-SPA.
Ses missions et son but social sont, dans le cadre des règles nationales, communautaires et internationales, de procéder à des activités de contrôle, de vérification, de certification et de recherche ayant trait à des projets technologiques, des produits, des installations dans le secteur maritime ainsi que dans le secteur de la production, et ce conformément à des demandes qui lui sont transmises par l'administration publique ou d'autres autorités.
Sa gestion ressortit du secteur privé, comme la plupart des sociétés de classification étrangères.
S'agissant de son statut, cet organisme comporte un conseil d'administration, un président, un vice-président, un comité exécutif et un comité technique, lequel est constitué de membres nommés par le conseil d'administration, de membres désignés directement par le ministre italien des transports et de la navigation, ainsi que par le ministre de la défense. Ce comité se prononce sur les règlements ayant trait à la classification, les programmes de recherche et tout ce qui a trait aux aspects techniques. Ces éléments sont soumis à son examen par le président et le conseil d'administration.
Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, RINA-SPA a été créé en août dernier. Le siège de cette société est situé à Gênes. Elle est contrôlée majoritairement par le registre italien naval. Elle a pour organes de direction un conseil d'administration, avec un président et un administrateur délégué qui a des fonctions de directeur général.
L'organisation opérationnelle de RINA-SPA est constituée principalement en deux services : un « service technique » avec une division navale, une division de certification et une division industrielle, et un « service opératif », qui gère tout ce qui est fait par les bureaux périphériques. Puis, il y a un « service administratif » qui s'occupe de l'administration générale de la société et un service pour la gestion du personnel.
Je suis pour ma part responsable de la division navale technique à Gênes et mon collègue est responsable d'une des sections faisant partie de la division navale.
La tâche principale et traditionnelle de RINA est de procéder à la classification des navires. Il faut classer les bateaux, c'est-à-dire établir le degré de confiance que mérite chacun d'eux par rapport à la navigation qu'il va devoir effectuer.
Donner une classification veut dire que l'on respecte les conditions requises, telles que définies par les règlements dont RINA s'est pourvu.
Le processus de classification a trait à l'élaboration des normes et des règles ainsi qu'à tous les processus et procédures comportant le respect de ces règles.
Il s'agit d'abord de la vérification et du contrôle des projets puis du contrôle à bord de l'exécution de ces projets qui ont été approuvés par la direction générale. Il s'agit de surveiller l'exécution au cours de la construction des navires. Nos règlements prévoient l'exécution de toute une série d'opérations. Il y a d'abord l'approbation du concept et du projet, puis il est procédé aux différents essais.
S'agissant du renouvellement des certificats délivrés, les règlements prévoient des visites périodiques.
En plus de l'activité de classification, il existe comme pour tous les registres, une activité à la requête de l'administration.
En ce qui concerne les fonctions exercées par RINA pour le compte des administrations, vous connaissez notre activité concernant les navires battant pavillon italien. Les tâches statutaires s'opèrent en exécution d'un règlement de sécurité approuvé par l'administration italienne en juin 1962, règlement aux termes duquel RINA peut effectuer toutes ses activités de certification avec des délégations directes et indirectes. En effet, pour certains certificats statutaires - portant en particulier sur la sécurité dans la construction et sur les certificats de franc bord - l'administration italienne délègue à RINA la délivrance directe de ces certificats.
En ce qui concerne la délivrance des certificats de sécurité pour les bateaux accueillant des passagers et celle des certificats de sécurité et d'équipement pour les bateaux transportant des marchandises, l'administration italienne intervient, avec l'aide de RINA, par l'intermédiaire d'une commission de visite qui est constituée au fur et à mesure pour l'inspection de chacun des bateaux.
Avec l'entrée en vigueur de la directive n°94-57, RINA a obtenu la reconnaissance de la part de l'administration italienne et celle-ci, en ce moment même, est en train d'établir les procédures de délégation de ses fonctions dans le respect des régimes de concurrence fixés par la directive.
En outre, en plus de l'administration italienne, RINA a été autorisé par environ soixante-dix administrations à effectuer la délivrance des certificats statutaires dans le respect des conventions et conformément à des règles nationales quand les administrations s'en sont pourvues.
Pour les aspects autres que la délivrance des certificats, RINA a été la première société de classification qui a, en 1992, signé deux accords de collaboration avec la coast guard, en particulier pour les bateaux de croisière. Ces accords prévoient la délégation de tâches ayant trait à l'application de certaines parties de la convention SOLAS.
M. le Président : Pouvez-vous expliciter ce point ?
M. Antonio PINGIORI : En 1992, RINA a signé un accord de coopération avec le corps américain des coast guards. Sur la base de cet accord, RINA obtient délégation des tâches de contrôle à bord de bateaux de croisière neufs ou non neufs, dont le but est de naviguer aux Etats-Unis. RINA a obtenu cette délégation pour des raisons pratiques, car ce sont les Etats-Unis qui ont la responsabilité de contrôler le respect de la convention SOLAS pour les bateaux de croisière. Les Etats-Unis ont délégué à RINA une partie de cette activité.
S'agissant des critères pour la création des normes ou règles, RINA, comme toues les sociétés de classification, crée des règles sur la base des conventions internationales et des conditions préétablies par l'IACS. En conséquence, RINA met ces règles à jour : elles sont préparées par des techniciens de la division technique de la direction générale ; elles sont ensuite soumises à l'examen critique et préliminaire d'un groupe d'experts indépendants - ces derniers apportent à RINA une vaste expérience dans différents secteurs - ; elles sont ensuite approuvées par un comité technique du registre italien naval.
Ces réglementations représentent la base de toute l'activité du RINA, aussi bien en ce qui concerne l'approbation de la conception des plans, l'activité des techniciens et celle de la direction générale, que pour ce qui concerne l'activité des contrôleurs des zones périphériques qui disposent donc de la réglementation et de toutes les modalités techniques nécessaires pour rédiger les rapports et les instructions détaillées en vue de l'application et l'interprétation de la réglementation. Ils sont aidés dans cette tâche par un système d'information au niveau de l'entreprise.
Je peux vous donner deux informations concernant le RINA en termes de personnels.
Le personnel de RINA est constitué d'environ 650 employés. Nous avons 55 bureaux et 250 inspecteurs exclusifs.
Aujourd'hui nous classons ou certifions une flotte d'une capacité de 17,5 millions de tonnes, 45 % étant constitués par des bateaux battant pavillon italien et le reste par des bateaux battant pavillon non italien.
En guise de conclusion, j'aimerais évoquer ce qui continue d'être notre engagement international et notre activité au sein de l'OMI.
Nous avons fourni deux présidents à l'IMC et un premier directeur général, M. Pinelli. L'actuel vice-directeur général est M. Patofato.
Quelle est notre activité au sein de l'OMI ? Il nous est demandé d'assumer un rôle de conseil par l'administration italienne pour le compte de laquelle, depuis toujours, nous agissons en tant qu'organisme technique.
Notre participation aux comités et sous-comités de l'OMI avait comme objectif précis et primordial d'assister l'administration italienne sur le plan technique.
Hors de l'OMI, nous sommes également membres de l'IACS. Au niveau communautaire, nous avons toujours été présents dans les groupes de travail de la Communauté européenne puis de l'Union européenne pour prêter assistance à l'administration italienne.
Nous participons aussi, au niveau international, au travail effectué au sein de toutes les différentes organisations existantes.
Nous contrôlons, avec une attention plus particulière ces dernières années, l'activité des relations entre les administrations concernant le contrôle des navires. Nous avons créé à cette fin une section technique au sein de la division navale. Il s'agit de personnes qui s'occupent plus particulièrement d'un problème donné.
Tout à l'heure j'ai fait allusion brièvement à l'organigramme de RINA. En ce qui concerne plus particulièrement le secteur technique et naval, il existe des sections qui sont en rapport avec un département qui regroupe donc lui-même plusieurs sections. Le chef du département dépend du chef de la division navale.
Dans le département de la gestion des navires en exercice - qui effectue la classification -, il a été créé une section qui s'occupe directement de toutes les questions et problèmes liés à l'activité du contrôle par l'Etat du port.
M.Volta, si vous le souhaitez, peut entrer dans le détail de cette activité qui est importante pour nous. Elle consiste à contrôler toutes les problématiques qu'un navire peut rencontrer au cours de son exercice.
M. le Président : Pourriez-vous auparavant nous donner des précisions sur votre section spécifique pour le contrôle de l'Etat du port. Exerce-t-elle uniquement son activité pour l'Italie ?
M. Antonio PINGIORI : Nous appelons la section spécifique par un acronyme : ADM , c'est-à-dire « les relations avec l'administration ». Il s'agit d'une section qui s'occupe des relations avec les administrations pour tout ce qui concerne les problèmes de contrôle par l'Etat du port. Nous excluons l'administration italienne de ce cadre car nous avons à l'heure actuelle une délégation quasi totale pour la délivrance des certificats. Pour l'administration italienne nous exerçons donc directement une activité de flag state, au moyen de la délivrance de certains certificats et en participant aux commissions de visite pour la délivrance des certificats au nom de l'administration.
Revenons à la section ADM. Elle s'occupe des questions et problèmes concernant les navires ne battant pas pavillon italien. Il s'agit d'une activité de contrôle par l'Etat du port pour le compte de l'Italie.
L'activité de port state faite par l'Italie est une activité indépendante, c'est-à-dire une activité que l'administration italienne exécute de manière autonome.
Nous sommes un organisme technique de l'administration italienne. Chaque fois que celle-ci juge nécessaire d'avoir une vérification technique plus approfondie, elle peut se servir du support technique de RINA. Mais cette activité de port state est une activité auxiliaire à l'activité de port state de l'administration italienne. Il s'agit d'une activité discrétionnaire en fait de la part de l'administration italienne elle-même.
Si vous le souhaitez, je puis entrer dans le détail de certaines questions. Si vous voulez connaître notre activité en termes de contrôle de la flotte, il est important d'entendre en détail ce que représente notre activité et, si vous le permettez, M. Volta peut intervenir maintenant.
M. Massimo VOLTA : Je suis responsable de la section qui s'occupe des navires en exercice, laquelle appartient au département de la gestion de la flotte.
Dans ce département, il existe une section - M. Pingiori vous en a déjà parlé - qui s'occupe des relations avec les administrations. L'une des tâches de cette section consiste à interagir avec les parties concernées et à s'occuper des questions liées à l'activité du contrôle par l'Etat du port. Cette activité a été mise en _uvre par les administrations des ports pour contrôler le standard des navires étrangers qui arrivent dans les ports nationaux. Par exemple, en France et en Italie, cette section suit les résultats des contrôles des ports italiens et des ports français dans le cadre de réglementations internationales, comme la directive communautaire n°94-57 ou bien le Mémorandum de Paris.
L'esprit de ce contrôle par l'Etat du port est de vérifier que les navires qui arrivent dans les ports répondent aux normes internationales et nationales. Chaque fois que l'on rencontre une déficience ou quelque problème et que le bateau visité est considéré comme ne correspondant pas à ces normes, RINA, comme toutes les autres sociétés de classification, collabore directement avec l'administration qui a exécuté le contrôle de l'Etat du port, ainsi que le prévoit une norme procédurale de l'IACS. En substance, l'objectif principal est d'échanger des informations sur la nature des déficiences et, par le biais d'une collaboration, de ramener ce navire dans le cadre des standards des normes admises.
Dans ce cadre, RINA est actif depuis le début et il entretient des relations de coopération avec des administrations, telles que les coast guards américains, l'administration italienne et d'autres administrations, au niveau des directions générales et, à l'échelon local, au niveau des bureaux des représentants. Cette démarche a pour unique objectif de coopérer lors de l'exécution de ces contrôles.
Mise à part la tâche liée spécifiquement à l'intervention sur les navires, la section qui s'occupe des relations avec les administrations s'attache de toute façon à maintenir des contacts avec les administrations et les organismes qui s'occupent de ces activités, comme par exemple l'Union européenne, le Mémorandum de Paris, celui de Tokyo, et j'en passe.
En outre, la section a pour responsabilité de procéder à une analyse des statistiques concernant les déficiences rencontrées sur les différents navires pour pouvoir orienter les normes et les procédures afin d'éviter la répétition d'événements constatés sur les navires retenus dans les ports.
Les statistiques et l'expérience accumulée dans l'activité de contrôle des ports sont répertoriées dans une banque de données prévue à cet effet pour l'étude de ces événements. Sur la base de cette expérience, il est possible d'améliorer les procédures afin d'éviter que les navires restent dans les ports. Il s'agit ainsi de créer un « bagage culturel » qui permet, par exemple et comme ce fut le cas très récemment, de pouvoir prendre en charge des séminaires. Nous faisons part de notre expérience à l'administration italienne et dans ces séminaires les employés de RINA préposés à la coordination et à l'exécution des tâches concernant l'activité de contrôle par les Etats du port entrent en relation avec les fonctionnaires des différentes administrations qui s'occupent des mêmes problèmes. Il y a donc là un échange de points de vue qui débouche sur une coopération concernant l'activité de contrôle par les Etats du port, tout cela dans le but d'améliorer la procédure de coopération entre notre société de classification et l'administration qui exécute les contrôles dans les ports.
M. Antonio PINGIORI : Je voudrais ajouter encore quelques éléments relatifs à la création et à l'élaboration des règles. Nous avons toujours été impliqués dans l'activité des différents comités et sous-comités de l'OMI. Nous avons toujours été actifs et nous avons participé à l'élaboration des règles internationales. Grâce à cette expérience, nous avons très souvent inséré dans nos règlements, soit en ce qui concerne les classes, soit suite à des demandes spontanées, des éléments qui ont été exigés plus tard au niveau international.
Le code ISM en fournit un exemple. Au début des années quatre-vingt-dix nous l'avons introduit dans nos règlements de façon volontaire et nous avons essayé d'agir à l'égard de l'armateur pour qu'il se rapproche de ce type de règles, différentes par principe des règles relatives à la construction. Du côté de l'administration italienne, nous avons collaboré pour que cette norme entre en vigueur en avance, avant même la date requise par l'Union européenne, tant pour les bateaux de croisière que pour les bateaux-citernes en général qui battent pavillon italien.
A ce stade je n'ai rien à ajouter mais je suis disposé à apporter des précisions sur certains éléments à votre demande.
M. le Président : Nous souhaitons en effet vous poser quelques questions.
Quel est votre rôle en tant que société de classification exerçant une délégation de la certification des navires pour d'autres Etats que l'Etat italien ? Pour quels pays assurez-vous de fait ce rôle ?
Nous sommes allés à Malte et nous savons la place que vous y occupez. Quelle est votre action pour d'autres Etats que Malte où vous vous substituez à l'administration d'Etat - ce qui ne constitue nullement une faute - afin de valider la qualité des bateaux et les certifications ?
Autrement dit, quelle est la place que Malte prend dans votre activité et y a-t-il d'autres pays pour lesquels vous remplissez le même rôle ?
M. Antonio PINGIORI : Comme je vous l'ai dit, nous assurons des activités statutaires au nom des administrations, pour l'administration italienne bien sûr, mais aussi pour soixante-dix autres administrations pour lesquelles nous avons délégation pour délivrer la totalité ou une partie des certificats statutaires. Malte est une de ces administrations. Dans le respect de la convention de l'OMI qui prévoit les critères pour la délégation, l'administration nous a permis de délivrer les certificats pour le compte de l'Etat maltais. Elle est l'une des nombreuses administrations pour lesquelles nous pouvons délivrer ces certificats.
Voici une donnée plus précise : le nombre de navires pour lesquels nous avons délivré des certificats au nom de l'administration maltaise est d'environ 190 ! Cette donnée a été mise à jour fin 1999.
M. le Président : Quels sont les autres pays importants dans votre activité ?
M. Antonio PINGIORI : L'Italie est le plus important. Voici quelques chiffres qui illustrent le degré d'importance de l'activité de certification par RINA pour le compte de tel ou tel pays : RINA certifie 1 350 bateaux pour l'Italie, 190 pour Malte, 120 pour Panama, 37 pour le Liberia, 46 pour les Bahamas et 23 pour Chypre.
M. le Président : Il s'agit du nombre de bateaux que vous avez certifiés depuis de nombreuses années ou bien est-ce un chiffre cumulé ?
M. Antonio PINGIORI : Non ! Ce sont là les données qui ont trait à la flotte que nous certifions, avec mise à jour fin 1999.
Fin 1999, le nombre des navires battant pavillon italien certifiés était de 1 350. Le total de la flotte que nous certifions est de 2 000 navires environ. La différence - 2 000 moins 1 350 - vous donne une idée de l'importance de la flotte que nous certifions et qui ne bat pas pavillon italien.
M. le Président : Récemment, nous avons appris que votre société de classification avait refusé de continuer à classer des bateaux. Ce point a été relaté dans la presse voici un mois à peu près. Il s'agissait, me semble-t-il, de vingt-deux bateaux. Pour quelles raisons avez-vous refusé de continuer votre activité sur ces navires ?
M. Antonio PINGIORI : Naturellement, la direction générale de RINA crée des normes pour évaluer la qualité des navires. Ces normes sont appliquées pour les bateaux en activité par les techniciens de nos bureaux et de nos secteurs. Nous avons estimé, au cours des visites périodiques ou occasionnelles, que ces navires ne continuaient pas à conserver les niveaux imposés par nos règles.
M. le Président : Vous procédez à une telle démarche pour la première fois ou est-elle annuelle ?
M. Antonio PINGIORI : Je ne peux pas vous dire que cette démarche est menée annuellement, mais elle s'opère de façon continue car les techniciens des bureaux, en collaboration avec la direction générale, doivent évaluer et contrôler chaque navire en fonction ou chaque navire souhaitant être classé par RINA.
Au cours des précédentes années, nous avons refusé des navires qui demandaient la classification de RINA. Ils ont été refusés parce qu'ils ne correspondaient pas à nos prescriptions. De même, si des bateaux en fonction, soumis à des visites, ne respectent pas nos conditions requises, ils peuvent être exclus de nos registres de classification.
M. le Président : Nous avons des informations que vous connaissez sûrement et qui montrent que les contrôles effectués par les coast guards et dans le cadre du Mémorandum de Tokyo aboutissent à des ratios de rétention de navires calculés en fonction des sociétés de classification en exercice. Les résultats ne sont pas très satisfaisants pour RINA. Le savez-vous ? Avez-vous pris des mesures pour y remédier ? Avez-vous des commentaires à faire sur cette constatation ?
M. Antonio PINGIORI : Comme vous l'avez dit et comme l'a dit M. Volta tout à l'heure, la section qui se consacre à ces problèmes s'occupe de gérer tous les signaux qui pourraient montrer des déficiences que les contrôles effectués par les Etats du port pourraient mettre en évidence sur nos bateaux. Cette section a continuellement la tâche de contrôler, de vérifier, de gérer ces problèmes et d'agir pour que ces manquements n'aient plus lieu.
Concernant les statistiques relatives au port state control, il faut comparer différentes données et tenir compte aussi des statistiques du corps américain des coast guards, où nous sommes dans une excellente position par rapport à d'autres sociétés de classification.
M. le Président : Quel est votre sentiment sur les transferts de classe et sur la manière dont ils se passent ? Il se trouve que RINA est souvent concerné par ces transferts de classe. Pensez-vous qu'il faut réglementer ce dispositif ?
M. Antonio PINGIORI : RINA, qui fait partie des sociétés de l'IACS, s'en tient aux procédures que l'IACS a mises en _uvre à ce jour. RINA, comme toute autre société de classification membre de l'IACS, respecte les procédures.
Je crois qu'au niveau de l'IACS on est en train d'évaluer, à la lumière de certains événements, si cette procédure présente des déficiences, des défauts, des lacunes. RINA, comme toute autre société de classification, agira pour combler et éliminer ces éventuelles lacunes.
Mme Jacqueline LAZARD : La question que je voulais poser sur les transferts a déjà été soulevée.
Etes-vous en mesure, messieurs, puisque vous disposez de statistiques de la fin de 1999, de nous indiquer le nombre de navires qui ont été retenus dans les ports et qui ont été classés par votre société de classification ?
M. Antonio PINGIORI : Je dispose de statistiques concernant la rétention des bateaux pour les années 1998 et 1999.
En ce qui concerne le Mémorandum de Paris, voici quelques chiffres. Le nombre de bateaux classés par RINA ayant fait l'objet d'une rétention lors de ces deux années est de 150. Mais en ce qui concerne la rétention ayant trait à la classe attribuable à l'activité RINA, nous sommes à 30 navires pour 1999. Le chiffre de 150 est la somme de 1998 et 1999. Le chiffre de 30 correspond au nombre de bateaux retenus pour des raisons de classe en 1999 seulement.
En ce qui concerne le Mémorandum de Tokyo, pour les deux années, on dénombre 27 rétentions ou arrêts des navires classés par RINA. Je ne puis dire si ces rétentions sont dues à la classe parce qu'avec le Mémorandum de Tokyo il n'est pas possible d'identifier celles qui ont trait à la classe.
Concernant les coast guards américains, en deux ans, sur 24 navires classés par RINA un seul a été retenu pour non-respect de la classe.
Ce sont des données officielles que vous pouvez retrouver dans les statistiques des différents Etats du port.
M. Gilbert LE BRIS : Vous avez fait état tout à l'heure d'un accord de 1992 concernant une délégation partielle par les Etats-Unis dans la vérification de la conformité des bateaux de croisière à la convention SOLAS. S'agit-il essentiellement des bateaux de l'armement du Coast Guard ou cet accord concerne-t-il également les bateaux d'autres armements ?
J'aimerais également savoir à quelle hauteur se situe la police d'assurance-responsabilité de la société par action RINA-SPA ?
M. Antonio PINGIORI : L'accord avec les coast guards avait trait à la totalité des bateaux passagers classés par RINA. Nous avons donc des navires de l'armateur du Coast Guard, de P&O et de Carnivale. D'ailleurs, je ne crois pas qu'il y ait des bateaux de croisière sous pavillon italien. C'est une activité que nous assumons pour les navires classés par RINA.
Je ne saurai répondre à la deuxième question. Chef de la division technique, j'ignore tout, au plan de l'assurance, de nos rapports avec les sociétés d'assurance. Je suis totalement ignorant en la matière.
M. Jean-Michel MARCHAND : Au début de votre propos sur vos activités et en particulier sur les activités de classification de navires, vous nous avez dit que vous travaillez dans le cadre des règlements internationaux et aussi dans le respect des règlements dont RINA s'est pourvu. Vous nous avez dit que vous pratiquiez des visites périodiques.
Comme vous nous avez donné deux types d'informations - les gens qui travaillent pour votre société de classification et ensuite le nombre de bateaux dont vous avez la responsabilité -, pouvez-vous maintenant nous dire combien vous faites de visites et d'inspections sur une année ? Si les chiffres ne sont pas précis, pouvez-vous du moins nous donner un ordre d'idée ? Pouvez-nous indiquer aussi quelle est la périodicité moyenne des contrôles que vous pratiquez ?
M. Antonio PINGIORI : Je peux simplement dire que le certificat de classe a une validité de cinq ans. Le renouvellement est effectué après une visite spécifique, la plus sévère qui puisse être effectuée. Par ailleurs, les navires sont également soumis à une visite périodique annuelle.
Ensuite, eu égard à des avaries éventuelles, on peut effectuer d'autres visites occasionnelles. Mais les visites importantes sont la visite spéciale et la visite annuelle.
M. le Président : Trouvez-vous logique que ce soit une même société de classification qui assure à la fois la certification des navires pour le compte d'une administration, pour l'Etat du pavillon, et la classification du bateau pour le compte de l'armateur ?
Cette réflexion ne concerne pas que RINA. D'autres sociétés de classification font la même chose. Nous nous interrogeons sur cette situation qui concerne plusieurs Etats, souvent de petits Etats qui ne peuvent pas ou qui ne veulent pas se doter d'une administration et qui veulent néanmoins avoir une flotte.
M. Antonio PINGIORI : Je vais essayer de répondre à la question en deux parties.
Premièrement, si je prends comme exemple l'Italie, la certification de classe a été rendue obligatoire depuis longtemps pour les bateaux battant pavillon italien. Quand la commission de visite italienne effectue la visite pour la délivrance du certificat statutaire, on contrôle l'existence du certificat de classe.
Deuxièmement, au sein de l'OMI, la convention SOLAS prévoit que le navire doit être construit conformément aux normes des registres de classification pour ce qui est de la structure, des machines, et des installations électriques.
De plus en plus, le certificat de classe devient un certificat statutaire. Je ne crois donc pas que l'on puisse considérer cela comme une interférence avec la délivrance des certificats d'Etat.
M. le Président : Récemment, au niveau de l'Union européenne, la Commission a fait des propositions visant à organiser et mettre en _uvre un système d'inspection de l'ensemble des sociétés de classification et à améliorer les contrôles de sécurité dans les ports. Etes-vous favorables à une telle procédure ?
M. Antonio PINGIORI : Les actions qui peuvent servir à élever les normes de sécurité en général sont tout à fait bien accueillies par RINA, comme par les autres sociétés de classification, bien entendu. Je pense que de telles actions doivent faire l'objet de discussions dans un cadre international, que ce soit au niveau européen ou aux niveaux de l'IACS ou de l'OMI. Cela me paraît tout à fait évident !
Mme Jacqueline LAZARD : D'après l'état que vous nous avez donné pour la fin de 1999, pouvez-vous nous indiquer parmi les navires que contrôle votre société de classification, le nombre de pétroliers et de navires transportant des matières dangereuses ?
M. Antonio PINGIORI : En 1999, le nombre des pétroliers classés ou certifiés par RINA était d'environ 260. Il faudrait ajouter à ce chiffre les navires transportant des produits chimiques ou des gaz. Mais je ne dispose pas de ces informations à l'heure actuelle. Le chiffre que je vous ai donné concerne uniquement les pétroliers.
M. le Président : Je vous remercie beaucoup d'avoir bien voulu vous prêter à cette audition.
M. Antonio PINGIORI : Je vous remercie également, monsieur le président, de la possibilité que vous nous avez donnée d'exposer notre point de vue. Merci à tous.
N.B. : Ci-après traductions provenant des personnes auditionnées, non vérifiées par la commission.
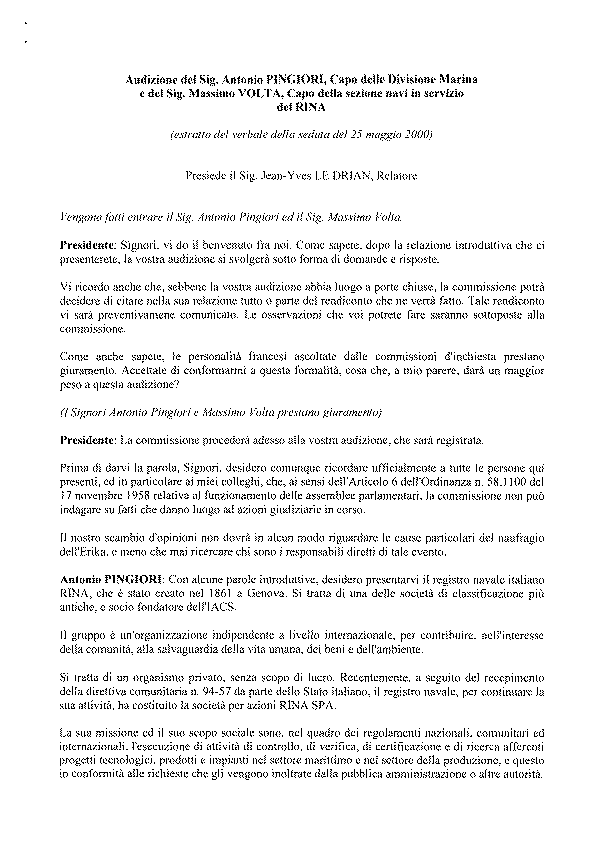
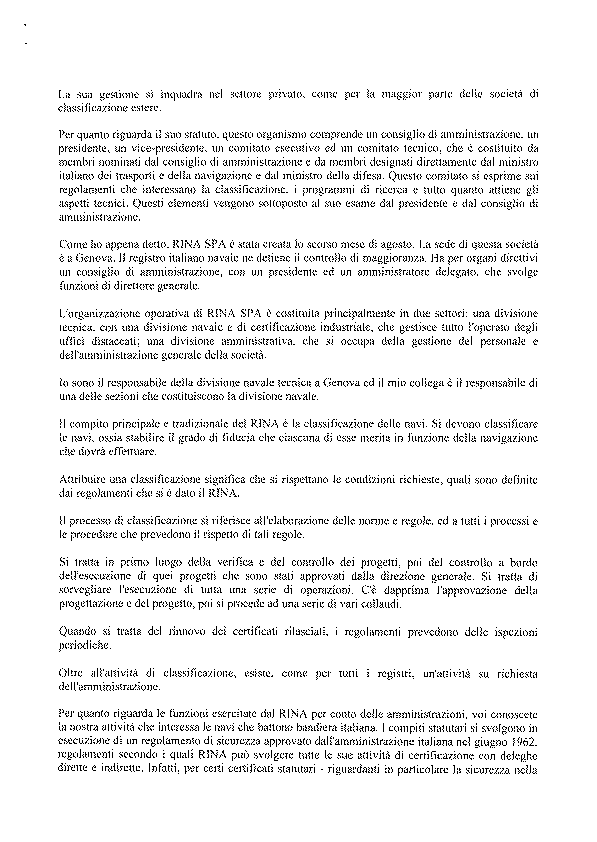
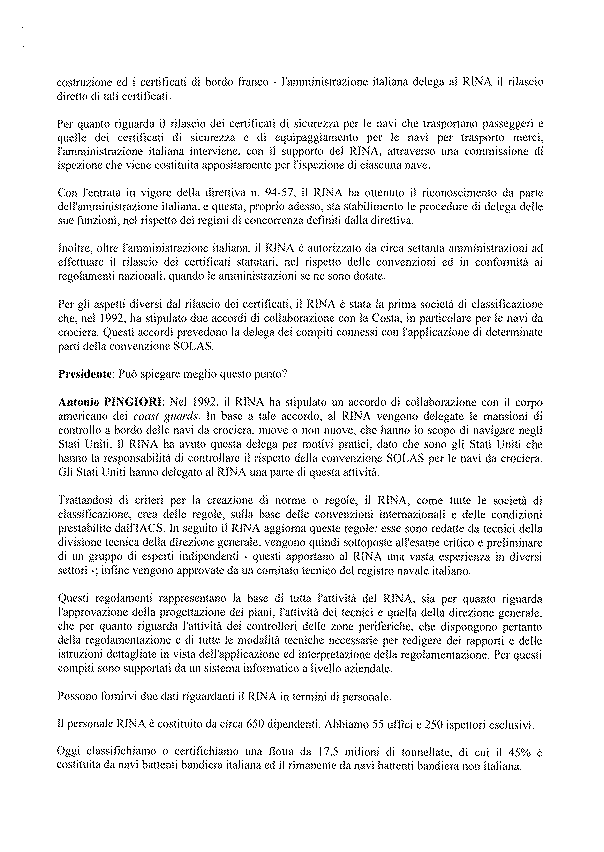
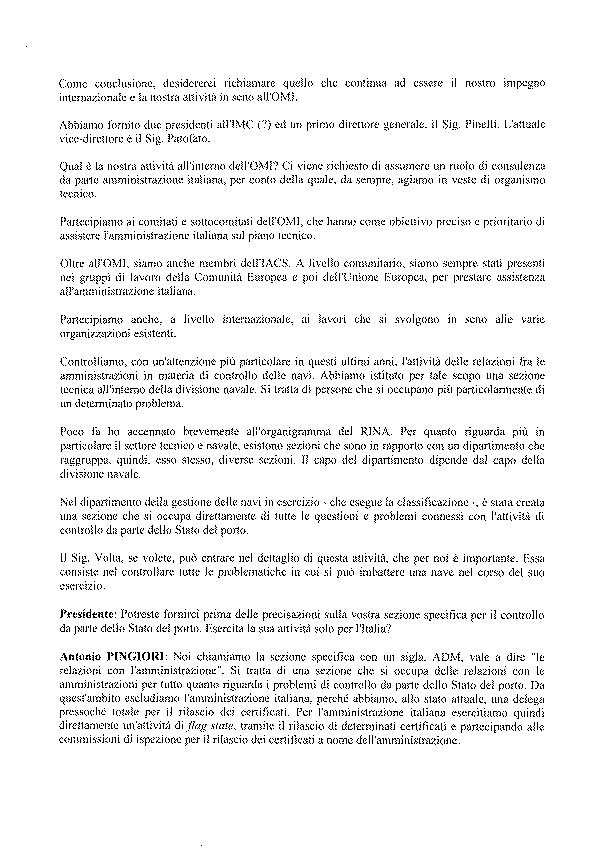
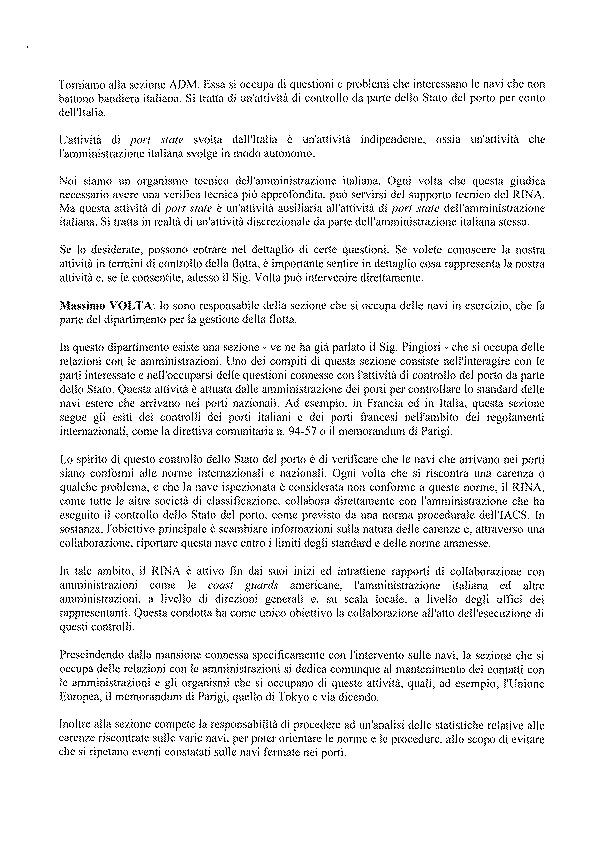
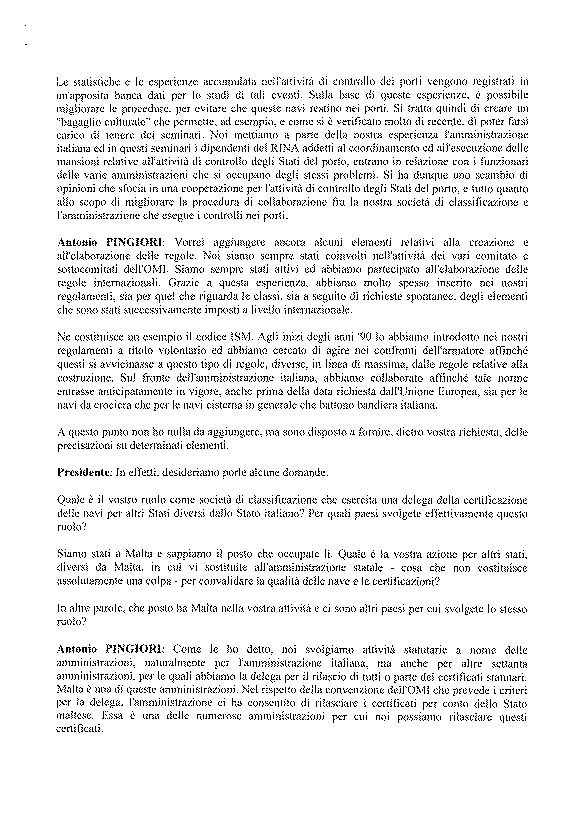
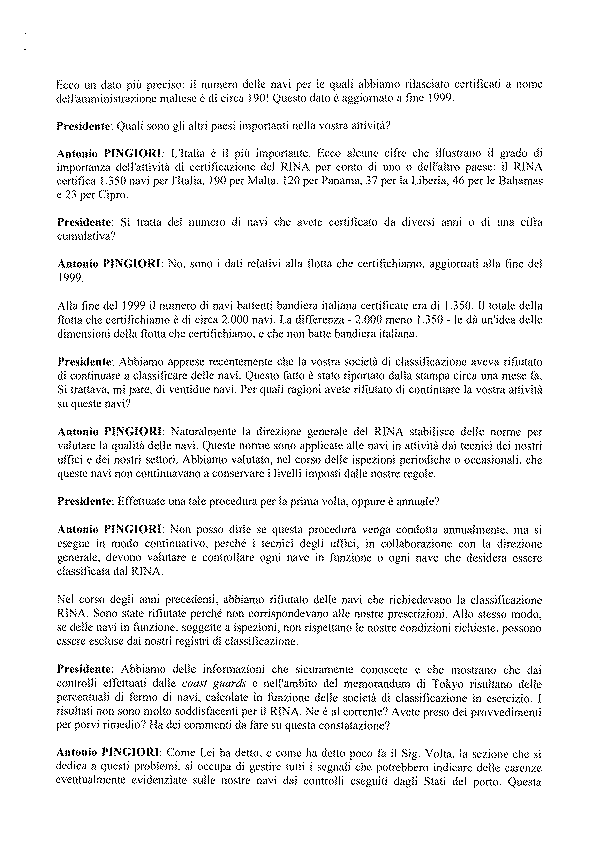
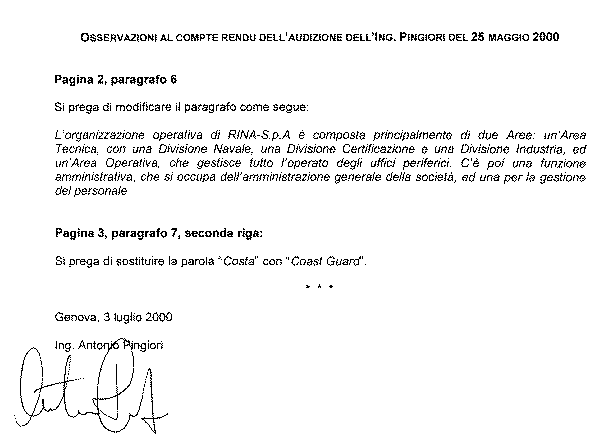
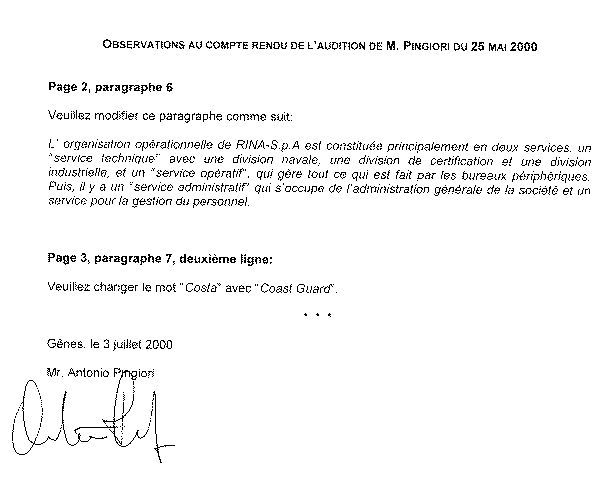
Audition de Mme Michelle DEMESSINE,
secrétaire d'Etat au Tourisme,
accompagnée de MM. Bruno FARENIAUX, directeur de cabinet,
Didier BOURGOIN, conseiller technique,
et Jean-Claude BENOIT, chargé de mission
(extrait du procès-verbal de la séance du 25 mai 2000)
Présidence de M. Daniel PAUL, Président
Mme Michelle Demessine, MM. Bruno Fareniaux, Didier Bourgoin et Jean-Claude Benoît sont introduits.
M. le Président leur rappelle que les dispositions législatives relatives aux commissions d'enquête leur ont été communiquées. A l'invitation du Président, Mme Michelle Demessine, MM. Bruno Fareniaux, Didier Bourgoin et jean-Claude Benoît prêtent serment.
Mme Michelle DEMESSINE : M. le président, madame, messieurs les commissaires, je souhaiterais en premier lieu vous remercier d'avoir inclus les conséquences de l'Erika sur l'économie touristique de notre pays, dans le cadre de vos travaux parlementaires.
Il est vrai que le tourisme est un secteur qui dépend beaucoup de la qualité paysagère et environnementale des sites qui permettent son développement, particulièrement sur le littoral.
Le naufrage de l'Erika et les intempéries de la fin de l'année 1999 ont constitué pour notre pays, et plus particulièrement pour les régions de l'arc atlantique, un véritable drame écologique et économique.
Mon propos portera aujourd'hui essentiellement sur la marée noire et ses conséquences sur le tourisme, un des secteurs économiques les plus touchés par cet événement.
Ce propos ne sera ni catastrophiste, ni délibérément optimiste. Il se veut simplement lucide. Cette lucidité faisant apparaître parfois, vous le verrez, quelques vérités contradictoires.
Je souhaiterais en premier lieu, rappeler en quelques chiffres, le poids du tourisme dans notre économie nationale et dans celle des principales régions touchées par le naufrage de l'Erika.
En 1999, la France, première destination touristique au monde avec plus de 72 millions de visiteurs étrangers, a enregistré un chiffre d'affaires touristique dépassant les 700 milliards de francs, qui s'est traduit par un excédent, à la balance des paiements, de plus de 85 milliards de francs.
Deux millions de personnes travaillent aujourd'hui directement ou indirectement dans ce secteur, qui a créé pour la seule année 1999, près de 30 000 emplois, dont 25 000 dans l'hôtellerie-restauration.
Dans cet ensemble, les 31 millions de touristes accueillis chaque année dans les trois régions du littoral atlantique (Bretagne, Pays de la Loire et Poitou-Charentes) dégagent un chiffre d'affaires supérieur à 70 milliards de francs.
Si le tourisme connaît aujourd'hui une croissance spectaculaire, il repose néanmoins sur un tissu de petites et moyennes entreprises qui restent globalement fragiles, car sensibles aux moindres variations des contextes socio-économiques nationaux et internationaux.
Le naufrage de l'Erika et ses conséquences sur l'environnement et sur l'économie locale, ont mis gravement en péril le déroulement d'une saison touristique particulièrement prometteuse, et ont entaché sérieusement l'image touristique de la côte atlantique tout entière.
Face à ce drame, il fallait réagir extrêmement vite.
Aussi, dès le 27 décembre, j'ai souhaité mettre en place un dispositif particulier de soutien à l'économie touristique, qui avait été exclue des programmes d'indemnisation lors des précédentes marées noires ayant frappé la Bretagne.
Ainsi, des rencontres avec les professionnels du tourisme et les élus, ont permis d'analyser de manière précise, les difficultés spécifiques rencontrées par le tourisme. Elles ont également permis d'identifier rapidement un certain nombre de mesures qui seraient à même d'y faire face.
Dès le 13 janvier, j'ai pu présenter au Premier ministre, tous les enjeux que représentaient pour l'économie nationale, les répercussions de la marée noire sur l'industrie touristique, et faire prendre en compte, dans le programme d'indemnisation du gouvernement, les particularités de ce secteur.
A compter de cette date, des délais et des remises en matière d'impôts ont été accordés, pour les entreprises qui se trouvent en butte avec des problèmes de trésorerie. Ceux-ci concernaient plus particulièrement la taxe professionnelle, la taxe d'habitation ou l'impôt sur le revenu. Ils venaient compléter les procédures de dégrèvement déjà existantes pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties.
De même, les entreprises qui en ont fait la demande auprès des organismes sociaux, peuvent bénéficier de délais de paiement sur les charges sociales.
Le 28 février, au CIADT de Nantes, je présentais un certain nombre de mesures complémentaires, plus spécifiques, en faveur des entreprises et des communes touristiques ayant subi des préjudices dans le cadre d'un plan de soutien à l'économie touristique des régions atlantiques.
A travers les dégâts environnementaux, il est très vite apparu que c'était l'image même du tourisme français qui avait été atteinte.
Aussi, en premier point de ce plan d'action, ai-je souhaité mettre en _uvre rapidement, tant en France qu'à l'étranger, une campagne de communication en partenariat étroit avec les comités régionaux et départementaux du tourisme des régions les plus touchées, dans un souci constant de coordination et d'efficacité.
Cette campagne qui constitue une première dans notre pays, s'est déroulée durant les mois de mars et avril derniers, dans la presse étrangère et en France sur les grandes chaînes de télévision, où des spots ont été diffusés sur le thème : « Respirez, vous êtes sur la côte atlantique ».
Son budget global s'élève à 71,5 millions de francs dont 41,5 millions de francs apportés par l'Etat, auxquels s'ajoute une mise à contribution de 30 millions de francs obtenue de TotalFina. Par ailleurs, un certain nombre de régions et de départements concernés, ont souhaité mettre en _uvre des campagnes de communication complémentaires. Celles-ci ont mobilisé un investissement supplémentaire, de la part de ces régions, de l'ordre de 43 millions de francs.
Ce sont donc au total 114,5 millions de francs qui ont été consacrés, en 2000, à la restauration de l'image touristique de la France, et plus particulièrement de sa côte atlantique.
Nous recueillons aujourd'hui les fruits de cette campagne, mais j'aurai l'occasion d'y revenir plus tard.
Le second point du plan d'action concerne des mesures générales en faveur des entreprises.
Suite à la marée noire, de très nombreux établissements doivent faire face à une dégradation de leurs comptes d'exploitation, liée à l'interruption partielle ou totale de leur activité, qu'ils cumulent pour quelques-uns d'entre eux avec les dégâts des intempéries.
Pour les aider dans cette passe difficile, et favoriser leur accès au crédit, j'ai obtenu que le bénéfice du « fonds de garantie tempêtes » soit étendu aux entreprises touchées par la marée noire et ce, à concurrence de 70 millions de francs.
Cela devrait permettre aux entreprises concernées, l'accès à un montant global de prêts de plus d'un milliard de francs, leur permettant de reconstituer leur trésorerie.
La Banque de développement des PME (BDPME) garantira ces prêts à hauteur de 70 %.
Le troisième point du plan d'action a consisté à instaurer au sein de mon ministère, un outil de mesures pour l'Etat, mais surtout pour les professionnels, des inévitables pertes d'exploitation qui ne pourront être constatées réellement qu'à la fin de la saison.
Compte tenu des enjeux, il s'est avéré indispensable de renforcer l'observation des évolutions touristiques (évaluation des baisses de réservations et de chiffre d'affaires, modification des comportements des clientèles, études prospectives).
Ainsi, 2,5 millions de francs de crédits ont été consacrés à ce dispositif exceptionnel d'observation économique qui a été mis en place début janvier, avec le soutien méthodologique de l'inspection générale des finances, et sous la responsabilité de notre observatoire national du tourisme. Il a pour objectif de créer un système de référence fiable, permettant aux entreprises d'étayer et de justifier leur demande d'indemnisation à leurs assurances, comme au FIPOL, puisque les dommages subis par les acteurs du tourisme y sont éligibles.
La prise en compte par le FIPOL, des dommages subis par l'économie touristique, aura un effet sur le taux d'indemnisation qui sera retenu en juillet prochain. En effet, celui-ci dépendra de l'évaluation globale des sinistres et en particulier dans le secteur qui est le principal concerné : le tourisme.
Le système d'observation mis en place, en lien avec ma collègue Florence Parly, doit nous permettre d'approcher au plus près la réalité des conséquences de la marée noire. Nous disposerons ainsi d'une première évaluation crédible de l'impact de celle-ci sur la fréquentation touristique dès la mi juin.
Enfin, quatrième et dernier point, la remise en état du littoral atlantique sera l'occasion d'améliorer et de moderniser son offre touristique. Différentes actions seront ainsi menées sur trois ans, touchant à : l'aménagement des stations touristiques en vue d'une meilleure utilisation des plages et d'une gestion plus optimale des flux touristiques dans le respect de l'environnement propre au littoral ; l'amélioration de l'environnement et du cadre de vie des villages de vacances et des campings ; et la mise en conformité des villages de vacances pour l'accueil des classes de mer.
Ces mesures encourageront des démarches de filières coordonnées à l'échelon régional, de manière à favoriser des actions intercommunales entre les stations littorales et leur arrière-pays.
Pour mener à bien ces différentes actions, le Gouvernement a pris la décision de consacrer une enveloppe de 114 millions de francs, qui permettront d'élaborer des avenants aux volets tourisme des contrats de plan mis en place avec les régions Bretagne, Pays de la Loire, Poitou-Charentes et Aquitaine pour la période 2000/2003.
Il convient maintenant de se pencher sur les effets concrets de ces différentes mesures, notamment en matière de fréquentation touristique depuis janvier et pour l'avenir.
Malgré tous nos efforts, je tiens à souligner qu'il existe un certain nombre de difficultés objectives à mesurer, au plus près des réalités, l'impact véritable de la marée noire sur cette fréquentation. En effet, sur le littoral atlantique, la saison touristique dépend d'un certain nombre de facteurs, qui cette année encore, en conditionneront pour partie le succès.
En premier lieu les conditions climatiques jouent toujours, sur ce littoral, un rôle majeur.
Ensuite, le caractère spécifique de la fréquentation est sur cette côte lié à un fort taux d'implantation de résidences secondaires qui jouent là un rôle plutôt favorable.
Enfin, ce secteur géographique fait traditionnellement l'objet de peu de réservations de dernière minute, à la fois de la part du public français qui représente 60 % de la clientèle, mais aussi de la part du public étranger représenté à 80 % par les ressortissants d'Allemagne, de Grande-Bretagne, de Belgique, des Pays-Bas et, dans une moindre mesure, de Suisse et d'Italie.
Je précise que traditionnellement, dans ces régions, la part du chiffre d'affaires réalisée sur réservation, ne dépasse pas les 35 %.
Tenant compte de ces réserves, il nous est possible de faire un certain nombre de constats.
Ainsi, dans les régions Bretagne, Pays de Loire et Poitou-Charentes, et sur les quatre premiers mois de cette année, l'hôtellerie n'a pas connu de chute spectaculaire de ses taux d'occupation. La fréquentation y est effectivement équivalente, voire même supérieure à celle de l'an dernier. Cependant, il m'apparaît important de relativiser ce résultat, qui est dû, pour une part importante, aux séjours des professionnels et des bénévoles liés à la remise en état des sites touchés par la marée noire.
En revanche, on enregistre durant la même période une baisse du taux d'occupation des établissements le week-end, de l'ordre de 10 à 13 %, ce qui tendrait à montrer une défection de la part de la clientèle de proximité.
Une observation plus fine des vacances de printemps et des premiers week-ends de mai, fait apparaître les résultats suivants. Concernant l'hôtellerie, celle-ci enregistre une baisse de la fréquentation de 10 à 20 % dans les établissements des départements de Vendée, de Loire-Atlantique et du Morbihan, de 0 à 10 % dans ceux de Charente-Maritime et du Finistère, où seule, la côte sud est touchée par la marée noire. Enfin, on constate une légère hausse (1 à 5 %) de cette fréquentation dans les Côtes d'Armor.
Concernant les meublés, ce mode d'hébergement semble davantage affecté puisqu'on y enregistre une baisse de sa fréquentation, de l'ordre de 30 à 40 % en Loire-Atlantique et dans le Morbihan, de 20 à 30 % en Vendée et dans le Finistère. Les Côtes d'Armor et la Charente Maritime sont quant à eux stables.
Pour les Gîtes de France, on enregistre une baisse de 20 à 30 % en Vendée, de 10 à 20 % en Loire-Atlantique et dans le Morbihan, de 0 à 10 % en Charente-Maritime et dans le Finistère. Dans les Côtes d'Armor, on constate par contre une augmentation de 3 à 10 %.
Globalement, 46 % des offices de tourisme considèrent que les vacances du printemps 2000 ont été analogues à 1999. 41 % d'entre eux estiment cette fréquentation en baisse. En dehors de l'hébergement, les activités les plus touchées sont les activités de pleine nature, les activités nautiques et fluviales et la restauration, dans une moindre mesure.
J'ai demandé à notre observatoire national du tourisme de procéder à une analyse comparative des réservations entre la saison 2000 à venir et la saison 1999. Celle-ci s'est avérée impossible à mettre en _uvre, car nous ne disposons à ce jour d'aucune information en provenance des professionnels sur la situation des réservations des années antérieures qui nous permettrait de faire des comparaisons et d'établir des prévisions de fréquentation fiables.
Aussi, tout ce que vous pouvez lire ou entendre dans les médias nationaux ou étrangers, ne repose sur aucune valeur scientifique et résulte souvent d'interprétations généralement subjectives.
Néanmoins, pour satisfaire notre souci d'anticipation de la saison, notre observatoire national du tourisme s'est livré, avec le soutien technique de la SOFRES, à des enquêtes sur les intentions de départ à destination de l'arc atlantique auprès d'un échantillon de 1 870 touristes français.
Les résultats des deux vagues d'enquêtes réalisées en mars et au début de ce mois, montrent que 16 % des personnes ayant l'intention de partir en vacances et connaissant déjà leur lieu de destination, partiront cet été sur l'arc atlantique. Ce taux, qui n'a pas varié d'une enquête à l'autre, ne révèle donc aucun effondrement de la destination par rapport au début de l'année, ni d'une année sur l'autre d'ailleurs. En effet, ce taux était de 17 % en 1999. Il nous faudra néanmoins attendre la prochaine vague du mois de juin pour avoir une idée plus précise encore du maintien du taux de fidélisation de nos concitoyens pour ce littoral atlantique.
Concernant les résultats de la campagne de communication que nous avons menée en France et à l'étranger, nous disposerons dans les semaines à venir, des résultats d'études post-test, que nous avons fait réaliser et qui feront l'objet d'analyses précises de la part de notre ministère.
Néanmoins, je puis d'ores et déjà vous dire que concernant le marché français, les opérations de communication de Maison de la France et des Comités régionaux et départementaux de tourisme, ont atteint une partie de leurs objectifs. En effet, dans les régions du littoral aquitain et de Poitou-Charentes comme du Nord Bretagne, qui n'ont pas été touchées directement par la marée noire sur leur environnement, mais qui ont subi un préjudice d'image, l'analyse de la fréquentation lors des vacances de printemps et des premiers week-ends de mai, démontre une nette amélioration de la situation qui laisse présager pour elles un bon déroulement de leur saison.
L'amélioration n'est pas aussi significative pour les départements directement touchés par les effets du naufrage de l'Erika. Je pense au Finistère, au Morbihan, à la Loire-Atlantique et au nord de la Vendée, même si l'on constate d'un département à l'autre, une réelle reprise des demandes d'information et même des réservations.
Concernant nos visiteurs étrangers, qui représentent un peu plus de 30 % de la fréquentation touristique de la côte atlantique, une fois encore, les résultats sont contrastés.
Je rappellerai rapidement les poids respectifs de nos principales clientèles touristiques étrangères de la côte atlantique. La Grande-Bretagne arrive en tête, avec 35 % de la fréquentation étrangère. Elle est suivie de l'Allemagne qui en représente 20 %, des Pays-Bas pour 14 % et enfin de la Belgique pour 10%.
Sur le marché allemand, nous enregistrons une baisse des réservations et des intentions de départ de l'ordre de 24 %. Aux Pays-Bas, on constate un report de fréquentation sur la Méditerranée et l'intérieur de la France. L'Italie reste quant à elle, un marché beaucoup plus stable. L'effet Erika s'y est estompé rapidement et n'y est plus d'actualité. En Grande-Bretagne enfin, si la destination France reste globalement stable et si les courts séjours y enregistrent de bons résultats, nous constatons dans nos bureaux, une baisse moyenne de 18 % des demandes d'informations spontanées sur les régions de l'arc atlantique. Celle-ci était de l'ordre de 25 %, il y a encore quelques semaines, ce qui dénote une amélioration.
Pour conclure, je dirai que si la côte atlantique a été très touchée dans son image, les résultats enregistrés en ce début d'année, et les perspectives pour la saison estivale, sont nettement en dessous de ce que nous redoutions le plus.
Rappelons que les premières estimations, au lendemain du naufrage de l'Erika, nous laissaient présager le pire, avec des phénomènes d'annulations et de baisses prévisibles de fréquentation estimées par les tours-opérateurs en particulier étrangers, aux alentours de 35 à 60 %.
Je le confirme, la lucidité a pris le pas sur le catastrophisme. L'action, très tôt engagée, par le Gouvernement, les collectivités locales et territoriales, tous les acteurs du tourisme, avec l'aide des milliers de bénévoles, y a largement contribué.
Je tiens à souligner à ce propos, l'investissement permanent de mon administration centrale et de ses services déconcentrés, qui ont été, depuis le 27 décembre dernier, aux côtés des professionnels du tourisme et des collectivités, pour les soutenir dans leurs initiatives de reconquête de l'image de leur littoral, et les aider dans toutes leurs démarches administratives nécessaires à leur indemnisation.
Loin de moi pourtant, la tentation d'affirmer que tout est redevenu normal. Sur les 400 kilomètres de côtes touchées par la marée noire, tous ne l'ont pas été de la même manière. Je pense en particulier à ceux qui ont été le plus meurtris, dans les îles, dans la Loire-Atlantique et le Morbihan. Mais la zone impraticable s'est fort heureusement considérablement réduite. Et l'on constate, même à l'intérieur de cette zone, de grandes disparités.
Pour autant, la mobilisation de tous, j'en suis convaincue, contribuera à redonner progressivement à l'Atlantique, à ses plages et à ses îles, leurs atouts touristiques.
Nous restons vigilants et mobilisés aux côtés de la grande famille du tourisme, pour réussir malgré l'adversité, cette saison touristique 2000.
M. le Rapporteur : Merci, Madame la Ministre, de votre exposé extrêmement précis.
Selon vos dires, vous avez abondé l'observatoire du tourisme de 2,5 millions de francs pour en faire un outil d'appréciation très précis, un système de comparaisons et de références fiable, et vous deviez disposer de données mi-juin. A votre connaissance, ces chiffres seront-ils reconnus crédibles par le FIPOL ? Le FIPOL a-t-il fait une déclaration à ce sujet ?
Une de nos préoccupations principales étant la difficulté d'émargement au FIPOL, je souhaiterais avoir des éléments de réponse à cette question.
Ensuite, vous avez annoncé des chiffres significatifs. Je souhaiterais savoir si la collaboration et la coordination entre votre ministère et les comités régionaux de tourisme s'est bien faite, en cohérence afin d'inciter à la fréquentation.
Ma préoccupation sur les chiffres, ne porte pas tant sur la restauration de l'image que sur les entreprises d'hôtellerie et de restauration. Pouvez-vous indiquer le niveau de mobilisation des fonds que vous avez annoncés ?
Par ailleurs, pourriez-vous préciser si la BDPME a effectivement joué son rôle de garant à 70 % ? Cet engagement est-il effectif ?
Il semble en effet que la question principale concerne la trésorerie des entreprises d'hôtellerie, pendant la période transitoire, puisque le FIPOL ne pourra intervenir effectivement qu'une fois la constatation effectuée. Il y a donc une période difficile de transition pour les entreprises qui vivent en partie avec les arrhes versées, lesquelles seront moins importantes compte tenu de la diminution de la fréquentation.
Enfin, les meublés peuvent-ils faire l'objet d'un remboursement FIPOL ? Si oui, quels seront les critères retenus ?
Pouvez-vous également nous faire parvenir, à la mi-juin, les derniers chiffres dont vous disposerez sur le niveau de fréquentation ? Le rapport sera déposé fin juin ou début juillet et il serait utile que nous puissions les publier.
M. le Président : Un certain nombre de données chiffrées pourront être communiquées par la suite.
Mme Michelle DEMESSINE : Votre première question est de savoir si le dispositif que nous avons mis en place sera reconnu par le FIPOL.
M. le Rapporteur : Il s'agit de savoir si les éléments de contrôle de l'observatoire du tourisme seront reconnus valables par le FIPOL .
Mme Michelle DEMESSINE : Pour l'instant, je ne peux répondre complètement par l'affirmative. La négociation va se conclure au mois de juillet, et il n'y a encore aucune déclaration précise allant dans ce sens. Nous sommes en contact permanent avec leurs conseillers tourisme, et ils sont demandeurs d'aide et de fiabilité.
Notre objectif est d'avoir un outil d'arbitrage afin que ce ne soit pas seulement le FIPOL, comme dans les situations antérieures, qui ait les pleins pouvoirs de décider de la manière dont il va indemniser, et ce, devant des partenaires individuels et trop fragiles pour apporter des éléments pouvant être reconnus scientifiquement.
L'objectif est d'apporter des marges de négociation et d'appréciation professionnelles d'une technicité incontestable. Il s'agit d'éviter toutes les contestations habituelles des compagnies d'assurance tout en ayant, dès le départ, un contact avec le FIPOL. Nous sommes en collaboration, mais la transaction n'est pas faite, d'autant que nous n'avons pas encore les éléments concrets.
M. le Président : Cela veut-il dire que les organismes qui estiment être lésés et qui sont dans la perspective de perdre un certain nombre de sommes du fait de la marée noire, doivent s'adresser à vous, par le biais de ce dispositif, afin d'être mieux défendus face au FIPOL ? Je pense notamment à un certain nombre d'organismes très précis.
Mme Michelle DEMESSINE : S'ils rencontrent une difficulté sur un dossier avec le FIPOL, ils peuvent s'adresser au Secrétariat d'Etat au tourisme. Mais l'observatoire est un instrument d'analyse, chargé de travailler à des règles qui serviront à la négociation globale, ce qui déterminera le pourcentage.
Le tourisme ne peut pas être quantifié avant que nous ayons pu l'observer complètement. Si nous n'avions pas pris les devants sur cette question, nous aurions pu nous retrouver avec une consommation des crédits du FIPOL, sachant que l'économie touristique serait arrivée après les autres, alors même qu'elle subit les préjudices les plus importants. Cela a permis, dès le départ, de placer l'économie touristique comme étant un partenaire avec lequel il fallait compter, et dont il fallait essayer d'évaluer le préjudice. Nos délégués régionaux au tourisme siègent à la commission départementale d'indemnisation.
Je vais donner la parole à mon conseiller spécial qui suit les contacts avec le FIPOL. Il va présenter l'état des relations entre le FIPOL et l'administration du tourisme.
M. Didier BOURGOIN : Dès la fin janvier, le FIPOL a missionné un cabinet anglo-saxon de consultants spécialisés pour faire une première évaluation, et ensuite travailler au calcul d'indemnisation. Ce cabinet est en contact permanent avec nous. Tous les ratios dont parlait Mme Demessine, qui résulteront des travaux de notre observatoire du tourisme et de l'Inspection des finances, sur les calculs des pertes d'exploitation, seront rendus publics. Chacun des opérateurs du tourisme qui aura été lésé pourra les utiliser et se retourner vers nos propres services délégués régionaux au tourisme, ainsi que vers les commissions départementales d'indemnisation, qui assureront l'encadrement au plus près du terrain.
Il ressort des entretiens avec le FIPOL et avec le cabinet de consultants que les dernières marées noires sur lesquelles ils sont intervenus, notamment dans le sud du Pays de Galles, ont entraîné peu de dommages à l'industrie touristique. Ils sont en fait davantage demandeurs d'aide, qu'inquiets de l'information que l'on pourrait leur apporter.
M. le Rapporteur : Comment fonctionnera la commission départementale d'indemnisation?
M. Didier BOURGOIN : Elle est rattachée aux préfets. Chaque préfet préside une commission départementale d'indemnisation qui réunit autour de lui le TPG et les différents services techniques, dont les délégués régionaux au tourisme. Ils pourront aider et conseiller les demandeurs au niveau de leur dossier d'indemnisation, en cas de difficulté de liaison avec le FIPOL. Cela fonctionne de cette façon pour les indemnisations dans le secteur de la pêche, où là, les préjudices sont déjà subis. C'est un modèle de fonctionnement assez similaire.
M. le Rapporteur : Sur la campagne de communication, quelles sont vos relations avec les comités régionaux de tourisme ?
Pouvez-vous apporter des précisions concernant la BDPME, les prêts, et les problèmes de trésorerie intermédiaire avant le FIPOL ?
Vous avez précisé que des campagnes complémentaires avaient été mises en _uvre par les comités régionaux de tourisme. Concernant l'organisation de la campagne, quelles ont été vos relations avec les comités régionaux de tourisme ? On peut observer une campagne nationale, faite à votre initiative, et différentes campagnes locales. A mon avis, dans le contexte actuel, il semble préférable d'indiquer qu'il faut aller en France atlantique plutôt que dans tel ou tel département.
Mme Michelle DEMESSINE : M. Fareniaux, mon directeur de Cabinet, a mené toute la négociation avec les régions, il va pouvoir vous répondre de façon précise.
M. Bruno FARENIAUX : Nous avions la préoccupation de coordonner l'ensemble de l'effort promotionnel, à la fois sur le marché français et sur les marchés étrangers.
Dans un premier temps, il est vrai que nous avons eu la tentation, pour les régions de l'arc atlantique directement touchées, de pouvoir communiquer en bénéficiant de subventionnements de la part de l'Etat, et non pas en nous inscrivant dans une démarche globale. Donc, chaque région, chaque département, est venu chercher la subvention.
Dans un second temps, nous assistions à un autre type de comportement. Les régions de l'arc atlantique, indirectement touchées, c'est-à-dire atteintes essentiellement sur les problèmes d'image, comme le Poitou-Charentes et l'Aquitaine, ont eu la tentation de communiquer en France et à l'étranger, sur le registre : « Nous ne sommes pas touchés par l'Erika ».
Pour éviter ce type de message et cette déperdition d'image, nous avons réuni les trois régions principalement concernées, les régions Poitou-Charentes et Aquitaine, ainsi que les cinq comités départementaux des régions les plus touchées, afin de définir avec eux une méthodologie commune de campagne de communication. Nous nous sommes mis d'accord pour que cette communication soit coordonnée par Maison de la France sur la base d'un message unique à l'étranger, et d'une campagne télévisuelle commune en France, basée sur la thématique que vous connaissez.
Néanmoins, pour chaque département ou chaque région qui en aurait les moyens et qui souhaiterait le faire, la communication se ferait par le biais de campagnes individuelles, mais avec une signature conjointe sur les spots publicitaires.
Nous avons souhaité que cela se fasse, avec l'incitation, pour les régions s'inscrivant dans cette démarche, de pouvoir bénéficier des tarifications accordées dans ce genre de circonstances, par l'intermédiaire des services d'information du Gouvernement ; par exemple en accordant le bénéfice de réductions sur les coûts des campagnes télévisuelles.
Cet argument qui leur permettait de faire un effort supplémentaire en termes de communication, nous a permis de les rassembler sur un seul et unique message, et au-delà, d'éviter des campagnes qui auraient pu apparaître quelque peu dispersées.
M. le Rapporteur : Moins que l'on ne pouvait le craindre.
M. Bruno FARENIAUX : A l'étranger, en revanche, il n'y a eu aucune campagne individuelle. L'ensemble des documents publiés l'ont été sous une seule bannière, celle de Maison de la France.
Mme Michelle DEMESSINE : J'ajouterai que cela a valeur d'exemple. C'est un modèle de bonne gestion d'un budget de communication, sans gâchis ni rajouts. Cette expérience menée avec les régions a une valeur pédagogique pour la suite. Ce type de campagne pourra être reproduit.
Le fonds de garantie de la BDPME est doté de 70 millions de francs et est opérationnel depuis plus de deux mois. Très peu d'entreprises, jusqu'ici, ont demandé à en bénéficier.
Les entreprises attendent d'avoir plus de précisions sur le niveau de baisse de leur d'activité, afin de dimensionner correctement le montant de leur emprunt. Il est actuellement difficile de faire cette évaluation, et le secteur bancaire, chargé de diffuser l'information sur cette mesure, pourrait être plus performant, malgré les relances du Gouvernement et de la BDPME. On note une réticence du secteur bancaire à s'inscrire dans cette démarche.
L'information sur ces mesures arrive difficilement vers les principaux bénéficiaires. J'ai édité une plaquette à 80 000 exemplaires, qui dépasse les circuits habituels des préfectures, et qui a été adressée le plus systématiquement possible en direction des bénéficiaires potentiels.
Concernant les mesures directes « marée noire », il n'y en aura pas beaucoup d'autres hormis celles des pertes d'exploitation. L'effet « marée noire » est souvent mélangé avec les effets de la tempête, puisque les mêmes produits touristiques ont subi les deux préjudices : celui du déficit d'image et celui de la tempête. Par exemple, les terrains de camping ont été très touchés sur cette zone. Nous avons mis en place des mesures pour faire face aux destructions. Une grande partie des équipements des terrains de camping, tels que clôtures et environnement paysager, étaient non assurables.
Il en va de même en ce qui concerne les structures du tourisme social et associatif, qui ont subi des dommages non assurables. La circulaire est partie depuis la mi-avril, elle est dans les préfectures, et sur cette mesure-là, nous allons avoir un taux de consommation complet.
M. Bruno FARENIAUX : 20 % ont déjà été engagés.
M. le Rapporteur : Sur les 70 millions ?
M. Didier BOURGOIN : S'agissant des 70 millions du fonds de garantie, il n'y a pas suffisamment de dossiers. J'ai l'exemple rapporté ce matin même par le délégué régional de la BDPME : aujourd'hui, environ une vingtaine de dossiers sont en cours d'instruction pour 30 millions de francs de garantie. Ce n'est pas un retard d'instruction, mais les entreprises intègrent dans le fonds de garantie leurs problèmes de trésorerie, et ne savent pas exactement redimensionner cette trésorerie. Elles n'ont pas la perspective et la visibilité de ce qui va se passer en juillet et août, et attendent jusqu'au dernier moment pour refaire un emprunt et lisser leur trésorerie afin d'éviter de faire du découvert autorisé. Il y a donc très peu de dossiers.
Mme Demessine vous parlait des opérations sur la zone Erika, touchée à la fois par la tempête et par la marée noire. Sur les 90 millions de francs inscrits au collectif budgétaire, 22 millions sont déjà engagés - je parle bien de tempête et pas de marée noire - sur la zone commune. C'est effectivement la partie qui va en bénéficier le plus, et le plus vite.
M. le Rapporteur : Qui instruit les dossiers sur le fonds de garantie ? A qui cela s'adresse-t-il ?
M. Didier BOURGOIN : Nous diffusons l'information auprès des professionnels et des organisations professionnelles. Normalement, le banquier est le premier interlocuteur du chef d'entreprise. Il doit informer le chef d'entreprise sur le fait qu'il peut lisser ses échéances, et qu'à ce titre, il peut bénéficier d'une garantie.
Il faut être très clair. Lorsque l'on offre une garantie de 70 % de l'Etat et que l'on peut négocier la reconversion d'anciens emprunts et obtenir des taux moins élevés, pour la trésorerie, les banquiers ne se montrent pas toujours très enthousiastes. La BDPME les relance, puisque c'est elle qui dispense la garantie aux banquiers, mais effectivement, sur le terrain, l'agencier de la banque, soit n'est pas toujours informé, soit ne se révèle pas aussi solidaire qu'il le faudrait.
M. le Rapporteur : Qui aide les propriétaires de meublés ?
M. Didier BOURGOIN : Les meublés sont éligibles à l'indemnisation du FIPOL. Les propriétaires sont aidés par les cinq grandes fédérations avec lesquelles nous sommes en contact depuis début janvier, telles que la FNAIM, la fédération des Gîtes de France, etc. Ces cinq grandes fédérations couvrent 90 % des meublés. Elles diffusent l'information auprès de leurs adhérents, ainsi que les comités départementaux de tourisme, qui détiennent la liste des meublés.
Ceux qui ne sont pas déclarés, ne payant pas l'impôt, ne sont éligibles à rien. Ils sont très nombreux.
Quel que soit leur statut juridique, tous les demandeurs sont recevables, dans la mesure où le FIPOL a un fonctionnement de type universel. Tout le monde a droit à l'indemnisation, et au même taux : personnes physiques, sociétés de droit privé, sociétés de capital.
M. le Rapporteur : Dans la négociation globale avec le FIPOL sur la définition du taux, qui pilote au niveau du Gouvernement ?
M. Bruno FARENIAUX : C'est le ministère des affaires étrangères ; le suivi technique étant assuré par le ministère de l'économie et des finances.
M. le Rapporteur : Comment fonctionne la problématique de l'Etat par rapport au FIPOL, en dehors de votre propre relation avec le délégué au tourisme ?
M. Bruno FARENIAUX : La relation avec le FIPOL est bien assurée au niveau gouvernemental, c'est le Quai d'Orsay qui négocie avec le FIPOL. Ensuite, la direction des Affaires Juridiques au ministère des Finances, c'est-à-dire l'ex-agent judiciaire du Trésor, assure l'expertise. Nous sommes systématiquement associés à toutes les négociations, réunions interministérielles, et à tous les échanges.
Le c_ur de la difficulté de la détermination du taux est l'hypothèque que fait peser le poids de l'industrie touristique dans la sinistre de l'affaire Erika. Nous avons été très étroitement associés au moment où il a fallu définir le taux. C'est bien l'intérêt de l'industrie touristique.
Si le FIPOL, organisation multilatérale qui voit la zone Erika depuis l'autre bout de la planète, avait défini son taux en mars, compte tenu des chiffres catastrophistes qui circulaient - 10 milliards, 20 milliards d'indemnisation -, on aurait pris le chiffre de sinistre global, divisé le nombre de récipiendaires, pour atteindre un taux qui aurait été affecté de 5 à 10 %.
L'objectif du Gouvernement, de Mme Demessine auprès de ses collègues de la Chancellerie et du Ministère des Finances, a été d'obtenir que ce taux ne soit défini que le plus tard possible. Ce choix du terme de début juillet n'est pas anodin. Tous les travaux en cours se fondent sur cette date : ceux de l'Inspection générale des Finances, de notre observatoire, et les enquêtes SOFRES. Il faut que nous soyons tous prêts, et de manière interministérielle, dans la deuxième quinzaine de juin, afin de participer à la détermination du montant du FIPOL.
M. le Président : Nous souhaitons disposer de vos éléments sur les préjudices de l'industrie touristique avant la mi-juin.
M. Pierre HERIAUD : Merci de nous avoir donné de nombreuses informations, notamment sur toutes les enveloppes que vous avez pu obtenir. Mais certaines qui ne dépendent pas de vous ont dû être consommées pour partie, et il serait intéressant de les connaître.
Au niveau de votre ministère, avez-vous recensé les démarches que les entreprises ont pu faire auprès des organismes, Trésorerie générale, Trésor public et autres administrations ? Je parle des démarches pour bénéficier de délais, voire de remises. La connaissance de ces montants nous donnerait une idée de la difficulté rencontrée par les entreprises à payer des charges à l'issue de la saison touristique. Ma première question porte sur les remontées que vous auriez à ce sujet.
Ensuite, sur l'attentisme bancaire, quelles sont les instructions reçues par les banques ? Dans le cadre des crédits garantis par la BDPME, est-ce le taux auquel elles devraient consentir les prêts pour pouvoir bénéficier de l'aide qui pose problème ? Si tel est le cas, il ne faudrait peut-être pas s'étonner de trop d'attentisme de leur part car on se trouve, en termes de crédits, dans le cadre potentiel d'adjudication qui pose des problèmes de lenteur. Bien évidemment, les établissements bancaires ne se précipiteront pas. C'est un problème essentiel de relation entre l'entreprise et son banquier habituel.
On vient de voir, pour la BDPME, qu'une vingtaine de dossiers ont été présentés. Je remarque quand même que s'il y avait quarante dossiers de même montant, on aurait pratiquement le montant des 70 millions BDPME, puisque ces vingt dossiers représentent la somme de 30 millions. Il suffirait de doubler le nombre de ces dossiers pour arriver rapidement au plafond de garantie.
J'aimerais avoir quelques précisions sur les injonctions qui ont pu être données aux établissements bancaires.
Mme Michelle DEMESSINE : S'agissant des mesures d'accords de délais de paiement pour les charges fiscales et sociales, en cas de trésorerie difficile, le dispositif est connu et mis en place par les préfets. Cette mesure s'applique correctement, mais n'est pas beaucoup utilisée. Pour l'instant, seul le département du Morbihan a enregistré une quinzaine de demandes, d'ailleurs toutes honorées favorablement. Cela s'explique en partie, puisque pour l'économie touristique, la saison n'est pas encore terminée et qu'aucune entreprise ne voit vraiment clair en sa situation.
M. Didier BOURGOIN : Je voudrais faire la césure totale entre le fonctionnement du fonds de garantie et les prêts bonifiés à 1,5 % qui ont été accordés.
Pour les prêts bonifiés, il s'agit clairement de problèmes d'appels d'offres.
Pour ce qui est du fonds de garantie, les banques ne reçoivent de l'Etat strictement aucune instruction sur les pratiques de taux qu'elles ont à mettre en _uvre pour bénéficier de la garantie. Les banques pratiquent les taux qu'elles veulent, et appellent ensuite la BDPME en garantie. L'attribution ou non de cette garantie apportée par la BDPME, avec sa filiale Sofaris, n'est absolument pas liée au taux pratiqué. C'est d'ailleurs un critère qui n'est pas étudié par la BDPME. Ce serait irrecevable.
Je me suis mal exprimé tout à l'heure. Les 30 millions que j'évoquais ne sont pas le montant total de la garantie appelée, mais représentent le relais sur le montant total des emprunts.
Les emprunts qui pourraient être consentis grâce aux 70 millions, se situent aux alentours de 200 à 300 millions de francs. Le chiffre sur le montant total du fonds de garantie dit « tempête », de 200 millions, est d'environ un milliard.
M. Gilbert LE BRIS : Madame la Ministre, merci pour les précisions et la présentation que vous avez faites sur les données touristiques, au regard de ce problème de l'Erika.
Les difficultés objectives sont difficiles à mesurer, puisque nous sommes dans un domaine du non-dit, des impressions et des sentiments. Un problème, cependant, demeure : celui de l'Erika. Le traitement de l'épave de l'Erika va se faire au tout début de la saison touristique. J'aimerais savoir si vous avez des contacts avec vos collègues chargés du suivi de cette affaire, concernant sa gestion médiatique. Nous allons nous retrouver en pleine saison, ou juste en avant saison, avec ce problème de la cargaison. Y a-t-il une stratégie médiatique à l'égard du tourisme ?
Au-delà de l'émotion ressentie, se pose la question de la durée, plus particulièrement en ce qui concerne la Bretagne. Cette région supporte en effet trente-deux ans de marée noire. Son image globale est atteinte. Au-delà de l'année, ne faudra-t-il pas chercher des solutions de mise en valeur de la Bretagne, en espérant trouver également des méthodes pour éviter que cela se reproduise ?
Autre question annexe. Les communes littorales ont souvent mis en place une taxe de séjour. Certaines communes, dans le souci d'être agréables à ceux qui viennent quand même cet été, ont pensé supprimer cette taxe de séjour. Est-il envisagé des compensations pour ces mesures ponctuelles de suppression de la taxe de séjour ?
Dernier point, je ferai une remarque en ce qui concerne les meublés. Il faudrait que reçoivent des instructions, non seulement la FNAIM ou d'autres comités départementaux de tourisme, mais aussi tous les professionnels de la location saisonnière, à savoir les agences immobilières, les notaires, les offices de tourisme.
Mme Michelle DEMESSINE : Cette question concerne plus particulièrement M. Gayssot, mais nous vivons tous, comme les professionnels du tourisme, avec cette épée de Damoclès que représente l'épave. Nous portons cependant toujours l'espoir que nous allons réussir, y compris au niveau du pompage.
Bien entendu, nous travaillons ensemble avec M. Gayssot sur la gestion de la marée noire. C'est un travail commun à nos deux Cabinets.
En ce qui concerne la gestion médiatique, nous allons travailler conjointement à propos de l'épave. Il est extrêmement difficile de gérer cette situation, au vu de l'utilisation catastrophiste qu'en font les médias.
J'ai eu de nombreux contacts avec les patrons de chaînes sur ce sujet. Il faut savoir que pour une grande part, les résultats de la mauvaise fréquentation seront imputables au catastrophisme. Je peux vous donner un exemple : les îles ont beaucoup souffert, mais la mobilisation et les campagnes leur ont permis de remonter la pente, sauf celles qui sont en permanence dans l'_il du cyclone. L'Ile de Groix est actuellement en train de remonter la pente et connaît une très bonne fréquentation sur les dernières vacances, avec une perspective de réservations au-dessus de la moyenne.
En revanche, Belle-Ile subit de plein fouet les conséquences du catastrophisme, et bien que très proches l'une de l'autre, ces deux îles n'enregistrent pas la même réaction.
Des informations circulent qui ne reposent sur rien, notamment celle qui consiste à dire que l'épave fuit à nouveau. Personne ne peut affirmer que le fioul qui arrive sur les plages, provient de l'épave. Nous savons qu'il y a du fioul en circulation.
Nous restons vigilants pour que cette nouvelle épreuve que nous allons subir tous ensemble se passe du mieux possible. Avec M. Gayssot, nous prendrons probablement une initiative particulière, sur les lieux, au moment où se passera l'événement. Nous voulons ainsi montrer aux professionnels du tourisme que nous tenons compte de tous les éléments nécessaires à la réussite de la saison.
Nous essayons également, avec les autres ministères, de mettre en place un nouveau dispositif concernant le nettoyage : un « 48 heures chrono ». Il s'agit d'avoir un dispositif spécifique interdépartemental au niveau des moyens, qui permette, lorsque des souillures arrivent sur une plage, de nettoyer la plage en 48 heures. Cela représente une garantie de sécurité et de confort pendant la saison touristique.
Pour le moment, nous sommes en train de limiter au maximum les dégâts, et cette action doit se poursuivre sur le long terme. Tel est le sens des avenants de contrats de plan : donner une chance à ce littoral, le moderniser, travailler plus en coordination entre le littoral et l'arrière-pays, et donner des moyens pour favoriser cette offre touristique.
En matière de communication, nous ferons le point à la fin de la saison sur les secteurs qui en auront encore besoin de façon qu'il y ait encore une ligne spécifique dans le budget 2001. Je l'ai introduite dans la négociation que nous allons commencer avec le ministère des Finances.
En ce qui concerne TotalFina, nous ne fermons pas la porte, c'est une première vague. Nous avons souhaité refaire le point ensemble, à la fin de la saison, pour voir comment TotalFina peut continuer à soutenir.
S'agissant de la taxe de séjour, c'est la première fois que j'entends cette proposition. Je ne suis pas sûre que ce soit une bonne proposition. En particulier sur la clientèle française, il y a un autre ressort à faire fonctionner : celui de la solidarité. C'est une valeur qui fonctionne bien. On a pu le constater dans les sondages et au travers du mouvement de nettoyage qui s'est opéré. Il me semble qu'il vaut mieux continuer à jouer sur ce registre de la solidarité, plutôt que sur celui de la taxe de séjour. Il est préférable de continuer à la percevoir car elle représente quand même un moyen de financement du tourisme local.
S'agissant des meublés, je suis d'accord pour dire qu'il faut mobiliser tous les acteurs concernés, notamment les offices de tourisme.
Mme Jacqueline LAZARD : Je voulais vous interroger sur les relations du Ministère avec les médias. Vous avez répondu. On peut en effet parler, non seulement de catastrophisme, mais aussi de désinformation.
L'observatoire national du tourisme a fait une enquête sur les probabilités de fréquentation des plages de l'Atlantique, et il semblerait que ce soit le même pourcentage que l'année dernière. Je me demandais s'il n'y avait pas lieu de communiquer à ce propos, mais apparemment, vous envisagez d'attendre.
Mme Michelle DEMESSINE : Je ne veux pas communiquer en ce moment. Si je communique, ce sera de ma propre volonté, dans une démarche personnelle qui ne sera pas une réponse à une campagne qui va dans tous les sens.
Nous avions envisagé de faire une grande opération de communication sur une plage, avec tous les grands médias, et le concours de nombreuses personnalités. Malheureusement, avec les nouvelles arrivées, ce n'était pas jouable. Cet objectif n'est cependant pas abandonné, et nous avons pris des contacts avec France 3, qui est d'accord pour nous aider dans cette démarche. Nous le ferons après la saison, en termes de bilan et de projection sur la saison prochaine.
M. le Président : J'ai une question à laquelle vous avez d'ailleurs répondu en partie. Est-ce que la leçon de cette catastrophe maritime et littorale ne doit pas vous pousser davantage à diversifier la nature des produits touristiques proposés sur nos différents littoraux ?
La Méditerranée ne se résume pas à Saint-Tropez et ses plages. Elle offre aussi un arrière-pays et d'autres richesses. Dans le même ordre d'idée, on peut respirer l'air de la côte atlantique ailleurs que sur ses plages.
Mme Michelle DEMESSINE : Tout à fait. La première démarche est de créer des mesures d'urgence et de soutien. La deuxième, dans le cadre des contrats de plan, consiste à travailler à une modification de l'offre touristique : une offre plus diversifiée, donc moins basée sur le mono-produit, et apte à répondre aux vraies attentes des touristes d'aujourd'hui.
Audition de M. Jean-Claude GAYSSOT,
ministre de l'Equipement, des transports et du logement
(extrait du procès-verbal de la séance du 25 mai 2000)
Présidence de M. Daniel PAUL, Président.
M. Jean-Claude Gayssot est introduit.
M. le Président lui rappelle que les dispositions législatives relatives aux commissions d'enquête lui ont été communiquées. A l'invitation du Président, M. Jean-Claude Gayssot prête serment.
M. Jean-Claude GAYSSOT : Le 20 janvier dernier, vous avez décidé, dès la reprise de la session parlementaire, de créer cette commission d'enquête sur la sécurité du transport maritime des produits dangereux ou polluants.
Comme je vous le disais il y a cinq mois, il est bien lorsque survient un tel drame pour l'environnement et l'économie que le Parlement et le Gouvernement se retrouvent autour d'une volonté commune : celle de comprendre et d'examiner tout ce qui a pu contribuer à la catastrophe afin d'éviter qu'un tel événement ne se reproduise.
Renforcer la sécurité maritime après la catastrophe de l'Erika, tellement douloureuse pour l'ensemble de nos concitoyens qui ont vu les côtes françaises souillées, c'est avant tout, me semble-t-il, mettre fin au système qui privilégie la recherche du transport au plus bas prix au détriment de la sécurité des hommes et de l'environnement. C'est lutter contre toutes les formes de complaisance, contre le dumping social et contre le dumping en matière de sécurité.
Cette bataille pour la sécurité, j'ai commencé de la mener dès mon arrivée au Gouvernement, en 1997, en redonnant progressivement des moyens budgétaires et humains à une administration qui en avait singulièrement manqué pendant de nombreuses années.
Dès mon premier budget, devant la représentation nationale, le 25 octobre 1997, j'avais soulevé la question des navires de complaisance et de la lutte pour la sécurité des transports maritimes.
J'insistais alors sur le fait que la sécurité maritime avait trop longtemps été négligée et qu'il était nécessaire d'augmenter les effectifs des centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage, des centres de sécurité des navires et d'investir dans l'achat de vedettes de surveillance et de nouveaux baliseurs.
Je signalais aussi la nécessité de travailler activement auprès de l'Organisation maritime internationale et de l'Union européenne pour renforcer les règles relatives à la sécurité maritime.
C'est dans cet esprit, qui a toujours été le mien, que le Gouvernement a rapidement pris un certain nombre de mesures et déjà engagé des démarches auprès des instances internationales compétentes pour améliorer la sécurité maritime et ce sur trois plans.
Premièrement, sur le plan des engagements, notamment budgétaires et humains, en France pour assurer plus efficacement les missions de surveillance, de contrôle et d'intervention de l'Etat :
Sur le plan de l'intervention en premier lieu, la catastrophe de l'Erika a montré que nos dispositifs de lutte contre la pollution méritaient d'être améliorés.
Pour le plan Polmar terre, je crois qu'il faut d'abord reconnaître l'immense mobilisation tant des services de l'Etat que des élus du littoral et des bénévoles. A l'avenir, il nous faut véritablement être capables d'offrir non seulement des matériels ou des techniques d'expertise, mais encore une meilleure capacité d'encadrement et d'organisation.
Le Comité interministériel de la mer, qui s'est tenu le 28 février dernier a d'ailleurs commencé à tirer les premiers enseignements de cette situation et a confié à une mission le soin d'élaborer, pour le prochain comité interministériel, des propositions sur l'organisation de l'action de l'Etat en mer et à une mission d'inspection celui de faire un retour plus spécifique sur Polmar terre et la prise en compte de l'environnement.
S'agissant de l'appui à l'expertise par les institutions publiques, celles-ci me paraissent avoir accompli leur mission dans une large mesure. Il est vrai que chaque pollution est un cas particulier et que la météo comporte encore une marge d'incertitude. Le Comité interministériel de la mer a décidé de mieux identifier en permanence les capacités d'expertise existantes et de développer un réseau de recherche et d'échanges technologiques coordonnés.
Pour les matériels, une veille technologique existe et les stocks constitués depuis l'affaire de l'Amoco-Cadiz ont été efficacement mobilisés et concentrés sur la côte atlantique avant même l'arrivée de la première goutte de pétrole. Mais ensuite, sur zone, les aléas des prévisions ont rendu difficile le positionnement précis de ces moyens et les conditions météorologiques - c'était au moment des grandes tempêtes de décembre - en ont réduit l'efficacité. Sur le terrain, les administrations ont été mobilisées et ce de façon exceptionnelle. Pourtant, il y a eu des critiques que je comprends bien. C'est pourquoi des démarches de retour d'expérience ont été engagées pour améliorer le dispositif et des crédits supplémentaires débloqués pour reconstituer les stocks et réaliser les exercices plus régulièrement.
Quant aux types de matériels à prévoir, le fuel lourd de l'Erika ne représente, me dit-on, que 2 % de ce qui transite au large d'Ouessant et il nous faut donc nous préparer à traiter une grande variété de produits, avec des matériels qui ne sont pas obligatoirement adaptés à tous. Des progrès ont été faits chaque jour depuis le 12 décembre pour expérimenter ces nouveaux matériels. Certains ont servi dès la fin décembre, d'autres seront pré-positionnés dans le cadre du dispositif de sécurité pour le traitement de l'épave et donc pour le pompage.
Enfin, c'est l'ensemble de l'organisation des plans de secours en mer que le Gouvernement entend réexaminer à la lumière de l'expérience afin de renforcer la continuité entre l'action en mer et l'action à partir du rivage, d'améliorer la coordination interdépartementale, la coopération internationale et de maintenir un dispositif opérationnel et à jour.
Au-delà de l'organisation de l'intervention, une politique de la sécurité maritime efficace doit se développer dans le cadre d'orientations stratégiques s'appuyant sur des structures adaptées. C'est ainsi que j'ai engagé le plan de modernisation des affaires maritimes, du dispositif de surveillance et de contrôle, la professionnalisation des CROSS, la création de l'inspection du travail maritime pour mieux appréhender les conditions de travail et favoriser la prise en compte du facteur humain, élément essentiel de notre société.
S'agissant du volet humain et financier, le dernier Comité interministériel de la mer a consacré le renforcement des moyens les plus urgents attribués à la sécurité maritime en prévoyant notamment :
- le doublement du nombre d'inspecteurs de la sécurité maritime en trois ans et le renforcement des CROSS ;
- l'accélération de la remise en état de la signalisation maritime - phares, balises, flottes de balisage - par un plan de 300 MF sur trois ans ;
- la création de 30 postes d'officiers de port ;
- le renforcement des moyens d'intervention par la mise en place d'un quatrième remorqueur en Manche, d'un nouvel hélicoptère Dauphin et par l'affrètement d'un navire spécialisé dans la pollution.
D'autres mesures, encore à l'étude, seront présentées dans le cadre du prochain Comité ainsi que l'a annoncé le Premier ministre, et notamment le renforcement de la compétitivité du pavillon français.
Deuxièmement, au niveau d'une charte qui consacre les engagements des entreprises françaises qu'il s'agisse des pétroliers, des affréteurs, des armateurs ou des sociétés de classification :
Le 10 février dernier, j'ai réuni l'ensemble des opérateurs du secteur. Après des débats, dont je dois souligner devant vous la grande qualité, entre les représentants des institutions internationales, les représentants du personnel, et les divers professionnels concernés, les pétroliers, les armateurs, les sociétés de classification ont signé une charte dans laquelle ils se sont engagés en leur nom propre en faveur d'un renforcement de la sécurité des transports maritimes
Ont été notamment décidés : l'abandon de l'utilisation des navires à simple coque dès 2008 ; des contrôles plus approfondis et plus réguliers des structures des navires ; l'utilisation de pavillons respectant les réglementations internationales, notamment en ce qui concerne les conditions de travail des marins et une amélioration de la transparence dans l'activité du transport maritime.
Cette activité doit entrer dans une nouvelle ère : celle de la responsabilisation. C'est cette voie que les signataires de la charte ont choisie en présence du Gouvernement.
Troisièmement, au niveau des propositions auprès de nos partenaires européens mais également auprès de l'Organisation maritime internationale - l'OMI - et du FIPOL pour faire évoluer la prévention, le contrôle, les sanctions et la responsabilité des opérateurs, trois memoranda ont été déposés.
Le 15 février 2000, la France a transmis à l'OMI, au FIPOL et à la Commission européenne ces trois memoranda regroupant les propositions d'amélioration que la France souhaite faire aboutir au plan international.
Ces propositions sont guidées par trois priorités : prévenir, contrôler, responsabiliser.
Prévenir, c'est améliorer la surveillance des navires en étendant l'identification systématique des navires dangereux et en exigeant la transmission préalable d'un dossier de sécurité avant l'accès à un port européen.
Contrôler, c'est accélérer l'élimination progressive des pétroliers à simple coque les plus anciens de façon à s'aligner sur les dispositions déjà fixées par les Etats-Unis pour leurs eaux territoriales - Oil Pollution Act de 1990 -harmoniser les conditions de travail des équipages par la ratification des conventions de l'OIT, renforcer le contrôle de la structure des navires en cale sèche et assurer un meilleur contrôle des organismes chargés de la sécurité : inspecteurs des Etats du port et du pavillon et sociétés de classification.
Responsabiliser, c'est accroître la transparence sur la connaissance des navires grâce à la mise en commun d'informations sur la base de données Equasis, relever le plafond d'indemnisation du FIPOL pour les victimes des marées noires et revoir le mode de calcul des contributions.
La Commission européenne, sur la base du Mémorandum français qui lui a été adressé, a présenté, lors du Conseil européen des transports du 28 mars dernier, ses premières propositions : assurer un contrôle plus étroit des sociétés de classification, renforcer les contrôles de l'Etat du port en améliorant le ciblage des navires à inspecter, en particulier la structure des navires, accélérer le calendrier d'élimination des pétroliers à simple coque les plus anciens en s'alignant sur les dates retenues par les Etats-Unis, dont je précise qu'elles sont fixées à 2010.
Le Portugal qui préside actuellement l'Union européenne et, bien sûr, la France qui la présidera au second semestre 2000, sont déterminés à faire aboutir ces propositions rapidement et par les voies les plus appropriées - directives européennes et OMI. Les premières propositions devront aboutir avant la fin de cette année.
Par ailleurs, s'agissant de nos propositions à l'OMI, son secrétaire général vient de répondre favorablement à la demande que j'avais formulée de faire avancer rapidement les propositions françaises, en particulier l'élimination accélérée des pétroliers à simple coque.
Enfin, une discussion sur la réforme du FIPOL est engagée avec nos partenaires. Dans un premier temps, un consensus s'est nettement dégagé pour que soit augmenté à court terme le plafond de responsabilité dans le cadre des conventions existantes.
Une évolution de plus long terme sur les modes de contribution est envisagée et une nouvelle augmentation des plafonds, proposée par la France, est à l'étude.
Au-delà des mesures déjà prises, il nous reste encore à assurer le traitement de l'épave afin qu'elle ne constitue plus une menace pour nos côtes. Cette action débutera dans quelques jours, donc au début du mois de juin.
Cette mission, que le Premier ministre m'a confiée le 3 février dernier, je l'exercerai jusqu'au bout avec un triple souci :
- la sécurité pour les hommes et l'environnement ;
- le traitement complet de l'épave ;
- la rapidité d'engagement et de conduite de l'opération.
Comme vous le voyez, le Gouvernement a mis en _uvre tous les moyens pour renforcer durablement la sécurité maritime.
Nous devons mobiliser l'ensemble de nos partenaires, les institutions internationales, l'Organisation maritime internationale et la Commission européenne pour aboutir au plus vite.
Je suis sûr que votre commission d'enquête renforcera cette volonté pour éviter que de telles catastrophes ne se reproduisent et je souhaite très sincèrement que nous continuions à travailler ensemble pour faire progresser la sécurité maritime, indispensable au développement de ce mode de transport qui est un complément et un substitut à tout autre.
M. le Président : Merci, monsieur le ministre.
M. le Rapporteur : Monsieur le ministre j'aurai plusieurs questions à vous poser.
Par rapport au dispositif européen, nous avons pris connaissance avec intérêt des propositions faites à la fois par la France et la Commission, au Conseil européen des transports du 28 mars, et noté d'ailleurs une certaine similitude entre elles. Cela étant, elles modifient assez sensiblement les pratiques en cours.
Posez-vous un diagnostic sur la possibilité d'aboutir de l'ensemble du dispositif proposé et comment envisagez-vous le rôle d'accompagnement que pourrait jouer le Parlement dans cette affaire ?
M. Jean-Claude GAYSSOT : Pour être très franc, je dirai que j'ai senti, dès le moment de la catastrophe une indiscutable volonté de la Commission d'aider à faire avancer les choses. Je le souligne parce que je l'ai vécu directement et qu'avec la Commissaire, Mme de Palacio et le Directeur des transports et de l'énergie, M. François Lamoureux, nous avons alors multiplié nos contacts et été très fréquemment en rapport. C'est une volonté que j'ai véritablement sentie et je tiens à le souligner devant vous parce que c'est un élément important.
La Commission a proposé, dans le cadre de sa communication sur la sécurité, trois textes réglementaires - deux directives et un règlement - portant sur le renforcement du contrôle de l'Etat du port, sur le renforcement du contrôle des sociétés de classification et sur l'élimination, à terme, des navires à simple coque.
Ces propositions, comme vous l'avez dit justement, reprennent certaines des préoccupations exprimées par la France dans ses memoranda. Elles vont, de notre point de vue, dans le bon sens et constituent une avancée indispensable. Toutefois, je tiens à dire qu'elles n'épuisent pas - loin s'en faut - les réformes nécessaires.
A cet égard, les memoranda français comportaient des propositions supplémentaires importantes sur le contrôle de sécurité a priori dans les ports - lequel pourrait donc avoir lieu avant que les navires ne longent nos côtes - sur la responsabilisation des opérateurs de transport, sur les sanctions qui pourraient être infligées mais aussi sur un mécanisme d'indemnisation plus efficace pour les victimes et plus incitatif pour les opérateurs : c'est en ce sens que je parlais tout à l'heure d'évolutions à plus « long terme ».
En effet, on ne voit pas pourquoi ceux qui s'engagent dans la modernisation et la sécurité de leurs bâtiments devraient payer autant que ceux qui traînent les pieds pour les mettre aux normes.
M. le Rapporteur : Là, vous faites allusion au FIPOL ?
M. Jean-Claude GAYSSOT : Oui, je parle de la contribution au FIPOL, car c'est dans ce cadre que ces propositions ont été avancées. Le Mémorandum prévoyait également la mise en place d'un système de contrôle des inspecteurs de sécurité et l'harmonisation vers le haut des conditions d'emploi et des statuts des marins.
Vous me demandez de poser un diagnostic mais j'ai le sentiment que c'est plutôt un pronostic que vous attendez de moi !
M. le Rapporteur : Disons une perspective !
M. Jean-Claude GAYSSOT : Je crois que les trois textes de la Commission pourraient aboutir - je ne donne aucune garantie car cela ne dépend pas que de nous - dans le cadre de la présidence française, ce qui explique que j'ai pu avancer l'idée que ce soit avant la fin de l'année, mais il nous faut engager des discussions sur les autres propositions.
M. le Rapporteur : Ma deuxième question sera d'un tout autre ordre. Lors du dernier Comité interministériel de la mer, un certain nombre de dispositions ont été prises, notamment celle qui vise à doubler le nombre des inspecteurs.
Or, au fil des auditions de la commission d'enquête, nous mesurons la difficulté qu'il y a à trouver des personnels compétents non seulement pour l'administration d'Etat mais également pour d'autres secteurs du contrôle, y compris pour le vetting que les compagnies pétrolières effectuent pour leur propre compte.
Le recrutement souffre d'un manque de personnels ayant la qualification, la compétence indispensables pour juger de la qualité d'un bateau et plus encore l'expérience dont on voit bien qu'elle est essentielle pour un tel exercice puisque tous les acteurs que nous avons entendus ont déclaré vouloir privilégier d'anciens commandants de bateau à qui « on ne la fait pas » et « qui ont l'_il » si vous me permettez ces expressions.
C'est une situation préoccupante et j'aimerais savoir si vous avez déjà engagé des réflexions sur la possibilité, soit d'élargir le recrutement des écoles de la marine marchande, soit de prévoir des cursus particuliers pour ceux qui voudraient s'orienter vers cette carrière d'inspecteur. En effet, malgré la volonté financière qui a conduit à créer des postes, on sent bien qu'on risque de manquer de personnels pour les occuper...
M. Jean-Claude GAYSSOT : Vous soulevez là un problème tout à fait réel auquel nous sommes effectivement confrontés. Nous avons ouvert un concours. Mais nous n'avons finalement pu retenir qu'un seul candidat, les autres ne répondant pas au niveau exigé.
Le Gouvernement ayant pris la décision de doubler le nombre d'inspecteurs de la sécurité maritime dans les trois ans à venir, il est évident que la situation doit évoluer. Pour répondre à votre préoccupation, je signale : premièrement, que nous travaillons à l'augmentation du niveau de rémunération pour rendre la fonction attractive puisque au dernier concours, pour treize postes, il y a eu moins de candidats que de postes offerts ce qui est assez paradoxal...
M. le Rapporteur : Cela ne m'étonne pas...
M. Jean-Claude GAYSSOT : ... deuxièmement, que nous envisageons l'élargissement du cursus de l'école de la marine de Nantes pour trouver une solution à ce problème.
Pendant que vous me posiez cette question, l'idée suivante m'est venue à l'esprit : si nous avons les garanties que, dans chaque port, le contrôle non seulement de l'Etat du pavillon mais également de l'Etat du port s'effectue, cela renforcera la vigilance et les possibilités de contrôle par rapport aux navires qui entreront dans nos ports.
Cela étant, je partage votre avis sur ce point, il faut absolument faire progresser les choses pour avoir des recrutements qui soient à la hauteur voulue.
M. le Président : Le fait qu'il y ait eu moins de treize postulants pour treize postes est-il simplement lié au niveau de rémunération ou y a-t-il d'autres raisons ? La responsabilité de l'inspecteur qui doit donner son accord pour qu'un navire reparte n'est-elle pas jugée trop lourde ? Il est important de savoir quelles sont les causes de ce problème pour savoir quelles réponses y apporter.
M. Jean-Claude GAYSSOT : Je crois, monsieur le Président, qu'il faut y regarder de plus près, y compris pour ce qui concerne l'attrait de nos propres formations en amont...
A votre question, j'ai envie de répondre que les deux aspects sont sûrement liés dans la mesure où les effets d'une meilleure rémunération et d'une plus grande attractivité se répercuteraient sur la prise en compte de la responsabilité.
Il me semble évident, qu'il y a un lien entre les deux aspects de la question que vous soulevez et que c'est en travaillant ce lien que nous avancerons. Si la formation de base est insuffisante, il est également vrai que les candidats sont peu nombreux et il est normal que les capitaines au long cours soient payés à leur juste valeur.
M. le Rapporteur : Ainsi que je l'ai déjà évoqué, cette difficulté s'observe tant au niveau des sociétés de classification que des personnels de vetting des chargeurs. Ce manque de personnel qualifié est pratiquement une vraie constante et va devenir un véritable problème national.
Je souhaiterais vous interroger maintenant sur deux autres points pour examiner ce qui s'est produit à la suite de la pollution et en tirer d'éventuelles leçons. Nous avons le sentiment que chacun a fait son métier mais que la somme des actions des uns et des autres n'a pas permis d'obtenir une bonne coordination. S'il n'y a rien à dire sur le comportement de l'un ou de l'autre ou de telle ou telle administration, en revanche, il y a à dire sur l'organisation générale et j'en donnerai un exemple très révélateur : les médias expliquent que l'Erika fuirait encore alors qu'on croit savoir que ce n'est pas vrai. Il y a donc problème de communication, entre autres, dont on peut dire qu'il existe depuis le début de l'affaire...
Je sais que vous n'avez été que tardivement en charge du dossier - le 3 février avez-vous dit - mais il me semble que des missions ont été mandatées par le Premier ministre à ce sujet. Puisque vous dites vous-même dans votre propos qu'il faut renforcer la coopération interdépartementale et internationale, comment l'entendez-vous ? Avez-vous déjà tiré des enseignements ou une réflexion est-elle en cours pour améliorer la coordination de l'action de l'Etat dans ce type d'événements?
M. Jean-Claude GAYSSOT : Il est vrai qu'un dispositif existait - Polmar mer, Polmar terre - qui concernait plusieurs ministères.
A l'évidence, le besoin d'une meilleure coordination est apparu à la lumière des événements. C'est sûrement avec ce souci que le Premier ministre m'a confié, la responsabilité du traitement de l'épave, car nous ne parlons à présent que du traitement de l'épave. Cette responsabilité, je l'assume pleinement, bien sûr en coordination avec d'autres mais à titre personnel, et je l'assumerai pleinement dans l'esprit que j'ai rappelé en préambule.
Nous avons donc décidé, à l'occasion du Comité interministériel de la mer, de tirer les enseignements de cette affaire. Avec le retour d'expérience nécessaire, nous avons, à cet effet, mis en place une mission - la mission Théry - pour éviter que ne se reproduisent des situations de ce type.
Pour autant, je partage votre analyse : pris séparément, chacun a tenté de faire exactement ce qu'il croyait devoir faire dans le cadre de ses prérogatives mais le besoin de cohérence et d'organisation apparaît tout à fait indispensable.
Maintenant, pour ce qui concerne le traitement de l'épave vous avez évoqué les fuites dont parle la presse.
Je suis tous les jours, même si le traitement proprement dit de l'épave n'a pas encore commencé, ce qui se passe sur les deux morceaux du bateau qui sont à onze kilomètres l'un de l'autre, par cent-vingt mètres de fond ce qui n'est pas de nature à nous rassurer sur le comportement de leur structure.
On me dit qu'il ne s'agit pas, en l'état actuel des choses, de fuites mais de suintements : on a parlé d'une dizaine ou d'une quinzaine de litres par jour et quand j'ai posé la question de savoir ce qu'il en advenait, il m'a été répondu que ces quelques litres quotidiens remontaient en surface où il y avait irisation et évaporation.
Toutefois, un système de surveillance permanente est en place. Lorsque de vraies fuites ont été constatées, le colmatage a été immédiatement engagé. Maintenant, nous ne maîtrisons, ni les informations reproduites dans les médias, ni les déclarations des uns ou des autres.
Pour ce qui est de la communication sur cette affaire, il existe, d'une part ce qu'on appelle « le fax Erika » qui est publié régulièrement, d'autre part des réunions qui, comme je m'y étais engagé, se déroulent de façon périodique à Rennes et où il est fait état des éléments que je viens de vous rapporter. Je précise que ce dispositif va être considérablement renforcé dès le démarrage du traitement de l'épave et si cela vous intéresse je vous exposerai dans le détail ce que j'envisage de faire.
M. le Rapporteur : Ma dernière question aura trait à la coopération internationale. Pour en revenir à la prévention et aux problèmes de circulation, comptez-vous prendre des initiatives, d'une part avec les Britanniques, et d'autre part avec les voisins de la France en Méditerranée pour renforcer les moyens de contrôle de la circulation et les moyens d'intervention en commun ?
Vous nous avez dit avoir mentionné dans l'un des memoranda la possibilité d'interpeller les bateaux avant leur arrivée dans les ports européens ce qui est une très bonne mesure pour autant qu'on ait les moyens de l'appliquer ; des initiatives ont-elle été prises ou sont-elles prises pour renforcer les moyens de coopération entre les pays voisins ?
J'ajoute, et ce faisant j'anticipe sur les conclusions de la commission puisque ce sujet occupera sûrement une place significative dans le rapport, que nous sommes très frappés par la situation en Méditerranée où manifestement on n'a pas du tout imaginé qu'une telle catastrophe pouvait survenir alors qu'il apparaît que le trafic pétrolier y est croissant et qu'il va encore se trouver renforcé par les récentes découvertes de pétrole dans le Caucase, et où, comme il n'existe pas de zone économique exclusive, un accident de ce type serait encore beaucoup plus lourd de conséquences qu'en Bretagne ou en Atlantique, d'autant qu'il n'y pas d'outils d'intervention.
Nous avons pu constater qu'il existait seulement un accord entre le département des Alpes-Maritimes et Gênes pour la protection du secteur et que le CEDRE Méditerranée, se limitait à deux personnes en poste à Malte et à un emploi-jeune pour couvrir la zone allant du Liban à Gibraltar...
M. Gilbert LE BRIS : J'ai une question qui complète celle de notre Rapporteur puisqu'elle a également trait à la prévention et au retour d'expérience.
A l'heure actuelle, sans parler de l'Erika qui était un cas différent, pour venir en aide à un pétrolier qui se trouverait en difficulté au large des côtes bretonnes, comme cela arrive malheureusement trop souvent dans un endroit où des bateaux de toutes tailles se croisent, se doublent, les uns étant au travail ou en flânerie, les autres en panne car on rencontre toutes les situations, on dispose des remorqueurs Abeilles International de Brest ou de Cherbourg. Leurs contrats sont actuellement prolongés mois après mois sans que l'on sache très bien ni combien de temps cela va durer, ni dans quelles circonstances.
Dans ces conditions, avez-vous le sentiment qu'institutionnellement - et vous allez laisser parler votre c_ur puisque nous avons déjà évoqué ce sujet dans d'autres circonstances - il est bon que des remorqueurs type Abeille soient mis à la disposition du préfet maritime, à charge pour lui de les mettre en action, quand on sait que le budget qui lui est imparti au titre du ministère de la défense privilégie toujours les moyens opérationnels de défense nationale et non les moyens de prévention de nos côtes, et que l'arbitrage se fait toujours en faveur de la mission prioritaire ?
Ne serait-il pas plus satisfaisant que, d'une façon ou d'une autre, ces moyens soient rattachés à un ministère comme le vôtre ou qu'une entité prenne en charge la défense de nos côtes ?
Par ailleurs, concernant les moyens matériels mis en _uvre pour la prévention, j'ai évoqué l'incertitude qui planait encore au niveau des remorqueurs Abeilles, et j'aimerais savoir si une réflexion est en cours au sein de votre ministère ou du Gouvernement pour voir quels sont les trous du dispositif ? Jean-Yves le Drian vient d'en pointer un en Méditerranée mais il me semble qu'il y en a un autre dans le Golfe de Gascogne, étant précisé que, pour la Manche, nous n'en sommes encore qu'à un système provisoire puisque le contrat passé avec le bateau-phare turbo est à durée déterminée et qu'il faudra bien sortir de ce système temporaire.
Ma question comporte donc deux volets puisqu'elle vise à savoir où en est la réflexion sur la prévention et au niveau institutionnel et au niveau matériel.
M. Jean-Claude GAYSSOT : Je répéterai d'abord qu'une mission travaille sur l'action de l'Etat en mer, précisément à partir de ces questions que vous posez les uns et les autres et que nous nous posons. C'est bien à la lumière de cette mission que nous pourrons apprécier ce qu'il y a lieu éventuellement de modifier, de conforter, de coordonner ou de consolider.
Je profite d'ailleurs de cette occasion pour dire quelque chose qui me tient à c_ur : nous sommes certes confrontés à ces catastrophes écologiques qui peuvent d'ailleurs se doubler de drames humains - je rappelle que le sauvetage des vingt et un marins de l'Erika a été plus que difficile - mais je crois honnêtement et objectivement - sans dire qu'il ne s'est rien fait dans le passé après l'Amoco-Cadiz, car ce serait injuste puisque des avancées ont été enregistrées, notamment au niveau des rails - que le risque est toujours grand, une fois la catastrophe passée et l'émotion retombée que le « train-train », si on peut employer cette expression à propos de bateaux, reprenne le dessus.
Personnellement, je crois qu'une convergence est en train de s'opérer entre cette émotion, cette révolte presque des populations concernées par la pollution - l'engagement de l'Etat dont la charte maritime qui vient d'être signée est la preuve, l'Europe et même l'OMI, et que nous sommes aujourd'hui en capacité de faire bouger les choses. C'est un point capital comme l'est aussi l'intervention des élus aussi bien au niveau de la commission d'enquête qu'à celui de l'aide qu'elle va nous apporter pour améliorer la situation et les moyens dont nous disposerons à cet effet.
Je referme cette parenthèse mais je crois qu'elle est importante !
Pour vous apporter une réponse plus précise et concrète, je dirai que nous avons décidé d'affecter un nouveau remorqueur en Manche. Le système, comme vous l'avez rappelé, est sous responsabilité du ministère de la défense et bien entendu, il nous faudra veiller - et la mission Théry doit nous y aider - à faire en sorte que cette dimension de prévention ne passe pas au second rang par rapport à d'autres activités.
Dans le domaine de la coopération, qui donne lieu à débat, certains pays souhaitant la création de garde-côtes européens, je pense qu'en cherchant à obtenir un système totalement intégré et commun on risque d'avoir plus de difficultés qu'en agissant en coordination et en coopération, y compris sur des bases de critères communs. En effet, des critères communs faciliteront l'action, compte tenu du fait que l'harmonisation à l'échelle européenne est, contrairement à ce que d'aucuns pensent, un facteur de lutte contre la bureaucratie et permet une action moins administrative et donc plus efficace.
Actuellement, je rencontre les responsables de tous les pays : je viens d'Espagne, de Finlande, j'ai eu un entretien avec mes collègues italiens, une rencontre très importante avec mon homologue allemand Reinhard Klimmt ainsi qu'avec la ministre belge des transports, le tout en moins d'une dizaine de jours...
Là encore, je trouve une volonté commune croissante, notamment chez nos proches voisins.
Vous avez parlé de la Méditerranée et de l'Espagne par rapport à la prévention en Atlantique. Il faut d'abord savoir que nous coopérons avec ce pays sur la base d'un contrat à durée déterminée. Mais c'est une question qu'il faudra sûrement étudier car j'estime qu'il n'y pas lieu, dans ce domaine, de jouer la précarité, y compris au niveau des accords.
Pour la Méditerranée, la référence à la zone exclusive économique n'entre même pas en jeu ; l'affaire va donc se régler à la Convention de Barcelone, puisque nous avons proposé, sur le volet environnement, que désormais la Méditerranée soit concernée par cette mesure. Nous souhaiterions que ce point soit réglé à la Convention de Barcelone et nous travaillons pour qu'il en soit ainsi.
Il est d'ailleurs intéressant de le faire pour une bonne raison qui est la suivante : nous pouvons évidemment toujours considérer que nous sommes chez nous dans nos eaux territoriales et que nous pouvons y faire ce que nous bon nous semble à ceci près que les navires passent bien au-delà de leurs limites - l'Erika était environ à 70 kilomètres de la côte. Comme ils sont néanmoins dans la zone exclusive économique, à partir du moment où il y a une référence à l'économie et que l'incidence sur l'économie est réelle, notamment en matière de pollution et d'environnement c'est donc, à mon avis, dans ce sens qu'il faut intervenir.
Par ailleurs, j'ai évoqué précédemment le système Equasis. L'Europe y a adhéré sans réticence, mais elle n'a pas été la seule puisque les Etats-Unis ainsi que certains pays du sud-est asiatique ont fait de même.
Quel est l'avantage d'Equasis ? De permettre à tout moment d'avoir des informations sur un bateau qui est au large et qui fait route vers un port, de savoir son âge, les réparations dont il a été l'objet, le nom de la société de classification dont il relève.
Autrement dit, c'est un outil qui nous met en alerte : savoir que le bateau a subi telle et telle réparation va permettre d'exercer de manière plus précise les contrôles et la surveillance. Alors qu'aujourd'hui nous sommes pratiquement « aveugles » par rapport aux 300 000 mouvements de bateaux que supporte la Manche et aux quelque 50 000 qui se font au large d'Ouessant...
Il faut pouvoir obtenir des informations sur les navires qui croisent le long de nos côtes, car si nous avions la capacité, au niveau de l'Etat du port, d'exercer un contrôle assez efficace pour bloquer les navires défectueux, cela viendrait renforcer la prévention.
Dans le système aérien - ce qui ne signifie pas qu'il ne demande pas, lui aussi, à être amélioré -, un certain nombre de garanties sont apportées sur les appareils à l'échelle mondiale. Sans prétendre qu'il faille exactement copier le dispositif parce que les choses ne se présentent tout à fait de la même façon, je pense que c'est l'état d'esprit qui doit nous animer.
M. Georges SARRE : Monsieur le ministre, je souscris à nombre de vos propos mais j'ai une vue plus pessimiste des choses.
Je commencerai par une citation : « tant que les affréteurs ne seront pas responsables, le problème ne sera pas résolu » déclarait la commissaire européenne chargée des transports, un mois après la catastrophe de l'Erika, faisant, en cela, d'ailleurs écho au Président de la République française qui affirmait le 20 janvier 2000 : « L'équité commande que les pollueurs, armateurs et affréteurs soient les payeurs ! ».
Aujourd'hui, cinq mois après la marée noire, on peut craindre que les mesures de prévention et de dissuasion capables d'éviter la répétition d'une telle catastrophe demeurent inexistantes ou insuffisantes.
A preuve, monsieur le ministre, la modestie que vous avez soulignée, même si vous l'avez fait en termes plus élégants, des trois projets de directive soumis au Conseil des ministres européens du 22 mars sur le renforcement du contrôle des sociétés de classification et des navires anciens et sur l'obligation des double coque à partir de 2015 - d'après mes informations mais j'ai cru vous entendre parler de 2008... Limitées, en outre, à l'adoption prochaine de mesures institutionnelles telles que la création d'un fichier sur l'état des navires - Equasis dont vous venez de parler - et d'une Agence de la sécurité maritime, les autres propositions communautaires ne contribueront donc que symboliquement à la réduction des risques de pollution.
Comme le recommandait déjà, en juillet 1994, la délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne dans son rapport sur la sécurité maritime, il convient d'exiger impérativement la mise en cause de la responsabilité des chargeurs dans les transports par mer des hydrocarbures. Or, c'est ce que refuse à présent la Commission de Bruxelles arguant « de la complexité du problème ». Tout cela n'est pas le fruit du hasard mais de la pression des lobbies pétroliers et armatoriaux, particulièrement actifs depuis le naufrage de l'Erika.
En dépit de cette réticence de la Commission soumise aux influences des intérêts professionnels en cause, il semble toutefois encore possible, au niveau national, de mettre en jeu la responsabilité des chargeurs et des pétroliers.
En effet, à l'heure où la Commission et le Conseil des ministres s'apprêtent à adopter une directive sur la responsabilité environnementale, visant notamment à consacrer la responsabilité des seuls exploitants des moyens de transport et à exonérer les véritables donneurs d'ordre, industriels du pétrole et de la chimie, il demeure toujours possible, en France, de sanctionner ces derniers, car comme le mentionne le Livre Blanc du 9 février 2000 : « les Etats peuvent, conformément à l'article 176 du traité, décider que d'autres parties sont également susceptibles d'être reconnues responsables » - note figurant au paragraphe 44 - raison pour laquelle il est indispensable que notre Commission d'enquête demande, pour ne pas dire exige, l'adoption, en France, par le Parlement, de dispositions législatives appropriées pour reconnaître la responsabilité financière et pénale des affréteurs et propriétaires des cargaisons dans le domaine du transport maritime.
A cet effet, monsieur le ministre - c'est au politique que je m'adresse - je souhaiterais vous poser trois questions.
La première concerne la lutte contre les dégazages sauvages dont nous devons vous féliciter. Depuis le mois de février, plusieurs dizaines de pollutions par dégazages en mer ont été déplorées mais à peine une demi-douzaine de navires, dont un appartenant à M. Vincent Bolloré, ont pu être verbalisés en raison non seulement de l'insuffisance de nos moyens de surveillance aéromaritimes, mais également de la complexité des voies de recours international. Pourquoi ne pas rendre obligatoire dans les ports le dégazage des cuves, opération de vidange très peu coûteuse, avant d'autoriser l'appareillage du navire ?
La deuxième question a trait à l'application, suggérée par M. Lionel Jospin à la mi-février, d'une taxe sur les tankers âgés et dangereux.
Pourquoi attendre pour mettre en _uvre cette taxe de dissuasion d'emploi de navires-poubelles faisant escale en France, alors qu'il n'existe aucun risque de détournement de trafic vers les ports étrangers pour l'alimentation de nos raffineries et dépôts pétroliers ?
La troisième et dernière question est relative à la mise en jeu de la responsabilité des affréteurs de navires pétroliers et chimiquiers, comme l'autorise la directive européenne en préparation sur la responsabilité environnementale, qui renvoie, une fois de plus, au Livre Blanc du 9 février 2000.
Bien que le projet actuel concentre la responsabilité sur l'exploitant, la Commission souligne que : « Les Etats peuvent décider que d'autres parties sont susceptibles d'être reconnues responsables, conformément à l'article 176 du traité « . Le Gouvernement envisage-t-il de faire adopter en France une loi fondée sur cet article 176 pour permettre de mettre en cause, à l'avenir, la responsabilité des affréteurs de navires pétroliers ?
M. Jean-Claude GAYSSOT : Je ne suis ni optimiste, ni pessimiste : je suis déterminé, confiant et vigilant. Voilà quel est mon état d'esprit !
Comme vous, je suis déterminé, et je crois que c'est un sentiment unanimement partagé, à ce que la donne soit changée dans le domine du transport maritime. C'est pourquoi vous avez pu noter que mon introduction se fondait sur l'idée qu'il faut bannir la recherche du transport au plus bas prix quand elle se fait au détriment des hommes et de l'environnement : c'est ma démarche et je n'en démordrai pas plus que ne le fera le Gouvernement !
Vous avez évoqué, à tort, 2015 : actuellement la date est fixée à 2019, excepté pour les Etats-Unis qui ont pris, eux-mêmes, la décision unilatérale d'interdire à partir de 2010 les navires à simple coque ce qui est parfaitement leur droit. Je ne critiquerai donc pas cette décision américaine si ce n'est pour dire qu'elle présente pour nous un sacré inconvénient. En effet, dans la mesure nous en resterions à cette date de 2019, les navires qui ne pourront plus faire escale dans les ports américains, iront ailleurs et en particulier en Europe ce qui justifie la proposition communautaire de retenir pour date, non pas 2015 mais 2010 ! Je pense que cette bataille-là, il nous faut la gagner !
Je me suis félicité de ce que la date proposée - ce qui prouve qu'il y a des possibilités d'avancer - dans la charte signée en France par les armateurs, les sociétés de classification et les opérateurs concernés à l'échelle de notre pays, qu'il s'agisse de filiales de multinationales pétrolières ou de groupes français, ne soit pas 2010 mais 2008, alors qu'on savait que celle de 2010 avait été retenue à l'échelle américaine. J'avais démarré les propositions à 2005 ce qui a conduit certains des signataires à me reprocher de vouloir « les mettre sur la paille » et c'est l'échéance de 2008 qui a finalement été choisie.
Pour ce qui est de la responsabilité des affréteurs notamment, je vous accorde qu'il est effectivement indispensable et normal de la mettre en évidence, mais au niveau du FIPOL puisque c'est auprès de lui que les affréteurs cotisent.
Outre l'interdiction d'utiliser des navires à simple coque à partir de 2010, outre les propositions que nous soumettons en matière de contrôle des structures et autres qui vont les concerner directement puisque les bateaux jugés défectueux à la suite des contrôles pourront se trouver immobilisés au port, il existe une responsabilisation directe de l'affréteur au niveau du FIPOL, comme il y une responsabilité directe des sociétés de classification qui donne d'ailleurs matière à discussions.
Il faudrait obtenir des garanties pour éviter qu'une société de classification laisse partir un navire en le déclarant en bon état quand ce n'est pas le cas
L'un des moyens efficaces pour responsabiliser les affréteurs consiste, d'une part à augmenter les plafonds d'indemnisation car cela se matérialise en monnaie sonnante et trébuchante, d'autre part à les mettre à contribution en fonction de la qualité des navires.
Nous voudrions voir accepter une démarche positive et constructive dans ce sens.
M. le Président : Par la prime à la qualité ?
M. Jean-Claude GAYSSOT : Exactement, de manière à ce que, tout en augmentant la cotisation au FIPOL, celui qui utilise de bons navires ne paie pas autant, voire paie moins, que celui qui a recours à de mauvais navires...
L'application immédiate en France de la taxe européenne dont a parlé le Premier ministre est une proposition française, mais le problème qui se pose et qui donne matière à réflexion, tient au fait qu'en adoptant cette mesure uniquement au niveau national on risque de voir les navires se détourner de nos ports sans pour autant les empêcher de longer notre littoral...
M. Georges SARRE : Il n'y a pas de détournement de trafic à craindre...
M. Jean-Claude GAYSSOT : C'est une opinion que tout le monde ne partage pas !...
D'ailleurs, s'il n'y a pas de détournement, si les bateaux défectueux peuvent quand même venir, cela signifie que la mesure n'a pas atteint son but...
Je prends donc le problème dans l'autre sens en disant que c'est au niveau européen qu'il faut mettre en _uvre une disposition efficace...
M. Georges SARRE : A défaut...
M. Jean-Claude GAYSSOT : A défaut mais pas seulement, car il y va de l'intérêt de la France qui, elle aussi, a une vocation maritime. Personnellement, je crois au transport maritime et comme je le disais aux armateurs et aux affréteurs le plus grave obstacle au développement du transport maritime, y compris dans notre pays, c'est son insécurité pour les hommes et l'environnement.
C'est sous cet angle que j'envisage le problème, mais je crois qu'au niveau européen et international, il faut faire avancer les choses pour éviter de nous retrouver avec des distorsions qui, sans éliminer le danger de pollution, risqueraient de nous priver d'une partie de notre trafic.
Vous avez soulevé le problème du déballastage que tout le monde appelle à tort « dégazage ». Ce n'est malheureusement pas le seul à se poser car outre les déballastages des pétroliers, il y a les vidanges de ces moteurs énormes qui équipent tous les bateaux.
Le déballastage consiste à vider les cuves et les ballasts des navires pour les débarrasser des résidus pétroliers qu'ils contiennent. Voilà quel est le but technique de l'opération mais certains navires rejettent aussi illicitement les déchets qui sont liés à l'exploitation tels que les huiles de moteur et autres.
Les deux pratiques, qu'il s'agisse de déballastage ou de vidange, doivent être considérées comme illicites, traquées et sanctionnées. A ce propos, je vous signale que, si ma mémoire est bonne, la loi prévoit de les punir par trois mois à deux ans de prison ferme et un million de francs d'amende, même s'il est vrai que les condamnations se comptent sur les doigts d'une main...
M. le Président : Il y a eu une seule condamnation !
M. Georges SARRE : Non, trois.
M. Jean-Claude GAYSSOT : En revanche, il semble aussi que des opérations telles que « Rail propre » aient permis, d'abord de prouver que de tels actes existaient, ensuite de « coincer » quelques-uns de leurs auteurs, puisque je crois que plusieurs de ces affaires viennent d'être déférées devant la juridiction compétente en la matière, en l'occurrence le Tribunal de Paris. Nous souhaitons que la Justice les mène à leur terme et que des sanctions soient prononcées.
Par ailleurs, nous avons mis en place des moyens de surveillance dont deux avions Polmar des douanes et deux avions de surveillance maritime basés à Lann-Bihoué. Nous avons constaté une quarantaine de pollutions dont, compte tenu de la difficulté à les identifier, seulement trois ont été verbalisées.
Dans le cadre du dernier Comité interministériel de la Mer, nous avons décidé de doter la France de nouveaux moyens de surveillance par l'accélération du plan douanes Polmar afin de disposer, dès l'an prochain, pour la surveillance, de deux nouveaux avions encore plus modernes.
Comme je l'ai dit, la France soutiendra activement l'adoption de la directive européenne obligeant les navires à attester du dépôt de leurs déchets avant de quitter un port de l'Union.
Toutefois, la France prévoit, ce qui est important, d'appliquer cette directive sans en attendre l'adoption, anticipant ainsi le dispositif européen.
M. le Rapporteur : J'ai déposé un amendement dans ce sens !
M. Jean-Claude GAYSSOT : Oui et je suis également décidé à donner suite à cette possibilité.
A cela vient s'ajouter l'augmentation du nombre des officiers du port, mais j'ai demandé que l'on ne s'en tienne pas là. En effet, je suis convaincu - et je sais bien que lorsque j'ai, pour la première fois, émis cette idée à l'Assemblée nationale, elle a laissé certains perplexes - qu'en faisant travailler nos scientifiques, nos chercheurs, nos techniciens, certaines personnes très intelligentes vont trouver un moyen, outre l'interdiction de quitter le port sans satisfaire aux obligations de déballastage qui supposent que les ports soient équipés en conséquence, de détecter les pollueurs.
M. le Président : Les équipements doivent suivre mais également les tarifs...
M. Jean-Claude GAYSSOT : On pourrait admettre que ces obligations soient remplies dans un port ou dans un autre en fonction des distances, du moment qu'on puisse vérifier techniquement, visuellement, que le déballastage a été bien effectué dans un port, car si tel n'est pas le cas, cela signifie qu'il a eu lieu en mer ce qui est un délit.
C'est dans cette optique que j'ai émis l'idée d'une possible « boite noire » car je dois vous confier une chose : le pétrole, ça se marque, grâce à une sorte « d'ADN du pétrole ». Je peux vous garantir que cela se fait car j'ai posé la question à des scientifiques qui m'ont répondu que c'était une partie jouable et que des études étaient actuellement menées pour identifier les produits transportés. Si elles aboutissent, elles permettront de connaître l'origine des déchets déversés et de vérifier que les déballastages ont bien lieu dans les ports et pas ailleurs.
Mme Jacqueline LAZARD : Monsieur le ministre, beaucoup de choses ont déjà été dites puisque vous avez déjà répondu à de nombreuses questions et que vous nous avez apporté par votre exposé de multiples éléments d'information, mais je reviendrai néanmoins sur la prévention avant d'aborder tout ce qui concerne l'intervention en aval en cas de catastrophe.
Vous avez indiqué que vous envisagiez de doubler le nombre des inspecteurs malgré les difficultés de recrutement évoquées. A cet égard, je pense, et je crois que vous en serez d'accord avec moi, qu'aussi longtemps que la question de la rémunération n'aura pas été réglée, vous n'aurez pas beaucoup de candidats à ces concours pour occuper ces postes qui sont pourtant à grande responsabilité. C'est là un problème très important que le Gouvernement doit prendre à bras-le-corps.
Il me semble également nécessaire de procéder à une meilleure répartition des moyens aussi bien maritimes qu'aériens sur l'ensemble du territoire : nous avons évoqué le problème pour la Méditerranée, mais il se pose également pour le Golfe de Gascogne qui, actuellement, n'est pas surveillé.
Concernant l'intervention en aval des catastrophes, n'estimez-vous pas, monsieur le ministre, que les moyens sont trop dispersés entre l'administration militaire et l'administration civile, entre le secteur public et le secteur privé, entre les départements et les régions, entre les différents préfets et qu'il serait bon de réfléchir à une administration unique ?
Je terminerai en vous interrogeant sur le pétrolier à double coque dont on n'ignore pas qu'il présente un risque sérieux d'explosion en cas de collision à plus de trois n_uds : les services de votre ministère qui en sont sûrement informés ont-ils réfléchi au projet européen de l'E3 et qu'en pensez-vous, vous-même ?
M. Jean-Claude GAYSSOT : Je précise à propos de la dernière partie de votre intervention, que vous ne m'avez jamais entendu parler d'un navire à double coque, mais simplement de l'interdiction des navires à simple coque.
Évidemment, mon propos peut être interprété et puisque je dis qu'il ne faut plus de navires à simple coque, on pourrait en déduire que je souhaite des navires à double coque mais ce ne serait pas tout à fait exact.
En effet, je suis de ceux qui pensent, comme vous, - après je laisserai le soin aux spécialistes et aux techniciens de se prononcer car il faut être prudent et savoir qu'il peut y avoir derrière ce genre d'appréciation des intérêts, y compris d'ordre économique - que les navires à pont intermédiaire sont au moins aussi efficaces que les double coque, voire plus efficaces si j'en crois certains.
Nous allons voir si, à l'échelle européenne, le débat portera sur les navires double coque ou à pont intermédiaire. Si tel est le cas, je ne serai pas de ceux qui partiront en guerre contre les double coque - personne ne le comprendrait - mais je me battrai pour qu'ils ne soient pas imposés de manière exclusive. Ma démarche consistera donc à laisser les navires à pont intermédiaire, si on nous dit qu'ils sont aussi efficaces ou plus efficaces que les double coque, à les laisser se substituer aux navires à simple coque.
Entre nous soit dit, je me suis rendu, il y a deux jours en Espagne et j'y ai rencontré mon homologue espagnol qui a attiré mon attention sur le point suivant : si, à l'échelle mondiale, on commence à dire qu'à partir de 2010 il ne doit plus y avoir de navires à simple coque - le but étant que les choses avancent en concomitance non seulement au niveau de la France, mais aussi à celui de l'Europe et de l'OMI - cela signifie que nous pouvons connaître une relance de la construction navale.
M. Georges SARRE : Il faudra rouvrir des chantiers...
M. Jean-Claude GAYSSOT : Je dis cela au passage, mais il est certain qu'à l'échelle française et européenne il nous faudra « tirer le fil » de cette possibilité ; je referme cette parenthèse parce qu'elle déborde un peu le cadre de la commission d'enquête.
En ce qui concerne la coordination, je rappelle que la mission Théry a justement pour objectif de fournir des éléments de réponse pour faire bouger les choses et améliorer l'efficacité du système, y compris en aval. Si les missions des uns et des autres ne sont pas homogènes, la tâche est d'une difficulté évidente soit parce qu'il devient alors impossible de faire converger tous les éléments, soit parce que certaines contradictions peuvent apparaître. Je crois donc qu'il faut veiller à obtenir cette homogénéité et, à ce propos, je vous signale, puisque certains réclament un corps spécial de garde-côtes européens ou autres, que si l'on n'y prend pas garde, cette idée s'inscrira dans le sens de l'hétérogénéité de la démarche. En effet, si quelque part, un dispositif spécial ne traite que de la mer, et qu'en aval on s'occupe de la cohérence de l'action entre la mer et la terre, on peut rencontrer des difficultés accrues.
D'ailleurs, je crois savoir, mais peut-être l'avez-vous vous-mêmes vérifié, que des dissensions apparaissent souvent entre les garde-côtes américains et les différentes administrations du pays...
M. le Président : Nous sommes allés aux Etats-Unis la semaine dernière et nous avons passé quatre jours avec les garde-côtes !
M. Jean-Claude GAYSSOT : Et ce que je viens de dire est une bêtise ?...
M. le Président : Par principe, vous n'en dites jamais et, dans ce cas précis, cela se vérifie... (Rires.)
Vous me permettrez, monsieur le ministre de faire une observation qui rejoindra nos préoccupations à tous : j'ai le sentiment qu'à l'OMI un certain nombre de personnes font preuve de bonne volonté mais qu'il y a aussi, au sein de cette organisation, des pesanteurs, pour ne pas dire plus.
Or, j'ai l'idée - c'est d'ailleurs aux Etats-Unis qu'elle a été soulevée ou qu'en tout cas, elle m'est venue à l'esprit - que l'insécurité maritime met en cause la souveraineté des Etats : quand un pays voit, comme la France, ses côtes polluées, envahies, menacées sur 400 kilomètres, cela met en cause la liberté des individus, la liberté d'entreprendre, de développer une économie. C'était d'ailleurs l'objet de la récente intervention de Mme Demessine...
Dans ce genre de situations, on peut parler d'une atteinte à l'intégrité territoriale d'un Etat...
M. Jean-Claude GAYSSOT : Oui !
M. le Président : Par conséquent, il n'est pas anormal que, face à ce genre de phénomènes, les Etats à titre particulier, mais dans le cadre de l'Europe évidemment tous ensemble, disent à un certain moment à une organisation internationale : « Cela suffit comme cela ; nous exigeons que des mesures soient prises ! » Ce fut facile en 1990, pour les Etats-Unis...
M. Jean-Claude GAYSSOT : Ils ont agi tout seuls !
M. le Président :...c'est un peu plus compliqué pour nous, mais je vous rejoins totalement lorsque vous dites qu'il y a une conjoncture, une conjonction d'événements, une émotion, qui peuvent permettre de faire basculer la situation et de gagner, dans les mois ou les années qui viennent ce que nous n'avons pas pu obtenir depuis une trentaine d'années. Je pense que nous sommes d'accord là-dessus...
Nous sommes sans doute également tous unanimes pour dire que les compagnies pétrolières, les pétroliers, les affréteurs ont une responsabilité.
Je pense aussi - et je crois que le rapporteur en sera d'accord - que les États-Unis n'ont pas tort de mettre une pression énorme sur les armateurs en les prévenant que leurs navires n'entreront dans leurs ports et dans leurs eaux territoriales qu'à partir du moment où ils auront souscrit une assurance ou pris les moyens suffisants pour réparer les dommages qu'ils sont susceptibles de causer.
Quand je vois que l'Erika va coûter 1, 20 milliard de francs au FIPOL et 80 millions de francs à l'armement, je trouve cela scandaleux !
M. le Rapporteur : D'autant que l'armateur va être remboursé par l'assurance...
M. le Président : Je répète que je trouve cela scandaleux et que je considère, à tout le moins, que la pression devrait être mise sur la Commission européenne.
Je crois savoir que Mme de Palacio n'est pas opposée à cette idée mais qu'elle en réserve l'application à une deuxième série de directives. Il faut que la pression soit mise suffisamment sur la Communauté européenne, ainsi que sur l'OMI par contrecoup, pour augmenter de façon considérable les exigences à l'égard des armateurs. Cela répondra au souci des armements du pavillon français et leur permettra de dire qu'ils ont un pavillon propre. En effet, quand on n'effectue pas le tri entre les mauvais et les bons armements ce sont les seconds qui payent.
L'une des leçons que je retire de ce voyage aux Etats-Unis est qu'il faut certes faire payer ceux qui profitent de la situation et font les mauvais choix, c'est-à-dire les affréteurs mais pénaliser aussi un peu plus les mauvais armateurs. Ce serait là l'occasion d'éjecter ces armateurs qui ont un unique bateau et qui sont domiciliés là où il est difficile d'aller les chercher.
Tel est le commentaire que je souhaitais ajouter !
M. Jean-Claude GAYSSOT : Permettez-moi, monsieur le Président, d'ajouter un commentaire au vôtre pour vous dire que j'y souscris complètement.
Mme Jacqueline LAZARD : Je ne sais pas s'il s'agit pour moi d'ajouter un commentaire aux commentaires. Tout ce que je peux dire, c'est que je n'ai pas eu le plaisir d'aller aux Etats-Unis, que j'ignore comment les choses peuvent s'y passer mais que si les autorités américaines ne laissent pas venir tous les navires, elles en laissent partir qui ne sont pas en bon état ce qui fait qu'elles ne sont pas, non plus, tout à fait irréprochables !
Pour en revenir à ce bateau de type E3, je crois savoir, monsieur le ministre, que les Etats-Unis, justement, n'y sont pas favorables et qu'on risque, en raison de l'importance du trafic vers l'Amérique d'avoir simplement des bateaux « double coque ». On sait pourtant, si j'en crois les spécialistes du transport et de la construction maritimes que nous avons auditionnés, tous les dangers qu'ils présentent en cas d'échouement au-dessus de trois n_uds, vitesse qu'ils dépassent presque tous, pour ne pas parler du fait qu'ils vieilliront très mal, qu'avec l'âge ils deviendront encore plus dangereux et demanderont à être contrôlés encore plus souvent...
Je crois que l'Europe, a également un travail à faire pour mettre plus en valeur le bateau à pont intermédiaire. C'est en tout cas mon avis, étant entendu que je ne suis pas technicienne...
M. Jean-Claude GAYSSOT : Nous ne le sommes ni les uns, ni les autres ! Je voudrais simplement préciser que si j'ai des contacts avec nos voisins européens, j'en ai également avec d'autres pays dont les Etats-Unis.
D'après ces contacts, il est apparu que la démarche des personnalités que j'ai rencontrées s'orienterait plutôt vers un soutien des positions françaises et européennes et d'une évolution dans le sens que nous proposons.
Puisque vous me dites qu'il y a débat entre l'E3 et les double coque, je vous informe que le pont intermédiaire est inclus dans la réglementation de l'OMI.
Il y a là un vrai débat, non pas simplement de méthode mais aussi de stratégie.
Certains me disent en effet que les propositions françaises à l'échelle européenne sont très bonnes mais qu'aussi longtemps que l'OMI n'aura rien décidé, il ne faudra pas agir... C'est ainsi que, de fil en aiguille et dans l'attente de la décision de l'OMI, rien ne se fait ni en France, ni en Europe.
D'autres font la constatation suivante : si l'OMI n'a rien décidé c'est bien parce qu'il y a des réticences qui freinent l'évolution.
Les Américains ont donc agi de leur côté tandis que nous nous retrouvons dans la difficulté que nous avons soulignée précédemment.
La stratégie consiste à faire en sorte qu'à l'échelle européenne, et même à l'échelle nationale chaque fois que cela fait avancer le problème, d'où la signature de la charte et le dépôt de l'amendement que nous avons évoqués, la volonté signalée tout à l'heure de ne pas attendre des propositions pour agir se concrétise tant qu'elle n'entrave pas la lutte que nous menons contre la pollution et l'insécurité maritimes.
Exprimons donc notre grande détermination, faisons tout ce qui est possible à l'échelle européenne et, simultanément, agissons au sein de l'OMI ! Il faut être décidé à faire ce qu'il faut sans attendre et ne pas agir dans un premier temps en envisageant de s'occuper de l'OMI dans un second temps. Nous agissons, nous, tout en travaillant pour que l'OMI fasse de même.
Telle est la voie sur laquelle je pense que nous devons nous engager !
J'ai discuté avec le Président des armateurs européens qui est danois et dont j'ignore si vous l'avez rencontré. Je puis vous dire qu'il a soutenu toutes mes propositions sans émettre la moindre réserve, si ce n'est qu'il m'a objecté qu'il était impossible d'agir à l'échelle européenne !
C'est un homme très décidé à faire évoluer la situation, mais il n'empêche qu'il n'entend pas que les choses puissent ne pas se faire d'abord à l'échelle de l'OMI !
M. le Rapporteur : C'est un problème de stratégie !
M. Jean-Claude GAYSSOT : C'est donc bien à un problème de stratégie que nous sommes confrontés !
Pour autant je ne prétends pas qu'il faille nous occuper uniquement de l'Europe : il faut aussi faire évoluer la situation au niveau international. Il faut donc suivre cette construction stratégique mais avec la détermination d'agir à l'échelle européenne.
Le Conseil des ministres des transports doit se réunir, avant que je ne le préside à partir du premier juillet, pour examiner un texte de conclusions.
A partir de là, sous la présidence française, il faudra faire l'impossible pour traduire les décisions et les propositions.
C'est vraiment un beau combat qu'il faut mener, à la fois pour l'environnement, pour les hommes, pour les équipages mais également pour l'activité du transport maritime qui peut se développer dans de bonnes conditions.
Audition de MM. Patrick BORÉ et Joël BOUTROLLE
de la société Barry Rogliano Salles
(extrait du procès-verbal de la séance du 25 mai 2000)
Présidence de M. Jean-Yves LE DRIAN, Rapporteur.
MM. Patrick Boré et Joël Boutrolle sont introduits.
M. le Président leur rappelle que les dispositions législatives relatives aux commissions d'enquête leur ont été communiquées. A l'invitation du Président, MM. Patrick Boré et Joël Boutrolle prêtent serment.
M. Joël BOUTROLLE : Patrick Boré et moi-même sommes courtiers d'affrètement pétrolier et appartenons à la société Barry Rogliano Salles - B.S.R. - qui est une société de courtage bien connue du monde maritime.
Nous jouons un rôle d'intermédiaires, pour ce qui concerne notre activité spécifique qui est liée au pétrole, entre les affréteurs et les armateurs y compris, éventuellement, lors de la conclusion des contrats d'affrètement.
Pour situer la taille de notre entreprise, je dirais qu'elle emploie un peu plus de cent personnes à Paris, qu'elle compte quelques bureaux à l'étranger et qu'en termes d'activité, elle se situe au troisième ou quatrième rang mondial.
C'est une société à laquelle notre parcours personnel est lié puisque nous l'avons quittée en 1986 pour créer notre propre société - B.B.W. - que nous avons, par la suite, revendue au groupe Barry Rogliano, dont nous sommes devenus partenaires et associés depuis maintenant cinq ans.
Je suis moi-même directeur général adjoint du groupe Barry Rogliano Salles et en même temps responsable de son département d'affrètement de navires transporteurs de pétrole et plus généralement de liquides. M. Boré est, quant à lui, responsable de l'activité des affrètements au voyage dudit département.
Je pourrai vous donner évidement beaucoup plus de détails sur notre activité et son rôle si cela répond aux informations que vous attendez de nous...
M. le Président : Dites-nous comment se passent très concrètement les transactions.
M. Joël BOUTROLLE : C'est une longue histoire !
Au nombre des acteurs du marché pétrolier, on trouve bien entendu les armateurs, c'est-à-dire les propriétaires des navires, les affréteurs qui sont les propriétaires des cargaisons, étant entendu qu'à chaque besoin d'affrètement, il est possible de faire appel aux services d'un courtier.
Ce dernier essaiera, pour répondre à la demande spécifique et précise d'un affréteur, d'identifier le tonnage disponible et de trouver un terrain d'entente entre les deux parties pour aboutir à la signature d'un contrat dont il négociera les termes et les conditions.
Si l'affaire se conclut, il suivra ensuite la totalité de l'opération depuis le moment de la nomination de la cargaison jusqu'à celui de son déchargement complet, après quoi il s'assurera du suivi juridique et financier de l'affaire jusqu'à ce qu'elle arrive à son terme.
Le rôle du courtier peut aller au-delà du déchargement s'il faut suivre les surestaries : quand les bateaux prennent un certain retard ou dépassent les temps impartis par le contrat de transport pour le chargement et le déchargement, des pénalités sont en effet appliquées aux affréteurs et il appartient au courtier d'assister les armateurs pour les aider à récupérer les sommes qui leur sont dues.
Le courtier n'intervient pas seulement au moment de la conclusion de l'affaire mais bien tout au long de son déroulement, jusqu'à son terme, c'est-à-dire jusqu'à l'extinction de toute créance de l'une ou de l'autre partie.
C'est un rôle qui, quand on l'expose, paraît assez simple, mais qui est en fait relativement complexe car il demande d'avoir des bases de données très importantes, de façon à ce qu'il soit possible de répondre à chaque demande par une offre de tonnage satisfaisante.
Il convient aussi de préciser que ce rôle d'intermédiaire n'est ni indispensable - des affaires peuvent se traiter sans l'intervention d'un courtier -, ni exclusif - un affréteur ou un armateur pouvant faire appel à plusieurs courtiers pour une même demande.
Il dépend de notre compétence de répondre par la meilleure offre possible a la demande qui émane soit de l'affréteur, soit de l'armateur : de l'armateur parce qu'il aura des navires pour lesquels il lui faudra trouver des cargaisons ; de l'affréteur parce qu'il aura des cargaisons spécifiques qui nécessiteront un tonnage particulier pour leur transport. Il s'agit donc d'identifier le mieux possible la demande de l'affréteur - je dirais que la première demande vient de l'affréteur -, de trouver les navires qui correspondent à cette demande et, ensuite, de négocier au mieux le contrat pour que ses termes et ses conditions soient les plus proches possible du marché.
J'ajouterais que notre rôle veut - et ce n'est pas fuir nos responsabilités que de le dire - que nous ne soyons jamais partie prenante à la décision. Nous avons purement un rôle d'intermédiaire et jamais un rôle décisionnel.
Je pense que j'ai réussi à expliquer de façon assez synthétique ce qu'était la fonction du courtier d'affrètement.
Le rôle de la société Barry Rogliano ne se limite pas à cette fonction puisqu'elle sert également d'intermédiaire pour les contrats d'achat et de vente de navires, pour les contrats de transport de marchandises sèches, pour les navires spécialisés tels que les navires offshore de forage, les remorqueurs, les ro-ro, les porte-conteneurs...
Je dirais donc de notre groupe qu'il couvre, toujours en tant qu'intermédiaire, la totalité du secteur maritime.
M. le Rapporteur : En ce qui concerne le transport pétrolier, qui sont vos clients en France ?
M. Patrick BORE : L'ensemble des groupes pétroliers français qui ne sont plus très nombreux aujourd'hui du fait de leurs fusions. Nos principaux clients sont, bien sûr, les groupes Elf et Total qui aujourd'hui ne font plus qu'un mais dont les opérations d'affrètement se traitaient encore récemment à Paris pour ce qui concernait Elf, et à Londres pour ce qui concernait Total. Ce sont les deux seuls affréteurs français qui nous interrogent aujourd'hui pour le transport du pétrole. Nous avons d'autres clients étrangers, mais je réponds à votre question qui ne vise que la France.
M. le Président : Comme vous dites avoir des bureaux à l'étranger, je voulais parler de Paris.
M. Patrick BORE : Notre activité se situe à 90 % en dehors de la France. Autrefois les sociétés Shell, B.P., Mobil France passaient par l'agence de Paris qui était très importante et traitaient également les problèmes d'approvisionnement maritime. Elles sont aujourd'hui entre les mains des sociétés-mères qui se trouvent soit à New York, soit à Londres pour B.P. Cela étant nous avons, à Paris un portefeuille important de clients étrangers !
M. le Président : Dont ces sociétés ?
M. Patrick BORE : Dont, par exemple, le groupe B.P. à Londres, avec qui nous avons gardé d'excellents contacts !
M. le Président : Les demandes des chargeurs, en particulier des pétroliers, sont généralement des demandes d'affrètement au voyage ou pour une plus longue durée ?
M. Patrick BORE : Les deux !
M. Joël BOUTROLLE : Il faut ajouter que, dans notre métier, nous avons également pour tâche de générer ou de susciter des affaires. Il n'y pas systématiquement une demande pour une opération ; il nous appartient aussi, si nous voulons développer notre activité de façon plus satisfaisante, de proposer des opérations à nos affréteurs ou à nos armateurs. Il peut s'agir d'opérations complexes qui peuvent être de long terme. Nous organisons régulièrement des affrètements en période ainsi que des opérations qui entraînent des montages plus complexes.
Nous ne nous limitons pas aux affaires SPOT et nous avons plusieurs types de contrats qui vont du contrat SPOT au contrat de durée en passant par ceux qui peuvent inclure la vente du navire, voire sa construction.
Certaines opérations peuvent à la fois comporter une construction et un contrat d'affrètement aussi bien de durée qu'au voyage : il y a plusieurs types de contrats possibles !
M. le Président : Vous avez un fichier-clients des armateurs qui recourent à vos services mais avez-vous des repères quant à la qualité des bateaux que vous proposez aux affréteurs et, si oui, sur quelles bases ?
M. Patrick BORE : Nous avons d'abord un support informatique très important : nous adhérons à une base de données à laquelle contribuent plusieurs courtiers à travers le monde, aussi bien au Japon qu'aux Etats-Unis, en Norvège ou ailleurs. Elle nous permet, à nous courtiers adhérents, de localiser très rapidement la position des navires.
Il s'agit avant tout d'avoir la position géographique du navire qui est primordiale pour une demande d'enlèvement dans une quelconque partie du monde, mais nous avons également accès, bien entendu, aux informations concernant la taille du navire, son âge, et ses principales dimensions.`
Au stade de la recherche, nous ciblons avant tout les navires en fonction de leur positionnement, de leur taille, et maintenant de leur âge puisque aujourd'hui nos principaux clients ont pris à ce sujet les décisions que vous connaissez.
Ensuite, nous procédons à une sélection des bateaux dont nous transmettons la liste à notre client qui, lui-même, nous indique quels sont ceux que ses services d'inspection jugent acceptables et quels sont ceux que ces mêmes services rejettent.
Il y a donc une sélection qui s'opère mais, sur le plan technique, elle relève du client.
M. le Président : Vous n'avez pas accès à la banque de données SIRE ?
M. Patrick BORE : Non, nous n'y avons pas accès !
M. le Président : Et comment s'appelle votre banque de données ?
M. Patrick BORE : C'est le système SIS, qui nous informe d'abord de la position des navires. Une fois le navire sélectionné, il nous appartient de demander à l'armateur ses caractéristiques techniques, ses périodes de dry dock, sa classification, toutes précisions qui sont nécessaires avant d'entamer les négociations.
M. Joël BOUTROLLE : Du reste, aucun affréteur n'affréterait un navire sans s'assurer de la validité de certains certificats avant le terme d'un affrètement. Ce n'était pas le cas il y a vingt-cinq ou trente ans mais je dirais que depuis une bonne dizaine d'années, tout affréteur va s'assurer de la validité des certificats ; il va donc demander à l'armateur de remplir un questionnaire que l'on appelle généralement le questionnaire OCIMF, lequel comprend les dates d'émission des certificats et leur durée de validité.
Ensuite, l'affréteur a, comme vous le savez sans doute, un service de vetting, qui est le service d'inspection interne aux compagnies pétrolières, dont il va solliciter l'accord sans lequel il n'affrétera pas le bateau.
Notre rôle est de demander les certificats, de nous assurer que la fiche du questionnaire que nous transmettons à l'affréteur est bien remplie. Mais, encore une fois, à supposer que nous recevions un faux, il nous serait impossible de le vérifier. C'est à l'affréteur qu'il appartient, au vu des documents, d'abord de définir si la totalité des réponses satisfait à sa demande, ensuite de vérifier avec son service de vetting, qui est généralement indépendant du service d'affrètement, que le bateau est bien acceptable et accepté.
M. le Président : Quand un armateur devient votre client, s'engage-t-il à vous fournir les informations complètes avant que vous ne proposiez votre offre à un chargeur ? Avez-vous en votre possession les principales appréciations des sociétés de classification, ou, pour caricaturer les choses, ne servez-vous que de « boîte aux lettres » en proposant le bateau sans porter de jugement ?
M. Patrick BORE : Même si, aujourd'hui, certains chargeurs se regroupent, chaque client a son propre service d'inspection.
Auparavant, chaque compagnie pétrolière avait son propre questionnaire et il nous appartenait de l'adresser à l'armateur et de faire en sorte qu'il soit rempli avant l'affrètement du navire. Aujourd'hui, les compagnies utilisent de plus en plus le même questionnaire ce qui simplifie beaucoup les choses, surtout pour les armateurs.
Ce questionnaire fait partie intégrante du contrat et il représente donc un engament moral de la part de l'armateur qui le signe et le joint au contrat.
Il en va donc de la bonne foi de l'armateur mais nous n'avons pas, pour ce qui nous concerne, la possibilité de vérifier avec les sociétés de classification, par exemple, si ce qui figure comme réponses au questionnaire est vrai ou pas.
Cela étant, nous travaillons quand même avec des armateurs de première classe et de surcroît sur un marché assez étroit où les affréteurs sont amenés à se retrouver très souvent en face des mêmes armateurs.
J'ai vingt-cinq ans d'expérience et jamais un affréteur ne m'a signalé ou reproché la transmission d'un questionnaire comportant de fausses déclarations sur les périodes de validité des certificats ou autres.
M. Joël BOUTROLLE : A propos de la société de classification, je pense que même les affréteurs ne sont pas en mesure de savoir quelles sont ses recommandations relatives à la classe du navire.
Elles figurent dans un document qui est transmis au moment de la cession d'un navire - les choses vont peut-être changer, du moins je l'espère - et malheureusement le client, et a fortiori le courtier, ne peut pas obtenir ces conclusions. C'est quelque chose qui, à ma connaissance, n'est transmis qu'à l'armateur. Personnellement, je trouve cela regrettable mais c'est comme cela !
M. Gilbert LE BRIS : Comme votre société de courtage est une grande société et que vous venez de nous dire que vous aviez un peu de métier dans cette profession, j'aimerais que vous en décriviez l'évolution et notamment que vous nous parliez des contrats à temps et des contrats SPOT de manière à établir la fréquence des uns par rapport aux autres.
Par ailleurs, pouvez-vous nous parler de la surcapacité ou de la sous-capacité des flottes et nous dire si vous avez plus, ou moins, de difficulté qu'avant à trouver les clients et les bateaux pour faire les transactions ?
M. Joël BOUTROLLE : L'évolution est toujours dictée par un marché. Le courtier, dont c'est le rôle, fixe quelque part le marché. Or, le marché pétrolier est fluctuant et très erratique : des moments de grande dépression alternent avec des périodes de forte hausse comme celle que nous traversons, par exemple, aujourd'hui.
Si je remonte au tout début de mon expérience professionnelle, soit trente ans en arrière, je constate une énorme évolution de l'affrètement pétrolier qui n'est plus du tout aujourd'hui ce qu'il était alors. A l'époque, il se traitait souvent autour d'une table, au cours d'un déjeuner, en quelques minutes, sans pratiquement qu'aucune précaution ne soit prise.
Il est clair que cette activité a subi des évolutions tout à fait considérables, que des précautions très importantes ont été prises, que les restrictions ont été nombreuses et je dirais que la profession, dans son ensemble - armateurs, affréteurs et courtiers confondus - a manifesté des exigences de plus en plus importantes au fil des années.
Pour en revenir à votre question sur les contrats à temps, je pense qu'elle est d'une grande importance dans la mesure où, pour moi en tout cas, il est clair que lorsque l'on contrôle un bateau à temps, on va avoir les moyens et la volonté d'aller plus au fond de l'examen de qualité que pour un navire affrété au voyage.
M. le Président : Est-ce à dire que les navires affrétés au SPOT présentent moins de garanties de sécurité que les navires affrétés à temps ?
M. Joël BOUTROLLE : Ce n'est pas exactement cela.
Un affréteur qui va s'engager pour un an, deux ans, voire cinq ans, sur un navire va attacher beaucoup plus d'importance à certains détails : par exemple, il ira, sinon systématiquement du moins fréquemment, voir le bateau en cale sèche pour vérifier précisément la qualité de ce navire ; il ira sans doute - c'est du moins ce que faisaient certaines compagnies pétrolières - rencontrer les commandants pour voir comment tout est organisé ; il aura des moyens de vérification plus poussés et surtout il souhaitera davantage vérifier sur quel type de navire il va s'engager, considérant que, sur une période longue, sa responsabilité et son risque sont sans doute plus grands.
Le temps de réaction pour un affrètement SPOT, qui résulte souvent d'une décision instantanée, est rarement important. En outre, il serait inimaginable et de surcroît totalement impossible pour un affréteur d'aller visiter en cale sèche tous les bateaux affrétés au voyage.
Je pense donc très profondément que la couverture time charter, la couverture période, est une formule qui permet d'avoir accès à des navires de meilleure qualité ou, plus exactement, d'aller plus au fond de la vérification de la qualité d'un navire.
Cela étant, cette question a donné lieu à un grand débat car il ne faut pas oublier que quand on affrète un bateau en time charter, on augmente son risque « tonne-mile » par rapport à un navire pris au SPOT. Je sais, par exemple, qu'avant que n'intervienne la fusion, la politique de la compagnie Total était de prendre les bateaux en time charter, ce qui lui permettait de mieux contrôler son risque shipping et d'être plus sûre de la qualité des navires affrétés, tandis que la société Elf, partant du principe que la responsabilité d'un affréteur était de diminuer au maximum son exposition « tonne-mile », n'utilisait pratiquement que des navires au voyage. Ce sont là deux philosophies profondément différentes !
Personnellement, j'ai tendance à penser que l'option de période diminue le risque mais augmente la quantité de mouvements sur les navires de la compagnie.
Je crois que c'est une question très importante qui ne peut pas se résumer de façon simpliste et qui renvoie à un débat très intéressant.
M. Patrick BORE : Pendant très longtemps, les compagnies pétrolières ont été propriétaires de leurs navires ou affrétaient des navires en période et la flotte mondiale se répartissait à parts égales entre les bateaux appartenant à des armateurs indépendants et ceux appartenant à des compagnies pétrolières.
Au fil des temps, et surtout depuis cinq ou dix ans, c'est-à-dire depuis que le risque de pollution a pris une certaine importance, les choses ont changé : les Américains ont été les premiers à montrer la voie en se débarrassant peu à peu de leurs navires et en devenant des affréteurs, occasionnellement en période, mais pratiquement toujours au SPOT.
Aujourd'hui il, est vrai, comme le disait Joël Boutrolle, que la question donne lieu à un grand débat et que certaines compagnies pétrolières reviennent sur leur position. Ainsi, on a vu certains Américains commander des bateaux neufs aux chantiers coréens et japonais et quelques compagnies pétrolières effectuer un retour à l'armement.
Aujourd'hui, le ratio navires appartenant à des armateurs indépendants / navires appartenant à des compagnies pétrolières doit être au grand maximum de deux tiers / un tiers, même si les compagnies pétrolières asiatiques conservent le contrôle de leurs navires ce qui pèse dans la balance.
M. Joël BOUTROLLE : Votre question comportait un autre volet concernant la surcapacité des flottes. Si j'ai bien compris, vous souhaitiez savoir s'il y avait une corrélation entre le niveau de marché et la sécurité maritime.
Je pense que c'est, là aussi, un point très important.
Durant ces périodes de marché extrêmement déprimé que j'évoquais - on en a connu et on sait qu'elles durent beaucoup plus que les périodes fastes -, quand un armateur ne peut pas payer ses frais financiers d'achat de navires et quand le marché SPOT ne lui permet que de couvrir son running cost, son coût opérationnel, il peut ne pas avoir les moyens d'assurer un entretien satisfaisant de ses bâtiments ce qui pose de graves problèmes.
En d'autres termes, plus un marché est mauvais et plus la qualité générale du tonnage se dégrade. C'est sur l'entretien des bateaux que porte la première économie qui, à long terme, s'avère stupide puisque les navires finissent par se détériorer complètement.
Il n'empêche que les armateurs très tendus sur le plan financier cherchent à restreindre leurs dépenses et sacrifient, soit leur budget pour les équipages - d'où le grand débat sur le serpent de mer des pavillons de complaisance, sur lequel nous reviendrons peut-être -, soit leur budget d'entretien - ce qui pose un problème grave -, soit leur budget de renouvellement de flotte - ce qui pose un problème non moins grave.
A ce propos, je voudrais attirer votre attention sur un point qui me paraît être tout à fait fondamental et dont la presse ne s'est pas absolument pas fait l'écho lors de l'affaire de l'Erika.
A cette époque, le marché était extrêmement déprimé puisque le niveau des frets permettait tout juste de payer les équipages : il n'était pas question d'amortir un navire et il était très difficile pour un armateur de faible capacité financière d'assurer une maintenance très satisfaisante.
Si j'insiste sur le fait que le marché était très déprimé, c'est parce que, dans ces conditions, que vous ayez eu un bateau neuf ou un bateau ancien importe peu puisque le marché n'a pas plus à offrir : si la compagnie Total avait affrété un bateau neuf, elle n'aurait pas payé plus cher que ce qu'elle a payé pour l'Erika et si elle y avait trouvé un intérêt financier, la différence aurait été négligeable.
La dépression du marché faisait que les gens n'attachaient pas assez d'importance au fait que le fioul, marchandise dangereuse et polluante par excellence - c'est le plus polluant de tous les produits pétroliers que l'on puisse transporter - aurait normalement dû voyager sur des navires de meilleure qualité.
En outre, compte tenu des conditions de délabrement du marché, ce qui est complètement absurde, alors même que pour transporter le fioul il aurait été raisonnable, à mon sens, d'imaginer de prendre les meilleurs bateaux, on ne trouvait pas ou très peu de bons bateaux !
M. le Président : Pourquoi ?
M. Joël BOUTROLLE : Parce que le marché donnait une prime - légère, bien entendu - pour les cargaisons de produits raffinés, les naphtas, les essences, les gaz-oil et autres produits de ce genre.
Le fioul, qui offrait peu de marges mais qu'il fallait écouler, qui était très peu bénéficiaire puisque brûlé essentiellement dans des centrales thermiques pour produire de l'électricité - la cargaison de l'Erika était destinée à ENEL en Italie -, ne donnait pas droit à une telle prime !
M. Patrick BORE : Pour compléter cette réponse, il convient de préciser qu'une fois qu'il a chargé du fioul, il est très difficile de nettoyer un navire et d'y charger ensuite un produit blanc, ce lui qui ferme certaines possibilités...
M. le Président : Il devient dédié ?
M. Patrick BORE : Exactement, il devient dédié au transport du fioul.
M. Joël BOUTROLLE : Il faut savoir que dans les produits raffinés, on distingue deux catégories : les produits noirs et les produits blancs. Les produits noirs correspondent essentiellement aux fiouls et les produits blancs comprennent des produits qui, des plus lourds aux plus légers, vont des gaz jusqu'aux essences, naphtas et autres en passant par le gas-oil.
Un navire de transport de produits raffinés est un navire dont les citernes intérieures sont peintes, ce qui facilite le nettoyage et rend possible le passage d'un produit noir à un produit blanc.
Le problème, c'est que ces bateaux récents dont le revêtement est de bonne qualité se présentaient de préférence sur les marchés qui leur offraient le plus de marges, donc ceux qui proposaient les frets, sinon les plus attrayants, en tout cas les moins minables compte tenu de la situation du moment.
M. le Président : De la situation de l'époque ?
M. Joël BOUTROLLE : Oui, je ne parle pas d'aujourd'hui puisque l'affaire de l'Erika a fait exploser le marché...
En conséquence, ces bateaux revêtus et modernes se spécialisaient surtout dans ces coupes légères que sont les essences, naphtas, et autres condensats, tandis que le fioul voyageait toujours sur des bateaux dédiés qui malheureusement étaient très souvent les bateaux les plus anciens arrivés en fin de carrière.
Ce problème a été clairement celui de l'Erika mais, encore une fois, s'il y avait eu des bateaux modernes, je ne pense pas que leur affrètement aurait coûté beaucoup plus cher. A mon avis, il aurait mieux valu prendre des bateaux modernes en affrètement à temps qu'on aurait dédiés au fioul, mais cela n'a pas été le cas.
Mme. Jacqueline LAZARD : Ma question portait sur la valeur du produit transporté et l'offre qui peut y correspondre en matière de navire. Comme pour l'illustrer, je voulais prendre l'exemple de l'Erika, vous venez partiellement d'y apporter réponse.
Dans votre propos liminaire vous avez souligné que votre rôle consistait à proposer la meilleure offre particulière : en cas de transport de fioul lourd on peut considérer qu'il y a une demande particulière. Or, d'ores et déjà, vous savez que vous n'avez à proposer que de vieux bateaux peut-être, de ce fait, un peu plus dangereux.
M. Joël BOUTROLLE : Que les choses soient bien claires : nous n'étions pas courtiers de l'Erika ! Mais nous aurions pu l'être.
Mme Jacqueline LAZARD : J'avais bien compris, mais, par hypothèse, j'évoque une situation où les sociétés de courtage n'ont pas à proposer de bateaux de grande qualité.
M. Patrick BORE : Le transport du fioul est un marché captif qui concerne surtout le marché européen et le cabotage. Il s'agit d'un tout petit marché qui intéresse essentiellement les côtes atlantiques et méditerranéennes et sur lequel 70 % des navires ont plus de vingt ans d'âge.
Lorsqu'une demande de transport de fioul nous est adressée, s'agissant du marché européen je le répète, nous savons que les affréteurs qui en sont eux-mêmes informés, auront dans 90 % des cas à sélectionner des bateaux anciens du type de l'Erika : il n'y a pas d'autre choix puisqu'il n'existe pas d'autres navires !
M. Joël BOUTROLLE : C'est également vrai pour d'autres régions : les DOM ont souvent été ravitaillés avec des navires anciens, mais cela renvoie à un autre débat qui consiste à déterminer si un vieux navire est un mauvais navire.
Mme. Jacqueline LAZARD : Vous nous avez également dit que dans le cadre de vos fonctions, vous pouviez intervenir dans la vente ou l'achat de navires. Dans ce domaine où vous faites des propositions, vous n'avez pas, non plus, accès aux informations concernant l'état des navires et vous n'êtes pas amenés à les vérifier ?
M. Patrick BORE : Nous parlions alors d'affrètements au voyage.
M. Joël BOUTROLLE : Les responsables du département des ventes et des achats de navires ont, bien entendu, accès à ces informations du registre et peuvent demander les classes. Ces documents leur sont fournis.
Mme. Jacqueline LAZARD : Ah bon, c'est rassurant !
M. Joël BOUTROLLE : Heureusement, parce que les armateurs veulent quand même être informés sur ce qu'ils achètent !
Mme. Jacqueline LAZARD : Bien sûr, mais j'avais cru comprendre que c'était à eux de procéder à ces vérifications.
Pour en revenir à votre activité première qui est de mettre en relation un affréteur et un armateur, dans la mesure où vous n'avez pas un rôle décisionnel, où se situe votre responsabilité ?
M. Joël BOUTROLLE : C'est une question qui nous a aussi été posée au Sénat et qui intéresse beaucoup nos interlocuteurs.
Je dirai que notre responsabilité est totalement nulle si on l'envisage sous l'angle juridique, puisque nous ne prenons jamais la décision, quand bien même nous le regrettons.
Quoi qu'il en soit notre métier est ainsi fait et nous ne prenons jamais de décision : nous n'avons pas à en prendre et ce serait d'ailleurs une faute professionnelle que de le faire ! Nous n'avons pas même le droit de prendre une discrétion et de l'utiliser pendant un certain laps de temps : c'est une des règles de la chambre syndicale et il n'est pas question d'y déroger !
Cela étant dit, on peut dire que, tous, nous avons notre réseau d'informations : nous connaissons la réputation de nos partenaires, leur renommée, leur façon de travailler et c'est là qu'intervient tout le poids de notre expérience.
Il est tout à fait évident que nous savons que certains armateurs sont meilleurs que d'autres. Il est tout à fait évident que chez B.R.S., nous avons toujours évité certains armateurs que nous estimons peu sérieux.
C'est notre politique, étant entendu que nous pourrions parfaitement présenter et affréter les bâtiments d'un armateur non sérieux sans commettre pour autant de faute professionnelle. Nous ne le faisons pas, car nous préférons risquer de perdre une affaire que de nous retrouver dans une situation impossible à gérer.
Nous avons connu des armateurs, que je ne nommerai pas parce que nous ne sommes pas ici pour faire le procès des uns ou des autres, avec qui nous avons toujours refusé de travailler. Considérant que ni leur réputation, ni leur moralité professionnelle n'étaient fiables, nous préférions en rester éloignés.
Maintenant, nous ne sommes pas non plus des saints !
M. Patrick BORE : Face à la mondialisation, les groupes pétroliers fusionnent mais les armateurs aussi, ce qui donne des conglomérats aussi bien en Asie qu'aux Etats-Unis. Les responsables des affrètements, aussi bien chez les armateurs que chez les affréteurs, se connaissent parfaitement bien, étant donné qu'ils sont tous appelés à voyager et à se rencontrer ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques années.
Joël Boutrolle disait tout à l'heure qu'il arrivait que les opérations se traitent directement sans courtier et c'est vrai. C'était une chose impensable il y a dix, quinze ou vingt ans, quand les acteurs ne se connaissaient pas, mais aujourd'hui, ils se connaissent et les affréteurs affrètent, dans la plupart des cas, des navires appartenant à des armateurs qu'ils connaissent très bien !
Mme. Jacqueline LAZARD : Votre responsabilité se mesure donc finalement à la fidélisation de vos clients ?
M. Joël BOUTROLLE : Lorsque vous travaillez avec des clients comme Total, Elf, B.P., vous savez que vous travaillez, par définition, avec des affréteurs de qualité. C'est du moins comme tels que nous les considérons et nous n'avons donc pas à avoir d'inquiétudes !
Il y a aussi des affréteurs de deuxième ou troisième ordre dont j'aimerais d'ailleurs que nous puissions parler par la suite, parce le rôle que jouent ces traders constitue un problème extrêmement grave que n'évoquent pas les médias aujourd'hui mais qui va bientôt poser une difficulté majeure au niveau de la sécurité.
Nos principaux clients étant, par définition, des groupes de qualité, ils font ou devraient faire preuve d'exigence sur l'état du tonnage qu'ils peuvent accepter.
Je considère d'ailleurs que c'est une grande malchance que cette catastrophe de l'Erika ait frappé le groupe Total, parce qu'il est clair que tous nos clients ont toujours eu le souci d'améliorer la qualité des navires.
Je vous parlais précédemment des évolutions enregistrées au cours des trente dernières années, et il est indéniable que ce sont les compagnies pétrolières qui sont à l'origine de ce mouvement, puisque ce sont elles qui ont mis en pratique certaines règles assez contraignantes. A chaque fois qu'un pas en avant a été franchi, c'était toujours à l'initiative des compagnies pétrolières et jamais à celle des armateurs !
A chaque accident, de nouvelles règles sont entrées en vigueur et c'est ainsi qu'elles sont devenues de plus en plus strictes.
C'est une grande malchance que le naufrage de l'Erika ait concerné le groupe Total parce qu'il faisait partie de ceux qui menaient une réflexion tout à fait cohérente sur l'amélioration de la qualité et qui identifiaient le risque du transport maritime.
Je me rappelle d'avoir été très frappé, à l'arrivée de M. Tchuruk à la présidence de Total, de voir que, pratiquement dans chaque bureau, était apposée une petite affichette sur le rôle et la responsabilité de la compagnie en matière d'environnement. Je pense que ce n'était pas destiné à endormir la vigilance des gens, mais que cela répondait à une décision de politique générale qui émanait du président.
Le terrible accident de l'Erika s'est produit et je pense qu'au lieu de vouloir systématiquement vouer aux gémonies une compagnie pétrolière, il serait préférable de considérer que cette catastrophe peut devenir une chance pour la profession, dans la mesure où elle fournit l'occasion de poser enfin les vraies questions pour savoir comment améliorer réellement la sécurité maritime.
Je ne pense pas que la présentation que les médias ont donné du débat soit de nature à faire avancer cette réflexion.
M. le Président : Pour l'instant, non !
M. Joël BOUTROLLE : En revanche, il est indéniable, six mois après l'événement et pour notre plus grande satisfaction, que la réflexion se poursuit et que les dossiers ne sont pas recouverts. Je constate aussi que les autorités politiques ne considèrent pas l'affaire comme close, qu'elles continuent à en faire état ce qui, à ma connaissance, n'était pas le cas pour les catastrophes antérieures. Je pense donc qu'il est permis d'attendre des avancées.
Maintenant, j'aimerais en venir aux risques que représentent les traders.
M. le Président : Comment définissez-vous cette fonction ?
M. Joël BOUTROLLE : Je vais vous dire très brièvement ce qui se passe aujourd'hui.
Dans le cas de l'Erika, il est très clair que le groupe Total n'avait aucune responsabilité juridique au niveau du transport du produit. Mais il a fait l'objet d'une telle pression citoyenne et médiatique qu'il s'est retrouvé, en quelque sorte, englué dans une responsabilité morale qu'il assume en ayant, d'ailleurs, selon moi, pas d'autre alternative.
La grande crainte qui est la mienne, c'est qu'en essayant de dire que le transport échappe à la responsabilité de l'affréteur, certaines cargaisons fassent l'objet d'une intermédiation commerciale. Il suffit, pour évaluer la situation, de se souvenir des propos de la compagnie Shell qui déclarait qu'elle aurait accepté de charger sur ce bateau, mais jamais d'y mettre sa cargaison... C'est une position inacceptable qui revient à dire que l'on appréhende le risque différemment selon que l'on est, ou non, propriétaire de la cargaison.
Je considère que c'est là une dérive dangereuse et je redoute que certaines cargaisons ne soient vendues, à la raffinerie, à un tiers qui sera une petite société incapable de faire face à un risque de pollution majeure et qu'ensuite ce trader ne revende la cargaison délivrée à son véritable destinataire.
Or, le risque de pollution étant lié au transport, je souhaiterais, même si je sais que c'est impossible, que ce maillon de la chaîne soit systématiquement intégré. Il faut en tout cas y réfléchir activement.
M. le Président : Ce serait presque la fin de votre métier...
M. Patrick BORE : Non pas du tout ! Pendant très longtemps, les compagnies pétrolières ont acheté, transporté ou fait transporter leur pétrole pour leurs besoins propres de raffinage. La plupart faisaient même construire des bateaux, comme le Batilus, selon des normes adaptées à des routes spécialisées. Les bateaux empruntaient donc toujours les mêmes itinéraires et retournaient à vide au port de chargement, aussi bien en Méditerranée qu'au départ du Golfe persique ou ailleurs.
On a trouvé du pétrole dans toutes les mers du monde et on a vu se développer ce qu'on appelle le « trading international », que pratiquent d'ailleurs aujourd'hui les compagnies pétrolières. Cette situation a ouvert de gigantesques débouchés pour les traders, sociétés indépendantes qui peuvent employer de vingt à trente personnes, avoir une boîte postale aux Bermudes ou n'importe où, traiter et négocier de fabuleuses quantités de pétrole qu'ils achètent directement aux pays africains ou arabes pour les revendre parfois aux compagnies pétrolières.
Ils ont les moyens d'obtenir des prix intéressants et souvent très compétitifs sur ce qu'on appelle le marché SPOT. Aujourd'hui, bon nombre de navires affrétés le sont par ces traders qui revendent leurs cargaisons aux compagnies pétrolières soit à bord des navires, soit rendues à destination.
M. le Président : Ces traders peuvent être vos clients ?
M. Patrick BORE : Tout à fait ! Nous avons des traders pour clients.
Très vite, les compagnies pétrolières ont réagi et maintenant quasiment chaque grosse compagnie pétrolière a elle-même un service trading pour concurrencer ces traders et négocier au mieux son pétrole vers toutes les destinations du monde.
Il n'en reste pas moins qu'il reste de nombreux traders sur le marché !
M. Joël BOUTROLLE : Par ailleurs, il ne faut pas jeter systématiquement l'anathème sur les traders.
Il peut, cependant, se trouver des traders de deuxième ou troisième catégorie - nous en identifions et nous en connaissons avec qui, dieu merci, nous travaillons peu -, et même des traders dont nous savons qu'ils sont dangereux. Le jour où l'un d'eux affrétera un navire responsable d'une pollution, il disparaîtra dans la nature et on aura beau parler de responsabilité morale, on ne trouvera plus personne.
Une compagnie pétrolière comme Total est quand même plus rassurante dans la mesure où la pression peut s'exercer assez fortement sur elle pour qu'elle accepte d'avoir une responsabilité morale, tandis que rien ne sera possible contre un trader qui déposera son bilan et s'évanouira dans la nature.
C'est là qu'est le risque aujourd'hui !
M. le Président : Et, à votre avis, ce système se trouve aujourd'hui limité par l'action des grandes compagnies ?
M. Patrick BORE : Il n'est pas limité, il est concurrencé. Mais le nombre des traders n'a pas diminué pour autant - bien au contraire - au cours des dix dernières années.
M. Joël BOUTROLLE : Depuis la catastrophe de l'Erika, nous risquons de voir le trading reprendre un peu ses droits, à cette différence près qu'aujourd'hui l'opinion est tellement frappée par cette affaire que, même le responsable d'un terminal pétrolier, se sent concerné. On voit très nettement, dans les contrats de vente et d'achat de produits, par exemple, que les restrictions sur la qualité des navires sont très importantes, ce qui n'était pas le cas auparavant.
Certains de mes amis, courtiers de vente et d'achat de produits m'ont dit qu'aujourd'hui les exigences des réceptionnaires étaient très importantes : ils n'acceptent plus sur leurs terminaux des navires de médiocre qualité. Le contrôle s'exerce de plus en plus sur toute la longueur de la chaîne.
Il faut garder à l'esprit que notre sécurité dépend de ce contrôle de toute la chaîne et de l'assurance qu'elle ne comporte pas de maillon faible, étant entendu que le maillon du transport est celui de la pollution : il est très important de s'en souvenir !
M. le Président : Quels sont les moyens d'améliorer la situation par rapport aux traders ?
M. Patrick BORE : Les moyens sont pris par les réceptionnaires ou les chargeurs. Comme il y a des points de chargement et de déchargement, le trader a toujours face à lui, à un moment ou à un autre, une compagnie pétrolière.
Aujourd'hui, le trader ne peut donc plus, comme c'était le cas auparavant, affréter un navire sans poser de questions techniques parce que, s'il veut vendre sa cargaison à une compagnie pétrolière, il sera amené à présenter les mêmes garanties que celles qu'exigerait cette compagnie pétrolière si elle assurait elle-même l'affrètement du navire. Il y a donc là une évolution !
M. le Président : C'est-à-dire ?
M. Patrick BORE : C'est-à-dire que le bateau devra être approuvé selon le système d'inspection de la compagnie pétrolière.
Si la compagnie Total affrète un bateau, elle va effectuer un contrôle comme je l'ai explique tout à l'heure, mais si elle achète une cargaison à un trader avec une livraison CIF - Cost, insurance and freight -, elle n'acceptera le contrat transporté que si le navire a été accepté par son service vetting dans les mêmes conditions que si elle avait fait elle-même l'affrètement.
M. le Président : C'est systématique ?
M. Patrick BORE : Oui !
M. le Président : Donc vos craintes tombent ?
M. Patrick BORE : Non, car en ce qui concerne la responsabilité civile et pénale en cas d'accident, certains traders étant domiciliés aux Bahamas, il n'est pas certain, s'il y a poursuite judiciaire contre eux, de voir, comme cela a été le cas avec Total, des fonds débloqués tout de suite en faveur des collectivités locales et des autres victimes.
M. Joël BOUTROLLE : En outre, il n'y a pas que les compagnies pétrolières à être réceptionnaires : vous pouvez aussi bien avoir une petite centrale thermique microscopique qui se moquera totalement de la qualité du navire.
M. le Président : Et comment lutter contre ce phénomène ?
Je n'avais pas intégré l'idée que les traders peuvent vendre à d'autres qu'à des compagnies pétrolières ; si c'est le cas, on en revient à notre point de départ puisqu'il n'y a plus de contrôle des navires...
M. Joël BOUTROLLE : A la lecture du compte-rendu de la catastrophe de l'Erika, il est permis de penser que les causes de l'accident ne sont pas étrangères à la classe du bateau et que si les recommandations de la classe avaient été disponibles à l'époque, le service vetting de Total n'aurait, peut-être, voire sans doute pas, retenu ce pétrolier.
Ce serait déjà un énorme progrès si l'on pouvait avoir une ouverture des recommandations de la classe ou une publicité de ces informations à travers EQUASIS, par exemple.
Je pense aussi qu'il y a des limitations, peut-être catégoriques mais qui ne seraient probablement pas mauvaises, qui consisteraient à fixer l'âge maximum des navires à vingt ans.
M. Patrick BORE : Les mesures qui ont été prises récemment, notamment les limitations d'âge, s'appliquent aussi aux traders, puisque les navires de plus de vingt ans ne sont pas autorisés à décharger aujourd'hui dans les ports français.
Donc un trader, s'il veut vendre une cargaison sur le marché français, ne pourra plus affréter un navire de plus de vingt ans.
Le trader, qui va toujours essayer de rentabiliser la vente de sa cargaison au mieux, donc se donner le plus de possibilités de la vendre, ne pouvant pas se permettre d'écarter le marché français, sera amené à prendre, au même titre que les compagnies pétrolières, un bateau plus moderne.
Je pense que cette restriction d'âge est déjà une mesure importante, d'autant qu'elle est valable pour tout le monde puisqu'il est interdit aux navires de plus de vingt ans d'entrer dans les eaux territoriales françaises.
M. Joël BOUTROLLE : Il est encore un autre problème que je trouve affolant, et qui ne retient pas beaucoup l'attention : du fait de la position de notre pays et de l'existence du rail d'Ouessant, si une collision survient entre deux bateaux chargés de fioul, même si ce sont des bateaux modernes, on n'évitera pas une pollution majeure.
Je trouve cela extrêmement préoccupant car si de nombreuses dispositions ont été prises pour limiter ce risque, il existe néanmoins : vous avez d'énormes navires qui croisent dans le rail d'Ouessant et mon sang se glace en pensant à une éventuelle collision dans ce rail.
M. le Président : Les trafics sont quand même séparés !
M. Joël BOUTROLLE : Y compris avec des trafics séparés, les risques de pannes de machine, de bateaux qui se mettent de travers ou de collisions survenant par derrière demeurent.
M. le président : Peut-on avoir une idée de la part de pétrole commercialisée par les traders au niveau mondial ?
M. Joël BOUTROLLE : Vous parlez du pétrole commercialisé par les traders ou selon le système du trading ?
Cette précision a son importance car, ainsi que vous le disait précédemment M. Boré, les compagnies pétrolières pratiquent aussi le trading, sous leur nom.
M. le Président : Oui, mais le risque est alors limité.
M. Joël BOUTROLLE : Il existe de grosses sociétés de trading pur comme Glencore ou Vitol...
M. Patrick BORE : C'est très difficile à évaluer car la vente peut intervenir avant chargement.
M. le Président : Votre audition doit être la quarantième à laquelle nous procédons et c'est la première fois que nous abordons ce sujet.
M. Joël BOUTROLLE : C'est aussi parce que nous avons nos chevaux de bataille !
Nous avons beaucoup réfléchi au problème de l'Erika et je pense qu'au niveau de la profession nous avons même été ceux qui ont décidé de se « mouiller » le plus. Beaucoup se cachent dans ce genre de situations en pensant que moins on parlera d'eux et mieux ils se porteront. Lorsqu'on appartient à une société comme B.R.S., on se doit d'être courageux et de dire ce qu'on a à dire. En l'occurrence, nous avons refusé de nous joindre au cortège de tous ceux...
M. le Président :... qui tapaient sur Total ?
M. Joël BOUTROLLE : Voilà, parce que j'estime qu'il faut évoquer le problème avec plus de discernement et de professionnalisme.
Encore une fois, la réaction des médias est tout à fait compréhensible, parce qu'il s'agit d'un drame affreux et qu'on peut parfaitement se mettre à la place de tous ces gens qui ont vu leurs plages souillées par du fioul. Il n'empêche que, pour ce qui nous concerne, nous sommes amenés à envisager le problème sous un angle plus professionnel.
M. le Président : Vous avez bien fait une communication dans la presse ?
M. Joël BOUTROLLE : Oui à plusieurs reprises, notamment dans Les Echos, dans L'Expansion. Nous nous sommes assez largement exprimés.
M. le Président : Vous avez conservé ces articles ?
M. Joël BOUTROLLE : J'ignore s'il y a eu une revue de presse mais j'ai gardé, à titre personnel, plusieurs articles que je peux vous faire parvenir.
Nous ne craignons vraiment pas de nous exprimer sur le sujet parce qu'il nous semble important de profiter de cet événement épouvantable pour faire en sorte qu'il ne se reproduise plus. Les fortunes de mer existeront toujours, mais si cette catastrophe nous permet de réfléchir, tous ensemble, indépendamment des opinions politiques des uns ou des autres dont on se moque parfaitement, ce sera déjà bien ! Ce qu'il faut, c'est identifier le problème pour tenter d'éviter qu'il ne se reproduise. C'est ce à quoi nous voulons parvenir !
M. Patrick BORE : Dès aujourd'hui les mesures prises sont telles que la plupart des armateurs disposant de bateaux anciens les envoient à la casse, faute de leur trouver un emploi sur le marché européen.
Il nous faut rester vigilant sur ce point : de nombreux armateurs grecs disposant de vieux navires nous disaient, il n'y a pas encore si longtemps, que l'effet Erika passerait comme les autres et qu'il leur suffirait de faire preuve de patience et d'attendre qu'il soit oublié pour pouvoir replacer leurs vieux bateaux. Eh bien, il ne faut pas qu'il en soit ainsi.
M. Joël BOUTROLLE : Je n'ai pas l'impression que les choses prennent cette tournure !
M. Patrick BORE : La catastrophe de l'Erika remonte à six mois. Elle est donc encore très récente. Il faut poursuivre l'action, pendre des mesures en permanence et veiller surtout à ce qu'elles soient respectées.
M. Joël BOUTROLLE : Je dirais que c'est là le grand rôle des autorités politiques. D'abord, la presse s'est emparée du problème avec une force et une virulence extrêmes ; ensuite, le relais a été pris par les politiques et il faut s'en féliciter parce que c'est grâce à eux que la question reste d'actualité. L'intérêt ne doit surtout pas retomber !
Je crois qu'il y a une volonté d'intervenir à l'échelle européenne et il est très intéressant de constater que le problème n'est plus local mais clairement européen, voire international.
Nous avons vu des acteurs majeurs du marché pétrolier prendre des décisions extrêmement importantes.
M. Patrick BORE : Oui, mais seuls les Français respectent aujourd'hui à cent pour cent la charte qui vient d'être signée.
M. Joël BOUTROLLE : En matière de qualité des navires, certains acteurs, tels les Coréens et les Japonais, avaient, depuis de nombreuses années, des exigences que les autorités françaises n'avaient pas le courage d'imposer : il faut quand même le dire !
M. le Président : Quelles étaient ces exigences ?
M. Joël BOUTROLLE : Les Japonais refusaient, il y a déjà longtemps, de prendre des bateaux de plus de quinze ans.
M. le Président : Ils leur refusaient l'entrée de leurs ports ?
M. Joël BOUTROLLE : Oui, et ils refusaient même de les affréter.
Les Coréens - M. Boré connaît cela mieux que moi puisqu'il suit de plus près l'affrètement SPOT - ont commencé à jouer une politique de qualité.
Je suis quand même frappé que des gens comme les Iraniens, les responsables de NITC pour ne pas les nommer, qui avaient de très vieux bateaux, aient décidé depuis un certain nombre d'années de se doter d'un tonnage d'une qualité exemplaire : c'est très impressionnant !
C'est en France que les gens traînaient les pieds pour prendre de telles mesures.
M. Patrick BORE : En France et en Europe !
M. Joël BOUTROLLE : Oui, ne parlons pas des Italiens !
M. le Président : Est-ce que cette prise de conscience que vous avez observée depuis le naufrage de l'Erika, s'est traduite, au niveau des prix du fret et dans quelle proportion ?
M. Patrick BORE : Tout à fait !
M. le Président : Parce que l'offre de tonnage à diminué ?
M. Patrick BORE : L'offre de tonnage moderne étant plus faible et les affréteurs privilégiant maintenant ce type de tonnage, le marché s'en est trouvé bien entendu très secoué et l'on assiste aujourd'hui à un bon nombre de commandes de navires neufs de toutes tailles : aussi bien des transporteurs de produits raffinés que de gros transporteurs de brut !
L'effet Erika a un énorme impact non seulement à l'ouest de Suez, c'est-à-dire en Europe et aux Etats-Unis, mais aussi vers l'Asie !
M. Joël BOUTROLLE : Il se trouve que nous sommes conseillers d'EDF en matière de sécurité, et encore une fois à la suite de l'affaire Erika, nous avons été extrêmement impressionnés de voir à quelle vitesse cette entreprise, pourtant considérée comme étant d'une réactivité extrêmement lente, a pris des dispositions. Elle a réalisé que si elle achetait des cargaisons délivrées, même si elle ne faisait qu'accueillir les bateaux sans responsabilité juridique sur ses propres terminaux, elle pourrait se retrouver confrontée à une responsabilité morale effrayante en cas de pollution.
M. le Président : A quelle activité d'EDF faites-vous allusion ?
M. Joël BOUTROLLE : Aux livraisons de fioul pour les centrales thermiques !
Quand un bitumier coule, cela produit un gros bloc de bitume ; quand un vraquier coule, hormis peut-être la citerne de soute, il n'y a pratiquement pas de pollution. Le vrai problème, c'est le fioul, produit dont il faut précisément se débarrasser parce qu'il est composé des résidus de la distillation.
M. le Président : Vous est-il arrivé de sortir des armateurs de votre fichier-clients ?
M. Patrick BORE : Oui, tout à fait, mais cela se produit maintenant de moins en moins parce que, comme le rappelait M. Boutrolle, le marché a été si mauvais, pendant les années quatre-vingt notamment, que les petits et les mauvais armateurs, pour qui il n'y avait pas de place, ont disparu. Il ne reste plus aujourd'hui que des armateurs de premier plan.
Il peut aussi se trouver encore quelques amateurs de moindre importance, surtout sur les marchés captifs. Ils effectuent, en Europe, des transports de cabotage sur de petits parcours avec des bateaux de petite taille. Ils ont peu de moyens et une petite surface financière, mais ils peuvent être sérieux.
S'agissant de la flotte pétrolière actuelle, les exigences des affréteurs sont telles que seuls existent des armateurs de grande renommée.
M. le Président : Dans le cas de l'Erika, considérez-vous l'armateur comme un armateur de premier plan ou comme un de ces armateurs que vous venez de décrire ?
M. Patrick BORE : C'est un armateur qui jouit, encore aujourd'hui, d'une bonne réputation. Toutefois, il a une petite surface financière puisque je crois qu'il disposait de quatre ou cinq navires de taille identique à celle de l'Erika. Ce n'est pas un armateur de grande envergure.
Il était cependant considéré comme un armateur sérieux sans quoi d'ailleurs Total ne l'aurait pas pris.
Mme. Jacqueline LAZARD : Vous connaissez, bien sûr, tout cela beaucoup mieux que nous, mais je ne suis pas certaine que l'armateur de l'Erika soit sérieux.
Je croyais, au vu de l'expérience qui est la vôtre, depuis trente ans de métier que, pour vous, la responsabilité première était celle des armateurs et voilà que vous nous dites qu'il y a très peu de mauvais armateurs : à entendre vos propos, j'avais cru comprendre qu'il y en avait, quand même, de par le monde, d'assez peu sérieux.
M. Patrick BORE : Nous faisions allusion aux vingt ou trente dernières années mais, aujourd'hui, les exigences des pétroliers sont telles qu'un armateur non sérieux et manquant de surface financière ne peut y faire face.
M. Joël BOUTROLLE : Je crois aussi, madame, qu'il est possible de dire qu'il y a un « avant » et un « après » Erika : la situation que nous connaissons aujourd'hui sur le marché est fondamentalement différente de celle du mois de décembre.
Je répète que nous étions alors dans un très mauvais marché. Des précautions étaient, bien entendu, prises au niveau des compagnies pétrolières - dont je vous ai dit que, depuis vingt ans, les exigences étaient de plus en plus importantes -, mais elles n'étaient absolument pas du niveau que nous connaissons aujourd'hui.
En matière de sécurité, la réaction des compagnies pétrolières a été tellement ahurissante qu'on a peine à l'imaginer.
M. le Président : Depuis l'Erika ?
M. Joël BOUTROLLE : Absolument ! Je me souviens parfaitement que les catastrophes de l'Exxon Valdez, de l'Amoco-Cadiz, ont suscité une certaine panique et des réactions de même que l'échouement consécutif à une panne de moteur du navire de Frederiksen (?) en Cornouailles, mais leur ampleur n'a jamais été comparable à celles qu'a entraînées l'Erika. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, il s'agissait d'une pollution par le fioul qui est le produit le plus horrible qui existe - une vraie saleté ! - alors que les autres pollutions étaient causées par du pétrole brut qui s'évapore et qui provoque des dégâts beaucoup moins importants.
En conséquence, que l'on prenne des précautions maximales pour transporter le fioul, je m'en félicite tous les jours. Je considère que ce sera l'énorme acquis du naufrage de l'Erika et j'espère que les politiques continueront à imposer leur réflexion.
Pour ce qui nous concerne, en tant que courtiers, nous sommes bien décidés à poursuivre cette discussion et cette réflexion qui est très importante...
M. le Président : Mais en votre qualité de courtiers, vous ne disposez pas d'autres moyens que la parole.
M. Joël BOUTROLLE : Mais elle sert beaucoup : les politiques le savent bien !
M. le Président : Oui, mais ils disposent aussi du pouvoir législatif ce qui est différent !
Je ne le dis pas par provocation mais parce que, alors qu'on sent dans votre propos une volonté déontologique forte, vous constatez, lorsqu'on vous interroge, que vous êtes impuissants faute d'avoir accès aux informations des sociétés de classification, par exemple, ni même d'avoir un pouvoir décisionnel.
M. Joël BOUTROLLE : Cela fait partie de nos regrets, mais depuis six mois, depuis le naufrage de l'Erika, nous prêchons la bonne parole.
Il faut savoir qu'en trente ans de métier, alors que je vis au quotidien le transport maritime, jamais je n'ai vu quelqu'un s'intéresser aux problèmes de sécurité maritime : tout le monde s'en moque et il aura fallu cette catastrophe pour que l'opinion commence à être sensibilisée au problème.
Pour ma part, j'aurais aimé être convoqué dans le cadre de commissions au Sénat, à l'Assemblée nationale et c'est avec une grande joie que je m'y serais exprimé. Mais je n'ai jamais été consulté !
Aujourd'hui, nous commençons à être écoutés, ce dont nous nous réjouissons car cela signifie que nous allons pouvoir enregistrer des avancées. C'est pourquoi nous serons toujours disponibles. C'est aussi pourquoi j'ai incité ma société à nous laisser dire ce que nous avons à dire : il y a des choses à dire sur ce problème et nous sommes bien placés pour en parler puisque, au-delà de l'aspect global nous sentons le marché, nous baignons dedans. Nous ne prenons le parti ni de l'armateur, ni de l'affréteur ; nous tentons de voir ce qui se passe dans la réalité de l'affrètement.
Je trouve, par exemple, que Francis Vallat est une personnalité formidable. Il est maintenant en dehors de tout cela puisqu'il n'est plus armateur, mais il reste un des seuls à avoir dit en permanence des choses sensées et courageuses : chapeau !
S'il n'y avait que des gens comme lui, qui savent de quoi ils parlent, pour se lever, dire ce qu'il faut faire et proposer d'identifier les problèmes et d'en parler, ce serait mieux.
Cela explique que dans notre revue annuelle vous trouviez la formule suivante : « Ne nous trompons pas de cible ! »
Mme. Jacqueline LAZARD : Votre société s'occupe uniquement du transport de pétrole ?
M. Patrick BORE : Elle s'occupe de tout ce qui touche au maritime.
Mme. Jacqueline LAZARD : Même si vous prétendez qu'il n'y a plus beaucoup de mauvais armateurs, cela n'empêche pas qu'un certain nombre de bateaux soient régulièrement retenus dans les ports...
M. Patrick BORE : Si vous regardez bien, vous verrez que la plupart de ces bateaux ne sont pas des pétroliers.
Mme. Jacqueline LAZARD : C'est bien pourquoi je vous ai demandé si vous vous occupiez uniquement de pétrole.
M. Patrick BORE : Le marché du pétrole étant un marché étroit, les gens s'y connaissent et rares sont les pétroliers arrêtés dans les ports français.
Mme. Jacqueline LAZARD : Mais vous conviendrez que dans d'autres domaines, il existe de armateurs qui ne sont pas irréprochables.
M. Patrick BORE : Oui, dans le vrac notamment, mais c'est un type de transport qui n'est pas soumis aux mêmes exigences de sécurité que celui des produits dangereux.
M. le Président : Au cours d'une transaction, est-ce que les autres produits dangereux font l'objet de précautions particulières ? Je pense aux gaz, à l'industrie chimique ou à des conteneurs qui pourraient transporter des produits identifiés comme dangereux ?
M. Joël BOUTROLLE : Il existe un système, que personnellement je ne connais pas très bien, pour les produits dangereux chimiques. Ce secteur d'activité dispose d'un système global de sources d'information, d'une sorte de tronc commun, ce qui n'est malheureusement pas le cas du secteur pétrolier.
M. le Président : Nous avons interrogé les compagnies pétrolières sur ce modèle de vetting commun et elles nous ont répondu qu'elles n'en veulent pas !
M. Joël BOUTROLLE : Non, elles n'en veulent pas !
Le système EQUASIS est une idée intéressante, à laquelle tout le monde ne croit pas, mais qui demande à être approfondie. Je pense qu'il serait formidable de parvenir à avoir une base de données commune qui serait alimentée par des professionnels, sans compter que cela représenterait des économies pour tout le monde !
M. le Président : Je pense qu'EQUASIS est une formule qui va se mettre en place mais le CDI - Chemical distribution Institute - ne se limite pas à l'information commune : il va jusqu'au contrôle commun puisque la profession s'est dotée d'un corps d'inspecteurs spécialisés et polyvalents.
M. Patrick BORE : C'est peut-être plus facile pour le secteur chimique dans la mesure où seuls deux grands groupes au monde se partagent l'activité du transport. De surcroît, le trafic est moindre, alors que le secteur du pétrole regroupe bien une centaine d'armateurs indépendants.
M. Joël BOUTROLLE : Pour ma part, je suis sidéré et je trouve un peu pathétique, à l'époque où les avancées technologiques permettent d'aller sur la lune et d'envoyer des sondes sur Mars, qu'on puisse ne pas savoir pendant les quinze jours qui suivent l'accident si la nappe de fioul avance ou recule.
Il est ahurissant de penser que l'on n'a pas réussi à imposer un certain nombre de systèmes de récupération des résidus en mer et qu'on finisse toujours par manier le seau et la pelle ! Pour moi, c'est fou et je ne comprends pas qu'il n'y ait pas une volonté politique forte pour se pencher sur la question de la récupération des déchets en mer.
En France, où l'on avait pourtant pris des moyens considérables avec l'Abeille Flandre et les autres bateaux pour secourir les pétroliers en détresse, on a attendu, pendant quinze jours, de voir le pétrole venir s'étaler sur les plages.
M. le Président : Et de plus, il n'est pas arrivé là où on l'attendait !
M. Patrick BORE : C'est d'autant plus grave que ce transport se fait, ainsi que je le disais tout à l'heure, très souvent en cabotage, donc très près des côtes.
M. Joël BOUTROLLE : On va chercher du pétrole par mille mètres de fond et on ne peut pas le récupérer en surface ?
M. le Président : L'observation est très juste ! Manifestement, on n'avait jamais imaginé une telle pollution en mer et les plans POLMAR-mer et POLMAR-terre ne prévoyaient que le ramassage de la pollution à terre.
M. Joël BOUTROLLE : J'espère qu'une réflexion est conduite sur le sujet...
M. le Président : Tout à fait et nous nous efforçons d'y contribuer. Si nous avons évoqué avec vous les questions de prévention, nous avons entendu d'autres personnes à propos de la lutte contre la pollution.
M. Patrick BORE : Le système américain est onéreux, mais très efficace.
M. le Président : Ce qui m'a beaucoup frappé, c'est moins le système de garde-côtes que nous connaissions un peu, que leur unité d'intervention pour tout, au niveau non seulement de l'arrivée des bateaux, mais aussi de la lutte contre la pollution ou du remboursement des préjudices.
Il n'y a qu'une structure là où, en France, il doit y en avoir quinze.
C'est une première leçon à retenir, la seconde étant les garanties que doivent présenter les bateaux en matière de lutte contre la pollution : le bateau doit même communiquer le nom de la société qui se chargera du nettoyage en cas de pollution
M. Joël BOUTROLLE : Ce sont encore des avancées dues aux pollutions et notamment à celle de l'Exxon-Valdez.
M. le Président : Effectivement !
Nous pouvons toujours rêver d'une Coast guard, mais la situation européenne est telle que ce n'est pas pour tout de suite !
Je pourrais parfaitement en défendre l'idée dans mon rapport, mais cela n'aurait pas d'autre effet que de m'attirer un succès d'estime pendant une quinzaine de jours : les conditions politiques ne sont pas réunies pour cela.
En revanche, il est parfaitement envisageable de structurer davantage les relations entre les différents pays européens pour élaborer des normes de fonctionnement communes !
M. Joël BOUTROLLE : Si on appliquait de façon très stricte et rigoureuse les réglementations existantes, ce serait déjà bien !
M. le Président : C'est vrai, mais cela concerne le port, alors que les questions principales sont de savoir comment régler les normes de circulation en Manche, en mer du nord et en Méditerranée et comment bien coordonner nos interventions. Tout cela peut relever d'une Agence maritime européenne.
A mon avis, il ne faut pas obligatoirement associer une Agence maritime européenne à des garde-côtes européens, dont l'existence relève d'un v_u pieux dans la mesure où elle suppose un début d'abandon de souveraineté dans le domaine de la défense.
On peut le réclamer mais, très concrètement, il faudra compter vingt ans pour voir la revendication aboutir, alors que l'on obtiendra beaucoup plus vite des protocoles communs d'utilisation conjointe des moyens des Etats membres de l'Union européenne.
M. Patrick BORE : Eh bien, bon courage !
M. Joël BOUTROLLE : Surtout, ne lâchez pas la proie parce qu'actuellement les réactions vont vraiment dans le bon sens. Elles sont beaucoup plus importantes qu'on ne peut l'imaginer !
M. le Président : Existe-t-il une organisation professionnelle des courtiers au niveau international ?
M. Patrick BORE : Il existe une chambre syndicale en France.
M. le Président : Avez-vous partagé vos impressions avec vos collègues de cette chambre syndicale ?
M. Patrick BORE : Non, pas à ma connaissance. Il faut dire qu'il ne reste que deux courtiers parisiens qui interviennent dans le domaine pétrolier. La chambre syndicale est donc davantage occupée par les autres activités maritimes.
Entretien du rapporteur avec
Mmes Elisabeth BORNE et Bettina LAVILLE, conseillères,
au Cabinet de M. Lionel JOSPIN, Premier ministre
(extrait du procès-verbal de la séance du 31 mai 2000)
Mmes Elisabeth Borne et Bettina Laville sont introduites.
M. le Président leur rappelle que les dispositions législatives relatives aux commissions d'enquête leur ont été communiquées. A l'invitation du Président, Mmes Elisabeth Borne et Bettina Laville prêtent serment.
M. le Rapporteur : Mesdames, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Je souhaiterais que vous m'expliquiez l'organisation de l'Etat pendant la crise. Comment circulait l'information ? Quelles relations entreteniez-vous avec le secrétariat général à la mer et les ministres de l'intérieur et de la défense ? Enfin, avez-vous constaté des lacunes dans le dispositif mis en place, et si oui, lesquelles ?
Mme Bettina LAVILLE : Le cabinet du Premier ministre a été informé, dès le naufrage, de manière extrêmement régulière. Trois conseillers ont suivi cette affaire de près : Mme Borne, l'amiral Dumontet et moi-même. Le dispositif nous a été fourni par le secrétariat général à la mer qui nous a transmis l'ensemble des informations à sa disposition, provenant à la fois du ministère de l'intérieur et de la préfecture maritime. Et cela jusqu'au moment où, quelques jours après le naufrage, nous avons décidé de tenir une réunion quotidienne pour faire le point sur la situation avec le secrétariat général à la mer, ce dernier faisant lui-même une réunion préparatoire avec l'ensemble des administrations concernées. Nous avions donc tous les jours un suivi du fuel, dont l'exactitude s'est avérée contestable.
Le 25 décembre après-midi, le général Dumontet et moi-même avons tenu une réunion de crise ; ces réunions ont ensuite eu lieu de manière quotidienne la première semaine, et de façon un peu plus espacée par la suite. Tel a été le dispositif de Matignon.
Le rôle du secrétaire général de la mer a été très important, puisqu'il était le point de coordination. Les informations remontaient directement aux ministres par les soins de l'ensemble des membres des cabinets présents à cette réunion, et nous, nous informions le Premier ministre.
Si nous devons donner une appréciation, je dirai qu'au moment de la crise il y a eu une mobilisation générale, en particulier des préfets. Nous avons décidé de changer le préfet responsable de la coordination des secours, dès que nous avons constaté que le fuel était arrivé non pas en Charente-Maritime ou au sud de la Vendée, mais beaucoup plus haut ; le PC a donc été déplacé à Rennes par le préfet de zone de défense. Cette décision administrative a été lourde à prendre, mais elle était motivée par deux raisons. D'une part, le lieu d'arrivée du fuel, et, d'autre part, la tempête qui a frappé dans la nuit du lundi à mardi ; l'ensemble du PC de crise de Charente-Maritime a dû faire face à ce second événement. Il était armé pour une crise, mais pas pour celle-là.
Le secrétariat général à la mer a joué son rôle d'animation et de coordination, en liaison constante avec les préfets et la préfecture maritime. Mon sentiment est qu'il a plus joué un rôle de coordination que d'initiative.
Mme Elisabeth BORNE : Chacun sur le terrain s'est mobilisé, a essayé de faire au mieux, avec certains problèmes d'interface sur lesquels l'on pourra peut-être revenir. Chacun a essayé de répondre en mobilisant les moyens dont il disposait. Le secrétariat général à la mer a joué un rôle de relais et de transmission, et n'a sans doute pas pris beaucoup d'initiatives.
M. le Rapporteur : Avait-il les moyens d'en prendre ? J'ai le sentiment que l'arbitrage politique, y compris en ce qui concernait les affaires secondaires, était assuré par vous. J'ai l'impression que vous étiez amenées à vous occuper de choses dont vous n'auriez pas dû vous occuper si tout avait bien fonctionné ; vous aviez en effet des relations directes avec le préfet maritime et certains préfets. Or il ne nous apparaît pas convenable que le Premier ministre soit en première ligne dès le début de l'affaire. On a, en fait, le sentiment d'un secrétariat général à la mer transparent dans sa capacité à réagir.
Mme Bettina LAVILLE : A ce sujet, je peux faire plusieurs commentaires, non seulement conjoncturels, mais également de fond.
Nous avons eu effectivement le sentiment d'être assez vite en première ligne. Mais cela était un peu inévitable ; il s'agissait d'une catastrophe littorale importante, doublée, trois jours après, d'une tempête extrêmement violente. On voit donc assez mal comment le cabinet du Premier ministre aurait pu éviter d'être en première ligne, d'autant que le Premier ministre s'est déplacé immédiatement.
En revanche, il est vrai que nous avons eu le sentiment, non pas d'avoir à décider à partir d'un certain nombre de propositions qui nous étaient faites, mais de suggérer les termes des décisions.
Mme Elisabeth BORNE : Instruire les dossiers plutôt qu'arbitrer.
Mme Bettina LAVILLE : Nous avons en effet eu parfois un rôle d'instruction des décisions à prendre que nous n'aurions pas dû avoir. En revanche, nous n'avons pas eu, parfois, du secrétariat général à la mer, tous les termes des décisions à prendre ; nous avons dû recouper avec le préfet maritime et l'ensemble des préfets.
M. le Rapporteur : C'est bien le sentiment que nous avons : vous aviez des relations directes avec les préfets et le préfet maritime.
Mme Elisabeth BORNE : Via les ministères, tout de même. Via le cabinet pour le préfet maritime et le cabinet militaire de Matignon, et via le ministère de l'intérieur pour les préfets.
Je voudrais insister sur les circonstances conjoncturelles. Tous ceux qui se penchent sur le dossier soulignent tout de même qu'il s'agit de la pollution qui a affecté le linéaire de littoral le plus important que l'on ait jamais connu. Et à cette pollution s'ajoute la tempête du siècle au moment des fêtes de fin d'année, à un moment où un certain nombre de fonctionnaires ont légitimement prévu d'autres occupations ! Sans oublier le souci du bug de l'an 2000 qui mobilisait pas mal d'énergie au ministère de l'intérieur, en termes de vigilance et de capacité d'intervention.
Il s'agit tout de même là de circonstances qui peuvent expliquer que l'on ait eu, en face de nous, des administrations qui semblaient parfois dépassées par les événements. On peut bien entendu regretter de ne pas avoir eu des dispositifs qui se mettaient en ordre de marche et se déroulaient de façon plus systématique ; on peut également regretter de ne pas avoir eu des administrations en situation de force de propositions plus structurées. Mais l'on doit tenir compte de ces événements qui sont tout de même exceptionnels.
Mme Bettina LAVILLE : Au-delà du conjoncturel, deux choses m'ont frappée. Tout d'abord, l'absence de mémoire écrite, enregistrée et utile du naufrage de l'Amoco-Cadiz. Les enseignements, tirés de ce naufrage, ont été de tradition orale, en particulier par un certain nombre de fonctionnaires ou d'élus bretons. Une administration dans l'Etat, peut-être les administrations qui ont précédé le secrétariat général à la mer, aurait dû garder ces informations d'une manière plus prégnante. C'est l'un des enseignements utiles pour l'avenir.
Ensuite, les administrations ont eu foi dans les systèmes d'informations scientifiques, et particulièrement dans les systèmes météo, de façon trop importante ; et quand le cabinet du Premier ministre émettait des doutes sur cette circulation par modèle informatique du fuel dans mer, l'ensemble des services nous ont répondu que ces informations étaient parfaitement fiables. Nous avons d'ailleurs tiré les conséquences de cela en renforçant l'ensemble des crédits d'études et de recherche de certains organismes afin d'avoir une meilleure traçabilité des pollutions en mer.
M. le Rapporteur : Vous parliez tout à l'heure de problèmes d'interface. Et je voudrais avoir votre sentiment sur l'articulation POLMAR Terre et POLMAR Mer.
Une de nos observations portera certainement sur la communication à l'égard des acteurs et du public. Je ne parle pas uniquement de la communication sur la toxicité, mais nous avons le sentiment que l'on a oublié le volet POLMAR Communication ; or la communication, aujourd'hui, a un rôle essentiel. De nombreuses bévues de communication ont été commises, souvent plus par maladresse que par intention, c'est vrai. Et notamment, nous ne savions pas quand l'Etat parlait.
Mme Elisabeth BORNE : Parmi les faiblesses du dispositif que nous avons pointées - et elles ont été mentionnées à la réunion du CIM du 28 février -, nous avons relevé l'aspect expertise, que Bettina Laville a mentionné, ainsi que l'aspect dialogue et information du public et des partenaires.
Cela renvoie à quelque chose de plus profond : l'administration, en temps normal, n'a pas une tradition d'information du public et de communication. Alors, dans une période de crise comme celle que l'on vient de connaître, il est certain que la communication n'était pas une priorité, chacun communiquant comme il le pouvait.
Nous avons pu aussi constater, et nous l'avions souligné lors du CIM, que la relation entre l'administration et ses partenaires potentiels n'est pas suffisamment structurée. Il y a de l'information à donner aux acteurs locaux, il y a de la mobilisation et des synergies à organiser avec les acteurs locaux ; or il s'est avéré que la capacité à organiser le travail avec les collectivités locales, à mobiliser les bénévoles et à les associer à des dispositifs devait être renforcée.
Mme Bettina LAVILLE : Je n'ai pas un sentiment aussi négatif sur la communication. Au départ, le dispositif d'information a été fidèle à l'ensemble du plan de crise : le préfet de la Rochelle était le chef du PC. Ensuite, il y a eu un premier problème, la pollution n'est pas arrivé là où elle était attendue ; il y a donc eu un déplacement de l'information, qui, normalement, aurait dû être assurée par le préfet de zone de défense, mais qui a été assumée, avec l'accord du secrétariat général à la mer, par le préfet maritime qui avait une vision immédiate de l'arrivée de la pollution. J'ajouterai d'ailleurs que les reconnaissances étaient extraordinairement difficiles, la météo étant très mauvaise pendant près de 10 jours ; les reconnaissances ont donc été beaucoup plus rares qu'on ne l'avait souhaité.
Puis, début février, le Gouvernement a ressenti le besoin d'une parole ministérielle de coordination, cette mission a été confiée à Jean-Claude Gayssot.
Nous avons donc eu trois séquences. Premièrement, une information de proximité qui intéressait le public - où le fuel allait-il arriver, sur quelle plage, comment il se déplace. Deuxièmement, une information sur l'ensemble du dispositif qui s'est tenue au niveau du représentant de la zone de défense. Et, enfin, la parole du ministre désigné par le Gouvernement. J'ai donc l'impression que le dispositif de communication était relativement correct.
En revanche, l'adaptation de la surprise, qu'a constitué le lieu de pollution, à la source d'information - la personne qui disait la parole publique - a été beaucoup plus compliquée.
Mme Elisabeth BORNE : Je crois effectivement qu'il y a eu beaucoup d'informations données et une réelle volonté de transparence ; simplement la communication ne répondait aux attentes, en ce sens que les gens voulaient savoir ce qui allait se passer - en effet, nous ne répondions pas puisque la nappe, obstinément, n'allait pas là où l'on pensait qu'elle devait aller - et ce que nous allions faire. La frustration vient donc du fait que l'on n'était pas capable de dire au public ce qui allait se passer et ce que nous allions faire.
M. le Rapporteur : Qui articule les plans POLMAR Mer et POLMAR Terre ?
Mme Elisabeth BORNE : Selon l'instruction de 1997, c'est le ministère de l'intérieur.
Les interventions en mer se sont bien passées ; tant qu'il s'est agi de s'assurer qu'il n'y avait pas de vies en jeu ou de remorquer au mieux l'épave, la responsabilité de la préfecture maritime s'est exercée sans aucune contestation.
Dès lors que la pollution a commencé à affecter la côte et qu'il a fallu faire jouer conjointement des moyens d'intervention en mer et terrestres, c'est le ministère de l'intérieur qui a assuré cette coordination. Et nous avons rappelé à l'occasion du CIM du 28 février qu'il appartenait au préfet de zone de défense de coordonner les plans POLMAR Terre et POLMAR Mer.
Il ne s'agit pas de faire de la coordination, comme ça, un beau matin. Tout cela doit se préparer, avec la mise en place d'états-majors communs, c'est-à-dire détacher des civils auprès de l'état-major militaire, et des militaires auprès de l'état-major civil.
M. le Rapporteur : Je ne suis pas sûr que cela se soit passé ainsi. Prenons un exemple précis : les moyens antipollution sont de la compétence de la marine, à Brest ; le préfet de zone a-t-il dit à l'amiral qu'il organisait la mise en _uvre de ses moyens ?
Mme Bettina LAVILLE : Il est évident que le préfet de zone étant à Rennes, il a délégué un certain nombre de choses au préfet du Finistère et au préfet maritime.
Mme Elisabeth BORNE : Je pense que les services sur le terrain ont souffert et que la préfecture maritime a eu du mal à assurer les liaisons avec l'ensemble des préfets. C'est en effet inhabituel de devoir se coordonner avec plusieurs préfets. Peut-être que le dispositif qui s'est mis en _uvre aurait mieux fonctionné s'il n'y avait eu qu'un préfet. Mais je n'ai pas eu le sentiment qu'il y ait eu de réels cafouillages.
Mme Bettina LAVILLE : Non, je ne le pense pas non plus.
M. le Rapporteur : Vous évoquiez pourtant des problèmes d'interface.
Mme Elisabeth BORNE : Non, je disais que, notamment dans la préparation de la crise, l'on s'était rendu compte a posteriori que les responsabilités n'étaient pas déclinées suffisamment finement, de manière nominative : Il importe de savoir qui doit aller où en cas de crise. Il convient en effet, face à un tel événement, que la feuille de route soit claire. Or même si la circulaire de 1997 est assez précise, cela n'a pas été décliné à un niveau suffisamment fin pour que le dispositif se mette en route de façon automatique.
Mme Bettina LAVILLE : Je pense qu'il y a eu deux choses. D'une part, les administrations sur le terrain ont été un peu rigides par rapport à des textes qu'elles ont bien appliqués ; il y a peut-être eu un problème d'adaptation à la nature particulière de cette marée noire. D'autre part, elles ont eu en face d'elles des élus et des médias qui ont joué l'adaptation immédiate à un terrain qui était extrêmement mouvant et large, sans tenir compte du fait que le service public a à assurer un traitement général de toutes sortes de phénomènes, tels que la sécurité des biens et des personnes, la sécurité environnementale, la sécurité sanitaire, le nettoyage immédiat, la coordination et l'encadrement des bénévoles... C'est cela qui a créé un déséquilibre.
Par ailleurs, les élus se sont fortement mobilisés et ont proposé d'eux-mêmes un certain nombre de secours qui ont été acceptés et utilisés, dans une coordination entre l'Etat et les collectivités locales qui a été bien meilleure que ce que l'on a dit.
Mais il y a eu, forcément, le global en face du particulier. Quand les médias interrogent le maire d'une commune, ce dernier annonce tout ce qui ne va pas dans sa commune. Alors que l'Etat doit faire face à un problème global.
Mme Elisabeth BORNE : Il ne faut pas oublier non plus que les services de terrain ont été « au charbon » sur des problèmes complexes et sur une durée extrêmement longue. Nous avions également relevé, le 28 février, le manque de capacité que l'on a, dans un tel cas, à redéployer des moyens et à venir en appui. Manifestement, les services de l'Etat ne peuvent pas être dimensionnés pour faire face, à un endroit donné, à des crises aussi complexes et aussi longues.
En revanche, il faut que les administrations, centrales, régionales ou même locales, organisent le renfort des services qui sont sur le terrain lorsqu'ils ont à faire face à des circonstances aussi difficiles.
M. le Rapporteur : Vous travaillez sur ce thème actuellement ?
Mme Elisabeth BORNE : On a déjà posé le principe. Il s'agit de redéfinir les plans d'urgence, or nous avons engagé une réflexion sur leur actualisation.
Les plans d'urgence doivent prévoir les conditions dans lesquelles l'on peut renforcer en cas de crise les services qui se trouvent principalement au feu, et ce de façon très opérationnelle.
M. le Rapporteur : Comme cela est prévu pour les pompiers.
Mme Elisabeth BORNE : Il faut se rendre compte du travail que les administrations ont accompli ! Elles fournissaient un effort énorme pour régler un problème qui revenait deux jours après ; et ce sur une période très longue.
M. le Rapporteur : S'agissant de la crise elle-même, par rapport à l'Amoco-Cadiz, beaucoup d'argent a été mis sur la table pour réparer, par le FIPOL - 1,2 milliard de francs -, Totalfina et l'Etat. Qui coordonne la bonne cohérence de l'ensemble de ces moyens ? N'est-il pas souhaitable qu'une personne, au niveau de l'Etat, tienne une sorte de tableau de bord de la mise en _uvre des interventions financières ?
Mme Bettina LAVILLE : Cette question s'est posée immédiatement, et la coordination financière a été faite assez normalement par le cabinet du Premier ministre, avec les trois personnes que j'ai citées tout à l'heure plus le préfet Christnacht et notre collègue du budget. Il s'agit là du fonctionnement normal de l'Etat compte tenu des crédits engagés.
Les crédits POLMAR ont, à chaque fois, été confirmés en réunions interministérielles, les crédits d'urgence ayant été décidés lors des deux réunions présidées par le Premier ministre - le mardi 28 décembre et au mois de janvier. Etant donné qu'il s'agissait de crédits exceptionnels ou de crédits identifiés sur des lignes existantes mais de toute façon supplémentaires - ils sont d'ailleurs au collectif -, il est évident que tout cela a été coordonné au plus haut niveau de l'Etat.
M. le Rapporteur : Ma question concernait davantage le suivi de ces crédits.
Mme Elisabeth BORNE : Le suivi des crédits POLMAR est assuré par le ministère de l'environnement, et les relations avec le FIPOL relèvent du ministère des affaires étrangères avec l'appui de celui des finances. Par ailleurs, un certain nombre de dispositifs d'avances ont été mis en place avec un ministère gestionnaire.
De façon assez naturelle aussi, nous avons été amenés à organiser des réunions de coordination, notamment parce que le FIPOL, comme nous nous y attendions, prend son temps pour mettre en place ses remboursements. Nous avons donc décidé d'activer des dispositifs d'avances au plan national afin que les populations et les professionnels qui ont besoin d'argent n'attendent pas plusieurs mois avant d'être remboursés.
M. le Rapporteur : C'est pourtant ce qui se passe ! Car la mise en _uvre du dispositif
- annoncée par le Premier ministre le 28 février - consistant à faire faire des avances de trésorerie par la BDPME n'est toujours pas opérationnel. Il va sans doute se mettre en place la semaine prochaine.
Mme Elisabeth BORNE : Voilà un autre exemple : soit nous sommes dans la vie courante, et nos administrations mettent en _uvre des procédures auxquelles elles sont habituées, soit nous sommes confrontés à des phénomènes exceptionnels et il faut une mobilisation permanente pour arriver à faire mettre en _uvre par nos administrations des procédures inhabituelles ! On se rend bien compte que face à des phénomènes tels que ceux que l'on vient de vivre, il faut mobiliser une grande énergie, d'abord pour que l'on prenne les décisions nécessaires, et, ensuite, pour que l'argent arrive dans la poche de celui auquel il est destiné.
Mme Bettina LAVILLE : D'ailleurs, on a nommé le préfet Lebeschu pour gérer ce type de dispositif pour la tempête. La partie POLMAR s'est bien passée, l'argent a été dépensé très vite...
Mme Elisabeth BORNE :... la partie OFIMER est maintenant bien enclenchée. Cela a mis du temps, c'est vrai, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des procédures de contrôle sur les crédits publics. Bien entendu, nous pouvons progresser et nous inspirer des dispositions prises par les assurances qui, en dessous d'un certain seuil, payent pratiquement automatiquement ; mais l'administration ne sait pas faire cela !
On ne peut pas mettre les crédits sur la place publique et les distribuer comme ça, mais nous devons trouver des solutions qui nous permettent d'aller plus vite. Nous devons trouver un meilleur équilibre entre le légitime souci de ne pas dépenser n'importe comment les deniers publics et la nécessité d'aller vite en cas de situations exceptionnelles.
En ce qui concerne les dispositifs d'avances, c'est compliqué à mettre en place quand on est dans l'exceptionnel.
M. le Rapporteur : La mission Lebeschu ne concernera pas la marée noire.
Mme Elisabeth BORNE : Les dispositifs d'aides sont très ciblés. Face au problème concernant les paiements du FIPOL, nous avons pris la décision d'élargir le champ des dispositifs d'avances et d'augmenter les taux.
La mission Lebeschu se justifiait par le grand nombre de départements touchés et le nombre important de lignes budgétaires concernées. Les cibles, s'agissant de la pollution du littoral, sont les pêcheurs, les conchyliculteurs et le secteur du tourisme.
M. le Rapporteur : Envisagez-vous de réviser la circulaire de 1997 - si oui, dans quel sens ?
Mme Elisabeth BORNE : L'économie générale de la circulaire ne me semble pas devoir être remise en cause. Et nous attendons les conclusions de la mission Thery pour nous prononcer, mais il est vrai que certains points méritent sans doute d'être précisés.
M. le Rapporteur : Y a-t-il d'autres points que ceux que nous avons évoqués que vous estimez devoir être précisés ?
Mme Elisabeth BORNE : Nous n'avons pas beaucoup parlé de la préparation à la crise ; il convient de se demander qui se sent en charge de la préparation de la crise, qui se sent en charge de la maintenance, par exemple, du matériel POLMAR, qui se sent en charge de l'actualisation du plan POLMAR Mer et des exercices coordonnés POLMAR Mer-POLMAR Terre prévus par la circulaire.
M. le Rapporteur : Il devrait y avoir une mémoire des éléments de ce type centralisée au ministère de l'intérieur.
Mme Elisabeth BORNE : C'est le cas pour tous les plans d'urgence, mais pas pour l'opérationnel. Il important de faire des circulaires, indiquant qu'il convient de réviser régulièrement les plans, mais il faut que cela soit fait. Qui cependant se sent en charge d'aller dire « montrez-moi vos plans POLMAR Terre ou POLMAR Mer actualisés » ? Qui se sent en charge de déclencher le renouvellement du matériel POLMAR Terre ? Qui se sent en charge de dire que cela fait trop longtemps qu'il n'y a pas eu d'exercices communs ? Il y a sans aucun doute des choses à améliorer dans toute cette préparation opérationnelle.
Mme Bettina LAVILLE : J'ajouterai deux éléments. Tout d'abord, la prise en compte du risque. Il y a d'ailleurs eu une communication à ce sujet lors de la journée du 28 février, et une structure de coordination des risques a été créée auprès de la direction de la prévention et des pollutions du ministère de l'environnement qui est chargée, en plus, des risques naturels majeurs. Il s'agit là, en fait, de la vision « risque environnemental », puisque vous avez toutes les interrogations sur les risques sanitaires et le risque à long terme sur l'environnement, qui n'est peut-être pas assez présente dans toutes les instructions du ministère de l'intérieur.
La connaissance du sujet évolue et une actualisation est indispensable. Nous avons commencé à la faire en prenant cette décision au mois de février, et ce comité va certainement faire d'autres propositions.
Ensuite, de nombreux propos ont été tenus par des responsables politiques sur une structure politique de gestion des risques. Le Gouvernement a décidé de s'en tenir là, puisque les dispositifs de coordination existent, mais il est certain qu'au ministère de l'environnement - et c'est d'ailleurs le sens de la réforme présentée en conseil des ministres la semaine dernière -, il y a un besoin de renforcement considérable des moyens, tout simplement parce que cette structure « risques naturels et technologiques majeurs » se trouve au sein d'une direction qui, elle-même, a des charges de plus en plus importantes, étant donné qu'elle est l'organe de contrôle des déchets, de tout ce qui est technologique, etc.
Il y a donc un besoin de renforcement et de « réidentification » du directeur de la prévention et de la pollution avec son rôle de coordonnateur de la prévention contre les risques.
M. le Rapporteur : Cela complique le dispositif entre ce personnage renforcé et les autres partenaires de l'intervention.
Mme Bettina LAVILLE : Ca ne le complique pas, ça l'actualise par rapport à la réalité de sites actuels où les catastrophes environnementales risquent d'être de plus en plus importantes. On ne peut pas, aujourd'hui, avoir un dispositif uniquement sécurité, protection civile au sens strict du terme. La protection civile s'est adaptée à ces risques environnementaux, mais elle doit être en relation avec les experts et les spécialistes. Or ces derniers se trouvent au ministère de l'environnement.
Mme Voynet a souvent dit, et très justement, que les Français la rendaient responsable de l'évaluation des risques et des secours sur la pollution, alors que, finalement, sur le plan des textes, elle avait une responsabilité extraordinairement limitée ; ce sont le ministre de l'intérieur, le secrétariat à la mer et le préfet maritime qui détiennent l'ensemble des responsabilités. Mais il est vrai que lorsque l'environnement est atteint, les citoyens considèrent qu'il en va de la responsabilité du ministre de l'environnement ; or tous les moyens sont à la disposition réglementaire des autres !
Il s'agit là d'un sujet de société fondamental qui est la cause principale du malentendu politique entre l'opinion publique et le ministre de l'environnement.
Entretien du rapporteur avec M. Jean-Paul PROUST,
directeur de cabinet de M. Jean-Pierre CHEVENEMENT,
ministre de l'Intérieur
(extrait du procès-verbal de la séance du 31 mai 2000)
M. Jean-Paul Proust est introduit.
M. le Président lui rappelle que les dispositions législatives relatives aux commissions d'enquête lui ont été communiquées. A l'invitation du Président, M. Jean-Paul Proust prête serment.
M. le Rapporteur : Cette audition a surtout pour objet de définir le rôle du ministère de l'Intérieur dans la mise en _uvre du plan POLMAR terre lors de l'accident de l'Erika, de voir avec vous la manière, d'une part dont s'est appliquée l'instruction du 17 décembre 1997 du Premier ministre, d'autre part dont vous avez pu apprécier les relations entre POLMAR terre et POLMAR mer, et de connaître éventuellement les dispositions que vous pensez utiles de prendre pour éviter un certain nombre d'inconvénients qui ont pu alors se manifester.
Je vous donne la parole pour un exposé liminaire. Je reviendrai sur un certain nombre d'interrogations que je peux avoir à ce niveau de l'enquête
M. Jean-Paul PROUST : Je ferai une très brève introduction compte tenu du fait que je suis plutôt là pour répondre à vos questions. En outre, comme vous avez entendu de nombreuses personnes et que vous savez déjà beaucoup de choses, elle sera plutôt plus formelle.
Je dirai simplement que le ministère de l'Intérieur a en charge la sécurité civile et la sécurité publique et qu'à ce titre, il est responsable de la sécurité civile sur le territoire à l'exception de sa partie maritime.
Pour exercer cette responsabilité, il dispose de la Direction de la défense et de la sécurité civiles et des préfets qui ont une responsabilité directe puisque ce sont les préfets de département - nous serons certainement amenés à dire ensuite un mot de la zone - qui ont, sur le terrain, la responsabilité de la mise en _uvre des secours et notamment, s'agissant des plans POLMAR, celle de la mise en _uvre de POLMAR terre.
Cela étant précisé, je rappellerai simplement que lorsqu'est survenu le naufrage de l'Erika, le 12 décembre, la sécurité civile en a été informée, comme c'est normal, par le préfet maritime : je m'en souviens très bien puisque l'on m'a moi-même alerté estimant, à juste titre, que cette information devait rapidement remonter. J'ai donc été alerté le jour même par la sécurité civile qui est dotée d'une écoute permanente à travers la COAD, la cellule opérationnelle permanente d'écoute, d'intervention et de coordination.
L'information était, à cette date, une information brute de décoffrage puisqu'elle faisait état d'un accident survenu à ce pétrolier et de risques, qui n'étaient pas considérés comme immédiats, de pollution par hydrocarbures.
A partir de là - je vous dirai ensuite ce qui me semble pouvoir être amélioré au niveau du dispositif - une liaison très régulière, quotidienne et permanente a été établie entre la COAD et la préfecture maritime pour suivre l'évolution du risque.
Je passe très vite sur les détails pour ne pas perdre trop de temps en précisant néanmoins que l'on nous a indiqué, à ce moment-là, via la préfecture maritime et la météo, que le risque était ciblé, comme on l'a pensé durant très longtemps, sur l'île d'Yeu qui était considérée comme le centre de gravité vers lequel devaient se diriger les nappes.
D'après les informations qui nous ont été communiquées très rapidement à partir du 15 décembre, étaient essentiellement menacées les zones comprises dans un triangle qui allait au nord au maximum jusqu'à Noirmoutier et qui touchait une partie du département de la Gironde : vous imaginez bien ce triangle allant du nord Gironde au sud de la Vendée et dont le point central était l'île d'Yeu.
A partir de ce moment-là, ayant à charge de coordonner le dispositif, nous avons, évidemment à titre préventif à ce stade, mobilisé les moyens de lutte contre la pollution à terre. Ces derniers se composaient notamment de tout le matériel qui pouvait se trouver stocké ici ou là en matière de tuyaux- barrages ou autres et d'autre part, évidemment des moyens humains à commencer par les nôtres, c'est-à-dire les unités de la sécurité civile.
Au vu de toutes les informations prévisionnelles qui nous étaient communiquées, ils ont été en grande partie positionnés sur le triangle auquel je faisais allusion.
Quand la menace s'est faite plus imminente, le Préfet de Charente-Maritime a été désigné comme coordonnateur dès le 17 décembre. Pourquoi lui ? Tout simplement parce que, dans le cadre de ce triangle, il était au centre du dispositif qui devait concerner trois départements : d'abord, la Charente-Maritime et ensuite, accessoirement, le sud de la Vendée et le nord de la Gironde. Son rôle de coordination consistait à répartir les moyens : il s'était livré d'ailleurs à des exercices et ses équipes avaient déjà posé des protections en de nombreux endroits de son département.
On ne nous jamais annoncé - je n'accuse personne en le disant mais je me borne à constater une faille de nature technique dans le dispositif - qu'il y avait modification de la cible et de la progression des nappes. Je peux le dire de manière certaine : c'est tellement vrai que je me rappelle que le 23 décembre très précisément nous avons été informés, toujours via la sécurité civile mais, cette fois, par l'intermédiaire des préfets que des traces de pollution avaient été observées dans le Finistère sud. C'est une information qui, évidemment, nous a fait dresser les cheveux sur la tête puisqu'elle ne correspondait pas du tout aux estimations précédentes.
M. le Rapporteur : C'était le 23 décembre ?
M. Jean-Paul PROUST : Il me semble mais je ne saurais pas dire si c'était le 23 décembre au soir.
En revanche, je me souviens parfaitement de la journée du 24 décembre en raison des fêtes de Noël : je me rappelle nettement avoir eu de très nombreuses conversations dans la nuit de Noël avec les préfets locaux et la sécurité civile. C'est à ce moment-là, alors que l'on prétendait que le pétrole découvert dans le Finistère n'était pas dû à l'Erika, que nous sont parvenus les premiers résultats d'analyses qui laissaient à penser, certes sans certitude, qu'il pouvait en être autrement...
C'est ce qui nous a conduits, un peu dans la précipitation, mais cela dès le 24 décembre, a essayer de redéployer le plus vite possible les moyens en hommes et en matériel dont nous disposions et d'en mobiliser de nouveaux. Je m'en souviens d'autant mieux qu'un avis de mauvais temps, qui s'est matérialisé ensuite par la fameuse tempête de décembre, avait été lancé et qu'avec le préfet du Morbihan nous tentions l'impossible pour parvenir à faire passer à Belle-Ile et Groix, îles qui se trouvaient menacées, une compagnie de sécurité civile.
M. le Rapporteur : Le 24 décembre en fin d'après-midi ?
M. Jean-Paul PROUST : Oui et c'est alors que nous avons entrepris de redéployer nos moyens un peu dans la précipitation, la situation étant aggravée par l'avis de tempête. Cette circonstance n'arrangeait vraiment rien puisque les tempêtes rendent inopérants tous les barrages et autres matériels de protection disposés avant la plage...
Encore une fois, je n'accuse personne mais je constate qu'il y a eu un problème de non-prévision technique, scientifique, puisque c'est vraiment en les voyant arriver que nous avons été informés de la destination des nappes.
Cette imprécision explique que l'on ait déclenché, d'une part le plan POLMAR terre d'abord en Charente-Maritime, puis en Vendée où les nappes étaient attendues et d'autre part le plan POLMAR terre le 25 ou le 26 décembre sur les départements bretons.
M. le Rapporteur : Il a été déclenché, pour le département du Morbihan, dans l'après-midi du 24 décembre...
M. Jean-Paul PROUST : En effet, car là-bas les préfets, informés du risque par l'arrivée des premières boulettes de fioul qui ont été suivies dans la nuit de Noël de nappes plus importantes, ont agi tout de suite !
C'est le 25 décembre au matin que l'on a mesuré l'ampleur des dégâts !
Nous avons donc redéployé rapidement le dispositif : je crois pourvoir dire que nous avons agi, aussi bien pour les unités de la sécurité civile que pour les moyens militaires ou matériels, le plus vite possible de manière à les répartir au mieux.
A cela est venu s'ajouter, le soir du 26 décembre avec la grande tempête dévastatrice, un handicap supplémentaire dans la mesure où ce sont, bien entendu, les mêmes moyens qui interviennent dans le plan POLMAR et dans le cadre des secours à apporter aux victimes en cas de tempête.
Nous avons donc dû faire face à deux catastrophes cumulées ce qui a posé - et je parle en qualité de fonctionnaire du ministère de l'Intérieur - la question des arbitrages inévitables dans ces cas-là des moyens à répartir : ceux qu'il était possible d'affecter au plan POLMAR et ceux, surtout humains, qu'il était possible de mobiliser pour pallier les méfaits la tempête.
Parallèlement le 28 décembre, nous avons évidemment reconfié la coordination du dispositif, suite à sa remontée vers le nord, au préfet de zone de défense ouest !
M. le Rapporteur : Avant de revenir sur ce qu'il conviendrait de changer, avez-vous le sentiment que, dans la préparation du plan POLMAR terre côté Noirmoutier/Ile d'Yeu
- mais la même chose vaut pour les actions suivantes - vous aviez suffisamment de moyens techniques ?
C'est la sécurité civile qui faisait appel aux dispositifs antipollution existants : avez-vous senti sur le plan technique que, dans certains cas, les plans POLMAR n'avaient pas été révisés depuis longtemps ?
M. Jean-Paul PROUST : Non, je n'ai pas senti cela ! De toute façon un plan d'intervention c'est essentiellement - et, heureusement, cela était quand même à jour - l'inventaire de tous les moyens susceptibles d'être mis en _uvre et des moyens de les acheminer, assortis des bons numéros de téléphone et de fax... C'est essentiellement cela car le mode d'emploi revient à la Direction des secours, étant entendu que deux marées noires ne se ressemblent pas : nous en avons, encore une fois, eu la preuve.
Ce qui est primordial, c'est que ceux à qui incombe la responsabilité des secours ne perdent pas du temps et puissent, dans les meilleurs délais, mobiliser tout ce qui est mobilisable : à cet égard, je n'ai pas perçu dans la rédaction de POLMAR - où j'ai noté des failles que je signalerai plus tard - de dysfonctionnements.
Bien sûr, les plans doivent être à jour et il faudrait demander à chaque préfet si son plan l'était mais je ne crois pas que ce soit là un problème...`
M. le Rapporteur : Ils n'étaient pas tous à jour ! Certains n'avaient pas été répétés ni révisés depuis plusieurs années mais ce n'était pas le cas partout !
M. Jean-Paul PROUST : Ils n'étaient peut-être pas tous à jour...
Pour ma part, très honnêtement, hormis cet effet de surprise infiniment regrettable, j'estime qu'après l'arrivée du pétrole, les préfets ont mis en _uvre avec tous les moyens locaux et en bonne liaison avec les collectivités, le maximum de moyens disponibles et qu'ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire.
Cela étant, force est de reconnaître qu'une fois le pétrole en vue - et ce n'est pas au député du Morbihan que je vais l'apprendre - on n'a pas, surtout si les conditions météorologiques sont défavorables comme c'était le cas, les moyens techniques de l'empêcher de s'échouer, étant précisé qu'il va de soi que je ne parle que de la partie POLMAR terre et non pas de ce qui peut se faire en amont.
En cas de tempête, les tuyaux s'avèrent inopérants et une grande marée pousse la nappe très haut, or il faut bien avouer que toutes les conditions métrologiques étaient défavorables.
M. le Rapporteur : Quelles sont les failles auxquelles vous avez fait allusion ?
M. Jean-Paul PROUST : La faille principale réside dans l'imprévision du phénomène mais on peut essayer de trouver des solutions pour éviter qu'elle ne se reproduise.
M. le Rapporteur : C'est-à-dire ?
M. Jean-Paul PROUST : Des mesures ont déjà été prises qui vont dans ce sens et je vais vous livrer mon sentiment mais ce n'est que mon sentiment...
Je considère que la zone de défense ouest n'est, comme beaucoup d'autres, pas suffisamment équipée pour jouer pleinement son rôle. Elle est dotée de moyens de coordination insuffisants mais je dirai que c'est le cas de toutes les zones de défense de création récente, exception faite, d'une part de la zone sud-est qui, pour des raisons historiques avec les feux de forêts, bénéficie d'une organisation opérationnelle très puissante, et d'autre part de l'Ile-de-France où se trouve la préfecture de police.
Vous me permettrez donc de décrire comment les choses se passent, y compris au niveau de la météorologie dans la zone de défense sud-est où le système opérationnel de Valabre est très au point : la météorologie a, au sein du centre opérationnel, ses propres installations et ses propres prévisionnistes qui sont évidemment en liaison permanente avec les centres météo.
Ces prévisionnistes mandatés au centre reçoivent, sur terminal, toutes les informations utiles et travaillent dans la salle du centre opérationnel en collaboration avec les pompiers et les autres experts ce qui permet de dresser tous les jours une carte des risques pour le lendemain...
L'organisation est très performante, car, en fonction de cette carte prévisionnelle, les avions et tous les moyens humains et matériels terrestres sont déployés de manière à être les plus efficaces possible, sachant que c'est à tel endroit que le mistral va souffler le plus fort etc. Ce sont là des prévisions fiables à 98 %.
En conséquence, si je fais le rapprochement, j'ai tendance à dire que l'on pourrait s'inspirer de ce dispositif et qu'il n'y a pas de raison majeure qui s'oppose à ce qu'on ait, un jour, un système scientifique aussi performant sur les courants et les vents de mer que sur le mistral et les vents de terre.
Dans le cas du sud-est, la coordination s'effectue en temps réel et si je n'ai pris que l'exemple de la météo, il faut savoir que tous les grands services publics sont également présents et coordonnés en temps réel sous l'autorité du préfet de zone, étant précisé que les moyens militaires le sont aussi grâce à la liaison permanente assurée par les officiers de liaison entre les deux états-majors : l'état-major du général commandant la circonscription zone défense et le CIRCOSC - Centre interrégional de coordination des opérations de sécurité civile - de Valabre qui est l'état-major du préfet de zone.
J'ajoute que ce qui est vrai pour les incendies l'est aussi pour les avalanches. Je peux me montrer assez précis sur ce sujet pour avoir été préfet des Bouches-du-Rhône et vous assurer que lorsqu'une avalanche se produit dans les Hautes-Alpes comme ce fut le cas lors des malheureux accidents des Ors...
M. le Rapporteur : C'est cette organisation qui joue son rôle ?
M. Jean-Paul PROUST :...la direction des secours est assurée par le préfet de département mais c'est l'organisme support qui envoie tous les moyens. Or; dans les dix minutes qui suivent l'information, les premiers hélicoptères décollent de n'importe quel point de la zone... En cas d'avalanche les chasseurs alpins se mobilisent avant même que je ne sois informé parce qu'ils ont pris l'habitude de travailler en temps réel...
M. le Rapporteur : Au CIRCOSC de Valabre ?
M. Jean-Paul PROUST : Exactement !
Si je me suis permis cette digression c'est parce que cette organisation constitue pour moi la référence de l'outil permettant une coordination des secours...
M. le Rapporteur : Oui, c'est intéressant !
M. Jean-Paul PROUST : Cela m'amène à dire un mot sur la liaison entre les plans POLMAR mer et POLMAR terre.
Je crois qu'ils s'articulent autour de gens qui s'entendent bien et qui font preuve de bonne volonté mais qui n'ont pas, en amont, une structure organisée en permanence pour leur permettre de fonctionner ensemble.
A l'inverse, dans le cas précité, le général commandant gouverneur de Marseille et commandant de la zone de défense militaire et le préfet ont chacun leur état-major opérationnel mais avec des liaisons radio et autres et également des officiers de liaison : j'avais, quand j'étais préfet à Marseille, un homme qui était le correspondant de l'état-major militaire, en permanence au CIRCOSC.
M. le Rapporteur : Théoriquement, cela devrait être également le cas pour les plans POLMAR...
M. Jean-Paul PROUST : Oui, mais à Valabre ils sont tellement habitués à travailler en temps réel en permanence qu'en cas d'avalanche dans les Alpes, il ne faut pas plus de dix minutes pour que les hélicoptères militaires soient mis à la disposition du préfet civil des Hautes-Alpes.
M. le Rapporteur : A ce moment-là, ils sont mandatés par le CIRCOSC de Valabre ?
M. Jean-Paul PROUST : C'est lui qui assure, à l'arrière, ce travail de coordination des moyens !
Pour ce qui nous concerne, nous avons déjà tiré des conséquences de ce qui s'est produit en décembre puisque nous avons estimé qu'il y avait trop de zones de défense et qu'elles n'étaient pas forcément bien équipées...
Cette constatation a déjà amené le Conseil de défense à faire passer, par un décret qui va sortir dans quelques jours, le nombre de zones défense de neuf à sept.
Nous étions en effet dans une mauvaise configuration géographique puisque théoriquement la zone défense pour la Charente-Maritime était Orléans où l'on ne dispose pas du moindre équipement, ni de la moindre liaison avec le préfet maritime ! On supprime donc les zones défense d'Orléans et de Dijon.
Comme, de surcroît, nous pensons qu'une zone défense doit s'appuyer sur une région relativement puissante et dotée de moyens suffisamment significatifs, nous conservons les sept zones défense suivantes : Paris, Lille, Rennes, Bordeaux, Marseille, Lyon et Metz. Nous avons également procédé à des redécoupages puisque le Limousin et la Charente vont être rattachés à Bordeaux et la partie nord à Rennes.
Si les catastrophes de décembre s'étaient produites dans ce cas de figure, seules deux zones défense auraient été concernées mais elles auraient eu au moins l'habitude de travailler avec la marine puisque ce sont deux zones défense du littoral atlantique, à savoir Rennes et Bordeaux.
J'en profite pour ajouter qu'en Méditerranée le dispositif qui a été le moins bien couvert par le CIRCOSC de Valabre était le système POLMAR ou secours en mer dans la mesure où il n'existait pas avec la marine cette liaison qui était entretenue avec l'armée de terre : il n'y avait, par exemple, pas de marin de permanence...
C'est vrai qu'il faut donc rapprocher, selon moi, les états-majors des préfets de zone et des préfets maritimes. Personnellement, je considère, dès qu'il y a déclenchement de POLMAR mer, qu'un officier responsable de haut niveau devrait être dans la zone défense terre pour participer et aider à la préparation de POLMAR terre.
Le problème est aussi de nature matérielle parce que, pour que fonctionne le système tel que je l'ai décrit, il faut disposer d'un lieu hyperéquipé : c'est bien gentil de faire venir un officier de marine mais encore faut-il lui offrir véritablement tous les moyens de liaison modernes au sein d'une structure opérationnelle...
M. le Rapporteur : Et cela n'existe pas ?
M. Jean-Paul PROUST : Cela n'existe pas à Rennes ou seulement à l'état embryonnaire...
M. le Rapporteur : Cela n'existe pas du tout à Rennes !
M. Jean-Paul PROUST : C'est bien pourquoi notre première décision, qui est de ramener les zones défense à un nombre inférieur vise, non seulement à les faire correspondre à un territoire cohérent mais aussi à disposer de moyens financiers parce que budgétairement, cela va coûter cher !
Si nous voulons une organisation qui fonctionne, il faut prévoir une structure du type CIRCOSC de Valabre...
M. le Rapporteur : En Bretagne ?
M. Jean-Paul PROUST : Pour l'Ouest à Rennes, pour le Sud-ouest à Bordeaux, pour le Nord à Lille, pour l'Est à Metz et pour la région Rhône-Alpes à Lyon. Avec de telles structures, nous serons quand même beaucoup mieux préparés à gérer les crises mais cela suppose un équipement sophistiqué, une veille et une autre exigence qui est la suivante : cet état-major de crise doit absolument assumer des missions permanentes faute de quoi il aura des périodes d'inertie et ne pourra jamais bien fonctionner.
Nous avons donc pour objectif de confier à la zone défense toute une série de missions permanentes d'où la discussion qui s'instaure actuellement sur une éventuelle fusion des CRIR pour la régulation routière et les zones défense.
En effet, à partir du moment où existent un outil perfectionné et une veille permanente d'écoute sous le commandement d'un officier de gendarmerie, autant qu'ils soient affectés tous les week-ends à la sécurité routière quand ils ne sont pas réquisitionnés pour POLMAR...
Ce système outre un officier de gendarme, pourra faire intervenir des pompiers, des officiers de liaison, étant entendu que ces derniers se verront confier de multiples activités...
Au nombre d'entre elles on peut penser à la régulation routière mais aussi aux actions de déconcentration que l'on souhaite conduire, notamment en matière de la sécurité publique, de façon à ce qu'en cas de manifestation, par exemple, Rennes puisse prendre la décision d'envoyer des renforts dans le Morbihan...
Dans notre esprit, si les départements en sont d'accord mais à mon avis, ils ne peuvent que l'être parce que ce serait une source importante d'économies, il faudrait parvenir à mettre sur pied au niveau zonal, avec les moyens des départements concernés, une organisation des sapeurs-pompiers qui dispenserait d'avoir une cellule d'intervention chimique et radiologique par département mais permettrait, pour certains types de catastrophes graves, de préparer la mise en commun de tous les moyens humains et matériels. Il y a largement de quoi occuper à plein temps un pompier en lui confiant l'organisation, à partir des corps les plus importants de Bretagne, de colonnes d'intervention civiles bretonnes qui, comme les UIISC - Unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile -, pourraient entrer en action au premier coup de sifflet pour faire face aux catastrophes !
Je veux dire par là qu'il faut avoir une équipe de gens de haut niveau qui aient en permanence des responsabilités mais qui soient susceptibles de se mobiliser de façon opérationnelle quand le besoin s'en fait sentir, y compris au niveau de la régulation interhospitalière en cas de crise.
M. le Rapporteur : Dans l'hypothèse où ce dispositif se mettrait en place, cela signifierait que l'outil serait similaire à celui du préfet maritime, donc que l'on aurait deux dispositifs : un état-major POLMAR mer à Brest qui, lui, a vocation à couvrir la zone allant de l'Espagne au Cotentin et qui regroupe des représentants des différentes administrations, - y compris également la météo ce qui n'était pas le cas antérieurement...
M. Jean-Paul PROUST : Il faudrait voir si la météo doit intégrer les deux systèmes: quoi qu'il en soit il faut qu'elle serve les deux puisque des liaisons sont prévues...
M. le Rapporteur : ...et l'autre dispositif avec une relation permanente...
M. Jean-Paul PROUST : Non seulement une relation permanente à travers des officiers de liaison mais également des exercices permanents et de véritables états-major mixtes dès que le plan POLMAR mer est activé.
Il faut que la Marine dispose d'une salle à Rennes et qu'elle y soit pré-positionnée avec tous les moyens de liaison utiles. Le système ne se limite pas au détachement d'un homme...
Sans avoir une unité de lieu il faut, d'une part que, de Brest, on puisse envoyer à l'officier en poste à Rennes auprès du préfet de zone toutes les informations en temps réel, d'autre part que l'officier concerné soit en mesure de les gérer.
Aujourd'hui nous devons avoir recours aux moyens qui existent mais c'est le genre d'endroit où le système de vidéo-conférence trouverait sa pleine efficacité et serait tout à fait indiqué: on peut imaginer des réunions communes entre Rennes et Brest par vidéo-conférences...
M. le Rapporteur : Et, dans une telle configuration qui, selon vous, gérerait les moyens POLMAR terre?
M. Jean-Paul PROUST : D'après moi, cette cellule, placée sous l'autorité du préfet de zone de défense, serait une cellule de coordination, de répartition et d'affectation des moyens mais elle n'aurait pas vocation à diriger les secours. En ce domaine, elle n'interférerait pas sur l'action de terrain du préfet dans le cadre classique départemental. Elle ne commanderait pas sur le terrain.
Son rôle se limiterait à évaluer les moyens, à les répartir en fonction de priorités, à faire remonter les besoins, mais aussi des synthèses, au niveau parisien par le biais de la sécurité civile pour pallier les manques, à charge pour la sécurité civile à Paris de mobiliser, au niveau national, voire international, les moyens réclamés.
M. le Rapporteur : Ce qui est frappant dans POLMAR mer, c'est que le préfet maritime n'a ses fonctions qu'en période de crise. Le reste du temps, les administrations telles que les douanes, ou la gendarmerie maritime peuvent décider d'acheter tel équipement sans tenir compte des acquisitions des autres...
Il faut donc que le préfet maritime, coordinateur, soit aussi régulateur des moyens techniques qui seront sous sa responsabilité en période de crise. Cela suppose qu'il puisse avoir une mission de caractérisation des matériels dont les administrations sous ses ordres pourraient avoir besoin, de manière à assurer une cohérence. Cela pourrait aller jusqu'au constat que puisqu'il manque tant de boudins pour faire barrage au fioul ou tant de cribleuses, il conviendrait d'en acheter...
M. Jean-Paul PROUST : ...qu'il conviendrait d'en acheter ou de demander à Paris d'en envoyer ou d'aller en chercher, comme cela a été le cas pour les milliers de groupes électrogènes qui sont venus de l'étranger après la tempête...
Si on manque de boudins, allons les chercher à Rotterdam, à Amsterdam ou achetons-en ! Cela renvoie à la prévention. Elle relèverait de la même structure qui l'assumerait de façon intelligente au niveau national, car il faut qu'une régulation nationale permette d'utiliser les matériels du Nord-Pas-de-Calais en Bretagne si besoin est, et réciproquement.
M. le Rapporteur : Cela signifie que vous allez proposer une modification de la circulaire de 1997 ?
M. Jean-Paul PROUST : Nous allons même - et je ne dis pas cela pour que vous nous aidiez quand bien même il serait bon que vous puissiez le faire - dans les mesures nouvelles, soumettre une demande pour équiper deux zones défense en 2001.
En effet, sur les sept zones, comme je vous le disais tout à l'heure deux zones
- celles de Paris et Marseille - sont déjà équipées, et nous voudrions - ce qui sans ruiner l'Etat coûte quand même assez cher - pouvoir équiper deux zones par an, tant en moyens qu'en personnels, et redéfinir leur rôle exact.
M. le Rapporteur : Vous voulez donc modifier la circulaire ?
M. Jean-Paul PROUST : Outre la modification de la circulaire, nous prévoyons la promulgation de décrets, car il convient de doter le préfet de zone d'une véritable autorité, notamment par rapport au préfet de département.
Les plans neige qui sont en vigueur dans la vallée du Rhône sont sous l'autorité d'une seule autorité de commandement car il ne s'agit pas que l'un s'amuse à dire qu'il ferme une bretelle d'autoroute quand l'autre décide de la rouvrir... En cas de chutes de neige catastrophiques, il faut que des décisions soient prises de manière cohérente pour toute la vallée du Rhône.
M. le Rapporteur : A la question que nous nous posions de l'unité d'action POLMAR mer/POLMAR terre, vous répondez qu'il faut créer, un peu sur le modèle de ce qui existe pour le préfet maritime, une unité centralisatrice de sécurité par zone qui fonctionne en articulation directe avec POLMAR mer ?
M. Jean-Paul PROUST : Oui mais en articulation réelle...
M. le Rapporteur : Et qui dirige l'articulation comme outil de connexion alors que dans la circulaire c'est au ministre de l'Intérieur qu'il appartient de diriger l'articulation POLMAR mer/ POLMAR terre ?
M. Jean-Paul PROUST : Oui au niveau central et interministériel, mais je crois que la connexion doit être locale et je répète que cela ne vaut pas que pour POLMAR. Pour rester dans le domaine maritime, pensons, dans la mesure où cela intéresse et le préfet maritime et le préfet terrestre, à l'organisation du secours en mer en cas de grosse catastrophe comme, par exemple, une unité à grande vitesse qui se crashe avec 700 ou 800 passagers.
M. le Rapporteur : Dans ce cas, qui est responsable des secours ?
M. Jean-Paul PROUST : C'est le préfet maritime qui est responsable du secours en mer
- il n'y a aucun problème là-dessus - mais il ne va pouvoir agir que s'il travaille en collaboration avec les préfets terrestres : si vous avez des centaines de blessés, il faut en organiser l'accueil ce qui relève d'une action à terre. Les marins iront chercher les blessés mais on va demander aussi que les blessés soient répartis par hélicoptère dans les différents centres hospitaliers.
M. le Président : L'hypothèse la plus spectaculaire étant celle du pétrolier important qui percute, au c_ur de l'été et en pleine tempête, un ferry rempli de passagers...
M. Jean-Paul PROUST : En matière de scénario catastrophe, on peut ajouter un incendie...
M. le Rapporteur : Mais c'est possible !
M. Jean-Paul PROUST : Ce n'est, effectivement pas, une hypothèse complètement folle...
Quand je voyais partir les navires à grande vitesse, les NVG, qui assurent les liaisons avec la Corse, je me disais parfois qu'en cas de problème la catastrophe serait sérieuse, y compris en termes d'organisation des secours...
C'est pourquoi il y a une nécessité absolue de créer une structure adaptée qui servirait non pas uniquement en cas de déclenchement du plan POLMAR, mais aussi en maintes autres circonstances.
M. le Président : Vous ferez valoir ces préoccupations dans le cadre du prochain Comité interministériel de la mer ?
M. Jean-Paul PROUST : Oui, les grandes lignes de la réforme ont été proposées par le ministre de l'Intérieur et décidées lors du comité interministériel de la mer du 28 février et lors du conseil de défense du 30 mars, mais je crois que le problème tient à la bonne articulation civilo-militaire qui, par tradition, fonctionne très bien avec l'armée de terre et un peu plus difficilement avec la marine - ce n'est pas une accusation mais un constat. Il faut bien admettre qu'il est plus rare que la marine travaille avec des civils que l'armée de terre qui, par définition, y est parfaitement habituée.
M. le Rapporteur : Sauf sur POLMAR mer où elle travaille avec des administrations paramilitaires...
M. Jean-Paul PROUST : Oui... De toute façon, on doit pouvoir y parvenir ! Avec les militaires de l'armée de terre, les croisements d'états-majors fonctionnent très bien ! Je ne vois pas pourquoi il n'en serait pas de même avec la marine. Si, dans une zone de défense, un général qui a des missions militaires, se voit de temps en temps, en cas de catastrophe, confier des missions civiles, l'état-major ne change pas.
M. le Rapporteur : Sauf que c'est parce qu'il est préfet maritime que le préfet a autorité sur la gendarmerie maritime...
M. Jean-Paul PROUST : Je veux simplement dire par là que l'armée de terre met ses moyens spécifiques à disposition en cas de catastrophe, alors que la marine donne parfois l'impression que seul le préfet est entouré d'un petit staff, mais que la marine est faite pour la guerre.
Quand on y réfléchit bien, les chasseurs alpins ont aussi pour vocation de faire la guerre, les hélicoptères de l'armée de terre sont destinés au même but et il n'empêche que c'est la même organisation sophistiquée, conçue pour la guerre, qui, en cas de catastrophe, se met en place pour donner un coup de main très efficace...
M. le Rapporteur : Vous seriez donc favorable à la suppression de ce régime particulier dont jouit le préfet maritime ?
M. Jean-Paul PROUST : Non, je suis favorable à ce qu'il ait de très grandes responsabilités dans la marine.
M. le Rapporteur : Mais c'est le cas ?
M. Jean-Paul PROUST : C'est le cas mais il ne doit pas y avoir deux chapeaux : il est entendu que je me prononce sous réserve, car cela relève d'un domaine qui n'est pas le mien et que je ne prétends pas connaître...
M. le Rapporteur : Ce qui m'a beaucoup frappé à Brest où nous avons suivi une réunion hebdomadaire du préfet maritime, c'est qu'il avait des informations civiles et militaires et que les différents membres de son état -major, aussi bien civils que militaires, étaient amenés à intervenir. Cela étant, si je vois très bien la nature du dispositif à mettre en place au niveau de Rennes, je pense qu'il faut aussi agir au niveau de Brest. En effet, les locaux où est appelé à travailler le préfet maritime quand il est préfet maritime en situation de crise sont dans un état invraisemblable...
M. Jean-Paul PROUST : Il faut aussi peut-être prévoir des cellules techniques. Bien entendu, il faudra toutes les regrouper. On m'a dit que, sur les événements de décembre, certaines personnes du CEDRE savaient des choses mais n'ont rien osé dire, parce que cela ne correspondait pas aux déclarations de la météo... Là-dessus, je ne me prononcerai pas mais ce que je sais c'est qu'il faut mettre des experts ensemble quelque part. En l'occurrence, je pense qu'ils auraient dû être, non pas à Toulouse, mais à Brest en liaison directe et permanente avec Rennes...
M. le Rapporteur : Vous parlez de la météo ?
M. Jean-Paul PROUST : Oui mais pas que de la météo, je parle aussi de tous ceux qui, comme les membres de l'IFREMER peuvent avoir des choses à dire...
M. le Rapporteur : Il y a une grande interrogation sur l'erreur météorologique...
M. Jean-Paul PROUST : Oui, il y a une grande interrogation...
M. le Rapporteur : Soit c'est l'erreur du siècle, soit il y a d'autres raisons...
M. Jean-Paul PROUST : Je n'y connais rien donc je ne dirai rien sinon que, pour moi, il y a une interrogation énorme. Je constate simplement qu'il y a eu une erreur considérable mais ce n'est qu'une constatation...
M. le Rapporteur : Nous éprouvons une très vive inquiétude quant aux risques, à terme, de pollution en Méditerranée. Qu'il n'y ait ni zone économique exclusive, ni relations sérieuses entre Etats comme celles que nous entretenons avec les Britanniques, sont autant de facteurs de préoccupation.
M. Jean-Paul PROUST : C'est une mer de tous les dangers, car on y dispose encore de moins de moyens que pour l'Atlantique, en tout cas au niveau juridique.
M. le Rapporteur : Curieusement on est parti d'un événement qui s'est déroulé dans l'océan Atlantique pour en arriver à cette conclusion que la Méditerranée est la mer de tous les dangers...
M. Jean-Paul PROUST : En revanche, c'est une zone où la marée noire serait plus facile à traiter à terre parce que même si le vent peut souffler, il y a moins de marées.
M. le Rapporteur : L'impact sur le tourisme serait désastreux et extrêmement spectaculaire !
M. Jean-Paul PROUST : Oui, le soir du festival de Cannes, par exemple... (Sourires.) Très sérieusement, il y a effectivement un risque assez considérable !
Audition de Mme Dominique VOYNET,
ministre de l'Aménagement du territoire et de l'environnement
(extrait du procès-verbal de la séance du 6 juin 2000)
Présidence de M. Daniel PAUL, Président
Mme Dominique Voynet est introduite.
M. le Président lui rappelle que les dispositions législatives relatives aux commissions d'enquête lui ont été communiquées. A l'invitation du Président, Mme Dominique Voynet prête serment.
Mme Dominique VOYNET : Mesdames et messieurs, le naufrage de l'Erika au large des côtes bretonnes le 11 décembre 1999 est venu tragiquement rappeler les risques environnementaux et économiques du transport maritime de substances polluantes. Les conséquences écologiques de cette marée noire ne sont pas encore connues avec précision et il faudra des années pour en avoir une vision complète. Le CIADT du 28 février dernier a d'ailleurs mandaté le ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement pour mettre en place un réseau de suivi de ces conséquences à long terme, et a prévu, à cette fin, la somme de 35 millions de francs, dont 10 millions de francs dès cette année. D'ores et déjà, on peut rappeler que plus de 60 000 oiseaux morts ont été récupérés sur notre littoral ce qui, compte tenu des oiseaux morts en mer sans qu'on les trouve, laisse supposer une mortalité totale se chiffrant en centaines de milliers, au détriment souvent d'espèces protégées et déjà menacées.
Les dégâts économiques ne sont pas connus non plus avec précision. Le premier préjudice a été celui subi par les activités de pêche à pied et de ramassage de coquillages, par la pêche en mer et l'activité conchylicole, ainsi que par la production de sel à Guérande et Noirmoutier. Le préjudice subi par ces acteurs économiques devrait être de l'ordre de 300 millions de francs. C'est toutefois l'atteinte à l'image du littoral concerné et les dommages au secteur touristique qui en découlent qui sont susceptibles de provoquer les pertes les plus importantes. Les chiffres les plus hétérogènes circulent sans qu'aucun ne soit sérieusement validé. Le Premier ministre a demandé à l'inspection des finances et au secrétariat d'Etat au tourisme de produire une estimation aussi fiable que possible avant la fin du mois. En tout état de cause, les conséquences seront lourdes et le littoral atlantique portera pour longtemps encore les stigmates de cette catastrophe.
Dès l'annonce du naufrage, le Gouvernement s'est mobilisé pour en pallier au mieux les conséquences. Je me suis rendue sur place, dès le 15 décembre en compagnie de Jean-Claude Gayssot, pour prendre connaissance du dispositif de lutte en mer. Les 25 et 26 décembre, j'étais sur les plages aux côtés des populations touchées par les premiers arrivages de fioul, ainsi que des milliers de militaires, fonctionnaires et bénévoles qui avaient entrepris de réparer les dégâts. J'y suis retournée à plusieurs reprises, et notamment le 15 janvier, où j'ai installé l'observatoire associatif des conséquences de la marée noire, et le 21 février.
Dans le détail, les responsabilités du ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement ont été les suivantes : gérer le fonds POLMAR qui finance l'effort de nettoyage, veiller à ce que ce nettoyage restaure autant que faire se peut la qualité écologique du littoral touché, et en tout cas ne la dégrade pas, s'assurer d'un traitement approprié des déchets.
Sur le premier point, mon département ministériel a mis en place dans des délais extrêmement brefs le fonds POLMAR qui permet de financer l'effort de nettoyage. Dès le 30 décembre, 30 millions de francs étaient délégués aux préfets concernés pour faire face aux dépenses d'urgence. Le fonds était porté à 120 millions de francs le 12 janvier, puis à 560 millions de francs par le CIADT du 28 février. Il est maintenant prévu de l'abonder de 360 millions de francs supplémentaires pour couvrir les nouveaux besoins signalés par les préfets, ce qui porterait l'effort de l'Etat à 920 millions de francs. La rapidité de la mise à disposition de ces crédits a permis de financer sans délai l'acquisition du matériel nécessaire ainsi que le recours à des entreprises notamment pour le transport des déchets.
En ce qui concerne les moyens humains, comme vous le savez, le ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement ne dispose pas en propre d'effectifs susceptibles de nettoyer les côtes et ce sont pour l'essentiel les ministères de la défense nationale et de l'intérieur qui ont accompli l'effort nécessaire, environ 2 000 personnes étant en permanence affectées au nettoyage. Pour compléter cet effort, le ministère de l'emploi et de la solidarité et le ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement ont décidé la création de 900 contrats à durée déterminée de 3 mois, financés par le fonds POLMAR. Enfin, des milliers de bénévoles sont venus participer à l'effort collectif. L'ampleur de cette mobilisation et de la solidarité nationale qu'elle exprime ont, je crois, apporté aux populations touchées un peu de réconfort dans cette épreuve, et je tiens à la saluer.
Le nettoyage du littoral n'est pas terminé pour autant, loin s'en faut. Dès le début de la marée noire, j'avais insisté sur le caractère particulier de celle-ci, dû notamment à l'éloignement du lieu du naufrage par rapport aux côtes. De ce fait, l'étendue du littoral touchée est très importante et les arrivages se font par petites quantités dispersées dans le temps ; une grande patience est et sera donc nécessaire avant que le littoral ne retrouve complètement son état antérieur. L'amertume de ceux qui nettoient et voient revenir sans cesse des pollutions est très compréhensible, mais il ne faut pas relâcher l'effort.
Bien entendu, il n'est pas question pour autant de nettoyer à n'importe quel prix. Le premier impératif a été, dès le début de la marée noire, d'assurer la sécurité des personnes. Les premiers arrivages ont coïncidé avec les tempêtes exceptionnelles qui ont causé de si gros dégâts dans notre pays. Il a donc fallu tout d'abord éviter que professionnels et bénévoles ne prennent des risques inconsidérés en nettoyant sur des rochers glissants menacés par les vagues.
Les impératifs de sécurité sanitaire ont également été immédiatement pris en compte. Le centre antipoison de Rennes, saisi par la DDASS du Morbihan, rendait ainsi le 21 décembre un avis sur les risques sanitaires liés au ramassage du pétrole et préconisait une stratégie de prévention. Ces recommandations m'ont été présentées à la cellule de crise de La Baule, lors de mon déplacement du 25 décembre. En parallèle, dès le 23 décembre, le CEDRE fournissait sur son site Internet, à la demande de mon ministère, des informations sur la nature du fioul. Ces informations ont été réactualisées régulièrement par la suite et accompagnées, dès le 3 janvier, de recommandations à l'intention des intervenants. Lorsque début février, à la suite d'informations diffusées par le laboratoire Analytika, une polémique a éclaté sur la nature du fioul, le ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement a saisi l'INERIS et un institut néerlandais indépendant, le RIVM, pour faire toute la clarté nécessaire sur la question. Leurs premières conclusions ont été remises le 15 février et leur rapport définitif les 7 et 8 mars ; immédiatement rendus publics, ils permettent de conclure que : le fioul déversé correspond bien à la définition du fioul numéro 2 ; de ce fait et comme tout hydrocarbure, il présente un caractère toxique et potentiellement cancérigène ; compte tenu des précautions prises, du port de vêtements de précaution, et surtout des faibles durées d'exposition, ce risque cancérigène peut être considéré comme négligeable.
Un suivi épidémiologique a été mis en place par l'Institut de veille sanitaire, avec notamment la distribution d'un questionnaire aux personnes ayant participé au nettoyage pour déceler le plus vite possible d'éventuelles menaces pour la santé publique.
Veiller à la sécurité sanitaire, c'est aussi assurer celle des touristes et des baigneurs. Le secrétariat d'Etat à la santé vient d'adresser dans cette optique une circulaire aux préfets leur proposant des critères précis pour autoriser ou non la fréquentation de chacune des plages touchées en fonction de son état.
En ce qui concerne plus directement les compétences du ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement, j'ai veillé à ce que les opérations de nettoyage ne se fassent pas au détriment de l'environnement et que la reconquête de la biodiversité soit au c_ur des préoccupations de chacun. Les DIREN ont ainsi fait réaliser une expertise systématique des sites à nettoyer pour déterminer les techniques les plus appropriées et les moins nocives pour le milieu ainsi que pour proposer des stratégies de réhabilitation progressive des milieux. Cent millions de francs ont été attribués dans cette optique lors du CIADT du 28 février, dont 40 millions de francs au bénéfice du Conservatoire du littoral, auxquels s'ajoutent 7,5 millions de francs attribués au ministère de l'équipement, des transports et du logement pour le rechargement des plages.
Les associations ont, de même, été aidées dans leur mobilisation exemplaire pour sauver ce qui pouvait l'être. Un observatoire associatif de la marée noire a été installé, avec l'aide de mon ministère. Les centres de soins aux oiseaux mazoutés se sont constitués en réseau sous la coordination de l'Union nationale des centres de soins assistée par l'école nationale vétérinaire de Nantes et le centre de l'Ile Grande ; 10 millions de francs ont été affectés à cette fin sur le fonds POLMAR.
En ce qui concerne les déchets, les sites de stockage intermédiaires où, dans l'urgence, des hydrocarbures avaient pu être entreposés dans les premiers jours du nettoyage, dans des conditions parfois contestables, sont progressivement remis en état selon les instructions de mes services. Je me suis moi-même rendue sur certains sites pour veiller à la bonne mise en _uvre de cette réhabilitation. Enfin, le stockage de longue durée et l'élimination définitive des déchets collectés s'opèrent sous la responsabilité de TotalFina Elf dans des conditions que j'ai souhaitées les plus transparentes possible pour éviter de reproduire les anomalies constatées à la suite du naufrage de l'Amoco-Cadiz. A ce jour, plus de 160 000 tonnes de déchets sont ainsi stockés ; leur élimination devrait prendre environ un an.
En ce qui concerne les trois responsabilités directes du ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement, la gestion du fonds POLMAR, le suivi et la réparation des dommages écologiques et le traitement des déchets, il me semble donc que ce qui devait être fait l'a été.
En matière de réparation, il reste un très gros chantier : le pompage des soutes de l'épave. Le Gouvernement a immédiatement considéré que la persistance de 15 à 20 000 tonnes de fioul au large de notre littoral ne pouvait être tolérée. Là aussi, c'est à TotalFina Elf d'assumer la responsabilité de ce pompage. Comme vous le savez, c'est mon collègue Jean-Claude Gayssot qui a été chargé de coordonner l'action de l'Etat sur ce chantier. Je peux cependant vous préciser que l'opérateur chargé de la réalisation des travaux a été choisi (il s'agit du consortium Coflexip/Stena/Stolt). Les matériels nécessaires arrivent actuellement à Brest ; les premières opérations devraient débuter ce mois-ci et durer jusqu'à l'automne. Je puis vous assurer de ma vigilance ainsi que de celle de mes services pour que l'ensemble des mesures nécessaires à prévenir des pollutions lors de ce chantier périlleux soient bien prises.
Réparer, c'est aussi indemniser les victimes. L'Etat a immédiatement mis en place un dispositif d'urgence en ce sens : le fonds POLMAR prend en charge les coûts de nettoyage engagés par l'Etat, les collectivités locales et les associations ; l'OFIMER paye une avance de 50 % des dégâts concernant les métiers de la mer, et la BDPME fait de même pour les autres acteurs économiques. Ce sont le ministère de l'agriculture et de la pêche et le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, qui assurent, au niveau gouvernemental, le suivi de ce dispositif.
Il serait toutefois choquant que ce soit aux contribuables français de supporter seuls les énormes coûts de cette catastrophe. Je suis très attachée au principe pollueur-payeur ; là comme ailleurs, il doit s'appliquer. Un dispositif d'indemnisation a été mis en place par convention internationale : il s'agit du FIPOL, abondé par les contributions des importateurs d'hydrocarbures. Je souhaite que ce fonds assume sa mission en assurant une indemnisation aussi rapide et complète que possible. Il est clair qu'actuellement, on est loin du compte.
Le FIPOL se réfugie derrière le plafond de 1,2 milliard de francs par sinistre, fixé internationalement et devant ce qu'il présente comme la nécessité d'assurer le même taux d'indemnisation pour tous pour ne pas commencer à indemniser tant qu'il n'a pas d'estimation suffisamment précise du montant global des dégâts. Le taux d'indemnisation devrait être fixé début juillet. Je souhaite, bien entendu, qu'il soit le plus élevé possible, mais en tout état de cause, si les dommages touristiques atteignent ce qui est évoqué ça et là, compte tenu du plafond susmentionné, l'indemnisation par le FIPOL sera loin d'être complète. L'Etat a fait un effort en annonçant qu'il ne demanderait au FIPOL le remboursement de ses dépenses qu'après l'ensemble des acteurs économiques. Il faudra que TotalFinaElf prenne complètement ses responsabilités pour que le niveau d'indemnisation soit au bout du compte, acceptable par tous. Dès le début de la crise le 28/12/99, j'ai convoqué M. Desmaret et l'administrateur du FIPOL, M. Jacobsson, pour leur rappeler les responsabilités qui devront peser sur le pollueur.
Enfin, pour réparer à long terme les conséquences de la marée noire, ainsi que plus généralement celles des catastrophes qui ont durement touché la France à la fin de l'année dernière, l'Etat a décidé lors du CIADT du 18 mai dernier une aide de 4 milliards de francs dans le cadre des contrats de plan Etat-région pour améliorer structurellement la situation des régions touchées.
Réparer les conséquences du naufrage de l'Erika est une tâche énorme qui mobilise toute l'attention du Gouvernement depuis bientôt six mois. Nous ne pouvons évidemment pas nous satisfaire de cette approche strictement curative et il faut tout faire pour prévenir de futures catastrophes. La France a mis en place un dispositif complet en ce sens.
Au niveau national, il s'agit de renforcer les moyens de contrôle, de surveillance, de prévention et d'intervention. Le comité interministériel de la mer, qui s'est tenu le 28 février à Nantes, a arrêté un dispositif de mesures en ce sens qui sera complété lors du prochain CIMER (Comité interministériel de la mer) à la fin de ce mois. Ont notamment d'ores et déjà été annoncés : le doublement en deux ans du nombre d'inspecteurs de sécurité et le renforcement de leur formation ; le renforcement et la professionnalisation des CROSS ; la mise en place d'un remorqueur d'intervention supplémentaire dans le Pas-de-Calais et le lancement d'une réflexion pour améliorer ce dispositif. On sait ce que nous devons aux Abeilles qui, quotidiennement, nous évitent des naufrages du type de celui de l'Erika ; leur flotte a cependant vieilli et il est essentiel que nous disposions des remorqueurs les plus récents. Cette amélioration devra se faire avec un haut degré d'exigence sur la qualification et le professionnalisme des équipages de ces remorqueurs : c'est un sujet sur lequel les syndicats sont actuellement, à juste titre, extrêmement vigilants.
Sont également prévus l'acquisition d'un nouvel avion POLMAR, d'un hélicoptère de moyen tonnage pour le sauvetage en mer, et l'affrètement d'un navire spécialisé en matière de dépollution ; la mise en place d'un dispositif garantissant qu'un navire ne puisse plus quitter un port français s'il ne peut pas démontrer que ses déchets et résidus de cargaisons ont été déposés dans une installation appropriée. Cette disposition, en cours d'adoption au Parlement dans le cadre du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation communautaire, est essentielle pour lutter contre les dégazages, dont une catastrophe telle que celle de l'Erika ne devrait pas masquer les impacts considérables. On estime ainsi, par exemple, que rien qu'en Méditerranée, les dégazages sont responsables du déversement en mer de plus de 800 000 tonnes d'hydrocarbures par an.
Le dispositif de répression des infractions en la matière est également à améliorer. Je me félicite, à cet égard, que la proposition de loi présentée par le député Le Bris durcissant les peines pour ce type de délit vienne dans les prochains jours en discussion à l'Assemblée nationale ; en complément de cette proposition, ce sujet fera partie des priorités du prochain CIMER .
Je voudrais encore citer : le renforcement des mesures de protection de la Méditerranée avec notamment la création d'une zone de protection écologique pour permettre à la France de procéder aux contrôles nécessaires en dehors de ses eaux territoriales.
Enfin, parce que, quelle que soit l'importance des mesures de prévention mises en _uvre, la catastrophe peut toujours se produire et qu'il faut être prêt à y faire face, le Gouvernement a entrepris de dresser le bilan du fonctionnement du plan POLMAR lors de la marée noire de l'Erika afin d'identifier les dysfonctionnements éventuels et de proposer les améliorations nécessaires. Mon département ministériel y est étroitement associé, son service d'inspection nouvellement créé devant me remettre un rapport en ce sens avant la fin de ce mois.
Mais la France ne peut évidemment pas tout faire seule : la réglementation du transport maritime dépend en effet, pour une très large part, de règles fixées au niveau international et communautaire, qui doivent être complétées et améliorées et dont il faut mieux contrôler l'application. C'est pourquoi le Gouvernement a proposé à la Commission européenne, à l'OMI et au FIPOL trois Mémorandums afin de progresser sur la sécurité du transport maritime et la prévention des pollutions. Ces propositions s'articulent autour de six axes :
- renforcer les réglementations relatives aux navires et aux équipages pour éviter les poubelles flottantes : l'élimination progressive des navires citernes à simple coque est à cet égard un outil puissant de renouvellement des flottes ; l'harmonisation par le haut des conditions de travail des équipages est également une priorité ;
- éviter le transit à proximité des côtes françaises et l'arrivée dans nos ports des navires dangereux qui pourraient subsister, ce qui passe notamment par une obligation de signalement systématique des navires transportant des produits polluants ou dangereux à l'entrée dans les eaux territoriales des Etats membres de l'Union européenne ainsi que par la création d'un régime d'autorisation préalable pour l'accès aux ports communautaires ;
- pour bien mettre en _uvre cette mesure, assurer une meilleure transparence sur l'état des navires, en particulier par la généralisation de la base de données EQUASIS, créée sur l'initiative de la France et de la Commission européenne ;
- renforcer les contrôles de la sécurité des navires en portant à deux ans et demi l'intervalle maximal entre deux contrôles de structure (au lieu de 5 ans actuellement), et en mettant en _uvre au niveau communautaire un système commun de contrôle des organismes chargés de la sécurité, pour renforcer notamment la compétence et l'indépendance des sociétés de classification ;
- responsabiliser davantage l'ensemble des acteurs du transport maritime : la France propose à cette fin de modifier le mode de calcul des contributions au FIPOL pour prendre en compte des critères représentatifs de l'état des navires choisis ; la mise en _uvre d'un régime de responsabilité des propriétaires de cargaisons, qui s'ajoute au régime actuel de responsabilité plafonnée des propriétaires de navires, est également à l'étude ;
- mieux indemniser les victimes des catastrophes en portant le plafond du FIPOL à un milliard d'euros et en assurant une meilleure prise en compte des dommages à l'environnement, actuellement largement ignorés : le FIPOL et les pollueurs en général ne paient pas pour les oiseaux morts, pour les espèces menacées, pour le paysage défiguré ou pour l'impossibilité de profiter des plages...
Il faut cependant noter que, aussi imparfait soit-il, le dispositif du FIPOL a toutefois le mérite d'exister. Rien de similaire n'est en place pour les pollutions par d'autres substances que les hydrocarbures. Le prochain CIMER devra préciser selon quelles modalités la France proposera à ses partenaires un dispositif de prévention des pollutions et d'indemnisation par les autres substances potentiellement dangereuses, et elles sont nombreuses ! Mon département ministériel s'est d'ores et déjà mobilisé sur le thème et préparera avec l'INERIS et le CEDRE la création d'une base de données sur les produits et les méthodes de lutte .
J'en ai terminé avec mes propos liminaires et me tiens maintenant à votre disposition pour répondre à vos questions. Le naufrage de l'Erika est une catastrophe pour les populations concernées et les écosystèmes littoraux ; j'espère qu'il servira au moins à faire progresser la sécurité et la prévention pour que ces scènes pathétiques d'oiseaux mazoutés et de plages souillées ne reviennent plus avant longtemps.
M. le Rapporteur : Madame la ministre, notre mission ne se limite pas à l'analyse de l'événement. Il s'agit aussi pour nous de faire des propositions en tenant compte de ce qui s'est passé pour que de tels événements ne se reproduisent plus.
Je reviendrai tout d'abord sur « l'avant » Erika. Dans le cadre de vos compétences, et dans le cadre de l'instruction du Premier ministre du 17 décembre 1997, vous avez à assurer la préparation à la lutte contre la pollution. Vous êtes-vous interrogée sur l'inventaire des lieux utilisables pour le stockage, avant l'événement, et des matériels opérationnels disponibles ? Nous avons en tout cas constaté, dans un certain nombre d'endroits, que cela ne s'était pas fait ou ne se faisait pas.
En ce qui concerne l'événement lui-même, on a cru déceler des dysfonctionnements dans les prises de décision au niveau du Gouvernement, pendant cette période. Comment jugez-vous la coordination des services de l'Etat pendant la crise et comment établissez-vous votre rôle dans cette affaire ? Vous en réfèreriez-vous en permanence au secrétariat général à la mer ? Est-ce que vous avez senti un manque de cohérence ? Pensez-vous qu'il serait utile de prendre des mesures pour rendre le dispositif plus cohérent et plus efficace ?
S'agissant du plan POLMAR lui-même, vous avez indiqué le montant des financements mis en place par l'Etat. Les moyens financiers disponibles sont en effet importants : 920 millions de francs de l'Etat, 850 millions de francs du groupe TotalFina Elf, et 1,2 milliard de France du FIPOL. Pouvez-vous nous faire un point de l'état de mobilisation de ces crédits ? Avez-vous rencontré, dans cette gestion du plan POLMAR, des difficultés ? Enfin, comment tout cela se déroule actuellement ?
Je terminerai par deux questions, la première concernant la toxicité. Nous avons été frappés par la multiplicité des acteurs qui ont défini la toxicité, à tel point que la commission d'enquête a jugé utile de les réunir pour essayer d'y voir clair. Ne vous semble-t-il pas souhaitable que, dans l'avenir, il y ait un seul acteur, un seul référent ? Il pourra bien sûr être contesté par d'autres laboratoires, mais au niveau de l'Etat, il serait chargé de déterminer la toxicité du produit en cause. Vous avez parlé du CEDRE et de l'INERIS, quels enseignements tirez-vous de ce qui s'est passé à ce niveau-là ?
Ma seconde question est relative à la Méditerranée. La commission d'enquête est très frappée par la non-préparation à de tels événements s'ils se déroulaient en Méditerranée. Nos déplacements sont très alarmants. Si une catastrophe du même type se déroulait en Méditerranée, on ne voit pas comment on mobiliserait les moyens nécessaires pour lutter contre la pollution. Le correspondant du CEDRE en Méditerranée, l'organisme méditerranéen chargé des problèmes de pollution, est composé de deux ou trois personnes, pour une zone qui va de Beyrouth à Gibraltar ! Je sais que vous êtes consciente de ce problème, puisque vous proposez une zone de protection écologique. Pouvez-vous nous préciser comment cette zone va se mettre en place, quels moyens y seront affectés, et si elle s'intégrera à la convention de Barcelone ; y a-t-il, à ce sujet, une collaboration internationale ?
Mme Dominique VOYNET : En ce qui concerne l'instruction du 17 décembre 1997, je ne suis pas convaincue, sans l'avoir apprise par c_ur, qu'elle donne au ministère de l'environnement la responsabilité de préparer la lutte contre la pollution. En effet, le secrétariat général de la mer et les préfets sont chargés d'assurer la préparation à la lutte contre la pollution. En revanche, le rôle des DIREN est évoqué dans le domaine du stockage des déchets ; et il est évoqué à tort, le stockage des déchets relevant non pas des DIREN, mais des DRIRE.
Ce travail a été fait, département par département. Et lors de la mise en place des cellules de crise, on a effectivement eu à disposition relativement vite des sites de stockage intermédiaire de déchets. En revanche, dans l'urgence, il est parfaitement exact que des maires ou des fonctionnaires de l'Etat ont pris l'initiative de préconiser des sites d'urgence - qui étaient vidés jour après jour - qui ne figuraient pas dans les relevés du plan POLMAR et qui, pour certains, se sont avérés de mauvais sites. Je prendrai l'exemple de sites en haut de plages ou de sites situés à proximité immédiate de cours d'eau. Dès le 15 janvier, des instructions ont été données aux services des DRIRE pour procéder à un inventaire exhaustif de ces sites, à leur fermeture rapide et à une réhabilitation après diagnostic de la situation.
Je dois dire que nous avons recherché dans quelles conditions l'instruction du 17 décembre 1997 avait été préparée. Nous n'avons pas retrouvé de traces de réunions interministérielles formelles qui auraient permis à l'ensemble des ministères d'apporter leur contribution. Si cela avait été le cas, nous aurions certainement souhaité insister sur deux points qui sont pratiquement absents de cette instruction. D'une part, permettre d'associer de façon formelle les DIREN aux cellules de crise, ce qui n'est pas le cas et ce qui les a conduit, dans certains cas, à intervenir tardivement. D'autre part, nous aurions souhaité renforcer l'instruction dans le domaine de la prise en compte des préoccupations environnementales, puisque cette instruction n'évoque pratiquement pas la question des oiseaux ou les milieux naturels.
Comment juger de la coordination des services de l'Etat ? Cette question est très large, puisqu'aux différents temps de la mobilisation du Gouvernement et des administrations pour lutter contre la marée noire, des services différents ont pu être mobilisés. Nous avons été informés en temps et en heure du naufrage. C'est le 12 décembre à 17 h 40 que le ministère a été alerté officiellement par le secrétariat général à la mer, même si nous étions déjà informés par la radio - il est normal que l'on s'intéresse au devenir d'un bateau en perdition au large de la Bretagne.
Pendant toute la phase de pollution en mer, la coordination de la lutte en mer a été assurée par la préfecture maritime qui a eu le souci de nous tenir régulièrement informés des moyens mobilisés et des informations rassemblées sur place. Vous le savez, je me suis rendue le 15 décembre sur le site avec Jean-Claude Gayssot ; je dois d'ailleurs faire état de notre surprise car à cette date, 48 heures à peine après le naufrage, on ne voyait plus que quelques taches éparses de fioul en surface ; la plus grande partie de la pollution était déjà entre deux eaux, non détectable par les avions des douanes.
J'ai un souvenir très précis de la réunion des services de l'Etat qui s'en est suivie, au cours de laquelle les responsables de Météo France nous ont expliqué que cela ne les handicapait pas pour modéliser le devenir des nappes de polluants. Ils évaluaient à environ 3 % le rôle des vents et à 97 % le rôle des courants. Il est vrai qu'à cette époque, ils ont été relativement rassurants, puisqu'ils en ont déduit que la plus grande partie de la nappe devait évoluer de façon parallèle au littoral en fonction des courants dominants connus dans cette zone.
Dans la suite des événements, l'action à terre était coordonnée par le ministère de l'intérieur. On peut noter quelques difficultés liées à l'incertitude sur la zone d'arrivée des pollutions : avant que la pollution arrive à terre, c'est le préfet de Charente-Maritime qui avait été désigné comme coordonnateur, alors que la pollution a été massivement constatée plus au nord. Le 26 décembre, le préfet de la zone de défense ouest était donc désigné pour le remplacer. Cette désignation était opportune mais tardive. Son rôle réel de coordination par rapport au préfet directement concerné - tel que celui de Loire-Atlantique, qui était en première ligne - mériterait sans doute d'être examiné de façon plus approfondie ; ce sera l'un des objets de la mission de retour sur expérience qui a été demandée par le Gouvernement.
Au niveau central, la coordination était organisée à trois échelons : à Matignon, sous la présidence de Mmes Borne et Laville et de l'amiral Dumontet, au ministère de l'intérieur, au centre opérationnel et d'aide à la décision, et au secrétariat général de la mer. Nous n'avons pas une appréciation très claire de la valeur ajoutée et de la complémentarité de ces coordinations multiples. Nous avons eu l'impression de devoir participer à de très nombreuses réunions où se répétaient des choses relativement proches. Je suis incapable de vous dire quels étaient les sujets traités de façon spécifique dans chacun de ces lieux de coordination, je crois que tous les sujets étaient abordés dans tous ces lieux, ce qui était relativement lourd à assurer pour les membres de mon cabinet.
Quel a été mon rôle dans cette affaire ? Je voudrais insister sur un point : il existe une réelle distorsion entre les attentes du public à l'égard du ministère de l'environnement et l'étendue objective de ses compétences telles qu'elles sont rappelées dans la circulaire du 17 décembre 1997 et telles qu'elles relèvent de la définition de mon champ de compétence et de la nature des services dont je peux disposer sur le terrain.
J'ai veillé à ce que l'ensemble des directions concernées de mon ministère soient mobilisées ; je n'ai donc pas géré cette affaire comme un épisode normal du fonctionnement du ministère. Nous avons mis en place, très rapidement, une cellule de crise à laquelle participaient en priorité le directeur de l'eau et ses équipes, la direction de la prévention des pollutions et des risques - qui a été très mobilisée sur la question de la nature du fioul, de sa toxicité, et du contact avec les instituts à qui nous avions demandé d'éclairer notre lanterne sur la justesse des précautions qui avaient été préconisées -, la direction générale de l'administration et du développement, qui était chargée des aspects budgétaires, ainsi que la direction de la nature et des paysages, qui était en contact constant avec les DIREN dans la phase où étaient nécessaires les diagnostics des sites et l'élaboration des bonnes méthodes de restauration de ceux-ci.
En ce qui concerne la mobilisation des crédits POLMAR, nous sommes loin d'avoir eu des problèmes de gestion, si je mets de côté la petite difficulté qu'a consisté le déblocage dans l'urgence, entre Noël et le Nouvel an, de plusieurs dizaines de millions de francs pour intervenir à un moment où les exercices budgétaires ne sont pas faciles. Je voudrais d'ailleurs vous inviter à comparer l'ampleur du travail réalisé avec de très faibles moyens par les services de mon ministère avec le rythme de la mobilisation des crédits dans d'autres catastrophes - je pense notamment aux inondations de l'Aude.
Cela étant dit, j'ai été confrontée à des interpellations nombreuses de la part d'usagers, d'élus d'acteurs économiques, qui ne comprenaient pas les modalités et la lourdeur du fonctionnement du FIPOL. Cela a été l'objet d'une bonne partie de la réunion de Vannes, où de nombreux élus étaient présents et où les difficultés de ces professionnels ont été évoquées.
S'agissant de la toxicité du fioul, je voudrais vous rappeler que nous avons eu à gérer deux phases. Une première phase de travail « normal » : le ministère de la santé a fait son travail, il s'est intéressé à la nature du produit, à sa toxicité pour l'être humain et à l'élaboration des préconisations et des conseils de précautions pour les bénévoles et les professionnels. Dès le 21 décembre, l'on disposait de toutes les données, et le 25 décembre, alors que les premières nappes de fioul arrivaient sur la côte, ces données étaient largement diffusés sous forme de fiches pratiques dans les cellules de crise, le long du littoral.
Parallèlement, nous avons, au ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement, assumé notre travail qui était, cette fois, d'évaluer l'impact sur l'environnement. Le service de la recherche de mon ministère a été mobilisé, et en l'absence de l'aptitude pour lancer des programmes de recherche en vraie grandeur, nous avons essentiellement collecté des données bibliographiques pour essayer d'anticiper sur d'éventuelles conséquences. Nous avons rendu public le rapport du ministère de l'environnement, qui a été mis sur Internet rapidement.
Seconde phase, les polémiques. Des polémiques sur la nature du produit, des polémiques sur la nature des précautions à prendre pour manipuler ce produit. Et nous n'avons pas nié les inquiétudes du public, puisque du côté du ministère de la santé comme de celui de l'environnement, il a été demandé des analyses complémentaires pour confirmer la nature du produit et sollicité des instituts variés pour évaluer la dangerosité et la toxicité de celui-ci.
Cela étant dit, et vous avez parfaitement raison, il aurait été utile, dans ce contexte, de disposer d'une agence de sécurité sanitaire de l'environnement pour croiser les éléments d'ordre sanitaire et les éléments d'ordre environnemental. En effet, nous avons été régulièrement interpellés sur des différences de forme dans la formulation des données, alors que sur le fond, tout le monde était d'accord.
En ce qui concerne le travail du CEDRE et de l'INERIS, je voudrais ici me dissocier des critiques véhémentes qui ont touché le CEDRE. Ou plutôt, si je devais formuler une critique, ce serait une critique à l'égard de l'ensemble des acteurs de cette catastrophe : nous avons souffert d'un manque de pluralisme dans la collecte des données. Je me suis sentie rassurée de constater que le CEDRE et Météo France avaient les mêmes interprétations concernant l'évolution de la nappe, le rôle respectif des vents et des courants, et les zones d'échouage prévisibles des polluants. Et c'est uniquement a posteriori que nous avons pris conscience qu'il était en fait naturel qu'ils aboutissent aux mêmes conclusions, puisqu'ils partaient des mêmes données.
Je serai donc attachée, dans l'avenir, à diversifier les sources d'expertises pour permettre de croiser les points de vue et donc de consolider les éléments qui nous sont fournis. Cependant, les éléments qui ont été fournis par le CEDRE aux différentes étapes de la catastrophe m'ont semblé solides, parfois formulés sous une forme prudente et interrogative, avec le souci de ne masquer ni la réalité ni les interrogations ou les doutes qui pouvaient subsister à chaque étape.
Quid de la Méditerranée ? Je partage votre analyse, monsieur le rapporteur, nous avons impérativement besoin de développer une stratégie complète destinée à prévenir la survenue de catastrophes. En revanche, la formule prudente que vous avez utilisée en disant « si une catastrophe identique devait survenir, on serait mal armé » ne se justifie pas, puisque des catastrophes identiques sont déjà survenues, y compris dans la période récente ; quelques jours après le naufrage de l'Erika une catastrophe de même nature a été enregistrée dans la mer de Marmara.
Sur l'invitation de mon homologue suédois, je me suis rendue en mer Baltique dont le cas de figure est comparable avec la Méditerranée : il s'agit de pays dont le niveau de vie et les capacités de mobilisation et d'intervention sont très hétérogènes, où il existe des difficultés linguistiques et des difficultés de coordination technique. Mais tout cela n'a pas empêché la mise en place d'une stratégie complète de prévention des catastrophes associant des moyens de remorquage, des moyens de réaction rapides en cas de difficulté et des moyens de prévention de l'arrivée des matières polluantes sur la côte.
J'en ai retenu une leçon, qui a été martelée par tous les interlocuteurs que j'ai rencontrés au cours cette journée : tout faire pour que le fioul n'arrive jamais à terre. Cela a conduit, en mer Baltique, à mobiliser d'énormes moyens d'intervention en mer. Nous avons, en France, développé le recours à des barrages destinés à empêcher l'accostage immédiat des matières polluantes à terre, en Baltique, on privilégie l'intervention plus loin des côtes.
Il s'agit là d'une expérience dont on pourrait s'inspirer en Méditerranée. Serge Antoine, l'un des grands pères fondateurs de la politique de l'environnement en France, a suggéré qu'une rencontre ait lieu entre les pays riverains de la Baltique et ceux de la Méditerranée. Cette initiative avait déjà été engagée par la Finlande il y a quelques années, elle devrait être reprise avec le souci de déboucher dans des délais raisonnables.
La mise en place de la zone de protection environnementale en Méditerranée en est au tout premier stade de préparation. Evidemment, nous tiendrons la commission d'enquête informée de l'avancée des discussions et des négociations internationales en la matière.
M. Edouard LANDRAIN : Madame la ministre, la manière dont vous relatez le naufrage de l'Erika marque un certain flottement dans les différents ministères : manque de coordination et sans doute manque d'affectation des responsabilités des uns et des autres ; vous avez parlé des déchets, des DIREN, de la DRIRE, du transport, de la défense, du secrétariat à la mer, de votre propre ministère... Nous avons l'impression que rien n'a été véritablement défini, et le seul fait d'avoir été prévenue plus de trois heures après l'événement par la radio peut étonner, quand on sait l'importance que l'on peut porter à ce genre de catastrophe, surtout après l'Amoco-Cadiz et le Torrey Canyon.
Je vous poserai quatre questions. Premièrement, l'hypothèse d'une rupture d'un navire au large avait-elle été déjà envisagée ? Ou, au contraire, les différentes études avaient-elles été réalisées pour des naufrages à la côte, vraisemblablement avec des produits différents du fioul numéro 2 ? La perte d'un fioul numéro 2 avait-elle été envisagée dans les études antérieures ?
Deuxièmement, nous avons l'impression qu'il y avait un manque de coordination des plans POLMAR terre et mer avec les différents ministères, et le vôtre en particulier. Même s'il est vrai que tout le monde s'en est inquiété, il me semble que vous n'avez pas suffisamment communiqué entre vous. Vous nous avez même dit que les différents thèmes étaient repris dans toutes les réunions sans que cela avance.
A la suite des accidents de l'Amoco-Cadiz et du Torrey Canyon, des études sérieuses ont-elles été réalisées pour coordonner l'ensemble des préoccupations, depuis les problèmes de navigation jusqu'aux problèmes de naufrage et d'environnement ?
Troisièmement, la France va assumer la présidence de l'Union européenne. Avez-vous déjà prévu des rencontres avec vos collègues européens pour mettre en place un plan qui serait recommandé à toutes les nations européennes ?
Quatrièmement, vous avez parlé de l'évaluation des dégâts que l'on ne peut pas encore chiffrer. Comment allez-vous y participer, avec qui et dans quelles conditions ? Comment pensez-vous arriver à une estimation correcte, que ce soit au niveau de l'environnement ou du tourisme ?
Enfin, dernière question, si vous me le permettez, monsieur le président, ne pensez-vous pas que ce que vous êtes en train de faire, notamment les recherches dans l'urgence de données bibliographiques, n'aurait pas pu être fait avant ? N'aurions-nous pas dû disposer de plans de réponses aux multiples problèmes qui se sont posés ?
Mme Dominique VOYNET : Monsieur Landrain, je n'ai pas l'intention de vous laisser reformuler à ma place ce que j'ai dit. C'est une chose que j'ai apprise, car le greffier retient ensuite ce qu'il veut ! Ainsi, je n'ai certainement pas dit qu'il y avait eu, au moment du naufrage, un certain flottement de la part de l'Etat, parce que je pense le contraire - et j'ai dit le contraire. Au moment du naufrage, la coordination des efforts de lutte en mer était assurée de façon non équivoque par le préfet maritime qui a fait son travail et qui a eu le souci de nous informer régulièrement, en temps et en heure. Je ne vois pas ce que cela aurait changé que je sois prévenue une heure trente ou deux heures après le naufrage ; j'ai été prévenue d'une façon qui m'a permis de réagir rapidement - et de toute façon mon ministère ne dispose pas de moyens d'intervention en mer.
J'ai évoqué les informations obtenues par la radio parce que, comme tous les Français, je m'intéressais à un événement sérieux, au-delà de la mobilisation propre de mon ministère. Je ne peux donc pas vous laisser dire cela. Je n'ai pas avoué avoir été prévenue trois heures après. J'ai eu le souci, alors que vous ne m'aviez pas posé la question, de préciser l'heure exacte à laquelle on m'avait prévenu, pour montrer que le secrétariat général à la mer, malgré l'urgence - il avait décidé de réagir sur le terrain en coordination avec la préfecture maritime - avait eu le souci de prévenir les différents acteurs de l'Etat. Je ne veux donc pas travailler dans cet état d'esprit.
Deuxième point, il paraît évident qu'une meilleure coordination des plans POLMAR terre et POLMAR mer doit être effectuée. Ce sera l'une des leçons fortes de l'événement. Il paraît évident aussi que l'on doit se donner les moyens de garder la mémoire de ce qui s'est passé. Ce qui m'a frappée, alors que mon ministère ne possède pas d'archives considérables compte tenu de son ancienneté et de ses moyens, c'est la difficulté à retrouver des éléments qui n'ont que vingt ans, concernant les naufrages antérieurs.
Je n'évoquerai que pour mémoire le travail réalisé par la commission d'enquête à la suite du naufrage de l'Amoco-Cadiz ; il concerne pour l'essentiel mes collègues de la défense et des transports. Je voudrais insister davantage sur des éléments qui avaient été collectés, à l'époque, par des associations, des élus ou des services de mon ministère concernant les déchets et les oiseaux. Ainsi, nous avons eu des difficultés à retrouver des éléments concernant la récupération par les habitants d'une partie des matières polluantes, et à identifier les lieux dans lesquels elles avaient été stockées. La catastrophe de l'Erika aura au moins servi à ce que l'on procède à un bilan complet des sites pratiquement oubliés où il y a encore des déchets.
Même chose en ce qui concerne les oiseaux, puisqu'un gros travail avait été réalisé par les associations pour essayer de tirer le bilan des différentes techniques de soin des oiseaux - à l'époque de l'Amoco-Cadiz - et qu'il n'en reste pratiquement pas de trace dans les services de l'Etat, vingt ans plus tard.
Je ne peux pas vous laisser dire non plus, monsieur le député, que l'on traitait des différents sujets dans toutes les réunions mais que cela n'avançait pas ! J'ai effectivement dit que l'on traitait de tous les sujets dans chacune des réunions, mais je n'ai jamais dit que cela n'avançait pas ! Si j'ai parlé d'un peu de perte de temps et d'énergie liée à la juxtaposition de ces réunions, je n'ai pas dit que cela n'avançait pas. Au contraire ! Je pense que les décisions ont été prises et que les moyens ont été dégagés quand nous en avons eu besoin.
Je ne peux pas non plus vous laisser dire que rien n'a été fait depuis vingt ans. Je vous invite à reprendre les éléments rendus publics à l'occasion des vingt ans du CEDRE. Cela a été l'occasion de faire le point sur les connaissances accumulées ces dernières années en matière de pollution et de sécurité maritimes. En revanche, nous découvrons chaque jour des champs nouveaux d'investigation. C'est la raison pour laquelle j'ai pris l'initiative d'évoquer spontanément d'autres polluants que les hydrocarbures ; en effet, on met l'accent sur les hydrocarbures, mais il existe de nombreuses autres matières polluantes qui sont transportées. Il existe également beaucoup de matières qui ne sont pas considérées comme polluantes mais dont l'impact sur le milieu marin n'est pas négligeable. J'ai d'ailleurs évoqué, lors d'une question d'actualité, le naufrage aux îles Lavezzi d'un bateau qui transportait des céréales et qui a stérilisé des surfaces considérables de fonds marins.
En ce qui concerne le travail avec nos collègues de l'Union européenne, j'avais pris l'initiative, en mars, de solliciter la présidence de l'Union, pour que la commissaire européenne aux transports vienne devant le Conseil de l'environnement faire le point sur les mesures à prendre en matière de sécurité maritime et de protection de l'environnement en cas de pollutions par des hydrocarbures. Mme de Palacio est donc venue et a présenté ses projets. Il a été convenu de la revoir pour faire le point sur l'avancement de ces dispositions. Il est important que les ministres de l'environnement continuent à exercer une pression amicale mais ferme sur leurs collègues des transports pour que les considérations environnementales et écologiques ne soient pas oubliées.
S'agissant de l'évaluation des dégâts, j'ai cherché à être aussi honnête que possible. En effet, nous sommes confrontés non pas à un manque de moyens pour évaluer les pertes et le préjudice écologique, mais plutôt à la nécessité d'avoir un débat d'orientation philosophique. Il est à peu près possible d'évaluer la perte patrimoniale, c'est-à-dire le nombre d'oiseaux tués et le coût de reconstitution des écosystèmes dégradés, même s'il est difficile de chiffrer la valeur d'un oiseau. En revanche, il est encore compliqué d'évaluer de façon précise la perte générée par la dégradation des conditions d'accès à certains espaces ; quand une plage est fermée, on sait évaluer le préjudice économique pour la commune, mais le préjudice en termes d'attractivité, de qualité de la vie, de plaisir, de confort, est quelque chose de très difficile à faire.
J'ai chargé la direction des études économiques et d'évaluation environnementale de mon ministère de suivre cette question, parallèlement à un travail qui est mené, site par site, pour tenter de dresser un bilan. Bien entendu, ce bilan est difficile à établir : pour ce qui concerne la dynamique des populations des espèces, par exemple, on ne pourra travailler que dans la durée. Les scientifiques considèrent qu'à moyen terme, les conséquences ne seront pas forcément dramatiques pour les espèces végétales et animales du littoral. Evaluer le préjudice, cela suppose de dire à quel moment on l'évalue.
A cette heure, une bonne partie du préjudice écologique est liée aux conditions et aux méthodes de nettoyage parfois hasardeuses qui ont été mises en _uvres - comme cela avait d'ailleurs était le cas pour l'Amoco-Cadiz.
M. Jean-Michel MARCHAND : Madame la ministre, je voudrais revenir sur le dernier point que vous venez d'évoquer, notamment sur les conséquences sur les espèces, les écosystèmes et la biodiversité.
Vous venez de le dire, il y a eu, au début, des bonnes volontés mais parfois des méthodes un peu hasardeuses pour nettoyer les plages, et les conséquences immédiates, visibles, ne seront pas les conséquences réelles. J'ai envie de faire le parallèle avec ce que nous avons découvert lors de notre visite aux Etats-Unis où un organisme - auprès du ministère du commerce - est responsable à la fois de l'expertise des dégâts, du choix des sites à réhabiliter et de la mise en _uvre de cette réhabilitation.
Jusqu'à aujourd'hui, l'idée était que la mer finit toujours par réparer ; or force est de constater, après le Torrey Canyon et l'Amoco-Cadiz, que la mer ne finit pas toujours par réparer et que les conséquences restent importantes. L'Etat a engagé de l'argent pour restaurer un certain nombre de milieux ; TotalFinaElf a également débloqué des fonds, mais pour leur avoir posé la question, il en garde dans le cadre d'une fondation la maîtrise et l'affectation. Or lorsqu'on connaît les relations qui se sont établies entre cette entreprise et un certain nombre de maires qui ont décidé de porter plainte, on peut se poser un certain nombre de questions sur les choix de sites qui seront faits.
Ma question est la suivante : l'observatoire créé le 15 janvier a-t-il pour vocation de suivre les conséquences sur les écosystèmes, de proposer un certain nombre de choix de réhabilitation et d'en suivre les différentes opérations ? Sinon, qui a cette vocation ? Si oui, qui va payer ? Le principe pollueur-payeur va-t-il s'appliquer aussi sur le moyen et le long terme, car l'on peut s'imaginer que les conséquences de cette pollution seront encore présentes dans quinze ou vingt ans ?
Si cet observatoire possède toutes ces responsabilités, peut-il être élargi dans le cadre de l'Union européenne ? La France pourrait proposer qu'il puisse être opérationnel sur les côtes de la façade atlantique, de la Baltique et de la Méditerranée.
Si nous ne disposons pas de cet outil, à qui va-t-on confier - et sous quelle responsabilité - les projets envisagés par les associations et les élus pour que les dégâts puissent être non seulement effacés, mais également réparés ?
Mme Dominique VOYNET : Je ne l'ai évoqué évidemment que très rapidement, mais j'éprouve le besoin d'insister sur ce point : bien entendu, il est faux d'affirmer que la mer finit toujours par réparer, et il serait également faux de considérer que l'arbre marée noire puisse cacher la forêt pollution.
En ce qui concerne les maux dont souffrent les milieux marins, notamment par défaut d'assainissement, par ruissellement ou érosion, par l'ensemble des pollutions d'origine tellurique, par déchets solides et par déballastages sauvages - qui représentent des quantités beaucoup plus importantes que les marées noires proprement dites - nous devons posséder une stratégie qui permette de prévenir, et le cas échéant de réparer, l'ensemble des dégâts qui génèrent la dégradation des milieux marins.
Nous entendons évidemment mobiliser l'ensemble des services de l'Etat, et notamment les DIREN, des établissements publics dans leur diversité, l'Institut français du pétrole, l'INERIS, le CEDRE, l'IFREMER, l'IFEN, l'Agence de sécurité sanitaire des aliments et demain sans doute l'Agence de sécurité sanitaire de l'environnement, les universités, les équipes gestionnaires des sites protégés, afin de dresser un bilan exhaustif des conséquences écologiques de la marée noire. Avec une difficulté réelle : on n'a pas un point zéro sur la totalité des sites. On possède un bilan exhaustif de la situation antérieure sur les sites très connus et très étudiés parce qu'exceptionnels et très protégés. On connaît moins bien les sites « banals » du littoral.
On a aussi une réelle difficulté à dresser un bilan, à cette heure, de l'ensemble des conséquences. Cela paraît évident pour les oiseaux, par exemple. Sur une même espèce, les guillemots de Troïl, vous avez des nicheurs sédentaires, et des migrateurs. Si l'on sait qu'il n'y avait plus que 250 ou 300 couples de guillemots nicheurs en France, et qu'il y a eu des dizaines de millions de guillemots tués, il devient évident qu'il faudra procéder à des comptages précis en séparant les deux types de population. Pour les espèces végétales, les lichens, on devra faire des bilans à court terme et à moyen terme, et assurer un suivi dans la durée.
L'observatoire de suivi associatif a pour unique objet de reconnaître la mobilisation forte des bénévoles et des associatifs et de leur octroyer les moyens qui leur permettront de contribuer à ce travail qui repose, pour l'essentiel, sur les épaules de l'Etat, ce qui est normal. Le CIADT a décidé un certain nombre de mesures qui doivent nous permettre de faire face.
Il a décidé, notamment, la mise en place par les ministères concernés d'un dispositif pérenne et coordonné de mobilisation des organismes à des fins d'expertise, et de la création, auprès de mon ministère, d'un comité d'experts en matière de pollution marine ; je les ai rencontrés lors du CIADT de Nantes, le 28 février, et j'ai été étonnée de la diversité des compétences et des structures qui travaillent sur ces questions. Il est donc non seulement indispensable qu'ils se parlent, mais que leurs travaux remontent auprès de mon ministère afin que l'on puisse éclairer les décisions publiques. Il a également été décidé que mon ministère aurait désormais en charge la co-tutelle de l'IFREMER.
Nous avons par ailleurs créé un réseau scientifique de suivi des conséquences écologiques et écotoxicologiques de la marée noire, co-animé par l'INERIS et l'IFREMER pour les aspects environnementaux, par l'INERIS et l'Institut de veille sanitaire pour les aspects sanitaires, avec une affectation de 10 millions de francs de crédits au ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement et au secrétariat d'Etat à la santé pour y faire face.
M. Michel HUNAULT : Madame la ministre, je voudrais revenir sur les décisions que vous avez prises, ainsi que le Gouvernement, dans le cadre du CIADT. Vous avez annoncé, après les contrats de plan, une rallonge financière concernant les dégâts de la tempête et de la marée noire.
Ma question est assez précise : qu'attendez-vous des régions ? Je crois que les mesures que vous avez annoncées et les sommes qui seront consacrées aux conséquences de la tempête et de la marée noire appellent un partenariat avec les régions. Comment tout cela va-t-il se dérouler ? Pouvez-vous apporter des précisions quant aux modalités et au calendrier de déblocage de ces sommes ?
Enfin, en ce qui concerne la pollution du milieu marin, le Gouvernement entend-il être beaucoup plus sévère sur les rejets en mer de certaines stations qui ne sont pas équipées en matière de traitement et d'assainissement ?
Mme Dominique VOYNET : S'agissant du CIADT, je pense utile, si cela ne sort pas du champ de la commission d'enquête, de vous préciser le contenu des documents qui y ont été diffusés et qui font état des clés de répartition de cette enveloppe de 4 milliards de francs entre les régions, en fonction des préjudices constatés dans les forêts ou sur le littoral.
Le CIADT a mandaté les préfets des régions Bretagne, Pays-de-Loire, Poitou-Charentes et Aquitaine afin de proposer aux collectivités qui le souhaitent des avenants aux contrats de plan pour faire face aux conséquences de la marée noire et des tempêtes - et elles sont parfois assez étroitement imbriquées. Les actions devront s'inscrire dans les thèmes suivants : restauration écologique des sites - les plages, les réserves naturelles et les sites classés, les dunes, les zones humides, les estuaires, les forêts littorales, les accès publics au littoral, le sentier littoral -, défense contre la mer et lutte contre les inondations, restauration, réhabilitation de digues perets épis destinés à la protection des zones habitées et travaux de remise en état dans les ports, actions de prévention et de lutte contre les inondations ; actions liées à la remise en état et à l'amélioration des hébergements touristiques ; investissements des collectivités portant sur les équipements collectifs des plages, sur la valorisation des sites bâtis ou naturels ; production touristique, commercialisation de nouveaux produits par des groupements de professionnels ; remise en état et actions de protection des outils de production dans le domaine de la pêche, de la conchyliculture ou de la filière salicole ; actions collectives pour améliorer la gestion du domaine maritime concédé ; programmes d'actions en faveur des commerçants et artisans dépendant fortement des activités les plus touchées.
Il sera, par ailleurs, proposé aux régions de participer aux programmes de recherche mis en place au niveau national sur le thème des pollutions marines et accidentelles et les conséquences écologiques sur le littoral.
Les préfets ont donc la tâche, d'ici au mois de juillet, sur la base d'un mandat de négociation, de conclure des avenants aux contrats de plan avec les collectivités qui le souhaitent. Il va de soi que nous n'entendons pas financer la totalité de ces avenants par des crédits d'État, mais la clé n'a pas été fixée de manière drastique : cela dépendra aussi des difficultés des collectivités en cause.
En ce qui concerne les rejets des stations d'épuration, la législation relative à l'assainissement est assez complète et les sanctions qu'elle prévoit sont sévères. Il paraît donc difficile d'envisager une nouvelle punition, la plus douloureuse des punitions ne serait-elle pas d'ailleurs l'élaboration, peut-être, d'une liste rendue publique des communes qui n'ont pas encore satisfait à leurs obligations légales- compte tenu de l'impact touristique que cela aurait pour celles-ci ! Ce critère est d'ailleurs d'ores et déjà pris en compte pour décider d'attribuer ou non le pavillon bleu aux plages en plus des éléments habituels sur la qualité sanitaire du sable ou de l'eau. Nous n'avons donc pas envisagé de mesures pénalisantes supplémentaires au-delà de ce que risquent les communes qui ne satisfont pas à leurs obligations légales.
M. Serge POIGNANT : Madame la ministre, partant du principe que l'on peut toujours faire mieux en matière de coordination, que suggérez-vous pour améliorer le dispositif en cas de nouvelle catastrophe ? Lorsque nous avons parlé de toxicité, vous avez évoqué l'Agence de sécurité sanitaire. Les CIADT ne se réunissent pas dans l'urgence, les préfets prennent l'avis des ministères ; que suggérez-vous pour que les choses fonctionnent mieux ?
Vous nous avez dit « j'ai été rassurée par les prévisions des lieux d'échouage ». Pour ma part, je ne suis pas rassuré du tout, car les nappes de pétrole ne se sont pas échouées là où elles étaient attendues !
Par ailleurs, madame la ministre, que pensez-vous de l'idée selon laquelle, comme pour les transports de matière nucléaire, l'affréteur est responsable de sa marchandise et donc de la pollution ?
Enfin, que pensez-vous de l'instauration d'un système de garde-côtes ?
Mme Dominique VOYNET : Monsieur Poignant, je le redis, mais sans esprit polémique, nous nous sommes dit beaucoup de choses et il est possible que l'on ne se soit pas toujours bien compris : je n'ai pas été rassurée par les prévisions des lieux d'échouage ! J'ai simplement dit que le 15 décembre, les éléments qui nous ont été fournis étaient plutôt rassurants.
Il est vrai qu'en tant que ministre, et alors que l'on n'est pas forcément spécialiste en courantologie et en météo, il est difficile de remettre en cause des éléments fournis par plusieurs services de l'Etat dont la crédibilité est reconnue. L'expérience a montré que ces prévisions étaient fausses, il conviendra donc, dans le cadre de la mission de retour sur expérience, de dire pourquoi et comment on peut y remédier.
En ce qui concerne une éventuelle amélioration de la coordination, je pense que l'on peut et que l'on doit faire mieux. Mais je n'ai pas, de mon ministère, une vision complète et exhaustive de la situation ; vous serez mieux placés que moi pour apprécier cette situation, puisque vous aurez entendu tous les intéressés.
Du point de vue de mon ministère, nous avons souffert d'être sollicités sur de très nombreux sujets pour lesquels nous n'avions ni compétences réelles, ni moyens d'intervention réels. Nous avons énormément souffert d'être confrontés à une attente de présence territoriale forte alors que ce ministère ne dispose pas de direction départementale de l'environnement. Comment être visible sur le terrain, avec la casquette du ministère de l'environnement, alors que, dans les régions concernées, nous n'avions que quelques dizaines d'agents tout au plus ! C'est une réelle difficulté, à la fois pour assurer cette présence de proximité souhaitée par les élus et les acteurs de terrain et pour faire remonter les informations.
L'expérience a montré que les services de l'Etat présents sur le terrain n'avaient pas une culture écologique et environnementale qui leur permettait de transmettre en temps et en heure des informations qui nous auraient été utiles. L'expérience a montré aussi que certaines questions ont été posées, alors qu'elles ne l'avaient jamais été par le passé. Je pense notamment à la question de savoir s'il fallait ou non autoriser l'entrée d'eau dans les étiers des marais salants. L'Agence de sécurité sanitaire des aliments était parfaitement capable de nous donner des valeurs guides de concentration d'hydrocarbures dans le sel. Mais comment traduire une donnée sur un produit fini en termes de normes sanitaires, en préconisations opérationnelles pour les acteurs économiques qui se demandaient s'ils pouvaient faire entrer de l'eau.
Il s'agit de questions pour lesquelles on tâtonne un peu ; mais cela ne veut pas dire que l'on ne fait pas notre travail. On cherche à étayer les impressions, les intuitions, par la collecte d'un maximum d'informations et par de très nombreuses rencontres avec les acteurs de terrain.
En ce qui concerne TotalFinaElf, j'ai été la première à rencontrer M. Desmarest le 28 décembre pour le mettre en face de ses responsabilités. Ce jour-là, il éludait encore beaucoup en me disant de m'adresser au FIPOL à qui il payait ses cotisations d'assurance, en refusant toute responsabilité. Il est évident que l'on devra faire évoluer le régime de responsabilité pour que le propriétaire de la cargaison assume les siennes. Cela fait d'ailleurs partie des propositions annoncées par la France dans les trois Mémorandums envoyés à l'Organisation maritime internationale, au FIPOL et à la Commission européenne.
Enfin, quant à votre proposition d'instaurer un système de gardes-côtes, je retiens du rapport de la commission d'enquête qui avait été élaboré à la suite du naufrage de l'Amoco-Cadiz et de ma visite un Suède un élément : peu importe que le système soit militaire ou civil, ce qui compte c'est que les moyens soient dédiés à la lutte contre les pollutions marines, et notamment contre les pollutions par hydrocarbures.
Un des mes collaborateurs, ironiquement, a pointé le fait que l'on trouvait scandaleux qu'un pétrolier affrète un bateau de 24 ans, alors même qu'il s'agit de l'âge des Abeilles ! Vous savez comme moi qu'un programme important d'investissements est prévu pour remettre à niveau ces bateaux.
M. Pierre HERIAUD : Madame la ministre, je ferai tout d'abord une remarque, qui sera peut-être suivie d'une question, puis, je vous demanderai une précision sur un chiffre donné tout à l'heure en matière de préjudice.
Ma remarque concerne l'impréparation du plan POLMAR terre. Quand en juillet 1999, ce plan a été mis en révision, alors qu'il datait de 1985, et qu'étaient convoqués le banc et l'arrière-banc de tous les services administratifs de l'Etat, les sapeurs-pompiers, etc., les maires n'étaient pas présents. J'y étais simplement invité en tant que représentant des maires du littoral. Je me suis permis d'insister pour que, dans les commissions que nous mettons en place actuellement, les maires soient représentés, car s'il arrivait une nouvelle catastrophe, ce sont bien eux qui seraient concernés directement sur le terrain et qui auraient à savoir, en fonction des productions ostréicoles, ce que l'on transfère et quels sont les sites de repli.
Malheureusement la catastrophe de l'Erika s'est produite avant que le plan POLMAR terre soit totalement révisé.
Tout le monde sait que pour atteindre un objectif, il faut une bonne préparation. Demain, à 15 heures, vous êtes informée d'un nouveau naufrage, avez-vous la conviction que tous les services sont prêts à coordonner leurs efforts pour que tout se déroule bien et de façon différente de ce qui s'est passé à partir du 26 décembre ?
En ce qui concerne le chiffre de 300 millions de francs pour le préjudice subi
- vous avez parlé de celui des pêcheurs à pied, mais il doit concerner également les ostréiculteurs -, je souhaiterais avoir des précisions sur le montant du préjudice - les méthodes d'évaluation - et sur les modalités de réparation.
M. Léonce DEPREZ : Je suis de ceux qui ont posé de nombreuses questions écrites au ministre de l'environnement à propos de la pollution en mer, et vous aviez répondu que la difficulté résidait dans le contrôle de ceux qui polluaient. On vient d'en faire la douloureuse expérience.
Le problème de la pollution est un problème général qui ne se limite pas aux marées noires. C'est un problème qui demande une autorité politique qui ne s'exprime pas aujourd'hui. Or l'Union européenne ne montre pas sa volonté d'aboutir à une autorité politique capable de faire respecter une discipline en mer. Je soulève cette question, car en prenant la présidence de l'Union, la France a l'occasion de faire avancer les choses en ce domaine.
Second point, la situation du Pas-de-Calais : nous allons, je le crains, vers une catastrophe qui sera encore plus grave que celle de l'Erika. Le moment n'est-il pas venu de discipliner les cheminements maritimes pour les transports de pétrole et de produits toxiques ? Allons-nous pouvoir continuer à tolérer en Manche un trafic qui bat les records du monde ? Ne devrions-nous pas instituer des règlements au niveau européen visant à interdire les transports de pétrole et de produits toxiques par le Pas-de-Calais, compte tenu des risques de collision qui sont beaucoup plus importants qu'ailleurs ?
Mme Dominique VOYNET : Vous posez des questions dont vous savez qu'elles excèdent mon champ de compétences ministérielles en espérant que, nature et sincère comme je dois l'être devant une commission d'enquête, je mettrai en difficulté certains de mes collègues ! Je vous invite à poser ces questions aux personnes qui sont en charge de ces secteurs. Comment voulez-vous que j'aie une connaissance précise et exhaustive de tous les cheminements maritimes ? Je sais que le rail du Pas de Calais existe, qu'il est très utilisé, qu'il y a une voie amont et une voie aval. Et c'est d'ailleurs en intervenant préventivement que la préfecture maritime et les CROSS font la preuve quotidienne de leur efficacité et de leur utilité, car pour un bateau qui coule et qui pollue, comme l'Erika, nombre de catastrophes sont évitées. Je pense que Jean-Claude Gayssot serait plus précis et complet sur cette question.
L'Union européenne a été interpellée par le Mémorandum du gouvernement français, et je dois dire que nous avons été agréablement surpris de la réaction rapide de la commissaire européenne en charge des transports, Mme de Palacio ; au-delà de l'émotion, au-delà de l'interpellation dans l'urgence, il faudra veiller à ce que nos partenaires européens traduisent dans les faits leur engagement.
Vous avez insisté sur la difficulté de contrôler les activités polluantes. Après avoir admis la philosophie largement partagée dans mon ministère qui consistait à dire que plutôt que de réclamer la mise en place de directions départementales de l'environnement, il fallait chercher à convertir aux bienfaits du développement durable et à la culture environnementale les directions départementales de l'agriculture, les directions départementales de l'équipement, les DDASS, etc., je ressens de plus en plus le besoin de disposer d'agents de l'environnement sur le terrain, non seulement pour exercer les missions traditionnelles de ce ministère, mais également pour renforcer les moyens du contrôle effectif du respect de la législation, la mise en place d'une police de l'environnement, au-delà des efforts concédés aujourd'hui par la gendarmerie nationale pour former des agents dans la constatation d'infractions dans ce domaine.
Je prends note de la demande, qui me paraît légitime, des maires dans la phase de révision des plans POLMAR. J'ai noté « trop nombreux plans » : c'est une plainte lancinante des préfets qui critiquent le fait que chaque ministère, chaque administration élabore ses demandes de planification, de préparation. Nous sommes confrontés à de très nombreuses tâches de ce genre, d'élaboration de zonages, de schémas, de plans, etc., avec de vraies difficultés liées à la mise en cohérence de ceux-ci et à la nécessité de les réviser régulièrement. Mais nous veillerons à ne pas rajouter des outils inutiles mais plutôt à mieux utiliser les outils existants.
Si une nouvelle catastrophe se produisait demain, je pense que nous aurions gardé la mémoire de ce qui s'est passé et nous veillerons à être plus efficaces encore, notamment pour éviter certaines erreurs, notamment en ce qui concerne les méthodes d'intervention sur le terrain. Il va de soi que les décisions qui ont été prises lors du CIADT n'ont pas encore toutes porté leurs fruits : les décisions d'achat de nouveaux avions et bateaux, les créations de postes, etc.
En ce qui concerne l'évaluation du préjudice, le travail est plus dur qu'il n'y paraît et très inégal dans sa complexité selon les secteurs. S'agissant des pêcheurs et des conchyliculteurs, l'OFIMER accorde des avances remboursables de 50 % du préjudice subi, avec un plafonnement de 200 000 francs par dossier. Fin mai, 416 dossiers avaient été déposés correspondant à un préjudice déclaré de 23, 5 millions de francs ; 308 dossiers avaient été effectivement examinés pour un préjudice reconnu de 13, 6 millions de francs, correspondant à un montant d'avances de 6,8 millions de francs. Six millions de francs avaient été effectivement payés.
Ces montants sont à comparer au préjudice total des pêcheurs et conchyliculteurs que le ministère de l'agriculture et de la pêche estime à environ 200 millions de francs. Nous sommes donc loin du compte, mais vous aurez noté que la plus grande partie des dossiers ont été traités - en général les petits dossiers ; le gros du préjudice correspond donc plutôt aux dossiers qui seront présentés ultérieurement. Ceux qui peuvent attendre l'indemnisation du FIPOL n'ont pas forcément utilisé le dispositif de l'OFIMER.
Pour les collectivités, la quasi-totalité des dépenses engagées sont éligibles au fonds POLMAR. Je n'ai pas une évaluation au jour le jour de ce qui a été engagé, mais la totalité des sommes qui avaient été débloquées avant le collectif budgétaire ont été engagées et déléguées aux préfets.
Quant au tourisme - c'est là que se situe la difficulté -, les chiffres les plus fantaisistes circulent et les éléments d'appréciation de la perte d'attractivité et de la baisse des fréquentations sont encore largement débattus. Je ne voudrais pas généraliser de façon hâtive, mais je peux vous dire, pour en avoir discuté pas mal avec les acteurs locaux, que les éléments sont très contrastés à ce jour. Il semblerait que la fréquentation des Français, notamment des régionaux, soit maintenue voire plus forte qu'on ne l'attendait, mais qu'en revanche il y ait une baisse des réservations internationales.
La solidarité nationale va-t-elle compenser la baisse des réservations émanant de l'étranger ? A cette date, on pourrait presque affirmer que c'est le cas ; bien entendu, on ne pourra en être sûr qu'à l'issue de plusieurs saisons touristiques. Une mission du ministère de l'économie et des finances et du secrétariat d'Etat au tourisme doit rendre compte, dans les prochains jours, des efforts pour évaluer le préjudice, puisqu'il s'agit d'avoir le maximum d'éléments avant la prochaine réunion du comité exécutif du FIPOL prévue pour le 3 juillet.
Par ailleurs, la mise en place d'un dispositif d'avances similaire à celui de l'OFIMER a été convenu pour les professionnels du tourisme, mais, à cette heure, il n'est pas encore opérationnel. Je ne sais pas quels sont les chiffres que l'on peut avancer : il est dit qu'une baisse de 15 % de la fréquentation correspondrait à une perte de 3 milliards de francs. La marge d'incertitude est importante et si l'on veut être sérieux, on ne donne pas de chiffre.
En ce qui concerne l'environnement, je vous l'ai dit, on ne pourra pas dresser un bilan complet avant plusieurs années, et compte tenu du fait que le FIPOL ne prévoit pratiquement pas l'indemnisation du préjudice écologique, on sera sans doute amené à compter essentiellement sur les moyens nationaux pour faire face en la matière.
Je n'ai pas envie de laisser tomber ce sujet pour autant, parce qu'il est essentiel, pour l'avenir, que le FIPOL prenne en compte ces dégradations du patrimoine et intègre le préjudice écologique dans ses grilles d'indemnisation.
M. François CUILLANDRE : Je voudrais revenir, madame la ministre sur le rôle des Abeilles. Nous avons parlé du drame de l'Erika, mais pour un drame qui se produit, de nombreux autres sont évités grâce notamment au rôle joué par ces remorqueurs. Le contrat des Abeilles est en train d'être renégocié, mais personne ne peut dire aujourd'hui quelle société enlèvera le marché, à la suite de l'appel d'offres.
Cependant, il serait totalement incompréhensible et inadmissible que pour des économies qui globalement, en bout de course, lorsqu'une catastrophe se produit, seraient des économies de bout de chandelles, ce marché puisse être confié à une société qui ne présenterait pas toutes les garanties - je ne fais pas là le parallèle avec le marché de l'Abeille Supporter.
M. le Rapporteur : Madame la ministre, je voudrais vous faire part d'un ou deux points techniques qui ne fonctionnent pas. Tout d'abord, s'agissant du plan POLMAR, savez-vous que les communes qui n'ont pas bénéficié de l'aide d'autres communes en personnels et en matériels, ne sont pas remboursées par le plan POLMAR - alors que celles qui ont apporté leur aide le sont ? La commune concernée aurait donc eu intérêt à ne rien faire et à utiliser les moyens des autres communes ! D'ailleurs si une autre catastrophe de ce type se produit, il est certain que les maires concernés ne bougeront pas ! Je sais bien que vous n'êtes pas directement concernée puisque c'est Bercy qui supervise, mais vous êtes gestionnaire des fonds.
Ensuite, vous avez parlé de la BDPME, mais le dispositif n'est toujours pas au point ! Je n'exclus donc pas d'inviter le patron de la BDPME devant cette commission afin de savoir ce qui bloque.
Nous souhaiterions par ailleurs pouvoir bénéficier de vos réflexions à la suite du dernier CIADT, avant de publier le rapport de la commission. De la même manière, pouvez-vous nous donner des informations plus précises, avant la fin du mois de juin, sur la zone de protection écologique de la Méditerranée - ou du moins votre problématique.
Mme Dominique VOYNET : Peut-être aurez-vous le temps d'auditionner le fonctionnaire chargé de préparer ce rapport, afin qu'il puisse vous commenter un travail qui n'est pas totalement finalisé. Cette méthode est certainement atypique, puisque ce travail est effectué sous la responsabilité du ministre par ses fonctionnaires et qu'il n'est pas public, mais je ne verrais aucun inconvénient à cette audition.
En ce qui concerne la problématique de la Méditerranée, je vous ferai passer les documents nécessaires : les éléments techniques sur la localisation de cette zone, les éléments juridiques qui fondent la mise en place de cette zone de protection, etc. Je trouve également indispensable de vous donner des éléments plus complets sur les mesures décidées lors du CIADT ; certaines sont déjà en place, d'autres en préparation, notamment celle qui concerne l'avenant au contrat de plan.
Audition de M. Georges TOURRET,
directeur du Bureau enquêtes-accidents-mer,
et de M. Jean-Louis GUIBERT,
secrétaire général de l'Institut français de navigation
(extrait du procès-verbal de la séance du 7 juin 2000)
Présidence de M. Daniel PAUL, Président
MM. Georges Tourret et Jean-Louis Guibert sont introduits.
M. le Président leur rappelle que les dispositions législatives relatives aux commissions d'enquête leur ont été communiquées. A l'invitation du Président, MM. Georges Tourret et Jean-Louis Guibert prêtent serment.
M. Georges TOURRET : Comme nous l'avions fait lors de notre première audition, nous allons essayer de vous répondre de façon concertée dans les deux approches que nous avons poursuivies : à qui avons-nous affaire, et à quoi avons nous affaire ?
Je répondrai sur ce qui concerne les personnes et le fonctionnement de l'exploitation de l'Erika. M. Jean-Louis Guibert répondra sur ce qui concerne le navire, ses faiblesses, les contraintes qu'il a subies et le déroulement des opérations.
Par rapport à notre première audition, nos travaux ont avancé de la façon suivante : dans une première phase, nous avons approfondi les sources d'informations dont nous disposions quant au propriétaire, au gestionnaire et quant à l'ensemble de l'opération et du comportement de chacun ; la deuxième phase, à laquelle nous avons consacré l'essentiel de nos travaux, a consisté à baser notre réflexion sur des éléments factuels, et nous pensons être les seuls, pour le moment, à avoir agi de cette façon.
De ce fait, nous avons tout d'abord commandé à l'Institut de recherche de la construction navale - IRCN -, une série de calculs quant aux contraintes supportées par le navire, par rapport à son échantillonnage tel qu'il était annoncé. Les conclusions que nous pouvons en tirer vous seront exposées, mais à titre provisoire, car ces calculs ne sont pas terminés et nous avons introduit un certain nombre d'hypothèses supplémentaires.
Ensuite, nous nous sommes attachés à obtenir des éléments factuels et matériels, quant à l'état du navire lui-même. Je vous ai apporté, à titre d'exemple, des débris informes provenant de l'Erika, qui sont représentatifs d'un certain degré de corrosion apparent. Ces débris ont simplement une valeur d'exemple car il est très difficile de localiser leur emplacement exact dans le bateau et d'en tirer les conséquences par rapport à la structure. Nous avons un autre débris plus important, que nous avons fait analyser par un laboratoire d'Etat, le laboratoire central des Ponts et Chaussées. Cette analyse porte sur un fragment, mais elle indique un certain nombre de résultats qui vous seront exposés.
Enfin, notre attention a été appelée sur la mise en cause du fonctionnement des services de l'Etat dans l'organisation de la surveillance, puis dans l'alerte. Nous avons repris et approfondi tout ce que nous avions fait sur ce sujet, et là aussi, nous vous dirons pourquoi nous ne modifions pas de façon sensible les premières conclusions que nous vous avions exposées en janvier, sur le rôle de tout un chacun.
Voilà globalement les paramètres. Je vous propose maintenant de répondre à vos questions.
M. le Rapporteur : Pouvez-vous tout d'abord exposer les observations dont vous venez de parler ?
M. Georges TOURRET : Je propose de vous dire à peu près où nous en sommes dans les résultats partiels des calculs de l'IRCN, et de vous communiquer les premiers résultats donnés par le laboratoire central des Ponts et Chaussées concernant la mesure de corrosion sur un élément.
M. le Président : Les quatre points que vous avez exposés rejoignent les préoccupations principales.
Quid de la propriété du navire ? A la lecture de la presse, ce matin, il reste encore une nébuleuse autour de l'Erika. Avez-vous pu pénétrer plus avant cette nébuleuse ?
Ensuite, s'agissant de la fracture qui s'est produite, la presse a parlé de la mise en cause des uns et des autres. On nous a dit que le bateau fuyait avant son naufrage : y a-t-il eu fracture auparavant ? La fracture a-t-elle été brutale ou s'est-elle réalisée progressivement ? Il faut que nous ayons un certain nombre de réponses à ces questions.
M. Georges TOURRET : M. le président, nous sommes très prudents dans les problèmes d'analyse. Nous avons identifié, dès le départ, les problèmes comme étant des problèmes de structure. Tout ce que nous avons recueilli depuis ne nous a pas contredit. Vous posez une question très précise, mais nous sommes beaucoup plus prudents, puisque la phase de calcul est en cours. Nous avons établi deux protocoles de calculs qui vous seront exposés.
Au préalable, je vais répondre à votre première question sur la propriété et la gestion du navire.
La propriété du navire, comme je vous l'avais dit la dernière fois, a été revendiquée explicitement par M. Giuseppe Savarese. Nous avions affaire à une nébuleuse d'entités difficilement identifiables, qui toutes, fin décembre-début janvier, déniaient être les propriétaires de ce navire. Aujourd'hui, nous avons une personne indiquant être le propriétaire.
Il est vrai que nous nous posions la question de savoir si M. Savarese était engagé directement ou s'il y avait d'autres entités derrière. Lors de notre dernière rencontre, je ne vous ai pas laissé ignorer, qu'officiellement, Tevere Shipping n'est pas la propriété de M. Savarese, mais celle de deux autres sociétés libériennes installées au Liberia, dont nous avons les coordonnées. Nous avons demandé à notre ambassade du Liberia de faire une investigation auprès du registre de commerce de ce pays afin de savoir qui se trouve derrière.
Nous avons donc aujourd'hui quelqu'un qui nous dit être l'armateur, mais entre-temps, un certain nombre d'interrogations sont nées sur le fait que ce ne soit qu'une couverture, et qu'il y ait d'autres intérêts derrière.
Au niveau de nos possibilités, nos moyens d'investigation s'arrêtent à un moment donné. Nous ne sommes pas un service d'investigation de sources non ouvertes et je crois que nous nous heurtons, de ce côté là, à un mur.
D'autant que le problème se mélange avec celui lié à la gestion du navire lui-même. Le navire est géré par deux entités : une principale et l'autre déléguée. La première est Panship, à Ravenne. Nous en avons rencontré les responsables. Dans le cadre du code ISM - International Safety Managment -, cette société est la « personne désignée » pour organiser les réponses d'urgence à terre.
Par ailleurs, cette personne a délégué le soin de recruter l'équipage à Herald Maritime Services, à Bombay. Herald Maritime Services est engagée dans un bras de fer avec Panship et M. Savarese, en raison d'un contentieux financier important sur des factures de main-d'_uvre non réglées par le propriétaire-gestionnaire du navire au fournisseur de main-d'_uvre. Il y a donc des déclarations très complexes de la part des gestionnaires de l'équipage, Herald Maritime Services : ces déclarations sont certainement influencées par la possibilité ou non de recouvrer leur créance.
Il est apparu que l'ensemble constitué par M. Savarese, Panship, les autres parties prenantes, y compris l'affréteur à temps, la société Bahamo-helvétique dénommée Selmont et l'agent maritime Amarship installé à Lugano, était un bloc difficilement dissociable. Afin d'éviter toute polémique et toute interprétation inutile, je me demande si nous n'allons pas globalement les désigner collectivement comme étant « les armateurs ». A charge, ensuite, pour les juridictions compétentes qui auront à traiter des responsabilités pénales ou des responsabilités civiles, de séparer le bon grain de l'ivraie. C'est effectivement une nébuleuse très difficile et nous avançons prudemment, car il est clair que les entités en question ne sont pas sans défense par rapport à leur propre image de marque.
En résumé, il y a un bloc que l'on va nommer « les armateurs », et un bloc que l'on va nommer « les affréteurs », car là aussi, la complexité est importante entre Total-Raffinerie et Total-International installé aux Bermudes ou à Londres.
Est-ce que cela modifie beaucoup notre réflexion ? Il nous a semblé finalement que ce n'était pas directement influent par rapport aux propositions que nous pourrions faire. Nous avons au moins une certitude : celle qu'il y a bien une seule société de classification. Une seule entité s'est occupée techniquement du navire pour en contrôler l'état par délégation, soit de l'armateur, soit de l'Etat du pavillon, et c'est effectivement le RINA.
M. le Rapporteur : Ceci étant, par rapport à ce que vous avez dit la dernière fois, il y a des éléments nouveaux dans la chaîne des sociétés liées à l'armateur, ce que vous appelez le « paquet armatorial ». Pouvez-vous nous parler des deux sociétés dont vous venez de faire état ?
M. Georges TOURRET : Les sociétés libériennes ?
M. le Rapporteur : Nous savions que Tevere Shipping était constitué de deux entités libériennes. Ma question concerne les deux autres sociétés dont je n'avais jamais entendu parler.
M. Georges TOURRET : Le contrat à temps de Total était bien conclu avec Selmont. C'est une société des Bahamas, constituée il y a longtemps, et dont l'unique actif, au moment des faits, était précisément l'affrètement de l'Erika.
Les informations qui tombent de tous côtés n'ont pas forcément éclairé notre lanterne. La situation étant tellement complexe, je ne suis pour l'instant pas en mesure de démêler l'écheveau des conditions dans lesquelles l'Erika a été acquis ni celui de sa situation patrimoniale exacte. Je n'irai pas plus avant, car cela n'ajouterait rien par rapport au travail que M. Guibert, les experts et moi-même faisons. Il est clair que nous sommes en face d'une responsabilité émiettée. De nombreux partenaires interviennent, et quelques éléments nautiques seulement viennent se greffer sur cette situation.
M. le Président : C'est un élément important. Pour nous, il y a évidemment des leçons à tirer : c'est la mission de la commission d'enquête. Il apparaît bien que ce genre de travail est rendu plus difficile par la situation d'une partie - je dis bien d'une partie seulement - du transport maritime, qui, au fil des dernières années, a progressivement cassé les réseaux et mis en place une nébuleuse.
Nous pourrions préconiser aux autorités maritimes internationales, voire aux autorités politiques de la Commission européenne, d'exiger le maximum de transparence.
Je suppose que l'enquête judiciaire en cours se heurte également au même problème que vous. Compte tenu d'autres expériences, nous ne sommes pas certains que derrière cette nébuleuse, il n'y ait pas d'autres intérêts, d'autres problèmes qui se cachent. Force est de constater que l'on touche probablement ici à des hommes qui ne sont plus tout à fait dans une légalité parfaite.
M. Georges TOURRET : Je me garderai bien de dire le moindre mot sur la légalité de ceci ou de cela.
Comme nous l'avons écrit dans le rapport annuel que nous avons fait parvenir à votre commission, nous avons rencontré plusieurs fois ce problème de la dispersion des responsabilités. A l'occasion de sinistres maritimes concernant des navires de commerce battant des pavillons de libre immatriculation, nous nous sommes trouvés plusieurs fois devant des gens qui disaient ne pas connaître l'armateur et n'être que ses agents. A cet égard, nous avons des difficultés. Nous les avons eues sur les cargos de Port la Nouvelle, et sur un autre navire qui avait fait naufrage dans l'océan Indien.
Nous devons donc tirer des conclusions en termes de sécurité. A cet égard, le code ISM a prévu quelque chose de relativement clair. Par rapport aux normes établies et aux questions d'urgence en situation de crise, il doit y avoir une personne désignée, c'est à dire quelqu'un qui porte la responsabilité.
A tous égards, mais c'est une piste que nous avons en tête, le système en question conduit à sous-traiter la responsabilité. Les propriétaires sont les véritables décideurs économiques de l'entreprise. L'armateur va déléguer sa responsabilité dans le cadre d'un contrat commercial, à une personne - le shipmanager -, qui va porter la responsabilité effective, moyennant rémunération.
Je n'ai pas d'idée sur ce sujet : cette question de responsabilité déléguée par un acte de commerce se retrouve probablement dans d'autres secteurs d'activité. Dans le secteur du transport maritime, c'est une situation préoccupante dans laquelle, à un certain niveau de discussion avec la personne désignée, celle-là nous dit que ce n'est plus elle, mais quelqu'un d'autre qui est concerné. Et ainsi de suite.
Il faut reconnaître qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus dans le cas de figure de l'armateur unitaire, comme pouvaient l'être les frères Pereire. Nous estimons, au terme de l'analyse, que cette dilution, cet éclatement ne contribuent pas forcément à la sécurité.
Sur ce point précis, je voudrais vous dire comment, du côté de la personne désignée, s'est passé l'après-midi du 11 décembre 1999. La personne désignée, en l'occurrence, a été alertée assez vite par son commandant. Ceci a été fait à travers une ligne de message dont le contenu n'est pas tout à fait le même que celui que le commandant a adressé aux autorités à terre. Mais le principal problème de la personne désignée a été de contacter toutes les autres parties prenantes au processus décisionnel. Cela lui a demandé un tel délai qu'elle n'a pas eu le temps de contacter les services de l'Etat effectivement chargés de l'opération.
La personne désignée a commencé par prévenir le propriétaire, l'assureur corps, le P & I, l'agent maritime du disponent owner qui a prévenu lui-même l'armateur disposant, et ainsi de suite. Finalement, la gestion de cette multiplicité d'intervenants, en situation de crise, est génératrice de circuits qui freinent la rapidité de réaction.
M. le Rapporteur : Voulez-vous dire que le code ISM devrait prévoir un dispositif, un code de conduite, permettant d'éviter que le transfert de responsabilités pour gérer les situations de crise aboutisse à la dilution de cette même responsabilité ?
M. Georges TOURRET : On peut difficilement dire, à partir d'un exemple - celui de l'Erika ou un autre -, que le système de l'ISM et de sa personne désignée moyennant finances est bon ou mauvais. Nous, enquêteurs du bureau-enquêtes-accident, nous travaillons dans la récurrence. C'est la principale différence entre le BEA-mer et une commission d'enquête technique, telle qu'elle pouvait être constituée précédemment. Cette dernière faisait son analyse, en tirait des conclusions et ne les inscrivait pas nécessairement dans un continuum historique. Nous allons nous efforcer de faire le contraire.
Nous sommes tombés a contrario sur une preuve de l'utilité de ce travail. Nous avons repris et observé finement l'analyse du sinistre du Tanio, en 1980. Très curieusement, nous avons trouvé qu'une grande partie des recommandations faites à l'époque, recoupait une partie de celles que nous allons faire. Il y a donc une récurrence.
Vous avez raison de poser la question, mais il nous faut plus de séries pour pourvoir répondre de façon fondée. Par exemple, s'agissant des mesures d'épaisseur, on ne va pas conclure, à partir de quatre morceaux dont nous disposons, que le navire était entièrement corrodé. Il en faudra un peu plus, significativement placés.
Nous souhaitons tout d'abord nous en tenir à des points factuels, puis à la mesure de la récurrence de tel ou tel type d'événement. Telle est notre démarche.
Nous pouvons aborder maintenant les problèmes relatifs aux calculs qui ont pu être faits. M. Guibert va vous exposer où nous en sommes et vous donner les compléments d'informations que vous pouvez souhaiter.
M. Jean-Louis GUIBERT : Avant d'aborder les calculs, j'aimerais préciser quelques points, ne serait-ce que parce qu'ils ont beaucoup trop défrayé la chronique.
Nous sommes tout d'abord revenus sur la chronologie des événements, depuis que nous avons commencé à savoir qu'il y avait quelque chose, jusqu'au naufrage lui-même.
Le rapport provisoire - et c'est normal, au bout d'un mois seulement après le naufrage -, ne se basait que sur la main courante du CROSS, c'est-à-dire uniquement sur les messages échangés entre le navire et la terre. Il est vrai que ces messages étaient assez peu nombreux, pour des raisons techniques que je vous avais exposées. En effet, au lieu de travailler en phonie, on a travaillé par télex, système beaucoup plus lent dans le processus d'exploitation. Sur cet aspect, il ne nous manquait pratiquement rien. Nous nous demandions cependant qui savait quoi et à quelle heure.
Il faut rentrer dans la deuxième série de messages, celle adressée par le navire à son armateur et qui, par le même truchement, donne les éléments à l'opérateur - Panship -, pour s'apercevoir que l'armateur avait en effet beaucoup plus d'informations. Les renseignements donnés étaient plus nombreux, plus précis. Mais à partir du moment où le commandant avait redressé son navire, son message était aussi rassurant pour son armateur que pour les autorités à terre. Ce message était du genre : « J'ai redressé mon navire et j'ai repris la situation en main ».
De ces deux séries de messages, il apparaît qu'entre le premier appel de détresse à 14 h 08, le samedi, et le naufrage, les informations sur tout ce qui s'est passé dans la journée - mouvements de ballast, déballastages, transferts de cargaison, fissures sur le pont - n'ont vraiment été connues du CROSS et, de facto, de la préfecture maritime, que le samedi à 23 h 30. C'est un point important.
Un élément perturbateur est intervenu à cause d'un troisième message. En fait, au moment où le navire a lancé son appel de détresse, il y avait plusieurs navires autour, dont un navire de guerre britannique qui a entendu le message et lui a demandé s'il avait besoin d'assistance, ce qui était normal. Et là, le bord répond : « J'ai une gîte importante, j'ai des fissures sur le pont, mais je redresse la situation et j'ai la situation en main ». Par conséquent, l'Erika informe le navire britannique qu'il n'a pas besoin d'assistance.
M. le Président : A-t-on cet enregistrement ?
M. Jean-Louis GUIBERT : Oui, nous avons cet enregistrement, mais nous ne l'avons connu et surtout interprété que très longtemps après, du fait de sa mauvaise qualité MHF. C'est le 10 janvier, en recevant une copie de la main courante du navire de guerre britannique qui n'avait rien dit aux autorités françaises, que l'on a pu lire ce message clairement. C'est important à signaler car cela entraîne beaucoup de conséquences par la suite.
M. Georges TOURRET : Nous pouvons vous le faire entendre.
M. le Rapporteur : Nous vous croyons sur parole.
M. Georges TOURRET : Il est difficile de l'écouter dans le détail en raison du crachotement et de l'accent indien, mais quelqu'un - le commandant ou l'officier de garde - dit : « My deck is cracked ». Nous l'avons écouté de nombreuses fois, et avons eu du mal à l'entendre puis à l'analyser. Notre surprise a été de lire dans la presse : « My deck is broken », ce qui n'a pas la même signification. Le message, tel qu'il est retranscrit dans la main courante, dit bien que le pont est « cracked », ce qui ne veut pas dire qu'il a craqué, mais qu'il est fissuré.
M. Jean-Louis GUIBERT : Le deuxième point que j'aimerais aborder à titre liminaire est le suivant : on a essayé de replacer le rôle des CROSS et des préfectures maritimes dans ce genre d'opérations.
Deux CROSS sont intervenus : le CROSS Corsen et le CROSS Etel.
La zone de responsabilité du CROSS Corsen s'étend depuis le Mont Saint-Michel jusqu'au parallèle de Penmarc'h. Jusqu'à preuve du contraire, il s'est contenté de recevoir le compte rendu de navire du passage de l'Erika, lors de son entrée dans le dispositif de séparation du trafic couvert par son radar. Le navire est passé normalement et sans signalement d'avarie. Il n'y a pas donc pas de signalement d'avarie au passage à Corsen et dans le rail descendant. Après le passage du parallèle de Penmarc'h, le bateau est sorti de la zone de compétence de Corsen, dont le rôle principal est la surveillance de la circulation maritime, puis le sauvetage et la surveillance des pêches.
L'Erika est ensuite rentré dans la zone d'Etel : c'est pratiquement tout le golfe de Gascogne jusqu'à la limite avec les Espagnols. Le rôle du CROSS d'Etel est plus axé sur le sauvetage en général, y compris hors de ses limites puisqu'il est le correspondant international des autres centres de sauvetage à travers le monde, puis la surveillance des pêches. Ce sont là ses deux missions fondamentales. L'aspect circulation maritime n'est pas tout à fait dans ses habitudes, d'autant qu'il n'a pas de radar. Il faut savoir qu'un radar côtier porte à 30 milles nautiques, soit environ 55 km. Tant que le navire n'est pas dans le rayon de ce radar - et même si l'on avait comme d'aucuns le suggèrent une couverture radar tout le long de la côte atlantique -, cela ne donne pas grand-chose pour ce genre d'accident. Il s'agit là d'une réponse qu'il faut faire en tant que de besoin.
Etant dans la zone d'Etel, c'est le CROSS Etel qui reçoit l'appel de détresse, le message de 14 h 08, et qui le traite comme une affaire de sauvetage par la mise en alerte des moyens, notamment pour le sauvetage des personnes si cela s'avérait nécessaire.
Dans les faits, il y a d'abord un accusé de réception du message. Ensuite, on s'assure qu'il s'agit bien d'une détresse en demandant des précisions. Pour ce type de transmission d'alerte, il existe à peu près 90 % de fausses alertes. C'est la raison pour laquelle il y a un délai supplémentaire afin de s'assurer du bien-fondé de l'alerte.
Si l'on considère la durée du message, le temps de la transmission et de la vérification, à la question « où en êtes-vous », on se trouve environ une demie heure plus tard avec la réponse suivante : « J'ai une gîte, mais je reprends la situation en main, et ne demande plus assistance ». Là aussi, il s'agit d'une précision importante. Il était alors 14 h 34. Vous voyez que c'est très rapide.
La question se pose de savoir quelle suite on doit donner après un appel de détresse de ce genre. Le problème est simple : vous avez une tempête de force 9-10 sur le golfe de Gascogne ; vous avez une dizaine d'opérations de sauvetage en cours, la plupart concernant des navires de plaisance, mais l'une d'entre elles posant des problèmes au préfet maritime depuis près de 24 heures dans le golfe de Saint-Nazaire - le Maria K. Par conséquent, dans le cas où quelqu'un dit qu'il ne demande plus assistance, le réflexe est de penser que c'est une affaire à mettre de côté et qui ne nécessite pas l'urgence. On reste en veille, mais sans plus.
Les informations sont transmises à la préfecture maritime en temps réel. La préfecture maritime est elle-même pourvoyeur de moyens, puisque les opérations de sauvetage sont coordonnées par les CROSS, sous la responsabilité du préfet maritime, mais avec délégation permanente. La situation est la même, on reste en stand-by avec un Atlantique et un Super Frelon à une heure de décollage.
Ceci a duré jusque dans la soirée, où l'on apprend qu'un certain nombres d'événements sont advenus sur le navire. On apprend qu'à 23 h 30, le navire a eu de la gîte, qu'il a effectué un certain nombre de mouvements de ballast, et qu'il rallie le port de Donges. On a eu du mal à lui faire dire vers quel port de refuge il se dirigeait, au point que l'on avait envisagé que cela pouvait être La Corogne. Dans cette hypothèse, le navire aurait peut-être mieux épaulé la mer. Je pense néanmoins que le port de La Corogne, compte tenu des ennuis de pollution qu'il a rencontré par le passé, aurait posé des problèmes pour accueillir l'Erika.
Il s'est donc adressé au port de Donges, qui n'a pas refusé de l'accueillir, mais a simplement dit qu'en cas de fuite, il considérerait à nouveau la question et prendrait ses responsabilités à ce moment-là.
Par conséquent, le CROSS, à 23 h 30, informe l'officier de permanence de la préfecture maritime sur le fait que le navire va trouver refuge dans le port de Donges. L'officier de permanence de la préfecture maritime va lui-même attendre l'évolution de la situation.
Il faut savoir que les CROSS constituent l'oreille des préfets maritimes. Ils ont une couverture VHF et MHF qui correspond aux obligations du SMDSM - système mondial de détresse et de sécurité maritime. Ils sont les seuls à pouvoir correspondre et communiquer avec les navires de commerce. Le COM - centre opérationnel de la marine - n'a pas ces moyens. Il n'a des moyens de communication qu'avec la Marine nationale. Tout ce qu'entend le CROSS est répété au COM, mais celui-ci ne peut ni vérifier ni entrer dans le dialogue. Le dialogue se fait entre le navire et le CROSS, puis entre le CROSS et la préfecture maritime.
Voilà les précisions que je souhaitais apporter.
S'agissant des éléments techniques pris en considération depuis notre première audition, nous avons surtout lancé une série de calculs indispensables. Nous avons noté qu'aucune autre commission d'enquête technique n'avait pratiqué ces calculs, sauf celle du RINA, dont le rapport a défrayé la chronique.
Nous avons effectué des calculs et analysé des échantillons.
Concernant les échantillons, nous disposons de ce que l'on appelle une lisse ou une serre, c'est à dire un renfort longitudinal assez long qui renforce les parois du navire, les murailles, le pont, les fonds et la cloison longitudinale qui se trouvait entre le ballast n°3 et la citerne n°2. Ces renforts étaient fortement corrodés, et avaient eu des problèmes de travaux en 1998.
Un renfort, retrouvé par un pêcheur, a été soumis à examen, et a pu être situé dans le plan du navire. Il se trouvait dans la citerne n°2. L'analyse révèle une corrosion de l'ordre de 30 % de la semelle - la partie plate - du fer, en L, et de 45 % pour l'autre partie. Autrement dit, nous avons bien la preuve que la corrosion, à l'intérieur de ce compartiment, s'était développée de manière extrêmement importante. Nous espérons obtenir quelques éléments supplémentaires et nous pensons aboutir à peu près aux mêmes chiffres.
Ce n'est donc plus une corrosion de 10 % telle qu'annoncée par les relevés d'échantillonnages effectués par le RINA en 1998. En effet, une corrosion de 10 % est normale pour un navire de 25 ans et permet de passer dans les limites de résistance de la poutre navire. A plus de 30 %, nous avons là des éléments qui, à défaut d'être totalement probants, sont très indicatifs.
M. le Rapporteur : Est-il est envisageable d'arriver à une dégradation aussi rapide entre 1998 et fin 1999 ?
M. Jean-Louis GUIBERT : Oui, absolument. Cette citerne qui n'était pas, de prime abord, dédiée au ballastage, ne l'a été officiellement et techniquement que lors des réparations de 1997. Depuis deux ans, deux citernes étaient uniquement dédiées à cette eau de mer de ballastage, ou au vide, et soumises aussi à la température et à cette corrosion envahissante.
Tous les experts s'accordent à reconnaître que faute d'entretien et de protections suffisamment efficaces, les pertes d'échantillonnage peuvent atteindre en six mois les 25 à 30 %. Le commandant Mathur l'avait constaté dans le cadre des visites qu'on lui avait demandé d'effectuer tous les six mois et ce n'est pas pour rien que Panship elle-même avait demandé d'effectuer ce type de visites tous les six mois. Le seul problème est que l'on voit relativement peu de choses dans ce genre de circonstances. De visu, le dernier expert du RINA, qui est passé en novembre 1999, soit un mois avant l'accident, a relevé un nombre d'éléments suffisants pour dire qu'il faudrait refaire des mesures d'échantillonnages avant le mois de janvier, notamment dans un ballast qui avait été vérifié un an auparavant. Il y avait donc quand même quelque chose d'assez indicatif.
Dans les calculs, nous avons observé un échantillonnage diminué de 12 à 13 %. Si l'on ajoute l'effondrement de la cloison, on atteint entre 16 et 23 %, donc des limites assez importantes.
Nous avons demandé à l'IRCN de calculer toutes les situations du navire, depuis le départ de Dunkerque jusqu'à l'arrivée dans le golfe de Gascogne : avant la gîte, avec la gîte, puis avec chacun des mouvements effectués parfois mis en cause. Le résultat des calculs révèle qu'une fois tous les mouvements effectués, dans la fin de soirée du samedi, d'une part, le déballastage a fortement diminué le moment fléchissant dans la région centrale du navire - ce qui est quand même important car c'est elle qui fatigue le plus -, et d'autre part, dans tous les cas, les efforts calculés demeurent inférieurs aux efforts admissibles.
Ceci est cohérent avec notre hypothèse, quant à l'origine de l'accident, qui est la rupture au moins partielle de la cloison longitudinale entre la citerne n°3 et le ballast n°2. Pour nous, ceci explique la gîte prise le samedi après-midi, et qui a fait l'objet de l'appel de détresse de 14 h 08.
Nous avons également fait vérifier les contraintes, et notamment celles dues à la vitesse.
Pour la vitesse, c'est du calcul : pour le navire avec le maximum de mer et de houle sur l'avant, on compare à vitesse nulle et à vitesse de 6,8 n_uds, qui est à peu près la vitesse que le navire avait compte tenu de la météo. On s'aperçoit que l'on a un tangage un peu plus important et un effet d'accélération verticale un peu plus grand à 6,8 n_uds.
En revanche, on note que les efforts les plus importants, les fameux moments fléchissants et les efforts tranchants, ne sont pratiquement pas augmentés. J'avais d'ailleurs dit à l'époque que lorsque l'on descend en dessous de 6,8 n_uds, on n'est plus tellement man_uvrant.
Puis nous avons fait un calcul de l'inertie des sections. Il s'agit de la résistance de la section principale du navire, compte tenu des échantillonnages. Sur la base théorique d'un relevé d'échantillonnage datant de 1998 qui aurait perdu 10 %, avec la cloison originale en moins, on arrive, avec les raidisseurs en place - à supposer qu'ils soient restés en place -, à une perte de 6 % ; et sans les raidisseurs, on parvient à 23 %. On est encore dans les limites admissibles du point de vue de la résistance.
Comme l'hypothèse du navire avec une cloison effondrée ou partiellement effondrée permet de rester dans les limites de résistance, et que le navire continue, a priori, à flotter jusqu'au moment du naufrage, le dimanche matin, j'ai donc demandé des calculs complémentaires qui démontreraient qu'il casse.
L'idée était de se baser sur le moment où le commandant signale du pétrole à la mer et qu'il voit s'en aller une partie du bordé de muraille de la citerne n°3. Cette partie de bordé de muraille, avec les raidisseurs, se trouve à 6 milles nautiques.
M. le Rapporteur : Quelle heure était-il ?
M. Jean-Louis GUIBERT : L'information du navire l'établit à 6 h 12 du matin. Le commandant dit à son armateur, et pas au CROSS, que son bordé de muraille tribord a été emporté. Le bateau se casse à 8 h 08 et coule vers 8 h 15, soit deux heures après.
Dans les derniers moments, le navire devait avancer à 2 n_uds, cela correspond à deux ou trois heures de route, par rapport à la position de l'épave.
C'est un élément important qui prouve qu'à partir de ce moment-là, ce bordé de muraille manquait. D'après les calculs, non seulement la cloison est effondrée entre la citerne n° 3 et le ballast n° 2, mais on n'a plus de bordé sur le ballast. Autrement dit, le ballast et la citerne sont directement en communication avec la mer. Quand on refait les calculs de moments fléchissants et d'efforts tranchants, on dépasse alors de 60 % les valeurs admissibles.
Autrement dit, en l'état actuel des choses, nous pensons que c'est cette hypothèse de la cloison effondrée qui génère les premiers éléments. Dans un deuxième temps, avec les efforts dus à la mer, les bordés de muraille ont été enfoncés, non seulement par les mouvements de cargaison se produisant entre la citerne n° 3 et le ballast N° 2, mais aussi par l'assaut de la mer sur la muraille. La muraille étant sollicitée des deux côtés, les renforts corrodés s'étant effondrés, le bordé a disparu. Il n'y a alors plus de flottabilité dans cette zone milieu.
Le navire est une poutre avec deux semelles : le pont - la semelle supérieure -, et le fond - la semelle inférieure - ; ce sont les parties qui travaillent le plus. Il y a quatre éléments longitudinaux : les deux bordés de murailles et les deux cloisons longitudinales. A partir du moment où vous perdez deux de ces éléments, il ne reste plus que les deux derniers éléments longitudinaux, la muraille bâbord et la cloison longitudinale bâbord. L'autre moitié a disparu.
S'agissant des calculs de résistance par les éléments finis, calculs assez lourds qui intègrent notamment les éléments d'échantillonnage, ils devraient être terminés dans les prochaines semaines.
Si nous pouvons en avoir une preuve plus concrète, nous ferons donc apparaître des diminutions d'échantillonnages beaucoup plus importantes que celles annoncées, et atteignant 30 à 35 %. Je crois que cela suffit à expliquer que le bateau était corrodé et que c'est bien l'origine de la cassure. C'est le but de nos recherches ; nous sommes une commission technique.
On sait que l'on ne pourra pas lutter, en mer, contre toute pollution qui arrivera fatalement à terre, quels que soient les moyens mis en _uvre. Il faut en revanche éviter que les navires se cassent. A cet égard, nous avons fait un certain nombre de propositions, plus détaillées que celles du rapport préliminaire.
Le rapport préliminaire prévoyait le contrôle des sister-ships. Cela a été suivi d'effets, puisque sept navires ont été vérifiés très rapidement : au mois de janvier, quatre étaient complètement arrêtés et l'un d'entre eux a été envoyé immédiatement à la ferraille. Cela a également provoqué la sortie de vingt navires du registre classés par RINA et d'une vingtaine de navires immatriculés sur le registre maltais.
Contrairement à ce que pouvait penser l'OMI, il n'était pas nécessaire de savoir quel morceau du navire avait cassé. Il suffisait de dire que le bateau avait cassé et qu'il était temps d'intervenir au moins sur ces navires-là, puis sur les autres. Le problème est que dans la situation opaque dont M. Georges Tourret a parlé tout à l'heure, seule la société de classification peut être repérée. Peu importe, d'ailleurs, son nom, puisqu'elle seule possède tous ces éléments et que l'on ne peut les trouver nulle part ailleurs.
Les rapports du Bureau Veritas représentaient très peu de choses. A priori, le dossier avait été donné auparavant au RINA. Au moment du transfert de classe, il y a eu visite d'un inspecteur de cette société de classification déclarant que le navire n'était pas en bon état, et recommandant de ne pas le prendre, sauf à faire des travaux très conséquents. La recommandation de ne pas prendre un navire est une formule normale dans les sociétés de classification. Quand il y a un transfert, c'est la direction qui décide ou non de prendre le navire, quitte à faire des travaux.
De la même façon, dans le rapport Roquemont sur le Tanio - dont les conclusions soulignent d'ailleurs que si l'on tenait compte des propositions techniques, on éviterait bon nombre de problèmes -, il nous est rappelé que les aciers vieillissent, qu'ensuite des fragilités s'installent, et qu'enfin, à un certain stade, le fait de réparer les navires en remettant 100 tonnes de tôles est une aberration. On introduit ainsi de nouvelles contraintes dans la construction du navire, avec des aciers neufs, mais pas forcément de la même qualité que des aciers de 25 ans d'âge. Des problèmes techniques apparaissent et amènent à être plus prudents en amont, sur l'état général d'un navire vieillissant, soit en le réformant, soit en fixant une limite d'exploitation de manière à permettre à l'armateur de changer son navire.
Cette pratique va à l'encontre de l'arrêt brutal de la vie des navires, à 15 ou 25 ans. L'effet pervers d'une telle règle est que les navires ne seront plus entretenus deux ans et demi avant. Six mois pour une citerne de ballast qui se corrode, cela prouve bien qu'il faut agir avant.
S'agissant des sociétés de classification, un souci subsiste. Les propositions que nous avons faites ont été reprises sur le plan politique, au niveau Bruxellois. Cela se passe moins bien à l'OMI, pour des raisons évidentes. L'IACS est en train de « resserrer les boulons », de profiter du temps qui passe, afin de reprendre l'auto-contrôle de ses sociétés de classification, et surtout, d'échapper aux contrôles de l'Etat du port et de l'Etat côtier. C'est extrêmement grave : si nous n'avons pas la possibilité d'accéder à leurs dossiers, nous serons totalement dans l'incapacité de faire des enquêtes telles que celles que nous menons. Elles sont déjà très difficiles à conduire puisque pour avoir des éléments, il faut passer soit par Malte, soit par l'armateur. L'IACS va jusqu'à se proposer de faire elle-même un bureau d'enquête international, auquel l'OMI, comme par hasard, pourrait recourir pour pallier les carences de l'Etat du pavillon.
J'insiste sur ce point, mais je crois qu'il est fondamental. Il s'agit là d'un niveau international, où la gestion technique du transfert de flotte serait de plus en plus sous l'emprise des sociétés de classification, sans aucun droit de regard, pour des raisons, tenant non seulement au propriétaire-armateur, mais surtout à la souveraineté de l'Etat du pavillon.
A Londres, en face de M. O'Neil, je me suis heurté à l'idée selon laquelle l'Etat du pavillon prendrait les choses en main, car il y va de sa souveraineté.
M. le Rapporteur : Sur ce point, les récentes propositions européennes vous conviennent-elles ? Vous apparaissent-elles suffisamment cohérentes ?
M. Jean-Louis GUIBERT : Dans la série des recommandations, les recommandations techniques du BEA ont été reprises dans la charte sur la sécurité du transport pétrolier de M. Gayssot, transposées et aménagées par Mme de Palacio au niveau de la Commission européenne, et transmises enfin à l'OMI qui continue à ne pas bouger du tout.
Je suis un peu contre les critères d'âge. Il est cependant vrai qu'il est difficile de faire admettre l'idée selon laquelle l'expertise d'un navire doit être faite par des experts d'horizons différents, dès lors que l'on commence à avoir de sérieux doutes sur sa possibilité de continuer à naviguer. Je crains que si l'on continue à laisser opérer seul un expert - aussi qualifié soit-il - dans une citerne de 300 000 tonnes, les contrôles ne soient pas suffisamment efficaces.
M. Georges TOURRET : On peut même signaler des reculs. Lors de notre première enquête, nous avons demandé les documents du Bureau Veritas. Nous les avons obtenus uniquement parce que Malte a bien voulu que nous les ayons, ce qui montre les capacités de blocage d'une administration maritime au demeurant légère dans ses structures. Le RINA ne nous avait pas communiqué les documents, et ne l'a fait qu'à la suite de notre conférence de presse, dans laquelle nous avions fait état de cette non communication. A partir de ce moment, nous avons eu un mois de coopération active des sociétés de classification. Comme par hasard, le NKK japonais qui, dix-huit mois avant, nous avait refusé la communication d'un dossier sur un autre navire, nous a envoyé la totalité de ce dossier sans autorisation de l'Etat du pavillon.
A la suite de la dernière réunion de l'IACS, le balancier est revenu dans l'autre sens. Nous avons demandé à l'IACS la communication des éléments relatifs aux sister-ships de l'Erika, qui avaient tous des faiblesses de structure. Je vous dis cela afin de vous montrer que quand on raboute la partie avant et la partie arrière de l'Erika, il y a un manque au milieu. Ce manque est constitué par ces citernes de ballast, qui sont en même temps les zones les plus surveillées, et les plus réparées. Nous avions donc une vraie réflexion sur les sister-ships. La réponse des sociétés de l'IACS fut celle-là : « Vous êtes priés de vous adresser aux Etats du pavillon et aux armateurs ». Pour entrer dans la documentation technique, il faut en réalité que deux gardiens de prison, chacun doté d'une clé différente, nous ouvrent la porte : il nous faut l'autorisation de l'armateur et celle de l'Etat du pavillon. Ce n'est pas acquis.
Nous avons demandé aux autorités maltaises, qui ont toujours sous leur pavillon deux sister-ships de l'Erika, de nous donner les éléments de dossier dont elles disposaient. Elles nous ont répondu, pour l'un, en trois lignes, que le bateau était suivi par le DNV - c'est à dire les Norvégiens -, et qu'il était toujours en bon état, et pour l'autre, également en trois lignes, qu'à première vue, le pont était corrodé, mais sans plus. Nous n'avons pas eu communication de l'intégralité du dossier des analyses internes de l'IACS.
Autrement dit, nous avons un système central, celui des sociétés de classification, qui agissent à la fois sous couvert de propriétaires difficiles à identifier et d'Etats du pavillon à surface réduite. Pour gérer dix fois plus de navires que la flotte française, l'Etat maltais a dix fois moins de fonctionnaires. On se retrouve avec un système qui va se verrouiller lui-même. Les gens vont se contrôler eux-mêmes, ou par l'intermédiaire d'une association professionnelle dans laquelle les objectifs ne sont pas forcément des objectifs techniques.
M. Jean-Louis GUIBERT : Je vous fais passer quelques photos du bateau, lorsqu'il a quitté le Bureau Veritas, avant de rentrer au RINA.
La première vous montre un collecteur avec un emplâtre. La seconde vous permet de voir un pont couvert de rouille, ce qui indique un état de corrosion très évolué. La troisième illustre un décollement de plaque de rouille. La dernière est intéressante car elle vous présente un renfort complètement dissocié du bordé.
M. le Rapporteur : Vous en arrivez à un diagnostic sévère à l'égard des sociétés de classification. Cela signifie-t-il pour vous que le combat principal consiste à obtenir que toutes les données d'EQUASIS, soient rendues publiques et accessibles à tous ? Est-ce un bon axe d'attaque que de se battre sur ce point, y compris au niveau de l'OMI ?
M. Jean-Louis GUIBERT : Il y a deux points.
Le premier concerne toutes les parties au navire et conditionne le reste.
Le second concerne effectivement le suivi du navire. A la question du suivi avec une possibilité de contrôle, on peut souhaiter qu'EQUASIS soit la réponse adéquate. En effet, une banque de données contenant le maximum d'éléments, accessible à tous, serait la meilleure des solutions.
Malheureusement, une base de données ne restitue que ce qu'on lui donne. Au début de l'affaire, quand nous avons cherché qui était qui, la base de données était constituée de documents du Lloyd's sous différentes formes : navires, armateurs, sociétés. Même avec ces documents, nous avons commis des erreurs et nous n'avons pas obtenu toute la vérité. Le risque est celui d'être rassuré par une base de données ne contenant que les informations qui ne gênent personne.
M. Georges TOURRET : Un dossier de navire représente une masse importante de cartons. L'ensemble de la documentation technique dont nous disposons sur l'Erika, en provenance des sociétés de classification, représente plusieurs cartons de déménagement. C'est donc un volume considérable qui n'est pas très accessible sur une base de données de type EQUASIS.
Nous sommes confrontés à un refus des sociétés de classification qui veulent rester maîtresses de leurs propres évaluations. C'est une chose sur laquelle nous allons buter.
Notre demande est la suivante : dès lors qu'un événement fait intervenir un Etat côtier, c'est-à-dire un Etat victime, ou même un Etat ayant droit à faire des enquêtes, les dossiers doivent être librement accessibles. Cette demande est peu soutenue. Nous sommes aujourd'hui confrontés au blocage de l'IACS et de ses membres qui la refusent toujours.
A cet égard, le Bureau Veritas et le Lloyd's Register of Shipping se sont battus, au moment de la rédaction de la charte de M. Gayssot, pour que cela ne passe pas. J'ai assisté à la rédaction de la charte de M. Gayssot. Ce point a constitué près de la moitié du temps des débats de la commission. Ni le Bureau Veritas ni le Lloyd's Register of Shipping, présents tous les deux et porte-paroles de l'IACS, ne l'ont accepté. Depuis que L'IACS a « resserré les boulons » entre ses membres, la devise est la suivante : « Pas d'_il extérieur sur ce que nous faisons ».
Le droit de regard extérieur est subordonné à l'autorisation de l'armateur et de l'Etat du pavillon. Or, comment peut-on avoir confiance en un Etat du pavillon, dont l'essentiel des services techniques est précisément constitué par les sociétés de classification ?
Nous allons demander un droit de regard. Si lors d'un sinistre, les enquêteurs techniques que nous sommes - qui disposons en permanence du minimum de capacité de réaction et d'un formalisme moins développé que les instances judiciaires - n'avons pas accès à ces données, il nous est relativement difficile de faire notre travail. L'IACS nous répond qu'elle ne cache pas les données aux autorités de justice. A un détail près : les autorités de justice obtiennent ces données selon un processus relativement long.
M. le Rapporteur : Cela ne peut pas jouer en prévention.
M. Georges TOURRET : Les autorités de justice ne font pas non plus la gestion de la récurrence. L'Erika, pour nous, est d'autant plus intéressant que nous pouvons l'inscrire dans le continuum du Tanio. C'est le continuum, non seulement avec les sister-ships, mais aussi avec tous les bateaux qui font à peu près le même métier.
Je vous rappelle un élément de notre rapport du 13 janvier, que personne n'a contesté : les produits les plus polluants sont transportés par les navires pour lesquels il existe une susceptibilité forte d'accident ou d'avarie. On se retrouve, sur les côtes françaises, avec deux navires de plus de 20 ans, le Tanio et l'Erika, dans lesquels l'acier a vieilli. Il serait intéressant pour vous d'avoir la publication du rapport de M. Roquemont sur le Tanio, datant de 1980. C'est très explicite : l'acier vieillit, et on ne peut pas demander à un navire ancien, fut-il bien entretenu, d'avoir les mêmes qualités qu'un navire récent. Il faut prendre des précautions. M. Roquemont disait qu'il serait bon d'envisager de réduire le port en lourd et donc les contraintes : on ne demande pas à un vieillard sympathique et en bonne forme de fournir les mêmes efforts que son fils de 25 ans !
Nous demandons ce libre accès, chaque fois que nous devons traiter...
M. le Rapporteur : ... Chaque fois que vous devez traiter un problème. Cela veut-il dire que vous ne mettez pas de normes ?
M. Georges TOURRET : Selon nous, il ne s'agit pas de dire que l'on va intégrer dans EQUASIS une brève description du navire par la société de classification. Si EQUASIS doit avoir l'ensemble des dossiers de toutes les sociétés de classification sur les 54 000 navires de la flotte mondiale, on va se retrouver devant la bibliothèque de Borgès, même informatisée !
M. le Président : Est-il possible de dire la chose suivante : pour entrer dans la communauté européenne, il faut qu'un Etat du pavillon s'engage à fournir, à la demande d'un autre gouvernement, tous les éléments relatifs aux navires sur lesquels il a accepté de mettre son pavillon ? C'est la bataille de l'OMI.
M. Georges TOURRET : Est-ce que ce sera voté à l'unanimité ou à la majorité qualifiée ? Les Grecs pourront constituer un blocage ou pas ?
M. le Président : A ma connaissance, sur un certain nombre d'éléments, nous allons vers des votes à la majorité qualifiée.
Il faut exiger des candidats à l'adhésion à l'Union européenne - et c'est fait pour Malte et Chypre qui ne sont pas dans la Communauté européenne - qu'ils n'entrent pas dans la Communauté européenne avant d'avoir mis en place un certain nombre d'éléments sur ces questions, ce qui renvoie probablement cette échéance à un assez long terme.
Par ailleurs, si cela se fait au niveau des Etats européens, ne pourrait-on pas considérer l'Europe, et notamment les ports du nord tels que Rotterdam, Hambourg, Anvers, comme une donnée incontournable du commerce maritime international ? Quelle compagnie de navigation peut dire qu'elle n'ira jamais à Rotterdam ? Aucune.
M. Jean-Louis GUIBERT : Vous avez raison, c'est la bonne idée. Mais pour avoir beaucoup fréquenté l'OMI, je peux vous dire que cela ne passera pas. La position de M. O'Neil est que l'Europe ne prend pas de mesures unilatérales. Les Etats-Unis le peuvent, mais il n'y a pas de trafic longitudinal : les navires arrivent droit à la côte, on les arrête avant et ils ne rentrent que si c'est bon. C'est difficile à faire chez nous, ne serait-ce que si le bateau passe dans la Manche pour aller à Rotterdam ou à Hambourg. Sur cet aspect, l'OMI ne fera sûrement rien, parce que la majorité des gens y seront opposés, et notamment tous les pavillons de complaisance.
Ensuite, à l'OMI, je n'ai jamais vu que l'on votât. Les décisions se prennent toujours par consensus.
Néanmoins, c'est certainement une solution à condition que l'Europe veuille bien jouer le jeu, et ne le fausse pas, comme elle le fait parfois dans l'application du Mémorandum de Paris, avec certaines distorsions dans l'application des règles. C'est une solution, mais il faut vraiment une volonté politique ferme de l'Europe.
M. le Rapporteur : Vous dites que chaque Etat devrait pouvoir accéder à l'information sur les navires auprès de l'Etat du pavillon. Mais à partir de quel moment ? A partir du moment où il y a un doute ?
M. Jean-Louis GUIBERT : Oui, à partir du moment où il y a un doute.
A un premier stade, il y a des Mémorandums sur les contrôles par les Etats du port. La black list, évitée pendant longtemps, existe aujourd'hui. Nous avons donc des données permettant de dire que tel bateau pose, a priori, des problèmes. Il faut quand même se méfier des changements de pavillons et de noms qui faussent le jeu.
A un deuxième stade, un navire subit le contrôle du Mémorandum de Paris, de Tokyo ou d'ailleurs. Lors d'une visite dans un port français, on demande accès au dossier de classification parce que l'on trouve que certains éléments sont à éclaircir et que la certification est trop belle pour être vraie.
Au troisième stade, il ne s'agit plus de l'Etat du port, mais de l'Etat côtier. C'est le cas de l'Erika. Nous avons un bateau accidenté pour lequel il est inadmissible de ne savoir ni pourquoi ni comment c'est arrivé.
Il semble, dans le cas de l'Erika, qu'il serait bon que la société de classification dispose, dans son dossier informatique sur le navire, d'éléments concernant au moins la structure et la stabilité. Ainsi, face à un problème de gîte, le commandant s'adresse immédiatement à son armateur ou à la société de classification qui, ayant toutes ces données, fait le calcul de la situation du navire et peut préconiser des mesures de ballastage, de déballastage, pour ne pas ensuite mettre en cause ce qui a été fait par le commandant de son propre chef. Ce serait une mesure intéressante et, sur le plan technique, positive pour les sociétés de classification, qui pourraient gérer la situation en proposant des solutions.
Cela répond à une question qui a été posée : pourquoi le préfet maritime n'a-t-il pas donné d'ordres à ce bateau ? Mais sur quoi pouvait-il s'appuyer ? Je ne parle même pas de l'aspect juridique ou du fait de se substituer au commandant, qui est le seul maître à bord et à pouvoir apprécier la situation sur place. Jamais, en ma qualité d'adjoint au préfet maritime, je n'aurais conseillé de dire au navire de faire demi-tour ou d'aller ailleurs. Quels seront les problèmes induits dans de nouvelles conditions de mer ? Quelles seront les répercussions du point de vue de la tenue du bateau ? On va peut-être créer un danger encore plus grand. C'est impossible à gérer depuis la terre. C'est le problème des VTS
- vessel trafic services - : un CROSS ne donne jamais d'ordres à un navire. Si un CROSS demande à un navire de changer de cap parce qu'il se trouve en position d'abordage, il ne peut pas savoir si, entre les navires qu'il identifie bien, il ne se trouve pas un navire de pêche ou un bateau de plaisance vis-à-vis duquel la man_uvre pourrait s'avérer dangereuse.
Nous ne sommes pas dans l'aéronautique : il n'y a pas d'aiguilleurs des mers. Il faut bien garder cela en mémoire, sinon on fera une erreur fondamentale.
M. Georges TOURRET : La position a été exprimée dans plusieurs instances par des personnes privées ou des experts publics. Ils ont fait savoir que l'on aurait pu éviter de graves problèmes si le navire, au lieu de faire route sur Donges, était revenu sur Brest. La route pour revenir sur Brest n'est d'ailleurs pas la même qu'à l'aller, car il faut passer par Armen.
Il faut penser à la situation du préfet maritime, en termes de conseil. Même le ship-manager n'était pas abonné à la banque de données permanente du RINA et à son service qui fournit des calculs à tout moment de telle ou telle situation.
On se retrouve alors en face d'avaries mal identifiées, sur une structure que personne ne connaît, et selon que la corrosion est à 10 ou à 30 %, les calculs de résistance ne sont pas les mêmes. Comment une autorité quelconque peut dire, dans une telle situation, qu'il faut revenir par ici, avec une situation météorologique aléatoire, instable. Le navire se trouve au milieu du golfe de Gascogne. Pour revenir là, à 8 n_uds, il faut treize heures. Dans un tel laps de temps - treize heures, c'est long -, la météo tourne.
Par ailleurs, pour aller à Donges, la route est à peu près saine ; il n'y a pas d'obstacles. Pour Armen, c'est moins évident. Une animation des courants autour de l'île de Sein montre bien une situation complexe et difficilement prévisible. La situation se résume simplement : soit l'Erika était encore en état de navigabilité relative et rien ne permettait de penser qu'il en aille autrement et il n'y avait alors pas d'objection à ce qu'il aille sur Donges ; soit il n'était pas en état, et prendre une décision demandait alors un temps de calcul et de réflexion qui n'est pas dans la mesure d'un préfet maritime et de ses services, alors même que les gens qui connaissent le navire observaient un mutisme complet. Le seul qui connaissait la coïncidence entre les zones des avaries, les réparations de l'année précédente, et l'état de corrosion, c'était quand même bien la personne désignée, le ship-manager représentant la collectivité complexe que je vous ai désignée comme étant « les armateurs », à charge pour la justice d'y reconnaître les siens.
M. le Rapporteur : Vous avez dit qu'en votre qualité de services de l'Etat côtier, vous souhaitiez avoir des éléments complets d'information en possession des sociétés de classification. Nous avons rencontré les autorités de Malte et du Liberia. Quelles préconisations pourrait-on faire à des petits Etats décidés à avoir une flotte de qualité suffisante, mais dans l'incapacité d'avoir une administration suffisante par manque d'habitants ?
Nous ne pouvons pas dire à Malte, qui compte de 400 000 à 500 000 habitants, qu'elle doit se doter d'une administration comparable à celle de la France. Que pourrait-on leur dire ? N'ayant personne à mettre à leur disposition, nous leur avons déjà conseillé, afin d'assurer leur légitimité d'Etats, de se débarrasser des sociétés de classification - RINA ou autres - pour assurer la certification des bateaux immatriculés à leur registre.
M. Jean-Louis GUIBERT : Il doit y avoir dix personnes dans l'administration maltaise, dont trois inspecteurs qui, de temps en temps, voient un bateau, on ne sait pas très bien dans quelles conditions. Il est clair qu'ils ne peuvent pas être à la hauteur des 1 500 navires immatriculés sur leur registre et qui, heureusement pour eux, ne croisent pas souvent au large de leurs côtes.
On peut leur préconiser de déléguer. La délégation se fait naturellement, comme en France, pour partie aux sociétés de classification. La seule obligation à assortir à cette demande, est qu'ils soient en mesure de contrôler eux-mêmes la société de classification. Il n'y a plus besoin d'autant de monde : deux ou trois experts suffisent pour vérifier de temps en temps une visite de navire ou demander que les dossiers leur soient communiqués.
Actuellement, ils ne le font pas parce que c'est un peu un piège. Si on leur dit de déléguer en assurant le contrôle de la délégation, il est évident qu'ils endossent ainsi une partie de la responsabilité, et de la culpabilité. Nous n'avons pas osé utiliser ce mot dans notre rapport provisoire, mais on peut se demander dans quelle mesure l'Etat du pavillon n'a pas une responsabilité dans l'accident.
La méthode est celle du contrôle du contrôleur. C'est valable dans tous les pays. Lors des débats à Fontenoy, sur les délégations données au Bureau Veritas, nous hésitions sur la manière de contrôler les délégations qui avaient été données. Nous avons résolu la question en ne contrôlant pratiquement pas.
En revanche, en Tunisie, ils ont établi un contrat de contrôle et d'obligation des sociétés de classification auxquelles ils délèguent partie de leurs pouvoirs. Je pense que l'on doit passer par ces moyens et que ceux-ci doivent être imposés par l'OMI. L'OMI ne peut ignorer les Etats dits de complaisance : il faut qu'elle leur dise de se doter, soit d'une administration compétente, soit d'une structure permettant de contrôler leurs délégataires.
Aux termes de l'accord tunisien, les sociétés de classification doivent établir un compte rendu mensuel de leurs visites et de leurs observations. Même chez nous, il n'y a rien : sur un navire français, sauf accident, le Bureau Veritas peut refuser de communiquer le dossier du navire.
M. Georges TOURRET : S'agissant de petits Etats désirant se doter d'une flotte, et n'ayant pas d'administration maritime, on pourrait ajouter la proposition suivante : donner délégation permanente aux Etats concernés par les enquêtes pour obtenir des sociétés de classification la totalité du dossier, le problème essentiel étant d'avoir plusieurs regards sur le même dossier car un seul ne suffit pas.
M. le Rapporteur : Rapidement, et pour revenir à la chronologie : nous avons reçu les gens de Météo France, et nous avons été troublés, au point que certains ont jugé bon de rendre publiques certaines informations. Le problème posé est que globalement, les personnels de Météo France n'ont pas été très bons pour se tromper à ce point sur le lieu d'arrivée des nappes. Bien évidemment, ils se sont rendu compte de l'ampleur de l'erreur et ils nous ont présenté une modélisation. D'après cette modélisation, si le bateau avait commencé à fuir au large de Brest, on s'expliquerait mieux qu'il y eût deux arrivages de nappes : l'un, au Sud Finistère-Morbihan, non prévu, parce que venant d'une source avant le lieu du naufrage ; l'autre, correspondant au lieu du naufrage, et qui est à peu près conforme à ce que Météo France annonçait dans ses prévisions. Cela voudrait dire que le bateau fuyait avant et que cela n'aurait été ni repéré, ni déclaré. Telle est la conclusion, à la fin de l'audition.
M. Jean-Louis GUIBERT : En tant que président de la commission marine du conseil supérieur de la météorologie, j'ai eu à connaître de cette question depuis un moment, dont j'ai discuté longuement avec Philippe Dandin, chef prévisionniste maritime à Toulouse.
Dans notre rapport préliminaire, nous ne disons jamais que le bateau a fuit avant, tout simplement parce que nous n'avions strictement aucun élément pour étayer cette hypothèse. En l'état actuel de la chronologie, nous n'en avons pas d'avantage. Le seul moment où l'on apprend qu'il y a du pétrole à la mer est le dimanche, à 6 heures du matin.
L'autre source est le rapport du RINA, selon lequel il y avait depuis longtemps une fissure dans la coque. Cette fissure se situe d'ailleurs dans une zone curieuse qu'ils auraient dû vérifier au chantier de Bjiela ; cependant le but de leur rapport était de montrer que ce n'était pas de leur faute, mais celle du capitaine, qui ne se serait pas rendu compte que son bateau avait cassé et prenait l'eau. Je schématise.
Une fissure donne des fuites relativement faibles. Mais par ce temps-là, une fissure se transforme rapidement en cassure. Sur le plan du calcul, la réponse est claire. Nous sommes partis de l'idée que la cloison s'est écroulée et que le bordé a été emporté. Ce qui est confirmé par les faits.
Si l'on prend le problème sous l'angle inverse : il se produit tout d'abord une cassure, puis la cloison s'écroule. La solution reste la même et le bateau coule à partir de 14 h 08, puisque c'est d'abord une partie de la muraille qui lâche. A ce moment-là, se crée une communication du ballast avec la mer ; à 14 heures, la cloison s'effondrant, on parvient aux 160 % de mouvements fléchissants, et le bateau ne tient pas jusqu'au lendemain matin à 8 heures.
En cas de fuite de pétrole, détourner le pétrolier vers Brest aurait orienté la pollution à Portsall. Plus bas, avec le vent à la dérive ? Il est vrai que le modèle montre une pollution au pays bigouden. Mais comme plus tard, il apparaît que l'emplacement de l'épave fait que du pétrole arrive également au pays bigouden, il y a peut-être quelque chose avant, mais il y sûrement quelque chose après.
Météo France a dit, avec prudence, que les nappes de fioul pouvaient venir également de l'endroit où se trouve l'épave. C'est pour nous une hypothèse privilégiée.
Ceci étant, nous allons voir si par le calcul nous pouvons trouver quelque chose d'autre entre le dispositif de séparation du trafic et le point de rebroussement du navire. Mais au vu des indications données par le capitaine à son armateur, il n'y a rien du tout là dessus, alors qu'il donne beaucoup de détails.
M. le Rapporteur : Il s'en serait aperçu, de toutes façons.
M. Jean-Louis GUIBERT : Oui et il avait lui-même transféré du pétrole du ballast n° 1 tribord au ballast n° 1 central, craignant que les fissures - dont il pensait qu'elles se trouvaient dans la citerne n° 1 alors qu'elles étaient dans le n° 2 - ne se propagent dans le ballast n° 1 et ne provoquent une pollution. Quand il a déballasté le n° 2, alourdi par de l'eau de mer et du pétrole - on lui a reproché de l'avoir fait trop tardivement -, il a pris soin de ne pas rejeter de pétrole à la mer. Il avait quand même présent à l'esprit le souci d'éviter une pollution.
Il y a une possibilité mathématique qu'il y ait eu des rejets avant, mais il n'avait pas de raisons de rejeter, il était en charge.
M. le Rapporteur : Et ce serait moins important que cela.
M. Jean-Louis GUIBERT : Oui, c'est ce que je pense.
M. le Rapporteur : Et comment expliquez-vous une telle erreur d'appréciation de météo ?
M. Jean-Louis GUIBERT : Il y a eu une guerre entre deux modèles anglo-saxons et le modèle de Météo France. Les deux modèles anglo-saxons donnaient des prévisions a priori plus satisfaisantes et plus alarmistes. Le modèle de Météo France - MOTHY -, développé plus récemment, prend en compte, comme tous les autres, les bases de données pour les courants. Il a fait un très bon calcul de dérive sur un voilier qui avait chaviré, et l'on a retrouvé le navire pratiquement là où le calculateur l'avait indiqué. J'avais néanmoins fait remarquer à la Commission marine du conseil supérieur de la météorologie, qu'il s'agissait d'une expérience portant sur un objet flottant, symétrique, dans des conditions bien connues.
Dans le cas de l'Erika, la situation était très différente : le pétrole de la tranche n° 2 est parti sous la pression et s'est ensuite dispersé par nappes parfois agglutinées et parfois invisibles. Il y a eu des courants sous-marins. Le calcul global donne effectivement ces possibilités. Mais plus on approche de la côte, plus les courants changent et donnent des résultats différents. La modélisation est une très bonne chose, mais plus on approche de zones perturbées, plus il faut que le calculateur reçoive l'aide de l'opérateur avec les bons paramètres à adapter à la situation exacte du moment. Cela n'est pas une critique de MOTHY en l'occurrence. Mais il y a obligation d'assister l'ordinateur en permanence.
Les personnels de Météo France ont été bons sur la vitesse et la date d'impact du polluant à terre a été bonne à quelques heures près. Je pense qu'il y a peut-être eu un certain nombre d'erreurs sur les courants ; on a découvert d'une certaine manière, qu'à 30 nautiques dans le sud de Penmarc'h, on a des courants qui peuvent ramener du pétrole au pays bigouden.
M. Georges TOURRET : Vous allez voir le film de la cassure de l'Erika, qui provient de la Marine nationale.
Au moment de la cassure, à 8 heures du matin, d'énormes quantités de pétrole jaillissent. On les voit très bien car le film est en infrarouge et le pétrole à 65°C est matérialisé en noir. Avant le moment de la cassure, on ne voit pas de traces tout autour du bateau. D'après les calculs, ces énormes quantités auraient dû se retrouver sur l'île-d'Yeu. On en a retrouvé, mais en quantité bien moindre. Les grandes quantités sont arrivées quelque part entre La Baule et La Turballe, et sur Belle-île. Il y a donc sur le modèle, une incertitude quant aux zones mais aussi quant aux quantités. Le jour de Noël et les jours suivants, le maximum de moyens avaient été concentrés sur la Vendée.
(Diffusion du film)
M. Georges TOURRET : Les grandes quantités annoncées sur l'île-d'Yeu n'y sont pas arrivées, ni avant, ni après la date annoncée. L'île-d'Yeu n'a reçu que quelques petites boulettes. Il y a quand même un problème d'incertitude sur le modèle.
M. Jean-Louis GUIBERT : En fait il y a eu un problème de dispersion. Il y a trois ou quatre ans, un conteneur de détonateurs s'était perdu au large du cap Finisterre espagnol. On a retrouvé des détonateurs sur la côte espagnole, jusqu'à Brest et même en Manche. Autrement dit, plus on est à l'ouverture du golfe de Gascogne, plus on a cette dispersion avec les courants et les vents. Sur le trajet entre Ouessant et le Finistère espagnol, plus on est vers l'Espagne, plus on diffuse sur toute la côte atlantique française. C'est une impression ; il faudra voir si cela se vérifie.
On constate que la partie arrière a coulé plus à l'est que la partie avant. En dépit de ses efforts, l'Abeille n'a pas réussi à remonter la partie arrière vers les grands fonds, ce qui n'aurait pas été pour autant une bonne solution, à cause d'un risque d'implosion des citernes. Il était difficile d'appréhender ce qu'il fallait faire, ce qui prouve bien la difficulté des prises de décision.