N° 1781
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 7 juillet 1999.
RAPPORT D'INFORMATION
DÉPOSÉ
en application de l'article 145 du Règlement
PAR LA COMMISSION DES FINANCES, DE L'ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU PLAN (1) en conclusion des travaux d'une mission d'évaluation et de contrôle constituée le 3 février 1999 (2),
ET PRÉSENTÉ
PAR M. DIDIER MIGAUD,
Rapporteur général,
Député.
--
ANNEXE N° 3
LES AIDES À L'EMPLOI
Rapporteur spécial : M. Gérard BAPT
Député
(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.
(2) La composition de cette mission figure au verso de la présente page.
Parlement.
La commission des finances, de l'économie générale et du plan est composée de :
M. Augustin Bonrepaux, président ; M. Didier Migaud, rapporteur général ; MM. Jean-Pierre Brard, Arthur Dehaine, Yves Tavernier, vice-présidents, MM. Pierre Bourguignon, Jean-Jacques Jégou, Michel Suchod, secrétaires ; MM. Maurice Adevah-Poeuf, Philippe Auberger, François d'Aubert, Dominique Baert, Jean-Pierre Balligand, Gérard Bapt, François Baroin, Alain Barrau, Jacques Barrot, Christian Bergelin, Eric Besson, Alain Bocquet, Jean-Michel Boucheron, Michel Bouvard, Mme Nicole Bricq, MM. Christian Cabal, Jérôme Cahuzac, Thierry Carcenac, Gilles Carrez, Henry Chabert, Didier Chouat, Alain Claeys, Charles de Courson, Christian Cuvilliez, Jean-Pierre Delalande, Francis Delattre, Yves Deniaud, Michel Destot, Patrick Devedjian, Laurent Dominati, Raymond Douyère, Tony Dreyfus, Jean-Louis Dumont, Daniel Feurtet, Pierre Forgues, Gérard Fuchs, Gilbert Gantier, Jean de Gaulle, Hervé Gaymard, Jacques Guyard, Pierre Hériaud, Edmond Hervé, Jacques Heuclin, Jean-Louis Idiart, Mme Anne-Marie Idrac, MM. Michel Inchauspé, Jean-Pierre Kucheida, Marc Laffineur, Jean-Marie Le Guen, Guy Lengagne, François Loos, Alain Madelin, Mme Béatrice Marre, MM. Pierre Méhaignerie, Louis Mexandeau, Gilbert Mitterrand, Jean Rigal, Alain Rodet, Nicolas Sarkozy, Gérard Saumade, Philippe Séguin, Jean-Pierre Soisson, Georges Tron, Philippe Vasseur, Jean Vila.
*
* *
La Mission d'évaluation et de contrôle est composée de : MM. Philippe Auberger, Augustin Bonrepaux, présidents ; M. Didier Migaud, rapporteur général ; Mme Nicole Bricq, MM. Gilles Carrez, Christian Cuvilliez, Francis Delattre, Raymond Douyère, Daniel Feurtet, Hervé Gaymard, Jean-Jacques Jégou, Marc Laffineur, Pierre Méhaignerie, Gérard Saumade, Michel Suchod, membres titulaires ; MM. Jean-Pierre Brard, Jérôme Cahuzac, Yves Deniaud, Gilbert Gantier, Pierre Hériaud, Jean Rigal, membres suppléants.
Ont également participé à ses travaux les membres suivants de la commission des finances, de l'économie générale et du plan : M. Gérard Bapt, rapporteur spécial des crédits de l'Emploi et de la solidarité - Travail et emploi ; M. Jacques Barrot, rapporteur spécial des crédits de l'Emploi et de la solidarité - Formation professionnelle ; M. Tony Dreyfus, rapporteur spécial des crédits de l'Intérieur - Sécurité ; M. Jean-Louis Idiart, rapporteur spécial des crédits de l'Equipement, des transports et du logement - Transports terrestres, ainsi que M. Jean-Jacques Filleul, rapporteur pour avis de la commission de la production et des échanges pour les crédits de l'Equipement, des transports et du logement - Equipement et transports terrestres et M. Louis Mermaz, rapporteur pour avis de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République pour les crédits de l'Intérieur - Police.
S O M M A I R E
___
Pages
INTRODUCTION 5
I.- L'ÉVALUATION N'ÔTE PAS TOUT CONTENU POLITIQUE AU DÉBAT SUR LES AIDES À L'EMPLOI 7
A.- UN FORT ENJEU POLITIQUE 7
1.- Le verdict du taux de chômage 7
2.- La place pour des choix de société 11
B.- UN CHAMP PRIVILÉGIÉ POUR L'ÉVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES 12
C.- TROUVER LE BON COMPROMIS ENTRE LA COMPLEXITÉ ET L'EFFICACITÉ 15
II.- DES INSTRUMENTS D'ÉVALUATION PERFECTIBLES 17
A.- LA DIFFICULTÉ D'APPRÉCIER LA DÉPENSE POUR L'EMPLOI 17
B.- L'INCERTITUDE DES RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS DES DIFFÉRENTS DISPOSITIFS D'AIDE À L'EMPLOI 20
III.- LE BON EMPLOI DES FONDS PUBLICS EN CE QUI CONCERNE LES AIDES À L'EMPLOI 23
A.- LA CRÉATION NETTE D'EMPLOIS PEUT NE PAS ÊTRE L'UNIQUE OBJECTIF DES AIDES À L'EMPLOI 23
B.- LA CONFIRMATION DE LA STRATÉGIE D'ABAISSEMENT DU COÛT DU TRAVAIL 28
C.- LA QUESTION DU CONTENU DE L'ENRICHISSEMENT DE LA CROISSANCE EN EMPLOIS 31
CONCLUSION 35
PROPOSITIONS 39
ANNEXES :
1.- Structure et évolution de la dépense pour l'emploi au sens de la DARES. 43
2.- Note de l'INSEE, de la Direction de la prévision et de la DARES sur les effets sur l'emploi des allégements de charges sur les bas salaires : quelques enseignements tirés des sources statistiques disponibles 45
AUDITIONS 53
1.- M. Liêm Hoang Ngoc, coordonnateur de l'étude réalisée pour l'Office parlementaire d'évaluation des politiques publiques (6 mai 1999) 55
2.- M. Christian Lhote, directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de l'Orne (6 mai 1999) 97
3.- Table ronde sur les aides à l'emploi : M. Claude Seibel, directeur, et M. Alain Gubian, chef de la mission « Analyse économique », de la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES) du ministère de l'emploi et de la solidarité, M. Jean-Philippe Cotis, directeur, direction de la prévision du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, M. Arnaud Leenhart, représentant du Mouvement des entreprises de France (MEDEF), M. Jean Lardin, président de la commission des relations du travail de l'Union professionnelle artisanale (UPA), M. Liêm Hoang Ngoc, Coordonnateur de l'étude réalisée pour l'Office parlementaire d'évaluation des politiques publiques (27 mai 1999) 105
4.- Mme Martine Aubry, ministre de l'emploi et de la solidarité (17 juin 1999) 151
INTRODUCTION
La Mission d'évaluation et de contrôle de la Commission des finances (MEC) a retenu les aides à l'emploi parmi les thèmes qu'elle a approfondis au cours de sa première session.
Lors de sa réunion du 2 avril 1998, la Commission des finances avait déjà souhaité que l'Office parlementaire d'évaluation des politiques publiques décidât de faire réaliser une étude sur le rôle des flux financiers entre les collectivités publiques et les entreprises en matière d'emploi. Cette étude, confiée à des membres du METIS (Mutation Espace Travail Industrie et services Stratégies) (1), unité de recherche associée au CNRS, en collaboration avec le LEST (Laboratoire d'Économie et de Sociologie du Travail d'Aix-en-Provence), unité propre au CNRS, a été remise à l'Office le 31 mars dernier. Il est apparu de bonne méthode d'utiliser le résultat de ces travaux pour nourrir la réflexion des membres de la Mission, lorsqu'il recoupait la démarche suivie par cette dernière.
En effet, conformément à son rôle spécifique, la Mission a envisagé la question des aides à l'emploi en termes de coût-efficacité des différents types d'aide, c'est-à-dire qu'elle a fait sienne l'approche qui est traditionnellement celle la Cour des comptes lorsqu'elle contrôle un dispositif d'aide au regard du bon emploi de l'argent public. Une telle approche l'a conduite à exclure tout examen des dispositifs très récents comme celui du programme «Nouveaux services-Nouveaux emplois» (emplois jeunes) ou l'aide accompagnant la réduction du temps de travail, qu'il s'agisse du dispositif de la loi Robien ou des aides accompagnant le passage aux 35 heures.
La Mission n'a de même pas étendu son champ d'investigation aux décisions annoncées, par le Gouvernement, en matière d'abaissement du coût du travail et à leurs modalités de financement.
La Mission a organisé ses auditions autour de trois axes :
· l'exploitation de l'information contenue dans l'étude précitée réalisée par des membres du METIS et du LEST ;
· la présentation et la critique générale des enquêtes ou des travaux économétriques existant en matière d'efficacité des aides à l'emploi ;
· le point de vue des praticiens : employeurs et administrateurs des services déconcentrés du ministère du travail, de l'emploi, et de la solidarité.
La Mission a commencé par entendre, le jeudi 6 mai 1999, M. Liêm Hoang Ngoc, coordonnateur de l'étude réalisée pour l'Office parlementaire d'évaluation des politiques publiques. Le jeudi 27 mai 1999, elle a organisé une table ronde à laquelle ont participé, outre M. Liêm Hoang Ngoc, les représentants de la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES) du ministère de l'emploi et de la solidarité, M. Claude Seibel, directeur, et M. Alain Gubian, chef de la mission « Analyse économique » à cette direction, et M. Jean-Philippe Cotis, directeur de la prévision au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.
A cette même table ronde, ont pris part des chefs d'entreprises, en la personne de M. Arnaud Leenhart du Mouvement des entreprises de France (MEDEF) et de M. Jean Lardin, président de la commission des relations du travail de l'Union professionnelle artisanale (UPA). Le jeudi 6 mai 1999, la Mission avait entendu M. Christian Lhote, directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de l'Orne.
La Mission a achevé son cycle d'auditions en entendant, le jeudi 17 juin 1999, Mme Martine Aubry, ministre de l'emploi et de la solidarité, sur les possibilités d'augmenter l'efficacité des aides ciblées et sur l'adaptation des aides générales.
Le présent rapport présente les enseignements qui peuvent être retirés de ces travaux.
I.- L'ÉVALUATION N'ÔTE PAS TOUT CONTENU POLITIQUE AU DÉBAT SUR LES AIDES À L'EMPLOI
À propos de l'évolution des politiques de l'emploi, on a récemment pu parler de « révolution silencieuse ». Ce changement est l'aboutissement d'un processus d'où il ressort que les politiques de l'emploi « se sont construites depuis le milieu des années 1970 sur un mode cumulatif, de nouvelles mesures s'ajoutant ou se substituant chaque année aux anciennes. Les conséquences de ce mode d'élaboration d'une politique publique, sans cesse soumise au verdict des chiffres du chômage ont déjà été soulignées : stratification des mesures, faible durée de vie des dispositifs, multiplication des effets d'annonces politiques, complexité croissante du champ de ces politiques (...)» (2).
1.- Le verdict du taux de chômage
Dans ce constat, il importe, en raison même de la démarche suivie par la Mission, de ne pas sous-estimer ce que peut représenter ce verdict des chiffres du chômage. Il s'agit d'une dimension primordiale pour l'approche politique, et dans les alternances que notre pays a successivement connues depuis 1981, ce verdict des chiffres du chômage a compté pour beaucoup.
Pour une part importante, toute évaluation a posteriori des dispositifs successifs d'aides à l'emploi est conduite à critiquer d'abord la priorité qui a pu être donnée, à tel ou tel moment, au développement quantitatif de certains dispositifs. Il n'en demeure pas moins que, pour le politique, ni la question du montant des dépenses d'aides à l'emploi, ni la sensibilité à ce problème, n'ont la même dimension selon que le taux de chômage croît ou diminue. Mais la Mission n'a de toute façon pas cherché à faire l'historique des politiques de l'emploi. Elle s'est délibérément placée au terme de la « révolution silencieuse » précitée.
De ce point de vue, on peut penser, comme M. Christian Lhote, directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de l'Orne lors de son audition, que : « le procès fondé sur la multiplication d'aides subsistant les unes à côté des autres est maintenant un débat dépassé. Depuis une dizaine d'années, les aides mises en place se substituent à d'autres qui sont supprimées ».
Le tableau suivant récapitule les principales mesures de politique de l'emploi intervenues depuis 1973, en faisant apparaître les dates de début et de fin des dispositifs successifs. Sans doute le dispositif d'ensemble est-il complexe. Sans doute des simplifications sont-elles encore souhaitables et possibles. Mais l'architecture d'ensemble des aides apparaît globalement fixée, au point que toute remise en cause risquerait de relever moins du débat sur la plus ou moins grande efficacité d'un type d'aide que du débat de société.
LES PRINCIPALES MESURES DE POLITIQUE DE L'EMPLOI DEPUIS 1973 |
||||||||
Emploi marchand aidé |
Emploi |
Stages de formation professionnelle |
Cessation anticipée d'activité | |||||
1973-75 |
Contrat emploi-formation (1975-1983) |
. AFPA (fin des années 1940-) ; . FFPPS (1972-) |
. Allocation spéciale FNE 60 -65 ans (1967-79) . Garantie de ressources 60-65 ans (1972-1983) | |||||
1976-1980 |
. Pactes pour l'emploi des jeunes (1977-1982) : CEF, stages pratiques . Exonération de cotisations sociales . Exonération de charges pour les apprentis (loi de 1979) . Aide aux chômeurs créateurs d'entreprise |
. Pactes pour l'emploi des jeunes (1977-1982) ; . Stages d'insertion et de qualification . Stages de mise à niveau (1976-1990) |
||||||
1981-1983 |
. Emplois d'initiative locale (1981-1987) |
Rapport Schwartz . Stages d'insertion professionnelle et sociale (16-25 ans ; 1982-1990) . Stages régions (1983-) . Stages FNE/CLD (1983-1989) |
. Retraite à 60 ans . Allocation spéciale du FNE pour les 55-59 ans (1981-) . Contrats de solidarité . Pré-retraite-démission (1982-1983) ou progressive (1982-) | |||||
1984-1985 |
. Formations en alternance : Contrat de qualification et contrat d'adaptation (1984-) . Stage d'initiation à la vie professionnelle (1984-1991) |
. Travaux d'utilité collective (1984-1989) |
. Stages modulaires (1985-1989) |
. Dispense de recherche d'emploi (1984-) | ||||
1986-1987 |
. Exonération de cotisations sociales pour embauche de jeunes ou formation en alternance (1986-1987) . Contrat de réinsertion en alternance (CLD : 1987-1989) |
. Stages de réinsertion en alternance (CLD : 1987-1989) . Convention de conversion (1987-) |
||||||
1988-1991 |
Contrat de retour à l'emploi (CLD : 1989-1995) . Exonération de charges pour le premier salarié (1989-) . Entreprise d'insertion (1990-) . Exo-jeunes (1991-1993) |
. Contrat emploi solidarité (1990-) |
. Crédit formation individualisé jeunes (1989-) . Actions d'insertion et de formation (CLD : 1990-1993) |
|||||
1992-1998 |
. Emplois familiaux (1992-) . Allégement des charges sur les bas salaires (1993-) . Abattement temps partiel (1992-) . Contrat initiative-emploi (CLD ; 1995-) |
. Contrat emploi consolidé (1992-) . Contrat emploi de ville (1996-1997) . Emplois jeunes (1997-) |
. Stages d'insertion et de formation à l'emploi (SIFE) (1994-) |
. Allocation de remplacement pour l'emploi (ARPE) (1995-) | ||||
CLD : chômeurs de longue durée : AFPA : association pour la formation professionnelle des adultes ; FPPS : fonds de la formation professionnelle et de la promotion sociale. Entre parenthèses : dates de début et de fin des entrées dans le dispositif. D'après B. Roguet et P. Marioni « Les programmes mis en _uvre depuis 1973 : coûts et bénéficiaires » in Dares, La politique de l'emploi, La découverte, 1997. Tableau actualisé par ses auteurs. Source : Norbert Holcblat, la politique de l'emploi en France, in Les politiques de l'emploi en Europe et aux Etats-Unis, sous la direction de Jean-Claude Barbié et Jérôme Sautié, PUF, 1998. |
||||||||
En effet, il est toujours possible, au nom de la pure cohérence intellectuelle et de l'efficacité, de réclamer la suppression de dispositifs d'aide à l'emploi. Si l'on prend, par exemple, le cas des dispositifs de retrait d'activité, une évaluation en termes de coût-efficacité strictement économique peut conduire à constater que de tels dispositifs :
· ne sont pas créateurs nets d'emploi, puisqu'ils permettent au mieux de remplacer un salarié partant par un salarié remplaçant ;
· ont un coût croissant, puisqu'au-delà du coût résultant de l'entrée dans le dispositif (raisonnement en flux), il faut prendre en compte le coût total de la mesure (raisonnement en « stocks » cumulés des bénéficiaires) ;
· rendent plus rigides la dépense pour l'emploi car, à raison même de l'existence de ce « stock », les marges de redéploiement se trouvent amenuisées ;
· entrent de plus en plus en contradiction avec les évolutions démographiques qui conduisent à réfléchir aux mesures nécessaires à l'équilibre des régimes de retraite par répartition ;
· ont un coût économique puisqu'elles suppriment la part d'amélioration de la productivité liée à l'expérience des salariés.
En conclure qu'il faut purement et simplement supprimer tout dispositif de retrait d'activité, méconnaîtrait pourtant le contexte global dans lequel s'inscrit ce type de dispositif, même en période de diminution du chômage. D'autres éléments doivent être pris en compte dans un bilan coût/efficacité qui ajoute à l'approche strictement économique la prise en compte des aspects sociaux de la mesure, comme :
· la sélection opérée par le marché du travail, c'est-à-dire, en fait, les pratiques de beaucoup d'entreprises qui ne sont pas favorables aux travailleurs « âgés ». Ainsi que l'a souligné la ministre de l'emploi et de la solidarité devant la Mission, il existe un réel problème sur « les moyens de répondre à l'anxiété des hommes et des femmes qui atteindront l'âge de la retraite dans dix ans et ont travaillé soit tôt, soit sur des emplois pénibles ou dont la formation professionnelle a été rendue obsolète par le progrès technique » ;
· la difficulté soulignée, celle-là, par M. Christian Lhote de faire comprendre à des salariés de 40 ans que l'on garderait dans l'entreprise des gens âgés de plus de 57 ans et qu'eux-mêmes seraient remis sur le marché du travail.
En outre, il ne faut pas perdre de vue, comme l'a souligné M. Claude Seibel, directeur de la DARES, que la France a devant elle un problème de vieillissement de sa population active qui pourra « se concrétiser dans un certain nombre de branches par des situations analogues à ce que l'on a observé au début des années quatre-vingt, dans les chantiers navals, la sidérurgie, les charbonnages. »
2.- La place pour des choix de société
Cela signifie-t-il qu'un regard rétrospectif n'aurait plus d'utilité ? Au contraire, il permet plusieurs constatations qui n'ont en rien perdu de leur pertinence et montrent que les choix, en matière de politique de l'emploi, demeurent autant des débats de société, c'est-à-dire des choix politiques, que des querelles d'économistes.
En premier lieu, il existe des « modèles » de politique de l'emploi qui diffèrent selon les pays. Le rapport réalisé pour l'Office parlementaire d'évaluation des politiques publiques distingue un modèle anglo-saxon, caractérisé par un faible ratio dépense publique pour l'emploi /PIB, un modèle germanique caractérisé par de fortes dépenses de formation et d'aides à l'embauche et un modèle sud-européen, qui recouvre les situations de la France et de l'Italie, caractérisé par une importante dépense de préretraites et un montant de plus en plus important d'aides à la création d'emplois.
Le tableau suivant, issu de l'étude précitée, met en évidence la structure des politiques de l'emploi dans quelques pays européens en 1996-1997.
STRUCTURE DES POLITIQUES DE L'EMPLOI DANS QUELQUES PAYS EUROPÉENS EN 1996-1997 (en %) |
||||||||
France |
Italie |
R-U |
Suède | |||||
Administration, service public de l'emploi Formation professionnelle Mesures en faveur des jeunes Aides à l'embauche Mesures en faveur des handicapés Indemnisation du chômage Retraite anticipée |
5,5 9,5 1,9 9 7,4 65,7 1,3 |
5,1 11,5 7,7 15,3 2,6 46 11,5 |
2 0,5 21,4 31,1 - 34,7 10,2 |
12,2 6,1 8,8 - 1,4 71,4 - |
6,1 10,1 0,5 16,5 15,8 50,8 - | |||
Source : OCDE, Perspectives de l'Emploi, 1998*. * Structures en % calculées sur la base des données en pourcentage du PIB. Les totaux sont légèrement différents de 100 en raison des approximations. |
||||||||
Ces différences ont aussi un contenu politique, que M. Claude Seibel, directeur de la DARES a souligné, lors de sa participation à la table ronde du 17 mai dernier, comme le fait que certains modèles, complaisamment mis en avant, reposaient sur une part importante de travailleurs découragés de se porter candidats à la reprise d'un emploi.
En deuxième lieu, il a existé une hausse tendancielle du niveau de la dépense pour l'emploi en France. L'étude réalisée pour l'Office parlementaire des politiques publiques, à partir de données de la DARES, rappelle qu'avec un point de départ fixé en 1973 à 0,90 % du PIB, on était arrivé à des niveaux de 2,83 % en 1981, 3,62 % en 1986, 3,51 % en 1988, 4,16 % en 1993, 3,78 % en 1995. Le niveau demeure aujourd'hui de l'ordre de 4% du PIB.
En troisième lieu, cette hausse même de la dépense publique ne pouvait que donner naissance à une critique des approches purement quantitatives et justifier la recherche de redéploiements. Les étapes successives de la politique de l'emploi en France trouvent ici leur explication. Cette recherche d'une plus grande efficacité a visé la répartition entre les dépenses actives et les dépenses passives, et celle entre les mesures ciblées et les mesures générales.
Il apparaît ainsi que la terminologie des évaluateurs a déjà été reprise par les politiques.
B.- UN CHAMP PRIVILÉGIÉ POUR L'ÉVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES
Si les politiques n'ont pas trouvé le « remède miracle », ce n'est pas faute d'avoir soumis à l'évaluation les dispositifs qu'ils ont adoptés.
Pour sa part, la Cour des comptes a fréquemment exposé, dans ses rapports publics, les résultats des enquêtes menées sur les dispositifs d'aides publiques à l'emploi successivement mis en _uvre depuis le début des années 1980. Tel fut le cas pour l'indemnisation des travailleurs sans emploi (1983, 1987 et 1993), pour les emplois d'initiative locale (1985), pour les aides à la localisation d'activités créatrices d'emplois (1987), pour le Fonds national de l'emploi (1989), pour certaines aides de l'Etat au maintien et à la création d'emplois (1995), pour les contrats emploi-solidarité (1996), pour l'insertion par l'économique (1998).
Par ailleurs, l'analyse des aides à l'emploi constitue en permanence une part de l'activité de la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques du ministère de l'emploi et de la solidarité (DARES). Rien qu'en 1998, la publication de la DARES intitulée « Premières informations et Premières synthèses » a publié des numéros sur :
· les attitudes des Français sur le chômage et la politique de l'emploi dans les années 80 et 90 ;
· le chômage de longue durée et les politiques de l'emploi ;
· sortir du chômage : des chances inégales selon le contexte social ;
· les contrats initiative emploi en 1997 ;
· les attitudes des Français à l'égard du chômage et de son indemnisation et des politiques de l'emploi ;
· le retour à l'emploi après une convention de conversion ;
· les incitations financières en faveur du travail à temps partiel ;
· les emplois-familiaux et les organismes de services aux personnes en 1997 ;
· les demandeurs d'emploi en activité occasionnelle ou réduite ;
· les entreprises et les aides à l'emploi en quatre mesures (apprentissage, contrat de qualification, contrat initiative emploi et exonération pour l'embauche d'un premier salarié).
En 1999, la même publication a déjà concerné :
· la mise en _uvre locale du programme « nouveaux services-emplois jeunes » ;
· le premier bilan d'une année de programme « nouveaux services-emplois jeunes » ;
· sortir du chômage : reprendre un emploi ;
· le devenir des personnes sorties par anticipation d'un contrat emploi consolidé trajectoires professionnelles et récurrence du chômage ;
· quinze ans de métiers, l'évolution des emplois de 1983 à 1998.
Sur le plan européen, enfin, la mise en place d'une procédure de surveillance multilatérale conduit à renforcer le rôle de l'évaluation politique. L'article 128 du traité instituant la Communauté européenne, dont la mise en _uvre anticipée avait été décidée lors du Conseil européen réuni à Luxembourg les 20 et 21 novembre 1997, prévoit que le Conseil élabore annuellement, à la majorité qualifiée, des lignes directrices dont les Etats membres tiennent compte dans leurs politiques de l'emploi, et procède annuellement « à la lumière des lignes directrices pour l'emploi, à un examen de la mise en _uvre des politiques de l'emploi des Etats membres ». Ce travail donne lieu à l'élaboration de rapports, qui doivent permettre à la fois :
· d'avoir une meilleure connaissance des « modèles » nationaux de politiques de l'emploi, au travers des plans nationaux pour l'emploi ;
· de faire apparaître les mesures dont l'efficacité est la plus grande, et que la Commission et le Conseil pourront même qualifier de « bonnes pratiques ».
La mise en place de ces procédures n'en est qu'à son commencement, mais elle ne pourra que contribuer à une meilleure évaluation des politiques de l'emploi. Lors de son audition par la Mission, la ministre de l'emploi et de la solidarité a, par exemple, indiqué que les emplois-jeunes suscitaient l'intérêt de certains de nos partenaires, tandis que les capacités de certains territoires italiens à susciter le développement local grâce à une mise en cohérence de l'action des collectivités locales, du secteur financier et des entreprises devaient être analysées avec attention.
À terme, cette surveillance multilatérale devrait donc permettre d'améliorer l'efficacité des aides à l'emploi. C'est la raison pour laquelle le rapporteur spécial des crédits du budget du travail et de l'emploi devra désormais en rendre compte.
C.- TROUVER LE BON COMPROMIS ENTRE LA COMPLEXITÉ ET L'EFFICACITÉ
La tentation de tout évaluateur est sans doute de voir partout de l'excessive complexité, ce qui lui permet d'y apporter ses clartés. Il est vrai que les dispositifs d'aide à l'emploi sont complexes. Les chefs d'entreprise que la Mission a entendus l'ont déclaré. Mais la complexité ne signifie pas nécessairement l'absence de toute lisibilité. La « sédimentation » des aides, le cheminement progressif des politiques d'aide à l'emploi expliquent beaucoup de l'état de choses actuel.
Le danger d'une approche trop exclusivement « de terrain » est de ne voir que l'aide qui convient ou manque dans un cas donné et, par conséquent, la tentation est grande de considérer comme inutiles les aides répondant à d'autres situations. Le représentant du MEDEF a ainsi estimé, à la lumière de son expérience de dirigeant d'industrie « autant on peut supprimer certaines aides ciblées, autant celles concernant la formation me paraissent tout à fait utiles ». Au cours de la même table ronde, M. Jean Lardin a déclaré : « Pour l'Union professionnelle artisanale, les aides ciblées sont contestables. Elles ont un effet pervers sur les entreprises. Elles peuvent créer des effets d'aubaine et troubler le jeu de ce que doit être une véritable embauche ». Cette déclaration ne s'accorde d'ailleurs pas avec le constat fait par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de l'Orne, lors de son audition, d'où il ressort que ce sont surtout les petites entreprises qui accèdent aux aides ponctuelles aux embauches comme l'apprentissage, le contrat de qualification ou le contrat initiative emploi. En revanche, les aides collectives et les aides à la formation (dispositifs de formation du FNE, aide à la formation ou à l'adaptation du personnel) sont, selon lui, davantage utilisées par les entreprises de taille importante.
À l'inverse, le danger d'une approche trop bureaucratique est de vouloir atteindre une trop forte spécialisation des aides pour tenter de répondre à toutes les situations envisageables, ce qui ne peut qu'aboutir à des conditions de mise en _uvre trop complexes finissant par dissuader les éventuels bénéficiaires. S'y ajoute la crainte des « chasseur de primes » qui conduit à fixer des conditions d'attribution tatillonnes, sources de contentieux inévitables.
Il est difficile de trouver un compromis entre ces approches, M. Liêm Hoang Ngoc ayant même souligné l'existence d'un « double paradoxe » : les entreprises qui déclarent connaître un problème de coût salarial ont peu recours aux dispositifs de politique de l'emploi ; les entreprises qui utilisent ces dispositifs sont essentiellement celles qui en sont informées, sans nécessairement rencontrer un problème de compétitivité et de coût salarial.
Il convient donc de rechercher la stabilité des dispositifs qui permet une plus large connaissance de leur existence et garantit, de ce fait, une plus grande égalité d'accès. Cette stabilité n'est possible qu'au prix d'une simplification des aides, c'est-à-dire en distinguant des grandes catégories d'objectifs, et en laissant « au terrain » une certaine latitude de mise en _uvre.
Cela conduit donc à recommander de privilégier les dispositifs anciens, même au prix d'adaptations plutôt que les dispositifs nouveaux, sauf à procéder par substitution. Il faut bien reconnaître qu'il est plus facile d'aboutir à ce type de préconisation, directement issue d'une approche en termes d'évaluation a posteriori, en ayant le recul de vingt-six ans d'application des aides à l'emploi que dans l'urgence politique à laquelle les différents gouvernements ont dû faire face.
Enfin, et une fois encore, l'évaluation se doit d'être complète, en particulier pour les dispositifs ciblés ou constituant des « dépenses passives », qui sont fortement mis en cause au stade atteint par les politiques de l'emploi. S'il ne doit y avoir aucun « tabou » quant à l'évaluation des dispositifs existants, toute évaluation est incomplète si elle ne prend pas en compte les conséquences des suppressions proposées pour les publics appelés à bénéficier de ces aides. Une mesure de retrait d'activité ou une mesure de traitement social ne doit pas être condamnée par principe. Mais elle doit être supprimée si un autre dispositif permet de mieux atteindre l'objectif poursuivi de maintien du lien social ou du lien avec le marché du travail.
Une étude récente de la DARES (3) a montré qu'à côté des régimes d'assurance chômage ou de solidarité, le RMI joue le rôle de dernier volet d'indemnisation du chômage, les chômeurs inscrits au RMI étant surtout soit des chômeurs de très longue durée ayant épuisé leurs droits, soit de jeunes actifs exposés à un « chômage récurrent » leur interdisant de se constituer des droits.
Le politique ne peut, lui, se contenter d'évaluer a posteriori les dispositifs, séparément les uns des autres, et de suggérer des réformes partielles. C'est sa responsabilité, et sa dignité, d'assumer les conséquences sociales « en chaîne » des réformes qu'il a décidées.
II.- DES INSTRUMENTS D'ÉVALUATION PERFECTIBLES
A.- LA DIFFICULTÉ D'APPRÉCIER LA DÉPENSE POUR L'EMPLOI
La notion de dépense pour l'emploi n'est simple qu'en apparence. S'il est logique d'y inclure les dépenses se rapportant à l'emploi engagées par l'Etat, les collectivités territoriales, les entreprises au titre d'une obligation légale ou conventionnelle et l'UNEDIC, on peut en relever pourtant deux définitions distinctes.
La première est celle retenue par l'OCDE. Elle inclut les dépenses des administrations centrales ou décentralisées et celles des régimes d'assurance chômage financées par des contributions obligatoires des employeurs. La typologie de l'OCDE distingue sept catégories de dépenses :
· les dépenses d'administration et des services publics de l'emploi ;
· les dépenses de formation professionnelle (formation des chômeurs adultes et des travailleurs menacés de perdre leur emploi ; formation des adultes occupés). Mais, dans le cas de la France, cette catégorie n'inclut pas les dépenses des employeurs au titre de la participation obligatoire à la formation professionnelle ;
· les mesures en faveur des jeunes (jeunes chômeurs et jeunes défavorisés ; aide à l'apprentissage et aux autres types de formation des jeunes à caractère général) ;
· les mesures d'aide à l'embauche (subventions à l'emploi dans le secteur privé ; aides aux chômeurs créateurs d'entreprises, créations directes d'emploi dans le secteur public ou dans les organismes sans but lucratif) ;
· les mesures en faveur des handicapés (réadaptation professionnelle et emplois destinés aux handicapés) ;
· l'indemnisation du chômage ;
· la retraite anticipée pour motifs liés au marché du travail.
Le tableau suivant, tiré de l'étude réalisée pour l'Office parlementaire d'évaluation des politiques publiques, met en évidence le niveau de la dépense pour l'emploi au sens de l'OCDE pour différents pays.
DÉPENSES POUR L'EMPLOI ET TAUX DE CHÔMAGE DANS DIFFÉRENTS PAYS DE L'OCDE EN 1996-1997 | |||||
Canada |
Espagne |
Etats-Unis |
France | ||
Dépenses totales (% du PIB) |
3,79 |
1,65 |
2,37 |
0,43 |
3,13 |
Dépenses actives (en % DPE) |
33 |
29 |
21 |
40 |
42 |
Taux de chômage en 1997 |
9,7 |
9,2 |
20,8 |
4,9 |
12,4 |
Italie |
Japon |
Pays-Bas |
Royaume-Uni |
Suède | |
Dépenses totales (% du PIB) |
1,96 |
0,5 |
4,86 |
1,47 |
4,25 |
Dépenses actives (en % DPE) |
55 |
20 |
31 |
29 |
49 |
Taux de chômage en 1997 |
12,0* |
3,4 |
5,2 |
7,1 |
10,2 |
* en 1996. Source : OCDE, Perspectives de l'emploi, 1988 et rapport commandé par l'Office parlementaire d'évaluation des politiques publiques. | |||||
Lors de la table ronde organisée par la Mission le 27 mai dernier, M. Claude Seibel, directeur de la DARES, a indiqué que l'OCDE retient une définition « relativement ramassée » de la dépense pour l'emploi, car cette organisation « insiste beaucoup sur le thème des dépenses d'activation vers la recherche d'emploi ». On peut souhaiter, avec lui, que la Communauté européenne, avec la mise en place de la procédure de surveillance multilatérale des plans nationaux pour l'emploi, contribue à l'amélioration des instruments statistiques permettant les comparaisons entre Etats membres de l'Union européenne, d'autant plus que la plupart d'entre eux se sont dotés d'une même monnaie.
La seconde définition est celle retenue par la DARES. Elle est plus large que celle de l'OCDE. Outre les dépenses des administrations publiques (Etat, établissements publics et collectivités locales), de l'UNEDIC et de l'Association pour la structure financière (ASF) destinée à financer les conséquences de l'abaissement de l'âge de la retraite, elle recouvre les dépenses des employeurs au titre de la participation obligatoire à la formation professionnelle. En revanche, cette notion n'inclut pas les compensations des exonérations générales de charges sociales. Dans sa typologie, la DARES distingue huit catégories de dépenses :
· Deux catégories sont qualifiées de « dépenses passives » : l'indemnisation du chômage et l'incitation au retrait d'activité ;
· Six catégories sont qualifiées de « dépenses actives » :
- la formation professionnelle. Il convient de relever que la notion de dépenses de formation professionnelle au sens de la dépense pour l'emploi diffère de celle de dépenses de formation professionnelle au sens du compte économique de la formation professionnelle. Cette seconde notion recouvre la totalité de l'effort de formation professionnelle consenti par la collectivité, sans que le lien avec l'emploi soit directement recherché ;
- la promotion de l'emploi (contrats emploi-solidarité et contrats emplois consolidés ; exonérations de cotisations sociales faisant l'objet d'une compensation : jeunes en apprentissage, contrat de qualification ou chômeurs de longue durée en contrat de retour à l'emploi ou contrat initiative emploi ; primes à l'embauche : primes du CIE, des formations en alternance, d'apprentissage ; aides aux chômeurs créateurs ou repreneurs d'entreprises ; actions de l'AGEFIPH en faveur de l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés ; subventions pour l'insertion par l'économique) ;
- les exonérations non compensées (exonération à l'embauche du premier salarié, abattement en faveur des emplois à temps partiel, exonérations accompagnant le contrat emploi-solidarité ou le contrat emploi-consolidé) ;
- le maintien de l'emploi (indemnités spéciales de montagne ; indemnisation du chômage partiel ; dépenses d'accompagnement des restructurations comme les congés de conversion, l'aide au passage à temps partiel, les cellules de reclassement) ;
- l'incitation à l'activité (garanties de ressources des travailleurs handicapés ; aides à l'installation des jeunes agriculteurs) ;
- le fonctionnement du marché du travail (subvention à l'ANPE).
A l'occasion de la table ronde du 27 mai dernier, M. Alain Gubian, chef de la mission « Analyse économique » de la DARES, a insisté sur la nécessité s'imposant à elle d'avoir présentes à l'esprit les exigences de la comparaison internationale. C'est la raison pour laquelle la DARES ne prend pas en compte la ristourne dégressive dans son agrégat, mais la fait apparaître par ailleurs.
Une difficulté particulière tient enfin au traitement des aides des collectivités décentralisées. Comme l'avait déjà relevé la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur les aides à l'emploi de 1996, l'effort des collectivités locales est imparfaitement appréhendé. Elle relevait que ne sont prises en compte que les dépenses de formation des régions, les primes régionales à l'emploi et à la création d'emploi, les exonérations de taxe professionnelle accordées de plein droit et sur agrément aux entreprises s'engageant à maintenir ou créer des emplois au titre de l'aménagement du territoire, et l'action sociale des départements pour les chômeurs.
Il serait souhaitable que la Cour et les chambres régionales des comptes puissent contribuer à une amélioration des connaissances à cet égard.
B.- L'INCERTITUDE DES RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS DES DIFFÉRENTS DISPOSITIFS D'AIDE À L'EMPLOI
A partir de l'étude réalisée pour l'Office parlementaire d'évaluation des politiques publiques, la Mission a mis en évidence l'existence d'évaluations macro-économiques et micro-économiques. La synthèse réalisée, dans le rapport précité, des différentes études tendant à évaluer les dispositifs d'aide à l'emploi, fait apparaître des conclusions marquées d'une extrême prudence. Les différents modèles d'évaluation souffrent d'un trop grand écart entre la représentation théorique de l'entreprise qui les sous-tend et les faits constatés. Les simulations au moyen des modèles économétriques reposent sur une entreprise représentative de toutes les entreprises, c'est-à-dire sur le postulat d'une uniformité de réactions aux mesures de politique de l'emploi (raisonnement à partir d'une demande de travail agrégée).
La table ronde du 27 mai dernier a d'ailleurs montré qu'il existait « des nuances d'appréciation », entre les économistes qui y ont pris part, sur la validité des résultats des évaluations macro-économiques...
Les évaluations micro-économiques consistent, pour leur part, à comparer la trajectoire de retour à l'emploi d'un groupe de demandeurs d'emploi bénéficiaires des aides publiques et celle d'un groupe témoin de demandeurs d'emploi non bénéficiaires. L'étude réalisée pour l'Office parlementaire d'évaluation des politiques publiques indique que l'incertitude affectant les résultats de telles études tient à la difficulté méthodologique de mettre en évidence des caractéristiques inobservées de chaque groupe qui ont une influence sur les variables du résultat. La comparaison des trajectoires de retour à l'emploi des chômeurs selon qu'ils ont ou non bénéficié d'un emploi aidé paraît mieux correspondre aux conditions de la prise de décision politique.
Dans quelle mesure, les travaux d'évaluation peuvent-ils fonder, à eux seuls, une décision de suppression ou d'aménagement des dispositifs d'aides à l'emploi ? Votre Rapporteur reconnaît qu'il est difficile, pour lui, de répondre à cette question, même après les travaux de la Mission auxquels il a participé. Si l'on prend l'exemple de l'exonération pour l'embauche d'un premier salarié :
· les représentants patronaux à la table ronde organisée par la Mission ont pu donner à penser qu'ils doutaient de son efficacité ;
· lors de son audition, la ministre de l'emploi et de la solidarité a, elle, souligné la complexité de la question et le fait que l'embauche d'un premier salarié était toujours très difficile pour des raisons tant psychologiques que pratiques ;
· une enquête sur l'exonération pour l'embauche d'un premier salarié réalisée, à un an d'intervalle, auprès des mêmes entreprises au sujet de la même embauche, a montré que 40 % des entreprises bénéficiaires déclarant avoir procédé à l'embauche grâce à la mesure à la première interrogation avaient répondu un an plus tard, qu'elles auraient de toute façon recruté la même personne sans la mesure (4).
S'il faut souhaiter une amélioration qui soit de l'ordre du possible, votre Rapporteur s'attachera plus particulièrement à suivre les programmes annuels d'études micro-économiques des dispositifs d'aides à l'emploi réalisés par la DARES ou financés sur les crédits d'études statistiques du budget dont il assume le suivi.
III.- LE BON EMPLOI DES FONDS PUBLICS EN CE QUI CONCERNE LES AIDES À L'EMPLOI
A.- LA CRÉATION NETTE D'EMPLOIS PEUT NE PAS ÊTRE L'UNIQUE OBJECTIF DES AIDES À L'EMPLOI
La Mission a repris la grille d'analyse mise à sa disposition par les évaluations déjà réalisées. Sa formulation la plus récente a été donnée, en ce qui concerne les aides ciblées, par l'étude de la DARES intitulée « Les entreprises et les aides à l'emploi en quatre mesures », publiée au mois de novembre 1998 (5). Cette étude distingue :
· l'effet emploi net d'un dispositif : en l'absence du dispositif, l'employeur interrogé déclare qu'il n'aurait pas embauché, ni sans aide, ni sous un autre dispositif ;
· l'effet emploi-substitution : en l'absence du dispositif, l'employeur interrogé déclare qu'il en aurait utilisé un autre, mais qu'il n'aurait pas embauché sans aide ;
· l'effet d'aubaine : en l'absence du dispositif, l'employeur interrogé déclare qu'il aurait de toute façon embauché. On peut même distinguer une « aubaine nette », le recours à un autre dispositif étant exclu, et une « aubaine-substitution », le recours à un autre dispositif étant possible.
Le graphique de la page suivante, tiré de cette étude, présente les résultats des différents dispositifs étudiés (exonération du premier salarié, contrat initiative emploi, contrat de qualification et apprentissage) au regard de ces différents effets tels qu'ils sont déclarés par les employeurs ayant répondu aux enquêtes. La DARES a en effet décidé de conduire parallèlement des enquêtes sur plusieurs dispositifs d'aides avec un questionnaire identique quant à l'effet de ces dispositifs sur l'emploi. Une telle harmonisation apparaît de nature à améliorer la comparaison entre les différentes aides.
La DARES a résumé l'appréciation d'ensemble qui ressort de cette étude dans les termes suivants : « Ces aides contribuent, en premier lieu, à réduire la sélectivité du marché du travail au profit des moins qualifiés et des chômeurs de longue durée. L'effet net sur l'emploi est beaucoup plus variable : relativement important pour les contrats d'apprentissage et de qualification, il est modeste s'agissant du CIE et de l'exonération 1er salarié. »
COMPARAISON DES DISPOSITIFS ET DES ENQUÊTES
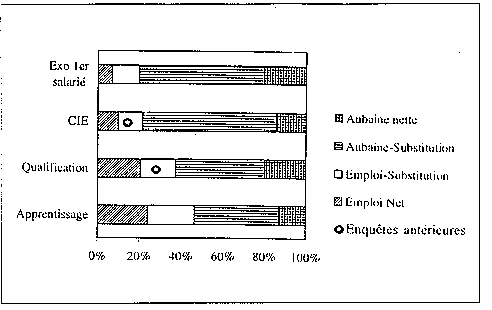
La mention « d'enquêtes antérieures » vise des résultats antérieurs aux enquêtes harmonisées.
Source : DARES, Premières synthèses, novembre 1998, n° 46-1.
La création nette d'emplois peut donc ne pas constituer l'unique critère d'évaluation d'une aide à l'emploi. Pour les aides ciblées, la modification de l'ordre dans la file d'attente des demandeurs d'emploi, au bénéfice de ceux qui sont les plus éloignés du marché du travail, doit être le premier élément à prendre en compte. En raison de l'extrême sélectivité du marché du travail et de la médiocre « employabilité » de certaines personnes en état durable de chômage, il existe donc un volet incompressible de mesures ciblées.
Lors de son audition par la Mission, M. Christian Lhote, directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de l'Orne, évoquant le CIE, a indiqué : « je crois que l'on a absolument besoin d'instruments de ce type pour permettre l'accès du public exclu au marché du travail et à l'entreprise.(...) Il faut relativiser le terme d'effet d'aubaine. C'est peut-être une aubaine pour le chômeur de longue durée d'être recruté.»
Le débat sur ce type d'aide se présente donc moins en termes de suppression ou de maintien qu'en termes de définition stricte des publics cibles.
Par exemple, le CIE a été recentré sur les publics prioritaires. Dans l'attente des résultats des contrôles effectués par la Cour des comptes, on peut relever les résultats de l'étude précitée de la DARES indiquant que :
· interrogés pour savoir s'ils se seraient reportés sur un autre dispositif en l'absence de celui utilisé, 78 % des établissements répondent positivement pour le CIE ;
· le recours au CIE modifie six fois sur dix le profil des salariés recrutés en matière d'âge, de formation ou d'expérience, au profit de personnes moins expérimentées ou moins formées ;
· 41 % des établissements interrogés déclarent que, sans aide, ils auraient embauché de préférence une personne inscrite depuis moins de 12 mois à l'ANPE.
Et la DARES observe : « Le recours au CIE a modifié au total trois fois sur quatre le profil de la personne embauchée. L'atténuation de la sélectivité à l'embauche est bien le principal apport de ce contrat, notamment chez les utilisateurs intensifs. »
AVANTAGES FINANCIERS ET EFFET EMPLOI : En abaissant le coût du travail, les aides à l'emploi incitent certaines entreprises à procéder à des embauches qu'elles n'auraient pas effectuées autrement. On peut raisonnablement supposer que cet effet emploi est d'autant plus important que l'abaissement du coût du travail est conséquent. Dans 40 ans de politique de l'emploi, la DARES a calculé des coefficients de création nette d'emploi à partir de l'allégement du coût du travail de chaque dispositif et en essayant de tenir compte des caractéristiques propres aux contrats en alternance qui permettent de payer le salarié en dessous du salaire minimum. Avec cette approche, le coefficient emploi du CIE est plus fort que celui du contrat de qualification. Tel qu'il se dégage des enquêtes, l'effet emploi du CIE, relativement à celui des autres dispositifs, apparaît plus faible que ce que laisserait envisager la comparaison des seuls avantages financiers. Plusieurs facteurs peuvent expliquer ces différences. D'abord, les contraintes associées à l'embauche sont fort différentes. Le CIE est sans doute le dispositif pour lequel les contreparties en termes de caractéristiques de la personne embauchée sont le plus fortement ressenties par les employeurs. Probablement moins à cause d'une éventuelle productivité plus faible des personnes embauchées - l'enquête montre que le temps d'adaptation des bénéficiaires du CIE n'est pas plus long que celui des autres salariés pour un même poste - qu'à cause des réticences que peut provoquer le parcours antérieur des personnes concernées. Les employeurs semblent considérer qu'au risque lié au poste (dont la rentabilité est jugée insuffisante pour qu'il soit créé en l'absence d'aide), l'embauche dans le cadre d'un CIE ajoute un risque lié au salarié qui réduit le caractère incitatif de la baisse du coût du travail. Ensuite, des effets liés au type d'embauche ou des biais liés au statut de la personne répondant à l'enquête permettent d'expliquer l'absence apparente d'écart entre le CIE et l'exonération pour l'embauche d'un premier salarié. En premier lieu, pour chaque dispositif hors apprentissage, l'effet emploi déclaré est de 7 à 8 points supérieur quand la personne qui répond à l'enquête est le chef d'entreprise. En second lieu, toutes choses égales par ailleurs, l'effet emploi est plus fort lorsque l'embauche correspond à une création de poste et non pas à un remplacement sur un poste existant. Or, pour l'exonération pour l'embauche d'un premier salarié, en dehors du cas rare du remplacement d'une personne non comptée comme salarié, il s'agit toujours d'une création d'emploi et le répondant est chef d'entreprise. En se limitant au cas des réponses faites par les chefs d'entreprise au sujet d'une création d'emploi, l'effet déclaré sur l'emploi du CIE s'élèverait alors à 29 %. |
Source : DARES, Les entreprises et les aides à l'emploi en quatre mesures, Premières informations et Premières synthèses, novembre 1998, n° 46-1 |
En ce qui concerne, les aides au secteur non marchand, une même préoccupation de recentrage sur les publics prioritaires est apparue. S'agissant du contrat emploi solidarité (CES), la Cour des comptes avait critiqué le fait que des publics relativement les moins défavorisés tendaient à concurrencer efficacement les plus éloignés de l'emploi dans l'accès aux CES. Dans la partie du rapport public de la Cour des comptes pour 1998 consacrée aux suites données à ses observations antérieures, la ministre de l'emploi et de la solidarité a indiqué les mesures prises pour garantir le recentrage au bénéfice des publics prioritaires :
· la répartition des crédits du CES s'effectue désormais en « mois-CES » et non plus en nombre de conventions ;
· depuis 1997, les critères de répartition des crédits prennent en compte non seulement l'état de consommation des années précédentes, mais aussi des critères objectifs liés à la situation du chômage et de l'emploi au niveau régional ;
· en 1998, a été mis en place le programme de globalisation et de déconcentration des mesures de lutte contre le chômage de longue durée permettant d'adapter le niveau des enveloppes de mesures (CES, contrats emploi-consolidé (CEC), stage d'insertion et de formation à l'emploi, contrat initiative-emploi, stage d'accès à l'entreprise) aux besoins des demandeurs d'emploi sur le plan local ; la répartition du nombre d'entrées par mesure s'effectue au niveau local sur la base de diagnostics locaux élaborés en liaison avec les partenaires du service public de l'emploi, dans le cadre d'un volume annuel financier impératif.
· Avec la généralisation de cette globalisation territoriale, il s'agit, selon les termes d'une circulaire du 15 juin 1998, « d'atteindre les objectifs fixés par le Gouvernement en matière d'emploi à travers l'élaboration et la mise en _uvre d'une politique locale d'accès à l'emploi ».
En outre, la loi du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions a fait des CES et des CEC des moyens presque entièrement réservés à l'accès à l'emploi des personnes en voie d'exclusion. L'objectif que les bénéficiaires du RMI et les chômeurs de longue durée représentent, en 1999, au moins 75 % des personnes recrutées en CES et en CEC est en voie d'être atteint, comme l'a indiqué la ministre de l'emploi et de la solidarité lors de son audition par la Mission. A ce titre, l'Agence nationale pour l'emploi joue un rôle central en effectuant un « diagnostic individualisé » pour orienter et sélectionner les personnes relevant de ces dispositifs de dernier recours.
La démarche de globalisation et l'individualisation doit donc permettre d'améliorer l'efficacité des dispositifs d'aide qu'elle concerne, étant entendu qu'une évaluation approfondie devra tenir compte du parcours ultérieur des bénéficiaires, compte tenu même d'un taux de retour à l'emploi propre à un contexte de réinsertion et parfois de « resocialisation ».
B.- LA CONFIRMATION DE LA STRATÉGIE D'ABAISSEMENT DU COÛT DU TRAVAIL
La réduction du coût du travail, en laissant de côté la question de la modération salariale, est-elle créatrice d'emplois ? Cette question a fait l'objet de débats importants, au cours des réunions de la Mission, à propos des allégements de charges sociales sur les bas salaires, élément central de la « révolution silencieuse » des politiques de l'emploi menées en France.
Le point de départ de la « controverse » qui a marqué les travaux de la Mission a été la position exprimée par M. Liêm Hoang Ngoc, coordonnateur de l'étude réalisée pour l'Office parlementaire d'évaluation des politiques publiques. Il a douté que l'exonération générale de cotisations sociales sur les bas salaires soit la meilleure solution possible, car si elle bénéficie aux entreprises de main d'_uvre, elle allège aussi les charges des autres entreprises, ce qui n'est pas satisfaisant en termes de rationalité de la dépense pour l'emploi. Il a insisté sur la diversité des situations des entreprises, en termes de situation financière et de stratégie d'emploi, et souligné qu'il n'est pas possible de tirer de la situation d'un secteur donné une préconisation pour l'ensemble des secteurs d'activité. Dans certains secteurs, il peut effectivement exister des problèmes de coût du travail, mais les mesures vont pourtant bénéficier à tous les secteurs et à toutes les entreprises. Il a souligné que ce débat recouvre également un débat de société sur le point de savoir quelle priorité la France doit se donner, entre le développement de l'emploi qualifié ou celui de l'emploi non qualifié. Selon lui, une politique d'abaissement du coût du travail n'est justifiée que si deux conditions sont réunies : la première tenant à l'existence d'une pénurie de main d'_uvre qualifiée, et la seconde, à l'existence d'une forte élasticité emploi/salaire (effets en termes de création d'emplois de la diminution du niveau de salaire). Or, encore selon lui, les travaux économétriques n'ont pas mis en évidence une élasticité de cette nature qui soit globalement significative. En outre, en France, le coût global du travail se situe dans la moyenne européenne et a évolué à un rythme inférieur aux gains de productivité et à l'inflation. Pour le coût du travail non qualifié, les résultats ne sont, toujours selon lui, pas apparus statistiquement significatifs.
Lors de la table ronde du 27 mai 1999, il a résumé cette analyse en disant : « centrer toute la politique de l'emploi sur la réduction du coût du travail me semble bien peu rationnel pour rationaliser la dépense pour l'emploi ».
Cette position a été critiquée par la DARES et la direction de la prévision. Lors de la table ronde précitée, leurs représentants ont remis aux membres de la Mission le résumé d'une étude faite par l'INSEE, la direction de la prévision et la DARES sur les enseignements pouvant être tirés de sources statistiques disponibles quant aux effets sur l'emploi des allégements de charges sur les bas salaires. Il ressort de ce document, présenté en annexe au présent rapport, que « selon les évaluations macro-économiques, environ 150 000 emplois auraient été créés grâce aux allégements de charge sur les bas salaires entre fin 1995 et fin 1998, ce qui peut être rapproché de la stabilisation de la part des emplois peu qualifiés dans l'emploi privé. Dans le même temps, la proportion de salariés rémunérés en deçà de 1,3 SMIC mensuel a augmenté nettement entre mars 1994 et mars 1998 : + 6 points pour l'ensemble des salariés, + 8 points pour les seuls salariés non qualifiés. Cette croissance s'observe surtout au cours des deux dernières années » . Le directeur de la prévision a fait état des analyses du CSERC faisant ressortir, comme le montre le graphique suivant, « un coût du travail peu qualifié très élevé en France » si l'on compare le coût relatif du salaire minimum par rapport au salaire moyen.
COÛT RELATIF DU SALAIRE MINIMUM PAR RAPPORT AU SALAIRE MOYEN
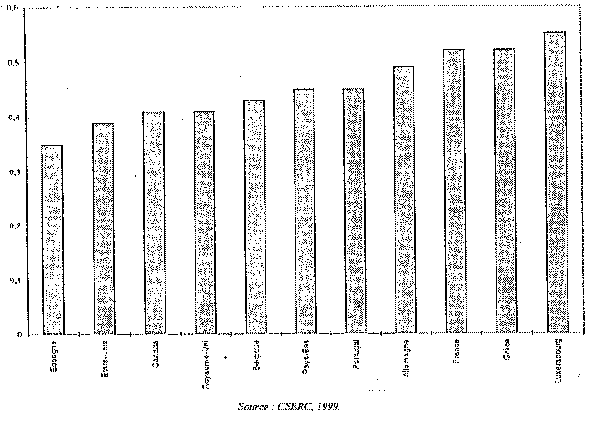
Au cours de cette table ronde, les représentants du patronat ont, pour leur part, attaché « beaucoup d'importance » à la réduction du coût du travail.
Lors de son audition, la Ministre a d'une certaine manière clos le débat sur le plan de l'évaluation politique, telle qu'elle est réalisée par la Mission, lorsqu'elle a indiqué que « l'accord est donc général sur le diagnostic » du problème du coût du travail non qualifié. La baisse du coût du travail est donc confirmée comme élément structurel de la politique de l'emploi, le directeur de la Prévision ayant même considéré que : « le fait d'avoir eu un coût du travail peu qualifié extrêmement élevé par rapport à la moyenne et le fait de le ramener à des niveaux plus normaux n'est pas vraiment une aide à l'emploi. C'est plus la correction d'une erreur, malheureusement collective (...). Ce n'est pas tant une aide à l'emploi que le retour à des fondamentaux plus sains. »
C.- LA QUESTION DU CONTENU DE L'ENRICHISSEMENT DE LA CROISSANCE EN EMPLOIS
Dans une étude récente de l'UNEDIC (6), il est indiqué que : « Dans les années 70, il fallait une augmentation d'au moins 2,6 % du PIB marchand pour qu'il y ait création nette d'emplois. Ce rythme est tombé à 2,2 % dans les années 80 et à 1,2 % depuis 1990 ».
Cette même étude observe que l'enrichissement de la croissance en emplois est, sur la dernière décennie, expliqué :
· pour 10 % par la déformation sectorielle (c'est-à-dire le développement des activités tertiaires) ;
· pour 40 % par le développement du temps partiel ;
· pour 20 à 30 % par le développement des emplois courts ou précaires ;
· pour 20 à 30 % par la politique d'allégement des charges sociales.
Selon l'auteur de l'étude précitée, « le fait que la croissance française soit plus riche en emplois repose en grande partie sur la montée en puissance du travail à temps partiel ».
Par rapport aux autres pays, le travail à temps partiel a longtemps été relativement moins utilisé en France. On a pu citer les chiffres de 1973, date à laquelle pour 4 % de salariés à temps partiel dans notre pays, la proportion atteignait 10 % en Allemagne, 14 % au Japon, 15 % aux Etats-Unis et 16 % au Royaume-Uni. Une rupture est apparue en 1992, année de l'institution d'une exonération de charges de 50% , ramenée ensuite à 30 %. L'auteur précité relève que le travail à temps partiel « a autant augmenté entre 1992 et 1996 qu'entre 1978 et 1990 ».
Dans la note commune de l'INSEE, de la direction de la prévision et de la DARES du 9 avril 1999, une appréciation plus nuancée est portée : « Il est pour autant difficile de séparer, dans l'accélération du développement du temps partiel observé à partir de 1992, ce qui est lié aux mesures spécifiques d'abattement, aux allégements de charges sur les bas salaires et aux autres facteurs structurels et tendanciels ».
Pour leur part, les auteurs de l'étude réalisée pour l'Office parlementaire d'évaluation des politiques publiques observent que les incitations pour le salarié à prendre un travail à mi-temps antérieures à 1992 sont restées relativement inefficaces, qu'il s'agisse des préretraites progressives, de l'indemnité compensatrice pour les chômeurs reprenant une activité moins rémunérée que l'allocation de chômage car « l'impact de ces dispositifs (...) a été sans commune mesure avec l'ampleur du volume de travail à temps partiel qui s'est développé en dehors de toute aide. » En revanche, ces mêmes auteurs soulignent que dès que l'Etat a encouragé cette forme d'emploi, grâce à l'utilisation de mesures de politique de l'emploi visant à abaisser le coût du recours au temps partiel par l'allégement des cotisations sociales patronales, « les données récentes font apparaître le succès de cette mesure en termes de créations d'emplois ».
Ainsi qu'il l'a indiqué lors de l'audition par la Mission de la ministre de l'emploi et de la solidarité, votre Rapporteur insiste pour que ne soit pas méconnu, dans l'évaluation du dispositif d'abattement au titre du temps partiel, les conditions de vie difficiles que recouvre, en réalité, la dénomination quelque peu abstraite de « temps partiel contraint ».
Il faut d'ailleurs rappeler que les contrats de travail à temps partiel annualisé conclus postérieurement à la loi du 13 juillet 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail n'ouvrent droit au bénéfice de l'abattement qu'en cas d'application, dans l'entreprise, d'un accord sur le temps partiel pratiqué à la demande du salarié (« temps choisi »).
Avec les aides à l'emploi, la Mission n'a pas craint de retenir un thème qui, s'il était complexe, lui permettait, mieux que d'autres, à raison même de ses enjeux, de faire la preuve du caractère novateur de sa démarche et de son intention de la mener à son terme. Peut-on trouver meilleur terrain qu'une enveloppe globale d'aides ou d'exonérations de l'ordre de 350 milliards de francs, dans une conception large de la dépense pour l'emploi, recouvrant des dispositifs complexes longtemps marqués par une instabilité certaine et le sentiment, non totalement faux, d'un « maquis » d'aides maîtrisé par les seuls initiés ? Bref, une présomption forte de perte d'efficacité.
Pour garantir son intervention, la Mission a d'abord dû délimiter le champ de son intervention. Elle a mis à part les importantes inflexions introduites depuis 1997 pour examiner la structure traditionnelle des aides à l'emploi, telle qu'elle a été héritée de l'évolution des politiques de l'emploi depuis 1973 : un volet d'aides ciblées en direction des personnes les plus touchées par la sélectivité du marché du travail, un volet d'aides générales autour de la ristourne dégressive et un volet d'organisation de la cessation anticipée d'activité. Seul, un tel recul rendait possible, s'agissant d'une première évaluation parlementaire, l'approche en termes stricts de coût-efficacité, reprise de l'examen du bon emploi de l'argent public traditionnel à la Cour des comptes.
La deuxième tâche de la Mission a été de se doter d'une « grille de lecture » des différentes aides et, s'agissant ici du premier enseignement de ses travaux, les données disponibles ont montré qu'il existe de fortes marges d'amélioration des modalités d'évaluation de la politique de l'emploi. Des documents dont la Mission a eu connaissance et des auditions auxquelles elle a procédé, il ressort de trop fortes disparités ou insuffisances.
Les disparités sont manifestes dans la définition même des agrégats représentatifs de la dépense pour l'emploi. Le bon sens parlementaire et le bon sens gestionnaire voudraient que l'on disposât de données stables, exhaustives, permettant les comparaisons dans le temps et entre les différents types de politiques de l'emploi. Sans même parler des contraintes propres aux comparaisons internationales, dont on peut penser qu'elles iront en s'amplifiant au sein de l'Union européenne, il apparaît, par exemple, que la connaissance de l'action des collectivités locales pour aider l'emploi demeure lacunaire. Paradoxalement, ce manque presque complet d'information porte sur des aspects qui correspondent aux démarches d'individualisation des mesures et de rapprochement de la prise de décision des bassins d'emploi qui sont désormais mises en avant, par l'Etat, dans l'attribution de ses aides visant les publics les plus éloignés du marché du travail. Ce constat avait été celui de la Commission d'enquête sur les aides à l'emploi de 1996. Il est apparu à la Mission que ni les suites données à cette dernière, ni, plus récemment, les travaux de l'Office parlementaire d'évaluation des politiques publiques n'avaient permis de progresser en ce domaine. La Mission a pensé que la Cour des comptes et les chambres régionales des comptes pourraient apporter d'utiles éclaircissements sur ce point.
Sans parler même des désaccords entre économistes, les insuffisances des résultats de certaines enquêtes visant à apprécier les motivations des employeurs qui utilisent les aides sont manifestes. N'y a-t-il pas matière à perplexité lorsque des enquêtes auprès d'employeurs sur l'utilisation d'un même dispositif d'aide font apparaître des réponses contradictoires, du même employeur, à la même question, dans deux enquêtes successives, sur les mêmes embauches aidées ? Et encore lorsqu'il apparaît que l'appréciation faite de la réponse doit varier selon que c'est l'employeur qui a ou non répondu lui-même au questionnaire ?
La Mission a donc considéré qu'il fallait généraliser et perfectionner les évaluations. Il est clair pour elle que c'est d'abord par le suivi des trajectoires de retour à l'emploi des bénéficiaires après qu'ils soient sortis des dispositifs aidés qu'il faut tendre à apprécier l'efficacité des dispositifs et les aménagements et redéploiements qu'ils nécessitent.
La troisième tâche de la Mission consistait à savoir quel doit être l'objectif principalement poursuivi par les aides à l'emploi. A cet égard, elle a abouti à la conclusion que la création nette d'emplois ne pouvait être le seul objectif de ces aides. C'est la raison pour laquelle elle a estimé pouvoir, sans rien abdiquer, reprendre à son compte la terminologie des évaluateurs lorsqu'ils parlent de « modification dans la file d'attente des demandeurs d'emploi ». Encore faut-il, la validité de cet objectif reconnue, ne pas se contenter d'en avoir une conception paresseuse, empreinte d'un économisme étroit. Pour la Mission, dès lors qu'on s'est donné les moyens de rétablir les « fondamentaux » en termes de croissance et d'abaissement du coût du travail, il demeure un exigeant devoir de vérifier les conditions réelles de mise en _uvre des dispositifs ciblés visant les personnes les plus éloignées du marché du travail, sans qu'il s'agisse de se limiter à vouloir garder la maîtrise du coût global d'un volant de dispositifs « parking ». Bien au contraire, il s'agit de se doter de moyens permettant de ne pas se résigner à ce que certains demeurent durablement exclus du marché du travail.
La dernière tâche de la Mission a été d'oser « mettre sur la sellette » un certain nombre de dispositifs et de montrer, dès son avènement, qu'elle était disposée à y procéder sans tabou. Si elle n'a matériellement pas pu, dans le temps qui lui était imparti au cours de cette première session, procéder successivement à l'examen de chaque dispositif d'aide, la Mission a néanmoins tenu à marquer clairement le principe qui doit guider l'action de la Commission des finances lorsqu'elle propose à notre Assemblée l'adoption de crédits ou d'allégements fiscaux ou sociaux au titre de l'aide à l'emploi. Elle l'a fait de deux façons :
- en suggérant de diminuer des aides dont elle a raisonnablement présumé, au vu des résultats de ses travaux sur les mécanismes des décisions de création d'emplois et d'embauches, qu'elles offraient de forts effets d'aubaine. C'est le cas pour l'exonération de cotisations sociales patronales pour l'embauche d'un premier salarié ou la réduction d'impôt pour création d'emploi des entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ;
- en fixant un clair principe d'action en matière de ce qu'il est convenu d'appeler les « mesures d'âge ». Pour la Mission, ces mesures constituent un non-sens économique et social puisqu'elles facilitent, grâce à l'argent public, l'adoption par les entreprises d'un management imprévoyant ou sans imagination de leurs effectifs et de leur pyramide des âges. La Mission a donc estimé qu'il convenait, dans ce domaine, d'émettre un « message fort » en demandant la quasi-suppression des actuelles préretraites totales du FNE. Son raisonnement a consisté à marquer les insuffisances de ce dispositif, en raison de l'absence d'obligation de remplacement des salariés bénéficiaires. Cette insuffisance est manifeste par rapport au régime de l'allocation de remplacement pour l'emploi (ARPE), au financement duquel l'Etat ne participe d'ailleurs pas, sauf à titre résiduel pour certains anciens combattants d'Afrique du Nord. Mais, il va bien entendu de soi qu'il n'a jamais été question pour la Mission de préconiser la remise en cause de l'allocation de cessation anticipée d'activité des salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante ou des salariés et anciens salariés reconnus atteints d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante.
Enfin, votre Rapporteur ne voudrait pas donner le sentiment que la Mission aurait méconnu les mesures de redéploiements des crédits et de recentrage des dispositifs, déjà engagées par le Gouvernement et les services du ministère de l'emploi et de la solidarité. Elle a bien vu, par exemple, que, dans la partie de son rapport public pour 1998 consacrée aux suites données à ses observations antérieures, la Cour des comptes a fait état de mesures prises pour garantir que les crédits du contrat emploi solidarité servent d'abord aux publics prioritaires. Elle a également noté qu'un recentrage du CIE avait été engagé. Cette réponse anticipée aux conclusions de la Mission montre bien la contribution que cette dernière peut apporter, au-delà de la nécessaire revalorisation du rôle de l'Assemblée nationale, à la pleine réalisation des objectifs que s'est fixés le Gouvernement, en suggérant des réformes éclairées par un contrôle parlementaire rénové.
PROPOSITIONS
1.- METTRE UN TERME AU FINANCEMENT PUBLIC DE PRÉRETRAITES SANS EMBAUCHES COMPENSATRICES
Cesser toute participation systématique du Fond national de l'emploi (FNE) au titre de nouvelles préretraites organisant la cessation totale d'activité non suivie d'embauches de remplacement (coût total 1999 : 4 milliards de francs).
2.- RESTREINDRE LES EFFETS D'AUBAINE
a) Réduire de moitié la durée de l'exonération de cotisations patronales pour l'embauche d'un premier salarié (coût total : 2,5 milliards de francs d'exonérations non compensées pour la sécurité sociale).
b) Supprimer pour l'exercice 2000 le crédit d'impôt pour création d'emplois des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés (perte de recettes pour l'Etat évaluée à 2,7 milliards de francs).
3.- SYSTÉMATISER ET APPROFONDIR L'ÉVALUATION DES DISPOSITIFS D'AIDES À L'EMPLOI
a) Evaluer les contrats aidés du secteur marchand et non marchand au moyen d'études monographiques ciblées des trajectoires de sortie des bénéficiaires et évaluer les conditions réelles dans lesquelles les salariés intérimaires ou recrutés à durée déterminée accèdent aux contrats à durée indéterminée.
b) Demander à la Cour des comptes et aux Chambres régionales des Comptes d'assurer une évaluation coordonnée des aides à l'emploi des collectivités territoriales.
4.- REPENSER LA RÉGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE DES AIDES D'ÉTAT ET LE SOUTIEN COMMUNAUTAIRE AUX ACTIVITÉS INNOVANTES
Atteindre un meilleur équilibre des politiques européennes de la concurrence, des négociations commerciales internationales et de l'emploi au moyen d'une approche moins systématiquement défavorable aux aides sectorielles favorisant la modernisation et d'un soutien accru aux activités innovantes.
5.- RECENTRER LA DÉFINITION DES AIDES À L'EMPLOI
Ne plus inclure dans la dépense pour l'emploi et ne plus considérer comme des aides à l'emploi la participation financière de l'Etat à des mesures ne concourant pas à la création d'emplois.
ANNEXES
ANNEXE 1
STRUCTURE ET ÉVOLUTION DE LA DÉPENSE POUR L'EMPLOI AU SENS DE LA DARES (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||
1990 |
1991 |
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 | |||||||||||||||||||||||||
En MF |
En % |
En MF |
En % |
En % |
En MF |
En MF |
En % |
En MF |
En % |
En MF |
En % |
En MF |
En % | ||||||||||||||||||
Dépenses passives |
56,8 |
55,6 |
54,3 |
51,4 |
50,1 |
48,7 |
48,0 |
||||||||||||||||||||||||
- Indemnisation du chômage |
87 374 |
39,8 |
101 772 |
42,1 |
115 109 |
43,4 |
123 289 |
41,9 |
118 296 |
40,2 |
112 559 |
38,9 |
117 235 |
38,4 | |||||||||||||||||
- Incitation au retrait d'activité |
37 109 |
16,9 |
32 653 |
13,5 |
28 879 |
10,9 |
27 987 |
9,5 |
28 912 |
9,8 |
28 347 |
9,8 |
29 288 |
9,6 | |||||||||||||||||
Dépenses actives |
43,2 |
44,4 |
45,7 |
48,6 |
49,9 |
51,3 |
52,0 | ||||||||||||||||||||||||
- Formation professionnelle |
67 371 |
30,7 |
73 828 |
30,5 |
80 604 |
30,4 |
89 712 |
30,5 |
86 258 |
29,3 |
81 483 |
28,2 |
85 749 |
28,1 | |||||||||||||||||
- Promotion de l'emploi |
14 675 |
6,7 |
18 290 |
7,6 |
22 731 |
8,6 |
30 207 |
10,3 |
34 958 |
11,9 |
40 480 |
14,1 |
45 973 |
15,1 |
||
- Exonérations non compensées |
1 408 |
0,5 |
3 202 |
1,3 |
4 653 |
1,8 |
7 219 |
2,5 |
9 363 |
3,2 |
10 494 |
3,6 |
10 585 |
3,5 | ||
- Maintien de l'emploi |
3 467 |
1,6 |
3 483 |
1,4 |
4 057 |
1,5 |
6 227 |
2,1 |
5 725 |
1,9 |
4 746 |
1,6 |
5 049 |
1,7 | ||
- Incitation à l'activité |
4 504 |
2,1 |
4 432 |
1,8 |
4 441 |
1,7 |
4 929 |
1,7 |
5 009 |
1,7 |
5 479 |
1,9 |
5 749 |
1,9 | ||
- Fonctionnement du marché du travail |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
TOTAL |
219 334 |
100 |
241 895 |
100 |
265 214 |
100 |
294 580 |
100 |
293 919 |
100 |
289 438 |
100 |
305 311 |
100 | ||
(1) Les données pour 1997 sont en cours de finalisation par la DARES. Source : Ministère de l'Emploi et de la Solidarité - DARES - En millions de francs courants. | ||||||||||||||||
ANNEXE 2
Note de l'INSEE, de la Direction de la prévision et de la DARES sur les effets sur l'emploi des allégements de charges sur les bas salaires : quelques enseignements tirés des sources statistiques disponibles
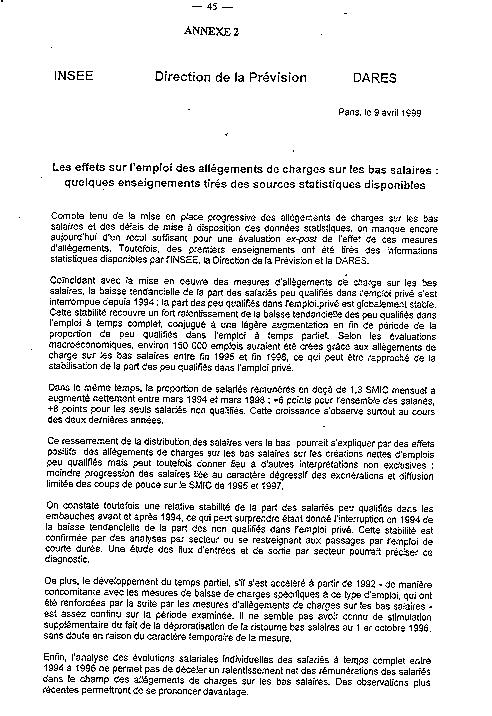
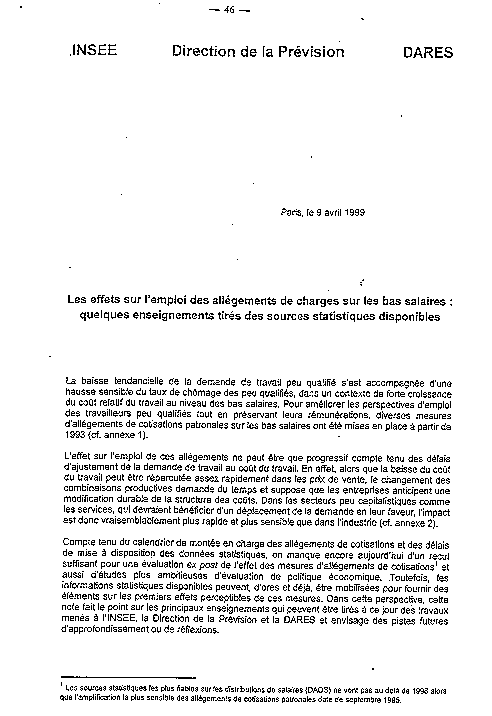
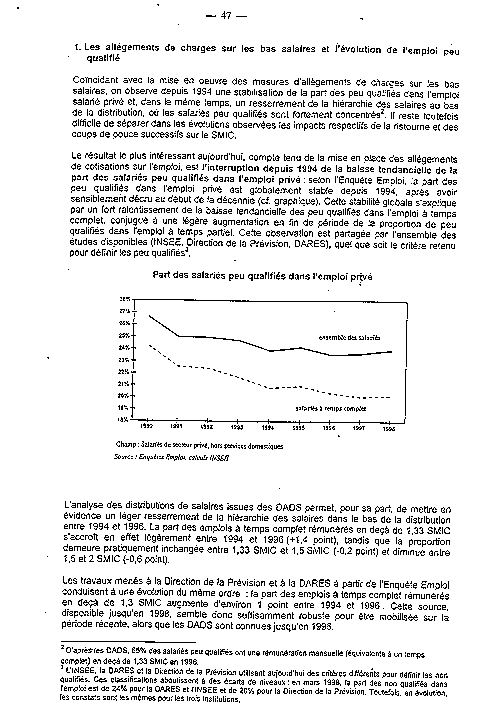
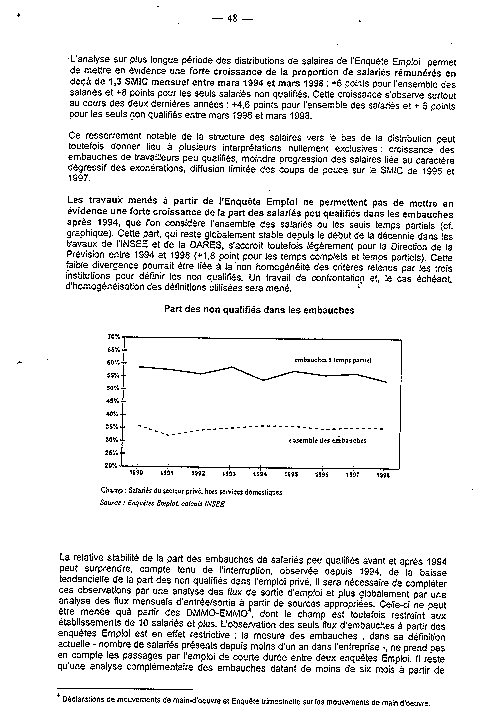
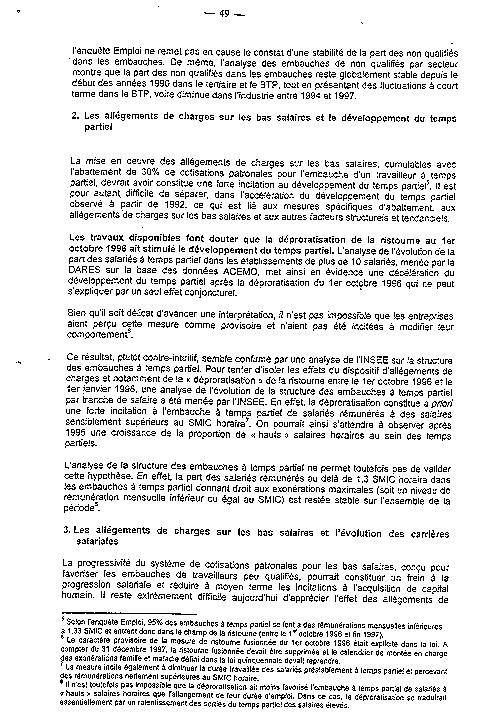
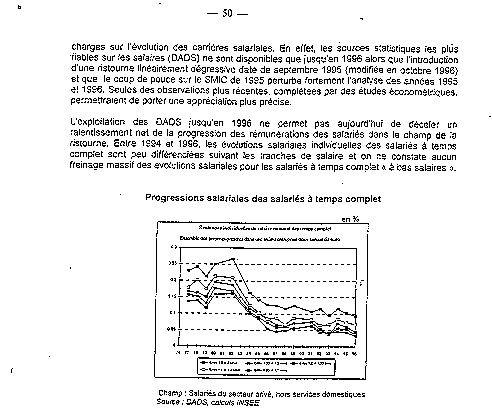
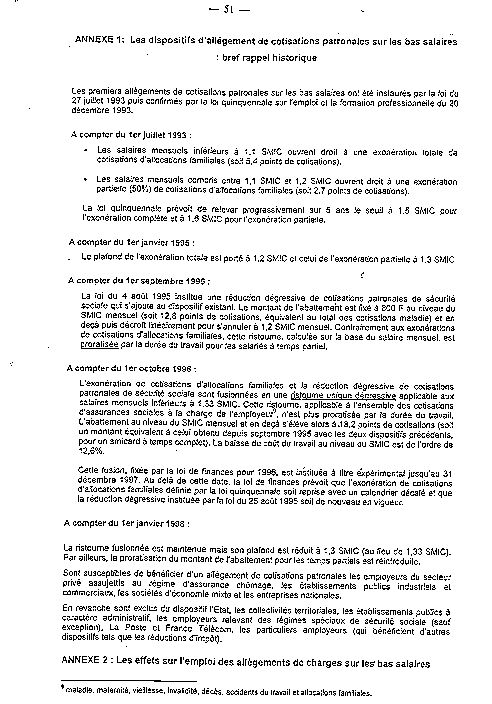
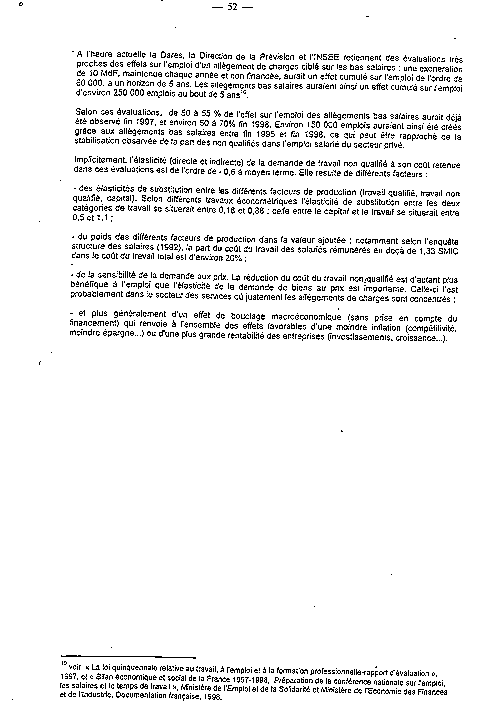
AUDITIONS
1.- Audition de M. Liêm Hoang Ngoc, coordonnateur de l'étude réalisée pour l'Office parlementaire d'évaluation des politiques publiques
(Extrait du procès-verbal de la séance du jeudi 6 mai 1999)
Présidence de M. Augustin Bonrepaux, Président
A l'invitation du Président, M. Liêm Hoang Ngoc est introduit. Le Président lui rappelle les règles définies par la mission pour la conduite des auditions : pas d'exposé introductif, échange rapide des questions et des réponses.
Le Président Augustin Bonrepaux : Après la politique autoroutière, la gestion des effectifs et des moyens de la Police nationale, la formation professionnelle, nous entamons aujourd'hui un nouveau cycle d'auditions publiques consacré aux aides à l'emploi. Nous allons le faire, et c'est là l'originalité de cette démarche, en partant d'une étude effectuée pour le compte de l'Office parlementaire d'évaluation des politiques publiques, sur saisine de notre commission des Finances en mars dernier. Cette étude, confiée au METIS et au LEST et coordonnée par M. Liêm Hoang Ngoc, avait pour objet d'évaluer le rôle des flux financiers entre les collectivités publiques et les entreprises en matière d'emploi. Le Bureau de la Commission a décidé de la rendre publique la semaine dernière.
Je vous propose, dans un premier temps, de procéder à l'audition de M. Liêm Hoang Ngoc selon la formule traditionnelle des questions, qui seront d'abord posées par le rapporteur spécial, M. Gérard Bapt, rapporteur de l'étude devant l'Office d'évaluation des politiques publiques, et ensuite, par les membres de la mission.
Dans un deuxième temps, nous entendrons M. Christian Lhote, directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de l'Orne, que nous avons convié pour nous faire part, en tant qu'homme de terrain, de ses jugements sur cette étude et de la manière dont il pouvait apprécier, dans les différentes entreprises de son département, les aides publiques à l'emploi.
Je souhaite que ces auditions nous permettent de connaître un peu mieux l'efficacité des aides qui sont actuellement en vigueur pour l'emploi et de nous éclairer aussi sur ce qu'il y aurait à faire pour améliorer encore leur efficacité.
M. Gérard Bapt, rapporteur spécial : Nous avons déjà eu l'occasion d'échanger sur l'étude du METIS et du LEST. La méthode que je proposerai pour l'audition de M. Liêm Hoang Ngoc est inspirée par les deux orientations de la démarche générale de notre mission d'évaluation et de contrôle : faire le bilan de l'efficacité des engagements budgétaires pour une politique donnée, aujourd'hui la politique publique de l'emploi ; rechercher les moyens de donner le maximum d'efficacité à ces engagements budgétaires.
La justification de l'inscription des politiques d'aide à l'emploi à l'ordre du jour de la mission d'évaluation et de contrôle apparaît à l'évidence dans les pages introductives du rapport où figure l'évolution de la dépense publique en faveur de l'emploi : de 0,9 % du PIB, en 1973, à 4,37 % du PIB en 1996. Les mêmes pages amènent, tout de suite après, à se poser, à l'évidence, la question de l'efficacité de cet engagement budgétaire. En effet, selon la DARES, l'évolution des flux d'aides à l'emploi et du nombre des chômeurs suit, depuis 1973, une pente ascendante totalement coïncidante.
Je propose de distinguer deux phases dans l'audition de M. Liêm Hoang Ngoc. La première serait centrée sur les politiques publiques de l'emploi et leur évolution, en France, par comparaison avec ce qui se passe dans les autres pays de l'Union européenne : il s'agirait de faire un premier bilan de l'efficacité des aides à la création d'entreprises avec aide à l'embauche, laissant de côté la dimension formation professionnelle traitée par ailleurs avec le rapporteur spécial, Jacques Barrot. Je suggère d'interroger M. Liêm Hoang Ngoc sur l'efficacité des mesures ciblées, leurs effets pervers et la possibilité de réaliser, après le recentrage du CES, du CIE, des préretraites, de nouvelles économies pour redéployer les crédits sur des mesures plus efficaces.
La deuxième partie concernerait les allégements généraux de charges qui ont considérablement augmenté dans le budget du ministère du Travail et de l'Emploi, qu'ils soient sans contrepartie, c'est la ristourne unique dégressive, ou avec contrepartie, ce sont les mesures en relation avec la réduction du temps de travail.
M. Liêm Hoang Ngoc pourrait, par deux introductions courtes, alimenter les deux phases de notre audition.
M. Liêm Hoang Ngoc : Les deux parties que vous me proposez de développer correspondent aux deux parties du rapport. Je commencerai par exposer un très bref résumé de la première partie.
Notre souci, dans cette partie, a été un souci pédagogique de répertorier l'ensemble des flux financiers entre les collectivités publiques et les entreprises en matière d'emploi. Il nous semblait que les catégories habituellement utilisées par l'OCDE et la DARES étaient insuffisantes pour bien sérier l'ensemble des mécanismes en jeu à chaque fois que se prend une décision de politique publique.
Nous avons considéré, parmi les flux financiers consacrés à l'emploi, quatre catégories : les dépenses traditionnellement dites « passives » par l'OCDE, qui sont les dépenses d'indemnisation du chômage ; les dépenses inhérentes à la formation destinée à améliorer le capital humain des chômeurs, et également à améliorer la qualité de la main-d'_uvre à la disposition des entreprises ; les mesures d'ordre général qui visent à rendre la croissance plus riche en emplois, et enfin, les mesures dites « ciblées » ou « spécifiques » cherchant à mettre en _uvre un principe de discrimination positive, c'est-à-dire de modifier la file d'attente des chômeurs. Nous nous sommes surtout centrés sur les deux dernières catégories.
Dans la comparaison des politiques de l'emploi mises en _uvre dans les différents pays, on peut, à la serpe, distinguer trois grands modèles.
Le premier est le modèle anglo-saxon, caractérisé pas un effort faible de dépenses pour l'emploi en proportion du PIB. Les dépenses, dans ce cas, sont essentiellement centrées sur l'indemnisation des chômeurs et sur la formation.
A l'opposé, on a un pôle où l'engagement des pouvoirs publics en matière d'emploi est très fort. Il s'agit du pôle suédois et allemand, essentiellement, où les dépenses sont consacrées à la formation et aux aides à l'embauche.
Entre ces deux pôles, on trouve les pays du sud de l'Europe comme la France et l'Italie. La France, par exemple, est caractérisée d'une façon qualitative par l'importance croissante des dépenses correspondant aux préretraites et des aides à la création d'emplois.
La répartition de ces dépenses s'est sensiblement modifiée depuis 1973. Jusqu'en 1985, en France, ce sont essentiellement des dépenses passives qui sont importantes, notamment des dépenses d'indemnisation de chômage et de mise en préretraite. Ce n'est qu'à partir de 1985 que les pouvoirs publics posent le problème de l'activation systématique des dépenses publiques, dont le but est de stimuler la création d'emplois plutôt que de procéder au traitement social du chômage.
Mais la catégorie des politiques actives est elle-même trop large pour évaluer l'efficacité de chaque mécanisme mis en jeu par les différents dispositifs.
Nous avons, dans ce rapport, distingué les mesures d'ordre général et les mesures spécifiques.
La période récente voit une montée en puissance des mesures d'ordre général visant à rendre la croissance plus riche en emplois. En 1993, les mesures d'ordre général ne représentaient que 7,1 milliards, alors que les mesures spécifiques représentaient 34,8 milliards. En 1997, le rapport s'est complètement inversé puisque les mesures d'ordre général sont devenues majoritaires avec 54,5 milliards, alors que les mesures spécifiques recouvrent seulement 50,9 milliards de francs.
Parmi les mesures d'ordre général, les mesures d'abaissement du coût du travail constituent le principal volet. Dans ces mesures, nous avons inclu les exonérations d'ordre général sur les bas salaires telles que la ristourne dégressive, qui n'est pas intégrée dans les catégories de la dépense publique de l'emploi selon la DARES.
Pour les mesures d'ordre général, la période récente a introduit une innovation, puisque, depuis la loi Robien, les pouvoirs publics s'interrogent sur la portée des politiques de réduction de la durée collective du travail. Jusqu'alors, en matière de temps de travail, c'était l'approche de temps partiel qui, depuis 1990 et l'abattement de 40, puis de 30 %, était prédominante. Les réflexions autour de l'abaissement de la durée collective du travail commencent à poindre avec la loi Robien, puis avec la loi Aubry d'orientation et d'incitation sur laquelle nous reviendrons dans la deuxième partie.
Parmi les mesures spécifiques, là aussi, les mesures privilégiant l'abaissement du coût du travail sont majoritaires. Les mesures phares sont sans doute le CIE, l'aide pour l'emploi des jeunes et, dans le secteur non-marchand, le CES.
Après avoir établi cette typologie des aides à l'emploi, nous avons essayé d'établir une synthèse la plus exhaustive possible des études existantes d'évaluation.
Contrairement à ce que l'on pourrait penser, les conclusions des études sont très réservées et très partagées. Les modèles d'évaluation ne sont absolument pas complètement affirmés et sûrs d'eux-mêmes parce qu'il y a un écart entre la représentation théorique et les faits, tels qu'on peut les constater.
Que nous disent les évaluations établies à partir des simulations, des modèles économiques utilisés pour préparer les mesures de politiques de l'emploi ?
Les évaluations sont très partagées quant aux effets de la réduction du coût du travail. Il y a peu d'études qui concluent de façon ferme et définitive que le chômage est dû essentiellement à un coût du travail excessif en France.
Là où il y a véritablement débat, c'est sur le problème du travail non qualifié. Là encore, les économistes sont partagés quant aux effets potentiels d'une réduction du coût relatif du travail non qualifié sur l'emploi.
Les études plus qualitatives contiennent un élément intéressant qui explique peut-être la prudence des conclusions des études macro-économiques établies à partir de modèles. En effet, les études macro-économiques considèrent qu'il existe une entreprise représentative de toutes les entreprises qui réagissent de la même façon aux diverses politiques de l'emploi. Dans les études qualitatives, on constate que cette hypothèse d'une entreprise représentative mérite relativisation car il y a une pluralité de logiques d'entreprises décelables quand on établit des monographies. Cela explique vraisemblablement que l'ensemble des entreprises ne réagit pas de la même façon à des mesures, notamment d'ordre général, de politiques de l'emploi.
On peut, dans cette perspective, relever ce qu'une étude précédente du METIS a appelé le double paradoxe de la politique d'aide à l'emploi. On peut le résumer de la façon suivante.
Tout d'abord, les entreprises qui déclarent avoir un problème de coût salarial ont peu recours aux dispositifs de la politique de l'emploi. A contrario, les entreprises qui recourent aux dispositifs de politiques de l'emploi sont essentiellement des entreprises qui sont informées de ces dispositifs mais n'ont pas nécessairement un problème de compétitivité de prix et de coût salarial et sont positionnées sur des créneaux plutôt hors prix.
En guise de conclusion et pour introduire la discussion, je dirai que la principale limite que rencontrent les évaluations des politiques de l'emploi est de considérer que les entreprises réagissent toutes de la même façon à la politique de l'emploi. Ces études considèrent ce que les économistes appellent l'existence d'une demande de travail agrégé, c'est-à-dire une demande de travail donné par une entreprise représentative type réagissant à la baisse du coût salarial. La philosophie des politiques de l'emploi a été, durant les vingt dernières années, d'adapter l'offre de travail à cette entreprise représentative, soit par la formation pour mettre le capital humain en état de répondre à la demande de travail, soit en adaptant le coût de l'offre de travail par des politiques d'abaissement du coût salarial. Reste à savoir si cette approche a une efficacité « technique ». C'est un premier débat.
Si l'on considère que la pluralité règne dans les entreprises, tant en matière de situation financière qu'en matière de stratégie vis-à-vis de l'emploi, est-ce que des mesures d'ordre général trouvent leur efficacité technique ?
Le deuxième débat est un débat de société, sur lequel nous reviendrons dans la deuxième partie, et qui consiste à savoir si, aujourd'hui, la priorité du pays est de développer l'emploi non qualifié ou l'emploi qualifié.
M. Gérard Bapt, rapporteur spécial : Deux questions se posent. La première naît du propos de M. Liêm Hoang Ngoc selon lequel ce seraient les entreprises qui en auraient le moins besoin qui utilisent le plus les aides à l'emploi. Nous sommes directement interpellés en termes d'efficacité de l'engagement budgétaire.
La deuxième question est de savoir s'il a discerné des mesures qui, à l'heure actuelle, pourraient faire l'objet d'économies en fonction de cette constatation. Je pense là avant tout aux mesures ciblées, qu'elles soient générales ou territorialisées.
M. Liêm Hoang Ngoc : En ce qui concerne les mesures ciblées, j'ai indiqué que leur part relative avait décru au profit des mesures d'ordre général. La question est de savoir quelle est la priorité. Certains experts estiment que les politiques ciblées sont nécessaires pour modifier l'ordre de la file d'attente, et mettre en place une discrimination positive rendant plus employables les publics défavorisés.
Le CIE est une mesure phare en matière de politique ciblée. On peut en tirer les premiers bilans, comme la DARES l'a fait dans de nombreuses études.
D'après les bilans, 50 % des embauches réalisées dans le cadre du CIE n'auraient pas concerné le public intéressé si ce contrat n'avait pas existé. Le CIE peut donc être jugé positif si l'on considère que la moitié des embauches a concerné des chômeurs non employables.
Cela dit, les mêmes études de la DARES mettent en évidence l'importance de l'effet d'aubaine. Dans les questionnaires envoyés, on relève que 56 % des embauches font l'objet d'un tel effet.
Il est dès lors très difficile de faire des recommandations. Il est important que le CIE continue d'exister, mais comment neutraliser les effets d'aubaine ? Nous ouvrons le débat sur l'assiette des cotisations patronales qui devrait plus ou moins favoriser tel ou tel type d'entreprise en fonction de sa stratégie de l'emploi et de sa situation comptable.
Il me semble difficile, aujourd'hui, de pratiquer de nouvelles coupes dans les dispositifs ciblés. Ils se sont, en part relative, réduits par rapport à ce qu'ils étaient il y a un certain temps. Le chômage des jeunes représente une forte proportion ; le taux de chômage des jeunes est de 25 %. Il semble difficile de remettre en cause des dispositifs ciblés de type APEJ ou CES.
Toute la réflexion devrait s'engager autour de la façon de mieux répartir le financement de la protection sociale en fonction du comportement des entreprises vis-à-vis de l'emploi, ce qui permettrait de neutraliser, à mon sens, les effets d'aubaine.
M. Jacques Barrot, rapporteur spécial : Je suis un peu étonné, tout de même, de voir que vous laissez entendre qu'il y a encore beaucoup d'hésitations sur l'efficacité de la baisse du coût du travail non qualifié. Hier encore, le CSERC a apporté une preuve supplémentaire de cette efficacité.
Par ailleurs, je trouve très difficile de porter un jugement sur une politique qui a été hélas pratiquée à faible échelle, et récemment, depuis la loi quinquennale. Le scepticisme des experts m'étonne et je le vois d'ailleurs se réduire d'année en année. Il ne faudra peut-être pas attendre la fin du siècle prochain pour s'apercevoir que le coût du travail moins qualifié joue un rôle majeur.
Vous avez dit une chose très juste : le problème des politiques est d'adapter l'offre de travail de deux manières, par la formation, c'est pour cela qu'il faut professionnaliser mieux les jeunes, et par le coût, pour le travail moins qualifié.
Je suis vraiment stupéfait de voir autant d'hésitations, chez les experts, sur des politiques que le bon sens de tous les jours semble vérifier. Pouvez vous m'indiquer les économistes qui contestent cette politique et au nom de quoi ils la contestent ?
M. Liêm Hoang Ngoc : J'ai pris connaissance du rapport du CSERC hier. Il n'apporte aucun élément nouveau aux études existantes. C'est une synthèse des études existantes sur l'abaissement du coût du travail. Nous avons une interprétation sensiblement différente.
D'où vient la divergence ? Pour répondre à cette question, je dirai d'abord que les politiques d'abaissement du coût du travail non qualifié ne se justifient techniquement que sous deux conditions.
La première est qu'il existe une pénurie de main-d'_uvre qualifiée. Je ne suis pas convaincu qu'il y ait, dans ce pays, une pénurie de main-d'_uvre qualifiée. Beaucoup d'études montrent au contraire qu'il y a un excès d'offre de main-d'_uvre qualifiée. Faut-il cibler la politique de l'emploi en direction des non-qualifiées alors que se trouve un problème de chômage du côté des qualifiés ?
Deuxième remarque : l'efficacité des politiques d'abaissement du coût du travail suppose qu'il existe une forte élasticité emploi-salaire chez les travailleurs non qualifiés. L'élasticité est un terme technique désignant tout simplement l'effet, en termes d'emploi, de l'abaissement du salaire. Est-ce que cette élasticité est forte en France ? Je peux vous garantir qu'il y a un véritable débat et des travaux qui s'échinent à mettre en évidence une élasticité emploi-salaire.
On peut tout d'abord dire que l'élasticité emploi-salaire, à l'échelle macro-économique, n'arrive pas à être mise en évidence. Il n'y a pas de coefficient significatif au niveau global. La plupart des études économiques s'accordent pour dire qu'il n'y a pas de problème global de coût du travail en France. D'ailleurs, le coût du travail, globalement, se situe largement dans la moyenne mondiale et européenne. Surtout, le coût du travail français, charges sociales comprises, continue à évoluer, selon les études de l'INSEE, à un rythme inférieur non seulement aux gains de productivité mais également à l'inflation.
S'il n'est pas au niveau du coût global du travail, le problème se trouve peut être posé au niveau du travail non qualifié, auquel les études accordent leur plus grande attention. Sur le travail non qualifié, les études de référence sont celles de Bazen. La conclusion des auteurs est très prudente. Ils considèrent tout d'abord que l'élasticité emploi-salaire des jeunes est très faible, c'est-à-dire qu'il faudrait vraiment abaisser beaucoup le coût du travail des jeunes pour avoir un effet substantiel sur l'emploi. Quand cette élasticité peut être mise en évidence dans les régressions, on se rend compte qu'elle n'est pas statistiquement significative.
L'étude la plus approfondie a essayé de mesurer les effets des variations du salaire minimum sur l'emploi dans quatre secteurs à forte proportion de smicards : l'industrie alimentaire, l'industrie agricole, les services marchands et le commerce. On se rend compte que l'élasticité n'est forte (0,4 et 0,3) que dans les cas du commerce et des services marchands. Dans ces cas, les auteurs reconnaissent qu'elle n'est pas statistiquement significative. Cela peut changer, cela peut être de l'ordre de l'aléatoire.
Ces conclusions prudentes nous amènent à nous interroger sur l'opportunité de mesures d'ordre général. Je ne conteste pas que, dans certains secteurs, il puisse exister un problème de coût du travail. Mais à ce moment là, la mesure appropriée n'est pas une mesure d'ordre général qui va bénéficier à tous les secteurs et à toutes les entreprises, c'est une aide sectorielle. Malheureusement, les aides sectorielles, telles que l'aide textile, sont aujourd'hui interdites par les directives communautaires. Il s'agit pour nous de trouver un autre principe qui permette de sélectionner la direction des flux financiers afin d'aider les entreprises qui ont vraiment un problème de coût du travail, et de modifier la charge de financement de la protection sociale en ce sens.
M. Gérard Bapt, rapporteur spécial : On parle d'économies sur certains chapitres budgétaires du budget de l'emploi, pour redéploiement sur d'autres actions. Il est très difficile d'en trouver, notamment après le recentrage du CIE, du CES, et la diminution des dépenses concernant les retraits d'activités. La théorie défendue, y compris dans certains secteurs du patronat, selon laquelle il faut supprimer un certain nombre d'aides qui seraient inutiles, pour financer des mesures qui seraient plus efficaces et qui restent à déterminer, doit être aujourd'hui combattue. La suppression d'aides, désormais, viserait à abandonner certains éléments du traitement social du chômage, c'est-à-dire à modifier la liste d'attente pour favoriser des demandeurs d'emploi dont l'employabilité est plus faible que d'autres demandeurs d'emploi. C'est la première remarque.
Avec la deuxième remarque, je voudrais aller plus loin dans le questionnement concernant le travail non qualifié. Les bas salaires ne correspondent pas obligatoirement à des salariés peu qualifiés. Nous sommes très contents, dans nos permanences, quand nous trouvons des emplois à des « bac plus 4 » ou « plus 5 », y compris si le salaire est à moins de 1,3 fois le SMIC. La notion de bas salaires et de salariés peu qualifiés ne présente aucun caractère d'automaticité.
Un certain nombre d'enquêtes, notamment du CSERC, reprises par la presse, révèlent que le problème, en France, vient du fait que le niveau du SMIC serait plus près du salaire médian que dans les autres pays européens, 60 % dit-on, en France, par rapport à 40 % chez certains de nos partenaires européens.
Dans la perspective du passage aux 35 heures, avec la question, difficile à traiter, de l'impact sur le SMIC de la diminution de la durée légale hebdomadaire du travail, ne croyez-vous pas que le problème des allégements du coût se pose ?
M. Liêm Hoang Ngoc : C'est une question importante. Une étude réalisée par Francis Cramars(?) a cherché à comparer les effets de la différence entre le niveau du salaire médian et le salaire minimum sur l'emploi au niveau international. Les enseignements en sont très riches. Évidemment, on constate que le salaire minimum s'est rapproché du salaire médian en France, par comparaison avec des pays comme les États-Unis, la Grande-Bretagne ou le Canada. La question est de savoir si ce resserrement de l'éventail des salaires s'est traduit par des pertes d'emplois. Le résultat de l'étude conduit, pour la France, en comparaison avec d'autres pays, à une réponse négative. Même si le salaire minimum français est un peu au-dessus des salaires minimums d'autres pays, la part de l'emploi située à ce niveau est plus élevée. Cela veut bien dire que le niveau du salaire minimum n'a pas été nécessairement un obstacle au développement de l'emploi selon les comparaisons internationales.
Les études économiques ne fournissent pas véritablement d'argument tranché montrant que le SMIC est un obstacle à l'emploi. On peut lire les études à la façon du CSERC si l'on considère que les conclusions doivent être débarrassées de la prudence nécessaire. Mais si l'on considère la prudence nécessaire à la démarche scientifique, tant et si bien que cette démarche constate des insuffisances méthodologiques, on est obligé de conclure à la prudence et de nuancer les conclusions quant aux effets nocifs du salaire minimum sur l'emploi.
M. Jacques Barrot, rapporteur spécial : Je reviens en arrière. Vous avez dit : l'aide est valable s'il y a pénurie des moins qualifiés et s'il y a une forte élasticité. En réalité, il faut adapter l'offre de travail mais il faut l'adapter par le coût et par la formation. Il est évident que si on fait appel à une main-d'_uvre moins qualifiée, il faut en même temps la former. Il faut mener les deux politiques ensemble. Si vous ne menez qu'une politique par le coût, cela ne peut pas marcher. C'est une vérité d'évidence.
Deuxièmement, vous dites une forte élasticité. Le gouvernement actuel a pris une mesure intelligente, malheureusement pas assez étendue, sur la baisse de la TVA dans les travaux d'amélioration du logement. Ce qui prouve que la baisse du coût du travail est efficace. Je souhaite qu'on élargisse cette mesure.
Je ne comprends pas tous ces scrupules d'analystes théoriques. Je ne comprends pas pourquoi des vérités d'évidence sont ainsi occultées par des études les plus savantes les unes que les autres. C'est ce qui paralyse l'action : ces excès de prudence devant des vérités d'évidence.
Enfin, je ne peux pas vous laisser dire ce que vous avez dit sur les politiques sectorielles. M. Van Miert lui-même vous dira que tous les experts d'Europe reconnaissent qu'il faut faire quelque chose sur le travail moins qualifié avec des critères « tous secteurs ». Mais il faut prendre un salaire moins qualifié et, évidemment, une définition que nous n'avons pas en France, le travail manuel.
Peu importe les critères. Il ne s'agit pas de faire du sectoriel pur par branche, mais de voir les secteurs où il y a du travail moins qualifié et du travail manuel. Vous ne me direz pas qu'il n'y a pas une réaction rapide à un travail moins cher ; la réponse ne passe pas par le salaire et je vous rejoins sur les effets du SMIC et sur le fait que les charges se concentrent sur le travail moins qualifié.
Je n'arrive pas à entrer dans une démarche qui semble entièrement conçue pour contester ce que nous voyons à l'_il nu dans la réalité.
M. Liêm Hoang Ngoc : Permettez-moi un élément de réponse. Nous ne sommes pas complètement en désaccord lorsque vous dites qu'il s'agit d'adapter l'offre de travail à la demande de travail.
Mon propos allait plus loin et consistait à dire que la principale limite des économistes avait été de négliger la pluralité des demandes de travail. Il s'agit d'adapter l'offre de travail non pas à une demande de travail, c'est-à-dire à la demande de travail d'entreprises qui auraient uniquement un problème du coût du travail, mais à l'ensemble du tissu des entreprises qui est complètement hétérogène. Les entreprises qui utilisent aujourd'hui du travail qualifié et qui mènent une stratégie de compétitivité hors coût n'ont pas de problème de coût salarial.
Pour une grande entreprise qui a des taux de marge reconstitués et qui mène une stratégie à forte valeur ajoutée, une baisse du coût salarial a un effet marginal sur l'emploi.
Ce que je voulais dire, ce n'était pas qu'il n'y avait pas de problème de coût du travail : loin de moi cette idée. Je pense qu'il y a des entreprises qui souffrent d'un problème du coût du travail. Tout le problème en matière d'aide à l'emploi est de bien cibler les endroits où l'on oriente les flux financiers. Ma préoccupation, dans ce rapport, était de mettre sur la table les conditions d'une efficacité des financements.
Comment faire pour privilégier les entreprises qui ont un problème de coût salarial parce qu'elles utilisent relativement plus de main-d'_uvre que les autres entreprises, d'autant qu'il s'agit dans certains cas d'entreprises dont la situation comptable est moins bonne ? Deux critères entrent dans cette réflexion : le critère comptable et le critère de la stratégie vis-à-vis de l'emploi. Comment alléger la charge de ces entreprises sans tomber dans le travers d'alléger la charge de tous au nom du fait qu'il faille alléger la charge de quelques-uns ?
Le principal problème des exonérations de cotisations sociales se trouve posé là aujourd'hui. Une exonération d'ordre général sur les bas salaires n'est pas forcément la meilleure solution. Elle bénéficierait certes aux entreprises de main-d'_uvre, mais au regard de la rationalité de la dépense pour l'emploi, il y aurait du gaspillage de deniers publics.
Je suis de ceux qui pensent que la dépense publique a un rôle important dans l'économie, mais il s'agit tout de même de la rationaliser et je ne suis pas pour gaspiller les deniers publics quand on peut les économiser.
M. Daniel Feurtet : Je réagis à la dernière partie du premier propos que vous avez tenu tout à l'heure. Je pense qu'il faut partir du point de vue que notre économie est très développée. Nous ne sommes pas un pays en voie de développement ou sous-développé, mais un pays qui dispose d'entreprises, de savoir-faire, de technologies, de formations, donc un pays hautement développé.
Il faut donc se poser la question suivante : est-ce qu'un pays hautement développé comme le nôtre doit freiner le développement de ses salariés hautement qualifiés ? Tout à l'heure, on semblait mettre en dualité la formation qualifiée et la formation non qualifiée. A mon avis, il n'y a pas de dualité, mais un mouvement de l'économie et de notre société. Est-ce que notre société génère, du point de vue de ce développement, toute une série de services et d'emplois beaucoup moins qualifiés ? Tout le monde répond oui. Il ne faut pas être un très grand économiste pour observer ce mouvement dans notre société.
C'est là où se pose à mon avis le problème. Comment continuer à bien dépenser pour pouvoir assumer ce niveau de développement technologique, scientifique, y compris de coopération internationale, donc de conquête des marchés internationaux et, en même temps, faire que ce mouvement qui génère un certain nombre d'emplois beaucoup moins qualifiés puisse trouver aussi un emploi ? Tel est l'objectif de toutes les politiques conduites.
Je ne sais pas s'il est encore pertinent de parler de coût du travail comme concept. On pourrait parler aussi de coût du chômage, en donnant au mot « coût » une signification un peu péjorative. Je serais plutôt tenté de dire : comment la dépense publique participe-t-elle de l'encouragement à la création d'entreprises et à la défense d'entreprises ? Les questions sur les charges se posent à ce point, mais toutes charges comprises : pas simplement les charges sociales, mais l'ensemble des charges, y compris l'accès au financement des entreprises. Quel est le poids de ces charges sur des entreprises qui, par essence, doivent appeler fortement de la main-d'_uvre ? Il y a une recherche à entreprendre. Je lis aussi des travaux d'économistes, y compris du conseil d'analyse économique que le Premier ministre a mis auprès de lui. Ils sont très partagés. J'aurais tendance à penser que ces charges globales, sur ce type d'entreprise, sont aujourd'hui beaucoup trop lourdes.
Quelle politique conduire pour faire en sorte que l'allégement de ces charges d'ensemble soit incitatif à l'embauche ? Je ne parle pas simplement pour résoudre le problème des trois millions de chômeurs, mais dans un mouvement plus général de la société.
M. Liêm Hoang Ngoc : Je pense que nous empiétons sur le deuxième débat.
Je prolongerai la réponse que je viens de donner à M. Jacques Barrot. La politique de l'emploi, aujourd'hui, s'est centrée uniquement sur l'adaptation de l'offre de travail. On n'a pas pris en compte le fait qu'il y avait plusieurs types d'entreprises. Il y a des entreprises où l'emploi est un poids plus important que d'autres et qui subissent nécessairement des charges plus importantes.
Tout le problème d'une nouvelle politique de l'emploi serait d'essayer de discriminer les aides aux entreprises, selon leur stratégie, leur situation, et non pas seulement selon le type de main-d'_uvre qu'elles utilisent. On a trop orienté, à mon avis, les aides en fonction des caractéristiques de l'offre de travail et on a négligé le fait que ce sont les entreprises qui perçoivent les aides, et qu'une entreprise n'est pas égale à une autre.
Entre une entreprise qui a des taux de marge et des taux d'autofinancement reconstitués, dont les profits ne se matérialisent pas en termes d'investissement et d'emploi, et une entreprise riche en main-d'_uvre et étranglée par ses charges financières, les effets sont radicalement différents. Les effets d'un abaissement d'ordre général sont bénéfiques pour la petite entreprise, mais également pour l'entreprise qui n'en a pas besoin et qui utilise, elle aussi, du travail non qualifié.
Tout le problème est de trouver un mode de financement de la protection sociale, puisque telle est la principale charge qui pèse sur le coût salarial des entreprises. Comment trouver un financement de la protection sociale encourageant les entreprises qui décident de développer l'emploi ?
Telle est la préoccupation de votre questionnement ; mais je pense que nous empiétons sur le deuxième débat.
M. Philippe Auberger, co-Président : La discussion très importante entre M. Jacques Barrot et M. Liêm Hoang Ngoc me fait dire qu'il y a une erreur fondamentale dans l'analyse d'un certain nombre d'économistes : ils raisonnent comme si l'offre de travail était une offre purement française. L'offre de travail est mondiale. Si on regarde le secteur du textile, DMC, entreprise qui emploie encore 10.000 personnes en France, va en délocaliser 5.000 dans les 5 années qui viennent parce que, dans les pays d'Asie du sud-est, la dévaluation consécutive à la crise des monnaies asiatiques en 1997 abaisse de 30 à 40 % le coût du travail.
Le fait que des dentistes s'adressent à des prothésistes en Asie du sud-est prouve bien que l'offre est mondiale. Si on raisonne uniquement sur l'offre française, on fait une erreur grave.
Il faut regarder les aides ciblées avant de discuter des problèmes généraux. Parmi les aides ciblées, il y en a une qui m'interpelle et sur laquelle, malheureusement, le rapport est trop elliptique, ce sont les préretraites. Leur coût est considérable. Il semble qu'il n'y avait en fait pas de critères, d'analyses objectives, sur le fait d'accorder ou non ces aides. On nous dit que c'est pour profiler la pyramide des âges du personnel. Qu'est-ce que cela veut dire ? Il y a le problème de l'expérience, de la technicité. Tout ceci ne semble pas pris en compte. Il semble que ces aides soient données à la tête de l'entreprise sans critères objectifs.
Or, cela m'interpelle de dépenser une vingtaine de milliards de francs sans critères objectifs et, de plus, dans un sens contraire au rapport Charpin et à beaucoup d'analyses du problème de la retraite.
Je voudrais savoir clairement si cette aide est justifiée et si l'on ne pourrait pas introduire des critères permettant d'accorder ces aides de façon plus rationnelle qu'aujourd'hui.
M. Liêm Hoang Ngoc : Sur les délocalisations, qu'il n'y ait pas de malentendu. Je n'ai jamais dit qu'il n'y avait pas de problème de délocalisation. Je pense au contraire que les problèmes de délocalisation sont forts principalement dans les secteurs du textile/habillement et des chaussures.
C'est encore une affaire de sélectivité dans les aides à l'emploi que de considérer ces problèmes en détail. Est-ce que globalement il y a un problème de délocalisation ? Regardons les chiffres. La part des investissements directs français vers les pays à bas coûts salariaux ne représente que 3 % des investissements directs à l'étranger. Où se font les investissements directs ? Sur le territoire européen. Tout simplement parce que le monde est encore partagé en une triade entre la zone dollar, la zone euro et la zone asiatique, et que ces trois zones ont chacune une cohérence interne. D'où, sans doute, la cohérence du projet européen.
En la matière, vous vous rendez compte que les délocalisations ne concernent que quelques secteurs. Comment faire vis-à-vis de ces secteurs ? Est-ce que des mesures d'ordre général sont appropriées ? Je ne le pense pas. J'ai apporté un élément de réponse tout à l'heure en évoquant les aides sectorielles, mais la question est aujourd'hui compliquée par le fait que les directives communautaires interdisent les exonérations de type textile qui étaient des exonérations s'adressant à un secteur qui en avait particulièrement besoin. Il va falloir trouver un autre mode de financement qui va dans le sens que je viens d'indiquer, c'est-à-dire qui distingue les entreprises en fonction de leur politique de l'emploi.
Sur la question des préretraites, vous avez raison d'attirer l'attention sur l'importance de ce choix car il s'agit bien d'un choix de société. Le débat sur les préretraites est à inclure dans le débat sur la réduction du temps de travail, sur le temps de travail durant la vie d'un individu. Si l'on considère que dans certaines professions, il faille envoyer les gens en retrait d'activité ou en pré-retraite d'activité, ce n'est pas un critère économique qui va guider la chose mais un choix de société.
Ensuite, les critères économiques vont entrer en jeu : vaut-il mieux avoir une main-d'_uvre expérimentée, qualifiée, payée plus cher qu'une main-d'_uvre jeune qui entre et qui doit se former ? Est-ce que l'on privilégie l'insertion des jeunes ou l'expérience des anciens ? Est-ce un débat économique ou un débat de société ? C'est à la représentation nationale de trancher.
En tout état de cause, les préretraites constituent la mesure qui a eu la plus grande efficacité en termes de lutte contre le chômage, que ce soit au début des années 80 ou actuellement mais elles coûtent très cher. Vous avez raison d'indiquer qu'il y a un arbitrage à faire, mais il est du ressort de la décision politique.
M. Jean-Jacques Jégou : Je croyais, en entrant ici, que nous allions aborder tout de suite les propositions. Je reconnais néanmoins que, au fur et à mesure que M. Liêm Hoang Ngoc nous dit des choses, les questions me viennent à la bouche.
Je suis frappé du fait que le mot qui revient en permanence chez lui est la prudence. Ce qui prouve bien que même les économistes distingués sont au moins aussi dubitatifs que les misérables députés de base que nous sommes.
Au début de votre propos, vous avez dit : je ne suis pas sûr qu'il y a rapport entre le coût du travail et le chômage. Je pense tout de même qu'on ne peut pas balayer d'un revers de manche la spécificité de la situation française. Chaque fois que nous avons pris des mesures, par exemple, sur la fiscalité, pour les emplois familiaux, on a vu qu'il y avait création d'emplois, peut-être effet d'aubaine, mais aussi, dans un secteur comme le bâtiment, un facteur de blanchiment du travail.
Quant au double paradoxe, je suis d'accord avec vous. Il est assez extraordinaire de voir que les entreprises qui se plaignent du coût du travail, ne bénéficient pas le plus des aides. On s'aperçoit qu'il y a vraiment dispersion de l'argent public - je pense au CIE. Il y a effet d'aubaine, mais dans une certaine limite. Peut-on parler d'effet d'aubaine quand les mesures sur les charges permettent à un employeur de conserver un salarié qui n'était pas autrement employable? Que devient ensuite l'objet du CIE si ces personnes ne restent pas très longtemps dans l'entreprise ?
A terme, cette dépense publique est-elle réellement efficace ? J'aurais tendance à répondre non, mais je souhaiterais que vous me donniez votre réponse.
La dernière question est la suivante. Avez-vous une explication de la spécificité française qui fait que l'on crée moins d'entreprises en France que dans les pays comparables ?
M. Liêm Hoang Ngoc : La première question renvoie à l'évaluation des effets d'aubaine. Sur le CIE, c'est en réalité un effet de substitution qui se produit, puisque les entreprises auraient embauché une autre catégorie de main-d'_uvre que celle bénéficiant de la mesure.
C'est véritablement un principe de discrimination positive qui est en jeu puisqu'on va recruter des non qualifiés alors qu'on aurait peut-être recruté des qualifiés à la place.
Est-ce souhaitable ? Est-ce gaspiller de l'argent ? Sur le principe de la discrimination positive, on est encore renvoyé à un débat de société. Faut-il privilégier l'intégration des jeunes ? Quand on embauche un non qualifié à la place d'un qualifié, c'est le travailleur qualifié qui va se trouver au chômage. L'existence de ce choix est liée au rationnement du volume global de l'emploi, sur lequel il faut également s'interroger.
Par rapport à votre deuxième question, j'irai plus loin dans la comparaison internationale. J'étais surpris qu'on ne me pose pas la question par rapport au modèle américain. Si on compare le dynamisme de l'économie américaine et celui, supposé moins important, de l'économie française et européenne, il y a matière à s'interroger. La thèse la plus fréquemment en vogue consiste à dire : parce qu'il n'y a pas de salaire minimum aux États-Unis, le coût du travail non qualifié y est plus élevé, et cela incite non seulement les employeurs à embaucher du travail non qualifié, mais aussi à créer des entreprises pour embaucher notamment des travailleurs non qualifiés.
Quand on regarde de près, on se rend compte que l'éventail des salaires américains n'a pas bougé depuis 10 ans. Or, la dynamique de l'emploi est très forte. Ce n'est donc pas cela qui explique la dynamique de la création d'emplois américaine par rapport à la dynamique européenne.
Ce qui explique cette dynamique, c'est sûrement une politique macro-économique beaucoup plus expansionniste, qui a créé un environnement macro-économique favorable au développement de l'emploi et à la création d'activités.
La moitié des emplois créés aux États-Unis, depuis le début des années 90, ne sont pas des emplois de services. Ce ne sont pas des emplois payés en dessous du salaire minimum français. Ce sont des emplois au-dessus du salaire médian, qualifiés, et dans des secteurs à forte valeur ajoutée.
Attention aux raccourcis un peu rapides. On se rend compte qu'une action sur le volume global de l'emploi, c'est-à-dire sur l'environnement macro-économique qui gonfle les carnets de commandes des entreprises, peut être un remède aussi important que des politiques ciblées ou générales qui ne font finalement que modifier la file d'attente. Mais c'est un autre débat qui sort un peu du cadre du rapport.
M. Pierre Méhaignerie : Votre deuxième réponse à Jacques Barrot a beaucoup infléchi vos premiers propos et donc réduit un peu mon taux d'adrénaline. Mais ce que vous venez de dire le fait remonter.
Vous dites : le salaire minimum est-il un obstacle à l'emploi ? Vous répondez globalement non, comme si d'une moyenne on peut tirer une conclusion. Bien entendu, le salaire minimum n'est pas un obstacle à l'emploi dans des secteurs où la productivité évolue rapidement, où la concurrence mondiale est moins forte ; mais, dans des secteurs de services où la productivité est faible, il est bien entendu que le niveau minimum de salaire a une conséquence immédiate sur le chômage. Vous oubliez de dire qu'aux États-Unis, le salaire moyen est beaucoup plus élevé que le salaire minimum, à la différence de la France, mais que le salaire minimum, dans les services, est pratiquement le même depuis dix ans.
En revanche, les salaires des conventions collectives de branches comme le bâtiment et les travaux publics sont élevés. Vous en concluez que ce sont des résultats ou des décisions de macro-économie qui ont modifié, pour l'essentiel, les évolutions. Je trouve cela surprenant.
Je souhaiterais vraiment que vous veniez de temps en temps faire des stages de micro-économie sur le terrain. Tout d'abord, l'étude Mac Kinsey a montré que, quand vous comparez les taux d'emploi dans le commerce, vous constatez des différences étonnantes selon le niveau minimum du salaire. Les emplois de service à domicile, par exemple aux personnes âgées, constituent un marché potentiel énorme, mais pour qu'il se révèle, nous sommes obligés, aujourd'hui, de le subventionner massivement. Quant aux emplois-ville, si la perspective d'augmentation de la cotisation à la caisse de retraite des collectivités locales est de 3 ou 5 %, nous n'allons pas recruter pendant 2 ans, pour absorber cette augmentation.
Dans les emplois de l'industrie automobile ou de téléphones portables, lorsque les équipementiers reçoivent des donneurs d'ordres une obligation de baisser leurs coûts de 5 % par an, que font-ils ? Ils sont obligés d'envisager la délocalisation.
Franchement, votre manière de raisonner en moyenne générale me stupéfie. J'aimerais que de temps en temps, les universitaires viennent sur le terrain écouter.
M. Liêm Hoang Ngoc : Loin de tout esprit polémique, encore une fois, je pense que nous ne sommes pas en désaccord sur tout. Je pense que dans certains secteurs, comme vous l'avez indiqué, il y a un réel problème de coût du travail. Pour moi, ce n'est pas un problème d'ordre général, mais un problème localisé, sectoriel, et qui demande un traitement approprié si l'on veut rationaliser la dépense publique.
Quant à votre remarque sur l'exception et la règle, je peux vous retourner l'argumentation. Est-ce que du fait qu'il y a des problèmes localisés et sectoriels de coût du travail il est scientifiquement possible et rigoureusement exact de déduire une théorie générale liant le chômage à un coût du travail excessif ? Il me semble que c'est un peu ce que vous êtes en train de faire.
On ne peut pas ériger une théorie générale de l'emploi uniquement sur un problème de coût du travail, de problèmes constatés uniquement dans certaines entreprises et dans certains secteurs de l'économie.
Quant à l'efficacité des politiques d'abaissement du coût du travail, elle n'est pas étrangère à l'environnement macro-économique. Allons plus loin dans ce que vous dites. Admettons qu'aux États-Unis, le coût du travail ait une influence forte sur l'emploi dans les services marchands. Elle est en, grande partie également liée au fait que l'environnement macro-économique des entreprises qui évoluent dans ce secteur est en expansion. Le fait qu'en Europe, on ait un environnement plutôt morose déprime même les entreprises à qui sont adressées les mesures d'abaissement du coût du travail : alors, le recours des aides à l'emploi est uniquement un recours comptable qui ne développe pas nécessairement l'emploi, parce que l'environnement macro-économique n'est pas le bon avec un taux de croissance bien inférieur au taux de croissance potentiel.
M. Raymond Douyère : Je voudrais poser une question un peu à l'inverse de toutes celles qui ont été posées. J'ai bien retenu, de ce que M. Liêm Hoang Ngoc a dit, la nécessité, parfois, d'avoir une politique ciblée de baisse de coût des charges. En même temps, il en a déterminé une certaine inefficacité, tout au moins des effets d'aubaine.
Je voudrais savoir si, dans vos études, vous avez posé l'hypothèse de la suppression totale des aides et recherché quel serait l'effet macro-économique de l'investissement par l'État à due concurrence dans l'économie ? On renverse totalement la charge de la preuve.
M. Liêm Hoang Ngoc : Cela n'a jamais été fait mais c'est une idée intéressante que nous devrions explorer.
M. Jérôme Cahuzac : Nous avons tous compris le socle de votre argumentation : l'abaissement du coût du travail dans certaines entreprises ou filières est quelque chose à explorer, tout le problème étant de savoir comment. Si vous avez raison, peut-on raisonner a contrario ?
Depuis quelques années, l'abaissement du coût du travail existe jusqu'à 1,33, puis 1,3 fois le SMIC. Avez-vous pu constater que ce phénomène de trappe à bas salaires n'existe que dans les entreprises pour lesquelles l'abaissement du coût du travail permettrait précisément d'embaucher ? Ou, à l'inverse, n'existe-t-il que dans les entreprises pour lesquelles cet abaissement du coût du travail n'aurait, en termes d'emploi, qu'un effet marginal ?
M. Liêm Hoang Ngoc : Il est trop tôt pour évaluer l'efficacité de la ristourne dégressive. Je ne connais pas d'étude qui l'ait fait.
Le risque qui peut être souligné est que se constitue une trappe à bas salaires non seulement dans les entreprises utilisant de l'emploi non qualifié mais aussi dans les autres entreprises. Le choix est le suivant : est-ce que l'on encourage la substitution du travail qualifié par du travail non qualifié ou est-ce que l'on développe le travail qualifié ?
M. Didier Migaud, rapporteur général : Ce sont des questions à la frontière de la première et de la seconde partie. A vous entendre, depuis quelques années, en fait, on se « plante » complètement dans la politique en faveur de l'emploi. Vous nous expliquez qu'il peut y avoir un problème de coût du travail, mais dans des secteurs bien définis. On pourrait donc en tirer la conclusion que les mesures ciblées sont les plus pertinentes. Or, vous avez fait le constat que les mesures ciblées, en proportion, ont baissé et que, ces dernières années, on a plutôt privilégié les mesures d'ordre général qui, pour vous, ne sont pas pertinentes, compte tenu du fait qu'elles ne répondent pas suffisamment au problème du coût du travail dans les secteurs difficiles et qu'elles bénéficient à des entreprises alors même qu'elles n'en ont pas besoin.
Cela voudrait dire qu'il faut aller à l'inverse de ce qu'on a fait. Mais, à ce moment-là, on est confronté à un problème de réglementation européenne qui, justement, impose de recourir à des mesures d'ordre général et non pas ciblées.
M. Pierre Méhaignerie : Sauf paritaires.
M. Didier Migaud, rapporteur général : Quelles seraient les propositions que vous formuleriez afin de dépasser ce problème ?
Si, globalement, le problème ne vient pas du coût du travail, pensez-vous qu'il peut tenir à l'assiette et qu'un changement d'assiette pourrait fournir une réponse partielle ?
M. Liêm Hoang Ngoc : Vous avez assez bien synthétisé ma pensée, à une exception près : selon moi, les mesures ciblées sont nécessaires et les mesures d'ordre général peuvent avoir une efficacité et relever d'un choix de société important.
Parmi les mesures d'ordre général, par exemple, se sont développées des mesures visant à la réduction de la durée collective du travail. C'est une nouvelle piste qui vient d'être explorée depuis la loi Robien ; les politiques correspondantes visent à développer l'emploi à durée indéterminée et à temps plein pour tous les salariés. Sa logique est un peu différente d'une logique de temps partiel puisqu'on continue de viser l'insertion des actifs par l'emploi à temps plein et à durée indéterminée. C'est une mesure générale qui a un impact fort en termes de choix de société et qui mérite d'être explorée. Nous aurons peut-être l'occasion de parler de l'évaluation des lois Robien et Aubry, dont les conclusions sont prudentes mais pas si négatives que cela.
Il est vrai que les aides sectorielles dont vous avez parlé sont désormais interdites à l'échelle européenne, mais le phénomène des effets d'aubaine n'était pas absent de ces aides elles-mêmes. Dans un même secteur, des entreprises peuvent suivre des logiques complètement différentes. Ce n'est pas parce qu'une entreprise a un choix technique et un type de marché donné qu'elle va gérer sa main-d'_uvre comme l'entreprise voisine du même secteur. Quand on met les pieds dans les entreprises, on se rend compte que dans un même secteur, il y a des logiques complètement hétérogènes.
Au passage, je fais peut-être partie des économistes qui ont le plus le souci du terrain par rapport à ceux qui tirent des conclusions sur les effets du salaire minimum en considérant une demande de travail agrégé, et qui ne mettent pas les pieds dans les monographies d'entreprises. C'est une parenthèse que je pensais importante à faire par rapport à une remarque qui m'a été faite tout à l'heure.
Si, dans ces aides sectorielles elles-mêmes, les effets d'aubaine ne sont pas nécessairement absents, il faut inventer autre chose.
Quelles propositions peut-on faire pour discriminer les aides en fonction des politiques de l'emploi des entreprises et de leur situation financière ? Dans le rapport, nous mentionnons essentiellement trois possibilités qui sont évoquées par ailleurs dans le rapport Chadelat.
La première possibilité est d'étendre l'assiette de financement de la protection sociale à la valeur ajoutée, ce qui aurait pour effet d'inclure l'ensemble des revenus d'exploitation des entreprises dans le financement de la protection sociale.
La deuxième possibilité serait d'élargir l'assiette de financement à l'excédent brut d'exploitation, qui est un dérivé de la valeur ajoutée. C'est inclure directement les profits d'exploitation dans le financement de la sécurité sociale. Les entreprises ayant un profit important et des taux de marge confortables financeraient la protection sociale plus que les autres.
La troisième possibilité serait de conserver une assiette salaire, mais de moduler les cotisations, c'est-à-dire d'instaurer plusieurs taux de cotisations en fonction de la part des salaires dans la valeur ajoutée, donc en fonction de l'emploi et des salaires versés par les entreprises, compte tenu de la réalisation de leur chiffre d'affaires.
Ces trois propositions traduisent le souci de modifier un peu la charge du financement de la protection sociale en faisant contribuer beaucoup plus les entreprises dont la situation financière est confortable et dont la politique de l'emploi ne privilégie pas le développement de l'emploi. Au contraire, l'objectif est de stimuler les entreprises en difficulté financière et qui choisissent de négocier sur l'emploi ou de développer l'emploi.
Ce principe serait intéressant puisque l'aide ainsi calculée s'adresserait, certes, à tous les secteurs, mais discriminerait beaucoup plus les entreprises que les secteurs, et on aurait un ciblage assez fin des endroits où il faut prélever pour financer la protection sociale.
M. Gérard Bapt, rapporteur spécial : Une réflexion sur le problème de la prudence. M. Jégou disait tout à l'heure que les économistes étaient comme les députés face à l'emploi : prudents. Nous sommes prudents, sauf lorsque nous sommes en campagne électorale et que nous avons un gadget qui va permettre de régler le problème de l'emploi : l'activation des dépenses passives du chômage, le CIE, la RTT, etc.
Lorsque nous mettons en pratique, effectivement, nous sommes amenés à plus de prudence.
Clairement, la conclusion que l'on peut avoir de l'expérience du CIE est que dans 80 % des cas, l'entreprise n'a pas embauché parce qu'il y avait le CIE, mais qu'elle a embauché au moyen du CIE parce qu'elle avait besoin d'embaucher en raison d'une demande. C'est une notion de base qui éclaire un peu le débat.
Par ailleurs, qu'il s'agisse des aides ciblées, dont nous savons qu'elles sont surtout utilisées par les grandes entreprises qui ont le plus de moyens - nous parlerons peut-être de la complexité pour les entreprises, notamment PME-PMI, de l'accès à certaines aides à l'embauche - ou des mesures générales qui entraînent des effets d'aubaine puisqu'elles profitent à la fois aux entreprises qui en ont vraiment besoin et aux autres, le SMIC pose actuellement un vrai problème puisque nous avons plus de salariés au SMIC que dans d'autres pays. L'augmentation du SMIC de 11,5 % entraînée par la réduction du temps de travail va avoir tendance à aggraver ce nombre ainsi que le phénomène de trappe à bas salaires.
Il serait important, à ce moment de notre débat, que M. Liêm Hoang Ngoc nous parle de la façon dont il a fait fonctionner le modèle économétrique pour tester la réforme, qu'il suggère, de la structure du prélèvement social sur l'entreprise.
Déjà, M. Malinvaud avait suggéré de modifier cette structure en modulant le taux de cotisation en fonction du niveau de salaire. Il se trouve qu'un certain nombre d'effets négatifs ont été mis en exergue par rapport à cette proposition, mais la piste de base est la réforme de la structure.
Il serait intéressant que M. Liêm Hoang Ngoc nous présente le modèle Malinvaud, modèle économétrique classique, et la façon dont sur les trois pistes, et notamment les deux principales - le transfert sur tout ou partie des cotisations sociales patronales de la base salariale vers la valeur ajoutée ou la modulation du taux de cotisation de ce prélèvement social par un ratio tenant compte de la valeur ajoutée - le fonctionnement de ce modèle peut faire apparaître un effet positif pour l'emploi qui permettrait de discriminer les entreprises dont la masse salariale est importante de celles qui distribuent beaucoup de profit.
Pour le grand public, il est incompréhensible qu'un PDG annonce qu'il va supprimer 2.000 emplois dans telle ou telle région en promettant à ses actionnaires, l'an prochain, une augmentation significative du retour en dividendes.
Le Président Augustin Bonrepaux : Chers collègues, je vous rappelle que nous procédons à une audition. Je demande à chacun de vous de ne pas faire état de ses réflexions personnelles - vous aurez l'occasion de les exposer dans d'autres enceintes - mais de poser des questions précises sur les travaux qui ont été faits. Nous avons aujourd'hui l'auteur d'un rapport ; il faut essayer de retirer le plus d'intérêt possible de sa venue. Je vous demande de poser des questions précises qui appellent des réponses précises.
Si j'ai bien compris, on vous demande de nous exposer comment vous avez utilisé le modèle Malinvaud pour aller plus loin et pour faire des comparaisons sur les transferts de cotisations sociales sur la valeur ajoutée, sur l'excédent brut d'exploitation ou sur un jumelage des deux. Dites-nous comment vous avez procédé et quels sont les premiers résultats.
M. Liêm Hoang Ngoc : Notre démarche a été de reprendre strictement la structure du modèle Malinvaud pour éviter toute polémique sur les jeux de langage différents qu'on aurait utilisés et les conclusions qui seraient contenues dans les hypothèses. En reprenant les hypothèses de départ du modèle Malinvaud, nous avons été surpris de constater que ce modèle avait été écrit à la hâte et qu'il n'avait pas été achevé.
Dans un modèle macro-économique, vous tenez compte de l'ensemble des effets possibles d'une mesure, d'un côté, sur l'offre, de l'autre côté, sur la demande. Sur l'offre, il s'agit du coût des facteurs de production : coût du capital, coût du travail. De l'autre côté, le financement d'une mesure oblige à prélever sur une certaine catégorie de la population, et a donc un effet sur la consommation, l'investissement, sur la dépense en général de l'économie, donc sur la demande.
Quand vous écrivez un modèle, vous êtes obligé de prendre en compte l'ensemble de ces effets, sinon vous parvenez à des conclusions partielles. Or, le modèle Malinvaud ne prend en compte que les effets d'offre, à travers une baisse du coût relatif, en omettant d'évaluer l'impact de la mesure sur la demande et sur les catégories d'agents économiques sur lesquelles on allait prélever le financement de cette mesure.
Nous avons eu le souci d'être complets en incluant à la fois les effets d'offre et les effets de demande.
Dans le débat public, quatre propositions de réforme sont actuellement avancées. Je vais énoncer globalement les mécanismes et les conclusions auxquelles les simulations conduisent à propos de chacun d'eux.
La première proposition de réforme est celle du rapport Malinvaud. C'est celle d'une baisse classique des cotisations sociales patronales.
Dans son modèle, M. Malinvaud n'explore pas la baisse des cotisations sur les bas salaires. Il prend uniquement une catégorie de travail et il explore une baisse générale du coût salarial via les cotisations patronales. C'est seulement le travail qu'il prend en compte.
La simulation montre que la mesure d'abaissement du coût du travail ne peut être efficace que sous deux conditions.
La première est que les dépenses sociales n'augmentent pas. Dans l'hypothèse indiquée, c'est que les dépenses sociales baissent parce que lorsque vous financez la mesure, vous êtes obligés de prélever sur une autre catégorie de la population pour financer la protection sociale. Si vous ne voulez pas déprimer la demande face au prélèvement, vous êtes obligé de réduire les dépenses sociales pour ne pas avoir à prélever ce supplément sur l'autre partie de la population. La mesure ne peut donc fonctionner que si les dépenses sociales baissent.
La deuxième condition du fonctionnement de la mesure est que les salaires augmentent pour compenser le déficit de demande dû à la baisse des dépenses sociales. Dans un modèle bouclé, les salaires sont amenés à monter.
Il y a donc deux conditions pour que le scénario Malinvaud fonctionne : diminution des prestations sociales pour ne pas avoir à financer la mesure par un prélèvement sur une autre catégorie d'agents économiques, et augmentation des salaires dans l'ensemble de l'économie pour maintenir le niveau de la demande globale.
Ce sont des conditions très restrictives.
Le deuxième scénario est celui de la valeur ajoutée.
Les réflexions autour de la proposition d'asseoir le financement de la protection sociale sur la valeur ajoutée tiennent compte de trois limites des politiques traditionnelles d'abaissement du coût du travail que reprennent les propositions Malinvaud. Ces trois limites sont les suivantes.
Premièrement, le modèle Malinvaud ne peut fonctionner que si l'élasticité emploi-salaire est forte, ce qui est peu avéré en France, comme on l'a vu, s'il existe une pénurie de main-d'_uvre qualifiée.
La deuxième critique vis-à-vis du scénario Malinvaud est que les effets d'aubaine sont inévitables, si l'on considère que le tissu des entreprises est « pluriel ».
Enfin, le troisième reproche fait au scénario classique est qu'il entretient une trappe à bas salaires et qu'il débouche sur un choix de société où la structure de l'emploi est une structure d'emplois non qualifiés.
Pour ceux qui préconisent une assiette de type valeur ajoutée, les arguments sont à la fois économiques et sociaux.
Commençons par les arguments économiques. Le premier argument est que l'assiette valeur ajoutée évolue au même rythme que la croissance du PIB, alors que l'assiette salaire a baissé depuis 10 ans. Pour le financement de la sécurité sociale, on a une assiette beaucoup plus stable.
Le deuxième argument en faveur d'une assiette valeur ajoutée est que le financement par cette assiette ne modifie pas la charge globale qui pèse sur les entreprises mais en modifie la répartition.
Le troisième avantage est que la contribution sur la valeur ajoutée éviterait le gaspillage des deniers publics lié aux effets d'aubaine inhérents aux exonérations classiques de charges sociales.
Enfin, la contribution valeur ajoutée évite le problème de la trappe à bas salaires puisqu'il n'y a pas d'effet de seuil, alors que dans un cas d'exonération classique sur les bas salaires, vous êtes obligé de fixer un seuil susceptible de créer des trappes à bas salaires.
Quant aux effets de la mesure, la simulation fait apparaître un transfert partiel du financement de la sécurité sociale vers la valeur ajoutée. Autrement dit, concrètement, il s'agit d'une baisse à court terme des charges sociales, financée par une nouvelle contribution sur la valeur ajoutée. Pour compenser le déficit de ressources, on va créer une contribution sur la valeur ajoutée. Les effets sur l'emploi sont positifs, à dépenses sociales maintenues. Lorsque vous transférez le financement de la sécurité sociale sur la valeur ajoutée, l'effet à court terme est une baisse du coût relatif du travail. A long terme, ce financement ne pèse pas sur la demande, même si l'on maintient les dépenses sociales, puisque le prélèvement ne se fait pas sur les ménages qui consomment, mais sur les entreprises qui font du profit. Dans le modèle, l'investissement dépend du coût relatif des facteurs et de la demande globale.
On a repris exactement la même structure de modèle. Comme le prélèvement ne pèserait pas ici sur les ménages mais sur la valeur ajoutée, il pèserait à égalité sur le capital et sur le travail, sans effet dépressif sur la demande. La dépense sociale peut donc être maintenue et la demande globale continue à soutenir la croissance économique. L'effet favorable à l'emploi que l'on observe est dû, à court terme, à un effet coût et, à long terme, à une neutralité du prélèvement sur le capital et sur le travail, puisque le capital et le travail contribueraient à égalité au financement de la sécurité sociale.
C'est l'argumentation économique. Il faut ajouter l'argumentation sociale, c'est-à-dire le choix de société intervenant dans cette prise de décision.
Les partisans du transfert vers la valeur ajoutée invoquent deux types d'arguments relevant du choix de société.
Le premier est que certaines dépenses sociales revêtent aujourd'hui un caractère universel, les dépenses maladie, par exemple. Il est dans ce sens logique d'étendre la sphère du financement de la sécurité sociale à d'autres catégories que les seuls salaires. Le RDS, la CSG avaient déjà étendu l'assiette de financement de la sécurité sociale. La valeur ajoutée, pour le moment, n'est pas incluse dans cette assiette. C'est un argument en faveur d'une couverture universelle.
Le deuxième argument relève également du choix de société mais il n'a pas forcément à voir avec l'assurance universelle. Si l'on considère que tous les revenus d'exploitation, dans l'entreprise, doivent participer au financement de la sécurité sociale, il est logique que les profits, qui sont un dérivé de la valeur ajoutée, soient inclus dans le financement de la sécurité sociale.
Voilà les arguments économiques et sociaux qui militent en faveur de la contribution valeur ajoutée.
Deux autres scénarios ont été testés. Dans le troisième, on transfère le financement de la protection sociale vers une assiette excédent brut d'exploitation. Dans ce cas, on retrouve les mécanismes à l'_uvre dans le scénario valeur ajoutée, à ceci près que l'on taxe beaucoup plus le capital. Le coût relatif du capital est augmenté. L'effet sur l'emploi est plus important, car si le coût relatif du capital augmente, cela veut dire que le coût relatif du travail baisse. L'inconvénient est que, si le coût relatif du capital augmente, comme l'investissement dépend du coût relatif des facteurs et de la demande, on a un effet dépressif sur l'investissement.
Enfin, le dernier scénario, privilégié par M. Chadelat, est celui d'une modulation des cotisations, toujours assises sur les salaires, en fonction d'un critère économique qui serait la part des salaires dans la valeur ajoutée, c'est-à-dire le ratio masse salariale/valeur ajoutée. La modulation serait donc verticale, compte tenu d'un critère évalué à partir de la moyenne nationale de la part des salaires dans la valeur ajoutée : elle jouerait au-dessus d'un certain seuil et en dessous d'un certain seuil, de sorte que les entreprises ayant une forte part des salaires dans la valeur ajoutée, donc qui ont développé l'emploi, payent moins de cotisations sociales, alors que les entreprises qui auraient une part plus importante de profit dans la valeur ajoutée paieraient plus de cotisations sociales.
Dans le cas de la modulation, le scénario simulé est sensiblement le même que le scénario Malinvaud. Il correspond à une baisse générale de charges sociales assises sur les bas salaires, à la différence près qu'on module ces taux de cotisation. Il y aurait deux ou plusieurs taux de cotisation au lieu d'un seul. Cela suppose que les dépenses sociales diminuent et que les salaires augmentent.
A titre d'argumentation sociale, un certain nombre de partisans de cette assiette considèrent qu'elle peut être acceptable par ceux qui rejettent l'extension du financement de la protection sociale à la valeur ajoutée comme étant une fiscalisation.
M. Jacques Barrot, rapporteur spécial : Sur le scénario contribution valeur ajoutée, vous dites qu'il n'y a pas d'effet d'aubaine. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas d'effet d'aubaine ?
M. Liêm Hoang Ngoc : Parce qu'on va faire financer les entreprises en fonction de leur résultat comptable, à la différence des baisses classiques de charges où l'on ne tient pas compte de la situation financière des entreprises.
M. Gilles Carrez : Je voudrais poser une question précise. Si j'ai bien compris, dans deux scénarios, le scénario Malinvaud où l'on procède à une baisse du coût du travail par le biais de la baisse des cotisations sociales, ou dans le scénario où l'on substitue tout ou partie de l'assiette salaire, deux conditions doivent être remplies pour que cela fonctionne en termes de création d'emplois : la première est que la dépense sociale baisse, et la deuxième est que les salaires augmentent.
Avez-vous testé des modèles économétriques sur l'influence sur l'emploi en prenant comme hypothèse de départ une baisse de la dépense sociale et, plus généralement, une baisse de la dépense publique ? Avez-vous des modèles qui prouvent que la baisse de la dépense sociale, de la dépense publique, et corrélativement, l'augmentation du salaire disponible, conduisent à des augmentations d'emplois ? Ce type d'analyse peut être très intéressant pour notre réflexion.
M. Liêm Hoang Ngoc : Tout à fait. Le premier modèle met en scène ce scénario où cela marche si on baisse les dépenses.
On est renvoyé à un choix de société. A mon sens, le débat n'est pas technique. Sur le terrain technique, on peut trouver les conditions pour que chaque scénario ait une efficacité en termes d'emploi. Le problème est celui du choix de société sur les catégories de revenus qui financent la protection sociale.
Des simulations faites à l'OFCE et qui reprennent à peu près les mêmes hypothèses, considérant que la baisse de la dépense sociale étant impopulaire, ont testé le scénario symétrique qui est le financement de la mesure non pas par un prélèvement sur les autres catégories de la population ou en abaissement des dépenses sociales, mais par le déficit budgétaire. Les effets sur l'emploi seraient importants.
M. Jérôme Cahuzac : Pour compléter la question de notre collègue M. Carrez, quand vous parlez de la baisse des dépenses sociales, parlez-vous de leur baisse en valeur absolue ou seulement de la baisse de leur croissance ?
S'il s'agit de diminuer la croissance des dépenses sociales, c'est un sujet qui peut être abordé sans trop de passion. Qui ne serait pas d'accord ? S'il s'agit de la baisse en valeur absolue des dépenses sociales, le problème est différent.
Ma deuxième question concerne la part des salaires dans la valeur ajoutée. Vous dites que les salaires ont perdu dix points dans la valeur ajoutée. C'est exact, mais si on veut être précis, on doit dire que la période de baisse part à partir de 1985. Si l'on prend des périodes plus longues pour notre pays ou des périodes comparables pour d'autres pays, on s'aperçoit d'une remarquable stabilité des salaires dans la valeur ajoutée. Confirmez-vous ce fait et en déduisez-vous un argument supplémentaire pour un transfert partiel d'assiette vers la valeur ajoutée ?
Ma troisième question concerne l'investissement. C'est un des contre-arguments classiques opposés à la proposition éventuelle d'un transfert partiel vers la valeur ajoutée. Jusqu'à quel transfert, selon vous, peut-on aller, sans déprimer l'investissement ?
M. Liêm Hoang Ngoc : Sur votre première question, il s'agit d'une baisse en valeur absolue. Nous avons testé les deux. Dans le cas de la baisse relative, comme dans le cas de la baisse en valeur absolue, cela marche.
La part des salaires dans la valeur ajoutée est un argument classique. Sur le long terme, la part des salaires dans la valeur ajoutée, au fil des siècles, a été stable, mais n'oublions pas que le long terme est fait d'une succession de courts termes. Si l'on prend l'évolution de la part des salaires dans la valeur ajoutée de ces dix dernières années et qu'on la met en parallèle avec l'évolution des grandeurs macro-économiques telles que la croissance, on peut s'interroger sur le fait que cette évolution de courts termes puisse avoir un impact de plus long terme sur les régimes de croissance des pays européens.
Si l'on maintient une telle part des salaires dans la valeur ajoutée basse, sur une durée moyenne assez longue, on peut avoir des impacts importants et négatifs sur la consommation et sur la croissance et, au bout du compte, la croissance potentielle va se réduire et exercer elle-même ses répercussions en terme de répartition des revenus.
L'évolution que l'on a depuis 10 ans va peut-être infléchir les choses dans le siècle qui vient si l'on considère le long terme.
Toujours est-il qu'en ce qui concerne la part des salaires dans la valeur ajoutée, il est clair qu'une assiette valeur ajoutée est au moins aussi stable que l'assiette salaire sur le long terme et qu'on n'aura pas de surprise si l'on prélève sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les variations potentielles des ressources disponibles pour financer la sécurité sociale.
Enfin, sur l'investissement, il n'y a évidemment pas grand-chose dans les modèles, puisque, traditionnellement, l'investissement y dépend de deux variables qui sont le coût relatif capital/travail et la demande globale. On n'inclut pas le profit en tant que tel comme déterminant de l'investissement. C'est essentiellement un effet sur le coût du capital qui est susceptible d'exercer un effet dépressif sur l'investissement.
Les propositions Chadelat considèrent que le problème se trouve uniquement posé pour l'assiette EBE. Pour l'assiette valeur ajoutée, le taux de contribution pèse à égalité sur les salaires et sur le capital et fait que le coût relatif du capital n'est pas augmenté sur le long terme. Il n'y a donc pas d'effet dépressif sur l'investissement à long terme puisque la charge globale de financement qui pèse sur les entreprises n'est pas accrue. C'est simplement la répartition de cette charge qui est modifiée. Comme le prélèvement sur le long terme se fait à égalité sur le travail et le capital, le capital ne subit pas d'effet dépressif. Ce n'est que dans le cas de l'assiette EBE que le coût du capital est alourdi.
Une étude de Sterdyniak et Villa a conclu que si l'on voulait, sur la base d'une assiette excédent brut d'exploitation, fixer le taux de contribution à 9,2 %, comme pour la contribution sur la valeur ajoutée, il faudrait réduire les cotisations patronales sur les salaires jusqu'à 11,1.
Pour la valeur ajoutée, la proposition de Chadelat était un taux de contribution à 9,1 %.
M. Pierre Méhaignerie : Quel scénario privilégiez-vous puisque nous sommes face à la nécessité d'augmenter le SMIC de 11,4 % au cours de l'année 2000 ?
Nous sommes dans un environnement européen. Est-il possible, compte tenu des risques sur l'investissement, de prendre cette décision sans accompagnement psychologique vis-à-vis des entreprises à haut niveau d'investissement et de valeur ajoutée ?
M. Liêm Hoang Ngoc : Dans le cas de l'assiette valeur ajoutée, encore une fois, le problème ne se trouve pas posé, puisque sur le long terme, la structure des coûts de production est inchangée.
Partons du scénario valeur ajoutée qui est la matrice centrale de la réflexion. Dans ce cas, à court terme, la compensation est une baisse des charges, une baisse du coût relatif du travail.
M. Jacques Barrot, rapporteur spécial : Ce qui prouve leur bien-fondé.
M. Liêm Hoang Ngoc : Dans le scénario que l'on a testé, on a repris la structure du modèle Malinvaud, où l'on a une fonction de production à facteurs substituables. Nécessairement, quand vous baissez le coût relatif du travail, cela marche. En prenant ce scénario, on ne peut qu'aboutir à cette conclusion.
Mais l'effet d'un transfert sur la valeur ajoutée est mécaniquement une baisse des charges. Vous baissez les charges et vous transférez sur la valeur ajoutée. Il y a donc une compensation importante pour les entreprises.
M. Jacques Barrot, rapporteur spécial : Si on le fait, c'est que l'on y croit.
M. Liêm Hoang Ngoc : L'effet valeur ajoutée, autre assiette, est également présent.
Dans ce modèle, le problème se trouve beaucoup moins posé que dans le scénario 3, scénario excédent brut d'exploitation, où il y a effectivement un risque d'alourdissement du coût du capital et un problème d'investissement que j'ai souligné.
Dans le scénario 2, le problème est atténué. Dans le 3, il est présent. Dans le 4, on retrouve le scénario Malinvaud.
Quel scénario privilégier ? Encore une fois, je pense que ce n'est pas du ressort de l'expert. Chaque scénario a ses conditions d'efficacité économique, sous certaines conditions. Des éléments peuvent militer en faveur de chacun des scénarios. La conclusion du rapport consiste à dire que le choix de société sera sans doute celui qui primera puisqu'il s'agira de faire contribuer certaines catégories de revenus plutôt que d'autres au financement de la protection sociale.
En termes d'efficacité pure de la dépense pour l'emploi, si l'on veut éviter les effets d'aubaine et les effets pervers des exonérations classiques de charges, je pense que les scénarios 2, 3, et 4, méritent d'être pris en considération. Si l'on a peur de taxer les entreprises hautement capitalistiques et qui investissent fortement en capital, le scénario 2 me paraît économiquement le plus efficace.
M. Jean-Jacques Jégou : Je n'ai pas le sentiment que vous ayez répondu à M. Méhaignerie sur le fait d'absorber l'augmentation du coût des 35 heures dans ce domaine. C'est de cela dont il s'agit sur le besoin de financement.
Pour l'application des différentes propositions de changement d'assiette des cotisations sociales, nous ne sommes pas capables de connaître la valeur ajoutée de certaines branches : secteur associatif, secteur public, entreprises publiques. On pénalisera donc l'entreprise individuelle ainsi que les entreprises capitalistiques.
Votre proposition a des défauts. Ce prélèvement deviendrait une imposition de toute nature, au sens de l'ordonnance organique sur les lois de finances, relevant de la compétence de l'article 34 de la Constitution. Il porterait atteinte au principe de la gestion paritaire des cotisations sociales, et entraînerait une lourdeur supplémentaire de notre gestion.
L'assiette de la valeur ajoutée, on l'a dit, est plus liée à la conjoncture. Vous avez dit vous-même qu'il n'y avait pas d'effet d'aubaine pour les entreprises non cotées qui n'ont pas le souci de distribution. Au moment de l'augmentation de l'imposition des sociétés, une présentation des résultats pourrait conduire à diminuer les résultats sur la valeur ajoutée.
N'y a-t-il pas une crainte, finalement, que ce transfert conduise à une baisse des recettes qui ne soit pas seulement conjoncturelle, mais aussi stratégique pour un certain nombre d'entreprises ?
Après le cri du c_ur de Jacques Barrot tout à l'heure, je remarque que ce que vous avez contesté tout à l'heure, vous le reconnaissez finalement dans votre proposition.
M. Liêm Hoang Ngoc : Je pense que nous sommes au c_ur du débat.
Précisément, la mise en _uvre d'une telle assiette à l'occasion du passage aux 35 heures serait un signal particulièrement stimulant pour les entreprises qui ont ou qui vont négocier sur l'emploi parce qu'elle va encourager les entreprises qui sont dans une logique d'accord offensif pour un coût budgétaire bien moindre que celui des aides habituelles : le coût est quasiment nul, si vous changez l'assiette des cotisations patronales ou si vos modulez les cotisations.
M. Jean-Jacques Jégou : Vous venez de dire que c'est dans la stratégie offensive pour les 35 heures ?
M. Liêm Hoang Ngoc : Oui, dans le cadre du passage aux 35 heures. Si j'ai bien compris, une deuxième loi va fixer le cadre du passage définitif aux 35 heures. Le contenu de cette loi mérite ensuite discussion.
La mesure la plus efficace pour stimuler la négociation offensive sur l'emploi à moindre coût est d'alléger les charges des entreprises qui négocient sur l'emploi. La meilleure façon de le faire est de changer d'assiette, selon les propositions évoquées.
La seule solution en ce qui concerne le SMIC est d'augmenter le SMIC horaire de 11,4 %. C'est la seule solution possible parce que, dans la plupart des accords que nous avons recensés, il y a compensation salariale. Autrement dit, le salaire horaire augmente dans les accords d'entreprises signés.
Si l'aménagement de la réduction du temps de travail se fait correctement, avec une négociation permettant d'allonger la durée d'utilisation des équipements, de maintenir la compensation salariale, de réduire substantiellement la durée du travail, il y a moyen de maintenir une compensation salariale qui se matérialiserait, à l'échelle macro-économique, par un salaire minimum horaire plus important. Il présenterait l'avantage particulier d'éviter l'écueil du double SMIC, conduisant à payer des travailleurs aux mêmes qualifications à deux taux de salaires différents. Il y a un problème d'équité majeur. Vous allez avoir des problèmes sociaux, si vous faites cela.
Faute d'une telle mesure, vous n'allez pas pouvoir encourager, comme cela est proposé, le temps partiel choisi. Le temps partiel, en France, est essentiellement du temps partiel long et contraint. Si le temps partiel est rémunéré à un taux horaire inférieur au taux du temps plein à 35 heures, il n'y a pas beaucoup de salariés qui vont choisir le temps partiel.
On n'aura alors pas stimulé le temps partiel choisi, alors que l'objectif est de limiter le temps contraint et d'encourager le temps choisi. Au contraire, on encouragera le temps partiel contraint puisque les entreprises auront intérêt, dans bien des cas, à du temps partiel contraint long, aux alentours de 25-30 heures.
S'il n'y a pas de problème de coût du travail global, je ne pense pas que l'augmentation du SMIC soit un réel obstacle à l'emploi, dans le cadre du passage aux 35 heures, si se mettent en place les accords offensifs dans la majorité des entreprises.
Sur l'assiette valeur ajoutée, la définition d'une assiette de prélèvement, comme la définition de toute norme en économie, est en grande partie conventionnelle. Dans bien des cas, les nomenclaturistes se sont évertués à donner un nom et à circonscrire des choses qui étaient dans le flou. C'est précisément la norme qui construit ensuite l'essence des choses et qui fait que quelque chose qui n'existait pas devient réel.
On peut donc très bien trouver une définition de la valeur ajoutée et faire en sorte que cette norme s'applique à toutes les entreprises. D'ailleurs, M. Chadelat en propose une, complètement réelle, contenue dans l'article 1647 B du Code général des impôts : la valeur ajoutée est l'excédent hors taxes de la production sur les consommations de bien et services en provenance de tiers. C'est parfaitement identifiable.
M. Pierre Méhaignerie : Pas pour la fonction publique.
M. Liêm Hoang Ngoc : Il y a une réflexion à avoir. Pour le moment, le débat sur la valeur ajoutée porte essentiellement sur les entreprises privées, mais on peut essayer de trouver une norme qui s'appliquerait...
M. Raymond Douyère : Sur les acteurs privés aussi.
M. Liêm Hoang Ngoc : Dans les propositions que j'ai vues, une part de l'assiette de financement resterait assise sur les salaires. Il n'y a aucun inconvénient à ce que le système continue à être financé de la sorte pour la fonction publique.
La gestion paritaire est une question importante à laquelle j'ai consacré quelques lignes, pensant qu'elle allait faire débat dans le mouvement social. L'argument en sa faveur est généralement attaché à au refus de l'extension de l'assiette des cotisations à d'autres catégories de revenus que les salaires pour financer la protection sociale. Sous le titre Puissances du salariat, Bernard Friot vient d'exposer l'argumentation la plus claire et la plus poussée en ce sens.
Selon cette argumentation, la sécurité sociale doit être gérée paritairement parce que les prestations sociales sont du salaire indirect conquis par les travailleurs et sont le fruit d'une lutte sur le partage du revenu dans l'entreprise, dont les travailleurs doivent avoir la maîtrise et qui est matérialisé par ce salaire indirect. Toute tentative d'étendre l'assiette serait vécue comme une tentative de détruire cette position du salariat dans le contrôle du partage des revenus.
Telle est la position développée dans cet ouvrage. La fiscalisation est perçue comme une solution libérale où l'on inciterait progressivement les citoyens, et non pas les salariés, à recourir à l'assurance privée à côté de la couverture universelle que consisterait la dépense fiscalisée. L'ensemble fiscalisation, épargne, fonds de pension se mettrait en _uvre. C'est une argumentation cohérente. Elle est tout aussi cohérente que l'argumentation de ceux qui pensent que les dépenses sociales sont aujourd'hui universelles et que l'ensemble des catégories de la population doit y contribuer.
Dans ce débat de société qui est important, les deux positions ne me paraissent pas si antinomiques que cela. Pourquoi ?
La première position se rattache à une tradition où l'on met l'accent sur la démocratie sociale, c'est-à-dire sur le contrôle du surplus par le salarié de l'entreprise.
La deuxième tradition, celle de la fiscalisation, est liée à l'idée d'une démocratie politique où l'impôt doit financer la solidarité. Ce sont deux traditions vertèbres de nos sociétés contemporaines, et en particulier, du projet de société français, entre lesquelles doit nécessairement intervenir un compromis. Si vous voulez rendre réelle la démocratie politique formelle, vous êtes obligé de compléter les institutions de la démocratie politique par des institutions sociales dans l'entreprise et dans la négociation politique.
De même, pour la logique de financement de la protection sociale, un compromis est sans doute nécessaire entre une logique de solidarité issue de la tradition de la démocratie politique et la gestion paritaire de la sécurité sociale issue du nécessaire relais que constituent les acteurs sociaux dans la démocratie salariale. Cela ne me semble pas si incompatible.
Si vous prenez l'assiette valeur ajoutée, on ne peut pas dire qu'elle concerne des revenus qui ne sont pas des revenus d'entreprise. Au contraire, la valeur ajoutée inclut le profit d'exploitation, précisément réalisé à partir de la mise en _uvre du travail salarié dans l'entreprise. Si vous incluez la valeur ajoutée, vous incluez directement les revenus de l'exploitation de l'entreprise.
Il me semble que cette logique n'est pas si antinomique et qu'il y a possibilité de compromis entre la logique politique, la logique sociale, et la nécessité de faire en sorte que des relais s'établissent à tous les niveaux.
Au cas où la question de l'extension de l'assiette serait quand même trop conflictuelle, on peut toujours envisager la solution de la modulation sur la base d'une assiette salaire. Dans la simulation, les effets économiques à l'_uvre sont ceux du scénario Malinvaud ; ils sont atténués parce que l'on a une modulation, mais le mécanisme économique serait le même. Si le choix de société est de maintenir l'assiette salaire, on peut envisager la solution 4.
Les risques d'évasion fiscale sont présents dans tous les domaines, pas seulement dans le domaine du financement de la protection sociale. Avec l'actuelle assiette, il y a aussi de l'évasion fiscale. Le travail au noir, dans les services aux ménages, est quand même prédominant. Si vous taxiez la valeur ajoutée, ce ne sont pas les ménages qui embauchent les femmes de ménage qui paieraient le plus de charges sociales.
En l'occurrence, on aura réglé le problème de l'évasion fiscale dans certains secteurs. On en créera peut-être d'autres, mais c'est le propre de chaque prélèvement que de subir le problème de l'évasion fiscale. Les contrôleurs des impôts sont là pour cela. J'ai discuté avec les syndicats des impôts qui sont partisans d'une telle assiette parce qu'elle est relativement contrôlable au regard de la comptabilité des entreprises.
M. Jacques Barrot, rapporteur spécial : Si l'on retient ce scénario de la valeur ajoutée, le vrai problème est de faire le dosage. On peut faire un transfert très partiel mais, à ce moment-là, on va vers une complexité accrue et je ne suis pas sûr que les résultats escomptés soient significatifs.
On peut faire un transfert plus massif d'assiette, mais est-ce qu'il ne va pas y avoir des différences de traitement considérables par rapport à la situation actuelle ? Des secteurs à forte valeur capitalistique qui ont besoin d'investissement ne vont-ils, par une réaction de peur, freiner l'investissement ?
M. Chadelat a buté là-dessus en disant qu'il fallait faire un transfert très progressif dans le temps.
A votre sens, faut-il faire un transfert partiel et très progressif ou un transfert beaucoup plus massif ? Dans les deux cas de figure, il existe des inconvénients importants.
Il vaut peut-être mieux garder un statu quo en jouant sur une baisse des cotisations et en allant chercher dans le budget quelques économies.
La question précise, pour répondre à la recommandation du Président Bonrepaux, est de vous demander si vous avez regardé les différents scénarios transfert partiel, progressif ou beaucoup plus massif d'une assiette sur l'autre.
M. Liêm Hoang Ngoc : En ce qui concerne l'investissement, le problème ne se situe pas aujourd'hui dans un prélèvement qui pèserait sur les profits. Les profits des entreprises fortement capitalistiques sont au-delà des records historiques. Pourtant, elles n'investissent pas.
Comment stimuler les entreprises qui font de l'emploi ? Je vous rappelle que les taux d'épargne des entreprises capitalistiques sont extrêmement forts, les plus élevés que l'on ait connu au cours de ce siècle. Faire participer les profits au financement de la sécurité sociale ne me paraît pas être un obstacle fondamental à la consolidation de la croissance, si les autres mécanismes sont mis en _uvre, comme je l'ai montré dans les simulations.
Faut-il un transfert progressif ou brutal ? Dans le scénario commandé, on a testé un transfert partiel, un transfert progressif qui aurait par ailleurs l'avantage de concilier les différentes logiques sociales à l'_uvre et permettrait de conserver un certain financement paritaire de certaines dépenses. L'idée testée est plutôt celle d'un transfert partiel, même si le débat reste ouvert par la suite sur l'opportunité, en termes de coût social, d'un transfert total.
Le Président Augustin Bonrepaux : Quel est l'ordre de grandeur envisagé, dans votre évaluation, sur le transfert partiel ? A quel niveau vous situez-vous ?
M. Liêm Hoang Ngoc : Nous n'avons pas fixé d'ordre de grandeur, nous avons juste simulé l'impact de la mesure. L'ordre de grandeur que nous avions en tête est de 9,2 %. C'est celui de M. Chadelat.
M. Jean-Jacques Jégou : Cela fait une TVA à 30 %.
M. Liêm Hoang Ngoc : Le 9,2 a été pris en compte dans le scénario EBE. Dans ce cas, il y a transfert partiel.
Dans le cas de la valeur ajoutée, nous n'avons pas pris en compte de chiffrage précis, mais un approfondissement de l'étude, avec des moyens et des bases de données plus importantes, nous permettrait de le faire.
M. Marc Laffineur : Une simulation a-t-elle été faite sur les créations d'emploi dans le cas où l'on supprime toutes les aides à l'emploi et que l'on diminue les charges ?
Par ailleurs, je suis d'accord avec vous sur le fait qu'il est difficilement défendable d'avoir deux SMIC différents.
Néanmoins, un problème va se poser, là où il n'y a pas de possibilité de gain de productivité, s'il y a une augmentation de 11 %.
M. Liêm Hoang Ngoc : La simulation dont vous parlez est sans doute celle de la baisse des dépenses. Elle fait partie du scénario Malinvaud.
M. Marc Laffineur : En faisant la différence des emplois créés par toutes les aides à l'emploi qui ont pu exister, et les emplois qui seraient créés si l'on supprimait ces dépenses publiques ?
M. Liêm Hoang Ngoc : Nous sommes dans une problématique d'évaluation. Aucun organisme n'a jamais réussi à évaluer de façon précise ce chiffrage.
La seule chose que l'on puisse faire est de procéder par enquêtes monographiques auprès des entreprises, c'est-à-dire de leur envoyer un questionnaire leur demandant si elles auraient créé des emplois si elles n'avaient pas bénéficié d'aides. Mais nous avons des panels très réduits, dont on ne peut pas tirer de conclusion globale. C'est la raison pour laquelle aucune étude ne mesure les effets que vous mettez en évidence et qui seraient le principal objectif d'une évaluation. Pour le moment, les méthodes d'évaluation n'existent pas.
La seule méthode est de prendre des modèles, d'évaluer une élasticité emploi-salaire, et de voir ce que serait l'effet de la mesure. L'autre possibilité est de faire des enquêtes monographiques auprès des entreprises. On est relativement dans le flou.
Je reviens sur votre question concernant le chiffrage. Nous n'avons pas débouché sur une proposition de réforme précise parce que nous donnons des ordres de grandeur. Les chiffrages sont illisibles pour vous parce qu'ils sont dans les annexes que personne n'a réussi à lire. Nous sommes obligés de les publier par souci de crédibilité vis-à-vis du rapport Malinvaud qui va nous être opposé.
Sur l'assiette valeur ajoutée, la baisse d'un point de cotisation et le transfert correspondant sur la valeur ajoutée accroîtraient l'emploi de 0,6 %.
M. Jérôme Cahuzac : Est-ce linéaire ?
M. Liêm Hoang Ngoc : Oui. Après, il faudrait préciser la nature de la mesure que vous entendez mettre en place et procéder à des simulations sur des bases de données réelles afin de savoir combien d'emplois cela créerait. Nous ne pouvons donner là que des ordres de grandeur.
Le Président Augustin Bonrepaux : Quel prélèvement de cotisations cela entraîne-t-il sur la valeur ajoutée ?
M. Liêm Hoang Ngoc : A peu près 0,8. C'est un ordre de grandeur.
M. Philippe Auberger, co-Président : Je me demande si, en fait, le scénario valeur ajoutée n'est pas imaginé pour atténuer les effets de la diminution du temps de travail, notamment sur l'équilibre des finances sociales.
Je m'explique. Le rapport le dit, et nous le constatons sur le terrain, la diminution de la durée du travail, l'application de la loi sur les 35 heures, entraînent une stabilisation, en francs constants, de la masse salariale dans beaucoup d'entreprises. Comme les effets de la création d'emplois sont relativement faibles, la combinaison de ces facteurs aboutit à un tassement de l'évolution de la masse salariale par rapport à ce que l'on aurait sans loi sur les 35 heures. L'effet est très préoccupant sur la situation des finances sociales, l'équilibre de la sécurité sociale, puisqu'on n'aura pas les rentrées de cotisations correspondantes. Il faut trouver une nouvelle ressource qui permette de compenser cet effet et qui ait le moins d'effets négatifs possibles sur l'emploi. D'où cette idée d'une cotisation sur la valeur ajouter qui serait plus dynamique qu'une cotisation sur les salaires et qui, de ce fait, permettrait de compenser largement l'effet sans avoir un effet très sensible sur l'emploi.
C'est un peu comme cela que je vois évoluer les choses, beaucoup plus que par un effet dynamique sur l'emploi du fait d'un transfert des cotisations sur la valeur ajoutée.
Que pensez-vous de mon scénario ?
M. Liêm Hoang Ngoc : Je pense qu'on peut le lire dans l'autre sens. Si vous transférez le financement sur la valeur ajoutée, vous pouvez avoir comme effet un gonflement de la part des salaires dans la valeur ajoutée par le fait que les entreprises riches en main-d'_uvre embauchent. La part des salaires dans la valeur ajoutée va augmenter dans certaines entreprises, alors qu'elle n'a fait que baisser ces derniers temps pour plusieurs raisons.
L'un des arguments de M. Chadelat est de dire : comme l'assiette salaire a baissé, on va prendre l'assiette valeur ajoutée. Ce n'est pas l'argument central qui a imprégné nos développements. Je suis plutôt partisan de l'augmentation de la part des salaires dans la valeur ajoutée parce que le partage des revenus, aujourd'hui, me paraît un peu trop défavorable aux revenus qui s'orientent vers la consommation. Je ne vois pas d'inconvénient à ce que la part des salaires dans la valeur ajoutée augmente.
Quant aux effets des 35 heures, c'est la même chose. Si les accords offensifs se mettent en place, la part des salaires dans la valeur ajoutée va augmenter, surtout si une compensation salariale ou un salaire minimum horaire maintenu sont prévus.
La préoccupation d'une telle réforme n'est pas de maintenir une part faible des salaires dans la valeur ajoutée mais, bien au contraire, de stimuler l'emploi.
Le Président Augustin Bonrepaux : Je voudrais poser deux questions.
La première question concerne les observations faites par ceux qui sont opposés au transfert d'une part des cotisations sociales sur la valeur ajoutée en soutenant qu'il va pénaliser l'investissement. Vous avez répondu par un autre argument selon lequel à l'avenir, les salaires vont augmenter, la valeur ajoutée va se réduire, et cela n'aura pas l'effet escompté.
Quelle est votre réponse ?
Deuxième question. Il y a une autre proposition que celles que vous faites, celle de réduire les cotisations en les faisant supporter par les dépenses publiques. Quels sont à ce moment-là les effets ?
M. Liêm Hoang Ngoc : Une précision importante. Les salaires sont inclus dans la valeur ajoutée. Si la part des salaires dans la valeur ajoutée augmente, cela ne pose pas de problème puisqu'ils participent à égalité avec les profits au financement de la protection sociale. Le problème se trouverait posé par l'assiette EBE, qui repose uniquement sur les profits.
Quant au scénario de la baisse des cotisations supportée par les dépenses publiques, c'est le scénario que nous évoquions tout à l'heure.
Si vous baissez les cotisations, l'effet sur l'emploi dépend du type de prélèvement que vous réalisez par la suite. Si vous prélevez sur les ménages en augmentant la TVA, par exemple, l'effet n'est pas terrible. Même M. Malinvaud reconnaît que c'est la dernière chose à faire. Le prélèvement sur la TVA ne créerait pas beaucoup d'emplois. Au contraire, il pèserait sur la consommation et, dans un modèle macro-économiquement bouclé, il donne une croissance plus faible et une augmentation du chômage.
On peut financer la mesure par l'impôt sur les sociétés, mais on est exactement dans le cas EBE et le risque est le problème de l'investissement à terme.
La meilleure solution est sans doute de financer la mesure sur la valeur ajoutée. A défaut, il faut pratiquer le déficit budgétaire, comme le propose l'OFCE.
M. Jean-Jacques Jégou : Nous parlions tout à l'heure des effets d'aubaine. Avez-vous pensé aux aides qui n'ont pas d'efficacité et qui sont des effets d'aubaine pour des sociétés qui savent profiter ?
M. Liêm Hoang Ngoc : Cela fait par partie de ma préoccupation que d'identifier ces aides.
Le Président Augustin Bonrepaux : Monsieur Liêm Hoang Ngoc, vous avez répondu à toutes les questions. Je vous remercie de votre contribution et des réponses que vous avez apportées.
2.- Audition de M. Christian Lhote, directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de l'Orne
(Extrait du procès-verbal de la séance du jeudi 6 mai 1999)
Présidence de M. Augustin Bonrepaux, Président
A l'invitation du Président, M. Christian Lhote est introduit. Le Président lui rappelle les règles définies par la mission pour la conduite des auditions : pas d'exposé introductif, échange rapide des questions et des réponses. Il donne ensuite la parole, pour une première question, à M. Gérard Bapt, rapporteur spécial de la commission des finances, de l'économie générale et du plan sur les crédits du travail et de l'emploi.
M. Gérard Bapt, rapporteur spécial : Monsieur le Directeur, vous avez compris, en assistant à l'ensemble du débat de ce matin, l'esprit qui nous anime. Nous nous tournons aujourd'hui vers vous pour vous poser la question suivante : existe-t-il encore des aides inutiles, c'est-à-dire des aides qui, sans inconvénient sur le plan économique ou sur le plan de l'impératif social, pourraient être supprimées pour faire des économies de dépenses publiques ?
Il y a d'une part l'indemnisation du chômage et, d'autre part, le financement des retraits d'activités considérés comme des dépenses passives concernant la politique de l'emploi. Avez-vous, sur le terrain, une opinion sur de nouvelles avancées d'activation de ces dépenses ?
La troisième question concerne l'accès des entreprises du secteur marchand aux différentes aides, dans la mesure les entreprises qui bénéficiaient le plus de ces aides étaient souvent de grandes entreprises, et trop souvent des entreprises qui n'en avaient pas réellement besoin alors que, les PME-PMI ou les entreprises qui avaient réellement besoin de ces aides étaient les moins utilisatrices. Y a-t-il un problème d'information ? De complexité des mesures ? Comment, sur le plan administratif, sur le terrain, vit-on cette problématique ?
M. Christian Lhote : Je vais essayer de répondre à ces questions mais avec l'éclairage d'un homme de terrain et pas celui d'un universitaire.
A propos des aides inutiles, votre première question, je ne pense pas que toutes les aides puissent être modifiées, à un moment ou un autre, pour que l'État puisse mieux répondre aux besoins d'entreprises ou de populations spécifiques. Que des aides s'usent parce qu'on s'en sert, que leur efficacité dans le temps se réduise, cela paraît effectivement possible. L'ensemble des gouvernements sous lesquels j'ai eu à travailler ont toujours fait évoluer ces aides, parfois en oubliant de supprimer celles qui existaient précédemment. Le procès fondé sur la multiplication d'aides subsistant les unes à côté des autres est maintenant un débat dépassé. Depuis une dizaine d'années, les aides mises en place se substituent à d'autres qui sont supprimées.
Sur l'activation des dépenses passives, en matière d'indemnisation du chômage, je ne pense pas qu'il soit possible, que ce soit au niveau de l'allocation spécifique de solidarité pour ce qui est des aides d'État, ou au niveau des aides d'assurances - mais il reviendrait aux partenaires sociaux d'en décider - de réduire le taux d'indemnisation des demandeurs d'emplois. Or, c'est seulement en réduisant les taux que l'on pourrait aujourd'hui éventuellement retrouver une capacité de réactiver de la dépense.
Sur le retrait d'activité, j'ai entendu tout à l'heure votre réaction par rapport aux allocations spéciales du fonds national de l'emploi. Leur montant global, en 1999, est d'environ 4,85 milliards de francs. Elles se sont considérablement réduites au cours des 5 dernières années, atteignant 10 milliards de francs en 1995. Les bénéficiaires étaient 152.000 en 1995 et sont moins de 100.000 en 1999. Il y a eu une baisse importante de ces dépenses passives.
Ceci dit, même si, dans un certain nombre de cas, où des grands groupes mettent en avant cette possibilité d'utiliser du FNE pour réduire leur pyramide des âges, la majorité des aides du FNE consenties sur le terrain tiennent à des plans sociaux et à des réels licenciements.
Il est difficile de faire comprendre à des salariés de 40 ans que l'on garderait dans l'entreprise des gens âgés de plus de 57 ans et qu'eux-mêmes, on les remettrait sur le marché du travail. Vous êtes élus locaux, vous savez qu'il est des explications que les salariés, et les chefs d'entreprise même, ne comprennent pas.
On ne peut parler d'un recours massif aux allocations spéciales du FNE et les chiffres de votre budget montrent bien que ce recours a été réduit dans une période où, l'activité économique étant plus satisfaisante, le nombre de licenciements économiques a été réduit. Les ASFNE ont suivi la réduction du nombre de licenciements économiques et n'ont pas été utilisés au-delà du raisonnable.
Vous avez évoqué le problème de l'accès des entreprises aux aides et la différence entre les grandes et les petites entreprises. Je ne sais pas si cela tient à la ruralité de l'Orne et à l'absence de grandes entreprises, mais d'après les constats que je peux faire sur le terrain ce sont, plutôt que les grosses entreprises, les petites entreprises qui accèdent aux aides à l'emploi citées dans le rapport : l'apprentissage, le contrat de qualification, le CIE ; ce sont d'abord les entreprises commerciales, les entreprises de services dans l'hôtellerie et la restauration qui accèdent au CIE, beaucoup plus que les entreprises industrielles. Les entreprises industrielles recherchent souvent un personnel plus qualifié et plus capable de suivre une formation qu'elles envisagent tout à fait de mettre en place. Les grandes entreprises que je vois agir dans le département ont recours à des contrats de qualification avec des groupes de jeunes en formation beaucoup plus qu'à des recrutements sous forme de CIE.
Les petites entreprises sont, quant à elles, un peu moins aujourd'hui que l'intérêt du CIE a été réduit, intéressées par le gain immédiat en termes de réduction de charges sociales et d'aides d'accompagnement au recrutement dont elles peuvent bénéficier. C'est au moins le constat de terrain.
Pour ce qui est des aides collectives et des aides à la formation, les entreprises de taille importante qui ont des directions de ressources humaines performantes et des services de formation ont tendance à mobiliser beaucoup plus que les PME les dispositifs de formation du FNE, les aides à la formation et à l'adaptation du personnel. Pour tout ce qui est aides individualisées, aides ponctuelles aux embauches, c'est beaucoup plus, dans un département de la taille de l'Orne, des entreprises de taille très modeste, les TPE, qui y ont recours.
M. Jacques Barrot, rapporteur spécial : Merci, Monsieur le Directeur, de votre témoignage que je trouve personnellement très conforme à ce que je crois.
Sur la formation en alternance, pensez-vous que notre contrat de qualification est assez bien calibré ? Ne rêvez-vous pas parfois d'un contrat de qualification plus efficace ?
Est-ce que le CIE, recentré comme il l'a été sur les chômeurs de très longue durée, vous paraît avoir une efficacité ? Les derniers chiffres montrent une baisse significative du chômage de longue durée. Est-ce que le CIE reste pour vous un outil précieux, notamment pour aller repêcher les salariés qui, passé un certain âge, auraient les pires difficultés à trouver une nouvelle insertion ?
M. Christian Lhote : Pour ce qui est des formations en alternance, le contrat de qualification répond bien aux besoins des entreprises. Il est aujourd'hui, à mon sens, utilisé peut-être trop massivement pour la formation de techniciens ou de techniciens supérieurs, c'est-à-dire pour des formations de niveau 4 et 3, et pas suffisamment au bénéfice des formations de niveau 5. Ceci dit, les niveaux 5 peuvent encore suivre massivement la voie de l'apprentissage, 90 % des contrats d'apprentissage conclus dans un département comme l'Orne bénéficient à des niveaux 5.
Il me semble que le contrat de qualification devrait pouvoir être recalibré vers des préparations de métiers beaucoup plus que pour des préparations de diplômes. On y est déjà parvenu dans certaines branches. Mais des branches importantes, comme le bâtiment, prévoient toujours la préparation par la voie du contrat de qualification des diplômes ou titres classiques de l'Éducation nationale.
Vous demandez si le CIE recentré a une efficacité. Je crois que l'on a absolument besoin d'instruments de ce type pour permettre l'accès du public exclu au marché du travail et à l'entreprise.
J'ai, en la matière, un regret, c'est que les acteurs de terrain sont, pour l'octroi de certaines aides à l'emploi, parfois confrontés à des situations où il est impossible par exemple de refuser à un employeur de recruter un salarié par la voie du CIE alors que, si ce salarié remplit les conditions administratives d'accès à ce contrat, il n'en est pas obligatoirement justiciable. Il faut savoir que les demandeurs d'emplois qui ont une activité quasiment à temps plein dans le travail temporaire, dans l'intérim, continuent à être inscrits comme demandeurs d'emplois, voient leur ancienneté de chômage continuer à s'accroître et peuvent, à l'arrivée, bénéficier d'un CIE. Des corrections ont été apportées sur 1999 pour nous permettre, ainsi qu'à l'ANPE, de prendre en compte ces éléments.
Comme le rapport de la mission le montre, les aides ciblées ont pour objectif de corriger les files d'attente du chômage. Les files d'attente du chômage sont éminemment fluctuantes. Quand on aide plus particulièrement la création d'emplois ou l'emploi des jeunes, on voit les chômeurs de longue durée monter en flèche. Quand on donne une aide plus ciblée à des chômeurs de longue durée, c'est le chômage des jeunes qui s'accroît. L'offre de postes d'insertion ou de postes aidés reste toujours insuffisante par rapport au public prioritaire qu'il nous faut traiter.
Les modifications des publics cibles ou des publics que nous traiterions dans les files d'attente pourraient être vues de manière plus simple en listant l'ensemble des publics prioritaires : travailleurs handicapés, chômeurs âgés de plus de 50 ans, bénéficiaires du RMI, etc.
La correction devrait à mon sens pouvoir être apportée et la priorité donnée de manière plus rapide, ne serait-ce que par un arrêté du Ministre en début d'exercice, après le débat parlementaire sur la loi de finances. Cela permettrait de corriger plus vite qu'aujourd'hui, où nous sommes obligés d'attendre un décret ou la modification d'une loi pour tel ou tel instrument.
M. Philippe Auberger, co-Président : Monsieur le Directeur, trois brèves questions.
Première question. Vous avez estimé que les conventions de conversion ont été à peu près inéluctables pour atténuer les effets du licenciement économique. Je partage assez largement votre point de vue.
Cela dit, on constate, au niveau local, que ces conventions de conversion ont dans l'ensemble une efficacité très faible et que le coût qui en résulte pour les finances publiques n'est pas vraiment en relation avec l'efficacité. N'y aurait-il pas quelques mesures de recalibrage à envisager dans ce domaine ?
Deuxième question. Pouvez-vous nous dire quels sont, à votre avis, les effets sectoriels, s'il y en a eu, de la baisse généralisée des charges, notamment celle pratiquée en 1995 ? Est-ce que cette baisse des charges très conséquente sur les salaires les plus faibles a conduit des entreprises à externaliser un certain nombre de fonctions ?
Troisième question. Pensez-vous qu'il serait justifié de mettre en _uvre une nouvelle mesure assez forte sur l'emploi des jeunes dans les entreprises ? Si oui, quel type de mesure faut-il envisager ?
M. Christian Lhote : Pour ce qui concerne les conventions de conversion, il y en a effectivement peu actuellement, puisque les licenciements économiques sont à un niveau particulièrement faible, et nous nous trouvons aujourd'hui plutôt confrontés au resserrement des équipes de l'ANPE travaillant avec l'Assédic sur les parcours de conversion, et à quelques craintes quant à la dissolution, à la perte de savoir-faire en matière d'accompagnement.
Ceci dit, des accompagnements se développent par ailleurs, au sein de l'ANPE, pour les chômeurs de longue durée, dans le cadre du plan national.
Pour les effets sectoriels de réduction des charges, je vous avouerai n'avoir pas constaté, dans l'Orne, que des secteurs professionnels auraient accéléré l'externalisation d'un certain nombre de missions.
Il est vrai que, par restructuration des entreprises à taux de salaire moyen plus fort que dans d'autres secteurs, je pense aux entreprises de la métallurgie, de la chimie, de la transformation des matières plastiques, le transfert des charges peut amener les chefs d'entreprises à être tentés d'externaliser une part de leur activité pour bénéficier de prestations équivalentes à celles qu'assurent des salariés en interne, mais qui ne soient pas couvertes par la même convention collective.
Je n'ai pas l'impression que 1995 ait amené des changements de ce type. Ils avaient eu lieu avant, non pas dans le cadre de l'économie de charges sociales, mais dans le cadre de l'économie globale sur la masse. Il est plus facile, en effet, de négocier un coût de prestation avec un prestataire de services qu'une réduction de salaire avec un salarié ne pouvant plus effectuer son activité professionnelle et qui, sur un poste de nettoyage ou de gardiennage, serait conservé dans la même unité. On a vu ce mouvement se mettre en place depuis les années 1980.
Pour ce qui est de la mise en _uvre d'une mesure forte envers les jeunes pour l'accès à l'entreprise, je ne suis pas certain que nous n'ayons pas aujourd'hui, dans l'ensemble de nos instruments, d'instruments suffisants. L'accès des jeunes à travers le contrat d'orientation pour une première expérience, au contrat d'adaptation qui permet déjà un accès facile à l'entreprise, et au contrat de qualification pour des jeunes dont la qualification serait insuffisante, m'apparaît déjà satisfaisant.
Ce qui est le plus en cause est effectivement la timidité de l'entreprise, aujourd'hui, devant l'acte de recrutement, cette attitude amène à un recours important au travail temporaire et, dans le cadre du travail temporaire, à une exigence de savoir-faire, d'adaptabilité immédiate et de qualification qui, parfois, ne peut pas être satisfaite par un jeune.
M. Daniel Feurtet : Compte tenu de l'ensemble des dispositifs et des intervenants possibles à la fois pour l'entreprise et pour la personne qui cherche un emploi, n'avez-vous pas le sentiment d'une assez grande dispersion ? Au niveau d'un département, n'y aurait-il pas besoin d'une plus grande coordination à la fois des services de l'État, directement compétents de ce domaine, et des services qui en dépendent pour une part, compte tenu de l'investissement public ? D'un département à un autre, les effets sont plus ou moins importants. Si je prends le département de la Seine-Saint-Denis, l'effet de la dispersion est assez redoutable.
L'échelon du département est-il pertinent ? quelle coordination pour rendre plus efficace la dépense publique dans ce domaine ?
M. Christian Lhote : Entre la Seine-Saint-Denis et l'Orne, l'échelle est totalement différente. 300.000 habitants dans l'Orne, cela n'a rien à voir.
Les agents publics qui ont mené des actions diverses - car il n'y a pas que l'État qui intervient maintenant mais aussi le conseil régional en matière de formation, le conseil général en matière de dispositifs d'insertion - les partenaires prestataires pour le compte de l'État, établissements publics type ANPE, AFPA, etc., ont tous senti depuis plusieurs années la nécessité de coordonner leur action.
Vous avez entendu parler du service public de l'emploi. Un noyau dur, dans ce service public de l'emploi, regroupe autour du préfet la direction départementale du travail, l'agence nationale pour l'emploi, l'AFPA, la déléguée aux droits des femmes, un représentant des systèmes de formation publique pour les adultes, et, depuis peu, un représentant de la DDASS.
L'ensemble des départements que je connais associent au service public de l'emploi les représentants des régions des départements et des villes à travers les missions locales. C'est une question d'échelle : la pratique conduit à réunir 25 personnes dans le département de l'Orne. Je ne sais pas si le nombre de missions locales pourrait permettre, en Seine-Saint-Denis, d'avoir une réunion de ce type. C'est dans ce cadre que la coordination peut se faire.
Les cinq dernières années ont été à peu près partout l'exemple d'une meilleure coordination entre les actions de lutte contre l'exclusion, les actions d'insertion, entre les conseils généraux et l'État, et les actions de formation entre les conseils régionaux eux-mêmes. Les conseils régionaux ont, depuis le 1er janvier 1999, la compétence complète en matière d'insertion des jeunes, y compris sur des actions non qualifiantes. La collaboration qui s'était engagée dans le passé entre l'État et le conseil régional, en Basse Normandie, se poursuit de la même façon. On ne peut pas travailler les uns sans les autres.
Est-ce que le service public de l'emploi est la seule instance de régulation ou la meilleure ? Je n'en sais rien. En tout cas, je la pratique, et je la trouve relativement efficace.
Le Président Augustin Bonrepaux : Une dernière question. Comment effectuez-vous le contrôle de l'utilisation réelle, effective des aides attribuées ? Avez-vous des exemples d'effets d'aubaine qu'on pourrait corriger et comment ?
M. Christian Lhote : Pour ce qui est des aides à la formation, je pense aux jeunes avec le contrat d'apprentissage, le contrat de qualification, on est effectivement un certain nombre de partenaires à vérifier que l'aide est utilisée dans le cadre réglementaire prévu. Les services d'inspection de l'apprentissage vérifient l'assiduité des jeunes dans les CFA pour ce qui est de l'apprentissage. Les organismes mutualisateurs vérifient, avant de payer à l'entreprise les aides, que les jeunes ont été effectivement présents dans les organismes de formation, et ne rémunèrent à l'entreprise la prestation de formation qu'en contrepartie du certificat de présence.
Sur d'autres actions de type CIE, aide au recrutement, sur l'effet d'aubaine, la règle, actuellement, ne nous permet pas de nous opposer au recrutement d'un salarié sous le statut CIE par une entreprise qui envisageait de procéder à un recrutement. L'objectif est bien de lutter contre une exclusion, contre un chômage de longue durée. Supposons que l'entreprise qui recrutera ait prévu de procéder à un recrutement : oui, l'aide CIE est seulement destinée à permettre que l'on substitue à un salarié qui n'est pas en difficulté une personne chômeur de longue durée, bénéficiaire du RMI, qui serait restée autrement demandeur d'emploi.
En cela, il faut relativiser le terme d'effet d'aubaine. C'est peut-être une aubaine pour le chômeur de longue durée d'être recruté.
Le Président Augustin Bonrepaux : Monsieur le Directeur, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions.
3.- Table ronde sur les aides à l'emploi
Participants :
MM. Alain Gubian, chef de la mission « Analyse économique » (DARES) au ministère du travail, de l'emploi et de la solidarité ;
Liêm Hoang Ngoc, coordonnateur de l'étude du METIS (Mutation Espace Travail Industrie et Services Stratégies) et du LEST (Laboratoire d'Économie et de Sociologie du Travail) publiée en annexe du rapport de M. Gérard Bapt, au nom de l'Office parlementaire d'évaluation des politiques publiques ;
Jean Lardin, président de la commission des relations du travail de l'Union professionnelle artisanale ;
Christian Lhote, directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de l'Orne ;
Jean-Luc Tavernier, sous-directeur chargé de l'emploi à la direction de la prévision au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Arnaud Leenhart, représentant du MEDEF.
(Extrait du procès-verbal de la séance du jeudi 27 mai 1999)
Présidence de M. Augustin Bonrepaux, Président.
A l'invitation du Président, les participants à la table ronde sont introduits. Le Président leur rappelle les règles définies par la mission pour la conduite des auditions : pas d'exposé introductif, échange rapide des questions et des réponses.
Le Président Augustin Bonrepaux : Je remercie les différents intervenants qui ont bien voulu répondre à notre invitation pour apporter des réponses aux questions que les membres de la mission voudront bien leur poser et je remercie une nouvelle fois la Cour des comptes de participer à nos travaux, de nous avoir éclairés et apporté des suggestions sur la façon dont nous pouvions conduire cette réunion.
Je donne tout d'abord la parole au rapporteur spécial, en demandant à chacun de poser des questions courtes et aux différents intervenants de répondre brièvement, afin que nous puissions, au cours de ces deux heures, balayer l'ensemble des problèmes qui se posent.
M. Gérard Bapt, rapporteur spécial : Je salue les deux chefs d'entreprises, MM. Leenhart et Lardin, ainsi que les directeurs d'administration qui sont ici à notre invitation pour traiter du sujet que la MEC a choisi d'évoquer aujourd'hui. En effet, l'effort public pour l'emploi étant supérieur à 300 milliards de francs et apparaissant dans le budget de l'État pour quelque 160 milliards de francs, il était naturel que l'efficacité de cet engagement budgétaire en matière de créations d'emplois soit examinée sur une période très longue puisque nous traiterons des aides à l'emploi, mais aussi de la formation professionnelle.
Il a été décidé que la réunion de ce jour donnerait lieu à une confrontation d'idées à partir du rapport présenté par M. Liêm Hoang Ngoc sur la base d'un travail réalisé pour l'Office parlementaire d'évaluation des politiques publiques, confrontation entre la façon dont les chefs d'entreprise, les fonctionnaires sur le terrain - malheureusement, nous n'aurons pas de directeur départemental du travail avec nous ce matin - et les administrations des ministères de l'économie et des finances et du travail et de l'emploi peuvent réfléchir ensemble sur les mesures en faveur de l'emploi, sur la manière dont ces dernières sont perçues et reçues sur le terrain et sur leur efficacité en matière de création effective d'emplois ou d'élévation du niveau de qualification des salariés dans les entreprises.
Deux types d'aides à l'emploi retiennent particulièrement mon attention, sur lesquelles nous souhaiterions entendre réagir les personnes réunies ici. Ce sont, d'une part, les aides à l'emploi ciblées, qu'il s'agisse d'aides destinées à des publics à privilégier ou de mesures territorialisées, et d'autre part, les aides à l'emploi générales.
En fait, deux décisions portant sur les bas salaires venant d'être prises en matière d'allégement de charges sociales par le Gouvernement, le débat sur ce point n'est plus tout à fait d'actualité.
En revanche, la façon dont la loi Robien et la première loi d'incitation et d'orientation à la réduction du temps de travail avec création d'emplois de Martine Aubry ont pu être mises en place et reçues sur le terrain me semble essentielle à évoquer ici.
Donc, sur les aides ciblées et sur les allégements de charge liés à la réduction du temps de travail, nous souhaiterions que MM. les représentants du MEDEF et de l'UPA puissent intervenir.
Le Président Augustin Bonrepaux : Encore faudrait-il poser une question précise, monsieur le rapporteur spécial.
M. Gérard Bapt, rapporteur spécial : La MEC a longuement réfléchi, d'une part, en ce qui concerne les aides ciblées, au contrat initiative emploi, qui fait suite au contrat de retour à l'emploi, et d'autre part, aux aides concernant les contrats de qualification, d'orientation et d'apprentissage, qui se situent entre l'aide à la création d'emplois et la formation professionnelle.
M. Arnaud Leenhart : Concernant les aides ciblées que vous venez d'évoquer, contrats initiative emploi et contrats de qualification et d'apprentissage, je répondrai plus en tant que dirigeant d'entreprise qu'en tant que représentant du MEDEF. Je n'ai, pour ma part, jamais beaucoup pris de décisions en fonction de la fiscalité liée à telle ou telle aide. En tant que chef d'entreprise, je considérais que je devais favoriser mon entreprise et, éventuellement, favoriser tout ce qui avait trait à la formation.
Mais je n'ai jamais tellement pris de décisions en pensant, par exemple, qu'il fallait attendre que telle ou telle personne soit dans le cadre d'un contrat d'initiative emploi pour pouvoir tirer un bénéfice fiscal de son embauche. Je n'ai jamais embauché que les gens que j'avais envie d'embaucher, rarement avec l'idée d'avoir telle ou telle prime. J'ai toujours considéré qu'une direction d'entreprise ne se faisait pas en fonction d'une fiscalité assise sur tel ou tel emploi.
Je me positionne là comme le chef d'entreprise que j'ai été pendant trente ans.
Ce commentaire est également valable pour les contrats initiative emploi, qui ont été extrêmement coûteux, que nous avions, en tant que CNPF à l'époque, jugés comme tels. Ils ont été modifiés par la suite pour l'être moins, et qui n'ont pas donné les résultats attendus.
Par contre, les aides à la qualification, l'apprentissage et la formation, sont extrêmement importantes. Autant on peut supprimer certaines aides ciblées, autant celles concernant la formation me paraissent tout à fait utiles. Le leitmotiv dans la métallurgie est de prendre 1 % de nos effectifs en apprentissage ou qualification, avec l'idée d'aller plus loin plus tard.
Si nous prenons des apprentis, c'est que nous considérons que l'entreprise est réellement formatrice et qu'il serait bon d'entrer de plus en plus tôt dans l'entreprise. La formation par alternance est une excellente occasion pour rentrer tôt dans l'entreprise. A une époque où il va peut-être falloir cotiser plus longtemps, il faut mettre les pieds dans l'entreprise le plus tôt possible.
Nous faisons donc des contrats formation. Il faut continuer à aider ces contrats d'apprentissage. Nous ne le faisons d'ailleurs pas uniquement en disant que nous prendrons ces apprentis chez nous après. Nous pensons que, même si nous n'avons pas forcément d'emplois à offrir chez nous, il est de notre devoir de les former. C'est un rôle que nous jugeons extrêmement important.
M. Jean Lardin : Pour l'Union professionnelle artisanale, les aides ciblées sont contestables. Elles ont des effets pervers sur les entreprises. Elles peuvent créer des effets d'aubaine et troubler le jeu de ce que doit être une véritable embauche. C'est la raison pour laquelle, monsieur le rapporteur, nous contestons le bien-fondé de ces aides et ne sommes très enclins à vous demander de continuer dans cette voie.
Pour ce qui est des contrats de formation, plus particulièrement des contrats d'apprentissage, je me permettrai de faire une réflexion : dans ce cas, ne parlons pas d'aides, mais plutôt d'indemnité compensatrice. En effet, s'agissant des contrats d'apprentissage, ce que nous appelons communément des aides n'est, en fait, qu'une compensation pour le temps que le chef d'entreprise ou le tuteur-formateur consacre à la formation du jeune. Dans l'artisanat, nous l'évaluons à 30 % du temps qui est généralement consacré à la production.
Dans ce cas, l'aide apportée n'en est pas vraiment une, il s'agit bien plus d'une indemnité qui compense une dépense réalisée par le chef d'entreprise. C'est la raison pour laquelle, j'aimerais que le distinguo soit clairement fait. Nous essayons, pour notre part, de le faire, parce que cela nous permet de lever un peu la tête.
Ce sont des réponses très rapides à des questions précises. Mais si le temps nous le permet, et au moment où le président le souhaitera, nous pourrons développer.
M. Claude Seibel : Je n'ai pas, en tant que directeur de la DARES, à porter des jugements de valeur, comme peuvent l'être les appréciations que portent les chefs d'entreprise responsables de l'action. Je rappellerai néanmoins puisque, semble-t-il, le contrat initiative emploi est considéré comme étant coûteux, qu'il répond à un objectif qui est certes celui de créer des emplois, mais surtout celui de permettre à des personnes qui sont en situation difficile par rapport au marché du travail, notamment aux chômeurs de longue durée, de se réinsérer.
Il est important de noter qu'aussi bien le contrat de retour à l'emploi, devenu, en 1995, le CIE et, ensuite, rendu moins coûteux pour les finances de l'État dans sa troisième version, est un succès sur deux plans.
D'une part, son taux de création nette d'emplois est parmi les plus élevés des politiques ciblées et, d'autre part, et c'est important à mes yeux, il se conclut par une insertion définitive dans l'entreprise, qui est un élément très important si on le compare à d'autres dispositifs. C'est le seul dispositif qui soit vraiment orienté sur le retour des populations fragiles et en difficulté vers le secteur marchand.
Ce sont des éléments qu'il faut absolument prendre en compte pour conserver une vision globale des politiques d'emploi.
M. Didier Migaud, rapporteur général : Monsieur le directeur, pourriez-vous nous préciser quelques chiffres. Vous nous dites que le taux de création nette est important, qu'il y a une insertion définitive dans l'entreprise, pourrions-nous avoir une idée de l'évaluation que vous avez faite de ces dispositifs ?
M. Claude Seibel : M. Alain Gubian et moi-même allons nous efforcer de répondre à toutes vos questions, mais je précise que je suis personnellement intéressé à ce que s'établisse un dialogue avec votre mission, c'est-à-dire que nous puissions préparer ce type de questions. Nous répondrons, bien sûr, mais j'aurais préféré que nous nous mettions d'accord sur les thèmes que vous souhaitiez aborder.
M. Didier Migaud, rapporteur général : L'un des intérêts de cette mission de contrôle, c'est qu'effectivement, les choses ne soient pas obligatoirement préparées. Même si vous avez des fonctions très horizontales, il est intéressant que vous puissiez réagir et rendre compte du travail qui est fait, notamment au niveau de l'évaluation. Le caractère spontané, même s'il doit s'appuyer sur des réalités concrètes, peut être intéressant pour notre mission.
M. Alain Gubian : J'insiste bien sur le fait que ce dont on parle avec le contrat initiative emploi, c'est d'une aide ciblée sur un public particulier, dont on pense qu'il est le plus éloigné du retour à l'emploi. Il ne faut donc pas le confondre avec les aides générales, dont la vocation, plus large, est de créer des emplois et qui s'adressent à une population par définition moins ciblée.
Cela ne veut pas dire pour autant que ces aides n'ont pas un effet net sur l'emploi parce que, d'une certaine manière, elles utilisent les mêmes instruments que les aides générales, c'est-à-dire la baisse du coût du travail.
Se pose alors, concernant la baisse du coût du travail, la question de savoir si l'on croit ou non que celle-ci a un effet sur l'emploi. Pour ma part, en raison de travaux qui ont été faits sur le sujet et sur lesquels j'imagine que nous reviendrons au cours de la discussion, je m'inscris dans la position qu'abaisser le coût du travail a un effet net sur l'emploi et enrichi la croissance en emplois, qu'on le fasse par une aide générale ou par une aide ciblée. C'est particulièrement vrai du CIE, puisque, dans ce cas, la baisse du coût du travail peut être particulièrement forte. Elle atteint 40 % lorsque l'on cumule l'exonération et la prime maximale, c'est-à-dire pour les publics les plus en difficulté. Elle est évidemment bien inférieure si le public est en difficulté moindre, c'est-à-dire s'il s'agit d'un chômeur de longue durée entre un et deux ans.
Sur la base de cet effet net constaté sur l'emploi, il faudrait démystifier le thème de l'effet d'aubaine. On entend parler d'effet d'aubaine comme si toute aide à l'emploi devait donner un emploi supplémentaire, comme si un chef d'entreprise qui utilise une aide n'aurait pas créé l'emploi sans elle et le créerait avec. Cela paraît un peu curieux quand on fait le simple calcul que dix salariés au SMIC coûtent le même prix que dix-sept salariés en CIE. Ce petit calcul démontre bien que si une entreprise voulait utiliser massivement le CIE et remplacer dix salariés par dix-sept CIE, il n'y aurait que sept créations d'emplois par rapport à ce qu'elle aurait fait.
De toute façon, toute aide à l'emploi, vu que l'on n'abaisse pas le coût du travail de 100 %, génère nécessairement des effets d'aubaine, en ce sens que des emplois auraient de toute façon été créés sans la mesure par un certain nombre de chefs d'entreprise. En moyenne, la proportion est relativement forte, mais il faut bien s'entendre sur l'ampleur d'emplois créés nette. Le chiffre utilisé actuellement dans les estimations de la DARES, et ceci depuis la mise en _uvre du CIE, est de l'ordre de 20 %. Lorsque je dis que dix CIE égalent dix-sept salariés, cela veut dire que sur dix-sept salariés, on en a sept créés, soit 40 %, sur lequel nous retenons un taux de moitié, soit un taux de 20 % de création d'emplois. Donc, pour cent CIE, vingt emplois nets supplémentaires.
Ces taux sont issus de calculs de type macro-économiques, qui utilisent les travaux portant sur le lien entre l'emploi et le coût du travail, mais qui sont aussi confortés par des enquêtes faites auprès des entreprises qui répondent sur le fait qu'elles auraient ou non créé l'emploi.
Les mécanismes qui font que les emplois sont créés ne sont pas forcément, ne sont pas seulement, que l'entreprise aurait au même moment pensé embaucher ou ne pas embaucher. Cela peut être aussi qu'elle abaisse ses prix, que son coût est moindre et que, très rapidement, un supplément de demandes lui est adressé et que de ce fait, elle est amenée à embaucher.
Pour l'aspect création nette, c'est donc le chiffre de 20 % que l'on retient. Sur un stock de 400 000 CIE au niveau maximum, vers le milieu de l'année 1997, cela nous fait en gros 80 000 emplois supplémentaires.
Mais le point qui me paraît encore beaucoup plus important, c'est que cette aide s'adresse à un public particulier et des travaux en cours, en partie déjà réalisés, laissent entrevoir que la substitution entre un chômeur de longue durée et une embauche de salarié normal est loin d'être négligeable, certes pas de 100 % mais de l'ordre de 50 %. Ce résultat nous paraît fort intéressant à prendre en compte, dans la mesure où il indique une modification de la structure du chômage.
Quand on regarde la montée du chômage de longue durée sur la période de 1990 à maintenant, pour prendre à la fois le creux qui a précédé le CIE et le CIE, on remarque bien, dans les périodes de montée en charge du CIE, un infléchissement significatif de la courbe du chômage de longue durée par rapport à l'évolution du chômage lui-même.
Il y a donc à la fois un effet de création net et un effet de substitution, évalué dans les enquêtes autour de 50 %. Cela mériterait sans doute des travaux supplémentaires d'évaluation de la structure du chômage de longue durée.
Sur une aide de ce type se pose évidemment toujours la question de savoir si le calibrage était le bon : n'a-t-on pas trop ou pas assez donné en termes d'aides ? Ce problème de calibrage s'est d'ailleurs posé dans le cas du CIE, puisque l'aide a été révisée de manière à être progressive en fonction de la difficulté d'insertion sur le marché du travail, selon la durée du chômage de longue durée. Mais il est vrai, en règle générale, qu'il n'est pas toujours simple de calibrer une mesure au bon niveau. Quoi qu'il en soit, personne n'imaginait que cette aide puisse créer des emplois nets à hauteur de 100 %.
M. Jean-Philippe Cotis : Quelques commentaires proches de ce que vient de dire Alain Gubian.
Nous considérons que les dispositifs d'apprentissage et de formation, sont de bons dispositifs, efficaces, et les pays qui réussissent bien dans ce domaine, comme l'Allemagne, montrent bien ce que peuvent apporter des formations en alternance.
Sur le CIE, l'objectif est bien sûr de créer des emplois, mais surtout de lutter contre la marginalisation et contre ce que nous appelons dans notre jargon « les effets d'hystérèse ». Quand on sombre dans le chômage de longue durée, il y a un risque de rupture totale avec le marché du travail ; il s'ensuit une catégorie de chômeurs extrêmement difficiles à réintégrer en phase de reprise économique.
Cela coûte évidemment beaucoup plus cher qu'une création d'emploi classique. Viser ces publics est un objectif extrêmement important des politiques de l'emploi, et de justice sociale aussi.
M. Gérard Bapt, rapporteur spécial : Ces premiers échanges ont fait surgir deux problématiques.
Les chefs d'entreprise nous disent que les aides ciblées ne les intéressent pas et qu'ils embauchent sur d'autres critères mais qu'en revanche, les aides à l'apprentissage ou à la qualification les intéressent. Je suis tenté de poursuivre le débat en répondant aux chefs d'entreprise que, du point de vue politique et de l'État, l'aspect social de l'accès à l'emploi, le fait de rapprocher de l'emploi les demandeurs d'emploi d'un niveau d'employabilité moindre, est aussi à prendre en compte.
Quand on cherche à analyser l'efficacité de l'engagement budgétaire public, il est sûr que la notion d'effet d'aubaine doit être nuancée par la notion d'efficacité sociale, d'intérêt social.
Concernant le CIE, le rapport de M. Hoang Ngoc faisait état de chiffres comparables, 20 à 25 % de créations, qui permettaient néanmoins d'anticiper la création d'emplois qui auraient été créés plus tard et l'ont été plus tôt, et 50 % qui sont soit de l'effet d'aubaine, soit de l'effet social.
Le second aspect touche à la complexité de ces mesures en faveur de l'emploi. Avez-vous, par exemple, entendu parler d'une mesure d'aide à l'embauche des fils de harkis ? Elle se traduit par une prime de 20 000 francs. Il s'agit là d'une mesure ciblée sur un public très restreint. Pensez-vous que de telles mesures présentent un intérêt ?
Souvent, en tant qu'élus locaux, dans le cadre de comités de bassin pour l'emploi ou de plans locaux d'insertion par l'économique, nous envoyons des missi dominici dans les entreprises pour tenter de placer des personnes en difficulté, qui présentent quand même de l'intérêt, en disant que l'on va les suivre et que l'entreprise bénéficiera de tel et tel avantage si elle les prend. Ces démarches vous paraissent-elles intéressantes ? Sont-elles licites ?
Pourriez-vous approfondir ces deux aspects d'un point de vue opérationnel et porter un jugement sur l'efficacité sur le terrain de ces mesures ?
M. Arnaud Leenhart : Il existe tellement de mesures que je ne connaissais pas celle concernant les fils de harkis. Nous ne sommes pas des chasseurs de primes. Mais il est certain que lorsqu'une proposition nous est soumise, nous l'examinons.
M. Jean Lardin : A mon accent, vous avez bien compris que je suis plutôt du Sud de la France. Il y a une concentration de Harkis près de Villeneuve-sur-Lot. Etant d'un département voisin, l'Aveyron, je connaissais la mesure, par curiosité. Mais je ne peux pas vous dire comment mes collègues artisans du département du Lot-et-Garonne, puisque c'est ma référence la plus proche, accueillent cette mesure.
En tant qu'individu, je peux comprendre qu'un gouvernement prenne de telles mesures, mais nous n'avons pas conduit de véritable réflexion sur ce point qui me permette de donner un avis au nom de l'UPA.
En revanche, je vais quand même citer un exemple. Nous avons connu les exonérations de cotisation d'allocations familiales accordées à des entreprises situées dans les zones de revitalisation rurale. Cette mesure a fait l'objet d'une première annonce, puis d'une loi.
Aujourd'hui, les tribunaux de sécurité sociale sont en train de juger parce que certaines entreprises pensaient y avoir droit, et que les URSSAF ont continué à appeler les contributions. Les jugements sont en cours.
En fait, toutes ces mesures ponctuelles sont très difficiles à connaître parce qu'elles s'appliquent à des confettis du territoire, portent sur telle ou telle catégorie d'individus, et, finalement, sont assez méconnues - la preuve, nous avons bien dû, l'un et l'autre, avouer notre méconnaissance sur l'une d'entre elles. Ce sont des mesures difficiles à analyser et à faire vivre et, enfin, elles sont interprétables.
Dès lors, on met dans l'embarras l'artisan peintre de Laguiole qui, en toute bonne foi, n'a pas payé les cotisations d'allocations familiales et le directeur de l'URSSAF qui lui a appliqué les 10 % de pénalités de retard. L'artisan est allé voir son syndicat, nous l'avons accompagné et nous sommes maintenant au tribunal. L'objectif initial n'était pas celui-là !
Il faut donc veiller à apporter toute la clarté, l'explication, l'information nécessaires pour bien expliquer aux gens pour quoi c'est fait.
M. Jacques Barrot : Je me permettrai de faire une remarque avant de poser ma question.
En fait, le vrai problème, c'est le coût du travail. La notion de primes n'a de sens que si elle abaisse le coût du travail de manière durable. La grande critique que l'on peut faire à ces systèmes mis en place dans la loi Pasqua, c'était de créer - et je fais droit à ce que dit Jean Lardin - des primes temporaires. Je ne vois pas pourquoi l'on baisserait le coût du travail dans une région difficile pendant deux ans. Il faut le baisser durablement.
Par contre, je répondrai au président Leenhart, que je respecte pour sa compétence, que le CIE est autre chose : c'est une baisse momentanée du coût du travail pour laisser à l'entreprise le temps de remettre à niveau le chômeur de longue durée qui n'a plus, malheureusement, les bons réflexes. Ce n'est pas un service à l'entreprise. A la limite, c'est la société qui demande à l'entreprise de bien vouloir prendre un chômeur de longue durée pour le hisser justement à un niveau où, ensuite, il n'aura plus besoin de bénéficier d'un traitement spécifique.
Il faut bien distinguer les deux. Il me semble que l'on peut se mettre assez d'accord avec des remarques de bon sens.
Je crois personnellement à l'efficacité de la baisse du coût du travail durable. La baisse du coût du travail momentanée peut être justifiée quand on a affaire soit à un apprenti, soit à un titulaire de contrat de qualification, qui ne peut pas produire ce que produit quelqu'un qui est de plain-pied dans le métier.
Elle se justifie également pour un chômeur de longue durée. Il est vrai, président Leenhart, que ce n'est pas la demande de l'entreprise mais, comme le disait M. Cotis, c'est la demande de la société, car on évite à ce chômeur de longue durée de glisser peu à peu vers le RMI et l'assistance
Les auditions auxquelles nous avons procédé ont laissé, semble-t-il, aux commissaires - je parle sous le contrôle du président Bonrepaux et de notre rapporteur général - une inquiétude quant à la manière dont les fonds de la formation professionnelle sont utilisés, avec toujours des stocks de fonds qui ne sont pas employés aussi efficacement et rapidement que souhaitable. Nous avons le sentiment qu'il faudrait, dans la collecte et dans l'utilisation de ces fonds qui sont alimentés par des cotisations obligatoires des entreprises, parvenir à plus d'efficacité.
Pourrions-nous avoir votre réaction sur cette question qui a beaucoup agité notre mission ? Je sais que c'est un sujet difficile, mais nous avons le sentiment que les collectes sont diverses et multiples - et je sais bien qu'il faut provisionner le risque formation, que certaines formations ne sont pas suivies jusqu'au bout, etc. - mais qu'il faudrait néanmoins une dynamisation plus forte de ces fonds pour permettre à un plus grand nombre de jeunes Français d'entrer plus vite dans ces contrats qui ne sont pas des contrats d'emploi, de travail, mais de travail-formation.
M. Arnaud Leenhart : Des réformes importantes ont tout de même été opérées il y a quelques années, avec la suppression de pas mal d'organismes de collecte, puisque les OPCA ont maintenant une existence plus concrète. Qu'il y ait encore à faire, je le pense aussi, mais des réformes sont en cours et d'autres sont discutées. Je n'ai pas de réponse immédiate à vous apporter, mais nous nous employons à ce que cette formation soit dispensée correctement. Personnellement, je ne dispose pas de données très nouvelles sur ce point dont je pourrais vous faire part.
M. Jean Lardin : Deux types de réponse.
Tout d'abord, j'ai bien entendu M. Barrot nous dire que la nation demandait, à un moment donné, aux entreprises de faire un effort sur tel ou tel type de public. Je voudrais rappeler l'effort constant de l'artisanat pour donner des perspectives aux jeunes de notre pays, notamment au travers de l'apprentissage, apprentissage que nous avons porté à bout de bras pendant des décennies et qu'aujourd'hui, tout le monde reprend sous le vocable d'alternance, en élargissant le dispositif.
J'aimerais que vous appréciez l'effort qui a été le nôtre, qui ne fut pas toujours pris en compte, du moins financièrement.
Aujourd'hui encore, nous nous trouvons dans une situation délicate, car le soutien qu'apportent les conseils régionaux sur l'effort pédagogique, puisque ce sont eux qui aujourd'hui ont en charge ce type de problème, est très variable avec des efforts à hauteur de 10 000 francs par apprenti dans certaines régions et de 23 000 francs dans d'autres. Cela pose donc le problème des disparités de traitement, mais aussi de la difficulté à assumer nos fonctions.
Prenons l'exemple des métiers du bâtiment. Voilà une profession dans laquelle la situation est aujourd'hui bien meilleure, mais durant les dix dernières années, nous avons vécu des périodes plus difficiles. Néanmoins, chaque année, il sortait environ entre 70 et 80 000 salariés de nos professions. Tous les appareils de formation confondus n'en formaient que 40 000 à peine.
Vous rendez-vous compte du déficit et de la marge de progression possible ? Voilà un outil sur lequel nous pourrions éventuellement peser pour donner des perspectives encore plus larges aux jeunes. Or, l'orientation des jeunes vers les métiers manuels de l'artisanat se fait souvent par défaut. J'aimerais qu'au niveau de l'orientation, vous soyez persuadés des efforts qui restent à faire pour que ces orientations soient de véritables choix professionnels, de véritables choix de société et non une succession de carences avec, au bout, une seule alternative : ne rien faire ou aller vers les métiers manuels.
Les métiers manuels ont aussi besoin de faire entrer de l'intelligence dans la profession. Je vous invite à réfléchir à ceci : vous confiez la réparation de vos véhicules à des artisans et à des salariés mécaniciens, j'aimerais pour vous que ce soient des gens compétents ; vous logez dans des bâtiments construits par des artisans et leurs salariés, j'espère que vous avez le sentiment d'y être en sécurité ; lorsque ce matin pour déjeuner, vous avez mangé un croissant, un collègue pâtissier l'avait certainement préparé, j'aimerais pour votre santé que ce soient des gens compétents.
En ce qui concerne la formation professionnelle, je rappelle, s'agissant de l'artisanat, la situation dans laquelle vous nous avez mis, lorsque la loi de 1971 a été votée et que les entreprises de moins de dix salariés ont été exclues du bénéfice des moyens de formation professionnelle. Nous avons dû " ramer " et attendre 1982 pour que la loi accorde la possibilité aux chefs d'entreprises artisanales de se former, de se perfectionner. Et nous avons dû attendre l'accord UPA de 1985 avec les partenaires sociaux pour pouvoir mettre en place ce qui était au début les fonds d'assurance formation des salariés des entreprises artisanales et ce qui est aujourd'hui les OPCA.
Si je me suis permis de revenir ainsi sur l'histoire, c'est pour vous inviter à faire attention à ne pas mettre la gestion du dispositif de formation professionnelle dans un seul outil parce que, dans ce cas, ce seraient les intérêts des plus grands qui seraient pris en compte. Ceux des artisans, malheureusement, n'ont pas été dans l'histoire de notre pays toujours pris en compte. Aujourd'hui, nous avons su créer une brèche, conquérir notre place, je vous invite à regarder de près le retour vers la formation de l'artisanat. Vous verrez que cela valait le peine de permettre à ces OPCA de l'artisanat de voir le jour.
M. Didier Migaud, rapporteur général : Je voudrais profiter de nos interlocuteurs, qui représentent à la fois l'administration et le monde de l'entreprise, pour qu'ils puissent nous apporter quelques précisions sur le coût du travail.
M. Jacques Barrot en a dit un mot ainsi que Gérard Bapt. Chacun y pense. Tout tourne autour de ça : le coût du travail est-il élevé, trop élevé ?
Un chef d'entreprise aura peut-être toujours tendance à le considérer comme trop élevé mais, la DARES, la direction de la prévision, M. Liêm Hoang Ngoc, peuvent sans doute nous apporter quelques brèves précisions sur le coût du travail en France par rapport à celui de nos partenaires et concurrents étrangers. Pourriez-vous également, puisque cela entre dans le cadre de notre mission, situer ce que peut représenter la taxe professionnelle dans les charges de l'entreprise ?
A cet égard, nous aimerions notamment demander aux chefs d'entreprises si les taux de la taxe professionnelle sont, pour eux, des critères de choix quand ils décident d'implanter une entreprise ou de créer des activités à un endroit. Font-ils référence à ce type de charge ?
M. Claude Seibel : Sur le coût du travail en France, les investigations que nous avons conduites avec la direction de la prévision et l'INSEE en vue de la Conférence nationale du 10 octobre 1997, nous semblent être des sources encore d'actualité, qui permettent de répondre à votre question.
On constate qu'actuellement, au niveau du coût global du travail, en moyenne, la France ne se trouve pas dans une situation pénalisée par rapport aux autres pays européens, ce qui est un point très important. Mais quand on rentre à l'intérieur de ce coût du travail, nous avons deux problèmes, l'un est dans le partage entre coût salaire direct et charges, partage déséquilibré pour la France au détriment du salaire direct pour un coût global identique, l'autre est que nous avons, par rapport à certains pays européens mais surtout par rapport aux États-Unis, une difficulté assez grave concernant le coût du travail du salarié non qualifié. Nous partageons cette difficulté avec d'autres pays européens, dont l'Allemagne.
C'est ce que l'on peut dire succinctement.
M. Liêm Hoang Ngoc : Monsieur le rapporteur, vous avez raison de dire que la question cruciale est celle du coût du travail.
Mais je reviens sur ce qu'Alain Gubian disait tout à l'heure concernant les créations nettes à propos du contrat initiative emploi. Il est vrai que l'objectif du contrat initiative emploi est avant tout un objectif dit « de discrimination positive ». Nous avons distingué dans notre rapport l'ensemble des objectifs de la politique de l'emploi et avons mis l'accent sur le fait que c'était un objectif de modification de l'ordre de la file d'attente.
Évidemment, on ne peut pas attendre d'une mesure comme celle du CIE de créer des emplois, mais le CIE atteint tout à fait cet objectif de modification de la file d'attente. Je ne reviens pas sur le chiffre donné par M. Gubian, mais il est vrai que dans un cas sur deux, il modifie le comportement d'embauche des employeurs qui n'auraient pas embauché de chômeur de longue durée.
Quant à l'effet net sur la création d'emploi, il est en effet celui qui a été donné.
Mais je tenais, à cet égard, à préciser que pour obtenir cet effet net sur l'emploi, la baisse du coût du travail a dû être extrêmement importante, de l'ordre de 40 %. Cela a donc coûté très cher. Ce chiffre signifie, tout simplement, que l'élasticité pour les non qualifiés est très faible dans notre pays lorsqu'elle est significative statistiquement. C'est ce que fait ressortir l'ensemble des travaux économétriques. Si l'élasticité est faible, si l'emploi est très peu sensible au coût du travail, c'est donc que l'emploi dépend d'autre chose que du coût du travail et que si vous voulez provoquer des créations d'emploi par la baisse du coût du travail, cela coûte extrêmement cher.
Il faut provoquer une baisse de 40 % du coût du travail pour obtenir l'effet net de 20 % en ce qui concerne le CIE. C'est un élément qui mérite d'être pris en compte si l'on veut rationaliser la dépense publique pour l'emploi.
Le problème central est-il véritablement un problème de coût du travail ? Dans notre rapport, nous avons attiré l'attention sur le fait que ce problème pouvait exister dans certains secteurs soumis aux délocalisations, tels que le textile. Ce problème pouvait être constaté économétriquement dans des secteurs tels que le commerce et les services marchands. Dans ces cas - mais peut-être une autre partie de la réunion sera-t-elle consacrée à cela -, d'autres mesures que celles d'abaissement du coût du travail semblent appropriées pour traiter ce problème. Il s'agit de prendre en compte la pluralité des situations des entreprises qui ne souffrent pas toutes d'un problème de coût du travail.
Quant à la hiérarchie des coûts salariaux, nous en dressons un état des lieux dans la synthèse qui se situe chapitre 4 du rapport, où l'on peut voir, comme le constate l'ensemble des institutions, que le problème du coût du travail global en France n'est pas véritablement le plus élevé de l'Union européenne.
Quant au débat sur le problème du coût du travail des personnes non-qualifiées, nous avons également les chiffres et vous serez étonnés de constater que la France se place seulement en sixième position parmi ses partenaires européens, derrière l'Italie, les Pays-Bas, et derrière l'Allemagne évidemment. Mais on ne peut pas vraiment dire que la France soit pénalisée en matière de coût du travail non qualifié. Qu'il faille cibler un certain nombre de mesures, je veux bien en convenir, dans l'objectif de rendre plus employables des personnes en difficulté, mais centrer toute la politique de l'emploi sur la réduction du coût du travail me semble bien peu rationnel pour " rationaliser " la dépense pour l'emploi.
M. Jean-Philippe Cotis : Globalement, le coût du travail dans l'économie française n'est pas trop élevé. Nous avons une bonne compétitivité internationale et une bonne profitabilité de l'investissement.
En revanche, le coût du travail peu qualifié était beaucoup trop élevé, notamment dans les années 80. Il a été rééquilibré depuis par des baisses de charges, mais il demeure encore légèrement élevé, même par rapport à la moyenne européenne.
M. Hoang Ngoc donne dans son rapport des chiffres qui datent de 1988 ...
M. Liêm Hoang Ngoc : De 1998.
M. Jean-Philippe Cotis : Le tableau 25 donne le coût du travail par catégorie en Europe en 1988, mais peut-être s'agit-il d'une faute de frappe. Un rapport du CSERC, très intéressant et très soigneux, donne des chiffres de 1997 sur le sujet. Il compare le coût relatif du salaire minimum par rapport au salaire moyen, on constate que la France est le grand pays européen qui a le coût relatif le plus élevé. J'ai ici avec moi le graphique tiré du rapport du CSERC sur ce sujet en 1997, que je puis vous laisser.
Nos propres analyses font donc ressortir un coût du travail peu qualifié très élevé en France ainsi que dans d'autres pays européens, ce qui expliquerait peut-être assez largement le handicap de création d'emplois que nous connaissions par rapport à d'autres grands pays du G7, notamment dans le secteur des services, alors que notre taux de croissance sur longue période n'est pas beaucoup plus faible que la moyenne du G7. Il est assez proche. A croissance donnée, nous avions un déficit de création d'emplois très net, notamment dans le secteurs des services. Il nous semble donc que c'était un point important.
Le fait que l'on a sans doute créé 500 000 emplois de plus, sur les cinq dernières années, que ce que l'on aurait pu escompter si les comportements sur le marché du travail étaient restés les mêmes, nous semble indiquer qu'il y a un faisceau de présomptions qui montre que la baisse du coût du travail peu qualifiée a joué un rôle important. Ce n'était pas la seule mesure, mais elle n'est pas négligeable.
Notre autre sentiment est que cette bonne surprise en matière de création d'emplois s'explique pour moitié par la baisse des charges sur le travail peu qualifié. Mais cinq ans, c'est une période un peu courte pour les statisticiens et les économètres pour être totalement sûrs de ce qui s'est passé, mais plus le temps passe et plus le faisceau de présomptions semble concordant.
Sur la notion d'effet d'aubaine dans le cas du travail peu qualifié qui a été assez mal traitée en France, à la fois en termes de prélèvement, de système de prélèvement, de prestations et de coût du travail lui-même puisque tous ces éléments sont très défavorables au travail peu qualifié, nous avons pris un peu de retard dans le traitement de ces problèmes. Ce sujet a été négligé. Le fait d'avoir eu un coût du travail peu qualifié extrêmement élevé par rapport à la moyenne et le fait de le ramener à des niveaux plus normaux n'est pas vraiment une aide à l'emploi. C'est plus la correction d'une erreur, malheureusement collective, qui remonte à longtemps mais ce sont des politiques que partagent beaucoup de nos partenaires européens et d'autres pays industriels. Ce n'est pas tant une aide à l'emploi que le retour à des fondamentaux plus sains.
Il s'est passé quelque chose sur le travail peu qualifié, notamment sous l'effet des nouvelles technologies de l'information et de la concurrence Nord-Sud, qui fait que la demande de travail peu qualifié a chuté brutalement. Aux États-Unis, la solution qui a été retenue et qui ne nous convient pas du tout, c'est que le salaire des moins rémunérés s'est effondré de 20 ou 30 % dans l'absolu en vingt ans aux États-Unis. C'est une mauvaise réponse à apporter.
En revanche, une baisse de charges, donc une solidarité nationale, pour réduire le travail tout en maintenant la rémunération nette reçue par le salarié est une solution qui conjugue l'efficacité économique et la justice sociale. C'est ainsi que nous le voyons.
L'objet de ces politiques n'est pas de créer plus d'emplois peu qualifiés, mais d'endiguer l'érosion du stock d'emplois peu qualifiés que nous avons subie depuis vingt ans. Aux États-Unis, par exemple, il n'y a pas eu d'explosion de petits boulots, le stock d'emplois peu qualifiés est resté ce qu'il était. Cela s'est fait au prix de baisses de salaire insupportables. La voie européenne qui semble se dégager dans les grandes orientations de politique économique ou de politique pour l'emploi à Bruxelles, est celle qui consiste à faire baisser le travail tout en préservant la rémunération afin que le retour à l'emploi soit rémunérateur pour un salarié et que nous n'ayons pas de working poors à l'américaine.
M. Arnaud Leenhart : Je citerai quelques faits précis.
Je suis entouré d'entreprises qui, sans parler de délocalisation, parlent de relocalisation. J'ai en tête des exemples d'entreprises sous-traitantes de l'automobile auxquelles le fabricant assemblier dit : « Je veux votre technique, vos produits, mais vous ne les ferez pas en France parce que vous n'y arriverez pas. »
Ce phénomène ne touche donc pas seulement le textile. Il y a manifestement dans le coût du travail des choses qui font que telle ou telle usine a été implantée au Portugal ou en Tchéquie parce que cela ne collait pas en France. Nous en avons des exemples très précis. C'est la raison pour laquelle je pense que le coût du travail a beaucoup d'importance.
M. Didier Migaud, rapporteur général : La taxe professionnelle ?
M. Arnaud Leenhart : En ce qui concerne la taxe professionnelle, j'avais l'habitude de regarder combien cela coûtait chaque fois qu'un ouvrier rentrait dans mon usine. Et cela coûtait beaucoup plus cher que d'aller à un match de football ! Tous les matins quand un ouvrier pointe, cela me coûte 200 francs dans certaines usines, 100 francs dans d'autres, 250 francs ailleurs ; les disparités sont extrêmement fortes. C'est le prix d'entrée de l'ouvrier dans l'usine parce que c'est sa participation à la taxe professionnelle.
J'ai donc l'habitude de regarder combien coûte le fait qu'un ouvrier vienne travailler dans mon usine. Je constate qu'il existe de grandes disparités et que dans « l'attractibilité » de notre pays, certains étrangers incluent la taxe professionnelle dans le coût du travail parce que, finalement, elle est imputée sur chaque personne qui vient travailler. En raison des taxes importantes qui sont les nôtres, une telle analyse nous défavorise par rapport à d'autres pays qui n'ont pas de taxes du type de notre taxe professionnelle. C'est en cela qu'il convient de la comprendre dans le coût du travail.
Le Président Augustin Bonrepaux : La suppression de la part des salaires va simplifier votre travail.
M. Arnaud Leenhart : Elle simplifie certainement le travail, mais il faut aller un peu plus loin, il ne faut pas que la partie investissement vienne compenser. Mais, j'admets tout à fait que c'est un premier pas.
M. Jean Lardin : UPA est attaché à ce que l'on réduise le coût du travail. Aussi nous employons-nous à le faire réduire par tous les moyens disponibles, y compris par la baisse du taux de la TVA, qui contribue également au coût du travail.
Mais si nous voulons abaisser le coût du travail, c'est pour qu'un maximum de personnes puissent consommer nos prestations, c'est pour élargir notre marché. Ce qui nous permettra d'accueillir des jeunes supplémentaires dans nos entreprises.
S'agissant de la taxe professionnelle, nous sommes enracinés dans les territoires et nous sommes donc très vigilants sur ce qui est fait en la matière. En tout cas, la première initiative qui consiste à baisser le taux de la part salariale nous semble aller dans le bon sens. Nous en sommes d'accord.
Vous nous suggériez de dire ce qui détermine la localisation de nos activités et de nos entreprises. Pour nous dans l'artisanat, c'est le marché ; l'existence d'un marché, sans lequel on ne peut créer l'activité.
Je rappelle que nos activités ne sont pas délocalisables. C'est la particularité des entreprises artisanales.
A vrai dire, je ne sais si tout ce travail statistique auquel on fait référence vous permet de voir la réalité de l'emploi dans le secteur de l'artisanat. Je vous rappelle que l'INSEE ne s'est intéressée à ce qui se passait dans les entreprises de moins de vingt salariés que depuis peu. Aujourd'hui encore, il n'existe pas de véritable statistique pour notre secteur d'activité. Au cours des dix dernières années, c'est pourtant dans nos activités qu'ont été créés le plus d'emplois. Avez-vous des chiffres qui vous permettent d'évaluer ce qui s'y passe ? En dehors du répertoire informatisé des métiers que tient l'INSEE, pour le reste, il n'y a pas de chiffres. Chacun produit les siens.
M. Liêm Hoang Ngoc : J'apporterai deux éléments de réponse à cette question.
Je reviens sur les propos de M. Cotis : les 350 000 emplois créés cette année sont-ils le fait de l'abaissement du coût du travail ou d'une reprise de la croissance ?
On peut mettre cela en parallèle avec l'évolution de l'emploi aux États-Unis. Alors que la structure du marché du travail n'a pas tellement évolué depuis dix ans, comment expliquer l'explosion de l'emploi, notamment dans les secteurs qualifiés à forte valeur ajoutée, si ce n'est parce que la croissance américaine est dynamique et qu'elle est accompagnée par des politiques macro-économiques appropriées ?
Ma deuxième remarque, je ne souhaite pas que l'on se méprenne sur le sens de mon propos, je n'ai jamais dit qu'il n'y avait pas de problème de coût du travail, notamment dans l'artisanat. Je pense qu'il existe en effet des secteurs dans lesquels se pose un problème de coût du travail, mais ce n'est pas l'ensemble de l'économie française qui souffre de ce problème. Établir une théorie générale à partir de cas exceptionnels me paraît être un contresens, tout au moins pour quelqu'un qui fait un peu de théorie économique.
A ce propos, je pense que ce que nous avons développé dans la dernière partie du rapport peut être utilisé à bon escient par les décideurs de la politique publique pour fonder un nouveau principe d'aides à l'emploi et de politique de l'emploi qui consisterait non seulement à adapter l'offre à la demande de travail, mais à prendre en considération la pluralité des situations d'entreprises. Par exemple, l'extension de l'assiette de financement de la sécurité sociale à quelque chose comme l'excédent brut d'exploitation ou, selon une variante étudiée par Bercy en ce moment, à l'assiette de l'impôt sur les sociétés est intéressante parce qu'elle met plus à contribution, pour le financement de la sécurité sociale, les entreprises qui n'ont pas de problème financier et qui ont détruit des emplois. Par contre, les entreprises comme celles de l'artisanat qui sont particulièrement dynamiques en matière de création d'emplois bénéficieraient, dans ce cas, d'une baisse des charges sociales.
L'effet d'un transfert vers des assiettes de ce type revient à alléger la charge sociale des entreprises qui créent de l'emploi. C'est, à mon avis, un principe qui mérite d'être fouillé et développé dans l'avenir.
M. Jean-Philippe Cotis : En ce qui concerne les statistiques sur l'artisanat, nos collègues de l'INSEE ne sont pas présents, aussi je me permets de dire pour eux que leur problème est leur difficulté à obtenir des réponses des petites entreprises. Sans réponses, on a du mal à produire des statistiques.
A propos de ce que vient de dire M. Hoang Ngoc, bien entendu, il y a en France du chômage par insuffisance de débouchés des entreprises, que nous évaluons à deux ou trois points de taux du chômage, soit près de 500.000 à 700 000 chômeurs. Donc une bonne politique macro-économique qui crée de la croissance crée des emplois.
Depuis cinq ans, à croissance macro-économique donnée, nous avons 400 à 500 000 emplois de plus que ce que nous observions dans le passé. Je vous laisserai également deux graphiques avec ce que nous aurions eu avec les comportements anciens sur le marché du travail et ce que nous observons dans nos simulations. Il ne s'agit pas de dire qu'en 1998, les créations d'emplois ne sont pas massivement liées à une forte croissance. Il est évident que oui.
M. Jean-Jacques Jégou : Monsieur le président, je sais qu'il est difficile de gérer les files d'attente des questions des commissaires, mais il n'est pas toujours facile pour nous de nous replacer dans la discussion. Je voulais réagir déjà sur les premiers échanges qui ont eu lieu, en revenant sur des aspects qui nous préoccupent.
Nous sommes ici la mission d'évaluation et de contrôle. Je pense qu'il faudra encore quelque temps avant que l'on puisse se mettre d'accord sur le coût du travail réel dans ce pays ; il y a un monde entre les estimations et ce que disent les chefs d'entreprise, et M. Leenhart a parfaitement dit les risques et la connaissance qu'il avait de relocalisations ou délocalisations. Aussi, je voudrais poser des questions à M. Seibel et aux chefs d'entreprises sur deux points.
Premièrement, il s'agit de l'importance des différentes aides.
Nous avons parlé des CIE, il en existe bien d'autres, dont certaines sont même inconnues des chefs d'entreprise. Quant à l'importance de cette aide, des dizaines, voire des centaines de milliards sont mis pour réduire le chômage. Existe-t-il des comparaisons européennes qui prennent en compte la masse globale, c'est-à-dire le coût de l'argent mis dans le budget de l'État, y compris dans le coût du travail, de l'aide accordée aux entreprises mais aussi, par exemple, la participation de l'État à la réduction de la part salariale pour la taxe professionnelle et d'autres aides encore ? Cette comparaison pourrait être faite avec nos partenaires de la Communauté européenne, et éventuellement les États-Unis. On glose depuis longtemps, mais j'aimerais connaître l'importance de cette aide par rapport aux emplois créés et au taux de chômage dans les pays avec lesquels on peut faire une comparaison.
Au passage, il est peut être intéressant de connaître la réaction de l'État vis-à-vis de l'inemployabilité des salariés. On a évoqué tout à l'heure les Pays-Bas où des mesures particulières ont été prises à cet égard.
Deuxièmement, concernant la formation professionnelle ou ce que l'on appelle maintenant la formation en alternance, j'ai noté que M. Leenhart est resté très discret sur la question que lui a posée Jacques Barrot. Je voudrais insister en demandant aussi bien à M. Leenhart qu'à M. Lardin s'ils estiment que d'une part, les 130 milliards de budget de la formation professionnelle sont bien utilisés, au vu des dysfonctionnements que nous avons vus, pas seulement sur la collecte mais aussi sur l'utilisation des fonds, plus particulièrement d'une association comme l'AFPA, et d'autre part ce qu'ils pensent de la qualité des formations, c'est-à-dire, en fait, du rapport qualité-prix entre des dépenses importantes et leur résultat sur la qualité des formations mises en _uvre pour accompagner les aides de l'État en matière de CIE, de formation ou de certains apprentissages. Etes-vous satisfaits de la formation de vos futurs salariés par rapport à ce que vous payez ?
M. Arnaud Leenhart : Je connais surtout la formation-apprentissage-alternance dans la métallurgie. Nous avons un certain nombre de centres de formation et la qualité des apprentis de l'industrie me paraît assez satisfaisante. Peut-être avez-vous des données allant en sens contraire, mais, pour notre part, nous avons réellement de grosses satisfactions et nous constatons une augmentation assez sensible de notre taux d'activité ces dernières années.
M. Jean Lardin : J'ai déjà dit ce que je pense de cette question.
Les moyens de la formation professionnelle aujourd'hui sont-ils bien utilisés ? Globalement, je pense que oui. Il n'empêche qu'ici ou là, j'ai bien encore quelques idées pour améliorer le dispositif et faire en sorte que tout franc destiné à la formation professionnelle se traduise effectivement en heure de formation ou, du moins, que le maximum de l'argent se traduise en heure de formation. Mais sans doute reste-t-il ici ou là quelque nettoyage ou élagage à faire.
Sur l'adéquation entre la contribution des entreprises de l'artisanat à l'effort de formation et le retour qu'elles en ont, je dirais qu'il est relativement correct. Nous souhaiterions néanmoins que l'effort de l'État puisse venir compléter l'effort des entreprises.
En tant que chef d'entreprise, je veux bien investir, parce que la formation, ce n'est pas un coût, mais un investissement. C'est du moins l'idée que nous avons réussi à faire vivre dans l'artisanat. Nous sommes prêts à investir, nous aimerions que l'on nous accompagne dans notre investissement et qu'une une aide vienne consolider le dispositif.
Je vous rappelle qu'en dehors de l'apprentissage, pour certains métiers de l'artisanat, notamment les métiers d'alimentation, il n'existe pas d'autre appareil de formation dans notre pays. Le dispositif Education nationale ne touche pas ces métiers-là. M. le ministre Jacques Barrot, qui accueille dans son fief l'école de la pâtisserie, peut en témoigner. C'est uniquement l'effort des entreprises qui permet d'investir et de former ceux qui, demain, vont occuper ces métiers.
M. Claude Seibel : Sur les premières questions de M. Jégou, nous pouvons mobiliser, à ce stade, deux sources d'information : d'une part, l'OCDE, mais sa représentation des dépenses publiques pour l'emploi est relativement ramassée, sommaire, car, en fait, l'OCDE insiste beaucoup sur le thème des dépenses d'activation vers la recherche d'emploi. Nous constatons en France une baisse de la part des dépenses passives et, au contraire, une stimulation des dépenses actives qui représentent aujourd'hui 52 % du total des dépenses pour l'emploi au sens strict.
D'autre part, les Communautés européennes, avec lesquelles nous voudrions aller plus loin. Nous espérons, avec les autres pays, dans le cadre des plans nationaux pour l'emploi et des lignes directrices, pouvoir faire apparaître la situation et surtout l'évolution de la situation dans chacun des pays. C'est assez délicat mais, malgré tout, en termes de dépense publique pour l'emploi global, on constate que la France se trouve en position moyenne par rapport aux quinze autres pays.
Un pays qui m'a beaucoup étonné par son taux de chômage relativement bas, c'est le Danemark, dont le taux de dépenses publiques pour l'emploi est de 6 % du PIB. Nous sommes sensiblement au-dessous. C'est tout à fait étonnant.
Par ailleurs, il est des dépenses dont on se demande si elles doivent figurer dans les dépenses pour l'emploi ou, au contraire, s'il s'agit de politiques visant à gommer le problème.
Les cas les plus intéressants de ce point de vue sont les Pays-Bas et l'Angleterre.
En ce qui concerne les Pays-Bas, nos honorables collègues se sont embarqués dans une politique dite de handicap social. Nous avons actuellement aux Pays-Bas 900 000 personnes dont un nombre non négligeable est dans une situation relevant d'un nouveau statut, qui a pignon sur rue, mais qui consiste en fait à être retiré du marché du travail. C'est une politique tout à fait malthusienne. Evidemment, une fraction d'entre eux sont vraiment des gens inaptes au travail, mais on n'a pas 900 000 handicapés sociaux dans un pays comme les Pays-Bas. Le problème est budgétaire parce que les Pays-Bas n'arrivent pas à assurer ce volant.
Autre exemple assez différent : celui de l'Angleterre, où les restrictions sont très fortes au niveau des familles en ce qui concerne l'indemnisation liée à la non-reprise d'un travail. Nous avions, avec l'INSEE, essayé de regarder ce que pouvaient représenter ces politiques quasiment forcées de retrait du marché du travail de travailleurs découragés au sens qu'ils ne se portent même pas candidats parce qu'il n'y a pas d'emplois et qu'ils perdraient un certain nombre d'avantages sociaux. Nous étions arrivés, pour les hommes entre vingt-cinq et soixante ans, à 3 millions d'hommes qui étaient dans une position de retrait.
Faut-il comprendre de telles politiques dans les politiques pour l'emploi ? J'en doute. De ce point de vue, il existe un ensemble de préretraites qui est en train de diminuer progressivement, il existe des dispenses de recherche d'emplois. On peut penser qu'une part du RMI peut correspondre à ce type de population mais, en proportion de notre population active, c'est quelque chose de beaucoup plus bas. Nous n'avons pas véritablement cet ensemble très important de personnes que l'on pourrait appeler des travailleurs découragés.
M. Daniel Feurtet : Ces situations sont terribles, on peut arriver à une situation où les gens ne participent plus à rien et souhaitent bénéficier de tout. C'est une organisation de société assez redoutable. Ce sont des choix. C'est pour cela que le jeu de comparaison d'un pays à un autre est souvent à manier avec une extrême précaution.
Sur la notion du coût du travail, faisons attention au confort politique et peut-être intellectuel autour de cette notion. Cela ne veut pas dire dans mon esprit que cela n'existe pas. Cela existe sur le territoire national entre des entreprises qui, du point de vue de la structure de production, utilisent plus ou moins de main-d'_uvre. Cela existe aussi sur le terrain de la concurrence du fait de l'internationalisation des processus de production, des échanges et autres sur le territoire européen et dans des pays dont la situation sociale n'est pas forcément identique, mais elle existe de toute façon. Donc, dans le jeu de la concurrence saine, ce n'est pas une question que nous pouvons écarter.
Je dis attention au confort puisque d'autres coûts pèsent aussi sur les entreprises et nous savons bien les uns et les autres que l'économie et les entreprises fonctionnent avec toute une série d'autres mécanismes. C'est la raison pour laquelle je dis qu'il faut faire attention aux arguments parfois trop confortables que l'on peut éventuellement échanger rapidement sur des estrades lors de campagnes électorales ; après, c'est un peu plus compliqué que cela.
La question que je voudrais poser concrètement aux chefs d'entreprise est la suivante : la dépense publique, les dispositifs publics mis à la disposition des chefs d'entreprises pour pouvoir faire fonctionner l'entreprise et répondre à la fois aux enjeux économiques et aux enjeux sociaux vous semblent-ils aujourd'hui bien adaptés ? Vous avez donné une partie de la réponse. J'ai tendance à penser qu'ils paraissent parfois s'empiler, se complexifier et qu'ils sont peu saisissables en fonction des moyens dont dispose telle ou telle entreprise. Peut-être que de ce point de vue, dans les remarques que nous aurons à faire sur l'évaluation, il faudra insister sur le fait que ces dispositions soient moins complexifiées et plus efficaces ? N'avez-vous pas le sentiment que sans avoir éliminé un dispositif, on en rajoute tout de suite un autre sans en l'avoir complètement évalué ?
M. Arnaud Leenhart : Permettez-moi d'élargir la question. J'avais dit, monsieur le président, que j'étais obligé de partir à 11 heures, et il est 11 heures 15.
Effectivement, tout ce qui va vers des simplifications plutôt que vers des empilages est une bonne mesure. Nous avons parlé de formation et je crois qu'effectivement la contribution des entreprises à la formation est quelque chose d'indispensable.
Il y a un autre type d'aides qui nous met dans un environnement favorable des entreprises, c'est tout ce qui a trait à l'aide à la recherche. Cela n'a pas été évoqué mais il est vrai que chaque pays a des procédés différents en la matière : aux États-Unis, ce sont des contrats d'étude ; ici, des aides à la recherche, des facilités concertant des amortissements, etc. Tout cela est très utile. Tout ce qui nous met dans des conditions favorables pour l'entreprise - formation et recherche - est bon, il faut aller vers la simplification des mesures.
Permettez-moi d'aborder le sujet lié aux décisions qui sont en train de se prendre concernant les cotisations sur les salaires, qui vont évoluer dans les temps qui viennent. Nous considérons que sont empilées des mesures qui seront difficiles, délicates, théoriques, pénalisantes. Il y a là quelque chose qui va venir changer la concurrence entre les entreprises parce qu'il y aura des transferts d'une entreprise à d'autres, de main-d'_uvre, ou non de main-d'_uvre. Il y a là un grand travail de simplification à faire.
Pour évoquer les questions qui sont présentes dans le rapport tel que je l'ai lu et répondre à quelques-unes des questions qui s'y posaient, nous avons dit que cette loi des 35 heures avait amené une dynamique dans les négociations. Une comparaison a même été établie par rapport à ce qui s'était passé avec la loi Robien. La dynamique dans les négociations est venue du côté des branches. On ne s'y attendait pas tellement. Il n'y a pas eu de négociation au niveau des branches dans la loi Robien parce que celle-ci accordait des aides ponctuelles pour des entreprises qui voulaient entrer dans le jeu, augmenter l'effectif et diminuer le temps de travail. Elle n'appelait pas d'accords de branche. La loi Robien est même venue interrompre certains accords de branche qui étaient en train de se négocier par rapport à ce qu'était l'accord des partenaires du 31 octobre 1995. Il y a donc eu, au contraire, interruption de la négociation de branche. La loi Robien n'a porté que sur des entreprises. C'est la raison pour laquelle vous voyez une assez grande différence entre ce que vous pensez être la dynamique des négociations dans le cadre actuel parce que énormément de branches ont négocié pour essayer d'encadrer le problème des 35 heures.
Je ne veux pas faire de polémiques sur les résultats qui sont relativement insignifiants au niveau des accords d'entreprise. Il y a des accords de branche qui sont importants, des accords d'entreprise très peu nombreux - vous savez qu'il y a eu, selon les chiffres du ministère, 4076 accords début mai, soit 0,34 % des entreprises qui ont du personnel qui ont négocié. Je n'insiste pas là-dessus, il y a effectivement extrêmement peu d'accords d'entreprise. Ce que je crains énormément à travers ce qui va se passer, c'est que l'on confonde ce qui vient d'être dit concernant le coût du travail et le fait qu'il est nécessaire d'abaisser le coût du travail dans des proportions souvent importantes. C'était la démarche qui avait démarré avec la mesure de 1,3 SMIC, 1,33 qui est devenu 1,3. On s'est arrêté là et maintenant on veut amplifier. Il y a là nécessité d'abaisser le coût du travail. Des mesures sont prises dans ce sens. Et se cache derrière la partie qui est nécessaire, celle de compenser la décision au niveau du SMIC, de mettre dans ce ramassage de recettes ce qui sera la compensation, qui doit être de l'ordre de 10 à 12 milliards, concernant le SMIC à 35 heures.
Les nouvelles telles qu'elles sont annoncées ne sont pas très claires. Nous sommes préoccupés parce que l'on nous avait dit que les 35 heures s'autofinanceraient, or, on voit que ce n'est pas le cas. Donc, arrive maintenant ce que nous pensions voir arriver, c'est-à-dire des impôts, l'écotaxe, l'impôt sur les bénéfices. Nous sommes relativement heureux que l'on n'ait pas touché la valeur ajoutée. Celle-ci était un transfert d'entreprises vers d'autres entreprises, cela changeait assez le paysage des entreprises et, par ailleurs, la taxe sur les valeur ajoutée était une taxe sur les investissements, parce qu'il y avait une taxe sur les amortissements à travers cela. Nous nous plaignons suffisamment que les investissements n'ont pas repris dans les entreprises pour ne pas ajouter cette difficulté. Au fond, le fait de mettre cela à travers des impôts est la moins préjudiciables des mesures qui pouvaient être prises s'il fallait compenser.
Nous continuons à penser qu'il fallait que ce soit pris sur des économies faites par la dépense publique, mais les charges telles qu'elles sont prévues sont un peu moins pires que ce qu'aurait été la valeur ajoutée...
Mme Nicole Bricq : Alors, tout va bien !
M. Arnaud Leenhart : Non, tout ne va pas bien !
A propos de l'impôt sur les bénéfices, je voudrais dire simplement que l'impôt sur les bénéfices des sociétés qui sont souvent des sociétés industrielles qui font les trois quarts des exportations en France est assez pénalisant. L'écotaxe, comme l'impôt sur les bénéfices, aura forcément une charge qui nous met en difficulté par rapport à nos concurrents.
L'aide pérenne qui va rester est une aide qui va s'autofinancer. Compte tenu de ce que nous voyons au niveau de l'emploi, j'en suis moins sûr.
Mon message est qu'il faut du temps pour négocier. A l'heure actuelle, on ne voit pas très bien la possibilité qu'il y aurait s'il n'y a pas un certain temps pour négocier. Il faut qu'il y ait également de l'espace dans la négociation, c'est-à-dire que les accords de branche soient reconnus.
Je voulais vous livrer ces réflexions avant de m'en aller.
Le Président Augustin Bonrepaux : Nous vous remercions d'être resté si longtemps.
M. Jean Lardin : Il est dommage que M. Leenhart doive partir, mais je ferai d'abord deux réflexions sur le problème du coût du travail et du transfert de charge, notamment au travers de l'impôt sur les sociétés. Cela me paraît extrêmement dangereux parce qu'il est bien évident que les grands groupes industriels vont s'arranger pour faire leurs bénéfices dans les pays où ils auront moins d'impôt sur les sociétés. C'est ce qui se dessine déjà. On va donc diminuer l'assiette de paiement de ces charges.
Monsieur Seibel, quel est en Europe le pays qui crée le plus d'emplois par pourcentage de croissance ?
M. Claude Seibel : Actuellement, ce sont les Pays-Bas.
M. Jean Lardin : Je suis d'accord avec M. Feurtet sur les trois observations qu'il a faites concernant l'empilage, la complexification et le manque de visibilité. C'est la raison pour laquelle je considère que la dépense publique aujourd'hui n'est pas bien adaptée.
S'agissant de ce que disait M. Leenhart, j'ai, en tant que représentant d'entreprises différentes, une autre vision des choses. Tout d'abord, nos entreprises sont fortement utilisatrices de main d'_uvre et n'ont pas, par rapport au coût du travail, la même approche que les entreprises au nom desquelles M. Leenhart s'est exprimé.
Dans ce contexte, nous sommes d'accord sur le principe de la réduction des charges patronales. En revanche, nous sommes pour l'instant très réservés sur la mise en _uvre. Du moins, nous considérons que la communication qui en a été faite est plutôt trouble et ne nous permet pas de dire qu'en dehors du principe, nous sommes d'accord sur le dispositif arrêté. Sur le principe nous sommes d'accord, mais il faut clarifier la mise en _uvre du dispositif parce que lorsque l'on regarde de près, la communication faite par le ministère du travail donne matière à plusieurs interprétations. Voilà ce que je pouvais dire à ce sujet.
En revanche, certaines mesures nous paraissent intéressantes. Pour créer de l'emploi dans notre pays, par ricochet, il faut s'intéresser au dispositif de transmission d'entreprises, notamment dans les milieux ruraux. Si l'on fait vivre de véritables dispositifs de transmission-reprise d'entreprises, nous aurons au bout des emplois maintenus, voire créés. Ce qui se fait naturellement dans les concentrations urbaines ne se fait pas naturellement dans les milieux ruraux. Dans le milieu rural profond, il existe de petites unités qui répondent au besoin des populations et lorsque le chef d'entreprise arrive à l'âge de la retraite, parce que tout repose sur lui, il n'y a plus de possibilité de création d'activité. Un jeune ne peut pas reprendre la clientèle. C'est condamné pour toujours. Il y a peut-être là de véritables mesures à prendre qui seront créatrices d'emplois. Certes les milieux ruraux ne sont pas toujours considérés dans le cadre des grandes mesures pour la création d'entreprises ; je vous rappelle que la notion de milieu rural est une agglomération de moins de 2 000 habitants et que 80 % de notre territoire est concerné par cette question.
Le Président Augustin Bonrepaux : M. Lardin vient de dire que la dépense publique lui paraissait mal adaptée et manquait de lisibilité. Peut-être M. Seibel pourrait-il indiquer comment la rendre plus lisible ?
M. Claude Seibel : L'indicateur que j'ai utilisé pour vous répondre un peu au tac au tac est la croissance annuelle par tête. Ce sont donc actuellement les Pays-Bas, sur une période d'une quinzaine d'année, qui, avec une croissance de productivité par tête de 1 %, ont la productivité la plus faible, donc un retour en termes de croissance de l'emploi. Mais je précise tout de suite qu'il s'agit d'emplois à temps plein et à temps partiel.
Donc, si nous avions un indicateur comme celui de la productivité horaire, ou si nous essayions de regarder l'équivalent temps plein des emplois, nous aurions un résultat sans doute assez différent dans la mesure où les Pays-Bas doivent avoir un taux de temps partiel de 36 % environ.
M. Jean-Philippe Cotis : On n'est pas forcément très loin actuellement, mais je pense que ces tableaux très synthétiques peuvent intéresser les membres de votre commission.
Sur la question que vous posez, il est évident que nous nous efforçons de rendre la plus précise possible la description de tous les flux financiers d'une part et, d'autre part, des personnes bénéficiaires des grandes politiques d'emploi a travers plusieurs outils : la dépense publique pour l'emploi qui est publiée tous les ans, le compte de la formation professionnelle. Des travaux extrêmement importants sont faits par la Cour des comptes et nous permettent de repérer les éléments où il faut que nous progressions sur la connaissance de ces fonds publics consacrés aux politiques d'emploi.
Un des points sur lesquels nous sommes en train d'essayer avec les conseils régionaux d'améliorer la connaissance de l'information, ce sont les dépenses consacrées par les régions à la formation professionnelle, en particulier la formation professionnelle des jeunes.
Nous avons bien prévu dans la loi quinquennale qu'il y ait des remontés d'information suite à la décentralisation, en 1994, mais nous nous rendons compte que ce n'est pas suffisant pour avoir une vision complète et précise de toutes les modalités de prise en charge de la formation professionnelle au niveau régional. C'est un travail sur lequel nous sommes heureux d'avoir l'aide de la Cour des comptes.
Sur ce sujet de la dépense publique en matière d'emploi, l'idéal est de pouvoir s'inscrire dans une stratégie globale la plus cohérente possible, non d'avoir des aides ciblées, mais de viser plutôt de grandes cibles, par exemple ce que l'on fait pour le CIE, pour les publics en difficulté ou pour les bas salaires. Ensuite, avoir quelques dispositifs éventuellement de nature générale et supprimer toute une myriade de dispositifs très pointus dont on n'est pas sûr qu'ils soient efficaces. Il y en a un certain nombre. Je ne sais pas, par exemple, si l'aide à l'embauche au premier salarié est très efficace.
M. Jacques Barrot : Quand on parle de la dépense publique et de l'emploi, ne faut-il pas affiner les choses, parce qu'il y a la création d'emploi, d'un côté, et de l'autre, la lutte contre l'exclusion et il y a constamment un chevauchement entre les deux.
Il y a des aides qui, évidemment, aboutissent à la création d'emplois, encore que je ne croie pas beaucoup à des aides directes à la création d'emploi. Il y a quelques variables générales. Le coût du travail en est une, ce n'est pas la seule - je rassure M. Hoang Ngoc - mais c'est quand même une variable importante, notamment dans les services.
Puis, il y a la lutte contre l'exclusion. Le modèle hollandais me semble ici efficace. Vous dites qu'il y a une productivité qui n'augmente pas beaucoup parce qu'en réalité, avec la même croissance, on met beaucoup plus de gens en situation d'activité, c'est-à-dire que l'on réduit le phénomène d'exclusion.
Pour vraiment éclairer ces politiques, il faudrait arriver à avoir un double regard. Ce qui relève de dispositifs généraux qui permettent de créer de l'emploi, puis tous les mécanismes qui visent tout simplement à maintenir en état d'activité un certain nombre de gens pour leur éviter l'exclusion. Il me semble que ce serait plus éclairant.
Cependant, je persiste à penser, à la suite de l'échange qui vient d'avoir lieu, que nous avons, mes prédécesseurs et moi, et le gouvernement actuel, commencé à tailler dans les dispositifs qui étaient jugés les moins efficaces.
C'est vrai que les aides, les primes à une première embauche, à une deuxième embauche ne semblaient pas d'une efficacité particulière. Tout doucement la toilette a commencé. Reste à savoir si la toilette peut être poursuivie et achevée, le président Bonrepaux a raison.
Personnellement, je considère qu'elle l'est assez parce qu'il ne faut non plus faire disparaître des mécanismes qui servent à lutter contre l'exclusion. Le problème ne sera pas d'avoir des emplois parce que nous aurons de la peine à pourvoir les emplois à partir des années 2005. Le véritable problème est celui de l'inemployabilité d'un certain nombre de gens.
M. Philippe Auberger, co-Président : Monsieur le président, on a fait allusion au sujet sans vraiment l'aborder, il y a parmi les dépenses actuelles dans le domaine de l'emploi, un secteur qu'il faudrait, à mon avis, regarder de près et dont les effets à la fois économiques et sociaux devraient être regardés de près, c'est le système du financement public des préretraites. Là-dessus, certains de nos interlocuteurs pourraient-ils nous donner quelques éléments parce que nous paraissons dans une situation totalement contradictoire avec la politique générale en ce qui concerne l'équilibre des systèmes de retraite. On s'aperçoit que la préretraite est un système extrêmement coûteux.
M. Claude Seibel :Je crois pour répondre à M. Barrot qu'il faut en effet avoir parfois une double lecture, et même un triple lecture, d'un certain nombre de dispositifs. Le débat sur le CIE l'a montré. Ce n'est pas un dispositif dont le seul objectif est de créer de l'emploi. C'est aussi un dispositif qui s'efforce de lutter contre la marginalisation sur le marché du travail. On peut en effet, c'est un objectif que l'on retrouve dans la loi de lutte contre les exclusions, retrouver un certain nombre de dispositifs à l'intérieur de la trentaine de mesures principales qui sont en train d'être mises en place, dont l'objectif principal consiste à essayer de restaurer l'employabilité de personnes qui, malheureusement, sont passées dans une situation de chômage. La difficulté est que, dans le cas français, le lien « emploi vers emploi » est sans doute préférable pour maintenir l'employabilité que le passage emploi-chômage-emploi. On a, par rapport à d'autres pays, une pénalisation sans doute plus forte du fait que l'on se retrouve avec des phases qui s'allongent pour certaines personnes, comme on dit pudiquement, « hors du marché du travail ». C'est le premier point. Je suis totalement d'accord pour dire qu'il faut avoir la capacité de qualifier tel type de mesure en lui donnant son aspect principal.
Deuxième élément, je ne crois pas que le cas des Pays-Bas, que j'admire pour de nombreuses autres raisons, soit un cas transposable dans notre pays. D'abord parce que les Pays-Bas ont tout de même mis en place une politique malthusienne de retrait très actif du marché du travail. Ensuite, le passage aux Pays-Bas vers une productivité par tête assez faible vient d'un développement massif du travail à temps partiel qui correspond à un modèle culturel, qui n'est pas forcément là encore transposable dans le cas français. Dans l'équilibre des rôles homme-femme, il y a certainement des différences importantes entre les pays d'Europe. Ce que nous constatons malgré tout, c'est que parmi les 19 % de salariés à temps partiel, la part de ceux qui voudraient travailler davantage est particulièrement forte en France. C'est donc une situation qui est davantage contrainte en France qu'elle ne l'est, par exemple, aux Pays-Bas. En Angleterre, c'est pire encore parce qu'il y a des temps partiels de quelques heures avec une rotation extrêmement rapide. Il faut donc faire très attention aux transpositions de modèle.
Sur les préretraites, je n'ai pas à porter de jugement de valeur. Je constate simplement qu'il y a eu une période dans notre honorable société où l'on a cru qu'il fallait secouer le cocotier, préretraite et insertion des jeunes, et que l'on s'en tirerait. A la fin des années 70, au début des années 80, il y a alors eu une période où le montant des préretraites dans notre pays est passé de 200 000 entrées en préretraite par an à 700 000. Cela a eu un effet mécanique, une baisse du chômage, mais aussi des conséquences très importantes sur les dépenses publiques lestées par l'obligation de financer ces préretraites et des effets à moyen et long termes qui sont moins positifs qu'on ne le croit sur l'emploi et le chômage.
Il me semble que cette époque est révolue parce qu'il y a une prise de conscience que ces politiques sont coûteuses, fondamentalement malthusiennes.
Cela ne veut pas dire que nous soyons sortis de l'auberge. Nous avons devant nous, à un rythme sans doute mal perçu par la société, un vieillissement de la population active. Ce vieillissement peut se concrétiser dans un certain nombre de branches par des situations analogues à ce que l'on a observé au début des années 80, dans les chantiers navals, la sidérurgie, les charbonnages. On repart vers ce type de politique croyant que l'on est gagnant.
Il y a sans doute eu dans notre société française une sorte d'accord assez profond entre l'État, les gouvernements, les partenaires sociaux et les salariés eux-mêmes pour accepter ou rechercher ce type de situation. Je pense donc que la clarification du rôle des préretraites est quelque chose de tout à fait fondamental. Je me situe là en dehors du problème du financement des retraites, mais dans le cadre de la population active pour lequel, en effet, à partir d'un certain âge, pour des gens ayant des niveaux de formation initiale relativement faibles, vous avez en France, sur une population active dans le privé d'environ 14 millions de personnes, 5 à 6 millions qui sont actuellement de niveau de formation initiale inférieure au niveau 4. Lorsque l'on se trouve à devoir utiliser de nouveaux dispositifs techniques de l'informatique un peu pointue, il y a des gens qui disent qu'ils préfèrent se retrouver dans une situation peut-être moins intéressante financièrement, mais, en tout cas, plus calme. C'est une caractéristique très importante dans la société française.
M. Liêm Hoang Ngoc : Je voulais revenir sur le problème de la lisibilité de la politique de l'emploi. Il est vrai que lorsque l'on regarde la myriade de dispositifs qui existent, on a du mal à s'y retrouver. Néanmoins, quand on essaie de cerner la logique des politiques de l'emploi menées depuis vingt ans, on peut distinguer trois grandes périodes : tout d'abord, dans les années 70 et au début des années 80, la part des politiques passives est importante, parmi lesquelles les préretraites occupent une place prépondérante ; puis, au début des années 90, apparaît le thème de l'activation des dépenses passives avec la découverte des politiques ciblées ; arrivent, enfin, en puissance, à la fin des années 90, les mesures d'ordre général, qui dépassent les mesures ciblées depuis deux ans.
Si on lit tout cela à la loupe, on peut dire que, dans les deux dernières années, le choix fait par les pouvoirs publics est plutôt celui d'enrichir le contenu en emplois de la croissance. Si l'on considère que parmi les politiques actives, les deux priorités sont le ciblage des politiques pour modifier l'ordre de la file d'attente et la modification du contenu en emplois de la croissance, la montée du deuxième type d'objectif peut être relevé dans les années récentes.
Quand on parle de contenu en emplois de la croissance, il y a plusieurs manières d'atteindre cet objectif et le projet d'extension de l'assiette des cotisations patronales pourrait être l'occasion pour les pouvoirs publics d'annoncer clairement la couleur en matière de principe de politique de l'emploi. C'est une chose qui pour le moment est présentée comme une mesure technique, la baisse des charges financées par l'impôt sur les sociétés.
Or, si vous réfléchissez bien, ce scénario correspond au scénario n°3 simulé dans le rapport. Mais dans le modèle très simple que nous avons fait, il n'y a pas d'amortissement et de dotation. Donc, l'assiette prise en compte est le chiffre d'affaires moins la masse salariale. C'est une partie de l'assiette de l'impôt sur les sociétés qui, elle-même, est en partie dérivée de l'assiette valeur ajoutée. Mais dans l'assiette de l'impôt sur les sociétés, vous ajoutez les résultats financiers.
Grosso modo, on peut dire que cette assiette est en partie dérivée de la valeur ajoutée. Elle est plus restreinte puisqu'il y a l'inconvénient de devoir appliquer un taux d'imposition plus élevé puisque l'on ne taxe pas le travail, mais il est possible de présenter ce type de réforme comme un nouveau principe de politique de l'emploi, où les grosses entreprises qui font des profits financent les baisses de charges sociales des entreprises de main-d'_uvre qui ont besoin de développer l'emploi. Le principe est simple, c'est un peu la philosophie du basculement progressif vers une assiette dérivée de la valeur ajoutée.
La deuxième chose que je voulais dire à propos de la question sur le contenu en emplois de la croissance, c'est que lorsque l'on regarde les modèles européens et, plus généralement, les modèles de politique de l'emploi, vous avez trois façons d'enrichir le contenu en emploi de la croissance. La première façon, c'est de stimuler l'emploi à faible productivité, c'est la voie britannique ; c'est stimuler l'emploi dans les services ou les gains de productivité sont faibles, de sorte que le niveau de productivité dans l'économie s'abaisse et que vous ayez un contenu en emplois de la croissance. Si vous choisissez cette voie, vous choisissez évidemment la voie de la trappe à bas salaires et à basse qualification. C'est un choix. Pourquoi pas ?
La deuxième voie pour enrichir le contenu en emplois de la croissance, c'est l'une des variantes de la réduction du temps de travail, qui est le temps partiel. C'est la voie hollandaise, c'est également la voie britannique. On peut supposer que si vous généralisez le temps partiel, et il n'y a pas besoin d'établir un équivalent entre temps plein et temps partiel, il suffit de généraliser le temps partiel en passant par exemple à 30 heures payées 30. Dans ce cas, vous enrichissez également le contenu en emplois de la croissance. C'est ce que font les Hollandais et les Britanniques. C'est la philosophie, par exemple, de l'abattement pour l'embauche d'un temps partiel.
La troisième et dernière voie, c'est ce que j'appellerais « la voie 2RT », c'est la philosophie des lois Robien et Aubry. C'est le scénario de la réduction et réorganisation du temps de travail, qui est la voie actuellement explorée.
Voilà pour clarifier en termes typologiques la logique des politiques de l'emploi telles que l'analyste peut les répertorier.
M. Jean-Philippe Cotis : Je ferai quelques remarques disparates.
Concernant les exemples de nos voisins, sans vouloir mésestimer les performances anglaises, qui sont certainement intéressantes, lorsque l'on additionne le taux de chômage et le taux des « handicapés », on a du mal à voir une baisse de cet indicateur depuis le début des années 90. Il y a une part de traitement statistique qui n'est pas à négliger.
En termes de polarisation d'exclusion sociale, lorsque l'on calcule en Grande-Bretagne un taux de chômage des couples, c'est-à-dire un couple où personne ne travaille et un couple où l'un des deux travaille, c'est le taux de chômage le plus élevé d'Europe, de 20 %. Il faut donc bien regarder les expériences nationales. Il est vrai que tout n'est pas non plus transposable dans l'expérience britannique, loin de là.
En ce qui concerne la stratégie générale en matière de lutte contre le chômage en France, quelques axes sont clairs. D'une part, il y a l'idée de résorber ce chômage keynésien par une politique macro-économique plus adaptée que celle que nous avions eue au début des années 90 : budget desserré et conditions monétaires très restrictives qui était aussi une politique reganienne qui n'a pas fonctionné. L'idée que nous avons beaucoup à gagner est importante.
Le deuxième élément est d'accroître le contenu en emplois de la croissance. Cela ne veut pas dire que l'efficacité de l'économie baisse. La productivité globale des facteurs de production ne ralentit pas. Ce qui se passe, c'est que l'on utilise mieux la ressource abondante du facteur travail et que l'on utilise de façon plus efficace et parcimonieuse le facteur plus rare qu'est le capital.
Autrement dit, ce que l'on observe en France depuis le début des années 90, c'est à la fois un ralentissement de la productivité apparente du travail parce que l'on fait entrer sur le marché, notamment dans le secteur des services, des gens qui n'y arrivaient pas, mais en contrepartie on observe une très forte remontée de la productivité apparente du capital qui s'était continuellement détériorée depuis le début des années 80, voire le milieu des années 70.
Il ne faut pas penser qu'enrichir le contenu en emplois de la croissance, c'est réduire l'efficacité économique ; c'est simplement allouer correctement les facteurs de production disponibles. De ce point de vue, la France a beaucoup progressé, puisque l'on est passé d'un point mort de croissance à partir duquel on pouvait créer des emplois qui étaient de plus de 2 % dans les années 80, à quelque chose qui est compris entre 1,3 et 1,5 %. Nous nous sommes beaucoup rapprochés des mieux-disants. Nous partons de très loin. Le stock de chômeurs est extrêmement important, mais nous avons progressé.
Le troisième élément, c'est de lutter contre les effets d'hystérésis. L'hystérèse en physique est un phénomène dans lequel l'effet persiste alors que la cause a disparu. Clairement, un chômeur qui perd un emploi en basse conjoncture parce que son entreprise n'a plus de débouché peut se retrouver deux ans après chômeur de longue durée, peu employable, découragé et faire partie de ce que dans notre jargon nous appelons le chômage structurel. Il est alors plus difficile de le réintégrer. Donc des dispositifs comme le CIE, qui sont coûteux, cherchent à contrecarrer ce type d'effet qui est manifeste dans les pays européens. Nous avons vu le taux de chômage monter après les deux chocs pétroliers, lorsque, ensuite le prix du pétrole est retombé en 1986, nous n'avons pas vu le taux de chômage redescendre.
Cet élément de contenu en emplois de la croissance beaucoup plus élevé nous a beaucoup aidé en France à résister au ralentissement conjoncturel européen et à maintenir un climat de confiance élevé des ménages, à la différence d'autres pays, parce que les inquiétudes sur le marché du travail étaient beaucoup plus faibles.
Sur le temps partiel, il est vrai que le temps partiel en France est contraint dans une part croissante. Cela reflète en partie un déséquilibre du système d'incitation français. Il y a des aides importantes, voire généreuses du côté des employeurs. En revanche, on a peu réfléchi à ce qui se passait du côté des salariés, des personnes qui essaient de revenir en prenant un travail à temps partiel. Il y a des situations où l'on est à la limite de perdre de l'argent quand on veut reprendre un travail à temps partiel faiblement rémunéré.
Quand on fait les deux en même temps, il n'est pas étonnant que la dynamique soit surtout impulsée du côté des entreprises et que l'on ait un déséquilibre. C'est un reproche que nous font l'OCDE et d'autres institutions, nous avons un problème d'équilibre des incitations : on donne beaucoup aux entreprises et l'on ne donne pas beaucoup aux salariés.
Cela renvoie à un problème qui nous tient beaucoup à c_ur, celui des trappes, soit pauvreté soit chômage, c'est-à-dire une situation dans laquelle on perd des prestations sociales sous condition de ressources très brutalement lorsque l'on revient sur le marché du travail et dans laquelle on perd aussi des exonérations fiscales ; par exemple pour la taxe d'habitation, il y a un abattement important, une exonération, quand on est hors du marché du travail. Lorsque l'on reprend un travail, on perd le bénéfice de l'exonération. En France, pendant des années, on a négligé ce problème des travailleurs peu qualifiés à qui l'on met beaucoup de boulets. C'est un parcours du combattant. Il y a là aussi un élément de politique de l'emploi qui relève de la justice sociale ; il faut faire quelque chose de plus systématique pour aider cette partie de la population.
Sur le changement d'assiette, le plus important, c'est ce que l'on finance une baisse du coût du travail peu qualifié qui nous semble avoir un potentiel de création d'emplois important. Notre sentiment après avoir réfléchi sur les prélèvements eux-mêmes, c'est qu'il n'y a pas de changement d'assiette miracle et que le redéploiement des prélèvements à long terme ne modifie pas tellement le niveau de l'emploi. Ce sont un peu des vases communiquants, entre la TVA, la cotisation à la valeur ajoutée, la taxation du capital productif, voire des opérations générales sur le coût du travail ; l'effet net d'un ripage d'un financement à l'autre est sans doute de deuxième ordre par rapport à l'ampleur du problème.
En revanche, la cotisation à la valeur ajoutée pose d'autres problèmes de mise en _uvre administrative. C'est une assiette qui est très malléable, difficile à cerner en pratique. Si on la gère comme l'impôt sur les sociétés, nous allons nous trouver dans un système d'acomptes compliqué à gérer. Il y a des problèmes de gestion très importants dans ce domaine. Il faut vraiment être sûr d'avoir un gain d'emplois très important pour se lancer dans une opération qui peut être par ailleurs très complexe du point de vue de sa mise en _uvre.
Sur les préretraites, j'avais un dernier point. C'est une mesure sociale qui concerne des travailleurs peu qualifiés âgés qui ont souvent plus cotisés que la moyenne des retraités. Cela est certainement justifié. Son effet sur l'emploi est clairement faible et l'extension de dispositifs de ce type à d'autres publics serait sans doute problématique. Cela pose notamment un problème à long terme. Si l'on a systématiquement des préretraites pour toutes les catégories de salariés, on crée des anticipations particulières au sein des entreprises. Qui investira dans la formation des quadra s'il sait que dix ans plus tard, il existe un système public qui crée une forme de subvention au retrait ?
Il est très paradoxal, dans un monde où l'espérance de vie s'accroît continuellement, de considérer que dans les professions normales et celles de l'avenir, on est âgé à partir du milieu de la cinquantaine. C'est très inquiétant d'avoir ce type de référence culturelle. On n'est plus jeune beaucoup plus longtemps.
M. Alain Gubian : Je voudrais redire la difficulté d'apprécier la dépense pour l'emploi, notamment la dépense publique. Plusieurs préoccupations doivent rester présentes à l'esprit des statisticiens et des économistes, notamment de ceux de la DARES. L'une d'elles est effectivement la comparaison internationale. Nous devons nous inscrire dans ce souci de comparer nos dépenses pour l'emploi avec celles des autres pays. Cela se fait déjà dans le cadre de l'OCDE, mais Eurostat lance aussi un grand programme pour cela.
Cela signifie que l'on ne peut pas traiter de la même manière une partie de la politique pour l'emploi aujourd'hui mise en _uvre, qui a été largement commentée, qui est la politique d'enrichissement de la croissance en emplois, et la ristourne dégressive ou les prolongements des exonérations-famille. Si l'on voulait avoir une dépense pour l'emploi maximum, on mettrait toutes les actions publiques qui ont un effet sur l'emploi.
Nous essayons donc d'avoir un concept large, qui couvre l'ensemble des moyens de la collectivité qui visent l'emploi ou le traitement du chômage, y compris ceux des entreprises pour la partie formation professionnelle. Cela s'appelle la dépense pour l'emploi, elle est de l'ordre de 320 milliards de francs, soit 4 % du PIB.
Mais pour pouvoir la comparer avec celle des autres pays, on ne prend pas en compte la ristourne de 40 milliards de francs, que l'on ne masque pas, mais que l'on fait apparaître ailleurs parce qu'elle peut être analysée, d'un point de vue économique, comme la poursuite de politiques antérieures de déplafonnement des cotisations sociales.
Nous avions d'abord un prélèvement dégressif. Il est devenu progressivement proportionnel. Aujourd'hui, il commence à devenir progressif sur une plage de salaire. Si nous avions financé cette ristourne dégressive ou l'exonération familiale par une hausse des cotisations sur les plus hauts salaires, nous aurions opéré un reprofilage, et nous aurions également eu des effets emplois, un coût net apparent nul.
Il est donc difficile de savoir si l'on doit ou pas mettre 40 milliards d'allégement bas salaires dans un agrégat. Nous avons fait le choix de ne pas le faire. Néanmoins, dans nos publications, nous le faisons apparaître à côté, pour bien montrer qu'il peut y avoir des restructurations. Mais l'OCDE reste préoccupée et Eurostat, dans sa nouvelle nomenclature, nous demande également de ne pas inclure ces politiques. Nous avons donc un agrégat qui concerne plutôt des politiques concernant des personnes repérables par des contrats de travail ou, si ce sont des chômeurs, parce qu'ils reçoivent une indemnité.
Pour ce qui est de la politique plus ciblée sur les aides à l'emploi marchand ou à l'emploi non marchand - nous en avons peu parlé -, les préretraites et les stages de formation professionnelle, nous avons un agrégat plus restreint de l'ordre de 120 milliards de francs, comprenant quatre grandes catégories.
Premièrement, les aides à l'emploi principalement ciblées sur des publics, comme l'exonération premier salarié, avec pour objectif, la création du premier salarié. On peut discuter sur la mesure, mais elle appartient effectivement à cet agrégat.
Deuxièmement, les aides à l'emploi non marchand, c'est-à-dire l'ensemble des CES, du contrat emploi consolidé, ou des emplois jeunes aujourd'hui.
Troisièmement, les stages de formation professionnelle, avec l'ensemble de la panoplie.
Quatrièmement, ce que nous avons évoqué tout à l'heure, à savoir les préretraites.
Ce sont là les quatre parties de cet ensemble de 120 milliards de francs, toujours à l'exclusion des aides générales.
Je mettrai à votre disposition des documents que nous avons faits parce que la question qui se pose est aussi celle de l'efficacité relative de l'ensemble des dispositifs. Nous avons, en 1996, fait à la DARES un travail d'évaluation comparée de ces quatre grands groupes. L'un crée des emplois marchands, l'autre plutôt des emplois non marchands, les autres retirent progressivement ou durablement de la population active des dispositifs. Tous ont un effet sur le niveau du chômage. Sur la longue période, dans les périodes où l'on a massivement utilisé les stages et les préretraites, nous constatons un effet de court terme très important sur le chômage. Dans les périodes de fort accroissement du chômage, il était certainement pertinent d'en freiner la montée.
Cela étant, en faisant une analyse plus globale et en prenant en compte non seulement l'effet direct sur le chômage, mais aussi l'effet du financement et l'effet de retour macroéconomique de ces mesures - c'est-à-dire entre autres l'effet sur l'équilibre du marché du travail, donc, l'effet sur salaires -, on se rend compte que, dans une perspective de moyen long terme, l'efficacité comparée du dispositif est beaucoup plus similaire à celle que l'on a à court terme.
A court terme, il est clair qu'une préretraite réduit de un pour un le chômage, mais ce n'est vraiment qu'en ayant une vision à très court terme car, très rapidement, le financement d'une telle mesure et l'effet sur les salaires d'un point de vue macroéconomique provoque une déperdition ; l'augmentation du stock de préretraites engendre évidemment un effet en retour négatif, d'autant plus que les préretraites sont des flux qui constituent des stocks et qu'il faudrait toujours augmenter le stock pour avoir un effet durable sur l'évolution du chômage.
Quand on compare ces quatre grands dispositifs, on s'aperçoit qu'à moyen long terme, les effets sur le chômage sont plutôt assez proches.
Pour ce qui est des aides à l'emploi marchand, donc le rôle du coût du travail, il faut garder présent à l'esprit que les coûts affichés dans les budgets publics sont toujours un peu trompeurs. Ce sont des coûts que l'on peut qualifier de type ex ante. Ces coûts que l'on met d'un côté, ont, en retour, des effets positifs sur les comptes sociaux. Les emplois créés paient des cotisations sur d'autres comptes ; cela a, par exemple, des effets sur les comptes de l'UNEDIC.
Mais il faut aussi retenir - et c'est un point de vue qui est traité dans l'étude que j'évoque - le point de vue ex post.
Ce concept s'applique également à la politique d'abaissement du coût du travail, la politique de ristourne. On considère souvent les 40 milliards de francs actuels en les divisant par un nombre d'emplois créés, et l'on parvient ainsi à un chiffre astronomique de coût de la mesure. Mais si l'on tient compte des effets en retour sur la croissance et sur les ressources de cette politique, on obtient un coût ex post bien plus faible. C'est ce qui était mis en avant dans l'étude commune DP-DARES-INSEE de 1997 concernant le bilan de l'économie française.
La vision est toujours un peu étriquée quand on s'arrête au coût ex ante de la mesure. Si la mesure a un effet durable sur le chômage, elle s'autofinance partiellement au bout d'un certain temps. Si elle a un fort effet sur le chômage à court terme et de moins en moins marqué à long terme, son coût ex post est, en fait, beaucoup élevé que celui affiché dans le budget public.
Il faut donc essayer d'avoir aussi ce point de vue ex post pour mesurer l'efficacité relative des dispositifs.
M. Francis Delattre : Si l'on doutait encore que l'on puisse tordre les statistiques dans tous les sens pour parvenir à des conclusions parfaitement contraires, nous venons d'en faire la démonstration.
Mais il est au moins une statistique sur laquelle tout le monde s'accorde - car notre objectif en analysant ces budgets est de savoir si tous ces dispositifs sont bien pertinents, c'est-à-dire s'ils vont dans le sens d'une diminution de l'ensemble de ces aides diverses - c'est qu'à la courbe des pays qui, depuis dix ans, ont engagé sérieusement une diminution globale de leurs prélèvements correspond une courbe semblable de diminution du chômage.
L'un des intervenants nous disait que ces mesures ont des effets assez locaux en fonction des publics et que, finalement, c'est la cohérence des décisions macroéconomiques qui est intéressante. Aussi, j'aimerais savoir si vous avez pu étudier les effets sur l'emploi de la diminution de 1 % de l'ensemble des prélèvements globaux dans notre pays. Nous sommes à 40-45 %, la moyenne européenne est à 40-41%. Pour tendre vers la moyenne européenne, avez-vous étudié diverses hypothèses et leur effet sur l'emploi en France ?
Enfin, concernant les 330 milliards d'aides directes de soutien à l'emploi - en fait, globalement dans le budget de l'État, c'est la moitié - je n'ai pas vu dans les documents que nous avons reçus la façon dont s'opère le « dispatching » sur les autres aides. Pourriez-vous, pour travailler de façon plus globale, nous donner un document ratifiant ces 330 milliards ?
M. Jean-Philippe Cotis : Du point de vue de l'analyse économique, toutes choses égales par ailleurs, il est clair que si l'on réduit le prélèvement, c'est vrai de nombreux prélèvements, on constate des effets positifs en matière d'emplois. C'est incontestable.
La question est ensuite de savoir ce que finançait le prélèvement comme dépenses, car il y a des dépenses publiques efficaces et d'autres qui ne le sont pas. Je paraphrase là mon ministre, mais il est incontestable qu'une baisse des prélèvements réduirait le chômage et améliorerait la situation de l'emploi.
Toute la question est de savoir quelles dépenses réduire. Souvent, évidemment, ces dépenses ont aussi un impact sur l'emploi. La difficulté réside donc dans l'arbitrage. Mais il est vrai qu'une baisse des prélèvements ne fait jamais de mal à la sphère productive. La question est la façon de la financer.
M. Francis Delattre : C'est vague.
M. Jean-Philippe Cotis : Je puis vous donner des chiffres, vous dire, par exemple, si je baisse la TVA, combien cela crée d'emplois, de même pour les baisses de charges.
Selon nos instruments, l'idée est en gros que, pour la plupart des prélèvements, une baisse de 10 milliards crée 20 à 25 000 emplois.
M. Liêm Hoang Ngoc : D'un point de vue purement empirique, il n'y a pas de corrélation entre le niveau des prélèvements obligatoires, le niveau des dépenses publiques et les indicateurs de performances économiques tels que les taux de croissance et les taux de chômage dans les différents pays. On n'en trouve pas. Les chiffres le montrent.
Cela veut tout simplement dire que le poids de ce que vous appelez « l'État » dans l'économie est un choix de société, qui n'influence pas nécessairement des performances économiques. C'est ce que je peux vous dire en termes purement empiriques.
Maintenant, sur le terrain plus théorique, l'objet du rapport qui m'avait été confié était d'évaluer, notamment, les effets d'une baisse des prélèvements type charges sociales sur l'emploi.
J'abonde tout à fait dans le sens d'Alain Gubian. Nous avons, dans le modèle qui a été utilisé, repris la structure du modèle Malinvaud, que nous avons complété en tenant compte précisément des effets sur le long terme du financement de la mesure que constitue une baisse de charges sociales.
Dans cette optique, dans les quatre scénarios que nous avons envisagés - Malinvaud, valeur ajoutée, excédent brut d'exploitation (EBE), et modulation en fonction de la part des salaires dans la valeur ajoutée - les différents types de prélèvement, contrairement à ce que Jean-Philippe Cotis semblait dire, ont une influence sur le volume des créations d'emploi.
Nous avons évalué ces quatre scénarios et constaté que celui qui crée le plus d'emplois est celui dans lequel la baisse des charges est financée par l'assiette EBE, c'est-à-dire par les profits des entreprises, et pas le scénario initialement retenu par Malinvaud, puisque lorsque nous évaluons le scénario Malinvaud dans notre modèle, nous constatons que la mesure n'est efficace que si elle s'accompagne d'une baisse des dépenses. Dans le cas contraire, pour financer la mesure, il faut prélever sur les ménages et, donc, sur la consommation.
Donc, la mesure n'est efficace que si vous baissez les dépenses sociales et augmentez les salaires pour compenser le déficit de demandes qui intervient.
Dans l'hypothèse où l'on baisse les charges, les assiettes les plus efficaces consistent soit à étendre la valeur ajoutée, soit à taxer l'EBE, ce qui a un effet plus important puisque l'on alourdit le coût relatif du capital et, donc, on crée plus d'emplois. Ce sont les deux scénarios qui ont été mis en évidence du point de vue du potentiel de création d'emplois.
M. Claude Seibel : Nous mettrons à votre disposition toute la série de documents correspondants à la dépense pour l'emploi, notamment l'année 1997, qui est en cours de finition. Comme je l'ai expliqué, nous avons eu quelques problèmes sur certains types de dépenses. Je rappelle que ces dépenses pour l'emploi ne comportent pas que celles engagées par l'État ou les ministères qui coopèrent à la politique pour l'emploi. Il y a aussi toutes les sommes consacrées à l'indemnisation du chômage, sommes versées par les partenaires sociaux dans le cadre de l'UNEDIC. Je pense également, pour ce qui est de la formation professionnelle, à deux sources de dépenses importantes : celle des conseils régionaux avec les deux étapes de décentralisation - 1983 et 1993 - et celles des entreprises, que l'on retrouve dans les 83 milliards que nous avons.
M. Philippe Auberger, co-Président : A-t-on vraiment raison de se féliciter de l'enrichissement de la croissance par l'emploi ? Ne constate-t-on pas un ralentissement très important de l'effort d'investissement dans notre économie ? N'a-t-on pas, en fait, privilégié le court terme par rapport au long terme, parce que l'effort d'investissement, c'est l'avenir de notre croissance à moyen et long terme ? Peut-on dire, comme cela l'a été, que c'était le signe d'une meilleure utilisation de l'allocation des ressources disponibles, notamment dans le domaine du capital ?
Personnellement, je m'interroge. Évidemment, c'est la mode de dire que nous avons une croissance plus riche en emplois ; en fait, cela veut dire que notre productivité du travail baisse, ce qui n'est pas forcément un bon signe pour notre économie.
M. Jean-Philippe Cotis : A mon avis, la productivité des salariés installés, ceux qui n'étaient pas chômeurs, n'a pas ralenti.
M. Jacques Barrot : Je suis bien d'accord avec vous !
M. Jean-Philippe Cotis : C'est un effet d'addition.
Dans des secteurs comme celui des services à la personne, où le déficit de création d'emplois était manifeste par rapport à d'autres grands pays industriels, nous les avons fait entrer sur le marché du travail. Il n'y a pas de signe de ralentissement de la productivité globale des facteurs.
On se rapproche du régime de croissance équilibré à l'américaine. Nos amis américains, à la différence des Européens, ont eu une productivité du capital qui ne s'est jamais effondrée comme en France, où l'on a manifestement gaspillé le capital, pour des raisons diverses.
Nous assistons depuis 1993 à une très forte remontée de la productivité du capital, qui s'explique sur le terrain. M. Leenhart est parti, mais il vous expliquerait comment cela se passe. Nous avons un redéploiement des facteurs de production, et notre efficacité productive, le progrès technique, n'a pas ralenti.
M. Jacques Barrot : Eh non !
M. Claude Seibel : Si l'on regardait la productivité de l'ensemble chômeurs+salariés, on ne verrait pas signe d'un ralentissement. C'est vraiment le potentiel de production qui augmente, en incluant des gens dont la productivité marginale était la plus basse et qui rencontraient une barrière de coût du travail.
Très longtemps, les Américains ont eu un taux d'investissement plus faible que le nôtre ainsi qu'une productivité du capital bien meilleure. En même temps, par des moyens non extrapolables - nous évoquions tout à l'heure des working poors -, ils ont eu une performance en termes d'emploi bien meilleure.
Le problème européen est d'arriver à corriger la structure du coût du travail, notamment du coût des plus qualifiés, d'améliorer le fonctionnement du marché du travail de manière à obtenir les mêmes résultats macroéconomiques mais sans les problèmes de baisse de salaire des plus pauvres, etc.
Pour revenir sur les aides à l'emploi, sur les prélèvements, un type de baisse de prélèvement a un impact très fort sur l'emploi : il s'agit des baisses de charges sur les bas salaires, parce qu'il y a un problème important à résoudre au départ. Les autres prélèvements ont un effet à peu près équivalent en termes d'efficacité sur l'emploi.
Ce diagnostic est, en gros, partagé par la DARES et est assez consensuel. Le rapport Malinvaud au nom du Conseil d'analyse économique (CAE) dit la même chose : il y a donc une certaine équivalence des prélèvements, sauf dans un secteur où le problème initial à corriger est très important.
Puis, il y a un effet comptable. La création d'un emploi peu qualifié est budgétairement beaucoup moins coûteuse qu'une baisse de charges générale. Cet effet joue aussi.
M. Jacques Barrot : Je reviens sur les propos de M. Hoang Ngoc car je trouve un paradoxe étonnant dans ses positions : il doute beaucoup de l'efficacité de la baisse du coût du travail et, en même temps, il défend l'idée qu'il faut changer la base des cotisations pour, justement, l'asseoir plus facilement sur la valeur ajoutée, telle que vous l'avez définie tout à l'heure, plutôt que sur la masse salariale.
Je trouve là un paradoxe, c'est-à-dire qu'il doute de la réduction du coût du travail sur les emplois moins qualifiés - ce qui me paraît pourtant assez évident dans certains secteurs, notamment le secteur des services - et, en même temps, pour le reste des salaires, il a l'air d'avoir tendance à dire que si l'on prélevait un peu plus sur le capital et un peu moins sur les salaires, cela irait mieux.
J'ai peut-être une vision un peu simpliste, mais j'ai tendance à penser que sur les emplois moins qualifiés, le coût du travail est très déterminant et qu'au contraire, sur les emplois les plus productifs de la nation, c'est l'investissement, matériel et immatériel, qui est déterminant. Je sais bien que dans la masse salariale, il y a l'investissement immatériel, mais je n'arrive pas à comprendre sa position.
M. Liêm Hoang Ngoc : J'attendais cette question.
Nous sommes d'accord pour dire que les entreprises qui utilisent du travail non qualifié en majorité ont un problème de coût, mais il ne s'agit pas de toutes les entreprises. C'est le problème fondamental qui fonde notre désaccord ou notre malentendu. Certaines entreprises ont un problème du coût du travail parce qu'elles utilisent notamment de la main-d'_uvre non qualifiée. Est-ce pour autant qu'il faut alléger le coût de la main-d'_uvre qualifiée pour toutes les entreprises qui en utilisent, qui ne sont pas positionnées sur le créneau de compétitivité coût ou qui ne subissent pas un problème de coût ?
C'est une décision budgétaire importante, qui engage quelques milliards de francs. Et c'est exactement le problème que je pose.
Deuxièmement, en alourdissant le coût relatif du capital, allons-nous déprimer l'investissement sur le long terme ?
Je n'ai pas le sentiment que la restauration de la part des profits dans la valeur ajoutée depuis quinze ans soit allée de pair avec une reprise de l'investissement. Les taux d'investissement sont à un niveau relativement bas et la France et l'Europe souffrent sans doute d'une situation d'épargne excessive des entreprises, parce que les profits d'hier ne sont pas les investissements d'aujourd'hui et ne seront pas les emplois de demain.
Tout le problème est donc de stimuler les entreprises qui créent des emplois, quitte à financer l'effort de solidarité en faisant participer les entreprises qui ont eu des profits mais ne les ont pas utilisés pour investir et créer des emplois.
Cela dit, vous avez raison de relever un paradoxe, car ce basculement, qui est une des propositions du rapport, s'accompagne de la baisse du coût du travail.
Comment répondre à ce paradoxe ?
La première réponse, c'est que j'ai été extrêmement conservateur dans la rédaction du modèle. J'ai repris le modèle Malinvaud, en le complétant. J'ai admis qu'il y avait un problème de coût du travail, cela va dans votre sens, et dans les quatre scénarios, on a admis qu'en abaissant le coût relatif du travail par rapport au coût du capital, on pouvait créer des emplois mais à la condition que l'assiette de financement de la mesure soit favorable.
Le cas favorable, c'est précisément le cas « valeur ajoutée » ou le cas « EBE », parce qu'ils permettent de faire peser l'effort de financement de la mesure sur les entreprises qui peuvent le supporter et de ne pas taxer les ménages comme ce serait le cas dans l'hypothèse d'une taxe sur la valeur ajoutée classique, qui pèserait sur la consommation ou déprimerait la demande.
M. Jean-Philippe Cotis : Nous avons quelques nuances d'appréciation sur ce sujet.
La part des profits s'est fortement restaurée. Elle s'était beaucoup dégradée au cours des deux premiers chocs pétroliers parce que ce sont les entreprises qui ont payé la facture énergétique. Donc, la part des profits s'était abaissée dans la valeur ajoutée. Mécaniquement, la part salariale remontait donc. Ensuite, en 1986, les entreprises ont bénéficié de la baisse du prix du pétrole ; cela a fait remonter mécaniquement la part des profits et baisser la part des salaires.
Un second phénomène, dont on peut débattre, a également joué : le coût du capital a changé. Les taux d'intérêt ont été extraordinairement élevés et ont certainement pesé sur la part des salaires dans la valeur ajoutée ; il fallait bien payer les charges financières. Or depuis le début des années 90, nous avons le sentiment que la part des salaires dans la valeur ajoutée s'est relativement stabilisée. Dans cet environnement, le coût du capital a bien baissé et nous pouvons espérer que la part des salaires remonte dans la valeur ajoutée.
La question est de savoir ensuite, compte tenu de cette part des salaires qui va sans doute remonter puisqu'elle était très dynamique sur les années récentes, comment l'on partage cette croissance plus forte de la masse salariale entre création d'emplois et hausse des rémunérations par tête.
Quand on dit que la part des salaires dans la valeur ajouté a augmenté et qu'il n'y a pas eu d'investissement entre-temps, cela veut dire que le coût du capital était beaucoup plus important. Nous sommes maintenant revenus à des niveaux de profitabilité élevés. Il faut attendre, à mon avis, que l'environnement macroéconomique soit plus porteur, qu'apparaisse aussi de la demande avant de porter un jugement sur le fait que l'investissement n'est pas reparti.
Par ailleurs, je pense que les entreprises utilisent aujourd'hui leur capital de manière plus économe et que nous ne reverrons peut-être pas des reprises de l'investissement aussi fortes que dans le passé, parce que, finalement, les besoins et le taux d'utilisation des capacités dans la période de reprise ne se sont pas beaucoup accrus au fil des années récentes. Cela prouve que les entreprises avaient du répondant en termes de productivité.
Donc, attendons d'avoir une reprise avérée et des conditions de demande raisonnables pour juger des effets d'une amélioration de la profitabilité liée à la baisse des taux d'intérêt qui, dans certains pays d'Europe, est encore récente.
Il y a un certain paradoxe à dire que les taux d'intérêt réels ont été très élevés pendant dix ans et que cela a assassiné l'économie française et lorsqu'ils baissent, à se demander si l'on ne pourrait pas faire remonter le taux du capital.
C'est un peu une remarque de café du commerce, mais que l'on peut corroborer par des modèles plus sophistiqués. Cela nous aidera-t-il à faire redémarrer l'investissement ? Peut-on dire sans attendre que ça y est, que l'investissement n'est pas reparti alors même que l'on a eu quelques difficultés conjoncturelles. Cela me paraît un peu paradoxal.
M. Liêm Hoang Ngoc : Pour répondre à cet argument « café du commerce », je dirai que les entreprises sensibles aux taux d'intérêt ne sont pas les grandes entreprises, car ces dernières ne se financent plus auprès des banques, mais auprès des marchés financiers. Celles qui sont sensibles aux taux d'intérêt sont précisément les petites entreprises que la réforme fiscale sur les cotisations patronales veut encourager, en alourdissant justement la taxation des entreprises qui font du profit et qui ne se financent pas auprès des banques.
M. Philippe Auberger, co-Président : Mais les fonds propres ne sont pas gratuits !
Le Président Augustin Bonrepaux : Monsieur Lardin, une conclusion ?
M. Jean Lardin : Je couperai ce dialogue entre économistes distingués pour revenir au niveau de l'artisan que je suis, et dire que depuis une dizaine d'années, les entreprises artisanales ont continué à investir parce qu'en fait, c'est le principe de la bicyclette qui s'applique à elles : si elles arrêtent de pédaler, elles tombent. Nous ne pouvons donc pas nous arrêter d'investir. Voyez les effets sur l'emploi. Je vous laisse juges.
Le Président Augustin Bonrepaux : Je remercie tous les intervenants pour leurs réponse denses et très précises.
4.- Audition de Mme Martine Aubry, ministre de l'emploi et de la Solidarité
(Extrait du procès-verbal de la séance du jeudi 17 juin 1999)
Présidence de M. Augustin Bonrepaux, Président
A l'invitation du Président, Mme Martine Aubry est introduite. Le Président lui rappelle les règles définies par la mission pour la conduite des auditions : pas d'exposé introductif, échange rapide des questions et des réponses. Il donne ensuite la parole, pour une première question, à M. Gérard Bapt, rapporteur spécial de la Commission des finances, de l'économie générale et du plan.
M. Augustin Bonrepaux, Président.- Je suis heureux d'accueillir en votre nom la ministre de l'emploi et de la solidarité qui a répondu à notre invitation.
Madame la ministre, les réunions de la Mission d'évaluation et de contrôle deviennent habituelles tous les jeudis matin ; depuis le début de l'année, nous sommes orientés vers un certain nombre de problèmes comme celui des autoroutes, de la police et, particulièrement les aides à l'emploi sur lesquelles Gérard Bapt, rapporteur spécial, effectue un travail depuis plus d'un an, car c'est au mois de mars de l'année dernière que nous avions demandé à l'Office parlementaire d'évaluation des politiques publiques de réaliser une étude pour déterminer si les aides à l'emploi étaient efficaces et si les crédits de l'État étaient bien utilisés.
Concernant ce travail de suivi et ces problèmes, nous sommes aidés par les conseils de la Cour des comptes qui travaillent sur toutes ces questions et je remercie encore le Premier Président et les membres de la Cour des comptes qui sont présents aujourd'hui de nous avoir aidés, ainsi que du travail que nous allons pouvoir entreprendre au cours de l'année prochaine compte tenu que cette mission d'évaluation et de contrôle n'en est qu`à ses débuts et que nous espérons qu'elle se traduira progressivement par une gestion beaucoup plus rigoureuse des crédits et, surtout, une plus grande efficacité dans tout ce qui est entrepris.
Pour que cette audition soit également la plus efficace possible, nous avons l'habitude de procéder par questions. Je demanderai au rapporteur spécial de commencer, avec des questions simples et concises, et nous souhaitons que les réponses soient de même.
Ensuite les membres de la mission auront à poser des questions de façon que nous puissions étudier l'ensemble de tout ce qui est en vigueur actuellement, notre mission ayant pour objectif d'évaluer l'efficacité des politiques en cours.
Dans la période actuelle et au moment où des débats sont en cours pour envisager une évolution ou une modification de ces aides, certaines questions toucheront à l'actualité avec, par exemple, l'efficacité de la baisse des cotisations patronales, mais l'essentiel doit être une évaluation précise de ce qui a été fait jusqu'à présent.
M. Gérard Bapt.- Madame la ministre, dans ce que vient de dire Monsieur le Président Bonrepaux, j'ai proposé à mes collègues de la mission d'évaluation et de contrôle de procéder en trois étapes en essayant de regrouper les questions dans l'esprit qui anime ce contrôle de crédits existants, l'efficacité des mesures budgétaires concernant tout d'abord les aides ciblées, ensuite les aides générales et, dans un troisième groupe, le problème d'actualité de réforme du dispositif d'allégement des cotisations patronales et les problèmes que cela peut susciter dans d'actualité.
D'une manière générale et ayant travaillé avec les magistrats de la Cour des Comptes, nous souhaiterons avoir - si ce n'est aujourd'hui tout au moins dans un terme proche puisqu'il s'agit de la présentation des documents budgétaires - des précisions concernant la façon dont le budget peut être modifié dans sa présentation, notamment par rapport à la réforme du prélèvement social dans l'entreprise, la seconde dimension étant celle des problèmes de coordination et de lisibilité concernant des mesures fongibles qui sont, non seulement les contrats aidés dans le secteur non marchand, mais aussi le CIE.
Il serait intéressant, pour juger de l'efficacité de ces mesures, que par sondage sur tel ou tel bassin d'emplois, nous puissions évaluer à la sortie de ces contrats aidés ou à un ou deux ans de distance, le devenir des salariés en cause, afin de juger de la meilleure efficacité de ces différents types de contrats aidés concernant le chômage de longue durée ou les personnes les plus éloignées de l'emploi.
Concernant le groupe des aides ciblées, les travaux de la mission ont conduit à penser que le critère d'appréciation de l'efficacité doit être un impact sur la modification de l'ordre dans la file d'attente des chômeurs, en particulier en renforçant la plus grande employabilité de ceux qui sont les plus éloignés du marché du travail car l'efficacité économique en matière de création pure d'emplois, nous le savons, est minoritaire dans cet engagement budgétaire.
La mesure, concernant le secteur marchand, est celle du Contrat Initiative Emploi. Ce contrat a été recentré concernant les publics concernés, amenant à un redéploiement de crédits. 6 milliards de francs ont été inscrits en 1999 dans la loi de finance initiale après 13 milliards de francs dans la loi de finance de 1998.
Cette mesure doit s'évaluer en fonction de l'état actuel de la structure du chômage et si les résultats sur les chiffres globaux de chômage sont positifs mois après mois, nous sommes alertés par la stagnation ou l'évolution négative des chômeurs de très longue durée d'une part, et de plus de 50 ans d'autre part.
N'y aurait-il pas matière à améliorer le dispositif du contrat Initiative Emploi pour le rendre plus efficace sur ces publics ciblés et, en particulier, Madame la Ministre, concernant la façon dont les versements ont lieu de manière à inciter le mieux possible le chef d'entreprise à utiliser ces contrats pour des publics en difficulté ? Nous avons noté que le premier versement n'est effectué que quatre mois après la conclusion du contrat, n'est que de 6.000 F et ne correspond pas aux 2.000 F par mois sur les quatre mois auxquels l'employeur pourrait prétendre.
Ne faut-il pas majorer l'aide directe qui, après reciblage, restait à 2.000 F par mois pour les personnes les plus éloignées de l'emploi avec notamment plus de trois 3 ans de chômage ou bien plus d'un an ou de deux ans concernant les R.Mistes ou les personnes handicapées ?
Mme Martine Aubry.- Merci, Monsieur le Président. Avant de répondre précisément à la première question, je voudrais redire la stratégie que nous nous sommes fixée depuis deux ans en matière d'emploi qui permet sans doute d'expliquer un certain nombre de recentrages auxquels a donné lieu le budget de l'emploi et ce, d'autant plus que je voudrais répéter que, malgré le financement de programmes nouveaux comme les emplois jeunes, la RTT et la loi sur les exclusions, le budget de l'emploi a augmenté en deux ans de 12,3 milliards de francs, les mesures nouvelles dont je viens de parler ont eu un coût de l'ordre de 26 milliards de francs, ce qui signifie que nous avons pu « avaler » les évolutions spontanées du budget, plus une grande partie des mesures nouvelles par une réaffectation du budget du ministère de l'Emploi.
En effet, ces 12,3 milliards de francs sur deux ans équivalent à 8,2 % d'augmentation du budget, soit le PIB en valeur sur la même période. Si une priorité a été donnée au budget de l'emploi qui a augmenté plus que les autres budgets, il a néanmoins augmenté comme le PIB en valeur par des réaffectations de crédits, ce qui correspond à la logique du travail de votre Commission.
Je rappelle que nous avons établi trois constats pour redéfinir ces objectifs prioritaires dans le budget de l'emploi : la croissance était nécessaire, mais pas suffisante pour faire reculer le chômage. Pour une croissante plus forte - ce n'est pas une incantation - nous nous sommes donné les moyens. Je ne rappelle pas l'augmentation des allocations, des minima, le basculement des cotisations sociales sur la CSG ; nous sommes à 0,5 point de croissance au-dessus des autres pays européens alors que nous étions à 0,5 point au-dessous les quatre années précédentes.
Cette stratégie porte ses fruits en termes de croissance. Mais nous l'avons souhaitée plus riche en emplois et, je le dis parce que cela explique les nouveaux programmes et les nouveaux emplois ; nous sommes aujourd'hui à environ 200.000 emplois jeunes créés, la RTT : 1.500.000 salariés à 35 heures depuis la loi et 71.000 emplois créés ou préservés, et la réforme des prélèvements fiscaux sociaux dont nous parlerons à la rentrée.
Nous avons également souhaité que cette croissance bénéficie à tous d'où cet objectif, alors que la FRANCE a créé 620.000 emplois depuis deux ans de ne pas oublier ceux qui sont sur le bord de la route et, notamment, les chômeurs de longue durée, et si la bonne utilisation des crédits de l'État est une règle qui doit être générale et permanente, la « priorisation » des crédits de l'État dans une période de croissance doit être encore plus nette, car nous devons nous attacher à aider ceux qui, spontanément, ne rentreraient pas sur le marché du travail et c'est bien la logique que nous avons suivie depuis deux ans, en révisant de manière progressive, mais profonde, les aides à l'emploi dans le sens que vous venez de signaler, Monsieur le rapporteur spécial.
Tout d'abord, en limitant les effets d'aubaine et les effets pervers. C'est ainsi que nous avons supprimé l'exonération Madelin pour les salariés entrepreneurs individuels, ainsi que l'abattement temps partiel annualisé en l'absence d'accord d'entreprise, que l'exonération premier salarié a été plafonnée au SMIC, que les primes à l'embauche et de qualification ont été réservées à ceux qui n'ont pas un diplôme équivalent au bac, que le crédit d'impôt emplois familiaux a été réduit de moitié et que la ristourne Juppé a été proratisée.
Dans tous les cas, nous n'avons effectué aucune réduction des volumes à la date d'entrée en vigueur. Nous constatons une hausse mais, avec, encore une fois, une révision progressive des aides pour éviter ces effets d'aubaine et ces effets pervers.
Le recentrage des CIE et des CES a permis de réaliser des économies substantielles - près de 10 milliards de francs tout en maintenant dans ces deux dispositifs le nombre de places pour les publics en réelle difficulté et même en les augmentant.
Enfin nous avons procédé à des économies liées à l'amélioration de la situation économique et sociale, économies sur l'indemnisation du chômage, la Sécurité Sociale et le RMI, par rapport à la tendance et, sur les mesures d'accompagnement, des restructurations pour lesquelles nous avons par ailleurs demandé une participation plus importante des entreprises.
C'est le cas du doublement de la contribution Delalande en cas de licenciement des salariés de plus de 50 ans et, pour le nouveau dispositif de préretraite que nous mettons en place qui limitera, pour les entreprises qui ont les moyens de le faire, celles qui ne sont pas en grandes difficultés, la part de financement de l'État dans les préretraites, de manière importante.
Je voulais rappeler, Monsieur le Président, avant d'entrer dans la première question, l'axe qui a été le nôtre : La croissance, des pistes nouvelles qui ont un coût (je l'ai dit) : 25,7 milliards de francs pour 1997 à 1999, avec les emplois jeunes, l'exclusion et la RTT mais, en parallèle, le recentrage d'un certain nombre de dispositifs pour éviter les effets d'aubaine et les effets pervers, pour recentrer vers ceux qui en ont le plus besoin et économiser sur un certain nombre de dispositifs.
Le Contrat Initiative Emploi : il a été créé en 1995 par le gouvernement Juppé, en remplacement du Contrat de Retour à l'Emploi.
Je crois que l'on peut dire qu'il a été la source de très importants effets d'aubaine puisque les chefs d'entreprise ont déclaré eux-mêmes que pour 10 embauches en CIE une ou deux seulement n'auraient pas eu lieu sans l'aide.
Le coût de l'emploi réellement créé était très élevé - près de 350.000 F par an- et il n'est pas étonnant que malgré une augmentation très rapide du CIE à sa création, puisqu'en dix-huit mois nous avons atteint 375.000 personnes en CIE fin 1996, l'emploi marchand n'ait pas progressé pendant la même période : 40.000 de l'année 1995 à fin 1996.
Or, les aides à l'embauche par les entreprises, je vous l'avais dit, doivent être ciblées sur les publics qui n'ont pas d'autres perspectives d'emploi, pour changer l'ordre dans la file d'entrée dans les entreprises. Pour ce faire, il faut qu'elles soient véritablement efficaces et influent sur le profil des embauches. C'est pourquoi le gouvernement Juppé avait amorcé le mouvement à l'été 1996 en recentrant le CIE après en avoir constaté les dérives, la prime de 2.000 F par mois avait été supprimée pour les chômeurs de longue durée ayant moins de deux ans d'ancienneté au chômage et abaissée à 1.000 F pour ceux qui avaient deux ans de chômage.
Nous avons accentué ce mouvement, notamment en demandant à l'ANPE de discuter avec les entreprises et rendant obligatoire la demande de CIE, préalable à l'embauche. Il nous paraît très important - et nous y reviendrons quand nous parlerons des plans nationaux d'action pour l'emploi- que dans le cadre du nouveau départ, cette rencontre avec chaque chômeur de longue durée qui doit amener à trouver les bons parcours pour les remèdes vers l'emploi, le CIE soit un des outils dont dispose l'ANPE pour aider les chômeurs de plus longue durée à rentrer dans les entreprises, avec une discussion entre l'ANPE et l'entreprise sur les personnes qu'elle peut effectivement prendre en CIE
Je dois dire que dans la grande majorité des cas, cela fonctionne très bien.
Par ailleurs, les résultats sont là, la part des chômeurs de plus de deux ans est passée de 30 % en 1997 à 41 % début 1999 et celle des Rmistes a été portée de 14 % à 16,5 % dans le même temps. Ainsi, si le nombre total des entrées s'est réduit (et c'était là ce que nous souhaitions : éviter les effets d'aubaine), 212.000 en 1997, 196.000 en 1998 et sans doute de l'ordre de 160.000 à 170.000 cette année, cela ne s'est pas fait au détriment de ceux qui en ont besoin compte tenu que leur nombre et leur part relative ont crû.
Ce recentrage a permis de cadrer le CIE principalement vers les chômeurs de plus de deux ans et les Rmistes mais également - et nous avons pris un décret en décembre 1998 - vers les jeunes sans aucun diplôme professionnel, sortis notamment en état d'échec scolaire de l'entreprise.
M. Philippe Auberger, co-Président.- Vous nous avez dit que le nombre d'entrées dans le CIE diminuait, que la proportion de personnes augmentait ainsi que le nombre absolu des publics ciblés. Cela ne découle pas forcément des deux éléments précédents. Pouvez-vous nous donner pour les publics privilégiés, le nombre absolu d'entrées, ce qui étayera toute discussion ?
Mme Martine Aubry.- Nous avions 30 % de 212.000 personnes en 1997, nous avons aujourd'hui 42 % de 160.000 ou 180.000 personnes en 1999.
Nous sommes passés de 63.000 à 67.000 ou 70.000, selon ce que nous aurons cette année, si nous avons 160.000 ou 180.000 CIE cette année.
M. Gérard Bapt.- Concernant les mesures d'aides ciblées au secteur marchand, il serait intéressant que vous donniez une information concernant la montée en charge des Contrats de Qualification Adultes qui ressortent de la loi contre l'exclusion et qui intéressait M. Barrot.
Mme Martine Aubry.- Vous savez que dans la loi contre les exclusions nous avons tenté de réfléchir, toujours dans le même objectif qui est le nôtre, d'éviter de « caser » les chômeurs de longue durée quand ils viennent à l'ANPE compte tenu de ce qui est administrativement disponible (un CES, un CEC, ou une formation), mais que ce soit fait à partir d'une analyse de la personne, de son projet, de l'état professionnel, psychologique et matériel dans lequel elle se trouve, afin que nous soyons capables de conclure avec elle un parcours qui la mène vers la qualification et l'emploi.
A cet égard, il nous manquait un certain nombre d'outils ; nous parlerons des Contrats Emploi Consolidé pris en charge à 80 % par l'État sur cinq ans dans quelque temps. C'est le cas des Contrats de Qualification Adulte. Les jeunes adultes sortis en situation d'échec scolaire ou sans diplôme ou avec un diplôme totalement dépassé et qui, en règle générale, n'ont pas encore travaillé ou très peu travaillé dans des petits boulots, se retrouvent sur le marché du travail en totale capacité physique et psychologique de volonté de se former, en ayant néanmoins une difficulté à entrer dans une formation théorique telle que peuvent être celles de la formation classique, qu'elles soient données par les professions ou par l'AFPA qui, par ailleurs, s'oriente de plus en plus vers la formation en alternance.
Nous avons pensé qu'il était peut-être utile, principalement pour ces jeunes adultes, même si le dispositif reste large, de tenter une expérimentation sur les Contrats de Qualification Adulte en en prévoyant 5 000 en 1998 et 10 000 en 1999. Ce dispositif, comme tout nouveau dispositif, a mis du temps à démarrer (nous sommes à 780 entrées fin mai), mais c'est souvent le cas pour les dispositifs de formation en alternance.
Le Contrat de Qualification Jeune créé en février 1984 n'a décollé qu'à partir de 1986. Ce n'est pas étonnant. Nous atteindrons un rythme annuel de l'ordre de 4 000, au-dessous de notre objectif, mais nous continuons les débats avec un certain nombre de professions et avec Nicole Péry nous avons signé un accord avec l'Artisanat du Bâtiment qui s'est engagé à prendre 1 000 contrats ; cela se passe bien.
Il est intéressant de voir que le profil des personnes qui entrent sont des chômeurs de longue durée, des Rmistes, mais des personnes qui sont en bon état pour entrer dans une formation qualifiante. Cela démarre lentement, car c'est un dispositif qui n'est pas utile à tous, qui est très ciblé vers certains publics mais qui manquait à notre palette d'outils pour aider ceux qui sont hors du marché du travail à y revenir.
M. Jacques Barrot.- Le vrai problème nous concernant est l'arrivée à terme des premiers Contrats d'Emploi Consolidé. Il s'agit de personnes qui ont effectué plusieurs CES auparavant, puis cinq ans de Contrat d'Emploi Consolidé et il est vrai qu'aujourd'hui il manque une sortie pour ces personnes qui parfois ont repris, à travers leur expérience de CEC, un peu le goût et la motivation du travail. Un réel problème se pose pour la suite des CEC
M. Gérard Bapt.- C'est à l'évidence un problème budgétaire. Les CEC sont beaucoup plus pris en charge dans la nouvelle mouture que dans l'ancienne. S'il y a eu un certain redéploiement en recentrant sur les publics les plus prioritaires concernant les CES, permettant une décélération du budget (moins de 10 milliards de francs contre 11,6 milliards de francs l'an dernier), il existe une montée en charge des Contrats Emploi Consolidé à plus de 5 milliards de francs désormais, ce n'est pas sur ce chapitre, concernant des personnes les plus éloignées de l'emploi, que des économies ultérieures pourront se faire.
Mme Martine Aubry.- Nous avons procédé à une importante réforme des emplois de solidarité, les CES ou CEC, notamment dans la loi contre l'exclusion en créant le nouveau contrat de 5 ans pris en charge à 80 % par l'État qui est destiné aux personnes dénuées de toute perspective en matière d'emploi.
Il n'existe pas de critères, Monsieur le ministre, pour entrer dans ce CEC de cinq ans et quelqu'un qui ne serait pas passé par un CES pourrait y entrer. Je pense à des Rmistes de longue durée, et nous avons demandé à l'ANPE de commencer par revoir toutes les personnes qui sont au R.M.I depuis 10 ans. Il y en a 10 %, ce qui énorme. Ce sont, d'après moi, les publics prédestinés à ce type de Contrat Emploi Consolidé de 5 ans, financé par l'État.
Pour des publics qui n'ont aucune chance de par leur âge, leur état de santé ou leur situation personnelle, d'entrer dans un emploi direct (public ou privé), c'est vers eux que ces CEC peuvent aller.
Bien évidemment, si des personnes sortent du premier CES ou des premiers CEC et se retrouvent encore dans cet état professionnel et personnel, elles peuvent rentrer dans ces CEC de 5 ans.
Nous avons eu hier les résultats de la région Rhône-Alpes sur les anciens Contrats Emploi Consolidé qui ont été créés en 1992 : 55 % des personnes en sont sorties en CDI. Même s'il reste des personnes en grande difficulté - vous avez soulevé ce point - qui peuvent rebondir sur un CEC à 80 %, le fait d'avoir sur des publics en très grande difficulté un résultat qui se confirmera au niveau national est tout à fait intéressant.
Ces nouveaux CEC pris en charge à 80 % par l'État vont vers un public en grande difficulté qui n'aurait pas d'autres solutions. Notre objectif est de passer de 30 000 nouveaux contrats par an à 50 000 en 1999 et 60 000 en l'an 2000 ; sur les cinq premiers mois de l'année nous sommes à 21 850 contrats, soit plus de 60 % par rapport à la même période de 1998. Nous atteindrons notre objectif en maintenant ce rythme.
Cela est largement lié au travail effectué par l'ANPE qui reçoit les chômeurs de longue durée, les Rmistes et notamment ceux qui sont dans cette situation depuis très longtemps et c'est à eux que nous proposons des solutions qu'ils n'avaient pas jusqu'à présent et ne leur permettaient pas de sortir de l'assistance.
Deuxième recadrage des emplois de solidarité : l'utilisation du Contrat Emploi Solidarité comme un outil de remobilisation par l'exercice d'une activité professionnelle dans le cadre de ce nouveau départ. Nous avons eu trop tendance précédemment à utiliser le CES en y mettant les personnes pour un an renouvelable une ou deux fois sans nous en occuper. Un CES peut être un contrat de 3 ou 6 mois qui peut être un passage pour un chômeur de longue durée afin de lui permettre de reprendre confiance et d'avoir une activité avant de l'intégrer dans un parcours de formation et de qualification.
La tâche actuellement menée par l'ANPE (dont je salue le travail considérable), sur les nouveaux départs qui a permis la réduction des chômeurs de longue durée - ce qui n'était pas arrivé depuis 10 ans - de 60 000 en moins de 3 mois, vise à examiner le cas de chaque personne et à lui trouver la bonne solution en continuant de le suivre avec un CES plus fluctuant et plus souple.
Le problème n'est pas réglé en « casant » quelqu'un dans un CES. Il faut continuer à le rencontrer et voir si son état personnel s'améliore afin de le sortir vers la qualification et l'emploi.
Nous sommes passés d'une logique administrative à une logique individualisée.
Nous avons recentré les CES et les CEC sur les publics qui n'ont pas d'autres solutions d'emploi avec des objectifs quantifiés pour le CES : 65 % en 1998, 75 % en 1999 et 80 % en l'an 2000. Cet objectif a été atteint, puisque le taux de prioritaires s'établit à 75,8 % en mai, contre 57 % en 1997 quand je suis arrivé, ce qui a permis d'augmenter ce stock de prioritaires en CES qui est passé de 162 000 à 180 000, tout en réalisant des économies budgétaires, puisque nous dépensons aujourd'hui 9,9 milliards de francs pour les CES contre 12 milliards de francs en 1997.
La situation n'est pas la même et, bien évidemment, nous avons tous utilisé les CES pour des publics non prioritaires quand des personnes, en période de crise, étaient au chômage depuis un certain temps, avaient la capacité de trouver un emploi, mais ne le trouvaient pas. Il était totalement justifié d'éviter des dérives évidentes que nous avons dans certains cas -M. Barrot ne me contredira pas- dans des collectivités territoriales, des ANPE ou des services publics : « Cherche CES bac + 4 avec expérience professionnelle » ce qui était en tout état de cause, inacceptable.
Mme Nicole Bricq.- Ce type de situation existe encore.
Mme Martine Aubry.- De moins en moins et, de plus, l'ANPE n'y répond pas. Quand la croissance revient et que les emplois se recréent, ce public trouve du travail et nous devons nous recentrer vers ceux qui ont des difficultés, c'est ce que nous avons fait et les chiffres le démontrent à ce jour.
M. Pierre Méhaignerie.- Si les CEC apportent une bonne réponse, nous avons cependant un problème sur les collectivités qui, par les chantiers d'insertion, avaient utilisé totalement des CES plus des CEC qui arrivent aujourd'hui au terme des cinq ans. Dans le département, nous en avons plus de 300. Nous parvenons à les envoyer pour un tiers dans le secteur privé, mais pour les deux tiers ayant une très faible productivité nous n'avons que deux solutions : soit leur dire : « C'est fini » ce qui, humainement, est impossible, ou les reprendre au niveau du SMIC, ce que nous avons fait pour 40 personnes.
Cette situation pose des problèmes de comparaison du fait de la productivité, par rapport à des salariés en entreprise privée et payés au SMIG. Nous en aurons 300 dans les 5 ans à venir. N'y aurait-il pas une solution à trouver ?
Mme Martine Aubry.- Je crois, Monsieur le ministre, avoir déjà répondu : les CEC à 80 % payés par l'État sur 5 ans, peuvent bénéficier à ces personnes. A qui s'adressent-ils ? Aux chômeurs de longue durée, Rmistes ou aux plus de 50 ans et aux chômeurs de très longue durée, de plus de 3 ans. Nous avons également mis en place une catégorie ouverte : « Personnes rencontrant des difficultés particulières d'insertion » quel que soit le statut qui était le leur auparavant, même si elles étaient en CES ou en CEC
Je ne dis pas que nous allons y mettre tous ceux qui étaient en CEC, mais tous ceux qui sont en situation difficile seront au RMI si nous les renvoyons dehors, ce qui serait aberrant, car c`est justement ceux-là que nous voulons accueillir dans les CEC
M. Pierre Méhaignerie.- Cela mérite des précisions sur le terrain.
Mme Martine Aubry.- La circulaire est très claire, mais en cas de difficultés dans telle ou telle région, je ne manquerai pas de faire passer les messages. Il ne faut pas que ce soit général.
La facilité pour un élu est de dire : « Maintenant que l'État les prend à 80 % je ferai basculer tous mes CEC vers les CEC pris à 80 % par l'État. » Il n'existe pas d'automatisme. Dès lors que la personne sortant de ce CES ou CEC continue à être dans une situation telle qu'elle n'a aucune chance d'entrer en formation ou dans un emploi public ou privé classique, il existe l'opportunité au cas le cas, de la faire entrer dans ce CEC
M. Gérard Bapt.- Ce débat est intéressant, car il démontre la difficulté que nous avions touchée lors de nos précédentes réunions sur l'efficacité des aides publiques et le traitement social. Vous avez indiqué un chiffre, concernant le cas du CEC, sur le devenir ces salariés : 55 % sortis en C.D.I. est un chiffre très positif et vous avez répondu à ma question.
Nous sommes ici en mission d'évaluation et de contrôle pour tenter d'avoir la plus grande efficacité possible, de réaliser des économies et de redéployer. Les élus locaux ont des revendications concernant des publics très en difficulté, d'où la complexité de la tâche concernant le budget Travail-Emploi.
Je souhaitais terminer ce chapitre Aides ciblées par le chapitre des Préretraites progressives, M. Philippe Auberger souhaitait vous interroger sur ce chapitre qui a vu ses crédits diminuer assez sensiblement en 1999, loi de finance initiale, mais qui pose le problème par rapport au pourcentage des demandeurs de plus de 50 ans actuellement.
Mme MartineAubry.- Il existe une réduction des crédits sur les préretraites progressives liée au fait qu'il n'y avait pas de demandes. La préretraite progressive est à mes yeux un élément très important qui a été mis en place en 1992. Il y a eu moins de demandes ces derniers temps. Un rapport est réalisé sur la demande du Premier ministre concernant les préretraites progressives, visant effectivement à réfléchir à ce point.
A cette occasion, je dirai quelques mots sur ce problème des préretraites et des préretraites progressives en particulier. Nous avons plusieurs dispositifs et c'est pour cette raison que les crédits des préretraites progressives ont diminué ; l'ARPE, mise en place par les partenaires sociaux, a visé à faire partir des personnes qui avaient commencé à travailler très tôt et à les remplacer par des jeunes.
Ce dispositif a touché de plein fouet ceux qui auraient pu entrer en PRP. De manière plus générale, nous avons à réfléchir à la façon de traiter toute la population des hommes et des femmes qui arriveront dans les 10 ans qui viennent à l'âge de la retraite et qui ont commencé à travailler tôt, ou sur des emplois pénibles, ou dont la formation n'a pas suivi les évolutions technologiques.
Pour ma part, je crois malsain de continuer à faire ce que nous avons tous fait depuis des années, à savoir financer - y compris pour des entreprises qui ont des résultats - l'absence d'anticipation qui a été la leur pour préparer les salariés aux qualifications et aux emplois de demain et à traiter leur pyramide des âges.
C'est la raison pour laquelle j'ai arrêté les plans sociaux dans l'Automobile et commencé à rediscuter avec eux mais, derrière l'Automobile il existe beaucoup d'autres secteurs. Il ne me paraît pas souhaitable que l'État continue de financer des préretraites au taux où elles étaient financées, autour de 80 % en moyenne, payées par l'État, dans des secteurs qui ont les moyens de traiter ce problème.
En revanche - et c'est le dispositif que nous mettons en place, qui est général et ne s'applique pas qu'à l'Automobile - il est très important de le faire à un moment où sera traité le problème de la retraite, pour enlever des anxiétés à des hommes et des femmes qui savent que si l'âge de la retraite devait se poursuivre, ils n'auraient aucune chance de retrouver du travail, craignant par ailleurs d'être licenciés à partir de 55 ans. Nous devons leur dire que nous avons traité leur problème.
C'est la raison pour laquelle nous travaillons à un autre dispositif de FNE qui s'appliquera à des entreprises qui ne sont pas obligatoirement en difficulté, qui ne nécessitent pas une aide de l'État allant jusqu'à 80 %, mais qui permettent, sur un public particulier comme les personnes qui sont âgées puisqu'il s'agit de préretraites, qui ont commencé à travailler tôt ou dont les tâches étaient pénibles, qui sont « usées » et incapables aujourd'hui, parce qu'elles n'ont pas été préparées, de remplir les emplois de demain, de les aider à sortir correctement du marché du travail.
Néanmoins, il ne faut pas que l'État paie à 80 % mais que les entreprises contribuent beaucoup plus fortement. C'est la négociation que nous avons pour un deuxième système de préretraite FNE moins coûteux pour l'État et qui règle des problèmes sociaux nécessaires à traiter.
M. Jacques Barrot.- J'enchaînerai sur la liaison ANPE et AFPA puisque cela faisait partie, sur le versant formation professionnelle, de la façon de voir l'évolution de la situation.
Bien que Mme Nicole Péry ait répondu en partie à cette question, ce sera peut-être être utile, car vous avez indiqué, Madame la ministre, que vous souhaitiez revenir sur l'ANPE dans son rôle d'insertion.
Comment concilier cette mission à la fois de placement qui est celle de l'ANPE qui, par ailleurs a progressé en matière de placement et, conjointement, ce rôle d'insertion en liaison avec l'AFPA ?
La deuxième question est liée à l'aide à l'emploi qui était le problème de savoir comment vous pensiez articuler progressivement sur la RTT la mise en _uvre d'un capital temps formation, compte tenu que cet élément fait partie de ce que nous allons tenter de proposer dans notre rapport sur la formation professionnelle, afin de voir comment, progressivement, pourrait être mis en place un système de formation tout au cours de la vie, le congé individuel de formation apparaissant comme une formule qui n'est plus tout à fait adéquate et qui mobilise des sommes à la fois importantes, mais sans doute insuffisantes, si nous voulons demain avoir un système accessible à tous les salariés.
Mme Martine Aubry.- Monsieur le Président, les deux contrats de progrès et particulièrement celui de l'ANPE que nous venons de signer de nouveau, insistent très fortement sur la nécessaire synergie entre l'ANPE et l'AFPA qui a bien avancé ces dernières années, mais doit se consolider.
Quand j'ai dit que nous passons d'une logique administrative à une logique individuelle, cela signifie que j'ai souhaité recentrer l'outil AFPA vers son objectif initial, à savoir la formation prioritaire des demandeurs d'emplois, car il existait une certaine tendance à passer des contrats avec des entreprises privées, certes sans doute utiles sur le plan financier, mais beaucoup moins par rapport à la mission initiale de l'AFPA.
Je ne suis pas opposée au fait que des salariés s'intègrent à des stages de chômeurs, mais il faut que l'AFPA soit recentrée sur sa mission qui est de former et qualifier des demandeurs d'emplois. C'est ainsi que nous avons recentré le contrat de progrès, et le lien avec l'ANPE est essentiel.
Dans le cadre de ce nouveau départ qui touchera 850 000 chômeurs de longue durée et Rmistes l'ANPE reçoit ces personnes et définit avec elles un parcours, car certaines ont besoin d'un passage par un emploi d'insertion, et je rappelle que dans la loi contre les exclusions nous avons demandé une présentation des candidats à l'insertion aux entreprises d'insertion par l'ANPE
Cela entre toujours dans la même logique, que ce soit les personnes reçues et accueillies à qui l'on propose un emploi d'insertion ou un CES dans le cadre de leur parcours et, de la même manière, certains peuvent entrer en formation qualifiante et l'AFPA est là pour proposer ces formations.
Cette synergie est tout à fait essentielle.
Concernant l'ANPE, elle a procédé, depuis le début des années 1990, à un changement complet dans ses méthodes de travail et son positionnement. Aujourd'hui, nous avons un service public particulièrement performant même s'il continue à avoir des moyens inférieurs à ceux existant dans d'autres pays.
Au début des années 1990, l'ANPE n'était pas suffisamment tournée vers les entreprises et il est exact que, de ce fait, ses relations avec les demandeurs d'emplois la conduisaient à faire un travail extrêmement lourd d'inscription (qui est actuellement réalisé par l'UNEDIC puisque nous avons transféré les inscriptions de l'ANPE vers l'UNEDIC) et était surtout tourné vers l'accueil, l'inscription et la proposition de formation ou de contrats d'insertion.
Concernant le travail mené afin que l'ANPE se tourne vers les entreprises (j'avais moi-même, en 1991, demandé que l'ANPE aille à la rencontre des petites et moyennes entreprises), les chambres de commerce, la CGPME, l'U.P.A. avaient travaillé avec nous à un programme pour que les prospecteurs placiers aillent dans les entreprises, les aident et les conseillent et ne leur envoient pas, quand une offre d'emploi a été déposée, les 100 personnes inscrites sur la qualification mais fassent le tri dans l'intérêt de l'entreprise et dans celui du salarié.
Cette démarche a été non seulement comprise, mais réalisée de manière importante car, aujourd'hui, l'ANPE a une part sur le marché des offres d'emplois de 50 %. C'est un élément extrêmement important quand on sait que les grandes entreprises ont leur propre marché du travail et, en règle générale, n'ont pas besoin de passer par l'ANPE
Ce recentrage était nécessaire et les agents de l'ANPE ont bien compris que la meilleure façon de rendre service aux chômeurs était de leur procurer un emploi et d'aller les chercher où ils étaient, à savoir dans les entreprises, et ce travail a été bien mené.
Ma conviction en arrivant en 1997 était que nous étions passés d'un tropisme accompagnement social du chômeur à un tropisme un peu trop tourné essentiellement vers les entreprises.
Il faut garder cet acquis qui est majeur, mais se retourner, surtout dans cette période de croissance, vers les chômeurs de longue durée, les Rmistes et les jeunes les plus en difficulté pour les ramener individuellement vers la qualification et l'emploi.
C'est dans cet esprit que nous avons à la fois renforcé les moyens de l'ANPE : 2.500 emplois supplémentaires en passant de 12.500 à 15.000 après 4 ans de quasi stagnation des effectifs dans un contexte de forte montée du chômage de longue durée, ce qui représente une hausse de 20 % des conseillers au contact des demandeurs d'emplois, ainsi que 700 emplois complémentaires dans les missions locales et les permanences d'accueil, d'information et d'orientation (PAIO), en partenariat avec les collectivités locales, car ce sont elles qui reçoivent, pour les jeunes, l'équivalent de ce que reçoit l'ANPE concernant les adultes.
Cette disposition doit nous permettre de répondre à l'engagement que nous avons pris au niveau européen, car nous le souhaitons sur le plan français, qui est d'accompagner dans la durée les chômeurs de longue durée et les jeunes sans qualification pour les ramener vers la qualification et l'emploi.
Je salue de nouveau le travail par l'ANPE qui, pendant 10 ans, a subi la crise de plein fouet en voyant arriver tous ces demandeurs d'emplois à la suite de licenciements économiques extrêmement lourds, a tenu le choc malgré les moyens insuffisants et qui, aujourd'hui, a su rebondir vers les entreprises en apportant un service plus performant et de qualité reconnue par les enquêtes menées auprès de ces dernières tout en étant capable d'accompagner dans la durée des chômeurs de longue durée pour leur trouver la bonne solution afin de rentrer au c_ur du marché du travail.
Nous avons les uns et les autres réussi en l'espace de 10 ans à faire de l'ANPE (qui était souvent critiquée par tous et peut-être parce que les politiques ne lui avait pas donné les moyens et le recentrage nécessaire pour travailler) un service public, avec l'AFPA, particulièrement performant au service des demandeurs d'emplois et des entreprises.
M. Jean-Jacques Jégou.- Je rebondis sur les questions posées par Jacques Barrot sur l'ANPE et l'AFPA.
Madame la ministre, si nous pouvons être parfaitement d'accord avec ce que vous venez de dire concernant l'ANPE et les efforts considérables qui ont été faits, il n'en est pas de même pour l'AFPA.
L'audition que nous avons eue de son Directeur Général il y a quelques mois, le démontre et je ressens dans vos paroles une tentative depuis votre arrivée en 1997 sur, sinon la fusion (que j'avais demandée quand j'étais rapporteur spécial) mais tout au moins la nécessité que l'ANPE tire vers le haut l'AFPA, qui a des moyens considérables mais voit moins de 200.000 stagiaires par an. Quand je vous entends dire que l'AFPA doit faire de la formation en alternance, je partage parfaitement votre point de vue.
Il existe des champs énormes, à la fois pour ce que traite l'ANPE, les missions locales et les PAIO, mais aussi pour tout le public dont vous nous avons parlé, Pierre Méhaignerie, Jacques Barrot et le rapporteur spécial Gérard Bapt, sur les formations en alternance que pourraient faire les CES et leur consolidation, ne serait-ce que pour en verser une partie dans le secteur marchand.
Ne pourriez-vous pas, dans cet esprit plus optimiste avec la reprise de la croissance et la performance de l'ANPE, non pas accélérer cette « fusion » mais, à défaut, concrètement, de nous dire comment vous verriez l'amélioration de la productivité de l'AFPA qui a de grandes possibilités et des personnels d'une grande compétence mais qui finalement « patine » et pourrait être tirée vers le haut par l'ANPE et ses performances.
Mme Martine Aubry.- Monsieur le député si à mon arrivée je n'ai pas augmenté les crédits de l'AFPA, c'est parce que je partage en partie vos propos. Nous avons travaillé avec le nouveau Directeur Général, à un contrat de progrès qui part de la situation qui était celle de l'AFPA et j'ai promis que les crédits accompagneraient le mouvement à condition qu'il existe.
Ce mouvement doit avoir lieu dans trois domaines. Tout d'abord faire entrer progressivement et prioritairement les chômeurs vus par l'ANPE dans l'AFPA. Nous souhaitons arriver à 80 % des entrées à l'AFPA, envoyées par l'ANPE, dans la logique que j'ai exprimée, à savoir un service intégré avec l'ANPE sur le conseil professionnel et la formation.
Le but n'est pas d'améliorer la qualité, car si les entreprises sont allées vers l'AFPA, et c'est peut-être là une des dérives auxquelles nous avons assisté ces dernières années, c'est parce que la qualité de la formation est excellente. Maintenant que nous avons fait de la qualité, nous devrions pouvoir faire de la quantité et garder la même qualité. Notre souci est de recentrer l'AFPA vers les chômeurs (et notamment, ceux qui en ont le plus besoin), d'utiliser les capacités et les compétences de l'AFPA qui sont très importantes et reconnues à l'extérieur, pour maintenant donner de l'ampleur à cette action, notamment ciblée vers les chômeurs et ceux qui sont inscrits à l'ANPE
C'est ce que nous avons demandé à l'AFPA pour les années qui viennent et c'est au vu de ce qui se fera que les crédits de l'État accompagneront ce mouvement, afin de développer l'offre.
M. Philippe Auberger, co-Président.- Je partage le sentiment de M. Jean-Jacques Jégou. Tel que je le vois au niveau local, il reste un problème AFPA alors que l'ANPE a profondément évolué.
Concernant le domaine du bâtiment, actuellement, nous constatons dans nos différents départements une pénurie de travailleurs qualifiés alors que les prix du bâtiment commencent à reprendre en raison d'une meilleure activité mais sans suffisamment de main-d'_uvre qualifiée. L'AFPA, dans mon département, détient un ensemble de formations en direction du bâtiment, mais nous constatons que, pour différentes raisons, la situation « patine ».
Je ne suis pas certain que le fait d`éloigner trop l'AFPA des entreprises et de leurs besoins, sans avoir un bon mixte entre le public véritablement très défavorisé et le public qui demande à améliorer ses compétences et qui est peut être déjà salarié, soit un élément favorable, car il faut améliorer l'employabilité de ces personnes, dans le secteur du bâtiment et s'en donner les moyens, et ceux utilisés ne donnent pas satisfaction.
M. Pierre Méhaignerie.- Madame la ministre, la réussite d'une politique de l'emploi dépend, certes, de l'État et de sa mobilisation, mais également de la solidarité et de la mobilisation des acteurs locaux. Ne serait-il pas envisageable d'expérimenter ce que pourrait donner, dans une dizaine de cas, un type de conseil d'orientation autour de l'AFPA , de façon que tous les acteurs se mettent ensemble ?
M. Gérard Saumade nous disait qu'avec 18 % de taux de chômage à MONTPELLIER, il ne trouvait plus de personnel dans certains secteurs. Nous sommes agressés par des artisans et des entreprises qui nous disent : « Quand finirez-vous avec vos méthodes d'assistance alors qu'il est impossible de trouver de la main d'_uvre ? » Sur tous ces problèmes qui vont devenir plus cruciaux, surtout si la croissance continue, ne serait-il pas envisageable, de façon à éviter l'éparpillement multiple des forces, de faire en sorte qu'une fois par an, l `ensemble des forces au niveau des bassins d'emplois se retrouve autour d'un conseil d'orientation de l'ANPE ?
Mme Martine Aubry.- Je n'ai pas dit que l'AFPA ne devait pas travailler en contact avec les entreprises mais qu'elle n'était pas faite pour former les salariés des entreprises. Bien au contraire, dans le contrat de progrès, nous lui demandons de rester en contact avec les professions et les entreprises pour évaluer leur besoin quantitatif et qualitatif, à savoir de faire évoluer leur formation en liaison avec les besoins.
Nous ne leur avons pas demandé de se couper des entreprises, mais d'accentuer le lien avec les secteurs et les entreprises tout en recevant, en revanche, des demandeurs d'emplois plus que des salariés, car ces derniers peuvent être formés dans le cadre des formations, dans le système de la formation professionnelle continue.
Je partage tant vos propos concernant le bâtiment que ceux de M. Pierre Méhaignerie sur l'artisanat et le commerce. Nous avons des secteurs d'activité où aujourd'hui, le problème est que les demandeurs d'emplois ne veulent pas s'y diriger et notamment les jeunes. Ce n'est pas un problème de l'AFPA qui n'est pas adaptée car elle a des formations de grandes qualités. Je pense au bâtiment et aux métiers de bouche (boucherie, pâtisserie et autres) sur lesquels les jeunes ne veulent pas s'orienter.
De ce fait, nous avons commencé avec Nicole Péry - et j'en parlais avant-hier avec le Président de l'Union Professionnelle Artisanale - un travail dans lequel nous sommes prêts à aider au financement de cette formation. Toutefois, le problème aujourd'hui n'est pas celui-là, mais celui de convaincre les jeunes que ce sont des métiers qui sont de vrais métiers et qu'ils ont effectivement intérêt à les regarder.
Nous sommes convenus avec l'Union Professionnelle Artisanale - et c'était un débat intéressant et sans vouloir mettre un élément qui risque de nous diviser dans ce débat - que les 35 heures étaient très certainement un moyen de faire changer l'image de l'artisanat, car quand nous demandons aux jeunes qui entrent dans des formations techniques pourquoi ils ne vont pas vers ces métiers, c'est en règle générale la durée et les conditions de travail qui les rebutent.
M. Pierre Méhaignerie.- Ainsi que les salaires.
Mme Martine Aubry.- Oui, d'où la baisse des charges, Monsieur le ministre, ce qui a une certaine cohérence. C'est ma conviction profonde.
Je crois que nous avons maintenant environ quelques mois, voire même 2 ans, pour progresser sur ces secteurs.
Je ne parle pas du bâtiment pour lequel les besoins existent maintenant et qui a fait d'énormes progrès pour améliorer ses conditions de travail et attirer des jeunes. Un public jeune va vers le bâtiment, car travailler dehors dans des conditions de relations qui sont plus souples que dans une entreprise classique correspond à un certain nombre de jeunes que nous devons amener vers ces travaux.
Concernant l'artisanat et le commerce, nous sommes convenus avec l'UPA de monter des contrats - des engagements de développement de la formation professionnelle - et des campagnes d'information au fur et à mesure de cette arrivée vers les 35 heures, qui doit changer l'image de marque de ces métiers. Il est dommage de voir qu'en France nous avons des places d'apprentissage, ou à l'AFPA dans des métiers de bouche, qui sont de véritables métiers où les jeunes ne vont pas.
Compte tenu de la présence ici de quelques Présidents de région, je voudrais énoncer les faits simplement : nous avons des efforts à faire dans deux domaines. Tout d'abord, pour que ces jeunes puissent entrer en apprentissage dans ces métiers, il faut qu'ils aient les acquis de base : lecture, écriture et calcul.
Aujourd'hui, de nombreuses régions, malgré la décentralisation de la formation, ne montent pas ces formations et de nombreux jeunes sont complètement décalés parce qu'ils ne peuvent pas entrer dans une formation qualifiante, car il leur manque la base. Maintenant qu'il existe une décentralisation de la formation professionnelle, je l'ai dit à plusieurs reprises et nous avons le même problème pour le programme TRACE, il faut que les régions acceptent de financer ces stages de mise à niveau qui permettront à ces jeunes d'entrer dans les formations qualifiantes ou dans l'apprentissage dans ces secteurs. Certaines le font, mais je sais que d'autres aussi considèrent que ce n'est pas à elles « De faire ce que l'Education nationale n'a pas fait ».
Je le regrette, mais je ne mets pas un jeune de 25 ans en classe de CM1, je dois lui faire suivre une formation. Comme il ne peut plus être dans l'Education nationale et qu'il existe une décentralisation de ces fonds, il faut que les régions acceptent les préformations qui sont les conditions pour que ces jeunes aillent vers ces métiers. C'est également une des difficultés que nous avons pour recruter dans ces métiers.
Mme Nicole Bricq.- C'est une question périphérique qui entre dans le cadre de notre mission et dans celui de la loi contre les exclusions. Nous avons voté une disposition qui consiste à accorder un cumul partiel entre le RMI et le retour à l'emploi. Sommes-nous en capacité de montrer que cette disposition législative a des vertus incitatives vers le retour à l'emploi en termes quantitatifs ou qualitatifs ?
Mme Martine Aubry.- Un problème d'application s'est posé, non pas en raison d'un retard des textes qui sont sortis immédiatement mais du fait que les Caisses Nationales d'Allocations Familiales ont changé leur réseau informatique et ont eu du mal à intégrer ce texte (elles le font actuellement). Des retards ont eu lieu dans certaines régions, mais pas partout, pour appliquer ce texte directement, afin de permettre le cumul partiel commençant à 100 % puis diminuant entre un minima social et un salaire. Ces difficultés sont quasiment derrière nous maintenant, mais il en existe encore.
M. Gérard Bapt.- Madame la ministre a salué les efforts de l'ANPE Nous le constatons en tant qu'élus locaux, elle s'est rapprochée des entreprises et des collectivités locales dont l `effort est également à saluer car elles ont souvent créé dans les mairies lors de missions locales des points d'emplois passant convention avec les ANPE pour avoir un rôle de prospecteur placier et d'orientation de proximité.
Madame la ministre, concernant le problème de l'adaptation des aides générales, pour aller directement à des questions qui ont été soulevées à l'occasion de la table ronde avec des chefs d'entreprise concernant des dispositifs dont nous pouvons nous poser le problème de leur efficacité, nous avons eu la surprise d'entendre les représentants du MEDEF et de l'UPA nous dire qu'ils préféraient des allégements de charges à une aide à l'embauche d'un premier salarié et critiquer les aides territorialisées, en arguant du fait que seules les grandes entreprises ayant capacité de recevoir, de traiter et de mettre en _uvre ces informations pouvaient s'en saisir du moins beaucoup plus que la PMI.
Pensez-vous que des économies budgétaires sont à faire sur ce type de dispositif ?
Mme Martine Aubry.- C'est une des questions les plus difficiles, car ce sont des questions que nous pouvons nous poser et la réponse est autant psychologique qu'économique. Quelle est l'appréciation de l`exonération (qui coûte 2,7 milliards de francs au régime général) en termes de créations d'emplois et d'effets d'aubaine ? Ce dispositif prévoit une exonération totale des cotisations patronales du régime général lors de l'embauche du premier salarié pour les entreprises, soit environ 250 00 F par an au SMIC.
Nous avons débattu de ce dispositif puisque nous l'avons modifié en plafonnant au SMIC la part de l'assiette pouvant donner lieu à cette exonération, à savoir une exonération forfaitaire et non pas proportionnelle au salaire comme c`était le cas précédemment. Il ressortait d'enquêtes menées auprès de chefs d'entreprise que sur 100 embauches en exonération premier salarié, 64 auraient eu lieu au même moment et avec les mêmes personnes sans l'exonération.
C'était un effet de pure aubaine fréquent pour les aides à l'embauche dans le secteur marchand et beaucoup plus élevé que d'autres dispositifs de la même enquête, puisque nous constatons seulement 9 % d'effets d'aubaine pour le Contrat d'Apprentissage, 12 % pour le Contrat de Qualification et 16 % pour le Contrat Initiative Emploi. C'est pourquoi nous avons transformé en cette exonération forfaitaire l'embauche du premier salarié.
Faut-il aller plus loin, la supprimer ? Nous pouvons difficilement aller au-delà. Je suis hésitante, car le passage à l'embauche du premier salarié est toujours difficile. La personne qui est seule avec son époux ou son épouse à travailler, par exemple dans un commerce ou une toute petite entreprise hésite, non seulement parce qu'elle s'engage vis-à-vis de quelqu'un d'extérieur à le payer, mais également en raison de toutes les démarches. Je ne suis pas encore convaincue qu'il faille aller au-delà et la supprimer, mais l'avis de votre Commission me sera tout à fait utile, car je n'ai pas de conviction définitive.
Sur les aides territorialisées, nous avons des travaux d'évaluation de l'IGAS et de l'Inspection Générale des Finances sur ces aides, à savoir les zones de revitalisation rurales et urbaines et les zones franches. Les travaux d'évaluation démontrent une faible efficacité en termes de création d'emplois.
Dans ces aides, nous visons deux objectifs : certes, si possible, des créations nettes d'emplois mais surtout des localisations différentes d'emplois par rapport à celles qui auraient eu lieu par ailleurs. C'est autant un élément d'aménagement du territoire et de lutte contre l'exclusion dans les quartiers ou dans des zones rurales qui est objectivement recherché, qu'une création nette d'emplois.
Parce que nous avons une zone franche, aucune entreprise ne se dira : « Il y a une zone franche, je vais créer des emplois ». En revanche, une entreprise qui aurait créé des emplois peut envisager de se placer dans cette zone franche en raison des aides complémentaires.
Donc, pas d'effet sur la création d'emplois mais, très certainement, une aide à l'affectation à la localisation vers des lieux qui en ont besoin.
A partir de là (je tiens à dire que nous travaillons avec Claude Bartolone sur ces aides), il n'a jamais été dans notre esprit - contrairement à ce que j'ai pu entendre - de les supprimer, mais d'éviter les effets d'aubaine de certaines d'entre elles.
Je me permettrai de vous donner un exemple personnel. Nous avons à LILLE une zone franche et, la plupart des terrains disponibles appartenant à la ville et ayant l'opportunité de dire oui ou non à une entreprise pour qu'elle s'installe, nous avons décidé d'être beaucoup plus stricts que la loi et, au lieu de considérer que seuls 10 % des embauches devaient se faire chez les habitants du quartier nous avons fixé un minimum de 50 % et nous sommes arrivés à 90 %. Nous avons refusé toutes les délocalisations qui ne créaient pas un minimum de 20 % d'emplois supplémentaires.
Pour quelqu'un qui était au c_ur de LILLE et venait s'installer dans la zone franche uniquement pour avoir les avantages, nous les avons supprimés ; nous avons également effectué une chasse aux boîtes aux lettres puisque la mairie de LILLE a envoyé, tant au fisc qu'à l'URSSAF, la liste des noms des entreprises, que nous avons relevés, et qui n'avaient qu'une simple boîte aux lettres et non pas une réelle activité sur le quartier.
Cette action qui nous a permis d'être une des villes qui a créé le plus d'emplois pour les habitants des quartiers, doit pouvoir être étendue dans la loi, en imposant un plus grand montant des emplois créés pour les personnes du quartier et, mon souhait - que d'après moi Claude Bartolone partage - est que les élus locaux puissent avoir un avis plus important à donner, car c'est bien localement que l'on sait si telle entreprise bénéficie uniquement d'un effet d'aubaine ou a une réelle activité et crée des emplois.
C'est autour de ces réflexions que nous travaillons actuellement avec l'idée que, dans ces domaines, il nous faut développer des partenariats locaux. C'est essentiellement autour des élus locaux en partenariat avec les entreprises, les associations et le service public que nous pourrons parvenir à avoir des démarches positives.
M. Pierre Méhaignerie.- Est-il possible d'expérimenter ce conseil d'orientation autour de l'ANPE et des forces locales dans les deux ans qui viennent avec 7 ou 8 expériences qui permettraient d'en voir l'efficacité ?
Mme Martine Aubry.- Cela existe déjà. Quand un élu entre dans cette démarche, il est possible de réfléchir à des expérimentations plus formelles et de proposer à un certain nombre d'élus d'entrer dans cette logique. Certains le font déjà et c'est totalement efficace.
De plus, une mission parlementaire a été confiée à Chantal Robin-Rodrigo et Pierre Bourguignon qui doivent nous remettre dans quelques jours le rapport sur les aides ciblées géographiques.
M. Gérard Bapt.- Monsieur le Président, concernant l'abattement de cotisations pour le temps partiel dont les répercussions sociales posent des interrogations, il existe sûrement des divergences de point de vue, notamment entre M. Jacques Barrot et moi-même, sur l'opportunité de conserver ou de supprimer cet abattement pour le temps partiel, concernant un temps partiel qui est largement subi quand il s'agit de salariés chefs de famille, ce qui revient à les faire vivre à la limite de la pauvreté.
Quelle est votre opinion, ou votre intention, sur cette mesure qui coûte 2,8 milliards de francs de perte de recettes pour le régime général ?
M. Jacques Barrot.- Je me permets, pour être bien clair, de préciser que, me concernant, je suis pour le maintien de l'aide, mais en partageant le bénéfice entre l'entreprise et le salarié. C'est une nuance. Je reconnais que le système qui ne bénéficie qu'à l'entreprise n'est pas satisfaisant.
M. Martine Aubry.- Si vous ne l'avez pas fait, Monsieur le ministre, c'est que vous savez que c'est difficile à réaliser. Nous pouvons y parvenir avec la baisse des charges sociales. Nous avons modifié un certain nombre de dispositifs sur le temps partiel l'année dernière, puisque nous avons réservé les exonérations sur les temps partiels aux entreprises qui ont signé un accord définissant les modalités qui garantissent que le temps partiel est pratiqué à la demande du salarié.
L'esprit est d'aller vers le temps choisi et non pas d'aider ces entreprises qui imposent ce temps aux salariés. Nous avons relevé le plancher d'heures ouvrant droit à l'aide, de 16 à 18 heures et nous avons supprimé l'avantage excessif qui cumulait la ristourne Juppé et la ristourne temps partiel car, auparavant, pour un mi-temps à deux SMIC horaires cumulant la ristourne avec l'abattement temps partiel, l `exonération atteignait 90 % des cotisations patronales de Sécurité Sociale.
Le sujet du temps partiel sera traité dans les deux lois, la deuxième sur la RTT ainsi que celle sur les charges sociales.
Je ne vous en donnerai pas aujourd'hui le détail, car nous sommes en pleine concertation et nous n'en sommes pas arrivés à ce point. Je peux néanmoins vous en donner deux axes majeurs. Il nous semble qu'il faut aller vers une définition du temps partiel, qui soit celle de tous les autres pays européens et accroisse la clarté et simplicité, à savoir que « le travailleur à temps partiel est celui qui est au-dessous de la durée collective affichée dans l'entreprise ».
Nous devons favoriser au maximum ce temps choisi. A cet égard, il existe de nombreux accords de passage aux 35 heures extrêmement intéressants concernant le temps partiel. Non seulement parce que certains temps partiels ont pu augmenter, en passant du temps subi faible à du temps plus élevé, mais également parce que de nombreuses modalités laissent le choix de passer du temps plein au temps partiel et inversement, de manière beaucoup plus souple qu'auparavant. Nous devons nous appuyer sur ces accords extrêmement intéressants.
Nous devons entrer dans une logique où les charges sociales et leur réduction soient proratisées au niveau du temps partiel. Compte tenu que nous allons avoir une baisse des charges sociales globales, le pourcentage de la baisse de charges sociales devra correspondre, pour l'employeur, à la durée du travail. Ma conviction profonde est que le but de la réforme des charges sociales que nous engageons (dont je rappelle que le montant excède largement le coût de la durée du travail, avec une baisse de ces charges sociales, notamment pour les bas salaires) est d'avoir un double objectif : un objectif de création d'emplois, mais aussi un objectif de traiter les problèmes des bas salaires dans un certain nombre de professions.
Je crois qu'un certain nombre d'entre elles, celles qui utilisent beaucoup de temps partiel, attendent cette réforme des charges sociales pour traiter les deux problèmes conjointement.
M. Jean-Jacques Jégou.- Sur le problème du temps partiel subi, un certain nombre d'entreprises n'ont pas l'utilité de salariés à temps complet. Dans des entreprises que je connais dans mon secteur, s'est mis en place « le temps partagé » avec des cadres d'un certain âge qui retrouvent du travail entre deux ou trois entreprises et, d'après moi, l'aide pourrait être accentuée dans ce domaine. Ce processus a été long à démarrer, car il n'est pas dans la culture de notre pays mais il est avantageux de pouvoir redonner du travail à des cadres de haut niveau que certaines PME n'ont pas la possibilité d'employer à temps complet, soit parce que la charge de travail n'est pas suffisamment importante, soit parce que c'est hors de leurs moyens.
Il faut se méfier, sur un autre sujet, du travail en entreprises temporaires qui est une possibilité d'avoir accès de nouveau à l'emploi, mais je pense à ces créations d'entreprise où il existe de nombreuses demandes qui pourraient être accélérées en favorisant ce temps partagé dans certains postes de haut niveau et de cadre.
M. Pierre Méhaignerie.- Vous avez dit que les 35 heures pouvaient améliorer l'image de certains emplois où les jeunes ne veulent pas aller. Je partage cet avis. Cela supposerait que la démarche sur la fonction publique n'aille pas vers 35 ou 32 heures en plus des autres avantages car, dans ce cas, l'affluence sur le secteur public ne serait encore que renforcée. C'est la question de la différenciation comme élément de justice.
Vous avez également déclaré que la baisse du coût du travail dans le cadre des 35 heures, SMIC, jusqu'à 1,8, excédera le surcoût du travail 35 heures. Or, le calcul que nous avons ne compense que 6,5 % du surcoût de 11,4 %, si nous y ajoutons les 4 000 F, plus ce qui est prévu et qui reste en pointillé.
Un problème de mot se pose. Soit il ne convient pas d'appliquer le mot « baisse des charges » s'il s'agit d'une compensation partielle, soit en effet, si nous allons plus loin, nous pourrons accepter le mot de baisse des charges, mais dans le cas présent, nous restons dans l'ambiguïté.
Mme Martine Aubry.- J'ai oublié de dire que nous pensons qu'il faut que le temps partagé non seulement existe mais soit développé, ce qui est déjà le cas. Une bonne façon d`y parvenir est aussi de rendre plus facile les groupements d'employeurs. J'avais demandé un rapport à M. Praderie qui m'a été rendu.
Dans la loi sur la durée du travail nous souhaitons rendre plus facile les groupements d'employeurs qui sont une facilité pour les salariés, car un certain nombre de petites entreprises pourraient voir dégager le chef d'entreprise de tâches comptables et administratives en partageant à plusieurs un comptable ou un commercial. Nous comptons faciliter et favoriser la mise en place de ces groupements d'employeurs.
Un mot sur les charges sociales, pour dire que je ne vous donnerai pas aujourd'hui la totalité des dispositifs, car nous sommes en pleine concertation sur ce dispositif.
Monsieur le ministre, quant j'utilise des mots, j'essaie de faire en sorte qu'ils soient conformes à la réalité. Quand je dis que c'est bien un allégement des charges sociales auquel nous parviendrons, c'est bien évidemment pour les salariés non qualifiés, et principalement les bas salaires, que la réduction des charges sociales qui sera proposée par le gouvernement ira au-delà du coût du travail pour ces bas salaires.
C'est la raison pour laquelle l'UPA, la dernière organisation que j'ai rencontrée, mais aussi certaines fédérations appartenant au MEDEF avec qui nous avons commencé à débattre de ce barème, se réjouissent de cette réforme. J'espère que vous me croirez sur parole qu'il est évident que nous ne baissons pas les charges sociales pour ne pas les baisser. Nous les baissons pour les baisser, pour les bas salaires.
M. Pierre Méhaignerie.- Dans le cadre des 35 heures.
M. Didier Migaud.- Ont été mis en place dans les différents pays de la Communauté Européenne des plans d'action nationaux pour l'emploi. Quel enseignement pouvons-nous tirer de la surveillance multilatérale de ces plans d'action nationaux institués au niveau communautaire, quant à l'efficacité réelle des différents modèles nationaux de politique de l'emploi ?
Mme Martine Aubry.- Monsieur le député, je pense que ces plans nationaux d'action pour l'emploi sont une innovation tout à fait positive. Quand le Premier ministre, à son arrivée, les avait demandés au Conseil Européen de Luxembourg pour l'emploi, tout le monde - et peut-être nous-mêmes - était assez sceptique sur ce à quoi nous pouvions arriver. Pour avoir assisté à de nombreux conseils des ministres des Affaires Sociales, derrière mon ministre, ou en tant que ministre, depuis 20 ans c'est la première fois que nous arrivons à traiter de manière précise et quantifiée des objectifs en matière d'emploi au niveau européen.
Je considère que ces plans nationaux d'action pour l'emploi, qui doivent beaucoup au travail effectué par le Président en exercice du Conseil, qui était le Premier ministre du Luxembourg, au moment où ils ont été adoptés et qui n'a pas accepté que nous restions dans des formulations générales mais que chaque gouvernement s'engage sur des objectifs quantifiés et vérifiables, sont des éléments essentiels dans plusieurs domaines, à la fois sur le nouveau départ (car c'est ainsi que cela a été appelé pour les jeunes sans qualification et les chômeurs de longue durée), sur le travail que nous pouvons être amenés à faire pour les personnes handicapées, sur la meilleure intégration des femmes sur le marché du travail mais, au-delà, sur la surveillance multilatérale et l'échange de bonnes pratiques.
Nous n'en sommes qu'au début et je ne peux pas vous dire aujourd'hui : « C'est formidable, nous avons tout appris des uns et des autres », mais nous commençons à échanger sur ce que nous faisons.
Nous concernant, les emplois jeunes ont beaucoup intéressé nos voisins : Tony Blair a mis en place cette disposition dans le cadre de son « new deal », en partie, les Hollandais également et, aujourd'hui nous sommes questionnés par les Espagnols et les Italiens sur ce programme.
A l'inverse, je suis extrêmement intéressée de comprendre et de voir ce qui se passe en Italie sur le développement local, où les Italiens ont réussi à faire travailler en réseau les PME, les secteurs bancaire et industriel autour de démarches qui ne sont pas éloignées de celles que soulevait M. Pierre Méhaignerie, à savoir une mise en cohérence dans les bassins d'emplois entre les collectivités locales, le secteur financier et les entreprises.
Nous savons très bien que notre pays centralisé, peut-être au niveau de l'État mais tout autant au niveau des banques et des grandes entreprises, est aujourd'hui un frein au développement local et à celui des PME alors que c'est là où se trouve l'emploi de demain.
Je pense que le MEDEF a un rôle important à jouer en la matière et quand nous voyons que la grande distribution serre de manière extrêmement forte les petites et moyennes entreprises, que les grandes entreprises françaises ont toujours des délais de paiement extrêmement élevés par rapport à leurs sous-traitants, que le secteur bancaire français s'intéresse beaucoup moins au développement régional et local peut-être parce que nous avons moins de banques régionales et locales, ce n'est pas par hasard que les banques installées régionalement, aident aujourd'hui au développement des PME
Si le MEDEF a un rôle à jouer, c'est aussi de voir au sein des entreprises comment effectivement aider à leur développement et non pas à leur étranglement comme c'est le cas actuellement dans certains secteurs.
Ce qu'on fait les Italiens en la matière nous intéresse profondément. De la même manière, nous regardons les Pays-Bas - non pas pour sortir, comme ils l'ont fait, des centaines de milliers de personnes du chômage pour les nommer « handicapées », car c'est une réduction du chômage qui ne me paraît pas extrêmement saine- et nous tentons à l'inverse de faire que ceux que l'on appelle des « handicapés sociaux » et que je ne me résous pas à considérer comme devant rester dans l'assistance, entrent au c_ur du marché du travail.
En revanche, autour du travail à temps partiel, nous avons vu, sur le développement d'un temps choisi, des éléments intéressants aux Pays-Bas qui peuvent nous interpeller.
J'ajoute que le Premier ministre part au Danemark, demain et après-demain, pour regarder les exemples danois en matière de créations d'emplois où des expériences peuvent nous être utiles. Je ne pense pas pouvoir dire que les plans nationaux d'action pour l'emploi nous ont permis d'aller très loin en la matière mais qu'une dynamique commence.
M. Gérard Bapt.- Nous passerons au problème de l'allégement des cotisations patronales, sachant que vous ne pourrez pas répondre à toutes nos interrogations sur des questions en cours de réflexion et d'arbitrage au sein du gouvernement pour être ensuite examinées par le Parlement.
A été annoncée la réforme de la ristourne unique dégressive avec l'augmentation à 1,8 fois le SMIC du plafond de salaire auquel cette ristourne nouvelle mouture s'appliquera. Pourriez-vous donner quelques informations à cet égard ?
De plus, à l'occasion de l'examen du rapport sur le problème de la réforme du prélèvement social de l'entreprise, il a surgi ici - et je parle sous le contrôle de mes collègues de l'opposition - un consensus pour une réforme qui aurait pris en compte la référence à la valeur ajoutée dans ce prélèvement social.
Des interrogations se posent, concernant le type de financement de cette mesure - quelque 20 milliards de francs - s'agissant soit d'une recette quelque peu aléatoire, la base de l'impôt sur les sociétés, qui par ailleurs peut être considérée comme pouvant donner lieu à délocalisation de la part de groupes multinationaux et d'autre part, l'assiette éco-taxe qui semble ne pas être très adaptée à l'idée de pérennité de la ressource de la protection sociale concernant une taxe qui vise à limiter l'effet de pollution et de production de CO².
M. Augustin Bonrepaux, Président.- Il faut tout d'abord en rester à notre rôle d'évaluation et de contrôle et passer ensuite aux questions qui peuvent vous intéresser.
Madame la ministre, il conviendrait que vous nous indiquiez quels sont les défauts des mécanismes qui existaient jusqu'à présent, en particulier de ceux de la ristourne dégressive qui appelle des corrections, et ce que vous envisagez de faire pour la corriger.
Cela nous avait conduits à soumettre ces questions des aides à l'emploi à une étude dans le cadre de l'Office, car nous ignorions quels étaient les effets de cette ristourne.
Pouvez-vous nous dire les effets de cette réforme et les défauts du mécanisme qui appellent des corrections ?
M. Philippe Auberger, co-Président.- Vous avez raison, Monsieur le Président, il faut recadrer notre débat. Nous sommes une Mission d'Evaluation et de Contrôle. Nous n'avons pas à nous saisir des projets qui ne sont pas élaborés par le gouvernement.
Quand vous êtes venue, Madame Aubry, à différentes reprises devant la Commission des Finances, vous nous aviez dit que vous vous posiez des questions sur la ristourne Juppé que vous trouviez coûteuse, qu'elle conduisait à des effets d'aubaine et que les chiffres de créations d'emplois qu'elle avait pu générer étaient sans doute faibles.
C'est le constat que je croyais avoir entendu les années précédentes.
Nous n'avions pas d'éléments précis et je crois que nous n'en avons toujours pas, pour savoir si nous pouvons partager ce jugement ou pas. Nous souhaiterions savoir, alors que vous allez réutiliser - si nous avons bien compris ce que nous a expliqué hier M. Dominique Strauss-Kahn - en quoi ces 43 milliards de francs sous une autre forme de ristourne qu'il a dénommée la « ristourne Aubry »
En quoi la ristourne Aubry/Strauss-Kahn sera-t-elle différente de la ristourne Juppé et permettra-t-elle de remédier aux défauts que vous aviez décrits concernant cette dernière ?
M. Jean-Jacques Jégou.- Sur l'expression de recyclage qui a été employée par le ministre en Commission de Finances hier, je suis tout à fait d'accord avec les propos du Président Auberger sur le fait que notre mission d'évaluation et de contrôle est de voir la façon dont varieront les aides et quels sont les changements qui peuvent advenir sur l'utilisation de l'argent public.
Mme Martine Aubry.- J'ai été amenée à plusieurs reprises à parler de ce problème des bas salaires et j'aimerais, Monsieur Auberger, que vous vous reportiez à ce que j'ai dit et écrit.
J'ai écrit deux livres qui comportent chacun un chapitre sur ce sujet et nous avons eu un débat extrêmement important lors de la proposition de loi présentée par M. Barrot sur les charges sociales, l'année dernière au mois de décembre. Je n'ai jamais dit que la ristourne dégressive était trop coûteuse et avait entraîné des effets d'aubaine. Je lui ai fait d'autres critiques que je rappellerai.
Je vous cite ce que j'ai déclaré le 30 janvier 1998 lors de la discussion de cette proposition de loi : « Que ce soit au moment de la discussion du budget ou lors de l'examen de la loi de financement de la Sécurité sociale, ou tout au long des derniers jours, j'ai toujours dit très clairement que nous estimions nous aussi dans notre grande majorité qu'il y avait dans notre pays un véritable problème des charges pesant sur les bas salaires ».
J'ai repris les critiques que j'apportais aux systèmes qui avaient été mis en place.
Il existe un problème de coût du travail sur les bas salaires, les emplois non qualifiés dans notre pays. Nous ne sommes pas les seuls, l'ensemble des pays de l'OCDE, ont plus ou moins été confrontés à cette question, l'Allemagne et les Pays-Bas, ces derniers ayant baissé les charges sociales. L'Allemagne a des salaires réels trop élevés et nous-mêmes avons une part des charges sociales (et non pas un salaire de base) élevée, qui entraîne un coût du travail des salaires non qualifiés aujourd'hui important, pose problème au moment de l'intensification de la concurrence internationale et doit nous amener à y réfléchir.
La réponse que nous souhaitons apporter n'est pas celle de certains pays anglo-saxons, à savoir de baisser le salaire réel et d'avoir une flexibilité du salaire versé au salarié vers le bas, mais de s'intéresser au financement de la Sécurité Sociale et aux charges sociales qui portent sur les salaires dans notre pays.
C'est, d'après moi, le même raisonnement qui a entraîné le gouvernement précédent à mettre en place la ristourne dégressive. Je n'en conteste pas les objectifs ni le diagnostic puisque nous avons fait le même. Je ne dis pas qu'il soit trop coûteux, car je m'apprête à le multiplier par 2,5 et je ne dis pas, non plus, qu'il a donné lieu à des effets d'aubaine car, autant quand nous instituons un dispositif du type initiative emploi nous mesurons le nombre de chômeurs de longue durée de plus, qui sont embauchés par rapport à la période antérieure autant, quand il s'agit d'exonération de bas salaires, il est extrêmement difficile d'en mesurer la part dans les créations d'emplois qui auraient lieu par la suite.
Tous les économistes nous disent qu'effectivement sur le moyen et le long terme, nous sommes capables de mesurer l'effet en termes de créations d'emplois d'une baisse des charges sociales sur les bas salaires. C'est l`élément qui nous intéresse aujourd'hui.
Concernant la ristourne mise en place par les gouvernements Balladur et Juppé, les économistes et les études qui ont été réalisées démontrent que la création d'emplois liée à ces 45 milliards de francs de ristourne dégressive est de l'ordre de 40 000 chaque année pendant 5 ans. Ces chiffres peuvent paraître faibles.
Un million de francs par emploi, par rapport à la RTT ou aux emplois jeunes, c'est beaucoup plus cher. Mais j'ai dit moi-même -Monsieur Auberger, et je vous demanderai d'avoir la gentillesse de vous reporter à ce débat- que je ne considérais pas qu'il fallait s'appuyer sur ces chiffres pour estimer qu'il ne fallait rien faire, car nous étions dans une période de crise.
On n'embauche pas parce qu'on a moins de charges sociales mais quand on a des besoins et, dans une période où la consommation était très basse, les années précédentes, où la croissance n'était pas là, ce n'est pas le fait de baisser les charges sociales qui génère de l'embauche.
Ma conviction profonde est qu'il y aura des créations d'emplois ou des emplois préservés et je crois qu'il faut le dire aujourd'hui alors que notre pays traverse sur le textile et l'habillement une crise majeure liée au fait, non pas seulement des compétiteurs extérieurs, de la Corée ou autres, mais que des pays comme la Turquie et le Portugal ont été aidés par les fonds de la Communauté Européenne pour se moderniser et nous font une concurrence effrénée y compris sur des produits de qualité.
J'ai traité ce sujet avec M. Van Miert car le plan Borotra était considéré comme illégal mais, en même temps, on ne peut pas aider d'autres pays de l'Union Européenne à se développer et à nous faire concurrence par d'autres biais, si nous n'avons pas le droit d'aider nos entreprises. Ce débat est clair.
Pour les secteurs exposés à la concurrence internationale, préserver les emplois en FRANCE et éviter les délocalisations, c'est aider à la baisse des charges sociales. De la même manière, pour beaucoup d'entreprises du commerce et de l'artisanat, les services aux personnes et les services de l'environnement, nous devons baisser le coût du travail, notamment non qualifié, et des bas salaires si nous souhaitons voir développer l'emploi plus rapidement que ce qui aurait lieu normalement.
Je pense à tous les problèmes des services aux personnes et de l'environnement. Ma conviction profonde est que nous devons faire cette réforme. J'ai critiqué la méthode qui a été utilisée par le précédent gouvernement sur les modalités et le mode de financement et non pas les objectifs.
Sur les modalités, parce que je crois au contraire que cette réforme était la moins coûteuse par rapport aux effets qui ont été entendus. La mise en place de cette pente extrêmement brutale a fait que l'on pouvait afficher une baisse du coût du travail jusqu'à 1,3 SMIC, mais la vérité est qu'il baissait véritablement entre le SMIC et 1,1 SMIC. A 1,2 SMIC, c'était négligeable et à 1,3 SMIC on était pratiquement à zéro.
Les baisses ont été concentrées, pour en limiter le coût, en bas de l'échelle des salaires, ce qui a eu sans doute un effet en matière d'emploi et nous le mesurerons dans l'avenir, mais également un effet social extrêmement lourd qui est un effet de trappe à bas salaires ainsi que de pousser les entreprises à rester avec des bas salaires afin de pouvoir bénéficier de ces réductions de charges sociales.
J'ai critiqué les modalités choisies et nous travaillons au contraire sur une courbe lissée qui n'entraîne pas cet effet de rupture et ce cassage qui est une trappe à bas salaires dans notre pays.
Nous en avons critiqué le mode de financement puisque cette ristourne dégressive de 45 milliards de francs a été financée par une augmentation de la taxe sur la valeur ajoutée qui en a limité les effets, car l'augmentation de la TVA est supportée par les ménages et, dans une période où il était nécessaire de relancer la consommation, on a « tapé » sur la consommation. Cela n'a pas été financé par les entreprises, vous l'avez suffisamment dit pour que cela puisse être repris, mais quand ce ne sont pas les entreprises, ce sont les ménages.
M. Philippe Auberger, co-Président.- Les analyses démontrent que les payeurs définitifs de la T.V.A. sont pour partie les ménages entre la moitié et les deux tiers, pour partie les administrations et pour partie un certain nombre d'entreprises qui n'ont pas la possibilité de déduire la T.V.A. et sont encore nombreuses : la banque, l'assurance et autres où la T.V.A. n'est pas généralisée. Le partage est un peu différent.
Mme Martine Aubry.- Je ne veux pas engager de polémique dans un travail aussi sérieux. 95 % ont été payés par les ménages mais, à court terme, c'est la consommation qui en a subi les conséquences et ce n'est pas un hasard si nous nous sommes trouvés à 0,5 % au-dessous de la moyenne en termes de taux de croissance par rapport aux pays européens, alors que, depuis, nous avons relancé la consommation en arrêtant de pénaliser les ménages et, notamment, ceux qui consomment beaucoup.
En effet, ceux qui sont d'abord touchés par la T.V.A. sont les ménages qui ont une propension à consommer très élevée et dépensent tout ce qu'ils gagnent, à savoir ceux qui ont les revenus les plus bas. C'est bien un des éléments qui a contribué au fait que la consommation soit faible dans notre pays et que le taux de croissance soit inférieur à celui de nos voisins alors qu'avec la politique inverse, nous avons aujourd'hui un taux de croissance supérieur de 0,5 % à la moyenne européenne.
C'est bien parce que nous ne voulons pas agir ainsi que nous prévoyons de financer autrement cette baisse des charges sociales et ce avec trois principes :
· Une réforme qui mobilisera des moyens importants autour de 110 milliards de francs, 2,5 fois plus que la ristourne Juppé, ce qui prouve que je ne considérais pas que le montant global était trop élevé.
· Une réforme qui ne fera pas appel aux ménages, mais qui procédera par rééquilibrage entre entreprises, entre les entreprises capitalistiques et les entreprises de main-d'_uvre dans un objectif d'aider les PME, les entreprises de main-d'_uvre et les entreprises créatrices d'emplois.
· Une réforme qui supprimera la trappe à bas salaires.
A partir de là, je pense que votre commission peut être, je l'espère, dans sa totalité d'accord avec ce que je dirai, car vous tentez d'examiner la bonne utilisation des fonds publics.
Quand on met 1 F d'aide aux entreprises, est-on certain que cela a un effet ? Vous comprendrez pourquoi nous avons voulu lier cet élément aux 35 heures. Nous pensons que pour s'assurer que cette réduction des charges sociales ait une contrepartie, nous devons nous mettre dans une logique de l'affecter aux entreprises qui entrent dans une démarche favorable à l'emploi.
C'est parce qu'il n'est pas possible - et nous le savons tous - de mesurer un effet positif en matière d'emplois que nous ne pouvons pas lier la réforme des charges sociales aux seules entreprises qui créeraient de l'emploi. Ce serait aberrant, car nous serions amenés à aider les entreprises qui sont sur les marchés porteurs comme la téléphonie et à ne pas aider l'habillement qui se bat pour rester dans notre pays pour créer et préserver des emplois. L'indicateur création d'emplois n'est pas à lui seul le bon indicateur.
Il nous faut en revanche aider les entreprises qui se mettent dans une démarche favorable à l'emploi pour les préserver comme pour les créer.
C'est la raison pour laquelle nous avons pensé que l'accroche aux 35 heures, à savoir à des entreprises qui, de toutes les façons vont créer ou préserver de l'emploi dès lors qu'elles passent de 39 heures horaire collectif à 35 heures, était le meilleur moyen de nous assurer d'une contrepartie en matière d'emplois, qu'ils soient préservés ou créés.
Il existe un grand débat dans notre pays sur le fait que les emplois préservés ne sont pas des emplois. Parlez-en à ceux qui vont être licenciés et s'inscrivent à l'ANPE Ils considèrent que quand ils gardent leur emploi, cela a un effet sur l'emploi.
C'est bien pour cette raison que nous avons souhaité raccrocher cet élément aux 35 heures. Nous sommes là pour parler du passé et non pas de l'avenir, mais cela me permet de le dire : si nous accrochons cette baisse des charges aux 35 heures, ce n'est pas essentiellement pour compenser le coût des 35 heures, mais pour aller au-delà, et l'accroche aux 35 heures vise essentiellement notre volonté d'apporter cette baisse de charges sociales aux entreprises qui entrent dans une démarche de création ou de sauvegarde d'emplois par les 35 heures.
Financer le surplus au-delà du coût de la durée du travail, 25 milliards de francs en partie par l'impôt sur les sociétés et en partie sur une éco-taxe, me paraît aller en partie dans le sens que M. Gérard Bapt proposait, qui était de l'asseoir sur la valeur ajoutée qui implique les salaires, les impôts, et l'amortissement (ne pas taxer les impôts et l'amortissement ne paraît pas poser de problème) et les résultats, à savoir les profits, les résultats financiers et les placements qui peuvent être utilisés à l'investissement ou distribués ou placés.
C'est sur cette partie que nous allons financer pour la moitié la réduction complémentaire des charges sociales, uniquement pour les entreprises de plus de 50 millions de francs de chiffre d'affaires.
Cela signifie - et je reviens à la valeur ajoutée -, que nous touchons là une partie de la valeur ajoutée qui n'était pas jusqu'à présent sollicitée pour financer la Sécurité Sociale. C'est la partie qui nous intéresse car, dans le fond, avec une assiette valeur ajoutée (un prélèvement de 1 % fait 55milliards de francs), les 12,5 milliards de francs dont nous parlons équivalent à un peu plus du tiers des 55 milliards de francs de l'assiette valeur ajoutée. Puisque les salaires font 60 % de la valeur ajoutée, nous sommes dans la même logique.
Quant à l'éco-taxe, dont le ministre de l'Economie et des Finances s'occupe et même si je ne parle pas sur les dossiers de mes collègues qui les suivent particulièrement efficacement, je note que de toutes les façons, nous l'aurions eue, car elle sera une obligation au niveau européen. Les Allemands et les Anglais l'ont déjà mise en place et les Italiens s'y emploient.
Nous n'avons pas souhaité, comme les Allemands ou les Italiens, en faire seulement une contribution complémentaire sur les entreprises, mais affecter le produit de cette contribution, que nous aurions de toute façon faite, à la baisse des charges. Nous la redistribuons donc au sein des entreprises. Globalement, il n'y aura pas de prélèvement supplémentaire sur les entreprises, mais bien un transfert par cette éco-taxe et l'impôt sur les sociétés des grandes entreprises capitalistiques, vers les petites entreprises ou les entreprises de main-d'_uvre.
M. Gérard Bapt.- Concernant le problème de forme sur laquelle je ne vous demande pas une réponse immédiate, mais insiste sur la visibilité budgétaire concernant la façon dont un fonds d'affectation spéciale pourrait être créé et, de ce fait, sortirait du budget Travail et Emploi. Sans doute pourrons-nous en reparler dans le débat de la loi de finances ?
Avec la question de l'aide pérenne que M. Jégou, souhaite soulever, nous vous demandons de préciser si cette aide sera réservée aux entreprises qui sont entrées dans la loi d'orientation et d'incitation et sera la continuation des aides incitatives déjà données, ou si elle aura vocation à aller à toutes les entreprises et à être un complément d'allégement général des charges sociales, si elle est destinée à toutes les entreprises qui respecteraient ce qui sera la loi, à savoir le passage aux 35 heures de la durée hebdomadaire légale.
Mme Martine Aubry.- Nous décomposons aujourd'hui le problème puisqu'il existe des modes de financement différents. Pour l'entreprise, il y aura une annonce d'un barème général d'abaissement des charges sociales qui additionnera les 45 milliards de francs de la ristourne Balladur Juppé, les 40 milliards de francs de l'aide structurelle et les 25 milliards de francs de l'aide complémentaire : l'ensemble, 110 milliards de francs environ, donnera lieu à une baisse des charges sociales qui ira entre le SMIC et 1,8 fois le SMIC pour se terminer par l'aide structurelle de l'ordre de 4 000 F.
C'est bien un dispositif que nous mettons en place et qui sera réservé dans sa globalité aux entreprises qui seront passées à 35 heures. C'est un accompagnement de la loi mais, de toutes les façons, elles auront passé un accord sur les 35 heures.
M. Philippe Auberger, co-Président.- Elle peuvent faire 37 h ou 38 heures.
Mme Martine Aubry.- Elles ne le peuvent pas. Nous connaissons ce problème par c_ur.
M. Philippe Auberger, co-Président.- M. Strauss-Kahn nous a dit le contraire.
Mme Martine Aubry.- Il vous a peut-être parlé d'une phase de mise en place.
M. Philippe Auberger, co-Président.- Hier, peut-être sur une question de M. Méhaignerie ou de moi-même, M. Strauss-Kahn nous a dit qu'il n'y aurait pas de conditions nouvelles imposées à la ristourne Juppé et qu'elle ne serait pas liée aux 35 heures.
Mme Martine Aubry.- La ristourne Juppé perdure pour tous ceux qui ne passent pas à 35 heures. Nous ne revenons pas en arrière. M. Strauss-Kahn a eu raison de s'exprimer ainsi, mais la réforme que nous mettons en place, à savoir l'allégement bien plus important des charges sociales, s'appliquera aux entreprises qui réduisent la durée du travail à 35 heures. Elles peuvent faire quelques heures supplémentaires, mais ne peuvent pas dire : « Je passe un accord à 35 heures et je me place à 37 heures ou 38 heures tout au long de l'année ».
Toutes les aides qui existent depuis 1981 sur les CES, durée du travail, l'aide incitative que nous avons mise en place, nous amènent à vérifier que l'entreprise ne dit pas : « Je signe formellement un accord à 35 heures et je me mets à 37 ou 38 heures ». Au-delà de ce point, il n'y aura pas de conditions complémentaires. C'est un accompagnement qui vise bien évidemment à aider et à inciter les entreprises à passer aux 35 heures, mais c'est un accompagnement qui va au-delà du coût de la RTT
M. Pierre Méhaignerie.- Cette politique peut être intéressante dès lors que conjointement l'État parvient à assurer une maîtrise des dépenses publiques. Cette politique peut être parfaitement valable et justifiée dès lors que nous n'appliquons pas la même politique à tout le secteur public avec les conséquences qu'il y aurait sur la dépense publique.
Mme Martine Aubry.- J`entends votre remarque, mais je ne réponds pas à une question qui n'est pas encore arbitrée et, compte tenu que je m'occupe essentiellement du régime général, je préfère limiter mes réponses à ce champ.
M. Philippe Auberger, co-Président.- J'ai une question que peut-être le rapporteur spécial n'a pas osé poser, mais qui résultait de ce qui a été dit hier par M. Strauss-Kahn : sur les trois parties du financement (les 43 milliards de francs de la ristourne Juppé, les 25 milliards de francs des deux nouvelles mesures fiscales et environ 45 milliards de francs improprement appelés « recyclage »). Dans ce montant, si nous avons bien compris, une partie concerne l'UNEDIC, une autre la protection sociale, et une troisième le budget de l'État.
Sur cette dernière, je me permets de vous interroger dans la mesure où vous pouvez nous donner des indications. Votre budget sera-t-il mis à contribution pour cette partie, ou celui des charges communes concernant l'emploi risque-t-il d'être mis à contribution ? Dans l'affirmative, sur quel domaine particulier il y aurait-il « recyclage » de fonds budgétaires ?
Mme Martine Aubry.- Bien évidemment, l'État prendra sa part dans ce recyclage pour la part des entrées en termes d'impôts. De plus, il faut bien le dire, nous aurons des réductions, par exemple de dépenses RMI ou allocation de solidarité spécifique dès lors que le chômage s'améliorera. Cet élément doit être pris en compte dans la clé du recyclage. Nous sommes en pleine discussion avec l'UNEDIC avec qui nous avons de nombreux dossiers à traiter car, depuis quelques années, quantités de contentieux n'ont pas été résolus.
S'il n'y avait que le problème du recyclage à traiter, je m'en tirerai assez bien. Si je n'avais pas d'autres engagements pris et non résolus, ce serait plus facile.
Il aurait été préférable que l'ancien ministre des Finances et l'ancien ministre du Travail ne signent pas une lettre non seulement laissant, de manière définitive, les milliards donnés mais, également, en s'engageant à reprendre un prêt, dans quelques semaines, de 10 milliards de francs. Cet accord a été signé et c'est la première fois qu'un État signe un accord sans y mettre aucune clause de retour à bonne fortune.
C'est dire qu'en évoquant la bonne utilisation des crédits de l'État, il existe d'autres sujets à traiter que ceux dont nous avons parlé ce matin.
M. Augustin Bonrepaux, Président.- Nous observons qu'un certain nombre d'entreprises, dont par ailleurs les résultats ne sont pas négligeables, prévoient de licencier pour améliorer leurs résultats. Dans ces conditions, comment le Fonds National pour l'Emploi se comporte-t-il ? Laisse-t-il les entreprises réduire les emplois et donc améliorer les comptes, ce qui serait finalement au détriment des contribuables ?
Mme Martine Aubry.- Il faut répondre en plusieurs temps. Ainsi que je vous l'ai dit, le Fonds National pour l'Emploi qui finance essentiellement les préretraites et ce, à 80 % par l'État a, dans mon esprit, pour vocation d'aider les entreprises en grande difficulté, ou les régions, ou les secteurs où il existe des licenciements importants avec des personnes qui auraient du mal à retrouver un emploi.
Vous vous souvenez que j'avais eu un petit conflit avec M. Jacques Calvet en 1992 parce que j'avais considéré que le fait que l'État verse 1 milliard de francs par an en préretraites au secteur automobile se justifiait peut-être au moment de la grande crise automobile, mais ne se justifiait plus quand le résultat des entreprises devenait positif.
Cette logique m'a amenée, dès mon arrivée en juin 1997, à prévenir les entreprises automobiles qu'il n'y aurait plus un 17ème et un 18ème plan social en 1998 et 1999 comme c'était le cas depuis 16 ans dans notre pays, et que le milliard versé chaque année en moyenne aux entreprises automobiles, au titre des préretraites, n'avait plus beaucoup de raison d'être au moment où elles affichaient des milliards de résultats.
Cela étant dit, je ne veux pas en tirer pour conséquence qu'un groupe, parce qu'il fait des résultats, ne devrait effectuer aucun mouvement de restructuration en son sein. Il est très possible d'envisager que, dans certains secteurs, des licenciements soient nécessaires pour s'adapter, bien que l'on gagne de l'argent par ailleurs et je ne pense pas que le fait de réaliser des résultats interdise de licencier. Il existe des nécessités de restructuration.
En revanche, ma conviction a toujours été la même : nous devons demander aux entreprises de contribuer à la hauteur de leur situation financière. La qualité du plan social - j'ai écrit à mes Services dès le mois de septembre 1997 - et la négociation entre l'État, ses représentants, la Direction Départementale du Travail et les entreprises sur la qualité du plan social, doivent dépendre de la situation de l'entreprise.
Nous devons être extrêmement sévères pour financer des préretraites si l'entreprise gagne de l'argent et ne fait pas elle-même des efforts pour replacer ses salariés, pour aider des entreprises à revenir dans son bassin d'emplois. C'est cette logique qui est aujourd'hui la nôtre quand nous parlons avec les entreprises.
Cela me semblait néanmoins insuffisant et il fallait aller au-delà.
C'est la raison pour laquelle, ainsi que je vous l'ai dit précédemment, je suis allée parler avec la Commission Européenne d'un nouveau dispositif de départ de retraite qui entraînerait une aide de l'État moins importante et s'appliquerait à des salariés qui auraient du mal à retrouver un emploi s'ils étaient licenciés du fait de leur âge ou de leur usure au travail, où l'État interviendrait de manière moins importante sur le plan financier, car les entreprises seraient susceptibles d'en financer en grande partie le coût.
M. Augustin Bonrepaux, Président.- Je vous remercie, Madame la ministre, des réponses très complètes que vous avez apportées.
____________
N° 1781.- Rapport d'information de M. Didier Migaud, Rapporteur général, déposé en application de l'article 145 du Règlement par la commission des finances, en conclusion des travaux d'une mission d'évaluation et de contrôle constituée le 3 février 1999.- Annexe 3 : Les aides à l'emploi.- Rapporteur spécial : M. Gérard Bapt.
() En septembre 1998, le METIS est devenu MATISSE (Modélisations Appliquées, Trajectoires Institutionnelles, Stratégies Socio-Economiques - CNRS - UMR n° 85 95).
() Christine Daniel, Droit social, Janvier 1998, Les politiques d'emploi : une révolution silencieuse.
() Perte d'emploi et passage par le RMI, DARES, Premières informations et Premières synthèses, n° 25-1, juin 1999.
() Jérôme Gautié, Les évaluations d'ordre micro-économiques : impact sur les bénéficiaires et effets directs sur l'emploi, in Les politiques de l'emploi en Europe et aux Etats-Unis, sous la direction de Jean-Claude Barbier et Jérôme Gautié, PUF, 1998.
() DARES, Premières informations et premières synthèses, novembre 1998, n° 46-1.
() Arnaud Gérardin, chargé d'études à l'UNEDIC, Croissance et emplois : quelques remarques, Droit social, Mai 1999.