N° 2072
______
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le mardi 11 janvier 2000.
RAPPORT D'INFORMATION
DÉPOSÉ
en application de l'article 145 du Règlement
PAR LA COMMISSION DE LA PRODUCTION ET DES ECHANGES (1)
sur l'évolution de la distribution,
ET PRÉSENTÉ
PAR M. JEAN-YVES LE DÉAUT,
Rapporteur,
en conclusion des travaux d'une mission d'information présidée par
M. JEAN-PAUL CHARIÉ,
et composée en outre de MM. Claude BILLARD, Alain COUSIN, Jean-Claude DANIEL, Léonce DEPREZ, Eric DOLIGÉ, Pierre DUCOUT, Philippe DURON, Jean PRORIOL, Jacques REBILLARD et Patrick RIMBERT,
Députés.
--
(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.
Commerce et artisanat.
La commission de la production et des échanges est composée de : M. André Lajoinie, président ; MM. Jean-Paul Charié, Jean-Pierre Defontaine, Pierre Ducout, Jean Proriol, vice-présidents ; MM. Léonce Deprez, Christian Jacob, Daniel Paul, Patrick Rimbert, secrétaires ; MM. Jean-Pierre Abelin, Yvon Abiven, Jean-Claude Abrioux, Stéphane Alaize, Damien Alary, André Angot, André Aschieri, François Asensi, Jean-Marie Aubron, Pierre Aubry, Jean Auclair, Jean-Pierre Balduyck, Jacques Bascou, Mme Sylvia Bassot, MM. Christian Bataille, Jean Besson, Gilbert Biessy, Claude Billard, Claude Birraux, Jean-Pierre Blazy, Jean-Claude Bois, Daniel Boisserie, Maxime Bono, Franck Borotra, Christian Bourquin, Mme Danièle Bousquet, MM. François Brottes, Vincent Burroni, Alain Cacheux, Dominique Caillaud, André Capet, Jean-Paul Chanteguet, Jean Charroppin, Philippe Chaulet, Jean-Claude Chazal, Daniel Chevallier, Pierre Cohen, Alain Cousin, Yves Coussain, Jean-Michel Couve, Jean-Claude Daniel, Marc-Philippe Daubresse, Philippe Decaudin, Mme Monique Denise, MM. Jacques Desallangre, Eric Doligé, François Dosé, Jean-Pierre Dufau, Marc Dumoulin, Dominique Dupilet, Philippe Duron, Jean-Claude Etienne, Alain Fabre-Pujol, Albert Facon, Alain Ferry, Jean-Jacques Filleul, Jacques Fleury, Nicolas Forissier, Roland Francisci, Claude Gaillard, Robert Galley, Claude Gatignol, André Godin, Alain Gouriou, Michel Grégoire, Gérard Grignon, Hubert Grimault, Lucien Guichon, Gérard Hamel, Patrick Herr, Claude Hoarau, Robert Honde, Claude Jacquot, Mme Janine Jambu, MM. Aimé Kergueris, Jean Launay, Thierry Lazaro, Jean-Yves Le Déaut, Patrick Lemasle, Jean-Claude Lemoine, Jacques Le Nay, Jean-Claude Lenoir, Arnaud Lepercq, René Leroux, Roger Lestas, Alain Le Vern, Félix Leyzour, Michel Liebgott, Lionnel Luca, Jean-Michel Marchand, Daniel Marcovitch, Alain Marleix, Daniel Marsin, Philippe Martin, Jacques Masdeu-Arus, Marius Masse, Roger Meï, Roland Metzinger, Pierre Micaux, Yvon Montané, Gabriel Montcharmont, Jean-Marie Morisset, Bernard Nayral, Jean-Marc Nudant, Jean-Paul Nunzi, Patrick Ollier, Joseph Parrenin, Paul Patriarche, François Patriat, Germinal Peiro, Jacques Pélissard, Mmes Marie-Françoise Pérol-Dumont, Annette Peulvast-Bergeal, MM. Serge Poignant, Bernard Pons, Jacques Rebillard, Jean-Luc Reitzer, Gérard Revol, Mme Marie-Line Reynaud, M. Jean Rigaud, Mme Michèle Rivasi, MM. Jean Roatta, André Santini, Joël Sarlot, Mme Odile Saugues, MM. François Sauvadet, Jean-Claude Thomas, Léon Vachet, Daniel Vachez, François Vannson, Michel Vaxès, Michel Vergnier, Gérard Voisin, Roland Vuillaume.
SOMMAIRE
___
Pages
ASSEMBLÉE NATIONALE 1
AVANT-PROPOS par M. Jean-Paul CHARIÉ, président de la mission d'information 9
INTRODUCTION 13
Les Supercentrales d'achat : de véritables oligopoles 14
La promotion tue-t-elle la production ? 15
I.- L'évolution de la distribution et du marché des produits de grande consommation en France 19
A.- Les grossistes : un stade indispensable 19
1. Le commerce de gros fournit des services indispensables 19
2. Le commerce de gros est menacé par le poids de la grande distribution 20
B.- La distribution 21
1. Définition et historique des différentes formes de points de vente au détail 21
2. Les parts de marché des différentes formes de commerce : le consommateur apprécie les grandes surfaces de vente comme le commerce de centre-ville ou de quartier 26
3. La puissance de la grande distribution française et son affrontement avec les grands fournisseurs 39
C.- L'impact du commerce électronique 108
II.- Les relations contractuelles entre fournisseurs et revendeurs 115
A.- L'abrogation, en 1996, de l'interdiction du refus de vente 115
1. La réforme de 1996 115
2. La libération du refus de vente doit être maintenue 120
B.- de la négociation commerciale à la domination commerciale 120
1. L'application des conditions générales de vente 126
2. La coopération commerciale : la poule aux oeufs d'or 132
3. L'application du principe de non-discrimination 146
4. L'abus de dépendance économique 150
C.- Le référencement 159
1. La notion de référencement et sa consistance 160
2. Le droit en vigueur 166
3. Quelques pratiques abusives relevées par la mission 167
D.- La rupture des relations commerciales 169
1. La menace de rupture 170
2. La rupture brutale des relations commerciales établies 172
III.- La gestion des prix 141
A.- La facturation 141
1. La réforme de 1996 141
2. Le droit en vigueur 143
B.- La revente à perte 149
1. La réforme de 1996 était nécessaire 150
2. L'analyse du droit en vigueur 155
3. L'interdiction de revente à perte est respectée 158
C.- Les prix abusivement bas 165
1. La mise en place de l'interdiction 165
2. Le droit en vigueur 166
3. L'application de l'interdiction des prix abusivement bas 169
D.- Les délais de paiement 172
1. Le règlement des factures 175
2. Les délais de paiement réglementés sont respectés sauf pour les achats de vin 177
3. La détermination des délais de paiement négociés contractuellement entre les entreprises conduit à des dérives 179
E.- Le double affichage des prix ne résout pas les problèmes 182
F.- Les promotions 185
1. Le droit en vigueur 186
2. Il n'y a pas eu application de ces dispositions jusqu'à présent 188
G.- Les soldes 189
1. Le droit en vigueur 190
2. La persistance d'une concurrence déloyale par des pratiques d'offres de prix réduits ou soldés 193
IV.- L'application de la loi par l'administration et les tribunaux 195
A.- L'action de la DGCCRF 195
B.- Les pouvoirs des agents de l'administration 197
C.- La place du conseil de la concurrence 200
1. Renforcer le rôle de prévention confié au Conseil de la concurrence et lui donner un rôle de médiation 201
2. Rendre le Conseil de la concurrence plus « réactif » aux atteintes à la concurrence 203
3. Mieux sanctionner les abus de dépendance économique 204
D.- Le droit européen se préoccupe avant tout du marché 205
E.- Les procédures contentieuses 207
1. La politique d'action publique en matière de relations commerciales 207
2. La difficulté de réunir les preuves 209
3. Les peines encourues sont insuffisantes 210
V.- Le droit d'établissement des commerces 213
A.- L'équipement commercial en place 213
1. Les grandes surfaces en activité 213
2. L'évolution des autorisations d'ouverture 216
B.- Les procédures d'autorisation prévues par la loi Royer 220
1. Le champ d'application du régime des autorisations 222
2. Les instances de décision 225
3. Les critères de décision des CDEC et de la CNEC 230
4. Les voies de recours contentieux 233
C.- Les schémas de développement commercial 234
1. Une autre conception de la concurrence 234
2. Les schémas reposent sur quatre objectifs majeurs 235
3. Les axes du dispositif législatif à mettre en place 236
D.- Le commerce de centre ville : les villes françaises sont-elles condamnées à devenir des villes à l'américaine ? 237
1. L'intercommunalité est primordiale 240
2. La modification des règles fiscales est indispensable 241
3. Engager un véritable partenariat avec les municipalités, les communautés, et avec l'Etat 242
E.- Les magasins d'usine 243
CONCLUSION 247
A.- La filière agricole 247
1. Mettre fin aux prix déstructurant le marché 248
2. Imposer le respect de la qualité et de l'origine 250
3. L'organisation professionnelle des filières agricoles et la nécessité de régulation des marchés 252
B.- Les règles de concurrence loyale dans les rapports entre fournisseurs et distributeurs 255
1. Faire appliquer la loi actuelle sur les relations contractuelles et la coopération commerciale 255
2. Redéfinir le cadre contractuel des relations avec les PME-PMI 258
3. Les délais de paiement fournissent une trésorerie à bon compte 262
4. Améliorer l'application de la loi 264
5. Mieux encadrer l'évolution du commerce 267
AUDITION DU 30 NOVEMBRE 1999
DE LA COMMISSION DE LA PRODUCTION ET DES ECHANGES
271
EXAMEN EN COMMISSION 301
AVANT-PROPOS
par M. Jean-Paul CHARIÉ, président de la mission d'information
Stimuler l'initiative individuelle pour améliorer les conditions de vie des hommes, telle est la vertu de la libre concurrence.
Pour une société de progrès à dimension humaine, il n'existe pas de meilleur système économique. Il est exigeant. Il repose sur trois principes fondamentaux :
- le libre exercice de la concurrence : cette liberté doit être effective pour tout entrepreneur, quel que soit son statut, quelle que soit sa taille, quel que soit son domaine d'activité, quelle que soit son ancienneté. La libre concurrence doit être une compétition, certes saine, mais permanente. Elle ne réserve aucune priorité, aucune rente à qui que ce soit. Et les accords entre des partenaires (producteur-commerçant) ne doivent pas conduire à restreindre la concurrence ou à entraîner la constitution de monopoles, négations même de la concurrence ;
- le libre choix des clients : les consommateurs - finalité du système - assument une part majeure du bon fonctionnement de la libre concurrence. S'ils sont libres de le faire, ce sont eux qui choisiront les meilleurs produits et justifieront l'innovation et le progrès au meilleur rapport qualité-prix. Mais, les pouvoirs des consommateurs sont relativement limités, surtout dans un marché sans frontières, ni géographique ni technique ni culturelle, et reposant sur des méthodes pour « faire acheter » dépassant souvent la capacité de jugement de chacun. C'est la concurrence qui devrait permettre de dénoncer, mettre en garde, alerter les consommateurs... Mais, pour l'instant, cette maturité de la « publicité comparative » n'est pas atteinte ;
- pour garantir ces deux libertés, sans lesquelles la libre concurrence n'est qu'illusion, il est du devoir des pouvoirs publics de fixer des règles et de les faire appliquer. Ici comme dans tout autre domaine, la liberté des uns s'arrête à celle des autres. C'est vrai : il y a trop de règles et pas assez de solidarité. Mais le pire serait l'absence de lois. Les plus grands libéraux, les plus grands pays de liberté sont ceux qui appliquent des règles de vie en société et sanctionnent sévèrement leur non-respect !
Or ces droits fondamentaux sont bafoués, et la libre concurrence se retourne contre le progrès pour l'homme quand :
· des agriculteurs, dont pourtant les qualités de production répondent aux exigences nouvelles des consommateurs, croulent sous les dettes parce qu'ils vendent, à quelques centimes près, en dessous de leurs coûts de revient, leurs produits sur lesquels, par ailleurs, leurs clients dégagent plusieurs francs de marge. L'esprit de partenariat en libre concurrence ce n'est pas « tu payes ou tu meurs » ; il est « tu gagnes et je gagne » !
· Des entreprises qui, n'ayant plus le choix des réseaux de débouché, doivent payer pour être reçues, payer pour être référencées, payer pour être achetées, payer pour être en rayon, payer pour recevoir leur argent... Il est secondaire, à la limite, de savoir d'où viennent les responsabilités, de savoir si ce constat est - et il l'est - ou non généralisé. Le principe même d'obtenir ou d'accorder, sans contrepartie équivalente, des avantages qui condamnent la pérennité d'entreprises et donc restreignent la concurrence est contraire aux règles de la libre concurrence.
· Des grossistes qui assurent pourtant des fonctions essentielles tenant à l'organisation et la diversité de la distribution ne profitent pas des mêmes avantages que leurs concurrents de la « grande distribution ». On recommande aujourd'hui aux petites entreprises de la production ou du commerce de s'organiser entre elles ; or cette organisation était naturellement assumée par le stade de gros tant que celui ci n'était pas victime de pratiques discriminatoires.
· Des commerçants, de proximité ou spécialisés, de nos villes et de nos villages, supportent des charges supérieures, achètent plus cher et ne bénéficient pas des « marges arrières »... Comment peuvent-ils, dans ces conditions, rester concurrentiels ? Bravo à tous ceux qui y parviennent, mais à quel prix humain ? Si les pratiques étaient différentes, le commerce de centre-ville ne serait pas réduit en France à 20 % seulement du commerce global, alors qu'il représente 70 % du commerce en Grande-Bretagne. Si les pratiques étaient différentes on ne nous annoncerait pas, par exemple, qu'il n'est plus rentable d'ouvrir un commerce spécialisé de jouets dans une ville de moins de 35 000 habitants. La libre concurrence, c'est aussi un enjeu d'aménagement du territoire !
· Des consommateurs achètent « moins cher » de la viande... dans laquelle de l'eau a été ajoutée : même « moins cher », c'est un prix de l'eau encore trop cher ! Mais qui le leur dit ? On leur vend « moins cher » des produits bien présentés mais dont les qualités gustatives et diététiques ont disparu, qui ne sont pas mûrs ou qui pourrissent rapidement. Même moins cher, c'est encore trop coûteux pour des produits qu'on jette sans les consommer ou qui rendent malades. Que dire du développement de la politique des « remises » quand on fait une « bonne affaire » en achetant plus cher que chez le commerçant qui ne fait pas de remise ? La politique du « coûte que coûte moins cher » coûte très cher aux consommateurs et à notre société !
Ce ne sont que quelques exemples de dysfonctionnements de la libre concurrence. Mais, ce ne sont pas des exemples difficilement identifiés par quelques parlementaires en mal d'activité. Si, à l'unanimité de tous les groupes politiques, une mission parlementaire sur l'évolution de la distribution a été créée et menée, c'est que les problèmes sont réels et graves de conséquence pour notre société. Le seul souci des membres de la mission a été celui-là : nous ne sommes pas contre telle ou telle forme de commerce (lire, en annexe du rapport, l'éloge fait, une fois encore, par moi-même, aux apports des « grandes surfaces » à l'occasion de l'audition du 30 novembre 1999 de la commission de la production et des échanges) ; nous avons le devoir de dénoncer les pratiques contraires aux règles de la libre concurrence et de contribuer à les faire disparaître. Qui peut nous le reprocher ?
En saluant sans réserve la qualité d'écoute, d'attention et de travail des membres de cette mission et en particulier celle de Jean-Yves le Déaut qui en assuma la rédaction du rapport, il me reste deux points à souligner dans cet avant-propos :
- est-il acceptable de tenter, par des subventions publiques à l'efficacité aléatoire, de sauver des entreprises performantes, mais en déficit parce qu'exploitées par leurs partenaires commerciaux, alors qu'il suffirait de faire appliquer les règles de bon sens, de solidarité et morales qui doivent caractériser la libre concurrence ? Or c'est parfois l'administration chargée de les faire appliquer, qui les interprète en détournant la volonté du législateur (voir l'exemple sur les conditions générales de ventes que devraient avoir les grandes surfaces prestataires de services, dans la partie II du rapport). C'est une des raisons du mal français. Les textes législatifs peuvent et doivent être améliorés comme le proposent nos conclusions. Mais il est d'abord indispensable de faire appliquer les textes existants. Les gouvernements, par une volonté politique plus ferme, doivent faire évoluer des cultures et des attitudes au sein de certaines de leurs propres administrations. Notre travail de législateur est bien modeste s'il n'est pas correctement appliqué ;
- notre humilité est encore plus grande quand on mesure les enjeux que représentent la dimension internationale du marché (il est aujourd'hui moins coûteux pour une grande surface de faire venir certains produits d'Asie que de les acheter en France) ou l'arrivée imminente du commerce électronique (demain il suffira de parler, sans même procéder à une reconnaissance vocale préalable, à un ordinateur qui coûtera moins de 10 000 francs pour acheter dans le monde entier des services et produits en bénéficiant de conseils et de prestations supérieurs à ceux rendus par les commerçants traditionnels, les grands magasins ou les grandes surfaces).
Mais ce n'est pas pour nous décourager car, la France, grâce à ses entreprises, grandes ou petites, de la production ou du commerce, possède tous les atouts pour relever tous ces défis, si les rapports entre fournisseurs et distributeurs redeviennent de vrais rapports de partenariat et de solidarité.
LA GRANDE DISTRIBUTION, BOUC ÉMISSAIRE ?
J'ai accepté d'être le rapporteur de la mission d'information sur l'évolution de la grande distribution car les mouvements qui s'opèrent dans ce secteur sont stratégiques. Les capitaux et les transactions financières en jeu sont pharaoniques : 2500 milliards de francs par an de transactions commerciales sont régis par l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence.
Par ailleurs, la grande distribution française opère un mouvement de concentration sans précédent. Aujourd'hui, cinq groupes d'acheteurs se sont formés dans des « supercentrales d'achat » : Carrefour/Promodès, Leclerc/Système U (Lucie), Auchan, Cora/Casino (Opera), Intermarché. Le nouveau groupe Carrefour/Promodès dépasse 33 % des parts de marché dans 48 villes françaises de plus de 40.000 habitants. De ce fait, les rapports entre les producteurs de biens de consommation (70.000 entreprises, 400.000 agriculteurs) et les 60 millions de consommateurs sont analogues au passage dans le goulot d'étranglement d'un sablier. Au point d'étranglement du sablier, cinq groupements de distributeurs contrôlent la vente de plus de 90 % des produits de grande consommation.
Cette situation renforce de nouvelles craintes chez les fournisseurs des centrales d'achat de la grande distribution. Les agriculteurs ont dénoncé ces dérives en août 1999 lors d'une crise sur les fruits et légumes. Mais aujourd'hui beaucoup de responsables de petites et moyennes entreprises ont pris le relais de la contestation et exprimé leur ras le bol. Pour eux, la « coopération commerciale » est un euphémisme car elle est devenue pour la grande distribution « la poule aux _ufs d'or », leur permettant sans réelle contrepartie de réclamer toujours plus, menaçant de destruction le maillage national de l'agriculture et des petites et moyennes entreprises de l'industrie et du commerce.
La grande distribution n'apprécie pas, bien sûr, d'être considérée comme un bouc émissaire et prétend qu'à partir d'un problème réel concernant les prix agricoles, on a abouti à une revendication qui profite à certains grands groupes multinationaux. Loin de nous l'idée de procéder à une chasse aux sorcières. Les grands groupes de distribution français font partie des premiers groupes mondiaux. Leurs enseignes font travailler des entreprises françaises ; ils sont dotés d'une grande capacité d'exportation.
Il faut également prendre en compte le fait que ce mouvement de concentration est général et que le numéro 1 mondial Wal-Mart, qui vient d'acquérir Asda en Grande-Bretagne, réalisait en 1998 un chiffre d'affaires (131 milliards d'euros) 2,5 fois supérieur à celui de Carrefour/Promodès (54 milliards d'euros).
De ce fait, les responsables des grandes enseignes affirment qu'il ne faut pas bousculer l'édifice législatif construit patiemment et qu'il faut affirmer le principe de la liberté des relations commerciales. Pour eux, la meilleure régulation n'est pas celle de l'intervention réglementaire de l'Etat, mais celle de la liberté des prix sur le marché.
Les 12 députés de la mission d'information, se sont donc immergés dans le monde de la distribution et ont décortiqué les pratiques qui régissent les rapports entre les producteurs de biens de consommation (agriculteurs, PME-PMI et grands groupes industriels) et la distribution. Nous avons cherché à être objectifs, écoutant les arguments des uns et des autres, les confrontant, les évaluant, pour au bout de près de cinquante auditions des principaux acteurs en France ou dans certains pays européens, livrer un diagnostic. Il correspond à l'avis unanime de la mission d'information.
LES SUPERCENTRALES D'ACHAT : DE VÉRITABLES OLIGOPOLES
Les concentrations dans la grande distribution ont conduit à de véritables oligopoles. Ceux-ci ont été confortés par la création de supercentrales d'achat. La part de marché de ces groupements de distributeurs constitue une menace pour le maintien d'une concurrence saine et loyale. Les marchés financiers ne s'y sont d'ailleurs pas trompés quand on constate l'évolution à la hausse des cotations des valeurs des grandes enseignes de distribution comparée à celle des valeurs de référence du CAC 40 et du Dow-Jones.
Sur les dix plus grosses entreprises mondiales dans l'agro-alimentaire, six sont aujourd'hui des groupes de distribution. Wal-Mart, (USA, n° 1), Carrefour/Promodès, (France, n° 3), Metro (Allemagne, n° 6), Kroger (USA, n° 7), Intermarché (France, n° 9), Ahold (Pays-Bas, n° 10) et seulement quatre sont des multinationales fabriquant différents types de produits de grande consommation : Philips Morris (USA, n° 2), Unilever (anglo-néerlandais, n° 4), Nestlé (Suisse, n° 5) et Procter & Gamble (USA, n° 8).
La fausse coopération commerciale : des pratiques inadmissibles qui se sont généralisées.
Alors que la situation est déjà jugée critique, on assiste depuis quelques années au développement de pratiques commerciales illégales ou à la limite de la légalité qui ont de graves conséquences sur la santé économique des exploitations agricoles ou des PME et PMI. La modification de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 interdisant la revente à perte a certes constitué une amélioration de la législation, mais les responsables de la grande distribution ont fait preuve d'une grande inventivité afin de contourner les règles légales afin de facturer aux fournisseurs des prestations commerciales sans rapport avec la réalité des prestations effectuées.
Les dirigeants de la grande distribution relativisent ces dérives et affirment qu'elles sont marginales. Tel n'est pas l'avis de la mission d'information qui pense au contraire que les pratiques dénoncées ne constituent que la partie émergée de l'iceberg, car les prélèvements financiers sans contrepartie se sont généralisés.
Nous ne voulons pas diaboliser le secteur de la distribution ; nous ne sommes pas les porte-parole de « syndicats d'industriels soutenus par plusieurs personnalités et différentes institutions », suivant l'expression du président d'Intermarché, mais nous avons le devoir de dénoncer les déviances que nous avons détectées, de tenter de rétablir des relations plus vertueuses et de proposer des systèmes de régulation.
Un duel de géants entre la grande distribution et les multinationales au détriment des PME.
Certes, les problèmes ne sont pas les mêmes suivant les différentes catégories de fournisseurs : agriculteurs, PME-PMI et producteurs multinationaux de biens de grande consommation. Alors que les grands groupes internationaux ont les moyens financiers de lancer un nouveau produit (ce qui correspond quelquefois à plus de 100 millions de francs d'investissement) et donc à imposer au distributeur des gammes entières de produits, les petits fournisseurs et les agriculteurs sont sans armes efficaces et sont obligés d'accepter leurs conditions, car la perte du client par déréférencement est synonyme de la disparition de l'entreprise. Dans un premier temps, ces pratiques ont entraîné une réduction importante des marges, ce qui a induit une limitation de la capacité d'investir. Cela a conduit à des concentrations dans la production. Là où il y a trente ans il existait 160 producteurs de pâtes alimentaires en France, il en reste aujourd'hui moins de 10. Il y a donc menace sur la diversité des marques et des produits. Le consommateur subit l'uniformisation de l'offre. Les centrales d'achat ont tendance à réduire au maximum le nombre de leurs fournisseurs pour abaisser les coûts, et parallèlement les multinationales réduisent le nombre de marques qu'elles mettent sur le marché.
La mission propose de réguler et de moraliser les rapports contractuels, car les petits fournisseurs sont les premières victimes de ce double duel de géants qui oppose, d'une part, les enseignes de distribution entre elles et, d'autre part, la grande distribution et les sociétés industrielles multinationales.
LA PROMOTION TUE-T-ELLE LA PRODUCTION ?
Dans la mesure où toute revente à perte est interdite, les grands groupes se disputent le consommateur à coups de bons d'achat, de rabais ou de promotions, en tirant très bas les prix indiqués sur les catalogues promotionnels et en exigeant des fournisseurs ces prix promotionnels. Les prix des fraises sont ainsi fixés au mois de mars, soit deux mois avant le début de la campagne, et la crise agricole du mois d'août 1999 était déjà scellée au mois de juin car ces prix « virtuels » avaient été négociés avant d'être imprimés sur les catalogues. La promotion tue donc la production.
Les sommes en jeu sont gigantesques, puisque chaque grande enseigne dépenserait entre deux et trois milliards de francs par an en promotion et publicité (1). C'est peu par rapport aux 20 à 30 milliards de « marges arrières » assurées (1). La bataille de géants entre distribution et multinationales est encore plus rude, mais aboutit aux mêmes effets. Les multinationales de l'agro-alimentaire qui, grâce à leurs propres campagnes publicitaires font la promotion de leurs produits, exigent de disposer de toujours plus de place sur le linéaire pour vendre leurs produits, éliminant de fait leurs concurrents moins puissants. Dans le domaine de la coloration, L'Oréal capte 81 % du marché en France, 77 % dans celui des produits coiffants, Unilever 51 % du marché de la margarine. Ces firmes multinationales ont paradoxalement intérêt à payer de la coopération commerciale puisqu'elles contribuent à asphyxier leurs concurrents.
La grande distribution, qui devrait soutenir les PME face à la concurrence et aux pressions des grands groupes industriels, ne le fait pas, car elle préfère ponctionner sans risque plusieurs milliards chaque année. C'est, selon l'avis des membres de la mission, une politique à courte vue car cette stratégie risque de conduire à la mort de la « poule aux _ufs d'or ».
Pour contrer l'offensive des multinationales de l'agro-alimentaire, la stratégie développée par la grande distribution est de fabriquer des produits sous leurs propres marques : les marques de distributeur. Il apparaît à la mission que le développement de ces marques de distributeur risque de placer encore plus les PME-PMI et les agriculteurs en situation de dépendance économique, car en cas de déréférencement, c'est la mort assurée d'une entreprise dépendant pour une grande partie de ses activités des commandes d'une supercentrale d'achat.
Le consommateur est devenu captif.
Le discours des grandes enseignes et des multinationales est répétitif : « on choisit pour vous des produits de qualité au prix le plus bas ». Ce n'est pas réellement exact car du fait des marges arrières prélevées par le distributeur, le prix du produit est en fait plus élevé qu'il ne devrait l'être. Certes, depuis l'interdiction de la revente à perte, il n'y a pas eu d'inflation, notamment sur les produits agro-alimentaires. Cela vient tout simplement du fait que les gains de productivité ont été repris par les marges arrières et que les marges bénéficiaires des petits producteurs ont fondu comme neige au soleil. En définitive, le consommateur est perdant, car s'il profite de prix bas sur certains produits d'appel (dans l'alimentation, ce sont 10 % à 15 % des linéaires), il paie le prix fort sur les autres. De plus, cette politique aboutit à l'uniformisation des produits. Les producteurs multinationaux veulent, pour réduire leurs coûts, diminuer le nombre de marques ; cette moindre diversité peut s'accompagner d'une baisse de la qualité car très souvent les innovations sont venues de petites entreprises qui n'ont plus aujourd'hui les moyens d'investir dans la recherche et le développement.
Le consommateur est donc de plus en plus captif, captif de la grande distribution car le commerce de centre-ville n'a pas toujours su s'adapter aux demandes du consommateur, captif du matraquage publicitaire qui lui est asséné à coups de spots télévisés par les marques, de catalogues dans les boîtes aux lettres et de pages de journaux par les enseignes de distribution, captif de la qualité des produits qui lui sont présentés sur les linéaires. On lui assure plus de sécurité alimentaire, mais pourquoi dans ce cas les distributeurs ne développent-ils pas plus la traçabilité, ne mettent-ils pas plus en avant les marques, les labels, les appellations d'origine, les produits du terroir. On lui parle d'agriculture raisonnée sans qu'un réel cahier des charges ne définisse les conditions dans lesquelles ces produits doivent être fabriqués.
On parle au consommateur de produits sans organisme génétiquement modifié (OGM) et certaines enseignes en ont même fait un argument publicitaire, alors que les tests de détection n'étaient pas encore au point et qu'aucun importateur de lécithine de soja n'est à même de prouver la totale séparation des filières avec OGM et sans OGM depuis la semence jusqu'au transformateur final, puisque des millions d'hectares de soja génétiquement modifiés sont cultivés dans le monde. L'affaire récente de la contamination à la dioxine des huiles animales originaires de Belgique l'a démontré : il est difficile de suivre à la trace des produits alimentaires dans un système de plus en plus mondialisé. Le consommateur ne sait plus qui croire.
La commission de la production et des échanges suit avec attention les questions d'urbanisme commercial et de droit de la concurrence. De nombreux rapports ont été établis sur ces sujets depuis la IXème législature (1988). Il convient de citer les rapports suivants :
- rapport présenté par M. Jean-Marie Bockel sur le projet de loi d'actualisation des dispositions relatives à l'exercice des professions commerciales et artisanales (n° 1764 du 28 novembre 1990) ;
- rapport d'information de MM. Jean-Paul Charié et Pierre Estève sur les délais de paiement entre les entreprises (n° 2610 du 15 avril 1992) ;
- rapports présentés par M. Pierre Estève sur le projet de loi relatif aux délais de paiement entre les entreprises (n° 2618 du 16 avril 1992, n° 2710 du 19 mai 1992, n° 2805 du 18 juin 1992) ;
- observations faites par M. Alain Brune (annexe au rapport n° 2941 du 10 octobre 1992 de la commission des lois) sur le projet de loi relatif à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ;
- rapport d'information de M. Jean-Paul Charié, « Un enjeu de société : vers une concurrence libre et loyale » (n° 836 du 9 décembre 1993) ;
- rapport d'information de M. Jean-Paul Charié, « Pour une libre concurrence à dimension humaine : redéfinir les règles de loyauté » (n° 2187 du 27 juillet 1995) ;
- rapports présentés par M. Jean-Paul Charié sur le projet de loi sur la loyauté et l'équilibre des relations commerciales (n° 2595 du 6 mars 1996, n° 2801 du 21 mai 1996) ;
- rapport présenté par M. Ambroise Guellec sur le projet de loi relatif au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat (n° 2787 du 14 mai 1996) ;
- documents de synthèse du secrétariat de la commission de la production et des échanges du 8 octobre 1996 sur les lois n° 96-588 du 1er juillet 1996 sur la loyauté et l'équilibre des relations commerciales (tome sur le droit de la concurrence) et n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat (trois tomes sur l'urbanisme commercial, le commerce et l'artisanat).
Votre rapporteur a repris dans le présent rapport d'information certaines des analyses du droit en vigueur et de l'évolution de la réglementation depuis 1945 contenues dans ces rapports, qui sont épuisés, en raison de leur caractère synthétique, des travaux d'études approfondies auxquels elles ont donné lieu et de la brièveté des délais imposés à la mission pour présenter son rapport. En effet, la mission d'information a été constituée le 20 octobre 1999 (après décision du 13 octobre de la commission de la production et des échanges) et a dû achever ses auditions le 22 décembre 1999 et ses travaux le 11 janvier 2000.
I.- L'ÉVOLUTION DE LA DISTRIBUTION ET DU MARCHÉ DES PRODUITS DE GRANDE CONSOMMATION EN FRANCE
A.- LES GROSSISTES : UN STADE INDISPENSABLE
1. Le commerce de gros fournit des services indispensables
Le commerce de gros est méconnu de nos concitoyens. Il assure pourtant l'approvisionnement de la quasi-totalité des grands hôtels, restaurants et services de restauration collective et de la majorité des petits commerces traditionnels. En outre, il constitue une interface dynamique entre les producteurs et importateurs et les points de vente au détail : de ce point de vue, il assure la sélection des produits, le suivi de la qualité, la définition des besoins du marché, l'enlèvement, le transport et le stockage des marchandises. Dans la filière des produits frais, le stade de gros gère le marché au jour le jour : il rend des services incontestables aux producteurs en amortissant les fluctuations quotidiennes du marché par une gestion dynamique des stocks et une évaluation prévisionnelle des besoins du marché tant au regard des quantités que des prix de vente (le commerce de gros effectue des péréquations permanentes de prix entre les livraisons des différentes unités de production). Le grossiste joue ainsi souvent un rôle de financier pour le petit producteur (les règlements sont rapides et des conditions de crédit sont offertes) et conçoit le circuit de commercialisation le mieux adapté à ses produits. En fait, le grossiste ne travaille plus à la commission mais fait du véritable négoce en achetant et revendant à ses risques.
Par rapport à une centrale d'achat de la grande distribution, la spécificité d'un grossiste tient à son obligation d'être en mesure de répondre à tous les besoins des commerces de détail et des hôtels-restaurants tant du point de vue qualitatif (variétés, produits spécifiques, etc.) que du point de vue quantitatif (livraison d'unités ou de tonnes), quel que soit le lieu ou le moment. Souvent le grossiste est conduit à devoir écouler ce que la centrale d'achat n'a pas voulu prendre chez le producteur car ne répondant pas à la demande de la majorité des consommateurs (certaines pièces de carcasses, par exemple) ou difficile à commercialiser en raison de sa nature (produit d'une qualité non normalisée, volumes insuffisants, etc.).
Le savoir-faire du grossiste est apprécié des producteurs qui ont l'assurance de discuter des contrats d'achat avec des acheteurs connaissant parfaitement le métier et les contraintes de la production. Le commerce de gros a, de ce fait, souvent un rôle de conseil auprès du producteur, sa relation avec la production reposant sur des engagements contractuels de longue durée.
L'importance sociale du commerce de gros est renforcée par sa capacité d'assurer un contrôle de la qualité et de la sécurité alimentaires. Cependant, on constate que la traçabilité se met en place plus lentement que dans le circuit de la grande distribution (pour des raisons techniques évidentes dues à l'éclatement de la filière de commercialisation).
En dernier lieu, le commerce de gros contribue de manière capitale à l'équilibre entre le commerce de proximité de centre-ville ou de quartier (petit commerce indépendant, halles, marchés) et le commerce de périphérie (hypermarchés et supermarchés, cash-and-carry), en permettant à cette première forme de commerce de survivre de manière indépendante. C'est pourquoi la mission invite les municipalités à associer les représentants du commerce de gros aux réflexions sur l'évolution et l'aménagement commercial des quartiers et des centre-villes.
2. Le commerce de gros est menacé par le poids de la grande distribution
Les statistiques de l'INSEE fournissent l'évolution suivante du nombre d'entreprises de commerce de gros et de leurs effectifs salariés et non salariés :
NOMBRE D'ENTREPRISES COMMERCIALES IMMATRICULÉES ET EFFECTIFS
(au 31 décembre)
nomenclature NAF |
1996 |
1997 |
1998 |
Intermédiaires de commerce |
37 162 |
35 630 |
36 812 |
CG de produits agricoles bruts |
8 154 |
8 077 |
7 966 |
CG de produits alimentaires |
20 193 |
20 210 |
20 095 |
CG de biens de consommation non alimentaires |
34 651 |
35 061 |
35 802 |
CG de produits intermédiaires non agricoles |
17 075 |
17 171 |
17 387 |
CG de biens d'équipement professionnel |
33 683 |
33 861 |
34 310 |
Autres commerces de gros, non classés ailleurs |
4 740 |
4 984 |
5 333 |
Commerce de gros (y compris intermédiaires) |
155 658 |
154 994 |
157 705 |
Effectifs salariés |
884 300 |
887 200 |
908 100 |
Effectifs non salariés |
51 100 |
51 300 |
n.d. |
Source : INSEE - fichier SIRENE France métropolitaine
La taille des entreprises de commerce de gros est modeste : selon les indications données par M. Arnaud de Morcourt, directeur général de la Confédération française du commerce de gros et du commerce international (CGI), 80 % d'entre elles emploient moins de vingt personnes mais 80 % d'entre elles réalisent également plus de 50 millions de francs de chiffre d'affaires. Les enquêtes de l'INSEE indiquent qu'en 1997, 52,8 % des entreprises du commerce de gros, y compris les intermédiaires du commerce, employaient de un à neuf salariés (soit trois en moyenne) et 32 % aucun. Les marges des entreprises sont cependant très faibles : les marges brutes sont comprises entre 6 et 12 %, voire 15 % pour les produits très périssables ; leur marge nette avant impôt est souvent inférieure à 1 %, soit deux fois moins que celle de la grande distribution.
Le commerce de gros est tout d'abord touché directement par la croissance des ventes en grande surface. Il souffre également du rachat des petits commerces traditionnels par les grandes enseignes de grande distribution ou de leur affiliation à des centrales d'approvisionnement de la grande distribution (par exemple, les petits commerçants Proxi de Promodès). En outre, il subit la concurrence des magasins cash-and-carry (surfaces de vente en gros et en détail spécialisées en alimentaire, réservées théoriquement aux professionnels mais dont les cartes d'adhésion sont largement distribuées auprès d'organismes et entreprises les plus divers) dont le marché est contrôlé à 95 % par les enseignes Metro (distributeur allemand) et Promocash (Carrefour) qui achètent en commun au sein de la même centrale.
Le texte de l'avis n° 97-A-04 du Conseil de la concurrence du 21 janvier 1997 relatif à diverses questions portant sur la concentration de la distribution est reproduit en annexe du rapport. Il est la dernière analyse officielle disponible de l'état du marché de la distribution en France (en 1996).
1. Définition et historique des différentes formes de points de vente au détail
Jusqu'en 1975, la vente au détail des produits de grande consommation hors boulangerie-patisserie et automobiles était majoritairement effectuée dans des petits commerces de moins de 400 m², de forme traditionnelle le plus souvent. A partir de 1990, les ventes dans les grandes et moyennes surfaces dépassèrent celles réalisées dans le petit commerce (voir les tableaux de la répartition des parts de marché ci-après).
a) Les anciennes formes de grande distribution
Jusqu'aux années 1970, la grande distribution française était dominée par trois formes de commerce :
- les grands magasins : cette forme de commerce est née en France et presque simultanément en Angleterre (fondation de la Belle Jardinière en 1824, du Bon Marché en 1852, du Bazar de l'Hôtel de Ville en 1855, du Printemps en 1865, de la Samaritaine en 1870, des Galeries Lafayette en 1895). Le concept repose sur le regroupement dans un même bâtiment d'une gamme très étendue de produits non alimentaires (à l'origine, essentiellement d'équipement de la personne) vendus à l'origine par des hôtesses puis aujourd'hui souvent en libre-service dans des rayons. Chaque rayon d'un grand magasin est considéré comme une surface de vente spécialisée disposant de personnels d'accueil chargés de conseiller le client. Les grands magasins louent également des stands à des fournisseurs. Les plus grands de ces commerces multispécialistes atteignent en France 50 000 m² ;
- les magasins populaires : cette forme de commerce est apparue aux Etats-Unis en 1879. Le premier magasin populaire fondé en France fut Uniprix en 1931 ; suivirent Prisunic (propriété du Printemps) en décembre 1931 et Monoprix (propriété des Galeries Lafayette) en 1932. Tati fut créé en 1949. Le concept reposait sur la vente de toutes les marchandises à un prix unique, le plus bas possible (10 F à l'origine, les quantités vendues et les poids des lots étaient calculés en fonction de ce prix) ; cette technique de vente a été abandonnée à la seconde guerre mondiale. L'assortiment est restreint à une offre de produits d'usage courant. Les magasins populaires proposent entre 7 000 et 10 000 références, essentiellement dans l'alimentaire, les cosmétiques, le bazar et l'habillement ;
- les succursalistes et coopératives de consommation : cette forme de commerce est apparue au XIXème siècle. Ces magasins, à dominante alimentaire pendant longtemps, ont été constitués en réseaux par des entreprises de gros à vocation régionale. Le concept repose sur la vente en libre-service avec un service aux consommateurs reposant sur une recherche de la qualité. Félix Potin a été fondé en 1844, Radar (sous la dénomination Dock Rémois) en 1887, Casino en 1898, Viniprix en 1932. Docks de France (enseignes Mammouth et Atac), les Comptoirs Modernes (enseignes Comod et Stoc), Promodès (enseignes Continent, Champion, ...) et Système U sont nés de cette forme de commerce. Cependant, avec la généralisation du super et de l'hypermarché dans les années 1970, cette forme de commerce a dépéri (réorientation de Casino, Promodès et Système U vers la vente en super et hypermarché, disparition de certaines Coop en 1985, dépôt de bilan de Codec en 1990).
b) Les nouvelles formes de la grande distribution
Aujourd'hui, le grand commerce est dominé par la vente en supermarché et en hypermarché qui totalise près du tiers de la vente des produits de grande consommation en France.
Le supermarché est une forme de vente mise au point aux Etats-Unis dans les années 1930. Le concept repose sur la vente en libre-service du plus large assortiment de produits alimentaires sous un même toit (paiement des marchandises à la sortie du magasin par passage à des caisses indifférenciées) et au prix le plus bas. Etant donné l'exigence d'un large échantillonnage de produits alimentaires, la surface de vente d'un supermarché est nettement supérieure à celle d'un commerce traditionnel (entre 400 et 2 500 m² selon les statistiques de l'INSEE). Le premier supermarché ouvert en France fut Bardou en 1957, à Paris.
Le supermarché réalise les deux tiers de son chiffre d'affaires dans l'alimentaire. Il propose environ 10 000 références.
L'hypermarché est une forme de vente inventée en France en 1963 : le premier hypermarché Carrefour a ouvert à Sainte-Geneviève-des-Bois dans l'Essonne le 15 juin 1963. Le concept repose sur la vente en libre-service du plus large assortiment de produits tant alimentaires (deux tiers de l'assortiment et des ventes) que non alimentaires, sous un même toit installé en dehors des agglomérations et disposant d'un emplacement de stationnement étendu (un véhicule étant supposé nécessaire pour emporter les achats). L'hypermarché est également caractérisé par une recherche systématique du prix le plus bas (« discount »). Ce prix dit cassé est obtenu par une réduction de la marge brute moyenne des magasins (qui tombe à 15 % contre 23 % dans le commerce alimentaire et 28 % pour le commerce non alimentaire), rendue possible, à l'origine, par une rationalisation de la politique d'achat, les économies d'échelle, la compression des investissements physiques au mètre carré de surface de vente et la compression de la marge nette (1 à 2 %, voire un temps moins de 1 %) et l'absence de vendeurs en rayon.
L'hypermarché a une surface de vente d'au moins 2 500 m2 selon les normes INSEE. Il propose au moins 40 000 références, mais leur nombre peut atteindre 80 000, voire 130 000 dans les plus grands hypermarchés Auchan (dont la politique de diversification de l'offre conduit à multiplier les références comme nous l'a précisé Francis Cordelette, président d'Hypermarchés Auchan). Les références dans l'alimentation sont au nombre de 3 000 à 5 000, mais peuvent atteindre 8 000.
L'objectif d'un hypermarché, qui est devenu celui de tous les magasins des enseignes de grande distribution hormis les grands magasins et magasins populaires, est de maximiser le rapport entre le bénéfice net et le capital investi, et non entre le bénéfice brut et le chiffre d'affaires. A cette fin, les frais généraux doivent être limités, les ventes être massives et la rotation des marchandises rapide. En outre pour éviter d'investir dans les stocks, les produits doivent être vendus avant d'être payés à leur fournisseur (au départ de la croissance, en 1968, le rapport moyen était de 23 jours contre 44 jours), ce qui dégage une trésorerie permettant de financer une croissance des implantations, de ne pas recourir aux prêts bancaires et de présenter un résultat net positif. Le gagnant était le consommateur.
Le concept de vente au prix le plus bas possible par la réduction des marges de tous les intervenants de la filière et des frais généraux a cependant été lancé par M. Edouard Leclerc, en 1949, dans un hangar de Landernau rendu célèbre par son huile et son sucre vendus 25 % moins cher (il annonçait des ventes au prix des grossistes). Incontestablement Edouard Leclerc a changé radicalement la manière de faire du commerce en France. La révolution qu'il a provoquée a marqué durablement tous les grands distributeurs français.
Ce modèle économique s'est imposé à toute la grande distribution hormis les grands magasins et les magasins populaires. Il a été le moteur de l'expansion à l'étranger des hypermarchés français. Carrefour a commencé à s'implanter à l'étranger dès les années 1970 (2) : en Belgique, en Suisse (mais se retire du pays en 1991), en Italie et en Grande-Bretagne en 1969 (avec des alliés locaux), en Espagne en 1973, au Brésil en 1975, en Autriche en 1976, en Allemagne en 1977 (mais ferme ses magasins en 1979), puis vinrent l'Argentine en 1982, les Etats-Unis en 1988 (mais se retire du pays en 1993), Taiwan en 1989, le Portugal en 1990, le Mexique et la Malaisie en 1994, la Chine en 1995, la Corée du Sud et la Thaïlande en 1996, Singapour en 1997, la Colombie et le Chili en 1998, etc. La stratégie de Carrefour a eu un effet d'entraînement sur les autres enseignes, qui s'est conjugué avec les difficultés croissantes d'obtenir en France des autorisations d'implantations supplémentaires, notamment lors de périodes de « gel » des autorisations (1984-1985 et 1993-1997). Aujourd'hui, les enseignes d'hypermarchés et de maxidiscompte françaises (Carrefour, Continent, Auchan, Casino, Cora, Intermarché, Castorama, Leclerc, etc.) sont les établissements de vente au détail massive les mieux implantés en dehors de leur sol national, au point de dominer certains marchés nationaux ou de les avoir radicalement orientés vers la forme de distribution en hypermarché.
Depuis la fin des années 1980, une nouvelle forme de commerce importée d'Allemagne (mais qui est née parallèlement au Japon) s'installe en France : le maxidiscompte (« hard discount »). Les premières enseignes sont apparues en France en 1988 : Aldi, Lidl et Norma, enseignes allemandes. Carrefour avec l'enseigne Ed et Europa Discount, Intermarché avec CDM, Franprix avec Leader Price, etc. ont rapidement investi ce marché (voir les tableaux ci-après et celui dans le chapitre sur l'équipement commercial au titre V du présent rapport). Le concept repose sur la vente de produits de base, essentiellement alimentaires, sous marque de distributeur exclusivement, ou presque, et dans une gamme de choix limitée à une ou deux références, au prix le plus bas. Le prix de vente le plus bas est obtenu par une politique de sélection des fabricants ayant la capacité de fournir en grosses quantités des produits de qualité basique mais constante sur l'année, au prix le plus bas possible (grâce à une prévision des commandes sur un an et des engagements pluriannuels), et par l'absence d'investissement dans l'aménagement du magasin, la présentation des produits, etc. et l'emploi d'un personnel en nombre réduit. Le nombre de références offertes est compris entre 600 et 1 000.
Ce concept a été mis au point par Aldi. Ce groupement a été fondé en 1960 par deux frères, Karl et Theo Albrecht. L'activité commerciale des deux frères commença en 1946 où prisonniers de guerre, ils sont libérés par les Alliés et reprennent le magasin familial. En raison de la pénurie d'après-guerre et en l'absence de capitaux, ils ne proposèrent que deux cents références avant tout dans l'alimentaire. En 1950, ils orientèrent leur commerce vers l'offre de produits à prix réduits (« discount »). Cette forme de vente correspondait exactement aux besoins de la population qui devait limiter ses achats au strict nécessaire. En 1961, la société fut scindée : Aldi Nord, basée à Essen, fut prise par Theo et Aldi Sud, basée à Mülheim, par Karl. Et en 1962, le premier magasin de vente en libre-service fut ouvert à Dortmund par Theo Albrecht. Depuis, le système Aldi n'a pas fondamentalement changé (les frères Albrecht se sont retirés de la direction de leur entreprise en 1993).
Un magasin d'Aldi n'offre que six cents références au prix le plus bas possible et vendues tout au long de l'année sans promotion à prix cassé, mais Aldi Nord s'est écarté du modèle traditionnel pour offrir jusqu'à sept cent cinquante références. Cette politique est permise par un coût en personnel très réduit (3 % du chiffre d'affaires contre 13 % pour les autres enseignes allemandes (3)) et la compression des frais généraux (absence de décoration, offre des produits dans leur conditionnement de transport, magasins strictement fonctionnels et de taille réduite : jusqu'à 1 000 m2 avec un emplacement de stationnement réduit).
Depuis 1999, Aldi ne vend plus aucun article sous marque du fabricant. Les six cents références sont basiques mais leur qualité est testée en permanence, y compris par des organisations de consommateurs (elle doit être semblable à celle du produit dominant du marché). Cette stratégie donne aux deux sociétés une grande puissance d'achat puisqu'en moyenne chaque référence génère un chiffre d'affaires de 50 millions de marks. Si Aldi détient 13 % de parts de marché dans la vente de produits alimentaires en Allemagne, sa part atteint 30 % pour certaines des références vendues dans ses magasins.
La discussion avec le fournisseur est donc sévère mais elle porte aussi bien sur le prix que sur la qualité et les caractéristiques du produit et se conclut par un contrat de vente portant sur plusieurs années avec des engagements fermes de commandes de volumes. Aucune remise de coopération commerciale n'est demandée ni à la signature du contrat, ni en cours d'exécution. Lorsqu'il est décidé d'introduire un nouveau produit, le directoire de l'entreprise doit décider d'en retirer un autre pour maintenir le nombre de références en magasins à six cents. C'est ainsi que, selon les évolutions de la consommation, à échéance des contrats, sauf si la qualité d'une référence n'est plus satisfaisante, quarante à soixante produits sont sortis des linéaires et autant sont introduits chaque année (mais s'il s'agit de déréférencement stricto sensu le contrat en cours est exécuté et Aldi verse les sommes dues pour les commandes convenues, même si le produit est invendu).
Le groupe gère des filiales d'approvisionnement des magasins (34 pour Aldi Nord et 24 pour Aldi Sud au début 1999) qui sont des plates-formes de réception des produits et qui fournissent chacune une cinquantaine de magasins. Si le nombre de magasins de la zone augmente et dépasse les soixante-quinze, une nouvelle filiale et un nouvel entrepôt sont créés, en principe. Ce schéma permet de mettre en place une gestion à flux tendu : les achats d'Aldi portent sur des camions entiers mais les livraisons sont effectuées par palette et par entrepôt. A partir du dépôt, chaque filiale possède sa flotte de véhicules pour l'approvisionnement des magasins.
Aldi s'étend à l'étranger avec le même concept de vente : il s'est installé en Autriche en 1967, aux Pays-Bas en 1975, en Belgique en 1986, en France en 1998 (Aldi Nord), en Grande-Bretagne en 1990. Chaque fois le groupe a introduit la vente en magasin de maxidiscompte dans le pays. Indiquons que les deux sociétés possèdent exclusivement des magasins de ce type.
2. Les parts de marché des différentes formes de commerce : le consommateur apprécie les grandes surfaces de vente comme le commerce de centre-ville ou de quartier
Les tableaux ci-après, établis à partir des données figurant dans les comptes du commerce de l'INSEE, montrent l'emprise croissante du grand commerce, dominé par les enseignes d'hyper et de supermarchés depuis les années 1980, sur le marché des produits de grande consommation.
L'INSEE définit comme suit les différentes formes de commerce recensées dans ses comptes.
A. L'INSEE classe les commerces non spécialisés selon deux critères : la surface des magasins et la part des ventes en produits alimentaires.
1. Dans le commerce non alimentaire (magasins réalisant moins d'un tiers de leur chiffre d'affaires en produits alimentaires), on distingue :
- les « grands magasins » (code NAF 52.1H) (Printemps, Galeries Lafayette, Samaritaine, ...), dont la surface de vente est d'au moins 2 500 m², avec un assortiment maximum de produits non alimentaires, sans spécialisation ;
- les autres magasins non alimentaires non spécialisés (NAF 52.1J) (bazars, ...), dont la surface de vente est inférieure à 2 500 m².
2. Les magasins à prédominance alimentaire sont ceux qui réalisent plus d'un tiers de leur chiffre d'affaires en produits alimentaires. On distingue :
- les grandes surfaces :
. les « hypermarchés » (NAF 52.1F), dont la surface de vente est d'au moins 2 500 m² ;
. les « supermarchés » (NAF 52.1D), dont la surface est comprise entre 400 et 2 500 m² et qui réalisent plus des deux tiers de leur chiffre d'affaires dans la vente de produits alimentaires ;
. les « magasins populaires » (NAF 52.1E) (Monoprix, essentiellement aujourd'hui), de même taille que les supermarchés mais qui réalisent entre un tiers et deux tiers de leur chiffre d'affaires en alimentaire. Les magasins offrent un assortiment limité aux besoins courant et un libre-service alimentaire. Ils sont installés en centre-ville ;
- les petites surfaces :
. les « supérettes » (NAF 52.1C), dont la surface de vente est comprise entre 120 et 400 m² ;
. les « alimentations générales » (NAF 52.1B) dont la surface de vente est inférieure à 120 m².
Par ailleurs, parmi les magasins alimentaires, les magasins dits de maxidiscompte ne constituent pas une catégorie particulière dans les nomenclatures. Ils sont repérés par leurs enseignes et sont présents dans les supérettes (moins d'un tiers d'entre eux) et dans les supermarchés.
B. Le commerce de détail alimentaire en magasin spécialisé regroupe les unités faisant plus de la moitié de leur chiffre d'affaires dans l'une des huit gammes de produits alimentaires (NAF 52.2). Aucun critère de taille ou de nombre de magasins n'est introduit par l'INSEE.
Les différentes gammes de produits alimentaires sont :
- fruits et légumes frais, - pain, pâtisserie et confiserie,
- viandes et produits à base de viande, - produits laitiers,
- poissons, crustacés et mollusques, - tabac et cigarettes,
- boissons, - épicerie et divers.
C. Le commerce de détail non alimentaire regroupe les unités (entreprises ou établissements) qui réalisent au moins deux tiers de leur chiffre d'affaires de détail en produits non alimentaires.
Les différentes gammes de produits non alimentaires sont :
- produits pharmaceutiques, - meubles et équipement du foyer,
- articles médicaux et orthopédiques, - électroménager et radiotélévision,
- parfums et produits de beauté, - quincaillerie, peintures et verre,
- textiles, - livres, journaux et papeterie,
- habillement, - produits divers non alimentaires.
- chaussures et articles en cuir,
PARTS DE MARCHÉ - ENSEMBLE DES PRODUITS COMMERCIALISABLES (1)
SÉRIE DE 1962 À 1995
(en %)
formes de vente |
1962 |
1970 |
1980 |
1990 |
1993 |
1995 |
Grandes surfaces alimentaires : |
3,1 |
9,5 |
18,6 |
29,7 |
31,7 |
33,2 |
_ Hypermarchés (2500 m2 et plus) |
0,0 |
2,2 |
9,4 |
16,8 |
19,2 |
20,2 |
_ Supermarchés (de 400 à 2500 m2) |
0,6 |
4,0 |
7,0 |
11,7 |
12,5 |
12,9 |
_ Magasins populaires (de 400 à 2500 m2) |
2,5 |
3,3 |
2,2 |
1,2 |
1,1 |
1,0 |
Petites surfaces succursalistes d'alimentation générale (moins de 400 m2) |
|
|
|
|
|
|
Grands magasins |
2,7 |
2,9 |
2,2 |
1,6 |
1,4 |
1,3 |
Vente par correspondance généraliste (VPC) |
} 1,2 |
0,7 |
1,0 |
1,0 |
} 1,8 |
1,2 |
Autres généralistes |
0,7 |
0,7 |
0,6 |
0,5 | ||
Grand commerce non alimentaire spécialisé |
0,0 |
1,0 |
3,9 |
7,1 |
8,7 |
9,1 |
GRAND COMMERCE : |
14,0 |
21,1 |
30,2 |
41,4 |
45,8 |
47,2 |
Petites surfaces d'alimentation générale indépendantes (moins de 400 m2) |
|
|
|
|
|
|
Commerce des viandes |
9,2 |
8,2 |
6,1 |
3,7 |
3,2 |
2,8 |
Autres commerces de détail alimentaires spécialisés |
|
|
|
|
|
|
Pharmacies |
3,5 |
4,3 |
4,1 |
5,4 |
6,1 |
6,4 |
Petit et moyen commerce spécialisé non alimentaire |
|
|
|
|
|
|
PETIT ET MOYEN COMMERCE (2) : |
63,0 |
55,9 |
46,1 |
39,5 |
37,3 |
35,5 |
ENSEMBLE DU COMMERCE DE DÉTAIL |
77,0 |
76,9 |
76,2 |
80,9 |
83,0 |
82,8 |
Autres ventes au détail (3) |
23,0 |
23,1 |
23,8 |
19,1 |
17,0 |
17,2 |
dont : Boulangerie-pâtisserie |
3,6 |
3,3 |
3,0 |
2,6 |
2,5 |
2,4 |
Réparation et commerce de l'automobile |
9,0 |
8,9 |
11,6 |
8,2 |
7,3 |
7,7 |
Ensemble des ventes au détail |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
EN MILLIARDS DE FRANCS TTC |
142,0 |
282,3 |
955,5 |
1985,7 |
2102,0 |
2192,7 |
(1) Les produits commercialisables sont les produits susceptibles d'être vendus par le commerce de détail ; ils ne comprennent pas les automobiles.
(2) Y compris le commerce de petites surfaces, indépendant organisé (franchise, groupements d'achats)
(3) Dans cet ensemble sont regroupés : les ventes des boulangeries et pâtisseries (classées dans les industries agro-alimentaires), les ventes de pneus, d'accessoires et de carburants par le commerce de l'automobile ; les ventes au détail des autres secteurs (commerce de gros, prestataires de services, producteurs).
Source : INSEE - comptes du commerce
Nota : série statistique non disponible au delà de 1995. L'année 1962 est l'année précédant l'apparition du premier hypermarché (à Sainte-Geneviève-des-Bois, dans l'Essonne).
PARTS DE MARCHÉ - ENSEMBLE DES PRODUITS COMMERCIALISABLES
(HORS VÉHICULES AUTOMOBILES)
SÉRIE DE 1993 À 1998
(en %)
formes de vente |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
Alimentation spécialisée, artisanat commercial et petites surfaces d'alimentation générale |
|
|
|
|
|
|
Grandes surfaces d'alimentation générale : |
31,4 |
32,6 |
32,8 |
32,9 |
33,0 |
33,1 |
_ Supermarchés |
13,2 |
13,4 |
13,7 |
13,7 |
13,7 |
13,7 |
_ Magasins populaires |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,5 |
0,4 |
0,4 |
_ Hypermarchés |
17,6 |
18,6 |
18,5 |
18,8 |
18,9 |
18,9 |
Grands magasins et autres magasins non alimentaires non spécialisés |
|
|
|
|
|
|
Pharmacies et commerce d'articles médicaux et orthopédiques |
|
|
|
|
|
|
Magasins non alimentaires spécialisés (hors pharmacies) |
|
|
|
|
|
|
Commerce hors magasin : |
4,3 |
4,3 |
4,5 |
4,4 |
4,4 |
4,4 |
_ Vente par correspondance |
2,1 |
2,2 |
2,1 |
2,1 |
2,1 |
2,1 |
_ Autres |
2,1 |
2,1 |
2,4 |
2,3 |
2,3 |
2,3 |
Réparations d'articles personnels et domestiques (1) |
|
|
|
|
|
|
ENSEMBLE COMMERCE DE DÉTAIL ET ARTISANAT À CARACTÈRE COMMERCIAL |
85,1 |
85,0 |
85,1 |
84,8 |
84,6 |
84,9 |
Ventes au détail du commerce automobile (2) |
9,5 |
9,7 |
9,7 |
10,0 |
10,3 |
10,2 |
Autres ventes au détail (3) |
5,4 |
5,3 |
5,1 |
5,2 |
5,1 |
4,9 |
ENSEMBLE DES VENTES AU DÉTAIL |
100 % |
100 % |
100 % |
100 % |
100 % |
100 % |
EN MILLIARDS DE FRANCS (4) |
2178 |
2210 |
2263 |
2306 |
2362 |
2443 |
Source : INSEE - comptes du commerce
(1) Pour leurs ventes au détail et leurs prestations de réparation
(2) A l'exclusion des ventes et réparations de véhicules automobiles, y compris les ventes et réparations de motocycles
(3) Ventes au détail du commerce de gros, de divers prestataires de services et ventes directes des producteurs
(4) Du fait de la révision en cours des comptes nationaux, ce chiffrage est susceptible de modifications. Il faut donc davantage s'attacher aux parts de marché relatives des formes de ventes les unes par rapport aux autres qu'à leur niveau absolu.
Nota : série statistique disponible à compter des résultats de l'année 1993.
Les tableaux issus des comptes du commerce établis par l'INSEE sont révisés chaque année. Leurs chiffres ne peuvent donc pas être comparés d'une publication à l'autre. La série reproduite dans le présent tableau et les suivants n'est donc pas harmonisée avec celle ayant été utilisée pour la confection du précédent tableau.
PARTS DE MARCHÉ PAR TYPES DE COMMERCE
ENSEMBLE DES PRODUITS (hors véhicules automobiles)
Type de commerce |
1993 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 | |
Grand commerce alimentaire |
31,4 |
32,6 |
32,8 |
32,9 |
33,0 |
33,1 |
Grands magasins et grandes entreprises de VPC |
3,0 |
3,0 |
2,8 |
2,9 |
2,8 |
2,9 |
Grand commerce non alimentaire en magasin spécialisé |
7,7 |
8,5 |
8,9 |
9,2 |
9,5 (*) |
9,9 (*) |
Grand commerce : |
42,1 % |
44,1 % |
44,5 % |
45,0 % |
45,3 % |
45,9 % |
Petit commerce alimentaire et artisanat |
14,2 |
13,6 |
13,3 |
13,0 |
12,9 |
12,7 |
Pharmacie, commerce d'articles médicaux et orthopédiques |
|
|
|
|
|
|
Petit et moyen commerce non alimentaire |
22,9 |
21,6 |
21,4 |
20,9 |
20,4 |
20,2 |
Petit et moyen commerce et artisanat : |
42,9 % |
40,9 % |
40,6 % |
39,8 % |
39,2 % |
39,0 % |
Ventes au détail du commerce et de la réparation automobile (hors vente et réparation de véhicules) |
|
|
|
|
|
|
Autres ventes au détail (1) |
5,4 |
5,3 |
5,1 |
5,2 |
5,1 |
4,9 |
Ensemble des ventes au détail |
|
|
|
|
|
|
PARTS DE MARCHÉ PAR TYPES DE COMMERCE
PRODUITS ALIMENTAIRES (hors tabac)
Type de commerce |
1993 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 | |
Grand commerce alimentaire |
59,7 |
61,8 |
62,5 |
62,9 |
63,0 |
63,2 |
Grands magasins et grandes entreprises de VPC |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,6 |
Grand commerce non alimentaire en magasin spécialisé |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 (*) |
0,1 (*) |
Grand commerce : |
60,3 % |
62,3 % |
63,1 % |
63,5 % |
63,6 % |
63,9 % |
Petit commerce alimentaire et artisanat (y compris marchés) |
|
|
|
|
|
|
Pharmacie, commerce d'articles médicaux et orthopédiques |
|
|
|
|
|
|
Petit et moyen commerce non alimentaire |
0,8 |
0,8 |
0,9 |
0,9 |
1,0 |
1,0 |
Petit et moyen commerce et artisanat : |
36,5 % |
34,6 % |
33,9 % |
33,1 % |
32,7 % |
32,3 % |
Ventes au détail du commerce automobile |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,3 |
0,4 |
0,6 |
Autres ventes au détail (1) |
3,0 |
2,9 |
2,8 |
3,0 |
3,3 |
3,3 |
Ensemble des ventes au détail : |
100 % |
100 % |
100 % |
100 % |
100 % |
100 % |
(*) Estimation en fonction du classement des entreprises sur la base de l'EAE96 de l'INSEE.
(1) Ventes au détail du commerce de gros et de divers prestataires de services et ventes directes des producteurs.
Nota : Série statistique disponible à compter des résultats de l'année 1993.
Source : INSEE - comptes du commerce pour 1998.
PARTS DE MARCHÉ PAR TYPES DE COMMERCE
PRODUITS NON ALIMENTAIRES (hors véhicules automobiles)
1993 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 | ||
Grand commerce alimentaire |
17,9 |
18,8 |
18,7 |
18,9 |
19,0 |
19,1 |
Grands magasins et grandes entreprises de VPC |
4,4 |
4,4 |
4,2 |
4,2 |
4,2 |
4,2 |
Grand commerce non alimentaire en magasin spécialisé |
|
|
|
|
|
|
Grand commerce |
34,1 % |
36,3 % |
36,6 % |
37,2 % |
37,8 % |
38,5 % |
Petit commerce alimentaire et artisanat (y compris marchés) |
|
|
|
|
|
|
Pharmacie, commerce d'articles médicaux et orthopédiques |
|
|
|
|
|
|
Petit et moyen commerce non alimentaire |
34,9 |
32,9 |
32,6 |
31,7 |
31,0 |
30,7 |
Petit et moyen commerce et artisanat |
45,2 % |
43,0 % |
43,0 % |
42,0 % |
41,2 % |
41,0 % |
Ventes au détail du commerce automobile |
14,8 |
15,2 |
15,2 |
15,6 |
16,0 |
15,7 |
Autres ventes au détail (1) |
5,9 |
5,5 |
5,3 |
5,2 |
5,0 |
4,7 |
Ensemble des ventes au détail |
100 % |
100 % |
100 % |
100 % |
100 % |
100 % |
(*) Estimation en fonction du classement des entreprises sur la base de l'EAE96 de l'INSEE.
(1) Ventes au détail du commerce de gros et de divers prestataires de services et ventes directes des producteurs.
Nota : Série statistique disponible à compter des résultats de l'année 1993.
Source : INSEE - comptes du commerce pour 1998.
Les tableaux montrent la croissance continue des hypermarchés en France mais également la permanence d'un tissu très important de petits détaillants généralistes à dominance alimentaire ou spécialisés (petites surfaces de moins de 120 m2 ou moyennes surfaces de 120 à 400 m2). Ces commerces irriguent le territoire des c_urs de ville jusqu'aux villages ruraux. Leur présence se traduit par un service de proximité irremplaçable auquel nos concitoyens sont très attachés tout comme ils apprécient d'effectuer leurs courses en grande surface, comme le montre les chiffres indiqués ci-après.
Le consommateur a un comportement rationnel qui le porte à faire ses achats en grande surface où les prix sont moins élevés et où tous ses achats peuvent être effectués en un même lieu, mais il a également une approche sensible qui le rend attaché à l'existence d'un commerce de proximité traditionnel. Du point de vue de la consommation, on ne devrait donc pas opposer commerce de quartier et commerce de périphérie, mais s'attacher à les rendre complémentaires.
L'INSEE estime que la valeur moyenne d'un achat s'élevait, en 1998, à 342 F dans un hypermarché, à 220 F dans un magasin de maxidiscompte et à 206 F dans supermarché et que 83 % des ménages français se rendaient dans un hypermarché ou un supermarché, 13 % déclarant faire leurs courses dans un magasin de maxidiscompte et 14 % dans une supérette.
La distribution française a su anticiper les évolutions de la consommation : diversification de l'offre, compétitivité des prix, facilités d'accès pour le consommateur.
ÉVOLUTION DU GRAND COMMERCE À DOMINANTE ALIMENTAIRE
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 | |
Hypermarchés | |||||
Parc au 31 décembre |
1 048 |
1 087 |
1 112 |
1 123 |
1 135 |
Surface de vente (en milliers de m2) |
5 869 |
6 158 |
6 323 |
6 388 |
6 491 |
Supermarchés | |||||
Parc au 1er septembre |
6 317 |
6 278 |
6 233 |
6 185 |
6 077 (*) |
Maxidiscomptes | |||||
Parc au 1er septembre |
1 121 |
1 470 |
1 613 |
1 796 |
2 171 (*) |
Surface de vente (en milliers de m2) |
749 |
991 |
1 096 |
1 219 |
1 424 |
(*) A compter de 1998, le dénombrement des supermarchés n'inclut plus les magasins de maxidiscompte alimentaire et le dénombrement des maxidiscomptes inclut l'ensemble des magasins de maxidiscompte alimentaire et plus seulement les supermarchés.
Source : Hypermarchés : INSEE - comptes commerciaux de la Nation
Supermarchés et maxidiscomptes : Points de vente
ÉVOLUTION DU PARC DES HYPERMARCHÉS AU 31 DÉCEMBRE, DE 1991 À 1998 (en nombre de magasins et en surface de vente)
Surface de vente |
1991 |
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 | ||||||||
Parc |
Surface |
Parc |
Surface |
Parc |
Surface |
Parc |
Surface |
Parc |
Surface |
Parc |
Surface |
Parc |
Surface |
Parc |
Surface | |
2 500-4 999 |
502 |
1 645 |
523 |
1 717 |
558 |
1 850 |
578 |
1 914 |
589 |
1 940 |
601 |
1 983 |
605 |
1 989 |
610 |
2 012 |
dont 2500-2999 |
219 |
587 |
221 |
590 |
229 |
610 |
241 |
639 |
251 |
665 |
256 |
679 |
259 |
687 |
258 |
685 |
3000-4999 |
283 |
1 058 |
302 |
1 127 |
329 |
1 240 |
337 |
1 275 |
338 |
1 275 |
345 |
1 304 |
346 |
1 302 |
352 |
1 327 |
5 000-7 499 |
204 |
1 250 |
209 |
1 283 |
206 |
1 266 |
217 |
1 327 |
224 |
1 357 |
231 |
1 399 |
232 |
1 404 |
236 |
1 437 |
7 500-9 999 |
115 |
979 |
125 |
1 074 |
135 |
1 156 |
132 |
1 129 |
143 |
1 236 |
144 |
1 245 |
146 |
1 263 |
144 |
1 249 |
10 000-14 999 |
76 |
887 |
85 |
994 |
94 |
1 091 |
103 |
1 187 |
114 |
1 326 |
117 |
1 367 |
121 |
1 403 |
126 |
1 462 |
15 000 et plus |
11 |
195 |
13 |
228 |
15 |
260 |
18 |
312 |
17 |
299 |
19 |
329 |
19 |
329 |
19 |
331 |
Ensemble des hypermarchés |
908 |
4 956 |
955 |
5 296 |
1 008 |
5 623 |
1 048 |
5 869 |
1 087 |
6 158 |
1 112 |
6 323 |
1 123 |
6 388 |
1 135 |
6 491 |
Formes d'appartenance |
1991 |
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 | ||||||||
Parc |
Surface |
Parc |
Surface |
Parc |
Surface |
Parc |
Surface |
Parc |
Surface |
Parc |
Surface |
Parc |
Surface |
Parc |
Surface | |
Indépendants |
366 |
1 289 |
416 |
1 524 |
472 |
1 769 |
501 |
1 904 |
531 |
2 051 |
551 |
2 142 |
564 |
2 194 |
569 |
2 239 |
Grandes entrep. d'hypermarchés |
542 |
3 667 |
539 |
3 772 |
536 |
3 854 |
547 |
3 965 |
556 |
4 107 |
561 |
4 181 |
559 |
4 194 |
566 |
4 252 |
Ensemble des hypermarchés |
908 |
4 956 |
955 |
5 296 |
1 008 |
5 623 |
1 048 |
5 869 |
1 087 |
6 158 |
1 112 |
6 323 |
1 123 |
6 388 |
1 135 |
6 491 |
Le parc recense les unités de magasins. Les surfaces de vente sont exprimées en milliers de mètres carrés.
Source : INSEE - division « commerce ».
SURFACE DES MAGASINS DE DÉTAIL
secteurs d'activité |
1996 |
|||
TOTAL des magasins à PRÉDOMINANCE ALIMENTAIRE : |
140 014 000 m2 | |||
moins de 120 m2 |
123 905 000 m2 | |||
120 à 400 m2 |
7 195 000 m2 | |||
400 m2 et plus |
8 914 000 m2 | |||
Magasins non spécialisés : |
35 723 000 m2 | |||
moins de 120 m2 |
21 951 000 m2 | |||
120 à 400 m2 |
5 129 000 m2 | |||
400 m2 et plus |
8 643 000 m2 | |||
Magasins spécialisés (y compris charcuteries) : |
59 279 000 m2 | |||
moins de 120 m2 |
56 942 000 m2 | |||
120 à 400 m2 |
2 066 000 m2 | |||
400 m2 et plus |
271 000 m2 | |||
Boulangeries - pâtisseries : |
45 012 000 m2 | |||
moins de 120 m2 (ou considérées comme telles) |
45 012 000 m2 | |||
PHARMACIES |
23 574 000 m2 | |||
moins de 120 m2 (ou considérées comme telles) |
23 574 000 m2 | |||
TOTAL des magasins NON ALIMENTAIRES hors pharmacies |
198 855 000 m2 | |||
moins de 120 m2 |
159 189 000 m2 | |||
120 à 400 m2 |
26 767 000 m2 | |||
400 m2 et plus |
12 899 000 m2 | |||
Magasins non spécialisés |
1 299 000 m2 | |||
moins de 120 m2 |
512 000 m2 | |||
120 à 400 m2 |
219 000 m2 | |||
400 m2 et plus |
568 000 m2 | |||
Equipement de la personne |
62 943 000 m2 | |||
moins de 120 m2 |
52 795 000 m2 | |||
120 à 400 m2 |
8 006 000 m2 | |||
400 m2 et plus |
2 142 000 m2 | |||
Equipement du foyer |
26 685 000 m2 | |||
moins de 120 m2 |
16 617 000 m2 | |||
120 à 400 m2 |
5 645 000 m2 | |||
400 m2 et plus |
4 423 000 m2 | |||
Aménagement de l'habitat |
31 095 000 m2 | |||
moins de 120 m2 |
23 671 000 m2 | |||
120 à 400 m2 |
4 425 000 m2 | |||
400 m2 et plus |
2 999 000 m2 | |||
Parfumerie loisirs sports |
38 850 000 m2 | |||
moins de 120 m2 |
33 511 000 m2 | |||
120 à 400 m2 |
4 439 000 m2 | |||
400 m2 et plus |
900 000 m2 | |||
Produits divers |
37 983 000 m2 | |||
moins de 120 m2 |
32 083 000 m2 | |||
120 à 400 m2 |
4 033 000 m2 | |||
400 m2 et plus |
1 867 000 m2 | |||
Source : INSEE - Enquête annuelle d'entreprises 1996
STRUCTURE DU COMMERCE SPÉCIALISÉ EN MAGASINS SPÉCIALISÉS
SELON LE FORMAT PRÉPONDÉRANT DES MAGASINS GÉRÉS PAR LES ENTREPRISES
1995 | ||||
Secteurs |
Nombre d'entreprises |
Nombre de magasins des entreprises |
Part du chiffre d'affaires dans le secteur | |
Équipement de la personne |
521 |
1 472 |
||
2 287 |
3 932 |
12,3 % | ||
Petites surfaces |
45 235 |
57 226 |
69,8 % | |
Ensemble |
48 043 |
62 630 |
100,0 % | |
Équipement du foyer |
2 848 |
3 992 |
63,3 % | |
4 445 |
5 426 |
18,6 % | ||
Petites surfaces |
13 598 |
14 640 |
18,1 % | |
Ensemble |
24 058 |
100,0 % | ||
Aménagement de l'habitat |
1 630 |
2 450 |
||
4 333 |
14,7 % | |||
Petites surfaces |
24 434 |
26 287 |
27,6 % | |
Ensemble |
29 615 |
33 070 |
100,0 % | |
Parfumerie, loisirs, sports |
276 |
630 |
||
2 554 |
3 036 |
|||
Petites surfaces |
28 738 |
32 990 |
62,4 % | |
Ensemble |
31 568 |
36 656 |
100,0 % | |
Divers |
1 060 |
1 277 |
||
3 160 |
3 699 |
15,1 % | ||
Petites surfaces |
30 236 |
29 769 |
75,7 % | |
Ensemble |
34 456 |
34 745 |
100,0 % | |
Ensemble des secteurs |
6 335 |
35,0 % | ||
15 997 |
15,7 % | |||
Petites surfaces |
142 241 |
160 912 |
49,3 % | |
Ensemble |
164 573 |
191 159 |
100,0 % | |
Source : INSEE - comptes du commerce (dernières données disponibles, premier bilan pour 1998).
Remarque : Le secteur de l'équipement du foyer comprend beaucoup plus d'entreprises gérant des grandes surfaces que les autres secteurs, en raison de l'encombrement des meubles et des matériels électroménagers
3. La puissance de la grande distribution française et son affrontement avec les grands fournisseurs
Affirmons d'emblée que nous nous félicitons de la puissance commerciale des enseignes de grande distribution françaises. Les critiques qui pourront être émises vis-à-vis de certaines pratiques commerciales ne doivent pas être interprétées comme une volonté politique de réduire le poids de nos enseignes qui assurent une présence française à travers le monde et sont appréciées de nos concitoyens. Les solutions aux problèmes que la mission d'information a détectés ne passent pas par un affaiblissement des groupes français de distribution mais par une modification du comportement et des pratiques de tous les partenaires économiques tant fournisseurs que distributeurs.
a) La concentration de la distribution française s'accentue : elle est aujourd'hui en situation d'oligopole. L'incertitude de la concurrence internationale.
Depuis le début des années 1990, les rachats et fusions se sont multipliés dans la distribution française. On trouvera ci-après quelques étapes décisives de cette concentration des principaux groupes de grande distribution alimentaire français.
AUCHAN :
1990 : Docks de France prend 17 % du capital de la société alsacienne de supermarchés, qui prend parallèlement 4 % du capital de Docks de France.
1992 : Prend le contrôle de la société alsacienne de supermarchés pour un coût de 2,1 milliards de francs, soit une somme correspondant à 24 % du chiffre d'affaires.
1994 Rachète le groupe portuguais Pao de Açucar.
1995 : Accord de partenariat avec Controladora Commercial Mexicana pour l'implantation et la gestion d'hypermarchés au Mexique.
1996 : OPA inamicale sur Docks de France (en août) ; le prix de l'acquisition atteint 19,3 milliards de francs, soit 41 % du chiffre d'affaires de Docks de France en 1995 ; les enseignes Mammouth (hypermarchés) et Atac (supermarchés) deviennent la propriété d'Auchan. Ce rachat conduit à l'éclatement de la centrale d'achat Paridoc (voir Carrefour).
CARREFOUR :
1991 : Acquiert Montlaur, en règlement judiciaire pour 1,1 milliard de francs, soit l'équivalent de 25 % du chiffre d'affaires de Montlaur.
Rachète Euromarché, en difficulté financière depuis 1988, pour 5,5 milliards de francs, soit une somme correspondant à 20 % du chiffre d'affaires, et devient la première enseigne française d'hypermarchés (devant Leclerc et Intermarché) et la troisième d'Europe (devant Metro et Tangelmann).
Acquiert 10 % du capital de Picard Surgelés.
1994 : Prend la majorité du capital de Picard surgelés.
1995 : Le groupe financier espagnol March porte sa participation dans le capital de Carrefour de 4 à 5 %.
Signe un accord de joint-venture avec le distributeur chinois Lin Ha pour l'ouverture d'un hypermarché à Shanghaï.
1996 : Suite à l'acquisition par OPA de Docks de France par Auchan et l'éclatement de la centrale d'achat Paridoc, Coop de l'Atlantique, Guyenne et Gascogne et le groupe Charenton rejoignent le groupe Carrefour.
Entrée de Carrefour dans le capital de la société GMB, holding du groupe Cora, à hauteur de 42,4 %, avec l'accord de la famille Bouriez, en versant une somme de 3,11 milliards de francs, soit l'équivalent de 22 % du chiffre d'affaires annuel de Cora. Le ministre chargé de l'économie valide cette concentration le 29 juillet 1997.
1998 : Prend, en août, le contrôle des Comptoirs modernes par une OPA amicale assortie d'une OPE permettant d'acquérir 72,7 % du capital que Carrefour ne contrôlait pas (les Comptoirs modernes et Carrefour avaient une centrale d'achat commune, Cometca, et une filiale commune gérait 16 hypermarchés Carrefour ; Carrefour possédait 22,8 % du capital des Comptoirs modernes et 31,9 % des droits de vote) : l'OPA valorise les Comptoirs modernes à 23,82 milliards de francs, soit 72,73 % de son chiffre d'affaires 1997. Cette acquisition fait de Carrefour le premier distributeur français et lui permet de devenir un groupe complètement multiformat. La structure Carrefour Marchandise France prend en charge les négociations tarifaires des achats alimentaires (marques nationales et premiers prix) et les marques propres.
1999 : Lance le 9 septembre une OPE sur Promodès (une action Promodès échangée contre six actions Carrefour), close le 13 octobre.
CASINO :
1990 : Acquiert La Ruche méridionale pour 3 milliards de francs, soit une somme correspondant à 36 % du chiffre d'affaires annuel de La Ruche méridionale et place tous ses hypermarchés sous l'enseigne « Géant Casino ».
1992 : Reprend à Rallye ses actifs dans la distribution alimentaire, soit 44 hypermarchés, 196 supermarchés et 70 cafétérias (la valeur de l'acquisition est estimée à 4 milliards de francs soit 20 % du chiffre d'affaires annuel des magasins). En contrepartie, Rallye reçoit 30 % du capital de Casino.
1996 : Accord avec le groupe Dairy Farm pour ouvrir des hypermarchés en Asie du Sud-Est.
1997 : Rachète Franprix et Leader Price pour 3,8 milliards de francs, soit l'équivalent de 43 % de leur chiffre d'affaires global.
Entre dans le capital de Monoprix à hauteur de 21,4 % pour 900 millions de francs, soit 21 % de son chiffre d'affaires annuel.
Prend le contrôle de Mariault, essentiellement implanté dans le grand Ouest avec les enseignes Spar, Vival et Coccinelle (plus de 600 magasins au total).
Accord avec Promodès pour que Casino adhère à compter du 1er janvier 1998 à la centrale d'achats des produits non alimentaires de Promodès.
1999 : Annonce, en avril, la création d'Opéra, centrale d'achats pour les produits alimentaires et non alimentaires, commune à Casino et Cora.
COMPTOIRS MODERNES :
1980 : Fusion avec Major par OPE assortie d'une OPA d'un montant de 1,44 milliard de francs, soit l'équivalent de 48 % du chiffre d'affaires de Major.
1993 : Rachète la Société alsacienne de supermarchés.
1996 : Rachat par OPA de l'enseigne espagnole Supéco.
28 août 1998 : Prise de contrôle des Comptoirs modernes par Carrefour à la suite d'une OPA amicale.
COOP :
1990 : Fusion des Coop de Normandie avec les Coop de Picardie.
CORA :
1989 : Rachète la Société européenne de supermarchés pour 1,4 milliard de francs, soit une somme correspondant à 38 % du chiffre d'affaires.
1996 : La famille Bouriez laisse entrer Carrefour dans le capital de la société GMB, holding du groupe Cora, à hauteur de 42,4 %.
GALERIES LAFAYETTE :
1991 : Acquièrent les deux tiers du capital des Nouvelles Galeries par une OPA d'un montant de 2,15 milliards de francs, soit l'équivalent de 15 % du chiffre d'affaires annuel.
1992 : Portent leur participation dans le capital des Nouvelles Galeries de 72 à 100 %.
Signent un accord de partenariat avec le groupe Mobilier de France dont les 30 magasins prennent l'enseigne Atlas en qualité de franchisés, et qui est repris par la Compagnie de distribution du meuble (CDM) créée à cette occasion par Jean-Pierre Andrevon ; CDM rachète également les actifs de Lévitan (45 magasins de meuble).
1997 : Monoprix, propriété des Galeries Lafayette, (227 magasins dont 156 possédés en propre), grâce à l'appui de Casino (voir développements sur ce groupe), rachète Prisunic (137 magasins dont 110 possédés en propre). Regroupement des achats des deux groupes, la centrale d'achat de Monoprix étant déjà adossée à celle de Casino.
LECLERC et SYSTEME U :
1998 (fin juin) : Les adhérents du groupement Leclerc et les associés de Système U approuvent le principe du rapprochement des deux groupes afin de mettre en place une centrale d'achat commune, l'Union des coopérateurs indépendants européens (Lucie), chargée dans un premier temps de la négociation commerciale, du référencement des grands fournisseurs, des produits premiers prix, des importations et de la recherche de fournisseurs.
10 mars 1999 : La création de Lucie est notifiée à la Commission européenne.
GROUPE PINAULT :
1989 : La Redoute prend 50 % du capital de la Maison de Valérie.
1990 : Conforama prend le contrôle de Mobis (n° 3 du secteur).
1991 : Acquiert Conforama.
Rachète le groupe Printemps à la famille suisse Mauss-Nordmann, et prend ainsi le contrôle de 55 % du capital de La Redoute.
1993 : La FNAC est reprise par la Compagnie immobilière Phénix (CIP, filiale de la Compagne générale des eaux) et Altus finance (filiale du Crédit Lyonnais).
1994 : Le Crédit Lyonnais cède le contrôle de la FNAC au groupe Pinault.
1995 : Poursuivant son recentrage, le groupe Pinault cède l'une de ses dernières filiales industrielles, France Portes.
1998 : Prend une participation majoritaire dans le capital de Guilbert (n° 1 européen de la vente de fournitures et de matériels de bureau).
PROMODÈS
1990 : Codec dépose son bilan ; Promodès acquiert une partie de ses actifs et accueille des anciens adhérents Codec.
Le groupe régional Arlaud, propriétaire de l'enseigne Record, adopte la franchise Promodès.
1991 : Reprend les 47 hypermarchés des Coop d'Allemagne.
Rachète le deuxième groupe succursaliste espagnol DIRSA.
Prend, avec effet au 1er février 1992, 50 % du capital des Coop de Champagne (6 hypermarchés, trentaine de supermarchés).
1992 : Accord pour la reprise de 100 % du capital du grossiste lorrain BRCM.
Rachète au groupe Disco (filiale à 66 % de Marland distribution) ses libres-services.
1993 : Rachète au groupe Pinault son activité de restauration hors foyer, Discol.
1995 : Accord de franchise avec le groupe belge Mestdagh.
1997 : Echec de la double OPA inamicale sur Casino et sa holding de contrôle Rallye.
Rachète au groupe britannique Tesco les magasins Catteau (acquis par Tesco en 1992) pour 2,51 milliards de francs, soit 54,5 % du chiffre d'affaires (7 hypermarchés, 73 supermarchés).
1999 : Lancement le 9 septembre d'une OPE de Carrefour sur Promodès, close le 13 octobre.
RALLYE :
1990 : Prise de contrôle de 60 % du capital du groupe Genty, pour 2,23 milliards de francs, soit une somme correspondant à 28 % du chiffre d'affaires annuel de Genty.
1992 : Reçoit 30 % du capital de Casino en contrepartie de la cession à ce groupe de ses actifs dans la distribution alimentaire (44 hypermarchés, 196 supermarchés, 70 cafétérias).
Ces mouvements de concentration aboutissent à la constitution de groupes de distribution réalisant au moins 80 milliards de francs de chiffre d'affaires annuels et à la réduction du nombre d'enseignes dans chaque forme de point de vente au détail (voir tableaux ci-après et au chapitre suivant).
La constitution de grands groupes de distribution n'est pas un phénomène spécifiquement français. Une étude d'ACNielsen de la distribution alimentaire en Europe en 1999 montre que la concentration en France est dans la moyenne européenne. Cette étude, réalisée avant la fusion de Carrefour avec Promodès, indique que les cinq premiers distributeurs d'un pays détiennent les parts de marché suivantes dans leur pays :
Finlande : 93,8 %
Suède : 88,0 %
Autriche : 80,0 %
Pays-Bas : 79,3 %
Allemagne : 75,2 %
France : 72,8 %
Grande-Bretagne : 67,0 %
Portugal : 52,2 %
Belgique : 51,6 %
Danemark : 47,2 %
Espagne : 38,9 %
Italie : 35,8 %
Mais le mouvement de concentration des centrales d'achat en France est le plus spectaculaire d'Europe. En 1992, un fournisseur de produits de grande consommation pouvait s'adresser, en France, à 18 grands acheteurs ; ils ne sont aujourd'hui, avec la création de Lucie et la fusion de Carrefour et de Promodès, plus que cinq (voir le tableau ci-après des centrales d'achat).
Les données reproduites ci-après sont celles établies par la revue Libre Service Actualités (LSA). On trouvera au paragraphe précédent ainsi qu'au titre V du présent rapport l'état de l'équipement commercial selon les statistiques de l'INSEE.
CLASSEMENT (LSA) DES HYPERMARCHÉS IMPLANTÉS EN FRANCE
Octobre 1999 |
Fin 1996 | ||||||
ENSEIGNES |
Nombre de magasins |
part du parc total |
Surfaces totales |
part des surfaces du parc |
Nombre de magasins |
Surfaces totales | |
Centre Leclerc |
L |
397 |
34,76 % |
1 727 664 |
26,20 % |
387 |
1 626 523 |
Carrefour |
C |
132 |
11,55 % |
1 252 061 |
18,98 % |
115 |
1 137 428 |
Auchan |
A |
120 |
10,50 % |
1 031 836 |
15,64 % |
52 |
548 717 |
Mammouth |
A |
enseigne reprise par Auchan |
90 |
556 820 | |||
Géant Casino |
O |
108 |
9,45 % |
722 112 |
10,95 % |
111 |
719 741 |
Intermarché |
I |
92 |
8,05 % |
298 000 |
4,52 % |
80 |
255 110 |
Continent |
C |
87 |
7,61 % |
572 148 |
8,67 % |
79 |
525 499 |
Cora |
O |
57 |
4,99 % |
495 455 |
7,51 % |
54 |
458 424 |
Hyper U |
L |
33 |
2,89 % |
116 959 |
1,77 % |
30 |
98 859 |
Stoc |
C |
25 |
2,18 % |
71 857 |
1,09 % |
17 |
49 265 |
Super U |
L |
24 |
2,10 % |
63 832 |
0,96 % |
19 |
49 294 |
Hyper Champion |
C |
23 |
2,01 % |
69 158 |
1,04 % |
22 |
62 140 |
Champion |
C |
9 |
0,78 % |
24 300 |
0,36 % |
||
Casino |
O |
6 |
0,52 % |
16 645 |
0,25 % |
||
Rond-Point |
O |
6 |
0,52 % |
44 571 |
0,67 % |
5 |
37 959 |
Match |
O |
6 |
0,52 % |
16 050 |
0,24 % |
6 |
16 150 |
Atac + Hyper Atac |
A |
5 |
0,43 % |
17 460 |
0,26 % |
6 |
19 160 |
Maximarché |
O |
2 |
0,17 % |
5 400 |
0,08 % |
5 |
15 225 |
Provencia |
3 |
8 200 | |||||
Migros |
O |
2 |
0,17 % |
9 000 |
0,13 % |
2 |
9 000 |
Rallye |
O |
2 |
0,17 % |
15 470 |
0,23 % |
2 |
15 470 |
Record |
C |
2 |
0,17 % |
11 918 |
0,18 % |
2 |
8 787 |
TOTAL |
1 142 |
100 % |
6 593 555 |
100 % |
|||
Source : Atlas de la distribution LSA 2000 et LSA 1999 (pour les données chiffrées ; le rattachement aux centrales d'achat a été effectué par le secrétariat de la commission de la production et des échanges de l'Assemblée nationale).
Centrales d'achat : A = Eurachan ; C = Carrefour-Promodès ; I = ITM Entreprises ; L = Lucie ; O = Opéra. (voir tableau ci-après le détail des affiliations de chaque centrale). Voir rattachement des enseignes ci-après.
LSA indique que les hypermarchés employaient, en octobre 1999, 233 284 personnes, offraient 1 083 781 places de stationnement et 8 835 pompes à essence
CLASSEMENT (LSA) DES SUPERMARCHÉS IMPLANTÉS EN FRANCE
Octobre 1999 |
Fin 1996 | ||||||
ENSEIGNES |
Nombre de magasins |
% du parc total |
Surfaces totales |
% des surfaces du parc |
Nombre de magasins |
Surfaces totales | |
Intermarché |
I |
1 566 |
27,41 % |
2 166 982 |
33,46 % |
1 557 |
2 081 199 |
Super U |
L |
521 |
9,12 % |
755 711 |
11,67 % |
510 |
702 029 |
Champion |
C |
509 |
8,91 % |
690 284 |
10,66 % |
449 |
593 237 |
Stoc |
C |
463 |
8,10 % |
612 794 |
9,46 % |
357 |
455 582 |
Casino |
O |
406 |
7,10 % |
443 740 |
6,85 % |
410 |
447 090 |
Shopi |
C |
399 |
6,98 % |
220 089 |
3,39 % |
442 |
237 123 |
Atac |
A |
311 |
5,44 % |
388 126 |
5,99 % |
328 |
411 867 |
Écomarché |
I |
248 |
4,34 % |
142 808 |
2,20 % |
241 |
116 553 |
Franprix |
O |
241 |
4,21 % |
155 972 |
2,40 % |
250 |
159 512 |
Marché U |
L |
179 |
3,13 % |
132 884 |
2,05 % |
204 |
150 073 |
Supermarché Match |
O |
140 |
2,45 % |
187 608 |
2,89 % |
138 |
182 461 |
Centre Leclerc |
L |
109 |
1,90 % |
182 418 |
2,81 % |
122 |
201 285 |
Coccinelle |
O |
67 |
1,17 % |
39 964 |
0,61 % |
||
G 20 |
O |
55 |
0,96 % |
30 780 |
0,47 % |
||
Comod |
C |
52 |
0,91 % |
28 633 |
0,44 % |
||
Maximarché |
O |
48 |
0,84 % |
36 492 |
0,56 % |
||
Spar |
O |
41 |
0,71 % |
22 355 |
0,34 % |
||
Maxicoop |
O |
37 |
0,64 % |
44 872 |
0,69 % |
47 |
55 640 |
Coop |
O |
33 |
0,57 % |
16 962 |
0,26 % |
||
8 à Huit |
C |
30 |
0,52 % |
12 830 |
0,19 % |
||
TOTAL |
5 712 |
100 % |
6 474 841 |
100 % |
|||
Source : Atlas de la distribution LSA 2000 et LSA 1999 (pour les données chiffrées ; le rattachement aux centrales d'achat a été effectué par le secrétariat de la commission de la production et des échanges de l'Assemblée nationale).
Centrales d'achat : A = Eurachan ; C = Carrefour-Promodès ; I = ITM Entreprises ; L = Lucie ; O = Opéra. (voir tableau ci-après le détail des affiliations de chaque centrale). Voir rattachement des enseignes ci-après.
LSA indique que les supermarchés employaient, en octobre 1999, 157 014 personnes, offraient 675 024 places de stationnement et 14 747 pompes à essence.
CLASSEMENT (LSA) DES MAGASINS DE MAXIDISCOMPTE IMPLANTÉS EN FRANCE
Octobre 1999 |
Fin 1996 | ||||||
ENSEIGNES |
Nombre de magasins |
% du parc total |
Surfaces totales |
% des surfaces du parc |
Nombre de magasins |
Surfaces totales | |
Lidl |
727 |
30,66 % |
494 724 |
31,37 % |
517 |
349 497 | |
Aldi |
375 |
15,81 % |
249 271 |
15,80 % |
286 |
191 484 | |
Leader Price |
O |
312 |
13,15 % |
251 686 |
15,95 % |
194 |
152 343 |
Ed le marché discount |
C |
301 |
12,69 % |
208 631 |
13,22 % |
6 |
4 499 |
Le Mutant |
O |
191 |
8,05 % |
114 524 |
7,26 % |
165 |
104 360 |
CDM (Intermarché) |
I |
161 |
6,79 % |
97 995 |
6,21 % |
147 |
90 464 |
Ed l'épicier |
C |
116 |
4,89 % |
37 651 |
2,38 % |
||
Norma |
86 |
3,62 % |
56 128 |
3,55 % |
|||
Penny Prix Bas |
65 |
2,74 % |
41 955 |
2,66 % |
|||
Treff marché |
28 |
1,18 % |
14 125 |
0,89 % |
|||
Discount V |
6 |
0,25 % |
3 780 |
0,24 % |
|||
Discount |
1 |
0,04 % |
500 |
0,03 % |
|||
Les Halles d'Auchan |
A |
1 |
0,04 % |
4 500 |
0,28 % |
||
P&B |
1 |
0,04 % |
1 600 |
0,10 % |
|||
TOTAL |
2 371 |
100 % |
1 577 070 |
100 % |
|||
Source : Atlas de la distribution LSA 2000 et LSA 1999 (pour les données chiffrées ; le rattachement aux centrales d'achat a été effectué par le secrétariat de la commission de la production et des échanges de l'Assemblée nationale).
Nota : en 1996, les magasins de maxidiscompte étaient recensés parmi les supermarchés. Le tableau ci-dessus les réincorpore ; ils ont été retirés du tableau précédant recensant les supermarchés.
Centrales d'achat : A = Eurachan ; C = Carrefour-Promodès ; I = ITM Entreprises ; L = Lucie ; O = Opéra. (voir tableau ci-après le détail des affiliations de chaque centrale). Voir rattachement des enseignes ci-après.
LSA indique que les magasins de maxidiscompte employaient, en octobre 1999, 9 560 personnes, offraient 76 984 places de stationnement et 231 pompes à essence.
ENSEIGNES DES GRANDES SURFACES DE VENTE ALIMENTAIRE FRANÇAISES
Auchan : enseignes Auchan, Mammouth et Atac (anciennement Docks de France, en voie de disparition), les Halles Auchan
Carrefour : enseignes Carrefour, Ed le marché discount, Ed l'épicier, Marché Plus
Comptoirs modernes (4) : enseignes Stoc, Comod
Cora : enseignes Cora, Match, Supermarché Match
Rallye : enseigne Rallye
Casino (5) : enseignes Géant Casino, Casino, Franprix, Coccinelle et Spar (anciennement appartenant à Mariault), Leader Price
Promodès : enseignes Continent, Champion, Shopi, 8 à Huit, Record (ancienne enseigne du groupe Arlaud), Dia, Proxi, Corsaire, Promocash (grossiste), Sherpa
Leclerc : enseigne Centre Leclerc
Système U : enseignes Hyper U, Super U, Marché U
ITM Entreprises : enseignes Intermarché, Ecomarché, CDM, Relais des Mousquetaires
Coop d'Alsace : enseignes Coop, Rond-Point, Maxi, Le Mutant.
Les enseignes de grande distribution françaises se distinguent par une rentabilité de leurs surfaces de vente qui est très élevée au mètre carré. A ce titre, Auchan est l'enseigne réalisant les meilleures performances puisqu'elle dépassait les 110 000 F de chiffre d'affaires au mètre carré en 1998, alors que les supercenters de Wal-Mart aux Etats-Unis ne réalisaient que 36 000 F au mètre carré.
La revue LSA avait établi dans son numéro du 28 janvier 1999 le classement suivant des enseignes d'hypermarchés réalisant plus d'un milliard de francs de chiffre d'affaires annuel (6) :
LES 96 HYPERMARCHÉS
DÉPASSANT LE MILLIARD DE FRANCS DE CHIFFRE D'AFFAIRES EN 1998
Nombre de magasins |
Surface moyenne (en m2) |
Chiffre d'affaires moyen (en milliards de francs) |
Rendement | |
Auchan |
38 |
12 300 |
1,474 |
110 727 |
Carrefour |
44 |
12 300 |
1,412 |
104 364 |
Continent |
4 |
11 346 |
1 162 |
95 512 |
Cora |
2 |
13 238 |
n.c. |
n.c. |
Géant |
1 |
17 116 |
n.c. |
n.c. |
Leclerc |
5 |
11 000 |
1,106 |
90 512 |
Source : LSA n° 1615, p. 46.
On comprend que de cette puissance de vente découle une puissance d'achat. Celle-ci se mesure par la concentration des achats des enseignes de grande distribution dans des centrales d'achat, qui sont des structures permettant à des magasins différents, relevant d'entreprises distinctes et n'appartenant pas au même groupe, d'unir leur forces d'achat face aux puissants fournisseurs que sont les groupes multinationaux.
L'Institut de liaisons et d'études des industries de consommation (ILEC), qui regroupe les plus gros fournisseurs de produits de grande consommation, a évalué la concentration de la puissance d'achat des distributeurs européens dans le secteur des produits alimentaires à la date d'août 1999. Il ressort de l'étude que la concentration est maximale en France et que six centrales d'achat - et désormais cinq avec la fusion de Carrefour et de Promodès - commercialisent 93,6 % des produits alimentaires commercialisés en France. Il faut toutefois indiquer qu'à la date du 11 janvier 2000, la fusion des centrales des enseignes Leclerc et Système U (centrale Lucie du tableau ci-après) et celle des centrales de Carrefour et de Promodès (centrale Carrefour du tableau) n'étaient pas effectives ; ces structures n'avaient signé aucun contrat d'achat ni adressé la moindre facture.
PARTS DE MARCHÉ DES CENTRALES D'ACHATS DES DISTRIBUTEURS
À DOMINANTE ALIMENTAIRE EN FRANCE (hors Corse et DOM-TOM)
Situation à août 1999 |
Part du marché total |
Hypermarchés |
Supermarchés et magasins populaires (2) |
Maxidiscompte |
LUCIE |
19,4 % |
26,7 % |
15,9 % |
0,1 % |
Leclerc |
13,9 |
25,0 |
3,2 |
0,1 |
Système U |
5,5 |
1,7 |
12,7 |
- |
OPÉRA |
19,1 % |
15,8 % |
21,4 % |
23,3 % |
Casino (a) |
10,4 |
9,1 |
8,9 |
- |
Coop de Normandie + Le Mutant (a) |
0,7 |
- |
0,4 |
7,1 |
Francap (a) |
1,3 |
- |
1,9 |
0,1 |
Monoprix Primo (a) |
2,6 |
0,5 |
7,1 |
- |
Cora + Match (b) |
3,8 |
6,1 |
2,5 |
- |
Coop d'Alsace + Migros + La Moderne (b) |
0,3 |
0,1 |
0,6 |
- |
CARREFOUR |
28,3 % |
33,0 % |
24,1 % |
14,5 % |
Promodès |
10,7 |
8,8 |
14,9 |
- |
Carrefour + Picard + Erteco (c) |
13,4 |
22,7 |
- |
14,5 |
Comptoirs modernes + PG (c) |
3,2 |
0,6 |
8,1 |
- |
Coop de l'Atlantique (c) |
0,6 |
0,5 |
0,8 |
- |
Guyenne & Gascogne (c) |
0,3 |
0,3 |
0,2 |
- |
Chareton (c) |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
- |
ITM ENTREPRISES (Intermarché, les Mousquetaires, CDM) |
14,8 % |
3,8 % |
31,9 % |
7,0 % |
EURACHAN |
12,0 % |
20,3 % |
6,3 % |
0,2 % |
Auchan + Atac + Larc |
11,5 |
20,2 |
5,3 |
0,2 |
Schiever |
0,5 |
0,1 |
1,0 |
- |
AUTRES (Aldi, Lidl, etc.) |
6,4 % |
0,4 % |
0,4 % |
54,9 % |
(1) Calculé sur la base des chiffres d'affaires TTC de 1998 hors vente de carburant.
(2) Calculé sur la base des surfaces de vente existant à la fin de 1998.
(a) Magasins indépendants affiliés à la centrale Casino.
(b) Affiliés à la centrale Loceda-Hypersélection.
(c) affiliés à la centrale Carrefour/CM&affiliés.
Source : ILEC, 31 août 1999. Les formats de magasin de vente au détail pris en compte dans l'étude sont les hypermarchés, les supermarchés, les supérettes, les magasins de proximité, les magasins populaires et les magasins de maxidiscompte. Elle exclut les grossistes et le cash and carry.
Nota : Une enquête d'ACNielsen France répartissait comme suit les parts de marché des centrales d'achats en 1998 : Lucie = 21,1 % ; Carrefour + Comptoirs Modernes = 17,8 % ; Casino + Cora + Monoprix = 16,8 % ; Intermarché = 15,4 % ; Auchan = 13,0 % ; Promodès = 11,6 %.
Pour établir une comparaison européenne, l'ILEC a déterminé le poids des six premières centrales d'achats de chaque pays européen dans la distribution des produits alimentaires ; les résultats sont les suivants :
France : 97,7 % hors maxidiscompte ; 93,6 % maxidiscompte inclus
Belgique : 84,4 %
Pays-Bas : 81,3 %
Grande-Bretagne : 72,5 %
Allemagne : 70,6 %
Italie : 64,9 %
Les fusions et regroupements d'entreprises de distribution rappelées dans la chronologie ci-dessus, ainsi que les constitutions de supercentrales d'achats ne sont pas sans conséquences financières pour les fournisseurs de ces enseignes. Des contributions financières sont exigées par le biais de remises ou ristournes supplémentaires. Parmi les pratiques actuelles, on peut citer les deux suivantes :
- la « corbeille de la mariée » : les fournisseurs des enseignes se regroupant sont « priés » de contribuer financièrement à l'acquisition ou au regroupement, au nom de la « massification des achats » de la nouvelle entité, qui doit leur être profitable. Cette demande de remise supplémentaire, parfois à titre rétroactif sur les achats de l'année en cours ou des années précédentes, pourrait être justifiée quand un regroupement d'entreprises de distribution donne lieu à la création de débouchés nouveaux pour un fournisseur. Mais cela est rarement le cas si ce dernier vend aux deux distributeurs qui fusionnent ; or le versement d'une corbeille de mariée est pourtant exigé d'eux ;
- la demande d'alignement des conditions de vente à la nouvelle entité sur les conditions les plus favorables accordées précédemment à celle des deux entreprises qui fusionnent. Un regroupement ou une fusion permet aux deux distributeurs de comparer les conditions de vente qu'ils ont obtenues d'un même fournisseur. Il est justifié commercialement d'attendre des fournisseurs l'octroi de meilleures conditions de vente puisque l'acheteur est plus gros qu'auparavant. En revanche, ce qui est déloyal et abusif est de donner un caractère rétroactif à cet alignement, les contrats signés doivent être exécutés en l'état. Cependant, selon les informations communiquées par les enseignes de distribution, on constate, à l'inverse, que les discriminations pratiquées par les gros fournisseurs, légales au regard des termes de l'article 36 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence (voir titre II du rapport), sont importantes et que leur justification n'est pas toujours claire. On comprend dès lors que les fusions dans la distribution soient mal vécues par les multinationales de l'alimentaire et du non-alimentaire : elles mettent à jour des politiques commerciales intuitu personae de ces groupes.
De l'avis même des industriels, l'alignement des conditions de vente peut se comprendre mais le bien-fondé de la pratique de la corbeille de la mariée est totalement nié car ils jugent, à bon droit, qu'une fusion d'enseignes ne leur fournit pas de linéaires supplémentaires ; il n'y a donc pas de création de courant d'affaires pour eux.
b) La réussite des groupes français de distribution. La crainte de la concurrence de Wal-Mart
Les deux tableaux suivants font apparaître la puissance de la grande distribution française dans le monde. La fusion de Carrefour et de Promodès place la nouvelle entité en tête des distributeurs européens, nettement devant Metro, mais elle reste loin derrière Wal-Mart (entreprise créée en 1962 par Sam Walton, devenu le distributeur n° 1 des Etats-Unis en 1990 aux dépens de Sears Roebuck et dont le chiffre d'affaires a été multiplié par 3,6 entre 1990 et 1998). Cette concurrence des supermarchés « discount » de Wal-Mart est redoutée de tous les distributeurs français pour trois motifs :
- l'entreprise dispose de capitaux suffisants pour acheter, chaque année, un distributeur de la taille de Casino, comme l'a rappelé M. Antoine Guichard, lors de l'audition du 30 novembre 1999 (voir compte rendu en fin de rapport). Notamment, le résultat net de Wal-Mart a atteint 4,43 milliards de dollars en 1999, pour 137,6 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Or, les dirigeants de Wal-Mart ont décidé de s'implanter en force sur les grands marchés européens en rachetant des actifs d'entreprises de distribution (rachats d'Interspar - 74 magasins - et de Wertkauf - 21 magasins - en Allemagne en 1997 puis d'Asda (7) en Grande-Bretagne en 1999). Jusqu'à présent, la France n'a été la cible d'aucun distributeur alimentaire américain généraliste ;
- Wal-Mart pratique le prix bas de manière systématique (comme les Centres Leclerc) pour attirer la clientèle. Aux Etats-Unis, la concurrence sur les prix imposée par les 564 supercenters (10 à 20 000 m2) de Wal-Mart et ses 1 860 magasins de maxidiscompte a entraîné la faillite d'une quinzaine de grands magasins et de chaînes de distribution à bas prix en 1999. Au Royaume-Uni, Wal-mart a annoncé que les prix dans les magasins Asda allaient baisser de 10 à 15 % d'ici 18 mois alors qu'on estime qu'ils étaient déjà 5 à 10 % plus bas que ceux de ses concurrents. En Allemagne, il a décidé de baisser ses prix de 13 à 23 % au début janvier 2000. La puissance d'achat de Wal-Mart auprès des multinationales fait craindre aux distributeurs français qu'il n'obtienne de bien meilleures conditions de vente qu'eux, ce qui rendrait impossible une concurrence sur les prix, limitée par le seuil de revente à perte en France. Les consommateurs ne doivent pas se réjouir pour autant car on a constaté que lorsque les concurrents locaux de Wal-Mart avaient disparu aux Etats-Unis, les prix remontaient et la qualité de service baissait ;
- les pratiques commerciales mises en _uvre par Wal-Mart dans ses relations avec ses fournisseurs sont celles qui prévalent dans la quasi-totalité des pays, mais pas en France, à savoir la négociation d'un prix d'achat net de toutes remises de coopération commerciale (« prix net-net ») et l'absence de facturation de coopération commerciale. Le prix convenu lors du contrat d'achat est dit « net-net-net ».
Interrogés lors du déplacement de la mission en Allemagne où Wal-Mart est très actif, les fournisseurs français et allemands se déclarent satisfaits de leurs rapports commerciaux avec ce groupe. Ils les jugent plus sains que les relations commerciales avec les enseignes françaises en France.
LISTE DES 25 PREMIERS DISTRIBUTEURS MONDIAUX EN 1998
Nom |
Chiffre d'affaires HT 1998 |
Magasins (en propre et sous enseignes) |
Pays d'im-planta-tion |
Enseignes | |
1 |
Wal-Mart - |
117 935 (a) |
3 599 |
9 |
Wal-Mart, Wal-Mart Supercenter, Wertkauf, Sam's club, Wal-mart Neighborhood market |
2 |
Métro AG - |
46 884 |
2 085 |
20 |
Makro, Métro, Keufhof Galeria, Kaufhof Mode & Sport, Real, Allkauf, Kriegbaum, Extra, Media Markt , Saturn, Praktiker, Wrichs |
3 |
Kroger - |
36 925 (r) |
3 370 |
1 |
Kroger, Dillons, King Soopers, Fry-`s, Gerbes, Jr. Food Stores, City Market, Tom Thumb, Fred Meyer, QFC, Ralphs, Smith's, Kiwk Shop, Quik Stop Turkey Hill Minit Market, Loaf'N Jug, Mini Mart ? Merksamer, Fox's, littman, Barclay Jewelers, Fred meyer |
4 |
ITM Entreprises -France (supermarché) |
35 000 (e) |
3 148 (e) |
6 |
Intermarché, Ecomarché, CDM, Bricomarché, Vêtimarché, Procomarché, Eurospar, Interspar, Kodi, Netto, Spar |
5 |
Ahold - |
33 369 (r) |
3 927 |
17 |
Albert Heijn, Stop & Shop, Giant, Edwards, Bi-lo, Tops, Finast, Pathmark, Pingo Doce, Mana, Sesam, Bompreco, Disco, Santa Isabel, Martin's Super G, Ter Huurne, Dialco, Dumaya, Euronova, Looking Good, Parksons, Yahan Liancheng, Long (y compris JV) |
6 |
Carrefour (1) - |
32 395 (r) |
1 661 |
20 |
Carrefour, Lojas Americanas, Ed l'Epicier, Europa Discount, Picard Surgelés, Stock, Comod, Marché Plus |
7 |
Sears, Roebuck - |
31 458 |
5 132 |
2 |
Sears, Sears Hardware, Orchard Supply Hardware, Sears Dealers, The Great Indoors, NTB National Tire & Battery, Sears Auto Centers, Sears Catalog, Sears Home Life |
8 |
Albertson's - |
30 745 (r) |
2 563 |
1 |
Acme markets, Jewel Food Stores, Lucky Stores, Osco Drug, Sav-on-drugs, Albertson's, Village Market, Max Food and Drug |
9 |
Rewe - |
28 990 |
11 509 |
9 |
Toom, Globus, Rewe, Otto mess, Desuma, Jumbo, Penny, Direkt, Eins-A, Klee, Frick ProMarkt, Uni-markt Elektroland, Diehl, Kressner, Idea, Sconti, Billa, Merkur, Mondo, Emma, BIPA, Otto Mess, R-Kauf, Kontra, Groka, Minimal, H |
10 |
Kmart - |
28 861 |
2 161 |
1 |
Kmart, Big Kmart, Super Kmart |
11 |
Tengelmann - |
27 504 (r) |
7 853 |
11 |
A&P, Kaiser's, Obi, Plus, Tengelmann, Grosso, Magnet, Hermans, Interfruct, Ledi, Modea, Skala, Superal, Waldbaums, SuperFresh, Farmer Jack, Save-A-Center, Super FoodMart, Food Emporium, Kohl's, Dominion, Food Basics, Tip |
12 |
Edeka - |
26 587 |
11 746 (e) |
2 |
Martkauf, BIG, Kaufmarkt, E.Center, Dixi, Edeka, Helco, Nanz SVA, Allfrish, Otto Reichelt, Basar, Diska, Delta, Preisfux, Ceka, Magnet, BVA, Elkos, Herkules, Sport Treff, Gartenland, Krane, Alfti |
13 |
Dayton Hudson - USA (Multiformat) |
26 528 |
1 182 |
1 |
Target, Super Target, Mervyn's, Dayton's, Hudson's, Marschall Field's. Catalogues : Lake Wobegon USA catalog, Signals catalog, seasons catalog, circa : The Collectors |
14 |
J.C. Penney - USA (magasin populaire) |
26 103 (e) |
4 578 |
4 |
J.C. Penney, J.C. Penney Collection, J.C. Penney Catalog, J.C. Penney Home Store, Eckerd |
15 |
Aldi - Allemagne (maxidiscompte) |
26 092 (e) |
4 000 (r) |
9 |
Aldi, Hofer, Trader Joe's, Aldi Market |
16 |
Home Depot - USA - (grande surface de bricolage) |
25 900 |
761 |
3 |
Home Depot, Expo Design, Center, Home Depot Pro, Maintenance Warehouse |
17 |
Ito-Yokado - Japon (convenience stores) |
24 601 |
17 494 (e) |
19 |
7-Eleven, Daikuma, Mary Ann, Steps, Oshman's, Robinson's, York Benimaru, York Mart, Ito-Yokado, Shilipu |
18 |
Tesco - Grande Bretagne (supermarchés) |
24 322 |
821 |
8 |
Tesco, Tesco Metro, Lotus, Global, Tesco Express, Tesco Extra |
19 |
Safeway Inc. - USA (supermarchés) |
23 208 (r) |
1 623 |
3 |
Oaken Keg Spirit Shops, The Great Alaska Tobacco Company, Carr Quality Centers, Eagle Quality Centers, Vons, Dominick's, Safeway |
20 |
Sainsbury - Grande Bretagne (supermarchés) |
23 106 |
823 (e) |
2 |
Sainsbury's, Shaw's Supermarket, Savacentres, Homebase |
21 |
Auchan - France (hypermarché et supermarché) |
22 562 |
1 527 |
11 |
Auchan, Alcampo, Citta Mmercato, Aucha, Gruppo Rinascente, Eco-Service, Jumbo, Pao, Atac, Sabeco, Upim Rinascente |
22 |
Centres Leclerc - France (hypermarché et supermarché) |
22 105 (e) |
823 |
4 |
Leclerc, Leclerc Bricolage, Jardi-Leclerc, Leclerc Vêtements, Leclerc meubles, Leclerc Chaussures, Centres-l'auto |
23 |
Costco - USA (club-entrepôt) |
20 425 |
294 |
6 |
Price Club, Costco Wholesale |
24 |
Promodès (2) -France (multiformat) |
19 620 |
4 711 |
12 |
Continent, Continente, Dia, Minipreco, Shopi 8 à Huit, Codec, Di per Di, Proxi, Promocash, Puntocash, Grossiper, Docks Market, Modelo, Champion, Catteau, Mega Fresco, Mestdah, Niki |
25 |
Daiei - Japon (discount) |
18 910 |
8 871 (e) |
2 |
D-Mart, Big-A, Half & Top, Lawson , Athine, Bonte, Cordoba, D's Home Shop, Gourmet City, Joint, Lobelia, marche Robelt, Kou's, Media Calley, Mega Vandle, Printemps Ginza, Zenon (5) |
(...) |
|||||
32 |
Casino - France (multiformat) |
14 155 |
4 799 |
7 |
Géant, Smart & Final, Libertad, Casino, Disco, Franprix, Leader Price, Petit Casino, Spar, Vival |
Source : PricewaterhouseCoopers Global Retail Intelligence System, reproduit par LSA n° 1632 du 27 mai 1999.
(a) : dont 14,5 milliards de dollars de chiffre d'affaires réalisé en Europe
(e) : estimé ; données non disponibles.
(r) : chiffres d'affaires réactualisés en fonction des dernières acquisitions et des fusions avalisées par les assemblées générales d'actionnaires.
(i) : estimations sur la base des résultats du premier semestre 1998 et du dernier semestre 1997, derniers résultats publiés.
(1) : y compris Comptoirs modernes.
(2) : Promodès avec ses 36 % dans l'italien GS et ses 27,5 % du belge GB, participations qui peuvent devenir majoritaires à partir de 2000 et 2003 ; le groupe réalise potentiellement un volume d'affaires de 25 320 millions d'euros.
(3) : si l'on s'en tient au chiffre d'affaires de Pinault-Printemps-La Redoute dans la distribution grand public (51,8 % du total) contre 41,8 % à distribution professionnelle (Guilbert et Rexel) et 6,4 % au commerce international, le groupe arrive en 52ème position.
IMPLANTATION INTERNATIONALE DES ENSEIGNES FRANÇAISES INTÉGRÉES
(au 8 décembre 1999)
auchan |
promodes |
carrefour *** |
comptoirs modernes *** |
casino |
cora | |
Belgique |
60 HM 533 SM |
7 HM 52 SM 156 MD | ||||
Espagne |
36 HM 92 SM |
56 HM 67 SM 33 CC 1965 MD |
58 HM 74 SUP |
28 SUP Maxor 46 SUP et HYP Supeco |
||
France |
119 HM 228 SUP 498 PRO |
94 HM 594 SM 1431 PRO 129 CC |
117 HM 417 MD |
16 HM * 488 Stoc 197 Comod 102 Marché Plus |
112 HM 1209 SM 3228 PRO |
59 HM 144 SM |
Grèce |
6 HM 81 SM 30 PRO 102 MD |
|||||
Hongrie |
1 HM |
2 HM 24 MD | ||||
Italie |
32** HM 200 SUP 145 MP |
14 HM 18 SM 255 PRO 9 CC |
6 HM 48 MD |
|||
Luxembourg |
1 HM |
14 SM 11 MD | ||||
Pologne |
3 HM 11 SM |
21 PRO |
6 HM |
11 HM |
||
Portugal |
11 HM |
10 HM 50 SM 287 MD |
5 HM |
|||
République tchèque |
3 HM |
|||||
Turquie |
3 HM |
2 HM |
||||
Argentine |
1 HM |
33 MD |
22 HM |
8 HM 18 SUP |
||
Brésil |
69 HM 81 SUP |
23 Stoc SuperMercado |
45 HYP 225 SUP 74 PRO |
|||
Chili |
2 HM |
|||||
Colombie |
2 HM |
partenariat **** |
||||
Etats-Unis |
1 HM |
220 LSG |
||||
Mexique |
1 HM |
17 HM |
6 LSG |
|||
Uruguay |
à venir |
1 HYP 19 SUP |
||||
Venezuela |
Partenariat **** |
|||||
Chine |
1 HM |
1 HM |
19 HM |
|||
Corée |
11 HM |
|||||
Hongkong |
4 HM |
|||||
Indonésie |
1 HM |
2 HM |
||||
Malaisie |
6 HM |
|||||
Singapour |
1 HM |
|||||
Taiwan |
22 HM |
2 HM |
||||
Thaïlande |
1 HM |
9 HM |
20 HM |
|||
Vietnam |
1 HM | |||||
Dubaï - EAU |
2 HM |
|||||
Ile Maurice |
1 HM |
|||||
Madagascar |
1 SUP |
|||||
Maroc |
3 HM |
HM = hypermarché, SM = supermarché, MD = maxidiscompte, MP = magasin populaire,
PRO = commerce de proximité, LSG = libre service de gros.
* avec Carrefour.
** 25 HM Citta Mercato en partenariat avec le groupe Ifil.
*** Carrefour détient 98,37 % du capital de Comptoirs modernes.
**** Prise de participation de 25 % dans Exito : 16 HM, 124 SUP, 12 MP.
Source : fédération des entreprises du commerce et de la distribution (www.fcd.asso.fr).
Nota : Le tableau ne recense que la présence des distributeurs adhérents de la fédération des entreprises du commerce et de la distribution, ce qui exclut les centres Leclerc et ITM Entreprises (Intermarché) :
Intermarché est présent, en 1998, au Portugal (71 magasins + 29 Ecomarchés), en Belgique (40 magasins + 2 Ecomarchés), en Espagne (38 magasins), en Italie (7 magasins), en Pologne (3 magasins), et au travers d'une alliance avec Spar, en Allemagne et par une alliance avec Ro-Na Disnat, au Québec.
Leclerc est présent en Pologne (4 magasins), au Portugal (5 magasins), en Espagne (4 magasins).
Contrairement aux groupes américains qui tirent leur puissance de la taille du marché américain des biens de grande consommation, les grands distributeurs français tirent leur force de leur exceptionnelle internationalisation. Le tableau ci-dessous montre la part importante prise par le chiffre d'affaires réalisé par les points de vente français à l'étranger.
Comme on l'a vu en début de chapitre, l'internationalisation de la grande distribution française est ancienne ; elle remonte aux années 1970, mais le phénomène s'est accéléré dans les années 1990. Dès l'origine, l'implantation ou l'achat de magasins à l'étranger résultait d'une stratégie commerciale de recherche de volumes d'achats suffisants pour obtenir les meilleures conditions des fournisseurs. Le gel des autorisations de création de grandes surfaces en France, appliqué en 1983-1985 et surtout de 1993 à 1996, a fortement contribué à l'internationalisation de la grande distribution française en conduisant ses responsables à tourner la croissance de leur entreprise vers les marchés extérieurs, la concurrence sur le nombre de mètres carrés en France étant arrêtée, sauf rachat d'entreprises. Les marges arrières versées par les fournisseurs ont permis de dégager les moyens financiers de cette expansion sans avoir à recourir à l'endettement bancaire. En définitif, le cadre législatif de l'activité commerciale de la grande distribution française en France lui a donné l'assise lui permettant de s'internationaliser en force.
INTERNATIONALISATION DES GRANDS DISTRIBUTEURS FRANÇAIS
(en milliard de francs)
Chiffre d'affaires réalisé en France |
Chiffre d'affaires réalisé à l'international |
Parts du chiffre d'affaires à l'international | |
Auchan |
91,6 |
56,4 |
38,1 % |
Carrefour |
101,8 |
78,0 |
43,4 % |
Casino |
76,4 |
16,4 |
17,7 % |
Promodès |
79,6 |
49,1 |
38,2 % |
Leclerc (1) |
137,5 |
2,5 |
1,8 % |
(1) Chiffre d'affaires TTC estimé.
Source : Secrétariat d'Etat aux PME, au commerce et à l'artisanat.
Un grand argument avancé par la grande distribution (voir audition du 30 novembre 1999) pour soutenir son internationalisation est qu'elle entraîne dans son sillage à l'étranger des petites et moyennes entreprises productrices de denrées ou de produits non alimentaires. Cet argument doit être nuancé : dans tous les pays d'implantation, un distributeur se doit impérativement de fournir des produits locaux et s'adapter au mode de vie et au goût du pays. Les produits des PME françaises - il convient en effet d'écarter les produits des multinationales comme Danone ou l'Oréal qui bénéficient des investissements de promotion de leur société pour pénétrer les marchés étrangers - amenés par les enseignes de grande distribution sont avant tout des produits alimentaires sur lesquels se fonde la renommée de la France (vins, eaux minérales, produits laitiers, biscuiterie, ...). Globalement, dans un hypermarché, le nombre de références provenant de PME françaises est faible. Nous avons ainsi constaté qu'en Espagne, pourtant très proche des centres de production français, peu de produits de PME françaises étaient présents sur les linéaires des hypermarchés français, mais contrairement aux idées répandues, la grande distribution française met sur ses linéaires espagnols plusieurs produits agricoles français.
Mais, ce faible taux - répétons-le, imposé par les comportements de consommation - n'est pas négligeable en termes de volumes d'affaires. Ainsi, de l'avis des industriels eux-mêmes, l'implantation en force de la grande distribution française en Argentine (Carrefour, Casino, Auchan) a ouvert d'importants débouchés à de nombreuses PME, leur assurant un développement international. Il en est de même au Brésil.
c) Le duel de géants entre les multinationales productrices de biens de consommation et les groupes de distribution au détriment des PME
Les rapports entre la distribution et l'industrie n'ont jamais été équilibrés et sereins en France. Avant 1960, il fallait légiférer pour empêcher les producteurs d'imposer des conditions déloyales aux revendeurs et d'entraver le développement des nouvelles formes de distribution à bas prix. Depuis les années 1970, les pouvoirs publics sont intervenus pour contenir la croissance de la grande distribution vis-à-vis des petits commerces et l'empêcher d'abuser de sa puissance d'achat vis-à-vis des fournisseurs.
Nous estimons qu'il faut cesser de montrer du doigt la grande distribution pour dénoncer les dérives que nous connaissons et la charger de tous les maux alors que les pouvoirs publics ont une grande part de responsabilité dans l'exacerbation du rapport de force (disons clairement que jusqu'au milieu des années 1980, derrière un discours hostile aux pratiques de la grande distribution, celle-ci a reçu un constant soutien pour assurer une maîtrise de la hausse des prix sur les produits de grande consommation, objectif primordial de tous les gouvernements pendant très longtemps) et que la dérive est également imputable aux pratiques cachées des grands groupes multinationaux fournisseurs de biens de consommation qui trouvent avantage à ce qu'il n'y ait qu'un dialogue unique, même musclé, entre eux et la distribution et ont cherché à éliminer leurs concurrents fournisseurs par une surenchère des offres et des remises arrières ou conditionnelles.
Bien entendu, les PME sont hors d'état de surenchérir sur les remises particulières et la coopération commerciale proposées par les multinationales ou demandées par la grande distribution. Nous avons recueilli des témoignages de cette stratégie de surenchère des plus grands fournisseurs mondiaux de biens de grande consommation. Votre rapporteur citera un premier exemple fourni à la mission par le président d'une des plus grandes enseignes françaises de distribution : en décembre 1999, Danone lui a proposé d'augmenter ses prix de 10 % tout en lui reversant 7 % au titre de prestations de coopération commerciale ; il laissait aux commerciaux des deux groupes le soin de trouver un habillage juridique, c'est-à-dire une contrepartie quelconque, à cette nouvelle marge arrière. Comment une PME indépendante - il faut en effet écarter les fournisseurs de marques de distributeurs qui ne paient pas de coopération commerciale -, même avec un produit de renom, peut-elle conserver des têtes de gondole ou un bon positionnement promotionnel face à une telle surenchère ? En revanche, Danone refuse catégoriquement de réduire cette coopération commerciale et, à due concurrence, ses prix de vente. Cette politique est commune à tous les gros fournisseurs, à l'exception de Procter & Gamble qui a proposé de baisser ses tarifs de base de 9 % avec une réduction parallèle de 9 % des marges arrières qu'il reverse, pour tenter d'obtenir un avantage compétitif sur ses concurrents en abaissant son seuil de revente à perte (les lessives sont en effet revendues au seuil de revente à perte dans les hypermarchés).
Autre exemple : Cadburry refuse de modifier ses conditions générales de vente, ce qui est son droit, ou de signer des conventions de ristournes, pour ne pas baisser ses prix de vente aux consommateurs, mais propose des remises de coopération commerciale très substantielles. Plusieurs distributeurs nous ont fait comprendre que cette stratégie prédatrice pour les PME-PMI était dictée par l'Institut de liaisons et d'études des industries de consommation (ILEC), association regroupant les plus gros fournisseurs de la grande distribution.
Par ailleurs, la mission d'information souligne que si les rapports entre les industries multinationales et la distribution sont âpres en raison des volumes financiers gigantesques en jeu, les deux parties parviennent à un équilibre leur permettant de se développer sur le long terme. Les arguments démontrant la position dominante des uns ou des autres ne sont pas, dans les deux cas, dénués de fondement :
- on estime que cinquante produits, tous fournis par des multinationales ou des grands groupes français, font plus de la moitié du chiffre d'affaires d'un magasin (par exemple, à Auchan, les 42 plus gros fournisseurs réalisent 50 % du chiffre d'affaires des hypermarchés) ; or, comme une étude l'a montré, si un consommateur comparant les prix d'un magasin à un autre parvient à détecter une différence de prix de 0,5 % sur les produits les plus basiques, il ne peut mémoriser les prix que de cinquante produits au maximum, qui sont ces mêmes produits fournis par les multinationales et les grands groupes. Les enseignes de grande distribution expliquent donc qu'elles ne peuvent pas se passer de ces produits et sont contraintes d'acheter toute la gamme de la multinationale pour obtenir ses remises quantitatives afin d'être compétitives sur les prix de vente ;
- le montant des achats d'une centrale d'achat peut atteindre 20 à 40 % du chiffre d'affaires de la multinationale réalisé en France, mais les produits de celle-ci peuvent totaliser 30 à 40 % du chiffre d'affaires d'un linéaire ;
- selon M. Daniel Bernard, président de Carrefour, la position dominante de la grande distribution française est inexistante : ses « dix premiers grands fournisseurs mondiaux représentent 26 % de (son) chiffre d'affaires épicerie, alors que (Carrefour) ne représente que 1,3 % du leur » (voir compte rendu de l'audition du 30 novembre 1999 de la commission en annexe du rapport) ;
- le degré de concentration dans l'industrie est sans commune mesure avec le degré de concentration atteint par les centrales d'achats car le marché de l'industrie agro-alimentaire notamment est mondial. Ainsi Danone, selon le produit considéré, ne contrôle que 5 % des ventes de produits alimentaires en France (les autres industriels de l'agro-alimentaire ne détenant qu'au maximum 1 % de parts de marché). Cependant, il convient de rappeler qu'il existait il y a 20 ans environ 160 producteurs de pâtes alimentaires en France ; ils sont moins de dix aujourd'hui. Dans le domaine de la conserverie de légumes, il n'existe plus que deux fabricants français et cinq européens alors que dans les années 1990 il y avait 5 conserveries en France et 18 en Europe. Il n'existe plus qu'un seul fournisseur de café français aujourd'hui (la PME Fichaux). Les exemples de concentrations dans l'industrie sont multiples ; la différence avec la distribution ne tient qu'au volume de chiffre d'affaires des entités industrielles qui sont nettement inférieures à celles de la distribution. M. Jacques-Edouard Charret, directeur général d'Opéra, a indiqué, lors de l'audition du 30 novembre 1999 devant la commission, que les deux grands fournisseurs mondiaux de céréales réalisaient 70 % des ventes de céréales en France, dans les couches-culottes le taux atteint 72 %, dans l'alimentation infantile 82 %, dans le chewing-gum 99 %, dans les lames de rasoirs plus de 80 % : la concentration industrielle peut atteindre des niveaux supérieurs à ceux de la distribution.
RÉSULTATS DES GROUPES DE DISTRIBUTION FRANÇAIS
(en milliard de francs)
Chiffre d'affaires |
resultat net |
resultat d'exploitation | ||||
1997 |
1998 |
1997 |
1998 |
1997 |
1998 | |
E. Leclerc/Système U (1) |
190,60 |
195,00 |
nc |
nc |
nc |
nc |
Carrefour |
169,27 |
179,79 |
3,58 |
4,24 |
5,81 |
6,76 |
Intermarché (2) |
141,60 |
154,00 |
nc |
nc |
nc |
nc |
Auchan |
139,10 |
148,00 |
nc |
nc |
nc |
nc |
Promodès |
110,67 |
128,69 |
1,62 |
1,92 |
2,85 |
3,26 |
Casino |
76,26 |
92,85 |
1,11 |
1,41 |
2,16 |
2,90 |
Comptoirs modernes (3) |
32,75 |
37,15 |
0,55 |
0,65 |
1,14 |
1,57 |
Monoprix et Prisunic |
16,30 |
20,59 |
0,11 |
0,17 |
0,32 |
0,42 |
(1) Chiffre d'affaires TTC cumulé (estimé).
(2) Chiffre d'affaires TTC hors Spar.
(3) Carrefour a procédé à l'intégration des résultats de Comptoirs Modernes par mise en équivalence en 1998.
Source : secrétariat d'Etat aux PME, au commerce et à l'artisanat.
LES 30 MARCHÉS DE BIENS DE CONSOMMATION LES PLUS CONCENTRÉS DE FRANCE
MARCHÉS |
Chiffre d'affaires (en milliards de francs) |
groupe 1 |
Parts de marché |
groupe 2 |
Parts de marché |
Parts de marché des deux premiers |
Chewing-gum |
1,3 |
Kraft |
64 % |
Wrigley's |
35 % |
99 % |
Coloration |
1,9 |
L'Oréal |
81 % |
Schwarzkopf |
9 % |
90 % |
Rasoirs |
1,7 |
Gillette |
65 % |
Wilkinson |
20 % |
86 % |
Pâte à tartiner |
1 |
Ferrero |
82 % |
Hillsdown |
3 % |
85 % |
Produits coiffants |
1,9 |
L'Oréal |
77 % |
Procter |
6 % |
83 % |
Nourriture infantile |
4,1 |
Danone |
47 % |
Nestlé |
35 % |
82 % |
Margarine |
2,2 |
Unilever |
51 % |
Unigate |
27 % |
78 % |
Bières |
7,5 |
Danone |
51 % |
Heineken |
27 % |
78 % |
Maquillage |
1 |
L'Oréal |
60 % |
Chanel |
16 % |
76 % |
Nourriture pour animaux |
8,3 |
Mars |
43 % |
Nestlé |
32 % |
75 % |
Vaisselle machine |
1,4 |
Unilever |
56 % |
Benckiser |
17 % |
73 % |
Thé |
1 |
Unilever |
53 % |
Twinnings |
20 % |
73 % |
Couches culottes |
4,2 |
Procter |
47 % |
Kimberly C. |
25 % |
72 % |
Shampoings |
3,2 |
L'Oréal |
56 % |
Procter |
16 % |
72 % |
Céréales |
2,9 |
Kellogg's |
45 % |
Nestlé |
25 % |
70 % |
Désodorisants |
1,2 |
Reckitt & C |
38 % |
SC Johnson |
30 % |
68 % |
Barres chololatées |
1,5 |
Mars |
38 % |
Nestlé |
29 % |
67 % |
Essuyage récurage |
1 |
Spontex |
38 % |
3M |
28 % |
67 % |
Liquide vaisselle |
1,1 |
Colgate |
44 % |
Henkel |
22 % |
66 % |
Assouplissant |
1,2 |
Colgate |
45 % |
Henkel |
20 % |
65 % |
Jus réfrigérés |
1,1 |
Tropicana |
43 % |
Andros |
20 % |
62 % |
Déodorants |
2,1 |
L'Oréal |
33 % |
Unilever |
29 % |
62 % |
Café |
7 ?5 |
Kraft |
44 % |
Sara Lee |
17 % |
61 % |
Boissons sans alcool |
6,1 |
Coca-cola |
49 % |
Schweppes |
12 % |
61 % |
Hygiène féminine |
3,8 |
Procter |
34 % |
Vania |
27 % |
61 % |
Lessives |
7,7 |
Procter |
36 % |
Unilever |
24 % |
60 % |
Riz |
1,6 |
RCL |
36 % |
Mars |
24 % |
60 % |
Plats cuisinés surgelés |
2,7 |
Nestlé |
39 % |
Unigate |
20 % |
59 % |
Panification sèche |
1,6 |
Danone |
50 % |
Krisprolls |
9 % |
59 % |
Huile |
3,9 |
Lesieur |
45 % |
Unilever |
14 % |
59 % |
TOTAL |
87,7 |
Moyenne |
50 % |
Moyenne |
21 % |
71 % |
Ces chiffres excluent les éventuels volumes réalisés sous marques de distributeurs. Données 1998/1999
Sources : Linéaires/Panel de distributeurs/Sources fabricants
Les chiffres d'affaires des plus grandes multinationales de l'industrie agro-alimentaire sont du même ordre de grandeur que ceux des groupes de distribution comme le montre le tableau ci-après.
CHIFFRE D'AFFAIRES DES MULTINATIONALES DE L'AGRO-ALIMENTAIRE
Société |
Activités principales |
Chiffre d'affaires 1997 | |
1 |
Philip Morris (USA) |
Bières, multiproduits |
56 114 |
2 |
Unilever (anglo néerlandais) |
multiproduits |
48 816 |
3 |
Nestlé (Suisse) |
Eaux minérales, multiproduits |
48 274 |
4 |
Procter & Gamble (USA) |
Huiles, snacks, boissons sans alcool |
35 764 |
5 |
Pepsico Inc. (USA) |
boissons sans alcool, snacks |
29 292 |
6 |
Diageo Plc. (Royaume-Uni) |
Vins et spiritueux, bières, crèmes glacées, légumes transformés |
24 464 |
7 |
Conagra Inc. (USA) |
Viandes et produits carnés, produits laitiers, produits de la mer, plats préparés, sauces, huiles, conserves |
23 841 |
8 |
Novartis (Suisse) |
Alimentation infantile et diététiques, semences |
21 503 |
9 |
Sara Lee Corp. (USA) |
Snacks, conserves de légumes, produits de boulangerie, café, thé, produits carnés, surgelés |
19 734 |
10 |
Coca-Cola Co. (USA) (voir plus loin Coca-Cola Enterprises Inc.) |
Boissons sans alcool |
18 868 |
11 |
Danone (France) |
Multiproduits, bières, eaux minérales |
15 150 |
12 |
Mars Inc. (USA) |
Confiserie, alimentation animale, riz, sauces, crèmes glacées |
14 500 |
13 |
Archer-Daniels-Midland (USA) |
Amidon et dérivés, farine, huiles, alimentation animale |
13 853 |
14 |
IBP Inc. (USA) |
Viandes, aliments pour le service de restauration |
13 259 |
15 |
Kirin Brewery (Japon) |
Bières, vins et spiritueux, boissons sans alcool, biotechnologie, horticulture |
12 444 |
16 |
Seagram (Canada) |
Vins et spiritueux, boissons sans alcool (cette activité a été vendue en 1998) |
11 752 |
17 |
Coca-Cola Enterprises Inc. (USA) |
Boissons sans alcool |
11 278 |
18 |
Anheuser-Busch Cos (USA) |
Bières |
11 066 |
19 |
Eridania Beghin-Say |
Sucre, huiles, produits amylacés |
10 899 |
20 |
Asahi Breweries (Japon) |
Bières, boissons sans alcool |
10 854 |
Source : Panorama des restructurations financières dans l'industrie agro-alimentaire mondiale - les 100 leaders mondiaux de l'industrie agro-alimentaire mondiale en 1997 - édition 1999.
d) Les PME ont besoin de la grande distribution pour se développer (et réciproquement)
La difficulté des relations entre les PME-PMI et la grande distribution est connue et ancienne ; elle tient à la situation de dépendance économique dans laquelle se trouvent ces petits fournisseurs vis-à-vis d'acheteurs très puissants. La fédération des entreprises du commerce et de la distribution (FCD), sensibilisée à cette question, avait d'ailleurs établi des engagements solennels de ses adhérents pour stabiliser leurs relations avec les PME et mis en place une structure d'observatoire (voir les deux documents reproduits ci-après). Nous ne pouvons qu'approuver ces orientations, mais également constater que de gros progrès sont à réaliser pour les concrétiser.
M. Paul-Louis Halley, président de Promodès, a attiré l'attention de la mission sur le fait qu'il existe une catégorie de PME très prospères que l'on n'entend pas, et une catégorie moins prospère qui ressent fortement les relations avec la grande distribution et appréhende le déréférencement ; or le déréférencement est, selon lui, le résultat d'une concurrence entre industriels : ce sont les concurrents des PME qui les font sortir des linéaires parce que leurs produits sont meilleurs en termes de qualité ou répondent plus aux attentes des consommateurs ou parce qu'ils mettent le prix pour les sortir des linéaires, c'est-à-dire qu'ils proposent des remises de coopération commerciale considérables pour disposer en entier du linéaire réservé aux marques industrielles.
La mission estime que pour favoriser la présence des produits des PME et PMI sur les rayons des grandes surfaces françaises, les mètres carrés de surface de vente dont elles disposent devraient être accrus. Des autorisations doivent être délivrées aux demandes d'agrandissement, en les conditionnant par des engagements écrits de présence de produits de PME-PMI dans les linéaires ainsi allongés et par la présentation de projets de synergie avec les commerces de centre-ville et de proximité. Aujourd'hui la rareté des surfaces disponibles permet aux multinationales d'accaparer des rayonnages entiers ; il faut mettre un terme à cette concurrence disproportionnée.
Il faut ensuite souligner que le vecteur le plus dynamique de la présence des PME dans les linéaires est constitué par les marques de distributeur. Incontestablement ces marques propres de la grande distribution ont permis aux PME d'accroître leurs parts de marché. Mais cela s'est fait au prix d'une dépendance économique très forte au point qu'une PME fabricant une marque de distributeur est avant tout un sous-traitant de la grande distribution : la marque est la propriété de l'enseigne, le cahier des charges draconien de production est élaboré par l'enseigne, si l'enseigne retire la marque à la PME celle-ci se retrouve avec un outil de production inutilisable (voir le paragraphe sur les marques de distributeur dans le chapitre de la partie II du rapport relatif à la dépendance économique).
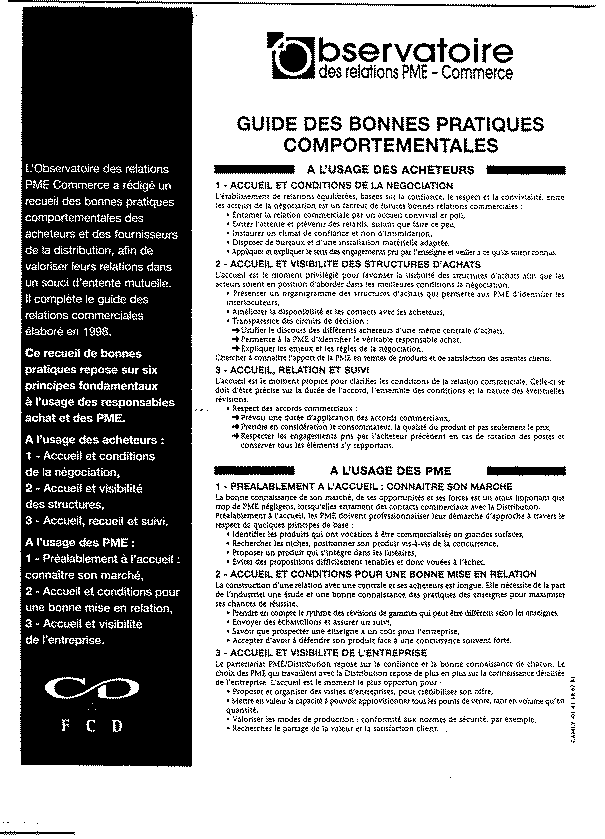
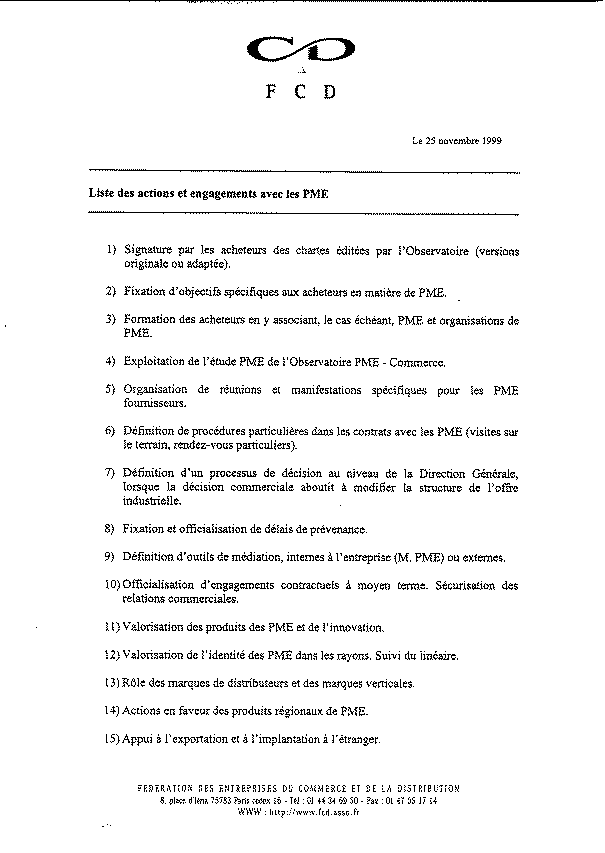
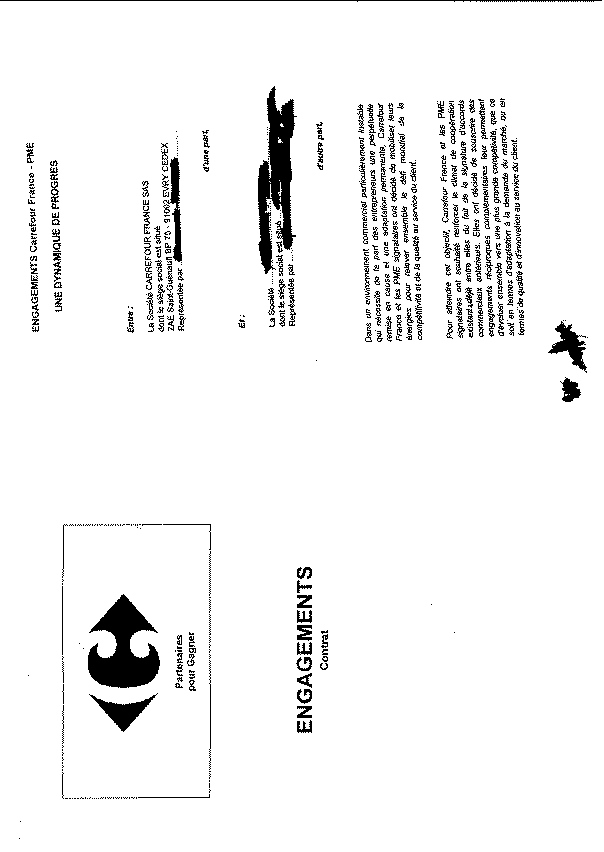
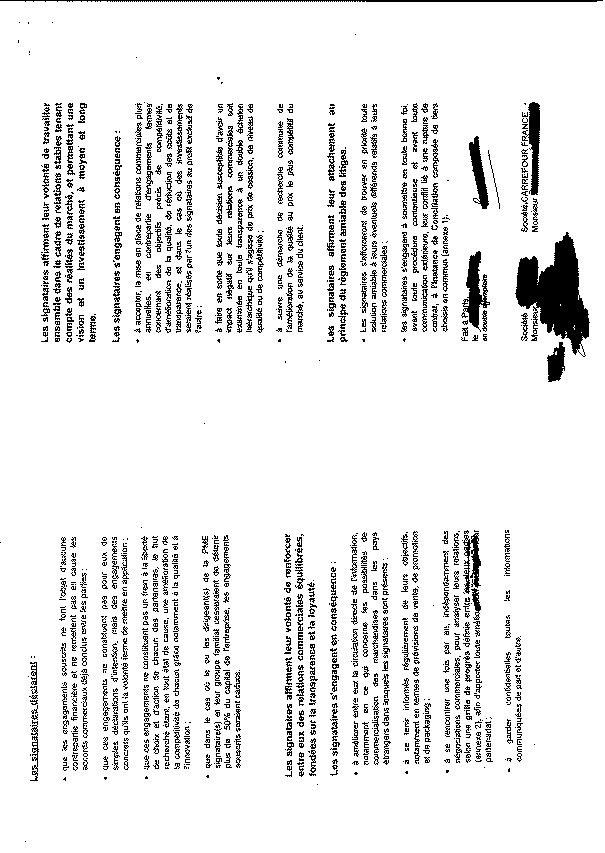
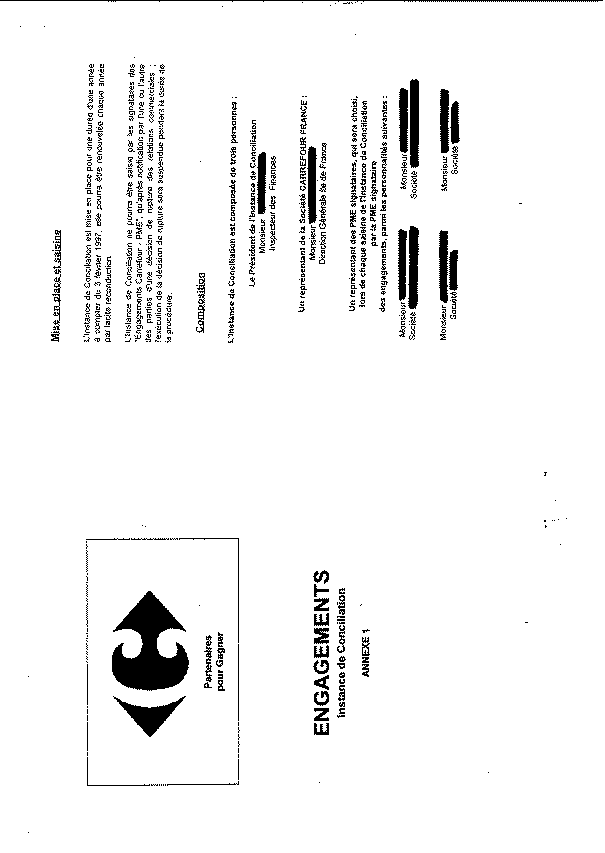
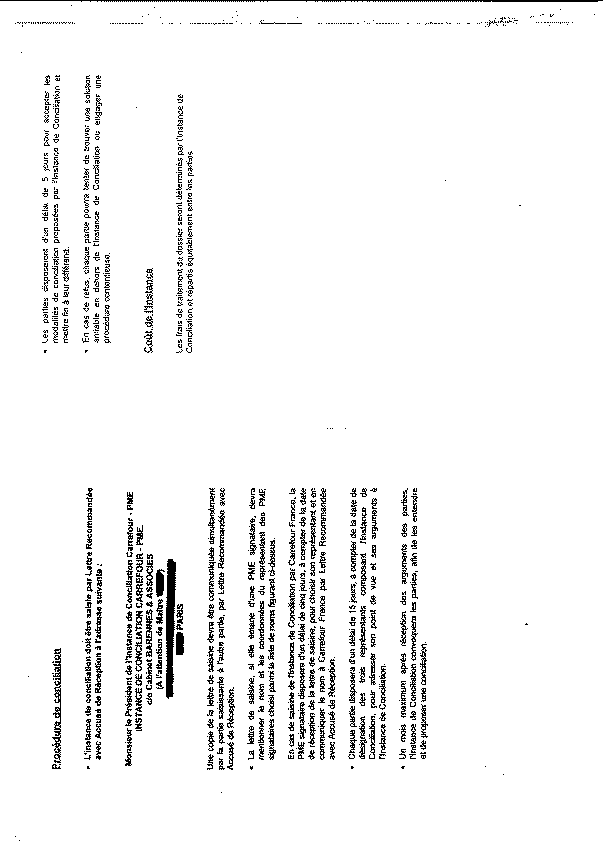
e) La concentration conduit à abaisser la qualité
La concentration de la production et de la distribution vont immédiatement conduire à une baisse de la qualité des produits.
Les extraits ci-après d'une lettre d'un consommateur adressée à la mission d'information illustrent les incidences sur la qualité des déréférencements de nombreux petits producteurs. Elle prouve que la compétition féroce pour obtenir des places sur les linéaires entraîne un nivellement par le bas de la qualité. Voici ces témoignages :
1er exemple : Magasin Shopi de Levallois.
« Comme dans tous les magasins de ce genre, on y vend du saumon fumé sous cellophane. Généralement, c'est du saumon fumé de 2ème zone, composé de lichettes qui ne sont pas présentables et sont tout juste bonnes à faire des canapés. Miracle : il y avait une exception, du saumon de marque Roch'Land. Chaque étui contient seulement deux grandes tranches, de grande qualité, sans le moindre déchet et pesant chacune de 50 à 70 grammes pièce. Bien sûr un peu plus cher, mais la qualité se paye.
« Un beau jour, ce saumon a disparu des rayons. Le magasin avait décidé de le déréférencer. Il est très probable qu'il s'agissait d'un bras de fer avec Roch'Land. Avec quelques amis, nous sommes allés les uns après les autres demander des explications et protester contre cette suppression en disant que ce n'est pas cela qui nous ferait acheter les autres marques et que nous irions ailleurs. Je dois dire que le gérant du magasin était de notre avis, il a fait le siège de sa direction, et c'est grâce à lui que nous avons pu obtenir le retour du produit. C'est malheureusement un cas exceptionnel. »
2ème exemple : Magasins Leclerc. Il s'agit apparemment de tous les magasins Leclerc.
« Leclerc a déréférencé toutes les conserves de légumes Jockey de marque Cassegrain (Bonduelle). Il s'agissait là encore de conserves cuisinées de grande qualité, un peu plus chères que les autres. J'imagine que Bonduelle a dû refuser de se plier aux ukases de Leclerc. Pour donner le change, Leclerc les a remplacées sur les rayons par des conserves Daucy avec une même forme de boîte carrée !... Nous les avons essayées. Là encore, chute de la qualité, et nous nous procurons maintenant les conserves Bonduelle chez l'épicier du coin. Le bras de fer dure depuis 2 mois et il continue. »
3ème exemple : Franprix - Magasin de Levallois, rue du Président Wilson
« Nous avions trouvé dans ce magasin un produit que l'on ne trouve nulle part ailleurs : les "brioches tranchées aux raisins" fabriquées à La Capechagnière (85260) par les Etablissements Gilles Fonteneau. Une qualité rare, équivalente à celle que l'on peut trouver en pâtisserie. Ce produit exceptionnel a un beau jour disparu des rayons. Nous avons protesté auprès de Franprix et demandé des explications. Réponse : "le fournisseur refuse de nous livrer !..." Il ne faut pas être grand clerc pour comprendre que Fonteneau a refusé le racket. Le bras de fer dure toujours. »
Les multinationales de l'agro-alimentaire ou des autres secteurs tendent d'ailleurs aujourd'hui de limiter le nombre de références, car ils ont acquis des positions dominantes sur les linéaires. Dans la filière des rasoirs (1,7 milliard de francs de chiffre d'affaires en France), deux enseignes se partagent 86 % du marché, dans la nourriture pour enfants, deux marques se partagent 82 % du marché (4,1 milliards de francs de chiffre d'affaires en France). Le consommateur n'aura donc bientôt plus le choix, et l'innovation sera immanquablement freinée.
Le plus grave est sans doute qu'à ce phénomène de concentration de la production, les perdants sont très certainement les produits régionaux. Dans la filière des articles de jardin, des fabriquants assuraient des fabrications diversifiées, aujourd'hui, les grandes enseignes de bricolage n'en veulent plus. L'enseigne veut un minimum de fournisseurs pour réduire le nombre de marques sur le linéaire.
L'exemple de Gouvy, société établie en Meurthe-et-Moselle depuis 25 ans et qui fabrique des outils de jardin, prouve bien qu'à l'inverse du discours dominant des grandes enseignes, les produits régionaux et les produits de qualité sont les grands perdants des concentrations de grandes enseignes.
Dans le domaine alimentaire, ces dérives sont encore plus criantes. Les marques disparaissent les unes après les autres, au jeu des rachats successifs d'enseignes par des sociétés mondialisées. Les centrales d'achat ont tendance à se délocaliser aujourd'hui en Europe, demain aux Etats-Unis ou ailleurs.
L'exemple des aliments susceptibles de contenir des organismes génétiquement modifiés (OGM), illustre les problèmes posés par la mondialisation de la production et de la distribution, lorsque les mêmes règles ne s'appliquent pas dans différents pays du monde.
En 1999, il y a eu sans doute 40 millions d'hectares de plantes transgéniques cultivées dans le monde (8). En 1998, 30 millions d'hectares avaient été cultivés, principalement aux Etats-Unis, au Canada ou en Argentine. Les cultures transgéniques concernaient principalement le soja (15 millions d'hectares) et le maïs (8 millions d'hectares). Votre rapporteur avait estimé, après avoir conclu qu'il ne pensait pas qu'il y ait de danger identifiable pour la santé, qu'il restait des questions à résoudre en termes d'environnement, qu'il fallait donner des autorisations au cas par cas, mais que le consommateur devait pouvoir conserver le libre choix, et choisir ce qu'il mange. Pour que ce choix puisse être fait, il lui semblait nécessaire d'assurer l'information des consommateurs par l'étiquetage. Plusieurs pays ont dû se battre pour obtenir, au niveau européen, l'obligation d'indiquer si un produit contient ou non des OGM, toutes autres mentions n'étant en définitive que trompeuses. L'étiquetage implique donc l'organisation de la traçabilité, c'est-à-dire du suivi d'un produit de la fourche, dans les champs, à la fourchette, sur la table.
Ceci implique également une méthode fiable de détection et la fixation d'un seuil d'exemption de déclaration d'un produit OGM. Il a aujourd'hui été fixé à 1 %. En effet, il ne faut pas confondre le problème de seuil avec le problème de sécurité alimentaire. S'il y a le moindre doute sur un aliment, il faut l'interdire concluait votre rapporteur. Mais que signifie un seuil fixé unilatéralement en Europe si les Etats-Unis ne procèdent à aucun étiquetage ?
C'est donc au niveau international, que nous devons imposer un étiquetage clair qui donne aux consommateurs tous les éléments informatifs : origine, composition de l'aliment, valeur nutrionnelle, modification par transgénèse, etc. L'Union européenne devait fixer une liste d'aliments et d'ingrédients alimentaires à base de soja ou de maïs transgénique exemptés de l'obligation d'étiquetage. Comme cette liste négative n'a pas été établie, comme la traçabilité n'existe pas, comme les industriels de l'agro-alimentaire achètent leurs produits de base sur le marché mondial, comme Greenpeace en profite pour alimenter son "fond de commerce" en semant le trouble chez le consommateur avec des listes blanches de produits sans OGM et des listes noires de produits avec OGM (qu'ils proposent donc de boycotter), le commerce des produits alimentaires prétendus exempts d'OGM devient de la pure supercherie. En effet, les dosages quantitatifs n'existent pas, les associations sont incapables de déceler de très faibles quantités d'OGM. Il est donc malhonnête d'écrire "nous avons reçu des garanties de non-utilisation d'OGM de nombreux fabricants..." quand ceux-ci sont totalement incapables de déceler la totalité des variétés végétales cultivées aux USA ou en Chine, par exemple, surtout lorsque les séquences amorcées ne sont pas connues.
La seule solution est effectivement d'avoir une règle identique pour tous les pays. Il faut discuter ces questions dans le cadre de l'OMC, exiger la traçabilité des produits et informer le consommateur par l'étiquetage. Car toutes les enseignes, même celles qui basent leur communication sur des produits non OGM, vendent aujourd'hui des produits qui en contiennent, même si c'est à l'état de traces. Ces enseignes ne sont pas en infraction avec la législation européenne qui vient de fixer un seuil de 1 %, mais il y a, de l'avis de votre rapporteur, tromperie et il nous apparaît inadmissible qu'on prenne à ce point le consommateur pour un « gogo », lui vantant des qualités floues : « agriculture raisonnée », ou hypothétiques : « produits sans OGM ».
La véritable qualité peut être obtenue en valorisant des produits identifiés, régionaux, en faisant la promotion des critères de qualité de notre agriculture, plutôt qu'en s'approvisionnant à bas prix, chaque jour sur les marchés internationaux. La qualité des produits mais également la sécurité alimentaire sont affectées par cette recherche des prix les plus bas. C'est sûrement une des explications de la rupture dans la chaîne du froid observée dernièrement dans la commercialisation de rillettes contaminées à la listériose. Ces choix de la qualité et de la sécurité alimentaire devraient être ceux de la grande distribution. Ce ne sont malheureusement pas ceux que la mission d'information a observés.
f) La dimension territoriale de la distribution des biens de grande consommation
La manière dont sont réparties les surfaces de vente au détail des produits de grande consommation sur le territoire et l'équilibre entre les différentes formes de distribution (commerces de proximité, grands magasins, supermarchés, hypermarchés, magasins de maxidiscompte ; commerces spécialisés et généralistes ; commerces de centre-ville ou de quartier et commerces de périphérie) relèvent d'un choix d'aménagement du territoire et de développement social.
Nous avons la conviction que le Parlement doit veiller à ce que le système commercial français soit équilibré et équitable et bénéficie aux consommateurs qui sont également des citoyens.
C.- L'IMPACT DU COMMERCE ÉLECTRONIQUE
Les technologies de l'information et de la communication, à travers le développement du commerce électronique, vont sans doute provoquer des bouleversements sur les circuits de distribution qui, même s'ils restent difficiles à évaluer aujourd'hui, seront sans rapport avec les conséquences induites par la vente par correspondance traditionnelle ou le Minitel. M. Francis Lorentz a largement développé cette évolution dans son rapport sur le commerce électronique remis au ministre de l'économie et des finances (1998). En 2000, le montant des ventes par Internet devrait dépasser celui des ventes par Minitel, pour atteindre 3,8 milliards de francs, selon une enquête du Benchmark Group auprès des 75 sites marchands français les plus actifs.
En effet, le commerce électronique :
- permet d'accéder à une multitude de produits,
- ignore les frontières,
- permet au consommateur de trouver le produit qu'il recherche en insérant ses caractéristiques dans un moteur de recherche,
- permet au consommateur de comparer rapidement toute une série de produits et d'effectuer des recherches de prix le plus bas.
Ces éléments sont la base d'une concurrence accrue entre les distributeurs. Le développement des sites marchands sur le web, la croissance exponentielle du nombre d'internautes, les efforts du Gouvernement pour définir un cadre juridique au commerce électronique, en vue notamment de garantir la sécurité des échanges, ne seront pas sans conséquence sur les systèmes de distribution.
Après la révolution constituée par l'émergence des grandes surfaces face au petit commerce, allons-nous assister à une seconde révolution qui verrait les « webmarchés » menacer la prépondérance des grandes surfaces sur le commerce de détail ? Il serait bien sûr illusoire de vouloir répondre d'une manière définitive à cette question ; le développement du commerce électronique peut représenter tout autant une menace qu'une nouvelle opportunité de développement pour les grands distributeurs, tout comme il peut être une chance à saisir pour les petites entreprises afin d'accéder à un marché plus vaste.
Quoi qu'il en soit, les « grandes man_uvres » ont déjà commencé dans le secteur du commerce en ligne.
1. Tous les grands distributeurs français ou internationaux possèdent leur propre site, même si tous ne proposent pas de vente en ligne.
2. Une stratégie d'alliance entre les sites portails d'accès à Internet et les grands distributeurs se met en place aux Etats-Unis.
En décembre 1999, Kmart, troisième chaîne de distribution américaine, a créé en partenariat avec Yahoo le site bluelight.com, qui permet d'acheter les produits de Kmart et de surfer sur le web gratuitement, en bénéficiant des services de Yahoo. Dans le même esprit, Wal-Mart, n° 1 mondial de la grande distribution, a ouvert un site marchand sur le web et a conclu, le 16 décembre 1999, avec AOL, premier fournisseur d'accès à Internet, un accord de coopération permettant au premier de bénéficier d'une publicité sur les portails d'accès d'AOL et à ce dernier de bénéficier d'un démarchage pour ses services auprès des clients passant dans les magasins Wal-Mart.
On peut raisonnablement penser qu'un tel mouvement va gagner dans les mois ou les années qui viennent l'Europe et la France. Les supermarchés G 20 proposent déjà sur leur site une vente par Internet de produits alimentaires. Promodès se lance également avec sa filiale Ooshop. Le groupe Pinault (Printemps, La Redoute, FNAC,...) offre des services de télécommunications en s'alliant à un opérateur international et organise son site pour intégrer commerce, télécommunications et services multimédias et interactifs. M. Jean-Paul Giraud, directeur général de la FNAC, a toutefois indiqué à la mission d'information que si le livre, le disque, la micro-informatique et les voyages étaient les quatre produits les plus vendus sur le net, sa société ne souhaitait pas, pour l'instant, s'engager dans la vente électronique pour créer son propre concurrent à ses magasins. Cependant, le groupe Pinault est le n° 1 français du commerce électronique dans le secteur de la distribution : en 1998, il a réalisé par ce média un chiffre d'affaires de 28 millions de francs. Des investissements très substantiels sont nécessaires pour maîtriser cette forme de vente : en 1998, le groupe Pinault a réalisé 42 millions de francs d'investissements, montant qui sera doublé en 1999. En dehors du champ de la grande distribution, rappelons qu'un accord a déjà été conclu entre Yahoo et Banque directe en France.
Il ne semble pas que les distributeurs européens aient compris l'importance de cet enjeu. En Espagne, MM. Juan Arenas Uria, directeur général de l'association nationale des grandes entreprises de distribution, et Jose Larramendi, directeur général d'Eroski, enseigne de grande distribution espagnole, nous ont même indiqué qu'ils ne croyaient pas à la concurrence du commerce électronique sur la distribution en hypermarché avant dix ans en raison de la dimension sociale de l'acte d'achat par les ménages dans les hypermarchés, qui sont considérés comme un lieu de sortie en famille. On continuera bien sûr à acheter son poisson ou ses carottes chez le commerçant ou dans la grande surface... mais on peut s'interroger sur les moyens de commandes des consommateurs de demain qui consultent souvent les catalogues de la grande distribution avant certaines périodes de l'année. Quand Cora, pour Noël, lance un catalogue de « 2000 idées de fête », c'est le type même d'information qui pourrait être fournie en ligne par une galerie marchande virtuelle et inciter certaines PME, refusant la coopération commerciale sans contrepartie, à s'orienter vers ces nouveaux moyens de communication.
3. Parallèlement, nous assistons à un développement des sites marchands - hors sites des grands distributeurs - sur le web.
On estime qu'à la fin 1999, plus de deux millions de particuliers étaient abonnés, en France, à un service d'accès à Internet et qu'un tiers des internautes avait effectué au moins un achat en ligne. Au total, au troisième trimestre 1998, Médiamétrie estimait qu'il y avait eu 5 212 000 internautes sur les douze derniers mois en France (enquête 24 000 Multimédia de Médiamétrie ; consulter le site www.mediametrie.fr) et Médiangles qu'en novembre 1999, la France comptait 5,7 millions d'internautes âgés de 15 ans et plus s'étant connectés au moins une fois sur les trente derniers jours personnellement (accès à partir de son domicile, son lieu de travail, une école ou une université ; consulter le site www.csa.fr). Aux Etats-Unis, où l'on comptait 101 millions d'internautes adultes à la mi-1999 (contre 84 millions fin 1998, 65 millions mi-1998 et 52,6 millions mi-1997) et 118,4 millions en novembre 1999 (enquête Nielsen et NetRatings), on estime que 55 % des foyers américains ont déjà effectué un achat en ligne. AOL, n° 1 mondial des services en ligne, a annoncé avoir vendu en 1999 plus de 10 milliards de dollars par Internet, dont 2,5 milliards rien que pendant les fêtes de fin d'année.
LE COMMERCE ÉLECTRONIQUE EN CHIFFRES, EN FRANCE
1996 |
1997 |
1998 |
1999 | |
Nombre de sites marchands |
nc |
120 |
600 |
900 |
Chiffre d'affaires des ventes d'entreprises à des particuliers (en millions de francs) |
nc |
42 |
400 |
1 300 |
Nombre de consommateurs |
20 000 |
60 000 |
210 000 |
700 000 |
Proportion dans la population totale des internautes |
4 % |
6 % |
7 % |
10 % |
Source : Le Journal du Net (Benchmark Group), cité par La Tribune du 23 décembre 1999.
Selon la Commission européenne, le chiffre d'affaires du commerce électronique en Europe pourrait atteindre 340 milliards d'euros en 2003. Cependant, EDS estime que « 75 % des internautes souhaitant acheter en ligne abandonnent en cours de route, découragés par une navigation trop complexe, une offre pas assez claire ou une curiosité jugée trop envahissante » (consulter le site http://www.eds.com/)
Le commerce électronique favorise l'émergence de nouveaux acheteurs, d'une nouvelle catégorie de « détaillants » qui n'appartiennent pas aux circuits traditionnels de la grande distribution ou du petit commerce.
On le voit, l'hypermarché traditionnel va sans doute être de plus en plus confronté :
- à la concurrence des sites marchands et des galeries marchandes virtuelles ;
- à la concurrence du site web de sa propre enseigne.
Pour l'instant, les conséquences de cette concurrence restent limitées. Les ventes en ligne représentent, surtout en Europe, qu'une infime partie des transactions commerciales. Même aux Etats-Unis, le commerce électronique n'occupe qu'une place réduite, les prévisions pour 2002 indiquant qu'il ne représenterait que 3 à 4 % du commerce de détail.
En outre, les ventes en ligne restent principalement limitées à des produits comme les livres, les disques, les voyages, les équipements et les services en micro-informatique, les services financiers - notons toutefois qu'il s'agit des créneaux sur lesquels les grandes surfaces essaient de se positionner de plus en plus.
Par ailleurs, les consommateurs ne pourront ou ne voudront tout acheter en ligne. Il en va ainsi des produits frais ou de ceux dont ils souhaitent avoir la jouissance immédiate sans en attendre la livraison. Mais le délai de livraison proposé peut être court : Wal-Mart s'engage à livrer les commandes dans le monde sous deux à huit jours selon le tarif choisi.
Malgré ces obstacles, les perspectives de développement du commerce électronique sont réelles. Elles ne pourront être sans conséquence sur l'organisation des circuits de distribution ; le commerce électronique représente une nouvelle méthode de vente qui va concurrencer les hypermarchés sous leur forme traditionnelle. Les grandes enseignes l'ont compris aux Etats-Unis puisqu'il semble bien qu'elles prennent le virage de la vente en ligne. De même, les petites entreprises, mais aussi les petits commerces, peuvent voir dans le commerce électronique une occasion à saisir pour s'ouvrir de nouveaux marchés. Encore faut-il cependant qu'ils se dotent d'une logistique performante de stockage et d'acheminement des produits. De ce point de vue, les entreprises françaises de grande distribution disposent d'un atout par rapport à la plupart de leurs concurrents européens qui doivent faire appel aux services de grossistes, de sociétés spécialisées ou de leurs fournisseurs pour assurer les fonctions de logistique. Leur logistique devra cependant s'adapter à des livraisons de petites quantités en milieu urbain, ce qui est d'un coût élevé. Cette mutation est à la portée des groupes français qui sont multiformat et gérants de petits commerce de proximité.
L'exemple américain souligne l'importance de la logistique en matière de commerce électronique. Les plus grands distributeurs doivent passer des accords avec les entreprises postales ; c'est ainsi qu'un quart des volumes transportés par UPS résulte de commandes de biens passées par voie électronique.
Le marché américain montre également que le commerce électronique se traduit par une guerre des prix acharnée. Le critère de prix semble être déterminant aux yeux du consommateur pour passer sa commande (sans doute du fait des moteurs de recherche). Les sites pratiquent donc le prix le plus bas de manière systématique, ce qui ne manque pas de laisser très interrogatif sur la rentabilité commerciale des sites, y compris le n° 1 mondial Amazon.com. Cependant, tant que les cours de bourse de ces sociétés poursuivent leur croissance folle, aucun banquier ou homme d'affaires ne se soucie de ce détail. Il est d'ailleurs vraisemblable que la rentabilité de ces affaires commerciales passe par les activités accessoires à la vente (prestations publicitaires, remises de fournisseurs pour apport de chiffre d'affaires, reversement de charges d'accès téléphoniques, etc.), ce qui, sous un certain angle, rappelle le système commercial de la grande distribution française classique ...
Le commerce électronique : menace ou opportunité de développement pour la grande distribution ? Il n'est pas possible d'y répondre aujourd'hui, mais la mission d'information recommande de suivre très attentivement ce secteur dont chacun peut pressentir les répercussions sur les circuits de distribution.
Nous recommandons particulièrement aux PME-PMI qui souhaitent se lancer dans le commerce électronique de se faire référencer dans les principaux annuaires et dans les moteurs de recherche. Nous invitons les pouvoirs publics à favoriser et soutenir la création d'annuaires, répertoires et moteurs de recherche francophones et à encourager la conclusion d'accords de réciprocité portant sur l'accès à des moteurs de recherche nord-américains.
Le 6 mai 1998, M. Dominique Strauss-Kahn, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, a annoncé dix mesures gouvernementales pour le développement du commerce électronique (consulter le site Internet ministériel : www.finances.gouv.fr). En outre, le décret n° 99-1048 du 14 décembre 1999 a créé une mission pour le commerce électronique. Cette mission, présidée par M. Francis Lorentz, qui est chargé de ce dossier par le Gouvernement depuis 1997, doit prendre fin le 15 décembre 2001 ; un rôle de concertation entre les acteurs des secteurs privé et public lui est confié ; elle doit établir « un tableau de bord du commerce électronique » pour mesurer les progrès accomplis, effectuer des comparaisons internationales et préparer une conférence nationale annuelle ; elle est chargée d'actions de communication et participe aux travaux interministériels sur l'adaptation du cadre juridique applicable au commerce électronique et à Internet.
Les problèmes juridiques très nombreux qui se posent en matière de reconnaissance juridique des contrats dématérialisés, des pertes fiscales pour les Etats si les opérateurs évoluent depuis des pays tiers, de sécurisation des transactions commerciales, de confidentialité des échanges et de paiements en ligne, de certification des opérateurs, de règlement des litiges, des problèmes de propriété intellectuelle, vont nécessiter le vote de textes législatifs, la publication de textes réglementaires mais également la conclusion d'accords internationaux.
Le 7 décembre 1999, le Conseil des ministres de l'Union européenne a adopté une proposition de directive sur le commerce électronique (en cours d'examen par le Parlement européen). Ce texte prévoit que les sites commerciaux seront soumis aux lois commerciales du pays dans lequel ils sont établis, et non du pays de l'acheteur, et reconnaît la valeur juridique du contrat d'achat par Internet. Elle exclut, en outre, toute responsabilité des fournisseurs d'accès sur les transactions et ne lui impose pas de surveiller les informations qu'il transmet ou stocke.
En revanche, la directive ne détermine pas quelle sera la loi applicable aux transactions par voie électronique lorsqu'elles sont conclues entre un vendeur et un consommateur : « la présente directive n'a pas pour objet d'établir des règles spécifiques de droit international privé relatives aux conflits de lois et de juridictions et ne se substitue pas aux conventions internationales y afférentes ». L'article 3 de la directive, qui prévoit que la loi nationale du territoire sur lequel un prestataire de service commercial est établi s'impose à lui, exclut expressément de son champ d'application les contrats passés avec les consommateurs.
Selon l'Institut national de la consommation, l'article 5 de la convention relative à la loi applicable aux obligations contractuelles, signée à Rome le 19 juin 1980, pourra s'appliquer aux ventes par voie électronique. Cet article prévoit que le consommateur est protégé par sa loi nationale pour tous les contrats dont « la conclusion a été précédée dans ce pays d'une proposition spécialement faite ou d'une publicité, et si le consommateur a accompli dans ce pays les actes nécessaires à la conclusion du contrat » ou « si la cocontractant du consommateur a reçu la commande du consommateur dans ce pays ». Cette convention est en cours de renégociation. La question n'est donc pas tranchée.
Les responsables d'annuaires et de répertoires devront se porter garants des entreprises qu'ils référencent et il serait sans doute souhaitable d'aller vers la certification de certains sites pour que le consommateur puisse juger de la confiance à accorder à un site.
Même si aujourd'hui les échanges commerciaux par Internet restent marginaux, il nous apparaît important que les entreprises englobent ces nouvelles technologies dans leur stratégie de développement commercial, en se donnant les moyens de recevoir les commandes en ligne et de conclure des transactions. Nous sommes persuadés que ces techniques se développeront parallèlement à l'activité de logistique, secteur qui s'est largement transformé dans le domaine de la vente sur catalogue.
II.- LES RELATIONS CONTRACTUELLES ENTRE FOURNISSEURS ET REVENDEURS
Les relations commerciales entre fournisseurs et revendeurs sont régies par le principe de la liberté contractuelle. Ce principe résulte de l'article 1101 du code civil.
Ce principe a une valeur législative et la loi peut donc en encadrer l'exercice en matière commerciale. L'absence de valeur constitutionnelle de la liberté contractuelle a été constatée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 94-348 DC du 3 août 1994 (« aucune norme de valeur constitutionnelle ne garantit le principe de la liberté contractuelle »). Le principe de liberté figurant à l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ne saurait donc être étendu aux contrats et donc au commerce. Cependant, le Conseil constitutionnel a jugé, dans sa décision n° 98-401 DC du 10 juin 1998, qu'il était « loisible au législateur d'apporter à la liberté d'entreprendre qui découle de l'article 4 de la Déclaration de 1789, les limitations justifiées par l'intérêt général ou liées à des exigences constitutionnelles, à la condition que lesdites limitations n'aient pas pour conséquence d'en dénaturer la portée ».
A.- L'ABROGATION, EN 1996, DE L'INTERDICTION DU REFUS DE VENTE
a) La situation antérieure à 1996
M. Jean-Paul Charié a résumé dans son rapport n° 2595 du 6 mars 1996 l'historique de l'interdiction du refus de vente. En voici le texte :
« L'interdiction du refus de vente a, pour la première fois, été édictée par l'article 38 de l'acte dit loi du 21 octobre 1940 modifiant, complétant et codifiant la législation sur les prix. Le dispositif était le suivant : « Est également considéré comme hausse illicite de prix le fait, par tout commerçant, industriel ou artisan : 1° De conserver les produits, matières ou denrées destinées à la vente en refusant de satisfaire, dans la mesure de ses disponibilités, aux demandes de sa clientèle dès lors que ces demandes ne présentent pas un caractère anormal ; ».
« La prohibition s'appliquait aussi bien aux ventes aux consommateurs qu'aux ventes réalisées entre les entreprises pour leur activité professionnelle.
« L'établissement de ce délit pénal puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 16 F à 100.000 F. était motivé par la hausse des prix endémique et l'état de pénurie général dans lequel se trouvait l'économie.
« Ces dispositions furent expressément déclarées nulles par l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix. L'article 37 de ladite ordonnance ne conserva qu'une interdiction « de conserver les produits destinés à la vente en refusant de satisfaire, dans la mesure de ses disponibilités, aux demandes des acheteurs ou de refuser de satisfaire, dans la mesure de ses moyens, aux demandes de prestations de services, dès lors que ces demandes ne présentent aucun caractère anormal et que la vente des produits ou la prestation des services n'est pas interdite par une réglementation spéciale ou soumise à des conditions qui ne sont pas remplies » (art. 37-1°-a). La prohibition, dont le non-respect était sanctionné pénalement, visait en fait la rétention de produits plus que leur vente. Cependant, pour la première fois, les services étaient pris en compte par la loi.
« Le décret n° 53-704 du 9 août 1953 relatif au maintien ou au rétablissement de la libre concurrence industrielle et commerciale rétablit le délit pénal de refus de vente, en conservant l'extension aux prestations de service. Le a) du 1° de l'article 37 de l'ordonnance du 30 juin 1945 relative aux prix assimila désormais « à la pratique des prix illicites, le fait par tout commerçant, industriel ou artisan, de refuser de satisfaire dans la mesure de ses disponibilités aux demandes des acheteurs de produits ou aux demandes de prestation de services lorsque ces demandes ne présentent aucun caractère anormal, qu'elles émanent de demandeurs de bonne foi et que la vente de produits, ou la prestation de services n'est pas interdite par la loi ou un règlement de l'autorité publique, ainsi que de pratiquer habituellement des majorations discriminatoires de prix qui ne sont pas justifiées par des différences de prix de revient ».
« Le décret de 1953 marqua un net infléchissement dans la législation française dans la mesure où il avait pour objectif d'assurer une égalité de traitement entre les différentes formes de commerce face aux producteurs et d'empêcher les industriels de priver -par leur puissance qui était dominante à l'époque- des nouveaux commerces d'un approvisionnement dont ceux-ci avaient besoin pour se développer.
« Le décret n° 58-545 du 24 juin 1958, pris en vertu d'une habilitation législative donnée par la loi du 13 décembre 1957 dans le but d'assurer la stabilisation des prix et l'organisation du marché, précisa le dispositif d'interdiction du refus de vente en permettant de refuser les commandes ou les demandes de prestation de service dont les conditions n'étaient pas conformes aux usages commerciaux. Il prohiba également les conditions discriminatoires de vente pratiquées habituellement et non justifiées par des hausses de prix de revient.
« L'objectif était désormais d'empêcher les industriels d'étouffer la grande distribution naissante dont les méthodes de vente étaient inhabituelles et dont la politique, soutenue par les pouvoirs publics, reposait sur une compression des marges et des coûts et une obtention de remises d'échelle et visait à lutter contre les prix élevés.
« Le dispositif de l'article 37-1°-a résultant du décret du 24 juin 1958 était le suivant : « Est assimilé à la pratique des prix illicites le fait : 1° Par tout producteur, commerçant, industriel ou artisan : a) De refuser de satisfaire, dans la mesure de ses disponibilités et dans les conditions conformes aux usages commerciaux, aux demandes des acheteurs de produits ou aux demandes de prestation de services, lorsque ces demandes ne présentent aucun caractère anormal, qu'elles émanent de demandeurs de bonne foi et que la vente de produits ou la prestation de service n'est pas interdite par la loi ou par un règlement de l'autorité publique ainsi que de pratiquer habituellement des conditions discriminatoires de vente ou des majorations discriminatoires de prix qui ne sont pas justifiées par des augmentations correspondantes du prix de revient de la fourniture ou du service ; ».
« Le I de l'article 63 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat abrogea l'interdiction de pratiquer habituellement des conditions de vente ou des majorations de prix discriminatoires non justifiées par des augmentations de prix de revient.
« A l'abrogation de l'ordonnance du 30 juin 1945 relative aux prix le dispositif d'interdiction du refus de vente ou de prestation de services était donc le suivant :
« Art. 37.- Est assimilé à la pratique des prix illicites le fait :
« 1° Par tout producteur, commerçant, industriel ou artisan :
« a) De refuser de satisfaire, dans la mesure de ses disponibilités et dans les conditions conformes aux usages commerciaux, aux demandes des acheteurs de produits ou aux demandes de prestation de services, lorsque ces demandes ne présentent aucun caractère anormal, qu'elles émanent de demandeurs de bonne foi et que la vente de produits ou la prestation de services n'est pas interdite par la loi ou par un règlement de l'autorité publique ; ».
« Le contrevenant était passible d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 60 francs à 200.000 francs.
« L'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 a transformé l'infraction pénale en délit civil, c'est-à-dire que la personne commettant une faute constitutive de refus de vente ou de prestation de services engage sa responsabilité et, en cas de plainte, l'oblige à réparer les préjudices ainsi causés. Cette obligation joue également vis-à-vis des tiers à la transaction avortée qui peuvent demander réparation. Ainsi, le refus de vente ou de prestation est resté une pratique interdite per se.
« Affirmer que cette interdiction n'existe pas revient à prôner l'anarchie et la loi du plus fort : le code civil n'interdit pas de causer dommage à autrui, il exige simplement que la victime est en droit d'obtenir réparation, mais cela ne signifie pas que la loi n'interdit pas, dans son principe, d'avoir une conduite qui cause dommage à autrui. Il en est de même pour le refus de vente, la loi proscrit ce comportement dans les relations entre professionnels en tant que tel, sauf lorsque certaines conditions sont réunies. Il ne faut pas dire « le refus de vente est libre en France sauf dans telles situations... » mais « le refus de vente est interdit sauf dans telles situations... ». L'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ne reconnaît donc pas, a priori, un caractère licite au refus de vente.
« Le juge civil ou commercial est d'ailleurs en droit d'annuler un refus contraire aux dispositions de l'article 36 de l'ordonnance, comme il peut annuler une vente discriminatoire ou une vente liée.
« Le 2 de l'article 36 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 qualifie ainsi de comportement fautif le refus opposé aux demandes des acheteurs ne présentant aucun caractère anormal et faites de bonne foi ou qui n'est pas justifié par un contrat régulier (en particulier d'exclusivité) conforme à la législation sur les ententes, la position dominante et la dépendance économique.
« La réforme de 1986 s'est accompagnée de la suppression de deux causes susceptibles d'exonérer le vendeur de son obligation de satisfaire aux demandes régulières d'un acheteur : l'insuffisance de ses disponibilités et l'impossibilité de satisfaire à la demande dans les conditions conformes aux usages commerciaux. La référence aux usages commerciaux n'a toutefois pas totalement disparu du nouveau dispositif d'interdiction du refus de vente car un tel refus n'est pas fautif lorsque la demande est anormale. Or, une demande non conforme aux usages commerciaux, notamment une demande accompagnée d'exigences exorbitantes en matière de délai de paiement, pourra vraisemblablement être considérée comme anormale.
« En revanche, l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 a maintenu le délit pénal de refus de vente ou de prestation de services aux consommateurs (article 30 codifié sous l'article L. 122-1 du code de la consommation). Pour la première fois, les relations avec les consommateurs suivaient un régime différent des relations commerciales entre les professionnels. »
b) Les motifs de l'abrogation de l'interdiction du refus de vendre
La prohibition du refus de vente était depuis longtemps contestée. La doctrine juridique rejoignait d'ailleurs les conclusions de l'analyse économique et des praticiens : le rapport de force s'était inversé au profit des distributeurs dans les années 1970 et 1980, et l'économie est devenue tellement dominée par la demande que le refus de vente ne pouvait qu'être exceptionnel. La commission présidée par M. Donnedieu de Vabres, qui avait été chargée d'élaborer un projet d'ordonnance sur le droit de la concurrence en 1986, avait d'ailleurs recommandé l'abandon pur et simple de l'interdiction du refus de vente. M. Edouard Balladur, ministre de l'économie et des finances, ne l'avait finalement pas suivie par souci d'accompagnement de la suppression du contrôle des prix et d'acclimatation des acteurs économiques au jeu de la concurrence.
En 1995, 38 affaires avaient été portées devant les tribunaux de grande instance ou de commerce pour refus de vente abusif (dont 12 par assignation ministérielle). Aucune législation des pays européens voisins n'interdisait en soi le refus de vente entre professionnels.
La suppression de l'interdiction a essentiellement été justifiée par les arguments suivants (voir JO.débats AN, 28 mars 1996, p. 2178 et s. et 29 mai 1996, p. 3593 et s. ; voir le rapport de M. Jean-Jacques Robert n° 336 (Sénat), pp. 80 et 81) :
- l'interdiction du refus de vente avait été établie par l'acte dit loi du 21 octobre 1940 puis par l'ordonnance du 30 juin 1945 sur les prix pour des raisons tenant à l'état de pénurie de l'économie : cette situation n'existe plus ;
- l'interdiction a été maintenue dans le but d'empêcher les industriels de priver les nouvelles formes de commerce d'un approvisionnement indispensable à leur émergence et à leur développement : le rapport de force est aujourd'hui inversé en dépit de la puissance de certaines multinationales industrielles et le marché est dominé par l'abondance de l'offre de produits et services ;
- l'autorisation du refus de vente permettra aux fournisseurs de résister au chantage commercial que des revendeurs peuvent exercer sur des produits leaders et ainsi tendra à rééquilibrer les rapports entre fournisseurs et revendeurs ;
- les industriels pourront, à l'occasion du lancement d'un nouveau produit, sélectionner les revendeurs en fonction d'une certaine stratégie commerciale.
La suppression de l'interdiction du refus de vente figurant auparavant au 2 de l'article 36 ne prive pas les entreprises confrontées à un refus de vente de tout recours si celui-ci est abusif. En effet, un refus de vente abusif peut toujours être poursuivi sur le fondement de plusieurs dispositions législatives :
- lorsqu'il constitue un abus de position dominante, au titre de l'article 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 (cet article dispose expressément que « ces abus peuvent notamment consister en refus de vente ... »),
- lorsqu'il résulte de l'exploitation abusive d'un état de dépendance économique (article 8 de l'ordonnance),
- lorsqu'il est la manifestation d'une entente illicite (l'article 7 de l'ordonnance interdit expressément les pratiques qui « tendent à limiter l'accès au marché »).
Cependant dans ces trois cas, l'auteur du refus de vente ne peut être sanctionné qu'à condition que la pratique ait eu pour objet ou pu avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché ;
- lorsqu'il constitue une discrimination abusive au sens du 1 de l'article 36 ;
- lorsqu'il se traduit par une rupture brutale d'une relation commerciale établie, telle que définie au 5 de l'article 36 ;
- lorsqu'il cause un dommage à autrui : en application de l'article 1382 du code civil, son auteur doit le réparer dès lors qu'il est fautif au regard du droit de la responsabilité civile.
2. La libération du refus de vente doit être maintenue
a) Le droit de refuser de vendre n'a pas donné lieu à des abus connus
Selon les informations communiquées par M. Jérôme Gallot, directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ses services n'ont été saisis d'aucune plainte portant sur des refus de vente jugés abusifs, en dehors des affaires relevant du titre III de l'ordonnance du 1er décembre 1986 (abus de position dominante).
La mission a constaté que les industriels, en général dirigeant de grands groupes ou ayant mis au point des produits innovants, sont satisfaits de disposer de cette liberté. Celle-ci est cependant peu utilisée, comme les députés et sénateurs ayant défendu l'abrogation de l'interdiction en 1996 l'avaient prédit, mais n'en conserve pas moins son utilité pour défendre une politique commerciale de fournisseur hors du système très strict de la distribution exclusive ou sélective.
b) Le problème de l'approvisionnement de coopératives d'achat d'artisans est cependant soulevé
Les artisans peuvent se regrouper en coopératives pour acheter de manière groupée leurs fournitures. Or, plusieurs de ces coopératives se plaignent de refus de vente de gros fournisseurs sur lesquels des enseignes de grande distribution exercent des pressions pour qu'ils refusent la vente à ces coopératives.
B.- DE LA NÉGOCIATION COMMERCIALE À LA DOMINATION COMMERCIALE
La négociation commerciale vise à déterminer les termes d'une opération d'achat ou de vente entre un fournisseur et un revendeur. Les conditions de son déroulement et les éléments sur lesquels elle porte et qui, au terme de la négociation, sont traduits dans le contrat de vente ou d'achat, sont au c_ur de l'essentiel des litiges actuels entre fournisseurs et distributeurs en France.
La mission d'information a la conviction qu'une correcte application de la loi et accessoirement une réorganisation concertée de certaines pratiques utilisées lors de cette négociation ou une clarification de leur conformité à la loi permettraient de résoudre de très nombreux litiges et de rééquilibrer les relations commerciales entre fournisseurs et revendeurs qui sont gravement perturbées par l'existence de faits abusifs déloyaux.
La négociation commerciale prend, en effet, en France, souvent la forme d'un rapport de force, d'une confrontation d'intérêts divergents. La mission a constaté que cela était également devenu le cas en Espagne où les rapports entre fournisseurs et distributeurs sont en tous points comparables à ceux existant en France. Cependant, l'exemple français n'est pas la norme : l'Allemagne ou le Royaume-Uni (voir les notes sur la distribution dans ces pays, en annexe du rapport) ne connaissent pas de tels rapports tendus, même si quelques pratiques déloyales sont observées entre fournisseurs et distributeurs ; le partenariat et le respect de la parole donnée sont de règle, comme dans la plupart des pays développés, y compris en Asie.
Certes, ces rapports difficiles et conflictuels n'existent pas toujours. Nous avons entendu des chefs d'entreprises moyennes témoignant de cas de convergences d'intérêts commerciaux entre eux et des distributeurs. Ce véritable partenariat permet de définir un même objectif commercial et de chercher de concert les conditions assurant aux deux partenaires de se développer, au bénéfice des consommateurs. Ce type de relations existe avant tout avec les PME-PMI fournissant des produits sous marque de distributeur. De même, l'audition du 30 novembre 1999 de la commission de la production et des échanges a montré que le secteur de l'horticulture et des pépinières semble vivre sur des rapports de sincère partenariat commercial (voir le compte rendu intégral en annexe du rapport).
Cependant, la mission a recueilli de nombreux témoignages, parfois dramatiques, montrant que la négociation commerciale est très mal vécue par les fournisseurs aussi bien en raison de sa forme que des conditions de vente qui sont exigées de la part des acheteurs. Plusieurs fournisseurs nous ont exprimé directement ou par des témoignages écrits qu'il n'y avait plus de négociation mais seulement des diktats de la centrale d'achat ou du responsable des achats d'un super ou d'un hypermarché. « Les nouveaux acheteurs sont des tueurs » nous a affirmé un dirigeant d'une PME.
On trouvera ci-après des témoignages reçus par la mission d'information sur ces relations conflictuelles.
Lors de l'audition du 30 novembre 1999 de la commission de la production et des échanges, M. Daniel Bernard, président directeur général de Carrefour, a estimé que ces exemples étaient marginaux et que leur mise en exergue cachait la majorité des relations commerciales sans problème établies par les enseignes de grande distribution françaises : « Que représente ces abus par rapport aux millions de commandes que nous passons chaque année ? Que représente la petite dizaine de factures, sorties de leur contexte, qui nous sont opposées par rapport aux millions de factures que nous réglons chaque année, faisant vivre des milliers d'entreprises ? Quelques dysfonctionnements justifient-ils de modifier une nouvelle fois une loi, dont nous avions prévu dès le départ les qualités et les défauts, au risque de revenir à une économie administrée et de pénaliser les PME françaises, alors que nous vivons dans des économies ouvertes où chacun peut acheter n'importe où dans le monde ? »
Pourtant, la mission juge que ces témoignages sont représentatifs de l'état d'esprit et de la consistance des relations commerciales entre les producteurs et les distributeurs en France. Ils ne forment pas le sommet d'un iceberg vertueux mais l'iceberg lui-même ; la dérive des abus est générale, les bonnes relations sont l'exception même si elles doivent être saluées et soutenues.
Par ailleurs, le président et le rapporteur de la mission ont eu grand mal à convaincre quelques producteurs de participer à l'audition du 30 novembre 1999 face aux présidents de Carrefour, Système U et Opéra, centrale d'achat de Casino et Cora. Les responsables des plus grands groupes français, y compris des multinationales, n'ont pas souhaité venir par crainte des conséquences commerciales de leurs propos. La presse n'a d'ailleurs jamais été en mesure de recueillir le témoignage d'un grand groupe sur la loyauté ou la confiance de ses relations avec la grande distribution.
Des exemples de partenariat doivent être cités car nous estimons qu'ils devraient inspirer toutes les relations commerciales. ITM Entreprises a établi des relations stables de partenariat avec de nombreuses PME-PMI françaises avec des contrats renouvelés souvent par tacite reconduction (ils sont d'une durée d'au moins trois à quatre ans). Selon plusieurs témoignages de ces chefs d'entreprises les relations commerciales se placent dans un climat de confiance : 3 000 petites ou moyennes entreprises régionales bénéficient de ces relations pour les approvisionnements locaux et 1 200 entreprises pour le marché national et européen. Promodès a également lancé sa marque « Reflets de France » dont les produits sont fabriqués par des PME qui ont trouvé les moyens par ce marché de se développer.
Mais même dans ce dernier cas, si la direction de l'enseigne n'y prend garde, les acheteurs finissent par imposer des exigences tellement insupportables qu'elles conduisent la PME à mettre des salariés au chômage, à arrêter des machines achetées à la demande de l'enseigne, etc. Tous les présidents de groupes de distribution estiment que des abus peuvent être commis par leurs acheteurs sur lesquels pèse une forte pression de rentabilité. M. Jérôme Bédier, président de la fédération des entreprises du commerce et de la distribution (FCD), nous a indiqué qu'une contractualisation de la place des PME-PMI dans les linéaires ne devrait pas relever d'une décision des acheteurs mais des directions des enseignes en raison des motifs stratégiques de cette politique.
A ce stade du rapport, il convient de rappeler que la négociation commerciale est libre ; c'est le fondement même de l'économie de marché.
Cependant, la loi fixe à cette liberté un cadre, qui est très limité, afin de garantir une loyauté et un équilibre minimal de la concurrence aussi bien entre les fournisseurs et entre les revendeurs (concurrence horizontale) qu'entre les fournisseurs et les revendeurs (concurrence verticale) :
- tout d'abord, certaines conditions de vente ou d'achat ne sont pas négociables : la loi impose ainsi des délais de paiement pour l'achat de certains produits ; elle interdit certains prix de revente (revente à perte de produits en l'état sauf exceptions, prix abusivement bas des produits transformés) ;
- la loi fixe des cadres contractuels précis pour certaines activités commerciales, comme le marché des espaces publicitaires ou la vente des livres ;
- la loi considère les conditions générales de vente du fournisseur, lorsqu'elles existent, comme étant le document de base d'une négociation commerciale. La circulaire Delors du 22 mai 1984 (voir ci-après) leur reconnaît un « rôle directeur (...) dans les relations commerciales » ;
- les modalités de calcul des pénalités pour dépassement des délais de paiement sont déterminées par la loi ;
- la loi considère les conditions générales de vente comme des documents contractuels engageant les deux partenaires, sous réserve des termes de la vente figurant dans le contrat de vente ou d'achat. Cependant l'établissement de conditions générales de ventes n'est pas impératif ;
- la discrimination au bénéfice ou au détriment d'un partenaire commercial est interdite lorsqu'elle n'est pas fondée sur des contreparties réelles ;
- l'exigence de conditions préalables à la négociation (référencement du fournisseur) est encadrée par la loi.
Il faut souligner que ce cadre législatif est spécifique à la France. Par exemple, les conditions générales de vente n'existent dans aucun grand pays européen, américain ou asiatique. Mais s'il n'existe pas de réglementation sur les délais de paiement ou les prix de revente, l'évolution des pratiques de la grande distribution conduit certains pays, comme l'Allemagne ou l'Espagne que nous avons visités, à introduire dans leur législation des dispositions encadrant la revente à perte, voire le respect des délais de paiement contractuels (en Espagne, loi votée le 16 décembre 1999). Il faut aussi souligner que le dispositif législatif est mal appliqué dans notre pays.
La négociation commerciale est traitée par le droit de la concurrence notamment sous quatre aspects : l'application des conditions générales de vente ; la coopération commerciale ; la discrimination commerciale ; l'abus de dépendance économique. Ces quatre points cristallisent les tensions entre fournisseurs et revendeurs. Les questions relatives à la fixation des prix et des délais de paiement sont étudiées dans la partie suivante du rapport relative à la gestion des prix.
La loi n° 96-588 du 1er juillet 1996, dite loi Galland, relative à la loyauté et l'équilibre des relations commerciales a permis de lever l'insécurité juridique pesant auparavant sur les niveaux légaux de prix de revente. Elle a mis fin à la « facturologie » et arrêté la concurrence, destructrice pour les fournisseurs, conduisant les grandes surfaces à annoncer des prix de revente toujours plus cassés au point d'être économiquement aberrants (voir partie III du rapport).
Cependant, les distributeurs, ne pouvant plus peser sur le prix de vente résultant du barème de prix et des conditions de vente des fournisseurs (la « marge avant », qui est le prix inscrit en bas de facture de vente ou d'achat des produits), se sont rabattus sur les rémunérations hors facture de vente ou d'achat, c'est-à-dire la marge arrière, pour obtenir les avantages financiers accordés auparavant essentiellement au travers de la marge avant. Cette marge arrière peut consister en une rémunération de services de coopération commerciale stricto sensu ou en des primes ou rémunérations diverses non liées à l'acte d'achat-vente des produits (souvent qualifiées de fausse coopération commerciale). La compétition horizontale entre distributeurs et verticale entre fournisseurs et distributeurs se place aujourd'hui sur le terrain de cette marge arrière.
L'Institut de liaisons et d'études des industries de consommations (ILEC) a évalué le double mouvement engagé depuis 1995 de rétrécissement de la marge avant (bénéficiant au fournisseur) et d'accroissement de la marge arrière (bénéficiant au client distributeur). Les deux tableaux sont reproduits dans le chapitre sur la coopération commerciale.
NÉGOCIATION COMMERCIALE ET FORMATION DES MARGES
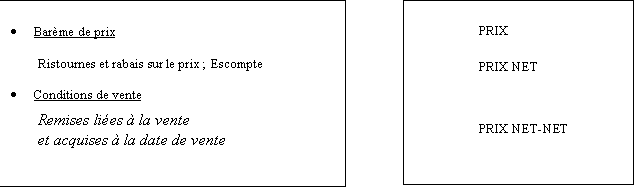
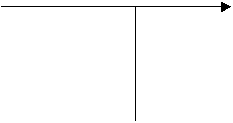
MARGE AVANT
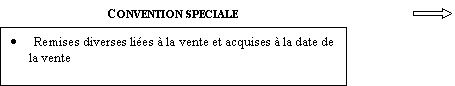
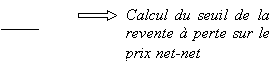
Facturation séparée
MARGE ARRIÈRE =
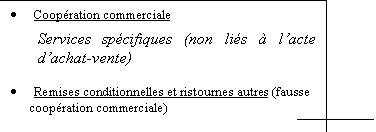
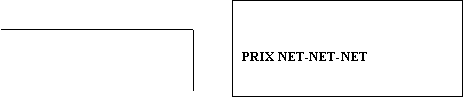
Propositions de la mission d'information :
- Faire figurer les services de coopération commerciale dans des conditions générales de vente du distributeur (à défaut de leur présence dans les conditions générales de vente du fournisseur).
- Appliquer les dispositions des circulaires Scrivener du 10 janvier 1978 et Delors du 22 mai 1984 aux services ne figurant pas dans des conditions générales de vente : les services rendus doivent être réels, identifiables et justifiés et leur rémunération avoir une portée restreinte par rapport aux avantages accordés en application des conditions générales de vente.
- Les remises exceptionnelles (ne pouvant figurer dans des conditions générales de vente) doivent également être marginales.
- Les conventions de ristournes particulières non liées à l'acte d'achat-vente ou à des services de coopération commerciale doivent être incorporées dans la marge avant (prix net-net) ou être marginales par rapport aux avantages accordés en application des conditions générales de vente.
1. L'application des conditions générales de vente
L'expression « conditions générales de vente » est d'usage courant et ancien mais n'a pas de définition légale ; elle est fréquemment utilisée par l'administration (voir par exemple la circulaire Delors du 22 mai 1984) et les tribunaux et figure même en fin de deuxième alinéa de l'article 33 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 (voir ci-après). Les conditions générales de vente regroupent les offres commerciales proposées par un fournisseur - producteur, industriel, artisan, importateur, grossiste, prestataire de services - à tous ses clients qui envisagent d'acquérir ses produits ou bénéficier de ses services. C'est donc un document synthétique, qui peut certes comporter plusieurs dizaines de pages, de l'offre de mise sur le marché d'un fournisseur ; il s'adresse à tous les clients potentiels et est élaboré et modifié (en général une fois par an) exclusivement par le fournisseur.
Un contrat de vente ou de prestation de service est l'application à un client précis de ces conditions générales de vente. L'usage a ainsi distingué les conditions générales de vente et les conditions de vente qui sont le résultat d'une négociation commerciale avec un client. La négociation commerciale étant libre, ces conditions de vente particulières peuvent s'écarter plus ou moins des conditions générales établies unilatéralement par le vendeur. Cet écart ne doit cependant pas être excessif au point d'accorder des avantages discriminatoires sans contrepartie à l'acheteur ou lui refuser des conditions dont bénéficient d'autres clients placés dans une situation commerciale comparable. Le caractère illicite de ces pratiques discriminatoires est posé par le point 1 de l'article 36 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986.
Ainsi, en France, la négociation porte d'abord sur la définition d'un prix de vente net, puis sur l'octroi de remises, rabais ou ristournes sur ce prix net, puis sur l'octroi de réduction de prix au titre de la coopération commerciale. La première étape est souvent éludée pour discuter immédiatement l'octroi de remises. Les deux autres étapes n'en sont pas à proprement parler parce que les demandes dont elles font l'objet sont continuelles tout au long de l'année.
Rappelons une nouvelle fois que les fournisseurs intervenant sur les marchés des pays étrangers n'ont pas de conditions générales de vente, y compris lorsqu'il s'agit de multinationales françaises. La négociation s'appuie donc sur des propositions quantitatives et qualitatives et de prix dits « nets-nets », c'est-à-dire incluant toutes les remises, rabais et ristournes dont le montant peut être déterminé à la date de la vente (conclusion du contrat). Les contrat signé inclut toutes les remises et ristournes qui seront octroyées en cours d'année.
La négociation d'un prix net-net est la norme internationale. M. Alfonso Merry del Val, délégué général de Continente Espagne, nous a d'ailleurs exprimé le v_u que les distributeurs espagnols, imprégnés des pratiques françaises, reviennent à ce principe simple.
a) Le contenu des conditions générales de vente
Les conditions générales de vente se divisent en général en des dispositions tarifaires (les barèmes de prix) et des dispositions sur la qualité des produits ou des services et les conditions dans lesquelles ils peuvent être cédés ou fournis et le prix peut être acquitté (les conditions de vente). La circulaire du 22 mai 1984 relative à la transparence tarifaire dans les relations commerciales entre entreprises, dite circulaire Delors, proposait une définition du contenu des conditions générales de vente :
« 1° les conditions générales de vente, établies par le fournisseur sous sa seule responsabilité, doivent traduire, lorsqu'elles sont différenciées en fonction des différentes modalités de transaction qui peuvent se présenter, les économies de coûts que le fournisseur peut objectivement attendre de celles-ci ;
« 2° le champ couvert par les conditions générales de vente doit être aussi large que possible ; il ne saurait être limité au seul tarif de base du fournisseur, même assorti d'un barème d'écart tenant compte, par exemple, des gains de productivité réalisés par le fournisseur en fonction des quantités livrées en une seule fois ou en un seul lieu, de la régularité des commandes, etc.
« Il doit comprendre également :
« a) les modalités de règlement : délai de règlement des marchandises, et montant des agios ou escomptes proposés aux clients en cas d'application d'un délai différent ;
« b) les rabais, remises et ristournes, sur facture ou différés, que le fournisseur est prêt à consentir à ses clients :
« soit en fonction des résultats escomptés de la transaction sur une période assez longue, un an en général, et mesurés sur la base de critères quantitatifs (chiffre d'affaires réalisé, progression du chiffre d'affaires, accroissement du volume des marchandises livrées ...) ;
« soit en rémunération de la prise en charge par ce dernier de certaines fonctions ou services commerciaux (tels que prise d'ordre, stockage, éclatement des livraisons vers les magasins de détail, services après-vente ...) ;
« c) les rémunérations de la prise en charge par le fournisseur de fonctions incombant normalement à ses clients (marquage du prix des produits, gestion de linéaire, etc.) ;
« 3° tout avantage financier, sur facture ou différé, doit être rattaché à des dispositions précises figurant dans les conditions générales de vente ;
« 4° il est indispensable que tout avantage particulier bénéficie dans les mêmes conditions aux autres clients du fournisseur, qui doit modifier en conséquence ses conditions générales de vente. De même, les opérations de promotion aux consommateurs décidées par le fournisseur doivent faire l'objet d'une information de tous les clients selon les mêmes modalités que les conditions générales de vente, dont elles font partie intégrante. »
L'article 33 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence précise que les conditions de vente « comprennent les conditions de vente et, le cas échéant, les rabais et les ristournes » et que « les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les modalités de calcul et les conditions dans lesquelles des pénalités sont appliquées dans le cas où les sommes dues sont versées après la date de paiement figurant sur la facture, lorsque le versement intervient au-delà du délai fixé par les conditions générales de vente. »
b) L'obligation de communiquer les conditions générales de vente
La loi n'a jamais imposé aux fournisseurs d'établir des conditions générales de vente, mais seulement, lorsqu'elles existent, de les communiquer aux acheteurs qui en font la demande. Certaines activités exercées sur des marchés extrêmement fluctuants rendent en effet impossible l'établissement de conditions générales de vente ou plus précisément de barèmes de prix.
L'obligation de communiquer à tout acheteur « son barème de prix et ses conditions de vente » a été introduite par l'article 37 de la loi Royer n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat qui disposait que « tout producteur est tenu de communiquer à tout revendeur qui en fera la demande son barème de prix et ses conditions de vente ». L'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix ne contenait aucune disposition sur les conditions générales de vente. L'article 1er de la loi n° 85-1408 du 30 décembre 1985 portant amélioration de la concurrence a modifié cette législation en abrogeant l'article 37 de la loi du 27 décembre 1973 et en insérant un 5° dans l'article 37 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix disposant qu'est assimilé à une pratique de prix illicite le fait « par tout producteur, grossiste ou importateur, de refuser de communiquer à tout revendeur qui en fera la demande son barème de prix et ses conditions de vente. Cette communication se fait par tout moyen conforme aux usages commerciaux de la profession concernée ».
L'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence a codifié cette dernière disposition sous son article 33 et a abrogé l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945.
L'article 18 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption a étendu l'obligation de communication aux prestataires de services afin d'appliquer cette règle de transparence au marché de l'espace publicitaire et de clarifier le périmètre de la coopération commerciale dont les services spécifiques ne peuvent correspondre aux services figurant ou devant figurer dans les conditions générales de vente des distributeurs ou de leurs centrales d'achat.
Cependant, la chambre commerciale de la Cour de cassation considère que, même en l'absence de barèmes préétablis, un fournisseur (une agence de publicité en l'occurrence) est tenu de communiquer les taux de ristournes accordés à ses clients habituels ou occasionnels et les volumes de commandes correspondants (affaire n° 92-11.425, arrêt du 18 janvier 1994). Un client étranger peut également bénéficier du droit à communication dès lors que les produits (ou services) sont achetés sur le territoire français, même s'ils sont commercialisés ou distribués à l'étranger (chambre commerciale de la Cour de cassation, 16 juin 1998, affaire n° 96-20.182).
Cette obligation de communication s'applique exclusivement aux relations commerciales entre professionnels, c'est-à-dire entre fournisseurs et revendeurs, par opposition aux relations entre un vendeur et un consommateur final. Elle peut être exercée par « tout acheteur de produit ou demandeur de prestation de services pour une activité professionnelle ». Elle ne peut donc pas être refusée à une centrale d'achat ou de référencement qui ne procède pas juridiquement à l'achat des produits mais est considérée comme un prestataire de services d'entreprises de distribution ou comme leur mandataire. En revanche, un concurrent d'un fournisseur ne saurait bénéficier de cette obligation : l'acheteur doit être au moins potentiel ou éventuel (Cour d'appel de Versailles, 13ème chambre, 3 avril 1997).
Comme on l'a vu avec la circulaire Delors du 22 mai 1984, l'administration fait une interprétation large de la notion de conditions générales de vente et donc du contenu de l'obligation de communication. Ainsi, dans une note de service n° 5322 du 3 février 1988, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes demandait que fussent soumises à communication les ristournes de référencement, les ristournes liées à la qualité du fournisseur ou du distributeur, les ristournes et remises spéciales, promotionnelles ou exceptionnelles, les ristournes versées pour des anniversaires, des fêtes ou des ouvertures de magasins.
Si cette interprétation de la loi s'appliquait au texte de l'ordonnance du 1er décembre 1986 avant sa modification par la loi du 1er juillet 1996, cette volonté de réduire au maximum le champ de la coopération commerciale, et donc des services spécifiques non soumis à l'obligation de communication, subsiste. Elle n'est pas en effet le seul fait de l'administration, la chambre commerciale de la Cour de cassation a notamment dans un arrêt du 27 février 1990 (affaire n° 88-12.189) imposé la communication de rabais et ristournes accordés à titre occasionnel, notamment au titre d'actions promotionnelles du distributeur. De même, la Cour d'appel de Versailles a, le 8 janvier 1998, condamné un fabricant à communiquer « l'ensemble des conditions, barèmes, taux de rémunération habituellement pratiqués, la nature et le nombre de services correspondants, les produits concernés et les facteurs généraux, objectivement définis, pris en compte pour la détermination des pourcentages de rémunération, afférents aux accords de coopération commerciale, à l'exclusion toutefois des contrats eux-mêmes ».
Ces interprétations et jurisprudences visent à assurer une transparence maximale aux transactions commerciales, dans le respect du secret des affaires, afin de garantir la loyauté et l'équilibre de la concurrence.
L'article 33 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 précise que la communication des barèmes de prix et conditions de vente « s'effectue par tout moyen conforme aux usages de la profession. »
A l'origine, l'article 37 de la loi Royer (voir ci-dessus) ne précisait pas les modalités de cette communication. Pour combler ce vide, la chambre criminelle de la Cour de cassation avait, dans un arrêt du 27 avril 1981 (affaire n° 79-93.619), exigé une communication par écrit. L'article 1er de la loi n° 85-1408 du 30 décembre 1985 précitée a rendu caduque cette jurisprudence en prévoyant une communication « par tout moyen conforme aux usages commerciaux de la profession concernée ».
La communication sous la forme d'un écrit reste en fait la modalité quasi générale utilisée par les fournisseurs. Cependant, cette rédaction de la loi prend aujourd'hui tout son intérêt avec le développement de l'échange de données informatisées. En effet, rien n'empêcherait un fournisseur de communiquer par voie informatique ses conditions générales de vente dès lors que se généralise dans son secteur d'activité la dématérialisation des documents commerciaux. Il est vraisemblable qu'avant dix ans le procédé électronique sera le moyen de communication le plus usité.
Indiquons, en dernier lieu, que le dernier alinéa (4°) de la circulaire Delors du 22 mai 1984 reproduit ci-dessus n'est plus appliqué : les avantages particuliers accordés à un client ou les opérations promotionnelles ne sont plus réintroduits dans les conditions générales de vente afin que tous les clients répondant aux conditions pour les obtenir puissent en bénéficier. De même, les clients ne sont pas systématiquement informés par leurs fournisseurs des opérations promotionnelles qu'ils décident (en général avec un client particulier).
En fait, ces avantages et promotions ont été considérés comme relevant de la coopération commerciale pure et donc comme n'ayant pas leur place dans les conditions générales de vente et non soumis au principe de transparence. Cette analyse est très contestable et relève avant tout d'une dérive de la notion de coopération commerciale comme on le verra ci-après.
c) Les conséquences d'un refus de communication
Toute infraction aux dispositions de l'article 33 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 est sanctionnée pénalement par une amende pouvant atteindre 100 000 F.
Avant son abrogation par l'article 57 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 relative à la constatation, la poursuite et la répression des infractions à la législation économique punissait de deux mois à deux ans d'emprisonnement et de 60 F à 200 000 F d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement la non-communication des barèmes de prix et des conditions de vente. Dans son texte d'origine, l'ordonnance du 1er décembre 1986 avait retiré à cette infraction le caractère de délit et son décret n° 86-1309 d'application du 29 décembre 1986 la punissait d'une contravention de 5ème classe. L'article 33 de la loi n° 92-1442 du 31 décembre 1992 relative aux délais de paiement entre les entreprises a rétabli le caractère délictuel de l'infraction et fixé la peine d'amende maximale à 100 000 F.
d) Le rôle directeur des conditions générales de vente dans les relations commerciales
Comme il a été indiqué, la circulaire Delors du 22 mai 1984 relative à la transparence tarifaire dans les relations commerciales entre entreprises considère qu'un « rôle directeur (...) doit revenir aux conditions générales de vente dans les relations commerciales » (voir son texte ci-dessus et ci-après dans les développements relatifs à la coopération commerciale). Cette disposition est le constat d'une pratique séculaire des entreprises de tous les pays industrialisés.
Le fait que les conditions générales de vente servent de base à la négociation commerciale entre entreprises a longtemps placé les producteurs et industriels en position de force face aux revendeurs. Cependant, afin d'empêcher leurs abus dans les relations commerciales, la loi a, depuis 1945, imposé plusieurs obligations aux fournisseurs :
- le refus de vente et les ventes liées leur ont été interdits jusqu'en 1996 (voir le chapitre ci-dessus) ;
- la transparence des conditions générales de vente leur a été imposée ;
- les pratiques de prix ou de conditions de vente discriminatoires ont été interdites par l'article 37 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat ;
- les prix minima de revente ou l'imposition de marges commerciales minimales ont été interdits, sauf pour la vente des livres.
La législation et la jurisprudence considèrent toujours aujourd'hui que les conditions générales de vente ont un rôle directeur dans les relations commerciales. Le législateur et l'administration ont ainsi toujours refusé de reconnaître toute base légale aux documents établis par l'acheteur dénommés « conditions générales d'achat » (voir notamment les débats à l'Assemblée nationale sur le projet de loi relatif à l'équilibre et la loyauté des relations commerciales en mars 1996) : ces documents établis unilatéralement comme les conditions générales de vente ne peuvent donc avoir un caractère contractuel ou un caractère interprétatif des dispositions contractuelles si les deux parties ne décident pas de faire figurer expressément leurs dispositions dans les clauses du contrat d'achat ou de vente ou de les transformer en un document contractuel.
En revanche, les conditions générales de vente engagent les deux parties dès lors qu'un contrat de vente est signé, sous réserve que celui-ci ne contienne pas des clauses écartant expressément des dispositions de ces conditions générales de vente. En outre, dans le silence du contrat de vente, leurs dispositions s'imposent aux parties.
L'application des conditions générales de vente peut constituer un instrument de domination du fournisseur. Ainsi les conditions générales de vente de Kraft Jacobs Suchard accordent une remise de 2,5 % aux clients commandant 44 marques ou plus de l'entreprise ; la remise tombe à 0,75 % si seulement 43 marques sont prises et à 0,25 % pour 37. Il est bien rare qu'un supermarché et, a fortiori, une supérette puisse écouler la totalité de ces références ; or, une enseigne de distribution a besoin d'obtenir le maximum de remises figurant dans les conditions générales de vente pour être compétitive. Une centrale d'achat cherchera donc à obtenir par tous les moyens cette remise supplémentaire de 2,5 % de la part de Kraft Jacobs Suchard. Chez Heineken, la remise de gamme maximale atteint 10,5 % si l'hypermarché prend 27 références ou 24 références si c'est un supermarché, ce qui peut poser un problème de surfaces de linéaires disponibles dans ce dernier cas.
2. La coopération commerciale : la poule aux _ufs d'or
La distribution moderne a pris peu à peu en charge, avec le perfectionnement de la vente en magasin populaire de centre-ville, en supermarché et en hypermarché, certaines fonctions autrefois assurées par le fournisseur. Parmi ces prestations figurent notamment des fonctions logistiques d'approvisionnement des magasins, les fournisseurs se contentant d'amener les produits à des bases logistiques redistribuant aux points de vente, la mise en avant des produits sur les rayons, les fournisseurs n'ayant plus besoin d'assurer la mise en valeur sur place de leurs marques, la centralisation des commandes et des facturations pour plusieurs points de vente, etc. L'ensemble de ces services fournis par les revendeurs à leurs fournisseurs, et qui sont indépendants de l'acte d'achat, forme aujourd'hui la coopération commerciale. En quelque sorte, la distribution est devenue un prestataire de services pour ses fournisseurs.
Ces services, dits spécifiques pour les distinguer des services liés à l'achat ou la vente même, ne sont pas nouveaux. Ils étaient autrefois assurés par le stade de gros. Le commerce de gros les assure d'ailleurs toujours lorsqu'il approvisionne des revendeurs qui ne sont pas distributeurs, à savoir les entreprises de restauration et d'hôtellerie, ou qui sont des petits commerces traditionnels indépendants.
La vraie coopération commerciale apporte des services incontestables aux fournisseurs. Ceux-ci n'en nient d'ailleurs pas le bien-fondé, mais la rémunération de ces services doit se traduire par des avantages commerciaux pour les fournisseurs ou des contreparties réelles comme le dispose l'article 33 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence.
La mission d'information a en effet été saisie de plusieurs dysfonctionnements. Ce sont des cas où des sommes importantes ont été « accordées » à des distributeurs alors même :
- qu'aucun service véritable n'était rendu
- ou que les prestations fournies ne correspondaient pas à celles convenues
- ou que la contrepartie n'avait aucune traduction commerciale ou financière positive pour le fournisseur
- ou que le même « service » était facturé plusieurs fois.
La coopération commerciale fait l'objet de nombreuses critiques de la part des fournisseurs. La mission estime que le caractère succinct du cadre législatif de la négociation commerciale est justifié dans la mesure où celle-ci nécessite un espace de libre discussion. Cependant, tous les partenaires s'accordent pour convenir que la loi doit garantir l'effectivité et la réalité de la contrepartie, aussi bien dans sa consistance qu'au regard de la loyauté de l'exécution de ces services spécifiques.
En quelque sorte, le contrat de coopération commerciale doit être exécuté loyalement et fidèlement et le service accordé doit se traduire par un avantage objectif et mesurable par le fournisseur, et la contrepartie ne doit pas être considérée comme constituée au motif que le contrat de coopération commerciale a été signé par le fournisseur. C'est pourquoi la mission n'est pas opposée au principe de la rémunération de services rendus par le client à son fournisseur dès lors que ces services constituent de vrais services apportant un avantage réel souhaité par le fournisseur. Elle demande instamment que la loi soit de nouveau appliquée dans le sens où elle a été élaborée et qui a été clairement exposé dans les circulaires Scrivener du 10 janvier 1978 et Delors du 22 mai 1984. Des instruction claires en ce sens devraient être établies par le ministère chargé de l'économie, et si cela s'avérerait nécessaire, la loi devrait être précisée afin d'incorporer les règles générales figurant dans ces textes interprétatifs.
Les pays européens sur lesquels la mission d'information a enquêté connaissent également ces services de coopération commerciale, alors même que les fournisseurs n'établissent pas de conditions générales de vente. En Allemagne, ils sont appelés « WKZ », en Espagne ils figurent sur des documents appelés « mantillas » et en Grande-Bretagne ce sont des « retainers ». Dans chacun des cas les services correspondent aux services spécifiques facturés en France (voir notes sur la distribution dans ces pays, en annexe du rapport).
a) Légalité et contenu de la coopération commerciale
Comme nous l'ont rappelé de nombreux interlocuteurs, la grande distribution a toujours perçu une rémunération pour des services spécifiques qu'elle rendait aux fournisseurs. Ces services étaient de nature commerciale : centralisation des paiements et des commandes, unicité des acheteurs, gestion des stocks et mise en rayon. Souvent le commerce de gros assurait des prestations comparables et les fournisseurs ont rapidement inséré ces prestations dans leurs conditions générales de vente au titre des remises et ristournes pour services rendus. A ces services s'ajoutaient ce qu'on appelait naguère la « publicité sur les lieux de vente ».
· La circulaire Scrivener du 10 janvier 1978
Au nom de la lutte contre l'inflation, les pouvoirs publics ont soutenu cette politique commerciale se traduisant par la réduction des prix de cession. Pour la première fois, la circulaire Scrivener du 10 janvier 1978 relative aux relations commerciales entre entreprises a considéré qu'un fournisseur pouvait, sans commettre une discrimination injustifiée au regard de la loi (voir ci-après l'étude du principe de non-discrimination), rémunérer par une réduction supplémentaire de prix certains services que lui rendait son client distributeur :
« 5. Les services effectivement rendus par les clients qui se traduisent par un allégement des charges du fournisseur peuvent être rémunérés par une réduction supplémentaire de prix. L'octroi de ces remises doit être proportionné à l'importance des transferts réels de charges du fabricant au client. Elles doivent correspondre à la rémunération d'un certain nombre de services commerciaux, tels que risque commercial élevé, prises de commande, facturation, entreposage, livraison, services avant-vente, service après-vente, etc. [Nota : ce point 5 vise les services figurant dans les conditions générales de vente]
« A l'inverse le transfert d'une fonction commerciale du distributeur au fabricant pourrait justifier une discrimination au détriment du distributeur.
« 6. Une coopération commerciale plus étroite entre fournisseur et distributeur peut être concrétisée dans des accords contractuels : ces accords permettent aux producteurs de développer leur expansion et aux distributeurs de stimuler leur stratégie commerciale.
« Les pouvoirs publics estiment que ces contrats doivent traduire la volonté des partenaires d'y souscrire en toute liberté. Ils doivent être écrits. En tout état de cause l'incidence de tels accords ne peut affecter que marginalement la différenciation résultant des conditions générales de vente auxquelles s'appliquent les paragraphes 4 et 5 ci-dessus.
« 7. L'appréciation des services rendus au fournisseur ou à l'acheteur et du coût de la coopération commerciale n'est pas susceptible d'une traduction mathématique dans les prix aussi rigoureuse que celle des quantités vendues. Mais il ne peut s'agir sur ces deux points que de correctifs d'une incidence limitée. Ce serait notamment trahir l'esprit du texte que de vouloir donner à la notion de service ou de coopération commerciale une influence telle sur le tarif du fournisseur qu'elle paralyse, en fait, toute possibilité de concurrence entre circuits différents. »
La jurisprudence a complété la liste des services cités dans la circulaire ci-dessus en ajoutant notamment les participations publicitaires, les opérations promotionnelles, l'animation commerciale, le paiement comptant, l'échelonnement des commandes, la tenue d'un stock permanent, l'offre par le distributeur de services à la clientèle (supermarchés par opposition au maxidiscompte), etc. La circulaire Delors du 22 mai 1984 avait également cité « l'éclatement des livraisons vers les magasins de détail ».
Si les pouvoirs publics ont admis la légalité des remises de coopération commerciale, ils ont souhaité en limiter le champ d'application. Le paragraphe 7 reproduit ci-dessus reste très prudent sur la portée que doivent avoir les accords de coopération commerciale (« correctifs d'une incidence limitée »).
La circulaire Scrivener du 10 janvier 1978 soumettait à trois conditions l'octroi de telles réductions de prix :
1. les services devaient être « effectivement rendus par les clients » ;
2. ils devaient se traduire par « un allègement des charges du fournisseur » ;
3. ils devaient être rémunérés par une remise « proportionnée à l'importance des transferts réels de charges du fabricant au client ».
La circulaire Scrivener a en outre bien distingué les services qui relevaient des conditions générales de vente, visés au point 5, des services qui en raison de leur objet spécifique doivent être traduits dans des contrats séparés mais ne peuvent « affecter que marginalement la différenciation résultant des conditions générales de vente ».
En somme, si les services de coopération commerciale devaient entraîner une différenciation plus que marginale ou avoir une incidence importante sur la fixation du prix global de l'ensemble des transactions entre le fournisseur et le revendeur, ils devraient être incorporés dans des conditions générales de vente. La circulaire Scrivener laisse supposer qu'elles devaient être les conditions générales de vente du fournisseur, mais on peut concevoir que le client établisse des conditions générales de vente de services de coopération commerciale.
· La circulaire Delors du 22 mai 1984
Face à l'extension des services de coopération commerciale et dans la perspective de la libération complète des prix, M. Jacques Delors, ministre de l'économie, des finances et du budget, précisa, dans une circulaire du 22 mai 1984 relative à la transparence tarifaire dans les relations commerciales entre les entreprises, le champ d'intervention des contrats de coopération commerciale et les conditions de légalité des rémunérations accordées à ce titre par les fournisseurs :
« II.- Coopération commerciale.
« Le rôle directeur qui doit revenir aux conditions générales de vente dans les relations commerciales ne fait pas obstacle à ce que les clients proposent aux fournisseurs des services particuliers, ni à ce que les parties mènent ensemble des actions se traduisant pour chacune par des avantages équilibrés.
« La coopération commerciale est un accord contractuel conclu entre un fournisseur et un distributeur qui, dans le cadre de leur politique respective, décident de collaborer pour augmenter, à un moindre coût, leur efficacité commerciale.
« L'accord est conclu pour une période relativement longue - plusieurs mois - ce qui distingue la coopération commerciale des opérations promotionnelles, de courte durée, répétitives ou ponctuelles.
« 1° Un accord de coopération commerciale porte sur la fourniture par un distributeur à son fournisseur de services spécifiques ne relevant pas des obligations résultant des actes d'achat et de vente.
« Le caractère spécifique et qualitatif des services rendus par le distributeur ne permet pas que leur rémunération soit annoncée par celui-ci.
« Les accords de coopération commerciale ne doivent pas néanmoins entraîner des discriminations injustifiées. En particulier, les services rendus par le distributeur doivent être réels et bien identifiables et leur rémunération justifiée.
« 2° Pour garantir la réalité et l'identification des services et la non-discrimination, les engagements réciproques et personnalisés souscrits par les parties dans le cadre de la coopération commerciale doivent être consignés dans un contrat écrit communicable à l'Administration sur simple demande de sa part et comportant au minimum les rubriques suivantes :
« - définition claire et précise des services fournis ;
« - définition des modalités d'application, durée et conditions de renouvellement du contrat ;
« - pénalités en cas de non-exécution du fait de l'une ou l'autre des parties ;
« - conditions de financement et modalités de règlement.
« En tout état de cause, les avantages consentis dans le cadre de telles actions communes ne peuvent avoir qu'une portée restreinte par rapport à ceux accordés en application des conditions générales de vente afin qu'ils ne remettent pas en cause le principe de transparence tarifaire et ne créent pas des discriminations injustifiées. »
Cette circulaire reprenait donc les trois conditions posées par la circulaire Scrivener pour considérer comme légales les remises de coopération commerciale :
- « les services rendus par le distributeur doivent être réels » ;
- ils doivent être « bien identifiables » ;
- « leur rémunération (doit être) justifiée » ;
- ils ne doivent pas créer « des discriminations injustifiées » ;
- les avantages financiers qui sont leur contrepartie doivent avoir « une portée restreinte » par rapport à ceux accordés en application des conditions générales de vente.
En outre, la circulaire Delors imposait l'établissement d'un contrat écrit de coopération commerciale, comportant notamment une définition précise des services et des pénalités en cas de non-exécution. Ce point était une nouveauté. Mais le dernier alinéa du paragraphe II reproduit ci-dessus restait prudent sur la portée des services de coopération commerciale puisqu'il maintenait l'exigence de « portée restreinte par rapport à ceux accordés en application des conditions générales de vente ».
· L'article 33, 5ème alinéa, de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986
L'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence a traduit dans la loi ces principes généraux afin de donner une base légale à la coopération commerciale. Son texte d'origine (article 33, 5ème alinéa) disposait que :
« Les conditions dans lesquelles un distributeur se fait rémunérer par ses fournisseurs, en contrepartie de services spécifiques, doivent être écrites. »
Ce dispositif a été modifié par l'article 18 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques afin, d'une part, de renforcer la transparence et la sûreté juridique des accords de coopération commerciale en substituant à la simple exigence d'un écrit l'obligation d'établir un contrat écrit en double exemplaire et, d'autre part, d'étendre le dispositif aux prestataires de services. La modification relative au contrat écrit reprend, en fait, la disposition de la circulaire Delors du 22 mai 1984. Désormais l'article 33, 5ème alinéa, de l'ordonnance du 1er décembre 1986 dispose que :
« Les conditions dans lesquelles un distributeur ou un prestataire de services se fait rémunérer par ses fournisseurs, en contrepartie de services spécifiques, doivent faire l'objet d'un contrat écrit en double exemplaire détenu par chacune des deux parties. »
Depuis la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993, ces dispositions n'ont fait l'objet d'aucune modification, y compris lors de la discussion du projet de loi sur la loyauté et l'équilibre des relations commerciales qui a pourtant fait l'objet, au printemps 1996, de deux lectures dans chaque assemblée mais au cours desquelles aucun amendement n'a été adopté, ni même déposé, sur ce dispositif.
Ce silence ou cette inaction peut aujourd'hui étonner mais il faut se rappeler qu'en 1996 le principal dysfonctionnement observé dans les relations entre fournisseurs et revendeurs et entre les distributeurs eux-mêmes tenait aux prix de revente en magasin (calcul du seuil de revente à perte, opérations promotionnelles totalement libres pour attirer la clientèle par des prix d'appel, prix abusivement bas). La loi dite loi Galland du 1er juillet 1996 a mis un terme à « la baguette à 1 F » et à la revente à perte en encadrant strictement le contenu des factures pour limiter l'incorporation dans celles-ci des remises et ristournes, en redéfinissant le seuil de revente à perte et en interdisant les prix de vente aux consommateurs des produits industriels inférieurs à leurs coûts de production et de transformation ainsi que les promotions sans stock. Cependant, en encadrant la marge avant des clients des fournisseurs, cette loi a reporté la négociation des remises et ristournes sur leur marge arrière, c'est-à-dire sur les opérations financières et commerciales placées hors du champ de la facture d'achat ou de vente des produits et des services.
En quelque sorte, la loi n° 96-588 du 1er juillet 1996 relative à la loyauté et l'équilibre des relations commerciales a atteint son but en mettant fin aux abus dénaturant la réalité économique des prix de revente aux consommateurs, mais au prix d'un déchaînement, au sens premier du terme, des forces de vente ou d'achat sur les marges arrières dont la réglementation n'avait pas été modifiée. Les lacunes du système économique ne sont donc pas nouvelles ; elles étaient seulement inexploitées par les acheteurs - et soulignons-le par de nombreux gros fournisseurs - avant 1997.
La mission d'information estime que cette situation résulte en premier lieu de l'inapplication des deux circulaires Scrivener du 10 janvier 1978 et Delors du 22 mai 1984. Les dysfonctionnements actuels sont le résultat du non-respect des règles posées par l'Etat et traduite au 5ème alinéa de l'article 33 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence.
Il s'est agi d'une véritable dérive tacitement acceptée par les services du ministère de l'économie. Cette dérive a porté aussi bien sur le contenu (ou absence de contenu) de la coopération commerciale que sur le montant de la rémunération des services de coopération commerciale.
b) Le contrôle de l'application de l'article 33 de l'ordonnance
Depuis 1997, le contrôle de la coopération commerciale est une tâche permanente programmée par le directeur général de la concurrence (voir titre IV du rapport sur l'action de la DGCCRF). Les vérifications sont systématiquement effectuées lors des contrôles sur pièce et sur place des factures et de l'application des conditions générales de vente. En 1998, 738 actions de vérification ont été effectuées sur l'application de l'article 33 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 (ces actions ont été conduites aussi bien chez les fournisseurs que chez les distributeurs) ; elles ont révélé un taux d'anomalie de 4 %. Au premier semestre 1999, 431 actions de vérification ont été menées ; elles se sont traduites par un taux d'anomalie de 3 %.
Ce faible taux d'infraction s'explique par le fait qu'il recense le nombre d'anomalies que les services de la DGCCRF ont pu démontrer. Or, il est extrêmement difficile pour les agents de l'administration d'entrer dans des relations commerciales entre deux partenaires qui veulent toujours les rendre les plus opaques possibles vis-à-vis de leurs concurrents. Les négociations commerciales sont par nature non transparentes et leurs termes ne sont jamais mutualisés, sauf dans le cas particulier des relations entre un distributeur et ses fabricants de marques propres où le distributeur demande le plus souvent à son fabricant de lui présenter ses livres de comptes. Il est donc difficile pour les fonctionnaires de la DGCCRF de démêler les fils de la coopération commerciale et de la discrimination tarifaire et des conditions de vente.
Ces anomalies donnent lieu à établissement d'un procès-verbal adressé au parquet. Le nombre de condamnations est faible : en 1998, sur 360 dossiers contentieux transmis au parquet, il y a eu 174 condamnations en première instance pour non-respect des articles 31 à 34 de l'ordonnance (111 au titre des facturations, 60 au titre de la revente à perte, 2 au titre de l'article 33 et 1 pour non-respect de l'interdiction des prix et marges minimums). Sur ces dispositions, la DGCCRF réalise environ 15 000 contrôles par an, et 20 000 sur l'ensemble des dispositions du titre IV.
Les condamnations pénales les plus fréquentes se traduisent par une amende de quelques dizaines de milliers de francs. Cependant, le 29 juin 1998, la Cour d'appel de Paris a condamné Intermarché à une amende de 300 000 F et son dirigeant à une amende 50 000 F en raison des termes trop généraux des facturations de vente de produits et surtout de coopération commerciale qui ne permettaient pas de prouver que les services qu'ils mentionnaient étaient des services spécifiques de coopération commerciale (prestations de « participation publicitaire ») et qu'ils avaient effectivement été rendus et bénéficié au fournisseur. Lidl a également été condamné à 250 000 F d'amende par le tribunal de grande instance de Strasbourg (jugement définitif). Les parties civiles obtiennent des dommages et intérêts significatifs à l'occasion des procédures portées devant le juge pénal : en 1998, en matière de facturation les organisations professionnelles ont obtenu 1 013 000 F.
c) La dérive du contenu de la coopération commerciale
Dans les faits et la pratique administrative, les services relevant naguère des conditions générales de vente (point 5 de la circulaire Scrivener reproduit ci-dessus) ont fini par être assimilés à des services spécifiques relevant de la coopération commerciale. Ils sont donc librement négociés, hors de toute exigence de transparence.
Aujourd'hui, le champ de la coopération commerciale se définit avant tout a contrario : on peut dire que sont considérés comme services spécifiques relevant de la coopération commerciale les services qui ne sont pas inhérents à la fonction de distribution, c'est-à-dire qui ne sont pas détachables ou concevables hors de cette fonction de distribution. Dès lors, l'administration et les tribunaux considèrent que tous les services visant à favoriser la vente de certains produits par rapport à d'autres similaires ou non relèvent de la coopération commerciale.
En revanche, les services constituant des modalités d'achat ne peuvent être accordés par des accords de coopération commerciale. De même, les avantages traduits par des rabais, remises ou ristournes dans les conditions générales de vente sont considérés comme placés hors du champ de la coopération commerciale.
La Cour de cassation a ainsi donné une interprétation large de la coopération commerciale en y incorporant toutes les obligations souscrites par un distributeur à l'exclusion de celles mises à sa charge par le code civil en exécution du contrat de vente qu'il a souscrit (Cour de cassation, chambre commerciale, 27 février 1990 : services allant « au-delà des simples obligations contractées ordinairement entre fournisseur et distributeur » et « des simples obligations résultant des achats et des ventes »). Mais cette doctrine n'était pas encore bien installée puisque le même arrêt avait conclu en écartant de la coopération commerciale l'obligation pour le distributeur de maintenir dans ses rayons un échantillonnage complet de la gamme des produits du fournisseur, ce qui relève aujourd'hui clairement d'une pratique de coopération commerciale.
Cette conception de la coopération commerciale conduit à faire des actions publicitaires ou de mise en valeur en magasin le principal canal de la coopération commerciale. Il est d'ailleurs fréquent que les fournisseurs appellent celle-ci la « participation publicitaire ». On peut citer :
- la présentation des produits en tête de gondole (9), la garantie d'emplacement dans un linéaire, la disposition spéciale des produits dans une allée, d'un panneau spécial attirant le regard des clients dans les allées ou sur les linéaires, etc.
- la mise en place d'un stand d'animation, des annonces sonores, l'installation d'affiches sur les aires de stationnement, etc.
- l'animation dans le magasin, la décoration spéciale pour attirer le chaland, etc.
- une campagne publicitaire, la présence du produit dans un catalogue ou un prospectus, etc.
Le versement de marges arrières prend également d'autres formes que la coopération commerciale stricto sensu, qui ne s'appuient pas sur la fourniture de services spécifiques par le distributeur.
On trouvera ci-joint l'exemple de la convention de ristourne établie par Leclerc et Intermarché.
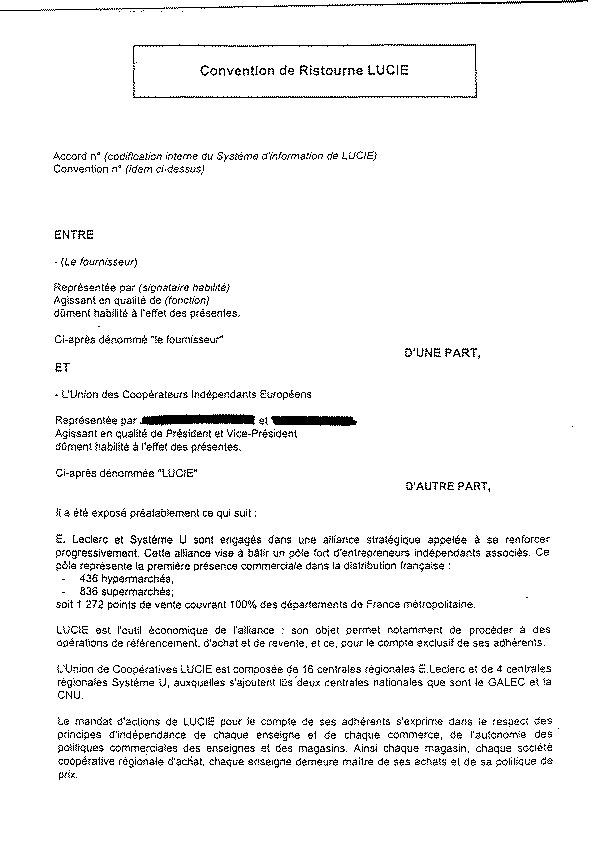
d) La dérive des prix de la coopération commerciale
En 1990, le rapport de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sur les pratiques tarifaires entre les entreprises en France, établi en application de l'article 12 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 (publié au BOCCRF du 12 janvier 1991), indiquait que les services de coopération commerciale étaient rémunérés fréquemment par un taux moyen de remise de 2 % calculé sur le prix des produits achetés par le revendeur.
Lors de son déplacement en Allemagne, la mission d'information a constaté que ce taux était encore fréquemment appliqué pour les achats de produits alimentaires. Cependant, le rapport de 1990 soulignait déjà que la coopération commerciale était une source importante de discrimination abusive dans la mesure où très peu de contrats définissaient précisément le service rendu par le fournisseur.
L'Institut de liaisons et d'études des industries de consommations (ILEC) a évalué le double mouvement engagé depuis 1995 de rétrécissement de la marge avant et d'accroissement de la marge arrière. Voici ces résultats :
ÉVOLUTION DE LA MARGE COMMERCIALE BRUTE TOTALE (AVANT + ARRIÈRE)
Secteurs d'activités |
1995 |
1997 |
1999 |
Epicerie |
100 |
127 |
146 |
Produits frais / ultra frais / surgelés |
100 |
104 |
106 |
Entretien / hygiène-beauté |
100 |
120 |
134 |
Liquides |
100 |
149 |
167 |
Autres secteurs (jouet, textile, etc.) |
100 |
104 |
109 |
Source : ILEC
RÉPARTITION DE LA MARGE COMMERCIALE EN POURCENTAGE ENTRE MARGES AVANT ET ARRIÈRE
Secteurs d'activités |
1995 |
1997 |
1999 | |||
Avant |
Arrière |
Avant |
Arrière |
Avant |
Arrière | |
Epicerie |
26 |
74 |
19 |
81 |
12 |
88 |
Produits frais / ultra frais / surgelés |
50 |
50 |
46 |
58 |
34 |
66 |
Entretien/hygiène-beauté |
- 6 |
106 |
18 |
82 |
14 |
86 |
Liquides |
- 1 |
101 |
18 |
82 |
11 |
89 |
Autres secteurs (jouet, textile, etc.) |
61 |
39 |
58 |
42 |
56 |
44 |
Source : ILEC
Lors de l'audition du 30 novembre 1999 de la commission (voir son compte rendu en fin de rapport), M. Luc Soupirot, exploitant agricole (production de légumes), nous a indiqué qu'il y a dix ans il versait 3 % de ristournes à Carrefour mais qu'aujourd'hui le taux est passé à 6,5 % auquel s'ajoutent une remise de référencement (de 1,5 %), des remises pour des promotions et des retours de produits, ce qui porte le total des remises hors factures à globalement sur une saison 10 %.
Une PME produisant des produits alimentaires du terroir a écrit à son député, M. Jérôme Cahuzac, député du Lot et Garonne : « Cette coopération commerciale, qui à l'origine était marginale, peut atteindre aujourd'hui 35 % du prix de vente du fournisseur. Ainsi, aujourd'hui, un produit vendu « à prix coûtant », sans marge par rapport au prix figurant sur la facture du fournisseur, laisse au distributeur une « marge arrière » de 35 % pour ses frais de distribution et son résultat ; elle va en s'amplifiant au fil des regroupements qui interviennent dans la distribution. Cette situation a pour conséquence l'application de prix de vente au consommateur anormalement élevés, pour tous les produits à marque par rapport aux produits à marque de distributeur, la coopération commerciale, obligatoirement prise en compte dans le tarif, n'étant pas répercutée dans le prix de vente au consommateur ».
Une grosse PME de biens d'équipement a vu passer les marges arrières qu'elle doit consentir à la grande distribution de 4 % à 6,5 % de son chiffre d'affaires en trois ans. Une autre PME réalisant 330 millions de chiffre d'affaires avec les grandes surfaces de vente reverse 22 % de ce chiffre d'affaires en coopération commerciale, contre 15 % il y a trois ans. Une opération promotionnelle ou une feuille publicitaire dans un catalogue est facturée de 300 000 à 600 000 F par une des plus grandes enseignes d'hypermarchés, ce qui peut porter le budget des « participations publicitaires » à deux ou trois millions de francs par an pour cette seule enseigne.
Selon, l'association nationale des industries agro-alimentaires, la grande distribution demande aujourd'hui jusqu'à 35 % de remises supplémentaires au titre de la coopération commerciale alors que les industriels étaient habitués à verser un taux de remise d'environ 5 %. Les sommes versées deviennent vite considérables pour les plus gros fournisseurs car la réussite du lancement d'un produit exige qu'il soit présent dans 40 % des points de vente d'un pays, soit au moins 600 hypermarchés en France. M. Thierry Jacquillat, directeur général de Pernod-Ricard, nous a indiqué que la coopération commerciale représentait entre 10 et 25 % du chiffre d'affaires des différentes sociétés du groupe.
L'évolution des prix de la filière laitière montre l'impact déflationniste de la coopération commerciale, sans que pour autant le consommateur en bénéficie au travers des prix de revente. De 1994 à 1997, les coopératives laitières, ce qui exclut Danone et Nestlé, ont perdu 0,4 à 0,6 point par an sur le prix de vente net-net-net (prix de vente ristournes incluses duquel sont déduites les remises de coopération commerciales) exprimé en francs courants du beurre et du lait de consommation et 0,8 à 1,2 point par an sur le prix net-net-net du fromage et des produits laitiers frais (les produits des coopératives laitières représentent 60 % des produits laitiers commercialisés en France). Le taux de marge de la filière coopérative est tombé à moins de 1 %, et la mission demande comment les transformateurs et producteurs pourront poursuivre leurs investissements dans la sécurité et la qualité. Pour les producteurs, le prix de vente courant a en revanche été stable sur cinq ans, mais il a baissé en 1999 (les prix en francs constants qu'ils ont touchés ont toutefois baissé), car un accord avec la distribution permet de reverser aux producteurs, par l'intermédiaire des transformateurs, une fraction du prix de revente ou une fraction de la marge perçue par la distribution lorsque les cours chutent. Mais la dégradation du prix net-net-net de la filière lait est entièrement imputable à la coopération commerciale : selon les indications fournies par la FNSEA, en 3 ans les remises de coopération commerciale se sont accrues de 10,29 % dans les produits laitiers alors que les prix de base n'ont augmenté que de 7,3 %. Le partage de la marge commerciale se fait depuis 1997 au détriment de la filière de la production laitière. Mais retenons également la conclusion de bon sens des représentants du CNJA : la coopération commerciale sur le lait de consommation n'a pas de sens car jamais elle ne permettra d'accroître la consommation ; elle est avant tout destructrice d'entreprises.
Toutes les études prouvent que les producteurs les plus puissants, comme les multinationales sont privilégiés par les distributeurs et que les produits qu'ils vendent sont mieux placés sur les linéaires.
3. L'application du principe de non-discrimination
La discrimination est inhérente au commerce : un acheteur ne peut répondre favorablement à toutes les offres équivalentes qui lui sont proposées et un vendeur sélectionne ses clients en fonction de sa politique commerciale ; un client cherche toujours à obtenir de meilleures conditions de vente que ses concurrents au motif que ses activités sont plus bénéfiques pour son fournisseur que celles de ces derniers. Il est donc naturel qu'un acteur économique traite différemment ses partenaires. Cependant, cette discrimination commerciale est fondée sur des faits économiques objectifs ; la discrimination ne saurait être une fin en soi, notamment elle ne doit pas être un moyen de pénaliser ou d'affaiblir le partenaire sur le marché.
L'article 85 du traité de Rome donne une définition claire de la discrimination abusive en matière commerciale : elle consiste à « appliquer, à l'égard de partenaires commerciaux, des conditions inégales à des prestations équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence ».
Le droit de la concurrence français s'appuie sur la définition figurant dans le traité de Rome. L'article 36 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence reprend une terminologie comparable pour définir le régime de responsabilité des entreprises en matière de relations commerciales professionnelles et ses article 7 et 8 interdisant les pratiques anticoncurrentielles portant atteinte au jeu de la concurrence sur le marché s'appuient sur la même interprétation de la notion de discrimination abusive.
La difficulté d'appréciation du caractère abusif de conditions de vente données tient en ce que le choix d'un client ou d'un fournisseur se fait à partir d'une multitude de critères qu'il est vain de formaliser exhaustivement. Ainsi, une direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a répondu à un chef d'entreprise que « concernant la facturation des insertions dans les catalogues publicitaires X (enseigne), il est difficile de caractériser une pratique discriminatoire en comparant votre contribution au coût de revient d'une page publicitaire. En effet, la contrepartie du prix réclamé a été réelle (les annonces ont bien été effectuées dans les catalogues) et le prix de cette prestation a été librement fixé par l'annonceur et négocié par les parties. »
a) La définition du principe de non-discrimination
Le fonctionnement correct d'une économie de marché postule que les opérateurs doivent être traités de manière indifférente par les offres et les demandes, c'est-à-dire être en position d'égalité au regard du contenu de ces offres et demandes, pour atteindre un optimum économique. Ce principe d'égalité n'est pas un principe d'identité mais un principe de non-discrimination exigeant que les opérateurs placés dans une même situation de droit et de fait doivent être traités de la même manière.
Le principe de non-discrimination dans les relations commerciales entre les entreprises a longtemps été absent des textes de loi ; il a fini par être introduit dans l'ordonnancement législatif par le décret n° 58-545 du 24 juin 1958 (pris sur habilitation législative), qui a complété la rédaction de l'alinéa a du point 1 de l'article 37 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 sur les prix par les dispositions suivantes (en italique) :
« Art. 37.- Est assimilé à la pratique des prix illicites le fait :
« 1° par tout producteur, commerçant, industriel ou artisan :
« a) de (...) ainsi que de pratiquer habituellement des conditions discriminatoires de vente ou des majorations discriminatoires de prix qui ne sont pas justifiées par des augmentations correspondantes du prix de revient de la fourniture ou du service ».
L'objectif du gouvernement du Général de Gaulle était de protéger la nouvelle forme de vente en supermarché, notamment les centres Leclerc, des pratiques discriminatoires des industriels, des producteurs et des grossistes visant à empêcher ces magasins de s'approvisionner dans des conditions identiques aux autres commerces, notamment en leur imposant des prix majorés sans justification économique autre que la volonté de les empêcher de pratiquer des prix bas.
La croissance de la puissance d'achat des enseignes de grande distribution ayant inversé le rapport de force entre les opérateurs, il est apparu indispensable de rendre cette législation réversible, c'est-à-dire applicable aussi bien aux fournisseurs qu'aux distributeurs. Cette réforme a été réalisé par l'article 37 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, dont le dispositif voté en 1973 était le suivant :
« Art. 37.- Il est interdit à tout producteur, commerçant, industriel ou artisan :
« 1° de pratiquer des prix ou des conditions de vente discriminatoires qui ne sont pas justifiés par des différences correspondantes du prix de revient de la fourniture ou du service ;
« 2° de faire directement ou indirectement, à tout revendeur, en fraude des dispositions du 1° ci-dessus, des dons en marchandises ou en espèces ou des prestations gratuites de services.
« Tout producteur est tenu de communiquer à tout revendeur qui en fera la demande son barème de prix et ses conditions de vente. »
La loi n° 85-1408 du 30 décembre 1985 portant amélioration de la concurrence a codifié au sein de l'article 37 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix ces dispositions, en en simplifiant la rédaction :
« Art. 37.- est assimilé à la pratique des prix illicites le fait :
« 1° Par tout producteur, commerçant, industriel ou artisan :
« (...)
« g) De pratiquer à l'égard d'un partenaire économique, de lui demander ou d'obtenir de lui des prix ou des conditions de vente discriminatoires ou encore des dons en marchandises ou en espèces dans des conditions de nature à porter atteinte à la concurrence. Lorsque ces avantages sont obtenus d'un partenaire en situation de dépendance, les peines applicables sont celles prévues à l'article 41 de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 [4 mois à 4 ans d'emprisonnement et 120 F à 400 000 F d'amende]. »
L'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence a retiré le caractère de délit à la discrimination commerciale illicite. Son article 36 dispose :
« Art. 36.- Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou artisan :
« 1. De pratiquer, à l'égard d'un partenaire économique, ou d'obtenir de lui des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d'achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence ; ».
Ces dispositions n'ont pas été modifiées depuis la publication de l'ordonnance.
Le principe de non-discrimination figure également à l'article 8 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence. Il permet de caractériser l'existence d'un abus de position dominante ou de dépendance économique : « ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires ainsi que dans la rupture de relations commerciales établies, au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées. »
Cette disposition signifie que toute mesure discriminatoire commise par une entreprise en position dominante ou commise à l'égard d'un partenaire en situation de dépendance économique constitue une infraction. L'ordonnance n'impose pas explicitement que la pratique, pour être discriminatoire, se traduise par un avantage ou un désavantage dans la concurrence, mais le Conseil de la concurrence ou tout tribunal saisi d'une plainte sur le fondement de l'article 8 de l'ordonnance ne peut prononcer une sanction que si la pratique a « pour objet ou (peut) avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché ».
b) L'application du principe se fait difficilement
Les condamnations pour pratiques discriminatoires commises par des entreprises en position dominante sont multiples. Il en est de même dans tous les pays.
Le Conseil de la Concurrence a également sanctionné les pratiques discriminatoires mises en _uvre dans le cadre d'ententes dès lors qu'elles avaient les effets indiqués. Ainsi la Cour de cassation a considéré illégales au sens de l'article 7 des remises prévues dans des conditions générales de vente d'entreprises signataires d'un accord de distribution car constitutives d'ententes restrictives de concurrence (Cour de cassation, chambre commerciale, 12 octobre 1993, affaire n° 91-16.988).
L'article 36 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 a dépénalisé l'interdiction des pratiques discriminatoires. Celles-ci sont interdites par la loi, mais leur mise en _uvre n'entraîne qu'une obligation de réparer : le contentieux est donc civil ou commercial, sous réserve d'une sanction infligée pour infraction à l'article 8 (sanction pécuniaire pouvant être prononcée par le Conseil de la concurrence et atteindre 5 % du montant du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France ; peine de six mois à quatre ans d'emprisonnement ou 5 000 à 500 000 F d'amende pouvant être prononcée par le juge pénal). On se reportera à la dernière partie du rapport pour l'étude du contentieux.
La coopération commerciale est devenue le domaine d'excellence de la discrimination commerciale, mais les deux concepts sont fondamentalement différents. En effet, contrairement à un accord de coopération commerciale, une discrimination commerciale peut être légale alors même qu'elle n'est pas accompagnée d'une contrepartie réelle pour le partenaire, dès lors qu'elle ne crée pas un avantage ou un désavantage dans la concurrence et que dans les conditions générales de vente elle est transparente et offerte à tous les clients potentiels. Ainsi, par le biais d'une discrimination commerciale, un déséquilibre du marché peut être corrigé sans que, par exemple, le revendeur accorde une contrepartie réelle mais également sans qu'il n'acquière un avantage dans la concurrence. Seul l'effet négatif sur le jeu concurrentiel existant sur le marché en cause peut conduire à qualifier une pratique d'abusivement discriminatoire. En cela, le dispositif de l'article 36 se rapproche beaucoup des dispositifs des articles 7 et 8 de la même ordonnance interdisant les ententes anticoncurrentielles et les abus de position dominante ou de dépendance économique. La mission reconnaît que cette analyse est bien théorique, mais elle explique la rédaction de l'article 36 et le fait que les services de la concurrence renoncent à introduire certaines actions devant les tribunaux.
Cette conception de la discrimination permet de justifier des pratiques discriminatoires nées du fait qu'un concurrent a, sur le même marché, mis en _uvre de telles pratiques. Cette exception d'alignement sur les conditions plus favorables accordées par un concurrent a explicitement été prévue par le législateur : le rapporteur, M. Robert Malgras, l'explique dans son rapport de nouvelle lecture (n° 3110, p. 8), « cette définition, inspirée de l'avis de la commission de la concurrence sur les centrales d'achat, permettrait d'autoriser des discriminations justifiées comme les exceptions d'alignement » ; de même lors du vote du projet de loi (JO.débats AN, 6 décembre 1985, p. 5447) le rapporteur déclara : « le critère (...) sera désormais l'atteinte à la concurrence, indépendamment de la notion de dépendance. L'exception sera autorisée dans la mesure où elle traduit le renforcement de la concurrence sur un marché ». Cette rédaction issue de la loi n° 85-1408 du 30 décembre 1985 portant amélioration de la concurrence, qui a été reprise par l'article 36 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, a renversé la jurisprudence de la Cour de cassation qui, sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973, avait condamnée, dans un arrêt du 22 juin 1981 de sa chambre criminelle(D. 1990.521), cette exception d'alignement.
Le rédaction de la loi conduit par ailleurs la victime d'une pratique discriminatoire à en apporter la preuve aussi bien quant à son existence et sa nature qu'à son étendue. Cependant, pour obtenir réparation, la victime n'a pas à montrer que des pressions anormales ont été exercées sur elle pour obtenir les conditions de vente discriminatoires en cause (par exemple, Cour de cassation , chambre commerciale, 27 janvier 1998, affaire n° 96-12.205).
4. L'abus de dépendance économique
Article 8 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 Est prohibée, dans les mêmes conditions, l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises : 1. D'une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci ; 2. De l'état de dépendance économique dans lequel se trouve, à son égard, une entreprise cliente ou fournisseur qui ne dispose pas de solution équivalente. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires ainsi que dans la rupture de relations commerciales établies, au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées. Article 36 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 Art. 36.- Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou artisan : (...) (Loi n° 96-588 du 1er juillet 1996, art. 14).- « 3. D'obtenir ou de tenter d'obtenir un avantage, condition préalable à la passation de commandes, sans l'assortir d'un engagement écrit sur un volume d'achat proportionné et, le cas échéant, d'un service demandé par le fournisseur et ayant fait l'objet d'un accord écrit ; » |
L'interdiction de l'exploitation abusive d'un état de dépendance économique vise à poser des limites à la domination d'un acteur économique sur son partenaire dans leurs relations bilatérales. Avant 1985, cette pratique anticoncurrentielle n'était pas appréhendée par le droit de la concurrence français. Elle figurait pourtant dans le droit allemand depuis 1957 (article 26 de la loi fédérale du 27 juillet 1957 relative aux restrictions de concurrence ; ses dispositions figurent aujourd'hui à l'article 20 de cette loi, notamment son alinéa 4, depuis sa modification par le 6ème amendement entré en vigueur le 1er janvier 1999) :
« Article 20.- Interdiction des pratiques discriminatoires et des entraves déloyales -(1) Il est interdit aux entreprises qui occupent une position dominante sur le marché, aux associations d'entreprises au sens des articles 2 à 8, 28, alinéa 1, des articles 29, 30, alinéa 1, et 31 et aux entreprises qui pratiquent des prix imposés aux termes des articles 15, 28, alinéa 2, 29, alinéa 2, et 30, alinéa 1, d'empêcher, directement ou indirectement et de manière inéquitable, une autre entreprise d'accéder à un marché normalement accessible à des entreprises similaires ou de lui infliger, de façon directe ou indirecte, un traitement discriminatoire injustifié par rapport à ces entreprises similaires.
« (2) L'alinéa 1 est également applicable aux entreprises et associations d'entreprises dont dépendent des petites et moyennes entreprises qui fournissent ou achètent un certain type de marchandises ou de services commerciaux dans la mesure où il n'existe pas pour elles de possibilités suffisantes ou réelles de s'adresser à d'autres entreprises. Au sens de la première phrase, le fournisseur d'un certain type de marchandises ou de services commerciaux est présumé dépendre d'un acheteur, lorsque ce dernier, outre les réductions de prix ou autres remises en usage dans le commerce, bénéficie régulièrement de faveurs spéciales qui ne sont pas consenties à des acheteurs analogues.
« (3) Il est interdit aux entreprises qui occupent une position dominante et aux associations d'entreprises telles que définies à l'alinéa 1 de profiter de leur situation sur le marché pour obliger d'autres entreprises exerçant des activités commerciales à leur accorder des conditions préférentielles injustifiées par les faits. La première phrase s'applique également aux entreprises et associations d'entreprises au sens de l'alinéa 2, première phrase, dans leurs rapports avec les entreprises qui dépendent d'elles.
« (4) Les entreprises qui sont en position de force sur le marché vis-à-vis de petits et moyens concurrents ne doivent pas exploiter cette position afin d'entraver, directement ou indirectement et de manière inéquitable, les activités de ces concurrents. Il y a pratique anticoncurrentielle au sens de la première phrase, notamment si une entreprise qui offre des marchandises ou des services commerciaux pratique des ventes à perte systématiques, à moins que cela ne soit justifié par les faits.
« (5) Si, à la lumière de l'expérience générale, certains faits donnent à penser qu'une entreprise a exploité sa position de force sur le marché au sens de l'alinéa 4, il incombe à cette entreprise de réfuter cette impression et de clarifier ce qui, dans son secteur d'activité, a pu créer une telle impression, dans la mesure où le concurrent concerné ou une association au sens de l'article 33 ne peut le faire et où elle-même, en revanche, a toute facilité pour le faire et peut se le voir demander.
« (6) Les associations économiques et professionnelles ainsi que les associations formées en vue de défendre les labels de qualité ne peuvent refuser l'admission d'une entreprise dès lors que ce refus constitue un traitement discriminatoire injustifié susceptible de placer injustement cette entreprise dans une position concurrentielle défavorable sur le marché. »
Sur la proposition formulée dès 1985 de la Commission de la concurrence, le Gouvernement a introduit cette infraction dans l'article 8 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence.
Une première amorce de l'interdiction de l'abus de dépendance économique avait toutefois été posée par l'article 1er de la loi n° 85-1408 du 30 décembre 1985 portant amélioration de la concurrence, qui avait modifié l'article 37 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix. Cet article interdisait les pratiques discriminatoires et précisait que « lorsque ces avantages [discriminatoires] sont obtenus d'un partenaire en situation de dépendance, les peines applicables sont celles prévues à l'article 41 de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 [4 mois à 4 ans d'emprisonnement et 120 F à 400 000 F d'amende] ».
Du fait que l'interdiction est aujourd'hui insérée dans le titre III de l'ordonnance du 1er décembre 1986, le Conseil de la concurrence est amené à statuer sur son respect, même si tout tribunal est habilité à faire application du dispositif (mais sans pouvoir disposer des prérogatives attribuées au Conseil de la concurrence ou infliger les sanctions prévues par l'article 13 de l'ordonnance).
La jurisprudence du Conseil de la concurrence, de la Cour d'appel de Paris et de la Cour de cassation est aujourd'hui bien établie. On peut se reporter à l'avis n° 97-A-04 du Conseil de la concurrence du 21 janvier 1997 sur diverses questions portant sur la concentration de la distribution, reproduit en annexe du présent rapport, pour l'analyse des critères d'appréciation de la situation de dépendance économique : sont primordiales l'importance de la part du fournisseur dans le chiffre d'affaires du revendeur, la notoriété de la marque du fournisseur, l'importance de la part de marché du fournisseur, l'impossibilité pour la victime de trouver des produits ou des débouchés équivalents.
b) Les déficiences du droit français
Le dispositif du point 2 de l'article 8 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 peut s'appliquer en plusieurs hypothèses : la dépendance d'un commerçant vis-à-vis des fournisseurs disposant d'un produit incontournable sur le marché ; la dépendance d'un fournisseur vis-à-vis d'un acheteur réalisant une part importante de son chiffre d'affaires ; la situation de certains sous-traitants à l'égard de donneurs d'ordre ; la dépendance d'entreprises vis-à-vis de conglomérats leur fournissant des matières premières et qui cessent l'approvisionnement en cas de pénurie afin de privilégier l'approvisionnement des sociétés de leur groupe (situation essentiellement tirée du cas allemand).
Cependant, la situation du fournisseur vis-à-vis du distributeur est au c_ur du dispositif français. Le ministre de l'économie et des finances avait, en 1985, expliqué au rapporteur du Sénat l'intérêt d'une législation sur l'abus de dépendance économique en citant le cas « du producteur qui réalise auprès d'une centrale d'achat une part importante de son chiffre d'affaires, à laquelle il ne peut renoncer sans mettre en péril son activité, et qu'il ne peut reconstituer rapidement auprès d'autres clients » (rapport n° 54 de M. Jean Colin, du 30 octobre 1985, p. 24). Cette circonstance et cet objectif conservent encore, et si ce n'est plus, toute leur pertinence.
Une première difficulté à laquelle sont confrontées des entreprises victimes d'un abus de dépendance économique tient à la nécessité pour ces dernières de fournir la preuve de leur état de dépendance économique. Cette règle résulte d'un principe général de procédure et a été explicitement rappelée par les arrêts de la Cour de cassation.
Il nous semble, en fait, pour faciliter l'aboutissement des recours de ces entreprises, particulièrement délicat de définir dans la loi une présomption de dépendance économique en raison de la variété des cas de figures susceptibles de donner lieu à application du point 2 de l'article 8 de l'ordonnance.
A la lecture des décisions de jurisprudence, le critère tenant à l'absence de solution équivalente pour la victime semble être une condition difficile à démontrer.
Mais la condition d'application du dispositif la plus difficile à mettre en évidence, au point d'être rédhibitoire, tient à la nécessité d'une atteinte au jeu de la concurrence sur le marché concerné par la pratique abusive mise en _uvre. Cette exigence résulte du renvoi du premier alinéa de l'article 8 aux conditions figurant à l'article 7 de l'ordonnance : la pratique doit avoir « pour objet ou (peut) avoir pour effet d'empêcher, de retreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché ».
Or, jamais une PME-PMI subissant des pratiques restrictives de concurrence par exploitation abusive de son état de dépendance économique ne sera susceptible d'affecter le jeu de la concurrence sur le marché sur lequel elle opère, même si les pratiques conduisent à la cessation de son activité. Dans le secteur des biens de grande consommation, une PME-PMI réalisant 100 millions de francs de chiffre d'affaires n'affecte pas par son activité, ou la cessation de son activité, le marché : quelles que soient les remises de référencement ou de coopération commerciale, quels que soient les produits qu'elle fabrique, quels que soient les types ou la consistance des abus subis, quels que soient les segments de marché, ces pratiques ne perturberont pas le jeu de la concurrence.
Dès lors, dans les relations entre fournisseurs et revendeurs où règnent des rapport de force permanents, des milliers d'entreprises vivent dans un état de dépendance économique, lorsque des abus surviennent, ils ne peuvent pas être sanctionnés par le Conseil de la concurrence. Or le conseil a clairement identifié, dans ses multiples décisions, certaines pratiques constitutives d'abus de dépendance économique : l'exigence de remises ou de dédommagements rétroactifs, l'exigence de fournitures gratuites sans contrepartie, la présentation de demandes excessives pour rompre des relations commerciales, l'exigence d'une corbeille de mariée lors d'une fusion d'enseignes ou d'une concentration d'acheteurs lorsque cette demande ne s'accompagne pas de l'offre par le distributeur de contreparties précisément définies ou de services de promotion des ventes, l'exigence de réduire des remises accordées à des concurrents. Des exemples de ces pratiques ont également été apportés à la mission.
Le législateur a, par la loi n° 96-588 du 1er juillet 1996 relative à la loyauté et l'équilibre des relations commerciales, tenté de combler certaines lacunes observées en complétant l'article 36 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 par la définition de certaines pratiques illicites caractéristiques d'une exploitation abusive d'un état de dépendance économique : il s'agit du référencement sans contrepartie (point 3 de l'article), de la menace de rupture des relations commerciales dans le but d'obtenir des conditions manifestement dérogatoires aux conditions générales de vente (point 4), de la rupture de ces relations sans préavis écrit (point 5) (10). Mais ces pratiques restrictives de concurrence n'engagent que la responsabilité civile et commerciale de ceux qui les commettent, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent être condamnés qu'à réparer. Or, si la PME victime a disparu à cause de ces pratiques, il est vain, pour le marché, d'obtenir des réparations après des années de procédure. A titre d'illustration de l'impossibilité de sanctionner, on peut se reporter notamment à la décision n° 93-D-21 du 8 juin 1993 du Conseil de la concurrence relative à la demande de corbeille de la mariée du groupe Cora, qui a constaté l'existence d'abus mais a conclu à l'absence d'atteinte au jeu de la concurrence sur le marché.
Par souci de rendre effective la loi et les intentions du législateur de 1985, la mission demande donc que la sanction de l'abus de dépendance économique soit déconnectée de l'exigence d'une atteinte au jeu de la concurrence sur le marché. Cette réforme passe par la réécriture du point 2 de l'article 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986. Cette proposition est étudiée en détail dans le chapitre sur le Conseil de la concurrence de la dernière partie du présent rapport en raison de ses conséquences sur l'activité du conseil et parce que cette réforme nécessite une réflexion bien plus profonde sur l'application de la loi par cette autorité administrative indépendante et l'administration. |
On peut, en outre, étudier la possibilité de compléter l'article 36 de l'ordonnance en inscrivant explicitement l'obligation de réparer toute exploitation abusive d'un état de dépendance économique. Mais nous attirons l'attention sur le risque de double emploi de cette disposition générale, constituant une solution simpliste, avec les points 3, 4 et 5 de l'article 36.
Par ailleurs, il est indispensable d'avoir à l'esprit l'objection formulée par M. Michel-Edouard Leclerc à une législation trop restrictive sur l'état de dépendance économique : au lieu d'apporter un soutien aux PME-PMI, elle risque de les pénaliser car les distributeurs, pour se prémunir de toute poursuite et condamnation, veilleront à ne pas leur attribuer des parts de marché trop substantielles, exigeront qu'elles se diversifient et trouvent plusieurs clients pour être référencées et refuseront d'accroître les commandes une fois qu'un certain chiffre d'affaires réalisé avec elles sera atteint.
Conscient de ces déviations, la mission estime que si une telle stratégie commerciale est mise en place, les courants d'affaires provenant de la distribution seront pour chaque PME peut-être réduits mais ils seront plus nombreux car la demande des grandes surfaces de vente devra être satisfaite notamment en produits sous marque de distributeur. Or comme on l'a vu, il est impératif pour les enseignes que ces produits aient une image de qualité et de terroir ; il est donc peu vraisemblable que la grande distribution fasse appel à des PME étrangères pour remplacer des PME françaises.
c) La place croissante des marques de distributeur
Nous sommes convaincus que les enseignes de grande distribution se différencieront de plus en plus sur le critère de la complémentarité des offres de services aux consommateurs et sur la qualité des produits et des services. Chaque enseigne a mis au point une marque de distributeur reposant sur une image de qualité forte.
Carrefour a été la première enseigne à offrir des produits sous marque propre. C'était en 1976 les « produits libres » dont la publicité vantait qu'ils étaient aussi bons et moins chers que les grandes marques. Les industriels virent immédiatement en eux une menace mortelle directe et les concurrents de Carrefour déréférencèrent les industriels fabriquant ces produits. Toutes les enseignes finirent pourtant par faire fabriquer des marques propres.
Les parts de marché des marques de distributeur (en valeur), hors produits des magasins de maxidiscompte, ont évolué comme suit en France selon les estimations d'ACNielsen :
1991 : 15,7 %
1992 : 17,2 % 1996 : 17,2 %
1993 :19,0 % 1997 : 18,0 %
1994 : 17,1 % 1998 : 19,4 %
1995 : 17,4 % 1999 (estimations) : 20,0 %
d) Les avantages et les inconvénients du système des marques de distributeur
Comme l'a souligné M. Daniel Bernard, président de Carrefour, lors de l'audition du 30 novembre 1999, le produit sous marque de distributeur bénéficie de l'image de l'enseigne et de sa force de vente et l'enseigne engage sa réputation et se bâtit une image de qualité sur ces produits. C'est pourquoi les produits du terroir sont très recherchés. Or, ce sont les PME-PMI qui sont en général en mesure de fournir ces produits du terroir.
Un responsable de l'agro-alimentaire a résumé ainsi le paradoxe de l'essor des marques de distributeur : « Les dés sont pipés. Vous avez affaire à des clients qui sont vos concurrents. Les marques de distributeur plastronnent au milieu du linéaire. »
L'intérêt des produits fabriqués sous marque de distributeur est évident puisque le distributeur achète souvent un produit au coût le plus bas, mais en assurant au producteur des volumes importants de vente. Les avis des producteurs divergent sur l'intérêt des marques de distributeur, les uns ayant signé des conventions de partenariat avec de grandes enseignes, les autres récusant cette position de vassal, en position de sous-traitance totale et de dépendance économique, où le prix, les investissements, la viabilité de l'entreprise dépendent totalement des commandes du distributeur.
Lors de l'audition du 30 novembre 1999 de la commission, M. Daniel Bernard, président directeur général de Carrefour, a expliqué que ses enseignes faisaient travailler les PME grâce aux marques de distributeur, que les PME représentaient 40 % de leurs références alimentaires, dont 17 % sous leurs marques propres, et a cité en exemple Cantalou, fabricant de chocolat qui, il y a dix ans, n'était rien et aujourd'hui est une grande entreprise. De même, selon lui, les petits brasseurs survivent grâce aux distributeurs et non grâce aux grandes marques industrielles. La grande distribution continue à acheter en France 35 % du textile qu'elle vend et elle absorbe entre 20 et 40 % des productions agricoles françaises.
ITM Entreprises (Intermarché) a poussé plus loin la logique d'intégration du stade de production, par volonté d'avoir une indépendance d'approvisionnement par rapport aux multinationales de l'agro-alimentaire. C'est ainsi que le groupe est entré dans le capital de plusieurs sociétés de production. Par exemple, ITM Entreprises travaille principalement avec Fichaux Industries pour le café. Dans plusieurs filières, Intermarché contrôle la production, la logistique, l'approvisionnement et la distribution. L'autonomie est assurée et la filière complète est maîtrisée.
Par les marques de distributeur, les grandes enseignes contrôlent maintenant le produit de l'exploitation à l'usine et aux rayons de magasins. Et, la mission a observé un déséquilibre de plus en plus grand dans l'offre sur les linéaires : le produit sous marque de distributeur occupe des places de choix alors que « il faut nous chercher à quatre pattes dans la cave » se plaint un industriel indépendant auditionné. « Aujourd'hui, le linéaire est un média. »
L'argument selon lequel grâce à la grande distribution de nombreux emplois sont conservés en France est cependant exact. Des expériences ont été menées par certaines enseignes pour réaliser un réapprovisionnement automatique : à chaque vente d'un produit à la caisse, une commande est adressée automatiquement à l'entrepôt. Ces expériences sont intéressantes car il est bien sûr totalement inconcevable de mettre au point un tel système avec des usines délocalisées à l'Ile Maurice ou au Bangladesh.
La grande distribution exporte des produits français fabriqués par des PME françaises à l'étranger. La marque « eau des montagnes d'Auvergne » est le premier article français vendu à Taiwan. Les « Galettes de Pont-Aven » se vendent au Brésil. Certaines enseignes aident, affirment-elles, les entreprises françaises à s'implanter à l'étranger, ce que confirment plusieurs industriels pour les cas de l'Amérique du Sud.
De plus, les grandes enseignes affirment qu'en dehors des référencements nationaux tout responsable régional ou gestionnaire d'un magasin a la possibilité de promouvoir des produits régionaux. Les chiffres qui correspondent à des productions régionales (hors fruits et légumes) sont cependant marginaux : ils sont inférieurs à 1 % des ventes.
La mission s'inquiète des évolutions actuelles des marques de distributeur. Lorsqu'un producteur devient totalement dépendant du distributeur, il est très fragile car s'il ne produit plus que des marques de distributeur, il n'a plus de clientèle propre. En cas de déréférencement, de changement de stratégie du distributeur, c'est la mort assurée. Cela pourrait malheureusement arriver pour un grand nombre de PME qui maillent le territoire national.
Les marque de distributeur ont d'autres inconvénients.
Les marges bénéficiaires sont assurées pour le distributeur du fait de la conjugaison des marges arrières sur les produits sous marque industrielle et des marges substantielles qu'il réalise avec ses marques propres. Plus les marges arrières augmentent, plus le prix du produit vendu au consommateur est élevé car l'industriel tente de compenser les reversements de marges arrières par un barème de prix plus élevé. Beaucoup de personnes auditionnées ont assuré à la mission que sans ces marges arrières, les prix auraient baissé, alors que les gains de productivité et de compétitivité n'ont servi qu'à financer la fausse coopération commerciale.
Cela a pour conséquence de favoriser les marques de distributeur et d'accroître, pour le seul distributeur, les marges bénéficiaires brutes qui peuvent être de 30 % ou 40 % sur ces produits. Les négociations se font sur la base de l'analyse de valeur en prix net, par la pratique d'appels d'offres annuels et la connaissance parfaite des bilans des entreprises partenaires. La diminution des tarifs payés au producteur est issue d'une véritable étude de comptabilité analytique.
Cela, d'autant plus, que les cahiers des charges prescrits aux entreprises sont très contraignants et leur font endosser la totalité des risques. Un interlocuteur désigne cette situation par l'aphorisme « à la production les risques, à la distribution les bénéfices ».
Le distributeur exige d'accroître la qualité, car les consommateurs sont souvent déçus par les produits génériques ou basiques. Ils réclament par exemple des matières premières et ingrédients où sont absents les organismes génétiquement modifiés, ou encore le remplacement des matières grasses animales - suspectes de contenir de la dioxine - par des matières grasses végétales plus chères, sans payer cette « assurance qualité ».
Des contraintes supplémentaires ont été imposées aux producteurs de marques de distributeur pendant la crise de la dioxine. De nombreuses enseignes ont refusé d'accepter des produits de biscuiterie si le fournisseur n'assurait pas qu'ils étaient totalement dépourvus de dioxine alors que les réglementations européennes étaient totalement floues et les analyses des différentes sortes de dioxine impossibles à réaliser. Dans ce cas, le producteur devait prendre tous les risques.
Mais, le plus grave semble que sur les marques de distributeur, tous les efforts de labellisation sont réduits à néant. Les grandes enseignes vendent leurs marques propres et de l'avis de la mission, il est urgent de bien préciser que tout signe de qualité doit rester la propriété du producteur qui doit en avoir la totale responsabilité et non revenir à la distribution. L'exemple d'enseignes qui utilisent sous leurs propres marques le label rouge pour des poulets a été cité (voir les développements sur la filière agricole en conclusion).
Certains producteurs montrent même, photographies à l'appui, que certaines enseignes font de la contrefaçon, plagient les innovations, même brevetées, en faisant fabriquer des produits identiques par des fournisseurs, en Asie par exemple (au besoin en lui faisant comprendre que le propriétaire du brevet va être déréférencé).
Il nous apparaît donc que la réglementation sur la séparation entre producteur et distributeur devrait être précisée. Aux Etats-Unis, un distributeur ou un prestataire de services n'a pas le droit d'être un fabricant ; AT&T a été démantelé pour ces motifs dans les années 1980. La mission est particulièrement attentive à ce que l'étiquetage indique dans le cas des marques de distributeur, l'entreprise qui a fabriqué le produit, le groupe auquel elle appartient et que les signes de qualité ou d'origine restent associés au producteur. |
Enfin, pour les marques de distributeur, les contrats et les cahiers des charges doivent préciser les responsabilités de chacun des acteurs de la filière dans l'exigence de qualité et de sécurité alimentaire.
Dans un arrêt du 5 juillet 1994, la chambre commerciale de la Cour de cassation a élevé au rang de « liberté fondamentale » la faculté pour un commerçant ou un industriel de choisir ses fournisseurs. De son côté, la Commission de la concurrence (transformée en Conseil en 1987) a, dans un avis du 14 mars 1985 sur la situation des centrales d'achat et de leurs regroupements, considéré que la liberté ainsi donnée aux acheteurs était « un des ressorts majeurs de la concurrence et le principal moyen par lequel le commerce stimule chez les producteurs l'accroissement de la productivité, l'amélioration de la qualité des produits et des services ainsi que l'abaissement des prix ».
Cette position rend caduques les dispositions de la circulaire Scrivener du 10 janvier 1978 relative aux relations commerciales entre entreprises qui, dans son interprétation de l'article 38 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat (article portant interdiction de pratiques discriminatoires), considérait comme condamnables les pratiques consistant à obtenir ou chercher à obtenir des fournisseurs « des prestations telles que droit d'entrée, primes de démarrage au titre des premières commandes, primes de référencement, cadeaux à l'occasion d'anniversaires, (...) ».
La jurisprudence considère donc la pratique du référencement comme licite en elle-même. Le Conseil de la concurrence a refusé d'y voir une pratique restrictive anticoncurrentielle (décision du 13 décembre 1994 sur les pratiques relevées dans le secteur des lessives). Cependant le référencement ne doit pas être pratiqué de manière discriminatoire ou donner lieu à des pressions anticoncurrentielles constitutives d'abus de position dominante ou de dépendance économique. En 1996, en raison des dérives constatées, le législateur a éprouvé le besoin d'encadrer cette pratique ainsi que le déréférencement.
Comme l'ont fait valoir nos interlocuteurs de la grande distribution, les industriels n'ont plus aujourd'hui d'équipes de vente pour aller négocier avec chaque point de vente. Le système du référencement permet de négocier les ventes à plusieurs centaines de points de vente en un seul rendez-vous, ce qui représente une économie réelle qu'il est justifié de faire payer. Nous pouvons accepter ce raisonnement dès lors que le versement de cette rémunération s'accompagne effectivement d'engagements de commandes fermes et ne traduit pas simplement un droit à commencer une négociation commerciale.
1. La notion de référencement et sa consistance
Le référencement est un contrat par lequel une structure - centrale d'achat ou centrale de référencement - représentant plusieurs revendeurs distributeurs, détaillants ou grossistes - autorise un fournisseur, en contrepartie de conditions de vente ou d'avantages financiers particuliers, à proposer ses produits (la revente des services n'existe pas à ce jour) à la revente chez ses affiliés.
Par opposition, le déréférencement est une pratique consistant à retirer à ce fournisseur l'autorisation d'accès à la centrale d'achat ou de référencement pour la revente de ses produits. Le déréférencement est une pratique unilatérale puisque seule la centrale en a l'initiative. Il peut être mis fin au contrat de référencement pour tous les produits du fournisseur, pour l'accès à seulement certaines enseignes affiliées à la centrale ou pour quelques produits précis.
Au delà des tarifs, la négociation du contrat de référencement donne lieu à une discussion sur les qualités du produit, les hypothèses de vente, les prévisions de parts de marché, les investissements publicitaires, les développements industriels possibles, etc. Une estimation volumétrique des ventes est toujours réalisée. Mais, le système français centre le référencement sur l'octroi, par le fournisseur, de contreparties financières et la réalisation de promotions commerciales par le revendeur.
a) Les remises de référencement
En 1996, l'Institut de liaisons et d'études des industries de consommation (ILEC) évaluait le budget moyen de référencement par enseigne pour un seul produit de marque nationale (rappelons que plusieurs enseignes sont adhérentes d'une centrale) à :
- de 1 à 3 millions de francs en France ;
- de 800 000 à 900 000 francs en Allemagne ;
- de 120 000 à 200 000 francs en Grande-Bretagne.
Ces chiffres n'ont cependant pas un grand sens économique car les rémunérations versées au titre de la coopération commerciale varient considérablement d'une entreprise à une autre et d'un produit à un autre.
Dès lors, une grande marque nationale peut être contrainte de verser jusqu'à 15 millions de francs pour pouvoir mettre dans les rayons des grands distributeurs un nouveau produit. Même une PME peut être conduite à verser sous forme de remises des millions de francs.
Selon les informations recueillies par la mission d'information, des sommes de cet ordre doivent être accordées par les fournisseurs :
« Afin de pouvoir être présent sur un prospectus national lors d'une opération spécifique, Promodès a demandé une participation de 50 000 F pour qu'un produit soit présenté sous forme d'une photo. Le chiffre d'affaires réalisé a été de 253 000 F. Notre participation au catalogue a donc été de 20 % du chiffre d'affaires généré. »
Le Conseil de la concurrence a reconnu la validité des « primes de référencement » dès lors que les remises étaient « calculées sur la base d'engagements d'achats négociés en fonction des potentialités des revendeurs » (décision n° 97-D-15 du 4 mars 1997, affaires Jean Chappelle, confirmée par la Cour d'appel de Paris dans un arrêt du 10 mars 1998). Il a estimé qu'elles ne constituaient pas des pratiques discriminatoires abusives dans la mesure où le fournisseur en tirait une contrepartie réelle consistant en l'assurance que leurs produits de marque seront mis en vente pendant de larges périodes et pour des assortiments importants. La Cour d'appel a cependant souligné, a contrario, qu'elles présenteraient un caractère anticoncurrentiel si elles n'étaient pas assorties d'une contrepartie réelle et objectivement définie pour le fournisseur. En conséquence, un référencement non suivi de commandes doit être considéré comme dénué de contrepartie réelle.
b) Les procédures de référencement
Les ristournes accordées par les fournisseurs pour la revente de leurs produits le sont aux revendeurs adhérents. Elles transitent par la centrale d'achat ou la centrale de référencement qui doit les reverser intégralement aux affiliés pour la part qui leur revient. La décision du 13 décembre 1994 du Conseil de la concurrence relative à des pratiques relevées dans le secteur des lessives, confirmée en appel le 1er décembre 1995, a mis en lumière les pratiques existant en la matière. Cependant, de plus en plus, les centrales d'achat ou de référencement se rémunèrent également par des prestations de services qui sont parfois fictives.
M. Jean-Paul Charié a, dans son rapport n° 2595 du 6 mars 1996 sur le projet de loi sur la loyauté et l'équilibre des relations commerciales, fait une analyse précise des principaux mécanismes de référencement existant en France. En voici son texte :
« Il n'existe pas de statut spécifique de la structure référençant les fournisseurs. Les statuts et les modes d'organisation varient notablement selon les enseignes de distribution.
« La jurisprudence a distingué la centrale d'achat, qui possède le statut de commissionnaire, de la centrale de référencement, qui est un courtier (la détermination de cette dernière qualité résulte d'un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 6 décembre 1988). La première est chargée de négocier pour ses commettants le meilleur assortiment et les meilleures conditions d'achat et de revente chez ses commettants auprès des fournisseurs. Sa fonction ne l'amène donc pas à acheter pour revendre dans un but lucratif ; elle n'est à aucun moment propriétaire des produits référencés.
« Le contrat liant les commettants à leur centrale d'achat est en principe de longue durée (jusqu'à 20 ans) et confie à cette dernière la tâche de sélectionner les produits à revendre, de déterminer un prix indicatif de revente et de planifier les approvisionnements. Les commettants présentent à leur centrale leurs besoins prévisionnels au regard de l'état du marché local.
« La centrale d'achat est rémunérée par ses commettants par une commission calculée, en principe, proportionnellement au montant des transactions effectuées pour leur compte ou au montant des ventes réalisées par chaque commettant. Il s'agit essentiellement de ristournes sur les ventes.
« La centrale d'achat peut être une association ou plus fréquemment, en raison de la nature et du volume des transactions qu'elle réalise, une société commerciale.
« La centrale de référencement met en relation des fournisseurs avec des revendeurs en s'assurant que ces derniers auront les meilleures conditions de vente possibles. Les ventes sont conclues directement entre le revendeur et le fournisseur, la centrale de référencement n'intervenant juridiquement en aucune manière dans celles-ci. La centrale est chargée de transmettre à ses affiliés une liste de fournisseurs référencés (avec leurs produits) et de communiquer à ces derniers la liste des revendeurs affiliés.
« La réalité des centrales est plus complexe que ne le fait paraître cette analyse juridique. En particulier, des centrales de référencement peuvent être amenées à négocier, notamment des volumes de commandes, en tant que commissionnaires. Un groupe de distribution ne choisit donc pas de mettre en place des centrales d'achat ou des centrales de référencement.
« La présentation des modes d'organisation et des structures juridiques de cinq groupes ou enseignes de distribution français permet de mieux saisir les mécanismes des systèmes de référencement.
· Les centres Leclerc sont régis par une association loi 1901 coprésidée par Edouard et Michel-Edouard Leclerc, l'Association des centres distributeurs Leclerc (A.C.D.LEC). L'Association autorise des commerçants indépendants à utiliser l'enseigne Leclerc et met à leur disposition des moyens d'achat et de revente, en particulier les centrales d'achat, sous réserve du respect d'un cahier des charges (11).
« A.C.D.LEC a en fait un rôle d'orientation stratégique. Elle regroupe plus de 600 adhérents qui sont des chefs d'entreprise indépendants, propriétaires de leurs magasins et donc responsables de leurs investissements.
« Les fournisseurs et leurs produits sont référencés à deux niveaux. Tout d'abord, pour que les produits d'un fournisseur arrivent sur les rayons d'un centre, il faut que ce dernier soit référencé à l'échelon national par le GALEC, groupement d'achats Leclerc. Le GALEC négocie pour l'ensemble des centres Leclerc les conditions d'achat auprès des fournisseurs (1700 référencés en 1992). C'est une société coopérative à capital variable. Il ne réalise que des prestations de services pour le compte des adhérents et du groupement. Les référencements qu'il accorde ne constituent qu'une autorisation de se présenter au référencement régional. Economiquement, il ne s'agit que d'un droit d'entrée.
« Le second échelon de référencement est donc régional. Il est réalisé par seize centrales d'achat régionales. Ce sont également des sociétés coopératives à capital variable. Ces référencements régionaux ne constituent pas non plus un droit à avoir ses produits présents sur les rayons des centres. Les référencements consistent à introduire les fournisseurs et leurs produits sur des banques de données et à convenir des conditions de vente, en particulier le prix net de revente. Les commandes et les achats sont décidés et effectués par les centres Leclerc qui règlent les factures d'achat.
· Le groupement Intermarché est également constitué de magasins indépendants. Il est coiffé par la Société civile des Mousquetaires et ITM Entreprises SA, société anonyme contrôlant ITM France SA, Cofipar SA et ITL France SA. Les royalties des contrats de franchise accordant aux magasins l'utilisation de l'enseigne et mettant à leur disposition les moyens d'achat et de vente du groupement remontent à cette société anonyme. Il n'existe aucun lien direct entre les fournisseurs et ITM Entreprises SA.
« Les référencements sont négociés et conclus par 43 sociétés centrales d'achats spécialisées (viandes, volaille, agrumes, parfumerie, vins, textile, automobile, etc.) qui sont des sociétés en nom collectif sauf sept d'entre elles qui sont des sociétés anonymes. Elles sont contrôlées à 90 % par ITM France SA et à 10 % par Cofipar SA.
« Les sociétés centrales d'achats passent les commandes de produits auprès des fournisseurs référencés selon les besoins des « bases ». Les bases - il en existe 38 - sont des plates-formes régionales chargées d'exploiter un fonds de commerce de réception et de stockage des marchandises pour le compte des sociétés centrales d'achats. Elles sont constituées sous la forme de sociétés anonymes contrôlées à 99 % par ITL France SA. Les produits entreposés ne leur appartiennent pas. Leurs immobilisations sont la propriété d'ITM Entreprises SA. Les fournisseurs livrent donc les bases qui livrent les points de vente. Ces derniers peuvent toutefois passer des commandes en direct à des fournisseurs.
« Les factures de vente des produits sont établies par les fournisseurs à l'ordre de la société centrale d'achats concernée et adressées à la base régionale livrée. Leur règlement est effectué par la société centrale d'achats (elles sont toutes situées au même siège).
« Les ristournes sont encaissées par ITM France SA qui dispose d'un mandat d'encaissement des sociétés centrales d'achats.
« La responsabilité d'ITM Entreprises SA dans l'activité des sociétés centrales d'achats, donc dans les référencements, est, en conséquence, limitée à son apport en capital dans ITM France SA (300.000 F de capital) et Cofipar SA (1.000.000F de capital).
« Les contrats de prestations de services (coopération commerciale) sont conclus avec les fournisseurs par les sociétés centrales d'achat. Les facturations sont établies par ITM France SA qui reçoit les règlements grâce à un mandat d'encaissement des centrales.
· Carrefour a une centrale de référencement nationale qui possède des compléments régionaux. Le référencement accordé à l'échelon national (2000 fournisseurs) donne droit au fournisseur à avoir ses produits présents sur les rayons de tous les hypermarchés Carrefour de France. Afin de compléter la gamme nationale, des fournisseurs sont en outre référencés à l'échelon régional et par magasin. Au total, en métropole, 25.000 fournisseurs sont référencés aux échelons régionaux et locaux. Une moyenne régionale est délicate à avancer car les écarts sont grands entre les départements. Rappelons qu'un hypermarché Carrefour contient en moyenne 50.000 à 60.000 références dont 6000 en épicerie. Ces chiffres représentent largement la moyenne des hypermarchés français, les hypermarchés Auchan étant ceux offrant le plus de références (environ 100.000, les plus grands complexes pouvant atteindre plus de 160.000 références).
« Carrefour est un groupe intégré. Ce sont donc des entités internes à la société qui sont chargées du référencement. Les centrales, nationale ou régionales, effectuant les référencements passent également les commandes auprès des fournisseurs, sauf en cas de livraison et de référencement direct auprès du magasin. Les commandes sont livrées à des entrepôts, plates-formes spécialisées (produits frais, détergents,...). Les magasins s'y approvisionnent selon leurs besoins.
« Mais dans tous les cas, les paiements sont effectués par un centre de règlement des fournisseurs qui règle les factures adressées à Carrefour et agit pour le compte des magasins.
· Promodès (enseignes Continent, Shopi,...) possède une centrale d'achat, la société Interdis, qui négocie les conditions de vente avec les fournisseurs et leur adresse les commandes, mais elle ne les référence pas. Le référencement est délivré par un service de la maison mère, « marketing enseigne », qui définit également les assortiments souhaités par la société. Les magasins Shopi, qui sont des commerces indépendants, empruntent également ces filières.
· Système U (32 hyper U, 505 super U et 205 marchés U, en 1994) est un mouvement de commerçants indépendants associés au travers de cinq centrales régionales qui sont des sociétés anonymes coopératives à capital variable. Ces cinq coopératives sont unies au sein d'une centrale nationale qui est également une société anonyme coopérative à capital variable. Celle-ci est chargée d'assurer la cohérence de la marque et des enseignes U. Elle définit le schéma d'organisation (communication, formation, finances, relations interprofessionnelles) et la politique d'achat nationale ; elle perçoit certaines ristournes et négocie des opérations de coopération commerciale nationales qu'elle facture et dont elle perçoit le règlement.
« Les centrales régionales définissent l'assortiment régional de base que les adhérents demeurent libres de prendre ou non. Elles achètent et paient les marchandises auprès des fournisseurs qu'elles ont référencés. Elles stockent celles-ci dans des entrepôts qu'elles gèrent et les livrent aux magasins. Elles conduisent les opérations de coopération commerciale régionale. L'essentiel des flux financiers du groupement passe donc par elles.
« Les commerçants adhérents choisissent librement les produits qu'ils mettent en vente en se conformant aux règles contenues dans la charte à laquelle ils ont souscrit en entrant dans le groupement. Ils peuvent réaliser des prestations de coopération commerciale locale (tête de gondole notamment) dont ils établissent la facture et reçoivent le règlement.
« Le système conserve une grande ambiguïté en raison de l'incertitude de la nature juridique des opérations commerciales des centrales (achat de marchandise, coopération commerciale) : elles peuvent agir pour leur propre compte ou en tant que mandataire des adhérents.
« La présentation succincte de ces différents systèmes met en évidence l'extrême complexité des mécanismes juridiques et économiques s'articulant autour des contrats de référencement. Il serait vain de vouloir réglementer les systèmes et encore plus de les sanctionner pénalement, d'autant plus que les pratiques sont très mouvantes. La loi doit strictement se limiter à définir les abus.
« Cette présentation montre aussi que l'entité délivrant le référencement n'est pas toujours celle qui passe les commandes ou effectue les paiements. »
Article 36 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 Art. 36.- Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou artisan : (...) (Loi n° 96-588 du 1er juillet 1996, art. 14).- « 3. D'obtenir ou de tenter d'obtenir un avantage, condition préalable à la passation de commandes, sans l'assortir d'un engagement écrit sur un volume d'achat proportionné et, le cas échéant, d'un service demandé par le fournisseur et ayant fait l'objet d'un accord écrit ; » |
L'article 14 de la loi n° 96-588 du 1er juillet 1996 a imposé au revendeur de s'engager par écrit à acheter un volume proportionné à l'avantage qu'il obtient en contrepartie de la passation de la commande et, le cas échéant, à effectuer une prestation de service demandée par le fournisseur. Ce dispositif figurant au point 3 de l'article 36 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence vise les remises de référencement mais sa rédaction en termes généraux lui permet d'avoir une application plus large et notamment toucher la revente de services.
L'avantage obtenu en contrepartie du référencement doit être accordé par le fournisseur, ou présenté par le revendeur, ou simplement considéré par l'un ou par l'autre, comme une condition préalable à la passation de commandes. L'engagement sur un volume d'achat ou la prestation d'un service demandé par le fournisseur doit avoir fait l'objet d'un accord entre les deux partenaires. Cette exigence a pour but de maintenir le caractère synallagmatique du contrat.
L'objectif de l'article 36-3 n'est pas d'interdire le versement d'une rémunération par le fournisseur pour le référencement d'un de ses produits, mais de garantir que cette rémunération soit proportionnelle à l'avantage commercial qu'il tire du référencement. Cet avantage peut consister ou bien en un volume de commandes ou, à défaut, en la prestation d'un service demandé par le fournisseur. Ce service ne saurait bien entendu, comme il a été précisé dans les travaux préparatoires à l'adoption du projet de loi (voir le rapport n° 2801 de M. Jean-Paul Charié, p. 57 et le JO.débats AN du 29 mai 1996, p. 3597), consister en le référencement lui-même.
L'ordonnance du 1er décembre 1986 précise clairement que la contrepartie naturelle d'un référencement est l'engagement sur un volume d'achats proportionné à l'avantage accordé, mais dans certains cas elle peut consister en une prestation de service spécifique (voir l'intervention de M. Jean-Paul Charié sur l'amendement n° 32, JO.débats AN, 29 mai 1996, p. 3597).
Les termes de la loi font supporter la responsabilité de l'infraction civile ou commerciale sur le distributeur (voir l'intervention du ministre chargé de l'économie, JO.débats AN, 28 mars 1996, pp. 2180 et 2181 et la rectification en ce sens de l'amendement n° 29).
3. Quelques pratiques abusives relevées par la mission
Le président d'une PME a adressé à la mission une description instructive du processus de négociation d'un référencement :
· « Que se passe-t-il sur le terrain ?
« Aucun distributeur ne s'engage sur un chiffre potentiel.
« La méthode la plus couramment utilisée consiste à nous demander une prévision de chiffre d'affaires du produit sur un an. Le plus souvent cette prévision est trouvée trop faible par le distributeur qui refuse de lancer un nouveau produit qui génère soi-disant moins que le plus petit produit de son assortiment. Il nous oblige donc à prendre des risques sur cette prévision sans que nous ne maîtrisions tous les paramètres de diffusion à ce moment de la vente.
« Une fois ce chiffre annoncé, il nous formule une demande en valeur absolue qui représente 10 % à 15 % du chiffre d'affaires potentiel. De plus, il nous demande de verser au moins 50 % de cette somme pour un test de trois mois, délai au delà duquel, soit il décide de retenir le produit, et nous devons payer le solde, soit il décide de ne pas référencer, et nous perdons la somme déjà versée. Dans le cas où le produit est retenu et qu'il n'atteint pas le chiffre d'affaires potentiel, aucun remboursement n'est effectué.
« Le fabricant doit donc prendre tous les risques à sa charge alors que le distributeur pour sa part est gagnant à tous les coups. Il est même plus gagnant lorsque le produit n'obtient pas les ventes attendues dans les trois mois de son lancement puisqu'il perçoit 50 % d'un budget qui a été calculé sur un chiffre d'affaires qui ne sera jamais atteint.
« L'autre variante de cette méthode consiste à traduire le budget de référencement en valeur relative et à l'inclure dans l'enveloppe totale des différés. De la sorte, si le fabricant ne lance pas de nouveaux produits l'année suivante, le distributeur se garantit le même taux de différés. »
Les chiffres suivants illustrent les abus subis par les PME dans leurs rapports avec les grandes enseignes de distribution. Une PME avait réalisé en 1997 moins de 20 millions de francs de chiffre d'affaires. Dans sa négociation avec l'enseigne de distribution, son objectif de chiffre d'affaires prévisionnel pour 1998 a été fixé à 23 millions de francs et le montant de sa « coopération commerciale » à 30 %. Celle-ci devait être prélevée mensuellement par compensation sur les factures dues par le distributeur, ce prélèvement mensuel étant fixé à 575 000 francs par mois. Le chiffre d'affaires réalisé en 1998 n'a en réalité atteint que 19 millions de francs. L'enseigne de la grande distribution a donc bénéficié d'un trop perçu de 1,2 million de francs. Après d'âpres discussions elle n'en a rétrocédé que la moitié, soit 600 000 francs, ce qui a porté le pourcentage réel de la coopération commerciale à plus de 33 %.
Les centrales de référencement installées à l'étranger se permettent tout :
· « Notre société était référencée par Leclerc depuis plusieurs années. En 1997, Leclerc nous informe avoir confié ses achats, pour les produits qui nous concernent, à une Centrale Suisse, dénommée EMD - European Marketing Distribution - située à Pfaffikon (canton de Zurich) et nous demande de prendre contact avec celle-ci pour obtenir le référencement à compter du 2ème semestre 1998. Rendez-vous fut pris à Zurich (à l'aéroport ... ). Il nous fut alors signifié que, si nous voulions continuer à être référencé, nous devions passer par cette centrale en lui octroyant une commission de 0,35 % sur le chiffre d'affaires global, avec un minimum perçu d'avance de 1 000 euros (65 000 F) .Il ne nous était rien proposé en contrepartie.
« Le minimum demandé - 10 000 euros - ne pouvait, en ce qui nous concerne, être amorti que dans la mesure où nous obtenions un minimum de chiffre d'affaires. La centrale EMD n'ayant pas voulu garantir ce minimum, il nous a été financièrement impossible d'accepter de telles conditions. Nous avons donc été déréférencés et avons perdu 6 millions de francs de chiffre d'affaires (soit l'équivalent de 6 emplois salariés). Bien plus, la centrale suisse EMD a prétendu nous réclamer le paiement du minimum garanti, alors que nous n'avions jamais été référencé par elle, et par conséquent, jamais livré les entrepôts Leclerc par leur entremise. (...)
« Il convient de noter que, pour l'année 2000, Leclerc semble avoir renoncé, en ce qui concerne les produits que nous commercialisons, à obliger les industriels à passer par la centrale EMD. »
Les référencement sans contrepartie existent encore :
· « La centrale d'achat Opéra demande à tous les fournisseurs de ses adhérents (Casino, Cora, Match) une somme fixe payable dans les délais les plus rapides. Cette somme est qualifiée de « participation de l'industriel à la création d'Opéra ». Elle est calculée sur les chiffres d'affaires réalisés par l'industriel en 1998 avec les enseignes membres de cette centrale (plus ou moins 150 000 F en ce qui nous concerne).
« Il n'est donné aucune contrepartie à cette somme, ni garantie de chiffre d'affaires, de référencement ou autres avantages. »
L'attention de votre rapporteur a été attirée par un témoignage écrit sur une pratique inquiétante liée au conditionnement de pommes de terre qui laisse supposer qu'un emballeur est imposé aux fournisseurs dans des conditions déloyales et peu transparentes par les grandes surfaces :
« Les centrales déguisent les prix d'achat chez les agriculteurs car elles les obligent à prendre des conditionnements chez un seul fournisseur référencé chez eux (Filpack, revendeur d'un Espagnol). Sinon, elles ne travaillent plus avec cet agriculteur (pommes de terre). Ces conditionnements peuvent être payés le double dans certains cas que chez un autre fournisseur. Les pommes de terre ne sont pas pour autant achetées plus cher à cet agriculteur.
« Une autre façon de se faire des marges cachées. Elles toucheraient sur le conditionnement et sur le produit fini vendu !
(...)
« Que faire ? Les consommateurs ne se rendent pas compte que d'ici quelques années il n'y aura plus de petits ni de moyens producteurs. Uniquement des conditionneurs qui achèteront leurs produits au Maghreb. Tout est fait à l'inverse de la demande des consommateurs. Nous ne connaissons plus l'agriculteur ; il est impossible de retrouver le producteur, ni la provenance. On standardise tout sous une marque avec obligation d'acheter les bandes de cette marque à un seul fournisseur plus cher dans une volonté évidente de faire plus de profits et de pouvoir un jour mettre en vente les pommes de terre de n'importe quelle région du monde achetées beaucoup moins cher avec beaucoup moins de contrôles sanitaires.
(...)
« Ce sont des faux référencements. Car un seul fournisseur obtient un rendez-vous. Les centrales ne regardent ni nos prix ni notre qualité de service ou de produit. Il n'y a pas de référencement. J'ai depuis un an, et même avant, demandé à recevoir un cahier des charges. Ni Auchan, ni Promodès, ni Casino ne l'ont fait. Pourtant ils ont tous référencé un seul fournisseur toujours le même, implanté depuis des années avec un système de dessous de table. Il n'y a aucune autre raison ! Si on leur demande, ils disent, c'est comme cela ! Pas d'explication sur leur choix.
« Aujourd'hui l'heure est grave car Intermarché vient aussi dans le plus grand secret de référencer toujours le même fournisseur. En plus, les clients doivent aussi changer de fournisseurs de cartons (box) dans lesquels ils envoient leurs sacs de pommes de terre conditionnées. Je suis sûre qu'ils touchent partout sinon ils n'auraient aucune raison de référencer un fournisseur de carton pour la livraison en magasin d'un produit qui sera de toute façon sorti de ce carton. Tous les frais sont à la charge du conditionneur (frais de nouveaux clichés, etc.) et les cartons sont plus chers ! Il n'y a plus que les Leclerc qui ne le font pas, mais je suppose que cela ne va pas tarder.
« Les gros conditionneurs marchent avec le système, ils répercutent le coût sur le fournisseur de pommes de terre toujours le même, c'est le producteur qui paie. Dans deux ans, seuls deux gros conditionneurs seront référencés ont décidé les centrales. Finis les petits ou moyens producteurs, ils ne pourront plus vendre et devront brader aux gros conditionneurs avant de disparaître avec leurs pommes de terre. Derrière, c'est toute la profession qui meurt : producteurs de légumes, fabricants de sacs, de filets, de bandes publicitaires, de cartons, etc. ».
D.- LA RUPTURE DES RELATIONS COMMERCIALES
On se reportera au début du chapitre précédent pour l'analyse de la notion de déréférencement.
Il faut souligner que la référence à des relations commerciales établies permet de dépasser la notion de cadre contractuel. Ainsi, les dispositions de l'ordonnance sont susceptibles d'être applicables aux relations commerciales engagées par anticipation de la signature du contrat, ou poursuivies après la fin du contrat liant les deux partenaires commerciaux, ou établies sans base contractuelle écrite.
Article 36 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 Art. 36.- Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou artisan : (...) (Loi n° 96-588 du 1er juillet 1996, art. 14).- « 3. (...) « 4. D'obtenir ou de tenter d'obtenir, sous la menace d'une rupture brutale des relations commerciales, des prix, des délais de paiement, des modalités de vente ou des conditions de coopération commerciale manifestement dérogatoires aux conditions générales de vente ; » |
L'article 14 de la loi n° 96-588 du 1er juillet 1996 a rangé au nombre des pratiques restrictives ou déloyales l'emploi de la menace de rupture brutale des relations commerciales pour tenter d'obtenir des prix, des délais de paiement, des modalités de ventes ou des conditions de coopération commerciale qui sont manifestement dérogatoires par rapport aux conditions générales de vente. Contrairement au point 3 de l'article 36, qui vise spécifiquement une pratique des revendeurs, le point 4 inséré dans l'article 36 concerne aussi bien des pratiques des acheteurs que des pratiques des vendeurs. Le dispositif s'appuie cependant sur les conditions générales de vente qui sont des documents établis par les fournisseurs. Rappelons en effet que la loi ne reconnaît pas l'existence, et donc l'opposabilité, d'éventuelles conditions générales d'achat.
Le dispositif de l'article 36-4 constitue une protection destinée aux fournisseurs menacés de déréférencement dans le but de les contraindre à revoir à la baisse leurs conditions générales de vente. Il ne peut s'appliquer qu'aux entreprises ayant établi un tel document (ce qui, au titre de l'article 33 de l'ordonnance, n'est pas obligatoire). Le fournisseur doit apporter la preuve de la menace et démontrer le caractère manifestement dérogatoire des exigences par rapport aux conditions générales de vente.
L'absence de référence aux usages commerciaux pour apprécier le caractère dérogatoire (ou exorbitant, comme le disposait le projet de loi d'origine) dans les cas où le fournisseur n'a pas établi de conditions générales de vente, est destinée à inciter les producteurs à établir de tels documents et à renforcer leur force juridique dans les relations commerciales établies. Il faut, de ce point de vue, noter que la loi ne se réfère pas aux « conditions de vente », documents qui sont le résultat d'une négociation entre le fournisseur et le revendeur, mais aux conditions générales de vente, documents qui ont un caractère unilatéral même si leur rédacteur ne peut que tenir compte de la demande existante lorsqu'il les établit (en dernier ressort, en tous les cas, il en est le seul maître).
b) Les pratiques déloyales relevées par la mission
La loi ayant encadré le déréférencement et la cessation des contrats d'achat, certaines enseignes ou responsables de magasins de grande distribution ont mis en place des systèmes de véritable « pourrissement » des produits du fournisseur pour que celui-ci s'incline devant les exigences du client ou quitte volontairement l'enseigne. Ainsi, afin de pénaliser le fournisseur :
- ses produits sont placés dans la plus mauvaise position sur le linéaire (complètement en bas ou très haut pour être inaccessibles à beaucoup de clients) ;
- le linéaire ou la section de linéaire n'est pas entretenu (rangement des produits, entretien, y compris des sols face aux produits comme l'a rappelé un membre de la mission ayant naguère reçu un témoignage en ce sens) ;
- des ruptures d'approvisionnement des linéaires se produisent fréquemment, notamment le samedi en début de matinée ;
- des prix de revente élevés sont pratiqués sur de courtes périodes bien choisies ;
- absence de soutien promotionnel ou négligences dans la promotion due au fournisseur ;
Il va de soi pour les distributeurs interrogés que toutes ces pratiques sont involontaires, accidentelles, dues à la négligence, le fait de personnes isolées et non responsables, anecdotiques, fantaisistes, imaginées par des esprits insatisfaits, etc. Les membres de la mission d'information, à l'unanimité, affirment qu'elles sont réelles, intentionnelles et quasi générales (mais toutefois pas pour la totalité des abus cités) et que leurs effets sont catastrophiques.
2. La rupture brutale des relations commerciales établies
Article 36 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 Art. 36.- Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou artisan : (...) (Loi n° 96-588 du 1er juillet 1996, art. 14).- « 3. (...) 4° (...) « 5. De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte des relations commerciales antérieures ou des usages reconnus par des accords interprofessionnels. Les dispositions précédentes ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou de force majeure ; |
A l'instar du 4 de l'article 36, le dispositif du 5 de l'article 36, introduit par la loi du 1er juillet 1996, s'applique aussi bien à l'acheteur qu'au vendeur même si son établissement a été motivé par des pratiques abusives de déréférencement. Est donc considérée comme déloyale la rupture brutale des relations commerciales établies avec un fournisseur ou un client, sans préavis écrit.
La loi n° 96-588 du 1er juillet 1996 n'a pas entendu encadrer les motifs d'une rupture des relations commerciales mais seulement établir une procédure permettant au partenaire victime de cette rupture de rechercher de nouveaux clients ou fournisseurs lui permettant de remplacer le courant d'affaires rompu. Une rupture de relations commerciales ne saurait donc être considérée comme illégale au motif que l'entreprise à l'origine de cette rupture n'en a pas donné les motifs à son partenaire qui en est la victime (voir par exemple l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 10 juin 1999, La Redoute, Le Printemps, FNAC et autres c/ Tir Groupé).
La rupture peut être totale ou partielle. La pratique des déréférencements partiels permet en effet de graduer la pression sur le fournisseur en ciblant le déréférencement sur des produits dont la présence dans les rayons n'est pas indispensable au revendeur mais dont la vente est indispensable pour le maintien du chiffre d'affaires de l'industriel ou du producteur. De même, l'industriel peut être tenté pour faire pression sur un revendeur (pour qu'il achète la gamme complète des produits, pour que ses produits soient mis en avant dans le magasin, pour avoir une planification des livraisons à sa convenance, etc.) en refusant de le réapprovisionner en produits « leaders » que recherche la clientèle.
Dans les cas visés aux 4 et 5 de l'article 36, pour obtenir réparation, la victime de la pratique devra prouver l'existence de la menace, le caractère brutal de la rupture des relations commerciales ou le caractère dérogatoire par rapport aux conditions générales de vente des demandes qui lui sont faites.
L'article 36-5 vise à encadrer les pratiques de déréférencement. Il subordonne le déréférencement à l'envoi d'un préavis écrit à l'intéressé. L'absence d'un tel écrit doit permettre à la victime d'établir devant les tribunaux la rupture brutale ; c'est le sens de cette précision qui résulte de l'adoption d'un amendement de la commission de la production et des échanges.
Cette procédure s'applique au déréférencement aussi bien d'un fournisseur que d'une gamme de produits ou d'un seul des produits. Il a en effet été constaté à plusieurs reprises que certains produits d'un fournisseur étaient littéralement pris en otage par le revendeur pour obtenir des conditions exorbitantes sur les produits phares ou stratégiques du même fournisseur, pour qui le maintien du niveau des ventes des produits non leader est indispensable à la préservation de ses marges et de son activité.
Ni le Parlement, ni le Gouvernement n'ont, en 1996, souhaité fixer dans la loi un délai minimal de préavis ou un mode de détermination de celui-ci (la commission de la production et des échanges avait cependant adopté un amendement en première lecture proposant de fixer un délai minimal de quatre mois, qui n'a pas été voté en séance publique). Les situations et les pratiques des différents secteurs de l'économie paraissaient en effet trop disparates pour arrêter un tel délai. De plus la loi aurait figé une situation par nature mouvante.
En Espagne, les Cortès ont adopté, le 16 décembre 1999, un projet de loi directement inspiré de l'article 36 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 imposant, entre autres dispositions, que la rupture de relations commerciales entre un fournisseur et un distributeur soit précédée d'un préavis de six mois.
Le préavis est défini tacitement, ou expressément dans le contrat de vente, en fonction des relations commerciales antérieures ou des usages reconnus par des accords interprofessionnels (afin de donner une base de référence aux partenaires ayant pour la première fois des relations commerciales). Cependant, comme il avait été indiqué par le rapporteur de l'Assemblée nationale, quasiment aucun accord interprofessionnel n'existe en dehors des filières agro-alimentaires et les accords interprofessionnels existants ne mentionnent aucun délai de préavis pour rupture de relations commerciales établies.
La loi admet cependant que le revendeur puisse ne pas respecter le préavis en cas de non-respect par le fournisseur de ses obligations ou en cas de force majeure (l'incendie du magasin a été donné en exemple lors de la discussion du projet de loi, voir JO.débats AN, 29 mai 1996, p.3598), afin de rappeler que les règles traditionnelles du droit civil des obligations continuent de s'appliquer en la matière.
La stratégie mise en place par certaines enseignes de distribution et centrales d'achat à la suite de la promulgation de la loi du 1er juillet 1996 et consistant à dénoncer les contrats d'achat quelques mois avant les négociations annuelles de référencement ne les exonère pas d'adresser un préavis écrit d'une durée adaptée aux relations qui ont été établies et de considérer qu'il y a rupture brutale si le fournisseur ou une partie de ses produits n'est plus référencé pour l'année suivante. En effet, d'une part, cette dénonciation ne s'accompagne pas d'une cessation des commandes, des livraisons et des paiements, et d'autre part, la brutalité d'une rupture des relations commerciales ne s'apprécie pas au regard de l'existence d'un contrat à la date de la rupture mais de l'ensemble des relations établies depuis plusieurs années souvent. Ainsi, une succession de contrats à durée déterminée établit des relations commerciales au sens de l'article 36 de l'ordonnance car c'est la rupture d'une stabilité des relations et la disproportion entre la durée de ces relations et la brièveté du délai accordé par le partenaire pour trouver des contrats de substitution ou reconvertir ses unités de production ou de vente qui ont été visées par le Parlement.
b) L'application des dispositions de l'article 36, alinéa 5
La diversité des pratiques et la variété des contraintes des différents secteurs de vente des produits de grande consommation n'a pas permis au législateur de fixer un délai de préavis dans la loi ni même un délai minimal.
La jurisprudence n'a pas imposé un délai uniforme mais a apprécié la brutalité de la rupture des relations commerciales en fonction de l'ancienneté des rapports commerciaux, leur stabilité et les usages du secteur en matière de cessation des relations commerciales lorsqu'il en existait. Une importante étude réalisée par Me Jean-Marie Meffre, avocat à la cour d'appel de Paris, a analysé les contentieux portant sur l'application de ces dispositions de l'ordonnance du 1er décembre 1986 (Lamy droit économique, bulletin n° 122, novembre 1999).
Le tribunal de commerce de Nanterre a ainsi jugé, le 20 novembre 1998 (1ère chambre), que des relations commerciales étaient établies du fait qu'il existait un courant d'affaires en constante progression entre les deux entreprises depuis plusieurs années et que plusieurs commandes, accompagnées d'un règlement, étaient passées par mois. La référence à « un courant d'affaires sans cesse croissant pendant x années » est fréquemment utilisée par les tribunaux pour motiver leur décision ; elle a été utilisée par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans l'arrêt Bridel du 28 février 1995 dans une affaire similaire de rupture des approvisionnements.
Cette démarche conduit les tribunaux à sanctionner, comme le souhaitait le législateur, les ruptures partielles de relations commerciales, qui conduisent à une chute du chiffre d'affaires du partenaire commercial. La cour d'appel de Rouen a ainsi, dans un arrêt du 3 novembre 1998, reconnu la responsabilité d'une entreprise, Saint-Gobain Desjonquères, pour avoir réduit de plus de la moitié le volume des travaux confiés à un sous-traitant, la société Antigone chargée de trier des flacons, puis avoir rompu complètement les relations commerciales, le tout sans préavis.
La loi permet donc de sanctionner ce que certaines entreprises appellent un déréférencement partiel, à savoir le retrait de la vente de quelques produits d'un fournisseur ou la cessation de la vente des références d'un fournisseurs dans quelques points de vente. Il faudrait que ce déréférencement partiel n'entraîne aucune baisse significative du chiffre d'affaires du fournisseur avec l'enseigne pour que la loi ne soit pas opposable à cette enseigne.
La détermination de la durée du préavis relève de l'appréciation souveraine des juges du fond et échappe donc à la Cour de cassation qui ne s'immisce pas dans l'appréciation des circonstances de faits. Les décisions judiciaires sont variées : le délai de préavis imposé est compris entre deux mois et deux ans, selon les affaires.
Dans l'étude précitée, Me Jean-Marie Meffre a résumé les critères pris en considération par les tribunaux pour déterminer la durée raisonnable du préavis : « l'ancienneté des relations, l'objet de l'activité, la notoriété des produits, la dépendance économique ou le caractère mono-client du partenaire, le volume d'affaires importantes et la progression constante du chiffre d'affaires, l'accord d'exclusivité, les investissements réalisés ».
La cour d'appel de Rouen, dans l'arrêt précité du 3 novembre 1998, a estimé qu'un préavis d'un an aurait dû être respecté pour la rupture de relations commerciales entre des partenaires liés pour une durée de cinq ans, renouvelable par périodes annuelles (sauf volonté contraire exprimée avec un préavis de trois mois, disposition devenue caduque).
Le tribunal de commerce de Paris a jugé, dans une décision du 2 avril 1999 (sté Esmar c/ Galeries Lafayette), que le préavis de quatre mois appliqué par les Galeries Lafayette pour mettre fin à la location d'un stand personnalisé mis à disposition d'une entreprise de mode dans son magasin du boulevard Haussmann était insuffisant (mais la décision n'a pas indiqué quel aurait dû être le délai minimal acceptable).
Les auditions de la mission d'information montrent qu'un délai de six mois paraît usuel dans le commerce des produits alimentaires, mais il est insuffisant si des investissements ont été effectués pour répondre à la demande des distributeurs ou s'il s'agit d'une PME qui ne dispose pas d'un carnet de clients suffisant pour lui permettre de se retourner. C'est pourquoi un délai d'un an est souvent souhaité car les contrats sont eux-mêmes annuels, ce rythme annuel influant directement sur les politiques commerciales et les investissements.
D'une manière générale, l'esprit de la loi est respecté par les tribunaux : ce préavis écrit doit avant tout permettre à l'entreprise, sans chute brutale de son activité, de trouver des contrats de vente ou d'achat de substitution ou lui permettre de réorienter ses unités de production ou de vente de manière à récupérer le courant d'affaires perdu sur un autre créneau économique.
() Estimations de votre rapporteur.
() Signalons toutefois que Prisunic s'était installé en Espagne dès 1964 et Docks de France, groupe succursaliste, également en Espagne en 1965.
() Mais les caissières, qui doivent retenir le numéro de code des six cents références qu'elles tapent sur leur clavier sans détourner leurs yeux du tapis de défilement des produits, pour éviter l'achat de caisses à lecture optique très coûteuses, sont payées 5 000 marks bruts par mois ! Les caissières passent la moitié de leur temps à la caisse et l'autre moitié à approvisionner et entretenir les rayons.
() Capital détenu à 22,89 % par Carrefour qui dispose de 33,16 % des droits de vote ; 66,60 % du capital et 51,31 % des droits de vote étant répartis entre les divers détenteurs de parts (marché boursier).
() Capital détenu à 53,6 % par le groupe Rallye et par 5,1 % par la famille Guichard.
() La revue LSA indique que le premier hypermarché français a avoir franchi le cap des deux milliards de francs de chiffre d'affaires sur un an a été l'hypermarché d'Auchan Vélizy le 31 octobre 1994 (il a réalisé 2,1 milliards de francs de chiffre d'affaires en 1998).
() Asda est le troisième distributeur alimentaire britannique : il possède 229 magasins, détient 12,6 % des parts de marché dans la distribution alimentaire. Il a été racheté 11 milliards de francs.
() L'utilisation des organismes génétiquement modifiés dans l'agriculture et dans l'alimentation. Rapport de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologies n° 1054 Assemblée Nationale - n° 545 Sénat, présenté par M. Jean-Yves Le Déaut (1998).
() Le commerce en libre-service s'est distingué par la mise à disposition des consommateurs des produits sur des linéaires appelés à l'origine, en raison de leur forme, des gondoles ; en début d'allée, là où le maximum de clients peuvent voir les produits exposés, se trouvent les têtes de gondoles.
() Voir l'analyse de ces dispositions dans le chapitre suivant relatif au référencement.
() Recherche du prix de vente le moins élevé, plafonnement du taux de marge ou respect d'un prix maximal par produit, soutien financier aux nouveaux adhérents, respect de ratios fonds propres/chiffre d'affaires (25 % en moyenne et 50 % après trois ans d'existence), plafonnement des frais financiers à 3,5 % du chiffre d'affaires, etc.
Article 31 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 Tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle doivent faire l'objet d'une facturation. Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la vente ou la prestation du service. L'acheteur doit la réclamer. La facture doit être rédigée en double exemplaire. Le vendeur et l'acheteur doivent en conserver chacun un exemplaire. La facture doit mentionner le nom des parties ainsi que leur adresse, la date de la vente ou de la prestation de service, la quantité, la dénomination précise, et le prix unitaire hors TVA des produits vendus et des services rendus (Loi n° 96-588 du 1er juillet 1996, art. 10) « ainsi que toute réduction de prix acquise à la date de la vente ou de la prestation de service et directement liée à cette opération de vente ou de prestation de service, à l'exclusion des escomptes non prévus sur la facture ». (Loi n° 92-1442 du 31 décembre 1992, art. 3) « La facture mentionne également la date à laquelle le règlement doit intervenir. Elle précise les conditions d'escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l'application des conditions générales de vente. » (Loi n° 96-588 du 1er juillet 1996, art. 10) « Le règlement est réputé réalisé à la date à laquelle les fonds sont mis, par le client, à la disposition du bénéficiaire ou de son subrogé. » (Loi n° 93-122 du 29 janvier 1993, art. 19).- « Toute infraction aux dispositions du présent article est punie d'une amende de 500.000 F. « L'amende peut être portée à 50 p. 100 de la somme facturée ou de celle qui aurait dû être facturée. « Les personnes morales peuvent être déclarées responsables conformément à l'article 121-2 du code pénal. Les peines encourues par les personnes morales sont : « 1° L'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 dudit code ; « 2° La peine d'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus, en application du 5° de l'article 131-39 du code pénal. » |
L'analyse des obligations s'imposant aux partenaires commerciaux en matière de facturation est indispensable pour comprendre la réforme de la revente à perte intervenue par la loi n° 96-588 du 1er juillet 1996 relative à la loyauté et l'équilibre des relations commerciales.
a) La situation antérieure à 1996
Monsieur Jean-Paul Charié a résumé dans son rapport n° 2595 du 6 mars 1996 l'historique de l'interdiction du refus de vente. En voici le texte :
« Une facture est un document écrit faisant état de l'existence, du contenu et des conditions d'une vente ou d'une prestation de services entre professionnels. Traditionnellement, elle avait un caractère purement comptable (elle permettait notamment l'enregistrement des opérations d'un commerce sur le livre-journal prévu par l'article 8 du code du commerce) et son établissement n'avait aucun caractère obligatoire. L'ancien article 109 du code de commerce la considérait comme un mode de preuve parmi d'autres des achats et ventes de nature commerciale (1).
« L'obligation d'établir une facture pour les achats de produits ou les prestations de services entre professionnels fut imposée par l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix (articles 46 à 49) (2). Elle apparaissait en effet comme le meilleur instrument du contrôle du prix mis en place par cette ordonnance.
« L'abolition du contrôle des prix par l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 n'a pas entraîné la suppression de cette obligation. En effet, l'abrogation de l'ordonnance du 30 juin 1945 sur les prix a nécessité le maintien d'un certain nombre de règles pour garantir l'effectivité et la loyauté de la concurrence dans le nouvel environnement économique ainsi libéralisé. Parmi ces règles figurent notamment l'interdiction de revendre à perte et celle d'imposer un prix ou une marge minimale, et auparavant l'obligation de réparer un refus de vendre anormal.
« Par souci d'efficacité, le dispositif de prohibition de la revente à perte a été légèrement modifié en 1986 afin notamment d'asseoir le calcul du seuil de revente à perte sur le prix d'achat porté sur la facture. L'établissement d'une facture devenait un élément pour permettre le contrôle de la revente à perte. »
La modification de l'article 31 de l'ordonnance est liée à la réforme du calcul du seuil de revente à perte (article 32 de l'ordonnance, modifié par l'article 11 de la loi n° 96-588 du 1er juillet 1996). Désormais, le prix effectif d'achat à partir duquel est déterminé le seuil en deçà duquel il est interdit de revendre un produit en l'état résultera du prix porté sur la facture.
La simplification des termes de l'article 31 a en outre pour objet de clarifier la rédaction du dispositif afin de mettre fin aux interprétations divergentes sur les rabais, remises ou ristournes devant être portées sur les factures et donc venant minorer le seuil de revente à perte. En effet, auparavant, seuls les rabais, remises ou ristournes « dont le principe était acquis et le montant chiffrable, à la date de la vente ou de la prestation de services » devaient figurer sur les factures.
L'état du droit était une source d'insécurité juridique et économique et avait généré des dérives dangereuses. On pourra se reporter aux pages 87 et suivantes du rapport de M. Jean-Paul Charié n° 2595 qui en a dressé la liste, analysé les effets et donné des exemples concrets très significatifs.
La finalité de la réforme de 1996 était de mettre un terme à ce qu'on appelait la « facturologie », c'est-à-dire à l'incertitude existant entre ce qui relevait de la coopération commerciale et devait faire l'objet d'une facturation séparée (empêchant d'abaisser le seuil de revente à perte) et ce qui relevait des services inhérents ou annexes à la vente ou l'achat et pouvait figurer sur la facture (et donc venir en déduction du prix de cession pour le calcul du seuil de revente à perte). Les acteurs économiques, les autorités de contrôle, les avocats et conseils, les tribunaux devaient chaque fois interpréter chaque remise, rabais ou ristourne pour savoir si son principe était acquis et son montant chiffrable (ces notions donnant lieu à des interprétations divergentes et des controverses doctrinales) et, en conséquence, si elle devait ou ne devait pas figurer sur la facture d'achat ou de vente.
L'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 impose d'établir une facture pour toute vente ou prestation de service entre professionnels, que ceux-ci soient producteurs, commerçants, artisans, prestataires de services, exportateurs ou importateurs. La facture doit être établie, en langue française si elle est émise sur le territoire français, par le vendeur, en double exemplaire dont l'un est remis à l'acheteur. Celui-ci est tenu de la réclamer. Son établissement s'effectue à la réalisation de la vente ou la prestation du service.
L'ordonnance précise les mentions que doit obligatoirement comporter une facture :
- le nom et l'adresse des parties,
- la date de la vente ou de la prestation de service,
- la quantité et la dénomination précise des produits vendus ou des services rendus,
- le prix unitaire hors TVA des produits vendus ou des services rendus,
- toute réduction de prix acquise à la date de la vente ou de la prestation de service et directement liée à cette opération de vente ou de prestation de service, à l'exclusion des escomptes non prévus sur la facture,
- la date de règlement,
- les conditions d'escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l'application des conditions générales de vente.
La loi n° 96-588 du 1er juillet 1996 a modifié le régime de la mention relative aux rabais, remises ou ristournes. L'article 31 imposait auparavant de mentionner les rabais, remises ou ristournes dont le principe est acquis et le montant chiffrable lors de la vente ou de la prestation de service, quelle que soit leur date de règlement. Cette modification du contenu des factures est entrée en vigueur le 1er janvier 1997.
Cette liste peut être rapprochée de celle figurant aux articles 289 du code général des impôts et 242 nonies de son annexe II. Ces dispositions fiscales imposent, en plus des mentions prévues par l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, la numérotation des factures et la mention pour chaque bien et service du taux de TVA légalement applicable, du total hors taxes et de la taxe correspondante par taux d'imposition ainsi que des numéros d'identification à la TVA du vendeur ou du prestataire et de l'acheteur ou du preneur.
En outre, il faut dénoncer l'inertie de l'administration fiscale qui n'a pas mis à jour les dispositions de l'article 242 nonies qui imposent toujours de faire apparaître « tous rabais, remises ou ristournes dont le principe est acquis et le montant chiffrable lors de l'opération », alors que cette réglementation des remises issue de l'ordonnance du 1er décembre 1986 a été abrogée par la loi n° 96-588 du 1er juillet 1996 dans le but de modifier les règles d'évaluation de la revente à perte.
Les dispositions du code général des impôts ne s'appliquent que lorsque le destinataire de la facture est une personne assujettie à la TVA ou une personne morale non assujettie, alors que l'article 31 de l'ordonnance s'applique à tous achats de produits ou de services. Ses dispositions ont donc un caractère beaucoup plus général.
En outre, le décret n° 97-497 du 16 mai 1997 relatif au numéro unique d'identification des entreprises impose aux personnes immatriculées au registre du commerce et des sociétés d'indiquer sur leurs factures leur numéro d'identification, la mention du registre suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est enregistrée et, le cas échéant, la qualité de locataire-gérant (3). Ces dispositions ne sont pas applicables aux bons de remis tenant lieu de factures dans les transactions très rapides du marché de gros.
a) La notion de réduction de prix
La réduction de prix couvre les rabais, remises et ristournes et les escomptes de caisse. Le droit fiscal français (article 267, II-1° du code général des impôts) et le droit européen (6ème directive du 17 mai 1977 d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires) se réfèrent déjà à cette notion qui a le mérite d'être de nature finaliste, la distinction entre les rabais, remises et ristournes étant floue.
La commission mixte paritaire qui a élaboré un texte commun aux deux assemblées lors de la discussion du projet de loi relatif à la loyauté et l'équilibre des relations commerciales a toutefois souhaité ne pas prendre en compte dans la détermination du seuil de revente à perte les escomptes qui n'étaient pas prévus sur les factures. Ceux-ci n'ont donc pas à figurer sur les factures.
On peut en effet distinguer deux types d'escompte : la réduction de prix convenue et accordée à la conclusion de la vente ou de la prestation de service pour un paiement plus rapide que celui prévu dans les conditions de vente et l'escompte obtenu par le client pour une anticipation de la date de règlement convenue dans le contrat de vente : cet escompte ne figure pas sur la facture car il n'est pas certain et dépend d'une décision unilatérale du client et ne correspond pas à un engagement contractuel. Cette seconde réduction de prix est calculée par application du barème des escomptes figurant dans les conditions de vente mais elle n'a pas un caractère acquis et ne saurait figurer sur la facture.
b) La notion de réduction de prix acquise
Au regard de la sémantique, l'expression « réduction de prix acquise » peut paraître insatisfaisante. Elle est pourtant entrée dans le langage courant et figure littéralement à l'article 11, paragraphe 3 de la 6ème directive du 17 mai 1977 (qui autorise les Etats membres à exclure de la base d'imposition « les rabais et ristournes de prix consentis à l'acheteur ou au preneur et acquis au moment où s'effectue l'opération »).
L'expression « réduction de prix acquise » doit être comprise comme une ellipse : elle vise les créances acquises par le client, c'est-à-dire exigibles, et constituées par les réductions de prix accordées par le fournisseur.
L'escompte a été écarté de l'obligation de mention sur les factures car les parlementaires, lors de la commission mixte paritaire, sont convenus que, par nature, il ne pouvait être considéré comme acquis à la date de la vente ou de la prestation de service.
c) La référence à la date de la vente ou de la prestation de service
Le caractère acquis de la réduction de prix doit s'apprécier à la date de réalisation de vente ou de la prestation de service.
La référence à la réalisation de la vente a été choisie par le législateur de 1996 afin d'appuyer le dispositif sur une notion déjà contenue dans le même article 31 de l'ordonnance : « le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la vente ou la prestation du service » (première phrase du deuxième alinéa).
L'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix prévoyait, en son article 46, deuxième alinéa (qui n'a subi aucune modification de 1945 jusqu'à son abrogation en 1986), que la « facture doit être réclamée par l'acheteur ; le vendeur est tenu de la délivrer dès que la vente ou la prestation de service est devenue définitive. » L'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 a opéré une simplification.
La notion de réalisation a été précisée par la note de service du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes n° 5322 du 3 février 1988. Elle a exposé que « par analogie avec la prestation de service qui ne se trouve réalisée qu'une fois exécutée, il peut être valablement affirmé que la vente est réalisée par la livraison ou la prise en charge de la marchandise. La date de réalisation s'entend donc comme étant celle de la livraison (franco), celle de la prise en charge par le distributeur (enlèvement) ou celle de la fin d'exécution de la prestation de service. En cas d'exécution fractionnée d'une prestation (location de véhicule par exemple), la facture doit être établie à chaque échéance normale de paiement. »
Il y a donc une identité entre la réalisation de la vente ou la prestation du service et la date de la facturation.
Dans les secteurs où à la date de livraison le prix de la marchandise n'est pas connu car il dépend d'une cotation ultérieure (cas des fruits et légumes, de la viande), la vente est considérée comme réalisée à la livraison dès lors que le mode de détermination du prix a été arrêté et que les parties n'interviennent plus ultérieurement dans sa fixation.
Il existe cependant des cas où un différé de facturation est toléré, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une parfaite concordance entre la date de délivrance de la facture et la réalisation de la vente. C'est notamment le cas du lait livré chaque jour mais facturé une fois par semaine. Cependant, un bon de livraison ou un document contenant toutes les mentions figurant sur la facture hormis l'élément indéterminé doit être remis à la livraison. Le délai de paiement courra à compter de la date de livraison ; il s'appuiera donc sur la date figurant sur ce document. Ce différé est toléré à condition qu'il soit léger.
Des factures récapitulatives peuvent également être émises. Elles sont admises à condition que les livraisons soient fréquentes et d'un faible montant (avant 1994, la DGCCRF imposait que leur valeur n'excède pas 3.000 F. et que leur périodicité soit de 10 jours maximum ; ces limites n'existent plus depuis une note du 28 mars 1994). L'administration fiscale exige que le délai de facturation n'excède pas 15 jours, sauf dérogation du directeur des services fiscaux qui peut le porter à 30 jours.
Mis à part ces cas spécifiques (auxquels on peut ajouter les factures relevés qui ne sont qu'un regroupement de factures déjà établies), la réalisation de la vente ou la prestation du service correspond donc à la date d'émission de la facture.
La loi n° 96-588 du 1er juillet 1996 ne s'est pas référée à la date de la facture car l'obligation de faire figurer la date d'établissement de la facture, prévue par l'article 48 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix (4) a été supprimée par l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986. A cette disposition a été substituée l'obligation de mentionner la date de la vente ou de la prestation de service sur la facture. Cette réforme permettait d'assurer un meilleur suivi des transactions couvertes par des factures récapitulatives. La date de la vente doit cependant coïncider avec la date d'établissement de la facture sauf cas des différés de facturation.
Le Parlement n'a pas souhaité, en 1996, remettre en cause cette avancée et a maintenu la cohérence de l'article 31 autour de la référence à la date de la vente. Il a en outre été souligné que ce dispositif mettait les partenaires économiques à l'abri d'une manipulation d'écriture sur les factures.
d) Les réductions de prix directement liées à l'opération de vente
La précision selon laquelle les réductions de prix portées sur la facture doivent être directement liées à l'opération de vente ou de prestation de service constitue un pilier fondamental de la réforme de l'article 31 de l'ordonnance. Les motifs qui l'ont inspirée ont longuement été commenté dans le rapport de première lecture de M. Jean-Paul Charié (n° 2595, p. 104, pp. 130 à 133 et p. 139) et expliqué en séance publique (JO.AN, 21 mars 1996, pp. 1946 et 1947).
Cette disposition vise à :
1° empêcher l'imputation du produit global d'une remise conditionnelle sur le montant de la facture ayant déclenché son acquisition (et correspondant à une fraction de la commande globale) :
Ainsi une ristourne conditionnelle de 5 % accordée pour l'année 1997 à la commande de la 100 000ème unité d'un produit au cours de cette année et imputable sur l'ensemble des produits commandés au cours de l'année ne pourra être imputée sur la facture de la 100 000ème unité et sur les factures d'achat suivantes de l'année 1997 qu'au prorata des produits facturés. A titre d'illustration, si le prix unitaire d'achat de ces produits est de 1 000 francs et que le 100 000ème produit est contenu dans une commande allant de la 80 001ème unité à la 100 000ème, la ristourne de 5 %, correspondant à une réduction de prix de 5 millions de francs à cette date (sur 100 000 unités), aurait pu réduire de 25 % la facture de 20 millions de francs des 20 000 unités et abaisser ainsi de 25 % le seuil de revente à perte, soit cinq fois plus que la remise consentie.
Désormais, la réduction de prix imputable sur cette facture ne pourra qu'être d'un million de francs, soit 5 % de la commande, les quatre autres millions de francs dus devant figurer sur une facture séparée ;
2° interdire d'imputer sur les factures les remises accordées par un fournisseur pour financer un service fourni par le client.
Ces précisions ont pour objectif d'empêcher d'abaisser artificiellement le prix effectif d'achat d'un produit et ainsi revendre en fait à perte un produit.
e) Les infractions sont sanctionnées pénalement
Le non-respect des dispositions de l'article 31 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 est sanctionné pénalement. Le contrevenant est passible, aussi bien en cas d'absence d'établissement ou de remise de la facture qu'en cas d'absence ou d'irrégularité d'une mention obligatoire, d'une amende maximale de 500.000 francs, qui peut être portée à 50 % de la somme facturée ou de celle qui aurait dû être facturée.
Ce sont les plus lourdes sanctions au sein du titre IV de l'ordonnance du 1er décembre 1986, ce qui souligne l'importance du respect d'une règle de transparence des relations commerciales et le caractère central de l'acte de facturation.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement et encourir une amende de 2.500.000 francs et l'exclusion des marchés publics pour une durée maximale de cinq ans. Le juge peut ordonner la publication de sa décision, intégralement ou par extraits, dans les journaux qu'il désigne, aux frais du condamné.
Les infractions fiscales sont réprimées par des dispositions spéciales : articles 1741 et 1786 du code général des impôts pour absence de facture, article 1740 ter du code général des impôts pour facture irrégulière.
Le vendeur et l'acheteur sont considérés comme coresponsables en cas d'infraction aux dispositions de l'article 31. Les obligations touchent de manière égale les deux parties puisque le premier est tenu de délivrer la facture et l'autre de la réclamer si elle ne lui a pas été remise.
Article 32 de
l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 « I. - Le fait, pour tout commerçant, de revendre ou d'annoncer la revente d'un produit en l'état à un prix inférieur à son prix d'achat effectif est puni de 500 000 F d'amende. Cette amende peut être portée à la moitié des dépenses de publicité dans le cas où une annonce publicitaire, quel qu'en soit le support, fait état d'un prix inférieur au prix d'achat effectif. « Le prix d'achat effectif est le prix unitaire figurant sur la facture majoré des taxes sur le chiffre d'affaires, des taxes spécifiques afférentes à cette revente et du prix du transport. « Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue au premier alinéa du présent article. « Les peines encourues par les personnes morales sont : « 1° L'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; « 2° La peine mentionnée au 9° de l'article 131-39 du même code. « La cessation de l'annonce publicitaire peut être ordonnée dans les conditions prévues à l'article L. 121-3 du code de la consommation. « II. - Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables : « 1° - Aux ventes volontaires ou forcées motivées par la cessation ou le changement d'une activité commerciale, « - aux produits dont la vente présente un caractère saisonnier marqué, pendant la période terminale de la saison des ventes et dans l'intervalle compris entre deux saisons de vente, « - aux produits qui ne répondent plus à la demande générale en raison de l'évolution de la mode ou de l'apparition de perfectionnements techniques, « - aux produits aux caractéristiques identiques, dont le réapprovisionnement s'est effectué en baisse, le prix effectif d'achat étant alors remplacé par le prix résultant de la nouvelle facture d'achat, « - aux produits alimentaires commercialisés dans un magasin d'une surface de vente de moins de 300 mètres carrés et aux produits non alimentaires commercialisés dans un magasin d'une surface de moins de 1 000 mètres carrés dont le prix de revente est aligné sur le prix légalement pratiqué pour les mêmes produits par un autre commerçant dans la même zone d'activité ; « 2° A condition que l'offre de prix réduit ne fasse pas l'objet d'une quelconque publicité ou annonce à l'extérieur du point de vente, « - aux produits périssables à partir du moment où ils sont menacés d'altération rapide. « III. - Les exceptions prévues au II ne font pas obstacle à l'application du 2 de l'article 189 et du 1 de l'article 197 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises. » |
La législation sur la revente à perte a été entièrement réformée par la loi n° 96-588 du 1er juillet 1996 relative à la loyauté et l'équilibre des relations commerciales, dite loi Galland. La mission estime que cette loi a atteint les objectifs pour lesquels elle a été votée, mais des dérives nouvelles sont apparues (inflation des rémunérations de coopération commerciale).
1. La réforme de 1996 était nécessaire
a) L'état du droit avant 1996 conduisait à une dérive suicidaire de la concurrence par les prix bas
La prohibition de la revente à perte a été introduite dans le droit français par l'article premier de la loi de finances rectificative pour 1963 n° 63-628 du 2 juillet 1963 portant maintien de la stabilité économique et financière. L'objectif était de protéger les petits commerces de détail traditionnels face à la puissance croissante des supermarchés. Dès leur apparition, les grandes surfaces avaient, en effet, adopté comme méthode de vente d'attirer les clients en proposant des prix cassés, dits « prix d'appel », sur certains produits de grande consommation.
Cette stratégie commerciale est très profitable. En effet, contrairement aux petits commerces, les grandes surfaces sont en mesure, en raison du très grand nombre d'articles qu'elles proposent à la vente, de compenser les pertes sur les ventes de produits à prix cassés par un relèvement sensible de leurs marges sur de nombreux autres produits. Cela n'est pas perçu par les consommateurs avant tout marqués par l'effet d'annonce publicitaire sur les produits revendus à perte.
La base de calcul du seuil de revente à perte est la facture d'achat délivrée par le fournisseur, et dont aussi bien le vendeur que l'acheteur doivent détenir un exemplaire. Celle-ci mentionnait, en application de l'article 31 de l'ordonnance, le prix unitaire hors taxes des produits vendus et les rabais, remises ou ristournes dont le principe est acquis et le montant chiffrable lors de la vente, quelle que soit la date de règlement de ces avantages. La somme était présumée, aux termes de la loi, être le prix d'achat effectif. Cette présomption avait été introduite dans la loi en 1986 afin de soutenir le recours, déjà difficile en termes de conséquences économiques, de la victime de la revente à perte. Cette présomption n'était pas irréfragable, un prix d'achat effectif différent pouvait être retenu si le revendeur démontrait que le prix figurant sur la facture n'était pas représentatif de la réalité de la transaction commerciale.
Le prix d'achat effectif prenait donc en compte les réductions de prix résultant de rabais ou remises ayant un effet immédiat à la conclusion de la vente. Il s'agissait des remises quantitatives, des remises promotionnelles, des remises qualitatives liées au transport, au stockage, au paiement comptant, etc.
La Cour de cassation, par un arrêt du 18 février 1991, avait autorisé les revendeurs à déduire du prix d'achat effectif les ristournes conditionnelles dès lors qu'elles étaient chiffrables au jour de la revente aux consommateurs. Ces ristournes déductibles sont des remises de prix dont l'application est différée et dont bénéficie l'acheteur si des conditions quantitatives ou qualitatives sont remplies à une certaine date future. De par la nature de ces ristournes, les cocontractants étaient dans l'impossibilité de faire figurer leur montant sur la facture d'achat à la date de la conclusion de la vente. Ceci ne faisait donc pas obstacle à leur prise en compte dans le calcul du seuil de revente à perte. Cependant, si à la date de la facturation, leur montant n'était pas connu avec une exacte précision, il devait l'être au moment de l'achat des produits par le consommateur. La ristourne type était celle consistant en une remise accordée en fonction du volume des ventes réalisées ou du chiffre d'affaires atteint. Quand elle était acquise son montant venait considérablement diminuer le prix facturé et légalisait un prix très bas.
La Chambre criminelle de la Cour de cassation avait également autorisé les revendeurs à déduire les rémunérations qu'ils percevaient en application d'un accord de coopération commerciale dès lors que la prestation de ces services était destinée à la vente du produit en cause, c'est-à-dire que ces services étaient imputés formellement à ce produit (par exemple, arrêts du 18 février 1991 et, a contrario, du 6 février 1990 et du 18 mars 1991). Rappelons que les accords de coopération commerciale sont régis par le sixième alinéa de l'article 33 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986. Notamment, ils doivent faire l'objet d'un contrat écrit en double exemplaire et doivent porter sur des services dits spécifiques rendus au fournisseur, c'est-à-dire sur des prestations qui ne se rattachent pas directement à l'acte d'achat et de vente du revendeur et qui dépassent donc le champ de sa fonction commerciale traditionnelle.
En conséquence, une ristourne de coopération commerciale portant sur une participation aux actions publicitaires du revendeur n'était pas déductible. Pour qu'elle le fût, il fallait qu'elle fût affectée explicitement à la promotion du produit. En ce cas, le contrat de coopération commerciale pouvait être considéré comme une remise hors facture déguisée, sa conclusion manifestant l'intention du fournisseur d'autoriser l'abaissement du seuil de revente à perte.
En particulier, les remises de tête de gondole affectées à des produits précis étaient déductibles car elles ne correspondaient pas, en fait, à une prestation de service effective mais sont des remises déguisées. Or, une tête de gondole peut être facturée jusqu'à un million de francs.
A ce prix d'achat effectif facturé, devaient être ajoutées les taxes sur le chiffre d'affaires et les taxes afférentes à la revente. Cette majoration concernait en particulier les cotisations de sécurité sociale perçues sur le tabac et les boissons alcooliques et les droits attachés à la vente des alcools visés à l'article 403 du code général des impôts (droits de consommation).
Ce prix d'achat devait enfin également être majoré, le cas échéant, du prix du transport du produit pour obtenir le prix d'achat effectif, c'est-à-dire le seuil de revente à perte. Si le revendeur s'était doté d'une flotte de camions, il n'avait pas à relever le prix d'achat du montant correspondant à la valeur du service car il s'agissait pour lui d'un coût et non d'un prix, qui est une somme à acquitter.
L'incorporation du coût du transport, et non de son prix, aurait permis de relever le seuil de revente à perte mais l'évaluation du seuil par le juge pénal n'aurait pas été aisée car celui-ci aurait été conduit à analyser les comptes d'exploitation du revendeur pour déterminer ce coût. Or, les règles de droit pénal doivent être d'application automatique pour être pleinement efficaces.
En résumé, le seuil de revente à perte était, avant 1997, calculé ainsi :
| Seuil de revente à perte = prix hors
taxes facturé (avant 1997) - remises ou ristournes de principe acquis et de montant chiffrable lors de la vente ou de la prestation - ristournes conditionnelles chiffrables au jour de la revente aux consommateurs - prestations de coopération commerciale destinée formellement à la revente du produit (constituant ainsi des remises déguisées) + TVA et taxes afférentes à la vente + prix du transport |
A ces considérations s'ajoutait également le droit d'alignement d'une enseigne sur un prix à perte pratiqué par un concurrent, ce qui générait des spirales entraînant la chute des prix en dessous de leurs coûts de revient.
b) La revente à perte a donc été redéfinie en 1996
La loi n° 96-588 du 1er juillet 1996 relative à la loyauté et l'équilibre des relations commerciales a modifié en profondeur le régime de l'interdiction de la revente à perte puisqu'elle a :
- redéfini le mode de détermination du seuil de revente à perte ;
- précisé que l'imputation des réductions de prix (rabais, remises, ristournes et escomptes facturés) sur les prix facturés doit s'effectuer au prorata de chaque référence pour déterminer le prix d'achat effectif de chacune d'elles ;
- créé une nouvelle infraction : l'annonce d'une revente à perte ;
- quintuplé le montant de l'amende en cas d'infraction et institué la responsabilité pénale des personnes morales ;
- redéfini les exceptions à l'interdiction de revendre à perte relatives aux produits périssables menacés d'altération rapide et au droit d'alignement.
L'interdiction de revendre à perte reste définie comme étant la revente d'un produit en l'état à un prix inférieur à son prix d'achat effectif. Cependant le prix d'achat effectif n'est plus présumé être le prix porté sur la facture d'achat, majoré des taxes et du prix du transport ; il est désormais considéré comme étant le prix unitaire figurant sur la facture, majoré des taxes et du prix du transport. Le lien entre le seuil de revente à perte et le prix figurant sur la facture est donc direct et irréfragable : il y a identité entre les deux notions sous réserve des majorations précitées.
La précision selon laquelle « le prix d'achat effectif est le prix unitaire figurant sur la facture (...) » vise à empêcher que le produit d'une réduction de prix accordée à un revendeur ne soit concentrée par lui sur une seule des références achetées afin d'obtenir un seuil de revente à perte très bas. Ainsi une remise globale de 5 % devra être imputée à hauteur de 5 % sur chaque ligne d'articles facturés et donc réduire de manière égale le prix effectif d'achat de chaque produit qui en bénéficie (voir le rapport n° 2595 précité, p. 137 pour illustration, et JO.débats AN, 21 mars 1996, pp. 1963 et 1964).
Lors de son déplacement en Allemagne, la mission d'information a constaté que l'Office fédéral des cartels avait adopté la même analyse pour l'intégration des remises dans le calcul du seuil de revente à perte. M. Dr Ruppelt, directeur de la section 9 de l'office, en charge des questions relatives à la distribution et aux rapports entre fournisseurs et revendeurs, a indiqué qu'à l'occasion d'une affaire survenue en juillet 1999 (voir ci-après) l'office avait décidé d'intégrer dans ce calcul les « remises particulières » en les répartissant au prorata des produits facturés selon leur poids dans le chiffre d'affaires de la vente car elles « font partie de la négociation globale du prix » (votre rapporteur attire l'attention sur cette expression qui souligne qu'en Allemagne la négociation porte traditionnellement sur la fixation d'un prix net-net et non sur la détermination de remises successives et de coopération commerciale, mais certains groupes comme Rewe commencent à exiger des remises de coopération commerciale qui restent cependant encore globalement marginales ; voir la partie II du rapport).
En cas d'annonce publicitaire d'une revente à perte, seule était passible de poursuite la publicité trompeuse (article L. 121-1 du code de la consommation). Or l'annonce d'une revente à perte pouvait être encore plus dommageable que la revente à perte en elle-même. En effet, cette pratique déloyale reposait sur le mécanisme des prix d'appel : les profits ne sont pas générés par les ventes des produits dont le prix est cassé mais sur les autres achats qu'effectuent les consommateurs attirés dans les magasins par ces prix : c'est le phénomène de l'îlot de pertes dans l'océan de profits. Cette concurrence est particulièrement restrictive dans la mesure où les petits commerces qui ne proposent à la vente qu'au plus 2 000 références ne peuvent pas lutter contre une grande surface qui dispose de 60 000 références, voire 100 000 ou 130 000.
Le montant maximal de l'amende est passé de 100 000 à 500 000 francs. Les contrevenants en sont passibles pour chaque infraction constatée, c'est-à-dire pour chaque annonce publicitaire et pour chaque produit revendu à perte dans chaque lieu de vente.
Les personnes morales responsables encourent une peine d'amende de 2,5 millions de francs. Leur condamnation peut être affichée ou diffusée par voie de presse écrite ou tout moyen de communication audiovisuelle.
A l'instar des nouvelles dispositions de l'article 28 de l'ordonnance introduites par la même loi du 1er juillet 1996, une décision de justice peut ordonner la cessation d'une annonce publicitaire d'une revente à perte conformément à l'article L. 121-3 du code de la consommation (5).
La loi n° 96-588 du 1er juillet 1996 a enfin abrogé l'article premier de la loi de finances rectificative pour 1963, qui définissait l'interdiction de revendre à perte et ses dérogations, afin d'intégrer l'ensemble de ses dispositions dans l'article 32 de l'ordonnance.
Parallèlement à cette codification au sein de l'ordonnance, certaines exceptions à l'interdiction de revendre à perte sont redéfinies :
1° la revente à perte des produits périssables à partir du moment où ils sont menacés d'altération rapide reste autorisée à condition que l'offre de prix réduit ne fasse pas l'objet d'une publicité à l'extérieur du point de vente.
La circulaire Scrivener du 10 janvier 1978 a établi une liste des produits pouvant bénéficier de cette dérogation :
« Viandes et abats comestibles frais ou réfrigérés.
« Jambon et épaule cuits, produits de charcuterie fraîche.
« Volailles et leurs abats comestibles, lapins domestiques et gibiers, réfrigérés ou frais.
« Poissons, coquillages, crustacés et mollusques, frais ou réfrigérés.
« Laits crus et pasteurisés. Laits stérilisés.
« Produits laitiers frais tels que :
- Yaourts, desserts (laits gélifiés) ;
- Crème fraîche ;
- Fromages frais ;
- Fromage à pâte molle ou à pâte pressée, cuite ou non, fromage à pâte persillée ;
- Beurre frais.
« Glaces, sorbets, crèmes glacées.
« _ufs frais ou réfrigérés.
« Légumes et plantes potagères à l'état frais ou réfrigérés.
« Fruits frais ou réfrigérés. Pain frais, produits frais de boulangerie, viennoiserie et pâtisserie fraîche.
« Levure de panification.
« Plantes vivantes et produits de la floriculture.
« Fleurs et boutons de fleurs coupés frais. »
N'entrent pas dans ces exceptions, les conserves et semi-conserves et les produits congelés ou surgelés ;
2° l'exception dite d'alignement est limitée aux commerces de moins de 300 m2 lorsque la revente à perte s'applique à des produits alimentaires, et aux commerces de moins de 1 000 m2 lorsque la revente à perte s'applique à des produits non alimentaires ;
3° l'exception relative au réapprovisionnement est précisée afin qu'elle ne s'applique qu'aux produits « aux caractéristiques identiques » et qu'elle ne puisse s'appuyer que sur le prix résultant de la seule nouvelle facture d'achat et non plus sur une référence à une valeur de réapprovisonnement.
L'ensemble de cette réforme de 1996 est entrée en vigueur au 1er janvier 1997.
2. L'analyse du droit en vigueur
a) La définition du seuil de revente à perte
L'objectif de la redéfinition du mode de détermination du seuil de revente à perte a été d'établir un mécanisme de calcul du prix d'achat effectif dont le résultat, une fois la vente réalisée, soit incontestable, invariable et non précaire. La solution retenue a été de redéfinir les règles de facturation des réductions de prix, (rabais, remises, ristournes et escomptes) et de lier de manière fixe le prix d'achat effectif au prix facturé.
Ce nouveau mécanisme restaure en outre la valeur de preuve des prix inscrits sur une facture. Trop souvent les seuils de revente à perte s'étaient retrouvés abaissés par l'incorporation de remises ou de frais de coopération commerciale déguisée extérieurs à l'acte d'achat et donc à la facture (voir les exemples et explications contenus dans le rapport de M. Jean-Paul Charié n° 2595, Xème législature, pp. 116 et 117 et pp. 122 et 123).
Le dispositif de l'article 32 de l'ordonnance est lié à celui de l'article 31. Ainsi la précision selon laquelle, pour calculer le prix d'achat effectif d'un produit, il faut imputer les réductions de prix sur chacun de ces produits, au prorata de leur montant résulte de l'indication que le prix d'achat effectif est le prix unitaire figurant sur la facture (article 32) et que les réductions de prix portées sur la facture doivent être directement liées à l'opération de vente (article 31).
Par ailleurs, la répression des annonces de revente à perte non conformes aux dispositions de l'article 32 participe de la même volonté exprimée par le nouveau dispositif de l'article 28 de l'ordonnance (article 9 de la loi n° 96-588) de lutter contre l'exploitation commerciale d'une pratique commerciale déloyale. Ce sont en effet souvent les campagnes de promotions qui sont les pratiques les plus nuisibles aux acteurs économiques.
b) Les exceptions à l'interdiction de revendre à perte
Depuis la mise en place de l'interdiction de revendre à perte en 1963, la loi prévoit six cas où l'interdiction ne s'applique pas. La loi n° 96-588 du 1er juillet 1996 a maintenu le principe de chacune de ces dérogations en apportant toutefois quelques modifications.
Ces six exceptions à l'interdiction de revendre à perte visent à prendre en compte les cas où la revente à perte n'a pas pour objectif de détourner la clientèle des commerces concurrents ou d'attirer une clientèle pour réaliser un profit sur elle, mais a pour objet d'éviter la perte pure et simple d'une marchandise qui sans prix très attractif ne serait pas vendue et devrait être jetée ou éliminée. Il est donc inopportun de limiter la liberté du commerce dès lors que la revente à perte est compatible avec les règles de loyauté et d'effectivité de la concurrence.
· Concernant l'interdiction d'effectuer une publicité extérieure au point de vente pour revendre à perte un produit périssable menacé d'altération rapide :
Cette dérogation a donné lieu à de nombreux abus maintes fois dénoncés par le monde agricole, en particulier en début de saison de vente d'un fruit ou légume. Il est en effet facile d'annoncer une grande promotion sur un fruit du fait qu'une chaîne de magasins dispose d'un stock menacé d'altération, mais cette campagne publicitaire poursuivra ses effets au-delà de la période d'écoulement du stock et les surfaces de vente concurrentes de la zone de chalandise seront en droit d'aligner leur prix de vente sur ce prix de revente à perte si elles vendent le même produit, ce qui est fréquent pour les produits alimentaires saisonniers.
La campagne publicitaire finit ainsi par faire effondrer les prix d'un secteur agricole entier et mettre en péril des exploitations dont l'équilibre financier dépend du chiffre d'affaires réalisé sur une courte période de l'année.
C'est pourquoi la loi n° 96-588 du 1er juillet 1996 a maintenu le principe de la dérogation concernant les produits périssables menacés d'altération rapide mais a limité son bénéfice aux cas où l'offre de prix réduit ne fait pas l'objet d'une publicité ou annonce à l'extérieur du point de vente (voir JO.débats AN, 21 mars 1996, pp. 1966 et 1967).
· Concernant la limitation du droit d'alignement aux petites surfaces de vente :
Cette dérogation vise à lutter contre la concurrence sauvage d'un commerçant vendant à perte un produit dans le but de perturber le marché local et en tirer un gain financier ou amoindrir la concurrence avant que la justice ait pu intervenir. En ce cas, les commerçants implantés dans la même zone d'activité peuvent aligner leur prix de revente des mêmes produits sur ce prix à perte.
L'appréciation de la licéité des pratiques de prix couvertes par cette exception est très délicate à réaliser lorsque l'alignement sur un prix de vente à perte est pratiqué par la plupart des surfaces de vente d'une même zone. En effet, il est difficile de déterminer quel est le prix à l'origine de l'alignement et ainsi apprécier si ce prix est « légalement pratiqué » comme le dispose la loi. En effet, l'alignement n'est possible que sur un prix légalement pratiqué.
Afin de lutter contre les pratiques collectives de vente à perte, la Cour de cassation a jugé (CCass., ch. criminelle., 11 mars 1991) qu'il appartenait « au revendeur d'apporter la preuve du prix sur lequel il prétendait s'aligner, sauf à la partie poursuivante à établir le caractère illégal de ce prix ». Ainsi, l'administration ou le ministère public doit démontrer l'illégalité du prix servant de référence à l'alignement et le prévenu la réalité matérielle de cet alignement (commercialisation antérieure du produit à un prix supérieur, concomitance dans le temps du prix de référence et du prix d'alignement,...).
La logique économique et juridique voudrait que l'on supprimât complètement l'exception du droit d'alignement. Le Parlement a décidé en 1996 de la maintenir pour les petits commerces car leur politique de vente ne repose pas sur des offres de prix cassés, parce qu'ils n'ont pas les moyens - financiers et en nombre d'articles vendus en magasin - de mener une guerre des prix et parce qu'ils ne bénéficient pas auprès de leurs fournisseurs des remises aussi importantes que leurs concurrents de la grande distribution.
En raison de l'importance des surfaces de vente nécessaires à l'exposition de certains produits non alimentaires, la loi n° 96-588 du 1er juillet 1996 a opéré une différenciation selon le produit revendu à perte :
- pour les produits alimentaires, le droit d'alignement est autorisé pour les surfaces de vente de moins de 300 m2. Ce seuil a été choisi pour coïncider avec celui applicable pour les autorisations de création ou d'extension prévues par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 réformant la loi Royer du 27 décembre 1973 ;
- pour les produits non alimentaires, le droit d'alignement est réservé aux surfaces de vente de moins de 1000 m2.
3. L'interdiction de revente à perte est respectée
La loi n° 96-588 du 1er juillet 1996 a permis de lever l'insécurité juridique pesant auparavant sur les niveaux légaux de prix de revente. Elle a mis fin à la « facturologie » et arrêté la concurrence, destructrice pour les fournisseurs, conduisant les grandes surfaces à annoncer des prix de revente toujours plus cassés au point d'être économiquement aberrants.
Cependant, les distributeurs, ne pouvant plus peser sur le prix de vente résultant du barème de prix et des conditions de vente des fournisseurs (la « marge avant », qui est le prix inscrit en bas de facture de vente ou d'achat des produits), se sont rabattus sur les rémunérations hors facture de vente ou d'achat, c'est-à-dire la marge arrière, pour obtenir les avantages financiers accordés auparavant essentiellement au travers de la marge avant. Cette marge arrière peut consister en une rémunération de services de coopération commerciale stricto sensu ou en des primes ou rémunérations diverses non liées à l'acte d'achat-vente des produits (souvent qualifiées de fausse coopération commerciale). La compétition horizontale entre distributeurs et verticale entre fournisseurs et distributeurs se place aujourd'hui sur le terrain de cette marge arrière (voir le chapitre du titre II du rapport consacré à la coopération commerciale).
Seul M. Michel-Edouard Leclerc demande instamment la suppression de l'interdiction de la revente à perte. Les autres groupes de distribution n'y sont pas favorables mais s'en accommodent. Le mécanisme de l'article 32 a conduit à une plus grande uniformisation des produits des multinationales et réduit les écarts de prix entre les produits d'un même rayon. Cependant une différenciation existe toujours grâce aux promotions et aux marques de distributeurs. La loi a en fait réduit l'intérêt des premiers prix dans certains rayons. En outre, comme l'a relevé l'Union professionnelle artisanale, l'écart des prix entre les grandes surfaces et les petits commerces indépendants et artisans a été sensiblement réduit ; un meilleur équilibre s'établit entre les détaillants de quartier et de centre-ville et les grandes surfaces de périphérie (l'écart sur une bouteille de Ricard n'est ainsi plus que de 10 à 15 F normalement, alors qu'avant 1997 il pouvait atteindre 40 F). De même, M. Jacques Périllat, président de l'Union des grands commerces de centre-ville, nous a indiqué que les prix des grands magasins et magasins populaires de centre-ville avaient été avant 1997 supérieurs de 12 % à ceux des supermarchés et hypermarchés de périphérie, alors que l'écart est aujourd'hui de 5 à 6 % en moyenne. Il semblerait que cet écart corresponde à un prix raisonnable de service de proximité pour une grande surface.
Pour maintenir des différences de prix, les distributeurs ne réalisent aucune marge commerciale sur les produits anciennement d'appel. Les industriels estiment que sur les 10 000 références alimentaires d'un hypermarché, 300 sont revendues avec une marge nulle. M. Christian Couvreux, président du directoire de Casino, estime lui que sur 10 000 références alimentaires 1500 à 2000 sont, par alternance, revendues avec une marge (avant) nulle ; ces références peuvent assurer jusqu'à 50 % du chiffre d'affaires de l'hypermarché dans l'alimentaire.
Les véritables prix cassés sont, en fait, aujourd'hui proposés avec l'aide de producteurs ou importateurs qui vendent aux grandes surfaces à des prix inférieurs aux coûts (français) de production mais sans revente à perte (on trouvera ci-après, au paragraphe a, l'analyse de plusieurs exemples de ces promotions). Comme nous l'a rappelé un président d'un des plus grands groupes français de distribution, aujourd'hui toutes les enseignes d'hypermarché vendent au seuil de revente à perte les grandes marques de lessive et si Procter & Gamble a proposé de baisser ses tarifs de base de 9 % avec une réduction parallèle de 9 % des marges arrières qu'il reverse, c'est uniquement pour tenter d'obtenir un avantage compétitif sur ses concurrents en abaissant son seuil de revente à perte. Cette multinationale peut se permettre d'adopter une telle stratégie commerciale car elle dispose d'une véritable force de frappe par ses campagnes publicitaires réalisées à l'échelon mondial.
L'importation parallèle permet, également, en toute légalité, de revendre en dessous du seuil de revente à perte lorsque le produit recherché est vendu moins cher à l'étranger. Leclerc a pu réaliser une opération promotionnelle avec des bouteilles d'Orangina achetées chez un grossiste belge lui-même client de l'embouteilleur belge de Pernod-Ricard, et transportées en France à moindre coût en raison de la proximité du territoire belge (ce type de promotion ne peut être réalisé qu'une seule fois, mais peut perturber le marché, sous réserve que le droit d'alignement n'est aujourd'hui plus autorisé pour les grandes surfaces de plus de 300 m2). En fait, les Centres Leclerc anticipent la réalisation du marché monétaire unique ; les différences de prix apparaîtront clairement entre les pays de l'Union au 1er janvier 2002 et les fournisseurs devront harmoniser leurs politiques tarifaires.
Pour les distributeurs, la loi n° 96-588 du 1er juillet 1996 a donné un grand avantage compétitif aux grands groupes de la production. Ainsi pour l'année 2000, les industries agro-alimentaires ont communiqué des barèmes de prix dont la hausse des prix est comprise entre 6 et 12 %, mais les PME doivent savoir que cette hausse vise à permettre d'accroître les remises de coopération commerciale et assurer ainsi une éviction plus rapide des concurrents. Comme nous l'a fait observer M. Christian Couvreux, président du directoire de Casino, jamais une PME ne proposera une hausse des tarifs de 12 à 15 % car cela entraînerait la cessation des commandes. Les têtes de gondole deviennent inaccessibles aux PME ; si rien n'est fait leur seule possibilité d'accès aux linéaires sera la fourniture de produits sous marque de distributeur.
En fait, comme nous l'a indiqué M. Paul-Louis Halley, président de Promodès, les enseignes de la grande distribution raisonnent en termes de marges globales. Si les barèmes de prix des fournisseurs augmentent, sans justification, de 12 à 15 %, il faut s'attendre à ce que les marges arrières augmentent d'autant. Dès lors le problème consiste en l'habillage de cette hausse ; c'est pourquoi il existe de la vraie coopération commerciale et de la coopération commerciale fictive. De ce point de vue, il est significatif, comme l'a indiqué M. Daniel Bernard, président de Carrefour, lors de l'audition du 30 novembre 1999, que bien que Carrefour obtienne 25 % de marges arrières en France sur les lames de rasoir, leur prix net de toutes remises est inférieur de 25 % à celui des mêmes lames vendues au Mexique alors que dans ce pays aucune remise de coopération commerciale ou marge arrière n'est versée.
L'association nationale des industries agro-alimentaires juge, en revanche, que les exigences de coopération commerciale de la grande distribution vont très au-delà de l'augmentation de tarif décidée par les fournisseurs. Les remises sont sans commune mesure avec la réalité des prestations ; elles visent à donner une marge nette aux distributeurs pour financer leur développement. Pour les industriels, la loi n° 96-588 du 1er juillet 1996 a donc permis à la grande distribution de redresser ses comptes : auparavant son taux de rentabilité, mesuré par le rapport entre les bénéfices bruts et le chiffre d'affaires, était de 0,5 %, aujourd'hui il est compris entre 1,5 et 2 % pour les principales sociétés. Rappelons que leur rentabilité mesurée par le rapport entre les bénéfices nets et les capitaux investis est la plus élevée de France, ce qui explique la croissance irrésistible des cours de bourse des sociétés cotées de la grande distribution.
a) Les enquêtes montrent que la loi est respectée mais les distributeurs parviennent à offrir des prix cassés
La mission a constaté que la réforme de 1996 est relativement bien appliquée par les distributeurs et que l'offre de produits revendus à perte ne constitue plus une pratique de la grande distribution française. M. Jérôme Gallot, directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, a indiqué à la mission d'information, lors de son audition, que seuls trois ou quatre cas de revente à perte étaient constatés chaque année par ses services. La précision du dispositif juridique, le caractère pénal de l'infraction et le report de la négociation sur la coopération commerciale expliquent ce résultat.
Des contrôles systématiques ont notamment été effectués par les services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à l'occasion des promotions exceptionnelles lancées au mois d'avril par Carrefour sur des articles de textile et par les différentes enseignes pour le passage à l'an 2000 : tous les prix annoncés respectaient la législation. En fait les enseignes importent les produits de pays à très faible coût de fabrication, le producteur accordant des prix de cession très bas en contrepartie de commandes plus substantielles par ailleurs sur d'autres produits ; en outre les quantités mises en vente sont très faibles (quelques milliers d'unités pour tout le marché français). On peut toutefois s'interroger sur la réalité économique de l'absence de revente à perte car ces promotions ne sont absolument pas rentables en elles-mêmes du fait qu'elles sont accompagnées de promotions publicitaires massives et coûteuses : ainsi, un costume (importé de Roumanie) vendu 550 F (acquis 455,26 F chez le producteur) a donné lieu à un engagement de frais publicitaires d'un montant de 2,3 millions de francs sur le jour de lancement de la promotion (5 000 unités étaient offertes) alors que la marge commerciale n'était que de 400 000 F.
Dans le secteur des produits alimentaires, Carrefour a vendu à l'occasion de son « mois historique », 40 000 cassettes d'agneau découpé européen (d'origine française, britannique et irlandaise) à 24 F/kg, ce qui n'a pu que se traduire par une perte de 4 F par kilogramme pour les transformateurs français car le producteur a pu vendre au prix du marché. Metro Cash-and-carry a, lui, revendu au mois de novembre 1999 le kilo de lotte à 59 F alors que le mareyeur qui le fournissait la mettait en vente à 69 F/kg : ce dernier a vraisemblablement récupéré les dix francs perdus en accroissant ses marges sur la vente d'autres poissons à Metro. Une autre enseigne de distribution a vendu, du 24 novembre au 4 décembre 1999, du grenadier importé mais mis en filet en France à 45 F/kg alors qu'à la criée son prix était au même moment compris entre 60 et 70 F/kg. Atac a proposé du 17 au 28 novembre 1999 le lot de 4 kg de coquilles Saint-Jacques d'origine française à 99,90 F, soit 24,97 F/kg, alors que les mêmes étaient vendues entre 25 et 29 F/kg au marché d'Erquy et à 38 F/kg à Rungis. Votre rapporteur pourrait multiplier les exemples de produits revendus en l'état à prix cassés déstabilisant les filières mais respectant les termes de la loi.
b) L'Allemagne connaît la dérive française d'avant 1996
Lors de son déplacement en Rhénanie-du-Nord-Westphalie (voir annexe du rapport), la mission a constaté que le phénomène de la revente à perte tendait à se répandre en Allemagne. Le directeur de la section 9 de l'Office fédéral des cartels, M. Dr Ruppelt, chargé notamment du contentieux des relations commerciales entre fournisseurs et revendeurs et des prix de revente, a été saisi, en juillet 1999, de plusieurs plaintes de petits commerçants en raison de la vente promotionnelle sur trois mois, par Rewe, d'une soixantaine d'articles dont les prix avaient été réduits de 25 %. La loi relative aux restrictions de concurrence (article 20, alinéa 4), dont le sixième amendement est entré en vigueur au 1er janvier 1999, n'interdit la revente à perte de produits en l'état que si la pratique est permanente (l'office a conditionné la pratique à sa mise ne _uvre sur des périodes « succinctes ») (6). L'Office des cartels a sélectionné 18 produits suspects d'être revendus à perte et conclu son enquête en jugeant que seuls trois de ces produits étaient revendus à perte mais avec seulement 3 % de perte, ce que la section 9 de l'office a estimé marginal et insuffisant pour être condamnable en raison du positionnement de ces produits sur le marché (produits non significatifs ; revente à perte de 3 % supportable par le marché, ce qui n'aurait pas été le cas s'il s'était agi de denrées périssables ; prix pratiqués par Rewe positionnés plutôt dans le haut de fourchette des prix de vente de ces produits sur le marché) et de l'absence d'intention prédatrice. Cette affaire souligne bien le fait que l'Office des cartels allemand, comme le Conseil de la concurrence en France, est avant tout le gardien de l'équilibre et du bon fonctionnement du marché, et ne sanctionne pas les abus exercés dans les relations commerciales qui ne causent pas de préjudice au libre jeu de la concurrence sur le marché.
Les dirigeants de Metro et d'Aldi dénoncent cependant cette méthode de vente en raison de son caractère antiéconomique et en viennent à demander l'intervention des pouvoirs publics pour la faire cesser, au besoin en légiférant.
Tout porte à croire que l'Allemagne est engagée dans une spirale de guerre des prix bas ou cassés. Les prix d'appel de Rewe pendant l'été 1999 ont enclenché le mouvement en raison de leur ampleur jusqu'alors inconnue en Allemagne tant par l'importance des baisses de prix, le nombre de produits concernés et la durée de la promotion. Les écarts de prix entre les magasins sont observés en permanence et le prix de cession a été placé au c_ur de la négociation commerciale.
c) L'Espagne a réformé son droit dans le même sens que la France
L'Espagne est davantage épargnée car sa loi n° 7 du 15 janvier 1996 sur la concurrence déloyale a interdit la revente à perte selon un mécanisme inspiré du droit français. On trouvera ci-après une traduction libre de la loi espagnole, dont la rédaction du paragraphe 4 de l'article 17 résulte d'une modification adoptée par les Cortès le 16 décembre 1999.
Articles 14 et 17 de la loi espagnole n° 7 du 15 janvier 1996 sur la concurrence déloyale Art. 14.- 1. Nonobstant les dispositions de l'article précédent, il est interdit d'offrir à la vente ou de vendre à perte, à l'exception des cas prévus aux chapitres IV et V du titre II de la présente loi, sauf si celui qui réalise cette vente à perte a pour objectif de s'aligner sur les prix d'un ou de plusieurs de ses concurrents qui ont la capacité d'affecter de manière significative ses propres ventes, ou s'il s'agit de denrées périssables dont la date de péremption est proche. Les dispositions de la loi sur la concurrence déloyale s'imposent dans tous les cas. 2. Pour l'application du paragraphe précédent, la vente à perte est constituée quand le prix d'un produit est inférieur au prix d'achat qui figure sur la facture, déduction faite, à proportion, des ristournes qui figurent sur celle-ci, au prix du renouvellement des produits si celui-ci est lui-même inférieur à celui-là, ou au coût effectif de production si l'article a été fabriqué par le commerçant lui-même ; ces prix s'entendent augmentés selon la cote des impôt indirects qui grèvent l'opération. 3. Ne seront pas pris en compte en vue de la déduction pour la détermination du prix dont traite le paragraphe précédent, les rémunérations ou rabais, de quelque nature qu'ils soient, qui constituent des compensations pour services rendus. 4. En aucun cas, les offres conjointes ou les cadeaux aux acheteurs ne peuvent faire obstacle à l'application des dispositions du présent article. Art. 17.- 1. A défaut de convention particulière, les commerçants doivent payer les marchandises qu'ils achètent le jour de livraison. 2. Les commerçants à qui sont remises les livraisons correspondantes auront pour obligation de faire immédiatement mention écrite de l'opération de livraison et de réception avec mention expresse de leurs dates. De même, les fournisseurs doivent indiquer sur leurs factures la date du paiement. 3. Quand les commerçants conviennent avec leurs fournisseurs de délais de paiement qui excèdent 60 jours après la date de livraison et de réception des marchandises, les modalités de paiement devront être précisées par écrit dans le document qui porte cet accord conjoint avec mention expresse de la date de paiement indiquée sur la facture. Ce document devra être remis ou accepté par les commerçants dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception des marchandises pourvu que la facture ait été envoyée préalablement. Pour la concession de délais de paiement supérieurs à 120 jours, le vendeur pourra exiger qu'ils soient garantis par aval bancaire, assurance de crédit ou caution. 4. Sans préjudice des dispositions mentionnées dans le paragraphe précédent, quand les commerçants conviennent avec leurs fournisseurs de délais de paiement supérieurs à 60 jours après la date de livraison et de réception des marchandises, les modalités de paiement devront être précisées par écrit dans le document qui porte cet accord conjoint avec mention expresse de la date de paiement indiquée sur la facture. Si les délais de paiement sont supérieurs à 90 jours, ce document est endossable sur ordre. Dans tous les cas, ce document devra être produit ou accepté par les commerçants dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception des marchandises, pourvu que la facture ait été envoyée préalablement. Pour la concession de délais de paiement supérieurs à 120 jours, le vendeur pourra exiger qu'ils soient garantis par aval bancaire, assurance de crédit ou caution. 5. Pour la mise en _uvre du présent article, s'agissant exclusivement des biens de consommation, il faut entendre par date de livraison la date réelle de livraison bien que, initialement, le titre de livraison soit distinct du contrat, dès lors que les marchandises ont été finalement acquises par le réceptionnaire. |
d) Un problème reste en suspens : les bons d'achat
En ce qui concerne la France, la mission s'interroge sur la pratique des bons d'achat, dont un exemple publicitaire est reproduit ci-après (la pratique est surtout le fait des chaînes de magasins indépendants). Elle consiste à offrir, pour l'achat de certains produits (ceux en promotion figurant dans les catalogues publicitaires), des bons de réduction d'un montant forfaitaire ou, lorsque l'opération concerne un rayon entier, proportionnel. La réduction de prix accordée par ces bons est imputable sur l'ensemble des achats dans le magasin.
A la suite d'une plainte d'Orangina contestant l'utilisation de ses produits pour servir de support à l'offre de bons de réduction pour l'achat de produits concurrents, les tribunaux ont admis la validité de cette pratique à condition que le bon d'achat ne porte pas sur l'achat de produits concurrents appartenant à la même section de marché et ne conduise pas à vendre en caisse des produits en dessous de leur seuil de revente à perte. Cependant cette dernière condition n'est pas contrôlable sauf à mettre un agent de la DGCCRF dernière chaque caisse de magasin pratiquant cette forme de promotion. Comme les caissières et caissiers sont dans l'incapacité de contrôler le franchissement du seuil de revente à perte des 80 000 références, au minimum, vendues dans un hypermarché, et d'effectuer des moyennes d'imputation de la réduction offerte au prorata de l'ensemble des produits achetés (la réduction s'impute sur le total de l'achat), l'offre de bons d'achat conduit à enfreindre, dans les faits mais occasionnellement, la législation sur le seuil de revente à perte.
La Cour d'appel d'Aix-en-Provence (jugement n° 95-4385 du 30 juin 1995) a validé la pratique des bons de réductions dès lors que ceux-ci sont accordés à la suite d'un achat d'un ensemble de produits commercialisés par différents industriels et non de produits d'une seule marque. La Cour de cassation a également déclaré licite les « bons cadeaux fidélité » offrant une réduction à valoir sur un achat effectué dans n'importe quel rayon d'un magasin (mais déclaré illicite le bon permettant d'acquérir, en fonction du nombre de points-fidélité obtenus, un ou plusieurs cadeaux figurant sur une liste limitative car il s'agit alors d'une prime différée contraire à l'article L. 121-35 du code de la consommation). La pratique ne peut donc être sanctionnée comme vente avec prime gratuite.
La mission d'information juge qu'il n'y a pas de solution juridique à ce problème qui est avant tout pratique. Les différentes réformes que nous avons étudiées sont impraticables dans les faits et risquent d'être totalement inopérantes. Par ailleurs, les cas de revente à perte intentionnelles par la technique des bons d'achat sont rares ; ils n'entrent pas dans la stratégie poursuivie par le groupement de M. Michel-Edouard Leclerc ou ITM Entreprises dont les enseignes utilisent fréquemment cette technique de promotion ; ils surviennent par le jeu même du mécanisme du bon d'achat.
Article 10-1 de
l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 « Sont prohibées les offres de prix ou pratiques de prix de vente aux consommateurs abusivement bas par rapport aux coûts de production, de transformation et de commercialisation, dès lors que ces offres ou pratiques ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'éliminer d'un marché ou d'empêcher d'accéder à un marché une entreprise ou l'un de ses produits. « Les coûts de commercialisation comportent également et impérativement tous les frais résultant des obligations légales et réglementaires liées à la sécurité des produits. « Ces dispositions ne sont pas applicables en cas de revente en l'état, à l'exception des enregistrements sonores reproduits sur supports matériels. » |
1. La mise en place de l'interdiction
Avant la loi n° 96-588 du 1er juillet 1996 relative à la loyauté et l'équilibre des relations commerciales, seule était interdite la revente à perte, et non la vente à perte (article premier de la loi de finances rectificative pour 1963 du 2 juillet 1963, modifié par l'article 32 de l'ordonnance du 1er décembre 1986). Ne sont en effet concernées par l'article 32 de l'ordonnance que les ventes entre professionnels et en aucun cas aux consommateurs. En outre, l'interdiction ne touche que les produits revendus en l'état ; elle ne peut donc pas concerner un produit dès lors qu'il a subi la moindre transformation après sa cession au revendeur, même si celle-ci ne porte que sur l'emballage ou le conditionnement, et a fortiori si le produit a été fabriqué par le revendeur. En dernier lieu, la prohibition n'inclut pas non plus les prestations de services.
La loi n° 96-588 du 1er juillet 1996 a introduit dans le droit français (à l'article 10-1 de l'ordonnance du 1er décembre 1986) une interdiction touchant les prix de vente (ou les pratiques de prix) aux consommateurs : les prix abusivement bas dits « prédateurs ».
Le caractère abusivement bas d'un prix est évalué par rapport aux coûts de production, de transformation et de commercialisation.
L'offre ou la pratique de prix bas est sanctionnée seulement quand elle a pour objet ou peut avoir pour effet d'éliminer d'un marché ou d'empêcher d'y accéder une entreprise ou l'un de ses produits.
L'interdiction ne s'applique pas aux produits revendus en l'état, qui bénéficient d'une interdiction de revente à perte réaménagée par les articles 1er et 2 de la loi n° 96-588 du 1er juillet 1996, sauf dans les cas de vente des enregistrements sonores reproduits sur supports matériels, c'est-à-dire des disques et cassettes audio.
L'insertion de cette prohibition dans un article 10-1 nouveau de l'ordonnance visait à confier le contentieux au Conseil de la concurrence. Cependant, à l'instar des interdictions définies aux articles 7 et 8 de l'ordonnance, la compétence du Conseil de la concurrence n'est pas exclusive. Les tribunaux civils, de commerce ou pénaux peuvent, à l'occasion des litiges ou des plaintes dont ils sont saisis, faire application de l'interdiction. L'article 26 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, qui permet aux juridictions de consulter le Conseil de la concurrence sur les pratiques anticoncurrentielles définies dans l'ordonnance, a ainsi été modifié par la loi n° 96-588 du 1er juillet 1996 afin de viser l'article 10-1.
Par ailleurs, la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat a mis en place un dispositif spécial (articles 37 et 38) définissant précisément et interdisant les prix abusivement bas en matière de transport routier de marchandises (voir le commentaire des articles sur le commerce).
La loi n° 96-588 du 1er juillet 1996 ne visait pas à réprimer les prix bas mais seulement les offres ou pratiques de prix aux consommateurs artificiellement bas faites ou mises en _uvre dans le but d'éliminer d'un marché ou d'empêcher d'accéder à un marché un concurrent. Seuls ont été visés par le législateur les prix dits prédateurs, et non les prix dès lors qu'ils sont inférieurs aux coûts de production, de transformation et de commercialisation.
1. L'interdiction englobe tous les produits dès lors qu'ils ne sont pas revendus en l'état.
Sont en premier lieu visés les produits fabriqués par le revendeur, que ce soit sur le lieu de vente ou non.
En second lieu les débats en deuxième lecture ont précisé la notion de produit transformé (JO.débats AN, 28 mai 1996, p. 3559). Le découpage d'une carcasse d'animal ou d'un poisson, l'évidement d'une volaille ou d'un poisson, la cuisson de crustacés, l'effeuillage de fruits ou légumes constituent une transformation. Le lavage des produits (allant au-delà du simple rafraîchissement) peut poser problème si le produit est modifié dans sa présentation.
Une opération de montage sur un produit implique que celui-ci n'est pas revendu en l'état. C'est en particulier le cas pour les matériels de bricolage ou de jardinage (pose du ciseau dans une tondeuse, par exemple) ou la vente de meubles livrés en pièces détachés et montés pour être revendus aux consommateurs.
Le reconditionnement d'un produit allant au-delà des simples étiquetage, mise en rayon ou dépalettisation constitue également une transformation. Sont par exemple visés la mise en barquette de fraises reçues en vrac et le changement d'emballage d'un produit.
2. L'article 10-1 est opposable à la prestation de services (JO.débats AN, 21 mars 1996, p. 1974, et 29 mai 1996? p. 3559 ; JO.débats Sénat, 9 mai 1996, p. 2438). La rédaction de l'article 3 du projet de loi était ambiguë et laissait penser que les services n'étaient pas inclus, les débats ont clairement montré l'intention d'appliquer à toutes les prestations de services l'interdiction figurant à l'article 10-1.
Le déplacement du dispositif du titre IV de l'ordonnance, où le projet de loi initial l'insérait (sous la forme d'un article 32-1 nouveau de l'ordonnance), à son titre III (article 12-1 après l'examen en première lecture à l'Assemblée nationale, puis 10-1 après le vote en première lecture au Sénat) implique l'inclusion des services bancaires dans son champ d'application. En effet, le paragraphe III de l'article 60 de l'ordonnance a rendu applicables aux banques les interdictions des pratiques anticoncurrentielles (figurant aux articles 7 et 8 dans la rédaction initiale de 1986). Aucune restriction n'a été formulée quant à l'application du dispositif à l'ensemble du secteur des services.
b) Le calcul du prix de référence destiné à apprécier le caractère abusivement bas d'un prix
Le caractère bas du prix d'un produit (ou d'un service) est apprécié par rapport à l'ensemble de ses coûts de production, de transformation et de commercialisation.
Le coût de production couvre le prix d'achat des produits ou des matières premières qui vont être transformés. L'évaluation du coût de la production et de la transformation implique l'étude de la comptabilité analytique des entreprises. Il faut en effet prendre en compte l'amortissement des matériels, les frais de personnel, etc. (JO.débats AN, 21 mars 1996, p. 1962).
Les coûts de commercialisation doivent entraîner l'incorporation des frais de personnel, d'entretien, de stockage, les frais généraux et l'amortissement du lieu de vente et des moyens de mise sur le marché (JO.débats AN, 21 mars 1996, p. 1969). Ils incluent le coût logistique de la vente du produit ou de la prestation de service tel que défini par le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur : « frais de livraison, de déchargement, de mise en rayon » (JO.débats AN, 21 mars 1996, p. 1959).
La loi précise que « les coûts de commercialisation comportent également et impérativement tous les frais résultant des obligations légales et réglementaires liées à la sécurité des produits ». Il s'agit des frais et des investissements imposés par les pouvoirs publics afin d'assurer la sécurité des consommateurs et ceux liés à l'hygiène et à la qualité sanitaire des produits (JO.débats AN, 29 mai 1996, p. 3559). Ces dépenses correspondent la plupart du temps au respect des normes de sécurité.
Dans le cas des disques et des cassettes audio enregistrées, le prix de référence est évalué par rapport aux coûts de production de l'industriel et de commercialisation de la chaîne de distribution. Leur vente est frappée d'une double interdiction : interdiction de nature civile de vendre en-dessous du coût de revient dans le but d'éliminer une entreprise ou un produit concurrent (article 10-1 de l'ordonnance) ; interdiction de nature pénale de revendre à un prix inférieur au prix d'achat effectif (article 32).
c) La condition d'éviction de l'entreprise ou du produit
Une offre ou une pratique de prix ne peut être sanctionnée sur le fondement de l'article 10-1 qu'à la condition qu'elle ait un caractère « prédateur », c'est-à-dire qu'elle ait « pour objet ou (puisse) avoir pour effet d'éliminer d'un marché ou d'empêcher d'accéder à un marché une entreprise ou l'un de ses produits ».
La rédaction de l'article est calquée sur celle de l'article 7 de l'ordonnance. Un recours pourra être formé sans attendre qu'une entreprise ou un produit soit évincé d'un marché. Le Conseil de la concurrence est d'ailleurs habilité à prendre des mesures conservatoires (article 12 de l'ordonnance) afin de prévenir une entreprise des conséquences d'une offre ou d'une pratique abusive. En outre, la rédaction permet d'éviter que des opérateurs puissants interdisent à des entreprises de se lancer sur un marché ou empêchent le lancement d'un produit ou service.
La prédation ou l'éviction peut concerner une entreprise (ou un de ses établissements) ou un produit (ou un service comme l'ont précisé les débats : à titre d'illustration, on peut citer la vente de séjours dans des pays méditerranéens afin d'empêcher l'agence de voyages voisine de vendre ses séjours en Italie et en Espagne pour lesquels elle a fait une publicité, ou la mise à disposition de machines à laver les voitures automatiques afin de détourner la clientèle des garages et des stations-service voisines).
L'élimination de l'entreprise, du produit ou du service s'apprécie par rapport au marché. Le marché peut être local (JO.débats AN, 21 mars 1996, p. 1974 ; JO.débats Sénat, 9 mai 1996, p. 2438). L'avis n° 96-A-05 du 2 mai 1996 du Conseil de la concurrence, sollicité par la commission de la production et des échanges de l'Assemblée nationale, précise en son point 5 « qu'une boucherie ou une boulangerie localisées à proximité d'une grande surface, vendant les mêmes articles et entre lesquelles il n'existe aucun obstacle à la mobilité physique des consommateurs, se trouvent sur le même marché », ces petits commerces peuvent donc bénéficier des dispositions de l'article 10-1 de l'ordonnance.
d) La procédure contentieuse applicable
L'application des dispositions de l'article 10-1 exige une expertise économique afin de déterminer le prix abusivement bas et apprécier l'objet ou l'effet de la pratique ou de l'offre. C'est pourquoi le contentieux a été confié au Conseil de la concurrence, mais il ne s'agit pas d'une compétence juridictionnelle exclusive. En effet, à l'instar des interdictions énoncées aux articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, les tribunaux civils ou de commerce peuvent appliquer à l'occasion des litiges dont ils sont saisis cette interdiction des prix abusivement bas.
La compétence du Conseil de la concurrence a des avantages certains :
- il dispose de moyens d'enquête et d'expertise importants ;
- ses membres ont une grande expérience et une bonne connaissance des pratiques et des méthodes de gestion des entreprises ;
- sa juridiction est nationale (la jurisprudence est donc dégagée rapidement), l'appel est formé devant la Cour d'appel de Paris ;
- la procédure peut être simplifiée en fonction de l'importance de l'affaire ;
- les droits de la défense sont garantis ;
- les sanctions qu'il peut infliger sont dissuasives (5 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France au cours du dernier exercice clos ou 10 millions de francs si le contrevenant n'est pas une entreprise).
3. L'application de l'interdiction des prix abusivement bas
En 1997, le Conseil de la concurrence a statué sur deux litiges : dans les deux cas (décision n° 97-PB-01 du 12 mars 1997 sur saisine de la société Cathild Industrie et décision n° 97-PB-02 du 27 mai 1997 sur saisine de la société moderne d'assainissement et de nettoiement) les demandeurs ont été déboutés :
- dans la première affaire, parce que le demandeur n'apportait « aucun élément suffisamment probant permettant d'établir que le prix offert par la société Nardi aurait été abusivement bas par rapport à ses coûts de production, de transformation et de commercialisation »,
- dans la seconde affaire, parce que l'offre de prix proposée suite à un appel d'offre pour une délégation de service public n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article 10-1 de l'ordonnance.
En 1998, le Conseil de la concurrence a examiné six affaires dont quatre sur saisine de deux disquaires (l'Audito au Havre et Madison à Villabé) mettaient en cause des offres de prix promotionnelles sur des disques pratiquées par l'Espace culturel E-Leclerc, Auchan, Mammouth et Carrefour. Le rapport du Conseil de la concurrence pour 1998 analyse ainsi ces quatre décisions importantes :
« Sur la base de ces principes, le Conseil a procédé, dans les quatre décisions en cause à une analyse en trois étapes : il a, d'abord, défini les coûts variables à prendre en compte, ensuite déterminé les coûts moyens totaux et, enfin, examiné s'il existait une manifestation d'éviction du marché. Les éléments comptables fournis par les distributeurs ont mis en évidence qu'en dehors du coût d'achat les autres coûts étaient fonction de paramètres étrangers au volume des ventes et ne pouvaient en conséquence être considérés comme des coûts variables. Une fois cette première délimitation établie, la recherche d'une éventuelle pratique d'éviction a été effectuée à partir d'un examen comparatif des prix de vente proposés dans les promotions aux prix d'achat des distributeurs. Sur l'ensemble des constatations effectuées, il a été relevé que la majorité des disques avaient été vendus à un prix supérieur au prix d'achat, les autres ayant été vendus à un prix égal au prix d'achat. A ce stade de l'analyse, le Conseil a conclu que les disques avaient été vendus à un niveau permettant d'assurer la couverture des prix d'achat.
« La seconde étape a consisté à examiner si les prix de vente étaient ou non inférieurs aux prix moyens totaux. La comptabilité analytique des distributeurs a permis d'identifier les autres postes de coûts : frais de personnel, frais de gestion courante, frais d'infrastructure, frais de services centraux. Conformément à la méthodologie définie dans l'avis n° 97A18, ces coûts ont été ventilés entre coûts variables et coûts fixes.
« En réponse aux observations du commissaire du Gouvernement, qui estimait qu'une partie des charges de personnel et des frais logistiques ou généraux étaient liés au volume d'activité et, en toute hypothèse, figuraient au nombre des coûts de commercialisation prévus à l'article 101, le Conseil a pris en compte les frais de personnel aux coûts variables. Cette intégration a été effectuée par imputation de ces frais de personnel aux disques vendus en promotion au prorata du montant de leurs ventes dans les ventes totales de disques. Les autres coûts (frais d'infrastructure, de services centraux, de gestion courante) ont été affectés aux disques sur la période de la promotion au prorata de ce que représentait le rayon concerné au sein du magasin.
« Sur la base des modes de calcul ainsi définis, il a été constaté :
· qu'au cours de l'opération promotionnelle de l'Espace culturel ELeclerc, sur 33 des 40 disques en cause, les coûts de personnel avaient été couverts et que globalement l'ensemble des coûts totaux déterminés sur les ventes des 40 disques de la promotion avait été couvert par le chiffre d'affaires réalisé sur ces mêmes disques. Une analyse plus précise par disques a fait ressortir que sur les 33 disques pour lesquels les frais de personnel étaient couverts, quinze d'entre eux avaient été vendus à un prix inférieur au coût moyen total ;
· qu'au cours de l'opération promotionnelle du magasin Auchan, huit des quinze titres en cause avaient été vendus à un prix inférieur au coût moyen total, dont quatre ne couvraient pas les frais de personnel ;
· qu'au cours de l'opération promotionnelle du magasin Carrefour, sur les quinze titres en cause, sept couvraient les frais de personnel, les huit autres étaient inférieurs aux coûts totaux et ne couvraient pas les charges de personnel.
« Ainsi, un certain nombre de disques avaient été commercialisés à des prix de vente inférieurs aux coûts moyens totaux. Les quatre dossiers d'instruction ne contenant aucun indice démontrant l'intention des grands distributeurs concernés d'éliminer du marché le magasin l'Audito, d'une part, et le magasin Madison, d'autre part, il convenait de vérifier si cette pratique de prix n'avait pas eu un tel effet. Pour ce faire, le Conseil s'est appuyé essentiellement sur des paramètres d'ordre comptable. Il a, en particulier, procédé à un examen comparatif portant sur les quantités vendues pour les disques en question, la part qu'ils représentent dans l'ensemble des ventes en promotion ainsi que dans les ventes totales de disques pendant la période de promotion, la part que le nombre de disques en promotion représente par rapport au nombre total de références commercialisées, le rapport entre le chiffre d'affaires réalisé pendant la période de promotion et le chiffre d'affaires annuel, afin de pouvoir identifier un éventuel effet d'entraînement des disques en promotion sur les achats d'autres disques, les écarts de prix, le niveau des marges. Ont été également prises en compte les informations ayant trait au caractère répétitif des opérations de promotion ainsi que les conditions de fonctionnement des distributeurs et, en particulier, les conséquences de leur appartenance à un groupe et leurs conditions d'achat.
« Sur la base de cette grille d'analyse, le Conseil a considéré, dans les quatre cas examinés, que les prix pratiqués n'étaient pas de nature à évincer le magasin l'Audito et le magasin Madison du marché et qu'en conséquence, les opérations promotionnelles n'étaient pas prohibées par l'article 101 de l'ordonnance. »
Dans ce cas précis, on peut s'interroger sur les motivations qui ont conduit le Conseil de la concurrence à appliquer trop à la lettre la loi, en perdant de vue son esprit et les objectifs du législateur. Des disques ont été vendus à un prix inférieur à leur coût de revient : il y a donc eu infraction. L'argument avancé par le conseil pour ne pas prononcer de sanction selon lequel « les prix pratiqués n'étaient pas de nature à évincer les magasins l'Audito et Madison du marché » est peu convaincant. En effet, si une grande enseigne vend des disques à succès à un prix inférieur au prix de revient, donc à perte, elle pénalise le disquaire qui offre à sa clientèle un panel varié de disques d'auteurs et de compositeurs moins connus. Ce dernier, grâce à des ventes sur certains disques à succès, peut couvrir les frais de commercialisation de disques de compositeurs moins connus, donc moins rentables. Il contribue donc au soutien à la création. Il y a, pour la mission, un paradoxe à prétendre défendre l'exception culturelle et la chanson française lors du vote de la loi en 1996 et des dernières négociations internationales à l'Organisation mondiale du commerce, et à accepter la fatalité de promotions de la grande distribution sur les disques qui asphyxient la création.
En 1999, le Conseil de la concurrence n'a pas eu l'occasion de statuer sur des litiges de prix abusivement bas.
La mission d'information attire à nouveau l'attention sur le problème des prix de revente de l'essence. En 1996, le Gouvernement avait imposé à l'Assemblée nationale en deuxième lecture de supprimer de l'article 10-1 l'exception concernant la revente de l'essence votée en première lecture par les deux assemblées, alors que celle touchant les enregistrements sonores reproduits sur supports matériels avait été maintenue. Pareillement, le Gouvernement avait imposé aux deux assemblées la suppression d'une disposition retenue par la commission mixte paritaire tendant à ce qu'une commission minimale de 8 % soit accordée sur le prix de vente hors taxes des carburants par les fournisseurs aux pompistes gérants libres ou mandataires et à ceux liés par un contrat de commissionnaire. En contrepartie le Gouvernement s'était engagé à mettre en place un soutien public aux petites stations-service des zones rurales en difficulté : l'article 130 de la loi de finances pour 1996 a modifié l'assiette de la taxe sur les grandes surfaces (article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972) notamment en y incorporant une surface calculée en fonction du nombre de position de ravitaillement en carburant ; selon les indications du Gouvernement (JO.débats AN, 15 novembre 1996, p. 7049) le produit de cette extension d'assiette était estimé à 60 millions de francs par an, cette somme devant être attribuée au comité professionnel de distribution de carburants qui était chargé de redistribuer ces fonds aux petites stations-service des zones rurales.
Ces financements semblent ignorés des principaux intéressés et nous nous interrogeons sur « l'évaporation » de ces 60 millions de francs.
La mission d'information a été saisie par le Conseil national des professions de l'automobile de pratiques déloyales de la grande distribution en matière de calcul du prix de revente à perte des carburants revendus à prix coûtant ou avec des marges de 1 à 5 centimes par litre.
Trois articles de l'ordonnance relative à la liberté des prix et de la concurrence organisent les délais de paiement entre les entreprises.
Article 31 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 Tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle doivent faire l'objet d'une facturation. Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la vente ou la prestation du service. L'acheteur doit la réclamer. La facture doit être rédigée en double exemplaire. Le vendeur et l'acheteur doivent en conserver chacun un exemplaire. La facture doit mentionner le nom des parties ainsi que leur adresse, la date de la vente ou de la prestation de service, la quantité, la dénomination précise, et le prix unitaire hors TVA des produits vendus et des services rendus (loi n° 96-588 du 1er juillet 1996, art. 10) « ainsi que toute réduction de prix acquise à la date de la vente ou de la prestation de service et directement liée à cette opération de vente ou de prestation de service, à l'exclusion des escomptes non prévus sur la facture ». (Loi n° 92-1442 du 31 décembre 1992, art. 3) « La facture mentionne également la date à laquelle le règlement doit intervenir. Elle précise les conditions d'escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l'application des conditions générales de vente. » (Loi n° 96-588 du 1er juillet 1996, art. 10) « Le règlement est réputé réalisé à la date à laquelle les fonds sont mis, par le client, à la disposition du bénéficiaire ou de son subrogé. » (Loi n° 93-122 du 29 janvier 1993, art. 19). - « Toute infraction aux dispositions du présent article est punie d'une amende de 500.000 F. « L'amende peut être portée à 50 p. 100 de la somme facturée ou de celle qui aurait dû être facturée. « Les personnes morales peuvent être déclarées responsables conformément à l'article 121-2 du code pénal. Les peines encourues par les personnes morales sont : « 1° L'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 dudit code ; « 2° La peine d'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus, en application du 5° de l'article 131-39 du code pénal. » Article 33 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 (Loi n° 93-122 du 29 janvier 1993, art. 18) « Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur, est tenu de communiquer à tout acheteur de produit ou demandeur de prestation de services pour une activité professionnelle, qui en fait la demande, son barème de prix et ses conditions de vente. » Celles-ci comprennent les conditions de règlement et, le cas échéant, les rabais et ristournes. (Loi n° 92-1442 du 31 décembre 1992, art. 3).- « Les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les modalités de calcul et les conditions dans lesquelles des pénalités sont appliquées dans le cas où les sommes dues sont versées après la date de paiement figurant sur la facture, lorsque le versement intervient au-delà du délai fixé par les conditions générales de vente. « Ces pénalités sont d'un montant au moins équivalent à celui qui résulterait de l'application d'un taux égal à une fois et demie le taux de l'intérêt légal ». « La communication prévue au premier alinéa » s'effectue par tout moyen conforme aux usages de la profession. Les conditions dans lesquelles un distributeur (loi n° 93-122 du 29 janvier 1993, art. 18) « ou un prestataire de services se fait rémunérer par ses fournisseurs, en contrepartie de services spécifiques, doivent faire l'objet d'un contrat écrit en double exemplaire détenu par chacune des deux parties. » (Loi n° 92-1442 du 31 décembre 1992, art .3) « Toute infraction aux dispositions visées ci-dessus sera punie d'une amende de 100 000 F. » (Loi n° 93-122 du 29 janvier 1993, art. 18) « Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal. » (Loi n° 96-588 du 1er juillet 1996, art. 12) « La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 dudit code. » Article 35 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 (Loi n° 92-1442 du 31 décembre 1992, art. 5) « A peine d'une amende de 500 000 F, le délai de paiement, par tout producteur, revendeur ou prestataire de services, ne peut être supérieur : « - à trente jours après la fin de la décade de livraison pour les achats de produits alimentaires périssables (loi n° 96-588 du 1er juillet 1996, art. 13) « , de viandes congelées ou surgelées, de poissons surgelés » (loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole, art. 101, XVII) « , de plats cuisinés et de conserves fabriqués à partir de produits alimentaires périssables », à l'exception des achats de produits saisonniers effectués dans le cadre de contrats dits de culture visés aux articles L. 326-1 à L. 326-3 du code rural [article 17 de la loi n° 64-678 du 6 juillet 1964 tendant à définir les principes et les modalités du régime contractuel en agriculture] ; « - à vingt jours après le jour de livraison pour les achats de bétail sur pied destiné à la consommation et de viandes fraîches dérivées ; « - à trente jours après la fin du mois de livraison pour les achats de boissons alcooliques passibles des droits de consommation prévus à l'article 403 du code général des impôts ; « - à défaut d'accords interprofessionnels conclus en application de la loi n° 75-600 du 10 juillet 1975 relative à l'organisation interprofessionnelle agricole et rendus obligatoires par voie réglementaire à tous les opérateurs sur l'ensemble du territoire métropolitain pour ce qui concerne les délais de paiement, à soixante-quinze jours après le jour de livraison pour les achats de boissons alcooliques passibles des droits de circulation prévus à l'article 438 du même code. » |
L'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence contient deux types de dispositions applicables aux délais de paiement entre les entreprises : son article 35 impose des délais pour l'achat de certains produits, ses articles 31 et 33 définissent les modalités par lesquelles les entreprises conviennent des délais de règlement de leurs transactions commerciales. Ce cadre législatif a été entièrement refondu par la loi n° 92-1442 du 31 décembre 1992 relatives aux délais de paiement entre les entreprises. Les dispositions générales du code civil relatives aux paiements restent par ailleurs applicables en l'absence de dispositions expresses de l'ordonnance (articles 1235 à 1248 du code civil).
L'excessive longueur des délais de paiement entre les entreprises est un mal de l'Europe du Sud.
Selon l'enquête de l'UFB-Locabail sur les délais de paiement des PME-PMI, le délai de paiement moyen effectif des clients des PME-PMI (qui est celui qui intéresse les rapports avec la distribution) atteignait 64 jours en France en 1998 (contre 66 jours en 1997), ce qui constituait son niveau le plus bas depuis 1991, alors qu'il atteint 29 jours en Allemagne et en Grande-Bretagne, mais 95 jours en Italie. La durée du crédit des fournisseurs des PME-PMI s'établissait à 53 jours en France (contre 51 jours en 1997, la dégradation provenant essentiellement de l'allongement des délais de paiement des entreprises de plus de vingt salariés : les PME de grande taille usent également de leur rapport de force avec leurs fournisseurs ce que ne peuvent pas faire les plus petites), à 22 jours en Allemagne, 33 jours en Grande-Bretagne et 74 jours en Italie.
Dans le dernier rapport de la Commission européenne sur les délais de paiement dans les transactions commerciales, paru en juillet 1999, la Commission européenne estimait le délai de paiement effectif moyen en Europe en 1996 à 54 jours (58 jours pour la France) et le délai contractuel moyen convenu entre les entreprises à 39 jours (contre 48 jours en France). Les pays dans lesquels les retards de paiement étaient les plus importants étaient le Portugal, l'Italie, la Belgique, la Grèce, les Pays-Bas et le Royaume-Uni. La Commission jugeait que dans 35 % des cas le retard de paiement était intentionnel.
Les délais de paiement posent trois types de problèmes : le respect du délai de paiement convenu ou fixé par la loi (c'est la question du règlement des factures) ; la fixation de délais de paiement maximums par la loi ; les modalités de détermination du délai de paiement entre les partenaires commerciaux.
La législation sur les paiements figure à la section première (« Du payement ») du chapitre V (« De l'extinction des obligations ») du titre III du code civil (articles 1235 à 1264). Les articles 1650 et 1651 du code civil disposent en outre que « la principale obligation de l'acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente » et que « s'il n'a rien été réglé à cet égard lors de la vente, l'acheteur doit payer au lieu et dans le temps où doit se faire la délivrance ».
Si le code civil précise que « le débiteur ne peut forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d'une dette, même divisible » (article 1244) et que « le payement fait au créancier n'est point valable s'il était incapable de le recevoir, à moins que le débiteur ne prouve que la chose payée a tourné au profit du créancier » (article 1241), rien n'était prévu dans la loi en ce qui concerne la détermination du moment de la réalisation du paiement.
L'article 10 de la loi n° 96-588 du 1er juillet 1996 a réglé la question pour ce qui concerne les obligations commerciales entre professionnels : le règlement est réputé réalisé à la date à laquelle les fonds sont mis, par le client, à la disposition du bénéficiaire ou de son subrogé. Le paragraphe II de cet article a complété le quatrième alinéa de l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 par la phrase suivante :
« Le règlement est réputé réalisé à la date à laquelle les fonds sont mis, par le client, à la disposition du bénéficiaire ou de son subrogé. »
L'objectif du législateur de 1996 était d'empêcher les man_uvres dilatoires visant à retarder l'encaissement par le créancier des sommes payées ou à jouer sur les dates de valeur (voir JO.débats AN, 21 mars 1996, pp. 1947 à 1949, et 28 mai 1996, p. 3570).
Du fait que la mise à disposition des fonds ne dépend pas de la seule volonté du débiteur, la loi n° 96-588 du 1er juillet 1996 ne dispose pas que « le règlement est réalisé à la date ... » mais que « le règlement est réputé réalisé à la date ... ». Ainsi une défaillance ou une erreur due au système bancaire, ou à la poste, ou à tout intermédiaire non lié au débiteur ne saura peser sur la responsabilité du débiteur.
La précision selon laquelle « les fonds sont mis, par le client, à la disposition du bénéficiaire ou de son subrogé » participe de la même préoccupation.
b) Les dérives actuelles affaiblissent les PME-PMI
Les principales difficultés consistent aujourd'hui à obtenir le paiement ou l'envoi d'une traite par le client. Ainsi, un chef d'entreprise (PME) ne peut compenser dans son bilan 14,3 millions de francs de marchandises livrées mais non payées et pour lesquelles aucune traite n'a été retournée, sur un chiffre d'affaires total de l'ordre de 70 millions de francs hors taxes. Recevant ses paiements dans un délai moyen de 149 jours (selon les résultats de son bilan, évaluation qui peut être faussée par le fait que le bilan est arrêté au 31 décembre ; le délai moyen peut être estimé à au moins 120 jours), il n'est pas en mesure de tenir financièrement et un de ses fournisseurs, Carrefour, lui a « offert » un service d'affacturage lui permettant de recevoir les paiements mais en contrepartie d'une remise mensuelle de 0,71 % pour la prestation financière d'avance de paiement et de 0,5 % pour le service de facturation (dénommé « coût de transfert », dont on apprend l'existence une fois que l'on souscrit au service d'affacturage, la lettre de proposition ne le mentionnant absolument pas), ce qui permet au distributeur de rémunérer ses paiements au taux de 14,52 % par an.
Avec un tel système, aucune banque n'est utile puisque les traites n'existent plus et plus le client allonge ses délais de paiement plus il gagne de l'argent ! Indiquons que, pour l'heure, ni la centrale de Promodès (mais cela risque d'être rapidement du passé) ni celle de Casino ni celles des magasins indépendants ne proposent ce service d'affacturage.
Pour lutter contre cette pratique, les PME-PMI demandent que la loi fixe le délai de paiement à 30 ou 60 jours maximum, selon les types de produits ou de services, ce qui correspond à une pratique internationale.
La mission d'information propose de compléter la loi pour garantir aux fournisseurs l'envoi des traites et ne pas être contraint de recourir à un service d'affacturage onéreux et imposé par le débiteur.
2. Les délais de paiement réglementés sont respectés sauf pour les achats de vin
a) L'origine de la réglementation remonte à 1985
La fixation, par la loi, de délais de paiement maxima pour le règlement des achats entre les entreprises remonte à 1985. La loi n° 85-1408 du 30 décembre 1985 d'amélioration de la concurrence a introduit un point 6 à l'article 37 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 sur les prix pour considérer comme illicite le paiement, par les entreprises commerciales, de leurs achats de produits alimentaires périssables et de boissons alcooliques ayant supporté les droits de consommation prévus à l'article 403 du code général des impôts au delà d'un délai de 30 jours après la fin du mois de livraison. L'article 35 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 a repris cette disposition en rendant passible tout contrevenant d'une amende de 5 000 à 100 000 francs.
L'intention du législateur de 1985 était de rétablir un équilibre de concurrence entre les grandes surfaces de vente, dont la puissance d'achat permettait d'obtenir des délais de paiement allongés, et les petits commerçants traditionnels. La rotation des stocks des produits alimentaires périssables est, en effet, très rapide en magasin : comme l'avait expliqué dans les années 1960 Marcel Fournier, l'inventeur de l'hypermarché, la différence entre la date de paiement au fournisseur (environ 45 jours en 1992) et le moment d'achat par le consommateur (2 à 3 jours) permet de dégager une trésorerie assurant le financement de la croissance de l'enseigne. Or, le petit commerçant ne peut obtenir de tels délais de paiement de ses fournisseurs et doit même souvent payer comptant ses achats de produits alimentaires périssables. Le délai de paiement maximal de 30 jours fin de mois rétablissait donc une équité de concurrence et évitait, en outre, aux fournisseurs de financer la grande distribution au détriment de l'équilibre de leurs comptes par le crédit interentreprises.
Le délai de paiement maximal applicable aux achats de spiritueux a une justification pratique. Cette règle a été fixée, comme la première relative aux produits alimentaires périssables, sur la proposition du Gouvernement. En nouvelle lecture devant l'Assemblée nationale, le 6 décembre 1985, le ministre chargé des relations avec le Parlement a ainsi expliqué les intentions du Gouvernement : « les fabricants et marchands en gros de boissons alcooliques seront ainsi amenés à recouvrer les sommes dues par leur clientèle en même temps qu'ils acquittent des droits dont ils sont redevables auprès du Trésor public. »
La loi n° 92-1442 du 31 décembre 1992 a tout d'abord rendu applicables les dispositions de l'article 35 de l'ordonnance aux producteurs et aux prestataires de services afin que les filières entières et les centrales d'achat soient concernées par les délais de paiement maximaux. Elle a également quintuplé la peine d'amende en portant son maximum à 500 000 francs.
Elle a ensuite fixé comme suit les délais de paiement :
- pour les achats de produits alimentaires périssables : 30 jours après la fin de la décade de livraison (c'est-à-dire le 10, le 20 ou le dernier jour du mois). Sont écartés les produits saisonniers achetés dans le cadre de contrats de culture car ils font l'objet d'un accord annuel entre l'agriculteur et le transformateur reposant sur un partage des fonctions et un paiement étalé sur un an ;
- les achats de bétail sur pied destiné à la consommation et de viandes fraîches dérivées : 20 jours après le jour de livraison. Ce délai a été calculé pour respecter le rythme hebdomadaire des marchés de bestiaux ;
- les achats de boissons alcooliques passibles des droits de consommation prévus à l'article 403 du code général des impôts : délai non modifié de 30 jours après la fin du mois de livraison ;
- les achats de boissons alcooliques passibles des droits de circulation prévus à l'article 438 du code général des impôts (à savoir les vins, cidres, poirés et hydromels, à l'exception des vins doux naturels et des vins de liqueur) : 75 jours après le jour de livraison, sauf si un accord interprofessionnel rendu obligatoire par arrêté ministériel a prévu un délai différent. Jusqu'à présent seuls les interprofessions des vins des Côtes-du-Rhône et de Bordeaux ont conclu un tel accord qui a été étendu. Il semble que ce délai de 75 jours soit très loin d'être respecté notamment en Champagne, en Alsace et en Bourgogne. La commission de la production et des échanges ayant confié à M. François Patriat une mission d'information sur l'économie de la filière viticole, votre rapporteur lui a demandé d'enquêter sur ce sujet.
On trouvera en annexe du rapport le texte de la note de service n° 5955 du 5 août 1993 du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes précisant la portée de ces nouvelles dispositions de l'article 35 de l'ordonnance. Contrairement à l'indication du dernier paragraphe du point 4.3.3.1 de la note, aucune mesure législative n'a corrigé le retrait des vins doux naturels et des vins de liqueur du champ d'application de l'article 403 du code général des impôts.
L'efficacité de cet article 35 de l'ordonnance a conduit les parlementaires à allonger la liste des produits dont le délai de paiement est plafonné par la loi :
- la loi n° 96-588 du 1er juillet 1996 relative à la loyauté et l'équilibre des relations commerciales a soumis au délai de paiement de 30 jours fin de décade les achats de viandes congelées ou surgelées et de poissons surgelés ;
- la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole a soumis à ce même délai les achats de plats cuisinés et de conserves fabriqués à partir de produits alimentaires périssables.
On ne compte pas le nombre d'amendements déposés et rejetés par le Sénat ou par l'Assemblée nationale... En fait, aujourd'hui la fixation d'un délai de paiement maximal par la loi ne cherche plus à rétablir la réalité économique des flux de trésorerie résultant de la rotation des stocks mais vise à rééquilibrer les relations commerciales entre les fournisseurs et les revendeurs.
Les contrôles de la DGCCRF montrent que les délais légaux prévus par l'article 35 de l'ordonnance sont respectés dans plus des trois quarts, voire 80 % des cas. Les cas d'infractions graves ne représentent que 3 % des contrôles.
3. La détermination des délais de paiement négociés contractuellement entre les entreprises conduit à des dérives
a) Le droit résulte de choix faits en 1992
A l'origine, l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ne contenait aucune disposition relative à la détermination des délais de paiement entre les partenaires commerciaux, hormis les deux cas visés à l'article 35 (achats de produits alimentaires périssables et de boissons alcooliques). Les partenaires convenaient donc librement du délai de règlement de leurs transactions commerciales ou des modalités de calcul de celui-ci.
En raison de la dérive croissante des délais de paiement convenus et surtout des délais de paiement effectifs, qui traduisait une généralisation des retards de paiement, le législateur est intervenu par la loi n° 92-1442 du 31 décembre 1992 relative aux délais de paiement entre les entreprises afin de modifier, entre autres, les articles 31 et 33 de l'ordonnance du 1er décembre 1986. Le dispositif finalement retenu pour la rédaction de ces articles résulte d'amendements votés par la majorité sénatoriale en nouvelle lecture et imposés à l'Assemblée nationale en lecture définitive, contre l'avis unanime des groupes politiques de l'Assemblée par vote bloqué, sur décision de M. Pierre Bérégovoy, Premier ministre. Les termes du débat parlementaire de l'automne 1992 posaient clairement les données du problème :
- l'Assemblée nationale, répétons-le à l'unanimité (voir le compte rendu des débats du 17 décembre 1992), souhaitait que « la facture mentionne également la date du règlement résultant des conditions de vente prévues à l'article 33 » et « précise les conditions d'escompte applicables en cas de paiement anticipé » (modifications de l'article 31 de l'ordonnance) ;
- le Sénat voulait seulement que « la facture mentionne également la date à laquelle le règlement doit intervenir » et « précise les conditions d'escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l'application des conditions générales de vente » (souhaitant faire un pas dans le sens de la position de l'Assemblée nationale, le Sénat ne s'était pas, en nouvelle lecture, référé à un « paiement anticipé » comme il l'avait fait en deuxième lecture, mais à une date calculée à partir des conditions générales de vente) ;
- l'Assemblée nationale souhaitait que les conditions de règlement précisent « les modalités de calcul et les conditions dans lesquelles des pénalités sont appliquées lorsque le versement des sommes dues intervient après la date de règlement visée à l'article 31 » (modifications de l'article 33) ;
- le Sénat voulait que ces pénalités fussent « appliquées dans le cas où les sommes dues sont versées après la date de paiement figurant sur la facture, lorsque le versement intervient au-delà du délai fixé par les conditions générales de vente » (là encore la référence aux conditions générales de vente était une amorce de compromis avec la position de l'Assemblée nationale).
En résumé, les députés jugeaient que la maîtrise des délais de paiement exigeait que les dates de règlement résultent d'une application des conditions de règlement figurant dans les conditions générales de vente ; les fournisseurs avaient donc la maîtrise des délais de paiement, sachant que si leurs conditions de règlement étaient excessives ils perdraient des clients et que dans plusieurs secteurs d'activité il n'existe pas de tels documents directeurs de la négociation commerciale. Les sénateurs estimaient, eux, que le délai de paiement devait conserver sa nature purement contractuelle et que les partenaires devaient pouvoir définir librement et bilatéralement les dates de règlement d'une transaction commerciale ; la loi ne devait intervenir que pour sanctionner les retards de paiement (sur ce point les deux assemblées étaient d'accord pour appliquer des pénalités pour retard de paiement d'un montant au moins équivalent à l'application d'une fois et demie le taux de l'intérêt légal). C'est la position du Sénat qui a finalement été adoptée.
Ces dispositions des articles 31 et 33 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 n'ont pas été modifiées depuis la promulgation de la loi du 31 décembre 1992. On se reportera à la note de service n° 5955 du 5 août 1993 du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, reproduite en annexe du rapport, pour l'analyse des dispositions de l'ordonnance (points 1, 2 et 3 de la note de service).
La loi n° 96-588 du 1er juillet 1996 relative à la loyauté et l'équilibre des relations commerciales a simplement complété le 4ème alinéa de l'article 31 de l'ordonnance afin de préciser que « le règlement est réputé réalisé à la date à laquelle les fonds sont mis, par le client, à la disposition du bénéficiaire ou de son subrogé. » Cette disposition a été analysée au paragraphe 1 ci-dessus relatif au règlement des factures.
b) Les délais de paiement diminuent globalement mais les dérives s'accentuent
Les statistiques et enquêtes de la Banque de France, de l'Observatoire des délais de paiement et des diverses institutions spécialisées montrent que les délais de paiement effectifs moyens diminuent en France depuis 1991 ou 1993. Cependant, le délai de deux mois actuel n'est qu'une moyenne incluant les achats de produits dont le paiement est réglementé par l'article 35 de l'ordonnance du 1er décembre 1986. Dans les secteurs des produits non alimentaires, plusieurs témoignages de fournisseurs de la grande distribution indiquent que les délais de paiement se dégradent : ainsi un chef d'entreprise fournisseur de biens d'équipement de la maison a vu ses délais de paiement passer de 108 jours en 1996 à 149 jours en 1998 et 179 jours en 1999.
La mission d'information estime que les délais de paiement ne devraient pas dépasser, en France, 60 jours, hors les cas spécifiques visés à l'article 35 de l'ordonnance ou les activités économiques fonctionnant avec une rotation des stocks très lente. Il serait, en outre, utile de transposer, sans attendre, le principe fixé dans la proposition de directive de la Commission européenne sur les délais de paiement, en discussion devant le Parlement européen, selon lequel, en l'absence de disposition contractuelle écrite ou d'indication des conditions générales de vente sur le délai de règlement à tenir, un délai de paiement de 30 jours est présumé convenu par les parties. Ce délai est calculé à partir du jour suivant la date de réception de la facture par le débiteur ou, en l'absence de facture, de la date de livraison des produits. Mais, en règle générale, en France, le contrat ou, à défaut, les conditions générales de vente mentionnent toujours une date de règlement ou un délai de paiement.
La proposition de directive contenait, en outre, dans sa version d'octobre 1998, une disposition répondant à certains dysfonctionnements constatés dans les relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs en France. Elle prévoyait que si le délai de paiement prévu dans le contrat de vente était supérieur à 45 jours à compter de la date de réception de la facture, l'acheteur devait fournir, à ses frais, une lettre de change à son fournisseur précisant explicitement la date de son paiement et devant être garantie par un établissement de crédit reconnu.
La mission d'information estime cette mesure très utile ; elle devrait être inscrite dans la loi (l'ordonnance du 1er décembre 1986 si l'on souhaite sanctionner pénalement son non-respect, ou, à défaut, le code civil), même si la version définitivement adoptée de la directive ne la contient plus (le conseil des ministres a souhaité l'écarter pour parvenir à un accord sur l'ensemble du texte, mais le Parlement européen y semble attaché).
La mission d'information a en effet constaté que les distributeurs débiteurs n'adressaient pas toujours de traite, ce qui plaçait le créancier dans l'impossibilité d'escompter la créance. En outre, les distributeurs ont souvent mis en place des services d'affacturage permettant aux fournisseurs de recevoir un effet de commerce escomptable et être payés, ce service étant bien entendu payant (voir ci-dessus les développements sur le règlement des factures).
La mission d'information souligne qu'il est indispensable que ce dispositif de communication d'une lettre de change ou d'un quelconque effet de commerce soit d'application automatique : sa présentation ne doit pas s'effectuer sur la demande du créancier sinon aucun fournisseur n'osera faire cette démarche auprès de son client. L'intervention d'un tiers, un établissement financier garantissant le recouvrement dans le délai indiqué par l'effet de commerce, est également fondamentale pour assurer l'efficacité du dispositif. En dernier lieu, si la date de paiement de l'effet de commerce dépasse le délai contractuel convenu, l'application des pénalités de retard prévues par le 3ème alinéa de l'article 33 de l'ordonnance (montant au moins égal à une fois et demie le taux de l'intérêt légal) doit être automatique et exécutée par l'établissement financier.
E.- LE DOUBLE AFFICHAGE DES PRIX NE RÉSOUD PAS LES PROBLÈMES
Jusqu'à l'adoption de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole, la réglementation de l'affichage des prix relevait exclusivement d'un souci de protection du consommateur et elle figurait entièrement dans des décrets, arrêtés et circulaires. Seule l'obligation générale d'information du consommateur sur les prix était inscrite dans un texte de loi : l'article L. 113-3 du code de la consommation (qui a codifié l'ancien article 28 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence) qui dispose que :
« Tout vendeur de produit ou tout prestataire de service doit, par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, informer le consommateur sur les prix, les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle et les conditions particulières de la vente, selon les modalités fixées par arrêtés du ministre chargé de l'économie, après consultation du Conseil national de la consommation.
« Cette disposition s'applique à toutes les activités visées au dernier alinéa de l'article L. 113-2 [activités de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques, notamment dans le cadre de conventions de délégation de service public]. »
Les litiges les plus fréquents soulevés par cette réglementation sont liés ou bien à l'usage des codes barres dont la programmation du prix peut différer de l'affichage en rayon ou des affichages publicitaires, ou bien à l'affichage des prix de produits soldés et les annonces de rabais, qui ne font pas apparaître le prix pratiqué avant les soldes ou les rabais.
Au regard de l'échéance de 2002, les enseignes de la grande distribution mènent une politique dynamique d'accoutumance à l'affichage des prix en euro. Les entreprises du commerce anticipent correctement la phase actuelle de transition. L'intervention des pouvoirs publics n'apparaît pas nécessaire.
Une nouvelle problématique a surgi avec la chute des cours des fruits et légumes frais en 1998 et au début de l'été 1999 et les accusations sur les pressions insupportables à la baisse des prix des grandes surfaces. Sur la proposition de M. Félix Leyzour, député des Côtes-d'Armor, un alinéa a été inséré dans l'article 71 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole afin de permettre au ministre de l'agriculture d'imposer un « double affichage des prix » en cas de crise conjoncturelle :
« En prévision de ces crises conjoncturelles, le ministère de l'agriculture et de la pêche, sur proposition des organisations syndicales ou de consommateurs et en concertation avec l'Observatoire des prix, peut rendre obligatoire l'affichage du prix d'achat au producteur et du prix de vente au consommateur sur les lieux de vente. »
Cette disposition a reçu une application par trois arrêtés du 13 août 1999 du ministre de l'agriculture et de la pêche instaurant l'affichage simultané du prix d'achat au producteur et du prix de vente au consommateur pour les pommes (du 14 août au 13 octobre 1999), les raisins de table (du 14 août au 13 octobre 1999) et les tomates et concombres (du 14 août au 13 novembre 1999). Ces arrêtés définissaient ainsi le prix d'achat (au kilogramme) au producteur :
« le prix d'achat au producteur est, pour un jour, une origine nationale, une catégorie de qualité et un calibre donnés, le prix net moyen payé au producteur pour l'achat du lot commercialisé de l'origine concernée, déduction faite des coûts de conditionnement et des ristournes éventuelles consenties par le producteur et figurant sur la facture ou les documents commerciaux établis par le premier metteur en marché de la marchandise.
« A défaut, en ce qui concerne les produits importés, le prix d'achat au producteur est, pour un jour, une catégorie de qualité et un calibre donnés, la cotation du produit commercialisé de l'origine concernée, établie par le service des nouvelles des marchés du ministère de l'agriculture et de la pêche le jour d'achat de ce produit par le vendeur au détail. »
Dans les faits, il n'y a pas eu double mais souvent triple affichage des prix sur les lieux de vente qui ont respecté cette réglementation. En effet, toutes les enseignes de grande distribution ont ajouté une information sur le prix intermédiaire d'achat des produits par le magasin, afin de ne pas laisser penser que la différence entre le prix d'achat au producteur et celui de vente au consommateur formait la marge brute du distributeur.
Les enquêtes d'opinion ont montré l'absence d'impact de cette mesure d'information, à laquelle se sont pourtant pliées toutes les grandes surfaces de vente montrées du doigt par les producteurs. Une fois la curiosité passée, les consommateurs s'en sont désintéressés.
En outre, il faut souligner que la quasi totalité des petits commerces traditionnels ne se sont pas pliés à ce double affichage. Or la grande distribution ne commercialisent qu'environ 40 % des fruits et légumes frais en France.
Pour le petit commerçant, cette mesure était inapplicable car le grossiste ou la centrale d'achat qui l'approvisionne est dans l'incapacité de lui indiquer la provenance exacte des produits livrés et donc leur prix d'achat au producteur. En outre, de nombreux commerçants ont fait savoir que ce double affichage aurait montré un écart de prix très nettement supérieur dans le commerce traditionnel par rapport aux grandes surfaces, ce qui n'aurait pas servi ceux-là même dont le circuit de commercialisation soutient les prix d'achat aux producteurs.
En conclusion, la transparence recherchée par le double affichage des prix n'est pas une solution permettant de contribuer au règlement du problème réel des prix abusivement bas d'acquisition des produits frais par la distribution. Les organisations de consommateurs y ont vu un surcroît de confusion pour le consommateur et les organisation agricoles, pourtant demandeuses comme la FNSEA, une mesure artificielle.
Cependant, la mission d'information estime que cette mesure a permis d'engager le dialogue entre les producteurs et les différents stades de la filière de commercialisation et d'apaiser certains conflits locaux, des fournisseurs livrant les supermarchés locaux pouvant constater les écarts de prix sur leurs produits. Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat aux PME, au commerce et à l'artisanat, a exprimé le souhait que cette disposition soit maintenue dans l'ordonnancement législatif car elle peut être un moyen d'assurer une transparence des prix utile pour certaines filières en période de crise. Cette situation reste cependant marginale au regard de l'ampleur du phénomène observé l'été dernier. Tout porte à croire que l'absence d'initiative concrète des partenaires économiques et des organisations professionnelles et syndicales depuis l'automne ne laisse rien augurer de bon pour les campagnes de l'année 2000. Il est impératif que des mesures structurelles préventives soient prises au printemps au plus tard.
De ce point de vue, la mission d'information invite le Gouvernement à ne pas hésiter à faire application des dispositions de l'article 1er de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 habilitant le Premier ministre à prendre, en cas de baisse excessive des prix, un décret en Conseil d'Etat, après consultation du Conseil national de la consommation, pour arrêter des mesures temporaires motivées par une situation de crise ou une situation manifestement anormale du marché. Des mesures de limitation de la chute des cours au départ de la production pendant deux ou trois mois peuvent suffire pour éradiquer des crises conjoncturelles aux répercussions graves et éviter de recourir à un versement de subventions par l'Etat pour soutenir les producteurs en difficulté.
Article 28 de
l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 « Toute publicité à l'égard du consommateur, diffusée sur tout support ou visible de l'extérieur du lieu de vente, mentionnant une réduction de prix ou un prix promotionnel sur les produits alimentaires périssables doit préciser la nature et l'origine du ou des produits offerts et la période pendant laquelle est maintenue l'offre proposée par l'annonceur. « Toute infraction aux dispositions du premier alinéa est punie d'une amende de 100 000 F. « Lorsque de telles opérations promotionnelles sont susceptibles, par leur ampleur ou leur fréquence, de désorganiser les marchés, un arrêté interministériel ou, à défaut, préfectoral fixe, pour les produits concernés, la périodicité et la durée de telles opérations. « La cessation de la publicité réalisée dans des conditions non conformes aux dispositions du présent article peut être ordonnée dans les conditions prévues à l'article L. 121-3 du code de la consommation. » |
L'article 28 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 avait été abrogé par la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993 et ses dispositions, qui sont relatives à l'information du consommateur sur les prix, aux limites de la responsabilité contractuelle et aux conditions particulières de vente, ont été reprises dans le code de la consommation sous l'article L. 113-3.
L'article 28 de l'ordonnance introduit par la loi du 1er juillet 1996 vise à encadrer les promotions des produits alimentaires périssables qui en certaines circonstances peuvent gravement déstabiliser toute une filière agricole. Les producteurs peuvent en effet subir des préjudices irréparables lorsqu'ils sont confrontés à des ventes de produits à prix cassés en début de saison : l'arrivée des premières récoltes, traditionnellement plus chères, est compromise et les produits perdus faute d'acquéreur, ensuite les prix de l'ensemble de la saison sont souvent irrémédiablement tirés vers le bas de manière artificielle.
a) L'information du consommateur est améliorée
Le nouvel article 28 édicté par la loi n° 96-588 du 1er juillet 1996 améliore, en premier lieu, l'information du consommateur lorsqu'une publicité mentionne une réduction de prix ou un prix promotionnel sur des produits alimentaires périssables.
Par consommateur, il faut entendre la personne qui utilise les produits à des fins qui ne sont pas professionnelles. Une liste des produits alimentaires périssables peut être établie à partir de la liste des produits périssables fixée par la circulaire Scrivener du 10 janvier 1978 pour la détermination des dérogations à l'interdiction de revendre à perte :
« Viandes et abats comestibles frais ou réfrigérés.
« Jambon et épaule cuits, produits de charcuterie fraîche.
« Volailles et leurs abats comestibles, lapins domestiques et gibiers, réfrigérés ou frais.
« Poissons, coquillages, crustacés et mollusques, frais ou réfrigérés.
« Laits crus et pasteurisés. Laits stérilisés.
« Produits laitiers frais tels que :
- Yaourts, desserts (laits gélifiés) ;
- Crème fraîche ;
- Fromages frais ;
- Fromage à pâte molle ou à pâte pressée, cuite ou non, fromage à pâte persillée ;
- Beurre frais.
« Glaces, sorbets, crèmes glacées.
« _ufs frais ou réfrigérés.
« Légumes et plantes potagères à l'état frais ou réfrigérés.
« Fruits frais ou réfrigérés. Pain frais, produits frais de boulangerie, viennoiserie et pâtisserie fraîche.
« Levure de panification.
« (Plantes vivantes et produits de la floriculture.
« Fleurs et boutons de fleurs coupés frais). »
N'entrent pas dans ces exceptions, les conserves et semi-conserves et les produits congelés ou surgelés.
La notion de publicité est prise dans son sens le plus large : c'est l'existence d'un message à destination d'un client potentiel qui est visé.
La publicité doit contenir les trois informations suivantes :
- la nature du ou des produits offerts ;
- l'origine du ou des produits offerts : il s'agit de l'indication du lieu de création du produit. L'arrêt du 25 avril 1985 par lequel la Cour de justice des Communautés européennes a condamné le Royaume-Uni pour entrave à la libre circulation des marchandises contraire à l'article 30 du traité de Rome, a précisé qu'un Etat membre ne pouvait pas imposer le marquage d'origine sur des produits ou sur leur point de vente sauf dans le but de protéger le consommateur, notamment pour éviter une confusion sur la provenance des produits (mais les producteurs sont libres de le faire figurer sur leurs produits).
En la matière, il ne s'agit pas d'une obligation générale mais seulement d'une obligation portant sur le contenu d'un message publicitaire particulier : celui mentionnant une réduction de prix ou un prix promotionnel.
Cette disposition est intéressante car elle doit apaiser les consommateurs et producteurs français de viande bovine qui craindraient que, sous couvert d'une opération promotionnelle avantageuse, des stocks de viande anglaise soient écoulés dans les grandes surfaces en France.
- la période pendant laquelle est maintenue l'offre : l'obligation ne porte pas sur l'indication de la durée mais sur la mention de dates.
b) Des arrêtés pourront limiter les promotions déstabilisatrices
L'article 28 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 autorise, en second lieu, les pouvoirs publics à limiter les offres de réduction de prix ou de prix promotionnel portant sur les produits alimentaires périssables (3ème et dernier alinéas de l'article).
La limitation peut porter sur la périodicité et la durée des opérations de promotion. L'encadrement est défini par produit. Il est décidé, en principe, par arrêté interministériel. Il devrait s'agir d'une décision collective des ministres chargés de l'économie ou des finances, du commerce et de l'agriculture. Cependant, en l'absence d'un tel arrêté, chaque préfet peut, dans les limites de son département, prendre un arrêté fixant un tel encadrement.
La décision de réglementation ne peut être prise qu'au motif que ces « opérations promotionnelles sont susceptibles, par leur ampleur ou leur fréquence, de désorganiser les marchés ». Les mesures peuvent donc être préventives et les ministres ou les préfets ne sont pas contraints d'attendre de constater des effets négatifs de telles opérations pour agir. Cependant, la loi a clairement confié à ces autorités un pouvoir conditionné et non un pouvoir discrétionnaire.
Par ailleurs, dans les cas où une publicité ne contiendrait pas les éléments d'information requis par l'article 28 de l'ordonnance ou ne respecterait pas les limitations fixées par arrêté interministériel ou préfectoral, une décision de justice pourrait ordonner sa cessation conformément à l'article L. 121-3 du code de la consommation (7).
Le décret n° 97-538 du 26 mai 1997 a inséré un article 33-1 dans le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 fixant les conditions d'application de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 afin de punir d'une contravention de 5ème classe les infractions aux dispositions de ce troisième alinéa de l'article 28 de l'ordonnance.
L'encadrement mis en place a un but avant tout préventif. Mais en cas de préjudice, le dispositif est conçu de manière à permettre l'action la plus rapide possible des pouvoirs publics. Si les campagnes publicitaires pour les produits alimentaires périssables sont aujourd'hui de plus en plus nationales en raison de l'intégration des chaînes de distribution, le législateur de 1996 a souhaité habiliter les préfets, qui sont sur le terrain, proches des commerçants et dont les décisions peuvent être prises très rapidement, à décider une limitation des opérations promotionnelles. Si un arrêté interministériel devait être pris ultérieurement en raison de l'ampleur nationale de la campagne et de ses effets néfastes pour les marchés, il se substituerait automatiquement à tous les arrêtés préfectoraux déjà publiés.
Ces nouvelles dispositions des 3ème et dernier alinéas de l'article 28 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 n'ont pas, à ce jour, donné lieu à application.
2. Il n'y a pas eu application de ces dispositions jusqu'à présent
Les conditions de diffusion publicitaire d'une réduction de prix à l'extérieur du magasin sont correctement respectées par la grande distribution. Les dispositions du premier alinéa de l'article 28 n'ont pas donné lieu à des sanctions pénales ; seules trois décisions de tribunaux correctionnels ont en fait été prises sur le fondement de l'article 28 de l'ordonnance. Selon les informations fournies, la bonne application des dispositions de l'article 28 est systématiquement vérifiée à l'occasion des contrôles effectués par les services de la DGCCRF sur les points de vente au détail.
En 1998, la DGCCRF n'a reçu qu'une plainte portant sur une publicité extérieure à un magasin n'indiquant pas quelle était l'origine du gruyère dont elle faisait état ; un procès-verbal a été dressé. Aucune plainte n'a en revanche été reçue s'agissant des fruits et légumes ou des viandes.
Par ailleurs, ni le Gouvernement ni aucun préfet n'a utilisé les possibilités ouvertes par le 3ème alinéa de l'article 28 de l'ordonnance. Il est apparu que les opérations promotionnelles, qui pouvaient avoir une grande ampleur, étaient en fait ponctuelles, les ventes des fruits et légumes frais portant notamment, pour la plupart, sur des périodes restreintes. Les préfets n'étaient pas en mesure d'intervenir. Le Gouvernement a, cet été 1999, de son côté, été saisi du problème de la chute des cours des fruits et légumes après les opérations promotionnelles qui avaient eu lieu en début de campagne dès juin. Une fois les arrêtés sur le double affichage publiés, on a d'ailleurs constaté qu'aucune promotion prédatrice n'avait été lancée sur les produits concernés. Mais l'efficacité de la disposition législative exigerait que le Gouvernement intervienne dès les premiers jours de la campagne d'un produit frais afin de limiter les perturbations du marché en restreignant la durée des opérations promotionnelles. En effet, ces premières promotions donnent au marché et aux consommateurs une sorte de prix de référence du produit frais concerné, qui ne correspond pas à l'équilibre économique du marché mais l'oriente pour toute la campagne de vente.
Article 28 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 I. - Sont considérées comme soldes les ventes accompagnées ou précédées de publicité et annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l'écoulement accéléré de marchandises en stock. Ces ventes ne peuvent être réalisées qu'au cours de deux périodes par année civile d'une durée maximale de six semaines dont les dates sont fixées dans chaque département par le préfet selon des modalités fixées par le décret prévu à l'article 32 et ne peuvent porter que sur des marchandises proposées à la vente et payées depuis au moins un mois à la date de début de la période de soldes considérée. II. - Dans toute publicité, enseigne, dénomination sociale ou nom commercial, l'emploi du mot : « solde(s) » ou de ses dérivés est interdit pour désigner toute activité, dénomination sociale ou nom commercial, enseigne ou qualité qui ne se rapporte pas à une opération de soldes telle que définie au I ci-dessus. Article 29 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 Des décret pris en Conseil d'Etat fixent les secteurs dans lesquels les annonces, quel qu'en soit le support, de réduction de prix aux consommateurs ne peuvent s'exprimer en pourcentage ou par la mention du prix antérieurement pratiqué, et la durée ou les conditions de cette interdiction. |
L'article 28 de la loi n° 96-603 a modifié le régime des soldes qui était antérieurement très complexe, la loi du 30 décembre 1906 sur les ventes au déballage ayant été modifiée par la loi n° 91-593 du 29 juin 1991 dans des conditions conduisant à distinguer trois types de soldes :
- les soldes occasionnels, soumis à autorisation du maire et correspondant aux ventes présentant un caractère réellement ou apparemment occasionnel, accompagnés ou précédés de publicité et annoncés comme tendant à l'écoulement accéléré de tout ou partie d'un stock de marchandises, conformément à l'article 2 du décret n° 62-1463 du 26 novembre 1962. Ces soldes étaient tombés en désuétude ;
- les soldes périodiques ou saisonniers, non soumis à autorisation, et pouvant avoir lieu deux fois par an au plus pour des périodes ne pouvant excéder chacune deux mois, et dont les dates de début sont fixées par le préfet de département, par référence aux usages.
L'article 2 du décret de 1962 précité précisait en outre qu'ils concernaient des marchandises démodées, défraîchies, dépareillées ou de fin de série, vendues en fin de saison, ne constituant qu'une partie du stock et dont la cession était effectuée dans le local où le commerce était habituellement exercé. Ces soldes pouvaient être ou non précédés ou accompagnés de publicité ;
- les soldes permanents, qui ne sont pas eux non plus soumis à autorisation du maire, correspondant aux ventes effectuées par les commerçants faisant profession de revendre des marchandises neuves dépareillées, défraîchies, démodées ou de deuxième choix.
Une clarification s'imposait d'autant plus que les soldes occasionnels étaient devenus inusuels et que l'article 1er bis de la loi de 1906, inséré par la loi n° 91-593 du 25 juin 1991 précitée, interdisait l'utilisation abusive du mot « solde(s) » et de ses dérivés pour des opérations ne relevant pas des catégories évoquées. La sanction prévue à l'article 2, d'une amende de 25 000 F, était lourde, l'infraction étant constitutive d'un délit. En outre, les marchandises mises en vente pouvaient être confisquées.
L'article 28 loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat procède à une simplification, supprimant les soldes occasionnels et la notion de soldes permanents. Seuls les soldes saisonniers sont clairement maintenus dans la notion de soldes.
1. Le paragraphe I de l'article 28 définit les soldes comme les ventes accompagnées ou précédées de publicité et annoncées comme tendant à l'écoulement accéléré des marchandises en stock, par une réduction de prix. Trois critères sont donc retenus :
- l'organisation d'une publicité ;
- la réduction du prix ;
- l'écoulement accéléré de marchandises en stock.
La définition retenue est plus large s'agissant des marchandises vendues. Toute référence à des marchandises éventuellement « passées » disparaît. Par ailleurs, le critère de la publicité, actuellement absent de la définition des soldes périodiques, est introduit.
Le deuxième alinéa précise que les soldes ne peuvent être réalisés qu'au cours de deux périodes par année civile, d'une durée maximale de six semaines et dont les dates seront fixées par le préfet. Il s'agit là d'une réduction des périodes par rapport au régime antérieur des deux fois deux mois. Pour justifier cette réduction, il a été avancé que la fidélisation des consommateurs aux opérations de soldes engendre un phénomène d'attentisme contribuant à faire baisser, au moins partiellement, la marge bénéficiaire des commerçants.
La référence à l'année civile pour apprécier le respect des deux périodes de six semaines vise à éviter l'enchaînement sans interruption des deux périodes de fortes ventes que sont celle qui précède les fêtes de Noël et du Nouvel An et celle qui correspond à l'écoulement accéléré des marchandises d'hiver. Le secteur le plus sensible est à cet égard celui du textile et de l'habillement. Si aucune référence à l'année civile n'avait été faite, on aurait pu envisager d'autoriser le début des soldes d'hiver avant le ler janvier de l'année, c'est-à-dire dès le lendemain de Noël.
En outre, les dates des soldes étant fixées dans chaque département, la loi évite au maximum le risque des distorsions de concurrence qui ne manqueraient pas de se produire en cas de décalage trop important entre les départements voisins partageant des mêmes zones de chalandise.
Enfin, l'article 28 de la loi n° 96-603 prévoit que les marchandises devront être proposées à la vente et payées depuis au moins un mois, à la date de début de la période de soldes considérée, pour pouvoir être proposées. L'objectif poursuivi est de lutter contre les faux soldes saisonniers qui seraient assez courants. Une lecture attentive de ces dispositions montre clairement que la notion de soldes doit se réduire aux soldes saisonniers, et que les ventes permanentes de marchandises « passées » ne pourront plus prétendre à cette appellation.
Ces dispositions ont été précisées par le décret n° 96-1097 du 16 décembre 1996. Il prévoit notamment la consultation, chaque année, par le préfet, des organisations professionnelles concernées représentées dans le département, des chambres consulaires du département et du comité départemental de la consommation. En outre, doivent être tenus à la disposition des agents de l'administration des documents justifiant que les marchandises vendues en soldes ont été proposées à la vente, et que leur prix d'achat a été payé, depuis au moins un mois avant le début des soldes. Toute publicité ne mentionnant pas la date du début de l'opération et la nature des marchandises soldées (lorsque les soldes ne portent pas sur la totalité du magasin) est punie d'une contravention de 5ème classe.
Une circulaire du 16 janvier 1997 a commenté l'ensemble de la réglementation.
2. Le paragraphe II de l'article 28 maintient l'interdiction d'utiliser le mot « solde(s) » ou ses dérivés pour des opérations qui n'en relèveraient pas. Cette interdiction ne tend à protéger dorénavant que les seuls soldes périodiques ou saisonniers.
3. L'article 29 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 a modifié la réglementation applicable aux annonces de réductions de prix qui reposait notamment sur l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973 sur l'orientation du commerce et de l'artisanat et l'arrêté 77-105 P du 2 septembre 1977 relatif à la publicité des prix à l'égard du consommateur.
Sur ces fondements, toute annonce de réduction de prix doit respecter les obligations applicables à toute publicité comportant l'indication d'un prix. Ces règles sont les suivantes :
- indication de la somme effectivement payée par l'acheteur pour le produit concerné ;
- disponibilité des produits pendant la période à laquelle se rapporte la publicité ;
- interdiction d'indiquer des réductions de prix qui ne seront pas effectivement accordées.
En outre, certaines mentions doivent être indiquées dans la publicité :
- à l'intérieur des magasins : elle doit mentionner le prix réduit annoncé, le prix de référence défini comme le prix le plus bas effectivement pratiqué par l'annonceur au cours des trente derniers jours précédant le début de la publicité ;
- à l'extérieur des lieux de ventes : toute publicité comportant une annonce de réduction de prix doit préciser l'importance de la réduction, soit en valeur absolue, soit en pourcentage, par rapport à un prix de référence, ainsi que les produits ou services concernés.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux réductions de prix ne concernant qu'une partie de la clientèle, notamment pour ce qui concerne les annonces de réduction de prix non chiffrées. Par conséquent, aucune disposition n'interdisait à un commerçant de consentir des rabais à ses clients, dès lors que ces annonces de rabais n'aboutissaient pas à une publicité mensongère.
L'article 29 de la loi n° 96-603 limite de façon beaucoup plus rigoureuse les annonces de réduction de prix en confiant au Gouvernement le soin d'interdire, pour une durée limitée, les annonces chiffrées de réduction de prix. Des décrets pris en Conseil d'Etat devront fixer les secteurs dans lesquels les annonces de réduction de prix aux consommateurs ne pourront s'exprimer en pourcentage ou par la mention du prix antérieurement pratiqué. Il devra également déterminer la durée ou les conditions de cette interdiction. Pourraient être visées, dans un premier temps au moins, les ventes de bijoux, de cuisines et de fourrures.
La loi n° 96-603 a considéré que certains secteurs d'activité commerciale étaient particulièrement exposés aux pratiques de quelques commerçants qui, par des annonces de réduction de prix tapageuses, concourent à la désorganisation du marché, à la fragilisation des entreprises concernées et à tromper le consommateur. Le législateur a jugé qu'en vidant l'annonce d'un contenu chiffré, ceci permettrait d'appeler l'attention du consommateur sur les secteurs affectés par des politiques promotionnelles trop souvent suicidaires.
La mission déplore qu'aucun décret en Conseil d'Etat n'ait été adopté.
2. La persistance d'une concurrence déloyale par des pratiques d'offres de prix réduits ou soldés
La loi donne une définition précise des soldes. Mais aux soldes s'ajoute la multiplication des opérations commerciales telles que les liquidations, les réductions de prix, les promotions à l'occasion d'anniversaires, de quinzaines, le développement des magasins ou dépôts d'usine. Toutes ces opérations commerciales ont pour conséquence de masquer le véritable prix et d'accroître la pression sur les fournisseurs. Elles créent des distorsions de concurrence supplémentaires entre la grande distribution et le commerce traditionnel qui ne bénéficient pas des mêmes moyens de communication. Par facilité ces opérations sont focalisées sur la réduction des prix mais d'autres formules promotionnelles pourraient être développées : quinzaine des provinces, quinzaine de la qualité, quinzaine d'information des consommateurs. L'imagination pourrait alors prendre le pouvoir en cherchant à orienter l'acte d'achat vers d'autres critères que celui du prix le plus bas !
Il convient, sans remettre en cause les soldes, les réductions de prix ou les liquidations, de mieux encadrer et limiter dans le temps leur usage. Le secrétariat d'Etat aux PME, au commerce et à l'artisanat vient de faire un pas en ce sens en recommandant aux préfets de fixer une date identique sur tout le territoire national à partir du 15 janvier 2000. Ceci permettra de séparer les achats traditionnels de fin d'année et les achats d'opportunité liés aux soldes. Les enseignements à tirer de cette recommandation seront intéressants pour l'avenir.
Cependant, d'ores et déjà, il faut faire valoir que toutes les grandes surfaces de vente ont mis en place des actions promotionnelles sur la première quinzaine du mois de janvier. Ces promotions visent à capter les dépenses que les consommateurs consacrent aux soldes. Les petits commerces de centre ville subissent durement cette concurrence nouvelle et opportuniste.
On peut recommander d'autres mesures comme le paiement des marchandises soldées 2 ou 3 mois avant la date de début des soldes au lieu d'un mois actuellement, ou encore la limitation des réductions de prix en pourcentage, le montant élevé de la réduction abusant souvent le consommateur. Une clarification du régime des soldes et des promotions s'impose. Un bilan de l'application de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 sur les liquidations devrait être établi pour éviter les dérives. La prolifération des magasins ou dépôts d'usine laisse également supposer une utilisation abusive de ce terme, comme cela sera analysé au dernier chapitre de la partie V du rapport.
Rendre plus transparentes les conditions d'achat et de vente est l'un des objectifs de la mission d'information. La dérive actuelle sous toutes ces formes des ventes au rabais doit inciter les pouvoirs publics à les recentrer sur leur vocation initiale d'écoulement de stocks invendus. Le parallèle pourrait être fait avec les fruits hors saison qui ont finalement dévalorisé les fruits de saison.
IV.- L'APPLICATION DE LA LOI PAR L'ADMINISTRATION ET LES TRIBUNAUX
Comme il a été analysé précédemment, la mission d'information estime que la loi est relativement complète et permet de remédier à beaucoup de situations abusives ; elle nécessite cependant d'être précisée sur quelques points et complétée sur d'autres. Il est en effet apparu que l'application de la loi n'était pas satisfaisante. Une tâche fondamentale et prioritaire est de restaurer l'effectivité de la loi. Cette situation est largement due à un manque de moyens de droit dont disposent les victimes et l'administration et l'ignorance des pratiques abusives. Parfois, l'action administrative s'est révélée inadaptée à l'évolution des relations commerciales, mais ce manque d'effectivité de la loi est rarement imputable à un manque grave de moyens matériels et jamais à un manque de compétence des agents de l'administration ou à une incompréhension des situations.
La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) est née en 1985 (décret n° 85-1152 du 5 novembre 1985) de la fusion de la direction générale de la concurrence et de la consommation et de la direction de la consommation et de la répression des fraudes. L'institution de cette administration centrale remonte à la création, en 1907, du service de la répression des fraudes, chargé de veiller à l'hygiène alimentaire après la mise en application de la loi du 1er août 1905 « sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles ». Ce même service est à l'origine de la direction générale de l'alimentation du ministère de l'agriculture, qui est chargée de contrôler la conformité des produits agricoles et alimentaires.
ÉVOLUTION DES EFFECTIFS DE LA DGCCRF
| (au 1er janvier) | TOTAL |
En administration centrale |
Dans les directions départementales |
1996 |
4 125 |
503 |
3 273 |
1997 |
4 111 |
485 |
3 228 |
1998 |
4 072 |
460 |
3 139 |
1999 |
3 995 |
458 |
3 075 |
2000 (PLFI) |
3 691 |
n.d. |
101 directions départementales |
Nota : le total inclut les agents dans les centres de formation, les directions nationales d'enquête et les laboratoires.
Source : rapports annuels d'activité de la DGCCRF et projet de loi de finances pour 2000.
L'arrêté du 20 février 1998, publié au Journal officiel du 24 février, a réorganisé l'administration centrale de la DGCCRF. Il dispose que la direction générale est composée de deux services : « Le service de la régulation et de la sécurité est chargé de concevoir les politiques globales qui assurent un bon fonctionnement de l'économie, notamment des rapports équilibrés entre producteurs et distributeurs, entre professionnels et consommateurs et de veiller à leur mise en _uvre. Le service des produits et des marchés est chargé de concevoir les politiques sectorielles adaptées aux différentes activités économiques dans les domaines de compétence de la direction générale [produits agricoles et alimentaires, santé, biens intermédiaires et d'équipement, biens de consommation, réglementation du commerce et de l'artisanat, énergie et réseaux locaux, transports et communication, services financiers, professions organisées] et de veiller à leur mise en _uvre. »
La vaste étendue des attributions de la DGCCRF doit être préservée car elle lui permet d'avoir une vision d'ensemble du fonctionnement des marchés et des entreprises. Ainsi, le contrôle d'un établissement ou d'un marché ne nécessite pas l'intervention de plusieurs services relevant de différents ministères.
VÉRIFICATIONS MENÉES PAR LA DGCCRF
1996 |
1997 |
1998 |
11 premiers mois de 1999 |
|
| Concurrence | 54 055 |
71 272 |
57 346 |
59 752 |
| Consommation | 198 422 |
217 914 |
236 236 |
197 264 |
| Qualité | 241 597 |
262 035 |
268 489 |
236 093 |
| Sécurité | 157 728 |
168 109 |
186 979 |
178 535 |
| Actions économiques (aides aux entreprises, etc.) | 3 988 |
5 288 |
3 785 |
3 810 |
| TOTAL | 655 790 |
724 618 |
752 835 |
675 454 |
Le rapport d'activité de la DGCCRF pour 1998 a donné la décomposition suivante des actions de vérification en matière de concurrence et de prix :
- Règles de transparence (facturation, CGV, ...) : 20 337
- Pratiques commerciales déloyales (sanctions civiles) : 1 080
- Pratiques commerciales déloyales (sanctions pénales) : 11 300
- Ventes soumises à autorisation et paracommercialisme : 13 806
- Concentrations (titre V de l'ordonnance) : 34
- Pratiques anticoncurrentielles (titre III de l'ordonnance) : 4 239
- Secteurs soumis à réglementation particulière : 720
- Etudes sectorielles vers une profession : 597
- Prix et tarifs publics : 5 233
Chaque année, le ministre chargé de l'économie définit les priorités d'action de la DGCCRF. Aujourd'hui, elles sont au nombre de trois : le contrôle des marchés publics, l'effectivité des règles de concurrence, la sécurité sanitaire des produits (dans l'ordre donné par le directeur général lors de son audition). Les première et troisième priorités ont une dimension interministérielle alors que sur le deuxième point seule la DGCCRF effectue cette tâche au sein des administrations d'Etat. Le directeur général définit également un programme d'actions trimestrielles ; ainsi au deuxième trimestre 1999 ont été programmées une tâche spécifique en matière de fruits et légumes et deux tâches dans le domaine du textile.
Les directions départementales de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes disposent chacune d'au moins 13 agents ; dans les départements les plus importants elles comptent 70 à 80 fonctionnaires.
On se reportera au titre II du rapport (chapitre relatif à la coopération commerciale) pour l'étude du contrôle du respect des dispositions de l'article 33 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 par les fournisseurs et distributeurs. Les vérifications opérées par les services de la DGCCRF ne font apparaître qu'un taux de 3 à 4 % d'anomalie. Selon les services, les infractions réelles sont bien plus nombreuses, mais ce faible taux d'anomalie correspond aux cas d'infraction que la DGCCRF a pu démontrer. Or, il est extrêmement difficile pour les agents de l'administration de s'immiscer dans des relations commerciales entre deux partenaires qui veulent toujours les rendre les plus opaques possibles vis-à-vis de leurs concurrents. Les négociations commerciales sont par nature non transparentes et leurs termes ne sont jamais mutualisés, sauf dans le cas particulier des relations entre un distributeur et ses fabricants de marques propres où le distributeur demande le plus souvent à son fabricant de lui présenter ses livres de comptes. Il est donc difficile pour les fonctionnaires de la DGCCRF de démêler les fils de la coopération commerciale et de la discrimination tarifaire et des conditions de vente.
B.- LES POUVOIRS DES AGENTS DE L'ADMINISTRATION
Les pouvoirs d'enquête des agents de la DGCCRF sont définis aux articles 45 à 48 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence et aux articles 31 et 32 du décret d'application n° 86-1309 du 29 décembre 1986 pour ce qui concerne les relations commerciales entre les entreprises et aux articles L. 215-1 et R. 215-2 à R. 215-23 du code de la consommation pour ce qui concerne l'application des règles applicables à la consommation et la répression des fraudes.
Articles 45 à 48 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 Article 45 Des fonctionnaires habilités à cet effet par le ministre chargé de l'économie peuvent procéder aux enquêtes nécessaires à l'application de la présente ordonnance. Les rapporteurs du Conseil de la concurrence disposent des mêmes pouvoirs pour les affaires dont le conseil est saisi. Des fonctionnaires de catégorie A du ministère chargé de l'économie, spécialement habilités à cet effet par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la proposition du ministre chargé de l'économie, peuvent recevoir des juges d'instruction des commissions rogatoires. Article 46 Les enquêtes donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux et, le cas échéant, de rapports. Les procès-verbaux sont transmis à l'autorité compétente. Un double en est laissé aux parties intéressées. Ils font foi jusqu'à preuve contraire. Article 47 Les enquêteurs peuvent accéder à tous locaux, terrains ou moyen de transport à usage professionnel, demander la communication des livres, factures et tous autres documents professionnels et en prendre copie, recueillir sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications. Ils peuvent demander à l'autorité dont ils dépendent de désigner un expert pour procéder à toute expertise contradictoire nécessaire. Article 48 Les enquêteurs ne peuvent procéder aux visites en tous lieux, ainsi qu'à la saisie de documents, que dans le cadre d'enquêtes demandées par le ministre chargé de l'économie ou le Conseil de la concurrence et sur autorisation judiciaire donnée par ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter ou d'un juge délégué par lui. Lorsque ces lieux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu'une action simultanée doit être menée dans chacun d'eux, une ordonnance unique peut être délivrée par l'un des présidents compétents. Le juge doit vérifier que la demande d'autorisation qui lui est soumise est fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information de nature à justifier la visite. La visite et la saisie s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. Il désigne un ou plusieurs officiers de police judiciaire chargés d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement. Lorsqu'elles ont lieu en dehors du ressort de son tribunal de grande instance, il délivre une commission rogatoire pour exercer ce contrôle au président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel s'effectue la visite. Le juge peut se rendre dans les locaux pendant l'intervention. A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite. L'ordonnance mentionnée au premier alinéa du présent article n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Ce pourvoi n'est pas suspensif. La visite, qui ne peut commencer avant six heures ou après vingt et une heures, est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant. Les enquêteurs, l'occupant des lieux ou son représentant ainsi que l'officier de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie. Les inventaires et mises sous scellés sont réalisés conformément à l'article 56 du code de procédure pénale. Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont transmis au juge qui a ordonné la visite. Les pièces et documents qui ne sont plus utiles à la manifestation de la vérité sont restitués à l'occupant des lieux. |
La loi donne à la DGCCRF de larges pouvoirs d'enquête. La mission d'information estime que l'étendue de ces pouvoirs, exceptionnelle dans le droit français, doit être maintenue ; elle est la condition de l'efficacité de l'action de l'Etat en matière de concurrence et de consommation. Elle juge que l'étendue des prérogatives des agents de la DGCCRF est la condition d'une action efficace de l'administration. Nous tenons à faire savoir que ces agents n'abusent pas de leurs pouvoirs, ils ont une haute conscience de leurs responsabilités et le souci de l'intérêt général, et des consommateurs et des victimes en particulier. Par ailleurs, il faut rappeler que le Gouvernement et le Parlement s'attachent à simplifier les formalités administratives imposées aux entreprises.
Le principal obstacle auquel se heurtent les agents de la DGCCRF est la difficulté de réunir les preuves d'une pratique illicite. Il leur est en effet très difficile de détecter les factures délictueuses et surtout de mettre la main sur les contrats illicites, en raison, comme on l'a vu, de l'opacité sciemment organisée des relations commerciales entre fournisseurs et revendeurs. Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat aux PME, au commerce et à l'artisanat, a ainsi fait part de sa déception pour l'impossibilité dans laquelle se sont trouvés les agents de la DGCCRF, lors d'un contrôle qu'elle avait suivi sur Avignon l'été 1999, de saisir des contrats de coopération commerciale manifestement abusifs au vu des factures adressées. Les agents de la DGCCRF ont le pouvoir d'exiger la présentation des documents commerciaux, mais si le responsable de l'entreprise affirme qu'ils n'existent pas ou fournit des documents ne correspondant pas, les agents doivent demander au président du tribunal de grande instance de les autoriser à effectuer une perquisition, conformément aux termes de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 (voir le chapitre ci-après sur les procédures contentieuses). Or, le document nécessaire pour obtenir cette autorisation totalise jusqu'à cent pages si l'affaire est délicate, ce qui est quasiment toujours le cas dans les affaires de bâtiment et de travaux publics.
C.- LA PLACE DU CONSEIL DE LA CONCURRENCE
Le Conseil de la concurrence a été créé par l'article 2 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence. Cette autorité administrative indépendante a pour origine la commission technique des ententes et des positions dominantes créée en 1953. Cette instance avait pour fonction de rendre des avis sur les actions concertées et les abus de position dominante au ministre de l'économie et des finances. Elle ne disposait d'aucun pouvoir d'enquête propre.
La loi n° 77-806 du 19 juillet 1977 relative au contrôle de la concentration économique et à la répression des ententes illicites et des abus de position dominante a substitué à cette commission une Commission de la concurrence composée de onze personnes nommées par décret, son président ayant un mandat de six ans et les dix autres commissaires un mandat de quatre ans. Cette autorité administrative indépendante ne rendait que des avis sur les pratiques anticoncurrentielles, mais ses moyens étaient accrus par l'affectation de fonctionnaires à temps plein. En outre un rôle consultatif général sur les questions de concurrence lui était attribué.
L'ordonnance du 1er décembre 1986 a considérablement élargi les pouvoirs et les moyens du Conseil de la concurrence par rapport aux autorités qui l'ont précédé. Elle l'a doté d'un pouvoir de décision propre lui permettant de sanctionner les pratiques anticoncurrentielles prohibées par les articles 7 et 8 de l'ordonnance (ententes illicites et abus de position dominante ou d'état de dépendance économique) puis, depuis la loi n° 96-588 du 1er juillet 1996, les prix de vente aux consommateurs abusivement bas (article 10-1). Outre les sanctions pécuniaires prévues par l'article 13 de l'ordonnance (d'un montant maximal égal à 5 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France au cours du dernier exercice clos), le conseil peut ordonner des mesures conservatoires selon la procédure définie à l'article 11.
Par ailleurs, le rôle consultatif du Conseil de la concurrence a été étendu ; il joue aujourd'hui le rôle d'expert officiel et indépendant en matière de concurrence et est, avec le ministre chargé de l'économie et les tribunaux, l'autorité chargée de faire respecter le droit de la concurrence européen en France. Le Conseil doit être obligatoirement consulté sur les projets de décret en Conseil d'Etat visant à lutter contre les hausses et les baisses excessives de prix (article 1er, qui n'a jamais été mis en _uvre), sur les projets de règlement comportant des restrictions quantitatives, établissant des droits exclusifs ou imposant des pratiques uniformes de prix ou de conditions de vente (article 6) ou sur les projets de concentration de nature à porter atteinte à la concurrence (article 38). De larges possibilités de consultation facultative sont en outre prévues pour le Gouvernement, les commissions parlementaires, les collectivités territoriales, les organisations professionnelles et syndicales, les organisations de consommateurs agréées, les chambres d'agriculture et consulaires et les juridictions.
Le Conseil de la concurrence peut être saisi d'un litige portant sur des pratiques anticoncurrentielles par le ministre chargé de l'économie, les entreprises concernées par les pratiques en cause, et les organismes autorisés à saisir pour avis le Conseil de la concurrence. Il peut en outre se saisir d'office d'une affaire. Cette autosaisine n'est toutefois pas possible lorsqu'il s'agit de prendre des mesures conservatoires. Les tableaux ci-dessous dressent un bilan de l'activité du Conseil de la concurrence ces dernières années.
LES DÉCISIONS ET AVIS DU CONSEIL DE LA CONCURRENCE (1995-1999)
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
||||||||
| Décisions | 106 | 97 | 113 | 108 | 98 | |||||||
| - statuant sur des griefs notifiés | 48 | 49 | 50 | 34 | 27 | |||||||
| - relatives à des demandes de mesures conservatoires | 17 | 9 | 8 | 17 | 12 | |||||||
| - irrecevabilité | 12 | 7 | 7 | 7 | 26 | |||||||
| - autres (classement, non-lieu, sursis à statuer) | 29 | 32 | 48 | 50 | 32 | |||||||
| Avis | 19 | 18 | 26 | 25 | 22 | |||||||
| - dont concentrations | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | |||||||
LES SANCTIONS PRISES PAR LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE (1995-1999)
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
|
| Nombre de décisions de sanctions | 38 |
41 |
36 |
32 |
14 |
| Montant total des sanctions (en millions de francs) | 481,182 |
106,316 |
164,423 |
93,075 |
61,350 |
| Nombre d'entreprises sanctionnées | 163 |
99 |
82 |
76 |
58 |
| Montant des sanctions (en millions de francs) | 478,105 |
105,044 |
161,900 |
90,073 |
60,715 |
| Nombre d'organisations professionnelles sanctionnées | 23 |
14 |
39 |
14 |
7 |
| Montant des sanctions (en millions de francs) | 3,077 |
1,272 |
2,522 |
3,002 |
0,635 |
1. Renforcer le rôle de prévention confié au Conseil de la concurrence et lui donner un rôle de médiation
La mission d'information juge que la mission d'observation du jeu de la concurrence en France confiée au Conseil de la concurrence pourrait être renforcée en lui permettant de se saisir d'office de toute question de concurrence afin de rendre un avis sur le sujet. Cet avis devrait être public. Le rôle préventif du conseil serait ainsi conforté.
Notamment, dans le cadre des enquêtes que le conseil devrait pouvoir mener de lui-même, comme il est proposé au b suivant, il devrait pouvoir rendre spontanément un avis sur la compatibilité avec le fonctionnement régulier de la concurrence des pratiques qu'il aurait mises en évidence. Selon l'intérêt de l'affaire, cet avis serait notifié aux parties en cause et au ministre chargé de l'économie ou serait, en sus de cette notification, publié.
Par ailleurs, le Conseil de la concurrence peut avoir un rôle d'apaisement des conflits entre fournisseurs et revendeurs grâce à sa capacité d'expertise et son autorité. La mission d'information estime qu'il devrait être associé à la commission proposée en conclusion du rapport pour arbitrer les conflits entre partenaires commerciaux portant sur des pratiques abusives. Différentes modalités sont envisageables :
- un de ses membres pourrait siéger dans cette commission ;
- le conseil pourrait saisir cette commission d'arbitrage lorsque des faits qu'il détecte correspondent à ses attributions ;
- il pourrait être saisi pour avis par cette commission au même titre que les juridictions en application de l'article 26 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et rendre des avis en forme simplifiée, au besoin sans mener une procédure contradictoire, pour ne pas retarder le traitement du litige.
Par ailleurs, la mission estime que le Conseil de la concurrence devrait pouvoir exercer lui-même un rôle de médiation. Ses décisions devraient être prises dans une forme simplifiée pour ne pas alourdir la tâche des rapporteurs et des membres du conseil et ne pas retarder le règlement des litiges. Cette nouvelle attribution doit être conçue comme un moyen d'éviter de créer un contentieux devant le conseil. En outre, l'ordonnance du 1er décembre 1986 devrait permettre au conseil ou à son président, de sa propre initiative, de proposer aux parties une médiation préalablement à l'engagement de la procédure contentieuse.
Dans les deux hypothèses, il conviendrait de créer des postes supplémentaires de rapporteurs affectés au conseil. La paix du commerce mérite cette dépense publique supplémentaire. En tous les cas, nous attirons l'attention sur le fait que ce renforcement ne doit pas être effectué par diminution des moyens de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) car cela reviendrait à habiller Paul en déshabillant Pierre dont l'Etat a absolument besoin avec la plénitude de ses moyens pour que son action soit efficace. Le Conseil de la concurrence dispose actuellement de 35 rapporteurs, dont seize emplois de rapporteur permanent.
Ces rapporteurs supplémentaires pourraient être pris dans la magistrature et les corps d'ingénieurs afin de compléter la composition des fonctionnaires rapporteurs actuels, qui aux deux tiers proviennent de la DGCCRF.
2. Rendre le Conseil de la concurrence plus « réactif » aux atteintes à la concurrence
Il convient de donner au Conseil de la concurrence les moyens d'être plus « réactif » aux problèmes de concurrence observés par les acteurs économiques sur le terrain.
Le conseil consacre l'essentiel de son temps à l'analyse économique des questions et des litiges dont il est saisi. Son expertise est incomparable et la qualité de ses membres et de ses rapporteurs donnent une autorité incontestable à ses décisions et ses avis, y compris à l'échelon européen (pour s'en rendre compte, il suffit de constater la rareté des décisions d'annulation de la Cour d'appel de Paris et l'attachement des opérateurs économiques à faire trancher des litiges par le Conseil). Cependant, ce travail d'analyse ne permet pas au conseil de statuer rapidement au fond. Le délai d'instruction des demandes par le Conseil de la concurrence est particulièrement long, chaque litige ou chaque avis nécessitant des investigations longues, des études complexes (sur l'état du marché, la nature et les effets des pratiques) et l'élaboration de dossiers volumineux (pour garantir le caractère contradictoire de la procédure et respecter les droits de la défense dans les procédures de sanction). Comme il nous a été résumé, lors de jour de l'audition par la mission d'information du Conseil de la concurrence, le conseil travaille d'une manière quasi-juridictionnelle de manière à traiter sous tous ses aspects une plainte.
Tout d'abord le Conseil de la concurrence dépend de DGCCRF pour la réalisation d'enquêtes qui ne seraient pas liées à une affaire dont il est saisi. Il ne dispose pas d'un corps d'inspecteurs, mais seulement de rapporteurs permanents affectés (un rapporteur général, un rapporteur général adjoint et seize rapporteurs permanents) et de rapporteurs extérieurs essentiellement détachés de la DGCCRF, qui détiennent, en application de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, un pouvoir d'enquête identique à celui des fonctionnaires habilités à cet effet de la DGCCRF pour les affaires dont est saisi le conseil. Les contrôles sur le terrain sont donc menés par les agents de la DGCCRF dans le cadre du programme d'enquêtes annuel arrêté par le ministre et son directeur général.
La mission d'information estime que le Conseil de la concurrence devrait avoir le pouvoir d'ordonner des contrôles afin d'envoyer, sans délai, sur le terrain, des agents habilités pour constater des faits suspects dès qu'ils sont signalés au conseil. En outre, cette capacité de contrôle permettrait au conseil de s'assurer de la bonne exécution de ses décisions. Lorsqu'il décèlerait des pratiques illicites, le conseil devrait, comme il a été indiqué au a ci-dessus, pouvoir rendre spontanément un avis sur leur compatibilité avec le fonctionnement régulier de la concurrence.
La constitution d'un corps d'inspecteur spécial n'est pas pour autant nécessaire, d'autant plus que sa formation réduirait les moyens d'action de la DGCCRF. Mais un changement d'ordre qualitatif du travail du conseil serait nécessaire. Nous avons la conviction que son autorité en serait d'autant plus accrue.
Le Conseil de la concurrence dispose de 35 rapporteurs, dont 16 emplois de rapporteur permanent, auxquels s'ajoutent les agents d'exécution, ce qui représente au total une centaine de personnes pour réaliser l'instruction des dossiers. Chaque année, environ 150 dossiers sont déposés au conseil, ce qui représente un volume d'affaires supérieur à ce que le conseil peut traiter chaque année. C'est pourquoi le stock d'affaires en cours atteignait 408 le jour de l'audition par la mission d'information du Conseil de la concurrence, soit l'équivalent de quatre ans et demi de travail.
Le conseil devrait également avoir la capacité de s'autosaisir si les entreprises victimes de pratiques anticoncurrentielles ou déloyales n'osent pas le saisir.
En dernier lieu, il serait utile d'accélérer la procédure permettant d'ordonner des mesures conservatoires. Ces mesures peuvent être d'une grande efficacité si elles sont mises en _uvre rapidement. Le référé judiciaire apparaît plus souple d'application ; il faudrait s'en inspirer, tout en conservant le nécessaire caractère contradictoire de la procédure.
3. Mieux sanctionner les abus de dépendance économique
Comme il a été analysé dans la deuxième partie du rapport, le Conseil de la concurrence n'est pas en mesure de sanctionner les abus de position dominante et surtout l'exploitation abusive d'un état de dépendance économique quand la pratique n'affecte pas le jeu de la concurrence sur le marché concerné. L'interdiction figurant à l'article 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 est en effet liée aux conditions de mise en jeu inscrite à l'article 7 (« lorsque [les pratiques] ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché »).
La mission d'information considère que l'abus de dépendance économique ne peut être véritablement sanctionné qu'en retirant cette condition d'atteinte au jeu de la concurrence sur le marché car les pratiques concernent des PME dont la disparition n'affectera jamais le marché.
Le législateur de 1996 a donné au Conseil de la concurrence des attributions en matière de contrôle des prix de vente aux consommateurs abusivement bas alors même que l'infraction n'est pas liée à une atteinte au jeu de la concurrence sur le marché. Il convient d'adopter une démarche comparable pour l'abus de dépendance économique. Ainsi l'article 10-1 de l'ordonnance prohibant les prix abusivement bas ne permet d'infliger des sanctions que lorsque les « offres ou pratiques ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'éliminer d'un marché ou d'empêcher d'accéder à un marché une entreprise ou l'un de ses produits » : c'est la sanction des prix prédateurs, par nature anticoncurrentiels, qui est visée.
L'attribution contentieuse du Conseil de la concurrence en matière d'exploitation abusive d'un état de dépendance économique pourrait donc être redéfinie en ôtant la condition d'atteinte au jeu de la concurrence sur le marché. Il s'agit de pouvoir sanctionner la pratique conduisant à la disparition de l'entreprise ou à son retrait d'un marché (comme en matière de prix abusivement bas il faut viser les cas d'éviction d'une entreprise ou d'un produit). Il faut en effet éviter que le droit ne permette la protection de rentes de situation détenues par des PME-PMI ou prémunir certaines d'entre elles des effets naturels de leur inefficacité économique.
En outre, cette réforme nécessiterait de redéfinir les cas d'abus cités au dernier alinéa de l'article 8. La liste des abus correspond plus à une situation d'exploitation abusive d'une position dominante qu'à une exploitation abusive d'un état de dépendance économique. Cette redéfinition permettrait de sérier les dysfonctionnements. En ce sens, il conviendrait de viser les pratiques illicites définies à l'article 36 de l'ordonnance.
Cette nouvelle définition de l'exploitation abusive de l'état de dépendance économique permettrait toujours de sanctionner les situations anticoncurrentielles actuellement visées par l'article 8 de l'ordonnance.
Certes, la mission d'information attire l'attention sur le fait que cette réforme de la répression des abus de dépendance économique peut, comme il a été indiqué dans la deuxième partie du rapport, passer par une modification de l'article 36 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 dans lequel serait insérée l'interdiction d'une telle exploitation comme nous venons de la décrire. Mais dans ce cas, ce seront les tribunaux civils ou de commerce qui seront en charge de l'application de cette mesure et le Conseil de la concurrence, notamment dans sa formation d'arbitrage, n'aura quasiment pas l'occasion d'intervenir. De même, les sanctions pécuniaires pouvant atteindre actuellement 5 % du chiffre d'affaires annuel hors taxes ne pourront pas être infligées si la pratique illicite ne figure pas dans le titre III de l'ordonnance du 1er décembre 1986.
D.- LE DROIT EUROPÉEN SE PRÉOCCUPE AVANT TOUT DU MARCHÉ
Le droit européen de la concurrence vise à garantir le libre jeu de la concurrence sur le marché communautaire. Il ne réglemente donc pas les relations commerciales entre les entreprises. La directive sur les délais de paiement est de ce point de vue une grande nouveauté, mais de portée très limitée en raison de son absence de caractère contraignant pour les entreprises (le délai de paiement de 30 jours a un caractère purement indicatif ou supplétif en cas d'absence d'indication d'un délai de paiement dans un contrat de vente ou d'achat, ce qui est rarissime aujourd'hui en France) ; seul le délai de paiement de 60 jours imposé aux administrations est impératif.
Le droit communautaire repose sur les articles 85 à 94 du traité de Rome, qui interdisent les ententes anticoncurrentielles, les abus de position dominante, le dumping et les aides d'Etat sauf exceptions, et encadrent les monopoles publics. Seuls les articles 85 et 86 concernent l'objet de la mission d'information. Les articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence sont directement inspirés de ces deux articles.
Articles 85 et 86 du
traité instituant la Communauté européenne Article 85 1. Sont incompatibles avec le marché commun et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre Etats membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun, et notamment ceux qui consistent à : a) fixer de façon directe ou indirecte les prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction, b) limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou les investissements, c) répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement, d) appliquer, à l'égard de partenaires commerciaux, des conditions inégales à des prestations équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence, e) subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats. 2. Les accords ou décisions interdits en vertu du présent article sont nuls de plein droit. 3. Toutefois, les dispositions du paragraphe 1 peuvent être déclarées inapplicables: - à tout accord ou catégorie d'accords entre entreprises, - à toute décision ou catégorie de décisions d'associations d'entreprises et - à toute pratique concertée ou catégorie de pratiques concertées qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, et sans: a) imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs, b) donner à des entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d'éliminer la concurrence. Article 86TOPFILE Est incompatible avec le marché commun et interdit, dans la mesure où le commerce entre Etats membres est susceptible d'en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d'exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché commun ou dans une partie substantielle de celui-ci. Ces pratiques abusives peuvent notamment consister à: a) imposer de façon directe ou indirecte des prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction non équitables; b) limiter la production, les débouchés ou le développement technique au préjudice des consommateurs, c) appliquer à l'égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence, d) subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats. |
Les nouvelles régulations proposées dans le présent rapport sont totalement compatibles avec le droit européen.
E.- LES PROCÉDURES CONTENTIEUSES
Articles 36 et 56 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 Article 36 (avant-dernier et dernier alinéas) L'action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne justifiant d'un intérêt, par le Parquet, par le ministre chargé de l'économie ou par le président du Conseil de la concurrence, lorsque ce dernier constate, à l'occasion des affaires qui relèvent de sa compétence, une pratique mentionnée au présent article. Le président de la juridiction saisie peut, en référé, enjoindre la cessation des agissements en cause ou ordonner toute autre mesure provisoire. Article 56 Pour l'application de la présente ordonnance, le ministre chargé de l'économie ou son représentant peut, devant les juridictions civiles ou pénales, déposer des conclusions et les développer oralement à l'audience. Il peut également produire les procès-verbaux et les rapports d'enquête. |
1. La politique d'action publique en matière de relations commerciales
Dans une économie de libre concurrence, il n'appartient pas à l'Etat d'être un acteur du marché, mais il lui incombe cependant de garantir la loyauté de l'exercice de cette concurrence par tous les acteurs du marché. En France, la loi a donné plusieurs moyens au Gouvernement pour exercer cette mission : certaines pratiques sont sanctionnées pénalement (facturation, conditions de vente, promotions illicites, revente à perte, prix imposés, délais de paiement réglementés). Cette pénalisation permet au Gouvernement de définir à l'intention des parquets une politique pénale répressive et engager des enquêtes administratives ; quant aux pratiques entraînant une réparation civile (article 36 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986), le ministre chargé de l'économie, le parquet et le président du Conseil de la concurrence sont habilités à introduire une action en réparation devant la juridiction civile ou commerciale.
Ce pouvoir d'intervention en matière civile et commerciale du ministre chargé de l'économie est justifié par la faiblesse économique des victimes des pratiques discriminatoires, par leur manque de moyens juridiques de défense et leur crainte d'affronter seul un de leurs clients ou fournisseurs. Trop d'infractions à la loi et au droit des contrats ou de détournements ne sont pas réparées parce que les victimes n'osent pas demander réparation ; elles estiment que les sanctions commerciales ultérieures risquent d'anéantir le dédommagement obtenu. Or, le respect de la loyauté de la concurrence devrait primer ; c'est pourquoi l'Etat doit pouvoir intervenir dans des relations de droit privé pour rétablir cette loyauté lorsqu'elle est rompue. La Cour de cassation a validé ce pouvoir d'introduire une action civile, mais la Cour d'appel de Paris vient de lui apporter une limite qui diminue fortement son efficacité : le ministre ne peut pas demander des réparations mais seulement la cessation d'une pratique illicite au motif qu'il n'est pas une partie au procès. Cette situation conduit à rendre peu efficace l'action du ministre car lorsqu'il introduit une action devant les tribunaux, l'enseigne met fin à la pratique litigieuse pendant l'audience et l'affaire s'arrête faute de plaignant qui ose la poursuivre en dommages et intérêts.
C'est pourquoi la mission propose de modifier la loi afin que le ministre chargé de l'économie puisse introduire une action en réparation de dommages causés par une pratique restrictive au titre de l'article 36 :
- ou bien le code de procédure civile peut être adapté à cet objectif,
- ou bien l'article 36 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 pourrait être complété afin de permettre au ministre chargé de l'économie de demander l'application d'amendes civiles d'un montant correspondant aux dommages et intérêts qui seraient dus aux victimes si elles s'étaient portées devant le tribunal. Ces sommes pourraient leur être reversées si elles le demandaient au tribunal dans un délai à déterminer.
Sous cette réserve, l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 donne des moyens juridiques au Gouvernement pour assurer des interventions efficaces. Cependant ceux-ci sont sous-utilisés. Cette sous-utilisation a deux causes essentielles :
- le caractère timoré de la politique d'action publique dans les relations commerciales entre entreprises, notamment en matière d'abus de dépendance économique ;
- la difficulté de réunir les preuves des pratiques anticoncurrentielles ou restrictives de concurrence ;
et une cause accessoire : l'obligation de sélectionner les enquêtes diligentées par les services de la concurrence en raison de l'étendue des attributions de la DGCCRF et de la limite de ses moyens matériels.
Les parquets classent trop d'affaires qu'ils jugent mineures alors que les preuves ont été réunies pour faire condamner un délit économique. Notamment, cet été le Gouvernement a conduit une vaste campagne d'enquêtes sur la commercialisation des fruits et légumes sur la région d'Avignon ; des reventes à perte, certes de quelques centimes, ont été avérées mais les dossiers ont été classés sans suite. Or, en matière commerciale, nous estimons que l'exemplarité d'une décision de justice peut avoir des effets bien supérieurs à une série d'enquête sur le terrain.
La sensibilisation et la formation des magistrats aux affaires commerciales doivent être poursuivies de manière prioritaire ; les cours de l'Ecole de la magistrature devraient intégrer des formations au droit de la concurrence amenant les élèves à s'intéresser aux pratiques commerciales des entreprises. La politique pénale, très orientée vers la répression des crimes et délits sur les personnes et les biens individuels, devrait se soucier davantage des délits commerciaux qui nuisent gravement à l'équilibre de notre société.
Comme on l'a vu, la DGCCRF définit des priorités d'enquête. il serait indispensable que le ministres de l'économie s'assure auprès de la ministre de la justice que ces actions soient relayées par les parquets.
2. La difficulté de réunir les preuves
On constate tout d'abord que l'administration et le ministère public reçoivent très peu de plaintes de victimes ; si la Cour de cassation a reconnu la légitimité du ministre chargé de l'économie à intervenir dans des rapports de droit privé au nom de l'ordre public économique, il ne peut le faire, en pratique, qu'avec l'accord de la victime. En matière pénale, une sanction ne peut, en effet, être infligée que si l'infraction et l'intention délictueuse sont démontrées devant le juge de manière certaine. En matière civile et commerciale, les causes et la consistance d'un dommage sont souvent difficiles à définir en raison de la complexité des rapports économiques (or la « vérité » naît de la confrontation devant le juge des parties au litige civil ou commercial). Dans les deux cas, les enquêtes sont très lourdes, nécessitent la mobilisation de dizaines de fonctionnaires pendant des semaines, voire des mois. Ainsi, M. Jérôme Gallot, directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, nous a indiqué que seules 11 actions civiles du ministre portant sur une infraction à l'article 36 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 étaient pendantes, en raison de cette charge de travail pour les services de la DGCCRF.
Par ailleurs, lors des contrôles des agents de la DGCCRF, il est très difficile de détecter les factures délictueuses et surtout de mettre la main sur les contrats illicites. Rappelons que Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat aux PME, au commerce et à l'artisanat, a fait part de sa déception pour l'impossibilité dans laquelle se sont trouvés les agents de la DGCCRF, lors d'un contrôle qu'elle avait suivi sur Avignon l'été 1999, de saisir des contrats de coopération commerciale manifestement abusifs au vu des factures adressées. Les agents de la DGCCRF ont le pouvoir d'exiger la présentation des documents commerciaux, mais si le responsable de l'entreprise affirme qu'il n'existe pas ou fournit des documents ne correspondant pas, les agents doivent demander au président du tribunal de grande instance de les autoriser à effectuer une perquisition, conformément aux termes de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986. Or, le document nécessaire pour obtenir cette autorisation totalise jusqu'à cent pages si l'affaire est délicate, ce qui est quasiment toujours le cas dans les affaires de bâtiment et de travaux publics.
Le recours au pouvoir de perquisition est donc très sélectif en raison de la lourdeur de la procédure. De nombreux dossiers ne peuvent donc être suffisamment étayés pour donner lieu à une condamnation pénale.
3. Les peines encourues sont insuffisantes
Le Conseil de la concurrence a le pouvoir d'infliger des sanctions pécuniaires pouvant atteindre 5 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France par l'entreprise au cours de son dernier exercice. Cependant, en général la montant des sanctions est faible au regard des enjeux économiques (voir le tableau dans le chapitre C sur la place du Conseil de la concurrence).
Répondant aux questions des membres de la mission, la présidente et les vice-présidents du Conseil de la concurrence ont fait observer que le conseil avait infligé une amende globale de 400 millions de francs (aux bénéficiaires de l'entente illicite) dans l'affaire du pont de Normandie, ce qui correspondait à 3 % du chiffre d'affaires. Si le conseil n'a pas été au-delà, cela est dû à la nécessité de ne pas appliquer la sanction maximale, même dans des affaires d'une extrême gravité, car le pire est toujours envisageable, et il faut pouvoir sévir encore plus.
La mission d'information est donc d'avis de porter à 10 % du chiffre d'affaires annuel hors taxes le montant maximal inscrit à l'article 13 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986.
Selon l'avis du Conseil de la concurrence, ses décisions sont correctement exécutées et les sanctions pécuniaires recouvrées de manière satisfaisante. Aucune réforme n'apparaît nécessaire sur ce point.
Concernant l'application des dispositions du titre IV de l'ordonnance sur la coopération et les remises et rémunérations diverses exigées des fournisseurs, il est indispensable que les sanctions pénales infligées soient au moins égales au bénéfice financier obtenu frauduleusement. Une amende de 50 000 F pour avoir forcé un fournisseur à verser 500 000 F ou dix fois plus pour des services de coopération commerciale non justifiés et non effectifs a un caractère dérisoire et le jugement pénal est très mal vécu par la victime.
La mission d'information recommande d'adapter la rédaction des sanctions inscrites au titre IV de l'ordonnance en ce sens.
Concernant l'application des dispositions de l'article 36 de l'ordonnance, dont le non-respect n'est pas sanctionné pénalement, la principale difficulté tient à ce qu'une condamnation à verser des dommages-intérêts n'incite pas les contrevenants à cesser la pratique illicite. En effet, la condamnation, qui n'est qu'éventuelle puisque la victime doit oser porter plainte et demander des dommages-intérêts, peut apparaître comme un investissement, d'autant plus que les effets d'une pratique restrictive ne sont pas que purement financiers : les rapports concurrentiels ont été modifiés au bénéfice, en général, de l'entreprise ayant commis l'infraction ; le rapport de force entre les deux partenaires a été bouleversé ; la victime a pu disparaître ; etc.
Il est tout d'abord indispensable que les victimes puissent obtenir réparation. Dans ce but, le ministre chargé de l'économie doit pouvoir, en introduisant une action, demander des dommages-intérêts au juge civil ou commercial au nom de la victime même si elle n'est pas partie à l'instance. En outre, il conviendrait d'étudier l'application d'amendes civiles en cas de condamnation, afin d'infliger un désavantage financier à l'auteur de l'infraction.
Aucune amende civile n'est prévue par les textes régissant le droit de la concurrence. En principe, l'amende civile a un caractère disciplinaire et sanctionne le non-respect de prescriptions formelles. C'est une mesure qui a pour objectif la bonne administration de la justice. Dans tous les cas, le ministère public et lui seul peut demander le prononcé de l'amende ; les parties au litige ne le peuvent pas.
L'amende civile permet, en fait, de sanctionner des comportements dilatoires et de pure chicane et elle n'est donc pas destinée à indemniser les parties. Elle génère un contentieux objectif mais trouve difficilement sa place dans un dispositif de responsabilité qui est par nature subjectif.
Son application au droit de la concurrence devrait cependant être étudiée. Actuellement elle est prévue dans les domaines suivants :
- en matière de tutelle, le juge des tutelles peut prononcer une amende civile dans le cas où les administrateurs légaux ne défèrent pas à ses injonctions (article 395 du code civil) ou lorsque les membres du conseil de famille n'assistent pas à la réunion sans excuse légitime (article 412 du code civil) : amende de 50 à 500 F (art. 1230 du code de procédure civile) ;
- pour la convocation de témoins dans une procédure civile, en cas de défaillance des témoins ou de non-respect de l'obligation de comparaître (article 207 du code de procédure civile) : amende de 100 à 10 000 F ;
- la production en connaissance de cause d'une pièce fausse devant le juge civil (article 305 du code de procédure civile) : amende obligatoire de 100 à 10 000 F ;
- le fait pour quelqu'un dans une procédure civile de dénier à tort un acte qui lui est imputé (par exemple, le refus de reconnaître sa propre écriture) (article 559 du code de procédure civile) : amende de 100 à 10 000 F ;
- le pourvoi en cassation abusif : amende d'un montant maximum de 20 000 F (article 628 du code de procédure civile) ;
- le non-respect de l'obligation d'obtenir un permis de démolir (article L. 432 du code de l'urbanisme) : amende de 2 000 à 500 000 F versée pour moitié à l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat et pour moitié à la caisse nationale des monuments historiques et des sites.
V.- LE DROIT D'ÉTABLISSEMENT DES COMMERCES
La mission d'information a souhaité aborder la question de l'urbanisme commercial. La loi Royer date de 26 ans, les formes de distribution évoluent fortement :
- les grands groupes sont aujourd'hui multiformat, c'est-à-dire qu'ils possèdent des enseignes de supérettes, de supermarchés, d'hypermarchés, de magasins de maxidiscompte qui posent chacune des questions d'urbanisme commercial et d'aménagement du territoire différentes ;
- les consommateurs sont attachés à la diversité de l'offre commerciale (hypermarchés comme commerces de quartier ou de centre-ville) : tous les élus doivent désormais appréhender la question des grandes surfaces de vente en termes d'équilibre des offres face aux besoins et de développement de l'équipement commercial entier dans un rayon bien plus grand qu'auparavant ;
- de nouvelles formes de distribution s'imposent, qui ne sont pas liées à une contrainte de surface : la maxidiscompte qui se contente de moins de 1000 m2, voire moins de 500 m2 ;
- chaque consommateur se sent à l'étroit dans les allées des supermarchés et des hypermarchés. Nous invitons les élus à visiter les hypermarchés et supermarchés allemands, espagnols, américains pour constater qu'une surface minimale, qui n'existe que très rarement en France, est indispensable pour le confort du consommateur (sans évoquer les questions de sécurité en cas d'affluence). En outre, notre souhait unanime d'accroître la présence des produits des PME-PMI impose d'allonger les linéaires disponibles. Il faut donc impérativement avoir une approche différente des questions d'agrandissement des surfaces de vente ayant obtenu une autorisation que des questions d'implantation nouvelle. Nous recommandons instamment de permettre aux enseignes d'accroître leurs surfaces de vente pour ces motifs ;
- la vente par Internet va bouleverser la distribution en Europe comme c'est déjà le cas aux Etats-Unis. La question des surfaces de vente risque dans dix ans d'être dépassée. Il ne faudrait pas qu'en 2010 les élus aient à affronter la question de la gestion de friches commerciales... (voir le dernier chapitre du titre I du rapport sur le commerce électronique).
A.- L'ÉQUIPEMENT COMMERCIAL EN PLACE
1. Les grandes surfaces en activité
Les tableaux ci-après dressent des inventaires des parcs de grandes surfaces de vente en place en France au cours des dix dernières années. Les données sont tirées des documents établis par la direction du commerce intérieur puis la direction des entreprises commerciales, artisanales et de services du ministère chargé du commerce. Il faut regretter que les séries statistiques ne soient pas harmonisées sur une longue période. Les décrochages entre les données des séries sont inexpliqués dans les documents du ministère alors même qu'ils sont parfois très importants.
PARC DES SUPERMARCHÉS (libre-service à dominante alimentaire de 400 à 2 500 m2)
1986 |
1987 |
1988 |
1989 |
1990 |
1991 |
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
|
Nombre |
5 720 |
5 912 |
6 100 |
6 400 |
6 550 |
6 700 |
7 100 |
7 400 |
6 317 |
6 278 |
6 233 |
6 185 |
6 077 |
Surface |
5 194 |
5 448 |
5 700 |
6 100 |
6 300 |
6 600 |
7 000 |
7 200 |
6 526 |
6 544 |
6 600 |
6 646 |
6 641 |
Source : INSEE, comptes commerciaux de la Nation (parc mesuré au 1er janvier de l'année). Les doubles barres séparent les séries statistiques de l'INSEE qui ne sont pas harmonisées. Les surfaces sont exprimées en milliers de mètres carrés.
PARC DES HYPERMARCHÉS (libre-service à dominante alimentaire de plus de 2 500 m2)
1986 |
1987 |
1988 |
1989 |
1990 |
1991 |
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
|
Nombre |
649 |
694 |
759 |
811 |
862 |
908 |
955 |
1 008 |
1 048 |
1 087 |
1 112 |
1 123 |
1 135 |
Surface |
3 667 |
3 872 |
4 166 |
4 409 |
4 704 |
4 956 |
5 296 |
5 623 |
8 869 |
6 158 |
6 323 |
6 388 |
6 491 |
Source : INSEE, comptes commerciaux de la Nation (parc mesuré au 1er janvier de l'année). Les doubles barres séparent les séries statistiques de l'INSEE qui ne sont pas harmonisées. Les surfaces sont exprimées en milliers de mètres carrés.
PARC DES SUPERMARCHÉS DE MAXIDISCOMPTE (à dominante alimentaire)
07/1991 |
07/1992 |
07/1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 (*) |
|
Nombre |
277 |
415 |
750 |
1 121 |
1 470 |
1 613 |
1 796 |
2 171 |
2 337 |
Surface |
749 |
991 |
1 096 |
1 219 |
1 424 |
1 600 |
(*) prévision de l'INSEE - Les surfaces sont exprimées en milliers de mètres carrés.
Sources : Série 1991 à 1993 : LSA n° 1377 du 16 décembre 1993 (magasins de maxidiscompte de plus de 400 m2).
Série 1994 à 1999 : La France des commerces, document établi annuellement par la direction du commerce intérieur. Ses données sont reprises de Panorama-points de vente (données calculées au 1er septembre de l'année). Avant 1994, les rapports de l'INSEE fournissent des chiffres incohérents avec les données ci-dessus (en 1993, seuls 245 magasins étaient recensés) ; ils étaient établis à partir d'un relevé des magasins d'un certain nombre d'enseignes.
PARC DES GRANDS MAGASINS
1978 |
1980 |
1983 |
1986 |
1989 |
1990 |
1991 |
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
|
| Nombre | 149 |
145 |
146 |
133 |
120 |
183 |
168 |
164 |
172 |
168 |
167 |
163 |
161 |
161 |
| Surface | 1 133 |
1 115 |
1 110 |
1 026 |
934 |
5 322 |
5 589 |
5 744 |
5 564 |
5 806 |
5 800 |
5 881 |
5 981 |
6 012 |
| Salariés | 58 400 |
55 500 |
52 600 |
36 400 |
27 200 |
29 829 |
29 400 |
29 848 |
31 304 |
30 957 |
29 454 |
29 440 |
29 014 |
28 830 |
Source : La France des commerces (documents établis annuellement par la direction du commerce intérieur). Jusqu'en 1989, les données reprennent les inventaires de l'Institut français du libre-service (données calculées au 31 décembre) ; à partir de 1990, elles sont tirées de Panorama-points de vente (données calculées au 1er septembre). Les surfaces sont exprimées en milliers de mètres carrés jusqu'en 1990 puis en surface moyenne par magasin à partir de 1990.
PARC DES MAGASINS POPULAIRES
1978 |
1980 |
1983 |
1986 |
1989 |
1990 |
1991 |
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
|
| Nombre | 685 |
661 |
612 |
598 |
538 |
531 |
507 |
483 |
454 |
425 |
400 |
378 |
344 |
318 |
| Surface | 932 |
901 |
839 |
815 |
771 |
1 421 |
1 451 |
1 470 |
1 453 |
1 466 |
1 502 |
1 527 |
1 586 |
1 637 |
| Salariés | 41 000 |
39 900 |
32 500 |
25 100 |
24 400 |
21 771 |
21 294 |
21 252 |
19 522 |
18 196 |
17 795 |
16 896 |
16 092 |
15 547 |
Source : La France des commerces (documents établis annuellement par la direction du commerce intérieur). Jusqu'en 1989, les données reprennent les inventaires de l'Institut français du libre-service (données calculées au 31 décembre) ; à partir de 1990, elles sont tirées de Panorama-points de vente (données calculées au 1er septembre). Les surfaces sont exprimées en milliers de mètres carrés jusqu'en 1990 puis en surface moyenne par magasin à partir de 1990.
PARC DES GRANDES SURFACES DE VENTE SPÉCIALISÉES
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
|
| Electroménager | |||||
| Nombre | 995 |
962 |
982 |
955 |
1 209 |
| Surface moyenne | 1 899 |
1 878 |
1 864 |
1 872 |
1 556 |
| Salariés | 21 296 |
21 413 |
21 668 |
21 577 |
24 185 |
| Bricolage | |||||
| Nombre | 2 229 |
2 555 |
2 530 |
2 489 |
2 510 |
| Surface moyenne | 1 753 |
1 735 |
1 793 |
1 877 |
1 918 |
| Salariés | 38 073 |
41 210 |
41 855 |
44 037 |
45 637 |
| Textile | |||||
| Nombre | 884 |
976 |
1 042 |
1 098 |
1 231 |
| Surface moyenne | 2 580 |
2 386 |
2 481 |
2 499 |
2 569 |
| Salariés | 5 935 |
6 711 |
7 017 |
7 493 |
8 218 |
| Jardinerie | |||||
| Nombre | 168 |
167 |
163 |
161 |
161 |
| Surface moyenne | 5 806 |
5 800 |
5 881 |
5 981 |
6 012 |
| Salariés | 30 957 |
29 454 |
29 440 |
29 014 |
28 830 |
Source : La France des commerces (documents établis annuellement par la direction du commerce intérieur). Les données sont reprises de Panorama-points de vente (données calculées au 1er septembre de l'année). Les surfaces sont exprimées en mètres carrés.
2. L'évolution des autorisations d'ouverture
Le tableau ci-après montre l'évolution des autorisations de création et d'extension de grandes surfaces de vente. La progression des autorisations a connu un tassement lors des périodes de « gel administratif des autorisations », les commissions n'étant pas convoquées. Le volume des autorisations a fortement cru en 1997 en raison de l'abaissement à 300 mètres carrés du seuil d'autorisation.
Années |
Surfaces autorisées par les CDUC puis CDEC |
Surfaces totales autorisées après recours |
1981 |
463 694 m² |
370 628 m² |
1982 |
439 191 m² |
468 391 m² |
1983 |
410 679 m² |
504 372 m² |
1984 |
400 619 m² |
546 817 m² |
1985 |
561 146 m² |
786 073 m² |
1986 |
536 004 m² |
627 785 m² |
1987 |
1 163 156 m² |
1 119 271 m² |
1988 |
1 387 277 m² |
1 383 803 m² |
1989 |
1 174 744 m² |
1 151 121 m² |
1990 |
1 677 303 m² |
1 702 598 m² |
1991 |
1 954 903 m² |
|
1992 |
1 908 316 m² |
Ministre : 1 925 571 m² CNEC : 69 191 m² |
1993 (cduc+cdec) |
295 624 m² |
206 915 m² |
1994 |
1 401 112 m² |
969 834 m² |
1995 |
928 393 m² |
815 494 m² |
1996 |
711 583 m² |
576 661 m² |
1997 |
1 098 494 m² |
1 241 249 m² |
1998 |
1 695 567 m² |
1 854 183 m² |
1999 (1er semestre) |
1 392 841 m² |
1 351 955 m² |
Source : secrétariat d'Etat aux PME, au commerce et à l'artisanat
BILAN DÉFINITIF DE L'ACTIVITÉ DES CDUC ET CNUC (1975 À 1993)
décisions des commissions départementales de l'urbanisme commercial |
||||||
Nombre de projets |
Surfaces demandées |
Autorisations |
Refus |
|||
11 565 |
39 598 525 m² |
Nbr : 5 802 |
16 088 332 m² |
Nbr : 5 763 |
23 510 193 m² |
|
bilan des décisions après recours devant le ministre (apres avis de la cnuc) |
||||||
Nombre de recours |
Autorisations |
Refus |
||||
total |
Nbr : 6 589 |
17 008 808 m² |
Nbr : 4 976 |
|||
SURFACES DE VENTE AUTORISÉES DE 1988 À LA FIN DU PREMIER SEMESTRE 1999
Années |
CDUC/CDEC (sans recours) |
Autorisations en appel |
|||
Créations |
Extensions |
Créations |
Extension |
||
1988 |
976 035 m² |
407 768 m² |
|||
1989 |
877 804 m² |
273 317 m² |
|||
1990 |
952 023 m² |
300 338 m² |
262 148 m² |
188 089 m² |
|
1991 |
1 166 440 m² |
337 265 m² |
249 255 m² |
99 321 m² |
1 852 281 m² |
1992 |
1 135 606 m² |
349 657 m² |
323 836 m² |
- ministre : 1 925 571 m² - CNEC : 69 181 m² |
|
1993 |
147 871 m² |
40 211 m² |
14 735 m² |
||
1994 |
464 330 m² |
224 937 m² |
207 727 m² |
969 834 m² |
|
1995 |
231 465 m² |
357 271 m² |
176 091 m² |
815 494 m² |
|
1996 |
334 001 m² |
15 690 m² |
130 240 m² |
||
1997 |
647 693 m² |
422 974 m² |
99 215 m² |
1 241 249 m² |
|
1998 |
1 023 221 m² |
606 199 m² |
120 518 m² |
1 854 183 m² |
|
1999 (1er semestre) |
504 563 m² |
987 m² |
0 |
1 355 445 m² |
|
(1er décembre) |
814 303 m² |
34 745 m² |
2 265 128 m² |
||
VENTILATION DES AUTORISATIONS DEPUIS 1997 (entrée en vigueur de la loi du 5 juillet 1996)
1997 |
1998 |
1999 (au 1/12) |
|||
CDEC |
Commerces | Créations | 617 545 m² |
962 995 m² |
1 331 618 m² |
| Extensions | 411 080 m² |
595 204 m² |
799 675 m² |
||
| Essences | Créations | 10 185 m² |
11 238 m² |
13 083 m² |
|
| Extensions | 1 442 m² |
2 044 m² |
2 306 m² |
||
| Automobile | Créations | 19 963 m² |
48 988 m² |
57 721 m² |
|
| Extensions | 10 452 m² |
8 951 m² |
12 322 m² |
||
Autorisations en appel |
Commerces | Créations | 98 108 m² |
119 526 m² |
34 143 m² |
| Extensions | 71 331 m² |
104 145 m² |
13 333 m² |
||
| Essences | Créations | 1 107 m² |
992 m² |
602 m² |
|
| Extensions | 36 m² |
100 m² |
0 |
||
| Automobile | Créations | 0 |
0 |
0 |
|
| Extensions | 0 |
0 |
325 m² |
||
TOTAL |
1 241 249 m² | 1 854 183 m² |
2 265 128 m² |
||
Source : secrétariat d'Etat aux PME, au commerce et à l'artisanat.
BILAN DES ACTIVITÉS DES CDEC ET CNEC
Années |
CNEC |
|||
Autorisations |
Refus |
Autorisations |
Refus |
|
175 473 m² |
68 430 m² |
84 996 m² |
518 263 m² |
|
1994 |
1 401 112 m² |
931 481 m² |
201 756 m² |
444 055 m² |
1995 |
928 393 m² |
705 842 m² |
248 968 m² |
356 776 m² |
1996 |
711 583 m² |
488 615 m² |
376 166 m² |
|
1997 |
1 098 494 m² |
625 772 m² |
191 330 m² |
259 298 m² |
1 695 567 m² |
922 886 m² |
199 513 m² |
233 548 m² |
|
1999 (jusqu'au 31 juillet) |
1 426 163 m² |
703 640 m² |
124 611 m² |
143 815 m² |
TOTAL |
7 436 785 m² |
4 446 666 m² |
1 301 356 m² |
2 331 921 m² |
RÉPARTITION DES SURFACES AUTORISÉES PAR NATURE D'ÉTABLISSEMENT
(en %)
| 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | |
| Hypermarchés | 21 | 19,6 | 21,1 | 24,9 | 29,5 | 28,7 | 19,0 | 26,3 | 21,5 | 32,7 | 25,8 | 21,3 |
| Supermarchés | 8,5 | 9,0 | 10,6 | 11,2 | 10,4 | 10,1 | 10,0 | 10,0 | 9,0 | 14,0 | 10,2 | 11,2 |
| 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998* | |
| Hypermarchés | 15 | 16,4 | 14,9 | 20,7 | 13,6 | 15,6 | 8,9 | 6,8 | 8,5 | 9,0 | 7,7 | 8,5 |
| Supermarchés | 11,5 | 11,8 | 13,2 | 9,6 | 8,9 | 10,1 | 6,6 | 12,6 | 14,5 | 11,0 | 12,6 | 12,7 |
* situation provisoire au 15 septembre 1999
Source : rapports sur l'exécution en 1993 et en 1998 de la loi d'orientation du commerce et de l'artisanat (ministère de l'économie, des finances et de l'industrie).
DENSITÉ
COMMERCIALE (pour 1000 habitants) DES HYPERMARCHÉS ET SUPERMARCHÉS
(à dominante alimentaire) EN FRANCE MÉTROPOLITAINE
DÉPARTEMENTS |
densité |
DÉPARTEMENTS |
densité |
| Ain | 262,68 | Indre | 286,36 |
| Aisne | 289,98 | Indre-et-Loire | 315,76 |
| Allier | 288,07 |
Isère | 226,06 |
| Alpes-de-Haute-Provence | 281,29 | Jura | 295,49 |
| Alpes-Maritimes | 176,64 | Landes | 347,51 |
| Ardèche | 216,42 | Loire | 217,04 |
| Ardennes | 298,88 | Loire-Atlantique | 327,65 |
| Ariège | 286,05 | Loiret | 328,33 |
| Aube | 304,49 | Loir-et-Cher | 276,07 |
| Aude | 271,48 | Lot | 282,86 |
| Aveyron | 242,59 | Lot-et-Garonne | 333,99 |
| Bas-Rhin | 297,18 | Lozère | 172,13 |
| Bouches-du-Rhône | 234,16 | Maine-et-Loire | 261,20 |
| Calvados | 308,69 | Manche | 270,12 |
| Cantal | 195,65 |
Marne | 315,55 |
| Charente | 336,98 | Mayenne | 281,12 |
| Charente-Maritime | 311,31 | Meurthe-et-Moselle | 310,28 |
| Cher | 275,90 | Meuse | 261,66 |
| Corrèze | 277,65 | Morbihan | 307,15 |
| Corse (total île) | 281,93 | Moselle | 348,06 |
| Côtes-d'Armor | 339,25 | Nièvre | 333,54 |
| Côte-d'Or | 328,01 | Nord | 266,10 |
| Creuse | 252,36 | Oise | 253,20 |
| Deux-Sèvres | 307,09 | Orne | 276,99 |
| Dordogne | 282,36 | Pas-de-Calais | 325,96 |
| Doubs | 293,93 | Puy-de-Dôme | 246,32 |
| Drôme | 259,26 | Pyrénées-Atlantiques | 310,14 |
| Eure | 287,63 | Pyrénées-Orientales | 286,82 |
| Eure-et-Loir | 287,51 | Rhône | 173,42 |
| Finistère | 328,90 | Saône-et-Loire | 321,65 |
| Gard | 269,48 | Sarthe | 296,94 |
| Gers | 284,64 | Savoie | 293,44 |
| Gironde | 321,01 | Seine-Maritime | 281,97 |
| Haute-Garonne | 291,99 | Seine-et-Marne | 266,41 |
| Haute-Loire | 175,72 |
Somme | 293,30 |
| Haute-Marne | 288,32 | Tarn | 249,54 |
| Hautes-Alpes | 319,25 | Tarn-et-Garonne | 308,24 |
| Haute-Saône | 259,40 | Territoire-de-Belfort | 315,86 |
| Haute-Savoie | 284,62 | Var | 269,01 |
| Hautes-Pyrénées | 285,73 | Vaucluse | 323,84 |
| Haute-Vienne | 328,18 | Vendée | 337,13 |
| Haut-Rhin | 329,46 | Vienne | 303,11 |
| Hérault | 261,00 | Vosges | 346,71 |
| Ille-et-Vilaine | 270,63 | Yonne | 351,63 |
| Paris | 96,65 | Val-d'Oise | 227,50 |
| Essonne | 250,32 | Val-de-Marne | 191,57 |
| Hauts-de-Seine | 115,58 | Yvelines | 226,48 |
| Seine-Saint-Denis | 192,92 | MOYENNE FRANÇAISE | 277,58 |
Source : revue LSA n° 1653, p. 49.
LES OUVERTURES DE SUPERMARCHÉS DE MAXIDISCOMPTE DE 1992 A 1998
(surface en milliers de m2)
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
|||||
| Nombre | Surface | Nombre | Surface | Nombre | Surface | Nombre | Surface | |
| ENSEMBLE DES OUVERTURES DE SUPERMARCHÉS | 390 | 306 | 334 | 251 | 404 | 300 | 326 | 252 |
| Part des ouvertures de maxidiscompte | 61,5 % |
52,3 % |
75,1 % |
67,7 % |
81,9 % |
75,0 % |
73,3 % |
63,5 % |
| OUVERTURES DE SUPERMARCHÉS DE MAXIDISCOMPTE (1) | 240 | 160 | 251 | 170 | 331 | 225 | 239 | 160 |
| - ouverture sous enseigne française (2) | 126 | 80 | 140 | 94 | 178 | 120 | 114 | 74 |
| - ouverture sous enseigne étrangère (3) | 114 | 80 | 111 | 76 | 153 | 105 | 125 | 86 |
| Part des ouvertures sous enseigne étrangère | 47,5 % |
50,1 % |
44,2 % |
44,7 % |
46,2 % |
46,7 % |
52,3 % |
53,8 % |
1996 |
1997 |
1998 |
||||
| Nombre | Surface | Nombre | Surface | Nombre | Surface | |
| ENSEMBLE DES OUVERTURES DE SUPERMARCHÉS | 182 | 134 | 169 | 132 | 93 | 74 |
| Part des ouvertures de maxidiscompte | 73,1 % | 67,9 % | 78,7 % | 70,5 % | 74,2 % | 63,5 % |
| OUVERTURES DE SUPERMARCHÉS DE MAXIDISCOMPTE (1) | 133 | 91 | 133 | 93 | 69 | 47 |
| - ouverture sous enseigne française (2) | 22 | 16 | 20 | 15 | 15 | 10 |
| - ouverture sous enseigne étrangère (3) | 111 | 75 | 113 | 78 | 54 | 37 |
| Part des ouvertures sous enseigne étrangère | 83,5 % | 82,4 % | 85,0 % | 83,9 % | 78,3 % | 78,7 % |
(1) Seuls les magasins de maxidiscompte de plus de 400 m2 sont considérés comme des supermarchés. Il faut préciser que de nombreuses supérettes de maxidiscompte (120 à 400 m2) ouvrent : plus des deux tiers des magasins de maxidiscompte sont des supermarchés, moins du tiers des supérettes.
(2) Les enseignes françaises de maxidiscompte sont : CDM, Dia, Ecomarché, ED l'épicier, Europa Discount, Europrix, Larc, Leader Price, Le Mutant
(3) Les enseignes étrangères de maxidiscompte sont : Aldi marché, Eda, Lidl, Norma, Penny, Profi, Treff marché.
Source :INSEE - division « commerce ».
B.- LES PROCÉDURES D'AUTORISATION PRÉVUES PAR LA LOI ROYER
La création d'établissements commerciaux ou la modification de leur nature et l'exercice d'activités commerciales sont régis par le principe de la liberté du commerce et de l'industrie posé par l'article 7 de la loi d'Allarde des 2 et 17 mars 1791 portant suspension de tous les droits d'aides, de toutes les maîtrises et jurandes et établissement des droits de patente : « A compter du 1er avril prochain, il sera libre à toute personne de faire tel négoce ou d'exercer telle profession, art ou métier qu'elle trouvera bon ; mais elle sera tenue de se pourvoir auparavant d'une patente, d'en acquitter le prix, et de se conformer aux règlements de police qui sont ou pourront être faits. »
Cette règle a une valeur législative et non constitutionnelle. Il s'agit d'une liberté publique, que le Conseil d'Etat considère cependant moins protégée que d'autres libertés comme celles d'aller et venir, de se réunir, d'imprimer et de diffuser une publication d'information (CE Section, 28 octobre 1960, Martial de Laboulaye). Le législateur est donc en droit de la limiter fortement si l'intérêt général l'exige.
Le Conseil constitutionnel a toutefois rangé parmi les principes de valeur constitutionnelle la liberté d'entreprendre (CC, 16 janvier 1982, loi de nationalisation). Ce principe a cependant une vocation beaucoup plus large que le principe de liberté du commerce et de l'industrie. Le Conseil constitutionnel veille à ce que le législateur ne commette pas d'erreur manifeste d'appréciation en mettant en place une législation qui aboutirait, en pratique, à empêcher toute initiative d'entreprendre dans un secteur économique. Les dispositions de la loi Royer du 27 décembre 1973, même si la loi elle-même n'a pas été soumise au Conseil constitutionnel en 1973, ont toujours été validées par le Conseil à l'occasion de recours contre des projets de loi qui en modifiaient le champ d'application ou la portée (notamment la décision n° 92-316 DC du 20 janvier 1993 sur le projet de loi relatif à la prévention de la corruption).
Dans les années 1970 et 1980, les articles 28 à 33 n'ont pas été modifiés alors que le nombre de mètres carrés autorisés s'était mis à croître fortement à partir de 1985.
Avant la promulgation de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993, trois adaptations techniques avaient été apportées :
1° la loi n° 90-1260 du 31 décembre 1990 d'actualisation des dispositions relatives à l'exercice des professions commerciales et artisanales avait soumis à un mécanisme d'autorisation la création d'ensembles de magasins réunis sur un même site et apparentés techniquement ou économiquement (introduction de l'article 29-1). Cette mesure visait à empêcher d'échapper aux seuils fixés par la loi par le fractionnement des centres commerciaux ;
2° le décret du 17 février 1992, modifiant le décret du 28 janvier 1974 portant application de la loi Royer, a rendu publics les votes au sein des commissions départementales, modifié la représentation des élus locaux et limité à deux mandats consécutifs les mandats des membres des commissions départementales et nationale ;
3° l'article 62 de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux DOM, aux TOM et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon a introduit un article 28-1 afin d'adapter partiellement la procédure d'autorisation aux départements d'outre-mer.
En revanche, les lois n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques et n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ont modifié en profondeur la loi Royer.
1. Le champ d'application du régime des autorisations
La loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat soumet à autorisation la création, l'extension ou la transformation des magasins de commerce de détail atteignant une certaine surface. La loi s'applique quelle que soit la forme de la vente dès lors qu'elle constitue une vente à un consommateur et qu'elle s'effectue dans un bâtiment (par opposition aux halles, foires, braderies,... qui ne sont pas des surfaces permanentes et n'exigent pas l'obtention d'un permis de construire). Le contenu des magasins de vente au détail et la méthode de vente sont donc indifférents.
Les seuils d'application du régime d'autorisation n'ont pas été modifiés de 1973 à 1996. A l'origine, ces seuils étaient les suivants :
- pour les constructions nouvelles entraînant création de magasins de commerce de détail : surface de plancher hors _uvre supérieure à 3000 m2 ou surface de vente supérieure à 1 500 m2 ;
- pour les constructions nouvelles entraînant création de magasins de commerce de détail dans les communes dont la population est inférieure à 40 000 habitants : surface de plancher hors _uvre supérieure à 2 000 m2 ou surface de vente supérieure à 1 000 m2 ;
- pour l'extension de magasins ou l'augmentation des surfaces de vente des établissements commerciaux ayant atteint les surfaces indiquées ci-dessus ou devant les atteindre ou les dépasser par la réalisation du projet d'extension : une autorisation est requise lorsque l'extension de la surface est supérieure à 200 m2.
La loi n° 90-1260 du 31 décembre 1990 précitée avait cependant soumis au régime d'autorisation les créations ou extensions de magasins faisant partie ou destinés à faire partie d'un même ensemble commercial. Cette disposition (article 29-1 de la loi Royer) visait à empêcher le contournement de la règle des seuils par le fractionnement des surfaces de vente. Ce même article, abrogé par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996, définissait la notion d'ensemble commercial.
La loi Royer précise par ailleurs qu'une nouvelle demande est nécessaire lorsque le projet de loi subit des modifications substantielles dans la nature du commerce ou des surfaces de vente ou en cas de modification d'une enseigne de distribution dans le projet soumis à la commission.
La loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat a profondément modifié le régime d'autorisation.
Elle a tout d'abord abaissé à 300 m2 le seuil de surface de vente entraînant l'application du dispositif d'autorisation aussi bien des créations que des extensions de magasins. Mais signalons que l'assiette de la taxe sur les grandes surfaces n'a pas pour autant été modifiée : n'y sont assujetties que les surfaces de vente d'au moins 400 m2 (loi n° 72-657 du 13 juillet 1972). Rappelons que cette taxe est destinée à financer l'aide au départ des commerçants et artisans et que l'excédent de son produit alimente, entre autre, le fonds d'intervention pour la sauvegarde de l'artisanat et du commerce (FISAC).
Elle a ensuite simplifié le dispositif de calcul du seuil :
- la distinction des seuils selon la population des communes d'implantation a été supprimée. Il est en effet apparu que ce critère restrictif n'avait pas apporté une protection supplémentaire aux commerces traditionnels des communes de moins de 40 000 habitants ;
- la distinction entre surface de plancher hors _uvre et surface de vente a été supprimée. Selon la direction du commerce intérieur, cette première notion n'avait été d'aucune utilité, seule la seconde était déterminante pour apprécier un projet ;
- la franchise de 200 m2 de surface de vente dont bénéficiaient les projets d'extension pour être dispensés d'une autorisation a été supprimée. Cette règle permettait de contourner la loi et duper les commissions départementales comme le montre l'exemple des extensions de surface du centre Leclerc de Pithiviers : en 1986, un centre Leclerc d'une surface de vente inférieure à 1 000 m2 est créé (aucune autorisation n'était nécessaire) ; le propriétaire du magasin utilise ensuite la franchise pour s'agrandir et porter sa surface à 1 200 m2 ; en 1994 il soumet à la commission départementale un projet d'extension que celle-ci autorise, le 13 février 1995, à hauteur de 562 m2, mais utilisant une nouvelle fois la franchise de 200 m2, il porte la surface de son magasin à 1 960 m2. Cette double utilisation de la franchise a été validée par la chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 14 septembre 1999. Par ailleurs, cette franchise était d'une application complexe lorsqu'elle s'appliquait à un ensemble commercial (à quel magasin affecter la franchise ? comment contrôler l'usage de cette franchise lorsque les lots étaient modifiés ?).
La loi du 5 juillet 1996 a en outre soumis à autorisation des opérations jusque là non concernées par la loi Royer :
- la création d'une station-service, quelle que soit sa surface, annexée à un magasin de commerce de détail ou à un ensemble commercial de plus de 300 m2 ;
- la réutilisation à usage de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 300 m2 libérée à la suite d'une autorisation de création de magasins par transfert d'activités existantes. Cette mesure visait à combler une faille de la loi puisqu'un détaillant pouvait auparavant ouvrir un commerce librement dès lors qu'il résultait d'un transfert d'activités existantes puis ensuite réutiliser l'espace de vente laissé ainsi libre à des fins commerciales ;
- la réouverture au public, sur le même emplacement, d'une surface de vente supérieure à 300 m2 dont les locaux ont cessé d'être exploités pendant deux ans. Cette disposition reprenait une règle figurant à l'article 39 du décret n° 93-306 du 9 mars 1993 ;
- les constructions nouvelles, les extensions ou les transformations d'immeubles existants entraînant la constitution d'établissements hôteliers d'une capacité supérieure à 30 chambres, seuil porté à 50 chambres dans la région Ile-de-France ;
- les changements de secteurs d'activités d'un commerce d'une surface de vente supérieure à 2 000 m2 ou 300 m2 lorsque l'activité nouvelle du magasin est à dominante alimentaire.
La loi considère en outre comme une extension l'utilisation supplémentaire de tout espace attenant à un magasin de commerce de détail.
La loi du 5 juillet 1996 a en revanche expressément exclu du champ de compétence des commissions départementales d'équipement commercial :
- les regroupements de surfaces de vente de magasins voisins, sans création de surface de vente supplémentaire, qui n'excèdent pas 1 000 m2 ou 300 m2 lorsque l'activité nouvelle est à prédominance alimentaire,
- les pharmacies,
- les halles et marchés établis sur les dépendances du domaine public,
- la création ou l'extension de garages (ou de commerces d'automobiles disposant d'un atelier d'entretien et de réparation) d'une surface totale de moins de 1 000 m2.
Enfin la loi a précisé que les autorisations sont accordées par mètre carré de surface de vente ou par chambre pour les hôtels. Cette mesure permet de sanctionner les infractions dès qu'il existe un mètre carré de surface non autorisé et d'appliquer une amende pour chaque mètre carré exploité sans autorisation. Certes, l'amende applicable est celle prévue pour les contraventions de cinquième classe mais si un magasin exploite indûment 100 m2, une amende d'un million de francs par jour d'ouverture peut être infligée au titulaire de l'autorisation.
En dernier lieu, la loi du 5 juillet 1996 a inséré dans l'article 28 de la loi Royer une disposition imposant que toute demande de création d'un magasin de commerce de détail ou d'un ensemble commercial d'une surface de vente supérieure à 6 000 m2 soit accompagnée des conclusions d'une enquête publique portant sur les aspects économiques, sociaux et d'aménagement du territoire du projet. Le tableau ci-dessous dresse le bilan d'application de cette mesure.
ÉTAT DES ENQUÊTES PUBLIQUES AU 31 JUILLET 1999
Demandes d'enquête publique |
Conclusions d'enquête publique |
Demandes déposées en CDEC suite à l'enquête publique |
Décision prise par les CDEC |
Dossiers en instance auprès des CDEC |
||||||
Nbre |
Surface |
Négatives |
Positives |
Nbre |
Surface |
Autorisation |
Refus |
Nbre |
Surface |
|
1997 |
19 |
1 243 000 m2 |
2 |
14 |
16 |
1 178 000 m2 |
9 |
7 |
0 |
0 |
de 1998 au 31/7/99 |
58 |
741 000 m2 |
4 |
50 |
50 |
621 000 m2 |
28 |
16 |
6 |
62 000 m2 |
L'originalité de la loi Royer du 27 décembre 1973 tient en ce qu'elle confie à une autorité administrative collégiale la mission d'autoriser ou de refuser la création, l'extension ou la transformation des grandes surfaces de vente au détail. Dès l'origine, l'objectif a été d'associer au sein de ces instances les élus locaux, les représentants du commerce et de l'artisanat et les représentants des consommateurs. L'échelon départemental a été choisi pour définir ses compétences territoriales ; il permettait de rester proche des réalités du terrain tout en ayant une vue globale des zones de chalandise.
Le régime de ces commissions départementales d'urbanisme commercial (CDUC) n'a pas été modifié pendant 20 ans.
En outre, le législateur de 1973 a souhaité assurer l'unité de la politique d'urbanisme commercial en permettant de faire appel des décisions des CDUC devant le ministre chargé du commerce, ce dernier devant recueillir l'avis d'une commission nationale, dont la composition reflétait celle des CDUC, préalablement à sa décision, qui était elle-même susceptible d'un recours en annulation devant le Conseil d'Etat.
a) La composition des commissions départementales
Le tableau ci-après compare les compositions successives des commissions départementales d'urbanisme puis d'équipement commercial (figurent en italique les modifications intervenues en 1996).
Le législateur de 1992 a voulu confier la responsabilité des décisions prises en CDEC aux élus. Cette approche de l'urbanisme commercial traduisait la volonté de considérer que les décisions d'autorisation ou de refus de création ou d'extension de grandes surfaces commerciales comme relevant de choix d'aménagement du territoire. Le choix des quatre élus locaux les composant était significatif de cette démarche puisqu'il s'agissait du maire de la commune d'implantation, des maires des deux communes les plus peuplées de l'arrondissement et du conseiller général du canton. Les CDEC étaient donc appréhendées comme des organes participant à l'aménagement du territoire ; leurs décisions devaient donc relever du pouvoir politique, et en particulier des élus locaux dont la légitimité est la plus forte en cette matière.
Cette nouvelle composition des commissions départementales mettait également l'accent sur la responsabilité des membres des CDEC vis-à-vis de ceux qui les ont élus (population, commerçants et industriels, artisans). Seul le représentant des consommateurs n'avait pas de légitimité issue d'une élection.
En 1996, l'approche du législateur a été opposée ; elle a visé à rééquilibrer la composition des CDEC au bénéfice des membres socioprofessionnels par la suppression d'un des élus qui en étaient membres (le maire de la 2ème commune la plus peuplée de l'arrondissement). Il a considéré que les élus politiques ne devaient pas faire la décision à eux seuls au sein des commissions départementales car ce sont les entreprises qui subissent le premier effet de l'installation et des extensions de grandes surfaces commerciales.
Auparavant, le législateur de 1992 avait souhaité éviter la présence dans les CDEC de concurrents directs ou d'alliés commerciaux du pétitionnaire, ceux-ci devenant juges et parties. C'est pourquoi la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 a attribué les sièges des représentants des activités commerciales et artisanales aux deux présidents de la chambre de commerce et d'industrie et de la chambre des métiers.
En dernier lieu, si la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 a ramené de deux à un le nombre des représentants des consommateurs au sein des commissions départementales, leur poids relatif dans les délibérations s'est en fait accru car les voix des consommateurs sont passés de deux sur vingt à une sur sept.
ÉVOLUTION DE LA COMPOSITION DES COMMISSIONS DÉPARTEMENTALES D'URBANISME PUIS D'ÉQUIPEMENT COMMERCIAL
LOIS |
Régime en vigueur avant
la loi du 29 janvier 1993 |
Loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 |
Loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 |
Président |
Préfet (ne prend pas part aux votes) |
Préfet (ne prend pas part aux votes) |
Préfet (ne prend pas part aux votes) |
Nombre de membres |
20 |
7 |
6 |
Composition |
· 9 élus locaux : . le maire de la commune d'implantation ;
. 1 élu local désigné en son sein par le conseil municipal de la commune chef-lieu du département (si la commune d'implantation fait partie d'un établissement public d'aménagement d'une agglomération nouvelle, un élu de l'organe délibérant de cet établissement) (dans les départements à densité de population inférieure à 1.000 habitants au km2, le maire de la commune la plus peuplée dans un rayon de 5 km autour du centre commercial (10 km lorsque la surface de vente atteint ou dépasse 5.000 m2) ; ce représentant n'est pas appelé à siéger dans le cas où le centre a une surface inférieure à 5.000 m2 et est implanté en tout ou partie sur une commune de plus de 40.000 habitants) ; . 7 élus locaux désignés par le conseil général avec l'indication de l'ordre dans lequel ils sont appelés à siéger en fonction de la présence ou non des 2 précédents élus locaux dans le cas des départements ayant moins de 1.000 habitants au km2 (ou seulement du précédent élu dans le cas des départements ayant plus de 1.000 habitants au km2), parmi lesquels au moins 4 maires, dont au moins 2 représentent des communes de moins de 5.000 habitants, s'il en existe dans le département ; à Paris : . 8 membres du Conseil de Paris. · 9 représentants des activités commerciales et artisanales : . 1 artisan désigné par la ou les chambres de métiers du département ;
. 1 représentant des grands magasins ou magasins populaires, . 1 représentant des succursalistes ou des coopératives de consommation, . 6 représentants du commerce indépendant, parmi lesquels un représentant du commerce non sédentaire et un du commerce associatif ; · 2 représentants des associations de consommateurs représentatives, choisis par le préfet. |
· 4 élus locaux : . le maire de la commune d'implantation (le maire de Paris peut être représenté) ; ailleurs qu'à Paris : . le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménage-ment de l'espace et de développement, ou un élu local qu'il désigne, dont est membre la commune d'implantation ou, à défaut, le conseiller général du canton d'implantation (pour les établissements publics regroupant plus de 3 communes, son représentant ne peut pas être un élu d'une des communes appelées à être représentées à la CDEC) ;
dans le cas où la commune d'implantation est située hors de l'agglomération parisienne et appartient à une agglomération multicommunale d'au moins cinq communes, les maires des 2 communes les plus peuplées sont choisis parmi ceux des communes de l'agglomération (si un des maires est aussi le conseiller général, le préfet désigne le maire de la 3ème commune la plus peuplée de l'arrondissement ou de l'agglomération multicommunale éventuellement concernée). à Paris : . le maire de l'arrondissement du lieu d'implantation ;
· 2 représentants des activités commerciales et artisanales : . le président de la chambre de commerce et d'industrie territorialement concernée, ou son représentant ; . le président de la chambre de métiers territorialement concernée, ou son représentant. · 1 représentant des associations de consommateurs
du département |
· 3 élus locaux : . le maire de la commune d'implantation (le maire de Paris ne peut plus être représenté); ailleurs qu'à Paris : . le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement dont est membre la commune d'implantation ou, à défaut, le conseiller général du canton d'implantation ;
dans le cas où la commune d'implantation est située hors de l'agglomération parisienne et appartient à une agglomération multicommunale d'au moins cinq communes, le maire de la commune la plus peuplée est choisi parmi ceux des communes de l'agglomération ;
. le maire de l'arrondissement du lieu d'im-plantation . 1 conseiller d'arrondissement désigné par le Conseil de Paris. · 2 représentants des activités commerciales et artisanales : . le président de la chambre de commerce et d'industrie territorialement concernée, ou son représentant ; . le président de la chambre de métiers territorialement concernée, ou son représentant. · 1 représentant des associations de consommateurs du département. |
Assistent aux travaux |
. maires des communes limitrophes
(participent avec voix consultative) ; . le directeur départemental de l'équipement ; . le directeur départemental du commerce intérieur et des prix (services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes) ; . en Ile-de-France, un représentant du préfet de région. |
. le directeur départemental de
l'équipement ; . le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ; . en Ile-de-France, un représentant du préfet de région. |
. 1 représentant des services de
l'équipement ; . 1 représentant des services de la concurrence et de la consommation ; . 1 représentant des services de l'emploi ; . en Ile-de-France, un représentant du préfet de région. |
La réorientation de la composition des CDEC décidée en 1992 a eu pour conséquence de confier l'instruction des dossiers soumis aux commissions départementales à la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, à laquelle est associée, au besoin, la direction départementale de l'équipement, sous l'autorité du préfet. Auparavant, les rapports d'instruction étaient réalisés par les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers. Cette réforme a été très contestée, en 1992, par les chambres consulaires qui y ont vu une marque de suspicion et un désaveu sur la qualité et l'impartialité de leur travail d'instruction. La loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 a cependant prévu que les membres des commissions soient en possession des pièces des dossiers soumis à leurs délibérations un mois au mois avant celles-ci ; les présidents des chambres consulaires peuvent donc les faire étudier par leurs services et faire connaître leurs conclusions aux membres de la CDEC.
En 1996, l'adjonction de la présence du représentant du service déconcentré de l'Etat chargé de l'emploi marquait la volonté d'adapter la politique de l'équipement commercial aux exigences de la politique de l'emploi.
Le réaménagement de la composition des CDEC voté en 1996 était lié à la modification des règles de vote au sein des commissions départementales et d'appel devant la commission nationale :
- les autorisations ne peuvent être accordées que par un vote favorable de quatre de leurs six membres ;
- l'appel des décisions des CDEC devant la CNEC doit être formé par deux membres de la CDEC dont un élu, au lieu de trois membres auparavant, le préfet ou le demandeur pouvant toujours faire appel individuellement.
Avec ces nouvelles règles, les membres socioprofessionnels ne pouvaient donc désormais plus former un appel à eux seuls comme auparavant.
En outre, l'exigence d'un vote favorable de quatre des six membres visait également à lutter contre les abstentions au sein des CDEC.
c) La composition de la commission nationale
La loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 a transféré à la commission nationale le pouvoir de décision sur les appels formés contre les commissions départementales que détenait depuis 1973 le ministre chargé du commerce : la commission nationale est devenue un organe de décision alors qu'elle était initialement une instance consultative placée auprès du ministre. Il faut toutefois rappeler que 80 % des avis de la commission nationale d'urbanisme commercial étaient suivis par le ministre (voir plus haut le tableau statistique sur l'évolution des équipements commerciaux).
d) La portée des décisions des commissions
Avant 1993, les commissions départementales ne pouvaient qu'autoriser ou rejeter dans leur totalité les projets qui leur étaient soumis. Cette règle entraînait en cas de rejet d'un projet ou bien la présentation d'un nouveau projet, infléchi en fonction de la décision de rejet ou bien - c'était l'hypothèse la plus fréquente - l'appel de la décision. Dans les deux cas, la charge de travail des commissions départementales ou nationale s'en trouvait accrue.
En revanche, le ministre chargé du commerce, autorité saisie des recours formés contre les commissions départementales avant 1993, pouvait, en appel, selon une jurisprudence constante du Conseil d'Etat, autoriser des projets en réduisant leur taille, dès lors que cette réduction ne nuisait pas au projet ou ne transformait pas sa nature. Dans les faits, le ministre a pu réduire jusqu'à un quart de la surface demandée.
La loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 a permis aux CDEC d'autoriser des projets en en réduisant les surfaces ou en en supprimant des éléments leur paraissant incompatibles avec les principes visés à l'article 28 de la loi Royer (voir le point 3 ci-après).
3. Les critères de décision des CDEC et de la CNEC
Les commissions d'urbanisme puis d'équipement commercial ne peuvent fonder, en droit, leurs décisions qu'en se référant aux seuls critères visés à l'article 28 de la loi du 27 décembre 1973. Ces critères n'ont subi aucune modification de 1973 à 1992.
Initialement, ces critères étaient ceux figurant aux articles 1er, 3 et 4 de la loi.
L'article premier de la loi du 27 décembre 1973 garantissait, dans sa rédaction initiale, la liberté d'entreprendre et la loyauté de la concurrence commerciale. Il fixait comme objectifs au commerce et à l'artisanat, la satisfaction des besoins des consommateurs, l'amélioration de la qualité de la vie, l'animation de la vie urbaine et rurale et l'accroissement de la compétitivité de l'économie nationale. Il chargeait les pouvoirs publics de veiller à permettre l'expansion de toutes les formes d'entreprises, à ce que la « croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux ».
L'article 3 imposait aux entreprises commerciales et artisanales de s'adapter aux exigences de l'aménagement du territoire. Le thème majeur de l'aménagement du territoire était, en effet, en 1973, le développement des agglomérations et la rénovation des cités hâtivement construites dans les années 1960.
La loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 a substitué à cette thématique la notion d'« équilibre des agglomérations » qui résumait fidèlement les principes généraux de la politique de la ville inscrits dans la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville, dont le premier alinéa de l'article premier énonçait qu'« afin de mettre en _uvre le droit à la ville, les communes, les autres collectivités territoriales et leurs groupements, l'Etat et leurs établissements publics assurent à tous les habitants des villes des conditions de vie et d'habitat favorisant la cohésion sociale et de nature à éviter ou à faire disparaître les phénomènes de ségrégation. Cette politique doit permettre d'insérer chaque quartier dans la ville et d'assurer dans chaque agglomération la coexistence des diverses catégories sociales ».
D'autre part, à la place de la notion d'« évolution des zones rurales et de montagne », la loi du 29 janvier 1993 a défini un critère de poursuite de l'objectif d'un « maintien des activités en zones rurales et de montagne ». Le législateur de 1992 a jugé que si l'implantation des grandes surfaces devait s'adapter aux exigences de l'aménagement du territoire, il n'appartenait pas aux commissions de vérifier la conformité des projets à la réglementation d'urbanisme applicable à leur site. Cet examen devait incomber à l'autorité chargée de délivrer le permis de construire et non aux CDEC et CNEC qui devaient prendre leur décision à partir de critères économiques.
Enfin, l'article 4 de la loi Royer chargeait les pouvoirs publics de faciliter le groupement d'entreprises et la création de services communs.
La loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 a à nouveau modifié la définition de ces critères en les regroupant sous l'article 28 de la loi du 27 décembre 1973. Le tableau ci-après compare l'évolution de ces critères.
LA COMMISSION DÉPARTEMENTALE STATUE EN PRENANT EN CONSIDÉRATION :
Texte d'origine de la loi Royer n° 73-1193 du 27 décembre 1973 |
Texte de la loi Royer issu de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 |
Texte de la loi Royer
issu de la |
La commission doit statuer suivant les principes définis aux articles 1er, 3 et 4 ci-dessus, compte de tenu de l'état des structures du commerce et de l'artisanat, de l'évolution de l'appareil commercial dans le département et les zones limitrophes, des orientations à moyen et à long termes des activités urbaines et rurales et de l'équilibre souhaitable entre les différentes formes de commerce. |
Dans le cadre des principes définis aux articles 1er, 3 et 4, la commission statue en prenant en considération : | Dans le cadre des principes définis aux articles premier et 4 ci-dessus, la commission statue en prenant en considération : |
| - l'offre et la demande globales pour chaque secteur d'activité dans la zone de chalandise concernée ; | - l'offre et la demande globales pour chaque secteur d'activité dans la zone de chalandise concernée ; | |
| - la densité d'équipement en moyennes et grandes surfaces dans cette zone ; | - la densité d'équipement en moyennes et grandes surfaces dans cette zone ; | |
- l'effet potentiel du projet sur l'appareil commercial et artisanal de cette zone et sur l'équilibre souhaitable entre les différentes formes de commerce ; |
- l'effet potentiel du projet sur l'appareil commercial et artisanal de cette zone et des agglomérations concernées, ainsi que sur l'équilibre souhaitable entre les différentes formes de commerce ; | |
| - l'impact éventuel du projet en termes d'emploi salariés et non salariés ; | ||
- la nécessité d'une concurrence suffisante au sein de chaque forme de commerce et d'artisanat. |
- les conditions d'exercice de la concurrence au sein du commerce et d'artisanat ; | |
- les engagements des demandeurs de création de magasins de détail à prédominance alimentaire de créer dans les zones de redynamisation urbaine ou les territoires ruraux de développement prioritaires des magasins de même type, d'une surface de vente inférieure à 300 mètres carrés, pour au moins 10 % des surfaces demandées. |
||
| La commission prend en compte les travaux de l'observatoire départemental d'équipement commercial pour statuer sur les demandes d'autorisation. | Les décisions de la commission départementale se réfèrent aux travaux de l'observatoire départemental d'équipement commercial. |
4. Les voies de recours contentieux
On consultera au début de la présente partie les tableaux statistiques sur les recours formés contre les décisions des commissions départementales.
Le législateur a toujours refusé d'ouvrir le recours à des personnes ayant un intérêt lésé par la décision de la commission départementale car comme c'est toujours le cas, cette possibilité de recours serait toujours utilisée, mettant à néant l'utilité d'un double degré de décision.
Il faut cependant rappeler qu'une personne ayant un intérêt à agir peut former un recours en annulation ou un recours en indemnité pour réparation du préjudice causé contre les décisions définitives des commissions, devant les tribunaux administratifs lorsqu'il s'agit d'une décision de CDEC ou devant le Conseil d'Etat lorsqu'il s'agit d'une décision de la CNEC (8) (ou auparavant du ministre). Le législateur a, en 1992, refusé, comme le proposait le Gouvernement à l'époque, d'ouvrir la possibilité de former un recours de plein contentieux contre les décisions de la CNEC (9). Ce choix était guidé par des raisons pratiques. En effet, dans le cadre d'un tel recours, le juge administratif statue en fonction du droit et des faits existant à la date de son jugement et non à la date de la décision attaquée comme dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir (recours en annulation). Or, pendant les deux ou trois années d'instruction du recours, un, voire plusieurs projets commerciaux nouveaux peuvent avoir été autorisés dans la zone de chalandise. Le Conseil d'Etat sera amené à prendre en considération cette nouvelle situation et peut-être rejeter des demandes ou les transformer profondément par réformation de la décision, ce qui n'aurait pas été possible en cas de recours pour excès de pouvoir. En fait, le législateur a refusé que le juge administratif substitue sa décision à celle des commissions instituées par la loi et que le Conseil d'Etat devienne en quelque sorte un troisième niveau de décision en matière d'urbanisme commercial (10).
La loi du 27 décembre 1973 ouvrait initialement ce recours au préfet, au pétitionnaire et à un tiers des membres de la CDUC, soit sept commissaires (sur vingt). La loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 a ramené à trois le nombre de personnes pouvant former collectivement un appel. Celui-ci était rendu beaucoup plus difficile puisque les CDEC étaient composées de sept personnes. Le but était de ne pas permettre aux représentants des activités commerciales et artisanales de former des recours à eux seuls. Cette réforme s'insérait dans la conception d'aménagement du territoire dans laquelle devait se placer, selon le législateur de 1992, les décisions en matière d'urbanisme commercial.
La loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 a modifié sensiblement les règles de recours formé collectivement par les membres des commissions départementales puisque celui-ci est désormais ouvert sur appel de deux de leurs six membres, mais un de ces deux appelants doit être un élu politique. La faculté donnée au préfet et au pétitionnaire de faire appel a été maintenue.
Cette nouvelle règle visait à imposer le caractère mixte de toute décision en matière d'urbanisme commercial : il s'agit à la fois d'aménagement du territoire qui relève de la responsabilité des élus locaux et de décision sociale et économique que les responsables socioprofessionnels siégeant sont les mieux à même d'appréhender.
C.- LES SCHÉMAS DE DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL
La mission d'information a approuvé les propositions de M. Jean-Paul Charié, son président, sur les schémas de développement commercial que l'on trouvera ci-après. Ces documents doivent devenir de véritables normes d'orientation en matière d'équipement commercial, en s'intégrant dans l'ensemble des documents d'urbanisme et en étant opposables aux tiers. Il est en effet déterminant que les schémas de développement commercial lient les autorités chargées de délivrer des autorisations pour l'installation ou l'extension des commerces et être opposables aux décisions d'urbanisme ou d'équipement commercial à l'appui d'un recours. A terme, il faut envisager la disparition du dispositif d'autorisation de la loi Royer, qui n'a pas atteint les objectifs pour lesquel il avait été conçu, et y substituer le mécanisme des schémas d'équipement commercial.
1. Une autre conception de la concurrence
Depuis plus de 25 ans les commerçants français faisaient pression sur l'État pour qu'il limite l'implantation des grandes surfaces. La loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, dite loi Royer, est une des plus contraignantes réglementations d'urbanisme commercial d'Europe et pourtant elle n'a rien entravé. C'est en France et en Belgique qu'il existe la plus forte densité de mètres carrés de supermarchés et d'hypermarchés d'Europe.
Le vrai problème ne vient pas de la présence des grandes surfaces mais de certains de leurs comportements déloyaux. En 1996, la législation sur les pratiques de prix anormalement bas a été améliorée. Il reste des efforts à mener sur les négociations commerciales, c'est l'objet de cette mission.
En 1996, le législateur a également ouvert la voie d'une petite révolution culturelle, économique et politique en envisageant de remplacer, à terme, le système de la loi Royer du 27 décembre 1973 par un mécanisme reposant sur des schémas de développement commercial. Dans le premier système quelques membres de commissions locales sont chargés d'autoriser ou non une création ou une extension de surface de vente de plus de 300 m². Le second mécanisme s'appuiera sur des objectifs politiques nationaux, régionaux et locaux définissant une stratégie locale de développement du commerce dans laquelle devront s'insérer les projets de création, d'agrandissement ou de transfert de surfaces de vente.
C'est une révolution culturelle car elle implique de ne plus considérer les « grandes surfaces » comme des « ennemis » mais comme des partenaires du dynamisme commercial et des petites entreprises.
C'est une révolution politique pour au moins deux raisons majeures :
- l'État continuera d'exercer sa mission en fixant un cadre législatif national, et chaque région, chaque territoire devra déterminer ses propres critères, laissant ainsi à la loi la possibilité de s'adapter à chaque spécificité locale ;
- les schémas de développement commercial seront une référence. Pour obtenir une autorisation, les pétitionnaires n'auront qu'à satisfaire un certain nombre des objectifs-critères proposés dans le schéma.
2. Les schémas reposent sur quatre objectifs majeurs
1° Favoriser la libre concurrence sans asphyxier la concurrence
La difficulté est de trouver le juste équilibre entre les « rentes de situation » et la « concurrence sauvage ». Les schémas ne doivent pas se traduire par le retour du corporatisme qui permettrait aux entreprises en place d'empêcher l'installation de nouvelles entreprises.
2° Aménager le territoire
Il s'agit de maintenir le commerce en ville, en périphérie et en milieu rural et d'éviter la concentration des commerces dans les grosses agglomérations. Ainsi, du fait de l'augmentation des charges fixes, il faut aujourd'hui deux fois plus de surfaces de vente pour dégager un supplément de chiffre d'affaires susceptible de compenser la hausse des frais fixes.
Le schéma de développement commercial devra rechercher une meilleure répartition des commerces sur l'ensemble du territoire et permettre de développer les services à la personne (commerces de proximité, livraison à domicile,...).
3° Veiller à préserver les marges d'exploitation des différentes formes de commerce
Sans créer des « rentes de situation », les commerces implantés conformément aux critères du schéma de développement commercial devront être économiquement viables et préserver les marges des concurrents compétents.
4° Maintenir et développer les services aux consommateurs
Tous les habitants, quels que soient leurs lieux d'habitation, devraient avoir accès à un minimum de services. Par conséquent, le schéma devra prendre en compte dans ses critères de délivrance des autorisations administratives les exigences suivantes en matière de prestation de services à la personne : proximité, qualité, diversité, prix et accès à ces services.
3. Les axes du dispositif législatif à mettre en place
Les schémas de développement commercial devront définir des séries de critères objectifs que les personnes souhaitant créer ou étendre une surface de vente devront satisfaire pour obtenir une autorisation. Ces critères seront valables pour toute création, transfert, agrandissement d'un point de vente au public de plus de 300 m² dans le cadre de la loi Royer du 27 décembre 1973, ou pour tout point de vente au public (agro-alimentaire, bricolage, cinéma, hôtellerie, services, banques...) si la loi est modifiée en ce sens.
Ces critères doivent être préalablement établis. Il est nécessaire que le schéma de développement commercial retienne, en plus ou au-delà du critère traditionnel de la surface (300 m²), des critères relatifs aux modalités de commercialisation, notamment la capacité à innover par rapport à la concurrence en offrant de nouveaux types de services au consommateur.
On peut citer les exemples de catégories suivantes de critères :
- l'aménagement du territoire (les centres villes, les périphéries et les zones rurales nécessitent des approches différentes) ;
- les moyens économiques et financiers et la rentabilité des commerces ;
- le partenariat, la synergie avec les autres commerces ;
- le caractère innovant de la surface de vente ;
- le service au consommateur ;
- la qualité architecturale du projet et son insertion dans l'environnement ;
- les capacités professionnelles des gérants ;
- l'impact sur l'emploi ;
- le rayonnement de la politique nationale des activités commerciales.
Il conviendra d'établir un plan pluriannuel intercommunal de développement du commerce qui devra être conforme à des orientations politiques, sociales (emploi et services à la personne) et humaines (valorisation des notions de proximité et de diversité correspondant à un choix de société dans laquelle l'homme retrouve une place centrale) et de fixer des règles claires et transparentes pour que les mécanismes de délivrance des autorisations ne fassent pas l'objet de suspicions.
Lancée par M. Jean-Pierre Raffarin, ministre des PME, du commerce et de l'artisanat, une phase d'expérimentation des schémas de développement commercial a abouti à une conclusion positive publiée par son successeur au ministère, Mme Marylise Lebranchu.
Il n'est toutefois pas souhaitable d'imposer la généralisation de ces schémas. Une période de sensibilisation et de maîtrise des changements de comportements qu'ils imposent doit être respectée. En revanche, pour chaque zone géographique qui se dote déjà d'un schéma de développement commercial, la mission d'information, rejoignant les propositions de Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat aux PME, au commerce et à l'artisanat, propose que chaque document serve de référence au préfet et à la commission nationale d'équipement commercial pour examiner les recours formés contre une décision d'une commission départementale d'équipement commercial non conforme au schéma concerné.
Une circulaire devra également préciser les garanties à apporter par les pétitionnaires de respect de leurs engagements.
D.- LE COMMERCE DE CENTRE VILLE : LES VILLES FRANÇAISES SONT-ELLES CONDAMNÉES À DEVENIR DES VILLES À L'AMÉRICAINE ?
Une grande majorité de Français rejette ce modèle, refuse de voir les centres des agglomérations se transformer en villes musée ou en villes dortoir, mais l'évolution est inexorable et la réalité est souvent difficile à regarder en face.
Depuis vingt ans, les habitudes des consommateurs ont changé. Alors qu'à la fin des années 1970, ils s'approvisionnaient à 25 % dans des grandes surfaces et à 75 % dans le petit commerce, c'est aujourd'hui exactement l'inverse. La part des petits commerces de détail, à dominante alimentaire, dans la vente des biens de grande consommation est passée, de 1986 à 1996, de 33 % à 20 %. 300 000 commerçants sont pourtant encore installés dans le centre des villes en France.
« Alors qu'il y avait, 600 magasins de type Monoprix ou Prisunic dans les centres urbains il y a 15 ans, il n'y en a plus que 300 aujourd'hui », déclarait à la mission d'information Monsieur Jacques Perrillat, directeur général de l'Union des grands commerces de centre ville. « On a fermé ce type de magasin dans les villes de 10 000 habitants, puis dans les villes de 20 000 habitants et ce sont aujourd'hui celles de 30 000 habitants qui sont touchées. La combinaison des hypermarchés et des magasins de maxidiscompte a eu des effets dévastateurs sur le commerce d'alimentation dans le centre des villes. »
Le consommateur est passé insensiblement du pot-au-feu au surgelé. Chacun d'entre nous a en effet un cerveau droit et un cerveau gauche. Le cerveau droit nous rappelle notre culture, les produits naturels, nous fait saliver lorsqu'on lui rappelle le lait à la ferme, mais l'autre lobe du cerveau intègre les nouvelles contraintes de la vie moderne où le couple travaille et ses neurones le conduisent chaque samedi vers le grand magasin où il remplit son caddie de plats cuisinés ou de biens de consommation vus à la télé. Certains consommateurs apprécient même que l'on fasse un régime ou la cuisine à leur place. Ils vont donc au supermarché parce que c'est plus simple, plus facile, plus pratique, plus rapide, moins cher. Il faut dire qu'ils sont lassés de ne pouvoir faire que 30 % de leurs achats dans un magasin de centre ville quand ils peuvent en effectuer la totalité dans un hypermarché périphérique disposant d'une galerie marchande associée. Mais le modèle que recherche notre société est-il vraiment celui de l'hypermarché gigantesque ou du multiplex regroupant 30 salles de cinéma ? Les 160 centres des aires urbaines comprenant entre 20 000 et 190 000 habitants sont-ils condamnés à dépérir ? Peut-on favoriser un équilibre et les régulations entre les différentes formes de commerce ? Doit-on baisser les bras et remercier la centralité qui fait partie de notre culture européenne ? En un mot, comment favoriser la reconquête du centre ville ? Car il faut bien reconnaître que la loi Royer du 27 décembre 1973 a été incapable de maintenir l'équilibre entre le c_ur des villes et les implantations d'hypermarchés à la périphérie. Si l'on veut rétablir l'équilibre, il faut inverser la tendance actuelle puisqu'en France, aujourd'hui, 20 % du commerce sont situés dans le centre des agglomérations et 80 % à la périphérie. Il convient également d'établir une discrimination positive pour favoriser la reconquête des centre-villes.
Cette évolution s'est traduite par des villes éclatées : centres anciens, quartiers périphériques sensibles, quartiers dortoir, quartiers résidentiels, centres des communes périphériques, faubourgs, zones d'activité, zones industrielles, technopôles.
L'exemple de Nancy est significatif : le centre historique a continué à jouer le rôle de pôle commercial attractif avec des rues marchandes, le marché central et un centre commercial très fréquenté doté d'un supermarché : le centre commercial Saint-Sébastien au centre ville, des locomotives commerciales telles que la FNAC, le Printemps ou le Hall du livre. Mais, les difficultés de circulation et la difficulté d'accès au centre pour les automobiles, les tarifs de stationnement trop élevés, une desserte des transports en commun peu adaptée et mal équilibrée entre différents modes de transport (voiture-tram-vélos), l'absence de secteur piétonnier, la fiscalité trop élevée pour les commerçants, ont conduit à un éclatement des offres commerciales sur la périphérie de la ville. Des hypermarchés et des supermarchés se sont développés au Sud et à l'Ouest, Vandoeuvre, Laxou et Houdemont, à l'Est à Essey et à Tomblaine ou au Nord à Frouard. Dans le même temps, les commerces des centres villes de Villiers, de Laxou, de Vandoeuvre qui totalisent plus de 70 000 habitants ont pratiquement disparu et dans les quartiers nouveaux comme le Haut du Lièvre, (10 000 habitants) le commerce de proximité ne s'est pas développé. Les responsables de l'urbanisation n'ont pas réussi à façonner ce que doit véritablement être un quartier : une ville dans la ville. Les zones d'activités et la technopôle de Nancy-Brabois n'ont pas généré de véritables pôles d'équilibres attractifs pour le commerce, l'industrie et les services.
Alors que le centre ville de Nancy avait jusqu'aujourd'hui résisté puisqu'une enquête de la chambre de commerce évalue le volume du commerce à 26 % dans le centre, pour 74 % dans la périphérie, de nombreux nouveaux projets pointent, notamment un projet Auchan qui augmenterait les surfaces commerciales de 20 000 m². C'est moins l'augmentation de la surface de l'hypermarché actuel qui passerait de 6 000 m² à 12 500 m², encore qu'avec une densité commerciale de 310,28 m² pour 1 000 habitants, la Meurthe-et-Moselle se situe déjà au-dessus de la moyenne nationale (277,58), que la création de 8 000 m² de galeries marchandes associées, correspondant à 80 boutiques qui risque de concurrencer l'actuel centre ville. Enfin, ce projet propose de créer 80 boutiques, c'est l'équivalent de deux rues. A cela s'ajoute un projet de création de 5 000 m² de commerces de moyenne surface, d'une nouvelle surface de bricolage et d'agrandissement des enseignes existantes. Tout cela est déraisonnable, car ces projets vont fragiliser encore plus le centre ville. Ils n'ont pas, selon votre rapporteur, été suffisamment discutés avec les habitants, car l'augmentation de surface d'un hypermarché pourrait se concevoir si elle se faisait dans des zones beaucoup plus proches du centre ville, jouant le rôle de locomotive pour les commerces existants. L'implantation à Nancy d'une surface près du centre serait, selon votre rapporteur, préférable à la création ex nihilo, dans un lieu à faible densité de population, et qui ne sera jamais considéré comme le centre de la cité avant au moins trente ans.
A côté des grandes surfaces se sont créées des galeries marchandes, mais la très grande majorité de nos concitoyens souhaitent que le commerce de centre ville survive. Il faut donc le soutenir, maintenir des équilibres, éviter les tensions entre ville centre et périphérie.
La ville de demain sera, de fait, multipolaire. Pour réorganiser les centres de ville, la mission préconise de travailler dans quatre directions : l'intercommunalité, la fiscalité, les animations et services, le partenariat. Il faut prendre en compte le coût de la ville et l'accès à la ville.
1. L'intercommunalité est primordiale
La réflexion sur l'équipement commercial doit se faire en termes d'aire urbaine, car c'est à cet échelon que les collectivités doivent organiser la gestion des équipements et des services publics.
La mission d'information recommande particulièrement un soutien au marché de gros : le commerce traditionnel (marchés couverts, petits commerces de proximité, commerce de centre-ville) doit sa survie à l'existence d'un marché de gros indépendant.
Notre philosophie est de maintenir les équilibres entre les différents circuits de distribution. Le commerce de gros représente encore aujourd'hui un tiers du commerce total français. Il subit aujourd'hui la concurrence de la grande distribution (sous la forme des magasins de cash-and-carry) mais apporte, sans conteste, un service supplémentaire dans le maintien de la diversification de l'offre.
La grande distribution peut, dans certains cas, limiter l'offre (il n'y a que 600 produits chez Aldi) et propose des produits à forte rotation au détriment de biens de consommation plus diversifiés.
La mission s'est inquiétée du risque d'uniformisation de l'offre des produits dans la grande distribution. Les grossistes jouent, de ce point de vue, un rôle majeur dans le maillage territorial de la distribution des productions et ils représentent, selon elle, des maillons essentiels pour le contrôle de la qualité et de la sécurité alimentaires. Il faut bien sûr soutenir le marché d'intérêt national de Rungis, mais nous sommes inquiets de voir que ces marchés de gros dépérissent dans les régions françaises. C'est le cas aujourd'hui à Nancy, où seulement deux grossistes résistent. C'est à l'échelon intercommunal que ces enjeux doivent être appréhendés et la Communauté urbaine devrait se battre pour faire vivre un marché de gros à Nancy.
C'est aussi au niveau intercommunal, où 20 à 50 communes peuvent être regroupées, que les schémas de développement commercial, les schémas directeurs, les plans d'occupation des sols et tous les documents d'urbanisme devraient être discutés. La mission partage l'avis de M. Michel Delebarre, président de l'association des maires des grandes villes de France, qui déclarait, il y a deux ans, que « les schémas d'urbanisme devraient être rendus indispensables par la loi et opposables aux tiers ».
Pourquoi rendre obligatoires des plans locaux de l'habitat et ne pas rendre obligatoires des directives en matière d'équipement commercial ? Il y aurait là une étape nouvelle dans la décentralisation et l'obligation pour les élus de trouver, au niveau d'un bassin de vie, l'équilibre entre commerce de centre-ville et grande distribution.
Ces schémas auraient également l'avantage d'apporter plus de complémentarité sur un même bassin d'emploi entre les villes moyennes et les grandes agglomérations.
2. La modification des règles fiscales est indispensable
Les inégalités sont criantes. Des écarts de un à six peuvent être observés sur un même bassin d'emploi. Les commerçants de centre-ville payent plus d'impôt alors que souvent la démographie est en baisse dans le centre-ville, que les jeunes quittent les centres parce que les loyers sont trop élevés, que souvent les sièges sociaux font de même, que les commerçants qui ont proportionnellement plus d'employés payent plus cher les rénovations des façades, que les baux commerciaux sont trop chers et que les coûts de livraison des marchandises sont eux aussi plus élevés.
Votre rapporteur estime qu'une réforme fiscale est indispensable et qu'il faut instaurer une taxe professionnelle d'agglomération (sur une communauté urbaine, avec répartition des recettes fixées entre les différentes collectivités). Le versement de cette taxe ne doit pas bien sûr être écrêté. D'autres mesures sur l'amortissement fiscal du droit au bail, la réduction des droits de mutation, la fixation d'un plafond des taxes foncières lors de la réforme des bases locatives sont nécessaires.
Il apparaît également important qu'il n'y ait pas de distorsion dans les amplitudes horaires entre le commerce de centre-ville et la grande distribution.
L'animation est nécessaire pour rendre plus attractif le centre-ville : la plus belle galerie marchande est le centre-ville. Le centre d'une ville est une galerie marchande à ciel ouvert et le consommateur s'y rendra si l'offre de vente de biens de consommation est suffisamment diversifiée et si des locomotives, comme la FNAC, des magasins comme le Printemps ou Virgin s'y installent. Le magasin vend des produits mais offre également des services à la clientèle. Les grandes enseignes de centre-ville, comme la FNAC, organisent 4 000 événements par an, galeries photos, expositions, espaces d'animation, forums rencontre. Les associations de commerçants doivent innover, aller dans cette voie et coordonner leurs actions. Le client se rend en centre-ville s'il est attractif, s'il peut facilement s'y déplacer, s'il peut concilier offre commerciale, convivialité et activités culturelles. Les services à la clientèle, comme les livraisons à domicile ou les services de portage peuvent fidéliser certains types de clientèles. La « centralité » correspond à « notre identité culturelle ».
Pourquoi ne pas créer de nouveaux emplois d'agents encaisseurs sur les aires de stationnement des grandes surfaces, comme cela vient d'être expérimenté à Tours ; leurs salaires seraient largement payés par les recettes, le client paye selon le temps exact de stationnement. Ils pourraient renseigner efficacement les clients du centre ville qui viennent souvent de la périphérie ou même d'autres départements. Il faut innover pour apporter des services au client : porte-monnaie électronique qui additionneront des temps de stationnement gratuits, payés par les commerçants, voiture électrique dans les secteurs piétonniers, stewart urbains, chariots de ville, consignes, garderies,... Les services à la clientèle, comme les livraisons à domicile ou les services de portage peuvent fidéliser certains types de clientèles. Ce sont des mesures de ce type, rajoutées les unes aux autres qui peuvent redonner de l'attractivité au c_ur des villes.
3. Engager un véritable partenariat avec les municipalités, les communautés, et avec l'Etat
Le consommateur déserte le centre-ville s'il n'y trouve pas à la fois la convivialité, l'accès facile et la diversité des produits et des services recherchés. Pour reprendre l'exemple de Nancy, la rue Saint-Jean, qui est l'artère principale commerçante, ne possède plus de grande brasserie ; l'installation d'un grand café aurait un effet certain sur l'animation de ce quartier.
Les villes, mais plus encore les établissements publics de coopération intercommunale, ont une responsabilité dans le soutien du commerce de centre-ville et l'essor de commerces de proximité dans les quartiers résidentiels et les quartiers sensibles ; cette politique doit s'appuyer sur trois axes :
a) Partenariat avec les associations de commerçants
Les collectivités doivent avoir une réelle politique de participation impliquant les commerçants dans tout ce qui concerne le commerce : soutien aux marchés de gros et aux marchés couverts, négociation des aménagements d'horaires, politique d'animation et de création d'événements, plan de déplacements urbains, création de pistes cyclables, politiques de transport en commun, création de zones piétonnes, politique de stationnement, création d'emplacements de stationnement, politique tarifaire de ces aires de stationnement (avec gratuité pour les habitants de centre-ville).
Trop souvent, les décisions viennent du sommet, sans réelle concertation avec les associations de commerce et d'usagers.
b) Une politique fiscale et foncière
Les coûts standard de gestion des commerces de centre-ville sont plus élevés. Il est urgent d'abaisser les charges immobilières et fiscales, notamment pour les commerçants qui embauchent en moyenne plus de personnels. Votre rapporteur propose d'adopter des mesures fiscales d'harmonisation de la fiscalité au sein d'une agglomération ou d'un pays mais également des allégements de taxe professionnelle, de taxe foncière ou des aides à l'immobilier commercial.
c) Une réelle politique de la ville tenant compte de la réalité d'aujourd'hui.
La ville de demain doit être repensée. Il n'est pas interdit d'innover pour modifier la situation actuelle : villes éclatées, zones dépourvues d'offre commerciale, meilleur équilibre des ratios entre grande distribution périphérique et commerce de centre-ville, mais il convient de proposer également la localisation de supermarchés dans le centre-ville en lien avec les rues commerçantes et en fonction des plans de déplacements urbains. Votre rapporteur considère que c'est ce qui devrait être fait pour le dossier Auchan à Nancy.
De l'avis de votre rapporteur, l'Etat doit bien sûr participer aux politiques d'aménagement urbain au moyen d'un financement du fonds d'intervention pour la sauvegarde de l'artisanat et du commerce (FISAC) et aider la ville centre qui assume les charges de centralité. Les différentes politiques devraient figurer dans les contrats de ville (développement commercial dans les zones défavorisées) ainsi que dans les contrats d'agglomération.
Le FISAC devrait, en milieu urbain, soutenir en priorité l'accès au centre-ville, les cheminements dans les zones commerçantes, la signalétique urbaine, les zones de stationnement prévues dans les plans de déplacements urbains, la restructuration des halles et marchés couverts.
Article 30 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 La dénomination de magasin ou de dépôt d'usine ne pourra être utilisée que par les producteurs vendant directement au public la partie de leur production non écoulée dans le circuit de distribution ou faisant l'objet de retour. Ces ventes directes concernent exclusivement les productions de la saison antérieure de commercialisation, justifiant ainsi une vente à prix minoré. |
L'article 30 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat a amorcé une réglementation des ventes réalisées par les magasins d'usine. Celles-ci restaient en effet exclues des dispositions du décret du 15 mai 1974 réglementant les ventes directes aux consommateurs du fait que ces point de vente ne pouvant être considérés comme des locaux non destinés à la vente, le régime des ventes au déballage n'avait pas vocation à leur être appliqué.
Précisons que la création et l'extension des magasins d'usine sont soumises à autorisation des commissions départementales d'équipement commercial selon le régime de droit commun.
Le législateur a donc cherché à assurer une meilleure transparence de ces ventes, en définissant la nature et l'objet du magasin d'usine et les conditions de l'utilisation de la dénomination de magasin ou de dépôt d'usine. La vente doit être réservée aux producteurs vendant au public la partie de leur production non écoulée dans le circuit de distribution ou faisant l'objet de retour et il doit s'agir exclusivement des productions de la saison antérieure de commercialisation, justifiant une vente à prix minoré.
L'article 14 du décret n° 96-1097 du 16 décembre 1996 pris pour l'application du titre III, chapitre Ier, de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 a précisé que « tout producteur, vendant directement au public une partie de sa production sous l'une des dénominations mentionnées à l'article 30 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée, tient à la disposition des agents habilités à opérer des contrôles toute pièce justifiant de l'origine et de la date de fabrication des produits faisant l'objet de ces ventes directes au public. »
La circulaire du 16 janvier 1997 portant sur la réglementation prévue par le chapitre premier, titre III de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 n'a pas apporté d'autres précisions à cette réglementation, si ce n'est que « les dénominations trompeuses utilisées par les distributeurs sur leur qualité de "fabricant" ou sur le caractère de "vente directe" doivent continuer à être poursuivies en vertu de l'article L. 121-1 du code de la consommation sur la publicité de nature à induire en erreur le consommateur » [peine de deux ans d'emprisonnement et de 250 000 F d'amende].
Cette forme de vente, dont le chiffre d'affaires dans l'habillement est estimé à 2 milliards de francs, pose de graves problèmes de concurrence déloyale, même si elle est soumise à la loi Royer comme toute surface de vente. Tout d'abord elle induit souvent le consommateur en erreur : la majorité des produits vendus dans ces surfaces de vente sont loin d'être constitués par des stocks invendus ou invendables, les magasins d'usine ne sont plus les annexes des fabriques permettant d'écouler leurs produits en direct. La plupart des produits mis en vente dans les magasins d'usine peuvent être trouvés au même moment dans des commerces de détail, traditionnels ou de libre-service.
En outre, toutes les enquêtes montrent que les rabais pratiqués par les boutiques des magasins d'usine ne sont pas à la hauteur des annonces des promoteurs des magasins d'usine dans lesquels elles sont logées. Pire, de nombreux produits mis en vente dans ces boutiques ne sont même pas bradés par rapport à leur prix de vente au détail dans les commerce de centre-ville.
La loi ne permet pas d'empêcher ces pratiques déloyales, sauf en cas de tromperie. Mais que représente l'amende de 50 000 francs infligée par la Cour d'appel de Reims le 2 juillet 1997 à un responsable d'un établissement se présentant à tort comme un magasin d'usine ?
L'Observatoire national du commerce a décidé de conduire une réflexion sur le concept des magasins d'usine. Son président, M. Patrick Rimbert, étant membre de la mission d'information, votre rapporteur a proposé de ne pas étudier davantage ce sujet et d'attendre les recommandations que formulera l'observatoire à Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat aux PME, au commerce et à l'artisanat.
La mission d'information sur l'évolution de la distribution a été constituée par la commission de la production et des échanges de l'Assemblée nationale à la suite de la crise agricole de l'été 1999 et des craintes suscitées par la fusion des groupes Carrefour et Promodès. La mission a souhaité développer de manière argumentée ses conclusions sur les dossiers agricoles. Il sera ensuite exposé les conclusions concernant la régulation des relations entre fournisseurs et distributeurs. La mission d'information n'a toutefois pas souhaité qu'un droit spécial soit aménagé au sein de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence en faveur de l'agriculture car le droit de la concurrence doit rester d'application générale.
Le débat actuel sur l'organisation des filières de consommation a pour origine la crise sévère de la filière fruits et légumes d'août 1999. Les revendications se sont ensuite élargies à tous les fournisseurs de la grande distribution qui ont souhaité que le Gouvernement organise des assises de la distribution. Les organisations agricoles ont demandé avec insistance à la mission d'information de ne pas passer sous silence ou pertes et profits les particularités du secteur agricole, particulièrement celles du secteur des fruits et légumes.
Les problèmes sont à la fois les mêmes que ceux rencontrés par les fournisseurs d'autres biens de consommation, mais ils sont souvent plus aigus et toute crise se traduit par l'effondrement des prix se traduisant par des catastrophes instantanées dans les exploitations agricoles.
Toutes les organisations professionnelles et syndicales agricoles rencontrées (voir liste en annexe du rapport) sont conscientes de la nécessité d'une meilleure organisation des marchés et d'adapter la production à la consommation. Elles savent que cette mise en équation est plus difficile à réaliser dans le secteur des fruits et légumes que dans celui du lait ou de la viande.
La complémentarité entre la vente directe au consommateur, l'importation, la transformation, la vente aux grossistes ou à une centrale d'achat devrait permettre d'améliorer sensiblement la distribution des produits agricoles.
1. Mettre fin aux prix déstructurant le marché
Tous s'accordent pour affirmer qu'il faut sanctionner les prix prédateurs, car la concurrence dans le domaine agricole est réellement pervertie.
En cas de crise grave, certaines organisations demandent l'application de l'article 1er de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, permettant de prendre, par décret en Conseil d'Etat, des mesures temporaires (un, deux ou trois mois, par exemple) pour lutter contre une baisse excessive des prix, notamment en fixant des prix minima de départ de production en fonction du coût de revient de la production. Ces prix pourraient être limités à des volumes de production. La mission d'information estime que cette possibilité devrait être utilisée par le Gouvernement, même si le ministère de l'économie et des finances y répugne dans la mesure où toute crise a pour conséquence mécanique des destructions d'emplois dans la filière agricole française et, par le jeu des importations, la promotion des produits provenant de pays où les salaires et les charges sociales sont plus bas.
Des organisations agricoles ont cité le cas du marché de la pomme : le fruit acheté cet été 1999 au producteur, en vrac, après cueillette, entre 1 F et 1,50 F le kilo (prix brut), soit en dessous de son prix de revient compris entre 1,70 F et 2,20 F, était revendu 12,90 F dans une enseigne et 25 F le kilo dans une autre.
Le porc est un cas un peu à part puisqu'il est en promotion six mois par an dans les grandes surfaces. La côte de porc a été proposée en promotion à 19,50 F alors qu'elle est vendue habituellement 40 F le kilo en rayon.
L'union du mareyage français décrit les mêmes phénomènes de prix d'appel ou de promotions qui perturbent gravement les filières (lire les exemples dans le point 3 du chapitre sur la revente à perte dans le titre III du rapport).
b) Les prix sur catalogue publicitaire sont virtuels et déstructurants
Les promotions de début de campagne contribuent même à créer des prix virtuels.
La promotion avec des produits d'appel est la recette toujours utilisée pour attirer le consommateur. Tout catalogue a sa page fruits et légumes, poissons, viandes et charcuterie. La pomme Jonagold à 0,75 euro le kilo, les carottes à 0,23 euro le kilo, les filets de truite fumée à 7,61 euros le kilo, ou les côtes premières d'agneau et le filet d'agneau à 7,61 euro le kilo ont pour objectif d'attirer le chaland. C'est sur ces prix promotionnels que se joue la compétition entre les enseignes de distribution. Malheureusement, le prix d'appel devient le prix de référence. Cette compétition a pour enjeu, dans le secteur agro-alimentaire, la réalisation de 800 milliards de francs de ventes : 1 % du marché capté par un concurrent correspond à un chiffre d'affaires supplémentaire de 8 milliards. On comprend mieux que, dans ce contexte, on mette souvent en seconde priorité la charte éthique ou encore les bonnes intentions et les bonnes pratiques.
Les promotions sur catalogues avant le début de la campagne ont des effets dévastateurs et déstructurants.
Lorsqu'une grande enseigne demande à un fournisseur de lui fournir des fraises à 9,80 F la barquette en début de campagne, ce prix est fixé en mars parce qu'il faut prévoir les délais de fabrication du catalogue. Ce même prix ne correspond pas à la réalité économique du marché de la production puisque deux mois avant la production, ni les volumes, ni les conditions climatiques ne sont connus. Même si, en mai, la fraise en barquette est proposée à 15 F le kilo au marché de Perpignan, les prix doivent baisser puisque les autres enseignes sont obligées de s'aligner sur le prix figurant dans les catalogues des concurrents. On explique ensuite au producteur que puisque les fraises sont annoncées à 9,80 F le kilo, c'est qu'il s'agit bien du prix du marché. Les commerçants de détail n'achètent donc plus au prix du marché de Perpignan et les cours s'effondrent. Le sort est jeté. La promotion a contribué à créer un prix de marché virtuel. Trop de promotion tue la production.
La crise des fruits et légumes du 23 août 1999 (abricots et pêches) était déjà inscrite dans les accords de catalogue passés le 24 juin, qui fixaient les prix de référence pour la campagne. Et pourtant la filière pêche s'est organisée pour limiter sa production à seulement 350 000 tonnes en 1999, alors que la production était double (750 000 tonnes) il y a dix ans.
Même les distributeurs reconnaissent les effets pervers de ce système d'annonce de prix sur catalogue et ont spontanément proposé de réduire les délais de préparation des catalogues. Actuellement le délai est de sept à huit semaines, les distributeurs estiment qu'il pourrait être abaissé rapidement à au moins trois semaines (voir le compte rendu de la réunion de la commission de la production et des échanges du 30 novembre 1999 ; les déplacements en Allemagne et en Espagne ont montré qu'un délai de dix jours est parfaitement possible).
Ce système est redoutable pour le fournisseur car s'il refuse le prix proposé, il ne sera pas référencé de toute la saison. Le système de référencement est, en effet pour les productions agricoles saisonnières, différent de celui pratiqué pour les autres biens de consommation : une enseigne référence, pour un produit, trois ou quatre fournisseurs et grossistes auxquels on demande d'adresser à la centrale chaque matin leur offre de prix et de volumes ; le prix le plus bas est retenu et est comparé avec ceux pratiqués à l'importation. La grande distribution achète souvent au prix le plus bas européen. Le titre III du rapport (point 3 du chapitre sur la revente à perte) donne un exemple de cassettes d'agneau découpé d'origine française, britannique et irlandaise.
De plus en plus, c'est le prix à l'importation qui est souvent utilisé comme prix de référence. Il s'agit là d'une dérive de l'économie de marché, car le prix de la pomme au Chili ne devrait en rien influer sur celle cultivée dans la vallée du Rhône.
2. Imposer le respect de la qualité et de l'origine
Cette politique va à l'encontre de la politique des labels, des appellations d'origine et de l'exigence de qualité. On ne peut pas vouloir afficher les prix les plus bas et exiger également, dans le cahier des charges des produits fabriqués sous marque de distributeur, des produits de qualité supérieure. On ne peut pas annoncer au consommateur « les prix sont les plus bas, venez chez moi plutôt que chez le concurrent » et affirmer que les produits sont sélectionnés sur des critères d'excellence. La qualité se paye. Elle a un prix. Elle ne peut pas s'accommoder des pratiques commerciales douteuses ni de prix prédateurs. Ces méthodes sont aux antipodes de l'exigence de qualité souhaitée par le consommateur. Avec une politique de prix sacrifiés, notamment en période de crise, les plus pénalisés sont ceux qui ont privilégié la qualité des produits.
La grande distribution avait pourtant senti passer le vent du boulet lors de la crise de la « vache folle » quand le consommateur s'était mis à douter de la qualité de la viande. Beaucoup d'enseignes s'étaient alors évertuées à démontrer qu'elles disposaient d'une bonne traçabilité. Intermarché était capable de prouver que le morceau vendu à l'étal de son rayon boucherie provenait d'un abattoir intégré et correspondait à une bête identifiée. Des labels « qualité France » se sont développés et Auchan a passé la crise en payant 2 F supplémentaires par kilo au producteur (avec des ventes de 10 % inférieures à celles précédant la crise). Cela n'a malheureusement pas duré. Le rapport développe dans sa première partie la question des produits provenant de plantes génétiquement modifiées utilisées dans l'agro-alimentaire ; ces exemples démontrent que la distribution n'a pas développé suffisamment la traçabilité. Le consommateur ne sait plus d'où provient le produit qu'il mange. Il a souvent subi plusieurs transformations et même si la sécurité alimentaire est sans aucun doute meilleure qu'il y a quelques années, les crises successives (vache folle, poulet à la dioxine, présence de boues d'épuration, etc.), les incertitudes sur les organismes génétiquement modifiés conduisent le consommateur à une quête mythique de la traçabilité ! Les circuits alimentaires s'allongent, les produits sont de plus en plus élaborés, mais le consommateur français exige encore plus qu'hier ; il veut savoir ce qu'il mange.
Il est très important que l'agrément des signes de qualité alimentaire (et même non alimentaire) ne soit délivré qu'au groupement de producteurs qui a mis au point le référentiel ; il doit en être le seul propriétaire. Il n'est pas souhaitable que des enseignes, par leurs marques de distributeur, s'approprient les labels rouges, certifications de conformité et indications géographiques protégées au détriment du producteur. Ce dernier doit en conserver la propriété, la maîtrise et la responsabilité vis-à-vis du groupement et des organismes certificateurs.
C'est pourtant le contraire qui est en train d'arriver aujourd'hui dans la filière de la volaille. Les groupes de distribution ont tendance à développer les marques de distributeur, avec les produits financiers dégagés par les marges arrières, tout en s'appropriant l'image de qualité des marques sous label. Pourquoi ne s'approprieraient-elles pas demain des appellations d'origine ?
Il est à notre sens important de bien séparer la production de la distribution en France. Intermarché a déjà aujourd'hui des filières totalement intégrées. L'intégration totale serait redoutable, car au-delà des tendances déjà observées à l'uniformisation des produits, le consommateur deviendrait totalement captif.
Il apparaît donc important à la mission que sur toute étiquette d'un produit apparaisse l'indication du producteur, même s'il travaille pour une marque de distributeur.
Les appellations d'origine et indications géographiques protégées devraient être soutenues, notamment pour les fruits et légumes, car il n'est pas tolérable qu'un distributeur oblige, par exemple, des producteurs d'abricots à vendre sous le nom de "terre et nature", alors que les producteurs possèdent déjà leur propre logo.
La mission d'information s'alarme, en outre, des mentions valorisantes, véritables « attrape-nigaud » pour le consommateur, apparaissant de plus en plus souvent sur les produits sous marque de distributeur. Elle pense, comme de nombreuses organisations agricoles, que toute appellation ou signe de qualité nouveau doit correspondre à un réel cahier des charges. La dernière loi d'orientation agricole, sous l'énergique détermination de notre collègue François Patriat, a d'ailleurs établi un véritable cadre politique de la qualité en France et a énuméré les signes de qualité et d'origine protégés et contrôlés (articles L. 601-1 et suivants du code rural) ; le consommateur doit savoir que toute autre indication n'est que publicité et peut se révéler fantaisiste.
L'exemple de la dénomination « agriculture raisonnée » est le type même de référence floue, destinée à faire croire au consommateur qu'il s'agit d'une reconnaissance officielle de qualité. Il faut traquer ces fausses marques de qualité. « L'agriculture raisonnée » apparaît au consommateur préférable à l'agriculture productiviste, mais cela risque de devenir un véritable « attrape-nigaud » pour lui, s'il se perd dans des dédales de qualificatifs complexes étiquetés de manière arbitraire. Entre agriculture raisonnée, agriculture biologique, filière sans OGM, labels rouges, labels France, appellations d'origine, produits du terroir (encore un signe non protégé !), produits de la ferme... le consommateur risque de ne plus s'y retrouver si la réglementation n'impose pas de publier le cahier des charges, ou du moins ses éléments principaux, correspondant à chaque mention ; cela est fait avec les poulets label rouge dont l'emballage indique les caractéristiques de l'élevage ; cela devrait être le cas pour chaque signe, reconnu ou non.
3. L'organisation professionnelle des filières agricoles et la nécessité de régulation des marchés
a) Permettre des ententes entre producteurs
Tout le monde déclare que pour diminuer les risques de crise, la profession agricole doit mieux s'organiser mais la réglementation sur les ententes fait qu'il est difficile de s'organiser entre producteurs agricoles.
Cette nécessité a été très largement reconnue par toutes les organisations professionnelles et syndicales, la confédération française de la coopération agricole résume bien le paradoxe de la situation à laquelle nous sommes parvenus : « La direction de la concurrence a surveillé depuis vingt ans les ententes agricoles, lorsque Leclerc ou Intermarché étaient considérés comme des PME. » Aujourd'hui ils sont parmi les plus grands groupes mondiaux.
Aujourd'hui, le droit européen interdit les ententes entre producteurs agricoles alors qu'il reste impuissant à légiférer sur les filières du secteur de la distribution. Les interprofessions sont pourtant un outil utile pour réguler le marché. Cependant, elles ne peuvent pas s'écarter de ce qui est expressément prévu par l'organisation commune des marchés et interférer avec les mécanismes de fixation des prix ou d'intervention. Une jurisprudence constante de la Cour de justice des Communautés européennes n'admet pas qu'un accord interprofessionnel aille au-delà des moyens permis par l'organisation commune des marchés pour atteindre les objectifs de la politique agricole commune.
En l'état actuel du droit communautaire, le champ d'intervention des interprofessions peut couvrir des domaines tels que :
- l'amélioration de la connaissance de l'offre et de la demande,
- l'adaptation et la régularisation de l'offre sans pour autant que l'interprofession se mue en gestionnaire du marché,
- la mise en oeuvre de disciplines professionnelles, de règles qualitatives et de normes techniques,
- l'établissement de programmes de recherche appliquée et de développement, notamment pour la mise en valeur de l'agriculture biologique et de méthodes de production respectueuses de l'environnement,
- la promotion des produits à la condition qu'il s'agisse d'une promotion générique ne mettant en exergue ni l'origine nationale ni la provenance, sauf lorsque le produit bénéficie d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée.
Dans le secteur agricole, la meilleure réponse est l'interprofession mais, dans le marché de la prune, par exemple, où il existe une concurrence bulgare et roumaine, lorsqu'on essaye d'organiser des échanges d'informations entre producteurs, cela est, en général, assimilé à une entente illicite. A notre avis, l'Etat et l'Union européenne devraient mieux définir le seuil maximal de concertation autorisée.
Il convient donc de mettre en place une organisation de l'offre efficace en renforçant l'organisation économique par un meilleur ancrage des organismes économiques dans les bassins de production. Les producteurs individuels devraient pouvoir être conventionnés et bénéficier des concours publics nationaux en association avec les organisations professionnelles.
L'organisation de certains secteurs a des effets bénéfiques sur les prix. C'est le cas, par exemple, de la fédération professionnelle de la pomme de terre, ail, oignon et échalote (FEDEPOM). On peut vérifier que dans des secteurs considérés comme traditionnels, l'innovation sert la qualité, permet des performances accrues, valorise, assure la promotion des produits, améliore le négoce, etc. En utilisant les nouvelles technologies de l'information, la FEDEPOM a mis au point, en collaboration avec d'autres organismes professionnels, deux pilotes de traçabilité au sein de la filière de la pomme de terre, depuis le stade des semences jusqu'au stade de la mise en marché par les opérateurs. La fédération professionnelle a privilégié la certification ISO 9002 garantissant les procédés de production dans l'entreprise, un service de qualité au client, la conformité de la commande, la maîtrise de la qualité des produits tout au long de la filière jusqu'au consommateur, les délais et le suivi de la satisfaction du client. Par ailleurs, la fédération a mieux contrôlé les volumes de mise en marché, la répartition des productions et réintroduit sur le marché des variétés qui avaient presque disparu au profit de la bintje.
C'est par des initiatives comme celle-ci que les professionnels pourront renforcer leur organisation économique et anticiper sur l'évolution des marchés, accompagner la gestion de crise, améliorer la qualité, la politique et la sécurité alimentaire, et enfin assurer la stabilité structurelle du marché.
Toutefois, la mission rappelle que la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole contient plusieurs mesures importantes allant dans le sens indiqué (renforcement des missions des interprofessions, possibilité de conclure des accords de crise et des accords dans les filières de qualité pouvant, dans les deux cas, contenir des dispositions sur des prix de départ de production et des volumes de production). Cependant, la profession n'a pas encore utilisé ces nouvelles possibilités qui étaient pourtant attendues depuis des années. La mise en _uvre de ces mesures permettrait de réaliser de nets progrès.
b) Développer le rôle des comités économiques de bassin
Ces comités de bassin doivent assurer une bonne représentation des producteurs, fixer leurs droits et engagements, mais surtout avoir la possibilité de demander la transmission des données relatives aux prix pratiqués et aux volumes commercialisés, sans que la DGCCRF considère ces échanges de données comme une pratique anticoncurrentielle.
Le Gouvernement peut, de l'avis de la mission, jouer un rôle important tant dans le soutien aux organisations professionnelles, l'intervention en période de crise, la définition des politiques à mener et des régulations nécessaires entre production et distribution, les négociations à l'échelon européen pour autoriser certaines ententes afin d'éviter les crises agricoles. Le Gouvernement devrait également clarifier les missions et définir le champ d'action de la DGCCRF.
c) L'intervention de l'Etat est nécessaire en cas de crise sur les prix
La mission d'information estime que l'Etat doit, en cas de crise conjoncturelle déstabilisant de manière anormale un marché particulier, mettre en _uvre le dispositif de l'article 1er de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 qui permet par un décret en Conseil d'Etat de prendre des mesures temporaires (au maximum six mois) pour lutter contre une baisse excessive des prix. Des prix minima de départ de production pourraient ainsi être fixés en fonction de certains volumes.
Ce dispositif n'a jamais été mis en _uvre. Le ministère chargé de l'économie craint les réactions de la Commission européenne et redoute les demandes en chaîne de multiples secteurs d'activité. Mais la mission d'information souligne que ce mode d'intervention éviterait une intervention de l'Etat ou de l'Union européenne par des subventions qui sont souvent plus déstructurantes et pas toujours efficaces. Parfois il suffit de quelques dizaines de centimes pour rééquilibrer le marché et permettre aux exploitations agricoles de passer une crise ; si elles peuvent encaisser le choc une année ou deux, on ne peut pas attendre de nos agriculteurs de supporter chaque année des ventes à perte. Or la mission d'information avertit solennellement qu'une nouvelle crise comme celle de l'été 1999 et les précédentes ne pourra pas être à nouveau amortie par les agriculteurs.
Par ailleurs, la mission d'information n'est pas favorable au double étiquetage des prix ni à l'imposition d'un coefficient multiplicateur. Le suivi des produits depuis des centaines de milliers de producteurs différents est difficile à mettre en _uvre, car il nécessite soit un équipement informatique en réseau très performant utilisé tout au long de la filière, soit un suivi permanent qui augmenterait sensiblement le coût des produits. Ces mesures ne peuvent s'appliquer qu'à des produits bruts car comment pourrait-on informer le consommateur des augmentations de prix dues à une transformation ? Comment différencier les prix bruts payés au producteur des prix intégrant déjà un tri, une transformation ou des étapes de valorisation ? Enfin, ces mesures ne règlent aucunement le problème des prix de départ de production inférieurs aux coûts de revient car en la matière il ne faut pas compter sur des effets vertueux de répartition de marges au bénéfice de la production. Il semble donc que ce sont de « fausses bonnes idées » qui créent plus de difficultés qu'elles n'en résolvent. Il nous apparaît plus efficace d'afficher les mentions d'origine géographique.
B.- LES RÈGLES DE CONCURRENCE LOYALE DANS LES RAPPORTS ENTRE FOURNISSEURS ET DISTRIBUTEURS
1. Faire appliquer la loi actuelle sur les relations contractuelles et la coopération commerciale
Dans les rapports commerciaux entre fournisseurs et distributeurs, la mission d'information a constaté que les principales dérives consistaient en un transfert excessif de marge au profit de la grande distribution par le système des marges arrières et l'allongement des délais de règlement effectif des factures de vente. Cette dérive a été permise par la situation de dépendance économique dans laquelle se trouve les PME-PMI, voire même certains groupes industriels, et par la surenchère de coopération commerciale que génère la concurrence horizontale imposée par les multinationales fournisseurs mondiaux de biens de grande consommation et leur affrontement avec la grande distribution française.
En revanche, la mission estime que les dispositions de la loi n° 96-588 du 1er juillet 1996 relative à la loyauté et l'équilibre des relations commerciales, dite loi Galland, concernant l'interdiction de la revente à perte et les prix abusivement bas, sont correctement appliquées et ne nécessitent pas d'être révisées.
a) Rappeler la portée de la loi sur la coopération commerciale
La mission juge prioritaire de rétablir une régulation de la coopération commerciale. Sa base juridique - le 5ème alinéa de l'article 33 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 - est satisfaisante si la loi est appliquée conformément aux circulaires Scrivener du 10 janvier 1978 et Delors du 22 mai 1984 qui ont interprété la législation alors en vigueur sur la coopération commerciale, qui a été codifiée à l'article 33 de l'ordonnance, comme le rapport l'a analysé avec précision (lire le titre II).
Pour clarifier le droit, la mission invite le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à publier une nouvelle circulaire d'interprétation reprenant les éléments clairs contenus dans les deux circulaires précitées, à savoir :
- les services spécifiques rendus par les distributeurs doivent être réellement rendus au client, être identifiables et correspondre à un besoin ou une attente du fournisseur qui en bénéficie ou à un allégement de ses charges ;
- la rémunération de ces services doit être justifiée et ne pas créer de discriminations injustifiées ;
- la rémunération de ces services (somme d'argent ou remise) doit être proportionnée au transfert de charges du fournisseur au distributeur ou à la nature effective du service rendu ; l'avantage ainsi consenti doit avoir une portée restreinte par rapport à ceux accordés en application des conditions générales de vente.
Les dérives actuelles sont le résultat de l'inapplication ou l'oubli par l'administration et les partenaires commerciaux de cet esprit et ces objectifs de la loi.
b) Rendre les rapports commerciaux plus transparents entre les partenaires
Dès lors que la loi est ainsi appliquée, la mission estime que les services de coopération commerciale devraient figurer, lorsque cela est possible, dans des conditions générales de vente. C'était le sens de la circulaire Scrivener du 10 janvier 1978.
La mission propose donc que les relations commerciales soient régulées par les partenaires commerciaux selon le schéma suivant :
- les fournisseurs présentent leurs offres de produits et de services dans des conditions générales de vente ;
- les revendeurs présentent leurs offres de services de coopération commerciale dans des conditions générales de vente. La prestation de ces services donne lieu à l'établissement d'un contrat écrit en partie double comme le prévoit la loi actuelle ;
- les remises exceptionnelles (dont la nature même empêche de les faire figurer dans des conditions générales de vente) et les ristournes non liées à un acte d'achat ou de vente et ne rémunérant pas un service de coopération commerciale doivent être traduites dans un contrat écrit et être justifiées par des contreparties réelles pour le fournisseur, et leur rémunération doit se traduire par des avantages financiers d'une portée marginale par rapport à ceux accordés au titre des conditions générales de vente.
Ce schéma impose que les contrats commerciaux et les factures soient clairs et précis dans leurs termes. Il n'est plus acceptable de facturer des milliers de francs une « mise en avant » sans indiquer en quoi elle consiste, une « participation publicitaire » sans donner les éléments permettant d'en vérifier l'effectivité, une « intensification commerciale » sans que le produit ou l'entreprise bénéficie de retombées commerciales.
Le Gouvernement devrait s'inspirer du dispositif applicable à celui de l'achat d'espaces publicitaires (articles 20 et 24 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, dite loi Sapin) : ces services doivent figurer dans des conditions générales de vente transparentes.
c) Supprimer la fausse coopération commerciale
Les distributeurs reconnaissent que des acheteurs peuvent commettre des abus en négociant des remises de coopération commerciale. Un accord unanime s'est fait devant la mission pour :
- interdire les factures rétroactives de coopération commerciale ou de toute autre remise ou ristourne ;
- interdire les factures de coopération commerciale ne correspondant pas à un service effectivement rendu.
La mission d'information a donc écarté l'idée d'interdire purement et simplement la coopération commerciale, c'est-à-dire la facturation des prestations par les distributeurs, qui avait été avancée par certains au début de ses travaux. Elle a également écarté les propositions tendant à définir dans la loi la consistance des services de coopération commerciale car la tâche serait vaine, ou à incorporer les marges arrières dans la marge avant en modifiant la définition du seuil de revente à perte. Il est certain que cette dernière proposition paraissait séduisante parce qu'elle conduisait à abaisser les prix de revente au consommateur, à rétablir une vérité des prix telle qu'elle existe dans les pays européens (sauf l'Espagne dont le système s'est calqué sur celui de la France). De l'avis de la mission, les demandes de prestations de coopération commerciale ne devraient pas excéder 4 ou 5 % du chiffre d'affaires hors taxes de la vente. Mais la mission a jugé qu'elle entraînerait une nouvelle guerre des prix contraignant les fournisseurs à tirer leurs barèmes de prix vers le bas, ce qui ne pourrait qu'inciter à délocaliser certaines productions, qu'elle concentrerait les conflits sur les niveaux de prix et mettrait la qualité et le service au second rang, qu'elle remettrait en cause le système de l'interdiction de la revente à perte qui est appliqué de manière satisfaisante. En résumé, il ne faut pas supprimer la coopération commerciale mais la moraliser.
La mission a donc préféré un mécanisme de régulation par les conditions générales de vente, l'interdiction de la fausse coopération commerciale et la limitation des demandes sortant de ce cadre.
A terme, la mission d'information a la conviction que les partenaires commerciaux devront, en France, revenir à la négociation d'un prix net-net-net (voir le schéma figurant dans le titre II du rapport, p. 89). On peut d'ailleurs se demander si la concentration des entreprises de distribution, la formation de multinationales fournisseurs de multiproduits et la mondialisation des échanges ne conduiront pas à accélérer cette évolution. On constate notamment que l'arrivée du numéro un mondial de la distribution, Wal-Mart, en Allemagne et en Grande-Bretagne conduit à de profondes remises en cause des distributeurs de ces pays. Il faut s'attendre cependant à ce que les distributeurs français résistent et s'efforcent de maintenir leurs volumes de marges arrières ; de même les multinationales souhaitent conserver le système de la coopération commerciale telle qu'elle existe (en en supprimant les abus tels que les factures rétroactives et les services virtuels) car elle leur permet d'asseoir leur domination par la surenchère des remises même si ce mécanisme passe par un affrontement sans concession avec la distribution. Mais ce sont les PME-PMI indépendantes, voire certaines grandes entreprises, qui en pâtissent.
2. Redéfinir le cadre contractuel des relations avec les PME-PMI
Une petite ou moyenne entreprise (PME) peut difficilement se définir en fonction de grandeurs économiques (200 employés ou un chiffre d'affaires annuel hors taxes de 200 millions de francs, par exemple). La loi ou les règlements n'établissent aucune définition générale. Dans les relations commerciales avec la grande distribution, la situation de dépendance économique atteint, en fait, de grands groupes industriels car la formidable puissance d'achat des enseignes crée une domination. De même, une enseigne peut se considérer en situation de dépendance vis-à-vis d'une PME qui détiendrait un produit de consommation incontournable et attendu par les consommateurs.
a) Assurer une stabilité des engagements contractuels
La mission d'information est favorable à ce que les contrats d'achat et de vente conclus entre les distributeurs et les PME-PMI aient une durée d'au moins un an, et lorsque l'enseigne de distribution demande à son fournisseur des investissements particuliers (pour le conditionnement, la transformation, la qualité des produits, etc.) pour lui passer des commandes, que ce contrat ait une durée d'au moins trois ans. La mission a reçu un accord général sur ces principes sains de partenariat (lire le compte rendu de l'audition du 30 novembre 1999 de la commission de la production et des échanges).
Ces contrats et les référencements doivent se traduire par des engagements fermes et des commandes.
La mission d'information invite les grandes surfaces de vente à valoriser les produits des PME-PMI dans leurs linéaires, qui sont quasiment monopolisés par les marques industrielles des multinationales. Les enseignes de grande distribution ont pris des engagements dans le sens d'une stabilité des relations contractuelles avec les PME et d'une valorisation de leurs produits (voir les documents de la fédération des entreprises du commerce et de la distribution et de Carrefour reproduits dans la première partie du rapport). Mais la mission juge que cette démarche doit être approfondie car ses résultats ne se font pas assez sentir.
Il s'agit d'un objectif primordial car les PME-PMI structurent le territoire français, sont un vecteur de qualité et d'innovation et créent la majorité des emplois en France. Cependant, il ne faut pas tomber dans une simplification qui au nom du principe « small is beautiful » voudrait que rien ne soit refusé aux PME et que toute exigence qui leur serait présentée lors d'une négociation soit considérée comme l'exploitation d'une situation de dépendance économique. Cette nouvelle régulation de la distribution exige également des chefs d'entreprises, qui y sont prêts, des efforts d'adaptation au marché très évolutif des biens de grande consommation, aux exigences de qualité et de sécurité croissantes voulues par le consommateur et que répercutent très bien les enseignes de distribution et, enfin, à la taille du marché de la consommation qui prend des proportions jusque-là inconnues.
b) Redéfinir l'abus de dépendance économique
L'exploitation abusive d'une situation de dépendance économique est prohibée par l'article 8, point 2, de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986. Cependant, le Conseil de la concurrence n'est pas en mesure de sanctionner les abus qu'il décèle car la loi exige que la pratique anticoncurrentielle ait « pour objet ou (...) pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché » pour rendre illicite l'abus. La mission estime nécessaire de rendre effective la loi.
Les fournisseurs n'osent pas attaquer les distributeurs du fait de la dépendance économique dans laquelle ils se trouvent vis-à-vis de ces derniers, et ce qui a sans doute le plus marqué la mission d'information est la loi du silence qui prévaut en public, les fournisseurs ne parlant qu'en privé des abus qu'ils subissent, demandant à ne jamais être cités par peur d'être déréférencés. Les autorités publiques, notamment la DGCCRF, ne s'autosaisissent que très rarement, et quand le ministre chargé de l'économie le fait, ce pouvoir lui est contesté par la Cour de cassation qui a limité son champ de compétence à la demande d'arrêt des pratiques abusives, ce qui ne lui permet pas d'introduire une demande de réparation.
La quasi totalité des représentants des fournisseurs et du monde agricole demande, dans ce but, de modifier l'article 36 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, qui interdit certaines pratiques restrictives, afin d'ajouter un alinéa interdisant l'exploitation abusive d'une situation de dépendance économique.
Tout en poursuivant le même but, la mission d'information estime prioritaire, par souci d'efficacité, de modifier l'article 8 de l'ordonnance. On pourra se reporter au chapitre sur la dépendance économique dans le titre I du rapport et au chapitre sur la place du Conseil de la concurrence dans le titre IV pour l'analyse précise des faits et du droit ayant conduit à cette conclusion. En résumé, l'article 8 permet au Conseil de la concurrence d'intervenir et d'utiliser ses pouvoirs d'instruction, d'expertise et de sanction que lui seul détient, alors qu'une révision de l'article 36 ne se traduira que par une condamnation à réparer prononcée par les tribunaux civils ou commerciaux.
L'attribution contentieuse du Conseil de la concurrence en matière d'exploitation abusive d'un état de dépendance économique pourrait être redéfinie en ôtant la condition d'atteinte au jeu de la concurrence sur le marché. Il s'agit de pouvoir sanctionner la pratique conduisant à la disparition de l'entreprise ou à son retrait d'un marché (comme en matière de prix abusivement bas il faut viser les cas d'éviction d'une entreprise ou d'un produit). Il faut en effet éviter que le droit ne permette la protection de rentes de situation détenues par des PME-PMI ou prémunir certaines d'entre elles des effets naturels de leur inefficacité économique. Afin de caractériser l'abus de dépendance économique, l'article 8 devrait se référer aux pratiques illicites définies à l'article 36 sans se limiter à cette énumération.
Cette réforme fondamentale doit être mise en place concomitamment avec la création de la commission d'arbitrage des pratiques abusives, le Conseil de la concurrence pouvant saisir cette dernière de certains des litiges dont il serait saisi et qui correspondrait aux attributions de cette commission, et avec la réorganisation des moyens du Conseil afin de lui donner une capacité d'enquête rapide sur le terrain, car ces litiges nécessitent souvent un traitement accéléré (voir ci-après les conclusions relatives au Conseil de la concurrence).
Parallèlement, on peut modifier l'article 36 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 mais il convient de veiller à ce qu'une disposition obligeant à réparer une exploitation abusive d'un état de dépendance économique ne fasse pas double emploi avec les points 3, 4 et 5 actuels de l'article 36 interdisant les remises de référencement sans contrepartie, les menaces de déréférencement pour obtenir des avantages dérogatoires et les ruptures de relations commerciales sans préavis.
c) Mettre en place une commission d'arbitrage des litiges contractuels
Les relations entre l'enseigne de distribution ou la centrale d'achat et le fournisseur sont souvent tendues, si ce n'est détestables. La dimension humaine des relations économiques est trop souvent oubliée. Les abus sont la plupart du temps commis sans risque de sanction car les victimes n'osent pas porter plainte ou même donner les éléments de preuve à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) pour introduire une action en justice (lire la partie IV du rapport).
Les litiges naissent souvent d'un manque de confiance dans son partenaire, d'une mauvaise interprétation de la loi et des conditions d'application des termes du contrat. Un règlement non contentieux de ces litiges est possible. C'est pourquoi la mission d'information recommande la création d'une commission d'arbitrage des pratiques abusives (CAPA).
Cette commission serait saisie des litiges bilatéraux survenant entre les partenaires commerciaux sur l'application d'une disposition de conditions générales de vente, de termes d'un contrat ou de mentions figurant sur une facture. Elle pourrait apprécier l'existence d'abus de dépendance économique, d'une pratique discriminatoire ou d'une pratique restrictive interdite par l'article 36 de l'ordonnance du 1er décembre 1986. La CAPA aurait une compétence nationale, mais devra disposer d'antennes dans chaque région pour être au plus près des réalités du terrain.
Cette commission devrait être composée à parité de représentants des fournisseurs (PME-PMI, agriculteurs, transformateurs, industriels, etc.) et des revendeurs (distributeurs et grossistes). L'Etat devrait être représenté au travers des administrations centrales concernées ainsi que par un membre du Conseil de la concurrence. La présence d'anciens magistrats pourrait également être utile au travail de la CAPA. Le secrétariat de la CAPA devrait être confié à la DGCCRF (ou au Conseil de la concurrence).
La CAPA doit pouvoir être saisie par n'importe quelle partie, par l'administration ou par le Conseil de la concurrence. Elle devrait également pouvoir s'autosaisir. Elle doit s'efforcer de concilier les deux partenaires et rendre une sentence arbitrale qui dit le droit, est source de droit et est opposable aux parties. Il convient de veiller particulièrement à la confidentialité des recours. Si l'une des parties refuse de participer à la procédure d'arbitrage, la CAPA doit rendre un avis qui expose son analyse des faits et l'interprétation du droit qu'elle fait au regard de la situation, puis saisir les tribunaux ou le Conseil de la concurrence du litige, ceux-ci s'appuyant sur son avis pour prendre leur décision.
Il serait également utile que la CAPA puisse adopter des recommandations que le ministre chargé de l'économie pourrait rendre publiques, comme il est procédé en matière de clause abusive avec la commission des clauses abusives (article L. 132-4 du code de la consommation).
En résumé, la CAPA doit devenir une autorité technique ayant une capacité d'expertise forte à laquelle les parties en litige peuvent se référer pour dire le droit et dont les arbitrages ou avis doivent permettre aux tribunaux ou au Conseil de la concurrence de juger plus rapidement une situation s'ils étaient saisis. Elle faciliterait ainsi l'action de la justice.
Pour ces raisons la mission a écarté la proposition consistant à donner un statut de médiateur à cette commission, car la médiation ne contraint pas en droit les parties, et les décisions d'un médiateur ne sont pas une source de droit.
La CAPA devrait être créée par la loi en raison des missions et pouvoirs qui seraient les siens. La mission d'information considère que la loi doit en fixer le cadre. Parce que la loi ne peut pas tout prévoir car l'économie de marché est par essence en permanente évolution, cette commission aura pour mission de réagir à toute nouvelle pratique jugée contraire à la loi, de veiller en permanence sur l'évolution des relations commerciales, de pouvoir s'autosaisir et par ses avis de préparer le travail du juge des litiges, au cas où elle ne parviendrait pas à mettre les parties d'accord.
Des moyens matériels en personnel, en locaux, en instruments d'analyse économique devraient être dégagés. Sur ce point, la mission insiste pour que ces moyens ne soient pas prélevés sur les dotations des ministères ou du Conseil de la concurrence car déshabiller Pierre pour habiller Paul ne rendrait pas l'action de l'Etat plus efficace. La commission devrait également rendre compte régulièrement de son activité aux commissions permanentes compétentes du Parlement car les règles du droit général de la concurrence relèvent en totalité du domaine de la loi.
3. Les délais de paiement fournissent une trésorerie à bon compte
Un autre dysfonctionnement étudié par la mission d'information est récurrent ; c'est celui des délais de paiement. Sans être partisane d'une économie administrée, la mission d'information considère qu'il convient d'introduire des régulations quand les rouages des négociations contractuelles sont grippés.
En dehors des délais de paiement réglementés applicables à l'achat de certains produits alimentaires, la mission d'information a noté une tendance à l'allongement des délais de paiement, qui sont passés couramment à 120 jours et plus pour certains biens de consommation. Les députés sont conscients que cet avantage rapporte aux enseignes de distribution des dizaines de milliards de francs de trésorerie par an. Or, les délais de paiement correspondaient à l'origine à la rotation des stocks dans les magasins ; l'amélioration de la logistique, les commandes en temps réel ont aujourd'hui abaissé les temps de rotation dans les hypermarchés et les supermarchés.
La mission propose donc d'avoir l'objectif de ne pas dépasser, hors les délais réglementés ou situations professionnelles spécifiques, un délai de paiement de 60 jours et qu'en tout état de cause, si le règlement n'intervenait pas dans un délai de 45 jours, que le client soit dans l'obligation d'adresser une traite à son fournisseur. On assiste, en effet, aujourd'hui à une situation incroyable, où le distributeur prélève par compensation financière des « factures de coopération commerciale » sans que le moindre service ne soit rendu, alors que le fournisseur attend plus de 120 jours pour être payé, sans pouvoir escompter la dette pour bénéficier d'un encours bancaire. Certaines enseignes n'hésitent d'ailleurs pas dans ce cas à vendre des services d'affacturage au taux de 1,21 % par mois (coût de l'argent et du service) et certains « distributeurs-financiers » réalisent l'exploit de prêter ainsi à un taux d'intérêt de 14,52 % par an le propre argent du fournisseur créditeur... Le banquier Ubu est revenu...
Ces conditions devraient, selon la mission d'information, être fixées dans des conditions générales de vente. Là aussi, on sait que l'on s'attaque à des intérêts financiers énormes car un rapide calcul montre que si l'on réussit à fixer en trésorerie la moitié des 2 500 milliards de francs de transactions annuelles pendant un mois de plus, cela créerait 125 milliards de francs de trésorerie, auxquels s'ajouteraient les placements financiers conséquents, le tout réparti entre six ou sept groupes de grande distribution.
Il pourrait être, en outre, utile de transposer, sans attendre, le principe fixé dans la proposition de directive de la Commission européenne sur les délais de paiement, en discussion devant le Parlement européen, selon lequel, en l'absence de disposition contractuelle écrite ou d'indication des conditions générales de vente sur le délai de règlement à tenir, un délai de paiement de 30 jours est présumé convenu par les parties. Ce délai est calculé à partir du jour suivant la date de réception de la facture par le débiteur ou, en l'absence de facture, de la date de livraison des produits. Mais, en règle générale, en France, le contrat ou, à défaut, les conditions générales de vente mentionnent toujours une date de règlement ou un délai de paiement.
La proposition de directive contenait, surtout, dans sa version d'octobre 1998, une disposition répondant à certains dysfonctionnements constatés dans les relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs en France. Elle prévoyait que si le délai de paiement prévu dans le contrat de vente était supérieur à 45 jours à compter de la date de réception de la facture, l'acheteur devait fournir, à ses frais, une lettre de change à son fournisseur précisant explicitement la date de son paiement et devant être garantie par un établissement de crédit reconnu.
La mission d'information estime cette mesure très utile ; elle devrait être inscrite dans la loi (l'ordonnance du 1er décembre 1986 si l'on souhaite sanctionner pénalement son non-respect, ou, à défaut, le code civil), même si la version définitivement adoptée de la directive ne la contient plus (le conseil des ministres a souhaité l'écarter pour parvenir à un accord sur l'ensemble du texte, mais le Parlement européen y semble attaché).
La mission d'information souligne qu'il est indispensable que ce dispositif de communication d'une lettre de change ou d'un quelconque effet de commerce soit d'application automatique : sa présentation ne doit pas s'effectuer sur la demande du créancier sinon aucun fournisseur n'osera faire cette démarche auprès de son client. L'intervention d'un tiers, un établissement financier garantissant le recouvrement dans le délai indiqué par l'effet de commerce, est également fondamentale pour assurer l'efficacité du dispositif. En dernier lieu, si la date de paiement de l'effet de commerce dépasse le délai contractuel convenu, l'application des pénalités de retard prévues par le 3ème alinéa de l'article 33 de l'ordonnance (montant au moins égal à une fois et demie le taux de l'intérêt légal) doit être automatique et exécutée par l'établissement financier.
Il faut donc déterminer avec minutie la position d'équilibre permettant des échanges équitables, car les PME, qui sont en France la principale source de création d'emplois, n'ont pas la taille ni le poids suffisants pour négocier dans de bonnes conditions de vente et de règlement avec la grande distribution.
4. Améliorer l'application de la loi
Comme il a été vu en matière de coopération commerciale et de marge arrière, veiller à ce que la loi soit correctement appliquée, dans son texte, son esprit et ses objectifs, est déterminant et peut empêcher que de nombreux dysfonctionnements, abus et litiges surviennent.
a) Prévenir les litiges et détecter les infractions
La mission d'information juge que la mission d'observation du jeu de la concurrence en France confiée au Conseil de la concurrence pourrait être renforcée en lui permettant de se saisir d'office de toute question de concurrence afin de rendre un avis sur le sujet. Cet avis devrait être public.
Afin de renforcer les moyens d'action du conseil, ce dernier devrait pouvoir mener de lui-même des enquêtes hors des litiges dont il est saisi. Il devrait également pouvoir rendre spontanément un avis sur la compatibilité avec le fonctionnement régulier de la concurrence des pratiques qu'il aurait mises en évidence. Selon l'intérêt de l'affaire, cet avis serait notifié aux parties en cause et au ministre chargé de l'économie ou serait, en sus de cette notification, publié.
Par ailleurs, le Conseil de la concurrence peut avoir un rôle d'apaisement des conflits entre fournisseurs et revendeurs grâce à sa capacité d'expertise et son autorité. La mission d'information estime qu'il devrait être associé à la commission proposée pour arbitrer les conflits portant sur des pratiques abusives. Différentes modalités sont envisageables :
- un de ses membres pourrait siéger dans la commission ;
- le conseil pourrait saisir cette commission d'arbitrage lorsque des faits qu'il détecte correspondent à ses attributions ;
- il pourrait être saisi pour avis par cette commission au même titre que les juridictions en application de l'article 26 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et rendre des avis en forme simplifiée, au besoin sans mener une procédure contradictoire, pour ne pas retarder le traitement du litige.
Par ailleurs, la mission estime que le Conseil de la concurrence devrait pouvoir exercer lui-même un rôle de médiation. Ses décisions, en ce cas, devraient être prises dans une forme simplifiée pour ne pas alourdir la tâche des rapporteurs et des membres du conseil et ne pas retarder le règlement des litiges. Cette nouvelle attribution doit être conçue comme un moyen d'éviter de créer un contentieux devant le conseil. En outre, l'ordonnance du 1er décembre 1986 devrait permettre au conseil ou à son président, de sa propre initiative, de proposer aux parties une médiation préalablement à l'engagement de la procédure contentieuse.
Dans les deux hypothèses, il conviendrait de créer des postes supplémentaires de rapporteurs affectés au conseil. La paix du commerce mérite cette dépense publique supplémentaire. D'une façon générale, la mission attire l'attention sur le fait que ce renforcement ne doit pas être effectué par diminution des moyens de la DGCCRF. Des rapporteurs supplémentaires pourraient être pris dans la magistrature et les corps d'ingénieurs afin de compléter la composition des fonctionnaires rapporteurs actuels, qui aux deux tiers proviennent de la DGCCRF.
b) Rendre le Conseil de la concurrence plus « réactif » aux atteintes à la concurrence
Il convient de donner au Conseil de la concurrence les moyens d'être plus « réactif » aux problèmes de concurrence observés par les acteurs économiques sur le terrain. Le conseil consacre l'essentiel de son temps à l'analyse économique des questions et des litiges dont il est saisi. Son expertise est incomparable et la qualité de ses membres et de ses rapporteurs donnent une autorité incontestable à ses décisions et ses avis.
Le Conseil de la concurrence dépend de DGCCRF pour la réalisation d'enquêtes qui ne seraient pas liées à une affaire dont il est saisi. Il ne dispose pas d'un corps d'inspecteurs, mais seulement de rapporteurs permanents affectés et de rapporteurs extérieurs. La mission d'information estime que le Conseil de la concurrence devrait avoir le pouvoir d'ordonner des contrôles afin d'envoyer, sans délai, sur le terrain, des agents habilités pour constater des faits suspects dès qu'ils lui sont signalés. La constitution d'un corps d'inspecteurs spécial n'est pas pour autant nécessaire. En outre, cette capacité de contrôle permettrait au conseil de s'assurer de la bonne exécution de ses décisions. Lorsqu'il décèlerait des pratiques illicites, le conseil devrait pouvoir rendre spontanément un avis sur leur compatibilité avec le fonctionnement régulier de la concurrence.
Le conseil devrait également avoir la capacité de s'autosaisir si les entreprises victimes de pratiques anticoncurrentielles ou déloyales n'osent pas le saisir. En dernier lieu, il serait utile d'accélérer la procédure permettant d'ordonner des mesures conservatoires.
c) Renforcer le pouvoir d'enquête de la DGCCRF
La mission d'information a constaté que peu d'actions judiciaires étaient introduites par le ministre chargé de l'économie et la DGCCRF au regard du nombre d'infractions présumées. Cette situation résulte de la crainte des victimes de porter plainte et de la difficulté extrême de réunir les preuves d'une pratique restrictive de concurrence. Certes, les agents de l'administration et du Conseil de la concurrence disposent d'un pouvoir de perquisition en application de l'article 48 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, mais une autorisation préalable du président du tribunal de grande instance est nécessaire et cette autorisation nécessite la présentation d'un dossier de plusieurs dizaines de pages (le chiffre de cent a été avancé comme étant une taille fréquente).
La mission propose donc de doter les fonctionnaires de la DGCCRF et les rapporteurs du Conseil de la concurrence habilités à cet effet d'un pouvoir de perquisition et de saisie comparable à celui dont disposent les agents des douanes lorsque des faits concordants de l'existence d'une infraction existent et qu'une plainte est déposée.
d) Garantir la réparation et la sanction des infractions
Les PME-PMI victimes de pratiques anticoncurrentielles visées au titre III de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ou de pratiques restrictives visées au titre IV n'osent pas porter plainte ou se constituer partie civile à un procès. Leur anonymat est une condition fondamentale pour assurer la poursuite des infractions et des pratiques illicites.
Le pouvoir du ministre chargé de l'économie d'introduire une action devant les tribunaux en cas d'atteinte aux dispositions de l'article 36 de l'ordonnance doit être complété afin qu'il puisse demander réparation des préjudices, capacité que lui a déniée la Cour de cassation au motif qu'il n'est pas une partie à l'instance.
Il convient également d'étudier la possibilité d'infliger des amendes civiles pour non-respect des dispositions de l'article 36, car on constate que les interdictions sont contournées par des man_uvres destinées à dissimuler les infractions. En outre, le versement de dommages-intérêts est peu dissuasif en raison des intérêts financiers en jeu ; plusieurs affaires ont même montré que des condamnations pouvaient être des investissements rentables : il faut donc infliger une pénalité pour dissuader les entreprises.
Concernant la répression des pratiques anticoncurrentielles (titre III de l'ordonnance), il apparaît opportun de porter à 10 % du chiffre d'affaires annuel hors taxes le plafond des sanctions pécuniaires que le Conseil de la concurrence est habilité à prononcer. En effet, le Conseil a déjà prononcé des sanctions atteignant 3 % du chiffre d'affaires et si le plafond actuel de 5 % est maintenu, il ne pourra que difficilement augmenter les montants des sanctions au nom du principe selon lequel le pire est toujours possible et doit pouvoir être sanctionné à sa juste mesure. Cette mesure constituerait un signal fort pour accroître substantiellement les sanctions des infractions économiques visées dans l'ordonnance du 1er décembre 1986.
5. Mieux encadrer l'évolution du commerce
a) Le stade de gros est indispensable
La mission d'information juge indispensables le maintien et le développement du stade de gros, qui contribue à l'équilibre du marché. Les pouvoirs publics, tant l'Etat que les échelons régional et intercommunal, doivent soutenir le commerce de gros. Celui-ci doit, en outre, être mieux associé aux décisions d'aménagement des structures commerciales, notamment de centre ville.
b) Corriger les dysfonctionnements en matière de soldes et de promotions
L'actualité a montré que les grandes surfaces de vente utilisent l'uniformisation des dates de début des soldes, au 15 janvier, pour mettre en place des promotions sur la première quinzaine du mois de janvier. Dès lors, les consommateurs consacrent le budget qu'ils avaient réservé aux soldes aux achats en promotion en grande surface, et le commerce de centre-ville et de proximité perd une grande partie de sa clientèle et une grande partie du chiffre d'affaires qu'il réalise en période de soldes, qui est déterminant pour son équilibre financier.
La mission estime donc indispensable d'encadrer les pratiques de promotion précédant la période de soldes ou concomitantes à elles. L'expérience d'une uniformisation au 15 janvier de la date de début des soldes risque d'être négative ou pas aussi positive que prévu en raison de la fuite des ventes vers les grandes surfaces périphériques.
c) Mettre en place des schémas de développement commercial opposables
La mission d'information demande que l'expérimentation des schémas de développement commercial soit généralisée. Ces documents doivent devenir opposables aux instances chargées de délivrer des autorisations d'ouverture ou d'extension de commerce ou d'urbanisme. Ils doivent également permettre d'apprécier la conformité des autorisations de création ou d'extension de grandes surfaces de vente en cas de recours.
En conclusion, si la mission d'information ne souhaite pas que l'ordonnancement législatif et réglementaire existant soit bouleversé, elle a constaté que les textes possèdent des failles importantes réduisant leur efficacité.
La mission d'information a dressé un tableau sans complaisance des rapports entre la grande distribution et la production. Sa philosophie est d'abord de faire appliquer la loi, de privilégier les relations contractuelles entre les parties et de modifier de manière mineure la loi pour donner les outils nécessaires aux acteurs de la filière de la consommation pour établir des relations commerciales équilibrées. Néanmoins, elle pense que le contrat commercial est le meilleur des outils s'il est équilibré et accessible aux contrôles de l'administration.
La loi et les circulaires d'application interdisent déjà les avantages discriminatoires et définissent le cadre des remises de marge arrière ; leurs principes devraient être rappelés avec précision et la création d'une commission d'arbitrage des pratiques abusives pourrait faciliter le règlement des litiges.
Par ailleurs, quelques modifications de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 devraient être apportées afin de créer la commission d'arbitrage des pratiques abusives, garantir que les abus de dépendance économique puissent être effectivement sanctionnés (modification de l'article 8, et accessoirement de l'article 36), renforcer le respect des délais de paiement convenus (article 33, ou modification du code civil), permettre au ministre chargé de l'économie d'introduire en instance une demande de versement de dommages et intérêts pour réparation d'une pratique restrictive (article 36), renforcer le pouvoir d'enquête des agents de la DGCCRF (article 48) et, enfin, renforcer le rôle du Conseil de la concurrence et lui permettre de sanctionner plus sévèrement les pratiques anticoncurrentielles.
Ces propositions apparaissent à la mission d'information être des mesures propres à rétablir l'équilibre des relations commerciales, à limiter - comme l'a demandé le Premier Ministre M. Lionel Jospin - les pratiques abusives dans la distribution, à trouver la juste place pour l'équilibre entre la production et la distribution. Elles ne forment pas un nouveau droit de la concurrence, mais une nouvelle régulation de ce droit.
Les commissions permanentes compétentes du Parlement devront être informées chaque année de l'évolution des rapports entre les acteurs de la filière de la production, de la transformation, de la distribution et de la consommation des biens de grande consommation, ainsi que de l'exercice de cette nouvelle régulation.
COMPTE RENDU DE L'AUDITION
de représentants de grandes surfaces de vente
et de fournisseurs de produits de grande consommation
PAR LA COMMISSION DE LA PRODUCTION ET DES ÉCHANGES
Mardi 30 novembre 1999
La commission a entendu, mardi 30 novembre 1999, sous la présidence de M. André Lajoinie, en présence de la presse, des représentants de grandes surfaces de vente et des fournisseurs de produits de grande consommation.
M. André Lajoinie, président : J'ouvre cette réunion de concertation organisée par la commission de la production et des échanges et la mission d'information sur l'évolution de la distribution qui a été constituée en son sein. Je remercie tous les participants : tout d'abord, le président de la mission, M. Jean-Paul Charié, et son rapporteur, M. Jean-Yves Le Déaut, puis, nos invités : MM. Daniel Bernard, président directeur général de Carrefour, Claude Blanchet, président des Serres du Salève, Jacques-Edouard Charret, directeur général d'Opéra, Antoine Guichard, président du conseil de surveillance de Casino, Jean-Claude Jaunait, président de Système U, Gérard Bourgoin, chef d'entreprise, Thierry Jégou, directeur des Pépinières de Kerisnel, Mme Danièle Lo Stimolo, économiste spécialisée dans le commerce des glaces et produits surgelés, MM. Michel Rulquin, président de Home Institut (produits cosmétiques), et Luc Soupirot, exploitant agricole du Loiret (production de légumes).
Je souhaite que la réunion se déroule dans la franchise et la cordialité malgré des divergences bien naturelles. J'ai cependant été frappé par les efforts accomplis par les responsables de la grande distribution dans le domaine de la traçabilité et de la sécurité sanitaire, en réponse aux préoccupations de l'opinion publique et des clients. Nous souhaiterions que ces efforts soient étendus aux relations entre distributeurs et fournisseurs. Peut-être est-ce un voeu pieux ? En tout cas, il vaut la peine d'être formulé.
M. Jean-Yves Le Déaut, rapporteur de la mission d'information sur l'évolution de la distribution : Merci Madame et Messieurs d'avoir accepté de venir débattre avec les députés de la commission de la production et des échanges, à l'initiative de la mission d'information sur l'évolution de la distribution. Il ne faut pas se cacher qu'un malaise existe aujourd'hui, ainsi que des incompréhensions. La loi Galland du 1er juillet 1996 a modifié profondément le système de la distribution notamment par une refonte de l'interdiction de revente à perte, l'interdiction des abus de déréférencement et d'autres éléments qui ont été mis en évidence depuis le vote de cette loi.
Le secteur de la distribution est très important pour notre économie. Le chiffre d'affaires des ventes de tous les biens commercialisables atteint 2 500 milliards de francs, dont la moitié provient du secteur agro-alimentaire. Les chiffres sont difficiles à cerner par secteur, mais ils sont impressionnants.
Aujourd'hui, les grandes entreprises de distribution sont concentrées ; ainsi il n'existe plus que cinq centrales d'achats. La première, Carrefour-Promodès, commercialise 28,3 % des produits alimentaires, Lucie, la centrale de Leclerc et de Système U 19,4 %, Opéra, la centrale de Casino et de Cora 19,1 %, Intermarché 14,8 % et Eurauchan 12,0 %.
Dans le même temps, les entreprises de production se sont également concentrées. Des groupes multinationaux se sont constitués, mais le plus important de ces groupes dans le secteur de l'alimentaire français, qui est Danone, ne représente que 5 % des ventes des distributeurs. Le secteur de la distribution s'est concentré plus rapidement que celui de la production. Chez les producteurs cohabitent donc des petites et des grosses entreprises.
Il est assez difficile de mettre en place une table ronde comme celle-ci. Notre but n'est pas de dresser les uns contre les autres ou de chercher des boucs émissaires, mais de se forger une opinion. Nous avons parfois l'impression de faire de la « géologie politique », en observant l'accumulation des lois jamais appliquées ou contournées. Faut-il à nouveau revoir l'ensemble du dispositif législatif en raison de pratiques abusives ? Ou, au contraire, faut-il trouver ensemble des terrains d'entente ?
Nous avons cherché à organiser des auditions parlementaires de ce type pour trouver un terrain éventuel d'entente. La loi existe déjà, mais elle n'est pas appliquée sur certains points. Quant aux contrats, ils sont normalement conclus pour être respectés. Avant les états généraux de la distribution, il s'agit de voir si entre ceux qui produisent et ceux qui distribuent, et qui jouent tous deux un rôle important dans l'économie du pays, il est possible de parvenir à établir des pratiques correctes.
Le but de la réunion d'aujourd'hui n'est pas de tendre un piège, mais d'envisager les accords possibles afin que la mission d'information puisse faire des propositions avant la tenue des états généraux de la distribution en janvier 2000. Nous nous sommes engagés dans cette mission avec beaucoup de conviction et de dynamisme.
M. Jean-Paul Charié, président de la mission d'information sur l'évolution de la distribution : M. le Président, Madame, Messieurs, je vous remercie beaucoup de votre participation. Pour aller dans le sens des propos du rapporteur, je voudrais introduire cette réunion par quelques considérations.
Pour l'organisation de la production et du commerce, de moins en moins de responsables prônent le « tout Etat ». Pour d'autres, il est de bon ton de prôner le « tout libéral ». Or, qui peut encore le nier, si le « tout Etat » entrave la concurrence, source de progrès pour l'homme, le « tout libéral » provoque les mêmes effets. Entre l'économie administrée par les pouvoirs publics et l'économie administrée par quelques puissances financières, quel est le mieux pour l'homme ? Je ne suis pas sûr que ce soit le « tout libéral ».
Une voie intermédiaire existe, que la très grande majorité des responsables politiques et du secteur économique, au-delà des clivages politiques traditionnels, cherchent à mettre en oeuvre : c'est la libre et loyale concurrence. Pour que la libre concurrence soit source de progrès pour l'homme, elle doit respecter des règles ! Si ces règles ne sont pas spontanément édictées et naturellement respectées par les acteurs, il est du devoir du Parlement et des pouvoirs publics d'intervenir. Tels sont les enjeux de la mission d'information sur l'évolution de la distribution et du débat d'aujourd'hui.
Vous avez bien voulu, M. le Président, soutenir cette mission d'information et organiser cette audition, nous tenons à vous en remercier. En ayant accepté que cette mission, créée à l'initiative de M. Jean-Yves Le Déaut et du groupe socialiste, soit présidée par un député de l'opposition et du groupe RPR, nous nous plaçons au-delà des clivages traditionnels et c'est exemplaire. Ce n'est pas en entretenant les clivages entre grandes et petites entreprises, entre grandes surfaces et petits commerces, entre fournisseurs et distributeurs que les problèmes, dérives et abus constatés disparaîtront. Au contraire, sortons de ces clivages stériles, de ces affrontements primaires ; ils ne peuvent qu'affaiblir les plus faibles et envenimer les problèmes.
La libre et loyale concurrence à dimension humaine fait appel autant à l'esprit de partenariat et de solidarité qu'à celui de compétition. La libre et loyale concurrence à dimension humaine oblige à être compétitif, certes, mais elle ne protège pas. Cependant, la libre et loyale concurrence n'est pas la loi de la jungle. Ce doit être, dans bien des cas, la politique bien comprise du gagnant-gagnant. En libre concurrence, chacun doit respecter la concurrence et privilégier le partenariat.
L'enjeu n'est pas de s'opposer aux grandes surfaces. Je l'ai toujours dit. Je l'ai toujours écrit :
- on ne peut pas être attaché à la libre concurrence et lutter contre une forme de commerce ;
- le libre-service, les principes du « servez-vous vous-même » et du « tout sous le même toit », qui caractérisent la grande distribution à la française, relèvent d'une forme loyale et bénéfique de la concurrence. C'est pour les consommateurs une véritable valeur ajoutée et un réel progrès ;
- les grandes surfaces ont aussi permis une baisse significative des prix de vente au détail en prenant, d'une part, moins de marge et en faisant, d'autre part, mieux jouer la concurrence entre les fournisseurs ;
- les grandes surfaces ont indéniablement permis une diffusion massive de nouveaux produits, une expansion sans précédent de l'offre et des choix, ainsi qu'une augmentation du rapport qualité-prix des produits.
Les grandes surfaces ont enfin permis et permettent encore à des PME de se développer et d'animer la concurrence.
Nous ne sommes pas contre les grandes surfaces, nous sommes contre des pratiques déloyales de concurrence. Là encore, en introduction à ce débat, je rappelle ce que j'ai toujours dit, ce que j'ai toujours écrit : les grandes surfaces sont responsables, mais elles ne sont ni les seules, ni les premières. Les pratiques aujourd'hui dénoncées ont parfois commencé à l'initiative de fournisseurs qui trouvaient plus simple et plus rentable d'acheter l'exclusion de concurrents. Ces pratiques ont été développées par certaines enseignes. Les autres ont été obligées de suivre car lorsqu'un concurrent gagne des parts de marché ou améliore sa rentabilité en recourant à des pratiques immorales, mais qui ne sont ni par le marché, ni par la loi, condamnables et condamnées, vous êtes obligé d'utiliser les mêmes méthodes.
Ce sont les politiques les premiers responsables de cette situation, car ils n'ont pas accepté de comprendre que pour protéger les plus petites entreprises du commerce et de l'artisanat, puis de l'industrie et de l'agriculture, que, pour organiser la libre concurrence, l'enjeu n'était pas de se battre contre la taille ou la forme de certains magasins, mais de sanctionner des comportements. C'est toute une culture de la politique française qui doit changer.
Les grandes surfaces de vente sont aujourd'hui montrées du doigt par ceux qui dénoncent ces pratiques. Cependant, dans d'autres secteurs, je pense en particulier à celui du bâtiment et des travaux publics ou à celui de l'automobile et de la sous-traitance, ce n'est pas mieux, or les enseignes de grande distribution sont pourtant absentes de ces secteurs.
L'enjeu de ce débat, l'enjeu de notre travail n'est donc pas de condamner tel ou tel acteur mais, au contraire, avec vous qui avez eu raison de venir aujourd'hui, de trouver les solutions pour mettre fin à des relations entre fournisseurs et clients qui n'ont plus rien à voir avec une économie de libre et loyale concurrence et qui minent les intérêts des consommateurs, des travailleurs, de la nation et de vos entreprises.
Certes, nous étudions un sujet très complexe, mais quelques principes peuvent nous aider à le clarifier.
La rémunération, la prise en compte équitable de prestations fournies par le revendeur est louable, a toujours existé et existe dans tous les pays. Elle est une des clés de la concurrence. En revanche, la non-transparence et le chantage « tu payes ou je te vire » sont inacceptables.
La négociation sur la qualité des produits, sur les économies d'échelle, sur la mise en oeuvre partagée de nouveaux produits, sur le développement des partenariats est l'un des fondements de la concurrence qui joue dans l'intérêt des consommateurs et des entreprises. Cependant, la rupture unilatérale des accords, le reniement de la signature des contrats, l'exigence des mêmes avantages sans apporter les mêmes contreparties sont contraires aux règles minimales de la saine concurrence.
La volonté d'être moins cher est l'essence même de la libre concurrence. Cependant, à vouloir vendre coûte que coûte moins cher, cela revient très cher à la société. Méfions-nous d'un système où certains, pour vendre moins cher, n'assument pas les mêmes charges que leurs partenaires ou leurs concurrents et donc les condamnent.
Je poserai trois questions.
- Pouvons-nous continuer d'entretenir un système qui consiste à subventionner des producteurs agricoles avec l'argent des contribuables, alors qu'il suffirait qu'ils puissent vendre leurs produits au juste prix ?
- Pourquoi les commerçants conseils et les artisans ne bénéficient-ils pas, eux aussi, des marges arrières ? Ils achètent plus cher, ils ne peuvent pas pratiquer la péréquation des marges entre les produits, ils supportent les lourdes charges de présence en centre ville et, en plus, on ne leur paye aucune prestation alors qu'ils assurent le conseil, le service après-vente, la proximité, etc.
- Comment les commerçants spécialistes (en carburant, disques, matériels informatiques, jouets, etc., et demain en voitures neuves) peuvent-ils continuer d'exister et d'apporter, toute l'année sur tout le territoire, des services de qualité à la population quand certains concurrents ont 20 % de leurs références qui leur apportent 80% de leur marge ?
Ces questions, qu'il est du devoir des politiques de se poser, ne sont pas celles soulevées d'elles-mêmes par certaines entreprises. Pourtant, elles peuvent l'être à l'avenir. Certaines enseignes ont déjà commencé et sont prêtes à développer un partenariat et une solidarité sur le marché intérieur, comme sur le marché à l'exportation. Cependant, il faut pour cela, et préalablement, comme nous l'avons fait en 1996 pour la réforme du calcul du seuil de revente à perte, imposer à tous les concurrents des règles de partenariat loyal.
J'admets que nous sommes fermes et virulents quand nous dénonçons certaines pratiques inadmissibles. Nous ne sommes pas opposés à telle ou telle forme de commerce ; nous sommes au contraire persuadés que c'est avec toutes les formes de commerce sans exception que nous devons ensemble servir les consommateurs et la société de progrès pour l'homme.
Ceux, quelle que soit leur taille, quel que soit leur métier, qui ne voudront pas suivre seront condamnés. Les autres pourront être fiers d'avoir contribué à restaurer une éthique de la production et des échanges, une éthique du commerce à dimension humaine, avec la généralisation du partenariat et de la solidarité. Tels sont les enjeux du débat d'aujourd'hui.
M. Daniel Bernard, président directeur général de Carrefour : Je vais effectuer une déclaration liminaire et engager le débat ensuite sur nos relations avec le secteur de l'agriculture et les PME.
A mon grand regret, je dois vous avouer que j'ai hésité à venir à cette audition. Toutefois, la considération que je dois à la représentation nationale et les responsabilités que j'exerce à la tête d'un groupe qui comptera demain 240 000 personnes dans 25 pays, et qui porte les couleurs de la France et la couleur des produits français dans le monde entier, m'ont conduit à participer à cette réunion, étant entendu que j'ai toujours des rapports très fructueux avec votre commission.
Je connais votre attachement aux vertus du débat démocratique et à la rigueur de l'information. Pourtant, le document préparatoire aux travaux de la mission d'information, au lieu d'ouvrir un débat constructif et serein, exprime une volonté de diabolisation. Je ne suis pas persuadé que ce soit le meilleur moyen d'aborder un problème, d'ailleurs maintes fois traité, et typiquement franco-français. S'il existe des dysfonctionnements dans les relations entre la distribution et l'industrie, si certains excès condamnables persistent encore, est-ce une façon de régler ces problèmes en les abordant sous l'angle de l'excès, de la caricature, de la simplification et de la généralisation ? Certainement pas ! Et sur ce point, je prends note avec satisfaction de vos propos préliminaires, M. le Président. Je suis convaincu que vous êtes nombreux à le penser également.
Je viens donc ici, bien entendu, pour répondre aux inexactitudes du document préparatoire, mais surtout pour apporter ma contribution à votre réflexion. Comment ? En expliquant le contexte des relations entre la distribution et ses fournisseurs et en vous présentant les réponses que Carrefour et Promodès, mais également mes collègues, apportent aux problèmes posés.
Il me paraît, tout d'abord, indispensable de vous rappeler dans quel cadre la distribution évolue.
Depuis trente ans, la distribution a démocratisé l'accès à la consommation : hier, le foie gras, le saumon ou les vins fins ; aujourd'hui, la micro-informatique ou le téléphone portable. Depuis trente ans, la distribution répond aux exigences de plus en plus fortes des consommateurs, et ceci dans le monde entier. Elle se retrouve aujourd'hui en position de garant de la qualité et de la sécurité alimentaire, ainsi que de relais vis-à-vis des industriels et du monde agricole car nous sommes les premiers exposés devant le consommateur. Depuis près de trente ans, la distribution française en général et Carrefour en particulier sont aux avant-postes du commerce mondial. Ceci a permis de diffuser partout dans le monde le mode de vie à la française et les produits de nos industriels. Si demain aucun groupe français n'est présent dans le monde, aucun produit français ne pourra s'y trouver.
Aujourd'hui, la globalisation s'impose à nous. Elle doit être régulée, mais elle est irréversible, n'en déplaise aux nostalgiques du protectionnisme. Dans le commerce, comme dans beaucoup d'autres secteurs économiques, la logique de la globalisation est d'entraîner des regroupements. C'est, par conséquent, une chance pour notre pays que d'avoir une distribution forte, solidement implantée à l'échelle internationale et capable de rivaliser avec ses grands concurrents mondiaux, principalement américains, qui sont beaucoup plus importants que nous. Après notre rapprochement avec Promodès, Wal Mart sera encore 2,5 fois plus important que nous.
Depuis dix ans, les groupes anglo-saxons sortent de leurs bastions pour contester nos positions sur nos grands marchés européens et dans le reste du monde. Alors que la fiscalité est très lourde, ce n'est donc pas le moment d'affaiblir les entreprises françaises par des législations pénalisantes. Depuis des siècles, le commerce évolue et c'est une activité qui ne peut vraiment s'épanouir que dans la liberté.
Nous avons également à faire face à des grands industriels mondiaux. Beaucoup sont plus importants que nous, plus concentrés, plus rentables et souvent dominants sur leur marché ou leur famille de produits. Vous les connaissez, ils s'appellent Coca-Cola, Unilever, Nestlé, Procter & Gamble, etc. Cependant, un point distingue la France : la part des petites et moyennes entreprises (PME) dans nos chiffres d'affaires. Cette relation peut être améliorée, les PME représentant 80 % de nos marques de distributeurs. Cette relation ancienne, durable, transparente, a permis à de nombreuses PME, qui n'étaient que de toutes petites entreprises, d'innover, de grandir et de créer des emplois dans notre pays. En effet, contrairement à une idée reçue, les PME font l'objet de toutes nos attentions, car elles jouent un rôle stratégique d'équilibre par rapport aux grands industriels mondiaux et assurent la diversité de nos assortiments et très souvent l'innovation.
Cependant, la distribution française n'a pas seulement une fonction économique. Elle a fortement contribué à l'emploi avec un solde positif de plus de 300 000 employés depuis vingt ans, sans compter les centaines de milliers d'emplois indirects chez nos fournisseurs (agriculteurs, groupes industriels et PME).
Venons-en aux principaux points soulevés par la mission d'information. Il me paraît nécessaire d'en finir avec la confusion qui règne dans le discours sur les relations entre la distribution et l'industrie.
Oui, Madame, Messieurs les parlementaires, le droit de la concurrence français est complexe. Probablement l'un des plus compliqués de l'Union européenne. Est-ce pour autant nécessaire d'ajouter encore une strate à l'empilement des lois, règlements et circulaires qui pèsent sur les acteurs du commerce ? Nous vivons déjà suffisamment dans l'instabilité juridique et fiscale !
Oui, Madame, Messieurs les parlementaires, il existe certains abus, comme il en existe partout. Mais cela n'est pas une raison pour jeter l'opprobre sur des catégories entières de citoyens. Que représente ces abus par rapport aux millions de commandes que nous passons chaque année ? Que représente la petite dizaine de factures, sorties de leur contexte, qui nous sont opposées par rapport aux millions de factures que nous réglons chaque année, faisant vivre des milliers d'entreprises ? Quelques dysfonctionnements justifient-ils de modifier une nouvelle fois une loi, dont nous avions prévu dès le départ les qualités et les défauts, au risque de revenir à une économie administrée et de pénaliser les PME françaises, alors que nous vivons dans des économies ouvertes où chacun peut acheter n'importe où dans le monde ?
L'encadrement de la coopération commerciale est un contrôle des marges qui ne dit pas son nom. Le contrôle des marges, c'est le contrôle des prix et ce serait un retour de vingt ans en arrière.
Oui, Madame, Messieurs les parlementaires, le commerce est le fruit d'une négociation entre un distributeur et un industriel. Le consommateur en sera toujours l'arbitre final. La négociation est l'acte fondateur et incontournable de notre métier. Elle a, depuis trente ans, généré le discount et largement profité aux Français en leur redistribuant du pouvoir d'achat, ce qui était nécessaire, en luttant contre l'inflation, et en donnant à la France une industrie des produits de grande consommation parmi les plus dynamiques du monde.
Oui, Madame, Messieurs les parlementaires, nous devons chaque année arbitrer entre de nombreux produits, en ajouter ou en supprimer. Notre responsabilité doit-elle pour autant être mise en cause alors que nos linéaires sont figés, ne peuvent être étendus, et que, malgré les promesses, aucune vraie politique de modernisation de l'appareil commercial n'a été entreprise dans ce pays ?
Ceci dit, voyons maintenant les principaux griefs figurant dans le rapport dont j'ai eu connaissance.
Concernant le déréférencement abusif, il est sanctionné par la loi comme tout contrat qui est violé abusivement. Que l'on applique donc la loi !
S'agissant des coopérations commerciales, elles sont autorisées par la loi et sont le résultat de contreparties économiques précises, faisant l'objet de contrats. Le fabricant qui prend place dans nos rayons réalise des économies importantes sur ses dépenses de publicité, ses dépenses commerciales et ses investissements logistiques. Il bénéficie d'emblée de l'image du distributeur. Il est légitime, par exemple, qu'il participe aux campagnes de publicité qui mettent en avant son produit à un coût quatre fois moins cher que la télévision ou la radio. Quelle PME dispose de moyens suffisants pour assumer une campagne médiatique nationale ? Ainsi, notre catalogue des trente-cinq ans a touché 18 millions de foyers. Qui peut remettre en cause aujourd'hui les remises liées aux quantités achetées et aux volumes ?
Concernant l'inflation des marges arrières, c'est à tort que la loi Galland a été accusée de l'avoir générée. Au contraire, le refus de vente, l'interdiction des prix abusivement bas, la suppression de l'exception d'alignement sont venus donner aux fabricants la maîtrise totale du barème sur facture, et pratiquement la maîtrise du prix de vente au détail par le seuil de revente à perte. D'ailleurs, en France, nous avons des prix d'achat industriels nets-nets, pour une marge arrière déduite, largement supérieurs à ceux d'autres pays de l'Union européenne.
La loi Galland a pacifié les relations entre les industriels et les distributeurs en les engageant sur le terrain du marketing et de la redistribution de la valeur ajoutée. C'est pour nous une voie à suivre. Et avant de vouloir modifier la loi encore faudrait-il qu'elle soit appliquée dans sa totalité. C'est d'ailleurs cette démarche du partage de la valeur que nous mettons en oeuvre depuis toujours avec les PME qui fabriquent nos marques propres à travers une coopération durable et transparente.
Quant à notre position dominante, elle est inexistante vis-à-vis des grands industriels mondiaux qui contrôlent leurs marques et génèrent une part de notre chiffre d'affaires plus grande que la part que nous représentons dans leur chiffre d'affaires. Ainsi, nos dix premiers grands fournisseurs mondiaux représentent 26 % de notre chiffre d'affaires épicerie, alors que nous ne représentons que 1,3 % du leur.
Pour ce qui concerne les PME, le simple énoncé de ce qui précède justifie au contraire le fait que nous les encouragions et qu'elles bénéficient d'un traitement différencié. Lorsque nous représentons 30 %, voire plus de 50 %, du volume d'activité d'une PME, nous lui permettons de se développer, de se diversifier et d'assumer la coresponsabilité de son développement et de sa rentabilité.
Bien entendu, nous avons depuis très longtemps pris conscience des particularismes des PME de ce pays par rapport aux grands industriels, de leur besoin de sécurité et de visibilité, notamment en raison de la concentration inévitable des entreprises de notre secteur. Cette concentration est inévitable car la taille est importante : si nous ne procédions pas à des rapprochements entre entreprises françaises, nous deviendrions la proie de grands prédateurs étrangers. Or, qu'est-ce qui est le plus inquiétant pour une PME française aujourd'hui, est-ce le rapprochement entre deux de ses clients français ou bien que l'un d'entre eux, voire les deux, soient rachetés par un groupe anglo-saxon qui vient de faire baisser les prix d'achat industriels de 10 % en Allemagne et en Grande Bretagne, en réduisant drastiquement l'assortiment de produits de PME ?
A ce propos, je me suis demandé pourquoi le rapport préparatoire ne s'attaquait pas une seule fois aux entreprises étrangères de distribution présentes en France et ne leur reprochait pas de mettre en danger les PME françaises. La raison est simple, c'est parce qu'elles n'achètent pratiquement pas en France. En ce qui nous concerne, nous n'avons pas attendu aujourd'hui pour faire évoluer nos relations avec les agriculteurs et nos fournisseurs PME. Je rappelle que nous avons mis en place, il y a plusieurs années, des contrats de filières agricoles avec 35 000 producteurs et éleveurs en leur donnant de la visibilité par des contrats annuels et des revenus supplémentaires par une rémunération supérieure aux prix du marché et un engagement sur les volumes.
La base des filières Carrefour est la qualité pour le consommateur. C'est le fondement de nos contrats. Nous définissons ensemble la qualité maximale dans un cahier des charges qui s'impose à l'ensemble de la chaîne, à savoir agriculteurs, transformateurs et distributeurs. Nous allons contrôler les fermes, ils viennent contrôler nos magasins.
Pour les PME, nous avons contractualisé nos relations dans des contrats de partenariat, portant sur la recherche de la qualité, l'innovation, le règlement amiable des litiges et l'aide à l'exportation. Nos relations sont contractualisées avec plus de 261 PME françaises et sont régies par ces contrats.
Cependant, nous avons décidé d'aller plus loin et pris cette année de nouveaux engagements dans la ligne définie par la Fédération des entreprises du commerce et de la distribution, notre syndicat professionnel, qui a elle-même pris de nombreuses initiatives en la matière, dont l'observatoire PME-commerce. Pour Carrefour et Promodès, nous nous sommes publiquement engagés à mettre en oeuvre les actions suivantes :
_ des contrats pluriannuels de trois ans, car c'est une sécurité pour les PME qui investissent,
_ un étalement des effets des déréférencements sur un an,
_ des rencontres régulières avec la hiérarchie de l'acheteur,
_ une charte de la relation commerciale qui s'impose aujourd'hui à nos acheteurs comme une obligation professionnelle et régit leurs comportements, notamment lors des négociations commerciales,
_ une formation de nos acheteurs à la connaissance spécifique des PME et de leurs contraintes,
_ un programme ambitieux de soutien à l'exportation et notamment une ouverture aux produits français de nos rayons à l'étranger,
_ une augmentation de la part des marques propres fabriquées par les PME dans nos assortiments.
En ce qui concerne les agriculteurs, nous avons décidé de passer le nombre des filières de qualité agricole de 80 à 200 au cours des trois prochaines années. En cas de crise avec chute brutale des cours, nous nous sommes engagés à mener la négociation sur la base d'un prix minimum garanti. Je dois d'ailleurs vous rappeler que nous avons régulièrement soutenu par des prix plus élevés les produits en crise, comme par exemple le b_uf lors de la crise de la vache folle, le porc, la tomate ou les fruits d'été dernièrement. Nous avons sauvé récemment des PME confrontées à la crise née de contaminations par la listeria. Enfin, nous privilégions l'approvisionnement local partout où c'est possible.
Dans la semaine où l'Organisation mondiale du commerce se réunit à Seattle avec des enjeux considérables pour nos agriculteurs et nos entreprises, je trouve déplacée une fausse querelle entre Français qui consisterait, une fois de plus, à faire croire que les relations entre les distributeurs et leurs fournisseurs ne sont fondées que sur des rapports de force. Face aux grands groupes industriels mondiaux, il faut des distributeurs forts pour maintenir l'équilibre entre eux et les PME. La concurrence n'est pas verticale mais horizontale. Il n'y aura pas de produits français dans le monde s'il n'y a pas de grands distributeurs français dans le monde.
Chez Carrefour, nous considérons que la contractualisation des relations entre les acteurs du commerce est la seule voie du progrès. Il faut une loi, pas une somme de lois. Il faut le respect du contrat, pas une somme de règlements. C'est d'ailleurs le propre de toute économie moderne. C'est la démarche que nous avons suivie avec nos partenaires industriels, partenaires sociaux, agriculteurs et PME. Et nous irons encore plus loin avec Promodès, au-delà des engagements que nous venons de prendre.
M. Michel Rulquin, président de Home Institut : Je vais me contenter de citer deux chiffres. Il y a quatre ans, je réalisais 100 millions de francs de chiffres d'affaires et je versais 7 millions de francs de participation publicitaire. L'année dernière et cette année, avec 127 millions de francs de chiffres d'affaires, j'ai versé 27 millions de francs de participation publicitaire. C'est le prix de l'usine, clé en main, payée comptant, que je viens de construire. Cela mérite réflexion car cet exemple concerne toutes les PME.
La semaine dernière, j'ai reçu une visite de mon banquier. Il m'a dit : « les fonds de roulement augmentent, vos rentabilités baissent, nous allons voir si nous continuons à vous accorder les mêmes encours ». Des signes préliminaires d'un malaise général existent. Nous devons apporter une attention particulière à ce problème, ces seuls chiffres le démontrent, en ne diabolisant personne.
M. Antoine Guichard, président du conseil de surveillance de Casino, ancien président de Casino : Je pense être le plus âgé de l'assistance. Je suis en retraite depuis trois ans. Je voudrais m'exprimer en tant que sage ayant passé près de cinquante ans de sa vie dans le métier de la distribution. Ceci m'amène à vous proposer quatre thèmes de réflexion : les concentrations, les filières agricoles, les PME et les lois, étant entendu que je suis entièrement d'accord avec les propos de M. Daniel Bernard.
Les concentrations sont inéluctables, compte tenu des moyens de plus en plus importants qui sont nécessaires pour gérer les entreprises, en particulier les outils informatiques. Il faut par ailleurs prendre en compte l'ouverture des frontières et le phénomène de la mondialisation. Wal Mart représente 800 milliards de francs de chiffre d'affaires annuel. Il peut se payer chaque année un groupe comme Casino en France, hypothèse très envisageable.
Par ailleurs, dans le secteur agricole, se pose un gros problème d'organisation des filières. Je me suis laissé dire que l'Institut national de recherche agronomique ne dépense pas tout son budget. Il serait obligé d'établir des contrats avec des filières espagnoles car les Français ne sont pas capables de consommer les crédits. Les relations avec le monde agricole posent problème. Je pense qu'il s'agit juste d'une question d'organisation de filières. Or 50 % de nos ventes proviennent des filières agricoles.
Les relations avec les PME pour des groupes de notre taille sont essentielles. Les PME sont même indispensables car elles représentent près de 60 % de notre chiffre d'affaires. Si elles disparaissaient, nous serions morts. Il nous faut absolument avoir une politique contractuelle avec les PME. Nous avons besoin qu'elles vivent, qu'elles soient prospères, qu'elles innovent et qu'elles gagnent de l'argent.
Enfin, il me semble qu'il existe des strates de législation suffisantes. Par quels moyens devons-nous régler les rapports entre fournisseurs et distributeurs ? Par le contrat librement négocié et respecté.
Bien entendu, il faut être extrêmement sévère et ne rien laisser passer lorsque les contrats ne sont pas respectés. C'est le rôle de l'Etat. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. L'expérience nous prouve qu'un excès de législation implique soit la sclérose de professions trop encadrées, soit le contournement de la législation qui ne peut évidemment pas prévoir tous les cas.
M. Jean-Yves Le Déaut, rapporteur de la mission d'information sur l'évolution de la distribution : Les PME représentent 64 % du chiffre d'affaires des fournisseurs en alimentaire et non alimentaire, mais seulement 14 % hors marques du distributeur, et 13 % des linéaires, selon l'observatoire du commerce.
M. André Lajoinie, président : M. Guichard, vous avez dit, et je vous approuve, que tout réside dans le contrat librement négocié et que c'est à la puissance publique de le faire respecter. C'est juste. Lorsque j'ai évoqué cette question avec Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat, elle a répondu qu'il fallait qu'une partie porte plainte afin que l'Etat puisse intenter une action. Que proposez-vous à cet égard ? Il est dommageable que quelques abus rejaillissent sur l'ensemble d'une profession.
M. Gérard Bourgoin, chef d'entreprise : Monsieur le Président, Madame, Messieurs, je voudrais expliquer les raisons de ma présence. Mon comportement n'a jamais été régi par la loi du silence. Les relations entre industriels, producteurs, créateurs et grands distributeurs ont toujours été fondées sur la prudence.
La question posée aujourd'hui par votre commission est celle-ci : existe-t-il de véritables abus de la part des distributeurs ? Si oui, doit-on légiférer ?
Le premier intervenant du côté des distributeurs a reconnu l'existence d'abus. Nous recevons des demandes injustifiables. Par exemple, comment peut-on réclamer à un patron d'industrie, à un créateur, 2 % sur son chiffre d'affaires de manière rétroactive, parce que deux ou trois clients ont décidé de fusionner ou deux ou trois centrales de faire cause commune ? Comment peut-on introduire rétroactivement des clauses dans ces fameux contrats négociés, dont parlait avec beaucoup de savoir-faire M. Antoine Guichard ? Comment le faire sans hypothéquer l'avenir alors que les marges réalisées ne permettent pas de dégager les moyens financiers de cette rétroactivité ? Comment peut-on, par exemple, profiter de sa position pour refuser le déchargement d'un camion qui est arrivé en retard parce que la législation, de plus en plus contraignante, sur les transports a imposé au transporteur de s'arrêter une demi-heure ? Que penser des demandes extravagantes de budget pour des opérations qui ne sont pas des promotions mais des anniversaires ? Comment ignorer qu'il n'y a pas de réciprocité dans les engagements pris ? Comment exiger des budgets de promotions ou de campagnes publicitaires sans que les distributeurs s'engagent sur des volumes, sur des chiffres d'affaires ? Il devrait y avoir réciprocité ; le contrat repose normalement sur le principe du « donnant-donnant ».
Dans certains cas, seul le fournisseur s'engage sur une perspective de chiffre d'affaires annuel et des montants de budgets de coopération commerciale qui seront dus au distributeur quels que soient la réalisation du chiffre d'affaires et les moyens mis en _uvre par ce dernier.
Tout le monde sait que le distributeur a été, à un moment de sa carrière et de son développement, capable de faire accepter l'inacceptable. Bien sûr, nous respectons nos clients. N'oublions pas que, dans les rapports commerciaux, ils sont rois. Nous l'apprenons dans les écoles de commerce. Pour les distributeurs, les consommateurs sont les seuls juges, les seuls maîtres à bord. Pour les industriels qui sont des PME, le client est forcément le distributeur.
Le système conduisant à accorder d'office un avoir créait des litiges sur certaines facturations, litiges qui ont heureusement tendance à diminuer. Le dialogue ouvert que nous avons aujourd'hui permettra sa disparition ; je le souhaite pour l'ensemble des PME françaises.
Bien sûr, personne ne peut ignorer cette menace catastrophique, « le sida pour l'industriel » qui s'appelle le déréférencement. La loi Galland du 1er juillet 1996 a pour titre « loi relative à la loyauté et l'équilibre des relations commerciales » et a modifié l'ordonnance du 1er décembre 1986 sur la liberté des prix et de la concurrence. Cette dernière a un titre premier qui prévoit la liberté des prix. Son titre II traite du Conseil de la concurrence. Son titre III porte sur les pratiques anticoncurrentielles. Son titre IV traite de la transparence des pratiques restrictives. Son titre V porte sur la concentration économique et son titre VI sur le pouvoir d'enquête. Cette loi est complète. Elle a tout prévu. Pourquoi sommes-nous là ? Tout simplement parce que cette loi n'est pas appliquée.
Je vais vous faire part de mes observations d'industriel de l'agroalimentaire, en vous précisant que de nombreux confrères m'ont téléphoné pour me demander d'être leur représentant ici et porter témoignage de la situation. Est-il nécessaire de légiférer ? A cette question, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les parlementaires, Messieurs les distributeurs, nous répondons « non ».
Pourquoi ? Aujourd'hui est prévue face aux débordements de la loi cette fameuse saisine de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). Imaginez ce que représente un tel type de contrôle pour un modeste industriel comme moi, implanté dans vingt départements français. Lors de la visite d'un inspecteur de la DGCCRF dans une usine, c'est le « branle-bas de combat ». Pouvez-vous imaginer que l'industriel appelle la DGCCRF pour régler un litige avec son distributeur ? Cela n'est pas pensable.
La DGCCRF a mené elle-même des enquêtes qui se sont traduites par des procès au tribunal correctionnel. Jamais les PME ne sont indemnisées, car elles ne se portent pas partie civile et elles ne le feront jamais car le client est roi et il serait incongru que les PME portent plainte contre leurs clients. Par ailleurs lorsque des PME sont entrées dans le jeu fallacieux de la facturation non fondée, elles sont devenues indirectement, aux yeux de la loi, complices de ce phénomène et donc indirectement en faute, d'où l'importance pour nous de respecter et d'appliquer la loi Galland.
Il semble exister une grande volonté de dialogue et de recherche d'une solution. Il faudrait éviter que cette loi connaisse des débordements. Faisons confiance aux hommes pour rétablir une plus grande loyauté dans les relations commerciales.
Il faut exiger que les coopérations commerciales et les participations publicitaires correspondent à de véritables services rendus à ceux qui payent ces factures de coopération. Il faut exiger qu'ensuite ces coopérations commerciales ou publicitaires ne soient facturées que concomitamment ou après service rendu, et non avant. Nous avons, pour la plupart, effectué le service militaire. Nous avons appris que la réclamation n'était permise au subordonné que lorsqu'il avait obéi. Je crois qu'il serait bon de se rapprocher de cela en imaginant que la PME ne peut payer que lorsque le service a été réellement rendu.
En conclusion, nous voyons poindre le principe de la conciliation. Il serait bien d'imaginer la mise en place d'une commission paritaire de sages. M. Guichard parlait de sa sagesse vu son âge. Etant aussi à la retraite, je peux le lui dire, car je suis aussi d'un âge certain et j'ai une certaine expérience : s'il existait une telle commission comprenant un industriel et un distributeur examinant ensemble les dossiers avec un parlementaire, chacun pouvant avoir deux ou trois suppléants comme dans les comités locaux de réinsertion, qui ne réinsèrent jamais, cela éviterait certainement beaucoup de drames.
Pour résumer, j'ai lu ce matin, dans un grand quotidien, une prise de position de la fédération des entreprises du commerce et de la distribution qui appelait à l'application de la loi Galland « bordée » par un système de commissions. Je souhaite que l'on s'oriente vers cette solution, que le débat s'engage et, si possible, débouche sur une conclusion.
M. Jean-Claude Jaunait, président de Système U : Il n'est pas possible de comparer les relations entre les distributeurs, d'une part, et les fabricants de grandes marques et les PME régionales, d'autre part. Ces entreprises sont complètement différentes et il ne peut pas exister une règle commune satisfaisante pour résoudre tous les problèmes.
La négociation n'a de sens que si une contrepartie réelle existe. C'est indispensable. Il doit être possible de négocier soit un prix, soit un service rendu. La loi Galland conduit à certains excès et rend moins facile la négociation du prix d'achat facturé. C'est particulièrement vrai pour les fabricants de grandes marques. A l'inverse, lorsque nous travaillons avec les fabricants de nos marques propres, les négociations se font sur des bases les plus proches possible du prix net-net. Nous mettons en place des relations directes de partenariat, ce n'est pas du tout le même rapport de force.
Pour nous, les marges arrières sont des fantômes. Ce sont des marges en différé. Pourquoi un fabricant veut-il que des remises de transport soient imputées sur la marge arrière, plutôt que sur facture au moment de la livraison ? Sur ce sujet, une médiation est nécessaire. Il n'est pas forcément logique que des éléments compris dans la marge arrière ne puissent pas être reportés sur la marge avant.
Il pourrait exister une chambre de conciliation ou de médiation. Elle serait nécessaire, car les entreprises ont besoin de se retrouver sur un terrain d'écoute, de discussion, d'appréciation. Cette chambre pourrait avoir une valeur d'exemple.
A propos des marges arrières, j'ai entendu la question suivante : le petit commerce peut-il en bénéficier ou profiter de prix de revient meilleurs ? Je connais une solution : il faut que les petits magasin deviennent un peu plus grands en essayant de s'adapter aux besoins du marché et qu'ils s'organisent en réseau. Ils seront ainsi capables d'apporter une réponse aux besoins des consommateurs et présenter des propositions d'achats aux fabricants. J'ai le souvenir aussi des modes de distribution du passé (je fais partie des plus anciens). Ils ont considérablement évolué. Auparavant, nous recevions des ballots de sucre en vrac. Aujourd'hui, nous les traitons par palette ou camion complet. Il est même possible de recevoir 28 wagons d'un même produit pour dégager des gains de productivité. Par ailleurs nous discutons avec les PME sur leur façon de travailler, de mieux vendre ensemble.
Rien ne peut être régulé par des règles simples. Aujourd'hui, seule compte la négociation assise sur des contreparties réelles. Il faut ensuite privilégier le contrat écrit au détriment du contrat oral en vue d'avoir une meilleure appréciation notamment sur la manière de traiter les conflits. Il faut également permettre à ceux qui veulent se plaindre de le faire par l'intermédiaire des organisations professionnelles qui sont des lieux de médiation.
J'entendais le rapporteur dire que les PME n'ont pas assez de produits présents en rayon. Un distributeur possède différents types de magasins, allant du magasin de proximité et du magasin de maxidiscompte au supermarché, à l'hypermarché et au centre commercial. Lorsque les prix se négocient sur des marges différées et que l'approvisionnement des petits magasins se met en place, indirectement, ils profitent des meilleurs prix de revient. Il ne faut pas évoquer les problèmes de la distribution d'une manière trop simpliste. La puissance d'achat des grands distributeurs permet à des magasins plus petits de vivre à côté d'eux. Les uns aident les autres. Je ne pense pas qu'il soit possible de les opposer.
Aujourd'hui, en tant que distributeur, nous avons deux types de démarche. D'abord, nous sommes des artisans ; nous avons le devoir de trouver le bon produit et de le « travailler » pour le présenter à la vente. Ensuite, nous sommes commerçants et distributeurs ; nous sommes hautement organisés et gérons nos affaires de façon moderne, informatisée en fonction de la palette de solutions qui s'offre à nous. Aujourd'hui, un petit commerçant isolé ou une petite ou moyenne industrie isolée n'a aucune chance de vivre. La seule solution possible réside dans l'indépendance à travers un réseau organisé ou une profession organisée. Cela leur permet de disposer de moyens d'information et de formation, mais aussi de moyens d'affrontement ou de conciliation. Je pense que nous devons y parvenir.
Où est l'abus ? Il est chez l'autre. Mais cet abus ne résulte-t-il pas du jeu de la négociation ? Je ne connais pas un acheteur qui ne soit pas à la recherche de la meilleure offre, du meilleur prix ; cela est humain.
Je voudrais évoquer un souvenir. En 1937, mes parents ont acheté un commerce et ils l'ont vendu en 1964. Pendant ces vingt-sept années, ils s'étaient contentés de poser un linoléum sur le parquet et remplacer le lustre par un tube à néon. A cette époque, ils étaient à la recherche de produits ; les clients venaient chez nous pour cela. Aujourd'hui, les magasins se modernisent et se transforment continuellement. Nous avons un besoin constant d'agrandir nos linéaires et nos rayons pour développer les gammes des produits offerts aux consommateurs.
Les distributeurs travaillent à l'échelon local, régional, national et international. La façon de travailler et les relations avec les PME et les grands fabricants sont très différentes selon l'échelon de la négociation. Nous sommes intéressés par les produits régionaux, car ils font partie de la gamme de produits que nous devons proposer à nos clients. Nous avons également besoin de travailler avec des PME pour trouver des produits sous notre propre marque. Nous travaillons donc de plus en plus sur le mode du « faire ensemble », ce n'est pas de l'oecuménisme, mais de l'économie ; c'est l'intérêt des distributeurs.
Vous avez raison de dire que des excès existent. Avec la circulaire Fontanet et, maintenant, la loi Galland les pouvoirs publics ont fait ce qu'ils estimaient utile pour empêcher ces abus. Je crois simplement qu'aujourd'hui il faut essayer de s'organiser en interprofession et charger nos organisations professionnelles de résoudre les problèmes. Nous progresserons par l'échange. Lors des crises de surproduction agricole, il n'est pas possible d'obliger le consommateur à consommer plus. Fatalement, les effets de la surproduction se reportent sur les prix. Dans ce cas, une distorsion existe entre le producteur qui voit ses prix et son revenu baisser alors que le distributeur n'est pas forcément atteint.
Il faut profiter de votre mission d'information pour affirmer la nécessité de règles commerciales saines et loyales, qui sont d'ailleurs nécessaires au progrès des commerçants et des distributeurs. Nous devons nous organiser en réseau et mettre en place des partenariats. Ce n'est pas la réglementation qui apportera le progrès mais notre bon sens économique.
Nous n'avons pas à craindre la loi, mais à en espérer une amélioration de la qualité des relations commerciales. Je comprends que certains puissent dire : « j'ai subi 27 % de dommages publicitaires » ; j'emploie volontairement des termes caricaturaux. Il n'est pas possible de subir des dommages sans que réparation soit demandée. Si ces dommages résultent d'un accord qui n'est pas le plus intelligent qui soit, il faut admettre qu'il aurait pu être établi autrement. Aujourd'hui, il faut, lors des discussions avec les fabricants et les PME, parler des avantages de la coopération commerciale, des économies qu'elle engendre et qui permettent d'améliorer les prix, au bénéfice, tout d'abord, des consommateurs.
M. André Lajoinie, président : J'ai retenu notamment quelques propos : des contreparties réelles doivent exister entre les cocontractants ; le contrat écrit doit supplanter le contrat oral et une possibilité de se plaindre doit exister. Nous devrons réfléchir à tout cela.
M. Thierry Jégou, directeur des Pépinières de Kerisnel : Je suis très ennuyé car les relations que j'ai avec les distributeurs sont saines, et je ne suis pas sûr d'avoir ma place dans ce débat. Je travaille dans le monde du jardin. Nous parlons produits, végétaux, contrats de culture, de formation. Dans mes relations avec la grande distribution - Carrefour, Auchan ou les grandes jardineries -, je n'ai pas ces soucis.
M. Claude Blanchet, président des Serres du Salève : Je souhaite compléter ces propos dans le même sens. Il m'a été demandé de témoigner sur le secteur du jardinage.
M. Jean-Paul Charié, président de la mission d'information sur l'évolution de la distribution : Excusez-moi. Pourriez-vous vous présenter un peu plus ?
M. André Lajoinie, président : M. Thierry Jégou est directeur des Pépinières de Kerisnel. C'est un groupement de vingt producteurs horticoles bretons. M. Claude Blanchet est le président des Serres du Salève. C'est l'enseigne de jardinerie Botanic.
M. Claude Blanchet, président des Serres du Salève : Il nous a été demandé de venir témoigner de la situation dans le milieu du jardinage, mais nous ne nous sentons pas concernés par les propos tenus, ni par la démarche des remises et de la recherche du prix. Nos relations avec les producteurs du monde végétal (pépiniéristes, horticulteurs) se caractérisent par une volonté de travailler dans le sens de l'innovation et de l'expérimentation pour faire progresser le marché. Nous avons la chance de travailler dans un secteur où les relations avec les clients sont fortes et probablement moins banales que dans le secteur alimentaire. Nous avons des relations de convivialité, de vrai partenariat. Nous travaillons ensemble sur des expériences commerciales, sans exercer des pressions. J'espère que cela durera.
Cette situation est peut-être due au fait que tous les professionnels de ce secteur ont des formations très proches et que le marché est très porteur. Ensemble, nous essayons de le faire progresser.
M. André Lajoinie, président : Mme Danièle Lo Stimolo, économiste, est également déléguée générale du syndicat Syndigel (produits surgelés).
Mme Danièle Lo Stimolo, économiste : Il m'a été demandé d'intervenir intuitu personae en tant qu'observateur de la situation. Je représente effectivement également une organisation professionnelle.
Le secteur des glaces et produits surgelés touche aux produits industriels et alimentaires et intéresse vivement la distribution moderne. Il a été très souvent le premier exposé à certaines pratiques commerciales qui sont parfois contestées. Il était très intéressant d'entendre les deux intervenants précédents qui ont affirmé avoir d'excellentes relations avec la distribution.
Je voudrais faire observer que sur un PIB de plus de 8 000 milliards de francs, la grande distribution en représente à peu près un quart et le commerce 28 % des entreprises. Alors que le droit de la concurrence concerne toutes les relations commerciales, seules les relations de la distribution avec l'industrie posent problème. En réponse à la question : « pourquoi ces rapports sont-ils tendus ? » je voudrais faire quelques observations.
Les intervenants du secteur horticole ont souligné qu'ils se trouvaient sur un marché très porteur, en forte évolution, qu'ils tentaient ensemble de développer. C'est une caractéristique qui distingue leur secteur de celui de l'alimentation où les relations sont les plus tendues. La part du budget des ménages consacrée aux produits alimentaire se réduit en effet. L'absence d'expansion du marché de l'alimentation, qui est un marché de masse, est probablement à l'origine des tensions entre producteurs et distributeurs.
Comme l'a souligné M. Jean-Paul Charié, le comportement des partenaires commerciaux est le noeud du problème. Il faut avoir bien présent à l'esprit que le déséquilibre des relations est dans la nature des choses et qu'il n'appartient pas à la loi d'essayer de le gérer.
Par ailleurs, les entreprises ont pour objectif de maximiser leurs profits. Elles n'ont pas un rôle philanthropique. Je ne suis pas du tout d'accord avec certains intervenants de cette table ronde. Je crois qu'il appartient à la loi de régler ce problème du déséquilibre, donc du rapport de force. Je voudrais faire deux citations. La première est de Montesquieu : « c'est une expérience éternelle que tout homme, qui a du pouvoir, est porté à en abuser ». Cela paraît naturel et nous n'y pouvons rien. La deuxième est de Lamennais : « entre le faible et le fort, c'est la liberté qui opprime et la loi qui libère ». Je pense que le droit de la concurrence a ce devoir de permettre aux uns et aux autres d'agir librement, mais dans des limites strictement définies. A cet égard, certains ont dit que le droit de la concurrence n'avait pas à être modifié, qu'il était très bien en l'état. Cependant, je considère qu'il n'est pas satisfaisant, car il est contradictoire et n'est pas appliqué, particulièrement dans le secteur du commerce de gros. Ce dernier s'est vu écarté du marché avec ces différentes pratiques. Lorsque les rabais, remises et ristournes ont progressivement augmenté, l'industrie et le commerce de détail ont commencé à mettre en situation défavorable et de distorsion concurrentielle le commerce de gros. Ces distorsions se sont aggravées lorsque la coopération commerciale s'est développée sur la base des services que la distribution prétendait offrir à ses fournisseurs. En fait, il s'agissait uniquement des services commerciaux relevant de la fonction même de commerçant, et que notamment que le commerce de gros apportait à ses clients et ses fournisseurs autant à l'amont qu'à l'aval.
La conséquence de la négociation sur des coopérations commerciales a été de faire payer par le détaillant des frais qui auraient dû normalement être pris en charge par le grossiste. Le commerce de gros, dans beaucoup de secteurs, a disparu de l'intermédiation industrie/commerce. Il existe encore dans certains secteurs où la grande distribution n'est pas encore présente, notamment dans la restauration. J'attire cependant votre attention sur le fait qu'actuellement, les mêmes pratiques se développent aussi dans ce secteur ; elles auront de toute évidence les mêmes conséquences. La conséquence ultime de l'éviction du commerce de gros est un niveau de coûts dans la distribution très supérieur à ce qu'il pourrait être si le commerce de gros apportait sa valeur ajoutée d'intermédiation générique.
La question de la coopération commerciale me paraît être certainement le coeur du problème. Je vous ai dit qu'elle avait évincé le commerce de gros car elle rémunérait des fonctions que ce stade assurait. J'observe que la coopération commerciale apporte, même lorsqu'elle est officielle, équitable ou justifiée, une rémunération de charges d'exploitation normales d'un commerçant distributeur. Elle le met en situation avantageuse par rapport à la concurrence. Par conséquent, elle aboutit à des distorsions de concurrence quasi systématiques.
Nous nous apercevons que l'ordonnance du 1er décembre 1986 a été essentiellement conçue pour régenter et encadrer les relations verticales industrie/commerce, alors qu'elles représentent un quart de l'économie. Elle a oublié, de façon regrettable, que la concurrence - autant entre distributeurs qu'entre industriels - était aussi horizontale et surtout qu'il fallait veiller à la préserver. Actuellement, on observe que la coopération commerciale crée des distorsions de concurrence graves entre très grandes entreprises et PME. Elle défavorise très lourdement les PME par rapport aux grandes entreprises industrielles. Entre les distributeurs eux-mêmes, elle crée des distorsions systématiques à géométrie variable.
Le texte actuel de l'ordonnance n'est pas satisfaisant. Le commerce de gros et le secteur des produits surgelés souhaitent depuis longtemps, et je réitère la demande, que l'alinéa de l'article 33 autorisant la coopération commerciale soit supprimé. Ceci permettrait de réactiver toute la discussion et la négociation à laquelle le commerce de gros tient tout autant que les industriels et les distributeurs. Je considère que cette négociation doit et peut exister dans le cadre des conditions générales des fournisseurs. A cet égard, un véritable dialogue de sourds existe actuellement entre les industriels et la distribution. En effet, depuis la loi Galland, les industriels ont cru pouvoir établir des conditions générales de vente extrêmement restreintes en termes d'offres de barèmes et de rémunération d'éventuelles coopérations commerciales. En aucun cas, je considère qu'elles doivent être éliminées, mais néanmoins celles-ci doivent être ouvertes et transparentes. Aujourd'hui la coopération commerciale est négociée de façon opaque. Elle est proposée par le client et non par le fournisseur. Par conséquent, elle est valorisée à des niveaux totalement variables et non transparents et équitables. Finalement, je pense que la négociation doit exister, mais dans un cadre défini.
M. Jean-Yves Le Déaut, rapporteur de la mission d'information sur l'évolution de la distribution : Le débat est intéressant. Vous nous décrivez une situation qui n'est pas totalement satisfaisante tout en faisant des propositions. Nous, parlementaires, avons le sentiment qu'un réel problème existe dans les circuits de la négociation. Il faut distinguer, il est vrai, les grandes entreprises. Certains pensent que des rentes de financement sont assurées par la coopération commerciale, en contrepartie de prestations qui sont réelles et d'autres qui le sont moins.
Je vais vous lire une lettre qui m'est parvenue aujourd'hui ; elle provient d'une grande entreprise de l'agroalimentaire. Cette personne n'a pas osé venir. Elle me dit : « nous ne négocions plus. Nous constatons une exigence. Si nous ne nous y conformons pas, il y a toujours une sanction. Une grande enseigne m'a demandé de compenser la perte de marge due à la promotion faite sur mes produits. J'ai refusé. Depuis, cette enseigne prélève d'office sur les factures des pénalités de rupture atteignant plus de 100 % de la valeur du produit manquant. J'ai contesté ces pratiques, elle menace aujourd'hui de trancher dans mes gammes de produits si je continue à la relancer sur ce sujet. »
Aujourd'hui, un fournisseur n'attaque pas son client devant les tribunaux car cela signifierait qu'il quitte le terrain de la négociation et court le risque d'être déréférencé. Actuellement, l'Etat ne peut pas se substituer au plaignant. Peut-être faudra-t-il changer la loi à cet égard pour que les abus soient sanctionnés et donnent lieu à réparation.
M. Luc Soupirot, exploitant agricole : Je suis un petit producteur de concombres du Loiret. Je suis un peu effaré d'entendre de telles inepties de la part de ces messieurs des grandes surfaces. Je vis sur le terrain. Je connais vraiment la situation. La plupart des producteurs de concombres de France ont enregistré 250 000 F de pertes à l'hectare par rapport à leurs résultats de l'année dernière qui permettaient tout juste d'assurer l'équilibre des comptes. Voilà du concret. Lorsque vous parlez d'un problème d'organisation, je dis que c'est faux. En France, la plupart des régions sont très bien structurées et organisées parce qu'il s'agit là d'une condition nécessaire.
Cette année, il n'y a jamais eu de surproduction de concombres ou de tomates. Par conséquent, là n'est pas la cause de la chute des prix. La fixation des prix se fait au cours des négociations sur les promotions, six mois à l'avance. Ce mécanisme empêche les prix de monter lorsque la demande est plus forte que l'offre. Chaque semaine, nous effectuons des relevés de prix dans les grandes surfaces pour les comparer avec ce que nous percevons. Un produit qui nous est payé 1,90 F est vendu 6 F dans les grandes surfaces. Le constat est le même toutes les semaines ; les prix sont systématiquement multipliés par trois. Dans une grande surface, toute l'année, les concombres sont vendus 10 F les trois pièces. Souvent, celle-ci nous les paye 1,50 F ou 1,70 F au mieux. Pour équilibrer les comptes de nos entreprises pour qu'elles restent pérennes, il faudrait au moins céder le concombre à 1,80 F. En deçà, nous perdons de l'argent.
Je peux également parler des ristournes. J'ai travaillé pendant plus de dix ans avec Carrefour pour les produits d'espaces verts. Certains déclarent que tout se passe bien. Je dis que ce n'est pas vrai. Il y a dix ans, les ristournes étaient de 3 %. Ce taux était normal. Les grandes surfaces font valoir qu'elles ont permis de développer les petites entreprises ; c'est vrai, mais elles ont également augmenté les ristournes dans une proportion vraiment effarante. Maintenant, nous devons accorder des ristournes d'un taux minimal égal à 6,5 % du montant hors taxes des ventes, sans compter les reprises de produits lorsqu'ils ne sont plus bons et les promotions, qui deviennent une habitude. Globalement, sur une saison, nous atteignons plus de 10 % de ristournes. Si nous continuons comme cela, nous sommes condamnés à fermer toutes les entreprises. Or, uniquement dans le Loiret, l'agriculture représente plus de 9 000 emplois, probablement plus que le personnel de Carrefour en France.
Mon constat est peut-être un peu sévère, mais c'est la réalité. Nos entreprises comprennent en moyenne quatre ou cinq salariés. Nous voudrions continuer à vivre.
M. Jean-Claude Jaunait, président de système U : La fédération des entreprises du commerce et de la distribution va prochainement vous faire part d'opinions mesurées et de propositions pour la filière des fruits et légumes. Le contrat de culture nous permettrait de progresser. Son but est d'améliorer avec des groupes de producteurs la qualité du terroir ou de la production et de garantir les volumes. Il est vrai que le prix de cession est discuté au moment de la livraison, car nous sommes sur un marché fluctuant, non prévisible. J'admets qu'il y a des promotions de temps en temps, intéressantes pour le grand public et qui aident à augmenter les volumes de vente. Cependant, elles représentent quelquefois des efforts importants.
En réalité, plus les contrats de culture se développeront, plus le niveau de la qualité montera et plus les relations seront satisfaisantes. La surproduction met souvent sur le marché des produits en quantité excessive et d'une moins bonne qualité.
M. Jacques-Edouard Charret, directeur général d'Opéra : Je voudrais répondre aux propos relatifs à la distribution des fruits et légumes. Des sujets peu comparables sont mélangés. La fédération des entreprises du commerce et de la distribution a avancé des propositions qui me semblent aller dans le sens des souhaits de M. Luc Soupirot. Tout le monde s'oriente vers une contractualisation. Toutes les enseignes présentes, toutes celles représentées par la fédération des entreprises du commerce et de la distribution ont donné leur accord de principe pour établir un contrat annuel négocié une fois pour toutes.
Le problème des prix catalogue est réel. Notre métier est d'être très compétitif ; il est important que nous soyons bien placés en termes de prix. Or, les contraintes techniques pour imprimer un mailing conduisent souvent à décider du prix inscrit dans le catalogue publicitaire entre six et sept semaines avant le démarrage de la campagne. C'est un vrai souci. Il ne faut pas nous jeter la pierre. Nous sommes conscients de la dérive qui tire les cours vers le bas. Nous sommes prêts à travailler dans des délais beaucoup plus courts. Aujourd'hui, la plupart des entreprises de distribution présentes autour de cette table pensent qu'elles peuvent réduire le délai à trois semaines.
De plus, nous sommes prêts à nous engager à ne pas faire des campagnes de communication sur certains produits à des périodes prédéterminées. Le risque est réel au démarrage de la saison, pas en pleine saison. Cette proposition n'a pas encore reçu d'écho favorable.
Pour revenir aux fruits et légumes, il existe un vrai risque. Il faut être prudent. Cesser toute animation et toute promotion sur les fruits et légumes serait extrêmement préjudiciable à la filière agricole, comme à la distribution. Cela reviendrait à favoriser les importations au détriment des filières françaises. Il faut donc se montrer extrêmement vigilant.
Je rejoins M. Antoine Guichard pour dire que les filières agricoles sont peu ou mal organisées. Des marques nationales, véritablement capables de soutenir la production, n'existent pas. Chaque fois que des communications institutionnelles sont mises en place, comme la campagne « manger des pommes » qui était très sympathique, elles ne fonctionnent pas ; les volumes dans nos magasins sont en progression pratiquement nulle. Il faut donc être vigilant et ne pas prendre de mesures desservant les filières agricoles.
Je voudrais apporter mon témoignage sur les relations avec l'univers des produits de grande consommation. J'ai une particularité : ma vie professionnelle a été partagée entre l'industrie et la distribution. Je suis issu d'un grand groupe, leader mondial des produits de grande consommation. Cela fait sept ans que j'ai rejoint le groupe Casino. Il ne faut pas faire d'amalgame ; il existe de réelles différences entre les PME et les grands groupes. Vous avez cité des chiffres sur la concentration. J'en ai relevé quelques-uns afin que vous en soyez conscients. Dans le domaine des céréales, les deux premiers groupes actifs sur le marché français réalisent 70 % des ventes ; dans les couches le taux atteint 72 % ; dans l'alimentation infantile 82 % ; dans le chewing-gum 99 % ; dans les lames de rasoirs plus de 80 %.
Il ne faut pas mélanger les problèmes des PME et ceux des grands groupes. La négociation avec ces groupes peut être parfois tendue mais les relations sont beaucoup plus équilibrées que ce que l'on entend généralement. Il faut donc être extrêmement vigilant car certaines modifications de la loi pourraient être préjudiciables aux PME.
Si je suis Mme Danièle Lo Stimolo sur les produits surgelés, toute les remises de la coopération commerciale devraient être intégrées à la facture d'achat des produits. Je vous indique que cette solution est la mort annoncée de nombreuses PME. En effet, les marques de distributeurs seront les premières à souffrir de la baisse générale des tarifs. La capacité des grands marques à investir évincera les PME qui n'auront plus les moyens de se battre.
Il ne faut pas se tromper de combat et être attentif à ce qui est positif et à ce qui ne l'est pas pour les PME. Toutes les personnes ayant accepté de venir ce soir sont d'accord pour réprimer les abus. Il en existe, nous en convenons. Il n'est pas forcément facile pour un directeur des achats de « tenir à 100 % » les propos de l'ensemble de ses troupes, en permanence.
Il faut que ces abus soient sanctionnés, que les contrats soient respectés et qu'un organe de médiation ou de conciliation soit créé. Ce dernier pourrait saisir les représentants du pouvoir. Sont présentes, ce soir, des personnes de bonne volonté. Elles veulent aller dans le sens d'une conciliation, d'un partenariat, mais ne jouons pas avec le feu car vraisemblablement, les PME seront les premières à en faire les frais.
M. Léonce Deprez : Je pense que cette table ronde sera très utile car elle a déjà permis d'entendre des réponses aux questions que se posaient les députés. Dans l'esprit de certains intervenants, l'arsenal législatif est suffisant, il faut maintenant régler les problèmes par voie contractuelle.
J'ai retenu que les rémunérations obtenues par des marges arrières sont acceptables dans la mesure où elles sont fondées sur des services rendus. Quand le service n'est pas rendu, quel est le moyen de dénoncer le contrat qui n'est pas respecté ? L'organisme que vous proposez apporterait peut-être une solution à ce problème.
Vous nous avez fait comprendre finalement que, la croissance des marques de distributeurs avait, certes, un aspect négatif dans la mesure où les fabricants deviennent des sous-traitants, mais elle permet de faire vivre des PME à l'abri de la concurrence des grands groupes de producteurs.
Nous sommes tous très sensibles aux problèmes des agriculteurs. Les députés peuvent en dire plus sur ce sujet que certains leaders agricoles car ils vivent au contact du terroir. L'interprofession agricole ne doit-elle pas s'exprimer davantage et devenir plus forte pour dialoguer avec la grande distribution ? Nous avons le sentiment qu'elle ne se manifeste pas assez et n'a pas le poids nécessaire pour mettre au point des contrats de culture.
Nous ressentons une autre inquiétude à propos des villes moyennes de 30 000 habitants car des responsable d'enseignes de grande distribution nous ont dit qu'il n'y avait aucune chance de redynamiser leur centre-ville.
Tout à l'heure, M. Jean-Claude Jaunait a dit qu'il fallait que les petits et moyens magasins s'organisent en réseaux pour obtenir des avantages de la part d'une centrale d'achats. Pouvez-vous confirmer ces propos afin de calmer nos inquiétudes ? Les contrats, pourront-ils permettre d'aboutir à un résultat, de préférence à l'adoption de nouvelles lois s'ajoutant à celles existantes ? Le respect des contrats doit s'imposer dans une économie devant être à la fois sociale et libérale.
M. Pierre Ducout : Je rappelle d'abord qu'aucun rapport préparatoire n'a été établi. Des questions ont seulement été soulevées en vue de cibler les abus.
Pour faire un petit clin d'oeil à M. Gérard Bourgoin, je dirai que nous avons dans nos circonscriptions des commissions locales d'insertion qui, avec l'appui des entreprises aussi bien de la distribution que de la production, réussissent avec la croissance à créer quelques emplois.
Il est certain que nous avons suivi, depuis trente ou quarante ans, les progrès de la grande distribution. Cela a indiscutablement permis d'avoir un grand marché de la consommation en réduisant les coûts globaux. Il est également certain que le législateur doit s'assurer que les grands équilibres sont garantis. C'est un peu le rôle d'une mission d'information, qui ne veut pas changer systématiquement la loi, mais étudier ses conditions d'application.
A propos des grands équilibres entre les grands groupes de la distribution et de la production et les PME, je veux poser deux questions : pensez-vous qu'aujourd'hui les marges nécessaires aux uns comme aux autres sont correctement équilibrées ? Les PME ne deviennent-elles pas systématiquement des sous-traitants ? J'ai travaillé dans les travaux publics et le bâtiment. Nous savions que les sous-traitants étaient pressurés au maximum et qu'ils disparaissaient. Avez-vous des outils pour obtenir cet équilibre de marges pour les PME ?
Par ailleurs, les grands hypermarchés de la périphérie des villes sont souvent diabolisés alors qu'ils semblent complémentaires des autres modes de distribution. Le blocage des nouvelles implantations de grandes surfaces ne va-t-il pas créer des situations de monopole ou d'oligopole dans certains secteurs, provoquer des augmentations de prix et déséquilibrer l'ensemble du marché ?
M. Jacques Rebillard : Vous avez beaucoup parlé de contractualisation dans les filières agroalimentaires. Je voudrais que vous parliez du secteur textile qui est en complète décomposition. La grande distribution pourrait jouer un rôle pour aider ce secteur à refaire surface. La baisse des charges sociales ne suffira pas, il faudrait aussi augmenter les prix.
M. Jean-Yves Le Déaut, rapporteur de la mission d'information sur l'évolution de la distribution : Pensez-vous que l'augmentation de la coopération commerciale traduit un déséquilibre dans l'économie au profit de la grande distribution ? J'ai bien entendu les problèmes de compétition avec les grands distributeurs étrangers. L'équilibre est-il satisfaisant, non pas vis-à-vis des multinationales étrangères, mais de certaines entreprises françaises ?
Les petites entreprises pourront-elles investir dans l'innovation à partir du moment où la coopération commerciale absorbera leur marge ? Vont-elles respecter les exigences de qualité et de sécurité alimentaires ?
Ma deuxième question porte sur les marques de distributeur qui sont en croissance et font vivre de nombreuses PME. Dans deux affaires récentes concernant les organismes génétiquement modifiés et la dioxine, la responsabilité de producteurs a été mise en cause alors qu'ils ne sont plus réellement indépendants et travaillent en sous-traitant.
D'une part, les entreprises indépendantes sont devenues très fragiles face à la concentration des centrales d'achats ; elles disparaissent pour la plupart. D'autre part, de nombreuses PME font partie d'une filière intégrée, où elles ne sont plus que sous-traitantes. Le cahier des charges qui leur est imposé est un vrai problème. Ne constitue-t-il pas un contrat quelque peu léonin ?
M. André Lajoinie, président : Que pensez-vous des conséquences du commerce électronique sur l'avenir de la distribution ? Vous devez y réfléchir.
M. Félix Leyzour : J'aimerais entendre votre position sur l'idée d'établir un coefficient multiplicateur dans la filière des fruits et légumes. C'est une solution qui est souvent proposée lorsqu'il y a chute des cours.
M. Jean Proriol : Tout le monde semble dire que les lois manquent parfois leurs objectifs et qu'il y en a certainement assez, mais encore faudrait-il qu'elles soient bien appliquées. Si j'ai bien compris, malgré l'existence de lois, certains demandent qu'existe un contre-pouvoir dans les relations contractuelles. Mais les situations conflictuelles entre distributeurs et producteurs ne trouvent-elles pas leur origine dans le comportement des uns et des autres ?
J'ai apprécié les propos de M. Charret. Il nous a été objecté qu'il fallait faire attention au déréférencement portant simplement sur quelques mois. M Charret a proposé un contrat au moins annuel. D'autres petites entreprises font valoir que cette durée n'est pas suffisante et préféreraient des contrats plus longs, sur deux ou trois ans, qui permettraient aux industriels d'amortir leurs investissements. Le contrat d'un an n'est-il pas un peu court ?
Je n'ose poser ma dernière question. Vous avez tous parlé de marge arrière. Je n'ai rien compris à cette affaire. J'aimerais avoir des chiffres. Les marges arrières peuvent-elles être quantifiées ? Que représentent-elles ? Ma question est peut-être indiscrète. Faut-il plafonner les marges arrières ? C'est un autre débat.
M. Jean-Claude Jaunait, président de Système U : Il est certain que le commerce spécialisé progresse énormément. De retour des Etats-Unis, les familles Defforey et Fournier ont voulu appliquer en France les méthodes américaines. L'idée de vendre des casseroles et des vêtements sur une même surface et non pas dans des magasins séparés est à l'origine du premier magasin Carrefour, premier hypermarché à la française qui a connu un succès évident.
Aujourd'hui, le consommateur attend des distributeurs un ensemble de compétences qui nous permettent de sélectionner des produits, qui lorsqu'ils sont propres au magasin prennent l'enseigne comme marque. Nos magasins offrent un contenu global. Cela nous oblige à être performant, notamment au regard de l'achalandage, la compétence des vendeurs et l'organisation de la vente.
Le commerce spécialisé ne peut pas évoluer différemment. Il doit disposer de plus grandes surfaces de vente et avoir une organisation plus adaptée en amont et un savoir-faire permettant de « travailler le produit » comme s'il en était le fabricant. D'ailleurs, certains fabricants nous reprochent parfois de faire leur travail, mais nous sommes obligés de le faire, ou plutôt d'être à côté d'eux. Les grands groupes, comme Casino, travaillent de plus en plus dans cet esprit.
Concernant l'idée de « bonnes pratiques » évoquée par M. Proriol, nous pouvons progresser en recherchant avec les fournisseurs une valeur ajoutée car c'est notre intérêt de mieux vendre et que chacun soit satisfait. Ce travail est naissant. Pendant des années, nous avons vendu moins cher des produits de grandes marques. Nous avons su le faire, car c'était attractif. Aujourd'hui, nous devons complètement réorganiser notre travail.
Qu'est-ce qu'une marge arrière ? C'est une marge prise en arrière faute de la prendre en avant. Aujourd'hui, si les prix étaient complètement libres, la revente à perte serait systématique pour attirer le chaland et un autre déséquilibre apparaîtrait.
M. Jean-Paul Charié, président de la mission d'information sur l'évolution de la distribution : D'où l'intérêt de la loi.
M. Jean-Claude Jaunait, président de Système U : D'où l'intérêt de la loi, en effet. Qui dit, dans un pays civilisé, que la loi ne protège pas les individus ? Les règles sont nécessaires à l'indépendance et à la liberté de l'entrepreneur. L'excès de réglementation nuit à la performance de l'entreprise. C'est une philosophie.
M. Daniel Bernard, président directeur général de Carrefour : La rupture du contrat peut trouver son origine soit dans une pratique abusive et, dans ce cas, il faut appliquer la loi, soit parce que les parties ne parviennent pas à dialoguer, auquel cas il faut recourir à un arbitrage. Différentes instances existent pour cela. Nous en avons créé une où siègent plusieurs industriels proches de la fédération de M. Bourgoin. Lorsqu'un conflit est porté à l'arbitrage, généralement, cela s'arrange avant la sentence car les points de vue se rapprochent.
Toutes les entreprises grandissent, mais elles doivent en même temps fonder leur action sur un système de valeurs car les règlements à eux seuls ne peuvent pas tout résoudre. Autrefois, la politique sociale de la grande distribution a été très critiquée ; chacun se rappelle le débat sur le travail des caissières. Aujourd'hui toutes les caissières ont un rôle noble dans nos magasins. Elles sont d'ailleurs actionnaires de Carrefour, de Casino, etc. et vous n'entendez plus parler de ce problème. Je pense par ailleurs qu'on n'a pas le droit de rompre les relations avec une PME en 24 heures. Il faut observer des règles, discuter et respecter un délai ; dans mon entreprise ce délai est d'un an pour une PME avec laquelle nous avons une relation régulière.
Vous avez parlé d'un contrat pluriannuel. Cette proposition doit être appréciée selon le type de produit concerné. Pour un produit saisonnier, un contrat annuel comportant un engagement avec une PME sur des obligations en matière d'innovation est préférable ; nous travaillons à livre ouvert sur la rentabilité du produit. Le reversement de marges arrières n'est pas nécessaire. Pour les PME, le prix d'achat net-net est important. Nous les aidons à innover. Le yaourt avec 12 % de fruits n'a pas été inventé par les grands, mais par la PME Senoble, avec nous. Lorsqu'une PME doit construire une usine supplémentaire, il serait bien nécessaire que nous nous engagions pluriannuellement pour le banquier.
Sur le marché des lames de rasoirs, 25 % de marge arrière sont versés en France. Est-ce trop ou pas assez ? Au Mexique, aucune n'est accordée. J'ai pensé que dans ce pays nous étions dupés. Finalement, en marge nette, les lames de rasoir étaient 25 % moins cher qu'en France ; or, elles sont fabriquées dans des usines complètement automatisées. J'encourage votre mission à réaliser une étude comparative sur les prix d'achat nets-nets entre les différents pays. Ainsi, le café soluble est beaucoup moins cher en Espagne qu'en France.
M. Jean Proriol : il est dit que l'Europe du Nord n'a pas de système de marge arrière.
M. Daniel Bernard, président directeur général de Carrefour : Nous connaissons tous les systèmes de prix puisque nous sommes présents dans 25 pays. L'intéressant est de gérer la marge. La loi Galland était demandée par les grands industriels pour remonter les prix et afin que le prix d'achat, devenant le prix de vente au consommateur, soit le même pour tout le monde. Mais ces grands industriels ont dû discuter, en dehors de la facturation de l'achat, le travail accompli en logistique, en publicité, en mise en avant par la distribution. Le problème n'est pas le même avec les PME, avec lesquelles nous travaillons à livre ouvert.
On pouvait s'attendre à des effets pervers tels que notamment des importations ou des négociations à l'étranger dues à l'excès de réglementation en France. Nous en avons tous profité pour travailler avec les PME et faire baisser leurs prix. Les industriels ont constaté que les prix des grandes marques mondiales permettaient aux PME de vivre. Je vous encourage à lire le livre sur le marketing de Philip Kotler, il est très simple, il dit que vous devez dominer le produit au niveau mondial, supprimer des marques et éliminer les petits par l'imposition d'un barème. Messieurs, ne vous exposez pas à cela. Si vous reportez sur la facture les remises pour services spécifiques, vous favoriserez le leader mondial et éliminerez la concurrence française.
Je veux bien que la loi Galland soit abrogée. J'étais d'accord avec la proposition du rapport Villain tendant à supprimer le titre IV de l'ordonnance du 1er décembre 1986. Mais si vous le faites, vous relancerez la guerre des prix. Cela ne me gêne pas. Cependant, vous condamnerez les PME.
A cette table, nous sommes concurrents à tous les niveaux. Dans une ville de 30 000 habitants, vous trouvez des commerces de proximité, affiliés, modernisés, sous l'enseigne de Casino, Marché U, Shopi ou Huit à Huit. Vous pouvez trouver des supermarchés, comme Casino, Champion, Stock, et des hypermarchés, sûrement en périphérie, comme les hypers U, Géant, Carrefour. Partout, le client peut se rendre chez différents commerçants indépendants qui ont pu se créer grâce à nos groupes, sous des enseignes de qualité. Nos groupes sont tous aujourd'hui multiformes. Il faut que les industriels appliquent la même règle. Pourquoi éliminer les PME ? Cela n'a pas de sens.
M. Jean-Paul Charié, président de la mission d'information sur l'évolution de la distribution : Si on prend l'exemple des disques, on vous reproche de ne vendre que quelques références, les disques les plus demandés. Des magasins spécialisés ne peuvent plus être créés, notamment des disquaires dans les communes de moins de 30 000 habitants.
M. Daniel Bernard, président directeur général de Carrefour : J'allais chez un disquaire très important sur les Champs-Elysées. Il a été éliminé, non pas par Carrefour, mais par Virgin, lequel est fabricant de disques et en même temps concurrent de la grande distribution. Je vous signale que nous avons monté une logistique entièrement spécialisée sur le disque. Nous mettons en vente 10 000 titres. Le temps où les hypermarchés n'avaient que quelques disques est dépassé. Je suis très content que la FNAC fasse un excellent travail et vienne à nos côtés dans bien des pays. Dans la micro-informatique, Carrefour est le premier vendeur, mais Surcouf est notre premier concurrent. Nous sommes les premiers à vouloir dynamiser à nouveau les centre-villes, mais il faut créer des parkings et pas seulement des bureaux.
Nous parlons beaucoup des marges arrières, mais j'aimerais aussi parler de celles de l'Etat. Elles n'ont pas cessé d'augmenter. Vous avez noté des augmentations d'impôts depuis 1995. Pour Carrefour France, le supplément d'imposition représente 1,7 milliard de francs. Il s'agit aussi de marges arrières !
M. Jean-Paul Charié, président de la mission d'information sur l'évolution de la distribution : Oui, mais avec des contreparties.
M. Daniel Bernard, président de Carrefour : Vous avez voté des augmentations d'impôts depuis 1995. Pour Carrefour France, le supplément d'imposition représente 1,7 milliard de francs. Il s'agit aussi de marges arrières.
Vous avez parlé du textile. Sur le plan de la production, c'est un problème dans notre pays. Par les marques propres, il est possible de mener des actions intéressantes. Quand j'étais jeune acheteur, j'allais acheter des pantoufles à Nontron. Sur les quatre usines, il n'en reste aucune. Est-ce dû à la distribution ou aux charges sociales ? Carrefour se fournit en espadrilles en France, dans une PME très dynamique, très bien équipée. Vous pouvez aller la visiter, on vous confirmera qu'il n'y pas de problèmes avec nous.
Je vous cite un autre exemple qui concerne dans le fromage. Le munster et le maroilles ont été en situation difficile à cause de la listeria. Si nous n'avions rien fait, nos fournisseurs seraient morts. Nous avons réglé le problème et avons relancé la consommation du maroilles sur toute la France.
Je ne dis pas que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes, mais notre rôle ne se résume pas à vendre des couches Pampers. Nous vendons une diversité de produits. Nous avons essayé de réaliser douze variétés anciennes de tomates. Or, la Communauté européenne a adopté un règlement sur les variétés anciennes : si elles ne sont pas au catalogue officiel, il n'est pas permis de les cultiver. Nous nageons dans des excès de réglementation, alors que nous essayons de nous battre pour la qualité, la diversité, l'agriculture durable.
Tout n'est pas pour le mieux. Nous avons conscience de notre mission vis-à-vis des entreprises, de nos employés, qui sont nos collaborateurs, de nos partenaires et des grands groupes. Ne vous inquiétez pas pour ces derniers, ils sauront très bien discuter avec nous de l'amélioration logistique, la rationalisation des marges, des ruptures d'approvisionnement des promotions, pour gagner plus d'argent. Chez Procter & Gamble, fabricant des couches Pampers, 32 personnes dans le monde s'occupent de l'amélioration de « la profitabilité partagée ». Ne vous inquiétez pas pour les grands, ils réalisent des profits. Nous avons une responsabilité - c'est vrai - vis-à-vis de nos partenaires PME. Un partenariat c'est comme un mariage ; nous ne le réalisons pas pour le rompre le lendemain. Il faut des PACS entre entreprises.
Il faut sortir du dilemme de la diabolisation. Cela nous fait beaucoup de tort à l'étranger. Je pense que nous avons engagé un bon dialogue aujourd'hui. Nous avons parlé de la crise des fruits et des légumes et du concombre. Le concombre a constitué une filière de qualité, c'est un progrès.
M. Luc Soupirot, exploitant agricole : Il nous a été demandé de réaliser des produits de qualité depuis cinq ans déjà. Nous effectuons de la protection biologique intégrée (PBI). Nous n'utilisons plus de traitement. Demain, il nous sera demandé la traçabilité. Personnellement, je suis capable de la fournir mais si elle m'est demandée, je refuserai car mon produit ne me sera pas acheté plus cher. La protection biologique intégrée me revient 4 ou 5 F au mètre carré, alors qu'une lutte chimique traditionnelle coûte 2 F. Quant à la traçabilité, si j'achète un programme informatique, il me coûtera 15 000 F. Je ne dépenserai pas cette somme si je n'ai pas la garantie que mon concombre sera payé plus cher. Il faudrait aussi créer une sorte de label de qualité qui permette au client de distinguer entre le produit biologique et le produit tout venant. Aujourd'hui, nous sommes capables de mettre en place, en France, la traçabilité alors que dans d'autres pays ce n'est pas possible. Cependant, il faut vous engager à payer plus cher les produits de qualité.
M. Jean-Yves Le Déaut, rapporteur de la mission d'information sur l'évolution de la distribution : J'approuve tout à fait.
J'aimerais parler des marques de distributeur. Je me fais l'avocat du diable. Finalement, la situation est incroyable : certains producteurs disent qu'ils financent par la coopération commerciale leurs propres concurrents, qui sont aussi leurs clients ; ces derniers mettent en valeur leurs marques au beau milieu du linéaire, alors que leurs produits sont « à la cave ». N'existerait-il pas des moyens pour favoriser certaines entreprises ?
M. Daniel Bernard, président directeur général de Carrefour : Je vais partager la réponse avec M. Charret. Ce n'est pas une entente ! Les PME représentent 40 % de nos références alimentaires et 39 % de notre chiffre d'affaires. 23 % de nos références sont des produits fournis par des PME vendant sous leurs marques et 17 % des références sous nos marques propres.
La marque de distributeur est un thème extrêmement important. Aujourd'hui, dans le monde, la marque est rationalisée ; elle prend deux formes : soit une grande marque mondiale, soit une marque d'un grand distributeur ayant la confiance de ses clients et garantissant la qualité. Il peut s'agir d'un produit alimentaire, d'un vélo tout terrain Carrefour, d'un produit de placement, d'une assurance ou de vacances. Nous sommes nous-mêmes des éditeurs de marques. Pour éditer ces produits, nous travaillons avec un ensemble d'industries car nous n'avons pas d'usine. Il s'agit de coopération. Cela n'aurait aucun sens d'inventer un produit avec une firme, puis de la laisser tomber. Je peux vous citer l'exemple de Cantalou, dans le chocolat. C'est une grande entreprise aujourd'hui. Lorsqu'elle s'est mise à fabriquer les produits Carrefour en 1976, elle n'était rien. Un autre exemple avec Alpina : il y a 23 ans, personne ne voulait fabriquer les pâtes Carrefour ; aujourd'hui, cette entreprise travaille toujours avec nous. En plus, nous cultivons 2 000 hectares de blé dur avec elle en France.
M. Jean-Yves Le Déaut, rapporteur de la mission d'information sur l'évolution de la distribution : Il y a dix ans, il existait 160 marques de pâtes. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 12.
M. Daniel Bernard, président directeur général de Carrefour : Oui, mais Alpina est toujours présente. Dans la brasserie, des petits brasseurs français survivent grâce aux distributeurs et pas grâce aux grandes marques de bière étrangères.
La marque propre est un phénomène d'avenir. Demain, dans le monde, le marché sera réparti entre les grandes marques mondiales, quelques PME très fortes et les marques de distributeurs. Ces marques de distributeurs sont transnationales. Nous exportons des produits Carrefour fabriqués par des PME françaises dans le monde entier. La marque Eau des Montagnes d'Auvergne est le premier article français vendu à Taiwan. Les galettes de Pont-Aven se vendent bien au Brésil. Casino et Continent exportent ainsi des produits dans le monde entier.
Qui organise la filière des exportations ? Bien sûr, M. Bourgoin peut nous demander de l'aider à exporter au Brésil et nous aidons beaucoup d'entreprises à s'implanter à l'étranger. Nous avons mis en place une structure pour cela. Que feront les entreprises françaises et les PME face à la concurrence des grandes marques mondiales si elles n'ont pas de grands distributeurs pour les aider ? Rien.
La distribution française est constamment attaquée en France alors qu'un concurrent américain bénéficie partout de l'aide absolue de son gouvernement. Vous devez prendre en compte le fait que de grandes firmes étrangères en France sont déjà fortement implantées dans les secteurs du textile et du meuble, mais n'achètent rien en France. Or, nous achetons 35 %, au moins, de notre textile en France. C'est une performance par rapport aux coûts de production mondiaux. Finalement, les entreprises françaises ne souffrent pas de leurs clients, mais de la concurrence internationale. Il n'est pas possible d'ouvrir les frontières, vendre des TGV, etc. et de ne rien vouloir importer. Lorsqu'un produit connaît un problème, ce n'est pas forcément à cause de la grande distribution. Pour reprendre l'exemple des fruits, toute la Méditerranée, cet été, a été envahie par des fruits d'Espagne et de Turquie, pays où les prix sont très bas. Nous avons fait tout notre possible mais un jour, on nous demande de ne plus réaliser de promotion, et un autre de vendre un million de melons en trois jours. Nous les avons vendus. Ils n'étaient pas tous de bonne qualité ; des filières agricoles permettraient des résultats sans doute meilleurs.
Certes, nous ne sommes pas les seuls à aider l'agriculture, mais selon les produits, nous absorbons entre 20 et 40 % des productions françaises. Nous ne sommes pas des saints, mais des chefs d'entreprise responsables. Nous entendons être respectés au niveau mondial.
M. Jacques-Edouard Charret, directeur général d'Opéra : En ce qui concerne les marques de distributeur, il ne faut pas perdre de vue que le seul arbitre de nos éventuels conflits ou de nos différends est le consommateur final. Or, dans ses critères de choix, le magasin apparaît en troisième position. Une politique qui consisterait à surexposer les produits de la marque du distributeur au détriment des autres conduirait rapidement à une désaffection des clients. Les techniques de marketing sont assez pointues ; nous sommes très vigilants sur l'équilibre de l'offre dans les linéaires.
Pour le textile, nous avons cherché à mettre au point un système de réapprovisionnement automatique : à chaque sortie de produit à la caisse, une commande est adressée automatiquement à l'entrepôt. Il est impossible de mettre au point un tel système avec un fournisseur du Bangladesh ou de Tunisie. Nous avons réussi à le faire avec un fournisseur travaillant avec la grande distribution : Rouleau Guichard, mais cela a nécessité un travail de longue haleine.
Nous pouvons aider les PME autrement qu'à travers les marques de distributeur ; je citerai le cas d'un petit fabricant de biscottes du Sud-Est de la France, les biscottes Roger. Vous pouvez l'interroger. Il vous dira que s'il était resté dans le commerce traditionnel, il n'existerait plus aujourd'hui. La grande distribution représente 35 % de son chiffre d'affaires. Ses deux principaux clients sont Casino et Carrefour. Lorsqu'une vraie valeur ajoutée est créée, que le produit est particulièrement bien implanté dans une région, notre intérêt, vis-à-vis de nos clients, est de le présenter dans les linéaires. Les comportements abusifs existent, mais il faut aussi mettre en avant les nombreux exemples de partenariat.
M. Jean-Paul Charié, président de la mission d'information sur l'évolution de la distribution : Quelle réponse donnez-vous à la question sur le coefficient multiplicateur ?
M. Jean-Claude Jaunait, président de Système U : La crise a une seule véritable origine : une offre supérieure à la demande qui provoque une baisse des prix. Dans ce cas, les producteurs français sont gênés à l'exportation et il y a davantage de produits importés sur le marché. Dans cette hypothèse, le coefficient multiplicateur ne résout rien. Par rapport à un prix acheté, il sous-tend une limitation du prix de vente aux consommateurs. Or, entre l'achat et la vente, il existe toute une série d'opérations, notamment le conditionnement et le transport, qui constituent une valeur ajoutée. Cette évidence s'est imposée lors de l'opération récente d'affichage des prix d'achat au producteur. Lorsque les prix baissent, il est clair que nos marges ne diminuent pas forcément. J'ai effectué le calcul dans le cas de Système U : la marge semi-nette, à savoir avant impôt sur les sociétés, sur les fruits et légumes, était de 50 à 70 centimes par kilogramme en moyenne suivant le type de rendement. Même si la moitié de cette marge avait été reversée aux producteurs en difficulté, cela aurait été insuffisant. Peut-on envisager la mise en place de caisses de péréquation ? Nous sommes d'accord pour rechercher des solutions dans le cadre de l'interprofession.
Notre groupe, composé de petites coopératives réparties dans toute la France, s'appelait à l'origine UNICO. Il a failli disparaître en raison du conservatisme de ses dirigeants qui défendaient les acquis. Nous avons accepté la concurrence comme un stimulant, même si un excès de concurrence peut faire mourir. Ma philosophie est la suivante : développer l'interprofession pour parler des grandes causes et mettre en place une chambre de conciliation pour évoquer les petits conflits.
M. Gérard Bourgoin, chef d'entreprise : Je remercie la mission d'information de nous permettre de nous exprimer. Personne, en réalité, ne souhaite d'inflation législative ou réglementaire. Les problèmes que j'ai évoqués tout à l'heure étaient fondés sur mon expérience de producteur de produits agroalimentaires. J'ai reçu de nombreux coups de téléphone de producteurs de chaussures, de textile, de produits de la maison et d'hygiène. Nous avons discuté aujourd'hui des problèmes vécus au quotidien par l'ensemble des PME françaises. Dès lors que personne ne souhaite légiférer et qu'il existe par ailleurs une volonté évidente de conciliation, du moins de dialogue, nous sommes tous convaincus que nous devrons travailler dans l'esprit d'une plus grande loyauté des rapports commerciaux.
Vous avez, Messieurs les parlementaires, évoqué la question du contrat. Si les relations entre producteurs et distributeurs étaient régies par un contrat clair, annuel ou pluriannuel lorsque le producteur est obligé d'investir lourdement, il serait bon de prévoir une clause importante de révision des prix en cas de force majeure (variation des cours des matières premières, modification de la politique agricole commune, nouvelles obligations en matière de sécurité alimentaire, etc.). Cela a forcément une incidence et doit être prévu dans le contrat. Le distributeur doit s'engager à payer à la PME les révisions fondées. L'application de la loi sur les 35 heures va entraîner une augmentation de 12 % des coûts dans les activités qui emploient beaucoup de main d'_uvre ; l'écotaxe influera sur le prix de l'énergie. Le contrat doit donc prévoir l'absence de rejet systématique d'une augmentation de prix, dès lors qu'il s'agit de phénomènes échappant à la volonté des PME.
Il faut que les factures des marges arrières ou de coopération commerciale soient justifiées. Elles seront défendues plus ou moins bien par les industriels ; la discussion commerciale est toujours difficile. Nous ne respectons pas forcément uniquement les agneaux dans les affaires. Les facturations de coopération commerciale ou de promotions doivent être fondées, sinon elles doivent être supprimées. Il me semble qu'il existe un consensus entre nous autour des principes simples que je viens d'énumérer. Il nous faut par ailleurs une commission des sages pour régler les problèmes de la profession avant d'en saisir l'administration.
Nous n'avons pas évoqué le problème du seuil de dépendance économique. Lorsqu'un distributeur dit : « Monsieur le jeune producteur de verres en plastique, vous réalisez 35 % de votre chiffre d'affaires avec moi, c'est trop ; je vais chercher un deuxième fournisseur » ; c'est le type même du problème qui pourrait être arbitré par cette fameuse commission des sages, dite d'arbitrage. Une circulaire précisant d'une façon plus précise l'application de la loi Galland serait en outre utile. Il faut mettre fin à la situation des PME recevant des factures non fondées et confier ces litiges à la commission d'arbitrage.
M. André Lajoinie, président : Nous avons pris note ; la mission va réfléchir et envisager ce qu'il faut changer. Vous reconnaissez tous que des efforts sont à réaliser pour traquer les abus. Il faut pour cela des moyens, législatifs ou non.
M. Jean-Paul Charié, président de la mission d'information sur l'évolution de la distribution : Je veux remercier nos invités. Tout démontre que vous n'avez pas été pris dans un piège et que vous avez eu raison de venir. Vous avez eu le courage et l'honnêteté de reconnaître certaines pratiques. Le législateur a parfaitement conscience de la modestie de son travail et de la nécessaire prudence dont il doit faire preuve. Il existe de nombreuses lois et nous sommes de ceux qui, parfois, disent à certains de leurs collègues que ces lois peuvent se retourner contre ceux qu'elles voulaient défendre. En revanche, il est du rôle du politique de vous aider, Messieurs, à devenir des partenaires. C'est un enjeu de société.
M. Jean-Yves le Déaut, rapporteur de la mission d'information sur l'évolution de la distribution : Je voudrais préciser que je suis le rapporteur de la mission d'information mais qu'il n'existe pas de « prérapport ». Vous proposez une commission d'arbitrage, encore faut-il que les contrats soient respectés et qu'il y ait de bonnes pratiques fondées sur le principe de réciprocité. Nous souhaiterions avoir vos avis sur l'amélioration des instruments de lutte contre les menaces de déréférencement, sur la durée des contrats conclus avec les PME et les PMI - trois ans paraissent pour certains nécessaires -, sur le concept de dépendance économique - la législation actuelle n'est pas satisfaisante. En outre, la jurisprudence ne donne pas la possibilité à la puissance publique de se substituer aux producteurs en cas de contentieux. Ce point est majeur.
Je me félicite que vous soyez venus. Nous avons essayé, avec l'aide de notre président, de faire avancer la situation. Ce n'est pas terminé. La mission d'information va se rendre à l'étranger puis le 11 janvier 2000 nous rendrons notre rapport et nous en parlerons lors des états généraux de la filière de la consommation.
--____--
La commission a examiné, le 11 janvier 2000, sous la présidence de M. André Lajoinie, le rapport présenté par M. Jean-Yves Le Déaut en conclusion des travaux d'une mission d'information sur l'évolution de la distribution.
M. Jean-Paul Charié, président de la mission d'information, a remercié les membres de la mission d'information pour leur assiduité et l'état d'esprit constructif dans lequel ils ont mené leurs travaux qui contribueront à sensibiliser les parlementaires, le Gouvernement et l'opinion publique sur l'importance des questions étudiées. Il a souligné que la mission avait travaillé en dehors de tout clivage politique, ses conclusions ayant été adoptées à l'unanimité, sans réserves.
M. Jean-Yves Le Déaut, rapporteur de la mission d'information, a tout d'abord présenté le constat dressé par la mission d'information dont il a rappelé que le rapport avait été adopté à l'unanimité. Il a évoqué le mouvement exceptionnel de concentration qu'a connu le secteur de la distribution et qui se traduit par la constitution de cinq « supercentrales d'achat » (Carrefour/Promodès, Leclerc/Système U, Auchan, Cora/Casino et Intermarché) contrôlant la commercialisation de plus de 90 % des produits de grande consommation mis sur le marché. Le marché de ces produits peut donc être présenté sous la forme d'un sablier dont ces cinq « supercentrales » constitueraient le goulot d'étranglement entre les producteurs, que sont les 70 000 entreprises et les 400 000 agriculteurs, et les consommateurs. M. Jean-Yves Le Déaut a estimé qu'en conséquence, un véritable oligopole s'était constitué sur un marché pourtant immense puisqu'il représente plus de 2 500 milliards de francs par an. Il a toutefois précisé que si la grande distribution ne devait pas être un bouc émissaire, ces entreprises jouant un rôle important et faisant partie du paysage économique français, il convenait néanmoins de clarifier certaines de leurs pratiques.
La révision de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 par la loi n° 96-588 du 1er juillet 1996 relative à la loyauté et l'équilibre des relations commerciales, dite loi Galland, a constitué à cet égard un progrès, en particulier en précisant le régime de l'interdiction de la revente à perte. M. Jean-Yves Le Déaut a toutefois rappelé que la loi n'avait pu empêcher l'apparition de certains abus notamment en matière de coopération commerciale. Il a précisé que celle-ci pouvait correspondre à la prise en charge effective par les distributeurs de fonctions, notamment logistiques ou publicitaires, autrefois assurées par les fournisseurs et que ceux-ci sont prêts à rémunérer, mais qu'il pouvait aussi s'agir de pratiques illégitimes, les distributeurs exigeant des rémunérations sans contrepartie. Il a ainsi évoqué la pratique dite de la corbeille de la mariée. Il a également cité les pénalités de retard excessives infligées par les grandes surfaces de vente ainsi que le cas d'une centrale d'achat installée à Zürich et exigeant des fournisseurs le versement d'un droit d'entrée de 10 000 euros avant toute négociation. Il a insisté sur l'effectivité de ces pratiques qui ne sont pas marginales.
Plus généralement, M. Jean-Yves Le Déaut a évoqué le duel de géants opposant les multinationales de la production qui ont intérêt à asphyxier leurs concurrents et celles de la distribution, recherchant les coûts d'achat les plus bas, contre les effets duquel les petits producteurs qui maillent notre territoire, démunis de toute arme, ne peuvent lutter. Il a ensuite estimé que les guerres des prix auxquelles on pouvait assister nuisaient à la qualité des produits comme l'illustrent les récentes contaminations de listériose.
En ce qui concerne le secteur agricole, M. Jean-Yves Le Déaut a souligné que les conséquences néfastes des pratiques abusives de la grande distribution y étaient amplifiées par le cycle court des produits. Il a particulièrement dénoncé la pratique consistant, sous prétexte de préparation des catalogues publicitaires, à imposer les prix aux producteurs, sous peine de déréférencement, avant le début des campagnes de production et donc sans tenir compte de la réalité économique du marché, faute en particulier de connaître le volume de la production. Il a fait valoir que cela aboutissait à l'apparition d'une sorte de prix virtuel empêchant le fonctionnement normal du marché lorsque le prix réel constaté en cours de campagne de production se révèle plus élevé. M. Jean-Yves Le Déaut a ainsi estimé que la crise des fruits et légumes survenue cet été trouvait en fait son origine dans l'élaboration des catalogues de la grande distribution deux mois auparavant.
Il a ensuite précisé qu'il ne fallait pas diaboliser la grande distribution mais que la mission d'information s'était efforcée de réaliser un bilan sans complaisance et proposer des solutions. M. Jean-Yves Le Déaut a précisé que M. Christian Sautter, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qu'il venait de rencontrer avec M. Jean-Paul Charié, avait d'ailleurs reconnu que ces propositions étaient raisonnables.
En ce qui concerne les conclusions portant sur la filière agricole, il a rappelé que la mission jugeait tout d'abord prioritaire de mettre fin aux effets déstructurants des prix sur catalogue. Il a ensuite demandé que soit imposé le respect de la qualité et de l'origine, sujet sur lequel il a noté l'important travail de M. François Patriat, rapporteur de la loi d'orientation agricole, loi qu'il convient maintenant de bien appliquer. Il a ensuite indiqué que la mission d'information souhaitait une meilleure organisation professionnelle des filières agricoles, citant l'exemple du travail réalisé par la Fédération professionnelle de la pomme de terre, ail, oignon et échalote et qu'elle estimait également qu'il convenait de convaincre les autorités européennes de l'utilité d'ententes entre producteurs lorsqu'existent des ententes bien plus fortes entre distributeurs. Il a ensuite évoqué la nécessité de développer le rôle des comités économiques de bassin. Enfin, il a indiqué que la mission jugeait indispensable de lutter contre les prix prédateurs, au besoin par l'application des dispositions de l'article 1er de l'ordonnance du 1er décembre 1986, permettant d'adopter, par décret en Conseil d'Etat, des mesures temporaires pour faire face à une baisse excessive des prix. Il a déclaré que cette solution paraissait préférable à celle du double étiquetage, qui n'a guère d'effet dès lors que les produits sont valorisés.
En ce qui concerne le respect de règles de concurrence loyale dans les rapports entre fournisseurs et distributeurs, M. Jean-Yves Le Déaut a jugé qu'il convenait tout d'abord de faire appliquer la loi. Il a ainsi rappelé, qu'aussi bien la circulaire Scrivener du 10 janvier 1978 que la circulaire Delors du 22 mai 1984 organisaient la lutte contre la fausse coopération commerciale. Il a donc indiqué que la mission invitait M. Christian Sautter, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, à clarifier le droit en publiant, comme il s'est déclaré prêt à le faire, une nouvelle circulaire d'interprétation précisant que :
- les services spécifiques rendus par les distributeurs doivent être réellement rendus au client, être identifiables et correspondre à un besoin ou une attente du fournisseur qui en bénéficie ou à un allégement de ses charges ;
- la rémunération de ces services doit être justifiée et ne pas créer de discriminations injustifiées ;
- la rémunération de ces services doit être proportionnée au transfert de charges du fournisseur au distributeur ou à la nature effective du service rendu, l'avantage ainsi consenti devant avoir une portée restreinte par rapport à ceux accordés en application des conditions générales de vente.
M. Jean-Yves Le Déaut a également estimé nécessaire de rendre les rapports commerciaux plus transparents entre les partenaires et que cela impliquait en particulier de faire figurer, lorsque cela est possible, les services de coopération commerciale dans des conditions générales de vente. Il a précisé que la mission proposait en conséquence que les relations commerciales soient régulées par les partenaires commerciaux selon le schéma suivant :
- les fournisseurs présentent leurs offres de produits et de services dans des conditions générales de vente ;
- les revendeurs présentent leurs offres de services de coopération commerciale dans des conditions générales de vente. La prestation de ces services donne lieu à l'établissement d'un contrat écrit en partie double comme le prévoit la loi actuelle ;
- les remises exceptionnelles (dont la nature même empêche de les faire figurer dans des conditions générales de vente) et les ristournes non liées à un acte d'achat ou de vente et ne rémunérant pas un service de coopération commerciale doivent être traduites dans un contrat écrit et être justifiées par des contreparties réelles pour le fournisseur et leur rémunération doit se traduire par des avantages financiers d'une portée marginale par rapport à ceux accordés au titre des conditions générales de vente.
M. Jean-Yves Le Déaut a estimé qu'il importait que les contrats commerciaux et les factures soient clairs et précis dans leurs termes et qu'il n'était plus acceptable de facturer des prestations floues de « mise en avant » ou d'« intensification commerciale ». Il a ajouté que la mission jugeait nécessaire de supprimer la fausse coopération commerciale, ce qui impliquait l'interdiction :
- des factures rétroactives de coopération commerciale ou de toute autre remise ou ristourne ;
- des factures de coopération commerciale ne correspondant pas à un service effectivement rendu.
Après avoir rappelé qu'il existait aujourd'hui en matière de prix deux cultures en Europe, celle des pays d'Europe du Nord où existe une réelle vérité des prix et celle de la France ainsi que l'Espagne dont le système s'est calqué sur le nôtre, le rapporteur a précisé que, si la mission n'avait pas jugé opportun de supprimer la coopération commerciale en réincorporant les marges arrières dans la marge avant et d'imposer la négociation de prix nets-nets, celle-ci avait néanmoins la conviction que les entreprises françaises devront à terme, sous la pression de nos voisins, revenir à ce système qui est celui des pays d'Europe du Nord et des pays non européens. Il a ensuite insisté sur l'importance des enjeux représentés par ces propositions d'apparence technique en indiquant qu'on pouvait évaluer que la coopération commerciale rapportait jusqu'à 30 milliards de francs par enseigne et par an.
Puis, M. Jean-Yves Le Déaut a fait part de la préoccupation de la mission de voir redéfini le cadre contractuel des relations de la grande distribution avec les PME. Il a notamment évoqué la nécessité d'assurer la stabilité des engagements contractuels et d'encadrer les déréférencements ainsi que la situation d'extrême dépendance des fournisseurs dont la production est commercialisée sous une marque de distributeur. Il a indiqué que sur ce sujet, la mission recommandait une modification de l'ordonnance du 1er décembre 1986 pour redéfinir l'abus de dépendance économique. Compte tenu de la diversité des attributions et du manque de moyens de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, il a indiqué que la mission estimait particulièrement nécessaire de modifier l'attribution contentieuse du Conseil de la concurrence en matière d'exploitation abusive d'un état de dépendance économique en ôtant la condition d'atteinte au jeu de la concurrence sur le marché, qui n'est en pratique pas remplie dans les litiges impliquant des PME.
Le rapporteur a en outre précisé que la mission avait estimé que la mise en place d'un organisme veillant à la loyauté des pratiques commerciales, susceptible de s'autosaisir ou d'être saisi par le Conseil de la concurrence, le ministère ou des entreprises de manière confidentielle, était nécessaire. Cette commission d'arbitrage des pratiques abusives devrait être en particulier compétente pour arbitrer des litiges bilatéraux survenant entre les partenaires commerciaux sur l'application d'une disposition de conditions générales de vente, de termes d'un contrat ou de mentions figurant sur une facture.
Enfin, en ce qui concerne les délais de paiement, M. Jean-Yves Le Déaut a indiqué que la mission avait constaté qu'ils tendaient à s'allonger de manière déraisonnable. En outre, des distributeurs profitaient de l'état de dépendance économique de leurs fournisseurs pour ne pas leur adresser d'effet de commerce susceptible d'être escompté et leur proposer un service d'affacturage à taux d'intérêt élevé, ce qui conduisait à faire rémunérer par les fournisseurs l'argent que les enseignes leur devaient. Sur cette question, la mission recommande d'adopter une des dispositions de la proposition de directive européenne sur les délais de paiement prévoyant que lorsque le délai de paiement prévu dans le contrat de vente est supérieur à 45 jours à compter de la date de réception de la facture, l'acheteur doit fournir, à ses frais, une lettre de change à son fournisseur précisant explicitement la date de son paiement et devant être garantie par un établissement de crédit reconnu.
Une quatrième série de propositions porte sur la nécessité d'améliorer l'application de la loi existante. La mission d'information estime que le rôle du Conseil de la concurrence gagnerait à être renforcé, tant sur le plan de la prévention des litiges (capacité de s'autosaisir d'office de toute question relative à la concurrence) que sur celui de la détection et du traitement précontentieux des infractions (faculté de mener des enquêtes hors litiges dont il se trouve saisi et exercice d'un rôle de médiation entre des prétentions opposées).
Il conviendrait également de rendre le Conseil de la concurrence plus « réactif » aux atteintes portées à la concurrence : il serait ainsi opportun qu'il ait le pouvoir d'ordonner des contrôles afin de faire envoyer, sans délai, sur le terrain des agents habilités pour constater des faits suspects.
Le pouvoir d'enquête de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes devrait être renforcé, par exemple en dotant ses fonctionnaires et rapporteurs habilités d'un pouvoir de perquisition et de saisie comparable à celui dont disposent les agents des douanes.
Une dernière série de propositions porte sur les moyens de mieux encadrer l'évolution du commerce. Outre le maintien et le développement du stade de gros, un effort particulier doit être consacré à la correction des dysfonctionnements observés en matière de soldes et de promotions. Par ailleurs, l'expérimentation des schémas de développement commercial doit être généralisée et ceux-ci doivent devenir opposables aux instances chargées de délivrer des autorisations d'ouverture ou d'extension de commerces ou des autorisations d'urbanisme.
M. Pierre Ducout s'est félicité de la qualité du travail accompli par la mission d'information, son exhaustivité et son équilibre. Il a également salué la lisibilité des propositions qui ont été adoptées.
Il a estimé que quatre orientations majeures doivent désormais guider l'action des pouvoirs publics : une meilleure répression des pratiques abusives à travers la faculté d'autosaisine du Conseil de la concurrence, la nécessité d'éviter une diabolisation du comportement de la grande distribution, le souci de garantir les équilibres - tant au sein du secteur commercial qu'entre petites et grandes entreprises ou entre secteurs agricole, industriel et commercial - et la sauvegarde des spécificités nationales (activité et dynamisme des centre-villes, diversité qualitative des produits, etc.). Il convient en effet d'être vigilant vis-à-vis des pratiques parfois regrettables de certains grands groupes étrangers qui ne sont pas encore présents sur le marché français.
L'idée de rendre les schémas de développement commercial opposables lui a, enfin, semblé judicieuse, dans la mesure où elle peut être l'occasion de vérifier la réalité des améliorations que le développement des grandes surfaces de vente prétend apporter au consommateur.
M. François Patriat a indiqué qu'il ne voyait pas pourquoi il s'interdirait de diaboliser la grande distribution, secteur économique dont l'attitude se résume à être faible avec les durs et dur avec les faibles : les grandes enseignes discutent avec Coca-Cola mais écrasent les petits producteurs d'artichauts. En étant non seulement vendeurs mais aussi producteurs, voire usuriers, les distributeurs ont déséquilibré la filière commerciale. Il a cité un exemple édifiant : le jour où le gouvernement de M. Alain Juppé a décidé d'augmenter de 2 points le taux normal de la TVA, la grande distribution a fait comprendre à ses fournisseurs qu'il leur revenait de supporter cette hausse. Il faut non seulement dénoncer mais également lutter âprement contre ces pratiques. La question essentielle demeurant : faut-il continuer à concentrer l'offre ou au contraire la différencier et la segmenter ?
Après avoir relevé que sur un sujet de cet ordre des sensibilités différentes pouvaient s'exprimer au sein d'un même groupe politique, M. Christian Bataille a jugé que le travail de la mission d'information révélait un dépassement des clivages politiques et des intérêts politiciens. Il a dénoncé l'image d'un pays opposant une France des campagnes, des petits producteurs et des petits commerçants à une France urbaine livrée au monde de la grande distribution. Selon lui, les citoyens français n'ont pas une opinion aussi négative de la grande distribution que l'on veut parfois le laisser penser.
Le rapport de M. Jean-Yves Le Déaut est équilibré et la campagne publicitaire lancée par certaines grandes enseignes prouve que ces acteurs de l'économie sont sensibles à l'écho des travaux parlementaires. Il a estimé qu'il était temps que le Parlement prenne acte de l'évolution du commerce et a souhaité que les conclusions de ce rapport soient prises en compte par le Gouvernement.
M. Claude Billard a rappelé que les conflits de l'été 1999 entre les producteurs de fruits et légumes et les centrales d'achats de la grande distribution, d'une part, et la fusion annoncée de Carrefour et Promodès, d'autre part, ont été le révélateur de la situation malsaine existant dans ce secteur de l'économie. Le rapport présenté par M. Jean-Yves Le Déaut brosse un tableau assez sévère de la grande distribution et de ses pratiques et présente aux pouvoirs publics diverses propositions visant à assainir cette situation. Selon lui, le Gouvernement serait bien inspiré de les inclure dans son projet de loi sur les nouvelles régulations économiques.
Selon M. Claude Billard l'un des mérites de ce rapport est de mettre en lumière les méthodes commerciales singulières de la grande distribution. Du fait de ces pratiques et des concentrations, il n'y a plus aujourd'hui dans ce secteur de concurrence loyale et équilibrée mais uniquement des rapports de force fondés sur ce que le rapport définit comme un « abus de dépendance économique ».
Les groupes en situation de position dominante ont développé des pratiques connues sous le nom de « marge arrière » ou sous l'euphémisme de « coopération commerciale », qui s'apparentent en fait plus au chantage ou au racket et mettent en cause l'équilibre du système. Ces méthodes font peser sur les fournisseurs, l'ensemble des coûts et risques liés à la commercialisation de leurs produits. Désarmés face à leurs clients, ces fournisseurs sont obligés d'accepter leurs conditions s'ils ne veulent pas voir disparaître leur entreprise. La grande distribution contraint ainsi ses fournisseurs à vendre à perte et les tient en otages. Face à ce constat, le rapport souligne la nécessité de revoir les termes des relations commerciales entre fournisseurs et grande distribution car ceux-ci sont contraires aux intérêts des consommateurs, à ceux des entreprises de ce secteur et à l'emploi. Sans proposer de modifier la loi Galland, certes parfois inadaptée mais surtout mal appliquée, le rapport préconise de mettre en place de nouvelles règles permettant de sanctionner efficacement les pratiques abusives. Il s'agit ainsi d'étendre la notion d'abus de dépendance économique, de renforcer les moyens de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et de créer une instance de médiation pouvant saisir la justice. Toutes ces propositions, qui recueillent l'assentiment du groupe communiste, pourraient être complétées par une application effective de l'article 1er de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 donnant à l'Etat la possibilité d'intervenir en cas de crise conjoncturelle sur les prix.
En revanche, M. Claude Billard a estimé que le rapport aurait dû mettre l'accent, pour la condamner, sur la valorisation boursière au nom de laquelle s'effectuent les concentrations dans la grande distribution et qui est un facteur d'aggravation des conditions de travail, de la précarité de l'emploi et de maintien des salaires à un niveau bas.
Il a annoncé qu'au nom de son groupe il voterait en faveur de la publication du rapport.
M. Jean-Claude Daniel, après s'être félicité de la qualité des travaux de la mission, a estimé qu'il n'y avait pas de raisons de modifier en profondeur la législation en vigueur mais qu'il était nécessaire de procéder à une relecture de la loi afin d'en améliorer les modalités d'application et d'opérer quelques aménagements dont la portée n'est cependant pas mineure. S'agissant des rapports entre fournisseurs et distributeurs, il a jugé prioritaire de rétablir une régulation de la coopération commerciale et de permettre l'autosaisine des autorités compétentes en matière de concurrence. Concernant la grande distribution, il a souligné que les personnes entendues par la mission avaient compris qu'il fallait valoriser les produits des PME créatrices d'emplois mais que ce discours vertueux devrait se traduire dans les faits, les pages de publicité récemment parues dans les journaux donnant plutôt l'impression qu'il s'agissait d'un argument de promotion. Après avoir rappelé que les consommateurs avaient de fortes exigences non seulement sur le prix des produits mais aussi sur leur traçabilité et la sécurité alimentaire, il a estimé qu'il fallait clarifier les fonctions afin de déterminer qui édicte la norme et qui est chargé de la régulation. A cet égard, il s'est déclaré favorable à la création d'une commission d'arbitrage des pratiques abusives (CAPA), proposée par la mission d'information, tout en s'interrogeant sur la façon dont les parlementaires pourraient être associés aux travaux de cette instance. Il ne lui a pas paru souhaitable d'assurer une présence permanente des parlementaires au sein de cette commission, mais des modalités de son fonctionnement devraient être définies pour que des réunions soient tenues avec des parlementaires désignés à cet effet afin de faire le point sur son activité.
Abordant enfin les défis de l'évolution du commerce, il a mis l'accent sur l'urgence de mesures de régulation du commerce électronique et sur la nécessité de corriger les dysfonctionnements en matière de soldes, certaines grandes surfaces ayant mis en place des promotions au cours de la première quinzaine du mois de janvier, ce qui crée des difficultés pour les commerces de centre-ville pour lesquels les soldes ne pourront débuter qu'au 15 janvier.
Se félicitant à son tour de la manière dont la mission avait pu travailler sur un sujet vaste en constante évolution, M. Jean Proriol a déclaré partager le constat dressé par le rapporteur sur la loi du silence qui s'impose aux fournisseurs dans leurs rapports avec les centrales d'achat et les grands distributeurs par peur d'être déréférencés. S'appuyant sur le slogan « nos achats sont aussi nos emplois », il a mis l'accent sur la nécessité de redéfinir le cadre contractuel des relations commerciales entre les PME-PMI et la grande distribution pour se prémunir des risques de délocalisation. Il a notamment insisté sur l'utilité de limiter les marges arrières en suggérant qu'elles ne puissent pas excéder un pourcentage déterminé du chiffre d'affaires. Après s'être interrogé sur les effets de la concentration dans le domaine de la grande distribution, il s'est rallié aux propositions du rapporteur qu'il a jugées équilibrées et de nature à apporter un soutien aux PME et précisé qu'il voterait en faveur de la publication du rapport.
M. Léonce Deprez s'est réjoui de l'état d'esprit de coopération qui a prévalu au cours des travaux de la mission d'information, le mérite en revenant tant au président qu'au rapporteur. Ainsi, les points de vue ont pu se rejoindre, permettant d'aboutir à des conclusions communes. Des travaux de ce type contribuent indiscutablement à restaurer le rôle du Parlement. Laisser s'exercer sans contrôle les lois du marché peut conduire à affaiblir la démocratie, la loi du plus fort s'imposant sans partage. L'institution parlementaire, et plus particulièrement la commission de la production et des échanges, peuvent alors constituer un intermédiaire entre l'exécutif et les intérêts particuliers, afin de rechercher un équilibre et fixer des règles de bonne conduite entre les différents intervenants du marché. A ce titre, il a souligné que les grandes surfaces, qui s'étaient inquiétées de la création de la mission, ne devaient pas être considérées ni désignées comme boucs émissaires responsables des problèmes de la filière de la distribution.
Il a indiqué que, pour lui-même, la mission avait pleinement rempli son rôle d'information, s'agissant notamment du problème des détournements de marges ou de l'abus de dépendance économique, qui constituent autant de pratiques malsaines. Il a évoqué les déclarations faites par certains responsables de grandes surfaces au cours des auditions sur ces questions, reconnaissant la réalité des problèmes soulevés.
Il a considéré que les délais de paiement abusifs mettaient gravement en péril la survie des petites et moyennes entreprises et qu'il convenait d'y mettre fin. Il a en revanche estimé que le recours au double étiquetage des prix dans les grandes surfaces était inefficace, préférant l'application d'un prix minimum, mais uniquement durant les périodes de crise, car sinon cette disposition serait rapidement détournée par les acteurs de la filière.
Tout en reconnaissant une certaine pertinence à l'affirmation selon laquelle l'extension des marques de distributeur représentait un moyen de préserver l'existence de petits producteurs, il a considéré que cette évolution constituait une menace à l'encontre de la diversité des approvisionnements comme des débouchés des produits ; la plus grande vigilance s'impose donc.
Il a estimé nécessaire qu'une loi intervienne rapidement pour préciser et actualiser la notion d'abus de dépendance économique. En outre, il serait utile que les agriculteurs puissent disposer des moyens de renforcer leurs organisations interprofessionnelles.
Tout en se déclarant favorable à la création d'une commission d'arbitrage des pratiques abusives, il a considéré que seule sa structuration à l'échelon régional lui permettrait d'exercer un contrôle efficace.
Il a, par ailleurs, regretté que les grandes surfaces remplacent peu à peu les grossistes, qui représentent pourtant des intermédiaires utiles, parrainant notamment les entrepreneurs économiques locaux. Il a insisté pour que l'importance de ces entreprises soit prise en compte de manière volontariste dans les politiques de développement régionales et intercommunales afin de favoriser leur renaissance, les grossistes pouvant constituer un contrepoids face aux politiques d'achat des grandes surfaces.
En conclusion, il a souligné que le consensus qui se dégageait du débat démontrait qu'il était possible d'unir les forces politiques, par-delà leurs différences, pour travailler ensemble sur les problèmes vitaux de notre économie et garantir l'équilibre social de la nation.
M. André Lajoinie, président, citant Jean Jaurès, a estimé que le courage était de chercher la vérité et de la dire, cette mission d'information ayant permis de donner une voix à ceux qui n'osent pas s'exprimer.
Il a considéré que la légitimité de la grande distribution ne pourrait être garantie que si ses entreprises respectaient les droits de ses salariés, des petites et moyennes entreprises qui sont leurs fournisseurs, et des consommateurs. La permanence de cette légitimité constitue par ailleurs le meilleur moyen d'éviter l'entrée en France des grands groupes américains de la distribution, comme Wal-Mart, avec tous les dangers qui ne manqueraient pas d'en découler. Après les conclusions de la mission d'information, qui ne constituent qu'un début, le législateur devra prendre ses responsabilités.
Il a mis en avant l'atmosphère nouvelle qui règne en France depuis les récentes catastrophes qu'a subies notre pays, tempêtes et marée noire sur la côte Atlantique. Ces événements ont démontré à ceux qui estimaient qu'il y avait « trop d'État » que celui-ci était indispensable, de même que les services publics. Il a ainsi considéré que seul le service public permettait à des régions comme l'Auvergne d'être desservies par l'électricité.
M. Jean-Paul Charié, président de la mission d'information, tout en reconnaissant les apports du secteur et des entreprises de la grande distribution dans notre pays, a estimé qu'il convenait d'être très ferme envers certaines de leurs pratiques, inacceptables et dangereuses tant du point de vue de la santé que de l'aménagement du territoire.
Evoquant certaines récentes interventions de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) contraires à l'interprétation que le Parlement faisait de la loi, il a rappelé que l'exécutif devait mettre en _uvre les lois, conformément aux décisions du Parlement.
Il a déclaré que les travaux de la mission d'information avaient démontré qu'il fallait demeurer très humble au regard du développement du commerce électronique, rappelant que des ordinateurs seraient dès cette année en vente à des prix abordables et permettraient à ce type de vente d'offrir des services particulièrement attractifs sans recourir à une reconnaissance vocale préalable.
M. Jean-Yves Le Déaut, rapporteur de la mission d'information, a précisé que la mission avait exposé dans ses conclusions que la coopération commerciale hors conditions générales de vente ne devrait pas dépasser 5 % des avantages consentis par les conditions générales de vente. Le titre I du rapport contient , par ailleurs, des développements importants sur le commerce électronique pour montrer l'impact qu'il va avoir sur la distribution et le manque d'engagement des entreprises françaises dans cette révolution que chacun peut observer au travers des galeries marchandes virtuelles proposées sur Internet.
En dernier lieu, la mission a exprimé ses inquiétudes quant au développement des marques de distributeur, qui - il est vrai - peuvent apporter un soutien au développement économique de certaines PME-PMI, mais qui sont un vecteur d'une diminution de la qualité et de l'innovation et transforment les producteurs en sous-traitants.
La commission a ensuite autorisé, à l'unanimité, en application de l'article 145 du règlement et dans les conditions prévues à l'article premier de l'instruction générale du Bureau, la publication du rapport d'information.
--____--
N°2072. - Rapport d'information de M. Jean-Yves Le Déaut sur l'évolution de la distribution (production)
() L'article 109 du code du commerce, avant sa modification par l'article 11 de la loi n° 80-525 du 12 juillet 1980 relative à la preuve des actes juridiques, était ainsi rédigé :
« Art. 109.- Les achats et les ventes se constatent :
Par actes publics,
Par actes sous signature privée,
Par le bordereau ou arrêté d'un agent de change ou courtier, dûment signé par les parties,
Par une facture acceptée,
Par la correspondance,
Par les livres des parties,
Par la preuve testimoniale, dans le cas où le tribunal croira devoir l'admettre ».
() Les deux premiers alinéas de l'article 46 de l'ordonnance sur les prix (après modification par la loi n° 47-587 du 4 avril 1947) étaient ainsi rédigés :
« Tout achat de produits, denrées ou marchandises destinés à la revente en l'état ou après transformation, tout achat effectué pour le compte ou au profit d'un industriel ou d'un commerçant pour les besoins de son exploitation, doit faire l'objet d'une facture. Toute prestation de service effectuée par un professionnel pour les besoins d'un commerce ou d'une industrie doit également faire l'objet d'une facture. Cette facture doit être réclamée par l'acheteur ; le vendeur est tenu de la délivrer dès que la vente ou la prestation de service est devenue définitive. »
() En outre, s'il s'agit d'une société commerciale dont le siège est situé à l'étranger, la facture doit mentionner sa dénomination, sa forme juridique, le lieu de son siège social, s'il y a lieu son numéro national d'identification unique et, le cas échéant, son état de liquidation.
() Obligation résultant du fait « les originaux et les copies de factures doivent être remis en liasses par ordre de date » (disposition non modifiée de 1945 jusqu'à son abrogation en 1986).
() « Art. L. 121-3.- La cessation de la publicité peut être ordonnée par le juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites, soit sur réquisition du ministère public, soit d'office. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours. Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l'a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.
« Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant la chambre d'accusation ou devant la cour d'appel selon qu'elles ont été prononcées par un juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites.
« La chambre d'accusation ou la cour d'appel statue dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces. »
() « Art. 20.- (...) (4) Les entreprises qui sont en position de force sur le marché vis-à-vis de petits et moyens concurrents ne doivent pas exploiter cette position afin d'entraver, directement ou indirectement et de manière inéquitable, les activités de ces concurrents. Il y a pratique anticoncurrentielle au sens de la première phrase, notamment si une entreprise qui offre des marchandises ou des services commerciaux pratique des ventes à perte systématiques, à moins que cela ne soit justifié par les faits. »
() « Art. L. 121-3.- La cessation de la publicité peut être ordonnée par le juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites, soit sur réquisition du ministère public, soit d'office. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours. Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l'a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.
« Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant la chambre d'accusation ou devant la cour d'appel selon qu'elles ont été prononcées par un juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites.
« La chambre d'accusation ou la cour d'appel statue dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces. »
() L'exception de recours parallèle peut cependant être soulevée par le tribunal administratif vis-à-vis d'un recours contentieux formé par un membre de la CDEC qui a la capacité de faire appel devant la CNEC.
() Ce recours donne une plénitude de pouvoir au juge administratif puisqu'il lui permet d'annuler ou de réformer la décision administrative en fonction des critères de décision fixés par la loi et les règlements et d'accorder des indemnités au requérant.
() Par ailleurs, le projet de loi aboutissait à une incohérence : les décisions définitives des CDEC étaient seulement susceptibles de recours en annulation en indemnité alors que les décisions de la CNEC pouvait faire l'objet d'un recours de plein contentieux.
- Note sur la législation régissant la concurrence déloyale et la grande distribution en Allemagne 419
- Note sur la grande distribution alimentaire et les pratiques commerciales au Royaume-Uni 435
- Liste des auditions et déplacements de la mission d'information 471