N° 2590 ______ ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 ONZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 21 septembre 2000. RAPPORT D'INFORMATION DÉPOSÉ en application de l'article 145 du Règlement PAR LA COMMISSION DES FINANCES, DE L'ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU PLAN (1) ET PRÉSENTÉ PAR M. Jean-Marie LE GUEN, Député. -- (1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page. Marchés financiers. La commission des finances, de l'économie générale et du plan est composée de : M. Henri Emmanuelli, président ; M. Didier Migaud, rapporteur général ; MM. Michel Bouvard, Jean-Pierre Brard, Yves Tavernier, vice-présidents, MM. Pierre Bourguignon, Jean-Jacques Jégou, Michel Suchod, secrétaires ; MM. Maurice Adevah-Poeuf, Philippe Auberger, François d'Aubert, Dominique Baert, Jean-Pierre Balligand, Gérard Bapt, François Baroin, Alain Barrau, Jacques Barrot, Christian Bergelin, Eric Besson, Alain Bocquet, Augustin Bonrepaux, Jean-Michel Boucheron, Mme Nicole Bricq, MM. Christian Cabal, Jérôme Cahuzac, Thierry Carcenac, Gilles Carrez, Henry Chabert, Didier Chouat, Alain Claeys, Yves Cochet, Charles de Courson, Christian Cuvilliez, Arthur Dehaine, Jean-Pierre Delalande, Francis Delattre, Yves Deniaud, Michel Destot, Patrick Devedjian, Laurent Dominati, Tony Dreyfus, Jean-Louis Dumont, Daniel Feurtet, Pierre Forgues, Gérard Fuchs, Gilbert Gantier, Jean de Gaulle, Hervé Gaymard, Jacques Guyard, Pierre Hériaud, Edmond Hervé, Jacques Heuclin, Jean-Louis Idiart, Mme Anne-Marie Idrac, MM. Michel Inchauspé, Jean-Pierre Kucheida, Marc Laffineur, Jean-Marie Le Guen, Maurice Ligot, François Loos, Alain Madelin, Mme Béatrice Marre, MM. Pierre Méhaignerie, Louis Mexandeau, Gilbert Mitterrand, Jean Rigal, Alain Rodet, José Rossi, Nicolas Sarkozy, Gérard Saumade, Philippe Séguin, Georges Tron, Jean Vila. SOMMAIRE INTRODUCTION 7 A.- UN REDÉMARRAGE ÉCONOMIQUE FRAGILE MAIS CERTAIN 7 1.- Un processus de changement global est en marche 7 2.- Des pays à la recherche d'un nouveau modèle 8 B.- LES POTENTIALITÉS D'UN DIALOGUE EUROPE-ASIE 11 1.- Vers un renouveau du dialogue euro-asiatique 11 2.- La volonté de coordination régionale 12 C.- LA RÉFORME DU SYSTÈME FINANCIER INTERNATIONAL 14 1.- Le système financier international en question 15 a) Une dérégulation trop brutale ? 15 b) Une crise systémique d'un nouveau genre à l'ère de la globalisation 17 c) L'ancrage des monnaies asiatiques au dollar remis en cause par la crise 18 d) Vers une monnaie unique asiatique ? 20 2.- Les interventions critiquées du FMI et de la communauté internationale 22 a) Le FMI n'a su ni prévoir ni prévenir la crise 22 b) Les réactions brutales et inadaptées du FMI et de la communauté internationale 23 c) Le bilan de l'action du FMI et de la mobilisation internationale 23 3.- Propositions 24 a) Repenser le rôle des institutions financières internationales 24 b) Maîtriser la globalisation 28 c) Faire émerger un prêteur en dernier ressort international 32 d) Améliorer les mécanismes de régulation des mouvements de capitaux 33 e) Promouvoir une taxation des mouvements de capitaux : la question de la taxe Tobin 36 D.- CONCLUSION 37 I.- ASIE 1997-2000 : CRISES, RÉMISSION, REBOND 7 A.- UN DRAME EN QUATRE ACTES 10 1.- 1996-1997 : on frappe les trois coups 11 2.- Acte I : une tourmente monétaire balaie l'Asie du sud-est (troisième trimestre 1997) 17 3.- Acte II : les « Tigres » sont touchés 25 4.- Acte III : chaos en Indonésie, répit ailleurs (janvier-avril 1998) 36 5.- Acte IV : rebond et extension de la crise : le système financier international au bord du gouffre (mai - décembre 1998) 44 B.- UNE CRISE EN DÉBAT 51 1.- Le consensus sur les lignes de faille des économies asiatiques 51 a) Une gestion macro-économique handicapée par les choix de la politique de change 51 b) La solidité du système productif affaiblie par des carences structurelles 62 2.- Les controverses sur la nature profonde de la crise 71 a) Une crise de solvabilité ? 72 b) Une crise de liquidité ? 75 c) Une crise de transition ? 78 C.- DE LA CRISE AU REBOND : UNE GRANDE PEUR POUR RIEN ? 80 1.- Répondre à la crise : les choix contestés de la politique économique 80 2.- Les conséquences sociales de la récession 87 3.- Le retour de la croissance : un déni de réforme ? 91 II.- VERS UNE NOUVELLE ASIE 7 A.- INTROSPECTION ET REMISE EN QUESTION : LES PAYS ASIATIQUES FACE À LA RÉFORME 8 1.- Des structures économiques bousculées 8 a) Le chassé-croisé entre dettes privées et dette publique 8 b) Un capitalisme en mutation ? 15 2.- Changement social et démocratie 22 a) De la crise à la réforme : vertus et limites de la déstabilisation 22 b) La crise comme opportunité démocratique 24 c) Une considération encore trop faible pour le monde du travail 29 d) La démocratisation : un processus fragile 31 B.- L'ASIE ENTRE AGRÉGATION ET INTÉGRATION 36 1.- La crise n'a pas contrarié le processus d'intégration économique 36 a) L'interprétation paradoxale des échanges intra-asiatiques avant et pendant la crise 36 b) L'interdépendance par l'investissement 43 2.- La crise a renforcé l'urgence d'une plus grande coopération monétaire 46 a) La crise a suscité un renforcement bienvenu de la coopération entre autorités monétaires 47 b) La coordination des politiques de change reste encore aujourd'hui un objectif impalpable 54 3.- La crise a confirmé les limites de la coopération politique 60 a) L'ASEAN peine à surmonter une sérieuse crise de légitimité 60 b) L'apaisement des tensions en Asie du nord masque mal la persistance d'antagonismes majeurs 63 c) Entre réforme et stabilité : l'inconnue chinoise 67 C.- LES VOIES PROMETTEUSES DU DIALOGUE EUROPE-ASIE 77 1.- Le sens du dialogue Europe-Asie 78 2.- L'ASEM, une ambition à faire vivre 89 III.- LE SYSTÈME FINANCIER INTERNATIONAL, ENTRE RÉFORME ET AJUSTEMENT 98 A.- UNE RÉFORME DU SYSTÈME FINANCIER INTERNATIONAL : POURQUOI ? POUR QUOI ? 99 1.- L'épreuve des faits 99 2.- La stabilité financière dans une économie mondialisée : la quête d'un nouveau Graal 105 B.- DES PROGRÈS SENSIBLES SUR LES MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT DES MARCHÉS 112 1.- Le renforcement de la discipline de marché 112 a) Transparence et information contribuent à la discipline de marché 112 b) Transparence et information ne sont pas une panacée 119 c) La lutte indispensable contre l'aléa moral 122 2.- Le renforcement des systèmes financiers 124 a) Le cadre général du renforcement des systèmes financiers 124 b) Le secteur bancaire, point nodal de la solidité financière 129 c) La dimension globale de la supervision financière 138 3.- Les zones d'ombre de la finance internationale 142 a) Les hedge funds : appétence pour le risque, aversion pour la réglementation 142 b) Les centres off shore sur la sellette 148 C.- UNE NOUVELLE ARCHITECTURE FINANCIÈRE INTERNATIONALE : GRANDS ENJEUX ET PETITS PAS 153 1.- L'équation impossible du « meilleur » régime de change 154 a) La bipolarisation annoncée des régimes de change des pays émergents 154 b) Un consentement résigné au flottement des trois grandes monnaies mondiales 162 2.- La maîtrise des mouvements de capitaux : un retour en grâce trop timide des solutions hétérodoxes 167 a) L'expérience chilienne a suscité un intérêt marqué pour les contrôles exercés sur les entrées de capitaux 167 b) L'expérience malaisienne a jeté le trouble chez les détracteurs des contrôles sur les sorties de capitaux 170 c) Promouvoir l'instauration de la taxe Tobin : un signe politique 173 3.- Le Fonds monétaire international au c_ur de la réforme 176 a) L'appel à un recentrage du FMI sur le c_ur de ses compétences 178 b) Des évolutions encourageantes 181 c) La participation du secteur privé à la maîtrise des crises financières 188 d) Pour un prêteur international en dernier ressort 193 D.- DONNER UN SENS À LA GLOBALISATION 197 1.- Une nouvelle légitimité pour les institutions de Bretton Woods 198 a) Une représentativité perfectible 198 b) Le « consensus de Washington », une idéologie dépassée 201 2.- Pour un nouveau mode de gouvernement de la mondialisation : dépasser le G 7 203 Examen en commission 208 ANNEXE : liste des personnalités rencontrées 213 HONG-KONG 214 JAPON 215 CORÉE DU SUD () 217 RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE () 218 ÉTATS-UNIS 219 NEW YORK 219 BOSTON 219 WASHINGTON 219 INDONÉSIE 221 SINGAPOUR 222 FRANCE 223 EXAMEN EN COMMISSION 331 ANNEXE : LISTE DES PERSONNALITÉS RENCONTRÉES 337 Trois ans après, on pourrait croire que la grave crise financière qui a secoué l'Asie s'est évanouie sans presque laisser de traces. Rien n'aurait vraiment changé, ni là-bas ni ailleurs. D'ailleurs, l'économie mondiale ne connaît-elle pas des temps de croissance inégalée, et l'Asie un renouveau de son dynamisme économique ? Enfin, chacun constate que la spéculation et les phénomènes de bulle financière continuent d'être plus redoutés que combattus. Cette vision - ou plutôt cette tentation du déni - est d'abord, sans doute, celle des spéculateurs et de certains milieux dirigeants des pays asiatiques, peu désireux de se pencher sur leurs faiblesses passées et présentes : on mesure en cette occasion comment, chez certains, l'absence de mémoire succède à l'esprit moutonnier. Pourtant cette attitude, si elle devait l'emporter, serait sans doute dramatique et conduirait tôt ou tard non seulement à une rechute, mais surtout à des désordres financiers mondiaux plus difficiles à maîtriser, cette fois. Si cette menace existe, et s'il faut être très vigilant face à ce genre de menaces, il ne faut pas non plus verser dans le catastrophisme. Le scénario noir que nous venons de tracer n'est pas le plus sûr. A.- UN REDÉMARRAGE ÉCONOMIQUE FRAGILE MAIS CERTAIN 1.- Un processus de changement global est en marche La plupart des rencontres que votre Rapporteur a pu faire dans le cadre de la mission que lui a confiée la Commission des finances, de l'économie générale et du plan, l'amènent en effet à penser que des leçons ont été tirées de la crise. Ainsi, pour beaucoup de responsables politiques et économiques en Asie, la crise financière a d'abord été le moment d'une très forte prise de conscience des faiblesse structurelles de leurs économies et de leurs sociétés. En outre, cette prise de conscience a été renforcée par les changements politiques qui sont apparus à la suite de la crise. Le choc social a ainsi constitué l'amorce, ou l'affirmation de profonds changements politiques : l'exemple de l'Indonésie ou de la Corée est frappant. De manière générale, contrairement à ce qu'on aurait pu redouter, cette période correspond d'une façon ou d'une autre à l'affaiblissement des conservateurs de tous bords. Globalement, les pays touchés par la crise ont connu une marche en avant alliant progrès démocratique et réforme économique. Certes, le dialogue social est sans doute encore trop peu développé, même si ici ou là des progrès peuvent être constatés, notamment dans le dialogue avec les syndicats. Ce n'est pas le signe le moins encourageant que de constater ce mouvement-là, qui déjoue les prévisions pessimistes de ceux qui voyaient dans la crise l'occasion d'un repli nationaliste ou identitaire de pays asiatiques tournant définitivement le dos à une évolution démocratique. Au total, au milieu des difficultés politiques et des souffrances sociales, le changement en Asie de l'Est s'est mis en marche à la suite de la crise de 1997. Si, aujourd'hui, des lenteurs et des résistances aux réformes nécessaires apparaissent à nouveau, c'est aussi le résultat d'une amélioration de la conjoncture. En effet, paradoxalement, le retour rapide de la croissance peut parfois faire douter de la nécessité des réformes. De même, sur le plan des rapports de forces entre partenaires sociaux, une certaine revalorisation des actifs peut rendre plus intransigeants les acteurs de l'ancienne économie, hier affaiblis par la tourmente financière. Force est aussi de constater que l'impatience de certains commentateurs ou des organismes internationaux ne prend pas toujours en compte les réalités locales politiques et sociales. Ceux-ci imposent, en effet, un rythme de réformes très soutenu, sur la base d'un calendrier quasi hebdomadaire, quand ils ne négligent pas les conséquences sociales ou politiques de leurs recommandations. Il n'en reste pas moins que, dans leur très grande majorité, les décideurs ont conscience du chemin qu'ils devront parcourir pour mettre leur économie à l'abri d'une rechute brutale. D'ailleurs, les signes de fragilité n'ont pas tous disparu : dans un certain nombre de pays, les créances bancaires ne semblent pas être provisionnées à un niveau suffisant, du moins au regard des normes de gestion appliquées par les banques américaines ou européennes. Ceci fait peser un risque de rechute non négligeable sur des économies convalescentes, qui n'ont pas achevé la restructuration de leur système bancaire. 2.- Des pays à la recherche d'un nouveau modèle Le besoin de changement ne se limite pas au domaine économique et social : sur le plan idéologique, le fameux discours sur le « modèle asiatique », conçu comme l'alliance « vertueuse » d'un modèle politique autoritaire et d'une économie de marché tirée notamment par l'exportation et insérée dans la globalisation, a montré ses limites. Les dérives de ces « capitalismes monopolistes d'Etat » sont aujourd'hui patentes. La spéculation, la corruption, la mauvaise allocation des ressources, la volatilité des capitaux, leur concentration illégitime entre quelques mains, l'absence de concurrence, sont autant de tares qui empêchent ces économies de passer à un stade supérieur de développement. Parallèlement, l'insuffisant développement de l'Etat de droit, la faiblesse du système éducatif, l'absence de filet de protection sociale se font cruellement sentir. Or, certaines voix en Occident allaient jusqu'à reconnaître une légitimité à cette forme prétendument nouvelle de despotisme éclairé, évoquant même un effondrement du modèle occidental, miné par ses faiblesses. M. Paul Krugman - dont nous ne partageons pas, loin de là, toutes les thèses - décrit cet aveuglement de certaines élites occidentales avec cruauté : « Il était une fois des leaders d'opinion occidentaux qui se virent à la fois effrayés et impressionnés par les extraordinaires taux de croissance obtenus par diverses économies orientales. Même si celles-ci restaient nettement plus pauvres et plus petites que les économies occidentales, la rapidité avec laquelle elles s'étaient transformées de sociétés paysannes en puissances industrielles, leur aptitude à maintenir des taux de croissance égaux à des multiples des taux observés dans les pays avancés et leur capacité croissante à défier et même, dans certains secteurs, à surpasser la technologie américaine et européenne, tout cela remettait en question la domination non seulement de la puissance occidentale, mais aussi de l'idéologie occidentale. Les dirigeants de ces pays ne partageaient pas notre foi dans les bienfaits du libre-échange et des libertés individuelles. Ils affirmaient avec de plus en plus de force que leur système est meilleur : les sociétés qui acceptent des gouvernements forts, autoritaires même, en même temps que la restriction des libertés individuelles dans l'intérêt commun, qui acceptent de prendre leur économie en charge et de sacrifier l'intérêt à court terme du consommateur pour le plus grand bien d'une croissance à long terme, celles-là finiront par faire mieux que les sociétés de plus en plus chaotiques d'Occident » (1). Ces discours de complaisance sont aujourd'hui bien discrédités. C'est peu dire que les discours d'autosatisfaction sur le « modèle asiatique » ont perdu beaucoup de crédibilité en Asie même. Pour autant, l'adoption pure et simple du modèle de société anglo-saxon ne séduit pas. Au delà d'une mondialisation pour partie acceptée ou subie, aucun de ces pays n'est prêt à se laisser imposer un modèle de société qui dissoudrait son identité culturelle, sa souveraineté - d'autant plus farouchement défendue qu'elle est très souvent récente - ou la forme de consensus social qui le structure. Pour les observateurs et, de plus en plus, pour les acteurs économiques et politiques, l'enjeu social et l'enjeu économique sont indissolublement liés : certaines élites asiatiques ont ainsi compris que la seule croissance du PIB ne pouvait suffire à assurer un développement harmonieux. L'éducation, la protection sociale, l'organisation des relations entre partenaires sociaux, un système politique démocratique, tout cela contribue à l'essor des pays émergents ou en développement, et cela seul permet de passer à un stade de développement supérieur, y compris au strict point de vue économique. Par ailleurs, le modèle économique privilégiant les exportations a perdu de sa crédibilité. Certains pays d'Asie parmi les plus développés (Corée du Sud, Hong Kong, Singapour) subissent en effet la concurrence de pays moins développés (Indonésie, Malaisie) sur des secteurs à forte intensité de main d'_uvre. De plus, la fragilité d'une économie tournée principalement vers l'exportation et l'apparition d'une classe moyenne potentiellement consommatrice de produits locaux ont fait prendre conscience de la nécessité de créer un marché intérieur. Celui-ci doit être entendu de deux façons : au sein de chaque pays, où seule la consommation intérieure peut rendre plus solide la croissance ; au sein de la zone, les pays d'Asie découvrant peu à peu leur communauté d'intérêt et la complémentarité de leurs économies. En règle générale, la crise financière de 1997 a également été l'occasion d'une prise de conscience des opinions publiques et de beaucoup de responsables sur les insuffisances et les dangers de la « mondialisation », dont ils ont longtemps été des partisans d'autant moins nuancés qu'ils en étaient grandement bénéficiaires. On a pu ainsi assister à l'émergence, en Asie, d'une vision critique de l'ordre économique mondial. Les négociations de l'OMC et les événements de Seattle ont encore accru ces interrogations. L'Asie orientale a longtemps été un partenaire totalement acquis au dogme d'un mondialisme libéral, n'ayant d'autre aspiration que de profiter de l'aubaine que représentait la réduction des barrières commerciales. Aujourd'hui, l'Asie cherche pour elle-même des modèles de sociétés acceptables et des formes d'organisation de la globalisation économique qui lui permettront de se faire entendre et de se défendre contre ses errements. Insistons sur ce point : cette prise de conscience est d'autant plus remarquable qu'elle ne s'est pas accompagnée de la tentation du repli. B.- LES POTENTIALITÉS D'UN DIALOGUE EUROPE-ASIE Des craintes de la mondialisation et des échecs du « modèle asiatique » naissent de puissantes interrogations, qui créent pour les Européens des opportunités de dialogue et de travail très importantes avec les pays d'Asie de l'Est. 1.- Vers un renouveau du dialogue euro-asiatique Né avant la crise, le dialogue euro-asiatique a commencé à s'installer principalement au travers de la création de l'Asia-Europe Meeting (ASEM) dès le sommet de Bangkok, en 1996. Dans un premier temps, les événements de 1997 ont évidemment freiné cette dynamique. Non que l'Europe fût totalement absente ou ait manqué de solidarité : en maintenant ouverts ses marchés, en agissant au sein des organisations financières internationales ou en prenant, dans un certain nombre de pays, l'initiative d'une renégociation « à chaud » des créances bancaires privées, l'Europe L'aide des pouvoirs publics a été également marquée. Par le biais d'un fonds fiduciaire, l'Europe a financé à hauteur de plus de 40 millions d'euros des actions réalisées par la Banque mondiale. Cet engagement doit être maintenu comme l'un des symboles de notre volonté d'être aux côtés des pays asiatiques. En 1998, le sommet de Londres a été l'occasion d'affirmer cette solidarité et la confiance envers nos partenaires asiatiques. Mais force est de constater que les changements politiques et l'accaparement légitime des gouvernements de la zone par leurs problèmes internes n'ont pas permis jusqu'ici de donner au dialogue Europe-Asie l'ampleur espérée. C'est pourquoi le sommet de Séoul, en octobre 2000, représente une grande opportunité. La réussite de ce sommet tiendra peut être moins à l'annonce de décisions spectaculaires qu'à l'affirmation de la qualité politique des échanges et au processus de réflexion qu'il pourrait initier. En particulier, le sommet de Séoul pourrait déboucher sur un renouveau de la réflexion sur les fondements de l'ordre économique mondial. L'avenir des négociations de l'OMC, comme la réforme des institutions de Bretton Woods et, plus généralement, ce qu'il convient d'appeler la nouvelle architecture du système financier international, participent de ce dialogue. Des intérêts ou des approches parfois divergents sur des questions importantes ne devraient plus faire obstacle à une véritable réflexion sur les procédures et le cadre des discussions relatives aux formes de régulation de l'économie mondiale. Il y a désormais, chez la plupart de nos interlocuteurs asiatiques, un véritable intérêt à traiter de ces questions, alors même qu'ils n'en voyaient pas vraiment la nécessité, il y a quelques années. Qu'il s'agisse des aspects techniques ou politiques, ces questions sont au c_ur de la réflexion des pays de l'ASEAN. 2.- La volonté de coordination régionale On a déjà souligné comment ces pays, en plein c_ur de la crise, avaient repoussé la tentation isolationniste, y compris la Malaisie, bien qu'elle ait adopté une voie singulière pour le traitement de la crise. L'idée de la nécessité de politiques coordonnées au plan régional comme la nécessité de nouvelles règles du jeu au plan mondial ressortent comme les premières conséquences de la crise. Peut-être contre toute attente, la crise a, en effet, favorisé une prise de conscience régionale. Dans les premiers mois de la crise, notamment lors de la réunion du FMI à Hong Kong, en septembre 1997, l'idée d'un Fonds monétaire asiatique a été avancée, notamment par le Japon. Cette proposition a été mal reçue par les partenaires occidentaux, qui n'y voyaient pas un projet crédible. Ils l'interprétaient surtout comme une forme d'échappatoire aux réformes souhaitées. Certains pays asiatiques, au premier rang desquels la Chine, qui y percevait trop clairement une man_uvre japonaise, y étaient d'ailleurs très hostiles. Rejetée, cette idée a vécu sous d'autres formes. Le Japon a tenté de reprendre l'initiative avec le plan Miyazawa, assurant très spectaculairement un rôle de solidarité asiatique. Il souhaite aujourd'hui développer l'internationalisation du yen. M. Chi Hung Kwan, économiste de Hong Kong, membre de la Brookings Institution et du Nomura Research Institute de Tokyo, spécialiste des économies asiatiques, souligne, dans un ouvrage paru en décembre 1998 : « Promouvoir l'utilisation du yen en tant que monnaie régionale est également dans l'intérêt du Japon. Alors que l'Asie absorbe à présent 40% de la totalité des exportations japonaises, instaurer la stabilité entre le yen et les autres monnaies asiatiques rendrait le Japon moins vulnérable aux fluctuations du taux de change yen-dollar » (2). L'origine de la crise ayant été liée, techniquement, à des questions monétaires (entre autres, la fragilité des parités fixes avec le dollar) la réflexion autour de l'avenir des marchés et de leur fluctuation a posé bientôt la question d'éventuelles coordinations. La naissance concomitante de l'euro a frappé les esprits et, quelles que soient les interrogations qui peuvent naître de son évolution par rapport au dollar, la force économique et politique que donne la maîtrise d'une monnaie commune a été souvent soulignée. Mais des obstacles importants apparaissent dès qu'on évoque une perspective similaire pour l'Asie : l'homogénéité insuffisante des économies et des échanges, le développement inégal des structures de contrôle et de régulation économique, l'absence de marché commun, et, bien sûr, les différends géopolitiques régionaux, sans parler de l'hostilité évidente... des Etats Unis. Pourtant, l'habitude a été prise de réunir les ministres des finances (et non plus seulement les banquiers centraux ou les directeurs de ministère) pour des sommets réguliers qui aboutissent à des prises de position communes ou à des recommandations aux pays réunis. Le processus ne doit pas être négligé. S'il est déraisonnable d'imaginer une monnaie commune à court ou moyen terme, l'Europe a tout à gagner - pour développer sa vision multipolaire du monde comme pour améliorer la régulation du système financier international - à appuyer ce processus, techniquement, intellectuellement et politiquement. Un nouveau pas en avant vient d'être fait lors de la dernière réunion de la Banque asiatique de développement, à la surprise d'un grand nombre d'observateurs qui doutaient - et doutent parfois encore - de la volonté des Etats asiatiques d'avancer en matière de coopération des politiques monétaires. Le 6 mai dernier, les ministres des finances de l'ASEAN + 3 ont adopté ce qu'on appelle désormais l'« initiative de Chiang Maï ». Il s'agit, tout d'abord, d'instaurer une surveillance des flux de capitaux privés pour prévenir toute nouvelle crise financière. Par ailleurs, pour faire face à des attaques spéculatives, le mécanisme de swap de devises a été confirmé et va s'élargir, au-delà des cinq pays fondateurs, à cinq autres pays : Brunei, Vietnam, Cambodge, Myanmar et Laos. Enfin, signe qu'avance l'idée d'une coopération à l'échelle de la région (incluant le nord de l'Asie), un élargissement au Japon, à la Chine et à la Corée du Sud est envisagé, avec un fonds d'intervention qui pourrait atteindre 40 à 50 milliards de dollars. Sans doute, le dollar restera pendant longtemps encore la principale monnaie de réserve et d'échange. Mais notre vision politique comme la volonté de promouvoir l'euro doivent nous amener à soutenir ce processus. Grâce à ce dialogue concret, nous serons plus à même de mener une réflexion convergente sur les questions touchant à la nouvelle architecture du système financier international. C.- LA RÉFORME DU SYSTÈME FINANCIER INTERNATIONAL Que l'on considère que la crise est due principalement aux excès des mouvements de capitaux, ou que l'on pense que l'éclatement de la bulle financière n'est que le facteur déclencheur qui a mis à jour les faiblesses structurelles des systèmes économiques des pays émergents d'Asie, il apparaît clairement que la crise asiatique est en grande partie une crise du système financier international. MM. Olivier Davanne, Fred Bergsten et Pierre Jacquet soulignent ainsi que « la succession de graves crises financières et monétaires internationales a donné au débat sur « l'architecture financière internationale » un regain d'urgence. De fait, il est difficile d'adhérer à la thèse selon laquelle une telle série de catastrophes résulte de la simple coïncidence d'erreurs locales et indépendantes, sanctionnées rationnellement par les investisseurs » (3). Ainsi, il paraît difficile de nier que l'Asie a été confrontée à une crise systémique. La communauté internationale a en effet été frappée, à juste titre d'ailleurs, par la généralisation de la crise à des pays aux économies fort différentes. Cette propagation de la crise par le canal financier suffit à infirmer son explication par les seules faiblesses internes d'économies asiatiques arrivées à un même stade de développement, ayant les mêmes structures économiques et financières. Il y a bien eu une défaillance du système financier international, qui s'est traduite par l'apparition d'une crise systémique. En effet, si la crise n'était due qu'à des facteurs internes aux pays concernés, tels la faiblesse du système bancaire et le caractère malsain du financement des entreprises, des pays comme Hong Kong et Taïwan - auxquels on n'attribue pas les mêmes faiblesses qu'à la Corée ou à la Thaïlande - n'auraient pas été affectés. Or ils ont été attaqués, ce qui montre bien que la crise dans laquelle ils ont été emportés a quelque chose à voir avec une crise systémique. Enfin, il est clair que les pays occidentaux ont craint les répercussions de la crise asiatique sur leurs propres économies. Longtemps, les Etats-Unis et l'Europe se sont alarmés des dangers que faisaient peser sur la croissance mondiale les retombées de la crise asiatique. Les marchés ont également été très sensibles à ces risques. On a craint la transmission de la crise par le canal des échanges, et la baisse de la croissance mondiale suite à l'effondrement de la demande des pays asiatiques importateurs de produits européens et américains. Mais plus encore, on a longtemps redouté la transmission de la crise par le canal financier. Les bourses occidentales étaient sous la menace d'un krach boursier importé. Il n'est pas évident de faire aujourd'hui le bilan des effets réels de la crise asiatique sur les économies occidentales. La bonne conjoncture, en particulier américaine, a permis de maîtriser ce qui pour certaines économies n'a représenté qu'un trou d'air. Mais quoi qu'il en soit, il semble bien que la crise asiatique a causé un ralentissement assez important de la croissance mondiale, qui a justifié les inquiétudes de l'année 1998, et justifie que l'on s'interroge sur le système financier international et sur son avenir à la lumière de la crise de 1997. 1.- Le système financier international en question a) Une dérégulation trop brutale ? La crise asiatique a rendue incontournable la réflexion sur la dérégulation financière dans les pays émergents. Ainsi, la manière dont ont été programmées et réalisées ces dérégulations, le rythme et l'encadrement de ces mouvements massifs d'ouverture des marchés sont contestables. M. Michel Aglietta fait de cette dérégulation financière mal maîtrisée l'une des causes de la crise : « La crise asiatique a mis en évidence les défauts des tentatives précédentes destinées à réduire la fragilité financière. A présent, on admet largement le caractère potentiellement désastreux de la combinaison qui associe liberté des mouvements de capitaux et mauvaise régulation bancaire » (4). Des économistes asiatiques partagent cette analyse. M. Yung Chul Park, économiste du Korea Institute of Finance, incite les pays émergents à la prudence dans leur processus de dérégulation : « Comment les pays émergents peuvent-ils réussir leur intégration dans le système international ? Au vu des récentes crises financières d'Asie orientale, il semblerait qu'ils doivent se montrer très prudents dans l'ouverture de leur marché monétaire et de leur marché de capitaux » (5). Était-il en effet nécessaire d'agir si rapidement et de libéraliser les mouvements de capitaux, sans prendre le temps de mettre en place les structures d'encadrement et de contrôle du marché financier qui existent dans les pays industrialisés ? Pouvait-on exiger des pays asiatiques émergents qu'ils franchissent en une seule fois toutes les étapes que nous-mêmes avons mis des années à franchir ? On peut en douter, et ce d'autant plus que cette dérégulation brutale des marchés financiers dans les pays émergents a sans doute accru la fragilité du système financier international en rendant les capitaux plus volatiles. Cet avis est partagé par de nombreux économistes. M. Michel Aglietta, dont nous suivons dans ce rapport un grand nombre d'analyses, recommande ainsi d'être prudent à l'avenir : « Ce raisonnement conduit à recommander aux pays qui n'ont pas encore libéralisé leurs systèmes financiers, une ouverture ordonnée et progressive, l'adoption de directives internationales, ainsi que la production de meilleures données de marché et la promotion de la transparence à ceux qui l'ont fait. » (6). On peut également douter de l'opportunité de favoriser le développement des capitaux à court terme pour financer les économies des pays émergents. Ce mode de financement leur a-t-il été bénéfique ? Ces capitaux offraient en effet des taux plus avantageux que les systèmes plus classiques, mais le prix à payer pour cette facilité d'obtention des liquidités a été une fragilisation de leur système financier, une volatilité plus grande des capitaux, une grande tentation pour des investisseurs locaux qui se sont longtemps cru invulnérables en raison de leurs liens politiques avec le pouvoir. Ainsi, l'erreur de la communauté internationale, notamment des organismes financiers internationaux, a sans doute été de penser qu'il suffisait d'éradiquer l'Etat interventionniste de jadis pour laisser le marché s'exprimer. Or, la réforme aurait plutôt dû consister en une transformation du modèle étatique : il fallait substituer l'Etat de droit à l'Etat interventionniste et autoritaire, et non pas remplacer l'Etat par le marché. Il aurait sans doute fallu agir moins précipitamment lorsqu'on a décidé de libéraliser les marchés financiers. Il est important de se rendre compte de cette erreur, qui n'a pas été sans conséquences sur l'ampleur de la crise asiatique de l'été 1997. Aucun pays concerné ou potentiellement candidat à une telle libéralisation des mouvements de capitaux ne souhaite revenir en arrière. Mais des modalités particulières, adaptées au contexte des marchés émergents de la zone asiatique, peuvent cependant avoir leur place ici et permettre une dérégulation douce. b) Une crise systémique d'un nouveau genre à l'ère de la globalisation M. Michel Aglietta donne la définition suivante du risque systémique : « C'est l'apparition d'équilibres anormaux, c'est-à-dire socialement inefficients, dans lesquels un système économique peut se trouver enlisé du fait que les comportements individuels rationnels ne produisent pas d'ajustement de marché spontané qui puisse faire sortir le système de l'état macroéconomique défavorable dans lequel il se trouve » (7). Ce que cette crise a montré, dans sa partie financière, c'est bien l'incapacité du marché à se fixer de lui-même les règles propres à assurer sa préservation. La dimension systémique de la crise financière explique d'ailleurs sa rapidité de propagation dans des pays aux économies structurellement différentes. Ainsi apparaît, au niveau macroéconomique, la question de la gestion des risques. La recherche de rendements toujours plus importants et plus rapides peut occulter les nécessités d'une saine appréciation du risque par les gestionnaires de capitaux. L'aléa moral a pu s'installer parce que ces gestionnaires pensaient reporter le risque sur d'autres acteurs, ou en tout cas, le reporter à plus tard. L'écroulement soudain des établissements bancaires renvoie, sans doute possible, à une faiblesse structurelle du système bancaire que la crise n'a fait que révéler. L'insuffisance du contrôle des investissements par les banques et les organismes étatiques ainsi que l'aisance avec laquelle les sociétés pouvaient trouver des crédits sur le marché des capitaux ont préparé l'effondrement de 1997. Au niveau microéconomique, la libéralisation des mouvements de capitaux - même si elle n'est pas remise en cause - et l'émergence des hedge funds (ou d'autres fonds spéculatifs) comme partenaires importants dans la structure de financement des entreprises ont eu pour conséquence une transmission fulgurante de la crise de la sphère financière vers l'économie réelle. Cependant, les mouvements de panique et de contagion qui ont suivi le déclenchement de la crise et l'ont amplifiée révèlent une défaillance du système financier international. Les investissements massifs en Asie et les phénomènes de spéculation, en particulier dans le domaine de l'immobilier - conduisant à la formation d'une bulle spéculative qui a finalement éclaté à partir de juillet 1997 - renvoient à une anomalie du système financier international : les intérêts immédiats des spéculateurs ont pris le pas, dans ce cas précis, sur l'intérêt à moyen et long terme du marché. Le système financier international a été un facteur important de fragilisation des marchés financiers et des économies asiatiques (et au-delà). En ce sens, la crise asiatique est bien une crise d'un nouveau genre. C'est une crise caractéristique de la nouvelle ère de la globalisation, que nous vivons depuis quelques années. Cette crise est une vraie crise moderne, une crise des emprunteurs privés, et non pas une crise souveraine. Il faut donc trouver des parades à ce nouveau type de crise, afin de prévenir son retour, ou si on ne peut éviter d'en connaître à nouveau, pour réagir au mieux lorsqu'une telle crise se présente. c) L'ancrage des monnaies asiatiques au dollar remis en cause par la crise La volatilité des taux de change des monnaies asiatiques a été à la fois le signe et la cause de l'instabilité du système financier international. Signe de l'instabilité, dans la mesure où cette volatilité des monnaies renvoie au déplacement brutal de capitaux et non pas à des évolutions rapides des échanges commerciaux ou des autres transactions courantes ; cause de l'instabilité, dans la mesure ou la spéculation sur les monnaies a été un des facteurs déclencheurs de la crise et une des composantes de la volatilité des capitaux internationaux. Par ailleurs, une politique de change fixe par rapport au dollar, adoptée par la majorité des pays de la zone, n'était pas le choix le plus adéquat. Comme le font remarquer MM. Olivier Davanne, Fred Bergsten et Pierre Jacquet, l'ancrage nominal sur une monnaie étrangère présente des dangers non négligeables : « Tant que l'ancrage paraît crédible, les entrées de capitaux peuvent être considérables et conduire au surinvestissement ou à la surconsommation, en particulier lorsqu'un secteur bancaire local mal supervisé encourage un endettement excessif des agents privés aussi bien que publics. La surévaluation du taux de change, la faiblesse des bilans et un endettement lourd en devises étrangères rendent, toutefois, le pays très vulnérable à tout renversement des anticipations. Non seulement les capitaux qui sont entrés peuvent facilement sortir mais, dans ce tout nouvel univers de forte mobilité internationale des capitaux, les taux de change fixes deviennent très vulnérables aux sorties spéculatives de capitaux à court terme. Les crises asiatique, russe et brésilienne des années 1997-1999 et la crise du peso mexicain de 1994 en fournissent une illustration éloquente » (8). De plus, afin de financer leur économie et de répondre aux demandes d'emprunteurs nombreux, les pays émergents d'Asie ont souvent laissé se créer des dettes importantes en dollars. Or, les évolutions du dollar peuvent rendre très délicat le remboursement de ces dettes, ou du moins leur maîtrise. En effet, le maintien de la parité des monnaies asiatiques avec le dollar n'est tenable à long terme que si les cycles économiques américain et asiatique sont en phase. Au contraire, la déconnexion des cycles américain et asiatique a été patente dès 1995, rendant de plus en plus néfaste l'ancrage des monnaies asiatiques au dollar. Les gouvernements des pays d'Asie du sud-est ont compris le danger que faisait courir cet ancrage à leurs économies. Il semble que l'on s'achemine vers une évolution majeure des politiques monétaires de la zone. Le refus d'un peg liant les monnaies locales au dollar commence à devenir une position majoritaire. A partir de là, deux positions extrêmes se dessinent : soit la dollarisation complète des économies asiatiques, soit l'instauration de monnaies locales flottantes, sans zones cibles ni bandes de fluctuations définies. La première solution ne ferait qu'amplifier les inconvénients actuels de l'ancrage au dollar. La seconde solution renforce, quant à elle, les risques de déstabilisation des marchés financiers. Des changes flottants attireraient forcément les spéculateurs, ce qui aurait pour conséquence immédiate d'aggraver l'instabilité monétaire dans une zone fragile. Les incertitudes et les coûts liés à cette volatilité des taux de change seraient sans doute importants. Les économies de la zone en paieraient le prix fort : l'évolution aléatoire et brutale du prix des exportations et des importations, l'incertitude liée aux emprunts et aux dettes libellés en devises créeraient un climat général de fragilité et d'instabilité. d) Vers une monnaie unique asiatique ? Certains gouvernements asiatiques semblent réfléchir à une position intermédiaire entre ces deux extrêmes. Il s'agit désormais - la plupart des acteurs en sont d'accord - de créer une zone de stabilité en Asie. Par le passé, la monnaie a pu être utilisée comme une arme économique. Le taux de change était utilisé comme un outil efficace de pénétration des marchés étrangers, ou entre les pays asiatiques exportateurs eux-mêmes. Les Japonais ont ainsi utilisé le yen à des fins offensives, au prix d'une instabilité financière et d'ajustements parfois douloureux pour leurs partenaires commerciaux. Cette période semble révolue. Les acteurs économiques et politiques développent à présent une problématique toute différente. Les responsables politiques sont conscients que la convergence des politiques économiques apporte plus de bénéfices que la guerre économique : les politiques monétaires ont ainsi gagné en maturité. Il faut souligner cette attitude nouvelle en Asie. Que le Japon, la Chine, la Corée, Taïwan, l'Indonésie et bien d'autres encore envisagent de coordonner leurs politiques économiques est déjà en soi une victoire, un progrès majeur, qu'il faut saluer. Dans ce contexte, l'idée de créer une monnaie unique asiatique reprend en partie de son sens. Il est évident qu'une telle idée est quelque peu utopique, pour des raisons à la fois historiques, politiques et économiques. Il n'en reste pas moins que la convergence des économies asiatiques amène leurs dirigeants à réfléchir à une coordination croissante de leurs politiques économiques. Le point culminant, l'aboutissement de cette coordination serait bien sûr la création d'une monnaie asiatique : certains économistes asiatiques proposent de créer une telle monnaie à partir des deux piliers monétaires régionaux que sont le yen et le yuan. Ils ont d'ores et déjà trouvé un nom synthétique pour cette nouvelle monnaie, le « yan », contraction phonétique de yen et yuan. Quoi qu'il en soit, et quels que soient les délais nécessaires à la création de cette monnaie unique, l'idée progresse. Si un tel projet réussit à vaincre les réticences et à surmonter les méfiances nationales, il est clair qu'il ne verra pas le jour avant dix, voire vingt ans. Mais il n'est pas interdit d'aller dès à présent vers une plus grande intégration régionale, qui semble bien être le sens de l'histoire. Ainsi, une bonne transition consisterait à sortir du dilemme « changes flottants ou ancrage au dollar » en définissant un panier de monnaies ordonné autour du dollar, de l'euro, du yen et dans une moindre mesure du yuan. C'est également l'avis de MM. Olivier Davanne, Fred Bergsten et Pierre Jacquet : « Une parité de référence doit impérativement être définie par rapport à un panier de monnaies tenant compte de la structure des échanges extérieurs. Celui-ci doit au minimum être composé du dollar, de l'euro et du yen » (9). M. Chi Hung Kwan, dont nous avons déjà cité plus haut les travaux, est conscient que la monnaie unique asiatique, si elle doit exister un jour, ne s'imposera pas avant de longues années. Il propose comme étape transitoire que les différentes monnaies asiatiques s'ancrent à un panier de monnaies dans lequel le poids du dollar serait largement pondéré par le yen, constituant ainsi une « zone yen » Ces paniers différeraient suivant la structure économique des différents pays et leur relation à l'économie japonaise, selon qu'ils en sont complémentaires ou concurrents. Il estime que : « le poids « optimal » attribué au yen dans ce panier de monnaies varierait d'un pays à l'autre, en fonction surtout du degré de concurrence de ces pays avec le Japon. [...] Les pays dont le revenu par habitant est élevé sont plus probablement dans une relation concurrentielle vis-à-vis du Japon que les pays où le revenu par habitant est bas. Ainsi, la Corée du Sud devrait ancrer sa monnaie davantage sur le yen que la Thaïlande, qui, a son tour, devrait attribuer un plus grand poids à la monnaie japonaise dans son panier de monnaies que l'Indonésie, par exemple. Toutes choses étant égales par ailleurs, les pays de la zone à haut revenu sont les candidats les plus appropriés pour constituer une union monétaire avec le Japon » (10). Une telle démarche aurait deux conséquences majeures : d'une part, elle apporterait une stabilité certaine aux économies asiatiques en faisant dépendre l'évolution de leur monnaie d'un panier de devises plus représentatif de la structure de leur commerce extérieur. D'autre part, elle préparerait doucement à une coordination des politiques monétaires des pays de la zone. Ainsi, les responsables japonais, au premier rang desquels le ministre des finances, M. Miyazawa, ont annoncé récemment qu'ils souhaitaient internationaliser le yen. Ils ne semblent pas avoir abandonné l'idée d'un fonds monétaire asiatique. Si un tel fonds ne voit pas le jour, les discussions que mènent les gouvernements asiatiques à ce propos font tout de même avancer les pays de la zone dans la direction d'une coopération renforcée. L'initiative de Chiang Maï, que nous évoquions plus haut, va évidemment dans ce sens. 2.- Les interventions critiquées du FMI a) Le FMI n'a su ni prévoir ni prévenir la crise Les critiques portent tout d'abord sur le rôle du FMI dans la prévention et la détection de la crise asiatique. Il lui a été reproché, tout d'abord, d'avoir préparé le terrain à la spéculation et à la crise, en recommandant une ouverture brutale des marchés de capitaux. Par ailleurs, il a été critiqué pour ne pas avoir vu venir la crise et pour ne pas avoir pris la mesure de celle-ci lorsqu'elle a débuté. Sur le premier point, il est clair que la doctrine du FMI en matière de libéralisation des mouvements de capitaux a contribué à l'émergence de marchés financiers fragiles, très attractifs pour les investisseurs internationaux, mais trop peu encadrés, trop sensibles aux mouvements erratiques des capitaux internationaux. Les marchés asiatiques ont ainsi attiré des investissements trop rapides et anarchiques, et n'ont pas fait assez de place aux investissements directs étrangers. La critique que nous avons portée contre la manière dont a été menée la dérégulation des marchés financiers en Asie concerne évidemment au premier chef le FMI. Il faut cependant être juste, et reconnaître que cette doctrine n'a pas non plus été remise en cause fondamentalement par la communauté internationale. Sur le deuxième point - l'incapacité du FMI à prévoir l'éclatement de la bulle financière et le déclenchement de la crise - les critiques sont également fondées. Il faut associer à cette critique du FMI les agences de notation, dont on peut penser qu'elles n'ont pas rempli leur rôle en n'alertant pas suffisamment à temps les acteurs économiques et financiers sur les dangers d'éclatement de la bulle. Ainsi, la mauvaise appréciation de la situation macroéconomique sur la zone asiatique n'est pas le fait du seul FMI. Personne n'a vu venir cette crise, qui s'est déclarée de manière brutale dans un contexte où les fondamentaux économiques des pays d'Asie (chômage bas, inflation limitée, croissance forte) ne laissaient en rien présager une telle crise. Mais la position idéologique qui veut qu'avec un marché des capitaux totalement libéralisé et une économie dérégulée, les pays émergents doivent rester sur un sentier de croissance de 10% par an en moyenne, a sans doute aveuglé les experts du FMI. Ils n'ont pas analysé avec suffisamment d'objectivité les faiblesses des économies asiatiques et n'ont pas su percevoir les premiers signes d'essoufflement, les premiers « ratés » de ces économies émergentes. L'aveuglement d'une partie de l'intelligentsia politique et économique des pays occidentaux, soumise à l'emprise idéologique du « miracle asiatique », dont ils ne remettaient en cause aucun élément, a également joué un rôle. b) Les réactions brutales et inadaptées du FMI A cette lacune du FMI dans le suivi de la conjoncture internationale et régionale s'ajoutent ses erreurs d'appréciation lors des premières semaines de la crise. Le plus gros reproche qui a été fait au FMI est d'avoir été très long à s'intéresser réellement à la crise asiatique. Le caractère systémique de la crise a été plutôt minoré par les responsables du FMI, à son début. Il est clair, par ailleurs, qu'ayant mal jugé de l'ampleur et de la nature de la crise, l'implication du FMI dans sa résorption a été tardive et, dans un premier temps, trop timorée. Les actions du FMI, relativement inadaptées et trop timides, n'ont pas permis d'enrayer la crise. Par ailleurs, les fonds injectés à l'été 1997 étaient insuffisants. La communauté internationale, en particulier les Etats-Unis, ont également été trop longtemps réticents à débloquer des fonds suffisants, à la hauteur de la crise. De plus, suivant un schéma classique des années 1980, appelé souvent « consensus de Washington », le FMI a préconisé dès le début de la crise des solutions « à l'africaine » pour assainir les économies asiatiques en pleine récession : réduction du déficit public, rigueur budgétaire... Cette attitude a asséché la demande intérieure des pays touchés par la crise et a empêché un redémarrage rapide de l'économie. Il s'agit là d'une erreur stratégique lourde de conséquences. La seconde erreur a été de vouloir maintenir à tout prix l'ouverture des marchés, empêchant la demande interne de se reconstituer et privant les entreprises locales de l'oxygène dont elles avaient besoin pour redémarrer ou éviter de basculer dans la faillite. c) Le bilan de l'action du FMI et de la mobilisation internationale Trois ans après le début de la crise, le bilan de l'action du FMI est sévère mais plus nuancé. Les premiers mois de la crise ont en effet été marqués par l'apathie et des actions trop peu nombreuses et inadaptées. Mais ces insuffisances reflétaient aussi, en partie, l'attitude des nations occidentales, au premier rang desquelles les Etats-Unis. La comparaison avec la crise mexicaine, où le FMI, poussé par les Etats-Unis, a agi rapidement et massivement, a d'ailleurs contribué à nourrir un ressentiment anti-FMI, anti-occidental et anti-américain chez les Asiatiques. Quand les risques de contagion ont commencé à apparaître et que la crise a menacé de peser sur la croissance mondiale, la mobilisation internationale a été plus forte. Le FMI a su faire preuve d'un peu plus de souplesse, devant l'échec manifeste de ses plans structurels, reprenant même parfois à son compte des mesures qu'il dénonçait avec la dernière vigueur quelques mois auparavant (que l'on songe notamment à l'initiative malaisienne de fermeture de ses frontières, qui n'a pas nui à la Malaisie pour surmonter la crise). L'intervention européenne a existé et a été appréciée des Asiatiques lorsqu'elle a été perceptible. Si les Européens n'ont pas été très présents pour forcer le FMI à intervenir massivement et rapidement, ils ont, par la suite, apporté des aides ponctuelles qui n'ont pas été négligeables, même si elles restaient en-dessous des besoins réels des pays touchés par la crise. Le bilan que l'on peut dresser trois ans après est donc mitigé. a) Repenser le rôle des institutions financières internationales Les critiques portées contre le FMI et les autres organismes internationaux (Banque mondiale, OMC, etc.) sont fondées, pour bon nombre d'entre elles. C'est pourquoi il nous semble important de prendre rapidement les mesures qui s'imposent pour restaurer la légitimité des organismes internationaux, faute de quoi nous n'aurons plus d'outils pour réguler l'activité des marchés et du commerce mondial. Pour prendre le cas du seul FMI, notons qu'il est contesté aussi bien dans son action que dans son principe, ainsi que dans sa composition. En effet, c'est la légitimité même de l'organisme international qui est en cause : son action dans la prévention et la résolution des crises est sujette à caution, même si cette action là n'est pas nulle. Le FMI a été aveuglé en Asie, où il a tout de même sous-estimé les difficultés nées du passage d'un modèle de société à un autre, d'un stade de développement à un autre, et n'a pas su trouver les réponses adaptées à la crise. La composition et l'idéologie du FMI expliquent en partie cet aveuglement. Pour ce qui est de son idéologie, nous avons vu comment le schéma classique de résorption de la crise appliqué par le FMI dans les pays asiatiques (réduction des déficits, maintien de l'ouverture des marchés) s'est révélé peu productif, voire néfaste. Pour ce qui est de la composition de ses instances, il est clair que l'absence des pays concernés au premier chef par les décisions des organismes internationaux pose problème. N'ont véritablement voix au chapitre que les représentants des créditeurs, c'est-à-dire les pays industrialisés les plus puissants, au premier chef les Etats-Unis. Le FMI a ainsi été la cible d'attaques diverses. Accusé d'étatisme, il est aussi, paradoxalement, accusé d'être l'un des principaux vecteurs de la mondialisation. L'accusation d'étatisme est surtout présente aux Etats-Unis. Les milieux les plus libéraux, au Congrès notamment, reprochent au FMI d'être inutile, dangereux, cher et inefficace : inutile, parce qu'ils estiment que l'action des seuls marchés suffirait à assurer un fonctionnement harmonieux du système international ; dangereux, au sens où son action brouille les informations sur les marchés et risque de créer de l'aléa moral ; cher, parce que ce sont les contribuables, notamment américains, qui participent indirectement à son financement ; inefficace enfin, puisque ses dernières interventions n'ont pas empêché les crises asiatique, russe, brésilienne d'éclater. La seconde accusation prend le contre-pied de la première. Elle s'exprime dans les milieux anti-mondialisation, nébuleuse encore floue mais qui a acquis une visibilité et a commencé à s'organiser à l'occasion du sommet de l'OMC à Seattle, en décembre 1999. Pour eux, le FMI, l'OMC et la Banque mondiale imposent un modèle de société uniforme, fondé sur le libéralisme. Leurs opposants en font les créateurs et les propagateurs de la mondialisation à laquelle ces instances internationales fourniraient un cadre idéologique et des outils puissants. Ces deux accusations sont évidemment excessives, quoiqu'à des degrés divers : le FMI n'est vraiment pas étatiste. Cette accusation est en effet difficilement soutenable, les actions du FMI en faveur de la dérégulation et de l'ouverture des marchés le démontrent. M. Michel Aglietta rappelle, à ce propos, l'évolution du FMI et du cadre idéologique dans lequel il a mené ses actions : « D'une institution monétaire vouée à gérer les ajustements macro-économiques des pays endettés, le FMI s'est converti en agence de développement, prônant des réformes micro-économiques pour "libérer" les marchés intérieurs. Il a perdu toute neutralité politique vis-à-vis des pays membres pour se faire l'avocat d'un modèle libéral de développement » (11). De plus, le FMI n'a ni créé, ni permis seul le développement de la mondialisation, même s'il a favorisé ce développement, en agissant dans le sens de l'ouverture des marchés, facteur essentiel de la mondialisation. Ces affirmations ont, cependant, toutes deux quelque chose de vrai : le couple FMI / Banque Mondiale est l'une des rares instances, avec l'OMC, dont les actions fixent le cadre de la globalisation. D'ailleurs, le FMI a montré lors de la crise asiatique qu'il n'a pas fait sa révolution, et qu'il envisage toujours les risques souverains comme ceux contre lesquels il doit agir en priorité, alors que les risques de marché sont désormais les plus probables et les plus dangereux. Il a encore du mal à appréhender l'augmentation des risques systémiques. La réflexion ne doit pas s'arrêter au cadre du seul FMI : c'est l'ensemble de l'architecture financière internationale qui doit être auscultée, réformée et démocratisée. Il convient ainsi de repenser l'articulation entre les différents organismes internationaux (FMI, Banque Mondiale, OMC), ainsi que la coordination de leurs politiques. Pourtant, sortant du cadre strict institué par ses statuts, le rôle du FMI a déjà évolué à partir des années 1980. Le tableau ci-après montre comment M. Daniel Delalande présente cette évolution (12). La rénovation de l'architecture financière internationale est devenue une question majeure. Quittant son mandat de directeur général du FMI, M. Michel Camdessus a plaidé pour un rapprochement avec la Banque Mondiale et l'engagement commun des deux institutions dans la lutte contre la pauvreté. Il déclarait vouloir recentrer les actions du FMI sur la lutte contre la pauvreté, par le biais d'actions structurelles, en pratiquant des remises de dette et des prêts à taux très bas aux pays les plus pauvres. La vente d'une partie du stock d'or du FMI pour financer les allégements de dette des pays les plus pauvres a été annoncée en septembre 1999. L'ÉVOLUTION DU RÔLE DU FMI
D'après Clark, « Should the IMF become more adaptive ? », IMF Working Paper, n°96/17, février 1996. Prenant le contre-pied de ces propositions, une commission, nommée à l'initiative du Congrès américain et présidée par M. Allan Meltzer, a publié un rapport au mois de mars dernier. Il demande au FMI de « limiter ses prêts à la fourniture de liquidités à court terme, de mettre fin aux pratiques actuelles de crédits à long terme pour réduire la pauvreté ». Cette vision très réductrice du FMI lui conférerait un rôle de prêteur en dernier ressort pour les économies émergentes en proie à une crise de liquidité. Le FMI interviendrait pour mettre en place dans les pays pauvres ou émergents les règles de l'orthodoxie budgétaire, et s'interdirait d'utiliser tout autre outil de régulation. Enfin, les auteurs du rapport proposent de réduire considérablement le rôle de la Banque Mondiale, qui ne prêterait plus qu'aux pays n'ayant pas accès aux marchés financiers, et devrait, d'ici à cinq ans, cesser ses prêts aux nations dont le revenu annuel par habitant dépasse 4 000 dollars. Ce rapport, d'inspiration très libérale, emprunte aux critiques et propositions livrées par M. Jeffrey Sachs. Dans une tribune, reprise par Libération le 8 octobre 1999, il déclare en effet : « Il est donc temps [que le FMI] revienne à sa fonction de base : la supervision du système monétaire international, et à la rigueur l'octroi de quelques prêts d'urgence. Il devrait y avoir cinq programmes du FMI par an et non cinquante. La Banque mondiale n'est pas dans une situation plus brillante. [...] Une bonne partie des prêts [qu'elle accorde] pour financer des projets pourraient l'être par des établissements privés. Il faudrait donc procéder à des coupes claires au sein de la Banque mondiale pour que celle-ci se concentre sur la production de données systématiques, favorise les innovations scientifiques axées sur les problèmes des pays pauvres [...] et étudie les enjeux mondiaux à long terme » (13). Notre position est toute différente. Pour des raisons que nous expliquons plus loin, nous estimons que le FMI ne peut pas jouer le rôle de prêteur en dernier ressort au niveau international. Ses missions principales doivent être la surveillance, l'analyse et l'information sur la situation économique mondiale et sur les marchés financiers internationaux, ainsi que le soutien à la balance des paiements. Par ailleurs, il doit continuer à mettre en place des mécanismes d'aide structurelle aux pays en développement. Le FMI reste légitime pour ce type d'actions et pour intervenir auprès des Etats, dans une perspective de moyen terme. Par contre, les interventions relevant de la problématique du prêteur en dernier ressort doivent associer le FMI et un réseau de banques centrales qui s'appuierait sur l'outil technique qu'est la Banque des règlements internationaux. En effet, le système financier international, qui met en jeu des sommes d'argent hors de proportion avec les capacités d'action des Etats, ne peut plus reposer uniquement sur la socialisation des risques. Pour conduire cette réforme, nous devons être en mesure de dire quel sens nous comptons donner à la globalisation. Un principe simple doit nous guider : la globalisation a été jusqu'ici un phénomène concernant les marchés. Elle doit aujourd'hui se décliner dans le champ institutionnel. A la globalisation financière et commerciale doit répondre une globalisation politique, incluant des politiques économiques globales, régionales ou internationales. Pour cela, les institutions financières internationales doivent être mieux coordonnées, mais surtout ne doivent plus être entachées du soupçon de partialité. Des politiques globales ne sont légitimes et réellement globales que si elles sont librement acceptées et mises en place par l'ensemble des acteurs concernés. Il ne saurait être question d'accepter la confiscation de ces politiques économiques mondiales par un groupe d'acteurs, quel qu'il soit. · Donner une dimension politique au système financier international La réforme majeure est donc celle de la démocratisation. La France a, depuis plusieurs mois, avancé la nécessité de renforcer la dimension politique du FMI. L'une des pistes consistait à faire de son comité intérimaire une véritable instance politique, dotée d'un pouvoir de décision. A cette proposition institutionnelle, qui est le fait de la France et de certains de ses partenaires européens, on peut opposer la position américaine. Elle consiste à proposer un certain nombre d'axes de travail sur des points techniques, à l'intérieur de groupes informels. Les Américains restent fortement opposés à toute tentative visant à donner un cadre politique aux instances financières internationales. Ils proposent en revanche d'ouvrir aux pays émergents les travaux du G 7, de manière ponctuelle, dans le cadre de ce qui a d'abord été un G 22, puis un G 33, puis un G 20. Ces deux positions opposées renvoient à deux logiques, deux choix, qui ont chacun leur cohérence : - d'un côté, la solution présentée par les Etats-Unis se situe dans une logique unipolaire, ceux-ci restant un poids lourd économique pesant sur toutes les décisions importantes et traitant les questions difficiles surtout de façon bilatérale. Seuls les pays ayant un poids économique appréciable peuvent espérer avoir une influence secondaire sur les décisions engageant l'avenir de l'économie mondiale. - d'un autre côté, la position française est liée à la question de la multipolarité. Elle implique de changer la logique qui prévaut dans la détermination du pouvoir relatif des Etats dans les instances de décision des institutions financières internationales. Désormais, le poids réel des États membres dans ces instances de décision serait jugé à l'aune de leur importance politique. On peut se demander si cette dernière position n'est pas trop institutionnelle. Elle présente aussi l'inconvénient majeur d'être perçue comme trop timide par les pays émergents. En effet, la politisation des instances financières internationales existantes serait un moyen pour les puissances moyennes - telles que la France ou d'autres pays développés - de renforcer leur présence et leur poids au sein du système financier international, au détriment des Etats-Unis, sans pour autant profiter vraiment aux pays émergents. Or, le rééquilibrage des instances de décision des institutions financières internationales doit être l'occasion d'une réelle démocratisation. On peut oser ce slogan, qui peut être repris par les pays émergents : pas de politisation des institutions financières internationales sans réelle démocratisation. Il n'est pas acceptable pour les pays émergents d'assister à une redistribution des cartes qui ne se traduise pas par une augmentation de leur influence dans les instances de décision. · Démocratiser les instances internationales Cette position répond à des aspirations démocratiques favorisées par la globalisation. De telles aspirations se sont exprimées lors du sommet de l'OMC à Seattle, avec l'émergence de revendications en faveur d'une réelle démocratisation et d'une politisation des décisions des organismes économiques internationaux. De même, lors du sommet de la CNUCED à Bangkok, la présence d'organisations non gouvernementales asiatiques a marqué une étape dans la démocratisation des relations économiques internationales. Ainsi, le renforcement de la dimension politique du FMI et des autres instances économiques et financières internationales est rendu pressant par la volonté légitime des pays émergents ou en développement de participer à l'élaboration des règles régissant l'économie mondiale. En effet, l'instauration d'une logique politique dans les instances internationales ne peut se faire sans bouleversement des règles de décision. L'octroi d'un pouvoir de décision politique, c'est-à-dire la capacité d'engager des opérations qui ne soient plus seulement techniques, suppose de passer à une représentation plus démocratique. La participation aux décisions de tous les pays concernés par leurs effets est une nécessité inscrite dans les fondements du système démocratique. Il semble évident que l'Europe comme l'Asie ont intérêt à ce que l'économie mondiale soit multipolaire. Il faut sortir de la logique de rapports de force qui prévaut au sein du G 7 et aller vers une démocratisation des institutions financières internationales. Parce que la globalisation financière impose de nouvelles règles, procure de nouvelles perspectives de richesses mais aussi fait naître de nouveaux risques, les économies nationales doivent s'allier pour trouver de nouvelles parades et forger de nouveaux outils d'intervention. Pour être légitimes, ces nouveaux moyens d'action politique doivent être mis à la disposition de tous les pays concernés. Il faut faire entrer toutes les nations - y compris, d'ailleurs, les responsables politiques de ces pays et pas seulement les banquiers centraux - dans les instances de décision des organismes économiques internationaux. La proposition de Jacques Delors tendant à mettre en place un Conseil de sécurité économique va dans ce sens. C'est sur ce type de propositions que la France doit se battre et convaincre ses partenaires de l'Union Européenne de se battre à ses côtés. La démocratisation du FMI, de la Banque mondiale et des autres institutions financières internationales est nécessaire mais pas suffisante. Il faut permettre à la communauté internationale, dont les représentants légitimes sont les responsables politiques, de mener une politique économique mondiale. La globalisation de l'économie impose la mise en place d'un nouveau processus, légitimé par son caractère démocratique, capable d'impulser une telle politique. Ce processus devrait permettre d'unifier l'action des différentes institutions financières internationales auxquelles il donnerait un cadre. Celui-ci pourrait prendre la forme d'une assemblée délibérante, législative, édictant les règles encadrant l'activité économique mondiale, tout en bénéficiant par ailleurs d'un certain nombre de pouvoirs d'un organe exécutif, afin de permettre à ces règles d'être appliquées réellement. La France et les pays de l'Union européenne qui souhaitent la rejoindre doivent être à présent plus audacieux : la politisation du seul FMI ou de la Banque Mondiale ne peuvent seuls satisfaire les attentes légitimes des pays émergents et des pays en développement. Nos prises de positions sur la scène internationale, nos propositions institutionnelles doivent évoluer franchement. Ainsi, il faut partir du constat qu'une réelle démocratisation des institutions économiques et financières internationales suppose la mise en place d'une instance de régulation économique mondiale, une démarche d'un nouveau type garantissant le développement économique de la planète dans l'intérêt de tous les pays. Une telle instance ne peut être érigée que sur une base démocratique, ce qui implique nécessairement une remise en cause de nos positions au sein des instances économiques et financières internationales. La question est de savoir si, ce faisant, nous ne lâcherons pas la proie pour l'ombre. Pourrait-on gagner, grâce à la coopération avec un certain nombre de partenaires (pays émergents, pays en voie de développements, autres pays de l'Union européenne), ce que nous perdrions en influence directe au sein des structures internationales existantes ? La perte des petits bénéfices que nous retirons de notre présence au sein du G 7, au FMI, à la Banque Mondiale serait en effet le prix à payer d'une telle démocratisation. Mais on peut raisonnablement penser que nous réussirons à dégager des positions communes avec ces nouveaux partenaires et que, sortant du face à face avec les Etats-Unis, nous serons parmi les bénéficiaires de l'ouverture des instances internationales à d'autres partenaires. Enfin, la perspective d'un transfert vers l'Union européenne d'une partie de nos pouvoirs au sein des instances internationales renforcerait sans doute également nos positions. Ainsi, tout plaide pour la mise en place d'une structure politique, d'une instance de régulation économique mondiale sur une base démocratique : les attentes et demandes des peuples et des gouvernements jusqu'ici exclus de la régulation de l'économie mondialisée, le principe de légitimité démocratique, nos intérêts bien compris. Cette nouvelle instance internationale peut prendre diverses formes. Il n'est pas dans notre rôle de déterminer dès à présent ce qu'elle doit être. Il serait d'ailleurs contradictoire de plaider pour une participation de tous les pays du globe dans une instance démocratique dont on établirait l'architecture a priori, sans consultation. Mais la France, par ce qu'elle représente historiquement, politiquement et sur le plan économique, peut légitimement prendre l'initiative d'un appel visant à convoquer une assemblée constituante chargée de tracer les plans de la future architecture économique mondiale. Il serait bienvenu que nous organisions un grand forum mondial, où seraient invités à débattre les représentants des gouvernements, des Parlements nationaux et des organisations non gouvernementales. De ce forum pourraient être dégagées les pistes devant aboutir à la création d'une instance de régulation économique mondiale. c) Faire émerger un prêteur en dernier ressort international La crise asiatique a fait surgir la nécessité de trouver un prêteur en dernier ressort au niveau international. En effet, la crise de liquidité sur les marchés émergents d'Asie a conduit à une crise systémique sans que le FMI réussisse à enrayer le mouvement. La définition que MM. Michel Aglietta et Christian de Boissieu donnent du prêteur en dernier ressort, dans un rapport réalisé en 1999 pour le compte du Conseil d'analyse économique, permet de comprendre les raisons pour lesquelles le FMI est incapable de jouer ce rôle : « [Le prêteur en dernier ressort doit en effet permettre d'éviter une crise de liquidité]. Il doit agir immédiatement s'il a diagnostiqué qu'une crise de liquidité sur un marché précis dans un contexte donné peut engendrer une crise systémique. [...] Prêter en dernier ressort est un acte de souveraineté qui n'est crédible que si les moyens disponibles sont potentiellement illimités, c'est-à-dire non prédéterminés par des montants préalables ou empruntables instantanément ; bref, il faut une élasticité infinie de l'offre de monnaie. On appelle usuellement Banque centrale l'agent qui a ces caractéristiques, parce qu'il crée sa propre dette ex nihilo » (14). Le FMI, incapable de mobiliser des fonds à la hauteur de ce qui est nécessaire aujourd'hui pour enrayer une crise systémique et ne disposant pas de la capacité de créer la monnaie, n'est pas adapté pour ce rôle. MM. Michel Aglietta et Christian de Boissieu le soulignent : « Il est clair que le FMI, que les gouvernements ont toujours empêché de devenir une Banque centrale et qui ne peut même pas emprunter sur les marchés de capitaux, ne saurait jouer ce rôle » (15). Ainsi, la crise financière asiatique, qui signe le passage du risque souverain au risque de marché dans une économie ouverte où les capitaux circulent librement, appelle des solutions novatrices et des réponses adaptées. Là où, par le biais du contrôle des mouvements de capitaux, la logique de Bretton Woods localisait dans chaque pays le prêteur en dernier ressort, la libéralisation financière appelle des solutions transnationales et coordonnées. Suivant les recommandations de MM. Michel Aglietta et Christian de Boissieu, il nous semble à la fois efficace et réalisable de mobiliser un réseau de banques centrales pour jouer le rôle de prêteur en dernier ressort international. Ce réseau pourrait s'appuyer sur la Banque des règlements internationaux, outil technique qui a l'expérience de la coordination bancaire. Les banques centrales se mobiliseraient en fonction de chaque situation, de chaque crise, offrant ainsi à la communauté internationale un instrument souple et efficace de résolution des crises financières. En effet, si tout le monde s'accorde à dire que les ressources du FMI sont insuffisantes pour faire face aux crises systémiques modernes, aucun gouvernement ne souhaite augmenter sa dotation au Fonds à la hauteur de ce qui serait nécessaire pour assurer son efficacité. La mise en place d'un réseau de banques centrales permettrait de disposer d'un outil de résolution des crises systémiques suffisamment puissant pour être crédible, suffisamment peu cher pour emporter l'adhésion des pays partenaires, suffisamment souple pour adapter ses réponses à chaque crise. Il faut bien être conscient, par ailleurs, qu'à défaut de mettre en place un tel instrument, on se condamne à n'apporter que des réponses ultralibérales aux crises financières internationales. d) Améliorer les mécanismes de régulation des mouvements de capitaux Le système financier international actuel a montré son incapacité à maîtriser les mouvements erratiques de capitaux. La spéculation est ainsi apparue comme une des principales causes de l'instabilité financière. Au premier rang des accusés, les capitaux à court terme, dont l'« inflation » récente a accru la vitesse de déplacement des capitaux internationaux. La suppression des capitaux à court terme, quand bien même elle serait possible, n'est pas une solution. Ces instruments financiers ont une fonction dans l'économie mondiale et ne sauraient être purement et simplement supprimés au nom de la stabilisation des marchés financiers. Mais les capitaux à court terme sont d'un maniement délicat et nécessitent une infrastructure sophistiquée. C'est pourquoi il est tout à fait nécessaire de mettre en place un certain nombre d'institutions et de règles préalablement à toute déréglementation des marchés financiers. · Assurer la supervision des marchés financiers Ainsi, un organe de supervision des marchés financiers, capable d'évaluer la bonne application des règles prudentielles et la situation des marchés, est une nécessité. Leur généralisation pourrait être une nouvelle priorité du FMI, devenir une de ses missions centrales. Les investisseurs et les emprunteurs doivent pouvoir disposer de l'information la plus exacte possible afin d'éviter les distorsions de jugement et, autant que faire se peut, les phénomènes de panique. En effet, la mauvaise application de règles prudentielles par les débiteurs et créanciers privés a été l'une des causes de la crie asiatique. · Renforcer le système bancaire et sa surveillance La déréglementation ne peut être une réussite à long terme sans un système bancaire solide. La crise asiatique en fournit un exemple frappant : l'écroulement soudain des établissements bancaires renvoie à des défauts structurels du système bancaire que la crise n'a fait que révéler. La faiblesse du contrôle des investissements par les banques et les organismes de crédit, ainsi que la facilité avec laquelle ils pouvaient trouver des capitaux sur les marchés ont préparé l'effondrement de 1997. A cet égard, les banques européennes, très présentes en Asie, doivent profiter de la volonté des Asiatiques de reconstituer leurs systèmes bancaires en développant les échanges de savoir faire avec leurs homologues, en envoyant des cadres en Asie, en formant les cadres des banques locales à la gestion prudentielle. On l'aura compris, les pays émergents ont moins d'une déréglementation que d'une nouvelle régulation. Les instances financières internationales doivent inscrire dans leurs plans de déréglementation le renforcement du pouvoir et des capacités opérationnelles des structures de contrôle et de surveillance des marchés financiers. · Permettre un certain contrôle des mouvements de capitaux à court terme Par ailleurs, ils doivent accepter la mise en place de dispositifs intermédiaires, comme c'est le cas au Chili, où les entrées de capitaux ont été soumises à la constitution de réserves obligatoires non rémunérées jusqu'en septembre 1998, afin de dissuader les mouvements spéculatifs. MM. Olivier Davanne, Fred Bergsten et Pierre Jacquet décrivent ainsi les avantages du système chilien : « L'encaje chilien, taxe implicite sur les entrées de capitaux, semble avoir plutôt rendu service à ce pays en le rendant moins vulnérable aux retournements soudains qui ont tant pénalisé les pays asiatiques et d'autres pays d'Amérique latine. [...] La mise en place de contrôles sur les entrées de capitaux peut permettre aux pays en développement de poursuivre un objectif de stabilité du taux de change tout en conservant une certaine autonomie de politique économique nationale » (16). Mais, selon ces auteurs, ce système de contrôle des entrées de capitaux ne convient pas à toutes les situations : « C'est une option utile, pourvu que le pays soit capable de mener une politique macroéconomique convenable. A cet égard, tous les pays ne ressemblent pas au Chili. Les contrôles, quelles que soient les modalités de leur mise en place, sont de peu d'utilité dans les pays où l'administration est inefficace ou corrompue. Ils ne peuvent se substituer à une politique macroéconomique équilibrée » (17). Son application aux pays émergents ne saurait donc en aucun cas être systématique. Ainsi, les organismes financiers internationaux doivent accepter des pratiques de crise, voire la restauration du contrôle des changes, lorsque cela s'avère nécessaire pour éviter que le marché financier soit déserté par les capitaux internationaux. La réaction de la Malaisie lui a permis, lors de la crise asiatique, de limiter les pertes et de stopper le mouvement de panique qui risquait de s'amplifier. Ce genre de parade doit être encouragé par le FMI et la Banque Mondiale - sous réserve de sa bonne utilisation. · Améliorer la transparence des centres off-shore Enfin, on ne peut pas lutter contre la mobilité spéculative des capitaux sans assainir le marché financier international. La déréglementation impose de faire régner la plus grande transparence sur la provenance des capitaux investis sur le marché international. Ainsi, les zones de non droit en matière financière que sont les paradis fiscaux, les centres off shore ou tous les moyens utilisés pour masquer la provenance des capitaux, doivent être combattus. En ce qui concerne les hedge funds, il faudrait avoir la possibilité de mieux mesurer leurs engagements, mais aussi ceux des banques engagées à leurs côtés. Il faut se prémunir d'une fragilisation du système bancaire en cas de pertes massives de ces fonds spéculatifs. Quoi qu'il en soit, tout cela suppose un accord international, une politique commune des Etats et des institutions financières. e) Promouvoir une taxation des mouvements de capitaux : La mobilisation autour de la taxation des mouvements de capitaux connaît, depuis quatre à cinq ans, un succès que les récentes crises systémiques n'ont fait qu'amplifier. La taxe Tobin, du nom de son inventeur, M. James Tobin, prix Nobel d'économie, qui forgea l'idée de cette taxe en 1971, est symbolique de la volonté de retrouver une maîtrise sur l'économie et d'apporter une réponse politique à l'anarchie des marchés. Son principe est simple : taxer, à un taux très bas, les mouvements de capitaux afin de renchérir considérablement le coût des mouvement de capitaux très fréquents, c'est-à-dire les mouvements uniquement spéculatifs. Les ressources dégagées par cette taxe seraient par ailleurs utilisées dans le cadre de l'aide au développement. Cette taxe a été beaucoup critiquée. Irréaliste, incapable d'avoir une influence sur les mouvements de capitaux, pénalisant sans discernement les investisseurs et les spéculateurs : tous les reproches lui ont été adressés. Mais son principal avantage n'est pas de renforcer l'efficience des marchés. Comme l'a souvent expliqué M. James Tobin, il s'agit, au contraire, de « mettre un grain de sable dans le mécanisme financier international », qui, emporté par la logique de sa rationalité technique, peut avoir des conséquences destructrices majeures sur les économies, les sociétés et les hommes. Cette taxe aurait ainsi l'avantage de redonner un peu de matérialité au système financier international, tout en assurant un rôle correcteur et redistributeur limité mais nécessaire. Dans un récent rapport d'information sur les mouvements internationaux de capitaux, MM. Gérard Fuchs et Daniel Feurtet, députés, dégagent ainsi la raison d'être de cette taxe : « A force d'analyser la taxe Tobin au regard de la rationalité économique, l'on oublie trop souvent que la politique a pour fonction de corriger les déséquilibres de tous ordres, y compris et surtout lorsque le marché ne peut opérer cette correction. Chacun conviendra ainsi que l'aménagement du territoire n'est pas non plus rationnel, qu'il génère des dépenses budgétaires coûteuses avec le maintien de services publics en zone rurale, mais que cette dépense est indispensable à la cohésion de la nation. La taxe Tobin procède d'un raisonnement analogue, au nom d'un volontarisme politique. L'objectif est triple : réduire la volatilité des changes, restituer des marges d'action aux pouvoirs publics, enfin dégager de nouvelles recettes » (18). Mise en place dans un seul pays, la taxe Tobin serait au mieux symbolique, au pire dommageable, certainement inefficace. Son instauration doit se faire dans un cadre international. Peut-être la France doit-elle prôner d'abord sa mise en _uvre au sein de la Communauté européenne. Un élargissement de cette taxe au niveau mondial est une revendication que la France, avec ses partenaires de l'Union, doit porter aussi dans les instances internationales. La crise asiatique a mis en lumière les insuffisances du système financier international. L'architecture de ce système doit évoluer. L'environnement mondial a changé : l'internationalisation des échanges et des flux de capitaux se traduit par une internationalisation des risques, par une augmentation de la vitesse de contagion des crises et par une ampleur sans cesse croissante des volumes de capitaux. Enfin, l'apparition de crises d'un nouveau genre, non plus liées à un risque souverain mais à un risque de marché, impose la mise en place de nouveaux moyens de prévention et de résolution des crises. La nouvelle architecture financière mondiale que nous proposons se décline en deux branches, obéissant chacune à une logique propre. La complémentarité de leurs missions leur assure une cohérence que le système financier international n'a pas à l'heure actuelle. · Le premier axe de réforme concerne les organismes financiers internationaux. L'impératif présidant à cette réforme est celui de la démocratisation et de la politisation des institutions. Cet impératif est dicté par une exigence éthique et politique. ¬ L'absence de participation des pays émergents aux prises de décisions du FMI et de la Banque Mondiale n'est plus acceptable. Il n'est pas normal que les pays du G 7 décident de la politique économique mondiale. Il faut donc rénover les processus de décision de ces organismes internationaux. ¬ La démocratisation de ces institutions doit se faire sur une base politique, et non pas purement économique. Il faut rompre avec la logique qui domine dans des organismes comme le G 7, où la légitimité des pays décideurs tient à leur poids économique. Il s'agit de faire émerger une instance de régulation économique mondiale, fixant les grands axes du développement de la planète, où l'importance de chaque pays, donc son influence sur les décisions, dépendrait de son poids politique et non de son poids économique. ¬ La France doit être à la pointe de ce combat. Nous suggérons que les autorités françaises organisent un grand forum mondial où gouvernements, parlements nationaux et représentants des organisations non gouvernementales, réunis en assemblée constituante, traceraient les plans de cette instance de régulation économique mondiale. · Le deuxième axe de réforme répond au principe de réalité. Face à l'incapacité naturelle du FMI de mobiliser immédiatement les capitaux nécessaires pour enrayer les crises de liquidité et éviter qu'elles dégénèrent en crises systémiques, il faut qu'une institution nouvelle soit mise en place. ¬ La libéralisation des capitaux, l'informatisation progressive des transactions et la création de nouveaux produits financiers, plus souples mais aussi plus risqués, a profondément modifié le marché international des capitaux. Désormais, des sommes sans commune mesure avec les capacités d'intervention d'un pays isolé, ou même du FMI, sont échangées chaque jour. ¬ Si une crise de liquidité se déclare, avec un risque de contagion rapide, l'intervention d'un seul acteur - État ou FMI - serait dérisoire. Il faut donc faire émerger un prêteur international en dernier ressort, qui puisse intervenir immédiatement et dans des proportions suffisantes. ¬ Ce prêteur international en dernier ressort pourrait prendre la forme d'un réseau de banques centrales, celles-ci pouvant mobiliser immédiatement les capitaux nécessaires. La composition de ce réseau doit être suffisamment souple pour répondre à toutes les crises. Une telle institution à géométrie variable, dont les membres seraient mobilisés au cas par cas, minimiserait les risques de crise systémique et leur propagation. La coordination de ce réseau de banques centrales pourrait reposer sur l'outil technique que constitue la Banque des règlements internationaux, qui a l'expérience de la coordination bancaire au niveau international. Cet instrument serait souple, car adapté à chaque crise, efficace et puissant, car adossé à des banques centrales capables de mobiliser des capitaux importants rapidement, et peu cher, les pays partenaires n'ayant pas à augmenter leurs dotations au FMI. Nous aurions donc d'un côté la démocratisation du système financier international, avec comme horizon l'émergence d'une instance de régulation économique mondiale, non plus aux mains de techniciens ou de banquiers centraux, mais aux mains des peuples du monde entier par le biais de leurs représentants élus. Nous aurions également, d'un autre côté, un outil efficace d'intervention, dont se doterait la communauté internationale pour enrayer les crises systémiques déstabilisantes. La complémentarité des deux branches assurerait la cohérence du dispositif et fournirait une réponse adaptée au contexte économique globalisé et aux aspirations démocratiques qui caractérisent ce début de vingt et unième siècle. I.- ASIE 1997-2000 : CRISES, RÉMISSION, REBOND Lorsque s'est ouverte au Japon, le 11 mai 1997, la trentième session de la Banque asiatique de développement, l'heure était à l'optimisme. Les représentants des États membres de l'institution célébraient trente ans de croissance élevée, marquée par une décennie 1980-1990 exceptionnelle où le PIB s'était accru de 9% par an en moyenne. Il est vrai que les économies asiatiques semblaient entraînées par un élan irrésistible, sous l'impulsion de huit pays dont le décollage économique s'était étagé en trois vagues successives : le Japon, suivi des « Tigres » ou « Dragons » (Hong Kong, Corée du sud, Singapour et Taïwan) puis, à partir des années 1980, de l'Indonésie, de la Thaïlande et de la Malaisie. Ensemble, ces huit pays ont connu un taux de croissance deux fois plus élevé que celui des pays industrialisés et des autres pays asiatiques, trois fois plus élevé que celui de l'Amérique latine et près de cinq fois plus élevé que celui de l'Afrique sub-saharienne. De plus, le niveau de vie par habitant s'est également inscrit dans une dynamique de rattrapage, similaire à celle observée en Europe occidentale pendant les « Trente Glorieuses ». TAUX DE CROISSANCE DU PNB RÉEL PAR HABITANT (en % par an)
Source : Nicholas Crafts, « East Asian Growth Before and After the Crisis », L'augmentation du niveau de vie en termes réels ne se limite pas à une moyenne arithmétique qui pourrait être trompeuse : les gouvernements ont, en effet, mis en _uvre des politiques visant à répartir largement les fruits de la croissance. A l'exception de la Corée du Sud et de Taïwan, où la distribution du revenu était déjà sensiblement égalitaire, l'inégalité dans la distribution du revenu a décru plus vite que dans les autres pays en voie de développement. Ainsi, en 1993, la Banque mondiale estimait que les quatre dixièmes de la population indonésienne percevant les revenus les plus faibles recevaient au total 21% du revenu national, soit un pourcentage égal à celui observé en Suède ! PART DU REVENU NATIONAL PERÇUE PAR LES QUATRE PREMIERS DÉCILES DE LA POPULATION AU DÉBUT DES ANNÉES 90
D'après Banque mondiale, Economic Growth in East Asia, Economic Policy Forum L'amélioration des indicateurs sociaux a été la conséquence logique de cette croissance forte et habilement répartie. Selon la Banque mondiale, l'espérance de vie dans les huit économies les plus dynamiques est passée de 56 ans en 1960 à 71 ans en 1990. Dans ces mêmes économies, la proportion de personnes vivant dans la « pauvreté absolue », c'est-à-dire ne bénéficiant pas de prestations aussi nécessaires que l'accès à une eau de bonne qualité, la sécurité alimentaire ou la jouissance d'un toit, a chuté de 58% en 1960 à 17% en 1990 en Indonésie et de 37% à 5% en Malaisie sur la même période. Parallèlement, la mortalité infantile est passée, en Indonésie, de 118 décès pour 1000 naissances d'enfants vivants à 56 décès pour 1000 naissances entre 1970 et 1990 (19). Enfin, les succès incontestables des industriels asiatiques dans de nombreux créneaux, de plus en plus riches en contenu technologique (construction navale, mais aussi semi-conducteurs et équipements informatiques), ont accrédité l'idée d'une meilleure efficacité des systèmes productifs locaux sur leurs homologues occidentaux, désormais placés sur la défensive. N'avions nous pas vécu, en France, un psychodrame national lorsqu'en 1996, un gouvernement, normalement censé garantir les intérêts du pays, avait proposé de vendre au chaebol (conglomérat) coréen Daewoo, pour un franc symbolique, un leader mondial, mais français, de l'électronique ? Dans ce contexte, le rapport élaboré par la Banque asiatique de développement à l'occasion de sa session annuelle de 1997, visant à éclairer les tendances économiques et sociales de la zone pour les trois décennies à venir, estimait bien naturellement qu'une croissance robuste prévaudrait en Asie, et plus spécialement en Asie du sud et du sud-est, sur l'ensemble de cette période (20). Grâce à la globalisation et au progrès technique, la qualité de vie des populations s'améliorerait et les groupes les moins avantagés Sans négliger de détailler les conditions nécessaires pour que l'Asie profite des opportunités nouvelles offertes par la globalisation et le progrès technique (21), l'étude estimait que, d'ici à 2020, 30% de la population à faible revenu d'aujourd'hui auraient constitué une classe moyenne, dont les préoccupations seraient l'éducation secondaire et supérieure de ses enfants, le niveau des services publics, les retraites et la politique de santé en faveur des personnes âgées. L'ensemble des pays asiatiques semblait donc devenu une unique zone émergente, gommant leurs différences et entraînée par une dynamique commune sur la voie du progrès. De plus, la résistance offerte par plusieurs de ces pays aux turbulences financières issues de la crise mexicaine de l'hiver 1994-1995 suggérait que tout déraillement était improbable. Mais l'année 1997 restera plutôt dans l'histoire de l'Asie comme celle des illusions perdues. Une crise de change d'une rare violence a laminé les parités des monnaies coréenne, indonésienne, malaisienne, philippine et thaïlandaise, traduisant une défiance extrême des marchés financiers à l'égard des pays concernés. La crise financière, qui a suivi un déroulement saccadé, en plusieurs étapes, a entraîné une forte récession dans l'économie réelle des cinq pays touchés et s'est par ailleurs étendue à l'ensemble des marchés mondiaux de capitaux. Elle a donné lieu à des interprétations fortement divergentes, qui apparaissent, avec le recul, plus complémentaires que concurrentes. C'est pourquoi le rebond ou, à défaut, la rémission observés depuis 1999 doivent être mis à profit pour approfondir les réformes engagées plutôt que pour en contester la pertinence. Il n'est pas superflu de revenir sur le déroulement des événements qui ont secoué les marchés de capitaux à partir de 1997. Non pas que, le temps passant, le voile de l'oubli recouvre et éloigne inexorablement ce qui faisait, à l'époque, les grands titres de la presse. Mais une approche plus analytique de la chronologie, que donne seul le recul, permet de mettre en évidence les tendances de la crise et d'en appréhender les mécanismes. Par ailleurs, des informations nouvelles, recueillies, après les faits, dans le cadre d'études ou d'enquêtes auprès des acteurs du drame asiatique, apportent des éclairages complémentaires aux analyses qui pouvaient être effectuées sur le moment, au c_ur de la tourmente. Fixer un début à la « crise asiatique », c'est déjà, dans une certaine mesure, avancer une explication, ou tout au moins prendre parti sur la hiérarchie des tensions qui amènent à la crise et des facteurs qui la déclenchent. Dans l'enchaînement improbable de nécessités et de hasards qui a conduit au déferlement de 1997, un événement apparaît pourtant clairement comme ayant une signification particulière. Lorsque les autorités thaïlandaises décident, le 2 juillet 1997, de dévaluer leur monnaie, le bath, c'est une page de l'histoire monétaire (contemporaine) qui se tourne en Asie du sud-est. Le gouvernement thaïlandais reconnaît explicitement que le régime de change mis en _uvre jusqu'à cette date est devenu incompatible avec les conditions économiques intérieures et avec les « sentiments » des marchés. La dévaluation du bath entraîne, à la surprise générale, une spirale de dépréciation qui frappe peu à peu les monnaies des autres pays asiatiques. Il y a donc un « avant » et un « après 2 juillet » qui se distinguent sans ambiguïté, mais ne sont pas pour autant isolés l'un de l'autre. En effet, les signes annonciateurs de la crise s'étaient multipliés dans les mois précédents et la rupture n'était plus qu'une question de temps. Si le 2 juillet 1997 marque bien l'ouverture du drame asiatique, la période précédente aura vu frapper les trois coups. Mais qui pouvait les entendre ? 1.- 1996-1997 : on frappe les trois coups · Depuis 1996, la Thaïlande était considérée comme un pays vulnérable. Alors que la croissance avait atteint en moyenne près de 10% par an entre 1985 et 1995, elle s'est ralentie sensiblement en 1996, pour s'établir à 5,9%. En effet, l'économie était progressivement entrée dans un état de surchauffe, qui avait vu notamment le taux d'inflation progresser de 3,4% en 1993 à 5,1% en 1994 puis 5,8% en 1995, taux le plus élevé de la décennie. La banque centrale avait commencé à resserrer sa politique monétaire à la mi-1995, afin de ralentir l'activité. Ce faisant, elle avait mis en place des mesures destinées à pallier l'effet sur la liquidité de l'économie des entrées supplémentaires de capitaux extérieurs attirés par une rémunération plus élevée et par la politique de stabilité du taux de change. Ces mesures consistaient notamment en une augmentation des réserves obligatoires sur différentes opérations de court terme (dépôts en baths de moins d'un an de non-résidents auprès des banques commerciales, ressources extérieures de moins d'un an des institutions bancaires, non bancaires ou off shore, etc.). De même, des émissions de bons par la banque centrale visaient à retirer des liquidités du marché monétaire local (août 1995). Le ralentissement de la demande interne, amorcé en 1995, s'est conjugué, en 1996, à un ralentissement de la demande extérieure adressée à la Thaïlande. Alors que les exportations avaient affiché un taux annuel moyen de croissance de 18% en valeur entre 1990 et 1995, l'année 1996 a vu un renversement de tendance spectaculaire, les exportations chutant de 1,9% en valeur. Pour leur part, les importations stagnaient, après une véritable explosion en 1995 (+ 31,9%). En conséquence, le déficit commercial, qui avait déjà atteint le niveau inégalé de - 8,7% du PIB en 1995, s'est encore accru en 1996 pour atteindre - 8,9% du PIB. Pour sa part, la balance des transactions courantes se stabilisait à un niveau dégradé : - 7,9% du PIB en 1996 comme en 1995. « En un sens, il est naturel qu'un pays émergent avec des besoins en investissements productifs et en infrastructures importants affiche un déficit courant structurel, durant la phase d'industrialisation et de forte croissance » (22). Parallèlement, les perspectives budgétaires s'assombrissaient sensiblement, puisque les premiers résultats relatifs au mois de janvier 1997 laissaient présager l'apparition d'un déficit, ce qui ne s'était jamais produit depuis le début de la décennie. Ainsi, la Thaïlande abordait l'année 1997 dans des conditions macro-économiques moins favorables que les années précédentes. Les investisseurs internationaux commençaient également à s'inquiéter de l'endettement extérieur du pays, qui n'est soutenable à moyen terme que si la croissance des exportations en permet le service et le remboursement. Par ailleurs, les premiers craquements apparaissent dans le système financier. En janvier 1997, la première institution financière thaïlandaise, Finance One, fait part de difficultés dues aux opérations non performantes de promoteurs immobiliers. Le même mois, la rumeur assure que le promoteur Sompransong serait proche du défaut de paiement sur sa dette en devise. Ce défaut est confirmé le 5 février 1997. L'idée d'une dévaluation du bath commence à être largement répandue au sein des économistes et analystes de marché. Le mois de février 1997 voit la première alerte sérieuse. Le 14 février, l'agence de notation Moody's annonce qu'elle place sous surveillance, avec implication négative, la dette souveraine à long terme de la Thaïlande. Une forte pression vendeuse se développe sur le bath, contenue par une augmentation des taux d'intérêt. La rumeur voit derrière cette spéculation la main des hedge funds, y compris ceux gérés par M. George Soros (23). Cependant, les signaux sont manifestement brouillés, puisque, le 1er mars, le quotidien Le Monde estime que « l'homme d'affaires George Soros spécule sur la santé du bath ». Le journal précise à cet égard que « même George Soros serait intervenu, à la mi-février, dans la bataille du bath, la monnaie thaïlandaise victime d'une dure crise de confiance. Mais le célèbre spéculateur aurait fait le contraire de ce que l'on pensait : jouer la non-dévaluation du bath tout en laissant croire qu'il faisait le contraire. Et il y aurait gagné puisque le gouvernement thaïlandais ne manifeste, pour le moment, aucun penchant pour une dévaluation [...] ». Au mois de mars 1997, les marchés thaïlandais sont à nouveau agités. Le 4 mars, le banque centrale de Thaïlande annonce que la société Finance One doit être fusionnée avec la douzième banque commerciale du pays, afin de résoudre ses problèmes de liquidité. Parallèlement, dix autres établissements financiers sont priés de renforcer leurs fonds propres et leurs provisions pour créances douteuses, touchant surtout au secteur de l'immobilier. La chute de la Bourse de Bangkok amène les autorités à suspendre, dès le 6 mars, la cotation des titres financiers et bancaires. Face au trouble des marchés locaux, le gouvernement annonce, le 10 mars qu'il compte émettre pour 3,9 milliards de dollars de bons du Trésor afin d'acheter aux établissements en difficulté une partie des prêts douteux assis sur des actifs immobiliers. Les jours passant, le projet d'adossement de Finance One disparaît de l'agenda gouvernemental, ainsi que le projet de rachat des prêts douteux. Cependant, le marché des changes ne réagit pas à ces atermoiements internes. En revanche, le bath est confronté à une violente attaque à la mi-mai 1997. Selon une étude conduite par le FMI auprès de nombreux intervenants de marché, une rumeur commence à circuler, dans la soirée du 7 mai, sur la constitution d'une forte position vendeuse bath contre dollar par la branche de Hong Kong d'une grande banque thaïlandaise (24). Les opérateurs de marché en déduisent que les compagnies financières et les entreprises thaïlandaises, dont le financement extérieur devient de plus en plus difficile compte tenu de la détérioration de leur qualité d'emprunt, cherchent frénétiquement à acquérir des dollars. Plus tard dans la soirée, il apparaît que la Banque de Thaïlande a contacté directement plusieurs banques commerciales ou banques d'affaires étrangères pour leur vendre à terme des dollars contre baths et défendre ainsi la parité de sa monnaie. Le lundi 12 mai, la présence de la Banque de Thaïlande sur le marché est à nouveau signalée, celle-ci renouvelant sa défense du bath par le biais de ventes à terme de dollars contre baths. Entre les deux journées du 12 et du 13 mai 1997, la Banque de Thaïlande aurait ainsi engagé ses réserves de change à hauteur de 5 milliards de dollars. Le mercredi 14 mai, les attaques spéculatives repartent de plus belle et la Banque de Thaïlande dépense en quelques heures près de 10 milliards de dollars, toujours sous forme de ventes à terme. Il convient de remarquer que cette défense du bath par le biais de ventes à terme a pour corollaire la constitution, auprès des contreparties de la Banque de Thaïlande, de positions vendeuses à terme sur le bath. Or, la Banque de Thaïlande ayant, dans les premiers jours de sa défense, refusé de faire monter les taux d'intérêt, le différentiel de taux d'intérêt entre le bath et le dollar est resté faible (3% environ). Ceci permettait aux contreparties de financer à faible coût (1% environ) l'emprunt de baths destinés à être vendus immédiatement sur le marché, contribuant ainsi à affaisser la parité de cette monnaie, donc à matérialiser un gain à la fois sur le remboursement futur des baths empruntés et sur le dénouement de la position vendeuse à terme. Dans un contexte de défiance envers la devise thaïlandaise et la perspective d'une réévaluation apparaissant hautement improbable, cette tactique a pu être qualifiée par le FMI de « pari à sens unique ». En fait, les marchés estiment que la Banque de Thaïlande ne peut pas utiliser l'arme des taux d'intérêt pour contrer les pressions vendeuses sur sa monnaie. La situation tendue du secteur non bancaire est le facteur limitant : les compagnies financières sont plus dépendantes que les banques du marché monétaire et sont plus sensibles que celles-ci au niveau des taux. Divers éléments suggèrent, à cette date, que l'attaque de février 1997, qui a été combattue par un relèvement des taux d'intérêt, a détérioré la qualité de bilans de nombreuses compagnies financières. La Banque de Thaïlande ne pourrait donc plus compter désormais que sur ses réserves de change. De fait, le 15 mai, face à l'épuisement de ses réserves de changes, la Banque de Thaïlande se décide à abandonner une défense qui l'a amenée à mobiliser à terme plus de 23 milliards de dollars, chiffre non connu des opérateurs de marché à cette date. Elle fait monter les taux d'intérêt et institue un contrôle des capitaux qui sépare le marché domestique du marché off shore. L'objet des contrôles de capitaux est de limiter l'accès des spéculateurs au bath. Immédiatement, le coût de constitution des positions vendeuses sur le bath s'accroît fortement et les opérateurs se précipitent pour acheter du bath afin de couvrir leurs positions : les réserves de change de la banque centrale augmentent à nouveau tandis que la parité du bath est préservée. Selon le FMI, les pertes des contreparties de la banque centrale dans les contrats à terme « vente de dollars / achat de baths » auraient été comprises en un et 1,5 milliard de dollars sur la période comprise entre la mi mai et la fin juin 1997 (25). Parallèlement, une intervention conjointe d'autres banques centrales (autorités monétaires de Singapour et de Hong Kong, banques centrales de Malaisie et d'Indonésie) contribue à la stabilisation du taux de change. Pourtant, les premiers signes d'une contagion régionale apparaissent : entre le 9 mai et le 16 mai, le taux d'intérêt interbancaire au jour le jour passe de 14% à 16% pour la roupie indonésienne ; le même taux passe de 7% à 19% pour le ringgit malais et de 11% à 20% pour le peso philippin. Au début du mois de juin, un reflux des taux au jour le jour était observé sur ces trois monnaies, sans pour autant que celles-ci retrouvent leur niveau d'avant la crise. · Au début de l'année 1997, le deuxième « homme malade » de l'Asie - hors le Japon, englué dans une crise qui dure depuis 1990 - est indubitablement la Corée du sud. Entrée quelques semaines auparavant au sein du « club » des économies industrialisées que constitue l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE), la Corée du Sud est confrontée en janvier 1997 à une crise sociale importante, qui se traduit par des grèves et des manifestations violentes. Les salariés refusent une loi adoptée par le Parlement à la fin du mois de décembre 1996, qui instaure une plus grande flexibilité du travail et repousse de plusieurs années l'établissement de la liberté syndicale. Ainsi, la loi n'autorise la création de nouveaux syndicats qu'à compter de 2002 et ne prévoit de légaliser qu'en 2000 la Confédération coréenne des syndicats (KCTU, créée en 1995). Par ailleurs, elle autorise les entreprises à recourir à des travailleurs intérimaires en cas de grève ; elle ne reconnaît pas le droit d'association syndicale dans la fonction publique ; elle fait de la durée hebdomadaire du travail (44 heures) une valeur moyenne et non plus une valeur maximale. Mais ce qui préoccupe les opérateurs des marchés financiers n'est pas l'agitation sociale dans un pays qui est habitué à des luttes syndicales « musclée ». Les informations relatives à la santé du secteur productif sont autrement plus inquiétantes. Au début du mois de janvier 1997, les banques créancières du groupe sidérurgique Hanbo Steel refusent le renouvellement de lignes de crédit à court terme représentant plus de 350 millions de dollars tant que le fondateur et président honoraire du groupe, qui contrôle avec sa famille 46% du capital, n'aurait pas accepté par écrit une supervision de sa gestion. Face au refus du président et à l'impossibilité de trouver des sources de financement complémentaires, le groupe Hanbo fait défaut sur le remboursement de dettes venant à échéance, le 23 janvier 1997, et il est déclaré en faillite. Cette deuxième faillite d'un chaebol important (le quatorzième du pays par le chiffre d'affaires) (26) laisse les 45 banques créancières avec un arriéré de dettes se montant à environ 5,8 milliards de dollars. Il déclenche un scandale et suscite des interrogations renouvelées sur la santé du système bancaire coréen. Au chapitre du scandale, les liens supposés entre le chaebol et le fils du président coréen sont dénoncés : selon les détracteurs du président, ils auraient conduit les banques à accorder à Hanbo des financements de complaisance. La revue Asiaweek indique que « les partis d'opposition suspectent Hanbo d'avoir perçu des prêts s'élevant à 5.000 milliards de wons grâce à un soutien politique important. Le second fils du président Kim [Young Sam], âgé de 39 ans, était réputé être un ami de Bo Keun, 33 ans, troisième fils de Chung [le président de Hanbo] et n° 2 au sein du groupe. La rumeur prétend également que le jeune Kim [Hyun-chul, fils du président coréen Kim Young Sam] a exercé des pressions sur les banques pour qu'elles prêtent au chaebol » (27). La justice est saisie de l'affaire et procède à des investigations qui aboutissent, notamment, à l'arrestation du fils du président coréen, le 17 mai 1997, et à son inculpation pour trafic d'influence. Les responsables bancaires sont également sur la sellette. Le 5 février, les présidents de la Korea First Bank et de la Cho Hung Bank sont arrêtés pour avoir reçu des pots de vin du président et fondateur du groupe Hanbo, également placé sous les verrous. Le lendemain, les président des deux autres banques créancières sont interrogés par la justice, soupçonnés d'irrégularités dans l'octroi de prêts au sidérurgiste. Dans le domaine économique, la santé du secteur bancaire et le poids des créances douteuses sont désormais sur le devant de la scène. Les prêts des principaux créanciers de Hanbo ont été consentis sans garanties suffisantes et sont pratiquement irrécupérables. Selon le journal Le Monde, « Korea First Bank est la plus vulnérable, avec des créances s'élevant à 1,3 milliard de dollars, soit 60% du montant de ses avoirs : il lui faudra plus de dix ans pour éponger une telle ardoise » (28). Cependant, les difficultés ne se limitent pas à la Korea First Bank : « les sept plus grandes [banques] ont enregistré en 1996 des pertes s'élevant à 1,1 milliard de dollars. En l'absence d'évaluation officielle, les mauvaises dettes étaient estimées, avant l'affaire Hanbo, à quelque 24 milliards de dollars, soit 8% du total des prêts bancaires. Les banques ne doivent déclarer une créance douteuse que six mois après le versement du dernier intérêt. Sur ces 24 milliards, 3 milliards de dollars étaient déjà considérés comme irrécupérables au milieu de l'année dernière et beaucoup d'établissements sont en quasi-faillite » (29). Après Hanbo, un nouvel acteur important de la sidérurgie coréenne est déclaré en cessation de paiement le 19 mars 1997. Sammi Steel est alors le 26e groupe coréen et le troisième producteur mondial d'aciers spéciaux. Il apparaît que le groupe s'est lancé, dans les années 90, dans une politique d'acquisitions assez aventureuse et éloignée de son métier principal (30). La faillite de Sammi Steel fragilise un grand nombre de sous-traitants et dégrade à nouveau la qualité du portefeuille de prêts des banques coréennes : le montant des dettes du groupe s'établit à 2,2 milliards de dollars. Afin d'éviter une débâcle boursière sur les valeurs bancaires, la banque centrale de Corée est obligée d'annoncer qu'elle compte apporter une aide substantielle à la Korea First Bank en souscrivant des obligations émises par celle-ci à hauteur d'un milliard de dollars. Et tandis que le won continue de s'éroder lentement sur le marché des changes (31), d'autres signes de fragilité apparaissent. Le constructeur automobile Kia, troisième constructeur coréen, huitième chaebol national par la taille, connaît, à partir d'avril, des difficultés pour respecter ses échéances et faire face au paiement des intérêts. Le groupe textile Dainong, endetté à hauteur de 9 milliards de dollars, doit être soutenu par ses créanciers pour éviter un dépôt de bilan, en mai 1997. Cependant, lorsque, le 15 juillet 1997, les banques coréennes organisent un sauvetage d'urgence de Kia, incapable d'assumer la charge de sa dette qui s'élève à près 60 milliards de dollars, l'attention s'est détournée de la Corée pour se porter à nouveau vers le sud-est asiatique. 2.- Acte I : une tourmente monétaire balaie l'Asie du sud-est (troisième trimestre 1997) Après de nouvelles interventions le marché, semble-t-il, dans la journée du 2 juillet 1997, le gouvernement et la banque centrale de Thaïlande annoncent le même jour que le bath serait désormais soumis à un « flottement contrôlé ». Une « mission d'assistance technique » du Fonds monétaire international et de la banque centrale d'Australie doivent se rendre à Bangkok pour conseiller le gouvernement. Pour l'heure, il n'est pas question de solliciter auprès du FMI un programme de soutien financier en bonne et due forme. La première réaction des marchés financiers est favorable : la Bourse de Bangkok gagne 8% le lendemain de l'annonce et 8,5% le surlendemain. Selon le FMI, « les investisseurs étrangers étaient signalés comme payant des surcotes substantielles sur les titres dont l'achat leur était autorisé » (32). Les commentaires des analystes financiers font preuve d'appréciations nuancées. Ainsi, pour JP Morgan, « le flottement libre ne sera pas sans causer quelque souffrance. Il ne résout pas du jour au lendemain les problèmes de liquidité de la Thaïlande, les difficultés de son secteur financier ni les immenses besoins en capitaux du royaume. Néanmoins, les derniers événements mettent en lumière la détermination officielle à résoudre la crise et sont de bon augure pour les perspectives à long terme du royaume » (33). Pourtant, dans la journée, le bath chute de 15% sur le marché des changes domestique et de 20% sur le marché off shore. L'enquête menée par le FMI auprès des acteurs de marché (34) indique que l'abandon du lien quasi fixe entre le bath et le dollar a suscité des anticipations de dépréciation auprès des agents domestiques, qui s'étaient exposés au risque de change, notamment par le biais d'un endettement en devises sans couverture sur les marchés dérivés. Ces entreprises domestiques auraient alors acheté massivement des dollars sur le marché au comptant, concourant par là même au mouvement de dépréciation du bath dont elles cherchaient à se protéger. En revanche, aucune intervention proprement spéculative contre la monnaie thaïlandaise n'a pu être détectée au moment de la dévaluation : les opérateurs qui avaient pris position, dans les semaines précédentes, sur une dépréciation de la monnaie ont simplement constaté leurs gains. La question est alors posée de savoir si les autres monnaies de la région vont se trouver touchées, elles aussi, par une vague de dépréciation. Avec le recul, il apparaît que le sentiment général confirme l'idée d'une nécessaire répercussion régionale de la dévaluation du bath. Trois motivations principales peuvent être dégagées à l'appui de cette appréciation : - l'abandon par la Thaïlande du lien avec le dollar montre que ce « pilier » des politiques de change mises en _uvre dans la région n'est plus tabou. Dès lors qu'un premier pays a pris l'initiative de remettre en question le tabou, il n'est pas exclu que ses partenaires cherchent, eux aussi, à redonner quelque autonomie à leur politique monétaire, en renonçant de leur plein gré à la stabilité du taux de change. C'est, par exemple, l'opinion développée par T. Condon, économiste de change chez Morgan Stanley Dean Witter : « je ne pense pas qu'aucun de ces trois pays [Philippines, Indonésie et Malaisie] sera forcé de dévaluer sa monnaie à cause d'un effet de contagion en provenance de Thaïlande. Au contraire, les développements récents en Thaïlande provoqueront une réappréciation des mérites de la politique visant à maintenir un lien étroit avec le dollar américain » (35) ; - la baisse du bath redonne un avantage compétitif aux produits thaïlandais, que les autres pays pourront souhaiter réduire en diminuant à leur tour la parité de leur monnaie. S'exprimant plus spécifiquement sur le niveau relatif du bath et du peso, M. Bhaskaran, économiste chez SocGen Crosby Securities à Singapour, estimait ainsi qu'une dévaluation modeste (10%) du peso était probable, mais qu'elle pourrait être supérieure en fonction des mouvements observés sur le bath : « les produits thaïlandais sont aujourd'hui moins chers sur les marchés extérieurs, prenant vraisemblablement l'avantage sur des produits philippins similaires ». Constatant que les facteurs de production étaient désormais moins chers en Thaïlande, N. Brooks, analyste chez Peregrine Securities à Singapour, juge pour sa part que « pour rester concurrentiels, les autres pays asiatiques voudront faire apparaître qu'ils agissent pour rester attractifs aux yeux des investisseurs étrangers » (36) ; - en revanche, les économistes de JP Morgan ne retiennent pas l'hypothèse d'une réaction en chaîne de dévaluations compétitives. Pour eux, « le principal moteur derrière les évolutions récentes du marché n'est rien d'autre qu'une aversion accrue des investisseurs au risque à la suite de la dévaluation du bath. Il n'y a pas de signe de détresse économique aiguë qui appellerait d'autres dévaluations dans le reste de l'ASEAN » (37). En effet, la spécialisation du secteur productif est assez différente entre la Thaïlande, les Philippines et l'Indonésie, d'une part, et, d'autre part, la répartition géographique des importations et exportations est également quelque peu différente pour les deux pays qui ont les spécialisations les plus proches, à savoir la Thaïlande et les Philippines. Comme l'avaient prévu la plupart des observateurs - mais pas nécessairement pour les mêmes raisons - le mouvement de baisse s'étend aux autres monnaies de la région. Le 3 juillet, la banque centrale des Philippines se voit obligée de relever le taux au jour le jour de 15% à 24%, après avoir dépensé la veille, plus d'un milliard de dollars pour défendre le peso. Le 8 juillet, la banque centrale de Malaisie doit intervenir vigoureusement sur le marché pour soutenir le cours du ringgit. Le 11 juillet, la banque centrale des Philippines indique que la valeur du peso sera désormais fixée par le marché. Le flottement de la monnaie intervient alors que le taux d'intérêt au jour le jour a atteint 32%. La défense du peso ayant cessé, celui-ci se déprécie de 11% contre le dollar, alors que la bourse de Manille gagne 7,6%. Les investisseurs saluent en effet la décision des autorités philippines, qu'ils jugent conforme aux besoins de l'économie. Les pressions se font alors plus fortes sur le ringgit malais et la banque centrale de Malaisie est obligée de porter le taux au jour le jour à 50%. Elle abandonne la défense de sa monnaie le 14 juillet. Le même jour, le FMI décide de prolonger jusqu'au 31 décembre 1997 une facilité de crédit de 650 millions de dollars ouverte aux Philippines en 1994, qui aurait du expirer le 23 juillet 1997, et en augmente le montant pour le porter à 1,1 milliard de dollars. La seconde quinzaine de juillet 1997 ne connaît pas de trêve. Le Dr. Mahathir, Premier ministre de Malaisie, s'en prend alors aux spéculateurs dans des interventions retentissantes. Il récidive le 26 juillet en désignant nommément le financier George Soros comme responsable des attaques contre le ringgit. Incapable de rétablir la confiance des marchés, la Thaïlande fait, de son côté, officiellement appel au Fonds monétaire international le 28 juillet. Pour sa part, la banque centrale d'Indonésie n'a pas été, jusqu'ici, sérieusement inquiétée. Dans un mouvement qui est, à l'époque, jugé habile, elle décide même d'élargir de 8% à 12% la bande de fluctuation de sa monnaie autour de son cours cible moyen, le 11 juillet. De tels élargissements sont généralement effectués sous la contrainte des marchés et se présentent comme des dévaluations qui ne veulent pas dire leur nom. Au contraire, en agissant ici de façon préventive, la Banque d'Indonésie vise à aggraver l'incertitude sur le niveau souhaité de la parité de la roupie et à décourager ainsi les prises de position spéculatives contre sa monnaie. Dans un premier temps, cette décision est efficace : les achats de roupies par les banques et les entreprises indonésiennes propulsent le taux de change dans la partie supérieure de la bande de fluctuation (38). Mais rapidement, les investisseurs non résidents s'inquiètent de la vulnérabilité de la roupie à un renversement du comportement des investisseurs locaux. D'autant que les opérateurs de marché sont désormais plus attentifs à la sensibilité des bilans des entreprises domestiques au risque de change : la ruée des entreprises thaïlandaises vers le dollar pour couvrir leurs engagements en devises n'est pas si loin... Un courant vendeur se développe donc peu à peu sur la roupie, initié par les banques d'affaires et banques commerciales internationales. Devant le début d'érosion de la roupie, les banques commerciales indonésiennes renversent le sens de leurs opérations sur le marché des changes, dans un intervalle de deux jours seulement. Elles sont suivies peu après par les entreprises domestiques. Ce revirement conduit à une forte aggravation de la pression vendeuse sur la roupie, malgré les interventions de la banque centrale : - d'une part, banques et entreprises cherchent à solder les positions à terme qu'elles avaient prises auparavant ; - d'autre part, par un réflexe désormais bien connu, elles cherchent à couvrir leurs engagements en devises. Les réactions des autorités nationales et de la communauté financière internationale ne parviennent pas à enrayer le mouvement général de baisse des monnaies. Le 5 août, le gouvernement thaïlandais annonce les grandes lignes du plan qui est en cours de négociation avec le FMI : austérité budgétaire et restructuration du secteur financier en sont les deux chapitres principaux ; en particulier, le gouvernement s'engage à suspendre les opérations de 42 compagnies financières, en plus des 12 qui sont déjà suspendues depuis la fin du mois de juin. Le 11 août, suite à une réunion d'urgence organisée à Tokyo par le FMI, celui-ci annonce la mise en place d'un programme international de soutien financier à la Thaïlande, avec le concours de plusieurs donateurs bilatéraux, de la Banque mondiale et de la Banque asiatique de développement. LE « PAQUET FINANCIER » DU 11 AOÛT EN FAVEUR DE LA THAÏLANDE (en milliards de dollars)
Le 14 août, l'Indonésie abandonne le système de change contrôlé et laisse flotter la roupie, qui se déprécie immédiatement de 4%. Le 15 août, le dollar de Hong Kong est attaqué, mais un relèvement des taux d'intérêt (qui passent de 5,5% à 8% environ) casse la spéculation. Il est vrai que, le 16 août, une « source bien informée » située à Pékin laisse entendre que la Chine serait prête à dépenser 50 milliards de dollars pour la défense de la parité du dollar de Hong Kong. Mais, la même semaine, les autorités thaïlandaises surprennent à nouveau les marchés. Conformément aux engagements pris devant le FMI, elles publient pour la première fois le niveau de leurs engagements à terme en matière de réserves de change. Les opérateurs apprennent ainsi que la Banque de Thaïlande dispose de 30,0 milliards de dollars, mais que 23,4 milliards de dollars ont fait l'objet de ventes à terme, dont 8,6 milliards de dollars avec des contreparties domestiques et 14,8 milliards de dollars avec des contreparties non résidentes. Considérant de façon intempestive ces ventes à terme comme devant s'imputer sur le montant actuel des réserves (39), les marchés concluent que la Banque de Thaïlande ne dispose que de 6,6 milliards de dollars de réserves utilisables. Dans ces conditions, lorsqu'il sera effectivement déboursé, le « paquet financier » organisé par le FMI ne pourra porter leur niveau qu'à 23 milliards de dollars environ, soit le montant auquel le gouvernement s'est engagé à stabiliser ces réserves. Ainsi, estiment les marchés, la Thaïlande n'a aucune marge de man_uvre pour financer son déficit courant - dont on prévoit toujours qu'il atteindra plusieurs points de PIB en 1997. La seule possibilité de rééquilibrage du compte des transactions courantes réside donc dans une dépréciation supplémentaire du bath. Ce raisonnement relance le processus de dépréciation généralisée des monnaies de la zone. Les conditions de la confiance s'évanouissent peu à peu : en Thaïlande, l'affaiblissement du gouvernement fait douter de la détermination politique à mettre en _uvre le programme d'ajustement du FMI ; en Indonésie, des doutes commencent à apparaître sur la solidité du secteur financier et sur la pertinence de la politique suivie à cet égard par la banque centrale (40) ; en Malaisie, des signaux contradictoires sont envoyés par le gouvernement, qui ne semble pas pressé de renoncer à divers projets coûteux, alors qu'il l'a annoncé publiquement son intention de le faire. Les prêteurs internationaux poursuivent leur politique de repli et continuent à vendre les monnaies en déroute. C'est l'époque difficile où le Dr. Mahathir estime, lors de la conférence annuelle du FMI et de la Banque mondiale, à Hong Kong (septembre 1997), que les échanges de devises sont une activité immorale et que la spéculation devrait être interdite. Convié à la même conférence, le financier George Soros répond que « le Dr. Mahathir est une menace pour son propre pays » (41). L'annonce par les autorités indonésiennes, le 8 octobre, d'orientations politiques susceptibles de rassurer les marchés et de montrer la détermination du gouvernement a un effet apaisant pendant quelques jours. D'ailleurs, le sérieux de cette annonce est confirmé par le fait que le gouvernement demande officiellement un soutien au FMI et indique qu'il fera également appel à la Banque mondiale et à la Banque asiatique de développement. Enfin, l'opération de séduction des marchés utilise les leviers psychologiques, puisque le doyen de l'équipe qui avait lutté avec succès contre la grande crise de 1985 reprend du service comme conseiller économique du président, avec pour mandat de « mettre en _uvre toutes les actions nécessaires en coordination avec les agences gouvernementales ».
Mais la défiance reste vive. Le 14 octobre, les autorités thaïlandaises publient leur plan - très attendu - de restructuration du secteur financier, dont la teneur est accueillie favorablement. Cependant, les marchés s'interrogent sur les conditions réelles de mise en _uvre des mesures annoncées (42). Le 17 octobre, la Malaisie présente son budget pour 1998, qui déçoit les opérateurs : ils déplorent l'insuffisance des réductions de dépenses et l'effet globalement neutre des mesures fiscales. Pourtant, selon les économistes de Morgan Stanley Dean Witter, le budget exercerait un impact négatif équivalent à 3% du PIB (43). En revanche, les coupes budgétaires décidées par le gouvernement thaïlandais sont unanimement célébrées : conjuguées à celles déjà décidées en août, elles équivalent à près de 3,5% du PIB. Les analystes de JP Morgan remarquent cependant qu'il s'agit d'une « véritable austérité, compte tenu de la faiblesse de l'économie » (44). La faiblesse des monnaies persiste jusqu'à l'annonce, le 31 octobre, de la conclusion d'un accord entre l'Indonésie et le FMI. Le « paquet financier » est supérieur à celui consenti pour la Thaïlande : les contributions multilatérales ou bilatérales s'élèvent potentiellement à 38 milliards de dollars et sont organisées en deux « lignes de défense » : LES ENGAGEMENTS FINANCIERS EN FAVEUR DE L'INDONÉSIE (au 31 octobre 1997, en milliards de dollars)
- la première ligne de défense rassemble les contributions des institutions multilatérales et d'« autres sources de financement », au nombre desquelles la mobilisation par le gouvernement d'avoirs libellés en devises pour 5 milliards de dollars. Cette première ligne sera mise à la disposition de la banque centrale d'Indonésie en tout état de cause ; - la seconde ligne de défense ne sera mobilisée que si des circonstances adverses et imprévues nécessitent de renforcer les réserves de change de la banque centrale. Elle repose sur des contributions de donateurs bilatéraux. Le plan de sauvetage financier de l'Indonésie offre quelques semaines de répit aux pays du sud-est asiatique. Entre-temps, les turbulences se sont déplacées vers l'Asie du nord. 3.- Acte II : les « Tigres » sont touchés La situation économique de Taïwan n'a pas grand chose à voir avec celle des pays d'Asie du sud-est touchés par la crise monétaire. Cependant, il aurait été surprenant que la monnaie nationale, le dollar de Taïwan (NT$), soit épargnée par l'atmosphère de défiance qui règne dans la région depuis plusieurs mois. D'ailleurs, le dollar de Taïwan voit sa valeur s'éroder légèrement depuis le début de 1997 : il a perdu environ 4,5% contre le dollar américain (US$) sur le premier semestre. En revanche, il a monté sensiblement par rapport au yen et au deutschemark depuis le début de 1996. Le régime de change retenu par la banque centrale - flottement libre sur le moyen terme, mais amortissement des fluctuations de court terme par rapport au dollar américain - est mis à profit par la banque centrale pour ajuster le niveau de compétitivité-prix des produits taïwanais vis-à-vis de ses principaux partenaires commerciaux. En fait, le niveau modéré de l'inflation peut inciter la banque centrale à considérer sans appréhension une légère érosion du taux de change. Les perspectives de croissance sont bonnes, après le ralentissement de 1996. En définitive, « parmi les pays d'Asie du nord, Taïwan est celui qui a le moins de raisons de s'inquiéter à l'heure actuelle » (45). Dans ces conditions, la chute de 3,2% contre le dollar américain constatée entre le début du mois de juillet et la première semaine d'août 1997 est assurément sévère, en valeur absolue, mais reste modeste si on la compare à l'effondrement du bath. Les bons fondamentaux de Taïwan ne sont pas oubliés, puisque le taux de change se stabilise ensuite à 28,7 NT$ pour 1 US$ du début du mois d'août jusqu'au début du mois d'octobre. Le NT$ est alors à nouveau soumis à des pressions, vraisemblablement par suite d'un pur effet de contagion en provenance d'Asie du sud-est. La banque centrale dépense près de 4 milliards de dollars pendant la première quinzaine d'octobre et laisse monter les taux d'intérêt pour soutenir sa monnaie. Cependant, le 17 octobre, la décision est prise de laisser la valeur du NT$ être déterminée par les forces du marché : le taux de change tombe immédiatement à 29,5 NT$ pour 1 US$, soit son plus bas niveau depuis dix ans. Cette décision est, en règle générale, jugée favorablement et interprétée comme un simple « recadrage ». Par exemple, les économistes de la Deutsche Bank estiment que « la décision de la banque centrale conduit simplement à faire évoluer le taux de change en ligne avec son niveau réel pondéré [du poids des monnaies des partenaires commerciaux] et ne traduit pas une instabilité » (46). Pour leur part, les équipes de Morgan Stanley Dean Witter affirment que « la chute du NT$ n'a pas pour cause principale l'état des fondamentaux économiques » (47). En revanche, l'abandon du soutien du NT$ provoque une répercussion immédiate sur le dollar de Hong Kong (HK$). Les marchés appliquent à la situation comparée de Hong Kong et de Taïwan le même raisonnement qu'ils avaient appliqué à la situation comparée de la Thaïlande, des Philippines, de l'Indonésie et de la Malaisie : si les autorités de Taïwan sont dans l'incapacité de préserver la parité de leur monnaie, comment pourrait-il en être autrement pour les autorités de Hong Kong ? Dans la semaine du 20 au 24 octobre, la bourse de Hong Kong perd près de 25% et le taux d'intérêt interbancaire à trois mois bondit de 7% à 13% environ. Le 23 octobre, le taux d'intérêt au jour le jour atteint même 280%. Le taux de change du HK$ fluctue légèrement autour de son taux officiel de 7,8 HK$ pour 1 US$. Ces ajustements résultent du mécanisme de change fixe retenu pour définir la valeur du HK$ (appelé peg) : - l'Autorité monétaire de Hong Kong a pour politique d'échanger librement le dollar de Hong Kong contre le dollar américain au taux fixe de 7,8 HK$ pour 1 US$. En conséquence, les 20 et 21 octobre, l'Autorité monétaire vend passivement des dollars, prélevés sur ses réserves, aux banques de Hong Kong qui en achètent pour le compte de leurs clients ; - le dénouement de ces opérations s'effectue le 23 octobre, les banques devant fournir à l'Autorité monétaire les HK$ qui représentent la contrepartie des US$ achetés. Or le montant total des HK$ à remettre est supérieur au montant total des comptes courants des banques ouverts dans les livres de l'Autorité monétaire. Les banques doivent donc se procurer sur le marché interbancaire le solde des HK$ nécessaires. La forte demande qui en résulte sur ce marché propulse le taux d'intérêt au jour le jour à 280% et agit également sur les autres taux interbancaires, d'échéance plus longue ; - la hausse des taux d'intérêt provoque, de façon classique, une chute de la bourse de Hong Kong. Celle-ci est accélérée par la clôture de positions spéculatives prises sur la bourse par des investisseurs domestiques (achats à découverts), ces positions devenant trop coûteuses à financer du fait de la hausse des taux d'intérêt. On observe également des ventes de fonds de pension et fonds mutuels étrangers. Si ces mouvements résultent bien, à l'origine, d'une « spéculation » sur l'avenir immédiat de la politique de change de Hong Kong, il ne semble pas que les opérateurs de marché aient pris des positions spéculatives contre le HK$, au sens propre du terme. L'étude précitée du FMI donne trois éléments d'information permettant de tirer cette conclusion : - les ventes de HK$ contre US$ ont été le fait d'une multitude d'ordres de faible montant, suggérant fortement la réalisation d'opérations de couverture d'engagements extérieurs plutôt que la construction de positions spéculatives ; - cette observation est corroborée par le fait que, dans les quelques jours précédant la crise, la plupart des analystes financiers ont recommandé aux entreprises de Hong Kong de couvrir leurs risques de change ; - le marché boursier n'a pas fait l'objet de ventes à découvert particulièrement importantes pendant les turbulences du 20-24 octobre (48). La quasi-totalité des positions de vente à découvert ont été conclues pendant l'été, au moment où la bourse de Hong Kong a touché un plus haut niveau historique. Elles ont été maintenues jusqu'à leur échéance, la plupart des contrats de vente à terme arrivant à échéance en octobre étant d'ailleurs reportés sur l'échéance de novembre. La hausse des taux d'intérêt exerce alors une influence stabilisante sur les mouvements de capitaux. La détermination des autorités à défendre le peg étant avérée, nombre d'investisseurs cherchent à profiter de la rémunération offerte sur les instruments libellés en HK$, supérieure à celle offerte sur les instruments libellés en US$, alors qu'il est désormais certain que le HK$ ne sera pas dévalué et qu'il reste donc une monnaie « aussi bonne que le dollar ». Les capitaux reviennent à Hong Kong, l'Autorité monétaire enregistre une augmentation de ses réserves, tandis que les taux d'intérêt diminuent, sans toutefois retrouver leur niveau d'avant la crise. La crise boursière de Hong Kong marque le début d'une extension de la crise asiatique aux autres marchés émergents, d'une part, aux marchés financiers des pays industrialisés, d'autre part. Hong Kong, bien que soumise à nouveau à la souveraineté de la Chine populaire depuis le 1er juillet 1997, reste en effet considérée comme un « avant-poste » du capitalisme à l'occidentale en Asie. La faiblesse de la bourse de Hong Kong se répercute, naturellement, sur les sociétés britanniques encore fortement implantées sur le territoire, puis, par contagion, aux autres sociétés cotées à Londres. La bourse de New York est également touchée et perd 7,2% le 27 octobre, ce qui suscite une suspension momentanée des transactions. Les marchés d'Amérique latine sont également soumis à de fortes pressions. Elles résultent, bien entendu, du scepticisme des investisseurs face à des économies qui viennent juste de surmonter la crise mexicaine de 1994-95 et ses répercussions. Elles résultent également de comportement spéculatifs qui « jouent à la baisse » ces marchés traditionnellement fragiles. Elles résultent enfin du dénouement de positions à fort effet de levier, construites par des investisseurs résidents ou non résidents. L'assombrissement des perspectives financières entraîne, en effet, les intermédiaires financiers à opérer des appels de marge auprès de leurs clients à qui ils sont consenti un crédit pour se positionner sur un marché. Les clients peuvent alors répondre à l'appel de marge - mais ils doivent pour cela se procurer des liquidités, donc vendre certains de leurs actifs sur d'autres marchés - soit liquider directement leur position pour réduire l'effet de levier et satisfaire ainsi aux exigences de leur intermédiaire - auquel cas la vente affecte directement les actifs du marché sur lequel l'appel de marge a été effectué. L'étude précitée du FMI montre, par exemple, que les appels de marge sont l'une des causes premières de la chute du marché brésilien et des pressions sur le real qui sont apparues à la même occasion. De même, les appels de marge opérés par les intermédiaires sur les banques coréennes ont conduit celles-ci à liquider une partie des positions qu'elles avaient construites sur les marchés émergents, contribuant à leur instabilité. En effet, à l'automne 1997, la situation des entreprises et des banques coréennes inspire des inquiétudes croissantes. La liste des faillites s'allonge, même si les entreprises concernées n'ont pas l'importance du chaebol Hanbo. Selon JP Morgan, « jusqu'ici, les faillites de Hanbo, Sammi, Hanshin Construction, Jinro, Dainong et Kia à elles seules ont conduit à constater quelque 25 milliards de dollars de prêts non performants, soit l'équivalent de 5,6% du PIB, en plus des prêts non performants qui existaient déjà » (49). Les banques créancières sont également sous l'_il des marchés. Le 25 août, le gouvernement coréen annonce un plan visant à renforcer la solidité du secteur financier. La banque centrale de Corée doit prêter, dans le cadre d'une procédure de « prêts privilégiés », une somme comprise entre 2,2 et 3,3 milliards de dollars à la Korea First Bank. Le gouvernement s'engage également à soutenir, à hauteur de quelques centaines de millions de dollars, d'autres établissements fragilisés par les créances douteuses et annonce qu'il travaille à l'élaboration d'un plan global de stabilisation financière. Un fonds spécial est prévu afin de faciliter la cession par les banques de leurs créances douteuses ; le gouvernement se dit prêt à financer le fonds à hauteur de 3,8 milliards de dollars. Ce plan ne suffit pas à rassurer, comme en témoigne l'augmentation des primes de risque que doivent consentir les banques coréennes sur leurs emprunts à l'étranger : la prime de risque des obligations souveraines par rapport aux obligations à cinq ans du Trésor américain avait diminué régulièrement pendant toute l'année 1996 et avait atteint un minimum de 45 points de base en janvier 1997. Cette prime remonte d'environ 20 points de base au premier trimestre, puis bondit à la fin du mois de juillet. Au début du mois d'août, les émetteurs coréens bénéficiant du risque souverain paient une prime de 130 points de base par rapport aux obligations à cinq ans du Trésor américain. Parallèlement à cette aggravation du coût de leurs ressources, les banques coréennes se heurtent à la défiance des établissements financiers internationaux auprès desquels elles sollicitent des prêts : elles se voient refuser l'accès à des prêts d'échéance supérieure à un an ; certaines banques d'investissement n'obtiennent même que des financements d'échéance inférieure à un mois (50). Comme l'indiquent clairement les analystes de JP Morgan, « le problème n'est pas tellement la fuite des capitaux ou la spéculation, mais la réticence des investisseurs à renouveler les ligne de crédit à court terme existantes. La dette extérieure de la Corée n'est pas si élevée (125 milliards de dollars, soit 25% du PIB) et les crédits à l'exportation forment une large part de la dette à court terme qui s'élève à 80 milliards de dollars. Néanmoins, ceci cause une « impasse » mensuelle de refinancement de près de 4 milliards de dollars qui, compte tenu du faible niveau des réserves de la banque de Corée, pourrait rapidement miner le système financier domestique, provoquer une augmentation des taux d'intérêt et conduire à un effondrement » (51). Le 24 octobre, la notation du risque souverain de la Corée est dégradée. Cette décision lance une spirale de la défiance qui conduit bientôt à l'effondrement du taux de change : - la dégradation de la notation et l'augmentation des primes de risque amènent les gestionnaires des actifs internationaux des banques coréennes à procéder à des appels de marge sur les positions à effet de levier qu'elles ont pu construire sur les marchés émergents ; - pour faire face à ces appels de marge, les banques coréennes liquident une partie de leurs actifs sur les marchés émergents, favorisant par là même les turbulences qui y sont apparues ; - les ventes auxquelles procèdent les banques coréennes pèsent sur les prix des actifs émergents qu'elles possèdent toujours. Les investisseurs comme les prêteurs internationaux s'interrogent sur les pertes potentielles subies par les banques coréennes sur leur portefeuille d'actifs ; - les prêteurs réduisent alors peu à peu leurs lignes de crédits ouvertes au profit des banques coréennes, entraînant de ce fait à la fois une contrainte de financement pour celles-ci et une pression vendeuse sur le won ; - l'accélération de la dépréciation du won amène les entreprises coréennes exposées au risque de change à couvrir leur position, ce qui renforce naturellement la glissade du won ; - les difficultés rencontrées par les résidents coréens pour couvrir effectivement leurs positions soulèvent des questions sur le niveau des réserves de change réellement utilisables par la banque de Corée. Comme l'indique le FMI dans l'étude précitée, « avec les pressions exercées sur le taux de change, l'incertitude sur le niveau des réserves utilisables par la banque centrale et la forte demande de couverture et de réponse aux appels de marge par les agents domestiques, les opérateurs de marché intervenaient dans un environnement très incertain et avec un manque d'information évident. La ruée panique des agents résidents sur le marché des changes a exacerbé les pressions sur la Corée dans les mois de novembre et décembre » (52). La situation de la Corée empire de jour en jour. Le 14 novembre, le gouvernement présent un ensemble de treize lois visant à modifier en profondeur les structures du système bancaire et financier coréen, mais les forces parlementaires ne peuvent s'accorder que sur quatre d'entre elles. L'échec du projet renforce le sentiment général que la Corée ne pourra pas éviter de faire appel au FMI. Ultime tentative pour une solution purement nationale, le plan de stabilisation financière dévoilé par le gouvernement le 19 novembre est condamné, le lendemain, par une chute de 10% du taux de change. Le 21 novembre, le gouvernement annonce qu'il sollicite le soutien financier du FMI. Le gouvernement coréen et le FMI parviennent à un accord le 3 décembre. Le soutien financier apporté à la Corée s'élève à 57 milliards de dollars sur 3 ans, dont 21 milliards de dollars versés par le FMI, 10 milliards de dollars versés par la Banque mondiale et 4 milliards de dollars versés par la banque asiatique de développement. Par ailleurs, 22 milliards de dollars de contributions bilatérales constituent une seconde ligne de défense, selon le modèle inauguré pour le sauvetage de l'Indonésie. Conformément aux règles du FMI, le soutien financier est assorti d'un programme, constituant un engagement du gouvernement coréen, qui conditionne le versement effectif des fonds. En tout état de cause, 5,5 milliards de dollars doivent être versés immédiatement et il est prévu de verser 3,6 milliards de dollars supplémentaires le 18 décembre, puis 2 milliards de dollars le 8 janvier 1998, une fois que les autorités du FMI auront examiné les premières décisions du gouvernement prises en application du programme sur lequel s'est conclu l'accord. SOUTIEN FINANCIER À LA CORÉE (en milliards de dollars)
Contre toute attente, l'annonce du plan de sauvetage financier de la Corée ne stabilise pas les marchés. De mauvaises nouvelles raniment l'inquiétude générale concernant les risques financiers en Asie : - la tenue d'élections présidentielles, le 18 décembre, laisse planer une incertitude politique en Corée. D'ailleurs, le candidat de l'opposition, M. Kim Dae-jung, indique qu'il compte avoir des « consultations supplémentaires » avec le FMI s'il est élu ; - la poursuite des faillites entretient la défiance : le 5 décembre, le courtier Coryo Securities ferme ses portes ; il s'agit de la première institution financière coréenne à faire faillite depuis 1963. Le 6 décembre, le chaebol Halla succombe sous plus de 6 milliards de dollars de dettes ; - une note interne du FMI, dont le contenu parvient à la connaissance des marchés le 10 décembre, révèle que les réserves de change officielles s'établissaient à 23,9 milliards de dollars au 2 décembre, en diminution de 6,6 milliards de dollars par rapport au 30 octobre. Cette note du FMI indique, surtout, que 17,9 milliards de dollars de ces réserves ont été placés en dépôt dans des branches étrangères de grandes banques commerciales coréennes, pour contribuer à financer leurs besoins en dollars, et qu'elles ne sont pas mobilisables. Ainsi, le niveau des réserves de change réellement utilisables par la Banque de Corée n'est que de 6 milliards de dollars ; - la même note révèle que les engagements extérieurs à court terme de la Corée s'élevaient à près de 100 milliards de dollars à la fin du mois de septembre, au lieu des 65,6 milliards de dollars officiellement reconnus à cette date par le ministère des finances ; - la question de la dette à court terme venant à échéance à la fin de l'année (12 milliards de dollars environ) n'est pas réglée, et il est à craindre que les sommes que le FMI s'est engagé à verser dans l'immédiat ne suffisent pas. Le répit vient avec l'annonce, le 29 décembre 1997, que les banques internationales créancières de la Corée acceptent de surseoir, jusqu'au 31 mars 1998, au remboursement des prêts venant à échéance dans les prochaines semaines. Il est également convenu que des négociations s'engagent, sous l'égide de quatre banques chefs de file, sur les conditions de consolidation de ces prêts à court terme. La décision des banques commerciales lève l'hypothèque financière qui pesait jusqu'ici sur la Corée et sa monnaie. Elle contribue à une stabilisation des marchés financiers asiatiques. La fin de l'année 1997 marque donc un point d'arrêt pour la crise internationale proprement dite et ouvre quelques mois de relative sérénité. Seule l'Indonésie reste plongée dans la tourmente. ÉVOLUTION DES TAUX DE CHANGE DES PAYS TOUCHÉS PAR LA CRISE 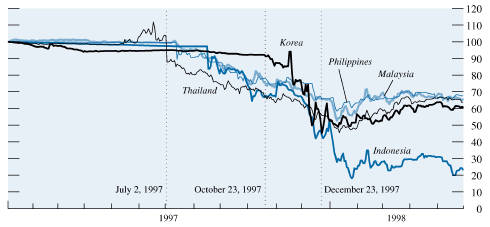 Source : FMI, International Capital Markets, septembre 1998. Mais la crise a laminé les taux de change des monnaies concernées. Entre le début du mois de juillet 1997 et la fin du mois de décembre de la même année, le dollar de Taïwan et le dollar de Singapour ont perdu chacun 15% de leur valeur contre le dollar américain ; le peso philippin a perdu 34% de sa valeur ; le ringgit malais a chuté de 35%, le bath thaïlandais a chuté de 47% ; le won coréen a abandonné 48% (53) ; enfin, la roupie indonésienne a perdu 56% de sa valeur par rapport au dollar (54). Par ailleurs, les cinq pays les plus touchés par la crise ont été victimes d'une hémorragie de capitaux, qui a ramené à zéro les flux de capitaux privés. Les flux de capitaux officiels se sont élevés à 28 milliards de dollars et ont permis de couvrir le déficit global des comptes courants. En revanche, les « autres mouvements de capitaux », qui incluent notamment les flux générés par les opérations des résidents, ont dégradé les conditions de financement des cinq pays pris ensemble. Les réserves de change ont diminué de 31,5 milliards de dollars FINANCEMENT EXTÉRIEUR DES CINQ PAYS (en milliards de dollars)
Une augmentation des réserves de change est comptée négativement puisqu'elle « absorbe » une partie des financements extérieurs du pays. Inversement, une diminution des réserves de change est comptée positivement puisqu'elle contribue à couvrir une partie du besoin de financement extérieur.
Le tableau ci-dessus permet de constater que les retraits des capitaux investis sur les marchés de titres (actions ou obligations) ont été importants : un renversement des flux de plus de 15 milliards de dollars environ a ramené leur contribution nette au financement des pays concernés de + 13,9 milliards de dollars en 1996 à - 1,5 milliards de dollars en 1997. Cependant, l'essentiel de l'étranglement financier extérieur a eu pour origine la contraction des encours de crédits des banques étrangères. Alors que celles-ci avaient financé la croissance des cinq pays asiatiques en leur accordant 62,7 milliards de dollars de crédits bancaires supplémentaires (nets) en 1996, elles ont diminué leurs encours de 21,2 milliards de dollars en 1997, ce qui traduit un renversement de flux de près de 85 milliards de dollars en une année. 4.- Acte III : chaos en Indonésie, répit ailleurs (janvier-avril 1998) L'assèchement de la liquidité externe des cinq pays concernés a eu des répercussions dramatiques sur le secteur financier et sur le secteur productif. A l'exception des Philippines, dont le système bancaire était plus solide, la Corée, la Malaisie, mais surtout la Thaïlande et l'Indonésie ont été confrontés à une crise bancaire qui a débouché sur une contraction du crédit offert à l'économie. On peut classer en trois catégories les origines de cette contrainte de crédit appliquée à l'économie : - les programmes d'assainissement du secteur bancaire et financier ont amené à mettre sous surveillance l'ensemble des établissements et à recommander la fermeture et la liquidation de certains d'entre eux, ce qui perturbait naturellement les circuits établis de distribution du crédit ; - le même processus d'assainissement visait à améliorer la capitalisation des établissements. Or, la possibilité de lever de nouvelles ressources par augmentation de capital étant quasi inexistante, compte tenu de l'état de délabrement général du secteur, donc de son caractère peu attractif pour d'éventuels investisseurs, l'amélioration des ratios de capitalisation des banques passait en partie par une inflexion du volume de leur portefeuille de prêts ; - enfin, la dégradation des conditions économiques générales , marquée notamment par l'augmentation du nombre des faillites, dégradait mécaniquement la qualité du portefeuille de prêts des établissements bancaires, renforçant par là même les contraintes imposées par le renforcement des normes de capitalisation. La Thaïlande a ajouté une dimension supplémentaire à ce schéma général. La crise bancaire y a débuté dès la seconde quinzaine du mois de juillet, avec le cloisonnement puis l'arrêt quasi total du marché interbancaire. Les déposants ont, par ailleurs, commencé à transférer leurs dépôts vers les établissements jugés les plus sûrs : les grandes banques de préférence aux petites, les banques publiques de préférence aux banques privées et les branches locales d'établissements étrangers de préférence aux banques nationales. Confrontée à cette déstabilisation du système bancaire, la banque centrale a mis en place un circuit de soutien inefficace. Elle a fourni des liquidités aux établissements en difficulté, sans pouvoir empêcher le drainage de celles-ci vers les établissements jugés sûrs. Pour limiter la création monétaire, elle a émis pour 15 milliards de dollars d'obligations afin de retirer du marché les liquidités qui lui revenaient par le biais des comptes ouverts dans ses livres par les établissements « sûrs ». Cette politique de soutien à « guichet ouvert » (55) a eu trois conséquences : un impact mitigé sur la liquidité effective des établissements touchés par la défiance des déposants ; la création d'une dette publique de 15 milliards de dollars, correspondant aux bons et obligations émis par la banque centrale pour stériliser la création monétaire ; un « enrichissement » de 15 milliards de dollars des banques saines, qui plaçaient en titres émis par la banque centrale la monnaie qu'elles drainaient auprès des déposants apeurés. C'est seulement à partir du mois de novembre 1997 et de la mise en place d'un nouveau gouvernement qu'une stratégie cohérente a été définie. Le gouvernement a, tout d'abord, procédé à la fermeture de 56 compagnies financières visées dans le programme du FMI. Il a également imposé de nouvelle normes de capitalisation et a instauré une garantie totale des dépôts. Dans un premier temps, ces mesures ont accentué la crise du crédit : ne pouvant lever de nouveaux capitaux, les banques ont été amenées à reduire au plus vite leur encours de crédits. Elles ont ainsi donné la priorité à leur ratio de solvabilité plutôt qu'au soutien à leurs clients. Les entreprises ont été le facteur d'un deuxième choc systémique. Le freinage de l'activité, le retrait des investisseurs étrangers, l'augmentation du service de la dette et le gel des dépôts dans les établissements financiers en faillite se sont conjugués pour peser sur les comptes d'exploitation et empêcher de nombreuses entreprises d'honorer leur dette. Dans la revue Économie internationale, MM. Joël Guglietta et Jérôme Sgard dressent un panorama édifiant de ce qu'ils appellent la « situation de jeu non coopératif stable » qui s'est alors établie entre les entreprises et les banques. « Incapables de servir leur dette, les entreprises ont interrompu tout service, un effet d'aléa moral très large s'ajoutant aux contraintes de paiement directes : nombre d'entreprises liquides ont arrêté de servir leur dette bancaire, par une réaction initialement opportuniste, qui est devenue très vite rationnelle au plan micro-économique. La rupture du système de crédit a en effet conduit à une situation de jeu non coopératif stable, qui se prolongera longtemps après que la crise de liquidité bancaire ait été résorbée. D'une part, après avoir interrompu volontairement leurs paiements, les entreprises solvables et liquides, dont dépendait la reprise de l'activité, n'avaient plus d'intérêt immédiat à normaliser leur position financière : dans une situation de crise bancaire aiguë, il était beaucoup plus rationnel pour elles de conserver leurs avoirs liquides [...]. D'autre part, les banques étaient incitées à refuser tout risque d'investissement privé du fait de l'incertitude majeure sur l'accès futur à la liquidité de leurs débiteurs : à partir de la fin 1997, il leur était impossible de savoir si un client en défaut de paiement était insolvable, s'il était solvable mais illiquide, ou s'il refusait de payer par opportunisme tactique » (56). La crise bancaire s'est donc transformée en crise monétaire, les mécanismes décentralisés de marché ne fonctionnant plus et les agents économiques n'ayant plus comme horizon temporel que le présent et l'avenir immédiat. Si la Thaïlande semble être un cas très spécifique, il est difficile de contester l'impact fortement récessif qu'a pu avoir la réfaction du crédit amorcée dans les derniers mois de 1997. Les premiers mois de 1998 ont été l'occasion de constater, en effet, les conséquences de la crise financière sur l'économie réelle (57). Une phase d'ajustement sévère s'est engagée. Elle s'est traduite par une baisse du PIB, entièrement imputable à une forte contraction de la demande interne des entreprises comme des ménages : - l'absence de mécanisme d'indexation des salaires a conduit à une diminution des salaires réels, dans un contexte d'augmentation de l'inflation importée par la dépréciation du taux de change. De même, l'inquiétude des ménages sur la situation économique d'ensemble a contribué à une diminution de la consommation ; - les entreprises ont été confrontées à la diminution de la demande en provenance des ménages, au resserrement de leurs conditions de crédit domestique et au repli des capitaux extérieurs (beaucoup d'entreprises de taille importante s'étaient endettées directement à l'étranger en devises). En conséquence, elles ont revu leurs projets d'investissement et diminué le niveau de leurs stocks ; elles ont également réduit leur personnel ; Ainsi, au premier trimestre 1998, le PIB a baissé de 4% en rythme annuel en Corée, de 6,2% en Indonésie et de 1,8% en Malaisie (58). En Corée, la demande des ménages a reculé de 10% et l'investissement de plus de 20%. Dans tous les pays, la chute de l'investissement a représenté la plus forte contribution à la diminution du PIB. La contrepartie de la contraction de la demande interne a été un rééquilibrage très rapide des comptes extérieurs. Les importations ont chuté en moyenne de près de 30% en valeur (exprimée en dollars), alors que les exportations n'ont été que légèrement érodées (exprimées en dollars). Au total, entre 1997 et 1998, la balance des transactions courantes s'est améliorée de près de 95 milliards de dollars et a présenté un excédent d'environ 70 milliards de dollars en 1998 (59). Le redressement des comptes courants, conjugué aux flux de capitaux officiels, a plus que compensé la diminution nette des financements privée - environ 30 milliards de dollars, toujours sous l'effet principal d'une réduction des encours de prêts bancaires - et a permis aux pays concernés d'augmenter leurs réserves de change d'environ 40 milliards de dollars. En revanche, l'Indonésie n'a pas réussi à retrouver la confiance des investisseurs internationaux. La crise économique y a évolué en crise politique et a conduit à l'éviction du président Suharto. Les deux facteurs principaux de cet enchaînement implacable ont été, en premier lieu, une perte de contrôle de la création de monnaie par la banque centrale et, en second lieu, le « brouillage » des signaux officiels quant à la volonté du gouvernement d'appliquer effectivement les mesures définies sous l'égide du FMI. Arrêté le 31 octobre, le programme de réformes associé au soutien financier du FMI et des autres contributeurs prévoyait, notamment, la fermeture de seize établissements bancaires insolvables, sur les 238 que comptait alors le secteur bancaire indonésien. Trente-quatre autres banques devaient faire l'objet de mesures de restructuration. Parallèlement, la banque centrale d'Indonésie avait annoncé qu'elle était prête à prévenir toutes les conséquences d'éventuels retraits de dépôts sur la solidité du système bancaire, en fournissant, si besoin était, les liquidités nécessaires aux établissements autorisés à poursuivre leurs activités. Contrairement aux attentes, le programme a provoqué une ruée des épargnants vers les dépôts bancaires et a donc engagé un processus de fragilisation de leurs ressources. Il semble que les rumeurs persistantes sur l'état de santé du président Suharto aient entretenu l'idée d'une prochaine instabilité politique. Par ailleurs, le nom des trente-quatre banques soumises à restructuration n'ayant pas été rendu public, la confiance du public dans l'ensemble du système bancaire a été ébranlée. Des rumeurs couraient également sur l'imminence d'une nouvelle vague de fermetures, alors que le gouvernement ne s'était pas prononcé sur une éventuelle garantie des dépôts. Conformément à ses engagements publics, la Banque d'Indonésie a ainsi été amenée à soutenir les établissements en difficulté et a accru la circulation monétaire. Dans les mois de novembre et décembre 1997, les agrégats monétaires se sont placés sur un sentier de croissance très élevé, laissant le champ libre à l'apparition d'une forte inflation. Une dynamique destructrice s'est alors établie entre croissance monétaire, inflation et dépréciation du taux de change. La valeur de la roupie contre le dollar a été divisée par trois entre la fin du mois de décembre 1997 et la fin du mois de janvier 1998. Par ailleurs, la détermination du gouvernement indonésien à exécuter sans faille les prescriptions du FMI n'est pas apparue suffisamment forte aux observateurs. Cette réticence s'explique assez naturellement, au regard des liens étroits entre la famille Suharto et les milieux d'affaires, d'une part, et de l'état général de l'économie d'autre part. Il convient de rappeler, notamment, qu'une sécheresse, en 1997, avait eu d'importantes répercussions sur la production agricole et que certaines régions d'Indonésie étaient menacées de disette (60). ÉVOLUTION DE DEUX AGRÉGATS MONÉTAIRES EN INDONÉSIE (en % d'évolution par rapport à leur niveau du mois de mars 1997) 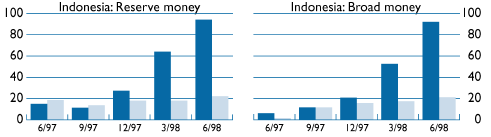 Source: IMF-Supported Programs in Indonesia, Korea and Thailand. A Preliminary Assessment, IMF Occasionnal Paper, n° 178, juin 1999 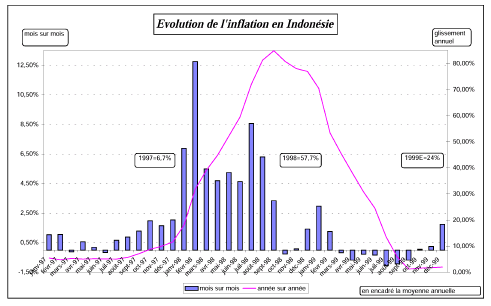 Source : Direction du Trésor, Le Courrier de l'Agence financière C'est ainsi que le gouvernement a relancé, en décembre 1997, certains projets d'investissement à l'utilité douteuse qu'il était convenu d'annuler dans le programme du FMI. De même, il a présenté, au début du mois de janvier 1998, un projet de budget fondé sur des hypothèses irréalistes relatives, notamment, au taux de change de la roupie - qui avait un impact évident sur l'évaluation de la charge de la dette publique contractée en devises - et au taux prévisionnel d'inflation. L'appréciation critique portée par le FMI sur ce projet de budget a ranimé les turbulences monétaires : le jour même, la roupie abandonnait 14% face au dollar et la bourse de Djakarta s'effondrait de 19%. La confiance dans le processus de restructuration bancaire était également ébranlée pour des motifs politiques. En décembre 1997, l'autorisation était donnée au fils du président Suharto de prendre le contrôle d'une petite banque (la banque Alfa), alors même que sa banque, Andromeda, faisait partie des seize établissements fermés le mois précédent. Une licence d'accès au marché des changes était immédiatement accordée à la banque Alfa, ainsi que l'autorisation de reprendre la majeure partie des activités auparavant exercées par la banque Andromeda. En définitive, le fils du président échappait à la restructuration bancaire par la simple modification du nom de sa société (61). Face à la crise politico-économique, une délégation conjointe du FMI, du secrétaire d'État américain à la Défense et du secrétaire-adjoint au Trésor américain s'est rendue en Indonésie pour rappeler au gouvernement la nécessité des réformes. Le programme initial du FMI a été amendé le 15 janvier, dans le sens d'une plus grande sévérité : révision du budget 1998-1999, suppression de nombreuses subventions, dont les subventions au projet d'avion à réaction et au projet de voiture nationale, démantèlement des monopoles de distribution de produits alimentaires et de produits semi-finis, suppression de projets d'infrastructures, etc. Cependant, malgré cette première alerte, le gouvernement indonésien a continué son jeu de « cache-cache » avec le FMI. Le plan de restructuration bancaire annoncé le 26 janvier allait, il est vrai, dans le bon sens en prévoyant - enfin - une garantie totale des dépôts bancaires, la constitution d'une agence gouvernementale chargée de la restructuration, l'ouverture sans restriction du capital des banques aux capitaux étrangers, la constitution d'un forum informel entre créditeurs et débiteurs privés pour négocier un rééchelonnement de la dette privée (65 milliards de dollars environ). Mais la réticence gouvernementale à appliquer effectivement ses engagements ne se démentait pas. Les déclarations du président Suharto mettant en doute la conformité du programme du FMI à l'esprit de la Constitution ne parurent pas particulièrement constructives. La suspension par le FMI du versement de 3 milliards de dollars prévus en mars 1998 faisait monter la pression internationale sur le gouvernement, tandis que la multiplication des « émeutes de la faim » (62) détériorait la situation politique intérieure. La réélection du président Suharto pour un septième mandat consécutif, le 10 mars 1998, est alors apparue comme la dernière « pirouette » d'un pouvoir en déroute, que des manifestations parfois sanglantes allaient bientôt emporter. De même, le débat engagé par le président Suharto sur l'instauration d'une parité fixe entre la roupie et le dollar, sur le modèle du currency board de Hong Kong, a pu être considéré comme un stratagème visant à détourner l'attention des difficultés internes. Un nouvel ajustement du programme du FMI, le 8 avril 1998, a ensuite contribué à réduire les tensions entre le gouvernement indonésien et l'institution internationale. En particulier, le FMI agréait la possibilité de maintenir des subventions sur certains produits de première nécessité et en faveur des PME. De même, les objectifs fixés en matière financière prenaient en compte la détérioration persistante du climat économique et accordaient plus de souplesse à la gestion des finances publiques, tout en prenant les dispositions nécessaires pour faire appliquer une politique monétaire stricte. C'est ainsi que, le 4 mai 1998, le conseil d'administration du FMI décidait de reprendre les versements prévus au profit de l'Indonésie dans le cadre du crédit stand by ouvert le 31 octobre 1997. Le retrait du président Suharto, le 21 mai 1998, levait finalement l'hypothèque fondamentale pesant sur la politique indonésienne, bien que la personnalité de son successeur, M. Habibie, eût suscité des interrogations dans la communauté internationale, tant sur son engagement en faveur des réformes économiques que sur la réputation qui lui était attachée d'une certaine sensibilité aux thèmes islamistes. Le 4 juin 1998, un accord est trouvé entre les banques créancières et les banques privées indonésiennes, qui porte rééchelonnement de la dette privée sur des périodes allant jusqu'à huit ans, assorti de garanties de change, pour un montant de 67,4 milliards de dollars. L'Indonésie décide également de garantir aux banques étrangères les crédits commerciaux qu'elles s'engageraient à maintenir au niveaux équivalents à ceux d'avril 1998. Bien que les fondements de la stabilité des prix et des changes aient enfin été établis, « les bases d'une consolidation durable de l'économie étaient beaucoup plus détériorées que dans le reste de la région : le système bancaire était largement détruit, la quasi-totalité du secteur privé en cessation de paiements et les relations financières avec le reste du monde étaient largement interrompues » (63). Mais à peine la situation était-elle apaisée en Indonésie que les pays d'Asie émergente étaient à nouveau placés sous une « pression monétaire », dont l'origine se situait cette fois au Japon. Pour autant, la stabilisation des taux de change n'était pas fondamentalement remise en cause. En revanche, la crise financière allait quitter l'Asie pour déferler sur les autres marchés émergents, puis les marchés des pays développés, mettant ainsi en danger la stabilité du système financier international tout entier. 5.- Acte IV : rebond et extension de la crise : le système financier international au bord du gouffre (mai - décembre 1998) Depuis son maximum historique face au dollar, atteint en avril 1995 avec un taux de change de 82 ¥/$, le yen n'avait cessé du chuter par rapport au dollar, dans un mouvement qui reflétait à la fois la vigueur persistante de l'économie américaine et l'incapacité du Japon à surmonter la crise apparue en 1990. Tout au plus, le printemps 1997 avait vu un renversement de tendance, sur la foi d'hypothèses optimistes quant à un retour de la croissance au Japon. Ces espérances ayant été rapidement démenties, la parité du yen s'était à nouveau inscrite sur une tendance décroissante, qui avait conduit à un taux de change d'environ 134 ¥/$ au milieu du mois de janvier 1998. Cette période a connu un deuxième revirement de l'opinion des marchés. En un mois, le yen s'est vigoureusement redressé, dans l'attente d'un nouveau plan de relance budgétaire et de mesures de déréglementation qui seraient éventuellement proposées dans le cadre de la réunion des ministres des finances du G-7, en février 1998. Selon la Banque des règlements internationaux, « l'amélioration des perspectives dans les autres pays de l'Est asiatique et les préoccupations des opérateurs de marché concernant des interventions des autorités monétaires japonaises ont également joué en ce sens » (64). Mais les attentes du marché furent déçues lorsque le ministre des finances du Japon annonça, en février 1998, que l'économie était « stagnante ». Le rapport sur lequel se fondait cette déclaration dressait « le plus sombre panorama du climat économique japonais depuis vingt ans » (65). Le plan de relance présenté par le gouvernement japonais, créant une stimulation budgétaire équivalente à 1% du PIB, se révéla très vite aussi inefficace que les plans précédemment adoptés en 1997. Pressé par ses partenaires du G-7 de relancer son économie, le Japon annonça, le 7 avril 1998, un nouveau plan de relance donnant une impulsion budgétaire évaluée à 3% du PIB. Mais cette décision laissait de marbre les marchés, plus sensibles peut-être à la révision des perspectives de notation du risque souverain par l'agence Moody's, le 3 avril 1998. Celle-ci mettait sous surveillance, avec implication négative, la note AAA des emprunts souverains japonais. Par ailleurs, la chute du yen suscitait des rumeurs d'abandon de la parité fixe entre le dollar de Hong Kong et le dollar américain, comme elle renforçait les craintes que la Chine ne soit conduite, tôt ou tard, à dévaluer sa monnaie pour reconquérir une partie de sa compétitivité. Peu à peu l'ensemble des marchés de la zone ont été pris dans un processus auto-entretenu d'érosion, qui a d'abord touché les bourses puis, au début du mois de juin 1998, les monnaies. La direction de la prévision du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie estimait, à cet égard, que « les perspectives de récession nippones inquiètent les marchés dans la mesure où elles accentuent les risques de déflation et de crise financière domestique. Cette situation se traduit par une baisse préoccupante de la devise japonaise qui déstabilise l'ensemble des économies de la région. En retour, les risques d'approfondissement de la récession nippone sont encore aggravés étant donné les liens privilégiés qu'entretient l'économie japonaise avec ces économies » (66). Le 12 juin 1998, le yen atteignait son cours le plus bas depuis huit ans face au dollar, au prix de 145 ¥/$. C'est alors que les autorités monétaires américaines et japonaises décidèrent d'une intervention commune pour soutenir le yen. Les États-Unis abandonnaient ainsi leur politique de non intervention directe sur la parité yen / dollar. Au-delà même du montant engagé par la Réserve fédérale, somme toute limité (vente de 2 milliards de dollars), le signal ainsi adressé aux marchés financiers a stoppé net la glissade du yen, qui s'est stabilisé aux alentours de 140 ¥/$ jusqu'à la fin du mois de juillet 1998. Les monnaies asiatiques ont alors rapidement surmonté un trouble qui n'avait été que passager et de faible ampleur. D'ailleurs, les analyses effectuées par la Banque des règlements internationaux suggèrent que le won coréen n'a pratiquement pas enregistré de perturbations : la volatilité de sa parité avec le dollar reste faible aux mois de mai et juin 1998. A la suite de la défaite électorale essuyée par le parti libéral démocrate aux élections sénatoriales, un nouveau gouvernement a été formé au Japon. La constitution laborieuse de ce gouvernement et les propos de son ministre des finances, M. Miyazawa, qui affirmait ne pas faire confiance aux interventions des banques centrales pour stabiliser ou orienter durablement à la hausse la parité du yen ont à nouveau poussé celle-ci à la baisse. Les mêmes phénomènes de mimétisme monétaire ont alors affecté les monnaies des autres pays de la zone, le dollar de Hong Kong subissant, pour sa part, des pressions sensibles. En août 1998, les attaques contre le dollar de Hong Kong se faisant plus violentes, les autorités ont considéré qu'elles étaient le fait de manipulations et non pas du fonctionnement normal des marchés. En conséquence, elles se sont départies de leur politique de non intervention et ont acheté pour quelque 15 milliards de dollars d'actions au comptant et à terme, soit 6% de la capitalisation boursière à cette date. Cette intervention a entraîné une détente des taux d'intérêt et une stabilisation des cours boursiers. Pour dissiper toute crainte concernant leur attachement traditionnel au libre jeu des forces de marché, les autorités se sont alors engagées à gérer leur portefeuille d'actions de façon « neutre » et à le liquider progressivement. Les craintes d'une prolongation de la crise japonaise, d'une aggravation de la crise des pays d'Asie émergente et d'une contagion à l'économie réelle des pays développés ont renforcé la nervosité des investisseurs. C'est dans ce contexte tendu que la Russie a pris, à la mi-août 1998, des mesures radicales pour maîtriser la détérioration des conditions de son financement externe. Les problèmes de maîtrise des finances publiques, l'accélération des émissions d'emprunts publics à court terme, la chute des cours des produits de base - en partie engendrée par la baisse de la demande mondiale en provenance des pays asiatiques - et l'appréciation du taux réel de change du rouble avaient peu à peu fait naître des doutes sur la capacité de la Russie à faire face aux obligations de sa dette interne et externe, à compter de la fin de l'année 1997. Au printemps 1998, le rouble a subi plusieurs attaques spéculatives, qui ont amené les autorités russes à relever fortement leurs taux d'intérêt. Ceux-ci ont atteint 150% à la fin du mois de mai, niveau difficilement tenable à la fois pour les agents économiques - via la diffusion de cette hausse sur les taux des prêts consentis par les banques à l'économie - mais aussi pour les finances publiques (67). Pour sauvegarder la stabilité du rouble, clef de voûte de la politique monétaire russe depuis quelques années, une aide internationale de près de 23 milliards de dollars a été mise en _uvre sous l'égide du FMI. Cependant, l'opposition du Parlement russe à d'énergiques mesures visant à améliorer les rentrées fiscales a réduit la confiance des marchés et accéléré l'hémorragie des réserves de change. Face à l'aggravation des problèmes de financement interne et externe, les autorités russes ont annoncé, le 17 août 1998, un plan articulé autour de trois mesures principales : l'élargissement, puis l'abandon de la bande de fluctuation du rouble autour de son taux de change objectif avec le dollar ; la suspension de la négociation des bons du Trésor, associée à une restructuration obligatoire de la dette fédérale interne ; un moratoire de quatre-vingt-dix jours sur le remboursement des dettes des entreprises et des banques envers les créanciers étrangers. La crise russe a exacerbé, chez les investisseurs internationaux, l'aversion pour le risque et l'appétence pour la liquidité et la sûreté. La progression des grands marchés boursiers occidentaux a été interrompue sous l'effet du moratoire russe et des inquiétudes grandissantes sur l'impact de la crise asiatique sur les bénéfices des entreprises cotées De plus, le brusque revirement du sentiment général des intervenants sur les marchés est venu interrompre le mouvement de convergence qui marquait, depuis 1994, l'évolution des taux d'intérêt. Certes, les effort des investisseurs pour se réfugier vers des placements « sûrs » ont accentué la tendance globale à la baisse des taux d'intérêt sur les titres d'État des pays industrialisés, mais ce mouvement s'est effectué de façon différenciée selon les pays. Les primes de risque constatées à l'émission ou sur le marché secondaire sur les titres obligataires émis dans les économies d'Asie émergente ou d'Amérique latine se sont progressivement élargies, ainsi, d'ailleurs, que celles appliquées aux entreprises américaines de « second rang ». C'est ce retournement de tendance sur l'évolution des marges de taux qui a conduit à sa perte le fonds spéculatif Long-Term Capital Management (LTCM). Celui-ci avait fondé sa stratégie sur deux hypothèses : la réduction des marges de taux d'intérêt entre les principaux instruments de dette disponible sur le marché, d'une part ; la réduction de la volatilité du prix des actifs financiers, d'autre part. Ces deux hypothèses se sont trouvées prises en défaut du fait de l'évolution des marchés au premier semestre 1998 (68). Selon le Comité sur le système financier global, il est possible que la suppression par la firme Salomon Brothers de son « plateau technique » consacré aux opérations d'arbitrage, le 6 juillet 1998, ait exercé une influence psychologique sur le marché en suggérant que l'arbitrage Les turbulences induites par la crise russe ont achevé de creuser les pertes de LTCM, réduisant d'autant la base capitalistique de cette société, déjà étroite du fait de l'utilisation à grande échelle d'un « effet de levier ». Face à l'ampleur des perturbations qu'aurait pu causer sur les marchés américains et étrangers une liquidation désordonnée des positions spéculatives prises par LTCM, la Banque de réserve fédérale de New York a invité les principaux actionnaires de LTCM - par ailleurs souvent ses créanciers - à recapitaliser le fonds. « Le risque d'une perturbation financière généralisée, en cas de défaillance soudaine du fonds, explique pourquoi des établissements du secteur privé ont accepté de participer à une solution concertée sous l'égide de la banque centrale » (70). La normalisation progressive des conditions de marché, marquée par un retour de la liquidité et une réduction de la volatilité, s'est engagée lorsque les banques centrales ont réduit leurs taux directeurs respectifs, à compter des tout derniers jours de septembre 1998. Cependant, l'impulsion principale est venue du signe particulièrement fort adressé aux marchés par la Réserve fédérale américaine, qui a procédé, le 15 octobre 1998, à une diminution supplémentaire de ses taux directeurs, avant la réunion de son comité de politique monétaire, prévue le 17 novembre 1998. La dernière vague de perturbations financières a touché l'Amérique latine à l'automne 1998. Bien que cette zone ait continué d'attirer des flux de capitaux substantiels pendant la crise asiatique, sa fragilité restait évidente : l'équilibre des comptes extérieurs y était précaire depuis plusieurs années, certains pays présentaient des situations politiques incertaines, d'autres ne parvenaient pas à réduire un déficit budgétaire élevé. En 1997, la crise asiatique avait remis en lumière les déséquilibres macro-économiques du Brésil : alourdissement du déficit des transactions courantes, difficulté de l'ajustement budgétaire. Après une attaque massive contre le real à la fin de l'année 1997, combattue par un triplement temporaire des taux d'intérêt et l'annonce de mesures budgétaires, le Brésil a vu son crédit international fragilisé par l'impossibilité de faire adopter par le Congrès fédéral la plupart des mesures de redressement budgétaire annoncées au plus fort de la crise. La cessation de paiements de la Russie, en août 1998, a amené les investisseurs nationaux et internationaux à reconsidérer leur exposition sur le Brésil. Du fait des sorties de capitaux, la banque centrale du Brésil a été confrontée à une diminution de ses réserves de change évaluée à 2,8 milliards de dollars en août 1998 et 21,5 milliards de dollars le mois suivant. malgré un nouveau relèvement des taux d'intérêt et l'annonce de mesures budgétaires, la pression sur le real n'a diminué que modérément. Le gouvernement fédéral brésilien a été amené à faire appel au concours du FMI. Celui-ci a organisé un « paquet financier » rassemblant, sur le modèle retenu en Asie, des contributions multilatérales et bilatérales organisées en deux lignes de défense. Cependant, la conclusion de l'accord avec le FMI et le premier décaissement des contributions, au début du mois de décembre, n'ont guère amélioré les perspectives sur la situation extérieure du pays : les primes de risque sur titres brésiliens internationaux sont restées élevées et les fuites de capitaux se sont poursuivies. Le doute s'est peu à peu accru sur l'efficacité des efforts entrepris : les investisseurs ont, notamment, réagi négativement au refus par le Congrès brésilien d'adopter certaines mesures budgétaires jugées essentielles, ainsi qu'aux réticences de certains États fédérés à participer au processus d'ajustement. Au mois de janvier 1999, les autorités ont abandonné le régime de change mis en _uvre depuis plusieurs années (71) et ont laissé flotter le real. Celui-ci a perdu 40% de sa valeur dans les deux mois qui ont suivi sa mise en flottement. LES ENGAGEMENTS FINANCIERS EN FAVEUR DU BRÉSIL (2 décembre 1998, en milliards de dollars)
* * * Apparue dans un petit pays d'Asie du Sud-est en juillet 1997, la crise financière s'est progressivement étendue à toute la région, puis a frappé des économies jugées plus matures, comme la Corée ou Hong Kong. Elle a ensuite fait chuter plusieurs autres marchés émergents, en Russie ou en Amérique latine, tout en déstabilisant profondément les marchés de capitaux des pays développés. La surprise causée par cette succession d'événements, par leur violence, par la profondeur de leurs conséquences sur certains pays affectés, par le caractère éminemment contagieux des turbulences financières, par l'apparente impuissance des institutions multilatérales à endiguer leur cours, ont naturellement aiguillonné l'intérêt des économistes. L'analyse des causes de la crise est apparue bien vite comme un préalable indispensable à la compréhension de ses développements et à la définition des mesures propres à en prévenir le retour. Mais cette recherche en responsabilité s'est transformée ipso facto en débat sur « la responsabilité dans la crise », qui a donné lieu, pendant près de deux ans, à de vives polémiques. Les explications ex post des événements économiques ont ceci de rassurant qu'elles permettent, en règle générale, d'intégrer de façon harmonieuse les faits observés au cadre théorique ou idéologique privilégié par l'auteur desdites explications. La mise en évidence des mécanismes de la crise permet d'insérer celle-ci dans des relations de causalité et d'en montrer la quasi nécessité. La prévision économique est, évidemment, une discipline aux résultats plus aléatoires. Puisque l'année 1997 avait vu le déclenchement d'une crise financière majeure en Asie, il fallait donc que fussent développées des analyses qui permettraient de montrer que cette crise était sinon inéluctable, du moins susceptible d'être expliquée. La littérature économique a, rapidement, mis en évidence plusieurs « lignes de faille » des économies asiatiques, sur lesquelles un consensus s'est peu à peu cristallisé. En revanche, des clivages vifs sont apparus sur l'interprétation de la nature profonde de la crise. 1.- Le consensus sur les lignes de faille des économies asiatiques a) Une gestion macro-économique handicapée · Les pays d'Asie émergente ont en partie fondé leur stratégie d'industrialisation sur l'établissement d'un lien « fixe » entre leur monnaie et le dollar. Ce lien s'est renforcé au fur et à mesure de leur intégration croissante dans le commerce mondial. Il peut reposer sur une règle institutionnelle, comme à Hong Kong, ou résulter d'une politique de stabilisation autour d'une parité-cible. Cependant, le cas de Hong Kong mis à part, l'existence d'un lien entre la monnaie nationale et le dollar ne signifie pas que le taux de change est fixe. Au contraire, les pays asiatiques suivent une politique d'ajustement de leur change qui autorise une certaine souplesse autour de la parité-cible déterminée par les autorités. Par exemple, l'Indonésie semble avoir fait le choix d'une stabilisation de son taux de change réel vis-à-vis du dollar, c'est-à-dire du taux de change corrigé du différentiel d'inflation entre les deux pays. Cette politique conduit à une dépréciation continue et régulière de la parité-cible nominale, le taux de change du marché fluctuant dans une bande étroite autour de la parité-cible (72). Ainsi, le taux de change moyen en 1990 était de 1 842,8 roupies pour un dollar ; il est passé à 2 342,3 roupies pour un dollar en moyenne en 1996, soit une diminution de 21% environ. En revanche, le taux de change réel est resté quasiment stable sur la même période (73). La Corée, pour sa part, a mis en _uvre une politique de change relativement souple. Si l'on prend pour référence la parité nominale moyenne sur la période 1981-1995, soit 770 wons pour un dollar environ, les fluctuations de ce taux de change ont pu atteindre - 15% en 1985 (soit environ 900 wons pour un dollar) et + 15% en 1989 (soit environ 660 wons pour un dollar). En revanche, le taux de change nominal est resté contenu dans une fourchette de +/- 5% autour de son niveau moyen de 1991 à 1996. Par ailleurs, le taux de change effectif - c'est-à-dire vis-à-vis de l'ensemble des devises des partenaires commerciaux, pondérées par le poids de ces partenaires dans le commerce extérieur de la Corée - s'est continûment déprécié de 1989 à 1995, la diminution atteignant au total 30% (74). Une telle stratégie de change avait trois avantages : - en ancrant la parité de la monnaie nationale sur une référence monétaire extérieure, elle favorisait une convergence des taux d'inflation et contribuait ainsi à stabiliser les conditions de compétitivité ; - plus directement, l'alignement sur le dollar, après les dévaluations effectuées dans le milieu des années quatre-vingt, a permis aux économies asiatiques de bénéficier de la baisse du dollar vis-à-vis des autres grandes monnaies mondiales après 1985, puis de la montée du yen face au dollar de 1989 à 1995 ; - enfin, la stabilité du taux de change permettait aux pays asiatiques de réduire le coût de leur financement extérieur, les investisseurs étant fondés à exiger une prime de risque de change inférieure à celle qu'ils auraient exigé en régime de change flottant. La politique ainsi retenue est efficace tant que le cycle économique est à peu près synchrone entre les pays dont les monnaies sont liées et dès lors que le pays dont la monnaie constitue la devise de référence - les États-Unis - a une part importante dans les échanges extérieurs du pays émergent. Ces deux conditions se sont progressivement affaiblies. Par exemple, Mme Denise Flouzat estime qu'« à partir de 1992-1993, l'ancrage nominal au dollar s'est révélé nuisible en accentuant le déséquilibre du cycle économique, c'est-à-dire en accélérant le mouvement de croissance et le mouvement d'investissement extérieurs. Cet effet s'est finalement révélé plus important que la contribution à la désinflation de l'ancrage au dollar » (75). · Le lien fixe entre les monnaies asiatiques et le dollar n'a pas permis de corriger la dégradation de la compétitivité apparue au milieu des années quatre-vingt-dix. Cette dégradation s'est traduite par un creusement des comptes courants équivalent à plusieurs points de PIB. Assurément, la trajectoire suivie par chaque pays est particulière : par exemple, la Malaisie a enregistré son déficit courant le plus élevé en 1994 ÉVOLUTION DU SOLDE DES TRANSACTIONS COURANTES (1990-1996) (en % du PIB) 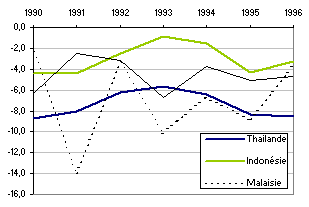 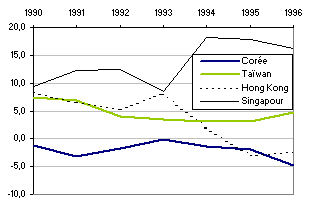 Source : G. Corsetti, P. Penseti, N. Roubini, What caused the Asian currency Un schéma similaire peut être observé pour la Thaïlande : un déficit courant élevé en 1990 et 1991 (supérieur à 8% du PIB), une réduction notable entre 1992 et 1994 (environ 6% du PIB) et une dégradation sensible en 1995 et 1996 (respectivement - 8,4% et - 8,5% du PIB). Pour sa part, à l'exception de l'année 1991 (- 3,2% du PIB), la Corée a connu des déficits courants inférieurs à 2% du PIB entre 1990 et 1995. En revanche, l'année 1996 a vu une singulière dégradation, le déficit courant se creusant à - 4,8% du PIB. En tout état de cause, la Malaisie mise à part, il apparaît clairement que les soldes courants se détériorent à partir de 1994 dans les quatre autres pays les plus touchés par la crise (Corée, Indonésie, Philippines, Thaïlande). Plusieurs facteurs ont été mis en avant pour expliquer cette détérioration. En premier lieu, le lien des monnaies concernées avec le dollar aurait conduit à une appréciation du taux de change réel. Selon G. Corsetti et al. (76), en prenant 1990 pour année de base (77), le taux de change réel se serait apprécié de 19% en Malaisie, 23% aux Philippines, 12% en Thaïlande, 8% en Indonésie, 18% à Singapour et 30% à Hong Kong. En revanche, les taux de change réels de la Corée et de Taïwan se seraient dépréciés respectivement de 14% et 10%. Selon les mêmes auteurs, la majeure partie de l'appréciation du taux de change réel se serait produite après 1995, alors que le dollar montait vis-à-vis des autres grandes monnaies mondiales. L'analyse en termes de taux de change réel est insuffisante pour expliquer à elle seule la crise de change : deux des pays les plus touchés (Indonésie et Thaïlande) ont vu une appréciation de leur taux de change réel inférieure à celle observée aux Philippines ou en Malaisie ; Singapour et Hong Kong n'ont pas été emportés par la crise bien que l'appréciation de leur taux de change réel ait été très nettement supérieure à celle des autres pays. D'ailleurs, la détermination du taux de change réel fait appel à un certain nombre de conventions et de choix de calcul, qui rendent les évaluations différentes selon les analystes (78). Le choix de la date de référence est également important et peut, éventuellement, conduire à des conclusions opposées. Enfin, l'influence du change sur la position concurrentielle du pays dépend plus du taux de change réel effectif - tel que défini à la page 85 du présent rapport - que du taux de change réel. Ainsi, dans son 67e Rapport annuel, publié en juin 1997, la Banque des règlements internationaux indiquait que le taux de change réel effectif de l'Indonésie, de la Malaisie et de la Thaïlande était égal - à quelques pour-cent près - à son niveau de 1990, celui de la Corée étant déprécié de 5% environ, après avoir été déprécié de 10% environ de la fin de l'année 1992 au milieu de l'année 1995. En deuxième lieu, les exportations des pays asiatiques ont été affectées par la grave crise survenue en 1996 sur le marché des semi-conducteurs. L'offre a continué de croître rapidement, malgré la faiblesse de la demande et le fléchissement des prix. Selon diverses estimations, les prix en dollar des semi-conducteurs ont perdu jusqu'à 80%, faisant baisser ceux des autres produits électroniques. Or, les pays d'Asie ont massivement réorienté leur système productif, dans la première moitié des années 1990, vers les produits électroniques. Entre 1990 et 1995, la part de ces produits dans les exportations totales est ainsi passée de 30% à plus de 50% en Malaisie, de 25% à près de 40% en Corée, de 25% à environ 45% aux Philippines, de 17% à 35% en Thaïlande (79). En troisième lieu, les pays touchés par la crise auraient été soumis à une concurrence croissante de pays asiatiques dont les coûts de production sont moins élevés ; la concurrence de la Chine est souvent évoquée dans la littérature économique consacrée à la crise asiatique. Des appréciations diverses ont été portées sur l'influence qu'aurait pu avoir la dévaluation du yuan en 1994. Certains auteurs estiment que la compétitivité-prix des produits chinois aurait été fortement accrue, ce phénomène pouvant d'ailleurs être observé dès 1992-1993. En effet, la dévaluation du taux officiel du yuan n'a fait qu'aligner celui-ci, avec quelques trimestres de retard, sur le niveau effectif utilisé dans les transactions commerciales. En tout état de cause, la montée en puissance des exportations chinoises est incontestablement l'un des phénomènes ayant fragilisé la position exportatrice des autres pays asiatiques. En définitive, la rigidité relative des parités des monnaies asiatiques a empêché l'expression des vertus rééquilibrantes qu'opère une dépréciation du taux de change sur les échanges extérieurs. Cette rigidité a également eu des conséquences néfastes sur la préservation de l'équilibre intérieur. · Dans un contexte de libéralisation des relations financières extérieures, la priorité donnée à l'objectif de change a réduit l'efficacité de la politique monétaire. A cet égard, les pays asiatiques ont illustré, à des degrés divers, l'enseignement de la théorie économique connu sous le nom de « triangle d'incompatibilité de Mundell », selon lequel les trois objectifs de politique économique que sont la stabilité du taux de change, la liberté des mouvements de capitaux et l'autonomie de la politique monétaire ne sont pas réalisables simultanément. A des degrés et des rythmes divers selon les pays, la deuxième moitié des années 1980 a vu s'engager un mouvement appuyé de libéralisation financière et, plus spécifiquement, de libéralisation des relations financières avec l'étranger (80). La politique d'intégration au sein du commerce mondial a, rapidement, suscité la suppression des restrictions et contrôles afférents aux paiements et transferts relevant des transactions courantes. Ainsi, l'Indonésie et la Corée ont accepté les obligations de l'article VIII des statuts du FMI en 1988, suivis par la Thaïlande en 1990 (81). Le développement économique devant être soutenu par les entrées de capitaux étrangers, leur régime a été largement assoupli, tant pour les investissements directs que pour les investissements de portefeuille. Avec l'Alien Business Law (1972) et l'Investment Promotion Act (1977), la Thaïlande disposait depuis longtemps d'un cadre juridique favorable aux entrées d'investissements directs, les secteurs ouverts à l'étranger et les exigences imposées aux investisseurs ayant été notablement allégées par ces deux lois. De même, le traitement des investissements de portefeuille était considéré comme peu contraignant, tout comme celui applicable à la réalisation d'emprunts auprès de non-résidents. Diverses mesures ont assoupli davantage ce régime sur la période 1985-1997 : incitations fiscales à l'investissement dans des secteurs déterminés, rapatriement libre des capitaux investis, des dividendes et remboursements de prêts aux filiales implantées localement. En 1985, l'Indonésie appliquait des contrôles sélectifs à l'entrée des capitaux : les investissements directs étaient limités par des plafonds fixés à la propriété étrangère, les non-résidents n'avaient pas le droit d'acheter des actions sur la bourse de Djakarta et des limites strictes étaient imposées aux emprunts à l'étranger. Ce régime a été assoupli progressivement, le nombre de secteurs ouverts à l'investissement direct étant accru et les plafonds à la propriété étrangère étant limité à certaines productions. Un nouvel allégement des contraintes a été entrepris en 1989, avec l'autorisation donnée aux investisseurs étrangers d'investir sur le marché boursier et d'acquérir jusqu'à 49% du capital des entreprises cotées. Les restrictions imposées aux emprunts bancaires auprès des non résidents ont également été levées. En revanche, à la suite de la « surchauffe » observée en 1990 et 1991, les autorités ont rétabli un contrôle quantitatif sur les emprunts extérieurs effectués par les banques et les entreprises d'État (82), sanas pour autant ralentir le mouvement de libéralisation des investissements de portefeuille. La Corée est marquée par la persistance d'un encadrement réglementaire assez strict et d'un rôle limité dévolu aux mécanismes de marché. Ainsi, il semble que le taux d'intérêt, qui reflète le prix du temps, ait traditionnellement joué un rôle mineur dans la conduite de la politique économique. La politique de libéralisation des relations financières extérieures semble avoir été fortement influencée par les développements observés autour des transactions courantes : au cours de la période 1986-1989, la Corée est confrontée à un fort excédent courant et la Banque de Corée engage des réformes visant à développer les sorties de capitaux et à limiter les entrées nettes de capitaux (83). En revanche, la dégradation de l'excédent courant en 1989 a suscité un changement de politique, l'objectif étant alors de favoriser les entrées de capitaux. Les autorités coréennes ont ainsi autorisé à nouveau les banques coréennes à lever des fonds à l'étranger, élargi les secteurs ouverts à l'investissement direct et relevé les plafonds en deçà desquels les investissements directs étaient automatiquement autorisés. La politique de promotion des investissements de portefeuille a été approfondie à partir de 1992. Cependant, comparée à d'autres pays de la région, la Corée a maintenu son compte de capital sous liberté surveillée. Ceci explique que, par exemple, certains comportements très spéculatifs comme les emprunts de monnaie locale par des non-résidents n'ont pas été observés pendant la crise de novembre-décembre 1997. Pour autant, les pays concernés ont également libéralisé les sorties de capitaux. A l'exception d'une interdiction applicable aux prêts bancaires et à caractère financière en faveur des non-résidents, l'Indonésie appliquait un régime très souple depuis 1985. A la fin des années 1980, la Corée a libéralisé l'investissement direct à l'étranger et certains investissements de portefeuille effectués par les investisseurs institutionnels. Cette politique a été reprise à partir de 1991, avec notamment une extension des activités autorisées à investir à l'étranger et l'autorisation donnée aux résidents de détenir à l'étranger des avoirs en devises. La libéralisation a été plus lente et moins complète en Thaïlande : par exemple, les résidents ne sont autorisés à consentir des prêts à leurs filiales étrangères que s'ils en détiennent plus de 25% et doivent obtenir l'autorisation de la Banque de Thaïlande si le montant annuel des prêts est supérieur à 10 millions de dollars. La libéralisation financière a permis un développement exceptionnel des entrées de capitaux dans les pays asiatiques, à partir de la fin des années 1980. Les hésitations de la croissance dans le monde industrialisé, notamment en Europe et au Japon, et le niveau comparativement plus bas des taux d'intérêt incitaient les détenteur de liquidités à chercher sur les marchés émergents des rémunérations supérieures à celles qu'ils pouvaient espérer sur les marchés matures. Par ailleurs, la stabilité du taux de change, le maintien pendant plusieurs années de taux de croissance élevés et la perspective d'une poursuite de cette tendance, les taux d'intérêt réels supérieurs à ceux des pays industrialisés rendaient les économies asiatiques attractives. L'Asie de l'Est est devenue la destination principale des flux de capitaux privés au début des années 1990, sa part dans les flux dirigés vers les pays émergents passant d'environ 10% au début des années 1980 à plus de 40% dans les années 1990 (84). Rapporté au produit intérieur brut, le volume cumulé des entrées de capitaux s'est élevé à 51,5% en Thaïlande, 45,8% en Malaisie, 23,1% aux Philippines, 9,3% en Corée et 8,3% en Indonésie. Alors que la Thaïlande recevait des flux relativement réguliers, équivalant à près de 10% du PIB chaque année sur la période, la Malaisie connaissait un profil annuel plus heurté : en 1992 et 1993, les entrées de capitaux ont représenté 15,3% et 23,2% du PIB respectivement (85). La nature des flux de capitaux a été différente selon les pays. L'excédent du compte de capital était égal à 1 milliard de dollars en 1987 en Thaïlande ; il est passé à 9 milliards de dollars en 1990 et à 21 milliards de dollars en 1995. Les investissements directs représentaient à ces mêmes dates 182 millions de dollars, 2,3 milliards de dollars et 1,2 milliard de dollars. En revanche, les investissements de portefeuille étaient respectivement égaux à 346 millions de dollars, - 38 millions de dollars et 4,1 milliards de dollars. Enfin, les « autres investissements », qui incluent les emprunts bancaires auprès de l'étranger, s'élevaient à 534 millions de dollars, puis 6,8 milliards de dollars et 16,6 milliards de dollars. Pour sa part, la Corée est un exportateur d'investissements directs : les flux nets d'investissements directs ont représenté environ - 0,3% du PIB sur la période 1990-1996. Les investissements de portefeuille ont contribué au financement de la balance des paiements à hauteur de 1,9% du PIB en moyenne sur la même période, alors que les « autres investissements » y ont contribué à hauteur de 1% du PIB en moyenne (86). Deux politiques peuvent être adoptées pour faire face à un afflux de capitaux. Les autorités monétaires peuvent décider de laisser leur monnaie s'apprécier. Elles peuvent ainsi contenir l'augmentation de la liquidité de leur économie, au prix d'une dégradation de la compétitivité extérieure ; ce fut le choix de Singapour. Elles peuvent, au contraire, donner la priorité à la préservation de la stabilité du taux de change, mais doivent alors gérer les conséquences de ce choix sur les conditions de l'équilibre monétaire intérieur. En effet, la stabilisation du taux de change dans un contexte d'entrées de capitaux a pour corollaire l'augmentation des réserves de change, du fait des interventions de la banque centrale, qui achète des devises en vendant de la monnaie nationale. Il s'ensuit une augmentation de la masse monétaire mise à la disposition du système bancaire. Si celle-ci vient à être utilisée comme base de financement d'une extension du crédit intérieur, la quantité de monnaie en circulation dans l'économie s'accroîtra dans des proportions qui peuvent menacer la stabilité des prix et contrecarrer les objectifs de la banque centrale en matière d'inflation. Par ailleurs, l'augmentation de la demande interne, favorisée par le crédit, se traduira par une détérioration du solde des transactions courantes, le taux de change stable ne pouvant assurer un rééquilibrage. La réponse de la politique monétaire consiste à « stériliser » les conséquences des entrées de capitaux sur la base monétaire. Le principal moyen de stérilisation est la vente de titres publics par la banque centrale aux établissements bancaires : la vente « absorbe » leurs liquidités excédentaires. Si le volume de titres publics détenus par la banque centrale est insuffisant pour alimenter un courant de ventes soutenu (87), celle-ci peut décider d'émettre ses propres instruments de dette. Ainsi, en 1987, la banque de Thaïlande a émis des bons de maturité comprise entre six mois et un an. Les banques centrales de Corée, d'Indonésie, des Philippines et de Malaisie ont fait de même. Cependant, la politique de stérilisation est coûteuse pour la banque centrale : elle émet (ou vend) un titre d'endettement en monnaie locale, sur lequel elle doit servir un taux d'intérêt élevé (88), dont la contrepartie initiale est l'augmentation des réserves de change provoquée par l'entrée des capitaux. Ces réserves sont investies en titres publics de l'État émetteur de la devise, qui servent un intérêt moindre. Par exemple, les réserves en dollars sont placées, en règle générale, sur le compte ouvert par la banque centrale dans les livres de la Réserve fédérale américaine et investies en bons du Trésor américain. En définitive, la stérilisation dégrade le compte d'exploitation de la banque centrale. Une politique de stérilisation est donc difficilement soutenable à moyen terme, si les entrées de capitaux persistent. D'ailleurs, elle a été mise en _uvre de façon assez discontinue : en 1989, 1992 et 1993 en Corée, de 1990 à 1993 puis en 1996 en Indonésie, de 1990 à 1993 aux Philippines, de 1992 à 1993 en Malaisie. Seule la Thaïlande a pratiqué la stérilisation de façon suivie de 1988 à 1995 (89). Cependant, la stérilisation peut être remplacée, ou épaulée, par d'autres procédures. Les dépôts liquides du gouvernement auprès des établissements bancaires ont parfois été transférés dans les livres de la banque centrale (90), mais surtout les réserves obligatoires constituées par les banques commerciales auprès de la banque centrale ont été augmentées à plusieurs reprises au cours, des années 1990, notamment en 1996 en Malaisie, en Thaïlande et en Indonésie. Le paradoxe des politiques de stérilisation est que, plus elles sont efficaces en termes de maîtrise de la masse monétaire, moins elles contribuent à réduire les flux de capitaux qui en sont la cause première. En effet, en contraignant la liquidité bancaire, la stérilisation contribue à stabiliser les taux d'intérêt internes à un niveau élevé, ce qui maintient l'appétence des capitaux étrangers pour la monnaie nationale... La stérilisation des entrées de capitaux bute donc sur un paradoxe essentiel : complète et efficace, elle conduit à des coûts quasi budgétaires trop importants pour la banque centrale ; inexistante ou timorée, elle laisse le champ libre à une explosion de la masse monétaire. Entre ces deux extrêmes, le choix est difficile et amène, en tout état de cause, à tolérer une expansion vigoureuse du crédit intérieur pas forcément compatible avec l'état général de l'économie. ÉVOLUTION DU CRÉDIT BANCAIRE AU SECTEUR PRIVÉ (1990-1997) (en % du PIB) 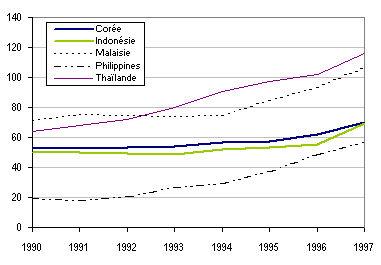 Source : G. Corsetti, P. Penseti, N. Roubini, What caused the Asian currency Le graphique ci-dessus établit une distinction claire entre la Corée et l'Indonésie, d'une part, la Malaisie, les Philippines et la Thaïlande d'autre part : - les deux premiers pays connaissent, certes, une légère accélération de la distribution de crédit bancaire au secteur privé entre 1996 et 1997. Il s'agit vraisemblablement, dans le cas de la Corée, de la nécessité pour les banques de soutenir leurs débiteurs défaillants ou confrontés à la perspective d'un dépôt de bilan. Cependant, sur l'ensemble de la période, la croissance du crédit bancaire reste relativement contenue ; - dans les trois autres pays, il apparaît que la politique monétaire a été impuissante à endiguer la montée du crédit bancaire, malgré la stabilité obtenue en Malaisie entre 1991 et 1994. Ces résultats doivent, cependant, être relativisés : la Banque des règlements internationaux indiquait ainsi qu'en 1995, le crédit bancaire au secteur privé représentait 63,3% du PIB aux États-Unis, 115,1% du PIB au Japon, 96,1% du PIB en Allemagne, 99,7% du PIB au Royaume-Uni (91). Le niveau atteint en 1996 par le crédit bancaire au secteur privé dans les pays asiatiques doit donc être apprécié, de préférence, dans une perspective dynamique, qui renvoie à la capacité pour le secteur bancaire de maîtriser les risques découlant d'une expansion très rapide de ses créances sur l'économie, dans un intervalle de temps limité. Cette approche amène ainsi à découvrir la deuxième catégorie de « lignes de faille » qui affectaient la solidité des économies asiatiques. b) La solidité du système productif affaiblie En soi, l'apport de capitaux étrangers ne représente pas une menace pour l'économie qui les accueille. Ils sont souvent une condition du développement et tendent à favoriser, en tous les cas, l'expansion des capacités productives. A long terme, le caractère soutenable des entrées de capitaux résulte de leur orientation vers des investissements susceptibles de réduire à terme le ratio d'endettement du pays, soit qu'ils génèrent directement un flux d'exportations, soit qu'ils contribuent à accélérer la croissance. · La question de l'efficacité du capital investi est donc cruciale. Or, la plupart des observateurs s'accordent à dire que cette efficacité a diminué dans les années 1990. Au plan macro-économique, ce phénomène se serait traduit par un « sur-investissement », dont on peut trouver une indication dans l'augmentation de la part des investissements dans le PIB au cours de la période 1993-1996. Par exemple, en Thaïlande, l'investissement représentait environ 28% du PIB dans les années 1980, mais a crû jusqu'à 42% du PIB en 1991, puis s'est stabilisé autour de 40% du PIB. Par ailleurs, l'efficacité de l'investissement vis-à-vis de la croissance s'est progressivement réduite : alors qu'en 1990, il fallait investir 2,2 points supplémentaires pour obtenir un point de croissance supplémentaire, en 1996, il fallait investir 2,6 points supplémentaires pour augmenter d'un point le taux de croissance (92). L'une des raisons de cette efficacité déclinante de l'investissement a été, dans certains pays, le fort développement de l'immobilier et des infrastructures. Au plan des principes, il est difficile de contester l'impact bénéfique des investissements en infrastructures sur le processus de développement. Encore faut-il qu'ils soient adaptés aux besoins effectifs du pays et qu'ils n'effectuent pas de prélèvement excessif sur les ressources disponibles. L'investissement immobilier, lui aussi, a des vertus évidentes, ne serait-ce que parce qu'il traduit pour une large part l'accession des masses urbaines à des conditions de vie meilleures. Dans les faits, la frénésie immobilière de la dernière décennie ne peut échapper à aucun observateur. Toute personne qui a eu l'occasion de se rendre en Asie n'aura pas manqué de s'étonner des multiples chantiers de construction qui ponctuaient les paysages de l'Asie émergente. De plus, l'essentiel du développement immobilier a été financé par endettement : en Indonésie, le crédit des banques commerciales au secteur foncier et immobilier a progressé en moyenne de 54% par an entre 1993 et 1996 (93). En Corée, en revanche, le sur-investissement a plutôt débouché sur une expansion excessive des capacités de production, qui a pesé sur la profitabilité des groupes industriels. Les chaebols ont entrepris, entre 1993 et 1996, une stratégie ambitieuse de diversification et d'augmentation de leur base productive, par le biais de financements à court terme obtenus auprès des banques. Mais sur cette période, le taux de retour avant impôt des sociétés industrielles a été inférieur au coût de la dette, à l'exception des entreprises sidérurgiques. Il semble que l'expansion des capacités de production ait conduit à une concurrence accrue qui aurait pesé sur les prix et dégradé ainsi la rentabilité des investissements. Cette dégradation met en évidence l'influence néfaste d'un effet de levier d'endettement excessif - rapport du montant de la dette de l'entreprise à celui de ses fonds propres - sur les performances des entreprises. Entre 1991 et 1996, l'effet de levier a doublé en Thaïlande et en Malaisie et a augmenté d'environ un tiers en Corée. Cette évolution était plus dangereuse pour la Corée, compte tenu du fort levier d'endettement qui marque traditionnellement la structure de financement des entreprises. Entre le début de 1996 et le milieu de l'année 1997, le levier d'endettement est passé de 300% à 400% dans l'industrie manufacturière. Pour les trente plus grands chaebols, le levier d'endettement est passé de 387% à 518% entre 1996 et 1997 (94). Parmi les chaebols ayant fait faillite dans le courant de l'année 1997, quatre avaient des leviers d'endettement supérieurs à 1000% : New Core (1224%), Halla (2068%), Sammi (3245%) et Jinro (8600%) (95). · La vulnérabilité du secteur privé a également été accrue par l'augmentation de son endettement extérieur à court terme. Plusieurs indicateurs peuvent être utilisés pour estimer la capacité d'un pays à assumer ses engagements extérieurs grâce à ses ressources liquides. Le ratio de la dette extérieure à court terme aux réserves de change s'est accru fortement entre 1994 et 1997, comme le montre le schéma ci-après, à l'exception de l'Indonésie pour lequel le ratio dette / réserves est resté stable, à un niveau cependant supérieur à 100%. RAPPORT DE LA DETTE À COURT TERME (en %) Moyenne pour les 5 pays juin 1994 : 100 juin 1997 : 134 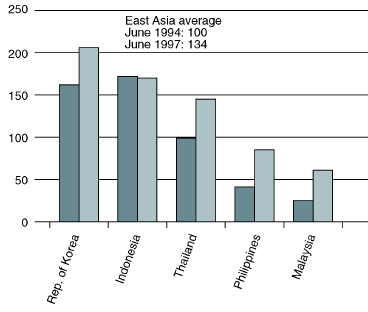 Source : Banque mondiale, Global Economic Prospects 1999, décembre 1998. Dans les trois pays les plus touchés par la crise (Indonésie, Corée, Thaïlande), le ratio dette / réserves avait dépassé 100% en 1997. Au contraire, on peut remarquer que la Malaisie et les Philippines, qui bénéficiaient de ratios inférieurs à 100% n'ont pas été obligées de recourir à des financements d'urgence fournis par la communauté internationale (96). Un autre indicateur permet d'obtenir une appréciation plus large de la vulnérabilité externe d'une économie : il tend à rapporter non plus le montant de la dette, mais la masse monétaire aux réserves de change. Ce ratio permet d'évaluer le risque de défaut du pays au cas où, les résidents perdant subitement confiance dans leur monnaie nationale, souhaiteraient la convertir en devises dans le cadre d'un régime de change fixe. Parmi les pays dont le ratio masse monétaire / réserves de change dépasse 300%, se trouvent l'ensemble des cinq pays asiatiques touchés par le crise, mais aussi les pays latino-américains les plus fragiles (Mexique, Brésil, Argentine), ainsi que la Russie. Rapport de la masse monétaire aux réserves de change (en %) INDICATEUR COMBINÉ DE VULNÉRABILITÉ EXTERNE (JUIN 1997) Rapport de la dette à court terme aux réserves de change (en %) 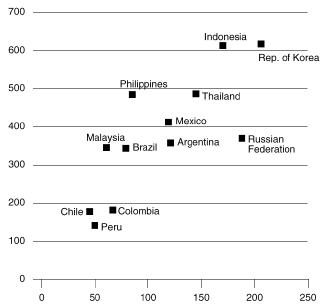 Source : Banque mondiale, Global Economic Prospects 1999, décembre 1998. La vulnérabilité des entreprises ou des systèmes bancaires des pays émergents a été aggravée parce qu'une part croissante des emprunts était effectuée à court terme, pour être fréquemment utilisée pour des emplois à long terme, difficilement liquides. Les bilans des entreprises, bancaires ou non bancaires, était donc exposé à ce qui est couramment dénommé un « risque de transformation », qui obère leur capacité à faire face à leurs échéances. Il convient de remarquer que le métier bancaire repose, pour une large part, sur le mécanisme de transformation, en particulier pour les banques de dépôt. Les banques accordent des prêts, qu'elles refinancent par le biais des dépôts recueillis par leur réseau. Ces dépôts étant des placements à vue sont, par nature, parfaitement liquides. Cependant, le risque découlant de cette transformation est réduit parce que les dépôts sont globalement stables et que leur éventuelles fluctuations peuvent être assez aisément appréhendées. Il en va tout autrement lorsque les ressources à court terme dont dépend la banque pour assurer le refinancement de son portefeuille de prêts proviennent de lignes de crédit interbancaire. Leur renouvellement dépend de l'appréciation que la banque créancière porte sur la banque débitrice ; l'expérience apprend que cette appréciation est plus volatile que celle de la grande masse des déposants particuliers. De plus, au déséquilibre des maturités dans les bilans des banques et entreprises, s'ajoutait un désajustement dans les monnaies utilisées pour libeller d'une part les engagements, d'autre part les avoirs. Les emprunts s'effectuaient généralement en dollars ou en yen pour être convertis en monnaie locale et financer des investissements remboursables en monnaie locale. En l'absence de couverture à terme des engagements en devises, les bilans étaient donc exposés à un risque de change. Les causes en sont connues et résultent pour l'essentiel de deux phénomènes : - les conditions de taux d'intérêt et d'inflation plus élevés dans les pays asiatiques que dans les pays industrialisés rendaient plus avantageux un endettement en devises, dans le cadre d'un régime de change fixe ou à évolution prévisible (cas de l'Indonésie) ; - l'environnement fiscal et réglementaire était, souvent, fortement incitatif vis-à-vis de l'endettement en devises. Ainsi, aux Philippines, les profits des banques sur les revenus provenant d'emprunts en devises étaient taxés au taux de 10% alors que leurs profits « normaux » étaient taxés au taux de 35% ; de même, les banques philippines étaient soumise à des réserves obligatoires de 13% pour les dépôts en pesos contre zéro pour les dépôts en devises. Par ailleurs, de nombreux pays ont créé des centres off shore dotés de facilités réglementaires et fiscales pour les opérations conduites en devises. Le régime des Bangkok International Banking Facilities, créé en 1992, avait pour ambition initiale de concurrencer Singapour comme place financière régionale. Elles se sont rapidement transformées en instruments de financement en devises des besoins des entreprises thaïlandaises. La Malaisie a tenté une démarche similaire avec le centre off shore de Labuan. Enfin, il faut relever qu'une couverture à terme intégrale des engagements en devises reviendrait à rendre équilibrée la position extérieure du pays concerné. Cela suppose qu'il y ait, à l'étranger, des investisseurs désireux de détenir la monnaie de ce pays, pour une quantité égale à celle qui résulte des opérations d'endettement des résidents. Ce cas de figure apparaît peu probable dès lors qu'il subsiste une différence notable de développement entre les deux pays. · Les comportements du secteur financier ont sapé sa solidité et obéré sa capacité à amortir une crise financière. Cette carence a des conséquences d'autant plus graves que l'intermédiation bancaire est très importante en Asie. Comme l'explique Mme Denise Flouzat, « le niveau d'épargne est très élevé dans les pays asiatiques car les ménages sont contraints d'épargner une part substantielle de leurs revenus, les gouvernements ne réservant dans les budgets des États qu'une place modique aux dépenses de santé et d'éducation. L'investissement est aussi majoritairement privé. Les banques jouent donc un rôle dominant dans l'intermédiation financière, assurant la transmission de l'épargne aux investisseurs. Même lorsque les entreprises se développent, elles demeurent la propriété de leurs fondateurs ou de leur enfants car ils préfèrent s'endetter auprès des banques plutôt que de voir diluer le capital et d'en perdre le contrôle » (97). Assurément, ce schéma général présente quelques variations selon les pays considérés. Il n'en demeure pas moins que les marchés financiers ne constituaient pas une source privilégiée de financement pour les entreprises asiatiques. Par exemple, en 1995, 8,2% des flux de financement des entreprises thaïlandaises venait des augmentations de capital, 5,5% de l'émission d'obligations, 15,1% de capitaux non bancaires, 18,1% d'endettement auprès des compagnies financières et 53,1% d'endettement auprès des banques (98). A l'exception de la Corée et de Taïwan, le financement obligataire représente une part négligeable de l'endettement des entreprises. Si, en moyenne, la capitalisation obligataire des marchés asiatiques représentait 28% de la capitalisation des marchés d'actions en 1991, elle n'était plus que de 8% une fois retirés les marchés coréens. A titre de comparaison, la capitalisation du marché obligataire américain représentait, à la même date, 54% de la capitalisation du marchés d'actions (99). La solidité du secteur bancaire est donc, dans ce contexte, un élément essentiel de la stabilité de l'économie dans son ensemble. Or, justement, cette solidité était de plus en plus sujette à caution au vu de l'expansion du crédit évoquée ci-avant. Dans tous les pays concernés, la libéralisation progressive des relations financières avec l'étranger s'est conjuguée à une libéralisation interne des conditions de financement de l'économie. Selon des trajectoires diverses, les pays ont démantelé peu à peu l'encadrement quantitatif et qualitatif du crédit et la réglementation des taux d'intérêt, notamment ceux applicables aux ressources des banques. Pendant plusieurs années, la hausse du prix des actifs financiers ou immobiliers et l'expansion du crédit bancaire se sont mutuellement renforcées. Les établissements bancaires investissaient directement en actions ou prenaient des participations dans d'autres types d'institutions financières soumises à un contrôle moins rigoureux de la part des autorités ; ces établissements pouvaient donc, en leur nom propre mais avec les garanties économiques offertes par leur actionnaire bancaire, explorer des risques normalement interdits à leur maison-mère. De même, l'essor de l'immobilier a alimenté l'expansion du crédit à ce secteur : les emprunteurs levaient des fonds - même à des taux d'intérêt élevés - pour acheter des actifs qui s'appréciaient rapidement, alors que les banques continuaient à octroyer des crédits, puisque la valeur de leurs garanties augmentait. Selon la Banque des règlements internationaux, « la forte rentabilité de ces actifs en Asie pendant les premiers stades du boum en a majoré le prix et souvent incité les banques et autres institutions financières à se livrer une concurrence acharnée, qui a comprimé leurs marges au moment même où les risques augmentaient. Or, il est très difficile de savoir à partir de quel point le prix d'un bien immobilier dépasse sa valeur actualisée, surtout dans les pays en développement où il est malaisé d'évaluer les gains à venir » (100). Des difficultés sont apparues lorsque, à compter de 1993 environ, les prix des actifs immobiliers ou des actions des sociétés opérant dans le secteur de l'immobilier ont quitté la trajectoire ascendante sur laquelle ils étaient placés depuis quelques années pour se mettre à fluctuer. Au début de l'année 1998, les analystes de JP Morgan estimaient que les risques bancaires liés à l'immobilier étaient « élevés » en Indonésie, au Japon, en Malaisie et en Thaïlande, et « modérés » à Hong Kong, aux Philippines, à Singapour et en Corée (101). Indépendamment de la fragilisation découlant des phénomènes de « bulle » spéculative sur les bilans bancaires, la qualité du portefeuille de prêts était également affaiblie par les liens étroits entre le secteur bancaire, le pouvoir politique et le secteur productif. Les banques ont fréquemment consenti des prêts, soit sur incitation du pouvoir politique, soit parce qu'elles étaient contrôlée par les groupes industriels eux-mêmes (102). Ce que, dans le langage inimitable des institutions internationales, la Banque des règlements internationaux qualifie de « prêts dirigés » a trouvé en Corée une intensité particulière. Le gouvernement coréen était l'actionnaire principal des cinq grandes banques commerciales jusqu'en 1983 et exploite encore cinq banques d'affaires. Dans les années 1960, les taux d'intérêt des prêts bancaires ont été maintenus artificiellement bas, certains secteurs pouvant, de plus bénéficier des prêts à taux privilégié (entreprises exportatrices, exploitations agricoles, entreprises de pêche). Dans les années 70, la politique de développement par la constitution d'un secteur des industries chimiques lourdes a intensifié les interventions gouvernementales dans l'allocation du crédit domestique : près de la moitié du crédit consenti par des institutions bancaires ou non bancaires relevait d'une politique de « crédit dirigé ». La libéralisation progressive du secteur bancaire dans le courant des années 1980 a réduit cette part au pourcentage encore respectable de 30% (103). Le sur-investissement dans l'industrie chimique lourde a laissé des séquelles dans les bilans des banques. En 1986, les « prêts non performants » - c'est-à-dire les prêts n'ayant toujours pas donné lieu au paiement prévu de l'intérêt dans un certain délai après l'échéance normale du coupon - représentaient 11% du total des prêts consentis par les cinq grandes banques commerciales et trois fois la valeur nette de ces banques. « Au regard des principes normaux de marché, la plupart des grandes banques auraient été considérées comme insolvables » (104). ESTIMATION DE LA PROPORTION DE PRÊTS NON PERFORMANTS (en % du montant total des prêts)
Source : JP Morgan, Asian Financial Markets, 24 avril 1998. En dernier lieu, la dégradation des conditions de l'exploitation bancaire s'est également traduite dans les résultats financiers. Évoquant l'expansion « extraordinaire » du crédit dans les économies émergentes d'Asie, la Banque des règlements internationaux estime, à cet égard, que « les banques où le crédit se développait très vite acceptaient des marges de plus en plus étroites, alors même que les entreprises prenaient plus de risques. [...] Les marges d'intérêt nettes des banques ne dépassaient guère leurs coûts d'exploitation et, par conséquent, elles ne se protégeaient pas vraiment contre les risques. Pourtant, ceux-ci augmentaient à mesure que de nouveaux domaines d'activité s'ouvraient, que les entreprises s'endettaient et que l'explosion de la valeur des actifs (immobiliers, en particulier) exposait les emprunteurs et les détenteurs de garanties au risque de chute des prix » (105). Le panorama du secteur financier et bancaire montre donc un faisceau de failles structurelles majeures, qui l'ont empêché d'amortir les effets de la crise financière. Au contraire, rappelait M. Trichet, gouverneur de la Banque de France, au cours d'un entretien avec votre Rapporteur, la fragilité du système financier a plutôt joué dans le sens d'une aggravation de la crise, de la rapidité de sa propagation et de sa transmission quasi immédiate à l'économie dite « réelle ». * * * L'étude a posteriori de la crise a fait ressortir des faiblesses profondes dans les économies asiatiques. Celles-ci auraient été empêchées par une politique de change trop rigide de conduire avec la souplesse nécessaire les ajustements permettant de gérer correctement le cycle macro-économique. Des défauts structurels se seraient aggravés de ce fait dans les années récentes, conduisant à un surendettement difficilement soutenable et à une fragilisation néfaste du secteur financier. Ainsi, la crise asiatique apparaît-elle clairement comme une nécessité. Cependant, elle apparaît aussi comme une énigme. Pourquoi les faiblesses structurelles et les désajustements macro-économiques n'ont-ils pu être corrigés de façon graduelle ? Pourquoi l'Asie a-t-elle pu connaître pendant trois décennies des performances uniques, malgré les défauts dont le modèle de croissance asiatique est aujourd'hui affublé ? Pourquoi les investisseurs ont-ils prêté si longtemps à l'Asie, jusqu'après le début de la crise, alors que les carences du système productif n'étaient pas inconnues ? C'est autour de ces questions que s'est rapidement dessinée une ligne de clivage sur l'interprétation des signes de faiblesse offerts par les économies asiatiques et sur la hiérarchisation qu'il convenait d'effectuer entre, d'une part, les facteurs de la crise d'ordre interne et, d'autre part, les facteurs d'ordre externe. 2.- Les controverses sur la nature profonde de la crise Dès les premières semaines de la crise, deux « écoles » se sont distinguées. Certains analystes ont attribué l'origine de la crise aux politiques économiques conduites par les gouvernements des pays concernés. Pour eux, la crise traduit l'inquiétude des créanciers de ces pays quant à leur capacité à rembourser les dettes contractées à l'étranger. Elle est une réaction salutaire des marchés, qui sanctionnent un dérèglement essentiel du mode de croissance asiatique. Elle est une crise de solvabilité. D'autres observateurs incriminent les marchés financiers internationaux. Pour eux, la crise est la conséquence d'un dérèglement de ces marchés, qui sanctionnent de façon excessive l'incapacité des pays concernés à faire face ponctuellement à une échéance de leur dette. Elle est une crise de liquidité. Votre Rapporteur estime que ce panorama binaire peut être enrichi, en prenant en compte les contributions apportées au débat par les personnes qui ont tenté d'introduire la problématique du développement dans leurs analyses. La crise apparaît alors comme la conséquence dramatique de désajustements consécutifs à la transition entre un ancien et un nouveau mode de développement. La première interprétation de la crise met l'accent sur les « lignes de faille » détaillées précédemment. Les responsables politiques des pays asiatiques n'auraient pas maîtrisé correctement la surchauffe apparue dans la première moitié des années 90. Il en serait résulté la création de « bulles » spéculatives, essentiellement dans l'immobilier et les actifs financiers, qui auraient fragilisé les agents économiques. Parallèlement à ces déséquilibres fondamentaux, les distorsions structurelles de la politique économique auraient précipité le déclenchement de la crise de change, en juillet 1997. Les tenants de cette interprétation en viennent rapidement à dénoncer les interactions trop étroites entre l'exercice du pouvoir politique, du pouvoir financier et du pouvoir économique. Les liens incestueux entre milieux d'affaires et responsables politiques ont faussé les signaux normalement adressés aux décideurs par le marché. Ces mêmes liens ont dénaturé les conditions d'appréciation des risques et provoqué une mauvaise utilisation des capitaux disponibles. Le fameux modèle asiatique de développement n'est donc, en définitive, qu'un « capitalisme de copinage » qui, au mieux, arrivait à bout de souffle, au pire, n'avait pu construire son succès que sur la complaisance et l'aveuglement des pays occidentaux. Il doit s'effondrer dès lors que les marchés, leurs yeux enfin dessillés, le confrontent aux mécanismes sains de la rationalité économique. Dans cette analyse de la crise, le thème de l'aléa moral devient central. Au niveau de l'entreprise, les pressions politiques pour maintenir des taux de croissance élevés ont suscité une longue tradition de garanties et quasi-garanties publiques aux projets privés, dont certains, d'ailleurs, ont été entrepris sous le contrôle direct du gouvernement, soutenus par des subventions ou financés par des prêts privilégiés. Les stratégies de production du secteur privé ont naturellement sous-estimé les coûts et surtout les risques afférents aux projets mis en _uvre. Avec l'impression que les gouvernements viendraient en tout état de cause soutenir les entreprises défaillantes, les investisseurs ont été amenés à croire que le retour sur investissement était pratiquement immunisé contre les chocs économiques. Au niveau du secteur financier, une réglementation lacunaire et une supervision laxiste, desservie par un degré d'expertise insuffisant, ont empêché les autorités d'imposer une gestion des risques efficace aux établissements bancaires et assimilés. D'ailleurs, les mêmes autorités n'ont pas manqué d'établir de multiples distorsions dans la sélection des financements. Une tradition largement partagée de « crédit par les relations personnelles » a minimisé les déterminants traditionnels de l'activité bancaire et a fragilisé un système par ailleurs sous-capitalisé. Enfin, l'aléa moral apparaît dans le comportement des banques internationales, qui, jusque dans la période précédant immédiatement la crise, ont prêté aux pays asiatiques sans se soucier, apparemment, de respecter les pratiques normales d'évaluation du risque. Sous-jacente à ce « syndrome de sur-financement » (106), la présomption que les crédits interbancaires transfrontaliers seraient effectivement garantis, soit par une intervention directe des gouvernements concernés, soit par le biais des institutions multilatérales comme le FMI, a été le facteur essentiel de cette insouciance interbancaire. L'analyse présentée ci-dessus apparaît dominante au sein du FMI et du Trésor américain, de la plupart des banques centrales des pays industrialisés ainsi que de nombreux universitaires. Sans négliger les phénomènes de marché, elle porte en elle la condamnation du modèle asiatique de développement et, en miroir, la promotion d'un modèle économique occidental - et plus particulièrement anglo-saxon. Aux yeux des tenants de cette thèse, la sortie de crise suppose la réalisation de deux conditions. Il convient tout d'abord de rétablir la confiance des marchés, car une crise de solvabilité peut difficilement se résoudre si le débiteur défaillant ne peut compter que sur ses propres moyens. C'est pourquoi les pays concernés doivent pouvoir bénéficier d'un financement de sauvetage, sous l'égide du FMI, accompagné des mesures macro-économiques permettant de stabiliser la monnaie et de rétablir les relations financières avec l'étranger. En second lieu, il convient de mettre en _uvre des réformes de structure, puisque la défaillance du débiteur provient d'un dysfonctionnement grave de son économie, qui a rendu son endettement insoutenable. Il s'agit, dans tous les sens du terme, d'une « normalisation » des économies des pays touchés par la crise. Assurément, cette présentation schématique de l'interprétation « fondamentaliste » de la crise recouvre une diversité de nuances parmi les promoteurs de cette interprétation. A l'une des extrémités de ce spectre, l'analyse de MM. G. Corsetti, P. Pesenti et N. Roubini représente la version la plus pure de l'interprétation fondamentaliste. Elle fait de l'aléa moral l'« alpha et l'omega » de la crise asiatique ; elle embrasse dans une même réprobation les faiblesses structurelles des modèles asiatiques et leurs dérèglements macro-économiques. La conviction des auteurs est telle que, même lorsque les statistiques ne semblent pas totalement probantes, une explication fournie à point nommé vient éclairer ce que les chiffres sont impuissants à démontrer. Par exemple, en matière d'inflation, « le tableau général est clair : dans tous les pays, les taux d'inflation étaient relativement bas dans les années 90 », les seules exceptions étant les Philippines, Hong Kong et la Chine. Mais, remarquent les auteurs, « les problèmes des secteurs bancaires et financiers observés dans plusieurs pays asiatiques dans le courant des années 90 ont soulevé des doutes considérables sur la capacité de ces pays à maintenir une inflation basse dans un avenir proche. [...] Pour ces raisons, les dépréciations nominales des monnaies asiatiques en 1997 étaient cohérentes avec les conséquences inflationnistes attendues des sauvetages des banques et sociétés financières ». Dans le même esprit, la présence d'excédents publics dans les pays concernés masquait le fait que les sauvetages des secteurs bancaires et financiers allaient peser fortement sur les finances publiques. Pour sa part, le FMI met l'accent sur les faiblesses du secteur financier et, dans une moindre mesure, sur les questions de « gouvernance » des économies. Il se montre plus prudent sur la participation de facteurs purement macro-économiques à la crise. Au contraire, il a estimé que « les difficultés des pays de l'Asie émergente ne sont pas principalement le résultat de déséquilibres macro-économiques » (107). Puis, ultérieurement, le discours s'est affiné et le FMI indique désormais que la crise résulte en partie de déséquilibres macro-économiques externes, reflets d'un taux d'investissement élevé et de forts entrées de capitaux, qui ont été exacerbés par l'appréciation du dollar. Le discours du FMI sur le mécanisme de propagation de la crise a, lui aussi, subi une légère inflexion. En 1998, il estimait que la contagion a touché les économies de la région qui semblaient exposées à une perte de compétitivité, à la suite de la dévaluation du bath, ou qui étaient perçues par les investisseurs comme souffrant des mêmes problèmes macro-économiques ou financiers. Aujourd'hui, le FMI évoque le « cercle vicieux » de la dépréciation monétaire, de l'insolvabilité et des sorties de capitaux, provoqué par un « changement dans le sentiment du marché » (108). Pour sa part ; P. Krugman, professeur d'économie internationale au Massachussets Institute of Technology et spécialiste des crises de change, a concentré son analyse de la fragilité du secteur financier sur les faiblesses de la régulation qui encadre son fonctionnement. Dans une conférence donnée au Japon en janvier 1998 (109), il a mis en avant la formation des bulles spéculatives, favorisées par l'aléa moral, puis leur explosion qui engage les intermédiaires financiers sur la voie de la faillite : la chute des prix des actifs provoque la défaillance des intermédiaires, qui les force à cesser leurs opérations et à liquider leurs actifs, ce qui alimente la baisse des prix. « Cette circularité peut expliquer à la fois la remarquable sévérité de la crise et l'apparente vulnérabilité des économies asiatiques à des crises auto-entretenues, ce qui, en retour, aide à comprendre le phénomène de contagion entre des économies par ailleurs dépourvues de liens économiques très étroits ». Avec cette approche de la crise, P. Krugman n'est pas très loin de rejoindre les tenants de la seconde interprétation, qui met l'accent sur l'illiquidité des pays asiatiques plutôt que sur leur supposée insolvabilité. Remarquant que la dette extérieure de la Corée ne représentait qu'un pourcentage limité de son PIB, M. Martin Feldstein, directeur du National Bureau of Economic Research, a développé, dans un article de la revue Foreign Affairs (110), la thèse de la crise de liquidité. Celle-ci ne révèle qu'un déséquilibre temporaire de la balance des paiements, un défaut sur une échéance ponctuelle, et ne signifie en rien que le pays concerné doit être considéré comme insolvable. Cette analyse conteste donc le fait que le modèle asiatique de développement soit affligé de tares dirimantes. Elle s'appuie, d'ailleurs, sur les performances passées des pays concernés pour relever que les « faiblesses structurelles » qui sont aujourd'hui dénoncées n'ont pas empêché l'Asie émergente de susciter l'envie des pays occidentaux au vu des taux de croissance enregistrés pendant près de trois décennies. D'ailleurs, la prétendue rationalité des marchés - présentée comme une force de rappel brutale mais salutaire pour ces économies à la dérive - n'a pas empêché la cécité des investisseurs, qui ont prêté sans compter à l'Asie alors même que les « faiblesses structurelles » étaient largement connues. M. Joseph Stiglitz, alors économiste en chef de la Banque mondiale, a même renvoyé ironiquement les détracteurs du modèle asiatique aux louanges qui étaient adressées à celui-ci quelques mois avant le déclenchement de la crise. Dans une allocution au Forum sur le développement en Asie, organisé à Manille en mars 1998, il relevait ainsi que « curieusement, beaucoup des facteurs identifiés comme étant les problèmes actuels des économies de l'Asie émergente sont étonnamment similaires aux explications qui étaient auparavant mises en avant à propos de leurs succès. Gérer les problèmes d'information réciproque de façon efficace, y compris par le biais de la coordination entre les milieux d'affaires et le gouvernement, était considéré comme une marque du succès de ces économies ; mais cette coordination est aujourd'hui assimilée à du copinage politique et le manque de transparence est considéré comme l'un des plus graves défauts. L'ouverture aux marchés internationaux était célébrée comme l'un des fondements du succès, cependant que l'insistance à éliminer les barrières au commerce et aux flux de capitaux est une composante importante des programmes de réforme. » « La stabilité macro-économique, incluant une faible inflation, était unanimement reconnue comme l'un des facteurs des remarquables performances des économies asiatiques ; cependant, le programme de réforme de la Corée inclut une disposition prévoyant l'établissement d'une banque centrale indépendante dont le seul objectif serait la stabilité des prix. La promotion de la concurrence, notamment à travers les politiques de soutien à l'exportation, était célébrée comme étant l'un des piliers des brillantes performances de ces économies ; cependant, le manque de concurrence entre les conglomérats est vu désormais comme un défaut critique. » « Enfin, [...] ce qui était considéré auparavant comme des marchés financiers solides, capables de mobiliser des flux d'épargne élevés et de procéder de façon remarquablement efficiente à leur allocation est devenu aujourd'hui des marchés financiers fragiles qui ont une part importante de responsabilité dans la présente crise » (111). En règle générale, les analyses que fait M. Joseph Stiglitz de la crise asiatique remettent en cause l'idéologie libérale, qui considère que des marchés financiers libres de toute entrave sont favorables à la croissance de l'activité. De plus, une libéralisation trop rapide peut fragiliser un système financier et par là même réduire la croissance. M. Jeffrey Sachs, directeur du Harvard Institute for International Development, radicalise encore l'analyse « financière » de la crise asiatique. Il reconnaît, assurément, que l'Asie émergente s'est exposée au chaos parce que ses systèmes financiers étaient fondés sur la pratique à grande échelle de méthodes d'initiés, de corruption, de mauvaise gouvernance, qui ont engendré des investissements inefficaces et des bulles spéculatives. Cependant, M. Jeffrey Sachs conteste que tous ces éléments aient pu conduire de façon quasi mécanique à la crise telle qu'elle a été observée. Il note, en particulier, que la crise n'avait pas été anticipée bien que les inquiétudes se fussent faites plus pressantes sur la Thaïlande au premier semestre de 1997. Son approche de la crise repose sur trois piliers : en premier lieu, l'Asie a été touchée par des chocs macro-économiques internationaux difficiles à apprécier par les acteurs du marché ; en deuxième lieu, ces facteurs internationaux ont interagi avec les faiblesses propres des systèmes financiers locaux et ont rendu les économies asiatiques vulnérables ; en troisième lieu, les marchés financiers font preuve d'un degré élevé d'instabilité intrinsèque. En d'autres termes, pour M. Jeffrey Sachs, « la crise asiatique est plus une crise du capitalisme occidental qu'une crise du capitalisme asiatique » (112). Un tel positionnement intellectuel a d'évidentes conséquences sur l'appréciation qu'il convient de porter sur les programmes de réformes associés par le FMI à ses programmes de sauvetage financier. Il en est de même pour la troisième catégorie d'interprétation de la crise. Dans son ouvrage intitulé Dragon de feu, dragon de papier. L'Asie a-t-elle un avenir ?, M. François Godement s'écarte des approches anglo-saxonnes, centrées sur les controverses relatives aux causes économiques de la crise financière, pour développer une approche plus structurelle, qu'il a bien voulu développer à l'intention de votre Rapporteur au cours d'un entretien. Un point de départ de la réflexion est le paradoxe largement répandu qui veut que la crise ait été à la fois imprévisible et inévitable. Crise imprévisible, car les comportements des acteurs - notamment des investisseurs et des opérateurs de marché - sont un paramètre éminemment volatil. En matière financière, la confiance a vocation à être remise en cause à tout moment, et, si elle est partagée entre une masse critique d'agents, la perte de confiance a rapidement des conséquences majeures. D'ailleurs, l'organisation des réflexes économiques autour de dogmes universellement connus, enseignés et partagés par les décideurs, limite la diversité des réactions et favorise les comportements grégaires. L'économie internationale, dans sa dimension financière, recèle donc une part croissance d'instabilité. Parallèlement, la crise était inévitable en ce sens que les économies asiatiques étaient affligées de défauts de plus en plus rédhibitoires. M. François Godement rejoint ici les analyse « classiques » relatives aux faiblesses structurelles de l'Asie émergente. Pour autant, le krach des monnaies asiatiques doit être replacé dans la perspective d'une « histoire financière planétaire » et ne peut se comprendre qu'au regard de l'ombre portée de la crise subie par le Japon depuis 1990, d'une part, du « bras de fer monétaire entre le Japon et les États-Unis », d'autre part. Ce bras de fer se traduit par la forte variabilité du taux de change du yen vis-à-vis du dollar. Il ne résulte pas des données objectives que pourraient constituer les positions successives de l'équilibre de marché, en fonction de l'évolution des fondamentaux économiques comparés des deux pays. Au contraire, le taux de change du yen évolue au gré des tensions politiques qui ponctuent régulièrement les vicissitudes du combat économique entre les États-Unis et le Japon. Ces incertitudes monétaires constituent une « prime pour la spéculation » et favorisent la formation de bulles spéculatives : au Japon entre 1985 et 1989, en Asie émergente entre 1990 et 1996. Lorsque la bulle éclate, la crise apparaît. Par ailleurs, les années récentes sont marquées par la confirmation du renouveau industriel des États-Unis et de l'érosion de la position relative de l'Asie. Dans un monde où les flux financiers sont globalisés, l'adaptation de l'Asie à un nouveau régime de croissance se traduit par une vulnérabilité accrue, en l'absence ou du fait de la faiblesse des mécanismes de régulation. Ainsi, « les structures et les politiques économiques asiatiques ont révélé leurs limites quand elles ont été confrontées à un programme de libre-échange commercial et de libéralisation financière inspiré de l'Occident développé ». En définitive, pour M. François Godement, « la crise asiatique ne trouve son origine ni dans l'échec du modèle asiatique ni dans l'existence de la spéculation internationale. Elle représente l'échec des économies asiatiques à passer d'un système fermé de propriété du capital et d'allocation autoritaire des ressources au jeu d'un nouveau système ouvert et aux règles transparentes. L'Occident a poussé l'Asie vers le libéralisme économique. Mais quand l'Asie a voulu à son tour se saisir du feu proverbial du marché, elle s'est brûlée les doigts ». * * * L'ampleur des divergences entre les deux principales « écoles de pensée » relatives aux origines de la crise ne pouvait manquer de se refléter dans les commentaires portés sur les décisions de politique économique adoptées par les autorités locales pour y faire face. Car si le diagnostic du mal diffère, les remèdes qu'il convient de prescrire au patient différeront aussi. Au-delà des controverses académiques - assurément stimulantes, au plan intellectuel - et au-delà des dissertations relatives aux conséquences de la crise sur le système productif, c'est bien le sort des populations qui est en jeu, alors même qu'elles sont quasiment exclues du champ de la réflexion des « experts ». A cet égard, on a sans doute trop négligé l'impact profond de la crise sur le tissu social des pays touchés par la crise. Enfin, la stabilisation économique observée dans la plupart des pays en 1999, puis le rebond amorcé dès l'année 1999 ou en 2000 ont pu faire croire que la crise n'avait été qu'un « mauvais moment », une parenthèse douloureuse mais sans conséquence majeure. Il n'en est rien et la crise marque bien, aux yeux de votre Rapporteur, une césure essentielle dans l'histoire de l'Asie émergente. C.- DE LA CRISE AU REBOND : UNE GRANDE PEUR POUR RIEN ? 1.- Répondre à la crise : les choix contestés de la politique économique Comme cela a été indiqué auparavant, le débat théorique sur les causes profondes de la crise a trouvé un champ d'application dans la critique des programmes de sauvetage financier mis au point par le FMI. L'école « fondamentaliste » estime que l'intervention du FMI a conduit à circonscrire rapidement la crise - nonobstant les phénomènes de contagion qui étaient inévitables, compte tenu des similarités des économies concernées. L'école « financière » affirme, au contraire, que le FMI n'a fait qu'exacerber la crise en se concentrant sur les réformes structurelles internes applicables aux pays touchés, alors que le dysfonctionnement des marchés financiers est l'origine première des difficultés en Asie. La philosophie de l'intervention du FMI en Asie a été présentée de façon synthétique, en 1998, par M. Camdessus, alors directeur général du Fonds : « aussitôt qu'il a été fait appel à lui, le FMI s'est mobilisé rapidement pour aider la Thaïlande, puis l'Indonésie, puis la Corée à formuler des programmes de réformes visant à résoudre au fond leurs problèmes et à restaurer la confiance des investisseurs. Au vu de la nature de la crise, les programmes sont allés bien au-delà du traitement classique des déséquilibres budgétaires, monétaires ou externes. Leur but est de renforcer les systèmes financiers, d'améliorer la gouvernance et la transparence, de restaurer la compétitivité économique et de moderniser l'environnement légal et réglementaire » (113). Les conditions essentielles posées à l'octroi des concours financiers du FMI reposaient sur deux postulats : la nécessité de réformer les économies, avec un accent particulier mis sur la restructuration du secteur bancaire ; la nécessité de maintenir des taux d'intérêt élevés pour éviter les sorties de capitaux et les attaques conte la monnaie. C'est en fonction de ces deux postulats que doivent être examinées les questions et critiques qui ont été adressées dès les premiers mois de la crise aux décisions de politique économique préconisées par le FMI. · Le resserrement de la politique monétaire et le relèvement des taux d'intérêt ont-ils aggravé la crise ? Plusieurs analystes ont estimé que l'application de taux d'intérêt élevés a eu des sévères répercussions sur les économies asiatiques. Elles auraient été impuissantes à enrayer la dépréciation des monnaies, mais auraient approfondi la crise en causant la faillite de nombreuses banques et entreprises, étranglées par des charges financières accrues. La politique la plus appropriée aurait donc consisté à maintenir une politique monétaire accommodante et des taux d'intérêt modérés. Certains affirment même qu'un abaissement des taux d'intérêt, et non leur relèvement, aurait plus facilement et plus rapidement rétabli la confiance des investisseurs internationaux et stoppé l'hémorragie de capitaux, en affermissant les conditions d'une reprise du crédit et de l'activité. Il n'est pas aisé de trouver une réponse. Il est clair que le choc subi par les économies asiatiques à travers la chute libre de leur monnaie pouvait éventuellement dégénérer en hyperinflation. Il est clair, aussi, qu'une augmentation des taux d'intérêt est classiquement considérée comme un moyen efficace d'accroître l'offre de fonds prêtables, c'est-à-dire, en l'occurrence, de limiter les sorties de fonds prêtés... On peut d'ailleurs remarquer que la politique suivie dans un premier temps par les gouvernements thaïlandais et malaisien consistait justement à éviter une contraction monétaire forte et une élévation importante des taux d'intérêt. En effet, les autorités monétaires étaient comme prises dans un étau entre la volonté de défendre la parité de leur monnaie et le danger que ladite défense faisait courir à leur système financier. Les interventions sur le marché des changes, puis la séparation entre marché domestique et marché off shore par la Banque de Thaïlande, au printemps 1997, n'ont cependant pas empêché la poursuite des pressions sur le bath. De même, le maintien, jusqu'en décembre 1997, de taux d'intérêt modérés par la banque centrale de Malaisie n'a pas eu l'influence souhaitée sur la confiance des investisseurs et a amené ceux-ci à continuer de réduire leurs positions, le ringgit se dépréciant au total de 40% avant que la banque centrale ne se décide à relever ses taux. Si la « riposte monétaire » aux attaques portées contre le taux de change et aux fuites de capitaux paraît être une réponse appropriée, l'enjeu est la vitesse avec laquelle il est possible de sortir de ce scénario de contrainte monétaire, qui n'est bien adapté qu'au plus aigu de la crise. · Le FMI a-t-il préconisé à tort un resserrement de la politique budgétaire ? Le fondement de la critique sous-jacente à cette question réside dans le fait, incontestable, que les finances publiques étaient en excédent au moment où la crise s'est déclenchée (114). De même, compte tenu de cette tradition d'équilibre budgétaire, le niveau de la dette publique était modeste. Dans ces conditions, les recommandations des premiers programmes relatives à la constitution d'excédents budgétaires sensibles ont pu apparaître comme une contrainte inutile appliquée à une économie en état de choc. La réponse du FMI repose sur trois arguments principaux : - l'affichage d'une politique budgétaire laxiste ou, tout au moins, relâchée, aurait été néfaste au rétablissement de la confiance. Les investisseurs auraient douté de l'engagement réel des gouvernements à rétablir l'équilibre de leurs paiements courants, donc à se donner les moyens d'assurer normalement le service de leur dette ; - le sauvetage et la restructuration du secteur financier allaient susciter des coûts importants, difficiles à évaluer dans les premiers mois de la crise, mais qui s'élevaient certainement à plusieurs points, voire plusieurs dizaines de points de PIB. Dans ces conditions, les finances publiques seraient mises à contribution et il convenait de préparer ce choc budgétaire par la rénovation des bases fiscales et un réexamen des dépenses, en vue d'améliorer la pertinence des choix de politique budgétaire ; - les récessions profondes subies par les pays asiatiques n'ont été anticipées par personne, ni au FMI ni parmi les économistes privés. Les premiers commentaires relatifs à la crise envisageaient un simple ralentissement de la croissance. Les prévisions de croissance ont, ensuite été révisées peu à peu à la baisse, ce mouvement étant très progressif. La récession ne s'est révélée que lentement. Il convient, aux yeux de votre Rapporteur, d'accorder plus de poids au troisième argument qu'aux deux premiers. Pour autant, on peut s'étonner du décalage certain entre, d'une part, l'optimisme longtemps persistant en matière de croissance et, d'autre part, les discours pessimistes sur l'état de délabrement des systèmes financiers et la nécessité de les placer au c_ur des réformes structurelles recommandées par ailleurs. Or, l'impact profondément récessif d'une crise bancaire généralisée est connu depuis longtemps. Depuis le début des années 90, le FMI avait lui-même placé les crises bancaires au centre de sa réflexion sur la fragilité des pays émergents. Il est clair que le FMI a ici péché par aveuglement en n'articulant pas assez distinctement le juste diagnostic porté sur les systèmes financiers asiatiques et les déterminants de la politique budgétaire. Ainsi, le programme économique pour la Corée indiquait qu'en raison du ralentissement de la croissance, de la dépréciation du taux de change et du coût des fonds publics nécessaires à la recapitalisation des banques, le budget serait passé en déficit en 1998. « Afin d'y remédier et pour alléger les contraintes qui auraient pesé [de ce fait] sur la politique monétaire, des mesures budgétaires supplémentaires équivalentes à 1-1,5% du PIB environ seront mises en _uvre pour réaliser au moins l'équilibre budgétaire, ou un léger excédent, à la fois grâce à des mesures fiscales et à des diminutions de dépenses. Ces mesures incluent l'augmentation des taxes sur les huiles minérales, qui est déjà entrée en vigueur, un élargissement de la base de la TVA et des mesures ponctuelles en matière d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés ; elles incluent également des coupes dans les dépenses courantes et, de façon plus limitée, dans les dépenses d'infrastructures et autres dépenses d'investissement » (115). Le FMI a d'ailleurs révisé, à partir du premier trimestre 1998, les objectifs budgétaires imposés aux gouvernements pour aller dans le sens d'un assouplissement. Néanmoins, la relative rigidité du FMI sur la politique budgétaire l'a peut-être conduit à des dérapages regrettables. Ainsi, votre Rapporteur a pu prendre connaissance des éléments troublants rapportés par MM. S. Radelet et Jeffrey Sachs dans une publication déjà citée du Harvard Institute for International Development. Selon ces auteurs, un tournant essentiel pour l'Indonésie s'est produit avec l'annonce par le gouvernement, le 6 janvier 1998, de son projet de budget pour l'année fiscale 1998-1999. « Le budget proposait une augmentation de 32% des dépenses en termes nominaux et en roupies. Ce projet de budget a immédiatement été dénoncé avec vigueur par le Trésor américain et par le FMI comme étant incompatible avec le programme du FMI ; il indiquait que l'Indonésie ne réalisait pas ce programme avec le sérieux nécessaire. Comme peu de personnes extérieures [aux institutions concernées] avaient eu effectivement accès aux documents confidentiels du FMI, ces allégations n'ont pas pu être vérifiées de façon indépendante et les marchés financiers se sont effondrés. Malheureusement pour l'Indonésie, les affirmations en provenance de Washington se sont révélées trop hâtives. L'augmentation des dépenses résultait uniquement de la prise en compte des effets de la dépréciation monétaire et, en termes réels, le budget présentait une réduction des dépenses. Quelques jours plus tard, Stanley Fischer, [directeur général adjoint] du FMI était cité comme affirmant que le nouveau budget n'était "pas aussi mauvais que ce qui a été dit" et, quelques semaines plus tard, le FMI approuvait un budget comportant une augmentation de 46% des dépenses, bien supérieure. » (116). · Le traitement de choc infligé aux systèmes bancaires a-t-il accru les difficultés des banques saines et solvables ? Peu d'observateurs critiquent le principe d'une restructuration du secteur bancaire dans le cadre des programmes approuvés par le FMI. Cependant, certains s'interrogent sur le fait que ces restructurations aient pu avoir des effets secondaires néfastes, notamment en jetant le doute sur la solidité du secteur dans son ensemble, donc en réduisant la confiance du public dans les banques gérées de façon saine et techniquement solvables. La panique bancaire en Indonésie est, évidemment, à l'origine de ces interrogations. Dans un entretien accordé à l'hebdomadaire Asiaweek, M. Jeffrey Sachs estimait ainsi que « le FMI a pris de nombreuses mesures réduisant la confiance. En particulier, je le critique pour avoir fermé de façon abrupte des institutions financières dans les pays asiatiques, envoyant ainsi le signal remarquablement rude, non préparé et dangereux... selon lequel vous feriez mieux de récupérer votre argent sinon vous risquez de le perdre » (117). La critique est en partie fondée. Assurément, le FMI a beau jeu de rappeler l'inertie générale du gouvernement indonésien vis-à-vis des réformes, le sort particulier fait au fils-banquier du président Suharto, l'absence totale de garantie des dépôts effectués auprès des établissements promis à la fermeture et l'absence de toute information sur les dépôts effectués auprès des établissements non mentionnés dans le cadre du programme. Le FMI met également en avant le fait que les mouvements de retrait général de dépôts, qui s'étaient engagés également en Thaïlande et en Corée à l'annonce de leurs programmes d'ajustement respectifs, ont été très rapidement arrêtés. Il n'empêche que le flou entretenu sur l'avenir des établissements bancaires autres que les seize initialement condamnés à la fermeture a été un des facteurs essentiels de la ruée vers les dépôts. Le FMI n'a pas prêté suffisamment attention, dans les faits, à ce que le public puisse penser qu'il subsistait, au sein du système bancaire, des établissements en sursis. Paradoxalement, dans le cas de l'Indonésie, la panique bancaire a eu pour effet de créer ou d'accroître les difficultés des banques nationales solides tout en réduisant les contraintes de liquidité pesant sur les banques d'État, alors même que la situation financière de celles-ci n'était guère brillante et que leurs principes de gestion n'étaient pas parmi les plus performants ! Plus largement, MM. S. Radelet et Jeffrey Sachs estiment que l'accent mis par le FMI sur « la résolution des problèmes de l'Asie [...] a imposé des coûts excessifs aux économies d'Asie émergente sans accorder suffisamment d'importance aux problèmes fondamentaux causés par l'instabilité des marchés financiers internationaux » (118). De fait, on peut se demander si les modalités d'intervention du FMI étaient bien adaptées à la situation des pays plongés dans la crise et si les financements apportés dans le cadre des programmes de sauvetage répondaient véritablement à leurs objectifs affichés. · Les financements du FMI ont-ils été efficaces ? Trop peu, trop tard : tel est l'un des reproches fréquemment adressés au FMI. Et la chronologie de la crise montre bien que le FMI a été « à la remorque » des événements plutôt qu'en avance sur les errements des marchés. Il faut convenir que le FMI ne peut pas entreprendre d'actions de son propre chef : il doit être sollicité par un gouvernement puis faire approuver par son organe exécutif, le conseil de direction, les accords qu'il est, le cas échéant, parvenu à conclure avec les autorités du pays demandeur. Le FMI dépend ainsi du bon vouloir des États, et l'on sait que la Thaïlande a tenté jusqu'au bout de défendre seule la parité de sa monnaie, dans la perspective justement d'éviter un recours au « gendarme financier » du monde. Pour autant, les réflexes du FMI l'ont conduit à négliger, dans un premier temps, la dimension nécessairement régionale de la crise, alors que certains commentateurs se posaient déjà la question d'une éventuelle contagion des turbulences aux voisins de la Thaïlande. Assurément, il paraît difficile pour cette institution multilatérale dévolue à la préservation de la stabilité financière d'aller clamant que la Thaïlande n'est que le premier domino d'une série et que celle-ci va bientôt frapper ses voisins... mais quels voisins ? Si elle avait été adoptée, cette attitude de « pompier pyromane » aurait été vertement critiquée - à juste titre. Mais le nécessaire cloisonnement des interventions du FMI ne pouvait servir de prétexte à un rétrécissement de sa vision. En 1998, la leçon a porté : le plan de soutien au Brésil présente très clairement un caractère préventif - et il est d'ailleurs décrit officiellement comme tel. La dévaluation du real en janvier 1999 montre, cependant, qu'une assistance précoce du FMI n'est pas nécessairement un gage de succès. Le volume des financements accordés a suscité des commentaires mitigés. Si les uns - principalement situés dans la frange ultra-républicaine du Congrès américain - voyaient dans le montant des concours du FMI une dérive dangereuse et ruineuse pour les contribuables occidentaux, d'autres, au contraire, estimaient que ces financements, pour importants qu'ils fussent en valeur absolue, ne répondaient pas aux besoins des pays bénéficiaires. Sur ce dernier point, en tout cas, la réponse ne fait plus aucun doute. « Aussi important que fût ce financement officiel, il ne pouvait suffire à soutenir les programmes [de réforme] en Indonésie et en Corée qu'assorti de l'hypothèse qu'il provoquerait une réaction largement positive de la part des marchés, notamment dans la première phase des programmes. Il était reconnu, cependant, qu'il existait un risque substantiel que les sorties de capitaux privés soient supérieures à ce qui était prévu. Si ce risque avait dû se concrétiser et que le financement du programme se soit ainsi révélé inadéquat, les sentiments qui avaient suscité à l'origine la panique des investisseurs auraient été confirmés, conduisant à un cercle vicieux » (119). Le « cercle vicieux » de la fuite devant la monnaie aurait alors conduit les économies asiatiques vers une déroute encore plus violente que celle observée dans les faits. Les conséquences sociales de la récession en auraient été plus dramatiques encore. 2.- Les conséquences sociales de la récession La crise financière a interrompu trente ans de croissance élevée qui se sont traduits par de remarquables progrès au regard de la réduction de la pauvreté et de l'élévation des indicateurs sociaux. L'impact social a été rapide et complexe, reflétant la diversité des situations initiales, de la sévérité du choc financier, des politiques gouvernementales et du contexte politique. La diminution de la demande de travail a été, naturellement, le canal le plus important par lequel la crise a frappé les ménages. De plus, de nombreux ménages à hauts revenus ont enregistré des pertes importantes sur le revenus de la propriété. En conséquence, la répartition de l'origine des revenus s'est sensiblement modifiée au profit des revenus issus de l'activité personnelle. En Corée, la part des salaires et traitements dans le revenu disponible est passée de 55% en 1997 à 51% en 1998 ; la part des revenus assimilables à des profits est restée stable à 9% environ ; la part des revenus issus de l'activité personnelle a augmenté de 33% à 37% (120). Les chocs les plus importants sur le niveau de l'emploi domestique ont été observés en Indonésie, en Corée et en Thaïlande. Les Philippines, qui étaient restées quelque peu à l'écart de la surchauffe économique précédant la crise, ont moins souffert et la Malaisie a fait porter sur les travailleurs étrangers l'essentiel de l'ajustement. La réduction de la demande de travail s'est faite principalement ressentir à travers une diminution des salaires réels. Mais on a pu observer des différences importante selon les pays, en fonction de la souplesse du marché du travail et de l'importance du secteur informel de l'économie. Le chômage et le sous-emploi ont crû fortement en Corée et en Thaïlande. Les taux d'activité ont chuté sensiblement en Corée et en Malaisie, mais sont restés quasiment constants en Thaïlande. Ils ont augmenté en Indonésie, sous l'effet d'un accroissement de la présence des femmes sur le marché du travail, celles-ci tentant de suppléer la chute du revenu des ménages. La Corée a connu le plus fort accroissement du chômage, qui est passé de 2,5% de la population active quelques mois avant la crise à 8,7% en février 1999, avant de revenir à des niveaux inférieurs à 5% de la population active vers la fin du troisième trimestre 1999. De plus, de nombreuses personnes se sont retirées du marché du travail, n'étant donc plus comptées parmi la population active. En fait, entre le deuxième trimestre de 1997 et le quatrième trimestre de 1998, la population coréenne non active a augmenté de 9%, soit 1,2 million de personnes. La plupart des nouveaux chômeurs étaient des journaliers ou des travailleurs temporaires, ainsi que des travailleurs indépendants, cette dernière catégorie de personnes n'ayant, en général, pas accès à une assurance chômage (121). Par ailleurs, la crise de l'emploi a plus frappé les femmes que les hommes : entre octobre 1997 et octobre 1998, le niveau de l'emploi féminin a chuté de près de 20% alors que le niveau de l'emploi masculin s'est réduit de 7%. Le nombre de contrats de travail à court terme s'est accru pour les femmes et a décru pour les hommes. L'Indonésie présente un contraste marqué avec la Corée. Ceci ne doit pas étonner, puisque, parmi les pays les plus touchés par la crise, la Corée est le plus riche, le plus urbanisé, le plus industrialisé, alors que l'Indonésie est le plus pauvre, le plus rural et celui où l'agriculture occupe la part la plus importante de la production. Le chômage déclaré a augmenté modérément en Indonésie, puisqu'il est passé de 4,7% de la population active en août 1997 à 5,5% en août 1998, en dépit de la contraction massive de la production. Le sous-emploi a également augmenté, bien qu'une mesure précise de ce phénomène soit difficile. En revanche, le taux d'activité a augmenté, du fait de la participation plus importante des femmes au marché du travail : 55% seulement des femmes âgées de 25 ans et plus étaient actives en 1996, mais cette proportion s'est élevée à 72% en 1998. L'Indonésie est le seul pays où les taux d'activité ont augmenté, ce qui reflète le niveau initial très bas du revenu, la vulnérabilité importante des ménages pauvres, la sévérité de la crise économique et l'absence ou l'inefficacité des mécanismes de protection sociale. Cependant, le principal impact de la crise sur le niveau de vie des ménages est venu de la diminution des salaires réels. Les salaires officiels ont décliné de 34% en termes réels entre 1997 et 1998, les revenus agricoles chutant, pour leur part, de plus de 40%. De plus, la chute du revenu de l'ensemble de la population doit aussi se lire dans le transfert massif de main d'_uvre du secteur formel vers le secteur informel (62,8% de l'emploi total en 1997 et 65,4% en 1998) et des secteurs de production modernes vers le secteur agricole (40,8% de l'emploi en 1997 et 45% en 1998). L'évolution de l'emploi en Thaïlande représente un cas de figure intermédiaire : le taux de chômage est passé de 2,3% de la population active en février 1997 à 4,8% en février 1998 (mais 6,1% sur l'ensemble de l'année) et 5,4% en février 1999. A la différence de la Corée, la reprise économique ne semble pas, pour l'instant, avoir de conséquence sur le niveau de l'emploi. Le sous-emploi (défini en Thaïlande par une durée du travail hebdomadaire inférieure à 20 heures) a également beaucoup augmenté pendant la crise ; selon la Banque mondiale, il est possible qu'une partie du sous-emploi observée en 1997 et 1998 se soit transformée en chômage effectif en 1999. Mais, comme dans les deux pays précédemment évoqués, c'est la chute des salaires réels qui le plus durement éprouvé les revenus des ménages. Entre février 1997 et février 1998, le revenu des ménages a chuté de 6% en moyenne. Ceci recouvre une différence entre la chute observée chez les ménages urbains (- 8,3%) et celle, moindre, observée chez les ménages ruraux (- 4,7%). Les travailleurs malaisiens ont bénéficié de la place exceptionnellement importante qu'occupaient les étrangers sur le marché du travail (environ 20% de la population active). Le retour dans leur pays de ces travailleurs ainsi que la diminution des taux d'activité ont limité la progression officielle du chômage, qui est passé de 2,7% de la population active en 1997 à 3,2% en 1998. Aux Philippines, le taux de chômage est élevé (8 à 9%) et le pays est exportateur net de travail dans la région et au-delà. Le chômage a légèrement augmenté en 1998, puis est revenu aux niveaux traditionnellement enregistrés. Par ailleurs, les salaires réels sont restés stables. Les dépréciations massives des monnaies nationales ont conduit à des changements importants dans le niveau des prix relatifs. Bien que des données précises manquent souvent, il apparaît que le niveau relatif des prix des denrées alimentaires a légèrement augmenté, à l'exception de l'Indonésie, où leur niveau au premier trimestre de 1999 est supérieur de 30% environ à leur niveau du deuxième trimestre de 1997. ÉVOLUTION DU PRIX RELATIF DES DENRÉES ALIMENTAIRES (indice 100 = 2e trimestre 1997) 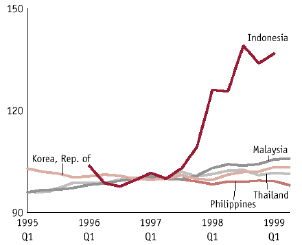 Source : Banque mondiale, East Asia. Recovery and Beyond, mai 2000 Ce comportement des prix des denrées alimentaires explique à la fois le déclenchement des « émeutes de la faim » - essentiellement urbaines - qui ont contribué à la chute du président Suharto et le maintien d'une certaine stabilité politique dans les campagnes, qui a évité des explosions sociales potentiellement beaucoup plus dévastatrices puisque susceptibles de toucher les populations rurales plus nombreuses. L'accroissement du chômage a eu des répercussions importantes sur la pauvreté. Celle-ci a augmenté de façon substantielle dans tous les pays touchés par la crise. Selon les informations recueillies par la Banque mondiale, la Corée a connu la plus forte augmentation du nombre de pauvres : alors que 7,5% des résidents urbains étaient considérés comme pauvres (au sens des statistiques coréennes) au premier trimestre 1997, cette proportion était montée à 23% au troisième trimestre de 1998 ; en revanche, dès le quatrième trimestre de 1998, une amélioration était engagée puisque le nombre des résidents urbains pauvres ne représentait plus que 16% du total. L'Indonésie a été touchée par les chocs économiques, politiques et climatiques, El Niño ayant provoqué une forte sécheresse. 19 à 20 millions de personnes sont passées au-dessous du seuil de pauvreté national, ce qui représente une augmentation sensible de leur proportion dans la population totale : 11% en 1996, mais 20% en 1999. En Thaïlande, le taux de pauvreté est passé de 11% en 1996 à 13% en 1998 et 1,1 million de personnes sont passées au-dessous du seuil national de pauvreté. CRISE ET PAUVRETÉ EN CORÉE (1996-1998) (en millions de personnes)
Le seuil de pauvreté est égal à 8$ par personne et par jour. L'extrême pauvreté s'entend de la situation des ménages dont la consommation par tête est inférieure à 80% du seuil de pauvreté. Le critère de pauvreté marginale s'établit à 80-100% du seuil de pauvreté. Le critère de fragilité s'établit à 100-120% du seuil de pauvreté. Source : Banque mondiale, East Asia. Recovery and Beyond, mai 2000 En définitive, la crise asiatique a eu des répercussions importantes sur le niveau de vie et le bien-être des populations. Cependant, l'augmentation de la pauvreté et des inégalités a été, en règle générale, moindre que ce qui était craint. Plusieurs explications ont pu être avancées pour expliquer ce phénomène favorable, mais curieux. Tout d'abord, la mobilité des travailleurs entre secteur formel et secteur informel comme entre les zones urbaines et les zones rurales a réduit l'impact de la crise en répartissant plus largement son fardeau social. De plus, les changements de prix relatifs consécutifs aux dévaluations ont amélioré la situation relative des personnes pauvres vivant en milieu rural, mais capables d'échanger les surplus agricoles sur des marchés, spécialement à l'exportation. On a ensuite observé une modification des comportement des ménages, qui ont réduit leur épargne et procédé à une réallocation de leurs dépenses en faveur des biens de première nécessité. Enfin, la contraction de la production a été moins forte et moins durable que ce qui était prévu. Les optimistes affirmeront qu'il s'agit de la plus récente manifestation d'un « miracle asiatique » qui perdure ; les pessimistes y verront une incitation à retarder les réformes jugées indispensables à un retour durable de l'Asie sur les chemins de la croissance et du progrès. 3.- Le retour de la croissance : un déni de réforme ? Le paysage économique de l'Asie a changé profondément en 1999. A l'automne 1998, plusieurs pays étaient plongés dans la récession, les flux de capitaux étaient devenus négatifs et les perspectives étaient extrêmement défavorables. Au début de 1999, un taux de croissance annuel moyen de 4,4% était cependant prévu pour l'ensemble de l'Asie. Il a été révisé à 5,7% au dernier trimestre de 1999 et le taux effectif de croissance en 1999 devrait s'établir au-delà de 6%. La reprise plus rapide que prévu qui a été constatée au cours de la première moitié de l'année 1999, en Corée, en Thaïlande, aux Philippines et en Malaisie, découlait d'une politique budgétaire et monétaire relativement accommodante et d'une résurgence des exportations favorisée par une forte demande mondiale de produits électroniques. La confiance des consommateurs s'est également améliorée, fournissant un socle solide à la demande intérieure. Dans la seconde moitié de l'année, la reprise a été soutenue par le maintien de politiques favorables à la croissance. · En 1999, la Corée a obtenu des performances remarquables, inégalées depuis 1988. Le taux de croissance s'est établi à 10,7%, ce qui marque un renversement spectaculaire par rapport à la récession de - 6,7% enregistrée en 1998. Au plan de l'offre, le secteur manufacturier a nourri la reprise ; au plan de la demande, le rebond rapide de la consommation domestique et l'investissement en équipements productifs ont apporté une forte contribution à la croissance, tandis que la diminution des stocks ralentissait, exerçant ainsi une influence négative moindre qu'en 1998. Cependant, le secteur du bâtiment a continué à se contracter et le commerce extérieur a fourni une contribution négative à la croissance. En dépit du taux élevé de croissance, l'inflation est resté très basse : l'évolution de l'indice des prix est passée de + 7,5% en 1998 à + 0,8% en 1999, l'une des meilleures performances des années récentes. L'appréciation du won entre 1998 et 1999 a contribué à la stabilité du niveau des prix. De façon générale, les conditions de financement de l'économie se sont grandement améliorées. Le niveau des réserves de change s'est accru rapidement. En effet, l'excédent des transactions courantes s'est élevé à 41 milliards de dollars, principalement du fait de la chute des importations résultant de la récession. L'excédent a alimenté les réserves de change, qui sont passées de 10 milliards de dollars à la fin de l'année 1997 à 74 milliards de dollars à la fin de l'année 1999. Parallèlement à cette reconstitution des réserves de la Banque de Corée, le won s'est stabilisé, en 1999, aux environs de 1 150 wons pour un dollar. Les exportations ont encore augmenté en 1999, aidées par l'appréciation du yen et la reprise générale en Asie. Les industries lourdes et les industries chimiques ont le plus profité de ce contexte favorable. Cependant, la forte reprise de la demande intérieure à provoqué une augmentation des importations (+ 29%) nettement supérieure à la progression des exportations (+ 10%). Ainsi, l'excédent commercial est revenu de 42 milliards de dollars en 1998 à 29 milliards de dollars en 1999, soit 7% du PIB. Le gouvernement a maintenu la politique expansionniste adoptée au milieu de l'année 1998 pour faire face à la récession. Le projet de budget prévoyait une augmentation des dépenses de 5,5% conduisant à un déficit égal à 5% du PIB. Du fait de la croissance, les dépenses se sont accrues de 10%, mais le déficit a pu être ramené à 3% du PIB. Pour sa part, la stabilité du taux de change étant acquise et l'inflation restant sous contrôle, la banque centrale a continué la diminution de ses taux directeurs jusqu'en mai 1999, puis a stoppé ce mouvement. La croissance devrait légèrement décliner en 2000 puis 2001, sous l'effet d'un moindre dynamisme de la consommation et du commerce extérieur. Compte tenu du niveau atteint au dernier trimestre de 1999, le chômage devrait se stabiliser aux environs de 5% de la population active. · Après une récession profonde en 1998, qui a conduit à enregistrer un recul de 10,4% du PIB, la Thaïlande a montré des signes de rémission dès le début de l'année 1999. In fine, la croissance s'est établie à 4,1%, sous l'impulsion favorable du secteur manufacturier et de la demande domestique, stimulée par la politique budgétaire. Le taux d'utilisation des capacités de production a atteint 63%, nettement au-dessus des 50% observés en 1998, bien que ce résultat soit encore loin des taux de 70 ou 80% atteints auparavant. L'agriculture n'a crû, en valeur, que de 0,5%, mais cette contre-performance relative résulte de ce que l'augmentation de la production des principales denrées, notamment le riz, le caoutchouc et le maïs, a été compensée par un repli sensible des prix agricoles. La demande intérieure s'est redressée et a progressé vigoureusement aux deuxième et troisième trimestres 1999 ; elle a atteint 8,5% sur l'ensemble de l'année. Le tourisme a poursuivi sa croissance, 8,5 millions de personnes ayant visité la Thaïlande en 1999, soit une progression de plus de 10% par rapport à 1998. Entre 1998 et 1999, le taux moyen de chômage n'a que légèrement régressé, revenant de 6,1% à 5,9%. Les programmes publics d'emploi ont fortement accru l'emploi temporaire, alors que le secteur agricole a absorbé un nombre significatif de travailleurs urbains licenciés, retournés dans leur province d'origine. Le gouvernement a continué de relâcher progressivement les objectifs de déficit public. Les projections initiales prévoyaient un déficit public égal à 7,2% du PIB, en augmentation sensible par rapport au ratio de 5,5% exécuté l'année précédente. En 1999, le gouvernement a financé deux programmes budgétaires, constitués de dépenses s'élevant respectivement à 1,4 milliard de dollars et 2,7 milliards de dollars, assorties de réductions d'impôts et de droits de douane. Le programme de mars 1999 visait à améliorer la situation de l'emploi et à stimuler la consommation privée ; le programme d'août 1999 s'est concentré sur le mesures fiscales et douanières, le régime des fonds d'investissements en actions, les mesures favorables à la reprise dans le secteur immobilier et le financement des petites et moyennes entreprises. Malgré la détente de la politique monétaire, la grande liquidité du marché interbancaire et la diminution des taux d'intérêt, la distribution de crédits s'est à nouveau contractée en 1999, sous l'effet des réévaluations des stocks de prêts non performants et du renforcement des obligations prudentielles en matière de fonds propres et de provisionnement des pertes sur créances douteuses. Malgré la légère érosion des excédents commerciaux et courants, la performance du secteur exportateur s'est améliorée en 1999, la contre-valeur en dollars des exportations s'accroissant de 7,4%. Conséquence logique de la reprise économique, les importations se sont accrues de 17,7%, ramenant l'excédent commercial à 7,2% du PIB au lieu de 12,7% du PIB en 1998. Le compte de capital a enregistré un déficit dû aux sorties nettes de capitaux, égal à 6,1 milliards de dollars, qui traduit le remboursement progressif de certains emprunts extérieurs, notamment ceux effectués par les Bangkok International Banking Facilities. En conséquence, la dette extérieure s'est réduite, passant de 86,2 milliards de dollars en 1998 à 75,6 milliards de dollars en 1999. La structure de la dette extérieure de la Thaïlande s'est également transformée : la part de la dette à court terme n'atteint plus que 19% au lieu de 27% en 1998 ; la part du secteur public a triplé pour atteindre 48% du total en 1999. Les réserves de change s'élevaient à 34,8 milliards de dollars à la fin de l'année 1999. Votre Rapporteur rappelle que, compte tenu de son redressement économique, la Thaïlande a décidé, en septembre 1999, de ne pas utiliser les deux dernières tranches du crédit attribué par le FMI dans le cadre du programme de sauvetage adopté le 20 août 1997. Au total, sur un « paquet financier » de 17,2 milliards de dollars (122), la Thaïlande a tiré 14,1 milliards de dollars. · La crise s'est apaisée en Indonésie et quelques signes de reprise sont apparus à la fin de l'année 1999 : le PIB a progressé de 0,2%, ce qui ne représente, finalement qu'une stagnation au niveau de la production effectuée en 1998, qui avait chuté de 13,2% par rapport à l'année précédente. La reprise initiée dans l'agriculture, s'est progressivement étendue à d'autres secteurs. L'industrie manufacturière a connu une expansion de 2,2%, sous l'influence favorable de l'industrie exportatrice du pétrole et du gaz, alors que le bâtiment n'enregistrait qu'une augmentation de 1,1%. Le secteur des services a pâti de la contraction des services bancaires et financiers : il s'est replié de 1,5% par rapport à 1998. La reprise de la demande a, dans un premier temps, été soutenue par l'augmentation de la dépense publique, la consommation privée ayant pris le relais par la suite ; l'investissement privé a poursuivi son repli, à la suite des difficultés observé dans le processus de restructuration de la dette privée des entreprises. La pression de la crise sur le revenu des ménages s'est à peine allégée. Le taux de chômage est passé de 5,5% en moyenne sur 1998 à 6,3% en août 1999, pour décliner légèrement après cette date. Par ailleurs, les salaires réels ont augmenté, mais restent inférieurs de 20 à 25% au niveau d'avant la crise. La baisse des prix des produits alimentaires a été le facteur principal de désinflation, étayée par le rétablissement des circuits de distribution alimentaire, l'appréciation de la roupie sur le marché des changes et la vigilance de la politique monétaire. Alors que la roupie s'était échangée à un taux compris entre 7 500 roupies pour un dollar et 17 000 roupies pour un dollar en 1998, les fluctuations se sont limitées à la fourchette [6 800 - 9 500] roupies pour un dollar en 1999. L'appréciation du taux de change n'a pu compenser les effets de l'inflation et le niveau réel du change de la roupie est resté inférieur de près de 30% à ce qu'il était avant la crise, conférant ainsi un avantage comparatif significatif aux producteurs indonésiens sur leurs concurrents situés en Thaïlande, aux Philippines ou en Malaisie. Cependant, les performances du secteur exportateur sont restées médiocres. Les exportations ont décliné de 7,4% en 1999 et les importations se sont à nouveau contractées, avec une baisse de 10,8%, du fait de la chute des importations de biens d'équipements. Dans ces conditions, l'excédent courant de 4,9 milliards de dollars reflète plus la profondeur de la crise que la reprise des secteurs ouverts vers l'extérieur. Le compte de capital a bénéficié d'une diminution des sorties de capitaux consécutive aux accords de rééchelonnement de la dette, alors que les entrées de capitaux officiels ont, elles aussi, diminué. · La Malaisie a connu une reprise vigoureuse, marquée par un taux de croissance du PIB égal à 5,4%, qui succède à une contraction de 7,5% en 1998. Cette forte croissance a contribué à réduire le chômage, celui-ci revenant de 3,2% de la population active en 1998 à 3% environ en 1999. A l'exception du bâtiment et des mines, toutes les grandes production ont enregistré une amélioration de leurs performances. Le secteur manufacturier a connu une expansion de 13,6%, grâce à la forte demande étrangère de produits et composants électroniques. Une augmentation importante de la production d'huile de palme a rejailli sur l'agrégat relatif au secteur agricole dans son ensemble, qui a progressé de 3,8%. La contraction de l'activité dans le bâtiment s'est légèrement ralentie. L'inflation a reculé, passant de 5,3% en 1998 à 2,8% en 1999. Ces bonnes performances sont dues à la stabilisation du taux de change, à un ralentissement de la hausse des prix des produits alimentaires et à la persistance d'un excès de capacités productives, qui empêche l'apparition de tensions sur les prix des produits. L'appréciation des monnaies des partenaires commerciaux de la Malaisie, alors que la parité du ringitt est fixe depuis septembre 1998, a donné aux exportations un avantage compétitif certain. Cependant, l'amélioration de la compétitivité-prix a été érodée par la détérioration de la compétitivité-coût vis-à-vis de pays qui s'orientent de plus en plus vers la production de certains biens à faible valeur ajoutée déjà produits en Malaisie. La balance des paiements s'est encore améliorée en 1999, du fait de l'élargissement de l'excédent commercial et de flux entrants de capitaux à long terme. Alors que l'excédent de 1998 résultait de la contraction des importations, le surplus de 1999 s'explique par un niveau légèrement supérieur des exportations en début d'année, conforté ensuite par un taux d'évolution identique pour les exportations et les importations. Les réserves de change se sont accrues et ont atteint 30,9 milliards de dollars, soit la valeur de six mois d'importation. La croissance devrait s'accélérer en 2000 et se stabiliser en 2001, sous l'effet d'une reprise de la consommation privée, qui réduirait l'excès de capacités de production et inciterait à une augmentation de l'investissement. * * * Le retour de la croissance, précoce en Corée, plus hésitant en Indonésie, aurait pu dresser des obstacles sur la voie des réformes. Mais votre Rapporteur a pu constater que l'impulsion initiée en 1997 et 1998, sous la contrainte de la crise, reste une force motrice centrale dans le paysage économique, social et politique de l'Asie d'aujourd'hui. Un retour en arrière paraît impossible : c'est une nouvelle Asie qui se construit sous nos yeux. Trois ans après le déclenchement de la succession d'événements qui, partant de Thaïlande en juillet 1997, se sont étendus en quelques mois à l'ensemble de l'Asie, on demeure surpris par l'ampleur du choc subi par cette région du monde. Choc économique, comme l'ont montré les développements précédents, mais aussi choc psychologique et ébranlement politique. En 1997, ce ne sont pas seulement quelques dizaines de milliards de dollars qui sont partis en fumée dans les flux et reflux dévastateurs des capitaux internationaux ; ce sont aussi quelques certitudes - ou quelques illusions - qui se sont définitivement consumées sur le bûcher des vanités. Pendant des années, et à l'exception, peut-être, de la Chine, les pays asiatiques ont vécu et construit une histoire organisée autour de la relation avec l'Occident. La lutte pour l'émancipation, puis le développement au forceps des États-nations ont peu à peu cédé le pas à la volonté de rattrapage économique et d'égalisation des niveaux de vie. « Aussi bien, voire mieux, et en tout cas plus vite » que les anciens maîtres occidentaux aurait pu être le mot d'ordre de pays où la croissance tenait lieu de viatique politique et où l'énergie de la population était habilement canalisée vers l'amélioration du bien-être collectif. Et, de fait, le dynamisme économique de l'Asie était considéré comme le moyen qui permettrait de « rendre sa dignité à une région qui avait été menacée d'asservissement et de misère » (123). Alors que les pays occidentaux passaient, au fil des années, de l'ignorance du phénomène à l'indifférence, puis à la considération et, enfin, à l'inquiétude, les opinions, en Orient et en Occident, se sont rejointes au début des années 1990 dans une même admiration du « modèle asiatique de développement », censé faire bientôt de l'Asie le troisième pilier du monde industriel. Mais les dernières années de ce siècle finissant resteront celles qui auront vu ce défi asiatique se briser avec l'échec d'économies mercantilistes incapables de supporter la confrontation avec les principes néo-libéraux d'inspiration anglo-saxonne. L'heure est donc venue, pour les pays asiatiques, d'engager une démarche d'introspection et de remise en question, afin de comprendre ce qui, dans le processus antérieur de développement, a provoqué la faillite rapide de méthodes si efficaces pendant trois décennies. Ce faisant, les pays concernés ne pourront manquer de s'interroger sur la consistance de l'idée asiatique et sur la pertinence d'une construction régionale qui relève plus d'une agrégation fragile de composantes autonomes que de l'intégration solide de destins partagés. Cette possible « reconstruction asiatique » offre à l'Europe l'opportunité de faire entendre son message politique et social et de montrer que le tropisme américain n'est pas l'unique chemin vers l'équilibre et la prospérité. A.- INTROSPECTION ET REMISE EN QUESTION : LES PAYS ASIATIQUES FACE À LA RÉFORME La crise financière de 1997 et son prolongement économique en 1998 ont prélevé un lourd tribut sur la croissance, l'emploi et les niveaux de vie. En mettant en évidence les carences des systèmes productifs dans les pays concernés, ils ont imposé la nécessité de réformes profondes. A cet égard, le FMI et ses programmes - d'ailleurs non impliqués dans les restructurations entreprises en Malaisie - n'ont été que les messagers accessoires d'évolutions inéluctables. La Thaïlande, l'Indonésie, la Malaisie et la Corée ont donc rejoint le Japon sur le chemin de la réforme. Comme lui, ils doivent désormais composer avec la brutalité des exigences posées par le capitalisme mondial. Ils doivent également gérer les conséquences de bouleversements qui dépassent largement le simple cadre des systèmes économiques pour toucher aux fondements politiques et sociaux du lien national. 1.- Des structures économiques bousculées a) Le chassé-croisé entre dettes privées et dette publique Surmonter rapidement les effets de la crise et retrouver les moyens d'une croissance forte et durable impose de revitaliser le secteur financier, afin de ranimer la distribution du crédit et de soulager de sa dette le secteur privé non bancaire. Les pays touchés par la crise se sont attelés résolument à cette tâche, à la fois en mobilisant des fonds publics importants et en favorisant la rencontre des débiteurs et des créanciers. La restructuration bancaire est au c_ur des politiques nationales de rénovation financière. Compte tenu de l'importance du stock de « mauvaises créances », le retour des taux d'intérêt à leur niveau d'avant la crise (124) ne suffisait pas à assainir le secteur bancaire en restaurant sa profitabilité opérationnelle. La guérison par les flux étant impossible, il fallait donc mettre en _uvre des remèdes portant sur le stock de créances. ÉVALUATION DE LA PROPORTION DE PRÊTS NON PERFORMANTS (en % du portefeuille total de prêts)
(a) L'estimation « non officielle » inclut, notamment, les prêts non performants détenus par les structures publiques de défaisance. Source : Banque asiatique de développement, Asian Development Outlook 2000, mai 2000 Dans tous les pays, mais avec plus ou moins d'intensité, les autorités se sont efforcées de respecter trois principes généraux gouvernant la restructuration financière : - réduire le risque d'aléa moral associé à l'utilisation de fonds publics en faisant en sorte d'accroître la participation de l'État dans le capital des banques bénéficiant d'une recapitalisation ; - assurer un degré minimum de participation du secteur privé par le biais d'incitations budgétaires ou réglementaires ; - accompagner le processus de sauvetage financier d'une amélioration exhaustive du cadre légal et institutionnel dans lequel opère le secteur bancaire. Deux approches ont été retenues pour traiter le problème des prêts non performants. L'Indonésie, la Corée et la Malaisie ont choisi une méthode centralisée, avec la constitution de structures publiques de défaisance chargées de « nettoyer » les bilans des banques en achetant leurs prêts non performants. La Thaïlande n'a retenu ce procédé que pour la liquidation des 56 compagnies financières fermées en novembre 1997. La restructuration des prêts non performants a été laissée à la discrétion des banques, à charge pour elles de constituer, le cas échéant, une structure de défaisance autonome. Dans ce cadre, la principale source de dépenses publiques provient des actions entreprises par l'État dans les banques dont il est actionnaire, deux d'entre elles ayant été nationalisées à l'occasion de la crise. Le schéma général d'intervention des structures de défaisance en Corée (KAMCO) (125), en Indonésie (IBRA) et en Malaisie (Danaharta) est le suivant : - elles achètent aux banques en difficulté leurs prêts non performants, avec une décote par rapport à leur valeur faciale, calculée selon les perspectives de recouvrement ultérieur de la créance (126). Les banques matérialisent donc une perte. La situation de l'IBRA est différente, puisque l'agence prend le contrôle des banques qui nécessitent une restructuration : les prêts non performants sont donc directement transférés à l'IBRA ; - elles revendent à des investisseurs les prêts non performants considérés comme viables, le plus souvent par des procédures d'enchères publiques et après une restructuration qui peut comporter, par exemple, un rééchelonnement ou une révision des termes de l'emprunt. Il arrive que les sommes retirées de ces ventes soient supérieures au prix auquel les créances concernées ont été acquises aux banques ; - au cas où les prêts non performants sont considérés comme non viables, elles revendent également les actifs saisis sur les débiteurs défaillants en application des mécanismes de garantie parfois associés aux prêts. Chaque pays a adapté ce schéma général à son contexte particulier. Ainsi, l'IBRA assure également la gestion et la vente des actifs qui lui ont été transférés par les actionnaires des banques nationalisées, fermées ou placées sous la tutelle directe de l'IBRA, en compensation du soutien de liquidité qui avait été apporté à ces banques par la banque centrale d'Indonésie. Les actifs considérés représentent environ 10 milliards de dollars, constitués autour de plus de 200 sociétés. De même, la KAMCO a été autorisée par le gouvernement coréen à intervenir directement dans la gestion des banques en difficulté pour accélérer leur redressement ; elle a également été autorisée à leur accorder des prêts. Enfin, à partir du second semestre de 1999, la politique d'assainissement du secteur financier a été étendue aux activités non bancaires, par exemple l'assurance dommages, l'assurance vie et les métiers liés à la gestion d'actifs : par exemple, la KAMCO a acheté auprès de certains fonds d'investissement coréens des actifs non performants, notamment dans le cadre du démantèlement de Daewoo. Dans les trois pays, une part substantielle des prêts non performants a été laissée dans les bilans des banques, à la fois pour des raisons logistiques - les structures de défaisance ayant déjà fort à faire pour gérer dans de bonnes conditions les créances douteuses qu'elles ont acquises - pour des raisons budgétaires - les achats de prêts non performants étant financés par émission d'obligations assorties ou non de la garantie de l'État - et pour responsabiliser les banques en réduisant les risques d'aléa moral : le sauvetage du secteur bancaire ne consiste pas à socialiser l'ensemble des pertes occasionnées par les comportements imprudents des années faciles. Ainsi, à la fin de l'année 1999, il apparaît que l'IBRA a acquis environ 35% des prêts non performants du système bancaire indonésien. La KAMCO a acquis environ 52% des prêts non performants dans l'ensemble du secteur financier coréen et, s'agissant de la Malaisie, Danaharta est entrée en possession d'environ 35% du total des prêts non performants. Les structures de défaisance ont vocation à se défaire des actifs qu'elles gèrent. La Corée et l'Indonésie ont officiellement adopté une politique de vente rapide, alors que la Malaisie a donné la priorité à la valorisation de ses actifs, afin de minimiser le coût pour les finances publiques. En fait, la réalité a déplacé la ligne de partage entre, d'une part, la Corée et la Malaisie, qui ont d'ores et déjà revendu près de 30% des actifs gérés et, d'autre part, l'Indonésie où des difficultés multiples ont freiné la réalisation du portefeuille d'actifs. Parallèlement au nettoyage de l'actif des bilans bancaires, les plans de sauvetage financier impliquent également une consolidation du passif de ces bilans, c'est-à-dire une recapitalisation par injection de fonds publics. En Corée, cette tâche est confiée à une institution spécialisée, la Korea Deposit Insurance Corporation (KDIC), dont la mission originelle consiste à assurer la garantie des dépôts accordée par le gouvernement. En Indonésie, l'IBRA met en _uvre un schéma de recapitalisation qui associe l'État et les actionnaires des banques, respectivement à hauteur de 80% et 20% du montant des fonds apportés. L'IBRA recapitalise directement les banques d'État ainsi que les banques passées sous sa tutelle. En Malaisie, le gouvernement a créé une agence spécialisée, Danamodal, dont les concours semblent pouvoir prendre la forme d'une participation au capital (avec présence au conseil d'administration) ou d'avances remboursables (127). En Thaïlande, les banques publiques ont bénéficié de près de 10 milliards de dollars d'apports de capitaux par l'État, alors que la plupart des banques privées ont refusé l'apport de fonds publics (128) et préféré asseoir leur recapitalisation sur des financements de marché. La recapitalisation bancaire a pour corollaire le passage d'une grande partie du système bancaire dans le secteur public. En Corée, la KDIC détient plus de 50% de la capitalisation du secteur et quatre banques commerciales étaient détenues à plus de 90%. Parmi elles, deux banques totalement insolvables avaient été nationalisées en janvier 1998. En Indonésie, la majeure partie de l'activité bancaire est désormais sous contrôle public, par l'intermédiaire de l'IBRA. Sur treize banques commerciales opérant en Thaïlande, sept sont privées et six publiques. Tous les gouvernements ont affiché leur intention de réduire la taille du secteur public bancaire, en remettant leurs participations sur le marché (l'IBRA a récemment placé par offre publique environ 25% du capital d'une de ses banques) ou en vendant en bloc les établissements à un investisseur ou un groupe d'investisseurs (par exemple, le gouvernement coréen a vendu la Korea First Bank à l'américain Newbridge Capital, mais a échoué dans sa tentative de vendre la Seoul Bank à la Hong Kong & Shangai Bank). Pour sa part, la Banque de Thaïlande éprouve quelques difficultés pour organiser le transfert au secteur privé des banques publiques. Depuis le début de 1998, quatre banques étrangères se sont implantées en Thaïlande à l'occasion de la mise en vente d'établissements en faillite, mais deux des banques nationalisées qui devaient être vendues avant le mois de mars 1999 n'avaient toujours pas trouvé preneur au printemps 2000. L'assainissement du secteur bancaire passe aussi par la réduction du nombre de banques, soit par fermeture et liquidation, soit par fusion. En Indonésie, l'IBRA a engagé le processus de fusion de quatre banques d'État au sein d'un nouvel établissement bancaire, dont les besoins en matière de recapitalisation sont évalués à près de 24 milliards de dollars. De même, huit banques passées sous le contrôle du gouvernement doivent être fusionnées d'ici quelques mois afin de constituer ce qui devrait être la première banque privée du pays, après sa privatisation programmée. Les autorités de Malaisie ont mis au point un plan global de restructuration du secteur bancaire à partir des 58 établissements existants. En juillet 1999, une première version prévoyait la constitution de six groupes bancaires autour de « chefs de file » désignés par le gouvernement. Considérant que le dispositif retenu faisait la part trop belle aux intérêts malais, la communauté chinoise avait fait valoir ses fortes réticences, notamment en transférant certains comptes vers les banques étrangères ou des établissements off shore. Bien que l'ensemble des protocoles prévus aient été signés en septembre 1999, le gouvernement a jugé préférable de revoir le schéma de restructuration et d'établir un processus plus ouvert. Dans un premier temps, la restructuration devrait passer par un regroupement des seules banques commerciales, sur une base volontaire, afin de constituer une dizaine de groupes, auxquels seront ultérieurement rattachées les sociétés financières et les banques d'affaires (129). S'agissant de la Corée, le tableau ci-dessous montre l'ampleur des restructurations intervenues. RESTRUCTURATION DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES EN CORÉE (de janvier 1998 à mars 2000)
Source : Financial Supervisory Commission, Financial Reform Enfin, les gouvernements ont procédé à une révision du cadre légal et réglementaire dans lequel opère le système bancaire. D'une part, le droit des faillites a été précisé, en général dans un sens plus favorable qu'auparavant aux créditeurs, d'autre part les règles régissant l'activité financière ont été renforcées. Par ailleurs, les exigences prudentielles ont également été resserrées (contrôle des positions de change, contrôle des grands risques, etc.) et, surtout, les autorités ont désormais pour politique de mieux contrôler leur respect effectif. Enfin, il convient de mentionner, pour la Corée, le regroupement au sein d'une entité unique, la Financial Supervisory Commission, des quatre organes de supervision financière qui avaient auparavant pour champ de compétence respectif la supervision des banques, des assurances, des organismes non bancaires et des marchés financiers. Le sauvetage du système bancaire et financier a un coût, qui est supporté par les finances publiques. L'ensemble des opérations de soutien bancaire effectuées par la banque d'Indonésie ou par l'IBRA ont, jusqu'à la fin de l'année 1999, mobilisé 68 milliards de dollars. Il est vraisemblable que ce coût s'élèvera à près 85 milliards de dollars, soit plus de 50% du PIB. Selon les estimations de la Banque mondiale, la dette publique de la Thaïlande devrait passer d'un niveau équivalent à 16% du PIB en 1996 à près de 60% du PIB à la fin de l'année 2000 (130). Enfin, en Corée, le coût total de l'assainissement du système financier a été estimé à environ 25 ou 30% du PIB. L'horizon est-il désormais dégagé pour les secteurs bancaires en Asie ? Selon des informations recueillies par votre Rapporteur auprès de représentants des banques occidentales en Asie, il semble que les pratiques de provisionnement des créances douteuses dans un grand nombre d'établissements locaux soient moins rigoureuses que celles retenues par les filiales des banques américaines ou européennes. Cela signifie que les comptes des banques asiatiques, dans plusieurs pays, ne reflètent pas correctement la qualité dégradée de leur portefeuille de prêts. Votre Rapporteur souligne que la solidité de la reprise et, surtout, la capacité des économies asiatiques à surmonter sans dommages un ralentissement ou un retournement de la croissance, pourraient être affectées par ce traitement comptable insuffisamment rigoureux des créances douteuses. b) Un capitalisme en mutation ? Le basculement entre dette privée et dette publique n'est pas qu'un phénomène comptable. Il traduit l'apurement du passé, bien sûr, mais également le fait que les économies asiatiques s'engagent sur des voies nouvelles. En premier lieu, parce que la capacité des finances publiques à faire face à une nouvelle crise serait, évidemment, plus faible à l'avenir et que les gouvernements sont donc fortement incités à rénover le fonctionnement de leurs économies. Mais, surtout, le sauvetage du système bancaire est la partie émergée d'une transformation plus vaste, qui touche aux fondements mêmes des capitalismes asiatiques. Assurément, les différents pays empruntent des chemins spécifiques. L'Indonésie s'efforce en premier lieu de liquider au mieux les séquelles - nombreuses - de l'ère Suharto. Le démantèlement des monopoles se heurte, naturellement, à l'hostilité des dirigeants en place et des forces politiques qui bénéficiaient de leurs largesses. Mais la détermination du gouvernement, qui a pu parfois sembler affaiblie, reste intacte, comme en témoigne le récent projet visant à mettre fin au monopole d'importation et exportation de pétrole détenu par la société Pertamina. De même, la Thaïlande a semblé donner une priorité à la question de la dette dans le secteur productif, grâce à la mise en place d'un « comité consultatif pour la restructuration de la dette des entreprises ». Chargé de favoriser les opérations de réaménagement de la dette privée, c'est-à-dire des prêts non performants restés à la charge des banques, ce comité a examiné et traité plusieurs milliers de dossiers. Il apparaît, cependant, que la plupart des accords se traduisent par un simple rééchelonnement des échéances, sans que la solvabilité de l'entreprise débitrice soit traitée au fond, et que les dettes couvertes par ces accords - extraites des statistiques relatives aux prêts non performants - reviennent ainsi rapidement dans le champ de compétence du comité... Des difficultés similaires sont constatées en Indonésie. A la suite de l'accord de Francfort relatif à la consolidation de la dette des banques indonésiennes envers les banques étrangères, conclu le 4 juin 1998, une structure légère, la Jakarta Initiative Task Force (JITF), a été mise en place en novembre 1998 par le gouvernement, afin d'établir un cadre informel de renégociation des prêts non performants entre les banques créancières et les entreprises débitrices. Alors que le montant total de la dette privée est évalué à près de 120 milliards de dollars, le nombre de dossiers gérés par la JITF s'est stabilisé aux environs de 300, représentant un montant de 25 milliards de dollars. De plus, le nombre de dossiers résolus n'était, à la fin du premier trimestre 2000, que de soixante, pour un montant de créances égal à 3 milliards de dollars environ. Dans le cas thaïlandais comme dans le cas indonésien, le processus de restructuration est handicapé par les réticences conjuguées des créanciers comme des débiteurs. Certains obstacles viennent des obscurités, incertitudes ou biais de la législation, notamment celle relative aux faillites. D'autres sont économiques : les débiteurs ne souhaitent pas voir remis en cause leur pouvoir dans l'entreprise, dans le cadre d'un programme global de désendettement et de recapitalisation ; les créanciers ne souhaitent pas grever leur compte d'exploitation par la constatation de pertes sur leurs créances douteuses, puisque les solutions issues des renégociations se traduisent, nécessairement, par un « partage du fardeau » entre créancier et débiteur. En revanche, la restructuration de la dette privée progresse rapidement en Malaisie, sous l'égide d'un comité similaire à ceux mis en place en Thaïlande et en Indonésie. Derrière ce qui n'est, au fond, qu'une discussion « commerciale » visant à répartir les pertes sur prêts non performants, se cache un processus plus important pour l'évolution à long terme des structures économiques asiatiques : un début d'émancipation des banques, qui devrait les conduire à jouer un rôle plus actif dans la détermination de l'allocation du crédit. L'un des facteurs de la croissance des pays asiatiques a été la disponibilité d'un crédit bancaire d'autant plus facile à obtenir que les banques étaient souvent liées aux groupes industriels, voire contrôlées par eux. La quasi-nationalisation des systèmes bancaires rompt ces liens privilégiés et établit les fondements d'une autonomie de la décision de crédit, qui devra désormais se fonder sur une analyse du risque et de la rentabilité plus que sur la solidité des liens personnels. On comprend mieux, dès lors, les atermoiements du gouvernement coréen qui peine à concrétiser sa volonté affichée de faire rapidement passer dans le secteur privé les banques actuellement sous contrôle public. Il lui est difficile de choisir entre des solutions dont les inconvénients respectifs sont clairs : l'entrée massive de capitaux étrangers, la mise sous tutelle des banques commerciales par les chaebols ou le retour à la situation observée après les privatisations bancaires des années 80, à savoir l'apparition de « banques sans actionnaires », dépourvues de tout poids dans la confrontation avec les grands groupes industriels. D'ailleurs, le président Kim Dae-jung a repris, en l'amplifiant, la politique de reprise en main progressive des chaebols qui a débuté, en fait, au milieu des années 1980. Dès cette époque, les chaebols avaient été taxés par le gouvernement de « diversification sauvage » et de surinvestissement. En 1984, une loi a limité le volume des prêts bancaires susceptibles d'être consentis aux chaebols ; ceux-ci ont contourné cette restriction en développant leurs relations avec les banques d'affaires et les autres institutions non bancaires. En 1987, la loi sur les monopoles et la concurrence a été révisée pour interdire les participations croisées directes entre entreprises d'un même chaebol. A la même époque, les échanges entre filiales ont été encadrés afin d'empêcher les chaebols de venir en aide aux sociétés les plus fragiles de leur groupe. En 1993, ont été instaurées des limitations sur les garanties de paiement réciproques entre les filiales d'un même chaebol. Ces décisions ont été impuissantes à enrayer la montée du rôle des chaebols dans l'économie coréenne et, surtout, dans le système de pouvoir économique. Dès son entrée en fonction, en janvier 1998, le président Kim Dae-jung a relancé le processus de normalisation des chaebols. Deux erreurs d'interprétation doivent être évitées. Tout d'abord, il ne s'agit en aucun cas de démanteler les chaebols ou de réduire leur capacité à s'imposer sur les marchés mondiaux ; au contraire, la politique du gouvernement consiste à les renforcer tout en cherchant à limiter leur emprise sur la conduite des affaires du pays. En second lieu, la démarche du gouvernement ne vise pas à revenir aux pratiques antérieures (intervention politique dans les stratégies économiques des entreprises, orientation de la production nationale vers des secteurs d'activité privilégiés) mais à récupérer un pouvoir d'initiative minimal qui correspond à ce que l'on pourrait appeler en France la capacité de conduire une politique industrielle. Plusieurs séries de mesures ont été adoptées par le gouvernement coréen. Certaines visent à améliorer le cadre de fonctionnement des entreprises : elles améliorent la protection des actionnaires - notamment les actionnaires minoritaires - face à la direction des entreprises, elles renforcent le rôle des administrateurs de société, elles instaurent une plus grande transparence dans la gestion. A ce titre, les chaebols sont obligés, depuis 1999, de présenter des « comptes combinés » qui visent à prendre en compte l'ensemble des opérations effectuées au sein d'un même groupe, de façon analogue aux comptes consolidés du droit commercial français (131). L'obligation de publier des comptes trimestriels est entrée en vigueur en 2000. Le gouvernement a également engagé trois processus visant à répondre aux besoins de restructuration des entreprises. Les cinq plus grands chaebols ont été invités à procéder à une restructuration « autonome » de leurs activités, en échangeant certaines de leurs participations pour réduire l'éventail des métiers pratiqués au sein d'un même groupe. Les chaebols de moyenne importance devaient mettre au point avec leurs créanciers des opérations de réaménagement de leur dette par le biais de « plans de restructuration du capital ». Enfin, les PME devaient bénéficier de l'aide de leurs créanciers dans le cadre d'un programme global de soutien défini par le gouvernement. A la fin de l'année 1998, le gouvernement a constaté que la restructuration des cinq principaux chaebols était moins avancée que celle des autres entreprises. Un accord a alors été conclu, autour de deux dispositions essentielles : - dans huit branches d'activité, les principaux producteurs devaient être regroupés, afin de ne laisser subsister qu'une ou deux sociétés. Ces concentrations concernaient notamment les semi-conducteurs et l'automobile. Par exemple, Daewoo devait abandonner l'électronique et les télécommunications pour se consacrer à l'automobile, à l'industrie lourde, aux services financiers et au négoce. Hyundai devait prendre le contrôle des activités électroniques de LG, tandis que Samsung échangeait son activité automobile contre le secteur électronique de Daewoo ; - parallèlement, les cinq chaebols devaient réduire de moitié le nombre de leurs filiales, la réduction de leur périmètre d'activité devant concourir à la diminution de leur ratio d'endettement et à l'assainissement de leur structure financière. L'accord de décembre 1998 n'a pas eu tous les effets escomptés. Si les échanges d'actifs dans l'électronique et les semi-conducteurs ont été effectivement réalisés (à l'exception des actifs de Daewoo, qui n'ont pas réussi à trouver preneur), la concentration dans l'automobile a échoué. Cet échec laissait le champ libre à l'entrée de constructeurs étrangers, comme le montre la prise de contrôle de Samsung Motors par Renault, au printemps 2000. Ces évolutions sont-elles suffisantes à elles seules pour évoquer avec quelque pertinence une mutation du capitalisme coréen ? A considérer simplement le « meccano industriel » auquel a voulu procéder le gouvernement avec les cinq chaebols, la réponse est clairement non. Cependant, le sens général de la démarche ne peut pas être occulté : il s'agit bien d'introduire plus de transparence dans le fonctionnement des chaebols et de les inciter à se comporter comme de véritables groupes industriels plutôt que comme des conglomérats multiformes. En ce sens, le processus voulu par le gouvernement est bien révélateur d'une évolution profonde dans le paysage industriel de la Corée. La dynamique est tout autre au Japon. Là, face à l'apathie persistante du personnel politique, mais après avoir tergiversé elle-même pendant quelques années, l'industrie a pris en main sa restructuration et le mouvement connaît une accélération très vive depuis 1998. Il ne s'agit plus seulement de réduire les coûts, mais de se conformer à de nouvelles règles du jeu, nécessaires pour conserver la taille critique dans des marchés globalisés. Les entreprises sont désormais privées du soutien inconditionnel des banques, qui sont d'abord préoccupées de réduire le poids de leurs créances douteuses. Elles ne peuvent plus compter sur la solidarité traditionnelle au sein des keiretsu, ces réseaux d'entreprises qui structurent l'économie japonaise. Le problème ne vient pas de la qualité de l'outil de production, toujours efficace et compétitif, mais de l'excédent de capacité, dont l'évaluation est difficile mais qui pourrait atteindre 15% du PIB. La Banque du Japon l'évalue, pour sa part, à environ 25% du stock de capital installé. Les grandes man_uvres industrielles amènent leur lot de fermetures d'usines, de réductions d'effectifs, de regroupements et de fusions. La notion même de keiretsu semble devenir obsolète, puisque la fusion programmée entre les banques Sakura et Sumitomo, annoncée pendant l'hiver de 1999, efface les frontières auparavant étanches entre Mitsui et Sumitomo, deux des keiretsu majeurs du Japon. Déjà, en août 1999, la décision de fusion annoncée par la Banque industrielle du Japon, la Dai-Ichi-Kangyo Bank et la Fuji Bank avait suggéré que le modèle du réseau était remis en question ; elle ne concernait cependant que deux établissements appartenant à des keiretsu « mineurs » et une banque indépendante de tout réseau industrialo-financier. Au demeurant, la réforme de la loi antimonopole, en décembre 1998, a levé l'interdiction de constituer des sociétés holding et, de ce fait, ôte une part de légitimité au réseau informel que constitue un keiretsu. Ces évolutions affectent les deux piliers de l'économie japonaise : le secteur électronique et le secteur automobile. Tous les deux ont entrepris de redéployer leurs relations avec leurs sous-traitants traditionnels pour chercher de meilleurs coûts. L'industrie électronique s'efforce d'embrasser avec autant de vigueur que son homologue américaine le mouvement de ce que l'on appelle communément la « e-économie », suivant en celà les évolutions d'entreprises aussi emblématiques que Sony (132). L'industrie automobile, par ailleurs, est prise dans le grand mouvement de recomposition de l'automobile mondiale, engagé il y a deux ans avec la reprise de Chrysler par Daimler-Benz. Au renforcement des participations au Japon de General Motors ont répondu la prise de participation de Renault dans Nissan, au printemps 1999, puis la prise de participation de Daimler-Chrysler dans Mitsubishi, au printemps 2000. Seuls Toyota et Honda restent, pour l'heure, pleinement indépendants. On touche là à un élément essentiel de la redéfinition des capitalismes, au moins en Asie du Nord. L'entrée du capital étranger au sein des entreprises est conçu comme un moyen de changer en profondeur les méthodes de management et d'acquérir les expertises qui font défaut. Cela a été clairement exprimé par les interlocuteurs de votre Rapporteur, en Corée comme au Japon. En un sens, il faut y voir la perpétuation d'une tradition déjà ancienne, qui consiste à intégrer et assimiler tout ce que l'étranger peut apporter de novateur. En l'occurrence, celui-ci n'a pas seulement apporté ses capitaux, ses hommes et ses méthodes. Il impose également ses normes et ses principes juridiques. Au delà même des deux grandes économies capitalistes d'Asie du Nord, la révision des méthodes de gestion des entreprises est portée par les modifications apportées à leur environnement juridique. En Malaisie, les entreprises doivent mettre leurs règles internes en accord avec un code de gouvernance élaboré par le gouvernement ; elles sont tenues de publier des comptes trimestriels, le cumul des mandats d'administrateur a été limité, l'autorité de supervision des marchés financiers a vu ses pouvoirs renforcés ; il est également prévu de renforcer la protection des droits des actionnaires minoritaires. En Thaïlande, la recapitalisation d'entreprises sur fonds publics est conditionnée à une révision des méthodes de gestion. Il apparaît à votre Rapporteur que les économies asiatiques, avec plus ou moins de détermination, en achoppant sur des obstacles plus ou moins importants, s'orientent peu à peu vers l'abandon du « capitalisme des parts de marché », qui était auparavant cultivé comme la norme de référence, au profit d'un « capitalisme de la rentabilité ». Assurément, une telle évolution ne se fait pas en quelques mois, ni en quelques années. Pour prendre réellement - et à supposer que ce soit effectivement le but recherché - la greffe suppose une évolution des mentalités qui pourrait s'étendre sur une génération. Cependant, tout en rejetant l'optimisme quelque peu béat qui irriguait, en janvier 1998, un article du New York Times (133), votre Rapporteur souhaite prendre quelque distance avec les idées développées dans un éditorial récent de la Far Eastern Economic Review (134). L'auteur y estime qu'un « choc tectonique » a frappé l'Asie en 1997, qui a conduit à deux changements notables : les entreprises vont être de plus en plus soumises à des mécanismes de marché et vont, en conséquence, devoir répondre de leurs performances devant leurs actionnaires et leurs créanciers ; les consommateurs vont exiger un meilleur rapport qualité-prix. A cet égard, on affirme souvent que l'Asie est à la veille d'une renaissance. Pourtant, « tout commencement suppose une fin. [...] Mais qu'est-ce qui a fini, au juste ? la culture du secret ? l'opacité ? le capitalisme de copinage ? La réponse la plus honnête est que presque rien n'a fini et donc que rien n'a changé ». L'auteur met alors en opposition le principe essentiel du capitalisme et de la concurrence, qui supposent la confrontation, et la culture asiatique qui repose sur l'harmonie. Tant que ce « besoin d'harmonie » sera présent, l'esprit vrai de la concurrence et du capitalisme ne pourra pas se développer. La conclusion du raisonnement est fausse alors que les prémisses en sont justes. Certes, la valorisation de l'harmonie dans les cultures asiatiques peut être un frein à l'introduction de comportements trop étroitement calqués sur le principe de « confrontation » inhérent au fonctionnement d'une économie de marché à l'anglo-saxonne. Mais il serait réducteur de faire de l'harmonie le principe essentiel de toute culture asiatique. L'histoire montre que le désordre et la révolte sont, tout autant, des constantes des comportements collectifs en Asie. D'autre part, votre Rapporteur retire de ses déplacements en Asie la conviction profonde que les changements provoqués par la crise et l'ouverture des systèmes économiques s'étendent bien au-delà du champ de l'économique et ont, d'ores et déjà, des échos incontestables dans le champ social et politique. 2.- Changement social et démocratie a) De la crise à la réforme : vertus et limites de la déstabilisation La crise a bousculé l'emploi, développé la précarité et accru la pauvreté. La réforme, elle, ébranle certains mythes et brise certains tabous. Il en est ainsi, par exemple, de l'« emploi à vie » au Japon. On sait mieux, maintenant, que la notion d'emploi à vie telle que nous l'évoquons repose essentiellement sur une méprise des pays occidentaux quant à une supposée réconciliation du capital et du travail en la personne du salarié modèle dévoué à son entreprise, celle-ci lui accordant la sécurité pour son emploi et la progression de son salaire. En fait, le couple séduisant « emploi à vie / salaire à l'ancienneté » n'est appliqué que dans les grandes entreprises et ne concerne que 20% des emplois, environ. La stabilité de l'emploi résulte plus de la conjonction des intérêts que d'une affection réciproque. Le système s'est construit dans les années 1920, mais a été généralisé dans les grandes entreprises après la Seconde guerre mondiale, dans un contexte de forte croissance et de besoins élevés en main d'_uvre. L'entreprise, formant ses salariés, avait intérêt à les conserver. En échange de sa fidélité, le salarié recevait des avantages importants - par exemple en matière de capital-retraite - dont il perdait la majeure partie s'il quittait l'entreprise... Comme l'expliquait M. Philippe Pons à votre Rapporteur, « le système avait en outre l'avantage, pour le patronat, de scinder en deux la population active : une aristocratie ouvrière protégée, défendue par un syndicat maison, et une masse de travailleurs privés des mêmes droits, qui étaient surtout les travailleurs temporaires ou les salariés des entreprises sous-traitantes ». Ce système est aujourd'hui « grignoté » par la restructuration : si les entreprises qui sont fondamentalement saines réduisent leurs effectifs par une limitation des embauches, des incitations volontaires et des départs en retraite anticipés, les sociétés les plus vulnérables procèdent de façon moins douce. Le mouvement est d'ampleur telle que le président du patronat japonais a fait publiquement état de son inquiétude et a mis en garde les grandes entreprises contre les dangers des recours aux suppressions massives d'emploi (135). Parallèlement, le principe de seniorité - qui lie la progression de carrière à l'ancienneté dans l'entreprise - est de plus en plus contesté : la rémunération au mérite reste encore marginale, mais se développe rapidement, et les jeunes diplômés cherchent une plus grande ouverture dans leur carrière en se dirigeant plus nombreux vers les entreprises de création récente et les établissements appartenant à des sociétés étrangères. Ces bouleversements ne concernent qu'une minorité de salariés japonais, mais les interlocuteurs de votre Rapporteur lui ont tous signifié l'importance que revêtent les évolutions en cours pour l'ensemble du monde du travail. Il n'est pas étonnant que la société japonaise, qui a cultivé le mythe de l'emploi à vie, ait du mal à accepter l'idée que celui est mis à mal. Ainsi M. Kuribayashi, professeur à l'université de Tokyo, estimait que « le Japon doit construire un système social qui combine l'efficacité et la justice. Aujourd'hui, de plus en plus, les gens ont tendance à penser uniquement en termes d'efficacité, ce qui peut entraîner des grandes différences de revenu ou de fortune. Ceci n'est pas bon pour la société japonaise » (136). Le cas japonais de l'emploi à vie est évidemment spécifique. Pour autant, les sociétés asiatiques, déjà confrontées aux mutations engendrées par trente ans de développement, pouvaient trouver dans la crise et la réforme un facteur supplémentaire de déstabilisation. La vision plutôt pessimiste du devenir du « modèle social asiatique », développée par M. Jean-Luc Domenach dans L'Asie en danger (1998), aurait été confortée. Faut-il donc s'étonner si le Japon, cinq ans après l'attentat au gaz sarin dans le métro de Tokyo, reste confronté au défi de la secte Aum et d'une vague de « nouvelles religions » ? Faut-il s'étonner de voir le mouvement Falungong prospérer aux dépens des derniers oripeaux idéologiques du communisme chinois ? De fait, la crise et la réforme remettent en cause les fondements d'une stabilité qui avait été érigée en vertu cardinale par les régimes politiques locaux. L'appétence du pouvoir pour la stabilité traduisait, au demeurant, une profonde aspiration sociale en ce sens. La tradition asiatique de séparation entre l'économique et le politique a longtemps servi les régimes établis et éclaire l'échec des tentatives de changement radical. Elle explique pourquoi les ouvertures démocratiques engagées dans la deuxième moitié des années 1980 aux Philippines (137), en Corée (138) ou à Taiwan (139) ont été des évolutions plutôt que des révolutions. La crise a contesté des pouvoirs qui avaient en partie fondé leur légitimité - et justifié leur « fermeture » politique - sur leur capacité à maintenir un taux de croissance élevé et à en répartir largement les fruits, tout en préservant les intérêts coutumiers, clientélaires et corporatifs. Elle a suscité un renouveau des aspirations démocratiques, dans une région plutôt caractérisée par la faiblesse de l'idée démocratique. M. Jean-Luc Domenach rappelait ainsi à votre Rapporteur que le messianisme communiste était définitivement éliminé, mais que l'image de dynamisme entretenue par la Chine pouvait offrir un dérivatif - bien pâle, assurément. De même, les expériences récentes de démocratisation évoquées ci-dessus n'ont pas eu par elles-mêmes de vertus démonstratrices : « l'opinion la plus répandue est que la démocratisation n'a pas nui au développement mais qu'elle ne l'a pas renforcé ». Enfin, cette grande démocratie régionale qu'est le Japon, plus mature depuis les alternances politiques des années 1990, a été frappée d'un « mutisme idéologique » dont on comprend bien les origines, à la fois historiques et économiques. Pourtant, la crise a affirmé, favorisé ou déclenché des processus démocratiques qui dépassent leur cadre national et prennent leur pleine signification par la dynamique qu'ils sont susceptibles d'engendrer dans la zone entière. b) La crise comme opportunité démocratique La transition miraculeuse de l'Indonésie est, à cet égard, le séisme le plus violent qui a affecté l'Asie en crise. Les conditions dans lesquelles s'est produit le départ du président Suharto ont, tout d'abord, conféré un tour dramatique à la succession du « patriarche ». Écarté du pouvoir par la pression de la rue et des morts autant que par celle de son entourage et par d'indirectes pressions internationales, l'ancien dirigeant ne pouvait laisser à son vice-président, M. Jusuf Habibie, que la mission difficile consistant à gérer la lame de fond du changement sans pouvoir réellement influer sur le cours des événements. La seule source de légitimité, la seule chance de survie de M. Habibie résidait dans une ouverture contrôlée du système politique. L'annonce de la tenue d'élections législatives en juin 1999, puis d'élections présidentielles à l'automne 1999, ainsi que la libéralisation du régime des associations et de la presse allaient très vite entraîner une fermentation politique exceptionnelle. La diminution du nombre de sièges réservés à l'armée au sein de la Chambre des représentants - élus - ainsi que la diminution du nombre des membres composant l'Assemblée consultative du peuple - qui renforçait le poids relatif des élus - a ouvert une fenêtre d'opportunité au peuple indonésien (140). Le taux de participation de 93% aux élections confirme son aspiration au changement. Dès lors, la victoire des forces d'opposition au scrutin du mois de juin scellait pratiquement le sort du président en exercice. Discrédité aux yeux de la communauté internationale par les massacres perpétrés en Timor oriental sous le regard bienveillant de l'armée indonésienne, critiqué dans son pays pour la débâcle politique qui s'ensuivit, touché par le scandale du détournement de fonds de la banque Bali (141), dépassé par les troubles indépendantistes et les affrontements inter-religieux aux Moluques, le président Habibie apparaissait à la fois comme un homme de l'ancien régime et comme celui qui avait trahi l'héritage de Suharto. Par l'une de ces subtilités qui rendent parfois la vie politique javanaise si déroutante, le choix des membres de l'Assemblée ne s'est pas porté sur la personne dont le parti avait recueilli le plus grand nombre de suffrages, à savoir Mme Mégawati Sukarnoputri, mais sur M. Abdurrahman Wahid, chef modéré du principal parti musulman. Celui-ci proposa habilement d'élire Mme Mégawati Sukarnoputri à la vice-présidence, conduisant ainsi à une configuration de l'exécutif très consensuelle et reflétant correctement l'expression du vote populaire. La transition démocratique de l'Indonésie est un processus difficile, qui ne signifie pas nécessairement une rupture complète avec le passé. Le processus électoral a, justement, montré que la culture traditionnelle indonésienne, fondée sur la recherche du consensus comme mode de gestion politique, avait résisté à trente ans de développement économique. Assurément, le processus de consolidation du pouvoir du président, marqué par des remaniements de cabinet, par la tension avec l'armée et par la prise en charge directe de certains dossiers économiques, peut faire croire qu'une dérive autocratique est engagée. De même, le fonctionnement du parti de Mme Mégawati Sukarnoputri a pu récemment être jugé peu conforme à l'image démocratique qui est associée à sa dirigeante. Des interrogations se font jour, ces derniers mois, sur les intentions et les méthodes des nouveaux gouvernants et sur leur capacité à affronter les problèmes de l'Indonésie. La découverte de cas de corruption dans l'entourage direct du président, la volonté de mise au pas du gouverneur de la banque centrale ou la confiance affichée du gouvernement en sa capacité à faire face aux revendications indépendantistes en Papouasie apparaissent à certains observateurs comme des réminiscences d'une époque qu'ils voudraient voir révolue (142). Pourtant, il faut bien mettre à l'actif du président Wahid l'apaisement récent observé dans la province d'Atjeh, où les violences séparatistes ont laissé place à l'amorce d'une solution politique, autour d'un projet tendant à conférer une large autonomie à la province. Pour sa part, le processus de décentralisation devrait conduire à réduire l'influence de Java sur l'ensemble du pays, mais il peut aussi être considéré comme un risque supplémentaire de voir s'ériger des « baronnies » locales. La démocratie indonésienne est encore fragile. Elle reste largement tributaire d'une culture politique élitiste, close et collégiale. Cependant, des forces sont à l'_uvre, qui peuvent l'enraciner peu à peu. La libéralisation de la presse comme les réformes institutionnelles qui s'engagent contribuent à construire un avenir différent. La Thaïlande est également le théâtre d'une expérience de modernisation politique suivie avec attention en Asie. Dans un pays comptant une dizaine de formations politiques s'appuyant sur un système de clientèles, la capacité de décision des coalitions gouvernementales successives allait s'affaiblissant. C'est pourquoi le gouvernement de M. Chuan Leekpai, porté au pouvoir par les élections de 1992 qui faisaient suite au coup d'État militaire de février 1991, a lancé un projet de révision constitutionnelle qui a abouti, deux législatures plus tard, en septembre 1997. Alors qu'elle aurait pu bloquer le processus, la crise économique a renforcé l'urgence de la modernisation institutionnelle et permis une conclusion des débats plus rapide que prévu. Le texte instaure l'élection au suffrage universel du Sénat, auparavant désigné par le gouvernement, et instaure également une série de mesures visant à éradiquer la corruption et les achats de vote. De l'avis général, cette pratique, endémique en Thaïlande, avait atteint son paroxysme lors du scrutin législatif de novembre 1996. A cette fin, les candidats aux élections sénatoriales, organisées en mars 2000, devaient se présenter sans étiquette ni affiliation à un parti politique, les dépenses électorales étaient interdites ainsi que toute action de propagande autre que les réunions électorales tenues par les candidats en personne. Les résultats du scrutin ont été plus favorables que prévu au camp de la réforme, qui en est sorti renforcé. Si le vote des campagnes a été peu novateur, plusieurs sénateurs élus à Bangkok sont issus du milieu associatif ou d'organisations non gouvernementales. Évidemment, personne ne s'attendait à ce que les pratiques électorales traditionnelles disparaissent comme par enchantement : ces élections ont été marquées, comme les précédentes, par le clientélisme, le règne de l'argent (143) et parfois même l'intimidation. Le fait nouveau est que la Commission de contrôle, nouvellement instituée, a annulé un nombre significatif d'élections (78 sur 200) et renvoyé devant les électeurs les candidats indélicats et leurs concurrents. Les « bonnes habitudes » étant décidément bien ancrées dans les m_urs, le corps électoral a été convoqué jusqu'à cinq fois dans certaines circonscriptions... Comme en Indonésie, le chemin de la démocratie est long et tortueux. La politique reste largement une affaire de famille, les conjoints et cousins élus servant à renforcer l'assise des « poids lourds » dans les assemblées locales ou nationales ; mais l'élection du Sénat au suffrage universel a commencé à changer la donne. Les achats de vote reposent certes sur des fondements culturels et sociaux bien établis (144), mais les règles nouvelles en matière de dépenses électorales peuvent faire évoluer les esprits. Le personnel politique s'est peu renouvelé, mais l'inculpation pour fraude du ministre de l'intérieur, en avril 2000, et sa démission obligée montrent que personne n'est plus intouchable. L'approfondissement de la démocratisation en Asie ne pourra pas se mesurer qu'à l'aune d'une plus grande sincérité des opérations électorales. L'élargissement de la liberté d'opinion et d'expression sont des facteurs tout aussi essentiels, ainsi que la démilitarisation de la vie politique et l'amélioration du fonctionnement de la justice. Pour être jeune, la démocratie coréenne n'en a pas moins franchi une étape significative vers la maturité, dans des circonstances rendues plus dramatiques par la simultanéité de la crise financière et des élections présidentielles, en décembre 1997. Sanctionnant la déception des espoirs placés dans le précédent président, les Coréens ont élu M. Kim Dae-jung, l'opposant de toujours, l'homme qui s'était dressé contre toutes les dictatures. Certes, M. Kim Dae-jung est aussi le produit des m_urs politiques coréennes et ne dédaigne pas employer les mêmes moyens que ses adversaires. Dans les quelques mois qui ont suivi sa prise de fonction, il a réussi à renverser en sa faveur l'équilibre des forces au Parlement grâce à plusieurs ralliements dont la motivation profonde a semblé relever davantage de la capacité de persuasion de l'administration présidentielle plutôt que d'un changement de conviction politique chez les personnes intéressées. Il reste sensible aux intérêts de sa région, la province de Cholla, sans pour autant reconstituer au profit de celle-ci les réseaux d'intérêt dont a pu bénéficier, par exemple, la province du Kyongsang, dont étaient originaires quatre de ses prédécesseurs. Mais le président Kim Dae-jung est avant tout un symbole. Aux élections de 1971, il fit campagne contre le général-président Park Chung-hee, auteur du coup d'État de 1961, qui entendait légitimer son régime par la voie du suffrage universel. Kidnappé à Tokyo, en 1973, par les services secrets sud-coréens, il ne dut qu'à une intervention des autorités américaines de ne pas être noyé en mer Jaune. Il devait passer au total près de six années en prison et une dizaine en résidence surveillée et a été exilé aux États-Unis. Il fut condamné à mort en septembre 1980, le pouvoir lui reprochant d'avoir fomenté les émeutes de Kwangju, dont la répression par les forces de l'ordre fit environ 500 morts. Une fois encore, les autorités américaines firent pression pour que la peine soit commuée en réclusion. Dans ce contexte, la politique de consensus et de réconciliation nationale engagée par M. Kim Dae-jung dès son investiture, le 25 février 1998, apparaît moins comme le fruit des nécessités politiques de l'instant que comme la mise en _uvre effective des convictions du nouveau président. Dans son entreprise d'affermissement de la démocratie, le président Kim peut compter sur la vigilance renouvelée du peuple coréen. Les années récentes ont vu l'émergence de collectifs de citoyens, qui s'efforcent de faire vivre au quotidien le processus de démocratisation. Celui-ci passe, en partie, par un renouvellement des m_urs politiques qui implique la dénonciation des abus : corruption et régionalisme sont désormais au banc des accusés. En janvier 2000, une initiative spectaculaire a défrayé la chronique : une association a établi et publié une liste de 164 hommes politiques soupçonnés par elle de corruption ; quelques jours plus tard, la Coalition des citoyens pour des élections générales - collectif regroupant près de 450 associations - a récidivé en publiant une liste de 66 personnes jugées « indésirables » pour les élections d'avril 2000. Le mois suivant, des marches de citoyens ont eu lieu dans de nombreuses villes, exigeant la fin de la corruption. c) Une considération encore trop faible pour le monde du travail A la mobilisation des citoyens a répondu la mobilisation des travailleurs. La marche en avant de l'idée démocratique appelait des avancées équivalentes pour le progrès social. Votre Rapporteur se réjouit d'avoir pu constater que plusieurs pays ont engagé une démarche de normalisation des relations sociales, en améliorant les conditions de la représentation syndicale et en élargissant les droits des travailleurs. Ainsi, en juin 1998, l'Indonésie a ratifié la convention n° 87 de l'Organisation internationale du travail de 1987 relative à la liberté syndicale et au droit d'organisation. Le gouvernement indonésien a également adopté un décret permettant la reconnaissance de nouveaux syndicats et l'implantation de plusieurs syndicats différents dans une même entreprise. Il a libéré certains dirigeants emprisonnés. La Thaïlande a organisé une conférence salariale tripartite entre le gouvernement, les syndicats et les organisations patronales afin, notamment, de faire au gouvernement des propositions sur l'évolution du salaire minimum. Après avoir associé les syndicats à l'_uvre de restructuration économique et sociale au sein d'une commission tripartite, dès le début de l'année 1998, le gouvernement coréen a légalement reconnu, le 23 novembre 1999, la seconde fédération syndicale, la KCTU. Cependant, il existe encore des limitations à l'exercice des droits syndicaux et les carences en matière de droits des travailleurs restent nombreuses. En Thaïlande, l'adhésion à un syndicat reste interdite aux fonctionnaires. La Corée s'est signalée par l'arrestation, en 1999, de près de 500 syndicalistes, nombre du même ordre que celui recensé pour 1998 par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), à laquelle sont affiliées les deux fédérations syndicales coréennes. « Globalement, alors que la crise a provoqué une poussée sans précédent de chômage dans toute la région, la répression antisyndicale est restée de mise. Y compris en Corée où, estime le rapport de la CISL, 488 personnes ont été arrêtées en 1998 en raison de leurs activités syndicales et en Indonésie où l'armée a continué de s'intéresser de beaucoup trop près aux "relations industrielles". Ainsi, le 30 juin [1998], des militaires ont tiré avec des balles en caoutchouc sur des travailleurs qui protestaient devant leur usine de Bekasi, à l'est de Djakarta, pour exiger de meilleures conditions de travail. Une vingtaine de manifestants ont été blessés et 106 ont été interpellés. Par ailleurs, Dita Sari, une militante syndicale emprisonnée en 1996, n'a toujours pas été libérée. Il est vrai que les habitudes ne changent pas du jour au lendemain » (145). Il faut reconnaître que les syndicats ont mis à profit les espaces nouveaux de liberté qui leur étaient octroyés pour appuyer leurs revendications sur une légitimité renouvelée. Ainsi, alors que le président Kim Dae-jung bénéficiait, au début de son mandat, d'une image favorable dans le monde du travail, son engagement en faveur des réformes économiques et de la restructuration des chaebols a rapidement suscité l'irritation puis l'opposition des deux grandes centrales syndicales. La KCTU a même refusé de participer, dans un premier temps, aux travaux de la commission tripartite chargée de définir, aux mois de janvier et février 1998, les contours de la réforme des chaebols, avant de s'associer à la démarche. Cependant, les relations entre le président Kim et les syndicats se sont progressivement détériorées : la KCTU a même présenté des candidats portant ses couleurs aux élections législatives d'avril 2000. Cet acte de nature politique est significatif de la profonde évolution qui s'est engagée en Corée. A Singapour, M. Sabur Ghayur, spécialiste des politiques économiques et sociales au bureau régional de la CISL - Asie pacifique, estimait, à l'intention de votre Rapporteur, que des progrès modestes, mais significatifs, aient été accomplis en Asie au cours des dernières années, notamment en Thaïlande et même en Malaisie où, malgré la sévérité des lois relatives aux droits syndicaux et aux relations du travail, les organisations syndicales auraient été associées par le gouvernement à certaines décisions (146). d) La démocratisation : un processus fragile En Corée comme en Thaïlande, en Malaisie ou en Indonésie, on pouvait craindre que la crise financière et économique n'entraîne des réactions nationalistes, des explosions xénophobes ou des déchirements communautaires. Il est vrai que le déchaînement de la crise comme l'intervention du FMI ont souvent été ressentis comme une humiliation nationale par les pays concernés. Sous le masque de l'humour, l'apparition de « menus FMI » frugaux dans les restaurants coréens, en décembre 1997, traduisait plus qu'un simple désenchantement dans la population. De même, les images télévisées de M. Michel Camdessus, alors directeur général du FMI, debout, les bras croisés, regardant le président Suharto, assis, signer le deuxième accord entre l'Indonésie et le FMI le 15 janvier 1998, sont apparues aux yeux des Indonésiens comme le symbole de l'abaissement national. C'est d'ailleurs ce pays, le plus touché par la crise, qui a connu les déchirements internes les plus violents. Les premiers mois de l'année 1998 ont vu, en effet, les populations musulmanes s'en prendre à la minorité chinoise, qui détient l'essentiel du pouvoir économique en Indonésie. Les Chinois représentent, en effet, 4% de la population, mais détiennent près de 70% de la richesse nationale. Parmi les douze familles les plus riches d'Indonésie, dix sont d'origine chinoise. Cette minorité était le bouc émissaire désigné de l'effondrement du pays. En fait, les victimes des émeutes anti-chinoises du printemps 1998 ont été, pour l'essentiel, les petites gens ou les membres de la classe moyenne, ceux qui avaient un magasin, un restaurant, un hôtel ou une PME. Depuis les massacres de 1965 (147), les véritables riches ont appris à protéger leurs intérêts et à diversifier la localisation de leurs actifs. La chute du président Suharto et la démocratisation de la vie politique ont avivé d'autres passions. Les affrontements religieux entre musulmans et chrétiens ont embrasé les Moluques et causé la mort de plusieurs centaines de personnes (148) ; les tribus locales et les migrants javanais se sont violemment heurtés à Bornéo ; les revendications indépendantistes d'un mouvement « emmené par des islamistes nostalgiques de l'ancien sultanat » (149) ont ranimé la violence dans la province d'Atjeh, dans le nord de Sumatra, faisant également plusieurs centaines de morts (150) ; bien qu'ils ne représentent plus de menace militaire depuis la répression conduite entre 1977 et 1979 puis en 1988 et 1989, les Papous d'Irian Jaya ont réclamé l'indépendance de ce territoire administré par l'Indonésie depuis 1963 et annexé depuis 1969 (151). Alors qu'elle est, elle aussi, un État multiethnique, la Malaisie a traversé la crise sans trop de dommages politiques. Certes, la rivalité entre le Premier ministre, M. Mohamed Mahathir, et son dauphin désigné, vice-premier ministre et ministre des finances, M. Ibrahim Anwar, a débouché, en juin 1998, par le remplacement de celui-ci au poste de ministre des finances, puis par son limogeage. Le procès ubuesque (152) intenté par la suite contre M. Anwar, puis sa condamnation à six ans de prison en avril 1999, ont terni ce qui devrait rester comme une réussite dans la gestion politique de la crise : l'absence visible de tensions inter-ethniques entre les Malais (50% de la population), les Chinois (30%) et les Indiens (10%) (153). Il faut certainement voir dans le maintien de la paix civile l'effet de la politique de discrimination positive engagée en 1969 par le gouvernement malaisien au profit des bumiputras, les « fils du sol », c'est-à-dire les Malais de souche. On peut également penser que les diatribes adressées aux marchés financiers par le Premier ministre M. Mahathir ont eu sinon pour objet, du moins pour effet de détourner les possibles tensions populaires vers de lointains « spéculateurs occidentaux ». GENÈSE ET PRINCIPES DE LA « NOUVELLE POLITIQUE ÉCONOMIQUE » Depuis la séparation d'avec Singapour, la vie politique locale s'est organisée autour de la suprématie de l'UMNO (154), suprématie que les partis de l'opposition vont peu à peu remettre en cause pour réduire la majorité de la coalition multiraciale [dont fait partie l'UMNO]. Le Democratic Action Party (plutôt chinois) va augmenter son audience au point de déstabiliser la coalition au pouvoir et de la voir passer en dessous de la barre des deux tiers des voix. Les Malais, qui vivent dans une situation économique de subsistance, à l'exception de l'élite administrative et de l'aristocratie, s'inquiètent de cette « remontée chinoise ». En mai 1969, des émeutes inter-raciales font plusieurs centaines de morts, les Malais s'en prenant violemment à la communauté chinoise et l'accusant de vouloir les déposséder de leurs droits « inaliénables » inhérents à leur autochtonie. [...] ... / ... GENÈSE ET PRINCIPES DE LA « NOUVELLE POLITIQUE ÉCONOMIQUE » (suite) 1969 constitue la date fondatrice d'une politique d'« affirmation positive » au profit des Malais. [...] La Nouvelle Politique Économique (NEP) sera alors mise en _uvre pour une durée de vingt ans autour de deux objectifs principaux : 1) couper les liens entre identité ethnique et statut socio-économique, c'est-à-dire entre niveau de vie et appartenance ethnique (les Malais vivant souvent dans les campagnes avaient un niveau de vie moyen inférieur à celui des Chinois, généralement urbanisés). Concrètement, des quotas dans les entreprises, dans les universités, dans l'administration, sont réservés aux Malais afin de favoriser à terme l'émergence d'une classe moyenne malaise ; 2) restructurer la société pour abolir l'identification de la race à la fonction économique. Pour que les Malais s'engagent dans les secteurs industriel et commercial, il fallait des politiques incitatives auxquelles les banques islamistes vont pourvoir [...] et que l'État va soutenir (les appels d'offre publics favorisent les entreprises malaises). Ainsi, en vingt ans, cette NEP va permettre l'apparition d'une classe malaise entrepreneuriale dynamique (qui contrôle aujourd'hui environ 25% de l'économie contre 2,5% en 1970). Source : Regards sur l'Asie orientale, Centre des hautes études Comme l'Indonésie, la Malaisie risque pourtant dans les prochaines années, voire les tout prochains mois, d'être confrontée à la question de la place de l'Islam dans la vie politique. Alors que l'Islam est inextricablement lié à l'identité malaise (155), le parti dominant, l'UMNO, se voit confronté depuis les élections législatives de novembre 1999 à la montée du Parti Islam SeMalaysia (Pas). Celui-ci a vu sa représentation parlementaire passer de 8 à 27 sièges (sur 193). Ces élections ont donné lieu à une modification importante du paysage politique malaisien. Le vote malais s'est divisé en deux parts quasiment égales au lieu de se porter en quasi totalité vers l'UMNO. Les suffrages que l'UMNO n'a pu recueillir sont allés pour l'essentiel vers le Pas, qui est ainsi devenu le principal parti de l'opposition. L'UMNO a conservé sa position dominante grâce au vote de la communauté chinoise. En fait, la rivalité entre l'UMNO et le Pas date des années 1960, lorsque le parti islamique a conquis deux États de la fédération, sans pour autant représenter un danger réel au plan national. Pour limiter la progression de l'organisation rivale, l'UMNO a donné une orientation plus « islamique » à sa politique, en créant notamment les banques islamiques de développement, mais en plaçant son action politique sous la bannière d'un Islam moderne et progressiste. Cependant, le Pas a peu à peu occupé et élargi la brèche religieuse ainsi introduite dans le discours politique. Les progrès récents de l'islamisme politique ont provoqué une certaine surenchère de la part du gouvernement, dirigé par l'UMNO (156). Il est difficile de savoir jusqu'où peut aller la concurrence que se livrent les deux partis concernés pour s'attirer les faveurs des électeurs musulmans. Peut-être faut-il voir dans le récent succès électoral du Pas la sanction infligée par les électeurs malais au gouvernement du fait du sort réservé par celui-ci à M. Anwar, qui semble avoir choqué une partie de la population. Si tel était le cas, un progrès supplémentaire de l'islamisme politique supposerait vraisemblablement que soient réalisées deux conditions. La première serait que le Pas affiche moins d'intransigeance religieuse, afin de ne pas s'aliéner les couches musulmanes urbaines et le vote des malaisiens non musulmans. La seconde serait que l'UMNO tienne compte du soutien apporté par la population à M. Anwar, qui s'était fait le porte-drapeau de la réforme économique avant d'être limogé. * * * Les défis internes des pays touchés par la crise sont immenses. Il leur faut achever de stabiliser, voire de reconstruire un système bancaire susceptible de reprendre la distribution du crédit. Après avoir écarté la réalisation du risque bancaire systémique, il leur faut consolider le reste de leur système financier. Ils doivent également restructurer leurs entreprises afin de les décharger du fardeau de la dette, mais aussi les rendre plus compétitives dans un contexte nouveau qui ouvre plus grand la propriété du capital. Ils doivent enfin supporter les chocs sociaux provoqués par ces bouleversements et gérer une transition politique rendue parfois incertaine par le « brouillage » des repères antérieurs. Pourtant, la sortie de crise ne peut se contenter de thérapies purement nationales. L'Asie, à défaut de former une entité aux contours définis, à défaut d'avoir la densité que lui prête parfois l'Occident, a besoin de trouver des solutions régionales plus fortes qu'aujourd'hui. M. Jean-Luc Domenach rappelait à votre Rapporteur que « la dynamique d'agrégation en Asie a toujours été économique, pour l'essentiel ». Cette dimension ne peut évidemment disparaître, mais elle devra être combinée à d'autres lignes de force, qui ne pourront pas éluder la thématique d'une construction politique de l'Asie. B.- L'ASIE ENTRE AGRÉGATION ET INTÉGRATION 1.- La crise n'a pas contrarié le processus L'intégration économique au sein d'une zone géographique relève de multiples facteurs, dont, pour l'essentiel, le développement des échanges commerciaux croisés et les échanges affectant les facteurs de production (investissements directs ou de portefeuille, migrations de main d'_uvre). Il n'entre pas dans le dessein de votre Rapporteur de peindre ici un tableau exhaustif de ces phénomènes. Une brève présentation des tendances à l'_uvre depuis quelques années permettra, en revanche, de mettre en perspective les évolutions observées en 1998 sous l'effet de la crise. a) L'interprétation paradoxale des échanges intra-asiatiques Depuis le début des années 1970, les pays d'Asie émergente ont connu un développement exceptionnel de leurs exportations, dont le taux de croissance est presque toujours resté supérieur à celui des exportations mondiales et à celui des autres régions en développement. Acteurs relativement mineurs des échanges internationaux, ces pays ont quasiment triplé leur part des exportations mondiales. Parallèlement, une part croissante des échanges des pays asiatiques a été dirigée vers d'autres pays de la zone. En conséquence, le volume et la valeur des échanges intra-asiatiques se sont accrus, surtout à partir de la seconde moitié des années 1980. Ce constat masque en fait des évolutions très différenciées, et une modification des positions relatives entre les différents pays. L'analyse de deux tableaux présentés dans le rapport annuel Asian Development Outlook élaboré par la Banque asiatique de développement, dans son édition de 1997, permet à cet égard de préciser les tendances à l'_uvre entre 1980 et 1994. PART DES DIFFÉRENTES RÉGIONS DANS LES EXPORTATIONS DES ÉCONOMIES ASIATIQUES EN DÉVELOPPEMENT ET DU JAPON (en %)
(_) EAD : Économies asiatiques en développement. Source : Banque asiatique de développement, Asian Development Outlook, 1997. PART DES DIFFÉRENTES RÉGIONS DANS LES IMPORTATIONS DES ÉCONOMIES ASIATIQUES EN DÉVELOPPEMENT ET DU JAPON (en %)
(_) EAD : Économies asiatiques en développement. Source : Banque asiatique de développement, Asian Development Outlook, 1997. Votre Rapporteur n'a pu avoir connaissance de tableaux complémentaires pour les années postérieures à 1994 et ne peut donc pas relier à ces développements les analyses relatives aux années de crise proprement dites. Les tableaux évoqués ci-avant répartissent les pays d'Asie en cinq zones élémentaires : les Nouveaux pays industrialisés (NPI : Corée, Hong Kong, Singapour, Taiwan), les pays d'Asie du sud-est, les pays d'Asie du sud (Inde, Pakistan, Sri Lanka), la Chine et le Japon. Ils dressent une matrice retraçant respectivement la part des exportations et importations de chacune de ces zones dans les exportations et importations totales desdites zones. Les enseignements de ces deux tableaux sont nombreux. A partir du tableau relatif aux exportations, on peut voir que : - l'importance du marché japonais a diminué pour l'ensemble des zones hors Japon : la part dans leurs exportations totales des exportations à destination du Japon est passée de 10,1% à 8,9% pour les NPI, de 34,5% à 18,3% pour les pays d'Asie du sud-est, de 22,2% à 17,8% pour la Chine (157) ; - en revanche, les NPI sont devenus un marché important pour le Japon, qui y écoulait 10,8% de ses exportations en 1980 mais 23,7% en 1994. Dans une moindre mesure, ce phénomène concerne aussi les pays d'Asie du sud-est, qui absorbaient 7,1% des exportations japonaises en 1980 puis 10,5% en 1994 ; - les pays d'Asie du sud-est ont un commerce très extraverti : les exportations « internes » à cette zone ne représentent que moins de 6% de leurs exportations totales sur l'ensemble de la période. Ces pays sont donc faiblement intégrés en matière d'exportations. Par ailleurs, ils ont réorienté la majeure partie de leur commerce extérieur du Japon vers les NPI : la part de leurs exportations absorbées par le Japon a chuté de 16,2 points (passant, comme cela a été dit plus haut, de 34,5% à 18,3%) alors que la part de leurs exportations absorbées par les NPI a augmenté de 10,1 points, passant de 15,5% à 25,6% de leurs exportations totales ; - l'importance des marchés asiatiques hors Japon (158) s'est accrue pour les quatre autres zones : la part dans les exportations totales des exportations à destination de ces marchés est passée de 22% à 45,1% pour les NPI, de 21,1% à 36% pour l'Asie du sud-est, de 31,7% à 39,6% pour la Chine (159), de 16,1% à 20,4% pour les pays d'Asie du sud. Le tableau relatif aux importations montre que : - le Japon est resté un fournisseur important des pays asiatiques, mais ses parts de marché se sont érodées : les importations en provenance du Japon représentaient 23,6% des importations totales de ces pays en 1980, mais 22,7% en 1994 ; - les pays d'Asie du sud-est n'ont que faiblement accru leurs parts de marché en Chine (2,4% en 1980 puis 3,9% en 1994) et les ont simplement maintenues dans les NPI (8,9% en 1980 et 1994). Leur faible degré d'intégration se traduit également par une « auto-couverture » limitée de leurs importations, qui est passée de 4% en 1980 à 5,8% en 1994 ; - le Japon s'est largement ouvert aux produits en provenance des NPI et de Chine. La part de ses importations totales assurée par ces deux zones représentait respectivement 3,6% et 3,1% en 1980 puis 12,9% et 11,2% en 1994 ; - les pays asiatiques hors Japon assurent entre eux plus du tiers de leurs importations en 1994 : 34,2% au lieu de 17,8% seulement en 1980. ÉVOLUTION DES ÉCHANGES INTRA-ASIATIQUES 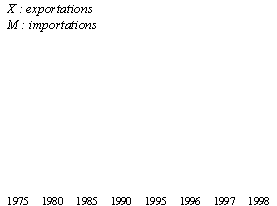 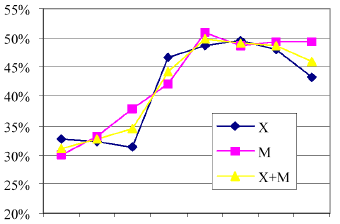 Source : Direction des relations économiques extérieures, Ces éléments partiels mais chiffrés suggèrent la complexité des faits qui se cachent derrière l'affirmation trop simple d'une « intégration croissante du commerce asiatique ». Au demeurant, celle-ci a connu une forte accélération dans la décennie 1985-1995. Mais l'augmentation des échanges entre pays asiatiques n'est pas pour autant synonyme d'intensification de ces échanges. De même que, dans l'analyse économique fondamentale, on distingue l'utilisation intensive de l'utilisation extensive des facteurs de production, de même dans l'étude des échanges internationaux, il convient de prendre en compte la taille respective des économies considérées. En effet, plus le commerce extérieur d'une région est dynamique, plus il est naturel - et quasi mécanique - de commercer avec elle. La place croissante de l'Asie dans les échanges mondiaux a donc exercé un « effet de taille » qui a naturellement polarisé vers elle une partie des exportations et importations des pays de la zone. On peut faire abstraction de cet effet de taille grâce à la notion d'intensité des échanges, qui rapporte ceux-ci au poids des zones considérées dans le commerce mondial. Il apparaît alors que les échanges intra-asiatiques ont progressé depuis 1985 mais sont devenus moins intenses. INTENSITÉ DES ÉCHANGES DANS L'ASIE EN DÉVELOPPEMENT coefficient d'intensité (sans unité) 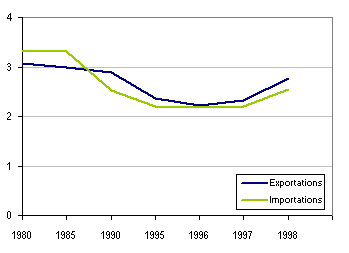 Source : Direction des relations économiques extérieures, L'année 1998 a enregistré les conséquences de la crise sur le commerce extérieur. La contraction des demandes domestiques s'est traduite par l'arrêt brutal de la progression des exportations à destination de la zone, celles-ci ne représentant plus que 43% des exportations totales en 1998 au lieu de 49% en 1996. Les importations ont évolué de façon moins orthodoxe. Même si, sur un plan comptable, les exportations régionales correspondent aux importations régionales, la chute brutale des importations totales a touché surtout les partenaires non asiatiques, de sorte que le poids relatif des importations régionales s'est maintenu et a même augmenté dans la plupart des pays, la seule exception étant Hong Kong. Selon le réseau des postes d'expansion économique en Asie, cette asymétrie s'explique par la chute des achats de biens d'équipement, traditionnellement adressés aux pays occidentaux, et par la composition des flux d'importations intra-asiatiques, surtout composés de matières premières et de demi-produits qui sont des intrants pour les exportations destinées aux marchés développés. Par ailleurs, comme le montre le graphique ci-avant, l'intensité des échanges intra-asiatiques a augmenté en 1998, tant pour les importations que pour les exportations : - le poids de l'Asie dans les importations mondiales a diminué alors que les importations intra-asiatiques sont restées stables ; - le poids de l'Asie dans les exportations mondiales a diminué plus fortement que la part des exportations intra-asiatiques dans les exportations totales de la zone. En 1999, la reprise des échanges de l'Asie émergente a été vigoureuse, le segment intra-asiatique en étant à nouveau l'élément moteur, avec une progression de 27,5% en rythme annuel sur le second semestre de 1999. Selon les informations recueillies par le réseau des postes d'expansion économique, les ventes de l'Asie émergente vers la Corée auraient même augmenté de 61,5% en rythme annuel ; les exportations asiatiques en direction de Taiwan se seraient accrues de 31,2%. « Le dynamisme des exportations vers ces deux pays s'explique dans une large mesure par le rôle d'intermédiaire qu'ils occupent entre, d'une part, la demande américaine et japonaise et, d'autre part, les maillons du circuit intégré électronique que sont les pays de l'ASEAN et, dans une certaine mesure, la Chine » (160). La notion de « circuit intégré asiatique » renvoie à la structure des échanges au sein de l'Asie développée ou émergente. Cette structure résulte, notamment, des tendances qui affectent la répartition des facteurs de production entre les différents pays. Il apparaît que les investissements effectués par les pays asiatiques à l'intérieur de la zone sont, depuis plusieurs années, un élément essentiel de l'intégration de leurs économies. A cet égard, la crise de 1997-1998 ne représente a posteriori qu'une perturbation passagère et minime. b) L'interdépendance par l'investissement L'essor des investissements directs en Asie émergente a pu être expliqué, jusqu'à une période récente, par le modèle classique du développement en « vol d'oies sauvages », d'ailleurs popularisé par des économistes japonais. Le Japon, principale puissance industrialisée, a commencé à délocaliser ses activités textiles vers les NPI dans les années 1960 pour faire face à la montée de ses coûts salariaux. Puis, pour répondre aux chocs pétroliers des années 1970, les industries lourdes japonaises se sont en partie délocalisées vers les pays asiatiques. Enfin, les années 1980 ont connu des investissements japonais de plus en plus importants dans des secteurs à la fois consommateurs de main d'_uvre et à contenu technologique plus élevé que le textile : l'industrie automobile, l'industrie électronique, l'industrie mécanique ont accru leurs capacités de production hors du territoire national. De même, les NPI ont délocalisé vers les pays de l'ASEAN, puis vers la Chine, une part croissante de leur production au fur et à mesure de leur industrialisation. L'interprétation de l'investissement direct comme conséquence directe du processus de développement et de sa diffusion au sein d'une zone géographique n'est pas l'unique clef de compréhension. La grande vague d'investissements directs japonais en Asie à partir de 1985 a plus à voir avec la réévaluation du yen consécutive aux accords du Plaza (septembre 1985) qu'avec un brusque « saut » dans les niveaux comparés de développement. De même, la reprise des investissements directs japonais après 1995 reflète avec un parallélisme surprenant la réévaluation de la parité du yen. L'augmentation des investissements directs des NPI en Asie émergente trouve également son origine dans la suppression, à la fin des années 80, de leur accès privilégié aux marchés de l'OCDE. Enfin, les investissements directs obéissent parfois à une logique de sécurité des approvisionnements, qu'illustrent par exemple les investissements japonais en Indonésie dans le secteur des ressources naturelles ou des produits de base. Il est encore difficile d'analyser l'impact de la crise sur les flux d'investissements directs au sein des pays asiatiques. Les données sont disponibles avec retard, les sources sont multiples et les façons de comptabiliser les investissements sont très diverses. Il semble que les flux d'investissements internes à l'Asie aient diminué en 1998, bien qu'il faille prendre en compte le fait que ces investissements sont comptabilisés en dollars et que l'effondrement des monnaies asiatiques a considérablement diminué le prix des actifs. Selon les informations publiées au début de l'année 2000 par la Conférence des Nations unies pour le commerce et le développement, les flux d'investissements directs à destination de l'Asie émergente auraient été stabilisés en 1999 (161), mais aucune information n'est disponible à la date de rédaction du présent rapport sur la nature et le niveau des flux d'investissements internes à la zone. Deux facteurs ont pu jouer en sens inverse : la récession ou la stagnation - y compris au Japon - et les surcapacités régionales ont pu limiter l'incitation des entreprises à investir hors de leurs frontières ; le processus de restructuration a ouvert des opportunités intéressantes, d'ailleurs favorisées par la plus grande ouverture manifestée par les autorités nationales vis-à-vis des investissements étrangers et par la diminution du prix des actifs. Au demeurant, l'intégration par les investissements n'est pas le seul fait des pays de la zone : les investissements réalisés par les firmes américaines ou européennes contribuent, eux aussi, à renforcer l'interdépendance des systèmes productifs locaux. A cet égard, la crise et les restructurations apparaissent donc plutôt comme des facteurs positifs, comme le montre, par exemple, la participation des entreprises occidentales à la recapitalisation des secteurs bancaires ou le développement des participations dans le secteur automobile. En fait, la géographie économique de l'Asie est de plus en plus ordonnée par une décomposition internationale des processus productifs, selon une différenciation entre recherche et développement, fabrication de composants sophistiqués, fabrication de composant simples et assemblage, qui a pour effet de répartir entre plusieurs pays les différentes phases de la production. Comme l'explique le réseau des postes d'expansion économique, « le poids et l'essor considérable des flux de composants donnent une mesure de ce nouveau circuit intégré : ils constituaient 46% des échanges manufacturés intra-asiatiques en 1996 contre 25% en 1986 et croissent de plus de 15% par an. Dans une branche comme l'électronique au sens large, ils représentent désormais 75% des échanges au sein de la région » (162). « La spécialisation électronique de la région [...] a la particularité de permettre une segmentation des processus productifs. Un wafer (163) exporté des États-Unis ou du Japon sera découpé aux Philippines d'où seront exportées des mémoires testées en Malaisie ; ces composants seront ensuite intégrés dans des lecteurs de disques ou des PC fabriqués à Singapour » (164). UN EXEMPLE DE « SPÉCIALISATION-PAYS » CHEZ TOYOTA · Thaïlande : moteurs diesel, tôles embouties, alternateurs, starters, directions, pare-chocs, panneaux de contrôle, phares, stabilisateurs; modèles HILUX (exporté aux Philippines) et SOLUNA (exporté à Singapour et Brunei) ; · Malaisie : boîtes de vitesses, amortisseurs, électronique embarquée, climatiseurs, amplificateurs, joints, antennes, allumage, systèmes de fermeture automatique. · Philippines : transmissions, joints, alternateurs, compteurs, pièces forgées. · Indonésie : Moteurs à essence, freins, systèmes de réglage de sièges, fermetures de portières, portières, fermetures électriques des vitres, modèle KIJANG (exporté à Brunei et Singapour). Source : Direction des relations économiques extérieures, En matière d'investissements automobiles, la conquête du marché local explique leur essor en Chine. Leur concentration en Thaïlande permet d'atteindre une masse critique, rendue encore plus déterminante par la disparition programmée des dernières barrières tarifaires au sein de l'ASEAN (165). Les Philippines, pour leur part, « pourraient tirer profit de leur spécificité culturelle (pratique généralisée de la langue anglaise) pour devenir le pôle R&D de l'industrie automobile dans la région. Deux décisions rendues publiques début mars par des équipementiers japonais semblent accréditer cette thèse » (166). Ce processus, où la logique nationale s'efface devant la logique de firme, favorise l'apparition de bassins régionaux qui s'organisent autour de pôles de croissance de plus en plus nombreux, souvent des villes de classe internationale, comme Hong Kong, Taïpei et Canton, autour desquelles s'organise le « triangle de Chine du Sud », ou encore Singapour, qui dirige le développement du triangle « Sijori » (Singapour / Johor / Riau) (167). A un moindre degré de développement, on peut également mentionner un « triangle de croissance » en gestation autour de la Corée, du Japon et de la région de Tumen, dans le nord-est de la Chine. Au-delà de perturbations passagères, la crise de 1997-1998 a peu de prise sur ces « tendances lourdes » de la géographie économique. L'Asie forme donc une zone où les liens économiques sont de plus en plus intenses, où les échanges de biens et services se développent plus fortement que dans les autres régions du monde et où les échanges de capitaux renforcent l'imbrication de systèmes productifs dont les modes de fonctionnement transcendent les frontières nationales. Pourtant, à cette dynamique d'intégration économique, on serait bien en peine d'associer une dynamique parallèle d'intégration monétaire. Les pères fondateurs de l'Europe avaient conçu le marché commun dans le cadre de la stabilité des changes issue du système mis au point à Bretton Woods. Lorsque ce système s'est effondré, les gouvernements européens ont conservé ce cadre de stabilité grâce aux mécanismes du « serpent monétaire européen », puis, à partir de 1979, du « système monétaire européen ». L'union monétaire est ensuite apparue comme le complément et l'aboutissement indispensable du marché unique. Rien de tout cela en Asie jusqu'ici. Pourtant, la crise a montré la nécessité de renforcer la coopération monétaire entre les pays asiatiques. 2.- La crise a renforcé l'urgence d'une plus grande coopération monétaire Le déroulement de la crise financière en 1997 a révélé la difficulté pour un pays confronté à une crise de change de gérer tout seul les pressions exercées par les marchés sur sa monnaie. Des réserves de change parfois très importantes se sont avérées insuffisantes pour faire face aux ventes de monnaie nationale. Après la dévaluation du bath et le début de la contagion, les pays asiatiques ont entrepris un renforcement bienvenu de leurs mécanismes de coopération. Cependant, la coordination des politiques de change reste pour l'heure un idéal introuvable. a) La crise a suscité un renforcement bienvenu de la coopération entre autorités monétaires · Pour retrouver l'impulsion originelle de la coopération entre les autorités monétaires, il faut remonter, au-delà de la crise asiatique, à la crise mexicaine de décembre 1994 (168). Dès le mois de janvier 1995, les gouverneurs des banques centrales de dix pays (169) se sont réunis à Hong Kong pour analyser les effets immédiats et retardés de la dévaluation du peso mexicain et leur contagion en Amérique latine. La réunion s'est achevée avec la conclusion d'un accord entre banques centrales, visant à accorder une aide immédiate, dans la limite d'un plafond de 500 millions de dollars, au pays qui en manifesterait le besoin. Ce cadre général prenait la forme de protocoles bilatéraux et multilatéraux entre les différentes banques centrales, conduisant ainsi à un « réseau d'accords » - certains n'étant pas rendus publics - plutôt qu'à un acte unique paraphé par tous. Par la suite, en juillet 1996, les gouverneurs des mêmes banques centrales, accompagnés du gouverneur de l'Autorité monétaire de Singapour, ont réanimé l'Executive Meeting of East Asia and Pacific Central Banks (EMEAP), créé en 1991, pour décider d'un agenda de travail plus ambitieux et renforcer les échanges de vues sur les systèmes régionaux de paiement, les transferts de capitaux, le financement de l'investissement, la supervision bancaire et la réglementation financière. Les actions conduites dans le cadre de l'EMEAP n'avaient pas pour objet premier de prévenir l'apparition des crises financières ou d'en limiter les conséquences. En revanche, le mécanisme de soutien réciproque entre banques centrales visait clairement à améliorer les conditions de mobilisation des réserves de change régionales : la crise de l'été 1997 a démontré son insuffisance. · La déroute monétaire thaïlandaise et sa transmission aux autres monnaies asiatiques ont incité le gouvernement japonais à proposer un projet beaucoup plus ambitieux : la création d'un véritable fonds monétaire asiatique (FMA), doté d'un capital d'une centaine de milliards de dollars dont une moitié aurait été fournie par le Japon et l'autre moitié par les autres pays membres du fonds. Les interlocuteurs de votre Rapporteur, aux États-Unis comme parfois en Asie, ont eu beau jeu de souligner combien la proposition formulée par le ministère des finances japonais visait, en fait, à préserver les intérêts économiques et politiques du Japon : - en instaurant un mécanisme de soutien aux réserves de change des banques centrales, le Japon visait à prévenir les crises de change, donc à empêcher une instabilité financière préjudiciable, notamment, aux intérêts des firmes japonaises implantées ou commerçant en Asie ; - en prônant une solution régionale à l'instabilité des marchés financiers, le Japon s'affichait comme l'« ami » de l'Asie et le véritable garant de la prospérité de la zone. De telles observations ont leur part de vérité : on a peine à croire que la politique du Japon - comme de tout autre pays, d'ailleurs - soit avant tout mue par l'altruisme et le désir de soulager les déboires de ses partenaires économiques. Mais il serait malvenu de ramener le projet de FMA à ces considérations purement égoïstes. En effet, les pays asiatiques ont peu apprécié la non participation des pays occidentaux au programme de soutien financier à la Thaïlande, décidé lors d'une réunion d'urgence convoquée à Tokyo par le FMI, le 11 août 1997. Le projet de FMA constitue aussi une réponse légitime à l'indifférence manifeste de l'Occident. Le projet de FMA a été présenté par le Japon à l'occasion de la réunion des ministres des finances de l'Asia-Europe Meeting (ASEM), organisée à Bangkok les 18 et 19 juillet 1997 (170). Immédiatement accepté par les pays de l'ASEAN, il semble avoir reçu un accueil poli mais réservé de la part des ministres européens présents à la réunion. A l'issue de celle-ci, le ministre des finances thaïlandais déclarait d'ailleurs qu'il était « trop tôt pour prendre une telle initiative » (171). La proposition japonaise a été à nouveau évoquée lors de la réunion des ministres des finances et des gouverneurs des banques centrales du G7, qui précédait la réunion annuelle du FMI et de la Banque mondiale, à Hong Kong, les 21et 22 septembre 1997. Le Japon fondait sa proposition sur trois motivations : en premier lieu, les pays asiatiques étaient mal représentés dans les instances dirigeantes et dans les processus de décision du FMI, et un fonds régional leur donnerait une plus grande capacité d'initiative et de décision ; en deuxième lieu, une solidarité régionale forte s'était déjà manifestée dans le cadre du sauvetage de la Thaïlande ; en troisième lieu, le FMI ne disposait que de ressources limitées, le FMA apparaissant ainsi comme un complément nécessaire et substantiel des concours susceptibles d'être apportés par un FMI fortement mobilisé en Europe de l'Est et en Russie. L'initiative japonaise s'est brisée sur l'opposition irréductible des pays occidentaux et du FMI, appuyés par la Chine et par les deux principaux contributeurs potentiels non japonais d'un FMA : Hong Kong et Taïwan. La problématique du FMA s'est nouée autour de deux questions, l'une « dite » et l'autre « non dite » : - dès l'origine, le Japon a indiqué que le FMA devrait opérer de façon indépendante du FMI et qu'un pays susceptible d'y avoir recours ne devrait pas nécessairement se plier au « faisceau » de conditions (ajustement macro-économique et réformes structurelles) associé par le FMI à ses interventions. Une telle démarche était évidemment inacceptable pour les dirigeants du FMI, rejoints en cela par les ministres américains et européens. Il est vrai qu'il est difficile d'écarter l'argument selon lequel les déséquilibres de balance des paiements ou les crises de change sont essentiellement le reflet de désajustements plus profonds (172) et nécessitent donc que la communauté internationale s'assure que les fonds qu'elle met à la disposition du pays demandeur ne seront ni gaspillés, ni impuissants à normaliser la situation. Les autorités occidentales ont immédiatement signifié au Japon qu'il était inconcevable qu'une conditionnalité moins rigoureuse que celle du FMI puisse être proposée à un pays asiatique, au risque de perturber la stabilité de l'ensemble des relations financières internationales ; - la proposition japonaise avait pour conséquence de créer un espace d'autonomie financière au profit des pays asiatiques, donc de réduire potentiellement le rôle des États-Unis dans la région. Au-delà du thème classique de la « préservation des intérêts américains », ce qui est en jeu est bien la capacité des États-Unis à conserver une relation monétaire et financière privilégiée avec le Japon, qui est son principal créditeur. En évoquant comme issue possible l'idée d'un FMA constitué au sein de l'APEC, F. Bergsten, ancien dirigeant du Trésor américain, président de l'Institute for International Economics, s'est fait l'interprète le plus explicite de cette objection « non dite » (173). La question de l'articulation ou de l'indépendance des interventions du FMI et du FMA est assurément centrale. Si la conditionnalité d'un FMA était plus lâche que celle du FMI, l'institution régionale risquerait de créer un « aléa de moralité », c'est-à-dire une incitation des acteurs privés ou des gouvernements à prendre des risques excessifs ou à suivre des politiques inadaptées. Le résultat de l'instauration du FMA serait alors une aggravation plutôt qu'une réduction des risques financiers. Sous la pression des autorités américaines et européennes, le Japon a progressivement amendé sa position sur l'autonomie du FMA. Quelques semaines plus tard, il n'était plus question que d'un mécanisme de financement complémentaire des actions du FMI et mis en _uvre dans le cadre des programmes définis par celui-ci. Cette réorientation a été définitivement acquise lors d'une réunion des pays d'Asie et du Pacifique, organisée à Manille les 18 et 19 novembre 1997 (174). La crise ayant touché à cette date l'Indonésie et la Corée, il convenait que fût montrée une volonté commune d'agir au plan régional pour la stabilité financière, tout en évitant de remettre en avant les controverses nées à propos du projet de FMA. La réunion s'est achevée sur la définition d'un « cadre d'action de Manille » organisé autour de quatre éléments : l'instauration d'un mécanisme régional de surveillance mutuelle, le renforcement de la coopération dans le domaine de la supervision bancaire, le soutien au projet de renforcement des ressources du FMI par le biais des Nouveaux accords d'emprunt (175), la définition d'un « accord de financement coopératif » (176) destiné à compléter les ressources du FMI. Confirmant par ailleurs le rôle central du FMI, le cadre d'action de Manille précisait que le mécanisme financier coopératif ne serait mis en _uvre que dans des circonstances exceptionnelles, au cas par cas, en consultation avec le FMI et pour compléter les ressources mobilisées par celui-ci. · Le cadre d'action de Manille a été le point de départ d'initiatives nouvelles qui se sont développées dans deux directions. D'une part, le Japon s'est efforcé d'asseoir son rôle de « pilier financier » de l'Asie. D'autre part, les pays asiatiques ont décliné et approfondi les processus multilatéraux annoncés dans le cadre d'action défini à Manille. Trois dispositifs ont fait l'objet d'annonces particulières par le gouvernement japonais. En mars 1998, un ensemble de mesures bilatérales a été présenté, pour un montant total de 22,6 milliards de dollars (prêts de l'Eximbank, garanties commerciales sur le risque à court terme, garanties de prêts non liés) (177). En octobre 1998, le « plan Miyazawa », du nom du ministre des finances de l'époque, a proposé aux pays asiatiques des financements de 30 milliards de dollars au total, organisés autour de trois composantes : - 15 milliards de dollars de facilités de crédit à court terme (qui ne constituent pas une enveloppe de crédits nouveaux) offertes aux pays asiatiques en cas de nouvelles difficultés graves au plan monétaire. Ces facilités reposent sur des fonds en dollars prélevés sur les réserves de change de la Banque du Japon, prêtés à 90 jours au taux du marché. A la date du 2 février 2000 (178), la moitié de l'enveloppe a été engagée, soit 5 milliards de dollars au profit de la Corée et 2,5 milliards de dollars au profit de la Malaisie (179) ; - 10 milliards de dollars de prêts et garanties accordés par l'Eximbank. Les prêts sont destinés à financer directement des infrastructures ou sont versés à une banque publique de développement. Les garanties peuvent être accordées à des emprunts émis par les gouvernements ou à des prêts accordés par des banques étrangères. Le bilan du plan Miyazawa au 2 février 2000 est difficile à interpréter sur ce point, car le tableau des aides accordées aux cinq pays asiatiques concernés mêle les prêts qui relèvent sans ambiguïté de l'initiative Miyazawa et d'autres prêts réalisés sous l'égide de la Banque mondiale et de la Banque asiatique de développement. Si l'on se limite aux premiers, le montant des engagements s'établit à 5,5 milliards de dollars ; si l'on y ajoute les seconds, le montant des engagements s'élève à 8,2 milliards de dollars ; - 5 milliards de dollars de crédits d'aide publique (prêts concessionnels) accordés par le Fonds de coopération économique à l'étranger. Sous le bénéfice des mêmes observations qu'au paragraphe précédent, le montant des engagements s'établit à 3 milliards de dollars ou 5,3 milliards de dollars. Enfin, en novembre 1998, le gouvernement japonais a annoncé qu'il contribuerait à hauteur de 3 milliards de dollars à un fonds de garantie de prêts d'un montant total de 5 milliards de dollars mis en place conjointement avec les États-Unis, la Banque mondiale et la Banque asiatique de développement. Parallèlement, les États membres de l'ASEAN ont décidé en 1998 de mettre en place un embryon de mécanisme de surveillance au niveau régional, l'ASEAN Surveillance Process (ASP). Son objectif est de prévenir de nouvelles crises financières, en développant des indicateurs d'alerte quantitatifs et qualitatifs et en permettant aux ministres des finances de discuter entre eux de façon confidentielle, deux fois par an, de la situation et de la politique économique de chacun des pays de la zone. Outre le secrétariat de l'ASEAN, qui fournit un support technique et administratif et rédige le rapport de surveillance préliminaire à chaque rencontre, la Banque asiatique de développement et le FMI apportent une aide importante : élaboration de la méthodologie, choix des indicateurs suivis, collecte et mise à plat des données statistiques, éléments d'analyse sur la situation économique et financière des États membres. Le premier exercice d'examen mutuel des situations économiques a été réalisé lors de la troisième réunion des ministres des finances de l'ASEAN, qui s'est tenue en mars 1999 à Hanoï. · Les réflexions sur le renforcement de la coopération monétaire et financière se sont poursuivies dans différentes enceintes (réunion des ministres des finances, réunion des adjoints des ministres et des gouverneurs adjoints des banques centrales, réunions élargies au Japon, à la Corée et la Chine, etc.). Après avoir évoqué une nouvelle fois la création d'un fonds monétaire asiatique lors de leur réunion tenue en mars 2000, les ministres des finances de l'ASEAN, du Japon, de la Corée et de la Chine ont définitivement écarté cette solution lors d'une réunion informelle tenue en marge de l'assemblée annuelle de la Banque asiatique de développement, le 6 mai 2000 à Chiang Maï (Thaïlande). En revanche, les ministres se sont mis d'accord sur ce qui est désormais appelé l'« initiative de Chiang Maï », mécanisme d'entraide qui comprend trois volets : - la réaffirmation du système de surveillance régionale mis en place en 1998 ; - la création d'un réseau d'institutions de recherche et de formation des hauts fonctionnaires et la multiplication des échanges d'experts en finances publiques et politique monétaire. Ce réseau s'appuierait sur le centre de formation régional fondé en 1972 par les banques centrales de l'ASEAN, mais serait donc élargi dans son champ géographique et dans ses compétences ; - surtout, l'« initiative de Chiang Maï » relance le processus de constitution d'une facilité de financement régionale destinée à compléter les mécanismes existants. Les ministres des finances ont décidé d'élargir au Brunei l'accord multilatéral d'échanges de devises institué en 1972, le Cambodge, le Myanmar et le Laos devant s'y agréger ultérieurement. Le montant des réserves de devises échangeables entre banques centrales sera porté prochainement à 500 millions de dollars au lieu de 100 millions de dollars actuellement. Les ministres ont également affirmé leur volonté de continuer à augmenter le montant de devises mobilisables dans les prochaines années. Les modalités pratiques de fonctionnement de l'accord d'échange ont été confiées au secrétariat de l'ASEAN. La principale nouveauté dans l'initiative de Chiang Maï est que l'accord d'échange de devises va être étendu au Japon, à la Chine et à la Corée, par le biais d'accords d'échanges bilatéraux avec chacun des pays de l'ASEAN. Il s'agit là de l'avancée la plus importante enregistrée ces dernières années en matière de coopération financière régionale. C'est cette décision qui établit la véritable portée de l'initiative de Chiang Maï, qui a pu, par ailleurs, être qualifiée à juste titre de « vin ancien dans une bouteille neuve » par la Far Eastern Economic Review (180). Ainsi, la coopération régionale a été marquée par des progrès majeurs dans les derniers mois écoulés. Non pas tant par le volume des capitaux mobilisables aujourd'hui ou à brève échéance dans le cadre coopératif tracé à Manille puis à Chiang Maï, mais plutôt par la participation à ce mécanisme coopératif des deux principales puissances industrielles de la région (Corée et Japon), du plus grand créditeur de la planète (Japon), et d'un des plus importants détenteurs de devises dans le monde (Chine). L'adhésion de ces trois pays donne à l'initiative de Chiang Maï une assise économique, financière et surtout politique que n'auraient jamais pu lui conférer à eux seuls les pays de l'ASEAN. Est-ce à dire que l'initiative de Chiang Maï et ses développements futurs sont susceptibles de limiter les risques de crise dans la région ? Votre Rapporteur n'en est pas persuadé, puisque les décisions intervenues à ce jour laissent de côté l'une des clefs de la stabilité monétaire : la gestion ordonnée des politiques de change. b) La coordination des politiques de change reste encore aujourd'hui C'est peu dire que la coordination des politiques de change entre les pays asiatiques a été malmenée lors de la crise de 1997 : cette coordination n'existait pas, dans les faits. De plus, l'Asie a été incapable d'apporter une réponse unique - voire d'opposer un discours unique - aux événements survenus à partir du mois de juillet. Au demeurant, la crise du système monétaire européen de 1992 comme la gestion « asymétrique » de ce même système par les autorités monétaires allemandes étaient également la marque du mauvais fonctionnement de mécanismes de coopération par ailleurs beaucoup plus formalisés. · Les apparences sont parfois trompeuses. Les pays touchés par la crise ont tous, à des degrés divers, rétabli un lien entre l'évolution de leur monnaie nationale et l'évolution du dollar. Il ne s'agit pourtant pas d'une démarche coopérative mais d'une convergence fortuite de volontés indépendantes. Une étude conduite en 1997 par les économistes du Centre d'études prospectives et d'informations internationales (CEPII) (181) illustre la notion de démarche coopérative et suggère que l'alignement sur le dollar traduit plutôt une absence de coordination, ce qui a parfois été exprimé sous le terme de « coordination par défaut ». Pour définir leur politique de change, les autorités monétaires doivent se poser la question suivante : est-il intéressant de modifier la parité de la monnaie nationale (vis-à-vis du dollar) lorsque la parité yen / dollar varie ? Dans une optique coopérative, tous les pays de la zone définiront leur politique en cherchant à maximiser le bien-être global de la zone, donc en tenant compte des répercussions de leurs décisions monétaires sur la compétitivité de leurs partenaires. En revanche, dans une optique non coopérative, chaque pays cherchera à maximiser son bien-être propre, sans se soucier des conséquences de ses décisions sur ses partenaires. La prépondérance (pour ne pas dire la quasi exclusivité) du dollar comme monnaie de facturation des échanges fait que le lien avec le dollar peut être la politique optimale, individuelle comme collective, coopérative comme non coopérative, si l'on ne considère que les flux monétaires liés aux échanges de biens et services. En revanche, si l'on prend en compte la dette extérieure et les flux d'intérêts qui en découlent, les stratégies de change optimales s'effectuent par l'alignement de la monnaie nationale sur un panier de monnaies - en l'occurrence le dollar et le yen - et impliquent un arbitrage entre les poids respectifs du yen et du dollar, selon deux clefs : la pondération de ces devises dans le libellé des instruments de l'endettement extérieur ; les impacts respectifs sur la balance des paiements des transactions commerciales et des flux d'intérêt. Compte tenu des données numériques relatives à la situation économique de la Chine et de quatre pays de l'ASEAN, l'étude montre que le choix d'une démarche coopérative doit se traduire par une pondération du yen plus importante dans le panier de monnaies. L'observation d'un lien étroit entre les monnaies asiatiques et le dollar suggère donc, aux yeux des auteurs, un manque effectif de coopération monétaire en Asie. · Si la volonté de coopérer n'est pas là, comment penser que puissent être stabilisées dans un avenir pas trop lointain les parités entre les monnaies asiatiques et le yen ? L'intérêt d'une telle démarche semble aller de soi : puisque l'Asie orientale devient de plus en plus intégrée, commercialement et financièrement, elle a besoin de réduire la volatilité des cours de change réciproques, et notamment de réduire la volatilité entre le yen et les autres monnaies, puisque l'Asie devient un partenaire toujours plus proche du Japon. Des économistes comme C.H. Kwan se sont faits depuis plusieurs années les chantres d'un rééquilibrage des relations monétaires en Asie. Remarquant que la croissance en Asie (hors Japon) est désormais fortement corrélée à la parité du yen par rapport au dollar (182), C.H. Kwan avance que le principal facteur explicatif de cette corrélation est le lien entre les monnaies asiatiques et le dollar, qui conduit à ce que les évolutions de la parité yen/dollar se reflètent dans des évolutions similaires de la parité yen/monnaies asiatiques, donc de la position concurrentielle relative des pays asiatiques et du Japon. C.H. Kwan identifie quatre mécanismes par lesquels la variation de la parité du yen (vis-à-vis du dollar et des monnaies asiatiques qui lui sont liées) influe sur la croissance : - la variation des coûts relatifs de production entre le Japon et les autres pays, qui rend plus ou moins attrayante la délocalisation d'industries japonaises vers les pays asiatiques concurrents ; - la variation du prix relatif des produits similaires fabriqués au Japon et dans les autres pays, qui affecte la compétitivité relative au sein de la zone ; - la variation du coût des intrants dans le processus de production, le Japon étant un fournisseur important (mais pas exclusif) des pays asiatiques ; - la variation du coût de la dette libellée en yen. Les deux premiers de ces facteurs sont corrélés positivement à la croissance asiatique : une hausse du yen renchérit les coûts et les prix relatifs japonais et incite les entreprises à se délocaliser comme les clients finaux à préférer les produits non japonais. En revanche, les deux derniers facteurs sont corrélés négativement à la croissance asiatique : une hausse du yen augmente le coût des intrants japonais incorporés aux produits asiatiques et majore la charge de la dette extérieure libellée en yen. L'impact effectif des variations du yen sur la croissance d'un pays déterminé dépend de sa structure de production et de sa structure d'endettement. La stabilisation des parités asiatiques mutuelles aurait donc de nombreux avantages. Au plan macro-économique, elle réduirait les fluctuations de la production et du revenu national, puisque l'ensemble de la zone réagirait de façon plus homogène à une évolution des parités vis-à-vis des partenaires extérieurs (États-Unis, Europe, etc.) (183). Au plan micro-économique, elle réduirait les coûts issus des opérations de couverture de change et les risques de change eux-mêmes, elle stabiliserait la valeur des actifs détenus dans les autres pays de la zone et réduirait la vulnérabilité du secteur bancaire (184). Il va de soi que ces deux derniers arguments concernent le Japon plus que les autres pays asiatiques. L'affaire est donc entendue : le yen devrait avoir plus de poids dans la détermination de la politique de change des pays asiatiques et, comme l'indique C.H. Kwan, « le "poids" optimal assigné au yen dans le panier de monnaies devrait être différent d'un pays à l'autre, dépendant largement du degré de concurrence entretenu avec le Japon. Ainsi, la Corée du sud devrait "coller" au yen plus que la Thaïlande » (185). En fait, on est là bien loin d'une véritable coopération monétaire : l'évolution proposée ne revient qu'à rétrécir le lien entre chaque monnaie nationale et le yen, sans instaurer une quelconque solidarité monétaire intra-asiatique puisque les différents liens restent indépendants les uns des autres. Elle ordonne les relations monétaires régionales autour du Japon et sert les intérêts de celui-ci autant qu'elle sert les intérêts de la zone asiatique prise ensemble. Elle peut même aller à l'encontre des intérêts profonds des pays asiatiques, si l'on considère que le « circuit intégré » de production vise en grande partie à satisfaire une demande finale extérieure à la zone, située aux États-Unis ou en Europe. Dans cette optique, il est vrai, la croissance des marchés intérieurs asiatiques pourra, à l'avenir, réduire la dépendance de la zone vis-à-vis de l'« extérieur », donc donner un fondement plus solide à une remise en cause du statut privilégié du dollar. · Dans ce contexte, l'idée d'une monnaie commune (ou unique) en Asie est plus une utopie sympathique qu'une perspective réaliste, au moins à l'horizon de quelques décennies. Le fait que le gouvernement philippin ait manifesté à plusieurs reprises de l'intérêt pour cette idée ne doit pas faire illusion, même si la question a été « mise à l'étude » à l'issue du sommet de l'ASEAN à Hanoï, en décembre 1998. De même, l'évocation par M. Donald Tsang, ministre des finances de Hong Kong, en octobre 1999, d'une union monétaire entre Singapour et Hong Kong effective à un horizon de cinq ou sept ans relève de la simple curiosité, en tant que telle - l'intéressé étant d'ailleurs revenu sur ses propos ultérieurement. En revanche, elle traduit bien le renouveau de la réflexion sur la coopération monétaire qui s'est fait jour en Asie à la suite de la crise. Selon ses promoteurs, la création d'une monnaie unique en Asie - à supposer que l'on puisse dès aujourd'hui définir précisément le périmètre de cette union monétaire - présenterait des avantages importants. Elle faciliterait les transactions commerciales et financières ; elle réduirait la dépendance des pays asiatiques vis-à-vis des grandes monnaies internationales, notamment le dollar ; elle serait un facteur puissant d'intégration. Plusieurs arguments sont apportés à l'appui de cette idée (186) : - la plupart des économies asiatiques peuvent être considérées comme des « petites » économies ouvertes, où la stabilité du taux de change a les vertus d'un stabilisateur automatique ; - les pays asiatiques partagent une même aversion envers l'inflation ; - une monnaie unique doit permettre de dynamiser la coopération régionale dans un sens favorable au développement et à la croissance, alors que l'intervention du FMI motivée par les crises de change de 1997 a soumis les pays concernés à une cure très sévère ; - une union monétaire pourrait permettre à Hong Kong de sortir de sa stratégie d'ancrage légal vis-à-vis du dollar, qui sera peut-être difficile à soutenir sur le long terme. Pour autant, les obstacles à l'établissement d'une monnaie unique sont nombreux. En premier lieu, une récente étude suggère que l'ASEAN à elle seule ne répond pas aux critères de ce que l'on appelle une « zone monétaire optimale » (187) : - les pays de l'ASEAN étant beaucoup plus ouverts que les pays européens, le commerce intra-régional a le même poids relatif dans le PIB de chacune des deux zones (environ 11%), mais représente une part plus modeste des échanges extérieurs totaux dans le cas de l'ASEAN ; - aucun chef de file monétaire n'émerge réellement, Singapour s'étant toujours refusé à internationaliser sa monnaie. D'ailleurs, hors de l'ASEAN, l'affaiblissement du Japon, la non convertibilité du yuan chinois et l'assise financière encore étroite de la Corée limitent la possibilité pour chacun de ces trois pays de prendre un leadership incontestable ; - le degré de convergence des économies est encore limité et l'ampleur des écarts de développement reste trop grande. Là encore, l'appréciation à porter est plus pessimiste encore si l'on étend le périmètre d'analyse à la Chine, au Japon et à la Corée ; - les chocs d'offre affectant les économies de l'ASEAN ne sont pas symétriques. Toutefois, il existe une corrélation historiquement élevée entre les chocs ayant affecté l'Indonésie, la Malaisie et Singapour, tandis que les Philippines et la Thaïlande sont, en général, confrontées à des chocs indépendants. En revanche, la vitesse d'adaptation de toutes ces économies aux chocs d'offre est très nettement supérieure à celle des pays européens. Mais votre Rapporteur, comme la quasi totalité de ses interlocuteurs, est convaincu que le principal obstacle à la construction monétaire de l'Asie est avant tout politique et réside dans l'animosité mutuelle, ou tout au moins la méfiance réciproque, qui marquent depuis toujours les relations entre les États asiatiques. Interrogé par Le Monde, en décembre 1998, sur la possibilité d'envisager un jour en Asie l'équivalent de l'euro, M. Eisuke Sakakibara, alors vice-ministre japonais des finances chargé des affaires internationales, et surnommé de ce fait « Monsieur Yen » dans les milieux politiques et économiques, déclarait : « en Europe, malgré la diversité des cultures et des histoires économiques, il y a beaucoup plus de similarités qu'en Asie. L'Europe peut devenir une région. Mais l'Asie ne peut pas devenir une région : l'Asie, c'est le monde. [...] Il est impossible d'unifier tout cela, comme cela se fait en Europe. [...] Une coopération souple, des réseaux, mais pas l'unification : c'est impossible pour l'Asie ! » (188). Fatalisme déplacé face à des potentialités ignorées ? Vision lucide de destins qui doivent se croiser sans jamais converger ? La seconde hypothèse reflète mieux le sentiment de votre Rapporteur, sans pour autant traduire un quelconque pessimisme sur les effets du nécessaire renforcement de la coopération politique. 3.- La crise a confirmé les limites de la coopération politique Si l'image convenue de l'« échiquier politique » a un sens, c'est bien en Asie que celui-ci est le plus fort... sauf à préférer évoquer le damier du jeu de go. Dans un cas comme dans l'autre, la complexité des règles et la dispersion rapide de l'« arbre » des coups possibles incitent votre Rapporteur à limiter son propos aux considérations qu'il juge essentielles. a) L'ASEAN peine à surmonter une sérieuse crise de légitimité Fondée en août 1967 par l'Indonésie, la Malaisie, les Philippines, Singapour et la Thaïlande, l'Association of South-East Asia Nations (ASEAN) affirmait sceller un processus de réconciliation après les turbulences postérieures à l'achèvement des indépendances. Si la première fonction de l'ASEAN était effectivement d'établir de nouveaux schémas de communication entre les États membres et de formaliser une atmosphère de confiance et de bonne volonté, deux autres dimensions sont très vite apparues. D'une part, l'ASEAN a visé à permettre un développement économique et social harmonieux, respectueux du rythme et des contraintes propres à chacun. D'où l'absence de toute volonté d'intégration régionale qui aurait impliqué une contrainte institutionnelle et aurait érigé la coopération comme une fin en soi et non comme un simple moyen. Le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures des États membres était le corollaire obligé de cette perspective : l'ASEAN a servi de caution aux pouvoirs en place. D'autre part, l'ASEAN a servi à asseoir les États membres sur la scène internationale. « L'Association joue sur un paradoxe apparent : instrument de consolidation des régimes en place, elle a institué un régionalisme tourné vers l'extérieur et les liens entretenus avec les grands partenaires internationaux l'alimentent et le renforcent. Grâce à l'Association et à l'assurance qu'elle fournit, le pays membres ne se sentent plus objets mais sujets du système international » (189). Jusqu'au milieu des années 1990, l'ASEAN s'est peu à peu construit une image forte et pouvait même apparaître comme le futur troisième pilier de l'Asie aux côtés de la Chine et du Japon. Elle avait adopté une position appréciée dans le conflit cambodgien, ce qui lui a valu de prendre une part importante à sa résolution, en 1991. Elle prenait des initiatives remarquées, comme la création, en 1994, du Forum régional de l'ASEAN, seule instance de sécurité en Asie orientale. Elle s'efforçait d'approfondir les relations économiques entre les pays membres, par exemple en mettant en place un schéma d'introduction d'une zone de libre échange (ASEAN Free Trade Area : AFTA) en 1992 (190). L'ASEAN traverse actuellement une crise de légitimité, sans doute la plus grave depuis sa naissance en 1967. Bien sûr, l'association a été déstabilisée par la crise et nombreux sont les observateurs qui déploraient, y compris devant votre Rapporteur, qu'elle n'ait pas été capable d'y apporter une réponse cohérente. Mais était-ce bien son rôle ? La véritable question consiste à savoir si une « association » d'États jaloux de leur souveraineté et réticents à toute contrainte institutionnelle est aujourd'hui la réponse la mieux adaptée aux défis que doit affronter la région (191). Votre Rapporteur a bien conscience des fortes interactions entre l'affaiblissement intérieur des systèmes politiques et sociaux et l'affaiblissement de l'ASEAN. Lorsque le ciment de la prospérité partagée disparaît, comme disparaissent les « pères fondateurs » dont les liens personnels renforçaient la cohésion de l'ensemble, la fragilité de l'édifice tout entier apparaît. Le registre d'excellence de l'ASEAN recouvre les domaines où l'État est fort : la diplomatie et la sécurité ; l'économique et le social en ont longtemps été les parents pauvres, d'autant que le dynamisme des forces économiques compensait largement la faiblesse des impulsions étatiques. Votre Rapporteur a rappelé les initiatives qui ont pu « poser », ces dernières années, l'ASEAN comme un acteur important de la scène régionale. Ces atouts se sont malheureusement évanouis dans les villages ensanglantés de Timor oriental et avec l'élargissement de l'association à trois pays dont le régime ou les pratiques politiques sont pour le moins contestables : Myanmar et le Laos ont intégré l'ASEAN en juillet 1997 ; le Cambodge a été admis en avril 1999, après un délai « de convenance » imposé par le coup d'État du co-premier ministre Hun Sen, quelques semaines avant la date initialement prévue pour l'admission (juillet 1997). Vidée de sa logique de rassemblement et de cohésion, l'ASEAN s'est lancée dans un processus d'élargissement qui ne pouvait masquer l'absence de projet politique (192). En ouvrant ses portes à trois États encore très décalés dans leur processus de développement, elle s'est également privée d'un levier d'intégration important (193). Plus grave encore, l'ASEAN n'a pu contenir l'émergence de tensions internes entre ses membres. C'est ainsi que la Malaisie et Singapour ont vu se ranimer un ressentiment jamais complètement disparu depuis la séparation forcée de 1965, mais ravivé par les difficultés économiques de la première et le relatif succès de la seconde face à la crise : la Malaisie a fermé la bourse parallèle qu'elle avait établie à Singapour, elle a durci ses exigences au regard de l'approvisionnement en eau de la cité-État, elle a interdit l'utilisation de son espace aérien pour l'entraînement des forces armées de Singapour. De leur côté les autorités singapouriennes ont causé quelques difficultés au bon fonctionnement du point de contrôle de l'immigration malaisienne à Singapour, situé sur le territoire de la cité. Entre la Malaisie et l'Indonésie, les tensions sont apparues au sujet du renvoi dans leur mère patrie des travailleurs immigrés indonésiens d'une part, de l'ingérence supposée de l'Indonésie dans le débat politico-judiciaire autour de M. Ibrahim Anwar d'autre part. Enfin, l'inquiétude manifestée publiquement par les autorités de Singapour en 1998 et 1999 sur l'évolution de la situation politique intérieure en Indonésie - et ses répercussions possibles sur la sécurité de la cité-État - ont suscité l'irritation de Jakarta. Par ailleurs, les grands incendies qui ont ravagé la partie indonésienne de Bornéo, en 1997, amplifiés par la sécheresse liée au phénomène climatique El Niño mais souvent provoqués par une déforestation mal encadrée, ont constitué un sujet de friction entre l'Indonésie et ses voisins (Malaisie, Brunei, Singapour) directement touchés par les incendie eux-mêmes ou affectés par les nuages de fumée qui obscurcissaient parfois totalement le ciel. Ce qui faisait il y a quelque temps la force et la souplesse de l'association - le principe affiché de non ingérence dans les affaires intérieures et la primauté de la logique étatique sur la logique régionale - est peut-être aujourd'hui un obstacle à un rebond de l'ASEAN. Il est hors de propos de « plaquer » sur les réalités régionales un mode de raisonnement « à l'européenne » ; cependant, votre Rapporteur juge importante la démarche engagée en 1998 par les ministres des affaires étrangères de Thaïlande et des Philippines, selon qui il convenait de reconsidérer le principe de non ingérence. Les réactions de leurs partenaires ont été plus que négatives et les trublions d'un jour ont fait mine de respecter à nouveau le credo régional lors de la réunion suivante des ministres des affaires étrangères, qui s'est tenue à Singapour les 23 et 24 juillet 1999. Même amoindrie, la fonction symbolique de l'ASEAN reste suffisamment forte pour que la question de la survie de l'association n'ait pas réellement de sens. L'ASEAN sera testée, dans les prochains mois et les prochaines années, sur sa capacité à accompagner les évolutions intérieures de ses membres et à apporter une réponse crédible aux réflexes de repli national (194). Cela implique certainement une révision de son fonctionnement - notamment au regard du principe de non ingérence - et suppose une stabilisation de la situation intérieure en Indonésie. b) L'apaisement des tensions en Asie du nord masque mal la persistance d'antagonismes majeurs Les deux « points nodaux » essentiels des tensions en Asie du nord, la question coréenne et la question taiwanaise, ont connu ces derniers mois un certain apaisement. Il va sans dire que celui-ci doit être apprécié à l'aune de relations politico-stratégiques complexes, dont la présentation dépasse évidemment le cadre de ce rapport d'information consacré à la crise financière asiatique. Fidèle à ses convictions et à son image, le président Kim Dae-jung a entrepris, dès son entrée en fonction, de rétablir avec la Corée du nord un dialogue quasiment réduit à néant les années précédentes. La crise nucléaire provoquée par le retrait de la Corée du nord du Traité de non prolifération, en mars 1993, avait ouvert un vide dans les relations entre les deux États et ramené au premier plan les États-Unis, garants de la sécurité de leur partenaire du sud. L'accord de Genève (octobre 1994), qui visait à mettre fin aux activités nucléaires militaires ou « suspectes » de la Corée du nord en échange de la fourniture de deux réacteurs à eau légère, a fait de la Corée du sud le simple banquier de ces deux réacteurs (195). Après la conclusion de l'accord de Genève, la Corée du nord avait adopté une attitude très dure vis-à-vis de son voisin du sud, cherchant notamment à le marginaliser en traitant uniquement avec les États-Unis. Puis la défection d'un haut dignitaire du Nord, en février 1997, a ruiné les fragiles efforts entrepris pour ranimer des discussions de paix dans le cadre de négociations quadripartites. La démarche de conciliation entreprise par le président Kim Dae-jung (196) a dû composer avec la politique de « chaud et froid » employée traditionnellement par les Coréens du nord. En mars 1998, les discussions quadripartites de Genève ont été suspendues sans perspectives de reprise. En avril 1998, les deux gouvernements se sont accordés pour reprendre des discussions bilatérales. En juin 1998, un sous-marin nord-coréen a été arraisonné dans les eaux territoriales sud-coréennes. En octobre 1998, les discussions quadripartites de Genève ont repris. Lorsque votre Rapporteur était en mission à Séoul, en juillet 1999, le pays était encore tout bruissant du grave incident naval survenu dans la zone maritime prolongeant la zone terrestre démilitarisée, qui s'était traduit par des échanges de tirs et la destruction d'un navire nord-coréen. Mais la déroute économique de la Corée du nord, dont la famine qui frappe sa population est la manifestation la plus tragique, a favorisé une plus grande ouverture. Le 10 avril 2000, les deux présidents coréens ont surpris le monde en annonçant la tenue d'un sommet historique, organisé à Pyongyang du 12 au 14 juin dernier. Concrètement, les résultats de ce sommet ne s'écartent guère des deux précédents accords de réconciliation conclu en 1972 et 1992 : réaffirmation du principe selon lequel la question de la réunification doit être décidée par le « peuple coréen » et qu'elle doit se développer à partir des positions de la Corée du sud, qui penche pour une fédération, et de la Corée du nord, qui prône une confédération ; engagement à _uvrer pour régler le problème des familles déplacées ; détermination à poursuivre la coopération économique et sociale ; intérêt à poursuivre le dialogue. Il reste évidemment aux deux parties à faire preuve de leur bonne foi et à faire vivre un accord historique dans sa signification plus que dans son dispositif. Le caractère très conflictuel des relations entre la Chine et Taïwan est également un élément structurant des relations politiques en Asie du nord. Cependant, les questions coréenne et taiwanaise ont tendance à occulter l'autre lieu de tension en Asie du nord, plus feutré mais peut-être plus insidieux : la rivalité entre la Chine et le Japon. Deux volontés parallèles de jouer un rôle important en Asie, deux puissances économiques (197), deux forces militaires en pleine croissance : les ingrédients de l'antagonisme sont bien là. Bien entendu, cet antagonisme ne se traduit pas par une confrontation trop visible : le « partenaire » américain, qui tient à la stabilité régionale, reste un grand ordonnateur du jeu asiatique. Mais il est des signes qui ne trompent pas. L'insistance de la Chine à minimiser le leadership japonais englué dans une longue crise, son opposition à l'idée japonaise de créer un fonds monétaire asiatique, l'instrumentalisation permanente du ressentiment national vis-à-vis du comportement japonais avant et pendant la Seconde guerre mondiale (198), la volonté de distendre les liens du dialogue américano-japonais (199) sont autant d'éléments constitutifs de cette lutte sourde. Du côté japonais, l'évolution récente du contenu de l'alliance stratégique avec les États-Unis s'est traduite par un élargissement ambigu du concept d'autodéfense (200) et des possibilités d'intervention des forces armées. De même, le Japon considère qu'il ne peut rester indifférent à la question taiwanaise, même si ses prises de position restent prudentes et s'articulent autour de l'adhésion au principe formel d'« une seule Chine ». Le Japon s'inquiète également du renforcement des capacités navales chinoises, susceptibles de remettre en cause la sécurité de voies maritimes d'approvisionnement de l'archipel. Enfin, après avoir progressivement renforcé le dialogue politique avec l'Inde - cependant momentanément suspendu à la suite des essais nucléaires indiens en 1998 - les autorités japonaises auraient évoqué récemment la possibilité d'établir un « partenariat stratégique » avec l'Inde, dont l'une des conséquences serait évidemment - au-delà des pures relations bilatérales - la constitution d'un « triangle » supposé stabilisateur dans l'équilibre des forces en Asie (201). Enfin, la situation dans la péninsule coréenne est l'un des éléments les plus directs de la tension. Le Japon s'est découvert une nouvelle vulnérabilité lorsque la Corée du nord a procédé au tir expérimental d'un engin balistique, le 31 août 1998. Il ne perçoit peut-être plus la Chine comme exerçant une influence modératrice sur un gouvernement toujours aussi imprévisible et dangereux (202). Ces points de friction s'inscrivent dans un contexte de renouveau nationaliste perceptible au Japon comme en Chine. Lors de la mission conduite par votre Rapporteur à Tokyo, en juillet 1999, le projet gouvernemental consistant à légaliser l'hymne et le drapeau japonais, dont l'usage était essentiellement coutumier depuis la fin de la Seconde guerre mondiale, a soulevé un large débat dans la société, escamoté par la brièveté de la discussion parlementaire. Alors même que la démarche du gouvernement a divisé l'opinion, elle s'est appuyée, en fait, sur la réaffirmation du sentiment national, dont l'expression la plus récente conteste la présence militaire américaine dans l'archipel. En Chine aussi, le renouveau nationaliste a pris pour cible privilégiée les États-Unis. La dénonciation du bombardement de l'ambassade de Chine à Belgrade (avril 1999) et les remous provoqués aux États-Unis par la publication du rapport Cox (203) fournissaient, au moment où votre Rapporteur était en mission à Pékin, la matière à une abondante littérature journalistique et à une logorrhée officielle dont les visées à la fois internes et externes ne pouvaient échapper à personne. Piloté, voire instrumentalisé par les différentes tendances de la direction chinoise, le nationalisme se nourrit du sentiment de confiance en soi qu'ont procuré les années de croissance, du développement progressif et réfléchi d'une conscience de l'abaissement historique de la Chine et du sentiment que celle-ci doit revenir à un « âge d'or » dont le contenu reste à définir, mais dont le périmètre passe nécessairement par Taiwan (204). La valorisation de l'idée nationale semble être aujourd'hui le seul recours idéologique d'un régime qui s'est attelé depuis 1978 à la modernisation économique du pays. Elle suggère le désarroi d'un pouvoir confronté aux exigences parfois contradictoires de la réforme et de la stabilité. c) Entre réforme et stabilité : l'inconnue chinoise Si l'année 1997 a été synonyme de crise financière pour la majeure partie des pays d'Asie orientale, sa signification aura été tout autre pour la Chine. En février 1997, la mort de Deng Xiaoping clôt la première ère des réformes économiques ; en juillet 1997, la rétrocession de Hong Kong intègre sans difficulté apparente un symbole du capitalisme au plus grand pays communiste, en vertu du principe « un pays, deux systèmes », et tourne une page essentielle du fait colonial en Chine. · La crise financière asiatique a été gérée comme une opportunité politique. Objectivement, la Chine avait peu de raisons d'être affectée par la déroute qui a frappé ses principaux voisins. La non convertibilité du yuan pour les opérations afférentes au compte de capital de la balance des paiements protégeait sa monnaie des attaques spéculatives (205). La prédominance des investissements directs sur les investissements de portefeuille donnait au capital étranger entré en Chine une stabilité sans équivalent dans le monde asiatique. Porté à près de 145 milliards de dollars en 1997, le niveau des réserves en devises conférait à la Banque populaire de Chine une capacité d'intervention d'autant plus importante que l'endettement extérieur restait très limité. Enfin, la diversification des exportations chinoises, supérieure à celle des autres pays asiatiques, explique que les dévaluations des monnaies touchées par la crise n'aient que modérément affecté les avantages comparatifs des exportations chinoises. Pourtant, le ralentissement de l'économie, provoqué par la politique de refroidissement engagée en 1993 et poursuivie jusqu'en 1997, devait se manifester dès 1998 et susciter des interrogations sur le maintien de la stabilité du yuan. Une dévaluation de celui-ci aurait été désastreuse pour le processus de stabilisation des économies touchées par la crise, car il aurait vraisemblablement conduit à relancer une série de dépréciations compétitives en Asie. La Chine a tenu bon et n'a pas manqué de valoriser son sens de la responsabilité auprès de ses voisins, des gouvernements occidentaux et des institutions financières internationales. La gestion politique de la non dévaluation du yuan a confirmé la capacité de la Chine à tirer le meilleur parti de ses faiblesses économiques. Au plan économique, la Chine avait peu d'intérêt à une dévaluation. La part importante des activités de transformation pour réexportation au sein de son commerce international réduisait mécaniquement les gains de compétitivité normalement attendus d'une telle opération. A une époque où la Chine cherchait à améliorer ses relations avec les États-Unis, une dépréciation monétaire aurait pu créer des tensions commerciales avec un partenaire représentant 20% des exportations nationales. De plus, il importait de ne pas effrayer ou brusquer les investisseurs étrangers, l'économie chinoise ayant besoin de leurs capitaux pour participer à la modernisation du pays. Enfin, une dévaluation du yuan aurait fait peser des doutes sur la préservation de la parité du dollar de Hong Kong et aurait pu entraîner de nouvelles perturbations sur cette monnaie, préjudiciables à l'économie du territoire. Au plan politique, la « responsabilité » dont faisaient preuve les autorités chinoises pouvait servir d'exemple vis-à-vis de Taiwan, en montrant que le pouvoir de Pékin était effectivement respectueux du principe « un pays, deux systèmes » et ne cherchait pas, par un moyen détourné, à faire rentrer dans le rang l'économie de Hong Kong. De même, la Chine pouvait se poser comme un pays soucieux de contribuer à la stabilité régionale en s'abstenant d'effectuer un réalignement monétaire potentiellement perturbateur. En persuadant le monde que la non dévaluation du yuan était un sacrifice que la Chine s'imposait pour contribuer à l'ordre économique international, celle-ci poussait également ses pions dans les négociations d'entrée dans l'Organisation mondiale du commerce (OMC). · Mais la crise allait bientôt rattraper le continent chinois et souligner la nécessité d'engager rapidement l'assainissement du secteur financier. Après avoir atteint près de 15% en 1992, sous l'influence des activités industrielles et du secteur de la construction, le taux de croissance du PIB a ralenti de façon continue, pour atteindre le chiffre de 8,8% en 1997, puis 7,8% en 1998. Cependant, on s'accorde à considérer qu'il faut retrancher au moins deux points aux chiffres officiels pour avoir une estimation plus réaliste du taux de croissance. En tout état de cause, et selon un schéma déjà observé dans le cas de la Corée du sud, la mauvaise allocation de l'investissement a créé des surcapacités qui, conjuguées au ralentissement de la croissance, ont dégradé la capacité des entreprises à rembourser leurs prêts (206). L'accumulation des prêts non performants a fragilisé le système bancaire, essentiellement à travers le bilan des quatre grandes banques commerciales chinoises qui sont propriété de l'État (207). Il est vrai que le savoir-faire financier, notamment les compétences nécessaires pour réaliser des analyses de risques, est notoirement insuffisant dans les banques chinoises : la plupart d'entre elles accordaient leurs prêts sur instruction des autorités centrales ou locales (208). Dans une conférence de presse donnée en mars 1999, le gouverneur de la Banque populaire de Chine indiquait que les prêts non performants des quatre banques commerciales d'État représentaient, à la fin de l'année 1998, 25% du total de leur portefeuille de prêts et que près de 8% étaient définitivement irrecouvrables. Le deuxième « point noir » du système financier chinois se situe dans le secteur non bancaire. Le développement des compagnies fiduciaires et d'investissement remonte au tout début de la réforme économique, puisque la Banque de Chine (209) a créé dès 1979 une division financière non bancaire en son sein, qui allait plus tard devenir la China International Trust and Investment Corporation (CITIC). Les compagnies fiduciaires ont été conçues en vue de compléter le système d'intermédiation de l'épargne, pour satisfaire aux besoins nouveaux de placements et d'investissements suscités par la réforme et difficilement assumés par les banques commerciales. Mais des comportements d'investissement hasardeux au début des années 1990 ont dégradé leurs conditions d'exploitation. A la suite du renforcement de ses activités de supervision par la Banque populaire de Chine, au milieu des années 1990, les difficultés du secteur non bancaire ont été révélées : ratios de capitalisation inadéquats, forte proportion d'actifs non performants, nombreuses opérations illégales. La banque centrale a décidé d'engager la restructuration ou la cessation d'activité de près de 300 institutions non bancaires (210). Parmi elles, la Guandong International Trust and Investment Corporation (GITIC) s'est vu interdire de poursuivre ses opérations en octobre 1998, la société se révélant incapable d'assumer la charge d'une dette supérieure à cinq fois ses capitaux propres. La GITIC a été mise en liquidation en janvier 1999, dans des conditions qui ont suscité l'irritation des créanciers étrangers. Après avoir indiqué, à la fin de l'année 1998, que les créances établies au bénéfice des investisseurs étrangers et enregistrées auprès de l'institution chargée de gérer l'endettement extérieur de la Chine seraient dûment remboursées, les autorités ont annoncé, en janvier 1999, que seuls les 25 000 déposants particuliers chinois seraient totalement indemnisés, alors que tous les autres créanciers devraient s'engager dans les procédures définies par la loi sur les faillites. Les créanciers étrangers pensaient en fait que leurs investissements étaient couverts par une garantie du gouvernement central. En les détrompant de la sorte, le gouvernement chinois a lancé plusieurs messages : - l'absence de renflouement préférentiel des investisseurs étrangers est normal, le gouvernement central n'étant pas comptable des errements d'établissements financiers contrôlés par les autorités régionales ou locales. En revanche, il assumerait ses responsabilités si une entreprises contrôlée par lui venait à être en difficulté ; - la faillite du GITIC est le prélude à un assainissement général du secteur non bancaire, ce qui devrait susciter la confiance des investisseurs, une fois passé le « désagrément » propre au cas particulier du GITIC ; - la Chine veut contrôler son endettement extérieur et ne pas connaître de dérive « à la thaïlandaise », ce qui devrait, également, susciter la confiance des investisseurs. Sur ce dernier point, le message a été parfaitement reçu, puisque le dernier trimestre de 1998 a été le point de départ d'une stabilisation, voire d'une légère diminution, des engagements bancaires extérieurs sur la Chine. Cependant, les flux d'investissements directs ont été peu affectés. Par delà la reprise en main des compagnies fiduciaires ou financières, qui s'entend aussi comme la volonté du gouvernement central de réaffirmer son autorité sur les régions, l'assainissement du système financier suppose la résolution du problème des prêts non performants. Conformément aux solutions adoptées dans les autres pays asiatiques, le gouvernement a procédé à la constitution de quatre sociétés de défaisance chargées de reprendre auprès des quatre banques commerciales et des trois banques spécialisées leurs prêts non performants constitués avant 1996, de les restructurer, de prendre possession des collatéraux, le cas échéant, et de vendre ceux-ci au meilleur prix. Au cas où elles ont affaire à des débiteurs défaillants mais viables, les sociétés de défaisance peuvent également procéder à des échanges de dettes contre actions, qui ont l'avantage d'alléger le fardeau de l'endettement pour les débiteurs et de favoriser le redressement de leur solidité financière. Les sociétés de défaisance se financent principalement par l'émission d'obligations à échéance de vingt ans, ce qui reporte d'autant le coût budgétaire des opérations d'assainissement du système bancaire. Par ailleurs, le gouvernement a affiché son intention de faire adhérer les banques commerciales aux ratios de solvabilité définis par le comité de Bâle (ratio Cooke). Ceci implique un effort budgétaire de recapitalisation dont l'ampleur exacte reste inconnue, mais qui sera au moins égal à plusieurs dizaines de points de PIB. Une autre mesure d'importance a été la modification des structures de la Banque populaire de Chine. Avant 1979, la Banque populaire de Chine était la seule institution bancaire ; à cette date ont été créées les quatre banques commerciales d'État, mais la Banque populaire continué d'exercer des activités commerciales pour son compte. Elle n'a commencé à fonctionner comme une véritable banque centrale qu'en 1984, mais il a fallu attendre 1995 pour que la loi précise pleinement son statut, ses compétences en matière de politique monétaire et ses autres responsabilités au regard du contrôle et de la supervision des institutions financières (211). En vertu de cette dernière loi, la Banque populaire de Chine ne doit pas interagir avec les autorités ou les agences régionales et doit appliquer des règles identiques à toutes ses branches et représentations locales. En fait, le découpage régional des subdivisions de la banque centrale favorisait l'apparition d'« interférences » avec les différents pouvoirs régionaux. Il en résultait un système où l'autorité de la banque centrale était exercée par le siège central et par les pouvoirs régionaux. La Conférence financière nationale, organisée en novembre 1997, a décidé de fermer l'échelon régional et de le remplacer par neuf subdivisions supra-régionales, mettant ainsi la Chine au diapason du système américain de Réserve fédérale (212). · Plus encore que la réforme du secteur financier, la réforme des entreprises, dernière étape du processus de modernisation engagé en 1978, est certainement la plus difficile. Tout au long du processus de réforme, le pouvoir n'a jamais fait que modifier l'environnement et le mode de fonctionnement des entreprises d'État, sans procéder à des restructurations à proprement parler. C'est ainsi que les prix ont été progressivement libérés et que les dirigeants des entreprises se sont vu accorder plus d'autonomie, tout en restant liés à l'État par l'intermédiaire de contrats de gestion censés déterminer conjointement les objectifs de l'État-propriétaire et les missions des directions-gestionnaires. Par ailleurs, le gouvernement a progressivement éliminé les protections dont bénéficiaient ces entreprises en autorisant la concurrence d'entreprises privées ou à capitaux mixtes ou contrôlées par les autorités locales. De même, les subventions ont été peu à peu réduites - ce qui explique également la montée de l'endettement des entreprises d'État, celles-ci ayant compensé la chute des ressources d'État par un recours accru au crédit bancaire. Suite à la relance politique du processus de réforme en 1992 (213), le gouvernement s'est engagé dans une nouvelle phase en 1993, à travers plusieurs programmes à moyen terme : adoption du principe de la séparation des fonctions de l'administration et des fonctions de l'entreprise, transformation des entreprises d'État en véritables sociétés, transfert à des entités constituées sous forme de sociétés de la gestion des actifs de l'État, amélioration des systèmes de surveillance interne des sociétés grâce à l'introduction de conseils d'administrations et d'assemblées générales d'actionnaires, renforcement du contrôle d'État sur les sociétés dont il est propriétaire grâce à la constitution d'un corps d'inspection, vente des « petites » entreprises d'État, développement d'une politique de fusions ou de faillites pour les entreprises d'État insolvables, suppression des fonctions sociales assurées par les entreprises (retraites, santé, éducation, logement), etc. En septembre 1997, le XVe Congrès du Parti communiste chinois a décidé de franchir une nouvelle étape et d'accélérer la restructuration d'un secteur productif d'État qui devenait un fardeau de plus en plus lourd. Le programme défini à cette occasion a réaffirmé la politique de désengagement des entreprises les plus petites - si le mot de « privatisation » reste banni, c'est bien de cela qu'il s'agit ; dans les entreprises moyennes ou grandes, mais non stratégiques, l'État s'oriente vers la constitution de participations « de référence », pas nécessairement majoritaires, aux côtés d'autres actionnaires ; enfin, l'État entend conserver la maîtrise d'un millier de grandes entreprises jugées stratégiques (défense, énergie, hautes technologies, infrastructures, etc.), qu'il compte structurer sur le principe des chaebols coréens pour en faire des conglomérats capables d'occuper une place significative du marché intérieur et de se mesurer à la concurrence mondiale. Paradoxalement, c'est donc au moment même où le modèle coréen des chaebols montrait ses limites que le pouvoir chinois en faisait la pierre angulaire du futur secteur industriel d'État. Enfin, en mars 1998, le Premier ministre nouvellement nommé, M. Zhu Rongji, a dévoilé un plan de réduction des pertes des entreprises d'État, étalé sur trois ans. Ce plan s'organisait autour de trois composantes : une diminution autoritaire ou incitative des capacités de production (notamment dans le textile) ; des suppressions d'emploi massives ; l'orientation des travailleurs licenciés vers des « centres de réemploi », censés leur fournir un subside, une formation et des offres d'emploi. Pour le secteur textile, l'objectif officiel du gouvernement était de supprimer 10 millions de machines et d'accueillir 1,2 million de travailleurs dans les centres de réemploi (214). Le mouvement de restructuration a été ralenti en 1998, compte tenu du ralentissement général de l'économie, de la montée du chômage, de l'atonie de la consommation des ménages - qui se traduit par un taux d'épargne de près de 40% du revenu disponible (215) - et de la montée des mécontentements. Mais l'objectif fixé par le gouvernement a été réaffirmé et poursuivi en 1999. Le gouvernement chinois semble donc décidé à trancher dans le vif, les simples modifications de l'environnement des entreprises d'État n'ayant pas suffi à leur donner l'efficacité escomptée. Il va devoir gérer les conséquences sociales de la restructuration, qui s'annoncent sévères. Les sureffectifs ont pu être évalués à près de 40 millions de personnes sur 140 que compterait le secteur productif d'État. « Pour les Chinois, c'est l'écroulement d'un monde. L'angoisse du chômage taraude désormais les friches industrielles du Hubei ou du Liaoning, comme à Valenciennes ou à Manchester. Officiellement, le taux de chômage est de 3,5%. Le chiffre fait hurler tous les économistes, y compris les chinois. Les licenciements récents sont ainsi considérés comme du chômage technique, le contrat de travail n'ayant pas été formellement "résilié". Quant aux sureffectifs dans les campagnes (100 à 150 millions de personnes), ils sont passés sous silence » (216). Dans ce contexte, la décision de poursuivre le processus d'entrée à l'OMC participe autant d'une volonté d'approfondir la modernisation du pays que d'obtenir, par cette « contrainte extérieure » que représentent les règles du commerce mondial, un nouveau socle sur lequel asseoir les réformes à venir. L'OMC sera d'ailleurs, le cas échéant, un bouc émissaire commode pour expliquer les difficultés futures (217). La « nouvelle frontière » de la Chine est bien là : comment légitimer des réformes désormais douloureuses auprès d'une population qui se voit privée peu à peu des rares acquis sociaux issus de la période flamboyante du communisme ? Comment légitimer un pouvoir qui a troqué en 1978 les habits usés de l'idéologie pour ceux de la modernisation, du progrès et... de l'enrichissement ? Comment stabiliser un édifice étatique et une unité toujours aussi fragiles, en évitant que ne s'agrègent en un mouvement national les mécontentements locaux ? La dynamique du capitalisme se fait chaque jour plus irrésistible, elle érode la capacité de l'État à imposer son rythme et à encadrer le processus, elle magnifie les possibilités d'échapper au lot commun grâce à la corruption et à la spéculation, elle creuse les inégalités. La Chine est confrontée à de multiples défis. Le credo économiste du Parti, entonné en 1978 (218), se voit contesté sur le plan matériel par les difficultés du ralentissement économique et de la restructuration, sur le plan des idées par l'émergence de sectes plus ou moins millénaristes comme le mouvement Falungong, contre lequel les autorités mènent actuellement une lutte sans merci, mais sans résultat probant non plus (219). Est-ce à dire que le pouvoir est assiégé et qu'une déstabilisation majeure menace aujourd'hui la Chine ? C'est improbable, mais les difficultés du régime sont évidentes. Sauf à envisager un brusque retournement des rapports de force au sein de la direction, qui ramènerait sur le devant de la scène des conservateurs ragaillardis par les échecs de leurs adversaires, le Parti ne pourra pas éluder l'approfondissement de certaines questions fondamentales sur les contradictions du « socialisme de marché » (notamment les implications politiques de l'autonomie accordée aux agents économiques), sur la forme de l'État (dans la perspective d'une réunification avec Taiwan et d'une redéfinition des pouvoirs des régions), sur le rôle du Parti, sur la logique d'une transformation du « gouvernement par la loi » en État de droit (220), etc. La Chine suivra son chemin propre, écartelée entre son désir de puissance et la conscience de ses faiblesses, entre sa volonté de modernisation et les hésitations d'un pouvoir moins certain, entre les sirènes de l'ouverture et le recours qu'offrirait un raidissement idéologique. S'il est une notion que tous les interlocuteurs de votre Rapporteur ont mise en avant, c'est bien celle d'« incertitude chinoise ». * * * Est-il alors réellement envisageable de voir apparaître une véritable « communauté d'Asie orientale » ? Réunis à Manille, en novembre 1999, les chefs d'État et de gouvernement des dix pays membres de l'ASEAN et les représentants des gouvernements chinois, coréen et japonais (dont, notamment, le premier ministre chinois M. Zhu Rongji) ont collectivement célébré l'apparition d'un « forum d'Asie de l'est », entité informelle, comme il se doit dans la région. Ce forum, connu désormais sous le sigle « ASEAN + 3 », est censé refléter l'apparition d'une « identité asiatique propre » (221), fondée notamment sur « l'émergence d'une ASEAN unifiée » (222). Mais l'« identité asiatique » n'exclut pas la diversité des points de vue. A peine l'« ASEAN + 3 » s'était-il introduit au monde que la Chine refusait de signer le code de bonne conduite sur la question des îles Spratleys et la mer de Chine du sud, prôné depuis plusieurs mois par le gouvernement philippin, tout en ayant fait savoir qu'elle en acceptait le principe (223). Le dossier du code de conduite sera, certainement, un bon test de la capacité du nouveau forum à traiter au fond les véritables questions de l'Asie orientale. Malgré ces vicissitudes diplomatiques, la réalité d'un forum asiatique ne fait pas de doute. Il ne faut pas se méprendre sur la signification d'une telle instance. La négliger sous prétexte qu'elle se fonde sur les mêmes principes consensuels que l'ASEAN et qu'elle n'est finalement que la reproduction en Asie du « concert européen » du XIXe siècle, serait passer à côté de son message : les pays d'Asie orientale veulent et peuvent se parler en dehors de toute interférence occidentale. Même si elle s'appuie sur la participation des trois pays d'Asie du nord aux travaux des comités et réunions ministérielles de l'ASEAN depuis environ trois ans, la démarche engagée est encore balbutiante. Autant que des objectifs externes, elle poursuit des objectifs internes - notamment la formalisation d'un dialogue politique multilatéral avec la Chine. Mais elle préfigure peut-être la constitution prochaine du troisième pilier de l'ordre politique et économique mondial, aux côtés de l'Europe et des États-Unis. C'est pourquoi l'Europe doit être attentive au processus qui a pris forme à Manille en novembre 1999. L'Asie est encore loin d'une intégration, au plan économique comme au plan politique. Elle est déjà plus qu'une simple agrégation de volontés. Dans cette mutation essentielle, l'Europe doit faire entendre sa voix et porter son message. C.- LES VOIES PROMETTEUSES DU DIALOGUE EUROPE-ASIE Après la crise, l'heure n'est plus à l'admiration sans retenue des réussites de l'Asie orientale, ni à la dénonciation frileuse d'une supériorité inéluctable qui conduirait à un pas de deux triomphal et exclusif entre l'Asie et les États-Unis. L'Europe n'a pas été renvoyée à son passé glorieux mais supposé sans lendemain ni boutée hors du monde en devenir. Bien plus, aux yeux de votre Rapporteur, la crise offre à notre continent l'opportunité de renforcer la relation Europe-Asie, afin que le trépied sur lequel se construit l'ordre politique et économique international soit plus équilibré et échappe à la logique de puissance des seuls États-Unis. Naturellement, les entreprises françaises et européennes doivent être des acteurs de cette relation. Elles ont d'ailleurs dépassé la vision d'une Asie confinée dans le rôle mineur d'un réservoir de main d'_uvre à bon marché, propre aux seules délocalisations. L'Asie leur apparaît pour ce qu'elle est : un ensemble de marchés à conquérir, effectifs ou potentiels, pleins de promesses et non exempts de risques, comme ceux qu'elles connaissent dans les pays industrialisés. Pour les entreprises françaises, l'Asie n'est pas non plus simplement considérée comme une terre d'exportation pour les produits de luxe ou les produits de bouche. Les marchés asiatiques sont désormais convoités, sans complaisances et sans illusions, car ils peuvent être la clef d'une présence mondiale. Et lorsque tel ou tel constructeur automobile s'implante en Chine ou prend une participation de référence dans un concurrent japonais ou coréen, ce n'est pas pour profiter de coûts prétendument plus bas - ce qui serait d'ailleurs une motivation erronée - mais pour satisfaire les besoins des consommateurs locaux ou régionaux, dans le cadre de partenariats bien compris. Le mouvement récent d'implantation des entreprises françaises ou européennes de services, comme la grande distribution, montre bien que la présence en Asie relève d'une logique de production et non de compression des coûts, un service étant généralement « consommé » sur place. Pour autant, l'Europe en Asie nécessite d'autres ambassadeurs : le développement de ces relations particulières que votre Rapporteur appelle de ses v_ux reposera d'abord sur la dimension politique du dialogue entre l'Europe et l'Asie. 1.- Le sens du dialogue Europe-Asie · La première vertu du dialogue Europe-Asie est de prétendre exister en tant que tel. En affirmant la légitimité d'une relation de continent à continent (224), l'Europe reconnaît la validité d'une approche régionale de l'Asie, qui dépasse le cadre des relations bilatérales et va même au-delà du multilatéralisme tel qu'il est classiquement conçu. Le dialogue Europe-Asie ne se veut pas un simple forum qui assemble, le temps d'une conférence, des États placés sur un pied d'égalité : il a une dimension collective forte, qui tranche avec le bilatéralisme traditionnel des États-Unis. Ce penchant pour le bilatéralisme traduit d'ailleurs la volonté d'établir un rapport de forces favorable aux États-Unis, qui ne reflète peut-être que la crainte de voir émerger un pôle asiatique plus solidaire et plus soudé. Assurément, un tel pôle serait susceptible de contrarier trop directement les visées américaines, ou, tout au moins, de nuire au rayonnement international du « modèle anglo-saxon ». A contrario, l'attitude des États-Unis vis-à-vis de l'idée asiatique suggère les vertus équilibrantes que pourrait avoir l'affirmation de l'Asie sur la scène internationale. Pour autant, l'objet du dialogue Europe-Asie ne peut pas être la fin des relations bilatérales. Les pays européens, chacun avec sa sensibilité, chacun assumant le legs de son histoire, entretiennent avec les pays asiatiques un faisceau particulier d'affinités ou d'indifférences qui ne saurait se dissoudre dans un « mélange » européen insipide parce que privé de sens. D'ailleurs, les rivalités commerciales restent bien présentes et rappellent que l'Europe est à la fois une union et une réunion d'États. Affirmer la nécessité d'un dialogue Europe-Asie, c'est d'abord prendre acte de l'interdépendance croissante des pays asiatiques. La dynamique d'intégration est forte dans le domaine économique, plus embryonnaire dans le domaine monétaire - quoique votre Rapporteur soit étonné de la multiplication des réflexions sur le thème d'une monnaie commune asiatique, même s'il s'agit surtout, pour l'instant, d'en contester la faisabilité à moyen terme ; elle est velléitaire et déclarative plutôt que réelle dans le domaine politique. Il est vrai que le concept même de « pôle asiatique » souffre de deux défauts majeurs : le déséquilibre entre ses membres potentiels et l'absence de conscience historique d'un destin commun. La Chine et le Japon sont des puissances mondiales et l'on peut se demander si ces deux pays souhaiteront un jour diluer cette puissance au sein d'un ensemble régional plus intégré au plan politique. Observons que le renforcement des liens économiques en Amérique du nord, grâce à l'ALENA (225), entre les États-Unis, le Canada et le Mexique, n'a pas jusqu'ici débouché sur une représentation politique commune vis-à-vis de l'extérieur... L'ASEAN a longtemps été considérée comme un instrument possible de rééquilibrage des relations inter-asiatiques. En un sens, au « trépied » Europe - Asie - États-Unis dans l'ordre politique mondial devrait répondre le trépied Chine - Japon - ASEAN dans l'ordre politique régional. Dans cette perspective, l'Indonésie a souvent été courtisée comme un contrepoids potentiel à l'influence de la Chine en Asie du sud-est. Cette vision tripartite de l'Asie orientale est-elle obsolète, la crise ayant rendu difficile l'émergence du leadership indonésien au sein de l'ASEAN ? Est-elle foncièrement inadaptée, car négligeant le rôle croissant de l'Inde, qui se tourne peu à peu vers ses voisins asiatiques ? Est-elle tout simplement irréaliste, compte tenu de la diversité d'intérêts qui sépare les États concernés ? Votre Rapporteur convient que poser le problème en ces termes conduit à buter sur un obstacle très difficile. Pour franchir l'obstacle, il faut donc renverser les termes du problème : il ne s'agit pas de se demander dans quelle mesure l'Europe peut tirer profit d'un dialogue avec une Asie orientale qui reste largement virtuelle. Il s'agit, au contraire, de s'interroger sur la capacité de l'Europe à promouvoir une intégration plus grande de l'Asie, grâce à l'établissement d'un dialogue qui affirme le fait régional et qui _uvre à le valoriser et à le renforcer. L'obstacle est ainsi transformé en défi politique. En faisant de la sorte le pari d'une « construction par le haut », la démarche européenne à l'égard de l'Asie s'appuierait sur l'esprit de ses origines, en 1950 puis 1957, mais surtout contribuerait à la stabilité régionale grâce au dépassement des nationalismes. · On peut, dès lors, espérer que, grâce au débat euro-asiatique, il sera possible de reconsidérer plus sereinement la polémique qui a fait rage depuis le début des années 1990, marquée par l'émergence d'un discours « asiatiste » affirmant la supériorité de « valeurs asiatiques ». Comme l'indique M. Jean-Luc Domenach, « par "asiatisme", nous entendons la tentative d'énoncer un discours idéologique d'un type nouveau, orienté d'abord non par une idée sur l'homme, et encore moins sur le monde, mais par une idée de l'histoire et du destin des sociétés asiatiques. Ce discours vise à faire apparaître une "asianité", c'est-à-dire une identité commune aux sociétés asiatiques, par opposition aux caractéristiques occidentales » (226). L'asiatisme naît, au début des années 1990, de la conjonction de trois phénomènes : le dynamisme économique des pays asiatiques, qui semblent s'engager l'un après l'autre sur les chemins glorieux de la croissance ; la chute de l'Union soviétique, qui provoque la disparition de la seule idéologie concurrente du libéralisme démocratique occidental ; l'intensification des relations économiques en Asie, qui accrédite l'idée d'un bloc régional en formation. Originaire de Singapour et de Malaisie, l'asiatisme ne constitue ni une théorie - car il ne présente pas de concepts organisés qui pourraient fournir une explication de faits universels - ni une doctrine - puisqu'il n'est pas inscrit dans un manuel ou un « ouvrage primordial » et ne cherche pas à constituer un réseau de militants. Le discours asiatiste est apparu, peu à peu, dans des articles ou des interventions de personnalités singapouriennes ou malaisiennes. Il cherche, pour l'essentiel, à expliquer le triomphe économique de l'Asie par l'existence de « valeurs asiatiques » propres à cette zone géographique mais partagées par tous les pays qui en font partie. En contrepoint, le déclin économique de l'Occident résulte avant tout de son déclin moral et social. L'économie devient donc le critère du succès et du progrès, tandis que la morale en est le fondement. Construction assez empirique, l'asiatisme ne fournit pas de recensement formel et définitif des « valeurs asiatiques ». Cependant, on y trouve des éléments incontournables, d'ailleurs identifiés auparavant par les spécialistes occidentaux de l'Asie : le respect des autres, le sens de la famille, l'éducation de masse, l'épargne et la frugalité, l'ardeur au travail, le dévouement à la communauté, le respect mutuel des citoyens et de l'État, un environnement moral sain, une presse « responsable », etc. Évidemment, l'Occident se voit affligé des maux qui sont comme le négatif des valeurs précitées : la priorité à l'individu, la déliquescence de la cellule familiale, le désir de jouissance, le délitement du lien social, etc. Il va de soi que la validité du discours asiatiste a été ébranlée, voire annihilée, par la crise de 1997. Même si la tentation était grande de dresser un tableau apocalyptique du combat entre l'Asie et les forces de la spéculation - la Malaisie n'y a pas résisté - le fait est que les valeurs asiatiques n'ont pas réussi à protéger l'Asie de l'effondrement. Plus encore, c'est bien le comportement des pays asiatiques avant la crise qui semble infirmer l'existence de valeurs asiatiques spécifiques. Les dépenses somptuaires de certains gouvernements dans des projets d'infrastructures démesurés étaient-elles donc la marque du sens asiatique, tant vanté, de l'épargne ? Les profits spéculatifs engrangés par les traders de Tokyo, Hong Kong ou Singapour, ou par les filiales financières de firmes industrielles représentaient-ils la quintessence de l'ardeur au travail telle que l'entendent les thuriféraires de l'asiatisme ? L'éducation de masse était-elle une priorité si forte en Thaïlande, quand les ingénieurs issus de son système de formation ne satisfaisaient qu'un tiers des besoins de l'industrie ? Les yuppies aux « poches percées », qui avaient fait en 1995 de la Thaïlande le huitième importateur mondial de voitures Mercedes, pouvaient-ils incarner véritablement la vertu de frugalité ? (227) L'Asie s'était donc perdue et les Asiatiques n'étaient plus « asiatiques »... En ce sens, le discours asiatiste aurait pu être interprété comme une tentative de faire retrouver ses repères, ses racines, son terreau culturel et social, à une population déboussolée par le contact avec le progrès et la proximité croissante de l'Occident. Mais l'asiatisme n'est pas le félibrige de l'Asie : il n'en a pas la portée littéraire - pas plus que le félibrige n'avait de réelle prétention politique ou morale - et les foucades du Dr. Mahathir sont loin d'avoir la dimension poétique des écrits de Frédéric Mistral. D'ailleurs, l'asiatisme se détourne des populations et constitue une réponse des seuls gouvernants à un Occident jugé dangereux. Parce qu'il trouve sa source, non auprès d'intellectuels en rupture de ban, mais au sein des cercles proches du pouvoir - quant ce n'est pas au sein du pouvoir lui-même - l'asiatisme apparaît comme une volonté de cautionner les ordres établis. Parce qu'il s'exprime essentiellement en langue anglaise, dans des supports médiatiques mondiaux, il apparaît comme un discours établi à destination de l'extérieur. Parce qu'il entend rassembler sous la bannière d'« asiatique » des éléments de civilisations aussi diverses que le bouddhisme, l'islam, le confucianisme et peut-être bientôt l'hindouisme, il apparaît comme un message à vocation plus universelle que régionale, quoiqu'il s'en défende. Comme l'explique avec vigueur M. Jean-Luc Domenach, « le discours que cette idéologie fonde obéit aux principales fonctions d'un discours identitaire : fonder un mythe (le succès par la vertu) et réunir par là des destins apparemment séparés ; faire de l'Autre un péril ; reconstruire, partiellement au moins, le temps, l'espace et les cultures de l'Asie ; orienter un combat pour le changement » (228). Dans ces conditions, on pourrait penser qu'il serait utile, voire nécessaire, de passer par pertes et profits ces « valeurs asiatiques » Pour autant, il faudra bien rejeter l'utilisation polémique qui en est faite, pour mieux comprendre ce que peut apporter l'asiatisme à la construction de l'Asie. Il revient certainement à l'Europe de dépasser le caractère « défensif » du discours asiatiste ; à cet égard, les contacts que votre Rapporteur a pu établir en Asie suggèrent que la plupart des dirigeants ont désormais compris que l'asiatisme entendu comme un irrédentisme culturel et social est une impasse. Il devient donc possible d'ouvrir un espace de discussion sur les rapports difficiles qu'entretient l'asiatisme avec les droits de l'homme. En dénonçant une entreprise de contrôle idéologique voulue par l'Occident, l'asiatisme ne fait pas seulement référence aux conflits relatifs au dumping social ou au respect de l'environnement. Il apporte sa « réponse » à la double question des droits de l'homme et de la démocratie « à la fois parce que ces questions sont vitales pour les gouvernements asiatiques et parce que, sur ce point, ils se savent entendus par leurs collègues du tiers monde » (229). Sur ces deux points, l'argumentation des zélateurs de l'asiatisme est souvent subtile. Les valeurs des droits de l'homme sont admises comme universelles, mais la façon dont elles sont mises en _uvre ne peut être identique d'un pays à l'autre, d'une civilisation à l'autre. M. Abdullah Badawi, ministre des affaires étrangères de Malaisie, interrogé par l'hebdomadaire Asiaweek, déclarait ainsi en octobre 1997 : « il n'y a pas de définition séparée des droits de l'homme pour l'Asie ou pour les autres régions. Ce que nous disons est que les mesures visant à protéger et à promouvoir les droits de l'homme doivent être différentes selon les régions et doivent prendre en compte les particularités locales, comme la situation politique, le niveau de développement socio-économique, les pratiques culturelles, les croyances religieuses. Une approche holistique et équilibrée tendant à promouvoir les droits de l'homme dans toutes leurs dimensions doit être l'objectif de tous les pays, mais [doit être réalisée] à la vitesse et à la période qui leur conviennent ». Les droits de l'homme doivent donc être insérés dans l'écheveau des contingences politiques nationales. Par conséquent, en Asie, la démocratie doit être consensuelle, disciplinée, assise sur la conscience que chacun a de ses responsabilités. Une telle approche des droits de l'homme et de la démocratie ouvre la voie à toutes les dérives. Il n'est pas étonnant que les dissidents s'élèvent contre ce qui est, il faut bien l'avouer, une remise en cause déguisée de l'universalité des droits de l'homme et une caution commode pour des régimes autoritaires. Votre Rapporteur ne peut manquer d'établir un parallèle édifiant entre les propos de M. Abdullah Badawi rapportés ci-avant et la vision profondément humaniste de M. Kim Dae-jung, alors opposant en retrait de la vie politique, dans un entretien accordé en 1994 au journal Le Monde. « Peut-on affirmer une tradition asiatique au nom de laquelle on pourrait rejeter les valeurs démocratiques ou les droits de l'homme comme étant l'expression d'une hégémonie occidentale ? Je ne le pense pas. La pensée asiatique a véhiculé des valeurs qui coïncident avec l'esprit de la démocratie. Ce qui nous a manqué, c'est la capacité de traduire ces valeurs en institutions et en un système politique. Pour un penseur comme Mencius, par exemple, qui vécut en Chine il y a plus de deux millénaires et exerça une grande influence sur le confucianisme, l'empereur, Fils du Ciel, a pour mission d'établir un bon gouvernement. S'il faillit, le peuple est en droit de le renverser. Il me semble qu'il y a là une correspondance avec l'idée de "contrat social" du philosophe anglais John Locke à la fin du XVIIe siècle. La compassion et la bienveillance qu'enseigne le bouddhisme ne se sont certes pas traduits en une Déclaration des droits de l'homme, mais cette doctrine n'en véhicule pas moins l'affirmation de la dignité et de l'absolu de la personne humaine. En Corée, le fondateur du mouvement religieux Tonghak (Savoir de l'Est) (230) identifie l'Homme au Ciel et affirme qu'on doit servir le premier comme on sert le second. Je crois que les racines de la démocratie et du respect de la personne existent dans les deux traditions occidentale et asiatique. La grande différence est que l'Europe a su les ériger en système social. Mais l'idée démocratique n'en existe pas moins aussi en Asie » (231). Ouvrir un espace de discussion ne signifie pas, naturellement, que la conception occidentale des droits de l'homme - après avoir pris connaissance des réflexions de Kim Dae-jung, il vaudrait mieux dire la traduction des droits de l'homme par l'Occident - va trouver un écho subitement favorable auprès des dirigeants asiatiques. Mais le fait même d'établir un lieu de débat offre la possibilité de dépasser le « conflit des civilisations » évoqué par M. Samuel Huntington dans un article désormais célèbre de la revue américaine Foreign Affairs (été 1993). · Au-delà du débat sur l'asiatisme, et malgré les difficultés et les tensions qu'une telle démarche peut impliquer, l'Europe doit faire valoir l'intérêt d'une relation euro-asiatique qui ne soit pas exclusivement commandée par des considérations économiques et commerciales. D'ailleurs, les tensions et les conflits trouvent aussi un terrain d'expression privilégié dans ces deux domaines... L'un des enseignements les plus importants de la crise asiatique est que les sociétés d'Asie orientale doivent s'extraire de l'« économisme » forcené qui les a orientées durant toutes les années de croissance. Certes, chacun y trouvait son compte : les gouvernants parce que le développement amenuisait les mécontentements, les gouvernés parce que l'économisme ambiant créait un climat favorable à l'enrichissement et donnait accès à une certaine modernité. Le choc causé par la crise donne à l'Europe l'opportunité de faire entendre un message différent et de rappeler que le monde ne se construit pas qu'avec des multinationales, des investissements ou des échanges de biens et services. Même si les États-Unis se font souvent les hérauts des droits de l'homme et d'une conception parfois très politique des relations internationales, l'Europe peut apporter des réponses pertinentes à ce messianisme américain qui n'est souvent que le faux nez d'un mercantilisme déguisé. L'essoufflement de l'Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) illustre la difficulté qu'il y a à nourrir une coopération sur des fondements uniquement économiques. Créée en 1989 à l'initiative de l'Australie, l'APEC visait à répondre à l'interdépendance croissante des économies situées sur la « façade » du Pacifique, dans un cadre informel organisé autour de réunions annuelles des ministres de l'économie et du commerce. L'objectif était de parvenir à définir des positions communes - ou à rapprocher les points de vue - dans la perspective de l'achèvement des négociations commerciales multilatérales connues sous le nom de « cycle d'Uruguay » et engagées en 1986. Les premières années ont été consacrées à la constitution d'un réseau de groupes de travail sur les sciences et les techniques, l'énergie, les ressources marines, les télécommunications, la libéralisation des échanges, etc. Le périmètre de l'organisation s'est également étendu, le premier élargissement étant d'ailleurs remarquable, puisqu'il concernait la Chine, Hong Kong et Taiwan (1991). Par la suite, le Mexique et la Papouasie -Nouvelle Guinée ont rejoint le forum multilatéral en 1993, suivis par le Chili en 1994. Mais la véritable émergence de l'APEC sur la scène internationale est venue de la décision du président Clinton de réunir à Seattle, en novembre 1993, un sommet informel des chefs d'État et de gouvernement des États membres, à l'issue de la réunion ministérielle normale. Dans leur déclaration finale, les participants au sommet affirmaient que cette réunion reflétait « l'apparition d'une nouvelle voix pour l'Asie-Pacifique dans les affaires du monde ». Reconnaissant leur interdépendance comme leur diversité économique, ils déclaraient « imaginer une communauté des économies d'Asie-Pacifique », fondée, entre autres, sur l'esprit d'ouverture et de partenariat. L'APEC était présentée comme un forum dédié à la réalisation d'avancées économiques tangibles. Une « communauté » va évidemment bien au-delà de la simple coopération. Cette déclaration ambitieuse a trouvé une traduction plus précise, l'année suivante, à l'occasion du sommet des chefs d'État et de gouvernement de Bogor (Indonésie). Ceux-ci se sont accordés sur l'objectif d'ouvrir davantage leurs marchés et de libéraliser complètement les échanges et les investissements, en 2010 pour les économies les plus développées et en 2020 pour les autres. Mais les déclarations d'intention se sont très vite heurtées aux pesanteurs de la réalité. Dès le sommet d'Osaka, en novembre 1995, les États-Unis ont obtenu qu'aucune exception ne soit expressément inscrite dans la liste des secteurs visés par le démantèlement des barrières douanières, mais le Japon et d'autres pays asiatiques ont fait admettre le principe de flexibilité, afin de tenir compte des différences de développement au sein de l'APEC. Les pays d'Asie considéraient dès cette date que le processus initié dans le cadre de l'APEC faisait la part trop belle aux intérêts des pays anglo-saxons en général et des États-Unis en particulier. Dans les réunions préparatoires au sommet, ceux-ci n'avaient eu de cesse de manifester leur souhait qu'un calendrier précis et contraignant soit mis au point pour être adopté par les chefs d'État et de gouvernement. Pour sa part, le Japon semblait vouloir utiliser l'APEC comme instrument dérivé de sa politique de coopération régionale (232). A l'issue du sommet, les observateurs estimaient que l'approche américaine, volontariste, avait été rejetée, au profit d'une approche d'inspiration « asiatique », plus pragmatique et plus consensuelle. Par la suite, le sommet de Manille, organisé en novembre 1996, a vu l'adoption d'un Plan d'action pour la libéralisation des échanges, compilation des plans d'action individuels présentés par chaque État membre. Semblant redynamiser l'APEC, il a également mis au point un accord sur les technologies de l'information, qui prévoyait la suppression des tarifs douaniers sur la plupart des produits informatiques ou relevant de l'électronique industrielle. Cet accord a été adopté quelques semaines plus tard par l'Organisation mondiale du commerce. L'APEC a ensuite été bousculée par la crise de 1997. Au sommet de Vancouver, en novembre de la même année, les pays asiatiques ont dénoncé la prétention du Canada, pays hôte et, à ce titre, maître de l'agenda, à évacuer la question de la crise pour ne retenir que des thèmes répondant aux seules préoccupations des pays occidentaux. Les chefs d'État et de gouvernement ont cependant approuvé le « cadre d'action de Manille », défini quelques semaines auparavant par les représentants des ministres des finances réunis dans la capitale philippine (233). Les résultats du sommet ont montré l'incapacité de l'APEC à aller très au-delà du discours convenu sur les vertus du libre-échange, les contenus des plans d'action individuels de libéralisation ne dépassant pas ce que les États membres proposaient par ailleurs dans le cadre de l'OMC. Pourtant, peut-être pour conjurer le mauvais sort, les États membres décidaient de libéraliser rapidement quinze secteurs d'activité, sur une base volontaire, neuf d'entre eux devant faire l'objet de négociations dès 1998 : chimie, énergie, biens et services liés à l'environnement, produits de la pêche, produits de la forêt, etc. L'élan de Bogor est définitivement retombé au sommet de Kuala Lumpur, en novembre 1998. Les États membres ont constaté leur incapacité à faire avancer le dossier de la libéralisation des neuf secteurs déterminés l'année précédente et ont renvoyé ce soin à l'OMC, mettant ainsi un coup d'arrêt à la dynamique commerciale propre à l'APEC. Surtout, le sommet a été perturbé par le discours du vice-président américain, Al Gore, qui a vilipendé les régimes autoritaires et apporté son soutien aux mouvements démocratiques, visant de façon transparente le cas de M. Ibrahim Anwar dont le procès venait de commencer. L'intervention du vice-président américain a, naturellement, provoqué de vives réactions de la part du gouvernement malaisien, par ailleurs hôte du sommet. Elle a aussi éclipsé le reste des débats et ranimé les interrogations sur la vocation et l'opportunité de l'APEC. Plusieurs personnalités - parmi lesquelles le président du Conseil économique du bassin pacifique, organisme de réflexion économique ayant milité pour la création de l'APEC à la fin des années 1980 - ont mis en cause l'utilité et l'efficacité de l'APEC, certains appelant même l'organisation à se dissoudre. L'élargissement de l'APEC au Pérou, au Vietnam, mais surtout à la Russie a suscité des craintes que l'organisation perde sa vocation géographique pour devenir un conglomérat de pays d'autant moins efficace que les intérêts de ses membres ne coïncideraient pas nécessairement avec ceux de l'aire Pacifique. Le sommet d'Auckland, en septembre 1999, n'a pas permis d'éliminer les interrogations. Le sommet a, d'emblée, été placé sous la pression politique des événements survenus au Timor oriental, la présidence néo-zélandaise décidant de convoquer de façon impromptue une réunion d'urgence sur cette question, invitant également le secrétaire britannique au Foreign Office, représentant d'un pays non membre de l'APEC. Au plan économique, le sommet s'est surtout positionné dans la perspective de la réunion ministérielle de l'OMC à Seattle, en novembre 1999. Cette brève rétrospective de l'APEC montre bien les deux difficultés essentielles qui sont apparues dans les travaux de l'organisation. Reposant sur le concept de « régionalisme ouvert », le processus de libéralisation ne limitait pas l'octroi de ses avancées aux seuls pays membres : toutes les concessions approuvées dans le cadre de l'APEC et effectivement mises en _uvre par les États membres avaient vocation à être applicables aux États extérieurs à la zone. Dans ces conditions, le moteur le plus puissant de l'APEC - l'intérêt commun de ses membres - était limité à certains sujets. C'est pourquoi la seule proposition forte de l'APEC en matière de libéralisation des échanges a porté sur les produits électroniques et informatiques, les pays de la zone assurant la majeure partie de la production et du commerce mondial pour ces produits. Par ailleurs, le mécanisme retenu pour procéder à la libéralisation des échanges peut être qualifié d'« unilatéralisme concerté ». Les propositions de libéralisation ne sont pas formellement négociées, chaque État membre faisant part à l'organisation d'une initiative élaborée dans les seules instances nationales. Présentée sous le nom de « plan d'action individuel », cette initiative ne voit pas son adoption conditionnée à des concessions similaires proposées par d'autres pays. Ainsi, toute réduction des barrières tarifaires proposée par un pays dans le cadre de l'APEC s'apparente à un « cadeau » fait aux autres États membres - et au reste du monde, du fait du principe du « régionalisme ouvert ». Dans ces conditions, les États sont incités à offrir peu de concessions, tout en en attendant beaucoup de leurs partenaires. Enfin, votre Rapporteur souligne le glissement progressif de l'APEC au cours des deux derniers sommets. La difficulté à concrétiser de réels progrès dans les domaines économique et commercial a été compensée par l'évocation des questions politiques les plus pressantes relatives à la zone du Pacifique. Mais ce glissement a été effectué « par défaut », presque à l'improviste, en tout cas sous la pression des événements et non en raison d'une démarche réfléchie. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si les « incursions » de l'APEC dans le champ politique se sont traduites par des controverses et des échanges de vues parfois peu diplomatiques... Ceci conforte votre Rapporteur dans l'idée que le dialogue Europe-Asie doit, d'emblée, se placer dans une perspective politique, afin d'éviter les malentendus et de clarifier les termes du débat. Au demeurant, les questions économiques ne peuvent pas être bannies : la réflexion sur le rôle de l'euro, le rôle du yen ou même la libéralisation des échanges ont naturellement leur place dans le dialogue euro-asiatique. Les relations entre l'Europe et l'Asie peuvent se déployer dans de multiples directions. Elles peuvent également s'inscrire dans des instances diverses : les relations bilatérales entre États, les relations bilatérales entre l'Union européenne et les pays asiatiques, les relations entre l'Union européenne et des organisations régionales. A ce titre, l'Union européenne entretient depuis 1980 des relations directes avec l'ASEAN, dans le cadre d'un accord de coopération qui devrait être étendu prochainement au Cambodge et au Laos. Les autorités de l'Union refusent jusqu'à présent l'extension de l'accord de coopération au Myanmar. Mais l'Asie orientale ne se limite pas à l'ASEAN. Votre Rapporteur a d'ailleurs indiqué que l'action de celle-ci tend à s'élargir avec la participation croissante de trois pays extérieurs à cette organisation : la Chine, la Corée et le Japon. Le cadre le plus adéquat pour que se développe le dialogue Europe-Asie doit nécessairement inclure ces trois derniers pays. Il existe depuis 1996 à travers l'Asia-Europe Meeting (ASEM). 2.- L'ASEM, une ambition à faire vivre · L'ASEM est un forum international encore très jeune : il a été créé en 1996, sur une idée avancée en premier lieu en octobre 1994 par M. Goh Chok Tong, Premier ministre de Singapour, au cours d'une visite officielle en France. Cette idée a été immédiatement soutenue par la France. L'ASEM se voulait d'abord un contrepoids à l'APEC, conçu comme une manifestation du côté États-Unis - Asie dans le triangle de stabilité de l'ordre mondial. L'ASEM rassemble les quinze États membres de l'Union européenne, sept des dix États de l'ASEAN (234), la Chine, la Corée et le Japon. Le premier sommet des chefs d'État et de gouvernement, organisé à Bangkok en mars 1996, aurait dû concentrer ses efforts sur les questions économiques, le thème retenu étant « un nouveau partenariat Asie-Europe en vue d'une plus grande croissance ». En fait, l'ASEM a dès l'origine affirmé sa vocation globale en définissant les trois piliers de son action : la promotion du dialogue politique, l'approfondissement des relations économiques et financières, le renforcement des liens culturels et sociaux. La place centrale du dialogue politique a été vigoureusement affirmée, même si, dans un réflexe tout asiatique, la déclaration commune adoptée à la fin du sommet indiquait que celui-ci devait être conduit sur la base de la non intervention, directe ou indirecte, dans les affaires intérieures des partenaires. Il est vrai que cette réserve était tempérée par la mention de l'observation nécessaire des règles du droit international, qui laissait la porte ouverte, notamment, à une intervention dans le cadre des Nations-Unies. Les participants au sommet ont insisté sur leur volonté d'instaurer un partenariat entre égaux. Ils ont également reconnu la nécessité de rendre plus dense leur dialogue et se sont accordés sur la mise au point de ce qui est désormais appelé le « processus ASEM ». Celui-ci s'appuie sur la diversité des lieux de discussion, pour en assurer la continuité et garantir la réalisation de progrès entre les sommets de chefs d'État et de gouvernement, qui se tiennent tous les deux ans. Ainsi le « processus ASEM » repose sur plusieurs niveaux de rencontres : - la réunion des chefs d'État et de gouvernement et du président de la Commission européenne donne l'impulsion et l'orientation générale du processus. Un cadre global de coopération euro-asiatique a été adopté lors du sommet de Londres (avril 1998) ; il devrait être révisé lors du sommet de Séoul, en octobre 2000 ; - la coordination générale et la responsabilité du dialogue politique sont confiées aux ministres des affaires étrangères, qui se réunissent chaque année intermédiaire entre deux sommets. Les ministres se sont réunis en février 1997 à Singapour et en mars 1999 à Berlin. Ils préparent également directement les sommets et se réunissent à cet effet dans les semaines qui précèdent ; - les piliers économique et financier ainsi que culturel et social reposent également sur des réunions ministérielles, ainsi que sur une institution ad hoc, la Fondation Europe-Asie (généralement désignée par son sigle anglais ASEF), inaugurée en février 1997 et située à Singapour. Il s'agit de la seule institution créée dans le cadre de l'ASEM, celui-ci ne disposant pas de secrétariat permanent ; - enfin, des réunions de hauts fonctionnaires (notamment les directeurs des douanes) et de différents groupes de travail permettent de faire progresser les dossiers. L'ASEM ne disposant pas de secrétariat permanent, la coordination des travaux est effectuée, du côté européen, par la présidence de l'Union et la Commission européenne, du côté asiatique par deux pays coordonateurs tournant régulièrement, qui sont actuellement la Corée et la Thaïlande. Le sommet de Londres (avril 1998) a été marqué par la crise asiatique, qui a fait l'objet de nombreuses discussions, y compris au regard de ses implications pour les relations entre l'Asie et l'Europe. Alors que l'Europe n'avait pas occupé le terrain politique au moment de la crise, laissant le champ libre aux initiatives des États-Unis, le sommet de Londres a été l'occasion de rappeler que la contribution des Quinze au financement du FMI atteint 30% de ses ressources alors que la part des États-Unis n'est que de 18,3%. Les participants au sommet ont également relevé que les banques européennes étaient plus engagées que les banques américaines en Asie et qu'elles avaient adopté une attitude constructive lors du processus de renégociation de la dette extérieure coréenne. Parallèlement, le sommet de Londres a débouché sur une « déclaration concernant la situation financière et économique en Asie », qui a manifesté de façon éclatante la différence entre l'approche américaine, marquée du sceau du libéralisme, et une approche européenne et asiatique plus soucieuse du sort des populations. La toute première phrase de cette déclaration met sur le même plan l'« incidence de la crise sur l'économie mondiale » et la « préoccupation [des dirigeants] sur son coût humain pour les populations d'Asie ». Si elle affirmait la nécessité de renforcer le rôle du FMI, de mettre en _uvre complètement les programmes d'ajustement définis par le FMI et la Banque mondiale, de réformer le système financier international pour en renforcer la stabilité, la déclaration commune insistait également sur la nécessité de « tenir compte des conséquences sociales des difficultés financières en Asie », de « protéger les dépenses sociales chaque fois que cela était possible » et « d'élaborer des systèmes de protection sociale bien conçus et d'un coût supportable pour protéger les plus démunis ». Enfin, à Londres, les dirigeants de l'ASEM ont indiqué leur volonté de maintenir un système commercial ouvert, déjouant ainsi les craintes de ceux qui avaient pu croire que la crise fournirait le prétexte à un repli protectionniste en Europe ou en Asie. · Un « bilan » de l'ASEM ne peut être aujourd'hui qu'un exercice de portée limitée. Le processus engagé à Bangkok en 1996 est encore trop récent, seuls deux sommets des chefs d'État et de gouvernement ayant été organisés jusqu'ici. Dans le domaine politique, les résultats sont encore assez modestes, la partie asiatique semblant moins portée à favoriser ce pilier de l'ASEM que les Européens. Cependant, les pays membres de l'ASEM se sont engagés à n'exclure a priori aucun thème du dialogue politique mais de réserver, dans un premier temps, les discussions à des sujets d'intérêt commun. C'est ainsi qu'à deux reprises, les chefs d'État et de gouvernement se sont penchés sur les questions touchant à la non prolifération et au contrôle des armements, ainsi qu'à la réforme des Nations-Unies. A cet égard, l'évocation de la « démocratisation » des institutions des Nations-Unies, notamment le Conseil de sécurité, suggère que l'ASEM - y compris dans sa partie européenne - a repris à son compte l'idée d'une redéfinition des membres permanents du Conseil de sécurité. Par ailleurs, les discussions ont porté sur les questions régionales (Irak, Cambodge, péninsule coréenne, Bosnie, Kosovo, etc.) et sur l'élargissement de l'Union européenne. A la suite d'une initiative conjointe de la France et de la Suède, lors de la première réunion des ministres des affaires étrangères à Singapour (février 1997), un séminaire juridique informel a été organisé. Le deuxième volet de l'ASEM, consacré à la coopération économique, s'est développé rapidement, sous l'égide de nombreuses réunions ministérielles et techniques. Les ministres de l'économie se sont réunis en septembre 1997 à Makuhari (Japon) et en octobre 1999 à Berlin. Ils se réuniront à nouveau en 2001 dans un pays asiatique. Ils ont discuté, entre autres, des relations économiques, des effets de la crise, du commerce, des investissements, des questions liées à l'OMC et de la croissance économique. Les ministres des finances se sont réunis en septembre 1997, à Bangkok, et en janvier 1999 à Francfort. Ils se réuniront à nouveau en 2001 au Japon. Ils ont abordé, entre autres, les perspectives macro-économiques, l'évolution des taux de change, l'union économique et monétaire et le secteur financier. Ils ont décidé de lancer des initiatives dans les domaines de la coopération douanière, du blanchiment d'argent et de la surveillance financière. Les directeurs généraux des douanes se réunissent tous les deux ans pour discuter plus particulièrement de procédures douanières et de leur application. A la suite du premier sommet de l'ASEM, à Bangkok, un « Forum des hommes d'affaires » a été établi sous la bannière de l'organisation et se réunit tous les ans. L'objectif consistait à créer une caisse de résonance qui permettrait aux besoins concrets du monde des affaires de trouver une expression auprès des autorités politiques. Les forums successifs ont permis des échanges de vues sur des questions telles que le financement des infrastructures (235), la propriété intellectuelle et la réduction des barrières commerciales relatives aux biens de consommation, le renforcement du soutien aux PME dans les pays où leur situation est la plus fragile au regard du tissu économique, etc. Deux actions concrètes sont désormais mises en _uvre, visant à répondre aux préoccupations des milieux d'affaires : - un Plan d'action pour la promotion de l'investissement (IPAP, en retenant le sigle anglais) : finalisé à Luxembourg dès juillet 1997 et avalisé par les ministres de l'économie en septembre 1997, l'IPAP répond à une initiative thaïlandaise. Il intervient dans deux domaines : la promotion des investissements et les règles applicables à l'investissement étranger. L'IPAP a suscité la constitution d'un groupe d'experts en investissements, chargé de suivre la mise en _uvre des actions décidées dans le cadre de l'IPAP ; - un Plan de facilitation des échanges (TFAP) : formalisé par les ministres de l'économie en septembre 1997, ce programme vise à aborder dans un même cadre l'ensemble des questions commerciales, douanières et réglementaires ayant une influence sur les relations commerciales entre l'Europe et l'Asie. Il a pour mission l'approfondissement des travaux de libéralisation engagés dans un cadre multilatéral et la poursuite des réflexions conduites en matière de normes et de propriété intellectuelle. La France a un rôle d'animation sur ce dernier sujet. Votre Rapporteur ne peut manquer non plus de signaler la création, à la suite du sommet de Londres et de ses travaux relatifs à la crise asiatique, d'un « fonds fiduciaire », le Trust fund, constitué auprès de la Banque mondiale, qui a été chargée de sa mise en _uvre en concertation avec la Commission européenne. Destiné au financement de l'assistance technique dans deux domaines, la restructuration du secteur financier et la lutte contre la pauvreté, il est réservé aux pays éligibles aux opérations de la Banque mondiale. Le fonds a été abondé à hauteur de 42 millions d'euros pour une durée de 18 mois, la France étant le plus important contributeur après la Communauté européenne. Ayant commencé ses activités au début de l'année 1999, il devrait avoir épuisé son enveloppe avant la fin de l'année 2000, selon les informations recueillies auprès de l'agence financière pour l'Asie du sud-est. L'APPRÉCIATION PORTÉE PAR LA BANQUE MONDIALE Le fonds répond, selon la Banque mondiale, au traitement de besoins qui demandent des interventions de long terme. Évoquant la vulnérabilité des pays asiatiques aux chocs externes (risques d'un ralentissement de la croissance et d'une crise boursière aux États-Unis), elle a noté que les conséquences en seraient atténuées par l'existence de facteurs stabilisateurs comme la flexibilité des taux de change et l'absence de bulle financière. Passant en revue les différentes actions engagées, pays par pays, par le fonds ASEM, le responsable de la Banque mondiale pour le secteur des banques et des entreprises a insisté sur le caractère sélectif des projets réalisés et sur leur cohérence. Il s'est néanmoins inquiété de la moindre ardeur réformatrice des gouvernements concernés dans le contexte actuel d'amélioration économique. Pour le proche avenir, la Banque privilégiera la poursuite des efforts en faveur de la restructuration bancaire, de la mise en _uvre de cadres légaux adaptés, et du développement de marchés de capitaux nationaux. De son côté, le responsable en charge des questions sociales a notamment observé que les lacunes de l'information statistique dans les pays aidés, comme l'expérience souvent faible des administrations sociales, avaient contribué à ralentir le déroulement des programmes. La Banque mondiale a vigoureusement plaidé pour le maintien et l'approfondissement de l'expérience de partenariat mise en _uvre grâce au fonds ASEM. Selon elle, une telle perspective répondrait au souci d'élargir les sources traditionnelles de financement de l'aide internationale et permettrait de pérenniser un précieux canal d'intervention de l'Union européenne en Asie. Le Dr. Djunaedi, président du Bappenas (Agence nationale pour le développement), qui s'exprimait au nom du gouvernement indonésien, a résumé la tonalité générale des interventions des participants asiatiques bénéficiaires du fonds. Appelant ses « amis européens » à poursuivre une assistance fondée sur une approche et une expertise spécifiquement européennes, notamment dans les domaines de l'économie, des institutions et de l'environnement, il a souligné combien les contributions passées et à venir du fonds ASEM étaient et seraient appréciées. Source : Agence financière à Singapour, Le Courrier de l'Agence financière Selon la Banque mondiale, le Trust fund a réussi à s'imposer, en dépit d'une visibilité réduite, face à des initiatives bilatérales plus anciennes ou beaucoup mieux dotées, comme celles lancées par le Japon ou l'Australie. La rapidité de mise en _uvre des dossiers est l'un des traits les plus convaincants du dispositif : en douze mois d'existence, 63 projets ont été réalisés pour un montant de 39,6 millions de dollars. La répartition sectorielle des financements fait apparaître une concentration sur les restructurations du secteur financier, qui ont absorbé 54,8% du total des montants affectés. Sur le plan géographique, les trois principaux bénéficiaires ont été la Thaïlande (7 millions de dollars, soit 17,7% du total), l'Indonésie (6,2 millions de dollars, soit 16% du total) et les Philippines (5,5 millions de dollars, soit 13,8 % du total). Ces pays ont reçu des dotations supérieures à celles de la Chine (5 millions de dollars), de la Corée (4,9 millions de dollars), du Vietnam (4,5 millions de dollars) et de la Malaisie (2,2 millions de dollars). En outre, 4,1 millions de dollars ont été engagés dans le cadre de programmes multinationaux axés sur le développement d'outils statistiques dans les domaines économique, bancaire et social, la mise en place de centres d'analyse des conséquences sociales de la crise et des politiques gouvernementales et l'amélioration du suivi de l'action sociale. Selon la Banque Mondiale, il est incontestable que son implication dans la gestion du fonds constitue un précieux atout, du fait de l'étendue de son implantation régionale et de son expérience dans l'assistance au développement. Enfin, le troisième « pilier » de l'ASEM est, pour l'essentiel, porté par la fondation Europe-asie, évoquée ci-avant. Selon la description qui en a été faite par son directeur, M. Tommy Koh, ancien ambassadeur d'Indonésie, « la philosophie de l'ASEF consiste à être pro-active et non réactive ; à créer une valeur ajoutée et éviter les duplications ; à être audacieuse et visionnaire ; à travailler en partenariat avec d'autres organisations compétentes et réputées ; à construire des réseaux avec tous les éléments de la société, y compris le secteur privé et les organisations non gouvernementales ; à maîtriser ses coûts et à éviter les idées et les schémas grandioses ; enfin à soutenir le « processus ASEM » et les pays membres de l'ASEM en mettant l'accent sur la qualité de nos actions et leur rigueur intellectuelle » (236). L'ASEF a réalisé une cinquantaine de projets impliquant près de 3.000 personnes, organisés dans près de vingt pays différents. l'ASEF se veut un intermédiaire entre l'Asie et l'Europe, pour expliquer les phénomènes importants qui se produisent dans l'une des deux régions et qui sont mal appréhendés dans l'autre. Par exemple, l'ASEF a organisé des présentations de l'euro à Hong Kong et à Singapour, ou encore une approche des élections indonésiennes de juillet 1999 à l'intention de journalistes asiatiques et européens. L'ASEF se voit également comme un « impresario culturel » (237), qui tente de mettre en relation des artistes asiatiques et européens à travers diverses manifestations. L'ASEF peut-elle devenir un jour un embryon de secrétariat de l'ASEM ? Il semble que telle ait été sa tentation, il y a quelque temps. Votre Rapporteur ne pense pas que sa situation actuelle et sa vocation essentiellement culturelle et sociale lui permette de prétendre à ce rôle. La Commission a d'ailleurs récemment fait savoir qu'elle ne jugeait pas nécessaire d'institutionnaliser l'ASEM plus avant et que la perspective d'instaurer un secrétariat permanent ne constituait pas une priorité. Le caractère informel de l'ASEM lui semble justifier le statu quo, qui, au demeurant, permet à la Commission de continuer à jouer un rôle essentiel au titre de coordonateur permanent pour la partie européenne. · Au-delà du « débat institutionnel », quel avenir, alors, pour l'ASEM ? La question est posée dans la perspective du prochain sommet de l'ASEM, qui se tiendra à Séoul en octobre 2000, et au cours duquel le Cadre de coopération euro-asiatique devrait être révisé. En avril 1998, les dirigeants asiatiques et européens réunis à Londres avaient décidé la constitution d'un « groupe de vision », dont l'idée avait été avancée pour la première fois en mars 1996 par M. Kim Young-sam, alors président de la Corée du sud. Formé autour de personnalités aussi éclectiques que M. Rainer Masera, ancien ministre du budget et de la planification du gouvernement italien, M. Percy Barnevik, président du conseil d'administration d'ABB, M. Il Sakong, ancien ministre des finances de Corée du sud, ou M. François-Xavier Ortoli, ancien président de la Commission européenne, le groupe de vision a remis son rapport « pour un avenir meilleur » (238) aux ministres des affaires étrangères réunis en mars 1999 à Berlin. Ce rapport est actuellement étudié dans l'ensemble des pays membres pour être, éventuellement, amendé puis présenté aux chefs d'État et de gouvernements lors du sommet de Séoul. Dès son préambule, le rapport insiste sur la nécessité d'approfondir le processus ASEM et les relations entre l'Asie et l'Europe, en se fondant sur une vision à long terme de ces relations. « Ce devrait être la vision qui dirige le processus et non l'inverse ». Votre Rapporteur adhère pleinement à la perspective qui est tracée dans le rapport : au-delà de quelques éléments rhétoriques sur l'intégration des deux régions au sein d'une « zone de paix et de développement partagé, une sphère de vie commune dans la prospérité », le groupe de vision met en avant, en tout premier lieu, la nécessité d'intensifier la connaissance réciproque des héritages culturels, des idéaux démocratiques, du capital éducatif, des aspirations intellectuelles, etc. L'ouverture progressive des marchés, visant l'établissement d'une zone de libre échange à l'horizon 2025, ne vient qu'en dernier lieu, comme un résultat... ou comme un résidu. Pour autant, le corps du rapport consacre ses développements les plus importants aux actions à caractère économique ; mais ceci paraît naturel, puisqu'il est plus facile d'identifier, dans ce domaine, les obstacles à franchir et les politiques à mettre en _uvre. Mais le groupe de vision aborde également le thème de la protection de l'environnement, dont on sait qu'il est sensible en Asie - et qu'il devrait peut-être le devenir un peu plus en Europe. Les questions relatives à l'éducation forment une part importante de la réflexion du groupe de vision : il appelle à l'adoption d'une Déclaration sur l'éducation au sommet de Séoul et propose de tripler en vingt-cinq ans les échanges d'étudiants entre l'Europe et l'Asie, une fois opéré un rééquilibrage des effectifs entre les deux zones. Enfin, le groupe de vision estime que le dialogue politique doit passer par la réaffirmation des principes de bonne gouvernance dans les relations internationales. Il souhaite que l'ASEM se positionne comme un moteur du dialogue entre l'Europe et l'Asie en matière de sécurité, alors que, jusqu'ici, les dirigeants de l'ASEM ont toujours affirmé leur volonté de traiter dans les structures existantes les questions de sécurité - notamment au sein du Forum régional de l'ASEAN. * * * Votre Rapporteur se réjouit de voir ainsi apparaître une vision commune entre les sensibilités asiatiques et européennes, portées par les différents membres du groupe de vision. Il s'agit là, peut-être, d'un résultat plus important encore que le contenu précis des propositions de cette instance. De même, il est permis de penser que le processus engagé par l'ASEM et incarné dans ce forum dépasse largement, par son existence même, les questions que l'on peut se poser sur son efficacité ou son devenir. L'ASEM est utile avant tout parce qu'il existe, parce que les États-Unis n'en font pas partie et parce qu'il est donc aujourd'hui le meilleur prétendant pour former le « troisième côté » du triangle de l'ordre politique et économique mondial. L'ASEM n'est pourtant pas une réalité « par défaut », un négatif sans projet de la présence américaine dans le monde. Aux deux extrémités de ce nouveau côté du triangle, on trouve deux régions qui veulent se respecter pour se parler, se parler pour se comprendre et se comprendre pour proposer des solutions aux grands problèmes du monde. Aux yeux de votre Rapporteur, ce qui unit réellement l'Asie et l'Europe n'est pas la recherche inutile et impossible d'un modèle commun, mais la critique commune du modèle dominant. C'est là la véritable voie du dialogue Europe-Asie. Celui-ci trouvera donc naturellement à s'exprimer sur l'amélioration du système financier international et sur la recherche des moyens propres à calmer la ronde folle des capitaux en liberté. III.- LE SYSTÈME FINANCIER INTERNATIONAL, La crise asiatique de 1997 et ses répercussions sur les marchés financiers des pays industrialisés à l'automne 1998 ont ranimé des débats anciens sur l'organisation des relations financières internationales et sur la nécessité ou l'inutilité d'en modifier les fondements. Bien entendu, cette organisation et ces fondements n'ont jamais été tenus pour définitivement acquis dans leur forme actuelle et ils occupent depuis longtemps une place importante dans les analyses à caractère académique. Cependant, les crises sont particulièrement propices aux remises en question et les grandes « ruptures » dans l'histoire monétaire mondiale - notamment l'instauration du flottement des monnaies en 1973, la démonétisation de l'or en 1976 ou la crise de la dette latino-américaine en 1982 - ont vu fleurir les propositions, voire des projets bien structurés, visant à réformer en profondeur le système financier international. Malgré tout, la crise de la dette latino-américaine avait été considérée comme une conséquence du comportement imprudent des banques internationales - et principalement des banques américaines - plus que comme une manifestation de défaillances dans le fonctionnement du système financier international. La deuxième moitié des années 1990 a vu un changement qualitatif dans ce processus quasi continu de « contestation douce ». Les chocs occasionnés à certains pays, certaines zones géographiques et même aux marchés financiers dans leur ensemble sont apparus suffisamment graves pour qu'une dynamique de la décision - et non plus seulement de la réflexion - soit engagée progressivement. Depuis le sommet de Halifax (Canada) en juin 1995, les chefs d'État et de gouvernement des pays du G7 ont inscrit à leur ordre du jour un renforcement de l'ordre financier mondial, dont les événements de 1997 et 1998 ont dramatiquement souligné l'opportunité et l'urgence. Renvoyant à leurs ministres des finances, en liaison avec les institutions financières internationales, le soin d'éclairer les problématiques les plus pressantes et les solutions envisageables, puis de décliner le détail des décisions prises lors de leurs sommets annuels, les chefs d'État et de gouvernement ont régulièrement évoqué les progrès du processus ainsi engagé, à Lyon (1996), puis Denver (1997), Birmingham (1998), Cologne (1999) et Okinawa (2000). Ainsi, contrairement à ce qu'une lecture superficielle de l'actualité pouvait laisser croire, la crise asiatique n'apparaît pas comme le déclencheur des velléités actuelles de réforme, mais s'inscrit dans un mouvement qui lui est antérieur. Pourtant, plus de cinq années après l'impulsion initiale donnée à Halifax, on peut légitimement s'étonner des avancées limitées qui ont été effectivement enregistrées jusqu'ici. Il n'est pas question pour votre Rapporteur de nier la difficulté des questions qui sont abordées par les instances chargées de définir les contours de la réforme et d'en préciser le contenu. Mais force est de constater que - pour le moins - celle-ci n'a pas débouché sur des bouleversements. Au reste, l'aboutissement du processus devait-il consister en des bouleversements ? On aurait pu le croire, justement, lorsqu'en décembre 1997 M. Robert Rubin, alors secrétaire américain au Trésor, s'était référé au concept nouveau d'« architecture financière internationale » pour faire de celui-ci l'objet de la réforme. L'expression a fait florès depuis. Elle s'apparente aujourd'hui à un rideau de fumée qui masque mal la maigreur des résultats obtenus, du moins lorsqu'on rapporte ceux-ci aux promesses qu'offrait le concept d'« architecture ». Peut-être faut-il voir dans ce dernier la répercussion incongrue dans le débat international de la controverse purement américaine opposant à l'époque le Congrès et l'Administration sur l'opportunité d'augmenter les ressources du Fonds monétaire international à l'occasion des Nouveaux accords d'emprunt puis de la onzième révision générale des quotes-parts : un bon compromis pouvait-il être de s'engager à _uvrer à une nouvelle « architecture » pour vaincre les réticences du Congrès ? Quoiqu'il en soit, la réforme se donne pour objectif d'améliorer la stabilité financière internationale. Elle a connu des développements particulièrement importants dans le domaine crucial du fonctionnement des marchés, mais a, jusqu'ici, peu modifié les fondements mêmes de l'ordre monétaire et financier mondial. Cette timidité - ou cette impuissance - appelle à redéfinir le mode de gouvernement de la mondialisation. A.- UNE RÉFORME DU SYSTÈME FINANCIER INTERNATIONAL : « Depuis le début des années quatre-vingt, nous vivons dans un monde de crises et nous nous y sommes habitués » déclarait à votre Rapporteur M. Jean-Claude Trichet, gouverneur de la Banque de France. Il est vrai que la fréquence des crises a clairement augmenté par rapport aux années 1970, comme l'indiquent divers recensements. De surcroît, pour les pays les plus souvent touchés, les crises se sont succédé à une fréquence supérieure à la moyenne « historique » d'une par décennie, suggérée dans les travaux de Kindleberger (239) et d'autres auteurs. INCIDENCE DES CRISES FINANCIÈRES DE 1970 À 1997 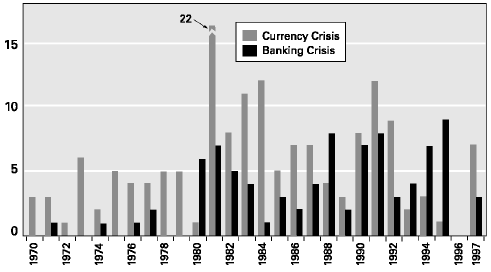 Source : Banque mondiale, Global Economic Prospects and the Developing Countries 1998/1999 : Beyond Financial Crisis, décembre 1998 Les crises récentes tendent également à être beaucoup plus sévères qu'auparavant. Dans les pays directement concernés, les pertes de production sont plus importantes que celles observées dans les pays du G7 lorsqu'ils connaissent une récession. Au Mexique, en 1995, comme en Thaïlande, en Malaisie et en Corée, en 1998, la chute du PNB s'est établie entre 6% et 8%. Ces reculs étaient plus importants que ceux subis par l'Argentine, le Brésil ou le Mexique dans les années 1980. L'effondrement économique de l'Indonésie en 1998 est unique en Asie mais reste comparable à celui subi par le Chili en 1982. Enfin, parce que les pays asiatiques mentionnés ci-avant connaissaient, les années précédentes, une croissance comprise entre 6% et 10% par an, le coût de la crise exprimé en termes de déviation par rapport au sentier moyen de croissance apparaît encore supérieur. Il faut remarquer également que, bien que le « trou d'air » de l'hiver 1998-1999 fût le moins ample des quatre ralentissements de la croissance mondiale observés dans les trois dernières décennies, il s'agit du seul incident de croissance qui ne soit pas dû à une initiative de politique économique d'un pays membre du G7, à l'exception des chocs pétroliers de 1973 et 1979 (240). Plus fréquentes et plus graves, les crises seraient également moins prévisibles. Assurément, la notion même de « crise », qui renvoie à celle de rupture, donc de soudaineté, est peu compatible avec la mise en _uvre d'un processus prédictif fiable. Pourtant, une crise est en général annoncée par l'accumulation de faiblesses économiques qui rendent le pays concerné vulnérable aux chocs. Les années récentes n'ont pas invalidé cette « règle » relevant au premier chef du bon sens, mais ont compliqué les conditions dans lesquelles elle peut être mise en regard de la réalité. Certes, la crise russe de l'été 1998 répondait aux critères « classiques » de la crise financière : déséquilibre budgétaire hors de contrôle, endettement public élevé, inflation non maîtrisée, comptes extérieurs très déséquilibrés. En revanche, ce sont bien les acteurs du « miracle asiatique » célébré par la Banque mondiale, qui ont été frappés en 1997, malgré leur croissance trentenaire conduite dans un contexte macroéconomique jugé équilibré ou soutenable. De même, le Mexique était considéré comme un « bon élève » de l'Amérique latine, ce qui n'a pas empêché l'effondrement du peso en décembre 1994 (241). Comme votre Rapporteur l'a indiqué dans un chapitre précédent du présent rapport, on sait bien découvrir après coup les racines des crises. Il n'empêche que celles-ci semblent échapper plus souvent qu'auparavant aux schémas préétablis. C'est ainsi que la recherche d'indicateurs permettant de discerner l'apparition des crises donne lieu à des opinions contrastées. Certains, comme M. Marcus Noland, économiste à l'Institute for International Economics - « réservoir de cerveaux » ayant pignon sur rue dans les milieux économiques et politiques américains - estiment que « l'on peut construire des précurseurs de crise assez robustes » (242). D'autres, comme M. Morris Goldstein, affirment que les indicateurs avancés des crises ne sont pas opératoires : même s'ils permettent de déceler assez tôt l'apparition de vulnérabilités, ils échouent à « détecter » ex post toutes les crises et ils annoncent des crises qui ne surviennent jamais... (243) Toutes ces observations sont-elles cependant suffisantes pour estimer que le système financier international a une part importante de responsabilité dans les crises récentes ? La réponse à cette question recouvre naturellement le clivage sur les interprétations de la crise asiatique qui a été exposé dans le premier chapitre du présent rapport. Certains observateurs estiment que les crises financières, pour pénibles que puissent être leurs conséquences pour les populations concernées, ne sont que le révélateur des erreurs de politique économique et de désajustements fondamentaux. Passées au crible de la discipline intransigeante des marchés financiers internationaux, les économies verraient leurs forces et faiblesses analysées, disséquées et, le cas échéant, sanctionnées. Par ailleurs, le système financier international n'aurait pas subi de rupture et aurait résisté sans dommages aux turbulences les plus fortes, même pendant l'automne 1998. Au contraire, le prompt rétablissement des marchés et la reprise rapide des relations financières entre les pays en crise et les sources étrangères de financement (244) suggéreraient que la souplesse des mécanismes régulateurs actuels confère une grande robustesse au système global. La Banque des règlements internationaux n'a-t-elle pas reconnu, par exemple, que le bon fonctionnement du marché interbancaire avait permis d'amortir les tensions extrêmes de liquidité observées à l'automne 1998 ? (245) Enfin, n'est-il pas paradoxal de dénoncer le retrait des capitaux bancaires hors de la zone asiatique, pendant les dix trimestres consécutifs qui séparent juin 1997 de décembre 1999, alors même que la crise est en partie attribuée à des entrées excessives de capitaux à court terme, pour l'essentiel d'origine bancaire ? Ces arguments ne sont pas dénués de tout fondement. Ils restent cependant impuissants à éclairer tous les aspects de la crise asiatique et de ses prolongements, dans leurs origines comme dans leur déroulement. Trois défauts peuvent être imputés au système financier international, qui ont concouru à créer les conditions des crises récentes et à en aggraver les manifestations. · Le système financier international n'a pas empêché les emprunteurs et les prêteurs de prendre des risques excessifs. Pour les emprunteurs, tout d'abord, il est clair aujourd'hui que la fixité du taux de change de la monnaie nationale a donné la fausse impression que le risque de change n'existait plus : cette impression était fausse car conditionnée par la capacité effective des autorités à maintenir à long terme la valeur externe de la monnaie nationale au taux officiel affiché. Sur le comportement des prêteurs, il reste difficile d'expliquer le maintien de flux financiers entrants importants jusqu'au déclenchement de la crise, voire après son déclenchement. Il faut également relever la faible pertinence des spreads - écarts de taux entre les dettes dans les pays émergents et les dettes similaires dans les principaux pays développés - comme signe annonciateur des crises, qui suggère que le marché ne donnait pas un prix correct au risque encouru sur les marchés émergents. · Le système financier international semble devenir le théâtre d'une déconnexion croissante entre la dynamique des marchés et l'évolution des fondamentaux économiques. En premier lieu, la volatilité à court terme du prix des actifs est plus grande que par le passé. Ceci est particulièrement vrai pendant les épisodes récents de crise, qui sont naturellement des périodes où l'on observe une forte augmentation de la volatilité. De tels événements ont pu être observés lors du krach boursier de 1987, lors de l'effondrement obligataire de 1958 ou de 1994, à l'occasion des fluctuations de la parité yen-dollar au milieu de l'année 1995 ou à l'automne 1998 (246). Un exemple extrême est la variation de près de 7% de la parité yen-dollar entre le 7 et le 8 octobre 1998, du fait du dénouement simultané de nombreuses positions spéculatives. En deuxième lieu, les marchés financiers sont exposés à des phénomènes de sur-réaction, qui peuvent conduire à des décalages entre valeur de marché et fondamentaux sur moyenne période. Dans le sens de la hausse, votre Rapporteur tient à noter que l'on ne dispose toujours pas d'une explication réellement convaincante des niveaux de valorisation atteints par les bourses américaines. Dans le sens de la baisse, il est surprenant de constater que des monnaies asiatiques dont la surévaluation en termes effectifs réels était au maximum égale à 10% avant juillet 1997 (247) ont été propulsées, quelques mois plus tard, à des niveaux représentant seulement la moitié de leur valeur initiale. En dernier lieu, les marchés semblent affectés par des phénomènes de contagion, qui connectent des segments ou des pays normalement isolés les uns des autres. Votre Rapporteur a déjà évoqué les répercussions, sur les marchés d'Amérique latine, du dénouement de positions construites par les banques coréennes dont la qualité de crédit était révisée par leurs créanciers (248). · Le système financier international a été exposé à un risque grave de rupture lors de la crise de l'automne 1998. Nonobstant les vertus des financements interbancaires évoqués ci-avant, un effondrement n'a vraisemblablement été évité que grâce aux interventions officielles qui ont pris deux formes. Tout d'abord, les autorités américaines ont organisé le sauvetage par ses créanciers du fonds Long Term Capital Management, afin d'éviter que le dénouement de ses positions spéculatives - qui aurait été la conséquence normale d'une mise en faillite - ne déstabilise les marchés. Ensuite, la Réserve fédérale a assoupli les conditions de liquidité aux États-Unis en procédant à trois diminutions de ses taux directeurs, à des dates rapprochées et, pour l'une d'elles, inhabituelle. En définitive, sans prétendre négliger les causes purement nationales des crises récentes, il y a eu sans ambiguïté apparition de crises par le système financier international, ce qui signifie ipso facto une crise du système financier international. Il y a à peine plus d'un an, la Banque des règlements internationaux estimait ainsi que « le système financier mondial, depuis les événements de l'automne [1998], apparaît être l'élément le plus vulnérable de nos économies de marché » (249). 2.- La stabilité financière dans une économie mondialisée : Le renforcement du système financier international constitue donc une priorité légitime pour les autorités politiques. Il doit se traduire par la recherche d'une plus grande stabilité, étant entendu que les deux dimensions de celle-ci - la stabilité du système et la stabilité par le système - sont étroitement interdépendantes. Pour autant, la notion de stabilité ne se laisse pas aisément définir. Intervenant au cours d'un séminaire organisé en août 1997 par la Banque fédérale de réserve de Kansas City, M. Andrew Crockett, directeur général de la Banque des règlements internationaux, indiquait qu'« il n'y a pas de consensus général relatif à la définition de la stabilité financière. Pour l'heure, en fait, chaque auteur donne sa propre définition » (250). Relevant que la stabilité financière concerne autant les institutions que les marchés, M. Crockett proposait d'organiser la réflexion autour des deux paradigmes suivants : - les institutions financières sont stables dans la mesure où les institutions clefs du système sont considérées, avec un fort degré de confiance, comme capables de satisfaire à leurs obligations contractuelles sans interruption ni assistance extérieure ; - les marchés financiers sont stables dans la mesure où les intervenants peuvent procéder en confiance à des transactions, à des prix qui reflètent les fondamentaux et qui ne varient pas de façon substantielle sur de courtes périodes lorsque ces fondamentaux n'ont pas variés eux-mêmes. La stabilité financière est un bien public puisqu'aucun de ses usagers - les utilisateurs de services financiers - ne prive les autres de la possibilité d'en bénéficier aussi. Les autorités publiques ont donc un intérêt à la préserver. Pour autant, les éventuelles interventions des autorités ne peuvent viser à rigidifier le système financier, confondant alors stabilité et absence de fluctuations. Au contraire, les prix de marché doivent fluctuer pour refléter au mieux les évolutions des fondamentaux. Il n'y a d'instabilité et de crise que lorsque les variations de prix provoquent des dommages économiques évidents, comme l'impossibilité de procéder aux transactions, l'impossibilité pour le marché de déterminer un prix, la désincitation à s'engager sur des horizons de moyen ou long terme, la perturbation des décisions d'épargne ou d'investissement. De même, les chocs reçus ou causés par les institutions financières ne relèvent de l'instabilité que s'ils causent des pertes de bien être au-delà d'un cercle limité de clients ou de contreparties : « les faillites occasionnelles de petites institutions ou les pertes substantielles éventuellement subies par les grandes institutions font partie intégrante du fonctionnement normal des systèmes financiers. En fait, elles exercent une fonction positive en rappelant aux intervenants de marché subsistants l'obligation d'exercer de façon disciplinée leurs activités avec les intermédiaires avec qui ils sont en relation » (251). La mondialisation financière de ces deux dernières décennies est-elle favorable ou nuisible à la stabilité ? Dans une première approche, on peut estimer que la mondialisation a favorisé la diversification des risques De fait, il n'est pas évident que certains des mécanismes mis en _uvre au cours du processus de globalisation soient intrinsèquement porteurs de plus de stabilité. Au plan géographique, la multiplication des investissements de portefeuille transfrontières a mis les marchés émergents de titres (essentiellement les marchés d'actions) au contact direct des marchés de titres des pays industrialisés. Or, remarquait récemment M. Stephen Roach, économiste en chef et directeur de la recherche économique de Morgan Stanley Dean Witter, « la capitalisation boursière combinée des États-Unis, de l'Europe et du Japon est actuellement d'environ 30 000 milliards de dollars. Par contraste, la capitalisation boursière totale des principaux marchés d'actions du monde en développement est inférieure à 1500 milliards de dollars. [...] Une modification de 1% dans l'allocation des seuls actifs américains porterait sur une valeur de 150 milliards de dollars, ce qui submergerait n'importe lequel des marchés d'actions émergents, conduisant à la constitution de ces « bulles » d'actifs qui n'ont été que trop évidentes dans les marchés émergents ces dernières années » (253). Parallèlement, les financements privés à destination des pays émergents ont fortement augmenté depuis les années 1970 et leur composition s'est modifiée. Marquée par la prépondérance des prêts bancaires dans la période 1973-1981 (63,9% des financements privés totaux), elle a fait une part croissante aux investissements directs (50,3% du total), aux investissements de portefeuille (16,4%) et aux émissions d'obligations internationales (15,2%) sur la période 1990-1997 (254). Cette évolution expose les flux de capitaux entre pays développés et pays émergents, ainsi que leurs marchés de changes, à une volatilité croissante inhérente à l'« intermédiation de marché », nonobstant le caractère stable des capitaux formant investissements directs. Sans prétendre épuiser la matière, votre Rapporteur souhaite suggérer d'autres pistes qui peuvent expliquer pourquoi la mondialisation financière n'est pas nécessairement synonyme de stabilité accrue : - dans le prolongement du développement précédent, la mondialisation financière s'est accompagnée de l'apparition de gestionnaires connus sous l'appellation anglo-saxonne de « crossover investors ». Il s'agit d'investisseurs dont le théâtre principal d'opérations est un marché déterminé mais dont le mandat de gestion autorise l'acquisition d'autres actifs, sous réserve de limitations déterminées (255). Peuvent ainsi être amenés à intervenir sur les marchés émergents les fonds à haut rendement, les fonds globaux de titres à revenus fixes, les fonds de pension, les compagnies d'assurances (0), etc. N'ayant pas de règles strictes relatives à l'allocation de leurs actifs hors de leur marché principal, ces investisseurs sont amenés à modifier leur exposition aux marchés émergents plus fréquemment que les investisseurs spécialisés dans ces marchés (1) ; - de même, la mondialisation met en contact des systèmes financiers développés et sophistiqués avec des systèmes financiers plus frustres et moins robustes. Dans le premier chapitre du présent rapport, votre Rapporteur a déjà présenté les effets désastreux du « crédit dirigé » sur la capacité des établissements bancaires des pays émergents à mettre en place des mécanismes efficaces d'évaluation et de gestion du risque. La finance globale a ses exigences et tous les établissements financiers ne sont pas égaux devant la crise. Que surviennent des phénomènes d'aveuglement réciproque, d'euphorie partagée et d'insensibilité au risque, la fragilité de l'ensemble du système mondial s'accroît en proportion du différentiel de développement entre pays industriels et pays émergents ; - la mondialisation s'entend non seulement dans une acception géographique, mais aussi au regard de la libéralisation des activités financières, qui a conduit à réduire la distinction entre institutions bancaires et institutions non bancaires. L'aggravation de la concurrence - qui peut être appréciée à la fois par le resserrement des marges d'intermédiation et par l'engagement plus récent du secteur dans une vague de restructurations sans précédent - augmente l'appétence des gestionnaires pour le risque et accroît en conséquence la vulnérabilité des établissements et la probabilité d'ajustements brutaux en cas de retournement des anticipations ; - le raccourcissement de l'horizon temporel des gestionnaires, qui sont souvent jugés sur leurs performances trimestrielles, et l'appréciation de leurs performances sur des bases relatives, par rapport au reste de la profession, et non absolues, pousse à l'adoption de comportements mimétiques qui sont potentiellement déstabilisateurs. Par ailleurs, la finance globalisée serait également sujette à d'autres phénomènes, impliquant les mécanismes mêmes du marché plus que le comportement des opérateurs, qui faciliteraient l'apparition de crises autoréalisatrices. La mondialisation financière a eu pour conséquence le développement de l'endettement international des agents privés - dont les crises, rappelle M. Michel Aglietta, conseiller scientifique au CEPII (2), « jalonnent la totalité de l'époque de l'étalon or pendant les quarante ans qui ont précédé la première guerre mondiale » (3). La fragilité financière devient alors un « fondamental » pris en compte par les agents économiques dans leurs décisions de placement et dans leur appréciation de la « bonne valeur » du taux de change, même si elle ne peut se repérer et a fortiori se mesurer à l'aide de variables micro- ou macroéconomiques déterminées et incontestables. La fragilité financière est au c_ur de l'apparition et de la propagation de la crise. Parce qu'il n'existe pas d'indicateur objectif sur lequel les anticipations des acteurs puissent se fixer, elle crée un univers d'équilibres multiples, la crise ne représentant rien d'autre qu'une transition brutale entre deux de ces équilibres. Par ailleurs, la fragilité financière constitue l'élément permettant d'établir le processus auto-entrenu caractéristique de la crise : - du fait des techniques modernes d'analyse et de gestion du risque, une augmentation de celui-ci mesurée par les outils internes de contrôle provoque des ventes de protection, les opérateurs pratiquant des stratégies de couverture en temps réel ; - la dépréciation du prix des actifs provoque une augmentation de la fragilité financière. Par exemple, les bilans des établissements bancaires sont dégradés ; les pertes potentielles sur des positions d'actifs ou de change constituées par le biais de produits dérivés augmentent le risque de défaut de leur détenteur - celui-ci étant de plus accru par l'effet de levier ; la charge d'une dette en devises est accrue, etc. Par ailleurs, des risques jusqu'alors masqués peuvent apparaître plus clairement. C'est ainsi que, si l'on considère le cas d'une entreprise endettée en devises, la répartition des risques semble claire avant la crise : le prêteur étranger, qui prête dans sa propre monnaie, ne supporte qu'un « risque de crédit » (4) ; l'emprunteur supporte un risque de change. Lorsque la crise se déclenche, la chute de la monnaie accroît la probabilité de défaut de l'emprunteur : le risque de crédit supporté par le prêteur augmente également et s'avère alors intégrer une composante croissante due au risque de change. En définitive, « selon les anticipations que les opérateurs font de l'incidence de la fragilité financière sur les mouvements des prix de marché et au premier chef sur le change, ils provoquent une spéculation qui valide leur perception de cette fragilité » (5). Il convient également de noter que l'évolution des méthodes de gestion du risque, notamment la valorisation des avoirs et engagements au prix du marché conjuguée à l'application du plus en plus générale de la méthode dite « VAR » (6), renforce les corrélations entre marchés et favorise l'apparition de phénomènes de contagion. La méthode VAR se prévaut en effet d'une mesure agrégée du risque, nécessitée par le principe de diversification des portefeuilles, sur la base de corrélations « historiques » observées entre les rendements et les prix des différents actifs sur les différents marchés. Un choc ou une crise sur un marché se traduit alors, du fait de ces corrélations, par une augmentation du risque mesuré par la méthode VAR sur les autres marchés ; cette augmentation du risque déclenche un processus de désengagement similaire à celui observé sur le marché initial, alors que rien ne justifie ce processus au vu des fondamentaux. Si les marchés sur lesquels la contagion se produit ne sont pas suffisamment « profonds » pour l'absorber, le désengagement peut à son tour déclencher une crise. On peut alors conclure, comme MM. Aglietta et de Boissieu, qu'« on prend à tort pour des contagions psychologiques en forme de paniques ce qui est imputable à des connexions systémiques provoquées par les ajustements au risque des participants des marchés financiers. Cette remarque est plutôt inquiétante parce qu'elle suggère que les crises en finance globalisée sont d'autant plus fréquentes qu'elles ne sont pas les conséquences de comportements aberrants, et donc rares, des opérateurs ». * * * Les développements précédents peuvent laisser songeur : les marchés seraient-ils donc à ce point devenus fous que les crises semblent être leur lot commun et leur destin programmé plutôt que des épisodes exceptionnels ? Ce serait oublier que les mécanismes et les comportements évoqués ci-avant reposent, avant tout, sur l'apparition de fondamentaux dégradés et que les phénomènes cumulatifs et brutaux caractéristiques des crises supposent que les anticipations des acteurs de marché s'orientent toutes dans la même direction au même moment. En termes de cybernétique, les « boucles de rétroaction » au sein des marchés sont en général négatives, donc stabilisantes, et ne deviennent positives, donc déstabilisantes, que dans des circonstances particulières que l'observation pratique et l'analyse théorique s'efforcent de mieux cerner. En fait, on peut affirmer sans crainte de paradoxe que les marchés restent l'instrument régulateur le plus puissant lorsqu'ils fonctionnent normalement, tout en étant sujets à des crises dont l'évolution récente de la finance globale accroît la complexité. Ainsi, le champ d'intervention de la puissance publique est tout tracé : renforcer la stabilité financière nécessite, tout d'abord, d'améliorer le fonctionnement normal des marchés, ensuite d'améliorer la capacité des acteurs de marché à supporter les déviations qui éloignent ceux-ci d'un fonctionnement normal, enfin de trouver les moyens de limiter l'extension et les répercussions des crises, à l'existence desquelles on doit bien se résoudre. La difficulté de la tâche apparaît dans toute son ampleur. Faisant la preuve que les institutions internationales sont capables de manier tout à la fois l'humour et le sérieux, la Banque des règlements internationaux écrivait ainsi récemment : « les mesures visant à prévenir les crises financières prennent de plus en plus en compte les interactions, aux effets insidieux, entre insuffisances microéconomiques et phénomènes macroéconomiques. Ces problèmes peuvent se manifester de trois façons : extrême volatilité à court terme des prix sur certains marchés, distorsions des prix à moyen terme, engendrant parfois des bulles spéculatives et des flux de capitaux excessifs, et contagion entre marchés et entre pays sans rapport avec les données fondamentales. La prévention doit alors se concentrer sur chacun des trois piliers qui soutiennent les systèmes financiers nationaux et internationaux : solidité des institutions financières, bon fonctionnement des marchés et fiabilité des infrastructures, telles que procédures juridiques et judiciaires, systèmes de paiement et de règlement ainsi que normes comptables. Pour chacun de ces trois piliers, trois autres éléments, de nature incitative cette fois, peuvent contribuer à favoriser des comportements prudents. Au départ figure obligatoirement la gouvernance interne, fondée essentiellement sur l'intérêt de l'établissement et la préservation du capital privé. A cela s'ajoutent un contrôle et une surveillance adéquats. Enfin, malgré les limites qu'elle comporte parfois, la discipline de marché doit avoir un rôle de plus en plus marquant à jouer dans un monde davantage soumis à la loi du marché. « Avec trois problèmes, trois piliers et trois thérapies correspondantes, rien d'étonnant qu'il reste tant à faire » (7). Pourtant, les efforts de la communauté internationale commencent à porter leurs fruits, les principales avancées ayant été enregistrées dans le domaine du fonctionnement des marchés. B.- DES PROGRÈS SENSIBLES SUR LES MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT DES MARCHÉS De nombreux forums ont été amenés à réfléchir aux évolutions du système financier international qu'il convenait d'engager à la lumière de la crise mexicaine, puis asiatique, puis russe. L'amélioration du fonctionnement des marchés a rapidement été désignée comme un domaine prioritaire et l'inscription de cette démarche dans les préoccupations naturelles, voire le mandat, d'organisations déjà existantes explique peut-être que des solutions aient été formalisées assez rapidement et que certaines soient déjà entrées en application. 1.- Le renforcement de la discipline de marché Sous l'appellation de « renforcement de la discipline de marché », il est loisible de placer beaucoup de choses : le resserrement des exigences de capitalisation des établissements financiers, par exemple, augmente le montant du capital risqué par les actionnaires, donc, normalement, l'incitation des dirigeants à adopter des comportements prudents. La perspective de devoir participer à un programme de réduction de dette, c'est-à-dire de supporter une part des pertes potentiellement subies dans les pays émergents peut également agir comme un adjuvant puissant aux signaux adressés par le marché sur l'articulation du risque et du rendement pour les investissements effectués dans ces pays. Ces considérations sont exactes mais votre Rapporteur se concentrera pour l'essentiel sur deux questions : l'information des acteurs de marché et la réduction nécessaire des racines de l'aléa moral. a) Transparence et information contribuent à la discipline de marché Nul doute que l'information soit une « matière première » indispensable à la réalisation d'un échange sur la base de la détermination d'un prix de transaction. Plus le marché sera nourri d'informations, plus tôt les opérateurs pourront prendre conscience des risques ou des opportunités qui apparaissent à chaque instant dans la situation générale du marché ou chez les agents susceptibles de devenir des contreparties dans une transaction financière. De même, lorsque l'information est diffusée largement, un nombre plus grand d'opérateurs peuvent l'intégrer à leurs anticipations, ce qui contribue à « lisser » les conditions dans lesquelles se forme le sentiment général du marché, qui n'est que la résultante des appréciations individuelles des opérateurs. La théorie économique s'est emparée de ces quelques vérités, pour expliquer qu'une des raisons essentielles d'un mauvais fonctionnement des marchés est l'« asymétrie de l'information », situation dans laquelle l'une des parties à un contrat financier a une information de meilleure qualité que l'autre partie, ce qui conduit à des transactions peu efficaces. Par exemple, un emprunteur est censé mieux connaître que le bailleur de fonds les rendements espérés et les risques associés aux investissements qu'il se propose de financer par emprunt. Confronté à deux projets d'investissement, un bailleur de fonds fera donc un choix non optimal, sur la base d'une information incomplète. Concrètement, il est évident que les emprunteurs doivent fournir une information complète et fiable sur leur situation économique et financière afin que les prêteurs puissent évaluer correctement les risques, identifier les difficultés, ajuster leur exposition à ces débiteurs et éviter de dégrader leur propre bilan. De même, les superviseurs bancaires doivent exiger la diffusion rapide d'informations financières de la part des établissements soumis à leur contrôle. L'exigence d'informations a pris une consistance spéciale après la révélation, à la fin du mois d'août 1997, de l'« horreur absolue » (8) suscitée par la révélation de l'état des réserves de change de la Banque de Thaïlande à la fin du mois de juillet, et, de la même façon, par la révélation en décembre 1997 du montant effectif des réserves de change de la Corée, inférieur à celui publié officiellement (9). Dans cette perspective, les autorités américaines ont milité pour accroître la transparence des informations relatives aux activités relevant de la sphère publique. Pour autant, la transparence ne peut se limiter à un champ trop étroit et la suite de la crise, notamment les développements consécutifs à la crise russe, ont montré la nécessité d'améliorer également l'information fournie par le secteur privé, position soutenue dès l'origine par les autorités françaises. Enfin, les institutions internationales, notamment le FMI, ont aussi été priées de participer à cet effort général de transparence. · Pour les autorités publiques, le processus a été engagé à la suite de la crise mexicaine. Le sommet des chefs d'État et de gouvernement du G7, à Halifax (juin 1995), avait mis l'accent sur l'intérêt d'un système d'alerte avancé, sous l'égide du FMI, fondé notamment sur la publication rapide de données économiques et financières essentielles. A cette fin, le comité intérimaire du FMI a demandé à la direction du Fonds, en octobre 1995, de mettre au point des normes destinées à guider les États membres désireux de disséminer plus largement ces informations économiques et financières. Deux catégories de standards ont été établies : la Norme spéciale de diffusion de données (NSDD), orientée vers les besoins des pays disposant ou cherchant à disposer d'un accès au marché international des capitaux ; la Norme générale de diffusion des données (NGDD), valable pour tous les États membres. La NSDD a été instituée en avril 1996 et ouverte à l'adhésion (volontaire) des États membres à la même date ; les États participant au processus sont désormais près de cinquante. La NGDD a été instituée en décembre 1997 ; douze États participent à l'heure actuelle au programme pilote de diffusion de la norme, qui devrait entrer en « phase active » au cours de l'année 2001. Les deux normes portent sur un ensemble de 17 catégories d'informations statistiques, comme les comptes nationaux, les taux d'intérêt, les opérations du gouvernement central, la balance des paiements, etc. En dépit de ces similitudes, les deux normes poursuivent des objectifs différents : la NGDD vise principalement à inciter les pays participants à améliorer la qualité des données qu'ils produisent et diffusent, en mettant en place un processus qui permet de recommander des « bonnes pratiques », de déterminer les insuffisances effectives et de définir des priorités. Les autorités sont amenées à définir des plans d'amélioration à moyen terme, sur la base desquels des actions d'assistance technique pourront être entreprises par les organisations multilatérales. Au contraire, la NSDD vise des données dont la qualité est déjà établie, mais prescrit des standards spécifiques portant sur la précision des données publiées, leur périodicité, l'assurance de leur qualité, etc. La norme fixe aussi des périodes de transition de durée limitée au-delà desquelles les pays participants doivent impérativement respecter les standards posés par la NSDD. Enfin, la norme impose aux États participants de fournir sur Internet, à partir d'une page spéciale, un point d'accès à l'ensemble des données visées par la NSDD. Les normes sont évaluées périodiquement (10) et il a été décidé, en mars 1999, d'enrichir très sensiblement la NSDD dans sa composante relative aux engagements extérieurs et aux positions de change. Il est vrai que les informations relatives à la position extérieure des pays émergents sont particulièrement pertinentes pour éclairer les choix des investisseurs. Dans cette même perspective, la communauté internationale s'est efforcée d'améliorer les informations relatives à l'endettement extérieur de pays sélectionnés en plus grand nombre. Le panorama semestriel publié conjointement par l'OCDE et par la Banque des règlements internationaux a fait place à une publication trimestrielle rassemblant des informations en provenance des deux mêmes institutions ainsi que du FMI et de la Banque mondiale. Le degré de détail des statistiques a été affiné : 14 rubriques sont couvertes dans la dernière publication, datant du mois d'août 2000, tandis qu'un accent particulier est mis sur les dettes et engagements exigibles à moins d'un an (3 rubriques). De la même façon, la Banque des règlements internationaux poursuit les efforts d'exhaustivité, de précision et de rapidité de ses statistiques bancaires consolidées ou détaillées par pays. Mais l'information des marchés doit aussi porter sur la conduite de la politique économique, afin d'alimenter les analyses relatives aux motivations, à la conception et aux résultats des choix y afférant. A cette fin, à la demande de son comité intérimaire, le FMI a mis au point deux codes de bonnes pratiques assortis de documents supports : - un code de bonnes pratiques pour la transparence budgétaire a été adopté par le comité intérimaire en avril 1998. Il définit des objectifs généraux dans quatre domaines : la clarification des rôles et des responsabilités entre secteur public et privé et entre les différents organes du gouvernement ; la mise à disposition publique d'une information précise, détaillée et fiable sur les activités budgétaires (contexte économique, préparation et exécution) ; la mise en _uvre d'un processus ouvert et structuré pour la préparation, l'exécution et le compte-rendu d'exécution du budget (11) ; l'assurance de la sincérité des informations budgétaires (12). Le code est appliqué par les États membres sur une base volontaire ; - un code de bonnes pratiques pour la transparence des politiques monétaires et financières a été adopté par le comité intérimaire en septembre 1999. Élaboré en coopération avec la Banque des règlements internationaux, et après consultation d'un groupe de banques centrales, d'agences financières, d'organisations régionales ou internationales et d'experts académiques, il est articulé autour des mêmes quatre domaines que le code de bonnes pratiques budgétaires et se trouve complété, de la même façon, par un document d'accompagnement qui détaille les principes énoncés dans le code, explique leur sens, expose des exemples d'application réelle, fournit des conseils de mise en _uvre. Les conditions d'application de ces codes sont au moins aussi importantes que leur définition. A cette fin, le FMI a décidé d'intégrer le code de bonnes pratiques budgétaires dans le processus de surveillance des économies des États membres, s'engageant ainsi dans ce qui a pu être appelé une démarche de « transparence sur la transparence ». Selon les informations recueillies par votre Rapporteur, ce processus n'est pas encore décidé pour le code de bonnes pratiques monétaires et financières, ce qui n'est pas étonnant compte tenu de son caractère plus récent. On a pu s'interroger sur les risques d'une transparence absolue vis-à-vis des marchés en matière de réserves de change et d'engagements extérieurs. Ainsi, M. Olivier Davanne indique que « les plus gros demandeurs de cette transparence sont les « hedge funds », ce qui, en principe, devrait inciter à une certaine prudence » (13). Concédant que l'information sur les comptes extérieurs doit être la plus complète possible hors période de crise, M. Davanne suggère que le FMI puisse lever temporairement, à la demande de l'État concerné, l'obligation de publier les réserves de change. Votre Rapporteur s'interroge sur la faisabilité de cette solution, étant entendu que M. Davanne lui-même relève que « cette option devrait être parfaitement connue des marchés, sinon elle créerait une surprise de nature à aggraver l'inquiétude des opérateurs à l'occasion de sa première utilisation ». D'ailleurs, compte tenu de l'inévitable délai qui sépare la publication des réserves et autres engagements extérieurs de la période de référence concernée, il est à craindre que la crise ne soit déjà dénouée ou très largement engagée lorsque le remède supposé prendra effet. · Les remarques de M. Davanne éclairent la nécessaire symétrie des obligations qu'il convient d'imposer au secteur public et au secteur privé. Les actions en faveur d'une meilleure transparence du secteur privé s'organisent essentiellement autour de la mise à niveau des systèmes comptables dans les pays émergents. Les questions relatives à l'emploi des instruments dérivés relèvent aussi de cette rubrique mais seront présentées ci-après dans les développements consacrés plus spécifiquement aux « institutions à fort effet de levier ». La transparence est nécessaire pour que les investisseurs bancaires ou non bancaires puissent forger un jugement sur leurs partenaires locaux sur des bases claires et sinon homogènes, du moins aisément accessibles. A cet égard, l'International Accounting Standards Committee (IASC), organisme international de droit privé rassemblant plus de 150 institutions compétentes en matière de comptabilité, a achevé en avril 2000 la rédaction d'un ensemble de quarante Principes fondamentaux de comptabilité, qui forment un sous-ensemble des Normes internationales de comptabilité édictées et régulièrement actualisées par l'IASC. Mais le rapport sur « la transparence et la responsabilité » établi sous l'égide du G 22 (14) soulignait à juste titre que les mauvaises pratiques comptables ne résultent pas de l'absence de principes ou de normes destinés à guider la compilation et la diffusion de l'information financière. Les difficultés observées découlent principalement du non respect des principes existants par les entreprises et de la carence des autorités à imposer leur application (15). Votre Rapporteur prend note du développement en cours, par la Banque mondiale, d'un outil de diagnostic visant à évaluer, dans un pays donné, l'état des normes comptables et les pratiques effectives. L'achèvement de cet outil permettra à la Banque mondiale d'intégrer les préoccupations de nature comptable dans ses programmes et projets d'assistance. · Enfin, la transparence du FMI lui-même est désormais considérée comme une contribution importante à une large dissémination de l'information. D'une part, le Fonds recueille, pour ses propres besoins, une quantité considérable de données économiques et financières, dont une partie est depuis longtemps déjà rediffusée aux acteurs économiques sous la forme de publications très spécialisées comme les Statistiques financières internationales, de périodicité mensuelle. Mais surtout, le Fonds exerce une mission de surveillance des économies des États membres et peut accorder des soutiens financiers aux États membres en difficulté. A cette fin, il est amené à produire des rapports de situation et des évaluations, à l'intention de son conseil d'administration, qui doit statuer sur des recommandations générales (dans le cadre de la surveillance), ou sur l'engagement du Fonds auprès d'un État membre puis le déboursement des tranches successives de financement. De plus, on peut légitimement estimer que les politiques mises en _uvre sous l'égide du Fonds, dans le cadre d'un programme de soutien, sont un élément important dans l'estimation de la trajectoire à moyen terme des pays considérés - qui ont justement une balance des paiements fragile et sont plus vulnérables aux crises financières. L'exigence de transparence s'est nourrie de cette logique, mais surtout des controverses sur le rôle du FMI dans la crise asiatique : la dénonciation des erreurs de politique économique imposées par le FMI aux récipiendaires de son aide s'est conjuguée à une dénonciation du secret qui entourait traditionnellement l'action du Fonds. Celui-ci aurait été d'autant moins sensible à la possibilité de formuler des jugements erronés qu'il fonctionnait à l'abri des regards... et des critiques. MM. Jeffrey Sachs et Steven Radelet se sont faits les détracteurs virulents du secret. Ces prises de position, largement relayées dans la classe politique américaine, ont donné lieu à des débats passionnés, mais surtout ont provoqué une « frénésie » de transparence au sein du FMI. Sans chercher désormais à s'abriter derrière le fait que les États membres sont « propriétaires » des informations recueillies et des documents qui s'appuient sur celles-ci (16), le Fonds a considérablement enrichi l'information publique : - l'usage des Notes d'information à la presse (puis « au public ») a été élargi, notamment aux conclusions du conseil d'administration sur les « consultations de l'article IV » des statuts (qui forment le cadre général de la surveillance) et les ajustements des politiques conduites par le Fonds (par exemple, politique des NSDD et NGDD, initiative sur la dette, etc.). Le Fonds encourage activement les autorités nationales à autoriser la diffusion de notes relatives aux consultations de l'article IV ; près de 80% des consultations ont donné lieu, ces derniers mois, à une telle publication ; - le FMI encourage également les autorités nationales à autoriser la publication des rapports préparés par les économistes du Fonds. Votre Rapporteur remarque qu'au printemps dernier, encore, les points de vue au sein du conseil d'administration différaient largement sur l'opportunité d'une telle politique (17). Près de soixante pays ont accepté jusqu'ici de participer au programme pilote lancé entre juin 1999 et décembre 2000 ; - enfin, l'utilisation des ressources du FMI donne lieu à la diffusion de documents plus nombreux : en juin 1999, le conseil d'administration a décider d'établir une présomption de publication des « lettres d'intention », qui constituent les programmes d'ajustement sur lesquels s'engagent les gouvernements, des « mémorandums de politiques économiques et financières », déposés par les gouvernements à l'appui du débours des tranches successives de financement, et des programmes de réduction de la pauvreté. Votre Rapporteur rappelle que cette politique de diffusion avait été engagée dès la fin de l'année 1996, facilitée notamment par l'ouverture du site Internet du FMI en septembre de la même année. Par exemple, les Notes d'information à la presse ont commencé à être publiées en mai 1997. La question a souvent été posée de savoir si la publication par le FMI d'informations « sensibles » pour les marchés ne serait pas de nature à inciter les gouvernements concernés à faire preuve de retenue dans leur relation avec le Fonds. Un tel effet collatéral de la transparence serait fâcheux puisqu'il priverait le Fonds de la « matière première » indispensable à une bonne compréhension des enjeux locaux et à la formulation de conseils appropriés. Cependant, un consensus s'est fait jour rapidement pour estimer qu'il revenait au Fonds d'élaguer en tant que de besoin les documents mis à la disposition du public. b) Transparence et information ne sont pas une panacée Disposer potentiellement de l'information n'est pas tout. Encore faut-il être incité à la recueillir effectivement (car toute information a un coût) et pouvoir l'utiliser à bon escient. Dans un monde financier qui tire son efficience théorique de l'hypothèse de rationalité - et même d'hyper-rationalité - des agents, ces deux conditions ne devraient pas poser de problèmes particuliers. Pourtant, les comportements moutonniers des opérateurs sont fréquemment dénoncés, et, d'ailleurs, l'histoire financière abonde en épisodes d'aveuglement euphorique suivis bientôt de désillusions fracassantes. Il n'est donc pas rare que le marché perde de vue certaines informations - relatives aux données dites fondamentales - au profit de certaines autres - par exemple, sur le sentiment supposé des autres opérateurs - qui provoquent les évolutions déstabilisantes. M. Olivier Davanne estime, par exemple, que les opérateurs du marché des changes sont très faiblement réceptifs à l'analyse fondamentale, alors que les intervenants des autres marchés ont une assez bonne idée du modèle de valorisation à utiliser (actualisation des bénéfices futurs, intégration de l'évolution des taux d'intérêt à long terme, etc.). Il estime que les économistes de marché « ont chacun leur propre modèle, souvent plus fondé sur des convictions personnelles que sur une analyse économique et statistique rigoureuse ». Ces économistes « concentrent leurs efforts pour anticiper celles des informations à venir qui vont surprendre les marchés. Ainsi, les forces stabilisatrices [...] paraissent plus faibles que sur d'autres marchés » (18). M. Olivier Davanne propose, en conséquence, d'améliorer la dissémination de l'analyse fondamentale chez les opérateurs et les investisseurs, par des actions d'incitation conduites par les organisations internationales et par une obligation faite aux grands établissements financiers de publier un certain nombre de prévisions « élémentaires » jugées indispensables à une bonne valorisation des actifs financiers. Il existe, justement, des intermédiaires de l'information, dont le métier consiste à analyser les informations « brutes », de nature fondamentale ou financière, et à formuler un jugement qui va servir de guide, sinon de règle, aux décisions des investisseurs (19). Les agences de notation fournissent ainsi aux marchés un jugement exprimé de façon synthétique par une note, accompagnée au moment où elle est donnée par les justifications adéquates. De même, les services de recherche économique et financière des établissements bancaires ou non bancaires publient leur production auprès de leurs services, de leurs clients ou du public. Le Fixed Income Weekly de la Deutsche Bank, ou encore le Global Markets Outlook and Strategy de JP Morgan, visent à éclairer les arbitrages des investisseurs entre devises, entre maturations, entre titres publics et titres privés, etc. Une erreur de jugement de ces intermédiaires d'information peut avoir des répercussions non négligeables sur le fonctionnement des marchés. A cet égard, les agences de notation ont été très critiquées du fait de leur médiocre performance pendant la crise asiatique. Comme les autres analystes, elles n'ont pas vu venir la crise, même si, selon le FMI, elles avaient identifié correctement les faiblesses croissantes de la zone (20). Le maintien de notes élevées jusqu'au déclenchement de la crise n'a pas contribué à modérer les entrées de capitaux ni à contrecarrer la diminution excessive des écarts de taux avec les pays industrialisés. Qui plus est, les dégradations brutales et parfois rapprochées effectuées au cours de la crise Il faut remarquer, à leur décharge, que les agences de notation ont procédé à des ajustements modestes à l'occasion des turbulences sur les marchés émergents consécutives à la crise russe d'août 1998. Elles ont manifestement fait la part des phénomènes de liquidité - indépendants des risques de solvabilité afférents aux emprunteurs dès lors que la crise de liquidité peut être enrayée - qui seuls peuvent servir de fondement sérieux à l'attribution d'une note (21). Cependant, à la suite de leur mésaventure asiatique et du flot de critiques qu'elles ont subies, les grandes agences de notation (Moody's, Standard & Poor's et Fitch-ICBA) ont décidé de porter une attention plus grande aux vulnérabilités du secteur bancaire et aux engagements publics contingents qui en découlent, au niveau et à la structure de l'endettement externe, aussi bien public que privé - en appréciant à cette occasion la dépendance du pays vis-à-vis de l'endettement à court terme et des flux financiers sensibles à une détérioration de la confiance, enfin à l'évaluation de la capacité des pays à résister à des pressions externes. En revanche, la question du traitement des phénomènes de contagion semble rester difficile à résoudre. Même muni de l'information la plus complète et la plus fiable, l'investisseur ou le prêteur peuvent être amenés à prendre des risques excessifs si des incitations existent à adopter des biais par rapport aux signaux adressés par le marché. L'exercice efficace de la discipline de marché passe par l'élimination des facteurs de l'aléa moral. c) La lutte indispensable contre l'aléa moral L'aléa moral tel qu'il est défini ci-avant - une réaction des débiteurs et créditeurs privés à des distorsions de marché qui provoque une prise de risque excessive - trouve à s'exprimer de préférence du fait d'une intervention intempestive de l'autorité publique dans le fonctionnement du marché. C'est ainsi que les garanties publiques offertes au secteur privé constituent, par exemple, un facteur d'aléa moral bien connu. En pratique, le caractère explicite ou implicite ainsi que l'ampleur effective des garanties offertes par les gouvernements sont très variables : celles-ci peuvent concerner de façon explicite des dépôts bancaires ou non bancaires ainsi que des instruments financiers à court terme. Mais des engagements d'entreprises ou de sociétés financières peuvent aussi bénéficier d'une garantie publique plus ou moins explicite. Enfin, l'aléa moral peut apparaître dès lors que les intervenants pensent qu'il existe une garantie publique. En Corée, par exemple, l'interférence traditionnelle du gouvernement dans l'allocation du crédit bancaire avait rendu les autorités « co-responsables » de la qualité des créances, ce qui impliquait aux yeux des banques coréennes, comme d'ailleurs de leurs créditeurs interbancaires étrangers, que le gouvernement couvrirait les pertes éventuelles et empêcherait tout défaut préjudiciable à la santé des banques domestiques. Cependant, en cas de crise, le coût de la socialisation du risque à travers l'octroi d'une garantie publique peut être contrebalancé par l'obtention de concessions de la part des créditeurs, sous forme d'extension de la maturité des prêts échus ou venant à échéance, d'une réduction de dette ou d'améliorations équivalentes en termes de charge de la dette. L'octroi d'une garantie permet également, si la crédibilité du gouvernement est suffisante, d'étouffer une crise de liquidité ou une panique bancaire. L'étendue des garanties ainsi accordées doit cependant être soigneusement évaluée, afin de ne pas faire peser de risque inutile sur les finances publiques. C'est ainsi que des questions ont pu se poser sur l'opportunité de la garantie de change accordée par la Corée dans le cadre de l'accord de restructuration de la dette interbancaire à court terme. Le régime juridique des faillites peut aussi constituer une incitation de marché efficace à l'adoption de comportements prudents. Des régimes bien conçus offrent le cadre légal permettant de traiter les problèmes des entreprises en difficulté avant qu'ils n'aient des répercussions trop importantes sur le reste du secteur productif et qu'ils n'influent sur la solidité du système bancaire. Par ailleurs, en offrant fréquemment au créditeur la possibilité de changer la direction de l'entreprise défaillante, ces régimes peuvent favoriser l'adoption de comportements prudents par les gestionnaires. Enfin, les régimes de faillite définissent un cadre adéquat pour la restructuration ou la liquidation des firmes concernées, fournissant ainsi une contribution intéressante à la résolution ordonnée des crises de paiements extérieurs dès lors que l'endettement externe du secteur privé est une contrainte importante pesant sur l'équilibre macroéconomique. Le renforcement des régimes nationaux de faillite a donc des répercussions indirectes sur la stabilité financière internationale. Pour autant, « il n'y a pas de code international des faillites ni de convention sur les faillites. Il n'y a pas non plus de cadre général reconnu au plan international ou un accord qui lierait les pays autour d'un ensemble de principes et de règles internationales sur la faillite, comme on en trouve dans d'autre domaines (notamment dans l'Accord général sur les tarifs et le commerce). En fait, les conventions dites « multilatérales » ont été relativement peu nombreuses. La plupart des efforts de coopération n'ont débouché sur rien ou ont été abandonnés, à l'exception d'une poignée de traités. Les traités bilatéraux, bien que plus nombreux, tendent à se limiter à la reconnaissance mutuelle et à l'exécution des jugements, plutôt que de définir un cadre global » (22). C'est pour pallier en partie ces manques que la Banque mondiale coordonne actuellement un effort engagé par plusieurs institutions multilatérales et par la communauté des experts (Association internationale des barreaux, Association internationale des syndics de faillite) pour développer un ensemble de principes et de lignes de référence sur les régimes de faillite. Les travaux conduits dans le cadre de cette initiative, en liaison étroite avec le FMI, devraient aboutir d'ici à la fin de l'année 2000. L'initiative de la Banque mondiale s'apparente aux travaux conduits dans le cadre de la Commission des Nations Unies sur la législation commerciale internationale (UNCITRAL), qui a débouché sur la mise au point, en 1997, d'un Modèle législatif de la faillite transfrontière, qui, comme son nom l'indique, ne constitue pas un traité mais un texte susceptible d'être intégré dans les différents systèmes juridiques nationaux. Si, effectivement, une partie de la prévention des crises financières passe par le renforcement du cadre juridique des faillites, notamment transfrontières, il est permis de penser que des actions situées plus en amont concourront au même objectif avant que des faillites ne soient constatées. La stabilité financière, au-delà des marchés, passe aussi par la solidité des institutions qui en assurent le fonctionnement et, au-delà, des systèmes financiers nationaux dans leur ensemble. 2.- Le renforcement des systèmes financiers a) Le cadre général du renforcement des systèmes financiers La notion de solidité renvoie, en miroir, à celle de faiblesse. Pour autant, il ne faut pas croire que seuls les pays émergents doivent s'atteler à la rénovation de leurs systèmes financiers. Les flux de capitaux excessifs à destination des pays asiatiques avaient, certes, une destination mais aussi une origine : les créditeurs sont tout aussi coupables de négligences ou d'aveuglement que leurs débiteurs. Les années récentes ont d'ailleurs montré qu'un haut niveau de développement n'est pas incompatible avec l'apparition de ruptures financières : la crise des caisses d'épargne américaines, en 1982, comme les crises bancaires scandinaves, au début des années quatre-vingt dix, se sont produites dans des États qui ne passent pas pour appliquer les réglementations et les contrôles les plus laxistes. La quasi-faillite de LCTM, en septembre 1998, rappelle également que les risques supportés par le système financier peuvent parfois déborder les marchés et prendre les autorités par surprise. · De nombreux forums se sont penchés sur la question complexe du renforcement des systèmes financiers. Malgré cette diversité - ou peut-être grâce à elle - un consensus est rapidement apparu sur les grandes lignes de la méthode qui paraît aujourd'hui la plus efficace pour atteindre cet objectif. Cette méthode s'appuie sur trois piliers. Dès avril 1997, le rapport sur « la stabilité financière dans les économies des marchés émergents », établi par un groupe de travail rassemblant des représentants du G 10 et de plusieurs économies émergentes, estimait que l'établissement d'un corpus de principes fondamentaux et de saines pratiques devait constituer le socle de toute action d'envergure visant à renforcer les systèmes financiers émergents. « Dans tout domaine d'activité pertinent au regard de la robustesse des systèmes financiers, un ensemble unique de principes devrait être développé au cours d'un processus international de consultation très large, impliquant des experts nationaux ayant une expérience approfondie des questions concernées. Les principes développés dans les différents domaines d'activité devraient être mutuellement cohérents et appliqués en fonction des circonstances prévalant dans chaque pays » (23). L'avantage d'un corpus étendu de principes et saines pratiques est triple : - le processus d'élaboration étant conduit sur la base d'une expertise large, la « robustesse » technique des principes et pratiques recommandées donne un point de référence aux autorités financières domestiques et à leurs gouvernements pour évaluer la nature et le degré des risques encourus dans les secteurs concernés. Il en est de même pour l'évaluation pratiquée par les acteurs de marché, comme pour celle qui peut être effectuée par le FMI dans le cadre de son processus de surveillance ; - la diversité du panel d'experts ayant élaboré le recueil de principes et bonnes pratiques peut aussi faciliter son acceptation et son appropriation par les pays susceptibles d'en appliquer le contenu ; - enfin, la focalisation de ces guides sur des principes et des pratiques autorise une flexibilité de bon aloi lorsqu'il s'agit d'en assurer la mise en _uvre effective dans des pays qui peuvent différer profondément dans leurs cultures juridiques et économiques. A Denver (1997), les ministres des finances du G 7, puis les chefs d'État et de gouvernement ont endossé les conclusions du groupe de travail et ont ainsi donné une légitimité politique forte à ses recommandations (24). Ensuite, le groupe de travail du G 22 consacré au « renforcement des systèmes financiers » a réaffirmé la légitimité de cette démarche de « normalisation » en étendant son champ d'application. La définition d'une doctrine internationale dans les domaines principaux intéressant la stabilité financière ne serait d'aucune utilité si les pays concernés restaient indifférents à sa mise en _uvre. Il faut donc que les autorités et les acteurs du secteur privé soient confrontés à des incitations bien conçues, afin que la somme de réflexions internationales intégrées dans les recueils de bonnes pratiques trouve sa pleine efficacité. Il s'agit là du deuxième « pilier » de la méthode. A cet égard, les travaux accomplis dans le cadre du G 22 sont tout à fait intéressants. Sans grande surprise, le rapport du groupe de travail sur le renforcement des systèmes financiers estime que les « incitations de marché » sont un moyen efficace de mobiliser les pays émergents : la diffusion d'informations précises sur l'état du système financier permettra au marché, en théorie, d'affiner son évaluation du risque de crédit et d'ajuster la rémunération de ses placements en conséquence. On sait cependant ce qu'il est advenu de ce beau principe, à la lumière de l'inertie des marges (spreads) sur les marchés émergents avant le déclenchement de la crise asiatique. De même, la réalisation d'évaluations standardisées portant sur le respect des codes de principes fondamentaux et de bonnes pratiques pourrait déboucher sur une notation. Le groupe de travail reconnaît, cependant, qu'une telle mesure peut se heurter au caractère très général des principes et pratiques énoncées et qu'une notation peut s'en trouver déséquilibrée en faveur d'un jugement subjectif et au détriment des éléments objectifs ; d'ailleurs, le rapport indique que les opinions sont restées partagées au sein du groupe. Enfin, l'ajustement des règles d'entrée sur le marché opposables aux nouveaux établissements, notamment étrangers, peut renforcer l'incitation à appliquer les principes fondamentaux définis par la communauté internationale, renforcée en l'occurrence par la possibilité de voir se développer des transferts de savoir-faire de la part des nouveaux entrants. Cependant, le rapport du groupe de travail du G 22 a jugé nécessaire de compléter ces indications plutôt naturelles par deux autres moyens moins orthodoxes : - l'intégration du risque pays dans les normes prudentielles exigées des établissements bancaires ou financiers. Cela amènerait à rendre plus coûteux, car plus risqués, les financements accordés aux pays qui n'appliqueraient pas les bonnes pratiques internationales ; - l'inclusion obligatoire de mesures relatives au secteur financier dans la conditionnalité associée aux programmes de soutien des institutions financières internationales (c'est-à-dire, essentiellement, le FMI). Votre Rapporteur constate que le groupe de travail du G 22 est allé, pour ces deux derniers points, au-delà de la simple « incitation ». Il est difficile d'en tirer une interprétation définitive : s'agit-il simplement de tirer parti d'évolutions déjà amorcées dans la régulation du système financier international (révision programmée du ratio international de solvabilité bancaire - dont les tenants et aboutissants seront présentés plus en détail ci-après ; expérience des programmes de soutien consentis à la Thaïlande, à l'Indonésie puis à la Corée) ? S'agit-il, au contraire, de suggérer que la difficulté principale dans la démarche de « normalisation » internationale résidera justement dans la lenteur de mise en application par les pays émergents ? Les vicissitudes de l'impulsion réformatrice en Asie, qui semble s'étioler au fur et à mesure que s'éloigne le souvenir de la crise et que se développent les effets positifs de la reprise économique, font craindre à votre Rapporteur que la deuxième analyse ne soit plus adéquate. · Les domaines de la réforme peuvent être regroupés en deux catégories. Tout d'abord, un certain nombre de propositions concernent la gestion publique des risques financiers globaux (entendus ici comme dépassant le cadre d'un seul acteur financier pour toucher à l'économie nationale dans son ensemble). Par exemple, la Banque mondiale et le FMI ont engagé la rédaction d'un guide de principes généraux pour la gestion de la dette, qui couvrent à la fois la dette domestique et la dette extérieure. Ce guide vise à formuler des recommandations suffisamment générales pour être applicables à des pays dont les structures d'endettement sont variées et qui se situent à des étapes différentes de leur développement financier. Un premier document préparatoire a été achevé pendant l'été 2000 ; une phase de présentation et de consultation doit se dérouler pendant le deuxième semestre 2000 et le guide devrait pouvoir être approuvé lors de la réunion du Comité monétaire et financier international en avril 2001. Une autre question importante touche à la gestion de la liquidité globale de l'économie, entendue non pas comme l'accès des agents aux moyens de paiement domestiques, mais comme la maîtrise des contraintes de liquidité générées par l'endettement à court terme, notamment en devises. A la connaissance de votre Rapporteur, aucun travail de « normalisation » internationale n'est en cours à l'heure actuelle, mais le groupe de travail du G 22 a estimé que la gestion de la liquidité devait dépasser le cadre des établissements financiers pour être envisagée à l'échelle de l'économie. Mais le consensus est général pour estimer que le renforcement des systèmes financiers passe avant tout par le resserrement des conditions de gestion du risque au sein même des établissements : - autour de l'expression peut-être un peu galvaudée de « bonne gouvernance », c'est l'ensemble des modes de gestion du pouvoir et d'articulation des pouvoirs dans l'entreprise qui sont sur la sellette. Le discours sur l'opacité des entreprises asiatiques et le goût des dirigeants pour les relations personnelles au détriment des relations « managériales » à l'occidentale constitue désormais une rengaine connue. Autour des Principes de gouvernance d'entreprise, développés en mai 1999 par l'OCDE, la Banque mondiale a entrepris un dialogue et des consultations avec plusieurs pays émergents pour définir un cadre général d'évaluation afférent au respect de ces principes ; de même, la Banque mondiale entend concevoir bientôt un guide de réforme au service d'une meilleure gouvernance d'entreprise ; - au-delà des arrangements institutionnels relevant de la gouvernance, les instruments de contrôle interne constituent la première ligne de défense au service d'une gestion maîtrisée du risque : avant d'être les garants de la stabilité financière nationale et internationale, les établissements financiers sont avant tout comptables de leur propre survie. Il n'est donc pas étonnant que les dispositifs de contrôle fassent l'objet d'une attention soutenue (25). Le défi essentiel des années récentes et futures consiste à « adapter les outils de gestion des risques à des marchés de plus en plus globaux, à des instruments de plus en plus sophistiqués et à des conditions de marché potentiellement plus volatiles (incluant la disparition potentielle de la liquidité sur le marché) » (26). Votre Rapporteur mentionnera simplement deux documents d'importance. Le Cadre général pour les systèmes de contrôle interne dans les organisations bancaires, publié en septembre 1998 par le comité de Bâle sur le contrôle bancaire, identifie treize principes utiles à une configuration efficace desdits systèmes, comme la nécessité pour la direction de bien comprendre les risques encourus par l'établissement, le caractère permanent et décentralisé du contrôle des risques, l'existence de systèmes d'information fiables et de canaux de communication efficaces au sein des établissements, etc. Émanant d'un groupe de grandes institutions financières américaines, le rapport sur « l'amélioration des pratiques de gestion du risque de contrepartie » contient un ensemble de recommandations pour une bonne gestion des risques de crédit, de marché et de liquidité. Les rédacteurs du rapport affichent leur réticence à une codification précise des pratiques de gestion du risque, les évolutions constantes de l'environnement financier justifiant à leur yeux une flexibilité et une adaptabilité importante de ces pratiques ; - la discipline de marché, notamment à travers la transparence des établissements sur leur exposition aux risques pays ou à certaines catégories d'instruments financiers, incite à renforcer la solidité des institutions ; - enfin, il ne faut pas exclure la possibilité que les principes régulateurs sous-jacents aux règles de bonne gouvernance, à la mise en _uvre des contrôles internes et à la discipline de marché puissent échouer à garantir un fonctionnement prudent des institutions financières. C'est la raison d'être de la deuxième ligne de défense, relevant des autorités publiques, que constituent la réglementation et la supervision. b) Le secteur bancaire, point nodal de la solidité financière La deuxième ligne de défense revêt une importance toute particulière lorsqu'elle porte sur les activités du secteur bancaire. L'intérêt des autorités pour la solidité de ce secteur est justifiée par trois caractéristiques : le secteur bancaire est le principal créateur de monnaie et le plus important gestionnaire des disponibilités à caractère monétaire ; il est la source majeure de financement de l'économie, par le biais de la distribution de crédit, et joue donc un rôle essentiel dans l'évolution de la demande ; il gère une grande partie des instruments de paiement et se trouve donc titulaire d'une responsabilité particulière au regard du bon déroulement des échanges de biens et services. La solidité du secteur bancaire dans les pays émergents a conquis une place importante dans les préoccupations du FMI depuis le début des années 1990. Non pas qu'une négligence coupable ait prévenu, antérieurement, la mise en place de politiques appropriées, mais parce que la priorité des années 1980 était la stabilisation macroéconomique, notamment à travers la réduction des déficits budgétaires et la maîtrise de l'inflation, ainsi que le traitement de la crise de la dette pour les pays latino-américains. La rémission des tensions dans ces domaines a permis au Fonds de réorienter ses réflexions et d'accorder une attention plus soutenue aux questions structurelles en matière financière. Les crises mexicaine, asiatique et russe ont donc rattrapé un processus encore jeune et immature, qui pouvait cependant capitaliser sur les efforts entrepris depuis longtemps déjà au sein du comité de Bâle sur le contrôle bancaire, établi en 1974 à la suite de la faillite de la banque allemande Herstatt. Le comité de Bâle, dont la logistique est assurée par la Banque des règlements internationaux, a reçu du conseil des gouverneurs du G 10 une triple mission : faciliter les échanges d'informations sur les activités des banques à vocation internationale, améliorer les techniques de contrôle de ces établissements, fixer des normes minimales communes. Lesdites normes n'ont pas de force juridique mais sont, en général, reprises comme fondement des réglementations nationales au sein des États membres du G 10 et au-delà. Anciens et importants, les travaux du comité de Bâle ne peuvent être présentés ici dans leur intégralité. Cette démarche excèderait d'ailleurs le cadre du présent rapport d'information. Votre Rapporteur se contentera donc d'évoquer les questions les plus directement liées aux conséquences des crises financières récentes. A cet égard, deux leçons doivent être tirées en matière de normes prudentielles et des activités de supervision qui leur sont associées. LES OBJECTIFS PRINCIPAUX DE LA RÉGLEMENTATION BANCAIRE _ la stabilité monétaire : elle implique, au minimum, une identification précise des établissements qui contribuent à la création monétaire et une connaissance précise de l'évolution de leurs opérations actives et passives ; elle peut rendre nécessaires des prescriptions plus contraignantes, comme la constitution de réserves obligatoires ; _ la stabilité du système bancaire : elle vise à éviter le risque systémique, c'est-à-dire l'apparition de défaillances en chaîne ; elle implique une surveillance adéquate des établissements de crédit ; _ la protection des intérêts de la clientèle : elle doit garantir un équilibre convenable dans les relations entre les établissements et leurs clients, notamment lorsqu'il s'agit de personnes physiques ; ceci passe, entre autres, par des mesures adéquates d'information ou par le respect de clauses types, à l'exemple des dispositions d'inspiration consumériste existant dans d'autres secteurs ; _ le bon fonctionnement du système bancaire : il vise à assurer, au moindre coût, la qualité et l'efficacité des services rendus à la clientèle et aux autres établissements, notamment grâce à la mise en _uvre de systèmes de paiement et règlement performants et sûrs ; _ l'égalité d'accès à la profession : elle tend à garantir l'ouverture de la profession à de nouveaux établissements, donc à maintenir son caractère concurrentiel, facteur d'efficacité économique et de discipline collective ; _ l'orientation des placements et des financements : elle se propose de réaliser une allocation des ressources financières conforme aux objectifs généraux de la politique économique. D'après P. H. Cassou, La réglementation bancaire, Société éducative financière internationale (Québec), 1997. · La crise a confirmé la pertinence globale des normes sur l'adéquation des fonds propres des banques, tout en soulignant la nécessité d'en corriger certains aspects et de poursuivre les travaux relatifs à leur évolution prochaine. Cette appréciation pourrait sembler déplacée, au vu du nombre et de la gravité des faillites bancaires observées au Mexique comme en Asie émergente depuis 1995. D'ailleurs, juste avant la crise, les fonds propres des banques asiatiques respectaient, parfois même très au-delà, les normes minimales déterminées par le comité de Bâle. Mais les faiblesses des banques asiatiques étaient ailleurs, dans des zones impuissantes à être éclairées par la mesure très synthétique offerte par le célèbre ratio Cooke. En revanche, il est exact que les banques prêteuses, dans le cadre d'une supervision plus affinée et d'une exposition aux risques globalement moins hasardeuse que celle de leurs contreparties, ont été correctement protégées par les exigences de capitalisation inspirées de ce ratio. Celui-ci fixe le montant total des fonds propres à 8% au moins des engagements de l'établissement pondérés en fonction de leur risque. La norme d'adéquation des fonds propres détermine, bien entendu, la nature des fonds propres, les conditions dans lesquelles certains types de fonds propres peuvent être comptabilisés pour être mis en regard des engagements, les pondérations applicables aux différentes catégories d'engagements, etc. L'objectif fondamental du ratio d'adéquation des fonds propres est de garantir une solvabilité minimale de la banque. Des interrogations se sont fait jour, peu de temps après la crise asiatique, sur l'éventualité que certaines caractéristiques de la norme d'adéquation des fonds propres aient introduit des biais préjudiciables dans le comportement des banques créditrices et n'aient ainsi favorisé l'accumulation excessive d'un endettement interbancaire contracté par des contreparties locales : - un « biais géographique » en faveur de la Corée pourrait avoir résulté de l'entrée de ce pays dans l'OCDE dans les derniers jours de décembre 1996. En effet, les créances en monnaies non nationales sur les pays dits « de la zone A » (c'est-à-dire les pays membres de l'OCDE et ceux qui sont partie prenante des Accords généraux d'emprunt avec le FMI) sont affectées d'un coefficient de pondération nul, c'est-à-dire que les banques ne sont pas obligées de couvrir ces engagements avec du capital pour garantir leur solvabilité au sens du ratio Cooke ; en revanche, les créances sur les pays de la zone B (tous les autres pays) sont affectées d'un coefficient de pondération égal à 100% ; - un « biais interbancaire », qui découle de ce que les créances interbancaires établies sur des contreparties situées dans la zone A sont affectées d'un coefficient de 20%, alors que ce coefficient n'est retenu pour les créances interbancaires sur des contreparties situées en zone B que pour celles dont l'échéance est inférieure à un an ; en revanche, pour les créances interbancaires localisées dans la zone B dont l'échéance est supérieure à un an, un coefficient de pondération de 100% est appliqué. Le comité de Bâle sur la supervision bancaire a cherché à déceler l'existence de tels biais. Les informations que votre Rapporteur a pu inférer d'un document de travail émanant de cette institution suggèrent que les preuves des biais, si ceux-ci existent, seront quasiment impossibles à matérialiser : les informations restent trop parcellaires sur la nature des créances interbancaires pour pouvoir établir des tests statistiques irréfutables (27). Pour le moins, aucune évidence forte d'un biais n'apparaît à l'examen des informations disponibles auprès de la Banque des règlements internationaux. Cependant, le groupe de travail constitué à cet effet estime que trois modifications méritent d'être considérées : la possibilité que les banques se voient affecter un coefficient de risque plus faible que les émetteurs souverains devrait être réétudiée ; la solidité d'une banque dépendant de son profil de risque propre, mais aussi de la qualité de la supervision qui est exercée sur elle, il pourrait être envisagé d'introduire un ajustement du coefficient de pondération en fonction de la qualité de la supervision, évaluée en fonction d'un ensemble de principes fondamentaux reconnus au plan international ; enfin, même s'il est vrai que le risque est en général en relation directe avec la durée de vie de la créance, cette relation s'inverse lorsque l'endettement à court terme devient excessif et que le système bancaire devient vulnérable à une crise de liquidité : la pondération des risques pourrait tenir compte de cet « effet de vulnérabilité ». Les crises de la deuxième moitié des années 1990 posent une question peut-être plus délicate encore que les biais potentiels du ratio Cooke. Tirant les conclusions du fait que l'innovation financière peut remettre en cause la capacité des règles actuelles de fonds propres à refléter correctement le profil de risque réel des établissements bancaires, le comité de Bâle a proposé, en juin 1999, une modification substantielle de la norme d'adéquation des fonds propres. Le nouveau cadre général pour l'adéquation des fonds propres serait ainsi organisé autour de trois piliers : le concept maintenu d'exigences quantitatives minimales de fonds propres, l'extension du processus de supervision exercé par les autorités en matière d'adéquation des fonds propres, le renforcement de la discipline de marché. Les principales innovations proposées par le comité de Bâle portent sur le premier pilier. En premier lieu, le comité de Bâle propose que les exigences minimales de fonds propres visant à couvrir le risque de crédit (c'est-à-dire le risque, classique, de défaut du débiteur) puissent être déterminées de trois façons différentes : - l'approche standardisée serait modifiée, en offrant aux établissements bancaires la possibilité de recourir à des évaluations externes du risque de crédit - par exemple, les notes émises par les agences de notation - pour déterminer les coefficients de pondération applicables à leurs créances. Les créances sur débiteurs ayant des notes élevées seraient affectées d'un coefficient de pondération inférieur à 100%, celles constituées sur des débiteurs mal notés pourraient se voir affectées d'un coefficient de pondération allant jusqu'à 150%. Dans l'esprit du comité de Bâle, le recours à des évaluations externes n'est qu'une option offerte aux banques et l'approche standardisée doit, par ailleurs, rester le lot de la majorité des établissements ; - certains établissements plus « sophistiqués » mettent en _uvre des processus internes de notation de leurs débiteurs. Le comité de Bâle envisage de permettre l'utilisation de ces notations internes, sous réserve de l'accord des autorités de supervision, pour déterminer les exigences en capital applicables aux créances concernées ; - certains établissements ont développé des modèles d'analyse et de gestion du risque de crédit. Par rapport à l'approche par notation, centrée sur la qualité des contreparties examinées séparément, les modèles de gestion du risque ont l'avantage d'évaluer globalement le risque supporté par le portefeuille de créances de la banque. Comme précédemment, le comité de Bâle propose que l'on envisage la possibilité que ces modèles de risque puissent servir de base à la détermination des exigences minimales de fonds propres. En deuxième lieu, le développement des techniques de réduction des risques (couverture d'un actif par un collatéral, utilisation de produits dérivés, constitution de garanties ou de sûretés, compensation entre risques au sein du bilan, etc.) n'est pas suffisamment pris en compte dans les règles actuelles. Le comité propose que le nouveau cadre général d'adéquation des fonds propres favorise les incitations à utiliser de telles techniques. En troisième lieu, le comité de Bâle envisage d'étendre le champ d'application des normes minimales de fonds propres à des risques qui sont, à l'heure actuelle, imparfaitement couverts par le système, en particulier le risque de taux d'intérêt et le risque d'exploitation. Il est ainsi proposé d'établir une exigence minimale en capital pour le risque de taux d'intérêt sur le portefeuille de créances lorsque celui-ci est significativement supérieur à la moyenne. Votre Rapporteur rappelle que le risque de marché (activités de négoce et opérations de marché) a été intégré dans les exigences minimales de fonds propres par un amendement à l'accord fondamental sur le ratio Cooke, adopté en janvier 1996, qui est entré en application en janvier 1998. Les propositions du comité de Bâle ont, en général, été reçues favorablement. Certaines d'entre elles soulèvent cependant des questions difficiles. Il en est ainsi de l'utilisation éventuelle de notes délivrées par les agences spécialisées pour la détermination du niveau des fonds propres. L'histoire récente montre que les performances de ces agences n'ont peut-être pas été à la hauteur de la confiance que leur manifeste le comité de Bâle. Celui-ci explique d'ailleurs que la mise en _uvre de cette possibilité supposera une évaluation de la capacité des agences à délivrer des notes fiables, donc une sorte d'accréditation par les superviseurs nationaux. De plus, la proposition du comité de Bâle suppose que les notes délivrées par les différentes agences accréditées soient sinon semblables, du moins homogènes. C'est généralement le cas, mais des différences d'appréciation importantes peuvent parfois apparaître. La dégradation récente de la notation du Japon par Moody's, qui ne gratifie plus la dette souveraine japonaise que d'un médiocre Aa2 alors que Standard & Poor's lui conserve le prestigieux AAA, note maximale (28), illustre cette difficulté pour l'heure non résolue, à la connaissance de votre Rapporteur. Dans la même veine, la deuxième source d'interrogations concerne l'utilisation des évaluations internes aux établissements bancaires pour déterminer les fonds propres minimaux exigibles en matière de risque de crédit. Là encore, les défaillances observées dans les années récentes incitent à penser qu'une mise en _uvre rapide de cet assouplissement serait certainement prématurée. De l'avis général, il reste un important travail de sophistication et de fiabilisation des modèles utilisés (29) ; la question de leur validation, par les banques et par les autorités de contrôle, reste également pendante. Votre Rapporteur rappelle, cependant, que les établissements bancaires ont d'ores et déjà la possibilité d'utiliser leurs propres modèles d'évaluation des risques pour la détermination des fonds propres applicables au risque de marché. Il faut bien être conscient des risques et potentialités contenus dans les propositions de réforme émises par le comité de Bâle. L'introduction de méthodes sophistiquées d'appréciation du risque offre une souplesse qui vise à ce que les exigences minimales de fonds propres correspondent au profil réel de risque supporté par l'établissement et à ce que les risques induits par les innovations financières soient pris en compte en temps utile et de façon adéquate. En contrepartie, elle expose le processus de capitalisation des banques aux incertitudes inhérentes aux modélisations de toute sorte ou à la part subjective inévitable dans toute évaluation du risque. Enfin, elle exige des banques comme des superviseurs l'apprentissage de nouvelles relations, la banque devant désormais démontrer auprès du superviseur la validité et la pertinence de ses procédures d'évaluation quantitative des risques. Il va de soi que l'extension du dispositif en « double ligne de défense » à la détermination des exigences minimales en capital suppose des compétences techniques et financières hors de portée de la plupart des pays émergents. C'est pourquoi le maintien d'une approche standardisée de l'évaluation du risque de crédit a été décidé par le comité de Bâle. Dans cette optique, le renforcement des systèmes financiers dans les pays émergents passe en grande partie par le renforcement de leurs autorités de supervision. · La crise a souligné l'urgence d'une meilleure supervision dans les pays émergents. Dès le sommet du G 7 à Halifax, en 1995, les ministres des finances des pays membres avaient préparé à l'intention de leurs chefs d'État et de gouvernement un rapport affirmant, entre autres, la nécessité d'impliquer les institutions financières internationales dans l'amélioration des systèmes de supervision des pays émergents. Puis, au sommet de Denver, en 1997, les chefs d'État et de gouvernement ont appelé à la diffusion rapide d'un document préparé sous l'égide du comité de Bâle, en liaison avec les représentants de plusieurs pays émergents, définissant vingt-cinq Principes fondamentaux pour un contrôle bancaire efficace (30). Conformément à leur appellation de principes fondamentaux, les vingt-cinq points représentent des exigences minimales qui, dans de nombreux cas, demanderont à être complétées ou affinées, de façon à prendre en compte les conditions et risques propres aux système financiers locaux. En découvrant, par exemple, que le comité de Bâle a jugé bon de préciser que « la liste des activités autorisées aux banques doit être précisément définie » (point 2), on mesure à quel point la supervision peut être embryonnaire dans certains pays. Pour autant, on ne peut adhérer aux thèses extrêmes et quelque peu utopiques, voire provocatrices, développées par M. Rudiger Dornbusch, professeur d'économie internationale au Massachusetts Institute of Technology. Celui-ci doute de la capacité des pays émergents à assurer une supervision correcte de leur système financier. En conséquence, il propose de supprimer leurs banques centrales et de faire assurer la supervision de leurs systèmes financiers par des institutions étrangères ou internationales. Il va de soi que votre Rapporteur ne peut qu'exprimer les plus vives réserves sur ces positions atypiques, qui traduisent une vision du monde ultralibérale et, certainement, un peu déconnectée des réalités. Les Principes fondamentaux pour un contrôle bancaire efficace couvrent les domaines suivants : les conditions préalables à un contrôle bancaire efficace, notamment au regard de la définition des responsabilités des autorités, de leur indépendance et de leurs moyens ; les conditions d'agrément et la structure de propriété des établissements de crédit ; les réglementations et exigences prudentielles ; les méthodes de contrôle bancaire ; les exigences en matière d'information ; les pouvoirs institutionnels des autorités prudentielles ; le contrôle des activités bancaires transfrontières. La crise asiatique a, une fois encore, aiguillonné les efforts de la communauté financière internationale : le comité de Bâle a confié à un comité ad hoc le soin d'étudier, dans les principaux pays émergents, l'adéquation des systèmes de supervision aux Principes fondamentaux. En 1998, un « groupe de liaison sur les Principes fondamentaux », composé d'une vingtaine de membres des pays du G 10, de pays émergents, du FMI et de la Banque mondiale, a été chargé de proposer des solutions aux points que le comité ad hoc avait jugé nécessaire de réviser ou de préciser. Dans cette même optique, un complément méthodologique a été élaboré pour guider les autorités désireuses d'orienter leurs activités selon les lignes directrices définies dans les Principes fondamentaux. En effet, « en Asie comme dans beaucoup d'autres régions, les autorités sont aujourd'hui pleinement conscientes de la nécessité non seulement de les suivre à la lettre, mais aussi d'en respecter l'esprit » (31). L'assistance technique de la communauté internationale aux autorités de supervision dans les pays émergents revêt ainsi un caractère prioritaire. Il faut donc se réjouir de la création par la Banque des règlements internationaux et le comité de Bâle sur le contrôle bancaire d'un Institut pour la stabilité financière. Implanté à Bâle et opérationnel depuis le début de l'année 1999, il a pour mandat de contribuer à l'amélioration des systèmes financiers dans le monde, notamment par le renforcement du contrôle prudentiel. L'Institut pour la stabilité financière devrait se consacrer d'abord au secteur bancaire avant d'élargir son champ d'activité à la surveillance en matière de titres et d'assurances. A travers des séminaires, des études techniques et des échanges de personnes, l'Institut cherche à répondre aux besoins exprimés par les contrôleurs bancaires. De leur côté, la Banque mondiale et le Gouvernement canadien ont créé en 1998 un « Centre international pour la surveillance du secteur financier », situé à Toronto, qui s'attache à renforcer les compétences professionnelles et les capacités d'encadrement des responsables du contrôle du secteur financier dans les pays industrialisés et les pays émergents. Ce centre et l'Institut pour la stabilité financière ont engagé une coopération d'autant plus nécessaire que leur champ d'activité est pratiquement le même et qu'il convient d'éviter les doublons et le gaspillage des moyens. Le centre de Toronto reçoit un soutien financier du FMI. Enfin, la mise au point des « programmes d'évaluation du secteur financier », exercés conjointement par le FMI et la Banque mondiale, est une contribution essentielle à l'analyse des vulnérabilités financières dans les pays émergents, qui commande la définition des mesures permettant de contrecarrer ces vulnérabilités. LES « FINANCIAL SECTOR ASSESSMENT PROGRAMS » (FSAPs) ET LES « FINANCIAL SECTOR STABILITY ASSESSMENTS » (FSSAs). Le Programme d'évaluation du secteur financier (FSAP) a été lancé à titre expérimental en mai 1999, conjointement par la Banque mondiale et le Fonds, afin de répondre aux appels de la communauté internationale en faveur d'une coopération internationale plus intense pour réduire la probabilité et / ou la sévérité des crises du secteur financier et la contagion entre pays. Il consiste en une évaluation très complète des systèmes financiers d'un pays qui vise notamment à : (i) identifier les vulnérabilités et les risques ; (ii) constater les besoins d'assistance technique et de développement du secteur ; (iii) évaluer le respect et la mise en _uvre des normes, codes et bonnes pratiques internationaux ; (iv) aider à concevoir les politiques appropriées pour remédier aux faiblesses constatées. Des missions composées d'experts du FMI, de la Banque mondiale et des organismes de supervision nationaux sont chargées de mener à bien cet exercice en étroite collaboration avec les autorités des pays concernés. Une attention particulière est portée au respect de la confidentialité des informations échangées, compte tenu des risques de marché liés à cet exercice. Des FSSAs, découlant des FSAPs, sont présentés au Conseil d'administration du Fonds, dans le cadre des discussions Article IV. Ils se concentrent davantage sur les questions qui présentent un intérêt pour l'activité de surveillance du Fonds. Douze pays se sont portés volontaires à un FSAP pendant la période pilote initiale d'un an. On a cherché, dans la mesure du possible, à disposer d'un échantillon assez représentatif de la complexité des systèmes financiers des pays membres ainsi que des différentes régions du monde. Des pays développés et des pays en développement participent à cette expérience-pilote. Lors de la revue de l'expérience, le 31 mars 2000, il a été décidé de poursuivre ces évaluations dans 24 pays en 2000. Source : Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, c) La dimension globale de la supervision financière La supervision des activités financières a donc entrepris un travail d'adaptation aux évolutions modernes de la finance. Pourtant, il est un domaine où les changements sont moins évidents mais où les débats commencent quand même à déborder les cercles académiques : une supervision organisée sur une base nationale et sectorielle est-elle encore pertinente dans un monde financier globalisé ? Jusqu'ici, la réponse apportée à cette question dérangeante est restée dans les limites de l'épure, à savoir le développement de la coopération entre les différents superviseurs. · La nécessité d'une coopération d'ordre géographique est déjà ancienne. Le comité de Bâle lui-même trouvait son origine dans le constat de défaillances grevant le processus de supervision des filiales étrangères des établissements bancaires ; le premier document publié sous sa signature, dénommé « concordat de Bâle » (1975), définissait des principes pour la répartition des tâches entre les autorités des pays accueillant les maisons mères ou leurs filiales. La supervision bancaire des établissements multinationaux est une activité complexe : le concordat de Bâle a été révisé trois fois, en 1983, en 1990 puis en 1996, pour tenir compte de l'expérience acquise. Par ailleurs, le comité de Bâle a cherché à tirer les enseignements de la faillite de la Banque de crédit et de commerce international (BCCI) en 1991 et de sa liquidation en 1992. Hors du champ bancaire, la coopération intéresse naturellement les autres activités financières. Les régulateurs de marché sont ainsi regroupés au sein de l'Organisation internationale des commissions de valeurs, qui contribue à l'élaboration d'un corps de règles harmonisées, sur le même mode que le comité de Bâle. Une association internationale à vocation similaire réunit les autorités de contrôle des assurances. Au plan européen, un dispositif particulier de coopération entre les régulateurs de marché a été adopté en 1999, qui vise à harmoniser les principes et pratiques de régulation encadrés par les directives européennes et à mettre en _uvre concrètement un accord multilatéral de coopération en matière de surveillance des marchés. Les régulateurs sont eux-mêmes réunis au sein d'une association européenne depuis le mois de décembre 1997. L'existence établie de principes généraux et de mécanismes de coopération ne répond pas en elle-même aux deux questions fondamentales que pose la segmentation nationale des activités de supervision : un contrôle organisé sur une base décentralisée est-il plus ou moins efficace qu'un contrôle centralisé ? le contrôle décentralisé risque-t-il de provoquer des phénomènes de « concurrence réglementaire » imposés aux autorités par la mobilité du capital et la liberté de prestation de services (en Europe) ? Ces deux questions renvoient aux deux dimensions de la segmentation géographique : la diversité des normes applicables ; la diversité des autorités compétentes. La montée en puissance des centres financiers off shore - qui seront évoqués plus en détail ci-après - offre un élément de réponse peu encourageant. Mais des raisons politiques et économiques évidentes limitent la place que ces « trous noirs » de la finance internationale peuvent espérer occuper dans le système financier global. Imagine-t-on un instant que les institutions financières américaines, britanniques, japonaises et européennes toutes ensemble se déplacent un jour vers les cieux plus cléments de quelques îlots tropicaux ? Cette « optimisation » fiscale ou réglementaire serait en fait un séisme dans la configuration du pouvoir mondial... La nécessaire proximité avec la clientèle, l'importance des infrastructures tout comme la recherche de la respectabilité limitent également les tentations coupables. Exprimant un consensus international, organisé par les principaux pays participant au système financier global, les recommandations du comité de Bâle connaissent en règle générale une application rapide dans la plupart des pays développés. Votre Rapporteur a souligné l'urgence de mettre en place des mécanismes qui permettront une diffusion plus rapide qu'auparavant de ces recommandations dans les pays émergents. Elles agissent, ainsi, comme un minimum minimorum qui impose un plancher aux éventuelles pressions exercées sur les systèmes réglementaires par l'essor de la concurrence découlant de l'intégration des marchés. On peut donc envisager que les normes prudentielles soient peu à peu soumises à une harmonisation de plus en plus forte, les divergences entre réglementations nationales ne devenant plus que résiduelles. En revanche, restent ouverts les problèmes posés par la diversité des interprétations d'une norme commune et par la diversité des environnements juridiques dans lesquels les normes communes doivent se développer. Sur ce dernier point, votre Rapporteur rappellera simplement l'impact des règles comptables applicables en matière bancaire au Japon et de l'interprétation retenue par les autorités japonaises pour la définition de certains capitaux propres, qui ont notoirement allégé la contrainte de fonds propres minimaux imposée aux banques japonaises dans la première moitié des années quatre-vingt-dix. Il est vrai que ce n'était pas là la seule faiblesse du système financier japonais... Aux yeux de votre Rapporteur, la solution à ces problèmes passe par l'approfondissement du dialogue entre les autorités nationales et non par la création de mécanismes formels de résolution des conflits qui pourraient les opposer. La situation en Europe est, cependant, assez particulière. En effet, le degré d'interpénétration des marchés financiers - encore partiel mais déjà conséquent - comme la démarche générale d'intégration communautaire amènent à s'interroger sur l'opportunité de créer, dans un secteur donné, un régulateur unique européen. L'argument classique de la perte de souveraineté ne peut qu'être relativisé par le transfert de la souveraineté monétaire au Système européen de banques centrales qui a déjà été consenti. Il faut reconnaître que l'apparition d'un régulateur unique paraît aller dans le sens de l'histoire plus que le maintien de la segmentation géographique. Pour voir apparaître une telle autorité, il faudra cependant tenir compte des obstacles découlant, notamment, de la résistance des autorités nationales de contrôle (notamment bancaires) et des impératifs liés à la supervision d'entreprises financières exerçant des activités relevant de plusieurs superviseurs. · La nécessité d'articuler les supervisions des différentes activités financières découle de la constitution d'entreprises globales, de conglomérats opérant dans plusieurs secteurs, de la banque à l'assurance, de la gestion d'actifs à la banque d'affaires. Intervenant, au mois de février 2000, dans une conférence intitulée « régulation internationale et supervision bancaire nationale », M. Rolf Breuer, président de la Deutsche Bank, estimait qu'« aujourd'hui, la ligne de partage entre les différents fournisseurs de services financiers est fluide. Et, alors que le métier bancaire connaît une « déconstruction », les distinctions entre les différents produits financiers s'estompent également. Les dérivés de crédit et autres innovations financières découpent les produits financiers en risques partiels, qui, en ultime analyse, ne résident plus dans les seules banques. Les innovations financières combinent des éléments de dette, de propriété et d'assurance. La déconstruction du métier bancaire illustre mieux que tout autre chose le fait que, désormais, tous les fournisseurs de services financiers agissent comme preneurs de risques et distributeurs de risques » (32). Là encore, la question se pose de savoir si la coopération est suffisante ou si l'efficacité passe par la constitution d'autorités de réglementation et de supervision intégrées. Dans le cadre des compétences qui sont les leurs, il ne revient pas aux forums internationaux de trancher le choix entre une supervision répartie et une supervision intégrée. C'est pourquoi le comité de Bâle sur le contrôle bancaire, l'Organisation internationale des commissions de valeurs et l'Association internationale des contrôleurs d'assurance ont simplement constitué, en 1996, un Forum conjoint rassemblant les autorités de supervision de treize pays dans les secteurs des banques, des marchés financiers et des assurances. Le Forum conjoint a travaillé à l'établissement de principes généraux sur la supervision des conglomérats financiers. Ses recommandations portent essentiellement sur l'adéquation des fonds propres, le partage d'informations entre les autorités et les principes susceptibles de présider à la désignation d'un « superviseur coordonnateur ». Le mouvement d'intégration semble cependant exercer des attraits croissants. En 1997, les autorités de régulation et de supervision britanniques ont fusionné pour constituer la Financial Services Authority (FSA), qui dispose désormais de la compétence de supervision pour les activités bancaires et d'assurance ainsi que sur les marchés financiers. La FSA équivaut donc au regroupement de la commission bancaire, de la commission de contrôle des assurances et de la commission des opérations de bourse. En France, M. Laurent Fabius, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, a annoncé le 11 juillet dernier que le Gouvernement envisage, d'une part, de fusionner la commission des opérations de bourse et le conseil des marchés financiers et, d'autre part, de rapprocher la commission bancaire et la commission de contrôle des assurances. Ces évolutions récentes ou à venir tirent la conclusion extrême des mutations provoquées par la finance globale. Elles n'apportent pas à elles seules la solution au problème de l'éclatement de la compétence de supervision face à des groupes financiers intégrés et transfrontières. Elles permettent assurément d'en prendre la mesure et sont, à cet égard, une contribution importante au renforcement de la stabilité financière. 3.- Les zones d'ombre de la finance internationale Dans un monde de la finance qui passe généralement pour être soigneusement réglementé et contrôlé, il existe pourtant des zones d'ombre, des acteurs opaques, des lieux de « faible droit » à défaut d'être de non-droit. Apparus sur le devant de la scène médiatique avec la spéculation contre le système monétaire européen en 1992, la chute de la livre sterling et de la lire italienne puis leur sortie du mécanisme de change, les fonds dits hedge funds se sont trouvés par la même occasion un porte-drapeau plutôt avenant en la personne de M. George Soros, spéculateur-philanthrope qui a rapidement affiché sa volonté de recycler une partie de ses gains en faveur de la transition de l'Europe de l'Est vers l'économie de marché. Las ! L'histoire retiendra certainement le milliard de livres gagné par lui contre la Banque d'Angleterre dans la spéculation de 1992. Mais elle retiendra également l'effondrement de Long Term Capital Management et de son dirigeant visionnaire, enfant chéri de la finance, M. John Meriwether, qui avait pourtant associé à la gestion de son fonds deux prix Nobel d'économie. Depuis l'automne 1998, les hedge funds sont les mauvais sujets du système financier international et se sont vus rejoindre dans l'opprobe par les centres financiers off shore, qui les ont certainement accueillis avec trop d'aménité. a) Les hedge funds : appétence pour le risque, Bien qu'il n'existe pas de définition universellement acceptée, on s'accorde généralement à qualifier de hedge fund (littéralement, « fonds de couverture ») un véhicule d'investissement collectif organisé sur une base ad hoc - généralement autour d'investisseurs qui ont un statut d'associés - et accessible à un public restreint. Le montant minimal de l'apport nécessaire pour devenir associé d'un hedge fund est élevé (parfois 5 millions de dollars), ce qui en réserve l'accès à la catégorie des « investisseurs avertis », capables d'évaluer le risque sous-jacent. Sur cette base, les hedge funds échappent à la plupart des réglementations (33). Les hedge funds portent en fait très mal leur nom : ils mettent en _uvre des stratégies spéculatives fondées sur la détection d'imperfections de marché, dans le cadre de risques déterminés. Les seuls risques contre lesquels les fonds se couvrent sont ceux qu'ils n'ont pas décidé explicitement d'assumer... Leur profil risque-rendement est déterminé par leur stratégie d'investissement. Les hedge funds n'étant pas soumis à de grandes exigences en matière d'information, il est difficile d'estimer l'importance du secteur. Selon diverses estimations, il existerait environ 5000 fonds, ayant recueilli entre 200 et 400 milliards de dollars et susceptibles de gérer entre 800 et 1000 milliards de dollars d'actifs (compte non tenu des montants notionnels sous-jacents aux opérations sur produits dérivés) (34). Ceci reste modeste en comparaison du volume total des actifs financiers de toute nature gérés au sein de l'OCDE, soit 23.400 milliards de dollars en 1995 (35). La plupart des hedge funds sont de taille modeste, le capital investi étant inférieur à 100 millions de dollars. TYPOLOGIE SOMMAIRE DES HEDGE FUNDS _ fonds « macro » : ils spéculent à une échelle mondiale sur les évolutions de prix de nombreux actifs financiers (actions, obligations, monnaies, matières premières négociables comme le pétrole ou les métaux précieux), en connection avec les changements présumés des conditions économiques générales ou des actions de politique économique. Leur critère d'investissement est plutôt le pays que la nature des actifs détenus ; _ fonds « marchés émergents » : comme les précédents, ils parient sur des renversements de prix découlant d'évolutions fondamentales. Cependant, ils sont spécialisés sur des zones géographiques spécifiques et opèrent généralement sur des classes d'actifs bien déterminées ; _ fonds « neutres » (market-neutral) : ils prennent des positions longues et courtes (c'est-à-dire achats fermes et ventes à découvert) totalement ou partiellement appairées, sur des actifs financiers plus ou moins fortement corrélés afin de minimiser le risque de marché. Leur appellation de fonds neutres résulte donc de ce que leur exposition globale au marché pris dans son ensemble est très réduite (36). Ils achètent des actifs jugés sous-évalués et vendent des actifs sur-évalués, en pariant sur le fait que le marché se rendra compte de ces déviations de prix par rapport aux fondamentaux et réduira l'écart entre les deux catégories d'actifs ; _ fonds « événementiels » (event-driven) : ils cherchent à tirer profit des événements spécifiques susceptibles de se produire dans la vie d'une entreprise. Il peut s'agir d'une recapitalisation ou d'une restructuration dans le cas d'une faillite, ou également du rachat par l'entreprise de ses propres actions ; _ fonds « à découvert » : ils empruntent des actions jugées surévaluées à des teneurs de marché et les vendent immédiatement, dans l'espoir qu'ils pourront les racheter ultérieurement à un prix inférieur afin de les restituer à leur teneur de marché ; _ fonds « opportunistes » : selon leur appréciation de la situation, ils choisissent parmi un large éventail de stratégies et d'actifs, qu'ils peuvent également employer simultanément ; _ fonds « à stratégies multiples » : ils mettent en _uvre simultanément deux ou trois stratégies d'investissement afin de diversifier les risques ; _ fonds « valeur » (value) : comme les fonds « neutres », ils achètent ferme des titres jugés sous-évalués et vendent à découvert des titres jugés sur-évalués, mais ne pratiquent pas de couverture globale vis-à-vis de l'évolution tendancielle du marché ; _ fonds « revenu » : ils visent à générer des flux de revenus importants et réguliers, les gains en capital étant ici secondaires ; _ fonds « croissance agressive » : ils investissent dans des actions dont ils attendent une forte revalorisation. Le secteur privilégié d'investissement est donc celui des petites et moyennes entreprises, _ fonds « cycliques » (market-timing) : ils accroissent ou réduisent leur exposition sur un ensemble de marchés (actions, obligations, fonds d'investissement, fonds du marché monétaire) selon leur position présumée dans le cycle ; _ fonds de fonds : ils investissent leurs ressources dans un « portefeuille » de différents hedge funds, parfois en utilisant l'effet de levier. De cette façon, les « petits » investisseurs peuvent investir dans de grands fonds ou diversifier leur exposition globale dans le secteur des hedge funds ; _ fonds sectoriels : ils spécialisent leurs investissements dans des branches d'activité particulières : services financiers, communication, technologie, santé, médias, etc. D'après « Hedge funds and their role in the financial markets », Le degré de levier mis en _uvre par les hedge funds constitue un point sensible de l'image de ces organismes dans l'opinion, après la révélation de leviers ayant dépassé plusieurs dizaines dans le cas de LTCM, et même plus de 150 à la veille de son sauvetage. En fait, le degré de levier dépend très fortement de la nature du fonds. L'effet de levier apparaît dès lors que les fonds opèrent en général avec les opérations de pension ou avec des produits comme les dérivés et les contrats à terme, tous instruments où des positions peuvent être construites en fournissant au teneur de marché un dépôt de garantie et non en payant la position pour sa valeur entière. Moins fréquemment, l'effet de levier provient de l'emprunt de disponibilités auprès de banques. Il semble que la plupart des fonds opèrent avec un levier inférieur à 2, seuls les fonds neutres se situant nettement au-dessus, avec un effet de levier de 4 en moyenne. Ces moyennes n'excluent ni des effets de levier ponctuellement beaucoup plus élevés, ni la mise en _uvre de stratégies ultraspéculatives par certains fonds. Au regard de la stabilité financière, les hedge funds posent deux types de problèmes : - la possibilité qu'une faillite ou un ensemble de faillites déclenche une crise systémique du fait de répercussions de grande ampleur sur le secteur bancaire. Votre Rapporteur tient à signaler que la défaillance simultanée d'un grand nombre de hedge funds est assez improbable, les profils d'exposition aux risques étant très spécifiques : par exemple, lors de la crise de 1998, seuls les fonds « marchés émergents » et « à découvert » auraient subi des pertes significatives (37). La possibilité d'une crise systémique vient de l'accumulation des risques permise par la mise en _uvre de l'effet de levier ; elle provient aussi des interactions qui peuvent apparaître entre cet effet et les autres risques ; - la perturbation éventuelle des dynamiques normales de marché et la remise en cause possible de l'intégrité du marché, c'est-à-dire la possibilité de mettre en _uvre des manipulations de cours. L'impact potentiel des hedge funds sur le fonctionnement des marchés a été évoqué par les autorités de certaines économies asiatiques moyennes - Hong Kong et l'Australie, pour l'essentiel - qui estiment que la construction, par les hedge funds, de positions importantes sur leurs marchés domestiques a eu pour conséquence de propager la crise financière apparue dans d'autres pays d'Asie, voire, à Hong Kong, avait pour objectif de déclencher une attaque contre la monnaie nationale. A la suite des turbulences de l'automne 1998, de nombreuses instances se sont penchées sur les hedge funds afin d'évaluer plus finement leur impact potentiel sur la stabilité financière et les réponses qu'il conviendrait d'y apporter. Votre Rapporteur citera pour mémoire : - le groupe de travail constitué par le comité de Bâle pour étudier les interactions entre les banques et les institutions à fort effet de levier, qui a débouché sur la publication d'un recueil de bonnes pratiques à l'intention desdites banques. Le comité de Bâle travaille maintenant à examiner la célérité avec laquelle sont diffusées ces bonnes pratiques ; - le rapport établi par le groupe spécial réuni sous l'égide de l'Organisation internationale des commissions de valeurs, qui s'est concentré sur la gestion du risque relatif aux sociétés de titres opérant avec des hedge funds ; - le groupe de travail de la Présidence des États-Unis, qui a produit un rapport sur les hedge funds, l'effet de levier et les enseignements à tirer de la quasi faillite de LTCM. Ce rapport presse les superviseurs du secteur bancaire, des titres et des produits dérivés de surveiller et d'encourager les améliorations des systèmes de gestion du risque des entités soumises à réglementation. Le rapport affirme aussi que la transparence doit être améliorée, estimant que les hedge funds doivent se voir imposer de diffuser au public une information plus importante et plus rapide ; - le Groupe sur la politique de gestion du risque de contrepartie, établi par plusieurs institutions financières privées américaines, qui a publié son rapport en juin 1999. Le rapport se garde de proposer une architecture d'ensemble et limite son objet à l'examen de questions techniques importantes mais très difficiles d'accès. Le rapport manifeste une certaine défiance vis-à-vis d'éventuelles obligations de compte rendu en direction des autorités, mais recommande que les intermédiaires financiers assumant un crédit important vis-à-vis de leurs contreparties ou une exposition significative au marché rencontrent les autorités de supervision de façon informelle pour discuter des conditions et tendances de marché susceptibles de conduire à un dysfonctionnement majeur du marché ou de déclencher une crise systémique ; - le groupe de travail multidisciplinaire sur l'amélioration de la transparence, qui mène une étude pilote pour évaluer l'efficacité de la politique de diffusion d'information par les firmes financières (réglementées ou non), en application de propositions faites par le comité sur le système financier global, relevant de la Banque des règlements internationaux ; - l'International Swaps and Derivatives Association (ISDA), qui a publié son Panorama 1999 du collatéral. Dans cette publication, l'ISDA analyse l'impact des dysfonctionnements de marché observés en 1997 et 1998 sur les dispositifs de collatéralisation et émet des recommandations pour réduire le risque associé aux opérations de collatéralisation. - le groupe de cinq gestionnaires de hedge funds, qui a publié en février 2000 un document présentant des bonnes pratiques pour les gestionnaires de hedge funds. Ce recueil fait des propositions en matière de structure générale, contrôles internes, surveillance du risque, transparence et diffusion des informations ; - le fonds Tiger a également publié, de façon volontaire, un rapport présenté dans le cadre des réflexions du groupe de travail de la Présidence des États-Unis. Ce rapport propose une description très détaillée des méthodes de gestion du risque mises en _uvre chez Tiger. Le groupe de travail du Forum de stabilité financière a formulé dix recommandations susceptibles de réduire les risques inhérents à l'existence des hedge funds : la gestion du risque de contrepartie doit être renforcée pour les institutions se portant contrepartie des hedge funds ; la gestion du risque mérite d'être améliorée au sein même des hedge funds ; le contrôle des autorités sur les institutions accordant un crédit aux hedge funds doit être renforcé ; la proposition de modification des règles d'adéquation des fonds propres bancaires doit être soutenue car elle incitera les banques contreparties ou créditrices des hedge funds à mieux évaluer, donc maîtriser leur exposition à ces entités ; les efforts entrepris par l'industrie doivent faire l'objet d'une attention soutenue de la part du comité de Bâle et de l'OICV ; l'infrastructure de marché doit être améliorée, notamment en clarifiant la documentation entre les différents produits, les pratiques en matière de collatéral et les pratiques d'évaluation ; les hedge funds, comme les autres institutions financières, doivent augmenter leur transparence envers le public ; les autorités doivent intensifier la surveillance des marchés financiers dans la perspective d'y détecter plus tôt la constitution de leviers importants et l'apparition de mouvements susceptibles d'affecter la dynamique naturelle des marchés ; enfin, un code de bonnes pratiques devrait être établi pour les transactions récurrentes sur le marché des changes. Ces recommandations ont été entérinées par les ministres des finances du G 7, ce qui devrait leur donner un poids supplémentaire vis-à-vis de l'industrie financière et faire espérer une mise en _uvre assez rapide. Le plus intéressant dans les conclusions émises par le Forum de stabilité financière est ce qui n'y est pas... Le groupe de travail a, en effet, examiné la possibilité de recommander d'autres mesures, plus directrices, sans toutefois y donner suite. Il a ainsi écarté l'idée que l'on aurait pu imposer, dans le cadre de la révision programmée de l'accord sur l'adéquation des fonds propres, une exigence minimale en capital spécifique pour les banques prêtant à des fonds opaques. De même, le groupe de travail a jugé que des raisons pratiques comme « philosophiques » l'amenaient à écarter l'idée de soumettre les hedge funds à une réglementation directe. On touche là au c_ur de la réflexion sur la place que doivent occuper les hedge funds dans l'« écologie du système financier international », pour reprendre l'heureuse expression employée par M. Jean-Claude Trichet, gouverneur de la Banque de France. Est-il légitime de conserver des entités soumises à une réglementation très minimale, sous prétexte qu'elles ne sont ouvertes qu'aux investisseurs avertis ? C'est oublier que la réglementation ne sert pas qu'à protéger l'épargnant - motif légitime, mais inopérant en l'espèce. Les modes de fonctionnement de certains hedge funds ont exacerbé les inquiétudes et justifié les propositions de réglementation directe. Or il ne faut pas oublier que les hedge funds ne sont pas les seuls intermédiaires financiers à utiliser l'effet de levier. Certains opérateurs sur les marchés à terme, comme les plates-formes de négociation pour compte propre des grands établissements financiers, prennent également des positions très ouvertes sur les marchés. Certaines informations suggèrent que les leviers mis en _uvre sont parfois tout aussi importants que ceux observés chez les hedge funds très spéculatifs. Dans ces conditions, il est clair que le réflexe le plus sain pourrait consister à concentrer les efforts de la réglementation non pas sur les institutions, mais sur les activités qui s'appuient, à titre temporaire ou de façon beaucoup plus permanente, sur un effet de levier. On conçoit la difficulté de la tâche. C'est pourquoi votre Rapporteur pense qu'il convient de se ranger à la position exprimée par le Forum de stabilité financière : l'idée d'une réglementation directe est écartée jusqu'à nouvel ordre, mais reste « sur la table » et pourra être réexaminée si les progrès volontaires réalisés à l'initiative de l'industrie financière sont jugés insuffisants, voire n'empêchent pas une nouvelle crise du type de celle vécue à l'automne 1998. b) Les centres off shore sur la sellette Les centres dits off shore sont depuis quelques années l'objet de toutes les attentions de la part de la communauté internationale. La raison principale réside, semble-t-il, dans leur fiscalité légère et dans le faible degré de transparence qui est imposé au secteur financier. Ces deux caractéristiques font des centres off shore un lieu privilégié de recyclage de l'« argent noir » et des profits illicites de toutes sortes. Le rapport d'information (n° 1802) sur la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale déposé par M. Jean-Pierre Brard, député, au mois de septembre 1999, présente un panorama complet de cette question et détaille les stratégies nécessaires pour réduire à merci ces flibustiers de la finance. Conformément à la mission qui lui a été confiée par la Commission des finances, votre Rapporteur se limitera ici aux considérations qui touchent à la stabilité du système financier international. Le premier élément à prendre en compte est qu'un centre financier off shore n'est pas nécessairement situé sur quelque îlot tropical désireux de sortir du sous-développement : un nombre non négligeable de pays développés se sont efforcés d'attirer de grandes concentrations d'activités exercées par des non-résidents, en offrant des incitations économiques soit dans leur propre système juridique, soit en établissant des zones économiques spéciales. De même, il existe des centres off shore réputés qui appliquent avec détermination les principes de bonne supervision reconnus par la communauté financière internationale ; votre Rapporteur remarque, à ce titre, que les centres financiers de Hong Kong et de Singapour sont, dans une large mesure, des centres off shore régionaux pour la zone asiatique, sans que personne ne mette en cause la solidité générale de leur système financier ni le caractère réglementé des activités qui y sont exercées. Les analyses les plus complètes sur les centres off shore ont été fournies par le groupe de travail ad hoc constitué par le Forum de stabilité financière, qui a remis ses conclusions au mois d'avril 2000. Celui-ci estime que les centres off shore ne paraissent pas jusqu'ici avoir été la cause de problèmes financiers systémiques, mais ont été impliqués dans certaines crises. Alors que les systèmes financiers deviennent de plus en plus interdépendants, les difficultés susceptibles d'apparaître au niveau d'un centre off shore pourraient avoir des conséquences plus fortes qu'auparavant sur les autres centres financiers. Les centres off shore « problématiques », c'est-à-dire réticents à adhérer aux normes internationales de supervision, permettent aux acteurs des marchés financiers de s'engager dans une démarche d'« arbitrage réglementaire » et forment donc un maillon faible dans le système financier global. Ils favorisent également la complexité et l'opacité des structures d'entreprise et des transactions financières, alors que chacun s'accorde à reconnaître qu'une meilleure transparence est favorable à la stabilité. Comme les hedge funds, les centres off shore posent des problèmes touchant à la fois aux questions prudentielles et à l'intégrité des marchés : - les problèmes d'ordre prudentiel sont multiples : la facilité d'établissement peut se traduire par une structure du capital ou de la propriété de l'entreprise défavorable à une bonne supervision (y compris de la part de superviseurs étrangers). La réticence de certains centres à coopérer avec leurs homologues étrangers limite les échanges d'information et la capacité à vérifier celles-ci, qui sont nécessaires à une bonne compréhension des risques supportés par un établissement ou un groupe. La faiblesse des régimes juridiques de supervision ou des moyens matériels alloués aux autorités de supervision, dans certains centres, peut nuire à leur capacité opérationnelle, même si elles sont disposées à coopérer de bon gré avec leurs homologues étrangers. En définitive, la capacité des autorités locales ou étrangères à détecter les expositions au risque excessives et les faiblesses dans le systèmes de gestion du risque est sérieusement remise en cause ; - de même, la faiblesse du cadre juridique ou pratique de la supervision et de la coopération internationale nuisent à la détection et au traitement des opérations abusives effectuées sur les marchés, particulièrement les marchés de titres. Le Forum de stabilité financière a déterminé un cadre général visant à encourager les juridictions concernées à adhérer rapidement aux normes et principes acceptés au niveau international : - le Forum de stabilité financière a identifié certains standards dont l'adoption rapide par les centres off shore revêt un caractère prioritaire. Ces standards touchent à trois domaines : la coopération transfrontière, le partage d'information et la confidentialité ; les pouvoirs principaux des superviseurs locaux et les conditions pratiques de leur mise en _uvre ; l'identification des clients et la traçabilité des opérations financières. Parmi l'ensemble abondant des recueils de principes, normes et bonnes pratiques publiés par les instances intéressées à la stabilité financière (comme les ministres des finances du G 7, le comité de Bâle ou l'OICV), le Forum a identifié ceux des principes énoncés qui relèvent des trois domaines prioritaires évoqués ci-avant. Leur agrégation forme donc le « corps de doctrine » des actions d'urgence visant à normaliser les activités des centres off shore ; - le Forum de stabilité financière a déterminé les composantes d'un programme d'évaluation des « performances » des centres off shore au regard du corps de doctrine évoqué précédemment et a estimé que le FMI était l'instance la mieux placée pour exécuter ce programme d'évaluation, compte tenu de sa collaboration croissante avec la Banque mondiale sur les questions financières ; - enfin, le Forum de stabilité financière a proposé un ensemble d'incitations susceptibles de faciliter l'adhésion rapide des centres off shore aux règles et principes contenus dans le corps de doctrine prioritaire. A la suite d'une enquête effectuée après de 67 centres financiers (30 centres financiers importants et 37 centres accueillant un volume significatif d'activités off shore), le Forum a réparti ceux-ci en trois groupes, selon la qualité estimée de leur système juridique et leur détermination à coopérer avec leur homologues : - le groupe I rassemble les centres considérés comme coopératifs et exerçant une supervision de qualité : Hong Kong, Luxembourg, Singapour et la Suisse. Dublin, Guernesey, l'Ile de Man et Jersey sont placés sur une « liste complémentaire » par le Forum de stabilité financière, celui-ci estimant qu'il existe encore des zones de progrès dans leur système de supervision et leur politique de coopération ; - le groupe II rassemble les centres qui sont généralement perçus comme disposant d'une infrastructure juridique de supervision relativement convenable, qui pèche par une mise en _uvre très perfectible : Andorre, Bahrein, les Barbades, les Bermudes, Gibraltar, Labuan (Malaisie), Macao, Malte et Monaco ; - le groupe III rassemble les centres qui sont considérés comme exerçant une supervision de mauvaise qualité et manifestant des réticences certaines à coopérer : on y trouve des pays comme les îles Caïman, Panama, les Seychelles, les Antilles néerlandaises, St. Kitts et Nevis, le Vanuatu, le Costa Rica, le Liban, le Liechtenstein, etc. L'objectif affiché des incitations est de faire en sorte que les pays relevant du groupe II rejoignent rapidement le groupe I et que des pressions croissantes soient exercées sur les pays du groupe III qui ne montrent aucune volonté d'amender leur politique. Le système d'incitations proposé par le Forum de stabilité financière veut combiner souplesse et fermeté. Ainsi, les autorités des centres off shore se verraient demander de publier une déclaration solennelle affirmant leur volonté de rentrer dans le droit chemin, à partir de laquelle la communauté internationale pourrait surveiller les diligences législatives et réglementaires effectuées par l'État concerné pour se mettre en conformité avec ses intentions affichées ; si aucun progrès n'était enregistré, il conviendrait alors d'appliquer des sanctions de plus en plus sévères. En contrepartie, un État manifestant sa bonne volonté pourrait bénéficier d'une assistance technique de la part des institutions multilatérales ou de la part d'autres États. Certaines des incitations-sanctions envisagées par le Forum de stabilité financière sont effectivement sévères et graduées. Le Forum envisage par exemple que des États confrontés à des difficultés avec un centre off shore publient à l'attention de la communauté financière une « lettre d'avertissement », que la participation des représentants de centres off shore aux forums d'experts multilatéraux soit conditionnée à un respect minimum des règles recommandées par ces forums, que l'accès à un soutien financier accordé par les institutions multilatérales soit conditionné aux progrès enregistrés vers la « normalisation juridique » du centre off shore, etc. Enfin, le Forum de stabilité financière envisage que, dans les cas extrêmes, les gouvernements et autorités de supervision puissent en arriver à interdire toute relation financière avec des contreparties localisées dans des centres off shore. Cette dernière proposition, qui rejoint les positions françaises exprimées en septembre 1999 devant le FMI et le G 7, n'a pas été jusqu'ici officiellement retenue par la communauté internationale. Alors que les ministres des finances du G 7 avaient semblé adopter une position plutôt déterminée, lors de la réunion précédant le sommet des chefs d'État et de gouvernement de Cologne, en 1999 (38), ils se sont faits moins diserts, dans leur rapport concluant la préparation du sommet d'Okinawa, en juillet 2000. En effet, les ministres des finances se sont contentés d'endosser l'identification par le Forum de stabilité financière des centres off shore devant être examinés en priorité, de confier au FMI le soin de conduire l'évaluation de ces juridictions - comme le suggérait le Forum de stabilité financière - enfin, de demander instamment aux pays visés qu'ils démontrent solennellement leur engagement à remédier aux lacunes révélées (ou confirmées) de leur politique financière. On peut penser que le G 7 n'a pas voulu heurter inutilement les États nommément recensés dans les rapports du Forum de stabilité financière et qu'il a voulu leur offrir - conformément, d'ailleurs, à la philosophie développée par le Forum - un espace de liberté pour une « amende volontaire ». Cependant, votre Rapporteur estime qu'il faudra bien, le temps venu, affirmer la détermination de la communauté internationale et les moyens qu'elle entend déployer pour parvenir à ses fins. * * * Les chantiers ouverts par la réforme de l'architecture financière internationale sont donc nombreux. Leur complexité et la difficulté des problèmes qu'ils soulèvent conduisent à penser qu'ils ne seront pas fermés de sitôt. Cependant, on ne peut manquer de remarquer la prudence des actions entreprises pour réduire concrètement les zones d'ombre que sont la faible réglementation des hedge funds et les régimes financiers laxistes et non coopératifs mis en _uvre dans le « noyau dur » des centres off shore. L'impulsion réformatrice, qui manifeste la prise de conscience partagée des dérives observées au sein du système financier international, se heurte là aux deux principes structurants que sont la liberté économique et la souveraineté des États. Entre ces deux murailles, le chemin de la réforme est étroit et semé d'embûches. Il n'est donc pas étonnant que, pour l'heure, n'aient été retouchés qu'à la marge les piliers de l'architecture financière internationale, qui manifestent les choix collectifs des États et incarnent leur volonté d'articuler le bien public et la logique des marchés. C.- UNE NOUVELLE ARCHITECTURE FINANCIÈRE INTERNATIONALE : GRANDS ENJEUX ET PETITS PAS L'espace monétaire international est l'un des lieux où peuvent se rencontrer les attributs de souveraineté des États. La monnaie y perd le statut privilégié qu'elle détient sur le territoire national : elle fractionne l'espace des échanges, elle acquiert une valeur qui peut être comparée à celle de ses homologues, elle n'a plus de pouvoir libératoire pour éteindre les dettes. La confrontation mondiale conteste les souverainetés monétaires. Un système monétaire international remplit donc trois missions fondamentales : il détermine les conditions dans lesquelles peut s'effectuer l'échange mutuel des monnaies ; il doit permettre l'ajustement de la position extérieure des pays ; il doit assurer l'accès aux liquidités internationales. Mais l'accroissement de la taille des portefeuilles, la plus grande substituabilité entre actifs financiers et une mobilité mondiale des capitaux toujours plus importante ont fait du système monétaire international un appendice, une simple infrastructure des marchés internationaux de capitaux. Ainsi, la valeur des monnaies n'a plus qu'un lien distant avec l'état des transactions courantes. Le système financier international, qui assure la circulation de l'épargne entre les pays, dirige le système monétaire international. En retour, les perturbations du système monétaire dérèglent le fonctionnement du système financier : un technocrate dira que de tels dérèglements vont provoquer une mauvaise allocation du capital ; un politique dira qu'ils nuisent au processus de développement des pays qui en ont le plus besoin... Cette articulation intime entre système monétaire et système financier et la tension qui en découle entre principes de marché et principe de souveraineté, éclairent la timidité de la réforme entreprise et expliquent pourquoi elle n'a pas, jusqu'ici, apporté de réponse claire dans ces domaines clefs que sont la définition des régimes de change, l'usage éventuel de restrictions aux mouvements de capitaux et la place du FMI dans la régulation de la finance mondiale. 1.- L'équation impossible du « meilleur » régime de change Au Mexique comme en Asie, en Russie comme au Brésil, la crise financière est d'abord apparue sous la forme d'une crise de change. Après avoir longtemps fermé les yeux, les marchés ont condamné des régimes de change objectivement intenables. Les « bons docteurs » du système monétaire international, penchés au chevet du patient, ont rapidement jugé qu'il convenait de réfléchir à une meilleure gestion du change dans les pays émergents. Oubli ou silence délibéré ? La plupart se sont montrés beaucoup plus silencieux sur les responsabilités nouvelles qui pourraient incomber aux autorités gérant les trois grandes monnaies mondiales. a) La bipolarisation annoncée des régimes de change des pays émergents · Les investigations qu'a conduites votre Rapporteur ont montré un large consensus sur ce qui pourrait apparaître comme l'un des principaux messages adressés à la communauté financière par les événements de ces dernières années : la crise asiatique a démontré que les régimes de changes fixes faiblement soutenus par les facteurs fondamentaux étaient intrinsèquement dangereux. Un change fixe est adopté par les autorités d'un pays en référence à une devise directrice, sur laquelle doit être alignée la monnaie nationale : depuis Galilée, on sait bien que l'on ne peut être « fixe » que par rapport à quelque chose de bien défini. Ce choix est généralement fait pour des raisons commerciales : les échanges de biens et services avec le pays de référence sont suffisamment importants, en proportion du PIB, pour que les variations éventuelles du taux de change aient un impact prononcé sur l'activité ; la stabilisation du taux de change contribue donc à la stabilisation de l'activité et de l'emploi. De plus, elle procure une bonne visibilité aux investisseurs et peut favoriser, le cas échéant, les entrées de capitaux nécessaires à l'obtention d'une croissance durablement soutenue. Mais, dans les pays émergents, où les tendances inflationnistes sont, en général, plus vigoureuses que dans les pays industrialisés, la fixité du change provoque souvent une appréciation progressive du taux de change réel, c'est-à-dire corrigé de la différence entre les taux d'inflation respectifs des deux pays. La perte de compétitivité se traduit, à brève échéance, par l'apparition d'un déficit de la balance courante (39). Par ailleurs, la fixité de la parité de la monnaie érode la perception du risque de change, qui subsiste malgré l'engagement officiel des autorités. Cette illusion monétaire provoque des entrées de capitaux excessives, qui traduisent la montée d'un endettement à court terme prétendument indolore. Lorsque survient la crise, l'ajustement est d'autant plus violent que la dépréciation subie du taux de change augmente la charge des intérêts de la dette et le service de son principal (40). En fait, la crise asiatique a surtout mis en évidence les coûts associés à la gestion d'une parité fixe, donc les conditions nécessaires pour que ce choix de politique de change ne se résolve pas en crise à plus ou moins brève échéance. Selon une étude publiée en 1995 par MM. Obstfeld et Rogoff (41), seuls quelques pays ayant un degré élevé d'ouverture aux mouvements de capitaux ont pu maintenir pendant plus de cinq ans un régime de parité fixe. Trois ensembles de conditions paraissent devoir exercer une influence sur le caractère soutenable à long terme d'une parité fixe (42) : - l'intensité des relations entre le pays décidant de fixer la parité de sa monnaie et le pays de référence : cette intensité s'apprécie à travers l'importance des liens commerciaux, la similarité des chocs susceptibles d'affecter les deux pays, l'influence de la monnaie du pays de référence sur le système économique et financier de l'autre pays ; - la flexibilité de l'économie, qui doit concerner à la fois les marchés de biens et services (y compris le marché du travail) et la politique budgétaire ; paradoxalement, d'ailleurs, la forte flexibilité exigée du secteur productif et de la politique budgétaire est reflétée - en négatif - par la soumission totale de la politique monétaire du « petit » pays à la défense de la politique de change retenue ; - la capacité d'indifférence aux marchés internationaux de capitaux : sous cette appellation tout personnelle, votre Rapporteur place, au choix, un faible degré d'intégration dans le système financier international ou bien un montant « élevé » (43) de réserves de change (les deux n'étant évidemment pas exclusifs). Enfin, une parité de change fixe procure à l'économie cet « ancrage nominal » dont la théorie dit qu'il peut être une condition de stabilité des prix intérieurs et dont l'histoire indique qu'il prend souvent la forme d'un lien fixe avec un actif extérieur : or ou devise. Un taux de change fixe fournit une ancre nominale claire, simple, facile à mettre en _uvre et ne supposant pas d'infrastructure financière très développée. Le thème de l'ancrage nominal trouve toute son utilité au cas où le « petit » pays est confronté à une situation de trop forte inflation, voire d'hyperinflation. La condition de proximité avec le pays choisi comme référence monétaire, comme la condition de flexibilité passent alors au second plan : l'objectif premier est d'ancrer les anticipations d'inflation et d'appuyer sur la fixité de la « valeur externe » du pays les actions de flexibilité interne dont on espère qu'elles aboutiront à briser l'inflation et à rétablir des mécanismes économiques normaux dans la sphère réelle. En définitive, le choix d'une parité fixe est soit très vulnérable, soit très exigeant. C'est pourquoi rares sont les pays qui ont décidé de se donner les moyens de soutenir un taux de change fixe durable. La forme ultime de cet engagement - hormis l'union monétaire ou la dollarisation - débouche sur la création d'une « caisse d'émission » (currency board). Il s'agit d'un système de change par lequel les autorités s'engagent à échanger librement, à un cours déterminé par la loi, tout actif monétaire domestique contre la devise à laquelle est rattachée la monnaie nationale. Les systèmes de caisse d'émission, qui avaient été choisis par près de 40 États en 1960, n'étaient plus que 9 à la fin des années 1980. Leur nombre est remonté à une quinzaine à la fin des années 1990. On y compte, notamment, Djibouti (depuis 1949, lié au dollar), Brunei Darussalam (1967, dollar de Singapour), Hong Kong (1983, dollar), l'Argentine (1991, dollar), l'Estonie (1992, deutschemark puis euro), la Lituanie (1994, dollar), la Bulgarie (1997, deutschemark puis euro) et la Bosnie-Herzégovine (1997, deutschemark puis euro). Le système de caisse d'émission procure une crédibilité importante à la parité sur laquelle se sont engagées les autorités : le coût politique d'une modification serait très fort, d'autant que la définition de la parité de la monnaie est de la compétence du législateur. Selon le FMI, les caisses d'émission permettent aux pays qui adoptent ce système de connaître rapidement une convergence avec le taux d'inflation observé chez le pays avec lequel la monnaie nationale est liée. Elles permettent également une forte convergence des taux d'intérêt et la diminution sensible des écarts de taux avec ce même pays - ce qui est la conséquence logique de la crédibilité (en termes psychologiques) et de la disparition de la prime de risque de change (en termes techniques). Mais le régime de la caisse d'émission est encore plus contraignant que le simple change fixe. La garantie totale donnée à la parité de la monnaie nationale a trois conséquences : - la flexibilité de l'économie doit être très forte, y compris au plan salarial, car tout ajustement des conditions externes passe par le seul canal des taux d'intérêt ; - de même, le système bancaire doit être très robuste, afin de pouvoir supporter sans trop de dommages une hausse brutale et prononcée des taux d'intérêt en cas de tension sur la parité (par exemple, en cas d'attaque spéculative) ; - la robustesse exigée du système bancaire découle également de ce que l'autorité monétaire n'est pas une banque centrale et ne peut donc pas agir comme modérateur des fluctuations à court terme de taux d'intérêt (par l'intermédiaire des interventions sur le marché monétaire) ni accorder de crédit : il n'y a pas de prêteur national en dernier ressort. En régime de caisse d'émission, la garantie de la valeur du change repose sur un élément objectif : pour satisfaire à son obligation légale de conversion sans limite d'un actif monétaire domestique, l'autorité monétaire doit détenir des réserves de change suffisantes pour couvrir la masse monétaire en circulation dans l'économie. Cette obligation technique (44) a longtemps été interprétée comme devant se rapporter à ce que l'on appelle la « base monétaire », c'est-à-dire la monnaie émise par les institutions clef de voûte du système monétaire national (45) et même, dans une acception encore plus étroite, par la seule quantité de billets en circulation. Sachant qu'en fait, il existe des actifs non monétaires mais parfaitement liquides donc convertibles à tout instant en monnaie (46), il faudrait que les réserves de change couvrent l'intégralité des actifs quasi monétaires, ce qui n'est jamais le cas. Par exemple, en 1997, les réserves de change couvraient plus de 400% de la base monétaire, mais seulement 22,4% des actifs quasi monétaires à Hong Kong ; à la même date, les réserves de change couvraient 105% de la base monétaire, mais 21,3% des actifs quasi monétaires en Argentine (47). En ce sens, on peut dire qu'il n'existe actuellement aucun régime de caisse d'émission totalement « pur ». Votre Rapporteur doit enfin évoquer la solution extrême qui consiste à abandonner la monnaie nationale et à établir le cours forcé d'une devise sur le territoire national. A la suite de l'effondrement monétaire observé à partir de 1998 (48), l'Équateur a décidé de remplacer le sucre par le dollar, à compter du mois de septembre 2000. · Peu de pays réunissent les conditions nécessaires pour assurer la pérennité d'un régime de change rigide. D'ailleurs, au-delà des arguments théoriques, les crises de la deuxième moitié des années 1990 agissent comme un repoussoir efficace. De fait, le flottement de la monnaie nationale a trouvé un certain attrait dans les milieux académiques. Il est vrai que le Chili, le Mexique, le Pérou, l'Afrique du sud ou la Turquie semblent avoir bénéficié plutôt que pâti de leur régimes de change flexibles pendant les récentes crises internationales. Les chocs causés par les dépréciations monétaires des autres pays ont été assez aisément absorbés et les coûts associés à la rupture d'un régime de change fixe ont été évités. Mais les vertus d'un régime de change ne se limitent pas à son comportement durant une crise. En conditions normales, le régime de change flexible procure une plus grande autonomie à la politique monétaire. Cela étant, il faut faire justice de l'argument classique selon lequel cette autonomie est totale. Prenons le cas d'un pays, confronté à une croissance trop forte, qui souhaite ramener l'économie sur un sentier soutenable par le biais de la politique monétaire. Le relèvement des taux d'intérêt va se traduire par une appréciation de la monnaie vis-à-vis de celles de ses partenaires. Par le biais des échanges commerciaux, dont les prix relatifs varient, le pays concerné exporte son inflation chez ses voisins. Ceux-ci devront alors relever leurs taux d'intérêt pour lutter contre les tensions inflationnistes : les politiques monétaires des principaux partenaires restent liées, mais cette liaison est moins forte qu'en changes fixes. La raison principale pour laquelle le régime de change flottant attire à nouveau l'attention est que l'incertitude sur la valeur du taux de change limite l'intérêt de l'endettement en devises et tend à allonger l'horizon des investisseurs. Ce régime éviterait ainsi l'apparition des vulnérabilités fondamentales qui ont conduit à la crise. Mais cette médaille a son revers : l'incertitude sur la valeur du taux de change provoque, normalement, un renchérissement du financement extérieur, les investisseurs exigeant en sus de leur rémunération « normale » une prime de risque. Mais celle-ci ne représente-t-elle pas, en quelque sorte, une assurance - imparfaite - contre le risque de crise ? Examinant la question des régimes de change lors de deux réunions, en septembre puis en décembre 1999, le conseil d'administration du FMI a tenu à souligner deux points importants : - en premier lieu, bien qu'un « degré substantiel de flexibilité du change » soit souhaitable pour la plupart des économies émergentes, « des taux de change totalement libres ne seraient pas une option viable pour ces économies », dont « beaucoup, en pratique, pourraient vouloir utiliser des interventions ou la politique monétaire pour guider les évolutions du change » ; - la flexibilité des changes ne dispense pas l'économie de mettre en _uvre un ancrage nominal. Puisque la valeur de la monnaie ne peut se rattacher à une ancre externe, le pays doit impérativement définir un cadre interne permettant de définir la valeur de la monnaie. Il lui faut donc déterminer un objectif monétaire - portant, au choix, sur un agrégat monétaire ou sur la valeur objectif de l'inflation - et assurer à la banque centrale l'indépendance opérationnelle nécessaire. Il est aussi indispensable d'établir le cadre intellectuel, statistique et comptable permettant de faire des prévisions d'inflation fiables et d'apprécier la situation conjoncturelle, ce qui n'est pas acquis dans de nombreux pays. · Après la crise asiatique - qui a mis en avant avec encore plus de force que la crise mexicaine la problématique des taux de change - le consensus économique avait condamné les pays émergents à n'avoir le choix qu'entre deux solutions dites « en coin » : dans l'un des coins, les régimes de change flexible, dans l'autre les régimes de change fixe. L'analyse sommaire des vertus et limites de ces deux solutions polaires, présentée par votre Rapporteur, suggère que les destins monétaires ne sont pas si tranchés et que les « solutions bancales » évoquées par MM. Davanne et Bergsten restent valables (49) : - la mise en _uvre des solutions « en coin » sous leur forme la plus pure entraîne des coûts élevés, que seuls certains pays peuvent supporter (50) ; dès lors que les solutions deviennent « impures », c'est-à-dire que le flottement n'est pas totalement libre ou bien que la fixité est ajustable ou révisable, il s'agit de régimes que l'on peut qualifier d'intermédiaires ; - le succès des solutions en coin repose en fait sur leur crédibilité, qui résulte, dans un cas comme dans l'autre, de la simplicité et de la clarté du régime de change retenu, mais surtout de la crédibilité et de l'efficacité des politiques macroéconomiques et structurelles qui sont mises en _uvre par les pouvoirs publics. Le même phénomène peut tout à fait s'appliquer aux solutions intermédiaires de change. Plus fondamentalement, votre Rapporteur s'étonne que l'on puisse ainsi affirmer que seules deux solutions aussi diamétralement opposées sont viables, alors que l'économie est, par excellence, un monde de compromis. Dans cette perspective, M. Davanne a proposé, dans deux récents rapports rédigés pour le compte du Conseil d'analyse économique, que les pays émergents mettent en _uvre un système de « parités de référence ajustables » organisé autour des éléments suivants : - la parité de la monnaie, définie sur la base d'un panier de devises représentatif de l'exposition extérieure du pays, serait ajustée à intervalles réguliers : « plutôt que de fixer le taux de change lui-même, il s'agit en fait de « fixer une méthode » permettant d'ajuster de façon régulière le taux de change en ligne avec l'évolution des fondamentaux économiques » (51) ; - en cas d'activité économique trop soutenue, le durcissement des conditions monétaires devrait pouvoir reposer en partie sur une appréciation du taux de change au-dessus de sa parité de référence, dans la mesure où la politique budgétaire ou les autres instruments de la politique économique semblent inadaptés aux circonstances du moment ; - la réponse à une pression à la baisse sur le taux de change devrait reposer sur un mécanisme « crédible, transparent et progressif » : s'il apparaît que la parité de référence ne correspond pas à l'état des fondamentaux, l'option d'un réajustement devrait être envisagée sans tabou ; si, au contraire, la parité de référence paraît correctement fixée, alors les autorités auraient intérêt à mettre en _uvre un mécanisme de défense souple, similaire à celui utilisé par la Banque de France de l'été 1993 au printemps 1995. Ces propositions sont intéressantes et méritent donc d'être étudiées de façon plus approfondie. En tant qu'elles conservent une dimension purement nationale à la gestion de la monnaie, elles ne doivent cependant pas faire perdre de vue que les « solutions bancales » ont aussi la vertu d'être les régimes de change les mieux adaptés à la coopération monétaire régionale et à la construction d'une identité monétaire régionale. Sur ces questions délicates, le FMI reste très prudent et se retranche, peut-être abusivement, derrière l'article IV de ses statuts, qui prévoit que la définition du régime de change est du ressort de chaque État membre. Il en est de même au regard de l'articulation des taux de change des trois grandes monnaies mondiales. b) Un consentement résigné au flottement · Présentant son appréciation sur le choix d'un régime de change dans le cadre de la réforme de l'architecture financière internationale, le conseil d'administration du FMI estimait qu'« il est vraisemblable que le système existant de change flexible entre les trois grandes monnaies continuera. De ce fait, les pays doivent s'adapter à un environnement global marqué par la variabilité des changes. Les désalignements importants et la volatilité des principales monnaies sont un sujet de préoccupation, principalement pour les économies petites, ouvertes et exportatrices de matières premières. La surveillance exercée par le FMI doit prendre en compte pleinement les effets de débordement des politiques macroéconomiques et structurelles dans les pays émetteurs des principales monnaies » (52). La problématique générale des taux de change entre le dollar, l'euro et le yen est brossée ici en quelques phrases, en quelques mots : flexibilité, volatilité, désalignements, conséquences néfastes sur des pays fragiles. L'appréciation portée par le Fonds sur les désalignements des changes entre les trois grandes monnaies est particulièrement intéressante. En effet, une fluctuation des taux de change ne signifie pas nécessairement qu'il existe un désalignement entre ces taux. D'ailleurs, évoquer un désalignement suppose de faire référence à un taux de change considéré comme normal, voire à une fourchette de change, qui puisse tenir compte, par exemple, de la position différente des pays dans le cycle économique. On conçoit tout l'intérêt qu'il y aurait à pouvoir identifier l'apparition d'un désalignement et à quantifier précisément son amplitude. Mais il existe de nombreuses pistes envisageables, qui paraissent mener à des destinations différentes : - certaines analyses sont fondées sur la comparaison de prix et de coûts entre les deux pays concernés. La théorie de la « parité des pouvoirs d'achat », énoncée dans les années vingt, définit le taux de change d'équilibre comme celui qui égalise le niveau des prix entre deux pays. D'autres théories dépassent le cadre de l'équilibre de la balance des paiements courants pour définir le taux de change d'équilibre comme celui qui rend soutenable la balance des paiements courants. On peut aussi passer par la comparaison des coûts salariaux. Votre Rapporteur citera enfin pour mémoire la « burgernomie », branche nouvelle de la science économique dont l'objet principal consiste à comparer le prix d'un hamburger dans différents pays et à en tirer une conclusion sur le niveau du taux de change d'équilibre ; au-delà de l'anecdote, le fondement théorique de cette approche se fonde sur le caractère universel de la fabrication de ce bien et l'identité de son processus de production dans tous les pays (53) ; - d'autres approches font intervenir de façon plus explicite les facteurs financiers. Ainsi, M. Davanne a pu analyser la corrélation entre l'évolution de la parité dollar - deutschemark entre 1975 et 1998, pour conclure qu'elle semble correctement représentée par l'évolution de l'écart de taux d'intérêt réel entre les États-Unis et l'Allemagne. La première difficulté est qu'il apparaît difficile de déterminer numériquement le taux de change d'équilibre (54) à un instant ou sur une période donnée. La deuxième difficulté est que le taux de change varie « naturellement » en fonction de la position relative des pays dans le cycle économique : il est patent que l'évolution de la parité du dollar depuis la création de l'euro est due, pour une part, au dynamisme surprenant de l'économie américaine alors que les perspectives de la zone euro paraissaient moins favorables. La troisième difficulté est qu'il convient d'interpréter le « résidu » non expliqué dans le cadre théorique proposé : ce résidu provient peut-être d'une sophistication insuffisante du modèle et pas nécessairement d'un désalignement des parités. · Devant tant d'incertitudes, on doit s'étonner de la régularité avec laquelle les ministres des finances du G 7 parviennent à se faire une opinion si arrêtée sur l'évolution des taux de change et l'opportunité d'adresser un signal au marché... Lors de leurs réunions trimestrielles, les ministres des finances du G 7 consacrent une partie de leur emploi du temps à l'examen des taux de change. Lorsque la situation paraît normale, le communiqué final indique que « [les ministres] ont réaffirmé qu'ils maintiendront une forte coopération pour promouvoir la stabilité du système monétaire international et pour que les taux de change entre les principales monnaies soient en accord avec les données fondamentales ». En revanche, les ministres des finances du G 7 ont repris à leur compte le concept de désalignement ou de déviation par rapport aux fondamentaux et l'utilisent lorsqu'ils estiment que la situation le nécessite. Ainsi, à l'issue de leur réunion du 20 février 1998, les ministres déclaraient que : « les taux de change doivent refléter les données économiques fondamentales et la volatilité excessive comme les déviations significatives par rapport aux données fondamentales sont indésirables. Nous avons insisté sur le fait qu'il est important d'éviter les dépréciations excessives qui pourraient aggraver des déséquilibres externes importants. Dans cette perspective, nous soutenons les efforts appropriés entrepris par le Japon visant à stimuler une croissance tirée par la demande interne et réduisant les déséquilibres extérieurs, corrigeant de ce fait la dépréciation excessive du yen. Nous continuerons à surveiller les développements sur les marchés des changes et à coopérer de façon appropriée ». Après que le même message a été répété à la réunion suivante, on sait que la Banque du Japon et la Réserve fédérale sont intervenues à l'été 1998 pour stopper la chute du yen. La surveillance trimestrielle exercée dans le cadre du G 7 conduit donc, le cas échéant, à des actions visant à adresser des signaux aux marchés des changes, par le biais d'interventions ou de tout autre moyen de la politique monétaire. Faut-il aller plus loin et proposer, comme MM. Olivier Davanne et Fred Bergsten, la mise en place d'une surveillance renforcée fondée sur des bases objectives, ou tout au moins plus lisibles ? Faut-il se contenter de ce qui semble être, vu de l'extérieur, un pilotage subjectif ? Faut-il, au contraire, s'engager dans la mise en place de « zones cibles » pour la parités des trois grandes monnaies ? Le thème des zones cibles a été développé au milieu des années 1980, dans le contexte d'une forte hausse du dollar, conclue en février 1985 avec une formidable bulle spéculative. Définir une zone cible consiste à déterminer une grille de parités de référence, assortie de marges de 10% ou 15% entre lesquelles peuvent se développer les forces du marché. Une réaction des autorités est souhaitable ou quasi obligatoire lorsque les parités effectives s'approchent des limites de fluctuations. Si, en septembre 1985, l'accord du Plaza visait à encadrer la baisse du dollar - déjà engagée sur les marchés quelques mois auparavant - pour en faire un processus ordonné, l'accord du Louvre (février 1987) a été la première tentative de création de zones cibles. Mais les perturbations financières de l'automne 1987 et la réaction des autorités monétaires qui s'ensuivit ôtent une grande partie de leur pertinence aux commentaires qui pourraient être établis à partir de cette brève tentative. L'arrivée du Chancelier G. Schröder à la tête du gouvernement allemand, en 1997, a permis à M. Oskar Lafontaine, alors ministre des finances, de remettre les zones cibles au c_ur du débat public. Depuis, l'idée resurgit périodiquement. Dans le deuxième rapport sur les questions financières internationales rédigé au nom du Conseil d'analyse économique, MM. Davanne et Bergsten émettent le souhait que la surveillance du G 7 s'exerce sur la base d'une appréciation d'un taux de change d'équilibre et des déviations par rapport à ce taux, compte tenu des facteurs conjoncturels et financiers susceptibles d'expliquer en partie ces déviations. « Un tel processus de « surveillance renforcée » constitue un préalable pour le nécessaire renforcement du processus de coordination internationale des politiques économiques » (55). Par ailleurs, MM. Davanne et Bergsten visent à ce que, sur la base de cette surveillance, le G 7 mette en place ultérieurement des zones cibles « muettes », c'est-à-dire non portées à la connaissance du public, mais sans engagement strict des autorités à défendre les limites de fluctuation. Les zones cibles « flexibles » (sans engagement ferme, mais avec publication de l'accord) et, a fortiori, les zones cibles « dures » (engagement strict de défendre les marges de fluctuation, portées à la connaissance des marchés) sont présentées comme relevant de perspectives beaucoup plus lointaines. En fait, MM. Davanne et Bergsten estiment qu'il n'est pas possible, à l'heure actuelle, de fixer des règles préétablies permettant de fonder la coordination des actions de politique économique qu'il conviendrait d'adopter pour corriger d'éventuels désajustements de change. La surveillance renforcée doit donc être considérée comme une solution de repli, en attendant que la « conscience coopérative » des trois grandes économies mondiales soit suffisamment développée pour envisager des actions communes, qui, par définition, devront arbitrer entre le bien être national et le bien être international. Face au même constat, M. Jean Pisani-Ferry, maître de conférences à l'École polytechnique, propose de sortir de cette impasse, non pas par le bas mais par le haut. Ainsi, pour M. Pisani-Ferry, la coordination entre les trois grandes économies mondiales n'est possible que si elle est séparée de ce qui a été son support privilégié jusqu'ici : la gestion des taux de change. Découpler gestion des changes et coopération économique serait la seule voie ouverte pour développer un système de pré-pilotage des politiques économiques. Votre Rapporteur estime qu'il convient d'appuyer la proposition prévoyant d'intégrer au processus de surveillance du G 7 un facteur d'objectivation des débats, dans le cadre du concept de « surveillance renforcée » développé par MM. Davanne et Bergsten. Pour le reste, il sera difficile d'aller plus loin : une trop forte stabilisation des taux de change pourrait aller à l'encontre des fluctuations inhérentes au cycle économique comparé des grandes monnaies ; elle transférerait vraisemblablement sur le marché des capitaux la volatilité observée sur le marché des changes ; elle subordonnerait de façon trop mécanique la préservation de l'objectif interne (la valeur de la monnaie par rapport aux biens et services nationaux) à l'objectif externe (la valeur de la monnaie sur les marchés des changes) ; enfin, elle ferait resurgir la problématique du « partage du fardeau » pour réaliser l'ajustement en cas de dérèglement. Déjà, en 1974, le Comité des Vingt avait vu ses débats entravés par l'impossibilité de trouver un terrain d'entente entre Américains, Japonais et Allemands sur la question de la répartition de l'ajustement monétaire entre pays structurellement déficitaires et pays structurellement excédentaires. De même, après 1979, le fonctionnement du système monétaire européen avait rapidement dérivé vers une asymétrie vertueuse mais bien peu coopérative, l'essentiel de l'ajustement reposant sur les pays ayant des difficultés à maîtriser leur inflation. Surveiller l'évolution des taux de change sur la base d'une évaluation quantitative objective, réalisée notamment par le FMI, constitue une tâche déjà suffisamment ambitieuse. Avant de prétendre mettre en _uvre des zones cibles, qui supposent une véritable volonté de coopérer au-delà de l'intérêt propre de chaque pays, il convient certainement de pratiquer quelque temps certains apprentissages élémentaires. D'ailleurs, le temps n'est peut-être pas si loin où l'on pourra évoluer sans heurt au-delà de la simple surveillance. Les zones cibles sont encore aujourd'hui un concept dérangeant ; elles pourraient cependant connaître le sort d'autres concepts dérangeants - notamment au regard des mouvements de capitaux - qui, décriés hier, reviennent aujourd'hui timidement sur le devant de la scène. 2.- La maîtrise des mouvements de capitaux : un retour en grâce trop timide des solutions hétérodoxes La vulgate libérale fait de la libéralisation des mouvements de capitaux le socle de la prospérité et la condition préalable à une bonne allocation internationale des ressources. Il est vrai que la rationalité économique voudrait que l'on favorise le placement de l'épargne excédentaire des pays industrialisés dans les pays moins développés, où le rendement du capital doit être supérieur puisque l'économie y est moins mature et que les besoins des populations sont plus importants. Mais c'est oublier trop vite que les capitaux laissés en liberté ont, en général, une fâcheuse tendance à aller et venir et que les marchés voient leur efficience supposée souvent prise en défaut. Les « mésallocations » de l'épargne mondiale sont peut-être aussi importantes et certainement plus fréquentes que les investissements véritablement judicieux et utiles. Ainsi, dans la première moitié des années 1990, les pays émergents les plus ouverts ont été confrontés à des entrées rapides de capitaux, qui ont développé des pressions inflationnistes et contraint l'orientation des politiques monétaires. En revanche, après la crise mexicaine, les inquiétudes se sont aggravées sur la possibilité que les capitaux à court terme ne cherchent subitement à sortir des frontières nationales. Ces inquiétudes se sont malheureusement traduites dans les faits pour un certain nombre de pays émergents. Ce n'est donc pas le moindre paradoxe de la libéralisation financière que d'avoir presque aussitôt généré ses anticorps, à travers un regain de la réflexion sur les moyens de maîtriser les mouvements de capitaux - ce que les économistes appellent « gérer le compte de capital » de la balance des paiements - mais surtout à travers la multiplication d'expériences dont certaines ont acquis valeur d'exemple. a) L'expérience chilienne a suscité un intérêt marqué Le succès du programme d'ajustement entrepris par les autorités chiliennes à la suite de la grave crise bancaire de 1982 a conduit, en 1989, à une activité économique trop soutenue. Le resserrement des taux d'intérêt décidé pour combattre la surchauffe est intervenu en même temps que les taux d'intérêt baissaient ailleurs dans le monde. Conjugué à une amélioration du sentiment du marché envers le Chili et à un nouvel appétit de crédit en direction de l'ensemble des pays émergents, ce phénomène a conduit à de fortes entrées de capitaux à partir de 1989. Le problème que devaient résoudre les responsables de la politique économique venait de ce que le relèvement des taux d'intérêt nécessaire pour rétablir l'équilibre interne était incompatible avec une appréciation de la monnaie, qui aurait fait replonger la balance courante dans le déficit. De plus, la politique d'assainissement budgétaire venait tout juste d'être lancée et ne disposait guère de marges de man_uvre pour un resserrement. En sens inverse, une politique de stérilisation des entrées de capitaux aurait contrecarré l'effort d'assainissement budgétaire. Pour sortir de l'impasse, les autorités chiliennes décidèrent en juin 1991 d'imposer sur l'endettement étranger une obligation de constituer des réserves non rémunérées, portant sur 20% des montants empruntés à l'exception des crédits commerciaux, dans la même devise que celle de l'instrument de dette. Les réserves non rémunérées agissent comme une taxe implicite sur le volume de l'endettement. Cette obligation a ensuite été ajustée : - pour concerner des opérations financières qui, bien que n'étant pas un flux de dette, étaient devenues un moyen d'investir des capitaux à court terme. La quasi totalité des mouvements de capitaux a fini par être couverte par la taxe implicite, à l'exception des crédits commerciaux et des investissements directs ; - pour augmenter le coût de la taxe implicite et renforcer son efficacité ; en mai 1992, par exemple, la proportion de réserves obligatoires a été portée à 30% du montant de l'opération d'endettement. A compter du mois de janvier 1995, les réserves obligatoires devaient être constituées en dollars seulement ; - pour alléger certaines contraintes, concernant, notamment, la duration des opérations d'endettement visées, la complexité et le coût administratif du contrôle. Face aux effets de la crise asiatique et de ses répercussions, le taux de réserves obligatoires a été ramené à 10% en juin 1998, puis l'obligation de réserves non rémunérées a été suspendue en septembre 1998. Comme l'indique Mme Sylvie Hel-Tellier, chargée de mission au Conseil d'analyse économique, « la non-rémunération de ces dépôts s'apparentait à une forme de taxation des entrées de capitaux. Elle était au départ conçue pour décourager les emprunts à court terme sans affecter les investissements étrangers à long terme. Avec cet instrument, la Banque centrale pénalisait les investisseurs cherchant à bénéficier des différentiels de taux d'intérêt et à spéculer sur l'évolution du cours du change ; en même temps, elle essayait de nuire le moins possible aux flux à long terme qui a priori sont associés à d'autres objectifs que la spéculation. [...] L'introduction de l'obligation d'une réserve non rémunérée sur les crédits externes était également motivée par des considérations de nature prudentielle : la mesure devait décourager le crédit externe à court terme sans affecter les investissements directs étrangers et favoriser le financement des entreprises par augmentation de capital plutôt que par endettement » (56). L'efficacité du système chilien de réserves obligatoires a provoqué de nombreuses analyses et un débat intense. En fait, la détermination des performances ou des faiblesses de ce genre de dispositif se heurte à l'impossibilité d'effectuer une comparaison avec la situation « test » où le dispositif en question n'existerait pas. En tout état de cause, l'impact économique des contrôles instaurés au Chili paraît limité et temporaire : - les variables macro-économiques semblent avoir été peu influencées par le dispositif de réserves non rémunérées : les économistes n'ont pas eu de preuve convaincante que le différentiel de taux d'intérêt avec les partenaires commerciaux et financiers se soit accru, libérant ainsi des marges de man_uvre pour la politique monétaire ; les flux totaux de capitaux ont été peu affectés, sauf un effet temporaire effacé au bout d'un an ; la plupart des études concluent enfin à l'indifférence du taux de change réel à la mesure décidée en 1991 ; - l'effet le plus important du système de réserves semble porter sur la composition des flux de capitaux, bien que les opinions des économistes restent très diverses. Il est vrai que des modes de contournement des contrôles ont certainement été mis en place, comme peut le suggérer l'augmentation sensible du poste « erreurs et omissions » de la balance des capitaux à chaque mesure de renforcement du dispositif. Ce qui est surprenant dans le débat sur le système chilien de contrôle des entrées de capitaux est que, malgré l'absence de preuves claires, évidentes et incontestables de leur efficacité, la certitude s'est progressivement répandue que le dispositif avait effectivement atteint son rôle, tout au moins partiellement. Votre Rapporteur ne saurait, évidemment, se substituer aux économistes chevronnés dont le métier est de traquer les corrélations au c_ur de la statistique, puis d'en inférer des causalités ou de tester la vraisemblance d'hypothèses déterminées. Il y a néanmoins quelque chose de troublant dans ce consensus croissant autour d'une certitude scientifique « molle ». Ainsi, l'expérience chilienne, bien qu'elle ne soit pas unique (57), a peut-être contribué à faire tomber un tabou sur le caractère « politiquement incorrect » des contrôles des capitaux. b) L'expérience malaisienne a jeté le trouble chez les détracteurs des contrôles sur les sorties de capitaux Un autre tabou est peut-être tombé grâce à l'action résolue - et perturbatrice - décidée par la Malaisie en septembre 1998. Alors que des sorties de capitaux substantielles étaient déjà intervenues et que les réserves s'étaient stabilisées à un niveau très inférieur à celui prévalant avant le déclenchement de la crise, les autorités ont introduit, à compter du 1er septembre 1998, un ensemble de contrôles sur les mouvements de capitaux qui a déclenché l'étonnement et l'inquiétude des milieux financiers. Parallèlement, le gouvernement décidait de fixer à 3,8 ringgits pour un dollar le taux de change de la monnaie nationale, qui est resté le même jusqu'à ce jour. Le dispositif très strict mis au point par le gouvernement malaisien s'organisait autour de deux axes : - supprimer la spéculation sur le ringgit grâce à l'élimination du marché off shore de la monnaie nationale. A cette fin, des limites ont été imposées aux exportations et importations de ringgit par les résidents et les non résidents, les banques malaisiennes se voyaient interdire de conduire certaines opérations financières avec les banques non résidentes, tous les ringgits détenus hors du territoire national devaient être rapatriés dans un délai d'un mois, les résidents étaient soumis à une interdiction totale d'accorder des facilités de crédit en ringgit aux banques correspondantes non résidentes et aux sociétés de bourse non résidentes, etc. - réduire les canaux ouverts aux sorties importantes de capitaux par des résidents ou des non résidents, notamment à travers l'introduction d'une période de douze mois avant que les non résidents ne puissent convertir en devises les sommes tirées de la vente d'actions sur la bourse de Kuala Lumpur ainsi que de tout avoir financier. Les entreprises étrangères souhaitant convertir leurs profits en devises pour les rapatrier devaient obtenir une autorisation de la banque centrale. En revanche, les flux liés aux investissements directs étaient exclus du champ des contrôles, ainsi que les intérêts, dividendes, droits et commissions divers. L'objectif premier du dispositif rigoureux ainsi défini était de redonner une marge de man_uvre à la politique monétaire afin d'abaisser les taux d'intérêt sans préjudice pour la parité du ringgit vis-à-vis du dollar, tout en empêchant les investisseurs étrangers de rapatrier leurs capitaux et d'assécher ainsi le financement de l'économie. Un assouplissement du contrôle des sorties de capitaux a été décidé en février 1999. Les contrôles quantitatifs, conçus pour la situation d'urgence qui prévalait au mois de septembre précédent, ont été remplacés par une taxation des transactions. La règle interdisant le rapatriement des investissements de portefeuille ainsi que des profits pendant une période de douze mois a été supprimée au bénéfice d'un système de taxation graduée, fonction de la date d'entrée des capitaux et de la durée de leur séjour en Malaisie. Enfin, en février puis avril 1999, les investissements immobiliers et les investissements effectués sur le marché boursier ouvert aux entreprises de haute technologie ont été exclus du champ de la taxation graduée (58). Le dispositif de contrôle des capitaux semble avoir rempli ses objectifs : le marché off shore du ringgit a effectivement été annihilé, empêchant ainsi toute spéculation contre la monnaie ; les sorties de capitaux ont été bien contenues. Parallèlement, le gouvernement a abaissé les taux d'intérêt et a ainsi évité d'aggraver la crise des bilans, notamment dans le secteur bancaire. Il s'est également engagé dans une politique macroéconomique jugée crédible, bien que le budget ait parfois été mis à contribution. Surtout, le gouvernement a lancé sans trop de retard la restructuration des secteurs bancaires et productifs et a ainsi contribué à asseoir la crédibilité de l'ensemble de sa politique économique auprès de la communauté économique et financière internationale. La plupart des observateurs s'accordent à penser que l'efficacité du système de contrôle résulte de plusieurs facteurs : son caractère extensif, qui lui faisait couvrir pratiquement tous les lieux de « fuites » de capitaux hors du pays ; une mise en _uvre stricte par un secteur bancaire discipliné, sous l'égide de la banque centrale ; le niveau adéquat des réserves de change ; l'état relativement acceptable des fondamentaux économiques lorsque les contrôles ont été mis en place ; la sous-évaluation du ringgit après que les autres monnaies de la région se furent mises à remonter ; le retour général de la confiance pour la zone asiatique. Après avoir été plus que fraîchement accueillie par les investisseurs, l'expérience engagée par la Malaisie a été considérée peu à peu avec un autre regard. Il est notable, en particulier, que la position du FMI, traditionnellement défavorable aux contrôles de capitaux, a évolué assez rapidement. Sans en arriver à se lancer dans un éloge appuyé de la politique poursuivie par la Malaisie en septembre 1998 puis février 1999, le conseil d'administration fait désormais part des différences d'appréciation qui existent entre ses membres sur la question des contrôles de sorties de capitaux. Le Fonds admet aujourd'hui explicitement que « les contrôles de capitaux ne peuvent pas se substituer à des politiques macroéconomiques saines, même s'ils peuvent procurer un espace de répit pour des actions correctrices » (59). Même si le conseil d'administration juge bon de rappeler les principales objections que l'on peut opposer aux contrôles des capitaux (60), il reconnaît cependant que l'« espace de répit » ouvert par les contrôles de capitaux n'est pas nécessairement étroit : « la marge de man_uvre que les contrôles de capitaux peuvent offrir à la politique économique a été très variable entre les différents pays, reflétant un grand nombre de facteurs comme le degré de flexibilité des changes, le niveau de développement des marchés financiers, la qualité des politiques prudentielles [vis-à-vis du secteur bancaire] » (61). Votre Rapporteur estime que l'expérience de la Malaisie a eu le grand mérite de remettre en cause la diabolisation des contrôles sur les sorties de capitaux, indépendamment de sa contribution à la gestion de la crise dans ce pays précis. Pour autant, il n'est pas question ici de faire l'apologie du contrôle en général, qui trop souvent a pu servir à masquer une absence de volonté politique et l'incapacité de traiter au fond les problèmes ayant provoqué la crise. Votre Rapporteur insiste sur le fait qu'un contrôle sur les sorties de capitaux ne se conçoit que comme un expédient provisoire : il doit s'insérer dans un ensemble cohérent de décisions de politique économique, dont il éclaire la finalité et dont il permet la mise en place. Un bon contrôle des capitaux se doit d'être un modèle de discrétion : il lui faut s'effacer lorsque son temps est passé... c) Promouvoir l'instauration de la taxe Tobin : un signe politique Il semble que toute communauté financière ait besoin d'une figure repoussoir, d'un symbole d'adversité à travers lequel peut se rejouer le drame éternel de la lutte entre le Bien et le Mal. Pendant longtemps, les contrôles de capitaux ont joué ce rôle. Leur retour en grâce, plus ou moins accepté, plus ou moins rapide, propulse sur le devant de la scène la taxe Tobin, qui devient ainsi l'un des concepts les plus sulfureux et les plus passionnels de la finance internationale. Proposée par M. James Tobin en 1971, puis précisée en 1978, la taxe Tobin peut être présentée comme un impôt à très faible taux prélevé sur toutes les transactions de change. L'objectif d'une telle taxe est double : - il s'agit, d'une part, de pénaliser la spéculation de très court terme, dont beaucoup d'économistes pensent qu'elle est déstabilisante car incapable d'intégrer les facteurs fondamentaux de l'échange, qui exercent une force de rappel lorsqu'un prix s'écarte de sa valeur d'équilibre ; - il s'agit, d'autre part, d'isoler les espaces monétaires nationaux et de redonner ainsi un espace d'autonomie à la politique monétaire. En effet, l'imposition d'une taxe sur les échanges de devises limite l'intérêt des arbitrages visant à profiter d'un différentiel de taux d'intérêt. Ultérieurement, la proposition initiale de M. Tobin a été enrichie en y intégrant une dimension humaine : le produit de la taxe aurait servi à financer les politiques d'aide au développement. Le débat sur l'instauration de la taxe Tobin a été vivement relancé ces dernières années, en France comme en Europe, autour de l'action de comités comme l'Association pour une taxation des transactions financières pour l'aide aux citoyens (ATTAC), créée en juin 1998. Depuis 1998, d'ailleurs, le Parlement est devenu l'une des enceintes où peut se développer le débat sur la taxe Tobin, à travers la discussion de nombreux amendements, déposés notamment dans le cadre des projets de lois de finances. Pourtant, l'idée de la taxe semble d'autant plus vivement défendue par les uns qu'elle est farouchement critiquée par les autres : - la taxe se tromperait d'objet, la spéculation la plus dangereuse sur les devises étant celle qui conduit à la rupture des taux de change fixes, donc à des variations de parités de plusieurs points, voire plusieurs dizaines de points de pourcentage ; - les spéculations de change les plus dangereuses pour les populations frappent, en général, les monnaies des pays émergents ; or celles-ci ne représentent qu'une part infime du total des transactions de change enregistrées dans les statistiques établies par la Banque des règlements internationaux ; - les transactions de change, même dénouées à échéance de deux jours, ne sont pas nécessairement à vocation spéculative : les marchés jouent pleinement leur rôle d'intermédiaire en recherchant, par tâtonnement, la contrepartie finale d'un vendeur de devise, ce qui nécessite de multiples transactions ; - même à très faible taux, la taxe représenterait un coût important pour les établissements teneurs de marché... et leurs clients. Les marges d'intermédiation réalisées sur les transactions de change sont, en général, de 0,02% pour les échanges réalisés entre teneurs de marchés et trois à quatre fois supérieures pour les transactions réalisées entre un teneur de marché et un autre établissement financier. De plus, les écarts de prix acheteur-vendeur sont très étroits : une taxe au taux de 0,05% serait équivalente, en ordre de grandeur, aux écarts de prix, donc assècherait totalement la liquidité du marché ; - il existe de grandes incertitudes sur le « lieu » où est réalisée la transaction, donc sur la législation applicable, la nature du collecteur de la taxe, l'identification parfois de la contrepartie, etc. L'avènement de marchés entièrement électroniques devrait encore compliquer la donne ; - enfin, à l'évidence, la « taxe Tobin dans un seul pays » conduirait à transférer les activités de change vers d'autres cieux plus cléments. Pour autant, votre Rapporteur voudrait minimiser d'emblée la portée de cet argument. Les principales places financières actives en matière de change sont Londres (32% des transactions totales en avril 1998), New York (18%), Tokyo (8%), Singapour (7%), puis Francfort, Paris, Zürich et Hong Kong (4% à 5% pour chacune). L'instauration de la taxe dans huit pays couvrirait donc déjà 85% du volume total des transactions, alors que la nécessité de développer les infrastructures destinées à assurer la sécurité et la fiabilité de ces marchés constitue un frein à l'entrée important pour les places financières qui souhaiteraient devenir des concurrents potentiels. Le tir de barrage contre la taxe Tobin est donc bien nourri et votre Rapporteur concède que les arguments avancés ne peuvent être écartés d'un revers de la main. C'est oublier, pourtant, que la taxe Tobin se situe sur un plan différent de celui sur lequel veulent se placer ses détracteurs : il est difficile de reprocher à la taxe de nuire au fonctionnement du marché des changes puisqu'elle vise précisément à placer « un grain de sable dans les rouages de la finance internationale », selon l'expression fréquemment attribuée à M. James Tobin. La revendication d'une taxe Tobin n'est pas un acte de rationalité économique mais traduit une démarche politique. Il s'agit, justement, de dire que la prétendue rationalité des marchés doit être battue en brèche par un outil dont la vocation est avant tout politique. C'est pourquoi la France - qui ne peut faire cavalier seul - doit porter l'idée de la taxe Tobin devant ses partenaires de la Communauté européenne et se faire, par cet intermédiaire, l'apôtre d'une vision différente de l'ordre monétaire international. La liberté des capitaux n'est pas une fatalité mais doit être le résultat d'un choix raisonné et encadré. En fait, on peut difficilement vouer aux gémonies les contrôles de capitaux et se recommander en même temps de l'approche aujourd'hui classique qui consiste à dire que la libéralisation des capitaux doit se faire de façon ordonnée. Le concept de « libéralisation ordonnée » renvoie clairement à une situation - évolutive, certes - où subsistent des contrôles de capitaux. Or, votre Rapporteur estime que les besoins des pays émergents en capitaux destinés aux investissements de long terme nécessite une réduction très maîtrisée des obstacles aux mouvements de capitaux. Mais, parallèlement, il faut affirmer que les crises financières Les solutions hétérodoxes ne sont plus une rareté : en septembre 1998, la Malaisie a osé une politique de contrôles de capitaux bien conçue et bien conduite, qui montre qu'en la matière, le pire n'est pas toujours sûr ; entre le 14 août et le 28 août 1998, Hong Kong a oublié quelque temps son credo libéral pour intervenir sur son marché des actions, en achetant des titres pour près de 15 milliards de dollars américains, soit 7% de la capitalisation boursière totale et près de 30% du flottant disponible sur le marché ; en 1998, à plusieurs reprises, le Brésil est intervenu massivement sur le marché de ses propres obligations Brady pour, d'une part, contrecarrer les spéculateurs qui vendaient ces obligations à découvert et, d'autre part, éviter en soutenant les prix que des appels de marge ne soit effectués auprès des banques brésiliennes détentrices à l'étranger de titres financés par effet de levier (62). Des idées anciennes resurgissent, des idées nouvelles émergent, des comportements inhabituels émaillent la vie du système financier international : comme à l'accoutumée, le monde de la finance globale continue de changer rapidement. Le FMI se doit de s'adapter, lui aussi, sous peine de se voir contesté plus encore qu'il ne l'est aujourd'hui. 3.- Le Fonds monétaire international au c_ur de la réforme M. Aglietta définit un système monétaire international comme la conjonction d'une structure et de principes d'action collective. La structure est constituée par l'ensemble des choix nationaux qui déterminent, pour chaque pays, le régime de change, le degré de liberté des capitaux et le poids des facteurs externes dans la détermination de la politique monétaire. Il s'agit, en bref, de l'ensemble des choix nationaux de positionnement sur le triangle d'incompatibilité de Mundell. Les principes d'action collective sont la conséquence d'une carence du système monétaire international, qui ne gère pas correctement les externalités créées par l'interdépendance des nations : « les marchés ne créent pas d'ajustements mutuellement acceptables quand les pays poursuivent des politiques économiques indépendantes. Quel que soit le régime de change, des marchés de capitaux ouverts ne provoquent pas les ajustements des taux de change réels d'équilibre capables de forcer l'abandon de politiques économiques incohérentes, sauf crise financière ou crise de change. D'un autre côté, le choix d'un contrôle des capitaux renforce la contrainte pesant sur la balance des transactions courantes et soulève la question de l'alimentation la plus adéquate en liquidités internationales » (63). Dans la philosophie des accords de Bretton Woods, la stabilité du système monétaire international ne pouvait plus être obtenue par l'unique intervention de règles contraignantes (comme à l'époque de l'étalon or), mais devait reposer aussi sur l'action collective. Celle-ci nécessitait la création d'une institution opérant selon le principe d'une assistance mutuelle entre ses membres : le Fonds monétaire international. Ainsi, le FMI était érigé en gardien des règles et des taux de change. Creuset de la conscience collective relative à la stabilité du système monétaire international, il devait aider à accoucher de politiques économiques nationales cohérentes avec l'exigence de stabilité du système global. Enfin, dans un monde marqué par le nombre réduit de monnaies librement convertibles, la faible mobilité des capitaux et la prépondérance des États dans les relations monétaires internationales, le FMI se voyait confier la mission de réguler l'alimentation des États membres en liquidités internationales. L'éclatement du système de Bretton Woods en 1973, avec l'introduction du flottement généralisé des monnaies, entériné en 1976 par les accords de la Jamaïque, a transformé les conditions d'exercice de la mission du FMI. Le contrôle préalable des décisions de change envisagées par les États membres s'est mué en « surveillance » bilatérale des politiques de change, assortie de la possibilité d'émettre des « recommandations » à l'intention des États membres. De même, une « conditionnalité » a été associée aux interventions du Fonds, qui est devenu un intermédiaire financier entre pays débiteurs et pays créditeurs. Les ressources du FMI se sont diversifiées, la durée de ses prêts s'est allongée et le montant moyen des financements a été accru. Puis le FMI s'est encore adapté aux conditions changeantes du système financier international. La multiplication des crises liées au compte de capital, plus brutales et plus rapides, a incité le Fonds à solliciter une augmentation de ses ressources permanentes, grâce à une augmentation des quotes-parts, et de ses ressources temporaires, avec la conclusion des Nouveaux accords d'emprunt. De même, le Fonds s'est efforcé d'accélérer ses processus de décision et, à la suite de la crise mexicaine de 1994-95, a mis en place une procédure de décision rapide, activée pour la première fois au moment de la crise thaïlandaise de juillet 1997. Le FMI a, par ailleurs, consacré des efforts particuliers à l'analyse des systèmes financiers et, notamment, des systèmes bancaires pour renforcer sa capacité d'expertise et de conseil à destination des États membres. Le FMI n'est donc pas resté inerte face aux mutations essentielles de l'environnement financier international. Volens nolens, il s'est efforcé de trouver des réponses aux questions nouvelles qui lui étaient adressées. C'est pourquoi les erreurs et les échecs constatés dans la gestion des dernières crises du vingtième siècle suscitent de fortes attentes pour une réorientation efficace de cette institution. a) L'appel à un recentrage du FMI sur le c_ur de ses compétences La récurrence des crises financières, les difficultés rencontrées par la communauté internationale pour les juguler, la dureté des crises économiques qui leur ont été associées, ont déchaîné un flot de critiques contre le Fonds monétaire international. Puis, après le temps de la critique est venu celui des propositions. La plupart d'entre elles, avec plus ou moins de virulence, plus ou moins d'arrières pensées, visent à recentrer les activités du Fonds et à recadrer ses moyens d'action. Ainsi, un rapport, établi en octobre 1999 par un comité ad hoc du Council on Foreign Relations (64), appelle le FMI (et la Banque mondiale) à « retourner aux sources ». Selon ce comité, le Fonds se disperse et perd de son efficacité en voulant trop en faire : en particulier, il devrait limiter à quatre domaines de politique économique le champ de la conditionnalité associée à ses prêts : la monnaie, le budget, le change et le secteur financier. La surveillance bilatérale doit se concentrer sur le respect de normes financières internationales et sur les fondamentaux macroéconomiques. Le FMI répond à plusieurs nécessités : contribuer à la prévention des crises ; aider les pays à résoudre leurs problèmes de balance des paiements de façon responsable au regard des intérêts de la communauté internationale ; traiter les crises de liquidité ; agir comme un gestionnaire de crise. Dans la même perspective, un rapport établi en avril 2000 sous l'égide de l'Overseas Development Council (65) affirme que le rôle essentiel du FMI réside dans la prévention des crises et, à défaut, dans la promotion d'un retour rapide à la normale après une crise. Le Fonds doit être essentiellement compétent sur les questions macroéconomiques et doit exercer une surveillance bilatérale approfondie, visant à minimiser la probabilité d'apparition des crises. Les prêts accordés par le Fonds devraient se limiter à un soutien de liquidité à court terme, même à destination des pays les plus pauvres. Mais les deux interventions autour desquelles s'est structuré le débat sur la réforme du FMI, ces derniers mois, sont le rapport publié en mars 2000 par la commission Meltzer, établie par le Congrès américain au moment où celui-ci autorisait enfin la participation des États-Unis à la onzième révision générale des quotes-parts, et le discours prononcé par M. Lawrence Summers, Secrétaire américain au Trésor, devant un auditoire de la London Business School, en décembre 1999. La commission Meltzer part du constat que « le FMI a consacré trop peu d'attention à l'amélioration des structures financières dans les pays en voie de développement et trop d'efforts à mettre sur pied des opérations de sauvetage coûteuses. Son système de gestion des crises à court terme est trop coûteux et trop peu réactif, ses conseils sont souvent incorrects et ses efforts tendant à influencer les politiques et les actions [des États membres] sont trop intrusifs ». Son jugement global est que « le FMI doit subsister en tant que gestionnaire de crise, en fonctionnant selon des règles nouvelles qui incitent les États membres à améliorer la sûreté et la solidité de leurs systèmes financiers ». En conséquence, la commission recommande que le FMI soit restructuré pour former une institution plus réduite, axée sur trois responsabilités seulement : - agir comme un quasi prêteur en dernier ressort pour les économies émergentes solvables, en procurant une aide de liquidité à court terme conçue de façon à éviter que les pays ne recourent trop souvent à cette assistance et selon des modalités qui éviteraient de retarder le développement, dans l'État membre, des institutions financières capables d'attirer des flux de financements internationaux privés ; - collecter et disséminer rapidement l'information économique et financière en provenance des États membres ; - fournir des conseils, et non imposer des conditions, relatifs à la conduite de la politique économique dans le cadre des consultations régulières de l'article IV avec les États membres. « La pratique actuelle conduisant à consentir des prêts à long terme en échange du respect de conditions dictées par le FMI doit être supprimée ». La commission Meltzer demande que la conditionnalité ex post mise en _uvre par le FMI, dans le cadre de ses programmes de soutien, soit remplacée par des conditions d'éligibilité ex ante aux ressources du Fonds. « Les pays qui respecteraient ces normes d'éligibilité pourraient recevoir une assistance immédiate, sans délibération ou négociation supplémentaire. Le FMI ne serait pas autorisé à négocier des réformes de politique économique : les politiques nécessaires pour améliorer les performances économiques et mettre fin à une crise sont bien connues ». Les recommandations de la commission Meltzer ont provoqué un vif débat aux États-Unis et ailleurs dans le monde (66). L'administration américaine n'a pas endossé les conclusions du rapport, en estimant que « les réformes proposées par la majorité de la commission [...] n'offrent pas de perspectives réalistes pour prévenir les futures crises financières et [...] pourraient substantiellement saper la capacité de réduire la vulnérabilité d'un grand nombre d'économie émergentes » (67). Ceci ne veut pas dire que toutes les pistes ouvertes par la commission Meltzer sont nécessairement impraticables. Le discours précité de M. Lawrence Summers montre qu'il existe quelques points de convergence avec les positions officielles de l'administration. Mais les conceptions qui sous-tendent les deux approches sont très nettement différentes : pour la majorité de la commission Meltzer, le soutien financier du FMI crée toujours un aléa moral et le Fonds doit donc rester cantonné dans un rôle limité ; pour M. Summers, le monde a besoin d'une institution internationale capable de catalyser la collaboration des politiques économiques, de prévenir les crises et d'aider les pays à surmonter celles qui surviennent néanmoins. Pour que le FMI puisse se « réinventer », M. Summers propose d'orienter les réflexions dans six directions : - la promotion des flux d'information en provenance des États membres vers les marchés et pas seulement vers les institutions financières internationales et le « club » des autres États membres ; - une attention plus soutenue portée aux conditions de la vulnérabilité financière, en complément du champ de compétence classique qu'est la macroéconomie. Le Fonds devrait, notamment, aider plus fortement les pays à déterminer le régime de change le mieux adapté à leur situation et fournir des conseils et une assistance technique plus nourris en matière de solidité du secteur financier ; - une plus grande sélectivité dans l'exercice de l'assistance financière au profit des États membres. Le FMI doit réduire le nombre de ses facilités de crédit, raccourcir la durée de ses engagements, mettre en place un système d'incitations financières visant à prévenir un recours excessif des États membres à ses ressources et promouvoir, en conséquence, un accès plus aisé ou un retour plus rapide de ces États au financement par le capital privé. Dans ce contexte, la conditionnalité associée aux programmes de soutien financier reste indispensable, mais doit être axée sur « les conditions nécessaires et suffisantes pour restaurer la stabilité et la croissance » ; - une meilleure interaction avec le secteur privé, notamment en facilitant la rencontre des débiteurs et des créanciers au cas où une restructuration de la dette souveraine se révèle nécessaire. Le FMI doit agir comme un catalyseur de solutions fondées sur des mécanismes de marché ; - une redéfinition du rôle joué à l'égard des pays les plus pauvres, axé sur une implication encore plus importante dans la lutte contre la pauvreté et un engagement volontaire dans les programmes officiels de réduction de dette ; - la poursuite de la modernisation de l'institution « FMI », qui doit passer par une meilleure représentativité des États membres dans les instances dirigeantes, un renforcement de la transparence, une plus grande capacité d'écoute des forces, intérêts et institutions extérieurs, notamment de la société civile. Les conceptions développées par le secrétaire américain au Trésor rejoignent en grande partie les positions défendues par d'autres gouvernements, dont le gouvernement français. Ceci explique que des évolutions très encourageantes aient d'ores et déjà été enregistrées au chapitre de la réforme du FMI. b) Des évolutions encourageantes Le FMI n'a pas attendu la confrontation des idées de la commission Meltzer et de l'administration américaine pour engager sa réforme, sous l'impulsion des principaux États représentés au conseil d'administration et en fonction des grandes orientations décidées dans le cadre du G 7. Certaines de ces évolutions ont déjà été présentées dans les développements du présent chapitre consacrés au renforcement de la discipline de marché et des systèmes financiers. Votre Rapporteur souhaite donc mettre l'accent sur ceux des ajustements entrepris qui touchent au fonctionnement propre du FMI. · La surveillance exercée par le Fonds sur les économies des États membres a connu deux évolutions importantes : - le traitement des questions financières a acquis une importance plus grande. Les services du FMI s'efforcent depuis plusieurs mois de développer les moyens de mieux évaluer la vulnérabilité financière des États, notamment grâce à la mise au point d'indicateurs relatifs aux avoirs et engagements extérieurs ou aux réserves nettes de change. Le FMI réfléchit également à l'utilisation éventuelle d'indicateurs d'alerte avancés comme aiguillons de la surveillance, étant entendu que leur capacité prédictive reste insuffisante à ce jour. De même, des travaux sont en cours pour évaluer l'intérêt d'une surveillance à grande fréquence des transactions de change ; - les questions régionales prennent de l'ampleur. Le processus de mise en _uvre de la monnaie unique européenne a joué, à cet égard, un rôle utile de sensibilisation. L'UEM fait désormais l'objet d'une évaluation régulière dans le cadre général du processus de surveillance du FMI. D'autres unions monétaires (comme l'Union économique et monétaire ouest-africaine) ont également fait l'objet d'un examen par le conseil d'administration du Fonds. Il semble, cependant, que des progrès puissent encore être attendus dans le domaine crucial des interactions entre un État membre et son environnement régional : une meilleure compréhension des forces d'intégration régionale prévalant en Asie aurait peut-être permis au FMI de mieux apprécier le potentiel de contagion de la crise thaïlandaise. · Le contenu de la conditionnalité associée aux interventions du FMI n'a pas, à la connaissance de votre Rapporteur, fait l'objet de décisions fermes de la part des instances dirigeantes du Fonds. Cependant, il convient de noter que M. Horst Köhler, directeur général du FMI, a organisé avant l'été 2000 une session spéciale du conseil d'administration pour évoquer le contenu de la conditionnalité et l'intérêt qu'il y aurait à la concentrer sur les domaines touchant au plus près à la stabilité financière, à l'équilibre macroéconomique et à la réduction de la pauvreté. Le consensus qui apparaît sur cette définition de la conditionnalité s'est également manifesté dans les débats tenus par le Conseil des gouverneurs, à l'occasion de l'assemblée générale du Fonds monétaire international, qui s'est tenue à Prague du 26 au 28 septembre 2000. · La coopération avec la Banque mondiale s'est notablement améliorée. Les mandats du FMI et de la Banque mondiale sont différents mais complémentaires : il faut donc que les responsabilités de chacun soient clairement établies et que des mécanismes efficaces de coopération permettent de mettre en _uvre des actions conjointes et assurent une bonne articulation entre les interventions conduites par ces deux institutions. Cependant, il ne faut pas s'attendre à ce que le FMI et la Banque mondiale aient, comme par enchantement, une vision toujours et partout identique sur le diagnostic qu'il convient de porter sur tel ou tel cas d'espèce. On sait que le débat sur la réforme des organisations financières internationales, de même que le déluge de critiques adressé au FMI lors de la crise asiatique, a été en grande partie alimenté par les prises de position divergentes des économistes du Fonds et de la Banque sur les causes de la crise et les remèdes à y opposer. Malgré le renforcement des liens entre le Fonds et la Banque, de telles divergences ne pourront jamais disparaître, car les objectifs poursuivis par les uns et par les autres ne coïncident pas nécessairement, non plus que les jugements d'experts, qui restent inévitablement entachés d'une certaine subjectivité. Toujours est-il que la cacophonie relative des dernières années sera certainement réduite par un rapprochement des « cultures » entre les deux institutions concernées et par la généralisation des actions communes autour du thème de la pauvreté d'une part, du secteur financier d'autre part. Ces deux domaines sont, en effet, les principales zones de recouvrement entre les mandats du FMI et de la Banque mondiale, à la lumière des événements récents. En septembre 1998, les responsabilités respectives des deux institutions ont été clarifiées et certains mécanismes formels de concertation ont été définis. Dans le secteur financier, la Banque et le Fonds ont créé un comité de liaison chargé de renforcer les conditions et les manifestations de la coopération opérationnelle. Ce comité suit également l'évolution du programme pilote d'évaluation des systèmes financiers (Financial Sector Assessement Programs, évoqués ci-avant). De même, l'extension de l'initiative de réduction de dette pour les pays pauvres très endettés (initiative PPTE) repose sur un travail d'analyse et d'instruction mené conjointement par les services du FMI et de la Banque mondiale. Enfin, dans le cadre de cette même initiative, un comité récemment constitué a pour mission de s'assurer, d'une part, que les programmes du FMI prennent en compte les conséquences sociales des processus d'ajustement et, d'autre part, que les programmes de la Banque mondiale s'insèrent de façon cohérente dans le cadre macroéconomique de référence visé par le FMI. Ces développements doivent être accueillis favorablement : il ne s'agit pas, pour aucune de ces institutions, de renier sa vocation et d'empiéter sur les compétences de l'autre, mais bien plutôt d'articuler des préoccupations, des concepts et des méthodes parfois différents autour de deux objectifs communs, le retour du pays concerné à la croissance et la reprise du développement. · Le FMI s'est engagé dans un processus de renforcement de l'évaluation, qui démontre sa volonté de se remettre en cause et d'ajuster au mieux ses méthodes aux objectifs de l'organisation. Ainsi, la qualité et l'efficacité des services fournis par le FMI dans le cadre de ses missions font l'objet d'audits internes. Les politiques ou programmes du Fonds sont soumis à des évaluations par les services eux-mêmes (revue bisannuelle du processus de surveillance, revue de la « facilité d'ajustement structurel renforcé », revue des programmes définis par le Fonds en Indonésie, en Thaïlande et en Corée, etc.). Depuis quelques années, des évaluations indépendantes effectuées par des experts extérieurs au Fonds ont été pratiquées sur des questions comme la définition des programmes destinés aux pays européens en transition, la communication externe du Fonds, les activités de surveillance, etc. Par ailleurs, à la suite des recommandations du Groupe des administrateurs chargés de l'évaluation, formé en 1996, le conseil d'administration a décidé, en avril 2000, de créer un service d'évaluation indépendant de la direction générale et rapportant directement au conseil d'administration. · Enfin, le Fonds a commencé à redéployer le champ de ses facilités et à en redéfinir les termes : - en janvier 2000, le conseil d'administration a décidé de supprimer la facilité de financement de stocks régulateurs, qui visait à fournir des ressources aux États membres pour les aider à financer leur contribution à la constitution de stocks régulateurs dûment approuvés. Le conseil d'administration a constaté que les stocks régulateurs avaient eu du mal à atteindre leurs objectifs, qu'il n'existait plus d'accords éligibles à la facilité, que celle-ci n'avait plus été activée depuis seize ans et que les autres facilités du FMI pouvaient satisfaire aux objectifs initiaux de ce mécanisme désormais obsolète ; - à la même date, le conseil d'administration a décidé de supprimer la composante relative aux « imprévus » dans la facilité de financement compensatoire et de financement pour imprévus. L'idée qu'un État membre, confronté à une dégradation imprévue de sa balance courante, puisse solliciter un concours complémentaire du Fonds alors même qu'il applique un accord précédemment approuvé par le Fonds n'était pas mauvaise, mais les administrateurs ont jugé qu'elle n'était plus suffisamment attractive et ont constaté que la facilité n'avait pas été mise en _uvre depuis huit ans ; - en mars 2000, le conseil d'administration a décidé de mettre fin à sa politique de « fonds de stabilisation des changes », instaurée en 1995 pour soutenir de façon préventive la balance des paiements, en complément du soutien accordé dans le cadre d'un accord de confirmation, au cours des phases initiales d'un processus de stabilisation monétaire par le taux de change. Aucun État membre n'a jamais demandé à ce que cette politique soit mise en _uvre ; - à la même date, le conseil d'administration a décidé de mettre fin à sa politique de financement partiel des coûts induits par les opérations de réduction de dette auprès des banques commerciales. A la suite de ces décisions, les mécanismes d'assistance non concessionnels mis en _uvre par le Fonds se réduisent à deux facilités : l'accord de confirmation (mécanisme principal d'accès aux ressources du Fonds) et la facilité de crédit élargie (FCE), instaurée en 1974 pour fournir une assistance à moyen terme (3 ou 4 ans) à des pays confrontés à des difficultés sérieuses de balance des paiements d'origine macroéconomique ou structurelle. Parallèlement, le FMI a mis au point deux nouvelles facilités destinées à renforcer sa capacité de prévenir ou de répondre aux crises financières : - en décembre 1997, en pleine tourmente coréenne, le conseil d'administration a créé la facilité de réserve supplémentaire (FRS), utilisée immédiatement au profit de la Corée. Ce mécanisme vise à offrir un soutien aux États membres qui connaissent des difficultés exceptionnelles de balance des paiements dues à un besoin de financement à court terme qui résulte d'une perte de confiance soudaine. Aucune limite n'est fixée aux financements susceptibles d'être octroyés par l'intermédiaire de la FRS. Les décaissements successifs doivent normalement être remboursés dans un délai d'un an à un an et demi. Pendant l'année qui suit la date d'approbation de ces concours, les utilisateurs de la facilité sont assujettis à une commission dont le taux dépasse de 300 points de base celui qui est appliqué aux tirages sur les ressources du FMI. Ce taux est majoré de 50 points de base à l'expiration de la première année, puis tous les six mois par la suite, à concurrence de 500 points de base ; - en mai 1999, le FMI a pour la première fois mis en place un mécanisme de soutien à titre préventif : la ligne de crédit conditionnelle (LCC). Celle-ci vise à fournir aux États membres mettant en _uvre des politiques économiques saines une ligne de défense contre les déséquilibres exceptionnels de balance des paiements qui pourraient résulter d'une contagion financière. Il s'agit donc de combattre des perturbations qui échappent en grande partie au contrôle du pays concerné et qui résultent principalement d'une évolution défavorable des marchés internationaux de capitaux consécutive à des événements survenus dans d'autres pays. L'octroi de la LCC est soumis à des conditions préalables : le pays ne doit pas être déjà confronté à un problème de balance des paiements résultant de la contagion ni être susceptible de recourir à brève échéance aux ressources du Fonds ; sa politique économique doit avoir fait l'objet d'une évaluation positive de la part du Fonds au titre des dernières consultations de l'article IV ; l'État membre doit entretenir des relations constructives avec ses créanciers privés, pour faciliter la gestion de son exposition extérieure ; l'État membre doit soumettre au Fonds un programme économique et financier satisfaisant. L'accès aux ressources de la LCC et leur emploi étaient, à l'origine, soumis aux mêmes règles que pour la FRS (absence de limites, taux d'intérêt, délai de remboursement des décaissements), mais les procédures de décaissement sont spécifiques. Plus d'une année s'est écoulée depuis la création de la LCC sans qu'aucun État membre ne demande à bénéficier d'une telle facilité, alors même que son caractère préventif devrait rendre une telle procédure attractive. C'est la raison pour laquelle le FMI, sous l'impulsion des ministres des finances du G 7, a décidé de revoir les caractéristiques de la LCC, en même temps qu'il a redéfini les conditions générales d'utilisation de ses ressources. Les principales questions relatives au dispositif de la LCC étaient au nombre de deux : la mise en _uvre de critères d'éligibilité a priori est-elle susceptible d'avoir des effets pervers ? le caractère préventif de la LCC ne commande-t-il pas une plus grande automaticité des décaissements en cas de contagion ? Pour la première de ces questions, il était craint que le fait qu'un pays demande au FMI le bénéfice d'une LCC ne déclenche à son encontre, alors même qu'aucune crise ne serait à l'_uvre au moment de la demande, une vague de défiance conduisant soit à une crise - ce que la LCC est justement censée éviter - soit à une aggravation des conditions de financement du pays sur les marchés internationaux de capitaux. Il ne semble pas, l'expérience des trimestres récents aidant, que de telles craintes soient justifiées ; en effet, plusieurs pays ont conclu avec le FMI (en dehors du mécanisme formel de la LCC) des accords préventifs, comme le Mexique en juillet 1999, la Colombie à la fin de l'année 1999 ou l'Argentine au début de l'année 2000, sans que les marchés n'aient interprété ces accords comme le signe d'une fragilité accrue et d'une crise prochaine. Plus préoccupant était le problème de savoir quelles pourraient être les conséquences d'une évolution défavorable de l'État membre au regard des critères d'éligibilité et d'une décision du FMI tendant à supprimer, en conséquence, le bénéfice d'une LCC précédemment accordée. Il est probable qu'une telle issue aurait des répercussions défavorables sur le crédit international du pays concerné ; il ne semble pas, cependant, qu'il faille en conclure trop vite au déclenchement nécessaire et inéluctable d'une crise financière. D'ailleurs, le conseil d'administration a réaffirmé encore récemment que le Fonds devait avoir les moyens de forcer la sortie d'un État membre hors du mécanisme LCC. Pour répondre à la deuxième question, le conseil d'administration a convenu, au début du mois de septembre 2000, qu'il fallait améliorer l'automaticité des décaissements de la LCC en cas de contagion. Il a décidé, en conséquence, de simplifier les procédures préalables à l'activation de la ligne de crédit. Par ailleurs, dans le cadre d'une réflexion générale sur les conditions d'utilisation des ressources du Fonds et les moyens d'inciter les États membres à en faire un usage adapté et modéré, les ministres des finances du G 7 ont demandé, lors de leur réunion du mois de juillet 2000 une révision des prêts du FMI. Selon des informations parues dans la presse, le conseil d'administration du Fonds aurait, dans un premier temps, été défavorable aux modifications demandées par le G 7, mais se serait rallié à son avis au cours d'une des réunions tenues au mois de septembre 2000. Les modifications décidées dans cette perspective sont au nombre de quatre : - les taux d'intérêt des facilités non concessionnelles sont soumis à un barème progressif en fonction de la durée de décaissement des fonds et du montant décaissé ; - en revanche, le taux d'intérêt applicable à la LCC est abaissé afin de rendre la facilité plus attractive et d'inciter les États membres à développer, dans ce cadre, des politiques préventives efficaces ; - les prêts à moyen terme accordés sous le bénéfice de la FCE doivent être confinés à des situations bien définies, dans lesquelles les réformes structurelles à moyen terme sont essentielles au rétablissement d'une balance des paiements solide ; - la durée moyenne pendant laquelle les ressources du Fonds sont mises à la disposition des États membres est réduite d'environ un an pour les accords de confirmation. Pour la FCE, les remboursements peuvent commencer dans un délai de quatre ans et demi, comme à l'heure actuelle, mais ils devront désormais être achevés dans un délai maximum de sept ans au lieu de dix ans actuellement. De façon générale, le Fonds devra s'attacher à obtenir des remboursements rapides dès lors que la balance des paiements de l'État membre sera solidement rétablie. Ainsi, l'impression d'une immobilité, voire d'un immobilisme, des institutions financières internationales, et notamment du FMI, qui pouvait résulter de l'approche superficielle retenue par le rapport de la commission Meltzer se trouve démentie par les faits : le FMI évolue et adapte les moyens de son action aux conditions changeantes du système financier international. Il reste pourtant deux domaines où l'on doit considérer que la réforme n'est qu'à peine commencée : la participation du secteur privé à la maîtrise des crises financières ; la mise en place d'un prêteur en dernier ressort au niveau international. c) La participation du secteur privé à la maîtrise des crises financières Derrière cet énoncé quelque peu abscons se trouve la nécessité, pour le FMI, de redéfinir précisément sa place dans un monde financier où le secteur privé occupe désormais le premier rang en matière de financements internationaux, de fourniture des liquidités internationales aux États dotés de monnaies convertibles et de circulation des flux de dettes, créances et moyens de paiement. Faire participer le secteur privé à la maîtrise des crises financières implique d'abord d'organiser le système financier international de façon à limiter la prise de risque inutile ou excessive, d'une part, et de renforcer sa capacité ainsi que celle des systèmes financier nationaux à mieux supporter les déviations de faible ampleur qui peuvent affecter son fonctionnement. Les deux premières parties du présent chapitre exposent de façon détaillée les initiatives récentes afférant à ces deux objectifs. Le thème de la « participation du secteur privé » prend une dimension nouvelle lorsqu'il s'agit de gérer les crises une fois qu'elles se sont déclenchées. Jamais plus, peut-être, que dans les récentes crises n'a été vérifié l'adage selon lequel à la privatisation des profits répond la socialisation des pertes. La communauté internationale doit trouver le moyen d'inverser cette logique immorale. Les moyens qu'il convient de mettre en _uvre doivent aussi s'adapter aux conditions nouvelles de l'endettement : les crédits bancaires ont perdu leur prédominance alors que l'endettement sous forme de titres obligataires s'est fortement accru. Les investisseurs se sont diversifiés et la « communauté des investisseurs » est moins structurée et plus dispersée qu'auparavant. De la même façon, les débiteurs sont, de plus en plus souvent, des sociétés qui émettent directement des titres sur les marchés internationaux de capitaux, la place des banques comme intermédiaires financiers n'étant plus aussi importante qu'il y a une dizaine d'années. Il en résulte que les crises d'endettement sont plus difficiles à gérer et que les restructurations de dettes sont moins faciles. Il paraît utile de distinguer deux domaines : la gestion des crises, qui fait référence à l'enchaînement temporel des événements qualifiant la crise, et la résolution des crises, qui ressortit au nécessaire processus de retour à la normale. En matière de gestion des crises, l'enjeu primordial est le maintien d'un accès à la liquidité internationale pour le pays touché par la crise. Il est clair, ici, que le rôle du FMI reste essentiel et qu'il garde le rôle principal. C'est d'ailleurs sa raison d'être et point n'est besoin de se référer à un nostalgique retour aux sources pour souligner combien la fourniture de liquidités internationales en temps de crise est la substance même du mandat originel du Fonds : l'assistance mutuelle entre les États membres. Pour autant, le secteur privé peut apporter une contribution bienvenue, notamment à travers la mise en place de lignes de crédit conditionnelles, similaires dans leur objet à la LCC créée tout récemment par le FMI. Dans de tels accords, les prêteurs internationaux s'engagent à mettre à la disposition du pays (ou d'institutions spécifiques de ce pays, par exemple, des banques déterminées), un montant maximal prédéterminé de devises, à un taux préfixé, tirable sous certaines conditions. La Banque mondiale recense trois avantages à ce genre de dispositifs (68) : - le pays bénéficie d'un coût allégé par rapport à la détention directe de réserves de change. En effet, la commission versée aux établissements financiers s'élève en général à 1% du montant inscrit dans la ligne de crédit ; en revanche, le coût de détention des réserves de change est approximativement égal à l'écart de taux entre les émissions souveraines du pays concerné et de ceux qui émettent les devises détenues ; - le pays bénéficie d'un « gain contractuel », puisque l'accord est, en général, conclu hors situation de crise. Fixé au moment de l'octroi de la ligne de crédit, le taux d'intérêt exigé sur les fonds décaissés en cas de tirage sur la ligne peut être notablement inférieur à celui qui pourrait résulter d'un financement d'urgence consenti au moment d'une crise ; - le pays peut également bénéficier d'un « gain transactionnel », que la Banque mondiale définit comme la réduction de la probabilité d'une crise du fait même de l'existence d'une ligne de crédit. D'ailleurs, celle-ci ne définit que le montant maximal susceptible d'être alloué au bénéficiaire et non le montant effectif des tirages qui pourront être effectués, permettant d'ajuster ceux-ci au mieux des besoins effectifs du pays à un instant donné. En décembre 1996, l'Argentine a ainsi conclu une ligne de crédit de 6,1 milliards de dollars avec treize banques commerciales. Ce montant est significatif, lorsqu'on le rapporte aux 18,1 milliards de dollars de réserves de change alors détenues effectivement par la banque centrale d'Argentine ou aux 23 milliards de dollars d'engagements extérieurs à court terme recensés à cette date auprès des banques déclarantes de la Banque des règlements internationaux. Une ligne de crédit similaire avait été conclue entre le Mexique et un consortium bancaire ; elle a été tirée en septembre 1998. Mais il convient de noter que les lignes de crédit conditionnelles qui avaient été conclues auparavant par l'Indonésie n'ont pas suffi à écarter la crise financière de l'automne 1997. C'est donc bien la résolution des crises qui est au c_ur de la problématique difficile de l'implication du secteur privé. Il s'agit ici de définir comment, pour quel montant et en fonction de quels critères doit être restructurée la dette extérieure d'un pays dont la solvabilité précaire a motivé la crise et a peut-être été aggravée par celle-ci. Pour mettre en _uvre un processus ordonné de sortie de crise, votre Rapporteur estime que la communauté internationale soit encadrer ses efforts par trois principes : l'équité, la solidarité et l'efficacité : - le principe d'équité vise à ce que chacun porte une juste part du fardeau de l'ajustement et qu'il n'existe ni instrument de dette, ni créancier qui bénéficient de privilèges indus ; - le principe de solidarité vise à ce que l'ajustement épargne autant que possible les populations des pays touchés par les crises, ce qui, on en conviendra, nécessite une rupture assez franche avec ce qui a pu être observé ces dernières années ; - le principe d'efficacité vise à ce que la perspective de participer à un processus de restructuration et de réduction de dette améliore le comportement des agents financiers (prêteurs comme emprunteurs) et contribue à une saine appréciation du risque. Pour reprendre l'image cybernétique déjà employée dans le présent chapitre, le principe d'efficacité tend à établir une rétroaction vertueuse entre la résolution et la prévention des crises. La notion même de « participation du secteur privé à la résolution des crises » a suscité de nombreux débats. Les représentants des créanciers internationaux ont fait valoir, par exemple, que les pertes enregistrées par les investisseurs sur les marchés émergents à la suite des crises de 1997 puis 1998 ont dépassé plusieurs dizaine de milliards de dollars. Il est vrai que les faillites d'entreprises ont, par définition, rendu irrécouvrables un certain nombre de créances détenues par des investisseurs étrangers. Il est vrai, également, que tous les investisseurs qui détenaient des titres libellés en monnaie nationale et non pas en devises ont été durement atteints par la chute des taux de change. Mais il faut faire valoir, aussi, que la plupart des créances libellées en devises étaient, par définition, insensibles à la variation de la valeur des monnaies émergentes, que les États souverains et, dans une moindre mesure, les banques n'ont pas fait défaut sur leur dette et que les créanciers à court terme - pour l'essentiel les banques occidentales qui avaient consenti des crédits interbancaires à leurs homologues des pays émergents - ont été plus que correctement protégés par l'intervention de la communauté financière internationale. Faut-il rappeler, par exemple, que les conditions de restructuration de la dette bancaire coréenne se sont traduites par des gains très substantiels pour les banques occidentales, qui - logique de crise oblige - ont imposé des taux d'intérêt supérieurs aux taux de marché sur les créances restructurées ? Il ne faut donc pas s'étonner si le secteur privé « a fait de la résistance » et si la communauté internationale a quelque peu peiné à définir des principes d'action clairs et opérationnels. Déjà, les lignes de force tracées en 1996 dans le rapport Rey, établi dans le cadre du Groupe des Dix à la suite de la crise mexicaine (69), avaient exploré les voies de la participation du secteur privé à la résolution des crises. Mais ces recommandations n'ont pas eu de suite, faute d'une réelle volonté de la part des États et institutions financières internationales, faute aussi peut-être d'un réel sentiment d'urgence. Après de nombreuses prises de position et pétitions de principe, il a donc fallu attendre le sommet des chefs d'État et de gouvernement du G 7 à Cologne, en juin 1999, pour voir apparaître un premier cadre formel définissant les modalités d'implication du secteur privé. Ce cadre a été précisé, en avril 2000, au cours des réunions respectives des ministres des finances du G 7 et du Comité monétaire et financier international du FMI : - le FMI doit désormais, pour toutes ses interventions financières, et au vu de la situation de la balance des paiements et des échéances de remboursement à moyen terme du pays concerné, préciser les hypothèses retenues en matière de financements privés. Autrement dit, pour chaque programme de soutien, le FMI doit déterminer un équilibre entre la contribution des institutions financières internationales, des créanciers publics bilatéraux (notamment ceux du Club de Paris) et des créanciers privés ; - le FMI doit également rappeler les règles essentielles qui doivent guider les restructurations de dette éventuellement nécessaires (au premier chef la comparabilité de traitement de tous les créanciers) pour assurer que le pays concerné retrouve une position extérieure soutenable à moyen terme ; - le FMI doit enfin afficher clairement ex ante quelles seraient les conséquences d'une éventuelle contribution insuffisante du secteur privé au regard des hypothèses prises dans le programme. Ce cadre général d'action devra s'avérer suffisamment solide pour résister aux tensions inhérentes au processus d'implication du secteur privé dans la crise. Ainsi, des questions importantes ne manqueront pas d'être évoquées au fur et à mesure de la mise en application des principes définis à Cologne : le caractère obligatoire ou volontaire de cette participation ; la compatibilité entre d'une part, la mise sur le même plan de tous les créanciers et de tous les instruments de dette et, d'autre part, le souhait souvent partagé d'accorder un statut privilégié à tel ou tel ; la bonne articulation entre le développement des dispositifs de sauvegarde (bénéficiant au débiteur) et le principe fondamental selon lequel les dettes doivent être remboursées, etc. Concrètement, la communauté financière internationale envisage de favoriser les moyens d'organiser les créanciers pour faciliter le dialogue avec les débiteurs. C'est ainsi que la mise en place de comités de créanciers est désormais encouragée officiellement par le FMI (70). L'intégration de clauses d'action collective dans les contrats obligataires internationaux semble devoir se généraliser, d'autant que le Royaume-Uni et le Canada ont eux-mêmes inséré de telles clauses dans certaines de leurs émissions internationales (71). Votre Rapporteur rappelle que la communauté financière privée a longtemps été réticente à de telles clauses, car elle estimait que celles-ci formalisaient ex ante la possibilité qu'un débiteur soit défaillant. Pour leur part, les débiteurs n'étaient pas beaucoup plus positifs, craignant que l'inclusion desdites clauses n'éloigne les investisseurs potentiels et ne conduise à renchérir leur endettement. Enfin, en matière de dette souveraine, un consensus semble se dégager sur la nécessité de confier au FMI une mission consistant à inciter les gouvernements à établir des relations suivies et régulières avec leurs créanciers. A l'issue de ce panorama, votre Rapporteur est convaincu que les efforts entrepris par la communauté internationale sont encourageants et doivent être poursuivis, au nom de l'efficacité et de la justice. Pourtant, le processus ainsi engagé repose, au yeux de votre Rapporteur, sur une ambiguïté dommageable et gênante : il suppose que les crises financières sont et seront essentiellement des crises de solvabilité, déclenchées lorsque les investisseurs internationaux perdent confiance dans la capacité du pays concerné à rembourser ses dettes. Or les grandes crises de cette fin de siècle, au Mexique ou en Asie étaient plutôt des crises de liquidité, au sens où la capacité des pays concernés à rembourser leurs dettes n'était pas fondamentalement remise en cause. La crise est plutôt venue de la réticence du secteur privé à assumer plus avant le décalage entre les avoirs et les engagements extérieurs à court terme de ces pays, dans un contexte de défiance généralisée où les mécanismes classiques d'ajustement des marchés par les prix semblaient impuissants à rétablir les conditions d'un équilibre. Justement, dépassant le cadre d'un pays unique, la crise observée sur les marchés financiers des pays développés à l'automne 1998 apparaît comme l'illustration presque caricaturale de la crise de liquidité, telle qu'elle avait pu être entr'aperçue au Mexique ou en Corée. Le traitement de telles crises est le domaine d'intervention par excellence du « prêteur en dernier ressort ». d) Pour un prêteur international en dernier ressort La notion de prêteur en dernier ressort a près de deux siècles d'existence. Pourtant, « la place du PDR [prêteur en dernier ressort] au sein de la théorie économique est étrange. Rares sont les sujets apparemment plus rebattus que celui-ci et pourtant il n'existe toujours pas de définition claire de ce qu'est un prêt en dernier ressort ni des critères qui en motivent la décision. [...] Cependant, de façon générale, on peut définir le prêt en dernier ressort comme une intervention reposant sur des mécanismes hors marché, réalisée dans le cadre d'une crise systémique menaçant les conditions normales de liquidité, et dont le but est de sauvegarder la pérennité du système financier. Le PDR est celui qui accepte d'endosser les risques que les autres refusent dans des circonstances de forte déstabilisation et d'incertitude » (72). En brossant cette définition à la fois précise et problématique du prêteur en dernier ressort, M. Michel Aglietta et Mme Caroline Denise éclairent la dimension manquante du système financier international tel qu'il fonctionne à l'heure actuelle. Votre Rapporteur a déjà montré que la globalisation financière favorise l'apparition de processus auto-entretenus, qui font transiter les marchés d'équilibre en équilibre par le biais de crises dévastatrices. L'essor des produits dérivés, en autorisant de puissants effets de levier, brouille l'horizon des agents et leur donne l'illusion de réduire les risques : ils ne font que les reporter sur d'autres agents, par l'intermédiaire d'engagements contractuels qui tissent un écheveau toujours plus serré d'obligations réciproques et provoquent de très forts besoins de liquidité lorsque la confiance commence à faire défaut. L'effet de levier en période faste et la tension sur la liquidité en cas de crise ne sont que les deux faces d'une même réalité : l'exposition croissante du système financier international au risque systémique. L'analyse des conditions contemporaines de fonctionnement des marchés financiers, comme l'expérience des crises récentes, montre donc qu'il convient d'établir une fonction de prêteur en dernier ressort au niveau international. Le système de Bretton Woods avait nationalisé la fonction de prêteur en dernier ressort grâce à la limitation des mouvements de capitaux. Il avait ainsi instauré une distinction tranchée entre d'une part, la fonction de prêteur en dernier ressort, exercée au niveau national par la banque centrale et, d'autre part, l'aide conditionnelle apportée par le FMI au financement temporaire de la balance des paiements. Il permettait surtout « de ne pas confondre le prêt en dernier ressort et la garantie systématique contre les pertes accordée par le FMI aux intérêts financiers conjugués des groupes dirigeants des pays débiteurs et des banques créancières, au détriment des populations des pays débiteurs qui en payent le coût social » (73). La multiplication des « paquets financiers », d'un montant toujours plus élevé, consentis au profit de plusieurs pays émergents dans les dernières années montre qu'un ersatz de fonction de prêteur international en dernier ressort existe, mais que cette fonction est mise en _uvre de façon très peu satisfaisante. Elle repose, en effet, sur plusieurs caractéristiques essentielles, qui suggèrent que le FMI n'est pas l'institution la mieux adaptée pour remplir ce rôle : - le prêteur en dernier ressort vise à enrayer des contagions financières et à rétablir un fonctionnement normal des marchés. Le FMI a pour vocation de soutenir la balance des paiements, de guider les politiques macroéconomiques et d'impulser des réformes de structure ; - le prêteur en dernier ressort a une connaissance approfondie des acteurs de marché, de leurs modes de fonctionnement et de leur exposition au risque. Le FMI a pour interlocuteur normal des gouvernements. Ses compétences sont surtout macroéconomiques et il n'entre pas dans sa mission de centraliser, traiter et analyser des informations de nature financière afférentes aux acteurs de marché ; - le prêteur en dernier ressort agit immédiatement et dispose d'une large autonomie d'appréciation. Le FMI met en _uvre des procédures longues, procède à des décaissements échelonnés et se trouve contraint, dans sa marge d'appréciation, par son mandat fondamental qui consiste à porter assistance à tout État membre dans le besoin ; - sa mission consistant à rétablir la liquidité d'un marché, le prêteur en dernier ressort a la capacité de créer de la liquidité de façon illimitée. Bien qu'en dernière analyse, les « capitaux propres » du FMI ne soient rien d'autre que le droit de tirer des devises auprès des banques centrales de chacun des États membres, le Fonds ne dispose que de ressources limitées. Il apparaît donc à votre Rapporteur que seul un réseau de banques centrales est en mesure d'assurer les fonctions dévolues à un prêteur en dernier ressort au niveau international. La Banque des règlements internationaux pourrait, dans cette perspective et selon les situations rencontrées, être l'un des instruments de ces interventions coopératives. Ce faisant, votre Rapporteur est bien conscient des limites qui peuvent entourer cette proposition : - très clairement, le prêteur en dernier ressort sous forme d'un réseau de banques centrales a comme champ d'intervention privilégié les crises de liquidité sur les marchés globaux, comme celles de l'automne 1998. Cela suppose que les banques centrales mettent au point des procédures d'urgence pour engager des actions rapides et coordonnées de façon efficace. Il faut donc préparer, très en amont des crises, les conditions de la collaboration et, notamment, harmoniser les méthodes d'analyse des conditions de marché, de façon à ce que les banques centrales n'aient pas trop de difficulté, dans une situation donnée, à rapprocher leurs points de vue et à dégager une vision commune de la situation des marchés ; - il est souvent difficile, notamment dans le cas des crises sur les marchés émergents, de distinguer entre crise de liquidité et crise de solvabilité. Selon les phases de la crise, d'ailleurs, les considérations de liquidité ou de solvabilité peuvent prendre une importance variable et s'entremêler de façon confuse. Il est, bien entendu, impossible d'imposer aux banques centrales la prise en charge des pertes d'institutions insolvables : ce n'est ni leur vocation, ni le meilleur moyen de réduire l'aléa moral. C'est pourquoi le FMI retrouve ici une place essentielle : il est l'intermédiaire institutionnel par lequel la souveraineté conjuguée des États membres s'impose à la souveraineté de l'État touché par la crise pour lui imposer de faire assumer le poids de l'insolvabilité de certaines institutions financières par la communauté nationale (en premier lieu les actionnaires), les créanciers assumant également leur part du fardeau. L'instauration d'un véritable prêteur en dernier ressort ne fait donc pas disparaître le besoin du FMI. Au contraire, leurs missions se complètent et doivent même s'épauler car aucun de ces deux acteurs de la finance internationale ne dispose de l'intégralité des compétences nécessaires pour juguler les « crises du XXIe siècle » : au réseau de banques centrales la capacité d'étouffer les crises de confiance et de rétablir le fonctionnement normal des marchés, au FMI le soin de définir la conditionnalité macroéconomique dont le respect par l'État membre conditionne le retour durable de la confiance. La clarification du rôle de prêteur international en dernier ressort est l'une des clefs de la lutte contre l'aléa moral qui s'est attaché aux interventions du FMI lors des grandes crises les plus récentes. Cette clarification devrait permettre de faire porter le fardeau de la résolution des crises sur les véritables responsables : les débiteurs et créditeurs imprudents, en épargnant mieux que cela n'est fait aujourd'hui des populations fragiles, qui n'ont souvent d'autre tort que celui de vivre dans un pays plongé trop brutalement dans le maelström de la globalisation financière. C'est en gardant à l'esprit le fait que la globalisation ne doit pas servir les intérêts de quelques uns ni contribuer à maintenir des pouvoirs épuisés ou corrompus que l'on doit reprendre à la base la problématique des relations économiques et financières internationales. Les insuffisances des mécanismes régulateurs, les progrès somme toute limités de la réforme financière, les hésitations - voire les réticences - des institutions ou des gouvernements, l'émergence d'aspirations populaires qui réclament d'avoir voix au chapitre nous imposent de regarder autrement le processus de mondialisation. Celui-ci semble avoir échappé à sa finalité essentielle, qui doit être de servir l'homme et d'épanouir la diversité des sociétés. La mondialisation n'apparaît plus que comme une mécanique infernale, échappant à l'individu pour se retourner contre lui. Il nous faut reprendre la maîtrise de la mondialisation pour ne plus laisser la main libre à la seule logique du marché. Il nous faut donner un sens à la globalisation. D.- DONNER UN SENS À LA GLOBALISATION On ne dira jamais assez combien l'échec de la conférence ministérielle de l'OMC à Seattle, en décembre 1999, a représenté et représente toujours un choc étonnamment perturbateur dans les rouages apparemment bien huilés de la mondialisation. Certes, l'échec avait une cause objective : les divergences trop importantes entre les principales parties prenantes, Union européenne et États-Unis, dans un contexte politique rendu peu propice au compromis par la perspective déjà trop présente des prochaines élections américaines. Mais l'échec de Seattle a eu aussi un visage : celui de l'irruption de la société civile dans le grand débat de la mondialisation. Il faut, bien sûr, faire la part des choses et ne pas associer dans un amalgame improbable les violences observées pendant les manifestations et l'expression légitime des inquiétudes ressenties face à la logique purement autocentrée du capitalisme mondial en liberté. Depuis Seattle, la réaction de la société civile face à la mondialisation est celle d'un corps social qui refuse de voir son destin confisqué par des forces qu'il ne maîtrise pas. On pourra assurément gloser longtemps sur le fait qu'à Seattle, les manifestants s'en prenaient justement à l'institution internationale capable d'introduire dans les relations commerciales ce ferment de régulation qui pourra y faire vivre, à terme, la notion de « bien public international ». Au regard de cette légitimité incomprise, il revient au politique de faire valoir les vrais enjeux de la régulation des relations économiques mondiales, mais aussi de répondre sur le fond aux aspirations exprimées à Seattle, puis au World Economic Forum mondial de Davos, ou au World Economic Forum asiatique de Sidney, ou encore, plus récemment, lors des assemblées générales conjointes de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international à Prague, en septembre 2000. La réponse à la crise de légitimité des institutions de Bretton Woods, en particulier le Fonds monétaire international, doit passer par des actes. 1.- Une nouvelle légitimité pour les institutions de Bretton Woods Votre Rapporteur a indiqué précédemment que le Fonds monétaire international avait reçu, à sa naissance, le mandat d'incarner le « bien public international » dans le domaine monétaire. Cela implique au minimum que l'institution « FMI » assure une représentation correcte, au sein de ses instances dirigeantes, aux intérêts respectifs de ses États membres et que le Fonds ne soit pas le vecteur d'une idéologie particulière mais le porteur de valeurs communes. Dans ces deux domaines, de nouveaux progrès ont encore leur place. a) Une représentativité perfectible Les instances dirigeantes du FMI sont au nombre de quatre, dont deux seulement détiennent un véritable pouvoir de décision : - le Conseil des gouverneurs - instance suprême de décision du Fonds monétaire international - est constitué d'un gouverneur et d'un gouverneur suppléant pour chaque État membre. Les gouverneurs, nommés par leur pays, sont le plus souvent ministres des finances ou gouverneurs de banque centrale. Le Conseil des gouverneurs est investi de tous les pouvoirs du Fonds monétaire international, qu'il peut déléguer, à l'exception de certains pouvoirs réservés, au Conseil d'administration. Il se réunit d'ordinaire une fois par an ; - le Conseil d'administration conduit les affaires courantes du FMI. Il se compose à l'heure actuelle de 24 administrateurs, nommés ou élus par des États membres à titre individuel ou par des groupes d'États, et du Directeur général, qui préside ses délibérations. Il se réunit plusieurs fois par semaine. Il fonde ses décisions sur des études effectuées par la direction et par les services de l'institution. Pour l'exercice 1999/2000, le Conseil a consacré plus de la moitié de son temps aux affaires concernant les États membres (consultations au titre de l'article IV, examen et approbation de crédits) et le reste essentiellement à des questions de politique générale (perspectives de l'économie mondiale, évolution des marchés internationaux de capitaux, surveillance, diffusion des données, situation de la dette, conception des mécanismes de crédit et élaboration des programmes du FMI, entre autres). Pour leur part, le comité monétaire et financier international (anciennement « comité intérimaire du Conseil des gouverneurs sur le système monétaire international ») et le comité du développement (officiellement : « comité ministériel conjoint des Conseils des gouverneurs de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international sur le transfert de ressources réelles aux pays en développement ») sont des organes consultatifs de 24 membres (gouverneurs du FMI, ministres ou autres responsables de rang analogue) qui se réunissent deux fois par an et doivent donner des avis et faire rapport à leur(s) Conseil(s) des gouverneurs sur les questions relevant de leur compétence. La clef de répartition des pouvoirs au sein des instances décisionnelles dépend des quotes-parts dont disposent les États membres. Ces quotes-parts ont une triple fonction : elles déterminent le montant des « fonds propres » alloués au FMI par chaque État membre ; elles déterminent le nombre de voix dont dispose chaque État membre pour les votes auxquels il est nécessaire de procéder ; elles contribuent à déterminer le montant des divers financements accessibles aux États membres confrontés à un déséquilibre de leur balance des paiements. Le choix a donc été fait, à la création du Fonds, de lier la capacité des États dans le processus de décision à leur capacité dans les relations économiques et monétaires internationales. Ceci fait du calcul des quotes-parts l'une des clefs de la représentativité des États membres. Or, indiquait M. Didier Migaud, Rapporteur général de la Commission des finances, dans le rapport sur le projet de loi de finances rectificative pour 1998, « le FMI a entendu déterminer des règles précises qui permettraient de fixer de façon mathématique les quotes-parts des États membres. Celles-ci doivent se fonder sur les caractéristiques économiques extérieures courantes, le montant des réserves officielles de change, etc. Cependant, les règles ainsi conçues ont essentiellement servi de guide à une appréciation plus souple des réalités » (74). Bien entendu, l'octroi de 250 droits de vote au minimum pour chaque État membre contribue à atténuer, pour les plus petits d'entre eux, les conséquences les plus brutales de la règle de proportionnalité qui conduit à attribuer un droit de vote pour 100.000 DTS de quote-part. Mais le vrai problème vient de ce que, de façon générale, les quotes-parts actuellement attribuées aux États membres reflètent de moins en moins leur poids relatif dans l'économie mondiale - même si votre Rapporteur ne méconnaît pas la difficulté de la tâche qui consiste à vouloir ramener à un indicateur numérique unique, appelé quote-part, l'ensemble des phénomènes très complexes qui gouvernent le « poids » d'un pays dans l'économie mondiale. QUOTES-PARTS AUPRÈS DU FMI : D'UN EXTRÊME À L'AUTRE... (en septembre 2000)
DTS : droits de tirage spéciaux ; en moyenne, au mois de septembre 2000, un DTS vaut quasiment 1,5 euro, soit 9,84 francs. La onzième révision générale des quotes-parts, entrée en vigueur en janvier 1999, a cherché, comme les précédentes, à remédier partiellement à ce défaut largement condamné par les pays émergents et par le Japon. Ce dernier pays, notamment, a pris la tête d'un mouvement qui vise à rééquilibrer l'allocation des quotes-parts entre les États membres en fonction d'une meilleure mesure de leur participation à l'économie mondiale. Votre Rapporteur est conscient de ce que, appliqué avec rigueur, en fonction des évaluations qui circulent çà et là, un tel mouvement conduirait en premier lieu à diminuer l'influence des pays européens au sein du Fonds, au profit des pays émergents. Il ne faut pas avoir peur de ce processus : on peut difficilement prêcher plus de justice et d'équité dans les relations internationales et, dans le même temps, refuser que la notion de « pays émergent » soit autre chose qu'une expression commode destinée à rester confinée à la littérature économique et financière et sans prise sur les réalités du pouvoir. On pourrait presque concevoir, s'il fallait être véritablement juste et équitable, de ne qualifier d'« émergent » que les pays qui parviennent à renforcer sensiblement leur poids au sein du FMI au fil des révisions successives des quotes-parts... Par ailleurs, il conviendrait certainement, aux yeux de votre Rapporteur, de ne pas attendre une éventuelle refonte en profondeur des quotes-parts pour réviser les règles relatives aux décisions prises à la majorité qualifiée, qui confèrent actuellement un droit de veto aux États-Unis, ceux-ci dépassant 15% des droits de vote. Il faudra également que le FMI finisse de se débarrasser des derniers oripeaux idéologiques de ce libéralisme quelque peu échevelé qui a pu, sinon dicter ses actes, du moins orienter son discours du milieu des années 1980 au milieu des années 1990. b) Le « consensus de Washington », une idéologie dépassée L'expression « consensus de Washington » a été forgée par l'économiste britannique John Williamson en 1990, pour caractériser l'orientation néolibérale des politiques alors recommandées par les institutions internationales aux pays d'Amérique latine (75). « Washington » s'entend, naturellement, du siège social des deux grandes organisations multilatérales qui définissaient le contenu de ces politiques - la Banque mondiale et le FMI - mais il s'entend aussi du siège du gouvernement américain, principal inspirateur de la lutte contre la toute puissance de l'État dans les pays émergents, initiée sous la présidence du Républicain Ronald Reagan. Le consensus de Washington recouvre, en fait, une dizaine réformes fondamentales, axées sur la stabilité macroéconomique, la libéralisation des systèmes financiers domestiques, la libéralisation du commerce, la privatisation, etc. Votre Rapporteur ne prétend pas prendre le contre-pied systématique de ce processus de réforme économique : cela reviendrait, en premier lieu, à nier ce qui est à l'origine même du FMI, à savoir la vision politique d'un retour à la prospérité conditionné par la libéralisation des échanges et la convertibilité des monnaies aux fins des transactions courantes. Cela reviendrait également à contester inutilement les bénéfices des politiques prônées par les institutions financières internationales, tant il est vrai que la forte présence de la puissance publique dans les pays émergents a pu longtemps dissimuler sous le masque social de la redistribution une utilisation trop peu efficace des ressources économiques. Mais il faut convenir que, sous la pression de leurs mandants - les principales puissances économiques occidentales - les mandataires du consensus de Washington n'ont peut-être pas exercé leur mission avec suffisamment de retenue. Portée par une dynamique propre des capitaux privés qui dépassait le cadre des décisions politiques, mais aussi par un soutien actif des gouvernements occidentaux, l'histoire récente de la libéralisation effrénée des mouvements de capitaux dans les pays émergents illustre trop clairement le fait que les puissants de ce monde ont parfois joué aux apprentis sorciers. En 1993, une étude approfondie produite par les services du FMI sur la libéralisation des capitaux avait conclu à l'intérêt économique d'une telle libéralisation (76). Cependant, elle avait identifié plusieurs difficultés pour engager rapidement ce processus dans les pays émergents ainsi que plusieurs conditions préalables à l'établissement de la convertibilité du compte de capital. La discussion de l'étude par le conseil d'administration du Fonds avait révélé une fracture entre les administrateurs. Pourtant, à l'occasion de l'assemblée générale du Fonds monétaire international marquant le cinquantième anniversaire de sa création, tenue à Madrid en octobre 1994, le comité intérimaire du FMI publiait une Déclaration de Madrid sur la coopération en vue de renforcer l'expansion mondiale, présentant une ébauche de programme économique fondamental en dix points, dans lequel il encourageait sans ambages les États membres à « supprimer les obstacles à la liberté des mouvements de capitaux ». Curieusement, la déclaration de Madrid faisait ainsi peu de cas des positions plus nuancées adoptées le même jour par les ministres des finances du Groupe des Dix, qui accueillaient favorablement « les efforts entrepris pour prendre conscience des risques découlant de l'utilisation des innovations financières ou des produits financiers à fort effet de levier » et qui soutenaient « les efforts engagés pour faire en sorte que les institutions financières de tout type aient un capital suffisant pour supporter l'intégralité des risques auxquels elles sont exposées » (77). Il a donc fallu que passe la crise mexicaine de l'hiver 1994-1995 pour que les impulsions politiques animant le Fonds monétaire international intègrent enfin l'idée que la libéralisation des mouvements de capitaux recèle plus de risques que d'avantages pour les pays qui ne s'y sont pas préparés (78). C'est ainsi que la Déclaration sur un partenariat pour une expansion durable de l'économie mondiale, adoptée en septembre 1996 par le comité intérimaire, a complété la déclaration de Madrid par un onzième point relatif au renforcement des systèmes financiers, tandis que le sixième point, portant sur la convertibilité des monnaies, en appelait désormais à un « progrès prudent vers une liberté accrue des mouvements de capitaux, grâce aux efforts visant à promouvoir la stabilité et la solidité financière ». Cette lucidité bienvenue était cependant encore trop tardive pour permettre d'éviter le désastre asiatique de l'année suivante. L'aggiornamento idéologique des institutions de Bretton Woods semble aujourd'hui bien engagé. L'accent mis sur la réduction de la pauvreté, sur l'importance des problèmes sociaux, sur la nécessaire appropriation par les gouvernements et les sociétés des réformes proposées dans le cadre de l'assistance multilatérale, paraissent avoir dépassé le cadre du discours-alibi pour devenir des lignes de force structurantes pour l'action du FMI et de la Banque mondiale. Il faut désormais aller plus loin et s'interroger sur les principes de gouvernement qui doivent présider à la formulation des règles de la mondialisation. 2.- Pour un nouveau mode de gouvernement de la mondialisation : dépasser le G 7 En fait, en 2000 comme en 1944, les gouvernements sont confrontés à la question essentielle qui consiste à savoir comment, dans l'ordre international, doit s'incarner un bien commun. Non pas, contrairement à ce qui est parfois affirmé, que la politique ait déserté le champ de la mondialisation : les relations économiques internationales ont toujours été et demeurent encore un champ privilégié d'expression des idées et valeurs politiques. Il s'agit plutôt de savoir comment les États peuvent s'extraire de la logique intellectuelle du marché et concevoir leur action autrement qu'en termes de concurrence avec les autres États. La première étape de cette refondation passe par la politisation des institutions financières internationales. A l'automne 1998, la France a ainsi proposé à ses partenaires de l'Union européenne et du G 7 de transformer le comité intérimaire du FMI en conseil, comme le prévoient d'ailleurs les statuts du Fonds, afin qu'il devienne un organe de décision authentique, approuvant par voie de vote les décisions stratégiques du Fonds. La France plaidait aussi, à juste titre, pour que la fréquence des réunions de cette instance soit accrue ; il est vrai que le rythme semestriel actuellement en vigueur ne pouvait convenir à une instance de décision. La proposition française a initialement rencontré un écho assez favorable parmi de nombreux États membres, mais s'est heurtée à l'hostilité des États-Unis. On peut comprendre, assurément, que la proposition française allait à l'encontre de ce principe de gouvernance bien anglo-saxon qui consiste à confier le travail courant à un « conseil d'administration » et à cantonner le « conseil de surveillance » à un rôle de supervision et d'orientation très général. Mais, dans la réponse américaine, il faut voir aussi le sentiment que les problèmes auxquels était confronté le système monétaire et financier international n'appelaient pas une réponse politique mais une réponse essentiellement technique. Les États-Unis resservaient ainsi le thème bien connu selon lequel le politique et l'économique occupent deux champs bien séparés : paravent commode, au demeurant, pour faire avancer à pas couvert les idéologies libérales... Forçant quelque peu la main de leurs partenaires, les États-Unis ont donc rejeté hors du FMI les velléités d'action visant à renforcer la dimension politique du système financier international. En novembre 1997, à l'occasion du sommet de l'APEC de Vancouver, le président Clinton a annoncé la réunion prochaine des ministres des finances et gouverneurs de banques centrales de vingt-deux États « importants » pour le système financier international, dont les sept pays membres du G 7 et quinze pays émergents (79). Ce qui allait bientôt être connu sous le nom de G 22 a tenu sa réunion constitutive en avril 1998, à Washington. Le G 22 allait rapidement confier à trois groupes de travail le soin d'éclairer les problématiques jugées alors les plus urgentes : la gestion des crises financières internationales, le renforcement des systèmes financiers, la transparence et la responsabilité. Le G 22 ne s'est plus jamais réuni en séance plénière. Les rapports élaborés par les groupes de travail ont été transmis au FMI avec mandat de les faire connaître à l'ensemble des États membres. En fait, les critiques relatives à la constitution du G 22, supposé refléter de façon excessive les intérêts des États-Unis et non les intérêts de la communauté financière internationale « importante » au plan systémique, allaient susciter une variation un peu approximative du périmètre de ce groupe ad hoc. Ainsi, au début de l'année 1999, un G 33 pouvait prétendre prendre la relève du défunt G 22 (80), sous l'impulsion des ministres des finances du G 7. Mais après quelques séminaires au printemps 1999, le choix a été fait de réduire à vingt États le format du « G-systémique ». Un G 20 a donc été constitué en septembre 1999 pour être le nouveau forum de consultation sur les questions relatives au système financier international (81) ; il a tenu sa première réunion à Berlin, en décembre 1999 et devrait se réunir à nouveau d'ici à la fin de l'année 2000. Concession limitée à l'initiative française, le comité intérimaire du FMI a été transformé en comité monétaire et financier international via une résolution adoptée en septembre 1999 par le conseil des gouverneurs. Mise à part la possibilité offerte au comité monétaire et financier international d'organiser des réunions préparatoires au niveau des suppléants - qui pourrait lui donner une plus grande autonomie de réflexion par rapport au conseil d'administration - la seule innovation qui le distingue vraiment du comité intérimaire réside dans le fait que son mandat est élargi aux questions financières. Votre Rapporteur admet que la proposition française souffrait d'une ambiguïté gênante : elle visait à renouveler le lieu où pourraient s'exprimer les orientations politiques fondamentales en matière monétaire et financière, mais s'inscrivait dans le cadre existant du FMI, c'est-à-dire, notamment, les structures actuelles du pouvoir. Les réticences des États-Unis peuvent alors s'éclairer sous un jour nouveau : il est moins dangereux de créer, à côté du FMI qui conserve le véritable pouvoir, des structures politiques consultatives sous la forme d'un « G » au format adapté, que de faire entrer le loup politique dans la bergerie de l'assistance multilatérale ; par ailleurs, créer le G 22 permet de se donner le beau rôle et d'apparaître comme la grande puissance qui ose officialiser la voix des pays émergents et dépasser ainsi le cadre du G 7. Mais la démarche américaine, endossée ultérieurement par le G 7, ne vise nullement à créer cette multipolarité traditionnellement appelée de ses v_ux par la France. Bien au contraire, en faisant du G 20 une instance consultative se réunissant annuellement, elle conforte la prééminence du G 7 dans la conduite des affaires mondiales et perpétue le face à face entre les États-Unis et leurs partenaires économiques, fondé sur la comparaison des rapports de force. La démocratisation des relations économiques et financières internationales implique de changer de référence. La mondialisation ne peut se contenter d'être gouvernée par une oligarchie censitaire du PNB. Il lui faut une enceinte plus vaste, plus politique, moins économique. Parce que la globalisation économique et financière impose de nouvelles règles, procure de nouvelles perspectives mais aussi fait naître de nouveaux risques, les pays doivent s'allier pour trouver de nouvelles parades et forger de nouveaux outils d'intervention. La proposition faite par M. Jacques Delors, il y a quelques mois, qui consiste à mettre en place un conseil de sécurité économique d'envergure mondiale, va dans ce sens. Cependant, une telle proposition pâtit de l'image d'efficacité toute relative qui est associée à l'action du Conseil de sécurité de l'ONU depuis l'origine. Or, il faut permettre à la communauté internationale, dont les seuls représentants légitimes sont les responsables politiques, de formuler puis conduire une politique économique mondiale. Entre la représentativité exhaustive de l'ONU et la souplesse opérationnelle du G 7, il y a place pour des structures innovantes, où les aspirations des pays émergents comme des pays les moins avancés puissent trouver à s'exprimer, hors du cadre technique trop étroit du FMI ou de la Banque mondiale. Il faudra, bien sûr, payer le prix de l'ouverture que préconise votre Rapporteur et accepter - sans grande souffrance, cependant - que soient ainsi remis en cause les petits bénéfices que procure à la France sa présence au sein du G 7. La sortie de la confrontation avec les États-Unis rend toutefois plus attrayant le pari de la démocratisation. Par son histoire qui porte la trace d'un combat permanent pour la démocratie, par la constance de son engagement en faveur d'une conception plus équilibrée de l'ordre mondial, la France peut légitimement et doit sans états d'âme prendre l'initiative d'appeler à la convocation d'un forum mondial de la gouvernance économique globale. Cette « assemblée constituante » aurait pour mission de tracer les plans de la future architecture économique mondiale, en confrontant les aspirations des gouvernements, des Parlements et des principales organisations non gouvernementales, dans un débat ouvert, sans tabous ni concessions. Ainsi pourra émerger ce gouvernement économique mondial dont votre Rapporteur proclame la nécessité, non pas institution supranationale condamnée à l'impuissance ou au despotisme, mais ensemble de principes et de règles fixant pour les temps à venir les grands axes du développement de notre planète. * * * Pour que les peuples du monde entier puissent se retrouver dans le grand mouvement de la mondialisation, pour que celle-ci ne soit pas un privilège supplémentaire accordé à une caste de pays riches mais un instrument maîtrisé au service de tous, il n'est d'autre solution que de reprendre sur de nouvelles bases les principes de l'ordre économique mondial. Les pistes avancées par votre Rapporteur bousculent certainement les idées reçues et peuvent susciter l'incompréhension. C'est pourtant la mission du politique que de refuser les fausses certitudes des situations acquises. Pour construire un monde meilleur, il faut réinventer les formes de l'action. Nous ne sommes qu'au début du chemin. La Commission des finances, de l'économie générale et du plan a procédé à l'examen du présent rapport d'information au cours de sa réunion du jeudi 21 septembre 2000. Votre Rapporteur a souligné l'intérêt d'une analyse de la crise asiatique et de ses conséquences qui dépasse le cadre des événements décrits « à chaud » et s'inscrive dans une perspective plus large. La répétition des crises financières depuis le milieu des années 1990 amène à s'interroger sur la nature de la crise asiatique. Pour certains observateurs, celle-ci était un phénomène endogène, propre à des pays affligés de défauts économiques patents : la crise n'est que la sanction d'une mauvaise gestion. D'autres pensent, au contraire, que la crise asiatique n'a été qu'une manifestation d'une crise plus générale de la finance « globalisée ». En fait, la croissance trentenaire des pays asiatiques touchés par la crise ne relevait ni du mirage, ni du miracle. La violence de la crise traduit l'interaction entre les tares de la gouvernance économique et des facteurs systémiques affectant le système financier international. Abordant les aspects régionaux de la crise, votre Rapporteur a indiqué que la très forte reprise constatée en 1999 et 2000 dans la plupart des pays touchés par la crise s'expliquait de deux façons : il y a, d'une part, l'effet normal et mécanique du rebond par rapport à une situation très déprimée en 1998, mais, d'autre part, une véritable reprise qui montre que la crise n'a pas cassé les ressorts ni les moyens de la croissance. L'Indonésie constitue, bien entendu, un cas très spécifique. Pour autant, le nouveau décollage de l'Asie en crise ne signifie pas que les fragilités structurelles ont été surmontées. Au plan politique, les réformes qui ont été imposées, parfois brutalement, par la communauté internationale ont effectivement poussé à la restructuration économique, mais ont parfois ébranlé profondément les fondements des systèmes politiques et sociaux. On peut dire aujourd'hui que le capitalisme à l'asiatique est remis en cause, mais beaucoup en Occident Cette appréciation est en grande partie injuste : il ne faut pas oublier que l'on demande à ces pays de réaliser des réformes et des mutations politiques et sociales qui ont pris des décennies dans les pays occidentaux, alors même que la Corée, la Thaïlande, la Malaisie, les Philippines et l'Indonésie étaient touchés par une crise sans précédent. Au contraire, on doit se réjouir de voir que ces pays ont traversé et surmonté la crise en approfondissant la démocratie et non en se repliant sur des pratiques autoritaires. Les élites ont pris conscience, très clairement, de la rupture que représente la crise. Dans les années 1980, un courant de pensée s'était développé au sein des milieux dirigeants asiatiques, d'ailleurs relayé très largement parmi les élites occidentales, l'asiatisme, qui prétendait expliquer que le miracle asiatique reposait sur une combinaison subtile d'efficacité économique et de système politique au mieux paternaliste, au pire autoritaire. Le modèle asiatique était destiné à supplanter un modèle occidental condamné du fait de ses laxismes. Aujourd'hui, les élites ont compris que le succès de leur modèle économique à venir ne peut reposer que sur la démocratisation de leurs systèmes politiques. A cet égard, on note une insatisfaction croissante des pays d'Asie vis-à-vis du modèle de société proposé par les Anglo-saxons. Alors qu'ils ont bénéficié pendant plusieurs lustres d'une globalisation gouvernée par les principes libéraux inspirés des États-Unis, ces pays sont aujourd'hui à la recherche d'un nouveau positionnement dans un monde qu'ils souhaitent multipolaire. L'Europe peut, justement, leur apporter non pas son propre modèle, mais l'expérience d'un mode de société différent du modèle dominant. L'intensité et la qualité du dialogue Europe-Asie sont donc une dimension essentielle de la redéfinition des rapports politiques mondiaux. D'ailleurs, malgré la persistance de forts antagonismes locaux, les pays asiatiques prennent conscience de la dimension régionale de leur destin et le message européen n'en prend que plus d'importance. Il faut donc réussir le troisième sommet de l'Asia-Europe Meeting (ASEM), qui se tiendra à Séoul en octobre prochain, afin de ne pas décevoir des attentes qui se font de plus en plus vives. Abordant la dimension internationale de la crise asiatique, votre Rapporteur a estimé qu'une déréglementation trop brutale des marchés nationaux de capitaux, assortie d'une carence de contrôles, de l'insuffisance des règles de gestion, de l'absence de culture de marché et d'une connexion trop rapide aux marchés internationaux, avait conduit à créer des déséquilibres économiques graves. Par ailleurs, la crise a revêtu une dimension systémique évidente : qu'y avait-il de commun, en 1997, entre une Indonésie encore fortement dépendante de ses matières premières et la Corée, puissance industrielle membre de l'OCDE ? Or la crise s'est répandue en Asie comme une traînée de poudre, portée par la logique moutonnière des marchés. A l'automne 1998, la Réserve fédérale américaine a même été obligée d'organiser un sauvetage du fonds spéculatif LCTM, acculé à la faillite. Enfin, la gestion des monnaies a été particulièrement déficiente avant la crise : ancrées au dollar, elles ont été victimes des incertitudes de la parité yen-dollar. L'euro lui-même semble aujourd'hui victime de ces dynamiques de marché dont on n'arrive pas toujours à discerner la logique et les fondements rationnels. Le FMI et la communauté financière internationale ont été vertement critiqués. Ils ont échoué à prévoir, puis prévenir la crise ; les réactions du FMI à la crise ont été assez brutales et les programmes de réforme préparés par le Fonds se sont révélés inadaptés. En négligeant le fait que le problème principal venait de l'excès d'endettement privé et non, comme en d'autres lieux et en d'autres temps, de la mauvaise gestion des finances publiques, le Fonds a préconisé des politiques trop restrictives qui ont aggravé la crise économique et précipité la crise sociale. Le « consensus de Washington » a pesé lourdement dans l'approche de la crise... Les défaillances dans la prévention et la gestion de la crise proviennent également du mode d'organisation et de fonctionnement du système financier international. De nombreuses personnalités ont préconisé d'engager une réforme profonde. M. Robert Rubin, alors secrétaire américain au Trésor, a évoqué, en décembre 1998, rien moins qu'une « nouvelle architecture financière internationale ». Or deux ans après, on doit constater que le bilan de la réforme est bien maigre. Par exemple, selon votre Rapporteur, il faut mettre en place un prêteur en dernier ressort, rôle que le FMI est incapable d'assumer aujourd'hui. Le traitement de la crise de LTCM a pu reposer entièrement sur les États-Unis, mais une crise plus grave serait bien moins facilement maîtrisée dans le cadre actuel. Il faut rappeler que le programme de soutien du FMI et de la communauté financière internationale en faveur de la Corée a été impuissant à rétablir la confiance et à enrayer la spirale de la crise. Le prêteur en dernier ressort est nécessaire, car il faut donner à la régulation une « arme de dissuasion » face à l'augmentation du risque systémique. Ce prêteur en dernier ressort ne peut prendre la forme que d'un réseau de banques centrales, coordonnées autour de la Banque des règlements internationaux. Au-delà des critiques portant sur la gestion de la crise asiatique, la contestation de la gouvernance financière mondiale prend de plus en plus de force et s'appuie sur un mouvement de citoyens qui pose de vraies questions. Par exemple, la présence des pays émergents au sein d'un forum équivalent au G 7, mais plus large, est d'ores et déjà posée. De même, la démocratisation du FMI fait l'objet d'un débat. La France a pris position dans ce débat en 1998, en suggérant de renforcer le rôle de l'organe politique du Fonds : son comité intérimaire. Cette proposition, pourtant insuffisante, a été repoussée. Or, seule une démocratisation réelle du mode de gouvernement de la mondialisation pourra créer un contrepoids à la puissance du marché. La France devrait prendre l'initiative de proposer la réunion d'un forum mondial, rassemblant les gouvernements, les parlements et les organisations non gouvernementales, qui serait érigé en « assemblée constituante » afin de proposer les règles d'un nouveau gouvernement économique mondial. En effet, les institutions actuelles ne permettent pas de développer une vision globale de la mondialisation : l'OMC ne traite pas des questions financières, le FMI n'aborde les questions commerciales que de façon incidente. La France, par sa tradition et sa culture politiques, doit porter cette aspiration démocratique. M. Yves Tavernier, vice-président, a relevé que la question de la régulation financière internationale serait bientôt évoquée à nouveau devant la Commission des finances, sur la base du rapport que le Gouvernement doit désormais déposer tous les ans concernant les activités du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Les questions financières internationales prennent plus d'importance au Parlement, comme en témoignent les débats qui ont eu lieu à l'occasion de la onzième révision générale des quotes-parts, où la contribution de la France s'est élevée à 26,3 milliards de francs. La France est le quatrième actionnaire du FMI et l'Europe y pèse plus, financièrement, que les États-Unis. Malgré tout, l'influence de l'Europe dans les décisions du Fonds reste inférieure à celle des États-Unis. M. Pierre Hériaud s'est déclaré en accord avec les orientations générales du rapport d'information, mais a estimé que le thème du « gouvernement mondial » pouvait avoir des implications juridiques fortes, et peut-être intempestives, sur les relations entre les banques centrales et les gouvernements. Votre Rapporteur a jugé que les modalités de coopération entre le Trésor américain et la Réserve fédérale semblaient satisfaisantes, ou tout au moins efficaces, sans que personne ne mette en doute la crédibilité de l'indépendance accordée à la banque centrale américaine. La notion de « gouvernement mondial » ne traduit pas une volonté de remettre en cause l'indépendance similaire dont peuvent jouir d'autres banques centrales, notamment la Banque centrale européenne, mais la nécessité de revoir les modalités de leurs rapports avec les gouvernements. Le gouvernement mondial que votre Rapporteur appelle de ses v_ux, ne s'entend pas comme une « cité mondiale » utopique, mais comme l'ensemble des règles qui doivent fonder une nouvelle régulation des relations économiques et financières internationales, par exemple en matière de dette, de redistribution du revenu mondial ou de réponse au risque systémique. La discussion de ces questions ne doit pas être l'apanage des technocrates et des banquiers centraux. En fait, le besoin d'un lieu de gouvernance politique est ancien et le forum existe déjà, à travers le G 7. La question qui se pose aujourd'hui consiste à savoir si cette enceinte est suffisante pour donner des normes légitimes à la globalisation. Au demeurant, la voix de l'Europe est effectivement trop confuse : il existe un déficit politique au niveau européen, qui empêche de peser davantage sur les décisions du Fonds monétaire international. La Commission a ensuite autorisé, conformément à l'article 145 du Règlement, la publication du rapport d'information. ANNEXE : Je tiens à remercier tout particulièrement les personnes suivantes qui, en France, en Asie ou aux États-Unis, m'ont apporté des informations précieuses sur la situation en Asie, trois ans après la crise, comme sur la réforme du système financier international. Dans chaque pays visité, les représentations diplomatique, commerciale et financière de la France ont apporté un concours précieux et efficace au bon déroulement de ma mission. Qu'elles trouvent ici l'expression de ma sincère reconnaissance. M. Jérôme Pasquier, consul général de France à Hong Kong ; M. Philippe Kaspi, conseiller commercial, poste d'expansion économique, consulat général de France à Hong-Kong ; M. Olivier Bullion, attaché commercial, poste d'expansion économique, consulat général de France à Hong-Kong ; M. George Pickering, chef du bureau Asie-Pacifique, Banque des Règlements Internationaux ; M. Guy Henriques, chargé de mission « secteur bancaire », Banque des Règlements Internationaux ; M. Jean-François Rigaudy, chef de la division Marchés de capitaux, Banque des règlements internationaux ; M. Joseph Yam, président, Hong-Kong Monetary Authority ; M. K. Y. Tang, économiste, division des analyses économiques, Gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong Kong ; M. Pierre Finas, directeur pour l'Asie du Nord, Crédit Lyonnais ; M. Victor Chu, président, First Eastern Investment Group ; M. Rony Chan, président, Hang Lung Group ; M. Urban Lehner, rédacteur en chef, Asian Wall Stret Journal ; M. Jean-Pierre Cabestan, directeur, Centre d'études français sur la Chine contemporaine ; M. Alvin Yiu-Cheong So, directeur, département des sciences sociales, Université scientifique et technologique de Hong Kong ; M. James Tang, directeur, département de politique et d'administration publique, Université de Hong Kong ; M. Ting Wai, professeur associé, département des études gouvernementales et internationales, Université baptiste de Hong Kong. S.Exc. M. Maurice Gourdault-Montagne, ambassadeur de France à Tokyo ; M. Frédéric Laurent, conseiller commercial, poste d'expansion économique, ambassade de France à Tokyo ; M. Hervé Gonsard, attaché financier, agence financière à Tokyo ; M. Gaël de Maisonneuve, premier secrétaire, ambassade de France à Tokyo ; M. Yoshito Sengoku, député, membre de la commission des Finances, Chambre des députés ; M. Katsuhiro Yokomitsu, député, membre de la Commission des finances, Chambre des députés ; M. Yoshimasa Hayashi, sénateur, secrétaire de la commission du Budget, Sénat ; M. Shuzo Nakamura, directeur du bureau Asie, Banque Mondiale ; M. Takashi Oyama, conseiller spécial, département « Économie internationale » et département « Marchés financiers », Banque du Japon ; M. Ippei Yamazawa, président, Institut des économies en développement (Japan External Trade Organization) ; M. Shotaro Oshima, directeur général, département des affaires économiques, ministère des Affaires étrangères ; M. Hiroyasu Ando, directeur général adjoint, département des affaires asiatiques, ministère des Affaires étrangères ; M. Yoshihiro Higuchi, directeur adjoint, département des relations économiques avec l'Europe, ministère des Affaires étrangères ; M. Seiji Shimpo, directeur général, Agence de planification économique ; M. Zembei Mizoguchi, directeur général, bureau « International », ministère des finances ; M. Katsufumi Kurihara, directeur adjoint, division de la recherche, bureau « International », ministère des finances ; M. Thierry Porté, président, Morgan Stanley Dean Witter Japon ; M. Michel Blanc, SCOR ; M. Robert Verdier, directeur général adjoint, BNP-Paribas Japon ; M. Philippe Pons, correspondant permanent au Japon, Le Monde ; Mme Akiko Fukushima, directeur de recherches, National Institute for Research Advancement ; M. Ryosei Kokubun, professeur de sciences politiques, Université de Chuo (Tokyo) ; M. Sei Kuribayashi, professeur de sciences sociales, Université de Chuo (Tokyo) ; M. Chi Hung Kwan, chercheur, Nomura Research Institute ; Mme Naoko Sajima, chercheur associé, National Institute for Defense Studies ; M. Takakage Fujita, directeur « Droits de l'homme et environnement », Parti social démocrate ; CORÉE DU SUD (82) S.Exc. M. Jean-Paul Réau, ambassadeur de France à Séoul ; M. Philippe Autié, premier conseiller, ambassade de France en Corée ; Mme Catherine Clément, premier secrétaire, ambassade de France en Corée ; M. Jean-Raphaël Chaponnière, conseiller économique, poste d'expansion économique, ambassade de France en Corée ; M. Jean-Jacques Faure, attaché scientifique, ambassade de France en Corée ; M. Oh Jong-nam, conseiller particulier pour les affaires économiques, Présidence de la République ; M. Uhm Rak-yong, vice-ministre des Finances et de l'Économie ; M. Bae Young-shik, directeur général, département de la coopération économique, ministère des Finances et de l'Économie ; M. Kim Dong-wook, président, commission des Finances et de l'Économie, Assemblée nationale ; M. Lee Han-dong, député, président du groupe d'amitié France-Corée ; M. Han Deung-soo, député, Assemblée nationale ; M. Kim Chan-jin, député, Assemblée nationale ; M. Kim Keun-tae, député, Assemblée nationale ; M. Park Bong-soo, chef de secrétariat, commission des Finances et de l'Économie, Assemblée nationale ; M. Lee Yong-keun, vice-président, Financial Supervisory Commission ; M. Lee Tae-kyu, directeur des affaires internationales, Financial Supervisory Commission ; M. Heo Young-koo, vice président, Korean Confederation of Trade Unions ; M. Sohn Byung-doo, directeur exécutif adjoint, Federation of Korean Industries ; RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE (83) S.Exc. M. Pierre Morel, ambassadeur de France à Pékin ; M. Pierre Boyon, ministre-conseiller pour les affaires économiques et commerciales, ambassade de France en République populaire de Chine ; Mme Anne Grillo-Nebout, premier secrétaire, ambassade de France en République populaire de Chine ; M. Li Jianghe, vice-ministre chargé de la réforme du système économique, Conseil des affaires d'État ; M. Zhang Wenzhong, député, membre du Comité permanent de l'Assemblée nationale populaire ; M. Yao Zehnyan, vice-président, Commission des affaires économiques et financières, Assemblée nationale populaire ; M. Su Jun, directeur adjoint des services, Commission des affaires économiques et financières, Assemblée nationale populaire ; M. Li Ruogu, directeur général, département international, Banque populaire de Chine ; M. Zhou Min, directeur général, conseiller du président, Banque de Chine ; M. Lin Yixiang, vice-président, China Securities C° ; M. Andrew Rothman, ministre-conseiller pour les affaires économiques, ambassade des États-Unis en République populaire de Chine ; Mme Kenny Richards, ministre-conseiller, ambassade d'Australie en République populaire de Chine ; M. Gregory Andrews, premier secrétaire chargé des affaires économiques, ambassade d'Australie en République populaire de Chine ; M. Greg Shea, directeur financier, Hewlett Packard ; M. Alban Yung, directeur des financements internationaux et des crédits à l'exportation, BNP Chine ; M. Marc d'Antras, directeur financier, Saint-Gobain ; M. Olivier Monange, vice-président, chambre de commerce et d'industrie France-Chine ; M. Michel Sevin-Allouet, directeur, Société générale Chine ; M. Philippe Gresinski, directeur, Crédit Lyonnais Chine ; M. Pierre Romestain, directeur, EDF Chine ; M. Denis Chin, chargé de mission, Saur Chine ; M. Jean-Claude Milleron, ministre-conseiller financier, ambassade de France à Washington ; M. Stéphane Chmelewsky, consul général de France à Boston ; M. Thierry Dissaux, conseiller financier, agence financière à New York ; M. Olivier Bouin, attaché culturel et scientifique, consulat général de France à Boston ; M. Ernest T. Patrikis, premier vice-président et conseiller spécial, American International Group Inc. ; M. David E. Weinstein, professeur d'économie japonaise, département d'économie, Columbia University ; M. Lawrence M. Sweet, vice-président, direction « Marchés émergents et affaires internationales », Federal Reserve Bank of New-York ; M. Daniel P. Kinney, chargé de mission, direction « Marchés émergents et affaires internationales », Federal Reserve Bank of New-York ; M. Marc Uzan, directeur exécutif, The Reinventing Bretton-Woods Committee ; M. Gerald Corrigan, directeur général, Goldman Sachs ; M. Nicholas Platt, président, Asia Society ; M. Rudiger Dornbusch, professeur, MIT World Economy Laboratory, Massachussets Institute of Technology ; M. Dwight H. Perkins, professeur d'économie politique, Harvard Institute for International Development, Harvard University ; M. Joseph J. Stern, directeur de recherche, Harvard Institute for International Development, Harvard University ; M. Bertrand Lavezzari, senior fellow, Weatherhead Center for International Affairs, Harvard University ; M. Marcus Noland, directeur de recherche, Institute for International Economics ; M. Matthew A. Reynolds, administrateur, sous-commission « Asie - Pacifique », Commission des relations internationales, Chambre des représentants ; M. Chi Hung Kwan, chercheur associé, Brookings Institution ; M. David H. Howard, directeur adjoint, département « Finances internationales », Board of Governors of the Federal Reserve System ; M. Thomas A. Connors, directeur adjoint, département « Finances internationales », Board of Governors of the Federal Reserve System ; M. Steven B. Kamin, assistant du directeur, département « Finances internationales », Board of Governors of the Federal Reserve System ; M. Nathan D. Sheets, chef de la section du développement international, département « Finances internationales », Board of Governors of the Federal Reserve System ; M. Nouriel Roubini, conseiller spécial du sous-secrétaire aux affaires internationales, département du Trésor ; M. Christopher P. McCoy, directeur adjoint, bureau « Asie et Pacifique », département du Trésor ; M. Keith A. Krulak, économiste, division des affaires internationales, département du Trésor ; M. Kenneth H. Austin, économiste, division des affaires internationales, département du Trésor ; S.Exc. M. Gérard Cros, ambassadeur de France à Jakarta ; M. Olivier Chambard, premier conseiller, ambassade de France à Jakarta ; M. Jacques de Croizant, conseiller de coopération et d'action culturelle, ambassade de France à Jakarta ; Mme Martine Vasseur-Emo, premier secrétaire, ambassade de France à Jakarta ; M. Abdurrahmann Wahid, Président de la République ; M. Widjojo Nitisastro, conseiller économique du président ; M. Nur Fuad, secrétaire général, ministère des Finances ; Mme Miranda Goeltom, vice-gouverneur, Banque d'Indonésie ; M. Mark Baird, Banque Mondiale ; M. Michael Edwards, Banque Mondiale ; M John McCarty, ambassadeur d'Australie ; M. Christian Ortoli, président directeur général, PT Indosuez Indonesia ; M. Yves Battais, directeur, Bank Crédit Lyonnais Indonesia ; M. Cacuk Sudariyanto, président, IBRA ; M. Edward Gustly, chargé de mission, The Jakarta Initiative ; S.Exc. M. Michel Filhiol, ambassadeur de France à Singapour ; M. Michel Planque, conseiller financier, agence financière pour l'Asie du sud-est ; M. Jean-Yves Leclercq, attaché financier, agence financière pour l'Asie du sud-est ; M. Tommy Koh, directeur exécutif, ASEF ; M. Yatiman Yusof, conseiller pour les affaires parlementaires, ministère de l'Information et des Arts ; M. Lew Syn Pau, député ; M. Sabur Ghayur, économiste syndical, département « Asie - Pacifique », Confédération Internationale des Syndicats libres ; Mme Mignon M. J. Chan, directrice générale, Pacific Economic Cooperation Council ; M. Mahizhnan Arun, directeur adjoint, Institute of Political Studies ; Mme Melina Nathan, chercheur associé, Institute of Defence and Strategic Studies ; M. Yeoh-Lam Keong, directeur adjoint, Government of Singapore Investment Corporation Pte Ltd ; M. Arjuna Mahendran, directeur de la recherche économique, SG Securities Pte Ltd ; M. Philippe Pellegrin, directeur général adjoint, Crédit Agricole Indosuez ; M. Philippe Cottus, directeur Asie-Pacifique, BNP ; M. Raymond Barre, ancien Premier ministre, député-maire de Lyon ; M. Michel Camdessus, ancien directeur général du Fonds Monétaire International ; M. Jean-Michel Séverino, vice-président pour l'Asie, Banque Mondiale ; M. Alain Guillouët, directeur, agence financière à Tokyo ; M. Jean-Claude Trichet, gouverneur de la Banque de France ; M. Jean Lemierre, directeur du Trésor ; M. Jean-François Stoll, directeur, Direction des relations économiques extérieures (DREE) ; M. Christophe Lecourtier, chef du bureau « Asie continentale », DREE ; M. Alain Miermont, bureau « Japon, Australie, Nouvelle Zélande, Océanie », DREE ; M. Pierre Barroux, directeur exécutif adjoint, ASEF ; M. Jean-Louis Beffa, président-directeur général, Saint-Gobain ; M. Thierry Breton, président-directeur général, Thomson Multimédia ; M. Louis Schweitzer, président-directeur général, Renault France International ; M. Olivier Davanne, économiste, Conseil d'analyse économique ; M. Christian de Boissieu, professeur d'économie, Université Paris I Panthéon-Sorbonne ; M. François Godement, maître de recherche à l'Institut Français des Relations Internationales, professeur à l'INALCO, membre du groupe consultatif du centre Asie de l'université de Harvard ; M. Jean-Luc Domenach, professeur de relations internationales, chercheur au CERI, directeur scientifique de l'Institut d'Études politiques de Paris ; Mme Agnès Benassy-Quéré, économiste, Centre d'études prospectives et d'informations internationales (CEPII) ; Mme Stéphanie Guichard, économiste, Centre d'études prospectives et d'informations internationales (CEPII) ; Mme Sophie Chauvin, économiste, Centre d'études prospectives et d'informations internationales (CEPII) ; Mme Evelyne Dourille, économiste, Centre d'études prospectives et d'informations internationales (CEPII) ; M. Jérôme Sgard, économiste, rédacteur en chef d'Economie Internationale, Centre d'études prospectives et d'informations internationales (CEPII) ; M. Philippe Delhaise, analyste-expert financier et bancaire, Thomson BankWatch Asia. 2590 - Rapport d'information de M. Jean-Marie Le guen sur le bilan et les enseignements de la crise financière en Asie (commission des finances) () Paul Krugman, La mondialisation n'est pas coupable. Vertus et limites du libre-échange, Paris, 2000 (pp. 163-164). () Chi Hung Kwan, The Yen, the Yuan, and the Asian Currency Crisis. Changing Fortune between Japan and China, Asia/Pacific Research Center, Stanford University, décembre 1998 (p. 22). () Olivier Davanne, Fred Bergsten, Pierre Jacquet, « Pour une gestion conjointe de la flexibilité des changes », Architecture financière internationale, Conseil d'analyse économique, 1999 (p. 9). () Michel Aglietta, « La maîtrise du risque systémique international », Economie Internationale, n° 76, 4e trimestre 1999 (p. 43). () Yung Chul Park, « What have we learned from the Korean financial crisis ? », The Asian Crisis, a New Agenda for Euro-Asian Cooperation, Singapour, World Scientific, 1998 (p. 74). Cet ouvrage reprend les contributions du colloque ASEF/CEPII sur la crise asiatique qui s'est tenu à Paris en mai 1998. () Michel Aglietta, op. cit. (p. 43). () Michel Aglietta, op. cit. (p. 44). () Olivier Davanne, Fred Bergsten, Pierre Jacquet, « Pour une gestion conjointe de la flexibilité des changes », Architecture financière internationale, Conseil d'analyse économique, 1999 (p. 12). () Olivier Davanne, Fred Bergsten, Pierre Jacquet, « Pour une gestion conjointe de la flexibilité des changes », Architecture financière internationale, Conseil d'analyse économique, 1999 (p. 43). () Chi Hung Kwan, Towards a Yen Bloc in Asia, Tokyo, Nomura Research Institute, mai 1999. () Michel Aglietta, op. cit. (p. 55). () Daniel Delalande, « Comment sortir de la crise mondiale », Cahiers français, n° 289, été 1999 (p. 66). () Jeffrey Sachs, « Réformons le FMI et la Banque mondiale », Libération, 8 octobre 1999. () Michel Aglietta, Christian de Boissieu, « Le prêteur international en dernier ressort », Architecture financière internationale, Conseil d'analyse économique, 1999 (p. 112). () Olivier Davanne, Fred Bergsten, Pierre Jacquet, « Pour une gestion conjointe de la flexibilité des changes », Architecture financière internationale, Conseil d'analyse économique, 1999 (p. 22). () Olivier Davanne, Fred Bergsten, Pierre Jacquet, ibid. (p. 23). () Gérard Fuchs, Daniel Feurtet, Réguler la mondialisation financière. Rapport d'information n°2476, Les documents d'information de l'Assemblée nationale, 2000 (p. 69). () Banque mondiale, « The Making of the East Asia Miracle », in World Bank Policy Research Bulletin, vol. 4, n° 4, août-octobre 1993. () Banque asiatique de développement, Emerging Asia : Changes and Challenges, 1997. () Le rapport mentionnait notamment l'ouverture économique, l'abandon des pratiques commerciales incompatibles avec les standards internationaux, l'amélioration de l'environnement, des infrastructures et de l'urbanisme, l'instauration de filets de protection sociale pour amortir le coût des restructurations, etc. () Caisse des dépôts et consignations, Zones émergentes, n° 2, janvier 1997. () Voir par exemple : « Battle for the bath. Thailand tries to vanquish the speculators », Asiaweek, 28 février 1997. () Les renseignements suivants sont tirés de l'étude « The Asian Crisis : Capital Markets Dynamics and Spillover », qui constitue le chapitre II du rapport annuel International Capital Markets établi par le FMI (septembre 1998). () Fonds monétaire international, « Developments and Prospects in Emerging Markets » International Capital Markets, septembre 1997 (page 35). () En 1985, le chaebol Kukje Group, alors huitième par la taille, avait fait faillite après que le gouvernement eut imposé aux banques créancières de ne pas renouveler leurs lignes de crédits. () « The Fall of Hanbo Steel », Asiaweek, 7 février 1997. () « Le système bancaire sud-coréen, déjà fragile, est touché par la faillite de Hanbo Steel », Le Monde, 5 février 1997. () Le Monde mentionne, par exemple, l'achat du plus grand immeuble de Corée et la constitution d'une équipe de base-ball. () Le won s'est engagé sur un sentier légèrement baissier en 1996. () Fonds monétaire international, « The Asian Crisis : Capital Markets Dynamics and Spillover », International Capital Markets, septembre 1998 (page 46). () JP Morgan, Emerging Markets Data Watch, 3 juillet 1997. () Fonds monétaire international, op. cit. () T. Condon, « Southeast Asia : Currency Realignment in ASEAN Dollar-Bloc » in Global Economic Forum, Morgan Stanley Dean Witter, 8 juillet 1997. () Citations extraites de « Battle over Asia's Money », Asiaweek, 28 juillet 1997. () JP Morgan, « ASEAN currency risks after the bath's fall » in Emerging Markets Data Watch, 11 juillet 1997. () Selon l'étude précitée du FMI, il semble que les banques et entreprises indonésiennes aient été effectivement optimistes sur les perspectives de stabilité de la roupie. Elles auraient alors pris position sur les marchés dérivés en vendant des swaps dollar contre roupie ou des options de change. L'objectif aurait été, selon le FMI, d'améliorer les résultats d'exploitation en encaissant les primes générées par la vente de ces produits dérivés. Une telle démarche est évidemment source de fragilité. () Cette assimilation est, effectivement, intempestive et le montant des ventes à terme ne peut être assimilé à un « gage » sur les réserves de change à hauteur de 1 pour 1. En effet, lors du dénouement de la vente, les contreparties de la Banque de Thaïlande devront bien se procurer les baths qu'elles se sont engagées à livrer. Comme le montre l'étude précitée du FMI, les différents moyens envisageables aboutissent, en tout état de cause, à une entrée de devises dans le pays. La perte réelle de réserves de change supportée par la banque centrale ne peut résulter, en première approximation, que de la variation du cours de sa monnaie entre la date de conclusion de la vente à terme et la date de son dénouement. () Les établissements financiers sains étant réticents à prêter leurs liquidités excédentaires aux établissements en difficulté, le bon fonctionnement du marché monétaire est affecté. La banque centrale « recycle » alors auprès des établissements en difficulté les fonds laissés en dépôt dans ses comptes par les établissements sains. Par ailleurs, la défiance envers la roupie est telle que la plupart des liquidités fournies au marché par la banque centrale sont immédiatement converties en dollars par les agents domestiques, alimentant ainsi la chute de la roupie. () Cité dans « A question of openness. At the 51st World Bank-IMF annual meetings in Hong Kong, Asia ponders the costs and benefits of freer markets », Asiaweek, 3 octobre 1997. () Il semble, notamment, que la définition des droits de propriété et, de façon générale, la mise en application du droit sur les faillites, aient été les éléments qui suscitaient le plus d'interrogations, notamment au regard du traitement à réserver aux 58 compagnies financières dont l'activité avait été suspendue. () Morgan Stanley Dean Witter, « Malaysia: The 1998 Budget: More Was Needed », in Global Economic Forum, 21 octobre 1997. () JP Morgan, « ASEAN's policy response to the currency crisis », in Emerging Markets Data Watch, 17 octobre 1997. () JP Morgan, « North Asia weathering currency storm », in Emerging Markets Data Watch, 18 juillet 1997. () Angus Armstrong, « Asia's currency crisis heads north », in Economic & Financial Outlook, Deutsche Bank, novembre 1997. () Andy Xie, Stephen Jen, « Taiwan : is There a Choice Between the Stock Market and the Currency ? », in Global Economic Forum, 21 octobre 1997. () L'étude précitée du FMI indique que le volume des ventes à découvert n'a représenté que 3% du volume total du marché pendant cet épisode, ce qui ne représente pas de déviation significative par rapport à la normale. () JP Morgan « Corporate restructuring for Korea and China », in Emerging Markets Data Watch, 8 août 1997. () Fonds monétaire international, « The Asian Crisis : Capital Markets Dynamics and Spillover », International Capital Markets, septembre 1998 (page 55). () JP Morgan, « Korea struggles to restore financial stability », in Emerging Markets Data Watch, 21 novembre 1997. () Fonds monétaire international, op. cit. () Encore faut-il tenir compte d'un rebond extrêmement vigoureux, dans les tout derniers jours de décembre, à la suite de l'annonce par les banques créancières du plan de rééchelonnement des dettes à court terme. Au plus bas, le won avait perdu plus de 55% de sa valeur par rapport au dollar. () JP Morgan, « Emerging Asia : throwing it into reverse », in Asian Financial Markets, 28 avril 1998. () Du mois de juillet au mois de novembre 1997, les banques thaïlandaises ont pu faire appel au soutien de la banque centrale sans que celle-ci n'exige la mise en place des collatéraux qui sont généralement la contrepartie de toute intervention du prêteur en dernier ressort. Les collatéraux sont des actifs appartenant à la banque demandant un soutien financier, qui servent à « gager » l'emprunt fait par elle auprès de la banque centrale. () Joël Guglietta, Jérôme Sgard, « Thaïlande : de la crise de croissance à la crise monétaire », in Économie internationale, n° 76, 4ème trimestre 1998. () Là encore, la Thaïlande montre quelque spécificité : entrée la première dans la crise financière, elle est également la première à en ressentir les effets dans l'économie réelle. Par exemple, la production industrielle commence à chuter dès le troisième trimestre de 1997. () Direction de la prévision, Note de conjoncture internationale, juin 1998. () Banque mondiale, East Asia. Recovery and Beyond, mai 2000 (page 35). () Jean-Claude Pomonti, « L'Indonésie éprouve de plus en plus de mal à gérer la crise », Le Monde, 8 janvier 1998. () Fonds monétaire international, IMF-Supported Programs in Indonesia, Korea and Thailand. A Preliminary Assessment, IMF Occasionnal Paper, n° 178, juin 1999 (page 59). () « Les maux de l'Indonésie », Le Monde, 17 février 1998. () Jérôme Sgard, « Les crises en Asie », in Économie internationale, n° 76, 4e trimestre 1998. () Banque des règlements internationaux, 68e Rapport annuel, juin 1998 (page 110). () Asian Development Bank, « The Financial Crisis in Asia », in Asian Development Outlook 1998, avril 1999 (page 23). () Direction de la prévision, Note de conjoncture intenationale, juin 1998. () Le seul paiement des intérêts de la dette publique absorbait 25% des recettes du budget fédéral en janvier 1998, puis 50% en juin 1998 (source : Banque des règlements internationaux, 69e Rapport annuel, juin 1999, page 54). () Le Wall Street Journal fait, pour la première fois, état de pertes subies par LTCM le 24 juillet 1998, soit bien avant le moratoire russe du 17 août. () Committee on the Global Financial System, A Review of Financial Markets Events in Autumn 1998, Banque des règlements internationaux, octobre 1999. () Banque des règlements internationaux, 69e Rapport annuel, juin 1999 (page 106). () Le taux de change du real contre le dollar se dépréciait régulièrement, à un rythme déterminé et encadré par les autorités. () Pendant la majeure partie des années 90, cette bande de fluctuation était de 2% au total. Elle a été élargie progressivement jusqu'à atteindre 8% au premier semestre 1997. () G. Corsetti, P. Pesenti, N. Roubini, What caused the Asian currency and financial crisis ? janvier-septembre 1998. () OCDE, Corée, Études économiques de l'OCDE, 1996 (pages 81-82). () D. Flouzat, La nouvelle émergence de l'Asie. L'évolution économique des pays asiatiques depuis la crise de 1997, Presses universitaires de France, coll. « Major », 1999 (pages 102-103). () G. Corsetti, P. Penseti, N. Roubini, op. cit. () La notion de taux de change réel faisant appel au différentiel d'inflation entre les deux pays concernés, le taux de change réel ne peut pas être calculé dans l'absolu. La seule grandeur accessible à l'analyse est l'évolution du taux de change réel entre deux dates déterminées. () Par exemple, un chercheur du département de recherche économique de la Banque fédérale de réserve de San Francisco estime que le taux de change réel s'est apprécié de plus de15% entre décembre 1994 et le premier trimestre 1997 en Indonésie, en Malaisie, aux Philippines et en Thaïlande. Il estime également que sur la période 1990-1997, le taux de change réel s'est apprécié de plus de 25% pour ces pays. Il estime, enfin, que le taux de change réel de la Corée s'est apprécié de 12% (R. Glick, « Thoughts on the Origins of the Asia Crisis : Impulses and Propagation Mechanisms », Pacific Basin Working Paper Series, n° PB 98-07, septembre 1998). () Banque mondiale, East Asia : the Road to Recovery, septembre 1998 (page 25). () Les informations qui suivent sont, pour l'essentiel, extraites de R.B. Johnston, S.M. Darber, C. Echeverria, Sequencing Capital Account Liberalization : Lessons from the Experiences in Chile, Indonesia, Korea and Thailand, Document de travail du FMI, WP/97/157, novembre 1997. () L'article VIII des statuts du FMI définit les obligations générales des États membres en matière de transactions courantes : interdiction de toute restriction sur les paiements, interdiction de toute pratique discriminatoire ou différenciée en matière de change. Il définit également les obligations des États membres au regard des avoirs détenus à l'étranger libellés dans leurs devises, ainsi que diverses obligations relatives à la collaboration avec le FMI (informations, consultations, etc.). () Il semble que les restrictions n'aient pas été rétablies pour les emprunts effectués par les sociétés commerciales, ce qui expliquerait que, contrairement à d'autres pays asiatiques, une part importante de la dette extérieure ait été portée par le secteur commercial plutôt que par les banques. () Par exemple, les autorités ont imposé des restrictions aux crédits commerciaux dont pouvaient bénéficier les entreprises coréennes ainsi qu'aux emprunts bancaires à l'étranger. () S. Takagi, T. Esaka, Sterilization and the Capital Inflow Problem in Asia (1987-97), Economic Planning Agency (Japon), mars 2000. () S. Takagi, T. Esaka, op. cit. () S. Radelet, J. Sachs, The Onset of the East Asian Financial Crisis, Harvard Institute of Development, mars 1998. () Cette situation était fréquente en Asie, la tradition d'excédents budgétaires ayant limité les émissions de titres d'emprunts d'État. () Dans le cas où la banque centrale vend un titre qu'elle possède déjà en portefeuille, par exemple un emprunt d'État, le coût s'entend alors comme l'intérêt versé par l'État qui ne revient plus à la banque centrale puisqu'elle ne possède plus le titre d'emprunt correspondant. () S. Takagi, T. Esaka, op. cit. () En Malaisie, près de 2,6 milliards de dollars relevant du Fonds de prévoyance des fonctionnaires auraient ainsi été transférés des banques commerciales vers la banque centrale en 1992. () Banque des règlements internationaux, 67e Rapport annuel, juin 1997 (page 119). () Fonds monétaire international, Thailand : Selected Issues, IMF Staff Country Report, n° 00/21, février 2000. () Fonds monétaire international, Indonesia : Statistical Appendix, IMF Staff Country Report, n° 99/39, mai 1999. () Fonds monétaire international, Republic of Korea : Economic and Policy Developments, IMF Staff Country Report, n° 00/11, février 2000. () G. Corsetti, P. Pesenti, N. Roubini, What caused the Asian currency and financial crisis ? janvier-septembre 1998. () Le renouvellement du crédit stand-by consenti au profit des Philippines doit essentiellement s'interpréter comme une mesure de précaution, les Philippines ayant rapidement renoncé à défendre leur monnaie par des interventions sur les marchés ou par l'augmentation des taux d'intérêt. () Banque de Thaïlande, Bank of Thailand Economic Focus : Focus on the Thai Crisis, vol. 2 n° 2, avril-juin 1998. () C. R. Harvey, A. H. Roper, « The Asian Bet », in Financial Markets & Development. The Crisis in Emerging Markets, Brookings Institution Press, 1999. () Banque des règlements internationaux, 68e Rapport annuel, juin 1998. () JP Morgan, « Financial restructuring is key to Asia's future », in Asian Financial Markets, 24 avril 1998. () Dans son étude East Asia. Recovery and Beyond (mai 2000), la Banque mondiale rappelle que la détention de banques par de grands groupes industriels est fréquente en Indonésie, en Malaisie et aux Philippines. Par ailleurs, même si le contrôle de banques de dépôt est interdit aux chaebols par la législation coréenne, les grands chaebols ont pu avoir un accès privilégié au crédit par le biais de banques d'affaires propriétaires. () E. Borensztein, J-W. Lee, Credit Allocation and Financial Crisis in Korea, IMF Working Paper, WP/99/20, février 1999. () E. Borensztein, J-W. Lee, op. cit. () Banque des règlements internationaux, 68e Rapport annuel, juin 1998 (page 126). () G. Corsetti, P. Pesenti, N. Roubini, What caused the Asian currency and financial crisis ? janvier-septembre 1998. () Fonds monétaire international, The IMF's Response to the Asian Crisis, site Internet du FMI, octobre 1998. () Fonds monétaire international, Recovery from the Asian Crisis and the Role of the IMF, site Internet du FMI, juin 2000. () P. Krugman, What Happened to Asia ? janvier 1998. () M. Feldstein, « This was Clearly a Case of Temporary Illiquidity rather than Fundamental Insolvency », Foreign Affairs, mars-avril 1998. () J. Stiglitz, Sound Finance and Sustainable Development in Asia, mars 1998. () S. Radelet, J. Sachs, The East Asian Financial Crisis : Diagnosis, Remedies, Prospects, Harvard Institute for International Development, 20 avril 1998. () M. Camdessus, The IMF's role in todays globalized world, communication au symposium FMI-Bundesbank, juillet 1998. () L'exception thaïlandaise étant ici rappelée. () Fonds monétaire international, Communiqué de presse 97/55, 4 décembre 1997. () S. Radelet, J. Sachs, The East Asian Financial Crisis : Diagnosis, Remedies, Prospects, Harvard Institute for International Development, 20 avril 1998. () « To stop the money panic », Asiaweek, 13 février 1998. () S. Radelet, J. Sachs, The East Asian Financial Crisis : Diagnosis, Remedies, Prospects, Harvard Institute for International Development, 20 avril 1998. () T. Lane, M. Schulze-Ghattas, « Program Financing and Market Reactions », in IMF-Supported Programs in Indonesia, Korea and Thailand, IMF Occasional Paper, n° 178, juin 1999 (page 21). () Banque mondiale, East Asia. Recovery and Beyond, mai 2000. () Banque mondiale, East Asia. Recovery and Beyond, mai 2000. () Au paquet initial de 16,7 milliards de dollars, le Brunéi a ultérieurement ajouté 500 millions de dollars. () J.L. Domenach, L'Asie en danger, 1998. () A l'exception de l'Indonésie. () La Korea Asset Management Corporation (KAMCO) a été créée en 1962, comme filiale de la Korea Development Bank, afin de servir de structure intermédiaire destinée à disposer d'actifs saisis auprès d'établissements bancaires en difficulté. Elle a été rétablie en novembre 1997, comme fonds d'acquisition et de gestion d'actifs bancaires non performants. Son actionnariat est réparti entre le gouvernement coréen (38%), la Korea Development Bank (31%) et 24 autres banques (31%). () Selon les informations fournies par KAMCO, il apparaît qu'en Corée, les prêts assortis de garanties ont été acquis avec une décote d'environ 50%, alors que les prêts sans collatéral ont été acquis avec une décote moyenne de 90%, pouvant aller parfois jusqu'à 99%. () Voir par exemple le Courrier de l'Agence financière pour l'Asie du Sud-Est, n° 157, octobre 1999 (page 14) et n° 162, mars 2000 (page 28). () Il semble que ces réticences aient été dues au désir des actionnaires de ne pas perdre le contrôle de leurs banques. () Agence financière pour l'Asie du sud-est, Le Courrier de l'Agence financière pour l'Asie du Sud-Est, n° 157, octobre 1999 (page 15). () Banque mondiale, East Asia Recovery Report, mars 2000. () L'introduction de véritables comptes consolidés est prévue, mais devrait être conditionnée par la réalisation d'autres réformes, comme la disparition des garanties intra-groupes et l'amélioration de la transparence et de l'opposabilité aux tiers des transactions intra-groupes. () Voir par exemple « Sony New e-Strategy », Asiaweek, 28 janvier 2000. () N. Kristof, « Crisis Pushing Asian Capitalism Closer to U.S.-Style Free Market », New York Times, 17 janvier 1998. () E. von Pfeil, « The Mirage of Asia's Change », Far Eastern Economic Review, 18 mai 2000. () Patrice Geoffron, « Le chantier des restructurations industrielles japonaises », Le Monde, 16 novembre 1999. () Entretien à l'ambassade de France à Tokyo, juillet 1999. () Le régime du président Marcos est tombé en février 1986 et une nouvelle Constitution a été adoptée par référendum en février 1987. () Les manifestations de juin 1987 ont abouti à l'amnistie de Kim Dae-jung, leader de l'opposition, emprisonné. La réforme constitutionnelle adoptée en octobre 1987 a instauré l'élection du président au suffrage universel direct et raccourci son mandat de sept à cinq ans ; elle a revalorisé le rôle du Parlement et établi des garanties en matière de libertés publiques. () En octobre 1986, le président Chiang Ching-kuo a décidé d'autoriser la création du Parti démocratique progressiste, formation indépendantiste. Par ailleurs, la loi martiale, en vigueur depuis 1949, a été abrogée en juillet 1987. () Les effectifs de la Chambre des représentants restaient fixés à 500, les militaires n'ayant plus que 38 sièges au lieu de 75. Les effectifs de l'Assemblée consultative du peuple étaient ramenés de 1000 à 700, soit les 500 membres de la Chambre des représentants plus 200 membres nommés, dont 135 représentant les régions et 65 représentant des « groupes fonctionnels » (religieux, fonctionnaires, anciens combattants, etc.). L'élection du président est du ressort de l'Assemblée consultative du peuple. () Près de 70 millions de dollars auraient été détournés de cette banque, recapitalisée dans le cadre du programme d'assainissement financier du FMI, au profit du parti au pouvoir, le Golkar, afin de faciliter l'achat de votes en sa faveur lors de la session de l'Assemblée consultative du peuple. () Voir notamment deux articles de José Manuel Tesoro : « Nation Adrift » et « Less Restless » dans Asiaweek, 7 juillet 2000. () Dans un dossier spécial consacré aux élections en Asie, l'hebdomadaire Asiaweek indique que les retraits d'argent liquide ont augmenté de 70% par rapport à la normale dans les jours précédant les élections sénatoriales (édition du 7 avril 2000). () On s'accorde à considérer que les sociétés paysannes, dominées par les chefs de village, qui pratiquent un « patronage » traditionnel et dispensent à la fois conseils et faveurs, rendent les populations rurales particulièrement vulnérables aux achats de vote. Par ailleurs, une étude du Programme des Nations unies pour le développement, conduite dans le cadre d'un programme d'éducation au vote concomitant aux élections législatives indonésiennes de juin 1999, suggère que les populations défavorisées ne considèrent pas la démocratie comme un moyen efficace d'améliorer leur quotidien et sont donc plus susceptibles de réagir favorablement aux « arguments monétaires » des candidats. () Luc Demaret, « Asie : répression sur fond de crise », in Le Monde syndical, 1er juin 1999. () Entretien à Singapour, 6 avril 2000. () Destinée à éradiquer le parti communiste indonésien, fort d'environ 3 millions d'adhérents au début des années 60, l'épuration déclenchée en 1965, lors de la prise du pouvoir par le général Suharto, a fortement touché la communauté chinoise, assimilée à une « tête de pont » de la Chine populaire. () Une « République libre des Moluques du sud » a été proclamée en 1950 mais n'a pas obtenu de reconnaissance internationale. Ses représentants vivent en exil aux Pays-Bas et ont annoncé, le 30 juin 2000, une coopération avec le Mouvement pour la libération d'Atjeh et l'Organisation Papouasie libre. Il semble que la République libre des Moluques du sud dispose sur place d'un soutien « indéniable mais difficilement quantifiable », selon des informations recueillies par l'Agence France-Presse (dépêche AFP du 30 juin 2000). () Philip Bruno, « La grande peur d'une balkanisation du plus grand archipel du monde », Le Monde, 9 septembre 1999. () Le mouvement indépendantiste athjenais fonde son combat sur la dénonciation de l'exploitation par le pouvoir central javanais des ressources naturelles d'Atjeh, d'une part, et sur la répression par la force des revendications des populations locales, d'autre part. () Contrairement à celle ayant visé Timor oriental, cette annexion a été reconnue par l'ONU. () Le vice-premier ministre déchu a été accusé de « complots contre l'État et sodomie ». () Les indigènes de Sabah et Sarawak représentent la majeure partie de la population non comptabilisée ici. () L'UMNO (United Malays National Organisation) s'est fixée comme objectif d'assurer aux Malais l'exercice du pouvoir politique après l'indépendance. () La Constitution de la Malaisie dispose que tout Malais est, par définition, musulman (cité dans Asiaweek, 16 juin 2000). () Par exemple, les fonctionnaires musulmans sont désormais obligés de suivre chaque semaine deux cours d'instruction religieuse. De même, le gouvernement a décidé d'instaurer des lois inspirées de la charia dans l'État de Johor, situé à l'extrémité méridionale du pays. () La Chine montre un profil irrégulier : la part de ses exportations absorbée par le marché japonais était égale à 22,3% en 1985, puis a chuté à 14,6% en 1990, mais est remontée à 17,8% en 1994. Pour les deux autres zones, la décroissance est régulière entre les quatre années recensées : 1980, 1985, 1990 et 1994. () Il s'agit donc des marchés représentés par les NPI, les pays d'Asie du sud-est, la Chine et l'Asie du sud. () Là encore, la Chine montre un profil irrégulier, les exportations absorbées par les marchés asiatiques s'élevant à 52% de ses exportations totales en 1990 avant de revenir à la valeur indiquée de 39,6% en 1994. () Direction des relations économiques extérieures, « Échanges : la très forte reprise de l'intra-asiatique », Revue Asie Actualités, n° 0002, 25 janvier 2000. () Conférence des Nations unies pour le commerce et le développement, Communiqué de presse TAD/INF/2834 du 25 janvier 2000. () Direction des relations économiques extérieures, Revue Asie Stratégies, n° 57, 13 mars 2000. () Un wafer est une plaque ronde de silicium, dont le diamètre est d'environ une dizaine de centimètres, sur laquelle sont gravés plusieurs dizaines ou centaines de circuits intégrés identiques. () Direction des relations économiques extérieures, « Les paradoxes de l'évolution des échanges intra-asiatiques », Les Notes économiques Asie, n° 41, 7 juin 1999. () L'apparition d'« économies externes », dues aux effets attractifs que provoque la concentration géographique d'une même activité, concerne également l'industrie électronique et informatique, ce qui explique, par exemple, le maintien d'activités de construction informatique à Singapour, malgré le coût de la main d'_uvre locale. () Direction des relations économiques extérieures, « Automobile : répartition des rôles au sein de l'ASEAN ? », Revue Asie Actualités, n° 00-05, 7 mars 2000. () Johor est l'État malais duquel a été détaché Singapour en 1965 ; Riau est un ensemble d'îles indonésiennes situées dans le détroit de Malacca. () Votre Rapporteur rappellera ici pour mémoire l'existence d'un accord d'échanges de devises conclu en 1977 dans le cadre de l'ASEAN, pour un montant total de 100 millions de dollars. Cet accord était destiné à résoudre les difficultés temporaires de balance des paiements, mais n'a jamais été mis en _uvre. () Australie, Chine, Corée, Hong Kong, Indonésie, Japon, Malaisie, Nouvelle-Zélande, Philippines et Thaïlande. () Il semble, cependant, que l'idée ait déjà été évoquée lors de la réunion de Tokyo, le 11 août 1997 (cf. Masaru Yoshitomi, How to avoid another capital account crisis, document de travail présenté à l'atelier de l'Institut de la Banque asiatique de développement sur les accords régionaux pour une nouvelle architecture financière internationale, Singapour, 7-8 juin 2000). () Agence France-Presse, « L'ASEAN renonce dans l'immédiat à créer un « fonds monétaire » régional », 19 septembre 1997. () « Essentiellement » est indispensable dès lors que l'on ne peut écarter non plus l'impact des comportements spéculatifs d'une part, de la surréaction naturelle des marchés d'autre part. () Voir par exemple Fred Bergsten, « Reviving the `Asian Monetary Fund' », International Economics Policy Brief, décembre 1998. () La réunion de Manille rassemblait les adjoints des ministres des finances et les gouverneurs adjoints des banques centrales pour l'Australie, Brunei, la Chine, Hong Kong, l'Indonésie, la Corée du Sud, la Malaisie, la Nouvelle-Zélande, les Philippines, Singapour et la Thaïlande ainsi que les États-Unis, le Canada et le Japon. Des représentants du FMI, de la Banque mondiale et de la Banque asiatique de développement étaient également présents. () Les Nouveaux accords d'emprunt complètent les Accords généraux d'emprunt, qui forment ensemble les deux mécanismes multilatéraux permettant au FMI d'emprunter des ressources supplémentaires auprès de certains États membres. La participation de la France aux Nouveaux accords d'emprunt et le montant susceptible d'être prêté au FMI dans ce cadre ont été autorisés par l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1997. Les Nouveaux accords d'emprunts ont été activés pour la première fois pour financer le programme de soutien au Brésil décidé en décembre 1998. () Il s'agit de l'expression employée dans une dépêche de l'Agence France-Presse (30 novembre 1997). () Selon le Service économique et commercial de l'Ambassade de France à Tokyo, le montant réel des engagements japonais nouveaux serait plutôt de 10 à 12 milliards de dollars. Par exemple, l'enveloppe allouée aux prêts de l'Eximbank était officiellement de 7,6 milliards de dollars, mais le Service économique et commercial notait que 5 milliards de dollars était déjà engagés dans le cadre des programmes de sauvetage du FMI. () Source : site Internet du ministère des finances du Japon, 18 juillet 2000 (adresse : www.mof.go.jp/english/index.htm). () De la même façon que les plans de soutien du FMI sont, au moment de leur annonce, des promesses de versements, ces 7,5 milliards de dollars sont des promesses de financement, qui n'ont, à la connaissance de votre Rapporteur, fait l'objet d'aucun tirage jusqu'ici. () G. P. Goad, « Asian Monetary Fund Reborn », Far Eastern Economic Review, 18 mai 2000 (votre Rapporteur tient à faire remarquer le caractère inexact du titre de cet article, l'initiative de Chiang Maï marquant, au contraire, l'abandon officiel du projet japonais de fonds monétaire asiatique tel que conçu à l'origine). () A. Bénassy-Quéré, Optimal Pegs for Asian Currencies, Documents de travail du CEPII, n° 97-14, octobre 1997. () Selon les évaluations effectuées par C.H. Kwan, une variation de 10% de la parité du yen face au dollar se traduit par une variation de 1% du PIB des pays asiatiques (hors Japon) (cf. C.H. Kwan, Towards a Yen Bloc in Asia, Nomura Research Institute, mai 1999). () En d'autres termes, l'impact récessif d'une hausse du yen serait plus également réparti au sein de la zone. En revanche, tous les pays bénéficieraient de l'expansion induite par une dépréciation du yen. () Le capital des banques japonaises étant libellé en yen, mais leurs prêts à l'étranger étant parfois libellés en dollar, l'évolution de la parité yen/dollar devrait, normalement, conduire les banques à ajuster le niveau de leurs ressources assimilables à du capital ou bien le niveau de leurs prêts afin de respecter partout et toujours les ratios prudentiels établis dans le cadre de la Banque des règlements internationaux. Un développement des prêts à l'Asie libellés en yen pourrait, au demeurant, réduire cette contrainte. () C.H. Kwan, Towards a Yen Bloc in Asia, Nomura Research Institute, mai 1999. () Source : JP Morgan, « The next big fx [foreign exchange] theme : regional currency blocs », in World Financial Markets, 2 juillet 1999 (pages 11-15). () T. Bayoumi, B. Eichengreen, P. Mauro, On regional monetary arrangements for ASEAN, novembre 1999, cité dans Le Courrier de l'Agence financière pour l'Asie du Sud-Est, n° 164, mai 2000 (page 3). () Brice Pedroletti, « Pour "M. Yen", l'euro sera un grand succès », Le Monde, 29 décembre 1998. () Centre des hautes études sur l'Afrique et l'Asie modernes, Regards sur l'Asie orientale, 1999. () La création de l'AFTA doit s'analyser comme la réponse de l'ASEAN aux craintes suscités par la mise en _uvre du marché unique européen, qui a souvent été perçue comme le désir des Européens de se retrancher à l'intérieur d'une « forteresse Europe ». () Le ministre philippin des Affaires étrangères déclarait ainsi, à l'occasion du sommet de l'ASEAN à Manille, en novembre 1999 : « il est devenu clair que, quand les choses commencent à aller mal en Asie du sud-est, il n'existe ni forum ni mécanisme adéquats pour résoudre les problèmes » (AFP, 22 novembre 1999). () Aux yeux de votre Rapporteur, la déclaration solennelle ASEAN Vision 2020, adoptée au sommet de Kuala Lumpur en décembre 1997, traduit moins la volonté de construire un projet politique que de conjurer le pessimisme ambiant à cette date. () La particularité de Singapour est, à cet égard, une exception dont la portée doit être relativisée : la prospérité de Singapour repose, en grande partie, sur le commerce intra-régional, donc sur les liens avec ses partenaires. De même, Singapour entretient des relations économiques étroites avec la Malaisie, qui est quelque sorte son « arrière pays ». () Lors du sommet de Manille (novembre 1999), les chefs d'État et de gouvernement de l'ASEAN ont décidé d'écourter de cinq ans la période de suppression progressive des droits de douane, pour les six membres les plus riches. Le délai supplémentaire accordé au Cambodge, au Laos, au Myanmar et au Vietnam a également été écourté de trois ans, ramenant la date de suppression des tarifs à 2015. Cependant, au printemps 2000, la Malaisie a décidé unilatéralement d'exclure son secteur automobile du champ d'application de l'accord de libre échange, pour lui permettre d'absorber le choc causé par la crise. Le 1er mai 2000, prenant acte de cette décision, les ministres du commerce de l'ASEAN ont autorisé l'ensemble des États membres à réviser, chacun pour ce qui le concerne, la liste des secteurs qu'ils ont déjà inclus dans le champ de l'accord de libre échange. () Selon les informations publiées dans la presse à l'époque, l'accord prévoyait que la Corée du sud assume 70% du coût de la construction des deux réacteurs, le Japon prenant à sa charge 20% et les États-Unis 10% (Philippe Pons, « L'accord entre les États-Unis et la Corée du nord. Le scepticisme prévaut à Séoul après le compromis sur le nucléaire », Le Monde, 25 octobre 1994). () Le président Kim a insisté à de nombreuses reprises sur sa volonté de ne pas précipiter une éventuelle réunification. Indépendamment de la charge que représenterait, à court terme, cette réunification pour une économie sud-coréenne qui n'a pas la même assise que l'économie ouest-allemande en 1989, la portée de cette affirmation était essentiellement politique. () L'une actuelle, l'autre en devenir, mais le PIB de la Chine se situe d'ores et déjà au septième rang mondial. () Lors de son voyage au Japon, en novembre 1998, le président Jiang Zemin a tenté d'obtenir, sans succès, des excuses écrites du gouvernement japonais pour les exactions commises sur le territoire chinois. () Les autorités chinoises ont obtenu du président Clinton que celui-ci ne s'arrête pas à Tokyo au retour de son voyage en Chine, en juin 1998. () Conformément à l'interprétation classique de la constitution par les autorités japonaises, le Japon s'interdit de participer à toute action d'autodéfense collective au sens que lui donne l'ONU. Cependant, les Nouvelles directives pour la coopération de défense États-Unis / Japon, signées en 1997 et adoptées par la Diète en 1999, ouvrent la porte à la mise en _uvre d'actions d'autodéfense collective conjointement avec les États-Unis (voir R. Serra, « Le monde politique japonais en quête d'une nouvelle politique de défense », in Chine, Japon, ASEAN. Compétition stratégique ou coopération ? La Documentation française, coll. Notes et études documentaires, septembre 1999). () T. Seki, « A Japan-India Front », Far Eastern Economic Review, 25 mai 2000. () Contrairement à tous les usages internationaux, la Corée du nord a procédé au tir de son missile balistique sans en avoir prévenu aucun pays. () Le rapport Cox sur les activités chinoises d'espionnage aux États-Unis en vue d'acquérir des renseignements nucléaires stratégiques a été publié en mai 1999. () Entretien avec M. Jean-Pierre Cabestan, directeur du Centre d'études français sur la Chine contemporaine, Hong Kong, juillet 1999. () Le yuan n'est librement convertible que pour les opérations liées aux transactions courantes, en conformité avec l'article VIII des statuts du FMI, aux obligations duquel la Chine a adhéré en 1996. () Les analystes de JP Morgan remarquent que la nature des surcapacités diffère en Chine et en Corée. En effet, la Chine s'est caractérisée par la multiplication des unités de production, empêchant l'apparition d'économies d'échelle, alors que la Corée a plutôt été victime d'une course au gigantisme des chaebols (voir « Corporate restructuring for Korea and China », in Emerging Markets Data Watch, 8 août 1997). () Le système bancaire chinois comprend également trois banques spécialisées (Banque de développement, Banque du développement agricole, Banque du commerce extérieur) et quatorze banques commerciales de moindre envergure. () Banque mondiale, East Asia. Recovery and Beyond, mai 2000 (page 88). () La Banque de Chine est l'une des quatre banques commerciales d'État et ne doit pas être confondue avec la Banque populaire de Chine, qui est la banque centrale. () Pour prendre la mesure de cette décision, il convient de rappeler que le secteur non bancaire comprenait, à la fin de l'année 1996, 11 compagnies d'assurance, 97 sociétés de titres, 244 compagnies fiduciaires et d'investissement, 67 compagnies financières et 16 sociétés de leasing (source : JP Morgan, « China's balancing act on financial reforms », in Asian Financial Markets, 24 avril 1998). () S. Kobayashi, J. Baobo, J. Sano, « The Three Reforms in China : Progress and Outlook », Sakura Institute of Research, RIM, n° 45, septembre 1999. () Le système fédéral de réserve est organisé autour de douze banques régionales, qui recouvrent chacune plusieurs États de l'Union. () Cette relance a été officialisée par un discours de Deng Xiaoping en visite dans la zone économique spéciale de Shenzhen, en janvier 1992. () S. Kobayashi, J. Baobo, J. Sano, « The Three Reforms in China : Progress and Outlook », Sakura Institute of Research, RIM, n° 45, septembre 1999. () « Les Chinois sont en train de mourir de leur épargne » déclarait à votre Rapporteur M. Alban Yung, directeur de BNP-Paribas Chine (juillet 1999). () Frédéric Bobin, « Chine : le chômage explose sur fond de restructuration », Le Monde, 5 mai 1998. () La Chine a conclu les négociations bilatérales avec les États-Unis en novembre 1999 et avec la Communauté européenne en avril 2000. () Sous réserve, bien entendu, de la lutte au sommet entre les deux grandes tendances que l'on appelle couramment « réformateurs » et « conservateurs » ; () Bien que les chiffres soient sujets à caution, les membres du Falungong seraient plusieurs millions, les autorités ayant « reconnu » environ 2 millions d'adeptes tandis que d'autres sources évoquent près de 40 millions de personnes. L'inquiétude du pouvoir est renforcée par le fait que le mouvement Falungong semble être implanté dans l'armée et dans les structures mêmes du Parti communiste. () La modification constitutionnelle de mars 1999 a, notamment, fait de la propriété privée une "composante importante" de l'économie socialiste de marché, et établi le principe du "gouvernement par la loi". L'étude de ce principe par les intellectuels et les autorités chinoises a débuté, en fait, à la fin des années 70, comme réaction à l'arbitraire des dernières années du maoïsme et de la révolution culturelle. () Entretien accordé par le ministre coréen des affaires étrangères à l'hebdomadaire Asiaweek (édition du 17 décembre 1999). () Entretien accordé par le ministre philippin des affaires étrangères à l'hebdomadaire Asiaweek (édition du 17 décembre 1999). () Pour autant, l'attitude chinoise (acceptation du principe mais refus du texte) a plutôt été interprétée par les observateurs comme un échec de l'ASEAN : il peut laisser la porte ouverte à des surenchères sur le terrain. De plus, la Chine a fait valoir à de nombreuses occasions qu'elle considérait que la question des Spratleys devait faire l'objet de négociations bilatérales et ne pouvait être traitée dans un cadre multilatéral tel que celui d'un sommet de l'ASEAN. () Même si l'on peut s'interroger sur le périmètre idéal desdits continents, étant entendu que, dans l'esprit de votre Rapporteur, l'Union européenne est l'entité politique naturelle qu'il convient de placer sous le vocable « Europe ». () ALENA : Accord de libre-échange nord-américain. () Jean-Luc Domenach, « L'asiatisme, une idéologie pour l'Asie ? », in L'Asie retrouvée, Éditions du Seuil, mai 1997. () Tous ces exemples sont extraits de l'éditorial « The Values of Values. Remember thrift, hard work, learning and humility ? », in Asiaweek, 5 septembre 1997. () Jean-Luc Domenach, « L'asiatisme, une idéologie pour l'Asie ? », in L'Asie retrouvée, Éditions du Seuil, mai 1997. () Jean-Luc Domenach, « L'asiatisme, une idéologie pour l'Asie ? », in L'Asie retrouvée, Éditions du Seuil, mai 1997. () Note de la rédaction du Monde : « Fondé par le prédicateur Choe Che-u (1824-1864), le Tonghak est un mélange de confucianisme et de taoïsme, conjugués à des pratiques chamanistes. Le mouvement connut un essor en réaction contre l'impérialisme occidental et la propagation du catholicisme. Sa doctrine contenait des éléments subversifs pour le pouvoir tels que l'égalité entre les hommes et la dignité des pauvres. Le Tonghak joua un grand rôle dans les révoltes paysannes de la fin du XIXe siècle ». () Philippe Pons, « Un entretien avec Kim Dae-jung. La pensée asiatique a véhiculé des valeurs qui coïncident avec l'esprit de la démocratie », Le Monde, 17 mai 1994. () « L'Asie-Pacifique enlisée », Le Monde, 17 novembre 1995. () Pour plus de détails, le lecteur pourra se reporter aux développements consacrés à la coopération monétaire en Asie et au cadre d'action de Manille, page 173 du présent rapport. () Ces sept pays sont le sultanat de Bruneï, l'Indonésie, la Malaisie, les Philippines, Singapour, la Thaïlande et le Vietnam. () Le premier Forum des hommes d'affaires avait, par exemple, recommandé la création d'un fonds euro-asiatique des infrastructures ou d'un instrument de financement équivalent. () Tommy Koh, « Enhancing Mutual Understanding Between Asia and Europe », Rapport de l'ASEF au sommet ASEM des hauts fonctionnaires diplomatiques, octobre 1999. () Asia-Europe Vision Group, For a Better Tomorrow. Asia-Europe Partnership in the 21st Century, mars 1999. () M. Charles Kindleberger a écrit l'un des ouvrages de référence sur les crises financières : Manias, Panics and Crashes : a History of Financial Crisis, 1989. () J. Sneddon Little, G. P. Olivei, « Why the Interest in Reform ? », Rethinking the International Monetary System, Federal Reserve Bank of Boston, Conference Series n° 43, juin 1999. () Dans son 65ème rapport annuel (juin 1995), la Banque des règlements internationaux estime que « les déficits extérieurs du Mexique coïncidaient avec des données fondamentales micro et macroéconomiques saines à de nombreux égards. Le solde négatif des paiements courants n'indiquait pas, comme naguère, une situation budgétaire non maîtrisée. En outre, les réformes structurelles avaient grandement accru la souplesse de l'économie et sa capacité de réaction aux signaux du marché ». () Entretien avec votre Rapporteur (Washington, janvier 2000). () M. Goldstein, « Commentary on `The Causes and Propagation of Financial Instability : Lessons for Policymakers' », Maintaining Financial Stability in a Global Economy, Federal Reserve Bank of Kansas City, août 1997 (page 106). () Les cas de la Russie et de l'Indonésie s'expliquant, à l'évidence, par la persistance de problèmes politiques et économiques fondamentaux non réglés. () Voir notamment le 69ème rapport annuel de la BRI : « [les] sources de financement [des banques] se sont réduites, se limitant essentiellement aux fonds recyclés sur le marché interbancaire et à la collecte de dépôts auprès d'investisseurs non bancaires » (juin 1999), ou encore, plus explicite, la publication trimestrielle Activité bancaire et financière internationale relative au quatrième trimestre 1998 : « Malgré les perturbations, l'interbancaire s'est relativement bien acquitté de la fonction qui est la sienne : répondre au comportement changeant des investisseurs » (mars 1999). () W. White, What have we learned from recent financial crises and policy responses ? Banque des règlements internationaux, document de travail n° 84, janvier 2000. () Pour plus de détails, le lecteur se reportera aux développements du premier chapitre du présent rapport consacrés aux explications macroéconomiques « fondamentales » de la crise asiatique. () Cette contagion doit être distinguée du repli enregistré, dans le courant de l'été 1998, sur l'ensemble des marchés émergents. Celui-ci découlait d'une approche plus « fondamentaliste » de l'investissement sur un marché émergent, à la lumière du risque nouveau mis en évidence par le défaut russe sur sa dette interne et le moratoire sur sa dette externe. () Banque des règlements internationaux, 69ème Rapport annuel, juin 1999 (page 4). () A. Crockett, « Why is Financial Stability a Goal of Public Policy ? », Maintaining Financial Stability in a Global Economy, Federal Reserve Bank of Kansas City, août 1997. () FMI, « Globalization of Finance and Financial Risks », International Capital Markets, septembre 1998. () S. Roach, Architectural Reform : Managing Financial Market Volatility in the New Millenium, Morgan Stanley Dean Witter, Special Economic Study, 31 mars 2000. () Banque mondiale, Global Development Finance 2000, avril 2000 (p. 126). () Voir, par exemple, Emerging Market Financing. Quarterly Report on Developments and Prospects, Fonds monétaire international, août 2000. () Votre Rapporteur remarque, cependant, que l'incitation des compagnies d'assurance à intervenir hors de leur marché national est limitée, pour des raisons d'exposition au risque, par la nécessaire adéquation entre la nature de leurs actifs et la nature de leurs engagements, pour l'essentiel libellés en monnaie nationale. () Ceux-ci ne peuvent, du fait de la nature de leur mandat, qu'arbitrer à la marge entre la détention de la liquidité et la détention d'actifs émergents, sans pouvoir se désengager totalement. Une réduction globale de leur exposition ne peut résulter que du retrait des fonds déposés auprès d'eux par les investisseurs « particuliers ». () Centre d'études prospectives et d'informations internationales. () M. Aglietta, Fragilité financière, crises et enjeux du contrôle prudentiel. Quelques leçons de l'expérience récente, intervention prononcée à la conférence internationale ABCDE Europe, juin 1999. () Il s'agit du risque (classique) que l'emprunteur fasse défaut sur sa dette, pour des raisons purement internes découlant de la qualité de sa gestion et du contexte économique dans lequel il évolue. () M. Aglietta, C. de Boissieu, « Le prêteur international en dernier ressort », Architecture financière internationale, Conseil d'analyse économique, 3ème trimestre 1999. () La méthodologie VAR (Value at Risk) consiste à évaluer le risque supporté par un portefeuille exposé à la variation de la valeur de marché de ses composantes. La VAR est la perte maximale (dans un intervalle de confiance déterminé) qui peut résulter de la détention dudit portefeuille pendant un laps de temps prédéfini. La VAR dépend donc à la fois de l'évolution « en tendance » envisagée pour les composantes du portefeuille, dans l'intervalle de temps prédéfini, et de la volatilité de leur prix. Le calcul de la VAR permet de déterminer le montant du capital mis en provision de la perte potentielle ; ce capital est d'autant plus élevé que la VAR est élevée. Selon MM. Pierre Cailleteau et Édouard Vidon, la VAR est généralement mesurée à l'horizon d'une journée, sur la base des évolutions de prix les plus récentes, par exemple les six derniers mois, avec une pondération plus forte pour les données les plus récentes (P. Cailleteau, E. Vidon, « La dynamique des crises financières internationales : quelques enseignements », Bulletin de la Banque de France, n° 64, avril 1999). () Banque des règlements internationaux, 70ème Rapport annuel, juin 2000 (p. 159). () JP Morgan, Emerging Markets Data Watch, 22 août 1997, p. 1. () Pour plus de détails, le lecteur se reportera aux développements consacrés à la chronologie de la crise asiatique, dans le premier chapitre du présent rapport. () Par exemple, la NSDD fait l'objet d'un rapport d'évaluation trimestriel. () Le code indique, par exemple, que la documentation associée au budget doit spécifier les objectifs de la politique budgétaire, le cadrage macroéconomique, les choix politiques fondamentaux et les principaux risques pesant sur l'exécution. Il indique également que les procédures d'exécution et de pilotage budgétaire des crédits doivent être clairement spécifiées, notamment grâce à la mise en place d'un système comptable exhaustif. () Le code mentionne, par exemple, la nécessité d'établir un organe d'audit, sous la responsabilité du Parlement, et de garantir l'indépendance institutionnelle de l'agence statistique nationale. () O. Davanne, Instabilité du système financier international, Conseil d'analyse économique, 1998 (page 30). () Le G 22 est un groupe de 22 pays, rassemblant 15 pays émergents autour des pays membres du G 7, le FMI et la Banque mondiale étant observateurs. Il sera évoqué plus loin dans ce chapitre. () Report of the Working Group on Transparency and Accountability, G 22, octobre 1998 (page 7). () Ceci est une présentation approximative de la réalité : si les informations brutes sont, évidemment, sous la responsabilité directe de l'État membre, les analyses et conclusions sont bien du ressort du Fonds. Appliquer la notion de « propriété de l'État membre » à celles-ci relevait d'une interprétation pour le moins extensive. () S. Fischer, Report of the Acting Managing Director to the International Monetary and Financial Committee on Progress in Reforming the IMF and Strenghtening the Architecture of the International Financial System, Fonds monétaire international, avril 2000. () O. Davanne, Instabilité du système financier international, Conseil d'analyse économique, 4ème trimestre 1998. () On sait, notamment, que certains fonds ont des règles de fonctionnement qui établissent des limites (planchers ou plafonds) à l'exposition à certains types de contreparties, en fonction, par exemple, de la notation qui leur est attribuée par les agences spécialisées. () Fonds monétaire international, International Capital Markets, septembre 1999. () Fonds monétaire international, op. cit. () P. Leake, A. Rogoff, G. Johnson, « At the insolvency masquerade, what mask for the IMF : international bankruptcy court, mediator or insolvency law reformer ? », Private Capital Flows in the Age of Globalization, Edward Elgar Publishing Ltd, 2000. () Working Party on Financial Stability in Emerging Market Economies, Financial Stability in Emerging Market Economies. A strategy for the formulation, adoption and implementation of sound principles and practices to strengthen financial systems, avril 1997 (page 5). Ce groupe de travail, constitué à la suite du sommet du G7 de Lyon (1996), rassemblait des représentants des pays suivants : Allemagne, Argentine, Corée, États-Unis, France, Hong Kong, Indonésie, Japon, Mexique, Pays-Bas, Pologne, Royaume-Uni, Singapour, Suède et Thaïlande. () Le rapport du groupe de travail sur la stabilité financière dans les économies des marchés émergents précisait, par ailleurs, quelques domaines privilégiés pour mettre au point des recueils de principes et de bonnes pratiques : les règles comptables, les systèmes de paiement et de règlement, la supervision bancaire, la supervision des marchés financiers, la supervision des activités d'assurance et le contrôle des conglomérats financiers. () Bien évidemment, cette attention ne date pas de la crise asiatique, ni même de la crise mexicaine. Au niveau européen, par exemple, la directive n° 92-30 du 6 avril 1992, prévoit les dispositions fondamentales relatives au contrôle interne des établissements financiers. () Fonds monétaire international, International Capital Markets 1999, septembre 1999. () R. Bonte, Supervisory lessons to be drawn from the Asian crisis, Comité de Bâle sur la supervision bancaire, document de travail n° 2, juin 1999. () La note AAA est non seulement prestigieuse, mais surtout essentielle pour conserver l'accès à certaines sources de financement qui sont tenues d'investir sur des supports notés AAA... () Un aspect actuellement étudié avec beaucoup d'attention concerne le comportement des modèles et méthodes de gestion du risque en situation de crise. () Les Principes fondamentaux pour un contrôle bancaire efficace ont été publiés en avril 1997, puis définitivement adoptés par le comité de Bâle en septembre 1997. () Banque des règlements internationaux, 68ème Rapport annuel, juin 1998 (page 187). () R. Breuer, « Regulation and banking supervision : Caught between the nation state and global financial markets », Deutsche Bank, EMU Watch, n° 86, 29 juin 2000. () Cette exemption n'est pas totale. Par exemple, un hedge fund qui opère aux Etats-Unis sur un marché organisé de produits dérivés doit être enregistré et se trouve sujet à la réglementation applicable sur ce marché aux organismes de placement collectif. Il doit répondre à des obligations de transparence, comme transmettre aux autorités des états financiers annuels et adresser à ses associés des rapports financiers trimestriels (source : F. Edwards, « Hedge Funds and the Collapse of Long-Term Capital Management », Journal of Economic Perspectives, vol. 13, n° 2, printemps 1999). () Forum de stabilité financière, Report of the Working Group on Highly Leveraged Institutions, avril 2000 (p. 79) et « Hedge funds and their role in the financial markets », Bulletin mensuel de la Bundesbank, mars 1999 (p. 34). () Cité dans « Hedge funds and their role in the financial markets », Bulletin mensuel de la Bundesbank, mars 1999 (p. 33). () En effet, le résultat du fonds devient quasiment indépendant de l'évolution générale du marché : si celui-ci baisse, les gains obtenus sur les ventes à découvert compenseront les pertes observées sur les titres achetés ferme ; en sens inverse, si le marché monte dans son ensemble, les gains résultant des achats fermes seront absorbés par les pertes subies du fait des ventes à découvert. Le gain du fonds dépend essentiellement de la réduction de l'écart relatif entre les actifs achetés fermes et les actifs vendus à découvert. () Bulletin de la Bundesbank, op. cit. () Le rapport établi à cette occasion par les ministres à l'intention de leurs chefs d'État et de gouvernement indique que les pays entretenant des relations étroites avec les centres off shore devraient exercer des pressions sur ces juridictions pour qu'elles se conforment aux normes internationales ; que le comité de Bâle devrait intégrer le respect de ces normes internationales dans les coefficients de pondération des risques, en matière d'adéquation des fonds propres ; que les groupes de travail constitués auprès de l'OICV et du comité de Bâle devraient conditionner la participation des experts nationaux au respect par leur pays des normes internationales ; enfin, que le Groupe d'action financière internationale devrait engager des actions concrètes pour obliger les pays récalcitrants à se mettre en conformité avec ses recommandations relatives au blanchiment d'argent. () Le cas du Brésil reste proche de ce schéma, bien que la banque centrale brésilienne ait appliqué une politique de dépréciation régulière de son taux de change, à la suite de la mise en place du « plan real » en 1994. En fait, les étapes initiales du plan real ont provoqué une forte appréciation du taux de change réel, que la politique de change n'a réussi à stabiliser qu'au début de 1997. Le déficit de la balance des paiements courants s'est creusé, tandis que le déficit budgétaire était aggravé par le niveau élevé des taux d'intérêt nécessaire pour maîtriser une demande intérieure vigoureuse. () Là encore, le cas du Brésil se distingue quelque peu du cas asiatique : le pays disposait de réserves de change importantes, notamment après l'activation du programme de soutien du FMI et de la communauté internationale, à la fin de l'année 1998. D'autre part, l'influence du change sur la charge de la dette s'exerçait essentiellement sur le budget de l'État - via les titres publics libellés en dollars ou indexés sur l'inflation ; les entreprises et les banques étaient moins exposées que leurs homologues asiatiques, car elles s'étaient couvertes depuis plusieurs années contre les fluctuations brutales du taux de change ou des taux d'intérêt. La dévaluation de janvier 1999 a donc eu un impact comparativement faible sur le secteur privé et le système bancaire. () M. Obstfeld, K. Rogoff, « The Mirage of Fixed Exchange Rates », Journal of Economic Perspectives, vol. 9, n° 4, 1995. () Les conditions ci-après sont énumérées dans une étude récente du FMI : Exchange Rate Regimes in an Increasingly Integrated World Economy, publiée sous l'autorité de l'économiste en chef du Fonds, M. Michael Mussa (avril-août 2000). Leur regroupement en trois catégories est sous la seule responsabilité de votre Rapporteur. () La notion d'« élevé » ne peut être ici définie a priori : elle dépend, justement, du degré d'intégration dans le système financier international et du positionnement effectif du pays par rapport aux conditions énumérées ci-avant. () L'obligation technique est la résultante inéluctable de l'obligation légale sus-mentionnée. () En régime de caisse d'émission, il n'y a pas de banque centrale : on ne peut donc pas dire que la base monétaire est de la « monnaie banque centrale ». Néanmoins, le système bancaire conserve généralement une structure pyramidale (dont le sommet, normalement occupé par une banque centrale, est ici tronqué) : il existe des banques principales et des banques secondaires. La base monétaire peut donc être définie comme la monnaie inscrite dans les comptes de ces banques principales. () En France, les livrets A et assimilés ont cette caractéristique. () A. Gosh, A-M. Gulde, H. Wolf, Currency Boards : the Ultimate Fix ? Fonds monétaire international, document de travail WP/98/8, janvier 1998. () Le sucre a été dévalué deux fois en 1998 puis a été laissé libre de flotter à compter de février 1999. En 1998, il a perdu 54% de sa valeur contre le dollar, puis 20% en 1999 et à nouveau 25% dans la seule première semaine de janvier 2000. Une fois tenu compte de l'érosion inflationniste, le sucre a perdu 47% de sa valeur face au dollar entre décembre 1997 et janvier 2000. () O. Davanne, F. Bergsten, « Pour une gestion conjointe de la flexibilité des changes », Architecture financière internationale, 3ème trimestre 1999 (p. 23). () Hong Kong a accepté une récession de 5,1% en 1998 comme prix de la défense de sa parité. L'Argentine a payé la crise mexicaine d'une chute du PNB égale à 4,6% et d'une grave perturbation de son système bancaire. () O. Davanne, F. Bergsten, « Pour une gestion conjointe de la flexibilité des changes », Architecture financière internationale, 3ème trimestre 1999 (p. 43). () Fonds monétaire international, Rapport annuel 2000, septembre 2000 (p. 44 de la version anglaise). () Le développement de la « burgernomie » a été si vif qu'une institution aussi sérieuse que la Banque de réserve fédérale de St Louis s'est intéressée à cette méthode - pour montrer, cependant, ses limites et ses faiblesses. () Votre Rapporteur rappelle, à ce titre, que certaines approches diffèrent même dans leur définition de ce qu'est l'équilibre... () O. Davanne, F. Bergsten, « Pour une gestion conjointe de la flexibilité des changes », Architecture financière internationale, 3ème trimestre 1999 (p. 35). () S. Hel-Tellier, « Les enseignements des politiques de contrôle des capitaux pour les pays émergents », Architecture financière internationale, Conseil d'analyse économique, 3ème trimestre 1999 (p. 214). () Le Brésil de 1993 à 1997, la Colombie de 1993 à 1998, la Malaisie en 1994 ou encore la Thaïlande de 1995 à 1997, ont mis en _uvre des contrôles sur les entrées de capitaux (source : Fonds monétaire international, Capital Controls : Country Experiences with their Use and Liberalization, IMF Occasional Paper, n° 190, février 2000). () I. Ötker-Robe, « Malaysia's Experience with the Use of Capital Controls », Capital Controls : Country Experiences with their Use and Liberalization, IMF Occasional Paper, n° 190, février 2000 () IMF Annual Report 2000, septembre 2000 (p. 44). () Ces objections sont au nombre de quatre : les pays confrontés à des déséquilibres graves sans possibilité crédible de les corriger à court terme n'ont jamais été capables de maîtriser les sorties de capitaux à grande échelle par l'intermédiaire de contrôles sur les mouvements de capitaux ; les contrôles réduisent parfois l'incitation des dirigeants à entreprendre les actions correctrices ; les contrôles peuvent être coûteux à terme en matière d'accès et de coût des financements internationaux ; les contrôles peuvent parfois exercer des effets collatéraux dommageables sur les partenaires économiques et financiers. () IMF Annual Report 2000, septembre 2000 (p. 44). () Fonds monétaire international, International Capital Markets, septembre 1999. () M. Aglietta, The International Monetary Fund and The International Financial Architecture, document de travail du CEPII, n° 2000-08, mai 2000. () Independent Task Force Report, Safeguarding Prosperity in a Global Financial System. The future of International Financial Architecture, Council on Foreign Relations, octobre 1999. () Overseas Development Council, The Future Role of the IMF in Development, avril 2000. () Trois membres de la commission ont voté contre le rapport, huit l'approuvant. Par ailleurs, plusieurs membres ont annexé des opinions dissidentes au texte du rapport. () US Department of the Treasury Response to the IFI Advisory Commission, juin 2000. () Banque mondiale, Global Development Finance 2000, avril 2000 (p. 112). () Groupe des Dix, The Resolution of Sovereign Liquidity Crises, mai 1996. () Fonds monétaire international, Rapport annuel 2000, p. 50. () Les clauses d'action collective, tendant à geler temporairement, sur une base volontaire, les droits des créanciers, visent à réduire au minimum les risques de litige ou le risque de voir une restructuration de dette bloquée par un seul créancier, l'unanimité étant normalement requise pour modifier les termes d'un contrat obligataire. () M. Aglietta, C. Denise, « Les dilemmes du prêteur en dernier ressort international », Revue française d'économie, vol. xiv, n° 4, automne 1999. () M. Aglietta, C. de Boissieu, « Le prêteur international en dernier ressort », Architecture financière internationale, Conseil d'analyse économique, 3ème trimestre 1999 (p. 117). () Didier Migaud, Rapport fait au nom de la Commission des finances, de l'économie générale et du plan sur le projet de loi de finances rectificative pour 1998, Assemblée nationale, XIe législature, n° 1224, 1er décembre 1998 (p. 203). () J. Williamson (ed.), Latin American Adjustment : How Much Has Happened ? Institute for International Economics, avril 1990. () D. Mathieson, L. Rojas-Suarez, « Liberalization of the Capital Account : Experiences and Issues », IMF Occasional Paper, n° 103, mars 1993. () Cité dans B. Herman (ed.), Global Financial Turmoil and Reform. A United Nations Perspective, United Nations University Press, 1999 (p. 15). () Comme le suggère la rédaction du rapport annuel du FMI pour l'exercice 1996-1997, le comité intérimaire semble avoir été instrumentalisé comme un porte-parole de la volonté du conseil d'administration, alors qu'il doit normalement conseiller celui-ci, c'est-à-dire transmettre à l'organe des décisions courantes du Fonds l'impulsion politique issue du conclave restreint des gouverneurs : « en septembre 1996, le Conseil [d'administration] a réexaminé le cadre général de la surveillance tel qu'il est défini dans la Déclaration de Madrid sur la coopération en vue de renforcer l'expansion mondiale. Tout en convenant que la stratégie énoncée dans la déclaration afin de soutenir et d'étendre la croissance reste valable, il a recommandé que le Comité intérimaire prenne en compte l'évolution des besoins de l'économie mondiale pour la préparer à relever de nouveaux défis et pour renforcer, dans plusieurs domaines, la mise en _uvre des politiques économiques par les États membres. Le même mois, le Comité intérimaire a incorporé ces conclusions dans la Déclaration sur un partenariat pour une expansion durable de l'économie mondiale, qui énonce une série de principes directeurs. » (FMI, Rapport annuel 1996-97, p. 2). () Afrique du Sud, Argentine, Australie, Brésil, Chine, Corée, Hong Kong, Inde, Indonésie, Malaisie, Mexique, Pologne, Russie, Singapour, Thaïlande. () Le G 33 incluait tous les pays membres du G 22, auxquels s'ajoutaient l'Arabie Saoudite, la Belgique, le Chili, la Côte d'Ivoire, l'Espagne, l'Égypte, le Maroc, les Pays-bas, la Suède, la Suisse et la Turquie. () Le G 20 comprend les pays membres du G 7, l'Afrique du Sud, l'Arabie Saoudite, l'Argentine, l'Australie, le Brésil, la Chine, la Corée, l'Inde, le Mexique, la Russie et la Turquie, ainsi qu'un représentant de l'Union européenne et un représentant du FMI et de la Banque mondiale. () Conformément à l'usage, les noms patronymiques des personnalités coréennes sont présentés avant leur prénom (en général composé). () Conformément à l'usage, les noms patronymiques des personnalités chinoises sont présentés avant leur prénom. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

