N° 2702 -- ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 ONZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 15 novembre 2000. RAPPORT D'INFORMATION FAIT AU NOM DE LA DÉLÉGATION AUX DROITS DES FEMMES ET A L'ÉGALITÉ DES CHANCES ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES (1) SUR LE PROJET DE LOI (n° 2605) relatif à l'interruption volontaire de grossesse et à la contraception. PAR Mme Danielle BOUSQUET, Députée. -- (1) La composition de cette Délégation figure au verso de la présente page. Avortement. La Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes est composée de : Mme Martine Lignières-Cassou, présidente ; Mmes Muguette Jacquaint, Chantal Robin-Rodrigo, Yvette Roudy, Marie-Jo Zimermann, vice-présidentes ; Mme Marie-Thérèse Boisseau, M. Michel AVANT-PROPOS 5 INTRODUCTION 7 I - L'ALLONGEMENT DU DÉLAI LÉGAL, VINGT-CINQ ANS APRÈS LE VOTE DE LA LOI VEIL : UNE ADAPTATION QUI S'IMPOSE. 11 A. VINGT-CINQ ANS APRÈS LE VOTE DE LA LOI VEIL, L'IVG DEMEURE UN PROBLÈME PRÉOCCUPANT DE SANTÉ PUBLIQUE. 11 1. Le nombre d'IVG en France reste élevé. 11 2. L'insuffisance de l'accueil du service public entraîne disparités et injustices vis-à-vis des femmes 12 B. L'ALLONGEMENT DES DÉLAIS : UNE ADAPTATION INDISPENSABLE DE LA LOI 14 1. Mettre fin au scandale des départs à l'étranger 14 2. L'allongement des délais permettra-t-il de résoudre tous les cas des femmes hors délais ? 16 C. LES CONSÉQUENCES DE L'ALLONGEMENT DES DÉLAIS 17 1. Quelle sera l'incidence médicale de l'allongement des délais ? 17 2. Comment aider les femmes et les médecins dans les situations les plus difficiles ? 20 3. L'allongement des délais va-t-il entraîner un risque d'"eugénisme" ? 21 D. POUR DE MEILLEURES CONDITIONS D'ACCUEIL ET D'ACCÈS À L'IVG. 23 1. Une prise de décision qui doit être entourée et respectée. 23 2. Un meilleur accès à l'IVG, en particulier à l'hôpital public. Le plan de Mme Martine Aubry 25 II - CONTRACEPTION ET IVG DES MINEURES : AMÉNAGER L'OBLIGATION DE L'AUTORISATION PARENTALE. 28 A. LES MINEURES FACE À L'IVG. 28 1. Les grossesses chez les mineures : une situation préoccupante. 28 2. L'obligation de l'autorisation parentale est trop rigide 29 B. UNE SOLUTION RAISONNABLE : L'INTERVENTION D'UN ADULTE RÉFÉRENT 32 1. Les réponses possibles au défaut de consentement parental 32 2. La solution retenue : l'intervention d'un adulte, choisi par la mineure 33 III - POUR UNE LARGE POLITIQUE DE PRÉVENTION : ASSURER UN MEILLEUR ACCÈS À LA CONTRACEPTION, AUTORISER LA STÉRILISATION EN L'ENTOURANT DES PRÉCAUTIONS NÉCESSAIRES 36 A. ASSURER UN MEILLEUR ACCÈS À LA CONTRACEPTION 36 1. L'échec contraceptif demeure, malgré une forte utilisation des méthodes contraceptives. 36 2. Pour une meilleure information à la contraception et une éducation à la sexualité 37 3. Une meilleure prise en charge de la contraception par la collectivité 39 B. ÉLARGIR LA CONTRACEPTION PAR UNE RECONNAISSANCE DE LA STÉRILISATION VOLONTAIRE 40 1. La stérilisation volontaire est encore peu développée en France. 40 2. La stérilisation demeure une intervention particulière. 42 3. Mettre fin au vide juridique concernant la stérilisation 43 TRAVAUX DE LA DÉLÉGATION 45 RECOMMANDATIONS ADOPTÉES PAR LA DÉLÉGATION 49 Annexe 1 : Comptes rendus des auditions de la Délégation 51 Annexe 2 : Liste des personnalités entendues dans le cadre des réunions de travail de la Délégation 221 Annexe 3 : Documents d'information 225 AVANT-PROPOS Le présent rapport est le fruit du travail collectif mené tout au long de l'année 2000 par la Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes. Le thème d'étude choisi, en début d'année, par la Délégation portait sur la santé des femmes. Mais, ses réflexions ont très vite été centrées sur le thème plus précis de l'IVG et de la contraception, compte tenu du caractère d'urgence que cette question a revêtu au cours de l'année 2000. La Délégation a mené quatorze auditions et huit réunions de travail, au cours desquelles elle a entendu une quarantaine de personnalités ; elle a également organisé un colloque le 30 mai dernier (1). L'objectif de la Délégation était - comme le prévoit son règlement intérieur - de publier cette étude dans le cadre du rapport annuel d'activité, qu'elle va prochainement faire paraître. Des circonstances nouvelles ont incité la Délégation à procéder autrement. L'examen, les 29 et 30 novembre prochain, du projet de loi relatif à l'IVG et à la contraception, présenté par Mme Martine Aubry, a conduit la Délégation à faire paraître, sous forme de rapport d'information sur ce projet de loi, l'étude, les recommandations et le compte rendu des auditions qui constituaient son thème d'étude annuel. Que toutes les éminentes personnalités entendues par la Délégation soient remerciées pour la franchise, la rigueur et la richesse de leurs témoignages qui contribueront à éclairer le débat qui va maintenant avoir lieu devant la représentation nationale. Martine LIGNIÈRES-CASSOU, Présidente MESDAMES, MESSIEURS, La maîtrise par les femmes de leur fécondité aura été une des grandes révolutions de société de la deuxième moitié du vingtième siècle. La contraception, cet "habeas corpus" moderne, dont parle Mme Geneviève Fraisse, offre désormais à la femme une double liberté : elle libère la femme de la tyrannie des lois de la nature et de la reproduction ; elle la libère aussi de la domination masculine et de l'injustice qui laisse les femmes seules à subir les conséquences de la grossesse ou de l'avortement. Cette liberté - "Notre corps nous appartient", slogan des féministes des années 70 - s'inscrit profondément dans des mouvements parallèles de la société : la conquête de la démocratie, le droit de vote acquis par les femmes en France au lendemain de la deuxième guerre mondiale, l'accession à l'égalité professionnelle puis à la parité en politique. Elle s'inscrit aussi dans les progrès de la science et de la médecine, qui ont permis cette émancipation par les découvertes, sans cesse renouvelées, des méthodes contraceptives et des techniques médicales. Cette conquête irréversible vers plus de libertés s'est appuyée sur les deux grandes lois fondatrices qu'ont été la loi "Neuwirth" du 28 décembre 1967 relative à la régulation des naissances et la loi "Veil" du 17 janvier 1975 relative à l'interruption volontaire de la grossesse, adoptées grâce au combat des femmes, des mouvements et des associations féministes - comme le Mouvement français pour le planning familial qui célèbre cette année les quarante années de sa création et de son travail militant - grâce aussi au courage d'hommes et de femmes politiques pour soutenir des textes qui, dans les assemblées comme dans la société, ont soulevé des passions considérables autour de débats de conscience et d'éthique. Ce n'est que lentement que ces lois ont été mises en application, la loi Neuwirth devant attendre plusieurs années ses décrets d'application, tandis que la loi Veil s'est heurtée dès le départ à une insuffisance de moyens dans le secteur public et aux fortes réticences, sinon "résistances" des médecins. La reconduction de la loi Veil fut cependant acquise le 30 novembre 1979, mais par une majorité légèrement plus faible qu'en 1974 (2), alors que l'opinion y était majoritairement favorable. Les acquis de cette loi sont incontestables. L'avortement n'a pas été banalisé, comme on pouvait le craindre, et ne s'est pas substitué à la contraception ; le nombre d'IVG n'a pas augmenté et demeure pour les femmes un ultime recours, jamais un acte banal ou anodin. Sur le plan sanitaire, la nouvelle législation s'est avérée très efficace : la médicalisation a eu pour conséquences les disparitions des morts et des lourdes séquelles de l'avortement clandestin. La "loi Roudy" du 31 décembre 1982 sur le remboursement de l'IVG, attendue depuis longtemps, est venue compléter l'ensemble du dispositif, tandis que la "loi Neiertz" du 27 janvier 1993 créait, pour protéger la pratique légale de l'IVG, le délit d'entrave à l'IVG, afin de se prémunir des agissements de certaines associations. * * * Qu'en est-il, plus de trente après la loi Neuwirth et vingt-cinq ans après la loi Veil ? La société française et les mentalités ont changé. De nouveaux problèmes, que la loi n'avait pas prévus, sont apparus. Les progrès de la science et de la médecine ont déplacé les débats. L'exposé des motifs du projet de loi, présenté par M. Lionel Jospin, Premier ministre, et par Mme Martine Aubry, alors ministre de l'emploi et de la solidarité, souligne la nécessaire modernisation de nos lois en matière de contraception et d'IVG : "Si ces deux lois ont été en leur temps des acquisitions fondamentales pour la vie des femmes au quotidien, elles ne sont plus aujourd'hui, près de trente ans plus tard, totalement adaptées ni à la réalité sociale, ni à la réalité médicale de notre pays. Elles méritent d'être actualisées et modernisées." La Délégation aux droits des femmes, à partir du colloque sur "Droits des femmes : contraception, IVG, pour un meilleur accès", organisé le 30 mai dernier, puis des nombreuses auditions de personnalités, professeurs et praticiens, chercheurs, personnels de santé, a tenté de cerner les nouveaux problèmes. _ L'IVG demeure aujourd'hui un problème préoccupant de santé publique. Le nombre d'IVG pratiqué annuellement en France, malgré une relative stabilisation, reste élevé, autour de 220 000, sans que l'on puisse, malgré les statistiques officielles, le chiffrer avec exactitude. La Délégation aux droits des femmes s'est efforcée, avec ses interlocuteurs, d'en rechercher les raisons dont la principale est l'insuffisance criante en amont de l'information et de l'éducation en matière contraceptive depuis trente ans. _ La loi de 1975 avait mis fin au scandale des avortements clandestins, évalués à l'époque à environ 300 000, dont toute une société s'était rendue complice. Le scandale s'est maintenant déplacé d'une pratique clandestine en France à l'IVG hors des frontières, lorsque les délais légaux sont dépassés. On évalue à 5 000 environ - ce ne sont là aussi que des chiffres approximatifs - le nombre de femmes qui, chaque année, dans des conditions difficiles, se voient contraintes d'aller avorter dans des pays voisins. Le projet de loi, pour résoudre ce problème, propose d'allonger le délai légal de l'IVG de dix à douze semaines de grossesse. La Délégation aux droits des femmes a tenté de cerner les motifs conduisant les femmes à dépasser les délais et les solutions recherchées (IVG à la marge des délais légaux, cliniques à l'étranger, interruptions de grossesse pour motifs thérapeutiques). La Délégation s'est également demandé si toutes les femmes "hors délais" seraient prises en compte par cette nouvelle disposition et elle a longuement interrogé ses interlocuteurs sur les conséquences médicales de cet allongement des délais. _ Le problème des adolescentes confrontées à une grossesse non désirée est préoccupant : 10 000 chaque année, dont 7 000 se terminant par une IVG. La situation d'une jeune fille qui entre dans la vie avec l'expérience traumatisante d'une IVG exige qu'une attention particulière lui soit apportée par un aménagement de l'obligation de l'autorisation parentale. La Délégation a exploré avec des juristes les alternatives possibles à l'autorisation parentale. Mais, bien en amont, se pose le problème d'une meilleure information et éducation des adolescents à la contraception et à la sexualité. _ Les adaptations législatives nécessaires devront s'appuyer sur une amélioration de l'accès à l'IVG dans les structures publiques. Des dysfonctionnements, des pesanteurs administratives, des moyens souvent insuffisants, des problèmes de statut des personnels ne permettent pas d'offrir partout les meilleures conditions aux femmes qui veulent recourir à l'IVG. Des études approfondies ont mis en lumière ces difficultés, auxquelles le gouvernement s'efforce de remédier depuis trois ans par une politique volontariste. _ Dans un souci de prévention de l'IVG, la Délégation a souhaité élargir ses recherches à une méthode de régulation des naissances I - L'ALLONGEMENT DU DÉLAI LÉGAL, VINGT-CINQ ANS APRÈS LE VOTE DE LA LOI VEIL : UNE ADAPTATION QUI S'IMPOSE. A. VINGT-CINQ ANS APRÈS LE VOTE DE LA LOI VEIL, L'IVG DEMEURE UN PROBLÈME PRÉOCCUPANT DE SANTÉ PUBLIQUE. 1. Le nombre d'IVG en France reste élevé. · La loi Veil a permis de mettre fin au scandale des avortements clandestins et à la détresse de ces milliers de femmes contraintes d'avorter dans des conditions souvent dramatiques (3), aidées par des associations, des militants, des médecins, comme le professeur Jacques Milliez, qui devant notre Délégation a évoqué son expérience et son engagement (4). Trois cent mille femmes, sans doute plus, chaque année, se trouvaient contraintes à cet acte douloureux, impliquant dans leur geste toute la société, les médecins, les associations, les juges qui n'appliquaient plus la loi. · Ce rappel est nécessaire car, si la clandestinité a disparu, le nombre élevé d'IVG par an, 220 000 environ, interpelle notre société : l'IVG demeure encore aujourd'hui, dans notre pays un problème de santé publique. Par rapport à nos voisins européens, la France avec un taux d'IVG de 15,4 0/00, pour les femmes en âge de procréer de 15 à 44 ans en 1997 (5), se situe à une place moyenne (Angleterre : 15,6 0/00 ; Allemagne : 7 0/00 ; Espagne : 5,7 0/00, Belgique : 6,8 0/00). Aux Pays-Bas, souvent cités en exemple, pour des raisons tenant à l'accès précoce à la contraception et aux politiques d'éducation dirigées vers les jeunes, cette proportion est de 6,5 0/00. Mais l'enquête récente de la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES) du ministère de l'emploi et de la solidarité note une progression de 6 % depuis 1990, soit 214 000 IVG en 1998 contre 202 000 en 1990 (6). · Ces chiffres, basés sur les bulletins d'interruption de grossesse établis par les établissements dans lesquels elle a lieu, ainsi que sur la statistique annuelle des établissements de santé qui recense toutes les IVG facturées au forfait, sont certainement inférieurs à la réalité. Comme le souligne le professeur Israël Nisand, dans son rapport sur "L'IVG en France" (7), il convient d'évaluer à 25 000 par an environ les IVG non déclarées, malgré l'obligation qui en est faite par la loi de 1975 qui charge l'INED, en liaison avec l'INSERM, d'analyser et de publier ces statistiques. Les sous-déclarations seraient de 5 % pour le secteur public et de 25 % dans le secteur privé. · L'enquête révèle une légère croissance du taux d'IVG chez les plus jeunes femmes. Le recours à l'IVG est plutôt stable au-delà de 2526 ans, alors qu'il augmente chez les plus jeunes. Les taux les plus élevés concernent les femmes de 20 à 24 ans, mais la plus forte augmentation concerne les 18-19 ans. Des hypothèses sont avancées pour expliquer ce phénomène, qui tient principalement à une évolution des modes de vie, dans un contexte marqué par la précarité économique (8). · Pour bien saisir l'ampleur du phénomène, il convient de replacer, au niveau mondial, l'IVG et les risques qu'elle entraîne. Chaque année dans le monde entier, 175 millions de femmes sont enceintes et 75 millions des grossesses ne sont pas désirées ; 40 millions se termineront par des avortements, dont 20 millions ne sont pas médicalisés. Toutes les trois minutes, une femme meurt encore de ce fait, soit 1 % de mortalité. Le combat pour les femmes, les médecins, les associations continue au-delà de nos frontières. 2. L'insuffisance de l'accueil du service public entraîne disparités et injustices vis-à-vis des femmes La diversité des structures, un contingentement des IVG, les problèmes posés par le statut des personnels sont à l'origine d'un traitement très inégal des demandes d'IVG. Un constat s'impose : le service public n'assure pas pleinement sa mission. · Le docteur Joëlle Brunerie-Kauffmann, lors du colloque du 30 mai dernier, a établi une typologie des structures d'accueil du secteur public : - les centres dits autonomes, mis en place pour appliquer la loi de 1975, souvent parce que les chefs de service, invoquant la clause de conscience, refusaient que l'IVG soit pratiquée dans leur service. Le personnel de ces centres est composé de médecins, souvent militants au départ, mais sous la responsabilité du directeur de l'établissement. Ces centres manquent souvent de moyens et de lits. - les centres intégrés dans un service hospitalier de maternité comme le centre Antoine Béclère à Clamart, où la diversification des activités permet au personnel de ne pas se consacrer exclusivement à l'accueil des femmes en IVG, ou dans un service de chirurgie comme le CIVG de l'hôpital de Bicêtre, visité par la Délégation, refait à neuf l'année dernière et disposant de toutes les installations nécessaires. - les structures d'accueil en milieu hospitalier. Dans ce cas, les IVG sont assurées intégralement par un service au sein de l'hôpital, au même titre que les accouchements, ce qui pour les femmes n'est pas forcément une bonne chose d'un point de vue psychologique. Il est difficile de comparer entre eux les niveaux de qualité de ces différentes structures. Dans les centres autonomes, le personnel est spécialisé, formé, volontaire et souvent l'accueil des femmes y est meilleur. Dans les centres intégrés, l'ensemble des activités du service a tendance à prédominer sur l'activité IVG en matière de moyens. · Les établissements privés assurent le relais des structures publiques, qui n'assurent que les deux tiers environ des IVG sur l'ensemble du territoire. L'accueil dans les cliniques privées est très inégal, en raison du non-respect des dispositions de la loi (non remise du dossier-guide, non-respect du délai de réflexion, recours fréquent à l'anesthésie générale, ...). · Des différences géographiques importantes sont relevées : un quart des départements métropolitains, concentrés en Ile-de-France et dans les régions du sud de la France, présentent des taux d'IVG supérieurs à la moyenne (9). En Ile-de-France, deux tiers des IVG sont réalisées dans le secteur privé. · Mme Chantal Blayo, professeur à l'université Montesquieu-Bordeaux IV, a expliqué devant la Délégation cette insuffisance par un contingentement dû à un manque de moyens, de lits, de praticiens, d'anesthésistes. Parfois, on sélectionne les femmes qui veulent avorter, en écartant d'office celles qui ont déjà connu plusieurs avortements, ou qui ne résident pas dans la même commune que l'établissement. La difficulté de recourir à l'IVG durant le mois d'août, en raison par exemple de l'absence de vacataires, a été soulignée. D'après Mme Chantal Blayo, qui a enquêté dans une douzaine de départements en 1999, la demande des femmes est souvent différée, parfois même refusée lorsque la durée de gestation est trop élevée. Certains établissements répondent soit qu'ils sont trop saturés, soit qu'ils sont complets et certaines femmes sont orientées vers le Mouvement français pour le planning familial (MFPF). Les femmes doivent donc souvent se "débrouiller" et ce sont les femmes les plus défavorisées qui rencontrent le plus de difficultés, faute d'informations ou faute de pouvoir payer l'avance que demandent généralement les cliniques privées. B. L'ALLONGEMENT DES DÉLAIS : UNE ADAPTATION INDISPEN-SABLE DE LA LOI 1. Mettre fin au scandale des départs à l'étranger · Il n'est plus possible de tolérer que soient laissées à l'abandon environ 5 000 femmes chaque année qui, ayant dépassé les délais, ne trouvent pas d'accueil en France et sont contraintes de partir à l'étranger. Notre pays se défausse en quelque sorte de ses responsabilités sur ses voisins européens... et, en France même, sur les associations, vers lesquelles les médecins orientent les femmes. Ce qui fait dire au professeur Chantal Blayo : "Il est tout de même paradoxal qu'un mouvement associatif soit nécessaire pour régler un problème de santé publique." · Le MFPF, à partir des "voyages" qu'il organise, et du nombre de femmes accueillies dans les cliniques anglaises et hollandaises où elles se rendent majoritairement, a pu établir des estimations qui sont sans doute inférieures à la réalité en raison du nombre de femmes qui passent par des filières de cliniques privées. · Les destinations des femmes ont changé. A la Grande-Bretagne et à la Suisse, sont maintenant préférés les Pays-Bas (66 % d'après une enquête du Planning) et plus récemment l'Espagne (Barcelone, Valence). · Les pays choisis le sont en fonction de leur législation plus libérale (10) en matière de délais. Quatre pays (Espagne, Grande-Bretagne, Pays-Bas, Suisse) vont jusqu'à vingt-deux semaines de grossesse, limite de la viabilité f_tale, terme ramené à vingt semaines aux Pays-Bas lorsqu'il y a doute sur le début de la grossesse. La Suède va jusqu'à seize semaines de grossesse ; la Belgique, l'Allemagne et l'Autriche jusqu'à douze semaines, délai proposé dans le projet de loi. Le Danemark, la Grèce et la Norvège vont, comme la France, jusqu'à dix semaines, mais au Danemark et en Norvège, des raisons socio-économiques permettent l'avortement jusqu'à vingt-deux semaines. b) Pourquoi des femmes dépassent-elles les délais ? · Les raisons du dépassement des délais sont complexes. Le docteur Danielle Gaudry, présidente du Mouvement français pour le planning familial, a présenté, lors du colloque du 30 mai dernier, une analyse portant sur 1 870 cas de femmes accueillies dans les vingt-trois permanences d'accueil du Planning en 1999 (11) : - problèmes relationnels au sein de la famille ou du couple, lorsque la grossesse est connue ; - cas (pour 20 %) de femmes, très jeunes, qui n'ont pas osé en parler au sein de leur famille et qui attendent jusqu'à ce qu'il ne soit plus possible de cacher leur grossesse ; - difficultés socio-économiques, violences sexuelles, dénis de grossesse, ambivalence vis-à-vis de la poursuite de la grossesse (10 % des cas). A ces difficultés qui tiennent à la femme elle-même, il faudrait, pour un certain nombre de cas, ajouter la complication de l'accès à l'IVG (manque d'information, lourdeur des formalités, rendez-vous différés, etc...). c) Des expériences pénibles qui coûtent cher. Pour les femmes, il en résulte un grand sentiment d'injustice, de culpabilisation et le vécu d'une expérience pénible. Par ailleurs, ces voyages à l'étranger coûtent très cher. Aux Pays-Bas, si le coût de l'IVG est gratuit pour les Hollandaises et les étrangères réfugiées, pour les Françaises, il est, avant douze semaines, de 2 400 F et au-delà de 5 400 F avec une nuit d'hébergement selon des informations communiquées à la Délégation. L'accueil dans ces cliniques, chaleureux, professionnel et déculpabilisant, n'est pas en cause, bien au contraire. Mais, pour les femmes, il en résulte une grande injustice, liée à des raisons financières. Où trouver l'argent pour ce déplacement décidé souvent dans l'urgence ? Qui va accompagner la femme ? Qui va garder l'enfant resté à la maison ? Comment justifier cette absence de vingt-quatre, quarante-huit heures à la famille et au bureau ? 2. L'allongement des délais permettra-t-il de résoudre tous les cas des femmes hors délais ? Mme Martine Aubry a estimé que 80 % des femmes devraient ainsi être aidées, soit la grande majorité des demandes tardives, entre dix et douze semaines de grossesse. D'après une enquête de 1999 réalisée principalement en région parisienne, où l'accès à l'IVG est difficile, le Planning familial, a ainsi évalué le nombre des femmes suivant le dépassement du délai légal :"40 % de ces femmes sont entre douze et quatorze semaines depuis les dernières règles, 29 % entre quinze et dix-sept semaines, 16 % entre dix-huit et vingt semaines et 9 % au-delà de vingt semaines". En l'absence d'une réelle enquête qui devrait être diligentée par le ministère de l'emploi et de la solidarité, il est difficile de chiffrer avec exactitude le nombre de femmes qui, d'une part, dépassent les délais de dix à douze semaines de grossesse et, d'autre part, sont au-delà. C. LES CONSÉQUENCES DE L'ALLONGEMENT DES DÉLAIS La Délégation, en auditionnant d'éminents professeurs de médecine, gynécologues-obstétriciens, scientifiques, a cherché des réponses à trois questions fondamentales : 1. Quelle sera l'incidence médicale de l'allongement des délais ? Sur cette première question, la Délégation a interrogé des experts de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé (ANAES). A la demande de la Direction générale de la santé, l'ANAES a établi, en février 2000, des recommandations, basées sur des avis d'experts, concernant l'IVG réalisée dans le cadre légal, dans un délai de quatorze semaines d'aménorrhée (12). Elle est en train d'élaborer un deuxième rapport correspondant à une analyse exhaustive et critique de la littérature scientifique internationale, dont le professeur Michel Tournaire a présenté les premiers éléments à la Délégation. a) Evolution des techniques médicales avec l'âge gestationnel Les méthodes techniques de l'IVG varient suivant l'âge gestationnel. En début de grossesse, jusqu'à douze semaines d'aménorrhée, le choix technique se situe entre les méthodes médicamenteuses (association du RU 486 ou mifépristone à une prostaglandine prise quarante huit heures plus tard) et les méthodes médicales et chirurgicales (aspiration, dilatation). · Jusqu'à sept semaines d'aménorrhée. La méthode médicamenteuse, relativement récente, présente de nombreux avantages en raison de son recours précoce et son faible risque de complication, en particulier d'infection. Cependant, elle nécessite pour la deuxième phase une hospitalisation d'une demi-journée, durant laquelle devrait se produire l'interruption volontaire de grossesse. Les conditions de son utilisation à l'hôpital et les difficultés qui entourent la délivrance du médicament conduisent à souhaiter, d'une part, de rendre plus accessible ce médicament, classé dans la catégorie des substances vénéneuses, et, d'autre part, d'offrir la possibilité d'y recourir en traitement ambulatoire, la femme restant en contact avec son médecin ou le centre médical. Parallèlement, la méthode chirurgicale est possible à ces dates, mais avec plus d'inconvénients. · De huit à douze semaines d'aménorrhée Pour la période de huit à douze semaines d'aménorrhée, la méthode chirurgicale serait conseillée par l'ANAES, avec recours à une préparation préalable du col de l'utérus. La méthode médicamenteuse est possible, mais avec des inconvénients notables : sa durée est variable et, parfois longue et s'accompagne de douleurs importantes, parfois d'hémorragies. En tout état de cause, Mme Martine Aubry a sollicité de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) une étude de faisabilité pour une extension de l'autorisation de mise sur le marché du RU 486 et pour une autorisation de prescription, sous conditions, à la ville. L'important est que les deux méthodes soient proposées aux patientes, car la méthode la mieux acceptée est celle préférée par la femme. · De treize à quatorze semaines d'aménorrhée (onze à douze semaines de grossesse) En ce qui concerne la période de treize à quatorze semaines d'aménorrhée, la principale méthode utilisée est la méthode chirurgicale, mais elle est plus délicate, avec un taux de complication plus élevé, estime le professeur Michel Tournaire (13 : "... le vécu de cette technique est considéré par l'équipe médicale comme clairement plus difficile que l'IVG réalisée dans le délai des douze semaines. En même temps, cette méthode chirurgicale a le très grand avantage d'être bien supportée par la femme - ce qui me semble être une priorité. Elle peut se comparer à une IVG effectuée au début de la grossesse, puisque la patiente, sous anesthésie générale, ne subira pas d'épreuve plus difficile que pour une IVG précoce." D'un interlocuteur à l'autre, les appréciations ont été diverses. "Jusqu'à douze semaines d'aménorrhée, on emploie une méthode d'aspiration, que l'on peut considérer comme un geste médical, alors qu'à partir de douze semaines, il s'agit d'un acte chirurgical ; les instruments utilisés nécessitent un complément de formation pour les médecins, car la pratique n'est pas tout à fait la même. Une réforme aussi importante ne peut pas se faire sans la participation des médecins" (14). Ou encore cette opinion : "Il se peut que les risques soient légèrement accrus, mais j'objecterai tout d'abord qu'entre dix et douze semaines, ils ne sont pas très significatifs, ensuite que ces risques diminuent au fur et à mesure que les équipes prennent l'habitude de pratiquer ces opérations, et enfin que, dans certains pays voisins, la limite de l'IVG peut atteindre jusqu'à vingt-quatre semaines, sans que l'on constate pour autant d'hécatombes ou de complications très graves" (15). En ce qui concerne les complications qui représentent moins de 1 % de l'ensemble des IVG, le risque relatif de douze à quatorze semaines d'aménorrhée est évalué à 1,3 ou 1,5 %. Cela dit, au fur et à mesure que le terme augmente, le risque augmente, tout en restant dans des proportions globalement faibles (16). b) Les réticences de certains médecins D'après les témoignages recueillis, mis à part les médecins hostiles par conviction à l'IVG, un certain nombre de généralistes, de gynécologues médicaux, pourtant favorables à l'IVG, voire militants, se montrent réticents et s'interrogent sur les techniques opératoires à 14 semaines d'aménorrhée. Peu formés à des pratiques chirurgicales tardives, ils appréhendent des interventions plus difficiles, qui en tout état de cause ne seront jamais gratifiantes. Ces méthodes pourtant largement utilisées aux Pays-Bas, en Angleterre, aux Etats-Unis, ne sont pas dans la culture française, qui préfère à un stade tardif le déclenchement médicamenteux, plus facile pour le médecin, mais douloureux pour les patientes. D'où en France, la tradition d'emploi de la péridurale. Ces pratiques demanderont des moyens plus importants et devront impérativement se pratiquer en bloc opératoire, avec accès à des moyens de transfusion et possibilité d'intervenir en cas d'urgence, estime le professeur Tournaire. Les équipes médicales qui n'en ont pas l'expérience devront s'y former. 2. Comment aider les femmes et les médecins dans les situations les plus difficiles ? L'allongement des délais permettra à un certain nombre de femmes, quelques milliers, d'être prises en charge. Mais des situations difficiles continueront de se présenter. La Délégation a souhaité explorer les voies permettant d'apporter des solutions aux femmes et aussi aux médecins, en allant notamment vers plus de collégialité dans le processus de décision. a) De l'interruption volontaire de grossesse pour motif thérapeutique à l'interruption volontaire de grossesse pour motif médical. L'interruption de grossesse pour motif thérapeutique peut être pratiquée dans deux cas : - "lorsque la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme" ; - "lorsqu'il existe une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic". Deux médecins doivent décider du recours à l'IVG après examen et discussion. Dans le premier cas, l'un de ces deux médecins doit exercer son activité dans un établissement d'hospitalisation public ou dans un établissement d'hospitalisation privé satisfaisant aux conditions imposées pour pratiquer des IVG. L'autre doit être inscrit sur la liste d'experts près la Cour de cassation ou près d'une Cour d'appel. Dans le deuxième cas, l'un des deux médecins doit exercer son activité dans un centre de diagnostic prénatal pluridisciplinaire. C'est dans ce cadre que les médecins sont appelés à répondre aux demandes de femmes, hors délais, souvent dans des situations particulièrement difficiles. Ils peuvent estimer, en leur conscience, qu'il existe un risque pour la santé de la femme, en s'appuyant sur la définition donnée par l'Organisation mondiale de la santé : "La santé est un état de bien-être physique, mental et social". "Dans ces situations, précise le professeur Milliez, nous demandons une évaluation d'experts à un psychiatre qui confirme, en produisant un certificat, qu'il y a un risque pour la santé de cette femme ou de cette jeune fille, et qu'il est nécessaire de procéder à une interruption médicale ou thérapeutique de grossesse. "Cet artifice légal nous permet de trouver des solutions aux situations les plus tragiques, celles qui pourraient conduire à des tentatives de suicide ou à des accouchements dans des conditions épouvantables, celles qui constitueraient véritablement des mises en danger de la vie d'autrui, si nous ne faisons rien". Aussi, la modification par le projet de loi de l'interruption de grossesse, pour motif thérapeutique, qui devient l'interruption de grossesse pour motif médical devrait permettre aux médecins d'intervenir dans ces cas limites, tardifs et particulièrement douloureux. b) Modifier la procédure vers plus de collégialité et de pluridisciplinarité Il semble d'après les témoignages recueillis que la procédure faisant appel à un médecin-expert ne soit pas vraiment appropriée. D'une part, les médecins-experts susceptibles d'intervenir en matière d'interruption de grossesse sont peu nombreux et difficilement accessibles. D'autre part, ces dispositions ne semblent pas prendre en compte au mieux l'intérêt des femmes et laissent entièrement la décision entre les mains des médecins. Aussi, votre Délégation souhaite introduire le principe de collégialité et de pluridisciplinarité par l'intervention d'une commission qui permettrait l'établissement d'un dialogue entre la femme ou le couple et les membres de cette commission. Celle-ci pourrait être composée de deux médecins, dont un responsable de service de gynécologie-obstétrique et d'un psychologue. La prise de décision pour la femme comme pour les médecins serait ainsi entourée des meilleures garanties. 3. L'allongement des délais va-t-il entraîner un risque d'"eugénisme" ? Dès l'annonce du projet gouvernemental, une polémique s'est faite jour autour de l'allongement des délais, susceptible d'entraîner des dérives eugéniques. Les progrès des sciences et techniques médicales, en particulier de l'échographie, la surveillance dont est maintenant entourée la femme enceinte, permettent de déceler de plus en plus tôt un doute sur l'évolution normale de la grossesse et l'apparition d'anomalies. D'ores et déjà, depuis une dizaine d'années, des examens pratiqués entre dix et douze semaines d'aménorrhée, avant donc la fin du délai légal, permettent de diagnostiquer des anomalies majeures et souvent incompatibles avec la vie (encéphalie, _dèmes généralisés...) entraînant une fin spontanée de la grossesse, mais aussi de petites anomalies, qui induisent un doute sur le devenir de l'enfant (bec-de-lièvre, doigt surnuméraire...). Un diagnostic du sexe peut aussi être effectué à ce stade. L'ensemble de ces malformations, selon les spécialistes interrogés, représente un taux de 2,5 % environ des grossesses, dont 1 % d'anomalies majeures. L'argumentation du délai de dix à douze semaines de grossesse permettrait à la médecine de connaître le sexe de l'enfant et d'obtenir des informations plus fines sur d'éventuelles anomalies. Ainsi, après la onzième ou douzième semaine, une fente labiale, qui n'était pas visible avant, peut désormais, mais très progressivement, être décelée. b) La découverte du sexe ou d'anomalies mineures va-t-elle entraîner un accroissement des demandes d'IVG ? Le professeur Didier Sicard, président du Comité consultatif national d'éthique (CCNE) répond sur ce sujet : "Je pense que cette question ne doit pas être traitée de cette façon, parce qu'il est attentatoire à la dignité des femmes de considérer qu'une grossesse puisse être vécue ainsi et qu'une femme puisse s'en débarrasser en fonction du sexe de l'enfant... En particulier, respecter les femmes, c'est ne pas leur faire porter d'emblée une responsabilité vis-à-vis d'elles-mêmes, comme si elles étaient désinvoltes vis-à-vis de leur grossesse. "Donc, même si la médecine peut apporter des informations permettant à un certain nombre de femmes de porter, sur leur grossesse, un jugement négatif, qu'elles n'auraient peut-être pas porté si elles étaient restées dans l'ignorance, je ne pense pas, compte tenu du faible nombre de cas en cause, que la découverte du sexe aboutisse à une augmentation des interruptions de grossesse. Je ne pense pas que l'on ait à craindre un eugénisme aggravé, parce que la question n'est pas de savoir si l'eugénisme existe - il existe de façon médicale, même si l'on ne veut pas le voir - et je ne pense donc pas que l'allongement du délai soit de nature à accroître le nombre d'interruptions de grossesse. "Je ne pense pas d'ailleurs que le débat sur l'eugénisme lié au délai d'interruption de grossesse ait un sens, en dehors de certains pays comme la Chine. Mais, dans ce pays, ce ne sont pas les femmes qui interrompent leur grossesse lorsqu'elles ont des filles, mais l'Etat chinois qui les y obligent, car c'est un Etat eugénique. Et la France ne l'est pas." Madame Martine Aubry, alors ministre de l'emploi et de la solidarité, a été claire sur le sujet : "Le sujet de l'eugénisme est un débat important que nous ne devons pas occulter... Mais il ne doit pas être confondu avec le débat qui concerne le droit à l'IVG, et encore moins faussement résolu par une mise sous tutelle des femmes". Votre Délégation estime que la polémique sur les risques d'"eugénisme" n'a pas véritablement d'objet à propos de l'IVG. Les cas de femmes ou de couples, que l'on soupçonne d'avoir eu recours à l'IVG pour une question de sexe de l'enfant à naître, sont tout à fait marginaux. S'agissant d'une anomalie légère, la décision de la femme devra être entourée, éclairée au maximum sur la possibilité de traitement du handicap, la prise en charge de l'enfant. Les familles ne sont pas toutes égales devant l'accueil de cet enfant. La recherche de l'enfant parfait, de l'enfant sur mesure, relève d'un fantasme. Ce que souhaitent les familles, c'est un enfant simplement normal. D. POUR DE MEILLEURES CONDITIONS D'ACCUEIL ET D'ACCÈS À L'IVG. Pour donner toute son efficacité à l'allongement des délais et respecter au mieux les droits et la volonté de la femme, il faudra d'une part améliorer l'accueil offert aux femmes lors de leur prise de décision, d'autre part favoriser l'accès à l'IVG dans les structures publiques, notamment par des moyens budgétaires accrus. 1. Une prise de décision qui doit être entourée et respectée. a) Pour un entretien qui ne soit plus imposé. Après la première consultation médicale en vue de l'IVG, la femme enceinte doit "consulter un établissement d'information, de consultation ou de conseil familial, un centre de planification ou d'éducation familiale, un service social ou un autre organisme agréé qui doit lui délivrer une attestation de consultation". C'est, munie de cette attestation, que la femme retourne ensuite chez le médecin pour une deuxième consultation médicale. Cet entretien préalable est souvent mal perçu par les femmes. Lorsqu'elles ont pris leur décision, il est ressenti comme superflu ou dissuasif et n'est plus qu'une formalité, "un papier" à aller chercher. La qualité de l'entretien est variable suivant, précisément, la réceptivité de la femme et l'accueil des conseillères conjugales. Le contenu de l'entretien apparaît pourtant capital pour les femmes qui hésitent encore ou qui ont besoin d'une écoute à un moment particulièrement difficile de leur vie, particulièrement pour les mineures. Aussi, le médecin, lors de la première consultation conjugale, devrait évoquer avec la patiente la possibilité et l'utilité de l'entretien, le proposer systématiquement sans l'imposer. L'entretien, accepté, sera ainsi mieux vécu par la femme. L'entretien devrait cependant rester obligatoire pour les mineures. b) Une revalorisation du rôle des conseillères conjugales Les personnels paramédicaux qui assurent ces entretiens assurent une mission de soutien psychologique absolument indispensable. Votre Délégation a reçu, en réunion de travail, des conseillères conjugales et les a interrogées sur le problème de l'entretien et sur celui de leur statut. · Ces personnels qui assurent la mission de l'entretien, voulu par la loi de 1975, n'y sont pas mentionnés. Afin de mieux reconnaître leur rôle, il conviendrait d'y faire référence explicitement à l'article L. 2212-4 du code de la santé publique. Les conseillères conjugales ont dû attendre longtemps avant que ne soient précisées leur rôle et leur formation (décret du 6 août 1992 et arrêté du 23 mars 1993). Mais elles n'ont ni statut, ni carrière propre et leurs rémunérations sont dérisoires. A l'heure, où le militantisme des premières conseillères conjugales, au lendemain de l'adoption de la loi Veil, se renouvelle difficilement, il serait temps de reconnaître à ces femmes, qui exercent une profession difficile, un véritable statut à partir de la reconnaissance d'un diplôme. Un délai d'une semaine doit s'écouler entre la première demande de la femme et la confirmation écrite remise au médecin. En comparaison avec les pays voisins, ce délai de réflexion est le plus long (trois jours en Allemagne, cinq jours aux Pays-Bas, sept jours en Italie, mais aucun délai en Grande-Bretagne, Danemark et Suède). La longueur de cette attente pour les femmes qui ont pris leur décision ainsi que pour les femmes pressées par des délais impératifs est mal ressentie. En cas d'urgence toutefois, au cas où le terme légal risquerait d'être dépassé, ce délai peut être réduit, mais le médecin demeure seul juge de l'opportunité de la décision. Il conviendrait peut-être d'introduire plus de souplesse dans l'appréciation de cette urgence à réduire la durée de la réflexion. Des médecins estiment en effet qu'une disposition en ce sens permettrait de faciliter la pratique précoce de l'avortement médicamenteux. 2. Un meilleur accès à l'IVG, en particulier à l'hôpital public. Le plan de Mme Martine Aubry a) Un plan concerté avec tous les partenaires Il y a deux ans, de septembre 1998 à juillet 1999, le ministère de l'emploi et de la solidarité, alerté par le rapport du professeur Nisand de février 1999 sur les difficultés de l'accès à l'IVG dans le secteur public, a entamé sur ce sujet une réflexion approfondie avec tous les partenaires concernés, dans le cadre d'un comité de pilotage. Cette large concertation, établie avec les professionnels de la santé, professeurs, praticiens, associations de planning familial, associations militantes, associations familiales, a abouti au plan présenté par Mme Martine Aubry en juillet 1999, basé sur l'importance d'une politique de contraception, prévention de l'IVG, considérée comme un ultime recours, et sur la nécessité d'un meilleur respect des droits des femmes et de l'accès à l'IVG. La ministre de l'emploi et de la solidarité l'a précisé dans sa conférence de presse du 14 septembre dernier. Dans le budget 2000, une enveloppe de douze millions de francs a été dégagée pour renforcer les équipes hospitalières pratiquant les IVG, en personnel et en moyens matériels, avec une répartition par régions selon leurs difficultés. Ces crédits ont permis, dès le mois de juin dernier, la création de nombreux postes (quinze équivalents temps plein médecins, 4 000 vacations médicales, sept équivalents temps plein non-médecins). Entendue par la Délégation aux droits des femmes, la ministre de l'emploi et de solidarité les a ainsi brièvement résumées : · Remédier à l'accueil insuffisant des femmes durant les mois d'été, par une planification d'ouverture des centres pendant cette période ; cette orientation fait suite à l'étude menée par le professeur Chantal Blayo en août 1999 et renouvelée cette année. · Pendre en compte la contraception et l'IVG dans les missions des commissions régionales de la naissance. · Mettre en place des permanences téléphoniques régionales (17), pour informer les femmes, même en plein mois d'août, des possibilités d'accueil. · Favoriser, pour l'IVG précoce, le recours à la méthode médicamenteuse. · Permettre aux femmes, mieux informées, de choisir elles-mêmes la méthode d'IVG. · Assurer l'IVG dans les meilleures conditions possibles de sécurité et de soutien psychologique, avec un accompagnement post-IVG. · Prendre en compte le bon fonctionnement de l'activité d'IVG dans les contrats d'objectifs et de moyens signés par les Agences régionales de l'hospitalisation (ARH) avec les établissements hospitaliers publics. d) Le problème des médecins des centres IVG est posé. Valoriser les activités des centres d'IVG passe d'abord par une amélioration de la situation des médecins, - et aussi des personnels non médicaux, comme les conseillères conjugales, abordée plus haut -. · Problème de recrutement. Les médecins qui travaillent comme vacataires, ou comme contractuels dans les centres, sont en général des gynécologues médicaux ou des généralistes. Cette génération militante disparaît et le renouvellement n'est pas assuré. Les solutions, suggèrent certains médecins, seraient de former les futurs généralistes dans les centres, qui par ailleurs pourraient être partie prenante dans la formation des futurs gynécologues médicaux. · Problème de statut et d'avenir professionnel. La situation des médecins-vacataires, rémunérés de façon dérisoire, n'est guère motivante. Certains suggèrent qu'au bout de deux contrats de trois ans, le médecin contractuel puisse se présenter à un concours interne pour devenir praticien hospitalier titulaire. Les centres eux-mêmes, pour plus d'efficacité et pour une meilleure reconnaissance au sein de l'hôpital, devraient acquérir au moins le statut d'unité fonctionnelle, sinon de service hospitalier. II - CONTRACEPTION ET IVG DES MINEURES : AMÉNAGER L'OBLIGATION DE L'AUTORISATION PARENTALE. 1. Les grossesses chez les mineures : une situation préoccupante. Un premier constat : on enregistre chaque année en France 10 000 grossesses adolescentes, dont 5 700 se terminent par une IVG. Le professeur Michèle Uzan, chef de service de gynécologie-obstétrique de l'hôpital Jean-Verdier de Bondy, auteur d'un rapport sur la prévention et la prise en charge des grossesses des adolescentes, remis en 1998 au directeur général de la santé, a présenté à la Délégation un certain nombre de chiffres préoccupants. - Plus la grossesse survient à un âge précoce, plus elle court le risque d'être interrompue : à l'âge de douze ans, plus de 80 % des grossesses évoluent vers une IVG, ce taux n'étant que de 20 à 25 % à l'âge de dix-huit ans. En moyenne, une grossesse adolescente sur deux va donc aboutir à une IVG, ce qui représente 3 % de l'ensemble des IVG en France. - En Seine-Saint-Denis, où a été menée l'enquête, la situation est encore plus difficile, en raison d'une population jeune et immigrée, avec une natalité élevée et un fort taux de précarité. Dans ce département, 5 % des IVG sont le fait de mineures. Pour 12 % de ces adolescentes mineures, il s'agit de récidive ; pour 4 %, l'IVG est consécutive à des violences sexuelles et 50 % de ces jeunes filles ne sont plus scolarisées. Ces situations sont intolérables, étant donné le caractère souvent dramatique des grossesses adolescentes, surtout pour les plus jeunes. Commencer son entrée dans la vie et dans la sexualité par une IVG est pour une jeune fille particulièrement traumatisant. Les raisons sont d'abord d'ordre social. La scolarisation de masse a créé un âge d'adolescence spécifique, entre enfance et âge adulte. La mixité scolaire a facilité, depuis une cinquantaine d'années, les relations entre les jeunes, tandis que les révolutions sexuelles et contraceptives ont entraîné une maturité des jeunes plus rapide. Elles tiennent aussi au caractère particulier de la sexualité des adolescentes, souvent irrégulière et imprévue, avec absence de contraception ou contraception mal maîtrisée. D'après l'enquête du professeur Michèle Uzan en Seine-Saint-Denis, 50 à 60 % des premiers rapports ont lieu sans contraception ; 70 % des adolescentes n'ont aucune contraception dans les trois mois qui précèdent une IVG et 20 % ont une contraception aléatoire qui va de la pilule oubliée jusqu'au préservatif laissé dans la poche 2. L'obligation de l'autorisation parentale est trop rigide a) Contradictions entre la minorité juridique de l'adolescente et sa maturité personnelle · L'adolescence est une période d'ambivalence : la jeune fille qui connaît une vie sentimentale, qui a vécu une relation sexuelle, se trouve dans une contradiction juridique et sociale, difficile à assumer : elle devient femme, mais elle reste mineure. Elle a besoin d'indépendance, mais demeure sous la protection de ses parents. "Sa jeunesse a besoin d'eux, et sa pudeur a besoin d'ombre. Ainsi naît l'intime, ce noyau autour duquel l'identité personnelle se développe" (18). L'arrivée d'une grossesse renforce cette distance. Si elle ne souhaite pas poursuivre sa grossesse, doit-elle demander à ses parents une autorisation parentale, dont elle a sans doute fait l'impasse pour ses premières expériences sexuelles, et sans doute sa contraception ? Cette obligation peut être une épreuve supplémentaire, voire même être perçue comme une violence morale exercée contre son intimité, relevant symboliquement de l'intrusion et de la punition. Il convient de prendre acte de cette réalité d'adulte, plutôt que de renvoyer l'adolescente à une minorité plus formelle que réelle. La loi doit s'adapter et accompagner un mouvement vers la responsabilité. · Dans certains cas, la recherche de l'autorisation parentale est impossible. Mme Nathalie Bajos, chercheure à l'INSERM, a établi une typologie des jeunes par rapport à l'autorisation parentale. Dans une majorité de familles tolérantes vis-à-vis de la sexualité, un dialogue peut se nouer à l'occasion de la grossesse de l'adolescente. C'est heureusement le cas le plus fréquent. Dans d'autres situations, où le milieu familial est hostile à la sexualité et prévenu par obligation, il y a crise, positive qui permet de renouer un dialogue, ou négative qui entraîne pour la jeune fille des violences psychologiques. Dans une minorité de cas, le milieu familial, hostile à la sexualité, ne peut être prévenu, pour des raisons culturelles, de mauvais climat familial, d'absence des parents... La situation de crise ainsi engendrée retarde l'annonce aux parents et l'accès au système de soins. Nombreuses sont les jeunes filles qui partent à l'étranger. Parfois, le médecin ferme les yeux sur la validité de la signature des parents. b) Le mineur se voit déjà reconnaître des droits propres. Il y a une certaine hypocrisie à exiger le consentement parental pour la mineure célibataire en matière de contraception et d'IVG, alors que des droits spécifiques et des responsabilités lui sont déjà reconnus : - La mineure mariée est dispensée du consentement parental pour une IVG. En effet, le mariage émancipe la mineure, mais la maternité ne l'émancipe pas. - La mineure célibataire peut, seule, avoir le droit de reconnaître son enfant et d'exercer son autorité parentale. Par contre, elle reste soumise à l'autorité de ses parents. - La mère mineure peut accoucher sous X. Elle peut abandonner son enfant. - Le mineur, qui peut être émancipé à partir de seize ans, n'est plus placé sous l'autorité de ses parents. - Le mineur peut être entendu dans toute procédure le concernant, en particulier dans les procédures liées à la séparation ou au divorce : la loi du 8 janvier 1993 a en effet intégré, dans le droit français le principe posé par la Convention des droits de l'enfant, de l'audition de l'enfant en justice. Le critère de l'âge est remplacé par la capacité de discernement. c) Une avancée des droits des mineures en matière de contraception et d'IVG Dans le domaine de la santé, le principe est que les parents (ou le représentant légal) doivent consentir à tout acte médical concernant les mineurs. Cependant des dispositions spécifiques ont été adoptées permettant déjà une reconnaissance des droits des mineures. · En matière de contraception - La loi du 4 décembre 1974, novatrice, autorise déjà les centres de planification ou d'éducation familiale, à délivrer à titre gratuit des contraceptifs aux mineures désireuses de garder le secret, sans l'accord des parents ou du représentant légal, reconnaissant ainsi une dérogation à l'autorisation parentale. La gratuité permet à la mineure d'y avoir recours, sans demander le bénéfice de la couverture sociale de ses parents. - La proposition de loi sur la contraception d'urgence, adoptée en première lecture le 5 octobre dernier par l'Assemblée nationale, avalisant le protocole national du 6 janvier 2000 sur l'organisation des soins et des urgences dans les établissements scolaires devrait permettre à toutes les femmes, y compris les mineures, d'accéder à la contraception d'urgence, désormais en vente libre et sans ordonnance en pharmacie. Les mineures souhaitant garder le secret pourront par ailleurs se voir prescrire la pilule du lendemain par les médecins, tandis que les infirmières seront habilitées à la délivrer, dans des conditions bien précises, prenant en compte notamment le refus de l'élève de tout contact avec sa famille. · Concernant l'IVG La loi de 1979, confirmant la loi Veil de 1975, a apporté un complément à l'obligation du consentement parental : "Ce consentement parental devra être accompagné de celui de la mineure célibataire enceinte, ce dernier étant donné en dehors de la présence des parents ou du représentant légal". La mineure peut donc exprimer sa volonté en toute liberté. d) A défaut de solutions légales, des solutions pragmatiques ont été recherchées. La loi du 17 janvier 1975 n'est plus adaptée aux évolutions juridiques et sociales. Trop rigide, elle ne prévoit pas de solutions permettant de pallier l'absence du consentement parental dont elle fait un droit absolu. Aucun moyen juridique n'est envisagé pour passer outre le refus parental. Les conflits de consentement sont diversement jugés par les tribunaux et, dans la pratique, les médecins trouvent des solutions en dehors de tout cadre juridique, mais en engageant leur responsabilité. Ainsi, de nombreux médecins libéraux ou exerçant en milieu hospitalier prescrivent des contraceptifs à des mineures, sans savoir si les parents sont au courant. S'agissant de l'IVG, les médecins recevant des mineures, non munies d'autorisation parentale, soit orientent la jeune fille vers d'autres solutions (associations, départs à l'étranger), soit acceptent de pratiquer l'IVG avec seulement le consentement écrit, en théorie, d'un parent ou d'un membre de l'entourage, la présence du parent n'étant pas requise. B. UNE SOLUTION RAISONNABLE : L'INTERVENTION D'UN ADULTE RÉFÉRENT 1. Les réponses possibles au défaut de consentement parental Des juristes ont exploré les alternatives possibles à l'autorisation parentale. a) L'intervention du juge pour enfants Elle n'est prévue par aucun texte, mais le juge des enfants est souvent saisi, lorsque le consentement parental est défaillant. Il est en effet compétent, selon l'article 375 du code civil, lorsqu'il existe un danger pour la santé, la sécurité et la moralité d'un mineur. Il a, par exemple, la faculté de suspendre certains droits des titulaires de l'autorité parentale, tels que celui de consentir à un acte médical ou chirurgical nécessaire à la santé de l'enfant. En pratique, les positions des juges des enfants sont très variables en fonction de leurs critères de valeurs personnelles. Certains se déclarent incompétents. D'autres autorisent directement l'IVG, ou bien retirent aux parents le droit de consentir à cet acte, en remettant à un établissement ou à un service le soin d'y consentir. Mais, il semble, d'après des témoignages, que les juges des enfants éprouvent beaucoup de réticences "à se mettre à la place des parents et à donner une autorisation d'IVG". En tout état de cause, le juge des enfants doit entendre, avant toute décision, les parents et l'enfant, et ne peut en aucun cas autoriser une mineure à recourir à une IVG à l'insu de ses parents. b) La notion de majorité sanitaire Plusieurs juristes ont évoqué devant la Délégation la notion de majorité sanitaire qui pourrait intervenir à partir de seize ans, pour les grandes adolescentes, en s'appuyant sur l'autonomie de la mineure pour certains actes qu'elle peut déjà accomplir seule (accouchement sous X, reconnaissance ou abandon d'enfant). Si la suppression du consentement parental permet de résoudre le problème juridique et de dégager la responsabilité des praticiens, les conséquences pour la jeune fille pourront être lourdes à assumer. Un dialogue avec la famille devrait être recherché en tout état de cause. Cette notion ne résoudrait cependant pas le problème des jeunes mineures en dessous de seize ans. Dans ces cas, hors consentement parental, pourrait être reconnue la compétence du juge des enfants, qui serait habilité à statuer en matière d'IVG. En cas de viol, de violences sexuelles, de péril grave pour la santé de la mineure, ou de l'enfant à naître, il y a possibilité de recourir à l'interruption médicale de grossesse. Mais, dans ces situations, l'autorisation parentale est presque toujours sollicitée par les établissements et services chargés de pratiquer l'IVG. 2. La solution retenue : l'intervention d'un adulte, choisi par la mineure Le projet de loi présenté par le gouvernement maintient le principe de l'autorisation parentale. "A l'heure, où nous souhaitons marquer l'importance que nous accordons à la responsabilité parentale et à la consolidation des liens familiaux, a souligné Mme Martine Aubry, il serait paradoxal de démobiliser les parents à une période de sa vie où justement la jeune fille a le plus besoin de leur accompagnement et de leur soutien". a) Les possibilités de dérogation à l'autorisation parentale Lorsque le dialogue avec la famille s'avère impossible et que la jeune fille néanmoins a besoin d'accéder aux soins nécessaires et souvent dans l'urgence, l'accompagnement d'un adulte, choisi par la jeune fille dans son entourage, est envisagé. Cela peut être une s_ur, une tante, un oncle, un médecin ou un travailleur social. Cette solution s'appuie notamment sur les recommandations du Conseil national du sida, concernant l'accès confidentiel des mineurs adolescents aux soins, remis à Mme Dominique Gillot, secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés, en avril dernier. Ce rapport suggère, en effet, "que par mesure d'exception législative au principe de l'autorité parentale, la confidentialité dans l'accès aux soins soit reconnue aux mineurs"... "lorsque ces derniers considèrent que la révélation de pratiques relevant de leur intimité jetterait sur eux le discrédit et l'opprobre, et pourrait avoir pour conséquence un dommage pour leur santé psychique ou leur intégrité corporelle." La règle générale demeure l'autorisation parentale. Mais exception est faite si la jeune fille peut montrer au médecin, à l'assistante sociale, qu'elle est dans une famille où le fait même d'en parler la mettrait en danger psychologiquement, physiquement. L'exposé des motifs expose très clairement ces situations de danger : - La crainte d'une incompréhension majeure de la famille peut susciter des conduites dangereuses (tentative d'auto-avortement, déni de grossesse parfois prolongé jusqu'au terme) ; - La nécessité du consentement des parents peut aussi s'avérer avoir des effets particulièrement dramatiques lorsque la mineure est enceinte à la suite d'un inceste ou d'un viol ; - Dans d'autres cas, malgré un dialogue entre la mineure et ses parents, une opposition persistante des parents à l'interruption volontaire de grossesse place la mineure en situation de grave détresse ; - Enfin, il est des situations où les parents sont absents ou injoignables. 1. La mineure qui désire garder le secret, lors de la consultation préalable, demande conseil sur le choix de la personne majeure susceptible de l'accompagner dans sa démarche ; 2. L'adulte choisi par elle-même, après discussion lors de l'entretien préalable, parmi son entourage, ou parmi les professionnels du CIVG ou du centre de planification, l'accompagnera dans sa démarche. 3. Le médecin, lors d'un dialogue avec la mineure, devra s'efforcer de la convaincre d'un contact nécessaire avec ses parents, qui sont les mieux à même de l'accompagner dans cette période difficile de son existence ; 4. Si la jeune fille persiste dans son souhait de garder le secret, ou si elle ne peut obtenir le consentement de ses parents, son seul consentement, exprimé en tête à tête avec le médecin, emportera la décision. 5. Il lui sera proposé une deuxième consultation après l'IVG, pour une nouvelle information sur la contraception. · Les conditions posées, qui ont pour but d'explorer toutes les possibilités de la recherche du consentement parental, suscitent quelques interrogations. Est-ce bien au médecin que revient cette mission, de s'efforcer, dans l'intérêt de la mineure, d'obtenir son consentement pour que le ou les parents, ou les titulaires de l'autorité parentale, soient consultés ? Le médecin voudra-t-il assumer ce rôle, qui n'est plus d'ordre médical, mais d'ordre psycho-social ? La Délégation a estimé que la conseillère conjugale, qui assure l'entretien préalable et qui a les compétences et l'expérience requises, serait mieux à même de remplir cette mission. III - POUR UNE LARGE POLITIQUE DE PRÉVENTION : ASSURER UN MEILLEUR ACCÈS À LA CONTRACEPTION, AUTORISER LA STÉRILISATION EN L'ENTOURANT DES PRÉCAUTIONS NÉCESSAIRES A. ASSURER UN MEILLEUR ACCÈS À LA CONTRACEPTION Bien que largement admise et utilisée en France, la contraception n'est pas parvenue à réduire sensiblement ces dernières années le nombre des grossesses non désirées, faute d'information et d'éducation, faute aussi d'une réelle prise en charge. Par ailleurs, la recherche en matière contraceptive n'a pas enregistré de progrès qualitatifs suffisants ces dernières décennies et n'offre pas de solutions assez diversifiées aux femmes. 1. L'échec contraceptif demeure, malgré une forte utilisation des méthodes contraceptives. · Plus de deux Françaises sur trois entre 20 et 49 ans utilisent une méthode contraceptive. Parmi les méthodes contraceptives, la pilule est de loin la plus répandue (près de 36 %) suivie du stérilet (16 %), du préservatif (près de 5 %) et de différentes méthodes non médicales (19). Le développement régulier des pratiques contraceptives n'a été entravé ni par les craintes des effets secondaires de la pilule ou du stérilet, ni par une lassitude supposée des utilisations. Ni la légalisation de l'IVG qui aurait pu conduire à un relâchement des pratiques, ni l'épidémie de sida, n'ont affecté les comportements contraceptifs. La pilule s'est rapidement imposée chez les jeunes femmes et son taux d'utilisation chez les 20-24 ans n'a cessé de croître, tandis que le stérilet apparaît de plus en plus comme la "méthode-relais", après 30 ou 35 ans. Le sida, au début des années 90, a conduit à développer de fortes campagnes en faveur de l'utilisation du préservatif, qui dans un premier temps s'est ajouté à l'utilisation de la pilule. Mais, plus récemment, on a noté une baisse de son utilisation, en raison d'un certain recul de la maladie et des craintes suscitées. · Des raisons complexes à l'échec contraceptif Une enquête qualitative récente de l'INSERM (20) conduite par Mmes Nathalie Bajos et Michèle Ferrand, entendue par la Délégation, s'est efforcée de répondre à la question suivante : "Dans un pays où la contraception est largement diffusée, ..., comment se fait-il que nous ayons un taux de grossesse non prévue et d'interruptions volontaires de grossesse aussi élevé ?" (21). Les entretiens approfondis menés avec des femmes ayant eu une grossesse non prévue ont permis de faire apparaître les difficultés inhérentes à la pratique contraceptive. Or, les échecs de contraception sont loin d'être tous évitables. Parmi les facteurs responsables de la grossesse, on relève des accidents de méthode (préservatif défectueux, "oublis" de pilule), l'infertilité supposée, une méthode inadéquate prescrite par le médecin. Des causes psychologiques plus profondes peuvent intervenir comme l'ambivalence quant au désir de grossesse. Un autre aspect est apparu, celui de la contraception vécue comme un enjeu des rapports entre hommes et femmes lors de leur relation sexuelle, lié souvent au refus du préservatif par l'homme et à la priorité accordée au plaisir sexuel masculin. Quant à "l'impossible démarche contraceptive", elle concerne des femmes qui sont dans des situations personnelles ou socio-économiques telles, qu'elles ne peuvent maîtriser aucune contraception. 2. Pour une meilleure information à la contraception et une éducation à la sexualité · L'information à la contraception. Les interlocuteurs de la Délégation ont tous souligné le caractère essentiel d'une information à la contraception, en amont, indispensable à une meilleure prévention des grossesses non désirées. Des résistances demeurent au point de vue psychologique et social, mais aussi au point de vue institutionnel. Aussi le gouvernement a-t-il décidé en 1999 de mener une politique active en matière de contraception, en lançant au début de cette année une vaste campagne d'information sur le thème "La contraception, à vous de choisir la vôtre". La dernière, datant de 1992, mettait principalement l'accent sur le préservatif. La campagne s'est articulée dans les média, presse, radio et TV, par des spots et des messages ciblés vers les jeunes de 15/25 ans, et hors média par la diffusion de douze millions de guide de poche sur la contraception dans tous les établissements scolaires et le réseau associatif. Parallèlement était mise en place une plate-forme téléphonique nationale permettant d'orienter les appels vers les structures d'information, ainsi que des actions au niveau local pour relayer la campagne. Comme l'a rappelé Mme Martine Aubry, le 14 septembre dernier, le bilan est positif d'après le post-test de la campagne réalisé par l'institut B.V.A.. Cependant, d'après une étude de l'INSERM qui a procédé à une évaluation, la campagne doit être complétée par des actions de proximité, un changement de comportement et une formation entre tous les professionnels de santé : "Sur ce sujet de la contraception, ... , la seule campagne audiovisuelle n'est pas suffisante. Elle est importante pour créer un bruit de fonds, interpeller, susciter les questions, prendre conscience d'un défaut d'information, mais elle ne suffit pas pour savoir précisément quelle contraception choisir à quel moment. Elle nécessite d'être accompagnée par des actions de proximité d'une part ..., mais surtout par un changement de comportement des professionnels de santé : médecins, généralistes, gynécologues, pharmaciens, infirmières scolaires. Selon les conclusions de l'étude, l'utilisation de la contraception ne s'améliorera de façon significative que si l'accent est mis sur la formation des professionnels chargés de la prescrire, de la distribuer ou de l'administrer, afin qu'ils accompagnent leurs actes d'une information et d'un dialogue plus adaptés aux besoins des demandeurs." 3. Une meilleure prise en charge de la contraception par la collectivité a) Le prix de la contraception et le problème de son remboursement · Le coût de certaines méthodes contraceptives demeure élevé. S'agissant d'une pratique de santé publique, la contraception devrait pourtant relever de la solidarité nationale et être proposée à un prix acceptable. Le problème se pose notamment pour les pilules de la troisième génération. Elles représentent actuellement 40 % des recours à la contraception et 55 % en coût financier de l'ensemble. Elles ne sont pas remboursées par la sécurité sociale et restent donc à la charge des femmes. De plus, le prix de ces pilules par rapport à celles de la deuxième génération ne semble pas justifié. Selon le professeur Alfred Spira, entendu lors du colloque du 30 mai dernier, "ce type de contraception n'a pas fait la preuve d'une amélioration du service médical rendu". Un dossier vient d'être déposé par le ministère de l'emploi et de la solidarité pour la mise sur le marché d'un générique de pilule de troisième génération, remboursable par la sécurité sociale, auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Des interrogations demeurent cependant sur les avantages médicaux réels de ces pilules. · Le stérilet est généralement utilisé par des femmes ayant entre 35 et 45 ans, qui ne veulent plus d'enfants, même si cette méthode est parfaitement réversible et peut être utilisée plus tôt. Son coût jusqu'à présent élevé en fait une contraception bon marché. Le remboursement par la sécurité sociale étant limité à 44 F dans le cadre du TIPS, Mme Martine Aubry a décidé en août dernier que le prix maximal de vente au public (actuellement libre) serait de 142 F, remboursable à hauteur de 65 %, la charge pour les femmes n'étant plus que d'environ 50 F. Pour leur part, les bénéficiaires de la CMU bénéficient d'une prise en charge à 100 %. b) Le problème de la gratuité pour les mineures Pour les mineures, l'extension de la gratuité du Norlévo, qui peut être déjà délivré dans les centres de planification familiale, et qui pourra l'être bientôt par les infirmières en milieu scolaire, a été débattu devant le Sénat le 31 octobre dernier. M. Lucien Neuwirth, rapporteur de la proposition de loi sur la contraception d'urgence (22), a proposé d'assurer la gratuité de la délivrance de ce contraceptif aux mineures en pharmacie, l'avantage étant de permettre aux adolescentes scolarisées de se procurer le Norlévo pendant les vacances scolaires et lorsque l'établissement ne dispose pas d'infirmière à temps plein, mais aussi de le mettre à disposition des jeunes filles en apprentissage ou non scolarisées. Par ailleurs, le coût du Norlévo en officine, non remboursé par la sécurité sociale, bien que relativement peu élevé (60 F environ), peut constituer un obstacle pour des jeunes filles en difficulté. On ne peut qu'approuver cette proposition. Elle va dans le sens d'une meilleure prévention, le pharmacien devant accompagner la délivrance de ce contraceptif de conseils appropriés et elle pallie les difficultés d'accès aux centres de planification familiale et aux services d'urgence des hôpitaux, en nombre insuffisant. Une convention, passée entre les pharmaciens et le département, responsable des Centres de planification, pourrait permettre le remboursement aux pharmacies. B. ÉLARGIR LA CONTRACEPTION PAR UNE RECONNAISSANCE DE LA STÉRILISATION VOLONTAIRE 1. La stérilisation volontaire est encore peu développée en France. a) Cette méthode de régulation des naissances est très développée dans les pays anglo-saxons et en Asie. La stérilisation féminine, comme la stérilisation masculine, est devenue le moyen de contrôle de la fécondité le plus utilisé dans le monde, aussi bien dans les pays en développement que dans les pays développés. D'après une étude de l'INSERM (23), au début des années 1990, sur une population totale de 900 millions de couples d'âge reproductif, on comptait 15 % de femmes stérilisées (soit 135 millions) et 4 % d'hommes stérilisés. La stérilisation occupe ainsi la première place, parmi les méthodes de régulation des naissances, loin devant le stérilet (11 % des femmes d'âge reproductif), la pilule (8 %), le préservatif (5 %) et les autres méthodes (11 %). Pourcentage de couples en âge de procréer utilisant la stérilisation comme méthode de régulation des naissances dans les pays développés
L'accès à la stérilisation varie cependant d'un pays à l'autre selon la culture, les m_urs, la situation démographique. C'est en Asie pour des raisons démographiques évidentes, que l'on trouve le plus fort taux de stérilisation : 34 % des couples d'âge reproductif en Chine, 31 % en Inde, 48 % en Corée du Sud. b) Notre pays demeure réticent à ces pratiques. Comparativement, ces méthodes sont encore peu utilisées en France. En 1994, 5 % des femmes mariées de 18-49 ans avaient été stérilisées à des fins contraceptives, soit environ 500.000 femmes, la proportion d'hommes vasectomisés étant négligeable. Le nombre d'interventions pratiquées à ces fins contraceptives a d'ailleurs tendance à diminuer, passant de 32.000 stérilisations annuelles vers 1980-1985 à 25.000 environ vers 1990. La stérilisation, qui n'a jamais été très répandue, est surtout le fait des femmes moins jeunes, qui anticipent le terme de leur fécondité. Pour les hommes, par contre, c'est un véritable choix pour le reste de leur vie. En tout état de cause, cette intervention fait dans notre culture l'objet d'une réticence certaine. 2. La stérilisation demeure une intervention particulière. · La stérilisation féminine par la section, la ligature ou l'obstruction des trompes, est une intervention d'ordre chirurgical, qui nécessite une anesthésie générale, tandis que la vasectomie est une opération simple et rapide qui se pratique sous anesthésie locale. Comme d'autres méthodes contraceptives, le but de cette intervention est de prévenir une fécondité non désirée. Mais, elle en diffère fondamentalement dans son but, car elle vise à la suppression définitive de la capacité de procréer. · L'efficacité des procédés pose avec gravité le problème de la réversibilité, au cas où l'homme ou la femme viendrait à regretter la décision prise de supprimer sa fécondité. Or cette réversibilité, possible techniquement, ne peut être garantie pour chaque personne individuellement. Pour l'homme, la réversibilité est possible, mais la technique microchirurgicale est très délicate et les résultats souvent aléatoires. Il existe cependant une possibilité de conserver la fertilité de l'homme par une congélation préalable du sperme et le recours à la procréation médicalement assistée. Pour la femme, la reperméabilisation tubaire, intervention lourde par microchirurgie, peut permettre la récupération des capacités procréatrices, avec un taux de réussite d'environ 60 %. En cas d'échec, demeure théoriquement l'option d'une fécondation in vitro. · Les demandes de reperméabilisation correspondant à l'expression d'un regret semblent cependant peu fréquentes et affectent surtout des femmes jeunes, amenées en raison des nouvelles circonstances de leur vie à vouloir retrouver leur fertilité et revivre l'expérience de la maternité. · La pratique de la stérilisation, en dehors de stricts motifs thérapeutiques, répond à des indications médicales majeures, lorsque la grossesse à venir constitue un risque pour la femme, mais aussi à des demandes à but contraceptif, auxquelles certains médecins acceptent de répondre en suivant un certain nombre de règles de prudence. Un certain nombre de femmes en effet ne supportent pas ou ne supportent plus la contrainte des méthodes contraceptives classiques ou décident, en couple, de limiter leur famille ou encore font un choix qui tient à leur histoire personnelle. 3. Mettre fin au vide juridique concernant la stérilisation a) Elle n'est ni autorisée, ni interdite. Au regard de la loi, en France, la stérilisation volontaire, qui n'est mentionnée dans aucun texte juridique, n'est en fait ni autorisée, ni interdite. Du point de vue pénal, elle relève des dispositions de l'article 222-9 du code pénal punissant "les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente". Cette incertitude juridique a permis, depuis ces dernières décennies, un certain développement du recours à cette méthode à des fins contraceptives. Cependant, la loi du 29 juillet 1994, introduisant dans le code civil un article 16-3 a apporté à cette pratique des limitations en précisant : "Il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité thérapeutique pour la personne. Le consentement de l'intéressé doit être recueilli préalablement, hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n'est pas à même de consentir." Cette notion de nécessité thérapeutique appliquée de façon stricte est devenue une source de difficulté supplémentaire à la mise en _uvre de ces interventions. b) Une évolution favorable ces dernières années Une évolution favorable s'est dessinée ces dernières années au plan déontologique et jurisprudentiel. Le Conseil national de l'Ordre des médecins en 1996, notamment, a pris une position claire en faveur de la stérilisation, comme méthode contraceptive, dans certaines conditions, et il a fixé un cadre déontologique. Le Comité consultatif national d'éthique (CCNE) a engagé en 1996 une réflexion approfondie sur le problème de la stérilisation volontaire envisagée comme mode de contraception définitive. Son rapport vise à souligner les interrogations éthiques que soulève toute éventualité de stérilisation, c'est-à-dire celle portant sur le droit d'un individu de limiter, voire de supprimer, ses capacités procréatrices. Sans prendre position sur les solutions envisagées, le CCNE a estimé fondamental de retenir le principe d'un consentement libre et informé sur la procédure de stérilisation, son irréversibilité variable et les risques d'échecs, et il suggérait, en ce cas, un délai de réflexion accordant à la personne concernée le temps et la possibilité d'explorer, avec d'autres consultants, les motifs et les justifications de la demande. Il renvoyait au législateur le soin de trancher ce débat de société. b) L'article 70 de la loi sur la CMU Les nombreuses prises de position des professionnels, en particulier des gynécologues-obstétriciens, en faveur d'un assouplissement du cadre législatif, ont conduit récemment le législateur à intervenir. C'est ainsi que l'article 70 de la loi sur la couverture maladie universelle (CMU), adoptée le 27 juillet 1999, modifie l'article 16-3 du code civil sur l'atteinte à l'intégrité physique, en remplaçant le terme de nécessité "thérapeutique" par celui de nécessité "médicale". Entrée en vigueur en janvier 2000, cette disposition met la loi en conformité avec la pratique des médecins et aligne notre pays sur la plupart des pays européens, dont les législations reconnaissent depuis longtemps la stérilisation. L'incertitude qui demeure, comme en témoignent des procédures récentes, devrait conduire le législateur à intervenir à nouveau afin de légaliser la stérilisation volontaire féminine ou masculine et d'établir des procédures permettant de respecter le consentement de l'individu, de protéger son choix en l'entourant de toutes les précautions nécessaires. Le syndicat national des gynécologues-obstétriciens de France estime que tout individu, homme ou femme, citoyen responsable, doit avoir le libre choix de sa procréation, et que la stérilisation comme moyen de contraception doit être reconnue par la loi. Ce n'est pas au médecin, mais à la personne en toute conscience, qu'il appartient de décider de cette intervention. La Délégation aux droits des femmes a estimé que la stérilisation volontaire à but contraceptif devrait être autorisée par un texte législatif spécifique prévoyant un cadre dans lequel les motifs médicaux et/ou personnels de chaque demande peuvent être explorés et les informations pertinentes dispensées, afin de protéger les personnes concernées d'une prise de décision irréfléchie. Les demandes de stérilisation formulées par des tiers pour des personnes estimées incapables de consentir doivent faire l'objet de dispositions spécifiques en vue de protéger les droits et intérêts des personnes. TRAVAUX DE LA DÉLÉGATION La Délégation s'est réunie, le mardi 14 novembre 2000, pour examiner le présent rapport d'information. La rapporteure en a présenté les grandes lignes et a ensuite donné lecture de ses propositions de recommandations. Elle a d'abord indiqué qu'elle souhaitait insérer une nouvelle recommandation, qui figurerait en tête de celles-ci, rappelant la nécessité d'une large politique d'information à la contraception et d'éducation à la sexualité, qui seule permettrait d'obtenir une baisse sensible du nombre d'IVG. Mme Martine Lignières-Cassou, présidente a fait observer que l'étude qualitative menée par l'INSERM avait montré que la recherche en matière de contraception n'avait pas fait de saut qualitatif depuis un grand nombre d'années et qu'une diminution des IVG pourrait être obtenue à la fois en facilitant l'accès à la contraception et en développant la recherche contraceptive. Les deux recommandations suivantes ont pour objet de permettre de disposer de statistiques fiables sur le nombre d'IVG dans le secteur public et privé et sur le nombre de femmes concernées par l'allongement des délais. Mme Martine Lignières-Cassou, présidente a indiqué que l'accès à l'IVG dans le secteur public n'est pas correctement assuré et qu'il serait important qu'un travail de suivi soit réalisé pour déterminer l'évolution du secteur public, suite à la circulaire de novembre 1999 de Mme Martine Aubry. Les trois recommandations suivantes portent sur les différentes méthodes possibles en matière d'IVG, sur la nécessité de donner à la femme le choix de la méthode qui lui convient le mieux, et sur l'intérêt de développer l'IVG médicamenteuse, en la rendant plus accessible qu'actuellement. Trois autres recommandations ont trait à l'entretien préalable à l'IVG, jusqu'à présent obligatoire et qu'il serait souhaitable de proposer systématiquement sans l'imposer, sauf aux mineures, pour lesquelles cet entretien sera le moment d'aborder le problème de l'accompagnement, si elles refusent d'en parler à leurs parents. L'une de ces recommandations évoque le rôle essentiel des conseillères conjugales, dont la profession devrait être valorisée. Mme Danielle Bousquet, rapporteure, a retiré une des recommandations qu'elle avait initialement proposée prévoyant un raccourcissement de sept à quatre jours du délai de réflexion car elle a estimé que le délai existant pouvait apporter une réponse à l'argument de ceux qui craignent un accroissement des IVG, en raison d'un dépistage accru des anomalies prénatales. Deux propositions de recommandations portant sur l'IMG proposent l'élargissement des critères permettant de pratiquer l'IMG, en raison du péril grave que la grossesse fait peser sur la santé de la femme et le recours à une commission ad hoc pour prendre la décision d'interruption de grossesse. Mme Danielle Bousquet a finalement estimé que le recours à une commission pluridisciplinaire, comprenant par exemple un gynécologue-obstétricien et un psychologue, permettrait, sans qu'il soit besoin d'élargir les critères de santé, de mieux prendre en compte la situation de la femme. La recommandation suivante souhaite un élargissement des méthodes contraceptives par un recours possible à la stérilisation à but contraceptif, dès lors qu'un protocole garantira que les conditions nécessaires à un consentement libre et éclairé de la personne sont réunies. Mme Martine Lignières-Cassou, présidente, a souhaité ouvrir le débat sur le problème de la stérilisation, car la France est un des rares pays où les femmes et les hommes ne peuvent avoir recours à cette pratique contraceptive. Elle a évoqué les deux avis du Conseil national consultatif d'éthique sur le sujet et elle a rappelé l'intérêt de l'expérimentation, entourée d'un protocole très strict, menée à l'hôpital de Nantes. La recommandation suivante étend le délai d'entrave à l'IVG créé par la « loi Neiertz » pour le rendre plus effectif. Mme Nicole Bricq a souhaité qu'une recommandation supplémentaire évoque les efforts budgétaires à consentir en matière d'IVG. Sur ce point, Mme Martine Lignières-Cassou, présidente, a souhaité que soient poursuivis les efforts entrepris dans le cadre du budget 2000 et que soit fait mention de l'importance des unités fonctionnelles d'orthogénie permettant d'assurer aux femmes les meilleures conditions techniques et de sécurité. M. Patrick Delnatte a estimé que ces unités fonctionnelles, sortes de centres de référence, devraient pouvoir fonctionner dans toute la France, à la fois pour l'IVG et pour l'IMG. La Délégation a adopté les recommandations proposées par la rapporteure et modifiées pour tenir compte de l'ensemble de ces observations. 1. La Délégation souligne la nécessité impérieuse d'une large politique d'information à la contraception et d'éducation à la sexualité en direction des jeunes, condition préalable et indispensable à toute perspective d'une diminution sensible des recours à l'IVG. 2. Il serait souhaitable d'améliorer le système du recueil des données sur l'IVG dans les secteurs public et privé pour une meilleure épidémiologie, en raison d'une certaine sous-déclaration des IVG, en particulier dans les établissements privés agréés. 3. Une enquête devrait être diligentée par le ministère de l'emploi et de la solidarité pour une meilleure estimation du nombre de femmes qui, avec la légalisation des nouveaux délais, pourront accéder à l'IVG en France. 4. L'interruption de grossesse médicamenteuse par la Myfégine présente de nombreux avantages, liés à son utilisation précoce, sans anesthésie, et sans danger pour la santé de la femme. Il conviendrait de rendre plus accessible ce médicament, classé dans la catégorie des substances vénéneuses, dont la distribution et l'administration sont soumises à de sévères restrictions par un arrêté du 10 septembre 1992. 5. Le recours à l'avortement médicamenteux devrait pouvoir s'accompagner d'une pratique ambulatoire sans hospitalisation nécessaire, en structure légère ou même à domicile, la femme restant en contact avec son médecin. 6. Le choix par la femme de la méthode de l'IVG est fondamental, car la méthode la mieux acceptée est la méthode préférée par la femme. Le médecin, dès la première visite, devrait informer la femme des différentes méthodes d'avortement (méthode médicamenteuse ou chirurgicale, avec anesthésie locale ou générale), de leurs avantages et de leurs inconvénients. 7. L'entretien qui a une fonction d'aide et d'écoute de la femme n'est trop souvent qu'une simple formalité ou prend un caractère dissuasif ou culpabilisant. Aussi, sauf pour les mineures, cet entretien préalable ne devrait pas être imposé, mais systématiquement proposé lors de la première visite médicale. 8. Concernant le recours à l'IVG de la mineure désirant garder le secret, il devrait revenir, non pas au médecin, mais à la conseillère conjugale lors de l'entretien préalable, de s'efforcer d'obtenir son consentement pour que les titulaires de l'autorité parentale soient consultés, puis de constater éventuellement que la mineure ne veut pas effectuer cette démarche ou que le consentement n'est pas obtenu. 9. Pour une valorisation à la fois du contenu de l'entretien et du rôle des personnels de santé qui l'assurent, il conviendrait de revoir la situation des conseillères conjugales en leur reconnaissant un véritable statut, un diplôme reconnu par l'Etat, une harmonisation de leurs situations et rémunérations. 10. L'attestation que la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme doit être fournie par deux médecins, dont l'un doit être inscrit sur la liste d'experts près la Cour de cassation ou près d'une Cour d'appel. Le recours à une commission ad hoc, pluridisciplinaire, comprenant par exemple un gynécologue-obstétricien et un psychologue permettrait d'aider à la prise de décision médicale, tout en prenant mieux en compte la situation de la femme. 11. Dans un souci de prévention et pour élargir le recours aux méthodes contraceptives - y compris pour les hommes -, la stérilisation à but contraceptif devrait être reconnue par un texte législatif, en entourant cette pratique de toutes les précautions, nécessaires notamment à l'expression d'un consentement libre et éclairé de la personne. 12. En matière pénale, le délit d'entrave à l'interruption légale de grossesse devrait trouver sa place dans le code pénal et pourrait être étendu, en plus des menaces ou actes d'intimidation, aux pressions morales exercées à l'encontre des personnels médicaux et non médicaux et des femmes venant subir une IVG. 13. Afin d'accueillir au mieux les femmes qui seront concernées par un allongement des délais, les efforts budgétaires entrepris dans le cadre du budget 2000 devront être poursuivis. Les femmes devront être reçues dans des unités fonctionnelles d'orthogénie leur assurant les meilleures conditions techniques et de sécurité. Comptes rendus des auditions de la Délégation Personnalités auditionnées par la Délégation au cours de l'année 2000
Audition de Mme Danielle Gaudry, responsable de la Confédération du Mouvement français pour le planning familial Réunion du mardi 21 mars 2000 Présidence de Mme Martine Lignières-Cassou, présidente Mme Martine Lignières-Cassou, présidente : Mes chères collègues, nous recevons aujourd'hui Mme Danielle Gaudry, responsable de la confédération du mouvement français pour le planning familial, accompagnée de Mme Fatima Lalem, dans le cadre de nos travaux portant sur la santé des femmes. Mesdames, nous savons que vous avez activement participé à la réflexion du professeur Nisand sur la situation de l'IVG en France, et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous souhaitons vous entendre. Mme Danielle Gaudry : Je commencerai mon propos par un rappel historique de notre association. Notre association a été créée en 1956 -elle s'appelait initialement "la maternité heureuse"- par un groupe de personnalités -médecins et non médecins, parents- pour faire face aux situations dramatiques que vivaient les femmes et les couples face aux grossesses désirées ou non. Notre mouvement d'éducation populaire laïc, qui s'est installé largement en France, a changé de nom et fait maintenant partie d'une association internationale de planning familial, l'IPPF. Nous avons une pratique de terrain très importante, qui fonde entièrement notre analyse. La situation et la parole des femmes, reprises par l'association, étayent nos propositions en faveur de certains changements. Nous souhaitons améliorer la situation des femmes en France, en nous basant notamment sur la prise de conscience de leur autonomie et de leur responsabilité. En ce qui concerne la situation de l'IVG en France, nous avons revendiqué, dès les années 70, une légalisation de l'avortement, dans le but de protéger les femmes à la fois dans leur santé et dans leurs droits. Nous gérons des associations départementales qui gèrent elles-mêmes des établissements d'information et des centres de planification où se déroulent des consultations de planning familial. Les établissements d'information font uniquement de l'information et des entretiens pré-IVG. En revanche, les centres de planification ont plusieurs missions, notamment de service public, puisque nous travaillons en collaboration avec les DDASS. Nous nous occupons de la contraception, des entretiens pré-IVG et de l'accompagnement des femmes dans ce domaine, de la prévention, du diagnostic et du traitement des maladies sexuellement transmissibles (MST) -depuis la "loi Calmat"-, ainsi que de l'accueil de femmes victimes de violences sexuelles. Nous connaissons bien la situation de l'IVG en France, car nous assurons un grand nombre d'entretiens pré-IVG ; nous accueillons aussi bien les femmes qui entrent dans le cadre de la loi française que celles qui en sont exclues. Nous avons d'ailleurs toujours émis des réserves sur la loi temporaire votée en 1975, puis revotée en 1979, car elle marginalisait et renvoyait à l'illégalité un certain nombre de femmes, ce qui créait une inégalité entre elles. Lorsque le professeur Nisand a été chargé d'établir son rapport, il a souhaité nous rencontrer, et nous avons pu ainsi participer à sa réflexion, notamment en ce qui concerne l'accueil des femmes, l'obligation de l'entretien social, la problématique des mineures et la situation des femmes étrangères. Par ailleurs, il a également pris en compte notre demande de dépénalisation de l'avortement - l'avortement étant toujours inscrit au code pénal. Il est important que le professeur Nisand nous ait entendues, car le discours de militantes féministes, parfois considérées comme extrémistes, n'est pas toujours bien perçu par la société française actuelle. Nous sommes donc satisfaites qu'il ait intégré cette demande de dépénalisation de l'avortement dans l'une des 25 propositions de son rapport. En 1992, nous avons été très déçues par le maintien de l'incrimination des IVG dans le nouveau code pénal. L'avortement n'est donc pas reconnu comme un droit à part entière, mais comme une possibilité, notamment quand une femme s'estime en détresse. Heureusement, Mme Neiertz a réussi à faire voter la suppression de l'article punissant l'auto-avortement ! L'avortement est un acte médical -cela été affirmé à l'Assemblée nationale en 1975-, et doit être reconnu comme tel. Il est vrai qu'il y a quelques années, nous avions revendiqué l'avortement libre et gratuit pouvant être effectué par des personnes autres que des médecins. Mais les choses ont évolué et, actuellement, nous disons que l'avortement est un acte médical, qu'il a contribué à l'amélioration de la santé des femmes, et qu'il doit être reconnu comme tel ; c'est tout de même le seul acte médical inscrit dans le code pénal ! Nous réfléchissons actuellement avec des juristes sur la dépénalisation de l'IVG. Cela est important pour le droit des femmes, pour leur santé également, car cet acte doit être accompli dans de bonnes conditions. Nous sommes satisfaites que le professeur Nisand l'ait bien compris et intégré dans son rapport. La problématique des mineures doit être traitée d'urgence. Il est inadmissible de renvoyer à l'illégalité une mineure et de l'obliger à prendre les papiers d'une amie ou à partir à l'étranger pour se faire avorter. Alors que l'on souhaite les intégrer dans la société, la loi les met à l'écart. Certaines mineures vivent dans des familles difficiles, elles sont marginalisées et la loi les renvoie encore plus à leurs difficultés. Il s'agit donc d'une véritable urgence, d'autant que les équipes médicales qui s'occupent des mineures s'essoufflent. Mme Fatima Lalem : Une mineure qui est en situation d'échec de contraception est plus pénalisée qu'une femme adulte qui peut, elle, accéder, dans les limites de la loi, à l'IVG. Alors que la sexualité des mineures est reconnue, puisqu'elles ont droit à la contraception de manière gratuite et anonyme, qu'elles ont la possibilité d'accoucher et d'assumer la naissance d'un enfant, ou même de l'abandonner -tout cela sans autorisation parentale-, on leur refuse le droit à l'IVG ; l'obligation de l'autorisation parentale a pour conséquence l'exclusion de certaines adolescentes du recours à l'IVG. Or actuellement, tout le monde met en avant les difficultés des grossesses adolescentes. Dans nos centres, nous constatons qu'un grand nombre de mineures sont face à cette difficulté et parfois à l'impossibilité d'en parler avec l'un des deux parents ; on pourrait donc envisager d'autres conditions à l'accompagnement familial, même si nous faisons tout notre possible pour trouver des espaces de médiation, trouver un autre adulte dans la famille -ou hors de la famille- qui pourrait éventuellement faire le lien avec les parents. Il n'en demeure pas moins que certaines mineures repartent en nous disant qu'elles vont réfléchir, continuent à cacher leur grossesse et se retrouvent dans les situations lamentables que nous connaissons tous. Mme Danielle Gaudry : S'agissant de l'entretien social obligatoire, nous nous posons des questions sur l'intérêt de cette obligation, un certain nombre de femmes, sûres de leur décision, ne venant que pour obtenir l'autorisation qui doit nécessairement se trouver dans le dossier médical du centre IVG. Que l'on propose un accompagnement aux femmes -et bien entendu aux mineures-, c'est bien. Que cet entretien soit obligatoire est un point sur lequel nous devons peut-être à nouveau réfléchir. Cela était sans doute nécessaire en 1975, mais 25 ans après, c'est peut-être à revoir. Certaines dispositions du rapport Nisand sont néanmoins discutables ; par exemple, une hypermédicalisation de tout ce qui gravite autour de l'avortement n'est pas forcément une bonne chose pour la responsabilisation des femmes et leur autonomie de décision. Le regroupement de l'accueil des femmes dans des centres hospitaliers et des unités de gynécologie obstétrique est une question sur laquelle nous devons réfléchir. Nous n'avons pas forcément de réponse, mais c'est un point qui doit être débattu. Où doit se situer la santé des femmes ? Uniquement dans les unités de gynécologie obstétrique des centres hospitaliers, ou doit-il y avoir des unités de proximité plus autonomes et plus à l'écoute des femmes ? C'est possible. Les CIVG ont fait la preuve de leur efficacité dans ce domaine, mais des unités plus légères sont peut-être nécessaires, notamment pour l'accueil de certaines femmes. Mme Fatima Lalem : Je voudrais aborder le problème de l'accès à l'IVG des femmes étrangères. L'obligation faite aux femmes étrangères d'avoir au moins trois mois de séjour en France pour pouvoir accéder à l'IVG correspondait au souci, à l'époque du vote de la loi, de lutter contre le "tourisme d'avortement". Les législations européennes ayant évolué dans ce domaine, en dehors de l'Irlande et de l'Allemagne, il me semble que cette crainte est devenue aujourd'hui obsolète. Les femmes étrangères actuellement en situation irrégulière peuvent accéder aux soins dans les hôpitaux, peuvent accoucher en France, mais, paradoxalement sont exclues de l'IVG ; cela nous semble tout à fait incohérent. Mme Danielle Gaudry : S'agissant des délais, nous ne comprenons pas pourquoi la France est en retrait par rapport aux autres pays européens - nous nous appuyons en effet beaucoup sur l'expérience internationale. Dans certains pays, les délais sont beaucoup plus avancés qu'en France, or l'ordre social n'en est pas pour autant troublé, et ce n'est pas dans ces pays-là que l'on compte le plus d'avortements. Les femmes bien informées s'alertent tôt lorsqu'elles ne désirent pas une grossesse. La grande majorité des femmes qui se retrouvent dans des délais avancés sont en réalité dans une situation de détresse catastrophique ; elles sont souvent dans des situations de rupture familiale. Bien entendu, nous prenons en compte les erreurs de diagnostics - elles existent -, ainsi que les dénis de grossesse. Il nous semble donc important que la France se dote d'un système dans lequel toute femme en demande d'avortement puisse être entendue. Nous ne voulons pas que l'on fasse n'importe quoi avec ces femmes ; elles doivent être davantage prises en considération que celles qui s'alertent tôt et qui connaissent les procédures à suivre. Le législateur devrait étudier les législations hollandaise, britannique et catalane à ce sujet, afin de voir comment l'on pourrait gérer ces demandes. Pour l'instant, on se contente de les renvoyer au planning familial en leur disant que nous allons trouver une solution ; c'est insupportable et d'une grande hypocrisie : autant trouver cette solution en France. Les médecins français ont les moyens techniques de pratiquer un avortement hors délai, puisqu'ils le font pour raison médicale. Quel délai souhaiterions-nous voir adopter ? Ce qui compte, pour nous, c'est le seuil de viabilité. Or ce seuil était fixé, voilà encore quelques années, par le code de la famille à 28 semaines après les dernières règles : avant, c'était un avortement, après, un accouchement. En 1993, M. Philippe Douste-Blazy, alors ministre délégué à la santé, s'alignant sur les recommandations de l'OMS, a ramené à 22 semaines le seuil de viabilité. Aujourd'hui, le problème est plus compliqué, car la notion de viabilité est laissée à l'appréciation du corps médical. Est-ce qu'il appartient au corps médical d'en juger ? Je ne sais pas. Mais pour l'instant, c'est la règle. Pour sa part, l'OMS définit les critères de viabilité soit à 22 semaines d'aménorrhée, soit par rapport au poids de naissance égal ou supérieur à 500 grammes. Imaginons le cas d'une interruption de grossesse spontanée à 24 semaines. La déclaration de naissance ne sera effectuée, en fait, que si le médecin juge que l'enfant était viable. Or une déclaration de naissance ouvre des droits pour la famille, notamment pour la femme, tels que le congé de maternité et les allocations. La notion de viabilité est actuellement extrêmement floue, elle évolue en fonction des progrès techniques de réanimation et de la définition que l'on en donne. Pour notre part, nous proposons que le délai coïncide avec le seuil de viabilité. Je terminerai mon propos en attirant votre attention sur le fait qu'en France on ne peut pas obtenir d'informations concernant l'avortement : l'article L. 647 du code de la santé publique parle de provocation à l'avortement. Vous me direz que la provocation et l'information sont deux choses différentes. Mais des personnes de notre association ont déjà fait l'objet de procès en 1986 et 1988, et une inculpation en cours concerne l'une de nos conseillères. Cet article est donc appliqué, et les personnes pouvant s'y référer sont diverses : le procureur -c'est actuellement le cas- ou des opposants à l'avortement, comme en 1988 l'association départementale de l'UDAF de Lyon. Il convient donc de faire la différence entre l'information et la propagande ; nos avocats en débattent, mais cet article, qui existe toujours, est utilisé. Or nous aimerions pouvoir, en France, parler librement de contraception, d'avortement et de sexualité sans que cela soit punissable. Les femmes ne peuvent assumer des choix importants touchant à leur vie et à leur santé que si elles possèdent tous les éléments d'information. Mme Martine Lignières-Cassou, présidente : Ma première question concerne la dépénalisation. Vous avez parlé de l'insertion de trois articles dans le nouveau code pénal en 1992. Pourriez-vous nous en dire plus à ce sujet, ainsi que sur la réflexion que vous menez avec l'aide de juristes ? En ce qui concerne les mineures, se pose à la fois le problème de l'accompagnement de la mineure et de sa responsabilité ; elles ont une majorité sexuelle à partir de 16 ans, elles ont le droit d'accoucher, d'abandonner leur enfant, mais ne peuvent pas avorter sans l'autorisation des parents. Avez-vous réfléchi, en termes juridiques, à la question de la responsabilité ? Dans son rapport, le professeur Nisand parle de la reconnaissance d'un droit propre, pour les adolescentes, à décider de l'IVG. Mme Danièle Bousquet : Je voudrais savoir quelle est la possibilité de saisir le juge des enfants, lorsqu'une mineure souhaite avorter et que ses parents ne lui en donnent pas l'autorisation ? Est-ce une pratique courante, et quels en sont les effets ? Mme Hélène Mignon : Votre association est implantée sur tout le territoire. Avez-vous des informations sur ce qui se passe dans les départements ? Savez-vous si, dans certains départements, l'on accepte de pratiquer un avortement chez une mineure qui n'a pas l'autorisation de ses parents, ou si, au contraire, cela est systématiquement refusé ? En ce qui concerne les femmes adultes n'avez-vous pas l'impression que, dans certains hôpitaux publics, on s'arrange pour ne pas intervenir dans les délais, et ensuite refuser de pratiquer l'avortement ? Mme Marie-Thérèse Boisseau : Le délai est aujourd'hui de 12 semaines d'aménorrhée. Vous avez d'abord parlé d'harmonisation européenne - 14 semaines -, puis vous êtes allées plus loin en proposant 22 semaines, seuil de viabilité reconnu par l'OMS. Les femmes qui dépassent les 12 semaines en France ne sont pas nombreuses ; si vous repoussez le délai à 14, voire à 22 semaines, il y aura toujours des femmes qui le dépasseront. Plutôt que de fixer un délai précis, ne serait-il pas plus intelligent de laisser, au-delà de 12 semaines, la décision à l'appréciation médicale ? On pourrait réfléchir à une formule juridique qui, à la fois couvrirait le corps médical et lui laisserait l'appréciation d'agir au cas par cas. Mme Danièle Bousquet : Il existe une réelle difficulté à trouver des médecins voulant bien pratiquer des avortements ; nombreux sont ceux, en effet, qui font jouer la clause de conscience, dont on peut se demander si elle a des raisons d'exister, s'agissant d'un acte médical. N'existe-t-il pas un risque réel de voir diminuer le nombre de médecins pratiquant des IVG, si le délai est prolongé ? Mme Danielle Gaudry : En ce qui concerne les trois articles qui ont été introduits dans le nouveau code pénal et notre demande de dépénalisation, je vous ferai, après la lecture des articles, le résumé de nos travaux en cours. Actuellement, les articles du code pénal sont ainsi rédigés : "Article 223-10- L'interruption de la grossesse sans le consentement de l'intéressée est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende." "Article 223-11- L'interruption de la grossesse d'autrui est punie de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende lorsqu'elle est pratiquée, en connaissance de cause, dans l'une des circonstances suivantes : 1°) Après l'expiration du délai dans lequel elle est autorisée par la loi, sauf si elle est pratiquée pour un motif thérapeutique ; 2°) Par une personne n'ayant pas la qualité de médecin ; 3°) Dans un lieu autre qu'un établissement d'hospitalisation public ou qu'un établissement d'hospitalisation privé satisfaisant aux conditions prévues par la loi. Cette infraction et punie de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende si le coupable la pratique habituellement. La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines." "Article 223-12- Le fait de fournir à la femme les moyens matériels de pratiquer une interruption de grossesse sur elle-même est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende. Ces peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 F d'amende si l'infraction est commise de manière habituelle." Nous souhaitons le retrait des articles 223-10, 223-11 et 223-12 du code pénal ; et ce n'est pas parce que ces articles n'existeront plus qu'il y aura un vide juridique, l'avortement étant inscrit dans le code de la santé publique. Nous proposons que les dispositions concernant la pratique par des médecins d'avortements en dehors du cadre de la loi soient inscrites dans le code de déontologie, puisqu'une mauvaise pratique médicale peut être sanctionnée par le conseil de l'ordre. En ce qui concerne les dispositions relatives aux non médecins qui pratiqueraient un avortement ou feraient pression pour qu'une femme avorte, nous proposons qu'ils soient poursuivis pour exercice illégal de la médecine et que l'on fasse une différence entre le délit d'habitude -s'il s'agit d'un acte répété- et le délit instantané. En ce qui concerne la personne qui ferait pression pour qu'une femme se fasse avorter, elle pourrait être poursuivie pour "violences volontaires commises sur autrui". Mme Marie-Thérèse Boisseau : L'exercice illégal de la médecine est bien entendu répréhensible. Outre la pratique illégale d'un avortement, qui se trouve dans le code pénal, ou figurent les articles concernant l'exercice illégal d'autres actes médicaux ? Mme Danielle Gaudry : Dans le code de la santé publique. L'avortement est le seul acte médical qui soit inscrit dans le code pénal. Mme Martine Lignières-Cassou, présidente : La pilule du lendemain est-elle considérée comme un moyen de contraception ou un moyen d'avorter ? Mme Danielle Gaudry : Il s'agit d'un moyen de contraception puisqu'elle n'empêchera pas une grossesse qui a déjà débuté. Elle permet simplement d'éviter qu'une grossesse ne débute. Mme Martine Lignières-Cassou, présidente : Si l'on développe les techniques abortives sans prescription médicale, n'allons-nous pas au-devant d'incriminations par les articles qui sont aujourd'hui dans le code pénal et demain, peut-être, dans le code de la santé ou le code de déontologie ? Mme Danielle Gaudry : Je ne pense pas qu'en France nous soyons prêts à mettre des produits abortifs en vente libre. La pilule du lendemain entre dans le champ de la contraception et non pas de l'avortement. Certains députés ont fait référence à une partie de la loi Neuwirth stipulant que tous les contraceptifs hormonaux doivent être délivrés sur ordonnance pour contester la mise en vente libre en pharmacie. Mme Fatima Lalem : En ce qui concerne les mineures, la question aujourd'hui est non pas celle de l'accompagnement, mais de l'obligation d'une autorisation parentale. La loi n'impose pas la présence physique du parent, mais dans de nombreux centres, les pratiques vont au-delà de la loi en exigeant cette présence physique. A la question de savoir si, dans certains départements de France, il y a une souplesse dans l'accueil des mineures, je vous répondrai, même s'il est difficile d'avoir une appréciation globale, que, au contraire, il y a un raidissement très important, puisque certaines structures réclament la présence physique d'un des deux parents. Mme Marie-Thérèse Boisseau : Mais une mineure peut présenter une fausse autorisation. Mme Fatima Lalem : La loi prévoit une autorisation écrite des parents. Certains responsables peuvent demander, par exemple, un double de la carte d'identité, mais ils ne peuvent pas obliger les parents à être présents physiquement. Mme Martine Lignières-Cassou, présidente : Si la mineure présente un faux, les équipes médicales, fragilisées, peuvent être mises en causes. Mme Danielle Bousquet : Dans le passé, des conseillères du planning familial qui avaient accepté de signer, ont parfois été mises en cause à titre personnel. Mme Marie-Thérèse Boisseau : Dans le cas d'une mineure qui rédige elle-même une fausse autorisation, que se passe-t-il ? Mme Fatima Lalem : Personne ne pourra vérifier. Mais lorsque les mineures se présentent dans nos structures, nous leur opposons les termes de la loi qui, parfois, les font fuir. Actuellement, s'agissant de la vérification administrative, les structures vont le plus loin possible, et nous n'avons pas l'impression que les stratégies de contournement fonctionnent. Un grand nombre de grossesses d'adolescentes s'expliquent par l'impossibilité d'obtenir cette autorisation d'avorter. Mme Danielle Gaudry : N'oublions pas que l'administration hospitalière exige la carte de sécurité sociale des parents. Mme Fatima Lalem : En ce qui concerne le juge des enfants, en pratique, dans les situations de grande difficulté, de violence, de danger pour la mineure, le juge peut être saisi. Mais quelle que soit la situation, le juge entendra les parents. Mme Martine Lignières-Cassou, présidente : Dans le rapport Nisand, une juge pour enfant expliquait qu'elle n'était pas favorable à ce que l'autorité du juge puisse se substituer à l'autorité parentale. Mme Marie-Thérèse Boisseau : La voie est étroite : faut-il ou non exiger l'autorisation parentale ? Dans certains cas, le dialogue va permettre à une famille de rétablir des rapports familiaux sains. Mme Martine Lignières-Cassou, présidente : Cela dépend des familles. Je pense aux familles de la deuxième génération d'immigrés chez qui le poids de la culture est très fort. Il est hors de question, pour les jeunes filles issues de ces familles, de demander l'autorisation d'avorter. Mme Danielle Gaudry : Si notre démarche est de rappeler systématiquement la loi aux mineures, c'est justement pour leur souligner ce qu'elles doivent faire et non pas pour entretenir la mauvaise relation qu'elles peuvent avoir avec leur famille. Bien entendu, on ne va pas au planning familial quand tout va bien ; la population que nous recevons n'est donc pas la plus favorisée en termes de relation familiale. Il est certain que pour certaines, le fait de parler, de renouer le dialogue avec les parents sera extrêmement bénéfique ; mais celles qui ne peuvent pas demander cette autorisation sont renvoyées à une grande solitude qui les poussent parfois à présenter de faux papiers. Mme Fatima Lalem : Bien entendu, certaines situations se débloquent très bien. Malheureusement, de nombreuses femmes sont renvoyées à elles-mêmes ; or nous considérons qu'aujourd'hui les droits des femmes ne doivent pas exclure une partie des femmes. Le droit de choisir doit être égal pour toutes. Pendant 25 ans, nous avons essayé de faire au mieux avec la loi, en prenant parfois le risque d'informer les femmes sur les possibilités d'avorter à l'étranger. Aujourd'hui, nous souhaitons que l'on pose à nouveau la question d'un droit égal et d'un accès égal à l'information, notamment avant qu'il y ait grossesse. A cet égard, la prévention a elle aussi besoin d'être revue et réaffirmée pour permettre à toutes les femmes d'avoir accès à la contraception. Ce sont toujours les mêmes catégories qui sont les plus défavorisées : les mineures et les femmes en grande difficulté. Mme Martine Lignières-Cassou, présidente : En ce qui concerne les mineures, comment leur permettre d'exercer un droit propre, tout en le conciliant avec la responsabilité parentale ? Mme Chantal Robin-Rodrigo : A partir du moment où les mineures de plus de 16 ans ont le droit d'accoucher, d'abandonner leur enfant, je trouverais tout à fait légitime qu'elles aient, de la même façon, le droit d'avorter ! Mme Danielle Gaudry : Nous avons mené une réflexion sur la sexualité des mineures, en excluant le rapport forcé. Le choix pour les mineures d'avoir une sexualité doit correspondre à une démarche de responsabilité. Cela dit, doit-on faire reposer sur leurs épaules toute cette responsabilité ? Nous, nous disons "oui", mais avec un accompagnement par quelqu'un de leur choix ; ce choix peut même se traduire, par exemple, par la mère de leur petit ami. Mme Fatima Lalem : L'âge du premier rapport sexuel a baissé, puisque 38 % des femmes ont leur premier rapport entre 14 et 17 ans, contre 29 % de garçons. Mme Danielle Gaudry : En ce qui concerne les délais, la moyenne est de 14 semaines en Europe ; la Hollande, l'Espagne et la Grande-Bretagne, ont, quant à elles, voté en faveur d'un délai de 22 semaines. En France, environ 5.000 femmes par an dépassent le délai des 12 semaines et vont se faire avorter à l'étranger, notamment en Hollande et en Espagne. Quant à la proposition de Mme Boisseau de laisser le médecin apprécier si l'avortement peut encore être pratiqué ou non, c'est laisser la femme face au pouvoir du médecin. Or le pouvoir du médecin existe et peut être critiqué ; tout dépend comment il est exercé. Par ailleurs, un certain nombre de médecins feront jouer la clause de conscience, que la femme se présente le lendemain de la fécondation ou à 22 semaines d'aménorrhée - voire même au-delà pour les avortements thérapeutiques. L'idéologie de chaque médecin va jouer dans son appréciation de la situation. Que l'on agisse au cas par cas, dans une structure particulière composée d'une équipe pluridisciplinaire qui prendrait la femme dans sa globalité, me paraît être une idée intéressante. Mais laisser un médecin seul face à une femme seule ne serait pas, à mon avis, une bonne solution. Autre question : y aura-t-il toujours des médecins pour pratiquer les avortements ? Une expérimentation a été réalisée, il y a quelque temps, avec l'accord de la DASS de Grenoble, sur des IVG pratiqués entre 12 à 16 semaines d'aménorrhée. Mais elle a été arrêtée à la demande de M. Bernard Kouchner. Actuellement, six centres IVG ou établissements de santé, publics ou privés à mission publique, se sont portés volontaires comme centres expérimentaux pour pratiquer des IVG au-delà des 12 semaines d'aménorrhée, dans le but d'éclaircir les conditions dans lesquelles les femmes pourraient trouver des solutions appropriées à leur demande. Il y a donc bien des équipes volontaires. Le rapport Nisand préconise la création de structures régionales pour les patientes qui dépassent le délai légal. Pourquoi pas ! Il s'agit peut-être là d'une solution raisonnable. Mme Fatima Lalem : En ce qui concerne la question relative à l'attitude d'un certain nombre d'hôpitaux publics, des propositions ont été faites par Mme Martine Aubry pour répondre aux difficultés que nous dénonçons depuis plusieurs années et qui se sont aggravées. On constate en effet, à Paris notamment, un désinvestissement du secteur public dans l'accueil des femmes en demande d'IVG. Un certain nombre de structures arrêtent de donner des rendez-vous à partir de 8 semaines de grossesse et les discours tenus sont très culpabilisants. La pratique de l'avortement est une fonction très peu valorisante dans un certain environnement et beaucoup de jeunes médecins s'en désintéressent. Ce sont en fait des médecins plus âgés, qui ont participé aux grands moments de la lutte sociale, qui continuent à assurer, pour l'essentiel, l'accueil de ces femmes. Ajoutons à cela que les structures d'IVG ferment pendant l'été. C'est donc le secteur privé qui répond aujourd'hui à la majorité des demandes des femmes. Mme Danièle Bousquet : Au-delà du fait que cette pratique ne soit pas valorisée, ne pensez-vous pas qu'une rémunération correcte des demi-journées de vacation, actuellement rémunérées à 220 F, pourrait être une motivation pour les jeunes médecins ? Mme Danièle Gaudry : Le prix de la vacation hospitalière, que ce soit pour les IVG ou pour autre chose, est absolument scandaleux ! Le prix du forfait IVG n'a pas bougé depuis 1991 ! Dans certains centres, les médecins peuvent être payés à l'acte. M. Nisand propose que l'IVG soit inclue dans la charge hospitalière, c'est-à-dire non pas sous forme de vacation, mais comme faisant partie du salaire. Puisque nous en sommes aux questions financières, je peux vous indiquer le salaire que perçoit ma remplaçante régulière, assistante à l'hôpital de Chartres : elle touche 13 500 F nets, pour un plein temps en dehors des gardes de nuit et elle est en fin d'assistanat ! Audition du Professeur Michèle Uzan, chef du service de gynécologie-obstétriquede l'hôpital Jean Verdier de Bondy Réunion du mardi 25 avril 2000 Présidence de Mme Martine Lignières-Cassou, présidente Mme Martine Lignières-Cassou, présidente : Mes chers collègues, nous avons le plaisir de recevoir le professeur Michèle Uzan, auteur d'un rapport sur la prévention et la prise en charge des grossesses des adolescentes. Madame le professeur, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes d'autant plus intéressés par vos travaux que la santé des femmes a été choisie cette année comme thème du rapport annuel de notre Délégation. Mme Michèle Uzan : Madame la présidente, mesdames, messieurs les députés, je vous remercie de m'avoir conviée à la présentation du rapport que j'ai remis en avril 1998 au professeur Joël Ménard, alors directeur général de la santé, sur la prévention et la prise en charge des grossesses des adolescentes. L'idée était de dresser un bilan de l'activité du service de gynécologie-obstétrique que je dirige à l'Hôpital Jean Verdier en Seine-Saint-Denis et de faire des propositions dont pourrait s'inspirer une politique de santé publique. Ayant pris la direction de ce service en septembre 1994, j'ai donc présenté un bilan d'activité sur quatre ans. Pour ce faire, j'ai auditionné trente-quatre acteurs de santé : médecins gynécologues-accoucheurs, sages femmes, conseillères conjugales, infirmières - hospitalières et scolaires -, psychologues, assistantes sociales, personnels des centres de planning, experts des urgences médico-judiciaires, institutrices et responsables de maisons maternelles. Dans le département de Seine-Saint-Denis, où vivent 1,4 million d'habitants, l'on compte environ 22 000 naissances par an. La natalité y est donc très forte (2,1 à 2,2 %), la population étant jeune et immigrée. Cependant, les résultats d'une enquête menée pendant huit jours sur les patientes venant consulter dans mon service ont démontré que plus de 52 % de cette population répondaient au moins à un critère de précarité. Le taux d'immigrés dans la population est élevé, puisque l'on compte cinquante-six nationalités. La presse nous a d'ailleurs baptisés "la maternité des sans-papiers". 93 % des patientes qui viennent accoucher à l'hôpital Jean Verdier sont domiciliées dans le département. Cet hôpital qui fait partie de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris est un petit hôpital à visage humain, comptant 360 lits, dont l'activité du pôle "mère-enfant", très forte, représente 60 % de l'activité globale de tout l'hôpital. Ce pôle comprend un service d'assistance médicale à la procréation, un service de gynécologie-obstétrique, un planning que je dirige, un service de pédiatrie, qui va de la néonatalogie jusqu'à l'unité d'adolescents, et, enfin, un service d'urgence médico-judiciaire. Je suis fière d'être la seule femme en France chef de service d'un centre hospitalier universitaire en gynécologie-obstétrique. Je suis particulièrement sensible aux problèmes de violences et de grossesses d'adolescentes : j'avais déjà créé, à l'hôpital Cochin, en 1984, une unité d'accueil aux femmes victimes de violences sexuelles. S'agissant de mon rapport sur les grossesses des adolescentes, j'ai centré mon étude sur le problème des grossesses des mineures, c'est-à-dire des adolescentes entre 12 et 18 ans. Nous savons que plus la grossesse survient à un âge précoce, plus elle court le risque d'être interrompue. A l'âge de 12 ans, plus de 80 % des grossesses évoluent vers une interruption de grossesse, alors qu'à 18 ans, seulement 20 à 25 % de celles-ci évoluent vers une IVG - chiffre comparable à celui de la population adulte. En moyenne, une grossesse adolescente sur deux va donc aboutir à une interruption volontaire de grossesse. Parmi les 5 millions d'IVG pratiquées par an dans le monde, 10 % sont effectuées chez les adolescentes ; en France, 3 % des IVG, et en Seine-Saint-Denis, 5 % des IVG, sont effectuées sur des mineures. Pour 12 % de ces adolescentes - mineures -, il s'agit de récidive - répétitions d'IVG - ; pour 4 % d'entre elles, l'IVG est consécutive à des violences sexuelles, et 50 % d'entre elles ne sont déjà plus scolarisées. Je rappelle que dans mon département, les trois quarts des IVG sont demandées par des Françaises métropolitaines et des DOM TOM, alors qu'un quart des demandes concerne la population immigrée. Quelle est l'évolution des grossesses chez les adolescentes ? Ce peut être une interruption volontaire de grossesse, une interruption médicale de grossesse s'il y a un contexte de violence ou de grande difficulté psychologique, ou la poursuite de cette grossesse : les grossesses d'adolescentes représentent 2 % de l'ensemble des naissances ; elles concernent un quart de Françaises métropolitaines ou des DOM TOM et trois-quarts d'immigrées. La sexualité des adolescentes est irrégulière et imprévue : 50 à 60 % des premiers rapports ont lieu sans contraception ; 70 % des adolescentes n'ont aucune contraception dans les trois mois qui précèdent une interruption volontaire de grossesse, et 20 % ont une contraception aléatoire qui va de la pilule oubliée jusqu'au préservatif laissé dans la poche. Les rapports sont souvent plus consentis que souhaités, parfois dans un climat de violence. Le professeur Garnier, chef de service des urgences médico-judiciaires à l'hôpital Jean Verdier, a relevé que les déclarations de sévices sur mineures ont été multipliées par douze et que les déclarations de violences sexuelles l'ont été par trois, depuis huit ans - de 1990 à 1998. Cela ne veut pas forcément dire qu'il y en a eu douze fois plus ou trois fois plus, mais, peut-être, qu'elles ont été déclarées plus souvent. L'enseignement de la sexualité est encore trop négligé en milieu scolaire et se heurte souvent à une double réticence : celle des enseignants et celle des parents. La campagne de 1992 sur le préservatif et le sida s'est focalisée sur le préservatif au détriment, me semble-t-il, de la contraception. La prise en charge des grossesses - et l'accouchement des adolescentes - doit être pluridisciplinaire, la prise en charge médicale étant un épiphénomène. Cette prise en charge est tout d'abord sociale, les déclarations étant souvent tardives ou les grossesses n'étant pas suivies du tout : plus de 60 % de ces grossesses évoluent dans un déni complet de cet enfant à venir. A ces grossesses sont associées des conduites additives - tabac, alcool et drogue - ; la précarité est importante, 25 % seulement des jeunes futures mamans sont scolarisées et 60 % sont célibataires. Un suivi psychologique est ensuite nécessaire. Il y en effet trois profils de grossesses. Premièrement, la grossesse culturelle, qui va survenir chez les jeunes gitanes ou chez les noires africaines, chez lesquelles la grossesse est voulue, espérée par un jeune couple et par la famille. Cette grossesse est souvent suivie dès le début et ne pose pratiquement aucun problème. Deuxièmement, les grossesses "misérables" qui surviennent chez des adolescentes que rien ne gratifie dans leur entourage, ni la scolarité ni le milieu familial. Cette grossesse va leur donner un statut environnemental et social, avec la prime de parent isolé et l'allocation jeune enfant. Troisièmement, les grossesses violentes qui concernent des adolescentes en colère, contre elles-mêmes et contre la société. Il y a chez ces adolescentes un désir de grossesse pour entrer dans le clan, pour se faire mal. En réalité, il s'agit d'un appel au secours, et cette grossesse est l'équivalent, chez certaines adolescentes, de la tentative de suicide. Elles vont alors se précipiter au centre de planning, car si elles voulaient être enceintes, elles ne souhaitent pas cet enfant. Enfin, il faut un suivi médical parce que nombre d'accouchements prématurés sont la conséquence d'un suivi tardif. Des progrès ont été réalisés en obstétrique ces trente dernières années sur la prématurité et le suivi précoce de la grossesse ; toute femme déclarant sa grossesse tardivement ou ne la faisant pas suivre du tout risque d'accoucher d'un prématuré. Un certain nombre de retards de croissance intra-utérins sont liés aux conduites additives et à la malnutrition de ces adolescentes. En outre, la maltraitance et les infanticides sont beaucoup plus élevés au cours de la première année de l'enfant. Nous avons donc une action à mener pour éviter la plupart des grossesses des adolescentes. Voici maintenant les propositions qui ont été faites à l'issue de ce rapport ; elles émanent non seulement du bilan que j'ai fait, mais également des trente-quatre personnes que j'ai auditionnées. Première proposition : la délivrance médicalisée de la contraception d'urgence. Cette proposition a été suivie d'effets rapidement, puisque j'ai remis mon rapport en avril 1998 et que la mise sur le marché de cette contraception a eu lieu en janvier 1999 pour le Tétragynon, et en mai 1999 pour le Norlévo ; à la nuance près que le Norlévo est en vente libre en pharmacie, alors que j'en avais proposé une délivrance médicalisée. Deuxième proposition : une campagne d'information en matière de contraception impliquant de nombreux partenaires de manière à multiplier les passerelles : infirmières scolaires, assistantes sociales, médecins généralistes, pédiatres et enseignants. Il serait également utile que la formation des futurs enseignants comporte une partie concernant la contraception. Il faudrait aussi créer des réseaux d'information et mettre en place un maillage autour des centres de planning où la contraception est délivrée gratuitement aux mineures. Mes propositions mettaient l'accent sur le problème des infirmières scolaires, sur l'apprentissage de la contraception et sur la contraception d'urgence. Comme vous le savez, Mme Ségolène Royal, alors ministre déléguée à l'enseignement scolaire, a mis en route un programme d'éducation à la sexualité et a permis aux infirmières des collèges de délivrer, de façon non répétitive et dans la grande urgence, la contraception dite du lendemain. Troisième proposition : organisation d'un programme à la vie et à la sexualité dans les collèges. Il s'agit d'un programme sur lequel j'ai travaillé avec Mme Ségolène Royal, fondé essentiellement sur des attitudes préventives, telles que l'hygiène corporelle et bucco-dentaire, les vaccinations, le lavage des mains, la prévention des accidents ménagers et des anomalies du comportement alimentaire - boulimie, anorexie -, les conduites additives - tabac, alcool, drogue -, les maladies sexuellement transmissibles, dont le sida, et les grossesses non souhaitées. Ce programme devait voir le jour à la rentrée prochaine. Quatrième proposition : les urgences de gynécologie obstétrique et les services d'accueil des urgences doivent être habilités (et approvisionnés) à délivrer la contraception d'urgence de façon anonyme et gratuite aux mineures et doivent fournir une première information sur la contraception et les maladies sexuellement transmissibles. En effet, la contraception est délivrée par les centres de planning mais ceux-ci ne sont ouverts que du lundi au vendredi de 9 heures à 17 heures ; or, en dehors de ces jours et de ces horaires, la contraception d'urgence peut être nécessaire. Cette proposition est en cours de réalisation dans les services de l'AP-HP. Tous les chefs de service vont donc recevoir un budget leur permettant de se procurer une contraception d'urgence. Par ailleurs, nous formons tous les jeunes médecins à délivrer, pendant leurs gardes, au moment où les centres de planning sont fermés, à la fois la contraception d'urgence et une information sur la contraception et les maladies sexuellement transmissibles. Cinquième proposition : dans les cas où l'accord parental est impossible à obtenir - ce qui est souvent le cas en Seine-Saint-Denis -, que les parents soient à l'étranger, décédés ou déchus de leurs droits, les juges des enfants doivent donner l'autorisation de réaliser les IVG. Pour en avoir fait souvent l'expérience, les juges des enfants ont beaucoup de réticences - et souvent plus les femmes que les hommes - à se mettre à la place des parents et à donner cette autorisation. J'ai également évoqué - pour certains cas précis et à partir de 16 ans - la notion de majorité sanitaire. L'idée est venue des médecins des urgences médico-judiciaires et des pédiatres qui travaillent dans mon environnement et concernerait les grandes adolescentes de plus de 16 ans. Cette majorité sanitaire pourrait être accordée, par exemple, quand le lien parental est complètement rompu, que les parents ne sont pas joignables ou que l'adolescente a déjà un enfant ou a déjà subi deux autres IVG. En revanche, en deçà de 16 ans, l'autorisation parentale nous a toujours paru souhaitable pour renouer le lien parental et impliquer les parents dans l'acte éducatif et l'accompagnement des adolescentes. C'est également dans cette catégorie d'adolescentes - les moins de 16 ans - que nous avons relevé le plus de violences intrafamiliales et d'abus sexuels. Lorsqu'un père téléphone pour prendre un rendez-vous pour que sa fille puisse subir une IVG, en donnant la date des dernières règles, il s'agit d'un signe de violence intrafamiliale et il convient alors de rencontrer ce père. En outre, des signalements au juge des enfants sont parfois nécessaires. Nous sommes donc attachés à la conservation de cette autorisation parentale, au moins pour les "petites mineures". Lorsque la grossesse est le résultat d'un viol, l'interruption médicale de grossesse, pour des raisons évidentes de détresse psychologique, est souvent retenue. Seul un psychiatre est habilité à donner cette autorisation. Or il nous semble qu'un assouplissement des règles d'obtention serait nécessaire. Le médecin des urgences médico-judiciaires - non psychiatre - qui a effectué la constatation du viol pourrait lui-même être habilité à donner l'autorisation de l'interruption médicale de grossesse. Dans ces cas particulièrement douloureux, l'exception législative circonstanciée et aménagée au principe de l'autorité parentale pourrait permettre aux mineures la confidentialité de cet acte thérapeutique, de la même façon que cette confidentialité peut être obtenue quand des mineures sont séropositives. Sixième proposition : lorsque la grossesse est poursuivie, la plus grande attention doit être portée à ces futures jeunes mamans pour les aider à poursuivre ou reprendre un projet professionnel, grâce à un quota de places d'accueil dans les maisons maternelles. Cette proposition a pour objet de rompre l'isolement des adolescentes enceintes en évitant la déscolarisation pendant la grossesse et après l'accouchement, et en facilitant le retour au collège. Il s'agit de définir une politique de priorité dans les crèches. Nous avons constaté des abus de certains enseignants qui relèguent ces élèves au fond de la classe comme étant le mauvais exemple, alors que certaines jeunes filles ont souhaité cette grossesse, ou en tout cas ont décidé de la poursuivre. Septième proposition : la mise en place d'un registre national des violences, des sévices sexuels et des grossesses survenant chez les mineures. Il s'agit d'un problème important pour la santé des mères et des enfants. En outre il serait intéressant de créer une commission ad hoc qui analyserait l'impact des mesures que je viens de vous rappeler. En conclusion, sachez que ce rapport m'a valu 12 000 lettres d'injures et des menaces de mort de la part d'individus qui refusent de voir la réalité. L'AP-HP a porté plainte pour moi. Quelles sont les actions de prévention qui sont à mener d'urgence ? La première est sans aucun doute la contraception d'urgence - que nous avons déjà acquise -, la seconde étant, s'agissant des adolescentes qui ont souhaité leur grossesse ou qui la poursuivent, de lutter contre les risques de la maltraitance du nouveau-né. Enfin, il convient d'éviter au maximum les IVG chez les adolescentes, par une information scolaire sur l'éducation sexuelle et sur la contraception. Mme Martine Lignières-Cassou, présidente : Plusieurs éléments de votre rapport me surprennent, en particulier la montée de la violence. Il est possible que les dénonciations soient plus nombreuses qu'il y a dix ans, mais lorsque vous dites que le nombre de viols a été multiplié par trois et le nombre de sévices par douze, ces chiffres me paraissent effrayants. Le rapport annuel de la Délégation aux droits des femmes portera cette année sur la santé des femmes, et notamment sur l'IVG. Nous souhaitons élaborer des propositions afin de modifier la législation relative à l'IVG sur quatre points : les étrangères résidant depuis moins de trois mois en France, les mineures, la dépénalisation et les délais. Nous allons nous concentrer essentiellement sur le problème des mineures, mais nous serions aussi intéressés à connaître votre point de vue concernant les femmes étrangères. S'agissant des mineures, pourriez-vous nous parler des deux médicaments relatifs à la contraception, le Tétragynon et le Norlévo, car j'ai l'impression qu'une campagne de dénigrement est en train de se mettre en place ; j'ai en effet reçu plusieurs mails m'indiquant que la prise de Norlévo comportait des risques. Où en est-on de la mise en place de la contraception d'urgence dans les collèges et les lycées depuis l'annonce qui en a été faite par Mme Ségolène Royal ? Pouvez-vous déjà mesurer les effets de la campagne pour la contraception qui a commencé en janvier dernier ? En ce qui concerne le programme à la vie et à la sexualité que vous préconisez de mettre en place dans les collèges et les lycées, j'ai le sentiment que la sexualité est prise sous l'angle non pas du plaisir mais des risques ; les jeunes sont ainsi éduqués pour affronter les risques de leur sexualité. Pourquoi ce choix ? S'agissant de l'autorisation parentale pour les mineures, vous semblez très attachée à cette autorisation, en tous cas pour les moins de 16 ans, même lorsque les grossesses résultent d'un inceste ; quel est le rôle du père dans cette situation ? Je me demande s'il s'agit vraiment d'une façon de mettre l'adulte en cause devant ses responsabilités. Autre point sensible : on connaît tous les réticences des juges des enfants à accorder l'autorisation de pratiquer une IVG ; est-ce réellement la meilleure autorité de substitution ? Enfin, je ne suis pas choquée par l'idée d'une majorité sanitaire pour les plus de 16 ans, puisque ces jeunes filles sont déjà autorisées à accomplir un certain nombre d'actes sans autorisation parentale - contraception, accouchement sous X, etc. Mme Marie-Thérèse Boisseau : Vous nous avez dit que 50 % des adolescentes enceintes pratiquaient une IVG ; que deviennent les autres, celles qui poursuivent leur grossesse ? Vous avez évoqué également le sujet de la maltraitance et de l'infanticide chez les adolescentes qui accouchent, avez-vous un pourcentage à nous citer ? S'agissant du Norlévo, pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous étiez favorable à sa délivrance médicalisée ? Le programme à la vie et à la sexualité prévu pour être présenté au collège doit-il vraiment l'être à ce niveau-là ? Personnellement, j'ai tendance à penser que c'est un peu tard, et que l'on devrait en parler avant. Vous avez par ailleurs insisté sur le rôle de l'Éducation nationale ; personnellement, je suis très réticente à ce sujet. Il me semble que l'éducation sexuelle, l'éducation à la vie, n'est ni du ressort de l'Éducation nationale, ni du ressort des parents, mais de celui d'équipes spécialisées. Enfin, j'ai bien noté que vous étiez catégorique s'agissant de l'autorisation parentale pour les mineures de moins de 16 ans. Or j'ai eu connaissance d'un certain nombre de cas pour lesquels il était hors de question de demander cet accord, car cela aurait déclenché un drame. Mme Raymonde Le Texier : Vous nous avez dit que 52 % des adolescentes enceintes répondaient à des critères de précarité. Mme Michèle Uzan : Non, je ne parlais pas uniquement des mineures. Nous avons mené une enquête - pendant huit jours - sur toutes les personnes qui venaient consulter dans mon service ; or une sur deux répondait au moins à un critère de précarité. Mme Raymonde Le Texier : Ma question n'a donc plus d'objet ; en fait, je me demandais si seules les jeunes filles issues de milieux défavorisés se retrouvaient face à une grossesse non désirée. Mme Michèle Uzan : Absolument pas, il y en a autant dans le 16e arrondissement de Paris et à Passy ! M. Patrick Delnatte : Les statistiques auxquelles vous faites référence sont-elles nationales ou propres à votre établissement ? Mme Michèle Uzan : Elles sont propres à mon établissement et issues du bilan d'activité réalisé sur quatre ans, de 1994 à 1998. M. Patrick Delnatte : Il s'agit d'un département "typé", si je puis m'exprimer ainsi, les problèmes sociaux y étant très importants. Il serait donc intéressant de connaître les statistiques nationales afin d'avoir une approche qui colle mieux à la réalité française. Mme Michèle Uzan : C'est l'objet de ma septième proposition. M. Patrick Delnatte : Quelles seraient les conséquences cliniques d'une augmentation des délais de l'IVG de deux semaines ? S'agissant de l'autorisation parentale, je suis frappé par les propos que tiennent les responsables de planning ou d'associations qui désirent, tout comme vous, maintenir cette autorisation et ne pas éliminer les parents. Avez-vous des formules de médiation à nous proposer lorsque cette autorisation ne peut absolument pas être obtenue ? Mme Michèle Uzan : S'agissant de la question des femmes étrangères, je vous ai dit, madame la présidente, qu'elles n'avaient recours à l'IVG que pour un quart d'entre elles, et qu'en général elles venaient nous consulter tout à fait dans les temps. Je vous parle là des adultes comme des adolescentes. Le nombre d'IVG est très important en France, et j'éprouve une grande difficulté à engager, et à maintenir actifs dans mon service, des médecins pratiquant les IVG. En effet, on ne peut pas pratiquer des IVG à vie ; il est indispensable de diversifier l'activité des médecins. Je suis donc très attentive au fait que, dans mon service, les médecins ne fassent pas seulement des IVG, mais qu'ils aient d'autres activités - de consultation, de contraception, de suivi de grossesse. Il ne me paraît pas souhaitable d'augmenter le nombre d'IVG en donnant la possibilité aux étrangères de passage de la pratiquer en France. Mme Martine Lignières-Cassou, présidente : Ce n'est pas exactement ce que j'ai voulu dire. Lorsqu'on discute avec les mouvements associatifs, deux types de catégories d'étrangères qui ont moins de trois mois de résidence apparaissent, sans oublier le problème, l'an dernier, des femmes kosovares. Mme Michèle Uzan : Pour les femmes kosovares, il s'agissait d'une situation d'exception. En France, les centres d'IVG sont pleins. Et il me paraît difficile - même si c'est toujours possible - d'obtenir plus de personnels et de crédits pour pratiquer les IVG, d'autant qu'il ne s'agit pas de la mission première d'un service de gynécologie-obstétrique. Il y a un seuil à ne pas dépasser dans un service qui forme les étudiants et qui a une activité de gynécologie-obstétrique. Ce ne seront donc pas les services hospitaliers qui accepteront d'en faire plus ; j'en parle librement puisque mon service est le troisième de l'AP-HP quant au nombre d'IVG pratiquées - entre 800 et 900 par an -, ce qui est très difficile pour les médecins qui s'en occupent. C'est la raison pour laquelle je souhaite qu'ils fassent également de l'éducation, de la prévention, du dépistage des maladies sexuellement transmissibles et des vaccinations, c'est-à-dire qu'ils aient une activité globale. Et je crains que l'afflux d'étrangères - et donc un accroissement d'IVG - ne nous empêche de bien pratiquer cette activité globale. Cela m'amène à la question de l'augmentation éventuelle du délai de deux semaines. Selon de nombreuses études, les femmes désirant pratiquer une IVG viennent nous consulter très tôt, avant sept semaines d'aménorrhée, et bénéficient en général d'une IVG médicamenteuse. Si l'on augmente les délais de l'IVG, je pense, malheureusement, que nous aurons toujours les mêmes retardataires qui se présenteront à quinze, seize, voire dix-huit semaines. Si ce délai est légalement augmenté, je respecterai la loi, mais il convient de savoir que, techniquement, l'acte est beaucoup plus difficile. Nous retrouverons alors les complications que j'ai connues lorsque j'étais jeune interne des hôpitaux, c'est-à-dire les plaies du col, les difficultés pour les curetages, des accouchements prématurés pour les grossesses à venir et davantage de complications maternelles, non seulement infectieuses mais également hémorragiques, ainsi que des utérus cicatriciels. En effet, le volume utérin augmentant avec la grossesse, nous allons devoir changer de technique, faire une dilatation instrumentale du col importante, ce qui conduit à un risque non négligeable de complications pour les grossesses à venir. Dans sa grande sagesse, le législateur de 1975 a bien défini le terme de douze semaines d'aménorrhée, donc dix semaines de grossesse ; il y a de ce fait assez peu de complications par la suite. Sachez que les deux-tiers des patientes qui viennent consulter pour une procréation médicalement assistée, en raison d'une stérilité secondaire, ont une IVG dans leurs antécédents. S'agissant de la contraception d'urgence, le premier médicament, le Tétragynon, dont la délivrance est médicalisée, est un concentré de pilule _stroprogestative - une association d'_strogène et de progestatif. Avant que le Tétragynon n'ait obtenu l'autorisation de mise sur le marché, on avait néanmoins l'habitude de le prescrire ; il s'agissait en fait de l'équivalent de quatre comprimés de Stédiril : on coupait quatre comprimés d'une plaquette, deux étaient pris dans les 72 heures après le rapport et les deux autres douze heures après. Il s'agissait donc d'un médicament dont on avait la pratique mais pas l'autorisation de mise sur le marché. Ce médicament a les mêmes contre-indications que les autres _stroprogestatifs, notamment l'hypertension sévère, les grandes migraines et les antécédents vasculaires importants. Mais il est exceptionnel qu'une mineure ait déjà fait un accident vasculaire cérébral, comme une hémiplégie, ou qu'elle ait une migraine grave ou une hypertension sévère. Néanmoins, la prudence est de mise. Le second médicament est le Norlévo qui peut-être acheté sans ordonnance. Il s'agit d'un progestatif pur qui n'a donc pas de contre-indications, s'il est pris, naturellement, une fois dans le cycle ; c'est la raison pour laquelle il a été mis sur le marché en vente libre. L'intérêt de cette contraception d'urgence est que la mineure - ou tout simplement la femme - puisse se procurer le médicament à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Son prix est relativement élevé, 55 francs, et non remboursé par la Sécurité sociale. L'inconvénient de sa distribution non médicalisée est que le pharmacien n'aura pas forcément le temps de demander si le rapport sexuel a eu lieu moins de 72 heures auparavant, et d'expliquer que, s'il y a eu un rapport comportant risque de grossesse, il y a également eu un rapport comportant un risque de maladies sexuellement transmissibles. Il ne lui parlera donc ni du SIDA, ni du préservatif, ni du fait que le Norlévo, tout comme le Tétragynon, n'est pas contraceptif à 100 % mais qu'il évite trois grossesses sur quatre. Ce sont les raisons pour lesquelles j'avais proposé une délivrance médicalisée du Norlévo ; le médecin qui l'aurait délivré aurait pris, lui, le temps de faire une véritable consultation et d'expliquer les avantages et les inconvénients de ce médicament. Cette consultation aurait donc été un moment privilégié pour demander à la jeune femme de revenir, après ses règles, pour parler de contraception. Par ailleurs, l'adolescente qui a déjà pris ce médicament se souviendra qu'il s'agit du Norlévo, qu'il coûte 55 francs - le prix de deux paquets de cigarettes -, et arrivera aisément à se le procurer, préférant prendre une fois du Norlévo si elle a un rapport imprévu que de s'astreindre à prendre la pilule de façon régulière alors qu'elle n'a que très peu, ou pas de rapports. La possibilité de se procurer cette contraception d'urgence dans les collèges et les lycées a pour objectif de venir en aide aux adolescentes en difficulté. Vous allez me dire qu'elles peuvent se la procurer facilement en pharmacie, pour seulement 55 francs. Lorsque je reçois une jeune fille en consultation pour une contraception, il est de mon devoir de lui expliquer également que l'on peut oublier sa pilule et que la contraception d'urgence existe. Or j'imagine mal une adolescente habitant un petit village, où tout le monde se connaît, entrer dans la pharmacie pour acheter du Norlévo. Je suis donc favorable à ce que ce médicament soit délivré par une infirmière qui pourra être une écoute privilégiée. L'idée est donc que l'infirmière accompagne l'adolescente dans un centre de planning - où elle pourra d'ailleurs se faire délivrer le Norlévo dans l'anonymat - et, le cas échéant, tente de joindre les parents, car il n'est pas anodin qu'une adolescente ait recours à une contraception d'urgence. En derniers recours, s'il est impossible de renouer momentanément ou définitivement un dialogue avec les parents, l'infirmière sera habilitée à délivrer, sous responsabilité médicale, cette contraception d'urgence. L'adolescente prendra le médicament devant elle et le reprendra douze heures après sous sa responsabilité. Bien entendu, il doit s'agir d'une délivrance exceptionnelle qui ne doit pas se reproduire tous les mois. En ce qui concerne l'autorisation parentale, je souhaiterais vous lire un courrier datant du 22 mars dernier. Comme je vous l'ai dit, je suis soucieuse d'appliquer les lois de la République, et j'ai demandé que l'autorisation parentale soit signée par un membre de la famille en présence soit d'une surveillante soit d'un médecin du centre de planning. Bien m'en a pris car la direction de mon hôpital a reçu le courrier suivant : "Monsieur le directeur - cette mère a donc écrit non pas au chef de service mais au responsable administratif - j'apprends avec stupéfaction que ma fille, âgée de 16 ans, a subi une IVG dans votre établissement mardi 14 mars 2000 ; or à aucun moment je n'ai été mise au courant de cette situation et j'aimerais en connaître la raison. Il me semble que légalement vous n'auriez pas dû pratiquer cette intervention sur ma fille mineure sans mon consentement, et j'aimerais avoir des explications. Quelqu'un a-t-il signé une autorisation en mon nom et place ? Auquel cas j'aimerais avoir une photocopie de cette autorisation. Ou bien est-ce que la légalité n'a pas été respectée ? De plus, on me demande de m'acquitter des paiements des différents actes qui ont été nécessaires à cette intervention, et cela me semble inacceptable étant donné le contexte. Dans l'attente d'une réponse rapide de votre part, je vous prie d'agréer, Monsieur le directeur, l'expression de mes salutations distinguées." Heureusement, dans le dossier de cette jeune fille, il y avait une autorisation signée. Une personne s'était présentée avec la carte d'identité de la mère - un adulte référent - et avait signé l'autorisation. Voici la réponse du directeur. "Madame, votre lettre du 22 mars concernant votre fille a attiré toute notre attention. Après enquête auprès du service, je suis en mesure de vous informer des éléments suivants : la légalité en ce qui concerne l'autorisation de pratiquer une IVG à une mineure a bien été appliquée ; ce document a bien été signé. On demande une carte d'identité et non pas un livret de famille. Dès lors que la mineure et la signataire de l'autorisation se reconnaissent comme étant mère et fille, pièces d'identité à l'appui avec noms correspondants, nous ne sommes pas en mesure de faire davantage d'investigations. Croyez bien que je suis très sensible à la situation difficile que vous traversez, vous et votre fille, et soyez sûr que je le regrette. Je vous prie de croire..." Cette autorisation parentale n'est donc pas toujours une chose évidente. Je sais qu'un certain nombre de mes collègues donnent le papier à la mineure qui fait le tour du pâté de maison et qui la signe, mais ils prennent des risques sérieux. Certaines IVG sont pratiquées sous anesthésie générale et un anesthésiste peut refuser d'endormir une mineure. Il est en effet obligatoire d'avoir l'autorisation des parents pour endormir une mineure que ce soit pour un accouchement ou pour une appendicectomie - c'est la raison pour laquelle les enseignants vous font signer une autorisation en début d'année. Donc, même si les IVG sont pratiquées en hôpital de jour, ces adolescentes sont accompagnées par un adulte qui doit signer l'autorisation. Mme Martine Lignières-Cassou, présidente : Vous allez donc plus loin que la loi en demandant que la mineure soit accompagnée par un parent. Mme Michèle Uzan : Pas pour pratiquer l'IVG, mais pour signer l'autorisation. Et j'aurais été bien ennuyée pour répondre à la lettre de cette mère si un adulte n'avait pas accompagné cette jeune fille. Mme Martine Lignières-Cassou, présidente : Cela fait malheureusement partie du détournement de la loi, et nous pouvons, les uns et les autres, être confrontés au problème de l'autorisation parentale. Mme Michèle Uzan : Il faut prendre le temps de discuter avec les adolescentes, et c'est le rôle des conseillères sociales. Cette année, toutes les mineures ont pu venir avec l'un de leurs parents pour signer l'autorisation. Mme Martine Lignières-Cassou, présidente : Je connais un certain nombre de cas pour lesquels l'autorisation parentale n'a pas été demandée, car elle ne pouvait pas être obtenue pour des raisons culturelles ; il y a donc eu détournement de la loi. Nous connaissons tous des exemples de ce type. Par ailleurs, je suis surprise que vous mainteniez l'obligation de l'autorisation parentale en cas d'inceste. Mme Michèle Uzan : Dans les cas d'inceste, il y a encore la mère. J'ai tout vu : des familles qui se sont reconstituées, des mères qui ont pu parler à leur fille. Je ne pense donc pas qu'il faille jeter aux orties l'autorisation parentale. Tout le monde doit faire son travail, y compris les juges des enfants ; or nous avons les plus grandes difficultés avec le tribunal de Bobigny. Ce qui me gênerait beaucoup, c'est qu'une adolescente de 14 ans puisse venir dans mon service, seule, subir une IVG. Si la situation familiale est particulièrement difficile, on pourrait éventuellement assouplir la règle en parlant "d'adulte référent" - une s_ur, une tante, un parent de la jeune fille. Il est vrai que certaines adolescentes n'ont pas pu faire la démarche jusqu'au centre de planning, ont subi leur grossesse et ont accouché sous X ; c'est dans ces cas-là que les maltraitrances et les infanticides se produisent. Or si elles avaient pu se rendre au planning avec un adulte référent, elles n'auraient certainement pas poursuivi leur grossesse. Mme Martine Lignières-Cassou, présidente : Les parents recevront la facture de l'intervention. Mme Michèle Uzan : Effectivement, le problème de la facture ne sera pas évité ; les parents auront à payer le ticket modérateur. Dans les cas où l'adolescente n'est pas accompagnée par un parent, on pourrait se poser la question de savoir si l'adulte référent pourrait prendre en charge le ticket modérateur. A moins que l'hôpital n'ait un crédit spécial pour prendre en charge ces IVG. En ce qui concerne la délivrance de la contraception d'urgence dans les collèges et les lycées, les infirmières ont été prises de court ; elles auraient aimé être informées avant que l'annonce n'en soit faite publiquement. Elles vont avoir besoin de soutien. J'avais proposé à Mme Ségolène Royal que les infirmières des collèges aillent passer une semaine dans les centres de planning pour faire connaissance des personnes qui y travaillent, voir comment les choses se passent, comment la contraception y est prescrite. Certaines d'entre elles ont applaudi cette décision des deux mains, car elles étaient satisfaites que l'on reconnaisse la difficulté de leur travail ; elles ont perçu cette décision comme une nouvelle mission éducative. Des infirmières et assistantes sociales de l'hôpital se sont rendues dans les collèges de Seine-Saint-Denis pour organiser des "forums contraception". Cependant, il est vrai qu'elles procèdent à une délivrance médicalisée alors qu'elles n'en ont pas le droit ; elles le font sous la responsabilité des médecins des collèges, mais je comprends parfaitement leur anxiété. Cette contraception d'urgence a un certain coût. Les hôpitaux de l'Assistance Publique vont recevoir des crédits, en revanche, je crois que les collèges n'auront pas de budget. Certains collèges ont reçu en tout et pour tout deux plaquettes de Norlévo à titre d'échantillons, ce qui me semble très insuffisant. Il serait donc intéressant que les collèges et les lycées fassent une évaluation de leurs besoins afin de prévoir un budget spécifique. En matière d'éducation dans les collèges, madame la présidente, vous trouvez que l'accent est davantage mis sur les risques que sur le plaisir. Il est vrai que depuis que le sida a fait son apparition, nous parlons plus en termes de risques que de plaisir. Nous avons pensé que les enseignants pouvaient jouer le rôle d'intermédiaires entre les élèves et un référent qui viendrait dans les collèges parler de la contraception, de la vie et de la sexualité. Je pense même que les jeunes enseignants seront capables d'enseigner cela s'ils sont formés ; ils pourront alors prendre le relais des référents. Mme Martine Lignières-Cassou, présidente : Vous avez même parlé d'emplois jeunes. Mme Michèle Uzan : Tout à fait, mais des jeunes formés qui aillent dans les centres de planning. Ce qui est important, c'est que le planning et l'hôpital soient ouverts à la ville et au collège. Pourquoi le collège ? parce que de nombreux jeunes quittent l'école assez tôt. Nous avions même pensé assurer cette éducation, comme en Hollande, dès le CME 2 ; mais tout le monde n'est pas prêt ; ce sera peut-être une seconde étape. Mme Martine Lignières-Cassou, présidente : Vous indiquez dans votre rapport que la Hollande a le taux de grossesse chez les adolescentes le plus bas du monde. Mme Michèle Uzan : Les familles hollandaises parlent en effet beaucoup de contraception, ce que notre culture judéo-chrétienne ne nous permet pas de faire en France. Mme Martine Lignières-Cassou, présidente : Nous sommes tous d'accord sur la nécessité de la présence d'un adulte - une s_ur, une tante ou un référent. On voit se développer un certain nombre de droits de l'enfant, mais j'ai le sentiment que l'on est tiraillé entre l'affirmation de la prise de responsabilité et l'autorité parentale. Mme Michèle Uzan : C'est après avoir rencontré un certain nombre de grandes adolescentes qui étaient déjà entrées dans la vie adulte depuis longtemps et qui avaient complètement coupé les ponts avec les parents, que l'on s'est posé la question de la majorité sanitaire. Il est difficile pour une adolescente complètement autonome - qui en est peut-être à sa troisième IVG - de demander une autorisation parentale. En revanche, à 13 ou 14 ans, cela me paraît beaucoup plus difficile de ne pas le faire. Venons-en aux adolescentes qui accouchent. Vous m'avez demandé de vous donner des statistiques concernant le nombre d'infanticides ; nous n'en avons pas, car il n'y a pas d'Observatoire pour comptabiliser les infanticides ou les violences sur mineurs. L'hôpital Jean Verdier reçoit, c'est évident, beaucoup plus d'enfants victimes de violence. Dans le rapport de l'INSERM "baromètre santé jeune", l'on peut trouver des chiffres d'infanticides qui, au cours de la première année, seraient multipliés par trois ou cinq, mais sans que soit définie la référence. Il me paraîtrait intéressant de pouvoir mettre en place un Observatoire qui pourrait signaler ce type d'événements et tenir des statistiques. Les violences sur mineurs - infanticides inclus - ne sont pas déclarées. Quelquefois, il peut s'agir de morts subites qui interviennent après un certain nombre de violences et de maltraitances. Nous avons donc une mission lorsque nous nous occupons d'une adolescente enceinte. Les neuf mois sont tout juste nécessaires pour maturer une grossesse : on ne devient pas mère parce qu'on est enceinte. On sait qu'il y a beaucoup de problèmes dans le rapport mère-enfant quand l'accouchement est prématuré, justement parce qu'il n'y a pas eu ces neuf mois pour donner la vie. Pour certaines mères, cela peut se faire très vite, pour d'autres les neuf mois sont parfois insuffisants. Dans certaines populations africaines, par exemple, les mères donnent un nom quand elles sont prêtes à accueillir l'enfant ; et souvent elles n'ont pas choisi le prénom quand l'état civil passe faire les déclarations de naissance. Il faut donc un certain temps pour mûrir une grossesse, et cela est frappant dans le cas des dénis de grossesse. Combien d'adolescentes sont venues me voir me disant qu'elles avaient mal au ventre, qu'elles saignaient et qu'elles devaient donc avoir leurs règles, alors qu'elles étaient prêtes à accoucher ! Je parle des adolescentes, mais il en va de même pour des femmes qui ont déjà eu des enfants ! C'est dans ces cas-là que la possibilité d'infanticide, de rejet de l'enfant est le plus important ; il n'y a eu ni maturation de la grossesse ni création d'un lien relationnel entre la mère et l'enfant. Si par chance nous les rencontrons à cinq ou six mois de grossesse, il nous appartient de restructurer ces adolescentes pour essayer de les remettre dans la réalité de cet enfant qui va naître, leur trouver un logement, une place dans une maison maternelle, etc. Ce qui est étonnant, c'est que les jeunes filles qui ont gardé leur enfant ont un taux d'allaitement équivalent aux autres mamans - 70 % en Seine-Saint-Denis. Elles doivent donc faire l'objet de toute notre attention, car elles ont été très courageuses de poursuivre leur grossesse, quelquefois contre leurs parents ou l'enseignant qui les a mises à la porte de la classe. Il nous appartient même de prévoir l'accouchement sous X ou parfois l'accouchement au secret. Il convient de noter par ailleurs que le déni de grossesse existe également chez les parents ; on ne veut pas voir ce qui est impossible à imaginer. Mme Marie-Thérèse Boisseau : Vous avez l'expérience d'un centre mixte : accouchements et avortements... Mme Michèle Uzan : Mais toutes les maternités de l'assistance publique ont un centre de planning ! Mme Marie-Thérèse Boisseau : S'agit-il selon vous de la meilleure formule, ou serait-il préférable de créer des centres d'orthogénie séparés ? Vous avez clairement expliqué pourquoi il est préférable de ne pas dépasser les douze semaines d'aménorrhée pour pratiquer une IVG ; mais sur 220.000 avortements, 6.000 femmes dépassent les douze semaines : que faut-il faire pour ces femmes ? Mme Michèle Uzan : Je ne suis pas favorable à la mise en place de centres d'orthogénie séparés, car même si la pratique des IVG n'est pas l'activité la plus noble et la plus gratifiante d'un service de gynécologie-obstétrique, elle fait partie des missions du service ; et le planning doit faire partie intégrante du service. Une jeune femme qui vient consulter au planning peut le faire pour différentes raisons : il peut s'agir d'une fausse couche, d'une grossesse extra-utérine ou d'une demande d'IVG. Les médecins qui l'accueillent doivent donc avoir une compétence de gynécologue-accoucheur - ils devront en outre lui parler de maladies sexuellement transmissibles, de contraception, et lui donner des conseils. Or les personnes qui travaillent dans des centres médicalisés de planning isolés sont soit médecins généralistes, soit gynécologues, mais sont assez peu accoucheurs. Une femme qui vient demander une IVG vient souvent sur un coup de tête, elle est angoissée parce qu'elle prenait trois comprimés de perlimpinpin et qu'elle a peur pour l'enfant. Elle préfère subir une IVG que de se poser trop de questions. Elle doit donc pouvoir rencontrer un médecin accoucheur qui la rassurera sur les effets du médicament en question ; mais il ne doit pas s'agir d'une consultation de dissuasion. La prise en charge de la patiente par le médecin doit être globale. Par ailleurs, de la même façon qu'elle a connu le chemin du planning, elle va peut-être connaître celui de la contraception ou celui de la maternité où elle mettra au monde ses autres enfants et, plus tard, celui où elle sera suivie pour son fibrome ou sa ménopause. Ces services doivent donc fonctionner comme des services de proximité et répondre à la médecine de la femme en général, et pas simplement à l'IVG. En outre, et je vous l'ai dit, il est très difficile de ne faire que des IVG et l'on aurait énormément de difficulté à recruter des médecins qui ne fassent que cela. Pour répondre à votre question concernant le délai de douze semaines, je ferai un bref retour en arrière. J'étais interne des hôpitaux avant la loi Veil, et j'ai vu énormément de femmes mourir à la suite d'avortements pratiqués après douze semaines de grossesse. Or cela a complètement disparu du fait de la médicalisation de l'IVG. Je ne suis pas une femme politique, je ne peux donc pas répondre à votre question "que faites-vous des femmes qui se présentent à plus de douze semaines". Je peux simplement vous donner des arguments médicaux. Si l'on augmente le délai de douze à quatorze semaines, des femmes se présenteront à seize, dix-huit ou vingt semaines ; or aujourd'hui, l'on s'occupe de nouveau-nés à partir de vingt-quatre semaines d'aménorrhée : où est la limite entre l'IVG tardive et l'accueil en réanimation néonatale ? Enfin, je crains que des complications ne resurgissent, liées à un problème de volume f_tal qui est plus important à quatorze semaines qu'à douze. Mme Martine Lignières-Cassou, présidente : Vous parlez, dans votre rapport, des grossesses résultant de viols, et vous préconisez l'interruption médicale de grossesse (IMG). Mme Michèle Uzan : Il s'agit de tout à fait autre chose, et la loi l'autorise. Par ailleurs, la technique n'est pas du tout la même. L'IMG se fait par les voies naturelles et la patiente est hospitalisée une semaine. Il s'agit d'un mini accouchement qui est très difficile à vivre. Et je ne parlerai pas des hystérotomies, c'est-à-dire des avortements par mini césarienne qui sont pratiqués jusqu'à vingt-quatre semaines outre-Manche, et qui laissent des utérus définitivement cicatriciels ; un accouchement par les voies naturelles est ensuite dangereux. Mme Martine Lignières-Cassou, présidente : Les législations de plusieurs autres pays européens vont plus loin que celle de la France et portent le délai à quatorze semaines d'aménorrhée. Connaissez-vous les difficultés que rencontrent vos confrères et les femmes qui subissent une IVG dans ces différents pays ? Je crois que le professeur Nisand est en train d'élaborer un rapport sur ces problèmes. Vous écrivez également dans votre rapport que 45 % des IVG pratiquées chez les adolescentes sont des IVG médicamenteuses, alors que le chiffre donné par le rapport Nisand - qui ne parle pas uniquement des adolescentes - est beaucoup plus faible. Est-ce un choix de votre service ? Mme Michèle Uzan : Pour bénéficier d'une IVG médicamenteuse, la patiente doit venir consulter relativement tôt. Et je ne vous cache pas que lorsqu'elle vient nous consulter dans les limites de sept semaines d'aménorrhée, au lieu de programmer la seconde consultation huit jours plus tard, on met en route la procédure d'urgence et l'on compacte les deux consultations afin de procéder à une IVG médicamenteuse. Cette technique d'IVG est certes plus douloureuse mais beaucoup plus anodine pour l'utérus ; l'_uf est plus petit, plus facilement expulsé, et il n'y a ni les man_uvres endo-utérines qui sont les grands vecteurs de dilatation du col - donc risque d'accouchement prématuré par la suite -, ni les aspirations, vecteurs d'infection. Il s'agit donc de "l'IVG idéale". Il est vrai, cependant, que cette technique demande beaucoup plus d'attention et de soins qu'une IVG par aspiration. Je suis d'accord avec le Professeur Israël Nisand quand il dit que l'IVG par aspiration est une solution de facilité - quelque soit le terme. Il s'agit en effet d'une mauvaise solution quand l'IVG médicamenteuse est encore possible. L'IVG médicamenteuse requiert un personnel formé et présent, une certaine technique et de l'écoute. Il vaut également mieux être accompagnée, car cela est plus douloureux qu'une IVG pratiquée sous anesthésie générale. Et je pense que c'est par facilité ou par manque de temps qu'un certain nombre de confrères pratiquent systématiquement l'IVG par aspiration ; lorsque la patiente est à six semaines d'aménorrhée, une telle IVG demande cinq minutes. C'est la raison pour laquelle j'attends beaucoup des campagnes d'information. J'espère que mes futurs collègues comprendront que s'il faut en arriver à une IVG, autant qu'elle soit pratiquée le plus tôt possible. Mme Martine Lignières-Cassou, présidente : En ce qui concerne la consultation préalable obligatoire, quel est votre sentiment sur son caractère obligatoire ? Vous paraît-elle par ailleurs plus importante que le suivi d'une femme qui vient de subir une IVG ? Mme Michèle Uzan : Vous savez qu'il y a aussi une consultation post-IVG. Elle est facultative, mais près de 75 à 80 % des femmes se rendent à cette consultation. La consultation préalable obligatoire me paraît très importante, mais je pense que la consultation post-IVG devrait être, elle aussi, obligatoire. Lorsqu'on démarre la consultation préalable, on s'aperçoit que la patiente vient pour s'informer. Dans la majorité des cas, elle est décidée à pratiquer une IVG, et on lui parle de l'après-IVG, c'est-à-dire la contraception, les vaccinations, les MST, etc. Mais toutes les femmes ne sont pas encore déterminées et cette consultation va leur permettre de prendre leur décision - avorter ou poursuivre la grossesse. La consultation post-IVG est également très importante, car s'y présenteront des femmes dépressives, qui regrettent déjà leur IVG ; et c'est à ce moment-là qu'elles vont entendre le mot "contraception" et entrer de façon adulte dans leur sexualité. Ces deux consultations sont finalement des consultations de prévention de la récidive. Audition de M. Etienne-Emile Beaulieu, Professeur au Collège de France Réunion du mardi 12 septembre 2000 Présidence de Mme Martine Lignières-Cassou, présidente Mme Martine Lignières-Cassou, présidente : Mes chères collègues, nous reprenons la série d'auditions que nous avons entamée, il y a déjà plusieurs mois, sur le thème de l'IVG et de la contraception. Nous accueillons aujourd'hui M. Etienne-Emile Baulieu, professeur au Collège de France. Professeur de biochimie à la faculté de médecine de Paris Sud, vous enseignez au Collège de France les principes et le fondement de la reproduction humaine et vous êtes également directeur d'une unité de recherche de l'INSERM. Vous avez fait d'importantes découvertes scientifiques, mais vous êtes surtout connu pour avoir découvert le RU 486. Membre de l'Académie des sciences, vous avez reçu de nombreux prix scientifiques, dont le prix Lasker en 1989 ; enfin vous avez publié plusieurs articles et ouvrages dont le dernier s'intitule "Contraception, contrainte ou liberté". Le rapport annuel de la Délégation aux droits des femmes portera cette année sur le thème de l'IVG et de la contraception. Nous avons donc souhaité vous rencontrer pour parler de l'IVG et, plus particulièrement, du RU 486. Je vous propose donc, dans un premier temps, de nous faire un rapide historique du RU 486, produit qui a eu des difficultés à s'imposer en France et dans un certain nombre de pays européens, puis, dans un second temps, de nous indiquer s'il est possible d'élargir l'utilisation du RU 486. M. Etienne-Emile Baulieu : Je me suis intéressé pour la première fois au problème de la contraception en France par l'intermédiaire d'un comité, créé par le Général de Gaulle, et chargé de travailler sur ce thème, au moment de l'élection présidentielle de 1965. Dans ce comité, appelé par la suite "Comité des 13 sages", j'étais le plus jeune, mais j'ai eu la chance d'être remarqué par le professeur Pincus, celui-là même qui avait mis au point la pilule contraceptive. Il m'a envoyé représenter la France - de façon officieuse - à l'Organisation mondiale de la santé qui discutait alors des méthodes contraceptives - thème apparu aux Etats-Unis en 1960, avec la mise sur le marché de la première pilule. J'ai ainsi pu obtenir de nombreux documents que j'ai portés à la connaissance de mes confrères. Nous avons ensuite élaboré un projet que la presse appela "Feu vert sur la pilule", recommandant au ministre de la santé et au président de Gaulle de faire avancer la question de la pilule contraceptive. Je fais partie de ceux qui pensent que la science progresse d'abord en fonction de la recherche scientifique, car je suis persuadé que, tôt ou tard, la connaissance aide les hommes ; et les scientifiques participent de façon décisive à l'évolution de la société. Spécialiste du type d'hormones impliquées dans la contraception telle que l'avait définie le professeur Pincus, l'une de mes motivations a été de défendre la cause de la condition féminine, notamment à travers le problème de la maîtrise de la reproduction. Venons-en à l'historique du RU 486. Le professeur Pincus, qui siégeait comme conseiller principal à la fondation Ford et qui souhaitait favoriser les méthodes de développement de la contraception m'a proposé un contrat intéressant pour que je participe à la recherche et au perfectionnement des méthodes contraceptives, mais j'ai refusé ; mon projet n'était pas d'affiner les méthodes de contraception, j'avais envie de faire quelque chose de nouveau, notamment dans les pays en voie développement, dans lesquels je m'étais rendu pour l'OMS. J'étais, en réalité, très intéressé par le fait que se trouvait, dans le principe même de la contraception, la possibilité de donner à la femme la liberté et le choix de la maternité. La fondation Ford, grâce au professeur Pincus, m'a fait confiance et m'a laissé mener mes recherches. C'est ainsi que la notion - qui n'existait pas à l'époque - d'anti-progestérone a été mise à jour ; il n'y avait pas, scientifiquement parlant, de produits "anti" permettant de comprendre comment a lieu la grossesse, et, éventuellement, de rendre possible son interruption. Avec l'aide de la firme pharmaceutique Roussel, nous avons développé le RU 486, qui a rencontré des difficultés dès sa conception. En effet, la firme Roussel était déjà largement sous le contrôle de la firme allemande Hoechst qui, pour des raisons idéologiques tenant à la personnalité de son président et pour des raisons commerciales - cela leur aurait causé des ennuis aux Etats-Unis -, a décrété que le RU 486 était immoral. Nous avons insisté sur le fait que ce médicament est aussi un produit anti-cortisone, puisque le RU 486 possède à la fois des effets anti-progestérone et anti-cortisone. Nous avons donc passé les premiers barrages dans les années 1975 - 1980. En 1982, j'ai publié, à l'Académie des sciences, une étude sur la première utilisation du RU 486 pour une IVG chez la femme. Cette publication a aussitôt été internationalement remarquée. L'OMS, très intéressée par cette découverte, a immédiatement demandé à la firme Roussel la permission d'effectuer, gracieusement, des recherches. Les résultats obtenus dans une vingtaine de pays ont été tout à fait concordants et ont prouvé la sécurité d'emploi du produit ; il n'y avait donc plus de raison de ne pas mettre cette pilule à la disposition des femmes qui en avaient besoin. On a alors formulé une demande d'AMM - autorisation de mise sur le marché - qui, après de nombreuses discussions, a été acceptée en 1988. La firme Hoechst a cependant exercé une forte pression sur les dirigeants de la firme Roussel et a obtenu le retrait du produit de l'AMM. Au même moment, se tenait au Brésil un congrès sur la médecine de la reproduction et je me suis exprimé devant trois ou quatre mille gynécologues dans une atmosphère extraordinaire. Le New York Times en a fait sa une et M. Claude Evin, alors ministre de la santé, a prononcé cette phrase superbe : "Un produit de ce type est la propriété morale des femmes". Des manifestations de femmes ont alors eu lieu partout dans le monde. Finalement, la firme Roussel a accepté de mettre le produit sur le marché en France. A l'heure actuelle, ce produit est utilisé par 30 % environ des femmes recourant à l'IVG. En France, selon les études réalisées, le RU 486 peut être donné jusqu'à 50 jours après les dernières règles, soit jusqu'à sept semaines de grossesse. Dans ce délai, 80 % des femmes l'utilisent. Il est donc regrettable que la majorité des femmes se présentent trop tard chez le médecin. Le produit a l'avantage de pouvoir être utilisé extrêmement tôt. Cette intervention hormonale qui rend l'utérus incapable de nider l'_uf est moins hasardeuse qu'une IVG par aspiration et donne de meilleurs résultats quand le traitement est appliqué très précocement. Parmi les questions que l'on doit se poser, il y a celle du délai de réflexion de huit jours - imposé par la loi Veil -, lorsque l'IVG est pratiquée avec un produit de ce type. En effet, plus l'intervention est précoce, mieux c'est. Le problème est suffisamment grave et difficile pour que les femmes, qui ne se décident pas à la légère, dans l'immense majorité des cas, puissent prendre le RU 486 sans attendre huit jours après la consultation médicale préalable. La méthode hormonale a comme avantage de modifier très rapidement l'état de la femme ; elle est d'autant plus efficace que le produit est pris très tôt. L'éducation générale à la sexualité, qui doit commencer au niveau du secondaire, devrait inciter les jeunes filles à consulter dès qu'elles ont un doute. Les méthodes actuelles de détection permettent un diagnostic sûr et donc de prendre une décision rapidement. Les retards de règles sont assez fréquents chez la femme ; de ce fait elles attendent souvent la deuxième période pour consulter ; mais le délai pour utiliser le RU 486 est alors dépassé. Nous avons eu beaucoup de mal à faire mettre le RU 486 à la disposition des femmes d'autres pays. En Grande-Bretagne et en Suède, le produit a été autorisé relativement rapidement, avec l'aide de médecins célèbres ayant une influence sur les instances ministérielles et parlementaires. Mais, dans le reste du monde, la situation était bloquée par la volonté de la firme Hoechst. La firme Hoechst-Roussel a voulu se défaire de ce produit, et c'est la société Exelgyn, que dirige l'ancien PDG de Roussel, le Docteur Sakiz, qui a reçu le brevet et les droits de ce produit. Après quelques débuts difficiles, il a obtenu l'approbation de différents pays européens, y compris l'Allemagne ; seule l'Italie ne l'utilise pas. Je vous signale, par ailleurs, que la firme Hoechst-Roussel ne voulait pas exporter ce produit en Chine. Mais les Chinois ont mis leurs chimistes au travail et recopié la molécule. Ce produit est donc maintenant utilisé par trois millions de Chinoises chaque année. Je vous indique également que le RU 486 a d'autres utilisations que l'IVG. Il est notamment un inducteur du travail lors de l'accouchement et permet de soulager la mère - ainsi que l'enfant - en facilitant la dilatation du col de l'utérus. Je trouve donc inadmissible de ne pas développer ce produit dans cet objectif. L'on pourrait également utiliser le RU 486 en contraception d'urgence pour traiter certains fibromes de l'utérus, pour soulager certains cancers, notamment féminins, ainsi qu'en tant qu'anti-cortisone, en particulier en psychiatrie. Nous avons en effet découvert qu'il pourrait avoir des effets positifs sur certaines graves dépressions. Il conviendrait donc, d'une part, au nom de la condition féminine, et, d'autre part, au nom de la santé publique, de favoriser les études sur le RU 486, alors qu'actuellement, aucune société ne réalise de recherche sur ce produit. Or, je puis vous affirmer qu'une femme, suivie depuis quatre ans pour un cancer de l'utérus, a été sauvée par ce produit ; elle en prend tous les jours depuis quatre ans et se porte très bien. La tolérance à ce produit est extraordinaire. Nous ne l'avions d'ailleurs pas prévu, mais nous ne savons pas tout lorsque nous faisons des recherches. Nous sommes désireux d'être contrôlés, notamment en ce qui concerne les suites de la commercialisation, ce qui n'est pas fait. D'ailleurs, il n'existe pas en France de suivi de l'avortement sur le plan médical ; on ne sait donc pas ce que deviennent les femmes qui ont subi une IVG, quel que soit le type de méthode employée. Il s'agit là d'un grand problème de santé publique. S'agissant du RU 486, je suggère donc que le produit soit "aidé", que des recherches soient entreprises, car, comme je viens de vous le dire, en dehors de l'IVG, il pourrait être utilisé pour les accouchements, la contraception d'urgence, le traitement des fibromes, la psychiatrie, etc... En ce qui concerne l'IVG, je ne suis pas partie prenante dans la question qui se pose de rallonger le délai de 12 à 14 semaines, dans la mesure où aucune étude n'a été effectuée avec le RU 486 pour savoir s'il est encore utilisable à ce moment-là. En Grande-Bretagne, le Wellcome Trust - fondation de mécénat scientifique qui dispose de beaucoup d'argent et qui cherche à le mettre à la disposition de grandes causes - est prêt à faire des recherches dans le domaine de la contraception avec le RU 486. Mais je trouve cependant un peu désagréable le fait d'être obligé de regarder chez nos voisins britanniques pour constater que des efforts sont réalisés dans ce domaine. Mme Martine Lignières-Cassou, présidente : Je voudrais revenir sur la réglementation concernant le RU 486 et sur son origine assez sulfureuse. Nous avons été surprises d'apprendre que ce produit était classé comme stupéfiant et qu'il n'était donc soumis à des conditions d'utilisation très strictes. Aujourd'hui, le RU 486 est utilisé par les médecins hospitaliers et dans les centres d'IVG jusqu'à la cinquième semaine de grossesse. Or, dans votre intervention, vous nous avez parlé de sept semaines. M. Etienne-Emile Baulieu : Effectivement, j'ai parlé de cinquante jours, donc sept semaines d'aménorrhée. Mais la définition de la grossesse est sémantiquement un peu délicate. Pour certains, la grossesse débute au moment de la conception, c'est-à-dire deux semaines après les règles - au moment de l'ovulation ; donc à ce moment-là ce n'est plus sept semaines, mais cinq. Les médecins des grandes sociétés médicales gynécologiques nationales et internationales considèrent, eux, que la grossesse débute au moment de l'implantation, soit une semaine après - vers le 22ème, 23ème jour du cycle ; la femme sera donc enceinte de quatre semaines. Enfin, si l'on fait débuter la grossesse au moment où la femme devrait avoir ses règles, cela fait trois semaines. S'agissant du RU 486 qui est enfermé dans un placard de la pharmacie de l'hôpital - tout comme la morphine -, je ne sais pas si c'est ironique ou insultant. Et, je le répète, une série de règlements empêche l'utilisation du RU 486 pour d'autres causes, notamment pour soulager la femme et l'enfant lors d'un accouchement difficile. Le statut du RU 486 devrait changer : on devrait tenir compte de la responsabilité des femmes - qui sont les premières impliquées - et de celle des médecins. Je trouve qu'il s'agit d'un manque de confiance envers les femmes et les médecins que de continuer à mettre sous clés un produit de ce genre. Mme Martine Lignières-Cassou, présidente : Nous nous posons une autre question sur l'utilisation du RU 486. Aujourd'hui, ce produit est soumis à la législation sur l'IVG, c'est à dire qu'il ne peut être utilisé que dans des établissements publics ou privés de santé. Les IVG médicamenteuses pourraient-elles être pratiquées, moyennant un contrôle des médecins bien entendu, et dans l'objectif d'une intervention précoce, dans les cabinets de ville ? M. Etienne-Emile Baulieu : Je pense que cela est tout à fait envisageable, à condition, bien entendu, que l'on s'adresse à un médecin et que, comme pour tout acte médical, ce dernier puisse disposer facilement de tous les moyens nécessaires, en cas de complications. Si la loi Veil impose que la prise du RU 486 se fasse dans des établissements publics ou privés de santé, c'est parce que nous ne voulions pas, à l'époque, faire de vagues. Il est intéressant que des études aient été menées en Grande-Bretagne pour savoir si les femmes préféraient se rendre à l'hôpital - en compagnie d'autres femmes - pour pratiquer l'IVG ou bien rester chez elle. La majorité des femmes ont répondu préférer se rendre à l'hôpital car, psychologiquement, elles ne se sentent pas seules. Mme Nicole Bricq : Vous nous avez fait remarquer qu'aucune recherche n'était menée sur le RU 486. On sait que les programmes de recherche sont très influencés par les marchés ; est-ce le cas en ce domaine ? M. Etienne-Emile Baulieu : La recherche médicale devrait être détachée de cette considération ; on ne cherche pas pour faire de l'argent. Un certain nombre de problèmes graves, qui nous pressent, se posent actuellement à la société moderne. Il conviendrait que des recherches soient menées au sein d'une institution internationale - non pas humanitaire au sens strict du terme - mais une institution dotée de moyens financiers, peut-être liée à l'OMS. En tout état de cause, il faut une aide publique, car ce type de recherche n'est pas rentable et n'intéresse donc pas les grands groupes privés. Mme Martine Lignières-Cassou, présidente : Il faut replacer le problème du RU 486 dans un débat plus large sur la place de la recherche aujourd'hui en France et en Europe. Mme Marie-Thérèse Boisseau : En quelle année l'Agence européenne du médicament a-t-elle donné son feu vert ? M. Etienne-Emile Baulieu : L'année dernière. Mme Marie-Thérèse Boisseau : Second point, vous nous avez dit que le RU 486 pourrait être utilisé pour la contraception d'urgence, en lieu et place du Norlévo. Pouvez-vous nous donner plus d'explications ? Mme Martine Lignières-Cassou, présidente : Nous avons toujours entendu dire que le Norlévo était non pas un abortif, mais un contraceptif. M. Etienne-Emile Baulieu : Le Norlévo est effectivement un progestatif - c'est une progestérone -, donc le contraire d'un abortif. L'idée du professeur Pincus était de se servir de la progestérone prématurément dans le cycle, afin de bloquer l'ovulation ; c'est ce que peut faire le Norlévo s'il est donné à temps. De plus, si l'on donne de la progestérone au moment où l'_uf est fécondé et commence à descendre le long de la trompe, on modifie la muqueuse de l'utérus et l'implantation devient alors impossible - ou elle sera de mauvaise qualité. Tel est l'effet du Norlévo, qui est d'ailleurs bien toléré. Et l'on parle de pilule contraceptive car, si vous vous souvenez de ce que je vous disais tout à l'heure, avant le 22ème jour, il y a fécondation, mais pas implantation, donc pas de grossesse ; il s'agit donc bien d'une contraception. La contraception d'urgence est une notion non pas biologique, mais comportementale. Dans le cas où il y a eu un rapport avec possibilité de fécondation, la prise de Norlévo va, d'une part, bloquer l'ovulation, s'il en est encore temps, et/ou, d'autre part, modifier la muqueuse de l'utérus pour que l'implantation ne puisse se faire ; il n'y aura donc pas de grossesse. Et le cycle suivant sera tout à fait normal, le trouble n'étant que passager. Un procédé, qui porte le nom d'un gynécologue canadien, M. Yuzpe, consiste à donner une pilule contraceptive contenant _strogène et progestatif en assez grande quantité dans les heures qui suivent le rapport ; aucune loi ne réglemente cette méthode. Le RU 486 est, quant à lui, un anti-progestérone ; le même résultat qu'avec le Norlévo ou le procédé de Yuzpe - on empêche l'utérus de se préparer à la nidation - est ainsi obtenu avec un produit différent. Une étude a été menée en Suède : des femmes volontaires ont pris le RU 486 systématiquement, au 20ème jour du cycle. A cette date, une dose de l'ordre de 10 milligrammes est suffisante ; ce qui est loin des doses administrées pour une IVG, qui vont de 200 à 600 milligrammes. Entre le 22ème et le 28ème jour du cycle, donc dans la deuxième période de la phase post-ovulatoire, une dose de 10 milligrammes aura plus d'effets que le Norlévo. Mais nous sommes là dans une période que certains déterminent comme correspondant au début de la grossesse ; par conséquent des polémiques peuvent avoir lieu. Il convient de tenir compte de l'irrégularité des règles : certaines femmes peuvent se trouver dans la deuxième période, au moment de l'administration du RU 486, qui sera alors plus efficace que le Norlévo. Cette période - entre l'ovulation et les prochaines règles - que j'ai appelée "contragestion", c'est-à-dire contre la gestation, est concernée par toutes les méthodes qui interrompent le processus menant à la grossesse. Il s'agit donc de méthodes contragestives. Je vous conseille de vous procurer les documents de l'OMS qui prouvent la meilleure efficacité du RU 486, et de mettre en discussion une étude sur cette question. D'aucuns vous répondront que si l'on dispose de pilules de 10 milligrammes, certaines femmes prendront des doses de 20 milligrammes pour pratiquer elle-même une IVG. Certes, mais des personnes se suicident bien avec de l'aspirine ! Audition de M. Lucien Neuwirth, Sénateur Réunion du 12 septembre 2000 Présidence de Mme Martine Lignières-Cassou, présidente. Mme Martine Lignières-Cassou, présidente : Dans le cadre de notre rapport d'activité et à l'occasion de la révision des lois sur l'IVG et la contraception, nous prenons conscience, monsieur le sénateur, qu'il convient de reprendre globalement ce sujet. Nous désirions donc vous entendre afin de faire avec vous le point de trente ans de législation sur la contraception et de savoir ce qu'il vous semblait nécessaire d'adapter aux réalités de notre époque. Nous avons, au cours de débats antérieurs, et notamment au cours du colloque que nous avons organisé fin mai et auquel vous avez assisté, posé le problème de l'accès à la contraception pour les mineures, celui de la publicité en matière de contraception, autant de problèmes que nous souhaiterions aujourd'hui évoquer avec vous. Quelle est votre analyse de la législation après trente ans d'application et quelles modifications vous semblent s'imposer ? M. Lucien Neuwirth : Madame la Présidente, je vous remercie de votre invitation à venir vous parler d'un sujet qui n'a jamais cessé de m'intéresser. D'abord, je soulignerai une première évidence : le monde évolue tous les jours ainsi que les comportements, les habitudes et les moeurs et il est clair que nous ne pouvons pas accepter de nous réfugier dans une situation à tout jamais figée. Mon souci, en ce qui concerne la contraception, est de faire en sorte qu'elle remplisse sa mission et je dois dire que, pendant des années, j'ai dû hurler dans le désert, estimant que l'information n'était pas faite comme elle aurait dû l'être, non seulement pour les filles mais également pour les garçons, à qui il convient de signifier qu'en la matière, ils ont, eux aussi, une part de responsabilité. A ce propos, un souvenir personnel m'a beaucoup marqué. Il remonte aux années soixante-dix quand Edmond Michelet se trouvait avoir en charge la censure cinématographique. Il m'avait appelé pour connaître mon jugement sur le film Helga, un documentaire fabuleux sur le développement du foetus qui se terminait par une scène d'accouchement que certains jugeaient choquante. Je me suis fait accompagner par des jeunes à la projection de ce film et je dois dire que leurs réactions ont été assez extraordinaires puisque, après avoir assisté à la scène de l'accouchement, qui était assez forte pour un jeune homme, le premier adolescent que j'ai interrogé m'a dit : « Pour moi, une surprise-partie, cela ne sera plus jamais pareil... », tandis que le second s'est extasié : « Ah, monsieur, c'est quand même formidable la vie ! ». J'ai alors pris conscience que ce style d'enseignement était au moins aussi nécessaire pour les garçons que pour les filles. Sur l'information des filles, j'avais d'ailleurs été déjà largement impressionné par une femme remarquable qui avait en charge la protection maternelle et infantile de la région parisienne et qui me faisait visiter un hôtel maternel recueillant les jeunes « filles-mères ». Je demandais à l'une d'elles, qui n'avait guère plus de quatorze ans, si elle ne savait pas qu'elle pouvait tomber enceinte et cette dernière m'avait répondu « Non, parce qu'on m'avait dit que pour avoir un enfant, il fallait coucher avec un homme, et que nous n'avons pas eu de rapport couchés mais debout dans les escaliers de notre HLM ... ». Je suis resté stupéfait ! Cette même personne m'avait déclaré qu'elle était scandalisée par le nombre d'institutrices qui disaient voir arriver en classe des petites filles blêmes au motif qu'elles avaient leurs règles sans même avoir été averties par leur mère que ce phénomène devait survenir. Figurez-vous qu'il y a moins de deux ans j'ai, à mon tour, rencontré une institutrice qui m'a dit la même chose, à savoir qu'une de ses élèves avait été extrêmement traumatisée d'avoir eu ses règles sans savoir ce qui lui arrivait. J'insiste donc sur cette nécessité d'information, car il me semble qu'il faut sensibiliser tous ceux qui vont être ou sont déjà des parents. C'est facile de dire à une petite fille pubère qu'elle va devenir une femme et pouvoir avoir des bébés : c'est normal la procréation ; il n'y a rien de plus normal et si nous en sommes arrivés là où nous sommes, c'est uniquement parce que l'information a été insuffisamment faite dans ce domaine. Puisque nous allons parler de contraception d'urgence, je tiens à attirer votre attention sur un autre problème qui me touche beaucoup : si la question des enfants mineurs se pose à certains, cela s'explique en grande partie par une carence de communication au sein des familles. Si tel n'était pas le cas, les petites filles dont nous avons parlé ne se seraient pas trouvées dans la situation qui était la leur, car elles auraient été averties par leur mère qui les aurait mises en garde contre le risque de se trouver enceintes. Nous avions créé une structure, le Conseil supérieur de l'information sexuelle, qui possédait une caractéristique à laquelle j'avais tenu tout particulièrement : y siégeaient des représentants des corps intermédiaires, c'est-à-dire aussi bien les syndicats ouvriers que les autres syndicats, ainsi que des représentants de toutes les familles et de toutes les religions. J'estimais, en effet, qu'il fallait passer par ces canaux pour faire de l'information en réglant, non pas les récepteurs sur les émetteurs mais bien l'inverse, c'est-à-dire en parlant le même langage que celui pratiqué par chaque catégorie sociale. La formule a particulièrement bien fonctionné pour le milieu rural : l'association des familles rurales s'est vraiment « mise en quatre » pour faire en sorte que les choses aillent au mieux. Ensuite, est venue cette longue période où l'on n'a plus fait d'information, avant d'y revenir notamment avec Bernard Kouchner, qui a eu le mérite d'essayer de faire repartir la machine. Mme Martine Lignières-Cassou, présidente : Madame Roudy l'y a beaucoup incité... M. Lucien Neuwirth : C'est vrai ! Mme Yvette Roudy : Cela remonte à 1981, et nous n'avons toujours pas de système permanent d'information, qui soit, en quelque sorte, banalisé, intégré dans notre culture, comme un élément naturel et normal, partout où il y a des jeunes, que ce soit à l'école ou ailleurs. Cela manque. Pendant deux ans, on a répété que l'on allait faire une campagne sur la contraception, sans jamais y parvenir. En réalité, nous nous laissons beaucoup trop freiner par ceux qui y sont opposés. Il faut réussir à banaliser l'information et à l'intégrer dans la norme. M. Lucien Neuwirth : Pour ce faire, il faut, à mon sens, repartir par les canaux naturels de diffusion que sont les représentants des syndicats, les associations familiales et autres, car il n'y a rien, je le répète, de plus naturel que la procréation. Je crois qu'il est fondamental de parvenir à cette banalisation de l'information que j'ai souhaitée et qu'on a instaurée dans d'autres domaines, tels que celui de la douleur. Le grand problème qui se pose, comme l'a souligné fort justement Mme Yvette Roudy, est d'ordre culturel. Il faut réussir à se convaincre que toutes les familles ne sont pas identiques : il y a les familles soudées et les familles monoparentales, au nombre de 1 200 000 rien que pour la France. Mme Martine Lignières-Cassou, présidente : Elles ne sont pas pour autant éclatées... M. Lucien Neuwirth : Non, bien sûr ! J'en arrive aux responsabilités par rapport au sujet qui nous intéresse, car il y a un problème culturel qui tient aux relations avec les parents et à l'autorité parentale sur laquelle on s'est focalisé. On a prétendu que, dans la loi de 1967, j'avais prévu qu'une autorisation des parents était obligatoire pour que les médecins puissent prescrire des contraceptifs : c'est faux ! Cela ne figure nullement dans la loi mais dans l'article 371-1 du code civil qui dit « L'enfant doit rester sous l'autorité des parents jusqu'à sa majorité ou son émancipation », et dans l'article 371-2 qui stipule « L'autorité appartient aux père et mère pour protéger l'enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité. Ils ont, à son égard, droit et devoir de garde, de surveillance et d'éducation. ». Ce qui, en revanche, figurait dans la loi c'était la distribution par les centres de planification ou d'éducation familiale de produits et objets contraceptifs aux mineurs : c'est ce que l'on a appelé la « petite loi » de 1974. Je pense qu'il y a un vrai problème en ce qui concerne la prescription médicale : en effet, les hormones ont des conséquences sur les individus, et beaucoup plus sur les enfants en formation que sur une femme déjà formée. Une prescription médicale me paraît donc nécessaire pour qu'un médecin puisse s'assurer qu'il n'y ait pas de contre-indications à la prescription des contragestifs qui ont la particularité de contenir des hormones : ils empêchent la nidation par des moyens chimiques mais ont, en plus, une action hormonale. Or, de mon point de vue, c'est cette action hormonale qui vient compliquer les choses et il nous faut y être attentifs. Le Norlévo, mis à part son léger apport d'hormones, n'a pas d'autres effets que ceux du stérilet dont l'usage est tout a fait défini et reconnu par la loi et qui ne suscite aucune polémique. Il empêche la gestation : il s'agit d'un contragestif et de rien de plus, même si, à son propos, on peut parler de contraception d'urgence puisque son action intervient après le rapport, plus exactement après la fécondation de l'ovule, mais avant la nidation, c'est-à-dire avant la formation du f_tus. Je pense que tout cela pourra s'énoncer assez clairement lors du débat au Parlement. Le problème qui perdurera et sur lequel les médias vont braquer leurs projecteurs reste celui de l'autorité parentale. Faut-il aller jusqu'à envisager une majorité sanitaire à partir de 16 ans ou retenir d'autres formules ? Le débat est très largement ouvert. Pour l'instant, en ce qui me concerne, je n'ai pas terminé ma réflexion et c'est pourquoi je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui pour entendre vos questions et finir de me convaincre moi-même sur ce problème de la contraception. Mme Martine Lignières-Cassou, présidente : La question qui est posée, monsieur le sénateur, est de savoir si les filles et les garçons ont à demander l'autorisation parentale en ce qui concerne leur sexualité. Aujourd'hui, une fille - je parle des filles puisque ce sont elles qui portent encore l'essentiel de la responsabilité en matière de contraception et ont à mener à terme une grossesse - peut se procurer des moyens de contraception dans un centre de planification ou d'éducation familiale, sans l'autorisation de ses parents. En posant le problème de l'autorisation parentale pour la contraception, il convient de se demander si cela correspond à nos pratiques « sociétales » : les filles demandent-elles à leurs parents l'autorisation d'avoir, ou non, une sexualité ? Il me semble qu'en pratique, la réponse est plutôt négative : elles en discutent certainement quand elles le peuvent avec leurs parents, mais nous ne sommes plus à une époque où les filles et les garçons demandent à leurs parents l'autorisation d'avoir une relation sexuelle. Mme Roselyne Bachelot : Elles ne l'ont jamais demandée. Mme Martine Lignières-Cassou, présidente : Effectivement, j'ai le sentiment qu'elles ne l'ont jamais demandée. Est-ce qu'à partir de là on décide que les mineures ont besoin de l'autorisation parentale pour avoir accès à la contraception, ou que, puisqu'elles font un certain nombre d'actes en toute conscience, il faut leur donner les moyens de se prémunir contre un certain nombre de risques, que ce soit en matière de grossesse, de sida ou de MST ? Mme Danielle Bousquet : Dans votre loi, vous aviez envisagé qu'un centre de planification ou d'éducation familiale puisse délivrer librement une contraception à une mineure sans que soit évoquée nulle part la question de l'autorisation parentale. En conséquence, je ne comprends pas la démarche qui est aujourd'hui la vôtre et qui vous amène à dire que cette question se trouvera au coeur du problème, en particulier au niveau des médias. En effet, votre loi, qui a maintenant déjà plus de vingt ans, résolvait ce type de problèmes. Puisqu'à l'époque ils n'ont pas posé de difficultés particulières, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas envisager, par analogie, que ce qui a été accepté en 1974, puisse être reconduit sans difficulté aujourd'hui. M. Lucien Neuwirth : Mes propos précédents allaient un petit peu plus loin puisque je pensais déjà à la distribution du Norlévo et à la contraception d'urgence, mais il est évident que, selon moi, le pire qui puisse arriver à une jeune fille est de débuter dans la vie avec une IVG : il faut tout faire pour éviter cela ! Mme Danielle Bousquet : Mais pourquoi pensez-vous que, maintenant, cette question va poser plus de problèmes qu'en 1974 où l'existence des centres de planification et la possibilité d'y prescrire des contraceptifs n'a provoqué que l'agitation d'un petit nombre de personnes ? M. Lucien Neuwirth : Toute la confusion vient du problème posé par la possibilité de délivrance de contraceptifs d'urgence par les infirmières scolaires. Pourtant, dans d'autres domaines, cette solution existe déjà : les médecins chefs de service établissent des protocoles, pour permettre, en leur absence, aux infirmières de remplir certains actes qu'elles ne pourraient pas assumer autrement. J'en veux pour exemple le décret qui permet aux infirmières d'intervenir à la place du médecin dans certaines situations spécifiques d'urgence : il est appliqué notamment en établissement hospitalier pour le traitement de la douleur. Une circulaire du 11 février 1999, prise en application d'un décret du 15 mars 1993, relative aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmière et d'infirmier, précisait ainsi que, face à une situation d'urgence et dans le cadre d'un protocole de soins déterminé par circulaire, les infirmiers étaient habilités à accomplir des actes non autorisés auparavant, pour permettre de soulager les patients souffrant atrocement. Il est donc possible de prévoir un article additionnel qui préciserait que, face à une situation d'urgence, dans le cadre d'un protocole de soins déterminé par circulaire, les infirmières scolaires sont habilitées à délivrer des moyens contraceptifs. Mme Martine Lignières-Cassou, présidente : Je tiens à dire que les six mois de mise en circulation du Norlévo montrent que tous, aussi bien les parents, les infirmiers, les responsables de l'Education nationale ainsi que les jeunes, ont fait preuve d'une très grande responsabilité. Mme Roselyne Bachelot : Pour que les choses soient bien claires dans le débat, je m'empresse de dire que je suis naturellement, depuis fort longtemps, une militante de la suppression totale de l'autorisation parentale, tant en ce qui concerne la contraception que l'avortement. Pour autant, M. Lucien Neuwirth vient de soulever un vrai problème concernant le code civil. Je crois qu'il faut le prendre avec beaucoup de sérieux sur le plan juridique pour ne pas risquer, ensuite, de voir le texte annulé lors d'un quelconque recours. Il faut donc bien voir que dans notre code civil la responsabilité sanitaire et morale d'un mineur incombe à ses parents et donc parvenir à étudier la question de manière très complète. M. Lucien Neuwirth vient d'évoquer la possibilité d'une éventuelle responsabilité sanitaire à seize ans. Cela me paraît contestable sur le plan éthique ; ensuite, selon moi, la suppression de l'autorisation parentale devrait valoir aussi bien à quinze ans qu'à quatorze ans. C'est une question de dignité, de liberté de son corps. M. Lucien Neuwirth : Egalement de maturité ! Mme Roselyne Bachelot : Une telle mesure ne fera que reculer les difficultés ! Certains se sont battus en faveur d'une piste très intéressante, mais qui demanderait une réflexion plus approfondie, en proposant une sorte de statut de la prémajorité. On pourrait imaginer un texte ample qui définirait des droits et éviterait la rupture brutale qui existe maintenant entre dix-sept ans et onze mois où l'on a aucun droit et dix-huit ans et un jour on les a brutalement tous. Cela étant, une telle réflexion allongerait beaucoup nos travaux et présenterait peut-être l'inconvénient de retarder les solutions sous prétexte de mieux faire : à force de vouloir faire mieux, on finit souvent par ne rien faire. Je me demande donc si la bonne piste ne serait pas de considérer que ces dispositions du code civil contreviennent à celles de la Convention des droits de l'enfant qui définit des droits de liberté et d'identité. Mme Martine Lignières-Cassou, présidente : Dans la législation actuelle, outre cet article du code civil qui est fondamental, nous avons toute une série de textes qui, d'ores et déjà, accordent aux mineurs certaines libertés dont la jouissance de leur corps à partir de quinze ans. Je vous rappelle, en effet, qu'à partir de cet âge, il n'y a plus de poursuites pour détournement de mineur. La loi reconnaît également déjà aux mineurs une certaine vie sexuelle, ainsi que le droit d'être entendu par le juge dès l'âge de treize ans. Mme Roselyne Bachelot : Je pose le problème sur un plan technique et juridique de façon à éviter de nous trouver face à un recours s'appuyant sur le fameux article 371 du code civil. Il faut essayer de contourner l'obstacle. Mme Yvette Roudy : Il y a la loi, les textes, mais il y a la vie ! Si la discussion qui nous réunit aujourd'hui a lieu, c'est parce que le problème des grossesses précoces nous a explosé au visage et qu'il a conduit, dans un certain désordre et une certaine improvisation, le législateur à intervenir. Je souhaiterais donc partir des faits en rappelant que force est de constater que, dans notre société, c'est de plus en plus jeunes que les jeunes filles ont des enfants. Mme Martine Lignières-Cassou, présidente : L'âge moyen du premier rapport sexuel n'a pas bougé : il reste à dix-sept ans. Mme Yvette Roudy : Les rapports de l'ONU rapportent que, globalement, les maternités sont de plus en plus précoces et c'est pourquoi il est demandé de faire davantage d'information à l'école et dans les lieux fréquentés par les jeunes. L'idée selon laquelle les enfants doivent naturellement se tourner vers leurs parents est tout à fait sympathique, mais on s'est aperçu qu'en pratique elle ne fonctionne pas toujours, et c'est un euphémisme, puisqu'il y a même des cas où les enfants ne se tournent surtout pas vers leurs parents. Par conséquent, lorsqu'un adolescent se trouve dans une situation où il a besoin de parler, envie de communiquer, il faut qu'il y ait des lieux et des personnes qu'il connaisse, qu'il puisse identifier, dont il puisse s'assurer de la discrétion et en qui il puisse avoir confiance, ce qui n'existe pas encore chez nous. Si l'on parle tant des infirmières c'est que, par la force des choses, elles sont dans de nombreux cas amenées à jouer ce rôle. Maintenant, sont-elles prêtes, formées et sommes-nous en droit d'attendre cela d'elles ? Je l'ignore. Je crois que, dans nos propositions, nous devrons penser à ces lieux, à ces personnes vers qui l'adolescent, garçon ou fille, doit pouvoir aller s'informer et poser des questions. Il s'agit d'information sexuelle générale, actuellement dispensée par des personnes qui ne sont pas forcément préparées, parce qu'elle n'a pas encore été vraiment prise au sérieux dans notre pays. Il faudrait maintenant se saisir du problème à « bras-le-corps », si j'ose dire, et voir avec les personnes qui ont réfléchi à la question, quelle est la structure à prévoir pour le résoudre. La médecine, la science ont prévu des moyens : il faudra demander aux juristes d'adapter les textes mais encore faut-il pour cela que nous sachions ce que nous voulons, nous, obtenir. Il s'agit, avant tout, d'une question de volonté politique. Mme Martine Lignières-Cassou, présidente : Je suis tout à fait d'accord avec votre proposition sur la création de lieux d'information permanents et identifiables pour les jeunes. On en a d'ailleurs bien vu la nécessité en tirant le bilan de la campagne nationale d'information sur la contraception qui a été conduite durant l'hiver 2000. Cela étant, je voudrais revenir sur l'intervention de Mme Roselyne Bachelot car, concernant l'arrêt du Conseil d'Etat portant sur le Norlévo, les attendus font simplement état de la distribution par l'infirmière. Donc, l'aspect de la question que vous avez soulevé se trouve résolu. Mme Roselyne Bachelot : Mais, comme c'était un acte administratif, l'affaire n'a été traduite que devant le Conseil d'Etat et non pas devant le Conseil constitutionnel. Mme Nicole Catala : On ne peut pas imaginer de supprimer les dispositions précitées du code civil. Cela reviendrait à déresponsabiliser les parents, dont on sait que dans certaines familles ils sont déjà défaillants. Quand on a abaissé la majorité à dix-huit ans, certains parents ont dit à leurs enfants de prendre la porte et de se débrouiller : cela a été fréquent. M. Lucien Neuwirth : Il y a un autre problème qui commence à m'angoisser : depuis un certain temps, on me demande de faire des conférences sur la Résistance -que je connais bien puisque j'y suis entré à l'âge de seize ans- devant des élèves qui préparent en fin d'année des dissertations sur le sujet. Or, je suis frappé par la boulimie des questions qui me sont posées : j'ai le sentiment que, sur ce sujet comme sur d'autres, la communication passe de moins en moins entre parents et enfants. Elle commence à se rétablir entre grands-parents et petits-enfants mais, entre parents et enfants, le silence est terrible. Je suis frappé de constater qu'il n'y a plus entre parents et enfants la communication qui existait auparavant. Il nous faut donc peut-être nous saisir du problème pour proposer aux enfants des lieux où ils pourraient parler et être écoutés. L'écoute est absolument nécessaire, d'où l'engouement pour l'Internet où l'on peut échanger et communiquer. Il y a un important besoin de communication qui n'est pas satisfait. Mme Martine Lignières-Cassou, présidente : Monsieur le sénateur, dans la loi de 1967, la publicité sur la contraception est interdite. Que pensez-vous, avec le recul, de cette disposition ? M. Lucien Neuwirth : On peut procéder à un nettoyage et à un élagage de la législation, dans la mesure où des renseignements, aujourd'hui donnés par téléphone, voire par Internet, pourraient, si on tombait sur un magistrat sourcilleux, donner lieu à poursuites. Ce qui est uniquement mis en cause par l'article 5 de la loi, c'est la publicité commerciale concernant les contraceptifs en dehors des revues médicales. Mme Roselyne Bachelot : De toute façon, cela renvoie à un autre problème, à savoir que la législation de la sécurité sociale interdit de faire de la publicité pour des produits remboursés, puisqu'on n'a pas le droit d'inciter à des dépenses remboursées par la sécurité sociale. En conséquence, pour tout ce qui touche aux contraceptifs remboursés, nous nous heurterons à des mesures qui ne sont pas d'ordre sanitaire, mais économique. Mme Danielle Bousquet : Tous les contraceptifs ne sont pas remboursés. Mme Roselyne Bachelot : Ceux qui sont au tableau relèvent d'une autre législation qui leur interdit de bénéficier de publicité puisqu'on n'a pas le droit de se les procurer sans ordonnance. La publicité ne peut donc s'exercer qu'en direction du corps médical. Mme Martine Lignières-Cassou, présidente : Un certain nombre de contraceptifs sortent désormais sans contre-indication. Ce phénomène, que nous connaissons avec le Norlévo, nous risquons de le retrouver dans les années qui viennent avec des pilules contraceptives à prise régulière : ce sont des pilules qui, au vu de l'application de la directive européenne, pourront ne pas être obligatoirement prescrites par un médecin, mais également ne pas être remboursées par la sécurité sociale. M. Lucien Neuwirth : J'estime qu'il faut prendre le problème de la contraception avec un certain calme, qu'il ne faut pas se crisper, mais l'étudier avec bon sens et sérieux et je suis convaincu que nous allons trouver la solution. Audition de Mme Maya Surduts, secrétaire générale, et de Mmes Valérie Haudiquet, Danielle Abramovici et Marie-Caroline Guérin, membres de la Coordination nationale pour le droit à l'avortement et à la contraception (CADAC), Réunion du mardi 19 septembre 2000 Présidence de Mme Martine Lignières-Cassou, présidente Mme Martine Lignières-Cassou, présidente : Mes chers collègues, nous accueillons aujourd'hui Mme Maya Surduts, secrétaire générale, et Mmes Valérie Haudiquet, Danielle Abramovici et Marie-Caroline Guérin, membres de la Coordination nationale pour le droit à l'avortement et à la contraception (CADAC), association loi de 1901, créée en octobre 1990 pour lutter contre les actions commandos menées contre les CIVG. La CADAC s'est particulièrement préoccupée du statut des CIVG et du remboursement des pilules contraceptives. Ce n'est pas une association de praticiens ou de terrain, elle ne reçoit donc pas directement le public ; c'est une association regroupant plusieurs associations. La Délégation aux droits des femmes ayant centré son rapport annuel sur le thème de l'IVG et de la contraception, nous avons souhaité vous rencontrer pour évoquer avec vous ces questions, dans la perspective du projet de loi annoncé par Mme Martine Aubry, qui doit être adopté en Conseil des ministres le 4 octobre prochain et qui porte sur la révision de la loi Veil et de la loi Neuwirth. Mme Maya Surduts : En premier lieu, je souhaite vous transmettre divers documents concernant la CADAC, ainsi que deux pétitions récentes lancées par la CADAC, le Planning familial et l'ANCIC, avec lesquels nous travaillons en partenariat depuis des années. Ces deux pétitions, qui expriment nos positions en matière d'IVG, ont été élaborées au mois de juillet, l'une à destination des femmes et l'autre à destination des professionnels de santé. Je voudrais appeler votre attention sur deux points. D'une part, nous siégeons au comité de pilotage du projet de loi sur l'IVG et la contraception et nous avons donc accompagné tout son processus d'élaboration. D'autre part, ayant été à un moment donné très préoccupées par la tournure prise par les événements, nous avons fait ce que nous pensions utile auprès des médias. Nous sommes extrêmement satisfaites de voir, après vingt-cinq ans, que ce gouvernement a enfin créé les conditions favorables à l'adoption d'une réforme. Mme Martine Aubry avait demandé au Professeur Israël Nisand en 1998, un rapport faisant le point de l'application des lois sur l'avortement et la contraception. Je tiens néanmoins à souligner brièvement à quel point les trois organisations - Mouvement français pour le planning familial, Association nationale des centres IVG et contraception (ANCIC) et CADAC - ont été déçues par le comportement de M. Israël Nisand. Ces trois associations, qui ont travaillé sans relâche pendant un an avec lui, ont ressenti un véritable sentiment de trahison. Nous avions même craint, à un moment donné, que le gouvernement ne soit influencé par ses prises de position, mais nous sommes satisfaites de constater que tel n'est pas le cas. Nous savons également qu'un certain nombre d'entre vous ont beaucoup _uvré et se sont mobilisées afin de faire aboutir le processus de réforme. Nous tenons à dire notre satisfaction sur les dispositions concernant l'allongement des délais. La CADAC, le Planning familial et l'ANCIC se sont prononcés en faveur de la dépénalisation et de l'absence de délai, mais nous n'ignorons pas que ce délai de douze semaines permettra à une majorité de femmes (80 %) de trouver une solution en France. Il est inadmissible que la quatrième puissance mondiale accepte aujourd'hui que cinq mille femmes partent à l'étranger pour avoir une IVG. S'agissant des mineures, nous sommes favorables à la suppression de l'autorisation parentale. Néanmoins, nous prenons acte de l'avancée proposée qui permettra à une jeune femme, qui ne peut obtenir l'autorisation parentale, d'obtenir néanmoins une IVG ainsi qu'un accompagnement avant, pendant et après cet acte. Quant à la question de l'IVG pour les femmes étrangères, elle a été réglée définitivement le 22 juin dernier. En 1975, il n'était pas possible d'obtenir plus, mais les problèmes rencontrés aujourd'hui sont liés aux insuffisances de la loi. A l'époque, nous n'étions pas d'accord avec le non-remboursement de l'IVG, la France étant alors le seul pays à avoir une loi autorisant l'IVG, mais ne prévoyant pas son remboursement. Nous aurions d'ailleurs souhaité que ce remboursement entre dans le cadre du budget de la sécurité sociale et non pas qu'il figure dans un budget spécifique. S'agissant des mineures, il convient d'évoquer le problème des inégalités sociales, ainsi que de l'information permanente. Les hôpitaux doivent disposer de moyens et les CIVG et centres de contraception doivent avoir un véritable statut unique, ainsi que le stipule une circulaire de 1982 qui n'a jamais été appliquée. Cette circulaire de 1982 a été adoptée à la suite de deux manifestations, organisées en 1979, en faveur de CIVG et de centres de planification familiale uniques. Nous souhaitons le remboursement de tous les moyens de contraception et attendons avec impatience l'arrivée sur le marché de la pilule générique de troisième génération, car actuellement 1,6 million de femmes ne sont pas remboursées de leurs frais d'achat de cette pilule contraceptive. Mme Danielle Abramovici : Je suis infirmière au CIVG de l'hôpital Saint-Louis. Mme Maya Surduts a insisté sur le fait que nous sommes favorables à des centres uniques qui allient à la fois la contraception et l'IVG, car nous pensons important pour les femmes d'avoir une structure particulière. C'est une situation très difficile pour une femme, lorsqu'elle vient pour une IVG, soit de se retrouver dans un service de maternité et de côtoyer des femmes qui ont des bébés, soit d'aller dans un service de gynécologie où les femmes sont venues consulter pour des problèmes d'infertilité. La femme ne doit pas être culpabilisée lors d'une IVG : c'est un moment particulier de sa vie ; il est important qu'elle soit bien reçue par un personnel motivé et formé et non par un personnel de remplacement qui travaille à certains moments dans d'autres structures. Il faut des moyens et des médecins qui aient un statut spécifique, car les CIVG souffrent d'un problème de recrutement de médecins par manque d'attractivité de leur statut. Ils sont souvent composés de médecins vacataires, qui peuvent être remerciés du jour au lendemain. De plus, dans le cadre de leurs études, les médecins devraient recevoir une formation particulière à l'IVG. Cela permettrait d'éviter les situations dramatiques rencontrées pendant l'été, lorsque les CIVG sont fermés et que les femmes, par manque de médecins compétents et de CIVG, dépassent le délai légal et sont obligées de partir à l'étranger. Par ailleurs, la mise en place de structures de planning familial est nécessaire afin d'aider à la contraception et de permettre un suivi après l'IVG, de manière à ce que cette IVG ne soit qu'un passage dans la sexualité et la maternité des femmes. Au CIVG de l'hôpital Saint-Louis, nous avons dû nous adjoindre les services d'une assistante sociale, car de plus en plus de femmes dans la précarité venaient consulter dans des situations dramatiques. Ces centres spécialisés spécifiques sont importants car, comme à Saint-Louis où cela commence à se mettre en place, ils permettent d'établir des liens avec les lycées voisins et d'éduquer les jeunes dans un lieu privilégié et non pas dans un service hospitalier, où ils ont du mal à se rendre. Dans un centre spécifique, avec du personnel formé à cet effet, un travail peut se mettre en place avec les jeunes. En conclusion, il faut des moyens et des centres qui allient la contraception et l'interruption volontaire de grossesse et qui disposent du soutien de médecins motivés et informés. Nous sommes satisfaites que des moyens soient régulièrement alloués pour les CIVG. Néanmoins, il conviendrait d'en faire un suivi et que leurs critères d'attribution soient mieux précisés. Une des raisons pour laquelle il est préférable d'avoir des centres spécifiques, c'est que, si le CIVG fait partie d'un service hospitalier, par exemple la maternité, il peut y avoir un risque que les fonds soient alloués plus particulièrement à la maternité qu'au CIVG. Mme Valérie Haudiquet : S'agissant des mineures, je voudrais dire notre satisfaction que figure, dans les dispositions du projet de loi, la possibilité d'une IVG pour les mineures qui se trouvent dans l'incapacité d'obtenir l'autorisation parentale. Par ailleurs, s'agissant du financement et du remboursement de cet acte, étant donné que la plupart des mineures sont, du point de vue de leur sécurité sociale, dépendantes de leurs parents et que, lorsqu'elles ne peuvent obtenir leur autorisation, un remboursement de l'IVG par la Sécurité sociale des parents est évidemment exclu, nous souhaitons que soit prévue la possibilité d'une aide médicale pour les mineures, ainsi que pour les jeunes majeures encore dépendantes de l'assurance-maladie de leurs parents. Je souhaiterais également intervenir sur la question des commandos anti-avortement. Depuis 1995, nous avons dû nous mobiliser très fortement et très régulièrement contre des commandos qui mènent leurs actions devant des cliniques parisiennes. Grâce à la mobilisation et au rôle qu'ont joué certains élus, nous avons obtenu une prise de conscience. Les préfectures se sont prononcées pour l'interdiction de ce type de rassemblement au motif de trouble à l'ordre public. Ce motif ne nous satisfait pas pleinement, mais cette décision a été pour nous un soulagement. Or, nous avons subi un revers ces derniers mois, puisque cette décision de la préfecture a été contestée en justice, au nom du droit d'expression et de manifestation. De ce fait, depuis quelques mois, les actions commandos, en particulier dans le XIIIe arrondissement devant la clinique Jeanne d'Arc, ont repris. Presque chaque mois, un rassemblement d'opposants à l'avortement s'organise à proximité d'une clinique qui pratique des avortements. Nous avons pu constater que les opposants à l'avortement avaient de sérieux appuis juridiques et qu'ils ont su faire évoluer leur forme de manifestation. Nous avons toujours indiqué que les termes de la loi Neiertz nous satisfaisaient pleinement dans la définition qu'elle donnait du délit d'entrave à l'avortement, mais cette loi n'est pas appliquée, puisque ses opposants trouvent toujours le moyen de se rassembler à proximité des cliniques. Malgré notre mobilisation et le relais pris par des comités de quartier qui se sont constitués, qui se renouvellent et s'élargissent, nous ne parvenons pas à venir à bout de ce problème. Mme Marie-Caroline Guérin : Je voudrais revenir sur le problème des mineures qui connaissent un nombre de grossesses et d'avortements en augmentation. Pour nous, cette évolution est dramatique. Dès lors que des jeunes filles ou femmes ont des grossesses non désirées et avortent, c'est une situation d'échec. Il nous semble donc important de mener une vraie campagne d'information sur la contraception et non pas une campagne ponctuelle tous les dix ans. Il faut des campagnes d'information à répétition, chaque année, pour que quelque chose se mette réellement en place. Le phénomène du sida a généré des campagnes d'information sur le sida, mais le reste des problèmes est passé à la trappe. Nous souhaitons donc des informations différenciées, visibles et continues, sachant que les campagnes d'information touchent les jeunes de façon différente selon leur milieu social. Même si, à l'Education nationale, il existe des textes, ils restent quelquefois lettre morte sur un certain nombre de problèmes. La première difficulté vient du fait que tous les personnels doivent s'imprégner du contenu du texte et les faire vivre. Les circulaires du 19 novembre 1998 "éducation à la sexualité et prévention du sida" et du 24 novembre 1998 "orientation pour l'éducation à la santé à l'école et au collège" ont remplacé les circulaires de 1996. Ces circulaires de 1998 ont des objectifs spécifiques en ce qui concerne la mise en _uvre des enseignements, la formation des personnels, les séquences d'éducation à la sexualité. Néanmoins, dans la réalité, l'information à la sexualité s'avère difficile à mettre en place. Nous demandons notamment que le Planning familial puisse venir sur les plages horaires de l'éducation à la sexualité. Dans l'établissement où je travaillais l'an dernier, le Planning familial est venu faire de l'information dans toutes les classes du collège. Cela a été possible, car nous avions un personnel mobilisé, une infirmière bien rodée, et ne rencontrions aucune opposition de la part du chef d'établissement, ni des parents d'élèves. Dans ce cas de figure, il existe des possibilités de faire circuler une information à la sexualité. Le Planning familial l'a fait dans mon établissement en refusant les adultes, afin de laisser les élèves du collège s'exprimer entre eux, ce qui est une formule intéressante. Cela dépend des équipes qui viennent dans les établissements. Nous souhaitons que ces circulaires ne restent pas lettre morte et que l'on puisse mener un vrai travail en équipe. Il convient d'ailleurs de souligner que tous les établissements scolaires de l'Education nationale ne disposent pas tous d'une infirmière. Mme Martine Lignières-Cassou, présidente : Cette remarque est intéressante car, dans l'heure précédente, nous avons examiné la proposition de loi sur la contraception d'urgence. De fait, nous avons déjà évoqué et repris, dans nos recommandations, les points que vous soulignez. Mme Marie-Caroline Guérin : S'agissant des inégalités de traitement, un établissement peut cumuler plusieurs handicaps. Un petit établissement en zone rurale n'aura ainsi ni infirmière, ni centre IVG à proximité. Sans même évoquer les zones rurales, j'ai une amie qui travaille dans un petit collège au Kremlin-Bicêtre qui vient d'obtenir, pour la première fois, une infirmière, une demi-journée par semaine. L'information doit se faire non seulement dans les médias, mais aussi dans les lieux où les jeunes sont présents, la scolarité étant une phase importante de leur cursus ; néanmoins, il ne faut pas oublier tous ceux qui ont "décroché" du système scolaire. De plus, nous tenons à ce que soit réintroduite la contraception d'urgence dans les établissements scolaires. Mme Martine Lignières-Cassou, présidente : Sur ce dernier point, vous êtes dans le droit fil de ce que nous proposons en matière d'information à la contraception et à la sexualité dans les collèges. Outre la présence d'infirmières et le fait que l'enseignement dispensé en quatrième et troisième ne doive pas être uniquement théorique, nous proposons de faire des comités d'éducation à la santé et à la citoyenneté les pivots de la coordination des équipes internes et externes des établissements du secondaire. Par ailleurs, lorsque nous avons reçu des représentants des lycéens, la semaine dernière, nous avons été frappées par le fait qu'un certain nombre d'entre eux sont tout à fait désireux de se former et de mener des groupes de parole de jeunes sur ces questions. Il y a donc là des dynamiques que l'on peut enclencher et qui peuvent dépasser le cadre académique. Vous avez, dans votre introduction, insisté sur l'intérêt d'une structure unique pour les CIVG et les centres de planification. On sait aujourd'hui que les CIVG ne se présentent pas tous sous cette configuration, car certains sont rattachés à des maternités et d'autres sont autonomes. Selon votre analyse, l'autonomie des centres semble être un point essentiel. Or, jusqu'à ce jour, dans le cadre des débats que nous avons eus, lors du colloque qui s'est tenu fin mai ou des auditions ultérieures, ce point n'est pas apparu très fortement. Il serait intéressant d'y revenir car, pour ma part, je suis quelque peu surprise de cette revendication. Nous avons noté vos remarques concernant les difficultés d'application de la loi Neiertz en ce qui concerne les commandos anti-IVG. C'est un point sur lequel nous devrons prochainement nous pencher. Lors de sa conférence de presse, au mois de juillet dernier, Mme Martine Aubry, ministre de l'Emploi et de la solidarité, avait insisté sur le fait que des permanences téléphoniques seraient mises en place cet été. J'aurais souhaité savoir si elles ont fonctionné ou non, et le bilan que vous en faites. Je souhaiterais également connaître votre appréciation sur les commissions régionales de la naissance qui doivent prendre en compte la dimension IVG et contraception. Les associations sont-elles informées du fonctionnement et de la mise en place de ces différents outils ? Quelle est votre position sur l'entretien préalable obligatoire en matière d'IVG ? Enfin, sur un sujet qui me tient personnellement à c_ur, j'aurais souhaité savoir si vous avez travaillé sur la stérilisation volontaire comme moyen de contraception. Mme Muguette Jacquaint : Nous avons déjà mené une réflexion approfondie sur certaines des questions posées. Nous avions ainsi reçu les conseillères conjugales avec lesquelles nous avions discuté du problème de l'entretien préalable. Je partage les avis exprimés sur la contraception et son remboursement. Dans une ville comme la mienne, j'ai fait le constat que les jeunes filles continuent de prendre la pilule de la troisième génération, car on leur dit qu'elle est mieux dosée. Quand une jeune fille ou femme se trouve face à un médecin ou un gynécologue, comment pourrait-elle contester cette prescription, même si son remboursement lui pose de sérieux problèmes ? Depuis des années, on attend un rapport sur la pilule de la troisième génération. Au regard du nombre de jeunes filles et femmes qui utilisent cette pilule de la troisième génération comme moyen de contraception, il conviendrait peut-être d'insister sur son remboursement. Mme Hélène Mignon : Les centres uniques me semblent être un élément très important. Quand une jeune femme se retrouve dans une maternité pour subir une IVG, psychologiquement, ce n'est bon ni pour la femme, ni pour les soignants. Sur ce point, je suis catégorique. Ensuite, dans le cadre d'une pédagogie de la contraception, il vaut mieux avoir un centre spécifique où la femme reviendra et où le moment difficile qu'elle y a passé restera peut-être moins douloureux dans sa mémoire, car il aura été accompagné. Pour les médecins et les soignants, c'est une situation difficile que de voir se côtoyer des femmes qui viennent pour des raisons totalement opposées. Entre celles qui viennent dans le souhait d'une maternité et celles qui viennent pour une IVG, il y a forcément, à un moment donné, culpabilité des deux côtés. Mme Marie-Françoise Clergeau : Les centres uniques me semblent un point intéressant à approfondir. Mme Danielle Bousquet : Quand on parle de lieu unique et spécifique, je m'interroge sur sa signification. Dans la maternité de l'hôpital public de ma ville, il y a effectivement des locaux spécifiques, mais ils sont néanmoins situés dans le même immeuble. La maternité est au premier étage et le CIVG au rez-de-chaussée. En fait, quand on parle de lieu unique spécifique, il s'agit de ne pas faire se côtoyer dans la même salle d'attente des femmes enceintes ou venant pour une maternité et des femmes venant subir une IVG. En revanche, il est bon que des femmes, qui ont eu une grossesse et qui ensuite souhaitent une contraception, puissent également venir dans ce lieu. Ce lieu doit être ouvert à toutes les femmes souhaitant une contraception. On ne peut mettre à part celles qui ont avorté et leur donner un accès particulier à la contraception. En fait, c'est un lieu spécifique à certains moments et commun à d'autres. Il ne faut jamais créer de ghetto ou de culpabilisation. Mme Maya Surduts : Lors de votre colloque, il semble que ce sujet ait été peu débattu. Ces centres sont pourtant une revendication de longue date du Planning, de la CADAC et de l'ANCIC. Un des obstacles à leur mise en place vient d'un problème budgétaire, car ils dépendent, d'une part, du budget global de l'hôpital et, d'autre part, de la DDASS. Mais on peut passer outre à ce problème, si une volonté politique est réellement affirmée. Dans son rapport, le professeur Israël Nisand n'a pas évoqué les CIVG, car il est favorable à des unités fonctionnelles. Nous sommes en désaccord sur ce point. Pour le professeur Nisand, qui a tendance à théoriser son vécu, tout part de l'hôpital ; c'est ce qu'il a fait à Poissy, c'est ce qu'il fait à Strasbourg. Il a cependant été dans l'obligation d'évoquer les CIVG de la région parisienne où la situation est particulièrement mauvaise. En effet, les deux tiers des IVG sont pratiqués dans le secteur privé, le tiers restant étant effectué dans des centres précaires, localisés dans des hôpitaux, comme le Kremlin-Bicêtre, Béclère, Beaujon, Saint-Antoine, Broussais, Colombes, etc... En revanche, les hôpitaux les plus prestigieux de Paris -Cochin, l'Hôtel-Dieu, La Pitié-Salpétrière- ne pratiquent qu'un nombre totalement dérisoire d'IVG. C'est pourquoi il est nécessaire d'exercer un contrôle sur les financements, notamment sur les 12 millions de francs débloqués par Mme Martine Aubry pour le statut de médecin praticien hospitalier mi-temps, qui doivent être reconduits chaque année. Nous voulons avoir la certitude que ces fonds parviennent au bon endroit pour la pratique des IVG. L'hôpital Béclère a fait une grève en juin-juillet dernier en faveur de sept de ses médecins, qui ont tous finalement obtenu leur statut. Néanmoins, les personnels ont poursuivi leur grève, car le problème des conseillères conjugales et la revalorisation de leur salaire n'a pas été réglé. Cela fait partie de nos revendications. Mme Marie-Caroline Guérin : S'agissant des permanences téléphoniques pendant l'été, la région parisienne, notamment le département de Seine-Saint-Denis, a connu une situation très difficile, avec des avortements qui ont fini par coûter très cher, car pratiqués en Angleterre, pour des raisons de délai. Mme Maya Surduts : Nous avons assisté à des situations terribles. Il y avait tellement de demandes que des femmes ont été renvoyées des Pays-Bas. Par ailleurs, l'autre grand problème était celui du taux de change de la livre anglaise, qui a beaucoup augmenté. De ce fait, en se rendant en Grande-Bretagne, des femmes ont dû débourser des sommes de l'ordre de 5 ou 6 000 francs pour une IVG. S'agissant de l'entretien préalable, le Planning, la CADAC et l'ANCIC sont contre l'obligation de cet entretien. S'agissant des comités régionaux de la naissance, nous n'y participons pas, car nous sommes une structure militante et non pas une structure de terrain. Nous n'avons donc que des remontées fragmentaires ; il conviendrait de vous adresser au Planning et à l'ANCIC qui participent, dans certaines régions, à ces structures, pour avoir des éléments plus précis. S'agissant de la pilule générique que Mme Martine Aubry nous avait annoncée, nous l'attendons. Le brevet devait en principe tomber dans le domaine public au milieu de l'année 2000 et à la fin de cette année, une pilule générique aurait dû être disponible. Or, lors du dernier comité de pilotage "avortement et contraception", nous avons été informées que ce serait plutôt au début de l'année prochaine. Ce sujet a été une de nos préoccupations majeures lors de ce comité de pilotage. Il fallait non seulement mener une campagne d'information sur la contraception, mais également créer les conditions matérielles pour que toutes les femmes puissent accéder à la contraception. Les moyens dont disposent les laboratoires sont phénoménaux. Ce sont eux qui financent les revues médicales et nombre de médecins généralistes sont informés par les laboratoires. C'est ce qui explique cette diffusion massive. Un de nos principes en matière de contraception et d'avortement est que ce sont les femmes elles-mêmes qui décident et non pas les médecins. Ce sont les rares actes médicaux où la femme ne demande pas un diagnostic au médecin, mais lui indique ce qu'elle veut. Ce point heurte les médecins ; ils n'aiment pas que les femmes viennent leur indiquer ce qu'elles veulent, car ils considèrent que, par leur formation, ils sont les seuls à même de dire aux patientes ce dont elles ont besoin. De plus, être enceinte ou veiller au choix de sa fécondation n'est pas une maladie. On sent un problème central de pouvoir ou un enjeu autre que nous avons du mal à saisir. Existe-t-il une contradiction entre la bioéthique et l'IVG ? C'est ainsi que l'on pourrait expliquer la montée au créneau de MM. Frydman, Nisand et Cohen. Nous avons eu connaissance de la philosophie de leur lettre envoyée à Mme Martine Aubry, dans laquelle ils faisaient part de leur crainte d'une hécatombe si les femmes décidaient d'une IVG après des tests prénataux. Il me semble que des enjeux politiques très importants, dans le domaine de la bioéthique, jouent contre les femmes. Il faut également accepter l'évolution des mentalités et de la réalité, par exemple le fait que les femmes ont des relations sexuelles plus précoces. Les lois doivent être en harmonie avec la réalité. Mme Valérie Haudiquet : S'agissant de l'entretien préalable, nous sommes opposées à son caractère obligatoire. Pour autant nous ne voulons pas que les conseillères et les autres personnels, qui sont là pour assurer l'accueil des femmes, disparaissent. Nous sommes pour que des entretiens soient proposés, mais sans leur donner un caractère obligatoire, car cela dénature leur objet. On pourrait imaginer, dans certains cas, que l'entretien ait lieu après l'IVG ou au moment souhaité par la femme. Certaines organisations d'opposants à l'avortement obtiennent encore actuellement l'agrément leur permettant de recevoir les femmes lors de ces entretiens. Les coordonnées de ces associations sont contenues dans le dossier que reçoivent les femmes qui veulent avorter. Quand elles se retrouvent, par méconnaissance, dans un lieu où on leur parle du bébé et des possibilités de le faire adopter, on peut imaginer les réactions que cela peut provoquer. Mme Danielle Abramovici : Je voudrais revenir sur l'IVG à l'hôpital. Au départ, la loi prévoyait qu'un certain pourcentage d'IVG serait pratiqué, dans tous les services de chirurgie, mais cela n'a jamais été appliqué. Une des raisons en est la clause de conscience des médecins. Sous prétexte de cette clause, certains médecins n'autorisent pas, dans leur service, la pratique des IVG. Sans l'exprimer officiellement, ils refusent les médecins volontaires pour pratiquer des IVG qui se présentent. Le choix de sa sexualité, de sa maternité et de sa contraception revient à la femme, qui ne doit subir aucune pression. C'est pourquoi, il est nécessaire d'avoir des structures spécifiques ayant du personnel volontaire, motivé et en mesure d'aider la femme. Même si la contraception ne doit pas uniquement se faire dans ce cadre, un centre spécifique peut être un moyen de déculpabiliser la femme, en lui montrant que ce n'est pas seulement un centre IVG, mais que c'est également un centre où elle peut parler de sa sexualité, de ses problèmes de contraception, voire de maternité, d'infertilité, des relations avec son mari. C'est la raison pour laquelle il y faut des personnels du Planning familial, des psychologues et des moyens qu'on ne peut avoir dans un service de maternité ou de gynécologie. C'est une structure à laquelle les soignants tiennent. Avant de travailler à l'hôpital Saint-Louis, je travaillais à l'hôpital de la Pitié-Salpétrière. Je voyais que mes collègues du service gynécologique vivaient mal leurs relations avec les femmes qui venaient et revenaient pour une IVG, car, en fait, on ne leur avait proposé aucune contraception. Un lieu spécifique ne signifie pas cependant un lieu caché dans l'hôpital. Par ailleurs, il devrait être possible de choisir sa méthode d'IVG et pouvoir utiliser le RU486 dans des centres, pour des grossesses très précoces. De tels centres n'ont pas besoin d'être très sophistiqués ni de proposer des soins. Mme Martine Lignières-Cassou, présidente : Le projet de loi devrait permettre de pratiquer l'IVG médicamenteuse hors de l'hôpital. Ce point me paraît très important, car, dans un hôpital, on effectue un acte chirurgical, mais dès lors qu'on effectue un acte médicamenteux, on change la nature de l'acte ; il n'est alors plus nécessaire d'être à l'hôpital. Mme Danielle Bousquet : Vous avez évoqué tout à l'heure un centre spécifique, ce sur quoi nous sommes d'accord, avec du personnel formé et motivé. C'est mon souhait, mais comment des gens peuvent-ils être formés et motivés, dès lors que l'on sait que les IVG sont souvent pratiquées par des militants de la génération précédente, qu'il n'y a pas de relève et qu'on a le plus grand mal à trouver des remplaçants ? Par exemple, à l'hôpital central de mon département, il a fallu trouver un remplaçant à l'un des médecins qui pratiquait les IVG. Nous avons écrit aux six cents médecins du département en leur proposant d'être vacataires. Quatre ont répondu. Voilà la réalité. Comment mobiliser les médecins ? Peut-on le faire au travers d'une augmentation de leur rémunération ? Avez-vous mené une réflexion sur ce point ? Mme Danielle Abramovici : En premier lieu, il faudrait donner une autre idée de l'IVG, car les médecins la considèrent encore comme un acte militant. Il faudrait que l'IVG soit présentée, dans la formation médicale, comme un acte médical normal. Mme Martine Lignières-Cassou, présidente : En écoutant différents témoignages, lors du colloque ou d'auditions ultérieures, j'ai été frappée par le fait que, dans l'esprit des gens, vingt-cinq plus tard, l'IVG est toujours considérée comme un échec et, de ce fait, n'est pas un droit. Mme Maya Surduts : C'est tabou. Mme Danielle Bousquet : C'est toléré, mais on ne fait pas changer les mentalités par la loi. Mme Danielle Abramovici : Le statut des médecins est une composante importante de ce problème. Mme Martine Lignières-Cassou, présidente : Il est inacceptable qu'une demi-journée de vacation soit payée 250 francs. Mme Maya Surduts : C'est pourquoi nous insistons pour qu'il existe des centres où l'on ne pratique pas uniquement les IVG à la chaîne, comme c'est parfois le cas. Afin de donner une autre image de ces centres, il leur faudrait intégrer l'ensemble de la réalité de la vie des femmes en matière de sexualité, que ce soit la contraception, les MST ou la ménopause. La fonction des médecins prendrait alors un autre sens. La pratique de l'IVG doit être incluse dans le cursus de formation et valorisée en termes financiers. Quand les militants, qui sont là depuis vingt ans vont partir, il n'y aura pas de relève. C'est une autre conception de cet acte qu'il faut avoir. Quand on entend certains dramatiser l'acte, dire que c'est le dernier recours, il faut aussi insister sur le fait que c'est une des grandes conquêtes de ce siècle. Non seulement cela a mis fin à la fatalité des grossesses non désirées et aux décès des femmes, mais cela reconnaît également une autre place aux femmes dans la société que celle d'être sur terre pour faire des enfants. Si ces points sont à mettre en évidence, il ne faut pas non plus occulter le fait que l'IVG fait partie du parcours de la vie d'une femme. La moitié des femmes avortent au moins une fois dans leur vie. L'avortement cristallise les rapports de domination homme/femme. Par ailleurs, le traitement que les télévisions ont fait des actions commandos a été dramatique. On montrait du sang, c'était le spectacle. On a dit qu'avorter c'est tuer, que la loi Veil est un génocide, pire que l'holocauste. Nos amis du Planning familial constatent que les femmes arrivent de plus en plus culpabilisées. Au sein de la CADAC, nous avons même eu des discussions où certaines disaient ne connaître personne dans leur entourage qui ait avorté. Ce n'est pas vrai. L'IVG ne concerne pas que des femmes jeunes ; il y a des femmes de tous les âges et de toutes les catégories sociales. Mme Marie-Françoise Clergeau : Les commandos anti-IVG mènent des actions à Paris, Nantes, et commencent à Strasbourg et Lyon. Par ailleurs, je voudrais savoir la façon dont vous avez ressenti la campagne sur la contraception qui a eu lieu il y a quelques mois. Mme Marie-Caroline Guérin : Elle a été invisible. Mme Maya Surduts : Insuffisante. Mme Marie-Caroline Guérin : Dans l'établissement où j'étais l'an dernier, l'infirmière a mis en évidence les dépliants envoyés dans les établissements scolaires, mais il n'est pas certain que cela soit le cas dans tous les établissements de France. Mme Martine Lignières-Cassou, présidente : Y a-t-il d'autres points que vous souhaitiez soulever ? Mme Maya Surduts : Le projet de loi doit à tout prix être adopté cette année. Mme Martine Lignières-Cassou, présidente : La première lecture devrait intervenir fin novembre ou début décembre. Mme Maya Surduts : Mme Martine Aubry déposera le projet lors du Conseil des ministres du 4 octobre. Ce qui est très positif, c'est qu'il n'y aura désormais qu'une seule loi relative à l'IVG et à la contraception. C'est une avancée considérable au niveau des mentalités qui permet de déculpabiliser les femmes. Plus la législation est libérale et moins on rencontre de problèmes. Mme Martine Lignières-Cassou, présidente : En ce qui concerne le délit d'entrave des commandos anti-IVG, nous avions pensé proposer un amendement. Dans le code de la santé publique, la sanction appliquée aux commandos anti-IVG est de 30 000 francs d'amende ou deux ans de prison. Doit-on augmenter ou non les sanctions ? Mme Maya Surduts : Les actions ne se font plus à l'intérieur des centres, mais dans l'enceinte de l'hôpital, comme ce fut le cas à Saint-Louis, ou dans des hôpitaux de province et quelques cliniques. Mme Marie-Caroline Guérin : Mais la justice ne l'interprète plus comme un délit d'entrave à l'IVG. Mme Muguette Jacquaint : Car il existe un droit de manifestation. Mme Maya Surduts : Quand la police encadre l'entrée et la sortie d'une rue où se trouve un centre faisant l'objet d'actions commandos, le riverain doit montrer patte blanche pour accéder à la rue elle-même, ce qui n'est pas une situation normale et dont on peut dire qu'elle perturbe l'ordre public. Mme Maya Surduts : Nous nous sommes constituées partie civile devant le tribunal administratif de Paris. Mais, dans un jugement du 17 mars 1999, rendu à l'occasion de la relaxe du Docteur Dor, la Cour d'Appel de Paris a considéré que la loi Neiertz réprimant les manifestations perturbant les centres d'IVG ne pouvait être appliquée sans atteinte à la liberté de manifester. Audition de Mme Martine Aubry, ministre de l'emploi et de la solidarité, Mme Ségolène Royal, ministre déléguée à la famille et à l'enfance, et Mme Dominique Gillot, secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés Réunion du mardi 3 octobre 2000 Présidence de Mme Martine Lignières-Cassou, présidente Mme Martine Lignières-Cassou, présidente : Je vous remercie, Monsieur le président de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, d'accueillir, dans votre salle de réunion, la Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes. Nous sommes aujourd'hui réunis avec nos collègues de cette commission pour recevoir Mme Martine Aubry, ministre de l'emploi et de la solidarité, ainsi que Mmes Ségolène Royal, ministre déléguée à la famille et à l'enfance, et Dominique Gillot, secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés. La Délégation aux droits des femmes a déjà eu l'occasion d'entendre, au mois de mars dernier, Mme Dominique Gillot, venue nous parler des problèmes de gynécologie médicale et d'IVG ainsi qu'au mois de juillet, Mme Ségolène Royal, venue nous présenter les résultats de la conférence de la famille et les problèmes liés à la contraception d'urgence. Notre Délégation a également organisé, au mois de mai dernier, un colloque sur le thème de l'IVG et de la contraception, dont les travaux étaient axés sur les problèmes d'accueil dans les structures publiques et d'allongement des délais ainsi que sur les problèmes rencontrés par les femmes étrangères - problèmes qui ont été réglés Comme vous le voyez, les thèmes de l'IVG et de la contraception des femmes sont au c_ur des préoccupations de la Délégation aux droits des femmes et seront d'ailleurs le thème de notre premier rapport annuel, puisque, comme vous ne l'ignorez pas, notre Délégation aura bientôt une année d'existence. Nous sommes, aujourd'hui, particulièrement heureux et heureuses de vous accueillir pour que vous nous exposiez, en avant-première, le projet de loi sur l'IVG et la contraception. Tout le monde a pris conscience que la société a évolué et que s'impose une révision des lois Neuwirth et Veil. Vous-même, Mme la Ministre, dès 1998, avez commandé différents rapports sur l'IVG, notamment aux professeurs Israël Nisand et Michèle Uzan. Vous avez également envoyé, au mois de novembre 1999, une circulaire aux directeurs d'hôpitaux relative la prise en charge des IVG dans les structures publiques. Demain, vous présenterez en Conseil des ministres un projet de loi dont nous souhaitons l'inscription rapide à l'ordre du jour de l'Assemblée et une adoption définitive avant le printemps prochain. Mme Martine Aubry, ministre de l'emploi et de la solidarité : Je vous remercie, Mme la présidente, de votre accueil et de nous avoir invité Dominique Gillot, Ségolène Royal et moi-même devant cette Délégation aux droits des femmes pour parler de la loi sur l'IVG, que je vais replacer dans le cadre général de l'action que nous menons sur les droits spécifiques des femmes - les droits à la contraception et à l'IVG. Je souhaite excuser l'absence de Mme Nicole Péry, qui se bat sur un autre terrain, puisqu'elle est actuellement au Sénat pour discuter de la proposition de loi relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes mais les propos que je vais tenir aujourd'hui sont bien ceux de ces quatre femmes, qui ont d'ailleurs fait des propositions communes au Premier Ministre, il y a maintenant plusieurs mois, pour faire avancer la contraception et l'accès à IVG dans notre pays. Je voudrais, en notre nom, vous dire combien nous sommes heureuses de constater que la parité règne au sein de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales. C'est un premier pas, qui ne nous étonne pas, quand on connaît son président, M. Jean Le Garrec, dont on sait le combat qu'il a mené pour le droit des femmes. Les hommes sont tellement rares à le faire que son action est à saluer et il est vrai que cette commission met la parité à l'ordre du jour. Nous savons que les droits des femmes ne sont jamais acquis et qu'il faut toujours se battre pour les maintenir. Ce ne sont pas les débats actuels qui nous démontreront le contraire. Ils sont l'occasion pour moi de saluer ceux et celles qui ont fait avancer ces droits, bien évidemment l'ensemble des femmes qui, à partir du Planning familial, des associations féministes et des associations pour le droit des femmes, ont permis à M. Neuwirth de déposer et faire voter la loi sur la contraception et ont donné à Mme Veil le courage de faire adopter la loi sur l'IVG, grâce, il faut bien le dire, au vote de la gauche. Il ne faut pas l'oublier aujourd'hui, car ce sont le combat de ces femmes et le courage des hommes et des femmes politiques qui, en votant ces textes, ont permis que les droits des femmes entrent dans la réalité. A notre arrivée en 1997, nous avons pu faire, avec un certain nombre d'entre vous d'ailleurs, un constat assez clair : il n'y avait pas eu de campagne générale sur la contraception depuis 1982, et si l'IVG ne s'était pas banalisée dans notre pays, comme le craignaient les adversaires de cette loi au moment de son vote en 1975, on comptait néanmoins, en France, plus de 200 000 IVG par an - chiffre très important par rapport aux 700 000 naissances enregistrées -, 10 000 grossesses non désirées chez les mineures dont 7 000 aboutissant à une IVG, et 5 à 6 000 femmes partant de France chaque année parce qu'elles ont décidé d'avoir recours à l'IVG et ne peuvent le faire dans les délais légaux fixés dans notre pays. Nous avons effectivement demandé aux professeurs Michèle Uzan et Israël Nisand de travailler sur les sujets de la contraception et de l'accès à l'IVG. Puis, j'ai demandé un rapport complémentaire, sur la pilule de troisième génération, au Professeur Spira, car il nous semblait nécessaire de traiter l'ensemble du problème, de la contraception à l'IVG. Nous avons, en juillet dernier, avec Mme Nicole Péry, annoncé un plan d'action destiné à faire progresser l'accès à l'IVG et la contraception dans notre pays. Nous n'avons conçu ce plan qu'après avoir lu les rapports, écouté nombre de spécialistes de ces questions, et avoir réuni pendant un an - de septembre 1998 à juillet 1999 - un comité de pilotage dans lequel étaient représentées les associations du Planning familial, des associations féministes, des associations familiales mais aussi des chercheurs et des professeurs, dont ceux que vous avez cités tout à l'heure. Avec eux, nous avons bâti un plan, annoncé en juillet 1999, qui s'articulait autour de trois idées clés. Il s'agissait, tout d'abord, de définir des politiques fortes d'accès en matière de contraception car, pour nous, l'IVG est bien un ultime recours et nous espérons faire en sorte qu'elle soit, chaque fois que possible, évitée, d'où l'importance que nous attachons à la contraception. Ensuite, tirant les conséquences des conclusions du "rapport Nisand", il convenait de rendre plus effectifs les droits existants en matière d'IVG, notamment l'accès à l'IVG dans les structures publiques. Enfin, ce plan invitait à travailler sur une éventuelle révision de la loi Veil, à laquelle nous nous sommes effectivement attelées cette année. Sur ces trois sujets, le Gouvernement a tenu parole et je vais maintenant évoquer devant vous les principaux points des deux premiers axes d'action, avant de parler de la révision de la loi Veil. Je crois en effet utile de la replacer dans un cadre plus général, car c'est bien ainsi que nous concevons le problème de l'IVG. Premier axe : mener une action forte en faveur de la contraception. Pour ce faire, vous le savez, nous avons mis en _uvre une vaste campagne d'information dotée d'un budget de 20 millions de francs, ciblée sur les populations les plus vulnérables et doublée d'une campagne dans les médias tournant autour de l'idée "La contraception : à vous de choisir la vôtre !", puisqu'aujourd'hui, le problème n'est pas le droit à la contraception mais bien le choix que chaque femme pourra faire de sa contraception ; cette campagne comportait une déclinaison particulière pour les DOM où le nombre d'IVG est particulièrement élevé ; elle était relayée par plusieurs milliers d'initiatives locales dont l'objectif était une information de proximité sur la contraception, à partir d'un guide de poche. La Délégation aux droits des femmes vient de dresser le bilan de l'ensemble de ces actions et vous verrez que les associations du Planning familial, les délégations départementales aux droits des femmes ou encore certains préfets, pour prendre des vecteurs différents, mais aussi diverses autres associations ont conduit des opérations très variées, allant d'actions dans les écoles à des pièces de théâtre, en passant par un travail auprès des détenus ou des gens du voyage, pour développer et faire connaître la contraception. Nous savions par ailleurs qu'il nous fallait atteindre une cible particulière, qui était celle des jeunes filles. En effet, la nécessaire diligence que les divers gouvernements ont eue pour faire connaître la nécessité du préservatif a entraîné, chez certaines d'entre elles, un oubli de la contraception, et, lorsque, après une relation relativement engagée avec un jeune homme, elles ont décidé de vivre avec lui, elles ont arrêté le préservatif, oubliant toute contraception. C'est ainsi que nous avons vu ces dernières années des IVG touchant des jeunes filles de milieux non difficiles, parfaitement informées sur le préservatif, par exemple, mais n'ayant plus la connaissance de la nécessité d'une contraception qu'avait pu avoir notre génération ; peut-être n'avons-nous pas rempli suffisamment notre travail d'information. Trois éléments sont à noter en ce qui concerne le bilan de cette campagne. Premièrement, un post-test réalisé par l'institut BVA fait ressortir que 40 % des Français déclarent avoir lu, vu ou entendu la campagne. Ce taux de mémorisation est très élevé pour les jeunes : 75 % pour les jeunes, 60 % pour les 15 à 25 ans et dans les DOM ; 91 % des personnes interrogées l'ont trouvée compréhensible et informative. En ce qui concerne la campagne grand média, le petit guide de poche que nous avons réalisé avec les associations, notamment avec le Planning familial, a servi de support à la mobilisation des acteurs de terrain. La campagne média a permis, me semble-t-il, de replacer la contraception au centre du débat public. Nous avions demandé, parallèlement au post-test de l'institut BVA, à une équipe de l'INSERM de travailler sur "l'avant et l'après" de cette campagne de contraception. Le rapport nous sera remis dans quelques jours, mais on peut déjà en donner les principales conclusions. Selon l'INSERM, une telle campagne ne peut pas être une simple campagne audiovisuelle, ce que nous savions, puisque nous avions mis en place d'autres actions de proximité. Le Docteur Nathalie Bajos, qui nous a présenté cette étude, nous a dit également qu'il faudrait essayer d'obtenir un changement de comportement des professionnels de santé - médecins généralistes, gynécologues, pharmaciens, infirmières scolaires - et faire en sorte que ces professionnels, qui sont chargés de prescrire, de distribuer ou d'administrer cette contraception, soient capables d'engager le plus tôt possible un dialogue avec les jeunes filles concernées. Je peux vous dire, d'ores et déjà, que le Gouvernement a décidé que cette campagne de contraception devrait être réitérée, année après année, et que les spots les mieux reçus seront repris dans une nouvelle campagne avant l'été 2001. De même, nous rééditons le guide de poche et organisons actuellement d'autres actions locales. Il nous faut donc maintenant établir le principe de campagnes régulières sur la contraception, car les nouvelles générations de jeunes filles ont besoin d'être informées. Nos efforts pour développer une politique active en matière de contraception ne se sont pas résumés à cette campagne sur la contraception. Tout d'abord, dès notre arrivée, nous avons incité à la mise sur le marché des premières pilules du lendemain : le Tétragynon, d'une part, et le Norlévo, d'autre part. Je ne m'étends pas sur la détermination qui a été la nôtre avec Bernard Kouchner pour faire en sorte, dans un premier temps, que cette pilule du lendemain puisse être mise en vente en pharmacie sans prescription médicale - la proposition de loi sur la contraception d'urgence permettra d'en assurer définitivement les bases - ni sur la détermination qui a été celle de Ségolène Royal, pour faire en sorte que des jeunes filles en situation d'urgence et de détresse puissent se la voir délivrée par les infirmières scolaires, sachant que dans notre esprit l'effet en est d'engager un dialogue avec la jeune fille et de la diriger vers un gynécologue ou un centre de Planning familial. Il ne s'agit, en aucun cas, de faire de la pilule du lendemain un moyen de contraception ordinaire. Ce serait une erreur totale. Il s'agit bien de gérer un problème de détresse pour, par la suite, entrer dans une contraception classique. Récemment encore - pour illustrer le fait que, sur ces problèmes, rien n'est jamais acquis - le laboratoire qui commercialise le Norlévo a décidé, après l'annulation par le Conseil d'Etat de la circulaire de Mme Ségolène Royal, d'en augmenter le prix. J'ai réagi aussitôt pour que le prix soit ramené au prix antérieur. On se rend bien compte que, dans ce domaine aussi, tout est toujours permis. De même, toujours à propos des moyens contraceptifs, nous avons fait en sorte que le recours au stérilet ne soit plus pénalisé pour des raisons financières, en fixant le prix de vente au public, qui était auparavant libre et de l'ordre de 300 francs, à 142 francs, remboursé à 65 % par la sécurité sociale. En conséquence, aujourd'hui, le coût d'un stérilet est de l'ordre de 50 francs pour une femme, alors qu'il était de 250 francs auparavant. Enfin, j'ai continué à _uvrer à la mise prochaine sur le marché d'un générique de la pilule de troisième génération alors même que, avec l'arrivée des brevets sur le marché, les laboratoires sont beaucoup plus ouverts qu'ils ne l'étaient, les années précédentes, pour accepter d'en réduire le prix. Je précise d'ailleurs qu'une étude nous pose problème en ce qui concerne les effets secondaires de la pilule de troisième génération ; aussi, avant de poursuivre les discussions, nous avons demandé une étude complémentaire sur ce point. Je vous rappelle que le "rapport Spira", que j'avais demandé à mon arrivée au ministère, confirmait que, s'il n'y avait pas d'apport supplémentaire en terme de contraception, il n'y avait pas non plus d'effets indésirables moins importants pour la pilule de troisième génération que pour celle de la deuxième génération. Cela ne justifiait en aucun cas que son prix puisse atteindre 130 francs alors qu'il est d'une quinzaine de francs pour une pilule de deuxième génération. Mais une étude récente laisse à penser que la pilule de troisième génération provoquerait certains effets indésirables. J'ai donc demandé que soit approfondie cette question avant de poursuivre les discussions sur son remboursement, à un tarif naturellement inférieur à celui d'aujourd'hui. Voilà pour la contraception ; nous devons donc continuer à lancer régulièrement des campagnes d'information et nous disposons maintenant d'un certain nombre d'outils à la disposition des femmes à des prix corrects. Deuxième axe : améliorer l'accès à l'IVG, notamment à l'hôpital public. Le "rapport Nisand" nous montrait que l'hôpital public ne remplissait pas totalement son rôle. L'accès à l'IVG des femmes au sein de l'hôpital pose problème, tout d'abord, parce qu'il mêle souvent des femmes enceintes qui viennent pour les visites prénatales à des femmes venues se faire pratiquer une IVG. Ensuite, certains hôpitaux ne laissent pas la possibilité de choix entre le RU 486, c'est-à-dire l'interruption médicamenteuse, et l'interruption médicale. Dès notre arrivée au Gouvernement, nous avons dû rechercher un laboratoire qui produise le RU 486, puisque le détenteur du brevet, le Docteur Sakiz, avait rompu avec le laboratoire qui le produisait et qu'à notre arrivée, le RU 486 n'était plus produit. Nous avons trouvé les moyens d'assurer sa production et, actuellement, il est exporté partout, même aux Etats-Unis. Nous faisons d'ailleurs des études pour savoir si son utilisation ne pourrait pas se faire au-delà du nombre de jours actuels. J'y reviendrais ultérieurement. Les points importants sont donc : l'accès à l'IVG ; le choix du type d'interruption de grossesse par la femme à chaque fois que c'est possible médicalement ; une interruption volontaire de grossesse dans les meilleures conditions possibles de sécurité et de soutien psychologique, lorsque cela est nécessaire ; et la nécessité d'un accompagnement à la sortie, car il est important que la femme ne sorte pas sans avoir eu une discussion sur sa contraception pour éviter une nouvelle IVG. Ce sont ces conditions d'accueil à l'hôpital que nous avons traitées, en ajoutant des moyens en personnel médical, en donnant le choix entre les diverses techniques, en élargissant les commissions régionales de naissance pour que chaque femme puisse, à partir d'un bureau ouvert dans chaque département, connaître les lieux d'accès à l'IVG à tout moment. De même, il y a maintenant une planification d'ouverture des centres pendant l'été, pour éviter les problèmes que nous avions constatés précédemment. Deux études réalisées pendant l'été 1999 et l'été 2000 montrent que, si tout n'est pas encore parfait, notamment en Ile-de-France, où il reste des problèmes lourds, cette planification a déjà été entreprise. Par ailleurs, nous avons souhaité que le bon fonctionnement de l'activité d'IVG soit pris en compte dans les contrats d'objectif signés entre les agences régionales hospitalières et les hôpitaux, pour que celle-ci soit prise en compte comme une réelle action de santé publique et non, comme c'est trop souvent le cas aujourd'hui, comme une action marginale. Un an après, le bilan est le suivant : renforcement des moyens en personnels et en argent ; mise en place d'une permanence téléphonique dans tous les départements, sauf un aujourd'hui - nous avons attribué 60 000 francs à chaque région pour sa mise en place ; planification durant l'été. Le problème demeure Paris intra muros ; paradoxalement, l'accès à l'IVG est plus facile dans des petites structures de petites villes que dans de grands hôpitaux des grandes villes, peut-être parce que certains professeurs considèrent que cette action n'est pas importante ou "intéressante" médicalement. Nous avons essayé de leur expliquer que l'important était de traiter les problèmes des femmes venues les voir et non pas de valoriser leurs propres actions. Les autres mesures du plan IVG seront progressivement mises en place. Vingt régions ont intégré les thèmes de la contraception et de l'IVG dans les missions de la commission régionale de naissance. Nous avons travaillé à faciliter le recours à l'IVG médicamenteuse. Nous avions saisi l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pour savoir si, comme à l'étranger, il était possible d'utiliser le RU 486 jusqu'au 63ème jour d'aménorrhée contre le 49ème jour aujourd'hui. L'AFSSAPS vient de répondre positivement. Des circulaires de bonne pratique vont être élaborées par l'ANAES dans les jours qui viennent. Voilà une présentation rapide du problème, mais il faudrait dire beaucoup encore, notamment notre souhait de faire en sorte que tout centre qui pratique les IVG soit, à terme, un centre qui puisse avoir accès à un bloc opératoire, comme cela est déjà le cas pour les IVG médicales, ainsi que sur la nécessité d'un soutien psychologique et de conseil en matière de contraception après une IVG. En ce qui concerne la révision de la loi Veil, troisième axe de notre plan d'action, nous nous étions donné un an pour y travailler, un an pour remettre les choses dans le bon ordre, c'est-à-dire parler d'abord de contraception et ensuite d'IVG ; un an pour travailler avec les experts et les médecins sur les diverses possibilités de modification de cette loi. En premier lieu, en ce qui concerne l'allongement du délai de dix à douze semaines, je rappelle que, dans quasiment tous les pays étrangers, notamment ceux qui ont récemment voté une loi sur l'avortement - comme l'Espagne et l'Italie - en se fondant sur les études médicales les plus récentes, c'est le délai de douze semaines qui a été retenu. Certains pays, comme la Grande-Bretagne, ont un délai de vingt-quatre semaines, hors interruptions médicales. C'est dire que la France avec ses dix semaines - qui s'expliquent en partie par le fait qu'elle avait voté une loi plus tôt que les autres - était en retard, si je puis dire, par rapport aux pays étrangers. Mais, nous nous devions - cela a été notre volonté à Nicole Péry, Dominique Gillot et moi-même - de vérifier qu'il n'y avait pas de problème de santé publique à passer de dix à douze semaines. Nous nous devions de poser la question de savoir s'il y avait nécessité de mettre en place des éléments particuliers en termes d'accompagnement médical et psychologique pour ce passage de dix à douze semaines. Après avoir réuni pendant un an un groupe de travail, la réponse de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation de santé (ANAES) a été de nous dire qu'avec les nouvelles techniques d'IVG, notamment ces médicaments qui permettent de dilater le col, la veille de l'intervention, il n'y avait pas de problème de santé publique particulier au passage de dix à douze semaines et qu'en conséquence, rien ne justifiait de prendre des mesures particulières sur le terrain médical. Je ne reviens pas sur le problème éthique qui a été traité lors du vote de la loi de 1975. D'ailleurs, le Comité national consultatif d'éthique n'a pas souhaité être saisi à nouveau de cette question, considérant qu'elle était derrière nous et que le passage de dix à douze semaines était un problème de santé publique. C'est donc bien sur ce problème que nous avons travaillé pendant un an avec l'ANAES ; après les multiples consultations que nous avons menées, nous avons présenté ces propositions. Le Professeur Israël Nisand, qui continue à préconiser le passage de dix à douze semaines, a néanmoins fait état, avant l'été, du fait qu'aujourd'hui, les nouvelles techniques d'échographie permettaient de déterminer, dès dix semaines, le sexe de l'enfant ainsi que certains handicaps. Il en avait à l'époque, tiré la conclusion - ce qu'il semble dénier aujourd'hui -, que les femmes pourraient pratiquer un certain "eugénisme ou des IVG de confort". Si nous n'avons pas été choquées, bien au contraire, du fait qu'il nous saisisse de ces nouvelles techniques échographiques, car nous devons prendre des décisions en toute connaissance de cause et qu'il était de sa responsabilité de le faire, je dois dire que nous avons toutes - je dis toutes, car ce sont des femmes qui se sont occupées de ce dossier, messieurs, mais je pourrais peut-être dire tous, vous nous le direz dans un moment - été choquées par ces termes. Chacun ici sait bien qu'une femme ne pratique pas une IVG par confort, que c'est toujours douloureux et traumatisant. Je donnerais pour preuve que cette tentation d'eugénisme n'a aucun sens, le fait qu'en Grande-Bretagne, où l'IVG peut être pratiquée jusqu'à vingt-quatre semaines, aucune modification n'est intervenue en ce qui concerne les raisons de demandes d'IVG ou le taux de naissance entre garçon et fille. C'est donc une question théorique, que seul un homme peut d'ailleurs se poser, me semble-t-il, et, évidemment, nous n'avons pas été amenées à retenir un tel sujet. Si dans quelques mois - comme les tests commencent à avoir lieu aujourd'hui - à partir d'une goutte de sang, on pourra connaître à partir de quatre ou cinq semaines le sexe de l'enfant, remettra-t-on en cause le droit à l'IVG ? Cela n'a aucun sens. Si nous croyons que les femmes doivent avoir le choix - et c'est notre cas - de la procréation ou de la non-procréation, cet acte doit leur appartenir en totalité. Il n'est pas question de les mettre sous une quelconque tutelle médicale, dès lors qu'il n'y a pas de problème de santé publique, ce que nous avons vérifié. Nous n'avons donc pas eu d'hésitation, à partir du moment où les problèmes de santé publique, les problèmes médicaux étaient traités, pour proposer d'allonger ce délai de dix à douze semaines. Le deuxième sujet qui nous était posé était celui de l'autorité parentale pour les mineures. Sur ce sujet, le débat a été, dès le départ, assez difficile car nous savons bien que nombre de mineures, de milieux qui peuvent être divers, n'ont pas la possibilité aujourd'hui d'obtenir une autorisation de leurs parents et pourraient prendre un risque pour leur santé, aussi bien physique que mentale, d'ailleurs. Certaines, refusant de la demander, ont aujourd'hui à nouveau recours à des pratiques que nous croyions oubliées dans notre pays, quand elles ne sont pas obligées de trouver de l'argent, par des moyens divers et variés, pour pouvoir aller à l'étranger. En même temps, je le dis clairement comme je l'avais dit dès juillet 1999, ce n'est pas au moment où nous accordons à la responsabilité parentale et à la consolidation des liens familiaux un poids particulier, au moment où nous demandons aux parents de prendre toutes leurs responsabilités de parents qu'il faut annuler cette obligation d'autorisation parentale pour les mineures, alors même, nous le savons, que la jeune fille vivra avec encore plus de difficulté ce moment traumatisant. Cela d'autant plus que, pour elle, c'est souvent un des premiers actes sexuels de sa vie, quand ce n'est pas une violence qui a entraîné la demande d'IVG. Aussi, après avoir beaucoup discuté avec les médecins qui les pratiquent, les infirmières et les assistantes sociales qui les reçoivent, il ressort très clairement que, dans trois cas sur quatre, la jeune fille dit qu'elle ne peut pas en parler à ses parents, mais que, dans 90 % des cas, après discussion avec l'assistante sociale et le médecin, après l'avoir aidée à trouver les mots, elle peut le faire. Je pense donc qu'il faut que nous gardions ce principe de l'autorisation parentale pour ne pas laisser seules ces enfants, parce que ce sont pour beaucoup des enfants, sans le soutien de leur famille et de leurs parents dans un moment difficile. Encore faut-il les aider à avoir ce dialogue, qui n'est pas facile. En même temps, la réalité est bien celle que nous connaissons. Il y a des jeunes filles - peu, quelques centaines - qui chaque année rencontrent de véritables difficultés. Aussi, proposons-nous, dans le projet de loi, de maintenir le principe de l'autorisation parentale mais de faire en sorte qu'après un premier entretien, au cours duquel le médecin aura entendu la jeune fille expliquer qu'elle ne peut pas en parler, après avoir essayé de la comprendre, essayé de l'inciter à en parler, cherché à la convaincre, que si cette jeune fille revient au second entretien avec l'incapacité d'en parler, il sera possible au médecin, non pas de passer outre à toute autorisation et accompagnement, mais de passer outre à l'autorisation des parents de la jeune fille, de permettre à celle-ci de venir accompagnée d'un adulte référent, adulte qu'elle devra choisir, soit dans sa famille soit, si elle n'a personne, au sein du Planning familial. Le Planning est tout à fait prêt à assumer cette tâche. Il nous semble que cette solution permet à la fois de conserver l'importance du rôle de la famille dans des moments douloureux pour les jeunes filles et de traiter d'autres cas tout aussi douloureux et même extrêmement dangereux pour la jeune fille, que nous connaissons aussi aujourd'hui. Troisièmement, nous proposons la suppression des sanctions pénales liées à la propagande et à la publicité pour l'IVG car, pour ne prendre qu'un seul exemple, le numéro vert que nous avons mis en place et qui permet aujourd'hui dans chaque département d'appeler pour savoir où l'on peut avoir une IVG, à quel moment et où sont les places disponibles, pourrait être considéré comme des informations et de la propagande pour l'IVG. Ces sanctions s'expliquaient bien à une certaine époque, elles n'ont plus de sens aujourd'hui. Nous avons, par ailleurs, intégré quelques modifications complémentaires dans le texte. La première consiste à faire en sorte que la prise en charge financière des IVG, réalisées sur des mineures qui souhaitent garder le secret, puisse être assumée intégralement par l'Etat, ticket modérateur compris, de façon à ce qu'aucune facture ne parvienne aux parents. La deuxième a pour objet d'ouvrir la possibilité qu'une IVG puisse éventuellement demain, si l'évolution des techniques l'autorise, se pratiquer en ambulatoire - on pense bien évidemment à l'IVG médicamenteuse - par des praticiens ayant passé convention avec un établissement de référence. Nous n'allons pas modifier cette loi de 1975 tous les jours, il faut donc anticiper sur les nouvelles techniques. La troisième modification vise à lever l'ambiguïté qui perdure sur le fait de savoir si un chef de service peut refuser d'organiser des IVG dans son service en invoquant la clause de conscience. Soyons clairs : la clause de conscience restera bien évidemment dans la loi, car chacun doit pouvoir ne pas réaliser, s'il le souhaite, une IVG, mais il nous semble qu'aujourd'hui, un chef de service ne peut pas accepter les fonctions de chef de service, s'il s'oppose à ce que ses collaborateurs pratiquent cette IVG dans son service. Il gardera la clause de conscience pour lui-même mais devra accepter, alors qu'il y a aujourd'hui des pressions très importantes, que l'IVG puisse avoir lieu dans son service. La quatrième modification a pour objet d'étendre aux Territoires d'Outre-Mer les dispositions du texte. Il nous est, en effet, apparu que ces mesures, parce qu'elles sont relatives au droit des personnes, devraient s'appliquer sans distinction à toutes les populations du territoire national. En ce qui concerne l'accès à l'IVG des étrangères en situation irrégulière, je vous confirme que le problème a été réglé lors de la recodification du code de la santé publique, en juin dernier. Enfin, nous travaillons actuellement avec le ministère de la justice pour proposer un amendement qui permettrait de "muscler" un peu la loi Neiertz, pour éviter que n'aient lieu des perturbations à l'accès à l'IVG ainsi qu'aux conditions de travail des personnels et d'accueil des patients. Je pense bien sûr aux actions de certaines associations, qui sont sanctionnées pénalement, mais dont certaines pratiques ne le sont pas. Nous avons donc tenu l'ensemble de nos engagements et respecté les délais que nous nous étions fixés avec l'idée de faire progresser les droits spécifiques des femmes mais aussi avec l'idée que la santé publique devait être notre mode d'approche de cette question. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes entourées du maximum d'avis médicaux afin de nous assurer que ce débat n'ouvrirait pas à nouveau le débat sur le droit à la contraception et l'accès à l'IVG dans notre pays mais, au contraire, le conforterait. M. Jean Le Garrec, président de la Commission des affaires culturelles, familiales et sociales : Mme la présidente de la Délégation aux droits des femmes, ma présence à votre côté est tout à fait volontaire et marque un symbole, celui de l'engagement du débat devant cette commission et devant votre Délégation. Mon propos se limitera à quelques remarques liminaires, étant donné que je suis en plein accord avec ce qui vient d'être exprimé par Mme Martine Aubry. Je voudrais, d'une part, rendre hommage à M. Lucien Neuwirth et à Mme Simone Veil qui ont mené, en leur temps, des combats extrêmement difficiles, que chacun a en mémoire, notamment celui de Mme Veil et, d'autre part, rappeler que, si j'étais présent dans le combat des droits des femmes, je n'en ai guère de mérite, car je ne fais qu'accompagner le combat de ma femme. Je raconterai simplement une petite anecdote : avant 1981, avant que je n'entre au gouvernement, pendant très longtemps, quand je tenais des réunions en province, après la sortie du premier livre de ma femme, qui portait le très beau titre des Messagères, on me demandait si j'étais le mari d'Evelyne Le Garrec. C'est le plus bel hommage que je puisse vous rendre, Mesdames. Pour revenir au débat de ce jour, vous avez raison de lier en permanence contraception, IVG et information. Il faut que ce discours soit nettement perçu, car on a tendance dans le débat à séparer les deux, ce qui est une erreur fondamentale. Vous avez souligné un aspect très important, celui des décalages de situations qui peuvent exister entre des structures différentes. Vous avez notamment fait remarquer que l'on trouvait probablement une meilleure approche des problèmes dans les petites structures, et une approche plus difficile dans les grandes. Nous devons y prendre garde, car cela peut créer des inégalités extrêmement lourdes. Votre souci de lier en permanence bloc médical, soutien psychologique et contraception me semble fondamental. J'insiste, pour ma part, sur le soutien psychologique car je suis de ceux qui ont été choqués - tout en respectant le professeur Israël Nisand - par l'utilisation de termes que nous ne pouvons accepter, ceux d'eugénisme et d'IVG de confort. Car ce n'est pas vrai. Pour toute femme, le recours à l'IVG est un traumatisme qui implique d'ailleurs un soutien psychologique. En la matière, Mme la ministre, cette dimension de votre réflexion est essentielle. Il faut poser le problème en des termes différents qu'il y a vingt ans. Vous avez raison de le poser en termes de santé publique. Nous vous soutenons en la matière. L'approche psychologique, qui est la marque d'un profond respect, et le fait d'assumer une responsabilité, qui est celles des femmes, doit être très nettement marquée dans nos positions et les discours que nous tiendrons. Croyez bien, mesdames les ministres, que nous seront à vos côtés dans ce combat et auprès de la Délégation aux droits des femmes. M. Michel Herbillon : Je poserai deux questions. Je sais que vous avez mis en place toute une série de barrières pour empêcher et prévenir les dérives et les dérapages qui peuvent exister dans ces domaines, mais comment pensez-vous éviter que la pilule du lendemain, qui ne devrait être qu'un moyen d'extrême urgence dans des cas de détresse, ne devienne un moyen de contraception plus ordinaire ? Vous avez indiqué que l'autorisation parentale restait nécessaire pour les mineures, sauf cas d'impossibilité majeure. Là aussi, ne craignez-vous pas que le recours à l'adulte référent ou au service du Planning familial ne devienne avec le temps une règle plus courante ? N'aurait-on pas pu imaginer des solutions pour, quoi qu'il arrive, essayer d'initier le dialogue, même s'il est difficile, surtout s'il est difficile, entre la jeune fille mineure et ses parents ? Mme Marie-Thérèse Boisseau : Tout d'abord, je suis pour ma part incapable de parler de droit à l'avortement. Nous n'avons pas droit à l'avortement... Mme Martine Aubry, ministre de l'emploi et de la solidarité : Je n'en ai pas parlé. J'ai parlé d'accès à l'IVG. Mme Marie-Thérèse Boisseau : ... mais je pense que la société a le devoir de venir en aide aux plus démunis. Nous avons aujourd'hui environ 220 000 avortements en France par an et 5 à 6 000 femmes qui vont à l'étranger. Je les ai rencontrées et je considère qu'elles sont parmi les femmes les plus démunies et que la société française a le devoir de régler les problèmes de ces femmes de ne pas les envoyer chez nos voisins. Passer de dix à douze semaines de grossesse ne résoudra pas les problèmes. On pourra discuter pour savoir si ce sont 40, 50 ou 80 % de femmes qui seront touchées par cette mesure. D'après les nombreux témoignages que j'ai eus, j'affirme qu'elles sont au maximum 40 %. Je vous pose donc la question très concrètement : que faites-vous pour les 60 % qui restent ? J'ai tendance, sans doute par déformation professionnelle, à faire confiance aux techniciens et aux praticiens et à beaucoup écouter et regarder avant de conclure. J'en ai rencontré beaucoup depuis un an et il est vrai que, du témoignage des uns et des autres, il ressort qu'il n'y a que peu d'avortements de confort. Mais il est vrai aussi que j'ai entendu parler, de toutes parts, de risques d'eugénisme. Cela vous arrange de les nier, mais il n'empêche que les spécialistes tirent, à ce sujet, la sonnette d'alarme. Je pense que vous faites un peu trop rapidement l'impasse sur ce grave problème. M. Denis Jacquat : Le texte présenté reflète une évolution nécessaire, qui demande cependant plus de garanties à mes yeux. Mme la ministre a évoqué le problème de la prévention, qui doit être renforcée, de l'éducation sexuelle à l'école, du rôle des parents et surtout celui des infirmières scolaires, ce qui m'inquiète beaucoup quand je vois leur nombre insuffisant. Je suis donc d'accord avec ce que vous avez dit, mais il faudrait nous donner plus de garanties. Par ailleurs, les sages-femmes nous ont saisis, car il apparaît que les infirmières auront le droit le donner la pilule du lendemain, alors que les sages-femmes libérales et même territoriales ou hospitalières ne l'ont pas. "C'est notre métier. Pourquoi pas nous", disaient-elles. M. Yves Bur : Le constat du nombre élevé d'avortements qui sont encore réalisés en France est un constat douloureux. Il nous appartient d'y apporter une réponse, certes de santé publique, mais aussi une réponse humaine. Il est absolument essentiel de rendre les politiques d'information et d'éducation plus efficaces. La nécessité de ces politiques avait déjà été soulignée, au moment du vote de la première loi, et nous ne sommes pas parvenus à des résultats probants. Il faudrait vraiment que des efforts particuliers soient consentis. Le développement du nombre des infirmières et de leurs fonctions en milieu scolaire, ainsi que tout ce qui a été engagé par le Gouvernement tout récemment va certainement dans le bon sens, mais ces efforts doivent pouvoir durer. C'est là que doit se porter l'effort, car les avortements ne sont que la résultante d'un ensemble d'échecs, dont l'échec en matière d'éducation et d'information. En ce qui concerne les risques d'eugénisme, il faut respecter ceux qui expriment de telles opinions, notamment le Professeur Israël Nisand. Cependant, si l'on veut dépasser le simple constat d'une divergence forte, ne serait-il pas souhaitable de consulter le Comité d'éthique, non pas sur le problème du délai, mais sur le risque d'eugénisme lui-même, afin qu'il nous éclaire de son avis d'ici le mois de novembre. Nous aurons sans doute l'occasion d'avoir un débat sur ce thème, qui ne sera pas celui de la durée, de ces deux semaines d'allongement, mais bien un problème de fond. Nous aurions là un éclairage qui serait utile pour faire avancer la réflexion de tous. M. Hervé Morin : Ma collègue Mme Marie-Thérèse Boisseau évoquait le chiffre de 6 000 femmes qui aujourd'hui vont pratiquer une IVG à l'étranger. A-t-on une idée du nombre de femmes réellement concernées par cet allongement du délai de dix à douze semaines ? Je me demande également pour quelle raison on s'arrête à douze semaines. Mme Christine Boutin : Il existe dans notre pays deux courants de pensée : l'un, qui est le droit des femmes à disposer de leur corps et l'autre, qui est le respect de la personne humaine dès la conception. Je me situe dans la seconde, ce n'est pas un scoop, mais il faut bien constater que ces deux courants de pensée sont inconciliables. Mme Yvette Roudy : Tout à fait. Mme Christine Boutin : Quant au débat que vous proposez - et je vous remercie de déposer ce texte pour qu'il y ait débat -, je tiens à dire solennellement à la Délégation aux droits des femmes et à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales que, pour ma part, je n'ai pas du tout l'intention de passionner le débat. Je souhaite que nous l'abordions avec paix et dans le respect des courants de pensée des uns et des autres. Vous avez une logique qui n'est pas la mienne. Elle est la vôtre, elle est celle de la majorité ici, elle est respectable. Il se trouve que j'ai une façon d'aborder l'avortement qui est autre et je trouve tout à fait dommage que cette autre manière ne soit pas prise en compte. Nous sommes toutes d'accord, en tout cas, pour dire que l'avortement est un échec, un échec pour la femme, un échec de la société. Nous sommes toutes d'accord pour dire que la femme est soumise à des pressions - pressions économiques, pressions affectives, pressions familiales - et qu'on la laisse absolument seule face à la décision qu'elle a à prendre, une décision gravissime qui lui appartient. Personnellement, je ne juge aucune femme qui décide de recourir à l'avortement, mais je trouve tout à fait dommage, alors que tout le monde s'accorde à reconnaître qu'il y a, pour des raisons très variées, une ambivalence, au moment de la décision entre le recours à l'avortement et le fait de pouvoir garder l'enfant, que l'on n'envisage pas, à l'occasion de ce débat, la possibilité de permettre à la femme d'avoir un véritable choix. Aujourd'hui, vous proposez de rallonger le délai légal d'avortement. Cela ne diminuera pas le nombre d'avortements. Vous justifiez cet allongement par le fait qu'un certain nombre de femmes partent à l'étranger. Ce sont exactement les mêmes arguments qu'il y a vingt-cinq ans. Je comprends ces arguments, je les respecte, mais je trouve fort dommage que vous n'offriez pas la possibilité d'une alternative. J'ai déposé une proposition de loi qui a été cosignée par quarante-trois députés. Je souhaiterais qu'il y en ait davantage et je suis convaincue, d'ailleurs, que, s'il n'y avait pas d'a priori en raison du fait que c'est moi qui ai déposé cette proposition de loi, même dans mon propre camp, cette proposition aurait été davantage cosignée. Quarante-trois députés, ce n'est déjà pas si mal. La question que je vous pose est simple : serait-il possible de travailler avec vos services pour voir si, véritablement, cette proposition de loi que j'ai déposée pourrait être intégrée dans le cadre de votre révision ? Elle ne remet absolument pas en cause votre orientation mais elle donne une autre façon d'aborder le problème de l'avortement. Mme Dominique Gillot, secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés : Que proposez-vous ? Mme Martine Lignières-Cassou, présidente : La proposition de loi de Mme Christine Boutin consiste à proposer, notamment, la création d'un fonds financier qui aiderait des femmes qui, placées devant le choix de l'avortement, le feraient pour des raisons sociales. Nous sommes sur une conception de l'avortement qui est un échec lié à des conditions sociales difficiles. Mme Christine Boutin : Je ne comprends pas votre intervention. Mme Hélène Mignon : Je vous livrerai deux réflexions. On parle d'eugénisme actuellement, mais lorsque les femmes de mon âge contractaient une rubéole en étant enceinte ou lorsque, dans l'entourage de ces femmes, une personne était atteinte de rubéole, le médecin ou le gynécologue leur conseillaient l'avortement, et puis s'en lavaient les mains. On aurait pu dire que c'était de l'eugénisme. Cela s'est pratiqué longtemps. En ce qui concerne l'autorité parentale, il est vrai qu'il faut absolument chercher à renouer le lien avec la famille, mais l'on sait très bien que, dans certains cas, ce ne sera pas possible, que ce serait même au risque de la vie de la jeune femme. On dit qu'il faut un accord parental pour une interruption de grossesse ou, éventuellement, pour la contraception du lendemain, mais lorsque cette jeune fille, si elle n'interrompt pas sa grossesse, se retrouvera mère, elle peut abandonner son enfant sans demander l'autorisation de ses parents et, si elle ne l'abandonne pas, c'est elle qui se trouve chargée de l'autorité parentale. Il y a là une cohérence à retrouver. Autre interrogation : on parle beaucoup des jeunes en milieu scolaire et universitaire, mais se pose aussi le problème des jeunes handicapés, en institution médico-sociale. Qu'en est-il de ce point de vue ? Mme Martine Aubry, ministre de l'emploi et de la solidarité : Je voudrais tout d'abord dire à Mme Marie-Thérèse Boisseau que je n'ai pas parlé de droit à l'IVG parce que je n'en parle jamais. Je pense que c'est d'un accès à l'IVG dont il faut parler, pour des femmes qui ont été en échec de contraception ou qui se sont vu violentées, par exemple, comme cela existe souvent. Vous n'avez donc jamais entendu ces termes dans ma bouche. Je comprends que certains les emploient, mais, en tout cas, je ne les emploie pas. Je pense que nous devons faire en sorte que le nombre d'IVG diminue dans notre pays. 220 000, ce n'est pas la banalisation que certains craignaient, mais 220 000, c'est trop. C'est la raison pour laquelle nous avons fait les choses dans le bon sens, me semble-t-il, c'est-à-dire que nous avons d'abord mis l'accent sur la contraception. Nous parlons donc d'accès à l'IVG justement pour accompagner, pour aider des femmes qui se trouvent à un moment donné dans une situation particulière et qui n'ont pas le désir d'avoir un enfant. Mme Christine Boutin, personnellement, je respecte les courants de pensée, c'est-à-dire que chaque personne a le droit de s'appliquer ce à quoi elle croit. C'est la raison d'être de la clause de conscience pour la pratique de l'IVG. De même, chaque femme a aujourd'hui, contrairement à ce que vous dites, la possibilité de choisir : elle utilise ou n'utilise pas le droit à la contraception comme l'accès à l'IVG. C'est un choix personnel que je respecte totalement, mais faut-il encore donner à chacun le choix d'avoir accès à l'IVG, notamment si elle le souhaite. Personne n'est obligé de se voir pratiquer une IVG dans notre pays... Mme Christine Boutin : Mais si, vous savez très bien que si. Mme Martine Aubry, ministre de l'emploi et de la solidarité : Donc, l'alternative aujourd'hui existe. La situation réelle des femmes, c'est souvent, avant des pressions sur l'IVG, des pratiques sexuelles obligées. C'est cela la vérité. Je ne crois pas que l'on puisse dire que les courants de pensée, que je respecte dès lors qu'ils ne dépassent pas un certain vocabulaire - ce qui n'a pas été votre cas aujourd'hui - ne soient pas tout à fait respectés. Chacun a le droit de s'appliquer ce dont il a envie. Je regrette que les problèmes d'eugénisme se présentent au moment où nous révisons la loi sur l'IVG. Je le dis très clairement. Aujourd'hui, et peut-être parce que nous avons, nous aussi, beaucoup consulté - je pense pouvoir dire sans exagérer que nous avons dû rencontrer, par petits groupes, entre cent et cent vingt personnes qui pratiquent des IVG -, ces personnes nous disent la même chose : premièrement, aujourd'hui, des malformations sont déjà connues dès les premières semaines et ces problèmes, que l'on nous pose maintenant, sont déjà posés. Par exemple, dans le service du professeur René Frydman qui aujourd'hui adopte les mêmes positions que le professeur Israël Nisand, j'ai rencontré des femmes qui pratiquent des IVG parce que, lui, n'en pratique plus, semble-t-il, depuis un certain temps. Il y a ainsi, aujourd'hui, par exemple, des problèmes qui se posent à des femmes en attente de jumeaux et de triplés et qui se demandent si elles ne vont pas pratiquer une IVG partielle. Ces problèmes-là se posent d'ores et déjà. C'est à chaque femme, bien informée sur les risques de santé, sur les risques sur sa propre vie en fonction de ses possibilités économiques, d'assumer un rôle parental, de prendre sa propre décision. Le passage de dix à douze semaines ne change en rien ces problèmes. C'est la raison pour laquelle le professeur Didier Sicard, qui préside le Comité national consultatif d'éthique, que nous avions contacté, nous a dit qu'il ne pensait pas souhaitable que ce comité soit consulté, considérant que le problème éthique était derrière nous, que le passage de dix à douze semaines ne changeait rien au problème éthique et qu'il s'agissait essentiellement d'un problème de santé publique. Je reprends l'exemple de la Grande-Bretagne parce que je crois qu'il est sain et parce que nous disposons d'études. Dans ce pays, où l'IVG se pratique jusqu'à vingt-quatre semaines, les médecins ne disent pas qu'il y a aujourd'hui des choix liés au sexe : cela paraît évident pour une femme, mais je comprends que certains se posent cette question, même si je ne crois pas que l'on puisse la poser en ces termes. Combien de femmes va-t-on aider en passant de dix à douze semaines ? Et pourquoi s'arrêter à douze semaines ? Les études laissent à penser que ce sont 80 % des femmes, qui aujourd'hui dépassent le délai, qui seraient concernés par son allongement. C'est ce qui est demandé par ceux qui pratiquent quotidiennement l'IVG, parce qu'à partir de douze semaines, on se trouve face à un enfant formé, donc, face à d'autres difficultés, y compris pour les médecins, et parce que le passage à douze semaines, c'est-à-dire quatorze semaines d'aménorrhée, laisse à penser que, même des femmes en détresse, qui ont un déni de grossesse, qui n'ont plus de contact avec leur propre corps, qui ne prennent plus en compte leurs propres difficultés, après trois mois et demi d'aménorrhée se posent ces questions. C'est la raison pour laquelle ceux qui pratiquent - car ce n'est pas notre opinion personnelle qui compte, mais celle de ceux qui pratiquent, - des experts, des médecins, des chercheurs - nous disent que le passage à douze semaines est nécessaire. Je suis d'accord avec Mme Marie-Thérèse Boisseau et M. Denis Jacquat pour dire que tout cela n'aurait pas de sens, si nous ne l'accompagnions pas d'information et de prévention, faites notamment par le biais de l'éducation sexuelle, de campagnes de contraception et autres. Il est vrai que nous ne réglerons pas tous les problèmes en passant à douze semaines, mais nous pouvons espérer que cet allongement du délai accompagné d'une action permanente d'information et d'éducation, notamment des jeunes, fasse reculer, dans notre pays, le nombre d'IVG qui est, pour toute femme, un traumatisme réel. J'en arrive aux problèmes des parents. Sur ce point, M. Michel Herbillon me posait deux questions : la pilule du lendemain ne risque-t-elle pas de devenir un moyen de contraception ordinaire ? Il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est effectivement un risque, s'il n'y a pas d'information et d'éducation. Simplement, s'il n'y a pas la pilule du lendemain, il y a l'IVG à terme ! La pilule du lendemain, c'est ce qui permet aujourd'hui d'éviter une IVG. C'est aussi ce qui permet le contact. Ségolène Royal pourra y revenir tout à l'heure à propos des infirmières scolaires, ainsi que Dominique Gillot, qui sera au banc du gouvernement avec moi lors du débat sur la proposition de loi relative à la contraception d'urgence. Je pense que toute personne en contact avec une jeune fille qui vient demander une pilule - et les pharmaciens mettent en place actuellement des formations à ce sujet - doit dire à cette jeune fille qu'elle doit aller chez un gynécologue ou doit lui donner l'adresse d'un centre de Planning familial pour qu'elle entre dans une logique de contraception. C'est, guidée par cette même logique, que Ségolène Royal avait prévu que ce contact soit l'occasion pour les infirmières d'insister sur la nécessité de la contraception. Il était prévu, qu'après avoir pris le rendez-vous, la jeune fille devait revenir voir l'infirmière pour lui dire si elle avait bien vu la personne du Planning familial ou le gynécologue et si elle avait maintenant un moyen de contraception. Si on laisse faire sans barrières, le risque existe. Mais, si l'on utilise cette occasion pour engager le débat et aller vers un moyen classique, normal, de contraception, nous en réduisons très considérablement les risques. De la même manière, pour ce qui est de l'adulte référent, tous les médecins que nous avons consultés nous disent que, pour nombre de jeunes filles, en parler à leur famille est difficile - mais ne pas en parler, pour la plupart d'entre elles, est également difficile- et qu'il n'est pas facile de se retrouver avec un adulte extérieur dans un moment aussi douloureux. La plupart d'entre elles ont besoin qu'on les accompagne, qu'on les aide à trouver les bons mots pour engager le dialogue avec leurs parents. C'est ce qui est prévu dans la loi. Cela dit, pour les cas dont nous avons parlé et que nous connaissons tous, qui ne se produisent pas uniquement dans les milieux maghrébins de quartiers difficiles, il faut que cet accompagnement existe. Je crois que l'on peut faire confiance à ceux qui reçoivent ces jeunes filles, lors de ce premier entretien, pour faire en sorte, autant que possible, que la famille puisse être informée et donner son accord. Ce sont là des sujets difficiles, je le dis très simplement. J'ai beaucoup travaillé et beaucoup réfléchi, non pas parce que je ne suis pas favorable à l'extension du droit des femmes, mais parce que, quand on touche aux problèmes de santé publique, c'est notre responsabilité, à Mme Dominique Gillot et moi-même, d'y réfléchir, parce que nous savons que ce sont toujours des moments douloureux et que nous devons savoir comment accompagner ces jeunes filles, ces femmes en difficulté. C'est pour cela que le soutien psychologique est aussi tout à fait essentiel dans les centres hospitaliers. C'est bien dans cet état d'esprit que nous avons fait ces propositions, tout en précisant à chaque fois quels sont les risques et la façon dont nous pouvons y remédier. M. Pierre Hellier : Vous avez parlé de risques pour la santé de la femme, mais, à ce moment-là, elle ne se trouve plus du tout dans le cadre de l'IVG normale mais dans un cadre d'interruption médicale de grossesse. Mme Martine Aubry, ministre de l'emploi et de la solidarité : La réduction embryonnaire n'est pas un cas d'interruption médicale de grossesse. L'interruption médicale de grossesse intervient lorsque la vie de la femme ou des enfants est mise en cause. On peut très bien attendre des triplés et ne pas souhaiter avoir des triplés parce que l'on pense que l'on ne pourra pas avoir les moyens ou, tout simplement, l'envie de pouvoir les éduquer... Mme Hélène Mignon : C'est du confort. Mme Martine Aubry, ministre de l'emploi et de la solidarité : Non, ce n'est pas du confort, c'est un choix. Ces questions se posent aujourd'hui à l'intérieur des dix semaines. Quand vous attendez un enfant et que l'on vous explique que vous en avez trois, vous pouvez vous demander si vous allez réussir à les éduquer. Ce problème se pose tous les jours à l'intérieur du délai de dix semaines. M. Hervé Morin : Ce n'est pas une question de confort, c'est simplement que vous vous trouvez face à un médecin qui vous dit qu'avec trois embryons, vous avez un risque de les perdre tous les trois. Mme Martine Aubry, ministre de l'emploi et de la solidarité : Cela, c'est un autre sujet. Lorsque le professeur Israël Nisand nous dit qu'à partir de dix semaines, on voit le sexe, on peut lui répondre que demain, on pourra le faire à partir de quatre ou cinq semaines et qu'un tel argument pourrait ramener l'IVG à rien. Le professeur Israël Nisand nous dit que l'on peut déceler certains handicaps ou problèmes à partir de douze semaines, mais aujourd'hui, on en voit en dessous des dix semaines. Dans le service du professeur René Frydman, il y a eu énormément de problèmes de cette nature. Des psychologues sont attachés au service. Ils voient des femmes qui disent ne pas se sentir capables d'élever trois enfants ou ne pas souhaiter avoir trois enfants et ce n'est pas pour des raisons médicales ou parce que leur grossesse risque de ne pas arriver à son terme, car dans ce cas, on est dans l'interruption médicale de grossesse. Quand cette question se pose, le débat a lieu avec le médecin. Les décisions sont prises. Ces sujets se traitent aujourd'hui déjà dans le dialogue qui s'instaure entre le médecin et la femme, l'assistante sociale et la femme. En revanche, la question que nous posions concernant le passage de dix à douze semaines, que nous nous devions de nous poser, Mme Dominique Gillot et moi-même, était de savoir si les risques étaient plus importants pour la femme dès lors que l'on passe de dix à douze semaines. Les réponses sont en général négatives. Mme Dominique Gillot, secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés : Pour compléter la réponse sur le risque de généralisation de la pilule du lendemain comme contraceptif ordinaire, les indications en provenance d'autres pays, qui ont mis en place cette contraception d'urgence, depuis des années, montrent exactement le contraire. En Finlande, par exemple, le recours à la contraception ordinaire a été fortement amplifié depuis l'intervention de la pilule du lendemain. Quand la contraception est un sujet abordé à l'occasion d'une situation d'urgence, c'est-à-dire lorsqu'une femme se sent en situation de risque de grossesse non désirée, cela conduit à une meilleure compréhension de l'intérêt de la contraception ordinaire. Cela dit, même si une jeune fille prenait cette pilule du lendemain plusieurs fois dans le mois, il n'y aurait pas de contre-indication, pas de problème de santé médical pour elle. Le problème serait plutôt financier, parce que la plaquette est très chère. Je pense donc que l'on arrivera assez logiquement à un autre mode de contraception, mieux adapté aux besoins de la sexualité en cause et aux moyens financiers à mobiliser. Quant au passage de dix à douze semaines, Mme Marie-Thérèse Boisseau s'est interrogée sur le fait de savoir ce qu'allaient devenir les autres femmes qui ne sont pas concernées, celles qui seront encore au-delà du délai des douze semaines. J'indiquerai simplement qu'une femme qui dépasse le délai de dix semaines aujourd'hui, a eu une difficulté de compréhension de ce qui lui arrivait, un retard de prise de conscience, un retard de décision, un retard tout court d'ailleurs. Ensuite, il a fallu qu'elle trouve l'adresse, la filière, les moyens pour accéder à cette IVG, ailleurs que sur le sol français. Donc, les délais se sont allongés. Or, l'allongement de la durée des délais proposé aujourd'hui rentre dans un dispositif global qui contribue à améliorer l'information sur la contraception. La contraception d'urgence, l'amélioration de l'accès à l'IVG, l'amélioration de l'accueil, l'amélioration des réponses, la permanence téléphonique, vont forcément raccourcir les délais et conduire à une amélioration, à une généralisation, autant que faire se peut, de l'interruption volontaire de grossesse médicamenteuse. Ce procédé allégera considérablement l'activité des centres et des plateaux techniques et permettra donc de raccourcir les délais d'attente. Nous savons bien, en effet, qu'aujourd'hui, un certain nombre de dépassements de délai sont liés à la mauvaise réponse apportée à des femmes qui téléphonent pour avoir un rendez-vous. Il faut vraiment voir cet allongement de la durée légale de recours à l'IVG dans un cadre plus général qui concourt à rendre plus facile l'accès à l'IVG quand il est nécessaire, de telle sorte que toutes les femmes puissent bénéficier de cette intervention sur le sol français, dans les mêmes conditions d'accueil, de sécurité sanitaire et de couverture sociale. Mme Ségolène Royal, ministre déléguée à la famille et à l'enfance : Je remercie très chaleureusement la Délégation aux droits des femmes soutenue par la commission des affaires sociales, car j'éprouverai une grande satisfaction dans l'hémicycle en faisant légaliser une circulaire qui, à l'époque, a fait l'objet de tant d'attaques et de mises en cause. C'est en effet une grande satisfaction de voir que, depuis, les esprits ont évolué, car si j'en crois un sondage réalisé, parmi deux grandes fédérations de parents d'élèves, l'adhésion au dispositif est maintenant massive. Tout le monde a bien compris que l'intermédiaire des infirmières scolaires était un plus dans le cadre de la vente libre du Norlévo. Je dirai simplement qu'aujourd'hui, en tant que ministre chargée de la famille et de l'enfance, c'est-à-dire attentive à la question du droit de la famille, du droit parental et du droit des mineurs, je me sens, à nouveau, complètement en phase avec le dispositif qui est aujourd'hui discuté, basé sur la reconnaissance du droit des mineures lorsqu'elles le souhaitent et lorsqu'elles l'expriment clairement, mais, en même temps, sur l'invitation au dialogue avec les parents. L'un d'entre vous demandait tout à l'heure pourquoi ne pas initier systématiquement le dialogue avec les parents. Je puis vous assurer que ce dialogue est systématiquement initié, puisque c'est aussi la mission qui est demandée aux infirmières scolaires et, en ce qui concerne l'IVG, c'est celui de l'adulte médiateur qui doit suivre l'adolescente pendant l'IVG et surtout après. On ne parle jamais de l'après, mais je crois que le principal traumatisme survient dans les mois qui suivent une interruption de grossesse. De ce point de vue, l'attention portée au suivi est capitale car, même s'il y a rupture du dialogue parental avant, on peut imaginer que, grâce à l'adulte référent, le dialogue pourra peut-être se renouer après l'IVG. M. Hervé Morin : En lisant différents documents sur la contraception d'urgence, j'ai constaté que celle-ci pourra être donnée sans autorisation parentale. Très bien, j'y suis favorable. La question que je me pose porte sur la contraception normale, car, aujourd'hui, il faut une autorisation parentale, même si, dans les faits, cela ne se passe pas ainsi, puisque bon nombre de médecins du secteur privé ou de certains Plannings l'accordent sans autorisation parentale. Cette mesure sera-t-elle supprimée ? Mme Martine Aubry, ministre de l'emploi et de la solidarité : Nous supprimons effectivement l'obligation d'autorisation parentale pour la prescription d'une contraception aux mineures. C'est une nécessité. M. Pierre Morange : Au sujet du projet de loi relatif à la pilule du lendemain, je tiendrais les mêmes propos que ceux que j'avais tenus au sein de la commission, puisque je ne vois aucun engagement financier ferme sur deux points qui posent problème. Le premier concerne l'embauche des infirmières scolaires ; tant que ce ne sera pas inscrit dans les faits, nous resterons dans le cadre d'une situation très symbolique, et le dispositif n'aura aucune crédibilité. Même si l'on parle de prévention et d'éducation et même si j'ai bien noté l'enveloppe financière de 20 millions de francs, qui serait reconductible, je conserve le sentiment que cette enveloppe est considérablement sous-dimensionnée par rapport aux enjeux fixés. Pour revenir sur l'augmentation de la durée légale de l'IVG, je ne reprendrai pas les arguments que je viens de citer. J'ai, pour ma part, le sentiment qu'il ne serait sans doute pas totalement inintéressant d'essayer de mettre en place des dispositifs permettant de raccourcir les délais administratifs actuels, car cela interfère fortement, on le sait, avec le problème de l'IVG. Il me semble, aussi, pertinent de prendre en compte l'avis de sommités médicales comme le professeur Israël Nisand. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont plus en phase avec vos recommandations que leurs avis ne doivent pas être pris en compte. J'ai le sentiment que le processus proposé ne répond pas à la totalité des demandes. On a fréquemment évoqué des cas dramatiques de jeunes mineures de quinze ans qui ont subi des violences sexuelles et qui se retrouvent avec des grossesses de quinze à seize semaines, pour lesquelles le dispositif prévu ne trouve pas de réponse. La proposition du professeur Israël Nisand concernant l'interruption médicale de grossesse me semblait une alternative intéressante. A tout le moins, je crois sage de l'étudier. Enfin, je rappellerai un élément à propos de la notion de suppression de l'autorisation parentale. Au-delà des problématiques que cela évoque, la notion d'un adulte référent me paraît juridiquement contestable, car nous pourrions être confrontés à un certain nombre de contentieux. Il peut également y avoir des contentieux sur le devoir d'information donnée par le praticien aux patients. Mme Jacqueline Mathieu-Obadia : J'ai écouté avec beaucoup d'attention vos propos concernant l'interruption de grossesse et la contraception et je suis parfaitement en accord avec vous pour dire à quel point il faut privilégier la contraception. Cela étant, je vous repose la question de manière très précise : quels sont les avantages du passage de dix à douze semaines ? Je ne les vois pas. J'ai certainement interrogé beaucoup moins de chefs de service ou de praticiens de terrain que vous, c'est évident, mais que je n'ai pas du tout eu les mêmes réactions sur les risques pour les femmes d'une interruption de grossesse pratiquée à dix semaines par rapport à une intervention pratiquée à douze. Manifestement, les risques et les complications sont nettement supérieurs, même si, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, une dilatation du col, la veille du jour de l'interruption de grossesse, est faite. Mme Catherine Génisson : Je me félicite de votre approche globale de la question et du fait que l'on mette l'accent sur la contraception. Cela me semble fondamental. Il est, à mon avis, très important, notamment pour les jeunes, d'avoir une approche multiple sur le sujet de l'éducation sexuelle, celle-ci pouvant se faire au niveau de la famille, de l'environnement périscolaire ou surtout en milieu scolaire. Il faut aussi savoir faire preuve d'imagination : les enseignants, s'ils sont aptes à le faire, ne sont sans doute pas les seuls intervenants à devoir prendre en compte cette question à l'intérieur du milieu scolaire. Les professionnels de santé ont aussi une part importante à jouer dans cette éducation sexuelle et cette sensibilisation à la contraception. En ce qui concerne l'interruption volontaire de grossesse, l'allongement des délais prend toute sa signification dans la mesure où de nombreuses autres mesures ont déjà accompagné et accompagneront cette nouvelle prise en charge de la femme qui demande une interruption volontaire de grossesse. En effet, l'organisation des services qui vont les accueillir, qu'ils soient hospitaliers ou extrahospitaliers, puisque l'on ouvre aussi cette possibilité, me semble tout à fait importante. Je m'attacherai particulièrement à défendre la formation des professionnels de santé, notamment celle des jeunes médecins. Il est important de leur donner la possibilité d'accéder à une formation spécifique sur ce sujet, non pas sur l'aspect purement technique, mais aussi sur l'approche psychologique de ces femmes. Un autre sujet qui n'a pas été abordé, me semble important : celui de l'accompagnement des femmes, au moment de l'interruption volontaire de grossesse et après, par les conseillères conjugales. Nous devons être très exigeants sur la formation de ces personnels. Mme Yvette Benayoun-Nakache : Je souhaiterais une simple précision sur les moyens juridiques que vous comptez mettre en place pour lutter contre ceux que l'on a appelé les commandos anti-IVG ? Mme Martine Aubry, ministre de l'emploi et de la solidarité : Deux rapports ont été demandés au professeur Israël Nisand, dont l'un porte sur l'IVG, car dans l'Est de la France il dirige un service qui fonctionne extrêmement bien, de l'accueil de la femme à la sortie. Le professeur Israël Nisand continue à dire qu'il est favorable au passage de dix à douze semaines. Il ne dit pas qu'il y a des problèmes médicaux spécifiques ou de santé publique à ce passage, mais il précise que les nouvelles échographies font naître de nouveaux risques. Ce n'est pas pour des raisons médicales qu'il s'interroge. Nous ne partageons pas ce point de vue. La quasi-totalité des personnes que nous avons rencontrées et qui pratiquent ces IVG, ainsi que ce qui se passe dans d'autres pays, une fois les dix semaines dépassées, montrent que ce risque n'existe pas dans les faits. Le professeur Israël Nisand nie aujourd'hui avoir tenu ces propos. Cela veut peut-être dire que sa parole était allée plus loin que sa pensée. Tant mieux, sauf qu'il a tout de même fait naître un débat qui, dans mon esprit, n'aurait jamais dû avoir lieu. Aujourd'hui, les interruptions médicales de grossesse sont utilisées en cas de viol, par exemple. Nous travaillons actuellement avec le ministère de la justice à une nouvelle rédaction qui permettrait de préciser dans les textes la notion de viol et d'inceste, comme c'est le cas dans les autres pays européens. Cela pourrait faire l'objet d'un amendement. De même, nous menons un travail, avec le ministère de la justice, pour compléter la loi Neiertz sur les actions anti IVG. C'est parce qu'il y avait encore quelques problèmes juridiques que nous n'avons pas pu inscrire ces points dans le projet de loi au moment où il a été soumis au Conseil d'Etat, mais nous y travaillons actuellement avec Mme Elisabeth Guigou. Nous savons que le passage de dix à douze semaines règle 80 % des cas de celles qui dépassent les délais aujourd'hui et que la technique est exactement la même à dix semaines qu'à douze semaines ; les médecins que nous interrogeons - nous nous sommes entourées de multiples avis - nous disent qu'il n'y a pas plus de risques à douze semaines qu'à dix, le risque d'infection ou de complication existant à dix comme à douze. D'ailleurs, aujourd'hui, un certain nombre de centres d'IVG qui ne sont pas reliés à un bloc opératoire refusent de pratiquer certaines IVG à partir de huit semaines. C'est la raison pour laquelle nous devons nous orienter vers des centres d'IVG liés partout à un bloc opératoire... Mme Jacqueline Mathieu-Obadia, M. Jean Le Garrec et M. Pierre Morange : Tout à fait. Mme Martine Aubry, ministre de l'emploi et de la solidarité : ..., et qui devront fonctionner en réseau. Nous avons déjà décidé de déterminer dans chaque département les centres IVG performants, en ce qui concerne l'accueil, le soutien psychologique et l'existence d'un bloc opératoire, pour que soient engagées à aller vers ces centres les femmes qui risqueraient de poser un problème, soit médical soit psychologique. Mon souci, à terme, - c'est pour cela que nous avons mis des moyens supplémentaires - est que tous les centres d'IVG en France offrent ces garanties, qui ne sont pas seulement médicales, mais aussi psychologiques. A partir du moment où les médecins me disent qu'il n'y a pas de problème particulier à douze semaines, par rapport à dix, notamment grâce à de nouvelles techniques de dilatation du col, je pense que nous pouvons les écouter. A cet égard, je n'ai pas de compétences, je ne fais que reprendre ce qui nous a été dit. Mme Ségolène Royal, ministre déléguée à la famille et à l'enfance : En trois ans, nous avons créé 1 600 postes d'infirmières, de médecins et d'assistantes sociales, sans doute autant qu'au cours des dix ans qui ont précédé. Il est vrai que certains établissements scolaires n'ont que des infirmières à temps partiel. Dans le prochain budget, M. Jack Lang créera 300 postes de personnels médicaux et sociaux. C'est un effort extrêmement important. Cette reconnaissance de leur rôle est un hommage rendu aux infirmières scolaires. Mme Martine Lignières-Cassou, présidente : La proposition de loi sur la contraception d'urgence servira de levier et permettra de reconnaître l'importance du rôle des infirmières scolaires en matière de santé publique. Audition du professeur René Frydman, chef de service de gynécologie-obstétrique à l'hôpital Antoine Béclère de Clamart Réunion du mardi 10 octobre 2000 Présidence de Mme Martine Lignières-Cassou, présidente Mme Martine Lignières-Cassou, présidente : Nous recevons le professeur René Frydman, gynécologue des hôpitaux de Paris, professeur des universités, chef de service à l'hôpital Antoine Béclère de Clamart, un des trois centres agréés en France pour le diagnostic pré-implantatoire, - le deuxième étant à Strasbourg et le troisième à Montpellier - technique qui permet de sélectionner génétiquement un embryon avant son transfert in utero. Vous êtes conseiller technique chargé de la recherche médicale et des questions d'éthique au cabinet du ministre de la recherche, M. Roger-Gérard Schwartzenberg. Membre de nombreuses sociétés savantes, vous avez également appartenu au Comité national d'éthique de 1986 à 1990. Vous avez publié plusieurs ouvrages, dont "L'irrésistible désir de naissance" en 1986 et "Dieu, la médecine et l'embryon" en 1997. Vous avez réalisé la première fécondation in vitro d'Amandine, le premier bébé éprouvette français, et vous avez fait naître le premier enfant après congélation embryonnaire. Notre Délégation s'intéresse plus particulièrement aux problèmes d'IVG et de contraception. C'est le thème de son rapport annuel et nous déposerons prochainement un rapport assorti de recommandations sur le projet de loi de Mme Martine Aubry. Nous avons souhaité rencontrer l'éminent spécialiste que vous êtes dans ce domaine et connaître votre appréciation sur l'ensemble de ces questions. La presse s'est fait l'écho de votre interrogation sur les risques de l'allongement du délai légal de dix à douze semaines. Vous avez fait paraître un article dans Le Monde, intitulé "IVG : l'inquiétante recherche de l'enfant parfait". Nous souhaiterions approfondir avec vous ce problème, si problème il y a, qui, selon vous, "crée une brèche dans le mode de réflexion éthique à la française". Professeur René Frydman : Pour rester sur le thème de l'interruption volontaire de grossesse, puisque vous avez eu l'amabilité de mettre quelques actifs à mon passé, je veux d'abord rappeler qu'avant la loi Veil, je comptais parmi les médecins qui ont essayé de faire avancer la situation en faisant accepter la médicalisation de l'IVG, sans laquelle le taux de mortalité et de morbidité des femmes était et reste très élevé. Mme Nicole Bricq : On s'en souvient ! Professeur René Frydman : Le projet de loi sur l'IVG et la contraception me pose problème, parce que je pense qu'à une bonne question, on fournit une réponse qui n'est pas tout à fait adaptée. La bonne question est celle de savoir comment aider les patientes ou les femmes qui dépassent le délai légal. La réponse proposée cantonne à deux semaines l'allongement du délai légal et ne résout pas l'ensemble du problème qui est, en fait, la prise en charge de ces femmes. D'après le Planning familial, mais peut-être disposez-vous d'autres chiffres, 3 000 femmes dépassent les quatorze semaines d'aménorrhée et 2 000 sont entre douze et quatorze semaines. Le projet ne concernerait donc que 1 % des femmes candidates à l'IVG aujourd'hui et ne règle pas le problème des 3 000 autres. Le point crucial, c'est que ce projet ne constitue pas une prise en compte globale du problème, mais une sorte de parcellisation de celui-ci. Cela me gêne, car tout n'est pas résolu. Par ailleurs, cet allongement du délai, envisagé sous l'angle de : "c'est un droit des femmes, un droit à l'exercice de la liberté des femmes" ne tient pas suffisamment compte du changement important qui survient dans l'acte d'IVG à partir de douze semaines. En effet, pour le médecin qui va participer à cet acte d'IVG, il s'agit d'un engagement qui n'est pas tout à fait de même nature que celui d'une l'IVG jusqu'à douze semaines. Pour parler simplement, jusqu'à douze semaines, on emploie une méthode d'aspiration que l'on peut considérer comme un geste médical, alors qu'à partir de douze semaines, il s'agit d'un acte chirurgical ; les instruments utilisés nécessitent un complément de formation pour les médecins, car la pratique n'est pas tout à fait la même. Une réforme aussi importante ne peut pas se faire sans la participation des médecins. Je ferai un parallèle en disant que, même si vous voulez améliorer le bien-être des voyageurs, quand vous faites une réforme de la SNCF, il est difficile de le faire sans l'accord des cheminots. C'est un peu la même situation et, à mon avis, on ne tient pas assez compte de la situation de la médecine en France. Je constate deux types d'opposition chez les médecins : il y a ceux qui ont une opposition de principe à l'IVG, quel qu'en soit le terme ; mais nous avons aussi, depuis le dépôt du projet de loi, beaucoup de médecins favorables à la prise en charge et à la médicalisation de l'IVG, qui s'opposent à la prise en charge de l'allongement du délai, en tout cas tel qu'il a été proposé. Or, la situation est extrêmement fragile. La raison pour laquelle beaucoup de femmes sont prises en charge tardivement, c'est que le service - en l'occurrence le service public - n'est pas à même d'accueillir correctement leurs demandes. Ce sont les difficultés d'accueil, certes plus ou moins sensibles selon la période de l'année, qui expliquent souvent ce retard dans la prise en charge. Alors que la première vague de médecins, relativement militants, qui réalisent ces actes d'IVG est en train de s'estomper, parce qu'ils atteignent l'âge de la retraite, la relève, en revanche, n'est pas prête. Des mesures d'incitation ont été prises, mais d'après ce que je sais, elles sont insuffisantes et il existe une difficulté de recrutement. Si nous ajoutons à cela le problème de changement de technique que j'évoquais, je crains que l'allongement du délai ne laisse 3 000 femmes en plan et n'accentue le hiatus entre le corps médical, pourtant favorable à l'IVG, et les femmes qui ont besoin d'une prise en charge. La question mérite d'être posée, à plus d'un titre. La solution me paraît un pis-aller qui ne répond pas aux nécessités. Quelle serait la solution possible ? Elle consisterait à faire participer les médecins à ce type de décision. Même les tenants de l'extension du délai à quatorze semaines minimum, qui, souvent, voudraient aller plus loin ... Mme Marie-Thérèse Boisseau : Vous parlez bien de semaines d'aménorrhée ? Professeur René Frydman : Les gynécologues parlent toujours en semaines d'aménorrhée. Il y a entre les semaines de grossesse et les semaines d'aménorrhée une différence de deux semaines. La loi Veil correspond à un délai de douze semaines ; la réforme qui est proposée, à un délai de quatorze semaines. Je disais donc que, même parmi les tenants de ce projet de loi, tout le monde s'accorde sur le fait qu'on ne peut pas imposer un acte à quelqu'un qui n'en aurait pas accepté le principe, surtout un acte qui, après douze semaines, est difficile psychologiquement ; il me semble donc problématique de ne pas avoir un consensus médical. Vouloir imposer la liberté des femmes en espérant que les médecins suivent me semble dangereux, quand je vois la fragilité de la prise en charge médicale et la situation de nombre de mes collègues. Bien sûr, il existe aussi des médecins prêts, dans le cadre de l'interruption médicale de grossesse, à être sollicités et à intervenir quel que soit le terme de celle-ci. Car, on oublie souvent de dire que la France est quasiment le seul pays où une interruption de grossesse peut se faire jusqu'à la veille de l'accouchement. Ce n'est pas la peine de citer en exemple la Suède, où l'IVG se pratique jusqu'à seize semaines, ou l'Angleterre où elle a lieu jusqu'à vingt-quatre semaines. En France, cette intervention se pratique jusqu'à quarante semaines. Il faut certes une raison spécifique, mais celle-ci peut être de plusieurs types : soit une raison f_tale et nous entrons dans le cadre particulier des centres de diagnostic pluridisciplinaires qui ont été créés il y a un an et demi, soit une raison maternelle, dans laquelle entrent également des indications psychologiques. Il suffit qu'un médecin expert, si son analyse l'y conduit, accepte la demande d'interruption de grossesse. Nous devrions donc plutôt accroître le nombre de médecins experts et ceux qui sont les plus favorables à l'acceptation de délais plus longs seraient des candidats tout choisis pour exercer leur art médical. Ce qui me semble dangereux, c'est cette césure d'une liberté de quinze jours complémentaires, qui ne prend pas en compte le nombre de femmes qui dépassent le nouveau délai, et c'est de faire intervenir une telle décision sans une certaine participation médicale. Mme Nicole Bricq : Je partage votre constat sur l'insuffisance de moyens, et la disparition de la première génération de médecins. Vous pensez donc qu'il vaut mieux développer la notion d'IVG thérapeutique. Mais nous ne répondrons pas alors au problème posé par les femmes, qui continueront à aller à l'étranger. Je voudrais comprendre quels sont les éléments psychologiques et médicaux qui peuvent faire que nous n'aurions pas besoin de légiférer, tout au moins sur cette notion de délai. Je pense qu'il y a une véritable réflexion à mener sur le problème des critères qui régissent l'interruption médicale de grossesse. J'aurais aimé que vous précisiez ces critères. Si je comprends bien votre point de vue, vous pensez qu'il est plus attrayant pour un médecin de pratiquer un acte médical en rapport avec une spécialité que de faire une IVG. Peut-être ai-je mal compris. Sinon, nous ne sommes plus du tout du côté des femmes, mais de celui des médecins. A l'étranger, en Europe, la question du délai n'est pas du tout posée de la même manière. Je suppose pourtant qu'en Espagne ou en Angleterre, les médecins ont les mêmes problèmes, même si la médecine est organisée différemment. Ils les résolvent différemment. Je ne comprends pas pour quelles raisons, en France, nous aurions un problème spécifique ? Mme Marie-Thérèse Boisseau : Je voudrais si possible en finir avec les chiffres. Vous avez dit qu'en passant de douze à quatorze semaines, on ne réglait le problème que de 2 000 femmes sur 5 000. Il en reste donc 3 000. Je suis pleinement d'accord avec vous. Or, le professeur Nisand, dans son rapport, et Mme Martine Aubry nous disent que 80 % des femmes seraient concernées. Pouvez-vous nous donner quelques précisions sur le nombre de femmes qui dépassent le délai de quatorze semaines ? Je partage pleinement votre analyse, selon laquelle en allongeant le délai jusqu'à quatorze semaines d'aménorrhée, nous n'aurons qu'une solution partielle du problème. Un certain nombre de vos confrères ont évoqué un risque d'eugénisme. J'aurais souhaité que vous puissiez vous exprimer sur ce problème extrêmement important. Mme Danielle Bousquet : S'agissant des chiffres, je me pose une question, mais pas tout à fait dans les mêmes termes que Mme Marie-Thérèse Boisseau, puisque, par définition, en partant à l'étranger, ces femmes échappent à la comptabilité. En traversant la frontière, elles ne disent pas pourquoi elles la traversent. Nous ne pourrons donc pas avoir de certitudes sur les chiffres. Cependant, cette bataille des chiffres modifie peut-être notre approche de la mesure envisagée. En effet, selon qu'elle permet de résoudre 80 % ou 30 % des cas des femmes, il est vrai que l'approche est différente. Mme Marie-Thérèse Boisseau : Non, cela ne change rien. Mme Danielle Bousquet : Plus précisément, je souhaiterais que vous puissiez nous expliquer pourquoi le fait que l'acte d'IVG devienne un acte chirurgical d'une autre nature après douze semaines, conduit des médecins favorables à la pratique de l'IVG à un raidissement de leur position. Enfin, en quoi une IVG médicale englobant une conception psycho-sociale conduirait-elle les médecins, qui seront donc confrontés au même acte chirurgical, à être tout à coup d'accord, alors qu'ils ne l'étaient pas ? Mme Martine Lignières-Cassou, présidente : Je pense que nous n'arriverons pas à une réalité des chiffres. Les seules informations dont nous disposons aujourd'hui sont celles collectées par le Planning familial. Or, les femmes qui partent avorter à l'étranger ne passent pas uniquement par lui. Dans son rapport, le professeur Israël Nisand reprenait les chiffres émanant du Planning et avançait le fait que le passage de dix à douze semaines de grossesse résoudrait en grande partie le problème. J'ai des interrogations quant à la façon dont vos collègues pratiquent à l'étranger. Nous avons peut-être en France, c'est sans doute historique, une césure entre l'interruption médicale de grossesse, appelée interruption thérapeutique à l'époque, et l'IVG car, dans l'esprit de beaucoup, cette dernière est considérée comme une IVG de confort qui permet de répondre à une certaine détresse. Notre débat d'aujourd'hui n'est-il pas "pollué" par cette césure un peu historique et par la façon dont nous avons conduit les débats, en France, il y a vingt cinq ans ? Concrètement, si l'on estime que le nombre de femmes dépassant les dix semaines de grossesse est de l'ordre de 5 000 aujourd'hui, cela ne représente qu'un ou deux cas par semaine et par département. Même si l'intervention est un peu plus compliquée, qu'il faille s'entourer de plus de précautions au-delà de dix semaines de grossesse, ne pensez-vous pas que nous avons les plateaux techniques et les médecins nécessaires dans les départements ? Professeur René Frydman : En ce qui concerne les chiffres, comme vous, je ne peux que regretter que nous n'ayons pas, en France, une évaluation suffisamment précise. Cette insuffisance statistique se retrouve pour tous les problèmes médicaux. En Angleterre, on vous dit qu'il y a 243 718 embryons congelés ; nous sommes bien incapables de répondre ainsi en France ! Pour les femmes qui partent à l'étranger, j'ai lu comme vous les chiffres du Planning familial qui font référence à 5 000 femmes. Ce sont par définition des estimations. La seule centralisation qui pourrait être faite, pourrait l'être par le Planning. Vraisemblablement, les chiffres indiqués ne correspondent pas à la totalité des cas. Mme Marie-Thérèse Boisseau : On ne peut donc pas plus parler de 80 % que de 40 %. Professeur René Frydman : En tout cas, je ne vois pas sur quoi on peut se baser aujourd'hui pour le dire, car nous manquons vraiment d'évaluation. Pour ma part, j'insisterai sur le point, dont tout le monde convient, à savoir que les chiffres devraient baisser, s'il existait une plus grande rapidité de la prise en charge, des campagnes d'information sur la contraception et une déculpabilisation de l'avortement. La France enregistre, par rapport à d'autres pays, et en particulier par rapport aux Pays-Bas, trois fois plus d'IVG en termes de quota d'IVG. Il y a vingt cinq ans, on n'a pas fait les campagnes d'information qu'il fallait, au moment où il le fallait. Y aura-t-il une baisse de 2 000 à 800 du nombre de femmes concernées ? Je ne le sais pas. Je le souhaite, mais ne peux l'affirmer. En ce qui concerne les problèmes chirurgicaux, je souhaiterais que vous écoutiez uniquement les personnes qui pratiquent et non ceux qui parlent. Tout d'abord, en ce qui concerne l'acte d'IVG, il existe une technique d'aspiration par canule qui va jusqu'à douze semaines. Au-delà de ce délai, vous n'utilisez plus l'aspiration et vous devez introduire des instruments chirurgicaux - des pinces - pour sortir l'embryon et l'évacuer progressivement de l'utérus. C'est un geste que l'on peut charger d'idéologie, banaliser ou, au contraire, "monter en épingle", mais incontestablement c'est un changement, parce que de douze à quatorze semaines d'aménorrhée, un phénomène d'ossification est en cours. On ne peut plus avoir recours à l'aspiration simple, on est souvent obligé de compléter la technique d'aspiration. Voilà pour la question de la technique. On ne peut pas nier que c'est une difficulté psychologique pour l'opérateur. Deuxièmement, j'aimerais que vous lisiez avec une grande attention le rapport de l'ANAES. Il indique clairement que plus une grossesse est jeune, moins il y a de complications. Donc, plus elle est avancée, plus les risques de complications sont importants. C'est malheureusement logique. Les techniques deviennent plus chirurgicales parce que l'acte est plus complexe à réaliser. On passe de techniques médicamenteuses à l'aspiration, puis aux techniques chirurgicales complémentaires. De la littérature que j'ai pu lire, qui est rare dans ce domaine, il ressort que l'on passe de 3 % de complications avant douze semaines - d'après une étude du Planning - à 6,3 %, d'après une étude suédoise, qui va, il est vrai, jusqu'à seize semaines. Ensuite, il faudrait pousser plus loin l'analyse et déterminer l'importance des complications. Mon troisième élément de réponse n'est pas quantitatif, mais qualitatif : cet acte est plus difficile à réaliser qu'une aspiration, car vous devez sortir souvent un membre après l'autre. Il y a une représentation visuelle qui, incontestablement, perturbe plus les médecins qui le pratiquent. Mme Nicole Bricq : Cela nécessite-t-il une anesthésie ? Professeur René Frydman : Une anesthésie générale. C'est un point sur lequel je voulais revenir. Le rapport de l'ANAES indique clairement que 75 % des IVG réalisées en France aujourd'hui, le sont sous anesthésie générale. Mme Nicole Bricq : Cela n'est pas normal. Professeur René Frydman : Je suis tout à fait d'accord avec vous. Normalement, nous devrions en faire beaucoup moins. Les médecins qui pratiquent et assument les IVG, ceux qui se sont engagés dans cette prise en charge, font beaucoup d'anesthésies locales. Les services ou les médecins qui en font peu font des anesthésies générales et les intègrent dans le programme du service chirurgical, ce qui en limite le nombre. D'où le paradoxe suivant : les services publics, qui en font peu, les font sous anesthésie générale, ceux qui en font beaucoup le font sous anesthésie locale. Effectivement, pour qu'il y ait une véritable activité, il faut avoir un secteur ambulatoire, qui ne nécessite pas la lourdeur de l'anesthésie, de la salle de réveil, etc. Les médecins qui pratiquent l'IVG sous anesthésie locale sont bien sûr certains gynécologues obstétriciens, mais aussi quelques gynécologues médicaux - pas suffisamment à mon goût - et de nombreux médecins généralistes. Avec l'extension du délai à douze semaines, ces derniers ne feront plus les IVG, en raison de risques de complication et des problèmes inhérents à la technique. Cette tâche incombera pour l'essentiel aux gynécologues obstétriciens. Lorsqu'on regarde ce qui se passe à l'étranger, c'est essentiellement le secteur privé qui s'occupe des IVG. D'ailleurs, tout le monde le dit : "On fait payer les femmes". Elles vont en Hollande, mais dans le système de fonctionnement hollandais, ce sont les cliniques privées - qui tournent d'ailleurs beaucoup avec les étrangères - qui sont le refuge, pas le service public. Il en est de même en Angleterre. Alors, nous disons un peu schématiquement que leurs motivations ne sont pas forcément les mêmes. Au regard de la situation du service public français, au sein duquel la prise en charge jusqu'à douze semaines est déjà une difficulté, nous aurons du mal à imposer une prise en charge supplémentaire, si le médecin n'y adhère pas. Pour revenir à la question posée : premièrement, c'est un geste chirurgical ; deuxièmement, il y a des complications possibles. L'investissement n'est donc pas le même, puisque l'on sait que le risque de complications existe et que l'acte est difficile à réaliser. A moins d'avoir des motivations financières, il faut, à tout le moins, être convaincu du bien-fondé de l'acte. La plupart des obstétriciens, qui sont parfois amenés à poser des indications jusque très tard dans la grossesse, savent très bien que c'est difficile. Il faut savoir que cette période de douze à dix huit semaines est la plus difficile, car, au-delà, nous passons à des techniques d'accouchement que paradoxalement nous maîtrisons mieux. A mon avis, sans adhésion du corps médical sur le bien-fondé de l'indication, nous risquons d'avoir une césure entre une partie qui ne pratique pas, une autre qui pratique pour des indications médicales et ne va pas jusqu'à la chirurgie, et une autre qui pratique chirurgicalement, Qualitativement, en cas de complication ou devant une situation difficile, s'ils n'adhèrent pas à l'indication, cela va mal se passer. Voilà mon pronostic. Mme Martine Lignières-Cassou, présidente : Vous n'avez pas le sentiment que nous revenons aux débats de 1975 ? Professeur René Frydman : Pas du tout, car si vous écoutez les médecins, vous verrez que ce sont ceux qui pratiquent des IVG qui s'interrogent aujourd'hui. Nous savons bien qu'une partie du corps médical n'adhère pas à l'IVG. Mais aujourd'hui, ce sont ceux qui pratiquent qui sont intervenus dans le débat. Ce n'est pas du tout le débat de 1975. Il est différent parce qu'il touche un autre domaine. Je sais bien que cette position est vécue comme une mise en balance du problème des médecins et de celui des femmes. Vous m'en voyez désolé, seulement cela me semble incontournable. On ne résoudra pas la médicalisation de l'avortement sans les médecins, en tout cas à ce terme de grossesse. Il faut y aller prudemment. Nous manquons d'évaluation, nous ne savons pas exactement combien de femmes sont concernées. Nous sommes dans une situation difficile car le système juridique est extrêmement fragile et si cette mesure n'a pas l'adhésion des médecins, elle sera encore plus fragile. J'en viens à votre question sur l'eugénisme. Mme Nicole Bricq : Vous n'avez pas répondu à ma question sur les critères. Professeur René Frydman : Pour ce qui est des critères, l'expert est soumis à une demande. Je suis expert et je reçois des demandes. Je dirais que ce ne sont pas les douze ou quatorze semaines qui me posent le plus de problèmes, mais plutôt les grossesses plus avancées, pour lesquelles les décisions sont très difficiles et pour lesquelles nous essayons de trouver la réponse la moins mauvaise. Nous ne sommes sûrs de rien. Nous faisons alors intervenir les critères médico-psycho-sociaux dans l'ensemble de la décision. Certains médecins les utiliseront plus et d'autres moins, mais ce seront les mêmes médecins qui accepteront de faire ou de ne pas faire. Il est impossible à ce terme-là de ne pas avoir une adhésion à la décision. Je le pense profondément. Vous avez eu l'occasion de voir des émissions que je n'ai pas toutes vues, d'entendre les réticences des médecins qui pratiquent les IVG. Mais le problème n'est pas tellement quantitatif, il est qualitatif. Lorsque vous réalisez un acte d'IVG difficile, avec un terme avancé, cela vous marque. Je regrette que nous n'ayons pas eu le temps de mener une enquête plus approfondie sur les motivations et sur la participation de l'ensemble du corps médical. Actuellement, les leaders de part et d'autre s'affrontent. Mais il serait plus intéressant de connaître exactement l'état des lieux, parce que l'on ne prendra pas en charge les femmes sans les médecins. Et, encore une fois, je distingue le service public du service privé. Mme Nicole Bricq : Si nous devions élargir la notion des fameux critères médicaux alors que, pour le moment, il y a une évaluation personnelle de l'expert, ma question est la suivante : est-ce que cela peut se codifier ? Professeur René Frydman : En tout cas, il serait intéressant d'avoir un état des lieux sur la pratique des IMG depuis plusieurs années. Or, nous n'en avons pas. Il est vrai, tout d'abord, qu'un certain nombre de demandes ne sont pas satisfaites parce que peu de médecins sont experts. Je propose que leur nombre soit très nettement élargi, qu'il n'y ait pas à franchir ce parcours du combattant pour être expert. Je fais une parenthèse : lorsqu'on demande à être expert, on le demande pour l'ensemble des procédures juridictionnelles, pas uniquement pour le problème de l'IVG, ce qui fait que les experts compétents sur ce sujet sont très peu nombreux. Faut-il rester dans ce cadre ? Pourquoi ne pas distinguer entre ceux qui voudraient être experts dans le domaine de l'IVG et ceux qui le seraient pour d'autres procédures judiciaires. L'objectif serait, quel que soit l'âge de la grossesse, d'avoir une prise en charge correcte des femmes qui ont un problème. Certaines vont être rassurées et poursuivre leur grossesse. Pour d'autres, qui ne vont pas pouvoir poursuivre pour de multiples raisons - psychologiques, voire sociales ou médicales - nous devons trouver une solution. La dernière question qui m'était posée concernait l'eugénisme. C'est un sujet sur lequel il faut être extrêmement prudent. Le titre de l'article du Monde dont vous avez fait mention, comme vous le savez, n'est jamais écrit par l'auteur de l'article, ni même parfois par celui qui recueille les propos. Aussi, je ne tiens pas ce titre comme étant le mien. En revanche, ce que j'ai écrit et ce que je pense, c'est qu'il faut que nous ayons une certaine cohérence, une certaine logique. Si l'on avance le principe de liberté comme l'élément fondateur de l'allongement de l'IVG, ce que nous avons entendu dire à plusieurs reprises, on ne peut pas bloquer cette liberté, comme c'est actuellement le cas, au tout début de la grossesse, au niveau embryonnaire. Ce n'est pas tout à fait par hasard si le professeur Israël Nisand et moi-même avons, les premiers, réagi, car nous sommes confrontés à un certain type de demande. Il ne s'agit pas de transposer schématiquement ce problème au problème de la prise en charge de l'IVG. Ce sont deux problèmes différents. Cependant, si la demande des femmes à quatorze semaines ou plus n'est pas, dans l'ensemble, une demande basée sur un choix d'enfants - ce sont des demandes d'IVG simplement tardives -, on ne peut nier que nous ouvrons là un débat, parce que, pour une autre frange de la population, qui n'est pas dans le cadre d'une demande d'interruption de grossesse, se poseront des choix qui vont être ouverts ou fermés. Je m'explique plus clairement. Lorsque la grossesse d'une femme éveille un doute chez nous à douze semaines, par exemple - je sais que nous parlerons ensuite de ce que l'on peut voir plus tôt -, nous essayons d'explorer ce doute, c'est-à-dire de voir, si oui ou non, cette grossesse présente une anomalie. Cette anomalie pourra être jugée en termes médicaux et, avec le couple, comme suffisamment grave pour accepter la demande d'interruption de grossesse ou, au contraire, assez légère pour que nous puissions rassurer le couple. C'est le type de demandes auxquelles nous avons à répondre en tant qu'experts. On voit bien, dans une espèce d'activité générale, de rapidité des décisions et d'inconfort que provoquent ces inquiétudes, que certaines décisions vont être prises rapidement, que le doute ne va plus être autorisé. Mais, encore une fois, il ne s'agit pas de la même population. Ne confondons pas et ne faisons pas un mauvais procès, comme je l'ai vu et entendu : il ne s'agit pas de dire que les 5 000 femmes entre douze et quatorze semaines seraient des femmes qui voudraient choisir leur enfant. Néanmoins, un certain nombre de femmes qui auront au cours de leur grossesse un doute sur son évolution, auront la possibilité, elles seules et sans appui médical - donc, nous n'en saurons finalement rien - de prendre une décision d'interruption. Cela, c'est en contradiction avec le fait qu'en début de grossesse, et particulièrement en phase embryonnaire, un tas de mesures limite la liberté - en ce qui concerne la femme seule, le choix du sexe, etc. -. C'est terriblement encadré. Vous avez sans doute lu dans la presse l'histoire de la maladie de Fanconi. Cela ne serait pas autorisé en France, alors que nous avons des couples qui font cette demande. Il est difficile d'imposer une interdiction de ce type à ce moment-là et d'accepter de donner une autorisation un peu plus tard. Je pense que nous devons avoir une certaine cohérence : il est difficile d'avoir une absence de liberté sur l'embryon, et une totale liberté entre 12 et 14 semaines. Je disais, dans les derniers paragraphes de l'article du Monde, que c'était une incohérence éthique. Je ne crois pas qu'il faille employer le mot d'eugénisme comme une chose qui serait de l'ordre du quantitatif, mais cet allongement s'appuie sur une notion de liberté découpée en tranches. Mme Martine Lignières-Cassou, présidente : Ne pensez-vous pas que le diagnostic prénatal s'améliorant au fil des années, la question que vous posez aujourd'hui, nous allons la retrouver plus aiguë demain ? Par ailleurs, vous dites qu'en Angleterre et aux Pays-Bas, c'est le secteur privé qui assure les IVG et qu'ils n'ont pas d'état d'âme. Je résume un peu brutalement votre propos. Mais, il y a aussi des pays où la législation sur l'IVG est bien de douze semaines et où ce n'est pas toujours le secteur privé qui assure cet acte. Avez-vous eu des contacts et des discussions à ce sujet avec vos collègues étrangers ? Professeur René Frydman : Oui, mais ces contacts n'ont aucune valeur statistique. Il s'agit de contacts personnels, je peux difficilement en faire état sur un plan statistique, si ce n'est que lorsque vous envoyez une patiente à l'étranger, elle va automatiquement dans les cliniques privées ; dans les hôpitaux, il y a très peu de pratique d'interruptions tardives. Vous me demandiez à propos du diagnostic prénatal si, à l'étranger, les pratiques étaient différentes. Bien entendu, leur pratique est différente. Lorsque les couples partent à l'étranger volontairement pour faire une interruption pour un bec de lièvre, il s'agit d'une pratique qui ne se fait pas en France, théoriquement, et qui se fait à l'étranger. C'est même pour cela que certains y vont. Seulement si vous demandez les statistiques anglaises ou hollandaises sur ce point, je ne suis pas sûr que vous obteniez de réponse, puisque ces pratiques s'inscrivent dans le cadre d'une demande d'IVG "banale". Dans ce genre de situations, je pense que l'on peut conseiller et plutôt aider les parents, sauf cas particuliers ; il m'est aussi arrivé d'accepter des interruptions médicales de grossesse uniquement pour un problème de bec-de-lièvre, car il y avait un problème psychologique majeur de couple. C'est du cas par cas. Mme Martine Lignières-Cassou, présidente : Le Danemark a une législation sur l'IVG allant jusqu'à douze semaines d'aménorrhée ; or le service public joue son rôle à plein. Professeur René Frydman : Je suis d'accord avec vous. Mais, les pays nordiques, premièrement, ont fait une campagne de contraception qui a diminué considérablement le nombre d'IVG. Deuxièmement, les médecins participent. Un entretien médical est fait. Même si, dans les cliniques privées, - y compris aux Pays-Bas, en Espagne, etc., où l'on sait pertinemment que c'est une pseudo-participation - cet entretien médical existe, ce qui fait participer le médecin à la décision ; il s'engage et assume ces responsabilités. Il y a donc une participation médicale. En ce qui concerne les motivations qui guident les médecins, effectivement, elles sont essentiellement lucratives dans le privé ; dans le public, elles sont très dépendantes de l'indication. Encore une fois, on pourrait faire une enquête auprès des gynécologues qui souhaiteraient être des conseillers experts pour ces questions. Nous aurions alors un exact tableau de la situation et les lieux où seront correctement prises en charge toutes les femmes ayant dépassé le terme actuel de douze semaines d'aménorrhée. C'est un préalable indispensable. La proposition actuelle risque de faire croire que l'on a résolu le problème alors que c'est une demi-mesure qui risque d'être plus délétère que bénéfique. Ce que je souhaite, c'est que la décision qui soit prise par le Parlement englobe l'ensemble des femmes dont la poursuite de la grossesse est problématique à partir de dix semaines de grossesse et sans limitation d'âge gestationnel, mais uniquement dans le cadre d'un accompagnement médical. Audition du professeur Alain Durocher, responsable du service des recommandations de l'ANAES, du professeur Michel Tournaire, chef du service de gynécologie-obstétrique à l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul et du docteur Bruno Carbonne, gynécologue-obstétricien à l'hôpital Saint-Antoine Réunion du mardi 10 octobre 2000 Présidence de Mme Martine Lignières-Cassou, présidente Mme Martine Lignières-Cassou, présidente : Nous recevons aujourd'hui le professeur Alain Durocher, responsable du service des recommandations de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé (ANAES), accompagné du professeur Michel Tournaire, chef de service de gynécologie-obstétrique à l'hôpital Saint-Vincent de Paul et du docteur Bruno Carbonne, gynécologue-obstétricien à l'hôpital Saint-Antoine. L'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, établissement public administratif de l'Etat créé en 1996, est un organisme scientifique et technique qui est un lieu d'expertise et d'échange avec les acteurs de la santé. Dans le cadre de sa mission, l'ANAES procède à des études d'évaluation, élabore des recommandations, réunit des conférences de consensus sur les grands thèmes cliniques, diagnostiques et thérapeutiques. A la demande de la direction générale de la santé, l'ANAES a remis en mars 2000 des recommandations sur l'IVG, et elle est en train d'élaborer un complément d'étude sur la pratique clinique de l'IVG et sur les problèmes posés par un allongement des délais. Nous vous remercions donc de nous présenter les dernières recommandations de l'ANAES en matière d'IVG. Professeur Alain Durocher : Je ferai un bref rappel méthodologique avant de laisser la place à mes collègues, qui sont spécialistes du sujet. Comme vous le disiez, l'ANAES a été saisie par la direction générale de la santé afin de faire des recommandations sur l'interruption volontaire de grossesse. L'ANAES a proposé de répondre en deux temps. Elle a, dans une première étape, proposé de faire une réponse basée sur des avis d'experts, obtenus par une méthode de consensus, qui a été formalisée en février 2000. En raison du temps imparti, il n'avait pas été possible de faire, à l'époque, une analyse de toute la littérature scientifique existant sur le sujet. Nous avions donc d'emblée suggéré d'assortir cette première étape d'une seconde correspondant à une analyse exhaustive et critique de la littérature scientifique internationale, afin de dégager les faits prouvés sur le plan scientifique de ce qui était encore du domaine de l'incertitude ou de l'opinion. C'est le travail mené actuellement par un groupe de vingt et une personnes, venues de tous horizons, réunies sous la présidence du professeur Michel Tournaire. Au sein de ce groupe, le docteur Bruno Carbonne a un rôle plus particulier d'analyse critique de la littérature qu'il restitue à ce groupe. En fonction de ce qui existe dans cette littérature et de sa propre expertise, ce groupe élaborera des recommandations. Certaines, seront basées sur des données scientifiques fortes ; mais comme nous ne disposons pas toujours, dans la littérature scientifique, de réponses fortes à toutes les questions que nous nous posons, d'autres recommandations seront basées sur l'avis des experts du groupe de travail, que nous ferons valider par un groupe extérieur - dans notre jargon, un groupe de lecture -. Il s'agit d'un groupe beaucoup plus large, de soixante à quatre-vingt professionnels de santé à qui nous demanderons leur avis sur ces recommandations. Nous pensons avoir fini ce travail à la fin de cette année. L'analyse de la littérature est un travail excessivement long et difficile qui demande du temps. Cela dit, cette analyse est déjà très avancée, grâce notamment à l'énorme travail fourni par le docteur Bruno Carbonne. Si l'ANAES ne publie pas officiellement ces recommandations à la fin de l'année, des documents intermédiaires seront disponibles et les grandes lignes en seront probablement connues avant la fin novembre. Nous devrions donc, à cette date, pouvoir vous en donner les grandes orientations et je pense même que, dès aujourd'hui, le professeur Michel Tournaire devrait pouvoir vous en fournir quelques-unes. Si vous le souhaitez, je pourrai répondre à vos questions d'ordre méthodologique, mais je laisserai le professeur Michel Tournaire et le docteur Bruno Carbonne répondre en tant que spécialistes, gynécologues-obstétriciens. Professeur Michel Tournaire : Le texte que nous élaborons actuellement est en bonne voie, puisqu'il a déjà soixante-neuf pages. J'ai sérié deux grandes questions. D'une part, quelles modifications apporter aux IVG dans l'état actuel de la législation, c'est-à-dire, selon la convention internationale, au cours des douze semaines d'aménorrhée ou dix semaines de grossesse ? Je parlerai plutôt en semaines d'aménorrhée, ce qui correspond aux normes internationales. D'autre part, quelle sera l'incidence de la prolongation éventuelle de la date pour les treizième et quatorzième semaines ? En ce qui concerne le début de grossesse, donc, jusqu'à douze semaines d'aménorrhée, le choix technique se situe entre les méthodes chirurgicales, qui n'ont pas changé depuis les années 70 - technique de dilatation/aspiration - et les méthodes médicamenteuses, plus récentes, qui comportent habituellement un médicament antiprogestérone - le RU ou mifépristone - associé quarante-huit heures plus tard à une prostaglandine. Pour la méthode médicamenteuse, actuellement, une obligation légale impose l'hospitalisation, lors de la deuxième phase, c'est-à-dire juste après l'administration des prostaglandines, pendant une demi-journée habituellement. Il se produit ou non d'ailleurs, physiquement, l'interruption de grossesse. Nous y reviendrons. Il y a une exigence de s'assurer que l'interruption de grossesse a eu lieu dans les semaines qui suivent. Sur le plan médical, d'après les données de la littérature, nous sommes amenés à préférer, jusqu'à sept semaines d'aménorrhée - et cette option sera sûrement définitive - la méthode médicamenteuse, car elle comporte moins de complications, en particulier, elle entraîne moins de risques d'infection. A cette date cependant, la chirurgie est déjà possible avec, peut-être, des inconvénients en termes d'infection, un taux d'échec qui n'est pas négligeable, mais il faut qu'elle soit disponible, si elle est préférée par la patiente. Une deuxième période se situe entre huit et douze semaines d'aménorrhée, donc à la fin de la période légale actuelle. Nous conseillerons la méthode chirurgicale, à une petite nuance près : à partir de dix semaines d'aménorrhée, il est conseillé d'avoir recours à une préparation préalable du col de l'utérus, soit par des médicaments, antiprogestérones ou prostaglandines, soit par des dilatateurs physiques. Sur cette période de huit à douze semaines d'aménorrhée, les méthodes médicamenteuses sont possibles. Cependant, elles présentent quelques inconvénients notables : la durée nécessaire pour aboutir à l'interruption de la grossesse par les prostaglandines est variable et parfois longue, elle dépasse souvent vingt quatre heures ; cette méthode s'accompagne, dans cette période, de douleurs importantes, qui ne sont pas faciles à gérer, plus importantes que dans la période initiale de sept semaines ; et il y a aussi un nombre non négligeable d'hémorragies assez importantes, qui peuvent demander d'avoir recours, dans certains cas rares, à une transfusion ; de plus, au cours de cette période, le taux d'échec n'est pas négligeable, puisque dans 10 % des cas environ, nous devons avoir recours à un geste chirurgical, c'est-à-dire une aspiration ou un curetage, secondairement. Pour toutes ces raisons, le groupe est en faveur de méthodes chirurgicales entre huit et douze semaines. En conclusion, sur les alternatives qui s'offrent pendant la période légale actuelle, notre préférence se porte, au début, sur la méthode médicamenteuse, puis sur la méthode chirurgicale. Mais tous les moyens doivent être disponibles pour pouvoir proposer les deux méthodes aux patientes, afin de respecter leur choix. Des études comparant les deux méthodes, chirurgicale et médicamenteuse, démontrent clairement, en effet, que la méthode la mieux acceptée est la méthode préférée par la patiente. Nous devons donc disposer de toutes les méthodes, même si nous incitons à aller plutôt vers celle qui donne le moins de complications. A propos de l'interruption médicamenteuse, se pose également la question de l'abandon éventuel de l'obligation actuelle d'une hospitalisation, lors de la prise des prostaglandines. Jusqu'à sept semaines d'aménorrhée, c'est-à-dire quarante neuf jours de grossesse, le groupe estime que cette hospitalisation ne doit pas être obligatoire. Cela peut donc conduire à une IVG à domicile, obéissant cependant à un certain nombre d'impératifs. Il faut déjà l'accord, et même le souhait, de la patiente. Il convient également de s'assurer des conditions d'hébergement et, plus encore, de la proximité d'un centre médical en cas de complications, même si au cours de cette période, les complications que l'on peut redouter avec les méthodes médicamenteuses - c'est-à-dire les hémorragies - sont tout à fait exceptionnelles. Ce qui nous a incités à prendre cette option, c'est que l'hospitalisation prévue est un peu rituelle : la patiente entre à l'hôpital, reçoit les prostaglandines, la grossesse en elle-même est interrompue mais la fausse couche elle-même peut se produire pendant l'hospitalisation ou plus tard à domicile. Donc, jusqu'à sept semaines d'aménorrhée, période durant laquelle nous préconisons la méthode médicamenteuse, cette obligation d'hospitalisation ne semble pas adaptée. Au-delà, nous déconseillons cette méthode à titre ambulatoire en raison du risque, d'une part, de douleurs - nettement plus fortes et importantes - et, d'autre part, d'hémorragies qui peuvent être graves. Mme Martine Lignières-Cassou, présidente : Au-delà, vous déconseillez la méthode médicamenteuse, ou le fait de la pratiquer en ambulatoire ? Professeur Michel Tournaire : Si elle est appliquée après les sept semaines d'aménorrhée, elle doit l'être forcément en hospitalisation, mais si l'on suit les recommandations, cette situation devrait être marginale, puisque nous ne conseillons pas, en priorité, cette méthode après sept semaines. La deuxième grande question qui se pose est celle des particularités de la période des treizième et quatorzième semaines. La principale méthode utilisée est la méthode chirurgicale. D'après la littérature, cette méthode est différente de celle employée jusqu'à douze semaines ; elle est plus délicate. En effet, il y a un taux de complications plus élevé, surtout des hémorragies d'une certaine abondance, pouvant nécessiter une transfusion sanguine et, éventuellement, mettre en danger la vie de la femme. Il peut y avoir des complications telles que des lésions utérines - déchirure du col de l'utérus ou déchirure plus importante de l'utérus - et parfois, des lésions des viscères - intestin, vessie. Durant cette période, la préparation du col est indispensable. Elle peut se faire par des moyens médicamenteux. Il peut s'agir d'antiprogestérones, qui doivent être administrées quarante-huit heures avant l'intervention, de prostaglandines particulières, telles que le misoprostol, administrées trois ou quatre heures avant l'intervention, ou de dilatateurs physiques, mis en place cinq à douze heures avant l'intervention. Le geste chirurgical proprement dit est différent, parce que l'aspiration, à cette date-là, est insuffisante pour obtenir l'interruption complète de la grossesse. Nous devons donc avoir recours à une méthode d'extraction avec une pince spécialement adaptée, qui va extraire le f_tus par fragments ainsi que le placenta, de préférence sous contrôle échographique, et, le plus souvent, du moins dans le contexte français actuel, sous anesthésie générale. Il faut bien dire que le vécu de cette technique est considéré par l'équipe médicale comme clairement plus difficile que l'IVG réalisée dans le délai des douze semaines. En même temps, cette méthode chirurgicale a le très grand avantage d'être bien supportée par la femme - ce qui me semble être une priorité. Elle peut se comparer à une IVG effectuée au début de la grossesse, puisque la patiente, sous anesthésie générale, ne subira pas d'épreuve plus difficile que pour une IVG précoce. Cette méthode, différente, va demander des moyens plus importants. Elle doit impérativement se pratiquer dans un bloc opératoire. Nous devons disposer dans un délai correct de moyens de transfusion et il faut s'assurer de la possibilité d'intervenir en urgence, en cas de complications, telles que des lésions de l'utérus ou des viscères. Nous pouvons être amenés à pratiquer, par exemple, une c_lioscopie sans délais pour dresser un bilan complet des lésions, qui peut déboucher éventuellement sur une véritable intervention. La sécurité de cette interruption de grossesse à treize-quatorze semaines dépend beaucoup de l'expérience de l'opérateur. Pour cette raison, nous considérons qu'il est indispensable que l'opérateur ait reçu une formation pour cette méthode, donc qu'il soit spécialiste en chirurgie gynécologique ou qu'un recours à un tel spécialiste soit possible sans délai. Cela explique que la méthode peut ne pas être adaptée à certains médecins qui, souvent militants, font des IVG depuis de nombreuses années. Certains d'ailleurs se dissocient un peu de cette avancée, parce qu'elle pose réellement des problèmes techniques pour sa réalisation. Un médecin généraliste ou un gynécologue médical, qui a une grande expérience de l'IVG actuelle, peut préférer, à juste titre, éviter de pratiquer des interruptions de grossesse à treize ou quatorze semaines s'il n'a pas reçu une formation complémentaire. Cette méthode est actuellement utilisée dans certains services de gynécologie-obstétrique dans le cadre des interruptions médicales de grossesse. Je ferai cependant une remarque à propos de cette méthode. Cette méthode de dilatation/extraction est très employée en Hollande, en Espagne, en Angleterre ainsi qu'aux Etats-Unis. Je m'étais rendu personnellement aux Etats-Unis dans les années 80 pour apprendre cette technique. Nous avons essayé de la diffuser en France, mais nous avons rencontré une certaine réticence, les médecins français préférant généralement employer des méthodes médicamenteuses. Je vous rapporte cela simplement pour vous dire que l'expérience de cette dilatation/extraction n'est pas très importante en France. Il y a donc nécessité de formation pour qu'elle soit disponible dans un nombre suffisant de centres. Mme Martine Lignières-Cassou, présidente : Pourriez-vous mieux nous expliquer pourquoi elle n'est pas très utilisée aujourd'hui ? Quand on fait une IMG en France aujourd'hui, ce n'est pas cette méthode qui est employée ? Est-ce une méthode très différente de la pince et de la fragmentation ? Professeur Michel Tournaire : Il s'agit bien de cette méthode, mais de nombreuses équipes, notamment dans les centres de diagnostic prénatal, préfèrent utiliser la méthode de déclenchement médicamenteux. Docteur Bruno Carbonne : De plus, lorsque l'on fait une interruption médicale de grossesse, on a besoin d'analyser le produit. Or, la fragmentation, qui empêche l'analyse, serait désastreuse de ce point de vue. C'est une autre raison du fait que les équipes adoptent la méthode médicamenteuse. Professeur Michel Tournaire : Oui, le contexte a des exigences différentes. C'est un aspect tout à fait important, mais qui n'explique pas tout. Si, par exemple, on fait une interruption de grossesse pour une trisomie 21, on n'a pas besoin d'analyses, puisque l'on a une information claire, mais la tradition française des équipes qui s'occupent de diagnostic prénatal est plutôt de faire un déclenchement médicamenteux. Les méthodes médicamenteuses existent pour les 13ème et 14ème semaines, mais les remarques faites pour la fin de la période légale actuelle se retrouvent à un niveau supérieur : les femmes devront recevoir des taux plus élevés de prostaglandines, ce qui va entraîner des douleurs plus intenses et qui demandera des moyens anti-douleur plus importants. Dans la littérature, les moyens employés sont presque uniquement des antalgiques, en particulier des morphiniques. On constate aussi en France une tradition, que l'on retrouve peu dans la littérature internationale, de mettre en place une péridurale. En effet, ces déclenchements médicamenteux s'accompagnent de douleurs au moins aussi intenses que celles de l'accouchement - plus douloureuses, en réalité - sans que cette intervention ait le bénéfice qu'a l'accouchement. Les patientes la vivent comme lourde. Cela explique que se soit établie, en France, une tradition d'emploi de la péridurale, lors de ces déclenchements médicamenteux, qui est tout à fait justifiée. Mais il existe peu d'études internationales sur ce sujet, car le déclenchement médicamenteux doublé d'une péridurale sont plutôt de tradition française et qu'il existe peu d'études spécifiques, tout du moins avec la rigueur scientifique nécessaire, sur ce point. En conclusion, en ce qui concerne ce terme de treize ou quatorze semaines, il s'agit d'une technique différente de celle employée avant cette période. Les médecins la possèdent dans un certain nombre d'équipes, mais pas dans toutes. Elle peut cependant se diffuser et s'apprendre. Comme le montre la littérature, elle nécessite des exigences en termes d'équipements et de praticiens qui en font une méthode clairement différente de celle qui se pratique jusqu'à douze semaines d'aménorrhée. Docteur Bruno Carbonne : Je voudrais juste préciser un point concernant les complications de l'interruption chirurgicale de grossesse. Ces complications, pour inquiétantes qu'elles puissent paraître, sont très rares. Elles représentent moins de 1 % de l'ensemble des interruptions de grossesse. Plus on avance en terme, plus ces complications sont fréquentes mais, en ce qui concerne la période qui suit immédiatement le délai légal actuel, c'est-à-dire de treize à quatorze semaines, le risque relatif de complications est de l'ordre de 1,3 ou 1,5 %. On ne multiplie donc que par 1,5 ce risque, qui reste malgré tout faible. Cela dit, au fur et à mesure que le terme augmente, le risque augmente également, tout en restant dans des proportions globalement assez faibles. Mme Martine Lignières-Cassou, présidente : Ce ne sont pas toutes les équipes qui pratiquent aujourd'hui des IVG qui, demain, à treize ou quatorze semaines d'aménorrhée, seront susceptibles de les pratiquer, et cela, pour des raisons techniques. Vous mettez en avant le risque technique, l'expérience de chirurgien gynécologique indispensable et les techniques qui sont différentes. Professeur Michel Tournaire : Oui. Mme Marie-Thérèse Boisseau : Les recommandations de l'ANAES insistent sur la nécessité d'un recueil national des données. Par ailleurs, vous paraissez assez favorable à un avortement à domicile jusqu'à sept semaines. Les deux a priori ne semblent pas compatibles, car comment faire une évaluation si la femme, après avoir obtenu ses médicaments, part à son domicile ? Docteur Bruno Carbonne : En cas d'IVG à domicile, la prise médicamenteuse se ferait, de toute façon, à l'hôpital puisqu'une telle interruption nécessite la prise successive de deux traitements, une antiprogestérone - la mifépristone - et une prostaglandine. Ces patientes seront donc forcément répertoriées au moment de la prise des médicaments. Par ailleurs, nous insistons également sur la nécessité, qui existe déjà, d'une visite de contrôle de ces patientes, après l'interruption de grossesse. Cela ne changerait rien sur ce plan, puisque aujourd'hui les patientes sont vues avant et qu'elles doivent être vues après. Il est vrai que certaines patientes pourraient ne pas se présenter à la consultation qui suit l'interruption de grossesse, mais c'est déjà le cas à l'heure actuelle. Ce ne sera pas a priori modifié par le fait que les patientes repartiront à domicile après la prise des médicaments. Mme Danielle Bousquet : Ce que vous dites laisse à penser qu'il pourrait être envisagé d'avoir, dans un même département, deux types de lieux pour les IVG : des lieux dans lesquels seraient pratiquées les IVG courantes de moins de douze semaines, qui seraient les mêmes que ceux que nous connaissons à l'heure actuelle et, éventuellement, un lieu par département pour les IVG de treize à quatorze semaines ; dans la mesure où celles-ci concerneraient un nombre restreint de cas puisque, d'après les évaluations que nous en avons, ces IVG plus tardives représenteraient trois ou quatre femmes par département et par semaine, ce lieu ferait appel à la technique plus spécifique que vous avez évoquée. Cela peut-il être envisagé ? Professeur Michel Tournaire : Deux aspects me paraissent confirmer cela. D'une part, il ressort de la littérature scientifique qu'il faut disposer de moyens différents pour répondre au risque plus élevé de difficultés et complications, et, d'autre part, à la lecture de la presse, il semble que cela réponde à une demande des médecins qui pratiquent l'IVG dans les centres actuels, qui ne se voient pas bien prendre en charge cette période supplémentaire, et qui la céderaient assez volontiers à des équipes plus spécialisées. C'est donc un besoin technique, mais cela correspond aussi à la pratique actuelle en France. Docteur Bruno Carbonne : Un certain nombre de départements qui prennent aujourd'hui en charge les IVG sont, d'ores et déjà, pratiquement prêts à élargir les délais. Je craindrais seulement - ce n'est pas un point de vue scientifique - un alourdissement de la procédure, car il faut qu'il y ait la possibilité d'un choix entre différents centres. Les centres hospitaliers qui disposent d'un bloc opératoire et ont la pratique des méthodes chirurgicales, par exemple, dans le cadre de l'interruption médicale de grossesse, pourraient être habilités. Un par département, cela me paraîtrait un peu restrictif. Professeur Alain Durocher : Je reviens sur un élément du texte, que vous avez rappelé, traduisant l'avis du consensus d'experts, selon lequel les structures pratiquant les IVG doivent être situées dans un établissement de soins, soit ayant un service de gynécologie-obstétrique, soit en convention avec un établissement disposant d'un plateau technique permettant de prendre en charge l'ensemble des complications d'IVG. Il y a donc obligation de pouvoir disposer, dans un délai relativement rapide, d'un plateau permettant de faire face à des complications. Cependant, il ne s'agit pas d'être trop restrictif, mais plutôt de s'assurer que l'on dispose des moyens nécessaires pour pratiquer l'IVG dans les conditions de sécurité optimales, quelle que soit la période. Mme Marie-Thérèse Boisseau : Jusqu'à sept semaines d'aménorrhée, vous préconisez les IVG médicamenteuses et, de huit à douze semaines, la méthode chirurgicale, même si l'on peut aussi pratiquer des IVG médicamenteuses. J'ai lu ou entendu que l'on pouvait utiliser le RU 486 dans les mêmes conditions, sans contre-indications majeures, jusqu'à neuf semaines, soit 63 jours. Pouvez-vous préciser votre position pour cette période ? Docteur Bruno Carbonne : La méthode médicamenteuse par mifépristone et prostaglandine est techniquement possible. Elle est d'ailleurs déjà utilisée dans certains pays. En France, à l'heure actuelle, elle n'est utilisée que jusqu'à sept semaines, mais en Grande-Bretagne, elle est utilisée, depuis un certain temps déjà, jusqu'à 63 jours, soit neuf semaines d'aménorrhée. C'est une question de seuil. Il y a un certain nombre de petits inconvénients qui sont plus fréquents entre sept et neuf semaines qu'auparavant : contre les douleurs, qui sont plus importantes, on a plus souvent recours à des antalgiques dits majeurs - c'est-à-dire des morphiniques - ; par ailleurs, les délais sont un peu plus longs à ce terme-là. Mais, techniquement, c'est tout à fait possible et il est encore envisageable de programmer une IVG dans le cadre d'une hospitalisation de jour. Il paraît assez important d'éviter de mettre en place des procédures qui prennent plusieurs jours et qui nécessitent une hospitalisation conventionnelle. Jusqu'à neuf semaines, la méthode médicamenteuse est envisageable. Mme Martine Lignières-Cassou, présidente : Avez-vous analysé les problèmes d'accès à l'IVG, notamment dans les structures hospitalières publiques ? Avez-vous une opinion sur les délais de réflexion, l'entretien préalable obligatoire, ou d'autres aspects du projet de loi ? Le syndicat national des gynécologues obstétriciens, qui se plaint d'un manque de moyens et de prise en charge, menace de faire une grève de l'IVG, à partir du 10 novembre. Avez-vous eu à estimer les besoins de l'hôpital public ? Avez-vous eu à analyser, non seulement les techniques pratiquées à l'étranger, mais aussi les législations qui y sont en vigueur, notamment la place du médecin dans le débat ? Professeur Alain Durocher : En ce qui concerne les modalités d'accès à l'IVG, nous n'avons pas trouvé de données dans la littérature ou dans les déclarations, qui nous permettent d'avoir une idée claire des difficultés d'accès à l'IVG, même si c'est un argument qui est clairement avancé par bon nombre de praticiens et de patientes. Nous n'avons pas de données objectives, épidémiologiques ou statistiques, mais nous savons bien que certains centres ne fonctionnent pas vingt-quatre heures sur vingt-quatre, que d'autres ne peuvent fonctionner sept jours sur sept, faute de praticiens. Aussi, initialement, le groupe d'experts avait-il indiqué dans ses recommandations qu'il souhaitait que l'on puisse avoir accès sept jours sur sept et vingt-quatre heures sur vingt-quatre à un plateau technique. Mais c'est un avis d'experts. Par ailleurs, nous n'avons pas étudié les législations étrangères. La mission de l'ANAES est une mission scientifique et professionnelle et nous ne nous sommes pas du tout placés sur un plan législatif et réglementaire. Mme Martine Lignières-Cassou, présidente : Le Planning familial nous dit qu'aujourd'hui, près de 5 000 femmes partent à l'étranger parce qu'elles ont dépassé les délais. Dans votre étude, avez-vous eu à aborder cette question et à évaluer ce que l'allongement du délai à treize et quatorze semaines d'aménorrhée représenterait, comme réponse, quantitative, à ce problème ? Professeur Alain Durocher : Je ne peux donner qu'une réponse partielle. Nous n'avons pas de données objectives chiffrées qui soient publiées sur cette période et donc sur les raisons qui font que les femmes atteignent cette période et sont obligées de faire appel à d'autres systèmes de prise en charge à l'étranger. Cela existe, personne ne peut le nier. Les causes de cet allongement sont probablement multiples. On sait, par exemple, que plus on attend, plus difficile est la décision. Le groupe d'experts avait insisté, et celui qui travaille actuellement insiste également, sur la nécessité d'une décision précoce, parce que l'IVG est alors plus facile à réaliser sur tous les plans, tant sur le plan psychologique et physique pour la femme, que sur le plan médical. Je n'ai pas, pour ma part, de réponse sur l'accès à l'IVG. Docteur Bruno Carbonne : L'accès à l'IVG est une question tout à fait fondamentale, mais, comme l'a dit le professeur Alain Durocher, nous n'avons pas de données scientifiques et très peu de données épidémiologiques. Les recommandations que nous pourrons être amenés à faire ne relèveront que de l'avis d'un consensus professionnel, l'avis d'experts. Pour avoir un meilleur accès à l'IVG, il faudrait pouvoir disposer d'un certain nombre de moyens, qui n'existent que dans peu d'endroits actuellement. Je pense, par exemple, à une ligne téléphonique dédiée spécifiquement aux IVG. Pour l'instant, les patientes sont aiguillées sur un bureau de rendez-vous dans lequel on donne aussi bien un rendez-vous pour une consultation prénatale que pour une hystérotomie ou une interruption de grossesse. Plus encore que la ligne dédiée, il faudrait un personnel totalement formé à la manière de prendre en charge verbalement une demande d'interruption de grossesse. Il y a vraisemblablement un besoin de moyens à mettre en place dans ce sens, afin de favoriser l'accès à l'IVG, d'autant que ces 5 000 patientes qui partent à l'étranger sont les seules dont on connaisse à peu près le nombre. N'y a-t-il pas plus de femmes qui dépassent douze semaines mais qui ne vont pas à l'étranger ? En fait, nous ne connaissons pas l'ampleur de ce problème. Professeur Michel Tournaire : Il faut bien dire que laisser ces femmes en détresse partir à l'étranger est tout à fait anormal. Des équipes sont amenées à prendre en charge ces patientes, comme on le fait pour une interruption médicale de grossesse, en décidant d'une intervention de type médico-sociale. Nous sommes amenés à prendre des décisions de ce type avec des patientes qui n'ont aucun moyen, qui sont perdues. Ce serait ne pas assister une personne en danger que de la laisser subir une pénalité supplémentaire dans un domaine difficile. Il faut trouver une solution pour éviter cette anomalie qui nous rappelle la période qui a précédé la loi et qui est à la base d'une grande injustice, parce que pour certaines, c'est simple et, pour d'autres, horriblement difficile. En nous penchant sur la question, nous nous sommes dits que, certes, on peut penser qu'aller jusqu'à treize ou quatorze semaines ne résolvait pas tout, mais que cela résout probablement une majorité des cas. Mme Martine Lignières-Cassou, présidente : Nous avons un grand débat sur ce point. Professeur Michel Tournaire : Cela en résout une majorité, que ce soit la moitié ou 80 % ; c'est déjà bien. De toute façon, à l'occasion de ce débat, l'accent a été mis sur cette difficulté majeure qui consiste à laisser ces femmes aller à l'étranger, dans des conditions difficiles et onéreuses. Nous pouvons espérer que ce pas franchi, de treize - quatorze semaines, résoudra un certain pourcentage de cas et que ce débat sera l'occasion d'envisager la prise en charge des patientes qui dépasseront cette nouvelle limite. Ce n'est peut-être pas parfait, mais cela nous paraît être un progrès pour un bon nombre de femmes - je parle en tant que praticien -. Cela nous semble apporter une solution intermédiaire acceptable en nous mettant au niveau d'un bon nombre de pays européens. Une autre solution aurait pu être de dire qu'il existe déjà l'interruption médicale de grossesse et qu'il suffit que les médecins décident de celle-ci. Autrement dit, le grand choix est de savoir si c'est la femme qui décide ou si ce sont les médecins. En ce qui concerne les médecins, dans la situation actuelle, le système est assez aléatoire. Dans le cas d'une interruption médicale de grossesse (IMG), lorsque nous découvrons une anomalie, selon la loi actuelle, c'est un médecin expert qui accepte ou non le recours à l'IMG. La décision pour la même situation varie d'un expert à l'autre. En cas de refus, ces femmes partent assez souvent à l'étranger pour interrompre leur grossesse. Il me semble que les médecins ne sont pas les mieux placés pour juger de la possibilité pour une femme de prendre en charge un enfant. Mme Danielle Bousquet : Je rejoins totalement le point de vue que vous venez de développer. Je partage comme vous l'idée qu'on ne résoudra pas l'ensemble des problèmes en passant de douze à quatorze semaines, mais qu'on résoudra cependant un grand nombre de cas. Pour ce qui est des autres, puisque le scandale de laisser partir ces femmes à l'étranger existe et existera encore en tout état de cause, l'idée que l'on commence à voir émerger - préconisée par un certain nombre de médecins - d'élargir la notion d'IVG médicale à des circonstances psycho-médico-sociales, vous paraît-elle possible dans le cadre de cette loi ? Si vous en êtes d'accord, peut-on envisager de mettre en place des critères qui feraient tomber la subjectivité à laquelle vous faisiez allusion, et qui reste le problème fondamental ? Le corps médical et notre société vous paraissent-ils prêts à entendre une "critérisation" sociale de cette détresse des femmes ? Professeur Michel Tournaire : Je vous répondrais que je suis favorable à ce que l'on introduise davantage de médico-social dans l'interruption médicale de grossesse, mais les situations sont tellement peu descriptibles que l'on ne parviendra pas à en faire une codification. Il existe tellement de situations sociales, médicales différentes, tellement de paramètres, que nous ne parviendrions pas à établir un catalogue qui soit vraiment adapté. Il faudra malgré tout garder l'avis médical, même si la loi permet d'introduire un critère médico-social. Actuellement, il faut une anomalie incurable au moment du diagnostic : c'est strict. Si nous voulons respecter strictement la loi, nous ne pouvons pas nous permettre aujourd'hui de prendre en compte des critères médico-sociaux. Si cette notion médico-sociale est introduite dans la loi, les experts pourront plus facilement accepter l'IMG dans ces cas. Docteur Bruno Carbonne : La loi actuelle prend en compte l'état f_tal et non pas l'état maternel. L'expertise des médecins s'applique à des situations dans lesquelles le f_tus est atteint de maladie incurable. Aller vers des critères médico-sociaux changerait complètement la vision des choses, car cela impliquerait une expertise de l'état maternel et des conditions psychologiques. Professeur Michel Tournaire : Une étude anglaise, qui date d'un certain temps, montre que le premier élément qui détermine la bonne intégration d'un individu dans son groupe est le contexte socio-économique. Nous pouvons considérer qu'un enfant, même sain sur le plan physique, placé dans un contexte socio-économique difficile, est déjà potentiellement handicapé. C'est malheureusement une réalité. En revanche, un enfant souffrant d'un léger handicap dans un milieu qui saura l'accueillir, effacera ce handicap. Cela m'amène à dire que les femmes et les couples ne sont pas égaux pour prendre en charge un handicap. C'est une certitude. Mme Martine Lignières-Cassou, présidente : Ne pensez-vous pas qu'il y a deux interruptions de grossesse possibles, l'une qui relève de préconisations thérapeutiques ou médicales, de l'état de l'embryon, et l'autre qui relèverait de raisons subjectives de la femme - ce qui est beaucoup plus sujet à caution dans nos mentalités - et que la loi de 1975 ne nous a pas permis de dépasser cette dualité ? Cette vision duale existe-t-elle dans tous les pays d'Europe ? La réalité y est-elle plus simple, moins passionnelle et moins culpabilisante ? Docteur Bruno Carbonne : Dans les pays où le délai d'interruption de grossesse est beaucoup plus avancé et où le choix de l'interruption de grossesse émane de la patiente, ce qui témoigne de la détresse, c'est simplement la demande d'interruption de grossesse, de la même manière qu'en France avant douze semaines. Il est vrai que la dichotomie que vous évoquiez n'existe pas du tout dans ces pays. Mais je n'ai pas d'éléments de réponse en ce qui concerne les autres pays ou les autres législations. Mme Martine Lignières-Cassou, présidente : A quels pays pensez-vous ? Docteur Bruno Carbonne : Je pense surtout aux Pays-Bas, à l'Angleterre et aux Etats-Unis, sachant que, pour ces derniers, le problème est un peu plus complexe, parce que le droit varie selon chaque Etat. Mais ce sont des pays qui ont des cultures très différentes de la nôtre. La vision de la détresse d'une femme n'y est pas forcément ressentie de la même manière. Professeur Michel Tournaire : Je voudrais aborder une question sur laquelle nous avons longuement discuté, qui fait beaucoup de bruit, je veux parler du risque d'"eugénisme". Nous avons du mal à comprendre cette objection. J'ai rassemblé quelques raisons qui montrent que ce risque n'est pas nouveau. La première est que l'échographie vaginale existe déjà depuis une dizaine d'années. Elle est pratiquée entre dix et douze semaines d'aménorrhée actuellement, c'est-à-dire avant la fin du délai légal d'interruption de grossesse. Elle découvre donc déjà des anomalies avant la fin du délai légal. La grande question est de savoir quelles anomalies peuvent être découvertes et ce qu'elles représentent numériquement. Pour l'ensemble des anomalies des enfants qui naissent en fin de grossesse, en prenant en compte les plus mineures, le taux d'anomalie est de l'ordre de 2,5 % ; les anomalies majeures, quant à elles, se situent d'emblée au-dessous de 1 %. Mais quelles sont les anomalies que nous pourrions diagnostiquer aux échographies précoces à onze, douze, voire treize semaines ? Il s'agit souvent, dans ces cas, d'anomalies vraiment majeures et, le plus souvent, incompatibles avec la vie. C'est l'exemple de l'anencéphalie - ces enfants qui ont une voûte crânienne ouverte et qui ne peuvent pas vivre. Ce sont les _dèmes généralisés, dont on sait que les grossesses vont s'interrompre d'elles-mêmes. Il y a une période, pourrions-nous dire, de sélection naturelle, au premier trimestre de ces grossesses, et certaines grossesses s'interrompent parfois quelques jours ou quelques semaines après la date d'échographie. Ce sont essentiellement des anomalies qui ne sont pas viables. Il y a aussi quelques rares cas d'anomalies qui vont demander un avis spécialisé. Nous entrons alors dans le cadre identique à celui de l'interruption médicale de grossesse après douze semaines, où des spécialistes vont se prononcer et dire à la femme leur pronostic pour l'enfant ; une décision sera alors prise après l'avoir informée. On parle d'échographie mais, depuis longtemps, des diagnostics sont réalisés avant la date légale d'IVG. Il y a eu une sorte de mode pour les diagnostics de caryotypes, c'est-à-dire pour la recherche d'anomalies chromosomiques par "prélèvement de villosités choriales", à dix ou onze semaines d'aménorrhée. Ce test permettait de connaître les anomalies majeures, par exemple, une trisomie 21, mais aussi de petites anomalies, induisant donc un doute sur le devenir de l'enfant avant la fin du délai légal d'IVG. Nous disposions également alors du diagnostic sur le sexe. Dans mon service, nous avons beaucoup pratiqué ce type d'examen - ensuite, nous sommes revenus à la technique de l'amniocentèse -. Sur 1 500 prélèvements réalisés de cette manière, les patientes ont eu des diagnostics d'anomalies mineures, sur lesquelles elles étaient informées et pour lesquelles elles voyaient le spécialiste qui leur expliquait ce que signifiait cette anomalie pour l'enfant à naître, au même titre que les patientes qui consultent actuellement à dix-huit semaines d'aménorrhée. J'irais même plus loin : la loi exige que l'on fasse aux femmes enceintes les tests de rubéole et de toxoplasmose. C'est obligatoire depuis 1992. Or ces tests vont conduire à des diagnostics, soit d'atteintes probables, soit, ce qui est pire, d'incertitudes sur la date de l'atteinte et donc de risque. Dans ces cas, il arrive, devant le doute, que certaines femmes décident d'interrompre la grossesse. Elles en ont le droit jusqu'à douze semaines. Tout cela existait déjà. Pourtant, personne n'a réagi, que je sache, contre les tests de la rubéole et de la toxoplasmose qui conduisent, d'une certaine façon, à un eugénisme. Il faudrait arrêter tout examen en cours de grossesse ! Il faut être clair : puisque parmi les mesures que nous pouvons prendre pendant la grossesse se trouvent des interruptions de la grossesse, il faudrait, en quelque sorte, arrêter de surveiller les grossesses. En ce qui concerne plus particulièrement le sexe, sur les 1500 cas dont je parlais, nous avons un très petit doute concernant une patiente dont nous pensons qu'elle a peut-être interrompu sa grossesse pour une raison de choix de sexe. La menace d'interrompre sa grossesse pour raison de sexe est un fantasme qui ne correspond pas à la réalité française. C'est peut-être vrai en Inde ou en Chine, mais en France, cela ne va pas déclencher de catastrophes. Mme Martine Lignières-Cassou, présidente : Que pensez-vous de l'entretien préalable ? Professeur Michel Tournaire : Je crois qu'il a sa raison d'être, qu'il apporte quelque chose. Mme Martine Lignières-Cassou, présidente : Dans les recommandations que vous avez faites, ou tout au moins dans la synthèse qui nous a été remise, et dans la présentation que Mme Martine Aubry en avait faite fin juin, elle insistait beaucoup sur ce sujet. J'ai eu le sentiment, en relisant le texte de sa conférence de presse, qu'elle souhaitait que le médecin ait plus de responsabilité dans l'entretien préalable, que l'entretien soit plus professionnalisé, et que vous entendiez donner des conseils pour le "codifier", si je puis dire. Le projet de loi ne dit pas un mot de cet entretien préalable. Mais je me suis demandée si l'une des pistes de travail durant l'été n'avait pas été, sur la base de vos recommandations, de faire "porter" l'entretien préalable par le médecin, de le professionnaliser, de faire en sorte que l'écoute soit plus grande dans les services, que le médecin ou un psychologue du service puisse être présent, etc. Il m'avait semblé que vous aviez beaucoup travaillé sur ce thème, que Mme Martine Aubry en avait repris des éléments lors de sa conférence de presse. Je m'attendais donc à voir bouger les choses en ce domaine. Docteur Bruno Carbonne : Je vais vous donner un avis tout à fait personnel, totalement en dehors de l'ANAES. Mis à part certains médecins qui ont, non pas une vocation, mais qui sont relativement militants en faveur de l'interruption de grossesse, il faut bien reconnaître que, dans la plupart des services, la réalisation des interruptions de grossesse n'est pas une activité qui réjouit les médecins. Il me paraît très important que ce soit une activité qui soit bien faite, avec un certain volontariat des médecins. Or, pratiquement, rien n'est fait pour motiver cette activité, ni en termes de moyens ni en termes de temps, puisque les consultations sont bien souvent chargées, et que nous disposons de peu de temps. Si l'on veut augmenter le temps d'écoute des médecins, il faudra modifier beaucoup de choses. La proposition d'une visite conjointe avec un psychologue me paraît très intéressante, mais il ne faut pas se cacher que l'organisation et les moyens qui sont dédiés à cette activité au sein des services, à l'heure actuelle, la rendent tout à fait impossible à réaliser, même si, dans l'absolu, c'est certainement une option intéressante. Aujourd'hui, les personnes qui s'occupent de cet entretien ont un temps d'écoute qui est effectivement uniquement consacré à cela, ce qui se défend aussi. Professeur Michel Tournaire : Dans la pratique de la médecine en France, il n'est pas habituel que le médecin pose des questions de type privé ou intime. C'est une question de culture locale. J'ai vu une attitude différente aux Etats-Unis et au Québec. Dans la check list québécoise, on doit demander si tout se passe bien avec le conjoint, ce qu'il en est de la sexualité, etc. Ce n'est pas du tout adapté à la France. Le versant social non plus n'en fait pas partie. C'est peut-être un tort, mais le médecin français n'a pas cette habitude. Il existe une certaine forme de pudeur française à ne pas entrer dans la vie intime des gens et dans leurs problèmes. Il me semble que la consultation sociale est spécifiquement faite pour cela. Cette dimension sera forcément remplie s'il y a un entretien. Elle ne le sera pas forcément par le médecin. Mme Martine Lignières-Cassou, présidente : Cela pose le problème, mais c'est un autre débat, des lois bioéthiques, car les capacités d'écoute du médecin en la matière me paraissent aussi fondamentales. Professeur Michel Tournaire : Oui, mais demander pourquoi une femme souhaite une interruption de grossesse... Il y a des questions qui relèvent de l'intimité : suspecte-t-elle que l'enfant ne soit pas du conjoint, etc. ? Je ressens, pour ma part, comme une agression que de poser ce type de questions. Nous pouvons penser que la psychologue ou l'assistante sociale seront plus à même de cerner ces questions parce que c'est leur rôle. Je ne pense pas que les médecins s'aventurent à poser ces questions, ni que les femmes s'épanchent volontiers sur ce genre de questions, dans le contexte français actuel, en tous les cas. Docteur Bruno Carbonne : C'est un constat, même si nous pouvons, malheureusement, le déplorer. Mme Martine Lignières-Cassou, présidente : En pensant à l'assistance médicale à la procréation (AMP), j'ai le sentiment qu'il n'y a pas assez de décodage pour les femmes et les couples de la part des médecins. Cela me paraît dommage parce que l'on passe tout de suite à des aspects techniques. Professeur Michel Tournaire : C'est sûrement vrai. Docteur Bruno Carbonne : Pour l'AMP, la visite va nécessiter un temps important et il y a beaucoup de questions qui, même sur un plan technique, sont nécessaires. En conséquence, les consultations sont forcément longues et permettent ainsi de poser des questions qui ne relèvent pas seulement de l'aspect purement technique. En matière d'IVG, la consultation technique peut être très rapide et, malheureusement, je crains qu'elle ne le soit très souvent. Hormis donner des moyens et du temps supplémentaires aux professionnels, je ne vois pas bien ce que l'on peut faire pour améliorer cette prise en charge. Mme Martine Lignières-Cassou, présidente : Lorsque nous discutons avec certains médecins au sujet de leurs confrères hollandais ou anglais, qui n'ont pas d'état d'âme pour pratiquer une IVG extrêmement tardive, la réponse qui nous est faite est, qu'étant donné que ce n'est pas un acte gratifiant et que, dans les pays qui nous entourent, cet acte se pratique dans des cliniques privées, ces médecins le font pour de l'argent. Vous qui avez eu l'occasion de faire le tour de divers pays, pourriez-vous nous dire comment se positionnent les médecins par rapport à ces questions d'argent ? Professeur Michel Tournaire : Pour ce que j'ai pu voir aux Etats-Unis, puisque je me suis rendu dans deux centres au début des années quatre-vingts, il y avait des gens qui consacraient leur temps et leur vie à l'interruption de grossesse, certains pour des raisons de revenu - ils le disaient tranquillement - d'autres sans aucune relation avec le revenu - étant salariés -, car ils considéraient que c'était une tâche médicale, pas des plus valorisantes, il est vrai, mais qu'ils acceptaient de faire. Cela fait partie des tâches et des devoirs du médecin. Lorsqu'on prend les chiffres, 3 ou 4 000 interventions réparties dans nos départements, cela représente environ une intervention par semaine et par département. Si certains, en conscience, ne parviennent pas techniquement à pratiquer cet acte, nous respectons leur position. Ils peuvent faire jouer la clause de conscience. lettre ANAES scannerisée à introduire Audition du professeur Jacques Milliez, chef du service de gynécologie-obstétrique de l'hôpital Saint-Antoine à Paris Réunion du 17 octobre 2000 Présidence de Mme Martine Lignières-Cassou, présidente Mme Martine Lignières-Cassou, présidente : Nous recevons le professeur Jacques Milliez, chef du service de gynécologie-obstétrique de l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Après avoir exercé vos activités dans plusieurs pays étrangers - aux Etats-Unis, en Tunisie, en Algérie -, vous avez été chef de service de gynécologie-obstétrique du centre hospitalier intercommunal de Créteil et, depuis 1992, vous exercez la même fonction à l'hôpital Saint-Antoine. Vous avez été de tous les combats en faveur de l'avortement. Vous avez publié, l'année dernière, un livre intitulé Euthanasie du f_tus - médecine ou eugénisme ?, dans lequel vous évoquez les difficultés et les incertitudes qui s'attachent aux décisions en matière d'interruption médicale de grossesse, c'est-à-dire après les douze premières semaines. Lors du débat du printemps dernier, vous avez pris une position opposée à celle du professeur Israël Nisand lorsqu'il a fait état de ses craintes d'eugénisme liées à l'allongement des délais. Prenant appui sur l'expérience anglaise, vous avez déclaré que ses craintes étaient purement théoriques et que sa vision de la femme était assez choquante. Alors que notre Délégation s'intéresse particulièrement aux problèmes d'IVG et de contraception, puisque nous déposerons un rapport assorti de recommandations sur le projet de loi de Mme Martine Aubry, nous avons souhaité connaître votre appréciation sur l'ensemble du projet de loi et en approfondir certains aspects, notamment ceux qui ont suscité des craintes d'eugénisme. Professeur Jacques Milliez : Puisque vous avez évoqué cette période des combats des années 70, je vous dirai d'où vient ma conviction à l'égard de l'interruption volontaire de grossesse et je vous expliquerai pourquoi celle-ci n'a pas changé. J'ai été nommé externe des hôpitaux de Paris en 1962. Je devais alors avoir dix-neuf ans et, à l'époque, les externes avaient des responsabilités dans les gardes et commençaient par des stages de chirurgie. Pendant ces stages, l'essentiel de notre travail de nuit consistait à accueillir et à soigner des femmes qui avaient été victimes d'avortements criminels, comme on les appelait alors ; nous dirions aujourd'hui "des avortements non médicalisés". Heureusement, dans la majorité des cas, il s'agissait de faire des curetages et puis, éventuellement, de transfuser ces femmes. Mais, quelquefois, les complications étaient plus graves : perforations utérines, péritonites, insuffisances rénales entraînant la mort, ou complications liées aux toxiques impliqués pour obtenir les avortements. L'avortement nous apparaissait donc comme une question de vie ou de mort et nous considérions qu'il était du devoir des médecins de ne pas exposer, par des avortements non médicalisés, la vie de ces femmes. C'était notre objectif. Le souci des médecins n'était donc pas en priorité un souci de liberté des femmes. Si je m'étais engagé dans cette démarche, ce n'était pas pour cette raison, mais parce que mon devoir de médecin était d'éviter qu'à cause d'avortements non médicalisés, des femmes puissent risquer leur santé, leur vie ou garder des séquelles qui les handicapent, par exemple des stérilités les empêchant ensuite d'avoir des grossesses. C'était une démarche médicale. Par la suite, je suis devenu interne. Nous recevions, pendant les gardes, des adolescentes auxquelles nous pratiquions des avortements médicalisés, afin d'éviter à ces gamines, qui n'avaient pas les moyens d'aller à l'étranger - en Suisse à cette époque -, un avortement non médicalisé et tous les risques qu'il impliquait. C'était cela notre engagement. C'était non seulement de parler, mais aussi de pratiquer pendant ces gardes, dans des conditions forcément illicites et illégales, des avortements médicalisés mais clandestins. Cette analyse ne peut être étrangère aux positions que je prends encore aujourd'hui. En France, il n'y a plus d'avortements non médicalisés, mais les risques demeurent au niveau mondial. Il faut savoir que chaque année, dans le monde entier, 175 millions de femmes sont enceintes et que 75 millions de grossesses ne sont pas désirées. Sur ces 75 millions de grossesses non désirées, 40 millions se termineront par des avortements, dont la moitié, soit 20 millions, ne sont pas médicalisés. A ce jour, toutes les trois minutes, une femme meurt encore parce qu'elle n'a pas d'avortement médicalisé. Cela représente 1 % de mortalité. Ce n'est donc pas une question que nous pouvons occulter, même si j'ai bien conscience que notre préoccupation aujourd'hui a un caractère spécifiquement français. Il y a encore une mortalité liée à l'avortement et ce combat, pour nous, continue au-delà des frontières. Cela dit, la question qui se pose aujourd'hui en France est celle de déterminer si l'on peut et si l'on doit élargir les délais légaux de l'IVG et de savoir comment cette question se pose en pratique. Plusieurs milliers de femmes sollicitent une interruption volontaire de grossesse au-delà du terme légal de dix semaines. Cette limite a pour effet d'envoyer 7 000 femmes à l'étranger, selon des statistiques qui ne me sont pas personnelles. Le nombre de celles qui sollicitent une IVG est cependant supérieur à ce chiffre de 7 000 - celles qui partent à l'étranger - car il faut également prendre en compte celles qui obtiennent une IVG dans nos centres d'interruption volontaire de grossesse. Ces chiffres - loin d'être négligeables - sont à replacer dans le contexte des 220 000 avortements pratiqués chaque année en France. Pourquoi des femmes demandent-elles une IVG au-delà du terme légal ? Nous ne nous arrêterons pas au terme de dix/douze semaines, car cette question se pose au-delà de ce délai ; nous pourrons ensuite revenir sur la question du délai de douze semaines. Je vous ai expliqué que mon engagement dans la lutte contre l'avortement n'avait pas un fondement théorique ou philosophique, mais qu'il résultait de la pratique et de l'expérience médicales. Cela le demeure. Si j'en parle, c'est que je reçois des femmes qui me demandent une IVG et à qui je suis chargé d'offrir une solution. Je puis affirmer que, dans ces délais, aucune femme ne demande d'IVG pour d'autres raisons que parce qu'elle n'a pas le choix. Ce n'est jamais une demande qui se fonde sur de la désinvolture, sur une négligence ou un caprice. Si elles viennent nous trouver- a fortiori à ces termes de grossesse déjà avancés -, c'est qu'on ne leur laisse pas le choix de faire autrement : soit, elles n'ont pas la possibilité de garder ces grossesses, soit ces grossesses sont devenues impossibles. Il y a toujours une raison majeure, dont il faut tenir compte, qu'il faut prendre en considération, et à laquelle il faut trouver des réponses. Pourquoi en arrivent-elles là ? J'atteste également du fait que ce n'est jamais leur faute. Si elles dépassent le terme légal, c'est d'abord qu'on les a mal informées sur l'accès à l'IVG ou qu'on les a fait "lanterner" pour essayer de les en dissuader. C'est aussi parce qu'elles sont totalement ignorantes - et je pense aux adolescentes - de ce que peut être une grossesse, de ce que peut être la signification d'un retard de règles, parce qu'à quinze ou seize ans elles n'ont jamais eu de règles régulières ; c'est une grossesse qu'elles n'imaginaient pas et qu'elles n'envisagent pas de pouvoir continuer. Il est impensable à cet âge de maintenir une grossesse non désirée et impossible. Ce n'est pas leur faute. Il n'y a pas eu d'enseignement à l'école sur la sexualité, sur les risques de grossesse et sur les manifestations d'une grossesse. Et, dans ces conditions, cette situation est intolérable. De plus, il faut avoir conscience que ces gamines ne trouvent souvent aucun adulte à qui se confier : les parents n'entendent pas ; les infirmières peuvent le faire, mais souvent ces enfants n'ont pas assez confiance pour aller les voir. Aucun adulte, aucun médecin ; elles ne connaissent pas le Planning familial. Finalement, elles risquent, comme je l'ai vu trop souvent, de faire des tentatives de suicide - et nous les retrouvons aux urgences - ou de poursuivre une grossesse clandestine et, comme cela a été révélé par la presse l'an dernier, d'accoucher dans les toilettes de leur collège ou de leur lycée dans des conditions épouvantables. Il m'est arrivé de recevoir des filles exsangues à la suite d'hémorragies de délivrance, lors d'un accouchement dans les toilettes du lycée. Leur enfant mort, elles vont être accusées d'infanticide ; or, elles arrivent quasiment mortes à l'hôpital, parce qu'aucun adulte n'a voulu les entendre, aucun adulte n'a voulu leur dire qu'il était possible d'interrompre leur grossesse au moment voulu, quelle qu'en soit la date. Il y a donc cette situation particulière de ces adolescentes extrêmement jeunes, parfois âgées de quatorze ans. Il y a aussi les pièges de la contraception ou de la nature. Certaines femmes ne savent pas qu'elles sont enceintes, parce qu'elles saignent tous les mois ou parce qu'elles utilisent une contraception et que, malgré la pilule ou le stérilet, elles ont eu une grossesse et que leur médecin, si elles en voient un, leur a dit que ce n'était rien. Bref, elles sont piégées par des échecs de contraception. J'estime que c'est à la médecine d'assumer ces échecs, sauf si elles souhaitent poursuivre leur grossesse, bien sûr. Ces quelques raisons expliquent que ces femmes n'ont, à mon sens, aucune responsabilité dans les délais qui leur sont imposés. Si elles viennent à ce moment-là, c'est qu'elles n'ont pas le choix : ces grossesses ne sont pas possibles. Si elles l'étaient au départ, elles sont parfois devenues impossibles, parce qu'elles ont perdu un emploi, parce que leur mari ou leur compagnon les a quittées ou pour toutes sortes de raisons. Certaines grossesses deviennent impossibles, alors qu'elles étaient souhaitées ou acceptées initialement. Il faut en tenir compte. Ce sont donc des grossesses qui ne sont vraiment pas possibles mais, je le répète, jamais par désinvolture, caprice ou légèreté. Ce ne sont jamais des prétextes futiles qui conduisent ces femmes à venir nous voir. Nous reparlerons du risque d'eugénisme, mais disons tout de suite que je n'ai jamais vu une femme me demander une interruption de grossesse en fonction du sexe de son embryon. Quel que soit le terme de cette grossesse, en dehors, bien sûr, des cas très particuliers que sont les maladies génétiques transmises par les chromosomes X, je n'ai jamais rencontré de femmes qui demandent une IVG pour des raisons de convenances, a fortiori à dix semaines. En revanche, j'ai vu, encore tout récemment, une femme demander une IVG parce qu'elle attendait des jumeaux et qu'elle ne voulait pas d'une grossesse gémellaire. Nous pouvons entendre ce type de demande dans certains cas. Par exemple, il y a quelques années, j'ai rencontré une femme qui avait eu trois grossesses gémellaires, trois fois des jumeaux, et qui m'a demandé si, au cas où elle attendrait encore des jumeaux la prochaine fois, j'accepterais de faire une réduction embryonnaire et de n'en conserver qu'un. Je lui avais répondu d'attendre d'être enceinte de jumeaux pour en reparler, mais que je ne disais pas non. Je ne l'ai pas revue. Certaines demandes peuvent donc être écoutées, mais elles constituent strictement l'exception et non pas la règle dans les demandes d'IVG. Les femmes qui viennent nous trouver sont toujours dans des situations tragiques. Quand elles arrivent à l'hôpital à Saint-Antoine, qu'elles viennent de province où elles ont été refusées par plusieurs médecins, quels sont les choix qui s'offrent à nous ? Tout d'abord, nous pouvons leur dire que bien qu'elles aient dépassé le terme, nous leur ferons une IVG : cela arrive, c'est même la règle. Personnellement je fais ce que j'estime être de mon devoir de médecin. Entre dix et douze semaines, cette IVG est quasiment toujours justifiée, et j'accepte de la faire. Je ne suis pas le seul, rassurez-vous. Il y a un certain non-dit, qui n'est pas forcément inutile et qui rejoint un peu le non-dit sur des questions comme l'euthanasie de l'adulte, etc. Ce sont des zones sur lesquelles on ne se prononce pas et des actes qu'on fait dans un tacite accord. Une deuxième solution consiste à tenir des propos de bonnes s_urs à la femme qui s'adresse à nous à des termes un peu plus largement dépassés, en lui indiquant que nous ne pouvons pas pratiquer d'IVG à ce terme, mais qu'elle peut poursuivre sa grossesse, garder son enfant, et trouver de bonnes âmes pour l'adopter, qu'il lui suffit pour cela d'accoucher sous X et d'abandonner l'enfant une fois qu'elle aura accouché. Proposer cela est strictement inhumain et inacceptable à des femmes au début de leur grossesse. Je n'en ai jamais vu aucune accepter un tel marchandage. C'est parfois possible quand les demandes sont formulées beaucoup plus tard, tout près du terme; et qu'il est alors hors de question d'interrompre la grossesse ; mais à ces termes-là, je n'ai jamais vu une femme accepter ce genre de chantage. La troisième et dernière possibilité consiste à les envoyer à l'étranger. C'est possible quand elles ont de l'argent, mais quand elles n'en ont pas, que fait-on ? Il y a là une discrimination par l'argent qui, de mon point de vue, est inacceptable. Nous n'avons pas le droit d'accepter que, - comme autrefois les filles de bonnes familles allaient en Suisse parce qu'elles avaient de l'argent - aujourd'hui les femmes aillent en Espagne, en Hollande ou en Angleterre, quand elles ont de l'argent ; sinon, quand elle n'en ont pas, comment faire ? Il faut sortir de cette hypocrisie et reconnaître qu'à des termes de dix-douze semaines, lorsque c'est possible, les médecins trichent un peu et font l'IVG. Mais que faire face à une grossesse un peu plus avancée ? Alors, - et je ne suis pas le seul à le faire - nous considérons qu'il existe un risque pour la santé mentale de la femme en s'appuyant sur la définition donnée par l'Organisation mondiale de la santé : "La santé est un bien-être physique, mental et social". Nous demandons une évaluation d'expert à un psychiatre qui confirme, en produisant un certificat, qu'il y a un risque pour la santé de cette femme ou de cette jeune fille, et qu'il est nécessaire de procéder à une interruption médicale ou thérapeutique de grossesse. Cet artifice légal nous permet de trouver des solutions aux situations les plus tragiques, celles qui pourraient conduire à des tentatives de suicide ou à des accouchements dans des conditions épouvantables, celles qui constitueraient véritablement des mises en danger de la vie d'autrui, si nous ne faisions rien. Pour une fois, le code pénal est là pour nous défendre. Servons-nous-en. En dehors de ces trois cas de figure, il n'existe pas d'autres solutions. En ce qui concerne l'extension des délais légaux de l'IVG de dix à douze semaines, ma réponse est affirmative pour les raisons que je viens de donner. Voyons quelles peuvent en être les conséquences. Levons tout de suite l'objection qui consiste à dire : douze semaines, c'est bien, mais que fait-on pour les grossesses qui dépassent ce délai ? En effet, ce n'est pas la question posée, qui ne concerne que le délai de douze semaines. Résolvons déjà ce problème et nous verrons ensuite éventuellement les autres. De la même façon, quand la limite a été fixée à dix semaines, on aurait pu s'interroger sur les semaines suivantes. Or, pendant vingt-cinq ans, ce délai a rendu service à beaucoup de femmes et évité des morts et des mutilations. Posons-nous donc les questions les unes après les autres. Quelles sont les autres objections à cet allongement du délai ? J'ai entendu dire que plus le terme de la grossesse avance, plus il peut y avoir de risques à pratiquer une IVG, par aspiration, en tout cas. A cet argument, je réponds qu'il se peut que les risques soient légèrement accrus, mais j'objecterai tout d'abord qu'entre dix et douze semaines, ils ne sont pas très significatifs, ensuite, que ces risques diminuent au fur et à mesure que les équipes prennent l'habitude de pratiquer ces opérations, et enfin que, dans certains pays voisins, la limite de l'interruption volontaire de grossesse peut atteindre jusqu'à vingt-quatre semaines, sans que l'on constate pour autant d'hécatombes ou de complications très graves. C'est un risque théorique qu'on ne peut pas nier mais auquel on peut remédier en faisant attention, en adoptant des méthodes particulières d'aspiration, en dilatant le col de l'utérus pour faciliter le curetage et, surtout, si l'on estime vraiment qu'il y a des risques chirurgicaux, en réfléchissant à la façon dont doivent se pratiquer les IVG en France en fonction du terme. En effet, en début de grossesse, jusqu'à quarante-sept jours d'aménorrhée, nous pratiquons des interruptions médicamenteuses de grossesse. Nous avons abandonné la méthode d'aspiration à la canule et nous donnons la pilule RU 486, suivie, deux jours après, d'un analogue de prostaglandine, le Cytotec, qui permet d'expulser l'embryon. Cette méthode est reconnue comme non dangereuse. Elle a succédé à d'autres médicaments, qui avaient été interdits en 1991, parce qu'en effet certaines prostaglandines ou analogues avaient pu provoquer des accidents coronaires. Nous savons maintenant - et ce, depuis dix ans - que l'association de mifégyne (le RU 486) et de misoprostol (Cytotec) n'est pas une thérapeutique dangereuse. A l'autre extrémité de la grossesse, pour les interruptions médicales ou thérapeutiques de quinze semaines à six mois et plus, dans certains cas, - nous sommes parfois obligés d'interrompre des grossesses à sept mois en raison de malformations f_tales ou de maladies maternelles - nous employons les mêmes médicaments - le RU 486 et le Cytotec - et il n'y a jamais d'accidents. Si nous craignons qu'au-delà d'un certain terme il puisse y avoir des complications chirurgicales, qui nous empêche d'avoir recours à nouveau aux méthodes médicamenteuses pour assurer les IVG ? Que l'on ne dise donc pas que, techniquement, il y a des risques supplémentaires. Cette affirmation montre que l'on n'a pas envisagé toutes les solutions. Reste l'objection dont il a beaucoup été question, celle du risque d'eugénisme, développée par le professeur Israël Nisand, jusque là partisan de l'élargissement des délais. Mais que veut dire exactement " eugénisme " ? Pour moi, l'eugénisme est le bien-naître. C'est sélectionner ou interrompre une vie pour éviter des tragédies. M. Israël Nisand est un des grands techniciens de l'échographie. Nous n'allons pas polémiquer, mais dès l'instant où l'on a introduit l'échographie en médecine, on a évidemment jeté les fondements d'un dépistage des anomalies du f_tus et, par conséquent, décidé qu'on allait interrompre des grossesses. On est eugénique à partir du moment où l'on interrompt une grossesse. Que ce soit à trois, quatre ou cinq mois, je ne vois pas la différence : à partir du moment où l'on accepte d'interrompre des grossesses parce qu'il y a des malformations de l'embryon ou du f_tus, on est eugénique. Il existe un eugénisme qui est acceptable, parce qu'il est fait à titre individuel, dans la confrontation singulière d'un médecin et d'un couple, qu'il est fait pour le bénéfice singulier d'un embryon ou d'un f_tus, dont on considère que la vie serait une tragédie et que, par compassion, les parents et les médecins acceptent de ne pas laisser vivre. C'est une démarche compassionnelle, singulière, individuelle. Même si c'est une mauvaise solution, c'est peut-être la moins mauvaise, et c'est une démarche individuelle. A l'opposé, il y a un eugénisme criminel qui est fait pour satisfaire des politiques, une politique de santé ou une politique en général, qui est le fruit d'une sélection d'individus à partir de critères qui n'ont aucun caractère singulier, qui sont coercitifs et destinés à satisfaire des politiques collectives. Je pense, par exemple, à l'eugénisme des nazis. Mais la frontière est extrêmement délicate à tracer. Ainsi, dans les pays méditerranéens (Grèce, Italie, Crète et Sicile), il existe des maladies de l'hémoglobine, des thalassémies ou des drépanocytoses et l'on traque ces mauvais gènes. Il s'agit d'une politique de santé publique qui est mise à la disposition des populations et des individus pour traquer un gène que l'on considère mauvais. On peut considérer que c'est ou non de l'eugénisme en fonction de la position où on se place. Pour donner encore un exemple, il existe une maladie redoutable du développement du cerveau de l'enfant, appelée maladie de Tay-Sachs, encéphalopathie dégénérative qui aboutit très rapidement à des handicaps majeurs des nouveau-nés. Cette maladie touche exclusivement les populations juives ashkénazes. Les rabbins ont donné leur autorisation pour que cette maladie de Tay-Sachs soit éradiquée dans les populations juives ashkénazes d'Amérique du Nord. Qu'appelle-t-on donc eugénisme ? Il existe une sélection d'individus à partir de critères qui sont d'une fluidité extrême. Il faut être très méfiant lorsqu'on utilise ce terme d'eugénisme, car il peut être à double tranchant. Pour en revenir à notre propos, je ne vois pas en quoi l'IVG correspondrait à un eugénisme criminel, puisqu'il s'agit d'une demande singulière adressée à des médecins et qu'il résulte d'un colloque singulier, nullement de l'application d'une politique générale. Je reprends l'argument que j'ai déjà utilisé : voyons ce qui se passe dans les pays voisins dont les délais d'IVG sont plus libéraux : Belgique, Allemagne, Angleterre, Hollande ou Espagne. Y a-t-il eu imputation d'eugénisme ? Y a-t-il des hécatombes d'embryons ? Je n'en ai, pour ma part, pas entendu parler. Pas plus qu'en France, en tout cas. Le fait de glisser le curseur de dix à douze semaines changerait-il les choses ? La raison invoquée, c'est que l'échographie serait de plus en plus performante et que nous verrions de plus en plus de détails - y compris le sexe de l'embryon - et de malformations qui inciteraient les femmes à demander des interruptions de grossesse pour des prétextes futiles. Tout d'abord, nous n'en sommes pas là, car l'échographie n'a pas encore la précision suffisante pour dépister autre chose que de graves malformations. Nous dépistions déjà, à ces termes de grossesse, des malformations embryonnaires manifestes, qui justifient de toute façon l'interruption médicale de grossesse, volontaire ou non. Ensuite, qui va se plaindre des progrès de l'échographie ? C'est assez surprenant de la part du professeur Israël Nisand, qui est un des promoteurs de l'échographie. A partir du moment où l'Écossais Ian Donald, a introduit le principe des ultrasons en médecine humaine et en échographie dans les années 1975, on a posé le principe d'un dépistage ante natal d'un certain nombre de malformations sur le f_tus et, maintenant, sur l'embryon. L'échographie est en soi un outil d'interruption de grossesse et donc d'eugénisme. Soit on décide de supprimer toutes les échographies, soit on les fait à tout le monde, mais en maîtrisant les progrès qu'elle suscite. Par ailleurs, c'est une théorie qui me paraît un peu spécieuse, car que je ne vois pas bien ce que nous dépisterions comme malformations mineures entre dix et douze semaines. Mme Martine Lignières-Cassou, présidente : Un bec de lièvre, par exemple. Professeur Jacques Milliez : Je ne pense pas que l'on puisse faire, en toute certitude, un diagnostic de bec de lièvre entre dix et douze semaines. Par ailleurs, les progrès de l'échographie continueront, et la question ne se posera plus entre dix et douze semaines, mais entre huit et dix. Jusqu'où allons-nous remonter ? De plus, si je suis cette logique, seul l'embryon in vitro aurait droit à l'exemption de toute investigation ? Ce n'est pas possible. Il faut avoir confiance dans les progrès de la médecine et il faut surtout avoir confiance dans la responsabilité des femmes. Il peut arriver que des femmes demandent des interruptions de grossesse pour un bec-de-lièvre, mais ces interruptions leur sont refusées après qu'on leur explique que c'est une malformation tout à fait opérable et guérissable. Je ne pense pas qu'il faille avoir une telle méfiance à l'égard des sollicitations des femmes. Je leur fais confiance et j'attends de voir les demandes d'interruptions de grossesse en nombre significatif pour les motifs qui sont invoqués. N'oublions pas que 220 000 interruptions de grossesse ont lieu chaque année et que si une bataille devait être menée, ce serait plutôt celle de la diffusion de la contraception et celle de la prévention de ces grossesses qui se terminent par des IVG. Mme Yvette Roudy : Alors que nous avons soutenu le professeur Israël Nisand, que nous avons fait des pétitions en sa faveur, que nous l'avons aidé à se faire connaître, je suis frappé d'entendre maintenant le professeur Nisand dire que dix et douze semaines, ce n'est pas la même chose, parce que le f_tus n'est pas dans le même état. Il brandit alors une image terrifiante : "A dix semaines, on aspire, à douze semaines, on fragmente !" L'image est immédiatement parlante : on va hacher un bébé. Qu'en est-il réellement ? Deux semaines font-elles une telle différence que cela obligerait à sombrer dans ces traitements terrifiants et barbares ? Professeur Jacques Milliez : Avant la polémique actuelle, de tels arguments ont été utilisés par ceux qui se sont durement opposés à nous - les commandos anti-IVG, les gars de "la Trêve de Dieu", et les autres -. Lorsqu'ils nous montraient l'image échographique du cri de l'embryon, c'était du même ressort. Il s'agissait de terrifier les femmes en leur montrant une image extrêmement crue de l'interruption de grossesse. C'est une pure escroquerie. On ne va pas terrifier les femmes en leur montrant ce qui se passe ! Il n'y a aucune mutation, aucune marche particulière ; il y a des transitions, extrêmement progressives, dans la taille de l'embryon, c'est évident, mais la technique utilisée à douze semaines est la même que celle utilisée à dix. Ce sont des canules un peu plus grosses. Il n'y a pas de fragmentation, il y a une aspiration de l'embryon. Il est évident que plus on avance dans la grossesse, plus cette aspiration peut exiger des canules de calibre élevé, la rendant plus laborieuse, mais là n'est pas la question. Mme Yvette Roudy : Il n'y a pas de fragmentation ? Professeur Jacques Milliez : Il n'y a pas de fragmentation. Il y a une aspiration. Encore une fois, je ne comprends pas ces réticences françaises très spécifiques alors que ces pratiques sont utilisées en Belgique ou en Allemagne. Je ne parle pas des IVG qui se font jusqu'à vingt-quatre semaines. Il est franchement malhonnête d'utiliser ces moyens de terreur à l'égard des femmes, d'autant que, si elles sont dans ces situations, c'est qu'elles n'ont pas le choix. Pourquoi alourdir la barque en leur montrant des images de terreur ? Mme Martine Lignières-Cassou, présidente : Je partage votre analyse sur l'eugénisme, tout en me disant que la sélection que l'on pratique aujourd'hui, ou que l'on pratiquera beaucoup plus encore demain, mériterait un débat public qui n'existe pas. Cette question n'a pas à être liée à proprement parler à celle de l'IVG, mais elle mérite d'être posée, malgré tout, notamment dans le cadre des lois bioéthiques. Ce qui me gêne, c'est que j'ai parfois le sentiment que la liberté ou la responsabilité des couples ou des femmes n'est pas toujours respectée. Professeur Jacques Milliez : Vous avez raison de poser la question de la sélection des individus, mais cette question n'est pas du domaine de l'IVG, c'est la question posée par le diagnostic pré-implantatoire, c'est-à-dire par le diagnostic sur l'embryon. Mme Martine Lignières-Cassou, présidente : On parlera dans les lois bioéthiques du diagnostic pré-implantatoire. Mme Yvette Roudy : Dans le domaine de la bioéthique, j'ai entendu parler d'un couple qui a créé un enfant in vitro de façon à soigner leur premier enfant qui était gravement malade. On a donc sélectionné un embryon qui n'était pas atteint de la maladie de sa s_ur et qui était compatible avec son système afin d'éviter le risque d'un rejet. Je trouve cela superbe : c'est un acte d'amour. Mais une autre demande me trouble un peu : celle d'un couple écossais qui, ayant déjà quatre garçons, souhaiterait une fille. Ces deux demandes sont très différentes, mais toutes deux nécessitent un diagnostic pré-implantatoire. Je pense donc qu'il faudra vraiment discuter à fond de ces problèmes, même si je ne sais pas si nous pourrons légiférer en la matière. Il me semble qu'il faut regarder au cas par cas. Que pensez-vous de ces deux cas ? Professeur Jacques Milliez : Je partage votre point de vue sur le premier exemple que vous citiez. C'est un acte d'amour. La situation de ce couple était extrêmement particulière, puisque leur premier enfant était atteint de la maladie de Fanconi, une anémie transmise génétiquement, dont il est possible, grâce à la génétique, de faire le diagnostic avant la naissance, par un moyen de diagnostic moléculaire. Ce couple a donc eu accès, de façon tout à fait légitime, au diagnostic pré-implantatoire, qui a permis de distinguer parmi les embryons fécondés in vitro ceux qui étaient atteints de la maladie et ceux qui ne l'étaient pas. Ils ont alors demandé très légitimement, et indépendamment de tout souci de traitement de l'enfant déjà né, que les embryons atteints ne soient pas replacés dans l'utérus. Je vous rappelle qu'au moment de la discussion de la loi sur la bioéthique de 1994, le Sénat avait refusé d'inclure le diagnostic pré-implantatoire. J'étais allé à l'époque voir le sénateur Claude Huriet pour lui dire que cela pouvait rendre service à des couples affectés par des maladies génétiques. Il a alors repris dans la loi exactement les termes que nous lui avions suggérés, c'est-à-dire "pour des couples ayant des enfants déjà nés porteurs d'une maladie génétique connue". Ce couple a eu un diagnostic pré-implantatoire qui leur a évité, premièrement, d'avoir un second enfant atteint de la maladie de Fanconi. Deuxièmement, cet enfant étant conçu - l'ont-ils conçu l'enfant pour cela ? Nous y reviendrons - ils ont à sa naissance prélevé un peu de sang du cordon placentaire. Ce n'est donc pas au détriment de l'enfant que s'est effectué ce prélèvement, qui a été fait sur ce que l'on appelle, en termes très généraux, des "déchets opératoires". Cet enfant a-t-il été conçu pour soigner son frère ? Si c'est le cas, je trouve, comme vous, que c'est un acte d'amour. Je ne vois pas pourquoi les gens n'auraient pas assez d'amour pour concevoir un enfant qui pourrait, aussi, contribuer à soigner le frère ou la s_ur déjà né. Cela ne me choque pas du tout. Je ne dis pas que l'on puisse le faire constamment, mais cela dépend comment cet enfant a été "conçu", dans tous les sens du terme. Si c'est un acte d'amour, je ne vois pas pour quelles raisons on le critiquerait. Le second cas dont vous parliez pose une vraie question. En Angleterre, comme en France, le diagnostic pré-implantatoire est encadré légalement, ce qui détermine ce qu'on peut et ce qu'on ne peut pas faire. Aux Etats-Unis, ce n'est pas du tout le cas. Dans ce pays, il existe en effet des centres qui offrent des enfants génétiquement parfaits : on fabrique des embryons et on teste vingt-quatre gènes de susceptibilité à partir de deux cellules de l'embryon. C'est la loi du marché, c'est la libre concurrence. On va dans ces centres, comme on va au Mc Donald, acheter son embryon génétiquement parfait. C'est la limite qu'il ne faut pas franchir. C'est la limite qui n'est pas acceptable, celle de la sélection d'embryons à partir de critères strictement subjectifs. Sur ce point, il y a nécessité d'avoir un débat au niveau national. Dans de tels cas, je suis formellement contre, car je ne crois pas qu'on ait le droit, en dehors d'une démarche médicale, d'opérer une sélection d'embryons. C'est un eugénisme, qui n'est pas un eugénisme bénéfique. Mme Marie-Thérèse Boisseau : Augmenter le délai légal de douze à quatorze semaines ne risque pas d'accroître le nombre d'avortements, car il est clair, lorsque l'on se reporte aux statistiques des autres pays qui permettent les IVG jusqu'à vingt-quatre semaines, que les avortements n'y sont pas, pour autant plus nombreux. Souvent même, ils le sont moins. Les risques médicaux, je n'y crois pas non plus. Tout cela est parfaitement au point aujourd'hui, encore que plus on avance dans le terme, plus il faut, me semble-t-il, des équipes spécialisées car, d'après les auditions précédentes, j'avais cru comprendre que passer de douze à quatorze semaines impliquait l'introduction d'une technique instrumentale différente, qui nécessitait des équipes plus "pointues". Vous avez parlé de 7 000 femmes qui dépasseraient le délai de douze semaines ; habituellement, on entend plutôt parler du chiffre de 5 000. Mais ces variations n'ont pas grande importance, c'est un ordre de grandeur et mes propos ne sont pas quantitatifs. Vous reconnaissez cependant que, même en passant à quatorze semaines, il restera encore des femmes qui seront au-delà de ce délai, et que plus on avance dans le terme, plus nous sommes en présence de femmes en grande difficulté. Au-delà du délai légal, qu'il soit de douze ou quatorze semaines d'aménorrhée, vous dites qu'il y a une sélection par l'argent. Certes, encore que par des moyens plus ou moins licites, parfois par des moyens sordides, beaucoup de femmes arrivent à trouver de l'argent pour partir à l'étranger. Je repose donc, inlassablement, ma question : si nous passons à quatorze semaines, que faites-vous des femmes qui dépasseront ce nouveau délai légal ? Si nous révisons la loi sur l'avortement, qui est une loi douloureuse et difficile, autant résoudre, une fois pour toutes, tous les problèmes. La première critique que je ferai du projet de loi, c'est que l'on s'arrête au milieu du gué. Cela ne me paraît satisfaisant à aucun point de vue, particulièrement pour les femmes qui seront au-delà des délais. Je ne suis pas sûre qu'allonger les délais aujourd'hui aille dans le sens de l'Histoire et du progrès, tant médical que social. En ce qui concerne le progrès médical, je suis personnellement très favorable au développement de l'avortement médicamenteux, qui me paraît bien supérieur à l'avortement instrumental. Dans ce domaine, il reste à faire en France énormément de progrès. L'avortement médicamenteux se pratique jusqu'à quarante-neuf jours environ, mais peut l'être jusqu'à cinquante-trois jours, avec des chances moindres de réussite. Cela me semble être une bonne formule, étant entendu que si nous avions une meilleure éducation sexuelle, si les femmes étaient plus averties, elles réaliseraient sans doute plus rapidement qu'elles sont enceintes. Les diagnostics de grossesse sont très faciles à faire et il faut miser, si je puis dire, au maximum sur cet avortement médicamenteux, qui se fait bien avant les quatorze semaines d'aménorrhée proposées dans le projet de loi. Pour des raisons sociales, j'ose espérer qu'un jour, proche, les femmes seront mieux accueillies dans les services publics. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Je considère un peu ce projet de loi comme une fuite en avant : avant de passer de douze à quatorze semaines, on pourrait commencer par balayer devant notre porte et faire en sorte que les services publics soient réellement au service de ces femmes, et répondent en temps et en heure à leurs besoins. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, vous le savez bien. Beaucoup de dépassements de délais résultent de la faute des services publics, qui sont aux abonnés absents, sous une forme ou sous une autre. Personnellement, il me semble qu'il serait souhaitable de faire de gros efforts de ce point de vue. C'est sans doute par là qu'il faut commencer. Sur les risques d'eugénisme, j'ajouterai trois points d'interrogation, car nous avons sur le sujet des témoignages qui sont diamétralement opposés. Vous avez parlé du professeur Israël Nisand, mais il n'est pas le seul. Nous avons eu, entre autres, la semaine dernière, le témoignage très clair du professeur René Frydman qui, lui aussi, agite la cloche de l'eugénisme. J'étais ce matin avec un cardiologue qui me disait que les premières écho-cardiographies f_tales avaient été faites en 1986, que deux ans après, on avait voulu en faire un bilan sur le plan européen, et que l'on s'était aperçu qu'en cas d'insuffisances mitrales - qui sont assez facilement diagnostiquées et qui ne sont pas toujours majeures - lorsqu'on l'annonçait aux parents, la question qu'ils posaient immédiatement était celle du sexe de l'enfant. Il y avait manifestement beaucoup plus de demandes d'avortements lorsqu'il s'agissait d'une fille. J'ai été très sensible, la semaine dernière, lors du témoignage du professeur René Frydman, au manque de cohérence entre la sévérité actuelle qui marque le diagnostic pré-implantatoire, et le libéralisme qui existerait si l'on passait à quatorze semaines pour les avortements. En d'autres termes, nous sommes très encadrés - à mon avis, sans doute trop - pour le diagnostic pré-implantatoire et, en revanche, à quatorze semaines d'aménorrhée, on pourrait faire ce que l'on veut. Il y a un manque manifeste de cohérence sur ce sujet au plan législatif. Mme Martine Lignières-Cassou, présidente : Avant de donner la parole au professeur Jacques Milliez pour la réponse aux questions médicales, je voudrais dire qu'un des soucis premiers de Mme Martine Aubry est bien d'engager le service public dans la prise en compte des démarches d'IVG. C'est le sens de la circulaire qu'elle a envoyé en novembre 1999. C'est la raison pour laquelle des crédits budgétaires ont été affectés à l'amélioration du fonctionnement des services IVG pour l'année 2000. Mme Marie-Thérèse Boisseau : Il y a le discours, il y a la circulaire et il y a les faits. Je souhaiterais que l'on fasse l'analyse de l'été dernier à Paris. Mme Martine Lignières-Cassou, présidente : Il y a une prise de conscience de la nécessité d'améliorer la prise en compte de l'IVG au sein du service public. Des moyens sont donnés, peut-être ne sont-ils pas encore suffisants, mais ils existent. Professeur Jacques Milliez : Avant de répondre à toutes vos questions et notamment à celle portant sur ce qu'il faut faire des femmes qui dépassent le délai de 14 semaines, je souhaiterais que vous me disiez : que faites-vous de celles-ci entre douze et quatorze semaines ? Mme Marie-Thérèse Boisseau : Je vais vous répondre. Nous avons 5 à 7 000 femmes qui dépassent le délai légal. Pour l'essentiel, ces femmes partent à l'étranger. Je considère que ce n'est pas normal. Honte à la société française qui refile ses problèmes aux autres pays. Nous devons donc traiter ces problèmes. Mais, aujourd'hui, ce sont des problèmes quantitativement marginaux : 5 000 cas sur 220 000 avortements, cela représente un peu plus de 2 % et, le pourcentage qui sera touché par le passage à quatorze semaines est très discutable, puisque personne n'est capable de se mettre d'accord sur les chiffres. Je propose que les femmes soient traitées au cas par cas et que l'on puisse au-delà de douze semaines avorter pour des raisons médicales, mais éventuellement aussi pour des raisons psychologiques et sociales. Professeur Jacques Milliez : C'est là qu'il y a une divergence absolue d'analyse entre ce que disent les professeurs René Frydman et Israël Nisand, ce que vous dites, et ce que je pense. On a l'air de considérer que les femmes font des avortements par caprice. Mme Marie-Thérèse Boisseau : Ce n'est absolument pas mon propos. Professeur Jacques Milliez : Je soutiens que ces femmes, qui font une demande d'avortement, se trouvent en situation de détresse. Une femme dont la grossesse arrive à ces termes-là, qui a vu son enfant bouger à l'échographie, ne va pas sans une excellente raison demander une interruption de grossesse. Le sentiment maternel, le sentiment de la femme est extrêmement fort. Je ne connais pas de femme - et je trouve insultant de le soupçonner - qui aille, parce que c'est permis, demander une interruption de grossesse à dix ou douze semaines d'aménorrhée. La réalité, ce n'est pas cela ; la réalité, c'est qu'elles sont désespérées et qu'elles n'ont pas le choix. Que l'on ne me dise pas que c'est pour des raisons d'échographie ! Jamais ! Ce sont des femmes qui sont dans la détresse, et l'allongement du délai d'IVG ne multipliera pas les détresses, ou c'est insinuer que le fait de leur accorder un degré supplémentaire de liberté amènerait les femmes à user mal de cette liberté. Je trouve cela insultant pour les femmes, car je n'ai jamais vu une femme qui n'ait pas regretté d'avoir à passer à travers cette épreuve. L'interruption de grossesse n'est pas une fantaisie. C'est une épreuve imposée à une femme par des circonstances extérieures dont elle n'est pas responsable, qu'elle subit douloureusement et durablement, avec des cicatrices indélébiles. Mme Marie-Thérèse Boisseau : Manifestement, nous ne nous comprenons pas. Je n'ai jamais dit le contraire de ce que vous dites. Je n'ai pas parlé de caprices de femmes. Je dis que ce sont des femmes en détresse. Alors, pourquoi vous arrêtez-vous au milieu du gué ? Pourquoi s'arrêter à quatorze semaines d'aménorrhée ? Que faites-vous des autres ? Vous n'avez pas répondu à cette question. Professeur Jacques Milliez : Je ne réponds rien, mais je vous demande ce que vous faites de celles qui ont entre douze et quatorze semaines ? Mme Marie-Thérèse Boisseau : Pour avoir rencontré des femmes dans ces situations et entendu de nombreux témoignages, je considère que neuf fois et demi sur dix, ces femmes sont dans une profonde détresse et qu'il n'y a en aucun cas, caprice ou avortement de confort. Je dis qu'il faut s'occuper de ces femmes, mais, justement parce qu'elles sont relativement avancées dans le terme de leur grossesse, elles ont sans doute plus de difficultés que d'autres. C'est la raison pour laquelle je souhaiterais que leur cas soit étudié au cas par cas, car je souhaite que toutes soient prises en compte. Or vous vous arrêtez au milieu du gué ! Professeur Jacques Milliez : J'avais compris que la question qui m'était posée était celle de savoir s'il était licite de pratiquer un avortement entre douze et quatorze semaines d'aménorrhée. Je n'avais pas compris qu'on parlait d'au-delà de ce terme. Si tel est le cas, c'est un autre débat. Mais je ne vois pas pourquoi on éluderait une question en en posant une autre : la question à laquelle il faut répondre, est celle de savoir si l'on est favorable ou pas à l'allongement du délai de dix à douze semaines de grossesse. Après, on verra. Je veux bien engager le débat, mais c'est une autre question. Je suis aussi partisan qu'il faille s'occuper des femmes qui dépassent les quatorze semaines d'aménorrhée par des méthodes et des approches différentes. Mais si la question posée, comme j'avais cru le comprendre, était de savoir s'il faut ou s'il serait acceptable d'élargir les limites chronologiques de l'IVG de douze à quatorze semaines d'aménorrhée, je vous ai répondu de façon positive. Au-delà de quatorze semaines, c'est autre chose, mais je ne souhaite pas m'arrêter au milieu du gué. Pas du tout. Pour ces femmes qui sont au-delà des quatorze semaines, il faut trouver une solution différente. Je vous ai dit tout à l'heure que, quand c'était nécessaire, elles pouvaient bénéficier d'une interruption médicale de grossesse, parce qu'il y a là une menace pour leur santé mentale, voire sociale. Des experts acceptent d'en convenir et de le certifier. Mme Martine Lignières-Cassou, présidente : Estimez-vous que la rédaction des textes qui actuellement régissent l'IMG - en cas de danger pour la santé de la mère ou de malformations f_tales - permet de répondre aux femmes qui ont dépassé les quatorze semaines d'aménorrhée ? Ce cadre vous paraît-il assez souple pour permettre à ces femmes d'obtenir une réponse positive ? Professeur Jacques Milliez : Je considère que ce cadre est souple et nécessaire car, effectivement, il faut avoir une réflexion médicale. Actuellement, les dispositions légales, avec la double expertise, dont éventuellement celle d'un expert psychiatre qui constate qu'il y a manifestement danger pour cette femme à poursuivre sa grossesse, nous le permettent. Nous entrons alors très légitimement, dans tous les sens du terme, dans la procédure de l'interruption thérapeutique de la grossesse, puisqu'elle est envisagée pour la santé de la mère. Il existe donc un cadre légal qui convient, pour l'instant. Il permet de ne pas s'arrêter au milieu du gué, à condition d'en avoir le souhait et la volonté. Mme Marie-Thérèse Boisseau : On nous a dit, la semaine dernière, qu'entre douze et treize semaines d'aménorrhée, s'opérait un changement qualitatif. En d'autres termes, l'embryon devient un f_tus et il y a un début d'ossification. Les femmes qui dépassent le délai de douze semaines d'aménorrhée, représentent 2 à 3 % de l'ensemble. Selon les témoignages, si vous fixez le délai légal à quatorze semaines, vous allez résoudre environ 1 à 1,5 % de ces cas. Pourquoi deux poids, deux mesures ? Je propose une solution plus globale qui permettent, à partir de douze semaines, de faire des avortements médicaux, quitte à étoffer les raisons pour lesquelles on peut les faire. Je ne comprends pas pourquoi vous faites cette césure à quatorze semaines. Professeur Jacques Milliez : Je fais une césure à quatorze semaines parce que je réponds à la question qui m'est posée. C'est le législateur qui pose cette césure, ce n'est pas moi. Moi, quand c'est nécessaire, je fais ce que je dois faire, législateur ou pas ! On fait toujours des lois qui rattrapent ou récupèrent les pratiques de la société. Si vous me demandez si l'on peut aller au-delà du délai de quatorze semaines, je vous répondrai que ce n'est pas la question à laquelle j'ai réfléchi. J'y réfléchirai quand la question se posera. J'ai réfléchi à la question qui m'était posée, du passage de douze à quatorze semaines d'aménorrhée. On me demande ce que j'en pense et je réponds que c'est possible, parce que je ne vois pas de transformation radicale de texture de l'embryon entre dix et douze semaines de grossesse qui fasse une énorme différence. Si c'était le cas, je ne vois pas pourquoi les Belges, les Allemands, les Espagnols et les autres ne l'auraient pas remarqué. Pourquoi sommes-nous les seuls ? C'est tout de même curieux que nous ayons là-dessus une spécificité, un blocage et que ce qui est possible ailleurs soit impossible chez nous. Il y a 300 millions d'Européens : j'espère que nous pourrons aller vers une législation commune. C'est mon v_u. J'ai beaucoup réfléchi à cette question. Je suis catholique. Je ne suis donc pas un farouche défenseur de l'avortement. Je considère que c'est la solution la moins mauvaise et que ce n'est pas à moi de juger. J'espère que nous irons vers une solution européenne qui trouvera un terme moyen et raisonnable pour ce qui peut ou non se faire. Cela dit, dans toutes les questions d'éthique et, par conséquent, probablement, dans la législation, il est nécessaire de placer une limite arbitraire. Il n'y a aucune raison rationnelle, cartésienne, de placer la barrière ici plutôt que là. Mais il y a un moment où il faut dire : "C'est là et c'est comme ça." Et, dans toutes ces questions d'éthiques, on constate une tendance au glissement, à la pente glissante, qu'il faut stopper, sans qu'il n'y ait forcément de raisons absolument explicites pour fixer là la limite. On peut, de façon non rationnelle, fixer la limite pour l'IVG pour l'instant à quatorze semaines d'aménorrhée. Mais, comme pour le clonage ou les sélections d'embryon, il faut savoir dire stop à un moment donné, parce que la société ne peut pas aller au-delà, même si nous n'avons aucune justification cartésienne pour expliquer ce choix. Mme Catherine Génisson : Vous avez dit qu'on utilise la méthode médicamenteuse jusqu'au quarante-neuvième jour et qu'ensuite, pour quinze semaines et plus, on pouvait aussi l'utiliser. Pourquoi n'utilise-t-on pas cette méthode médicamenteuse jusqu'à douze ou quatorze semaines ? Professeur Jacques Milliez : Le taux de succès d'expulsion embryonnaire, en tout début de grossesse, est suffisant pour apporter une bonne sécurité. Il n'est pas de 100 %, il doit être de 95 ou 96 %. Puis, plus on avance dans la grossesse, moins il y a de succès, plus il y a de rétention ovulaire, parce que l'embryon est effectivement trop petit et s'expulse mal. Il ne redevient susceptible d'être expulsé en totalité, sans risque de rétention, qu'après. Il existe un gap entre le moment où cette technique est utilisée au début et le moment où l'on peut à nouveau l'utiliser. Après, à partir d'un certain terme, nous n'avons pas d'autres choix que de l'utiliser. Mme Martine Lignières-Cassou, présidente : Le professeur Baulieu avait expliqué, lors de son audition, que l'on pouvait utiliser le RU 486, y compris pour des accouchements. Mme Marie-Thérèse Boisseau : Oui, mais pour d'autres raisons. Pour un assouplissement du col, mais pas pour l'expulsion. Professeur Jacques Milliez : Pour des raisons pratiques d'organisation, une IVG par aspiration médicale se déroule sur une journée ou moins d'une journée alors que, par méthode médicamenteuse, plus le terme avance, plus le temps passé à l'hôpital est long, de l'ordre d'un ou deux jours. Ce n'est pas du tout la même prise en charge. Mais, si c'est le prix de la sécurité, acceptons-le à partir de quatorze semaines. Néanmoins, avant quatorze semaines d'aménorrhée, il ne serait pas justifié d'y avoir recours. Nous pouvons y avoir recours mais l'aspiration par technique chirurgicale est faisable, et faite. Plus les équipes en auront la maîtrise, moins cette technique comportera de risques. Je comprends bien les réticences d'un certain nombre d'accoucheurs, quand on leur dit que les progrès de l'échographie ou autres conduisent à faire plus d'IVG. Cela ne les enthousiasme pas. Mais quand on leur montre les progrès de la célioscopie ou des techniques qui les amusent, ils les apprennent et les maîtrisent très vite. De la même façon, ils apprendront très vite à maîtriser, s'ils le souhaitent, les techniques qu'ils n'utilisaient pas jusque-là, c'est-à-dire l'aspiration entre douze et quatorze semaines d'aménorrhée. Ce n'est pas très compliqué. Cela demande de l'attention, cela demande de la formation peut-être, mais ce n'est pas inaccessible à des mains chirurgicales. Mme Marie-Thérèse Boisseau : On peut envisager à nouveau l'avortement médicamenteux à partir de la quinzième semaine ? Professeur Jacques Milliez : Oui. Même à quatorze semaines d'aménorrhée. Mme Marie-Thérèse Boisseau : Aux mêmes doses ? Professeur Jacques Milliez : Oui. C'est comme cela que cela se passe dans la pratique. A partir de ce terme, on n'accepte pas de prendre de risque. Mme Marie-Thérèse Boisseau : On ne fait plus d'avortement instrumental ? Professeur Jacques Milliez : Cela se fait exceptionnellement. Il m'est arrivé de le faire, et cela m'arrive encore parce que j'en ai une certaine pratique, lors d'interruptions thérapeutiques de grossesse, pour éviter de garder les femmes. Mais je préfère ne pas le faire. La sécurité, la sérénité, si tant est que l'on puisse parler de sérénité en la matière, est d'utiliser à partir de ce terme de quatorze à quinze semaines, les médicaments. Audition de Mme Michèle Ferrand sociologue au Centre national de la recherche scientifique Réunion du mardi 17 octobre 2000 Présidence de Mme Martine Lignières-Cassou, présidente Mme Martine Lignières-Cassou, présidente: Nous recevons aujourd'hui Mme Michèle Ferrand, sociologue au CNRS depuis 1979 et spécialisée dans le domaine des rapports hommes-femmes. Vous avez commencé votre carrière de recherche en travaillant sur l'avortement et en publiant, en 1987, un Que sais-je ? sur L'IVG en France. Vous avez ensuite travaillé sur les trajectoires familiales et professionnelles des femmes et des hommes vivant en couple et publié sur ce thème l'ouvrage : Entre travail et famille: dire sa vie. Vous avez également mené une enquête sur les femmes scientifiques de haut niveau - normaliennes et polytechniciennes - et sur le rôle de la famille dans la production de ces trajectoires. Vous travaillez actuellement avec l'INSERM sur une enquête portant sur la contraception en France aujourd'hui. Nous souhaiterions donc vous entendre sur cette enquête menée à partir de quatre-vingts entretiens de femmes ayant eu une grossesse non prévue. Mme Michèle Ferrand : Cette enquête qualitative, commencée il y a deux ans, réunit des chercheurs de l'INSERM et du CNRS. Dirigée par Nathalie Bajos (INSERM) et moi-même, elle a consisté en une approche spécifique du recours à l'IVG et de l'acceptation de la contraception en France. Elle a été menée à partir d'entretiens approfondis auprès des femmes, de manière à déterminer leur trajectoire, leur façon de vivre la contraception et leur situation en cas de grossesse non prévue. C'était la manière dont nous avions décidé d'aborder le problème : nous voulions rencontrer des femmes qui, dans les trois dernières années, s'étaient retrouvées enceintes sans l'avoir voulu, qu'elles aient par la suite choisi d'interrompre ou de poursuivre cette grossesse. Pour recruter ces femmes, nous sommes passées par un système assez peu fréquent en sociologie, celui de petites annonces parues dans les journaux féminins, placardées dans les bureaux du Planning, les centres d'IVG et les cabinets de consultation de gynécologues, à Paris et en province. Si nous avons choisi ce moyen pour recruter ces femmes, c'est parce que nous voulions des femmes qui aient envie d'en parler. Le problème de l'avortement, nous en étions convaincus et l'enquête nous a confortés dans cette position, est que la décision d'avorter n'est jamais un geste anodin pour les femmes ; les faire parler sur ce sujet ne l'est pas plus. Nous nous sommes dit qu'éventuellement, nous pourrions rééquilibrer l'échantillon par rapport à la population nationale, s'il nous manquait certaines catégories. C'est ce que nous avons dû faire, essentiellement pour les mineures qui, malgré des annonces parues dans la presse des jeunes, n'ont pas énormément répondu. Nous continuons d'ailleurs à travailler à l'heure actuelle, après la rédaction de ce premier rapport, au problème des mineures et à celui des femmes qui ont dépassé les délais - elles ont été également très difficiles à rencontrer puisqu'elles se sentaient dans l'illégalité et n'avaient pas forcément envie d'en parler, se sentant doublement stigmatisées -. Nous avons un échantillon qui ne se veut pas représentatif mais diversifié d'un point de vue socio-démographique, qui rend compte à peu près de toutes les catégories sociales, qui couvre l'ensemble des âges et des types de résidence (urbain/rural), et qui regroupe tous les cas de figures de situations matrimoniales - couple, situations de rupture et engagement dans une relation -. Nous avons constaté, en premier lieu, que nous ne pouvions pas faire de typologie de femmes, car nous n'avions pas affaire à des femmes à risques, mais à des situations à risques ; en fait, à un moment de leur trajectoire, pour des raisons extrêmement complexes, ces femmes se trouvaient enceintes sans l'avoir prévu. Nous avons essayé de voir comment ces femmes se situaient par rapport à la contraception ; comment elles avaient pris la décision d'avorter ou de conserver cette grossesse ; et, quand elles avaient opté pour l'IVG, comment s'était déroulé leur recours au système de soins. Nous avons découpé notre étude en différents chapitres qui recouvrent l'échec contraceptif, la décision de poursuivre la grossesse ou non et la façon dont l'appareil de soins a répondu aux demandes des femmes. Ce sont les trois grands axes de notre enquête, ces chapitres pouvant être décomposés en fonction de populations plus particulières, comme celle des mineures ou celle des femmes étrangères, - sur lesquelles nous n'avons pas beaucoup à dire pour l'instant, car il nous faut approfondir l'analyse -, ou encore celle des femmes ayant dépassé les délais. Elles constituaient les trois populations se situant à la marge de la législation actuelle sur lesquelles nous avions envie de porter un regard plus aigu. Nous avons constaté que nous pouvions placer quasiment toutes ces femmes sur un espèce de continuum en matière de pratique contraceptive, qui allait de l'acceptation la plus concrète et la plus totale à l'impossibilité contraceptive. Pour l'essentiel, ces femmes se disaient favorables à la contraception, bien informées, et l'utilisant, ce qui peut paraître assez étonnant. Un tiers des femmes que nous avons interrogées a poursuivi sa grossesse. Dans l'analyse concernant leur rapport à la contraception, nous avons mélangé les femmes qui avaient décidé d'interrompre leur grossesse et celles qui avaient décidé de la poursuivre. Nous avons donc analysé leur rapport à la contraception, quelle que soit l'issue de la grossesse. Nous nous sommes posés la question de savoir ce qui expliquait la grossesse non prévue. La première question était celle-ci : dans un pays où la contraception est largement diffusée, où seulement 2 à 3 % des femmes déclarent être dans la situation d'avoir des relations sexuelles, de ne pas vouloir d'enfant et de ne pas utiliser de techniques contraceptives quelles qu'elles soient - résultat de l'enquête de l'INED -, comment se fait-il que nous ayons un taux de grossesse non prévue et d'interruptions volontaires de grossesse aussi élevé ? La véritable question était : qu'est-ce qui se passe du côté de la contraception ? Mme Marie-Thérèse Boisseau : Pourquoi votre échantillon était-il limité à quatre-vingts femmes ? Est-ce suffisant pour être significatif ? Mme Michèle Ferrand : Une recherche qualitative ne vise jamais la représentativité. Mais, lorsqu'elle porte sur un échantillon diversifié du point de vue socio-démographique, elle permet d'identifier les processus qui conduisent les femmes à se trouver dans une situation donnée, ici être confrontée à un échec de contraception. Au-delà d'un certain nombre d'entretiens, il ne sert à rien d'augmenter encore l'échantillon car les différents processus ont déjà été repérés. Le plus souvent, les échantillons des enquêtes qualitatives portent sur une cinquantaine de cas. Ici, nous avons été au-delà parce que nous étudions des populations spécifiques : les jeunes, les femmes étrangères et les femmes hors-délais. A terme, nous espérons recueillir une centaine d'entretiens. En particulier, pour les mineures, nous n'en avons pas encore assez, ce qui explique que nous continuions. Pour les femmes étrangères, non seulement il nous faudrait en avoir davantage, parce que certaines sont venues un peu par hasard, mais il va nous falloir vérifier ce que nous apportent ces femmes, une fois que nous aurons établi leur appartenance sociale. Je ne m'étendrai pas plus longuement sur ce cas particulier, car nous devons encore avoir une vingtaine d'entretiens. Tout ce que nous pouvons dire sur les femmes étrangères, et notamment sur les jeunes femmes maghrébines ou d'origine maghrébine, lorsqu'on les remet à hauteur de la population française habituelle, en fonction du diplôme, de l'activité et du statut matrimonial, c'est qu'elles se comportent comme la population générale. En revanche, les mineures ou les jeunes femmes maghrébines de moins de vingt-cinq ans seraient plus proches des mineures de moins de dix-huit ans de la population française, petit retard d'âge certainement dû à la situation particulière que connaissent les mineures et, sans doute aussi, les jeunes filles maghrébines. Pour revenir à la contraception, une très grande partie des femmes que nous avons rencontrées avaient un rapport favorable à la contraception, la prenaient et ne souhaitaient pas être enceintes. Elles utilisaient ou avaient utilisé, de manière fréquente, constante et régulière, une contraception et ne voulaient pas être enceintes. La survenue de cette grossesse non prévue s'expliquait par plusieurs processus. Tout d'abord, il y a l'accident de méthode que tout le monde peut comprendre, qui renvoie à la différence entre l'efficacité pratique et l'efficacité théorique d'une méthode. Nous avons l'exemple tout à fait particulier d'une femme médecin en train de terminer sa thèse, qui s'est retrouvée enceinte sans l'avoir prévu et qui est certaine de ne jamais avoir oublié sa pilule. Ce n'était pas un drame pour elle, elle a d'ailleurs gardé cet enfant. C'était un peu prématuré par rapport à son projet. Elle dit elle-même : "De toute façon, tout le monde sait qu'il y a peu de risques avec la pilule, mais que les risques ne sont pas totalement nuls." C'était le cas le plus exceptionnel. Nous avons eu les accidents de méthodes que sont les accidents de préservatifs, les "oublis" de pilule ou les vomissements. Ce ne sont pas alors des oublis conscients ou inconscients, mais des problèmes de médicaments neutralisant l'effet de la pilule. Les femmes les ont évoqués spontanément, sans remettre en cause leur rapport à la contraception. Elles concevaient que la contraception ne soit pas fiable à 100 %. Le deuxième processus est très important aussi parce que les médecins y jouent un rôle, c'est celui de l'infertilité supposée. Il s'agit de femmes qui, soit se sont entendu dire par leur médecin qu'elles étaient hypofertiles, voire infertiles et qu'elles ne risquaient plus rien, soit même de femmes qui avaient consulté pour infertilité. Le cas le plus typique que nous avons rencontré plusieurs fois est celui d'une jeune femme mariée pendant plusieurs années avec un homme avec lequel elle souhaitait avoir un enfant et qui ne pouvait pas en avoir. Les années passant sans enfant, leur relation s'est détériorée et ils se sont séparés. Se pensant infertile, elle a eu une nouvelle relation et, le mois d'après, elle s'est trouvée enceinte. Classique, me direz-vous, mais toujours très surprenant pour ces femmes. Mme Catherine Génisson : On voit aussi cela, parfois, dans des cas d'adoption. Mme Michèle Ferrand : En revanche, trois autres situations sont beaucoup plus complexes. La première est celle de ce que nous avons appelé "la méthode inadéquate". Nous avons remarqué qu'à l'heure actuelle, les médecins accordent un bonus à la pilule en raison de sa grande fiabilité ; pourtant, sauf pour certaines femmes, la méthode préconisée par le médecin paraît inadéquate avec leur mode de vie. J'en donnerai deux exemples. Le premier est celui d'une jeune mère qui vient d'accoucher, qui reprend une pilule légèrement dosée pour pouvoir allaiter son enfant et qui, perturbée par les périodes d'allaitement et de réveils de son enfant en bas âge, a du mal à respecter, à ce moment assez difficile du point de vue de la gestion du temps, l'impératif de prendre la pilule à heure fixe. Le deuxième exemple est le cas, très clairement exprimé par une femme divorcée, qui élève seule ses enfants et qui a une nouvelle relation. Elle ne vit pas avec cet homme, leur relation est plus ou moins clandestine ou, plutôt, n'est pas clairement vécue au grand jour. Elle explique qu'il n'est pas facile de penser à prendre la pilule tous les soirs quand on n'a pas un homme dans son lit. Il y a une distance entre cette prise de contraception au quotidien et ses relations irrégulières avec un homme ; elle ne fait pas le lien entre cette pilule prise tous les soirs et sa liaison. Elle explique cet oubli en disant : "Avant, quand je vivais avec le père de mes enfants, je n'oubliais pas la pilule. Cette relation est relativement récente - trois mois - et il m'arrive de l'oublier." En tant que sociologue, il m'intéresserait de savoir ce que donnerait auprès des hommes la prise d'un placebo au quotidien, même pendant six mois, et notamment s'il n'y aurait pas d'oublis dus à des couchers tardifs. Mme Catherine Génisson : Avez-vous pu déterminer si, dans ces oublis, il n'y avait pas une part d'ambivalence ? Mme Michèle Ferrand : Nous avons effectivement évoqué l'idée de l'échec contraceptif au service de l'ambivalence. Mais nous ne l'avons pas associé à cette catégorie de femmes, parce que ces femmes n'étaient pas ambivalentes par rapport au désir d'enfant. Selon elles, elles n'avaient aucun désir d'enfant. Les psychologues pourraient dire que dans toute femme, il y a un désir d'enfant caché. Mais ces femmes disaient explicitement qu'elles ne voulaient pas d'enfant, qu'elles n'en avaient pas envie, que ce n'était pas un problème qui se posait pour elles. Pour d'autres femmes en revanche, et j'y reviendrai tout à l'heure, on a pu observer que l'ambivalence était à l'origine d'un échec de contraception. Les premières déclaraient avoir un rapport très positif à la contraception ; les deuxièmes, un rapport beaucoup plus réservé, puisque les méthodes qu'elles utilisaient ne les satisfaisaient pas. Il y a aussi un autre aspect, qui n'est pas très important dans notre étude, c'est celui de la contraception vécue comme un enjeu des rapports entre homme et femme au moment de la relation. C'est le problème du préservatif, mais c'est aussi celui de la contraception inadéquate pour la femme. Quand l'homme ne veut pas utiliser de préservatif et que la femme ne supporte pas la pilule, il y a indéniablement un enjeu réel dans chaque relation sexuelle. L'homme pousse généralement la femme à prendre la pilule, parce que c'est beaucoup plus confortable pour lui. Les femmes reconnaissent d'ailleurs très souvent que les hommes n'aiment pas les préservatifs et trouvent cela normal ; elles sont même suffisamment soucieuses du bien-être de leur partenaire pour s'en préoccuper en tentant, à nouveau, de prendre la pilule ou d'en essayer une différente, ou en étant prêtes à utiliser des méthodes telles que gel spermicide ou éponge, qu'elles-mêmes n'aiment pas tellement. Les hommes n'aiment cependant pas plus les spermicides, ou, plus exactement - ne généralisons pas - les hommes dont ces femmes nous ont parlé. Nous avons rencontré des cas de domination masculine aboutissant à des grossesses non désirées chez la femme. J'en donne deux exemples. Le premier est celui d'une jeune femme qui possède un BTS, qui a une relation avec un homme déjà marié ayant déjà plusieurs enfants avec plusieurs femmes. Elle est elle-même un peu perdue, vit chez sa grand-mère, n'a pas de famille à Paris et elle se raccroche à cette relation. Elle prend la pilule et elle s'attache à ne pas l'oublier ; elle est très sérieuse. Ce n'est pas le premier homme de sa vie et elle n'a jamais eu de problème avec la contraception. Elle oublie pourtant sa pilule et, le lendemain, voyant son partenaire, elle le prévient. Celui-ci lui dit : "Ce n'est pas pour une fois. Tu n'en mourras pas. Je ne mettrai pas de préservatif." A la suite de cette relation, il part en vacances. Elle se retrouve enceinte et elle est donc amenée à avorter sans qu'il soit là. Le second est celui d'une jeune femme qui utilise elle aussi la pilule depuis toujours. Elle a été malade la veille et pense avoir vomi sa pilule. Son partenaire refuse d'utiliser le préservatif, disant qu'ils ont toujours fait comme ça et qu'il ne voit pas pourquoi changer. Ces exemples nous sont apparus importants parce que se dessinent des enjeux sur lesquels nous ne pourrions pas agir du point de vue de la prévention en santé publique. C'est quelque chose de beaucoup plus ample. Mme Martine Lignières-Cassou, présidente : La pilule du lendemain peut aujourd'hui apporter une solution à ces cas. Mme Michèle Ferrand : Oui. La pilule du lendemain m'amène justement au dernier point concernant ces femmes qui sont très favorables à la contraception, ne veulent pas d'enfants et pensent faire ce qu'elles doivent pour ne pas être enceintes : la différence entre information détenue et information efficace. A cet égard, le cas des mineures nous paraît le plus net, mais cela concerne l'ensemble des femmes. Pour la majorité d'entre elles, nous constatons un déficit d'information sur les méthodes contraceptives et leur fonctionnement. Si vous les interrogez sur le fonctionnement de la pilule, vous vous rendez compte qu'elles ne le connaissent pas. Nous-mêmes d'ailleurs ne le connaissions pas. C'est grâce aux médecins qui participent à l'enquête que nous avons appris que la couverture de la pilule commençait au septième jour de prise et, qu'à partir du moment où on l'avait prise durant sept jours, si on l'oubliait le huitième, il fallait la reprendre immédiatement. Je parle de la pilule normale, pas de la mini-dosée. La plupart des médecins n'avaient pas donné cette information aux femmes. Le plus bel exemple concernant une mineure est celui d'une jeune fille qui rencontre son partenaire en classe. C'est son premier partenaire. Lui-même n'a jamais eu de relation sexuelle auparavant, ce qui écarte le risque du sida. Ils ont donc des relations sexuelles sans préservatif, sauf le quatorzième jour, se fiant à un manuel de biologie qui indique que l'ovulation se produit ce jour-là. Ce livre ne précise ni que les spermatozoïdes ont une durée de vie de quatre ou cinq jours, ni que l'ovulation peut se produire à une tout autre date que le fameux 14ème jour. C'est en cela que l'information est un aspect important du rapport à la contraception, car le rapport de ces jeunes filles à la contraception était très positif ; elles auraient volontiers pris la pilule, si elles avaient su où la demander. Autre exemple d'une mineure de quatorze ans qui a sa première relation sexuelle avec un partenaire d'une vingtaine d'années. Elle décide d'aller au Planning familial où on lui prescrit la pilule pour quelques mois, en lui faisant remarquer qu'elle commence tout de même un peu jeune. Résultat : elle ne retourne pas au Planning. Mme Martine Lignières-Cassou, présidente : Vos précédentes études montraient déjà que la tolérance vis-à-vis de la sexualité des jeunes et l'acceptation sociale conditionnent leur comportement. Mme Michèle Ferrand : Je vais directement aux conclusions : un des points fondamentaux en ce qui concerne les mineures, ce qui est le plus protecteur pour elles, c'est qu'elles puissent dire qu'elles ont une sexualité. La raison des retards d'annonce d'une grossesse aux parents, c'est qu'elles doivent parler de leur sexualité à leurs parents. Il semble que la notion d'adulte référent soit vraiment la bonne notion. Les mineures ne sont pas les inconscientes que l'on veut dire. La plupart du temps, excepté les très jeunes ou les cas un peu particuliers, ces jeunes filles auraient souhaité prendre une contraception sûre, sauf dans un cas qui nous amène à la deuxième catégorie de femmes. Nous venons de voir des femmes qui avaient un rapport positif à la contraception, qui ne voulaient pas être enceintes et qui pensaient avoir fait ce qu'elles devaient pour ne pas l'être. Il existe une seconde catégorie qui est celle de l'échec de contraception ou de la contraception au service de l'ambivalence. Cela se trouve, y compris chez des mineures. Mais d'abord, de quelles mineures parle-t-on ? Ce n'est pas pareil de parler d'une mineure de dix-sept ans et demi et d'une mineure de treize ou quatorze ans. Il existe aussi des mineures qui, certes, n'ont pas fait exprès d'être enceintes, mais pour lesquelles la perspective de la grossesse, qu'elles refusaient ouvertement, n'est pas si affolante, ni indésirable que cela, parce que cela les fera sortir de leur milieu, les fera sortir de l'école, leur donnera un statut, leur donnera un but. Toutes les grossesses de mineures ne sont pas des drames pour ces jeunes filles. En tout cas, ce n'est pas du tout comme cela qu'elles le vivent. Toutes les grossesses d'adolescentes ne sont pas des grossesses non désirées, même lorsqu'elles sont involontaires, puisque non programmées. Nous en avons eu une qui était programmée. Il s'agissait justement de la jeune fille qui s'était fait renvoyer du Planning à quatorze ans. S'étant retrouvée enceinte, elle avait subi une première IVG, puis à dix-sept ans et demi, elle a souhaité une deuxième grossesse pour forcer la main à ses parents, qui ne voulaient pas la laisser vivre avec son partenaire - toujours le même - qui avait maintenant vingt-six ans et un emploi leur permettant de s'installer. Les parents ont refusé, simplement parce qu'elle était mineure. Depuis sa précédente IVG, elle prenait la pilule. Elle a prétendu l'avoir oubliée, car elle n'a pas pu assumer de dire à ses parents qu'elle voulait un enfant. Comme vous le voyez, il y a encore des choses qui ne se disent pas entre les parents et les enfants ! Cette contraception au service de l'ambivalence, on la voit apparaître essentiellement dans une situation de couple stable, où l'enjeu est le moment d'arrivée de cette naissance ou la possibilité d'un enfant supplémentaire, avec lequel le partenaire n'est pas forcément d'accord. Dans ces cas, pendant un temps, la femme accepte le désir de son partenaire, puis les dérapages sont liés à ce désir d'enfant. Elles le reconnaissent facilement : "J'ai oublié, mais ce n'est pas par hasard". Il peut aussi se produire des situations dans lesquelles la femme est amenée à gérer un désir d'enfant réel, mais pas une grossesse dont elle pense qu'elle n'est pas réalisable matériellement. C'est le cas d'une jeune femme qui a déjà une petite fille d'une première union et dont le partenaire, divorcé avec une petite fille, vit à Paris alors qu'elle vit dans la région de Marseille. Ils se voient un week-end sur deux, l'un descendant ou l'autre montant. Elle n'a pas de travail à Paris et lui n'en trouvera pas en province. Elle a un très fort désir d'enfant, elle oublie vraiment sa pilule, s'en aperçoit le lendemain mais l'oublie une deuxième fois. Elle nous dit : "Mon c_ur et mon corps en voulaient, mais ma tête me disait non." L'ambivalence est très bien exprimée. Cela s'est terminé par une IVG parce qu'en plus, elle s'est rendu compte qu'elle était enceinte le jour de son licenciement. C'était, pour elle, un déchirement d'avorter. Elle avait très envie d'avoir un enfant de cet homme, elle avait déjà trente-six ans, âge qu'elle jugeait déjà avancé. Pourtant, il n'était absolument pas sérieux de conserver cette grossesse à ce moment-là. Très rapidement, j'évoquerai ce que nous avons appelé "l'impossible démarche contraceptive" qui touche très peu de femmes. Nous n'en avons rencontré que très rarement, mais nous aurons peut-être plus de cas lors de l'étude quantitative qui est en cours. Il s'agit de femmes qui ne contrôlent rien dans leur vie. Ce sont des femmes "en galère", des femmes maltraitées, des femmes qui n'ont pas de profession ou de moyens de survivre, qui sont dépassées par les événements. Avoir une maîtrise de la contraception leur paraît impossible. Ce sont elles qui risquent de présenter des IVG à répétition. Mme Martine Lignières-Cassou, présidente : Et le stérilet ? Mme Michèle Ferrand : Le stérilet pose le même problème : comment voulez-vous qu'une femme "en galère" puisse avoir un stérilet qui, jusque-là, valait 500 francs ? Nous sommes là confrontées à des situations extrêmement difficiles, même si elles ne sont pas majoritaires. Nous retrouvons le même phénomène dans le cas de femmes qui vont avorter trop tardivement. Ce qui explique alors les retards est le temps qu'elles ont mis à rassembler l'argent nécessaire pour l'échographie car, je vous le rappelle, l'échographie avant un avortement est payante. C'est considéré d'ailleurs comme très choquant par de nombreuses femmes. Nous retrouvons ce même processus à tous les maillons. Ce sont des femmes qui avorteront ou qui n'avorteront pas, qui abandonneront leur enfant ou essaieront de le garder, au fil de l'évolution de leur situation. Nous nous rendons compte que lorsqu'une femme ne maîtrise pas sa vie, on peut difficilement attendre d'elle qu'elle contrôle sa contraception. Sans doute, le cas le plus emblématique est-il celui d'une femme qui a réussi à survivre, malgré un viol vécu dans sa jeunesse qui a eu pour conséquence qu'elle ne supporte pas d'aller consulter un gynécologue. Or, pour avoir la pilule, il faut aller voir un gynécologue. Elle a réussi à "survivre" du point de vue contraceptif parce qu'elle travaillait dans une maternité et se procurait la pilule grâce à des copines infirmières. Puis, elle a changé de travail, a eu une relation très compliquée avec un homme, qui l'a plus ou moins prostituée. Elle s'est retrouvée sur le trottoir et a fait deux IVG. Pourtant, durant dix ans, elle avait eu une pratique contraceptive exemplaire. J'insiste sur ce point car, nous le voyons bien pour l'IVG, ce sont moins des femmes à risque que des situations à risque. Cette femme, cinq ans plus tôt, n'était pas du tout une femme à risque : elle avait trouvé un moyen de se procurer une contraception sûre, qu'elle utilisait bien. Il faut donc éviter de mettre cette idée de "femmes à risque" en avant. Il n'existe pas de femmes à risque, il existe des moments à risque, il existe des conjonctures de situations qui engendrent des risques. De même, nous ne pouvons pas dire globalement que certaines femmes avorteront plus que d'autres ou prendront plus facilement la décision d'avorter que d'autres. Comme l'échec de contraception, et pas forcément de la même façon, car ce ne sont pas forcément les mêmes raisons qui expliquent l'échec de contraception et la décision d'avortement, la raison et la décision d'avortement résultent d'un moment particulier. Ce moment est en liaison très forte, et principale, avec le partenaire du moment. C'est le facteur le plus important que nous ayons dégagé de notre enquête. Des histoires de femmes qui "font un enfant dans le dos des hommes", nous n'en avons pas rencontrées. Certaines d'entre elles ont réussi à "imposer" une grossesse alors que leur partenaire n'en voulait pas, mais c'était toujours dans le cadre d'un couple stable ayant déjà des enfants. Dans les cas de couples en difficulté ou de couples en train de se constituer, la priorité était donnée à la relation dans le couple, la première raison invoquée étant que l'on ne fait pas cela à un homme auquel on tient et que l'on ne commence pas une relation en ayant un enfant, la seconde étant que pour qu'un enfant soit bien, il lui faut un père et une mère. Si l'on ne peut pas y parvenir, il vaut mieux refuser la naissance et y renoncer. Ce dernier élément est très prégnant chez les femmes ; toutes celles qui ont gardé leur enfant avaient un père pour cet enfant. Celui-ci n'est pas forcément consentant, ce qui occasionne alors des négociations. Je pense notamment à l'exemple d'une institutrice qui avait déjà trois enfants et dont le mari ne voulait pas le quatrième parce que cela faisait "lapin". Elle lui a dit : "J'ai réussi à élever les trois précédents. Je réussirai à élever le quatrième. Si tu ne veux pas de cet enfant - et elle lui a mis le marché en main - tu peux partir." Il est resté, il a d'ailleurs fort bien accepté ce quatrième garçon, bien qu'ils aient espéré une fille. Je ne développe pas plus, mais le rôle et la place du partenaire dans la décision d'IVG est extrêmement important. Le second facteur, presque aussi important que le partenaire, concerne les conditions d'accueil de cet enfant. Un enfant doit être accueilli dans certaines circonstances ; toutes les chances doivent être mises de son côté et il est notamment très important pour les femmes qu'elles aient des conditions financières et matérielles qui leur permettent d'élever un enfant. Etre une mère ni trop jeune ni trop vieille est aussi un facteur qui peut jouer, mais de manière secondaire. Cela éloigne complètement le spectre d'un avortement de convenance. Ce n'est vraiment pas ce qui est en jeu pour les femmes quand elles décident d'avorter. Le troisième facteur, sûrement le moins important, concerne l'accès aux soins. Nous avons retrouvé ce qu'indiquait déjà le "rapport Nisand" l'année dernière : des conditions très inégales d'accès au système de soins et l'importance du premier interlocuteur rencontré par la femme. Si la première personne à qui elle en parle sait et connaît les réseaux de soins, il n'y aura aucun problème et elle avortera dans le temps. J'insiste sur le fait que la décision d'avortement se prend très tôt. Mis à part quelques cas très minoritaires d'ambivalence et qui, bien souvent, vont garder l'enfant, la décision des femmes est prise avant même la huitième semaine, immédiatement après le premier retard, dès qu'elles s'en aperçoivent et qu'elles font un test de grossesse. La décision est prise dans les quelques jours qui suivent le constat de la grossesse. En revanche, les femmes estiment qu'elles mettent beaucoup de temps pour trouver l'endroit où avoir cette interruption de grossesse, et elles vivent très difficilement le temps qui s'écoule entre le moment de la décision et celui où elles finissent par obtenir l'IVG. Les grossesses hors délais que nous avons rencontrées - à part les cas particuliers d'ambivalence qui tournent mal ou de mineures qui ont peur d'annoncer cette grossesse - sont le fait de femmes qui ne se rendent pas compte à temps qu'elles sont enceintes et/ou ont mis trop de temps à trouver un centre d'IVG. Il y a peut-être parfois un déni de grossesse mais, en tant que sociologues, nous ne pouvons qu'entendre le discours de la femme si elle nous dit qu'elle ne s'en est pas aperçue parce qu'elle avait eu quelques saignements ou qu'elle a téléphoné à son médecin, mais n'a pas pu le joindre. En conclusion, nous pouvons dire qu'il n'existe pas de femme type sur laquelle le législateur ou le prescripteur médical pourrait agir. C'est, à chaque fois, lié à la situation de la femme. Nous constatons également que de nombreuses améliorations restent à apporter en matière de conditions de prescription de la contraception et, surtout, en ce qui concerne la diffusion d'une information généralisée sur la contraception et l'IVG, qui sont très mal connues. M. Philippe Nauche : Je voudrais savoir si le délai légal actuel de dix semaines, était vécu par l'échantillon des personnes que vous avez rencontrées comme limitatif ou pas : cela leur a-t-il posé vraiment problème ? Vous répondez en partie à cette question lorsque vous dites que, généralement, les décisions sont prises très tôt et que c'est, en fait, plus le passage de la décision à l'acte en raison d'un cheminement compliqué qui crée des problèmes de délai. Le fait que ce délai soit de dix semaines a-t-il pu influer sur la décision des femmes que vous avez rencontrées de poursuivre ou non cette grossesse, en créant une tendance à se décider dans la précipitation ? Mme Michèle Ferrand : Je suis là en tant que chercheure ; je me borne donc à rapporter ce que disent ces femmes. Pour celles qui ont des perturbations de leur cycle pour des raisons médicales ou autres et qui s'aperçoivent qu'elles sont enceintes, non pas au premier mais au second retard de règles, il semble bien que ce délai de dix semaines soit très juste. Deux semaines de plus leur permettraient de ne pas vivre la double stigmatisation ; elles ne supportent pas l'idée qu'on leur dise d'aller faire ailleurs ce qui est illégal en France. C'est un aspect très traumatisant pour elles. Nous n'avons rencontré aucun cas où la femme se dise : "C'est trop tard, je le garde". Le seul cas qui s'en approche est le cas dramatique d'une femme qui s'est aperçue qu'elle était enceinte à cinq mois et demi de grossesse, alors qu'elle suppliait les médecins de lui expliquer ce qui lui arrivait. Elle s'était fait refaire le ventre et son gynécologue lui disait qu'elle était déjà ménopausée. C'est le fruit d'une erreur médicale manifeste. Elle est allée voir le professeur René Frydman qui lui a répondu : "Il est viable mais on peut le tuer, si c'est vraiment ce que vous voulez." Comme elle le dit maintenant, après avoir accouché prématurément d'une petite fille : "Je n'ai eu qu'un mois et demi de grossesse". C'est un cas particulier. Le fait de ne pas avoir rencontré d'autres cas de ce type ne veut pas dire qu'ils n'existent pas. De ma position tout extérieure, je serai assez partisane de rallonger le délai de deux semaines, parce que cela donnerait un peu plus de souplesse. Nous retrouverons sûrement alors les femmes "en galère", mais elles seront peut-être aussi dans les cas hors délais à quinze semaines. Nous n'en savons rien, tout ce que je peux dire c'est que, s'il n'y a pas d'erreur médicale ou d'erreur de diagnostic, la plupart des femmes se rendent compte de leur état à trois ou quatre semaines et avortent le plus rapidement possible, du moins dès qu'elles le peuvent et si elles ne rencontrent pas de difficultés pour accéder au système de soins. Mme Martine Lignières-Cassou, présidente : Même celles qui sont ambivalentes ? Avez-vous étudié les cas des mineures ? Mme Michèle Ferrand : Nous continuons l'étude les concernant parce que nous n'avons pas eu assez de cas. Mme Martine Lignières-Cassou, présidente : Votre analyse prend-elle en compte le critère de l'âge ? Les méthodes de contraception inadéquates augmentent-elles, par exemple, avec l'âge ? Mme Michèle Ferrand : Nous ne pourrons vous répondre qu'une fois l'étude quantitative réalisée. Nous ne pouvons pas donner de chiffres pour le moment, nous pouvons seulement montrer des cas de figure. Il serait illusoire sur un échantillon de quatre-vingts femmes de dire que tant de femmes sont dans telle ou telle situation. Mme Martine Lignières-Cassou, présidente : Parmi ces quatre-vingts femmes, avez-vous eu des demandes d'avortement de convenance, c'est-à-dire des demandes qui auraient été liées au sexe, à une malformation mineure ou autre ? Pensez-vous que la culpabilité que ressentent les femmes est toujours aussi grande qu'avant 1975 ? Mme Michèle Ferrand : Vous m'avez posé plusieurs questions : l'ambivalence rallonge-t-elle le délai ? L'ambivalence joue un rôle important pour ce qui est de l'échec de contraception. En revanche, quand la grossesse est là, les femmes ne sont plus ambivalentes. Elles savent. Elles peuvent hésiter un jour ou deux mais, d'après ce qu'elles disent, c'est le maximum. Elles ne retardent pas leur décision. Mme Catherine Génisson : Le "rapport Nisand" qualifie d'importante cette population de femmes ambivalentes qui vont jusqu'au bout des délais, dont on peut, à la limite, se demander si elles n'auraient pas gardé l'enfant. Avez-vous rencontré ce cas ? Mme Michèle Ferrand : Non. Mme Martine Lignières-Cassou, présidente : Les médecins qui sont contre l'allongement des délais nous disent que les femmes ambivalentes vont continuer à négocier avec leur compagnon jusqu'au bout des délais. Mme Michèle Ferrand : Mais elles ne sont pas ambivalentes, ces femmes, elles veulent leur enfant. Mme Catherine Génisson : Nous parlons toujours de la femme par rapport à son partenaire. Mais avez-vous rencontré le problème de l'ambivalence de la femme elle-même ? Mme Michèle Ferrand : Généralement, la femme ambivalente n'est pas claire avant la grossesse, ce qui peut expliquer l'échec de la contraception. Elle le devient quand elle s'aperçoit qu'elle est enceinte. La grossesse rend nécessaire une prise de décision. Toutes les femmes ressentent alors qu'il faut aller vite. Les chiffres sont parlants : plus de 60 % des femmes avortent avant huit semaines en France à l'heure actuelle. A mon avis, le problème de l'ambivalence existe donc vraiment au moment où la grossesse fait irruption, parce que c'est très difficile pour les femmes d'arriver à concilier tous leurs désirs : la profession, la relation avec le conjoint, la famille, les enfants. D'évidence, l'ambivalence est à creuser du point de vue de l'acceptabilité de la contraception et de la recherche d'une méthode plus adéquate en fonction de cette ambivalence. Pour certaines femmes, la contraception idéale n'existe pas. Elles disent, par exemple : "Un comprimé à prendre en début de chaque mois, on ne l'oublierait pas celui-là !" Si elles sont ambivalentes, elles l'oublieront quand même. La contraception est actuellement très inadéquate pour les femmes. Aucun progrès n'a été réalisé depuis des années. Mme Catherine Génisson : On parle beaucoup des femmes ambivalentes, mais toutes ne le sont pas. Mme Michèle Ferrand : La majorité ne l'est pas, c'est bien ce que j'ai dit. La première catégorie, qui n'est ambivalente, ni vis-à-vis de la contraception, ni de la grossesse, ni du désir d'enfant, qu'elles aient gardé ou non leur enfant, est la plus nombreuse. Car, je le répète, l'IVG n'est pas le refus d'enfant. C'est, bien plus que cela, l'affirmation que la maternité est irréalisable à ce moment-là. Nous avons rencontré des femmes qui se sont retrouvées enceintes alors qu'elles ne voulaient pas avoir d'enfant, et qui l'ont gardé ; et d'autres, qui ne voulaient pas être enceintes mais qui avaient envie d'enfant, qui ont pratiqué une IVG. C'est bien pour cela que la typologie ne fonctionne pas. On voit bien que ce sont des phases extrêmement contradictoires. Quant au problème des malformations et du sexe, nous n'en avons absolument pas parlé. Cela a été évoqué parfois pour des femmes qui avaient déjà trois enfants du même sexe. Nous leur demandions si, par hasard, c'était un enfant de l'autre sexe. Qu'elles aient avorté ou pas - nous avons eu les deux cas - l'attitude a été la même : un enfant, ce n'est pas un sexe. Il est impensable de détruire un enfant d'après ce critère, surtout si l'on a déjà des enfants de ce sexe-là. Elles ont déjà trois garçons, par exemple, vont-elles tuer le quatrième ? C'est inimaginable pour elles. La question de la malformation n'a pas été abordée parce qu'elle n'a pas été posée à l'époque. Par contre, la réponse est tout à fait évidente. Mais, encore une fois, ce n'est pas la recherche de l'enfant parfait, mais plutôt celle de l'enfant sans handicap. De la même façon que l'on veut réunir les meilleures conditions d'accueil de l'enfant, on veut lui donner toutes ses chances et un enfant handicapé aura moins de chances dans la vie. Si on peut l'éviter, on le fait. Il est évident que le problème va se poser de plus en plus tôt parce que, dans trois ans, on saura dépister à sept semaines les signes de mongolisme, par exemple. Ce n'est pas un argument qui a un sens pour les femmes et il n'a pas de sens non plus pour la majorité des médecins, me semble-t-il. En ce qui concerne le problème de la culpabilité, j'ai débuté mon travail sur l'avortement dans les années 1970. En 1971, j'ai réalisé une étude économique, juste avant l'arrivée de M. Jean Foyer au ministère de la santé, date à laquelle je n'ai plus eu accès aux informations qui devaient me permettre de chiffrer le coût de l'avortement clandestin, en France, à partir des données hospitalières. J'ai organisé des entretiens auprès de femmes qui avaient avorté dans la clandestinité ainsi qu'auprès de femmes qui avortaient après la dépénalisation de l'avortement. J'ai été frappée de constater que celles qui avortaient dans la clandestinité disaient qu'elles n'avaient pas le choix alors qu'après 1975, les femmes disaient qu'elles avaient le choix et que c'était cela qui était important. Elles tenaient un discours fort proche de celui des femmes actuelles sur les conditions dans lesquelles un enfant doit arriver. Elles étaient peut-être plus détachées de l'avis de leur partenaire. A travers certains de ces entretiens, il m'était apparu que, même si l'homme ne le voulait pas, elles pouvaient conserver une grossesse. Entre 1975 et 1980, l'idée dominante était que les femmes pouvaient faire face à la grossesse, si elles le voulaient vraiment. Elles le disent beaucoup moins maintenant. L'importance attachée au père aujourd'hui était très déniée durant la grande période du mouvement féministe. Les femmes considéraient qu'elles pouvaient se débrouiller si elles voulaient le garder, mais qu'elles avaient le droit de ne pas le garder, si elles ne le voulaient pas. En revanche, d'après leurs dires, les femmes avortaient d'un échec de contraception, de quelque chose qui grandissait en elles, dont elles ne voulaient pas. Je pense que l'échographie a eu une incidence extrêmement forte sur la représentation des femmes de l'embryon et du f_tus. Les femmes sont toutes conscientes de ce qu'elles font. Elles savent qu'elles sont en train d'avorter d'un enfant potentiel. Ce n'était pas forcément le cas dans les années 1978. Mme Catherine Génisson : Vous confirmez que dans les années 1970, les femmes revendiquaient leur droit de choix personnel et qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus en fonction de l'enfant à venir et des conditions de vie à venir de cet enfant que se prend la décision d'avorter ? Mme Michèle Ferrand : Je n'opposerais pas tout à fait les deux tendances. Mme Catherine Génisson : Vous constatez une évolution ? Mme Michèle Ferrand : Il y a une évolution ; il y a, en tout cas, une évolution du discours des femmes, une évolution de ce qu'il est légitime de dire quand on décide d'une IVG. Il est difficile de démêler les deux, mais aujourd'hui, c'est tout à fait évident, l'avortement ne s'est absolument pas banalisé. C'est toujours quelque chose de difficile à vivre pour la femme. Je ne dirai pas que c'est un acte douloureux, même si cela peut l'être pour certaines, mais ce n'est jamais un acte anodin. M. Philippe Nauche : Avez-vous rencontré des femmes qui s'étaient engagées dans une démarche d'IVG et qui, finalement, ont décidé de poursuivre leur grossesse ? Avez-vous eu le sentiment que le délai de réflexion, ce délai supplémentaire de huit jours, servait à quelque chose ? Pour les femmes pour lesquelles la réponse à la question de poursuivre ou non la grossesse n'était pas une évidence, qui intervient dans sa décision : la femme seule, la femme et son entourage, son compagnon ou époux, ou le médecin de famille avec lequel elle va en parler, et qui va faire passer un certain nombre d'options personnelles ? Mme Michèle Ferrand : Le délai de réflexion est jugé insupportable par les femmes justement parce qu'elles réfléchissent avant de prendre leur décision. Une fois leur décision prise, elles n'y reviennent pas. Ce délai de réflexion et l'entretien, si ce dernier est ressenti comme voulant les dissuader, sont très mal vécus. Par contre, il ressortait clairement d'entretiens que j'avais réalisés auprès de conseillères pré-IVG dans les années 80 qu'il existe un besoin de parole des femmes, que l'entretien ne suffit pas à combler. Elles ont toutes besoin de parler, mais pas forcément au même moment et de la même façon. Le plus efficace si l'on veut aider les femmes à vivre le mieux possible cette situation pénible, serait de leur proposer éventuellement un entretien avec une psychologue, au moment où elles le voudront, avant ou après. Avant, la priorité est tout de même d'avoir l'IVG. De ce que j'ai entendu, certains entretiens se sont très bien passés, pour d'autres, les femmes disent : "Elle était très gentille, mais...", pour d'autres encore, cela a aidé la femme. Nous ne pouvons pas porter un jugement trop péremptoire. Parfois, c'est le médecin qui a joué le rôle de conseillère, qui a aidé la femme à réfléchir et à voir ce qu'était le sens de sa décision, sans forcément chercher à l'amener à changer, mais simplement l'aider à réfléchir. C'est notamment le cas d'un gynécologue qui soignait cette jeune femme dont j'ai déjà parlé, qui l'avait consulté pour stérilité deux ans auparavant, et qui revient le voir, enceinte, en lui disant qu'elle ne peut pas garder cet enfant. Lui-même était un peu perturbé. Mais, il l'a écoutée. Ils ont parlé. Apparemment, ce dialogue a été très important. Elle ne souhaitait pas démarrer sa nouvelle relation par quelque chose qui ne serait bon ni pour la relation, ni pour l'enfant, qui risquerait de ne plus avoir de père, car l'homme aurait pu ne pas supporter d'avoir un enfant si précocement, au bout d'un mois. En ce qui concerne les femmes qui se sont engagées dans le processus d'IVG et qui ont renoncé après, nous avons deux cas. Le premier cas est celui d'une femme qui avait dépassé les délais, qui a eu une ambivalence et qui a continué sa grossesse en disant : "Les délais sont dépassés, je le garde." Mais son compagnon lui avait dit que ce n'était pas grave, qu'ils feraient face. Les deux phénomènes ont joué. C'est l'homme qui a accepté, finalement, qu'elle garde cet enfant. Nous ne savons pas ce qui se serait passé s'il avait maintenu sa position initiale. Le deuxième cas est celui d'une institutrice qui a poursuivi sa grossesse, mais qui pour faire plaisir à son mari, a fait toutes les démarches d'IVG nécessaires, sans être pour autant convaincue. Lorsqu'elle est arrivée chez la conseillère pour l'entretien, où son mari voulait l'accompagner et où elle a tenu à aller seule, elle a bien dit que, de toutes façons, elle n'avait pas du tout l'intention d'avorter, mais qu'elle avait fait les démarches pour son mari et que le soir même, elle lui dirait qu'elle le gardait. Sur la question de savoir qui décide, nous avons de nombreuses interrogations : avec qui prend-on la décision ? La femme prend-elle seule la décision ? En parle-t-elle à son partenaire ou pas ? Certaines femmes préfèrent ne pas en parler à l'homme, parce que, n'étant qu'une relation épisodique, il n'est pas concerné ; c'est une relation qui n'existe pas ou qui n'a pas de sens pour elles. Elles l'avertissent ou pas, et, en général, l'homme est tout à fait d'accord pour que cela se passe comme cela. D'autres n'en parlent pas pour ne pas mettre l'homme dans une situation difficile. C'est le cas de la jeune femme qui vit en province alors que son ami vit à Paris. Elle ne lui en a pas parlé. Elle en a parlé à sa mère et à sa meilleure amie. Elle l'a fait très vite parce qu'elle savait que ce n'était pas réalisable, qu'il était loin, qu'il allait souffrir de ne pas pouvoir venir, qu'il n'allait pas pouvoir l'aider. Ce n'était pas la peine de lui en parler. Mais c'est aussi une personne très secrète. Je lui ai demandé, au cours de l'entretien, si elle lui en parlerait un jour. Elle n'en savait rien, mais probablement le ferait-elle le jour où ils auraient un enfant. Mme Catherine Génisson : Y a-t-il eu des femmes qui n'en ont pas parlé à leur partenaire dans une relation très suivie ? Mme Michèle Ferrand : Non, nous ne l'avons pas rencontré dans notre échantillon. En revanche, nous avons rencontré des hommes qui étaient mal à l'aise pour gérer l'aide à la décision de leur femme. Opter pour le laisser-faire - "c'est à toi de décider" - qui est respectueux de la femme mais qui, en même temps, la renvoie à sa seule décision, n'est pas toujours facile pour eux. De plus, la femme peut vivre très mal le fait que l'homme lui dise que c'est au bout du compte à elle de prendre la décision. Une revendication des femmes de pouvoir décider peut être vécue comme un désintérêt par la femme : "C'est toujours pareil, c'est toujours notre problème et pas le leur !" Je pense que le rapport sera certainement intéressant dans la mesure où nous avons vraiment des histoires de vie. Nous avons essayé de montrer comment la décision s'inscrit dans une trajectoire, qu'elle n'est pas la décision d'une minute, mais qu'elle résulte, en fait, de tout ce que la femme a vécu auparavant et de ce qu'elle prévoit de vivre après. Ce n'est pas une décision non réfléchie ou non mûrie, c'est une décision qui a un sens dans la trajectoire de la femme. L'aspect sans doute le plus intéressant sera d'avoir montré que l'on peut pas tirer des conclusions trop rapidement et surtout que l'on ne peut amalgamer des situations qui sont très différentes. Un seul point sur lequel je voudrais insister est celui de la reconnaissance de la sexualité des mineures, mais aussi des maghrébines, qui sont également dans cette situation. Leur difficulté à accéder à la contraception passe par leur non-droit à la sexualité et l'exigence de virginité qui existe encore dans de nombreuses familles. Elles ont peur de se faire prendre - même des majeures qui gagnent leur vie ou qui font des études - avec une plaquette de pilules. L'une d'elles disait qu'elle n'était pas censée aller chez un gynécologue, qu'elle ne pouvait même pas se faire rembourser la consultation parce que sa mère ne comprendrait pas pour quelle raison elle y allait. L'acceptation de la sexualité de la femme par son entourage est un facteur très positif d'accès à la contraception. Il reste encore beaucoup de réticence à la sexualité des mineures, d'idées reçues selon lesquelles l'accroissement de la diffusion de l'information contraceptive augmenterait la pratique sexuelle des jeunes, ce qui n'est pas du tout le cas. Dans le cas des premières relations, l'autre véritable problème est le passage du préservatif à un autre moyen de contraception. Il y a là un vide, qui explique sans doute, d'après l'INED, la légère remontée des IVG chez les mineures. M. Philippe Nauche : Dans votre étude, vous avez considéré le préservatif comme une méthode contraceptive. Mme Michèle Ferrand : Oui. M. Philippe Nauche : L'objectif de la diffusion du préservatif aujourd'hui est la prévention des maladies infectieuses, pas forcément la contraception. Mme Michèle Ferrand : Nous considérons comme pratiques contraceptives toute pratique que la femme déclare mettre en _uvre, quel que soit son taux d'efficacité. Utiliser le retrait, cela veut dire se mettre dans la situation de ne pas avoir d'enfant : certaines utilisent cette méthode. Les autres utilisent des méthodes extrêmement diverses. Les unes utilisent le préservatif la moitié du mois et le reste du temps, pas de préservatif, dans une visée totalement contraceptive ; les autres, des systèmes comme Personna, un petit ordinateur qui permet de connaître son cycle. Il y a encore des femmes qui utilisent ces méthodes parce que les autres méthodes ne leur conviennent pas. Mme Catherine Génisson : Cela suppose d'avoir une certaine compréhension de l'outil utilisé. Nous connaissons toutes les limites de la méthode Ogino. Mme Michèle Ferrand : Personna affiche une fiabilité de 94 %, selon les laboratoires. C'est une méthode basée sur la production d'un certain type d'hormones qui se trouve dans les urines. Cela exige d'uriner tous les matins sur son petit bâtonnet et de le glisser dans l'ordinateur. Ce n'est pas tout à fait la méthode Ogino. Mme Martine Lignières-Cassou, présidente : Alors qu'en 1974, le taux de contraception était de l'ordre de 20 %... Mme Michèle Ferrand : Pas exactement : 20 % des femmes utilisaient alors une contraception moderne, médicalisée, c'est-à-dire, en fait, la pilule. Mais, il y avait d'autres méthodes - notamment le diaphragme -, qui a une très bonne efficacité. Mme Martine Lignières-Cassou, présidente : Aujourd'hui, près de 50 % des femmes utilisent une contraception, telle que pilule ou stérilet. Or, le nombre d'IVG n'a pas changé ces dernières années. On pense même que l'emploi du préservatif contre le sida, a occulté complètement, notamment chez les jeunes générations, une formation à la contraception. Sur le débat de l'IVG comme échec de la contraception, en fait, vous montrez qu'il existe un taux incompressible d'IVG. Mme Michèle Ferrand : Oui, je le pense. Mais, nous devrions pouvoir faire mieux. On a l'impression que le taux d'avortement reste constant mais, en fait, les taux de grossesses non prévues et de naissance non désirées, tout deux, diminuent. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de parents. On oublie toujours cela. Les hommes, ayant sur ce point rejoint les femmes, veulent de plus en plus des enfants. Ils en veulent peu, c'est cela le problème. Pendant longtemps, on a accepté la grossesse non programmée ; à l'heure actuelle, la grossesse non programmée ne l'est pas. On demande aux femmes de maîtriser tout. Elles le font tant qu'elles peuvent et, si cela ne marche pas, elles maîtrisent grâce à l'avortement. Mme Catherine Génisson : Il n'y aura donc pas une baisse significative du nombre d'avortements, mais un nombre d'IVG plus précoces. Mme Michèle Ferrand : A méthodes de contraception équivalentes, je ne vois pas pour quelle raison cela changerait. En revanche, si l'on prend en compte cette forte dominante des femmes qui adhèrent au principe contraceptif, qui croient faire bien en faisant ce qu'elles font et qui ne veulent pas d'enfant - ce qui représente malgré tout la majorité de notre population - on peut penser que si l'on progresse dans la contraception, on peut tout à fait y arriver. Nous pouvons le penser, si ce problème de contraception inadéquate était réglé, ce que personne ne veut entendre. Tout le monde veut entendre "la pilule, c'est parfait". Mais ce n'est pas vrai ; ce que disent les femmes, c'est que, sur trente ans, ce n'est pas vivable. C'est pour cela que le nombre d'avortements n'a pas diminué. La prescription contraceptive a augmenté, les femmes sont mieux "contraceptées" mais, en même temps, est montée l'intolérance d'une grossesse non programmée. Les deux phénomènes vont ensemble, car on ne peut pas dire aux femmes qu'elles doivent programmer leurs grossesses, et pour cela prendre la pilule, et leur dire simultanément qu'elles doivent les programmer, mais que si elles font une erreur, c'est tant pis pour elles. Elles veulent maîtriser jusqu'au bout. Elles adhèrent donc totalement à l'idée de la naissance programmée qui repose sur leur conception du bon moment pour accueillir un enfant. Or, elles n'auront pas beaucoup d'enfants, elles en auront deux. Donc, elles veulent choisir le moment où elles vont les avoir. Mme Catherine Génisson : Vous approuvez donc le projet de loi révisant les lois Neuwirth et Veil et se penchant sur le problème de la contraception. Mme Michèle Ferrand : C'est essentiel. Mais plus importante encore me paraît la suppression dans la loi de l'interdiction de la publicité et de l'information sur l'avortement et la contraception. Avec des affichages du genre : "Deux jours de retard de règles : consultez !" donnant un téléphone vert, comme cela s'est fait pour le sida, on peut allonger les délais jusqu'à douze semaines, mais je pense que ce sera de moins en moins nécessaire. Ce rallongement des délais est une mesure conservatoire, pour éviter que trop de femmes se trouvent dans cette situation extrêmement pénible d'aller avorter à l'étranger. Je ne suis pas médecin, mais la moitié des médecins que je connais me disent que cela ne change rien à l'acte jusqu'à la quatorzième semaine. Au-delà, ils disent que c'est un acte médical qu'ils ne savent pas faire et qu'il leur faudrait apprendre auprès des Anglais ou des Hollandais. Ils disent que si les femmes avortaient plus tôt, ce problème de délai ne se poserait plus. L'autre moitié des médecins disent qu'après douze semaines, il y a modification, ossification. Les premiers répondent que, de toute façon, il y a déjà ossification dès la dixième semaine, qu'ils sont obligés de fragmenter à la dixième semaine et que la majorité des IVG se font avant huit semaines. Mme Catherine Génisson : Avez-vous établi des comparaisons européennes sur les conséquences des décisions d'allongement du délai et d'une politique de contraception menée conjointement par rapport à l'IVG ? Mme Michèle Ferrand : Nous n'avons pas interrogé de femmes à l'étranger. Il ressort de la littérature que nous lisons sur le sujet que le pays dans lequel les délais sont les plus longs, où il y a le moins d'avortements, où les femmes avortent le plus tôt et où il n'y a pas de dérive eugénique, c'est la Hollande. Mme Catherine Génisson : La contraception y est très développée aussi. Mme Michèle Ferrand : Très développée. Il y a beaucoup moins de tabous sur la sexualité et une information très précoce. L'information ne doit pas seulement se faire en direction des femmes, mais aussi en direction des médecins, qui ont tendance à prescrire la pilule parce que c'est plus simple, au lieu de discuter avec la femme. Discuter avec la femme et se rendre compte que la pilule ne lui convient pas, cela veut dire qu'il faut discuter des autres méthodes. Mme Martine Lignières-Cassou, présidente : Qu'en est-il de la stérilisation volontaire ? Mme Michèle Ferrand : Nous en avons parlé parce que nombre de femmes se sont vu refuser la stérilisation sous prétexte qu'elles n'avaient que trente-cinq ans et qu'elles risquaient d'avoir un désir d'enfant par la suite. C'est le cas de cette jeune femme qui a eu son quatrième fils et qui disait à son mari qu'elle ne l'obligeait pas à rester si cela ne lui convenait pas. Cela dit, elle a aussi dit à son mari que comme c'était lui qui ne voulait plus d'enfant, il paraissait logique que ce soit lui qui se fasse stériliser. Lui ne veut pas en entendre parler. Elle aurait été prête à le faire, mais la stérilisation lui a été refusée parce qu'elle n'avait que trente-cinq ans. La loi est très ambiguë. Nous avons eu plusieurs femmes qui auraient pu éviter l'IVG par une stérilisation qu'elles avaient demandée et qui leur avait été refusée. Ce sont des femmes plus âgées. Nous aurons certainement, dans l'enquête quantitative menée auprès de 6 000 femmes, des données chiffrées intéressantes. Mais il faut attendre six mois. L'aspect intéressant est qu'une psychologue travaille avec nous. Elle ne fait pas toujours la même analyse que nous des entretiens. Elle voit du déni où nous n'en voyons pas forcément. Nous avons des interprétations différentes. Cela fera l'objet d'un chapitre, que nous présenterons dans le rapport définitif qui sera publié dans la collection de l'INSERM. Audition de Mme Marie-Cécile Moreau, juriste Réunion du mardi 17 octobre 2000 Présidence de Mme Martine Lignières-Cassou, présidente Mme Martine Lignières-Cassou, présidente : Nous avons le plaisir de recevoir Mme Marie-Cécile Moreau, juriste dans un office ministériel d'avoués à la Cour d'Appel de Paris, avec laquelle nous avions déjà travaillé quand nous examinions le projet de loi sur l'égalité en matière politique. Aujourd'hui, notre Délégation s'intéresse aux problèmes d'IVG et de contraception. Elle déposera, dans quelques jours, un rapport assorti de recommandations sur le projet de loi de Mme Martine Aubry. Aussi avons-nous souhaité vous rencontrer à nouveau pour approfondir les questions juridiques posées par un aspect particulier de ce projet, celui de l'aménagement de l'autorité parentale. Mme Marie-Cécile Moreau : Vous m'invitez aujourd'hui à parler de l'aménagement de l'autorité parentale dans un domaine particulièrement difficile, qui atteint notre sensibilité. Je tiens à souligner cela, parce que la sécheresse de la règle de droit pourrait le faire oublier, alors que c'est précisément en raison de l'aspect très émotionnel de ces questions que, nous, les femmes, en rejetons parfois l'aspect juridique. J'expliquerai d'abord les raisons pour lesquelles le refus ou l'impossibilité d'obtenir le consentement parental est insurmontable. Je dirai ensuite combien cette situation est anachronique. Enfin, de ce que j'aurai dit, nous pourrons induire des suggestions en vue d'améliorer les dispositions juridiques. Pourquoi le refus ou l'impossibilité de ce consentement se présentent-ils d'une manière aussi insurmontable ? Je ne pense pas que ce soit lié à la rigueur de l'autorité parentale, ni à son exercice. Je pense plutôt que la rigidité tient à la législation ; tout d'abord, à la loi de 1975, qui n'a pas prévu le moyen juridique soit de passer outre à ce refus, soit d'inventer des substituts, ou des suppléances à ce refus ou à cette impossibilité ; et à la loi de 1979, qui a encore aggravé la situation, en ajoutant à l'article de la loi de 1975 relatif à l'autorité parentale, les mots suivants : "Ce consentement devra être accompagné de celui de la mineure célibataire enceinte, ce dernier étant donné en dehors de la présence des parents ou du représentant légal". La totalité de l'article concernant l'autorité parentale n'a donc pas été dès 1975 rédigé dans sa forme actuelle. La modification opérée par la loi de 1979 a aggravé la situation, dans la mesure où le consentement parental reste requis, comme dans la loi de 1975, mais que se trouvent placées sur le même plan l'autonomie de la mineure enceinte et l'autorité parentale, sans que soit prévue la moindre mesure de suppléance permettant de passer outre à un refus parental. La loi sur l'hospitalisation des mineures pose également problème, dans la mesure où aucune juridiction, n'a reçu de la loi une compétence lui permettant de statuer en matière d'IVG, dans le cas où le consentement parental serait refusé ou inexistant. Lorsque les juges ont été saisis, ils n'ont pu que se déclarer incompétents. En effet, lorsque le juge qui devrait statuer quand le consentement parental n'est pas donné, est saisi - il s'agit le plus souvent du juge des enfants - il ne peut pas statuer, car il n'a jamais reçu le droit de statuer en matière d'IVG ; lorsqu'il statue en tant que juge de l'assistance éducative, il ne peut en effet statuer que lorsque l'enfant ou la santé de celui-ci est en danger. Or le fait d'être enceinte n'a jamais été tenu comme étant un danger, du moins dans le cas d'une IVG pour motif personnel. Nous sommes donc en face d'une rigidité de deux consentements opposés, celui des parents et celui de la mineure, sans que l'appareil juridique, que ce soit la loi ou le juge, ne puisse trancher le conflit. Or la rigidité n'est jamais acceptable pour le droit. Le droit a toujours créé des soupapes de sécurité, ne serait ce que celle de l'abus de droit. Cependant, dans le cas précis, comme aucun juge n'est compétent, aucun juge ne peut statuer non plus au titre de l'abus de droit. Selon moi, cette rigidité, qui existait déjà en 1975, a été encore renforcée en 1979, lorsque la loi a complété le texte dans le sens que je viens d'indiquer. Elle était alors difficile à accepter d'un point de vue juridique, mais elle s'expliquait sans doute par le compromis nécessaire à l'adoption de la loi de 1975. Vingt-cinq ans après, cette rigidité me paraît condamnable. La situation a changé. Je laisserai aux sociologues généralistes et aux sociologues du droit le soin d'expliquer comment l'autorité parentale a évolué en vingt-cinq ans. Pour le juriste, cette évolution a mis l'accent sur les droits des parents en matière d'autorité parentale, alors que celle-ci se définit comme étant un ensemble de droits, mais aussi de devoirs. Chacune d'entre nous peut mesurer les nouveaux développements qui se sont produits depuis vingt-cinq ans en ce domaine. Chacune peut aussi constater, en s'interrogeant elle-même, en interrogeant sa propre famille ou celle de ses proches, les développements qui, en regard, ont fait évoluer la minorité. La loi de 1979 a introduit dans la loi sur l'IVG la nécessité du consentement de la mineure enceinte, qui n'y figurait pas en 1975. Même si l'appareil juridique nécessaire n'est pas créé pour trancher les conflits éventuels, apparaît l'idée que la mineure a aussi un droit. Cela ne devait sans doute pas être évident en 1975, même s'il faut préciser qu'avant la loi de 1975, la mineure avait déjà la possibilité de recourir à la contraception. En 1979, la mineure obtient donc, sur cette IVG, des droits correspondant à ceux des titulaires de l'autorité parentale. En 1990, la Convention sur les droits de l'enfant est ratifiée. Cette dernière confirme l'autorité parentale - c'est même un des droits de l'enfant que d'avoir au-dessus de lui quelqu'un qui détienne l'autorité parentale - mais elle commence aussi à structurer ce que nous appelons les droits de l'enfant. La loi de 1993, qui a partiellement transposé cette Convention dans notre droit, crée un double mouvement : d'une part, elle va abaisser de quinze à treize ans, dans notre code civil, tous les âges auxquels l'enfant était appelé à donner son consentement personnel. Par exemple, s'il est amené à changer de nom parce que ses parents ont engagé une procédure de changement de patronyme, il doit donner son consentement à cette modification à partir de treize ans. D'autre part, des dispositions légales permettent au mineur d'être entendu devant les tribunaux, s'il est capable de discernement. On voit ainsi se constituer en face de la structure ancienne, mais vivante qu'est l'autorité parentale, confirmée par la Convention sur les droits de l'enfant, une personnalité nouvelle : celle du mineur, du "grand mineur" disons-nous dans notre jargon. C'est ainsi que, peu à peu, l'âge de dix-huit ans commence à recevoir de plus en plus d'exceptions ; exceptions qui sont la manifestation du consentement personnel donné par le grand mineur. Ce qui précède explique que la rigueur du texte de 1975, complété en 1979, soit anachronique, d'autant qu'avec la pilule depuis 1967, s'est établie une séparation entre vie sexuelle et procréation. Il faut sortir de cette rigidité, dont on voit qu'elle cache des situations qui ne sont pas toujours à l'honneur de l'autorité parentale. Examinons les décisions de jurisprudence répertoriées. Voyez la situation de la mineure traitée par le tribunal d'Evry, dont la mère, membre d'une association contre la loi de 1975, refusait son consentement pour ce motif. Prenez également le cas de la mineure de Bordeaux, à qui la mère refusait l'autorisation parce que cette mineure avait déposé une plainte au pénal pour pratiques incestueuses contre le père ; le marché était entre les mains de la mineure : autorisation donnée contre retrait de la plainte. Nous sommes bien là dans le cadre de ce que j'appelais tout à l'heure un abus de droit. Je considère donc que l'autorité parentale ne peut pas couvrir toutes les situations discrétionnairement voulues par les titulaires de l'autorité parentale, parce que le premier devoir de ces derniers reste de décider en fonction de l'intérêt du mineur. Peut-être que l'intérêt de la mineure commandait qu'elle ne subisse pas alors d'IVG, mais ce n'est sûrement pas sur une motivation de cette espèce que l'on pouvait fonder le refus. Il faut changer la loi. C'est une nécessité juridique. Reste à trouver l'exacte modalité de ces transformations. A cet égard, il m'apparaît que la solution la plus adéquate serait sans doute de créer une nouvelle majorité, pour l'IVG. L'instauration d'une majorité, "médicale" pour certains, "sanitaire" pour d'autres, correspondrait le mieux à ce qu'a été le mouvement de notre droit, dans le balancement entre autorité parentale et minorité depuis 1975. Nous parlons aujourd'hui de "grand mineur" et de "jeune majeur". En matière de contraception et d'IVG, je pense que c'est le grand mineur qui doit avoir une pleine disposition de sa vie sexuelle. Le problème est moins d'instaurer une majorité nouvelle, que de savoir à quel âge fixer cette majorité. Pour justifier ce changement légal, il ne faut pas la fixer trop près de l'âge de dix-huit ans. Sinon, ce serait pratiquement inutile. A mon sens, il faut la situer à quinze ou seize ans. En faveur de la fixation d'une majorité à quinze ans, on peut invoquer le fait que le code civil permet à la femme de se marier à cet âge. Cela n'a pas grand chose à voir avec la vie sexuelle, puisque celle-ci peut s'exprimer aussi hors mariage. En revanche, les statistiques me feraient pencher plutôt pour retenir l'âge de seize ans. Cependant, une autre question se profile immédiatement car, si nous fixons une majorité pour l'IVG (que ce soit à quinze ou seize ans), nous ne couvrons pas la totalité des cas - et notamment les grossesses très précoces - certaines étant répertoriées dès douze ans. Il y a donc deux problèmes posés : quel âge fixer et que faire pour les grossesses qui se développent chez des petites mineures ? Pour ces derniers cas, il serait nécessaire que la loi puisse désigner un juge qui recevrait cette compétence, parmi d'autres compétences, car nous ne trouverons pas de juges qui ne statuent que sur ces cas, de la même façon que nous ne trouvons pas de gynécologues qui ne veuillent faire que des IVG. En optant pour la création d'une majorité sanitaire, nous ferions progresser le droit à l'IVG ainsi que le droit des mineures, parce que cette nouvelle majorité pourrait être utilisée dans d'autres domaines, comme, par exemple, l'exercice de la religion. Mme Marie-Thérèse Boisseau : Vous disiez avoir une préférence pour fixer la majorité à seize ans. Pourriez-vous nous expliquer pourquoi vous optez pour cet âge plutôt que pour celui de quinze ? Que ce soit quinze ou seize ans, vous l'avez dit, cela ne règle pas le problème des jeunes mineures. Or, ce sont souvent les cas les plus graves, si l'on en croit les nombreux témoignages que nous avons entendus, puisque c'est dans cette tranche d'âge que se rencontrent le plus les problèmes de viols et d'incestes. Comment protéger ces jeunes mineures et comment les sortir de ces situations dramatiques ? Mme Martine Lignières-Cassou, présidente : A propos de cette distinction entre quinze et seize ans, vous avez cité le fait pour une jeune fille de pouvoir se marier dès l'âge de quinze ans. J'aurais aimé que vous reveniez également sur d'autres dérogations possibles, qui sont aussi significatives, en matière de sexualité. Mme Marie-Cécile Moreau : Je souhaiterais d'abord savoir si Mme Marie-Thérèse Boisseau est favorable à une majorité sanitaire ? Mme Marie-Thérèse Boisseau : Très honnêtement, aujourd'hui, je pèse encore le pour et le contre. Je comprends la notion de majorité sanitaire en matière d'IVG, mais que faut-il en penser dans le cas d'une jeune fille confrontée à un énorme problème de santé - qui souffre d'une tumeur au cerveau, pour prendre un exemple précis et récent ? Peut-on la laisser seule devant son problème, assumer et prendre seule les décisions en cette matière ? Mme Marie-Cécile Moreau : Je me suis sûrement mal exprimée. J'ai parlé du consentement. Cela ne veut pas dire - et loin de moi cette pensée - que, si le consentement n'est pas donné ou s'il est impossible, la jeune mineure entre douze et dix huit ans, reste seule. Je pense qu'il serait utile que la loi ou un décret d'application prévoie qu'elle soit accompagnée. A mon avis, ce serait à un juge de donner l'autorisation nécessaire, après que deux ou trois médecins se soient prononcés. Mme Marie-Thérèse Boisseau : Je réfléchis à votre hypothèse de majorité sanitaire. Si elle est valable pour l'IVG, elle serait aussi valable pour d'autres actes médicaux. Je cite donc cet exemple très précis d'une jeune fille de seize ans qui a une tumeur au cervelet et qui est parfaitement consciente. Au regard de la loi, elle serait donc adulte, si on introduit cette notion de majorité sanitaire. Si elle ne veut pas suivre de traitement, qui prendra la décision aux yeux de la loi ? Mme Marie-Cécile Moreau : En ce qui concerne l'IVG, qui est le problème qui m'est posé aujourd'hui, mais aussi en ce qui concerne cet autre problème que vous évoquez, rien n'empêcherait que cette majorité sanitaire laisse subsister le consentement des parents. L'intérêt de cette notion serait de ne pas bloquer la situation au cas où l'un des parents refuse son consentement pour une IVG. Mme Martine Lignières-Cassou, présidente : Ce n'est pas pour autant que la mineure serait seule. Etre responsable ne signifie pas pour autant être isolée. Mme Marie-Cécile Moreau : Le problème actuel, c'est que sans consentement - le consentement sous forme d'accord écrit, d'un papier - l'IVG n'est pas possible. Mme Marie-Thérèse Boisseau : Permettez-moi de vous soumettre une hypothèse de travail. Si la majorité sanitaire est fixée à seize ans, cela signifiera que l'on n'aura plus besoin d'une autorisation écrite des parents sur le plan scolaire. Si un enfant souffre d'une appendicite aiguë, qui se déclare en classe, par exemple, pourra-t-on l'opérer sans avoir eu le consentement des parents ? Mme Marie-Cécile Moreau : Je ne le crois pas du tout. Les autres textes ne vont pas se trouver ipso facto modifiés. Même si la loi est modifiée pour l'IVG, je ne vois pas au nom de quoi l'autorisation parentale ne serait pas requise pour toute autre forme d'intervention chirurgicale, d'autant plus que le consentement, qui doit être donné par celui qui exerce l'autorité parentale à l'hôpital, doit être formulé par écrit. C'est précisément ce qui pose problème dans le cadre des IVG. Mme Marie-Thérèse Boisseau : Il y aurait donc une majorité sanitaire strictement réservée à l'IVG ? Mme Marie-Cécile Moreau : Oui, si le législateur en décide ainsi. Le fait de modifier la loi de 1975 ne va pas modifier les autres lois. Mme Catherine Génisson : Je voulais préciser que la majorité sanitaire s'appliquerait uniquement à l'interruption volontaire de grossesse. Cela dit, je ne pense pas que le terme soit adapté, dans la mesure où il me semble que, quand on parle de majorité sanitaire, on considère que cette majorité concerne l'ensemble des problèmes de santé. Mme Marie-Cécile Moreau : Vous avez pu constater d'ailleurs que les termes ne sont pas encore fixés. Certains parlent de majorité médicale, d'autres de majorité sanitaire. Il conviendrait d'indiquer que, en matière d'IVG, pour les mineures de plus de quinze ou seize ans, le consentement de la jeune fille suffit. Dans la mesure où nous créons une césure entre zéro et dix-huit ans, nous l'appelons "une majorité", mais il est certain que cela ne modifie pas les dispositions du code civil selon lesquelles "la majorité est fixée à dix-huit ans". Il ne s'agit pas du tout d'une modification de cette disposition, mais simplement d'une modification à la loi de 1975. Mme Martine Lignières-Cassou, présidente : Le Conseil national du sida s'est penché sur le problème des jeunes mineurs qui ne souhaitent pas que leurs parents soient au courant de leur maladie ou des soins qu'ils reçoivent pour des maladies sexuellement transmissibles. Cette question se pose, en fait, de façon assez aiguë pour tout ce qui a trait à l'intime. Mme Marie-Cécile Moreau : C'est tout à fait justifié. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'âge de dix-huit ans paraît un âge trop élevé. Mme Martine Lignières-Cassou, présidente : Pour ceux qui verraient la césure plutôt vers quinze ans, vous vous êtes appuyée sur l'argument selon lequel une jeune fille peut se marier à quinze ans. Il existe aussi d'autres arguments qui vont dans le sens de cette césure à quinze ans, voire même à treize ans. Mme Marie-Cécile Moreau : La loi de 1993 a rabaissé à treize ans l'âge du consentement. Mme Danièle Bousquet : Pour qu'une mineure puisse se marier à quinze ans, le consentement des parents est-il requis ? Mme Marie-Cécile Moreau : Oui. Selon le code civil, elle a le droit de se marier à quinze ans et l'autorisation parentale doit être donnée par les deux parents. Il est cependant précisé que si les deux parents ne sont pas d'accord, cela vaut consentement. Lorsque le code civil a été conçu, on a ainsi prévu les cas de conflit entre les parents. Rien de tel dans la loi de 1975. C'est pour cela que nous en arrivons à cette situation. Que fait-on dans le cas où le consentement parental n'est pas donné, alors que la mineure souhaite une IVG ? Mme Martine Lignières-Cassou, présidente : Je reviens à ma question concernant l'âge, parce qu'il me semblait, notamment dans le domaine de la vie sexuelle, que, par exemple, les poursuites pour abus sur mineures n'étaient plus exercées dès lors qu'elles atteignaient l'âge de quinze ans ? Mme Marie-Cécile Moreau : Les pénalités varient en effet selon l'âge. Plus ils sont jeunes, plus il est grave d'abuser ou d'attenter aux m_urs sur des mineurs. La minorité est une circonstance aggravante, de même que le fait que l'attentat ou les violences soient opérés par une personne qui a autorité sur le mineur. Tout cela relève du code pénal. En matière d'IVG, nous sommes dans un cadre civil, même si existent aussi des contraintes pénales. Mme Raymonde Le Texier : Je trouve l'idée de majorité sanitaire tout à fait intéressante. J'en ai discuté avec des médecins généralistes, qui y seraient plutôt favorables, naturellement pour les IVG mais aussi pour le sida et les MST, ne serait ce que parce qu'il leur est parfois très compliqué de soigner la mineure qui ne désire pas que ses parents soient informés. Si l'on veut que cette majorité sanitaire ne s'applique qu'à l'IVG, il convient de ne modifier que la loi de 1975 complétée par la loi de 1979. Si l'on souhaitait aller plus loin et étendre la majorité sanitaire, non seulement à l'IVG, mais à tout ce qui touche à l'intimité, faudrait-il procéder de la même manière ? Il faut trouver une solution, en matière d'IVG, pour les situations dans lesquelles il est impossible d'obtenir l'autorisation parentale, mais cela ne veut pas dire pour autant qu'une jeune fille de dix-sept et demi ou dix-huit ans moins deux mois ne pourra pas se faire accompagner par ses parents si elle le souhaite et si elle entretient de bonnes relations avec eux. La loi qui permettra aux jeunes filles de pouvoir procéder à une IVG sans l'autorisation des parents, s'il leur est impossible de l'obtenir, ne signifiera pas pour autant que celles qui voudraient être accompagnées de leurs parents ne puissent le faire. De même, si nous élargissions complètement la majorité sanitaire et qu'elle couvre tout le champ de la santé, cela n'exclurait pas que l'adolescente, atteinte d'une grave maladie, dont parlait Mme Marie-Thérèse Boisseau, puisse être accompagnée de ses parents. Mme Marie-Cécile Moreau : Le problème ne se pose pas si la mineure et les parents sont d'accord pour l'IVG. Il ne se pose que si la mineure ne peut pas obtenir le consentement parental. C'est pour ces cas difficiles, souvent douloureux que nous envisageons de mettre en _uvre une modification légale. Il y a environ 10.000 mineures qui ont une grossesse non désirée. C'est pour elles qu'il nous faut trouver une solution. Cela n'aura pas d'effet pour les cas dans lesquels, fort heureusement, il n'y pas de difficultés. Mme Martine Lignières-Cassou, présidente : En fait, seulement 10 % de ces 10 000 mineures ont des difficultés à recueillir le consentement parental. Mme Marie-Cécile Moreau : En voyant les adolescentes confrontées à ces difficultés, nous voulons éviter qu'elles aient recours à des méthodes telles que des voyages à l'étranger ou des avortements clandestins. Nous devons toujours nous souvenir que nous sommes face à des situations très difficiles, auxquelles la loi en vigueur ne répond plus. Souvenons-nous que la loi de 1975 a été rendue nécessaire par le fait que la loi de 1920 n'était plus applicable, et n'était plus appliquée - le Parquet avait, à l'époque, donné des instructions pour qu'elle ne le soit plus - car en raison de l'état des m_urs, elle était devenue totalement anachronique. Nous sommes dans une situation identique aujourd'hui. C'est assez normal, cela tient au type de problèmes que nous sommes en train de vouloir résoudre. Mme Raymonde Le Texier : Nous parlons des 10 % de situations pour lesquelles il faut trouver des solutions, mais au-delà de ces 10 %, pour revenir sur l'idée de majorité sanitaire, je nous trouve assez timorées chaque fois que ces questions sont abordées. Il me plairait d'avancer un peu plus : pourquoi une jeune femme de dix-sept ans ou dix-sept ans et demi, même si elle a de bonnes relations avec ses parents, serait-elle obligée d'aller raconter sa vie intime pour avoir l'autorisation de faire une IVG ? Dans un sens, c'est son problème et, quand on entend certains parents, il peut être intéressant que cela reste son problème. Je souhaiterais que l'on dépasse ces 10 % de situations dramatiques. Mme Marie-Thérèse Boisseau : Vous parlez d'une majorité sanitaire à quinze ou seize ans pour l'IVG qui pourrait être étendue aux problèmes de santé liés à la sexualité : MST, sida, entre autres. La loi est aujourd'hui rigide, elle n'est plus adaptée à la réalité du moment et il faut la faire évoluer. J'en conviens tout à fait. Mais cette majorité sanitaire à seize ans ne résout pas le problème des douze-seize ans qui, pour moi, sont les plus difficiles, puisque c'est dans cette tranche d'âge que nous trouvons les sordides problèmes intra-familiaux, qui sont beaucoup plus fréquents qu'on ne le pense. L'article 6 du projet de loi qui nous est proposé me semble relativement souple. Il prévoit que l'on "essaie" de recueillir l'autorisation parentale ou celle du représentant légal, que le médecin doit "s'efforcer" de consulter ces personnes et qu'in fine, si l'on ne peut pas obtenir ce consentement, le médecin peut pratiquer l'IVG. Pour ma part, j'ai toujours peur de l'effet de seuil négatif, qui pourrait se produire, si nous en fixions un à seize ans ou quinze ans. Dans la rédaction actuelle de l'article 6 du projet de loi, on ne parle pas d'âge, on ne crée pas de tranches au sein des mineurs, on se situe simplement en dessous de dix-huit ans. Tous les cas de figures sont intégrés dans cette formulation, qui me paraît assez satisfaisante car elle permet, dans certains cas, de forcer - le terme est malheureux - la main des mineures qui ne veulent pas parler à leurs parents, et dont on s'aperçoit a posteriori que cela a été très bénéfique. Cela n'enlève pas la possibilité d'informer les parents. Que pensez-vous de cet article 6 ? Mme Marie-Cécile Moreau : Je trouve cet article un peu compliqué car, justement, si nous devons aller vers une modification de la loi de 1975, c'est en raison de l'évolution des vingt-cinq dernières années, qui a marqué - je le disais précédemment - à la fois l'autorité parentale et la minorité. Cela étant, il faut sans doute trancher de manière plus catégorique et j'irais volontiers dans le sens indiqué par Mme Raymonde Le Texier, car la rédaction actuelle de cet article contraint la mineure de dix-huit ans moins quinze jours, à aller chercher l'autorisation de ses parents. Il ne s'agit pas d'une une relation entre la mineure et ses parents, mais d'une relation entre la mineure, ses parents et le médecin gynécologue. Le plus souvent les difficultés naissent du fait que l'intervention n'est pas pratiquée par le gynécologue tant qu'il n'a pas l'autorisation parentale. A mon avis, la difficulté pourrait venir plus des médecins que de l'autorité parentale, qui serait plus un prétexte qu'une opposition. C'est la responsabilité des médecins qui est en cause. Tous ceux que j'ai interrogés m'ont dit que se posaient des problèmes importants de responsabilité. Ils ne voient absolument pas la question sous l'angle sous lequel nous la discutons aujourd'hui. Ils la voient sous l'angle de la responsabilité. Si la loi ne dit pas clairement que le consentement parental n'est plus requis "à partir de seize ans", je doute que, dans leur majorité, les médecins, qui pourraient être requis pour ces interventions, soient d'accord. Mme Catherine Génisson : Nous avons toutes la volonté de dissocier le problème de l'autorisation parentale et de la minorité, de celui de l'accompagnement nécessaire, tout en ayant en arrière-pensée la volonté de considérer que l'accompagnement parental est tout de même le meilleur accompagnement pour les mineures. C'est tout le débat que vous avez développé sur la relation entre autorité parentale et minorité. Je suis intéressée par votre proposition concernant une majorité sanitaire, mais dès lors que l'on parle de majorité sanitaire, je ne vois pas comment on pourrait la limiter à la seule interruption volontaire de grossesse, ni même à celle de l'intime. Parler d'une majorité sanitaire, c'est ouvrir un espoir, un champ qui mériterait un vaste débat, sur lequel je ne suis pas certaine que nous ayons suffisamment réfléchi. Pourquoi seuls les problèmes de l'intime et ceux qui touchent strictement à la vie sexuelle seraient-ils concernés par la majorité sanitaire ? Mme Marie-Cécile Moreau : Je partage assez votre avis. Cette majorité sanitaire pourrait être le modèle de la création d'une majorité plus précoce, qui pourrait aussi concerner, par exemple, l'exercice d'une religion. Sans changer l'article 388 du code civil, selon lequel le jeune est majeur à dix-huit ans, ce qui, je le répète, n'est pas mon propos, peut-être serait-il possible de préciser un âge charnière dans l'article 6 du projet de loi que vous me soumettez. Il faudrait rédiger cet article de la façon suivante : "Si la femme est mineure, non émancipée de seize ans...". Cela signifierait qu'au-dessous de cet âge, on suit la procédure indiquée par l'article L-2212.7 du code de la santé publique, dans sa rédaction prévue par le projet. C'est l'embryon d'une autre majorité pour les questions qui touchent à l'intime. Mme Danièle Bousquet : La définition de l'intime est vaste. Mme Marie-Cécile Moreau : C'est vrai. C'est pour cela que nous ne pouvons pas légiférer autrement que pour l'IVG. Ce que nous devons résoudre aujourd'hui, c'est le conflit de deux consentements inverses, en matière d'IVG. Mme Danièle Bousquet : Nous parlons de l'IVG et de la question de la redéfinition de la majorité dans ce domaine. Le législateur pourra ensuite, éventuellement, se saisir de l'avancée réalisée pour élargir cette notion et créer une majorité sanitaire. Dans le cas où une jeune mineure pourrait avoir un accident grave ou décéder lors d'une IVG, la question de la responsabilité du médecin se poserait-elle, dans la rédaction actuelle ? Mme Marie-Cécile Moreau : A mon sens, ce n'est pas dans le cadre de sa responsabilité en tant que médecin habilité à pratiquer une IVG, mais dans le cadre de sa responsabilité médicale, qu'une telle responsabilité pourrait être recherchée. Mme Nicole Bricq : L'alternative me semble simple. Il y a, d'un côté, la fixation d'un nouveau seuil, à quinze ou seize ans dont on ne pourra pas dire que l'application est limitée à la seule IVG. Il y a, de l'autre côté, la solution qui consiste à dire, qu'en cas d'absence de consentement des parents, la mineure, quel que soit son âge, peut demander l'interruption volontaire de grossesse. C'est ce problème-là qui est posé. Si nous introduisons un seuil, ne doutons pas qu'il modifiera la loi, et pas seulement celle sur l'IVG, car cela revient à introduire un nouveau concept de droit. Ayant fait partie de la commission d'enquête sur les prisons, j'ai pu observer que, quel que soit l'âge de la majorité pénale qu'on choisisse, on réintroduit de facto de nouvelles notions. On parle, par exemple, de "jeunes majeurs", désignant une catégorie qui n'existe pas de jure, mais qui existe bien de facto, parce que nous savons très bien qu'elle est traitée particulièrement. Il n'y a donc pas de bon seuil de jure. Mais, dans le cas qui nous occupe, c'est simple : soit nous mettons un seuil, qu'il soit à quinze ou seize ans, et la jurisprudence l'étendra à d'autres notions ; soit nous décidons - c'est la position que défendait Mme Raymonde Le Texier - que la mineure, quel que soit son âge, si elle n'a pas le consentement de ses parents et si elle est confrontée à une situation de détresse, est libre d'agir par elle-même face au médecin. Vous êtes en train de discuter de l'introduction d'une majorité sanitaire qui se limiterait au problème de l'IVG. Mais cela créera une nouvelle catégorie. Quant à l'intime, je ne saurais le définir juridiquement. Je prends un exemple : certains, comme vous le savez, ne veulent pas de transfusion pour leurs enfants. Si nous introduisons une notion de majorité sanitaire, la jeune fille ou le jeune garçon dont les parents ne veulent pas d'une transfusion, pourra dire qu'il en veut une. Il en aura le droit. Mme Marie-Cécile Moreau : Votre position consiste à dire c'est tout ou rien, car si vous ne voulez pas d'un palier, nous arrivons au tout ou rien. Le texte actuellement en vigueur ne me paraît plus adapté. De cette inadaptation, je ne peux passer, comme vous l'envisagez, à une situation où le consentement des parents serait purement et simplement supprimé. Nous ne pouvons pas accepter que, dès l'âge de douze ans, les enfants bénéficient, en matière d'IVG, d'une totale liberté. C'est de cela qu'il s'agit : de l'autonomie libre de la jeune mineure. Je n'y crois pas. Mme Martine Lignières-Cassou, présidente : Il me semble, comme le disait très justement Mme Marie-Thérèse Boisseau, que les grossesses des mineures très jeunes sont souvent issues de rapports forcés ou incestueux. Dans ces conditions, on ne peut pas demander le consentement des parents. Mme Marie-Cécile Moreau : Pour ces cas, il faut habiliter un juge à trancher la question, ce qui demande d'ailleurs à être précisé. Va-t-il lui être demandé de dire : "J'ordonne l'IVG", ou de dire : "Je dispense cette mineure de justifier d'un consentement écrit du parent" ? Ce n'est pas la même situation. Mme Marie-Cécile Moreau : Si nous décidons une césure à seize ans, il faudra trouver quelle réponse apporter aux mineures encore plus jeunes, celles dont parlait Mme Marie-Thérèse Boisseau. Nous avons un pivot solide, qui est le juge, à condition de l'habiliter, non seulement en désignant précisément tel ou tel juge, mais également en déterminant jusqu'où il pourra aller - autorisation d'une IVG ou dispense de l'autorisation - ce qu'aucun juge actuellement n'a le droit de faire. Mme Odette Casanova : Je voudrais faire une remarque à propos du terme de majorité sanitaire. Ne pourrait-on rédiger l'article du projet de loi sans parler expressément de majorité sanitaire, mais en disant simplement qu'entre dix-huit et seize ans, si l'autorisation parentale n'est pas donnée, la mineure pourra passer outre, ce qui éviterait d'employer ce qualificatif de majorité sanitaire, qui semble gênant. Mme Marie-Cécile Moreau : Il n'y a pas de choix : ou l'on s'en tient aux lois de 1975 et 1979, ou l'on crée un âge à partir duquel la grande mineure n'a pas besoin d'apporter le consentement par écrit du titulaire de l'autorité parentale ou de celui qui l'exerce. A mon avis, il est indispensable, alors, de prévoir qu'un juge, qui reste à désigner, ait une compétence en cas de conflit de consentements, parce que le conflit naturel entre deux conceptions est, en droit français, tranché par le juge si la loi, par avance, n'a pas prévu que dans tel ou tel cas, cela se résoudra de telle ou telle manière. Mme Marie-Thérèse Boisseau : Vous proposez donc qu'à partir de seize ans soit mis fin à l'autorité parentale et qu'en dessous de cet âge soit introduite une disposition permettant l'intervention d'un juge qui puisse faire en sorte de suspendre l'obligation de présenter l'autorisation parentale. Mme Marie-Cécile Moreau : C'est bien ce que j'ai voulu dire ; c'est une manière de faire correspondre notre droit à l'évolution actuelle qui fait que les mineurs sont majeurs avant dix-huit ans pour certaines questions. Audition du professeur Didier Sicard, chef de service de médecine interne à l'hôpital Cochin et président du Comité consultatif national d'éthique Réunion du mardi 7 novembre 2000 Présidence de Mme Martine Lignières-Cassou, Présidente Mme Martine Lignières-Cassou, présidente : Nous avons le plaisir d'accueillir le professeur Didier Sicard, ancien interne des hôpitaux de Paris, professeur agrégé de médecine interne à l'hôpital Cochin en 1978, puis chef de l'un de deux services de médecine interne de cet hôpital depuis 1993. Vous avez été conseiller médical du directeur général de l'AP-HP de 1993 à 1997, président de la Commission consultative de transfusion sanguine en 1991. Vous avez été en 1998, membre du Comité national des Etats généraux de la santé et responsable du thème "soins palliatifs et douleur" de ces Etats généraux. Grand spécialiste du sida, vous avez été nommé, en mars 1999, président du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé. Créé en 1983, ce comité a pour mission de donner son avis sur les problèmes moraux causés par les progrès des sciences et des techniques dans le domaine de la biologie, de la médecine et de la santé. Saisi au début du mois d'octobre par les Présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat sur le projet de loi de Mme Martine Aubry relatif à l'IVG et la contraception, le Comité consultatif national d'éthique n'a pas encore rendu d'avis sur ce texte, mais nous serions heureux de connaître, à titre personnel, votre appréciation sur l'ensemble du projet de loi. Je souhaiterais également que nous puissions évoquer, au cours de la discussion, un autre thème, qui n'est pas abordé par le projet de loi, mais qui a émergé au cours des auditions que nous avons eues ces dernières semaines, celui de la stérilisation volontaire comme acte de contraception, un thème sur lequel le Comité consultatif national d'éthique a déjà travaillé. Professeur Didier Sicard : Lorsque les présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale nous ont saisis de ce texte, j'ai constitué un groupe de travail, dont l'avis est aujourd'hui achevé. Je peux vous faire part de mon avis personnel, mais je ne peux pas faire état de l'avis du Comité, dans la mesure où nous sommes dans la situation absurde de ne pouvoir le réunir en comité plénier. En effet, tous les deux ans, un certain nombre de membres, qui sont élus pour quatre ans, doivent être renouvelés. La date butoir de ce renouvellement était le 9 octobre. Nous sommes aujourd'hui le 7 novembre et l'arrêté de nomination n'est toujours pas paru. J'ai donc écrit au Président de l'Assemblée nationale, il y a quelques jours, pour l'informer que notre travail était terminé, mais que je ne pouvais en faire état, dans la mesure où je ne peux pas réunir le comité plénier. Je ne sais toujours pas quand il pourra se réunir. J'espère bien sûr que ce sera le plus rapidement possible. En tout cas, dès que sa composition sera officiellement connue, je pourrais le réunir en urgence, puisque le travail de commission est terminé. Tant que les membres qui doivent être nommés n'ont pas participé à la discussion, je ne peux faire état que d'une opinion personnelle, car il ne peut être exclu que des opinions contradictoires s'expriment. Nous avons auditionné deux hommes et deux femmes : les professeurs Israël Nisand et Michel Tournaire, ainsi que Mmes Monique Canto-Sperber et Elisabeth Sledziewski. La première est directrice de recherche au CNRS, la seconde, maîtresse de conférence à la faculté de droit et de science politique de Rennes. Toutes deux avaient publié un article dans Le Monde, à quelques jours d'intervalle, d'opinion opposée, qui m'avaient paru de grande qualité. C'est la raison pour laquelle nous les avons consultées. Je souhaitais que nous ne repartions pas dans des débats trop académiques. La question dont nous sommes saisis est assez précise : le prolongement du délai d'interruption de grossesse fait-il courir un risque d'eugénisme ? Portons trois ou quatre regards sur ce problème. Premièrement, qu'on le veuille ou non, nous sommes entrés dans une société d'eugénisme médical. Il ne faut pas se voiler la face : avec l'échographie, le dépistage de la trisomie 21, la grossesse n'est plus une aventure qui survient sans regard médical. A la limite, la justice supporterait mal qu'une femme enceinte ne bénéficie pas de tout ce que peut offrir la médecine. Nous l'avons d'ailleurs vu lors des débats récents. La société considère qu'une grossesse doit faire l'objet d'une surveillance, afin de dépister les anomalies éventuelles. Cependant, la société ne prend pas la décision que tel enfant doit naître ou que tel autre ne doit pas naître. Nous ne sommes pas dans une société discriminatoire, ni dans une société qui sélectionne les individus. En même temps, ne soyons pas hypocrites : disons que notre société accepte que la médecine porte un jugement, parfois assez radical, sur l'opportunité de poursuivre telle ou telle grossesse. Deuxièmement, il ne faut pas exagérer le nombre de malformations qui aboutissent à une interruption de grossesse. On estime entre 2 et 2,5 % le nombre de malformations, allant du bec-de-lièvre au mongolisme, pouvant poser un problème d'interruption de grossesse. L'augmentation du délai de dix à douze semaines permet à la médecine d'obtenir des informations plus fines et de découvrir certaines anomalies. Avant dix semaines, par exemple, une fente labiale n'est pas visible ; après la onzième ou la douzième semaine, elle l'est davantage. Cela ne se voit d'ailleurs pas à dix semaines et un jour, c'est très progressif. On peut même imaginer qu'une échographie vaginale faite par un médecin très expérimenté peut la découvrir, dès la neuvième semaine, car cette découverte est en fait très dépendante de l'observateur. La question posée est, en réalité, de savoir si la découverte d'anomalies ou la découverte du sexe par les médecins exposent à un accroissement du nombre d'interruptions de grossesse. Je pense que cette question ne doit pas être traitée de cette façon, parce qu'il est attentatoire à la dignité des femmes de considérer qu'une grossesse puisse être vécue ainsi et qu'une femme puisse s'en débarrasser en fonction du sexe de l'enfant. Même si cela peut se produire, je pense qu'une société n'est jamais très digne lorsqu'elle juge une partie d'elle-même d'une façon aussi négative. Je crois toujours qu'il faut respecter les personnes dont on parle. En particulier, respecter les femmes, c'est ne pas leur faire porter d'emblée une responsabilité vis-à-vis d'elles-mêmes, comme si elles étaient désinvoltes vis-à-vis de leur grossesse. Donc, même si la médecine peut apporter des informations permettant à un certain nombre de femmes de porter, sur leur grossesse, un jugement négatif, qu'elles n'auraient peut-être pas porté si elles étaient restées dans l'ignorance, je ne pense pas, compte tenu du faible nombre de cas en cause, que la découverte du sexe aboutisse à une augmentation des interruptions de grossesse. Je ne pense pas que l'on ait à craindre un eugénisme aggravé, parce que la question n'est pas de savoir si l'eugénisme existe - il existe de façon médicale, même si l'on ne veut pas le voir - et je ne pense donc pas que l'allongement du délai soit de nature à accroître le nombre d'interruptions de grossesse. Je ne pense pas d'ailleurs que le débat sur l'eugénisme lié au délai d'interruption de grossesse ait un sens, en dehors de certains pays comme la Chine. Mais, dans ce pays, ce ne sont pas les femmes qui interrompent leur grossesse lorsqu'elles ont des filles, mais l'Etat chinois qui les y obligent, car c'est un Etat eugénique. Et la France ne l'est pas. Troisièmement, aller jusqu'à la dixième ou la douzième semaine de grossesse pose des questions différentes à l'équipe médicale et à la femme. Il ne faut pas oublier que l'objectif est d'empêcher 5 000 femmes, concernées par le dépassement des délais, d'aller à l'étranger. Sur le plan épidémiologique, les raisons pour lesquelles ces femmes interrompent leur grossesse ne sont quasiment jamais liées à la découverte du sexe ou d'une anomalie particulière. C'est plus souvent un problème d'intolérance ou de détresse psychique lié au fait qu'avec la contraception actuelle, des femmes, même des femmes qui ne sont pas toutes jeunes, peuvent être perdues dans leur cycle menstruel, ne plus savoir exactement pour quelle raison elles n'ont pas de règles. Bref, sans entrer dans les détails médicaux, c'est une situation relativement banale que des grossesses soient découvertes tardivement, après dix semaines. S'y ajoute le cas des femmes vivant dans des milieux défavorisés ou des mineures qui, lors d'une première grossesse, ignorent la signification d'une aménorrhée. Toutes ces circonstances font que la demande d'une interruption tardive de grossesse n'est pas tant liée à la question de la qualité du f_tus ou de l'embryon qu'au désir de la femme de l'interrompre. La médecine, pour sa part, peut être embarrassée, parce qu'à dix semaines, avec le RU 486 ou avec des techniques relativement simples, l'IVG, sans hospitalisation, peut être réglée dans la journée. La femme qui désire interrompre sa grossesse veut que ce soit fait tout de suite, parce qu'une fois la décision prise, les femmes n'ont pas tellement envie d'être confrontées à des débats sans fin. A onze ou douze semaines, l'IVG demande une intervention chirurgicale avec anesthésie. Il faut donc que des équipes médicales qui ont été relativement peu concernées jusqu'à présent, s'intéressent à ce problème, car un changement d'attitude médicale est nécessaire. C'est une des raisons pour laquelle certains médecins sont un peu réticents. Une autre raison, c'est que ce geste apparaît, pour la médecine, comme non gratifiant. On imagine mal un médecin, lors d'un dîner en ville, dire qu'il a fait quinze IVG dans la semaine. C'est toujours un geste qui se fait au sein d'une équipe soudée où le spécialiste risque très rapidement d'être pris dans une sorte d'idéologie négative ou positive, qui lui fait perdre un peu de recul. Allonger le délai à la onzième ou à la douzième semaine suppose que l'IVG soit un acte chirurgical qui, paradoxalement, retrouve sa noblesse, car il n'y a pas de raison que la médecine ne participe pas le mieux possible à aider les femmes. Il n'existe pas, en France, cette espèce d'ostracisme qui, dans certains pays, peut aboutir à des situations effrayantes, mais on ne peut pas non plus pratiquer des interruptions de grossesse dans un coin d'hôpital. C'est une activité qui, tant qu'elle ne sera pas respectée par la société, insultera, en fait, les femmes qui y ont recours et, par conséquent, les médecins. On voit très bien que cela a pour effet, d'une part, que les médecins ne se précipitent pas pour faire cet acte, d'autre part, que les échographistes, qui seront concernés au premier plan par ce prolongement de l'interruption de grossesse, se trouvent placés face à une responsabilité de plus en plus forte. En effet, si avant dix semaines, l'échographie ne donne que peu d'indications, à partir de la onzième semaine, en revanche, la femme peut très bien demander si son enfant est normal. Les mesures, qui seront de plus en plus précises, vont faire porter aux échographistes une responsabilité de plus en plus grande. On comprend donc très bien que ces derniers soient très réticents. S'ils font interrompre une grossesse qui se révèle ensuite normale, la femme portera plainte, mais s'ils ne diagnostiquent pas une grossesse anormale, la femme risque également de porter plainte. Nous risquons de nous retrouver dans la situation où des échographistes refuseront de faire de tels examens. Quatrièmement, le professeur Israël Nisand proposait que, jusqu'à dix semaines la loi de 1975 s'applique et que, de dix à douze semaines, l'on introduise une possibilité d'interruption médicale de grossesse, liée à une détresse psychologique définie assez largement, de manière à donner aux médecins un pouvoir de décision, tout en les encourageant à être assez larges d'esprit. Face à une telle solution, ma position personnelle est de considérer qu'il y a une sorte de dénaturation de la loi, parce qu'à mon avis c'est une loi médiane. Dans son article premier, elle dispose en effet que "la loi garantit le respect de tout être humain dès le commencement de la vie", comme s'il y avait un respect du f_tus a priori, alors qu'en même temps elle considère qu'une femme a le droit d'interrompre sa grossesse. Si, entre la dixième et la douzième semaine, la femme est soumise aux médecins par le biais de l'interruption médicale de grossesse (IMG), je pense que la loi serait dénaturée, parce que celle-ci a permis à la femme d'exprimer sa liberté par rapport à sa grossesse. On peut débattre sans fin sur le fait de savoir quelle est la liberté de la femme par rapport à son f_tus. Mais, à partir du moment où la loi a exprimé cette volonté, on peut difficilement considérer que la décision n'appartienne plus à la femme, mais qu'elle soit donnée aux médecins, car on peut alors imaginer qu'en fonction de l'idéologie, de la culture, du lieu, de la province ou de la région, les femmes seront soumises à un questionnement ou un regard différent, ce qui dénaturera la loi. C'est la raison pour laquelle j'estime que, même si ce transfert de l'IVG vers l'IMG apparaît au premier abord comme une solution très simple, celle-ci remet en cause la loi de 1975 d'une façon bien plus importante qu'on ne le croit. Autrement dit, pour ce qui concerne le délai d'interruption de grossesse, le problème ne tient pas tellement à une question de date - en dehors du fait qu'il faut que les CHU, les hôpitaux, les cliniques s'investissent beaucoup plus dans cette activité, n'en fassent pas une activité cachée mais une activité qui ait toute sa visibilité - mais il est en amont. Notre pays est en effet extrêmement en retard pour l'information sexuelle des jeunes filles et des jeunes garçons. Pourquoi ne pas enseigner, dès douze ans, à un garçon et à une fille qu'un premier rapport sexuel peut être suivi d'une grossesse et que devoir interrompre cette grossesse, même si l'on dit que ce n'est rien du tout, sera toujours un traumatisme ? Sans doute est-ce utopique, mais je crois que la sexualité peut être enseignée avec beaucoup de maturité, comme une forme de respect de l'autre. Sans doute faut-il faire en sorte que ce soient de jeunes adolescents qui forment des jeunes, que s'efface cette vision d'une sexualité interdite, d'une sexualité qui apparaît comme une menace pour la famille. Si l'on disait à une jeune fille de treize ans que son premier rapport sexuel peut être un grand bonheur, mais aussi un grand désastre s'il est suivi d'une IVG, si on lui apprenait ce qu'est une interruption de grossesse, comment cela se passe et comment elle se pratique, je pense que le nombre des IVG en France baisserait. Au lieu de bloquer le débat sur la question des dix, onze ou douze semaines, il vaudrait mieux considérer qu'une société est responsable de ses jeunes filles et de ses jeunes hommes, car les garçons aussi doivent savoir ce qu'est une grossesse et qu'une grossesse peut commencer un samedi soir. Ils doivent eux aussi pouvoir en parler. Je suis très frappé de constater que, dans les pays du Tiers-Monde, l'éducation sexuelle est mille fois mieux faite que dans les pays développés. Je le constatais au Pérou par exemple, où les adolescents de douze-treize ans ont une capacité à travailler en groupe et à apprendre ensemble le respect de l'autre à travers la sexualité, et où, paradoxalement, l'on considère que la sexualité ne doit pas être un cours de sciences naturelles, mais un apprentissage du respect de l'autre. A cet égard, le discours sur le préservatif devrait être, à mon sens, radicalement inversé. Il ne s'agirait plus de se protéger soi-même, mais de protéger l'autre ; cela me paraîtrait une façon de ne pas être chacun rivé à sa protection, mais tourné vers l'autre. La politesse sociale, c'est de protéger l'autre. En étant obsédé par soi, on finit par avoir des comportements narcissiques. L'allongement des délais n'est donc ni un problème majeur, ni un problème d'eugénisme ; c'est un problème chirurgical, qui est difficile pour les médecins. Ce sont les médecins qui font l'acte. En ayant plus de respect pour ceux qui pratiquent l'interruption de grossesse, les femmes seraient, elles aussi, plus respectées. Mme Martine Lignières-Cassou, présidente : Nous venons de recevoir une personne responsable d'un centre d'IVG en Hollande. Nous avons parlé des différences d'approche et de pratique concernant la sexualité et l'IVG. Elle nous disait qu'en Hollande, la technique utilisée entre dix et douze semaines de grossesse est la même. Après de multiples auditions, puisque notre Délégation avait choisi, bien avant que Mme Martine Aubry ne dépose son projet de loi, la contraception et l'IVG comme thème de notre rapport d'activité, nous avons le sentiment que les médecins qui se sont exprimés sur ce sujet sont surtout des médecins accoucheurs et qu'ils faisaient plus état de leurs craintes ou des difficultés liées à l'interruption médicale de grossesse (IMG). Il nous semble que nous parlons des mêmes femmes, mais que nous ne parlons pas de la même grossesse. Je partage tout à fait votre sentiment concernant l'eugénisme. J'aurais cependant aimé, et j'aimerais que dans ce débat on n'emploie pas des mots à tort et à travers. Notre société a décidé que la sélection des individus était possible, en fonction de certains critères médico-sociaux, et du choix des familles. Nous ne sommes une société où l'Etat met en place une politique de sélection à partir de certains critères. Donc, parlons de sélection, mais ne parlons pas d'eugénisme, parce que ce terme nous renvoie à un passé qui est très douloureux et qu'il empêche les médecins d'avoir un recul et une analyse de leurs pratiques. Il faudrait poser le débat de façon plus large, comme vous l'avez fait, mais aussi avec plus de sérénité. Un usage approprié des termes pourrait, me semble-t-il, faciliter la réflexion. Professeur Didier Sicard : Sur le plan technique, le professeur Michel Tournaire, qui préside actuellement le comité de l'ANAES spécifiquement désigné sur le sujet, nous a dit que la zone de risque hémorragique et de rupture utérine augmentait de façon un peu linéaire. Par conséquent, il comprenait très bien l'opposition de certains centres d'IVG à l'extension du délai, parce qu'ils ont l'impression d'encourir un risque plus important en intervenant à douze semaines qu'à dix. Mme Nicole Catala : Lorsque ce débat a commencé à se poser devant l'opinion, vous avez dit qu'il ne s'agissait pas à vos yeux d'une question éthique. Si tel est le cas, à quel stade de l'évolution du f_tus pourrait se poser une question éthique ? M. Patrick Delnatte : Le projet de loi prévoit que les établissements publics hospitaliers peuvent assurer le service d'IVG. Quel sera le sort des établissements qui, bien que n'étant pas publics, assument une mission de service public ? Je pense, par exemple, aux établissements hospitaliers d'inspiration religieuse dans de grandes universités, comme l'université catholique. Considérez-vous que cette mission de service public leur sera également imposée ? Professeur Didier Sicard : Il faut sortir l'IVG de cette sorte d'opprobre. Dans les années 80, c'est au médecin afghan, qui demandait un statut de réfugié politique, que l'on confiait les IVG, parce que ce n'était pas un acte assez "noble" pour un interne des hôpitaux de Paris ou pour un chef de clinique. Il existe donc bien cette idée que ce qui est noble, c'est de faire naître un enfant et que le reste est de l'ordre du désastre. Cela l'est sûrement pour une femme, mais le rôle de la médecine est de venir en aide. Je pense que les médecins doivent être très prudents avant de s'armer d'une carapace spirituelle. Qu'ils soient juifs, catholiques, protestants, musulmans, ils sont des médecins et n'ont pas à juger. Il existe d'ailleurs la clause de conscience. Lorsque j'étais conseiller d'Alain Cordier, directeur général de l'AP-HP, celui-ci disait qu'il était contre l'avortement, mais qu'il ferait tout ce qui était possible dans sa vie professionnelle pour aider l'Assistance publique à changer de politique à l'égard de l'IVG, parce que c'était sa responsabilité. Je ne pense pas que ce soit un problème éthique, mais un problème moral. A mon avis, l'interruption de grossesse est un problème moral qui concerne une femme ; ce n'est pas un problème éthique. Comment peut-on être rivé au statut ontologique de l'embryon ou du f_tus ? J'ai récemment préfacé un livre sur le statut du f_tus à travers les âges. On est atterré de constater que chaque période, chaque civilisation, chaque culture a donné au f_tus un statut qui lui paraissait définitif. Il appartient à chaque spiritualité, à chaque intelligence, à chaque femme d'en décider, même si la société a un droit de regard, mais on ne peut en faire un problème éthique. Ce serait la tragédie de l'éthique que de se prononcer sur les treize ou les dix semaines. Nous pouvons seulement dire que les arguments mis en avant par la société ne nous paraissent pas être éthiquement choquants. Il faut que les médecins soient capables de s'approcher de la femme qui demande une IVG sans chercher à lui faire partager leur culture personnelle, parce qu'ils ne sont pas à l'intérieur du corps de cette gosse de dix-sept ans ou de cette femme de quarante-cinq ans. Mme Jacqueline Mathieu-Obadia : Le problème moral est lié au respect, dont vous parliez tout à l'heure, du médecin vis-à-vis de la patiente, qui fait que la patiente se respecte elle-même selon le respect qui lui est porté. Mais l'éthique ne se situe-t-elle pas en amont, au moment où a lieu une conception féconde ? Je fais alors le lien avec ce que vous disiez à propos de l'enseignement de l'éducation sexuelle. Professeur Didier Sicard : Cela me paraît clair. Mme Martine Lignières-Cassou, présidente : J'aurais voulu revenir plus particulièrement sur un corps de médecins- celui des échographistes - dont l'importance va grandissant, non pas dans le cadre de l'IVG mais dans celui de l'IMG. J'ai le sentiment que, depuis cet été, ces deux notions sont mélangées, alors que, pour la femme, la démarche d'IVG ou d'IMG n'est pas la même. Même si, pour le médecin, l'acte peut être identique, à mon sens, cela ne le renvoie pas aux mêmes valeurs. Dans le cadre de l'IVG, il est clair que la place de l'échographiste sera, et est déjà, déterminante, ne serait-ce que parce qu'il n'a pas de recul par rapport à l'image, contrairement au médecin obstétricien qui reçoit dans son cabinet et qui peut prendre le temps d'annoncer certaines choses, notamment un handicap. En dehors des problèmes de responsabilité et d'assurance, qui peuvent être liés à l'exercice de cette spécialité, se pose le problème de la pratique de ce métier, parce que le médecin travaille en instantané et que les paroles et les annonces qu'il fait sont extrêmement lourdes. Professeur Didier Sicard : Effectivement, comme vous le disiez, à l'échographie, il y a des images, mais ce ne sont que des images. Parfois, des femmes prennent un document sur papier pour le montrer à leur médecin, mais celui-ci est incapable de le lire, car une échographie n'a pas de sens, c'est une image abstraite. Sa lecture est dépendante de l'opérateur ; un grand échographiste se trompera moins qu'un débutant. La responsabilité des échographistes va devenir énorme. S'il y a une confusion entre le droit et la médecine, c'est que les juristes sont persuadés que l'échographiste parle d'images réelles. En fait, il parle d'images virtuelles. Ces images virtuelles s'amélioreront, mais dépendront toujours de l'expérience. Nous sommes dans une illusion de critères. Je n'ai pas de réponse. En tout cas, c'est une interrogation. Je crains que dans de nombreux domaines - biologiques, échographiques et autres - on demande à la médecine beaucoup plus qu'elle ne peut donner. La médecine est fragile, elle raisonne parfois en termes de probabilité, parfois en termes de certitude, mais on ne peut pas lui faire porter de responsabilités excessives. Mme Marie-Thérèse Boisseau : Etes-vous favorable à l'allongement du délai ? Professeur Didier Sicard : Je ne suis ni favorable, ni défavorable. Je pense, à titre personnel, que l'allongement du délai ne pose pas de problème éthique de nature à mettre en péril la société ou à augmenter le nombre d'IVG. Quand une femme décide d'interrompre sa grossesse, elle ne le fait jamais par plaisir à onze semaines plutôt qu'à neuf. Quand elle le fait, elle le fait généralement, quelles que soient les raisons qui l'y poussent, dans une situation souvent dramatique. Le problème n'est pas l'extension de ce délai, le problème central est qu'il est ahurissant que la France se trouve dans la situation d'en dénombrer 220 000 par an. Nous sommes un pays record du monde en la matière, du moins dans les pays développés. La loi doit travailler sur le thème suivant : comment en est-on arrivé là ? Au fond, ce qui me choque, c'est de constater que l'on s'occupe de l'aval et pas de l'amont ; 220 000 grossesses interrompues, c'est insupportable pour ces femmes. Nous sommes une société frileuse. C'est sur cela qu'il faut travailler, plutôt que sur la question des dix ou douze semaines. Mme Marie-Thérèse Boisseau : Je comprends bien vos propos, mais le problème qui nous est posé est celui de l'allongement du délai de douze à quatorze semaines d'aménorrhée, avec la possibilité, pendant cette période, de faire des échographies que l'on ne pouvait pas faire auparavant. Un diagnostic est malgré tout posé par les échographistes, même si les images virtuelles peuvent être erratiques et faire apparaître des malformations qui, si on laisse la grossesse se poursuivre peuvent, dans certains cas, totalement se résorber. Que fait l'échographiste ? Il a le devoir d'en informer les parents ? C'est terrifiant. Professeur Didier Sicard : Je comprends très bien que les échographistes, professionnellement, soient contre cet allongement du délai, parce que c'est eux qui devront faire face au problème, mais je pense aussi que le problème ne doit pas être traité en termes professionnels, parce que si tous les problèmes de société étaient traités en fonction de tel ou tel corporatisme qui refuse de prendre de telles responsabilités, nous n'avancerions pas. Chacun resterait dans son pré carré. Il ne faut pas non plus trop amplifier le problème : sur les 220 000 interruptions de grossesse, les anomalies échographiques restent de l'ordre du dérisoire. Certes, leur perception augmente en allongeant le délai, mais faut-il pour autant faire d'un problème minoritaire, un problème qui expose des femmes à aller se faire faire une IVG dans un autre pays ? De plus, dire que des femmes vont demander une interruption de grossesse parce qu'elles voudraient une fille alors qu'elles ont un garçon, je trouve que c'est attentatoire à leur dignité. On ne peut pas considérer qu'une femme soit si indifférente à l'enfant qu'elle porte qu'elle puisse dire : " J'ai déjà trois garçons, je veux une fille" ou l'inverse. Si même cela devait arriver, je pense qu'il faut respecter ces femmes. C'est en les respectant que je trouve, paradoxalement, qu'il n'y a pas de danger à passer de douze à quatorze semaines d'aménorrhée. Face à ces quelques milliers de femmes qui sont perdues, ceux qui les ont rencontrées ne sont pas très fiers. Ce n'est pas une situation si rare que cela de découvrir une grossesse à dix ou onze semaines. Il ne faut pas non plus transférer sur l'échographie une responsabilité de découverte de fente labiale, qui me paraît un argument, certes véritable, mais aussi ultra-minoritaire. Mme Marie-Thérèse Boisseau : En termes de respect des femmes, vous seriez assez favorable à l'allongement du délai de douze à quatorze semaines. Mais, au-delà de ces quatorze semaines, il reste encore un certain nombre de femmes. Qu'en faites-vous ? Professeur Didier Sicard : C'est la raison pour laquelle il ne faut pas passer à l'IMG, parce que l'IMG pourrait tout à fait répondre à une détresse à quinze, à seize et à dix-huit semaines. Le délai étant prolongé jusqu'à quatorze semaines, que se passera-t-il pour celles qui atteignent les quinze, seize et dix-huit semaines ? Eh bien, c'est l'humilité d'une société qui, à un moment donné, n'accepte pas tous les deux ans de reculer le délai d'une semaine, et qui décide de traiter le problème non pas par l'allongement d'un délai mais en amont. Mme Marie-Thérèse Boisseau : Oui, mais il y a des femmes qui sont à quinze semaines d'aménorrhée. Qu'en fait-on ? Professeur Didier Sicard : Actuellement, les médecins dans le secret de leurs hôpitaux font des interruptions de grossesse à onze semaines, parce qu'ils ne veulent pas que la femme parte en Hollande. Ce sont des cas rares, et l'on ne peut pas légiférer à partir de cas rares. Il faut garder en tête que chaque semaine qui passe est une épreuve supplémentaire pour une femme. Je trouve, là encore, assez indigne de penser qu'une femme puisse vivre sa grossesse avec une indifférence telle qu'à seize semaines ce soit comme à douze. A mesure que la grossesse avance, se produisent des phénomènes physiologiques, des phénomènes d'appropriation de l'enfant qui font que plus une grossesse dure, plus elle a de chance d'être poursuivie. Paradoxalement, on pourrait pousser le raisonnement jusqu'à dire qu'une grossesse qui aurait été interrompue à dix semaines dans l'angoisse du temps qui passe ne l'aurait peut-être pas été avec un plus long délai. J'ai des exemples personnels de femmes qui, quelques jours après leur première demande d'IVG, découvrent que l'on peut s'arranger, que la famille va aider, etc. Au fond, le temps à beaucoup plus de chance d'inscrire le prolongement d'une grossesse que son interruption. Je ne pense pas que le risque d'une dérive de deux semaines soit de nature à interdire ce prolongement de délais. Audition du professeur Claude Sureau, président de l'Académie de médecine Réunion du mardi 7 novembre 2000 Présidence de Mme Martine Lignières-Cassou, présidente Mme Martine Lignières-Cassou, présidente : Nous recevons maintenant le professeur Claude Sureau, ancien chef de l'unité de gynécologie-obstétrique de l'hôpital américain de Paris. Vous avez présidé la fédération mondiale des gynécologues-obstétriciens de 1982 à 1985 et son comité d'éthique de 1985 à 1994. Vous présidez depuis 1996 l'institut fondé par le laboratoire Theramex, grand spécialiste des traitements hormonaux substitutifs contre la ménopause. Vous avez été élu président de l'Académie de médecine en janvier de cette année. Vous avez consacré vos recherches à l'activité utérine et à la circulation du f_tus. Vous avez publié en 1978, Le danger de naître, en 1990, Au début de la vie, en 1995, Aspects éthiques de la reproduction humaine, et votre dernier livre, Alice au Pays des clones, qui se présente sous forme d'un dialogue philosophique, est orienté vers une réflexion éthique de la reproduction. Notre Délégation, qui s'intéresse particulièrement aux problèmes d'IVG et de contraception, souhaiterait connaître l'appréciation de l'Académie de médecine sur le projet de loi de Mme Martine Aubry, ministre de l'emploi et de la solidarité, relatif à l'IVG et à la contraception. Nous sommes particulièrement intéressés par votre réflexion éthique en ce domaine. Je rappelle que vous vous êtes exprimé publiquement sur les problèmes d'eugénisme, considérant insupportable l'eugénisme pratiqué de façon systématique et coercitive, mais ne le trouvant pas condamnable s'il est pratiqué à titre individuel. Vous avez également déclaré que l'enfant sur mesure relève du pur fantasme. Enfin, vous venez de faire connaître votre opinion sur la requête des parents Perruche, qui vient d'être examinée par l'assemblée plénière de la Cour de cassation. J'aurais aimé que nous puissions parler également d'un sujet sur lequel vous avez travaillé, celui de la stérilisation volontaire. Professeur Claude Sureau : Je parlerai en premier lieu de la modification des lois sur l'IVG et la contraception, c'est-à-dire du projet de loi de Mme Martine Aubry, avant d'aborder les autres aspects qui viennent d'être d'évoqués. Il me semble qu'il y a deux niveaux de réflexion. Le premier a trait à certains aspects très concrets et très précis de la modification de la loi, sur lesquels l'Académie de médecine, que je préside actuellement, a initié une réflexion le 3 octobre dernier, au moment même où le projet de loi était rendu public. Le groupe de travail mis en place à cet effet a travaillé depuis lors, mais n'a encore soumis ses conclusions ni au conseil d'administration de l'Académie, ni à l'assemblée plénière. J'exprime donc un avis personnel, qui reflète malgré tout l'évolution des idées d'un groupe de travail de l'Académie même s'il n'a pas encore la signification d'un communiqué officiel de l'Académie. Ce petit groupe comportait des représentants de différents organes, dont le président du Conseil national de l'Ordre. Ses conclusions seront donc communes à l'Ordre, à l'Académie, ainsi qu'au Collège national des gynécologues-obstétriciens, puisque ces trois instances ont été impliquées. Nous n'avons voulu envisager que les problèmes strictement médicaux, et nous n'avons pas voulu nous prononcer sur ce qui n'est pas de notre ressort, à savoir les problèmes éthiques, philosophiques et les réflexions sur l'eugénisme, qui ont été très largement évoqués lors de la présentation du projet de Mme Martine Aubry. Je serai néanmoins tout à fait d'accord pour vous livrer mon sentiment personnel sur ce sujet. Notre position peut s'exprimer en trois points. Premièrement, sur le point crucial qu'est l'allongement du délai de douze à quatorze semaines - ou de dix à douze, selon le critère retenu - nous n'avons, par définition, que très peu d'informations et de documents en France, puisque nous manquons d'expérience en ce domaine ; mais nous ne bénéficions pas non plus des expériences étrangères, car il est très rare qu'une individualisation de cette période de deux semaines soit faite dans les études existantes. Il y a cependant un document remarquable sur le sujet, c'est le rapport de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé (ANAES). Sur le plan technique, il me semble répondre à la totalité des questions que l'on peut se poser. Notre position sera de dire que l'allongement de dix à douze semaines ne comporte pas d'augmentation considérable du risque... Mme Martine Lignières-Cassou, présidente : Pour la femme ou pour les médecins ? Professeur Claude Sureau : Dans la mesure où il y a un peu plus de risques pour la femme, il y a, par conséquence naturelle, plus de risques pour le médecin également. Mais, dans notre avis, ce que nous envisagions, c'était véritablement le risque pour la femme. Ce risque est un peu plus élevé. L'un des documents de l'ANAES faisait spécifiquement référence à la période de dix à douze semaines et faisait état à un risque relatif de 1,49, chiffre qui peut paraître important, mais qui signifie que le risque passera approximativement de 0,7 à 0,9 %, soit un petit risque supplémentaire. Ce risque constitue-t-il un argument permettant de dire qu'il est inimaginable d'envisager l'extension du délai d'interruption de grossesse ? Absolument pas, il constitue simplement un argument extrêmement fort pour que des précautions particulières soient envisagées. Par précautions particulières, j'entends l'environnement de l'hospitalisation, notamment le recours à l'anesthésie-réanimation, les possibilités transfusionnelles, l'utilisation d'une salle d'opération correctement équipée, etc. En effet, d'un acte souvent réalisé par aspiration à six semaines, que l'on peut qualifier de médical, on passe à un acte chirurgical avec dilatation du col de l'utérus. Il est également très important que les médecins qui pratiquent l'IVG à cette période aient de l'expérience. Cela signifie que la personne habituée à donner de la mifépristone à six semaines aura besoin d'une formation particulière pour pouvoir faire l'interruption de grossesse à dix-douze semaines, parce que le risque est plus élevé, même s'il ne l'est pas beaucoup plus. Une notion n'est d'ailleurs pas encore claire, à l'heure actuelle. Les statistiques révèlent des différences : pour les unes, le risque croît de façon régulière au fur et à mesure de l'évolution de la grossesse, ce qui était plutôt notre position ; pour d'autres, le risque reste stable jusqu'à la dixième semaine et connaît alors l'accroissement, que je citais tout à l'heure, à partir de cette période. Bref, sur le plan médical, nous ne voyons pas de raisons qui militeraient en faveur du maintien de la limite à dix semaines. Néanmoins, nous considérons comme absolument nécessaire la prise de précautions particulières. Deuxièmement, nous nous sommes permis de rappeler que l'interruption volontaire de grossesse n'est pas un moyen de contraception. Mme Françoise de Panafieu : Vous avez raison de le rappeler. Professeur Claude Sureau : Nous considérons qu'une information mieux développée, mieux comprise et mieux acceptée, permettrait de diminuer le nombre des interruptions volontaires de grossesse, dont les statistiques montrent qu'elles sont encore relativement élevées. Nous nous sommes permis d'ajouter, et j'espère que cela sera maintenu par notre assemblée, "à condition d'être l'objet d'un suivi médical, la contraception ne comporte que de très faibles risques pour la santé". Nous sommes globalement très favorables à la contraception, à son éducation et à l'utilisation qui en résulte. Troisièmement, nous avons ajouté un point qui vous semblera peut-être non pas ambigu mais incertain, parce qu'il n'est pas de notre ressort de légiférer mais du vôtre, qui porte sur les soins médicaux aux mineures, qui réclament actuellement l'autorisation légale des parents. Nous avons indiqué que "des mesures législatives particulières en ce domaine sont nécessaires dans l'intérêt des jeunes et pour mettre l'exercice de la médecine en conformité avec la loi" En effet, aujourd'hui, nous violons la loi en permanence. Nous y sommes obligés, lorsque nous nous retrouvons face à la situation délicate d'une mineure qui ne veut en aucun cas avertir ses parents, aussi bien pour la contraception que, surtout, pour l'IVG. Nous pouvons suivre la loi de manière stricte et nous protéger, en leur disant d'aller voir ailleurs ou d'en avertir leurs parents, ou au moins l'un des deux, puisque c'est l'obligation dictée par la loi actuelle. C'est de la protection médicale. Mais il faut bien le dire, la plupart des médecins, dans ces circonstances, prennent le risque de ne pas suivre la loi. C'est une situation à la fois inconfortable et injuste. C'est la raison pour laquelle nous serions tout à fait favorables à une disposition législative qui permette des exceptions. Nous n'avons pas à donner d'indication précise quant à la forme de cette disposition, mais notre opinion est tout à fait nette sur ce point. Telle est donc la position qui, je l'espère, sera la nôtre dans une quinzaine de jours, puisque, la semaine prochaine, je présente ces conclusions au conseil d'administration et, la semaine suivante, en assemblée plénière. Je peux vous dire, à titre tout à fait personnel, ce que je pense d'un argument qui a été évoqué passionnément dans la presse, mais que nous n'avons volontairement pas abordé, celui de l'eugénisme. A mon sens, il s'agit là d'une confusion des genres tout à fait regrettable. Le problème de l'IVG est un problème social et une décision personnelle qui s'inscrivent dans un cadre législatif extrêmement précis. Le problème de l'interruption médicale de grossesse (IMG), qui est tout à fait différent, est traité dans la même loi. J'ai d'ailleurs noté que, dans le projet de loi, il était question de remplacer le terme d'interruption "thérapeutique" de grossesse par le terme d'interruption "médicale" de grossesse. C'est le terme que nous utilisons maintenant couramment. Cela me paraît une excellente initiative, mais les deux domaines ne doivent en aucune manière être mélangés. Mme Martine Lignières-Cassou, présidente : Ils ne renvoient pas aux mêmes logiques. Professeur Claude Sureau : C'est exact, absolument pas. L'argument qui consiste à dire qu'en décalant la date limite de l'interruption de grossesse, on pourrait avoir connaissance de certains éléments, soit morphologiques, soit relatifs au sexe de l'enfant, qui influeraient sur la décision, ne me convainc absolument pas. On peut admettre qu'actuellement, on ne puisse connaître le sexe de l'enfant que par le biais de l'échographie, mais dans un délai très proche, dans six mois à trois ans, on pourra probablement avoir des informations sur l'état de l'enfant par une simple prise de sang chez la mère, à partir des cellules circulantes f_tales. Si l'on rédige la loi sur l'IVG en fonction de cette possibilité de dérive concernant l'IMG, il faudra également revoir bientôt la loi sur l'IVG à partir de six ou huit semaines ! Cela n'est pas raisonnable. Sur ce point, je me sépare tout à fait de ce que pense le professeur Israël Nisand. Il faut rester dans le cadre précis d'une IVG, telle qu'elle est définie par la loi de 1975 et l'on peut donc, sans grand inconvénient, la modifier dans le sens de l'extension. En ce qui concerne la stérilisation, je voudrais dire que l'article 16-3 du code civil est extrêmement mal rédigé et que sa modification, issue de l'article 70 de la loi du 27 juillet 1999 sur la CMU, ne l'a que peu aménagé. Dans sa version antérieure, cet article prévoyait que l'on ne pouvait faire une atteinte physique à la personne que dans le cadre d'un intérêt thérapeutique pour la personne. Le libellé "pour la personne" me paraît totalement incohérent. En effet, qui est cette "personne" ? Si c'est une femme que l'on va stériliser, ce sera cette femme. Mais si l'on prend cet article de loi au pied de la lettre, nous ne devrions plus jamais faire de césariennes d'indication f_tale. Dans le cas d'un f_tus qui subit une procidence du cordon et qui mourra sans césarienne dans les cinq minutes, c'est sur la mère que se fera la césarienne, mais la personne que l'on tente de sauver, c'est le f_tus. Or, concernant le f_tus, même si existe la règle infans conceptus (24),ce n'est pas une personne au sens habituel du mot ; la preuve en est que l'on fait des interruptions de grossesse. La "personne" serait donc celle dont on va ouvrir le ventre, mais cet acte se ferait au bénéfice d'une personne qui n'est pas encore née. C'est absurde. Des exemples semblables, il en existe beaucoup. Lorsque vous faites une circoncision, celle-ci a-t-elle un intérêt thérapeutique pour la personne ? Il faudrait sérieusement le démontrer. Dans son arrêt concernant l'hôpital d'Arles, à la suite d'une plainte déposée après une mort néonatale par anesthésie générale survenue lors d'une circoncision de convenance - je le précise car il s'agissait d'un musulman et d'une circoncision religieuse - le Conseil d'Etat s'est bien gardé, à la différence de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, de qualifier l'acte de circoncision. Il a simplement envisagé la nécessité de l'anesthésie, sans qualifier la nature de l'acte. C'est une formulation intelligente et audacieuse. Cet exemple est typique de l'absence d'intérêt thérapeutique pour la personne. Il existe bien d'autres situations. Un cas extrême est celui du don d'ovocytes pour fécondation in vitro. On prélève l'ovocyte chez quelqu'un que l'on va stimuler, à qui l'on va donner des traitements pour faire un acte chirurgical de prélèvement d'ovocytes, mais ce n'est pas cette personne qui en bénéficiera. On peut répondre que nous sommes là dans une situation particulière liée aux lois sur la bioéthique de 1994, et qu'on est fondé à stimuler l'ovulation et à ponctionner des ovocytes pour ce don d'ovocytes. Que l'on m'explique alors pour quelles raisons nous sommes obligés, à l'heure actuelle, de mettre l'acte de stimulation ovarienne et de prélèvement sous le nom de quelqu'un d'autre. Mme Martine Lignières-Cassou, présidente : Il s'agit de conserver l'anonymat du donneur, qui est un caractère fondamental des dons d'ovocytes. Professeur Claude Sureau : C'est justement attentatoire à l'anonymat. Une dame veut bien donner son ovocyte que nous allons utiliser pour une autre dame, qui n'a pas à connaître la première, ni réciproquement. Le prélèvement se fera donc sous le nom et dans l'intérêt de la receveuse mais concerne la donneuse. Cela ne colle pas. A cause de l'article 16-3, qui crée une confusion sur le terme de "personne". Il y a également une confusion qui nous gêne beaucoup sur le plan de la stérilisation, celui de l'intérêt thérapeutique. A la suite de la suggestion de M. François Autain, sénateur de Loire-Atlantique, le terme "thérapeutique" a été remplacé par le terme "médical". La discussion au Sénat est très claire : M. François Autain a dit spécifiquement que cette modification avait pour but de permettre la stérilisation. Nous nous en sommes réjouis, mais les arrêts de la Cour de cassation ont jusqu'à présent stigmatisé le caractère inadmissible, illégal et illicite de la stérilisation dite de convenance, de la stérilisation contraceptive, comme le dit la Cour de cassation d'une manière qui confine à l'humour. Comme s'il pouvait exister des stérilisations non contraceptives ! Cela a-t-il le moindre de sens ? A mon sens, toute stérilisation est, par définition, contraceptive. Mme Martine Lignières-Cassou, présidente : Dans les effets, mais pas dans l'intention. Professeur Claude Sureau : Objection totale : une stérilisation se fait dans une intention de contraception. Il n'existe aucune stérilisation non contraceptive. Mme Nicole Catala : Il existe bien des opérations, liées à un cancer, par exemple, qui vous rendent stériles. Professeur Claude Sureau : Je reconnais là une subtilité de la dialectique catholique. Je précise que je suis catholique. Les jésuites ont beaucoup utilisé la règle de l'effet second. Bien sûr, si l'on enlève un utérus, la femme devient stérile, mais c'est une hystérectomie, ce n'est pas une stérilisation. Quand nous parlons de stérilisation, nous parlons d'un n_ud, ou d'une section de la trompe, ou d'un clip. Cette technique ne peut avoir, c'est vrai aussi pour l'homme, qu'une visée contraceptive. C'est donc, à mon sens, une erreur profonde de la Cour de cassation de dire que les stérilisations d'indication médicale sont concevables, par opposition aux stérilisations contraceptives. Cela laisse supposer que la situation est bien catégorisable. On peut proposer à une femme qui a, par exemple, des saignements irréguliers ou une difficulté à utiliser la pilule, la stérilisation ; on peut, il est vrai, lui conseiller aussi de ne plus avoir de rapports ; c'est un moyen efficace pour ne pas avoir d'enfant ! Je suis très sérieux, parce que cela aboutit à dire que la contraception est un acte de convenance. Je sais que le terme heurte beaucoup de personnes, mais il faut bien le reconnaître. Il est d'ailleurs assez spécifique à la gynécologie. En cas de tumeur au cerveau ou de fracture de la jambe, la convenance n'intervient pas : il faut traiter votre tumeur ou votre fracture. Mais pour nous, gynécologues, 50 % de notre activité s'inscrit dans le cadre de la convenance, qu'il s'agisse de l'avortement, de la stérilisation, de la lutte contre l'infertilité ou de la lutte contre les troubles de la ménopause. J'ai toujours été frappé de constater qu'il a fallu attendre 1994 pour que l'assurance maladie cesse de considérer la péridurale comme une technique de convenance. Quelle extraordinaire situation ! Jusque-là, l'assurance maladie refusait son remboursement et il fallait que nous fassions de faux certificats, en prétendant que telle ou telle circonstance médicale imposait la péridurale. Mme Nicole Catala : J'ai du mal à vous suivre dans votre analyse. Vous venez de qualifier un certain nombre de pratiques médicales - les troubles de la ménopause, les troubles de la stérilité ou des troubles de santé spécifiquement féminins - de pratiques de convenance. Pensez-vous que soigner ces troubles est réellement une affaire de convenance ? Faut-il alors aussi considérer que la lutte contre la douleur, dont on parle souvent dans les hôpitaux, est une affaire de convenance ? Professeur Claude Sureau : Bien entendu, mais c'est une convenance légitime. Mme Geneviève Barrier, ancienne directrice du SAMU, qui a été mon anesthésiste pendant vingt ou trente ans, a souvent exprimé une opinion tout à fait raisonnable : "Si l'on avait appliqué aux hommes les contraintes que l'on applique aux femmes lorsqu'elles accouchent, on n'aurait jamais accordé d'anesthésie pour enlever une prostate." Cela revient à dire que l'anesthésie au cours d'une intervention chirurgicale est une anesthésie de convenance, parce que la lutte contre la douleur est une convenance. Cela me paraît évident. Il faut faire la part de l'élément péjoratif qui est inclus dans le terme de convenance. Malheureusement, l'évolution de la société actuelle débouche volontiers sur la non-prise en considération de la convenance légitime. Dans la convenance légitime, j'entends en particulier la sédation de la douleur. Mme Nicole Catala : Evitons alors le terme de convenance. Professeur Claude Sureau : Je cherche volontairement à choquer pour que les gens se rendent compte que la médecine n'est pas une activité simple. Finalement, la convenance, c'est la reconnaissance de la légitimité de la liberté humaine et de l'autonomie. On parle sans arrêt d'autonomie : si, par exemple, une femme préfère une hystérectomie dans un cas de pathologie quelconque à un traitement médical ? C'est son opinion, c'est son autonomie. On milite pour cela. Je suis d'accord. Mais il faut bien reconnaître que ce que l'on appelle le choix éclairé est finalement de la convenance. Pour moi, le terme de convenance ne présente pas de caractère péjoratif. Mme Nicole Catala : Une femme, qui vient de faire l'objet d'une opération pour un cancer du sein, se voit proposer une chimiothérapie. Elle accepte ou elle refuse, est-ce une question de convenance ? Professeur Claude Sureau : Oui, bien sûr. Je vais même plus loin. Lorsqu'une femme se fait opérer, par exemple, d'un cancer du sein et qu'on lui dit que l'on peut faire une intervention peu large ou une intervention plus large suivie de plastie, le choix pour la plastie ne sera-t-il pas un problème de convenance ? C'est son choix personnel, qu'il faut respecter. De la même façon, dans les lois sur la bioéthique, on nous impose que le couple existe depuis deux ans ou soit marié. Je n'hésite pas à le dire, cela fait partie des restrictions qui me choquent. Mme Martine Lignières-Cassou, présidente : Ce sont des convenances sociales. Professeur Claude Sureau : Des convenances sociales imposées. Je reconnais volontiers qu'il vaut mieux avoir deux parents : pas un de plus, pas un de moins, comme cela avait été dit dans un rapport Braibant du Conseil d'Etat en 1988. Mais lorsque les circonstances font qu'il n'y a pas deux parents, faut-il pour autant interdire la conception ? Cela me pousse à faire une remarque sur l'un des articles de la loi qui a trait à l'interdiction d'insémination pour les célibataires. Je n'y suis pas favorable pour les célibataires, bien entendu, mais cette interdiction est l'expression d'un mépris considérable de la femme. Certains pensent que si cette célibataire veut avoir un enfant, elle n'a qu'à se le faire faire par les moyens naturels. Cela me choque à deux titres ; d'une part, parce que nous n'avons pas, en tant que société, à interférer sur le moyen qu'utilise une femme pour avoir un enfant ; d'autre part, parce que c'est faire peu de cas des célibataires stériles. Vous vous souvenez de l'affaire Maria Pires ... Mme Martine Lignières-Cassou, présidente : C'est la veuve à laquelle on a refusé une réimplantation d'embryon après le décès de son mari, alors que le projet était un projet parental. Professeur Claude Sureau : Exactement. Mme Maria Pires et son mari ont eu quatre embryons congelés. Deux ont été implantés, mais elle a fait une fausse couche. M. Albino Pires s'est ensuite tué en allant la voir à l'hôpital de la Grave à Toulouse. Le médecin a refusé une nouvelle implantation, de même que le tribunal de grande instance et la Cour d'appel de Toulouse, puis la première chambre civile de la Cour de cassation. La première chambre civile a même eu l'audace de dire qu'il fallait donner le choix à Mme Maria Pires entre donner son embryon à un autre couple ou le détruire, alors que cette femme réclamait l'implantation de ses embryons ! Voilà l'aberration à laquelle on arrive avec cette obligation de couple, qui me paraît indéfendable. Bien sûr qu'il vaut mieux avoir un couple. Mais d'abord, comment vérifier la stabilité du couple ? Ce n'est pas le médecin qui pourra le faire. Il serait bon que la société, représentée par les parlementaires, porte sur le comportement intime, en particulier en matière de reproduction humaine, un regard qui ne soit pas fonction de ses a priori personnels. Je suis profondément choqué. L'article 16-3 du code civil, dont je parlais précédemment, précise qu'il ne faut pas d'atteinte au corps, hors circonstances médicales très particulières. Nous reprochera-t-on de mettre un stérilet ? Pourtant, quand on réfléchit, la différence est-elle énorme entre la pose d'un stérilet et une stérilisation ? Non. L'acte de pose d'un stérilet est un acte agressif, qui peut entraîner des complications et une stérilité définitive, du fait de ces complications. L'argument et l'interprétation de la Cour de cassation est que l'on n'a pas le droit de porter atteinte au corps humain. Mais quand vous mettez un stérilet dans un utérus, vous portez atteinte à son intégrité. M. Patrick Delnatte : A vous écouter, il ne devrait pas y avoir d'interdit sur ces sujets. Professeur Claude Sureau : Que l'on s'interroge me paraît de bon aloi. Je milite pour une discussion au fond, pour que la société soit instruite de ce qui se passe et que, dans le cadre individuel, une discussion s'engage, notamment avec le corps médical, sur tous ces éléments. Mais la rigidité de la loi, qui engendre des situations comme l'affaire Pires ou des attitudes de ce type, me choque profondément. Mme Jacqueline Mathieu-Obadia : Compte tenu de ce que vous dites, il y aurait lieu de ne plus légiférer et de traiter les situations au cas par cas, de faire du sur-mesure pour respecter, d'une part, les personnes qui s'adressent au médecin et, d'autre part, les médecins qui vont répondre aux situations. Professeur Claude Sureau : C'est l'objet d'une discussion que j'ai depuis plusieurs années avec le professeur Jean-François Mattéi. Une disposition de la loi sur la bioéthique me paraît très bonne, c'est l'interdiction du désaveu de paternité après insémination artificielle. Cela touche au problème de la filiation, de la situation de l'individu dans la famille et dans la société. Je trouve que c'est une bonne disposition, mais une des très rares. Mme Martine Lignières-Cassou, présidente : J'aimerais que nous revenions à l'IVG et à la contraception, qui nous préoccupent aujourd'hui, car si vous ne partagez pas les conclusions du professeur Israël Nisand sur l'eugénisme, vous avez à plusieurs reprises alerté l'opinion sur la question de l'eugénisme dans le cadre de l'IMG, notamment à propos du débat qui vient d'avoir lieu devant l'assemblée plénière de la Cour de cassation sur l'affaire Perruche. Professeur Claude Sureau : A vrai dire, je n'ai pas encore totalement fait ma religion. Ma première réaction est d'être tout à fait opposé à la position de la première chambre civile de la Cour de cassation. Mme Martine Lignières-Cassou, présidente : Je rappelle à mes collègues qu'il s'agit d'un cas de rubéole dans lequel la malformation d'un f_tus n'a pas été diagnostiquée alors que les parents avaient dit que si le f_tus devait être malformé, ils feraient un avortement ... Professeur Claude Sureau : On n'a pas diagnostiqué la rubéole et l'enfant est né avec de gros déficits oculaires : il est sourd, il est cardiopathe et, me semble-t-il, encéphalopathe. Mme Martine Lignières-Cassou, présidente : Non seulement les parents ont porté plainte, mais - c'est là que vous êtes intervenu pour dire que cela vous choquait profondément - l'enfant, qui a dix-sept ans aujourd'hui, a porté plainte également par l'intermédiaire de ses parents. Professeur Claude Sureau : La responsabilité médicale a été reconnue, celle du laboratoire et celle du médecin. Il n'y a pas lieu d'en discuter. La première chambre civile de la Cour de cassation a jugé que les parents ont droit à un dédommagement pour défaut d'information. Ce défaut d'information est clair et sans conteste. Le problème tient aux deux instances simultanées, l'une au nom des parents, l'autre au nom de l'enfant par l'intermédiaire des parents. Il faut savoir que des jugements ont déjà été rendus dans ce cadre, mais qu'ils étaient légèrement différents. Lorsqu'une IVG est ratée, par exemple, et qu'elle débouche sur une grossesse qui continue, on considère qu'il n'y a pas de préjudice, dans la mesure où l'enfant est normal. Des femmes ont porté plainte en disant que cet enfant était un préjudice du fait de son existence et de la non-réalisation de l'IVG ; la réponse de la justice a été négative. Dans des circonstances analogues, il a pu y avoir des accidents morphologiques sur l'enfant, en particulier qu'une jambe ait été arrachée par le chirurgien qui fait l'IVG. Dans ce cas, on a considéré qu'il y avait un préjudice direct et il y a eu indemnisation. Ont été jugés également, mais c'est plus compliqué, des non-diagnostics de prédispositions à une affection. Cela a été également reconnu, parce que l'on aurait pu éviter la conception. Dans le cas dont nous parlons, le problème est très spécifique. Le lien de causalité n'existe pas de manière directe, puisque c'est la rubéole qui est cause de la malformation et que le médecin n'en est donc pas responsable. Il n'est responsable que dans la mesure où il n'en a pas fait le diagnostic. Le même cas a été jugé par le Conseil d'Etat en 1997, dans une affaire où Valérie Pecresse était commissaire du Gouvernement. Cela s'était déroulé à l'hôpital de Nice et il y avait eu un non-diagnostic de mongolisme. Là encore, il s'agit d'une affection médicale : c'est la biologie qui fait le mongolisme, pas le gynécologue. Il y a eu là aussi plainte des parents et plainte au nom de l'enfant. Le Conseil d'Etat a répondu très habilement à la plainte des parents en incluant l'indemnisation de l'enfant dans l'indemnité parentale. C'est astucieux parce qu'il est clair que cet enfant aura besoin d'un secours toute sa vie, notamment à la mort de ses parents. Il y a donc une nécessité de prise en charge. Malheureusement, la première chambre civile de la Cour de cassation n'a pas fait de même. Elle a séparé les deux instances. De ce fait, il y a indemnisation pour défaut d'information de la famille et absence d'indemnisation pour l'enfant. Cela explique que l'assemblée plénière de la Cour de cassation va probablement confirmer l'avis de la première chambre civile, malgré l'arrêt de rébellion de la cour d'Orléans. On comprend très bien - c'est d'ailleurs ce que les avocats de la famille ont défendu - la motivation d'une décision en ce sens : c'est la nécessité de pourvoir à l'entretien de l'enfant. Mais il faut aussi mesurer les conséquences générales d'un tel argument. Premier élément à rappeler, c'est que la mère, Mme Perruche, dit qu'elle aurait fait l'interruption de grossesse, mais rien ne démontre de manière absolue qu'elle aurait réalisée. Réfléchissons à ce qui se serait passé si elle ne l'avait pas fait. J'y reviendrai dans un instant. Si l'on reconnaît que l'enfant Perruche, lorsqu'il était un embryon, par suite de son évolution ultérieure, a droit à une indemnité pour avoir vécu, cela veut dire qu'on lui reconnaît la qualité de sujet de droit. Or, nous savons bien que l'embryon et le f_tus ne sont pas des sujets de droit au sens strict et si l'on considère que l'embryon est un sujet de droit, c'est tout l'édifice de l'IVG qui s'effondre. C'est un peu paradoxal, parce que la qualité de sujet de droit est une qualité qui permettrait, dans le cas particulier, une indemnisation mais, par ailleurs, la loi ne reconnaît pas à l'embryon in utero la qualité de sujet de droit, puisqu'elle autorise l'interruption de grossesse. Mme Nicole Catala : Le droit applique la règle Infans conceptus pro nato habetur. Professeur Claude Sureau : La règle Infans conceptus pro nato habetur est une règle qui, sauf erreur de ma part, permet de bénéficier, en particulier, d'un héritage, avec référence à sa conception, une fois l'enfant né, "s'il y a intérêt". En revanche, dans ce cas, cela reviendrait à dire que l'on permet à cet embryon devenu adulte de réclamer la disposition d'une situation législative qui l'aurait conduit à être tué, si on la lui avait appliquée. La situation est pour le moins paradoxale. Mme Nicole Catala : Il existe des circonstances dans lesquelles l'embryon est sujet de droit. Un arrêt récent de la Cour de cassation a été rendu à propos d'un accident d'automobile ayant causé la mort d'un f_tus. La Cour de cassation a considéré que la mort du f_tus était un préjudice, que c'était la mort d'un être humain. Professeur Claude Sureau : Il faut remonter plus loin. Prenons l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon dans l'affaire où il y a eu confusion de noms entre deux patientes, l'une devant avoir la pose d'un stérilet, l'autre une ponction amniotique. Confusion de noms, absence de contrôle par le médecin, pose du stérilet chez la femme enceinte de cinq mois, interruption de grossesse. Le cas a été jugé par la chambre criminelle de la Cour de cassation, parce que la plainte avait été déposée pour homicide. La chambre criminelle a considéré qu'il n'y avait pas d'homicide, que l'interprétation du droit pénal était stricte et qu'en l'occurrence, ce cas n'avait pas été prévu par les textes et qu'il n'y avait pas d'homicide sur un f_tus. Sur ces entrefaites, sont venues en jugement l'affaire de Metz et celle de Reims. Je ne sais pas à laquelle vous faites allusion. L'une des deux a fait, en tout cas, l'objet d'une décision de la Cour d'appel et il n'y a pas eu de pourvoi en cassation. Ce qui est regrettable... Mme Nicole Catala : L'affaire à laquelle je faisais allusion a été jugée par la Cour de cassation, tout récemment. Professeur Claude Sureau : Dans l'affaire de Metz, il s'agissait d'un f_tus de huit mois perdu au cours d'un accident de voiture. C'était fort intéressant parce que l'on se disait que l'enfant, par définition, était viable. Je crois me souvenir qu'il n'y a pas eu de pourvoi en cassation. En revanche, une autre affaire est actuellement en instance de jugement, dans laquelle on attend la décision de la Cour de cassation. Nous sommes tous suspendus à cette décision par laquelle pourrait être reconnue ou non la qualité de personne humaine, sur le plan pénal, au f_tus. Dans l'affaire Perruche, si l'on considère que l'embryon avait droit à la mort du fait de sa malformation, quelle sera la situation d'une femme qui, informée du fait qu'elle attend un enfant malformé, surtout dans le cas d'une malformation sans atteinte de l'intelligence, refuse l'interruption de grossesse, ne serait-ce que pour des raisons religieuses. Si l'arrêt de la Cour de cassation va dans ce sens, qu'est-ce qui empêchera l'enfant devenu adulte ou ses ayants droit de porter plainte contre la mère pour ne pas l'avoir avorté ? A mes yeux, c'est l'élément fondamental. Si la décision se fait dans ce sens, cela ouvre la porte à une extension des plaintes pour vie de la part des enfants. On peut, en plus, imaginer d'autres difficultés si le couple se dissocie. En l'occurrence, le couple Perruche est dissocié, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas de dispute entre eux. On peut aussi tout à fait imaginer que le père pousse l'enfant non avorté à porter plainte contre la mère qui aura refusé l'avortement. Voyez toutes les conséquences. Cela signifiera concrètement que les médecins vont être à l'affût de la moindre malformation, parce que leur responsabilité se trouvera fortement engagée. Ils signaleront le moindre doigt surnuméraire et les mères en viendront à se demander si un jour ou l'autre, leur enfant ne les poursuivra pas. C'est extrêmement complexe. Vous connaissez le système des marqueurs pour dépister le mongolisme. Il y a quelques années, j'ai eu à connaître du cas d'une patiente dont les marqueurs étaient élevés. Nous lui avons fait une amniocentèse qui a révélé que l'enfant n'était pas trisomique. Elle a demandé cependant une interruption de grossesse. Au fond, elle appliquait le principe de précaution. On voit très bien l'application du principe de précaution à la pathologie f_tale. J'ai demandé ce qu'il fallait faire à une personne qui n'est pas suspecte d'être favorable à l'interruption de grossesse, puisqu'il s'agit de Mme Marie-Odile Réthoré, la continuatrice de Jérôme Lejeune. Elle m'a répondu qu'elle ne pouvait pas affirmer que cet enfant, dont l'amniocentèse est normale, mais les marqueurs anormaux, n'est pas exposé à un risque. On m'avait envoyé cette femme en consultation, parce qu'elle demandait une interruption de grossesse. Nous avons été obligés de lui dire que nous pouvions lui garantir que son enfant n'était pas mongolien, mais que nous ne pouvions pas affirmer qu'il ne pouvait y avoir absolument aucun risque. Elle a donc demandé l'interruption de grossesse. Nous étions plusieurs experts dans l'aventure ; nous avons accepté de lui faire son interruption de grossesse. Mme Françoise de Panafieu : Entre dix et douze semaines, vous dites que l'acte est différent, puisque l'on passe d'un acte médical à un acte chirurgical. Professeur Claude Sureau : Ce n'est pas aussi brutal que cela, parce qu'à neuf ou dix semaines, cela peut déjà être un acte chirurgical. Autrement dit, même à neuf semaines, on peut être amené à dilater le col. C'est progressif. Mme Françoise de Panafieu : A douze semaines, cela peut-il rester un acte médical ? Professeur Claude Sureau : Cela se peut, puisque à vingt-quatre ou vingt-six semaines, cela peut être un acte médical. On peut utiliser des drogues pour provoquer des contractions. Mais ce serait le plus mauvais moment pour le faire. D'ailleurs, le rapport de l'ANAES est tout à fait net sur ce point. Imaginez une femme qui vous dit qu'elle ne veut en aucun cas une dilatation du col et qu'elle préfère qu'on lui déclenche une sorte de travail. On pourrait le faire, cela prendrait éventuellement trois jours. Ce n'est probablement pas la situation la plus opportune. Mme Marie-Thérèse Boisseau : A quel âge passe-t-on de l'embryon au f_tus ? Professeur Claude Sureau : Théoriquement, d'après les livres, c'est deux mois, c'est-à-dire grosso modo dix semaines. C'est simplement commode, cela ne correspond pas à une réalité anatomique. Mme Marie-Thérèse Boisseau : Cela correspond à la fin de l'embryogenèse. Professeur Claude Sureau : Oui. Et au début de l'organogenèse, c'est vrai. Mme Marie-Thérèse Boisseau : C'est tout de même une réalité. Professeur Claude Sureau : C'est une réalité qui est moins marquée que l'implantation au septième jour ou que le tube neural au quatorzième. Dans l'évolution des embryons, vous avez des étapes extrêmement précises, mais à cette période cela devient beaucoup plus flou ; c'est fonction de la croissance de chaque embryon, de chaque f_tus. Mme Martine Lignières-Cassou, présidente : Avant de vous recevoir, nous avons reçu une praticienne hollandaise qui nous disait qu'aux Pays-Bas, jusqu'à douze semaines de grossesse, ils pratiquent l'aspiration... M. Patrick Delnatte : Les gynécologues français qui reçoivent, à leur retour, les jeunes femmes qui sont allées aux Pays-Bas sont parfois étonnés de ce qu'ils découvrent. Mme Martine Lignières-Cassou, présidente : Ce ne sont pas les échos que nous en avons eus. Professeur Claude Sureau : Il est vrai qu'ils ont plus d'expérience que nous. Plutôt que l'aspiration d'un f_tus de douze semaines, si j'avais à le faire, je préfèrerais utiliser une pince. Mme Marie-Thérèse Boisseau : Aspiration jusqu'à douze semaines et extraction ensuite ? Professeur Claude Sureau : Je dirai plutôt dilatation du col, mais je n'ai pas une très grosse expérience en la matière. J'ai l'expérience des interruptions de grossesse ou des évacuations utérines précoces. Dix-douze semaines, c'est généralement un moment où les gynécologues ne font rien de particulier. J'ai une très forte expérience de ce qui se passe après, bien entendu, avec le déclenchement du mini-travail. Mais j'ai eu à extraire des f_tus morts à ce terme. En général, je les extrayais avec une pince. Cependant, j'ai arrêté mon activité il y a déjà quelques années ; or, entre-temps, il y a eu des évolutions de la médecine, en particulier des drogues servant à relâcher le col. Je n'en ai pas l'expérience directe. Liste des personnalités entendues dans le cadre des réunions de travail de la Délégation (ces réunions de travail n'ont pas fait l'objet de comptes rendus écrits) Liste des personnalités entendues dans le cadre des réunions de travail de la Délégation au cours de l'année 2000
Les IVG en 1998", Etudes et Résultats, n° 69, juin 2000, Direction de la recherche des études de l'évaluation et des statistiques (DREES) 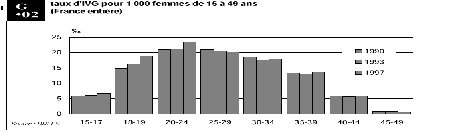 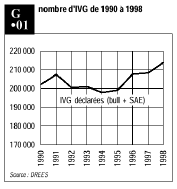 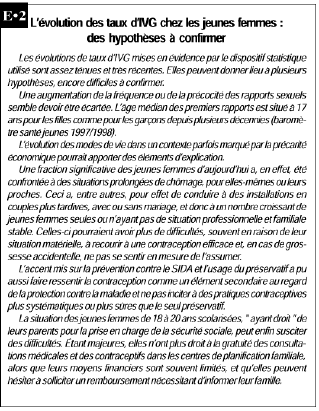 2702- Rapport de Mme Danielle Bousquet au nom de la délégation aux droits des femmes et a l'égalité des chances entre les hommes et les femmes (1) sur le projet de loi (n° 2605) relatif à l'interruption volontaire de grossesse et à la contraception. () Actes du colloque "Contraception, IVG : mieux respecter les droits des femmes", DIAN 45/2000. () Vote du 29 novembre 1974 : 284 voix pour, 189 contre. Vote du 30 novembre 1979 : 271 voix pour, 201 contre. () Les nouvelles générations ont sans doute oublié le calvaire qu'était à l'époque la recherche d'une filière pour l'IVG, décrit par Annie Ernaux, dans son livre, "L'avortement", Gallimard, 2000. () Audition du professeur Jacques Milliez, chef de service de gynécologie-obstétrique de l'hôpital Saint-Antoine à Paris, en annexe 2. () Rapport remis à Mme Martine Aubry, alors ministre de l'emploi et de la solidarité, et à M. Bernard Kouchner, alors secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale, en février 1999. () Voir en annexe 3 : "Interruptions volontaires de grossesse - indicateurs départementaux". () Voir en annexe 3 : Comparaisons européennes. () Actes du colloque "Contraception, IVG : mieux respecter les droits des femmes", DIAN 45/2000. () Audition du professeur Michel Tournaire, chef de service de gynécologie-obstétrique de l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul à Paris, en annexe 2. () Audition du professeur René Frydman, chef de service de gynécologie-obstétrique de l'hôpital Antoine Béclère à Clamart, en annexe 2. () Audition du professeur Jacques Milliez, chef de service de gynécologie-obstétrique de l'hôpital Saint-Antoine à Paris, en annexe 2 () Audition du docteur Bruno Carbonne, gynécologue-obstétricien à l'hôpital Saint-Antoine à Paris, en annexe 2. () B. Lempert. Pour que la loi protège l'intime. In : 12èmes Journées nationales d'études sur l'avortement et la contraception. ANCIC. 1997. () Accès à la contraception et à l'IVG en France - Premiers résultats de l'enquête GINE - 3 octobre 2000 - INSERM. () Audition de Mme Michèle Ferrand, sociologue au C.N.R.S., en annexe 2. () Proposition de loi sur la contraception d'urgence. Assemblée nationale : Proposition de loi n° 2567 de Mme Danielle Bousquet, déposée le 13 septembre 2000 ; Rapport de Mme Hélène Mignon au nom de la commission des affaires culturelles, n° 2588 ; Rapport d'information de Mme Marie-France Clergeau, au nom de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, n° 2593 Discussion et adoption, après déclaration d'urgence, le 5 octobre 2000. Sénat : Proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale, n° 12 (2000-2001) ; Rapport de M. Lucien Neuwirth, au nom de la commission des affaires sociales, n° 49 (2000-2001) ; Rapport d'information de Mme Janine Bardou, au nom de la Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, n° 43 (2000-2001) ; Discussion et adoption le 31 octobre 2000. () Les enjeux de la stérilsiation. A. Giami, H. Leridon. INSERM 2000. () Infans conceptus pro nato habetur quoties de commodo ejus : l'enfant conçu est réputé né chaque fois qu'il y va de son intérêt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

