Document mis en distribution le 16 mars 1999 N° 1468 -- ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 ONZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 11 mars 1999. RAPPORT FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE (1) SUR LE PROJET DE LOI (n° 1079) renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes, PREMIÈRE PARTIE PAR MME CHRISTINE LAZERGES, Députée. -- (1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page. Justice. La commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République est composée de : Mme Catherine Tasca, présidente ; MM. Pierre Albertini, Gérard Gouzes, Mme Christine Lazerges, vice-présidents ; MM. Richard Cazenave, André Gerin, Arnaud Montebourg, secrétaires ; MM. Léo Andy, Léon Bertrand, Emile Blessig, Jean-Louis Borloo, Patrick Braouezec, Mme Frédérique Bredin, MM. Jacques Brunhes, Michel Buillard, Dominique Bussereau, Pierre Cardo, Christophe Caresche, Patrice Carvalho, Mme Nicole Catala, MM. Olivier de Chazeaux, Pascal Clément, Jean Codognès, François Colcombet, Michel Crépeau, François Cuillandre, Henri Cuq, Jacky Darne, Camille Darsières, Bernard Derosier, Franck Dhersin, Marc Dolez, Renaud Donnedieu de Vabres, René Dosière, Julien Dray, Renaud Dutreil, Jean Espilondo, Mme Nicole Feidt, MM. Jacques Floch, Raymond Forni, Pierre Frogier, Claude Goasguen, Louis Guédon, Guy Hascoët, Philippe Houillon, Michel Hunault, Henry Jean-Baptiste, Jérôme Lambert, Mme Claudine Ledoux, MM. Jean-Antoine Léonetti, Bruno Le Roux, Mme Raymonde Le Texier, MM. Jacques Limouzy, Thierry Mariani, Louis Mermaz, Jean-Pierre Michel, Ernest Moutoussamy, Henri Nallet, Mme Véronique Neiertz, MM. Robert Pandraud, Christian Paul, Vincent Peillon, Dominique Perben, Henri Plagnol, Didier Quentin, Bernard Roman, Frantz Taittinger, André Thien Ah Koon, Jean Tiberi, Alain Tourret, André Vallini, Alain Vidalies, Jean-Luc Warsmann. PREMIÈRE PARTIE INTRODUCTION 11 I. - UNE GARDE À VUE MIEUX CONTRÔLÉE 14 1. L'évolution du cadre juridique de la garde à vue 14 a) La garde à vue jusqu'en 1958 14 b) Les réformes de 1993 15 2. Une mesure de police fréquemment utilisée 16 a) Les conditions d'exercice et les droits des personnes placées en garde à vue 16 b) Des statistiques en hausse 18 3. L'intervention de l'avocat dès la première heure de garde à vue 19 a) Les dispositions du projet de loi 19 b) Le financement de cette intervention 19 4. Les principales décisions de la Commission 20 II. - UN STATUT DE TÉMOIN ASSISTÉ CONFORTÉ 21 1. L'origine du statut de témoin assisté 21 2. Le nouveau champ d'application du statut de témoin assisté 23 III. - DES DROITS DES PARTIES RENFORCÉS 24 IV. UNE DÉTENTION PROVISOIRE PLUS EXCEPTIONNELLE DÉCIDÉE PAR UN JUGE EXTÉRIEUR A L'INSTRUCTION 25 1. Un environnement juridique de plus en plus libéral qui a donné lieu à des expérimentations multiples 26 2. Une pratique quotidienne de l'instruction 28 a) Une part continûment importante de la population pénale 28 b) Des durées moyennes de détention élevées 31 c) Qui sont les prévenus ? 32 d) L'issue de la détention provisoire 33 3. Une réforme contrastée de la détention provisoire 35 a) Le c_ur de la réforme : l'institution du juge de la détention provisoire 35 b) Des conditions de fond un peu plus contraignantes 37 c) Un ajustement limité des durées maximales d'incarcération 38 d) Une indemnisation améliorée 40 4. Les autres propositions de la Commission 41 V. - DES DÉLAIS DE PROCÉDURE PLUS RAISONNABLES 41 VI. - UNE LIBERTÉ DE COMMUNICATION PRÉSERVÉE 45 VII. - UNE MEILLEURE PRISE EN COMPTE DES DROITS DES VICTIMES 48 1. Des droits longtemps négligés 49 a) L'indemnisation des victimes 49 b) L'information et le soutien des victimes 52 2. Un renforcement limité des droits des victimes 53 3. Les principales décisions de la Commission 54 AUDITIONS 57 Audition de MM. Thomas Ferenczi, Antoine Garapon, René Rémond, Thierry Renoux et Hervé Temime 57 Audition de M. Noël Copin, Mme Anne d'Hauteville, MM. Jean-Louis Pelletier, Serge Portelli, Mme Sophie Clément-Mazetier et M. Daniel Soulez-Larivière 84 Audition de Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux, ministre de la justice 120 EXAMEN DES ARTICLES 133 Article premier (art. préliminaire du code de procédure pénale) : Principes fondamentaux de la procédure pénale 133 Après l'article premier 136 Article additionnel après l'article premier (art. 81 du code de procédure pénale) : Principe de l'instruction à charge et à décharge 137 TITRE PREMIER - DISPOSITIONS RENFORÇANT LA PROTECTION DE LA PRÉSOMPTION D'INNOCENCE 138 Chapitre premier - Dispositions renforçant les droits de la défense et le respect du principe du contradictoire 138 Section 1 - Dispositions relatives à l'intervention de l'avocat lors de la garde à vue 138 Article additionnel avant l'article 2 (art. 41 du code de procédure pénale) : Visite des locaux de garde à vue par le procureur de la République 138 Avant l'article 2 139 Articles additionnels avant l'article 2 (art. 62, 63, 153 et 154 du code de procédure pénale) : Limitation de la garde à vue aux personnes suspectées 139 Art. 63-1 du code de procédure pénale : Information de la personne placée en garde à vue 140 Art. 63-1 du code de procédure pénale : Droit au silence de la personne placée en garde à vue 141 Art. 63-2 du code de procédure pénale : Information de la famille ou de l'employeur 141 Article 2 (art. 63-4 du code de procédure pénale) : Intervention de l'avocat dès le début de la garde à vue 142 Après l'article 2 150 Article additionnel après l'article 2 (art. 77 du code de procédure pénale) : Information du procureur de la République sur les mesures de garde à vue 152 Après l'article 2 152 Section 2 - Dispositions relatives à la désignation de l'avocat 152 Article 3 (art. 115 et 116 du code de procédure pénale) : Modalités de désignation de l'avocat par une personne détenue ou au cours de la première comparution 153 Article additionnel après l'article 3 (art. 80-1 du code de procédure pénale) : Modalités de mise en examen 155 Section 3 - Dispositions étendant les droits des parties 155 Article 4 (art. 82-1 du code de procédure pénale) : Droit des parties de demander tout acte nécessaire à la manifestation de la vérité 155 Après l'article 4 159 Article 5 (art. 156, 164 et 167 du code de procédure pénale) : Renforcement du caractère contradictoire des expertises pénales 159 Après l'article 5 162 Section 4 - Dispositions relatives au témoin et au témoin assisté 162 Article 6 (art. 101, 109 et 153 du code de procédure pénale) : Dispositions relatives au témoin 162 Articles 7 et 8 (art. 113-1 à 113-8 et 197-1 [nouveaux] du code de procédure pénale) : Dispositions relatives au témoin assisté 164 Après l'article 8 169 Section 5 - Dispositions renforçant les droits des parties au cours de l'audience de jugement 170 Article additionnel avant l'article 9 (art. 312 du code de procédure pénale) : Renforcement du caractère contradictoire de l'audience criminelle 170 Article 9 (art. 442-1 [nouveau], 442 et 454 du code de procédure pénale ) : Renforcement du caractère contradictoire de l'audience correctionnelle 171 Après l'article 9 172 Chapitre II - Dispositions renforçant les garanties judiciaires en matière de détention provisoire 172 Article additionnel avant l'article 10 (art. 137 du code de procédure pénale) : Statut de la personne mise en examen 172 Article additionnel avant l'article 10 (art. L. 611-1 du code de l'organisation judiciaire) : Carte de l'instruction 173 Article additionnel avant l'article 10 : Carte judiciaire 173 Section 1 - Dispositions relatives au juge de la détention provisoire 173 Avant l'article 10 173 Article 10 (art. 137-1 à 137-5 [nouveaux] du code de procédure pénale) : Institution du juge de la détention provisoire - rapports avec le juge d'instruction et le Parquet 174 Article 137-1 (nouveau) du code de procédure pénale : Création du juge de la détention provisoire 175 Article 137-2 (nouveau) du code de procédure pénale : Contrôle judiciaire 179 Article 137-3 (nouveau) du code de procédure pénale : Modalités de certaines décisions du juge de la détention provisoire 181 Article 137-4 (nouveau) du code de procédure pénale : Modalités de certaines décisions du juge d'instruction 182 Article 137-5 (nouveau) du code de procédure pénale : Prérogatives du procureur de la République 183 Après l'article 10 183 Article 11 (art. 145-3 du code de procédure pénale) : Prolongation de la détention provisoire 184 Article 12 (art. 146 du code de procédure pénale) : Prolongation de la détention provisoire en cas de requalification correctionnelle 184 Article 13 (art. 147 du code de procédure pénale) : Mise en liberté du prévenu à l'initiative du procureur 186 Article 14 (art. 148 du code de procédure pénal) : Demande de mise en liberté par le prévenu 187 Section 2 - Dispositions limitant les conditions ou la durée de la détention provisoire 189 Avant l'article 15 189 Article 15 (art. 143-1 [nouveau] et 144 du code de procédure pénale) : Conditions autorisant le placement en détention provisoire 190 Article 143-1 (nouveau) du code de procédure pénale : Quantum de peines 190 Article 144 du code de procédure pénale : Motifs justificatifs 193 Article 16 (art. 145-1 du code de procédure pénale) : Durée de la détention provisoire en matière correctionnelle 195 Article 17 (art. 145-2 du code de procédure pénale) : Durée de la détention provisoire en matière criminelle 199 Après l'article 17 201 Article 18 (art. 141-3 du code de procédure pénale) : Prolongation de la détention provisoire en cas de révocation du contrôle judiciaire 201 Section 3 - Dispositions relatives à l'indemnisation des détentions provisoires 202 Article 19 (art. 149 et 149-2 du code de procédure pénale) : Indemnisation à raison d'une détention provisoire 202 Article 149 du code de procédure pénale : Fait générateur de l'indemnisation 203 Article 149-2 du code de procédure pénale : Procédure 205 Article additionnel après l'article 19 : Enquête sur la situation sociale et matérielle des prévenus incarcérés 205 Article additionnel après l'article 19 : Commission du suivi de la détention provisoire 206 Chapitre III - Dispositions renforçant le droit à être jugé dans un délai raisonnable 206 Article additionnel avant l'article 20 : Délai des enquêtes préliminaires 206 Article 20 (art. 77-2 et 77-3 [nouveaux] du code de procédure pénale) : Délai raisonnable en matière d'enquêtes de police judiciaire 207 Article 77-2 (nouveau) du code de procédure pénale : Durée de l'enquête 208 Article 77-3 (nouveau) du code de procédure pénale : Coordination 211 Article 21 (art. 89-1, 116, 175-1, 186-1, 207 et 207-1 du code de procédure pénale) : Délai raisonnable de l'information 211 Article 89-1 du code de procédure pénale : Information de la partie civile sur la durée de l'information 213 Article 116 du code de procédure pénale : Information de la personne mise en examen sur la durée de l'information 213 Article 175-1 du code de procédure pénale : Demande de clôture de l'information 213 Article 186-1 du code de procédure pénale : Appel des parties 215 Article 207-1 du code de procédure pénale : Contrôle de la durée de l'information par la chambre d'accusation 216 Article additionnel après l'article 21 : Information des parties civiles 218 Article additionnel après l'article 21 : Délai des commissions rogatoires et des expertises 219 Article additionnel après l'article 21 (art. 179 du code de procédure pénale) : Institution de délais d'audiencement correctionnel 219 Article additionnel après l'article 21 (art. L. 215-2 du code de procédure pénale) : Institution de délais d'audiencement criminel 219 Article additionnel après l'article 21 (art. L. 311-15 du code de l'organisation judiciaire) : Commission d'audiencement 219 Après l'article 21 220 Chapitre IV - Dispositions relatives à la communication 221 Article 22 (Art. 226-30-1 [nouveau] du code de procédure pénale) : Interdiction de publier l'image d'une personne portant des menottes ou de réaliser un sondage sur la culpabilité d'une personne mise en cause 221 Article 23 (art. 13 de la loi du 29 juillet 1881 et art. 6 de la loi du 29 juillet 1982) : Droit de réponse exercé par le ministère public 223 Article additionnel après l'article 23 (art. 9-1 du code civil) : Publication d'un communiqué en cas d'atteinte à la présomption d'innocence 225 Article 24 (art. 64 de la loi du 29 juillet 1881) : Arrêt de l'exécution provisoire d'une décision tendant à limiter la diffusion de l'information 225 Avant l'article 25 227 Article 25 (art. 11, 145, 177-1, 199, 199-1, 212-1 et 803 du code de procédure pénale) : « Fenêtres de publicité » dans la procédure pénale 227 TITRE II - DISPOSITIONS RENFORÇANT LES DROITS DES VICTIMES 233 Chapitre premier - Dispositions réprimant l'atteinte à la dignité d'une victime d'une infraction pénale 233 Article 26 (art. 226-30-1 [nouveau] du code pénal) : Atteinte à la dignité de la victime d'un crime ou d'un délit 233 Article 27 (art. 227-24-1 [nouveau] du code pénal) : Interdiction de publier l'identité d'un mineur victime d'une infraction 235 Articles additionnels après l'article 27 237 Article 227-24-2 du code pénal : Interdiction de publier l'identité d'un mineur en cas de fugue ou de suicide 237 Article 81 du code de procédure pénale : Dossier de personnalité de la victime 237 Après l'article 27 237 Chapitre II - Dispositions relatives aux associations d'aide aux victimes et aux constitutions de partie civile 238 Section 1 - Dispositions relatives aux associations d'aide aux victimes 238 Article 28 (art. 41 du code de procédure pénale) : Rôle des associations d'aide aux victimes 238 Articles additionnels après l'article 28 : 239 Conventionnement des associations d'aide aux victimes reconnues d'utilité publique 239 Articles 53-1 et 75 du code de procédure pénale : Information des victimes sur leurs droits dès le début de l'enquête 239 Section 2 - Dispositions relatives aux constitutions de partie civile 240 Article additionnel avant l'article 29 (art. 80-2 du code de procédure pénale) : Information des victimes sur leur droit de se porter partie civile dès le début de l'information 240 Article 29 (art. 420-1 du code de procédure pénale) : Conditions dans lesquelles la victime d'une infraction peut se constituer partie civile 240 Article 30 (art. 464 du code de procédure pénale) : Renvoi de la décision sur l'action civile à une audience ultérieure 242 Article 31 (art. 618-1 [nouveau] du code de procédure pénale) : Remboursement des frais irrépétibles 243 Articles additionnels après l'article 31 244 Articles 375-3 [nouveau] et 464 du code de procédure pénale : Information relative à la saisine de la commission d'indemnisation des victimes d'infraction 244 Articles 721-1 et 729 du code de procédure pénale : Prise en compte de l'effort d'indemnisation des victimes pour l'octroi de réductions de peines supplémentaires ou de libérations conditionnelles 244 Après l'article 31 244 Articles additionnels après l'article 31 244 Article 40 du code de procédure pénale : Motivation et notification par écrit des classements sans suite - Prise en charge par l'Etat des frais irrépétibles en cas de relâche ou d'acquittement 245 Article 583 du code de procédure pénale : Suppression de l'obligation de se mettre en état avant un pourvoi en cassation 245 Après l'article 31 245 TITRE III - DISPOSITIONS DE COORDINATION 245 Article 32 (art. 104, 105, 152 et 183 du code de procédure pénale) : Coordinations liées à la réforme du statut de témoin assisté 246 Article 33 (art. 83, 116, 122, 135, 136, 137, 138, 141-2, 144-1, 145, 145-1, 145-2, 185, 187-1 et 207 du code de procédure pénale) : Coordinations liées à la création d'un juge de la détention provisoire 247 Article 34 (art. 145 du code de procédure pénale) : Coordination liée aux conditions de mise en détention provisoire 250 Article 35 (art. 420-2 et 460-1 du code de procédure pénale) : Coordinations liées à la simplification des modalités de constitution de partie civile 251 Article 36 (art. 154 du code de procédure pénale) : Coordination des modalités de gardes à vue dans le cadre de commissions rogatoires 251 Article 37 (art. 82 du code de procédure pénale) : Coordination relative aux droits du procureur de la République en cas de demandes d'actes 251 Article 38 (art. 4 et 11 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945) : Coordination avec le droit applicable aux mineurs délinquants 252 Article 39 : Délai d'application des dispositions relatives à la détention provisoire 252 Article 40 : Application dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte 253 Titre 254
DEUXIÈME PARTIE TABLEAU COMPARATIF AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION ANNEXE 1 : Articles du code de procédure pénale cités en référence dans le projet de loi ANNEXE 2 : La garde à vue dans les principaux pays de l'Union européenne ANNEXE 3 : La détention provisoire dans les principaux pays de l'Union européenne ANNEXE 4 : L'activité des juges d'instruction LISTE DES PERSONNES ET DES ORGANISATIONS REPRÉSENTATIVES ENTENDUES PAR LE RAPPORTEUR MESDAMES, MESSIEURS, Dans sa déclaration de politique générale du 17 juin 1997, le Premier ministre annonçait une réforme d'ampleur de la justice : rendre celle-ci plus proche des citoyens, plus respectueuse des libertés et plus indépendante, c'est-à-dire renforcer l'Etat de droit. Renforcer l'Etat de droit, c'est en particulier renforcer la présomption d'innocence, même si l'article 9 de la déclaration des droits de l'homme et des citoyens dispose déjà, depuis le 26 août 1789, que : « Tout homme est présumé innocent, jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ». Renforcer l'Etat de droit, c'est aussi renforcer les droits des victimes, des droits dont il est indispensable qu'elles soient informées et auxquels elles doivent avoir accès. L'écoute, l'information, la réparation des victimes doivent donc être améliorées. La France est une démocratie, elle doit bénéficier d'un Etat de droit exemplaire. Le code pénal et le code de procédure pénale doivent donc satisfaire aux règles fondamentales qui garantissent les droits et libertés des citoyens et notamment aux principes inscrits dans la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et dans la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Le Conseil constitutionnel rappelle régulièrement que la prévention des atteintes à l'ordre public, notamment de celles à la sécurité des personnes et des biens, et la recherche des auteurs de l'infraction sont nécessaires à la sauvegarde des principes et droits à valeur constitutionnelle, mais qu'il appartient au législateur d'assurer la conciliation entre ces objectifs de valeur constitutionnelle et l'exercice des libertés qui sont également garanties par la Constitution, au nombre desquelles figure, au premier chef, la liberté individuelle. Ce projet de loi est précisément en lui-même un exercice de conciliation et d'équilibre entre des impératifs apparemment contraires. De la présomption d'innocence inscrite actuellement, non pas dans le code de procédure pénale mais dans le code civil à l'article 9-1, on voudrait faire un droit fondamental effectif et non pas une pétition de principe. Des droits accordés aux victimes, on voudrait qu'ils manifestent le respect essentiel dû à la victime, permettant de lutter contre le sentiment d'insécurité. La présomption d'innocence, a-t-on dit, désigne l'état à la fois provisoire et ambigu de celui, qu'on le veuille ou non, qui n'est plus tout à fait un innocent mais qui n'est pas encore un coupable. En deçà, il y a l'innocence et au-delà à nouveau l'innocence ou la culpabilité. Par conséquent, la fragilité de l'état de présumé innocent impose un encadrement juridique et en particulier : · une garde à vue mieux contrôlée ; · un statut du témoin assisté conforté ; · des droits des parties renforcées ; · une détention provisoire moins fréquente décidée par un juge extérieur à l'instruction ; · des délais de procédure aussi bien que de détention provisoire plus raisonnables. Dans une procédure qui n'est plus strictement inquisitoire, donc qui n'est plus rigoureusement secrète, la transparence nécessaire implique une liberté de communication préservée par des fenêtres de publicité. Nul n'ignore combien est difficile la garantie de la présomption d'innocence, droit fondamental. Bien que la présomption d'innocence gouverne le droit de la preuve, il existe encore des exemples de présomption de culpabilité. Et que penser de la mise en examen ou plus encore de la détention provisoire qui, par ses conséquences pratiques et psychologiques, est perçue comme un pré-jugement, comme une pré-punition, comme un à valoir sur la peine ? Aussi, faut-il une loi nouvelle audacieuse marquant de réelles avancées sans sacrifier aux nécessités de la poursuite et à la sauvegarde du droit à la sécurité. Nous voulons démontrer par ce texte, que la présomption d'innocence, que le procès pénal fait naître, sera demain moins blessée par ce même procès pénal qu'elle ne l'est aujourd'hui. Il en est de même pour les droits des victimes, dont nous désirons qu'ils soient mieux protégés demain qu'aujourd'hui. Depuis la fin des années 1970, une véritable politique d'aide aux victimes s'est peu à peu construite. Les grandes étapes en ont été la loi du 8 juillet 1983 marquant un nouveau stade dans la protection des victimes d'infractions pénales et la loi du 6 juillet 1990 qui a reconnu aux victimes de la délinquance ayant subi des atteintes graves dans leurs personnes, le droit d'obtenir la réparation intégrale de leur préjudice. Le message politique du projet de loi renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes est clair et s'inscrit dans une réforme globale de la justice. Sans chercher à réformer définitivement, il s'agit cependant de réformer suffisamment dans une perpétuelle quête d'équilibre. Une meilleure garantie des droits de la personne poursuivie doit aller de pair avec une meilleure garantie des droits des victimes et être conjuguée avec une meilleure garantie de la transparence des procédures, de l'égalité des armes, de la liberté de la presse dans le respect du secret de l'instruction, tel qu'il est défini par l'article 11 du code de procédure pénale. Le futur article préliminaire du code de procédure pénale, qui poursuit des fins pédagogiques, est porteur de l'ensemble des principes directeurs de la procédure pénale au c_ur desquels sont situées l'affirmation et la protection de la présomption d'innocence, l'affirmation et la protection des droits des victimes. * * * I. - UNE GARDE À VUE MIEUX CONTRÔLÉE Le projet de loi propose que la personne placée en garde à vue puisse bénéficier de l'assistance d'un avocat dès le début de cette mesure, et non plus après la vingtième heure. Cette disposition est le fruit d'une longue évolution au cours de laquelle les droits de la personne gardée à vue ont progressivement été étendus. Même placée sous le contrôle de l'autorité judiciaire, la garde à vue n'en demeure pas moins une mesure de police que le Gouvernement n'envisage de modifier qu'à la marge, sans changer véritablement sa nature comme le proposait en 1991 la commission Justice pénale et droits de l'homme, qui voulait en faire une mesure judiciaire. 1. L'évolution du cadre juridique de la garde à vue La garde à vue, telle qu'on la connaît, aujourd'hui est une mesure relativement récente, puisqu'elle n'est apparue officiellement qu'en 1958 avec l'adoption du code de procédure pénale. a) La garde à vue jusqu'en 1958 Historiquement, les actes de recherche ressortissaient à la compétence des magistrats qui devaient statuer rapidement sur l'éventualité d'une mesure c_rcitive prolongée. Ainsi, le code d'instruction criminelle ne prévoyait pas de dispositions générales sur l'arrestation par la police judiciaire et attribuait aux magistrats la conduite des enquêtes. La loi du 8 décembre 1897, en autorisant l'avocat à assister son client pendant les interrogatoires, a de manière indirecte favorisé le développement des mesures de garde à vue : afin d'éviter la présence de l'avocat, le parquet et la police mirent en place des enquêtes officieuses, qui se traduisirent par des rétentions arbitraires. Bien que précisée par une circulaire du ministère de l'intérieur de 1943, cette pratique restait illégale. En 1958, le législateur décida de légaliser la garde à vue en l'inscrivant dans le code de procédure pénale, tout en l'entourant d'un minimum de garanties. Le dispositif initial a subi de nombreuses modifications, tendant notamment à allonger le délai de garde à vue pour les infractions les plus graves. Les dernières réformes adoptées ont été en revanche inspirées par le souci de mieux protéger la personne placée en garde à vue, conformément à la Convention européenne des droits de l'homme. La condamnation de la France par la Cour de Strasbourg dans une affaire de garde à vue (arrêt Tomasi 27 août 1992) et les propositions de la commission Justice pénale et Droits de l'homme ont conduit à l'adoption des lois du 4 janvier et du 24 août 1993, qui procèdent à des aménagements substantiels du régime de la garde à vue. La loi du 4 janvier 1993 avait ainsi prévu l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue, dès sa première heure, sauf en cas de trafic de stupéfiants et de terrorisme, infractions pour lesquelles cette intervention était reportée après la quarante-huitième heure ; cette disposition devait entrer en vigueur le 1er janvier 1994, l'avocat intervenant après la vingtième heure pendant la période transitoire qui débutait le 1er mars 1993. La nouvelle majorité issue des élections revint sur ce dispositif, avant même son application, par la loi du 24 août 1993. Cette loi maintînt simplement l'intervention de l'avocat après la vingtième heure, reporta l'intervention de l'avocat après la trente-sixième heure pour certains faits de criminalité ou de délinquance organisées et la supprima en cas de trafic de stupéfiants ou de terrorisme. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 93-326 DC du 11 août 1993, a annulé cette dernière disposition : il a en effet considéré que le droit à s'entretenir avec un avocat au cours de la garde à vue constituait un droit de la défense, dont les modalités d'exercice pouvaient être différentes en fonction des infractions considérées, mais qui ne pouvait être totalement supprimé. Cette annulation a entraîné l'application du régime de droit commun en cas de terrorisme ou de trafic de stupéfiants, c'est-à-dire l'intervention de l'avocat après la vingtième heure, avant que la loi du 1er février 1994 ne retarde cette intervention après la soixante-douzième heure de garde à vue. 2. Une mesure de police fréquemment utilisée a) Les conditions d'exercice et les droits des personnes placées en garde à vue - Les conditions d'exercice de la garde à vue La garde à vue est une mesure qui peut être ordonnée par un officier de police judiciaire dans trois cas précis. En cas de crime ou de délit flagrants puni d'une peine d'emprisonnement, les personnes présentes sur le lieu de l'infraction, les personnes susceptibles de fournir des renseignements ainsi que les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices faisant présumer qu'elles ont commis ou tenté de commettre l'infraction peuvent, pour les nécessités de l'enquête, être gardées à vue pendant vingt-quatre heures, durée qui peut être prolongée de vingt-quatre heures, pour cette dernière catégorie de personnes, sur autorisation écrite du procureur de la République ; celui-ci peut exiger la présentation préalable de la personne gardée à vue ; il doit par ailleurs être averti « dans les meilleurs délais » de l'existence de la mesure initiale (articles 61, 62 et 63 du code de procédure pénale). En application de l'article 77 du code de procédure pénale, l'officier de police judiciaire peut, dans le cadre d'une enquête préliminaire et pour les nécessités de l'enquête, placer en garde à vue une personne à l'encontre de laquelle il existe des indices faisant présumer qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ; le procureur de la République doit être informé dans les meilleurs délais de cette mesure, qui est limitée à vingt-quatre heures, sauf prolongation pour une nouvelle durée de vingt-quatre heures sur décision du procureur de la République, après présentation de la personne à ce magistrat ou, exceptionnellement, après décision écrite et motivée sans présentation préalable. Enfin, l'officier de police judiciaire peut placer une personne en garde à vue pour les nécessités de l'exécution d'une commission rogatoire du juge d'instruction (article 154 du code de procédure pénale) ; il en informe dans les meilleurs délais le juge d'instruction, qui contrôle l'exécution de cette mesure ; la garde à vue ne peut excéder vingt-quatre heures, sauf autorisation écrite du juge d'instruction après présentation de la personne ; la prolongation est, dans ce cas aussi, limitée à vingt-quatre heures. Rappelons que la garde à vue en matière de terrorisme ou de trafic de stupéfiants est soumise à des règles particulières de prolongation et que la garde à vue des mineurs de treize ans est, sauf exceptions, interdite. L'article 124 du décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie précise le point de départ du délai de garde à vue. En cas de crime ou de délit flagrants, la garde à vue de l'auteur de l'infraction débute au moment où il est appréhendé ; pour les personnes auxquelles l'officier de police judiciaire interdit de s'éloigner du lieu de l'infraction, le délai de garde à vue court à compter du moment où la décision est notifiée aux intéressés. Lorsqu'un témoin a été contraint de comparaître, la garde à vue débute au moment où il est présenté à l'officier de police judiciaire. Le point de départ d'une garde à vue décidée immédiatement après l'audition d'un témoin qui a comparu librement doit être fixée de manière rétroactive au début de cette audition. Cette question du point de départ de la garde à vue, qui a donné lieu à une jurisprudence complexe de la Cour de cassation, risque de se poser avec une particulière acuité avec la réforme proposée, puisqu'elle conditionnera le moment de l'intervention de l'avocat. - Les droits des personnes placées en garde à vue Quel que soit le cadre dans lequel elle a été placée en garde à vue, la personne soumise à cette mesure bénéficie d'un certain nombre de droits définis aux articles 63-2, 63-3 et 63-4 du code de procédure pénale ; dès le début de la garde à vue, elle est immédiatement informée de ces droits. Elle peut ainsi faire prévenir par téléphone une personne avec qui elle vit, l'un de ses parents ou son employeur de la mesure dont elle fait l'objet ; toutefois, pour les nécessités de l'enquête (dépérissement des preuves par exemple), le procureur de la République, saisi par l'officier de police judiciaire, peut refuser de faire droit à cette demande (article 63-2). La personne gardée à vue ou, si celle-ci ne le demande pas, un membre de sa famille, peut obtenir la visite d'un médecin désigné par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire ; en cas de prolongation de la garde à vue, elle peut renouveler sa demande. Par ailleurs, le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire peut à tout moment faire examiner la personne gardée à vue par un médecin (article 63-3). Enfin, à l'issue de la vingtième heure, la personne placée en garde à vue peut demander à s'entretenir avec un avocat (article 63-4) ; si elle n'est pas en mesure d'en désigner un ou si l'avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander un avocat commis d'office ; à l'issue de l'entretien, qui ne peut excéder trente minutes, l'avocat, qui aura auparavant été informé par l'officier de police judiciaire de la nature de l'infraction recherchée, peut rédiger des observations écrites qui seront jointes à la procédure ; l'avocat ne doit pas faire état du contenu de l'entretien, ni même de son existence. En cas de délinquance ou de criminalité organisées, l'entretien ne peut intervenir qu'après la trente-sixième heures ; il est reporté après la soixante-douzième heure pour le terrorisme et le trafic de stupéfiants. Rappelons enfin que, dès le début de la garde à vue, les mineurs de seize ans doivent être examinés par un médecin et peuvent demander à s'entretenir avec un avocat. En 1997, 382 228 mesures de garde à vue ont été prises, soit une augmentation de 10,28 % par rapport à 1996 ; 15,48 % d'entre elles, soit 59 169, ont une durée supérieure à vingt-quatre heures. Il n'existe malheureusement pas de statistiques sur les gardes à vue de plus de vingt heures, mais il semble que leur nombre ait diminué de manière significative après la réforme de 1993. 39,44 % des gardes à vue sont décidées pour des vols, 37,23 % pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, des délits à la police des étrangers et des destructions ou dégradations, 15,54 % pour des crimes et des délits contre des personnes et 7,79 % pour des infractions économiques et financières. Rapportée au nombre d'infractions commises dans la catégorie considérée, on constate que la proportion de garde à vue est plus importante pour les crimes et délits contre les personnes et pour les infractions à la législation sur les stupéfiants ; ainsi les vols, qui représentent 64,24 % des infractions constatées au plan national, ne donnent lieu qu'à 39,44 % des gardes à vue. Les gardes à vue de moins de vingt-quatre heures sont essentiellement décidées pour des vols (85,58 %), celles de plus de vingt-quatre heures concernant des infractions plus graves (vols à main armée, homicides, viols et trafics de stupéfiants). De manière plus générale, sur 100 personnes mises en cause, on estime que 48 d'entre elles font l'objet d'une mesure de garde à vue. 3. L'intervention de l'avocat dès la première heure de garde à vue a) Les dispositions du projet de loi Reprenant la réforme proposée initialement par la loi du 4 janvier 1993 et alignant ainsi notre législation sur celle de la plupart des pays européens (voir annexe), l'article 2 du projet de loi prévoit l'intervention de l'avocat dès la première heure de garde à vue, avec une seconde visite après la vingt-quatrième heure en cas de prolongation. Cette modification ne concerne que le régime de droit commun, l'intervention de l'avocat étant maintenue après la trente-sixième heure en cas de délinquance ou de criminalité organisées et après la soixante-douzième heure en cas de terrorisme ou de trafic de stupéfiants. Outre l'information concernant la nature de l'infraction, l'avocat sera désormais informé des raisons juridiques de la garde à vue : en effet, lors d'une garde à vue décidée dans le cadre d'une enquête de flagrance, l'avocat ne s'entretiendra plus uniquement avec des personnes à l'encontre desquelles il existe des indices de culpabilité, comme c'est le cas actuellement où il n'intervient qu'après la vingtième heure, mais également avec des personnes présentes sur les lieux de l'infraction ou susceptibles de fournir des renseignements (articles 61 et 62 du code de procédure pénale). b) Le financement de cette intervention Partant du nombre de personnes gardées à vue plus de vingt-quatre heures, puisqu'il n'existe pas de statistiques concernant les gardes à vue de plus de vingt heures et de moins de vingt-quatre heures, l'étude d'impact a chiffré le coût de cette nouvelle disposition pour l'aide juridique. Appliquant le pourcentage de 40,6 %, qui est celui des personnes gardées à vue plus de vingt-quatre heures ayant sollicité la présence d'un avocat, au nombre actuel de gardes à vue, le Gouvernement estime à 140 732 le nombre de personnes susceptibles de demander l'assistance d'un avocat. A partir des tarifs actuels (300 F pour une garde à vue simple, 500 F pour une garde à vue avec majoration de nuit, 400 F pour une garde à vue avec déplacement et 600 F pour une garde à vue de nuit avec déplacement) et des catégories d'interventions constatées, l'étude d'impact propose un premier chiffre de 54,5 millions de francs. Reconnaissant implicitement que les contraintes supplémentaires d'organisation et de permanence générées par la réforme justifient une augmentation tarifaire, évaluée à 20 %, elle arrive à un chiffre final de 65,5 millions de francs. Sauf si l'intervention de l'avocat dès la première heure entraîne, comme en 1993, une diminution sensible du nombre de gardes à vue, cette estimation risque d'être sous-évaluée puisqu'elle est établie à partir des statistiques de 1996, bien inférieures, on l'a vu, à celles de 1997. Elle est aussi paradoxalement relativement optimiste, puisqu'elle suppose que les avocats qui acceptent actuellement de se déplacer après la vingtième heure le feront également dès la première heure. Or ces interventions seront plus nombreuses (140 700 contre 24 824 en 1996) et impliquent donc une réorganisation complète des barreaux, avec un système de permanence qui sera sans doute long à mettre en place. Cette collaboration des avocats est un élément clé du succès de la réforme. Il ne faudrait pas, en effet, que seuls les criminels organisés bénéficient dès la première heure de la présence d'un avocat, choisis par eux, tandis que les petits délinquants attendraient vainement un avocat commis d'office. Rappelons qu'actuellement seules 60 % des demandes d'avocat sont effectivement satisfaites et que les avocats sont principalement choisis par la personne gardée à vue, l'intervention d'un avocat commis d'office étant beaucoup moins fréquente. 4. Les principales décisions de la Commission Outre le problème de l'intervention effective de l'avocat évoqué ci-dessus, le rapporteur s'est inquiétée de la durée moyenne des gardes à vue. Ayant notamment la préoccupation d'éviter que l'intervention de l'avocat dès la première heure ne prolonge la durée des gardes à vues, au moins jusqu'à la vingt-quatrième heure, moment où l'avocat peut intervenir une deuxième fois. C'est pourquoi elle a proposé à la Commission, qui les a acceptés, deux amendements prévoyant la possibilité pour la personne gardée à vue de demander également l'intervention d'un avocat à l'issue de la vingtième heure et au milieu de la période de renouvellement de la garde à vue, à partir de la trente-sixième heure. Par ailleurs, elle a regretté que le contrôle du procureur de la République, pourtant explicitement prévu par la loi du 4 janvier 1993, demeure largement théorique, alors même que la garde à vue constitue une mesure grave, qui porte atteinte à la liberté individuelle. La Commission a donc adopté, sur sa proposition, un amendement qui complète les dispositions de l'article 41 relatives aux contrôles du procureur de la République sur les mesures de garde à vue par une phrase indiquant que chaque fois qu'il l'estime nécessaire, et au moins une fois par trimestre, ce magistrat visite les locaux de garde à vue. Dans le même esprit, elle a prévu que le procureur devrait être averti de la garde à vue dès le début de la mesure, et non pas « dans les meilleurs délais ». La Commission a également souhaité renforcer l'information des personnes gardées à vue, leur permettant de connaître la nature de l'infraction sur laquelle porte l'enquête, sans attendre l'éventuelle intervention de l'avocat qui, aux termes de l'article 63-4, a également accès à cette information. La personne gardée à vue sera par ailleurs informée de son droit de garder le silence. Enfin, la Commission a décidé de limiter la garde à vue dans le cadre d'une enquête de flagrance ou d'une commission rogatoire aux seules personnes à l'encontre desquelles il existe des indices faisant présumer qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction, comme c'est déjà le cas dans le cadre d'une enquête préliminaire. Cette modification permettra à la France de se mettre en conformité avec l'article 5 de la convention européenne des droits de l'homme. II. - UN STATUT DE TÉMOIN ASSISTÉ CONFORTÉ Le projet de loi étend le statut de témoin assisté, qui ne peut actuellement concerner que les personnes faisant l'objet d'une plainte avec constitution de partie civile ou d'un réquisitoire du procureur de la République, à toutes les personnes nommément visées par une accusation de la part d'un tiers (partie civile ou ministère public). Il renforce par ailleurs les droits attachés à ce statut en les alignant sur ceux des personnes mises en examen. 1. L'origine du statut de témoin assisté Ce statut est né de la nécessité de donner des garanties particulières aux personnes nommément visées par une plainte avec constitution de partie civile. Issu de l'ordonnance du 4 juin 1960, l'article 104 du code de procédure pénale permettait à ces personnes de refuser d'être entendues comme témoin ; le juge d'instruction devait alors les entendre comme inculpées, ce qui leur permettait de bénéficier de l'assistance d'un avocat ayant accès au dossier. Devant les inconvénients, notamment en terme d'images, du statut d'inculpé, une commission animée par le professeur Soyer proposa, en 1978, de créer une nouvelle catégorie juridique, celle du témoin assisté, permettant aux personnes mises en cause par une plainte avec constitution de partie civile d'être entendues comme témoins, mais avec l'assistance d'un avocat. La loi du 30 décembre 1987 modifia donc l'article 104 afin de prévoir qu'une personne nommément visée par une plainte avec constitution de partie civile avait le droit, sur sa demande, lorsqu'elle était entendue comme témoin, à être assistée par un avocat convoqué avant chaque audition et ayant accès au dossier. La loi du 4 janvier 1993 est allée plus loin en donnant à ces personnes le droit de demander le bénéfice de l'ensemble des dispositions applicables aux personnes mises en examen. Ce dispositif, entré en vigueur le 1er mars 1993, a été supprimé par la loi du 24 août de la même année qui a rétabli l'article 104 dans sa rédaction de 1987, moyennant quelques aménagements. Cette même loi du 24 août 1993 a créé une nouvelle catégorie de témoin assisté prévue au troisième alinéa de l'article 105 : les personnes nommément visées par un réquisitoire du procureur de la République et qui ne sont pas mises en examen doivent être entendues comme témoin assisté ; elles bénéficient alors de tous les droits des personnes mises en examen (droit de demander des actes et de déposer des requêtes en nullité, par exemple). Les juges d'instruction n'ont malheureusement que très rarement recours au statut de témoin assisté prévu par les articles 104 et 105. D'après les études conduites par les magistrats de la Commission de réflexion sur la justice présidée par le Président Pierre Truche, les rares cas recensés concernent uniquement des personnes visées par une plainte avec constitution de partie civile. Cette situation provient à la fois d'une méconnaissance de l'existence des dispositions des articles 104 et 105 et de la crainte qu'ont les juges de voir leur procédure annulée pour mise en examen tardive. Le premier alinéa de l'article 105 dispose en effet que les personnes « à l'encontre desquelles il existe des indices graves et concordants d'avoir participé aux faits » ne peuvent être entendues comme témoins, même assistés, et doivent donc être mises en examen. 2. Le nouveau champ d'application du statut de témoin assisté Afin, dans toute la mesure du possible, d'éviter les mises en examen, qui sont trop souvent perçues dans l'opinion publique comme une preuve de culpabilité, le Gouvernement a souhaité donner un nouvel élan au statut de témoin assisté. Il a écarté une modification de l'article 105 sur les mises en examen tardives, qui aurait permis au juge d'instruction, même en cas « d'indices graves et concordants », d'entendre comme témoin assisté une personne qu'il estimait inutile de mettre en examen. Cette solution avait notamment été envisagée par le rapport « Justice et transparence » rédigé en 1995 par la commission des Lois du Sénat. Comme le relève l'étude d'impact, une telle modification soulèverait en effet un certain nombre des difficultés. Elle conduirait notamment à rompre le principe d'égalité en donnant au juge d'instruction le pouvoir de choisir, de manière totalement discrétionnaire, entre la mise en examen et le statut de témoin assisté. Elle risquerait de provoquer une confusion dans les médias entre ces deux notions, aboutissant ainsi à une situation inverse de celle recherchée, l'opinion publique considérant le statut de témoin assisté comme la mise en examen des « notables » que les juges d'instruction n'auraient pas osé formellement mettre en cause. Ces considérations ont conduit le Gouvernement à conserver des critères précis permettant le recours au statut de témoin assisté. Une personne ne pourra bénéficier de ce statut que si elle fait l'objet d'une accusation de la part d'un tiers, accusation que le juge d'instruction considère comme insuffisamment fondée pour procéder à une mise en examen. L'article 7 du projet de loi propose donc d'assimiler l'hypothèse d'une plainte avec constitution de partie civile nominative à celle d'une plainte simple ou d'une dénonciation nominative suivie d'une ouverture d'une information contre X par le parquet : dans tous ces cas, la personne visée pourra bénéficier du statut de témoin assisté ; ce bénéfice lui sera obligatoirement accordé en cas de réquisitoire nominatif du procureur de la République ou de plainte avec constitution de partie civile, à condition toutefois, dans ce dernier cas, qu'elle en fasse la demande ; en cas de plainte ou de dénonciation, il ne s'agira que d'une simple faculté pour le juge d'instruction. Afin de simplifier le dispositif actuel, et par là même de favoriser le recours à cette procédure, le projet de loi unifie le statut de témoin assisté en alignant les droits qui y sont attachés sur ceux prévus par l'article 105 : le témoin assisté bénéficiera dans tous les cas des droits des personnes mises en examen. Par ailleurs, il est précisé que le témoin assisté ne prêtera pas serment, pour éviter d'éventuelles poursuites pour faux témoignage. Enfin, afin de prévenir d'éventuelles annulations de procédure, le projet de loi prend soin d'indiquer que les dispositions du premier alinéa de l'article 105 sur les mises en examen tardives ne sont pas applicables aux témoins assistés. III. - DES DROITS DES PARTIES RENFORCÉS Longtemps marginaux dans une procédure à dominante inquisitoire, les droits des parties au cours de l'instruction ont progressivement été renforcés, notamment avec la loi du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale. Poursuivant cette évolution, le projet de loi élargit les droits des parties, non seulement lors de l'instruction préparatoire, mais également au cours de l'audience de jugement. Il permet à la France de se rapprocher du principe de « l'égalité des armes » défini par la Convention européenne des droits de l'homme, conformément aux recommandations du rapport de la commission Justice pénale et droits de l'homme. - Les droits des parties au cours de l'instruction Les parties pourront désormais demander au juge d'instruction de procéder à tout acte jugé nécessaire pour la manifestation de la vérité (article 41) ; par ailleurs, elles auront également la possibilité de demander à ce que certains actes qu'elles ont sollicités (transport sur les lieux, audition d'un témoin ou d'une partie civile, interrogatoire de la personne mise en examen) soient effectués en présence de leur avocat, ce qui leur permettra d'avoir les mêmes droits que ceux du procureur de la République. Notons que, comme aujourd'hui, le juge d'instruction pourra toujours refuser ces demandes par une ordonnance motivée susceptible d'appel. L'article 5 renforce le caractère contradictoire des expertises pénales et prévoit qu'une copie de l'intégralité du rapport d'expertise, et non pas seulement de ses conclusions, pourra être communiquée, à leur demande, aux avocats des parties. On observera enfin, bien qu'il ne s'agisse pas exactement d'un renforcement des droits des parties, que le projet de loi assouplit les conditions de désignation d'un avocat par une personne détenue ou au cours de l'interrogatoire de première comparution (article 3). - Les droits des parties au cours de l'audience de jugement Consacrant une pratique judiciaire largement répandue, l'article 9 autorise les avocats des parties à poser directement leurs questions aux témoins, sans passer par l'intermédiaire du président du tribunal. Sur proposition du rapporteur, la Commission a étendu ce principe en matière criminelle. IV. - UNE DÉTENTION PROVISOIRE PLUS EXCEPTIONNELLE DÉCIDÉE PAR UN JUGE EXTÉRIEUR A L'INSTRUCTION « Ainsi, dans la réalité, le jugement rendu à l'audience par les magistrats du siège est précédé d'un véritable « préjugement » rendu au cours de l'information par le juge d'instruction, le plus souvent en accord avec le parquet. Dès le début de l'instruction, juge d'instruction et parquet apprécient souverainement d'une part, la gravité des faits et, d'autre part, l'importance des charges ou plutôt les probabilités d'une condamnation de l'inculpé à une peine d'emprisonnement ferme. C'est en fonction de cette appréciation de l'issue finale du procès, beaucoup plus que des craintes de voir l'inculpé se soustraire à la justice ou en contrarier le cours, qu'il est décidé de la mise en détention préventive de l'inculpé. » Cités par M. de Grailly, rapporteur de la loi du 17 juillet 1970 (1), ces propos tenus par M. Robert Badinter dans les colonnes du Monde des 12 et 13 avril 1970 conservent une singulière pertinence : si l'on substitue « mis en examen » à « inculpé » et « détention provisoire » à « détention préventive », le constat reste, hélas, d'actualité, en dépit de la dizaine de réformes dont la détention provisoire a fait l'objet depuis lors. Sans refaire ici le procès de la détention provisoire, on rappellera que, quoi qu'en disent parfois les magistrats, cette procédure constitue encore trop souvent un moyen de pression, dans un pays qui privilégie fortement l'aveu, et qu'elle n'est pas sans conséquences sur la nature même de la peine définitivement prononcée. Par ailleurs, trop de personnes sont placées en détention provisoire pour être finalement relaxées ou bénéficier d'un non-lieu, alors que l'incarcération est toujours une épreuve psychologique et matérielle épouvantable. Rappelons, en outre, que notre procédure est souvent mise à l'index par la Cour européenne des droits de l'homme, notamment en raison de la durée des détentions provisoires. De fait, on ne peut qu'être surpris par le décalage existant entre le foisonnement législatif auquel a déjà donné lieu le régime de la détention provisoire et la permanence des critiques qui lui sont adressées. Quelles que soient les tentatives pour tenter d'encadrer ce qui est intuitivement perçu par beaucoup comme un mal nécessaire, la pratique fait preuve d'une insolente inertie, la bonne volonté du législateur se heurtant non seulement à des contraintes matérielles, qui pourraient être surmontées, mais, aussi, à une logique autonome sur laquelle elle semble n'avoir que peu de prises. Dès à présent, il faut insister sur le fait que ces observations, et les développements qui vont suivre, ne concernent que la détention provisoire prononcée dans le cadre de l'instruction. Rappelons que la détention provisoire peut aussi intervenir à la suite d'une ordonnance de renvoi, en attente de comparution immédiate, ou bien en appel ou en pourvoi, ces trois dernières catégories représentant près de la moitié des flux annuels de placements en détention provisoire. Bien entendu, ces cas d'incarcérations procèdent d'une autre logique pénale, mais le rappel de leur importance numérique illustre, une fois de plus, la dualité de notre procédure pénale caractérisée par une montée en puissance des procédures rapides, qui constituent désormais le mode d'action publique de droit commun et la réponse pénale ordinaire à la petite et moyenne délinquance. Cette tendance lourde doit être prise en compte par le Parlement lorsque le gouvernement l'invite à légiférer sur des procédures qui, pour être essentielles, ne concernent cependant que 7 % des affaires présentées aux tribunaux correctionnels. 1. Un environnement juridique de plus en plus libéral qui a donné lieu à des expérimentations multiples A l'examen, peu d'institutions de procédure pénale auront autant mobilisé l'attention et le temps du législateur depuis près de trente ans, manifestation tangible de son désarroi face aux difficultés rencontrées pour assurer un équilibre entre les nécessités de l'information et la présomption d'innocence, consacrée par l'article 9 de la déclaration des droits de l'homme. Dans ce but, il aura cherché à rendre plus contraignant le recours à la détention provisoire par le juge d'instruction, mais aussi tenté des expériences innovantes qui cependant ont été peu mises en pratique. Si l'on remonte au code d'instruction criminelle de 1810, la procédure pénale admettait la détention préventive illimitée en matière criminelle jusqu'à la fin du procès. Postérieurement, la loi du 14 juillet 1865 a élargi le champ de la liberté provisoire, ce régime restant à peu près inchangé jusqu'à la réforme du 17 juillet 1970. L'inculpé pouvait demander à tout moment sa mise en liberté que le juge lui accordait - sous ou sans caution - ou lui refusait par une ordonnance susceptible de recours, qui, depuis la loi du 19 décembre 1952, devait intervenir dans les cinq jours. Les inculpés qui encouraient une peine correctionnelle inférieure à deux ans d'emprisonnement et avaient un domicile certain ou n'avaient pas déjà été condamnés pour crime ou délit à une peine supérieure à un an d'emprisonnement bénéficiaient d'une mise en liberté de droit cinq jours après le premier interrogatoire. Le nouveau code de procédure pénale, entré en application en 1959, a apporté des ajustements à ce dispositif mais n'en a pas modifié l'économie. La grande réforme intervient avec la loi du 17 juillet 1970, qui a transformé la détention préventive en « détention provisoire », laquelle ne peut être ordonnée qu'à raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté. Elle a surtout restreint les cas où la détention est possible, obligé le juge d'instruction à motiver précisément ses décisions en matière correctionnelle et, enfin, mis en place un régime d'indemnisation en cas de détention injustifiée. Parallèlement, elle a institué le contrôle judiciaire, mesure conçue, à l'origine, comme une alternative à l'incarcération mais qui, en pratique, est devenue peu à peu une alternative à la liberté. Bien que le recours à la détention provisoire ait été de nouveau encadré plus strictement par la loi du 6 août 1975, l'augmentation croissante des placements a incité le législateur, à partir de 1983, à multiplier les tentatives de réformes et ce dans deux directions. D'une part, plusieurs textes ont modifié les règles sur des points limités : la loi du 10 juillet 1983 a rétabli la condition de seuil de deux ans en matière correctionnelle, abolie par la loi « sécurité et liberté » ; celle du 9 septembre 1986 a de nouveau distingué selon qu'il s'agit d'un délit flagrant ou non ; quant à la loi du 30 décembre 1996, elle a précisé le critère de l'ordre public. D'autre part, le législateur a cherché une solution afin de ne plus laisser le juge d'instruction prendre seul une décision aussi grave, en écho aux nombreuses critiques stigmatisant la confusion des pouvoirs d'enquête et de jugement. La loi du 10 décembre 1985 a ainsi institué des « chambres d'instruction », composées de trois magistrats, dont au moins deux juges d'instruction, chargées notamment de se prononcer « sur les mesures privatives de liberté ». Cette loi fut abrogée avant même d'entrer en vigueur par celle du 30 décembre 1987, qui mettait en place des « chambres des demandes de mise en détention provisoire », au sein desquelles ni le juge d'instruction ni aucun magistrat ayant connu l'affaire en qualité de juge d'instruction ne devaient siéger. Ce texte connut le même sort que le précédent et fut abrogé, à son tour, par la loi du 6 juillet 1989, qui redonna au juge d'instruction la plénitude de ses prérogatives. Pourtant, le législateur confirma son intérêt pour la collégialité par la loi du 4 janvier 1993, qui créait des « chambres d'examen des mises en détention provisoire », comprenant le président du tribunal de grande instance et deux assesseurs non professionnels ; 1er janvier 1994, la détention était ordonnée par le président du tribunal ou un juge délégué. Ce régime transitoire n'a survécu que six mois, la loi du 24 août 1993 restituant, une fois encore, ses compétences au juge d'instruction. En définitive, à défaut d'une réforme en profondeur, le régime actuel de la détention provisoire, pour la description duquel on se reportera aux commentaires des articles du projet de loi, résulte donc d'une stratification d'aménagements ponctuels, dont on trouve la trace dans la rédaction parfois laborieuse du code de procédure pénale en la matière. Le dernier texte en date, la loi du 30 décembre 1996, n'a pas dérogé à la règle : bien qu'elle ait apporté des modifications intéressantes sur les conditions de fond du placement, sur la procédure et la durée de la détention provisoire, elle n'a pas toutefois imprimé un nouvel état d'état d'esprit de nature à infléchir significativement la pratique. Il est évident que ces tâtonnements législatifs s'expliquent par des raisons de fond - l'attachement viscéral de l'institution judiciaire au juge d'instruction, perçu comme la clef de voûte de la procédure pénale française - mais surtout matérielles, les effectifs des tribunaux n'étant pas suffisants pour assurer le fonctionnement d'instances collégiales. 2. Une pratique quotidienne de l'instruction En dépit de toutes les précautions textuelles prises pour cantonner la détention provisoire à une situation exceptionnelle, la pratique pénale en fait une institution courante - banale pourrait-on dire - de l'instruction. De fait, l'analyse statistique montre que cette forme d'incarcération concerne un très grand nombre de personnes pour des durées, en moyenne, élevées. a) Une part continûment importante de la population pénale En 1997, plus de 56 000 personnes ont été placées en détention provisoire, à quelque titre que ce soit, contre plus de 60 000 en 1996. De prime abord, ce résultat est plutôt satisfaisant, si l'on rappelle que le flux annuel atteignait près de 66 000 de placements en 1994 et près de 70 000 en 1992. Approchée en stock, la population carcérale comptait, au 1er janvier 1998, 50 774, détenus dont 20 301 prévenus. Globalement, après une nette décrue entre 1986 et 1988, période pendant laquelle la part des prévenus a été ramenée de 50 à 41 %, les résultats apparaissent finalement assez stables depuis une dizaine d'exercices, le taux de prévenus oscillant entre 43 % et 40 %, obtenus l'année dernière. En réalité, ce chiffre, qui reste impressionnant, agrège des situations hétérogènes, puisque tout détenu dont la condamnation n'est pas définitive - en appel ou en attente de jugement - est considéré comme un prévenu. Si l'on s'intéresse maintenant aux seuls prévenus dont l'affaire est en cours d'instruction, soumis au régime des articles 144 et suivants du code de procédure pénale, l'effectif placé en détention provisoire atteignait, à la même date, 14 452 personnes. En fait, pour nuancer quelque peu le constat d'ensemble dressé plus haut, force est de noter que la part des prévenus en cours d'instruction dans le total des prévenus tend à s'accroître régulièrement, passant de 68 % en 1986 à 71,2 % en 1998, comme le montre le tableau ci après.
L'analyse des flux annuels de placements en détention provisoire, rapportés aux mises en examen, permet également d'affiner le constat en demi-teinte formulé plus haut. En effet, on observe que le pourcentage des prévenus dans le total des personnes mises en examen est relativement stable, le « creux » constaté entre 1992 et 1994 ne se confirmant pas depuis lors.
En définitive, le rapprochement des données disponibles traduit une grande inertie dans le recours à la détention provisoire, laquelle constitue bel et bien un mode de « gestion » courant de l'information par les magistrats instructeurs. Quelles qu'en soient les justifications, ces chiffres sont difficilement acceptables pour un pays qui fait de la présomption d'innocence un grand principe de la République. Ce mauvais point est d'autant plus préoccupant que, sur ce point, notre pays occupe une place spécifique par rapport à ses voisins . En limitant la comparaison aux pays ayant des systèmes pénaux à peu près comparables - pour simplifier les pays de l'Europe continentale - on observe que le taux de prévenus avant jugement est sensiblement plus élevé en France : en 1996, il y atteignait 36,2 %, contre 22,8 % en Belgique, 25,2 % en Italie, 29,4 % en Allemagne, et 34,3 % aux Pays-Bas. Si l'on raisonne en taux de détention provisoire avant jugement (nombre de prévenus pour 100.000 habitants) afin de neutraliser l'impact des politiques pénitentiaires et des mesures de grâce collective, l'écart reste patent : 32,8 en France, 17,2 en Belgique, 21,5 en Italie, 24,3 en Allemagne, et 25,8 aux Pays-Bas. b) Des durées moyennes de détention élevées Au problème du nombre de personnes placées en détention provisoire s'ajoute celui de sa durée. En matière criminelle, la durée de détention provisoire a régulièrement augmenté depuis le début des années quatre-vingt-dix pour se stabiliser, à la fin de cette décennie, à près de vingt-trois mois, renouant ainsi avec les niveaux enregistrés à la fin de la décennie précédente. En matière correctionnelle, on perçoit également une tendance régulière à la hausse, la durée moyenne de détention passant de 3,4 mois en 1990 à quatre mois en 1997. Notons que ce chiffre peut apparaître, de prime abord, peu élevé mais en fait, il prend en compte les placements en détention provisoire prononcés dans le cas de la procédure de comparution immédiate - qui représente près de la moitié des flux annuels de placements - pour laquelle l'incarcération est limitée à deux mois en application de l'article 397-3 du code de procédure pénale.
Dans ce contexte, il est évident que la procédure du référé-liberté, dans laquelle le législateur avait placé de grands espoirs, n'est pas à la hauteur du problème : en 1997, sur 26.435 personnes mises en examen puis placées en détention provisoire, 428 avaient usé du référé liberté, soit 1,6 % du total, chiffre, à peine supérieur à celui enregistré en 1994, première année pleine pendant laquelle la procédure a été appliquée. Reconnaissons toutefois qu'il est encore trop tôt pour tirer un bilan de l'amélioration de la procédure apportée par la loi du 30 décembre 1996 précitée. (cf. supra). Quoi qu'il en soit, ces chiffres qui ne fournissent pas le nombre de remises en liberté prononcées à ce titre - données a priori indisponibles - sont évidemment dérisoires. La majorité des prévenus - 62 % - est représentée par des majeurs de plus de 25 ans. Les moins de 25 ans ne représentent donc que 38 % du total, dont 5,5 % au titre des moins de 18 ans, étant rappelé que les mineurs de moins de seize ans ne peuvent être placés en détention provisoire en matière correctionnelle. Sur moyenne période, ces proportions sont stables, puisqu'en 1993 les pourcentages étaient de respectivement 61 et 39 %. On notera toutefois une augmentation de la part des mineurs qui ne représentaient alors que 3,2 % du total des prévenus. En 1997, 65 % des prévenus encouraient des peines délictuelles supérieures à trois ans d'emprisonnement, ce pourcentage étant à peu près identique selon que la détention provisoire était prononcée au titre d'une infraction unique ou au titre d'infractions multiples. 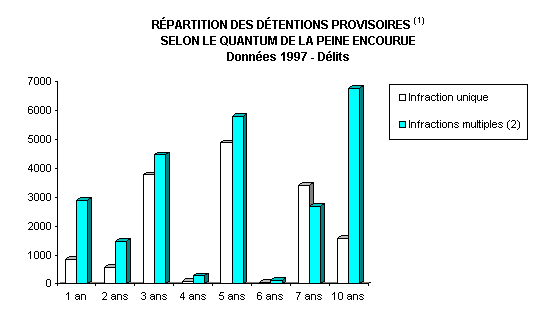 immédiate. (2) Il s'agit de condamnations comportant plusieurs infractions, dont l'infraction principale - la première enregistrée - est théoriquement la plus grave. Source : casier judiciaire. Ces statistiques sont particulièrement éclairantes dans le cadre d'une réflexion sur la modification des quantums de peines autorisant le placement en détention provisoire. d) L'issue de la détention provisoire Même si la très grande majorité des prévenus font l'objet d'un renvoi, puis d'une condamnation définitive, à l'issue de leur jugement, un nombre non négligeable d'entre eux bénéficient d'un non-lieu, d'une relaxe ou d'un acquittement, comme le montre le tableau ci-après.
Ce tableau serait incomplet si l'on omettait de retracer les activités de la commission nationale d'indemnisation, censée réparer les préjudices subis par les personnes mises en examen et détenues à tort. En 1997, la commission a été saisie de 383 requêtes, dont 188 au titre de l'année et 195 non jugées au titre des années précédentes. 131 décisions ont été rendues dont 65 ont accordé une indemnité pour un montant moyen par dossier de 63 000 F.
Sans être spectaculaire, l'évolution favorable constatée entre 1996 et 1997 s'explique par la modification de l'article 149 du code de procédure pénale, opérée par la loi du 30 décembre 1996 précitée. A cette occasion, l'exigence d'un préjudice manifestement anormal et d'une particulière gravité a été en effet supprimée, l'indemnisation devenant possible même en l'absence de dysfonctionnement du service public de la justice. 3. Une réforme contrastée de la détention provisoire Comme son nom l'indique, le chapitre II du présent projet de loi ne propose pas une réforme d'ensemble de la détention provisoire, mais vise au renforcement des garanties judiciaires entourant cette procédure. Il s'agit néanmoins d'une modification en profondeur, qui concerne à la fois la détermination de l'autorité compétente pour la prononcer, les conditions de fond du placement, la durée de la détention ou les procédures d'indemnisation. Pour autant, cette réforme est contrastée : si elle apparaît ambitieuse s'agissant de l'autorité compétente pour décider de la plus contraignante des mesures c_rcitives dont peut faire l'objet une personne mise en examen, elle semble plus timorée s'agissant des autres aspects, qu'il s'agisse des conditions de fond du placement ou de la durée de la détention, qui ne subissent que des ajustements limités, en retrait par rapport au texte de la proposition de loi de notre collègue M. Alain Tourret, adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture. a) Le c_ur de la réforme : l'institution du juge de la détention provisoire Après trois tentatives avortées, le présent projet de loi tente donc de répondre, à son tour, aux critiques récurrentes formulées contre la procédure pénale en vigueur, qui confie au juge chargé de l'instruction le pouvoir de placer la personne mise en examen en détention provisoire. Cette situation, qui prend une acuité particulière du fait de la place qu'occupe la détention provisoire dans la procédure pénale, est très souvent mise à l'index, ses détracteurs soulignant, à juste titre, que la confusion des rôles au profit du juge d'instruction affecte l'impartialité objective de la procédure pénale, que requiert l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. En outre, cette confusion est largement en porte-à-faux par rapport au principe de la séparation des fonctions d'investigations et de jugement, rappelé notamment dans la décision rendue par le Conseil constitutionnel n° 96-377 DC du 16 juillet 1996. Pour pallier ces inconvénients, le projet de loi propose dans son article 10 la création d'un « juge de la détention provisoire ». Désigné par le président du tribunal de grande instance, celui-ci aura rang de président, de premier vice-président ou de vice-président. Au-delà de la dissociation des fonctions, l'exigence de confier un contentieux difficile à un magistrat d'expérience se trouve ainsi satisfaite. Pour renforcer l'impartialité de ce magistrat, celui-ci ne pourra participer aux formations de jugement des affaires dont il aura eu à connaître en tant que juge de la détention provisoire. Saisi par une ordonnance motivée du juge d'instruction, le juge de la détention provisoire se substitue à ce dernier pour toutes les décisions de placement ou de prolongation de la détention provisoire, le déroulement des procédures étant inchangé. Notons, toutefois, qu'en application de l'article 25 du projet de loi, les débats contradictoires préalables au placement initial et à certaines prolongations peuvent être publics à la demande de la personne concernée. En revanche, le juge d'instruction garde la faculté de prononcer une mesure de contrôle judiciaire ; il conserve la prérogative de remettre en liberté le prévenu à tout moment et c'est à lui que sont adressées les demandes de remises en liberté, le juge de la détention provisoire ne devenant compétent que lorsque le magistrat instructeur refuse d'y faire droit. En définitive, le principe est que si deux avis concordants sont nécessaires pour placer une personne en détention provisoire, un seul suffit pour la remettre en liberté. Comme votre rapporteur a pu le constater au cours des auditions réalisées pour la préparation de ce rapport, beaucoup regrettent l'abandon de la collégialité au profit d'une procédure à juge unique. Nul doute que la formation collégiale peut apparaître intellectuellement plus satisfaisante, mais on sait que la mise en place d'une telle réforme impliquerait des moyens considérables, qui ne peuvent être mobilisés. Il convient de souligner que l'institution du juge de la détention provisoire nécessite, en l'état, selon l'étude d'impact du projet de loi, la création d'environ 170 postes de magistrats, dont 114 au titre des charges nouvelles et 56 pour permettre d'assurer le fonctionnement des formations de jugement du fait des incompatibilités pesant sur le juge de la détention provisoire. La proposition du gouvernement a donc l'avantage de permettre un progrès réaliste vers une plus nette séparation des fonctions d'instruction et de jugement ; on observera, cependant, qu'au cours des auditions, qui ont été faites par la Commission ou par le rapporteur, de nombreux intervenants ont exprimé le regret que ne soit pas institué un véritable « juge des libertés », compétent pour décider de toutes les mesures c_rcitives pouvant se révéler nécessaires dans le cadre de l'instruction. Séduisante en théorie, cette orientation aurait conduit à un bouleversement de la procédure pénale, véritable saut dans l'inconnu qui est loin, d'ailleurs, de faire l'unanimité parmi les différents acteurs du procès pénal, qu'ils soient avocats ou magistrats. Même si l'on peut s'interroger sur le caractère réduit, univoque et, somme toute, assez peu gratifiant, des fonctions confiées au juge de la détention provisoire, l'option retenue par le gouvernement a le mérite de concilier l'équilibre de la procédure pénale et le renforcement des garanties judiciaires en matière de détention provisoire. Telle est la raison pour laquelle, la commission n'a apporté que des ajustements techniques aux dispositions mettant en place cette nouvelle fonction juridictionnelle. b) Des conditions de fond un peu plus contraignantes Indépendamment de la révision des modalités selon lesquelles est prise la décision de placer une personne en détention provisoire, un meilleur encadrement de cette procédure doit être recherché par le réexamen des conditions de fond qui en autorisent le prononcé. L'objectif n'est évidemment pas de réduire le nombre des placements dans une perspective uniquement quantitative, mais de rechercher une meilleure proportionnalité entre l'infraction reprochée à l'intéressé et l'intensité de l'atteinte portée à sa présomption d'innocence. Le législateur a toujours considéré que la détention provisoire ne pouvait s'appliquer quelle que soit la peine encourue. Depuis 1983, elle peut être prononcée lorsque la personne mise en examen encourt une peine criminelle ou une peine correctionnelle égale ou supérieure à deux ans d'emprisonnement. Toutefois, en cas de flagrance, ce seuil a été ramené à un an par la loi de 1986. L'article 15 du projet de loi propose de fixer, en cas de délit, de nouveaux quantums de peine en distinguant deux situations : - le régime général, dans lequel la personne doit encourir une peine au moins égale à trois ans d'emprisonnement ; - le cas de délits contre les personnes, contre l'Etat, la Nation ou la paix publique et, quel que soit la nature du délit, le cas de condamnation antérieure à une peine d'emprisonnement, hypothèses pour lesquelles le seuil reste fixé à deux ans. Sans être symboliques, ces ajustements peuvent sembler modestes, surtout si on les compare au texte de la proposition de loi de M. Alain Tourret adoptée par l'Assemblée nationale qui, rappelons-le, retenait un seuil de trois ans pour les délits contre les personnes et l'Etat mais de cinq ans en cas de délits contre les biens. Votre rapporteur concède qu'à l'examen ces modifications peuvent conduire, dans certains cas, à des situations discutables, mais, à titre personnel, considère que les propositions de gouvernement pourraient être améliorées. En ce qui concerne les conditions de fond du placement en détention provisoire, le projet de loi n'apporte pas de modification spectaculaire puisqu'il se contente de limiter le champ d'application du critère tiré de la préservation de l'ordre public. En droit positif, la préservation de l'ordre public constitue un motif de placement et de prolongation de la détention provisoire. Ce critère, redéfini restrictivement par la loi du 30 décembre 1996, fait l'objet de vives critiques et son application a été invalidée par la Cour européenne des droits de l'homme dans son arrêt « Letellier » du 26 juin 1991, aux termes duquel les juges de Strasbourg ont refusé le recours à ce motif aux fins de prolongation d'une mesure de détention provisoire. L'article 15 du projet de loi propose de faire un pas dans cette direction de bon sens, en précisant que le motif d'ordre public ne peut justifier la prolongation de la détention provisoire, lorsque la peine encourue est inférieure à cinq ans d'emprisonnement. Votre commission propose, quant à elle, de tirer toutes les conséquences de la jurisprudence de la cour européenne en estimant que le motif d'ordre public ne peut justifier une prolongation de l'incarcération en matière correctionnelle, quelle que soit la peine encourue. c) Un ajustement limité des durées maximales d'incarcération L'essentiel des condamnations de la France par la Cour européenne des droits de l'homme au titre de la détention provisoire sont fondées sur le non-respect de l'article 5-3 de la convention de sauvegarde, selon lequel toute personne placée en détention provisoire doit être jugée dans un délai raisonnable. On citera notamment les arrêts I.A c/ France (23/09/1998), Muller c/France (17/03/1997), Tomasi c/France (27/08/1992) ou encore Kemmache c/ France (27/11/1991). Cette abondante jurisprudence met clairement en lumière le raisonnement tenu par la cour qui estime, d'une manière générale, que les différents motifs justifiant un maintien en détention provisoire tendent à s'épuiser avec le temps et, en conséquence, qu'à un certain moment, la durée de la détention a dépassé la « limite du raisonnable » (2). Depuis la loi du 30 décembre 1996, des progrès ont été accomplis, puisque le code de procédure pénale comporte désormais certaines dates butoirs. En matière correctionnelle, la détention est ainsi limitée à six mois lorsque la peine est inférieure ou égale à cinq ans (un an en cas de récidive), à deux ans lorsqu'elle est inférieure à dix ans et illimitée lorsqu'elle est égale à dix ans. Toutefois, l'ensemble de ces délais sont en théorie soumis à l'exigence de durée raisonnable, désormais expressément mentionnée à l'article 144-1 du code de procédure pénale. L'article 16 du projet de loi ne bouleverse pas cette architecture : la détention serait ainsi limitée à deux ans lorsque la peine encourue est égale à dix ans, sauf en cas de trafic de stupéfiants, de terrorisme, de proxénétisme, d'association de malfaiteurs et de délits commis en bande organisée, proposition qui devrait être de peu de portée pratique. Telle est la raison pour laquelle, sur proposition de votre rapporteur, la commission a décidé d'aller plus loin en fixant des durées maximales de détention. Concrètement, la détention provisoire en matière délictuelle serait limitée à quatre mois, lorsque la personne encourt une peine inférieure ou égale à cinq ans et n'est pas récidiviste, à douze mois dans les autres cas, mais à vingt-quatre mois dans le cas des infractions les plus graves pour lesquelles les investigations peuvent être les plus complexes. Toutefois, afin de tenir compte des contraintes pratiques évidentes, ces mêmes délais seraient portés à deux ou trois ans, en cas de commission rogatoire internationale. En matière criminelle, les progrès sont en revanche plus substantiels. Actuellement, une personne ne peut être incarcérée plus d'un an, cette période étant reconductible sans limites, sous réserve de la durée raisonnable déjà mentionnée. Ainsi, l'article 16 du projet limite la détention à deux ans lorsque la peine est comprise entre dix et quinze ans de réclusion, à trois ans lorsqu'elle est supérieure à quinze ans, mais inférieure à vingt ans de réclusion. Au-delà, la détention provisoire reste illimitée, de même que dans le cas où le prévenu se voit reprocher plusieurs crimes. Ici encore, sur proposition du rapporteur, la commission a souhaité amplifier la portée de ces mesures : en application de l'amendement qu'elle a adopté, la détention provisoire serait limitée à deux ans si la peine est inférieure à vingt ans de réclusion et à trois ans dans les autres cas. Cependant, comme en matière délictuelle, ces délais seraient majorés d'un an pour tenir compte d'une éventuelle commission rogatoire internationale d) Une indemnisation améliorée Comme on l'a vu précédemment, le régime d'indemnisation mis en place par la loi de 1970, bien qu'amélioré à plusieurs reprises, demeure encore très insatisfaisant. S'inspirant des mesures contenues dans la proposition de loi de M. Alain Tourret, l'article 19 apporte quatre aménagements intéressants, qui pallient la plupart des critiques adressées à la procédure actuelle : - Bien qu'il ne soit plus qualifié, la nature du préjudice subi par le demandeur est imprécise. En particulier, même si la rédaction ne l'exclut pas formellement, la prise en compte du préjudice moral est incertaine ; il est donc proposé de mentionner expressément la réparation du préjudice matériel ou moral. - Il a été beaucoup reproché à cette procédure d'être mal connue, aucune information spécifique n'étant organisée au profit de la personne faisant l'objet d'un non-lieu ou d'un acquittement ; fort opportunément, la notification d'une telle décision donnera lieu à information concomitante du droit à réparation. - La procédure devant la commission d'indemnisation avait un caractère juridictionnel imparfait, en raison en particulier de l'absence de motivation de ses décisions ; on ne peut que se satisfaire de l'article 19 qui revient, enfin, sur cette situation peu justifiable. Une telle option réduit les risques d'arbitraire et permet le développement d'une véritable jurisprudence. - Peu contradictoire, la procédure devant la commission donne lieu à des débats en chambre du conseil ; le projet de loi pose le principe inverse de la publicité des débats, sauf opposition du requérant. Ainsi remodelée, la commission d'indemnisation devrait avoir une activité plus soutenue, même si le gouvernement n'a pas osé franchir le pas de l'indemnisation automatique, solution qui peut, d'emblée, apparaître cohérente, dès lors qu'une détention justifiée cause toujours un préjudice à la personne qui en est la victime. Si l'on peut concevoir que, dans certaines situations particulières, l'invocation d'un préjudice soit plus contestable, il est souhaitable, hormis ces cas d'espèces, de tendre, autant que faire se peut, vers une indemnisation liée à toute privation de liberté injustifiée, le préjudice étant présumé. La rédaction retenue par la Commission va dans ce sens. Cette dernière a également souhaité, dans un but pédagogique et de responsabilisation, que les décisions concluant à l'indemnisation soient transmises aux magistrats qui ont concouru au placement en détention provisoire injustifié. Elle a également entendu améliorer la connaissance de la pratique de la détention provisoire, en créant une commission de la détention provisoire auprès du ministre de la justice. 4. Les autres propositions de la Commission A côté des aménagements décrits précédemment, la commission a complété le projet de loi sur plusieurs points. Tout d'abord, sur proposition du rapporteur, elle a estimé que la présente réforme devait être accompagnée d'une révision de la carte de l'instruction, dans l'esprit des réflexions menées par la Chancellerie, dont a fait part la garde des sceaux lors de son audition. Pour ce faire, elle propose de supprimer les dispositions du code de l'organisation judiciaire qui prévoient qu'il y a au moins un juge d'instruction par tribunal de grande instance. Ensuite, à l'initiative de M. Alain Tourret, elle suggère, plus largement, une révision de la carte judiciaire dans les deux ans de l'entrée en vigueur de la loi. Enfin, la commission, sur proposition du rapporteur, a posé le principe d'une enquête sociale systématique pour toutes les personnes placées en détention provisoire dans le cadre d'une information. V. - DES DÉLAIS DE PROCÉDURE PLUS RAISONNABLES Si elle est une condition évidente de bonne administration de la justice, la durée des procédures pénales est aussi, et surtout, une donnée essentielle du respect de la présomption d'innocence : comment celle-ci peut-elle être en effet garantie si, à des enquêtes policières illimitées dans le temps, succèdent des informations s'étalant sur plusieurs années conduisant à des renvois audiencés tardivement ? Pourtant, le code de procédure pénale ne contient aucune disposition d'ordre général tendant à limiter la durée excessive des procédures tant à l'égard des enquêtes que des informations. La question n'est abordée que de manière ponctuelle par certains articles relatifs aux délais des opérations réalisées dans le cadre des commissions rogatoires (art. 151) ou aux délais des expertises (art. 161). L'article 175-1, issu de la loi du 4 janvier 1993, apporte toutefois un embryon de réponse en prévoyant que les parties peuvent demander la clôture de l'instruction un an après leur mise en examen ou leur constitution de partie civile, sans que cette procédure donne lieu à une sanction particulière. On évoquera aussi les pouvoirs propres du président de la chambre d'accusation et ceux accordés aux parties lorsqu'aucun acte d'instruction n'a été accompli pendant quatre mois, en application des articles 221-1 et 221-2, qui constituent cependant des mesures essentiellement incitatives. Dans ces conditions, compte tenu de la tradition juridique française, il n'est pas surprenant que la jurisprudence montre une relative mansuétude vis-à-vis des procédures manifestement excessives, la plupart des décisions validant les durées de procédures compte tenu des actes nécessaires à l'information (Cass. crim, 6 février 1996) ou imputant les délais au demandeur (CA Pau, 13 mai 1992), même si l'on dénombre quelques jugements en sens contraire. Cette réserve des juridictions internes contraste vivement avec ce que l'on peut observer au niveau européen, l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme, directement applicable en France, consacrant le principe selon lequel toute personne impliquée dans une affaire pénale a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial dans un délai raisonnable. S'appuyant sur ces dispositions, la Cour de Strasbourg n'hésite pas à condamner régulièrement la France, comme par exemple, dans l'affaire Tomasi c/ France du 27 août 1992 dans laquelle la Cour, rappelant sa jurisprudence constante, considère que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause, la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes. Soulignons que le maniement de ce faisceau d'indices peut la conduire, en revanche, à valider une durée de procédure a priori excessive, comme dans l'affaire IA c/ France du 23 septembre 1998. Qu'en est-il de la réalité statistique ? Pour s'en tenir aux seules instructions, on observe que la durée moyenne des affaires terminées est de 16,2 mois en matière délictuelle et de 16,9 mois en matière criminelle, de très fortes disparités s'observant entre les juridictions, certaines d'entre elles enregistrant des durées moyennes dépassant nettement vingt-quatre mois en matière délictuelle, voire même frôlant les trente mois, comme le montre le tableau reproduit en annexe. Bien qu'elles soient à manier avec précaution, ces quelques données laissent transparaître l'existence de situations manifestement anormales. Pour corriger ces dysfonctionnements et traduire dans notre droit une garantie essentielle des justiciables, le projet de loi propose une panoplie de mesures, déclinées en trois axes. Tout d'abord, innovation essentielle dans notre droit pénal, le principe du délai raisonnable est enfin consacré en tant que tel par le nouvel article préliminaire, créé par l'article premier du présent projet. Ensuite, ce principe trouve une traduction pratique au niveau de l'enquête de police : le nouvel article 77-2 du code de procédure pénale permet à une personne placée en garde à vue et n'ayant fait l'objet d'aucune mesure dans un délai de huit mois de demander au procureur de la République de prendre une décision à son égard. Si celui-ci entend poursuivre l'enquête, il devra le demander au président du T.G.I. Notons que cette mesure doit se lire à la lumière d'autres dispositions figurant dans les autres projets de loi participant de la réforme de la justice. Ainsi, l'article 6 du projet relatif aux alternatives aux poursuites limite à huit jours la durée des enquêtes de flagrance, alors que l'article 8 du projet relatif au rôle du parquet et à l'action publique renforce le suivi des enquêtes préliminaires par le procureur de la République. A cet égard, la Commission a estimé opportun de reprendre ces dernières dispositions dans le présent projet de loi, tout en les rendant un peu plus contraignantes. Enfin, le principe du délai raisonnable est mis en pratique au niveau de l'instruction, selon des modalités qui ont pour objectif d'améliorer le dispositif de l'article 175-1 précité. Dans un premier temps, le juge d'instruction est ainsi invité à indiquer, en début de procédure, à la partie mise en examen ou partie civile, la durée probable de l'instruction s'il pense pouvoir l'achever en moins d'un an. A l'issue de ce délai, ou, à défaut, au bout d'un an, ces parties pourront demander au juge d'instruction de clôturer l'information. Il en est de même si aucun acte de procédure n'a été accompli en quatre mois. Si ce dernier refuse de faire droit à cette demande ou s'il ne s'est pas prononcé dans un délai d'un mois, les parties pourront saisir le président de la chambre d'accusation. Celui-ci a alors le choix : - il peut saisir la chambre d'accusation qui peut clôturer l'information, renvoyer l'affaire au juge d'instruction, en désigner un autre ou évoquer l'affaire elle-même ; - il peut ne pas la saisir et ordonner que le dossier soit renvoyé au juge d'instruction aux fins de poursuite de l'information. Comme on le constate, ce dispositif, qui permet, en théorie, un suivi plus méticuleux des dossiers d'instruction par la chambre d'accusation, est assez complexe et reste, en définitive, très largement incitatif, puisqu'aucun délai butoir ne vient sanctionner une procédure anormalement longue. C'est pourquoi, suivant le rapporteur, la Commission a préféré un dispositif alternatif selon lequel, à l'issue d'un délai de douze mois en cas de délit ou de dix-huit mois en cas de crime, les parties - témoin assisté, mis en examen ou partie civile - pourront demander la clôture de l'information. Le juge d'instruction devra alors transmettre le dossier au président de la chambre d'accusation, qui pourra, soit accorder un délai supplémentaire de six mois, soit saisir la chambre d'accusation, laquelle pourra, à son tour, clôturer l'affaire ou accorder un nouveau délai d'un an en matière délictuelle ou dix-huit mois en matière criminelle. A l'issue de ce délai supplémentaire, la chambre d'accusation pourra, le cas échéant, proposer un nouveau délai. Sans fixer systématiquement des délais butoirs d'instruction, qui pourraient conduire à des situations inopportunes, cette proposition confère un rôle plus directif à la chambre d'accusation et lui permet d'assurer, le cas échéant, un suivi plus rigoureux des instructions anormalement longues. A coté de cette mesure générale, la commission a tenu à améliorer le déroulement temporel des instructions, en organisant une information plus rigoureuse des parties civiles sur l'état d'avancement de l'instruction et en organisant une responsabilisation accrue des officiers de police judiciaire et des experts pour la gestion des délais qui leur sont impartis par le juge d'instruction. La maîtrise des délais d'instruction et des durées de détention provisoire est un objectif primordial, mais celui-ci risque d'être contrarié si, alors que l'instruction est close dans des délais raisonnables, le prévenu, le plus souvent incarcéré, doit attendre encore pendant une période de temps indéterminée que son affaire soit examinée au fond par un tribunal. C'est pourquoi, sur proposition de votre rapporteur, la commission a décidé de mettre en place des délais d'audiencement. Ainsi, en matière correctionnelle, il est proposé que le jugement au fond intervienne dans les deux mois, faute de quoi le prévenu est remis en liberté. Toutefois, pour tenir compte des contraintes pratiques, le tribunal pourrait prolonger cette mesure à deux reprises. Par ailleurs, s'inspirant d'une des dispositions figurant dans la proposition de loi de M. Alain Tourret adoptée par l'Assemblée nationale, la commission suggère de limiter à huit mois, prolongeable sous certaines conditions à vingt-quatre mois, la durée pendant laquelle un accusé, pour lequel l'ordonnance de prise de corps est devenue définitive, peut être incarcéré en attente de comparution devant la cour d'assises. En outre, afin d'améliorer les conditions d'audiencement, la commission a accepté une suggestion du rapporteur visant à organiser une commission paritaire siège-parquet afin de planifier la nature des audiences pénales devant le tribunal correctionnel. De nombreux magistrats entendus ont soutenu une telle démarche, permettant notamment de mieux équilibrer la part respective des audiences de comparution immédiate et de celles résultant d'un renvoi à la suite d'une instruction. VI. - UNE LIBERTÉ DE COMMUNICATION PRÉSERVÉE La conciliation de la liberté d'expression, du droit des citoyens à l'information, du respect de la présomption d'innocence et du secret de l'instruction est l'une des tâches les plus difficiles qui soit. L'article 10 de la convention européenne des droits de l'homme, qui garantit à toute personne la liberté d'expression, admet expressément que l'exercice de cette liberté soit soumis « à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions », afin de protéger « la réputation ou les droits d'autrui », « empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire ». Le projet de loi est parvenu à trouver un juste équilibre entre la liberté de la presse et la protection de la présomption d'innocence, la répression de certains excès constatés récemment étant contrebalancée par l'institution de « fenêtres de publicité » au cours de l'instruction. - Un aménagement limité de la liberté de la presse Conformément aux recommandations du rapport de la Commission de réflexion sur la justice, le projet de loi crée deux nouvelles infractions, le fait de diffuser l'image d'une personne non encore condamnée portant des menottes et celui de réaliser un sondage d'opinion sur la culpabilité d'une personne ou sur la peine susceptible de lui être appliquée, qu'elle punit d'une peine d'amende de 100 000 F (article 22). Par ailleurs, le paragraphe V de l'article 25 complète l'article 803 du code de procédure pénale, qui rappelle le caractère exceptionnel du port de menottes, afin d'y intégrer les dispositions d'une circulaire de 1993 sur les mesures que doivent prendre les forces de police pour éviter que soient prises des photos de personnes portant des menottes. Complétant le dispositif, déjà fort étoffé, qui permet à des personnes mises en cause de faire respecter le principe de présomption d'innocence, l'article 23 du projet de loi modifie les lois du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, afin de donner la possibilité au procureur de la République d'exercer un droit de réponse à demande de la personne concernée. Par ailleurs, cet article porte de huit jours à trois mois le délai pendant lequel la personne qui bénéficie d'un non-lieu, d'une relaxe ou d'un acquittement après avoir été mise en cause dans la presse audiovisuelle, peut exercer son action en insertion forcée, alignant ainsi ce délai sur celui qui existe en matière de presse écrite. Symbolique de la volonté du Gouvernement de parvenir à un juste équilibre entre la protection de la présomption d'innocence et la liberté de la presse, l'article 24, dérogeant au principe d'interdiction de revenir sur le caractère immédiatement exécutoire d'une ordonnance de référé, autorise le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, à arrêter l'exécution provisoire d'une ordonnance de référé limitant la diffusion de l'information, lorsque cette décision risque d'entraîner « des conséquences manifestement excessives ». - Des « fenêtres de publicité » strictement encadrées Tout en maintenant le principe du secret de l'enquête et de l'instruction posé par l'article 11 du code de procédure pénale, l'article 25 du projet de loi aménage des « fenêtres de publicité » destinées à éviter la propagation de rumeurs infondées portant atteinte à la présomption d'innocence. Il consacre dans le code de procédure pénale la pratique des communiqués du parquet, qui relevait jusqu'alors d'une simple circulaire, en prenant bien soin de préciser que ces communiqués devront se limiter à des « éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause ». Il étend la publicité des débats concernant le contentieux de la détention provisoire, qui n'existe actuellement que devant la chambre d'accusation, au débat contradictoire à l'issu duquel le juge de la détention provisoire décidera éventuellement de placer la personne mise en examen en détention provisoire ; la demande, formulée par la personne mise en examen ou son avocat dès l'ouverture de l'audience, pourra être refusée si le juge estime que la publicité est de nature à nuire au bon déroulement de l'information, à l'ordre public, à la dignité de la personne ou aux intérêts d'un tiers. Par ailleurs, il généralise la possibilité pour les personnes mises en examen de demander la publicité des débats devant la chambre d'accusation, possibilité qui n'existe actuellement, comme on l'a vu, qu'en matière de détention provisoire. Ainsi que le souligne l'exposé des motifs, cette disposition permettra à une personne mise en examen, si elle l'estime de son intérêt, de provoquer la publicité du débat sur les charges qui pèsent sur elle. Comme en matière de détention provisoire, la chambre d'accusation pourra refuser la publicité si celle-ci risque de nuire au bon déroulement des investigations, à l'ordre public, à la dignité de la personne ou aux intérêts des tiers. Rappelons en outre que le débat contradictoire devant le président du tribunal de grande instance sur la poursuite éventuelle de l'enquête après un délai de huit mois, prévu par l'article 77-2 du code de procédure pénale (article 20 du projet de loi), peut, à la demande de l'intéressé, se dérouler en audience publique, le président pouvant refuser la publicité pour les mêmes motifs que ceux évoqués ci-dessus. Enfin, l'article 25 modifie les articles 177-1 et 212-1 du code de procédure pénale, qui permettent à la personne bénéficiaire d'une décision de non-lieu de demander au juge d'instruction ou à la chambre d'accusation d'ordonner la publication intégrale ou partielle de cette décision dans la presse : outre la personne directement intéressée, la publication pourra être demandée par le ministère public ou décidée par les juridictions elles-mêmes, à condition d'obtenir l'accord du bénéficiaire ; par ailleurs, si la juridiction d'instruction refuse d'ordonner cette publication, elle devra rendre une ordonnance motivée. - Les principales décisions de la Commission La Commission a porté de 100.000 F à 200.000 F l'amende encourue en cas de diffusion d'une image de personne portant des menottes ou de sondage sur la culpabilité d'une personne mise en cause à l'occasion d'une procédure pénale. Elle a, par ailleurs, a supprimé la possibilité pour le procureur de la République d'exercer le droit de réponse à la place de la personne concernée, en considérant que ce droit devait rester strictement personnel. La Commission a également encadré la pratique des communiqués du parquet, en spécifiant que ceux-ci devaient avoir pour objet d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes ou de mettre fin à un trouble à l'ordre public et a précisé leur contenu en indiquant qu'ils ne devaient comporter aucune mention nominative, sauf accord de l'intéressé. Concernant la publicité des débats devant le juge de la détention provisoire et la chambre d'accusation, elle a supprimé la référence au « bon déroulement de l'information » comme motif de refus de la demande, considérant que cette notion donnait un trop large pouvoir d'appréciation aux magistrats. Enfin, la Commission a élargi la portée de l'article 9-1 du code civil en permettant à toute personne présentée publiquement comme pouvant être coupable de faits faisant l'objet d'une procédure judiciaire de demander l'insertion d'un communiqué pour faire cesser l'atteinte à sa présomption d'innocence. VII. - UNE MEILLEURE PRISE EN COMPTE DES DROITS DES VICTIMES Les victimes ont été pendant des décennies les grandes absentes du procès pénal. Leurs intérêts n'ont commencé à être pris en compte qu'au début des années soixante-dix, avec notamment la loi du 3 janvier 1977, qui a ouvert la voie à l'indemnisation des victimes d'accidents corporels. Prolongeant cette indispensable évolution, le titre II du projet de loi propose un certain nombre de dispositions destinées à renforcer les droits des victimes. Bien que présentées comme formant le deuxième volet du texte gouvernemental, après les articles relatifs au renforcement de la présomption d'innocence, ces dispositions sont peu nombreuses. Elles n'abordent ni la question de l'information des victimes, ni celle de l'insuffisance des réparations pécuniaires. 1. Des droits longtemps négligés Pendant de longues années, la procédure pénale a limité les droits des victimes à la possibilité de mettre en mouvement l'action publique et d'obtenir des dommages-intérêts en cas de condamnation de l'auteur de l'infraction. Les premières améliorations ont concerné la question de l'indemnisation des victimes, avec la mise en place des commissions d'indemnisation des victimes d'infractions. Par la suite, les efforts ont porté sur l'aide apportée aux victimes et sur leur information, à travers notamment le mouvement associatif. a) L'indemnisation des victimes Indépendamment de toute action pénale, la victime d'un fait « présentant les caractères matériels d'une infraction » peut saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (C.I.V.I.) pour obtenir la réparation du préjudice subi. - Le fonctionnement des C.I.V.I. La C.I.V.I. est une juridiction civile spécialisée, instituée dans le ressort de chaque tribunal de grande instance, composée de deux magistrats du siège et d'une personne qui s'est signalée par l'intérêt qu'elle porte aux problèmes des victimes. Elle doit être saisie dans un délai de trois ans à compter de la date de l'infraction ayant causé le dommage ou, si des poursuites pénales ont été engagées, dans un délai d'un an après la décision de la juridiction qui a statué définitivement sur l'action publique. L'indemnisation décidée par la C.I.V.I. est versée par le fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions. Lorsque la juridiction civile ou pénale statuant sur l'action civile a accordé à la victime une indemnité supérieure à celle accordée par la C.I.V.I., la victime peut demander à cette dernière un complément d'indemnité. Malgré l'indemnité de la C.I.V.I., la victime peut également exercer contre l'auteur de l'infraction une action civile devant les juridictions civiles ou pénales ; elle doit alors préciser, à peine de nullité du jugement sur les intérêts civils, le montant de l'indemnité accordée. Lorsque la victime, après le paiement de l'indemnité allouée par la C.I.V.I., obtient à un titre quelconque une réparation ou une indemnisation effective de son préjudice, le fonds de garantie peut demander à la C.I.V.I. d'ordonner le remboursement total ou partiel de l'indemnité accordée. Par ailleurs, le fonds de garantie est subrogé dans les droits de la victime qui a reçu une indemnité de la C.I.V.I. : il peut donc agir contre l'auteur de l'infraction afin d'obtenir le remboursement de cette indemnité. - Les conditions de saisine des C.I.V.I. Si le préjudice subi est un préjudice corporel, les conditions de saisine sont relativement souples : l'article 706-3 du code de procédure pénale dispose en effet que toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits ayant entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnelle égale ou supérieure à un mois ou ayant été victime d'une atteinte ou une agression sexuelle peut obtenir la réparation intégrale de son préjudice. Lorsqu'il s'agit d'un préjudice matériel ou d'un préjudice corporel avec une incapacité de travail inférieure à un mois, les conditions sont beaucoup plus restrictives : l'article 706-14 du code de procédure pénale n'autorise le recours en indemnité que si le préjudice résulte d'un vol, d'une escroquerie ou d'un abus de confiance ; la victime doit démontrer qu'elle ne peut obtenir à un titre quelconque une indemnisation effective suffisante de son préjudice et qu'elle se trouve, de ce fait, dans une situation matérielle grave ; enfin, ses ressources mensuelles doivent être inférieures au plafond prévu pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle, soit actuellement 7 300 F. En outre, la réparation accordée par la C.I.V.I. ne peut dépasser 22 000 F. Ajoutées aux délais fixés pour saisir la C.I.V.I., ces conditions très restrictives sont sources de déception pour les victimes de dommages matériels, qui n'obtiennent pas les réparations auxquelles elles estiment avoir droit. - L'activité des C.I.V.I. Si les montants des indemnités accordées par les C.I.V.I. ont fortement augmenté depuis la loi du 8 juillet 1983, ceux-ci demeurent en tout état de cause bien inférieurs aux sommes réclamées par les victimes, malgré le principe de la réparation intégrale du préjudice corporel.
L'examen des montants des indemnités réglées par le fonds de garantie fait apparaître les faibles sommes consacrées à l'indemnisation des dommages matériels, qui ne font que doubler entre 1991 et 1997, alors que dans le même temps les montants des indemnités versées pour des dommages corporels sont presque multipliés par quatre.
b) L'information et le soutien des victimes - Le rôle irremplaçable des associations Les premières associations d'aide aux victimes ont été créées il y a une quinzaine d'années, avec le soutien du ministère de la justice, des collectivités territoriales et des conseils de prévention de la délinquance, afin de mieux prendre en compte les besoins des victimes d'infractions pénales. En 1986 a été créé l'Institut national d'aide aux victimes et de médiation (I.N.A.V.E.M.), chargé d'animer et de coordonner les services d'aide aux victimes. L'I.N.A.V.E.M. regroupe aujourd'hui 150 services d'aide aux victimes, associations et bureaux municipaux, répartis sur l'ensemble du territoire français, qui animent 600 permanences d'accueil, reçoivent 100 000 victimes et réalisent 10 000 médiations pénales chaque année. Les associations d'aide aux victimes accueillent toutes les personnes victimes d'une infraction. Elles proposent une écoute privilégiée pour identifier les difficultés des victimes (sentiment d'isolement, souffrance psychologique ...), les informent de leurs droits (procédures judiciaires, systèmes d'indemnisation), les accompagnent dans leurs démarches (aide psychologique, préparation aux expertises et aux audiences) et les orientent si nécessaire vers des services spécialisés (avocats, services sociaux et médico-psychologiques, assurances). L'I.N.A.V.E.M. apportent à ces associations une assistance technique. Il coordonne leur action en cas d'accidents collectifs (accident du B_ing 747 de la T.W.A. en 1996 par exemple), propose des journées de formation et assure la promotion de l'activité des services d'aides aux victimes, encore mal connus du public et des professionnels. - La politique gouvernementale d'aide aux victimes Partant du constat que « les considérables progrès réalisés en ce qui concerne l'indemnisation des victimes d'infractions pénales n'ont pas été suffisamment accompagnés de mesures d'aide et d'assistance », le Gouvernement a voulu donner un nouvel élan à la politique d'aide aux victimes. La circulaire du 13 juillet 1998 traduit cette nouvelle priorité qui vise à donner à la victime toute sa place dans le procès pénal. Elle rappelle tout d'abord que l'action en faveur des victimes doit être renforcée à toutes les phases de la procédure pénale : quelle que soit la décision prise sur l'action publique, il est demandé au parquet d'assurer directement ou indirectement une information des victimes ; à l'audience, les magistrats du ministère public devront dans la mesure du possible requérir des mesures d'ajournement avec mise à l'épreuve, de sursis avec mise à l'épreuve ou de travail d'intérêt général, mesures qui permettent de mieux prendre en compte les intérêts des victimes ; enfin, l'indemnisation des victimes doit devenir l'un des principaux critères d'octroi des mesures d'aménagement de peines. La circulaire demande que cette politique dynamique d'aide aux victimes s'appuie à la fois sur l'institution judiciaire et sur le réseau associatif d'aide aux victimes. Elle rappelle que, dans chaque ressort de cour d'appel, un magistrat désigné par les chefs de cour est chargé « d'impulser, coordonner, soutenir et évaluer l'ensemble des actions mises en _uvre par les juridictions dans le cadre de l'aide aux victimes, de la prévention de la délinquance et de la récidive ainsi que de la médiation pénale et civile ». Après avoir souligné le rôle essentiel des services d'aide aux victimes fédérés au sein de l'I.N.A.V.E.M., elle encourage les différents acteurs judiciaires à resserrer leurs liens avec ces services et demande à l'institution judiciaire de donner toute la place qu'elles méritent aux associations autorisées à se constituer partie civile. Les annexes de la circulaire contiennent une série d'indications très précises qu'il serait fastidieux d'énumérer ici, mais qui donnent la mesure du travail à accomplir pour que les intérêts des victimes soient réellement pris en compte par l'institution judiciaire. Souhaitant approfondir sa réflexion sur cette question, la Chancellerie a, par ailleurs, mis en place une commission, présidée par Mme Marie-Noëlle Lienemann, chargé d'évaluer les dispositifs existants et de formuler des propositions susceptibles de mettre en _uvre une véritable politique publique d'aide aux victimes. Ce groupe de travail devrait remettre prochainement son rapport au Premier ministre, dont les conclusions pourraient être éventuellement reprises en deuxième lecture sous forme d'amendements. 2. Un renforcement limité des droits des victimes Le titre II du projet de loi, qui regroupe les « dispositions renforçant les droits des victimes », ne modifie qu'à la marge le dispositif d'aide aux victimes décrit ci-dessus. Il propose de mieux réprimer les atteintes à la dignité dont font parfois l'objet les victimes d'infractions pénales. Reprenant dans le code pénal, dans une rédaction plus conforme à la convention européenne des droits de l'homme, l'actuel article 38 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, l'article 26 punit ainsi de 100 000 F d'amende la diffusion d'images d'un crime ou d'un délit de nature à porter atteinte à la dignité d'une victime d'infraction pénale. Dans le même esprit, la diffusion de renseignements permettant d'identifier un mineur victime d'une infraction sera désormais interdite (article 27). L'article 28 consacre pour la première fois dans le code de procédure pénale le rôle des associations d'aide aux victimes : il complète pour cela l'article 41 de ce code relatif aux missions du procureur de la République, afin de préciser que ce dernier peut avoir recours à ces associations pour aider la victime, à condition, toutefois, quelles aient fait l'objet d'un conventionnement de la part des chefs de cour. Enfin, les articles 29, 30, et 31 simplifient certaines procédures afin de faciliter les conditions d'accès de la partie civile au procès pénal : le seuil du montant des dommages-intérêts au-dessous duquel la constitution de partie civile peut être effectuée par lettre sera supprimé, afin d'éviter à la victime d'avoir à se déplacer au tribunal ; de même, la constitution de partie civile par télécopie sera autorisée ; la victime aura désormais la possibilité de demander des dommages-intérêts au cours de l'enquête, par une simple déclaration devant un officier ou un agent de police judiciaire ; afin d'éviter que la victime qui ne peut justifier son préjudice à l'audience se voit refuser toute réparation, le tribunal, après avoir statué sur l'action publique, pourra désormais plus facilement renvoyer sa décision sur l'action civile à une audience ultérieure ; enfin, la victime pourra obtenir devant la Cour de cassation le remboursement des frais irrépétibles, comme les frais d'avocats, alors que ce remboursement n'existe actuellement que devant les juridictions du fond. 3. Les principales décisions de la Commission Tout en approuvant sans réserve les dispositions proposées, le rapporteur a considéré qu'elles n'allaient pas assez loin sur certains points et ne tenaient notamment pas compte de la nécessité d'améliorer l'information des victimes, nécessité rappelée par voie d'amendement à l'article préliminaire. Elle a donc proposé à la Commission, qui les a adoptés, une série d'amendements ayant pour objet, à tous les stades de la procédure, de mieux informer les victimes sur leur droit d'obtenir réparation du préjudice subi, en saisissant au besoin la C.I.V.I., et d'être assistées par un service ou une association d'aide aux victimes. Sur proposition du rapporteur, la Commission a également souhaité reprendre certains principes relatifs à l'indemnisation des victimes qui figurent dans la circulaire du 13 juillet 1998. Elle a ainsi inscrit dans le code de procédure pénale la nécessité de prendre en compte l'effort d'indemnisation des victimes dans l'octroi des réductions de peines supplémentaires ou des libérations conditionnelles. Elle a par ailleurs souhaité améliorer l'information du juge d'instruction et des juridictions de jugement sur la personnalité de la victime, en donnant au premier la possibilité d'ordonner, avec l'accord de la victime, une enquête permettant de connaître les conséquences de l'infraction subie sur sa santé, sa personnalité ainsi que sur sa situation matérielle, familiale et sociale. Enfin, la Commission a adopté le principe d'un conventionnement de droit pour les associations reconnues d'utilité publique. * * * Avant d'examiner le projet de loi, la Commission a procédé, le mercredi 20 mai 1998, à l'audition de MM. Thomas Ferenczi, journaliste, médiateur au journal Le Monde, Antoine Garapon, magistrat, secrétaire général de l'Institut des hautes études sur la justice, René Rémond, président de la Fondation nationale des sciences politiques, ancien membre du Conseil supérieur de la magistrature, Thierry Renoux, professeur de droit public à l'Université d'Aix-Marseille III, membre de la Commission de réflexion sur la justice et Hervé Temime, avocat à la Cour de Paris, ancien président de l'Association des avocats pénalistes. Mme Catherine Tasca, présidente de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République : A ce stade de la réflexion, il m'a paru très important de recueillir le point de vue de professionnels de la justice, mais également celui d'intervenants extérieurs, comme le sont M. Thomas Ferenczi et M. René Rémond. Je crois qu'il n'existe aucune grande réforme sociale au sujet de laquelle nous n'ayons pas intérêt à sortir du cercle des personnes que l'on peut considérer comme le plus directement impliquées, et qui pourraient être soupçonnées d'une approche corporatiste. Il nous a donc semblé fondamental de recueillir le point de vue des universitaires et des professionnels des médias. Je suggère d'aborder la réflexion selon trois grands axes : en premier lieu, les questions qui touchent au rôle et au statut des magistrats, à leur indépendance, puisque le premier texte examiné par le Parlement est celui relatif à la composition du Conseil supérieur de la magistrature ; ensuite, les problèmes qui concernent les libertés publiques, dont la présomption d'innocence et le rôle des médias - à cet égard, je me réjouis de la présence de M. Thomas Ferenczi ; enfin, le dossier de la justice au quotidien, de l'accès au droit et de l'accès au juge. M. René Rémond : Mme la Présidente, lorsque vous m'avez fait l'honneur de m'inviter à faire connaître mon sentiment sur les projets de réforme présentés à l'Assemblée nationale, vous m'avez suggéré d'orienter mon intervention sur les relations entre le monde judiciaire et le monde politique. A vrai dire, cette orientation m'a un peu embarrassé, puisque je n'appartiens ni au monde politique, ni au monde judiciaire, même si j'ai eu plus d'une occasion d'approcher l'un et l'autre. Je m'y conformerai, cependant, en vous soumettant quelques réflexions générales sur les rapports entre justice et politique, avant d'en venir à l'examen du projet de loi constitutionnelle. L'observateur, surtout s'il se double d'un historien, ne peut manquer d'être frappé par la place croissante que les questions relatives à la justice occupent dans l'esprit public, le débat politique et les travaux parlementaires. Il s'agit d'un changement profond. Quand on fait la comparaison entre ce qu'était le rôle du garde des sceaux il y a une cinquantaine d'années et ce qu'il est devenu maintenant, l'évolution est saisissante. Ce qui était autrefois une fonction largement honorifique, réservée à des hommes politiques émérites, est devenu l'un des postes les plus exposés. Les raisons, vous les connaissez, mais je les rappelle brièvement : la « judiciarisation » croissante de notre vie sociale, le recours de plus en plus fréquent à un droit considéré comme un arbitre objectif dans les contestations et surtout - c'est de mon point de vue l'élément fondamental de cette évolution - l'expression par l'opinion publique d'une exigence croissante de justice. A cet égard, le contenu de la démocratie a assurément changé, la justice en devenant un des critères principaux. La démocratie implique l'Etat de droit, et donc un fonctionnement indépendant, transparent et objectif de la justice. Ajoutons à cela le fait que la loi elle-même peut aujourd'hui être confrontée à une norme supérieure par le biais du contrôle de constitutionnalité. Je voudrais maintenant vous soumettre quelques réflexions que m'a inspirées la lecture de ces projets. Je les ai tous lus, mais je m'intéresserai surtout, puisqu'on a bien voulu rappeler que j'ai fait partie du Conseil supérieur de la magistrature, à celui qui concerne cette institution. Il est vrai que le Conseil auquel j'ai appartenu n'est pas le même que celui d'aujourd'hui : la composition en a été modifiée et ses attributions ont été étendues, ces changements étant conformes aux souhaits que nous avions alors formulés. Cependant, j'ai eu récemment l'occasion de rencontrer à la fois les anciens membres et les titulaires actuels, et j'ai été frappé de constater que les préoccupations demeurent les mêmes. Il existe donc une continuité dans l'institution, ce qui me qualifie peut-être pour formuler une appréciation sur le projet de loi constitutionnelle. Ce dernier a d'ailleurs mon assentiment. J'approuve l'extension des compétences et je me réjouis que la nouvelle composition affirme l'unité du corps - j'ai toujours pensé que la séparation entre parquet et siège n'avait pas de justification, dans la mesure où, très souvent, la carrière des magistrats s'effectue alternativement dans l'un et dans l'autre. Je me félicite qu'il y ait des personnalités extérieures, non seulement parce que j'ai joué ce rôle, mais parce que je crois indispensable, pour prévenir toute dérive corporatiste, que le Conseil supérieur de la magistrature comprenne des membres qui n'appartiennent pas au personnel judiciaire. Il faut rappeler que la justice n'appartient pas plus aux magistrats que la santé aux médecins ou l'enseignement aux professeurs. Ce sont des fonctions sociales qui s'exercent par délégation du peuple français. Je me suis d'ailleurs rendu compte que la présence de personnalités extérieures contribuait parfois à garantir la protection des magistrats contre les pressions ou les velléités de mise sous tutelle. Cela dit, je m'interroge sur l'effectif retenu. Je ne suis pas certain qu'il soit nécessaire que les personnalités extérieures soient plus nombreuses que les magistrats, dans la mesure où il n'y a pas de rapport de force entre les deux catégories et où il est rare que l'arithmétique joue dans les votes. La seule présence de quelques personnalités extérieures exerce un rôle de catalyseur. De plus, je m'inquiète un peu du nombre total de membres car vingt et un, c'est beaucoup pour fonctionner correctement. A l'expérience, je me suis rendu compte que neuf ou dix est un bon chiffre pour permettre à une instance de travailler convenablement. Ce qui fait l'efficacité du Conseil constitutionnel ou du C.S.A., c'est peut-être le nombre limité de membres Il existe d'autres sujets à propos desquels je me pose des questions, mais qui ne relèvent probablement pas de la loi constitutionnelle. Par exemple, qui sera le président de ce Conseil lorsqu'il ne sera présidé ni par le Président de la République, ni par le garde des sceaux, c'est-à-dire la plupart du temps ? Autrefois, il existait un doyen qui n'était d'ailleurs pas nécessairement le doyen d'âge. Par ailleurs, compte tenu de la charge croissante que représente la participation au Conseil supérieur de la magistrature - de notre temps, cela occupait déjà au moins deux journées par semaine, mais avec l'extension de ses pouvoirs, on se dirige vers le plein temps -, il conviendrait, dans le doute, de prévoir un système permettant aux personnalités extérieures d'exercer leurs attributions dans de bonnes conditions, sachant que les magistrats bénéficient déjà d'une décharge. Cette question est particulièrement importante, surtout si le Conseil continue, comme il est souhaitable, à aller sur le terrain et à visiter les juridictions, non pas pour inspecter - ce n'est pas son rôle - mais parce qu'il est indispensable de sortir du quai Branly pour découvrir sur place comment fonctionnent les tribunaux et quelles sont leurs difficultés. C'est ainsi que nous avions remis un rapport sur la pénurie des greffes. Ces problèmes ne relèvent probablement pas d'une loi constitutionnelle, mais je pense qu'il est bon que le législateur se les pose. S'il m'est permis d'aborder un sujet qui n'est pas à l'ordre du jour, je vous ferai part de mon étonnement à propos de la disparition du projet de réforme de la procédure criminelle. On se souvient qu'il y a deux ans, le gouvernement avait constitué un haut comité dont j'ai partagé la présidence avec M. Jean-François Deniau. Nous avons travaillé pendant trois mois en procédant à de nombreuses auditions et nous avions rédigé un rapport qui avait fait l'unanimité, duquel était sorti un projet de loi qui a été examiné en première lecture par l'Assemblée nationale. Souhaitant l'appel en assises, nous avions fait justice de l'objection selon laquelle, le jury se prononçant au nom du peuple français, il ne peut se tromper et nous nous étions prononcés en faveur du maintien du jury citoyen, en première instance et en appel. Puisque l'occasion m'est donnée de rappeler l'existence de ce projet, je dirai que cela ne me paraît pas moins important que la question de la présomption d'innocence. Et cela d'autant plus que le jury d'assises est une des rares occasions pour le citoyen de participer à la vie de la nation. En un temps où près de la moitié des Français sont exonérés d'impôt et ne contribuent donc pas aux charges publiques et où il n'existe plus de service national, cela me paraît important. M. Antoine Garapon : J'ai trouvé le projet du garde des sceaux très novateur par certains côtés, tout en ayant le sentiment qu'il s'arrête en quelque sorte au milieu du gué. De ce fait, il s'attire des reproches en provenance des deux rives, les uns estimant que l'on s'est trop éloigné vers l'indépendance de la justice, les autres qu'on ne s'en est pas assez rapproché. Tout d'abord, ce qui me frappe dans ces projets - et je le dis pour aussitôt le regretter - c'est qu'une fois de plus la justice administrative est exclue d'une réforme de la justice. Ce particularisme français est pourtant très dommageable à la qualité globale de notre justice. Nous manquons là une occasion de créer un Conseil supérieur de la magistrature qui soit commun aux deux ordres. En effet, le meilleur moyen d'atténuer le corporatisme des juges judiciaires n'est-il pas de le confronter au corporatisme des juges administratifs ? Contrairement à ce que l'on croit, le corps judiciaire est extrêmement politisé. C'est pourquoi il faut être très attentif à la composition du C.S.M., et notamment veiller à ce que les magistrats ne soient pas majoritaires. C'est ce que prévoit le projet de loi constitutionnelle. Je partage les inquiétudes de M. René Rémond à propos de l'effectif du C.S.M. Vingt et un, c'est beaucoup. J'attire également votre attention sur le mode de scrutin, qui risque de donner l'avantage au syndicat majoritaire. C'est un peu la solution de facilité pour tous les corps de l'Etat que de mettre en place, plutôt qu'une véritable indépendance, une cogestion du corps avec le syndicat majoritaire. Je serais donc favorable à ce qu'il y ait plus de « laïcs » au C.S.M., que le nombre de ses membres soit moins élevé, et que ceux-ci soient élus avec un mode de scrutin qui ne favorise pas le syndicat majoritaire. L'idée d'un conseil unique pour les magistrats du parquet et ceux du siège n'est évidente que pour les Français, et peut-être les italiens, en tout cas pour un nombre de pays très réduit. Cette confusion du parquet et du siège ne va pas de soi, et l'on pourrait imaginer un système permettant d'éviter des allers et retours trop fréquents d'une catégorie à l'autre. Par contre, il me semble qu'il faut encourager l'idée d'un recours citoyen, soit pour vaincre l'inertie d'un juge, soit pour se plaindre de son comportement. Cela dit, je ne suis pas sûr que les remèdes proposés soient les bons et il existe d'autres moyens pour vaincre l'inaction d'un procureur. Ainsi, on pourrait élargir le champ des personnes ayant qualité pour agir : cela permettrait à chaque citoyen de se constituer partie civile pour tous les délits causant un préjudice collectif, tels que les délits de corruption ou les atteintes à l'environnement. Je ne suis pas sûr que la commission envisagée pour remettre en question les classements sans suite ne soit pas un dispositif extrêmement complexe pour des gains finalement assez modestes, puisque celui qui aura protesté contre le classement d'une affaire n'aura pas pour autant la qualité pour agir une fois que l'affaire sera engagée. Il en est de même de la possibilité de se plaindre du comportement d'un juge. C'est une excellente idée, mais plutôt que de mettre en place des commissions à cet effet, ne vaudrait-il mieux pas élargir la saisine du C.S.M. à chaque citoyen ? Ce serait infiniment plus simple, tout en créant une nouvelle liberté publique à laquelle je suis personnellement très attaché, la faculté de se plaindre de son juge. Il suffirait de rattacher l'inspection des services judiciaire au C.S.M. pour que celui-ci puisse immédiatement diligenter une enquête. Cela permettrait d'éviter un dispositif vécu par mes collègues comme un geste de défiance à leur égard, et que l'on peut qualifier « d'usine à gaz ». Je constate aussi un attachement un peu fétichiste à la notion de politique pénale. Cette idée de politique pénale centralisée, inspirée par le garde des sceaux, est peut-être satisfaisante pour l'esprit, mais elle n'a que peu de réalité dans la pratique. D'abord, on ne peut concevoir d'imposer des priorités que si elles sont en nombre réduit. Or, les procureurs sont assaillis de priorités, ce qui fait que plus rien n'est réellement prioritaire. De plus, la seule politique pénale qui vaille, c'est celle qui est adaptée aux réalités du terrain, aux forces de police disponibles, aux équipements spécifiques se trouvant dans la juridiction du procureur : aéroport, marché d'intérêt national, etc. Un autre aspect du projet me paraît poser un problème : alors qu'il instaure un contrôle par les citoyens - ce qui est une excellente chose, en dépit des critiques de magistrats que l'on peut qualifier de corporatistes - il maintient la possibilité pour le garde des sceaux de saisir directement une juridiction. D'une part, je ne vois pas dans quelle situation pratique cette procédure pourrait être utilisée, et d'autre part, cela revient à maintenir un contrôle par le haut alors que l'on a déjà mis en place un contrôle par le bas. Il en va de même pour le juge des libertés : on instaure un échelon supplémentaire, sans toucher à l'institution du juge d'instruction qui est un des problèmes majeurs de notre procédure pénale. Il ne peut pas y avoir trois échelons : un juge d'instruction, un juge des libertés et un procureur. L'un d'eux est de trop. Soit on transforme le juge d'instruction en juge des libertés, soit on garde le juge des libertés, et c'est le procureur qui devient le superviseur de l'enquête. Garder les trois serait extraordinairement coûteux en personnel, pour une « plus-value » en terme de libertés individuelles qui ne serait pas à la hauteur de l'investissement financier et humain consenti. En conclusion, je dirais que la logique inaugurée par cette réforme est très positive : elle consiste à donner une responsabilité aux juges pour les sortir de leur face-à-face stérile avec le pouvoir. Mais je crois que l'on n'a fait que la moitié du chemin. M. Thierry Renoux : A titre liminaire, je voudrais poser une question : pourquoi un Conseil supérieur de la magistrature ? Tous les pays ne connaissent pas une telle institution. En Europe, on en retrouve l'équivalent dans les pays du sud principalement : le Portugal, l'Espagne, l'Italie, la Grèce, la Roumanie, la Bulgarie et Andorre. Par ailleurs, la Belgique et les Pays-Bas s'interrogent actuellement sur la création d'un Conseil supérieur de la magistrature compte tenu des dysfonctionnements de leur justice. Cette institution est spécifiquement française. Au XIXe siècle, les attributions disciplinaires étaient exercées par la Cour de cassation, mais ce n'est qu'en 1946 qu'a été créé le Conseil supérieur de la magistrature par la Constitution. Les raisons d'être d'un Conseil supérieur de la magistrature sont évidentes. Il s'agit, d'une part, d'éviter que le pouvoir politique ne puisse obtenir des faveurs d'un magistrat en le récompensant par un avancement. Cette préoccupation existait déjà avant la création du Conseil supérieur de la magistrature et il y était répondu par le tableau d'avancement. Il s'agit, d'autre part, d'éviter que le pouvoir politique ne puisse sanctionner un magistrat. Sur le plan constitutionnel, l'existence d'un Conseil supérieur de la magistrature est la traduction directe du principe d'égalité devant la loi qui implique, selon le Conseil constitutionnel dans une décision rendue en 1975, le principe d'égalité devant la justice. Le Conseil supérieur de la magistrature est donc le garant de l'indépendance de la justice. Le principe d'égalité devant la loi, affirmé par l'article premier de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, doit être conjugué avec l'article 9 de la même déclaration qui pose celui de la présomption d'innocence. J'en profite pour dire que le projet sur la présomption d'innocence me paraît excellent parce qu'il part de celle-ci pour en tirer les conséquences qui s'imposent sur le plan de la procédure pénale. Toute procédure pénale doit affirmer ce principe essentiel : nous sommes innocents et c'est à la partie poursuivante de démontrer la culpabilité. D'ailleurs, ce principe n'est pas seulement valable en matière pénale puisqu'il est inscrit dans le Code civil. Il faut cependant souligner que la présomption d'innocence cesse lors du premier jugement. Quelle est la nature du Conseil supérieur de la magistrature ? Si, à l'origine, l'influence parlementaire était forte, elle a été remplacée par l'influence présidentielle en 1958. Le Conseil supérieur de la magistrature est d'abord un conseil. Est-ce un conseil du pouvoir législatif, comme c'est le cas en Espagne du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire ? Cette appellation, d'ailleurs, me semblerait préférable, car la dénomination « Conseil supérieur de la magistrature » implique un corporatisme qui ne me plaît pas ; en outre, je suis favorable à un grand Conseil comportant une chambre administrative, une chambre financière et une chambre judiciaire. Il serait imaginable que les autorités parlementaires qui désignent des membres d'un Conseil supérieur de la magistrature puissent saisir ce conseil. En Italie, le Conseil supérieur de la magistrature élit son vice-président. C'est une bonne chose, car cette personnalité a vocation à incarner la justice, à lui donner un visage, ce qui, à mon sens, manque en France. Lorsque l'Assemblée nationale ou le Sénat sont en cause, leurs présidents peuvent intervenir, mais lorsque la justice est en cause, qui peut légitimement s'exprimer en son nom ? Le Conseil supérieur de la magistrature est aussi le conseil du pouvoir exécutif. J'observe que le comité de révision de la Constitution présidé par le doyen Vedel, ainsi que la commission Truche, avaient proposé que le garde des sceaux ne soit pas membre du Conseil supérieur de la magistrature, car il est à la fois demandeur et destinataire des avis du Conseil auquel il participe. C'est la raison pour laquelle la commission Truche avait également proposé de retirer au président de la République sa voix délibérative puisqu'il reçoit les propositions du Conseil. Le garde des sceaux est le premier responsable de la politique pénale et il est légitime qu'il s'exprime devant le Parlement pour en faire le rapport. Je suis plus sceptique quant à la publication des circulaires générales d'action publique. Comment imaginer par exemple que soit publié au Journal officiel un texte indiquant que seuls les auteurs de chèques sans provision d'un montant supérieur à 500 francs seront poursuivis ? De son côté, la commission Truche avait imaginé que l'Etat, plutôt que de donner des instructions générales aux parquets, puisse porter plainte, comme c'est actuellement le cas aux Etats Unis, en ayant recours à un magistrat de la chancellerie ou à un avocat. L'appel à la société civile dans la composition du Conseil supérieur de la magistrature est une bonne chose. Je rejoins, toutefois, les préoccupations des précédents orateurs sur le nombre des membres. La commission Truche en comportait vingt et un et j'ai remarqué qu'il était difficile de s'y exprimer dans de telles conditions. Il aurait été préférable de créer au sein du Conseil supérieur de la magistrature des chambres moins nombreuses. Le Conseil supérieur de la magistrature est ensuite une juridiction qui a pour objectif, d'une part, de mieux assurer l'indépendance du magistrat et, d'autre part, de protéger le citoyen contre les abus de la justice. L'indépendance n'est pas un privilège du magistrat, elle doit être assurée avant tout dans l'intérêt du justiciable. L'unité du corps de la magistrature ne me choque pas et elle a été reconnue conforme à la Constitution, le 11 août 1993, par le Conseil constitutionnel. Par ailleurs, le principe de l'opportunité des poursuites justifie l'unité du corps. Toutefois, comme le prévoit la commission Truche, il faudrait un délai pendant lequel il serait impossible de passer d'une fonction - parquet ou siège - à l'autre. Je me permets, au passage, de relever une inconstitutionnalité dans l'avant-projet : il ne peut être prévu par la loi organique la possibilité de déplacer d'office un magistrat du siège à titre disciplinaire alors même que cela ne figure pas dans le projet constitutionnel. Le Conseil supérieur de la magistrature a par ailleurs pour rôle de protéger le citoyen contre les abus des magistrats. Ceux-ci sont soumis à la responsabilité disciplinaire et à la responsabilité civile qui avait été étendue par la commission Truche avec des cas d'actions récursoires plus nombreux. La notion de responsabilité pour les magistrats du parquet est plus importante que la notion de faute. Le projet aborde la faute par le biais de la subordination au garde des sceaux. Ce n'est pas satisfaisant : les magistrats du parquet doivent être des magistrats responsables avant d'être des magistrats fautifs ou subordonnés. Les magistrats sont aussi soumis à la responsabilité pénale. Il faut cependant aborder cette question avec précaution pour éviter par exemple que des malandrins ne fassent asseoir sur la banc des accusés le juge qui les a condamnés. A ces responsabilités, on pourrait ajouter une responsabilité constitutionnelle. En Allemagne, la Cour constitutionnelle peut, à la demande du Parlement, destituer un juge qui aurait violé gravement la constitution. Deux procédures ont déjà été engagées. De surcroît, je pense à cet égard aux arrêts de règlement : comment sanctionner l'empiétement sur les compétences du pouvoir législatif que ceux-ci constituent ? Le principe d'une responsabilité constitutionnelle du magistrat permettrait d'assurer le respect du principe de la séparation des pouvoirs, essentiel à la démocratie. Pour résumer : pas de juge justicier, pas de juge serviteur, si ce n'est de la loi ; un contrôle politique de la fonction juridictionnelle, mais pas de politisation du corps. M. Thomas Ferenczi : Vous m'avez invité, Mme la Présidente, à réfléchir sur les relations entre le juge, le journaliste et le citoyen. Je vous donnerais le point de vue d'un journaliste parmi les autres. Le journaliste est au service du citoyen, il contribue à son information sans que celle-ci soit un but en elle-même, mais plutôt un moyen de faire vivre le débat démocratique. Dans sa mission, le journaliste doit se montrer critique par rapport aux pouvoirs, notamment par rapport au pouvoir politique. Cette fonction critique ne signifie pas prioritairement porter des jugements, mais avant tout exposer et expliquer. Le journaliste va donc enquêter pour faire apparaître des vérités cachées. Seul, il ne pourra pas aller très loin car il n'a pas les moyens dont disposent légitimement certains fonctionnaires pour convoquer des témoins ou effectuer des perquisitions. Il va donc s'appuyer sur les investigations d'autres corps professionnels : les juges, les policiers, les magistrats de la Cour des comptes, les parlementaires - je pense aux commissions d'enquête - les inspecteurs de l'administration, les inspecteurs des finances ou les inspecteurs de l'agriculture, qui ont effectué récemment un rapport sur le Crédit agricole en Corse ou encore l'I.G.A.S. qui a rendu un rapport sur le tabagisme publié par Le Monde. Grâce à tous ces moyens, il pourra révéler des vérités cachées ou déjouer les stratégies de communication de personnalités ou d'institutions. Le journaliste remplit-il aujourd'hui correctement sa mission d'enquête ? Je pense que les médias ont beaucoup progressé, mais il leur reste beaucoup de chemin à faire pour surmonter la tentation du conformisme et de la paresse, pour vaincre les résistances et affirmer leur indépendance par rapport aux divers pouvoirs. L'opinion reproche souvent aux médias - des sondages l'attestent comme de nombreux livres à succès, je pense à ceux de MM. Pierre Bourdieu et Serge Halimi - d'être trop complaisants et pas assez pugnaces. De nombreux exemples montrent que les médias n'ont pas été assez curieux ou qu'ils ont été manipulés, les plus célèbres étant ceux du charnier de Timisoara et de la guerre du Golfe. Dans ces derniers cas, les erreurs s'expliquent parce que les journalistes n'ont pas exercé convenablement leur esprit critique. Autre exemple : la presse n'a pas su apercevoir à temps les dérives du Crédit Lyonnais car elle a été abusée par ses services de communication ; dans cette affaire, il faut noter que les parlementaires ont été plus vigilants. On peut enfin citer l'exemple de la maladie de François Mitterrand : nos confrères étrangers ont été étonnés en apprenant que sa maladie remontait à l'année de sa réélection et que la presse n'en disait rien. Ces reproches ne sont donc peut-être pas totalement infondés, mais il faut souligner que l'enquête est un travail difficile qui demande de la persévérance, des compétences, en particulier sur les questions financières, et du courage, notamment celui de résister aux pressions. Les obstacles sont donc nombreux. Dans ces conditions, est-il judicieux d'en ajouter ? La France n'est certainement pas le pays où règne la plus grande transparence. Nous avons dans ce domaine encore beaucoup à apprendre des pays anglo-saxons où la tradition de l'enquête journalistique sans concession y est plus forte que chez nous. Il me semble préférable d'imiter ces pays plutôt que d'inviter ou de contraindre la presse à se modérer, d'une façon ou d'une autre. C'est à la fois la servitude et la grandeur du métier d'homme politique d'accepter d'être mis en cause avant même d'être jugé. Les lois actuelles qui punissent notamment la diffamation me paraissent un outil suffisant pour protéger les personnes mises en cause. Il appartient, bien entendu, aux journalistes de respecter les principes qui fondent, aux yeux des juges, la bonne foi, la légitimité du but poursuivi, l'absence d'animosité personnelle, la prudence et la mesure dans l'expression des propos et le sérieux et la qualité de l'enquête. Même si nous contestons certaines décisions judiciaires, je fais confiance au juge et il est essentiel qu'il se prononce sur nos éventuels errements. Pour le reste, le journaliste doit respecter une déontologie, respect auquel l'institution d'un médiateur contribue. Mme la Présidente : Je me permets de faire quelques remarques sur ces problèmes que j'ai connus professionnellement. Vous nous dites, M. Ferenczi, que l'on peut reprocher aux journalistes de ne pas être assez exigeants dans leur travail d'enquête. Vous n'avez pas évoqué un élément important du débat, à savoir l'atteinte à la vie privée ou au secret de l'instruction. Par ailleurs, outre la question de la responsabilité de journaliste, ne faudrait-il pas poser celle des grands groupes qui possèdent les médias les plus importants ? M. Hervé Temime : Je vous parlerai essentiellement du texte relatif à la présomption d'innocence et au droits de la défense, mais je voudrais d'abord faire deux observations qui ne sont pas tout à fait en dehors du cadre qui m'a été imparti. Premièrement, je voudrais reprendre ce qu'a dit M. René Rémond concernant le sort du projet instituant l'appel en cour d'assises. Je crois qu'il est absolument incompréhensible, pour les professionnels de la justice, quel que soit le corporatisme que l'on peut leur prêter, à juste titre d'ailleurs, vous avez eu raison, Mme la Présidente, de nous en accuser par avance... Mme la Présidente : J'ai parlé de « soupçon » ! M. Hervé Temime : Mais pour moi, la présomption d'innocence n'existe pas, et je vous le démontrerai. Donc à mes yeux, le soupçon suffit à condamner ! Je suis presque un journaliste, en tout cas plus qu'un juge ... Il est donc évident que nous sommes corporatistes, mais quoi qu'il en soit, je ne peux pas comprendre, compte tenu de la difficulté que nous avons eu à trouver un consensus sur la question du double degré de juridiction dans les affaires criminelles, comment un texte aussi capital pour le progrès de notre justice a pu être abandonné, pour des raisons financières qui, sans être mineures, sont tout de même insuffisantes. Je crois, en toute franchise, que ce projet est au moins aussi important que les meilleurs de ceux qui pourraient vous être soumis sur les sujets dont nous débattons aujourd'hui. Deuxièmement, je pense que le problème dont tout le monde parle, celui du lien entre la chancellerie et le parquet, est un faux problème. Il est peut-être très important pour vous, hommes et femmes politiques, probablement non négligeable pour les citoyens, mais ce n'est certainement pas le dossier majeur en ce qui concerne le fonctionnement de la justice. D'abord, cela ne concerne qu'un nombre très limité de dossiers. Ensuite, l'expérience montre qu'il est tout à fait possible d'atténuer par la pratique le soupçon permanent selon lequel le pouvoir politique exerce des pressions sur la justice. En revanche, en faire l'élément majeur d'une réforme de la justice nous fait oublier ce qui est, à mon sens, le véritable problème de notre justice pénale, c'est-à-dire la dépendance entre les juges du siège et le parquet. Nous avons besoin, en tant que justiciables, d'être convaincus que l'on nous juge dans le respect de la loi et en toute indépendance par rapport à ceux qui requièrent de poursuivre. Or, ce qui peut expliquer la réaction corporatiste excessive - et à mon avis très encourageante pour apprécier la qualité des textes qui nous sont soumis - des magistrats, c'est que ceux-ci, et notamment les juges d'instruction, ont le sentiment, pas tout à fait erroné, qu'on leur fait un mauvais procès. Car lorsque l'on parle des dérives de la justice, que nous constatons tous les jours quels que soient les progrès incontestables qui sont par ailleurs accomplis, notamment sur le plan de l'égalité des citoyens, c'est le juge d'instruction qui est en permanence mis en accusation. Celui-ci est à la fois mythifié d'une manière absolument ridicule, considéré par les médias comme une personne intouchable, engagé dans une lutte sans merci contre tous les maux de notre société, à commencer par la corruption et, à l'inverse, souvent désigné comme le responsable de tous les dysfonctionnements de la justice pénale. C'est totalement faux et on oublie généralement le rôle majeur du parquet dans la procédure pénale. Je ne parle pas seulement des « affaires », mais des procédures pénales dans leur plus grand nombre, qui mériteraient effectivement d'être mieux régulées. Personnellement, en lisant attentivement ce texte, que je ne connaissais que par ouï-dire, j'ai été étonné par sa qualité. Nous autres, avocats, avons pourtant un esprit très prompt à la critique peu constructive. Sur des questions pratiques, ce texte propose des avancées. Même si celles-ci peuvent paraître négligeables pour des gens qui, comme vous je l'espère, ont la chance de ne pas connaître la justice pénale, elles sont significatives. Je donne un exemple de ces anachronismes auxquels nous sommes quotidiennement confrontés. Savez-vous que quand un détenu écrit à son avocat pour lui demander d'assurer sa défense, celui-ci ne peut pas présenter la lettre au juge d'instruction pour avoir accès au dossier ! En effet, la loi dispose que le détenu doit écrire directement au juge. Compte tenu du mode de fonctionnement habituel de la justice, ce courrier passe entre les mains du vaguemestre puis est acheminé par fourgon et arrive à destination au bout de trois ou quatre jours. Cela peut paraître insignifiant, mais il aura fallu attendre ce texte pour modifier cet état de chose, ce à quoi les avocats n'avaient même pas songé. Il existe de nombreuses trouvailles comparables. En ce qui concerne la présomption d'innocence, je partage l'avis de M. Thierry Renoux : ce qui est intéressant dans ce texte, c'est qu'il fait de la présomption d'innocence le principe dont doit découler tout le fonctionnement de la justice. Alors qu'en l'état actuel des choses, je considère que la présomption d'innocence n'existe pas dans notre justice pénale. C'est un principe fondamental, mais qui est bafoué quotidiennement, d'une manière quasi mécanique. À mon sens, une bonne réforme de la justice doit faire en sorte que ce principe se traduise concrètement dans la réalité. Nous avons bien vu que la loi de janvier 1993, qui est d'ailleurs une très bonne loi, n'a pas suffi. On s'est contenté d'un changement de terminologie, passant de « inculpé » à « mis en examen ». Or, pourquoi a-t-on changé cette terminologie ? Parce que M. Michel Sapin, vérifiant dans le Robert le sens du mot « inculpé », avait lu cette définition : « présumé coupable » ! Il est évident qu'aujourd'hui le « mis en examen » est tout autant présumé coupable. Alors comment faire ? Je crois qu'il y a déjà, indiscutablement, des écueils à éviter : or, ce texte les évite. Le principal était de solenniser, voire de « judiciariser » davantage, le moment de la mise en examen. Il faut que celle-ci soit considérée de plus en plus comme le moment de l'ouverture des droits, et de moins en moins comme une phase de pré-jugement, donc de pré-condamnation. Quant aux droits qu'il conviendrait de renforcer, j'enfoncerai une porte ouverte en disant que la plus grave entorse à la présomption d'innocence, c'est la détention provisoire. Ce qui choque les professionnels les plus avertis, voire les plus cyniques, dans le fonctionnement de la justice pénale, c'est la façon dont la détention provisoire est ordonnée et prolongée, pas seulement par le juge d'instruction, mais aussi par la chambre d'accusation. Quel que soit le degré de conscience des magistrats qui la prononcent, je le dis en assumant totalement la responsabilité de mes paroles, la détention provisoire est parfois requise dans une indifférence absolue et dans un mépris total du droit des gens, surtout des plus faibles. Je suis particulièrement favorable à l'instauration d'un juge des libertés. Pourquoi ? Parce que je crois qu'il faut être réaliste - peut-être l'êtes-vous davantage que nous - on ne peut pas passer à un système accusatoire du jour au lendemain. Je le dis en tant que fondateur et ancien président de l'Association des avocats pénalistes, bien que je ne veuille me parer d'aucun titre : nous sommes absolument incapables d'assumer un système accusatoire avant dix ans, que ce soit du point de vue matériel, de la compétence ou de la déontologie. Les rapports sont actuellement trop mauvais entre les juges et les avocats pour permettre à ces derniers d'assumer un rôle dans l'enquête, quel qu'il soit. Dans la mesure où nous ne nous situons pas dans une alternative entre une procédure inquisitoire et une procédure accusatoire, je considère donc que le juge des libertés est absolument fondamental. Il faut tout faire pour rendre la détention provisoire plus difficile à ordonner et pour garantir davantage le droit des gens face à cette décision. Je trouve l'attitude des magistrats excessivement corporatiste à l'égard de ce projet de réforme. Les juges d'instruction, qui en privé acceptaient l'idée d'être peu à peu libérés de cette responsabilité, se sont cristallisés sur cette question, comme si la grandeur de la fonction de juge d'instruction n'était liée qu'à ce pouvoir d'incarcérer. Pourtant, ce texte défend le juge d'instruction, d'abord parce qu'il maintient son existence, et ensuite parce qu'il en fait le juge qui peut libérer. Le juge des libertés ne sera pas saisi lorsque le juge d'instruction aura décidé de libérer la personne mise en examen, soit en décidant de ne pas l'incarcérer au début de la procédure, soit en faisant droit à sa demande de mise en liberté. C'est donc un texte qui protège le juge d'instruction, même s'il dérange sa pratique routinière, avec des règles telles que le calendrier prévisionnel, tout en garantissant indiscutablement mieux le citoyen contre les abus de la détention provisoire. Je ne partage pas l'idée de M. Antoine Garapon, qui est cependant un des rares magistrats à accepter la critique avec autant de facilité - ils ne sont pas très nombreux, ceux qui ont pour métier de juger les autres, à accepter qu'on les juge. Le juge des libertés n'est pas une troisième partie au procès mais, à la limite, un troisième degré de juridiction, encore que cette expression soit excessive d'un point de vue strictement juridique. Par ailleurs, j'estime qu'il est indispensable de permettre la présence de l'avocat dès la première heure de garde à vue. Si l'on peut reprocher quelque chose au projet de réforme, c'est d'être encore trop timide en ce domaine. Je crois qu'il faudrait « judiciariser » un peu plus la garde à vue, en autorisant l'avocat à être présent au moment de son renouvellement et en lui donnant accès au dossier. Peut-être vos débats permettront-ils d'avancer sur ce point. Il faudrait également réfléchir à un régime juridique plus précis et plus rigoureux. Notamment, on oublie trop souvent que cette procédure est facultative. Quant à la phase du jugement, tous les professionnels de la justice, et probablement aussi les citoyens, sont pour l'introduction d'une plus grande part de contradictoire dans le débat, ce qui est une réforme indispensable. Mme la Présidente : Je vous remercie pour ces interventions très riches. Ce qui me frappe personnellement, c'est que chacun d'entre vous a placé le souci démocratique au c_ur du jugement qu'il porte sur ces textes, approche que nous partageons également. Mme Christine Lazerges : Il est vrai que le chantier de la réforme de la justice est immense, et qu'il comporte encore des vides. Nous en convenons. S'il le faut, un certain nombre de députés feront les propositions nécessaires pour les combler, notamment en ce qui concerne l'appel dans les affaires criminelles. Ne croyez pas que nous laisserons passer cette législature sans nous inquiéter du sort de ce projet. Certains pensent que nous sommes au milieu du gué, soit parce que nous ne traitons pas tous les problèmes, soit parce que nous ne les traitons pas jusqu'au bout. Je crois qu'il faut être très attentif sur ce point. Concernant le C.S.M., il me semble très important de rappeler que cette institution est à la fois un conseil et une juridiction, et que son existence est la traduction directe du principe d'égalité, lequel doit être conjugué avec la présomption d'innocence. À ce titre, je trouve symboliquement significatif que le nombre de magistrats siégeant au C.S.M. soit légèrement inférieur à celui de personnalités extérieures, et je sais gré à M. Antoine Garapon de l'accepter. Est-il possible de travailler dans un conseil comprenant vingt et un membres ? La question de M. René Rémond est importante. Nous avons, l'un et l'autre, siégé au Conseil national des universités, dans des sections différentes, où nous avons fonctionné suivant les années à dix-huit ou à trente-six. Je reconnais que ce dernier chiffre rend le déroulement des débats assez délicat et que nous nous en remettions généralement au rapporteur. A dix-huit, par contre, nous pouvions travailler. Vingt et un, ce n'est pas si éloigné, mais il s'agit d'un nombre maximum. Il faut aussi, si l'on veut que la présence de non-magistrats au C.S.M. ait un sens, que ceux-ci soient également déchargés professionnellement pendant la durée de leur mandat. M. René Rémond a raison d'insister sur ce point qui est une conséquence logique de l'extension des attributions du Conseil. Je souhaiterais poser une question d'ordre juridique à M. Thierry Renoux : peut-on imaginer que la loi organique instaure deux formations ? J'aimerais avoir la réponse tout de suite, pour être rassurée - ou inquiétée ... M. Thierry Renoux : C'est tout à fait possible, mais à mon avis, il faudrait que cela soit inscrit dans la Constitution. En effet, le Conseil supérieur de la magistrature actuel a pris l'habitude de siéger en assemblée plénière, ce qui n'était pas prévu dans son statut, pratique qui a d'ailleurs été très critiquée. C'est pourquoi il me semble que la Constitution devrait prévoir que le Conseil peut siéger en deux formations restreintes, sans qu'il soit nécessaire de préciser davantage. La seule difficulté est d'éviter que le nombre de magistrats diminue à cause de cette séparation. Mais c'est un problème purement technique. Mme Christine Lazerges : Un mot encore sur la politique pénale. Bien sûr, celle-ci doit se décliner au niveau local. Mais cela n'empêche nullement de définir au plan national une stratégie de réponse aux phénomènes criminels, à l'initiative du garde des sceaux. À propos du juge des libertés, nous serons très attentifs, au sein de la commission des lois, à ne pas créer une « usine à gaz ». Il en est de même en ce qui concerne les deux commissions de recours citoyen. Il y a sans doute un travail de simplification à faire, tout en restant très attachés à ces projets. Pour terminer, je dirais que j'ai été un peu étonnée que personne ne mentionne une disposition qui est, à mon sens, tout à fait capitale. Il s'agit de celle qui rend plus facile l'accès au droit en instaurant la compensation judiciaire et qui multiplie les formules procédurales en amont du déclenchement des poursuites. Sur le plan pratique, c'est peut-être le volet primordial. M. Antoine Garapon : C'est effectivement une avancée significative. Cela dit, les garanties sont tellement nombreuses qu'elles risquent de décourager les procureurs de se lancer dans la compensation pénale. Je me demande s'il ne faudrait pas mieux consacrer le droit d'admonestation du procureur, qui existe déjà dans la pratique. M. Louis Mermaz : Il a été dit que toute réforme de la justice devait être faite pour le justiciable et non pour le juge. C'est un principe de base. L'ensemble des textes qui nous seront soumis me semblent marquer un progrès, mais ils ne vont sans doute pas aussi loin que certains d'entre nous le souhaiteraient. Nous savons bien que le projet de loi sur la réforme du Conseil supérieur de la magistrature résulte d'un compromis entre le Premier ministre et le président de la République ; tout est donc déjà joué, mais le débat parlementaire permettra d'apporter un éclairage à cette réforme. Je voudrais demander aux divers intervenants présents ce matin comment assurer l'indépendance des magistrats, laquelle représente une garantie pour le justiciable. Les députés sont soumis au suffrage universel, le Gouvernement, théoriquement, est responsable devant législatif, mais qu'en est-il juges ? Devant qui sont-ils responsables ? On pourrait envisager de les élire, mais l'importance du Front national rend cette éventualité hasardeuse. Un magistrat, parmi les plus progressistes, a dit, dans une interview à Libération, que c'est le droit et la conscience des juges qui fondent leur indépendance. Je trouve cela un peu court. François Mitterrand demandait souvent aux magistrats, pour les taquiner, d'où leur venait leur vocation. C'est une bonne question, car le pouvoir de juger est redoutable. Je pense qu'il faut davantage de personnalités issues de la société civile au sein du Conseil supérieur de la magistrature. Pour ma part, je suis également favorable à la possibilité de faire appel des décisions des cours d'assises. L'argument financier n'est pas soutenable car les libertés individuelles n'ont pas de prix. Certaines décisions m'ont laissé perplexe - je pense à l'affaire Omar Raddad. A ce sujet, je note que si le président de la République envisage de l'élargir et de le renvoyer dans son pays, c'est que lui aussi a des doutes. Il faut souligner au passage que la mission du juge est aussi d'adapter les textes. Ainsi, de lourdes peines sont prévues à l'encontre de la personne qui ne respecte pas les réglementations en matière d'éclairage de façade, mais les juges n'appliquent jamais ces peines. La présomption d'innocence est souvent malmenée par le système inquisitorial qui donne une place importante aux aveux. En lisant la presse, on découvre que des personnes maintenues en détention provisoire sont libérées le jour où elles passent les aveux qu'on attendait d'elles. La détention provisoire devrait rester exceptionnelle, or le code de procédure pénale donne une grande latitude au juge. A ce sujet, je rappelle que l'Assemblée nationale a voté une proposition de loi de notre collègue Alain Tourret. En matière de presse, je crois qu'il est préférable de légiférer le moins possible. On peut en effet voir une garantie pour le justiciable dans le fait que les médias parlent de lui. A cet égard, rappelons-nous que l'embastillement consistait à enfermer les gens dans le plus grand secret. Si la presse est fautive, parce qu'elle calomnie par exemple, les lois actuelles sont suffisantes. Il n'y a qu'à voir l'exemple de ces deux journalistes du Canard Enchaîné qui ont été poursuivis en justice pour leurs écrits. Par ailleurs, lorsqu'il y a des fuites, la faute doit être recherchée chez l'auteur de la fuite, pas chez le journaliste, sauf si, bien entendu, celui-ci a utilisé des moyens frauduleux. M. Michel Hunault : L'ambition affichée est d'améliorer le fonctionnement de la justice, mais est-ce que les moyens suivront ? Je me souviens, lors de la précédente législature, avoir entendu Me Temime faire le même plaidoyer que ce matin et malheureusement, les choses n'ont guère changé depuis. Il ne faut pas perdre de vue le contexte dans lequel s'inscrit cette réforme. La démocratie est aujourd'hui malade et ce n'est pas un hasard si certaines des plus hautes personnalités de l'Etat sont mises en examen. Une réforme de la justice doit aujourd'hui viser deux objectifs : redonner à nos concitoyens confiance dans la justice et mieux protéger les libertés individuelles. Je me demande si le texte qui nous est soumis répond à cette double préoccupation. Je voudrais surtout revenir sur les propos de M. Thomas Ferenczi. Je suis personnellement choqué d'apprendre par voie de presse la mise en examen ou la garde à vue de quelqu'un. J'y vois une négation des libertés individuelles les plus essentielles car tout le monde ne sait pas que la mise en examen n'est pas un jugement sur la culpabilité d'une personne. La France a beaucoup à faire pour mériter son titre de pays des droits de l'homme quand on sait que 40 % des personnes se trouvant en prison sont en détention provisoire, ou encore que quatre à cinq prévenus s'entassent parfois dans des cellules prévues pour deux personnes. Je suis favorable à des mesures qui favorisent le respect des libertés individuelles, telles que la présence de l'avocat dès les premières heures de la garde à vue ou l'accès aux dossiers pour les mis en examen ... Si l'on tolère les mises en examen par voie de presse, il faut décider que le secret de l'instruction n'existe plus. Vous avez dit, M. Ferenczi, que, dans votre fonction critique par rapport au pouvoir, vous vous appuyez sur les juges. Il serait également souhaitable de tenir compte d'autres sources. Je vais vous donner un exemple très concret. Lors de la précédente législature, j'ai été le rapporteur de la commission des lois sur un texte relatif au blanchiment de l'argent. Un délit de blanchiment a finalement été voté, à l'unanimité, par l'Assemblée nationale. Un de vos collègues a consacré son émission, La marche du siècle, à la corruption. A cette occasion, il aurait été souhaitable d'y rappeler la contribution de la représentation nationale à la lutte contre ce fléau. Dans ce domaine, et plus précisément dans celui des marchés publics, les textes sont encore à améliorer. Est-ce en révélant que madame une telle a reçu 200.000 francs pour un rapport ou que monsieur un tel a acheté des chaussures à 11.000 francs que les journalistes s'attaquent au fond du problème ? Toutes ces affaires minent notre démocratie. M. Michel Crépeau : On a coutume de dire qu'un mauvais arrangement vaut toujours mieux qu'un bon procès. De manière plus générale, je pense, et c'est un avocat qui parle, que moins on a affaire à la justice, mieux on se porte. Mais, la justice est un mal nécessaire, alors autant faire en sorte qu'il soit le moins douloureux possible. Pour atteindre cet objectif, on parle beaucoup de l'indépendance de la justice. N'oublions pas d'abord que la justice est un droit régalien qui, de ce fait, appartient à l'Etat. Que va-t-il lui rester si, au moment où la construction européenne implique des cessions de souveraineté, il ne peut même plus mettre son nez dans les affaires de la justice ? L'indépendance des magistrats doit s'entendre vis-à-vis de tous les pouvoirs. A cet égard, il ne faut pas oublier le pouvoir des médias et le pouvoir de l'argent. M. Jean-Marie Messier déclarait l'autre jour que le vrai pouvoir est celui des entreprises. Va-t-il vouloir un jour contrôler la justice, notamment celle rendue par les tribunaux de commerce, au nom de ce pouvoir ? L'indépendance des magistrats a son importance, mais il ne faut pas perdre de vue l'essentiel, qui est le respect des libertés individuelles. Il est loin d'être totalement assuré dans notre pays. D'ailleurs, je vais interpeller le ministre de l'intérieur lors de la séance des questions au Gouvernement de cet après-midi au sujet du rapport de la commission des droits de l'homme du Conseil de l'Europe qui condamne sévèrement la France pour la manière dont sont traités les gens dans les commissariats de police. Ce sont là des problèmes autrement plus importants que la réforme du Conseil supérieur de la magistrature. Je vais être très concret. Je prends l'exemple d'une personne gardée à vue. On lui enlève ses lacets et sa ceinture, puis on lui met des menottes, parfois sans raison. Souvenez-vous de ce brave moniteur de haute montagne qui, après un accident, s'est vu menotté comme un criminel et a vu son image aussitôt diffusée sur toutes les télévisions de France. C'est scandaleux ! Je prends ensuite l'exemple d'une personne qui entre en prison. Là, c'est encore pire. Elle est d'abord fouillée au corps, je vous passe les détails, puis elle est jetée dans une cellule où s'entassent cinq bonshommes qui doivent se partager un seul « chiotte ». Où est la dignité de l'homme dans des conditions pareilles ? L'Assemblée nationale a réussi, grâce a une « niche » parlementaire, à voter un texte limitant les cas dans lesquels la détention provisoire pouvait être prononcée, mais le Gouvernement s'oppose maintenant à ce que ce texte soit discuté par le Sénat. M. Louis Mermaz : Tout à fait. M. Michel Crépeau : Le Gouvernement nous concède des séances réservées à la discussion de propositions de loi, mais elles deviennent des niches au sens propre du terme. L'indépendance des juges, c'est d'abord l'obligation de réserve. Combien de fois a-t-elle été violée ? Qu'on se souvienne du juge Pascal à Bruay-en-Artois, du juge Lambert dans l'affaire de la Vologne ou du procureur de Valenciennes dans l'affaire Tapie. Les exemples sont nombreux. Le problème de la justice au quotidien retient aussi mon attention. On n'en parle pas beaucoup, mais les difficultés sont pourtant nombreuses. Par exemple, le justiciable qui fait appel d'une décision d'un conseil des prud'hommes devra attendre trois ans, en moyenne, avant que la chambre sociale de la cour d'appel se prononce. Pourquoi ne pas appliquer le système retenu dans le temps pour les décisions des juges de paix dont la juridiction d'appel était le tribunal de grande instance ? Les difficultés dans les affaires familiales sont similaires. Autre exemple, celui des tribunaux administratifs qui, de plus en plus, se substituent aux maires en matière de permis de construire. Les recours en ce domaine étaient auparavant seulement jugés en excès de pouvoir, mais maintenant, les juges se prononcent en opportunité. Il suffit désormais qu'une association de « tordus » plus ou moins « verts » intente un recours et le projet du maire est saboté. Quelle que soit l'issue du procès, l'argent du contribuable aura été gaspillé et les emplois auront disparu, tout cela sans aucune conséquence pour l'association en question, car même si elle est condamnée pour procédure abusive, elle ne paiera rien puisqu'elle n'a pas un sou. Je suis heureux d'avoir entendu reconnaître par un magistrat, M. Antoine Garapon, que le corps des magistrats est un des plus politisés qui soit, évidence que l'on s'acharne à nier en haut lieu. Je voudrais rappeler, en ce qui concerne les rapports entre le parquet et la chancellerie, que le garde des sceaux n'intervient pas dans 99 % des cas. Il le fait de manière ponctuelle pour des cas politiques. C'est à lui de porter toute la responsabilité de telles interventions, mais ce n'est pas le simple citoyen qui doit être victime du corporatisme des magistrats. Pour finir, je souligne que la liberté de la presse va de pair avec la responsabilité des journalistes. M. Pierre Albertini : Je voudrais d'abord m'adresser à M. Thomas Ferenczi. Comment favoriser le respect d'une déontologie par les journalistes ? Je ne crois pas qu'un texte législatif ou réglementaire puisse y parvenir. Or, un tel objectif est primordial à l'heure où de grands groupes concentrent les vecteurs de diffusion de l'information. S'agissant du Conseil supérieur de la magistrature, je m'interroge, plus que sur sa composition, sur la dichotomie entre la procédure de proposition et la procédure d'avis conforme alors même que l'exposé des motifs du projet de loi se fonde sur l'unité du corps de magistrature. Enfin, on a peu parlé des rapports entre la justice et la police, question qui me paraît très importante. Pour conclure, je voudrais vous faire part de mon scepticisme quant à la réussite de cette réforme. Pour y parvenir, les citoyens doivent avoir confiance dans leur justice, or c'est loin d'être le cas. Si l'on envisage l'appel des décisions des cours d'assises, il faut savoir, je l'ai déjà dit il y a dix-huit mois, que les moyens ne seront pas suffisants. De toute façon, une telle réforme ne me paraît pas prioritaire. Je crois à la réforme des mentalités, à la justice au quotidien plus qu'aux grands principes qui se révèlent être souvent des fictions. M. Henry Jean-Baptiste : J'ai été particulièrement intéressé par les propos de M. Hervé Temime sur la présomption d'innocence. Il a souligné que la mise en examen créait dans l'esprit de l'opinion publique une présomption de culpabilité. Il est frappant de constater, à l'époque de la justice-spectacle, que si la mise en examen est largement rapportée par les médias, le non-lieu est très souvent passé sous silence d'autant plus que celui qui en bénéficie adopte la plupart du temps un comportement de coupable en se faisant le plus discret possible. Comment procéder, dans ces conditions, à une compensation judiciaire, pour reprendre l'expression de Mme Christine Lazerges, permettant de rétablir la vérité en matière de justice pénale ? M. René Rémond : Sur la remarque de M. Pierre Albertini concernant la dichotomie entre le pouvoir de proposition, pour les magistrats hors hiérarchie principalement, et l'avis conforme, je rappelle que la frontière a été déplacée. Lorsque j'étais membre du Conseil supérieur de la magistrature, le pouvoir de proposition ne concernait que les premiers présidents de cour d'appel et les magistrats du siège de la Cour de cassation. Cette liberté d'initiative était en fait limitée car nous ne pouvions puiser que dans le vivier des présidents de tribunaux de grande instance. Dans le projet, le pouvoir de proposition est étendu aux présidents de tribunaux de grande instance. Le problème ne se retrouve-t-il pas alors reporté en amont ? Mais aller plus loin signifierait que la gestion des carrières se trouverait transférée de la chancellerie vers le Conseil supérieur de la magistrature qui devrait alors être doté d'une administration et composé de membres à plein temps. Ce serait un changement profond qui ferait du conseil une autorité chargée de gérer la carrière de 6.000 magistrats. Or, la tâche du Conseil supérieur de la magistrature est déjà bien lourde. Par exemple, pour l'avis conforme, le conseil délègue un de ses membres pour consulter le dossier et présenter un rapport. Mais la question reste posée. Le Conseil, gardien de l'indépendance des magistrats, ne risque-t-il pas de tomber dans la dépendance corporative ? C'est un risque et je souscris à la réserve de M. Antoine Garapon sur le mode de scrutin. Il faut éviter qu'un groupe quelconque puisse avoir une hégémonie. Toutefois, je ne suis pas pessimiste. Les membres nommés échappent toujours assez rapidement à l'autorité de désignation quelle qu'elle soit. De plus, la présence de personnalités extérieures est une garantie et je ne pense pas qu'il s'agisse avant tout d'un rapport de force numérique : la présence de quelques personnalités bien choisies suffit à modifier profondément l'équilibre. Il faut enfin souligner que les problèmes d'interventions ne se posent que de façon très marginale alors que l'opinion s'imagine que l'indépendance des magistrats est constamment menacée. Un des éléments de cette indépendance réside dans la formation dispensée par l'Ecole nationale de la magistrature. Leur conscience doit être éduquée à ce moment-là. Aucun texte ne pourra se substituer à la liberté de décision du magistrat. M. Thomas Ferenczi : Il ne faut pas accuser la presse des dysfonctionnements de la justice. C'est vrai pour la présomption d'innocence : c'est avant tout la procédure pénale qui y porte atteinte. C'est vrai aussi pour l'usage des menottes. On a parlé de mise en examen par voie de presse. En tant que journaliste, ce qui m'importe, c'est l'exactitude de l'information. Si elle est exacte, j'estime que j'ai bien fait mon travail. Il y a certes là une violation du secret de l'instruction, mais le journaliste n'est pas tenu à ce secret. De plus, l'enquête parallèle menée par le journaliste peut être une garantie pour le justiciable, M. Louis Mermaz l'a rappelé, en permettant de débloquer des dossiers. Il faut par ailleurs bien comprendre que tel ou tel élément que nous rapportons - vous évoquiez, M. Michel Hunault, les chaussures de M. Roland Dumas ou le rapport de Mme Tiberi -, font partie d'un ensemble. Derrière ces faits en apparence mineure, il y a d'un côté l'affaire Elf et de l'autre celle de la mairie de Paris. Mme la Présidente, vous avez posé la question de la vie privée. Celle-ci doit être une barrière infranchissable, mais les frontières de la vie privée d'un homme public sont difficiles à définir. L'exemple de François Mitterrand est éclairant : Le Monde a considéré que sa vie amoureuse relevait de la vie privée, mais que sa maladie, qui pouvait affecter ses fonctions, devait être divulguée. L'exemple américain dans ce domaine risque de nous conduire sur un mauvais chemin. Vous avez aussi évoqué l'indépendance du journaliste par rapport aux grands groupes industriels. Le projet de Mme Trautmann, qui propose une sorte de loi antitrust, quoique je n'en connaisse pas encore les détails, est important. Pour lutter contre les dérives commerciales des journaux, il faut éviter toute confusion entre le pouvoir économique et celui de la presse. Par ailleurs, si je suis favorable à la constitution de grands groupes de communication, il me paraît dangereux que des groupes industriels, qui ont vocation à traiter avec l'Etat, possèdent des outils de diffusion de l'information. En ce qui concerne la déontologie, des textes existent et les magistrats sont là pour qu'ils soient respectés. De plus, il est exact que tout ce qui favorise l'indépendance des journalistes par rapport au pouvoir de l'argent va dans le sens d'un plus grand respect de la déontologie. Monsieur Jean-Baptiste, vous avez raison de souligner que les non-lieux ne sont pas annoncés par la presse de façon aussi spectaculaire que les mises en examen. Je souhaiterais dire pour conclure que les journalistes attendent du Parlement qu'il les encourage à remplir leur devoir d'enquêter sur des vérités cachées plutôt qu'il ne les en dissuade. M. Thierry Renoux : Je voudrais répondre à la question de la responsabilité, qui me paraît fondamentale. En effet, il ne saurait y avoir d'indépendance sans responsabilité. Cependant celle des différents pouvoirs publics constitutionnels n'est pas nécessairement la même. Celle de l'exécutif n'est pas la même que celle du législatif, et même au sein de ce dernier, il faut distinguer entre les deux assemblées du Parlement. Il en est de même pour les juges : les mécanismes de mise en jeu de leur responsabilité peuvent être différents. J'observerai, par ailleurs, qu'il n'y a pas de corrélation forte entre le nombre de non-magistrats siégeant au Conseil supérieur de la magistrature et le corporatisme de l'institution. À ce sujet, je souscris pleinement à ce qu'a dit M. René Rémond. Sur les neuf membres du Conseil constitutionnel, six procèdent d'une nomination parlementaire. Cela ne l'empêche pas de décider que certaines lois sont contraires à la Constitution. Ce n'est pas parce que l'on est nommé par le président de l'Assemblée nationale ou par celui du Sénat que l'on dépend de l'un ou de l'autre. Une distanciation finit par apparaître. J'observe, d'ailleurs, que le Conseil constitutionnel n'est responsable devant personne. Il existe une responsabilité des magistrats devant le Conseil supérieur de la magistrature, qui est une responsabilité disciplinaire. Il en existe également une devant la loi : si une jurisprudence ne convient pas, le législateur a la possibilité d'obliger, par la loi, le juge à en changer. Enfin, il y a une responsabilité devant le peuple. En effet, la grande différence entre notre système et le système américain, par exemple, c'est que dans le nôtre, même le Conseil constitutionnel ne peut empêcher que l'on modifie la Constitution si sa jurisprudence ne convient pas. Tandis qu'aux États-Unis, où les membres de la Cour suprême sont nommés à vie et sur critères politiques - ce qui autorise à poser la question de leur légitimité, surtout au bout de dizaines d'années d'exercice de leur mandat - il n'y a aucune révision de la Constitution lorsque la Cour suprême s'est prononcée. Du moins, le cas ne s'est-il présenté qu'une seule fois. La légitimité du juge tient donc au fait qu'il n'a pas le dernier mot. Le dernier mot appartient au législateur, et donc au peuple. Cette légitimité est donc à la fois technique et démocratique. J'observe d'ailleurs que, contrairement à ce que l'on croit, en France, la plupart des juges sont élus. Il existe 24.000 juges non professionnels - conseillers prud'homaux, membres de tribunaux de commerce ou de tribunaux paritaires de baux ruraux, etc. - qui sont élus, contre un peu plus de 6 .000 magistrats de carrière. Cela étant, l'élection n'implique pas forcément une meilleure qualité de justice. J'observe d'ailleurs que le C.S.M. n'est pas compétent à l'égard de ces juges occasionnels, ce qui est à mon avis un défaut qu'il conviendrait de corriger. Je terminerai en soulignant qu'il ne s'agit pas, face à la dérive à laquelle nous assistons dans notre démocratie, de substituer à la responsabilité politique la responsabilité judiciaire. Ce n'est pas parce que la responsabilité politique ne fonctionne plus depuis des années - et il est important de se demander pourquoi - qu'il faut demander au juge de combler ce vide. Enfin, sur la question de la nomination des parquetiers, il va de soi qu'un pouvoir de proposition du C.S.M. aurait pu être envisagé, mais la substitution de l'avis conforme à l'avis simple est déjà un progrès. Et si on parle déjà de corporatisme au sujet des magistrats, que dirait-on si on accordait ce pouvoir de proposition au C.S.M. ? C'est le cas en Italie, où l'homologue du Conseil supérieur de la magistrature exerce toute la gestion du corps, y compris pour le parquet, et se substitue ainsi au ministère de la justice. La question est donc de savoir si l'on veut garder ou non le ministère de la justice. M. Antoine Garapon : Il a été posé une question sur la police judiciaire. J'attire simplement votre attention sur la discordance entre le libellé prometteur de l'avant-projet de loi, évoquant le contrôle de l'autorité judiciaire sur la police, et le contenu de la réforme qui est beaucoup plus modeste. M. Hervé Temime : Je suis tout à fait d'accord avec M. Jean-Baptiste en ce qui concerne le non-lieu. J'y vois deux raisons fondamentales : la première est que pour les journalistes d'investigation, même s'il ne faut pas les mettre tous dans le même sac, c'est une non-information, cela ne les intéresse pas. Autant ils nous harcèlent pour savoir s'il est vrai qu'un de nos clients va être mis en examen, autant ils se renseignent à peine sur les décisions de non-lieu, si ce n'est pour être bien sûrs que ce qu'on leur annonce est vrai. Deuxièmement, je ne sais pas si le comportement de la personne qui bénéficie d'un non-lieu est celui d'un coupable, mais c'est en tout cas celui d'une victime d'une procédure judiciaire que, coupable ou innocent, elle a vécu de manière très violente. Et elle n'a donc généralement pas envie que l'on en parle, de même que celui qui est diffamé ne souhaite pas forcément faire un procès à son diffamateur. Je voudrais répondre à M. Pierre Albertini, dont j'ai trouvé les observations très intéressantes. D'abord, je considère toujours que la réforme de la cour d'assises est totalement prioritaire. Ensuite, je suis tout à fait d'accord avec lui pour dire que nous rapprocher des grands principes est probablement moins utile que d'essayer d'améliorer la justice au quotidien. Mais si je peux poser sur votre assemblée le regard de quelqu'un qui a le plus grand respect pour les hommes politiques et le politique en général, je dirai que si votre travail ne devait consister qu'à prendre acte des changements de mentalité, avant d'approuver des textes préparés par des services ministériels qui ne font eux-mêmes que prendre acte du travail de conseillers techniques dans notre genre, cela signifierait qu'il y a plus de servitude que de grandeur dans votre mission, quels que soient les avatars judiciaires que vous pouvez connaître ou pas. M. Pierre Albertini : Ce n'est pas ce que je propose au Parlement ! M. Hervé Temime : Je n'en doute pas. Je crois que la difficulté consiste justement à insérer dans la loi des dispositions suffisamment pertinentes pour faciliter un changement de mentalité, qui est nécessaire. Je pense, sans aucune naïveté, que c'est possible, et nous sommes prêts à vous y aider, si nous en sommes capables. Mme la Présidente : Il me reste à remercier très vivement nos cinq invités. Je voudrais vous dire, messieurs, que vos réflexions vont constituer un socle solide sur lequel fonder nos travaux. Et puisque cette réforme va se décliner en de nombreux textes législatifs, et va donc accompagner nos travaux pendant plusieurs mois, voire pendant plus d'une année, je voudrais vous assurer que je veillerai personnellement à vous tenir informé de l'avancement de nos débats, afin que vous puissiez réagir, que ce soit à l'occasion d'autres auditions ou par les communications que vous voudriez nous faire parvenir. Sachez-le, une rencontre comme celle de ce matin n'est que le début de notre travail, et j'entends bien lui donner des suites. * * * La Commission a également procédé, le mercredi 4 novembre 1998, à l'audition de M. Noël Copin, journaliste au Journal La Croix, président de Reporters sans frontières, Mme Anne d'Hauteville, professeur à la Faculté de droit d'Avignon, M. Jean-Louis Pelletier, président de l'Association des avocats pénalistes, M. Serge Portelli et Mme Sophie Clément-Mazetier, juges d'instruction au Tribunal de grande instance de Créteil et M. Daniel Soulez-Larivière, avocat. Mme Christine Lazerges, rapporteur : Avant que nous ne donnions la parole à nos invités, je voudrais rappeler les grands axes du projet de loi renforçant la présomption d'innocence et les droits des victimes. Le point de départ réside dans l'article 9-1 du code civil selon lequel : « Chacun a droit au respect de la présomption d'innocence » ; or, ce respect ne nous paraît pas suffisamment préservé. Il est indispensable que le code de procédure pénale comporte la liste des principes généraux qui fondent la présomption d'innocence, et nous comptons procéder à un énoncé précis et pédagogique. Je note d'ailleurs qu'il est relativement curieux que cet énoncé se trouve actuellement dans le code civil et non dans le code pénal. Il est également nécessaire qu'en amont du déclenchement des poursuites, la garde à vue soit revue. La situation de la législation française n'est pas, à cet égard, satisfaisante au regard des exigences de la Convention européenne des droits de l'homme. Par ailleurs, il convient de revoir la situation du témoin assisté, qui n'est ni un témoin ni un mis en examen, mais appartient à une nouvelle catégorie d'acteurs sur la scène pénale, qui doivent pouvoir échapper, au moins provisoirement, à l'infamie de la mise en examen. Dans cette perspective, la communication sur le procès pénal doit être mieux encadrée, ce qui se traduit par la définition d'infractions nouvelles en la matière. Enfin, bien entendu, la place de la victime dans le procès pénal est confortée. Je n'ai pas encore évoqué l'institution d'un juge de la détention qui est souvent présenté comme l'aspect le plus novateur du projet de loi. Bien sûr, la question de la détention provisoire doit susciter un débat, mais je crois que c'est loin d'être le seul problème que soulève le projet de loi soumis à notre examen. Je remercie nos invités de s'être déplacés, souvent de loin, pour venir nous faire partager leurs réflexions et leurs questions. Nous avons le souci de consulter tous ceux qui peuvent éclairer nos travaux. J'ai déjà procédé à de très nombreuses auditions, mais au-delà de ce travail personnel du rapporteur, il me semblait nécessaire que la commission des Lois procède à une large audition publique. M. Noël Copin : C'est un redoutable honneur que d'être le premier à intervenir. Je précise d'abord que, si je ne pense pas être très original, je m'exprime, en tout cas, en mon nom personnel. Je suis ancien directeur de la rédaction de La Croix, président de Reporters sans frontières, mais notre association ne s'occupe pas directement de questions de cette nature. J'interviens donc surtout en tant qu'ancien membre de la Commission de réflexion sur la justice, couramment désignée du nom prestigieux de son président, M. Pierre Truche. D'abord, je voudrais dire que je suis très fortement attaché au principe de la présomption d'innocence et je ne pense pas, en cela, être original au sein de ma profession. Je le précise parce que, lorsqu'il est question de présomption d'innocence, on a peut-être un peu trop tendance à présumer tout journaliste coupable de vouloir y porter atteinte. J'observe que c'est lorsque quelqu'un commence à être présumé coupable, que l'on déclare qu'il a droit à la présomption d'innocence. Je sais que le terme « présomption » se trouve dans les grands textes sacrés, qui remontent à 1789, mais il vaudrait peut-être mieux dire que l'on traite comme innocent celui qui est présumé coupable, aussi longtemps que cette culpabilité n'a pas été reconnue et sanctionnée. Je suis satisfait de constater que, dans le même esprit que les travaux de la Commission Truche, le projet de loi ne donne pas la priorité au débat présomption d'innocence-liberté d'expression. La Commission Truche avait souhaité, en effet, commencer par aborder les atteintes à la présomption d'innocence qui découlent de la procédure pénale et de sa mise en _uvre, affirmant qu'elle était d'abord l'affaire du magistrat. Sur cet aspect-là, j'interviendrai rapidement car je ne suis pas juriste de formation. Je donnerai mon accord aux travaux de la Commission Truche et au contenu de ce projet de loi, notamment en ce qui concerne les droits de la défense ; je suis favorable à la présence de l'avocat dès la première heure de la garde à vue. J'ai un petit regret qui tient au fait que l'idée de l'obligation d'enregistrement de l'interrogatoire n'ait pas été conservée. Si je me réjouis que le lien soit coupé entre l'enquête et la décision de mise en détention, je regrette également que le principe de la collégialité n'ait pas été retenu, pour des questions essentiellement budgétaires. J'en arrive à l'aspect qui me concerne le plus en tant que journaliste, c'est-à-dire les rapports entre présomption d'innocence et liberté d'expression. Il me semble qu'il ne faut pas en faire une querelle de principe, encore moins un affrontement entre des personnes qui appartiennent aux professions judiciaires et à celle de journaliste. Me permettrai-je de critiquer ici les travaux d'une Commission parlementaire sénatoriale qui s'est penchée sur le sujet il y a quelques années ; affirmant l'égale importance des principes de la présomption d'innocence et de la liberté d'expression, elle suggérait néanmoins qu'il soit prévu que « la liberté d'expression s'exerce dans le respect de la présomption d'innocence », ce qui serait une manière de reconnaître que l'un de ces principes est plus égal que l'autre, si je peux me permettre cette plaisanterie. En fait, il me semble que ces deux principes, que l'on oppose parfois, relèvent l'un et l'autre des droits de la personne, le premier définissant le droit d'être respecté dans sa vie privée et son honneur, le second le droit de tout citoyen de disposer des informations qui doivent lui permettre d'agir en tant que tel. Je n'ai pas de solution toute faite pour déterminer où il convient de tracer la ligne jaune. La question centrale est de savoir s'il est possible de distinguer, dans l'intention du journaliste de divulguer une nouvelle, non le désir de réaliser un scoop, ce qui est légitime, mais la volonté de provoquer un scandale ou de nuire à quelqu'un, du souhait d'informer le citoyen, ce qui est conforme à son rôle dans une société démocratique. A ce sujet, même si globalement mon appréciation est très positive, je voudrais formuler une critique sur une des dispositions du projet de loi. J'étais de ceux qui, au sein de la Commission Truche, souhaitaient que l'on interdise la diffusion de documents filmés ou photographiés de personnes menottées ou entravées, car je considère que c'est contraire à la dignité de la personne et que cela constitue donc une atteinte aux droits de l'homme. Mais, en choisissant de condamner les journaux ou les organes médiatiques qui vont diffuser de tels documents, on prend le fait pour la cause. La Commission Truche avait surtout insisté sur la nécessité de faire une application stricte de l'article 803 du code de procédure pénale, qui prévoit que nul ne peut être menotté ou entravé que s'il présente un danger pour autrui ou pour lui-même ou s'il est susceptible de tenter de prendre la fuite. Ce n'est que subsidiairement qu'elle évoquait la question de la diffusion des images. Or l'exposé des motifs du projet de loi mentionne d'abord le rôle des médias et n'envisage que deux pages et demie plus loin un aménagement de l'article 803 du code de procédure pénale incitant à prendre toutes mesures utiles pour éviter qu'une personne menottée ou entravée ne soit photographiée ou filmée. Je comprends, bien sûr, la raison de ce choix ; j'ai entendu de nombreuses personnes s'exprimer sur ce sujet et, assez récemment, dans un colloque, Mme Elisabeth Guigou : il est vrai qu'actuellement la responsabilité de tout incident retombe sur ceux qui sont chargés d'escorter le présumé innocent ou coupable, c'est-à-dire sur les policiers ou les gendarmes. Je crois cependant que l'on devrait être beaucoup plus strict et dire une fois pour toutes qu'il n'est pas permis de montrer en public une personne menottée ou entravée. Ce n'est qu'ensuite que l'on pourrait se prononcer sur la responsabilité des journaux et des organes de presse ou des médias qui publient de tels documents. A cet égard, j'approuve le choix qui est fait de ne pas mettre en cause le photographe ou le cameraman qui prendrait de telles images - parce qu'il ne peut dans l'instant vérifier qu'une personne est ou non menottée - mais de faire assumer la responsabilité au rédacteur en chef ou au directeur du journal qui prendrait la décision de diffuser ces images. M. Serge Portelli : Mme Sophie Clément-Mazetier et moi-même sommes juges d'instruction à Créteil, donc des praticiens depuis respectivement cinq et vingt-cinq ans. Nous souhaitons mettre notre expérience à votre disposition, en ayant pour objectif le service des libertés. C'est l'esprit qui nous a guidés dans la rédaction d'un certain nombre d'articles que nous avons publiés et envoyés aux membres de la Commission. Notre point de départ est la Convention européenne des droits de l'homme. Nous pensons que le code de procédure pénale français est très en retard par rapport aux principes posés par ce texte, qu'il viole même sur certains points. Il serait temps d'appliquer ce texte fondamental, de même que d'autres aussi fondamentaux que la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Nous pensons qu'il est difficile de faire confiance actuellement aux magistrats et d'attendre de la pratique que les grands principes soient réellement respectés. Nous sommes de farouches partisans de la loi, d'une loi beaucoup plus impérative, stricte, contraignante que celle qui existe actuellement, aussi bien en matière de garde à vue que de détention provisoire ou de mise en examen, voire de statut de la victime. Nous souhaitons que la justice, que nous vivons au quotidien, soit beaucoup plus humaine et c'est aussi à la loi qu'il appartient de l'humaniser. Pour autant, nous ne sommes pas de doux utopistes et si nous sommes partisans des libertés, nous considérons que la première d'entre elle est la sûreté. Chaque citoyen a le droit de vivre en sécurité, à l'abri des atteintes de la criminalité, mais il doit aussi être protégé d'une répression excessive. Nous souhaiterions vous présenter nos propositions, que nous avons déjà formulées par voie de presse et que nous vous avons transmises sous forme d'amendements. Le problème de la garde à vue nous paraît essentiel, parce c'est celui qui concerne le plus grand nombre de citoyens : 380.000 personnes environ ont été placées en garde à vue en 1997, dont 70.000 pour plus de 24 heures. Notre souci est de la rejudiciariser. Elle doit être effectuée par des officiers de police judiciaire. Lorsque cette procédure, déjà développée dans la pratique, a été créée en 1958, le code de procédure pénale en a subordonné l'exercice à une stricte condition d'équilibre. Si l'avocat était absent à ce moment capital qu'est l'arrestation, le juge, en revanche, devait être présent pour contrôler très étroitement la garde à vue. C'est ainsi qu'au bout de 24 heures, la personne gardée à vue doit, sauf circonstances exceptionnelles, être présentée au magistrat. Déjà en 1958, ces dispositions étaient en retrait sur la Convention européenne des droits de l'homme, qui venait d'être adoptée, et qui prévoit que toute personne arrêtée, privée de sa liberté, doit être aussitôt présentée au magistrat. Il serait donc au moins nécessaire que la loi soit appliquée et qu'au bout de 24 heures, 99 % des personnes soient présentées à un magistrat, pour qu'il contrôle les conditions de la garde à vue et, en même temps, dirige l'enquête. Or, en réalité, le gardé à vue n'est presque jamais présenté au magistrat qui est seulement consulté par téléphone. Il nous semble donc souhaitable que des dispositions plus contraignantes soient adoptées, qui auront inévitablement pour effet de faire diminuer le nombre de gardes à vue. Lorsque, en 1993, une loi a introduit l'avocat à la vingtième heure, le nombre de gardes à vue se prolongeant au-delà de ce délai a chuté en une année de 15.000. La sécurité ne souffrira en rien d'une baisse du nombre de gardés à vue. Il faut se garder de considérer la garde à vue comme une mesure ordinaire, alors que c'est une mesure terrible, particulièrement attentatoire à la liberté. C'est pourquoi il faut absolument éviter que les officiers de police judiciaire soient notés, comme ils le sont aujourd'hui, en fonction du nombre de gardes à vue qu'ils réalisent au cours d'une année. S'il est indispensable que l'avocat soit présent, notre idée aussi est de rejudiciariser la garde à vue en revenant à ce qui a été prévu par le législateur en 1958 et qui a été trahi par la pratique. S'agissant de la mise en examen, nous souhaitons qu'elle fasse l'objet d'une ordonnance motivée et susceptible de recours. Nous pensons qu'actuellement, la violation la plus grave du principe de la présomption d'innocence tient à la procédure de mise en examen, qui est l'une des mesures les plus attentatoires à la liberté et à l'honneur des personnes. Elle est, en effet, vécue, aussi bien par les personnes qui en font l'objet que par l'opinion publique, comme une véritable condamnation. Actuellement, si le juge d'instruction décide de mettre en examen n'importe qui, voire le président de la République, son seul souci est de prendre une date dans son agenda et d'envoyer une convocation. Cela ne nous semble pas compatible avec le niveau de protection des libertés que l'on peut attendre d'un pays comme la France. Obliger le juge à dire pourquoi il met en examen, c'est respecter la présomption d'innocence, qui suppose que celui qui accuse fasse le premier pas et non que la personne mise en examen ait à chercher désespérément pendant des mois et des années ce que le juge d'instruction a bien pu avoir en tête quand il l'a convoquée. Nous avons des exemples assez frappants de ce type de dérives dans l'actualité très récente. Actuellement, le juge d'instruction n'explicite ses motivations qu'au moment de l'ordonnance de non-lieu - il y a 7.000 à 8.000 non-lieux par an qui font suite à une mise en examen - ou de l'ordonnance de renvoi, qui intervient en moyenne dix-sept mois après la mise en examen. Or la loi interdit de faire appel de cette ordonnance de renvoi. Nous pensons également, et c'est indissociable, qu'il faut complètement revoir le statut du témoin assisté, non comme le fait le projet du gouvernement, mais d'une manière suffisamment attractive pour que le juge d'instruction change ses priorités et choisisse de recourir à cette procédure plutôt qu'à celle de la mise en examen. Il faudrait parvenir à changer les flux, de telle sorte qu'au lieu de 60.000 mises en examen par an, il n'y en ait plus que 30.000, tandis que les 30.000 personnes seraient placées en position de témoins assistés, ce qui protégerait réellement leur présomption d'innocence. J'en viens à la détention provisoire et, là aussi, je voudrais dire que nous n'avons confiance ni en nous-mêmes, ni dans nos collègues. C'est pourquoi nous souhaitons que la loi soit très contraignante. Le projet de loi prévoit d'instituer un juge des libertés qui répondrait à l'appellation peu gratifiante de juge de la détention. Je crains que ce ne soit pas en changeant de salle d'audience que l'on change de pratique. Il y a actuellement dans les prisons 15.000 personnes placées en détention provisoire sur ordre du juge d'instruction et 30.000 mises en détention provisoire sont décidées chaque année. Nous souhaitons nous aligner sur nos partenaires européens en faisant baisser sensiblement ces chiffres, qui devraient pouvoir être respectivement ramenés à 10.000 et 20.000, sans que la sécurité n'en souffre. Pour cela, il convient d'élever les seuils de détention encourus pour que les infractions les moins graves échappent à la détention provisoire. C'est la seule mesure efficace, alors que celle qui nous est proposée s'inspire de la loi de 1993, dont vous savez parfaitement qu'elle n'a rien changé. J'ajoute que, d'un point de vue budgétaire, il est dommage de mobiliser 70 postes de magistrats pour exercer les fonctions de juge de la détention, alors qu'ils seraient plus utiles ailleurs, pour sauvegarder les libertés. Outre l'élévation des seuils de détention encourus, il nous semble indispensable de limiter la durée de la détention provisoire à un an en matière en matière correctionnelle et deux ans en matière criminelle. On ne peut, en effet, au-delà parler de délai raisonnable. Il faut enfin que le projet de loi apporte une réelle amélioration au statut de la victime, point sur lequel il nous a le plus déçus parce qu'il ne comporte pratiquement aucune disposition significative. Nous souhaitons d'abord que la victime soit réellement informée afin qu'elle puisse faire valoir ses droits. Ainsi, lorsqu'une information est ouverte, le juge d'instruction doit prévenir la victime pour qu'elle puisse se constituer partie civile. Il faut aussi, quand un tribunal correctionnel ou une cour d'assises alloue des dommages et intérêts à une victime, que celle-ci sache qu'elle peut immédiatement en demander le versement à la commission d'indemnisation des victimes d'infractions. Beaucoup d'avocats ignorent cette procédure et même certains magistrats. Il importe aussi de faire savoir que la procédure de l'enquête de personnalité, qui existe déjà pour les personnes mises en examen et n'est d'ailleurs pas assez souvent mise en _uvre, peut également concerner les victimes. Il est anormal que, devant une cour d'assises, une personne décédée ne soit connue qu'au travers d'une photographie d'autopsie, alors qu'il s'agit d'une personne qui a eu une histoire, un passé. J'ai présenté l'essentiel des améliorations que nous souhaiterions voir apporter au projet de loi. Avec Mme Sophie Clément-Mazetier, nous pourrons aller au-delà lors de la discussion. Mme Anne d'Hauteville : Mon intervention se relie au dernier point évoqué par M. Serge Portelli. Je ne m'exprimerai pas tant, en effet, en qualité de professeur de droit pénal, qu'en tant que militante du mouvement associatif d'aide aux victimes. Je représente une association départementale et j'ai été présidente de l'Institution nationale d'aide aux victimes, dont je suis encore vice-présidente. J'ai évidemment consulté mes collègues pour pouvoir aussi m'exprimer en leur nom. Il est vrai que l'exigence d'information est essentielle, mais j'aimerais replacer la victime dans un cadre plus général et vous donner mon sentiment sur le projet de réforme, d'abord en me félicitant qu'à nouveau le législateur se penche sur la place de la victime dans le procès pénal. Lorsque celle-ci choisit de se constituer partie civile, c'est-à-dire d'être partie au procès pénal, elle le fait avec une double motivation. Si elle choisit la procédure pénale, alors qu'elle pourrait demander des dommages et intérêts dans le cadre d'une procédure civile, c'est d'abord parce qu'elle souhaite être présente au procès. Ensuite, elle le fait, bien sûr, pour demander réparation des dommages qu'elle a subis du fait de l'infraction. J'évoquerai successivement ces deux points en vous indiquant les modifications ou ajouts qu'il me semblerait souhaitable d'apporter au projet. S'agissant de la présence au procès pénal, elle ne sert pas à grand-chose si la victime n'est pas au courant de ses droits. L'objectif essentiel est donc qu'elle soit informée de l'existence des associations d'aide aux victimes, que le projet reconnaît comme partenaires de la justice, et des droits qu'elle peut exercer à tous les stades de la procédure judiciaire et même, en amont, de la procédure policière. Ce projet de loi - je m'en félicite - prévoit la possibilité pour la victime de présenter une demande de réparation aux services de police ou de gendarmerie lors d'une enquête de police. C'est une très bonne chose. Mais il est impératif - je suis favorable à une loi contraignante - que les services de police ou de gendarmerie informent les victimes, non seulement de leur droit de se constituer partie civile, mais aussi de l'existence de la commission d'indemnisation et d'associations d'aide aux victimes conventionnées par la justice, dont elles sont vraiment les partenaires. Il faut donc que les officiers de police judiciaire soient formés à cet effet. Nous y participons, mais laisser cela à des initiatives individuelles me paraît dommageable. Il serait nécessaire qu'il y ait une obligation d'information, qui pourrait peut-être revêtir la forme d'une lettre d'explications préparée par la Chancellerie, dont la remise à la victime serait mentionnée dans le procès-verbal de police. Il importe également - et le projet de loi devrait être précisé sur ce point - que, pour toute procédure, et non pas seulement dans le cadre de la troisième voie, le procureur de la République puisse s'appuyer sur les associations d'aide aux victimes et informer celles-ci qu'elles sont à leur disposition. Le service qu'elles rendent est totalement gratuit et reconnu par l'institution judiciaire. Il faut en outre que l'information des victimes se fasse à tous les stades de la procédure. Cette obligation incombe au juge d'instruction lorsqu'il reçoit une plainte avec constitution de partie civile, mais aussi lorsqu'il rencontre d'autres victimes qui n'ont pas déclenché l'instruction par constitution de parties civiles. L'information doit également avoir lieu au stade du jugement, et de plus en plus compte tenu de l'accélération des procédures, de la multiplication des comparutions immédiates, qui pose d'ailleurs des problèmes dont le projet fait état. Sans doute la prise en compte du droit des victimes ne doit-elle pas paralyser le cours de la justice pénale pour l'action publique, mais il est nécessaire que les victimes soient avisées du choix d'une procédure rapide. S'il n'est pas possible que l'action civile soit examinée en même temps que l'action publique, il faut prévoir un renvoi pour les intérêts civils, afin de donner à la victime la possibilité de présenter un dossier sérieux. Je voudrais aussi mettre l'accent sur la nécessité d'un accompagnement et d'un soutien psychologique. Une infraction pénale peut causer un traumatisme extrêmement fort, lourd pour la victime, tout comme le fait de se trouver confrontée à l'institution judiciaire. Bien sûr, les victimes sont soutenues par leurs avocats, mais nos services d'aide aux victimes proposent un accompagnement plus global, qui prend du temps, exige des explications, un soutien psychologique. A tous les stades de la procédure, il faut que cet accompagnement soit organisé. Enfin, toujours dans l'idée de donner toute sa portée à la présence de la victime dans le procès pénal, je crois qu'il faut insister sur le respect du principe de l'égalité des armes, issu de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Deux arrêts récents de la Cour de cassation rendus en 1997 ont affirmé ce principe à propos de l'article 546 du code de procédure pénale relatif aux voies de recours en matière de contraventions. La Cour a annulé l'ensemble d'une procédure, parce que seul le procureur général avait le droit de former un recours, ce droit n'étant reconnu ni à l'auteur de l'infraction, ni à la partie civile. Je pense que cette jurisprudence va s'étendre à d'autres textes du code de procédure pénale. Le principe de l'égalité des armes a été retenu par la Commission et par la Cour européenne. A mon avis, il va s'imposer à nos juridictions et au législateur. Il importe donc de revoir les dispositions du code de procédure pénale, tout au long de la procédure, à la lumière de ce principe. Je prendrai l'exemple de la réouverture d'une information sur charge nouvelle, sachant que c'est une question difficile et controversée. Actuellement, seul le procureur de la République dispose de ce droit, que la victime n'a pas. Je sais que de nombreuses constitutions de partie civile sont dilatoires et que les juges, au contact avec la réalité, ont du mal à contenir les actions vindicatives et dilatoires des victimes. Cependant, lorsqu'il y a véritablement des charges nouvelles, je ne vois pas pourquoi on ne reconnaîtrait pas à la victime le droit de demander au juge d'instruction de rouvrir l'information, de reprendre le dossier, quitte à consigner les frais du procès, comme pour la constitution de partie civile initiale devant le juge d'instruction, et à prévoir des sanctions en cas d'abus. J'en viens à la seconde raison qui conduit la victime à choisir la voie pénale, c'est-à-dire la volonté d'obtenir réparation. La Commission Delmas-Marty avait déjà affirmé comme principe fondamental, le droit d'obtenir effectivement réparation. Bien sûr, la réparation doit être recherchée d'abord auprès de l'auteur des dommages. La politique pénale, telle qu'elle est définie par la législation et mise en _uvre par les tribunaux depuis ces dernières années, n'oppose pas la réinsertion de l'auteur et la réparation demandée. Au contraire, dès lors qu'elle est supportable pour l'auteur, la réparation apportée à la victime peut participer à l'individualisation de la sanction et à la réinsertion du délinquant. Donc je pense que c'est une bonne chose et le projet de loi va dans ce sens. L'autorité compétente en la matière est évidemment le juge d'application des peines. La circulaire du ministère de la Justice de juillet 98 comprend un volet très intéressant sur ce point, qui insiste sur le développement des relations avec l'administration pénitentiaire, l'information du délinquant sur l'existence d'une victime, celle de la victime sur la situation du détenu, tout cela sous l'autorité du juge d'application des peines. Lorsque l'auteur n'est pas détenu, s'il bénéficie d'un sursis avec mise à l'épreuve, le juge d'application des peines se sent bien sûr encore compétent, mais ce n'est plus le cas lorsqu'il n'y a pas de mise à l'épreuve, parce qu'il ne souhaite pas être un agent de recouvrement des dommages et intérêts. Je le regrette parce que cela reste de sa compétence puisqu'il s'agit de l'application d'une peine. Si la victime est obligée de faire exécuter la décision de justice par elle-même, compte tenu du monopole, elle doit s'adresser à un huissier pour l'exécution forcée de la décision. Cela me semble une injustice fondamentale qu'il faut absolument réparer. Certes, les frais d'exécution des décisions de justice sont à la charge du condamné, mais la victime doit en faire l'avance, ce qui est insupportable, puisque la plupart du temps elle risque de les perdre, l'auteur étant insolvable. J'observe que la victime n'a pas à faire l'avance des expertises lorsqu'elle choisit la voie pénale. Il faudrait qu'il en aille de même pour les frais d'huissier, qui sont normalement à la charge de l'auteur et devraient entrer dans les dépens de justice si celui-ci est insolvable. Enfin, je voudrais évoquer la Commission d'indemnisation des victimes sur laquelle une réflexion est conduite par un groupe de travail institué au ministère de Justice. Je pense que lorsqu'une victime a tout fait pour faire exécuter les décisions de justice lui octroyant réparation, mais a laissé passer le délai de prescription d'un an prévu pour saisir la Commission, il faudrait reconnaître que c'est un motif légitime pour présenter sa requête. M. Daniel Soulez-Larivière : Je vais être très direct : je pense que ce texte est complètement sous-dimensionné ; c'est un cautère sur une jambe de bois, il court après l'événement. Il était déjà sous-dimensionné dans sa version première ; or il a réduit sa voile du fait de certaines vicissitudes, notamment des journées d'action d'associations et de syndicats de magistrats, dont la nature de l'activité me semble d'ailleurs mal définie du point de vue déontologique. En effet, autant on peut être satisfait, intéressé, passionné - ce qui est mon cas - par les travaux de M. Serge Portelli et de Mme Sophie Clément-Mazetier, autant on peut être surpris par les pressions exercées, qui ont abouti, au terme de discussions qui n'ont pas été menées au grand jour, au document insuffisant qui est proposé à l'examen du Parlement. Le projet de loi n'est pas satisfaisant parce que, d'une part, il ne tient pas compte d'une caractéristique essentielle de notre procédure, qui est la confusion des tâches juridictionnelles et de celles d'investigation et d'accusation, et d'autre part, il témoigne d'une méconnaissance de ce qu'est la défense. En ce qui concerne la confusion des tâches, elle s'illustre d'abord par la situation même du juge d'instruction, qui est à la fois investigateur et juge, comme le disait Robert Badinter, à la fois Maigret et Salomon. C'est le vice rédhibitoire de notre justice qui manifeste également son archaïsme par la confusion des tâches de l'accusation. En effet, le juge d'instruction est un accusateur, de même que le juge du siège qui, au cours du procès, passe son temps à exercer une contrainte psychique et verbale sur la personne qu'il interroge, alors qu'il va se retirer ensuite pour la juger. C'est une situation complètement aberrante et archaïque ; toute personne qui n'a jamais eu affaire à la justice et assiste à une audience, qui voit le résultat d'une instruction pénale, en ressort généralement épouvantée. Or, ce problème n'est pas traité par le projet de loi, qui se contente de redonner vie à l'ersatz de réforme résultant de la loi de janvier 1993, qui reprenait, sous forme homéopathique, certaines conclusions de la Commission Delmas-Marty, et avait suscité des menaces de grève du zèle des juges d'instruction. J'ai conservé quelques tracts qui, en substance, suggéraient aux magistrats de mettre en détention leurs « patients » pour montrer que le système ne marchait pas et bloquer l'institution du juge délégué. Je rappelle que ces réactions ont été efficaces, puisque la nouvelle majorité qui a succédé au gouvernement socialiste a abrogé la loi de janvier 1993, qui n'apportait pourtant qu'une réforme limitée par rapport à l'objectif qui aurait dû être atteint. Il serait donc nécessaire de remettre en cause la confusion des tâches entre l'accusation, l'investigation et le juridictionnel, et de reconstruire notre procédure pénale d'une manière plus fondamentale pour éviter l'écueil mis en lumière par la Commission Delmas-Marty dans ses conclusions : « Les membres de la Commission ont la conviction que le malaise actuel de la justice pénale tient moins à l'indifférence du législateur qu'à l'accumulation de réformes ponctuelles, partielles, ajoutant toujours de nouvelles formalités, de nouvelles règles techniques qui ne s'accompagnent ni des moyens matériels adéquats, ni d'une réflexion d'ensemble sur la cohérence du système pénal. » Le projet de loi méconnaît, par ailleurs, les réalités de la défense. Dans notre culture, le policier, le juge lui-même, bénéficient d'une certaine image de fonctionnaire public impartial. Dans ce système la défense n'a pas grand-chose à faire et constitue une espèce de pièce rapportée. Sous l'Ancien Régime, d'ailleurs, il n'y avait pas d'avocats, mais seulement des personnes qui développaient des mémoires écrits. La défense n'existait, ni à l'instruction, ni pratiquement à l'audience. Nous sommes encore dans cette logique. Lorsque l'on envisage la présence de l'avocat au cours de la garde à vue, on entend les mêmes critiques que celles qui étaient formulées en 1897 lorsqu'il a été introduit dans le cabinet du juge d'instruction : il s'agirait de désarmer l'Etat, d'assurer aux riches une défense dont les pauvres ne pourraient bénéficier, toute une série de sornettes répétées au cours des siècles. La réalité, c'est que le concept de défense individuelle n'est pas dans notre culture. Il en résulte une confusion dont je voudrais donner un exemple : le projet de loi prévoit que le procureur de la République est chargé de préparer les droits de réponse pour les personnes mises en cause. Pourquoi ne pas le commettre d'office pour les défendre ? Cela n'a aucun sens ! S'agissant de la garde à vue, sans doute est-il bon de faire venir un avocat dès la première heure. Mais il est tout aussi important de dire à la personne interrogée de quoi il s'agit. Car la garde à vue aujourd'hui est un jeu du chat et de la souris. La personne entendue ne sait pas vraiment ce qu'on lui veut. Il faudrait que les questions posées soient inscrites explicitement au procès-verbal et que celui-ci ne sorte pas, après 24 heures de garde à vue, sous la forme de deux pages complètement malaxées, qui ne restituent aucunement la vérité de ce qui s'est passé pendant un interrogatoire destiné à secouer le suspect et à lui extraire des aveux. Plutôt que de rassembler des preuves permettant de mettre en cause un suspect, il est hélas dans notre culture judiciaire de lui extorquer la vérité qu'on souhaite lui entendre dire. Au stade de l'instruction, je pense qu'il faut effectivement que l'ordonnance de mise en examen soit motivée. Cela me semble un scandale permanent que le juge d'instruction puisse garder pour lui, les faits qui justifient la mise en examen jusqu'à ce qu'il prenne une ordonnance de renvoi. Il m'arrive encore aujourd'hui de faire des demandes de non-lieu, en m'interrogeant sur ce que le juge reproche vraiment à la personne que je défends. Je suis, par ailleurs, très perplexe sur l'article 116 du code de procédure pénale, qui permet à la personne mise en examen de faire des déclarations spontanées. Je sais ce que cela veut dire trop souvent. Quoi qu'il en soit, je pense qu'il faut renforcer le rôle de la défense dans l'instruction pénale et obliger le magistrat instructeur à faire mention dans les procès-verbaux des incidents et des déclarations de l'avocat au cours des interrogatoires. Je pense qu'il faudrait également que la défense puisse exiger des audiences spéciales pour poser ses questions indépendamment de celles de l'instruction, plus de dix minutes avant le départ du greffier. S'agissant du juge délégué, il a été transformé en « croupion » dans le projet de loi qui vous est soumis. Au départ, il devait être un juge des libertés dont les pouvoirs se rapprochaient de ceux envisagés dans le rapport Delmas-Marty. Si politiquement il paraît impossible - je ne sais d'ailleurs pas pourquoi - de mettre en _uvre ce rapport, qui est le plus complet et le plus remarquable établi depuis 1988 sur le sujet, il faut au moins redimensionner le juge des libertés et le charger de tout ce qui est juridictionnel, c'est-à-dire de la mise en détention, des perquisitions ... C'est également à lui qu'il appartiendrait de décider, en cas de divergence, s'il convient de mettre une personne en examen ou de la placer en position de témoin assisté. Je voudrais aussi évoquer, même si c'est un petit détail, l'article 802 du code de procédure pénal, qui dispose que toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité, ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne. Une telle disposition fait appel à la subjectivité du juge. Il devient inutile d'invoquer une nullité parce que, dans la plupart du temps, les magistrats considéreront qu'elle n'a pas porté atteinte à la défense. Les décisions relatives à la garde à vue l'ont montré après l'introduction de ce texte. En ce qui concerne l'audience, je pense qu'il est indispensable de distribuer les rôles différemment. Il n'est pas possible de maintenir cette procédure de l'interrogatoire par le président, qui le transforme en acteur. Vous ne pouvez pas être juge et partie, accusateur et juge, interroger une personne dans le box des accusés pendant une journée ou deux et, ensuite, prétendre vous retirer pour délibérer. C'est au procureur qu'il appartient d'accuser, de poser ses questions, de traquer la personne prévenue ou accusée, d'exiger d'elle des réponses. Les juges doivent se taire ou, éventuellement, pour ne pas tomber dans les absurdités des systèmes accusatoires trop rigides, poser des questions. Il arrive qu'aux assises, les avocats généraux et les présidents décident de se répartir ainsi les rôles ; la justice a alors une autre allure. En France, elle ne souffre pas seulement de rendre des décisions injustes, comme dans toutes les sociétés, mais aussi de ce vice supplémentaire, qui est de rendre parfois des décisions justes qui paraissent injustes. C'est l'atteinte la plus catastrophique à la fonction judiciaire. Il n'est pas une seule affaire criminelle qui ne pose de problème aujourd'hui, qui ne suscite une sorte de mini ou de gros scandale, parce que les personnes qui assistent aux audiences ne comprennent pas que la justice se rende dans de telles conditions. Dans le cadre de la protection des victimes, il faut mettre fin à certains abus. Je voudrais évoquer celui qui permet aux parties civiles de citer directement à l'audience des personnes qui, soit ont été mises hors de cause pendant l'instruction, soit même n'ont pas été entendues. Je me réfère, par exemple, à l'affaire de Furiani dans laquelle le préfet de Haute-Corse, mis expressément hors de cause par la chambre d'accusation, a été cité directement devant le tribunal et s'est trouvé dans une situation tellement ambiguë sur le plan juridique que le président a précisé qu'il s'agissait d'un prévenu sous conditions suspensives, ce qui fera sourire les juristes. La jurisprudence de la Cour de cassation est totalement insuffisante. Lorsque le juge termine son instruction, il doit demander aux parties civiles si elles souhaitent d'autres mises en examen et, en cas de divergences, la chambre d'accusation doit pouvoir trancher définitivement. Sinon, ce n'est même pas la peine de maintenir une instruction. Au prochain accident de chemin de fer, toute la hiérarchie de la S.N.C.F. sera dans le box des accusés et la justice ne pourra pas être rendue. Si l'instruction ne sert à rien, il faut le dire et procéder par voie de citations directes à l'audience. S'agissant des droits des victimes, je crois - mais cette question n'est pas traitée par le projet de loi - qu'il faut revenir sur la confusion résultant de la jurisprudence de l'entre-deux guerres entre faute civile et faute pénale. La loi du 13 mai 1996 a tenté d'aborder ce sujet par un détour en précisant que pour être constituées, les infractions non intentionnelles doivent être le fait de personnes répondant à certains critères de pouvoir, de compétence, etc. Or la première décision rendue sur la base de cette loi par le tribunal de Rennes a montré que ce texte ne servait à rien. D'ailleurs, le président de la commission des Lois avait souligné, lors de sa discussion, que c'était une loi pédagogique, d'interprétation. Dans la deuxième affaire, celle des thermes Barbotan, le tribunal a considéré que le maire, qui avait le profil exact de ceux pour lesquels le Parlement avait souhaité écarter toute condamnation, à défaut de pouvoir agir, aurait dû démissionner. Cette loi est donc inefficace et il faut reprendre la définition de la faute civile et de la faute pénale. Si l'on souhaite éviter une inflation des procédures pénales, il convient d'offrir aux victimes une procédure qui puisse leur donner, au civil, les mêmes satisfactions légitimes. Un procès civil aujourd'hui, ce n'est rien pour une victime ; c'est essentiellement une procédure écrite, les avocats plaidant une demi-heure sans témoins. Or, pour l'application de la loi du 29 juillet 1881, la Cour de cassation a transposé les règles de la procédure pénale au civil. Dans le cadre d'un procès en diffamation au civil, il faut respecter toutes les règles de signification de preuves, de citation de témoins, etc ... Cette pratique semble parfaitement transposable dans les affaires d'infractions non intentionnelles redéfinies. Je termine en vous disant le bonheur que j'ai d'être entendu ici, entre un journaliste, dont j'approuve les propos et la conception qu'il exprime de la liberté d'expression, exercée conformément à l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, c'est-à-dire dans le respect des nécessités propres à une société démocratique, et des juges d'instruction qui, même s'ils ne partagent pas le même avis que moi sur la nécessité de séparer les tâches d'investigation et d'accusation des tâches juridictionnelles, développent néanmoins des arguments intéressants et proposent des textes absolument remarquables. Si vous ne pouviez ou ne vouliez pas prendre la direction proposée par la commission Delmas-Marty, je crois qu'il n'y a rien à rejeter dans ce qu'ils suggèrent, sauf le fait qu'ils souhaitent le maintien du juge d'instruction. M. Jean-Louis Pelletier : Mon propos ne sera pas aussi tranché que celui de mon confrère Me Soulez-Larivière. En fait, je ne parle pas en mon nom personnel, mais en celui d'une association, celle des avocats pénalistes, laquelle est constituée de praticiens du droit pénal. Ce projet a fait de notre part l'objet d'une réflexion collective. Nous nous sommes voulus avant tout pragmatiques et nous considérons qu'il constitue une avancée remarquable, parce qu'il va dans le sens d'une plus grande protection des droits des prévenus et des présumés innocents, mais également d'une garantie renforcée des droits des victimes. Cela étant, après ce satisfecit nuancé, je me dois d'exprimer quelques réserves. La première tient au fait que nous trouvons ce projet un peu frileux. Nous aurions souhaité qu'il s'inscrive dans une réflexion plus générale et qu'il conduise à une refonte totale du code de procédure pénale. Par référence aux travaux remarquables de la Commission Delmas-Marty, nous aurions aimé qu'une plus grande place soit faite au contradictoire, au niveau policier bien sûr, mais aussi et surtout au niveau judiciaire. Nous nous rapprocherions ainsi beaucoup plus d'un régime accusatoire ou para-accusatoire. Ce n'est pas que nous voulions nécessairement instaurer une justice de type anglo-saxon, mais nous souhaiterions que la présence de l'avocat, du défenseur, soit davantage confirmée. Par ailleurs, un problème crucial est laissé de côté, celui de l'institution d'une juridiction d'appel pour les décisions des cours d'assises. Il est regrettable que cette question, qui a suscité des débats sous plusieurs législatures, ne soit pas réglée, alors qu'elle se pose de manière aiguë à tous les praticiens du droit pénal. Quelques problèmes ont été éludés ou ne sont pas évoqués, notamment celui, qui pourrait faire bondir les juges d'instruction, de la responsabilité des magistrats, qui doit évidemment être de nature civile. Lorsque nous, qui sommes praticiens du droit pénal, nous oublions un délai, nous sommes considérés comme responsables et nous pouvons légitimement être attaqués et amenés, par compagnies d'assurances interposées, à supporter les conséquences pécuniaires de nos erreurs ou de nos fautes. Il nous paraît donc anormal que certains juges qui commettent des fautes n'aient, en fait de sanctions, qu'à subir un retard d'avancement. Une autre question n'est pas abordée, celle de la redéfinition du rôle exact de la chambre d'accusation. S'il est théoriquement très important, nous savons qu'en pratique, elle ne le joue pas, faute de moyens peut-être et d'un excès de travail. Quoi qu'il en soit, il est constant que les juges ne sont pas censurés, bien au contraire, notamment en matière de détention. Des statistiques privées réalisées sur les décisions rendues par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, toutes sections confondues, montrent que sur 100 recours en matière de détention, il n'y a, chaque année, que 10 % des décisions des juges d'instruction qui sont réformées. Il serait essentiel pour la défense de la liberté de se pencher sur la composition des chambres d'accusation et sur leur rôle exact. Il existe un autre problème qui n'est pas traité par le projet de loi, c'est celui du filtre théorique qui n'existe qu'en matière criminelle. Lorsque l'instruction est terminée, le dossier fait l'objet d'une transmission au procureur général, qui le remet à la chambre d'accusation. Celle-ci met du temps à se réunir et rend finalement un arrêt de renvoi, dont nous savons tous que, s'il a remplacé l'acte d'accusation, il revêt exactement la même nature. Cet arrêt de renvoi peut être frappé de pourvoi. C'est ainsi qu'à Paris, lorsque le dossier d'instruction est terminé, des personnes en état d'être jugées attendent parfois 18 ou 24 mois avant de comparaître effectivement devant la cour d'assises. Ces délais nous semblent anormaux et devraient pouvoir être supprimés. S'il est légitime que la chambre d'accusation joue le rôle d'un filtre éventuel par rapport aux juges d'instruction, elle ne devrait pas être appelée à statuer quand on soulève des nullités de procédure ; ce n'est pas théoriquement son rôle. Voilà les quelques regrets que nous exprimons sur les points qui n'ont pas été abordés. J'en viens maintenant au projet lui-même. Dans sa globalité, il nous donne satisfaction. Nous n'avons notamment pas de réserve particulière sur l'appellation de juge de la détention. C'est une question de terminologie subsidiaire et, en tout état de cause, nous préférons que les avocats soient compétents en matière de liberté. Nous regrettons en revanche que le juge de la détention soit seul. Nous aurions préféré qu'il s'inscrive dans une collégialité, dont très naturellement le juge d'instruction actuel aurait été radicalement exclu. S'agissant de la présence de l'avocat dès le début de la garde à vue, il est probable que, dans le cours de vos travaux, vous serez amenés à affiner les dispositions du projet de loi, éventuellement à les clarifier. Il convient, en effet, de préciser comment, sur un plan matériel, cette mesure sera conciliée avec les nécessités immédiates de l'enquête. Il faut savoir que les policiers ont fait contre mauvaise fortune bon c_ur en nous voyant arriver dans les locaux de la garde à vue à la vingtième heure. Mais tout se passe très bien désormais ; notre présence est entrée dans les m_urs, nous sommes normalement prévenus et nous ne sommes pas mal accueillis. Mais comment concilier la nécessité de prévenir l'avocat qu'il doit se déplacer avec le fait qu'il doit intervenir à la première heure ? Il faudrait qu'un délai lui soit accordé pour qu'il se présente effectivement. Nous savons que le placement en garde à vue comporte un certain nombre de formalités : la fouille réglementaire, les relevés anthropométriques, la notification des droits. Le temps nécessaire à l'accomplissement de ces formalités pourrait être mis à profit pour prévenir l'avocat désigné ou commis et lui permettre d'arriver. Je livre cette réflexion à votre appréciation. Dans le cadre de la garde à vue elle-même, il est regrettable que nous n'ayons pas accès au dossier, et que nous soyons, surtout à la première heure, confrontés à un client qui ignore ce qui lui est reproché. De ce regret, j'en viens à une véritable critique : il n'est pas normal que soit instaurée une sorte de justice à deux vitesses, qu'il y ait, au départ, deux catégories de délinquants potentiels. Pourquoi réserverait-on l'assistance de l'avocat à ceux qui en ont peut-être le moins besoin, tout en l'écartant pour les trafiquants de stupéfiants et les criminels en bande organisée ? Les avocats connaissent parfaitement leurs droits, mais aussi leurs devoirs. D'ailleurs, dans le cadre de notre association, nous mettons en garde contre les dangers qu'il peut y avoir à outrepasser ses droits, contre les risques qu'il peut y avoir à donner, dans le cadre de la garde à vue, des renseignements qui ne devraient pas être évoqués. Par ailleurs, nous déplorons une autre forme de justice à deux vitesses - et c'est peut-être encore plus important - au sujet du sacro-saint principe du secret de l'instruction. Le projet de loi prévoit que le débat sur la détention pourra être rendu public, ce qui est une très bonne chose, mais apporte immédiatement un correctif en spécifiant que la décision appartient à la juridiction saisie. Or depuis qu'une première brèche a été ouverte sur le secret de l'instruction par la loi de 1993, qui permet que le débat sur la détention devant la chambre d'accusation soit également public, je ne connais qu'un seul cas où une telle décision a été prise : c'était à Lyon, à la demande du prévenu, dans une affaire concernant un parlementaire depuis déchu de son mandat et cette mesure ne l'a pas servi. Chaque fois que j'ai sollicité de la chambre d'accusation que le débat soit public, elle m'a opposé un refus catégorique. C'est regrettable, car tout prévenu a le droit à la publicité, sous réserve que soient respectés les droits des autres personnes mises en examen. Ce n'est pas, en effet, parce qu'un prévenu souhaite que la presse assiste au débat le concernant qu'il faut nécessairement violer le secret de l'instruction pour les autres prévenus impliqués dans l'affaire, ou alors ce serait consternant. Toujours pour regretter l'existence d'une forme de justice à deux vitesses - mais je veux rester nuancé -, je voudrais évoquer une catégorie de justiciables qui nous paraît avoir des droits restreints, celle du témoin assisté. Je suis favorable à ce nouveau statut et je serais très heureux si son institution se traduisait par une diminution du nombre des mises en examen, même si je ne suis pas aussi optimiste que M. Serge Portelli et Mme Sophie Clément-Mazetier. Mais pourquoi empêcher ce témoin assisté de prêter serment ? Pourquoi en faire une espèce de sous-témoin ? Ou bien il est témoin assisté dans les conditions que prévoit la loi et il prête serment, ou bien il est d'ores et déjà mis en examen et il ne prête pas serment. Voilà les quelques réserves que nous souhaitons émettre. Vous allez débattre maintenant de certaines propositions ou amendements. D'ici à ce que le projet soit effectivement discuté devant le Parlement, s'il y a d'autres concertations, nous souhaiterions y participer, si vous le jugez possible. En résumé, ce projet de loi paraît constituer une avancée notable que nous approuvons dans son principe, comme tous les textes qui vont dans le sens d'un renforcement des garanties données aux justiciables. Notre regret majeur tient à l'absence de procédure d'appel en matière criminelle. Il nous semble qu'il serait possible de beaucoup simplifier le projet présenté par M. Jacques Toubon. Pourquoi restreindre le nombre des jurés au premier échelon ? Il suffirait, selon nous, que la voie de l'appel fonctionne, comme c'est trop rarement le cas, au travers de la cassation, qu'une nouvelle cour d'assises soit saisie, à condition, bien entendu, que celle-ci ne siège pas dans le ressort de la même cour d'appel que la première, pour éviter que les mêmes conseillers ne soient désignés. M. Jacques Floch : Ce n'est pas la première fois que je participe à un débat sur la présomption d'innocence, la réforme du code de procédure pénale ou du code pénal. J'en suis toujours sorti avec un sentiment d'insatisfaction et une certaine amertume. Nous sommes, chaque fois, soumis à d'énormes pressions venant de toute part, de nos organisations politiques, de tous les professionnels du droit, avocats, magistrats eux-mêmes, policiers, et très rarement, il faut le dire, des victimes. En outre, il y a évidemment tous les organes de presse. A chaque fois, nous avons essayé de résister à ces pressions. Toutes les propositions faites, susceptibles de conférer de nouveaux droits à ceux qui sont accusés, ne doivent pas leur en donner trop, pour ne pas paraître laxistes aux yeux de l'opinion publique. En même temps, il ne faut pas porter atteinte à certaines prérogatives, notamment à celles des policiers qui ont dans la garde à vue une responsabilité majeure. S'agissant des pouvoirs du juge, toute volonté de les modifier pour les rendre plus conformes au droit s'est heurtée aux juges eux-mêmes, aux professionnels du droit, à l'opinion publique, qui nous mettaient en garde sur le fait que le juge risquait d'être « désarmé » face aux personnes mises en accusation. Aujourd'hui, ces mêmes pressions s'exercent, mais je crois que le moment est venu de faire de la résistance. Si nous ne parvenons pas à adopter un texte qui marque quelques progrès, rien ne pourra plus être fait pendant un grand nombre d'années. Je pense que nous pourrions apporter au projet de loi une première modification en inversant son titre pour mentionner les droits des victimes avant le renforcement de la protection de la présomption d'innocence. Sans doute pourrions-nous également améliorer le contenu du texte qui, sorti de la Chancellerie, a une conception mineure des droits des victimes. En ce qui concerne la présomption d'innocence, il est nécessaire de conduire sur un sujet aussi grave une réflexion sérieuse. Cette semaine, dans un hebdomadaire, L'Evénement du Jeudi, un éditorialiste écrit au sujet de l'affaire Elf-Dumas : « heureusement que la présomption d'innocence et le secret de l'instruction ont été bafoués, sinon on n'aurait eu aucune information sur le sujet. » Le public accepte cela puisque L'Evénement du Jeudi se vend et a des lecteurs. D'autres journaux se sont, au contraire, fixé des règles déontologiques s'agissant de la présomption d'innocence et du secret de l'instruction. C'est le cas, dans ma région, d'un grand quotidien, Ouest France. Sans doute la question de la présomption d'innocence ne se résume-t-elle pas aux rapports avec les médias. Mais je crois nécessaire de préciser les rapports entre la justice et le droit à l'information. Dans le rapport de la Commission de réforme de la justice, présidée par M. Pierre Truche, et dans les autres travaux préparatoires au projet qui nous est soumis, on retrouve des propositions intéressantes à ce sujet. J'ai entendu avec beaucoup d'intérêt tous les intervenants. Le concours qu'ils apportent à ce débat nous sera très utile. Ce n'est pas en exerçant des pressions corporatistes, sans doute honorables, mais éloignées des préoccupations de défense des droits de l'homme, de la sécurité, de la sûreté de nos concitoyens, que l'on peut aider le législateur à faire son travail. Je ne voudrais pas, une nouvelle fois, être obligé de constater que nous ne parvenons pas à réaliser une réforme qui renforce la protection de la présomption d'innocence. C'est un sujet sur lequel nous devons pouvoir trouver une solution. Cela nous conduira certainement à bousculer certaines règles en matière, non seulement de garde à vue, mais aussi de mise en détention provisoire. Il suffirait pour changer totalement les choses de prévoir qu'une personne ne peut être placée en détention provisoire si les conditions prévues par le code de procédure pénale ne sont pas respectées. Avec un taux d'occupation de 120 % dans les prisons, il est impossible d'assurer aux prévenus une cellule individuelle et d'éviter de les mélanger avec des détenus qui subissent une peine. Pour avoir été rapporteur du budget des services pénitentiaires pendant quatre ans, j'ai visité de nombreuses prisons et je suis obligé de constater que la place y manque et que le droit n'y est pas respecté. Je crois que c'est une contrainte que les magistrats devraient prendre en compte avant de décider d'un placement en détention provisoire. Je conclurai en affirmant qu'il est temps de réaliser une réforme suffisamment profonde pour que notre pays puisse encore être considéré comme celui des droits de l'homme. M. Michel Hunault : Je voudrais d'abord préciser que nous sommes un certain nombre de parlementaires dans les rangs de l'opposition à approuver la philosophie de ce texte qui renforce les libertés essentielles, notamment la présomption d'innocence. Je reviens sur une disposition importante, celle de la création du juge de la détention provisoire. Je me souviens d'un article récent de mon confrère Pelletier dans le Figaro, assez injurieux d'ailleurs pour les juges d'instruction. Nous savons tous aujourd'hui que la détention provisoire est un moyen de pression. Le projet de loi qui nous est soumis ne va pas aussi loin que la proposition de loi présentée par Alain Tourret, adoptée en première lecture par l'Assemblée, qui tendait à réserver le recours à la détention provisoire aux poursuites engagées pour les crimes ou les délits les plus graves. Je souhaiterais savoir si nos invités ont le sentiment et la conviction que le juge de la détention n'utilisera plus la détention provisoire comme un moyen de pression. La solution proposée leur semble-t-elle préserver les libertés essentielles de tout individu ? M. Daniel Soulez-Larivière : Comme vous avez pu le constater, l'objection faite par l'Association des juges d'instruction à l'institution du juge délégué tient au fait qu'il ne connaît pas le dossier. C'est toute une philosophie, car connaître le dossier et manier la détention provisoire signifie qu'on ne traite pas le problème sur le terrain de la représentation du justiciable, mais sur celui de la liaison avec l'information elle-même. Dans ces conditions, je pense que retirer le pouvoir de mise en détention des mains du juge d'instruction, qui fait les investigations, marque déjà un petit progrès. Mais on ne peut pas indéfiniment empiler les juges les uns sur les autres. C'est pourquoi les propositions du rapport Delmas-Marty présentaient un intérêt, parce qu'elles tendaient à une redistribution des tâches entre le Parquet, chargé des investigations, et les juges du siège, chargés de l'instruction véritable. La solution apportée par le projet de loi n'est donc qu'une demi-mesure. Une véritable réforme de fond impliquerait une redistribution des tâches entre le parquet, la défense et les juges du siège. Mme Sophie Clément-Mazetier : Nous n'avons pas le sentiment que le juge de la détention aura une optique différente de celle du juge d'instruction. Nous craignons que sa mise en place ne soit insuffisante pour limiter vraiment le recours à la détention provisoire, dont le caractère excessif constitue un problème très grave et spécifiquement français. Nous considérons qu'un juge d'instruction ne doit pas statuer sur la détention provisoire, lorsque c'est lui qui, en fait, a mené l'enquête, par l'intermédiaire des policiers agissant sur commission rogatoire. Lorsqu'il découvre l'affaire parce que la personne lui est présentée par le procureur de la République, nous ne voyons pas pourquoi son appréciation différerait de celle de son collègue, qui a la même sensibilité, la même formation, a peut-être été un jour juge d'instruction ou le sera plus tard. Pendant les quelques mois au cours desquels l'institution du juge délégué a été en place, en 1993, la politique en matière de détention provisoire n'a pas varié. Nous proposons donc des mesures très différentes. Sans doute faut-il instituer un juge délégué ou juge de la détention lorsque l'enquête a été menée par le juge d'instruction et non pas par le Parquet, mais surtout la loi doit interdire le placement en détention provisoire pour motif d'ordre public en matière correctionnelle, fixer des délais butoirs infranchissables - d'un an en matière correctionnelle et de deux ans en matière criminelle - et élever les seuils de peines encourues à partir desquels le placement en détention provisoire est possible. En réponse aux propos de M. Jacques Floch, je voudrais souligner qu'il est paradoxal, lorsque le débat porte sur la détention provisoire, d'entendre parler de laxisme, comme si la détention provisoire était une peine. Il faut bien distinguer la détention provisoire, qui est une mise à l'écart rendue nécessaire pour les besoins de l'information, de la peine qui sera, le cas échéant, prononcée. Il est tristement vrai que la détention provisoire est actuellement un moyen de pression, mais il ne sert à rien de dénoncer cette réalité si l'on ne fait pas ce qu'il faut pour y mettre fin. Bien sûr, en matière criminelle notamment, il peut y avoir d'autres motifs de placement en détention provisoire que les nécessités de l'information, la dangerosité par exemple. Il est certain que, si l'on a vraiment des indices graves et concordants laissant supposer qu'une personne a commis des crimes en série, elle ne doit pas être relâchée avant d'être jugée. Mais il faut éviter le discours démagogique qui consiste à faire croire que toute personne qui a volé un _uf a troublé l'ordre public. M. Pierre Albertini : Je voudrais d'abord formuler une remarque de caractère général. Je crois que ce texte est d'inspiration cosmétique. Nous sommes très loin de l'ambition des propositions de la Commission Delmas-Marty, nous restons au milieu du gué, et l'insatisfaction que suscitent généralement les textes « mi-chèvre mi-chou » risque d'être d'autant plus aiguë qu'il y aura une addition de mécontentements. Il serait peut-être plus sage de renoncer à un texte qui n'apporte pas grand-chose, même s'il présente quelques aspects positifs, et de poursuivre une réflexion de plus grande ampleur, d'autant plus qu'il s'inscrit dans le cadre d'une réforme de la justice, annoncée et attendue, mais dont il reste difficile d'apprécier la cohérence d'ensemble parce qu'elle est tronçonnée. Je suis extrêmement sceptique sur l'efficacité probable du dispositif envisagé, même s'il témoigne de bonnes intentions. J'observe d'ailleurs deux lacunes essentielles. La première tient à l'absence de toute référence à la responsabilité disciplinaire des magistrats, qu'il faudra pourtant, un jour ou l'autre, évoquer en toute sérénité. La seconde repose sur le défaut de supervision de la police judiciaire par les magistrats. La France n'est pas une terre de libertés concrètes, mais de libertés abstraites, je l'ai souvent dit, et je crains que ce projet de loi ne m'apporte pas de démenti, parce qu'il ne me semble pas de nature à faire progresser la mécanique judiciaire. J'en viens à ma première question qui s'adresse à M. Noël Copin. J'ai l'impression qu'il y a dans ce texte une tentative inconsciente de créer un antagonisme entre la liberté d'information et la présomption d'innocence. Or je persiste à penser que la liberté d'information est aussi une garantie contre l'arbitraire, le fruit d'une conquête très lente de nos sociétés qui sont parvenues à donner un statut à l'information. Personnellement, je verrais assez volontiers disparaître les dispositions du projet de loi relatives aux médias parce que, à mon avis, elles ne constituent pas le meilleur moyen de forger une déontologie, qu'il appartient davantage aux hommes d'information qu'au législateur lui-même de définir. Ma deuxième question s'adresse plutôt aux avocats. Elle concerne les correctifs introduits à dose homéopathique dans notre procédure inquisitoire. Sans en être un partisan farouche, je ne crois pas que nous ayons les moyens de réaliser brutalement une révolution judiciaire. N'y aurait-il pas cependant des techniques qui permettraient d'améliorer sensiblement la procédure actuelle, assez largement archaïque et qui me paraît assez mal préserver les droits de la défense ? M. Alain Tourret : Le projet de loi soumis à l'Assemblée nationale marque incontestablement une avancée importante, qui me semble pourtant insuffisante. Je me demande s'il est réellement à la hauteur des problèmes que soulève le nécessaire respect de la présomption d'innocence. Compte tenu de la situation actuelle, il est indispensable, je crois, d'adresser à l'opinion publique autant qu'au monde judiciaire des messages forts. Or je ne suis pas sûr que la disposition centrale du projet de loi - la création d'un juge de la détention qui, par ailleurs, semble utile - soit, à cet égard, tout à fait convaincante. Il me semble que les dispositions votées par l'Assemblée nationale le 4 avril dernier réservant la détention provisoire aux crimes et délits les plus importants représentaient un message fort. Je regrette qu'elles soient gommées par le projet de loi. Je souhaiterais savoir ce que pensent nos invités de la suggestion que j'avais faite d'écarter la détention provisoire lorsque la peine encourue est inférieure à trois ans pour les délits contre les personnes et cinq ans pour les délits contre les biens et des contre-propositions de la Chancellerie qui abaissent respectivement les seuils à deux et trois ans. J'observe que l'absence de statistiques sérieuses permet difficilement d'apprécier l'effet qu'aurait cette baisse des seuils. L'abaissement des seuils par rapport au texte voté par l'Assemblée nationale, qui est proposé par la Chancellerie, est-il réellement nécessaire pour faciliter la manifestation de la vérité, pour préserver l'ordre public, pour protéger la société ? Je voudrais également aborder un problème plus technique, celui de l'égalité des différentes parties au procès. Je constate que la situation stratégique du parquet dans la salle d'audience marque l'imagination des personnes qui assistent au procès. En la modifiant, nous pourrions donner un signal fort au prix de simples travaux de menuiserie. J'observe également que, dans les grands procès, la multiplication des parties civiles fausse l'égalité. Dans le procès Papon, par exemple, 200 avocats des parties civiles se sont succédés, alors que l'accusé n'en avait qu'un ou deux. Cela ne me semble pas totalement satisfaisant, dès lors que les avocats des parties civiles jouent le rôle de procureurs bis. Le Président Truche, auquel je me suis ouvert de cette question, m'a dit qu'il ne voyait pas de solution à ce problème et que j'encourrai de violentes critiques en le soulevant. Avez-vous une autre réponse à m'apporter ? Pourrait-on envisager de regrouper certaines plaidoiries dans ces grands procès qui sont les plus médiatiques, sur lesquels l'opinion publique forge son appréciation de la justice ? Je souhaiterais savoir, par ailleurs, s'il vous semble possible de fixer un délai raisonnable pour la détention provisoire, au-delà duquel la remise en liberté serait obligatoire. Est-ce envisageable en matière criminelle ? On me dit qu'actuellement à Paris, il s'écoule, en moyenne, dix-huit mois entre la clôture de l'instruction et le passage devant la Cour d'assises. Ne faudrait-il pas fixer le délai maximum à six ou douze mois ? Dans les procès complexes, lorsqu'il y a quinze personnes mises en examen, les pourvois formés par les uns, les incidents de procédure soulevés par d'autres, retardent l'instruction et la difficulté de disjoindre les instances font qu'il est impossible d'obtenir un non-lieu avant la fin du procès. Cela me semble une grave atteinte au droit des personnes et à la présomption d'innocence. M. Robert Pandraud : En matière de justice, la réflexion doit être objective et dépasser les clivages politiques. Même si le texte qui nous est soumis ne règle pas tous les problèmes, il constitue quand même une légère avancée, et nous ne pouvons aller que de légère avancée en légère avancée ; j'y suis donc favorable. Nous nous plaignons toujours de l'insuffisance des droits et des prérogatives du Parlement. Je vous lance donc un appel, Madame le Rapporteur. N'êtes-vous pas la mieux placée pour modifier et compléter ce projet en tenant compte de toutes les objections qui sont soulevées ? La Chancellerie s'efforce de synthétiser les suggestions des divers lobbies, les propositions de telle ou telle catégorie de fonctionnaires, ou de ce que l'on appelle les professionnels du droit. Elle ne veut mécontenter personne. Mais vous disposez, à tous égards, d'une plus grande indépendance. Je souhaiterais que le reste de la législature soit mis à profit pour élaborer un projet à l'abri des pressions des lobbies. Pensez-vous, réellement, que le juge délégué sera utile ? Soit, il accédera aux requêtes du juge d'instruction, parce que ce sera son ami ou qu'il sera sensible au corporatisme que l'on rencontre dans toutes les professions, soit, au contraire, il les rejettera parce qu'il aura des difficultés personnelles, professionnelles, d'inscription au tableau d'avancement ou pour le simple plaisir d'ennuyer son collègue. Ne serait-il pas préférable que la chambre d'accusation soit obligatoirement saisie, même si cela implique qu'elle soit modifiée ? Une autorité collégiale offre toujours plus de garantie qu'un juge unique. S'agissant de la présence de l'avocat au début de la garde à vue, M. Jean-Louis Pelletier a souligné les difficultés qu'elle soulèvera. En province, les locaux de garde de vue peuvent se trouver dans une brigade de gendarmerie à 80 km du premier avocat. Il me semble cependant que quelqu'un peut être mis en garde à vue dans son bureau ou à son domicile. Avant la première heure, pendant que s'accomplissent les formalités substantielles à la garde à vue, il peut se poser des problèmes de traduction, pour un étranger qui ne parle pas le français ou qui feint de ne pas le parler. Ne pourrait-il pas y avoir une certaine période de neutralisation pendant laquelle la police effectuerait les formalités, laissant ainsi un délai raisonnable pour qu'un défenseur puisse arriver ? Il me semble nécessaire d'envisager une solution si l'on souhaite éviter que toutes les procédures soient annulées pour défaut d'avocat dès la première heure. Ce sont ces problèmes concrets qu'il convient de régler plutôt que de multiplier des réformes qui ne sont ni appliquées, ni applicables. Chaque garde des Sceaux, d'ailleurs, se croit dans l'obligation de déposer son propre projet. Et, comme nous vivons dans une période d'instabilité ministérielle plus grande que sous n'importe quel régime, l'instabilité législative, et donc l'incertitude juridique, n'a jamais été plus grande qu'aujourd'hui. Cela donne à la magistrature une marge de man_uvre considérable, d'où il résulte un équilibre difficile à tenir avec les médias. Bien sûr, on ne peut supprimer la liberté de la presse, mais il est quand même regrettable que les journaux soient quelquefois transformés en auxiliaires de justice, et que des articles inspirés puissent être, pour certains magistrats instructeurs, plus importants que des auditions ou des enquêtes menées normalement. Quant au problème qui n'est pas abordé par le projet de loi, celui de l'autorité des magistrats sur la police judiciaire - là aussi on est confronté aux pressions de lobbies divers - il ne pourra jamais être réglé, puisqu'en France, tous les policiers et les gendarmes font de la police judiciaire. Je ne suis pas sûr qu'un gouvernement ait un jour l'autorité nécessaire pour mener une réforme en la matière. Mme Frédérique Bredin : Chacun s'accorde à reconnaître que les intentions du texte sont bonnes. Les réserves exprimées concernent les mesures concrètes. Est-il possible d'aller plus loin ? Le texte n'est-il pas trop timide ou trop frileux sur certains points ? Je voudrais rapidement revenir sur quelques sujets précis. S'agissant de la détention provisoire, je voudrais savoir ce que vous pensez très concrètement des limitations prévues par le texte : trois ans pour les délits contre les biens, deux ans pour les délits contre les personnes. Que suggérez-vous, que proposez-vous en la matière ? Par ailleurs, le maintien du motif de l'ordre public pour le placement en détention vous paraît-il opportun ? Enfin, les délais butoirs proposés dans le texte pour limiter la durée de la détention vous semblent-ils cohérents ou faut-il les modifier ? En ce qui concerne l'instruction, la notion de délai raisonnable est retenue par le texte. Est-ce que l'institution d'un calendrier prévisionnel, qui serait notifié au début de la procédure par le juge d'instruction, vous paraît répondre aux problèmes qui se posent ? Il me semble, enfin, que l'on ne peut parler de la légitimité des juges sans évoquer leur responsabilité. C'est la condition de l'indépendance de la justice et de la magistrature et cela lui donne toute sa valeur. Pourrait-on connaître les mesures concrètes que vous proposez en la matière ? Mme le rapporteur : J'ajouterai deux ou trois questions à celles nombreuses qui viennent d'être posées. Sur la garde à vue, plusieurs idées ont été émises. Ne serait-il pas finalement plus protecteur que l'avocat intervienne avant la dixième heure, pour tenir compte des difficultés pratiques que soulève sa présence dans la première heure, puis à nouveau après la vingtième heure ? L'objectif est, d'une part, que les droits du gardé à vue soient énoncés très rapidement et, d'autre part, que la garde à vue soit aussi courte que possible. On a pu constater qu'avec l'intervention de l'avocat à partir de la vingtième heure, beaucoup de gardes à vue ne duraient plus que 19 heures. Que pensez-vous de l'enregistrement des interrogatoires au cours de la garde à vue, qui est déjà pratiqué en Grande-Bretagne et auquel le syndicat des commissaires de police nous a dit être favorable ? Nous souhaitons, par ailleurs, renforcer le contrôle des gardes à vue par le parquet, mais, en la matière, il est difficile de le faire autrement que par une incitation car, en instituant une obligation sanctionnée, nous entrerions dans le champ de la responsabilité disciplinaire des magistrats. Concernant le témoin assisté, M. Jean-Louis Pelletier a estimé qu'il était tout à fait contradictoire - et je le pense aussi - qu'il ne prête pas serment. Que perdrait-il à le faire ? L'institution de ce nouveau statut est l'un des points forts du projet que nous souhaitons conforter. Ferions-nous perdre au statut de témoin assisté une partie de son intérêt en lui demandant de prêter serment ? Je reviens peu sur la détention provisoire, parce que les questions essentielles ont déjà été posées. Vous paraît-il possible d'enserrer l'instruction elle-même dans des délais butoirs, qu'il y ait ou non détention provisoire ? La proposition qui pourrait être faite serait de deux ans en matière correctionnelle et de trois ans en matière criminelle, avec la possibilité d'une prolongation demandée par une ordonnance motivée bien sûr et octroyée uniquement par la chambre d'accusation. S'agissant des relations avec la presse, vous semble-t-il opportun de conférer au procureur de la République la possibilité d'exercer le droit de réponse à la place de quelqu'un d'autre ? Je n'en suis pas tout à fait persuadée personnellement. Concernant les victimes, Mme Anne d'Hauteville a évoqué les obligations du juge de l'application des peines. Pouvons-nous prévoir dans la loi qu'il se doit de veiller à l'exécution de la réparation, en liaison avec la victime et le directeur de la maison d'arrêt si le délinquant est détenu, et d'organiser les modalités de l'indemnisation ? Comment pourrions-nous mieux articuler l'obligation de réparation qui s'impose au délinquant lui-même à la suite de sa condamnation à des dommages et intérêts avec le rôle des commissions d'indemnisation des victimes d'infractions pénales. Il existe une sorte de confusion, dans l'esprit à la fois du délinquant et de la victime, sur ce double système d'indemnisation. M. Jean-Louis Pelletier : Comment améliorer les droits de la défense et assurer l'égalité entre les parties ? Il faut d'abord que les mentalités changent. Il n'est pas possible de généraliser. Au cours de l'instruction, dans la tenue des débats, en correctionnelle ou en cour d'assises, la situation est tout à fait différente selon la personnalité de celui qui dirige les débats. Devant une égalité apparente il y a, en fait, une inégalité totale. C'est pourquoi il faudrait affirmer très solennellement que celui qui dirige les débats, le juge d'instruction, le président du tribunal, doit être totalement impartial et instruire à charge et à décharge, sinon rien ne changera, malgré toutes les lois. Après 1993, des tentatives de changement se sont manifestées, sans que le code de procédure de pénale ne soit modifié. On a vu, notamment à Paris, dans la chambre compétente en matière de saisine directe, qu'une approche accusatoire pouvait être mise en _uvre. Le substitut présentait les moyens de l'accusation, le président restait un véritable arbitre, tout en remplissant ses fonctions, et la défense se comportait d'une façon tout à fait normale. Je n'ai pas constaté ce type de fonctionnement dans les tribunaux correctionnels, mais dans certains procès d'assises où, sans que ce soit le régime anglo-saxon, il y avait une avancée par rapport à la pratique habituelle. Ce que nous critiquons, en effet, c'est l'omnipotence du président. Tout le monde sait - il serait hypocrite de ne pas l'affirmer - qu'aux assises, un président peut arriver pratiquement à ce qu'il veut, que l'accusé soit coupable ou innocent et malgré la multiplication du nombre des jurés. Si l'on n'exige pas que le président ne soit qu'un arbitre, non seulement à l'audience, mais surtout dans le cadre du délibéré, rien ne pourra changer, quelles que soient les lois promulguées. Les présidents de cour d'assises sont désignés par les premiers présidents de cour d'appel. Dans certaines d'entre elles, rompant catégoriquement avec des usages plus anciens, les premiers présidents ont choisi de désigner une nouvelle génération de présidents, pas nécessairement jeunes, qui ont eu à c_ur - c'est encore le cas à Paris, mais aussi en province - de mener les débats de façon équilibrée. La justice s'en porte beaucoup mieux, aussi bien pour les accusés que pour les victimes. M. Daniel Soulez-Larivière : Je voudrais proposer une modification majeure : il faut que notre pays achève sa révolution judiciaire et finisse enfin par séparer les tâches qui concourent à l'exercice de la justice : investigation, accusation, défense, jugement. Il existe actuellement une trop grande confusion, à la fois dans les procédures et dans les corps. La première décision qui me semble s'imposer est la séparation des fonctions de parquetier et de juge, pour qu'il n'y ait plus de confusion, dans le corps même des magistrats, entre les avocats de la République et les juges. Le Président de la République a évoqué cette solution devant la Cour de cassation ; les premiers présidents de cour d'appel se sont prononcés en sa faveur, à l'unanimité ; d'autres l'ont fait également, et je m'honore d'en faire partie. Il faut confier les tâches d'investigation au parquet, tandis que les fonctions juridictionnelles appartiendraient aux juges ; il faut créer un juge de l'instruction qui en soit vraiment un. C'est ce que suggérait l'excellent rapport de Mme Delmas-Marty, le plus complet rédigé depuis dix ans sur ce sujet. Enfin, il faut réhabiliter la notion de défense, qui passe par des expressions concrètes comme l'intervention de l'avocat en garde à vue. Celui-ci n'est pas un ennemi de l'ordre public. Au contraire, en facilitant l'adhésion de la collectivité à la décision judiciaire, il participe d'un processus nécessaire à l'ordre public. Même si l'appellation d'« auxiliaire de justice » est imparfaite, elle témoigne du fait que l'avocat fait partie du processus judiciaire, qu'il est une pièce du moteur, qu'il doit intervenir à tous les stades de la procédure, à commencer naturellement par sa phase policière. Ce sont, pour moi, les points essentiels qui ne sont malheureusement pas abordés dans le projet de loi, qui semblent exclus de la réflexion. On tourne autour depuis cinquante ans et rien ne change réellement. Mme Anne d'Hauteville : Je voudrais dire, d'abord, que je suis très favorable à la suggestion de M. Jacques Floch d'inverser l'ordre de la présentation du projet pour mettre en tête les droits des victimes. Cela ne signifie pas, bien sûr, que je ne suis pas sensible à la protection des droits de la défense. Des progrès ont été réalisés en ce domaine, mais il est possible d'aller beaucoup plus loin. S'agissant des grands procès qui se tiennent en matière de catastrophes collectives, de crimes contre l'humanité, que M. Alain Tourret a évoqués, j'admets que la réponse judiciaire n'est peut-être pas totalement satisfaisante. Sans doute, le principe d'égalité des armes n'est-il pas parfaitement respecté dans ce type de situation et il faut certainement conduire sur ce point une réflexion. Mais je ne crois pas que l'on puisse en tirer des conséquences sur le droit des victimes de participer au procès. Quelles que soient les circonstances, elles restent seules face à l'auteur de l'infraction et à la justice. Une question a été posée sur le rôle du juge d'application des peines dans le processus de réparation. De plus en plus - et c'est positif - pour les petits dommages, la réparation fait partie de l'aménagement des peines. C'est un outil de responsabilisation du délinquant qui peut contribuer à sa réinsertion. Dans ce cas de figure, cela doit être une obligation pour le juge d'application des peines de concilier les objectifs de sanction et de réparation, dans un sens qui soit favorable à la société et acceptable pour la victime. Quand la réparation est indépendante de la sanction, notamment lorsque des dommages et intérêts importants doivent être versés à la victime, ce qui implique que des procédures civiles d'exécution soient mises en _uvre, je répète que la gratuité devrait être accordée à la victime, qui ne devrait pas avoir à faire l'avance des frais. La mise en place depuis 1983 et surtout 1990, d'un système parallèle d'indemnisation des victimes, qui passe par le recours à la commission d'indemnisation et le paiement par le Fonds de garantie, n'est pas toujours bien compris et peut même être ressenti par les auteurs d'infractions comme une sorte de « dédouanement » de l'obligation de verser des dommages et intérêts à la victime. Ce système est bien sûr favorable aux victimes, qui n'ont pas à supporter les nécessités de la réinsertion du délinquant et peuvent être indemnisées correctement dans un délai raisonnable, notamment en cas de dommages corporels graves. Il faut néanmoins tenter de concilier ce système avec l'obligation qui doit être faite à l'auteur de l'infraction de supporter le paiement des dommages et intérêts. Je crois qu'il faudrait favoriser les recours du Fonds de garantie qui sont aujourd'hui peu nombreux. Il me semble que l'administration pénitentiaire, le Fonds de garantie et les services judiciaires doivent travailler à une meilleure coordination. Il peut, en effet, y avoir un intérêt pédagogique à associer l'auteur à la réparation, même s'il ne peut pas tout rembourser ; une part peut être prélevée sur son pécule ou sur ses biens pour le paiement des dommages et intérêts. M. Robert Pandraud : Ne pensez-vous pas qu'il faudrait prévoir, dans un souci d'équilibre, une indemnisation des victimes d'erreurs judiciaires, qui serait du ressort des juridictions administratives, le système judiciaire étant un peu autoprotecteur ? Mme Anne d'Hauteville : La victime d'une erreur judiciaire n'est pas une victime d'infraction pénale. C'est donc un autre sujet. Mais je vous rejoins, il faudrait mener sur ce point une réflexion qui devrait déboucher sur une réforme. Mme le rapporteur : Le projet prévoit une meilleure indemnisation des personnes mises en examen, ayant fait l'objet d'un placement en détention provisoire et qui bénéficient ensuite d'un non-lieu. J'ajoute que le système judiciaire, s'il reste encore autoprotecteur, l'est de moins en moins. M. Alain Tourret : En 1989, il y a eu 2 000 cas d'indemnisations de personnes qui avaient été placées à tort en détention provisoire. M. Daniel Soulez-Larivière : Les indemnisations versées actuellement sont dérisoires. Mme le rapporteur : Mais le projet de loi et les amendements éventuels permettront d'aller plus loin. Aujourd'hui, les décisions de la commission d'indemnisation ne sont pas motivées ; elles le seront désormais, ce qui constitue un progrès considérable. Mme Sophie Clément-Mazetier : M. Serge Portelli et moi-même vous avons adressé des propositions d'amendements qui reprennent l'essentiel de ce que je vais vous dire. S'agissant de la détention provisoire, en réponse à Mme Frédérique Bredin, je crains que les seuils proposés par le Gouvernement, de deux et trois ans, ne changent rien à la situation actuelle. Nous souhaitons donc qu'ils soient fixés à trois ans pour les délits contre les personnes et cinq ans pour les infractions contre les biens, ce qui inclurait les infractions financières, contrairement aux craintes exprimées par certains parlementaires lors du débat qui s'est tenu à l'Assemblée nationale l'année dernière. La détention ne serait pas possible si la peine encourue était inférieure à ces seuils. Nous considérons, par ailleurs, que l'ordre public ne doit pas pouvoir être invoqué en matière correctionnelle et qu'une durée maximum de détention provisoire d'un an en matière correctionnelle et de deux ans en matière criminelle est tout à fait suffisante, d'autant que rien n'interdit, dans les affaires complexes, de juger une personne en cour d'assises pour un fait et de poursuivre l'instruction sur les autres aspects de l'affaire, alors que la personne est détenue, non plus à titre provisoire, mais en qualité de condamnée, ce qui est totalement différent. Nous pensons également qu'il est dommage que ce projet de loi, qui a pour objet de renforcer « la protection de la présomption d'innocence », ne traite que de l'instruction. Je rappelle, en effet, que les affaires donnant lieu à instruction ne représentent que 7 % de la totalité. Toutes les autres personnes sont jugées directement devant le tribunal correctionnel. Il est sans doute bon de prévoir de nombreuses garanties devant le juge d'instruction, mais ne pas les étendre à l'immense majorité des procédures nous semble très regrettable. Nous proposons que les seuils retenus soient étendus à la comparution immédiate, puisque c'est souvent dans cette formation que sont prononcés les mandats de dépôt. Il n'y a pas de raison que le choix procédural d'un procureur de renvoyer une personne devant un juge d'instruction ou un tribunal correctionnel emporte des conséquences différentes quant à la possibilité de la placer ou non en détention provisoire. La durée de la détention provisoire résultant d'une ordonnance de prise de corps, dans le cadre d'un renvoi devant la cour d'assises, devrait également être limitée. Il serait inutile de l'encadrer lors de l'instruction, si une personne doit ensuite attendre 18 mois au fond d'une prison avant d'être jugée. Je rappelle d'ailleurs que, pour des délits, la détention préalable au jugement n'est possible que pendant deux mois. En matière criminelle M. Alain Tourret proposait de la limiter à 12 mois. Il nous semble que l'on pourrait s'en tenir à 6 mois, mais sans doute faut-il poursuivre la discussion pour parvenir à un délai raisonnable et réaliste. En tout cas, faire l'impasse sur une réflexion relative à ce délai reviendrait à s'en tenir à des effets d'annonce sur la détention provisoire sans s'attaquer à sa réalité. S'agissant de l'intervention du procureur de la République dans les médias pour rectifier des informations sur une personne mise en examen, on voit mal comment celui qui l'a poursuivie pourra faire une mise au point à la presse sur la réalité de cette poursuite. Cela nous paraît un peu malsain. Par ailleurs, institutionnaliser des relations entre le procureur de la République et les journalistes nous semble dangereux. Il faut rappeler que la liberté de la presse est un principe essentiel, que la presse constitue un contre-pouvoir. Il serait périlleux que le procureur puisse apparaître exercer sur elle une pression. Pour garantir le respect de la présomption d'innocence par la presse, c'est à la procédure qu'il faut réfléchir. Car la presse ne fait que refléter ce qui se passe. C'est en ce sens que la motivation de la mise en examen nous paraît une réforme tout à fait fondamentale. Il est évident qu'une personne placée en situation de témoin assisté n'éveillera pas autant la curiosité des lecteurs, puisque son statut montrera que le juge n'a pas estimé qu'il y avait des indices graves et concordants permettant de prendre à son encontre une ordonnance motivée. On peut espérer que la presse attendra la mise en examen avant de mettre en cause la réputation d'une personne, comme elle peut le faire actuellement. La question de savoir si le témoin assisté doit prêter serment nous semble secondaire. Concrètement, il est évident que sa situation est préférable à celle du mis en examen, puisqu'il ne peut pas être soumis à un contrôle judiciaire ou placé en détention provisoire, qu'aucune ordonnance n'a établi qu'il existait contre lui des indices graves et concordants. Mme le rapporteur : Quel serait l'inconvénient de lui faire prêter serment ? M. Daniel Soulez-Larivière : Il n'aurait pas le droit de mentir. Mme Sophie Clément-Mazetier : Si un témoin assisté est ensuite mis en examen, ne risque-t-il pas d'être poursuivi pour faux témoignage s'il a menti ? M. Jean-Louis Pelletier : Le faux témoignage n'est constitué qu'à l'audience. Mme Sophie Clément-Mazetier : En ce qui concerne la garde à vue, la présence de l'avocat à la première heure, puis son absence, nous paraissent dangereuses. Son intervention initiale pourrait n'être qu'un alibi pour prétendre que les droits de la défense sont garantis. Il importe donc qu'il puisse revenir ensuite. Son rôle est différent de celui du juge d'instruction ou du procureur de la République, auquel il est indispensable que le gardé à vue soit, par ailleurs, présenté. Même si l'avocat est présent, ce n'est pas lui qui pourra ordonner aux policiers de procéder à des investigations à décharge ; seul un magistrat pourra s'en préoccuper et diriger l'enquête en ce sens. Enfin, nous pensons que l'avocat n'est pas suffisamment présent à l'instruction. Actuellement, nous sommes dans une procédure inquisitoire. L'avocat, très légitimement, attend que le juge d'instruction ait fini ses investigations pour s'interroger sur la nécessité de demander des actes. Selon nous, il devrait être associé, dès le départ, à l'instruction, pour éviter les retards ultérieurs de la procédure. Nous souhaiterions qu'il y ait un débat d'orientation de l'information en début de procédure, qui responsabilise les avocats. Ce serait une mesure technique incitative, qui n'empêcherait pas les avocats de demander ultérieurement tout acte qui leur paraîtrait nécessaire. Elle permettrait cependant de leur faire prendre conscience que leurs demandes peuvent être formulées rapidement s'ils souhaitent accélérer la procédure. M. Noël Copin : Je me réjouis, peut-être de façon un peu paradoxale, du fait qu'il a été assez peu question ce matin des médias. En même temps, je pense qu'il y aurait beaucoup de choses à dire. Je m'en réjouis, parce que cela montre que maintenant on dépasse cet antagonisme, évoqué tout à l'heure, entre justice et médias, au sujet de la présomption d'innocence. Il y a beaucoup d'autres questions à régler avant de « s'attaquer » aux médias. Je ferai, cependant, une petite parenthèse. Je me méfie d'un autre danger, celui de la connivence qui peut parfois apparaître, de l'instrumentalisation éventuelle des médias par des hommes de la justice. Si j'ai exprimé tout à l'heure une certaine satisfaction sur le contenu du texte qui vous est soumis, c'était par référence à d'autres débats. Je pense, par exemple, aux dangers qui semblaient peser sur les médias au travers d'initiatives comme l'amendement présenté par M. Alain Marsaud, il y a quelques années. Tant qu'il y aura des personnes arrêtées, qu'il s'agisse de garde à vue ou de détention provisoire, on ne fera pas croire à l'opinion publique, et difficilement aux médias, même aux journalistes qui ont fait du droit, qu'elles sont innocentes. On a dit que le projet était frileux. On avait formulé la même critique à l'égard du rapport Truche. On s'est référé, en revanche, au rapport extrêmement important de Mme Delmas-Marty. Tout ce qui va dans le sens de la limitation de la détention provisoire, d'une réglementation plus rigoureuse de la garde à vue, me semble positif. S'agissant des médias - et ce n'est pas une réaction corporatiste - je dirai que moins on légifère, moins on réglemente, mieux les choses vont. On responsabilise ainsi davantage les journalistes, qui prennent conscience de leur responsabilité et l'exercent au travers des chartes, des codes de déontologie, etc. L'important, pour nous, journalistes, et pour ceux qui nous regardent et nous jugent, c'est de nous demander si nous agissons vraiment conformément à notre mission qui est d'informer les citoyens. Si un journaliste ne respecte pas la loi - je pense que dans un pays démocratique, il doit savoir qu'il n'est, pas plus qu'un autre citoyen, au-dessus des lois - si, en conscience, il estime nécessaire de donner une information, il prend ses risques. C'est ce qu'avait fait Zola avec le fameux « J'accuse » ... Je terminerai sur l'affaire des menottes. Elle est concrète et très symbolique aussi. Même si je suis contre la publication dans les médias, sous quelque forme que ce soit, de documents montrant des personnes menottées, je souhaite cependant que les dispositions qui prévoient des peines d'amendes à l'encontre des médias soient supprimées. Il me semble préférable de donner la priorité au paragraphe VII de l'article 25, qui modifie l'article 803 du Code de procédure pénale pour limiter plus rigoureusement la présentation de personnes menottées. Je crois que c'est en amont et non pas en aval qu'il faut tenter de mettre fin à la publication de documents montrant des personnes menottées. Mme le rapporteur : Telle est bien mon intention, en effet. Je remercie tous nos invités pour l'ensemble des propositions qu'ils ont formulées. En conclusion, je dirai qu'il est vrai que le gouvernement n'a pas fait le choix de la révolution, mais de la réforme. Il appartient maintenant de lui donner toute sa portée. Je ne crois pas qu'il faille laisser entendre - ce serait une erreur majeure - que le texte ne porte que sur l'instruction. Il va bien au-delà, puisqu'il a pour objet, comme le montre son intitulé, de renforcer « la protection de la présomption d'innocence ». Il commence par l'énoncé des principes fondamentaux du procès pénal - ce qui n'avait jamais été fait - qui figureront enfin dans le code de procédure pénale. Il traite également de la garde à vue. En outre - c'est tout à fait significatif et presque révolutionnaire - ce même texte se préoccupe aussi des droits des victimes, alors que, jusqu'à présent, en droit pénal fondamental comme en procédure pénale, on a toujours traité séparément le délinquant et la victime. A cet égard, ce projet me paraît être un texte de politique criminelle au sens plein, parce qu'il essaie de conjuguer des dispositifs qui doivent protéger le délinquant, d'une part, et protéger la victime, d'autre part. La commission des Lois s'efforcera d'en faire, sinon une réforme définitive - il serait ridicule de l'envisager - du moins une grande réforme. Nous y serons aidés par l'ensemble des observations et des propositions formulées par nos invités, qui sont toutes extrêmement intéressantes. Nous ne souhaitons pas seulement modifier les textes, mais aussi les pratiques et l'organisation de la justice. A cet égard, il est une question qui n'a pas été évoquée ce matin, celle de la révision de la carte des juridictions d'instruction. C'est pourtant une des clés de la réussite de la réforme, notamment de l'institution du juge de la détention. J'estime qu'il est indispensable de modifier la carte des juridictions d'instruction, pour qu'avec 70 magistrats, nous puissions véritablement donner au juge de la détention tout le poids qu'il doit avoir et permettre qu'il ait cet autre regard distancié par rapport à celui du juge d'instruction, qui reste investigateur et juge. Ce sera peut-être l'objet d'une réforme ultérieure. * * * La Commission a enfin procédé, le mardi 9 mars 1999, à l'audition de Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux, ministre de la justice. La ministre d'abord souligné que le projet de loi s'inscrivait dans la réforme d'ensemble de la justice, annoncée par le Premier ministre dans sa déclaration de politique générale, qui a pour triple objectif de rendre la justice plus proche des citoyens, plus respectueuse des libertés individuelles et plus indépendante. Après avoir constaté que la réalisation de cette réforme était bien avancée, l'ensemble des projets de loi ayant été déposés sur les bureaux des assemblées, elle s'est félicitée que le premier à avoir été adopté soit celui relatif à l'accès au droit, devenu la loi du 18 décembre 1998, qui tend à renforcer la justice de proximité et à l'adapter aux besoins des Français. A ce titre, elle a précisé que, si seulement 16 maisons de la justice et du droit fonctionnaient avant juin 1997, 18 avaient été ouvertes depuis lors, dont 7 depuis le 1er janvier dernier, tandis que 41 projets étaient en cours d'examen. Elle a poursuivi, toujours sur le thème de la justice de proximité, en rappelant qu'un décret du 28 décembre 1998 réformant la procédure civile concourrait à l'accélération du règlement des litiges entre particuliers. Elle a également évoqué le projet de loi sur la simplification de la procédure pénale qui, après son adoption en première lecture par le Sénat, doit être examiné par l'Assemblée nationale le 23 mars prochain, soulignant que ce projet était de nature à apporter une réponse aux infractions de petite et de moyenne délinquance, à accélérer les affaires pénales et à faciliter l'entraide internationale en matière répressive. S'agissant du deuxième volet de la réforme de la justice, destiné à rendre la justice plus respectueuse des libertés, elle a rappelé qu'outre le présent projet, la loi du 17 juin 1998 sur la prévention de la délinquance sexuelle assurait une meilleure protection des victimes, notamment mineures. Quant au renforcement de l'indépendance de la justice, après avoir rappelé que le projet de loi constitutionnelle sur le Conseil supérieur de la magistrature, adopté en termes conformes par les deux assemblées depuis le mois de novembre 1998, était en attente d'approbation par le Congrès, elle a confirmé que le projet de loi sur les relations entre le parquet et la chancellerie serait débattu avant l'été en première lecture à l'Assemblée nationale. Elle a constaté qu'à peine plus d'un an et demi après l'annonce de la réforme, sa réalisation ne souffrait d'aucun retard par rapport au calendrier sur lequel le Gouvernement s'était engagé, les deux projets relatifs à la procédure pénale, en particulier, devant être examinés en première lecture d'ici l'été, de sorte que rien ne s'oppose à une convocation rapide du Congrès sur la réforme constitutionnelle. Abordant ensuite la présentation générale du projet de loi, elle en a souligné l'orientation prioritaire en faveur de tous les justiciables. Elle a appelé l'attention de la Commission sur l'action en faveur des droits des victimes, à ses yeux trop longtemps oubliées dans le procès pénal, les plus démunis étant les premiers concernés. Elle a fait part du souhait du Gouvernement que les victimes soient mieux protégées dans leur dignité, puissent plus facilement obtenir une indemnisation durant le procès et disposent, au cours de la procédure, des mêmes droits que l'accusation et la défense. Afin d'améliorer la situation des personnes mises en cause, elle a précisé que le projet de loi tendait à limiter la détention provisoire, à éviter les atteintes à la présomption d'innocence, à réduire la durée des procédures et des détentions. Elle a rappelé que, chaque année, plus de 300 000 personnes étaient placées en garde à vue. La garde des sceaux a ensuite insisté sur trois des choix du Gouvernement : elle a d'abord souligné le maintien et même le renforcement du juge d'instruction, illustré par la mise en place de pôles financiers, ajoutant qu'il se trouvait conforté dans son rôle d'arbitre neutre entre les parties ; elle a également mentionné la confirmation de la nature inquisitoire de notre procédure pénale, plus égalitaire que la procédure accusatoire qui favorise injustement les plus riches ; enfin, elle a évoqué la réaffirmation d'une conception du procès pénal fondée sur la déclaration des droits de l'homme et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Avant d'aborder la présentation détaillée de ses dispositions, elle a souligné que le projet de loi était un texte d'équilibre : entre l'efficacité de l'enquête et les droits des parties au procès, entre les droits des personnes mises en cause et ceux des victimes, entre la liberté d'expression et le respect de la présomption d'innocence à tous les stades de la procédure, la proposition de la Commission présidée par M. Pierre Truche tendant à interdire la publication du nom des personnes mises en cause ayant été écartée dans le souci du respect du droit de l'information. Parmi les dispositions destinées à une meilleure prise en compte du principe de présomption d'innocence, la ministre a d'abord présenté celles renforçant les droits de la défense et le respect du contradictoire : elle a ainsi évoqué l'intervention de l'avocat dès la première heure de la garde à vue, sauf dans les cas de criminalité ou de délinquance organisées, alors qu'actuellement, moins de 10 % des personnes gardées à vue peuvent s'entretenir avec un avocat, l'extension, en cours d'instruction, des droits des parties, qui pourront demander au juge tous les actes nécessaires, certains pouvant être effectués en présence de leur avocat, et l'amélioration de la procédure du témoin assisté, qui ouvre le bénéfice des droits de la défense sans mise en examen. Elle a ensuite indiqué que, pour renforcer les garanties en matière de détention provisoire, qui devrait devenir réellement exceptionnelle, le projet de loi confiait au juge de la détention provisoire la responsabilité de décider des placements en détention, de leurs prolongations et des suites à donner aux demandes de mise en liberté, de sorte que l'accord de deux magistrats soit nécessaire avant toute détention provisoire. Elle a ajouté qu'étaient revues les conditions de placement en détention provisoire en matière correctionnelle, ainsi que la durée de l'ensemble des détentions provisoires, l'indemnisation des détentions provisoires injustifiées étant améliorée. Elle a ensuite indiqué que le projet de loi renforçait le droit à être jugé dans un délai raisonnable, grâce à un contrôle de la durée des enquêtes et des instructions, et tendait à mieux répondre aux atteintes à la réputation d'une personne du fait de sa mise en cause au cours d'une procédure judiciaire, deux nouveaux délits étant créés, celui de publication de l'image d'une personne menottée ou entravée et celui de réalisation ou diffusion de sondages sur la culpabilité d'une personne poursuivie. Elle a enfin évoqué les dispositions relatives aux communiqués du procureur de la République, aux possibilités de débat contradictoire et public en cours de procédure, ainsi qu'au droit de réponse. Présentant en second lieu le volet relatif à l'amélioration de la situation des victimes d'infraction pénale, la ministre de la justice a indiqué que le principe selon lequel l'autorité judiciaire doit veiller, tout au long de la procédure, à la garantie des droits des victimes serait inscrit en tête du code de procédure pénale. Elle a évoqué la consécration législative du rôle joué par les associations d'aide aux victimes, les modifications permettant d'éviter aux victimes de se déplacer lors du procès, ainsi que la création de nouveaux délits, en cas de publication de l'image d'une victime dans des conditions portant atteinte à sa dignité et de publication de l'identité d'une victime mineure. La garde des sceaux a, en conclusion, rappelé que les idées forces du projet de loi étaient de rendre plus responsables les différents acteurs du procès pénal - sans que cet objectif ne témoigne d'aucune défiance à leur encontre - et de concilier de façon équilibrée les libertés individuelles avec les nécessités de la répression. Elle a donc annoncé son attitude très réservée sur toute modification tendant à déséquilibrer notre droit. En revanche, elle a indiqué qu'elle attendait avec intérêt les propositions de la Commission et considéré qu'un accord pourrait sans doute être trouvé sur de nombreuses améliorations envisagées par le rapporteur, qu'il s'agisse de la garde à vue, de la mise en examen, du témoin assisté, de la durée de détention provisoire des primo-délinquants, du débat contradictoire pour toute prolongation de détention correctionnelle ou des délais d'audiencement pour les détenus correctionnels. Mme Christine Lazerges, rapporteur, a considéré que le projet de loi réformait en profondeur la procédure pénale, renforçait l'Etat de droit et ménageait un équilibre subtil entre les nécessités de l'action publique et la préservation des libertés individuelles. Elle a estimé que la présomption d'innocence, toujours fragile, sortirait renforcée de cette réforme, tout comme les droits des victimes, dont la prise en compte est très récente et qui sont insuffisamment garantis. Elle a indiqué que les amendements qu'elle proposerait à la Commission seraient fondés sur le souci de renforcer en parallèle les droits des victimes et ceux des personnes poursuivies. M. Robert Pandraud a jugé déplorable, sur le plan des libertés individuelles, que des procédures puissent être déclenchées par des lettres anonymes et a regretté que le projet de loi n'interdise pas aux magistrats de prendre en compte cette source d'informations. Considérant que la France avait encore beaucoup de progrès à faire dans le domaine des droits de la défense, comme le lui rappelle régulièrement la Cour européenne des droits de l'homme, M. Philippe Houillon a estimé que le projet allait dans le sens d'une amélioration. Toutefois, il a regretté que le parquet reste une partie au procès pénal disposant de prérogatives exorbitantes, précisant que sa préférence allait à la création de deux corps distincts de juges et de procureurs. Il a souhaité savoir quel souci d'efficacité, évoqué par l'exposé des motifs du projet, justifiait que, dans certaines hypothèses, l'avocat ne puisse pas intervenir avant la trente-sixième heure. Il a considéré que cette dérogation jetait un discrédit sur les avocats, en laissant présumer qu'ils pourraient avoir des contacts avec les complices de la personne gardée à vue. Par ailleurs, il a proposé que le juge de la détention provisoire soit saisi par le parquet, plutôt que par le juge d'instruction, afin qu'il n'y ait pas de risque de préjugement. Enfin, il s'est interrogé sur l'applicabilité de la réforme dans les tribunaux comptant peu de magistrats. M. Claude Goasguen a estimé que le projet était globalement positif, tout en souhaitant que des amendements puissent accentuer sa dimension libérale, afin que les personnes mises en examen en France bénéficient des mêmes garanties que celles accordées dans les autres pays européens. Il a souhaité que cette réforme soit l'occasion d'une réflexion sur la place du juge d'instruction dans la procédure pénale, afin de limiter les excès de pouvoir qui peuvent lui être reprochés. Il a, notamment, suggéré que les ordonnances du juge d'instruction soient systématiquement motivées et puissent toujours faire l'objet d'un appel, voyant là un progrès considérable pour la défense et pour les libertés en général. Enfin, il s'est interrogé sur les moyens supplémentaires dégagés pour la mise en _uvre de la réforme, exprimant la crainte que la création d'un juge de la détention provisoire ne se solde par de vives déceptions, après avoir suscité de grands espoirs. M. Alain Tourret a indiqué qu'il déposerait des amendements tendant à améliorer ponctuellement le projet de loi, qu'il a jugé profondément novateur. Il a notamment souhaité que les préoccupations des victimes, souvent mal traitées pendant l'instruction et le procès pénal, soient mieux prises en compte, en prévoyant, par exemple, le rappel dans toute décision judiciaire de la possibilité de saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales. Il a également jugé nécessaire qu'un effort soit fait pour améliorer les conditions dans lesquelles sont traités les prévenus - notamment en cas de renouvellement de la garde à vue - et que le bénéfice des dispositions relatives à l'enregistrement des dépositions des mineurs victimes de sévices sexuels soient étendues aux mineurs gardés à vue. Par ailleurs, il a regretté que le projet ne reprenne pas les dispositions relatives à la détention provisoire contenues dans sa proposition de loi adoptée le 3 avril 1998 par l'Assemblée nationale. Sans remettre en cause le principe de la procédure inquisitoriale, il a regretté que le projet de loi n'aille pas plus loin dans la séparation des compétences du juge de l'enquête et du juge de la détention et des libertés, souhaitant que ce dernier soit également compétent en matière de contrôle judiciaire, afin d'éviter des chevauchements de compétences entre les deux juges. Enfin, il s'est interrogé sur l'opportunité de confier la saisine du juge de la détention provisoire au ministère public plutôt qu'au juge d'instruction. Soulignant qu'il appréciait l'effort, notamment budgétaire, entrepris par le Gouvernement en matière de réforme de la justice, M. André Gerin a indiqué que son groupe soutiendrait le projet de loi qu'il jugeait positif, même s'il n'allait pas aussi loin qu'il l'aurait souhaité. Il a considéré que la crédibilité de la réforme supposait qu'elle permette de faire reculer le sentiment d'impunité, tout en garantissant, parallèlement, les droits des personnes et la protection de la vie privée. Il a regretté que les efforts en faveur des victimes soient insuffisants. Enfin, il s'est demandé s'il n'aurait pas été souhaitable d'approfondir la réflexion sur la collégialité en matière de placement en détention provisoire, précisant qu'il y était favorable. M. Gérard Gouzes a d'abord déclaré qu'il jugeait le projet de loi équilibré. Il s'est félicité que l'intervention de l'avocat dès la première heure de garde à vue ne suscite plus de débat. Puis il a insisté sur la question de la durée de la détention provisoire et de celle de l'instruction, soulignant qu'en l'état actuel des choses elles étaient très excessives. Il a ensuite souhaité obtenir des précisions sur les moyens financiers qui seront dégagés pour permettre la mise en place du juge de la détention, sans laquelle la réforme serait vidée de tout contenu. Enfin, il a regretté que les décisions de la Commission d'indemnisation des détentions provisoires ne soient pas susceptibles d'appel. Après avoir exprimé son approbation sur les dispositions du projet de loi qui tendent à améliorer les droits des victimes, M. Michel Hunault a, en revanche, estimé que, sur d'autres volets du texte, de nombreux problèmes restaient en suspens. Il a ainsi évoqué la question de la détention provisoire, notamment pour les délits mineurs, insistant sur ses conséquences en termes de surpopulation carcérale. A cet égard, il a considéré que les solutions retenues dans la proposition de loi de M. Alain Tourret tendant à limiter la détention provisoire, adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture, étaient intéressantes, ajoutant qu'elles mériteraient d'être prises en compte lors de la discussion du projet de loi. Il a, par ailleurs, souligné que la publicité donnée à certaines affaires soulevait le problème du respect de la présomption d'innocence et estimé que, sur ce point, le projet de loi n'apportait pas de solutions satisfaisantes. Souhaitant enfin qu'un débat ait lieu sur la prescription du délit d'abus de bien social, il a annoncé son intention de défendre un amendement sur ce sujet. Mme Frédérique Bredin a estimé qu'en défendant à la fois la présomption d'innocence et le droit des victimes, le projet de loi soumis à la Commission constituait un texte important pour les libertés publiques. Elle a souligné le caractère innovant dans la procédure pénale des dispositions relatives aux droits des victimes, rappelant que le seul précédent en la matière était la loi relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs du 17 juin 1998. Elle a, par ailleurs, estimé qu'il existait en France un décalage entre les idéaux des droits de l'homme, hérités des grands principes de la Révolution française, et la réalité des commissariats, dans lesquels se déroulent chaque année 350.000 gardes à vue, et des prisons, qui abritent 20 000 prévenus. Rappelant que la France avait fait l'objet de nombreuses condamnations sur ces questions devant la Cour européenne des Droits de l'homme, elle a considéré qu'il convenait de mettre un terme aux gardes à vue sans communication avec l'extérieur, ainsi qu'aux détentions provisoires se prolongeant sans que les prévenus puissent connaître l'échéance de leur procès. Elle a estimé nécessaire de motiver le placement en détention provisoire, de le limiter dans le temps et d'améliorer l'indemnisation en cas de placement abusif. Dénonçant ensuite l'hypocrisie actuelle dans les relations entre la justice et la presse, elle a déclaré qu'il était nécessaire de prévoir des fenêtres de publicité dans la procédure, afin de concilier la liberté de la presse et le respect de la dignité des personnes. Après avoir exprimé son accord sur les dispositions du projet de loi améliorant les droits de la défense et la protection des victimes, M. Pierre Albertini s'est interrogé sur la pertinence de son intitulé, soulignant que, malgré son ambition, le texte risquait de se heurter à l'insuffisance des moyens mis en _uvre. Jugeant regrettable que le projet de loi n'aborde pas la question des relations entre la justice et la police judiciaire, il a, par ailleurs, considéré que le respect de la présomption d'innocence relevait davantage de la déontologie des magistrats et des journalistes que de la législation, dans la mesure où la liberté de la presse ne saurait être remise en cause de quelque manière que ce soit. Abordant la question de la détention provisoire, il a estimé que le caractère collégial de la décision de mise en détention aurait constitué une garantie bien supérieure à celle résultant de la distinction opérée par le projet de loi entre juge d'instruction et juge de la détention. Il a enfin considéré qu'il était nécessaire de restreindre les cas pouvant donner lieu à un placement en détention provisoire, ajoutant qu'il convenait également d'encadrer sa durée. Estimant que les juges d'instruction devraient être des arbitres impartiaux instruisant à charge et à décharge, Mme Nicole Catala a émis des doutes sur l'intérêt de l'institution du juge de la détention, s'interrogeant, en outre, sur les moyens qui seraient mis en _uvre pour financer le dédoublement entre juges d'instruction et juges de la détention. Elle a, par ailleurs, souligné que la protection de la présomption d'innocence soulevait de nombreuses difficultés, s'agissant notamment des sanctions en cas de diffusion d'images de personnes menottées ou entravées. Elle a enfin estimé nécessaire d'avoir une conception plus large des notions de dignité et d'honneur des individus, considérant qu'il fallait placer, en droit, sur un même plan la victime et la personne présumée innocente. Indiquant d'abord qu'il voterait sans doute le projet de loi, M. Pascal Clément a constaté que, depuis des années, la création d'un juge des libertés était évoquée, alors même que, selon lui, elle ne constituait qu'une sorte de pis aller face aux problèmes de la justice en France. Il a estimé en effet que, si le juge d'instruction exerçait ses prérogatives de manière satisfaisante, ce qui est la situation habituelle en France, la création d'un juge de la détention provisoire ne se justifiait pas. Il a regretté la suspicion qui pèse sur ce corps de magistrats, constatant que les chambres d'accusation confirmaient la presque totalité de leurs décisions. Il a, par ailleurs, observé que les juridictions ne respectaient pas toujours scrupuleusement les règles de procédure existantes, rappelant notamment qu'au Conseil supérieur de la magistrature les rapporteurs participaient également à la formation de jugement, ce qui est contraire au principe du jugement équitable proclamé par la Convention européenne des Droits de l'homme. Concernant la question du secret de l'instruction, il a constaté que, même dans les cas où l'on connaissait l'auteur de la violation du secret, aucune sanction n'était appliquée. Il a vivement regretté que, plutôt que de perfectionner notre système judiciaire, l'on préfère ajouter un nouveau dispositif qui risque de se révéler impraticable, notamment dans les petites juridictions. A cet égard, il a rappelé que de nombreuses réformes avaient échoué, certaines même n'allant pas au-delà du vote en première lecture, comme ce fut le cas, par exemple, pour la réforme de la cour d'assises, exprimant la crainte que l'on ne retombe dans les mêmes errements. Il a, par ailleurs, jugé que le texte proposé par la garde des sceaux risquait d'allonger les délais de jugement. Au total, il a regretté que la France soit incapable de faire fonctionner convenablement ses institutions judiciaires existantes. Constatant que le projet de loi s'attaquait à des problèmes rémanents, M. Guy Hascoët s'est interrogé, tout d'abord, sur la notion de garde à vue, remarquant notamment que, tout en affirmant le principe de la présence de l'avocat dès de la première heure, le texte maintenait trois exceptions à cette règle. Il s'est demandé en quoi la présence de l'avocat pouvait constituer une gêne pour l'enquête. Il a ensuite critiqué la procédure de comparution immédiate en ce qu'elle pouvait être utilisée de manière déviée. Il a fait part d'une expérience récente dans sa circonscription où, à la suite de quelques échauffourées entre des policiers et des jeunes, deux de ces derniers avaient comparu immédiatement devant le tribunal et risquaient d'être condamnés à plusieurs mois de prison, sans avoir pu, dans cette procédure d'urgence, faire valoir véritablement leurs droits. Il a appelé à ce que la présomption d'innocence soit respectée et a également fermement condamné tout soupçon de culpabilité fondé a priori sur l'appartenance à un quartier, l'origine ethnique ou sociale. A cet égard, il a souligné la différence du traitement appliqué aux jeunes de quartiers difficiles, d'une part, et, d'autre part, aux agriculteurs qui, ayant saccagé le bureau de la ministre de l'environnement, n'ont cependant pas été immédiatement présentés à la justice. Il a constaté, en le déplorant, que notre pays, par certains aspects, connaissait encore une justice de classe. Indiquant à titre liminaire qu'il voterait le projet de loi parce qu'il constituait un progrès, M. Michel Crépeau a néanmoins considéré que ce texte demeurait timide sur quelques points essentiels. Constatant que le projet interdisait la publication de photographies de personnes menottées, il s'est insurgé contre le fait qu'on puisse passer les menottes à des citoyens, procéder à des fouilles au corps humiliantes et les dépouiller de leurs vêtements lors de leur garde à vue. Il a considéré que ces pratiques constituaient des atteintes inacceptables aux droits des personnes et a proposé que les policiers contraints d'y recourir soient soumis à l'obligation de rédiger un rapport le justifiant. Il a regretté, par ailleurs, que les réformes de la justice se soient toujours heurtées à un manque évident de moyens, évoquant à cet égard la réforme relative à l'appel des jugements des cours d'assises. Il a estimé que les conditions de détention en France constituaient des violations des droits de l'homme particulièrement graves, soulignant qu'elles étaient dénoncées régulièrement par Amnesty International. Il a regretté également que l'on n'ait pas assumé le passage d'un système inquisitoire à un système accusatoire, considérant que celui-ci permettrait notamment de faire une économie de postes de magistrats. Il a souligné, en outre, que sa mise en _uvre serait, de toute manière, rendue nécessaire par la construction européenne, observant que le caractère fréquemment transnational des délits contraindrait à terme l'Europe à mettre en place un système judiciaire uniformisé. Il a indiqué qu'il aurait également souhaité voir clairement définis les rôles respectifs du parquet, de la police, et des magistrats. A ce titre, il a appelé de ses v_ux un dispositif qui ferait du garde des sceaux la seule autorité hiérarchique de la police judiciaire, le ministre de l'intérieur conservant sous sa responsabilité les actions de police administrative et de maintien de l'ordre public. Enfin, il a estimé que l'on ne pouvait apporter de réponse à 14.000 crimes, délits et contraventions en France sans que soit menée une véritable politique de dépénalisation. Il a déploré que les magistrats prennent l'initiative de définir de nouvelles infractions ou de nouvelles sanctions, évoquant à cet égard l'exemple des abus de biens sociaux, que la jurisprudence a jugés imprescriptibles, ou celui du blâme public suggéré par le ministère public auprès de la Cour de justice de la République. M. Jérôme Lambert a indiqué qu'il approuvait le maintien du système inquisitorial allié à l'introduction de quelques éléments de procédure accusatoire. Il a exprimé le v_u que la justice française ne ressemble pas à certaines autres, popularisées par une culture dominante qui se voudrait hégémonique. Il a rappelé, en effet, que, dans la procédure accusatoire, lorsqu'un prévenu était défendu dans de mauvaises conditions, ses droits étaient souvent très gravement bafoués. Il a souhaité savoir quels moyens le Gouvernement comptait demander au Parlement de voter pour faire face aux nominations des nouveaux juges de la détention provisoire. En conclusion, il a attiré l'attention de la ministre sur les conditions d'indemnisation des personnes ayant subi une détention injustifiée. En réponse aux intervenants, la ministre a apporté les précisions suivantes : - S'agissant la garde à vue, elle a rappelé que c'était l'opposition actuelle qui avait supprimé en août 1993 l'intervention de l'avocat à la vingtième heure en cas de trafic de stupéfiants ou de terrorisme et reporté celle-ci à la trente-sixième heure pour certains faits de criminalité organisée, avant de rétablir, à la suite d'une décision du Conseil constitutionnel, cette intervention à la soixante-douzième heure pour le trafic de stupéfiants et le terrorisme. Elle s'est opposée à la suppression de ces exceptions, faisant valoir qu'elles constituaient à la fois une mesure de protection pour les avocats, en leur évitant d'éventuelles pressions extérieures, et une mesure de protection de l'enquête. Indiquant qu'elle partageait avec le ministre de l'intérieur et le ministre de la défense le souci d'améliorer les conditions matérielles des gardes à vue, elle a précisé que des efforts avaient été faits récemment en la matière. Tout en reconnaissant que les fouilles avaient souvent un caractère humiliant, elle a fait observer qu'elles étaient en particulier nécessaires pour assurer la sécurité des autres personnes présentes dans les locaux de garde à vue. S'agissant de l'enregistrement sonore des interrogatoires, proposé notamment par la commission de réflexion sur la justice présidée par M. Pierre Truche, elle a déclaré qu'elle n'était pas contre le principe, mais qu'elle s'inquiétait des risques qu'il pouvait présenter, s'agissant tout particulièrement des conditions d'utilisation de la cassette audio dans la suite de la procédure et des éventuelles possibilités de manipulation. Elle a en outre fait valoir qu'une telle mesure nécessitait une mobilisation de moyens supplémentaires qui pourraient utilement être employés pour d'autres priorités. Enfin, elle a exprimé la crainte que cette procédure ne se retourne contre la personne gardée à vue, notamment en cas de rétractations d'aveux. - Sur la motivation et l'éventuel appel de la mise en examen, la ministre a rappelé que les articles 80-1 et 116 du code de procédure pénale obligeaient déjà le juge d'instruction à indiquer chacun des faits pour lesquels la personne était mise en examen ainsi que leur qualification juridique. Elle a estimé qu'imposer à ce magistrat de préciser les éléments à charge risquerait de transformer radicalement son rôle et de rendre plus difficile, dans la suite de la procédure, une instruction à décharge. Evoquant l'éventualité d'un appel, elle a souligné que cette possibilité renforcerait encore plus l'aspect « préjugement » de la mise en examen. - En ce qui concerne le droit des victimes, la garde des sceaux a annoncé qu'elle accueillerait avec un esprit constructif les améliorations proposées par les parlementaires, tout en soulignant qu'il lui fallait, malgré tout, tenir compte des contraintes financières. - Sur les dispositions relatives à la communication, elle a indiqué qu'elle serait hostile à tout amendement qui porterait atteinte à la liberté d'expression. - S'agissant du juge de la détention provisoire, la garde des sceaux a estimé que, même s'il devait effectivement être saisi par le juge d'instruction, la décision qu'il rendrait ne risquait pas d'apparaître comme un préjugement. Elle a souligné que l'objectif du projet de loi était, en revanche, d'exiger un double regard pour priver une personne de sa liberté, tandis que la décision d'un seul juge suffirait pour la remettre en liberté. Quant à l'éventualité d'une saisine directe du juge de la détention provisoire par le procureur de la République, elle a considéré qu'elle conduirait à réduire considérablement le rôle du juge d'instruction et, partant, à instituer une procédure de type accusatoire, ce qui n'est pas le choix du Gouvernement. Elle a observé qu'en fait, la réforme proposée tirait les leçons de l'échec des précédentes tentatives et en particulier de celui de la loi de janvier 1993, qui a buté sur une insuffisance de moyens, mais aussi sur une mauvaise définition du rôle du juge délégué qui, chargé de décider du placement en détention provisoire, avait cependant pu apparaître comme se bornant à entériner les décisions du magistrat instructeur. C'est pourquoi, a-t-elle indiqué, le projet de loi préconise que le juge de la détention ait grade de président ou de vice-président, ce qui représente une garantie d'impartialité et d'objectivité. Ajoutant qu'il était sans doute possible d'améliorer la dénomination de « juge de la détention provisoire », la ministre a cependant jugé qu'il ne serait pas opportun de l'appeler « juge des libertés », dans la mesure où cette qualification s'applique, en fait, à l'ensemble des magistrats du siège. - Quant au financement de la réforme, elle a précisé qu'il ne s'effectuerait pas à coûts constants, les moyens budgétaires mis à disposition de la justice permettant de recruter, sur deux à trois ans, une centaine de magistrats afin de permettre la mise en place des juges de la détention provisoire ; elle a souligné que, d'ores et déjà, soixante affectations avaient été décidées dans cette perspective, accompagnées de la création de postes de greffiers et du renforcement des moyens de fonctionnement des juridictions. Elle a insisté sur le fait que les difficultés que l'on observait actuellement dans les tribunaux étaient imputables à la pénurie de recrutements organisés entre 1996 et 1997, rappelant que les affectations étaient subordonnées à des délais de formation incompressibles. Elle a indiqué qu'en 1999, devraient apparaître les premières arrivées correspondant au concours de recrutement exceptionnel ainsi que celles résultant de l'augmentation des promotions de l'Ecole nationale de la magistrature. - Sur la détention provisoire, elle a admis que le projet de loi ne reprenait pas l'ensemble des dispositions contenues dans la proposition de loi de M. Alain Tourret adoptée par l'Assemblée nationale en avril 1998, soulignant cependant qu'il s'en inspirait, notamment en ce qui concerne la durée de la détention provisoire en matière criminelle, pour laquelle il est proposé de mettre en place des butoirs, alors qu'actuellement celle-ci est illimitée. Elle a observé, en revanche, que les mesures concernant les seuils de placement en détention provisoire n'avaient pas été repris en l'état, parce qu'il apparaissait préférable de laisser une certaine marge d'appréciation permettant l'individualisation des décisions. - En ce qui concerne le contrôle judiciaire, la ministre a indiqué que le Gouvernement avait souhaité que le juge d'instruction conserve ses compétences dans la mesure où la maîtrise de cette prérogative pourrait l'inciter à remettre plus facilement en liberté des prévenus incarcérés. - S'agissant de la collégialité, tout en considérant qu'elle restait un objectif qui devait être poursuivi, elle a noté que chaque réforme qui l'avait proposé avait échoué par manque de moyens, et souligné que le Gouvernement n'entendait pas être confronté à une telle situation. Ajoutant qu'une décision collégiale pourrait accroître le risque que l'ordonnance de placement en détention provisoire n'apparaisse en réalité comme un préjugement, elle a cependant précisé qu'il n'était pas exclu qu'une telle option soit envisageable dans l'avenir au vu des moyens qui seront disponibles. - En ce qui concerne la situation matérielle des prévenus incarcérés, la garde des sceaux a confirmé que les taux d'occupation carcérale les plus élevés s'observaient dans les maisons d'arrêt. Elle a souligné qu'indépendamment des effets de la réforme proposée par le projet de loi qui devraient conduire à diminuer significativement les flux de placements en détention, le Gouvernement entendait mettre l'accent sur le développement des libérations conditionnelles, programmer la construction de six nouveaux établissements et financer la rénovation de 1 100 places dans les prisons existantes. - Quant au système inquisitoire, elle a jugé qu'il convenait de le préserver parce que, à l'expérience, la procédure française présentait beaucoup d'avantages, en particulier si l'on s'oriente vers une spécialisation accrue des juges d'instruction, sur le modèle de ce qui est prévu dans les pôles financiers. - S'agissant de la mise en place des juges de la détention provisoire dans les petites juridictions, la ministre a indiqué que le Gouvernement avait examiné, avec les chefs de cour, quatre scénarios dont aucun n'entraînait la suppression de ces juridictions: le premier, qui envisage l'affectation de juges de la détention provisoire dans les 185 tribunaux de grande instance (T.G.I.), apparaît inutile et impossible à mettre en oeuvre ; le deuxième, qui préconise de nommer des juges de la détention provisoire dans certains T.G.I., tout en maintenant des juges d'instruction dans chacun d'entre eux, sur le modèle de ce qui existe pour les juges des enfants, est envisageable ; il en va de même du troisième qui conduit à n'affecter des juges de la détention provisoire et des juges d'instruction que dans certains tribunaux seulement ; enfin, on peut également opter pour la mise en place de chambres de T.G.I. détachées. La ministre a ajouté que, pour les plus petits ressorts, le Gouvernement réfléchissait à la possibilité de confier les missions de juge de la détention provisoire aux juges placés près du président, ce qui ne poserait aucun problème pour la composition des formations de jugement et permettrait une spécialisation des magistrats en charge de la détention provisoire. - Quant à l'organisation d'un appel des décisions de la commission d'indemnisation des détentions provisoires, tout en estimant qu'il était envisageable, elle a souligné la difficulté de déterminer la juridiction compétente dès lors que cette commission est formée au sein de la Cour de cassation. - Evoquant enfin le problème des dénonciations anonymes, la ministre a rappelé qu'elles n'étaient en tout état de cause qu'un élément de l'enquête et ne constituaient jamais une preuve, le procureur, conformément au principe de l'opportunité des poursuites, étant seul compétent pour apprécier la suite à leur donner. Après avoir souligné qu'elles pouvaient parfois se justifier, notamment dans les affaires de terrorisme et d'infractions sexuelles, elle a précisé que, selon la jurisprudence, elles ne pouvaient pas servir de base à une enquête de flagrance. Elle a en dernier lieu déclaré que le Gouvernement ne prendrait aucune initiative en matière d'abus de bien social. * * * Après l'exposé du rapporteur, la Commission a rejeté l'exception d'irrecevabilité n° 1 et la question préalable n° 1 présentées par M. José Rossi et les membres du groupe Démocratie libérale et indépendants. Article premier Alors que les premiers articles du nouveau code pénal rappellent les grands principes applicables en droit pénal (principe de légalité, interprétations stricte de la loi pénale etc..) et que le nouveau code de procédure civile s'ouvre sur un titre premier consacré aux principes directeurs du procès et de la matière gracieuse, le code de procédure pénale ne comporte aucune disposition rappelant les principes fondamentaux de la procédure pénale. La commission Justice pénale et Droits de l'homme a défini à partir du bloc de constitutionnalité, des textes internationaux de protection des droits de l'homme ratifiés par la France et du code de procédure pénale dix principes fondamentaux qu'elle a proposé d'inscrire en tête de ce code. Elle a en effet estimé qu'une telle inscription présenterait l'avantage « de rendre plus visibles à tous, aux justiciables comme aux professionnels du droit, les lignes de force d'une procédure pénale dont les règles techniques ne sont que le reflet plus ou moins intelligible, ..., de permettre un allégement des formalités de procédure, une clarification du régime des nullités et d'inciter à une démarche plus déontologique que formaliste en définissant l'esprit de notre procédure pénale ». L'article préliminaire, inséré en tête de code de procédure pénale par l'article premier du projet de loi, reprend cette idée, tout en présentant des différences sensibles avec les propositions formulées par la commission Delmas-Marty, puisque les principes énoncés ne comportent aucune référence à la procédure accusatoire et, pour ceux qui sont repris, sont formulés de manière beaucoup plus synthétique. Le paragraphe I rappelle que l'objectif des personnes concourant à la procédure pénale est la recherche de la manifestation de la vérité et introduit les principes énumérés aux deux paragraphes suivants. Le paragraphe II regroupe les garanties dont bénéficie la personne mise en cause. Au premier rang de ces garanties figure la présomption d'innocence, énoncée à l'article IX de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Le premier alinéa évoque également le respect des droits de la défense, protégés par l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme, et du principe du contradictoire que le Conseil constitutionnel a eu l'occasion d'affirmer à de nombreuses reprises. Le deuxième alinéa rappelle que l'autorité judiciaire doit assurer un contrôle effectif des mesures de contraintes dont font l'objet les personnes suspectées ou poursuivies, conformément à l'article 66 de la Constitution qui dispose que l'autorité judiciaire est gardienne des libertés individuelles. Il inscrit dans la loi le principe de proportionnalité posé par l'article VIII de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en indiquant que ces mesures de contrainte doivent être proportionnées à la gravité de l'infraction reprochée et strictement limitées aux nécessités de la procédure. Reprenant l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme qui a donné lieu à une abondante jurisprudence, le troisième alinéa rappelle que les personnes poursuivies doivent être jugées dans un délai raisonnable. Enfin, le dernier alinéa pose le principe de la prévention, de la réparation et de la répression des atteintes à la réputation résultant de l'accusation dont une personne fait l'objet et renvoie au code de procédure pénale, au code civil, au code pénal et aux lois sur la presse écrite ou audiovisuelle. Ces codes et lois contiennent en effet un certain nombre de dispositions permettant, soit de sanctionner la diffusion d'images portant atteinte à la réputation d'une personne (article 226-30-1 du code pénal créé par l'article 22 du projet de loi), soit de répondre à des atteintes à la présomption d'innocence (articles 9-1 du code civil, 117-1 et 212-1 du code de procédure pénale, droit de réponse des lois du 29 juillet 1881 et du 29 juillet 1982). On peut néanmoins légitimement s'étonner que l'affirmation de ce principe, qui n'est qu'une déclinaison du principe de présomption d'innocence, se trouve ainsi placée au même rang que des garanties fondamentales consacrées par le juge constitutionnel, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ou la convention européenne des droits de l'homme. Le paragraphe III, consacré aux droits des victimes, rappelle que l'autorité judiciaire doit veiller à la garantie de ces droits au cours de toute procédure pénale. La Commission a rejeté un amendement présenté par Mme Nicole Catala tendant à préciser la rédaction de l'article préliminaire du code de procédure pénale. Le rapporteur a jugé que la rédaction du projet de loi était plus claire et qu'il convenait de la maintenir, dans la mesure où elle renvoyait à des dispositions existant déjà dans le code. La Commission a été saisie d'un amendement présenté par le rapporteur, tendant, notamment, à faire ressortir plus nettement les garanties fondamentales dont les personnes poursuivies doivent bénéficier. Le rapporteur a considéré qu'il importait de présenter clairement les principes directeurs du procès pénal et de faire référence au contenu de certaines normes supérieures comme la Convention européenne des droits de l'homme. M. Robert Pandraud s'est interrogé sur la rédaction du dernier alinéa de cet amendement qui prévoit que toute personne condamnée a le droit de faire examiner sa condamnation par une autre juridiction. Il a souhaité savoir si cette mention impliquait l'institution d'une procédure d'appel des jugements des cours d'assises, précisant qu'il y était, pour sa part, favorable. M. Pierre Albertini a considéré que, si cette dernière phrase soulevait des difficultés, il était préférable de ne pas la retenir et d'attendre la réforme de la procédure criminelle. M. Jean-Pierre Michel a attiré l'attention des commissaires sur le fait qu'il existait également certaines contraventions qui n'étaient soumises à aucune procédure d'appel. Observant que l'amendement proposé par le rapporteur indiquait clairement que les personnes se trouvant dans des conditions semblables et poursuivies pour les mêmes infractions devaient être jugées selon les mêmes règles, M. Philippe Houillon a souligné que, dans les faits, il en était souvent tout autrement. Il a insisté sur le fait qu'aujourd'hui, des personnes ayant commis les mêmes infractions n'étaient pas condamnées aux mêmes peines selon les endroits où elles étaient jugées, reconnaissant d'ailleurs que cette forme d'inégalité était difficile à surmonter. Concernant le dernier alinéa de l'amendement, il a estimé qu'il n'avait pas de contenu juridique précis, et ajouté que, s'il visait les personnes condamnées, rien n'était dit des victimes déboutées. Il a considéré également que la rédaction proposée présentait une ambiguïté pour ce qui est de la possibilité d'exercer un recours en appel contre un jugement de cour d'assises. Mme Frédérique Bredin s'est au contraire félicitée de la rédaction proposée par le rapporteur en notant que la question du double degré de juridiction était essentielle et que l'Assemblée nationale avait déjà exprimé son accord sur la nécessité d'instituer un recours en matière criminelle. Le rapporteur a indiqué que son amendement faisait référence au principe du double degré de juridiction, rappelant qu'il reprenait en cela le texte de la Convention européenne des droits de l'homme. Elle a précisé que la partie du projet de loi concernée ici ne portait pas sur les victimes mais bien uniquement sur les personnes poursuivies. A l'issue de cet échange de vues, la Commission a adopté l'amendement présenté par le rapporteur (amendement n° 72). En conséquence, plusieurs amendements sont alors devenus sans objet : quatre amendements n° 1, 2, 3 et 4 de M. Patrick Devedjian, le premier qui réaffirme que le principe du contradictoire fait partie intégrante des droits de la défense et qu'aucune mesure restrictive de liberté ne peut être appliquée à une personne qui n'a pas été entendue après avoir pris connaissance de la totalité des charges qui pèsent contre elle, le deuxième précisant que le jugement doit se fonder sur des preuves loyalement obtenues, le troisième supprimant le dernier alinéa du paragraphe II de l'article premier, le dernier d'ordre terminologique ; deux amendements de M. Pierre Albertini, le premier proposant d'adopter l'expression « caractère contradictoire de la procédure » en lieu et place de celle, habituellement utilisée, de « principe du contradictoire », le second rappelant que les personnes mises en accusation doivent être jugées dans un délai raisonnable, conformément aux engagements internationaux ratifiés par la France ; deux amendements d'ordre formel de Mme Nicole Catala ; deux amendements, l'un de M. Alain Tourret et l'autre de M. Philippe Houillon, visant à rappeler que l'information des personnes poursuivies ou suspectées sur leurs droits est un principe qui doit connaître une mise en _uvre immédiate dès la garde à vue ; deux amendements enfin, l'un de M. Alain Tourret et l'autre de M. Claude Goasguen, réaffirmant que l'autorité judiciaire doit, en premier lieu, assurer la protection des droits des victimes. La Commission a adopté l'article premier ainsi modifié. La Commission a rejeté un amendement de M. Alain Tourret substituant aux termes « chambre d'accusation » ceux de « chambre d'instruction et des libertés ». Le rapporteur a jugé préférable de s'en tenir à la dénomination actuelle, considérant qu'il serait plus opportun de débattre de cette question de dénomination lors de la réforme de la procédure criminelle. Elle a également rejeté un amendement de M. Claude Goasguen prévoyant, comme le précédent, le changement de dénomination de la chambre d'accusation, mais substituant également aux termes « juge d'instruction » ceux de « juge de l'instruction et des libertés ». M. Philippe Houillon a jugé qu'il était souhaitable de procéder à cette substitution, afin de bien montrer que le juge d'instruction doit instruire à charge et à décharge. Puis la Commission a rejeté un amendement de Mme Nicole Catala prévoyant que toute personne est tenue d'apporter son concours loyal aux investigations de la justice pénale et sanctionnant les dépositions mensongères faites en vue de nuire à la manifestation de la vérité, après que le rapporteur eut rappelé l'existence de l'article 434-13 du code pénal, qui réprime le témoignage mensonger fait sous serment. Elle a également rejeté l'amendement n° 5 de M. Patrick Devedjian prévoyant la motivation des mises en examen, le rapporteur ayant indiqué qu'après avoir examiné cette question avec soin, elle en avait conclu qu'une telle disposition, si elle présentait certains avantages, risquait aussi de soulever des difficultés, notamment au regard du principe de la présomption d'innocence. Article additionnel après l'article premier La Commission a ensuite été saisie d'un amendement de M. Alain Tourret rappelant que la mission même du juge d'instruction est d'instruire à charge et à décharge. M. Alain Tourret a déploré qu'aujourd'hui l'essentiel de l'instruction soit conduit à charge. Il a exprimé le v_u que le juge d'instruction soit le fléau de la balance et non pas seulement l'un de ses plateaux. Mme Frédérique Bredin a jugé également que ce principe était essentiel et qu'il était important de le rappeler. M. Gérard Gouzes a observé que ce rappel dans la loi ne conduirait malheureusement pas à le rendre effectif dans la pratique judiciaire quotidienne. La Commission a adopté l'amendement de M. Alain Tourret (amendement n° 73). En conséquence, l'amendement n° 6 de M. Patrick Devedjian, ainsi que deux amendements de M. Pierre Albertini et de Mme Frédérique Bredin ayant le même objet que celui de M. Alain Tourret ont été considérés comme satisfaits. La Commission a également adopté un amendement de M. Philippe Houillon prévoyant que l'ordonnance de règlement comporterait désormais les mentions spécifiques relatives aux diligences accomplies pour instruire à charge et à décharge (amendement n° 74). M. Philippe Houillon a estimé que s'il était important de réaffirmer le principe de l'instruction à charge et à décharge, il fallait aussi lui donner une traduction concrète, ce qui était l'objet de son amendement. M. Pierre Albertini a fait connaître sa préférence pour un texte de portée plus globale, tandis que M. Robert Pandraud jugeait que, s'il était utile d'affirmer le principe, il était également nécessaire d'en expliciter une application possible. TITRE PREMIER chapitre premier Section 1 La Commission a repoussé un amendement d'ordre terminologique de M. Pierre Albertini modifiant l'intitulé du chapitre 1er du titre 1er en introduisant l'expression de « caractère contradictoire de la procédure ». Elle a ensuite adopté trois amendements identiques du rapporteur, de MM. Alain Tourret et Philippe Houillon, modifiant l'intitulé de la section 1 relative à la garde à vue (amendement no 75). Article additionnel avant l'article 2 La Commission a adopté un amendement du rapporteur prévoyant que le contrôle du procureur de la République sur les gardes à vue devait se traduire par au moins une visite trimestrielle des locaux de gardes à vue (amendement n° 76). Mme Frédérique Bredin a estimé que cette mesure était importante et qu'il convenait de la rendre obligatoire, alors que le code de procédure pénale en prévoit aujourd'hui seulement la possibilité. M. Gérard Gouzes a souhaité savoir s'il existait des statistiques sur les visites actuellement réalisées par les procureurs. Le rapporteur a indiqué que tel n'était pas le cas pour l'ensemble des parquets, même si certains d'entre eux avaient pris l'initiative de constituer de telles statistiques. La Commission a ensuite été saisie d'un amendement du rapporteur prévoyant que les personnes entendues comme témoin dans le cadre d'une enquête de flagrance, d'une enquête préliminaire ou au cours d'une commission rogatoire pouvaient, après deux heures d'audition, informer leur famille et leur employeur de leur présence dans un local de police. M. Arnaud Montebourg s'est interrogé sur la sanction applicable au non-respect d'une telle disposition. Le rapporteur a indiqué, en réponse, qu'il s'agissait de celle prévue dans le cadre de l'application des articles 63 et suivants du code de procédure pénale, c'est-à-dire la nullité. Mme Frédérique Bredin a jugé utile de consolider les droits des témoins. M. Gérard Gouzes a constaté qu'aujourd'hui, ces témoins entendus dans un commissariat pouvaient parfaitement téléphoner à leur famille, le rapporteur indiquant cependant que, dans les faits, tel n'était pas hélas toujours le cas. M. Philippe Houillon s'est interrogé sur l'intérêt de cette disposition, dans la mesure où l'on sait toujours où se trouve le témoin, puisque, par définition, il est convoqué par l'autorité de police. M. Robert Pandraud a jugé qu'il serait sans doute plus efficace d'instituer et d'appliquer de véritables sanctions disciplinaires à l'égard des officiers de police judiciaire et des juges d'instruction qui n'exerceraient pas correctement leurs prérogatives. M. Pierre Albertini a appelé à ce qu'on supprime certaines zones imprécises dans la législation relative à l'audition des témoins. M. Alain Vidalies s'est inquiété de dispositions proposées par le rapporteur. Il s'est, en particulier, demandé si, interprété a contrario, ce dispositif ne conduirait pas à interdire au témoin de téléphoner lors des deux premières heures d'audition. M. Alain Tourret a déclaré partager cette inquiétude et a souligné les effets pervers que pouvait susciter une telle rédaction. M. Guy Hascoët a souhaité, quant à lui, que l'on réaffirme le droit de la personne entendue comme témoin de prévenir aussitôt sa famille et son employeur. A l'issue de ce débat, la Commission a rejeté l'amendement présenté par le rapporteur. Articles additionnels avant l'article 2 (art. 62, 63, 153 et 154 du code de procédure pénale) Limitation de la garde à vue aux personnes suspectées La Commission a ensuite été saisie de deux amendements de Mme Frédérique Bredin permettant de limiter la garde à vue aux seuls suspects et précisant les conditions d'audition de témoins dans le cas d'enquête de flagrance et de l'enquête préliminaire. Elle a souligné que ces dispositions reprenaient les principes énoncés à l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme. Elle a ajouté qu'aujourd'hui l'article 62 du code de procédure pénale permettait de convoquer un témoin de manière contraignante, même sans recourir à la garde à vue. M. Arnaud Montebourg s'est interrogé sur l'état de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme en la matière, ainsi que sur le régime des nullités applicable au dispositif. M. Philippe Houillon a exprimé son accord sur le principe évoqué par Mme Frédérique Bredin, mais a considéré qu'il pouvait s'agir là d'une forme de préjugement et que cette distinction nette faite entre témoins et suspects pourrait paradoxalement conduire les juges d'instruction et les policiers à traiter systématiquement les témoins comme des suspects. M. Gérard Gouzes s'est interrogé sur la notion de « temps strictement nécessaire » à l'audition des témoins pendant lequel ceux-ci peuvent être retenus. Le rapporteur s'est déclaré satisfait que l'on mette enfin en conformité notre droit avec les dispositions de la Convention. Elle a souhaité que désormais les témoins soient dans une situation claire et que la garde à vue soit réservée aux seuls suspects. Elle a indiqué, par ailleurs, que la France n'avait pas été condamnée sur ce point précis à l'heure actuelle. Pour ce qui concerne le régime des nullités, elle a précisé qu'il demeurerait celui en vigueur actuellement. Elle a conclu en mentionnant que l'expression « temps strictement nécessaire » relevée par M. Gérard Gouzes existait déjà dans le code de procédure pénale. La Commission a adopté ces deux amendements (amendements nos 77 et 78). Art. 63-1 du code de procédure pénale Information de la personne placée en garde à vue La Commission a examiné trois amendements, l'un de M. Alain Tourret, l'autre n° 37 de M. André Gerin et le troisième de M. Philippe Houillon donnant à la personne gardée à vue le droit de connaître les raisons de son arrestation et les accusations portées contre elle, l'amendement n° 13 de M. Patrick Devedjian, donnant à cette personne le droit d'être informée des indices retenus contre elle ainsi qu'un amendement du rapporteur permettant au gardé à vue d'être informé de la nature de l'infraction sur laquelle porte l'enquête et lui donnant connaissance des dispositions de l'article 77-2. M. Alain Tourret a rappelé que l'article 5-2 de la Convention européenne des droits de l'homme prévoyait que « toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et toute accusation portée contre elle », ce que M. André Gerin a confirmé. M. Pierre Albertini a souligné que la communication des faits reprochés à la personne arrêtée était au c_ur du système des droits de la défense. Considérant que les termes employés par la Convention européenne des droits de l'homme, traduits de l'anglais, n'étaient pas satisfaisants, le rapporteur a indiqué qu'elle trouvait la rédaction de son propre amendement, qui ne reprend pas stricto sensu le texte de la Convention, mieux adaptée. Mme Frédérique Bredin a estimé que la proposition du rapporteur était effectivement la plus raisonnable pour mettre correctement en application les dispositions de la Convention. Défendant son amendement n° 13, M. Patrick Devedjian a considéré qu'il était nécessaire que la personne arrêtée soit informée de l'existence et de la nature des indices faisant présumer qu'elle avait commis ou tenté de commettre une infraction. Rappelant que l'on pouvait être retenu dans un local de police en qualité de témoin ou au titre d'une garde à vue, il a souligné que la procédure envisagée permettrait à la personne retenue de connaître son statut. M. Arnaud Montebourg a considéré qu'un suspect devait connaître les indices ayant conduit à son arrestation. En revanche, il a estimé que tout autre personne retenue dans un local de police en qualité de témoin n'avait pas à prendre connaissance de ces éléments. M. Alain Vidalies a fait observer que, si le défaut de communication des indices entraînait la nullité de la procédure, aucune investigation policière ne serait possible. Le rapporteur a indiqué qu'en cas de placement abusif en garde à vue, le prévenu pourrait faire annuler la procédure. La Commission a rejeté l'amendement présenté par M. Alain Tourret et l'amendement n° 37 de M. André Gerin. Elle a ensuite adopté l'amendement du rapporteur (amendement n° 79). En conséquence, l'amendement n° 13 de M. Patrick Devedjian et celui présenté par M. Philippe Houillon sont devenus sans objet. Art. 63-1 du code de procédure pénale Droit au silence de la personne placée en garde à vue La Commission a adopté un amendement présenté par Mme Frédérique Bredin modifiant le premier alinéa de l'article 63-1 du code de procédure pénale pour affirmer le droit au silence de la personne placée en garde à vue (amendement n° 80). En conséquence, l'amendement n° 7 présenté par M. Patrick Devedjian et l'amendement présenté par M. Philippe Houillon, considérés comme satisfaits, sont devenus sans objet. Art. 63-2 du code de procédure pénale Information de la famille ou de l'employeur La Commission a adopté un amendement présenté par le rapporteur modifiant le premier alinéa de l'article 63-2 du code de procédure pénale pour préciser que la personne gardée à vue a le droit de prévenir sa famille ou son employeur dans les meilleurs délais (amendement n° 81). Article 2 Cet article donne à la personne placée en garde à vue le droit de s'entretenir avec un avocat dès le début de cette mesure, et non plus à l'issue de la vingtième heure comme c'est le cas actuellement. Les conditions d'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue sont définies par l'article 63-4 du code de procédure pénale et par la circulaire du 1er mars 1993. - Les conditions de désignation de l'avocat Si la personne placée en garde à vue est immédiatement informée de son droit de s'entretenir avec un avocat (article 63-1), cet entretien ne peut intervenir dans le droit commun qu'après la vingtième heure. La personne qui sollicite la venue d'un avocat doit communiquer à l'officier de police judiciaire les coordonnées professionnelles de ce dernier ou, à défaut, tous les renseignements utiles permettant de les obtenir rapidement ; l'avocat choisi doit être en mesure de prêter valablement son concours. Si la personne gardée à vue n'est pas en mesure de désigner un avocat ou si l'avocat choisi ne peut être joint, elle peut demander un avocat commis d'office ; le bâtonnier est alors informé sans délai de cette demande. L'absence d'avocat après la vingtième heure n'entraîne cependant pas la nullité de la procédure, à partir du moment où les diligences nécessaires ont été accomplies : dans un arrêt du 13 février 1996, la Cour de Cassation a ainsi estimé que, si l'article 63-4 impose à l'officier de police judiciaire d'informer par tous moyens le bâtonnier de l'existence d'une telle demande, « il ne lui fait pas obligation de rendre effectif l'entretien avec cet avocat ». Comme le souligne la circulaire d'application du 1er mars 1993, l'éventuelle difficulté rencontrée par l'officier de police judiciaire pour contacter l'avocat choisi, le bâtonnier ou l'avocat désigné d'office, devra être mentionnée dans la procédure mais ne saurait être de nature à paralyser le déroulement de l'enquête. Le bon fonctionnement de ce dispositif suppose donc l'organisation de services de permanence au sein des conseils de l'Ordre, qui permettent d'éviter qu'une inégalité ne s'instaure entre les personnes gardées à vue selon qu'elles connaissent ou non un avocat prêt à intervenir sur le champ. - Les modalités d'intervention de l'avocat L'avocat est informé de la nature de l'infraction recherchée, mais n'a pas accès au dossier. La circulaire du 1er mars 1993 précise que l'officier de police judiciaire n'est pas tenu de l'informer des motifs du placement en garde à vue ni des perspectives d'évolution de la mesure. La durée de l'entretien, incluse dans le délai de garde à vue, est limitée à trente minutes et doit exclure le temps consacré aux préparatifs ; elle ne peut en outre être fractionnée. L'entretien se déroule sur les lieux de la garde à vue ou à l'occasion d'un transport, dans des conditions qui doivent garantir la confidentialité des propos échangés, ce qui interdit l'entretien téléphonique. A l'issue de son intervention, l'avocat présente, le cas échéant, des observations écrites qui sont jointes à la procédure. Lorsque qu'il fait état d'irrégularités graves, l'officier de police judiciaire en réfère sans délai au procureur de la République. L'avocat ne peut divulguer le contenu de l'entretien ni l'existence même de celui-ci pendant toute la durée de la garde à vue de son client, afin de ne pas nuire au bon déroulement des opérations. Notons enfin que l'intervention de l'avocat dans ce cadre bénéficie de l'aide juridique depuis la loi du 24 août 1993. - Les dispositions spécifiques en cas de criminalité organisée, de terrorisme ou de trafic de stupéfiants A la suite des lois du 24 août 1993 et du 1er février 1994, l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue en cas de délinquance ou de criminalité organisées, de trafic de stupéfiants et de terrorisme fait l'objet d'un régime spécifique dérogatoire au droit commun. En effet, en présence de faits susceptibles de constituer une association de malfaiteurs (article 450-1 du code pénal), du proxénétisme avec circonstances aggravantes (articles 225-7 et 225-9 du même code), de l'extorsion de fonds avec circonstances aggravantes (articles 312-2 à 312-5 et 312-7) ou une infraction commise en bande organisée prévue par les articles 224-3, 225-8, 311-9, 312-6 et 322-8 du code pénal, l'avocat ne peut intervenir qu'après la trente-sixième heure. Lorsque la garde à vue est soumise à des règles particulières de prolongation, c'est à dire en cas de terrorisme (article 706-23) et de trafic de stupéfiants (article 706-29), l'intervention de l'avocat a lieu à l'issue de la soixante-douzième heure. Rappelons que le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 93-326 DC du 11 août 1993, a admis le principe d'une intervention différée de l'avocat pour ces infractions complexes. b) Les modifications proposées par le projet de loi Reprenant la solution proposée par la loi du 4 janvier 1993, l'article 2 du projet de loi prévoit l'intervention de l'avocat dès le début de la garde à vue et propose quelques adaptations liées à cette mesure. Il ne modifie cependant que le régime de droit commun, les délais d'intervention de l'avocat en cas de délinquance ou de criminalité organisées, de trafic de stupéfiants ou de terrorisme demeurant inchangés. Le Gouvernement a en effet considéré que les investigations des enquêteurs sur ces faits, impliquant souvent plusieurs personnes, étaient par nature plus complexes et justifiaient l'octroi d'un délai supplémentaire avant l'intervention de l'avocat.
Bien que l'intervention de l'avocat dès le début de la garde à vue soit limitée par le paragraphe I de l'article 2 au régime de droit commun, cette modification nécessite une harmonisation rédactionnelle des dispositions applicables aux régimes dérogatoires, harmonisation à laquelle procèdent les paragraphes IV et V. Il convient de noter que, même si le texte prévoit une intervention de l'avocat « dès le début de la garde à vue », celle-ci ne sera effective qu'après un certain délai qui tient au temps nécessaire pour joindre l'avocat et pour que celui-ci puisse se rendre dans les locaux de garde à vue ; pendant ce laps de temps, les officiers de police judiciaire pourront poursuivre leurs investigations, comme c'est le cas actuellement lorsque l'avocat intervient à l'issue de la vingtième heure. Soulignons enfin que, selon la jurisprudence de la Cour de cassation évoquée ci-dessus, il s'agit pour la police d'une obligation de moyens et non de résultats. Le paragraphe II renforce l'information de l'avocat. Outre la nature de l'infraction sur laquelle porte l'enquête, celui-ci sera désormais informé de sa date présumée : cette précision lui permettra de savoir si la mesure de garde à vue a été décidée dans le cadre d'une enquête de flagrance ou d'une enquête préliminaire. Les bases juridiques de la garde à vue lui seront également communiquées : la personne gardée à vue pourra en effet être une personne qui se trouvait sur les lieux de l'infraction (article 61), une personne susceptible de fournir des renseignements (article 62) ou une personne contre laquelle il existe des indices faisant présumer qu'elle a commis l'infraction (deuxième alinéa de l'article 63), alors qu'actuellement ce ne peut être qu'une personne contre laquelle il existe des indices, puisque l'avocat n'intervient qu'après la vingtième heure et que la garde à vue d'un simple témoin est limitée au temps nécessaire à sa déposition. Afin de conserver un certain contrôle sur le déroulement ultérieur de la garde à vue, le paragraphe III prévoit la possibilité pour la personne dont la garde à vue fait l'objet d'une prolongation de demander à s'entretenir avec un avocat, qui pourra être différent de celui de la première heure, dès le début de cette prolongation. On peut penser que cette disposition contribuera en outre à limiter le nombre de garde à vue de plus de vingt-quatre heures, tout comme l'intervention de l'avocat après la vingtième heure a permis, à partir de 1993, de diminuer la durée des gardes à vue. La Commission a été saisie d'un amendement de M. Pierre Albertini donnant à la personne placée en garde à vue la possibilité de choisir le moment de l'intervention de son avocat, de l'amendement n° 8 de M. Patrick Devedjian autorisant la présence de l'avocat tout au long de la garde à vue et d'un amendement du rapporteur permettant à l'avocat présent dès la première heure de la garde à vue de revenir après la vingtième heure. M. Pierre Albertini a considéré que l'intervention automatique de l'avocat dès le début de la garde à vue n'était pas judicieuse, soulignant qu'à ce stade de la procédure, il revenait à l'officier de police judiciaire d'informer la personne gardée à vue de ses droits. Il a estimé qu'il serait plus logique de laisser l'intéressé déterminer le moment où il souhaitait que l'avocat intervienne, en disposant du temps nécessaire pour prendre connaissance des faits motivant sa garde à vue, de telle sorte qu'il soit en mesure de l'en informer. Il a par ailleurs approuvé le principe du retour de l'avocat à l'issue de la vingtième heure, soulignant qu'il permettrait de prévenir les mauvais traitements susceptibles d'être infligés à la personne placée en garde à vue. Il a ensuite dénoncé, comme une exception française, la méfiance existant à l'égard des avocats, estimant que le respect des droits de la défense n'était pas contradictoire avec l'efficacité de la répression. M. Robert Pandraud s'est inquiété de l'inégalité qui pourrait apparaître entre les personnes placées en garde à vue, selon qu'elles seraient ou non susceptibles de faire appel aux services d'un avocat. Il a, en outre, insisté sur la difficulté qu'il pourrait y avoir à trouver un avocat dans un délai court, évoquant, par ailleurs, les problèmes que posent la garde à vue des personnes non francophones ayant besoin d'un interprète. Il a enfin souhaité que la multiplication des interventions de l'avocat n'aboutisse pas à « désarmer » les officiers de police judiciaire. M. Alain Tourret a rappelé que toute personne peut bénéficier de l'assistance d'un avocat désigné d'office par le bâtonnier. M. Gérard Gouzes a, pour sa part, considéré qu'il était nécessaire de trouver un équilibre entre le respect des droits de la défense et l'efficacité du travail des enquêteurs. Exprimant son accord avec M. Pierre Albertini sur le rôle que devaient jouer les officiers de police judiciaire pour informer les personnes placées en garde à vue de leurs droits, il a cependant estimé que le dispositif proposé par le rapporteur, permettant l'intervention de l'avocat au début de la garde à vue et à partir de la vingtième heure, était complémentaire. M. Patrick Devedjian a souligné que l'institution de la garde à vue était le résultat d'une tradition de méfiance à l'égard des avocats, rappelant qu'elle avait été mise en place en 1897 après que les avocats eurent enfin obtenu le droit d'entrer dans les cabinets d'instruction. Il a remarqué, par ailleurs, que dans tous les autres pays européens la présence continue de l'avocat au cours de la garde à vue était acquise. Soulignant l'évolution des positions de l'opposition sur ce sujet, Mme Frédérique Bredin a précisé que l'intervention de l'avocat dès la première heure de la garde à vue signifiait que celui-ci pouvait intervenir à tout moment entre la première heure et la vingtième heure. Elle a, par ailleurs, indiqué qu'elle demanderait au Gouvernement des précisions sur les conditions concrètes de venue de l'avocat dans les locaux de la garde à vue. M. Claude Goasguen a souligné que les parlementaires devaient mener la réforme en ayant conscience que c'est la procédure pénale du XXIème siècle qu'ils mettaient en place. Il a indiqué qu'il présentait un amendement posant le principe selon lequel l'avocat devait être présent au cours des interrogatoires de la personne placée en garde à vue, observant que cette solution, la plus économe et la plus efficace, supposerait une simple coordination des horaires entre l'avocat et les officiers de police judiciaire. Il a regretté que la réforme proposée par le Gouvernement ne procède qu'à des aménagements techniques, jugeant qu'il convenait en fait de s'orienter vers une authentique procédure accusatoire. Après avoir rappelé qu'en 1993 l'opposition avait supprimé le juge des libertés et conforté la procédure inquisitoire, M. Jean-Pierre Michel a remarqué que le passage à une procédure accusatoire nécessiterait l'instauration d'un parquet, composé de fonctionnaires, alors que la révision constitutionnelle en cours allait, au contraire, dans le sens d'une plus grande indépendance des magistrats du parquet. Il a ajouté qu'elle supposerait, en outre, que les tarifs des avocats soient conventionnés et qu'il existe une véritable sécurité sociale judiciaire. Il a conclu qu'engager le débat sur la procédure accusatoire, sans avoir réfléchi aux conséquences pratiques d'une transformation du système, reflétait une attitude démagogique, laissant de côté le problème des inégalités sociales entre les prévenus face aux frais de justice. M. Christophe Caresche a considéré que le véritable intérêt de cet article résidait dans le fait qu'il instaure une logique de vérification des conditions de garde à vue. M. Alain Vidalies s'est interrogé sur le sens du « jusqu'au-boutisme » qui anime les membres de l'opposition. Il s'est félicité que l'Assemblée soit saisie d'un projet mettant en _uvre une évolution concrète et précise. Le rapporteur a jugé que la présence de l'avocat au début de la garde à vue et son retour après la vingtième heure constituaient une solution équilibrée, faisant observer que, depuis que l'avocat pouvait intervenir à la vingtième heure, le nombre des gardes à vue excédant cette durée avait été réduit à 15 %. Rappelant qu'en cas de prolongation de la garde à vue, l'avocat pourrait revenir à l'issue de la trente-sixième heure, elle a jugé que sa présence continue auprès de la personne placée en garde à vue aurait des incidences financières trop importantes. Par ailleurs, elle a souligné que ni le Président de la République, ni le Gouvernement n'avaient envisagé d'orienter la réforme vers la mise en place d'une procédure accusatoire. Ajoutant que celle-ci supposerait la suppression du juge d'instruction, elle a considéré que tel n'était pas l'objet de la réforme proposée, qui vise à améliorer la procédure mixte en vigueur dans notre pays en vue de conforter le respect de la présomption d'innocence. Mme Catherine Tasca, présidente, a jugé que les termes du débat étaient clairement posés puisque le Gouvernement et le Président de la République avaient opté pour un renforcement des droits de la défense au sein du système inquisitoire. A l'issue de ce débat, la Commission a rejeté l'amendement de M. Pierre Albertini et l'amendement n° 8 de M. Patrick Devedjian et adopté, en revanche, l'amendement du rapporteur (amendement n° 82). M. Patrick Devedjian a ensuite présenté l'amendement n° 9 précisant que l'absence de l'avocat lors de la garde à vue ne peut constituer un motif de nullité de l'enquête en cours. MM. Jean-Pierre Michel et Gérard Gouzes ont estimé que cette disposition soulignait les contradictions dans le discours de l'opposition qui affiche sa volonté de défendre la présence de l'avocat tout au long de la garde à vue et propose parallèlement d'écarter toute conséquence juridique s'il est absent. Le rapporteur, a indiqué que cet amendement était satisfait par la jurisprudence actuelle de la Cour de cassation. En conséquence, la Commission a rejeté cet amendement. La Commission a adopté un amendement de coordination de Mme Frédérique Bredin avec l'amendement limitant la garde à vue aux seuls suspects (amendement n° 83), un amendement similaire de M. Alain Tourret devenant, en conséquence, sans objet. Puis elle a été saisie de deux amendements identiques, l'amendement n° 10 de M. Patrick Devedjian et un amendement de M. Philippe Houillon, donnant aux avocats la faculté d'assister aux interrogatoires de police. Après que Mme Catherine Tasca, présidente, eut rappelé que la présence de l'avocat tout au long de l'interrogatoire avait été précédemment écartée, la Commission a rejeté ces amendements. Elle a également rejeté les amendements de conséquence nos 11 et 12 de M. Patrick Devedjian, ainsi qu'un amendement de M. Philippe Houillon permettant à l'avocat de s'entretenir avec la personne gardée à vue à compter de la dixième heure. Elle a, en revanche, adopté un amendement du rapporteur permettant à l'avocat de s'entretenir avec la personne dont la garde à vue a été prolongée au-delà de vingt-quatre heures, à compter de la douzième heure suivant cette prolongation (amendement n° 166). La Commission a ensuite été saisie de deux amendements identiques, l'un de M. Alain Tourret, l'autre de M. Philippe Houillon, visant à supprimer les exceptions à la présence de l'avocat dès la première heure en cas de proxénétisme, d'extorsion de fonds aggravée ou d'infractions commises en bande organisée. M. Patrick Devedjian a fait part à la Commission de son accord avec cet amendement en estimant que le respect de la présomption d'innocence et les droits de la défense ne sauraient connaître une application à géométrie variable. Citant la décision du Conseil constitutionnel du 11 août 1993 relative à la précédente réforme de la procédure pénale, il a fait observer que cette jurisprudence obligeait le législateur à une grande cohérence en cas de distinction entre différents régimes de garde à vue. A cet égard, il a remarqué que la distinction opérée par le projet de loi ne tenait pas compte de l'échelle des peines, pas plus qu'elle ne se fondait sur le critère de l'infraction en bande organisée. En réponse à cette intervention, M. Robert Pandraud a estimé que les distinctions entre les différents régimes de garde à vue n'étaient pas fondées sur la gravité des peines, mais sur la difficulté de l'enquête liée à la nature de certaines infractions. S'il a jugé que le régime spécifique applicable au proxénétisme était discutable, il a considéré qu'il était en revanche justifié pour les autres infractions, du fait qu'elles étaient commises en bande organisée. M. Gérard Gouzes a également souligné la légitimité de ce régime exceptionnel de garde à vue, en expliquant qu'elles concernaient le plus souvent, en raison de la nature des infractions visées, des personnes très au fait de leurs droits. Pour cette raison, il a considéré, pour ces infractions spécifiques, que l'application du régime de droit commun en matière d'accès des avocats aux personnes gardées à vue était susceptible de gêner les enquêteurs. M. Claude Goasguen a indiqué qu'il était favorable au maintien du régime exceptionnel de garde à vue pour certaines infractions, du fait des nécessités pratiques de l'enquête. Sur ce point, il a fait observer que sa prise de position en faveur d'une procédure accusatoire n'était pas contradictoire avec le souci de garantir l'efficacité du travail des enquêteurs. Mme Frédérique Bredin a expliqué que les exceptions au régime de la garde à vue mises en _uvre par le projet de loi se justifiaient, pour chaque infraction concernée, par l'intervention de bandes organisées plutôt que par le critère de la gravité des faits ou des peines encourues. Après avoir fait remarquer que le modèle américain de procédure accusatoire n'avait pas fait la preuve de son efficacité, M. Guy Hascoët a estimé que les exceptions au régime de garde à vue prévues par le projet de loi n'étaient pas réellement justifiées, ajoutant qu'elles pouvaient donner lieu à de nombreux abus. Jugeant que les infractions énumérées au sixième alinéa de l'article 63-4 du code de procédure pénale concernaient en réalité une dizaine de personnes par an, il a considéré qu'elles permettaient en revanche, dans de nombreux cas, de restreindre les droits des personnes gardées à vue sans justification réelle. Il a illustré son propos par les pratiques policières en matière de lutte contre le trafic de stupéfiants, en évoquant la rigueur du régime appliqué aux petits trafiquants, alors même que les politiques de lutte contre le trafic international ne sont pas à la hauteur des enjeux. Mme Christine Lazerges, rapporteur, a estimé qu'il était nécessaire de maintenir les exceptions à la présence de l'avocat dès la première heure de la garde à vue pour les infractions de terrorisme, de trafic de stupéfiants ou de proxénétisme. S'agissant de cette dernière catégorie d'infractions, elle a considéré qu'elle était souvent le fait de bandes organisées disposant de nombreuses ramifications internationales. Elle a, en outre, jugé que la décision du Conseil constitutionnel du 11 août 1993 validait la distinction entre différents régimes de garde à vue pour certaines infractions spécifiques. Suivant son rapporteur, la Commission a rejeté les amendements de M. Alain Tourret et de M. Philippe Houillon. Elle a également rejeté un amendement de M. Alain Tourret limitant aux seules infractions de terrorisme et de stupéfiants l'exception à la règle de la présence de l'avocat dès la première heure de la garde à vue. M. Pierre Albertini a ensuite présenté un amendement tendant à prévoir l'enregistrement des interrogatoires et confrontations lors de la garde à vue. Rappelant que la Commission Truche avait proposé cette disposition, il a estimé que l'argument du coût d'une telle mesure, invoqué par la garde des sceaux lors de son audition par la Commission, ne devait pas s'opposer à sa mise en _uvre, du fait des avantages qu'elle présenterait pour les personnes gardées à vue. Mme Frédérique Bredin a jugé que cette proposition était intéressante, mais a estimé qu'il convenait de réfléchir à la nature juridique de l'enregistrement et de son insertion dans les dossiers judiciaires. M. Gérard Gouzes a considéré que cette disposition risquait de se retourner contre les personnes placées en garde à vue, dans la mesure où l'enregistrement de leurs aveux éventuels limiterait les possibilités de rétractation. Il a également jugé que ces enregistrements pourraient donner lieu à des manipulations et qu'ils risquaient de compliquer la tâche de la défense. M. Robert Pandraud a affirmé son hostilité de principe à l'enregistrement des interrogatoires en estimant qu'ils étaient la marque d'une suspicion à l'égard des enquêteurs. Il a, en outre, fait observer que cette disposition risquait de paralyser les services de police en inspirant aux enquêteurs la crainte de faire l'objet de poursuites disciplinaires. Jugeant qu'une telle mesure pouvait se justifier pour les mineurs de 10 à 13 ans, le rapporteur, a considéré qu'elle nécessitait en revanche une réflexion plus approfondie pour les autres catégories de personnes placées en garde à vue. En conséquence, la Commission a rejeté cet amendement. La Commission a alors adopté l'article 2 ainsi modifié. La Commission a rejeté l'amendement n° 38 de M. André Gerin tendant à enregistrer les auditions des mineurs de 10 à 13 ans, ainsi qu'un amendement de M. Alain Tourret prévoyant l'enregistrement sonore des auditions de tous les mineurs. Elle a ensuite été saisie d'un amendement de M. Claude Goasguen tendant à instituer la présentation systématique aux magistrats des personnes dont la garde à vue fait l'objet d'une prolongation. Son auteur a fait observer que cette mesure visait à renforcer les droits des personnes faisant l'objet d'une garde à vue prolongée, en mettant en présence les différentes parties concernées. Affirmant que l'argument du coût d'une telle mesure ne saurait être opposé à une réforme de principe de la procédure pénale, il a indiqué que le législateur devait avant tout procéder en vue d'améliorer le droit et non en fonction des seules considérations de fait. M. Robert Pandraud a fait observer qu'une telle disposition pourrait s'appliquer sans trop de difficultés à Paris, mais qu'elle devenait irréaliste sur le reste du territoire, compte tenu du grand nombre de lieux de garde à vue existant en France. Il a par ailleurs jugé qu'il serait paradoxal de restreindre, au profit des magistrats, le rôle des officiers de police judiciaire, alors même que la loi vient d'en augmenter le nombre. Il a ainsi estimé qu'il était indispensable de trouver un équilibre entre les pouvoirs de l'officier de police judiciaire, le respect de la présomption d'innocence et l'efficacité de la lutte contre la criminalité. Le rapporteur a également insisté sur le caractère irréaliste de cet amendement, rappelant que certains tribunaux de grande instance pouvaient se trouver à plus de trois heures des lieux de garde à vue de leur ressort et que la France n'en comptait pas moins de 5 000. Elle a, par ailleurs, jugé que les moyens nécessaires au financement de ce dispositif étaient exorbitants au regard de son intérêt. Après avoir jugé qu'il ne fallait pas opposer à un argument de droit un argument de fait fondé sur les contraintes budgétaires, M. Patrick Devedjian a estimé que l'on ne pouvait pas à la fois s'opposer à la présence de l'avocat au cours de la garde à vue et à la présence du magistrat. S'agissant du financement des réformes de la justice, M. Gérard Gouzes a rappelé à l'opposition qu'elle avait adopté une réforme de la cour d'assises instituant un double degré de juridiction, sans prévoir les moyens nécessaires à sa mise en _uvre. M. Arnaud Montebourg a, pour sa part, estimé que l'activité législative ne saurait s'abstraire des moyens nécessaires à la mise en _uvre des règles de droit nouvelles. Il a fait observer que le Gouvernement actuel avait mis un terme à la stagnation des effectifs de la magistrature et qu'il ne serait pas opportun d'imposer aux nouveaux procureurs une présence obligatoire dans les commissariats et les brigades de gendarmerie. La Commission a rejeté l'amendement de M. Claude Goasguen. Article additionnel après l'article 2 La Commission a adopté un amendement de Mme Frédérique Bredin prévoyant que le procureur de la République est prévenu des gardes à vue réalisées dans le cadre de l'enquête préliminaire, dès leur début et non pas dans les meilleurs délais (amendement n° 84). Elle a ensuite examiné un amendement de M. Philippe Houillon tendant à prévoir, d'une part, qu'après la première comparution ou la première audition, les avocats peuvent se faire délivrer à leurs frais une copie de pièces du dossier et la transmettre à leur client, cette copie ne pouvant être communiquée à des tiers que pour les besoins de la défense, d'autre part, lorsque l'ordonnance de renvoi est devenue définitive, que le prévenu et la partie civile peuvent se faire délivrer copie du dossier à leurs frais, sauf en cas de peine encourue supérieure à cinq ans d'emprisonnement. Après que le rapporteur eut souligné l'insuffisante précision de la rédaction proposée, M. Alain Vidalies a considéré qu'il était légitime d'ouvrir la possibilité pour l'avocat de transmettre copie de certaines pièces à son client, tout en s'interrogeant sur l'utilité du deuxième volet de l'amendement. Mme Frédérique Bredin a également souligné l'intérêt de l'amendement. M. Patrick Devedjian a justifié le fait que la possibilité d'obtenir copie du dossier ne soit pas prévue lorsque la peine encourue est supérieure à cinq ans de prison, en rappelant que la délivrance est automatique en cas de procès d'assises. M. Claude Goasguen a proposé de modifier la rédaction de l'amendement pour porter le seuil à dix ans d'emprisonnement, afin de le faire coïncider avec la limite de compétence de la cour d'assises. M. Arnaud Montebourg a exprimé des réserves sur la disposition interdisant la communication aux tiers, excepté pour les besoins de la défense. M. Jean-Pierre Michel a considéré que ce dispositif ouvrait un risque de publication totale ou partielle du dossier en cours d'instruction. Après que la présidente eut suggéré que le dispositif de cet amendement soit amélioré avant d'être à nouveau soumis à la Commission, l'amendement a été retiré. Section 2 Article 3 Cet article simplifie les modalités de désignation de l'avocat par une personne détenue ou lors l'interrogatoire de première comparution - La désignation de l'avocat par la personne détenue L'article 115 du code de procédure pénale dispose actuellement que les parties peuvent, à tout moment de l'information, faire connaître au juge d'instruction le nom de l'avocat qu'elles ont choisi. En application de cet article, la personne détenue qui a demandé par écrit à un avocat de bien vouloir assurer sa défense est obligée d'écrire une nouvelle lettre au juge d'instruction l'informant de la désignation de son avocat, une fois que la réponse de ce dernier lui est parvenue. En pratique, cette échange de correspondances peut prendre une semaine, pendant laquelle l'avocat n'a pas accès au dossier et ne peut rendre visite à la personne détenue, comme le rappelle l'exposé des motifs du projet de loi La Cour de cassation, dans un arrêt du 27 novembre 1931, a confirmé que le choix de l'avocat devait être notifié au juge par la personne elle-même, et non par l'avocat ; si tel était le cas, le client devait confirmer ultérieurement ce choix. Soucieux de permettre à la personne détenue de faire valoir ses droits plus rapidement, le paragraphe I complète l'article 115 afin de préciser que, lorsque la personne mise en examen est détenue, la désignation de son avocat peut résulter d'une simple copie au juge d'instruction de sa lettre demandant à cet avocat d'assurer sa défense. Le texte précise que cette copie peut être totale ou partielle, afin de permettre de ne communiquer au juge d'instruction que les passages de la lettre concernant la demande. En pratique, cette disposition permettra à l'avocat de la personne détenue de venir voir le juge d'instruction avec la lettre de son client pour obtenir le permis de visite et consulter le dossier, comme c'est d'ailleurs semble-t-il déjà le cas dans certains cabinets d'instruction. Afin d'éviter d'éventuelles contestations, le choix de l'avocat devra être expressément confirmé dans un délai de quinze jours au juge d'instruction par la personne mise en examen qui, entre temps, pourra avoir été remise en liberté. La Commission a été saisie de l'amendement n° 14 de M. Patrick Devedjian supprimant le paragraphe I. M. Patrick Devedjian a estimé que cette disposition, qui correspond à la pratique actuelle, n'était qu'une fausse simplification, risquant de retarder sensiblement la communication des pièces aux personnes mises en examen. M. Pierre Albertini a présenté un amendement tendant à supprimer l'obligation pour le détenu de confirmer le choix de son avocat dans les quinze jours. Mme Frédérique Bredin, renvoyant à l'exposé des motifs du projet de loi, a insisté sur les délais résultant de la rédaction actuelle de l'article 115 du code de procédure pénale, lorsque l'avocat reçoit directement une lettre d'un détenu le désignant pour assurer sa défense. Le rapporteur a fait valoir que le délai de quinze jours demeurait justifié, au moins pour les cas où l'avocat refuserait de défendre le client qui l'aurait désigné. M. Arnaud Montebourg a estimé que la confirmation restait nécessaire, le courrier du client n'étant pas toujours suffisant ; il a cependant admis que l'on pouvait s'interroger sur la durée du délai. M. Pierre Albertini a alors rectifié son amendement, sur la proposition du rapporteur pour prévoir que le délai de confirmation de quinze jours ne fait pas obstacle à la libre communication du dossier à l'avocat. La Commission l'a adopté et a, en conséquence (amendement n° 86), rejeté l'amendement n° 14 de M. Patrick Devedjian. Elle a ensuite adopté un amendement de précision du rapporteur (amendement n° 85). - La désignation de l'avocat au cours de la première comparution Le deuxième alinéa de l'article 116 du code de procédure pénale dispose que, lorsque la personne mise en examen n'a pas choisi d'avocat, le juge d'instruction avise cette personne lors de sa première comparution de son droit de choisir un avocat ou de demander la désignation d'un avocat d'office ; l'avocat choisi ou, lorsqu'il s'agit d'une demande de désignation d'office, le bâtonnier est alors informé par tout moyen et sans délai. Tout en effet doit être mis en _uvre pour qu'un avocat puisse être présent lors de la première comparution. Afin d'améliorer la protection de la personne mise en examen, le paragraphe II de l'article 3 complète ces dispositions pour préciser que, si l'avocat choisi ne peut être contacté ou ne peut se déplacer, la personne est informée de son droit de demander l'assistance d'un avocat commis d'office. Il s'inspire de l'actuel article 63-4 du code de procédure pénale relatif à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue, qui prévoit la désignation d'un avocat commis d'office lorsque la personne gardée à vue n'est pas en mesure de désigner un avocat ou que l'avocat choisi ne peut être joint, tout en ajoutant le cas où l'avocat choisi ne peut se déplacer : les garanties accordées lors de la première comparution doivent être en effet plus importantes que celles accordées au cours de la garde à vue à une personne qui peut être un simple témoin et qui, en tout état de cause, n'est pas mise en examen. La Commission a adopté l'article 3 ainsi modifié. Article additionnel après l'article 3 La Commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à prévoir, à l'article 80-1 du code de procédure pénale, que la mise en examen doit être conditionnée à l'existence d'indices précis (amendement n° 87), après que M. Pierre Albertini eut émis des réserves sur l'instauration d'une gradation subtile entre indices, indices précis et preuves. Section 3 Article 4 Cet article donne aux parties le droit de demander tous les « actes nécessaires à la manifestation de la vérité » et leur ouvre la possibilité de demander à ce que certains actes réalisés à leur demande soient effectués en présence de leur avocat. La Commission a été saisie d'un amendement de M. Claude Goasguen proposant une nouvelle rédaction de l'article destinée à accélérer les procédures d'instruction en organisant notamment un débat d'orientation associant les parties à la construction du dossier. Soulignant que cet amendement, à la différence de plusieurs autres, n'avait pas pour objet d'instituer une procédure accusatoire, M. Claude Goasguen a insisté sur l'importance du stade de la procédure concerné par cet article, qui vise la rencontre de la personne mise en examen avec le juge d'instruction. M. Arnaud Montebourg s'étant interrogé sur la réalité de l'amélioration résultant de l'amendement de M. Claude Goasguen et le rapporteur ayant insisté sur la complexité du dispositif proposé, la Commission l'a rejeté. - Possibilité pour les parties de demander tout acte « nécessaire à la manifestation de la vérité » L'actuel article 82-1 du code de procédure énumère de manière limitative les actes que les parties peuvent demander au juge d'instruction : les parties civiles peuvent demander à être entendues et les personnes mises en examen à être interrogées ; si une partie peut demander une confrontation avec une autre partie ou avec un témoin, elle ne peut en revanche demander l'interrogatoire ou l'audition d'une autre partie (article C. 82-1) ; les parties peuvent également demander l'audition d'un témoin ou un transport sur les lieux ; enfin, elles peuvent demander au juge d'instruction d'ordonner qu'une autre partie produise une pièce utile à l'information. Cette liste est limitative et la circulaire du 1er mars 1993 rappelle que la loi ne permet pas aux parties de demander une mesure susceptible de porter atteinte aux droits fondamentaux des personnes, comme une perquisition ou l'interception de communication téléphoniques. Les parties doivent formuler leur demande par écrit et la motiver. Le juge d'instruction peut ne pas y faire droit par une ordonnance motivée rendue dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Cette ordonnance est susceptible d'appel dans les conditions prévues à l'article 186-1 du code de procédure pénale : saisine du président de la chambre d'accusation qui décide dans un délai de huit jours, par une ordonnance qui n'est pas susceptible de voie de recours, s'il y a lieu ou non de saisir la chambre d'accusation de cet appel ; en cas de saisine, la chambre d'accusation a deux mois pour statuer (article 194). Les limites actuelles posées aux demandes d'actes par l'article 82-1 constituent plus une source de difficulté procédurale qu'une garantie pour la bonne marche de l'information. La Cour de cassation elle-même a considéré que ces limites n'étaient pas pertinentes et accepté une demande de désignation d'un interprète pour une personne étrangère mise en examen, alors même que cet acte n'est pas cité à l'article 82-1. Poursuivant le mouvement amorcé avec la loi du 4 janvier 1993 pour renforcer le contradictoire pendant l'instruction, le paragraphe I de l'article 4 complète l'article 82-1 afin de préciser que les parties pourront également demander à ce qu'il soit procéder « à tous les autres actes qui leur paraissent nécessaires à la manifestation de la vérité ». Cette extension de leurs droits placent les parties sur un pied d'égalité avec le procureur de la République qui, en vertu du premier alinéa de l'article 82, peut requérir du juge d'instruction « tous les actes qui lui paraissent utiles à la manifestation de la vérité ». Les parties pourront désormais demander l'audition d'une autre personne mise en examen, la mise en examen d'une personne ou son placement sous écoute téléphonique, sans pour autant alourdir la procédure d'instruction puisque le juge pourra facilement refuser les demandes qu'il n'estime pas fondées. Rappelons en outre que le président de la chambre d'accusation pourra, en cas d'appel, confirmer ce refus par une ordonnance qui n'est pas susceptible de pourvoi. La Commission a adopté un amendement présenté par le rapporteur permettant d'inscrire à l'article 82-1 du code de procédure pénale, et non à l'article 82-2 comme le prévoit le projet, l'obligation pour les parties de formuler avec précision leur demande d'actes (amendement n° 88). Elle a ensuite rejeté un amendement de M. Alain Tourret réduisant les délais de réponse aux différentes mesures demandées par la personne mise en examen, le rapporteur ayant précisé que le délai de quinze jours proposé par l'amendement lui paraissait trop court. La Commission a également rejeté un amendement du même auteur ayant pour objet d'autoriser les parties à demander une enquête de personnalité, puis un amendement de M. Philippe Houillon visant à simplifier la procédure de demande d'actes au juge d'instruction. - Possibilité pour les avocats des parties d'assister à certains actes Dans le même esprit, le paragraphe II de l'article 4 insère un nouvel article 82-2 qui ouvre la possibilité aux parties de demander à ce que certains actes qu'ils ont sollicités soient effectués en présence de leur avocat. Actuellement, seul le procureur de la République peut assister aux transports sur les lieux (article 92 du code de procédure pénale), aux interrogatoires et confrontations de la personne mise en examen et aux auditions de la partie civile (article 119 du même code). En revanche, l'avocat ne peut assister aux actes demandés par son client. Ainsi, s'il peut demander à ce que son client soit, en sa présence, confronté avec un témoin ou qu'un témoin soit , en son absence, entendu par le juge, il doit demander une confrontation ou attendre l'audience devant le tribunal ou la Cour d'assises pour pouvoir poser directement des questions à un témoin. Le nouvel article 82-2 remédie à cette lacune en prévoyant que la partie qui demande à ce que le juge d'instruction procède à un transport sur les lieux, à l'audition d'un témoin, d'une partie civile ou d'une personne mise en examen peut demander à ce que cet acte soit effectué en présence de son avocat : désormais, l'avocat d'une personne mise en examen pourra demander à assister à l'audition d'un témoin. En application du troisième alinéa de l'article 82-2, le juge d'instruction pourra toujours refuser de faire droit à cette demande par une ordonnance motivée susceptible d'appel devant la chambre d'accusation dans les conditions prévues à l'article 186-1 du code de procédure pénale (voir ci-dessus). S'il accepte la demande, il devra convoquer l'avocat au plus tard deux jours ouvrables avant la date du transport sur les lieux, de l'audition ou de l'interrogatoire ; celui-ci ne pourra poser des questions qu'après y avoir été autorisé par le juge d'instruction (article 120 du code de procédure pénale). On observera que le procureur de la République qui demande à assister à un interrogatoire est prévenu par le juge d'instruction au plus tard l'avant-veille de cet interrogatoire (article 119 du code de procédure pénale). Pour éviter des demandes imprécises et dilatoires, le dernier alinéa de l'article 82-2 prévoit qu'elles doivent concerner des actes déterminés et préciser l'identité de la personne dont l'audition est réclamée. Ce nouveau droit donné aux parties n'est qu'une application du principe de « l'égalité des armes » et permet à la France de se mettre en conformité avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui rappelle que toute personne poursuivie a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge. Il n'alourdit pas la procédure d'instruction puisqu'il permet d'éviter les confrontations, par nature plus lourdes, et de préparer l'audience de jugement au cours de laquelle l'avocat pourra de toute façon interroger les témoins. Rappelons en outre que cette possibilité de présence de l'avocat n'existe que pour les actes demandées par l'une des parties : le juge d'instruction n'aura donc pas à prévenir à l'avance les parties de tous les actes auxquels il envisage de procéder. Si le juge d'instruction estime qu'il existe un risque de pression sur le témoin, il pourra toujours refuser la demande de l'avocat, comme il peut le faire actuellement pour les confrontations. Signalons enfin que l'article 37 du projet de loi complète l'article 82 du code de procédure pénale afin de donner au procureur de la République les mêmes droits : ce dernier pourra désormais demander à assister à tous les actes qu'il requiert, c'est à dire en pratique à l'audition d'un témoin, puisque les articles 92 et 119 lui permettent déjà d'assister au transport sur les lieux, aux interrogatoires et confrontations de la personne mise en examen et aux auditions de la partie civile. La Commission a adopté l'article 4 ainsi modifié. La Commission a rejeté deux amendements identiques, l'un n° 39 de M. André Gerin, l'autre de M. Philippe Houillon, enjoignant au juge d'instruction de prévenir la personne mise en examen qu'elle a droit au silence, le rapporteur ayant fait valoir que la rédaction actuelle de l'article 116 paraissait suffisamment protectrice. Elle a ensuite examiné trois amendements similaires, de MM. Alain Tourret, Pierre Albertini et Philippe Houillon, permettant aux avocats des parties et au procureur de la République d'intervenir plus activement dans les interrogatoires, confrontations et auditions. Le rapporteur ayant indiqué que ces amendements lui paraissaient aller à l'encontre du rôle du juge d'instruction, à qui il revient seul de mener l'instruction, M. Claude Goasguen a répondu qu'ils étaient cohérents avec la redéfinition du rôle du juge d'instruction proposée par le projet. M. Pierre Albertini a précisé qu'une telle possibilité n'enlevait pas au juge la direction de l'interrogatoire. Mme Frédérique Bredin a estimé que les amendements proposés permettaient de valider une pratique qui existe déjà. M. Gérard Gouzes a confirmé que l'article 120 de code de procédure pénale donnait déjà la possibilité aux avocats des parties et au procureur de la République de prendre la parole. Le rapporteur s'est inquiété des conséquences qui pourraient résulter pour les victimes d'une telle disposition, évoquant l'exemple des affaires de viol ; elle a jugé nécessaire que le juge d'instruction puisse contrôler les questions posées. Soulignant que, si cette disposition existait déjà, son application dépendait de la pratique des juges, M. Arnaud Montebourg s'est, dès lors, déclaré favorable à ce qu'elle soit expressément inscrite dans la loi. Précisant qu'il préférait la rédaction proposée par M. Pierre Albertini à celle de M. Alain Tourret, il a estimé que l'organisation d'un débat contradictoire au sein du cabinet du juge était indispensable. M. Philippe Houillon a indiqué qu'il retirait son amendement au bénéfice de celui de M. Pierre Albertini. Suivant son rapporteur, la Commission a rejeté les amendements de MM. Alain Tourret et Pierre Albertini. Article 5 Cet article comporte une série de dispositions destinées à renforcer le caractère contradictoire des expertises pénales. Le paragraphe I complète l'article 156 du code de procédure pénale, qui dispose que les juridictions d'instruction ou de jugement peuvent, à la demande du ministère public, d'office ou à la demande des parties et dans le cas où se pose une question technique, ordonner une expertise, afin de préciser que le ministère public ou la partie qui demande l'expertise peut indiquer dans sa demande les questions qu'il souhaite voir poser à l'expert. La Commission a examiné un amendement présenté par M. Claude Goasguen ayant pour objet de rendre l'expertise pénale contradictoire en permettant aux parties de participer à l'élaboration des questions et à la désignation des experts. M. Claude Goasguen a indiqué qu'il était nécessaire de cadrer davantage les expertises en permettant aux parties de se mettre d'accord sur les experts désignés. Le rapporteur a rappelé que le principe de l'accord entre les parties existait déjà. Observant que, dans la pratique, beaucoup de juges d'instruction ne le respectaient pas, M. Claude Goasguen a observé que cet amendement permettrait de faire face à la surenchère d'expertises et de contre-expertises, surenchère qui était souvent la conséquence d'une décision unilatérale du juge d'instruction sur le choix des experts. Il a ajouté que le débat contradictoire aiderait les juges à assumer des responsabilités de plus en plus lourdes, précisant que cette disposition recueillait d'ailleurs l'accord d'une large partie des magistrats. M. Pierre Albertini a souligné que l'accord entre les parties se traduirait seulement par la faculté de proposer des noms, ce qui permettrait certainement un gain de temps dans la procédure et préviendrait des demandes de contre-expertises inutiles. Observant que, dans la pratique, un avocat qui estimerait qu'un expert est partial le signalerait toujours au juge d'instruction, M. Arnaud Montebourg s'est dès, lors, interrogé sur l'utilité d'une telle disposition. La Commission a rejeté cet amendement. Puis, elle a rejeté un amendement présenté par M. Alain Tourret permettant au ministère public ou à une des parties de proposer des questions à poser à l'expert, ainsi qu'un amendement du même auteur réduisant les délais de réponse de l'expert. Le paragraphe II modifie l'article 164 du code de procédure pénale consacré à l'interrogatoire des personnes mise en examen par les experts. Le texte actuel prévoit que les experts ne peuvent interroger ces personnes qu'en présence du juge d'instruction, qui doit alors observer toutes les formalités prévues aux articles 114 et 119 (présence de l'avocat dûment convoqué, avertissement du procureur de la République). Il peut cependant être dérogé à ces dispositions dans trois cas : - lorsque le juge, à titre exceptionnel et par décision motivée, donne délégation aux experts eux-mêmes pour entendre la personne mise en examen ; - lorsque la personne mise en examen renonce à la présence du juge d'instruction et accepte de fournir aux experts, en présence de son avocat, les explications nécessaires à l'exercice de leur mission ; la personne mise en examen peut également, par décision écrite, renoncer à l'assistance de son avocat pour une ou plusieurs auditions ; - lorsque les experts sont des médecins ou des psychologues : afin de faciliter ce type d'expertise, difficile à réaliser en présence de tiers, et de préserver le secret médical, les médecins et les psychologues peuvent poser à la personne mise en examen les questions nécessaires à leur mission sans que le juge d'instruction ou les avocats soient présents. Le dernier alinéa de l'article 164 précise que ces dispositions sont également applicables aux personnes entendues comme témoin assisté en application de l'article 104 du code de procédure pénale. Afin de renforcer l'égalité des parties, le paragraphe II modifie ce dernier alinéa pour préciser que l'article 164 s'applique aussi à la partie civile. Il en profite également pour remplacer la référence à l'article 104 par la notion de témoin assisté, par anticipation des dispositions proposées à l'article 7 du projet de loi. Enfin, le paragraphe III modifie l'article 167 relatif aux communication aux parties et à leurs avocats des rapports d'expertise. Actuellement, seules les conclusions leur sont communiquées, soit par le juge d'instruction lui-même, qui les aura préalablement convoqués dans les formes prescrites par l'article 114 du code de procédure pénale (convocation cinq jours ouvrables avant l'audition), soit par lettre recommandée ; lorsque la personne est détenue, c'est le chef de l'établissement pénitentiaire qui se charge de cette transmission et qui adresse au juge d'instruction l'original ou la copie du récépissé signé. Ce dispositif est complété afin de préciser qu'une copie de l'intégralité du rapport est remise aux avocats des parties, s'ils en font la demande lors de leur convocation par le juge d'instruction. Le paragraphe III modifie également les dispositions consacrées à la notification par lettre recommandée ou par l'intermédiaire du chef d'établissement pour les personnes détenues, en substituant à la notification des conclusions celle de l'intégralité du rapport. Même si cette dernière modification est de nature à accroître les droits des parties, et donc les droits de la défense, puisque cette communication intégrale des rapports d'expertise permettra aux parties de mieux ajuster leurs critiques et de demander éventuellement une contre expertise, on peut s'étonner de son caractère systématique qui alourdit la procédure, d'autant plus que, dans le cas d'une communication par convocation, la copie de l'intégralité du rapport d'expertise n'est pas automatique et doit être demandée par les avocats des parties. En outre, il paraît contestable de faire parvenir directement aux parties des rapports d'expertise, alors même que l'article 114 n'autorise la communication des pièces de procédure que par l'intermédiaire de l'avocat et sous le contrôle du juge d'instruction. C'est pourquoi la Commission a adopté un amendement du rapporteur prévoyant que la notification par lettre recommandée du rapport d'expertise est envoyée aux avocats, et non aux parties, sur leur demande (amendement n° 89). La Commission a adopté l'article 5 ainsi modifié. La Commission a rejeté deux amendements de M. Claude Goasguen, le premier imposant au procureur de la République de justifier ses réquisitions, le second prévoyant une ordonnance motivée et susceptible d'appel pour les mises en examen. Section 4 Article 6 Les dispositions relatives à l'audition des témoins (articles 101 à 113) sont regroupées à la section IV du chapitre 1er du titre III du livre Ier du code de procédure pénale ; parmi elles figurent les articles consacrés aux témoins assistés (articles 104 et 105) qui bénéficient d'une procédure particulière. Afin de distinguer plus clairement les différentes procédures (« simple » témoin, témoin assisté), le paragraphe I de l'article 6 crée au sein de la section IV une sous-section 1 intitulé « Dispositions générales », qui regroupe les articles 101 à 113 relatifs aux « simples » témoins, l'article 7 créant une sous-section 2 consacrée aux témoins assistés qui comprend les nouveaux articles 113-1 à 113-8 ; par ailleurs, l'article 32 du projet de loi abroge l'actuel article 104 et modifie l'article 105 afin de faire disparaître les références aux témoins assistés. Le paragraphe II complète l'article 101 relatif aux modalités de convocation des témoins par le juge d'instruction (citation par huissier ou agent de la force publique, convocation par lettre simple ou recommandée ou par la voie administrative) afin de préciser que le témoin ainsi cité ou convoqué devra être avisé que, s'il ne comparaît pas ou refuse de comparaître, le juge pourra l'y contraindre par la force publique en application de l'article 109. Cet article indiquant que, si le témoin ne comparaît pas, le juge d'instruction peut, sur les réquisitions du procureur de la République, l'y contraindre par la force publique et le condamner à une amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe (jusqu'à 10 000 F), le paragraphe III le modifie afin d'y insérer une référence au témoin qui refuse de comparaître. Ces modifications simplifieront la procédure en permettant au juge d'instruction de recourir plus rapidement à la force publique contre un témoin qui refuse de comparaître, sans avoir à attendre le moment fixé pour la comparution de ce dernier. Le paragraphe IV modifie l'article 153 relatif à l'audition d'un témoin dans le cadre d'une commission rogatoire. Le 1° corrige une erreur de référence et le 2° insère un alinéa indiquant que la personne entendue comme témoin dans ce cadre ne peut être retenue que le temps strictement nécessaire à son audition, sauf si elle fait l'objet d'une garde à vue dans les conditions prévues à l'article 154. Cette disposition est à rapprocher de l'article 78 qui précise que, dans le cadre d'une enquête préliminaire, les personnes à l'encontre desquelles n'existent pas d'indices faisant présumer qu'elles ont commis l'infraction ne peuvent être retenues que le temps strictement nécessaire à leur audition. Comme le souligne l'exposé des motifs du projet de loi, il faudra, pour retenir une personne, nécessairement la placer en garde à vue ; celle-ci bénéficiera alors des droits reconnus aux personnes gardées à vue. La Commission a rejeté les amendements nos 15 et 16 de M. Patrick Devedjian, concernant la comparution de témoins. La Commission a ensuite adopté l'article 6 sans modification. Articles 7 et 8 L'article 7 crée une nouvelle sous-section au sein de la section IV du chapitre 1er du titre III du livre 1er du code de procédure pénale, qui regroupe huit nouveaux articles (articles 113-1 à 113-8) consacrés au témoin assisté ; ces articles étendent les possibilités de recours à la procédure du témoin assisté et simplifient le dispositif actuel en proposant un seul statut, quel que soit les modalités de mise en cause de la personne concernée. Quant à l'article 8, il permet au témoin assisté de faire valoir ses observations devant la chambre d'accusation en cas d'appel d'une ordonnance de non-lieu. a) Les limites du dispositif actuel Depuis la loi du 24 août 1993, il existe deux catégories de témoin assisté prévues respectivement par les articles 104 et 105 du code de procédure pénale . En application de l'article 104, la personne nommément visée par une plainte avec constitution de partie civile peut demander à être entendue comme témoin assisté ; le juge d'instruction doit l'avertir de ce droit lors de sa première audition et en faire mention au procès-verbal ; elle bénéficie alors des droits reconnus aux personnes mises en examen par les articles 114, 115 et 120, c'est-à-dire qu'elle ne peut être entendue qu'en présence de son avocat, qui a accès au dossier et qui peut poser des questions après y avoir été invité par le juge d'instruction. En outre, cette personne doit être avisée par le juge d'instruction, comme le sont les parties, que l'information est terminée (article 175 du code de procédure pénale) et les ordonnances de règlement doivent lui être notifiées (article 183). Les droits reconnus à ce témoin assisté sont limités. Ainsi, la Cour de cassation a jugé à plusieurs reprises qu'il n'avait pas la qualité de partie à la procédure et que, par suite, il ne pouvait se pourvoir en cassation contre un arrêt de la chambre d'accusation (Cass. crim., 30 octobre 1990, 20 mars 1995) ; de même, il ne peut faire appel des ordonnances du juge d'instruction. Comme l'a rappelé la doctrine, la personne relevant des dispositions de l'article 104 reste néanmoins un témoin ; elle doit prêter serment, avec les conséquences pénales qui en résultent en cas de témoignage mensonger. Cette situation ambiguë a d'ailleurs été critiquée par certains auteurs. Le statut de témoin assisté visé à l'article 105, résultant de la loi du 24 août 1993, confère des droits plus importants, mais ne concerne que les personnes nommément visées par le réquisitoire du procureur de la République : lorsque le juge d'instruction estime qu'il n'est pas nécessaire de mettre en examen ces personnes, il doit les entendre comme témoin assisté. Il s'agit dans ce cas d'une obligation pour le juge d'instruction , alors que dans le cas de l'article 104, l'audition comme témoin assisté n'est obligatoire que si l'intéressé le demande. Ce témoin assisté bénéficie de tous les droits de la personne mise en examen : lorsqu'elle demande l'assistance d'un avocat, le juge d'instruction doit convoquer ce dernier et procéder à l'interrogatoire en sa présence ; il doit également l'avertir de son droit de formuler une demande d'acte ou de déposer des requêtes en nullité (deuxième et quatrième alinéas de l'article 116). Ainsi que le souligne l'étude d'impact, « cette différence avec le témoin assisté de l'article 104 s'explique par le fait qu'une accusation émanant du ministère public a plus de poids qu'une accusation émanant de la partie civile, ce qui justifie un renforcement des droits de la défense. » Comme pour l'article 104, la doctrine a relevé les ambiguïtés de ce statut, la personne concernée devant prêter serment, avec les risques de poursuite pour faux témoignage que cela implique, alors même qu'elle bénéficie des droits du mis en examen qui lui ne prête pas serment. Les dispositions des articles 104 et 105 ont été très peu utilisées, sans doute en raison de leur caractère à la fois complexe et restrictif. Certains praticiens justifient également cet état de fait par la crainte des juges d'instruction de voir leur procédure annulée pour mise en examen tardive en application du premier alinéa de l'article 105. Le Gouvernement a donc souhaité modifier ces dispositions afin d'encourager les juges d'instruction à y recourir et de limiter ainsi les mises en examen. b) Une procédure simplifiée d'application plus large - Le domaine d'application du nouveau statut de témoin assisté Les articles 113-1 et 113-2 définissent le champ d'application de cette nouvelle procédure. Comme actuellement, les personnes qui ne sont pas mises en examen, mais qui sont visées par un réquisitoire introductif du procureur de la République, devront bénéficier du statut de témoin assisté (article 113-1) ; les personnes visées par une plainte avec constitution de partie civile, qui ne sont pas mises en examen, pourront également en bénéficier, cette possibilité devenant une obligation pour le juge d'instruction si la personne concernée en fait la demande (premier alinéa de l'article 113-2). A ces deux hypothèses prévues actuellement par les articles 104 et 105 du code de procédure pénale, le projet de loi ajoute le cas des personnes nommément visées par une plainte ou une dénonciation et qui ne sont pas mises en examen : le juge d'instruction pourra les entendre en qualité de témoin assisté, mais sera libre de refuser d'appliquer cette procédure, même si la personne concernée le demande (deuxième alinéa de l'article 113-2). Désormais, toute personne faisant l'objet d'une accusation de la part d'un tiers (partie civile ou ministère public) pourra bénéficier des droits du témoin assisté si le juge d'instruction estime l'accusation insuffisante pour procéder à une mise en examen ; dans certains cas (réquisitoire du procureur de la République, demande de la personne concernée en cas de plainte avec constitution de partie civile), ce statut sera de droit. La Commission a rejeté un amendement de M. Alain Tourret supprimant les dispositions selon lesquelles toute personne visée par une plainte ou une dénonciation et qui n'est pas mise en examen peut être entendue comme témoin assisté, après que le rapporteur se fut interrogé sur la portée de cette proposition. - Les droits du témoin assisté Le projet de loi unifie le statut du témoin assisté en lui attribuant les droits dont bénéficient actuellement les témoins assistés de l'article 105 : le nouvel article 113-3 précise en effet que le témoin assisté a les mêmes droits que les personnes mises en examen. Il devient donc une partie à la procédure et peut faire appel des ordonnances du juge d'instruction dans les conditions prévues aux articles 186 et 186-1. Les modalités selon lesquelles le juge d'instruction doit faire connaître ses droits au témoin assisté sont définies à l'article 113-4 : elles correspondent aux formules utilisées aux articles 80-1 et 116 pour la mise en examen par lettre recommandée et l'interrogatoire de première comparution. L'article 113-4 dispose en effet que le juge d'instruction, lors de la première audition du témoin assisté, constate l'identité de ce dernier, lui donne connaissance du réquisitoire du procureur de la République, de la plainte ou de la dénonciation et l'informe de ses droits ; cette information fait l'objet d'une mention au procès-verbal. Le juge d'instruction peut également faire connaître à une personne qu'elle sera entendue en qualité de témoin assisté par l'envoi d'une lettre recommandée ; cette lettre doit informer la personne de ses droits et lui donner connaissance du réquisitoire introductif, de la plainte ou de la dénonciation ; elle doit préciser que le nom de l'avocat choisi ou la demande de désignation d'un avocat commis d'office doit être communiqué au greffier du juge d'instruction. Cette procédure permettra à la personne ainsi avertie d'être assistée, lors de sa première audition par le juge, par un avocat convoqué cinq jours avant et ayant pu consulter le dossier. Comme pour la mise en examen, le juge d'instruction peut donc informer une personne de son statut de témoin assisté de deux manières : par oral, lors de sa première audition, ou par écrit, avec l'envoi d'une lettre recommandée. La Commission a adopté un amendement du rapporteur permettant au juge d'instruction de connaître tout changement d'adresse éventuel du témoin assisté (amendement n° 90), ainsi qu'un amendement du même auteur précisant le contenu de la lettre recommandée informant une personne de sa qualité de témoin assisté (amendement n° 91). L'article 113-5 précise que le témoin assisté ne peut être placé sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire, ni faire l'objet d'une ordonnance de renvoi ou de mise en accusation : si le juge d'instruction souhaite le soumettre à des mesures coercitives, il devra préalablement le mettre en examen, ce que prévoit expressément l'article 113-8. Afin de répondre aux craintes d'annulation de la procédure pour mise en examen tardive évoquées ci-dessus, l'article 113-6 précise que le premier alinéa de l'article 105, qui interdit au juge d'instruction d'entendre comme témoin les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves et concordants, n'est pas applicable au témoin assisté. La Commission a rejeté deux amendements de M. Alain Tourret, le premier prévoyant que le témoin assisté ne peut faire l'objet d'une ordonnance de règlement en dehors d'une ordonnance de non-lieu, et le second indiquant que la qualité de témoin assisté est indépendante de l'existence d'indices graves et concordants, le rapporteur ayant estimé que le texte du projet de loi était suffisamment clair sur ce point. Enfin, l'article 113-7 tient compte des réticences de la doctrine en la matière et prévoit que le témoin assisté ne prête pas serment. La Commission a rejeté deux amendements identiques présentés respectivement par MM. Philippe Houillon et Pierre Albertini, prévoyant que le témoin assisté prête serment, après que M. Philippe Houillon eut estimé nécessaire de distinguer sans ambiguïté la situation de témoin assisté de celle de mise en examen et que M. Pierre Albertini eut considéré qu'à défaut de serment, le statut de témoin assisté apparaîtrait comme un simple palier précédant la mise en examen. Par ailleurs, l'article 8 du projet de loi crée dans le code de procédure pénale un nouvel article 197-1, qui précise qu'en cas de non-lieu, l'avocat du témoin assisté pourra formuler des observations devant la chambre d'accusation ; la date de l'audience devra être notifiée à l'intéressé et à son avocat dans les conditions prévues à l'article 197 (notification par lettre recommandée cinq jours avant l'audience). Même si le témoin assisté bénéficie de tous les droits reconnus aux personnes mises en examen, et donc celui de présenter ses observations devant la chambre d'accusation par l'intermédiaire de son avocat, il paraît préférable de rappeler cette possibilité, le témoin assisté pouvant ne pas être considéré comme une partie à la procédure en cas de non-lieu. Signalons enfin que, dans le cadre d'une commission rogatoire, la police ne pourra entendre le témoin assisté qu'avec l'accord de celui-ci, comme c'est le cas actuellement pour les personnes bénéficiant de l'article 104 (paragraphe III de l'article 32 du projet de loi). - Les conditions de mise en examen du témoin assisté L'article 113-8 rappelle que le juge d'instruction peut mettre en examen une personne entendue comme témoin assisté à tout moment de la procédure et spécifie que cette mise en examen peut être effectuée par lettre recommandée conformément au troisième alinéa de l'article 80-1 (lettre donnant connaissance des faits justifiant la mise en examen et rappelant le droit d'être assisté d'un avocat) ; il précise également que cette lettre peut être envoyée en même temps que l'avis de fin d'information prévu par l'article 175, qui donne un délai de vingt jours à la personne mise en examen pour faire des demandes d'actes ou d'expertise (neuvième alinéa de l'article 81, de l'article 82-1 et premier alinéa de l'article 156) ou déposer des requêtes en nullité (troisième alinéa de l'article 173). Selon l'étude d'impact, cette dernière disposition sera de nature à favoriser le recours au témoin assisté, le juge n'étant pas obligé de convoquer la personne pour la mettre en examen, et à reculer dans le temps le passage du statut de témoin assisté à celui de mis en examen. La Commission a rejeté un amendement de M. Alain Tourret précisant les formalités nécessaires lorsque le juge d'instruction met en examen une personne entendue comme témoin assisté, le rapporteur et M. Arnaud Montebourg ayant fait valoir que le projet de loi permettait déjà de répondre à l'objectif poursuivi. La Commission a adopté l'article 7 ainsi modifié, puis l'article 8 sans modification. La Commission a rejeté l'amendement n° 17 de M. Patrick Devedjian, prévoyant que le juge d'instruction peut se déplacer dans son ressort sans avoir à en aviser le procureur de la République, ainsi qu'un amendement de M. Philippe Houillon ouvrant la même faculté lorsque le magistrat instructeur se transporte à l'extérieur de son ressort. La Commission a ensuite examiné l'amendement n° 18 présenté par M. Patrick Devedjian, précisant que l'officier de police judiciaire ne peut procéder à aucune perquisition qui n'est pas visée par la commission rogatoire ou autorisée par le juge mandant. Après que M. Pierre Albertini eut jugé nécessaire d'envisager à terme le rattachement de la police judiciaire au ministère de la justice, que M. Arnaud Montebourg eut fait valoir qu'il n'y avait pas, en pratique, de perquisition réalisée sans information préalable du juge d'instruction duquel émane la commission rogatoire et que le rapporteur eut souligné que la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation encadrait précisément la portée temporelle et spatiale des commissions rogatoires, la Commission a rejeté cet amendement, ainsi qu'un amendement ayant le même objet présenté par M. Philippe Houillon. Elle a également rejeté un amendement de M. Pierre Albertini indiquant qu'une dénonciation, qui ne comporte pas l'identité de son auteur, ne peut être utilisée comme moyen de preuve, son auteur ayant fait observer que si la dénonciation anonyme pouvait permettre le déclenchement d'une poursuite, elle ne devait pas, en revanche, constituer un élément de preuve dans le cadre d'une procédure pénale, M. Arnaud Montebourg rappelant, de son côté, qu'une dénonciation anonyme ne pouvait en aucun cas constituer un élément de preuve en application du droit positif, tout en reconnaissant qu'il pouvait y avoir un débat sur la question de la protection des témoins et des dénonciateurs. Section 5 Article additionnel avant l'article 9 La Commission a adopté un amendement du rapporteur autorisant les questions directes du ministère public et des conseils de l'accusé et de la partie civile dans un procès criminel (amendement n° 92). Article 9 L'actuel article 442 du code de procédure pénale oblige les parties et le ministère public à poser leurs questions au prévenu par l'intermédiaire du président du tribunal. Afin de renforcer le caractère contradictoire des audiences correctionnelles, l'article 9 modifie ce dispositif et autorise, sous certaines conditions, les questions posées directement au prévenu ou à toute personne appelée à la barre. Comme le rappelle l'exposé des motifs du projet de loi, il consacre une pratique judiciaire déjà largement répandue. Le paragraphe I insère dans le code de procédure pénale un nouvel article 442-1, qui dispose que le ministère public et les avocats des parties peuvent poser des questions au prévenu, à la partie civile, aux témoins et à toute personne appelée à la barre, après avoir demandé la parole au président ; cette faculté s'exerce sous réserve des pouvoirs du président, qui a la police de l'audience et la direction des débats (article 401 du code de procédure pénale) ; les parties civiles et le prévenu continuent de poser leurs questions par l'intermédiaire du président (deuxième alinéa de l'article 442-1), afin d'éviter tout incident. La Commission a adopté deux amendements identiques, le premier n° 19 de M. Patrick Devedjian et le second de M. Philippe Houillon (amendement n° 165 rectifié), prévoyant que le ministère public et les avocats des parties peuvent poser directement des questions au prévenu à l'occasion d'un procès correctionnel, après que M. Patrick Devedjian eut souligné que cet amendement permettrait de pallier les éventuelles interprétations restrictives de la chambre criminelle de la Cour de cassation. Par coordination, le paragraphe II supprime les dispositions de l'article 442 consacrées aux questions du ministère public et des parties. Enfin, le paragraphe III modifie le premier alinéa de l'article 454, qui indique que le président pose au témoin les questions qu'il estime nécessaires et celles proposées par les parties, afin de préciser que le ministère public et les parties posent leurs questions au témoin dans les conditions prévues à l'article 442-1. La Commission a adopté l'article 9 ainsi modifié. La Commission a rejeté un amendement présenté par M. Pierre Albertini prévoyant que les juges d'instruction sont choisis parmi les magistrats ayant plus de cinq années d'expérience, après que Mme Frédérique Bredin eut fait valoir que la question posée était essentiellement celle de la qualité des hommes et celle de la formation et que M. Alain Tourret eut souligné que l'institution de juges de la détention provisoire ayant au moins rang de vice-président permettrait de pallier l'éventuel manque d'expérience des juges d'instruction en ce qui concerne l'acte le plus grave décidé dans le cadre d'une information. CHAPITRE II Ce chapitre regroupe les dispositions qui sont sans doute parmi les plus emblématiques du projet de loi, tant il est vrai que la détention provisoire constitue le symbole le plus tangible de l'atteinte à la présomption d'innocence résultant de notre procédure. D'ailleurs, peu de dispositions du code de procédure pénale ont fait l'objet d'autant de modifications et de propositions de réformes plus ou moins radicales. Celle qui nous est proposée aujourd'hui est une des plus ambitieuses qui ait été soumise au Parlement dans la mesure où, s'inspirant des réformes inachevées de décembre 1985, de décembre 1987 et de janvier 1993, elle distingue l'autorité chargée de prendre la décision du placement en détention provisoire de celle chargée des investigations (section I). En outre, de manière moins convaincante, elle cherche à encadrer plus strictement les conditions de fond du placement en détention provisoire ainsi que sa durée (section II). Article additionnel avant l'article 10 La Commission a adopté un amendement de forme présenté par le rapporteur ainsi qu'un amendement du même auteur procédant à une nouvelle rédaction de l'article 137 du code de procédure pénale, afin d'énoncer clairement que la personne mise en examen est maintenue en liberté et, exceptionnellement, placée sous contrôle judiciaire ou mise en détention provisoire (amendements nos 93 et 94). Article additionnel avant l'article 10 Un débat s'est engagé sur un amendement du rapporteur tendant à supprimer l'article L. 611-1 du code de l'organisation judiciaire, selon lequel il y a un ou plusieurs juges d'instruction dans chaque tribunal de grande instance. M. Gérard Gouzes, président, s'est déclaré hostile à cet amendement au motif que la présence de l'Etat devait être affirmée sous toutes ses formes sur l'ensemble du territoire, tout en ne s'opposant pas à ce que les juges d'instruction puissent se déplacer et ne pas être rattachés à une seule juridiction. Exprimant la crainte que cet amendement ne se traduise par la présence de juges d'instruction au niveau des seules cours d'appel, M. Alain Tourret a estimé qu'une départementalisation des juges d'instruction serait plus adaptée. Favorable à une meilleure organisation et répartition des cabinets d'instruction sur le territoire national, pouvant aller jusqu'à une spécialisation, Mme Frédérique Bredin a soutenu cet amendement. Après que le rapporteur eut précisé que, par anticipation sur la nécessaire réforme de la carte judiciaire, le fait de couper le lien entre juge d'instruction et tribunal de grande instance permettrait de constituer des pools de juges mobiles, la Commission a adopté l'amendement (amendement n° 95). Article additionnel avant l'article 10 La Commission a également adopté un amendement (amendement n° 96) de M. Alain Tourret imposant la révision de la carte judiciaire dans les deux années suivant la promulgation de la présente loi, ce dernier amendement n'ayant pas l'aval de M. Gérard Gouzes mais obtenant l'approbation de M. Robert Pandraud. Section 1 La Commission a rejeté un amendement de M. Pierre Albertini et un amendement de M. Alain Tourret, tendant à modifier l'intitulé de cette section du projet afin de faire référence, le premier, au juge des libertés et, le second, au juge de la détention provisoire et des libertés. Article 10 Cet article insère, après l'article 137 du code de procédure pénale qui pose le principe de la liberté de la personne mise en examen, sous réserve du placement sous contrôle judiciaire ou, à titre exceptionnel, du placement en détention provisoire, cinq nouveaux articles relatifs au juge de la détention provisoire et aux rapports que ce dernier entretient avec le juge d'instruction et le parquet. A ce stade, il convient de brosser les caractéristiques essentielles de la procédure du placement en détention provisoire, les conditions de fond et de durée étant rappelées ultérieurement. D'ores et déjà, indiquons que, sauf la création d'un juge de la détention, l'architecture de cette procédure reste globalement inchangée. Actuellement, le juge d'instruction est compétent, en premier ressort, pour placer la personne mise en examen en détention provisoire et, le cas échéant, pour en ordonner la prolongation. Ce pouvoir revient, en revanche, à la chambre d'accusation, lorsqu'elle est saisie par le procureur de la République dans le cas où le juge d'instruction n'a pas suivi ses réquisitions tendant au placement en détention provisoire. Lorsqu'il envisage un placement en détention provisoire, le juge d'instruction doit informer l'intéressé qu'il a droit à l'assistance d'un avocat et qu'il dispose d'un délai pour préparer sa défense en application de l'article 145, alinéa 2. Si la personne mise en examen opte pour le débat différé, le juge peut alors demander son incarcération provisoire pour une durée qui ne peut excéder quatre jours, durée imputée sur celle de la détention provisoire, par le biais d'une ordonnance motivée non susceptible d'appel. En tout état de cause, la décision de placement suppose un débat contradictoire, qui a lieu soit immédiatement après la première comparution au cours de laquelle le juge a fait part de son intention de placer le mis en examen en détention provisoire, soit à l'issue du délai de quatre jours en cas de débat différé. En application de l'article 145, alinéa 4, le juge d'instruction statue en audience de cabinet ; il entend le ministère public, qui développe ses réquisitions écrites et motivées au vu des obligations de fond posées par l'article 144 (cf. infra) et les observations de la personne concernée ou de son avocat. A l'issue de ce débat, le juge peut décider de ne pas placer l'intéressée en détention, par simple mention au procès-verbal ou par une ordonnance non motivée dans le cas où la détention était requise par le procureur de la République. Si le juge entend, au contraire, placer le mis en examen en détention, il prend une ordonnance spécialement motivée comportant « l'énoncé des considérations de fait et de droit sur le caractère insuffisant du contrôle judiciaire et le motif de la détention par référence aux seules dispositions de l'article 144 » (article 145, premier alinéa). Un appel non suspensif peut être formé devant la chambre d'accusation par le parquet ou la personne concernée, respectivement dans les cinq ou dix jours qui suivent la notification de la décision. Toutefois, l'intéressé peut aussi user du « référé-liberté » qui permet à la personne mise en examen, en même temps qu'elle forme appel de l'ordonnance de placement en détention, de demander au président de la chambre d'accusation de déclarer son appel suspensif et d'ordonner sa mise en liberté immédiate. Celui-ci examine son appel immédiatement et, au vu des conditions de l'article 144, il peut ainsi infirmer l'ordonnance du juge, en décidant le cas échéant d'un contrôle judiciaire, la chambre d'accusation étant alors dessaisie. Dans le cas contraire, il renvoie l'affaire à la chambre d'accusation, car il ne peut, statuant seul, confirmer la décision du juge. Dans tous les cas et à tout moment, le juge peut, en application de l'article 147, ordonner d'office la mise en liberté de la personne détenue ; le procureur de la République a également la possibilité de la requérir à tout moment. Par ailleurs, l'article 148 donne à la personne détenue ou à son avocat la possibilité de demander une mise en liberté au juge d'instruction, qui doit statuer au plus tard dans les cinq jours de la communication au procureur de la République du dossier. Le juge décide par une ordonnance susceptible d'être contestée devant la chambre d'accusation, qui précise les considérations de droit et de fait justifiant sa décision, par référence aux dispositions de l'article 144. S'agissant des mineurs, dont le régime est fixé par l'article 11 de l'ordonnance du 2 février 1945, les conditions de formes sont identiques, étant entendu que la détention provisoire peut être ordonnée soit par le juge d'instruction, soit par le juge pour enfant. Seules diffèrent les durées de détention. Article 137-1 (nouveau) du code de procédure pénale Les quatre alinéas du présent article organisent l'insertion du juge de la détention provisoire dans la procédure pénale. On ne reviendra pas, dans le cadre de cette présentation technique, sur les motivations ayant présidé à ce changement fondamental de notre procédure, déjà évoquées dans la présentation générale du projet de loi. Sur le plan formel, ces dispositions rétablissent l'article 137-1, issu de la loi du 4 janvier 1993 et abrogé par celle du 24 août de la même année. Le premier alinéa pose le principe de la compétence du juge de la détention en matière de placement en détention provisoire ou de prolongation de cette dernière. En dehors des réserves que peut susciter cette dénomination peu valorisante pour le titulaire du poste, ces dispositions n'appellent que peu d'observations puisqu'elles ne font que consacrer une des propositions phares du projet de loi qui est le changement de l'autorité judiciaire chargée de prononcer la détention provisoire. Cet alinéa dispose, en outre, que le juge de la détention provisoire est compétent pour les demandes de mises en liberté. Cette formule lapidaire fait implicitement référence aux demandes formulées dans le cadre de l'article 148, c'est-à-dire celles effectuées par la personne ou son avocat et actuellement adressées au juge d'instruction. On verra ultérieurement que cette procédure est modifiée de sorte que, dorénavant, le juge de la détention provisoire soit saisi lorsque le juge d'instruction refuse d'y faire droit. En toute logique, cet alinéa doit également prendre en compte l'hypothèse visée à l'article 147, qui fait aussi l'objet d'un ajustement, selon lequel le juge de la détention provisoire est compétent pour prononcer la mise en liberté lorsque le juge d'instruction a refusé de suivre des réquisitions du procureur de la République en vue de la libération d'un prévenu. La Commission a rejeté l'amendement n° 40 de M. André Gerin instituant une chambre d'examen des mises en détention provisoire, un amendement de M. Pierre Albertini substituant au juge de la détention provisoire le juge des libertés et un amendement du même auteur confiant à la chambre d'accusation, et non au juge de la détention provisoire, le pouvoir de prolonger la détention provisoire. Le deuxième alinéa est relatif à la désignation du juge de la détention provisoire. Celui-ci est évidemment un magistrat du siège, ayant rang de président, de premier vice-président ou de vice-président, qui est désigné par le président du T.G.I, lequel peut se désigner lui-même. Les raisons de ce choix sont claires. Il s'agit, d'une part, de confier à un juge censé être plus expérimenté la décision de placer en détention, mesure considérée à juste titre comme la plus attentatoire à la présomption d'innocence. Il s'agit, en outre, de faire examiner la demande du juge d'instruction par une personnalité disposant d'une certaine autorité morale, étant entendu qu'en l'espèce leurs rapports ne procèdent pas de la relation hiérarchique mais davantage de la complémentarité. Outre ces questions de principe, le présent alinéa traite de la question du remplacement éventuel du juge de la détention provisoire, pour laquelle il est fait référence à l'article 50 relatif au remplacement du juge d'instruction. Ce renvoi est inapproprié dans la mesure où cet article donne alors compétence au tribunal de grande instance. En fait, il semble possible de faire l'économie d'une telle disposition dans la mesure où le président du T.G.I peut nommer temporairement un autre juge de la détention pour assurer le remplacement de celui qui est empêché. Tel est l'objet de l'amendement présenté par le rapporteur que la Commission a adopté (amendement n° 97). Enfin, il est prévu que, lorsqu'il statue à l'issue d'un débat contradictoire, le juge de la détention provisoire se fait assister d'un greffier. Le troisième alinéa se borne à indiquer que le juge de la détention provisoire ne peut participer au jugement des affaires pénales dont il a connu en qualité de juge de la détention provisoire, précision évidente que la rédaction n'apporte pas. Cette option peut apparaître logique puisqu'elle répond au principe d'impartialité objective auquel est censée répondre l'institution d'un juge de la détention mais elle ne va pas de soi : dans la réforme de décembre 1985, la détention était ordonnée par la chambre d'instruction à laquelle participait le juge ayant instruit l'affaire en cause. En contrepartie, elle soulève une difficulté pratique puisqu'il faudra assurer un roulement qui ne perturbe pas le fonctionnement des juridictions, en particulier des plus petites d'entre elles. Ceci explique l'augmentation des effectifs nécessitée par la réforme proposée. Le dernier alinéa de l'article 137-1 détermine les conditions dans lesquelles le juge de la détention provisoire devient compétent : il est saisi par une ordonnance motivée du juge d'instruction qui lui transmet le dossier de la procédure, après avoir recueilli les réquisitions du procureur de la République. La saisine du juge de la détention par ordonnance motivée appelle plusieurs observations. Sur le plan formel, le recours à une ordonnance peut surprendre mais une telle procédure semble nécessaire s'agissant des rapports entre deux magistrats du siège. En fait, le code de procédure pénale connaît d'autres exemples, tels que la saisine du tribunal correctionnel par le juge de l'application des peines aux fins de révocation du sursis avec mise à l'épreuve ou, plus communément, l'ordonnance émise par le juge d'instruction lorsqu'il estime qu'il existe contre une personne mise en examen des charges suffisantes qui font présumer qu'elle a commis un délit. A l'instar du précédent de janvier 1993, la saisine du juge de la détention provisoire n'est entourée d'aucun délai. En pratique, le juge d'instruction aura évidemment intérêt à saisir dès que possible son collègue chargé de la détention, lequel devra également statuer au plus vite. Inévitablement, la personne mise en examen devra attendre que celui-ci se prononce, après avoir patienté pour la présentation au parquet, le cas échéant, puis au juge d'instruction. L'accumulation de ces retenues à la disposition de la justice peut conduire, dans certains cas, à des situations de faits peu satisfaisantes mais on admettra qu'il semble hasardeux d'encadrer la nouvelle procédure dans des délais précis : trop brefs, ils risqueraient d'être impraticables ; trop larges, ils pourraient conduire à généraliser les effets pervers que l'on cherche à éviter. Enfin, le juge d'instruction doit transmettre le dossier de la procédure après avoir recueilli préalablement les réquisitions du parquet. On comprend le sens de cette mention mais sa rédaction prête à confusion car, dans la plupart des cas, la détention est sollicitée d'emblée par le parquet dès l'ouverture de l'information et le juge d'instruction dispose déjà, par définition, des réquisitions correspondantes. Sur le fond, la production d'une ordonnance motivée aux fins de saisine du juge de la détention provisoire ne devrait pas accroître la charge de travail des juges d'instruction dans la mesure où, d'ores et déjà, ces derniers doivent en rédiger une lorsqu'ils décident du placement en détention provisoire. En revanche, elle peut obliger le magistrat instructeur à dévoiler plus rapidement qu'aujourd'hui ses objectifs et sa stratégie d'enquête, puisque le débat contradictoire, prévu par l'article 145, est désormais porté devant le juge de la détention provisoire. Notons, enfin, que cette ordonnance n'est pas susceptible d'appel par la personne intéressée, mais, qu'elle peut, en revanche, être contestée par le procureur de la République, hypothèse, il est vrai, assez largement théorique. La Commission a été saisie de l'amendement n° 20 de M. Patrick Devedjian, ainsi que d'un amendement de M. Philippe Houillon à même finalité, tendant à préciser que le juge de la détention provisoire est saisi, non par une ordonnance motivée du juge d'instruction, mais par un réquisitoire du procureur de la République. M. Philippe Houillon a estimé que si le juge d'instruction transmettait le dossier de la procédure, cela signifiait nécessairement qu'il n'envisageait pas de laisser en liberté la personne mise en examen, ce qui revenait à un préjugement. Le rapporteur et Mme Frédérique Bredin ont jugé cet amendement incompatible avec la logique retenue par le projet de loi, consistant à faire intervenir deux magistrats du siège pour décider de la détention provisoire, alors qu'un seul est suffisant pour le maintien en liberté. M. Robert Pandraud a estimé qu'en pratique, le juge de la détention provisoire ne contredirait pas la décision prise par l'un de ses collègues du siège. La Commission a rejeté l'amendement n° 20 de M. Patrick Devedjian et l'amendement de M. Philippe Houillon, de même qu'un amendement de M. Alain Tourret substituant aux termes d'ordonnance motivée ceux d'avis motivé, le rapporteur ayant fait observer que certaines ordonnances sont insusceptibles d'appel. Puis, elle a adopté un amendement de précision du rapporteur (amendement n° 98). Enfin, la Commission a rejeté un amendement de M. Alain Tourret tendant à prévoir que le juge de la détention provisoire statue par une ordonnance motivée sur toutes les demandes dont il est saisi, le rapporteur ayant fait observer que l'article 145-1 lui fait déjà obligation de motiver les ordonnances prolongeant la détention. L'ensemble de l'article 137-1 ainsi décrit appelle quelques remarques complémentaires. Tout d'abord, on notera que la décision du juge de la détention provisoire n'est entourée d'aucun délai. Ici encore, la problématique du délai est une question de circonstances, sachant que le juge de la détention provisoire doit statuer dès qu'il aura pris connaissance du dossier. Ensuite, le juge de la détention provisoire est substitué au juge d'instruction pour tout ce qui concerne la prescription ou la prolongation de la détention provisoire, sans que la procédure soit par ailleurs modifiée : c'est devant lui qu'aura lieu le débat contradictoire, c'est lui qui rendra l'ordonnance spécialement motivée prévue par l'article 145. En dehors des présentes dispositions, seules sont donc nécessaires des mesures de coordination, prévues par l'article 33 du présent projet de loi. Article 137-2 (nouveau) du code de procédure pénale En application des articles 138 et 139 du code de procédure pénale, le contrôle judiciaire d'une personne mise en examen est ordonné par le juge d'instruction, par une ordonnance qui peut être prise à tout moment de l'instruction. Sans changement par rapport au droit positif, le présent article dispose, dans son premier alinéa, que le contrôle judiciaire est ordonné par le juge d'instruction, qui statue après avoir recueilli les réquisitions du procureur de la République. Mise à part la confirmation de la compétence du juge d'instruction, ces dispositions comblent une lacune actuelle du code de procédure pénale puisque, si le contrôle judiciaire peut être requis par le procureur de la République dans son réquisitoire introductif, il peut être également décidé par seul le juge d'instruction en cours d'instruction, auquel cas l'avis du procureur n'est pas nécessaire. S'agissant d'une mesure qui peut entraîner des contraintes très pesantes, l'avis du parquet n'est pas superflu ; aussi est-il opportunément proposé de le généraliser. Soulignons que cette observation aurait pu conduire à transférer la décision initiale du contrôle judiciaire, qui constitue de plus en plus un substitut à la liberté, au juge de la détention provisoire, mais les auteurs du projet de loi ont préféré maintenir le droit en l'état. Cette option est fondée, dans la mesure où elle conduit à faciliter le recours à une procédure considérée comme moins attentatoire à la présomption d'innocence. En outre, gardant la maîtrise du contrôle judiciaire, le juge d'instruction sera d'autant plus incité à maintenir le prévenu en liberté ou à faire droit à une demande de remise en liberté. Ajoutons enfin que ce choix aurait contribué à infléchir sensiblement la procédure pénale dans un sens franchement accusatoire, ce qui n'est pas l'orientation retenue. La Commission a rejeté un amendement de M. Alain Tourret tendant à confier au juge de la détention provisoire le soin de prescrire les mesures de contrôle judiciaire. Dans l'intérêt de la personne mise en examen, le rapporteur et M. Robert Pandraud ont jugé préférable que le juge d'instruction puisse assortir le maintien ou la remise en liberté d'un contrôle judiciaire sans avoir à en référer au juge de la détention provisoire, seule la décision de priver de liberté nécessitant d'être approuvée par deux magistrats et justifiant une procédure plus lourde. En revanche, le deuxième alinéa prévoit que le juge de la détention provisoire peut directement ordonner le contrôle judiciaire lorsqu'il est saisi d'une demande de placement en détention provisoire par le juge d'instruction. Cette mesure, qui évite que le juge de la détention provisoire ne soit confronté qu'à un choix binaire liberté - détention, est logique dès lors que le contrôle judiciaire était originellement conçu comme une alternative à la détention provisoire. Conformément à la pratique habituelle, le juge de la détention est, bien entendu, habilité à prendre tout ou partie des obligations prévues à l'article 138. La Commission a également rejeté l'amendement n° 21 de M. Patrick Devedjian et un amendement identique de M. Philippe Houillon tendant à priver le juge de la détention provisoire de la faculté d'ordonner un contrôle judiciaire, le rapporteur et Mme Frédérique Bredin ayant considéré que le juge de la détention provisoire, saisi d'une demande de placement, devait disposer du choix de maintenir la personne en liberté moyennant des obligations de contrôle judiciaire. Article 137-3 (nouveau) du code de procédure pénale Cet article prévoit que lorsqu'il ne prononce ni détention provisoire ni contrôle judiciaire, le juge de la détention provisoire n'est pas tenu de prendre une ordonnance. Il s'agit en fait de la transposition du principe selon lequel la liberté est la règle et n'a donc pas à être justifiée, contrairement au placement en détention provisoire. Si le juge de la détention provisoire use de la faculté offerte par le présent article, la rédaction conduit formellement à exclure l'appel éventuel du procureur de la République, puisque celui-ci peut, aux termes de l'article 186 modifié par l'article 33 du présent projet, interjeter appel de toutes les « ordonnances » du juge de la détention. En fait, cette rédaction ne soulève pas de difficultés pratiques dans la mesure où le procureur de la République pourra, en application de l'article 137-5 ci après, saisir directement la chambre d'accusation lorsqu'il n'est pas fait droit à ses réquisitions. La Commission a rejeté un amendement de M. Alain Tourret supprimant les articles 137-3 à 137-5 pour que le juge d'instruction statue par ordonnance en toute hypothèse, le rapporteur s'étant interrogé sur l'intérêt de cette disposition lorsque la personne mise en examen n'est placée ni sous contrôle judiciaire ni en détention provisoire. En conséquence, elle a également rejeté deux amendements ayant le même objet, l'amendement n° 22 de M. Patrick Devedjian et un amendement identique de M. Philippe Houillon. Enfin, après avoir adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n° 99), la Commission a rejeté un amendement de précision de M. Philippe Houillon. Article 137-4 (nouveau) du code de procédure pénale Le deuxième alinéa de l'article 137 prévoit que le juge d'instruction qui ne suit pas les réquisitions du procureur de la République tendant au placement en détention provisoire, à la prolongation de cette dernière ou au placement sous contrôle judiciaire n'a pas à rendre d'ordonnance motivée. Comme on l'a vu précédemment, cette option est logique puisqu'il s'agit d'une décision qui conduit au maintien de la personne concernée en liberté. En contrepartie, il est prévu que le procureur de la République puisse saisir la chambre d'accusation. Dès lors que le juge de la détention provisoire devient compétent pour prononcer chacune de ces décisions, tandis que le juge d'instruction reste un point de passage obligé pour le procureur de la République, ces dispositions doivent nécessairement être aménagées. Ainsi, l'article 137-4 nouveau prévoit que le juge d'instruction n'est pas tenu de statuer par ordonnance : - lorsqu'il ne transmet pas le dossier au juge de la détention provisoire alors qu'il est saisi de réquisitions en vue du placement en détention provisoire ou de sa prolongation ; - lorsqu'il ne fait pas suite à des réquisitions en vue du placement sous contrôle judiciaire ; rappelons que, dans cette hypothèse, le juge d'instruction reste compétent pour ordonner lui-même les mesures correspondantes, même si le juge de la détention provisoire est également habilité à les prononcer, une fois saisi, comme alternative à la détention provisoire. Dans ces cas de figure, le procureur de la République est informé par notification, qui lui est adressée par le greffier du juge d'instruction. Indiquons, toutefois, qu'il ne s'agit que d'une faculté accordée au juge d'instruction. Comme dans le droit actuel, celui-ci peut décider de statuer par ordonnance, ce qui permet au procureur de la République de former un appel devant la chambre d'accusation dans les conditions de droit commun. La Commission a rejeté un amendement de M. Philippe Houillon tendant à supprimer cet article. Article 137-5 (nouveau) du code de procédure pénale Comme on l'a vu précédemment, le juge de la détention provisoire n'est pas tenu de statuer par ordonnance lorsqu'il décide de ne pas placer la personne mise en examen en détention provisoire ; il en est de même pour le juge d'instruction qui ne suit pas les réquisitions du procureur de la République tendant à ce placement. C'est pourquoi, afin d'ouvrir une possibilité de recours au procureur de la République lorsque celui-ci n'a pas obtenu satisfaction, l'article 137-5 prévoit que ce dernier peut saisir directement la chambre d'accusation, dans les dix jours qui suivent la notification. Bien que la rédaction soit peu explicite, cette faculté concerne non seulement le cas où le juge d'instruction ne suit pas les réquisitions du membre du parquet, mais aussi celle ou le juge de la détention provisoire n'a pas statué conformément à ces dernières. Cette procédure n'appelle pas d'observation particulière puisqu'elle décalque celle qui est actuellement prévue par le deuxième alinéa de l'article 137. La Commission a rejeté l'amendement n° 23 de M. Patrick Devedjian et un amendement identique de M. Philippe Houillon tendant à supprimer cet article. Elle a ensuite adopté l'article 10 ainsi modifié. La Commission a rejeté un amendement de M. Alain Tourret prévoyant que le procureur de la République a le droit d'interjeter appel des ordonnances du juge de la détention provisoire et des libertés. Mme Frédérique Bredin a reconnu, à cette occasion, que les termes de « juge de la détention » n'avaient pas une connotation très positive et qu'il faudrait sans doute, avant le passage en séance publique, trouver une expression plus satisfaisante. Le rapporteur a exprimé son accord avec cette remarque, M. Louis Mermaz ayant noté que la garde des sceaux avait ouvert une piste à ce sujet en évoquant le « contrôle de la détention ». Puis la Commission a rejeté un amendement, également présenté par M. Alain Tourret, prévoyant que les parties ou les témoins assistés pourraient interjeter appel des ordonnances du juge de la détention. Le rapporteur a fait remarquer que ce recours était déjà ouvert par le code de procédure pénale, en application du présent projet de loi, le témoin assisté bénéficiant des mêmes droits que les personnes mises en examen. Article 11 L'article 145-3 du code de procédure pénale prévoit que, lorsque la durée de détention excède un an en matière criminelle ou huit mois en matière délictuelle, les décisions de prolongation, outre le débat contradictoire auquel elles doivent donner lieu, ou les refus de remise en liberté, doivent mentionner les indications particulières qui justifient la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure. Cependant, le juge d'instruction peut ne pas indiquer les investigations qu'il envisage lorsque cette indication pourrait les entraver. Le présent article n'apporte qu'une modification rédactionnelle à ce dispositif pour tenir compte du fait que le juge de la détention provisoire est désormais compétent pour statuer sur les demandes de prolongation de la détention provisoire. On peut toutefois se demander si la nouvelle architecture des placements en détention provisoire, conjuguée aux dispositions proposées en vue d'encadrer les délais de procédure par les articles 21 et suivants, ne limite pas l'intérêt de ce mécanisme institué par la loi de décembre 1996 afin d'améliorer l'information des parties sur la durée des procédures dont elles sont l'objet. Partant du principe qu'un excès d'informations ne peut pas nuire dans un domaine aussi sensible, votre rapporteur préfère néanmoins maintenir la mesure en l'état. La Commission a rejeté un amendement d'ordre rédactionnel présenté par M. Pierre Albertini. Puis elle a adopté l'article 11 sans modification. Article 12 Dès lors que les conditions de placement en détention provisoire diffèrent selon la nature de l'infraction, il est logique que celle-ci soit réexaminée lorsque le juge d'instruction est conduit à requalifier les faits en cours d'instruction. Si la requalification criminelle ne donne lieu à aucune procédure particulière, il n'en est pas de même en cas de requalification correctionnelle. Ainsi, l'article 146 prévoit que, dans une telle hypothèse, le juge d'instruction peut, après avoir sollicité des réquisitions du procureur, soit ordonner le maintien en détention provisoire - par le biais d'une nouvelle ordonnance prise en application de l'article 145-1, lequel renvoie à l'article 145, c'est-à-dire à une ordonnance spécialement motivée après débat contradictoire -, soit décider de sa mise en liberté assortie ou non du contrôle judiciaire. A l'examen, force est de constater que l'article 146 n'est plus d'un intérêt majeur depuis que les conditions de placements en détention sont assez largement unifiées. On peut néanmoins admettre qu'il conserve une certaine valeur informative pour le prévenu en raison des durées maximales de la détention provisoirequi diffèrent selon que l'on se trouve en matière correctionnelle ou criminelle. Afin de tenir compte du changement d'autorité chargée de décider du placement en détention provisoire, le présent article aménage ces dispositions en prévoyant que le juge d'instruction saisit par une ordonnance motivée le juge de la détention provisoire, à charge pour celui-ci de se prononcer sur le maintien en détention provisoire. Bien que le texte ne le précise pas, ce dernier devra statuer selon les modalités prévues aux articles 145 et 145-1. La Commission a rejeté l'amendement n° 24 de M. Patrick Devedjian ainsi qu'un amendement de M. Philippe Houillon ayant le même objet, aux termes desquels le juge de la détention provisoire doit être saisi par le procureur et non pas par le juge d'instruction pour statuer sur la détention ou la mise en liberté d'une personne mise en examen. Elle a également rejeté un amendement de M. Pierre Albertini modifiant la dénomination du juge de la détention provisoire. Elle a ensuite adopté un amendement de M. Alain Tourret harmonisant les délais laissés au juge de la détention provisoire pour statuer (amendement n° 100). Puis, elle a adopté l'article 12 ainsi modifié. Article 13 L'article 147 prévoit actuellement que le juge d'instruction peut, en toute matière et à tout moment, décider de la mise en liberté du prévenu, moyennant l'engagement de ce dernier de se présenter à tous les actes de procédure dès qu'il en est requis et d'informer le juge d'instruction de tous ses déplacements. Le procureur de la République peut également en prendre l'initiative, le juge d'instruction devant se prononcer dans les cinq jours qui suivent ses réquisitions. Conformément à la logique adoptée par le projet de loi, le présent article modifie ces dispositions afin de tenir compte de la création du juge de la détention provisoire, en distinguant, dans le cas où la demande de libération émane du procureur, deux hypothèses : - Si le juge d'instruction entend faire droit à la réquisition du parquet, il n'y pas de changement par rapport à la situation actuelle, puisque le magistrat instructeur peut, de lui-même, procéder à une remise en liberté. Bien que le texte ne le précise pas explicitement, il semble que celui-ci dispose de cinq jours pour statuer. Notons par ailleurs qu'en dépit du silence du texte, rien n'interdit au juge d'assortir la mise en liberté d'une ou plusieurs obligations de contrôle judiciaire. - Si le juge d'instruction s'oppose à cette demande, il doit, dans les cinq jours de la réquisition, saisir le juge de la détention provisoire en lui transmettant le dossier de procédure, qui comprend, en l'espèce, les réquisitions du procureur de la République, accompagné de son « avis motivé », formule ambiguë à laquelle on pourrait préférer celle d'une ordonnance motivée. Le juge de la détention provisoire doit alors statuer dans les trois jours, délai plus bref que celui imparti au juge d'instruction, de sorte qu'au total, la procédure ne soit pas trop longue ; on soulignera que cet argument aurait pu, a fortiori, plaider pour un raccourcissement du délai laissé au juge d'instruction pour transmettre le dossier. Dans ce cadre, le juge de la détention provisoire peut confirmer ou infirmer la position du juge de la détention provisoire. S'il confirme le maintien en détention, il devra, bien que le texte ne le précise pas, motiver son ordonnance au vu des éléments de fait ou de droit qui la fondent compte tenu des dispositions de l'article 144. Il peut également faire droit à la demande moyennant des obligations de contrôle judiciaire sur la base du deuxième alinéa de l'article 137-2 nouveau. (cf. supra). La Commission a rejeté un amendement n° 25 de M. Patrick Devedjian et un amendement similaire de M. Philippe Houillon prévoyant que le juge d'instruction doit passer par le procureur de la République pour saisir le juge de la détention provisoire. Elle a également rejeté un amendement d'ordre rédactionnel de M. Pierre Albertini. Puis elle a examiné un amendement du rapporteur prévoyant que le juge d'instruction saisit le juge de la détention provisoire par voie d'ordonnance, plutôt que par simple transmission du dossier accompagné d'un avis motivé. M. Philippe Houillon a estimé que cet amendement risquait d'aggraver le système, la prise d'une ordonnance relevant d'une logique de prédécision, alors même que le juge de la détention provisoire n'a pas encore statué. M. Jean-Pierre Michel a relevé qu'une ordonnance, étant un acte qui fait grief, était donc susceptible d'appel, ce que M. Alain Tourret a confirmé. Le rapporteur a souligné la portée purement technique de son amendement, mais, constatant que le débat n'était pas clos sur cette question, l'a retiré. La Commission a adopté cet article sans modification. Article 14 Que ce soit en matière correctionnelle ou criminelle, le prévenu ou son avocat peuvent demander à tout moment la mise en liberté. Dans ce cas, le juge d'instruction communique immédiatement le dossier de la procédure au procureur aux fins de réquisitions, et doit statuer dans les cinq jours qui suivent cette communication ; à cette occasion, il peut prononcer soit le rejet de la demande, soit son acceptation assortie, le cas échéant, de mesures de contrôle judiciaire. L'article 148 précise que l'ordonnance comporte l'énoncé des motifs de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision au vu des dispositions de l'article 144, obligation qui ne vise en pratique que les cas de rejet de la demande puisque la loi et la jurisprudence admettent que le juge n'est jamais tenu de motiver une remise en liberté. En application des articles 185 et 186, l'ordonnance de rejet peut être contestée devant la chambre d'accusation, soit par le parquet, soit par le prévenu. En revanche, l'appel contre une ordonnance faisant droit à la demande ne peut logiquement être formé que par le procureur de la République et n'est pas suspensif s'agissant d'une remise en liberté. L'article 148 précise enfin que lorsque le juge d'instruction ne s'est pas prononcé dans les délais impartis, le demandeur, ainsi que le procureur, peuvent saisir directement la chambre d'accusation, qui doit se prononcer dans les vingt jours, faute de quoi le prévenu est remis en liberté. Dans le même esprit qu'à l'article précédent, il est proposé d'adapter cette procédure lorsque le juge d'instruction entend ne pas faire droit à la demande du prévenu ou de son avocat. Dans ce cas, le magistrat instructeur doit transmettre la demande, dans les cinq jours - les observations formulées sur ce délai à l'article précédent valant également au cas particulier - qui suivent la communication des réquisitions du parquet, au juge de la détention, accompagné de son « avis motivé ». Le juge doit alors statuer dans les trois jours ouvrables, la rédaction proposée précisant explicitement que son ordonnance comporte l'énoncé des motifs de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision au vu des dispositions de l'article 144, mention qui ne vaut, par définition, que lorsque le juge de la détention provisoire ne fait pas droit au demandeur. En application des règles de droit commun modifiées par l'article 33 du présent projet, le procureur peut alors faire appel de cette ordonnance devant la chambre d'accusation. Il en est de même du prévenu, la rédaction actuelle de l'article 186 faisant déjà référence aux ordonnances et décisions prises dans le cadre de l'article 148. On notera que le présent article maintient, par erreur, le troisième alinéa de l'article 148 relatif à la décision du juge d'instruction, dispositions qui n'ont plus d'intérêt compte tenu des modifications apportées. La Commission a adopté un amendement du rapporteur procédant à sa suppression (amendement n° 101). Enfin, il est proposé de transposer au juge de la détention provisoire les règles actuellement prévues dans le cas où le juge d'instruction n'a pas statué dans le délai de cinq jours, étant entendu que ce délai est ramené à trois jours s'agissant de ce magistrat. Ce faisant, on notera qu'il n'existe plus de sanction en cas de carence du juge d'instruction, mais on peut admettre que cette hypothèse est, de facto, prise en compte puisque si le juge d'instruction n'a pas transmis la demande dans les cinq jours de la communication au parquet, le juge de la détention provisoire ne pourra pas se prononcer dans le délai qui s'impose à lui. La Commission a rejeté un amendement n° 26 de M. Patrick Devedjian et un amendement de M. Philippe Houillon ayant le même objet, prévoyant, là encore, la saisine par le procureur du juge de la détention provisoire, puis a rejeté un amendement d'ordre rédactionnel de M. Pierre Albertini. Elle a ensuite adopté l'article 14 ainsi modifié. Section 2 Une fois réglé le problème de l'autorité judiciaire chargée de prononcer le placement en détention provisoire, restent pendantes les questions des conditions de fond justifiant ce placement et de la durée de la détention, motifs qui ont justifié à de nombreuses - trop nombreuses - reprises la condamnation de la France devant la Cour européenne des droits de l'homme, comme on l'a vu dans le cadre de la présentation générale. Force est de constater que sur ce point, le projet de loi se montre moins audacieux, les avancées proposées étant assorties de multiples exceptions qui en atténuent singulièrement la portée. La Commission a rejeté un amendement présenté par M. Michel Hunault fixant des critères objectifs aux fins de limiter la possibilité laissée au juge de mettre une personne en détention provisoire, en augmentant en particulier le seuil de la peine encourue nécessaire pour justifier une telle détention. Article 15 Le présent article a une double portée. D'une part, il procède à une réécriture de l'article 144 du code de procédure pénale, particulièrement bienvenue tant la lecture de ces dispositions semble complexe. Pour ce faire, il scinde l'article 144 afin de distinguer les conditions tenant aux peines encourues, de celles tenant aux nécessités de l'instruction. D'autre part, il propose quelques aménagements de fond des conditions justifiant le placement en détention provisoire, avancées qui, à l'examen, apparaissent peu convaincantes pour garantir un recours moins systématique à cette pratique. Article 143-1 (nouveau) du code de procédure pénale Ce nouvel article du code de procédure pénale regroupe les dispositions relatives au quantum de peines encourues pouvant justifier un placement en détention provisoire, les motifs justifiant cette détention étant isolés dans l'article 144. Selon la rédaction actuelle de ce dernier, la détention peut être ordonnée ou prolongée en cas de crime ou, en matière correctionnelle, si la peine encourue est égale ou supérieure à un an d'emprisonnement en cas de délits flagrants ou égale ou supérieure à deux ans dans les autres cas. Aux termes du présent article, la détention provisoire pourrait être désormais ordonnée ou prolongée : · Lorsque la personne encourt une peine criminelle ; · Lorsque la personne encourt une peine correctionnelle égale ou supérieure à trois ans, ce seuil tenant compte de l'état éventuel de récidive qui, rappelons-le, conduit à doubler la peine. Cependant, cette norme générale connaît deux exceptions importantes : - le seuil de trois ans est ramené à deux ans s'il s'agit d'un délit contre les personnes (livre II code pénal) ou d'un délit contre la nation, l'Etat ou la paix publique (livre IV du même code) ; - le seuil est également ramené à deux ans lorsqu'il s'agit d'un délit contre les biens (livre III du code pénal) mais que la personne a déjà été condamnée, soit à une peine criminelle, soit à une peine correctionnelle d'au moins un an ferme. Le tableau ci après illustre ces changements.
Dans le cadre de la présentation générale du présent projet de loi, votre rapporteur a exprimé des doutes sur la portée des « assouplissements » ainsi proposés. Sans entrer dans le détail, rappelons que l'on pourrait émettre des réserves sur la prise en compte de l'état de récidive, qui semble contradictoire avec le principe même de la présomption d'innocence. Mais surtout, le relèvement des seuils semble trop modeste pour réduire les placements en détention provisoire, d'autant qu'il est assorti d'exceptions qui en limitent la portée. La Commission a adopté un amendement d'ordre rédactionnel présenté par le rapporteur (amendement n° 102). Puis, elle a été saisie d'un amendement de M. Alain Tourret exigeant pour la mise en détention provisoire que la peine encourue soit désormais de cinq ans d'emprisonnement en cas de délit contre les biens et de trois ans en cas de délit contre les personnes. M. Alain Tourret a rappelé que ce dispositif avait été adopté en avril 1998 par la Commission et par l'Assemblée nationale, lors de la discussion de la proposition de loi qu'il avait présentée. Il a notamment souligné que les commissaires socialistes avaient voté à l'unanimité cette disposition, tandis que la chancellerie, qui s'y était opposée en avril 1998, demeurait hostile à cet amendement. Il a regretté que les commissaires socialistes puissent changer de position sur un problème aussi important. Rappelant qu'il s'était prononcé contre cet amendement l'an passé, M. Robert Pandraud a indiqué qu'il le voterait néanmoins parce qu'il jugeait nécessaire que l'Assemblée soit cohérente et adresse ainsi à la chancellerie un message clair. Il a estimé que le présent débat confirmait le fait que le groupe socialiste considérait l'ordre du jour d'initiative parlementaire comme un simple accessoire dans le travail législatif. Il a conclu en indiquant qu'il ne souhaitait pas, sur ce texte, une « revanche des bureaux », trop souvent synonyme d'absence de volonté politique dans notre pays. M. Patrick Devedjian a fait savoir qu'il avait également voté contre cette élévation des seuils, parce que la proposition de M. Alain Tourret n'instituait pas de juge de la détention et que, dès lors, il n'était pas opportun de trop conforter les pouvoirs du juge d'instruction. Constatant que le présent projet de loi s'inscrivait dans une autre logique, distinguant la question de la détention provisoire et l'enquête judiciaire, il a fait part de son accord sur l'amendement de M. Alain Tourret. Mme Frédérique Bredin a indiqué que cet amendement lui paraissait intéressant et qu'elle regrettait de ne pas avoir été suivie par le groupe socialiste sur ce sujet. Elle a ajouté qu'un certain nombre d'autres amendements seraient proposés pour renforcer le débat contradictoire en matière de détention provisoire dans le souci de protéger les libertés individuelles. M. Arnaud Montebourg a fait savoir qu'il n'avait jamais exprimé son soutien à la proposition de loi présentée par M. Alain Tourret en avril 1998, se déclarant opposé à l'utilisation de seuils pour lutter contre les excès de la détention provisoire. Jugeant que le recours à ce procédé constituait un moyen trop uniforme et trop aveugle pour réellement contrecarrer les effets pervers de la mise en détention, il a ajouté qu'ils auraient également pour conséquence d'empêcher la détention dans un certain nombre de cas relevant des délits économiques et financiers. Il a précisé qu'il n'était pas, par principe, opposé à la détention provisoire, jugeant qu'il s'agissait d'un instrument judiciaire à préserver, dès lors qu'elle ne donnait pas lieu à des excès, insistant sur le fait qu'il ne fallait pas totalement déstabiliser l'appareil répressif. M. Alain Tourret a jugé que l'argument avancé par M. Arnaud Montebourg au sujet des délits économiques et financiers n'avait guère de fondement, puisque la plupart d'entre eux étaient punis d'une peine d'au moins cinq années d'emprisonnement, sauf en ce qui concerne l'abus de confiance. Il a fait savoir qu'il réserverait son vote sur le projet de loi en fonction de l'accueil fait à sa proposition. M. Jean-Pierre Michel a indiqué qu'il soutiendrait cet amendement, regrettant le changement d'attitude du groupe socialiste sur ce sujet. Il a insisté sur la nécessité de créer des seuils objectifs afin de limiter strictement la pratique de la détention provisoire qui, la plupart du temps, apparaît inutile. Constatant que la discussion sur cette question était riche, le rapporteur a observé qu'une solution médiane pourrait peut-être être trouvée d'ici le passage en séance publique, soulignant qu'en tout état de cause, ce débat méritait une réflexion approfondie. Mme Frédérique Bredin s'est réjouie de l'ouverture faite par le rapporteur, estimant en effet nécessaire de poursuivre la discussion sur cette question. MM. Louis Mermaz et Jean Codognès ont fait savoir qu'ils ne participeraient pas au vote sur cet amendement, espérant que le débat permettrait d'aboutir à un accord. La Commission a rejeté l'amendement de M. Alain Tourret, de même qu'un amendement de M. Pierre Albertini modifiant également le seuil de la peine de prison encourue pour justifier une détention provisoire. Article 144 du code de procédure pénale En droit positif, les conditions de fond du placement en détention provisoire sont également énumérées par l'article 144 du code de procédure pénale, selon lequel la détention provisoire est une mesure exceptionnelle qui ne peut intervenir, d'une manière générale, que, lorsque les obligations du contrôle judiciaire se révèlent insuffisantes. En outre, elle doit être justifiée : - par ce que l'on peut appeler les nécessités de l'instruction, c'est-à-dire pour éviter la disparition des preuves ou des indices matériels, les pressions sur les témoins ou la victime, ou la concertation frauduleuse entre les coauteurs ou complices ; - ou, à titre de mesure de sûreté, pour protéger la personne poursuivie, empêcher sa fuite ou mettre fin à l'infraction ; - ou pour préserver l'ordre public du trouble causé par l'infraction, étant entendu que, depuis la loi du 30 décembre 1996, ce motif, isolé au sein de l'article 144, est défini de façon plus restrictive puisque le trouble doit être à la fois « exceptionnel et persistant ». Enfin, la détention peut être également ordonnée en cas de non respect du contrôle judiciaire, quelles que soient les conditions réunies par ailleurs. En dehors d'une amélioration formelle, qui conduit cependant inopportunément à faire disparaître la référence au contrôle judiciaire, le présent article n'apporte que peu de modification au dispositif actuel. Il est ainsi proposé que le motif d'ordre public ne puisse plus justifier la prolongation de la détention provisoire lorsque la peine est inférieure à cinq ans d'emprisonnement. Ici encore, force est de constater que cet aménagement est insuffisant. Sans même évoquer la pertinence globale du motif d'ordre public, contestée par de nombreux juristes, les conséquences pratiques sont incertaines dans la mesure où, s'agissant d'une infraction punie de moins de cinq ans de prison, on imagine mal que, d'ores et déjà, celle-ci puisse être considérée comme causant un trouble « exceptionnel et persistant » à l'ordre public de nature à justifier une prolongation de la détention provisoire au delà des délais initiaux. Le rapporteur suggère donc de s'en tenir aux principes posés par la Cour européenne des droits de l'homme dans l'arrêt Letellier/France du 26 juin 1991, déjà cité dans la présentation générale. Cette juridiction a ainsi admis que le motif d'ordre public est acceptable pour un placement initial en détention, mais qu'il perd de sa pertinence au fur et à mesure du déroulement de l'instruction. Dès lors, le rapporteur propose, en matière correctionnelle, que le motif d'ordre public soit admis pour un placement en détention provisoire mais qu'il ne puisse plus être invoqué pour sa prolongation. On fera toutefois une exception pour les matières criminelles, eu égard à la nature même de certaines affaires. La Commission a adopté un amendement en ce sens du rapporteur (amendement n° 103). Mme Frédérique Bredin a souhaité qu'on envisage également la disparition du motif d'ordre public pour la mise en détention provisoire initiale en matière correctionnelle. M. Alain Tourret a fait connaître son accord sur ce dispositif qu'il avait lui-même proposé en avril dernier. Puis la Commission a rejeté un amendement de M. Alain Tourret qui, ayant un objet identique, a été considéré comme satisfait. La Commission a rejeté l'amendement n° 41 présenté par M. André Gerin supprimant le motif de troubles à l'ordre public pour justifier le placement en détention provisoire. Elle a également rejeté un amendement de M. Pierre Albertini prévoyant que seul le procureur de la République peut apprécier la réalité du trouble exceptionnel à l'ordre public justifiant une mise en détention provisoire. M. Patrick Devedjian a souligné qu'il était normal que la notion d'ordre public soit appréciée par le procureur et non par le juge d'instruction. Estimant que le parquet, devenu indépendant, n'aurait plus de légitimité à invoquer l'ordre public, M. Robert Pandraud a fait savoir qu'il s'abstiendrait sur cet amendement. La Commission a adopté l'article 15 ainsi modifié. Article 16 Avant l'adoption de la loi du 30 décembre 1996, en matière correctionnelle, lorsque la peine encourue était inférieure ou égale à cinq ans, la durée totale de la détention provisoire était limitée à six mois si la personne mise en examen n'avait jamais été condamnée à une peine ferme et à deux ans dans le cas contraire. Lorsque la peine encourue était supérieure à cinq ans, cette durée n'était pas limitée. La détention devait toutefois être prolongée par ordonnance motivée tous les quatre mois, et, lorsque la détention dépassait un an, à l'issue d'un débat contradictoire. La loi du 30 décembre 1996 a ramené la durée maximum de la détention en matière correctionnelle de deux à un an lorsque la personne encourt une peine inférieure à cinq ans et qu'elle a déjà été condamnée et limite à deux ans la détention de la personne encourant une peine supérieure à cinq ans mais inférieure à dix ans. (3)Au delà, s'applique l'article 144-1, introduit par cette même loi, s'inspire du principe de délai raisonnable posé par l'article 5-3 de la convention européenne des droits de l'homme, en prévoyant que le juge met fin à la détention dès que les conditions de l'article 144 ne sont plus réunies ou lorsqu'elle excède une « durée raisonnable ». En outre, l'obligation de procéder à un débat contradictoire pour la prolongation à été avancée du douzième au huitième mois. Le présent article ne bouleverse pas cette architecture, passablement complexe au demeurant, et se contente de réduire, à la marge, les cas où la détention correctionnelle peut excéder deux ans, lorsque la peine encourue est supérieure à cinq ans. Tel serait désormais le cas uniquement lorsque la personne encourt une peine égale à dix ans d'emprisonnement et est poursuivie pour trafic de stupéfiants, terrorisme, association de malfaiteurs, proxénétisme, extorsion de fonds ou pour une infraction commise en bande organisée. DURÉE DE LA DÉTENTION PROVISOIRE EN MATIÈRE CORRECTIONNELLE
DC : débat contradictoire. * : obligation de motiver l'ordonnance de prolongation en application de l'article 145-3. Il est à craindre que cette modification n'ait qu'une portée optique, dans la mesure où les placements en détention provisoire pour les infractions visées correspondent à l'essentiel des placements prononcés au titre d'une peine égale à dix ans. Quant au verrou constitué par l'article 144-1 relatif à la « durée raisonnable », les premières applications jurisprudentielles montrent qu'il est d'un maniement délicat : si la Cour de cassation se montre vigilante quant à l'existence des justifications apportées aux mémoires de demande de mise en liberté articulés sur la violation de la durée raisonnable (Cass.crim. 22 juillet 1997, n° 97-82777), elle se montre, en revanche, plus circonspecte sur le contenu de ces justifications, admettant la validité de considérations assez générales (Cass.crim.2 septembre 1997, n° 97-83234). Pour ces raisons, votre rapporteur plaide également pour une réforme plus radicale et plus simple : la détention provisoire serait ainsi limitée à quatre mois lorsque la peine encourue est inférieure à cinq ans et qu'il n'y a pas d'antécédents judiciaires, à 12 mois dans les autres cas, ou à 24 mois lorsque sont en cause certains délits spécialement graves ou complexes et que la peine encourue est égale à 10 ans. Toutefois, afin de conserver une certaine souplesse, ces mêmes délais seraient majorés d'un an dans le cas de commission rogatoire internationale, circonstance qui constitue un facteur objectif d'allongement des procédures. Bien entendu, afin de prévenir tout contournement de la loi, il faudrait que l'exécution cette commission rogatoire soit indispensable à l'achèvement de l'instruction. La Commission été saisie d'un amendement en ce sens présenté par le rapporteur. Estimant qu'un tel amendement présentait une avancée importante, notamment au regard de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, Mme Frédérique Bredin a déploré les temps de détention provisoire actuellement constatés. Elle a ajouté que les possibilités de prolongation en cas de commission rogatoire internationale permettraient de faire face aux lourdeurs inhérentes à cette procédure. M. Jean-Pierre Michel a approuvé la teneur de cet amendement, qui fonde sur des critères objectifs la durée de la détention provisoire, regrettant cependant que le problème du nombre de placements en détention provisoire ne soit pas abordé. Il s'est élevé en revanche contre le fait que la détention provisoire puisse être plus longue lorsque la personne mise en examen est récidiviste, estimant qu'une telle disposition constituait une atteinte au principe de la présomption d'innocence. M. Alain Tourret a considéré que la possibilité de prolonger la détention provisoire en cas de commission rogatoire internationale soulevait un réel problème, dès lors que la délivrance d'une telle commission pouvait être décidée à tout moment par le juge, sans qu'aucun contrôle ne soit exercé sur cette décision. Mme Frédérique Bredin a reconnu que les dispositions introduites pour les récidivistes pouvaient susciter des interrogations puisqu'elle introduisait dans la décision du juge un critère, non plus objectif, mais subjectif tenant à la personne mise en examen. Tout en écartant l'idée que les juges puissent utiliser les dispositions relatives aux commissions rogatoires internationales pour prolonger, de manière détournée, la durée des détentions provisoires, elle a admis qu'il conviendrait de mieux définir les affaires complexes sur la base d'éléments objectifs susceptibles d'être contrôlés précisément par les chambres d'accusation. Elle a ajouté qu'en l'état, l'amendement présentait une avancée par rapport au droit existant, notamment dans un contexte de délits financiers internationaux en augmentation, et permettrait de concilier efficacité de la procédure et présomption d'innocence. Revenant sur les objections formulées à l'encontre des dispositions concernant les récidivistes, M. Arnaud Montebourg a précisé que, dans les faits, le juge prenait déjà en compte, avant de décider la mise en détention provisoire, la personnalité du mis en examen et son éventuel passé judiciaire. Estimant que, dans les cas de délivrance de commission rogatoire internationale, il reviendrait aux chambres d'accusation de contrôler, au cas par cas, les conditions de délivrance, il a considéré que le texte proposé laissait une souplesse indispensable. Soulignant que la détention provisoire constituait une forme de précondamnation, ce qui est attesté par le fait que sa durée est décomptée de la condamnation finale, M. Patrick Devedjian s'est inquiété des dispositions relatives aux commissions rogatoires internationales, jugeant néfaste qu'une durée de détention soit soumise à des aléas de procédure et à la capacité de l'accusation à avancer dans ses investigations. Il a regretté que les droits de la défense ne puissent s'exercer de la même manière lors du débat sur le placement en détention provisoire qu'à l'occasion du prononcé de la peine définitive. La Commission a adopté l'amendement (amendement n° 104), ce qui a rendu sans objet l'amendement n° 42 de M. André Gerin limitant à un an la durée de la détention provisoire en matière correctionnelle. Puis elle a rejeté un amendement de M. Pierre Albertini confiant, en matière correctionnelle, la décision de prolongation de la détention provisoire à la Chambre d'accusation. En tout état de cause, soulignons que ces dispositions, aussi utiles soient-elles, ne valent que jusqu'à l'ordonnance de règlement rendue par le juge d'instruction. De fait, il n'existe pas de délais limitant réellement la détention provisoire après l'ordonnance de renvoi. En matière correctionnelle, l'article 179 du code de procédure pénale dispose que l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel est accompagnée d'une ordonnance prolongeant la détention pour une durée maxima de deux mois. Cette disposition permet théoriquement de limiter à deux mois les délais d'audiencement mais, en pratique, elle est contournée : le tribunal se réunit effectivement dans les délais impartis mais renvoie l'affaire à une audience ultérieure. Dans cette attente, le prévenu est maintenu en détention provisoire. Si l'on veut mettre un terme à cette pratique, il faut spécifier que le tribunal doit examiner l'affaire au fond dans un délai de deux mois, à l'instar du mécanisme prévu dans le cas de comparution immédiate. Votre rapporteur propose une disposition en ce sens, examinée plus loin (cf. infra articles additionnels après l'article 21). La Commission a adopté l'article 16 ainsi rédigé. Article 17 En matière criminelle (art. 145-2), la durée totale de la détention n'est pas limitée. Elle doit toutefois faire l'objet de prolongation tous les ans, par ordonnance motivée rendue à l'issue d'un débat contradictoire. Depuis la loi du 30 décembre 1996, les prolongations de la détention au delà d'un an après débat contradictoire sont ordonnées tous les six mois et non plus tous les ans.(4) En pratique, la seule limite est donc constituée, dans tous les cas par l'exigence du « délai raisonnable » prévu par l'article 5-3 de la Convention européenne des Droits de l'homme, directement applicable en droit interne. Le présent article propose d'établir des durées- butoirs en fonction de la peine encourue : - lorsque celle-ci est inférieure à vingt ans de détention ou réclusion criminelle, la détention provisoire ne pourrait excéder 2 ans ; - lorsqu'elle est comprise en vingt et trente ans, la détention ne pourrait excéder trois ans ; - au-delà, elle ne serait pas limitée sous réserve de la prise en compte du délai raisonnable. Dans tous les cas de figure, ces plafonds ne joueraient pas lorsque plusieurs crimes sont reprochés à la personne mise en examen.
Sur ce point, force est également de constater que les progrès sont modestes. Rappelant les observations formulées à l'article précédent, le rapporteur estime raisonnable de limiter à trois ans la durée de rétention criminelle. Cependant, comme en matière délictuelle, il semble raisonnable d'allonger ces délais d'un an en cas de commission rogatoire internationale, moyennant les mêmes réserves quant à la nature de cette dernière. Tel est l'objet de l'amendement présenté par le rapporteur que la Commission a adopté (amendement n° 105). Elle a, en revanche, rejeté un amendement de M. Pierre Albertini confiant, en matière criminelle, la décision de prolongation de la détention provisoire à la chambre d'accusation ; puis elle a rejeté deux amendements, l'un, n° 43 présenté par M. André Gerin, l'autre présenté par M. Philippe Houillon, ayant pour objet de limiter la durée de la détention provisoire en matière criminelle. Elle a ensuite été saisie d'un amendement de M. Alain Tourret substituant à la disposition, prévue dans le projet, qui écarte toute durée maximale de détention provisoire lorsque la personne mise en examen est soupçonnée de plusieurs crimes, une autre maintenant cette exception dans le seul cas de récidive. M. Alain Tourret a constaté que cette disposition méconnaissait la procédure qui consiste, en cas de pluralité des crimes, à traiter séparément chaque affaire. Le rapporteur ayant admis qu'il convenait de mieux définir la notion de pluralité de crimes, la Commission a adopté l'amendement de M. Alain Tourret (amendement n° 106). Dans le même esprit que ce qui a été dit en matière correctionnelle, ces mesures s'appliquent sans préjudice des délais d'audiencement. En l'état actuel du droit, à l'issue de l'instruction, si le magistrat instructeur estime que les faits peuvent être qualifiés de délit ou de crime, il renvoie le dossier à la chambre d'accusation. C'est cette dernière qui prononce, le cas échéant, la mise en accusation, l'arrêt qu'elle prononce valant ordonnance de prise de corps de l'accusé. Celui-ci est alors incarcéré en attendant son jugement. Or cette détention provisoire, qui n'est pas soumise aux dispositions des articles 144 et suivants du code de procédure pénale puisque l'instruction est close, peut être très longue compte tenu des lenteurs de la justice criminelle. A l'instar de ce que l'Assemblée avait adopté lors de l'examen de la proposition de M. Alain Tourret, le rapporteur suggère donc, en outre, de limiter également la durée d'audiencement de façon réaliste, compte tenu des lourdeurs de la procédure criminelle. (cf. infra articles additionnels après l'article 21). La Commission a adopté l'article 17 ainsi modifié. La Commission a examiné un amendement de M. Alain Tourret ayant pour objet d'aligner les quantums de peine applicables aux placements en détention provisoire dans le cadre d'une comparution immédiate sur ceux fixés dans le cadre d'une instruction. Le rapporteur ayant indiqué que cette disposition devait faire l'objet d'une coordination avec les dispositions retenues sur les seuils, la Commission a rejeté cet amendement. Article 18 Cet article vise à limiter la durée de la détention provisoire lorsqu'une personne mise en examen fait l'objet d'un mandat de dépôt à la suite de la révocation de son contrôle judiciaire et qu'elle avait déjà été placée en détention provisoire antérieurement. Il s'agit en fait d'infirmer une jurisprudence de la Cour de cassation qui conduit, dans cette hypothèse, à priver de tout effet les butoirs fixés par le code de procédure pénale. L'article 141-2 du code de procédure pénale dispose qu'une personne qui se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire peut, quelle que soit la peine encourue, être placée en détention provisoire. Dans le cas où la personne a déjà été incarcérée au titre de la même affaire, la chambre criminelle considère que l'inobservation volontaire des obligations du contrôle judiciaire permet de décerner mandat de dépôt « quelle que soit la durée de la peine d'emprisonnement encourue et celle de la détention provisoire antérieurement subie » (Cass. crim. 20 décembre 1983, BC n°349), arrêt confirmé par la Cour le 15 avril 1991. En fait, cette jurisprudence n'est pas satisfaisante puisqu'elle conduit à placer une nouvelle fois en détention une personne qui n'aurait pu l'être du fait de l'épuisement des délais légaux. Le 23 avril dernier, à l'initiative de M. Michel Dreyfus-Schmidt, le Sénat a adopté une proposition de loi précisant le mode de calcul de la durée maximale de détention provisoire dans le but de contourner cette jurisprudence, en prévoyant que cette durée s'apprécie compte tenu des différentes ordonnances de placement prises dans une même affaire. La solution proposée par le présent article poursuit le même objectif, selon des modalités différentes. Concrètement, il est ainsi proposé que, dans le cas où une détention est ordonnée à la suite d'une révocation du contrôle judiciaire, alors que la personne a été antérieurement détenue, la durée cumulée des détentions ne puisse excéder de quatre mois les plafond légaux. Par ailleurs, il est proposé de fixer un plafond, lorsque la personne, dont le contrôle judiciaire est révoqué, encourt une peine inférieure à deux ans d'emprisonnement, seuil en deça duquel le placement initial en détention n'est actuellement pas possible. Outre un ajustement rédactionnel, votre rapporteur estime souhaitable de limiter ce dernier plafond à quatre mois, en référence aux durées initiales « standards » retenues pour les détentions provisoires en matière correctionnelle. La Commission a adopté deux amendements en ce sens (amendements nos 107 et 108). Elle a ensuite adopté l'article 18 ainsi modifié. Section 3 Cette section propose un certain nombre de modifications des dispositions organisant une indemnisation à raison d'une détention provisoire, régime qui, en dépit d'une amélioration en 1996, n'apporte toujours pas satisfaction dans son état actuel. Rappelons que depuis 1971, la commission a reçu 2 132 requêtes. Article 19 Introduits par la loi du 17 juillet 1970, les articles 149 et suivants du code de procédure pénale ont pour objet de permettre l'indemnisation des personnes placées en détention provisoire et qui sont mises hors de cause à un moment quelconque de la procédure, en dehors de toute détention arbitraire, faute lourde ou déni de justice. Dans une certaine mesure, elles font écho à la convention de sauvegarde des droits de l'homme, qui consacre le droit à réparation au profit de la personne injustement détenue ou condamnée. Cette indemnisation est allouée par une commission qui a le caractère d'une juridiction civile et qui statue souverainement, ce qui, force est de le reconnaître, confère à la commission un caractère juridictionnel pour le moins imparfait. Celle-ci, ou chacune des formations qu'elle comporte, est composée du premier président de la Cour de cassation ou de son représentant qui la préside, et de deux magistrats du siège à la Cour de cassation ayant le grade de président de chambre, de conseiller ou de conseiller référendaire. Ces deux magistrats, qui peuvent être membre de chambre civiles ou de la chambre criminelle, sont désignés annuellement par le bureau de la Cour qui désigne trois suppléants. Article 149 du code de procédure pénale Jusqu'en 1996, pouvaient prétendre à indemnisation les personnes ayant fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure qui s'était terminée à son bénéfice par une relaxe, un acquittement ou un non lieu lorsque cette décision leur avait causé un préjudice anormal et d'une particulière gravité. Devant le caractère aléatoire de ces critères, la loi du 30 décembre 1996 a supprimé cette double exigence, l'existence d'un préjudice étant suffisant pour justifier une indemnisation. Cette modification législative a indéniablement produit un effet positif, puisque le nombre des indemnités allouées en 1997 a atteint 65 pour un montant de plus de 4 millions de francs contre 28 pour 1,2 million de francs l'année précédente. En fait, même ainsi corrigée, cette procédure reste peu efficace, en particulier parce que la commission d'indemnisation ne tient pas compte du préjudice moral. La proposition de loi adoptée à l'initiative de notre collègue Alain Tourret avait d'ailleurs proposé de combler cette lacune, l'accent étant également mis sur la nécessité d'informer toutes les personnes concernées de la possibilité de demander une indemnisation. Le présent article s'inspire de ces dispositions : - il complète le texte de l'article 149 de sorte que soit expressément visé le préjudice moral et matériel ; - il ajoute à cet article un alinéa prévoyant l'information de l'intéressé. Le rapporteur estime que ces ajustements sont utiles mais qu'ils restent insuffisants dès lors qu'il est difficile d'imaginer qu'une détention provisoire injustifiée puisse ne pas causer un préjudice à la personne intéressée. La Commission a examiné un amendement du rapporteur améliorant les conditions d'indemnisation afin de réparer le préjudice moral et matériel subi par les personnes ayant fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée par une décision de non-lieu, de relaxe et d'acquittement, tout en excluant la réparation lorsque cette décision résulte de la reconnaissance de leur irresponsabilité pénale, de la prescription ou de l'amnistie ou lorsque les personnes se sont laissées accuser à tort. Mme Frédérique Bredin s'est félicitée de l'indemnisation systématique proposée par l'amendement, mais s'est déclarée plus réservée sur les exceptions prévues, notamment sur l'auto-accusation. M. Jean Codognès s'est également interrogé sur la pertinence des exceptions, faisant valoir que la prescription pouvait s'appliquer à une personne non encore jugée et donc peut-être totalement innocente. Reprenant les propos de M. Jean Codognès, M. Alain Tourret a estimé qu'il serait préférable de laisser les magistrats décider du bien-fondé d'une indemnisation. M. Patrick Devedjian et M. Philippe Houillon se sont également déclarés hostiles aux exceptions. La Commission a néanmoins adopté l'amendement (amendement n° 109). La Commission a ensuite été saisie d'un amendement de MM. Philippe Houillon et Claude Goasguen prévoyant que la décision de la commission d'indemnisation allouant une indemnité est communiquée aux magistrats du siège ayant concouru à la mise en détention provisoire ou à son maintien, au président de la juridiction concernée ainsi qu'au représentant du parquet. M. Patrick Devedjian a indiqué qu'il avait déposé un amendement n° 33 dont l'objet était plus large, puisqu'il visait aussi la communication des décisions de relaxe et d'acquittement, faisant valoir que les juges d'instruction ignoraient trop souvent les décisions rendues par les juridictions de jugement. M. Jean-Pierre Michel a estimé que les dispositions proposées par M. Patrick Devedjian, aussi justifiées soient-elles, n'étaient pas de nature législative mais relevaient davantage de la circulaire. Tout en approuvant l'esprit de cet amendement, le rapporteur a estimé qu'il n'était pas nécessaire de diffuser cette décision auprès du parquet et a indiqué que l'amendement de M. Alain Tourret ayant un objet similaire, mais limitant la communication de la décision aux magistrats ayant concouru à la mise en détention provisoire ou à son maintien, lui paraissait préférable. La Commission a alors rejeté l'amendement de MM. Philippe Houillon et Claude Goasguen, ainsi que l'amendement n° 33 de M. Patrick Devedjian et adopté, en revanche, l'amendement de M. Alain Tourret (amendement n° 110). Article 149-2 du code de procédure pénale L'article 149-2 prévoit que la commission est saisie dans les six mois qui suivent la notification de la décision de non lieu, de relaxe ou d'acquittement. devant la commission, les débats ont lieu et la décision est rendue en chambre de conseil. La commission statue souverainement par une décision non motivée qui n'est pas susceptible de recours quel qu'il soit. Deux aménagements sont proposés. D'une part, les débats auraient désormais lieu en audience publique, sauf opposition du requérant ; cette option est judicieuse et permet d'organiser la transparence sur les travaux de la commission. D'autre part, la décision de la commission serait désormais motivée, ce qui est la moindre des choses puisque désormais les critères retenus par la Cour seront connus de tous et que le risque d'arbitraire sera amoindri. Notons par ailleurs que cette motivation de la décision de la Cour renforce le caractère juridictionnel de sa fonction. On pourra regretter, en revanche, que cette décision reste non susceptible d'appel mais la nature de la commission compétente, constituée au sein de la cour de cassation, rend peu envisageable l'organisation d'une voie de recours. Cette caractéristique de la procédure d'indemnisation n'est, de surcroît, pas incompatible avec nos engagements européens puisque le protocole n° 7 de la convention de sauvegarde n'exige une voie de recours que dans le cas de condamnation pénale. La Commission a rejeté un amendement de M. André Gerin instaurant un recours contre les décisions de la commission d'indemnisation des détentions provisoires. Elle a ensuite adopté l'article 19 ainsi modifié. Article additionnel après l'article 19 La Commission a adopté un amendement du rapporteur prévoyant une enquête sur la situation matérielle, familiale ou sociale des personnes placées en détention provisoire dans un délai de deux mois à compter de leur entrée dans la maison d'arrêt (amendement n° 111). Son auteur a fait valoir que cette enquête permettrait d'avoir tous les éléments nécessaires pour apprécier la nécessité d'une prolongation de la détention provisoire. Article additionnel après l'article 19 La Commission a ensuite été saisie de deux amendements, présentés respectivement par M. Alain Tourret et Mme Frédérique Bredin, tendant à instituer une commission de suivi de la détention provisoire ayant pour mission principale de réunir des données juridiques, statistiques et pénitentiaires concernant la détention provisoire. M. Alain Tourret a indiqué qu'il était actuellement extrêmement difficile d'obtenir des statistiques de la Chancellerie sur cette question. Après que M. Jean-Pierre Michel et le rapporteur eurent souligné que l'amendement de Mme Frédérique Bredin leur paraissait préférable, dans la mesure où il prévoyait la présence au sein de la commission de deux représentants du Parlement, et non d'un seul comme l'amendement de M. Alain Tourret, la Commission l'a adopté (amendement n° 112). L'amendement de M. Alain Tourret a été retiré. CHAPITRE III Ce chapitre regroupe deux articles visant à mieux encadrer les délais de la procédure pénale, qu'il s'agisse de l'enquête de police ou de l'instruction. Il s'agit de mettre en _uvre concrètement, une nouvelle fois, la notion de délai raisonnable consacrée par la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, érigée désormais en principe général de la procédure pénale par le présent projet de loi. Article additionnel avant l'article 20 La Commission a adopté un amendement du rapporteur qui prévoit que, lorsque l'enquête est menée sur instruction du procureur de la République, celui-ci fixe le délai à l'issue duquel elle devra être achevée et, lorsqu'elle est déclenchée d'office, les officiers de police judiciaire doivent prendre en compte son état d'avancement tous les quatre mois à compter de la date à laquelle les faits ont été portés à la connaissance de la police (amendement n° 113). Son auteur a indiqué que cet encadrement de la durée de l'enquête préliminaire, permettrait au ministère public, le cas échéant, d'en accélérer le déroulement. Article 20 Il est proposé d'insérer deux dispositions nouvelles dans le chapitre II du titre II du livre premier du code de procédure pénale, relatif aux enquêtes préliminaires. Rappelons que l'enquête préliminaire, définie par les articles 75 à 78 du code de procédure pénale, est le mode d'action de droit commun de la police judiciaire lorsque celle-ci agit avant l'ouverture d'une information. Elle se distingue de l'enquête de flagrance qui peut intervenir lorsque l'infraction punit d'emprisonnement se commet ou vient de se commettre ou lorsque l'infraction est réputée flagrante ; elle se différencie également, bien entendu, des investigations réalisées en vertu d'une commission rogatoire. L'enquête préliminaire est diligentée par le parquet ou menée d'office ; elle est conduite par des officiers ou par des agents de police judiciaire. Contrairement à l'enquête de flagrance, conduite par les seuls officiers de police judiciaire, elle n'a pas de nature c_rcitive : les actes qui sont effectués dans ce cadre nécessitant l'accord de la personne concernée, même si la législation tend à conférer des prérogatives de plus en plus étendues aux enquêteurs, à l'instar des auditions qui peuvent être forcées depuis la loi du 4 janvier 1993. Actuellement, il n'existe aucune disposition encadrant le déroulement temporel de ce type d'enquête, considéré parfois comme étant les plus attentatoires aux libertés. Il est vrai que le code de procédure pénale est également muet sur les délais des enquêtes dites de flagrance, mais le problème se pose ici d'une autre manière puisque, par définition, celles-ci sont forcément proches des faits commis. D'ailleurs, le projet relatif aux alternatives aux poursuites adopté par le Sénat (n° 998) consacre cet état de fait et propose expressément de limiter la durée de ces enquêtes à huit jours. Le Gouvernement suggère donc de préciser le régime des enquêtes préliminaires en organisant un enchaînement de délais, dès qu'une mesure de garde à vue survient (art. 77-2 ci-après). Cependant, notons que le projet de loi relatif à l'action publique en matière pénale et modifiant le code de procédure pénale (n° 957), prochainement examiné par notre Assemblée, contient des mesures qui vont dans le même sens. Ainsi, l'article 8 de ce projet insère deux nouvelles dispositions selon lesquelles, d'une part, le procureur de la République qui ordonne une enquête préliminaire doit en fixer le délai (art. 75-2 nouveau) et d'autre part, les enquêteurs devront rendre compte des enquêtes d'initiative au bout d'un an. Ces dispositions sont intéressantes, mais, compte tenu de leur connexité avec celles qui sont proposées au présent article, votre rapporteur a suggéré précédemment de les reprendre, selon une rédaction plus rigoureuse dans le cadre du présent projet de loi (cf. supra avant l'article 20). Article 77-2 (nouveau) du code de procédure pénale En dépit d'un mécanisme un peu lourd, le principe posé par l'article 77-2 nouveau est, en fait, assez simple : une personne qui a fait l'objet d'une garde à vue et à l'égard de laquelle aucune décision n'a été prise dans les huit mois pourra demander au procureur de la République de faire le point. Si celui-ci estime que l'enquête doit se poursuivre, il devra saisir le président du tribunal de grande instance qui prendra alors la décision. A ce stade, deux remarques s'imposent : il s'agit davantage d'une sorte de droit « d'évocation » accordée à une personne mise en cause que d'une limitation stricte des délais d'enquête ; la mesure constitue néanmoins une innovation qui conduit un juge du siège à exercer un certain contrôle sur les enquêtes policières. Le premier alinéa détermine le champ d'application de la mesure et son principe. Pour en bénéficier, la personne doit avoir été placée en garde à vue, dans le cadre d'une enquête de flagrance ou d'une enquête préliminaire en raison d'indices faisant présumer qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Cette formulation, qui reprend celles des articles 63 (garde à vue en cas de flagrance) et 77 (garde à vue dans le cas d'une enquête préliminaire) conduit à exclure les personnes gardées à vue comme témoin, ce qui est logique dans la mesure où celles-ci n'ont théoriquement pas vocation à faire l'objet de procédures. Ajoutons, de surcroît, que la garde à vue en cas d'enquête préliminaire n'est précisément possible que dans ce cas de figure. La Commission a adopté un amendement de coordination présenté par Mme Frédérique Bredin avec l'amendement limitant la garde à vue aux seuls suspects (amendement n° 114). Lorsque cette personne n'a pas fait l'objet de poursuites dans les huit mois, elle peut alors interroger le procureur de la République, du ressort dans lequel la garde à vue a eu lieu, sur les suites de la procédure. Ce mécanisme appelle deux observations. Tout d'abord, dans la mesure où n'est visé que l'engagement de poursuites, une personne ayant fait l'objet d'une médiation au sens de l'article 41, alinéa 6, pourrait donc se prévaloir de ces dispositions, ce qui semble pour le moins inopportun. Ensuite, on peut admettre que le délai de huit mois est trop long s'agissant d'une enquête préliminaire qui n'a donné lieu à aucune poursuite à l'égard d'un suspect. La Commission a adopté deux amendements du rapporteur, l'un d'ordre rédactionnel et l'autre réduisant de huit à six mois le délai au-delà duquel une personne ayant fait l'objet d'une garde à vue qui n'a été suivie d'aucune procédure peut saisir le procureur de la République (amendements nos 115 et 116). Le deuxième alinéa décrit le rôle du procureur de la République. Celui-ci, dans le mois qui suit la réception de la demande, dispose de trois possibilités : - il peut engager des poursuites contre l'intéressé ; - il peut lui notifier un classement sans suite ; notons qu'il serait également judicieux de prévoir que le procureur peut proposer une mesure alternative aux poursuites, théoriquement prononcée avant le déclenchement de l'action publique et ressortissant à l'enquête, mais pour laquelle il ne semble pas nécessaire de solliciter le juge du siège ; la Commission a adopté deux amendements en ce sens du rapporteur (amendements nos 117 et 118) ; - il peut estimer que l'enquête doit se poursuivre ; dans ce cas, il doit saisir, vraisemblablement par requête, le Président du tribunal de grande instance ; à défaut, les actes de procédures engagés à l'issue du délai d'un mois précité seront frappés de nullité. La saisine du Président du T.G.I. constitue une originalité incontestable de cette procédure dès lors qu'il n'est pas dans notre tradition juridique de faire contrôler les enquêtes de police par un magistrat du siège. Cette innovation doit cependant tenir compte du fait que ce « contrôle » devrait être, en pratique, exceptionnel. Par ailleurs, il faut rappeler que notre procédure pénale n'ignore pas totalement ce cas de figure, notamment pour l'autorisation des gardes à vue ou des perquisitions dans le cadre d'infractions de terrorisme, en application de l'article 706-23 et 24 du code de procédure pénale. La Commission a été saisie d'un amendement de M. Alain Tourret supprimant les dispositions qui prévoient la saisine du tribunal de grande instance par le procureur de la République. Son auteur a souligné la complexité du dispositif proposé par le projet de loi, jugeant préférable de prévoir une simple réponse par le procureur de la République. Après que le rapporteur eut fait valoir que le projet de loi permettait d'assurer un contrôle de l'enquête par le président du tribunal de grande instance, la Commission a rejeté l'amendement. Les troisième et quatrième alinéas organisent la procédure devant le président du TGI. Une fois saisi, celui-ci organise un débat contradictoire associant le procureur de la République et l'intéressé, assisté, le cas échéant, de son avocat. Aucun délai ne s'impose au magistrat du siège, mais on doit considérer que celui-ci fera diligence en tant que garant de la procédure. Si la personne le demande, le président peut décider, sans appel possible, que le débat se déroule en audience publique, sauf si la publicité risque de nuire à l'enquête, à l'ordre public, à la dignité des personnes ou à l'intérêt d'un tiers. La Commission a adopté un amendement de Mme Frédérique Bredin supprimant la référence au bon déroulement de l'enquête des exceptions susceptibles de justifier le refus de publicité du débat contradictoire devant le président du tribunal de grande instance et prévoyant une motivation de la décision de ce dernier sur la demande de publicité (amendement n° 119). Puis, elle a rejeté un amendement de coordination de M. Alain Tourret. A l'issue de ce débat, deux possibilités s'offrent au juge du siège : - il peut faire droit à la demande du procureur de la République en accordant un nouveau délai de six mois ; si rien ne se passe pendant cette prolongation, l'intéressé peut alors faire jouer de nouveau les dispositions de cet article ; - il peut refuser la poursuite de l'enquête, auquel cas le procureur de la République doit, soit engager des poursuites, soit procéder au classement sans suite. Ici également, il conviendrait d'autoriser le procureur de la République à recourir à une mesure alternative aux poursuites. Dans tous les cas, la décision rendue par le président est insusceptible d'appel. Article 77-3 (nouveau) du code de procédure pénale Cet article n'appelle que peu d'observations. Il prévoit, en effet, que lorsque le procureur de la République qui reçoit la demande n'est pas celui qui a conduit l'enquête, la demande est transmise sans délai par le premier au second, les délais courant à partir de la réception de la demande par ce dernier. La Commission a adopté l'article 20 ainsi modifié. Article 21 Le présent article modifie plusieurs dispositions du code pénal afin d'encadrer les délais de l'information. On rappellera que celle-ci est de 16,9 mois en moyenne pour les crimes et de 16,2 mois pour les délits, de grandes disparités s'observant cependant selon les juridictions, comme l'illustre le tableau retraçant les délais moyens d'instruction par le TGI, publié en annexe. Il est bien évidemment difficile de déterminer objectivement à quel moment la durée d'une instruction excède le « délai raisonnable » érigé en principe par l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme. En effet, celui-ci varie au gré de la diversité des affaires, cette observation de bon sens ayant récemment été rappelée par la Cour de Strasbourg dans un arrêt du 23 septembre 1998 « I.A c/France » précité. Cependant, on pourra, à tout le moins, s'interroger sur la durée moyenne des procédures dans certains tribunaux, surtout si on le rapporte au nombre d'affaires traitées. (cf. tableau reproduit en annexe). Dans sa rédaction actuelle, le code de procédure pénale est pour le moment, assez peu directif en cette matière. Néanmoins, trois mesures ayant pour finalité d'assurer un certain contrôle de la durée des informations peuvent être mentionnées. D'une part, l'article 175-1 permet à toute personne mise en examen ou à toute partie civile de demander, au bout d'un an, la clôture de l'information, soit par renvoi devant la juridiction de jugement, soit par non lieu. Le juge d'instruction peut, soit faire droit à cette demande, soit déclarer qu'il y a lieu à poursuivre. Si le juge d'instruction ne répond pas, la partie peut alors saisir la chambre d'accusation. Par ailleurs, l'article 221-1 confère un pouvoir propre au président de la chambre d'accusation : si un délai de quatre mois s'est écoulé depuis la date du dernier acte d'instruction, il peut saisir la chambre d'accusation qui peut, soit renvoyer le dossier au juge d'instruction, soit se substituer à lui. Enfin, l'article 221-2 dispose que, dans les mêmes circonstances, le délai de carence étant ramené à deux mois en cas de détention, une partie peut saisir la chambre d'accusation pour lui demander, soit de renvoyer l'affaire au juge d'instruction, soit se substituer à lui. Même si elles permettent exceptionnellement de dessaisir un juge d'instruction dans le cas de négligence patente (Chambre d'accusation Versailles, 11 mars 1985, D.1990, p.22), ces procédures restent en fait peu contraignantes. Dans le meilleur des cas, elles constituent une « incitation pédagogique » à relancer le traitement d'un dossier, mais elles ne permettent pas de mettre effectivement en pratique le principe de célérité. D'une manière générale, les mesures proposées par le présent article reposent sur l'idée d'une sorte de « contrat de procédure » : le juge d'instruction doit informer les parties des délais probables d'achèvement de la procédure qui peuvent être inférieurs à un an ; les parties sont alors susceptibles de demander la clôture de l'information lorsque les délais annoncés ne sont pas tenus, le cas échéant auprès de la chambre d'accusation si le juge d'instruction ne fait pas droit à sa demande. L'idée de ce mécanisme, qui repose sur la responsabilité du magistrat instructeur et le dialogue entre celui-ci et la chambre d'accusation, est intéressante mais sa mise en _uvre apparaît complexe et, en définitive, assez peu réaliste compte tenu des contraintes de l'instruction. En particulier, on ne voit pas bien quel pourrait être l'intérêt du juge à annoncer prématurément des délais d'instruction inférieurs à un an, sachant qu'il risque d'être confronté à une demande de clôture prématurée quand bien même l'affaire se révélerait plus complexe que prévue. Telle est la raison pour laquelle votre rapporteur suggère une solution alternative, en vertu de laquelle, au delà d'un certain délai, à la demande des parties, le suivi de l'information serait systématiquement encadré par la chambre d`accusation, qui serait alors habilitée à accorder, le cas échéant, des délais complémentaires pour mener à bien l'information. Article 89-1 du code de procédure pénale Innovation du projet de loi, cet article complète l'article 89-1 du code de procédure pénale relatif à la première audition de la partie civile d'un nouvel alinéa posant le principe de l'information de celle-ci sur la durée de la procédure. Concrètement deux cas de figure sont possibles : - si le juge estime que l'information peut être close en moins d'un an, il en informe la partie civile et l'avise qu'elle pourra demander la clôture de l'instruction ; - dans le cas contraire, il informe la partie civile qu'elle pourra demander la clôture au bout d'une année, à l'instar de ce que prévoit actuellement le code de procédure pénale. Ces dispositions n'appellent pas d'observations particulières. On se contentera de s'interroger sur l'intérêt, pour le juge d'instruction, de s'enfermer par avance dans des délais préfixés : dans bien des cas, le juge aura du mal à estimer, à quelques semaines près, le temps nécessaire pour mener à bien ses investigations. Article 116 du code de procédure pénale Cet article appelle peu de commentaire : il décalque les dispositions précédentes au profit de la personne mise en examen, son information étant alors effectuée lors de la première comparution. Article 175-1 du code de procédure pénale Il est proposé une nouvelle rédaction de l'article 175-1 afin d'apporter plusieurs modifications à la procédure actuelle. On rappellera qu'actuellement, une personne mise en examen ou la partie civile peut demander au juge d'instruction, un an après la mise en examen ou le dépôt de plainte, de clôturer l'information en ordonnant un renvoi ou un non lieu. Le juge, dans un délai d'un mois, accède à la demande ou déclare qu'il poursuit l'instruction. Si le juge ne s'est pas prononcé dans le délai d'un mois, le demandeur peut saisir directement la chambre d'accusation, qui de prononce dans les vingt jours de la saisine. Les quatre alinéas de l'article 175-1 modifié proposent les aménagements suivants. Tout d'abord, la personne mise en examen ou la partie civile pourraient désormais demander la clôture de l'instruction soit à l'issue du délai préfixé par le juge d'instruction lors de la première comparution ou de la première audition, soit au bout d'un an si le juge d'instruction n'a fixé aucun délai, soit, enfin, lorsqu'aucun acte de procédure n'a été accompli pendant un délai de quatre mois, formule qui s'inspire de celle actuellement prévue aux articles 221-1 et 221-2 précité. Ensuite, il est précisé que la demande doit être formulée selon les modalités fixées par le dixième alinéa de l'article 81, c'est-à-dire par une déclaration au greffier du juge d'instruction. La demande doit tendre au renvoi à la juridiction de jugement, au non lieu ou à la transmission de la procédure au procureur général, cette dernière mention visant l'hypothèse de la saisine de la chambre d'accusation en cas de crime. A l'instar du droit en vigueur, le juge d'instruction a un mois pour se prononcer, délai pendant lequel il peut faire droit à la demande, ou estimer qu'il y a lieu de poursuivre l'information. Partant, le demandeur peut saisir le président de la chambre d'accusation (cf. infra art. 207-1) - et non plus la chambre elle-même - non seulement lorsque le juge d'instruction ne s'est pas prononcé dans les délais qui lui sont impartis, mais aussi lorsqu'il n'a pas fait droit à la demande. Cette dernière mention conduit à reprendre à cet article la modification de l'article 186-1 proposée ultérieurement et qui tend à permettre, par ailleurs, l'appel des parties lorsque le juge décide de poursuivre l'information. S'agissant d'une ordonnance, il pourrait sembler plus orthodoxe de s'en tenir, en l'espèce, à l'appel de droit commun. En sens inverse, le dispositif gagnerait sans doute en cohérence et en lisibilité si le demandeur pouvait, au cas particulier, saisir directement la chambre d'accusation, solution vers laquelle semble, au demeurant, s'orienter l'exposé des motifs du projet de loi. Dans ces conditions, il pourrait être envisagé de faire l'économie de la procédure d'appel organisée plus loin. Quant à la saisine du président de la chambre d'accusation, on peut penser, dans le silence du texte, qu'elle s'effectue selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 173, c'est-à-dire par requête motivée dont une copie est remise au juge d'instruction qui transmet le dossier au président de la chambre d'accusation. Dans le cas où le juge souhaite poursuivre l'information, et qu'elle n'a pas opté pour la saisine de la chambre d'accusation, la partie peut formuler de nouveau sa demande auprès du juge d'instruction à l'expiration d'un nouveau délai de six mois. Précision nouvelle mais qui semble de bon sens, le quatrième alinéa de l'article 175-1 nouveau dispose, enfin, que les parties ne peuvent plus formuler leur demande quand le juge d'instruction leur a transmis l'avis par lequel celui-ci les prévient que l'information lui parait terminée. Article 186-1 du code de procédure pénale Cet article propose de corriger l'article 186-1 du code de procédure pénale relatif au droit d'appel des parties contre des décisions du juge d'instruction refusant de faire procéder à une mesure d'investigation qu'elles ont sollicité. Rappelons que le demandeur ne peut actuellement saisir la chambre d'accusation que dans le cas où le juge d'instruction ne répond pas à sa demande dans le délai d'un mois. En revanche, lorsque celui-ci décide de poursuivre l'information, le demandeur ne dispose d'aucune voie de recours. Il est proposé de combler cette lacune en mentionnant expressément l'ordonnance du juge d'instruction par laquelle celui-ci déclare poursuivre l'information parmi celles à l'encontre desquelles appel peut être formé par une partie. Comme on l'a vu, cet aménagement est, sur le fond, logique, mais il conduit à organiser deux voies de recours parallèles, à savoir l'appel de droit commun et la saisine directe de la chambre d'accusation. Compte tenu des observations formulées plus haut, le rapporteur estime préférable, dans le cas où ce dispositif serait maintenu, de supprimer la voie de l'appel pour donner toute sa portée à la nouvelle procédure Anticipant sur les dispositions relatives à la communication, il est également prévu que l'appel puisse être formé à l'encontre de celle relative à la publicité d'un non lieu à la demande de la personne concernée. Cette extension n'appelle pas d'observations particulières. Article 207-1 du code de procédure pénale Bien que ces dispositions soient intimement liées à celles qui précèdent, le projet de loi insère les mesures décrivant le rôle de la chambre d'accusation dans le cadre de la nouvelle procédure parmi celles qui la concernent dans le code de procédure pénale. Le nouvel article 207-1 organise donc les modalités selon lesquelles le président de la chambre d'accusation, ou cette dernière, peuvent, à la demande d'une partie, encadrer la durée de l'information. En application du deuxième alinéa de l'article 175-1 modifié, si le juge d'instruction n'a pas répondu à la demande dans le délai d'un mois ou s'il a décidé de poursuivre l'instruction, le demandeur peut saisir, dans les cinq jours de la notification de la décision, le président de la chambre d'accusation. Celui-ci joue le rôle de « filtre », puisqu'il lui appartient de décider, dans les huit jours de la transmission du dossier, de saisir ou non la chambre d'accusation, par une ordonnance non susceptible d'appel. Notons que cette mission de filtrage des saisines ne constitue pas une nouveauté, le président en étant déjà chargé en matière d'appel des ordonnances refusant une demande de mesures d'investigation (article 186-1) ou pour les saisines de la chambre d'accusation lorsque aucun acte de procédure n'a été accompli dans un délai de quatre mois (articles 221-1 et 221-2). Comme dans ces situations, le président de la chambre rend une ordonnance qui n'est pas susceptible de recours. Si le président accepte la saisine de la chambre, il transmet le dossier au procureur général, selon la procédure de droit commun devant la chambre d'accusation ; c'est en effet à ce dernier qu'il appartient de mettre en état l'affaire et d'y joindre son réquisitoire. Une fois saisie, la chambre, devant laquelle la procédure se déroule en chambre du conseil mais où les parties peuvent présenter des « observations sommaires » (article 199, deuxième alinéa), peut : - prononcer le renvoi devant la juridiction de jugement, soit, en matière criminelle, mettre directement en accusation devant la cour d'assise ; - déclarer qu'il n'y a pas lieu à suivre ; - évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles 201, 202 et 204, cette formulation traditionnelle permettant à la chambre d'accomplir les actes d'information qu'elle estimerait utiles ; - renvoyer le dossier d'instruction aux fins de poursuite l'information, au juge d'instruction initialement compétent ou à un autre. Dans ces deux dernières hypothèses, la partie demanderesse se retrouve au point de départ. Le texte ne contient aucune mention expresse, mais il semble logique d'admettre que le mis en examen ou la partie civile pourra alors faire jouer de nouveau les dispositions de l'article 175-1 au bout d'un an. Dans le cas où le président décide de ne pas saisir la chambre d'accusation, il ne peut que renvoyer le dossier au juge d'instruction aux fins de poursuite de l'information. Dans l'esprit des rédacteurs du projet, le président dispose d'une grande marge d'appréciation. Il pourra, en effet, prendre une telle décision parce que le juge d'instruction semble en état de clôturer l'information dans des délais rapide, mais aussi parce qu'il estime que les circonstances de l'affaire ou la nature des actes d'instruction à accomplir justifient des délais d'information importants. A l'instar de ce qui a été dit plus haut, dans cette hypothèse, les parties pourront invoquer de nouveau les dispositions de l'article 175-1 à l'issue des délais ouverts par ce même article. Comme on le constate, cette procédure en définitive assez lourde à mettre en _uvre permet de renforcer le suivi de l'information par la chambre d'accusation, mais ne conduit pas nécessairement à son accélération. En particulier, le renvoi au juge d'instruction, voire l'évocation de l'affaire par la chambre d'accusation elle-même, ne sont assortis d'aucun délai de nature à conforter la lisibilité des parties sur le déroulement de la procédure dont elles sont l'objet. C'est pourquoi, à défaut d'être remplacé par un mécanisme plus contraignant, ce dispositif gagnerait en efficacité si, à tout le moins, la poursuite de l'information était accordée moyennant le respect de certains délais fixés par la chambre elle-même ou son président et à l'issue desquels, si l'information n'est toujours pas close, ces autorités seraient systématiquement saisies de nouveau de l'affaire. * * * La Commission a tout d'abord rejeté un amendement de M. Alain Tourret prévoyant la saisine de la chambre d'accusation deux ans après la date d'ouverture de l'instruction, celle-ci pouvant, par une décision spécialement motivée, autoriser la poursuite de l'information pour un nouveau délai qui ne pourra excéder un an. Un amendement de MM. Philippe Houillon et Claude Goasguen, ayant un objet similaire, sans toutefois prévoir de délais-butoir, a été retiré. La Commission a ensuite adopté un amendement du rapporteur proposant une nouvelle rédaction de l'article, afin de prévoir, à l'issue d'un délai d'un an en cas de délit ou de dix-huit mois en cas de crime, la possibilité pour les parties, lorsque l'information n'est pas close, de saisir le juge d'instruction qui devra alors transmettre le dossier au président de la chambre d'accusation (amendement n° 120). Son auteur a indiqué que ce dernier pourrait alors, soit accorder un délai supplémentaire de six mois, soit saisir la chambre d'accusation qui pourra, à son tour, soit clôturer l'affaire, soit accorder un nouveau délai d'un an en matière délictuelle ou de dix-huit mois en matière criminelle. Elle a fait valoir que cette proposition, sans fixer des délais-butoir d'instruction qui pourraient conduire à des situations absurdes, permettrait à la chambre d'accusation d'assurer un suivi plus rigoureux des instructions anormalement longues. Les amendements de M. Alain Tourret supprimant les dispositions sur les délai prévisionnels donnés par le juge d'instruction sont devenus sans objet, ainsi que les amendements de Mme Frédérique Bredin, l'un de précision, l'autre prévoyant que le juge d'instruction statue par ordonnance spécialement motivée sur la poursuite de l'information. La Commission a ensuite rejeté un amendement présenté par Mme Frédérique Bredin prévoyant que la décision de prolongation de l'instruction par le président de la chambre d'accusation doit être spécialement motivée. La Commission a adopté l'article 21 ainsi rédigé. Article additionnel après l'article 21 La Commission a adopté un amendement de Mme Frédérique Bredin associant les victimes au déroulement de l'information en obligeant le juge d'instruction à les informer, tous les six mois, de l'état d'avancement de la procédure (amendement n° 121). Article additionnel après l'article 21 La Commission a adopté un amendement de MM. Philippe Houillon et Claude Goasguen associant les officiers de police judiciaire chargés de l'exécution d'une commission rogatoire et les experts à l'évaluation de la durée de leur mission (amendement n° 122). L'amendement de Mme Frédérique Bredin ayant un objet similaire a été considéré comme satisfait. Article additionnel après l'article 21 La Commission a adopté un amendement du rapporteur instituant un délai d'audiencement maximal de six mois pour les délits (amendement n° 123). Article additionnel après l'article 21 La Commission a adopté un amendement du rapporteur prévoyant un délai maximal d'audiencement de deux ans en matière criminelle (amendement n° 124). En conséquence, les amendements de MM. Alain Tourret et Philippe Houillon, visant à réduire la durée de la détention provisoire après le passage devant la chambre d'accusation, sont devenus sans objet. Article additionnel après l'article 21 Le rapporteur a présenté un amendement instituant une commission paritaire composée de magistrats du siège et du parquet en vue de définir l'organisation de l'audiencement dans les tribunaux de grande instance et de répondre aux dysfonctionnements constatés dans ces juridictions. M. Philippe Houillon a approuvé l'esprit de cette disposition nouvelle, tout en soulignant qu'elle ne résoudrait pas les problèmes d'organisation des juridictions qui s'expliquent par la capacité du parquet à choisir, en pratique, le juge saisi de l'affaire. La Commission a adopté l'amendement du rapporteur (amendement n° 125). La Commission a été saisie d'un amendement de M. Alain Tourret, tendant à préciser la durée des délais de prescription des délits. Son auteur a considéré qu'il convenait d'instituer un délai de prescription d'un an, courant à compter de tout acte d'instruction devant lui-même intervenir dans le délai de trois ans à compter de la date des faits, afin d'éviter la prolongation indue des procédures judiciaires. Il a, par ailleurs, estimé qu'il était nécessaire de mettre un terme aux hésitations de la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation en matière de prescription des délits d'abus de biens sociaux. Indiquant qu'il avait recueilli l'avis de magistrats et de commissaires de police spécialisés dans la lutte contre la corruption, il a jugé qu'une limitation du délai maximal de prescription à six ans, à compter du jour où les faits ont été commis, était satisfaisante, faisant observer qu'il était anormal que le délai de prescription applicable à un délit soit équivalent à celui applicable aux crimes contre l'humanité et ajoutant que ce délai de six ans n'aurait pas fait obstacle aux enquêtes en cours sur les affaires de corruption. Le rapporteur et Mme Frédérique Bredin ont, pour leur part, indiqué que cette disposition ne trouvait pas sa place dans un projet de loi consacré à la présomption d'innocence et aux droits des victimes et qu'il était, par ailleurs, trop complexe pour être réglé de la sorte. En conséquence, la Commission a rejeté cet amendement. CHAPITRE IV Article 22 L'article 803, inséré dans le code de procédure pénale par la loi du 4 janvier 1993, précise que le port de menottes est doit être réservé aux personnes considérées comme dangereuses pour autrui ou pour elles-mêmes ou susceptible de tenter de prendre la fuite. Par ailleurs, la circulaire du 1er mars 1993 indique que toutes les mesures utiles doivent être prises pour empêcher qu'une personne escortée ou entravée ne fasse l'objet de photographies ou d'un enregistrement cinématographique ou audiovisuel. Ces dispositions n'ont malheureusement pas suffit à éviter les abus, le cas le plus récent étant celui du guide mis en examen après l'avalanche des Orres, dont la photo, menottes aux poignets et encadré par deux gendarmes, a été publiée dans de nombreux journaux. De telles photos portent atteinte à la réputation de la personne mise en cause et bafouent la présomption d'innocence. C'est pourquoi l'article 22 du projet de loi, suivant en cela les propositions formulées par la commission présidée par M. Pierre Truche, propose d'interdire la publication de photos de personnes portant des menottes. Il insère dans le code pénal, dans un chapitre consacré aux atteintes à la personnalité, une nouvelle section intitulée « De l'atteinte à la réputation d'une personne mise en cause dans une procédure judiciaire », composée d'un article 226-30-1 dont le premier alinéa punit de 100 000 F d'amende le fait de diffuser l'image d'une personne mise en cause dans une procédure pénale et non encore condamnée faisant apparaître que cette personne porte des menottes. Dans la mesure où l'objectif est de préserver la présomption d'innocence, il est logique que cette disposition ne s'applique qu'aux photos de personnes n'ayant pas encore fait l'objet d'un jugement de condamnation. Il convient par ailleurs de souligner que le paragraphe VII de l'article 25 du projet de loi complète l'article 803 du code de procédure pénale afin d'y intégrer les dispositions de la circulaire de 1993 sur les mesures utiles que doivent prendre les forces de police et de gendarmerie pour éviter les photos des personnes portant des menottes. Dans le même esprit, le deuxième alinéa du nouvel article 226-30-1 interdit, sous peine d'une amende de 100 000 F, la réalisation ou la diffusion de sondages d'opinion portant sur la culpabilité d'une personne mise en cause dans une procédure pénale ou sur la peine susceptible d'être prononcée. Ces sondages, apparus récemment à l'occasion de grands faits divers, sont en effet de nature à porter atteinte à la présomption d'innocence. On observera qu'une telle interdiction avait été proposée tant par la commission Justice pénale et Droits de l'homme que par la commission de réflexion sur la Justice. Enfin, le dernier alinéa de l'article 226-30-1 précise que, lorsque ces délits sont commis par voie de presse, les règles particulières de prescription et de détermination des personnes responsables s'appliquent. La Commission a adopté un amendement de Mme Nicole Catala modifiant l'intitulé du titre de la section VII du code pénal pour y introduire une référence à la notion de dignité (amendement n° 127 rectifié). Puis elle a adopté un amendement du rapporteur corrigeant une erreur matérielle (amendement n° 126). Elle a ensuite été saisie d'un amendement de Mme Nicole Catala, instituant une peine d'amende de 100 000 F à l'encontre des personnes diffusant l'image d'individus mis en cause à l'occasion d'une procédure pénale et n'ayant pas encore fait l'objet d'un jugement de condamnation. M. Philippe Houillon a souligné que cet amendement aurait pour effet de renforcer le secret de l'instruction, puisqu'il allait au-delà de l'interdiction de la diffusion d'images de personnes menottées ou entravées. Il a regretté que le projet de loi n'aborde pas davantage le problème du respect du secret de l'instruction. M. Jean-Pierre Michel a estimé que cet amendement améliorerait le dispositif proposé par le Gouvernement en permettant une meilleure protection de la présomption d'innocence. M. Patrick Devedjian a, pour sa part, fait observer que cet amendement créait une infraction qui n'était pas définie d'une manière suffisamment précise. Le rapporteur a également jugé que cet amendement ne respectait pas le principe de légalité des peines et qu'il était, de ce fait, contraire à la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et à la jurisprudence du Conseil constitutionnel. La Commission a rejeté cet amendement. Elle a ensuite examiné un amendement de M. Alain Tourret, portant de 100 000 à 500 000 F le montant de l'amende applicable aux personnes diffusant des images de nature à porter atteinte à la présomption d'innocence et à 1 000 000 F le montant encouru en cas de récidive. Celui-ci a indiqué que le plafond des amendes devait être augmenté pour tenir compte des moyens financiers colossaux dont disposent certains organes de presse. M. Patrick Devedjian a émis des doutes sur l'opportunité de pénaliser cette matière en indiquant que la procédure civile devait suffire pour que les victimes obtiennent réparation du préjudice subi. Prolongeant sa réflexion, il a considéré qu'il était immoral que l'Etat gagne de l'argent en percevant des amendes et qu'il était illogique de mélanger compassion et répression. La Commission a rejeté cet amendement. Elle a, en revanche, adopté un amendement de Mme Frédérique Bredin, portant à 200 000 F l'amende applicable aux personnes ayant diffusé des images portant atteinte à la présomption d'innocence (amendement n° 128). Puis elle a rejeté un amendement de Mme Nicole Catala, tendant à réprimer la publication ou la diffusion de documents couverts par le secret de l'enquête et de l'instruction. Elle a enfin adopté un amendement du rapporteur, rappelant que les autorités ne doivent imposer que dans des circonstances exceptionnelles, définies de manière limitative, le port de menottes (amendement n°129). La Commission a adopté l'article 22 ainsi modifié. Article 23 Les personnes dont la présomption d'innocence est mise en cause ont à leur disposition plusieurs procédures pour faire cesser les atteintes dont ils font l'objet. Lorsque ces personnes sont placées en garde à vue, mises en examen ou font l'objet d'une citation à comparaître, d'un réquisitoire du procureur de la République ou d'une plainte avec constitution de partie civile, le juge peut, même en référé, ordonner l'insertion dans la publication concernée d'un communiqué destiné à faire cesser l'atteinte à la présomption d'innocence ; cette publication se fait aux frais de la personne physique ou morale responsable de cette atteinte (article 9-1 du code civil créé par la loi du 4 janvier 1993). Lorsque ces personnes bénéficient d'un non-lieu, elles peuvent demander au juge d'instruction ou à la chambre d'accusation la publication de la décision de non-lieu ou d'un communiqué informant le public des motifs de cette dernière (articles 177-1 et 212-1 du code de procédure pénale) ; les juridictions d'instruction, qui sont libres d'accéder ou non à ces demandes, choisissent les modalités de la publication, dont les frais sont à la charge de l'Etat. Enfin, les articles 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et 6 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle organisent un droit de réponse en faveur des personnes mises en cause. Toute personne « nommée ou désignée » dans un journal peut, dans un délai d'un an, faire parvenir une réponse que le directeur de la publication est tenue d'insérer gratuitement dans les trois jours s'il s'agit d'un quotidien ; le droit de réponse ne dépend pas d'une faute commise par le rédacteur de l'article et même l'information la plus objective peut y donner droit (Cass. Crim. 6 novembre 1956). En matière audiovisuelle, le droit de réponse ne peut être exercé que lorsque la personne ait été victime « d'imputations susceptibles de porter atteinte à son honneur ou à sa réputation », ce qui est toujours le cas d'une atteinte à la présomption d'innocence ; la demande d'exercice du droit de réponse doit être présentée dans les huit jours. Signalons en outre que ces mêmes articles prévoient que ce droit de réponse peut également être exercé par une personne mise en cause à l'occasion de poursuites pénales et qui a fait l'objet d'une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, dans un délai de trois mois (loi de 1881) ou de huit jours (loi de 1982) suivant cette décision ; cette action en insertion forcée a été introduite par la loi du 4 janvier 1993 en parallèle avec les articles 177-1 et 212-1 du code de procédure pénale. Jugeant sans doute ces dispositions insuffisantes, l'article 23 du projet de loi complète les articles 13 de la loi de 1881 et 6 de la loi de 1982, afin de permettre au procureur de la République d'exercer le droit de réponse à la demande d'une personne « nommée ou désignée à l'occasion d'une enquête ou d'une information dont elle fait l'objet » (article 13 de la loi de 1881) ou d'une personne « présentée comme faisant l'objet de poursuites pénales » (article 6 de la loi de 1982). Outre le fait que leur utilité n'est pas évidente étant donné le nombre de dispositions permettant déjà de réparer les atteintes à la présomption d'innocence, les modifications proposées dénaturent le droit de réponse. La doctrine a en effet toujours considéré que le droit de réponse était un droit strictement personnel, qui devait être exercé par l'intéressé lui-même. Par ailleurs, l'article 23 modifie le délai pendant lequel la personne bénéficiaire d'un non-lieu, d'une relaxe ou d'un acquittement peut exercer son action en insertion forcée en matière audiovisuelle et le fixe à trois mois, comme en matière de presse écrite. En effet, le délai actuel de huit jours, qui est celui prévu pour le droit de réponse « classique », ne se justifie pas dans ce cas, puisque par définition la mise en cause aura eu lieu longtemps avant la décision de non lieu. La Commission a été saisie de trois amendements identiques tendant à la suppression de l'article, le premier, n° 27 de M. Patrick Devedjian, le deuxième de M. Philippe Houillon, le troisième de M. Pierre Albertini. M. Patrick Devedjian a fait part de son hostilité de principe à ce qu'il est convenu d'appeler les « fenêtres de publicité », considérant qu'il était aberrant de confier à l'accusation la mission d'assumer le droit de réponse des personnes accusées mises en cause. Il a jugé qu'il serait préférable de confier cette fonction à un magistrat du siège. La Commission a rejeté ces trois amendements. Elle a, en revanche, adopté un amendement de M. Alain Tourret donnant une nouvelle rédaction à l'article 23, qui supprime la possibilité pour l'accusé mis en cause par la presse de demander au ministère public d'exercer à sa place un droit de réponse, tout en maintenant les dispositions portant à trois mois le délai du droit de réponse en cas de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement (amendement n° 130 rectifié). En conséquence, l'amendement de même nature du rapporteur est devenu sans objet, ainsi que l'amendement de Mme Frédérique Bredin, visant à rendre automatique l'intervention du ministère public en cas de demande d'un droit de réponse par une personne mise en cause dans une procédure judiciaire, de même que l'amendement du rapporteur précisant le régime des délais applicables en la matière. La Commission a adopté l'article 23 ainsi modifié. Article additionnel après l'article 23 La Commission a adopté un amendement de Mme Frédérique Bredin (amendement n° 131 rectifié), étendant le droit à la présomption d'innocence aux personnes qui, sans être directement concernées par la procédure, sont présentées publiquement comme pouvant être coupables de faits donnant lieu à enquête ou instruction judiciaire. M. Alain Tourret s'est félicité de l'adoption de cet amendement, soulignant qu'il rejoignait une proposition de loi qu'il avait lui-même déposée sur le sujet. Article 24 L'article 524 du nouveau code de procédure civile définit les conditions dans lesquelles l'exécution provisoire peut être arrêtée en cas d'appel : il doit s'agir d'une décision du premier président statuant en référé qui ne peut être prononcée que si l'exécution provisoire est interdite par la loi ou risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut seulement autoriser la substitution à la garantie primitive d'une garantie équivalente. Considérant, selon l'exposé des motifs du projet de loi, que le renforcement de la présomption d'innocence ne devait pas porter atteinte à la liberté d'expression, le Gouvernement a souhaité, pour les affaires de presse, déroger à l'interdiction de revenir en appel sur le caractère immédiatement exécutoire d'une ordonnance de référé posée par l'article 524. L'article 24 insère, dans la section du chapitre V de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse consacrée à la procédure, un article 64 qui permet au premier président, statuant en référé, d'arrêter l'exécution provisoire d'une ordonnance de référé limitant la diffusion de l'information, lorsque cette décision risque d'entraîner « des conséquences manifestement excessives ». Cette disposition reprend donc la formulation proposée à l'article 524 pour l'arrêt de l'exécution provisoire lorsque celle-ci n'est pas de droit. Rappelons que la jurisprudence a considéré à propos de cet article qu'engendrerait un risque de « conséquences manifestement excessives » l'exécution d'une mesure de nature à ruiner complètement la trésorerie d'une entreprise, interdisant la poursuite d'une activité ou bénéficiant à une personne qui ne possède aucun bien en France de nature à répondre à une éventuelle obligation de restitution. Bien que figurant dans la loi de 1881 sur la liberté de la presse, cet article s'appliquera également en matière audiovisuelle : en effet, il concerne de manière générale les ordonnances de référé limitant la diffusion de l'information, sans viser spécifiquement la presse écrite. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois qu'une mesure générale qui s'applique aussi bien à la presse écrite qu'à la presse audiovisuelle figure dans la loi de 1881 : ainsi, la jurisprudence a considéré que les dispositions sur la diffamation ou l'injure, rédigées en termes très généraux, s'appliquaient également aux propos tenus dans le cadre d'émissions de télévision. La Commission a adopté l'amendement de précision n° 28 de M. Patrick Devedjian. Puis, elle a adopté l'article 24 ainsi modifié. La Commission a rejeté un amendement de M. Pierre Albertini limitant la portée du secret de l'instruction aux personnes qui, concourant à la procédure, sont tenues au secret professionnel. Article 25 Cet article regroupe un certain nombre de modification du code de procédure pénale dont l'objectif commun est d'instaurer des « fenêtres de publicité » au cours de la procédure, qui permettront d'éviter des rumeurs infondées portant atteinte à la présomption d'innocence, tout en préservant le principe général du secret de l'instruction. La Commission a tout d'abord été saisie d'un amendement de M. Philippe Houillon proposant une nouvelle rédaction de cet article afin de supprimer le secret de l'instruction. Celui-ci a estimé que le maintien du secret de l'instruction, même assorti de « fenêtres de publicité », conduisait à pérenniser une hypocrisie qui ne correspondait plus à la réalité de la pratique judiciaire, soulignant, en outre, que les délais de la justice apparaissaient peu compatibles avec le besoin immédiat d'informations. M. Alain Tourret a estimé que le secret de l'instruction n'était, en fait, jamais assuré dans les affaires importantes et médiatiques, dans la mesure où il n'est pas opposable aux personnes mises en examen. Après avoir jugé difficile sa disparition complète, alors même qu'il contribue à protéger la présomption d'innocence, tout en reconnaissant qu'on ne pouvait pas interdire aux personnes mises en examen de faire des communications, il a néanmoins considéré que la situation actuelle était absurde, puisque le secret de l'instruction prévu par le code de procédure pénale n'était pas respecté et que ses violations n'étaient pas sanctionnées. M. Patrick Devedjian a fait valoir qu'on ne pouvait évidemment pas empêcher une personne mise en examen de procéder à des déclarations pour faire part de son innocence et a considéré que les réflexions sur l'évolution du secret de l'instruction conduiraient inévitablement à mettre en place une procédure accusatoire pour garantir une information transparente et loyale, préférable aux errements actuels. Après que le rapporteur, reconnaissant qu'il n'y avait pas de solution idéale, eut indiqué que le projet de loi proposait néanmoins un dispositif équilibré reposant sur le maintien du secret de l'instruction, tempéré par des rendez-vous périodiques de publicité permettant à chacune des parties d'effectuer des déclarations et de faire valoir son point de vue, la Commission a rejeté l'amendement de M. Philippe Houillon, ainsi qu'un amendement du même auteur instaurant des sanctions en cas de violation du secret de l'instruction, après que son auteur eut précisé qu'il fallait choisir clairement entre la suppression du secret de l'instruction s'il apparaissait inutile, indiquant que telle était, en fait, son opinion, ou son strict respect, s'il était nécessaire, ce qui impliquait de sanctionner lourdement ses violations. - Communiqués du parquet Afin d'éviter la propagation d'informations inexactes qui portent atteinte à la réputation des personnes mises en cause, nuisent au déroulement serein des investigations et sont parfois de nature à troubler l'ordre public, les procureurs de la République peuvent communiquer à la presse des renseignements sur des faits faisant l'objet d'enquêtes ou de poursuites pénales. L'intérêt de ces communications, dont les modalités figurent à l'article C. 24 du code de procédure pénale, a été rappelé dans une circulaire adressée en 1985 aux procureurs et procureurs généraux. Le Gouvernement a souhaité néanmoins conférer une plus grande légitimité à cette pratique, proposée depuis plus de vingt ans par les différentes commissions de réforme de la justice, en l'inscrivant dans la loi. Le paragraphe I de l'article 25 complète donc l'article 11 du code de procédure pénale, qui rappelle que la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète, afin de préciser que le procureur de la République pourra néanmoins rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ; ces éléments ne devront toutefois comporter aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause ; ces communiqués du parquet se feront d'office ou à la demande de la juridiction d'instruction (juge d'instruction ou chambre d'accusation) ou des parties. On observera que cette possibilité de communiquer est donnée au procureur de la République, et non au juge d'instruction, afin de rétablir un certain équilibre avec les avocats des parties qui n'hésitent pas à faire état dans la presse de certains éléments favorables à leur client. Après avoir rejeté l'amendement n° 29 de M. Patrick Devedjian supprimant les communiqués du procureur de la République, la Commission a adopté un amendement du rapporteur encadrant strictement leur pratique (amendement n° 132), Mme Frédérique Bredin ayant toutefois exprimé ses réserves sur le principe de ces communiqués, tout en reconnaissant que l'amendement proposé permettrait d'éviter les dérapages. Elle a ensuite adopté un amendement de Mme Frédérique Bredin limitant les communiqués du parquet aux éléments objectifs de la procédure et excluant les mentions nominatives (amendement n° 133), après que M. Alain Tourret eut souhaité connaître les sanctions en cas de non-respect de ces obligations et que Mme Frédérique Bredin eut précisé, en réponse, que la violation de ces dispositions pouvait entraîner la mise en jeu de la responsabilité civile et disciplinaire du magistrat. En raison des votes précédemment émis par la Commission, deux amendements de M. Philippe Houillon et de M. Alain Tourret supprimant les dispositions permettant au procureur de parler au nom de la juridiction de l'instruction sont devenus sans objet. - Publicité de la décision de placement en détention provisoire L'actuel article 199 du code de procédure pénale prévoit que les débats concernant le contentieux de détention provisoire devant la chambre d'accusation se déroulent en audience publique à la demande de la personne majeure concernée ou de son avocat, sauf lorsque la publicité est de nature à nuire au bon déroulement de l'information, aux intérêts d'un tiers, à l'ordre public ou aux bonnes m_urs ; la chambre d'accusation statue sur la demande, après avoir recueilli les observations du procureur général et, le cas échéant, des avocats des parties, par un arrêt qui n'est susceptible de pourvoi en cassation qu'en même temps que l'arrêt portant sur la demande principale. En revanche, le juge d'instruction qui envisage de placer une personne en détention provisoire statue après un débat contradictoire qui n'est pas public (article 145 du code de procédure pénale). Reprenant les termes de l'article 199, le paragraphe II de l'article 25 complète l'article 145 afin de préciser que, lorsque la personne mise en examen ou son avocat le demandera dès l'ouverture de l'audience, le débat contradictoire aura lieu en audience publique, sauf si la publicité est de nature à nuire au bon déroulement de l'information, à l'ordre public, à la dignité de la personne ou aux intérêts d'un tiers ; le juge de la détention provisoire, qui remplacera désormais le juge d'instruction, statuera sur cette demande après avoir recueilli les observations du ministère public, de la personne mise en examen et de son avocat. On observera que les dispositions proposées, qui pourront dans certains cas avoir un effet inverse à celui recherché et renforcer les soupçons qui pèsent sur la personne mise en cause, diffèrent de la procédure de l'article 199, puisque la décision du juge de la détention provisoire refusant cette demande ne sera pas susceptible de recours. Notons enfin que le texte substitue l'atteinte à la dignité de la personne à l'ancienne notion d'atteinte aux bonnes m_urs comme motif de refus de la demande. La Commission a adopté un amendement présenté par Mme Frédérique Bredin prévoyant que le critère du bon déroulement de l'information ne pourra pas être invoqué pour empêcher la publicité de l'audience devant le juge de la détention provisoire (amendement n° 134). Elle a, en revanche, rejeté l'amendement n° 30 de M. Patrick Devedjian et un amendement de M. Philippe Houillon supprimant l'ensemble des exceptions à la publicité des audiences, M. Philippe Houillon ayant estimé que les règles applicables au stade de l'audience du jugement devaient être étendues au niveau de l'instruction, tandis que le rapporteur soulignait, au contraire, que certaines situations objectives, tenant notamment à la dignité de la personne ou à l'intérêt des tiers, pouvaient justifier le refus de publicité. La Commission a ensuite adopté un amendement de M. Philippe Houillon prévoyant que le juge de la détention provisoire statue sur la demande de publicité par ordonnance motivée (amendement n° 135). - Action en insertion forcée à la suite d'une décision de non-lieu Les articles 177-1 et 212-1, introduits dans le code de procédure pénale par la loi du 4 janvier 1993, permettent à la personne bénéficiaire d'une décision de non lieu de demander au juge d'instruction ou à la chambre d'accusation d'ordonner la publication intégrale ou partielle de cette décision de non-lieu ou l'insertion d'un communiqué reprenant les motifs ou le dispositif de celle-ci ; les juridictions d'instruction choisissent les journaux ou les services de communication audiovisuelle concernés par la publication, les frais d'insertion étant à la charge de l'Etat (article C.177-1) ; elles peuvent, si elles estiment la demande infondée, ne pas y faire droit. Les paragraphes III et VI complètent ces dispositions sur deux points. Ils élargissent les personnes habilitées à demander une telle publication : outre la personne directement intéressée, la publication pourra être demandée par le ministère public ou décidée par les juridictions d'instruction elles-mêmes, à condition d'obtenir l'accord du bénéficiaire (1° des paragraphes III et VI). Cette disposition est à rapprocher de l'article 23 du projet de loi, qui permet au procureur de la République d'exercer le droit de réponse à la place de la personne intéressée, à sa demande. Le 2° des paragraphes III et VI précisent que le refus des juridictions d'instruction de faire droit à la demande de la personne concernée doit être motivé, la décision du juge d'instruction prenant la forme d'une ordonnance susceptible d'appel devant la chambre d'accusation ; la décision de la chambre d'accusation peut, elle, faire l'objet d'un pourvoi en cassation dans les conditions de droit commun. - Publicité des débats devant la chambre d'accusation Ainsi qu'on l'a vu précédemment, les débats devant la chambre d'accusation relatifs au contentieux de la détention provisoire peuvent se dérouler en audience publique à la demande de la personne concernée ou de son avocat. De même, en cas d'appel d'une ordonnance de non lieu motivée par l'irresponsabilité pénale de l'auteur de l'infraction, les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en séance publique si la partie civile ou son avocat en fait la demande dès l'ouverture des débats et si la publicité n'est pas de nature à nuire à l'ordre public ou aux bonnes m_urs (article 199-1 du code de procédure pénale). Ces dispositions constituent des dérogations au principe posé par le premier alinéa de l'article 199, selon lequel « les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en chambre du conseil ». Le paragraphe IV étend cette possibilité de publicité à tous les débats devant la chambre d'accusation, tout en maintenant le principe de secret posé par le premier alinéa de l'article 199. Comme l'indique l'exposé des motifs du projet de loi, cette disposition permettra à une personne mise en examen, si elle l'estime de son intérêt, de provoquer un débat public sur les charges qui pèsent sur elle et de faire connaître les arguments de sa défense. Le 1° complète le premier alinéa de l'article 199 sur le caractère non public des débats devant la chambre d'accusation afin de préciser que si la personne mise en examen majeure le demande, et ce dès l'ouverture des débats, ces débats se déroulent et l'arrêt est rendu en séance publique, sauf si la publicité est de nature à nuire au bon déroulement de l'information, à l'ordre public, à la dignité de la personne ou aux intérêts des tiers ; la chambre d'accusation statue sur la demande après avoir recueilli les observations du procureur général et, le cas échéant, des avocats des autres parties, par un arrêt rendu en chambre du conseil qui n'est susceptible de pourvoi en cassation qu'en même temps que l'arrêt portant sur la demande principale. Le dispositif proposé est donc similaire à celui actuellement prévu par le quatrième alinéa de l'article 199 pour le contentieux de la détention provisoire, qui lui-même a inspiré la procédure de publicité devant le juge de la détention provisoire prévue par le paragraphe II. On observera toutefois que la publicité devra être demandée par la personne elle-même, et non par son avocat, et que l'atteinte à la dignité de la personne constituera un motif pour refuser la demande, comme pour la publicité du débat contradictoire préalable à la mise en détention provisoire. Par coordination, le 2° supprime les dispositions de l'article 199 consacrées à la publicité du contentieux de la détention provisoire, désormais inutiles. La Commission a adopté un amendement de Mme Frédérique Bredin précisant que le critère du bon déroulement de l'information ne pourra plus être invoqué pour empêcher la publicité de l'audience devant la chambre d'accusation (amendement n° 136), ainsi qu'un amendement du rapporteur indiquant que l'avocat de la personne mise en examen devra pouvoir demander la publicité des débats devant cette même chambre (amendement n° 137) ; elle a, en revanche, rejeté l'amendement n° 31 de M. Patrick Devedjian supprimant l'ensemble des exceptions à la publicité des débats. Enfin, le paragraphe V supprime le deuxième alinéa de l'article 199-1 sur la publicité des débats en cas d'appel d'une ordonnance de non-lieu. On peut s'étonner de cette suppression, puisque cette disposition permet à la partie civile de demander la publicité des débats, ce qu'elle ne peut pas faire au titre du nouvel article 199. La Commission a donc adopté un amendement du rapporteur supprimant le paragraphe V (amendement n° 138). - Photographie ou enregistrement audiovisuel d'une personne menottée L'article 803, introduit dans le code de procédure pénale par la loi du 4 janvier 1993, définit strictement les conditions dans lesquelles une personne peut être soumise au port de menottes ou d'entraves : cette personne doit être dangereuse, pour elle-même ou pour autrui, ou être susceptible de s'enfuir. Les circulaires du 1er mars 1993 (article C.803), du 9 mars 1994 ainsi que la circulaire du ministre de l'intérieur du 4 février 1995 ont indiqué les modalités d'application de cet article. Il a ainsi été rappelé que le recours aux menottes doit être exclusivement réservé aux individus dangereux ou susceptible de s'enfuir. En pratique, il semble que les restrictions posées par cet article soient interprétées largement par les forces de police. Afin de limiter les atteintes à la présomption d'innocence qui en résultent, l'article 22 du projet de loi a fait de la diffusion de l'image d'une personne menottée un nouveau délit puni de 100 000 F d'amende. Dans le même esprit, le paragraphe VII complète l'article 803 afin de préciser que les forces de police doivent prendre toutes les mesures utiles pour éviter qu'une personne portant des menottes ou des entraves soit photographiée ou fasse l'objet d'un enregistrement audiovisuel ; ces mesures doivent être compatibles avec les exigences de sécurité. Ces dispositions se contentent de reprendre le dernier alinéa de l'article C.803, qui indique que toutes les mesures utiles doivent être prises pour empêcher qu'une personne escortée ou entravée fasse l'objet, de la part de la presse, de photographies ou d'un enregistrement cinématographique ou audiovisuel. La Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant le paragraphe VII, ses dispositions ayant été reprises sous forme d'un article additionnel après l'article 22 (amendement n° 139). La Commission a adopté l'article 25 ainsi modifié. TITRE II CHAPITRE PREMIER Article 26 Le troisième alinéa de l'article 38 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse interdit la publication par tous moyens de photographies, gravures, dessins et portraits dont l'objet est la reproduction de tout ou partie des circonstances d'un des crimes et délits prévus par les chapitres Ier, II et VII du titre II du livre II du code pénal (atteintes à la vie, à l'intégrité physique ou psychologique de la personne et aux mineurs ou à la famille) et punit une telle publication d'une amende de 25 000 F. L'incrimination est tellement large qu'elle interdit en théorie la publication de toute image se rapportant à l'infraction. En pratique, les poursuites du parquet sont rares et cette disposition ne permet pas de protéger efficacement les victimes. Appelée à se prononcer sur la publication de photographies de victimes de l'attentat de la station de métro Saint-Michel, la Cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 18 septembre 1997, a confirmé un jugement du tribunal correctionnel de Paris, en considérant qu'en raison de sa généralité, le troisième alinéa de l'article 38 de la loi de 1881 était contraire à la Convention européenne des droits de l'homme ; le pourvoi formé contre cet arrêt par le ministère public n'a pas encore été examiné par la cour de Cassation. L'article 26 substitue donc à cette disposition trop large, et donc inefficace, une incrimination spécifique destinée à protéger la dignité des victimes d'infraction. Le paragraphe I insère dans le code pénal, après la nouvelle section relative aux atteintes à la réputation d'une personne mise en cause dans une procédure judiciaire créée par l'article 22 du projet de loi, une section VIII intitulée « De l'atteinte à la dignité de la victime d'un crime ou d'un délit » et comprenant un article (article 226-30-2). Cet article punit de 100 000 francs d'amende, soit la même peine que celle prévue pour la publication d'images de personnes menottées, la diffusion de la reproduction des circonstances d'un crime ou d'un délit, lorsque cette reproduction porte atteinte à la dignité de la victime. L'incrimination est plus précise que celle actuellement prévue à l'article 38, puisqu'elle ne concerne que la publication d'images contraires à la dignité de la victime ; en revanche, les infractions visées sont en théorie plus nombreuses, puisqu'il s'agit de tout crime ou délit et non pas uniquement de ceux mentionnés dans certains chapitres de livre II du code pénal. Cette nouvelle incrimination figurant désormais dans le code pénal, le deuxième alinéa de l'article 226-30-2 précise que les dispositions des lois sur la presse écrite ou audiovisuelle relatives à la prescription (trois mois) et à la détermination des personnes responsables (le directeur de la publication) s'appliquent lorsque le délit est commis par voie de presse. Tirant les conséquences de ces nouvelles dispositions, le paragraphe II de l'article 26 abroge le troisième alinéa de l'article 38 de la loi de 1881, ainsi que le quatrième alinéa du même article qui précise que le délit de publication n'est pas constitué lorsque celle-ci aura été faite sur la demande écrite du juge d'instruction. Il paraît en effet difficile de préciser dans la loi que le juge d'instruction pourra faire publier une image portant atteinte à la dignité de la victime. La Commission a été saisie de l'amendement n° 44 de M. Patrick Devedjian visant à supprimer le I de cet article, qui sanctionne le fait de diffuser la reproduction des circonstances d'un crime ou délit lorsqu'elle porte atteinte à la dignité de la victime. Considérant que l'« atteinte à la dignité de la victime » était une notion floue, son auteur a jugé qu'il fallait s'en tenir aux dispositions du code civil qui sont très réparatrices. Le rapporteur a indiqué que l'article 26 n'introduisait pas de nouvelles mesures, mais ne faisait que reprendre, en la précisant, une disposition qui figure actuellement dans la loi sur la presse. La Commission a rejeté l'amendement n° 44 de M. Patrick Devedjian, de même qu'un amendement de M. Alain Tourret portant l'amende punissant la diffusion de la reproduction des circonstances d'un crime ou d'un délit de 100 000 F à 500 000 F. Elle a, en revanche, adopté un amendement du rapporteur complétant le I de cet article pour intégrer dans le code pénal les dispositions de la loi sur la presse sanctionnant le fait de diffuser des renseignements concernant l'identité d'une victime d'une agression ou atteinte sexuelles (amendement n° 140). La Commission a adopté l'article 26 ainsi modifié. Article 27 Certaines dispositions de la loi de 1881 sur la presse interdisent de publier l'identité d'un mineur dans des circonstances bien particulières. Ainsi, l'article 39 bis de cette loi punit de 40 000 F d'amende le fait de publier l'identité d'un mineur ayant quitté ses parents, son tuteur ou la personne qui était chargée de sa garde ou celle d'un mineur délaissé dans les conditions prévues par les articles 227-1 et 227-2 du code pénal. La publication de tout texte ou illustration concernant le suicide des mineurs est également interdite par l'article 39 ter, sous peine d'une amende de 40 000 F. Dans ces deux cas, il n'y a pas délit lorsque la publication aura été faite à la demande des personnes qui ont la garde du mineur, du ministre de l'intérieur ou du préfet du département, du juge d'instruction ou du juge des enfants (article 39 bis) ou encore du procureur de la République (articles 39 bis et 39 ter). Par ailleurs, l'article 39 quinquies punit d'une amende de 20 000 F et de deux ans d'emprisonnement la diffusion d'informations sur l'identité d'une victime, majeure ou mineure, d'un viol ou d'un attentat à la pudeur. Il n'existe cependant aucune disposition générale sur la publication de l'identité d'un mineur victime d'une infraction, alors même que l'article 14 de l'ordonnance du 2 février 1945 interdit une telle publication pour les mineurs délinquants. C'est pourquoi l'article 27 insère, dans la section du code pénal consacrée à la mise en péril des mineurs, un nouvel article 227-24-1 punissant de 100 000 francs d'amende la diffusion de renseignements permettant d'identifier un mineur victime d'une infraction. Le deuxième alinéa de cet article rappelle que, lorsque le délit est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les règles particulières de prescription et de détermination des personnes responsables sont applicables. Enfin, pour tenir compte des exigences de l'enquête ou de l'information, qui peuvent nécessiter la publication de tels renseignements, le dernier alinéa prévoit que le délit n'est pas constitué lorsque la diffusion est réalisée à la demande du procureur de la République, du juge d'instruction, ou du juge des enfants. La Commission a adopté un amendement de précision du rapporteur (amendement n° 142), puis rejeté un amendement de M. Alain Tourret accroissant le montant des amendes encourues. La Commission a ensuite adopté l'article 27 ainsi modifié. Articles additionnels après l'article 27 Article 227-24-2 du code pénal La Commission a adopté un amendement du rapporteur introduisant dans le code pénal les dispositions de la loi de 1881, qui interdisent de révéler l'identité des mineurs en cas de fugue ou de suicide (amendement n° 141). Article 81 du code de procédure pénale La Commission a examiné deux amendements ayant le même objet, le premier présenté par M. Alain Tourret et le second par Mme Frédérique Bredin, donnant au juge d'instruction la possibilité de constituer un dossier sur la victime, afin d'évaluer l'ampleur du préjudice subi. Le rapporteur ayant précisé que la rédaction de l'amendement de Mme Frédérique Bredin lui paraissait préférable, puisqu'il prévoyait l'accord de la victime pour la constitution du dossier, la Commission a adopté l'amendement de Mme Frédérique Bredin (amendement n° 143) et rejeté celui de M. Alain Tourret. La Commission a été saisie de l'amendement n° 34 de M. Patrick Devedjian autorisant la présence d'une caméra fixe lors des audiences de jugement. Précisant que cette faculté existait déjà dans de nombreux pays, M. Patrick Devedjian a insisté sur les vertus civiques de la publicité des procès, rappelant que la justice était rendue au nom du peuple français. Le rapporteur s'est inquiété des conséquences d'une telle mesure, notamment pour les victimes qui se retrouveraient livrées à la curiosité du public. Tout en reconnaissant l'intérêt civique des procès filmés, elle a considéré qu'il fallait adopter une démarche inverse, ayant pour objet d'accroître la protection de la victime afin de lui éviter tout nouveau traumatisme. Après avoir rappelé que, dans la grande majorité des cas, les victimes se font représenter au procès, M. Patrick Devedjian a observé que les procès étaient déjà publics. M. Alain Tourret a estimé qu'un problème pouvait aussi se poser pour les personnes relaxées et a conclu que l'enregistrement vidéo des procès ne devait être possible qu'en cas d'accord exprimé par toutes les parties. La Commission a rejeté l'amendement n° 34, ainsi que l'amendement n° 36 du même auteur prévoyant un enregistrement sonore des procès. Elle a ensuite été saisie de trois amendements, présentés respectivement par MM. Alain Tourret, Philippe Houillon et Pierre Albertini, ayant pour objet de mieux informer la victime de ses droits et notamment des possibilités de saisine de la commission d'indemnisation des victimes d'infraction. Le rapporteur ayant indiqué qu'elle avait présenté un amendement sur le sujet après l'article 28, la Commission a rejeté ces amendements. CHAPITRE II Section 1 Article 28 Comme le rappelle l'exposé des motifs du projet de loi, les associations d'aide aux victimes jouent un rôle de plus en plus important, sans qu'aucun article du code de procédure pénale n'ait consacré officiellement leur existence. L'article 28 comble cette lacune en complétant l'article 41 du code de procédure pénale, qui rappelle que le procureur de la République peut recourir à la médiation pénale, par un alinéa indiquant que ce dernier peut également faire appel à une association d'aide aux victimes ayant fait préalablement l'objet d'un conventionnement de la part des chefs de la cour d'appel, afin que celle-ci assiste la victime de l'infraction. Rappelons que, depuis le décret du 15 janvier 1997 portant déconcentration des décisions administratives individuelles, les associations d'aide aux victimes ne sont plus agrées au niveau national par le Garde des Sceaux, mais font l'objet d'un conventionnement au niveau local par les chefs de cour d'appel. L'article 28 se contente donc d'inscrire dans la loi ce principe de conventionnement déconcentré, conventionnement qui est d'ailleurs cité à l'article R. 121 pour les associations de contrôle judiciaire. Ce conventionnement préalable ne doit pas être confondu avec les conventions évoquées par la circulaire du 13 juillet 1998 relative à la politique pénale d'aide aux victimes. Cette circulaire a en effet invité le procureur de la République à arrêter avec les associations d'aide aux victimes, par voie de convention, leurs modalités d'intervention en faveur des victimes ; ces conventions doivent aussi prévoir le rôle des associations dans le cadre du traitement en temps réel des procédures pénales et décrire les modalités particulières de signalement et de prise en charge des victimes d'actes criminels graves, d'attentats, de catastrophes ou d'accidents collectifs ; la circulaire précise également que les conditions dans lesquelles les services d'aide aux victimes rendent compte de leur mission doivent être définies par voie conventionnelle. La Commission a adopté l'article 28 sans modification. Articles additionnels après l'article 28 La Commission a adopté un amendement présenté par M. Pierre Albertini ayant pour objet de conventionner de plein droit les associations d'aides aux victimes reconnues d'utilité publique (amendement n° 144). Articles 53-1 et 75 du code de procédure pénale La Commission a adopté un amendement présenté par le rapporteur permettant, dès le début de l'enquête, une meilleure information des victimes sur leur droit à obtenir réparation du préjudice subi (amendement n° 145). Section 2 Article additionnel avant l'article 29 La Commission a adopté un amendement présenté par le rapporteur prévoyant l'information des victimes sur leur droit de se constituer partie civile par le juge d'instruction (amendement n° 146). Article 29 Par dérogation aux dispositions de l'article 419 du code de procédure pénale, qui prévoient que la déclaration de constitution de partie civile se fait, soit avant l'audience au greffe, soit pendant l'audience par déclaration consignée par le greffier ou par dépôt de conclusions, l'article 420-1, introduit dans le code de procédure pénale par la loi du 2 février 1981, autorise la constitution de partie civile par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception qui doit parvenir au tribunal vingt-quatre heures au moins avant la date de l'audience ; cette possibilité est toutefois limitée aux demandes de restitution d'objets saisis ou de dommages-intérêts dont le montant ne dépasse pas le plafond de la compétence de droit commun des tribunaux d'instance en matière civile, soit 30 000 F (article R. 321-1 du code de l'organisation judiciaire) ; enfin, l'article 420-1 précise que la lettre doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives du préjudice subi et que ces deux documents sont immédiatement joints au dossier. Ces formalités dispensent la partie civile de comparaître. La jurisprudence a interprété strictement ces dispositions, refusant notamment la constitution de partie civile par télex (CA Pau 24 février 1993). Poursuivant l'évolution amorcée avec la loi du 2 février 1981, l'article 29 modifie l'article 420-1 afin de faciliter les constitutions de partie civile. Le paragraphe I supprime le seuil maximum au-dessus duquel la constitution de partie civile par lettre recommandée n'est pas possible (2°), autorise la constitution de partie civile par télécopie (1°), procédé déjà utilisé pour la notification de certains actes, et propose des harmonisations rédactionnelles liées à l'utilisation de ce nouveau procédé (3°). Désormais, la victime pourra se constituer partie civile par lettre recommandée ou par télécopie quel que soit le montant des dommages-intérêts demandés. Comme l'indique l'étude d'impact, la référence actuelle au taux de compétence des tribunaux d'instance n'a en effet aucune raison d'être, puisqu'il s'agit d'une règle d'organisation des juridictions civiles sans lien avec les règles de procédure pénale ; d'autre part, la gravité du dommage ne doit pas être un motif pour interdire la constitution de partie civile par lettre recommandée et obliger la victime à se déplacer, alors même qu'un tel déplacement peut être impossible en raison de la gravité du préjudice subi. Le paragraphe II complète l'article 420-1 afin de préciser que la demande de restitution d'objet ou de dommages-intérêts peut également être formulée au cours de l'enquête de police auprès d'un officier ou d'un agent de police judiciaire, qui dresse alors un procès-verbal ; si l'action publique est mise en mouvement, cette demande vaut constitution de partie civile ; le procureur de la République doit néanmoins avoir donné son accord. Cette dernière disposition permet de protéger la victime qui peut avoir intérêt, préalablement à sa demande, à consulter un avocat ou même une association d'aide aux victimes qui lui sera indiquée par le procureur de la République (article 28 du projet de loi). Cette procédure, déjà reconnue en pratique par certaines juridictions, permettra à la victime de mieux faire valoir ses droits dans le cadre des procédures rapides que constituent la convocation par officier de police judiciaire (article 390-1 du code de procédure pénale), la convocation par procès-verbal (article 394) ou encore la comparution immédiate (articles 395 et suivants). Par ailleurs, le paragraphe II précise que, comme la constitution de partie civile par lettre recommandée ou télécopie, la constitution de partie civile faisant suite à une demande de dommages-intérêts formulée au cours de l'enquête dispense la partie civile de comparaître devant le tribunal. Enfin, le paragraphe III procède à une harmonisation rédactionnelle liée à la nouvelle possibilité donnée à la personne lésée de se constituer partie civile par télécopie. La Commission a adopté l'article 29 sans modification. Article 30 L'article 464 du code de procédure pénale dispose que si le tribunal estime que le fait constitue un délit, il prononce la peine puis statue, s'il y a lieu, sur l'action civile. La jurisprudence a considéré que le tribunal était tenu de statuer par le même jugement sur les deux actions et que cette obligation était d'ordre public (Cass. Crim. 23 mars 1963). Elle a néanmoins estimé que l'article 464 n'interdisait pas le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure sur les seuls intérêts civils, lorsque des éléments nouveaux étaient apparus au cours des débats et avaient mis la partie civile dans l'obligation d'accomplir certaines formalités (Cass. Crim. 23 Oct. 1968) ; de même, le tribunal pouvait surseoir à statuer sur l'indemnisation de la victime et ordonner des mesures d'instruction complémentaires lui permettant de mieux évaluer le préjudice subi ; dans tous les cas, l'affaire devait être renvoyée à une date déterminée (Cass. Crim. 25 janv. 1973 ; 23 nov. 1976). La Cour de cassation a ainsi refusé un renvoi sine die dans l'attente des résultats d'expertise (Cass. Crim. 25 janv. 1973) ou de la production de justifications supplémentaires (Cass. Crim. 3 nov. 1983). L'article 30 du projet de loi clarifie cette jurisprudence complexe et étend les cas dans lesquels le tribunal peut renvoyer sa décision sur les dommages-intérêts à une séance ultérieure. Il complète pour cela l'article 464 par un nouvel alinéa qui précise que le tribunal, après avoir statué sur l'action publique, peut renvoyer l'affaire à une date ultérieure pour statuer sur l'action civile, même s'il n'ordonne pas de mesure d'instruction, afin de permettre à la partie civile d'apporter les justificatifs de sa demande ; ce renvoi peut avoir lieu d'office ou à la demande du procureur de la République ou des parties ; le tribunal doit alors fixer la date de l'audience à laquelle il sera statué sur l'action civile, cette précision permettant de consacrer un principe constamment réaffirmé par la jurisprudence. Cette modification permettra d'éviter que la personne lésée, qui ne peut justifier de son préjudice à l'audience, se voit refuser tout dommage-intérêt. Comme l'article précédent qui facilite les conditions de constitution de partie civile, elle cherche à préserver les droits des victimes d'infractions dont les auteurs sont jugés dans le cadre de procédures rapides. La Commission a adopté un amendement présenté par M. Alain Tourret permettant d'accorder de plein droit aux parties civiles le renvoi de l'audience (amendement n° 147). La Commission a adopté l'article 30 ainsi modifié. Article 31 L'article 475-1 du code de procédure pénale permet au tribunal de condamner l'auteur de l'infraction à verser à la partie civile une somme au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci ; le tribunal détermine cette somme en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, pour les mêmes raisons, renoncer à cette condamnation. L'article 700 du nouveau code de procédure civile prévoit une disposition similaire devant les juridictions civiles, l'article 629 indiquant expressément que cet article s'applique devant les chambres civiles de la Cour de Cassation. La chambre criminelle de la Cour de Cassation a néanmoins interprété strictement l'article 475-1 du code de procédure pénale et a refusé son application au pourvoi en matière criminelle (Cass. Crim. 3 mars 1993). Plusieurs praticiens ont critiqué cette jurisprudence qui conduit les parties civiles à supporter les frais exposés pour se défendre, alors même que le pourvoi formé par le condamné est rejeté ou n'est pas soutenu. Ces critiques ont été reprises par notre collègue François Colcombet dans une question écrite du 27 octobre 1997, qui souligne notamment que cette situation oblige les victimes à utiliser les sommes allouées au titre des dommages-intérêts pour payer leurs avocats, annihilant ainsi la réparation. L'article 31 met fin à cette jurisprudence contestable en permettant à la victime d'obtenir le remboursement des frais irrépétibles devant la chambre criminelle de la Cour de cassation. Il insère pour cela, dans la partie du code de procédure pénale consacrée aux pourvois en cassation, un nouvel article 368-1, qui précise qu'en cas de rejet du pourvoi formé par le condamné, les dispositions de l'article 475-1 sont applicables devant la Cour de cassation. Outre une meilleure protection des victimes, cette disposition permettra de prévenir les pourvois abusifs. La Commission a adopté l'article 31 sans modification. Articles additionnels après l'article 31 Articles 375-3 [nouveau] et 464 du code de procédure pénale La Commission a adopté un amendement du rapporteur ayant pour objet de mieux informer les victimes de leur possibilité de saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infraction (amendement n° 149). M. Alain Tourret a regretté que cet amendement ne prévoie pas, en cas d'absence d'information, que le délai d'un an pour saisir la commission est suspendu. Articles 721-1 et 729 du code de procédure pénale La Commission a adopté un amendement du rapporteur prévoyant que les efforts faits par les personnes détenues pour indemniser leurs victimes sont pris en compte dans l'octroi des réductions de peines supplémentaires ou des libérations conditionnelles (amendement n° 150). La Commission a ensuite examiné un amendement présenté par le rapporteur confiant au juge d'application des peines le soin de déterminer les modalités du versement des dommages-intérêts à la victime. Remarquant que les modalités du versement faisaient partie intégrante du droit à réparation des victimes et qu'elles pouvaient en cela constituer grief, M. Patrick Devedjian s'est déclaré défavorable à cette disposition, observant qu'en donnant compétence au juge d'application des peines, elle portait atteinte au principe de la procédure contradictoire. Soulignant que cet amendement ne faisait que reprendre des dispositions déjà prévues par circulaire, le rapporteur a cependant retiré son amendement. Puis, la Commission a adopté un amendement du rapporteur regroupant les dispositions relatives à l'indemnisation des victimes dans un chapitre spécifique (amendement n° 148). Articles additionnels après l'article 31 Article 40 du code de procédure pénale La Commission a adopté un amendement de Mme Frédérique Bredin prévoyant la motivation et la notification écrite à la victime du classement sans suite par le procureur (amendement n° 151). Prise en charge par l'Etat des frais irrépétibles La Commission a adopté un amendement de M. Alain Tourret prévoyant la prise en charge par l'Etat des frais irrépétibles en cas de décision de relaxe ou d'acquittement (amendement n° 152). Article 583 du code de procédure pénale La Commission a adopté un amendement de M. Alain Tourret supprimant l'article 583 qui oblige les personnes condamnées à une peine privative de liberté de plus de six mois de se constituer prisonnier pour faire examiner son pourvoi (amendement n° 153). La Commission a rejeté un amendement présenté par M. André Gerin permettant d'autoriser la révision d'un procès même en l'absence de faits nouveaux, lorsque la demande est légitime. TITRE III Ce titre regroupe les différentes mesures de coordination liées à la réforme du statut de témoin assisté (article 32), à la mise en place d'un juge de la détention provisoire (articles 33 et 34), à la modification des modalités de constitution de partie civile (article 35), à la présence d'un avocat dès le début de la garde à vue (articles 36 et 38) et à l'élargissement des droits des parties au cours de l'instruction (article 37). Les articles 39 et 40 prévoient respectivement de repousser l'application des dispositions sur la détention provisoire quatre mois après la publication de la loi et de rendre cette loi applicable aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte. Article 32 Cet article regroupe les mesures de coordination rendues nécessaires par les nouvelles dispositions relatives au témoin assisté proposées à l'article 7 du projet de loi (articles 113-1 à 113-8 [nouveaux] du code de procédure pénale). Le paragraphe I abroge l'actuel article 104 du code de procédure pénale relatif à la possibilité pour une personne nommément visée par une plainte avec constitution de partie civile de bénéficier de certains droits des personnes mises en examen, dont le contenu est repris et aménagé aux articles 113-2, 113-3 et 113-4. Le paragraphe II complète le deuxième alinéa de l'actuel article 105 du code de procédure pénale, qui indique que les personnes nommément visées par le réquisitoire du procureur de la République ne peuvent être entendues comme témoin, afin de rappeler que ces personnes peuvent être entendues comme témoin assisté, conformément à l'article 113-1 ; par coordination avec ce nouvel article, le paragraphe II supprime également le troisième alinéa de l'article 105 relatif à la possibilité pour le procureur de la République d'entendre de telles personnes comme témoin assisté. Le paragraphe III modifie l'article 152 du code de procédure pénale afin de préciser que les témoins assistés ne peuvent être entendus dans le cadre de commissions rogatoires par des officiers de police judiciaire qu'à leur demande, alors que le texte actuel ne prévoit cette possibilité que pour les témoins assistés « de l'article 104 », ceux « de l'article 105 » ne pouvant en aucun cas être interrogés par ces fonctionnaires. Dans la mesure où cette audition n'est possible qu'avec l'accord de l'intéressé, il n'y rien de choquant à prévoir cette possibilité qui permettra dans certains cas de gagner du temps. L'article 183 du code de procédure pénale précise que les ordonnances de règlement sont portées à la connaissance de la personne mise en examen et de la personne qui bénéficie des dispositions de l'article 104 ; le paragraphe IV se contente de remplacer cette dernière expression par celle de témoin assisté. La Commission a adopté un amendement de forme (amendement n° 154) et un amendement de coordination (amendement n° 155) présentés par le rapporteur. Elle a ensuite adopté l'article 32 ainsi modifié. Article 33 Cet article procède aux différentes coordinations rendues nécessaires par la création d'un juge de la détention provisoire (article 10 du projet de loi). La Commission a d'abord rejeté un amendement rédactionnel de M. Pierre Albertini. Le paragraphe I modifie l'article 83 du code de procédure pénale, qui dispose notamment que le juge chargé par le président du tribunal de l'information a seul qualité « pour statuer en matière de détention provisoire », afin de remplacer ce membre de phrase par une référence à la saisine du juge de la détention provisoire ou à la mise en liberté d'office. Le paragraphe II modifie l'article 116 du même code afin de préciser que la personne qui n'est pas placée en détention par le juge de la détention provisoire doit déclarer son adresse personnelle ou l'adresse d'un tiers à ce juge, qui lui-même l'avise qu'elle doit signaler au juge d'instruction tout changement d'adresse et que toute notification ou signification faite à la dernière adresse sera réputée faite à personne : en effet, le juge d'instruction ne procède pas à ces formalités lorsqu'il souhaite placer une personne en détention provisoire et ce sera donc au juge de la détention provisoire de le faire s'il décide de ne pas donner suite à la demande de mise en détention du juge d'instruction. Le paragraphe III modifie l'article 122 qui énumère les mandats décernés par le juge d'instruction : il supprime la référence au mandat de dépôt et ajoute une phrase précisant que c'est le juge de la détention provisoire qui seul peut décerner un mandat de dépôt ; il redéfinit par ailleurs le mandat de dépôt en indiquant qu'il s'agit de l'ordre donné par le juge de la détention provisoire au chef de l'établissement pénitentiaire de détenir la personne qui a fait l'objet de l'ordonnance de placement en détention provisoire. La Commission a adopté deux amendements de M. Alain Tourret précisant que le juge de la détention provisoire peut décerner mandat de dépôt ou mandat d'arrêt, après que ce dernier eut fait valoir que le mandat d'arrêt valait mandat de dépôt (amendements nos 156 et 158). Le paragraphe IV supprime le premier alinéa de l'article 135, qui précise que les conditions dans lesquelles le juge d'instruction peut délivrer un mandat de dépôt. Le paragraphe V complète l'article 136, afin de permettre de prononcer des sanctions disciplinaires contre le juge de la détention provisoire en cas d'inobservation des formalités prescrites pour les mandats de dépôt. Ces sanctions, qui sont actuellement prévues contre le juge d'instruction et le procureur de la République lorsqu'ils ne respectent pas les formalités prescrites pour les différents mandats, semblent peu utilisées. Rappelons que les articles 432-4 à 432-6 du code pénal permettent également de sanctionner les atteintes à la liberté individuelle commises par une personne dépositaire de l'autorité publique. La Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant la référence à la procédure de prise à partie, qui n'existe plus pour les magistrats professionnels (amendement n° 157). Le paragraphe VI abroge le second alinéa de l'article 137 qui précise que le juge d'instruction qui ne suit pas les réquisitions du procureur de la République en matière de détention provisoire n'a pas à rendre d'ordonnance motivée et que le procureur peut, dans ce cas, saisir directement la chambre d'accusation, ces dispositions étant reprises, avec des adaptations, aux articles 137-4 et 137-5 (article 10 du projet de loi). Le paragraphe VII modifie l'article 138 relatif au contrôle judiciaire, afin de préciser que le juge de la détention provisoire peut également ordonner ce contrôle, conformément aux dispositions du nouvel article 137-2. Le paragraphe VIII réécrit le premier alinéa de l'article 141-2, qui permet au juge d'instruction de décerner un mandat d'arrêt ou de dépôt à l'encontre d'une personne mise en examen qui se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire : désormais, le juge d'instruction ne pourra décerner à l'encontre de cette personne qu'un mandat d'arrêt ou d'amener et saisir le juge de la détention provisoire, qui seul pourra délivrer un mandat de dépôt, sous réserve des dispositions relatives à la durée cumulée des détentions provisoires à la suite de la révocation du contrôle judiciaire (article 141-3 créé par l'article 18 du projet de loi). Le paragraphe IX complète le deuxième alinéa de l'article 144-1, qui indique que le juge d'instruction doit ordonner la libération immédiate du prévenu lorsque les conditions exigées pour justifier le placement en détention provisoire ou sa prolongation (article 144 réécrit par l'article 15 du projet de loi) ne sont plus remplies, afin d'insérer une référence au juge de la détention provisoire. Le paragraphe X adapte l'article 145 relatif aux modalités de placement en détention provisoire : - le 1° remplace la mention de l'article 144, auquel le juge d'instruction doit faire référence lorsqu'il détermine les motifs de la détention provisoire, par celle des articles 143-1, 143-2 et 144 (article 15 du projet de loi) qui définissent les nouvelles conditions de la détention provisoire ; La Commission a adopté un amendement du rapporteur corrigeant une erreur matérielle (amendement n° 159). - le 2° précise que c'est le juge de la détention provisoire, et non le juge d'instruction, qui, lorsqu'il est saisi par ce dernier conformément au nouvel article 187-1, avise la personne mise en examen de son droit de disposer d'un délai pour préparer sa défense ; - le 3° modifie le quatrième alinéa, qui dispose que le juge d'instruction statue en audience de cabinet après un débat contradictoire, afin de substituer au juge d'instruction le juge de la détention provisoire. - Le 4° rappelle que le juge de la détention provisoire, comme actuellement le juge d'instruction, ne peut pas ordonner immédiatement le placement en détention lorsqu'un nouveau délai est sollicité par la défense. Les paragraphes XI et XII modifient les articles 145-1 et 145-2 relatifs à la durée de la détention provisoire en matière correctionnelle et criminelle afin de remplacer la mention du juge d'instruction par une référence au juge de la détention provisoire. La Commission a adopté deux amendements de coordination du rapporteur (amendements nos 160 et 161). Le paragraphe XIII complète l'intitulé de la section du code de procédure pénale consacrée à l'appel des ordonnances du juge d'instruction afin de faire référence aux ordonnances du juge de la détention provisoire. Le paragraphe XIV adapte l'article 185 afin de préciser que le procureur de la République peut interjeter appel des ordonnances du juge de la détention provisoire devant le chambre d'accusation. Le paragraphe XV remplace les références au juge d'instruction, qui figurent à l'article 187-1 instituant le procédure du référé-liberté, par celles au juge de la détention provisoire. Enfin, le paragraphe XVI modifie l'article 207 relatif aux décisions de la chambre d'accusation : - le 1° modifie le premier alinéa qui précise que, lorsque la chambre d'accusation a statué sur l'appel d'une ordonnance du juge d'instruction en matière de détention provisoire, le procureur général retourne sans délai le dossier au juge d'instruction, afin de remplacer l'ordonnance du juge d'instruction par celle du juge de la détention provisoire et d'adapter les références d'articles ; La Commission a adopté un amendement du rapporteur corrigeant une erreur matérielle (amendement n° 162). - le 2° complète le troisième alinéa afin de d'indiquer que l'ordonnance du juge de la détention provisoire frappée d'appel sort son plein et entier effet si elle est confirmée par la chambre d'accusation. - le 3° insère une référence au juge de la détention provisoire dans le dernier alinéa qui dispose que la chambre d'accusation peut se saisir de toute demande de mise en liberté non encore examinée par le juge d'instruction lorsqu'elle statue sur l'appel formé contre une ordonnance de refus de mise en liberté. La Commission a adopté l'article 33 ainsi modifié. Article 34 Cet article procède à une modification identique à celle proposée au 1° du paragraphe X de l'article 33, qui regroupe toutes les coordinations liées à la détention provisoire. La Commission a donc adopté un amendement du rapporteur supprimant cet article (amendement n° 163). Article 35 Par coordination avec le nouvel article 420-1 (article 29 du projet de loi) qui autorise la constitution civile par télécopie et qui prévoit que la demande de restitution d'objets saisis ou de dommages-intérêts formulée pendant l'enquête auprès d'un officier de police judiciaire vaut constitution de partie civile lorsque l'action publique est mise en mouvement, les paragraphes I et II modifient les articles 420-2 et 460-1, qui font référence aux demandes de restitution ou de dommages-intérêts et aux constitutions de partie civile par lettre, afin d'y substituer un renvoi général aux dispositions de l'article 420-1. La Commission a adopté l'article 35 sans modification. Article 36 Le nouvel article 63-4 du code de procédure pénale issu de l'article 2 du projet de loi renforce l'information de l'avocat de la personne gardée dans le cadre d'une enquête de flagrance, en précisant notamment que les dispositions législatives sur la base desquelles la garde à vue est décidée lui sont communiquées (simple témoin ou personnes à l'encontre desquelles il existe des indices). Par parallélisme, l'article 6 modifie l'article 154 du code de procédure pénale relatif aux gardes à vue dans le cadre de commissions rogatoires afin de préciser que l'avocat est informé que son client est gardé à vue dans le cadre d'une commission rogatoire. La Commission a adopté l'article 36 sans modification. Article 37 Le nouvel article 82-2 du code de procédure pénale créé par l'article 4 du projet de loi permet aux parties de demander à ce que le transport sur les lieux, l'audition d'un témoin, d'une partie civile ou d'une personne mise en examen effectués sur leur demande soient réalisés en présence de leur avocat. Par parallélisme, l'article 37 modifie l'article 82 du même code relatif aux actes que peut requérir le procureur de la République, afin de préciser qu'il peut demander à assister à l'accomplissement de ces actes. En effet, si les articles 92 et 119 permettent déjà au procureur de la République de se transporter sur les lieux et d'assister aux interrogatoires et confrontations de la personne mise en examen et aux auditions de la partie civile, même s'il n'est pas à l'origine de ces actes, ils ne mentionnent pas le cas de l'audition d'un témoin. La Commission a adopté l'article 37 sans modification. Article 38 Le paragraphe I de l'article 38 modifie l'article 4 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante afin de permettre aux mineurs de 16 à 18 ans de bénéficier dès le début de la garde à vue d'un avocat. Rappelons qu'actuellement, cette présence n'est possible que pour les mineurs âgés de moins de seize ans. Les modalités de placement en détention provisoire des mineurs âgés de plus de treize ans prévues à l'article 11 de la même ordonnance sont également modifiées, afin de préciser que la détention provisoire sera désormais ordonnée par le juge de la détention provisoire saisi par le juge d'instruction ou le juge des enfants, et non plus directement par ces derniers (paragraphe II). Après avoir rejeté un amendement rédactionnel de M. Pierre Albertini, la Commission a adopté l'article 38 sans modification. Article 39 Cet article propose de repousser l'application des dispositions relatives au juge de la détention provisoire (section 1 du chapitre II du titre premier) et celles limitant les conditions ou la durée de la détention provisoire (section 2 du chapitre II du titre premier) au premier jour du quatrième mois suivant la publication de la loi au Journal officiel, afin de permettre aux tribunaux d'organiser la mise en place de ce nouveau juge et aux juges d'instruction de mettre à jour leurs dossiers de détention provisoire. La Commission a adopté l'article 39 sans modification. Article 40 L'objet de cet article est de rendre le projet de loi applicable aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte, qui sont régis par le principe de la spécialité législative. La Commission a adopté un amendement de précision du rapporteur tenant compte du nouveau statut de la Nouvelle-Calédonie (amendement n° 164). Elle a ensuite adopté l'article 40 ainsi modifié. La Commission a rejeté un amendement de M. Pierre Albertini modifiant l'intitulé du projet de loi. * * * La Commission a adopté l'ensemble du projet de loi ainsi modifié. * * * En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République vous demande d'adopter le projet de loi (n° 1079) renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes, modifié par les amendements figurant au tableau comparatif ci-après.
__________ N°1468.- Rapport de Mme Christine Lazerges (au nom de la commission des lois) sur le projet de loi (n° 1079) renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes.- Première partie : Introduction, auditions, examen des articles. () Rapport AN n° 1147, 26 mai 1970, page 7 () Dans l'arrêt IA c/France, la Cour indique ainsi « La persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d'avoir commis une infraction.....est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention, mais au bout d'un certain temps, elle ne suffit plus ; la cour doit alors établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté. Quand ils se révèlent « pertinents » et « suffisants », elle cherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté une « diligence particulière » à la poursuite de la procédure ». () Enfin, rappelons que la détention provisoire des mineurs obéit à des règles spécifiques, régies par l'article 11 de l'ordonnance du 2 février 1945 : elle n'est possible que lorsque le mineur a plus de 16 ans et est limitée à un mois renouvelable une fois si la peine encourue est inférieure à sept ans ou un an dans les autres cas. () En matière criminelle, la détention des mineurs est limitée à un an maximum entre 13 et 16 ans et à deux ans maximum au-delà. © Assemblée nationale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
