Document mis en distribution le 12 avril 2000 N° 2327 ______ ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 ONZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 6 avril 2000. RAPPORT FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES, DE L'ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU PLAN (1) PAR M. Éric BESSON, Député. -- TOME I EXAMEN DES ARTICLES (1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page. Politique économique.
La commission des finances, de l'économie générale et du plan est composée de : MM. Henri Emmanuelli, président ; Didier Migaud, rapporteur général ; Jean-Pierre Brard, Arthur Dehaine, Yves Tavernier, vice-présidents ; Pierre Bourguignon, Jean-Jacques Jegou, Michel Suchod, secrétaires ; MM. Jean-Pierre Abelin, Maurice Adevah-Poeuf, Philippe Auberger, François d'Aubert, Dominique Baert, Jean-Pierre Balligand, Gérard Bapt, François Baroin, Alain Barrau, Jacques Barrot, Christian Bergelin, Éric Besson, Alain Bocquet, Augustin Bonrepaux, Jean-Michel Boucheron, Michel Bouvard, Mme Nicole Bricq, MM. Christian Cabal, Jérôme Cahuzac, Thierry Carcenac, Gilles Carrez, Henry Chabert, Didier Chouat, Alain Claeys, Yves Cochet, Christian Cuvilliez, Jean-Pierre Delalande, Francis Delattre, Yves Deniaud, Michel Destot, Patrick Devedjian, Tony Dreyfus, Jean-Louis Dumont, Daniel Feurtet, Pierre Forgues, Gérard Fuchs, Gilbert Gantier, Jean de Gaulle, Hervé Gaymard, François Goulard, Jacques Guyard, Pierre Hériaud, Edmond Hervé, Jacques Heuclin, Jean-Louis Idiart, Mme Anne-Marie Idrac, MM. Michel Inchauspé, Jean-Pierre Kucheida, Marc Laffineur, Jean-Marie Le Guen, Maurice Ligot, François Loos, Alain Madelin, Mme Béatrice Marre, MM. Pierre Méhaignerie, Louis Mexandeau, Gilbert Mitterrand, Jean Rigal, Alain Rodet, José Rossi, Nicolas Sarkozy, Gérard Saumade, Philippe Séguin, Michel Suchod, Georges Tron, Jean Vila. INTRODUCTION 11 PREMIÈRE PARTIE : RÉGULATION FINANCIÈRE 15 TITRE PREMIER : DÉROULEMENT DES OFFRES PUBLIQUES D'ACHAT OU D'ÉCHANGE 23 Article premier (Article 356-1-4 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales) : Transmission des pactes d'actionnaires au Conseil des marchés financiers 23 Article 2 (Article 34 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières) : Obligation d'effectuer les offres publiques sur un marché réglementé 31 Après l'article 2 (Article 34 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières) : Obligation d'effectuer les offres publiques sur un marché réglementé 33 Article 3 (Article 3 de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 instituant une Commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse) : Rectification des informations financières 33 Après l'article 3 35 Article 4 (Articles L. 432-1 et L. 439-2 du code du travail) : Information du comité d'entreprise en cas d'offre publique 36 Article 5 (Article 33 de la loi du 2 juillet 1996) : Limitation dans le temps des procédures d'offre publique 41 TITRE II : POUVOIRS DES AUTORITÉS DE RÉGULATION 43 Chapitre premier : Dispositions relatives aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement 43 Article 6 Articles 15, 15-2 (nouveau), 19 et 45 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit et articles 12, 13-1 (nouveau), 15 et 15-1 (nouveau) de la loi du 2 juillet 1996) : Agréments et autorisations du CECEI et de la COB 43 Après l'article 6 45 Article 7 (Article 15 de la loi du 24 janvier 1984) : Information du gouverneur de la Banque de France 46 Article 8 (Articles 15 et 17 de la loi du 24 janvier 1984 et articles 14 et 15 de la loi du 2 juillet 1996) : Conditions requises pour diriger un établissement de crédit et une entreprise d'investissement 47 Chapitre II : Dispositions relatives aux entreprises d'assurance 48 Avant l'article 9 48 Article 9 (Articles L. 321-10 et 322-4 du code des assurances) : Agrément des sociétés d'assurance 49 Article 10 (Articles L.322-2, L. 321-10 et L. 310-18 du code des assurances) : Qualification des dirigeants d'entreprises d'assurance 52 Article 11 (Article L.322-4 du code des assurances) : Information du ministre de l'Économie et des Finances 53 Chapitre III : Dispositions communes 54 Avant l'article 12 54 Article 12 (Article 35 de la loi du 2 juillet 1996) : Saisine du tribunal de grande instance de Paris 54 Article 13 (Articles 31-2 et 49-1 (nouveaux) de la loi du 24 janvier 1984, L. 310-12-2 (nouveau) du code des assurances et 38 de la loi du 2 juillet 1996) : Contrôle parlementaire 56 Article additionnel après l'article 13 : Associations de micro-crédit 59 TITRE III : COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DES AUTORITÉS DE RÉGULATION 60 Chapitre premier : Dispositions relatives au comité des établissements et des entreprises d'investissement 60 Article 14 (Articles 31 et 29 de la loi du 24 janvier 1984) : Composition du comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement 60 Article 15 (Article 31-1 de la loi du 24 janvier 1984) : Levée du secret professionnel 61 Article 16 (Article 31 de la loi du 24 janvier 1984) : Règlement intérieur du CECEI 62 Chapitre II : Dispositions relatives à la Commission des opérations de bourse 63 Article 17 (Article 2 de l'ordonnance du 28 septembre 1967 instituant une commission des opérations de bourse) : Collège de la Commission des opérations de bourse 63 Article 18 (Article 2 bis de l'ordonnance du 28 septembre 1967 : Délégation de signature au sein de la Commission des opérations de Bourse 64 Articles additionnels après l'article 18 : Organisation des Banques populaires 65 Système de compensation et de résiliation des créances 65 Après l'article 18 68 TITRE IV : AMÉLIORATION DE LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT D'ARGENT PROVENANT D'ACTIVITÉS CRIMINELLES ORGANISÉES 67 Article 19 (Article premier de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux) : Extension de la liste des professions soumises aux dispositions de la loi « anti-blanchiment » 67 Article 20 (Article 3 de la loi du 12 juillet 1990) : Extension du champ de la déclaration de soupçon 75 Article additionnel après l'article 20 : Création du comité de liaison de lutte contre le blanchiment 84 Article 21 (Article 12 bis de la loi du 12 juillet 1990) : Sanctions à l'encontre des centres financiers extra-territoriaux 84 Article additionnel après l'article 21 : Rapport au Parlement sur les mesures prises à l'encontre des centres "off-shore" 88 Article 22 (Article 16 de la loi du 12 juillet 1990) : Moyens d'information de TRACFIN 88 Articles additionnels après l'article 22 : Informations sur les suites données aux déclarations de soupçon 92 Article 23 (Articles L. 310-12 et L. 322-2 du code des assurances) : Adaptation du code des assurances aux dispositions de lutte contre le blanchiment 92 Article additionnel après l'article 23 : Sanctions administratives 95 Article 24 (Article 4 de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil) : Obligation d'immatriculation au registre du commerce pour les sociétés créées avant 1978 95 Article 25 (Article 450-1 du code pénal) : Participation à une association de malfaiteurs 98 Article additionnel après l'article 25 : Charge de la preuve en matière de présomption de blanchiment 100 Article 26 (Articles 324-7 du code pénal et 706-30 du code de procédure pénale) : Sanction complémentaire en cas de condamnation pour blanchiment 102 Après l'article 26 104 DEUXIÈME PARTIE : RÉGULATION DE LA CONCURRENCE 105 TITRE PREMIER : MORALISATION DES PRATIQUES COMMERCIALES 111 Avant l'article 27 111 Articles additionnels avant l'article 27 : Incidence des créations d'emplois sur les ententes 111 Prix des carburants 111 Avant l'article 27 111 Article 27 (Article 28 de l'ordonnance 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence) : Encadrement des annonces de prix promotionnels sur les fruits et légumes frais 112 Article additionnel après l'article 27 : Fixation de prix minimum d'achat aux producteurs de fruits et légumes 115 Après l'article 27 115 Article additionnel après l'article 27 : Rémunération des services spécifiques 115 Après l'article 27 116 Article 28 (Article 30 de l'ordonnance du 1er décembre 1986) : Commission des pratiques commerciales et des relations contractuelles 116 Article additionnel après l'article 28 : Commission d'examen des pratiques commerciales 120 Après l'article 28 120 Article additionnel après l'article 28 : Paiement des fournisseurs 120 Article 29 (Article 36 de l'ordonnance du 1er décembre 1986) : Précision de la notion de pratiques abusives, nullité de certaines clauses illicites et extension des prérogatives des pouvoirs publics devant les juridictions 120 Article 30 (Article L. 214-1 du code de la consommation) : Étiquetage et présentation des produits 130 Après l'article 30 131 Articles additionnels après l'article 30 : Modes de production raisonnés 131 Article 31 (Articles L. 112-3 et L. 112-4 (nouveaux) du code de la consommation et L. 641-1-2 (nouveau) du code rural) : Utilisation simultanée d'une marque commerciale et d'un signe d'identification 131 Après l'article 31 : 133 Articles additionnels après l'article 31 : Produits vendus sous marques de distributeurs 134 Protection de dénominations de chocolat 134 Prix de revente 134 Coopératives de commerçants 134 Dénomination produits "fermiers" 134 TITRE II : LUTTE CONTRE LES PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES 135 Chapitre premier : Procédure devant le Conseil de la concurrence 135 Article 32 (Article 4 de l'ordonnance du 1er décembre 1986) : Attributions du ou des rapporteurs généraux adjoints 136 Articles additionnels après l'article 32 : Prohibition d'exploitation abusive de la dépendance économique 137 Sanctions des pratiques anti-concurrentielles 138 Article 33 (Article 21 de l'ordonnance du 1er décembre 1986) : Notification des griefs et délais de consultation 138 Article 34 (Article 22 de l'ordonnance du 1er décembre 1986) : Procédure simplifiée 140 Article 35 (Article 23 de l'ordonnance du 1er décembre 1986) : Protection du secret des affaires 142 Article 36 (Article 24-1 (nouveau) de l'ordonnance du 1er décembre 1986) : Recours à l'expertise 143 Après l'article 36 145 Chapitre II : Avis et décisions du Conseil de la concurrence Article 37 (Article 12 de l'ordonnance du 1er décembre 1986) : Mesures conservatoires 145 Article 38 (Article 13 de l'ordonnance du 1er décembre 1986) : Sanctions prononcées par le Conseil de la concurrence 146 Après l'article 38 155 Article additionnel après l'article 38 : Absence du rapporteur général au délibéré du Conseil de la concurrence 156 Article 39 (Article 19 de l'ordonnance du 1er décembre 1986) : Conditions de recevabilité des saisines et de continuation des procédures 156 Article 40 (Article 20 de l'ordonnance du 1er décembre 1986) : Non-lieu et classement sans suite 158 Après l'article 40 160 Chapitre III : Pouvoirs et moyens d'enquête 161 Article 41 (Article 47 de l'ordonnance du 1er décembre 1986) : Pouvoirs des enquêteurs lors des enquêtes simples 161 Article 42 (Article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986) : Visites et saisies 162 Article additionnel après l'article 42 : Restitution des pièces relatives à des procédures anciennes 166 Article 43 (Article 50 de l'ordonnance du 1er décembre 1986) : Mise à disposition de fonctionnaires affectés au Conseil de la concurrence 166 Article 44 (Article 45-1 (nouveau) de l'ordonnance du 1er décembre 1986) : Compétence territoriale des fonctionnaires habilités à effectuer des visites 167 Chapitre IV : Dispositions diverses 169 Article 45 (Article 26-1 (nouveau) de l'ordonnance du 1er décembre 1986) : Spécialisation des tribunaux en matière de litiges relatifs au droit de la concurrence 169 Article 46 (Article 53-1 (nouveau) de l'ordonnance du 1er décembre 1986) : Coopération entre le Conseil de la concurrence et les autorités de la concurrence étrangères 171 Article 47 (Article 56 bis de l'ordonnance du 1er décembre 1986) : Pouvoirs d'enquête de l'administration en droit communautaire de la concurrence 173 Après l'article 47 175 TITRE III : CONTRÔLE DES CONCENTRATIONS 176 Article 48 (Article 38 de l'ordonnance du 1er décembre 1986) : Définition des opérations de concentration 176 Article 49 (Article 39 de l'ordonnance du 1er décembre 1986) : Opérations de concentration soumises à contrôle ministériel 178 Article 50 (Article 40 de l'ordonnance du 1er décembre 1986) : Obligation de notifier une opération de concentration 182 Article 51 (Article 41 de l'ordonnance du 1er décembre 1986) : Caractère suspensif de la notification 185 Article 52 (Article 42 de l'ordonnance du 1er décembre 1986) : Examen par le ministre de l'opération notifiée 186 Article 53 (Articles 42-1, 42-2 et 42-3 (nouveaux) de l'ordonnance du 1er décembre 1986) : Procédure en cas de saisine du Conseil de la concurrence et sanctions administratives 190 (Article 42-1 de l'ordonnance du 1er décembre 1986) : Procédure devant le Conseil de la concurrence 190 (Article 42-2 de l'ordonnance du 1er décembre 1986) : Décision des ministres concernés 193 (Article 42-3 de l'ordonnance du 1er décembre 1986) : Sanctions administratives 196 Article 54 (Article 44 de l'ordonnance du 1er décembre 1986) : Conciliation du secret des affaires avec l'audition de tiers et la publicité des décisions 198 Article additionnel après l'article 54 : Possibilité pour le comité d'entreprise d'obtenir une assistance technique 199 TROISIÈME PARTIE : RÉGULATION DE L'ENTREPRISE 201 TITRE PREMIER : DROIT DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES 205 Article additionnel avant l'article 55 (Article 97-1-1 (nouveau) de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales) : Droits des comités d'entreprise 205 Article 55 : Objet des articles du titre premier 205 Chapitre premier : Équilibre des pouvoirs et fonctionnement des organes dirigeants 206 Avant l'article 56 206 Articles additionnels avant l'article 56 (Articles 89, 129 et 152 de la loi du 24 juillet 1956) : Réduction du nombre maximal des membres de conseil d'administration et de conseil de surveillance 207 Adaptation de l'intitulé d'une sous-section de la loi du 24 juillet 1966 207 Article 56 (Articles 98 et 113 de la loi du 24 juillet 1966) : Rôles du conseil d'administration et de son président 207 Article 57 (Articles 115, 115-1, 116 et 117 de la loi du 24 juillet 1966) : Rôles et statuts du directeur général et des directeurs généraux délégués 213 Article 58 (Article 121 de la loi du 24 juillet 1966) : Conditions de révocation des membres du directoire ou du directeur général unique 223 Article 59 (Articles 100 et 139 de la loi du 24 juillet 1966) : Possibilité pour le conseil d'administration et le conseil de surveillance de prendre certaines décisions par « visioconférence » 225 Chapitre II : Limitation du cumul des mandats 228 Article 60 (Articles 92, 111, 127, 136 et 151 de la loi du 24 juillet 1966) : Limitation du cumul des mandats sociaux 228 Chapitre III : Prévention des conflits d'intérêts 236 Article 61 (Articles 101, 143, 262-11, 102, 144, 103, 145 et 262-12 de la loi du 24 juillet 1966) : Extension du régime d'autorisation des conventions entre les sociétés et leurs dirigeants 236 Article additionnel après l'article 61 (Article 29 ter de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises) : Régime des conventions entre les personnes morales et leurs administrateurs 241 Chapitre IV : Droits des actionnaires 242 Article 62 (Articles 225, 226-1, 227 et 226 de la loi du 24 juillet 1966) : Extension des droits des actionnaires minoritaires 242 Article 63 (Articles 161-1 et 165 de la loi du 24 juillet 1966) : Participation aux assemblées générales 248 Article 64 (Article 157-3 (nouveau) de la loi du 24 juillet 1966) : Information des actionnaires sur les rémunérations, avantages, mandats et fonctions des mandataires sociaux 255 Après l'article 64 269 Chapitre V : Identification des actionnaires 270 Article 65 (Articles 161-2 (nouveau), 263, 263-2, 263-3 à 263-6 (nouveau) et 356-1 de la loi du 24 juillet 1966) : Représentation et identification des actionnaires non résidents 270 Chapitre VI : Dispositions relatives au contrôle 277 Article 66 (Article 355-1 de la loi du 24 juillet 1966) : Notion de contrôle conjoint exercé dans le cadre d'une action de concert 277 Chapitre VII : Dispositions relatives aux injonctions de faire 281 Article 67 (Article 493 de la loi du 24 juillet 1966) : Recours aux injonctions de faire et demandes en référé 281 Article 68 (Articles 1843-3 du code civil et 2 bis (nouveau) de l'ordonnance n° 58-1352 du 27 décembre 1958 réprimant certaines actions en matière de registre du commerce et des sociétés) : Injonctions de faire 283 Chapitre VIII : Dispositions diverses et transitoires 286 Article 69 (Article 464-2 de la loi du 24 juillet 1966) Sanction des comportements fautifs des dirigeants d'une société par actions simplifiée 286 Article additionnel après l'article 69 : Délai d'application de la réduction du nombre maximal des membres de conseil d'administration et de conseil de surveillance 289 Article 70 : Délais d'application des dispositions relatives aux cumuls de mandats et au mandat de directeur général délégué 289 Après l'article 70 292 Article additionnel après l'article 70 (Articles n° 102, 208-1, 208-3 et 208-8 de la loi du 24 juillet 1966 et article L. 443-6 du code du travail) : Dispositions relatives aux options sur actions 292 Après l'article 70 292 TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU SECTEUR PUBLIC 294 Avant l'article 71 : Représentation des usagers au conseil d'administration ou de surveillance des entreprises assurant une mission de service public 294 Article 71 : Élargissement de la représentation de l'État aux entreprises privées dont il est indirectement actionnaire 294 Article 72 : Objet et régime juridique du contrat d'entreprise 303 Article 73 (Articles 4 et 7 de la loi n°83-675 du 26 juillet 1983 relative à la modernisation du secteur public) : Extension du champ d'application des contrats d'entreprise 306 Après l'article 73 308 Article 74 (Article 24 de la loi n° 93-923 du 19 juillet 1993) : Information du Parlement sur la situation économique et financière du secteur public et sur le transfert au secteur privé d'entreprises publiques 308 Après l'article 74 311 Depuis son adoption par le Conseil des ministres, le présent projet de loi suscite un intérêt croissant, qui contraste avec les reproches souvent contradictoires qui lui ont parfois été adressés. Il a fréquemment été dit que ce texte avait un contenu normatif faible, se contentait de retoucher sans véritablement aborder le fond, esquivait nombre de problèmes rencontrés actuellement par les secteurs de la distribution, par les concentrations économiques ou, d'une manière générale, par les entreprises. Il a aussi été reproché à ce texte de ne contenir que des dispositions techniques de faible importance, et d'être une sorte de projet portant « diverses dispositions » et non pas un texte cohérent aux objectifs clairs. En réalité, ces reproches contrastent, fortement, avec l'intérêt que le projet suscite. Le nombre d'amendements examinés par la commission des Finances, de l'Économie générale et du Plan, la diversité et l'importance des sujets qu'ils abordent, l'actualité des questions soulevées, témoignent en fait du bien fondé du dépôt de ce projet de loi, sur lequel le travail en commission a été particulièrement important. Le présent projet de loi correspond en effet à un triple objectif : - de modernisation de l'économie et de la gestion des entreprises ; - de transparence ; - et d'équilibre entre les acteurs économiques. Même s'il touche à des secteurs aussi différents que les prix des fruits et légumes à la consommation, l'agrément des entreprises d'assurance, la réglementation des offres publiques d'achat, la séparation des fonctions de président de conseil d'administration et de directeur général, la limitation du cumul de mandats des mandataires sociaux, la lutte contre le blanchiment des capitaux illégaux, c'est à chaque fois ce triple objectif qui se retrouve dans ses dispositions. Il n'est point besoin d'insister sur l'actualité récente pour montrer à quel point ce texte correspond à une nécessité profonde. Le rachat d'une grande banque française, le Crédit commercial de France, dont la capitalisation boursière représente plus de 11 milliards d'euros, par le groupe britannique HSBC, qui a une taille neuf fois plus importante, pose la question, cruciale, de l'internationalisation du système bancaire. Mais les affaires, plus anciennes, BNP-Société générale, Coca-Cola-Orangina, Carrefour-Promodès ou Totalfina-Elf posent la question, plus large, de la réglementation générale des offres publiques d'achat ou des offres publiques d'échange, et notamment de l'information du public, des actionnaires et celle des salariés des « sociétés cibles ». Contrairement, donc, aux critiques qui font grief à ce projet de ne comporter que des dispositions de droit évanescentes ou dispersées, le projet comporte au contraire des dispositions dont l'intérêt est évident et qui poursuivent toujours les mêmes buts. En ce qui concerne la modernisation, comment ne pas dire que la limitation du nombre de mandats des mandataires sociaux et l'affirmation du principe de séparation entre les présidents et les directeurs généraux des sociétés correspondent à une réelle novation dans notre droit, de nature à mieux identifier les prises de décision ? Les articles 56, 57 et 60 du texte, qui prévoient une telle limitation, ne peuvent pour autant être taxés d'interventionnisme des pouvoirs publics : ils laissent des options très ouvertes et très générales aux acteurs économiques. L'État n'entend pas régir la vie des entreprises - et d'ailleurs cette critique n'a jamais été sérieusement formulée - mais souhaite aboutir à une meilleure gestion des sociétés, en distinguant et en séparant les responsabilités de leurs organes dirigeants. La notion de régulation exclut par elle-même une trop forte réglementation. Poursuivant le même objectif, la possibilité de voter dans les assemblées générales ou dans les conseils d'administration en utilisant des moyens modernes de communication ne peut que faciliter la prise de décisions dans les entreprises, même si cette partie du projet peut soulever quelques problèmes techniques, qui, à la réflexion, ne paraissent nullement insurmontables. S'agissant de la transparence, il faut relever que l'article 4 donne aux salariés un moyen d'être informés, au moment d'une offre publique d'achat, des intentions du repreneur. L'article 64, pour sa part, impose une transparence en matière de rémunérations des mandataires sociaux. Sur ce point, particulièrement médiatique, notre pays ne fait qu'harmoniser sa pratique avec celle de nombreux pays européens, qui depuis longtemps pratiquent une telle publicité qui, en France, a encore un parfum de scandale. Le débat parlementaire permettra de clarifier la question du périmètre de cette publicité. Par ailleurs, même si certains jugeront le dispositif de l'article premier technique, votre Rapporteur insiste, quant à lui, sur l'intérêt que peut présenter la publication de pactes d'actionnaires. Dans le même sens, les articles 19 à 22 relatifs au blanchiment des capitaux correspondent à la fois à un objectif défendu par l'ensemble des pays européens, puisqu'ils anticipent la prochaine directive communautaire, et à une indispensable moralisation de certains pratiques. Il est étonnant que certaines professions ne souhaitent pas entrer dans le système TRACFIN, alors même que chacun a intérêt au bon fonctionnement de l'ensemble de ce système, qui garantit qu'aucun pays européen ne laisse place au soupçon quant à l'origine des capitaux. Il est donc de l'intérêt même des professions, bancaires ou non, de participer à ce système. Enfin, la question de l'équilibre entre les acteurs économiques est une constante de ce texte. Celui-ci est notamment recherché par les articles relatifs aux prix des fruits et légumes. Il n'est pas exagéré d'affirmer que les centrales d'achat et les grandes surfaces sont dans une position tellement dominante qu'elles peuvent conduire des petits producteurs à la ruine pure et simple. Sur ce plan, votre Rapporteur juge fermement que le projet ne va sans doute pas assez loin, tant est fort le déséquilibre entre distributeurs et producteurs. Répondent au même souci de rééquilibrage économique les dispositions concernant le droit de la concurrence, et notamment le rôle du Conseil de la concurrence, dont le texte renforce la capacité d'action et de sanction. Votre Rapporteur, tout en étant sensible à la nécessité de cette actualisation, souhaite, pour sa part, que ces moyens n'altèrent en aucun cas la responsabilité politique en matière de contrôle des concentrations économiques. Il incombe, en effet, aux pouvoirs publics, responsables politiques, et non à une autorité administrative indépendante, si incontestable soit-elle, d'assumer les décisions politiques dont ils répondent devant l'opinion publique. Or, sans remettre en cause le rôle du Conseil de la concurrence, il convient, d'une part, de s'interroger sur les procédures qu'il applique, notamment sur le fait que le projet de loi n'harmonise pas celles-ci avec les exigences les plus récentes de la jurisprudence communautaire et des règles du procès équitable telles qu'elles figurent à l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, et, d'autre part, sur la gradation et l'assiette des sanctions que celui-ci peut infliger. La récente condamnation de Microsoft aux États-Unis montre, ici encore, à quel point notre pays est en retard par rapport aux pays étrangers. Il reste que votre Rapporteur souligne la nécessité, vitale, de réaffirmer les compétences des pouvoirs publics en matière de contrôle de concentrations d'entreprises, qu'elles soient ou non bancaires. Poursuivant ce même souci de rééquilibrage, il faut mentionner l'article 62, qui vise à mieux préserver les droits des actionnaires minoritaires dans les sociétés ou encore, à ce titre, le contrôle accru des opérations de concentration (articles 48 à 54). Inscrit dans un contexte de libre circulation des capitaux, de multiplication des échanges, de mondialisation de la vie des entreprises, le présent texte correspond à la fois à la prise en compte, réaliste, de cette situation et à la nécessité de mieux garantir les droits des salariés, des producteurs, des consommateurs ou des actionnaires minoritaires. Cet objectif de modernisation n'est nullement contraire avec celui du rééquilibrage des rapports de force économiques. Faut-il rappeler qu'entre le faible et le fort, c'est l'absence de réglementation qui conduit au déséquilibre, et c'est la loi qui protège ? RÉGULATION FINANCIÈRE La première partie du projet de loi est relative au déroulement des offres publiques d'achat ou d'échange (titre Ier), aux pouvoirs des autorités de régulation (titre II), à la composition et au fonctionnement desdites autorités (titre III) et à la lutte contre le blanchiment d'argent provenant d'activités criminelles organisées (titre IV). Les titres Ier à III visent à réformer certaines pratiques sur les marchés financiers. Il s'agit essentiellement d'adaptations techniques pour remédier à des dysfonctionnements constatés lors des offres publiques de la BNP sur la Société générale et Paribas et de Totalfina sur Elf. En effet, les lois n° 89-531 du 2 août 1989, n° 96-597 du 2 juillet 1996 et n° 99-532 du 25 juin 1999 ont modernisé les marchés français et établi un cadre juridique permettant aux opérateurs de soutenir la concurrence des places internationales. Interrogés par votre Rapporteur, les professionnels estiment que les modalités de fonctionnement des marchés sont satisfaisantes, offres publiques comprises, et ne nécessitent que des modifications à la marge. Le Gouvernement, comme le Parlement, peuvent accepter cette analyse, mais ne peuvent toutefois se contenter de ces seuls aménagements alors que les processus de concentrations, de fusions et d'acquisitions mettent en jeu l'existence de millions de salariés. La novation politique du projet concerne l'intervention des salariés dans les procédures d'offres publiques. La première préoccupation des autorités de marché - Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement (CECEI), Conseil des marchés financiers (CMF) et Commission des opérations de bourse (COB) - est d'assurer une totale transparence du déroulement des offres. Aussi le projet prévoit-il la publicité systématique des pactes d'actionnaires concernant une société cotée à un marché réglementé, dès lors que ce pacte porte sur au moins 0,5 % du capital ou des droits de vote. L'existence de tels pactes - par nature confidentiels - altère la sincérité des offres et cet archaïsme du marché français doit être corrigé, sans limitation dans le temps. L'ancienneté de certains pactes, leurs conséquences éventuelles sur les successions ou les difficultés à les recenser ne peuvent constituer des arguments à l'encontre du dispositif, compte tenu de son importance pour l'image de la place de Paris. Le pacte Paribas/Axa/Peugeot/Pernod est l'exemple même d'une convention (fort ancienne) qu'il convenait de rendre publique devant l'offre d'achat de la Société générale par la BNP. Corollaire de la transparence, la véracité des notes adressées à la COB et des publicités destinées aux épargnants sont indispensables au fonctionnement harmonieux d'un marché. La chute récente du titre " World on line " à la bourse d'Amsterdam est l'exemple d'une réaction des investisseurs à l'encontre d'une information volontairement incomplète. L'offre publique de la BNP sur la Société générale a donné lieu à des publicités fondées sur des sondages erronés et des affabulations sur la création (ou la destruction) de valeurs. La COB a dû procéder à des rectifications dans l'urgence. Bien que ces événements présentent le caractère d'un épiphénomène, le législateur est placé devant le choix d'interdire la publicité durant une période d'offre (ce qui était récemment la conception américaine) ou de l'autoriser, dès lors qu'elle n'est pas trompeuse. L'article 3 du présent projet constitue un équilibre, en permettant à la COB de rectifier de sa propre initiative, et aux frais des entreprises concernées, les informations qu'elle juge douteuses. Les modifications rapides d'actionnariat au sein des sociétés conduisent en outre à instaurer de nouvelles conditions préalables à la délivrance de l'agrément aux établissements financiers et aux entreprises d'investissement. Le titre II tend à ajouter aux critères objectifs déjà prévus par les lois de 1984 et 1996 des critères plus subjectifs, par le biais desquels la COB et le CECEI pourraient introduire des éléments circonstanciels dans leur analyse, tels qu'un franchissement de seuil par un actionnaire de référence ou un changement de dirigeants à la suite d'une offre publique d'achat. De même, les organismes de tutelle des marchés pourront désormais apprécier la compétence des dirigeants, outre leur honorabilité. Les articles 9 et 10 étendent ce dispositif aux sociétés d'assurance, renforçant ainsi le pouvoir du ministre chargé de l'économie et de la Commission de contrôle des assurances. Les titres II et III contiennent, en outre, diverses mesures permettant aux autorités de marché de travailler dans une plus grande sécurité juridique. Les conditions de délégation de pouvoirs et de signature au sein de la COB et du CMF sont précisées afin de permettre aux parties à des offres publiques de disposer d'une base législative solide et d'éviter que des vices de procédure ralentissent le déroulement desdites offres. S'agissant de la partie relative aux sociétés d'assurance (articles 9 à 11), le présent projet vise à renforcer, à la marge, le dispositif de prévention s'appliquant à ces sociétés. La loi n° 99-532 du 25 juin 1999 sur l'épargne et la sécurité financière a amélioré les garanties offertes aux assurés en instituant un fonds de garantie en matière d'assurance des personnes, étroitement inspiré du principe du fonds de garantie des dépôts en matière bancaire. Le fonds de garantie des assurés joue un rôle essentiellement curatif et ne peut intervenir à titre préventif. En conséquence, il est nécessaire d'apporter quelques aménagements visant à améliorer la prévention et la transparence dans le secteur des assurances. On rappellera à cet égard que ce secteur opère déjà dans le respect d'une série de dispositions contenues dans le code des assurances, et sous le contrôle de la Commission de contrôle des assurances. C'est ainsi que le code des assurances impose aux sociétés d'assurance un certain nombre de règles prudentielles et d'obligations de provisionnement destinées à garantir le respect des engagements qu'elles prennent à l'égard de leurs assurés. De même, ce code détaille la réglementation applicable en cas d'insolvabilité d'une société d'assurance, procédure qui n'avait jamais été mise en _uvre jusqu'à ces dernières années. Jusqu'à présent, la Commission de contrôle des assurances est en effet parvenue à faire reprendre les engagements des assureurs en difficulté par d'autres entreprises d'assurance. La tâche a été facilitée par le souci de la profession de ne pas ternir la réputation du secteur en laissant une entreprise être liquidée. Il est vrai que les difficultés en matière d'assurance-vie sont restées rarissimes. Depuis qu'un contrôle spécifique des assurances a été mis en place dans les années 1930, on ne relève que deux cas : Prévoyance Sociale Vie, dont le portefeuille a été repris en 1996, sans perte pour les assurés, et, tout récemment, Europavie. Ce dossier est le premier qui a vu la mise en _uvre effective de la procédure de liquidation.
Le dossier Europavie était à l'évidence à l'origine des dispositions de la loi du 25 juin 1999 précitée, relatives à la garantie des assurés. Ce dossier est à nouveau à l'origine des articles 9 à 11 du présent projet de loi, qui concernent l'agrément préalable à l'exercice des activités d'assurance, l'honorabilité et la qualification professionnelle des dirigeants et les opérations de prise de contrôle d'une société d'assurance. Le projet de loi vise enfin à rappeler que le libre jeu des forces du marché ne saurait ignorer le rôle régulateur des autorités politiques et les droits des salariés. Il introduit en conséquence l'obligation pour les émetteurs d'offre publique dans le secteur bancaire et dans celui des assurances d'en informer préalablement les autorités de tutelle, et surtout, institue un droit nouveau pour les salariés : être associés aux offres publiques d'achat et d'échange (article 4 du projet de loi). Le code du travail prévoit actuellement un simple droit à l'information en cas d'offre publique. Le faible intérêt de ce dispositif explique sans doute la rareté de sa mise en _uvre puisque le seul cas recensé est lié à l'offre publique Strafor/Facom. L'article 4 du projet de loi instaure une obligation de délai pour informer les salariés ainsi que des sanctions en cas de méconnaissance des nouvelles dispositions. Ces dernières ne seront fondamentalement novatrices que si les syndicats de salariés savent en saisir l'intérêt, en demandant systématiquement leur application. L'audition d'un chef d'entreprise qui souhaite procéder à un achat ne présente pas un caractère purement symbolique. Elle oblige l'émetteur de l'offre à rencontrer ses futurs salariés, à connaître leur état d'esprit, à présenter un projet économique et ses conséquences sociales. Sans doute, le texte gagnerait à être plus précis quant au contenu des informations alors communiquées. La limite de ce dispositif est inhérente à la nature même des offres publiques. L'émetteur de l'offre n'est pas encore le détenteur du capital qu'il souhaite acquérir et n'a, en conséquence, aucun pouvoir de gestion. Les propos qu'il tient aux salariés ne l'engagent qu'à proportion des informations dont il dispose. Il reste à déterminer si le législateur doit se contenter d'un droit à l'information renforcé en faveur des salariés ou si l'on doit ouvrir un véritable droit d'influence des salariés sur les offres publiques. La logique des offres publiques - celle d'une confrontation entre détenteurs de capitaux - écarte la seconde proposition, sauf à opter délibérément pour une économie où la cogestion serait de règle. Mais la première n'est guère satisfaisante dans une société où la garantie contre les risques systémiques conduit à « socialiser les risques » alors que les profits demeurent d'ordre privé. Enjeu crucial de nos sociétés, l'emploi ne peut être une variable d'ajustement dans le cadre des fusions et acquisitions, sans que les salariés ne puissent disposer d'un droit d'alerte. Les réflexions préalables à l'adoption du présent projet de loi ont mis en lumière la nécessité de centrer l'intervention du chef d'entreprise, entendu par le comité d'entreprise, sur l'emploi. Il ne peut s'agir de garanties sur l'emploi - qui se heurteraient à la liberté de gestion des entreprises. Mais rien n'empêche la loi de contraindre le chef d'une entreprise émettrice à présenter un projet social comportant au minimum ses intentions liminaires sur l'emploi. Le titre IV vise à renforcer le dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux, mis en place par la loi du 12 juillet 1990. Deux préoccupations principales animent les dispositions qu'il contient. D'une part, il conforte ce dispositif dont le caractère innovant avait été fortement souligné, lors de son adoption. La loi de 1990 repose, en effet, sur l'implication des professions les plus susceptibles d'être confrontées à des opérations de blanchiment en instituant des obligations de vigilance particulières sur ces opérations ainsi qu'une obligation de déclaration à un service administratif spécifique, TRACFIN, en cas de soupçon. L'équilibre qu'elle instaure dépend, avant tout, de la coopération entre ces professions, dites « sensibles » ou « vulnérables » et les autorités compétentes en matière de blanchiment, dans le but de détecter et de prévenir des montages frauduleux. L'originalité de ce dispositif a pu susciter certaines réserves sur son caractère opérationnel. Le présent projet de loi vient démontrer, dix ans après, que ces réticences n'étaient pas fondées, mêmes si certaines améliorations restent souhaitables. Il reconnaît implicitement l'intérêt de la loi du 12 juillet 1990, que le développement des méthodes de blanchiment invite à renforcer. Estimer l'impact du blanchiment d'argent n'est, certes, pas un exercice aisé : il est, en effet, difficile de mesurer économiquement l'ampleur des activités illégales, sans compter que les produits des activités criminelles sont rarement blanchis dans le pays où ils ont été réalisés. Mais, cette difficulté peut, a contrario, être interprétée comme une preuve supplémentaire de l'efficacité des systèmes de prévention, de détection et de répression du blanchiment d'argent, qui ont progressivement été mis en place dans la plupart des pays occidentaux... Une estimation réalisée par le Fonds monétaire international évalue, cependant, l'ampleur du blanchiment à un montant supérieur à 1.000 milliards d'euros, représentant entre 2 et 5 % du PIB mondial, chaque année. Malgré son imprécision, ce chiffre ne peut qu'encourager à se mobiliser davantage en faveur de la lutte contre le blanchiment des capitaux. D'autre part, le projet de loi s'inscrit dans un contexte international, marqué par une globalisation financière croissante, qui incite à prendre en compte les menaces que le blanchiment fait peser sur la stabilité du système financier. Cette préoccupation est à l'origine de la création du Groupe d'action financière internationale contre le blanchiment d'argent (GAFI), lors du Sommet du G7 de 1989, chargé d'étudier et de proposer des mesures pour lutter contre le blanchiment d'argent. Auteur de quarante recommandations d'actions qui ont joué un rôle déterminant dans la prise de conscience de l'ampleur du phénomène et de la nécessité d'instituer des mesures permettant de le combattre, le GAFI a également examiné les problèmes posés par les pays et territoires qui coopèrent insuffisamment dans ce domaine, en particulier, les centres financiers extraterritoriaux, communément appelés « centres financiers offshore ». Dans ce cadre, il a définit une série de critères permettant d'identifier ces pays, en vue de faciliter l'application de mesures propres à les convaincre ou les contraindre de modifier leurs règles et pratiques dommageables pour la lutte contre la délinquance financière. Cette mobilisation internationale s'accompagne, par ailleurs, d'une réflexion au niveau des États membres de l'Union européenne, qui devrait prochainement aboutir à une modification de la directive du 10 juin 1991 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux. Le titre IV est très directement inspiré par l'ensemble de ces préoccupations. Dans le but d'adapter le système mis en place par la loi du 12 juillet 1990 à l'évolution des méthodes de blanchiment, son article 19 élargit le champ des obligations déclaratives découlant de cette loi à de nouvelles professions, jugées vulnérables en matière de blanchiment. Cette extension représente une première étape qu'il conviendra, sans aucun doute, de prolonger à l'issue de l'adoption de la directive modificative. Surtout, le présent projet de loi prévoit des mesures spécifiques à l'encontre des centres financiers extra-territoriaux afin de protéger l'efficacité du système de prévention et de lutte contre le blanchiment : les opérations réalisées avec ces centres devront être signalées à TRACFIN et pourront, éventuellement, être soumises à des conditions spécifiques, voire interdites, en cas d'absence persistante de coopération dans la lutte contre le blanchiment. Le titre IV a également pour objectif de renforcer les moyens d'information de TRACFIN, chargé de recueillir et d'analyser les déclarations de soupçon, transmises par les organismes et personnes soumis à la loi du 12 juillet 1990. Il pourra, ainsi, recevoir des éléments d'information complémentaires des administrations publiques, qui lui permettront de mieux apprécier les déclarations qu'il doit étudier. Enfin, les articles 24 et 25, inclus dans ce titre, renforcent la portée des sanctions applicables en cas de blanchiment, en permettant, d'une part, d'incriminer une association de malfaiteurs « en col blanc », et, d'autre part, de recourir à la saisie et à la confiscation des biens des personnes condamnées pour blanchiment, même lorsque le blanchiment ne provient pas du trafic de stupéfiants, comme c'est le cas actuellement. En définitive, ces dispositions devraient contribuer à renforcer sensiblement la lutte contre le blanchiment des capitaux. Pour autant, le chantier reste ouvert, dans la perspective de l'adoption de la directive modificative sur la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux. DÉROULEMENT DES OFFRES PUBLIQUES D'ACHAT OU D'ÉCHANGE (Article 356-1-4 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 Transmission des pactes d'actionnaires Le présent article étend l'obligation de transmettre au Conseil des marchés financiers (CMF) l'ensemble des clauses des pactes qui comportent des conditions préférentielles d'acquisition ou de cession d'actions sur un marché réglementé. 1.- Le pacte d'actionnaires : un acte contractuel confidentiel Le pacte d'actionnaires est un contrat signé par tous les actionnaires d'une société ou par certains d'entre eux. Le contenu de ce type de contrat n'est pas incorporé dans les statuts d'une société et a généralement pour objet de déterminer : - les modalités et conditions d'acquisition et de perte de la qualité d'actionnaire ; - les droits et obligations attachés à cette qualité ; - les règles d'organisation et de fonctionnement de la société ; - les modalités de participation des actionnaires à la gestion de la société. Ce contrat est généralement destiné à demeurer confidentiel. Il n'est donc pas porté à la connaissance des tiers non signataires. Le contenu d'un pacte d'actionnaires est très variable, selon les circonstances. Il peut être limité au règlement d'un point particulier. Il s'agira, par exemple, de la stipulation d'une clause de préemption par laquelle tout actionnaire souhaitant céder des actions s'oblige à en proposer prioritairement l'acquisition aux autres actionnaires ou à certains d'entre eux selon une procédure déterminée (clauses d'agrément et de préemption). Le pacte peut également stipuler l'obligation, pour l'actionnaire qui cède ses actions, de proposer aux autres actionnaires de les céder aux mêmes conditions. Deux motifs expliquent le succès des pactes d'actionnaires : - La liberté contractuelle : la loi du 24 juillet 1966 présente la caractéristique d'insérer les relations entre actionnaires et le fonctionnement de la société dans un cadre de règles souvent impératives, dont la rigidité est peu compatible avec la souplesse nécessaire au monde des affaires. Le pacte d'actionnaires constitue en quelque sorte une forme de réponse à cette rigidité. - La discrétion : la caractéristique d'un pacte d'actionnaires est, sauf exception, de ne pas être publié. En cela il se distingue des statuts d'une société qui doivent être déposés au greffe du tribunal où toute personne peut en prendre connaissance. Le pacte permet de conserver entre ses seuls signataires le secret de ses dispositions. La liberté contractuelle qui caractérise le pacte d'actionnaires rend difficile l'établissement d'une typologie de ces pactes. L'objet le plus fréquent vise les conditions d'acquisition, de détention ou de cession des actions, ou les conditions d'exercice du pouvoir au sein d'une société. - Clause d'acquisition conjointe : par une telle clause, un ou plusieurs actionnaires s'obligent à proposer à leurs cocontractants d'acquérir avec eux, dans des proportions déterminées par contrat, toute quantité d'actions qu'ils auraient la possibilité d'acquérir. - Clause de non-acquisition : ce contrat (également appelé clause de non-agression) engage les cosignataires à ne pas modifier à la hausse leur pourcentage initial de détention des actions et des droits de vote d'une société. Ils peuvent également s'engager à ne pas acquérir d'actions les amenant à dépasser certains seuils : une minorité de blocage, un contrôle majoritaire... - Clause d'inaliénabilité : chacun des signataires s'interdit d'aliéner ses actions. L'objectif est d'assurer une certaine stabilité dans la gestion des affaires sociales. Or, la libre disposition de son bien par le propriétaire est un principe fondamental du droit français (article 544 du code civil). Ce principe est applicable aux actions. La clause d'un pacte d'actionnaires qui interdirait toute aliénation des actions est nulle et ne souffre d'exception que si elle est temporaire et justifiée par un intérêt sérieux et légitime. - Convention de portage : la convention de portage est celle par laquelle une personne accepte de prendre, pendant un temps déterminé, la qualité d'actionnaire, à charge, pour celui qui lui demande de procéder ainsi, de lui assurer la reprise des titres concernés à la fin de la période de portage et de l'indemniser de tous les frais supportés par le porteur. - Clause d'agrément : ce contrat soumet à l'agrément préalable d'un organe qu'il détermine (conseil d'administration, assemblée générale...) l'entrée d'un nouvel actionnaire dans la société. Il est soumis au respect des articles 274 et 275 de la loi du 24 juillet 1966 relatifs au principe de libre négociabilité des actions et ne peut s'appliquer en conséquence à la cession d'actions entre actionnaires. - Clause de préemption : la clause de préemption est celle aux termes de laquelle toute intention de cession à titre onéreux donnera lieu, par le cédant, à une information aux autres actionnaires, précisant l'identité de l'acheteur éventuel, le nombre d'actions dont la vente est envisagée et le prix proposé. A partir de cette information, les destinataires disposent d'un délai pour acquérir aux mêmes conditions que celles proposées par l'acheteur. - Clause de retrait : ce contrat précise les conditions et modalités selon lesquelles certains actionnaires pourront obtenir des autres qu'ils leur achètent ou leur fassent racheter leurs actions. Il s'agit d'une promesse d'achat ou d'une option de vente. - Clause d'exclusion : lorsqu'un actionnaire ne satisfait plus à certaines conditions considérées comme essentielles au maintien de sa qualité d'actionnaire, il peut être stipulé que les autres actionnaires auront la possibilité de lui racheter ses titres. Si l'actionnaire visé par une telle mesure a signé la clause instituant cette procédure, il ne peut utilement contester l'expropriation dont il fait ainsi l'objet. 3.- Une exception à la confidentialité : la transparence du marché boursier Les pactes d'actionnaires ne sont pas incorporés dans les statuts et demeurent occultes. Le principe de transparence du marché boursier a toutefois abouti à ce que la loi ou certaines dispositions réglementaires rendent obligatoire la publicité de pactes concernant les sociétés cotées. C'est ainsi que l'article 356-1-4 de la loi du 24 juillet 1966 prévoit que « toute convention conclue entre des actionnaires d'une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, comportant des conditions préférentielles de cession ou d'acquisition d'actions, doit être transmise au Conseil des marchés financiers qui en assure la publicité ». C'est cette disposition que modifie le présent article. Dans sa rédaction actuelle, l'article 356-1-4 vise : - les conventions écrites. Seules de telles conventions peuvent faire l'objet d'une transmission ; - les conventions entre actionnaires. Une convention entre un actionnaire et un tiers non actionnaire n'est pas visée par le texte de l'article 356-1-4. Serait en revanche visée la convention passée, même avec un tiers non actionnaire, par plusieurs actionnaires ; - les conventions passées entre des actionnaires de sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ; - les conventions comportant des conditions préférentielles de cession ou d'acquisition d'actions. Ces conditions préférentielles peuvent notamment consister en un prix préférentiel ou en la préférence donnée à certaines personnes. Ainsi, sont visées par l'article 356-1-4 de la loi du 24 juillet 1966 : - les clauses de préemption ou « pactes de préférence » ; - les promesses de vente ou d'achat ; - les conventions d'apport de titres à une offre publique. Ne sont pas visés, en revanche, les pactes de non agression, les clauses d'inaliénabilité, les syndicats de majorité, les clauses d'exclusion. La publicité donnée par le CMF n'a pas pour objectif de révéler le détail des termes contractuels, mais se limite à mentionner : - l'identité des parties contractantes ; - le nombre d'actions incluses dans la convention ; - les types d'obligations et de prérogatives qui en résultent pour les signataires ; - la durée de validité des accords passés. On relèvera que l'obligation de publier certains pactes d'actionnaires n'est assortie d'aucune nullité ni d'une sanction spécifique. Seule peut être envisagée la mise en jeu éventuelle, si un préjudice a été causé par la non-révélation de la convention, de la responsabilité des signataires et de celle des administrateurs. Si cette dissimulation s'inscrit dans le cadre d'une man_uvre tendant à entraver le fonctionnement du marché, les sanctions pénales prévues par l'article 10-3 de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 sont applicables. Enfin, la COB peut décider d'appliquer des sanctions pécuniaires. 4.- Le contrôle du CMF sur les pactes d'actionnaires Le CMF ne peut se prononcer sur la validité d'un pacte d'actionnaires. Il doit en revanche déclarer irrecevable le projet d'offre publique qui, du fait de l'existence d'un tel pacte, ne respecterait pas le principe selon lequel tout projet d'offre publique doit pouvoir donner lieu à compétition. L'article 3 du règlement n° 89-03 de la COB a posé le principe que tout projet d'offre publique devait pouvoir donner lieu à compétition, celle-ci s'effectuant par le libre jeu des offres et de leurs surenchères. Le principe de liberté des conventions interdit par ailleurs au CMF d'assortir sa décision de recevabilité d'une offre publique de réserves qui obligeraient les opérateurs concernés à contracter contre leur volonté ou à renoncer à des accords conclus. En revanche, sont valables les promesses d'apport d'actions à une offre publique dès lors que : - portant sur 10,66 % du capital de la société cible, elles ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à rendre impossible une prise de contrôle d'une société par l'auteur d'une surenchère. Ainsi, elles ne portent pas atteinte au libre jeu des offres et des surenchères : - portant sur 10,66 % du capital de la société cible, elles empêchent un surenchérisseur d'acquérir au moins 95 % du capital de celle-ci et de bénéficier ainsi de l'intégration fiscale. Toutefois, cette conséquence ne rompt pas l'égalité qui doit être respectée entre initiateur et surenchérisseur, l'initiateur lui-même n'étant pas assuré d'obtenir ces 95 %. 5.- La transmission des pactes d'actionnaires au CMF Le principe de transparence des marchés financiers, notamment en cas d'offres publiques, ne s'accommode pas de la confidentialité des pactes d'actionnaires. Ces derniers peuvent en outre être utilisés par l'une des parties en cas d'OPA inamicale, comme l'a montré la tentative d'OPA de la BNP sur la Société générale. Or, la modernité d'un marché financier exige des règles du jeu claires et le droit des offres publiques obéit à un principe : celui de l'égalité des parties. Les pactes d'actionnaires peuvent avoir une influence souvent considérable dans la conduite des offres publiques, comme en témoignent les conventions concernant la Société Générale et Paribas, publiées par la COB. Accord concernant Paribas : Un protocole d'accord est intervenu le 17 mai 1989 entre la Compagnie Financière de Paribas (aujourd'hui Paribas) et Mutuelles Unies (aujourd'hui Mutuelles Axa). Ce protocole a été motivé par le désir des deux groupes de renforcer leur coopération et d'asseoir le caractère stable et français de leur actionnariat. Il prévoyait une prise de participation, à hauteur de 20 %, de Paribas dans la Compagnie Financière Drouot, aujourd'hui Finaxa dont Paribas détient actuellement 22,7 % du capital et 13,7 % des droits de vote. Il prévoyait également une augmentation de la participation du groupe Axa dans Paribas, qui devait atteindre 5 %. Elle est aujourd'hui de 7,16 %. Les parties se sont engagées à maintenir leurs participations réciproques pendant la durée de leur accord, "toute modification de la participation de l'une des parties devant être soumise à l'approbation de l'autre partie". Cet accord a été conclu pour une durée de 6 ans, tacitement renouvelable par périodes équivalentes, sauf dénonciation trois mois avant l'échéance, chaque partie s'engageant alors à donner à l'autre un droit de reclassement des actions qu'il détient. Les termes généraux de cet accord ont été transmis le 16 avril 1999 aux membres du conseil de surveillance de Paribas et au Président du conseil d'administration de la BNP. Accords concernant la Société Générale : Un accord est intervenu le 27 juin 1997 entre le groupe Pernod Ricard et la Société Générale relatif à la gestion de certaines participations détenues par les deux groupes. Aux termes de cet accord la société Santa Lina, filiale non cotée de Pernod Ricard, a accordé à la Société Générale un droit de préférence sur 1.393.901 actions Société Générale (soit 1,36 % du capital) qu'elle détient dans l'hypothèse où Santa Lina souhaiterait les céder, en la forme d'une option d'achat desdites actions consentie à toute personne désignée par la Société Générale. Cet accord stipule, en outre que, dans l'éventualité d'une offre publique initiée sur les titres de la Société Générale, le droit de préférence décrit ci-dessus deviendra caduc. Dans cette hypothèse, Santa Lina informera la Société Générale dans les 48 heures de l'avis de recevabilité d'une offre de son intention d'apporter ou non ses actions Société Générale à l'offre et, dans l'affirmative, que la Société Générale disposera d'un délai courant à compter du premier jour de bourse au cours duquel les contre-offres ou surenchères éventuelles ne seront plus recevables et expirant deux jours de bourse avant la clôture de l'offre la mieux disante pour présenter à Santa Lina une personne se portant acquéreur des titres Société Générale détenus par Santa Lina au prix de l'offre la mieux disante. Le 1er mars 1996, la Société Générale a conclu un accord avec Peugeot SA, renouvelable tacitement par périodes de deux ans à compter du 31 décembre 1997, relatif à la gestion des participations réciproques de la Société Générale dans Peugeot SA et de Peugeot SA dans la Société Générale. Cet accord est toujours en vigueur, ayant été tacitement renouvelé jusqu'au 31 décembre 1999. Aux termes de cet accord, Peugeot SA s'est engagée à ne pas céder sa participation dans la Société Générale, à hauteur de 1.697.551 actions (soit 1,66 % du capital), avant l'expiration de l'accord. En outre, Peugeot SA pourrait vouloir céder en cas d'augmentation de capital de la Société Générale, au profit d'un tiers désigné par la Société Générale. Enfin, Peugeot SA a accordé un droit de préemption à tout tiers désigné par la Société Générale sur les actions encore en sa possession pendant 5 ans à compter de l'expiration de l'accord. En cas d'offre publique, Peugeot SA, si elle souhaite apporter les actions qu'elle détient à une offre (y compris toute surenchère ou offre concurrente), doit en informer la Société Générale dans les deux jours de la parution de la décision du CMF prononçant sa recevabilité. Dans ce cas, la Société Générale dispose d'un droit de préemption sur ces actions, au bénéfice de tout tiers qu'elle désignera et au prix de la dernière offre ou surenchère. Elle doit alors en informer Peugeot SA au plus tard deux jours avant la clôture de l'offre. Ces accords contiennent des dispositions de même nature en ce qui concerne une partie des participations directes ou indirectes détenues par le groupe Société Générale dans Pernod Ricard, d'une part, et Peugeot SA, d'autre part. La participation du groupe Société Générale dans le groupe Pernod Ricard s'élève à 11,4 % du capital et sa participation dans Peugeot SA s'élève à 3,7 % du capital. Les termes généraux de ces deux accords ont été communiqués le 16 avril 1999 aux administrateurs de la Société Générale ainsi qu'aux personnes énumérées à l'article 4 du règlement n° 89-03 de la COB. Le présent article modifie en conséquence l'article 356-1-4 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales en prévoyant de porter à la connaissance du CMF tout pacte d'actionnaires portant sur au moins 0,5 % du capital ou des droits de vote d'une société. Le seuil de 0,5 % correspond à un choix délibéré, visant à rendre public le maximum de pactes d'actionnaires. A la différence de la rédaction actuelle de l'article 356-1-4 précité, le dispositif concerne « toute clause d'une convention », et non plus la seule « convention entre actionnaires d'une société ». En supprimant la référence aux personnes signataires, le présent article élargit le champ du contrôle du CMF et empêche les parties à une offre publique de recourir à des tiers, qu'ils soient ou non déjà actionnaires d'une société. Le texte donne une base législative au décret qui déterminera les conditions de transmission au CMF des clauses contractuelles susvisées. A défaut de transmission, les clauses du pacte sont suspendues. Le rôle du CMF est d'assurer la publicité du pacte d'actionnaires, afin que toutes les parties à l'offre publique puissent fonder leurs analyses à partir des mêmes éléments. Outre le contenu du pacte, il rend publique la date à laquelle il prend éventuellement fin. Le dernier alinéa du présent article règle enfin la question des pactes d'actionnaires conclus avant l'adoption de la présente loi. Ces pactes devront être transmis au CMF dans un délai de six mois après la publication de la loi, permettant ainsi aux marchés réglementés français de se rapprocher du droit applicable en Grande-Bretagne et aux États-Unis. * * * Votre Commission a d'abord rejeté deux amendements identiques de MM. Gilbert Gantier et Philippe Auberger, précisant la nature des conventions auxquelles s'applique l'obligation de transmission des pactes au Conseil des marchés financiers (CMF), avant de rejeter trois amendements identiques de MM. Gilbert Gantier, Philippe Auberger et Jean-Jacques Jégou, limitant l'obligation de transmission au CMF aux seuls pactes d'actionnaires postérieurs au 1er janvier 1995.Votre rapporteur a rappelé à cet égard que l'objectif du projet de loi était d'établir une totale transparence du marché financier et que la tentative d'OPA de la BNP sur la Société Générale avait mis en lumière l'existence de pactes anciens, le Président Henri Emmanuelli ayant souligné la rupture d'égalité qui pourrait résulter de ces amendements. Votre Commission a adopté l'article premier, sans modification. * * * (Article 34 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 Obligation d'effectuer les offres publiques Le présent article vise à imposer une totale transparence des offres publiques en prévoyant l'obligation de les effectuer sur un marché réglementé ou un marché reconnu par la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme. L'origine de cet article provient du constat d'un vide juridique, lors de la tentative d'OPA de la BNP sur la Société générale. La CGU, compagnie d'assurance britannique qui a de nombreux partenariats avec la Société Générale, a acquis hors marché plus de 3,6 millions de titres de cette dernière, afin d'y conforter ses positions. L'intermédiaire était la banque Schröder, banque britannique qui exerce en France selon le régime de la libre prestation de service (LPS). Par sa confidentialité, ce type d'acquisition viole l'esprit des OPA, dans la mesure où des titres sont achetés par une société qui n'en a pas publiquement manifesté l'intention et où la modification de l'actionnariat altère les analyses financières des auteurs de l'OPA. Cette pratique n'est pourtant pas totalement interdite par la loi. En l'espèce, c'est au titre de l'article 45 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modification des activités financières que la transaction a été annulée. Cet article prévoit en effet que les prestataires de services d'investissement agréés ou exerçant en France en LPS (ce qui était le cas de la banque Schröder) doivent, lorsqu'il s'agit de transactions sur un instrument financier admis aux négociations sur un marché réglementé au profit d'un investisseur établi en France, procéder auxdites transactions sur un marché réglementé d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE). Mais l'on relèvera que la COB s'est référée en la matière aux obligations de l'intermédiaire, et non au droit des OPA ou des OPE. Pour lever toute ambiguïté, le présent article prévoit que la totalité des transactions portant sur des titres concernés par une offre publique ne peuvent être réalisées que sur un marché réglementé d'un État membre de l'EEE, ou sur un marché à terme tel que défini par la loi du 28 mars 1885. Les marchés réglementés sont ceux sur lesquels les opérations sont caractérisées par le fait que les dispositions établies ou approuvées par des autorités compétentes définissent les conditions de fonctionnement du marché, les conditions d'accès, les conditions d'admission à la cotation et imposent toutes les obligations de déclaration et de transparence. Les autorités compétentes sont soit des autorités publiques, soit des organismes reconnus par le droit national. Les marchés non réglementés sont pour leur part des marchés organisés, fonctionnant de manière analogue à celle des marchés réglementés, mais sur lesquels la réglementation n'émane pas d'une autorité publique, ainsi que les marchés de gré à gré sur lesquels la loi des parties est la seule loi qui prévaut, même si les parties ont souvent recours à des contrats type définis par une association professionnelle. Les marchés reconnus par l'article 18 de la loi du 28 mars 1885, auquel le présent article fait référence, sont principalement les marchés étrangers de valeurs mobilières et les marchés de contrats à terme négociables. Le dispositif est assorti d'une double sanction : en premier lieu, l'article 45 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 déclare la nullité de toute transaction sur un instrument financier qui ne serait pas effectuée sur un marché réglementé. La transaction est ainsi réputée ne pas avoir existé. En second lieu, les détenteurs d'instruments financiers acquis en violation des dispositions du présent article sont privés du droit de vote pour toute assemblée d'actionnaires qui se déroulerait avant l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date de l'acquisition. Cette privation du droit de vote présente un caractère limité. Elle concerne les titres achetés en violation de la loi, mais ne s'étend pas aux titres acquis antérieurement, quelles que soient les conditions de leur acquisition. Le champ de la sanction correspond au champ de la violation. * * * Votre Commission a adopté l'article 2 sans modification. * * * Après l'article 2 Votre Commission a rejeté un amendement (n° 96) de M. Jean-Paul Charié relatif à la vérification par la Commission des opérations de bourse (COB) des informations fournies aux actionnaires, votre Rapporteur ayant indiqué que cet amendement était déjà satisfait par le droit existant. (Article 3 de l'ordonnance du 28 septembre 1967 Rectification des informations financières Le présent article complète le contrôle effectué par la Commission des opérations de bourse (COB) sur les publications effectuées par les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou figurant au relevé quotidien du hors-cote. Au premier abord, le présent article semble revêtir une portée anecdotique. Il est pourtant un élément essentiel au sein d'un dispositif qui vise à moraliser le comportement des entreprises à l'égard de leurs actionnaires et du public En l'état actuel du droit, la COB doit en effet vérifier la véracité des informations fournies aux actionnaires par les sociétés et peut leur ordonner de procéder à des rectifications, dès lors qu'elle constate des inexactitudes ou des omissions. Elle peut, de sa propre initiative, porter à la connaissance du public les observations qu'elle a émises à l'encontre d'une société. Le projet de loi renforce ce dispositif en prévoyant un double mécanisme : - si les sociétés ne défèrent pas à l'injonction de la COB (prévue par le troisième alinéa de l'article 3 de l'ordonnance n° 67-833 précitée), cette dernière pourra, toujours de sa propre initiative, procéder à une publication rectificative ; - les frais occasionnés par l'ensemble des publications rectificatives (corrections des omissions, erreurs ou malveillances des sociétés, observations de la COB) seront désormais à la charge des sociétés concernées. Cette réforme s'inspire d'une part des expériences étrangères, d'autre part des relations entre la COB et les sociétés placées sous son contrôle. Le contrôle des informations financières par les autorités régulatrices de marché diffère quelque peu. En France, la législation impose à la COB un contrôle a priori très approfondi, dont la mise en _uvre est lourde. Aux États-Unis, la Securities Exchange Commission opère un contrôle a priori moindre que celui de la COB, mais dispose de nombreux moyens pour un contrôle et des sanctions a posteriori. En pratique, l'on constate que les opérateurs sur les marchés se gardent de délivrer des informations erronées, afin de ne pas être contraints de les rectifier. La crédibilité des opérateurs est en effet fortement liée à la sincérité de leurs informations financières. La COB envisage actuellement d'alléger son contrôle a priori, prévu par le règlement n° 89-03. L'une des conditions de cet allégement est de donner une base légale aux injonctions adressées aux sociétés de rectifier leurs publications ou à la possibilité, pour la COB, d'y procéder par elle-même. L'article 3 du présent projet participe de cette réforme en renforçant les moyens de la COB pour un contrôle a posteriori. On observera en second lieu que la COB est rarement conduite à opérer des rectifications d'informations financières. Les comportements sur les marchés doivent certes être encadrés, mais les acteurs observent en règle générale une stricte autodiscipline. Seules les offres publiques d'achat (OPA) d'envergure ou ayant un caractère emblématique sont l'occasion de publications rectificatives. La tentative d'OPA par la BNP sur la Société générale en est l'illustration. Entre le 17 mars et le 31 août 1999, la COB a diffusé huit communiqués, dont quatre indiquaient des irrégularités : pactes d'actionnaires non écrits avec Axa, Pernod Ricard et Peugeot ; achats de titres Société générale par CGU PLC et General Accident Fire ; mise en garde du public sur des campagnes de presse abusives ; placement sous séquestre de 3,62 millions d'actions de la Société générale acquises par CGU PLC. De manière générale, la COB procède déjà gratuitement à ses publications rectificatives et le présent projet ne fait qu'entériner cette pratique. La COB émet en effet des communiqués de presse, qui sont en général repris par les agences spécialisées. Toutefois, existe toujours le risque que le communiqué soit repris partiellement, ce qui altérerait sa portée. En mettant à la charge des sociétés concernées les frais de publication, la loi dote la COB d'un instrument qui va au-delà de la simple gratuité. Elle permet à l'autorité régulatrice de disposer de moyens de communiquer analogues aux sociétés, y compris par des encarts (toujours très coûteux) dans la presse économique. Cela évitera ainsi à la COB d'être placée dans la situation de la Financial Services Authority britannique qui, en l'absence de base juridique, a été contrainte en 1999 d'acquitter à hauteur de 10 millions de Livres sterling les frais d'une campagne de presse rectifiant les informations volontairement erronées d'un fonds de pension. * * * Votre Commission a rejeté un amendement n° 97 de M. Jean-Paul Charié, relatif à l'édiction d'un règlement précisant les critères sur lesquels la COB pourrait se fonder pour déterminer les inexactitudes susceptibles d'être contenues dans les informations fournies aux actionnaires par les sociétés cotées ou figurant au relevé quotidien du hors cote. Votre Rapporteur a considéré que cet amendement ne faisait qu'entériner le droit et la pratique quotidienne de la COB, et était donc inutile. Votre Commission a ensuite adopté l'article 3, sans modification. * * * Votre Commission a rejeté un amendement de M. Gilbert Gantier visant à définir les cercles restreints d'investisseurs après que son auteur ait insisté sur la nécessité d'encourager les investissements privés et que votre Rapporteur ait estimé que l'actuelle rédaction de l'article 6 de l'ordonnance du 28 septembre 1967 assurait une meilleure sécurité juridique, en exigeant un lien avec un investisseur qualifié. * * * (Articles L. 432-1 et L. 439-2 du code du travail) Information du comité d'entreprise en cas d'offre publique Le présent article complète le dispositif relatif à l'information du comité d'entreprise d'une société qui fait l'objet d'une offre publique d'achat ou d'une offre publique d'échange. Dans sa rédaction actuelle, l'article 432-1 du code du travail prévoit que dans le domaine économique, le comité d'entreprise est obligatoirement informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise et, notamment, sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail, les conditions d'emploi, de travail et de formation professionnelle du personnel. Il est également précisé que le comité est informé et consulté sur les modifications de l'organisation économique ou juridique de l'entreprise, notamment en cas de fusion, de cession, de modification importante des structures de production de l'entreprise ainsi que lors de l'acquisition ou de la cession de filiales. Le chef d'entreprise doit indiquer les motifs des modifications projetées et consulter le comité sur les mesures qui sont envisagées à l'égard des salariés lorsque ces modifications comportent des conséquences pour ceux-ci. Il est également tenu de consulter le comité d'entreprise lorsqu'il prend une participation dans une société et de l'informer lorsqu'il a connaissance d'une prise de participation dans son entreprise. L'article 40 de la loi n° 89-531 du 2 août 1989 portant transparence du marché financier a, en outre, prévu qu'en cas d'offre publique sur une entreprise, le chef d'entreprise en informait le comité. Ce dernier a la possibilité d'inviter l'auteur de l'offre pour qu'il expose son projet devant lui. La loi n'oblige cependant pas l'auteur de l'offre à se rendre devant le comité d'entreprise et ne prévoit aucune sanction. Comme l'écrivait M. Christian Pierret, rapporteur de la loi du 2 août 1989 précitée, « le dispositif traduit le fait que l'entreprise n'est pas un ensemble économique et financier ordinaire, mais une institution complexe au sein de laquelle le rôle des hommes est essentiel. Il est logique dans ces conditions que le comité d'entreprise non seulement soit informé, mais qu'il puisse aussi entendre l'auteur de l'offre pour qu'il expose son projet devant lui. Cette proposition est équilibrée dans la mesure où cette audition suppose l'accord du chef de l'entreprise cible de l'offre publique. Ainsi serait évitée une information qui risquerait d'être trop facilement orientée » (1). L'analyse de M. Christian Pierret conserve aujourd'hui toute sa pertinence. La globalisation croissante de l'économie a multiplié les fusions, acquisitions, participations croisées et offres publiques de toutes sortes. De telles opérations constituent soit des vecteurs de croissance externe, soit des recentrages sur les métiers d'origine (se traduisant par la vente de filiales) ou de changements complets de stratégie, avec l'abandon d'activités jugées obsolètes au profit de nouvelles activités. Les calculs de rentabilité qui président à ces opérations assimilent le plus souvent les salariés à des variables économiques. Les « ventes par appartement » et les fusions entraînent généralement des licenciements, qu'il s'agisse du travail posté ou de l'encadrement, avec parfois une logique de pur profit financier qui fait fi de tout projet industriel. Le présent article n'a pas pour objectif de changer les règles qui encadrent les OPA ou les OPE. Le Gouvernement a clairement fait le choix d'une économie de marché, qui suppose de laisser aux entreprises leur liberté dans le choix de leur stratégie. Mais il met en place un mécanisme qui mettra en lumière les OPA et OPE purement spéculatives. Ce mécanisme concerne soit une société (paragraphe I), soit une holding à la tête d'un groupe (paragraphe II). En ce dernier cas, l'information est effectuée au niveau du comité de groupe. 1.- Un dispositif qui renforce l'information des salariés Le présent article renforce en premier lieu l'information des salariés. Comme dans la loi du 2 août 1989 précitée, la réunion du comité d'entreprise n'est pas une faculté. Elle est obligatoire, immédiate, et relève des obligations du chef d'entreprise. Le projet maintient de même au profit du comité d'entreprise la décision d'entendre l'auteur de l'offre. Le chef de l'entreprise auteur de l'offre sera néanmoins soumis à deux nouvelles obligations : - adresser au comité d'entreprise la note d'information visée par la Commission des opérations de bourse (COB) dans les trois jours qui suivent sa publication ; - se rendre à la réunion du comité d'entreprise pour expliquer son projet, si celui-ci souhaite l'entendre. Dans ce cas, la réunion a lieu dans les dix jours suivant la publication de la note. La portée de ces nouvelles obligations ne doit pas être mésestimée. Certes, juridiquement, elles ne font pas obstacle au déroulement des opérations, ni pour les OPA, ni pour les OPE, et ne sont que des aménagements de procédure. Mais elles introduisent un élément nouveau dans les relations sociales. Il est évident que l'auteur de l'OPA ou de l'OPE devra justifier publiquement son opération et prouver que son projet présente une véritable utilité économique, et non la seule recherche d'un profit financier à court terme. De leur côté, les représentants des salariés au comité d'entreprise seront tenus à un examen rationnel du projet de l'auteur de l'offre. Leur réaction sera un signal aux marchés financiers, et permettra d'introduire l'avis des salariés dans un domaine qui ne met habituellement aux prises que les analystes financiers. Le dispositif du Gouvernement souffre cependant d'une lacune. En se référant à la note d'information adressée à la COB, le projet de loi permet certes au comité d'entreprise de disposer d'information sur l'organisation, la situation financière et quelques renseignements d'ordre social, ainsi que l'évolution de la société qui procède à l'acquisition. Mais si l'on veut donner au mot « régulation » son sens politique, une information d'ordre financier à caractère général n'établit aucun équilibre dans les relations sociales en cas d'OPA. L'on complexifie tout au plus la procédure pour son auteur. Les salariés sont avant tout préoccupés par leur emploi. Or, la note adressée à la COB contient peu d'informations en la matière. C'est pourquoi votre Rapporteur propose d'inscrire dans la loi l'obligation pour l'auteur de l'offre d'indiquer précisément au comité d'entreprise ses orientations en matière d'emploi si l'acquisition de l'entreprise se réalise. 2.- Un dispositif assorti de sanctions A la différence de la loi du 2 août 1989 précitée, le dispositif est assorti de sanctions à l'encontre de la société qui conduit l'OPA ou l'OPE, et dont un dirigeant ou mandataire ne se rend pas à la réunion du comité d'entreprise. La société ayant déposé l'offre sera privée des droits de vote attachés aux titres de la société qu'elle aura acquise ainsi qu'au sein des conseils d'administration de ses filiales ( au sens de l'article 357-1 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales). La sanction sera levée dans deux cas : - lorsque le chef d'entreprise se sera rendu à la réunion du comité d'entreprise ; - si le chef d'entreprise ne fait pas l'objet d'une seconde convocation dans les quinze jours qui suivent la réunion initiale à laquelle il avait été convoqué. En ce dernier cas, l'absence d'une manifestation de volonté du comité d'entreprise équivaut à rendre la sanction sans objet. Le dispositif proposé par le Gouvernement repose sur un équilibre cherchant à concilier la liberté d'entreprendre et les droits des salariés. L'on relèvera cependant que l'application de la loi du 2 août 1989 n'a pas donné lieu, à ce jour, à des résultats probants. Elle a même débouché sur un paradoxe, dans la mesure où les dirigeants des sociétés effectuant une OPA ont souhaité rencontré les comités d'entreprises, alors que ces derniers ont refusé de les entendre. Dans la plupart des OPA, les salariés sont en effet utilisés, par leur encadrement, comme moyen de pression à l'encontre de la société qui a initié l'OPA. La réaction des salariés de la Société générale à l'égard de la BNP illustre cette situation. Cette attitude est compréhensible dans la mesure où ils n'ont qu'un rôle consultatif. Le présent article, même complété par un jeu de sanctions, ne modifie pas fondamentalement la donne sociale, et son application dépendra principalement de l'application qu'en feront les organisations syndicales. * * * M. Gilbert Gantier a présenté un amendement supprimant cet article, rejeté par la Commission, votre Rapporteur ayant rappelé que l'objectif de cet article était de renforcer le droit d'information des salariés dont l'entreprise faisait l'objet d'une offre publique. Votre Commission a adopté un amendement (n° 134) de votre Rapporteur tendant à ce que le point de départ de la procédure de consultation du comité d'entreprise soit le dépôt de l'offre publique au CMF, la référence à une simple annonce n'étant pas suffisamment précise. Elle a également adopté trois amendements identiques de votre Rapporteur et de MM. Gilbert Gantier et Jean-Jacques Jégou (n° 135), fixant à quinze jours le délai de convocation du comité d'entreprise, M. Gilbert Gantier ayant accepté de retirer un autre amendement incompatible avec ceux-ci, qui établissait ce délai à vingt jours. Votre Commission a rejeté un amendement de M. Christian Cuvilliez, relatif au délai d'expertise dont dispose le comité d'entreprise, votre Rapporteur ayant estimé que l'objectif de cet amendement était, en partie, satisfait par l'un de ses amendements. Elle a ensuite adopté un amendement (n° 136) de M. Philippe Auberger permettant au comité d'entreprise de se faire assister, préalablement et lors de sa réunion, d'un conseil ou d'un expert de son choix, votre Rapporteur ayant insisté sur le caractère positif du renforcement des moyens du comité d'entreprise, que cet amendement implique en cas d'OPA. Votre Commission a rejeté un amendement de M. Gilbert Gantier supprimant la procédure d'audition d'un dirigeant d'entreprise menant une OPA par le comité d'entreprise de l'entreprise cible, votre Rapporteur considérant qu'il s'agit d'une consultation qui n'engagera pas, pour l'avenir, ledit chef d'entreprise, mais permettrait une information des salariés. Elle a également rejeté un amendement de M. Philippe Auberger, prévoyant que le comité d'entreprise pourra rendre public le fait qu'un chef d'entreprise ayant déposé une offre publique ne se soit pas rendu devant lui et supprimant, dans ce cas, la sanction de privation des droits de vote, son auteur estimant cette sanction inadéquate. Sur ce dernier point, Votre Rapporteur a indiqué que le projet de loi n'interdisait nullement à un comité d'entreprise de signaler cette carence et que, de même, il pourrait très bien faire état, de sa propre initiative, des questions qu'il posait. Votre Commission a ensuite rejeté trois amendements identiques de MM. Philippe Auberger, Gilbert Gantier et Jean-Jacques Jégou donnant la possibilité au chef d'entreprise initiateur d'une offre publique de se faire représenter par une personne de son choix, MM. Jean-Jacques Jégou et Philippe Auberger ayant insisté sur les difficultés pratiques qu'il y aurait, dans certains cas, pour un dirigeant ou un mandataire, de déférer à la demande du comité d'entreprise, notamment lorsque ceux-ci sont étrangers. votre Rapporteur a estimé que la rédaction du projet était suffisamment large pour ne pas viser intuitu personae le seul chef de l'entreprise émettrice de l'offre, mais un membre de la direction. Il a confirmé, en demandant le rejet des amendements, que l'objectif de cet article était bien que les dirigeants d'une entreprise rencontrent physiquement, à cette occasion, au moins une fois les salariés de l'entreprise-cible et qu'il ne fallait pas que ces dirigeants se réfugient derrière un avocat ou un banquier-conseil. Votre Commission a rejeté deux amendements de M. Yves Cochet soumettant la réalisation d'une offre publique à l'acceptation d'une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, dans une entreprise ou à l'échelon d'un groupe, M. Yves Cochet ayant souligné la conformité de ce dispositif avec celui qui régit la réduction du temps de travail et la nécessité de conforter le rôle des syndicats représentatifs, votre Rapporteur ayant indiqué que l'objet du projet visait l'information des salariés, mais n'avait pas comme finalité de modifier les règles de l'économie de marché. Votre Commission a adopté un amendement (n° 137) de votre Rapporteur précisant que la note sur laquelle la COB appose un visa préalable à une offre publique doit contenir les orientations de l'acquéreur en matière d'emploi. Elle a enfin rejeté un amendement de M. Yves Cochet relatif au maintien du contrat de travail des salariés d'une société ayant fait l'objet d'une offre publique, votre Rapporteur ayant, à nouveau, rappelé que le projet se situait dans le cadre de l'économie de marché et ne visait pas, à cet article, à modifier les conditions de déroulement des OPA. Votre Commission a adopté l'article 4, ainsi modifié. * * * (Article 33 de la loi du 2 juillet 1996) Limitation dans le temps des procédures d'offre publique Le présent article donne pouvoir au Conseil des marchés financiers (CMF) de fixer la date de clôture d'une offre publique. L'article 33 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières renvoie au règlement général du CMF le soin de fixer les règles relatives aux offres publiques. Les procédures d'offres publiques se caractérisent par la surenchère des parties. Celle-ci n'est pas limitée dans le temps. Or, la tentative d'OPA de la BNP sur la Société générale a révélé différentes failles juridiques ayant contraint la Commission des opérations de bourse à intervenir à plusieurs reprises par des communiqués. La tentative de conciliation du gouverneur de la Banque de France n'a pas abouti. Il en est résulté une altération de l'image de la place de Paris, qui a conduit les autorités de tutelle des marchés à souhaiter, en certains cas, pouvoir mettre fin à une offre publique en fixant une ultime enchère, pour rétablir un fonctionnement harmonieux des marchés. Le présent article répond à ce souci en permettant au CMF, à partir de trois mois à compter du dépôt d'une offre publique, de fixer une date de clôture sur toutes les offres publiques portant sur une société. Il s'agit d'une faculté, le CMF pouvant évidemment laisser le marché arbitrer jusqu'au terme voulu par les parties. Sans préjuger de la rectification qui sera apportée au règlement général, le dépôt des dernières enchères devra être simultané pour assurer l'égalité des parties. * * * Votre Commission a rejeté un amendement de M. Philippe Auberger abaissant à deux mois le délai à l'issue duquel le règlement général du CMF peut fixer la clôture d'une offre publique, votre Rapporteur ayant jugé un tel délai matériellement trop court. Elle a adopté un amendement (n° 138) de M. Gilbert Gantier prévoyant que le CMF fixe ladite date de clôture après avoir entendu préalablement les parties à l'offre, son auteur ayant indiqué que cette procédure permettrait au CMF d'être informé au mieux et votre Rapporteur s'étant déclaré favorable à son adoption. Votre Commission a adopté l'article 5, ainsi modifié. * * * POUVOIRS DES AUTORITÉS DE RÉGULATION Dispositions relatives aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement (Articles 15, 15-2 (nouveau), 19 et 45 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 Agréments et autorisations du CECEI et de la COB Le présent article autorise le CECEI et la COB à subordonner les agréments et autorisations qu'ils délivrent à des conditions particulières et à des engagements des demandeurs. Le paragraphe I modifie l'article 15 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit. Cet article prévoit que les établissements de crédit doivent obtenir un agrément du CECEI préalablement à l'exercice de leur activité. Les critères que doit prendre en compte le CECEI tiennent à la liquidité de l'établissement, aux modalités de direction, à l'adéquation de sa forme juridique, à ses moyens techniques et financiers, et à la sécurité apportée à la clientèle. Le projet de loi ajoute à cette série de critères objectifs une faculté d'appréciation par le CECEI, en prévoyant des « conditions particulières visant à préserver l'équilibre de la structure financière de l'établissement et le bon fonctionnement du système bancaire ». L'agrément peut également être subordonné au respect d'engagements par l'établissement requérant. Ce dispositif trouve sa pertinence dans le cas où l'actionnaire d'un établissement bancaire modifie sa stratégie. En ce cas, celle-ci peut emporter des changements notables de son fonctionnement et retentir sur l'ensemble du système bancaire. L'agrément déjà délivré peut ne plus correspondre aux critères qui l'ont fondé. Le CECEI pourrait également être conduit à délivrer son agrément en fonction des engagements d'un actionnaire de référence (conservation du capital pendant une durée déterminée, pourcentage d'actions). Le présent article donne une base légale au règlement du CECEI pour soumettre son agrément à une nouvelle conditionnalité. L'insertion d'un article 15-2 au sein de la loi du 24 janvier 1982 précitée obéit à la même motivation, mais concerne plus spécifiquement les établissements bancaires ayant fait l'objet d'une offre publique d'achat. La modification de la structure du capital et des organes dirigeants retentit sur les conditions auxquelles était subordonné l'agrément. Le CECEI souhaite en conséquence disposer de la base légale pour que son règlement prévoit qu'il délivre une autorisation préalable, ou qu'il soit destinataire d'une déclaration ou d'une notification, dans les conditions fixées par un règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière. Si ce règlement exige une autorisation préalable, le CECEI peut l'assortir des mêmes conditions que l'agrément initial. Le dispositif maintient le retrait d'agrément par le CECEI à la demande de l'établissement bancaire, ou lorsque ce dernier n'a pas respecté les conditions de son agrément ou n'en a que fait usage dans un délai de douze mois ou encore lorsqu'il n'exerce plus d'activité depuis au moins six mois. Il ajoute à la liste de ces cas le non respect des engagements exigés par le CECEI de l'établissement requérant. Le paragraphe II du présent article insère des dispositions analogues au sein de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, pour les entreprises d'investissement et la fourniture de services d'investissement à un établissement de crédit. Le CECEI pourra exiger des « conditions particulières » (ce terme lui laissant une grande souplesse d'analyse) et le respect d'engagements supplémentaires par l'entreprise requérante, qu'il s'agisse d'un agrément initial ou d'un agrément supplémentaire à la suite des modifications des conditions auxquelles était subordonné l'agrément. Enfin, la COB pourra exiger des sociétés de gestion les mêmes obligations que les autres entreprises d'investissement. Les sociétés de gestion assurent la gestion de portefeuille pour le compte de tiers (article 4 de la loi du 2 juillet 1996 précitée) et entrent dans la catégorie des prestataires de services d'investissement. La COB disposera désormais de la base légale lui permettant d'assortir son agrément de conditions particulières et/ou d'engagements de la part de l'entreprise requérante. * * * Votre Commission a examiné un amendement de M. Yves Cochet inscrivant, parmi les critères au vu desquels le CECEI délivre son agrément, la prise en compte de la spécificité de certains établissements de crédit appartenant au secteur de l'économie sociale et solidaire, son auteur ayant insisté sur la spécificité que présente cette partie du secteur bancaire. Votre Rapporteur a fait part de sa sympathie pour le dispositif proposé, mais a indiqué que les critères d'appréciation du CECEI étaient fixés par la loi bancaire de 1984 et étaient liés principalement à des ratios de solvabilité et de liquidité, et que le CECEI ne disposait pas, en conséquence, de critères lui permettant de délivrer un agrément au regard du concept d'utilité sociale. M. Philippe Auberger a ajouté qu'il n'existait pas de définition de l'économie solidaire sur laquelle le CECEI pourrait se fonder. Votre commission a alors rejeté cet amendement. Votre Commission a adopté un amendement (n° 139) rédactionnel de M. Dominique Baert, avant de rejeter un amendement de M. Philippe Auberger, relatif à la coordination entre les décisions du CECEI et les appréciations de la Commission bancaire. M. Philippe Auberger a fait allusion à des cas de décisions, à ses yeux regrettables, par manque de coordination entre ces deux autorités. Le Rapporteur s'est prononcé contre l'amendement, dont on peut partager le principe mais dont les conséquences doivent être mieux mesurées. Il s'est engagé à étudier la question avant le passage en séance publique. M. Jean-Jacques Jégou a insisté sur le fait qu'une tel amendement permettrait d'améliorer le fonctionnement du CECEI. Votre Commission a ensuite adopté un amendement (n° 140) rédactionnel du Rapporteur, puis rejeté, par suite de sa décision précédente, un amendement de M. Philippe Auberger relatif à l'avis de la commission bancaire, préalable aux décisions du CECEI. Puis elle a rejeté un amendement de M. Yves Cochet relatif à l'agrément du CECEI sur un établissement de crédit relevant de l'économie sociale et solidaire, son auteur ayant souligné l'intérêt du développement d'outils spécifiques à l'économie solidaire. Elle a ensuite adopté un amendement rédactionnel (n° 141) de votre Rapporteur, puis l'article 6, ainsi modifié. * * * Votre Commission a rejeté un amendement de M. Philippe Auberger relatif aux offres publiques d'échange dans le secteur public, son auteur ayant insisté sur la nécessité d'adapter la loi du 6 août 1986, relative aux privatisations aux actuelles OPE, votre Rapporteur ayant déclaré que le projet de loi n'avait pas pour objectif de modifier les modalités d'application des privatisations. * * * (Article 15 de la loi du 24 janvier 1984) Information du gouverneur de la Banque de France Le présent article renforce les prérogatives du gouverneur de la Banque de France, en tant que président du comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement (CECEI). L'article 15 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit prévoit que ces derniers doivent obtenir un agrément du CECEI avant d'exercer leur activité. Il énumère les conditions préalables à la délivrance de cet agrément. Une offre publique dans le secteur bancaire obéit aux règles déterminées par l'article 33 de la loi du 2 juillet 1996 et n'est pas exclusive, une fois réalisée, de l'agrément du CECEI dans la mesure où le secteur bancaire tient une place spécifique dans l'économie. Pour renforcer le rôle préventif du CECEI, le présent article propose que le gouverneur de la Banque de France, président du CECEI, soit informé d'un projet d'offre, soit deux jours avant un dépôt devant le Conseil des marchés financiers (CMF), soit deux jours avant une annonce publique, si celle-ci est antérieure au dépôt devant le CMF. Ce dispositif ne présente pas seulement un caractère symbolique, qui marquerait la prééminence du gouverneur. Rien n'empêche en effet ce dernier de donner un avis public qui a valeur de signal aux marchés. Votre Rapporteur estime devoir renforcer le caractère préventif du dispositif, en rendant le ministre chargé de l'économie prioritairement destinataire de l'information relative à une offre publique, à charge pour lui d'en alerter ensuite le gouverneur de la Banque de France. L'État est, au travers des organismes qui assurent le contrôle de prudentialité et la gestion des risques, le garant de la bonne marche du système financier. Il est donc logique que le ministre ait connaissance le premier d'événements qui auront des conséquences sur les marchés. * * * Votre Commission a examiné un amendement de votre Rapporteur prévoyant que la personne émettrice d'une offre publique devait préalablement en informer le ministre chargé de l'Économie, à charge pour ce dernier d'en informer ensuite le Gouverneur de la Banque de France. Après que MM. Philippe Auberger et Jean-Jacques Jégou aient rappelé que le Gouverneur de la Banque de France était une autorité prudentielle, votre Rapporteur, puis le Président Henri Emmanuelli ont indiqué que cet amendement marquait le primat du politique sur une autorité administrative, ce dernier se déclarant surpris que le pouvoir législatif, chargé de contrôler l'exécutif, puisse envisager de laisser celui-ci se dépouiller de ses prérogatives au profit d'autorités administratives indépendantes. Il a souligné que le présent amendement n'établissait pas une hiérarchie mais une simple transmission d'information. Votre Commission a adopté cet amendement (n° 142), et l'article 7 ainsi modifié. * * * (Articles 15 et 17 de la loi du 24 janvier 1984 Conditions requises pour diriger un établissement de crédit Le présent article renforce les conditions exigées pour diriger un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement. L'article 15 de la loi du 24 janvier 1984 et les articles 14 et 15 de la loi du 2 juillet 1996 déterminent, parmi les conditions préalables à la délivrance de l'agrément pour les établissements de crédit et les entreprises d'investissement, les critères qui s'appliquent à leurs dirigeants. Ces critères sont l'honorabilité et l'expérience. Le projet de loi en ajoute un troisième, à savoir la compétence. Si l'honorabilité s'apprécie selon un mode objectif (absence de casier judiciaire), la compétence, comme l'expérience, sont des critères plus contingents, même si différents indices permettent de les évaluer. L'intérêt de ce dispositif est de donner au CECEI un élément supplémentaire d'analyse pouvant servir tant à la délivrance qu'au retrait de l'agrément. * * * Votre Commission a examiné trois amendements : - le premier de M. Jean-Jacques Jégou, supprimant la référence à la notion de compétence parmi les critères requis pour diriger un établissement bancaire ou une entreprise d'investissement ; - le deuxième de M. Philippe Auberger, supprimant l'expérience parmi les critères requis pour diriger un établissement bancaire ; - le troisième du même auteur supprimant cette même mention, s'agissant d'une entreprise d'investissement. M. Jean-Jacques Jégou a jugé que la notion de compétence était subjective et redondante par rapport aux critères déjà en vigueur. Faisant état de la situation du Crédit municipal de Paris, votre Rapporteur a jugé, au contraire, que cette notion serait utile. M. Philippe Auberger a estimé que l'expérience professionnelle n'était pas nécessairement un critère pertinent : une personne peut n'avoir aucune compétence en matière bancaire et être apte, par exemple, à diriger une compagnie d'assurance. Votre Rapporteur ayant émis un avis défavorable, la Commission a rejeté ces amendements. Votre Commission a adopté l'article 8 sans modification. * * * Dispositions relatives aux entreprises d'assurance Votre Commission a examiné un amendement de M. Philippe Auberger relatif à la création d'un service universel bancaire. Votre Rapporteur a jugé qu'il s'agissait d'une question politique fondamentale, qui relève à la fois du droit bancaire et d'une conception sociale de l'accès aux comptes. Il a rappelé que la commission dirigée par M. Benoît Jolivet siégeait actuellement sur ce thème et qu'il fallait, à tout le moins, en attendre les conclusions avant d'en donner une traduction législative. M. Jean-Pierre Balligand a fait part de ses doutes sur l'aboutissement rapide des travaux de cette commission. Après que le Président Henri Emmanuelli se soit interrogé sur la recevabilité financière de cet amendement, la Commission l'a alors rejeté. Un amendement de M. Gilbert Gantier relatif au secret professionnel au sein des établissements bancaires a été retiré par son auteur. (Articles L. 321-10 et L. 322-4 du code des assurances) Agrément des sociétés d'assurance Le présent article tend à compléter le régime d'agrément des entreprises d'assurance, prévu par le titre II du code des assurances. Le régime d'agrément est la condition initiale d'exercice des activités d'assurance. Il s'applique dans le cadre communautaire issu des principales directives : - Directive Établissement, pour l'assurance non-vie du 24 juillet 1973 ; - Directive Établissement, pour l'assurance-vie du 5 mars 1979 ; - Directive Liberté de prestation de service (LPS) en assurance-dommage du 22 juin 1988 ; - Directive LPS en assurance-vie du 8 novembre 1990 ; - Directive Licence unique pour l'assurance non-vie du 18 juin 1992 ; - Directive Licence unique pour l'assurance-vie du 10 novembre 1992. L'agrément administratif des entreprises françaises est prévu par les articles L. 321-1 et R. 321-1 et suivants du code des assurances. Délivré par le ministre chargé de l'Économie et des Finances, l'agrément est accordé pour les opérations pratiquées par une entreprise d'assurance. On notera que les entreprises de réassurance ne sont pas soumises à agrément pour exercer. Dans la mesure où la France continue d'appliquer la séparation entre les sociétés d'assurance-vie et d'assurance non-vie, il demeure nécessaire de disposer d'un agrément distinct pour chacun des contrats prévus par l'article L.3101 du code des assurances, à savoir : - les engagements dont l'exécution dépend de la vie humaine ; - les contrats d'épargne en vue d'une capitalisation ; - les risques de dommages corporels ; - l'activité d'assistance. L'agrément d'une entreprise communautaire est sollicité auprès des autorités de l'État membre sur le territoire duquel le siège social de l'entreprise se trouve. L'agrément obtenu pour une branche ou un groupe de branches couvre également les risques accessoires liés au risque principal assuré par le contrat. Enfin, l'agrément des entreprises non communautaires est délivré dans des conditions similaires à celles s'appliquant aux entreprises communautaires. L'article L.321-10 du code des assurances prévoit que le ministre délivre l'agrément après avoir pris en compte les moyens techniques et financiers de l'entreprise, l'honorabilité et la qualification de ses dirigeants, la répartition du capital et la qualité des actionnaires. Le paragraphe I du présent article ajoute un critère supplémentaire en ouvrant au ministre la possibilité d'octroyer l'agrément sous réserve d'engagements souscrits par l'entreprise acquérante. Cette disposition trouve son origine dans le cas Europavie et marque la volonté du Gouvernement de disposer de toutes les informations possibles pour apprécier la situation d'une entreprise d'assurance, ainsi que par voie de conséquence, de faciliter le travail de contrôle ultérieur de la Commission de contrôle des assurances (CCA). La rédaction du projet souffre cependant d'imprécisions, qui en limitent la portée. Le terme « engagements » a en effet un sens très précis en droit des assurances et correspond aux montants financiers censés couvrir les risques garantis par les compagnies. Abstraction faite de la sémantique (que l'on peut toujours corriger), le projet introduit ainsi dans les critères préalables à l'agrément une notion très générale, qui laisse au ministre un pouvoir discrétionnaire alors que l'article L.321-10 du code des assurances fait référence à des notions précises (capacité d'honorer les contrats, honnêteté des dirigeants). Votre Rapporteur s'interroge sur l'utilité de la mesure proposée. L'engagement, éventuellement accepté par une entreprise, la lie avant sa création et traduit en fait l'affirmation de la présence de l'État dans le secteur des assurances. Cette présence est souhaitable. Elle est même d'ordre public, compte tenu des risques systémiques analogues à ceux rencontrés dans le secteur bancaire. Mais l'on rappellera que la CCA est censée jouer ce rôle, notamment en appréciant la gestion d'une entreprise d'assurance au regard des risques qu'elle couvre. Le présent article ne résoud en rien le problème essentiel de la qualité du contrôle qu'elle exerce, qui tient à ses effectifs et à son professionnalisme. Le paragraphe II du présent article du projet de loi concerne les sociétés anonymes d'assurance et de capitalisation, dont les prises, extensions ou cessions de participations peuvent être soumises à un régime de déclaration ou d'autorisation, en application de l'article L.322-4 du code des assurances. Cet article établit essentiellement un contrôle de la qualité de l'actionnariat. Le projet propose, parallèlement au paragraphe I, d'ajouter également le respect de certains engagements au nombre des critères qui autorisent une opération capitalistique dans le secteur des assurances. La rédaction mentionne « une ou plusieurs des personnes ayant présenté une demande d'autorisation », ce qui vise les pactes d'actionnaires. Comme au paragraphe I, le projet souhaite ainsi renforcer le contrôle préalable, mais en se référant à un critère qui concerne la gestion des sociétés, il introduit un élément discrétionnaire dont l'application sera difficile. Dans le droit des sociétés, la responsabilité des actionnaires se limite en effet à leur apport et ne consiste pas en une responsabilité solidaire et infinie. Le paragraphe II comporte donc le risque de bloquer par anticipation toute opération de modification de capital, alors que la CCA dispose des instruments juridiques qui lui permettent de vérifier qu'une société d'assurance respecte les règles d'une gestion prudentielle. * * * Votre Commission a adopté l'article 9 sans modification. * * * (Articles L.322-2, L. 321-10 et L. 310-18 du code des assurances) Qualification des dirigeants d'entreprises d'assurance L'article L.322-2 du code des assurances soumet la fondation, la direction et l'administration d'une entreprise d'assurance ou de réassurance à une série de critères d'honnêteté et d'honorabilité. Les dirigeants ne doivent pas avoir été condamnés pour des crimes, avoir encouru des faillites personnelles ou fait l'objet d'une condamnation par une juridiction étrangère. Le paragraphe I du présent article précise qu'outre les conditions d'honnêteté, les dirigeants doivent posséder la qualification nécessaire à leur fonction. Il s'agit d'un renforcement du volet préventif du contrôle sur le secteur des assurances. On relèvera que le projet de loi ne renvoie pas au Conseil d'État le soin de déterminer par décret les éléments qui fondent cette qualification, laissant ainsi à la CCA une latitude d'action pour apprécier le professionnalisme des futurs dirigeants. La CCA étant soumise au contrôle du juge administratif, toute personne écartée d'une fonction de dirigeant pourra contester la décision devant le Conseil d'État. Le paragraphe II complète, pour coordination, l'article L. 321-10 du code des assurances. Le paragraphe III ajoute à la panoplie des sanctions, prévues à l'article 310-18 du code des assurances à l'encontre des dirigeants, la démission d'office, prononcée par la CCA. Cette mesure était demandée par les professionnels du secteur, qui avaient alerté les pouvoirs publics sur les risques d'un sinistre de l'entreprise Europavie. On rappellera que les sanctions sont prononcées lorsqu'une entreprise n'a pas respecté une disposition législative ou réglementaire dans le domaine relevant du contrôle de la CCA ou n'a pas déféré à une injonction. Ce dispositif permet d'éviter que l'État aille jusqu'à retirer son agrément à une entreprise d'assurance (ce qui aboutirait à sa cessation d'activité et au transfert de son portefeuille). * * * Votre Commission a adopté l'article 10 sans modification. * * * (Article L.322-4 du code des assurances) Information du ministre de l'Économie et des Finances L'article L. 322-4 du code des assurances soumet toute modification de capital des sociétés anonyme d'assurance et de capitalisation à un régime d'autorisation préalable, afin de préserver les intérêts des assurés. En application de l'article R.322-11-1 du code précité, le ministre chargé de l'Économie et des Finances dispose d'un délai de trois mois pour s'opposer à l'opération, après avis de la Commission des entreprises d'assurance. Les conditions générales d'offre publique sur les marchés financiers sont prévues par l'article 33 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières. Cet article donne compétence au Conseil des marchés financiers (CMF), qui apprécie l'offre publique d'achat obligatoire, la garantie des cours, l'offre publique de retrait et le retrait obligatoire. Le présent projet de loi ajoute une condition nouvelle aux opérations d'offre publique sur une société anonyme d'assurance : celle d'informer le ministre chargé de l'Économie de ce projet d'offre. L'exigence d'information est soumise au délai de deux jours ouvrés avant le dépôt du projet au CMF, ou l'annonce publique de ce projet. Pour le reste, le ministre chargé de l'Économie ne dispose d'aucun pouvoir particulier, sauf dans le cadre de la procédure évoquée supra dans le cadre de l'article L. 322-4 du code des assurances. On peut, dès lors, s'interroger sur la portée de cet article. Le code des assurances a confié au ministre l'essentiel du pouvoir décisionnaire en matière de modification de capital des sociétés anonymes d'assurance, et ses prérogatives sont renforcées par l'instruction qu'opère le CMF sur les offres publiques. Votre Rapporteur analyse le dispositif du projet de loi comme le renforcement de la prééminence du ministre en tant qu'autorité régulatrice. Ainsi est-il logique qu'il soit informé, avant l'ensemble des opérateurs de marché, des offres qui vont s'y dérouler, afin de disposer d'un délai de réflexion supplémentaire pour mettre en _uvre les procédures prévues par le code des assurances, s'il estime que les intérêts des assurés sont en cause. * * * Votre Commission a rejeté un amendement de M. Yves Cochet, soutenu par M. Christian Cuvilliez, prévoyant l'information préalable des commissions des Finances de l'Assemblée nationale et du Sénat avant tout projet d'achat d'une compagnie d'assurance, votre Rapporteur ayant rappelé que l'autorité de tutelle en la matière était le ministre chargé de l'Économie, et que l'on voyait mal comment y associer des commissions parlementaires. Votre Commission a ensuite adopté l'article 11 sans modification. * * * Dispositions communes Avant l'article 12 La Commission a rejeté deux amendements de M. Yves Cochet visant à introduire deux parlementaires au sein de la Commission bancaire. * * * (Article 35 de la loi du 2 juillet 1996) Saisine du tribunal de grande instance de Paris Le présent article complète les pouvoirs du Conseil des marchés financiers (CMF) en lui permettant de saisir le tribunal de grande instance de Paris statuant dans la forme des référés, en cas d'infraction à l'article 33 de la loi du 2 juillet 1996, relatif aux offres publiques. Cette disposition est analogue à l'ancien article 4-2 de l'ordonnance du 28 septembre précitée relative au statut de la Commission des opérations de bourse (COB), devenu l'article 12-2 de cette ordonnance après déplacement par la loi n° 89-535 du 2 août 1989. Le règlement général du conseil des marchés financiers prévoit dans son titre VII que le CMF s'assure par des contrôles sur pièces et sur place du respect de son règlement général et des obligations professionnelles par : - les prestataires habilités ; - les personnes fournissant en France un ou plusieurs services en libre prestation de services, sous réserve des compétences des autorités de l'État membre d'origine ; - les teneurs de compte-conservateurs ; - les entreprises de marché ; - les chambres de compensation ; - les dépositaires centraux. L'article 69 de la loi du 2 juillet 1996 précitée prévoit que le CMF peut adresser une mise en garde à tout prestataire de services d'investissement ou toute personne à raison du manquement à leurs obligations professionnelles. L'article 7-1-23 du règlement intérieur précise que le président du CMF, au vu des différents éléments d'information, peut saisir une formation disciplinaire ou saisir les présidents des différentes autorités de tutelle des établissements financiers, des entreprises et sociétés d'assurance et des entreprises de marché. Il peut également transmettre le dossier à la COB ou au Parquet. Le présent article ne remet pas en cause cette procédure, mais la complète, à l'instar des pouvoirs dont dispose la COB. Il est des circonstances où la longueur de la procédure fait obstacle à une prise de décision rapide. Or, les irrégularités sur les marchés doivent être promptement sanctionnées. Le Président du CMF pourra donc saisir le tribunal de grande instance de Paris, sans préjudice des procédures disciplinaires qu'il pourrait engager. L'objectif est de mettre fin rapidement aux irrégularités et d'en supprimer les effets. Les achats ou ventes issus de procédures irrégulières seraient ainsi considérés comme n'ayant jamais existé. Le président du tribunal de grande instance statue en la forme des référés, sa décision étant exécutoire par provision. Ce terme signifie que la décision est immédiatement applicable même s'il y a appel, afin de garantir la rapidité de la procédure. Pour éviter toute man_uvre dilatoire, le présent article précise que le président du tribunal est compétent pour connaître des exceptions d'illégalité. Il a donc compétence pour les litiges qui relèveraient normalement d'autres juridictions, y compris les litiges d'ordre pénal pour lesquels le CMF informe le procureur de la République de la procédure devant le tribunal de grande instance. Enfin, la peine est immédiatement applicable et ce caractère exécutoire est renforcé par la possibilité pour le tribunal d'ordonner une astreinte versée au Trésor public. * * * Votre Commission a adopté l'article 12, sans modification. * * * (Articles 31-2 et 49-1 (nouveaux) de la loi du 24 janvier 1984, Le présent article vise à préciser les conditions d'exercice du contrôle parlementaire en prévoyant que les commissions des Finances de l'Assemblée nationale et du Sénat procèdent, de leur propre initiative, à l'audition du gouverneur de la Banque de France, en sa qualité de président du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement (CECEI) et de président de la Commission bancaire, ainsi qu'à l'audition du président de la Commission de contrôle des assurances (CCA) et du président du Conseil des marchés financiers (CMF). Ce dispositif, en mettant sur le même plan d'une part le gouverneur de la Banque de France, d'autre part, les présidents de la CCA et du CMF, amalgame des situations nettement différentes. L'article 107 du traité sur l'Union européenne prévoit que « dans l'exercice des pouvoirs et dans l'accomplissement des missions et des devoirs qui leur ont été conférés par le présent traité et les statuts du Système européen de banques centrales, ni la Banque centrale européenne, ni une banque centrale nationale, ni un membre quelconque de leurs organes de décision ne peuvent solliciter ni accepter des instructions des institutions ou organes communautaires, des gouvernements des États membres ou de tout autre organisme. Les institutions et organes communautaires ainsi que les gouvernements des États membres s'engagent à respecter ce principe et à ne pas chercher à influencer les membres des organes de décision de la BCE. ou des banques centrales nationales dans l'accomplissement de leurs missions. » Cet article fonde l'indépendance institutionnelle de la B.C.E. et des banques centrales nationales. Cette indépendance vise à renforcer la crédibilité de la politique monétaire. Le Protocole n°3 sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne renforce également l'indépendance des membres de la BCE. L'indépendance de la BCE. et des banques centrales nationales n'est cependant pas incompatible avec son contrôle démocratique. Ce dernier est même de nature à la renforcer, en établissant une exigence de transparence et en permettant à la BCE. et aux banques centrales nationales de justifier leur politique. L'article 10 de la loi n° 98-357 du 12 mai 1998 prévoit ainsi que « dans le respect des dispositions de l'article 107 du traité instituant la Communauté européenne et des règles de confidentialité de la Banque centrale européenne, le gouverneur de la Banque de France ou le Conseil de la politique monétaire sont entendus par les commissions des finances des deux assemblées, à l'initiative de celles-ci, et peuvent demander à être entendus par elles ». Cette intervention législative a semblé nécessaire La rédaction des paragraphes II et III pose également un problème de principe. Appartient-il à la loi de définir le champ des autorités publiques que le Parlement peut auditionner ? La réponse est évidemment négative. L'article 5bis de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires prévoit qu'« une commission spéciale ou permanente peut convoquer toute personne dont elle estime l'audition nécessaire ». Il est de principe constant que le Parlement exerce ses fonctions de contrôle comme il l'entend, les seules limites de ce contrôle étant inscrites dans la Constitution, les traités internationaux et les textes qui régissent l'activité parlementaire. En outre, déterminer le champ des auditions parlementaires équivaut, a contrario, d'une part, à pouvoir le réduire à l'avenir. D'autre part, les autorités non citées pourraient s'estimer dispensées du contrôle parlementaire. Maîtresses de leurs travaux, les commissions des Finances de l'Assemblée nationale et du Sénat, comme l'ensemble des commissions permanentes, ont déjà le pouvoir -non explicite mais bien réel- d'auditionner, si elles le souhaitent, les présidents de la CCA et du CMF. La loi n'a pas compétence à déterminer les pouvoirs du Parlement. En conséquence, votre Rapporteur propose la suppression du présent article. * * * Votre Commission a examiné un amendement de suppression présenté par votre Rapporteur qui a indiqué que l'article 5 bis de l'ordonnance du 17 novembre 1958 donnait tous pouvoirs au Parlement pour entendre toute personnalité, y compris les personnes visées à l'article 13 du présent projet, qu'il s'agisse du gouverneur de la Banque de France, du Président du CMF, ou du Président de la Commission de contrôle des assurances. Il est donc inutile de restreindre la portée du contrôle parlementaire par un texte législatif. M. Philippe Auberger a néanmoins fait part des difficultés rencontrées dans certains cas, pour obtenir des informations de la part des personnes entendues, et a cité des exemples où le secret bancaire avait été opposé à une commission parlementaire. M. Francis Delattre, pour sa part, a rappelé que le gouverneur de la Banque de France invoquait en permanence son indépendance en matière de politique monétaire. Votre Rapporteur a répondu que les propos ou les attitudes de certaines personnes ne préjugeaient pas du principe fondamental par lequel les commissions parlementaires pouvaient entendre, comme elles le souhaitent, toute personne utile à leurs travaux et, qu'en toute hypothèse, cet article ne changerait rien à l'éventuelle mise en avant du secret bancaire par une personne auditionnée. M. Christian Cuvilliez a souhaité que le contrôle parlementaire soit réaffirmé et s'est interrogé sur la portée de la suppression proposée. M. Jean-Jacques Jégou a fait part de sa crainte qu'en l'absence de dispositif législatif le Président du CMF et le Président de la CCA ne puissent être entendus par les commissions parlementaires. Le Président Henri Emmanuelli a rappelé le contenu de l'article 5 bis de l'ordonnance du 17 novembre 1958 et a jugé en conséquence que les craintes de M. Jean-Jacques Jégou n'étaient pas fondées. Au contraire, le texte de l'article 13 dont on perçoit bien l'intention, aurait un effet restrictif sur le contrôle parlementaire puisqu'il limite les fonctions au titre desquelles les intéressés peuvent être auditionnés. M. Didier Migaud, Rapporteur général, a soutenu l'amendement de votre Rapporteur en affirmant qu'il s'agissait d'une question de principe, une loi ordinaire n'ayant pas vocation à encadrer les modalités du contrôle parlementaire, les commissions parlementaires pouvant auditionner qui elles souhaitent et M. Francis Delattre s'est rallié à cette position. Votre Commission a adopté cet amendement (n° 143) et, en conséquence, supprimé cet article. * * * Article additionnel après l'article 13 Votre Commission a examiné deux amendements similaires, l'un de MM. Éric Besson, rapporteur, soutenu par M. Jean-Pierre Balligand, l'autre de M. Jean-Jacques Jégou relatifs aux associations de micro-crédit à but non lucratif. Votre Rapporteur a indiqué qu'il s'agissait de favoriser la création d'entreprises par des chômeurs et par des titulaires du revenu minimum d'insertion (RMI). Après que M. Philippe Auberger se soit interrogé sur la nature des prêts consentis par les associations en cause, M. Jean-Jacques Jégou s'est rallié à la rédaction de votre Rapporteur, à la condition d'en être également signataire, et a retiré son amendement. La Commission a ensuite adopté l'amendement (n° 144) de votre Rapporteur. * * * COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DES AUTORITÉS DE RÉGULATION Dispositions relatives au comité des établissements de crédit (Articles 31 et 29 de la loi du 24 janvier 1984) Composition du comité des établissements de crédit Le présent article modifie la composition du CECEI, en y intégrant à titre permanent le président de la COB et le président du CMF. L'article 31 de la loi du 24 janvier 1984, qui fixe la composition du CECEI prévoit que ce comité comprend « le ou les représentants des autorités qui ont approuvé le programme d'activité de la personne dont le Comité examine la demande d'agrément. » En pratique, les présidents de la COB et du CMF participent en permanence aux délibérations. La modification proposée valide la pratique et renforce le poids du Comité en y intégrant à titre permanent deux autorités de marché. Le présent article procède également à un aménagement technique au sein du CECEI. Deviennent membres du comité un conseiller à la Cour de cassation, dans la mesure où le juge judiciaire dispose le plus souvent de la compétence pour les litiges sur les marchés financiers, et un représentant supplémentaire des organisations syndicales. Il procède enfin à une adaptation pour coordination avec le Conseil national du crédit et du titre. * * * Votre Commission a adopté l'article 14 sans modification. * * * Article 15 (Article 31-1 de la loi du 24 janvier 1984 Le présent article prévoit une exception à la règle du secret professionnel au sein du CECEI. L'article 31-1 de la loi du 24 janvier 1984 soumet au secret professionnel toute personne qui participe aux délibérations ou aux activités du CECEI. Ce principe souffre de rares exceptions, qui concernent l'autorité judiciaire, un État membre de la Communauté européenne dans le cadre de la délivrance d'un agrément ou la Commission des Communautés européennes, lorsqu'il s'agit du contrôle de la concurrence. Il est proposé d'ajouter une exception supplémentaire en permettant au CECEI de transmettre à toute personne physique ou morale intéressée le dossier d'une autre personne physique ou morale qui fait l'objet d'une instruction. L'objectif de ce dispositif est de permettre au CECEI de pouvoir instaurer une procédure contradictoire entre les parties, dans le cas où il est saisi, par l'une des parties opérant dans le cadre d'une offre publique, de documents qui mettent en cause la sincérité des informations livrées par l'autre partie. C'est ainsi que le CECEI a reçu, lors de la tentative d'OPA de la BNP sur la Société générale, des documents qui contestaient des éléments de ratios prudentiels. Votre Rapporteur ne conteste pas l'utilité pour le CECEI d'un tel dispositif, mais s'interroge sur sa portée. La transmission de documents est liée à l'accord de la partie concernée. Or, à moins qu'il s'agisse d'une OPA amicale, l'on voit mal l'une des parties accepter de transmettre ses analyses soit à l'autre partie, soit à toute autre personne. * * * Votre Commission a adopté un amendement (n° 145) rédactionnel de votre Rapporteur puis l'article 15 ainsi modifié. * * * (Article 31 de la loi du 24 janvier 1984) Le présent article vise à préciser les règles de fonctionnement du comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement (CECEI) et à le doter d'un règlement intérieur. L'article 31 de la loi n°84-46 du 24 janvier 1984 dispose que le CECEI prend les décisions et accorde les autorisations ou dérogations individuelles prévues par les lois et règlements applicables aux établissements de crédits et aux entreprises d'investissement. Il en fixe la composition. Il est en revanche muet sur les règles qui régissent ses délibérations et sur toute autre procédure interne. Actuellement, les modes d'activité du CECEI résultent de la pratique. Tel n'est pas le cas de la Commission des opérations de bourse (COB). L'article 2 bis de l'ordonnance n° 67-833 prévoit l'existence d'un règlement intérieur, publié au Journal officiel, qui précise les règles relatives aux délibérations de la Commission. L'utilité d'un règlement est de permettre aux opérateurs de marché d'être soumis à des règles écrites et non à des comportements aléatoires. Le présent article aligne le régime du CECEI sur celui de la COB : - en renvoyant à un décret en Conseil d'État le soin de déterminer les règles de majorité et de quorum qui encadrent les délibérations du comité. Le décret devra prévoir également les modalités de la consultation écrite en cas d'urgence, introduite dans la loi du 24 janvier 1984 précitée par l'article 36 de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 ; - en prévoyant l'établissement d'un règlement intérieur publié au Journal officiel sur les modalités d'instruction et d'examen des dossiers. * * * Votre Commission a adopté un amendement (n° 146) de M. Dominique Baert, précisant que le Conseil « arrête » lui-même son règlement intérieur, puis l'article 16, ainsi modifié. * * * Dispositions relatives à la commission des opérations de bourse (Article 2 de l'ordonnance du 28 septembre 1967 instituant une commission des opérations de bourse) Collège de la Commission des opérations de bourse Le présent article aménage, pour des raisons techniques, la composition du collège de la COB. L'article 89, paragraphe II, de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 précitée a modifié la composition du collège de la COB pour tenir compte, notamment, de la création du Conseil des marchés financiers (CMF). A ce titre, un membre du CMF, désigné par le Conseil, siège de droit au collège de la COB. La loi du 2 juillet 1996 ne prévoit pas de suppléance en cas d'empêchement du représentant du CMF. Or, ce représentant - actuellement le président du CMF - n'a pas souhaité participer aux délibérations de la COB à l'occasion de l'OPA de la BNP sur la Société générale et de celle de Total Fina sur Elf, dans la mesure où il exerçait son activité professionnelle au sein de la BNP (comme conseiller du Président), établissement bancaire impliqué dans ces deux offres publiques. Le deuxième alinéa du présent article introduit plus de souplesse en prévoyant dans le dispositif que le représentant du CMF est son président et qu'il peut être remplacé par un autre membre du CMF en cas d'empêchement. Le dernier alinéa du présent article procède enfin à un aménagement technique en prévoyant que siège au collège de la COB le président du Conseil national de la comptabilité. * * * Votre Commission a adopté un amendement (n° 147) de votre Rapporteur corrigeant une erreur de référence. Puis elle a examiné un amendement de M. Philippe Auberger, précisant que le suppléant du Président du CMF est désigné, non par ce dernier, mais par le Conseil lui-même. M. Dominique Baert a jugé que la rédaction proposée faisait disparaître le fait que le suppléant était désigné parmi les membres du Conseil. Il a proposé de sous-amender l'amendement afin de rétablir cette précision. M. Philippe Auberger a indiqué que la seule nuance qu'il souhaitait introduire tenait au fait que le suppléant était désigné par le Conseil et s'est donc déclaré d'accord avec le sous-amendement de M. Dominique Baert. Après que votre Rapporteur et le Président Henri Emmanuelli se soient déclarés en faveur de l'amendement ainsi modifié, votre Commission l'a adopté (n° 148), puis elle a adopté l'article 17, ainsi modifié. * * * (Article 2 bis de l'ordonnance du 28 septembre 1967) Délégation de signature au sein Le présent article renvoie au décret en Conseil d'État les conditions de délégation de signature au sein du collège de la COB. L'objectif est d'assurer la continuité des activités de la COB en cas d'absence de son président ou d'un membre du collège. En conséquence, le dispositif modifie l'article 2bis de l'ordonnance du 28 septembre 1967 précitée, relatif au règlement intérieur de la COB. Il prévoit en premier lieu que le président peut déléguer ses attributions pour ester en justice (à l'exclusion des juridictions pénales). En second lieu, le collège peut déléguer au président, ou en son absence à un autre membre, la signature des décisions à caractère individuel, à l'exception de celles concernant les pratiques ayant eu pour effet de : - fausser le fonctionnement du marché ; - procurer aux intéressés un avantage injustifié qu'ils n'auraient pas obtenu dans le cadre normal du marché ; - porter atteinte à l'égalité d'information et de traitement des investisseurs ou à leurs intérêts ; - faire bénéficier les émetteurs et les investisseurs des agissements d'intermédiaires contraires à leurs obligations professionnelles. De même, les sanctions pécuniaires à l'encontre des auteurs de pratiques illégales demeurent du ressort de la collégialité et ne pourront être déléguées. Le présent article dispose en outre que le président peut déléguer sa signature dans les matières où il tient une compétence propre. Il s'agit principalement de : Il est enfin prévu d'insérer dans le règlement de la COB une disposition analogue à celle inscrite à l'article 1.1.2. du règlement général du CMF, sur la consultation écrite du collège en cas d'urgence. Le cinquième alinéa (4°) du paragraphe I du présent article dispose que cette procédure relèvera de l'initiative du président de la COB, en cas d'urgence, sauf en matière disciplinaire. * * * Votre Commission a adopté un amendement (n° 149) rédactionnel de votre Rapporteur, puis l'article 18 ainsi modifié. * * * Articles additionnels après l'article 18 Organisation des Banques populaires Votre Commission a d'abord examiné un amendement (n° 150) du Président Henri Emmanuelli supprimant la dualité des structures centrales du réseau des Banques populaires, afin de renforcer cet établissement dans ses missions de régulation prudentielle et institutionnelle, son auteur ayant insisté sur le fait que les statuts de cet organisme devaient être adaptés et qu'il s'agissait d'une mesure de régularisation et de mise en conformité de la loi avec la pratique. Après que votre Rapporteur ait émis un avis favorable, la Commission a adopté cet amendement, le Président Henri Emmanuelli se félicitant du consensus sur cette question. Système de compensation et de résiliation des créances Elle a ensuite examiné deux amendements largement identiques, le premier de M. Jean-Pierre Balligand, le second de M. Philippe Auberger relatifs à la résiliation et la compensation globale des créances. M. Jean-Pierre Balligand puis M. Philippe Auberger ont insisté sur la nécessaire mise en place d'un tel dispositif à l'heure où la concurrence bancaire internationale s'intensifie et que le ratio Cooke fait l'objet de renégociations. M. Jean-Jacques Jégou a estimé que cet amendement permettra à la place de Paris d'opérer avec de meilleures armes face aux marchés de Londres et de Francfort. M. Dominique Baert a, pour sa part, rappelé que la commission des Finances avait adopté un amendement similaire en 1999, à l'occasion de la discussion du projet de loi sur l'épargne et la sécurité financière. Après que le Président Henri Emmanuelli se soit interrogé sur l'origine commune de ces amendements, identiques à une nuance près, M. Philippe Auberger a accepté de retirer son amendement au bénéfice de l'amendement (n° 151) de M. Jean-Pierre Balligand dont il est devenu cosignataire, amendement adopté par votre Commission. Après l'article 18 Votre Commission a enfin rejeté deux amendements de M. Jean-Jacques Jégou, le premier supprimant l'impôt de bourse, le second en abaissant les taux, le Rapporteur ayant indiqué qu'il y était hostile par principe et, qu'en outre, il s'agissait de cavaliers législatifs. Elle a enfin examiné un amendement de M. Yves Cochet rétablissant le droit de timbre sur les opérations de bourse effectuées par des non-résidents, M. Christian Cuvilliez ayant insisté sur l'objectif poursuivi par cet amendement, qui va à l'encontre de la position défendue par M. Jean-Jacques Jégou, votre Rapporteur ayant souligné que la suppression du droit de timbre était destinée à attirer les capitaux étrangers. Votre Commission a alors rejeté cet amendement. * * * AMÉLIORATION DE LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT D'ARGENT PROVENANT D'ACTIVITÉS CRIMINELLES ORGANISÉES (Article premier de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 Extension de la liste des professions soumises aux dispositions de la loi « anti-blanchiment » Le présent article vise à étendre le champ d'application de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux à de nouvelles activités et professions qui, bien que ne relevant pas du secteur financier, peuvent être sollicitées dans des opérations de blanchiment. Cette extension s'inscrit dans le cadre de la négociation d'une proposition de directive modifiant la directive du 10 juin 1991, relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux. A.- LES PROFESSIONS ACTUELLEMENT SOUMISES A LA LOI DU 12 JUILLET 1990 RELÈVENT, POUR L'ESSENTIEL, DU SECTEUR FINANCIER 1.- Le dispositif initial Lors de son adoption, la loi n°90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants visait exclusivement les établissements de crédits et les professions financières. Ces organismes, énumérés dans l'article 1er de la loi, couvrent pratiquement l'ensemble du secteur bancaire et financier, y compris le Trésor public, la Banque de France et les services financiers de la Poste, la Caisse des dépôts et consignations, les sociétés d'assurances et les mutuelles ainsi que les sociétés de bourse, auxquels la loi n°96-392 du 13 mai 1996 a ajouté les courtiers d'assurance et de réassurance. La définition de ces organismes a été précisée par la loi n°98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, afin d'intégrer, notamment, les entreprises d'investissements, suite aux modifications opérées dans le cadre de la loi n°96-957 du 2 juillet 1996 sur la modernisation des activités financières. Cette loi impose à ces organismes de faire preuve d'une vigilance constante sur certaines opérations (article 14) en s'assurant notamment de l'identité de leurs clients par tout document écrit probant (article 12) et en conservant ces documents pendant une période de cinq ans (article 15). Elle les oblige ainsi à se doter d'une organisation interne et de procédures particulières pour l'application de ses dispositions, notamment l'obligation de déclarer à un service spécialisé - TRACFIN - « les sommes inscrites dans leurs livres, lorsqu'elles paraissent provenir du trafic de stupéfiants ou de l'activité d'organisations criminelles » (article 5). Cette déclaration obligatoire ne porte pas sur un délit mais sur des opérations suspectes : elle est d'ailleurs effectuée auprès d'un service administratif et non auprès des autorités judiciaires. Il s'agit, en définitive, de favoriser la coopération entre des professions jugées « sensibles » ou « vulnérables » et les autorités compétentes, afin de détecter et prévenir les opérations de blanchiment des capitaux. Par ailleurs, l'article 2 de la loi du 12 juillet 1990 prévoit que les personnes autres que celles mentionnées à l'article 1er, qui, dans l'exercice de leur profession, réalisent, contrôlent ou conseillent des opérations entraînant des mouvements de capitaux, sont tenues de déclarer au procureur de la République les opérations dont elles ont connaissance et qui portent sur des sommes qu'elles savent provenir de l'une des infractions visées par l'article 3 de la loi. Cette obligation concerne certaines professions réglementées, comme les commissaires-priseurs, les huissiers de justice, les commissaires aux comptes, les conseils juridiques, les agents immobiliers ou notaires, étant précisé que « pour les avocats, il va de soi que toutes les informations dont ils acquièrent la connaissance dans l'exercice de la défense ne sont pas concernées par l'obligation de déclaration » (2) Elle peut également s'appliquer aux professions telles que celles de bijoutier ou d'antiquaire. Une circulaire du ministère de la Justice, en date du 28 septembre 1990, décrit ce dispositif de la manière suivante : « les personnes visées par l'article 2 auront, pour leur part, à faire connaître au procureur de la République les opérations dont elles ont connaissance dans le cadre de leur activité professionnelle sans nécessairement les effectuer elles-mêmes et relatives à des sommes qu'elles savent provenir de l'une des infractions prévues par l'article 627, alinéa 3, du code de la santé publique et par l'article 415 du code des douanes. Le système ainsi instauré est comparable, dans son esprit, à celui prévu pour les fonctionnaires et les autorités publiques par l'article 40 du code de procédure pénale ». Votre Rapporteur considère qu'un dispositif similaire pourrait être envisagé pour les autres obligations déclaratives découlant de la loi du 12 juillet 1990, étant précisé qu'une dérogation resterait naturellement prévue pour assurer le respect des droits de la défense, dans le cadre d'une procédure judiciaire formelle. 2.- Une première extension du champ d'application de la loi du 12 juillet 1990 Le champ d'application de la loi du 12 juillet 1990 est appelé à s'élargir, compte tenu de l'évolution des méthodes du blanchiment des capitaux. Les études réalisées par le Groupe d'action financière sur le blanchiment des capitaux (GAFI) soulignent, en effet, l'utilisation de méthodes très variées de blanchiment pouvant faire intervenir des acteurs qui n'exercent pas une activité directement en lien avec le secteur financier. Dans son dernier rapport sur les typologies du blanchiment des capitaux (3) le Groupe évoque ainsi la possible implication des courtiers en valeurs mobilières et matières premières ou en assurance, des « agents de création de sociétés », des professions immobilières, etc. Il relève, en outre, que « d'autres professions libérales - avocats, notaires et comptables, par exemple - jouent un rôle dans les montages de blanchiment d'argent ». La loi n°98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier a réalisé une première extension de la déclaration de soupçon, en y soumettant les professionnels du secteur immobilier. Désormais, les dispositions de la loi du 12 juillet 1990 s'appliquent également « aux personnes qui réalisent, contrôlent ou conseillent des opérations portant sur l'acquisition, la vente, la cession ou la location de biens immobiliers ». Cette extension aux professions de l'immobilier constitue un premier élément de réponse à la directive 91/308/CEE du 10 juin 1991 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment dont l'article 12 dispose que « les Etats membres veillent à étendre tout ou partie des dispositions de la présente directive aux professions et catégories d'entreprises, autres que les établissements de crédits et les personnes visées à l'article 2bis, qui exercent des activités particulièrement susceptibles d'être utilisées à des fins de blanchiment ». Un bilan de l'application de ce dispositif, établi par le service « TRACFIN » chargé de recueillir les déclarations de soupçon, montre qu'en 1998, les banques et les établissements de crédits ont représenté 67 % des déclarations reçues ; les établissements financiers publics 18 % ; les changeurs manuels 9 %, et les sociétés d'assurance moins de 5 %. B.- LES NOUVELLES PROFESSIONS VISÉES PAR LE PROJET DE LOI 1.- Un élargissement à certaines professions « vulnérables » Le présent article s'inscrit dans ce mouvement d'extension du champ de la loi du 12 juillet 1990 à de nouvelles professions qui, bien que n'appartenant pas au secteur financier, sont jugées « vulnérables » en matière de blanchiment. Le paragraphe I de cet article complète, en effet, l'article 1er de cette loi en ajoutant à la liste des organismes concernés par son application : - les experts-comptables ; - les représentants légaux et les directeurs responsables de casinos ; - enfin, les personnes se livrant habituellement au commerce ou organisant la vente de pierres précieuses, de matériaux précieux, d'antiquités et d'_uvres d'art. Le paragraphe II du présent article soumet ces professions, désignées par le terme de « personnes », aux mêmes obligations, protections et sanctions que celles prévues par la loi du 12 juillet 1990, pour les organismes financiers. Autrement dit, elles doivent respecter les obligations déclaratives que la loi de 1990 impose (articles 4 et 6). Dans ce cadre, la déclaration de soupçon qu'elles sont tenues d'effectuer est assortie de l'irresponsabilité civile et pénale, sous réserve que ces personnes soient de bonne foi (articles 8 et 9). Enfin, le fait d'informer le bénéficiaire des opérations ou sommes susceptibles de provenir du trafic de stupéfiants ou d'activités criminelles de l'existence de cette déclaration ou de ses suites peut être sanctionné par une amende de 15.000 à 150.000 francs (article 10). Ce texte omet, toutefois, de faire référence à l'article 7 de la loi, qui permet d'engager une procédure disciplinaire en cas d'omission de déclaration. Or, cette procédure peut être mise en _uvre pour les commissaires-priseurs, par exemple, visés par le 10° du présent article. Il convient donc de préciser ce renvoi, quand bien même il est sans objet pour certaines autres professions intégrées dans le dispositif. Cette extension du système de prévention du blanchiment à de nouvelles professions répond, en partie, aux préoccupations exprimées tant au niveau international que communautaire. A cet égard, votre Rapporteur rappelle que, dans une résolution du 9 mars 1999 (4), le Parlement européen a, en effet, invité la Commission à présenter une proposition de modification de la directive relative au blanchiment des capitaux qui prévoit l'inclusion, dans son champ d'application, « des professions susceptibles d'être impliquées dans le blanchiment des capitaux ou d'être exploitées abusivement par les blanchisseurs, comme les agents immobiliers, les négociants en _uvres d'art, les commissaires-priseurs, les casinos, les bureaux de change, les transporteurs de fonds, les notaires, les comptables, les avocats, les conseillers fiscaux et les experts-comptables (...) en vue de leur appliquer, en tout ou partie, les dispositions énoncées dans cette directive et, le cas échéant, de nouvelles dispositions tenant compte des circonstances particulières de ces professions et respectant pleinement, en particulier, l'obligation de secret professionnel qui leur est spécifique ». Cette préoccupation s'est traduite par l'adoption, le 14 juillet 1999, d'une proposition de directive (5) modifiant la directive du 10 juin 1991 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux. Le texte de cette proposition insère un nouvel article 2 bis qui élargit l'éventail des activités et professions soumises aux obligations de la directive, tout en précisant la liste des opérations pour lesquelles les notaires et les autres professions juridiques entreront dans son champ d'application _ pour l'essentiel, des activités relevant du domaine financier ou du droit des sociétés _. Outre les établissements de crédit et les institutions financières dont la définition est précisée dans l'article 1er de la proposition, les professions concernées sont les suivantes : - les commissaires aux comptes et comptables ; - les agents immobiliers ; - les notaires et autres membres des professions juridiques indépendantes lorsqu'ils représentent ou assistent des clients dans le cadre des activités suivantes : · l'achat et la vente de biens immeubles ou d'entreprises commerciales ; · la manipulation d'argent, de titres ou d'autres actifs appartenant au client ; · la constitution, la gestion ou la direction de sociétés, de fiducies ou de structures similaires ; · l'exécution d'autres opérations financières ; _ les marchands d'articles de grande valeur, tels que pierres et métaux précieux ; _ les transporteurs de fonds ; _ les gérants, propriétaires et directeurs de casinos. Votre Rapporteur observe que l'article 19 du présent projet de loi permet d'anticiper, en partie, la transposition de ce texte - qui n'a pas encore été adopté officiellement - pour un certain nombre de professions, à l'exception, toutefois, des transporteurs de fonds, des professions juridiques indépendantes et des commissaires aux comptes. Si l'absence des transporteurs de fonds de la liste des organismes auxquels s'applique la loi du 12 juillet 1990, ne soulève pas de réelle difficulté pour l'efficacité du système de lutte contre le blanchiment de l'argent ; il en va, en revanche, différemment, s'agissant des professions juridiques indépendantes et des commissaires aux comptes. 2.- Une évolution appelée à se poursuivre L'absence de certaines professions dans le champ du présent article ne manque pas de surprendre au regard des dispositions de la proposition de directive modificative. S'agissant des commissaires aux comptes, leur participation au dispositif de lutte contre le blanchiment d'argent ne pose pas de problème en soi mais doit être examinée au regard des obligations qui leur incombent, d'ores et déjà, en droit français. Les commissaires aux comptes sont, en effet, investis de nombreuses obligations d'information, en particulier, celle de révéler au procureur de la République « les faits délictueux dont ils ont eu connaissance » (article 233, alinéa 2 de la loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales). Cette obligation de dénoncer les faits délictueux, en rapport avec le fonctionnement de la société, est impérative. En vertu des mêmes dispositions législatives, la responsabilité du commissaire ne peut être engagée par sa révélation au parquet, même si elle aboutit à un non-lieu. En revanche, en cas de non révélation de tels faits, le commissaire s'expose à des sanctions pénales (article 457, alinéa 1er de la loi du 24 juillet 1966) et engage sa responsabilité civile. Une difficulté est donc d'articuler cette obligation avec celle de la déclaration de soupçon qui découlerait de l'assujettissement des commissaires aux comptes aux dispositions de la loi du 12 juillet 1990. Dans ce dernier cas, en effet, l'examen des faits repose sur une approche très différente dans la mesure où une déclaration de soupçon porte non par sur des faits manifestement délictueux, mais qui paraissent l'être. En outre, elle est transmise à un service administratif et non directement au parquet. Il n'en reste pas moins qu'elle est, selon votre Rapporteur, tout à fait compatible avec l'obligation découlant de l'article 233 (alinéa 2), sous réserve qu'elle ne soit pas considérée comme exclusive et que ses modalités d'application soient clairement explicitées. En revanche, la question de l'implication des professions juridiques indépendantes, et en particulier des avocats, dans le dispositif législatif de lutte contre le blanchiment des capitaux se pose en des termes différents. Dans la proposition de directive modificative, la Commission propose que dans le cas des notaires et des autres professions juridiques indépendantes, les obligations de la directive ne s'appliquent « qu'à certaines activités précises, relevant de la sphère financière ou du droit des sociétés, pour lesquelles le risque de blanchiment est le plus important ». Elle ajoute qu'étant donné leur statut particulier, « les avocats pourraient être exonérés de toute obligation en matière d'identification ou d'information, dans tous les cas liés à la représentation ou à la défense d'un clients dans une procédure judiciaire ». Ces préoccupations s'expriment dans les articles 2 bis et 6 du texte de la proposition de directive, ce dernier article réservant un traitement spécifique à la profession d'avocat. Il ouvre, ainsi, la possibilité aux États membres d'autoriser les avocats à communiquer leurs soupçons à leur barreau ou à une association professionnelle équivalente. Une dérogation est prévue lorsque ces informations sont fournies par un client dans le cadre d'une procédure judiciaire formelle. Toutefois, cette dérogation « ne saurait couvrir les cas dans lesquels il y a des raisons de soupçonner que des conseils sont sollicités en vue de faciliter le blanchiment des capitaux ». Votre Rapporteur considère que ces précisions sont utiles, en particulier pour garantir le respect des droits de la défense. Toutefois, à l'exception de ce cas, le respect des obligations de la loi du 12 juillet 1990 pourrait être imposé à l'ensemble des professions, sans distinction particulière, dès lors que, dans leur cadre de leur activité, elles sont confrontées à une opération financière suspecte. Cette approche présente l'avantage d'éviter toute forme de stigmatisation d'une profession, tout en impliquant un plus grand nombre d'acteurs dans la lutte contre le blanchiment d'argent. * * * Votre Commission a tout d'abord examiné les amendements identiques (n° 1) de la Commission des lois, et de M. Philippe Auberger visant à supprimer l'assujettissement des experts comptables aux obligations déclaratives découlant de la loi du 12 juillet 1990. Votre Rapporteur a émis un avis favorable à ces amendements, tout en faisant part, à titre personnel, de ses forts regrets. Le Président Henri Emmanuelli a rappelé qu'il s'agissait là d'une position, partagée au-delà de la commission des Lois, et s'est donc déclaré favorable à ces amendements. Après que M. Philippe Auberger ait fait part de sa satisfaction, votre Commission a adopté l'amendement (n° 1). Puis, votre Rapporteur a retiré son amendement dont l'objet est d'étendre la procédure de déclaration de soupçon aux professions réglementées qui sont amenées à réaliser, contrôler ou conseiller des opérations financières, dans les conditions définies par l'article 3 de la loi du 12 juillet 1990. Il a précisé que ces professions seront sans aucun doute intégrées dans le dispositif de lutte contre le blanchiment de l'argent, à l'issue de la négociation en cours portant sur la modification de la directive du 10 juin 1991, relative à la prévention de l'utilisation du système financier à des fins de blanchiment et qu'il convenait d'attendre l'issue de cette négociation. Insistant sur l'intérêt que représente la participation de ces professions à la lutte contre le blanchiment, il a toutefois invité M. Christian Cuvilliez à retirer un amendement de M. Yves Cochet dont la finalité est identique. M. Christian Cuvilliez, tout en souhaitant que la liste des professions soumises à la loi de 1990 soit la plus large possible, a indiqué qu'il retirait l'amendement, compte tenu du débat précédent. M. Michel Inchauspé a demandé si ces amendements incluaient les experts comptables. M. Éric Besson lui a répondu par l'affirmative, en soulignant que les amendements étaient, en toute hypothèse, retirés. Votre Commission a examiné un amendement de M. François d'Aubert incluant les avocats dans le champ d'application de la législation anti-blanchiment, lorsqu'ils interviennent dans les procédures d'infraction à la législation sur les stupéfiants. M. Philippe Auberger s'est étonné qu'un tel amendement, dont l'exposé sommaire présente les avocats comme « souvent... des auxiliaires de la criminalité » puisse venir en discussion. Le Président Henri Emmanuelli a rappelé qu'il n'était en aucune manière juge du contenu des exposés sommaires, mais que chacun apprécierait une telle mention. M. Gilbert Gantier, après avoir relevé que l'amendement visait des cas bien précis, a retiré l'amendement. Enfin, votre Commission a adopté un amendement (n° 152) de votre Rapporteur, qui ajoute une référence à l'article 7 de la loi précitée dans le but de permettre d'engager une procédure disciplinaire en cas de manquement à l'obligation de transmettre une déclaration de soupçon par les professions visées par cette loi. Votre Commission a adopté l'article 19 ainsi modifié. * * * (Article 3 de la loi du 12 juillet 1990) Extension du champ de la déclaration de soupçon Le présent article a pour objet de préciser et d'étendre le contenu de l'obligation de déclarer certaines sommes ou opérations auprès de la cellule TRACFIN, prévue par la loi n°90-614 du 12 juillet 1990 (A). Il vise, également, à permettre une meilleure connaissance des opérations d'un certain montant, réalisées avec des pays ou territoires jugés non coopératifs, conformément aux initiatives lancées, dans ce domaine, par la France, au plan international (B). A.- L'EXTENSION DU CHAMP DE LA DÉCLARATION DE SOUPÇON 1.- Un contenu précisé Le paragraphe I de cet article précise les termes définissant l'obligation de déclaration de soupçon, énoncés dans l'article 3 de la loi du 12 juillet 1990. En vertu de cet article, les organismes financiers et les personnes visées par la loi sont tenus de déclarer à la cellule TRACFIN les sommes qui « paraissent provenir du trafic de stupéfiants ou de l'activité d'organisations criminelles » ainsi que les opérations portant sur de telles sommes. Cette rédaction a été introduite par l'article 72 de la loi n°93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, dans le but d'élargir la notion de blanchiment à toutes les infractions graves, y compris celles commises par des organisations criminelles. Les organismes financiers, soumis à cette obligation, doivent assurer l'information et la formation de tous les membres concernés du personnel. Le décret n°91-160 du 13 février 1991 leur impose notamment d'adopter des règles écrites internes définissant les procédures destinées à mettre en _uvre les dispositions de la loi du 12 juillet 1990. La déclaration de soupçon est assortie du principe de l'irresponsabilité civile et pénale des organismes concernés, sous réserve de leur bonne foi (article 8). En outre, les responsables de ces organismes sont tenus à une obligation de discrétion concernant l'existence d'une déclaration et de ses suites éventuelles (article 10). Le paragraphe I du présent article prévoit deux modifications des termes utilisés pour définir l'obligation de déclaration de soupçon en vue d'en préciser la portée et de faciliter la sanction des manquements à cette obligation. D'une part, il vise les opérations « qui pourraient provenir » et non plus « qui paraissent provenir » du trafic de stupéfiants ou d'activités d'organisations criminelles. La rédaction actuelle impose, en effet, aux autorités de contrôle d'apporter la preuve de l'existence d'un élément matériel pour caractériser l'infraction et sanctionner un manquement à l'obligation de déclaration. La caractérisation des faits doit être précise, dès lors qu'en vertu de l'article 7 de la loi du 12 juillet 1990, l'autorité de contrôle doit, d'une part, aviser le procureur de la République qu'un organisme a omis d'effectuer une déclaration ; d'autre part, ouvrir une procédure disciplinaire à l'encontre de cet organisme. L'objectif recherché par le présent article est donc d'alléger la charge de la preuve qui lui incombe, en cas d'omission de déclaration, et faciliter la mise en _uvre d'une procédure disciplinaire. D'autre part, le paragraphe I du présent article substitue aux mots « activités d'organisations criminelles », les mots « activités criminelles organisées » afin de viser un type de comportement ou d'activité et non la participation à une organisation particulière, comme peuvent le laisser sous-entendre les termes actuellement utilisés. On peut d'ailleurs relever cette ambiguïté dans la circulaire de la Direction des affaires criminelles du ministère de la Justice pour l'application de la loi du 13 mai 1996 ___, qui indique que le champ d'application privilégié du blanchiment est « la lutte contre la criminalité organisée, c'est-à-dire celle qui est le fait de réseaux structurés qui recyclent le produit d'activités illicites au plan international ». Il s'agit, en outre, de se rapprocher des termes de la directive 91/308/ CEE du 10 juin 1991 relative au blanchiment des capitaux, qui fait référence à « la participation à des activités criminelles organisées ». 2.- Une obligation étendue Le paragraphe II de l'article 20 élargit le champ de la déclaration de soupçon en prévoyant qu'elle porte également sur « toute opération lorsque l'identité du donneur d'ordre ou du bénéficiaire reste douteuse malgré les diligences effectuées conformément à l'article 12 de la présente loi ». Cette extension de la déclaration de soupçon vise le cas où l'obligation de vigilance, définie par l'article 12 de la loi du 12 juillet 1990 ne permet pas d'établir, avec certitude, l'identité du bénéficiaire d'une opération qui atteint un certain montant pour les clients occasionnels ou semble être effectuée pour le compte d'un tiers. Dans ce cas, les organismes associés au dispositif de prévention de lutte contre le blanchiment, doivent se renseigner sur l'identité véritable des bénéficiaires. Si le respect de ces dispositions ne permet pas de déterminer l'identité de cette personne, l'obligation de déclaration, prévue par l'article 3 de la loi du 12 juillet 1990, s'appliquera désormais aux organismes concernés. Votre Rapporteur observe que les termes de « donneur d'ordre » et de « bénéficiaire » impliquent que l'organisme concerné doit se renseigner non seulement sur l'identité de la personne qui le sollicite pour une prestation de service particulière, c'est-à-dire le titulaire du compte, mais aussi sur celle de son bénéficiaire réel, s'il est distinct du client. L'objectif recherché est de permettre le signalement automatique à la cellule TRACFIN des opérations financières, dont l'origine mais aussi la destination, sont incertaines. Il importe, en effet, de donner à ce service les moyens de disposer d'un maximum d'informations sur les flux financiers qui demeurent anonymes, en raison, notamment, de leur traitement par des sociétés écrans ou du recours à des prête-noms. B.- LA DÉTECTION DES OPÉRATIONS RÉALISÉES AVEC LES CENTRES FINANCIERS EXTRA-TERRITORIAUX Enfin, le paragraphe III de l'article 20 vise à permettre au Gouvernement d'imposer aux organismes financiers de communiquer à la cellule spécialisée dans la lutte contre le blanchiment, TRACFIN, les opérations d'un certain montant, effectuées pour leur propre compte ou pour le compte de leurs clients avec des personnes physiques ou morales établies dans les Etats ou territoires jugés non coopératifs, communément dénommés « centres financiers offshore ». Plusieurs arguments militent en faveur d'une disposition visant spécifiquement les centres financiers extra-territoriaux. En premier lieu, leur existence menace l'efficacité des législations anti-blanchiment adoptées, depuis une dizaine d'années, par les pays membres du Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI). Ces centres offrent, en effet, une palette de services financiers qui permettent de contourner ces législations en facilitant l'ouverture de comptes bancaires anonymes ou codés, couverts par un secret bancaire très strict. Ils proposent, en outre, des formes variées d'entités juridiques dont l'activité, fictive, permet de conserver secrète l'identité de leur bénéficiaire ainsi que des formes complexes de représentation du propriétaire ou du bénéficiaire d'un actif. Cet environnement juridique contribue fortement à l'opacité des flux financiers et, en définitive, au développement des opérations de blanchiment. En second lieu, les autorités administratives et judiciaires de ces centres disposent de moyens extrêmement limités pour contrôler l'activité des banques et autres institutions financières. En outre, les centres financiers offshore ne participent que de manière très incomplète aux efforts de coopération internationale engagés par les pays du GAFI. Enfin, plus généralement, ces centres représentent un facteur important d'instabilité pour le système financier international. Dans un récent rapport sur les pays ou territoires non-coopératifs (6), le GAFI a défini vingt-cinq critères permettant d'identifier ces pays, sur la base de leurs règles et pratiques dommageables à la lutte contre le blanchiment.
Ce contexte justifie le dispositif proposé dans le paragraphe III du présent article, inséparable, dans son esprit, des dispositions de l'article 21 du présent projet de loi. Ce paragraphe complète l'article 3 de la loi du 12 juillet 1990 en permettant au Gouvernement d'étendre l'obligation de déclaration de soupçon aux opérations, d'un certain montant, réalisées avec des personnes physiques ou morales domiciliées ou ayant leurs intérêts économiques ou financiers dans un pays ou territoire non coopératif. La liste de ces pays doit être fixée par décret, dans le cadre des recommandations formulées par le GAFI. Cette mesure, justifiée quant à son fondement, s'avère cependant délicate à mettre en _uvre. Elle repose, en effet, sur la définition que donne « l'instance internationale de concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment de l'argent », c'est-à-dire le GAFI, des États et territoires jugés non coopératifs. Or, cette définition n'a pas de force juridique contraignante puisque le GAFI n'a pas de personnalité propre et que ses recommandations ne figurent, a fortiori, pas dans une convention internationale. Toutefois, ces considérations n'invalident pas le dispositif proposé dans la mesure où le Gouvernement n'est pas lié par cette définition et la liste de pays qui en découle : le présent article lui donne, en effet, la faculté d'imposer, par décret, une obligation de déclaration des opérations réalisées avec les pays figurant sur la liste du GAFI. S'agissant du problème de l'application concomitante de cette mesure par l'ensemble des pays du GAFI, il est indéniable qu'une décision unilatérale dans ce domaine serait tout à fait inefficace dans le contexte actuel de globalisation financière. Pour autant, votre Rapporteur considère comme légitime le souci d'afficher clairement la volonté de la France de mener à son terme la réflexion menée sur les centres financiers offshore. Il est donc favorable à l'affirmation du principe d'une telle obligation dans la loi du 12 juillet 1990, le renvoi à un décret pour déterminer ses modalités pratiques d'application (fixation du montant des opérations concernées, notamment) permettant de garantir une mise en _uvre conjointe. Enfin, il importe que le Parlement soit informé du bilan de l'extension de la déclaration de soupçon aux opérations réalisées avec les États et territoires jugés non coopératifs. Cette information pourrait passer par la transmission d'un rapport annuel sur l'application de ces dispositions ainsi que des mesures restrictives, prises en vertu de l'article 21 du présent projet de loi. * * * Votre Commission a rejeté deux amendements identiques de MM. Philippe Auberger et Jean-Jacques Jégou, et un amendement similaire de M. Gilbert Gantier, dont l'objet est de supprimer le deuxième alinéa de l'article 20 pour éviter de substituer aux termes « paraissent provenir » les mots « pourraient provenir », M. Philippe Auberger ayant jugé qu'une telle modification élargit de manière trop forte la portée de l'obligation de déclaration de soupçon, fondée sur une appréciation subjective des organismes concernés, votre Rapporteur s'étant déclaré défavorable à leur adoption. Votre Commission a ensuite examiné un amendement (n° 3) de la Commission des lois substituant à l'expression « de l'activité d'organisations criminelles » les mots « d'activités criminelles ou délictueuses organisées », pour élargir le champ de l'obligation de déclaration à ces activités. MM. Jean-Jacques Jégou et Michel Inchauspé se sont interrogés sur le sens de la notion d'« activités criminelles organisées » et son extension aux activités délictueuses proposée par cet amendement, en soulignant l'imprécision de ces rédactions. M. Philippe Auberger a fait part de l'impossibilité, pour une personne recevant des fonds, de savoir si elle est confrontée ou non à une activité « organisée ». Il s'est demandé si cette notion ne devrait pas être supprimée. Le Président Henri Emmanuelli a déclaré qu'il convenait d'adopter une attitude particulièrement prudente s'agissant de problèmes touchant à la définition même des crimes et délits. Il s'est demandé quelles seraient les incidences de cet amendement sur la fraude fiscale. M. Michel Inchauspé a souligné le paradoxe qu'il y avait d'une part, à éliminer certaines professions, dont les experts comptables, du champ d'application de la loi de 1990, tout en faisant peser sur les seules banques des obligations de plus en plus fortes. Il a jugé que l'extension du texte aux délits impliquait que la fraude fiscale entre dans son champ d'application. Il a donc considéré que ce texte étendrait très largement les obligations de transmission imposées aux banques, lesquelles, par prudence déclareraient un nombre extrêmement important d'opérations. Il a conclu en insistant sur le fait qu'un tel amendement aboutirait à fragiliser tout le réseau bancaire français, et qu'il conviendrait plutôt de s'intéresser aux dépôts réalisés dans les banques de Saint-Martin ou de Saint-Barth plutôt que d'aboutir à un système aussi négatif pour l'ensemble des banques françaises. Votre Rapporteur a indiqué qu'il s'agissait simplement d'introduire une notion plus conforme à la réalité dans la mesure où les fonds blanchis peuvent provenir d'un crime ou d'un délit. Cette précision permet aux organismes soumis aux obligations déclaratives découlant de la loi du 12 juillet 1990 de ne pas avoir à apprécier le caractère criminel ou délictueux d'un fait susceptible de provenir d'une activité de blanchiment. Une telle activité suppose toujours une organisation. Mais le texte demeure cantonné aux activités de blanchiment. M. François Goulard a souligné qu'il n'existait pas un seul cas dans lequel on pouvait reprocher à une banque de ne pas s'être conformée à l'obligation de transmission. En réponse, votre Rapporteur lui a répondu qu'il convenait de se départir en la matière de tout angélisme. Il a souligné que seulement 1.600 déclarations par an parvenaient à TRACFIN. M. Christian Cuvilliez, comme M. Yves Cochet ont souhaité que soit supprimée la référence aux activités organisées, de manière à étendre le champ d'application de la loi. M. Jean-Louis Dumont a fait part de ses réserves sur un amendement risquant d'ouvrir beaucoup trop largement le champ d'application de la loi de 1990 alors que celle-ci repose au contraire sur la volonté de cerner et combattre les seules activités de blanchiment. Usant de la faculté que l'article 38 du Règlement confère à un député qui n'est pas membre de la Commission d'y prendre la parole, M. Jacky Darne a présenté les travaux de la mission d'« informations communes sur les obstacles au contrôle et à la répression de la délinquance financière et du blanchiment des capitaux en Europe ». Le Président Henri Emmanuelli l'a interrogé sur la portée exacte de la mention des délits dans l'amendement de la commission des Lois. En réponse, M. Jacky Darne a indiqué que cet article continuerait à viser les seules activités de blanchiment. Il a ajouté que la commission des Lois avait adopté cet amendement dans cet esprit, en considérant que la référence aux délits constitue une simple précision qui ne bouleversera pas l'équilibre de cette loi. Il a déclaré que si la commission des Finances le souhaitait, elle pourrait supprimer cette référence. Le Président Henri Emmanuelli a rappelé que la notion de crime était distincte de celle de délit, et qu'une telle adjonction avait une portée juridique qu'il convenait d'éclaircir. Votre Commission a alors décidé de réserver le vote sur cet amendement (n° 3), souhaitant des informations complémentaires sur sa portée. Votre Commission a rejeté un amendement de M. Philippe Auberger supprimant la référence au caractère « organisé » des activités en cause. Votre Commission a rejeté trois amendements identiques présentés par MM. Philippe Auberger, Jean-Jacques Jégou, Gilbert Gantier, tendant à supprimer l'obligation faite aux organismes financiers de communiquer systématiquement au service spécialisé de lutte contre le blanchiment -TRACFIN- les opérations dont le donneur d'ordre ou le bénéficiaire n'a pu être identifié, malgré les diligences effectuées dans le cadre de l'article 12 de la loi du 12 juillet 1990. Votre Commission a adopté un amendement (n° 2) présenté par la commission des Lois, qui rend obligatoire l'extension de la déclaration de soupçon aux opérations réalisées avec des personnes établies dans un État ou un territoire jugé non coopératif par le Groupe d'action financière internationale sur le blanchiment des capitaux (GAFI). Cet amendement étend, par ailleurs, l'obligation de déclaration de soupçon aux opérations financières faisant intervenir des fonds fiduciaires ou d'autres entités juridiques, qui contribuent à l'opacité de ces opérations. M. Michel Inchauspé s'est déclaré hostile à cet amendement, estimant que la liste du GAFI était loin d'être exempte de reproches, et tenait compte de problèmes diplomatiques. Il a jugé que ce dispositif se traduirait par un très fort afflux de déclarations au service TRACFIN. M. Jean-Jacques Jégou s'est également interrogé sur la très grande extension que représente le nouveau dispositif. Du fait de l'adoption de cet amendement, trois amendements identiques de MM. Philippe Auberger, Gilbert Gantier et Michel Inchauspé prévoyant que le décret fixera le montant minimum des opérations soumises à déclaration et qu'il entrera en vigueur pour un ensemble d'États, ainsi qu'un amendement identique de M. Jean-Jacques Jégou sont devenus sans objet. En conséquence de la position qu'elle a adoptée au sujet de l'amendement (n° 3) de la commission des lois, elle a décidé de réserver un amendement de conséquence du Rapporteur. Votre Commission a alors réservé le vote de cet article. Au cours d'un examen ultérieur, votre Commission a rejeté l'amendement (n° 3) de la commission des Lois visant à étendre la déclaration de soupçon, prévue par la loi du 12 juillet 1990, non plus aux seules « activités criminelles organisées » mais également aux activités « délictueuses », estimant que cette notion était insuffisamment précise. Favorable à cette décision, votre Rapporteur a retiré son amendement, destiné à tirer les conséquences de la proposition de la commission des Lois, au plan formel. Elle a ensuite adopté l'article 20, modifié par les amendements qu'elle a adoptés. * * * Article additionnel après l'article 20 Création du comité de liaison de lutte contre le blanchiment Votre Commission a adopté un amendement (n° 4) de la commission des Lois instituant un comité de liaison de lutte contre le blanchiment, réunissant, auprès de TRACFIN, les professions soumises à la loi du 12 juillet 1990, les autorités de contrôle et les services de l'État concernés. Votre Rapporteur a approuvé ce mécanisme permettant un « retour d'information » vers les professions soumises à l'obligation de déclaration. * * * (Article 12 bis de la loi du 12 juillet 1990) Sanctions à l'encontre des centres financiers extra-territoriaux Le présent article instaure un dispositif permettant au Gouvernement de soumettre à des conditions particulières, voire d'interdire, des opérations réalisées avec des territoires ou pays jugés non coopératifs en matière de lutte contre le blanchiment. Ce dispositif complète l'obligation de déclaration instituée par l'article 20 du projet de loi, dans le cadre d'un système de « riposte graduée » préconisé par le Groupe d'action financière sur le blanchiment des capitaux (GAFI). A.- UN SYSTÈME DE « RIPOSTE GRADUÉE » À L'ENCONTRE DES CENTRES FINANCIERS EXTRA-TERRITORIAUX Le présent article prévoit l'introduction d'un nouvel article 12 bis dans la loi du 12 juillet 1990, qui habilite le Gouvernement à prendre des mesures de restriction des transactions financières menées avec des pays ou territoires, considérés par le GAFI, comme non coopératifs. Cette mesure s'inspire des recommandations formulées par le GAFI dans un récent rapport sur les pays et territoires non coopératifs (7). Dans ce rapport, le Groupe estime nécessaire de prendre en compte le niveau de gravité des déficiences constatées dans la législation et les pratiques des pays et de définir, à partir de cet examen, différentes catégories de pays non coopératifs. Il distingue ainsi : - les pays et territoires « de toute évidence non coopératifs » c'est-à-dire présentant de graves déficiences dans nombre de domaines ; - les juridictions « en partie non coopératives » qui se caractérisent par l'existence d'obstacles dans plusieurs domaines ; - enfin, les juridictions « de facto non coopératives » qui ne dressent pas d'obstacles significatifs dans les lois et règlements mais disposent d'un régime inefficace dans la pratique. Cette distinction doit conduire à l'adoption de mesures de portée différente, destinées à garantir la protection et l'efficacité des systèmes de lutte contre le blanchiment de l'argent. Dans cette perspective, le GAFI préconise un système fondé sur une phase de dialogue avec les pays jugés non coopératifs ; puis, en cas d'échec, de contre-mesures dont la mise en _uvre dépend de « la gravité des déficiences identifiées ». Dans cette architecture, une première contre-mesure consiste à imposer aux institutions financières des pays membres du GAFI de « prêter une attention particulière aux transactions financières réalisées avec des particuliers ou des personnes morales ayant leur compte dans une institution financière établie dans une « juridiction non coopérative ». » Cette mesure fait l'objet du paragraphe III de l'article 20, du présent projet. En dernier ressort, le GAFI recommande à ses membres de « déterminer s'il est souhaitable et possible d'assortir de conditions, de restreindre, de cibler, voire d'interdire les transactions financières avec ces juridictions ». Il ajoute que « ces mesures pourraient être un recours ultime si les pays ou territoires décidaient de maintenir les lois ou pratiques qui sont particulièrement préjudiciables à la lutte contre le blanchiment de capitaux ». Cette recommandation inspire directement le présent article, qui complète, ainsi, les dispositions du paragraphe III de l'article 20 du projet de loi et contribue à la mise en place d'un système de riposte graduée et ciblée, à l'encontre des centres financiers extra-territoriaux. B.- LES MODALITÉS DE MISE EN _UVRE PRÉVUES Le présent article permet au Gouvernement de décider, en dernier recours, l'interdiction partielle ou totale des opérations financières avec les pays ou territoires présentant les défauts les plus graves ou refusant d'améliorer leur législation anti-blanchiment. Il prévoit également que les mesures de restriction des mouvements de capitaux peuvent être temporaires ou définitives, dès lors qu'un nouveau décret peut modifier la liste des pays concernés dans le précédent décret. Enfin, elles sont prises « pour des raisons d'ordre public et par décret ». Cette dernière disposition mérite toutefois une attention particulière au regard du principe de libre circulation des capitaux au sein de l'Union européenne, et notamment de la jurisprudence la plus récente de la Cour de justice des Communautés européennes (8) qui affirme les conditions dans lesquelles des mesures de restriction de la circulation des capitaux peuvent être engagées, pour des motifs d'ordre public, en précisant les critères permettant d'édicter de telles mesures. Dans le cadre de cette décision, on observe, en premier lieu, que les circonstances spécifiques motivant la décision du Gouvernement sont, en principe, clairement affichées dans la mesure où cette décision résulte des travaux du GAFI, qui bénéficient d'une large publicité. En outre, l'objectif recherché est nettement défini puisque le GAFI est exclusivement orienté vers la lutte contre le blanchiment des capitaux. En second lieu, la décision de restreindre les transactions avec les pays non coopératifs est prise dans un cadre commun, qui associe l'Union européenne, membre du GAFI. La crainte d'une décision unilatérale dans ce domaine ne paraît donc pas justifiée, le présent article prévoyant, d'ailleurs, que cette décision est prise « pour assurer l'application des recommandations émises par l'instance internationale de concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment d'argent ». Votre Rapporteur ajoute que le contexte international est plutôt favorable à de telles mesures de restriction, comme en témoigne la position des États-Unis. Une adaptation de la législation vient d'être présentée, dans le cadre de l'International Counter-Money Laundering Act (9), qui prévoit certaines mesures permettant de restreindre l'utilisation des comptes de correspondants aux États-Unis pour certaines institutions, extraterritoriales ou autres, présentant une propension au blanchiment de capitaux. Enfin, cette décision n'intervient qu'après l'échec de mesures moins restrictives mises en _uvre à l'encontre de ces pays - en application de l'article 20 du présent projet de loi -, tandis que les voies de recours de droit commun peuvent être utilisées par toute personne ayant un intérêt à agir. Le dispositif proposé offre ainsi un cadre adapté pour la mise en _uvre de mesures plus contraignantes à l'encontre des pays non coopératifs qui refuseraient de modifier leur législation et leurs pratiques en vue de lutter efficacement contre le blanchiment de l'argent. Il serait utilement complété par la présentation d'un rapport annuel au Parlement, dressant un bilan de l'application des mesures prises à l'encontre des centres financiers extra-territoriaux. * * * Votre Commission a adopté un amendement rédactionnel (n° 153) présenté par votre Rapporteur ainsi que l'amendement (n° 154) de M. Philippe Auberger prévoyant le recours à un décret en Conseil d'État pour l'application des dispositions relatives aux centres financiers extra-territoriaux, dans la mesure où elles ont une incidence sur la libre circulation des capitaux, son auteur ayant jugé nécessaire d'assurer un fort degré de sécurité juridique à ce texte. Votre Commission a examiné un amendement de M. Yves Cochet, prévoyant d'interdire les opérations avec ces centres financiers dans un délai de trois ans. M. François Goulard a estimé que de telles dispositions étaient totalement inopérantes, puisqu'il sera aisé de les contourner en passant par des pays voisins. Ce genre de texte apporte une satisfaction morale, totalement illusoire et inefficace. Votre Rapporteur, a jugé que l'article 21 comportait déjà une restriction à la libre circulation des capitaux et qu'une restriction encore plus forte pourrait poser un problème au regard du droit communautaire. Votre Commission a rejeté cet amendement. Puis, votre Commission a adopté un amendement rédactionnel (n° 155) de votre Rapporteur, et rejeté quatre amendements identiques de MM. Philippe Auberger, Jean-Jacques Jégou, Gilbert Gantier et Michel Inschauspé, prévoyant l'intervention d'un décret fixant les mesures de restriction des opérations avec les centres financiers extra-territoriaux, et prenant effet à une date identique pour l'ensemble des partenaires de la France, dans ce domaine. Votre Commission a adopté l'article 21 ainsi modifié. * * * Article additionnel après l'article 21 Rapport au Parlement sur les mesures prises à l'encontre des centres « off-shore » Votre Commission a adopté un amendement (n° 5) de la Commission des lois, prévoyant la transmission d'un rapport annuel au Parlement sur l'application des mesures de déclaration ou de restriction des opérations réalisées avec des personnes établies dans un État non coopératif en matière de blanchiment. * * * (Article 16 de la loi du 12 juillet 1990) Moyens d'information de TRACFIN Le présent article renforce les moyens d'information de la cellule de coordination chargée du traitement du renseignement et de l'action contre les circuits financiers clandestins, TRACFIN, créée par l'article 5 de la loi du 12 juillet 1990, en lui permettant de recueillir les informations nécessaires à l'accomplissement de ses missions, auprès des administrations publiques. A.- LES MISSIONS DE TRACFIN Placée sous l'autorité du ministre de l'Économie et des Finances, la cellule TRACFIN, dont les modalités de fonctionnement sont précisées dans le décret du 9 mai 1990, a pour mission de recueillir et d'analyser les déclarations de soupçon effectuées par les organismes financiers et intermédiaires du secteur immobilier, conformément aux dispositions de la loi du 12 juillet 1990. Si les éléments recueillis mettent en évidence des faits susceptibles de relever du trafic de stupéfiants ou d'activités criminelles organisées, ces déclarations sont transmises au procureur de la République. Cette structure, qui permet aux organismes financiers de ne pas s'adresser directement aux autorités judiciaires, dispose d'un droit de communication étendu, qui l'autorise à : - recueillir les déclarations de soupçon, sur des opérations bancaires en cours (article 3) ; - se faire communiquer des pièces relatives à une déclaration, si l'opération bancaire a été bien effectuée (article 3) ; - rassembler les comptes rendus écrits rédigés par les organismes financiers, à l'occasion d'opérations complexes et sans justification économique (article 14) ; - se faire communiquer des documents d'identité des clients de ces organismes, dans le but de reconstituer l'ensemble des transactions effectuées par une personne ayant fait l'objet d'une déclaration de soupçon (article 15). La loi n°93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques a étendu ces pouvoirs d'investigation en prévoyant que la déclaration de soupçon porte, désormais, sur les opérations financières pouvant provenir d'organisations criminelles. Ce dispositif, qui repose sur l'existence d'un intermédiaire entre les organismes soumis à l'obligation de déclaration et les autorités judiciaires, présente le double avantage, d'une part, de permettre au déclarant de remplir son obligation sans craindre la mise en _uvre précipitée de poursuites ; d'autre part, de faciliter l'obtention d'informations complémentaires de celles recueillies par les services répressifs traditionnels. Cette procédure connaît une montée en puissance depuis sa mise en place : en 1999, TRACFIN a ainsi enregistré près de 1.600 déclarations de soupçon, contre 1.244 en 1998 (les affaires correspondantes représentent un montant cumulé de près de 2,5 milliards de francs ; plus de 20 affaires ayant un montant compris entre 3 et 10 millions de francs et autant dépassant 10 millions de francs) et déposé environ 120 dossiers auprès de la Justice. On relève, par ailleurs, que 85 % des déclarations reçues proviennent des banques et établissements de crédits tant publics que privés ; 9 % des changeurs manuels ; 5 % des sociétés d'assurances et moins de 1 % des entreprises d'investissement. Les intermédiaires immobiliers, soumis depuis peu à la loi du 12 juillet 1990, représentent, pour leur part, près d'une vingtaine de déclarations par an. B.- DES MOYENS D'INFORMATION RENFORCÉS Le présent article modifie l'article 16 de la loi du 12 juillet 1990 en vue de renforcer la capacité de collecte de l'information par TRACFIN, qui pourra ainsi s'adresser, non seulement aux officiers de police judiciaire et aux autorités de contrôle, mais également aux administrations de l'État, aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics. Cette modification vise à permettre à TRACFIN de réaliser, au mieux, les missions qui lui incombent, notamment celle de « recueillir, traiter et diffuser le renseignement sur les circuits financiers clandestins et le blanchiment de l'argent » (article 2 du décret du 9 mai 1990). Dans le cadre de cette mission, l'article 7 du décret précise que « les services d'enquête et d'inspection relevant du ministère de l'économie, des finances et du budget participent à l'exercice des missions incombant à la cellule TRACFIN dans le cadre des pouvoirs d'investigation qui leur sont attribués par la législation en vigueur ». Ces dispositions garantissent à TRACFIN une capacité d'intervention importante que le présent article vise à étendre afin de lui permettre de mieux appréhender le contexte dans lequel s'inscrivent les déclarations de soupçon qui lui sont adressées et approfondir l'analyse qu'il est chargé d'effectuer sur leur contenu. Le présent article autorise, en effet, les administrations d'État, les collectivités locales et leurs établissements publics à communiquer à TRACFIN « les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission ». Il s'agit d'une faculté, à laquelle ne peuvent cependant être opposées les dispositions relatives au secret professionnel applicables au sein de ces différentes administrations. Il convient de préciser que la communication de ces informations est encadrée par les dispositions de l'article 16 de la loi de 1990, qu'il est ici proposé de compléter. Son premier alinéa dispose, ainsi, que les informations recueillies par TRACFIN et les autorités de contrôle en application des articles 3, 13, 14 et 15 « ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles prévues par la présente loi », c'est-à-dire, exclusivement, dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de l'argent. La divulgation de ces informations est sanctionnée pénalement ; TRACFIN étant, toutefois, autorisé à les transmettre aux officiers de police judiciaire désignés par le ministère de l'Intérieur, dans les conditions fixées par un décret prévu à l'article 24, aux autorités de contrôle ainsi qu'au service des douanes. Ces dispositions visent à garantir « l'étanchéité » du service anti-blanchiment. L'article 16 de la loi du 12 juillet 1990 comprend toutefois une réserve concernant l'application de l'article 40 du code de procédure pénale : TRACFIN doit ainsi signaler au Parquet les faits qui, à l'origine, lui ont été déclarés comme paraissant relever du blanchiment de capitaux issus du trafic de stupéfiants ou d'activités criminelles organisées, mais qui constituent en réalité une autre infraction de blanchiment ordinaire ou même fiscale (encore que, dans ce dernier cas, l'action pénale relève d'une procédure spécifique impliquant le dépôt d'une plainte ministérielle après avis conforme de la commission des infractions fiscales). Dans le cadre ainsi délimité, la rédaction du présent article écarte tout risque de recoupement d'informations, à d'autres fins que la lutte contre le blanchiment des capitaux. Votre Rapporteur est favorable au contenu de cet article, destiné à conforter la cellule TRACFIN dans l'exercice de ses missions. Toutefois, un « retour » d'information paraît souhaitable, en direction des organismes ou des professionnels qui collaborent au dispositif, en particulier les banques et les établissements de crédit. Dès lors que ces organismes participent à la prévention du blanchiment, il n'est pas illégitime qu'ils soient informés, s'ils le souhaitent, des suites données aux déclarations de soupçon qu'ils ont adressées à TRACFIN. Votre Rapporteur propose donc d'autoriser TRACFIN à indiquer à l'organisme financier qui lui en fait la demande s'il a saisi le procureur de la République, sur le fondement de la déclaration de soupçon que cet organisme a effectuée. En outre, dans le but de renforcer la coopération entre les services participant à la lutte contre le blanchiment d'argent, votre Rapporteur suggère que TRACFIN soit informé des décisions définitives intervenues dans les affaires ayant fait l'objet d'une déclaration de soupçon, ce qui inclut les condamnations définitives ainsi que les décisions pour lesquelles une relaxe a été prononcée. Plus généralement, votre Rapporteur considère qu'au delà du présent projet de loi, une réflexion globale doit absolument être menée sur les moyens juridiques et matériels dont dispose TRACFIN pour exercer ses missions, afin d'amplifier significativement les actions de détection et de prévention des opérations de blanchiment d'argent. * * * Votre Commission a rejeté l'amendement présenté par M. Gilbert Gantier, précisant que TRACFIN peut communiquer les informations reçues en provenance des administrations publiques dans les cas visés aux deuxième et troisième alinéas de l'article 16 de la loi du 12 juillet 1990, c'est-à-dire aux officiers de police judiciaire, aux autorités de contrôle et au service des douanes. Votre Commission a adopté l'article 22, sans modification. * * * Articles additionnels après l'article 22 Informations sur les suites données aux déclarations de soupçon Votre Commission a adopté deux amendements (n° 156 et 157) présentés par votre Rapporteur, permettant, d'une part, à TRACFIN d'être informé sur les suites judiciaires données aux déclarations de soupçon qu'il a transmises au procureur de la République et d'autre part, autorisant ce service à indiquer à l'organisme financier, qui en fait la demande, si la déclaration de soupçon qu'il a effectuée a donné lieu à une saisine du procureur de la République, M. Michel Inchauspé ayant jugé cette précision utile. (Articles L. 310-12 et L. 322-2 du code des assurances) Adaptation du code des assurances aux dispositions de lutte contre le blanchiment Le présent article modifie le code des assurances dans le but d'associer explicitement la Commission de contrôle des assurances au dispositif législatif de lutte contre le blanchiment des capitaux, mis en place par la loi du 12 juillet 1990. Par ailleurs, il permet de mettre en cohérence les dispositions du code des assurances avec la création, en 1996, d'un délit général de blanchiment. En premier lieu, le paragraphe I du présent article intègre le contrôle du respect des dispositions de la loi du 12 juillet 1990 dans les missions de la Commission de contrôle des assurances, définies par l'article L. 310-12 du code des assurances. Il complète cet article en précisant que le contrôle de ces dispositions par la Commission porte sur « les entreprises mentionnées à l'article L.310-1 ainsi que (...) les personnes physiques ou morales mentionnées au cinquième alinéa et soumises à son contrôle ». Cette rédaction implique, de manière tout à fait explicite, que la loi du 12 juillet 1990 s'applique : - d'une part, aux entreprises qui, sous forme d'assurance directe, contractent des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, s'engagent à verser un capital en cas de mariage ou de naissance d'enfants, ou font appel à l'épargne en vue de la capitalisation et contractent à cet effet des engagements déterminés ; aux entreprises qui couvrent les risques de dommages corporels liés aux accidents et à la maladie ainsi qu'aux entreprises qui couvrent d'autres risques, y compris ceux liés à une activité d'assistance, ce qui exclut notamment les entreprises ayant exclusivement pour objet la réassurance ; - d'autre part, les personnes physiques ou morales ayant reçu de l'une de ces entreprises, un mandat de souscription ou de gestion, ou exerçant, à quelque titre que ce soit, le courtage d'assurance ou la présentation d'opérations d'assurance. Votre Rapporteur précise que la loi du 12 juillet 1990, en visant les établissements, institutions et services à vocation financière, quelle que soit leur forme juridique, s'applique non seulement aux banques, aux mutuelles, aux sociétés de bourse, aux commerçants changeurs manuels, et aux services dépendant de l'État mais également aux compagnies d'assurance. L'article 8 de la loi n°96-392 du 13 mai 1996 relative à la lutte contre le blanchiment et le trafic des stupéfiants et à la coopération internationale en matière de saisie et de confiscation des produits du crime a permis de préciser ce champ d'application, en y intégrant les courtiers d'assurance et de réassurance. Le présent article vise donc à faire explicitement référence aux dispositions de la loi du 12 juillet 1990 dans le code des assurances, sans que cette précision n'apporte de réel changement dans l'ordonnancement juridique actuel. Parmi les personnes visées par le paragraphe I figurent, en effet, les courtiers d'assurance et de réassurance. Cette mesure devrait néanmoins permettre de mieux associer les professions du secteur des assurances à la lutte contre le blanchiment. A l'heure actuelle, ces professions transmettent, en effet, peu de déclarations de soupçon (moins de 5%) à TRACFIN, qui entend intensifier son action de sensibilisation à leur égard. Par ailleurs, le paragraphe II du présent article modifie l'article L. 322-2 du code des assurances, qui énumère les cas dans lesquels une personne ne peut, à un titre quelconque, fonder, diriger ou administrer une entreprise soumise au contrôle de l'État en vertu de l'article L.310-1 précité, ni une société de participation d'assurance. Dans sa rédaction actuelle, l'article L.322-2 prévoit qu'une personne faisant l'objet d'une condamnation par application de l'article L.624 du code de la santé publique ou de l'article 415 du code des douanes entre dans le champ des interdictions qu'il énumère (1°, i)). Il fait ainsi référence à l'incrimination du blanchiment telle qu'elle était définie avant l'adoption de la loi n°96-392 du 13 mai 1996, qui a crée un délit général de blanchiment. Le présent article actualise donc le contenu de l'article L.322-2 en remplaçant la référence à ces articles par un renvoi aux articles 324-1 et 324-2 du code pénal, qui définissent désormais les infractions de blanchiment simple, pour le premier article, et de blanchiment aggravé, pour le second. Dans ces conditions, le contrôle effectué par la Commission de contrôle des assurances peut aboutir, en cas d'infraction, à des sanctions pénales, de cinq ans d'emprisonnement et 2.500.000 francs d'amende (article 324-1), peines qui peuvent être doublées lorsque le blanchiment est commis de façon habituelle, dans un cadre professionnel ou en bande organisée, en application de l'article 324-2 du code pénal. L'incrimination de blanchiment est ainsi insérée dans la liste des incompatibilités applicables au dirigeant d'une société d'assurance. En définitive, le présent article permet de lever toute ambiguïté quant à la participation des compagnies d'assurances au dispositif législatif de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent. Les précisions qu'il apporte sont de nature à clarifier l'état du droit applicable et les peines encourues en cas de manquement aux obligations découlant de la loi du 12 juillet 1990. Votre Rapporteur considère que ces précisions offrent l'occasion de s'intéresser aux sanctions administratives encourues en cas de manquement aux obligations déclaratives imposées par la loi du 12 juillet 1990. L'examen des sanctions disciplinaires prononcées par la commission bancaire, chargée du contrôle du respect des dispositions de cette loi par les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et les changeurs manuels, met en évidence leur faiblesse numérique. Il ne s'agit, certes, pas de l'indicateur le plus pertinent pour évaluer le contrôle effectué, dans la mesure où il ne fait pas apparaître les nombreuses enquêtes réalisées par ailleurs. En outre, il faut souligner que ce type de sanctions ne pourra être prononcé à l'encontre de l'ensemble des professions intégrées dans le dispositif de lutte contre le blanchiment de l'argent puisqu'elles ne sont pas toutes organisées autour d'une association professionnelle investie du pouvoir disciplinaire. Toutefois, votre Rapporteur suggère que le champ de ces sanctions, défini par l'article 7 de la loi du 12 juillet 1990 soit élargi, en ne visant plus uniquement le manquement à l'obligation déclarative prévue par l'article 3 de cette loi, mais le manquement à l'ensemble des obligations découlant de ladite loi. Là encore, il suggère qu'une réflexion plus approfondie soit désormais menée sur le contenu et l'étendue de ces sanctions. * * * Votre Commission a adopté un amendement (n° 6) de la Commission des lois, ajoutant le cas d'une condamnation sur le fondement de l'article 415 du code des douanes à la liste des incompatibilités relatives aux dirigeants de compagnies d'assurance. M. Philippe Auberger a jugé cette mention superflue, tandis que M. François Goulard a insisté sur le risque que présente toute énumération d'infractions. Votre Commission a adopté l'article 23, ainsi modifié. * * * Article additionnel après l'article 23 Votre Commission a adopté un amendement (n° 158) de votre Rapporteur dont l'objet est de renforcer le champ des sanctions administratives encourues en cas de manquement aux obligations imposées par la loi du 12 juillet 1990 aux organismes financiers et personnes visées par cette loi. * * * (Article 4 de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX Obligation d'immatriculation au registre du commerce Le présent article impose aux sociétés créées antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n°78-9 du 4 janvier 1978 de procéder à leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Cette mesure vise à lutter contre l'utilisation de sociétés de façade dans des opérations de blanchiment d'argent et devrait contribuer à une plus grande transparence. A.- LES ENJEUX DE LA MESURE PROPOSÉE L'obligation d'immatriculation de sociétés sur un registre public constitue un élément essentiel de transparence et de protection des droits des tiers. Cette obligation, qui existe en France depuis 1978 pour l'ensemble des sociétés, quelle que soit leur forme juridique, présente un réel intérêt dans la lutte contre le blanchiment des capitaux. Dans un récent rapport sur les typologies du blanchiment des capitaux ___ le GAFI a mis en évidence l'importance d'une telle obligation en insistant sur le rôle des « agents de création de sociétés » dans les opérations de blanchiment. Ces agents participent, en effet, à de telles opérations, en conseillant leurs clients sur les pays dont la réglementation permet la création rapide d'une société, sans exiger d'informations sur son propriétaire pouvant figurer sur un registre public. Le GAFI souligne que le manque de transparence des procédures de création de sociétés facilite, très souvent, les activités des blanchisseurs. Il recommande, par conséquent, « la promotion de normes minimales pour l'immatriculation et l'administration d'une société, ainsi que la transparence de la procédure ». Votre Rapporteur observe, par ailleurs, que le GAFI ___ retient comme critère d'identification des centres financiers extra-territoriaux, l'inadéquation des règles de droit commercial pour l'enregistrement des entreprises et des personnes morales. Le GAFI note, en effet, que « l'inadéquation des moyens d'identification, d'enregistrement et de diffusion de l'information concernant les entreprises et les personnes morales (identité des directeurs, dispositions réglementant le pouvoir d'engager l'entité, etc.) a des conséquences négatives » en limitant notamment les informations dont disposent les autorités administratives et judiciaires pour mener leurs enquêtes. Le présent article a donc pour objet de limiter les possibilités qui peuvent encore subsister en France d'utiliser des sociétés de façade pour des montages en matière de blanchiment de l'argent. B.- LES AMÉNAGEMENTS PROPOSÉS Depuis la loi n°78-9 du 4 janvier, les sociétés civiles bénéficiant de la personnalité morale doivent demander, comme les sociétés commerciales, leur immatriculation. Toutefois, les sociétés civiles constituées avant l'entrée en vigueur de cette loi, en l'occurrence le 1er juillet 1978, échappent à cette obligation. L'article 4, alinéa 4 de la loi prévoit, en effet, que « par dérogation à l'article 1842 du code civil, les sociétés non immatriculées à la date prévue à l'alinéa précédent conserveront leur personnalité morale. Les dispositions relatives à la publicité ne leur seront pas applicables ». En vertu du même alinéa, l'obligation de demander l'immatriculation reste possible, mais dans des conditions assez contraignantes : elle ne peut résulter que d'une requête présentée, au tribunal, par le ministère public ou tout intéressé, à la condition que celui-ci prouve son incapacité à obtenir des renseignements qui se trouveraient normalement rendus publics si la société était immatriculée et son intérêt à disposer de ces renseignements. Cette exception soulève le problème des sociétés qui se maintiennent « en sommeil », c'est-à-dire qui n'exercent pas de réelle activité mais peuvent offrir un cadre pour le montage d'opérations frauduleuses. L'exposé des motifs relève ainsi que « la non-immatriculation de ces sociétés rend particulièrement opaque la transmission des parts sociales, qui peuvent circuler de main en main, sans publicité, et sans qu'il puisse y avoir de certitude sur la date réelle de cession. Or, ces personnes morales ont, en droit positif, pleine capacité juridique pour transmettre un patrimoine important, notamment immobilier ». Instituer une obligation de déclaration pour ces sociétés présente donc un double intérêt. D'une part, cette obligation permet de disposer d'un certain nombre d'informations sur les sociétés, relatives à la personne morale (raison sociale ou dénomination, forme juridique, montant du capital social, adresse du siège social) ainsi qu'à la personne des associés ou des dirigeants (nom, prénoms, date et lieu de naissance ainsi que renseignements relatifs à la nationalité et domicile personnel des associés tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales ou des associés et tiers ayant le pouvoir de diriger la société ainsi que, le cas échéant, des administrateurs, membres du directoire et du conseil de surveillance et des commissaires aux comptes). D'autre part, elle s'applique aux sociétés étrangères. L'article 1er du décret n°84-806 du 30 mai 1984 dispose, en effet, que « les sociétés commerciales dont le siège est situé hors d'un département français et qui ont un établissement dans l'un de ces départements » sont tenues de demander leur immatriculation. Toutefois, pour qu'une immatriculation soit demandée, il est nécessaire que la société ouvre un établissement, quelle que soit sa forme (agence, succursale, etc.), en métropole française. Le présent article aboutit à la suppression de cette exception en abrogeant le quatrième alinéa de l'article 4 de la loi du 4 janvier 1978, à compter du premier jour du dix-huitième mois suivant la publication de la présente loi. Il impose, en conséquence, aux sociétés créées avant 1978, de procéder, dans ce délai, à leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. A défaut, les sociétés concernées perdent, de plein droit, leur personnalité morale, en vertu du principe général selon lequel elles n'en bénéficient qu'à compter de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés (articles 5 de la loi du 24 juillet 1966 et 1842 du code civil). Cette mesure permet, en définitive, d'ôter tout l'intérêt que pourraient avoir les blanchisseurs à recourir à des sociétés « coquilles vides ». * * * Votre Commission a adopté cet article, sans modification. * * * Participation à une association de malfaiteurs Le présent article a pour objet d'abaisser, de dix à cinq ans d'emprisonnement, le seuil des peines permettant l'incrimination d'association de malfaiteurs, définie par l'article 450-1 du nouveau code pénal, afin de permettre de sanctionner pénalement la participation à des activités financières criminelles. Votre Rapporteur rappelle que l'article 450-1 du nouveau code pénal définit et réprime l'infraction d'association de malfaiteurs. Cette infraction repose sur l'existence d'une entente entre plusieurs personnes, quelle que soit sa durée et le nombre de ses membres. Elle est constituée dès lors qu'une résolution d'agir en commun est « concrétisée par un ou plusieurs faits matériels ». L'association de malfaiteurs est punissable lorsqu'elle a pour but de préparer soit une ou plusieurs infractions que la loi qualifie de crime, soit un ou plusieurs délits correctionnels caractérisés par leur gravité et punissables, de ce fait, de dix ans d'emprisonnement. Parmi ces délits figurent l'aide au blanchiment de l'argent de la drogue (art. 222-38) ; l'importation ou l'exportation illicite de stupéfiants (art. 222-36) ; le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi illicite de stupéfiants (art. 222-37, al. 1er et 2) et l'offre ou la cession de stupéfiants à des mineurs (art. 222-39, al. 2). L'article 450-1 dispose que la participation à une association de malfaiteurs est frappée d'un « emprisonnement maximum de dix ans et d'une amende pouvant s'élever à 1.000.000 francs ». Aux termes de l'article 450-3, des peines complémentaires, telles qu'une interdiction des droits civiques, civils et de famille ou une interdiction de séjour, peuvent également être appliquées. Le présent article modifie ces dispositions, d'une part, en abaissant à cinq ans le seuil des peines permettant de qualifier une infraction d'association de malfaiteurs ; d'autre part, en réduisant la gravité des peines applicables, dans ce cas de figure. En premier lieu, cet article introduit un nouvel alinéa dans l'article 450-1 du nouveau code pénal, qui qualifie de participation à une association de malfaiteurs, « le fait, pour une personne, de participer à tout groupement formé ou toute entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un ou plusieurs délits prévus aux livres III et IV du code pénal et punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement ». Cette rédaction écarte la préparation de crimes pour retenir celle d'un ou plusieurs délits, réprimés par une peine d'au moins cinq ans d'emprisonnement. De plus, elle vise la participation d'une seule personne à une entente. L'objectif ainsi recherché est de sanctionner les associations de « cols blancs », c'est-à-dire de personnes qui interviennent dans le montage d'opérations de blanchiment. Cet article 25 revient, en définitive, à élargir l'infraction de blanchiment en amont, en permettant d'incriminer les actes préparatoires à une opération de dissimulation de l'origine des fonds ou le concours à une telle opération. Seront ainsi concernés les délits d'extorsion simple (art. 312-1 du code pénal), d'escroquerie simple et aggravée (art. 313-1 et s.), de blanchiment simple (art. 324-1) et de faux pour les actes émanant des administrations publiques (art. 441-2 et 441-3). En se référant à un seuil d'emprisonnement - en l'occurrence, de cinq ans - et non à un type particulier d'infraction, cet article conserve le caractère général du délit de blanchiment et s'inscrit dans la continuité du dispositif adopté en 1996 en matière pénale. Cette mesure est de nature à renforcer l'efficacité du système de prévention du blanchiment, dans la mesure où la poursuite pour association de malfaiteurs constitue l'un des principaux points d'ancrage de l'action publique. Des statistiques issues du casier judiciaire montrent, en effet, que la participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime a été à l'origine de 102 condamnations en 1998 ; la même infraction pour la préparation d'un délit, puni de dix ans d'emprisonnement, ayant donné lieu à 65 condamnations la même année. En second lieu, le présent article prévoit que la participation d'une personne à une association de malfaiteurs en vue de préparer l'un des délits constitutifs de la participation à des activités financières criminelles, est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 500.000 francs d'amende. La création d'une nouvelle sanction pour ce type de délit permet d'adapter le droit pénal aux infractions en lien avec le blanchiment. Comme le note l'exposé des motifs, elle s'inscrit, en outre, dans le cadre communautaire, l'action commune du 21 décembre 1998 visant les activités criminelles organisées mettant en jeu « l'association de plus de deux personnes agissant dans le but de commettre des crimes ou délits punissables d'une peine privative de liberté d'un maximun d'au moins quatre ans ou d'une peine plus grave ». * * * Votre Commission a adopté un amendement (n° 7) de précision de la commission des Lois, et l'article 25 ainsi modifié. * * * Article additionnel après l'article 25 Charge de la preuve en matière de présomption de blanchiment Votre Commission a adopté un amendement (n° 8) de la commission des Lois qui institue un mécanisme d'allégement de la charge de la preuve, sur le modèle du dispositif existant en matière de trafic des stupéfiants, lorsqu'une personne, en relations avec des personnes qui pratiquent le blanchiment, a un train de vie disproportionné par rapport à ses ressources, M. Philippe Auberger ayant fait part de son hostilité à une disposition d'application très aléatoire. Puis, elle a examiné l'amendement (n° 9) de la commission des Lois prévoyant de punir de deux ans d'emprisonnement et de 500.000 francs d'amende le manquement manifeste aux obligations de vigilance prévues à l'article 3 de le la loi de 1990. M. Michel Inchauspé a souligné que cet amendement crée un délit d'absence de vigilance, et conduira inévitablement à permettre de sanctionner des actes non délibérés. Il a estimé totalement scandaleux ce durcissement du texte, dont il a rappelé qu'il n'était applicable ni aux avocats, ni aux experts comptables et s'est demandé si l'on pouvait ainsi punir de sanctions aussi graves des activités non intentionnelles. M. Philippe Auberger a également estimé que la notion de manquement « manifeste » était particulièrement floue, dans la mesure, notamment où elle n'inclut, en elle-même, aucune répétition. M. Gérard Bapt s'est interrogé sur la définition même de l'obligation de vigilance mise à la charge de personnes, en dehors de leur intention de frauder. Il a demandé si le mot manifeste constituait un véritable éclaircissement du texte. M. François Goulard a souligné que le délit en cause était extrêmement mal qualifié, ce qui contraste avec l'extrême sévérité de la peine prévue pouvant aller jusqu'à deux ans de prison. Quels faits précis peuvent ainsi être réprimés ? Mme Nicole Bricq a souhaité savoir si d'autres obligations de vigilance étaient prévues par le code pénal et si le non respect de telles obligations était sanctionné par ledit code. Usant de la faculté que l'article 38 du règlement confère à un député qui n'est pas membre de la Commission d'y prendre la parole, M. Jacky Darne a souligné que ce dispositif devait être lu en fonction de l'article 3 de la loi et de l'obligation de déclaration en cas de soupçon. Le code pénal précise, en outre, qu'il n'est de délit qu'intentionnel. A la demande de M. Philippe Auberger, M. Éric Besson, Rapporteur a suggéré que le mot « manifeste » soit complété par un élément lié à la répétition des faits en cause. Par ailleurs, en réponse aux préoccupations exprimées par Mme Nicole Bricq et M. Gérard Bapt, il a proposé de préciser que le manquement visé porte sur l'obligation de déclarer certaines sommes dans les conditions prévues par l'article 3 de la loi du 12 juillet 1990. En tout état de cause, il s'est interrogé sur le point de savoir si la Chancellerie serait favorable à un tel amendement. Il a enfin souligné la nécessité de doter TRACFIN de moyens suffisants. Le Président Henri Emmanuelli a souligné qu'en matière pénale on ne pouvait en aucun cas se contenter de sanctionner des comportements vagues. Il a souhaité savoir à qui le texte était susceptible de s'appliquer. M. Augustin Bonrepaux a souligné que la lutte contre le blanchiment s'adressait par principe à des personnes désirant frauder, et qu'en considération de ce fait, il est nécessaire que les banques soient particulièrement prudentes. Votre Rapporteur a indiqué que l'élément intentionnel figurait de manière explicite notamment dans une circulaire de la Chancellerie, en date du 28 septembre 1990, dont il a donné lecture. M. Dominique Baert a fait état de ses réserves quant au dispositif proposé. Après un large débat, le Président Henri Emmanuelli a souhaité qu'en toute hypothèse le législateur n'aille pas, en cette matière complexe, au-delà de ce que souhaite la Chancellerie. Il convient de se défier de tout manichéisme dans la volonté de lutter contre le blanchiment des capitaux et de respecter les principes du droit pénal. La Commission a alors décidé de réserver le vote de cet amendement. Votre Commission, au cours d'un examen ultérieur, a rejeté l'amendement (n° 9) de la commission des Lois, précédemment réservé, votre Rapporteur ayant indiqué, qu'après réflexion, il n'était pas favorable à cette adoption. * * * (Articles 324-7 du code pénal et 706-30 du code de procédure pénale) Sanction complémentaire en cas de condamnation pour blanchiment Le présent article a pour objet d'aggraver les sanctions prévues en cas de délit de blanchiment en ajoutant la possibilité de recourir à la saisie et à la confiscation des biens des personnes condamnées pour ce délit. L'incrimination générale de blanchiment a été introduite par la loi n°96-392 du 13 mai 1996 relative à la lutte contre le blanchiment et le trafic de stupéfiants et à la coopération internationale en matière de saisie et de confiscation des produits du crime, qui a inséré dans le code pénal un nouveau chapitre intitulé « Dispositions relatives aux infractions de blanchiment » qui comporte les articles 324-1 à 324-9. L'article 324-1 définit le blanchiment comme « le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect. Constitue également un blanchiment le fait d'apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit ». Le délit de blanchiment est applicable au produit de tout crime ou délit, quelle que soit l'infraction dont proviennent les fonds. Puni de cinq ans d'emprisonnement et de 2.500.000 francs d'amende, ce délit peut être sanctionné par des peines doubles lorsque le blanchiment est commis de façon habituelle, dans le cadre professionnel ou en bande organisée : on parle alors de blanchiment aggravé (article 324-2 du code pénal). Le paragraphe I du présent article complète l'article 324-7 du code pénal qui prévoit que les personnes physiques coupables de blanchiment simple encourent également onze peines complémentaires, auxquelles l'article 324-8 ajoute l'interdiction du territoire français. Il peut s'agir : - de peines restrictives de liberté telles que l'interdiction de séjour (art. 324-7, 10°) ou l'interdiction de quitter le territoire français (art. 324-7, 11°) ; - de peines affectant le patrimoine des intéressés, comme la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution (art. 324-7, 8°), mais aussi des biens sans lien direct avec le blanchiment (art. 324-7, 6° et 7°) ; - enfin, de peines atteignant directement les droits et capacités : interdiction des droits civiques, civils et de famille (art. 324-7, 9°), interdiction d'exercer une fonction publique ou l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise (art. 324-7, 1°), etc. Le présent article ajoute à cette énumération une douzième peine complémentaire permettant de recourir à la confiscation des biens de la personne condamnée pour blanchiment. L'objectif recherché est de parvenir à punir la personne qui, bien qu'elle n'ait pas profité directement de l'opération de blanchiment, est intervenue dans sa préparation ou son déroulement, en tant qu'intermédiaire. A cette fin, la peine complémentaire prévue dans l'article 26 du présent projet de loi, permet d'atteindre le patrimoine propre de cette personne, ce qui n'est actuellement pas possible dans les autres cas, qui concernent seulement les biens en lien direct avec le blanchiment. Le paragraphe II modifie, en conséquence, l'article 706-30 du code de procédure pénale afin d'introduire une référence au délit de blanchiment, défini par les articles 324-1 et 324-2 du code pénal. Votre Rapporteur rappelle que cet article fait partie des règles de procédure particulières destinées à favoriser la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions en matière de trafic de stupéfiants (art. 706-26 à 706-33 du code de procédure pénale). Il prévoit qu'en cas d'information ouverte pour infraction aux articles 222-34 à 222-38 du code pénal, des mesures conservatoires peuvent être prononcées pour garantir le paiement des amendes encourues ainsi que l'exécution de la confiscation sur les biens de la personne mise en examen, prévue au deuxième alinéa de l'article 222-49 du code de procédure pénale (« confiscation de tout ou partie des biens du condamné, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis »). Conformément au dispositif prévu dans son paragraphe I, le présent article permet donc d'appliquer des mesures identiques en cas d'infraction de blanchiment. Logiquement, il fait, en outre, référence à la peine de confiscation, ajoutée au 12° de l'article 324-7, afin de permettre la mise en place de mesures conservatoires dans cette hypothèse. * * * Votre Commission a adopté l'article 26, sans modification. * * * Votre Commission a rejeté un amendement de M. François d'Aubert proposant une nouvelle définition du blanchiment se référant à une liste précise d'infractions ainsi que trois amendements identiques présentés par MM. Philippe Auberger, Jean-Jacques Jégou, Gilbert Gantier, dont l'objet est de préciser le caractère intentionnel du délit de blanchiment, lequel doit être commis « sciemment » et deux amendements identiques, de conséquence des précédents de MM. Jean-Jacques Jégou et Gilbert Gantier. Elle a également rejeté l'amendement de M. François d'Aubert dont l'objet est de définir un nouveau délit d'appartenance à une organisation criminelle. Enfin votre Commission a rejeté l'amendement présenté par M. Yves Cochet visant à mentionner exclusivement le blanchiment des capitaux dans l'intitulé du titre IV du projet de loi, sans référence à des activités criminelles organisées. Les relations entre les distributeurs et leurs fournisseurs connaissent des dérives inquiétantes à tel point qu'on a parfois pu les qualifier de « féodales. » C'est pourquoi le titre Ier entend moraliser les pratiques commerciales, combler les lacunes de leur réglementation et remédier aux écueils apparus lors de l'application de la loi dite « Galland » du 1er juillet 1996. Cette loi entendait encadrer les conditions de facturation des produits, mais, en réaction, les distributeurs ont développé les rémunérations hors factures. C'est ainsi que la « coopération commerciale » a connu depuis 1996 un essor sans précédent. Si elle n'a rien de choquant en soi, des dérives très importantes sont observées, consistant en la rémunération par le fournisseur de services qui ne lui sont pas réellement rendus par le distributeur. Le secteur de la grande distribution est marqué par une concentration croissante, qui accentue la faiblesse structurelle des fournisseurs. Cette situation est particulièrement flagrante dans le secteur des fruits et légumes frais. Les grandes surfaces effectuent des opérations promotionnelles, notamment en début de saison estivale, qui déstabilisent gravement cette filière et qui aboutissent à des prix aberrants, ne permettant même pas aux producteurs de pouvoir couvrir leurs coûts de revient. La poursuite de telles opérations conduirait à mettre en danger la survie de centaines d'exploitations agricoles, avec les lourdes conséquences sur l'emploi et l'aménagement du territoire que l'on imagine. C'est pourquoi l'article 27 du présent projet de loi vise à permettre à des accords interprofessionnels - ou, à défaut, à des arrêtés interministériels - de fixer des périodes pendant lesquelles la publicité sur les prix de ces produits est encadrée, voire interdite. Cette disposition vise à répondre aux crises agricoles telle que celle de l'été 1999, en permettant notamment de limiter les effets négatifs des prix sur catalogue. Votre Rapporteur observe que ce dispositif se borne à limiter les modalités de communication de prix promotionnels. Dès lors, il serait sans doute souhaitable de pouvoir introduire un dispositif plus efficace, permettant d'éviter que les producteurs ne soient contraints de vendre leurs produits en dessous de leurs prix de revient. Prenant acte de la détérioration des relations entre fournisseurs et distributeurs, l'article 28 crée une commission des pratiques commerciales et des relations contractuelles, composée paritairement de fournisseurs et de distributeurs, ainsi que de magistrats, de représentants de l'administration et de personnalités qualifiées. Cette commission a un rôle d'observation des relations contractuelles et a pour objet de valoriser les bonnes pratiques et de stigmatiser celles qui lui apparaissent abusives. Elle émet des avis et des recommandations. Cette création est la concrétisation des engagements pris par le Premier ministre lors des « Assises de la distribution », tenues le 13 janvier 2000. Votre Rapporteur s'interroge pourtant sur les moyens d'associer plus étroitement le Parlement aux travaux de cette commission et de lui reconnaître des prérogatives d'arbitrage. L'article 29 permet de sanctionner les abus de dépendance économique, même s'ils n'affectent pas le bon fonctionnement du marché dans son ensemble. Il complète, en outre, la liste des pratiques discriminatoires afin que les rémunérations d'opérations de coopération commerciale soient proportionnées au bénéfice que le fournisseur peut en tirer. Un principe de contrepartie réelle est donc introduit. Cet article permet de rééquilibrer les relations commerciales en interdisant les menaces de déréférencement, même partiel. Il permet aussi la fixation d'un préavis pour la rupture des relations commerciales, permettant ainsi d'accroître la sécurité juridique pour les fournisseurs. De plus, certaines pratiques particulièrement abusives pourront être frappées de nullité. Enfin, cet article élargit les compétences du ministre de l'économie devant les juridictions civiles et commerciales. En effet, par crainte de représailles des distributeurs, beaucoup de fournisseurs n'osent pas dénoncer les pratiques abusives dont ils sont victimes. Les articles 30 et 31 visent enfin à mieux encadrer les mentions portées sur l'étiquetage des produits. Depuis un certain nombre d'années déjà, la mise en _uvre du droit de la concurrence a connu, dans la plupart des pays industrialisés, un développement considérable. L'attention portée aux ententes et autres pratiques anticoncurrentielles s'est fortement accrue. En témoignent, aux États-Unis par exemple, la multiplication des procédures et, surtout, la véritable envolée des sanctions prononcées : alors qu'il ne dépassait guère 30 millions de dollars avant 1997, le montant total des amendes infligées a dépassé le milliard de dollars l'année dernière. De même, le procès antitrust intenté par les autorités américaines à l'encontre de Microsoft témoigne d'une forte pugnacité qui ne se limite pas au souhait de contrecarrer les ambitions des entreprises étrangères. Nul doute que les mouvements de concentrations trans-frontières, qui se multiplient dans un nombre croissant de secteurs (pharmacie, téléphonie, automobiles, ...) expliquent l'intérêt que les pouvoirs publics portent au respect des règles de la concurrence. Cependant, celles-ci ne constituent pas seulement une contrainte pour les entreprises, car ces dernières apprennent aussi, de plus en plus, à les utiliser comme une arme de guerre commerciale. A cet égard, le démantèlement des anciens monopoles publics (télécommunications, électricité) constitue un champ d'application privilégié de cette stratégie. La France n'est pas à l'abri d'une telle évolution. Depuis le début des années 1990, le nombre de saisines adressées au Conseil de la concurrence, autorité administrative indépendante mise en place par l'ordonnance du 1er décembre 1986, augmente fortement, atteignant un niveau record de 164 saisines en 1998. Parallèlement, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a examiné 369 concentrations. S'y ajoutent naturellement les nombreuses saisines des juridictions civiles et commerciales. Rançon du succès en quelque sorte, le Conseil de la concurrence fait face à une charge de travail grandissante. Le nombre de dossiers en instance augmente inexorablement et a doublé au cours des dix dernières années (il est passé de 186 en 1990 à 373 en 1999), tandis que la durée des procédures reste tout à fait insatisfaisante (environ trois ans et demi). Encore faut-il constater que des durées sensiblement plus longues restent encore trop fréquentes, puisque neuf procédures ont dépassé cinq ans en 1998 (soit 16 % des dossiers ayant donné lieu à une décision au fond, hors irrecevabilité et non-lieu). Au-delà des aménagements prévus par le projet de loi, fort bienvenus au demeurant et de nature à améliorer le déroulement des procédures, on ne pourra indéfiniment faire l'économie d'un débat sur le renforcement, qualitatif aussi bien que quantitatif, des moyens attribués au Conseil de la concurrence, tant la comparaison avec ses homologues étrangers n'est pas à l'avantage de notre pays. Le titre II de cette deuxième partie du projet de loi entend donc remédier à cette situation en renforçant les moyens du conseil et surtout, en aménageant les procédures devant lui, afin qu'il puisse plus efficacement se consacrer aux dossiers les plus importants ou les plus sensibles. Aujourd'hui, le Conseil de la concurrence reste trop largement tributaire de la DGCCRF, à laquelle il demande des enquêtes au coup par coup. Sans prévoir la mise en place d'un corps spécifique d'enquêteurs, au demeurant peu souhaitable, l'article 43 prévoit la possibilité d'une mise à disposition d'enquêteurs pour une période déterminée, plus longue qu'actuellement. Mais c'est surtout par l'aménagement des procédures que le projet de loi entend renforcer l'efficacité du conseil. D'une part, le projet de loi clarifie les modalités par lesquelles le conseil peut déclarer certaines saisines irrecevables (article 39), les classer sans suite lorsqu'aucune pratique anticoncurrentielle n'a été établie ou prononcer un non-lieu à poursuivre la procédure lorsque l'effet d'une pratique n'est pas important (article 40). Dans le même esprit, l'article 38 permet au conseil de se prononcer sur un dossier selon une procédure raccourcie lorsque l'entreprise incriminée ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés. Le projet de loi vise également à renforcer l'efficacité des procédures en facilitant la recherche des éléments de preuves. Outre un aménagement technique des conditions dans lesquelles les enquêteurs peuvent procéder à des visites et à des saisies (articles 42 et 44), il innove en introduisant une procédure de clémence, selon laquelle l'entreprise qui accepte de contribuer à l'enquête bénéficie d'une réduction de la sanction qui lui est infligée (article 38). Force est de reconnaître que cette acclimatation dans notre droit de procédures d'inspiration anglo-saxonne est vivement contestée. Il convient de noter que cette contestation s'était également faite jour lorsque la Commission européenne avait institué une procédure qui a fortement inspiré le projet de loi. Votre Rapporteur peut très bien comprendre le débat éthique que peut susciter ce qui, inutile de se cacher derrière les mots, constitue un encouragement à la délation. Pourtant, l'intérêt public que représente la mise au jour et la sanction des pratiques anticoncurrentielles justifie que l'on procède à ce renforcement des armes confiées au Conseil de la concurrence, quitte à ce que l'on en dresse, à terme, un bilan. L'actualité récente illustre le bien-fondé d'une telle disposition. Les autorités américaines ont pu, grâce à elle, établir la réalité d'une entente, dans les faits mondiale, concernant le marché des vitamines alors que la Commission européenne ou le Conseil de la concurrence, saisis également de ce dossier, n'avaient pu recueillir aucun élément de preuve et s'apprêtait à classer l'affaire. Le projet de loi vise en troisième lieu à sécuriser les procédures devant le Conseil de la concurrence. Celles-ci sont en effet placées sous la vigilance grandissante des juges. Il est vrai que, si elle s'inspirent fortement de celles suivies devant les juridictions, les procédures devant les autorités administratives indépendantes s'en distinguent sur certains points, qui fragilisent tout l'édifice. À cet égard, le Conseil de la concurrence est loin de constituer un cas particulier. C'est pourquoi, les articles 32 à 35 permettent de mieux distinguer ce qui relève de l'instruction de ce qui relève de l'examen au fond des dossiers. Cependant, votre Rapporteur ne peut manquer de s'étonner de l'absence de dispositions tirant les conséquences de la jurisprudence récente de la Cour de cassation déclarant contraire à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme la possibilité, donnée par l'ordonnance au rapporteur général et au rapporteur de participer au délibéré du Conseil de la concurrence, même sans voix délibérative. Enfin, en relevant fortement le plafond des sanctions pouvant être prononcées par le Conseil de la concurrence, le projet de loi ne fait qu'aligner notre droit sur celui de nos principaux partenaires. Il entend, en outre, adresser un signal soulignant la gravité que revêtent les pratiques anticoncurrentielles pour le fonctionnement de l'économie, en général, et les intérêts des consommateurs en particulier, gravité qui justifie un fort relèvement de sanctions aujourd'hui, sans commune mesure avec celles prononcées à l'étranger. Le titre III de cette deuxième partie procède à une refonte profonde de notre droit relatif au contrôle des concentrations. Cette refonte vise à tirer les conséquences de la mise en place en 1989, soit trois années après l'ordonnance du 1er décembre 1986, d'un tel contrôle au niveau communautaire et à rapprocher le dispositif français des pratiques étrangères. Ce double objectif apparaît d'abord au niveau des concepts. La définition que l'article 48 donne d'une opération de concentration est intégralement reprise du règlement communautaire. Surtout, les articles 50 et 51 posent le principe du caractère obligatoire et suspensif de la notification au ministre de l'économie d'un projet de concentration. C'est l'innovation essentielle du projet de loi qui rompt ainsi avec un dispositif fondé sur une notification facultative qui pouvait, en outre, intervenir après la réalisation effective de l'opération. Ce caractère obligatoire et suspensif oblige le projet de loi à procéder à d'autres ajustements importants. Les seuils au-dessus desquels une opération doit être notifiée ne retiennent plus de critères relatifs aux parts de marché, car ceux-ci seraient parfois trop délicats à apprécier (article 49). Les délais d'examen des procédures sont également fortement réduits. Ils passent ainsi de deux mois actuellement à seulement cinq semaines, lorsque le ministre ne saisit pas le Conseil de la concurrence. En cas de saisine de ce dernier, les délais peuvent, dans la meilleure hypothèse, être ramenés de six à cinq mois (article 52). En ce qui concerne le déroulement de la procédure de contrôle elle-même, le projet de loi ne modifie pas les rôles respectifs du ministre de l'économie et du Conseil de la concurrence. Comme le montre le schéma ci-contre, le premier reste au centre du dispositif. Il conserve ainsi son pouvoir discrétionnaire de saisir le Conseil de la concurrence lorsqu'il estime que l'opération est de nature à porter atteinte à la concurrence. De plus, il conserve la possibilité de « négocier » avec les entreprises des engagements de nature notamment à remédier à cette atteinte à la concurrence, engagements qui lui permettent ainsi d'autoriser l'opération. Comme actuellement, la saisine du Conseil de la concurrence reste cependant obligatoire si le ministre entend prendre à l'encontre des entreprises des mesures coercitives, telles qu'interdire l'opération ou subordonner l'autorisation à un certain nombre d'injonctions ou de prescriptions. Votre Rapporteur ne conteste pas l'économie générale du dispositif et l'équilibre qu'il maintient entre les compétences respectives du ministre et celles de l'autorité administrative indépendante qu'est le Conseil de la concurrence. Néanmoins, une autre logique était sans doute concevable, qui aurait rapproché notre pays de ses principaux partenaires, qui reconnaissent de plus larges prérogatives à leurs autorités indépendantes. Mais, elle aurait supposé une rupture brutale avec la situation actuelle, rupture qui apparaît largement prématurée. En matière de concentration comme dans d'autres domaines, votre Rapporteur ne milite pas pour un dessaisissement trop poussé du « politique ». D'ailleurs, il regrette que le ministre accepte, dans certains dossiers récents, de se lier les mains en annonçant par avance qu'il se respectera l'avis du Conseil de la concurrence. Le pouvoir décisionnel du ministre, responsable politiquement de la décision, doit être maintenu et affirmé. MORALISATION DES PRATIQUES COMMERCIALES Votre Commission a rejeté un amendement de M. Christian Cuvilliez tendant à interdire la vente au forfait de billets de spectacles cinématographiques, après que M. Jean-Pierre Brard ait jugé indispensable de défendre un cinéma de qualité. Articles additionnels avant l'article 27 Incidence des créations d'emplois sur les ententes Votre Commission a ensuite adopté trois amendements identiques, un amendement (n° 99) de la Commission de la Production et ceux de MM. Michel Inchauspé et Pierre Hériaud, précisant que la création ou le maintien d'emplois peuvent être pris en compte pour apprécier la contribution d'une entente au progrès économique. Prix des carburants Votre Commission a ensuite adopté deux amendements identiques (n° 100) de la commission de la Production et (n° 55) de M. Jean-Paul Charié, tendant à interdire les prix abusivement bas en matière de vente de carburant au détail. En conséquence, deux amendements similaires de MM. Yves Cochet et Philippe Auberger, relatifs à la vente de carburants au détail, sont devenus sans objet. Avant l'article 27 Votre Commission a ensuite rejeté deux amendements identiques (n° 54) de M. Jean-Paul Charié et de M. Philippe Auberger tendant à intégrer des coûts additionnels dans le calcul du prix d'achat effectif pour la revente des carburants, après que le Président Henri Emmanuelli a estimé leur rédaction particulièrement floue. * * * (Article 28 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 Encadrement des annonces de prix promotionnels sur les fruits Le présent article vise à encadrer les annonces de prix promotionnels concernant des produits alimentaires périssables. En effet, de telles promotions peuvent être de nature à désorganiser gravement les filières agricoles. C'est notamment le cas en début de saison, où les distributeurs pratiquent des prix très bas, alors que dans le même temps les producteurs mettent sur le marché leurs premières récoltes. Or celles-ci sont généralement plus chères ; dès lors elles ne trouvent pas preneur. Ce déséquilibre ne provient pas d'un jeu normal de la concurrence mais il traduit au contraire une distorsion dans les relations entre distributeurs et producteurs, au détriment de ces derniers. C'est pourquoi le présent article tend à encadrer les modalités de communication des opérations promotionnelles, voire à les interdire. L'actuel troisième alinéa de l'article 28 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 prévoit qu'un arrêté ministériel - ou, à défaut, préfectoral - peut fixer la périodicité ou la durée des offres de prix promotionnels. Cet encadrement est défini pour chaque produit, et concerne spécifiquement les promotions dont l'impact serait de nature à déstabiliser le marché. Dès lors, les pouvoirs publics peuvent ainsi agir avant que les effets négatifs soient constatés. Il est à noter que, selon le rapport de M. Jean-Yves Le Déaut (10), ni le Gouvernement, ni les préfets n'ont utilisé les prérogatives prévues par le troisième alinéa de l'article 28 de l'ordonnance du 1er décembre 1986. En effet, les opérations promotionnelles, notamment sur les fruits et légumes frais, portent sur des périodes très restreintes qui ne laissent, de facto, pas le temps de déclencher la procédure. En marge de l'encadrement des prix des opérations promotionnelles, le présent article vise à habiliter des accords interprofessionnels à définir des périodes pendant lesquelles les annonces de prix par catalogue - ou autre support promotionnel - sont encadrées, voire interdites. Si un tel accord fixe une période d'encadrement ou d'interdiction de telles annonces de promotions, un arrêté interministériel peut l'étendre. Mais le rôle moteur demeure, dans le présent article, conféré à la profession elle-même. Ce dispositif vient encadrer la liberté du commerce et de l'industrie, limitant ainsi la capacité du distributeur à communiquer les prix qu'il pratique. Le législateur peut encadrer la liberté du commerce dans le but de préserver l'ordre public économique. Interdire les annonces de prix promotionnels concernant des produits périssables en début de saison permettra de répondre à cette exigence. Pour autant, l'efficacité de cette mesure apparaît insuffisante car le dispositif ne porte que sur la communication des prix promotionnels et non sur la pratique même de ces prix. Le présent dispositif ne permet donc pas de mieux limiter les abus constatés ces dernières années, alors même que les promotions des distributeurs ont souvent abouti à proposer des prix de vente au public incompatibles avec les coûts de revient supportés par les producteurs. En effet, les prix annoncés par catalogue en début de saison servent de référence pour toute la durée de celle-ci. Etant donné que, à cette période, les producteurs mettent sur le marché leur première récolte, généralement plus chère, ils ne trouvent pas preneurs pour leurs marchandises. La désorganisation de la filière agricole qui s'ensuit constitue donc bien une atteinte manifeste au bon fonctionnement du marché. Si le dispositif encadre la liberté de communiquer, l'exercice de cette liberté se voit limité pendant les périodes fixées par les accords ; cette interdiction, limitée dans le temps, est parfaitement proportionnée au but recherché. La limitation de la faculté de communiquer pourrait concerner les « catalogues » et « tout autre support promotionnel ». Les supports concernés par une interdiction sont donc désignés de façon particulièrement large. Votre Rapporteur attire votre attention sur la nécessité, lors de l'application de ces mesures, de veiller à ce que la liberté de communiquer - qui a valeur constitutionnelle - ne soit pas gravement affectée. En outre, il faut observer que l'interdiction ne concerne que la communication relative au prix. C'est ainsi qu'il est toujours possible de faire de la promotion sur d'autres critères comme la qualité, la provenance ou la fraîcheur des produits. Des dispositifs similaires, tout aussi sévères, existent dans d'autres secteurs. C'est ainsi qu'en matière électorale, la loi dispose que, « pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection (...) l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite » ( article L. 52-1 du code électoral). De même, en matière de prévention du tabagisme, l'article 2 de la loi dite « Evin » du 10 janvier 1991 dispose que « toute propagande ou publicité, directe ou indirecte, en faveur du tabac ou des produits du tabac ainsi que toute distribution gratuite sont interdites. » En tout état de cause, la négociation interprofessionnelle est privilégiée dans la mesure où les arrêtés interministériels ne viennent qu'étendre les dispositions déterminées par les partenaires commerciaux. De même, l'intervention interministérielle présente un caractère subsidiaire à la négociation interprofessionnelle. En effet, si les partenaires commerciaux n'ont pas déterminé un encadrement des annonces de promotions, il revient alors à un arrêté interministériel d'encadrer ou d'interdire ces annonces, pour une période déterminée. Enfin, cette intervention interministérielle ne concernera que les secteurs qui en ont besoin. L'État dispose actuellement de prérogatives pour intervenir sur le marché. En cas de crise conjoncturelle déstabilisant de manière anormale un marché particulier, il peut mettre en _uvre l'article 1er de l'ordonnance du 1er décembre 1986. Cet article permet au Gouvernement, par décret en Conseil d'État, de prendre des mesures temporaires - au maximum pour six mois - afin de lutter contre une « baisse excessive des prix ». Cette disposition n'a jamais été employée, sans doute par crainte des réactions de la Commission européenne. Globalement, le dispositif proposé par le présent projet de loi ne semble pas répondre totalement aux difficultés rencontrées sur le marché des fruits et légumes frais. En effet, le dispositif permet seulement de limiter la communication sur des prix promotionnels, lesquels ne se verraient pas plus encadrés qu'actuellement. * * * Votre Commission a adopté l'amendement (n° 101) de la commission de la Production, procédant à une réécriture globale de cet article, tendant, d'une part, à ce que les indications de prix et de l'origine du produit soit inscrites en caractères d'une taille égale en matière de publicité pour les produits alimentaires périssables et, d'autre part, à ce que les annonces de prix promotionnels soient interdites, sauf si un accord interprofessionnel le permet. En conséquence, un amendement de M. Gilbert Gantier visant à empêcher l'intervention des pouvoirs publics dans cet article, les deux amendements identiques - celui de M. Philippe Auberger et de M Jean-Paul Charié (n° 65) - tendant à interdire la publicité à défaut d'accord interprofessionnel, ainsi que les trois amendements identiques de MM. Philippe Auberger, Pierre Hériaud et Michel Inchauspé, tendant à développer la démarche interprofessionnelle dans le secteur des fruits et légumes frais, sont devenus sans objet. L'article 27 a été ainsi rédigé. * * * Article additionnel après l'article 27 Fixation de prix minimum d'achat aux producteurs de fruits et légumes Après que M. Jean-Pierre Brard a retiré un amendement de M. Christian Cuvilliez tendant à améliorer l'efficacité de l'intervention des pouvoirs publics en cas de crise de marché, au profit d'un amendement (n° 159 rectifié) du Rapporteur, la Commission a adopté cet amendement tendant à permettre aux ministres de l'Économie et de l'Agriculture de fixer, par arrêté, un prix minimum d'achat pour les fruits et légumes frais, en cas de crise. Votre Commission a rejeté deux amendements identiques, l'un (n° 66) de M. Jean-Paul Charié et l'autre de M. Philippe Auberger, visant à renforcer la cohérence entre les articles 33 et 36 de l'ordonnance de 1986, puis deux autres amendements identiques, l'un de M. Philippe Auberger, l'autre, (n° 67) de M. Jean-Paul Charié tendant tous deux à instaurer des conditions générales de ventes uniques et, enfin, deux amendements identiques, l'un de M. Philippe Auberger, l'autre, (n° 68) de M. Jean-Paul Charié, tendant à éviter la multiplication des systèmes dites de « marges arrières » par leur limitation par les barêmes de prix. Article additionnel après l'article 27 Rémunération des services spécifiques Votre Commission a ensuite adopté un amendement (n° 102) de la commission de la Production étendant aux clients les conditions relatives à la rémunération des services spécifiques des distributeurs. En conséquence, deux amendements identiques, l'un, (n° 69) de M. Jean-Paul Charié, l'autre de M. Philippe Auberger sont devenus sans objet. Votre Commission a ensuite rejeté deux amendements identiques, l'un de M. Philippe Auberger, l'autre, (n° 70) de M. Jean-Paul Charié définissant le « service spécifique » pour limiter les « marges arrières ». * * * (Article 30 de l'ordonnance du 1er décembre 1986) Commission des pratiques commerciales et des relations contractuelles Le présent article crée une Commission des pratiques commerciales et des relations contractuelles entre les fournisseurs et les distributeurs. En effet, les relations entre les distributeurs - généralement leurs centrales d'achats - et les producteurs sont fréquemment tendues. Les abus commis par les distributeurs sont très souvent impunis dans la mesure où les victimes, n'osent pas porter plainte de peur de voir leurs produits « boycottés » par des centrales d'achat très puissantes. De même, par crainte de pertes de marchés, ces mêmes victimes ne transmettent aucun élément de preuve aux services de la DGCCRF. Pour mieux connaître ce secteur et améliorer la qualité des relations entre fournisseurs et distributeurs, le présent article vise à créer une Commission des pratiques commerciales et des relations contractuelles entre les fournisseurs et les distributeurs. Cette création avait été annoncée par le Premier ministre lors des « Assises de la distribution » tenues en janvier 2000. Cette Commission comprendra des membres des juridictions administratives et judiciaires, des représentants des producteurs - des secteurs agricoles, de la mer et de l'industrie agro-alimentaire - ainsi que des représentants des distributeurs, de l'administration et des personnalités qualifiées. Votre Rapporteur regrette qu'aucun parlementaire ne soit prévu pour siéger au sein de cette commission, voire la présider. La Commission des pratiques commerciales et des relations contractuelles entre les fournisseurs et les distributeurs aura pour mission de suivre ces relations, de promouvoir les bons usages commerciaux en travaillant pour cela avec les acteurs concernés. Il s'agit donc d'un rôle purement consultatif, ce que l'on peut regretter : sans méconnaître l'intérêt qu'il peut y avoir à définir de « bonnes pratiques », il convient de s'interroger sur les moyens qui permettent d'en assurer la diffusion et le respect. Pour mener à bien sa mission d'observation, la commission étudiera l'état des relations commerciales et la nature des pratiques qui peuvent y être observées. De plus, les contrats concernés pourront lui être soumis afin d'affiner sa connaissance du secteur. Ceci lui permettra de pouvoir indiquer quels sont les bons usages commerciaux. Cette mission d'observation se concrétise par une simple capacité à formuler des avis ou des recommandations sur les affaires qui lui sont soumises. A cet effet, elle peut être saisie par le ministre chargé de l'économie. De plus, elle peut être saisie par une personne morale présentant un intérêt à agir comme les organisations professionnelles ou bien les associations de consommateurs. Elle peut en outre se saisir d'office. La Commission des pratiques commerciales et des relations contractuelles entre les fournisseurs et les distributeurs peut formuler des avis qui permettent de dessiner le contour des bons usages en matière de relations commerciales. Son objet sera notamment d'énoncer publiquement les bonnes pratiques et de stigmatiser celles qui semblent déloyales. Pour mener à bien cette mission, il est important que distributeurs et producteurs fournissent à la commission de nombreux documents contractuels. La commission peut en outre adopter des « recommandations ». Sur ce point, le dispositif rappelle celui de la Commission des clauses abusives. Celle-ci a notamment pour mission de rechercher, dans les modèles de conventions qui lui sont soumis, les clauses qui lui paraissent abusives. En outre, l'article L. 132-4 du code de la consommation lui permet d'émettre des recommandations, éventuellement rendues publiques, tendant à obtenir la suppression ou la modification de certaines clauses. Enfin, la commission publie chaque année un rapport faisant la synthèse de son activité. Ce rapport est remis au Gouvernement qui le transmet au Parlement. Ce rapport est rendu public. On notera que cette formule, qui ne met pas sur le même plan le Gouvernement et le Parlement ne paraît pas la plus heureuse. Il serait souhaitable que le Parlement soit davantage associé aux travaux de cette commission, notamment en étant directement destinataire du rapport annuel. La commission, ainsi définie, semble ne jouir que d'une influence limitée sur les pratiques commerciales. Il serait souhaitable de la doter de missions d'études et d'enquête plus approfondies et de lui permettre d'émettre, préalablement à l'intervention des pouvoirs publics, des avis - lui permettant ainsi de pouvoir les alerter plus efficacement. Par ailleurs, le récent rapport de la commission de la Production avait souhaité la création d'une commission dotée de véritables prérogatives d'arbitrage, ce qui n'est pas le cas dans l'actuel dispositif. Le projet vise en effet à instituer une commission limitée à un rôle d'observation et ne disposant pas d'une mission de règlement non juridictionnel des litiges commerciaux. Or, la définition de véritables moyens d'intervention est le seul moyen efficace pour parvenir à réglementer des pratiques actuellement régies par la seule « loi du plus fort », c'est-à-dire donnant systématiquement l'avantage aux centrales d'achat. * * * Votre Commission a adopté un amendement (n° 103) de la commission de la Production procédant à une rédaction globale de l'article 28, précisant la composition de la Commission d'examen des pratiques commerciales, ainsi que les conditions de publicité de ses avis et recommandations. Cette commission se voit, en outre, attribuer un pouvoir de médiation et les parlementaires sont plus étroitement associés à ces travaux. En conséquence, sont devenus sans objet : - deux amendements identiques, insérant ce dispositif à un autre endroit de l'ordonnance (amendements n° 73 de M. Jean-Paul Charié et de M. Philippe Auberger) ; - deux amendements identiques, élargissant le champ de la commission à toutes les entreprises clientes (amendements n° 80 de M. Jean-Paul Charié et de M. Philippe Auberger) ; - l'amendement n° 71 de M. Jean-Paul Charié, visant les relations même non contractuelles ; - treize amendements modifiant la composition de la commission (les amendements 75 à 77 et 81 de M. Jean-Paul Charié, cinq amendements de M. Philippe Auberger, deux amendements de M. Gilbert Gantier, un de M. Michel Inchauspé et un de M. Pierre Hériaud) ; - deux amendements identiques autorisant la commission à entendre toute personne qu'elle juge utile de consulter (amendements n° 74 de M. Jean-Paul Charié et de M. Philippe Auberger) ; - deux amendements identiques de coordination (amendements n° 82 de M. Jean-Paul Charié et de M. Philippe Auberger) ; - un amendement de M. Jean-Pierre Brard permettant à la commission de proposer des solutions en cas de crise ; - trois amendements identiques permettant à la commission de recourir aux services des ministères concernés (amendements de MM. Philippe Auberger, Pierre Hériaud et Michel Inchauspé) ; - trois amendements étendant la saisine de la commission aux ministres de l'Industrie, du Commerce, de l'Artisanat, de l'Agriculture et du Tourisme (amendements n° 79 de M. Jean-Paul Charié et de M. Philippe Auberger) et au Conseil de la concurrence (amendement n° 72 de M. Jean-Paul Charié) ; - deux amendements identiques prévoyant la publicité des avis et recommandations de la commission (amendements n° 83 de M. Jean-Paul Charié et de M. Philippe Auberger) ; - deux amendements identiques permettant aux juridictions de consulter la commission (amendements n° 78 de M. Jean-Paul Charié et de M. Philippe Auberger) ; - trois amendements précisant le contenu du rapport annuel de la commission (amendements de MM. Philippe Auberger, Pierre Hériaud et Michel Inchauspé) ; - trois amendements précisant que le décret d'application déterminera les moyens attribués à cette commission (amendements de MM. Philippe Auberger, Pierre Hériaud et Michel Inchauspé). L'article 28 a ainsi été rédigé. * * * Article additionnel après l'article 28 Commission d'examen des pratiques commerciales Votre Commission a adopté un amendement (n° 104) de la commission de la Production, tendant à permettre à la commission d'examen des pratiques commerciales de questionner le Conseil de la concurrence. En conséquence, l'amendement n° 87 de M. Jean-Paul Charié est devenu sans objet. Votre Commission a ensuite rejeté deux amendements identiques (n° 105) de la commission de la Production et (n° 84) de M. Jean-Paul Charié, tendant à permettre au Conseil de la concurrence de se saisir d'office, pour émettre un avis sur toute question de concurrence. Elle a ensuite rejeté deux amendements identiques (n° 106) de la commission de la Production et (n° 85) de M. Jean-Paul Charié, tendant à permettre une application extraterritoriale des dispositions relatives aux pratiques anticoncurrentielles, ainsi que l'amendement (n° 86) de M. Jean-Paul Charié, visant à supprimer la procédure du décret pour déterminer la licéité d'une entente. Article additionnel après l'article 28 Paiement des fournisseurs Votre Commission a ensuite adopté l'amendement (n° 107) de la commission de la Production, tendant à améliorer le paiement des fournisseurs par leurs débiteurs. * * * (Article 36 de l'ordonnance du 1er décembre 1986) Précision de la notion de pratiques abusives, Le présent article vise à mieux réprimer les pratiques abusives, notamment en cas d'abus de dépendance économique et de menaces de déréférencement partiel. I.- Le présent article vise en premier lieu à préciser l'interdiction des avantages sans contrepartie (a) et à interdire explicitement l'abus de dépendance économique dans le cadre de relations ne déstabilisant pas le marché (b). a) La rémunération de services rendus par le client à son fournisseur est logique si ces services sont effectifs et apportent un avantage réel, souhaité par le fournisseur. La circulaire du 10 janvier 1978 relative aux relations commerciales entre entreprises autorise un distributeur à obtenir la rémunération de certains services par un fournisseur, au moyen de réductions supplémentaires de prix. Le point 5 de cette circulaire indique que ces contreparties doivent être réelles. La circulaire fixe la liste des services concernés, comme le risque commercial élevé, les prises de commande, la facturation, l'entreposage, la livraison, et de manière générale les services figurant dans les conditions générales de vente. Les remises de coopération commerciale peuvent donc être licites même si le point 7 de ladite circulaire souligne que les accords les prévoyant ne doivent avoir qu'une « incidence limitée » sur les tarifs pratiqués. La licéité des réductions de prix est donc soumise à trois conditions : - une condition d'effectivité : « les services » doivent être « effectivement rendus par les clients » ; - une condition de contrepartie réelle : « un allégement des charges du fournisseur » ; - et une condition de proportionnalité de la contrepartie : « l'octroi de ces remises doit être proportionné à l'importance des transferts réels de charge ». Le présent article vise à préciser que certaines formes de coopération commerciale - ou « marge arrière » - sans contrepartie proportionnée constituent un avantage discriminatoire - la liste de ces avantages discriminatoires n'est pas exhaustive. La recherche de « marges arrières » consiste à obtenir du fournisseur des rémunérations hors de la facture d'achat. Cette rémunération peut constituer la contrepartie d'une opération de coopération commerciale réelle, comme la « participation publicitaire » (animations commerciales, campagnes publicitaires, etc.). Or le contenu de la coopération commerciale connaît une dérive : des remises supplémentaires - dont le volume semble croissant - sont demandées, sans contrepartie réelle. Les efforts consentis par les fournisseurs devront être proportionnés aux avantages qu'ils retirent d'opérations d'acquisition ou d'un investissement. De telles participations leur sont en effet demandées lors de l'agrandissement de surfaces de vente ou lors du rapprochement de centrales d'achat ou de référencement (il s'agit notamment des pratiques dites « corbeille de la mariée »). Si les fournisseurs tirent un avantage de ces opérations en terme de débouchés pour leurs produits, il faut que leur participation reste proportionnée aux résultats qu'ils en escomptent. b) Le présent article vise par ailleurs à mentionner explicitement l'abus de dépendance dans le deuxième alinéa de l'article 36 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, le déconnectant ainsi de la notion d'atteinte à l'équilibre global du marché. Les critères de l'abus de dépendance ont été précisés par le Conseil de la concurrence. L'état de dépendance économique d'un fournisseur vis-à-vis d'un distributeur doit s'apprécier au regard de plusieurs critères et, notamment, de « la part du chiffre d'affaires réalisé par ce fournisseur avec le distributeur, de l'importance du distributeur dans la commercialisation des produits concernés, des facteurs ayant conduit à la concentration des ventes du fournisseur auprès du distributeur, de l'existence et de la diversité éventuelle de solutions alternatives pour le fournisseur ». Ces critères ne peuvent pas toujours être observés directement, c'est pourquoi d'autres éléments sont susceptibles d'être pris en compte comme la faiblesse des ressources financières du fournisseur, la faiblesse des marges des offreurs sur le marché sur lequel il opère, l'absence de notoriété de la marque du fournisseur, la durée et l'importance de la pratique de la politique de partenariat qu'il a éventuellement nouée avec le distributeur, l'importance et la surcapacité d'offre sur le marché de ses produits, l'importance des contraintes de transport de ses produits. L'exploitation abusive d'une situation de dépendance économique est déjà interdite par l'article 8, point 2 de l'ordonnance du 1er décembre 1986. Mais le Conseil de la concurrence n'est pas en mesure de déclarer illicite un abus commis par un distributeur envers un fournisseur, dans la mesure où une telle pratique n'affecte pas nécessairement le fonctionnement du marché, au plan macro-économique. Le présent article permet de préciser dans l'ordonnance du 1er décembre 1986 que le fait d'abuser de sa puissance d'achat ou d'abuser de la dépendance de son partenaire commercial constitue une pratique abusive, sans qu'il soit besoin de constater une atteinte au libre jeu de la concurrence sur le marché. Comme les pratiques visées aux quatrième et cinquième alinéas de l'actuel article 36 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, la notion d'abus de dépendance semble pouvoir s'appliquer aux acheteurs comme aux vendeurs. En effet, certains fournisseurs de produits à très forte notoriété et recherchés du public, disposent d'un poids dans leurs relations avec le distributeur dans la mesure où ce dernier est contraint d'acheter, du fait de la demande de sa clientèle. En revanche, l'abus de puissance d'achat ne vise, par définition, que les acheteurs. Le dispositif introduit vise à empêcher que le fournisseur en situation de dépendance doive accepter des conditions ou obligations injustifiées. Ce dispositif vise à rendre opérante dans le domaine de la distribution l'interdiction de l'abus de position dominante en interdisant explicitement au distributeur d'abuser de sa puissance. Cependant, il convient de noter que le Conseil de la concurrence a rejeté largement les demandes de fournisseurs prétendant être victimes d'abus de position de dépendance économique de la part de leur distributeur, en l'absence d'indices convergents permettant d'établir une telle position. De même, le conseil n'a pas admis que les fabricants de lessives (secteur oligopolistique), étant donné leur puissance économique, se trouvaient en situation de dépendance vis-à-vis des centrales d'achat des distributeurs. C'est pourquoi la notion de « puissance d'achat » introduite par le présent article doit permettre aux fournisseurs de pouvoir plus facilement prouver l'abus commis par le distributeur ou sa centrale d'achat. II.- Le présent article introduit un complément au cinquième alinéa de l'article 36 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 pour viser explicitement les menaces de déréférencements partiels. L'actuel cinquième (4°) alinéa de l'article 36 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 permet d'engager la responsabilité de celui qui tente d'obtenir des « prix, des délais de paiement, des modalités de vente ou des conditions de coopération manifestement dérogatoires aux conditions générales de vente » en menaçant son partenaire d'un déréférencement. Cet alinéa, introduit par la loi du 1er juillet 1996 vise aussi bien les pratiques des acheteurs que les pratiques des vendeurs. Cependant, il s'appuie sur les conditions générales de vente (il n'existe pas de conditions générales d'achat) qui sont produites par les fournisseurs. Dès lors, ce dispositif vise à protéger les fournisseurs contre une menace de déréférencement, les obligeant à baisser leurs prix. En tout état de cause, il convient ici de rappeler que le déréférencement ne présente pas, en lui-même, un caractère de pratique abusive. C'est ainsi que la cour d'appel de Paris a jugé que, pour une espèce qui lui était soumise, « le refus d'achat n'était pas en soi illicite, le déréférencement ne pouvant être abusif lorsque les partenaires sont de même taille, et qu'aucune atteinte n'a été portée à l'équilibre concurrentiel ». Cependant, la rupture des relations commerciales peut n'être que partielle, c'est-à-dire ne concerner qu'une partie de la gamme du fournisseur. En effet, le déréférencement partiel permet de mettre progressivement le fournisseur sous pression. Cette pratique repose sur le déréférencement des produits qui ne présentent pas pour le distributeur un intérêt majeur mais dont la vente est nécessaire pour assurer le chiffre d'affaire du fournisseur. Un déréférencement partiel permet d'obtenir par la suite des avantages supplémentaires concédés par le fournisseur. La seule menace d'un déréférencement partiel peut provoquer une renégociation et l'acceptation par le fournisseur de conditions plus avantageuses pour l'acheteur. Or la rédaction actuelle du cinquième alinéa de l'article 36 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ne prévoit pas ce dernier cas de figure. C'est pourquoi le présent article vise à combler cette lacune. III.- Le présent article précise les conditions de détermination de la durée du préavis précédant la rupture des relations commerciales. L'actuel sixième alinéa de l'article 36 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 dispose qu'une rupture brutale des relations commerciales, sans préavis suffisant, engage la responsabilité de son auteur. Cet alinéa, lui aussi introduit par la loi du 1er juillet 1996, vise aussi bien l'acheteur que le vendeur. Par ailleurs, ce dispositif dépasse les relations de distribution et s'applique à l'ensemble des relations commerciales, englobant ainsi les achats de produits ou encore les prestations de service. Cependant, ce sixième alinéa a pour objet principal les pratiques de déréférencement brutal pouvant être le fait des distributeurs. Le dispositif actuel permet de considérer qu'une rupture brutale des relations commerciales, avec un fournisseur ou un client, est déloyale - permettant ainsi à la victime d'obtenir réparation - si un préavis écrit n'est pas respecté. La loi du 1er juillet 1996 a donc institué, un principe de loyauté, en obligeant les partenaires concernés à respecter un préavis écrit, sauf en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. Le dispositif actuel ne vise pas explicitement les délais du préavis lors d'une rupture des relations commerciales. En effet, la loi du 1er juillet 1996 a seulement introduit une procédure permettant au client ou au fournisseur qui subit une telle rupture de pouvoir disposer d'un délai suffisant afin de rechercher un nouveau partenaire. Ainsi, les risques pour l'acteur économique concerné de voir son volume d'affaire brutalement chuter sont limités. En conséquence, le respect d'un préavis lors d'une rupture des relations commerciales suffit à la rendre loyale - sauf à démontrer un abus de droit - même si les motifs de la rupture ne sont pas communiqués au partenaire économique. Alors que la commission de la Production avait proposé d'introduire un délai de quatre mois à défaut d'usage reconnu par des accords interprofessionnels, l'idée de fixer un cadre rigide a par la suite été abandonnée. Les critères jurisprudentiels permettant de déterminer la durée appropriée du préavis sont : l'ancienneté des relations, l'objet de l'activité, la notoriété des produits, la dépendance économique du client, le volume et la progression constante du chiffre d'affaire, l'existence d'un accord d'exclusivité ou le niveau des investissements réalisés (11). Le dispositif actuel prévoit que la durée du préavis doit tenir « compte des relations commerciales antérieures » ou être conforme aux usages reconnus par des accords interprofessionnels. Le présent article vise à ce que des délais minima de préavis soient établis par des accords interprofessionnels. Les partenaires commerciaux sont donc invités à fixer de tels délais dans ces accords - dont l'objet n'est plus seulement de reconnaître des « usages » en la matière. De plus, le présent article prévoit que la durée du préavis doit être examinée en fonction de l'ancienneté des relations commerciales et de la durée minimale fixée par les accords précédemment mentionnés. Dès lors, le délai fixé par ces accords peut être allongé dans le cas de la rupture d'une relation particulièrement longue, ce qui va nettement dans le sens d'une plus grande sécurité juridique pour les fournisseurs. Cependant, il apparaît que de tels accords interprofessionnels sont quasiment inexistants, selon les informations recueillies par votre Rapporteur. C'est pourquoi le présent article vise à donner au ministre chargé de l'économie le pouvoir de se substituer aux partenaires commerciaux. A défaut d'accord interprofessionnel, le ministre « peut » fixer, par arrêté, par catégorie de produits, un délai minimum au préavis de rupture de relations commerciales. La mention « par catégorie de produits » permet de limiter l'action gouvernementale aux secteurs qui en ont besoin. Par ailleurs, de tels arrêtés pourraient « encadrer les conditions de rupture des relations commerciales notamment en fonction de la durée de ces relations ». Ces modalités restent à préciser, ainsi que les autres critères qui pourraient être pris en compte, en dehors de l'ancienneté des relations. IV.- Le présent article introduit un huitième alinéa visant la nullité de pratiques abusives particulièrement flagrantes. Les pratiques frappées de nullité sont le bénéfice rétroactif de remises ou d'accords de coopération commerciale (a) et le paiement d'un droit d'accès au référencement sans contrepartie (b). a) Cette disposition vise à moraliser la coopération commerciale. Les remises et les accords de coopération ne sont pas en soi répréhensibles. En effet, s'ils correspondent à une contrepartie proportionnée pour le fournisseur, ils sont tout à fait licites. Cependant, certaines clauses ou contrats prévoient que de telles dispositions peuvent se voir attribuer un caractère rétroactif. De telles dispositions constituent une pratique abusive particulièrement flagrante. L'article 29 prévoit donc la nullité de ces clauses ou contrats. b) Le présent article vise par ailleurs la nullité des clauses ou contrats prévoyant le versement d'un droit d'accès au référencement, préalable à toute commande. Il s'agit là d'une pratique discriminatoire particulièrement flagrante dans la mesure où elle est, d'une part, totalement dépourvue de contrepartie et, d'autre part, de nature à empêcher toute relation commerciale entre les partenaires. En effet, elle constitue un préalable auquel le fournisseur se plie afin de pouvoir être référencé. V.- Le présent article tend à élargir les prérogatives du ministre de l'économie devant les tribunaux civils ou commerciaux. Le dispositif actuel prévoit les conditions de saisine de la juridiction civile ou commerciale en ce qui concerne les pratiques mentionnées à l'article 36 de l'ordonnance du 1er décembre 1986. Dans sa rédaction actuelle, le ministre de l'économie et le parquet ont déjà la possibilité d'introduire une action devant les juridictions concernées. Les modifications du texte visent à étendre leurs prérogatives. En premier lieu, le présent article procède à une modification rédactionnelle en remplaçant la mention du « parquet » par « ministère public ». En effet, l'expression de « ministère public » est plus adaptée à la juridiction civile ou commerciale. Cette modification technique ne change rien sur le fond. L'action en réparation du préjudice subi par les victimes peut donc être introduite par le ministre de l'économie dès lors que ce préjudice découle d'une pratique interdite par l'article 36 de l'ordonnance. En donnant le droit d'agir aux pouvoirs publics à la place des victimes, le dispositif actuel a pris en compte le fait que certaines d'entre elles n'oseraient pas introduire elles-mêmes l'action, par crainte de représailles telles un déréférencement. Il permet donc, par des voies purement civiles, la répression des pratiques mentionnées à l'article 36 de l'ordonnance alors même que la victime s'abstiendrait d'agir. L'actuel pouvoir d'action du ministre en matière de concurrence ne peut tendre qu'à la cessation des pratiques illicites et non à la réparation du préjudice subi par les victimes. Il ne peut donc pas se substituer à ces dernières pour demander l'évaluation du préjudice subi et en solliciter la réparation. Le ministre ne peut pas non plus solliciter la restitution des prix et valeurs des biens en cause, en lieu et place des victimes. Enfin, il ne peut donc pas demander la nullité des conventions illicites. Pour répondre aux lacunes du dispositif actuel, le présent article vise à doter le ministre de l'économie et le ministère public des prérogatives juridiques nécessaires pour obtenir la réparation du préjudice subi - en l'absence de plaignant - et la nullité des clauses mentionnées au nouveau deuxième alinéa. Le présent article vise à permettre au ministre chargé de l'économie, tout comme au ministère public, de solliciter le juge afin qu'il ordonne la cessation des pratiques abusives, en l'absence de plainte de la part des victimes de ces pratiques. Le choix de la juridiction est contraint dans la mesure où un litige né de l'application d'un contrat commercial relève du juge commercial, conformément à la jurisprudence. Les pouvoirs publics pourront ainsi faire constater la nullité des clauses ou des contrats illicites. Ces derniers sont notamment définis par le nouvel alinéa introduit par le IV du présent article. La nullité vise d'une part les clauses - ou contrats - octroyant rétroactivement des remises, des ristournes ou le bénéfice d'accords de coopération commerciale et d'autre part le paiement d'un droit d'accès préalable au référencement. De plus, le ministère public ou le ministre de l'économie peuvent demander la répétition de l'indu, c'est-à-dire demander à la juridiction d'ordonner le reversement des sommes perçues grâce aux pratiques abusives. Enfin, le ministère public ou le ministre de l'économie peuvent demander à la juridiction saisie de prononcer une amende civile. Le montant maximal de cette amende est fixé à 2 millions d'euros. Une amende civile vise à sanctionner des pratiques abusives et le trouble à l'ordre public économique qu'elles constituent. Dans ce contexte, une telle mesure semble adaptée aux cas de pratiques commerciales abusives. Par ailleurs, une telle amende concerne les rapports entre personnes. Elle se distingue donc clairement de sanctions que peut prononcer le Conseil de la concurrence au titre des articles 7 et 8 de l'ordonnance. En effet, ces sanctions visent à réparer un dommage commis envers le marché en général, c'est-à-dire au plan macro-économique. En revanche, une amende civile vise à réparer un dommage lié à une pratique particulière, qui ne déstabilise pas le marché dans son ensemble. En dernier lieu, le présent article prévoit que la demande de réparation des préjudices subis peut être demandée par toute partie à l'instance. Cette formulation permet avant tout au ministère public ou au ministre de l'économie de pouvoir, en lieu et place de la victime des pratiques abusives, demander la réparation des préjudices. Cette réparation prend la forme de dommages et intérêts. VI.- Le présent article vise à réécrire le dernier alinéa de l'article 36 de l'ordonnance du 1er décembre 1986. L'actuel alinéa dispose que « le président de la juridiction saisie peut, en référé, enjoindre la cessation des agissements en cause ou ordonner toute autre mesure provisoire ». La nouvelle rédaction de cet alinéa mentionne « le juge des référés » au lieu du « président de la juridiction saisie ». En effet cette rédaction pouvait laisser penser qu'il s'agissait là du président de la juridiction saisie au fond. Désormais, il sera possible d'agir directement en référé. Cette action est ouverte au ministère public et au ministre de l'économie. * * * Votre Commission a rejeté deux amendements identiques (n° 88) de M. Jean-Paul Charié et de M. Philippe Auberger tendant à modifier la définition des pratiques abusives, ainsi que cinq amendements de M. Gilbert Gantier, le premier visant à limiter la preuve de la pratique abusive à un fait clairement établi, le second tendant à supprimer la référence à l'intérêt commun, le troisième visant à supprimer l'obligation de justifier les clauses des contrats, le quatrième excluant la notion de rupture partielle et le cinquième supprimant l'intervention du ministre de l'Économie dans la fixation des délais minima de préavis. Elle a ensuite rejeté deux amendements identiques, (n° 108) de la commission de la Production et de M. Philippe Auberger obligeant à motiver le préavis écrit lors d'une rupture des relations commerciales, ainsi que deux amendements identiques, de MM. Michel Inchauspé et Pierre Hériaud, obligeant à motiver le préavis écrit et fixant la durée minimale de ce préavis à six mois. Votre Commission a ensuite adopté un amendement (n° 109) de la commission de la Production, tendant à doubler la durée du préavis pour les cas où le produit est fourni sous marque de distributeur. Votre Commission a rejeté un amendement de M. Gilbert Gantier tendant à empêcher l'intervention du ministre de l'Économie dans les relations contractuelles, deux amendements rédactionnels (n° 89 et n° 90) de M. Jean-Paul Charié et un amendement de M. Gilbert Gantier, supprimant la possibilité de déclarer la nullité de certaines pratiques abusives. Votre Commission a ensuite adopté un amendement rédactionnel (n° 160 corrigé) de votre Rapporteur. Votre Commission a rejeté trois amendements de M. Jean-Paul Charié, (n° 95) relatif aux coopératives de commerçants, (n°s 91 et 92) permettant au juge pénal de sanctionner les pratiques abusives. Votre Commission a ensuite adopté un amendement rédactionnel (n° 161) de votre Rapporteur. Votre Commission a rejeté un amendement (n° 93) de M. Jean-Paul Charié tendant à supprimer la possibilité de pouvoir demander au juge la répétition de l'indu, ainsi qu'un amendement (n° 94) du même auteur supprimant la possibilité de demander au juge des dommages et intérêts. Elle a ensuite adopté l'article 29, ainsi modifié. * * * (Article L. 214-1 du code de la consommation) Étiquetage et présentation des produits Le présent article vise à permettre de mieux réglementer les mentions relatives aux modes de production des produits alimentaires et industriels. L'actuel article L. 214-1 prévoit notamment qu'un décret en Conseil d'État fixe les modalités de présentation, de promotion et d'étiquetage des produits. Sont ainsi concernées les mentions d'étiquetage relatives à l'origine des produits, leur composition, leurs qualités substantielles. Depuis plusieurs années, des mentions relatives au mode de production apparaissent sur les emballages et dans la présentation des produits. Il s'agit généralement de références floues visant à laisser entendre que le produit subit un processus de fabrication particulier. Une mention telle que « agriculture raisonnée » peut être, par exemple, perçue comme un gage de qualité. Il peut en résulter une confusion dans l'esprit du consommateur induite par ces mentions pouvant sembler valorisantes. Ces mentions, conçues comme des arguments de marketing, ne répondent généralement à aucun cahier des charges. Dès lors, le consommateur se trouve dans l'impossibilité de vérifier les allégations portées sur les produits. Le présent article introduit un neuvième alinéa dans l'article L. 214-1 du code de la consommation afin d'indiquer qu'un décret en Conseil d'État peut réglementer les mentions portées sur l'emballage et utilisées pour la présentation des produits, relatives aux modes de production. Cette réglementation concerne aussi « les factures, les documents commerciaux ou documents de promotion. » Dès lors, l'utilisation, en matière de publicité, de mentions relatives au mode de production se trouve elle aussi encadrée, ce qui est le corollaire logique du dispositif en matière de mentions portées sur l'emballage. Ce dispositif permet de mettre en _uvre les recommandations du rapport « Paillotin » remis au ministre de l'Agriculture en février 2000. Il sera d'application particulièrement large. En effet l'expression « mode de production » peut concerner les produits agricoles et alimentaires, mais aussi toute marchandise industrielle. Dans ce dernier cas, le dispositif peut être mis en _uvre pour encadrer les mentions relatives au respect de l'environnement ou encore au respect des règles sociales. * * * Votre Commission a adopté un amendement rédactionnel (n° 162) de votre Rapporteur. Votre Commission a ensuite adopté l'article 30, ainsi modifié. * * * Votre Commission a rejeté un amendement de M. Yves Cochet tendant à instaurer un label social, votre Rapporteur ayant souligné que cette possibilité est déjà ouverte par l'article 30. Article additionnel après l'article 30 Votre Commission a ensuite adopté un amendement (n° 110) de la commission de la Production tendant à encadrer les modes de production raisonnés. En conséquence, les deux amendements identiques de MM. Michel Inchauspé et M. Pierre Hériaud, ayant le même objectif, ont été retirés. * * * (Articles L. 112-3 et L. 112-4 (nouveaux) du code de la consommation Utilisation simultanée d'une marque commerciale Le présent article vise à encadrer l'utilisation simultanée d'une marque commerciale et d'un signe d'identification et prévoit les modalités de contrôle de ces dispositions. Les produits bénéficiant d'un « signe d'identification » sont ceux mentionnés à l'article L. 640-2 du code rural, créé par la loi n°99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole. Ces signes sont « l'appellation d'origine contrôlée, le label, la certification de conformité, la certification du mode de production biologique et la dénomination " montagne " ». L'étiquetage des produits concernés par ces signes d'identification connaît depuis plusieurs années une évolution préoccupante. En effet, le signe d'identification a tendance à apparaître de moins en moins lisiblement au profit de la mention - ou du logo - de la marque commerciale. Dès lors, le signe officiel est, en quelque sorte, « absorbé » par la marque commerciale. Cette dernière est susceptible d'accaparer le potentiel d'attraction du signe d'identification. Le problème se pose particulièrement dans le cas des marques de distributeurs. En effet, dans ce dernier cas, le nom du producteur n'apparaît pas sur le produit. Si un tel produit est doté d'un signe d'identification, seule la marque commerciale, dont le nom figure sur celui-ci, tire le bénéfice du prestige de ce signe. L'article L. 112-3, nouveau, du code de la consommation, précise qu'un décret en Conseil d'État peut venir encadrer les conditions de l'usage simultané d'une marque commerciale et d'un signe d'identification officiel de manière à rétablir la place des signes d'identification. Un tel décret peut concerner l'étiquetage d'une denrée alimentaire ou d'un produit agricole non transformés. Cependant, les vins, disposant déjà d'une réglementation spécifique et plus protectrice, ne sont pas concernés par ce nouveau dispositif. D'autre part, le présent article introduit dans le code de la consommation un article L. 122-4 (nouveau) qui permet aux agents mentionnés à l'article L. 215-1 du code de la consommation de rechercher et de constater les infractions aux dispositions de l'article L. 112-3. Les agents concernés sont notamment ceux de la DGCCRF, ceux de la direction générale des impôts ou encore les agents de l'État agréés et commissionnés par le ministère de l'Agriculture. L'article L. 215-3 du code de la consommation prévoit que les agents peuvent pénétrer dans les bâtiments de conditionnement, de stockage, de dépôt ou de vente ou dans les véhicules de transport de marchandises (mentionnés à l'article L. 213-4 du code de la consommation). Ils peuvent pénétrer dans tous ces lieux, même de nuit sauf s'ils sont affectés à l'usage d'habitation. Dans ce dernier cas, qui met en cause l'inviolabilité du domicile, protégée par le Conseil constitutionnel (n° 83-164 DC du 29 décembre 1983), les contrôles ne peuvent être effectués que de jour et avec une autorisation du procureur de la République, s'il y a opposition de l'occupant des lieux. Les agents peuvent aussi consulter tout document des administrations publiques, des établissements ou organismes sous contrôle public ou des entreprises et services concédés par une collectivité publique. Le présent article prévoit que les dispositions de l'article L. 112-4 s'appliquent à tout le chapitre II du titre premier du livre premier du code de la consommation. Outre les deux articles introduits par le présent article, ce chapitre comporte les articles L. 112-1 et L. 112-2 introduits par la loi du 9 juillet 1999 précitée. L'article L. 112-1 encadre l'étiquetage des produits bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée fromagère. L'article L. 112-2 définit le logo « appellation d'origine contrôlée » utilisé pour présenter les produits agricoles et alimentaires (à l'exception des vins). Lors de l'adoption de ces dispositions, il a été omis de préciser les modalités de recherche et de constatation des infractions à ce dispositif. C'est pourquoi le présent article étend le champ des mesures de contrôle à l'ensemble du chapitre II du titre premier du livre premier du code de la consommation. En dernier lieu, le présent article introduit un article L. 641-1-2 dans le code rural. Cet article reprend les dispositions de l'article L. 112-3 du code de la consommation. * * * Votre Commission a adopté l'article 31, sans modification. * * * Votre Commission a ensuite rejeté deux amendements, le n° 114 de la commission de la Production et le n° 51, de M. Jean-Paul Charié, tendant à étendre aux entreprises les dispositions protectrices du consommateur relatives au démarchage à domicile. Articles additionnels après l'article 31 Produits vendus sous marque de distributeurs Elle a adopté l'amendement (n° 111 rectifié) de la commission de la Production, obligeant à inscrire le nom du fabricant sur les produits vendus sous marque de distributeur. Protection de dénominations de chocolat Le Président Henri Emmanuelli et Mme Nicole Bricq ayant fait remarquer que la question semblait avoir été tranchée au niveau communautaire, votre Rapporteur a indiqué que la formulation retenue par l'amendement n° 112 rectifié de la commission de la Production, tendant à protéger certaines dénominations de chocolat, était compatible avec le droit communautaire. Votre Commission a alors adopté l'amendement n° 112 rectifié. Prix de revente Elle a adopté deux amendements identiques (n° 113 rectifié) de la commission de la Production et (n° 53) de M. Jean-Paul Charié tendant à définir le prix de revente. Coopératives de commerçants Après que M. Jean-Louis Dumont eut indiqué qu'il se ralliait à ces amendements, qui reprennent le dispositif contenu dans une proposition de loi adoptée à l'unanimité au sein du groupe interparlementaire de l'économie sociale, votre Commission a adopté deux amendements identiques (n° 115) de la commission de la Production et (n° 52) de M. Jean-Paul Charié, tendant à améliorer le cadre juridique des coopératives de commerçants. Dénomination produits « fermiers » Après que le Président Henri Emmanuelli eut souligné son intérêt pour cette question et souhaité s'y associer, votre Commission a adopté trois amendements identiques (n° 116) de la commission de la Production et de MM. Michel Inchauspé et Pierre Hériaud tendant à encadrer les conditions d'utilisation du qualificatif « fermier » pour les produits agricoles et alimentaires. * * * LUTTE CONTRE LES PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES Procédure devant le Conseil de la concurrence Avant de commenter les modifications apportées par le projet de loi à la procédure suivie devant le Conseil de la concurrence, il n'est pas inutile de décrire les principales étapes de celle-ci. Lorsqu'une saisine est jugée recevable, le président désigne, sur proposition du rapporteur général, un rapporteur. Celui-ci, tel un juge d'instruction, est chargé d'instruire les affaires qui lui sont confiées, à charge et à décharge. Pour se faire, il peut, pour réunir tous les éléments nécessaires à son information, procéder à des investigations, soit en confiant des enquêtes à des fonctionnaires de la DGCCRF désignés à cet effet à la requête du président du Conseil de la concurrence, soit en y procédant lui-même puisqu'il dispose des mêmes pouvoirs d'enquête que ceux-ci. En outre, le rapporteur peut procéder à des auditions qui donnent lieu à des procès-verbaux signés par les personnes entendues, qui peuvent se faire assister d'un conseil en vertu de l'article 20 du décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986. A l'issue de son instruction, le rapporteur peut formuler une proposition de non-lieu, s'il estime qu'aucun grief ne peut être formulé à l'encontre des personnes visées par la saisine. Dans ce cas, conformément aux dispositions de l'ordonnance du 1er décembre 1986, le Conseil de la concurrence se prononce après que les conclusions du rapporteur aient été transmises à l'auteur de la saisine et au commissaire du Gouvernement et que ceux-ci aient été à même de consulter le dossier et de présenter leurs observations. A l'inverse, s'il estime qu'il y a eu effectivement pratiques anticoncurrentielles entrant dans le champ d'application des articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, le rapporteur rédige une notification des griefs, document énumérant les pratiques reprochées aux personnes visées. Cette notification est faite par le président du conseil seul, le conseil ayant jugé qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait la signature du rapporteur. La notification des griefs ouvre la phase écrite de la procédure contradictoire, permettant aux parties et au commissaire du Gouvernement, comme le prévoit l'article 21 de l'ordonnance, de consulter le dossier et, dans un délai de deux mois, de présenter leurs observations. Après notification des griefs, le président du Conseil de la concurrence peut, en application de l'article 22 de l'ordonnance, choisir une procédure simplifiée, consistant à porter l'affaire devant la commission permanente, composée de lui-même et des trois vice-présidents, sans établissement préalable d'un rapport. Cette décision est notifiée aux personnes auxquelles les griefs ont été notifiés et au ministre chargé de l'économie. Ceux-ci disposent d'un délai de deux mois pour présenter leurs observations sur les griefs notifiés, lesquelles mettent un terme à l'instruction. Si le président ne choisit pas la procédure simplifiée, le rapporteur établit un rapport au vu des observations présentées par les parties et par le commissaire du Gouvernement sur la notification des griefs. Ce rapport doit contenir « l'exposé des faits et griefs finalement retenus par le rapporteur à la charge des intéressés ainsi qu'un rappel des autres griefs » (cf. article 18 du décret du 29 décembre 1986 précité). Ce rapport est notifié par le président aux parties, au commissaire du Gouvernement et aux ministres intéressés. Il est accompagné des documents sur lesquels se fonde le rapporteur et des observations produites. Les parties disposent à nouveau d'un délai de deux mois pour présenter un mémoire en réponse, qui peut être consulté par les autres parties dans les quinze jours qui précèdent la séance. Les séances du Conseil de la concurrence ne sont pas publiques mais leur déroulement respecte le principe du contradictoire. Les parties peuvent assister aux séances et être entendues si elles en font la demande et peuvent s'y faire représenter ou assister. Le conseil peut aussi entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile. (Article 4 de l'ordonnance du 1er décembre 1986) Attributions du ou des rapporteurs généraux adjoints Cet article précise les attributions du ou des rapporteurs généraux adjoints du Conseil de la concurrence. La fonction a été créée par la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et la sécurité financière, afin de renforcer la structure permanente du conseil. Comme le rapporteur général, le ou les rapporteurs généraux adjoints « sont nommés sur proposition du président par arrêté du ministre chargé de l'économie ». Leurs attributions n'étaient pas décrites de façon précise par les modifications introduites par la loi du 25 juin 1999, hormis la possibilité pour lui, au même titre que le rapporteur général ou le commissaire du Gouvernement, de présenter des observations lors des séances du conseil (cf. article 25 de l'ordonnance du 1er décembre 1986). C'est pourquoi le présent article autorise le rapporteur général à déléguer au(x) rapporteur(s) général(aux) adjoint(s) « tout ou partie de ses attributions au titre de la présente ordonnance ». Les conditions dans lesquelles cette délégation pourra intervenir seront précisées par décret en Conseil d'État. A l'heure actuelle, un seul rapporteur général adjoint a été désigné en octobre dernier ; d'après les informations recueillies par votre Rapporteur, il n'est pas envisagé d'un nommer un second. L'existence du rapporteur général adjoint devrait rendre inutile, à terme, l'existence du rapporteur général suppléant. En vertu de l'article 3 du décret du 29 décembre 1986, le rapporteur général suppléant est, en effet, l'un des rapporteurs permanents du conseil désigné par son président pour suppléer le rapporteur général en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci. Votre Rapporteur a présenté un amendement supprimant le renvoi à un décret en Conseil d'État prévu par ce présent article, tant celui-ci apparaît d'une lourdeur inutile, puisqu'on imagine mal ce qu'en serait le contenu. Par ailleurs, il semble plus judicieux d'insérer ce nouvel alinéa immédiatement après celui créant les rapporteurs généraux adjoints, plutôt qu'à la fin de l'article 4, à la suite des alinéas relatifs à l'organisation financière du conseil. * * * Votre Commission a adopté un amendement (n° 163) de votre Rapporteur supprimant le renvoi à un décret en Conseil d'État pour déterminer les conditions dans lesquelles le rapporteur général, peut déléguer ses attributions. Puis elle adopté l'article 32 ainsi modifié. * * * Articles additionnels après l'article 32 Prohibition d'exploitation abusive de la dépendance économique Votre Commission a adopté l'amendement (n° 117) de la commission de la Production redéfinissant l'interdiction d'exploitation abusive d'un état de dépendance économique en ôtant la condition d'atteinte au jeu de la concurrence sur le marché et permettant ainsi au Conseil de la concurrence de sanctionner plus facilement de telles pratiques. Sanctions des pratiques anti-concurrentielles Votre Commission a ensuite adopté un amendement de votre Rapporteur (n° 164) rendant plus aisément applicable l'article 17 de l'ordonnance qui sanctionne pénalement des personnes qui ont pris une part personnelle et déterminante dans la conception, l'organisation ou la mise en _uvre de pratiques anticoncurrentielles. * * * (Article 21 de l'ordonnance du 1er décembre 1986) Notification des griefs et délais de consultation L'article 33 modifie et complémente l'ordonnance du 1er décembre 1986, afin de préciser l'auteur de la notification des griefs aux personnes intéressées (I) et de permettre de prolonger les délais accordés aux parties pour formuler leurs observations (II). I.- En vertu de l'article 21 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, la notification des griefs aux intéressés est faite par le « conseil ». L'article 18 du décret du 29 décembre 1986 précité précise qu'il faut entendre par cette rédaction le président du Conseil de la concurrence, qui peut être suppléé par un vice-président en cas d'absence ou d'empêchement. La signature du président au bas de la notification des griefs, alors qu'il pourra être amené à présider la formation qui « jugera » l'affaire, apparaît, à une partie de la doctrine comme de nature à obscurcir la distinction entre l'instruction d'une affaire et la décision sur celle-ci, et pouvant donc être considérée comme une violation du droit à un procès équitable exigé par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. La jurisprudence de la cour d'appel de Paris et de la Cour de cassation devenant excessivement exigeante en cette matière (elles ont condamné la présence au délibéré du rapporteur général et du rapporteur, pourtant prévues par l'article 25 de l'ordonnance), le présent article entend prémunir le Conseil de la concurrence contre une éventuelle décision en ce sens. C'est pourquoi le paragraphe I confie désormais le soin au rapporteur général de procéder lui-même à la notification des griefs, en lieu et place du président. II.- L'article 21 de l'ordonnance accordent aux parties et au commissaire du Gouvernement un délai de deux mois pour consulter le dossier et présenter leurs observations tant à la suite de la notification des griefs que de la notification du rapport. Aucune disposition législative ne prévoit la possibilité de proroger ce délai. La cour d'appel de Paris a d'ailleurs toujours admis que le Conseil de la concurrence refuse de le faire, même si les parties estimaient n'avoir pu assurer leur défense dans des conditions normales. Cependant, il est arrivé au Conseil de la concurrence de prolonger ce délai à deux reprises dans une même affaire, eu égard aux conditions matérielles de la consultation d'un dossier concernant plus de quarante parties et comportant plus de 11.000 pièces. En l'espèce, la cour d'appel de Paris a annulé la procédure au motif que la deuxième prolongation n'avait bénéficié qu'à certaines des parties seulement. Il apparaît donc que le délai de deux mois peut, dans certaines circonstances, apparaître trop court. C'est pourquoi le paragraphe II du présent article propose d'insérer dans l'article 21 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 un alinéa autorisant le président du conseil à accorder un délai supplémentaire d'un mois pour la consultation du dossier et la production des observations des parties. Dans un souci de ne pas prolonger inutilement des procédures déjà longues, ce nouvel alinéa précise que la décision du président doit être justifiée par des « circonstances exceptionnelles » et qu'elle n'est susceptible d'aucun recours. * * * Votre Commission a rejeté deux amendements identiques de MM. Philippe Auberger et Gilbert Gantier visant à allonger de deux mois les délais consentis aux parties pour présenter leurs observations après la notification des griefs. Elle a ensuite adopté l'article 33, sans modification. * * * Article 34 (Article 22 de l'ordonnance du 1er décembre 1986) Le présent article facilite le déclenchement de la procédure simplifiée, modifie son déroulement, et renforce les sanctions auxquelles elle peut aboutir. L'article 22 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 autorise le président du Conseil de la concurrence à décider, après la notification des griefs, de recourir à une procédure simplifiée, renvoyant l'affaire devant la commission permanente sans établissement préalable d'un rapport. Dans ce cadre, la commission permanente dispose de la plénitude des attributions du conseil. En revanche, le montant maximum des sanctions pécuniaires n'est que de 500.000 francs pour chacun des auteurs, alors qu'il atteint 5 % du chiffre d'affaires ou 10 millions de francs, selon que l'auteur est une entreprise ou non, dans le cadre de la procédure normale. Le rapport du Conseil de la concurrence pour 1997 indique que son président « recourt largement à cette possibilité qui présente l'avantage, pour des affaires simples ou ne présentant pas de questions nouvelles, de raccourcir les délais d'instruction d'au moins six mois ». C'est ainsi que sur les 34 décisions statuant sur des griefs notifiés prises en 1998, neuf ont été examinées selon cette procédure simplifiée. Pour les années antérieures, les chiffres correspondants sont 11 sur 40 en 1995, 10 sur 49 en 1996 et 13 sur 50 en 1997. Le présent article apporte trois modifications aux dispositions relatives à la procédure simplifiée. En premier lieu, il précise que la décision appartiendra désormais non seulement au président mais aussi à « un vice-président délégué par lui ». Comme pour la notification des griefs, cette disposition répond au souci de sécuriser autant que faire se peut la procédure suivie devant le Conseil de la concurrence au regard des exigences de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. En effet, le président du conseil préside aussi la commission permanente. Dès lors, en choisissant de renvoyer l'affaire à une formation qu'il préside, il pourrait se voir reprocher d'avoir en quelque sorte « préjugé » l'affaire en reconnaissant, par le choix de la procédure simplifiée, qu'elle ne présente pas de difficulté ou revêt un faible caractère de gravité, justifiant des sanctions modérées. En prévoyant que la décision de recourir à la procédure simplifiée peut être prise par un vice-président, le présent paragraphe permet que l'affaire puisse être examinée au fond par une formation du conseil présidée par une autre personne. En deuxième lieu, en disposant qu'une affaire examinée selon la procédure simplifiée est portée devant « le conseil », le présent article permet de renvoyer l'affaire à l'une ou l'autre des formations du conseil et non plus, comme actuellement, à la seule commission permanente. Comme le précise l'article 4 de l'ordonnance, « le conseil peut siéger soit en formation plénière, soit en sections, soit en commission permanente ». La formation plénière est composée d'au moins huit conseillers (sur 17) et les sections d'au moins trois d'entre eux (la répartition des conseillers entre les quatre sections est décidée par le président). Comme on l'a vu, la commission permanente est, elle, composée du président et des trois vice-présidents. En troisième lieu, lorsque le conseil statue selon la procédure simplifiée, le plafond des sanctions pécuniaires qu'il peut prononcer est plus faible (500.000 francs) que s'il statuait selon la procédure normale (5 % du chiffre d'affaires ou 10 millions de francs lorsque l'auteur n'est pas une entreprise). Le projet de loi relève le plafond en cas d'utilisation de la procédure simplifiée, puisque celui-ci est presque multiplié par dix : 750.000 euros (soit 4.919.677,50 francs) au lieu de 500.000 francs pour chacun des auteurs des pratiques prohibées. Ce relèvement était vivement souhaité par le Conseil de la concurrence. Dans son rapport pour 1997, il notait en effet que « cette procédure ne peut être mise en _uvre dans certains cas, en raison même de la limitation du montant des sanctions pécuniaires prévue par l'article 22. » Il faisait observer que « le montant de 500.000 francs a été fixé il y a maintenant plus de dix ans lors de l'élaboration de l'ordonnance et n'a jamais été révisé depuis. » De son point de vue, cette situation pouvait rendre le recours à la procédure simplifiée inopportun, en raison de l'impossibilité de prononcer des sanctions réellement dissuasives, alors même que, « en raison du fait que la jurisprudence est désormais bien établie sur de très nombreux points, un nombre substantiel d'affaires (pourrait) être traité selon la procédure accélérée ». En effet, simplicité d'une affaire et gravité des pratiques condamnées peuvent aller de pair. De plus, l'article 34 précise que le plafonnement des sanctions pouvant être prononcées par le Conseil de la concurrence lors qu'il statue selon la procédure simplifiée ne s'applique pas lorsqu'il est fait application de la procédure décrite au paragraphe II de l'article 13 de l'ordonnance (procédure introduite par l'article 38 du présent projet de loi), c'est-à-dire lorsque les griefs notifiés ne sont pas contestés par leur auteur. Dans ce cas, la sanction prononcée peut atteindre le plafond de droit commun. Cette disposition, en ne prévoyant pas une « prime » à la non-contestation des faits, semble de nature à réduire les cas d'application effective de cette nouvelle procédure. * * * Votre Commission a rejeté deux amendements identiques de MM. Philippe Auberger et Gilbert Gantier abaissant les sanctions pouvant être prononcées par le Conseil de la concurrence lorsqu'est mise en _uvre la procédure simplifiée. Puis, elle a adopté un amendement de coordination (n° 165) de votre Rapporteur. Elle a ensuite adopté l'article 34, ainsi modifié. * * * (Article 23 de l'ordonnance du 1er décembre 1986) Protection du secret des affaires Le présent article vise à assouplir les refus de communication de pièces au cours de la procédure. Le caractère contradictoire de la procédure suivie devant le Conseil de la concurrence peut poser des difficultés au regard de la nécessaire protection du secret des affaires. En effet, les dossiers soumis à la consultation des parties peuvent comporter des informations confidentielles qui pourraient être exploitées par des concurrents, posant ainsi un grave préjudice à la partie victime de cette divulgation. C'est pourquoi l'article 23 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 permet au président du Conseil de la concurrence de « refuser la communication de pièces mettant en jeu le secret des affaires », les pièces concernées étant retirées du dossier et ne pouvant plus être invoquées par quiconque à l'appui d'un grief. Cependant, pour éviter que cette possibilité ne conduise à vider les dossiers de leur substance, ce refus ne peut être accordé si « la communication ou la consultation de ces documents est nécessaire à la procédure ou à l'exercice des droits des parties. » Le président peut prendre la décision de sa propre initiative ou à la demande d'une partie. Aux termes de l'article 19 du décret du 19 octobre 1987 relatif aux recours exercés devant la cour d'appel de Paris contre les décisions du Conseil de la concurrence, cette décision ne peut faire l'objet d'un recours qu'auprès de la formation du conseil lorsqu'elle examinera l'affaire au fond. Les décisions du président au titre de la protection du secret des affaires ne sont pas très fréquentes. Au cours des dernières années, il a ainsi pris 4 décisions de ce type en 1995, 10 en 1996, 8 en 1997, 10 en 1998 et 9 en 1999. Le projet de loi permet au président de déléguer à un vice-président la décision de refuser la communication d'une pièce. Dans le même souci de sécurisation des procédures suivies devant le Conseil de la concurrence, cette faculté de délégation permet de différencier l'autorité qui a pris la décision de refus de communication (ou a rejeté une telle demande) de celle qui présidera la formation du conseil qui examinera au fond l'affaire et donc éventuellement un recours fondé sur l'article 23 de l'ordonnance. Enfin, le présent article offre au président du Conseil de la concurrence la possibilité de limiter le refus de communication à certaines mentions seulement des pièces visées, mentions qui seront alors occultées. L'expérience montre, en effet, qu'il est parfois suffisant, pour protéger le secret des affaires, de masquer certains passages sans retirer l'intégralité de la pièce concernée. Cette faculté nouvelle apparaît de nature à mieux protéger les intérêts des parties, puisqu'elle permettra de concilier plus facilement protection du secret des affaires et nécessités de la procédure. * * * Votre Commission a adopté l'article 35, sans modification. * * * (Article 24-1 (nouveau) de l'ordonnance du 1er décembre 1986) Le présent article détermine les conditions dans lesquelles il peut être recouru à un expert au cours de l'instruction. La possibilité de recourir à un expert est d'ores et déjà prévue par plusieurs dispositions de l'ordonnance. Ainsi, l'article 25 autorise le Conseil de la concurrence à entendre toute personne « dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer à son information ». Par ailleurs, le jeu combiné des articles 45 et 47 autorise les rapporteurs à demander à l'autorité dont dépendent les enquêteurs de désigner « un expert pour procéder à toute expertise contradictoire nécessaire ». Cependant, ces dispositions ne peuvent donner pleinement satisfaction. D'une part, l'article 25 ne vise que les séances du Conseil de la concurrence, donc l'ultime stade de la procédure lorsqu'il examine l'affaire au fond. D'autre part, les rapporteurs ne peuvent eux-mêmes désigner d'office un expert, puisqu'ils doivent en faire la demande à l'autorité administrative dont dépendent les enquêteurs. Enfin, l'ordonnance est muette sur le déroulement de l'expertise et sur son financement. C'est pourquoi le projet de loi entend pallier cette insuffisance en précisant les règles de désignation des experts, les conditions dans lesquelles se déroulent leur mission et les modalités de financement de celle-ci. Le premier alinéa précise que la décision de désigner un expert incombe au rapporteur général du Conseil de la concurrence, saisi soit par le rapporteur en charge du dossier, soit par l'une des parties. Les demandes d'expertise et les décisions du rapporteur général peuvent intervenir « à tout moment de l'instruction ». Le deuxième alinéa précise les conditions dans lesquelles l'expertise se déroule. Le contenu de la mission impartie à l'expert doit être décrite dans la décision du rapporteur général. Le caractère contradictoire des opérations d'expertise est clairement affirmé, comme il l'est déjà dans l'article 47. En l'absence d'autre précision, il convient de se référer aux règles du nouveau code de procédure civile. Ces précisions répondent aux exigences du juge puisque, dans un arrêt de mars 1998, la cour d'appel de Paris a annulé l'ensemble d'une procédure au motif qu'une expertise n'avait pas respecté le principe du contradictoire : l'expert avait été désigné sans qu'une mission précise lui fût impartie et les requérants n'avaient pas été appelés à participer aux opérations d'expertise ni à faire valoir leurs observations. Le dernier alinéa du nouvel article 24-1 de l'ordonnance désigne la personne qui supporte la charge financière de l'expertise. Le principe est simple : c'est la personne qui en a fait la demande, donc la partie qui a saisi le rapporteur général ou le Conseil de la concurrence si la demande émanait du rapporteur. Cependant, le conseil peut déroger à ce principe en décidant, lorsqu'il prend sa décision sur le fond du dossier, de « faire peser la charge définitive sur la ou les parties sanctionnées dans des proportions qu'il détermine ». * * * Votre Commission a adopté deux amendements de votre Rapporteur, le premier (n° 166) précisant les conditions dans lesquelles le rapporteur général peut faire appel à des experts, et le second (n° 167) permettant de fixer un délai à l'expert pour remplir sa mission. Elle a ensuite adopté l'article 36, ainsi modifié. * * * Votre Commission a rejeté trois amendements identiques de MM. Philippe Auberger, Pierre Hériaud et Michel Inchauspé permettant de conclure dans le cadre d'une organisation interprofessionnelle reconnue les contrats tendant à faire face à des crises conjoncturelles affectant les productions de données agricoles périssables. * * * Avis et décisions du Conseil de la concurrence (Article 12 de l'ordonnance du 1er décembre 1986) Le présent article vise à faciliter les possibilités offertes au Conseil de la concurrence de recourir à des mesures conservatoires. Le Conseil de la concurrence peut prendre des mesures conservatoires, dont l'objet est d'éviter qu'une pratique éventuellement anticoncurrentielle ne poursuive ses effets pendant toute la durée de la procédure. Les mesures prononcées « peuvent comporter la suspension de la pratique concernée ainsi qu'une injonction aux parties de revenir à l'état antérieur ». Dans l'état actuel des textes et de la jurisprudence, cette possibilité est étroitement encadrée : - le conseil ne peut décider que les mesures « qui lui sont demandées » par le ministre chargé de l'économie ou par les personnes habilitées à le saisir, - il ne peut accorder de telles mesures que si « la pratique dénoncée porte une atteinte grave et immédiate à l'économie générale, à celle du secteur intéressé, à l'intérêt des consommateurs ou à l'entreprise plaignante » ; dans ce cadre, les mesures prononcées « doivent rester strictement limitées à ce qui est nécessaire pour faire face à l'urgence ». Ces conditions restrictives expliquent la relative rareté, au cours des dernières années, des demandes déposées (moins d'une vingtaine en moyenne chaque année depuis 1993) et de celles ayant reçu une suite favorable (14 seulement depuis 1993). Le présent article propose d'assouplir la première contrainte, en permettant au conseil de ne pas se sentir lié par la demande qui lui est présentée et donc de prononcer les mesures qui « lui apparaissent utiles ». Cet assouplissement avait été souhaité par le Conseil de la concurrence dans son rapport pour 1997. Il apparaît en effet que les auteurs des demandes n'ont parfois qu'une connaissance approximative des arcanes du droit de la concurrence et demandent des mesures conservatoires que le conseil est dans l'incapacité de retenir, soit parce qu'elles sont inadaptées, soit parce qu'il ne peut les prononcer (sanctions pécuniaires, réparation du préjudice subi ...). * * * Votre Commission a adopté l'article 37, sans modification. * * * (Article 13 de l'ordonnance du 1er décembre 1986) Sanctions prononcées par le Conseil de la concurrence Le présent article propose une nouvelle rédaction intégrale de l'article 13 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, qui est actuellement uniquement consacré aux décisions que peut prendre le Conseil de la concurrence (injonctions et sanctions pécuniaires). Cette nouvelle rédaction modifie le dispositif relatif aux sanctions que peut prononcer le Conseil de la concurrence et complète l'article 13 par deux paragraphes additionnels, le premier instituant une procédure simplifiée applicable lorsque les griefs ne sont pas contestés, le second créant un « dispositif de clémence », selon les termes de l'exposé des motifs. Le paragraphe I modifie l'article 13 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 dont les termes actuels prévoient que le Conseil de la concurrence « peut ordonner aux intéressés de mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles dans un délai déterminé ou imposer des conditions particulières ». Pour se faire, « il peut infliger une sanction pécuniaire applicable soit immédiatement, soit en cas d'inexécution des injonctions ». Le présent article précise les critères utilisés par le conseil pour déterminer le montant de la sanction infligée, modifie le plafond des sanctions et le mode de calcul de celui-ci et assouplit les modalités de la sanction complémentaire de publication de la décision. 1) L'article 13 adopte le principe de proportionnalité des sanctions pécuniaires que peut prononcer le conseil. En vertu de son troisième alinéa, ces sanctions doivent être « proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l'importance du dommage causé à l'économie et à la situation de l'entreprise ou de l'organisme sanctionné ». L'article 13 précise, en outre, qu'elles « sont déterminées individuellement pour chaque entreprise ou organisme sanctionné et de façon motivée pour chaque sanction. » En premier lieu, la nouvelle rédaction proposée complète la définition du critère relatif à la situation de l'entreprise ou de l'organisme sanctionné. Jusqu'à présent, le conseil appréhende la situation de l'entreprise par la prise en compte de sa taille et de sa situation financière. Comme il l'indique dans son rapport pour 1998, le critère de la taille lui permet « d'éviter qu'une sanction calculée "objectivement", c'est-à-dire uniquement en fonction de la nature des pratiques, de la dimension du marché, de la gravité et du dommage à l'économie, ne conduise à des sanctions inadaptées, notamment lorsque les auteurs des pratiques sont des entreprises de tailles très différentes ». Dans ce cadre, le conseil retient « l'indicateur le plus représentatif et le plus accessible de la taille d'une entreprise », à savoir son chiffre d'affaires, tout en l'affectant parfois d'un « coefficient de dimension » qui « peut éventuellement prendre en considération d'autres facteurs, comme le statut juridique de l'entreprise (entreprise indépendante, filiale d'un grand groupe) ou la diversité de ses activités ». Le critère de la situation financière permet au conseil de prendre en considération la « faculté contributive » de l'entreprise. A l'inverse, certaines « situations extrêmes, dépôt de bilan, redressement ou liquidation judiciaires, justifient un traitement particulier et peuvent conduire le conseil à fixer la sanction à un montant symbolique ou à renoncer à prononcer une sanction ; de même, le montant de la sanction peut être réduit pour tenir compte des résultats déficitaires de l'entreprise ». Désormais, le conseil pourra prendre en compte la situation du groupe auquel appartient l'entreprise sanctionnée. Un tel élargissement du critère devrait permettre au conseil de prononcer des sanctions plus élevées, la capacité financière du groupe étant généralement supérieure à celle de l'une ou l'autre de ses filiales. La nouvelle rédaction de l'article 13 introduit également un critère supplémentaire lié à la notion de récidive : la sanction devra être proportionnée également à « l'éventuelle réitération de pratiques prohibées ». Cette adjonction ne constitue qu'une confirmation de la jurisprudence du Conseil de la concurrence, qui a déjà à plusieurs reprises considéré que le fait que des pratiques analogues aient été déjà relevées dans des décisions ou avis antérieurs, a fortiori lorsqu'il s'agit des mêmes auteurs, constituait un facteur d'aggravation des faits. Dans ce cas, en effet, la volonté délibérée d'enfreindre les règles de la concurrence ne fait guère de doute, car les entreprises en cause « ne pouvaient ignorer ni la gravité des pratiques auxquelles elles se sont livrées, ni les sanctions pécuniaires qu'elles encouraient de ce chef ». 2) La nouvelle rédaction de l'article 13 procède à un doublement du plafond des sanctions pécuniaires et à une modification des règles de détermination de la base de référence de ce plafond pour les entreprises, modification allant également dans le sens d'un relèvement du plafond. A l'heure actuellement, le Conseil de la concurrence ne peut prononcer une sanction excédant 10 millions de francs pour une personne physique ou « 5 % du montant du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France au cours du dernier exercice clos ». Ces plafonds sont fortement augmentés. Pour une personne physique, il passe à 3 millions d'euros (soit 19.678.710 francs). Pour une personne morale, il passe à 10 % du chiffre d'affaires. Dans ce cas, c'est surtout la modification apportée à la détermination du chiffre d'affaires servant de référence qui devrait avoir les conséquences les plus importantes. Cette modification est double : _ d'une part, ce sera désormais le chiffre d'affaires « mondial » qui sera pris en compte ; il est même précisé que, si l'entreprise sanctionnée fait partie d'un groupe, c'est le chiffre d'affaires figurant dans les comptes consolidés ou combinés de celui-ci qui est pris en compte ; _ d'autre part, l'exercice de référence sera choisi parmi les « exercices clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en _uvre ». Il pourrait sembler étonnant d'accroître fortement le plafond des sanctions au vu du montant de celles qui sont effectivement prononcées par le Conseil de la concurrence. En effet, à l'inverse de ses homologues d'autres pays, le conseil inflige des sanctions de faible montant, comme l'indique le tableau ci-dessous :
D'une part, en retenant ces nouveaux plafonds, le projet de loi entend rapprocher notre droit du droit communautaire. En effet, en vertu de l'article 15 du règlement CEE n° 77/62 du 6 février 1962, la Commission peut prononcer des sanctions pouvant aller jusqu'à « 10 % du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice social précédent pour chacune des entreprises ayant participé à l'infraction. » D'autre part, il s'agit également d'adresser au Conseil de la concurrence un appel à plus grande sévérité à l'encontre de pratiques dont on a parfois trop tendance à minimiser le caractère dommageable pour l'économie en général et les consommateurs en particulier. Enfin, comme le souligne l'exposé des motifs du projet de loi, il s'agit de faire échec aux stratégies, constatées dans le passé, de certaines entreprises qui créent des holdings ou des sociétés écran et vident la société concernée par la procédure de l'essentiel de son activité afin de réduire le chiffre d'affaires servant de base au plafond de la sanction. Néanmoins, on peut se demander si le fait de permettre au Conseil de la concurrence de choisir parmi les chiffres d'affaires d'un trop grand nombre d'exercices comptables de référence n'est pas de nature à compliquer sa tâche. En effet, il serait ainsi amené à justifier son choix dans sa décision et s'exposer ainsi à d'éventuelles contestations devant le juge. Une règle simple - le chiffre d'affaires le plus élevé -, semblerait préférable sans compromettre, tout au contraire, l'objectif d'alourdissement des sanctions poursuivi par le projet de loi. 3) Actuellement le dernier alinéa de l'article 13 de l'ordonnance autorise le Conseil de la concurrence à « ordonner la publication de sa décision dans les journaux ou publications qu'il désigne, l'affichage dans les lieux qu'il indique et l'insertion de sa décision dans le rapport établi sur les opérations de l'exercice par les gérants, le conseil d'administration ou le directoire de l'entreprise ». Le Conseil de la concurrence n'a pas très souvent recours à cette faculté. Il n'a ordonné la publication de sa décision qu'à 9 reprises en 1995 (sur 39 décisions prononçant des sanctions ou des injonctions), 2 en 1996 (sur 41 décisions), 9 en 1997 (sur 39), 2 en 1998 (sur 34) et 4 en 1999 (sur 15). En revanche, il n'a ordonné l'affichage qu'à une seule occasion, en 1992. Pourtant, dans ses rapports, le conseil souligne que, au-delà du caractère de sanction, la publication a une vertu pédagogique et permet « de faire pénétrer l'esprit de concurrence chez les producteurs, les distributeurs et les consommateurs ». Le projet de loi apporte plusieurs modifications : _ il précise que la décision d'ordonner la publication doit être motivée ; cette exigence ne figure pas actuellement dans le texte de l'ordonnance, mais elle est déjà posée par la jurisprudence de la cour d'appel de Paris ; _ il permet que la publication porte non seulement sur la totalité de la décision, mais aussi sur un extrait de celle-ci ; cette faculté est bienvenue tant les décisions du Conseil de la concurrence sont parfois longues et rédigées dans des termes difficilement accessibles au grand public ; pour pallier cette difficulté, il est arrivé au conseil de diffuser un communiqué reprenant la substance des motifs et du dispositif d'une de ses décisions, initiative qui a été contestée devant la cour d'appel, qui s'est néanmoins déclarée incompétente. Cependant, la nouvelle rédaction proposée aboutit à supprimer les sanctions d'affichage et d'insertion dans les rapports de gestion des organes dirigeants de l'entreprise sanctionnée. D'après les informations recueillies par votre Rapporteur, cette suppression résulte d'une erreur de plume. Comme actuellement, c'est le conseil qui déterminera les modalités de la publication, celle-ci étant mise à la charge de la personne intéressée. Sur ce point, le conseil ne s'estime pas tenu de procéder à une répartition égalitaire de cette charge entre toutes les personnes sanctionnées, mais tient compte des circonstances de l'espèce. Le paragraphe II vise à réduire la durée de la procédure devant le Conseil de la concurrence, lorsqu'une entreprise ou un organisme ne « conteste pas la réalité des griefs qui lui sont notifiés ». Dès lors, « le Conseil de la concurrence peut, sans établissement préalable d'un rapport, prononcer la sanction pécuniaire prévue au I, en tenant compte, quant au montant de la sanction, de l'absence de contestation ». Si l'objectif poursuivi par cette procédure nouvelle est louable, le dispositif retenu ne semble pas entièrement satisfaisant. D'une part, cette procédure nouvelle ne se distingue pas suffisamment de la procédure simplifiée, ni quant au moment où elle peut être mise en _uvre (après la notification des griefs), ni quant à ses conséquences (éviter la phase d'établissement du rapport). En revanche, elle est mise en _uvre par le conseil lui-même, alors que la procédure simplifiée l'est par le président. Surtout, les sanctions pécuniaires sont soumises aux plafonds de droit commun et non au plafond particulier - et inférieur - de la procédure simplifiée. Dès lors, il est vraisemblable que la faculté ouverte par le présent paragraphe ne sera guère utilisée et que la non-contestation des griefs constituera rapidement un cas de mise en _uvre de la procédure simplifiée. D'autre part, cette procédure nouvelle ne peut être mise en _uvre qu'après la notification des griefs, c'est-à-dire à un stade déjà très avancé de la procédure. L'économie en termes de délai d'examen des saisines apparaît donc limitée. L'efficacité de la procédure nouvelle serait améliorée si elle pouvait intervenir davantage en amont. Même s'il existe des cas où les auteurs des pratiques portées devant le conseil ne sont connus qu'à un stade avancé de l'instruction, un tel déclenchement anticipé pourrait s'appliquer dans la majeure partie des saisines. Enfin, pour rendre la procédure attractive, il est nécessaire de tirer les conséquences de la non-contestation des faits en termes de montant des sanctions. Un plafond intermédiaire entre celui de la procédure simplifiée et ceux de la procédure de droit commun constituerait une forte incitation à cette forme de « plaider coupable ». Enfin, le paragraphe III introduit dans le droit français une procédure de clémence « lorsqu'une entreprise ou un organisme contribue ou a contribué à établir qu'une infraction visée à l'article 7 [c'est-à-dire une entente] a été commise ». Des dispositifs de ce type sont monnaie courante dans un certain nombre de pays étrangers, notamment ceux de tradition anglo-saxonne. C'est ainsi que la politique en matière d'indulgence (leniency en anglais) a fait l'objet d'une communication de la part du Département de la justice américain dès 1993. L'année 1999 a donné un exemple éclatant de la mise en _uvre de cette politique lors de l'affaire concernant une entente sur le marché américain des vitamines. Six groupes pharmaceutiques (3 européens et 3 japonais) mis en cause ont signé un accord amiable avec le millier d'industriels plaignants, atteignant un montant de près de 1,2 milliard de dollars. Les groupes Roche et BASF ont accepté de verser respectivement 632 et 287 millions de dollars. En revanche, Rhône-Poulenc Animal Nutrition, qui avait accepté de collaborer à l'enquête du ministère de la justice américain, ne verse « que » 87 millions de dollars, alors que sa part de marché n'était que légèrement inférieure à celle de BASF. S'inspirant de cet exemple, la Commission européenne a publié, en juillet 1996, une communication concernant « la non-imposition d'amendes ou la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes ». Dans ses considérants, la Commission explique qu'elle est « consciente du fait que certaines entreprises participant à des ententes pourraient souhaiter mettre fin à leur participation et l'informer de l'existence de l'entente, mais qu'elles en sont dissuadées par les amendes élevées qu'elles risquent de se voir infligées ». Elle estime alors « qu'il est de l'intérêt de la Communauté de faire bénéficier d'un traitement favorable les entreprises qui coopèrent avec elle » car « le bénéfice que tirent les consommateurs et les citoyens de l'assurance de voir ces pratiques révélées et interdites est plus important que l'intérêt qu'il peut y avoir à sanctionner pécuniairement des entreprises qui, en coopérant avec la Commission, lui permettent de découvrir et sanctionner une entente ou qui l'aident dans cette tâche ». Description du dispositif mis au point par la Commission européenne Il prévoit une gradation dans l'ampleur de la réduction des sanctions : - celle-ci est d'au moins 75 % de l'amende qui aurait été infligée en l'absence de coopération (le taux de réduction peut aller jusqu'à 100 %) si l'entreprise dénonce une entente avant que la Commission n'ait procédé à des vérifications ou ne dispose de preuves suffisantes de celle-ci, fournit une information exhaustive et accompagnée d'éléments de preuve, maintient une coopération permanente et totale tout au long de l'enquête et si elle n'a pas joué un rôle actif et déterminant dans la mise en place de l'entente ; - la réduction tombe de 50 à 75 % si l'entreprise remplit les conditions précédentes mais n'a dénoncé l'entente qu'après les premières vérifications de la Commission ; - la réduction n'est plus que de 10 à 50 % si l'entreprise coopérante ne remplit pas toutes les conditions ci-dessus, notamment quand elle ne conteste pas les griefs qui lui ont été notifiés. La procédure ne peut être mise en _uvre que lorsque c'est une personne dûment habilitée à engager l'entreprise qui souhaite coopérer qui prend contact avec la Commission. L'initiative individuelle d'un membre du personnel de l'entreprise n'est donc pas visée. Si à un stade quelconque de la procédure administrative les conditions énumérées ci-dessus ne sont plus réunies, l'entreprise ne pourra plus bénéficier du traitement favorable. Le fait qu'une entreprise bénéficie d'un traitement favorable en matière d'amende ne la protège toutefois pas des conséquences de droit civil de sa participation à l'entente. L'acclimatation en France de tels dispositifs de clémence fait l'objet de critiques récurrentes, leurs auteurs y voyant un encouragement à la délation, moralement condamnable. Il est vrai que ces procédures restent étrangères à nos traditions juridiques, puisqu'il n'y a guère qu'en matière de lutte contre le terrorisme que l'on retrouve des mesures analogues (12). Pourtant, il n'est pas niable que les enquêtes en matière d'ententes sont particulièrement difficiles, la longueur des procédures devant le Conseil de la concurrence l'atteste. Le recueil d'éléments de preuves est parfois problématique, d'autant plus qu'il est enserré dans des exigences jurisprudentielles qui, pour être légitimes, n'en sont pas moins rigoureuses. C'est pourquoi le projet de loi propose d'acclimater dans notre droit un mécanisme inspiré de l'exemple communautaire. Le dispositif proposé permet ainsi au Conseil de la concurrence, de sa propre initiative ou à celle du ministre de l'économie, d'accorder une mesure de clémence à une entreprise ou un organisme qui « contribue ou à contribué à établir » l'existence d'une entente. Ces mesures de clémence, qui sont « parties intégrantes » des décisions prises par le conseil, consistent en une exonération, qui peut être totale, de sanction pécuniaire. Elles font l'objet d'un « avis de clémence » définissant l'étendue de cette exonération adoptée par le conseil, après avoir entendu l'entreprise concernée et le commissaire de Gouvernement. Un nouvel avis peut être adopté par le conseil s'il constate « que les conditions de la clémence ne sont pas satisfaites ». Si l'économie générale du dispositif proposé est satisfaisante, la rédaction du paragraphe III l'est beaucoup moins. En effet, plusieurs ambiguïtés demeurent, quant au moment ou l'avis de clémence peut être adopté par le conseil ou quant à sa portée. C'est pourquoi votre Rapporteur a présenté un amendement proposant une réécriture globale de ce paragraphe, afin de définir plus précisément le déroulement de cette procédure, notamment : - les comportements qui peuvent justifier la clémence du Conseil de la concurrence : la révélation d'une des actions définies à l'article 7, la fin de sa participation à celle-ci et la contribution à l'établissement de la réalité de la pratique anticoncurrentielle ; - le contenu de l'avis de clémence : étendue des engagements de la personne qui en bénéficie et nature et montant des sanctions qui lui seront infligées lorsque le conseil statuera en application du I; - ses modalités d'adoption par le conseil après que le commissaire du Gouvernement et la personne concernée aient présenté leurs observations, sa transmission à cette dernière et au ministre et sa non publication ; - les conditions de sa mise en _uvre lorsque les engagements pris ont été tenus : l'avis de clémence est intégré à la décision finale prise par le conseil - et donc publié en maintenant qu'elle - et les sanctions prévues sont alors prononcées ; - les conditions dans lesquelles il peut être retiré ou modifié à tout moment et à la demande du rapporteur général ou du ministre chargé de l'économie ; le conseil prend sa décision après que le commissaire du Gouvernement et la personne concernée aient présenté leurs observations ; la décision du conseil est transmise à cette dernière et au ministre et elle n'est pas publiée. * * * Votre Commission a rejeté deux amendements identiques de MM. Philippe Auberger et Gilbert Gantier, fixant le plafond des sanctions pécuniaires par référence au chiffre d'affaires réalisé sur le marché sur lequel les pratiques sanctionnées ont été mises en _uvre, ainsi que deux amendements identiques des mêmes auteurs, précisant que le plafond des sanctions était augmenté lorsque l'intention frauduleuse des auteurs des pratiques anticoncurrentielles était établie. Elle a ensuite adopté deux amendements de votre Rapporteur, le premier (n° 168) évitant que le Conseil de la concurrence ait le choix entre un trop grand nombre de chiffres d'affaires de référence pour déterminer le plafond des sanctions qu'il prononce, le second (n° 169) rétablissant la possibilité pour le conseil d'ordonner l'affichage, la diffusion ou l'insertion de sa décision dans les rapports établis par les gestionnaires de l'entreprise. Elle a adopté un amendement (n° 170) de votre Rapporteur précisant les conditions de mise en _uvre de la procédure suivie lorsqu'une entreprise ne conteste pas la réalité des faits faisant l'objet de la saisine du Conseil de la concurrence, l'amendement n° 118 de la commission de la Production et des échanges devenant alors sans objet. Après avoir rejeté un amendement de M. Gilbert Gantier supprimant la procédure de clémence, votre Commission a adopté un amendement (n° 171) de votre Rapporteur déterminant plus précisément le déroulement de cette procédure. L'amendement n° 119 de la commission de la Production et des échanges est alors devenu sans objet, ainsi que deux amendements identiques de MM. Philippe Auberger et Gilbert Gantier. Elle a ensuite adopté l'article 38 ainsi modifié. Votre Commission a rejeté trois amendements identiques, l'amendement n° 120 de la commission de la Production et deux amendements de MM. Philippe Auberger et de Gilbert Gantier, tirant les conséquences de la jurisprudence récente de la Cour de cassation et supprimant la disposition de l'ordonnance autorisant le rapporteur général et le rapporteur à assister au délibéré du Conseil de la concurrence, après que votre Rapporteur eut fait observer que leur présence ne posait pas de problème lorsque le Conseil de la concurrence siégeait en tant qu'autorité consultative. Article additionnel après l'article 38 Absence du rapporteur général au délibéré du Conseil de la concurrence Votre Commission a adopté l'amendement (n° 172) de votre Rapporteur supprimant la présence du rapporteur général au délibéré uniquement dans le cas où celui-ci se prononçait pour sanctionner des pratiques anticoncurrentielles. * * * (Article 19 de l'ordonnance du 1er décembre 1986) Conditions de recevabilité des saisines Dans sa rédaction actuelle, l'ordonnance n'aborde que les conditions de recevabilité des saisines du Conseil de la concurrence. Avec la nouvelle rédaction proposée, son article 19 traitera des conditions dans lesquelles le Conseil de la concurrence peut déclarer une saisine irrecevable (premier alinéa) ou la rejeter (deuxième alinéa) ou prendre acte d'un désistement (dernier alinéa). 1) S'inspirant des hypothèses juridiques classiques d'irrecevabilité, le premier alinéa de l'article 19 prévoira désormais trois cas d'irrecevabilité des saisines du Conseil de la concurrence : le défaut d'intérêt ou de qualité pour agir, la prescription, et lorsque les faits invoqués n'entrent pas dans le champ de compétence du conseil (c'est-à-dire s'ils ne constituent pas des pratiques anticoncurrentielles au sens des articles 7 et 8 de l'ordonnance). Les conséquences pratiques d'une telle clarification apparaissent limitées, puisque le dernier cas est déjà expressément mentionné dans l'actuel article 19 et que les deux autres, même non évoqués par l'ordonnance, sont d'ores et déjà, au vu de la jurisprudence du conseil, constitutifs d'une cause de rejet de la saisine ou de non-lieu à poursuivre la procédure. S'agissant du défaut d'intérêt ou de qualité pour agir, il convient de constater que le Conseil de la concurrence vérifie déjà si le requérant a été dûment mandaté par les entreprises ou les organismes au nom desquels il agit. A cet égard, il examine s'il dispose de la qualité pour agir et justifie s'il intervient pour la défense des intérêts dont il a la charge. Cela concerne plus particulièrement les plaintes déposées par un organisme, plaintes qui doivent viser des pratiques susceptibles de causer un préjudice à leurs ressortissants ou à leurs adhérents. En revanche, en ce qui concerne la plainte déposée par une entreprise, le Conseil de la concurrence a jugé, dans une décision de 1994, qu'aucun texte législatif ou réglementaire ne lui permet de déclarer une saisine irrecevable au motif que le requérant n'établit pas que les pratiques dénoncées lui ont causé un préjudice. Concernant la prescription, l'article 27 de l'ordonnance stipule que « le conseil ne peut être saisi de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction ». Le Conseil de la concurrence fait naturellement application de ces dispositions et la prescription constitue l'une des motivations des décisions de non-lieu à poursuivre la procédure. 2) Dans la rédaction actuelle de l'article 19 de l'ordonnance, la circonstance que les faits invoqués « ne sont pas appuyés d'éléments suffisamment probants » constitue un motif d'irrecevabilité de la saisine du Conseil de la concurrence. La nouvelle rédaction du deuxième alinéa conserve cette exigence, mais en fait un motif de rejet de la saisine. Il convient de noter que cette exigence pourrait constituer un obstacle majeur pour les entreprises ou organismes saisissant le conseil, d'autant plus que celui-ci avait estimé, en 1988, que « de simples allégations ne sauraient être considérées comme des éléments suffisamment probants ». Cependant, retenant un raisonnement analogue à celui utilisé en matière de recevabilité des constitutions de partie civile en matière pénale, la cour d'appel de Paris a fait de cette exigence une interprétation large en jugeant, dans un arrêt de 1987, que pour que la saisine soit déclarée recevable, il suffit que son auteur produise « des éléments propres à établir la réalité ou, à tout le moins la vraisemblance des pratiques anticoncurrentielles alléguées ». 3) Enfin, le dernier alinéa de la nouvelle rédaction de l'article 19 de l'ordonnance précise les conséquences des désistements. Au cours de l'instruction, il peut arriver que l'auteur de la saisine signifie au conseil son désir de la retirer. A l'heure actuelle, aucune disposition législative ou réglementaire ne précise les conséquences d'un tel retrait. Dans les faits, c'est la commission permanente qui examine les désistements et décide alors du classement sans suite du dossier, à moins que le conseil ne décide de poursuivre la procédure, utilisant alors le pouvoir de se saisir d'office qui lui est reconnu par l'article 11 de l'ordonnance. En effet, le conseil estime qu'il est saisi du fonctionnement même d'un marché et non pas d'un litige entre des parties et que sa mission a pour finalité de défendre un ordre public économique : dès lors, il n'est lié ni par les demandes ni par les conclusions qui lui sont présentées. Cette position a été approuvée par la jurisprudence de la cour d'appel de Paris. Le projet de loi propose de confier au seul président du conseil, ou un président délégué par lui, le soin de donner acte des désistements. Cette simplification vise à désencombrer la charge de la commission permanente et permettra ainsi d'accélérer le traitement de ces dossiers. Cependant, il convient de préciser que cette nouvelle disposition ne doit pas être interprétée comme remettant en cause la « jurisprudence » du Conseil de la concurrence, selon laquelle un désistement ne met pas obligatoirement fin à la procédure si le conseil estime devoir s'auto-saisir. * * * Votre Commission a adopté l'article 39 sans modification. * * * (Article 20 de l'ordonnance du 1er décembre 1986) Non-lieu et classement sans suite Le présent article prévoit des cas dans lesquels le Conseil de la concurrence peut prononcer une clôture de l'instruction. Dans sa rédaction actuelle, celui-ci autorise le Conseil de la concurrence à décider « qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la procédure ». Hormis des précisions procédurales (l'auteur de la saisine et le commissaire du Gouvernement doivent avoir été mis à même de consulter le dossier et de faire valoir leurs observations), l'ordonnance est muette sur les motivations qui peuvent conduire le conseil à prendre une telle décision. Dans la pratique, le Conseil de la concurrence décide qu'il n'y a pas lieu à poursuivre la procédure essentiellement dans trois cas : les faits dont il est saisi ne révèlent pas l'existence de pratiques prohibées par l'ordonnance, il ne reste plus au dossier aucun élément permettant d'établir les pratiques dénoncées (notamment lorsque l'ordonnance autorisant une visite et une saisie a été cassée et annulée) ou les faits concernés sont prescrits. Comme l'article 39 du présent projet a distingué les cas d'irrecevabilité ou de rejet des saisines, le présent article clarifie les cas pour lesquels le Conseil de la concurrence peut prononcer le non-lieu à poursuivre la procédure ou procéder à un classement sans suite. Il s'agit de donner à ces deux procédures distinctes leur signification naturelle, telles qu'elles peuvent exister notamment en matière pénale. La nouvelle rédaction de l'article 20 de l'ordonnance précise que le non-lieu à poursuivre la procédure pourra être décidé « lorsqu'aucune pratique de nature à porter atteinte à la concurrence sur le marché n'est établie ». Comme il l'a été indiqué ci-dessus, le Conseil de la concurrence utilise déjà ce critère pour mettre fin à la procédure. En revanche, les deux autres critères retenus actuellement ont été traités à l'article 39 du projet de loi : l'absence d'éléments probants permettant d'établir les pratiques dénoncées est devenu un motif de rejet de la saisine (deuxième alinéa de la nouvelle rédaction de l'article 19 de l'ordonnance) et la prescription des faits un motif d'irrecevabilité de la saisine (premier alinéa de cette nouvelle rédaction). Par ailleurs, la nouvelle rédaction de l'article 20 de l'ordonnance maintient les règles procédurales actuelles : l'auteur de la saisine et le commissaire du Gouvernement doivent avoir été mis à même de consulter le dossier et de faire valoir leurs observations. Le dernier alinéa du nouvel article 20 de l'ordonnance met en place une procédure de classement sans suite des saisines du Conseil de la concurrence. L'objectif de cette procédure nouvelle est de permettre au conseil de traiter et de rejeter rapidement les affaires qu'il juge sans conséquence réelle et importante sur la concurrence. La décision de classement sans suite incombe au conseil, sous réserve du respect d'une condition de délai, du principe du contradictoire de la procédure et d'une condition de fond relative aux pratiques dénoncées : _ le conseil ne peut prendre une telle décision que dans un délai de six mois à compter de l'enregistrement de la saisine ; par cette limitation apportée au classement sans suite, le projet de loi vise à éviter que le conseil ne soit tenté d'utiliser cette possibilité pour liquider rapidement une partie de son stock d'affaires en instance ; _ comme pour la procédure de non-lieu, l'auteur de la saisine et le commissaire du Gouvernement doivent avoir été mis à même de consulter le dossier et de faire valoir leurs observations ; _ pour classer sans suite, le conseil doit établir, par « décision motivée » que « l'effet ou l'effet potentiel des pratiques en cause ne porte pas une atteinte substantielle à la concurrence sur le marché ». * * * Votre Commission a examiné l'amendement n° 121 de la commission de la Production supprimant la procédure de classement sans suite des dossiers ne présentant pas une atteinte substantielle à la concurrence. Usant de la faculté que l'article 38 du règlement confère à un député qui n'est pas membre de la Commission d'y prendre la parole et précisant que cet amendement avait été adopté à l'unanimité, M. Jean-Yves Le Déaut, Rapporteur pour avis, a indiqué que cette nouvelle procédure pourrait conduire à classer sans suite toutes les saisines concernant des petites entreprises, puisque celles-ci sont de trop petite taille pour que les pratiques anticoncurrentielles dont elles sont victimes soient considérées comme affectant réellement le jeu de la concurrence. De plus, il a estimé que le conseil pourrait être tenté d'utiliser le classement sans suite pour diminuer le stock des dossiers en instance. M. Philippe Auberger a contesté cette suppression, jugeant au contraire que le classement sans suite permettrait de remédier à la durée trop longue des procédures devant le Conseil de la concurrence. Partageant cet avis, Mme Nicole Bricq a suggéré que les moyens du conseil soient également renforcés pour remédier à son engorgement. Votre Rapporteur s'est déclaré favorable à cet amendement, même s'il s'est interrogé sur la possibilité de mettre au point, d'ici l'examen en séance publique, une nouvelle rédaction de cette disposition répondant aux objections des auteurs de l'amendement mais permettant de conserver une procédure, au demeurant très utile, de classement sans suite. Votre Commission a alors adopté l'amendement n° 121, et l'article 40 ainsi modifié. * * * Votre Commission a rejeté les amendements n° 58 de M. Jean-Paul Charié et n° 122 de la commission de la Production prévoyant que le Conseil de la concurrence est compétent pour appliquer les règles de la concurrence lorsque les pratiques en cause revêtent la forme d'un acte ou d'un contrat administratif. * * * (Article 47 de l'ordonnance du 1er décembre 1986) Pouvoirs des enquêteurs lors des enquêtes simples Cet article facilite la communication de documents lors des enquêtes simples, auxquelles les enquêteurs ont le droit de procéder d'eux-mêmes et sans autorisation judiciaire. Ces enquêtes se distinguent des opérations définies à l'article 48 de l'ordonnance, perquisitions et saisies, qui s'effectuent au contraire sous le contrôle du juge. En vertu de l'article 47, les enquêteurs peuvent donc « accéder à tous locaux, terrains ou moyens de transport à usage professionnel, demander la communication des livres, factures et tous autres documents professionnels et en prendre copie, recueillir sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications ». Le projet de loi n'apporte qu'une modification mineure à ces dispositions, de nature néanmoins à faciliter la tâche des enquêteurs : ceux-ci pourront « obtenir ou prendre copie par tous moyens et sur tous supports » des documents professionnels dont ils peuvent demander communication, et non plus seulement en « prendre copie ». Cette modification est de nature à faciliter le travail des enquêteurs ; d'une part en ne les astreignant plus à faire eux-mêmes le travail de copie d'une part, et à dépasser le recours à la seule photocopieuse pour utiliser l'ensemble des nouveaux supports informatiques d'autre part. * * * Votre Commission a adopté l'article 41 sans modification. * * * (Article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986) Le présent article apporte six compléments à l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, qui réglemente les visites ou perquisitions, ainsi que les saisies de documents auxquelles peuvent procéder les enquêteurs, à condition d'y avoir été autorisés par le juge. Il s'agit d'accroître l'efficacité de telles opérations et de renforcer leur sécurité juridique. Le paragraphe I étend la possibilité de saisie, aujourd'hui limitée aux seuls documents sur papier, à « tout support d'information », formule qui vise évidemment l'ensemble des supports informatiques (disquettes, disques durs,...). Cette adjonction permettra aux enquêteurs de pallier la raréfaction relative du support papier dans le monde des affaires ou du commerce. Le paragraphe II propose une nouvelle rédaction du deuxième alinéa de l'article 48 relatif aux éléments d'information au vu desquels le juge peut autoriser la visite et la saisie. Dans sa rédaction actuelle, les exigences de l'article 48 sont succinctes : « le juge doit vérifier que la demande d'autorisation qui lui est soumise est fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information de nature à justifier la visite ». La jurisprudence est abondante en cette matière. Toute la difficulté consiste à concilier l'exigence d'un contrôle du caractère fondé de la demande et l'objet même des visites et saisies, qui est précisément d'apporter la preuve des pratiques anticoncurrentielles. La première modification apportée à la rédaction actuelle de l'article 48 consiste à préciser que la demande doit comporter tous les éléments d'information « en possession du demandeur ». Cette formulation est d'ailleurs fréquente dans les nombreux textes analogues relatifs aux visites et saisies (cf. article L. 16 B du livre des procédures fiscales). Le juge devra donc fonder sa décision sur les seuls éléments que le demandeur possède, et non pas lui en demander d'autres, qu'il serait dans l'incapacité de fournir. La deuxième modification vise les cas de flagrant délit, lorsque l'administration ne dispose que de présomptions ou d'indices et que la visite a justement pour but de recueillir des éléments de preuve. Dans ce cas, « lorsque la visite vise à permettre la constatation d'infraction aux dispositions de la présente ordonnance, en train de se commettre », le juge se fonde sur une « demande d'autorisation (qui) peut ne comporter que les indices permettant de présumer, en l'espèce, l'existence des pratiques dont la preuve est recherchée ». Le paragraphe III insère, après le quatrième alinéa, un alinéa précisant la procédure de notification de l'ordonnance du juge autorisant la visite. La rédaction proposée est intégralement calquée sur celle de l'article L.16 B du livre des procédures fiscales relatif aux visites et saisies effectuées par l'administration fiscale : « L'ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée après la visite, par lettre recommandée avec avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis. » Ces précisions permettent de donner une date certaine à cette notification qui constitue, comme on le verra ci-dessous, le point de départ du délai de recours ouvert à l'occupant des lieux pour contester la légalité de l'ordonnance ou le déroulement des opérations. En vertu du sixième alinéa de l'article 48, la présence de l'occupant des lieux ou de son représentant est une condition de validité de la visite et de la saisie. Si celui-ci est introuvable, la possibilité d'appliquer les dispositions de l'article 96 du code de procédure pénale (réquisition de deux témoins) est discutable en raison du silence de l'ordonnance du 1er décembre 1986. C'est pourquoi le paragraphe IV introduit dans l'ordonnance des dispositions de cette nature. Il précise donc qu'« en cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire [qui assiste à l'opération] requiert deux témoins en dehors des personnes relevant de (l')autorité [de l'occupant des lieux] ou de celle de l'administration de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ». Une rédaction analogue figure à l'article L.16B du livre des procédures fiscales. La référence à la seule DGCCRF apparaît trop restrictive car l'article 48 de l'ordonnance est de portée générale et concerne les visites et saisies qui pourraient être effectuées par un rapporteur du Conseil de la concurrence. Il conviendrait donc de prévoir que les témoins ne peuvent être également choisis parmi les personnes qui relèvent de l'autorité du conseil. Le paragraphe V précise la procédure de restitution des pièces et documents saisis. Dans sa rédaction actuelle, le dernier alinéa de l'article 48 de l'ordonnance est pour le moins laconique, puisqu'il se borne à indiquer que « les pièces et documents qui ne sont plus utiles à la manifestation de la vérité sont restitués à l'occupant des lieux ». Le dispositif proposé pose le principe de la restitution des pièces dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la décision du Conseil de la concurrence est devenue définitive. Dans ce cadre, l'occupant des lieux est mis en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, de venir les chercher dans un délai de deux mois. A l'expiration de ce délai, les pièces lui sont restituées à ses frais. Ce dispositif devrait permettre de régler le problème pour l'avenir. S'agissant des procédures très anciennes, le Conseil de la concurrence risque d'être confronté à l'impossibilité de retrouver, pour leur adresser la mise en demeure prévue, les propriétaires des documents. En effet, les entreprises concernées ont pu disparaître ou être reprises, totalement ou partiellement, par d'autres. C'est pourquoi, il serait souhaitable de mettre en place une disposition transitoire permettant au conseil, après avoir fait publier la liste des dossiers relatifs aux procédures les plus anciennes, de procéder à la destruction des pièces non réclamées. Le paragraphe VI complète l'article 48 afin de déterminer les conditions dans lesquelles un recours peut être formé contre le déroulement des opérations de visite et de saisie. Cette question n'est pas traitée par l'ordonnance du 1er décembre 1986, si bien que la Cour de cassation a élaboré un dispositif jurisprudentiel à partir d'un raisonnement fondé sur la disposition de l'article 48 selon laquelle « la visite et la saisie s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées ». La cour a considéré que les pouvoirs du juge qui a autorisé l'opération s'étendent également à la constatation d'éventuelles irrégularités dans son déroulement si bien que toute personne intéressée peut contester la régularité des opérations de visite et de saisies, au moyen d'une requête devant le juge qui les a autorisées. Alors que certains présidents de tribunaux de grande instance avaient fixé un délai pour la présentation de telles requêtes, la Cour de cassation a jugé qu'une telle initiative excédait leur pouvoir : dès lors, en l'absence de tout délai de recours, il n'était pas rare de voir certaines entreprises engager des recours plusieurs années après le déroulement de la visite, voire après l'intervention du jugement et leur condamnation. Par un arrêt du 30 novembre 1999, la Cour de cassation a rompu avec cette jurisprudence ancienne. Elle a, en effet, estimé que la mission de contrôle du juge « prend fin avec les opérations, lors de la remise de la copie du procès-verbal et de l'inventaire à l'occupant des lieux ou à son représentant et qu'il ne peut être saisi a posteriori d'une éventuelle irrégularité entachant ces opérations ». Dès lors, toute contestation devra être portée, selon la cour, devant « les autorités de décisions appelées à statuer sur les poursuites éventuellement engagées sur le fondement des documents ainsi appréhendés ». Selon les cas, ces « autorités de décisions » sont les juridictions pénales, les juridictions civiles ou le Conseil de la concurrence. S'agissant de ce dernier, il peut sembler étonnant que la Cour de cassation confie à une autorité administrative indépendante le soin de vérifier si les opérations se sont bien déroulées telles que le président du tribunal les a autorisées. Le paragraphe VI entend donc revenir sur ce revirement de jurisprudence de la part de la Cour de cassation et régler définitivement les problèmes découlant de l'absence de délai de recours dans la jurisprudence antérieure. Il redonne donc la compétence au juge qui a autorisé la visite et enserre tout recours dans un délai de deux mois. La computation du délai de recours varie selon l'identité du requérant : - si celui-ci est l'occupant des lieux visités, le délai de deux mois court à compter de la notification de l'ordonnance qui a autorisée l'opération (cf. ci-dessus paragraphe III) ; - si le requérant est une personne mise en cause ultérieurement au moyen des pièces saisies au cours des opérations, le délai de deux mois court « à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de l'existence de ces opérations et au plus tard à compter de la notification des griefs prévue à l'article 21 ». Le projet de loi précise en outre que « le juge se prononce sur ce recours par voie d'une ordonnance, qui n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues au code de procédure pénale » et que ce pourvoi n'est pas suspensif. * * * Après avoir rejeté un amendement de M. Gilbert Gantier supprimant la disposition selon laquelle le juge pourrait se contenter d'indices pour autoriser une visite, votre Commission a adopté un amendement de précision (n° 173) présenté par votre Rapporteur. Elle a ensuite adopté l'article 42 ainsi modifié. * * * Article additionnel après l'article 42 Restitution des pièces relatives à des procédures anciennes Votre Commission a adopté un amendement (n° 174 rectifié) de votre Rapporteur instituant une disposition transitoire pour permettre au Conseil de la concurrence de restituer, ou de détruire si elles ne sont pas réclamées, les pièces des dossiers relatifs à des procédures ayant fait l'objet d'une décision devenue définitive avant le 1er janvier 1997. * * * (Article 50 de l'ordonnance du 1er décembre 1986) Mise à disposition de fonctionnaires affectés L'article 50 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 autorise le président du Conseil de la concurrence à faire appel aux fonctionnaires habilités par le ministre chargé de l'économie pour procéder à toute enquête que le rapporteur saisi du dossier juge utile. C'est donc au coup par coup que les agents de la DGCCRF sont appelés à mener des enquêtes à la demande du conseil et de ses rapporteurs. Si ceux-ci disposent des mêmes pouvoirs d'enquête que les agents de la DGCCRF, il est extrêmement rare qu'ils procèdent eux-mêmes aux enquêtes. Le Conseil de la concurrence ne dispose donc pas d'un corps d'inspecteurs permanents, mais seulement de rapporteurs permanents affectés (un rapporteur général, un rapporteur général adjoint et 38 rapporteurs permanents) et environ une dizaine de rapporteurs extérieurs nommés sur un dossier particulier. Seuls 16 emplois de rapporteurs sont ouverts en loi de finances, les autres rapporteurs étant essentiellement des fonctionnaires mis à disposition du conseil par la DGCCRF. Le conseil juge cette situation peu satisfaisante et il souhaiterait disposer d'enquêteurs qui seraient mis à sa disposition pour une période plus longue, afin de mener des enquêtes qui ne seraient pas définies à l'avance. Si l'on mesure l'intérêt d'une telle mesure, il convient de ne pas perdre de vue que les moyens d'enquête de la DGCCRF sont, eux aussi, limités. Ceux-ci sont répartis entre deux directions nationales d'enquête spécialisées (en matière de concurrence et de répression des fraudes) et de 7 brigades interrégionales d'enquête. C'est pourquoi le présent article complète l'article 50 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et renvoie à un décret le soin de préciser « les conditions dans lesquelles, à la demande motivée du président du Conseil de la concurrence, l'autorité [administrative] met, pour une durée déterminée, à disposition du rapporteur général du Conseil de la concurrence, des enquêteurs pour effectuer certaines enquêtes, conformément aux orientations définies par les rapporteurs ». Plus que la mise en place d'un corps particulier d'inspecteurs, il conviendrait que le Conseil de la concurrence puisse recouvrer une plus grande liberté de recrutement en termes de profil de ses rapporteurs. Le droit de la concurrence réclame désormais, en effet, de plus en plus de compétences en économie, en comptabilité ou de caractère plus technique, qu'il est difficile de trouver dans l'administration. * * * Votre Commission a adopté l'article 43 sans modification. * * * (Article 45-1 (nouveau) de l'ordonnance du 1er décembre 1986) Compétence territoriale des fonctionnaires habilités à effectuer des visites Cet article étend à l'ensemble du territoire national la capacité d'intervention des enquêteurs. En vertu de l'ordonnance du 1er décembre 1986, les enquêtes administratives sont diligentées par des « fonctionnaires habilités à cet effet par le ministre chargé de l'économie ». L'arrêté du ministre de l'économie et des finances du 22 janvier 1993 précise qu'il s'agit de fonctionnaires de catégories A et B placés sous l'autorité du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Cependant, l'arrêté précise que seuls les fonctionnaires de catégorie A sont habilités à procéder aux visites et saisies autorisées par ordonnance du président du tribunal de grande instance en application de l'article 48 de l'ordonnance. S'agissant des limites territoriales de la compétence de ces agents, l'article 5 de l'arrêté précise, en outre, que ces fonctionnaires « agissent soit dans l'ensemble du département où ils exercent leurs fonctions, soit, lorsqu'il est plus étendu, dans le ressort territorial de service auquel ils sont affectés ». Dès lors, ils ne peuvent exercer leurs pouvoirs d'enquête hors de ces limites. C'est ce qu'a jugé la Cour de cassation dans un arrêt du 10 décembre 1998, dans lequel elle a considéré « qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 28 du code de procédure pénale, de l'article 45 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et de l'arrêté du 22 janvier 1993 relatif à l'habilitation de fonctionnaires de la DGCCRF que les agents de cette dernière sont répartis dans des services ayant des compétences territoriales et ne peuvent licitement intervenir sur la base des pouvoirs qui leur sont confiés que dans le ressort territorial qui relève de la compétence du chef de service responsable de l'enquête ; qu'ils ne peuvent effectuer des actes d'enquête que dans ce ressort territorial ; qu'en demandant la communication de documents à des sociétés ayant leur siège social en dehors de l'Ille-et-Vilaine et du Finistère, leur ressort territorial, en l'espèce, dans les départements de la Marne, du Vaucluse et de l'Essonne, les agents des directions départementales de la DGCCRF ont violé les règles de compétence les régissant, les dispositions de l'article 47 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ne leur donnant des pouvoirs que dans leur ressort territorial ». C'est pourquoi le paragraphe I du présent article insère un article additionnel dans l'ordonnance, numéroté 45-1, qui précise que les fonctionnaires habilités en application du premier alinéa de l'article 45 de l'ordonnance « peuvent exercer les pouvoirs d'enquête qu'ils tiennent des articles 45 et suivants sur toute l'étendue du territoire national ». De même, le paragraphe II procède à la même précision, en insérant un nouvel article 215-1-1 dans le code de la consommation autorisant les agents de la DGCCRF à exercer les pouvoirs d'enquête qu'ils tiennent du livre II de ce code sur toute l'étendue du territoire national. * * * Votre Commission a adopté l'article 44 sans modification. * * * (Article 26-1 (nouveau) de l'ordonnance du 1er décembre 1986) Spécialisation des tribunaux en matière de litiges relatifs Le présent article introduit une disposition autorisant une spécialisation des tribunaux en matière de contentieux lié aux pratiques anticoncurrentielles. Le rôle des tribunaux dans le contrôle des pratiques restrictives et anticoncurrentielles est, en effet, important. C'est ainsi que les pratiques restrictives décrites par le titre IV de l'ordonnance relèvent de leur compétence exclusive, juge civil ou juge pénal selon qu'elles sont passibles de sanctions civiles ou de sanctions pénales. S'agissant des pratiques anticoncurrentielles définies par le titre III de l'ordonnance, la compétence du Conseil de la concurrence n'a pas fait disparaître celle des tribunaux. Depuis la mise en place de la législation sur les ententes, le juge civil, c'est-à-dire le plus souvent le tribunal de commerce, a toujours été compétent pour statuer sur des litiges nés de pratiques anticoncurrentielles. En application de l'article 9 de l'ordonnance, il constate la nullité des contrats ou de leurs clauses contraires aux dispositions du titre III. De même, il intervient lorsqu'il s'agit d'obtenir des dommages-intérêts de la part des entreprises coupables en réparation du préjudice subi. En revanche, depuis la dépénalisation des pratiques anticoncurrentielles, les poursuites pénales en cette matière ne peuvent plus intervenir que de manière marginale. Les poursuites sont alors fondées sur l'article 17 de l'ordonnance, qui punit toute personne physique « qui, frauduleusement, aura pris une part personnelle et déterminante dans la conception, l'organisation ou la mise en _uvre » de telles pratiques. Le présent article renvoie à un décret le soin d'établir la liste des tribunaux de commerce et des tribunaux de grande instance à qui seront exclusivement attribués les litiges relatifs aux pratiques anticoncurrentielles définies au titre III de l'ordonnance. En matière économique et financière, la spécialisation des tribunaux est relativement fréquente dans le domaine du droit pénal. Ainsi, l'article 704 du code de procédure pénale, introduit par une loi du 1er février 1994, prévoit la compétence d'un ou plusieurs tribunaux de grande instance dans le ressort de chaque cour d'appel pour « la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement » d'un certain nombre d'infractions dans « les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité ». Parmi la longue énumération de ces délits, on note ceux prévus par la loi de 1966 sur les sociétés commerciales, par la loi de 1985 relative au redressement judiciaire, par le code de la propriété intellectuelle, par le code des douanes, par le code de la consommation et par l'ordonnance du 1er décembre 1986... En matière civile, les seuls exemples de spécialisation des tribunaux de grande instance figurent aux articles L. 615-17 et L. 623-31 du code de la propriété intellectuelle, relatifs respectivement aux actions en matière de brevets et aux actions civiles en matière d'obtentions végétales. * * * La Commission a adopté l'article 45, sans modification. * * * (Article 53-1 (nouveau) de l'ordonnance du 1er décembre 1986) Coopération entre le Conseil de la concurrence et les autorités de la concurrence étrangères Le présent article autorise le Conseil de la concurrence à nouer des liens de coopération avec les autorités de la concurrence étrangères. La mise en place de telles procédures de coopération internationale est rendue d'autant plus nécessaire que l'on admet que les lois de la concurrence obéissent au principe de l'extra-territorialité. En effet, les principaux systèmes juridiques se réclament de la doctrine dite de l'effet : à partir du moment où une pratique a - ou peut avoir - un effet anticoncurrentiel sur le territoire d'un État, la loi de celui-ci est applicable quelles que soient la nationalité ou l'implantation des entreprises mises en cause. La rédaction retenue pour le nouvel article 53-1 s'inspire étroitement de la rédaction de l'article homologue de l'ordonnance du 28 septembre 1967 en ce qui concerne la Commission des opérations de bourse : - le premier alinéa organise l'échange d'informations et de documents entre autorités de la concurrence (y compris la Commission européenne), sous réserve de réciprocité et à condition que ces autorités soient soumises aux mêmes obligations en matière de secret professionnel ; - le deuxième alinéa permet la réalisation d'enquêtes par le Conseil de la concurrence ou le ministre chargé de l'économie à la demande des autorités homologues étrangères, sous réserve également de réciprocité ; - le troisième alinéa précise que l'obligation du secret professionnel ne fait pas obstacle à cette coopération ; - le dernier alinéa autorise le Conseil de la concurrence à refuser son assistance « lorsque l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, aux intérêts économiques essentiels ou à l'ordre public français ou lorsqu'une procédure pénale a déjà été engagée en France sur la base des même faits et contre les mêmes personnes, ou bien lorsque celles-ci ont déjà été sanctionnées par une décision définitive pour les mêmes faits ». Le nouvel article 53-1 diffère des dispositions relatives à la COB sur deux points. D'une part, il est précisé que cette coopération du Conseil de la concurrence avec ses homologues étrangères est limitée aux compétences du conseil et que le ministre chargé de l'économie est informé au préalable chaque fois qu'elle est mise en _uvre. Cette disposition s'explique par le fait que, dans le droit français de la concurrence, il existe deux autorités en matière de concurrence : le ministre de l'Économie et le Conseil de la concurrence. D'autre part, la disposition permettant à la COB de conclure des conventions organisant ses relations avec les autorités étrangères homologues n'a pas été reprise. * * * Votre Commission a examiné trois amendements identiques, l'amendement (n° 123) de la commission de la Production et ceux de MM. Philippe Auberger et Gilbert Gantier, précisant que les entreprises concernées doivent être informées de la nature des informations et documents transmis à ses homologues étrangers par le Conseil de la concurrence. Après avoir estimé que ces amendements risquaient de perturber la nécessaire coopération entre autorités de la concurrence, votre Rapporteur s'est rangé aux arguments de MM. Jean-Yves Le Déaut et Philippe Auberger soulignant qu'il s'agissait d'instituer une simple procédure d'information. Votre Commission a alors adopté les trois amendements. Deux amendements identiques de MM. Philippe Auberger et Gilbert Gantier instituant un mécanisme de recours à l'encontre d'une décision de transmission de documents, ont été retirés. A été rejeté un amendement de M. Gilbert Gantier prévoyant que les documents transmis ne pourraient être utilisés dans le cadre d'une procédure fiscale ou pénale. Votre Commission a adopté un amendement (n° 175) de votre Rapporteur autorisant le Conseil de la concurrence à conclure des conventions avec ses homologues étrangers pour organiser leur coopération. Elle a ensuite adopté l'article 46, ainsi modifié. * * * Article 47 (Article 56 bis de l'ordonnance du 1er décembre 1986) Pouvoirs d'enquête de l'administration en droit communautaire L'article 15 du règlement CEE du 6 février 1962 confère à la Commission européenne un certain nombre de pouvoirs pour mener à bien ses investigations. Cet article précise notamment que « les agents de l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel la vérification doit être effectuée peuvent, sur la demande de cette autorité ou sur celle de la Commission, prêter assistance aux agents de la Commission dans l'accomplissement de leurs tâches » et que « lorsqu'une entreprise s'oppose à une vérification (...), l'État membre intéressé prête aux agents mandatés par la Commission l'assistance nécessaire pour leur permettre d'exécuter leur mission de vérification ». Sous l'empire de l'ordonnance du 1er décembre 1986, ce n'est que la loi du 11 décembre 1992 relative aux procédures de passation de certains contrats qui a inséré l'article 56 bis dans l'ordonnance, mettant en _uvre cette obligation d'assistance. Cet article précise que, pour l'application des articles 85 à 87 du traité de Rome, le ministre chargé de l'économie et les fonctionnaires qu'il a désignés ou habilités et le Conseil de la concurrence disposent des pouvoirs qui leur sont reconnus par l'ordonnance. Le paragraphe I du présent article se borne à tirer les conséquences de l'entrée en vigueur, le 1er mai 1999, du traité d'Amsterdam qui a procédé à une renumérotation des articles du traité instituant la Communauté européenne. Ainsi, les articles 85 à 87 sont devenus les articles 81 à 83. Rappelons brièvement que l'article 81 interdit « tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun » et l'article 82 « le fait pour une ou plusieurs entreprises d'exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché commun ou dans une partie substantielle de celui-ci ». L'article 83, pour sa part, prévoit l'établissement des règlements ou directives d'application des deux précédents. Application respective du droit communautaire et du droit national en matière de pratiques anticoncurrentielles Les relations entre le droit communautaire et le droit national obéissent aux trois principes suivants : l'applicabilité directe du droit communautaire, l'applicabilité cumulative des règles communautaires et des règles internes et la primauté du droit communautaire en cas de conflit. Ainsi donc, une même pratique peut, en principe, faire l'objet de deux procédures parallèles, l'une devant les autorités communautaires, l'autre devant les autorités nationales. Il en résulte la possibilité d'un cumul des sanctions. En 1993, la Commission a publié une communication précisant le rôle dévolu aux juridictions nationales dans l'application des articles 81 et 82 du traité, afin d'améliorer la coopération entre elles. Si elle réaffirme que les juridictions nationales sont en mesure de se prononcer concurremment avec elle, la Commission recommande aux juridictions nationales de surseoir à statuer en attendant l'issue de la procédure entamée, le cas échéant, devant elle. En revanche, s'agissant de la possibilité d'accorder une exemption en vertu du paragraphe 3 de l'article 81, la Commission réaffirme sa compétence exclusive. Elle a également mis en place une procédure d'échange d'informations avec les juridictions nationales. En 1997, la Commission a publié une autre communication relative à sa coopération avec les autorités de la concurrence des États membres pour le traitement des affaires relatives aux pratiques anticoncurrentielles. Elle désire encourager les entreprises à s'adresser davantage aux autorités nationales. Pour effectuer cette répartition des tâches, elle prend en compte plusieurs critères, tels que les effets de la pratique en cause, la nature de l'infraction et l'intérêt communautaire. Lorsque les effets d'une pratique anticoncurrentielle sont limités au territoire d'une seul État membre, la Commission considère que l'autorité nationale de cet État est normalement la mieux placée pour traiter l'affaire. Cependant, les affaires présentant un intérêt particulier pour l'Union (affaires soulevant un problème juridique nouveau, affaires concernant une entreprise publique ou une entreprise bénéficiant de droits spécifiques ou exclusifs) devraient être traitées par la Commission, même si leurs effets sont localisés dans un seul État membre. Lorsque la Commission est saisie la première, elle peut rejeter la plainte lorsqu'elle constate que l'affaire ne présente pas un intérêt communautaire suffisant. Elle peut alors renvoyer le plaignant devant l'autorité de concurrence de l'État membre, à la double condition que le centre de gravité de l'infraction alléguée se situe manifestement dans un seul État membre et que la saisine de l'autorité nationale assure de manière satisfaisante la sauvegarde des droits du plaignant. Lorsque l'autorité nationale a été saisie la première, l'instruction est menée selon la procédure définie par le droit national. La Commission rappelle que l'autorité nationale, quand elle agit dans le champ matériel du droit communautaire, est tenue de respecter celui-ci et a la possibilité, lorsque l'application du droit communautaire soulève des difficultés particulières, de s'adresser à la Commission pour obtenir les informations nécessaires. Le paragraphe II du présent article 47 complète l'article 56 bis de l'ordonnance afin d'étendre les pouvoirs que le ministre chargé de l'économie et les fonctionnaires qu'il a désignés et habilités tiennent de l'ordonnance à l'application des articles 87 et 88 (nouvelle numérotation) du traité instituant la Communauté européenne. L'article 87 pose le principe de l'interdiction des aides d'État, tout en prévoyant un certain nombre d'exemptions. L'article 88 décrit la procédure d'examen des régimes d'aides d'État. L'introduction d'une telle décision dans l'ordonnance du 1er décembre 1986 s'impose en vertu du paragraphe 6 de l'article 12 du règlement CEE n°659/1999 du 22 mars 1999, selon lequel « lorsqu'une entreprise s'oppose à une visite de contrôle ordonnée par une décision de la Commission (...), l'État membre concerné prête aux agents et aux experts mandatés par la Commission l'assistance nécessaire pour leur permettre de remplir leur mission. A cette fin, les États membres prennent, après consultation de la Commission, les mesures nécessaires dans un délai de 18 mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement ». * * * Votre Commission a adopté l'article 47, sans modification. * * * Votre Commission a adopté un amendement (n° 176) de votre Rapporteur supprimant toute ambiguïté quant au caractère non déductible des bénéfices des sanctions pécuniaires infligées en application de l'ordonnance du 1er décembre 1986. * * * Le présent titre, composé des articles 48 à 54, procède à une profonde modification du titre V de l'ordonnance du 1er décembre 1986, intitulé « De la concentration économique », réécrivant intégralement 6 articles sur 7 (seul l'article 43 de l'ordonnance n'est pas modifié par le projet de loi) et insérant trois articles additionnels. Désormais, le titre V de l'ordonnance sera ainsi composé des articles 38 (Définition des opérations de concentration), 39 (Opérations de concentration soumises à contrôle ministériel), 40 (Obligation de notifier une opération de concentration), 41 (Caractère suspensif de la notification), 42 (Examen par le ministre de l'opération notifiée), 42-1 (Procédure devant le Conseil de la concurrence), 42-2 (Décisions des ministres concernés), (Article 38 de l'ordonnance du 1er décembre 1986) Définition des opérations de concentration Le présent article propose une nouvelle définition de l'opération de concentration. A l'heure actuelle, une telle définition figure à l'article 39 de l'ordonnance. Aux termes de celui-ci, « la concentration résulte de toute acte, quelle qu'en soit la forme, qui emporte transfert de propriété ou de jouissance sur tout ou partie des biens, droits et obligations d'une entreprise ou qui a pour objet, ou pour effet, de permettre à une entreprise ou à un groupe d'entreprises d'exercer, directement ou indirectement, sur une ou plusieurs autres entreprises une influence déterminante ». Cette définition, particulièrement extensive, ne posait pas de difficulté particulière dans un système de notification facultative, comme l'est encore aujourd'hui le régime français de contrôle des concentrations. Par contre, elle serait inadaptée au régime de notification obligatoire qu'entend mettre en place le projet de loi. En effet, un tel régime requiert une définition plus précise de l'opération de concentration permettant aux entreprises concernées de connaître, avec le maximum de sécurité juridique, l'étendue de leurs obligations déclaratives. Pour ce faire, le projet de loi n'innove pas. En effet, la définition qu'il propose est exactement celle retenue au niveau communautaire, telle qu'elle figure à l'article 3 du Règlement CEE n° 4064/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises. Cette reprise littérale de la définition communautaire couronne le processus d'unification du droit communautaire et des droits internes, notamment au niveau des concepts de base. Un tel processus est, en effet, indispensable car, à l'inverse de la solution retenue pour les pratiques anticoncurrentielles, le régime communautaire du contrôle des concentrations ne se superpose pas aux contrôles nationaux, mais s'y substitue au moins pour les concentrations de « dimension communautaire ». Cette identité des définitions devrait également permettre d'éviter, à l'avenir, des divergences d'interprétation entre les autorités françaises de la concurrence et la Commission européenne lorsque, par exemple, les unes jugent qu'une opération est une concentration alors que l'autre considère qu'elle est constitutive d'une entente. Aux termes de cette nouvelle définition, une opération est qualifiée de concentration dans trois cas : - « lorsque deux ou plusieurs entreprises antérieurement indépendantes fusionnent », c'est-à-dire lorsque deux ou plusieurs entreprises indépendantes créent une nouvelle entreprise et disparaissent en tant que personnes morales distinctes ou lorsqu'une entreprise est absorbée par une autre et perd ainsi la personnalité morale ; - « lorsqu'une ou plusieurs personnes détenant le contrôle d'une entreprise au moins ou lorsqu'une ou plusieurs entreprises acquièrent, directement ou indirectement, que ce soit par prise de participation au capital ou achat d'éléments d'actifs, contrat ou tout autre moyen, le contrôle de l'ensemble ou de parties d'une ou plusieurs autres entreprises » ; le 3° de l'article explicite la notion de « contrôle », en précisant que celui-ci « découle des droits, contrats ou autres moyens qui confèrent, seuls ou conjointement et compte tenu des circonstances de fait ou de droit, la possibilité d'exercer une influence déterminante sur l'activité d'une entreprise, et notamment : des droits de propriété ou de jouissance sur tout ou partie des biens d'une entreprise ; des droits ou des contrats qui confèrent une influence déterminante sur la composition, les délibérations ou les décisions des organes d'une entreprise » ; - lorsqu'une « entreprise commune accomplissant de manière durable toutes les fonctions d'une entité économique autonome » est créée. Il convient de noter que ce n'est que depuis mars 1998 que la création d'une entreprise commune relève du contrôle communautaire des concentrations, les opérations de ce type étant antérieurement traitées comme des ententes. D'ailleurs, le Conseil de la concurrence a déjà eu l'occasion de faire observer que la création d'une entreprise commune pouvait, selon les cas, être le moyen d'une simple entente entre les entreprises l'ayant constituée ou revêtir le caractère d'une véritable concentration structurelle du marché (si elle assure toutes les fonctions d'une entreprise autonome d'une manière durable et si sa création n'a pas pour objet, ou ne peut avoir pour effet, une coordination sur les marchés pertinents du comportement des sociétés-mères entre elles ou de l'une d'elles avec la filiale commune). Globalement, la nouvelle définition des opérations de concentration recouvre un champ analogue à celui couvert par l'actuelle définition issue de l'ordonnance du 1er décembre 1986. * * * Votre Commission a adopté un amendement rédactionnel (n° 177) de votre Rapporteur, puis l'article 48 ainsi modifié. * * * (Article 39 de l'ordonnance du 1er décembre 1986) Opérations de concentration soumises à contrôle ministériel Le présent article propose une nouvelle rédaction de l'article 39 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, visant à déterminer le caractère contrôlable d'une opération de concentration répondant à la définition posée à l'article précédent. En effet, toutes les opérations de concentration ne seront pas soumises à la nouvelle procédure mise en place par le projet de loi. Pour que cette dernière soit applicable, l'opération doit répondre à des critères de taille relatifs aux entreprises concernées (I) et ne doit pas relever de la compétence de la Commission européenne, telle qu'elle est définie par le Règlement CEE du 21 décembre 1989 précité (II). I.- En vertu du deuxième alinéa du nouvel article 39 de l'ordonnance, les opérations de concentration ne sont soumises à contrôle que si « les entreprises parties à la concentration ou les groupes auxquels ils appartiennent réalisent des chiffres d'affaires au moins égaux à des seuils fixés par décret en Conseil d'État ». D'après les informations recueillies par votre Rapporteur, les seuils envisagés seraient les suivants : _ le chiffre d'affaires total réalisé sur le plan mondial par toutes les entreprises concernées est supérieur à 150 millions d'euros (soit un peu moins d'un milliard de francs), et _ le chiffre d'affaires réalisé individuellement en France par au moins deux des entreprises concernées est supérieur à 15 millions d'euros (soit un peu moins de 100 millions de francs). Selon les prévisions du ministère de l'Économie, ces seuils devraient conduire à rendre contrôlables environ 300 opérations chaque année. Il faut dire que ces seuils sont sensiblement inférieurs à ceux actuellement définis à l'article 38 de l'ordonnance : chiffre d'affaires total réalisé par toutes les entreprises concernées supérieur à 7 milliards de francs et chiffre d'affaires réalisé individuellement par au moins deux des entreprises concernées supérieur à 2 milliards de francs. Il convient de noter que le projet de loi n'appréhende plus l'importance de l'opération de concentration qu'au travers du seul critère du chiffre d'affaires. Or, à l'heure actuelle, l'ordonnance du 1er décembre 1986 retient un second critère alternatif, celui des parts de marché. En effet, son article 38 vise les opérations menées par des entreprises réalisant ensemble « plus de 25 % des ventes, achats ou autres transactions sur un marché national de biens, produits ou services substituables ou sur une partie substantielle d'un tel marché ». La disparition du critère « parts de marché » s'explique par son inadéquation avec un régime de notification obligatoire des opérations de concentration. A l'inverse du chiffre d'affaires aisé à déterminer, la notion de parts de marché apparaît, en effet, beaucoup plus floue et difficile à appréhender, ne serait-ce que lorsqu'il s'agit de déterminer le marché pertinent de référence. Dans ses rapports, le Conseil de la concurrence souligne d'ailleurs pudiquement que cette détermination « a parfois été l'occasion d'un débat ». Ainsi par exemple, dans l'affaire du rachat d'Orangina par Coca-Cola, cette dernière soutenait que le marché pertinent était celui des boissons rafraîchissantes sans alcool, comprenant une gamme très vaste de produits tels que l'eau du robinet, les eaux minérales ou les jus de fruits. Au contraire, le Conseil de la concurrence a procédé à une segmentation plus fine, en prenant en compte d'une part le marché des boissons gazeuses sans alcool, autres que les colas, vendues dans les magasins alimentaires et, d'autre part, celui de ces mêmes boissons vendues dans les cafés, hôtels, restaurants et autres établissements de consommation hors foyer. C'est d'ailleurs l'impossibilité de conserver le critère « parts de marché » qui explique le fort abaissement des seuils. Il s'agit par ce biais de rendre contrôlables certaines opérations sur certains marchés réduits, qui n'en posent pas moins parfois des problèmes en termes de concurrence. On l'a vu, le projet de loi renvoie à un décret en Conseil d'État le soin de déterminer les seuils de chiffre d'affaires. Ce renvoi n'apparaît pas justifié. En effet, ces seuils sont des éléments essentiels de la procédure mise en place puisqu'ils en commandent la mise en _uvre. De plus, il y a quelque paradoxe à voir des dispositions, qu'une ordonnance a placées dans le domaine législatif, renvoyées dans le domaine réglementaire par une loi adoptée par le Parlement. II.- Pour être contrôlable au niveau national, une opération de concentration qui excède les seuils déterminés précédemment doit, en outre, ne pas entrer dans le champ de compétences de la Commission européenne. En effet, en vertu des dispositions des articles 1er et 21 du Règlement CEE du 21 décembre 1989 précité, une opération de concentration de « dimension communautaire » est de la compétence exclusive de la Commission et les États membres n'appliquent pas leur législation nationale sur la concurrence à de telles opérations. L'opération de dimension communautaire est définie à l'article 1er du Règlement CEE. Une telle opération doit dépasser les deux seuils suivants : - le chiffre d'affaires total réalisé sur le plan mondial par toutes les entreprises concernées représente un montant supérieur à 5 milliards d'euros (soit près de 32,8 milliards de francs), - le chiffre d'affaires réalisé individuellement dans l'Union européenne par au moins deux des entreprises concernées représente un montant supérieur à 250 millions d'euros (soit plus de 1,6 milliard de francs). Cependant, l'opération n'a pas la dimension communautaire lorsque, même si les deux montants ci-dessus sont atteints, chacune des entreprises concernées réalise plus des deux tiers de son chiffre d'affaires total dans l'Union à l'intérieur d'un seul et même État membre. Le Règlement CEE a été modifié en 1997 pour étendre la compétence communautaire. Est donc considérée comme ayant également la dimension communautaire, même si les seuils précédents ne sont pas atteints, l'opération pour laquelle : - le chiffre d'affaires total réalisé sur le plan mondial par l'ensemble des entreprises concernées représente un montant supérieur à 2,5 milliards d'euros (soit un peu plus de 16 milliards de francs), - le chiffre d'affaires total réalisé dans au moins trois États membres par l'ensemble des entreprises concernées est supérieur à 100 millions d'euros (soit un peu plus de 650 millions de francs), - le chiffre d'affaires individuellement réalisé dans ces mêmes trois États membres par au moins deux des entreprises concernées dépasse 25 millions d'euros (soit un peu plus de 160 millions de francs), et - le chiffre d'affaires total réalisé individuellement dans l'Union européenne par au moins deux des entreprises concernées dépasse 100 millions d'euros (soit un peu plus de 65 millions de francs) ; sauf si chacune des entreprises concernées réalise plus des deux tiers de son chiffre d'affaires total dans l'Union à l'intérieur d'un seul État membre. L'objet de cette extension est d'éviter aux entreprises d'avoir à multiplier les notifications dans plusieurs États membres selon des procédures et pour des résultats éventuellement différents. Il s'agit donc de renforcer la sécurité juridique des entreprises pour des opérations ayant un impact significatif dans plusieurs États membres en instituant un « guichet unique » et tout en préservant le principe de subsidiarité. Toutefois, l'article 9 du Règlement CEE précité organise une procédure de renvoi du contrôle de l'opération aux autorités nationales. La Commission peut, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, renvoyer à cet État le contrôle, total ou partiel, d'une opération de concentration : - si elle « menace de créer ou de renforcer une position dominante ayant pour conséquence qu'une concurrence effective serait entravée de manière significative dans un marché à l'intérieur de cet État membre qui présente toutes les caractéristiques d'un marché distinct », - ou si elle « affecte la concurrence dans un marché à l'intérieur d'un État membre qui présente toutes les caractéristiques d'un marché distinct et qui ne constitue pas une partie substantielle du marché commun ». Le dernier alinéa du nouvel article 39 de l'ordonnance fait référence à cette possibilité de renvoi et prévoit que la procédure nationale de contrôle est applicable à l'opération renvoyée « dans la limite de ce renvoi ». Depuis l'instauration de cette procédure de renvoi, la France a demandé et obtenu un renvoi total et sept renvois partiels (les deux derniers en date concernant les fusions Totalfina/Elf et Carrefour/Promodès). * * * Votre Commission a adopté un amendement (n° 178) de votre Rapporteur réintroduisant dans la loi la détermination des seuils de déclenchement de la procédure de contrôle des concentrations. Elle a ensuite adopté l'article 49 ainsi modifié. * * * (Article 40 de l'ordonnance du 1er décembre 1986) Obligation de notifier une opération de concentration Dans sa rédaction actuelle, l'article 40 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 traite de la notification d'une opération de concentration et des délais impartis au ministre de l'économie pour interdire l'opération ou l'autoriser sous certaines conditions. Dans la nouvelle rédaction proposée par le présent article, l'article 40 ne sera plus consacré qu'à la notification, devenue obligatoire, de l'opération de concentration. Depuis l'origine du contrôle des concentrations en France, la notification d'une opération a toujours eu un caractère facultatif : les entreprises concernées peuvent la notifier soit lorsqu'elle est encore à l'état de projet, soit dans les trois mois qui suivent le moment où cette opération a acquis un caractère définitif. L'avantage que les entreprises projetant une concentration ou l'ayant déjà réalisée peuvent retirer d'une notification réside dans l'impossibilité dans laquelle se trouve le ministre d'interdire l'opération ou d'ordonner diverses mesures la concernant après l'expiration du délai prévu par l'ordonnance (deux mois, ou six mois en cas de saisine du Conseil de la concurrence). Au contraire, en l'absence de notification, il n'existe aucune limite temporelle ni à l'intervention du ministre s'il se rend compte que l'opération porte atteinte à la concurrence, ni à la durée de la procédure de contrôle éventuellement mise en _uvre. Le projet de loi entend rompre avec le caractère facultatif de la notification, régulièrement qualifié par la doctrine de défaut le plus grave du système français de contrôle des concentrations. Ce faisant, la France rejoint la plupart des principaux pays industrialisés (Allemagne, Belgique, Canada, États-Unis, Italie, Japon, Union européenne). La nouvelle rédaction de l'article 40 de l'ordonnance précise les règles relatives à la notification. Pour ce faire, elle s'inspire également largement du règlement CEE du 21 décembre 1989, et notamment de son article 4. Outre son caractère obligatoire, le premier alinéa précise le moment auquel cette notification doit intervenir, à savoir « lorsque la ou les parties sont engagées de façon irrévocable, et notamment après la conclusion des actes la constituant, la publication de l'offre d'achat ou d'échange ou l'acquisition d'une participation ». Il précise, en outre, que le renvoi par la Commission européenne vaut notification. Il convient de noter que l'absence de notification peut être sanctionnée financièrement par le ministre en vertu du nouvel article 42-3 de l'ordonnance introduit par l'article 53 du projet de loi. Le deuxième alinéa précise les personnes auxquelles incombe la notification. Il s'agit des « personnes physiques ou morales qui acquièrent le contrôle de tout ou partie d'une entreprise ou, dans le cas d'une fusion ou d'une entreprise commune, à toutes les parties concernées qui doivent alors notifier conjointement ». Il précise également que le contenu de la notification sera fixé par décret. A l'heure actuelle, ce contenu est déterminé par l'article 28 du décret du 29 décembre 1986, tel qu'il a été modifié par un décret du 9 août 1995. La notification est accompagnée d'un dossier particulièrement fourni comprenant : - une copie des actes ou des projets d'actes soumis à notification et une présentation des aspects juridiques et financiers de l'opération ainsi que de ses objectifs économiques, - une présentation des entreprises concernées, comportant notamment les statuts, la liste des dirigeants et principaux actionnaires, le montant de leurs participations dans les autres entreprises qu'elles contrôlent, les pactes d'actionnaires, les effectifs, les comptes annuels, la liste des opérations de concentration réalisées au cours des trois dernières années, ... - une définition du ou des marchés de produits ou de services concernés par l'opération, leur étendue géographique et leurs caractéristiques (taille, répartition entre les principaux opérateurs, flux d'importations et d'exportations, facteurs contribuant à la détermination des prix, évolution des prix pratiqués au cours des cinq dernières années, conditions d'accès aux marchés,...), - la position sur ces marchés des entreprises concernées par l'opération (parts de marché, tarifs, principaux clients et fournisseurs, implantation des principales unités, accords de distribution, dépenses de recherche, dépenses de publicité,...). D'après les informations recueillies par votre Rapporteur, le contenu du dossier de notification devrait être allégé, notamment pour les opérations de faible ampleur. Le troisième alinéa instaure une information des acteurs et du marché, dès la notification d'une opération de concentration ou en cas de renvoi d'une opération par la Commission européenne. Cette procédure d'information s'inspire de celle prévue par l'article 4 du règlement CEE du 21 décembre 1989, selon lequel « lorsque la Commission constate qu'une opération de concentration notifiée relève du présent règlement, elle publie le fait de la notification, en indiquant le nom des intéressés, la nature de l'opération de concentration ainsi que les secteurs économiques concernés ». Le contenu de cette information, ainsi que ses modalités, seront déterminées par décret. Il n'est évidemment pas question de rendre publique l'intégralité du dossier de notification qui est, on l'a vu, particulièrement étoffé et susceptible de contenir des éléments relevant du secret des affaires. L'objectif n'est que de rendre publique l'existence d'une opération ainsi que ses principales caractéristiques, afin que les entreprises susceptibles d'être touchées par l'opération puissent se manifester et présenter leurs observations. Enfin, le dernier alinéa prévoit que le Conseil de la concurrence est destinataire d'un exemplaire du dossier de notification. Comme on le verra, cette simple information ne préjuge pas d'une éventuelle saisine du conseil, qui reste une prérogative à la discrétion du ministre chargé de l'économie. * * * Votre Commission a adopté un amendement rédactionnel (n° 179) de votre Rapporteur, puis l'article 50 ainsi modifié. * * * (Article 41 de l'ordonnance du 1er décembre 1986) Caractère suspensif de la notification Dans sa rédaction actuelle, l'article 41 de l'ordonnance de 1986 traite de l'examen d'une opération par le Conseil de la concurrence. De telles dispositions figureront désormais dans un nouvel article 42-1 de l'ordonnance (introduit par l'article 53 du projet de loi). Le nouvel article 41 pose le principe du caractère suspensif de la notification, puisqu'il dispose que « la réalisation effective d'une opération de concentration ne peut intervenir qu'après l'accord du ministre chargé de l'économie et, le cas échéant, du ministre chargé du secteur économique concerné ». Dans le régime actuel de notification facultative, ce caractère suspensif n'existait pas puisque, comme on l'a vu précédemment, la notification pouvait même être faite dans un délai de trois mois après la réalisation effective de l'opération. Il est clair que la suspension de l'opération, tant qu'elle n'a pas été explicitement ou tacitement autorisée, constitue un corollaire indispensable de l'obligation de notification permettant d'améliorer l'effectivité du contrôle mis en place par le projet de loi. En effet, une réalisation anticipée pourrait être difficile à dénouer si l'opération venait à être interdite, rendant le retour à la situation antérieure plus difficile, voire très coûteux pour les entreprises concernées. Le dernier alinéa de l'article 41 prévoit cependant une possibilité pour le ministre chargé de l'économie d'accorder aux parties notifiantes « une dérogation leur permettant de procéder à la réalisation effective de tout ou partie de la concentration sans attendre la décision » finale. L'alinéa précise que l'octroi de cette dérogation ne préjuge pas de la teneur de cette décision finale. Cette dérogation doit être demandée par les parties « en cas de nécessité particulière dûment motivée ». Cette disposition s'inspire du paragraphe 4 de l'article 7 introduit en 1997 dans le règlement CEE du 21 décembre 1989. Il est clair que ne pourront bénéficier d'une telle dérogation que les opérations qui apparaîtront, à premier examen, comme ne portant pas atteinte à la concurrence, même si la nécessité de procéder à un examen plus approfondi ne permet pas de prononcer à leur égard une décision d'autorisation dans des délais très brefs. La pratique communautaire, encore récente, montre que les quelques opérations ayant bénéficié d'une dérogation ont ensuite été déclarées compatibles avec le marché commun dès l'examen en premier phase. Les principales motivations invoquées par les parties sont des contraintes boursières ou inhérentes aux marchés publics. Il convient de noter que le non-respect du caractère suspensif de la notification peut être sanctionné financièrement par le ministre en vertu du nouvel article 42-3 de l'ordonnance introduit par l'article 53 du présent projet de loi. * * * Votre Commission a adopté l'article 51, sans modification. * * * (Article 42 de l'ordonnance du 1er décembre 1986) Examen par le ministre de l'opération notifiée Le présent article propose une nouvelle rédaction globale de l'article 42 de l'ordonnance du 1er décembre 1986. Dans sa rédaction actuelle, cet article traite des décisions que peut prendre le ministre à la suite de l'avis du Conseil de la concurrence. De telles dispositions figureront désormais dans un nouvel article 42-2 de l'ordonnance (introduit par l'article 53 du projet de loi). Le nouvel article 42 détermine le délai imparti au ministre pour se prononcer sur l'opération (paragraphe I), autorise les entreprises notifiantes à prendre des engagements à tout moment de la procédure (paragraphe II), énumère les suites que le ministre peut donner à son examen (paragraphe III) et prévoit un mécanisme de tacite autorisation en cas de silence gardé par le ministre (paragraphe IV). Le paragraphe I entend réduire les délais d'examen des opérations de concentration, contrepartie du caractère obligatoire de la notification et du caractère suspensif de celle-ci. Aux termes de l'actuel article 40 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, le ministre dispose de deux mois pour se prononcer sur l'opération qui lui a été notifiée. Le projet de loi réduit ce délai de moitié puisqu'il accorde cinq semaines au ministre pour se prononcer sur l'opération. Il précise, en outre, que le point de départ de ce délai est « la date de réception de la notification complète », précision qui ne figure actuellement qu'au dernier alinéa de l'article 28 du décret du 29 décembre 1986. En retenant ce délai raccourci, la législation française se rapproche des délais applicables chez nos principaux partenaires, où ils atteignent fréquemment un mois (Union européenne, Allemagne, Belgique, Espagne, États-Unis, Suède,...), même si certaines possibilités de prolongation restent ouvertes. Ce délai de cinq semaines peut être prolongé lorsque les entreprises notifiantes souscrivent tardivement des engagements (cf. paragraphe II ci-dessous) ou lorsque le ministre décide de saisir le Conseil de la concurrence (cf. article 53 du projet de loi). Le paragraphe II du nouvel article 42 autorise les parties ayant notifié l'opération à souscrire des « engagements ». Ces engagements viennent compléter la notification et il est précisé qu'ils peuvent être souscrits soit dès la notification, soit tout au long de la procédure tant que le ministre n'a pris aucune décision. L'actuel article 40 de l'ordonnance prévoit explicitement la possibilité pour les entreprises d'assortir leur notification, lors du dépôt de celle-ci, de tels engagements. En revanche, il reste muet sur l'existence d'une telle possibilité au cours de la procédure. Cependant, en prévoyant explicitement que des engagements peuvent être souscrits à tout moment, le projet de loi ne fait qu'entériner la pratique actuelle, qui voit l'administration et les entreprises concernées négocier de tels engagements. D'ailleurs, en l'absence de pouvoir d'injonction à ce stade de la procédure, ce n'est que par cette négociation que l'administration peut obtenir des aménagements de l'opération projetée sans avoir à saisir le Conseil de la concurrence, et donc prolonger la procédure de contrôle. Le paragraphe II reste particulièrement évasif sur la nature et l'objet des engagements souscrits par les entreprises, puisqu'il se borne à préciser qu'il s'agit de « mesures visant notamment à remédier, le cas échéant, aux effets anticoncurrentiels de l'opération ». Dès lors, ces engagements peuvent être aussi bien des mesures tendant au maintien de la concurrence que des mesures économiques d'ordre plus général de nature à améliorer le bilan économique de l'opération (telles que des engagements sur l'emploi ou sur le maintien en activité de certains sites). La possibilité offerte aux entreprises concernées de souscrire de nouveaux engagements tout au long de la procédure ne doit pas priver le ministre du délai nécessaire pour en apprécier la valeur. C'est pourquoi, le dernier alinéa du présent paragraphe prévoit une possibilité de prorogation du délai d'examen afin de laisser au moins trois semaines au ministre pour examiner les engagements souscrits. Si ces derniers sont souscrits au-delà d'un délai de deux semaines à compter de la notification complète, le délai imparti au ministre expire trois semaines après la date de réception de ces engagements. Ainsi, par exemple, si les engagements sont souscrits au cours des deux premières semaines, le délai global imparti au ministre reste de cinq semaines. Au contraire, s'ils sont souscrits plus tard, ce délai global peut atteindre six (si les engagements sont souscrits la troisième semaine), sept (en cas d'engagements souscrits la quatrième semaine) ou huit semaines (si les engagements ont été souscrits la cinquième semaine). Le paragraphe III énumère les suites que le ministre chargé de l'économie peut donner à l'examen de l'opération notifiée à l'issue du délai tel qu'il a été défini ci-dessus. Le ministre ne peut prendre que l'une des trois décisions suivantes : - « constater (...) que l'opération qui lui a été notifiée n'entre pas dans le champ défini par les articles 38 et 39 de l'ordonnance », c'est-à-dire qu'elle ne constitue pas une opération de concentration au sens de l'article 38 ou que les critères de contrôlabilité définis à l'article 39 ne sont pas réunis ; l'opération n'a alors pas à être autorisée et peut donc être réalisée sans autre formalité ; en raison de la précision de la définition d'une concentration et du caractère objectif et aisément vérifiable des critères, cette hypothèse devrait être excessivement rare ; - saisir le Conseil de la concurrence « si l'opération est de nature à porter atteinte à la concurrence, notamment par création ou renforcement d'une position dominante » ; - autoriser l'opération, tout en pouvant la subordonner à la réalisation effective des engagements souscrits. Le caractère exclusif, l'une de l'autre, de ces trois décisions possibles signifie que seule la saisine du Conseil de la concurrence permet au ministre, dans la suite de la procédure, d'interdire l'opération ou d'assortir son autorisation d'injonctions ou de prescriptions (cf. article 42-2 de l'ordonnance introduit par l'article 53 du projet de loi). De ce point de vue, le projet de loi ne modifie en rien la situation actuelle : le ministre reste le seul juge de l'opportunité de saisir le Conseil de la concurrence. D'ailleurs, des trois décisions qui s'offrent à lui, seule la saisine du conseil n'a pas à être motivée. Il convient de noter cependant que le refus du ministre de saisir le conseil est soumis au contrôle du juge administratif qui s'est reconnu compétent, dès 1982, pour apprécier une éventuelle erreur manifeste d'appréciation dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir. Le paragraphe IV reprend une disposition figurant actuellement à l'article 40 de l'ordonnance, selon laquelle en cas de silence du ministre à l'issue du délai qui lui est imparti, l'opération « est réputée avoir fait l'objet d'une décision d'autorisation ». Contrairement au droit actuel, le paragraphe IV ne mentionne pas le sort des engagements éventuellement souscrits par les entreprises concernées. Il convient de noter, cependant, que les cas d'absence de décision sont excessivement rares, l'administration ayant la volonté de prendre une décision explicite. * * * Votre Commission a rejeté quatre amendements de M. Jean-Paul Charié, (n° 62) relatif à l'intervention du Conseil de la concurrence en matière de pratiques anticoncurrentielles prenant la forme d'un acte ou d'un contrat administratif et (n° 59, 60 et 61) permettant au Conseil de la concurrence de s'autosaisir en matière de contrôle des concentrations ou d'être saisi par les entreprises qui réalisent l'opération. Elle a ensuite adopté trois amendements rédactionnels (n°s 180, 181 et 182) de votre Rapporteur. Puis, elle a adopté l'article 52, ainsi modifié. * * * (Articles 42-1, 42-2 et 42-3 (nouveaux) de l'ordonnance du 1er décembre 1986) Procédure en cas de saisine du Conseil de la concurrence Le présent article insère trois articles additionnels au sein de l'ordonnance du 1er décembre 1986, visant respectivement à décrire la procédure devant le Conseil de la concurrence, énumérer les suites données par le ministre à son avis et prévoir un certain nombre de sanctions administratives. (Article 42-1 de l'ordonnance du 1er décembre 1986) Procédure devant le Conseil de la concurrence Le présent article reprend des dispositions figurant actuellement aux articles 41 et 44 de l'ordonnance. Le premier alinéa décrit le rôle confié au Conseil de la concurrence : celui-ci doit examiner si l'opération qui lui a été renvoyée « est de nature à porter atteinte à la concurrence, notamment par création ou renforcement d'une position dominante » et apprécier « si l'opération apporte au progrès économique une contribution suffisante pour compenser les atteintes à la concurrence ». Pour rechercher l'incidence de l'opération sur la concurrence, le conseil prend en compte de multiples facteurs, comme il l'explique dans ses rapports : il s'agit « outre la part de marché de l'ensemble constitué à l'occasion de la concentration, les parts de marché des autres offreurs nationaux ainsi que diverses variables telles que, par exemple, la possibilité technique des importations à concurrencer les produits domestiques, les difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en facteurs spécialisés de production, l'importance des économies d'échelles et l'intensité capitalistique du secteur considéré, l'ampleur de l'investissement publicitaire nécessaire pour pénétrer ou se maintenir sur le marché, l'existence éventuelle de brevets de fabrication protégeant les entreprises parties à l'opération, les conditions de la concurrence antérieure entre les divers offreurs, ... ». Dans son analyse, le conseil s'en tient exclusivement à son domaine d'autorité de la concurrence et s'est toujours refusé à apprécier les conséquences de l'opération en matière sociale, d'aménagement du territoire ou d'indépendance nationale, dimensions qu'il juge relever de la seule compétence des ministres. Pour apprécier l'apport au « progrès économique », le Conseil de la concurrence dresse le bilan économique de l'opération. Pour se faire, il a, par le passé, pris en compte par exemple l'amélioration de la productivité des entreprises, le développement de leur capacité d'innovation grâce à la mise en commun de leurs moyens de recherche-développement, l'amélioration de la qualité des produits, la baisse des prix, la lutte contre la pollution,... L'actuel article 41 précisait, en outre, que le conseil devait également tenir compte « de la compétitivité des entreprises en cause au regard de la concurrence internationale ». Le nouvel article 42-1 ne reprend pas cette disposition, considérant à juste titre que cet aspect des choses rentre dans le bilan économique de l'opération et dans l'appréciation de son apport au progrès économique. Le deuxième alinéa de l'article 42-1 précise la procédure suivie devant le conseil. Comme en matière d'ententes et de pratiques anticoncurrentielles, la procédure se déroule de manière contradictoire. Plus précisément, comme c'est le cas actuellement (cf. premier alinéa de l'article 44 de l'ordonnance), sont applicables les dispositions : - du deuxième alinéa de l'article 21, selon lequel le rapport établi par le rapporteur du conseil est notifié aux parties, au commissaire du Gouvernement et aux ministres intéressés et est accompagné des documents sur lesquels se fondent son auteur et des observations faites par les intéressés ; - de l'article 23, permettant au président du conseil de retirer tout ou partie des pièces qui mettraient en jeu le secret des affaires ; - de l'article 24, sanctionnant pénalement la divulgation par l'une des parties des informations dont elle aurait pu avoir connaissance au cours de la procédure ; - de l'article 25, précisant le déroulement de la séance du conseil. Cependant, l'article 42-1 prévoit quelques différences entre la procédure en matière d'ententes et celle applicable en matière de concentration. D'une part, les parties n'ont que trois semaines, et non deux mois, pour présenter leurs observations au rapport. D'autre part, le conseil peut, entendre des tiers en l'absence des entreprises notifiantes. En matière d'entente, le conseil peut, certes, également entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile, mais dans ce cas les parties peuvent assister à cette audition. Le quatrième alinéa précise que « le conseil remet son avis au ministre dans un délai de trois mois ». Curieusement, l'ordonnance du 1er décembre 1986 est aujourd'hui muette sur ce délai donné au conseil. Il peut juste être déduit du fait que, en cas de saisine du conseil, le silence du ministre au bout de six mois vaut autorisation tacite de l'opération. Dès lors, le conseil disposerait donc actuellement d'environ trois mois et demi pour rendre son avis (six mois moins les deux mois accordé au ministre pour le saisir et un délai raisonnable pour prendre sa décision finale au vu de l'avis du conseil). Enfin, le dernier alinéa de l'article 42-1 confie au ministre le soin de transmettre « sans délai » l'avis du conseil aux entreprises notifiantes. En vertu des dispositions de l'article 30 du décret du 29 décembre 1989 précité, la transmission de l'avis aux parties n'intervient aujourd'hui qu'au moment où le ministre leur transmet son projet de décision définitive. Cette transmission anticipée est destinée à permettre aux entreprises concernées à souscrire des engagements de nature à remédier aux effets éventuels de l'opération avant que les ministres aient pris leur décision. * A l'article 42-1 de l'ordonnance, la Commission a adopté un amendement rédactionnel (n° 183) du Rapporteur, ainsi que trois amendements identiques (n° 184) de MM. Philippe Auberger, Michel Inchauspé et Pierre Hériaud prévoyant que l'examen des opérations de concentration prend également en compte la création ou le renforcement d'une puissance d'achat qui place les fournisseurs en situation de dépendance économique. Après avoir rejeté l'amendement n° 63 de M. Jean-Paul Charié prévoyant que l'avis du Conseil de la concurrence est également transmis aux entreprises réalisant la concentration, la Commission a adopté, après intervention de M. Philippe Auberger suggérant qu'une audition par le rapporteur est suffisante, un amendement (n° 185) du Président Henri Emmanuelli prévoyant que les comités d'entreprise des sociétés concernées par une concentration sont entendus à leur demande par le Conseil de la concurrence. * (Article 42-2 de l'ordonnance du 1er décembre 1986) Décision des ministres concernés A l'instar du nouvel article 42 de l'ordonnance, le présent article détermine le délai imparti au ministre pour se prononcer sur l'opération (paragraphe I), autorise les entreprises notifiantes à prendre des engagements (paragraphe II), énumère les décisions que le ministre peut prendre (paragraphe III) et prévoit un mécanisme de tacite autorisation en cas de silence gardé par le ministre (paragraphe IV). Le paragraphe I prévoit qu'après réception de l'avis du conseil, le ministre chargé de l'économie et, le cas échéant, le ministre chargé du secteur économique concerné disposent d'un délai de quatre semaines pour prendre une décision. Comme on l'a noté ci-dessus, une telle précision n'existe pas actuellement dans l'ordonnance, hormis le fait que les ministres doivent respecter le délai total de six mois à compter de la notification complète de l'opération. Ce délai peut être prorogé lorsque les entreprises notifiantes souscrivent tardivement des engagements. Le paragraphe II autorise les parties ayant notifié l'opération à souscrire des « engagements ». Ces engagements viennent éventuellement compléter ceux souscrits avant la saisine du Conseil de la concurrence. La transmission de tels engagements peut intervenir à tout moment, depuis l'instant où l'avis du conseil leur a été transmis et jusqu'à que les ministres prennent une décision. Les entreprises concernées disposent donc d'un délai sensiblement plus long que les quelques jours qui leur sont accordés aujourd'hui au moment de la transmission du projet de décision. Comme précédemment, le dispositif laisse au ministre le délai nécessaire pour apprécier la valeur de ces engagements : le dernier alinéa du présent paragraphe prévoit une possibilité de prorogation du délai d'examen afin de laisser au moins trois semaines au ministre pour examiner les engagements souscrits. Si ces derniers sont souscrits au-delà d'un délai d'une semaine à compter de la remise de l'avis du conseil au ministre, le délai imparti au ministre expire trois semaines après la date de réception de ces engagements. Le paragraphe III reprend les dispositions figurant actuellement à l'article 42 de l'ordonnance du 1er décembre 1986. Comme c'est le cas aujourd'hui, les ministres concernés peuvent, par arrêté motivé : - « interdire l'opération de concentration et enjoindre, le cas échéant, aux parties de prendre toute mesure propre à rétablir une concurrence suffisante », ou - « autoriser l'opération en enjoignant aux parties de prendre toute mesure propre à assurer une concurrence suffisante », ou - « autoriser l'opération en l'assortissant de l'obligation d'observer des prescriptions de nature à apporter au progrès économique et social une contribution suffisante pour compenser les atteintes à la concurrence ». Comme aujourd'hui, les ministres ont une totale liberté de décision et ne sont aucunement liés par l'avis rendu par le Conseil de la concurrence. Les cas de divergences, plus ou moins prononcées, ne sont pas rares. Il arrive que les ministres soient moins « sévères » que le conseil, autorisant une opération que le conseil avait proposé d'interdire, ne retenant pas les conditions suggérées par le conseil ou atténuant la portée de celles-ci. Parfois, ils ont fait montre d'une plus grande rigueur, interdisant une opération que le conseil proposait d'autoriser sans aucune condition. En ce qui concerne le choix des conditions posées à la réalisation d'une opération, l'administration affirme être guidée par plusieurs principes, tels que le principe de proportionnalité (qui implique de limiter les exigences imposées aux entreprises au strict nécessaire, au nom du principe général de liberté du commerce et de l'industrie), le respect des intérêts légitimes des entreprises (qui justifiera des délais raisonnables à la réalisation des conditions posées) et le caractère contrôlable des injonctions et prescriptions (afin d'éviter les mesures qui entraîneraient l'administration dans un contrôle permanent des entreprises ou qui seraient difficilement sanctionnables). Les conditions posées par les ministres sont de deux types. Elles peuvent être de nature structurelle (cession d'actifs précis, réduction de participations, maintien de réseaux de distribution distincts,...) ou plus comportementales (modifications des conditions de ventes, accord de licences ou de brevets à des tiers, maintien d'activités de recherche-développement en France,...). Reprenant la disposition analogue du dernier alinéa de l'actuel article 42 de l'ordonnance, le quatrième alinéa du présent paragraphe dispose que les injonctions et prescriptions « s'imposent quelles que soient les clauses contractuelles éventuellement conclues entre les parties ». Enfin, le dernier alinéa précise que « le projet d'arrêté est transmis aux parties intéressées, auxquelles un délai est imparti pour présenter leurs observations ». Cette disposition figure actuellement à l'article 30 du décret du 29 décembre 1986. Le délai laissé aux parties n'est pas précisé, mais il n'est que de quelques jours. Cette brièveté ne porte pas atteinte aux droits des parties puisque celles-ci ont, à l'occasion de la négociation avec l'administration tout au long de la procédure, eu connaissance de l'avis du Conseil de la concurrence et des éléments d'analyse qu'il comportait, ainsi que de la position qu'envisageaient de prendre les ministres et les raisonnements juridiques et économiques qui les y conduisaient. La rédaction du paragraphe III apparaît moins satisfaisante que celle de l'actuel article 42 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 : le fait que les « injonctions » et « prescriptions » figurent dans deux alinéas distincts pourraient laisser croire que ces deux types de conditions sont exclusives les unes des autres. Dans ce cas, cette interprétation conduirait à limiter inutilement la marge d'appréciation laissée aux ministres. Le paragraphe IV précise que si les ministres ne prennent aucune des décisions énumérées au paragraphe précédent (interdiction, autorisation assorties d'injonctions ou de prescriptions), ils autorisent l'opération par décision motivée, l'autorisation pouvant être subordonnée « à la réalisation effective des engagements pris par les parties ». L'existence de deux paragraphes distincts pour décrire les décisions que peuvent prendre les ministres résulte du désir de distinguer selon les décisions coercitives (interdiction, autorisation avec injonctions ou prescriptions) figurant au paragraphe III et celles qui ne le sont pas (autorisation simple, hormis éventuellement les engagements souscrits). Les premiers font l'objet d'un arrêté, tandis que les secondes ne sont justiciables que d'une « décision motivée », en l'occurrence une simple lettre du ministre de l'économie, le plus souvent signée, par délégation, par le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Comme dans le cas d'absence de saisine du Conseil de la concurrence, le paragraphe V reprend une disposition figurant actuellement à l'article 40 de l'ordonnance, selon laquelle en cas de silence du ministre à l'issue du délai qui lui est imparti, l'opération « est réputée avoir fait l'objet d'une décision d'autorisation ». Comme à l'article 52, le paragraphe V ne mentionne pas les engagements éventuellement souscrits par les entreprises concernées. * * * A l'article 42-2 de l'ordonnance, votre Commission a adopté quatre amendements rédactionnels et de coordination (n°s 186, 187, 188 et 189) de votre Rapporteur. * * * (Article 42-3 de l'ordonnance du 1er décembre 1986) Le présent article prévoit la possibilité pour le ministre chargé de l'économie d'infliger des sanctions administratives dans quatre cas : absence de notification (paragraphe I), réalisation effective d'une opération avant que celle-ci n'ait été autorisée (paragraphe II), omission ou déclaration inexacte dans le dossier de notification (paragraphe III) et non respect des prescriptions, injonctions et engagements dont l'autorisation était assortie (paragraphe IV). Seul ce dernier cas est déjà actuellement prévu par l'ordonnance du 1er décembre 1986 (cf. dernier alinéa de l'article 44). L'introduction des trois premières sanctions résulte logiquement du caractère désormais obligatoire et suspensif de la notification des opérations de concentration répondant aux critères définis par l'ordonnance. Sera donc désormais sanctionnable, le fait de réaliser une opération de concentration sans l'avoir préalablement notifiée. Dans ce cas, les personnes pouvant être sanctionnées sont bien évidemment les personnes auxquelles incombait la charge de la notification. Le ministre peut alors infliger une sanction pécuniaire dans la limite d'un plafond fixé à 1,5 million d'euros (soit un peu moins de 10 millions de francs) pour les personnes physiques et, pour les personnes morales, à 5 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France lors du dernier exercice clos, augmenté le cas échéant de celui qu'a réalisé la partie acquise au cours de la même période. Il convient de noter que pour un cas similaire, le règlement CEE du 21 décembre 1989 prévoit un plafond encore plus élevé puisqu'il atteint 10 % du chiffre d'affaires total des entreprises concernées. Le paragraphe I précise que, outre la sanction pécuniaire, le ministre « peut enjoindre aux parties de notifier l'opération, et accompagner l'injonction d'une astreinte », et saisir également le Conseil de la concurrence, et enclencher ainsi la procédure prévue aux articles 42-1 et 42-2. Il peut paraître étonnant de reconnaître au ministre la faculté de ne pas obliger les parties à notifier l'opération qui a été réalisée, alors que le non respect de cette formalité substantielle a été par ailleurs sanctionné, et l'a peut-être été lourdement. Le paragraphe II permet au ministre de sanctionner le fait de réaliser, avant l'intervention de l'autorisation du ou des ministres concernés, une opération de concentration ne bénéficiant pas de la dérogation prévue à l'article 41 de l'ordonnance. La sanction prononcée ne peut également dépasser le plafond défini précédemment. Le paragraphe III permet au ministre de sanctionner financièrement, dans la limite du même plafond, le fait d'omettre une information ou de donner une information inexacte lors de la notification de l'opération. La sanction pécuniaire peut, en outre, être accompagnée du « retrait de la décision ayant autorisé la réalisation de l'opération ». Dans ce cas, les personnes sanctionnées doivent soit revenir à la situation antérieure à l'opération de concentration, soit notifier l'opération dans un délai d'un mois à compter du retrait de l'autorisation. En cas de non respect de ce délai, les sanctions prévues en cas d'absence de notification peuvent être prononcées. Ces sanctions peuvent, à première vue, paraître disproportionnées par rapport aux faits incriminés. En fait, il est clair que ce ne sont que les omissions ou inexactitudes les plus graves qui sont visées, c'est-à-dire celles qui ont pu altérer l'appréciation que l'administration a portée sur l'opération contrôlée. Comme le fait actuellement le dernier alinéa de l'actuel article 44 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, le paragraphe IV prévoit un certain nombre de sanctions en cas d'inexécution d'une injonction, d'une prescription ou d'un engagement dans les délais fixés. Dans ce cas, le ministre chargé de l'économie peut saisir le Conseil de la concurrence, afin que celui-ci constate l'inexécution. Dans ce cas, le ministre de l'économie et, le cas échéant, le ministre chargé du secteur économique concerné peuvent : - soit retirer la décision ayant autorisé la réalisation de l'opération ; dès lors, à moins de revenir à la situation antérieure à la concentration, les parties sont tenues de notifier de nouveau l'opération dans le délai d'un mois à compter du retrait de l'autorisation, - soit enjoindre sous astreinte aux parties d'exécuter, dans un délai qu'ils fixent, les injonctions, prescriptions ou engagements non exécutés. En outre, les personnes auxquelles incombaient l'obligation non exécutée peuvent se voir infliger une sanction pécuniaire, qui ne peut dépasser le plafond défini aux paragraphes précédents. Il convient de noter qu'actuellement cette sanction pécuniaire est la seule qui peut être prononcée, dans la limite du même plafond (puisque c'est celui qui est appliqué aux sanctions que peut prononcer actuellement le Conseil de la concurrence). * * * A l'article 42-3 de l'ordonnance, elle a adopté un amendement (n° 190) de votre Rapporteur rendant obligatoire la notification de l'opération quand les entreprises ont été sanctionnées par le ministre pour défaut de notification préalable, ainsi que quatre amendements rédactionnels et de précision (n°s 191, 192, 193 et 194) du même auteur. Elle a ensuite rejeté deux amendements identiques de MM. Philippe Auberger et Gilbert Gantier diminuant les sanctions pouvant être infligées à une personne physique en cas de réalisation d'une opération de concentration avant que celle-ci ait été autorisée. Votre Commission a ensuite adopté l'article 53, ainsi modifié. * * * (Article 44 de l'ordonnance du 1er décembre 1986) Conciliation du secret des affaires avec l'audition de tiers Le présent article propose une rédaction nouvelle de l'article 44 de l'ordonnance du 1er décembre 1986. Aujourd'hui, ce dernier est composée de trois alinéas, relatifs respectivement à la procédure suivie devant le Conseil de la concurrence, aux règles de motivation et de publication des décisions ministérielles et aux sanctions applicables en cas d'inexécution des conditions posées à l'autorisation de l'opération. A l'exception des règles de la publicité des décisions ministérielles, tous ces points ont été traités par ailleurs par le projet de loi. Le nouvel article 44 vise à concilier la protection légitime du secret des affaires avec la possibilité pour le ministre d'entendre des tiers au cours de la procédure (paragraphe I) et la publicité des décisions ministérielles (paragraphe II). Le paragraphe I consacre la possibilité pour le ministre d' « interroger à tout moment tout tiers au sujet de l'opération, de ses effets et des engagements proposés par les parties ». Il précise qu'il peut le faire « en tenant compte de l'intérêt légitime des parties qui ont procéder à la notification à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués ». Cette disposition, dont le caractère normatif apparaît évanescent, s'inspire d'une disposition analogue figurant à l'article 18 du règlement CEE du 21 décembre 1989. Le paragraphe II précise que les décisions ministérielles prises en application des articles 42 à 42-3 et, le cas échéant, l'avis du Conseil de la concurrence sont publiées dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État. Actuellement, c'est l'article 44 de l'ordonnance qui précise qu'elles sont publiées au bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Là aussi, il est précisé que « le ministre tient compte de l'intérêt légitime des personnes physiques et morales citées à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués ». Cette disposition s'inspire également de l'article 20 du règlement CEE précité. Il convient de noter qu'une disposition ayant un objet analogue figure déjà à l'article 28 du décret du 29 décembre 1986 : « si les entreprises notifiantes estiment que certains documents inclus dans ce dossier présentent un caractère confidentiel, elles peuvent porter sur ces documents la mention "secret des affaires". Dans ce cas, le ministre chargé de l'économie leur demande de lui indiquer les informations dont elles souhaitent qu'il ne soit pas fait mention dans sa décision et dans l'avis du Conseil de la concurrence ». * * * Votre Commission a adopté un amendement rédactionnel (n° 195) de votre Rapporteur, puis l'article 54 ainsi modifié. Article additionnel après l'article 54 Possibilité pour le comité d'entreprise d'obtenir une assistance Votre Commission a adopté un amendement (n° 196) du Président Henri Emmanuelli permettant aux comités d'entreprise concernées par une opération de concentration de se faire assister par un expert rémunéré par l'entreprise pour étudier les conséquences de l'opération. * * * laisser la page blanche La troisième partie du présent projet est constituée de deux éléments, nettement distincts, le premier relatif aux droits des sociétés commerciales, le second relatif au secteur public. Le titre Ier réforme la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. Il comporte plusieurs volets. Le premier consiste à organiser la dissociation entre les fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général. Le deuxième renforce les règles relatives à la limitation des mandats sociaux. Le troisième étend le régime d'autorisation de certaines conventions établies au sein des sociétés. Le quatrième abaisse les seuils pour l'ouverture de certains droits aux actionnaires minoritaires et assure la transparence des rémunérations des mandataires sociaux. Le cinquième améliore la connaissance par les sociétés de leurs actionnaires. Le sixième reconnaît la possibilité d'un contrôle conjoint de plusieurs sociétés sur une autre, par référence à une action de concert. Le septième institue des injonctions de faire qui permettront aux actionnaires de faire valoir plus efficacement leurs droits d'accès aux documents sociaux, tandis que le huitième chapitre du titre comporte des dispositions diverses et transitoires. L'ensemble des dispositions pourrait paraître hétéroclite. Pourtant, elles vont toutes dans le même sens, celui de la transparence, de l'équilibre des pouvoirs et de la souplesse, en un mot de la modernisation du droit des sociétés. La loi du 24 juillet 1966 a fait l'objet, ces dernières années, d'un nombre impressionnant de propositions de réforme, qui montre que la nécessité de sa modernisation fait l'unanimité. Des propositions ont en effet été émises non seulement par les pouvoirs publics, au travers des groupes de travail constitués dans certains ministères et des rapports de parlementaires, de la Commission des opérations de bourse ou du Conseil économique et social, mais aussi par les représentants des entreprises, notamment par le livre vert de l'Association nationale des sociétés par actions (ANSA) ou les rapports Doucet pour la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, Pébereau pour l'Institut des entreprises, Viénot pour le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) et l'Association française des entreprises privées (AFEP). Ces propositions ont été relayées par les professionnels du droit et des comptes qui, à partir de leur expérience de la vie de l'entreprise, appellent de leurs v_ux la nécessaire modernisation de la loi du 24 juillet 1966. Pourtant, il ne s'agit pas ici de réformer tout le droit des sociétés Et il ne s'agit pas non plus, comme l'ont préconisé certains, de démanteler les règles existantes sous couvert de laisser plus de place à la liberté contractuelle, de s'inspirer benoîtement des modèles anglo-saxons de « corporate governance » dont la traduction française - « gouvernement de l'entreprise »- est à l'évidence inadaptée, ou encore de supprimer le droit pénal des sociétés. Cependant, les objectifs du présent projet sont ambitieux. Ils concernent la compétitivité des entreprises françaises. L'archaïsme de certaines dispositions de la loi précitée est en effet difficilement compatible avec l'internationalisation des mouvements de capitaux, le développement des grands groupes industriels faisant appel public à l'épargne, l'augmentation du nombre d'actionnaires et les exigences légitimes des actionnaires minoritaires. L'état actuel du droit des sociétés présente trois inconvénients : - il autorise, sur certains points, des pratiques qui, par rapport aux règles en vigueur à l'étranger, font figure d'exceptions difficilement justifiables. L'avènement de la zone euro contribue au développement des opérations entre les États membres de l'Union européenne. L'actionnariat des entreprises tend à s'internationaliser : la part des actions détenues par des non-résidents atteint en France 40 %, contre moins de 20 % au Royaume-Uni et moins de 10 % au Japon ou aux États-Unis. Ces tendances favorisent une harmonisation des modalités de gestion des entreprises vis-à-vis de laquelle les groupes français ne pourront pas durablement rester à l'écart ; - il se caractérise par un manque de transparence sur certains aspects de la gestion des entreprises, qui pénalise les actionnaires français. Ces derniers ne bénéficient en effet pas d'informations aussi précises que celles qui sont communiquées par les sociétés étrangères ; - il risque à terme de constituer un frein à l'investissement dans les sociétés françaises dont certaines modalités de gestion peuvent susciter la réticence des grands investisseurs internationaux. La transparence est en effet devenue un critère d'investissement pour de nombreux gestionnaires. L'enjeu de la modernisation du droit des sociétés, c'est aussi la clarté et la meilleure gestion. La distinction des pouvoirs du conseil d'administration, de son président et du directeur général - ces deux fonctions étant obligatoirement confondues depuis une loi du 10 novembre 1940 alors qu'elles sont séparées dans la presque totalité des sociétés britanniques - les dispositions tendant à empêcher les abus de cumuls de mandats, qui, au demeurant, devraient entraîner la diminution du nombre de conflits d'intérêts, ainsi que l'obligation d'information sur les rémunérations et les avantages versés aux dirigeants devraient y contribuer. Le dernier enjeu de la modernisation du droit des sociétés est lié à la dissémination actuelle de l'actionnariat. Elle rend nécessaire l'intervention du législateur afin de garantir les droits des petits porteurs et de leur faciliter l'accès aux assemblées générales notamment par un recours aux moyens modernes de communication. Il importe aussi de s'assurer de l'application effective des droits reconnus aux actionnaires dans la loi du 24 juillet 1966. Le présent projet de loi privilégie, à cette fin, le recours à la procédure de l'injonction de faire par rapport aux sanctions pénales qui, si elles offrent une protection indéniable, n'interviennent qu'a posteriori. Il s'agit, en définitive, de garantir une plus grande efficacité du droit des sociétés. Il convient d'insister sur le fait que l'ensemble des règles proposées ne contribue pas seulement à la « transparence » mais aussi à la bonne gestion des sociétés - les deux notions ne sont nullement contradictoires, au contraire - et à des apaisements : diminution des conflits d'intérêts entre direction, administrateurs, actionnaires et sociétés, comme de ceux entre les actionnaires minoritaires et les conseils d'administration. Le titre II de cette partie, relatif au secteur public dans l'économie consiste à assurer au marché un fonctionnement harmonieux dans la mesure où l'État en est aussi un acteur, par les participations qu'il possède dans certaines sociétés et la tutelle qu'il exerce sur les établissements publics ayant une activité commerciale. Ainsi, l'État doit tenir toute sa place au sein des entreprises dans lesquelles il a choisi de posséder une participation. Que ce choix ait pour origine la promotion du service public ou la protection d'un intérêt stratégique national, l'État doit être présent. Dans le cadre du processus de rénovation du rôle de l'État actionnaire, il convenait également de combler un vide juridique. En l'état actuel des textes, il n'est pas possible à un fonctionnaire de l'État d'être membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une entreprise privée dont l'État ne serait qu'indirectement actionnaire. Cette situation étant susceptible de se développer, il semble opportun que l'État puisse, avec l'accord de l'entreprise concernée, être représenté. C'est l'objet de l'article 71. Le bilan bi-annuel, prévu à l'article 74, relatif à la mission de l'État en tant qu'actionnaire et tuteur, fera utilement état de l'activité des représentants de l'État au sein des conseils d'administration ou de surveillance dont ils sont membres. L'État est aussi l'interlocuteur et le partenaire d'un certain nombre d'entreprises, sur lesquelles la collectivité fait peser des sujétions particulières, notamment au titre du service public. Le contrat est depuis longtemps l'instrument privilégié de cette relation qui doit concilier les légitimes attentes de l'État en termes de service offert aux citoyens et l'autonomie de l'entreprise dans ses activités commerciales. Ainsi, en 1969, l'État et la SNCF ont signé un contrat de programme relatif à l'équilibre financier de l'établissement public, en s'inspirant des conclusions du rapport de Simon Nora (1), paru en 1967. D'autres contrats de programme ou d'entreprises furent conclus jusqu'en 1981 entre l'État et certaines entreprises du secteur public (2), pour des durées de quatre ou cinq ans. La contractualisation est poursuivie à partir de 1982, dans le cadre nouveau issu de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification. L'article 11 de cette loi précise que les contrats de plan qui lient l'État et les entreprises du secteur public « portent sur les actions qui contribuent à la réalisation d'objectifs compatibles avec ceux du plan de la Nation ». De nombreux contrats sont alors signés, notamment avec les entreprises nationalisées en 1982. Le déclin progressif de la planification nationale a abouti à un recentrage de la contractualisation sur les entreprises de réseau, chargées d'une mission de service public. Actuellement, seuls EDF, GDF et la Poste ont un contrat en vigueur avec l'État. L'article 72, en instituant le contrat d'entreprise, a pour but de donner une base légale rationalisée et rénovée à ces contrats, en leur assignant le service public comme objet précis, en les déconnectant d'une planification nationale qui n'existe plus, tout en leur donnant le régime juridique que la loi du 29 juillet 1982 a fixé. L'article 73 de la présente loi améliorera la démocratie au sein des entreprises du secteur public. Les droits des conseils d'administration ou de surveillance, et des institutions représentatives du personnel sont approfondis, notamment par le droit de délibération ou d'information au sujet du contrat d'entreprise, et étendus à un ensemble de petites sociétés et d'établissements publics particuliers, qui sont aujourd'hui exclus de leur bénéfice. Enfin, l'article 74 permettra au Parlement d'être mieux informé sur l'activité du secteur public. Les rapports relatifs aux cessions d'actifs par l'État et à la situation économique des entreprises du secteur public sont fusionnés, tout en approfondissant le champ des informations qui y figurent. DROIT DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES Article additionnel avant l'article 55 (Article 97-1-1 (nouveau) de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales) Droits des comités d'entreprise Votre Commission a adopté un amendement (n° 197) portant article additionnel, de M. Jean-Pierre Brard, tendant à attribuer aux comités d'entreprise des actions et à leur accorder les mêmes droits que ceux des actionnaires minoritaires. Objet des articles du titre premier Le présent article annonce l'objet des articles du titre (à l'exception d'un seul) : la modification de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. Les articles 56 à 67 et 69 du projet réforment en effet la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, tandis que l'article 68 vise le code civil et l'ordonnance n° 58-1352 du 27 décembre 1958 réprimant certaines infractions en matière de registre du commerce et des sociétés. L'article n'apparaît pas pertinent. Il n'a aucun contenu normatif, et constitue une facilité d'écriture légistique peu orthodoxe, qui d'ailleurs ne se retrouve pas dans les autres parties du texte dont plusieurs articles peuvent aussi modifier les mêmes lois. Un vote sur un tel article n'aurait pas de signification. En outre, l'existence du présent article conduit à ne pas préciser le texte modifié en tête de chacun des articles suivants, ce qui ne peut qu'en gêner la lecture, et ne paraît donc pas conforme à l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité de la loi (13). Pour l'ensemble de ces raisons, votre rapporteur estime nécessaire de supprimer le présent article et, en conséquence, de réinsérer la référence à la loi du 24 juillet 1966 en tête de chaque article concerné. * * * Votre Commission a adopté un amendement (n° 198 corrigé) du Rapporteur supprimant l'article. L'article a donc été supprimé. * * * Équilibre des pouvoirs et fonctionnement des organes dirigeants Votre Commission a d'abord débattu d'un amendement de M. Yves Cochet, proposant un article additionnel qui tend à rendre obligatoire la présence d'administrateurs élus par les salariés au sein du conseil d'administration et du conseil de surveillance. M. Jean-Pierre Brard a remarqué que l'occasion était ainsi donnée de démocratiser les instances de direction tout en accroissant leur transparence. M. Philippe Auberger a rappelé que des mesures avaient déjà été prises pour rendre cette présence possible lorsque les salariés étaient associés à une augmentation de capital, mais que la logique de cet amendement lui semblait moins défendable. M. Jean-Pierre Brard ayant souligné la légitimité de la présence, dans les instances de direction, de ceux qui contribuaient à la création de richesse,votre Rapporteur l'a approuvé sur le fond, mais a objecté que plus de concertation était indispensable dans la mesure où certains syndicats s'y opposaient et que cette question serait abordée dans le prochain texte sur l'épargne salariale. M. Jean-Pierre Brard a alors retiré l'amendement, après avoir demandé que votre Commission auditionne les syndicats pour préparer ce dossier. Articles additionnels avant l'article 56 (Articles 89, 129 et 152 de la loi du 24 juillet 1966) Réduction du nombre maximal de membres de conseil d'administration et de conseil de surveillance Votre Commission a ensuite adopté un amendement (n° 199) portant article additionnel, proposé par votre Rapporteur, visant à réduire le nombre maximalde membres de conseil d'administration et de conseil de surveillance à 18, et à 24 en cas de fusion, après que M. Philippe Auberger eut reconnu le caractère néfaste des conseils pléthoriques mais regretté que la loi fixe un maximum arbitraire. Adaptation de l'intitulé d'une sous-section de la loi Votre Commission a enfin adopté un amendement (n° 200 rectifié) portant article additionnel de votre Rapporteur corrigeant l'intitulé d'une sous-section de la loi du 24 juillet 1966. (Articles 98 et 113 de la loi du 24 juillet 1966) Rôles du conseil d'administration et de son président Cet article représente l'une des pièces essentielles du projet, puisqu'il comporte le principe de la dissociation des fonctions de président du conseil d'administration de celles de directeur général. En conséquence, il précise le rôle du conseil d'administration d'une société anonyme (paragraphe I) et celui de son président (paragraphe II) : le premier a pour mission d'assurer un contrôle général de la gestion de la société et de délibérer de toute question intéressant sa bonne marche ; le second, qui n'a plus vocation à assurer la direction générale de la société, est chargé de veiller au bon fonctionnement des organes de la société, de présider et d'organiser les travaux du conseil et de parler en son nom chaque fois que la loi lui réserve un pouvoir propre. Ces précisions sont nécessaires dans la mesure où l'article 57 vise à dissocier, en principe, les fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général. Cet article 56 ouvre en outre la possibilité d'exception à ce principe : les statuts de la société pourront prévoir le cumul de ces deux fonctions. Le paragraphe I du présent article modifie les trois premiers alinéas de l'article 98 de la loi du 24 juillet 1966. Cet article 98, modifié par la loi n° 67-559 du 12 juillet 1967 et par l'ordonnance n° 69-1176 du 20 décembre 1969, définit les pouvoirs du conseil d'administration. Les dispositions de cet article sont le fruit d'une lente évolution historique : lorsque le conseil d'administration a été instauré dans la loi du 16 novembre 1940, ses attributions ont été énumérées dans les statuts, comme l'étaient auparavant les attributions déléguées au collège des administrateurs. Peu à peu, le conseil d'administration s'est vu reconnaître des pouvoirs propres, dans un ensemble d'organes hiérarchisés, ce qui a été consacré par la Cour de cassation, dans son arrêt Motte du 4 juin 1946. L'article 98 de la loi du 24 juillet 1966 a donc repris cette solution. Actuellement, le conseil d'administration a des compétences particulières, qui lui sont spécialement réservées par la loi, et il dispose d'un pouvoir général d'administration, étant « investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société » (art.98, al.1 de la loi du 24 juillet 1966). L'article 56 du présent projet de loi rappelle l'existence de ces pouvoirs spécifiques et modifie de manière marginale la définition de ses autres pouvoirs : la notion de « pouvoirs les plus étendus » disparaît au profit d'une formule plus restrictive : [il] « règle par ses délibérations les affaires de la société » et « se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société ». Cette notion de « bonne marche de la société » est nouvelle : elle désigne en fait la pérennité de la société. Les membres du conseil d'administration sont mandatés par les actionnaires pour veiller au devenir de leur capital. Placé à la charnière entre les actionnaires et les gestionnaires, le conseil d'administration doit défendre l'intérêt de l'actionnaire en faisant preuve de vigilance à l'égard de toutes les décisions qui pourraient avoir une incidence sur l'avenir de la société : insister sur ce point est utile. A côté de cette compétence générale, le conseil d'administration se voit doté d'une mission de contrôle étendue puisqu'elle s'exerce « à toute époque de l'année », qu'il est seul juge de l'opportunité des contrôles qu'il effectue - sans que son président ait à donner son approbation - et qu'il doit pouvoir disposer de tout document utile. Cette mission se rapproche fortement de celle du conseil de surveillance des sociétés anonymes dotées d'un directoire et d'un conseil de surveillance, définie à l'article 128 de la loi du 24 juillet 1966 : « A toute époque de l'année, le conseil de surveillance opère les vérifications et les contrôles qu'il juge opportuns et peut se faire communiquer les documents qu'il estime utiles à l'accomplissement de sa mission ». Ce rôle actif de contrôle doit être facilité par l'information continue dont bénéficie le conseil d'administration, qui « à toute époque de l'année, (...) reçoit toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission ». Les conditions dans lesquelles les actes du conseil d'administration engagent la société ne sont pas modifiées. La responsabilité civile des administrateurs est définie à l'article 244 de la loi du 24 juillet .1966. La rédaction proposée par le présent projet pour l'article 98 de la loi du 24 juillet 1966 y renvoie. Or, il ne semble pas qu'un tel renvoi soit indispensable, l'application de l'article 244 ne faisant aucun doute. Il se justifie par le fait qu'il met l'accent sur le maintien de la responsabilité des administrateurs, laquelle n'est nullement modifiée par la nouvelle définition du rôle du conseil d'administration. Le dernier alinéa du paragraphe I traite du cas spécifique du conseil d'administration des sociétés faisant appel public à l'épargne. Il impose l'obligation pour le conseil d'administration de telles sociétés d'établir un règlement intérieur qui organise ses travaux : fréquence des réunions et fixation de leur ordre du jour doivent suivre des règles figurant dans ce règlement intérieur. Ce dernier, qui ne fait pas partie des documents comptables qui doivent être présentés annuellement par le conseil d'administration ou le directoire de la société, doit être publié dans des conditions fixées par décret. Il est à noter que les documents comptables susmentionnés doivent être les mêmes pour les diverses sociétés commerciales dotées de la personnalité morale, mais que l'obligation du règlement intérieur, proposé dans le présent projet de loi, ne vaudrait que pour les sociétés faisant appel public à l'épargne. En effet, il est nécessaire, dans leur cas, à l'information des nombreux actionnaires, souvent petits : ils connaîtront ainsi, par exemple, les décisions de création de comités (comité de rémunération, d'audit...), les questions soumises à la discussion du conseil d'administration. Une telle publicité est de nature à combattre la passivité du conseil d'administration, dont chaque actionnaire aura facilement connaissance des activités, et à favoriser la diffusion des bonnes pratiques, résultat de comparaisons aisées entre celles des différentes sociétés faisant appel public à l'épargne. En revanche, l'obligation d'un tel règlement intérieur ne se justifie pas pour toutes les sociétés anonymes : si beaucoup d'entre elles en possèdent effectivement un, toutes n'en ont pas besoin. Dans les sociétés fermées, comptant un petit nombre d'actionnaires stables, le fonctionnement du conseil d'administration est connu par tous et un règlement intérieur est sans utilité. Le paragraphe II du présent article rédige l'article 113 de la loi du 24 juillet 1966 et disjoint le rôle du président du conseil d'administration des fonctions de directeur général. Il recentre le premier sur le conseil d'administration. Disparaît donc le premier alinéa de l'article 113 qui dispose que « le président du conseil d'administration assume, sous sa responsabilité, la direction générale de la société ». Cette réforme, très attendue par une partie des sociétés anonymes, vise à mettre fin à un système unique imposée depuis 1940. En effet, alors que la loi du 24 juillet 1867 se contentait de permettre aux administrateurs de choisir parmi eux un directeur ou de désigner un mandataire extérieur à la société, la loi du 10 novembre 1940 réagit contre l'éparpillement des responsabilités en instituant comme chef de la société anonyme le président-directeur général, qui sera autorisé, par la loi du 4 mars 1943, à se faire assister d'un directeur général adjoint. La loi de 1966 reprend cette réglementation en simplifiant la terminologie : le président-directeur général devient président du conseil d'administration et son directeur général perd la qualification d'adjoint. Cette obligation a privé les sociétés françaises de toute solution alternative au sein du modèle de société à conseil d'administration : la dissociation entre les fonctions de directeur du conseil d'administration et de directeur général est pourtant utilisée dans la presque totalité des sociétés cotées britanniques et dans environ 20 % des sociétés américaines. C'est une formule qui, selon ses promoteurs, a l'avantage d'être plus transparente que celle du « président-directeur général » dans la mesure où les pouvoirs de chacun sont clairement distingués et où l'équilibre des pouvoirs est plus facile à obtenir, personne n'occupant de position de domination. Les fonctions du président du conseil d'administration sont donc énumérées de manière exhaustive, leur objectif étant le bon fonctionnement des organes de la société : présidence et représentation du conseil d'administration, organisation de ses travaux, dont il rend compte à l'assemblée générale, droit de regard sur la capacité des administrateurs. Cette limitation de principe du rôle du président du conseil d'administration voit cependant sa portée assouplie par le dernier alinéa du paragraphe II du présent article, lequel prévoit une exception : la possibilité pour le président du conseil d'administration d'assurer les fonctions de directeur général. Cette possibilité n'est toutefois ouverte que si les statuts prévoient un tel cumul, c'est-à-dire à condition que cette solution ait été adoptée par l'assemblée générale extraordinaire « seule habilitée à modifier les statuts dans toutes leurs dispositions » (art. 153 de la loi du 24 juillet 1966). Les conditions de quorum sont particulièrement exigeantes et le vote se fait à la majorité des deux tiers : la possibilité de cumul doit donc recevoir, pour être ouverte, une très large approbation de l'assemblée générale. Le projet de loi promeut nettement le modèle de la dissociation en prévoyant, à l'article 70, l'obligation de réunir l'assemblée générale extraordinaire dans un délai de dix-huit mois après la publication de la présente loi afin qu'elle modifie les statuts de la société, si elle souhaite le maintien du cumul des fonctions. Votre Rapporteur est favorable, dans son principe, à cette dissociation des fonctions, qui est de nature à améliorer la gestion des entreprises concernées par un meilleur partage des responsabilités. Distinguer ce qui est de la compétence du conseil d'administration et les pouvoirs de son président, en tant que président du conseil et non en tant que directeur général, est nécessaire en cas de dissociation, mais aussi très utile en cas de cumul, afin d'éviter les conflits de compétences entre les différents organes. La mise en _uvre de la dissociation, telle qu'elle est prévue dans le projet, n'est pourtant pas sans présenter des difficultés, que votre Rapporteur aborde dans le commentaire de l'article 70. Le projet de loi précise que le président du conseil d'administration qui cumule ses fonctions avec celles de directeur général le fait en qualité de directeur général, titre qui se distingue donc de celui de président-directeur général, déjà absent de la loi du 24 juillet 1966. Dans la pratique, il continuait à être porté et le sera encore sans que cela pose de difficultés. Néanmoins, sa présence dans la loi serait de nature à apporter une certaine confusion dans la mesure où l'actuel « président-directeur général » était le résultat de la fusion des fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général, alors que la possibilité offerte par le présent article n'est pas celle d'une fusion, mais bien d'un véritable cumul de fonctions clairement distinguées. De manière cohérente, le président du conseil d'administration est, dans ce cas, soumis aux dispositions « de la présente sous-section », c'est-à-dire des articles 89 à 117, relatives au directeur général. * * * Votre Commission a adopté un amendement (n° 10) de la commission des Lois précisant les pouvoirs du conseil d'administration. Elle a rejeté deux amendements de M. François d'Aubert, l'un relatif à l'inopposabilité aux tiers des dispositions statutaires limitant les pouvoirs du conseil d'administration et l'autre tendant à modifier les pouvoirs du conseil d'administration. Elle a ensuite adopté un amendement (n° 201) du même auteur précisant que chaque administrateur a un droit d'information individuel et rejeté un amendement (n° 11) de la commission des Lois poursuivant le même objectif par une formulation différente. Votre Commission a rejeté deux amendements de M. Philippe Auberger, le premier supprimant l'obligation pour les conseils d'administration des sociétés faisant appel public à l'épargne d'adopter et publier leur règlement intérieur et le second autorisant les statuts à prévoir que certaines opérations actuellement soumises à l'autorisation du conseil d'administration pourraient être l'objet d'une ratification a posteriori. Elle a, de même, rejeté un amendement semblable de M. François d'Aubert. Votre Commission a rejeté deux autres amendements de M. François d'Aubert : l'un précisant les pouvoirs du président du conseil d'administration et définissant sa responsabilité à l'égard des tiers, l'autre exigeant explicitement que ce soit une personne physique. Votre Commission a rejeté un amendement de M. Christian Cuvilliez visant à interdire le cumul entre les fonctions de président du conseil d'administration et celles de directeur général. Votre Rapporteur a retiré un amendement tendant à prévoir que les statuts pourront confier au conseil d'administration le choix de la dissociation ou du cumul, son auteur annonçant qu'il se ralliait à l'amendement de la commission des Lois, compte tenu d'un sous-amendement qu'il proposerait M. Philippe Auberger ayant souligné les risques de conflits entre organes dirigeants que risquait d'entraîner l'amendement (n° 12) de la commission des Lois tendant à permettre au directeur général d'intervenir dans l'organisation des travaux du conseil d'administration, cet amendement a été rejeté. Votre Commission a adopté un sous-amendement (n° 202) de votre Rapporteur relatif aux pouvoirs du conseil d'administration à un amendement (n° 13) de la Commission des lois rendant optionnelle la solution de la dissociation. Votre Commission a adopté l'amendement (n° 13) de la Commission des Lois, ainsi sous-amendé. Votre Commission a rejeté deux amendements identiques, l'un de M. Philippe Auberger, l'autre de M. François d'Aubert permettant au conseil de surveillance de ratifier a posteriori certaines décisions au lieu de leur donner une autorisation préalable, et deux autres également identiques, des mêmes auteurs, qui imposaient, en cas de fusion ou scission, la transmission universelle des cautions, avals et garanties. Enfin, votre Commission a rejeté deux amendements identiques des mêmes auteurs, visant à permettre, dans le cas d'émissions obligataires, la délégation des pouvoirs des conseils d'administration ou du directoire à d'autres personnes que des membres du conseil. Votre Commission a adopté l'article 56, ainsi modifié. * * * (Articles 115, 115-1, 116 et 117 de la loi du 24 juillet 1966) Rôles et statuts du directeur général Les sociétés commerciales dotées d'un conseil d'administration ont aujourd'hui un président de conseil d'administration qui est aussi directeur général, et un ou plusieurs directeurs généraux. Le présent article vise à modifier cette organisation en dissociant les fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général et en remplaçant les autres directeurs généraux par des directeurs généraux délégués dans le but de favoriser un meilleur équilibre des pouvoirs. A.- PRINCIPE DE LA DISSOCIATION DES FONCTIONS DITES EXÉCUTIVES DES FONCTIONS DE PRÉSIDENCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION L'article 113 de la loi du 24 juillet 1966 définit les pouvoirs du président du conseil d'administration qui assume la direction générale de la société ; l'article 115 rend possible la nomination, par le conseil d'administration, sur la proposition du président, de directeurs généraux. L'article 56 du présent projet de loi, définissant de manière restrictive les pouvoirs du président de conseil d'administration, tend à rendre obligatoire, sauf exception, la nomination d'un directeur général, qui sera unique, et prévoit, en outre, la possibilité de nommer des directeurs généraux délégués. 1.- Nomination obligatoire d'un directeur général, possibilité de mandater des directeurs généraux délégués Le nouvel article 115 tel que proposé dans le présent article commence par évoquer l'exception avant de définir la situation générale : le dispositif qu'il prévoit s'applique, « sauf dans le cas visé au deuxième alinéa de l'article 113 », c'est-à-dire sauf lorsque les statuts prévoient le cumul entre fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général. Dans ce dernier cas, un directeur général ne doit pas obligatoirement être nommé ; en revanche le reste du dispositif s'applique et le conseil d'administration peut mandater des directeurs généraux délégués, mais pas d'autres directeurs généraux que celui qui est en fait le président-directeur général. Donc, lorsque le cumul n'est pas prévu dans les statuts de la société, la nomination d'un directeur général par le conseil d'administration est obligatoire : ce doit être une personne physique, et il ne peut y avoir qu'un seul directeur général. Le conseil d'administration détermine aussi sa rémunération. La possibilité de mandater un ou plusieurs autres directeurs généraux pour assister le président est remplacée par celle de nommer un ou plusieurs directeurs généraux délégués pour assister le directeur général : le titre change mais la fonction reste la même, ainsi que le régime juridique. Ainsi, la nomination sera effectuée par le conseil d'administration sur proposition du directeur général, comme il l'était auparavant sur la proposition du président. L'article 115 de la loi du 24 juillet 1966 dispose que deux directeurs généraux peuvent être nommés, en plus du président, dans les sociétés dont le capital est au moins égal à 500.000 francs, et, depuis la loi n° 88-15 du 5 janvier 1988, qu'ils peuvent être cinq « dans les sociétés dont le capital est au moins égal à dix millions de francs à condition que trois d'entre eux au moins soient administrateurs ». Le présent article propose de simplifier le dispositif en supprimant ces seuils : le nombre de directeurs généraux délégués sera fixé dans les statuts, et ne pourra dépasser cinq. Liberté est donc laissée de choisir le nombre qui figurera dans les statuts, sans conditions de capital. De même, le conseil d'administration est libre de choisir un directeur général et des directeurs généraux délégués parmi les administrateurs ou hors du conseil d'administration. C'est ce qui justifie la disparition, à l'article 117, de la disposition selon laquelle lorsqu'un directeur général est administrateur, la durée de ses fonctions ne peut excéder celle de son mandat. Comme pour les directeurs généraux sous l'empire de la loi du 24 juillet 1966 actuellement en vigueur, et pour le directeur général tel que défini dans le présent projet, le conseil d'administration détermine la rémunération des directeurs généraux délégués. Votre Rapporteur approuve les objectifs et le principe de la dissociation ainsi proposée, en particulier en termes de rééquilibrage des pouvoirs et de fonctionnement plus démocratique des organes dirigeants. Cependant, dans la mesure où les statuts peuvent prévoir le cumul des fonctions, il s'interroge sur la portée pratique du principe fixé par la loi : les exceptions, qui se justifient notamment pour les petites sociétés, ne risquent-elles pas d'être plus nombreuses que les cas où le droit commun s'applique ? D'autre part, si l'actuel « président-directeur général » n'est plus que directeur général, ne sera-t-il pas tenté de faire élire une personnalité de second plan comme président du conseil d'administration, ce qui lui assurerait le maintien de fait de sa prépondérance ? Les expériences étrangères, en particuliers anglo-saxonnes, plaident-elles vraiment en faveur de la dissociation ? Votre Rapporteur, qui est favorable au principe de cette disposition si elle améliore effectivement le fonctionnement des organes dirigeants des sociétés, souhaite que le débat permette de répondre à ces différentes interrogations. C'est dans cette perspective qu'il est favorable à un amendement du projet qui rendrait plus souple le passage d'une forme d'organisation de la direction à l'autre, c'est-à-dire du cumul à la dissociation des fonctions ou de la dissociation au cumul. 2.- Limitation du cumul des mandats Afin de s'assurer de la disponibilité du personnel dirigeant, condition du sérieux de son travail, le présent article propose de compléter l'article 115 par une limitation du cumul des mandats de ces personnes. La loi du 24 juillet 1966, telle qu'elle est actuellement en vigueur, ne pose que peu de limites, et ces limites sont trop peu restrictives : · les articles 92, 136 et 151 disposent que nul ne peut appartenir simultanément à plus de huit conseils d'administration ou de surveillance de sociétés anonymes ayant leur siège social en France métropolitaine, la limitation ne s'appliquant pas aux représentants de personnes morales ; · les articles 111, 127 et 151 limitent à deux le nombre de sièges de président de conseil d'administration ou de membres du directoire ou de directeur général unique qui peuvent être occupés simultanément par une même personne physique. Mais aucune disposition ne recoupe ces deux catégories : par exemple, un directeur général, lui même membre du conseil d'administration de la société qu'il dirige, peut appartenir à sept autres conseils d'administration. Le présent article vise à limiter ce type de cumul : il dispose que nul ne peut exercer plus d'un mandat de directeur général, de membre du directoire ou de directeur général unique (c'est-à-dire membre unique du directoire) et quatre mandats d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français, le mandat d'administrateur éventuellement exercé par le directeur général dans la société qu'il dirige n'étant pas comptabilisé parmi les quatre autorisés. Ne sont donc plus comptées au titre du cumul, les seules sociétés ayant leur siège social sur le territoire métropolitain, mais aussi celles dont le siège est situé dans les départements d'outre-mer, les territoires d'outre-mer et les collectivités d'outre-mer à statut particulier. En effet, la possibilité, ouverte par les dispositions de l'article 59 du présent projet, de participer au vote du conseil d'administration par visioconférence facilite les mandatements par des entreprises situées outre-mer et supprime leur spécificité, due à la distance qui les sépare de la métropole. Les autres limitations font aussi l'objet de modifications par l'article 60 du présent projet. Comme pour les limitations déjà en vigueur, toute personne en infraction doit se démettre de l'un de ses mandats dans un délai de trois mois, faute de quoi elle perd son dernier mandat et doit restituer les rémunérations perçues à ce titre. La validité des délibérations auxquelles elle a pris part n'en est pas pourtant remise en question, afin de garantir la sécurité juridique des tiers. C'est aux membres du conseil d'administration eux-mêmes et aux actionnaires qu'il incombe de veiller au respect des limitations de cumul de mandats : cette tâche sera facilitée par les dispositions de l'article 64 du présent projet dont le dernier alinéa propose de rendre obligatoire la communication, aux actionnaires, de la liste de tous les mandats et fonctions exercées par les mandataires de la société. L'information est de toute façon disponible au registre du commerce. La vigilance de tous devrait être stimulée par la publicité fâcheuse qui ne manquerait pas d'entourer la découverte de cumuls illégaux, et par le fait qu'ils engagent la responsabilité des coupables. Il est à noter que ces règles de cumul ne prennent pas en compte les fonctions de directeur général délégué, car des règles les concernant n'apparaissent pas utiles. En effet, les directeurs généraux délégués sont des salariés dont les fonctions, a priori, sont trop prenantes pour qu'ils songent à exercer d'autres mandats ; de plus, ils succèdent aux directeurs généraux, tels que définis dans la loi actuellement en vigueur, qui ne sont pas, pour les mêmes raisons, soumis aux règles de cumul. Les articles 92 et 111 prévoient une série d'exceptions à la limitation du nombre des mandats : mandat exclusif de toute rémunération, sociétés d'étude ou de recherche, sociétés de développement régional, instituts régionaux de participation, groupes de sociétés, sociétés d'assurance. Dans le présent article, ces exceptions sont modifiées, dans un sens plus restrictif pour les limitations de cumuls préexistantes comme pour la limitation de cumul prévue par le présent article. Les seuls mandats qui ne sont pas pris en compte sont les mandats dans les sociétés contrôlées, au sens de l'article 357-1 de la loi du 24 juillet 1966, exercés par des représentants permanents d'une personne morale. Il s'agit de ceux qui « contrôlent de manière exclusive ou conjointe une ou plusieurs autres entreprises ou [qui] exercent une influence notable sur celles-ci », dans les conditions précisées par l'article 357-1. Cela signifie que seuls les mandats exercés dans une société ainsi contrôlée par une société dans laquelle est déjà exercé un mandat ne sont pas pris en compte dans le calcul du plafond. Cette restriction est donc beaucoup moins large que la série d'exceptions figurant aujourd'hui à l'article 92 car toute société, quel que soit son objet, doit être l'objet d'une attention égale de la part de ses mandataires. Elle retient néanmoins la définition de la filiale la moins restrictive (14), afin notamment d'intégrer parmi les exceptions les sociétés de capital-risque. Votre Rapporteur s'inquiète néanmoins des problèmes que ces règles de cumul restrictives pourraient poser à des dirigeants de sociétés de petite taille ou à des dirigeants de coopératives agricoles (notamment les coopératives d'utilisation du matériel agricole, les CUMA) qui cumulent des postes de direction dont ils possèdent le titre sans que ce dernier entraîne pour eux un volume de travail important. D'autre part, ces dispositions relatives au cumul n'ont guère leur place dans cet article 57 du présent projet de loi alors que l'article 60 est spécifiquement consacré à cette question. Afin de renforcer la cohérence du projet de loi, votre Rapporteur considère donc qu'il convient de supprimer les trois derniers alinéas du paragraphe I du présent article, consacrés à ces limitations de cumul, pour en réintroduire les dispositions à l'article 60. B.- LIMITE D'ÂGE ET CONDITIONS DE RÉVOCATION Le paragraphe II de l'article 57 du présent projet de loi étend aux « directeurs généraux délégués », dont la dénomination est créée par le paragraphe I, les limites d'âge qui s'appliquent actuellement aux directeurs généraux : c'est la suite logique du changement de titre. Cette limite est de soixante-cinq ans, sauf si les statuts en fixent une autre, toute nomination d'une personne plus âgée est nulle et toute personne qui atteint cet âge limite est démissionnaire d'office. Le paragraphe III modifie l'article 116 de la loi du 24 juillet 1966 qui définit les conditions de révocation des directeurs généraux : elles sont revues en partie et étendues aux directeurs généraux délégués. En cohérence avec l'unicité du directeur général définie au paragraphe I du présent article, la formule de l'article 116 sur la possibilité de révocation passe du pluriel au singulier : « le directeur général est révocable à tout moment par le conseil d'administration » (et non plus « les directeurs généraux ») mais elle subit deux changements majeurs : · alors que les directeurs généraux étaient révocables sur proposition du président, le président n'a plus aucune compétence pour ce qui concerne le directeur général, ce qui est cohérent avec la disparition du cumul entre fonctions exécutives et fonctions de président du conseil d'administration ; · alors que la révocation des directeurs généraux n'avait nullement à être motivée et n'était assortie d'aucune garantie pour les personnes révoquées, celle du directeur général donne désormais droit à dommages-intérêts si elle « est décidée sans juste motif »; cette garantie vaut aussi pour les directeurs généraux délégués, qui sont révoqués sur la proposition du directeur général. Ce deuxième point constitue une avancée considérable pour la sécurité des fonctions de direction. En effet, jusqu'ici, les directeurs généraux, comme le président du conseil d'administration, les administrateurs et les membres du conseil de surveillance, pouvaient être révoqués ad nutum, « sur un signe de tête », c'est-à-dire sans qu'il y ait forcément de raison susceptible de justifier leur révocation. Cette révocation ad nutum étant d'ordre public, elle ne pouvait être ni limitée ni supprimée et des dommages-intérêts ne pouvaient être obtenus que dans deux cas : si la révocation était entachée d'abus de droit, telle la brusquerie, une publicité malveillante, ou si, en violation avec le principe du contradictoire, le directeur général n'avait pas été en mesure de présenter ses observations. La garantie nouvelle proposée par le présent article, et qui vaut de la même manière pour les directeurs généraux délégués, existe déjà pour les membres du directoire (art.121, al.1 de la loi du 24 juillet 1966) pour lesquels elle a été introduite dans le droit français des sociétés anonymes par la loi du 24 juillet 1966, ainsi que pour les gérants de société en nom collectif et de société anonyme à responsabilité limitée. Elle est de nature à renforcer l'indépendance des directeurs généraux et délégués, comme cela a été le cas pour le directoire. La jurisprudence a donné des éléments de définition du « juste motif », qui s'apprécie pour les membres du directoire comme pour les deux autres types de dirigeants mentionnés plus haut. Par exemple, il y a « juste motif » lorsqu'une faute de gestion a été commise. Cette différence de traitement entre d'une part les administrateurs, le président du conseil d'administration et les membres du conseil de surveillance, toujours révocables sans garantie, et, d'autre part, les directeurs généraux, directeurs généraux délégués, membres du directoire et directeurs général unique mieux protégés, s'explique par leur mode de nomination : les premiers sont nommés directement par l'assemblée générale des actionnaires, alors que les seconds le sont par le conseil d'administration ou par le conseil de surveillance. Dans le cas où le président du conseil d'administration assure aussi les fonctions de directeur général, il pourra bénéficier de la nouvelle garantie s'il est révoqué de ses fonctions, conformément au deuxième alinéa de l'article 113 tel que modifié par l'article 56 du présent projet de loi. Enfin, le paragraphe III s'achève sur l'adaptation aux directeurs généraux délégués d'une disposition valant dans le droit actuel pour les directeurs généraux : comme c'était le cas pour ces derniers en situation de vacance de la présidence, les directeurs généraux délégués restent en poste, sauf décision contraire du conseil d'administration, en cas de vacance de la direction générale. C.- POUVOIRS DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ET DES DIRECTEURS GÉNÉRAUX DÉLÉGUÉS L'article 117 de la loi du 24 juillet 1966 est relatif aux pouvoirs des directeurs généraux : le paragraphe IV du présent article vise à le modifier, afin qu'il aborde les pouvoirs du directeur général et ceux des directeurs généraux délégués. Les premiers sont ceux qui reviennent actuellement au président du conseil administration lequel assume la direction générale ; les seconds sont calqués sur ceux des directeurs généraux actuels. 1.- Les pouvoirs du directeur général Le directeur général, désormais unique, se voit reconnaître, dans le présent article, les pouvoirs « exécutifs » que détient actuellement le président du conseil d'administration. Ainsi, les dispositions que le présent article propose de retirer de l'article 113 de la loi du 24 juillet 1966 seront reprises, sans modification de fond, dans l'article 117. Comme actuellement le président du conseil d'administration, le directeur général « est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société », les seules limites étant l'objet social de la société et les pouvoirs que la loi attribue « expressément » aux assemblées d'actionnaires et au conseil d'administration. Cette dernière formule est plus simple dans le présent article que dans l'article 113 en vigueur : ce dernier mentionne les pouvoirs « que la loi attribue expressément aux assemblées d'actionnaires ainsi que les pouvoirs qu'elle réserve de façon spéciale au conseil d'administration ». Il reprend donc la distinction entre les pouvoirs spéciaux réservés par la loi du 24 juillet 1966 au conseil d'administration (mise en place des organes sociaux, mesures nécessaires au bon fonctionnement des assemblées d'actionnaires, accords d'autorisations...) et le pouvoir général d'administration : en effet, les premiers ne peuvent être exercés que par le conseil d'administration lui-même, tandis que le pouvoir général chevauche en partie celui qui est dévolu au président du conseil d'administration. Avec la dissociation des fonctions de directeur général et de président du conseil d'administration, la distinction susmentionnée ne pose plus de problème : le directeur général n'ayant plus de rôle au sein du conseil d'administration, ses pouvoirs sont totalement distincts de ceux du conseil d'administration, qu'il s'agisse des pouvoirs spéciaux ou des pouvoirs généraux. Les deux alinéas suivants reprennent exactement des dispositions de l'actuel article 113 : le directeur général, comme l'actuel président du conseil d'administration, représente la société dans ses rapports avec les tiers et engage la société exactement dans les mêmes termes. Il est à noter que l'article 117, dans la rédaction qui est proposée par le présent projet de loi, ne mentionne pas le fait que, lorsqu'un directeur général est administrateur, la durée de ses fonctions ne peut excéder celle de son mandat. La disposition n'existe pas non plus en ce qui concerne les directeurs généraux délégués (voir infra). Votre Rapporteur constate que le champ des pouvoirs conférés au directeur général est susceptible de recouvrir une partie de ceux confiés au conseil d'administration. Pourtant, le même chevauchement entre pouvoirs du conseil d'administration et pouvoirs de « président-directeur général » n'ayant pas entraîné de difficultés dans la pratique, il est probable que celui-là ne pose pas non plus de problème. 2.- Les pouvoirs des directeurs généraux délégués Le II de l'article 117 de la loi du 24 juillet 1966 tel que rédigé par le paragraphe IV du présent article fixe les pouvoirs des directeurs généraux délégués : ce sont les mêmes que ceux que l'actuel article 117 attribue aux directeurs généraux. Le changement ne porte que sur une dénomination : le mot : « président » est remplacé par les mots :« directeur général ». A cela près, les pouvoirs délégués sont déterminés par le conseil d'administration, en accord avec le directeur général et sont identiques à l'égard des tiers, à ceux du directeur général. Leurs pouvoirs étant les mêmes que ceux du directeur général, il est logique que les directeurs généraux délégués soient soumis aux mêmes règles de responsabilité, ce que prévoit le V du présent article. D.- RESPONSABILITÉ DES DIRECTEURS GÉNÉRAUX DÉLÉGUÉS En outre, le paragraphe V du présent article crée, après l'article 489 de la loi du 24 juillet 1966, le dernier avant le titre III portant dispositions diverses et transitoires, une section VI « Dispositions concernant les directeurs généraux délégués des sociétés anonymes », comportant le seul article 489-1. Ce dernier vise à étendre aux directeurs généraux délégués, selon leurs attributions respectives, les dispositions des articles 432 à 485-1. Ces dispositions sont relatives aux infractions concernant les sociétés par actions (articles 432 à 479) et à celles communes aux diverses formes de sociétés commerciales (articles 480 à 485-1). Le régime qui s'applique aujourd'hui aux directeurs généraux vaudra pour les directeurs généraux délégués, ce qui est la conséquence de leur changement de titre, et donc parfaitement cohérent. * * * Votre Commission a rejeté deux amendements de M. François d'Aubert, le premier visant à imposer que le directeur général soit un administrateur de la société, le second précisant que les pouvoirs du directeur général proviennent d'une délégation du président du conseil d'administration. Elle a adopté un amendement (n° 217) de votre Rapporteur supprimant les dispositions relatives au cumul des mandats présentes à cet article, afin de les réintroduire sous une forme plus claire à l'article 60 consacré au cumul des mandats. L'adoption de cet amendement de suppression a fait tomber neuf amendements : - deux amendements de M. Philippe Auberger, le premier visant à permettre à une personne exerçant une fonction exécutive au sein d'une société d'exercer également six mandats d'administrateur, le second visant à exclure les sociétés non cotées des règles de cumul des mandats ; - un amendement (n° 15 rectifié) de la commission des Lois prévoyant la possibilité pour une personne exerçant une fonction exécutive d'exercer deux mandats de ce type dans des sociétés non cotées ; - un amendement de M. François d'Aubert visant à exclure des règles de cumul des mandats ceux exercés dans des sociétés non cotées ou au sein de groupes de sociétés, et un amendement semblable de M. Philippe Auberger ; - un amendement (n° 16 rectifié) de la commission des Lois visant à élargir la dérogation concernant les mandats exercés dans des sociétés contrôlées aux personnes physiques, tout en la limitant à dix mandats ; - un amendement de M. Jean-Pierre Balligand visant à assouplir les règles de cumul pour les sociétés affiliées à un organe central ; - deux amendements de M. Pierre Hériaud, l'un semblable à celui de M. Jean-Pierre Balligand, l'autre étendant la dérogation aux personnes physiques, dans le cas de sociétés contrôlées. M. Philippe Auberger a demandé à ce que ses trois amendements soient néanmoins présentés dans le cadre de l'article 60. Votre Commission a rejeté l'amendement de M. François d'Aubert visant à exclure les directeurs généraux délégués de la révocation ad nutum, puis, par cohérence, un amendement (n° 17) de la commission des Lois relatif à la possibilité pour le directeur général de demander la convocation du conseil d'administration. Elle a également rejeté un amendement (n° 18) de la commission des Lois qui tendait à soumettre à la responsabilité civile le directeur général et les directeurs généraux délégués, votre Rapporteur, en accord avec MM. Philippe Auberger et Jean-Jacques Jégou, ayant regretté la brutalité de la mise en application de cette disposition. Votre Commission a enfin rejeté un amendement de M. Michel Inchauspé visant à supprimer, pour les sociétés non cotées, l'obligation d'un rapport trimestriel présenté par le directoire au conseil de surveillance. Votre Commission a adopté l'article 57, ainsi modifié. * * * (Article 121 de la loi du 24 juillet 1966) Conditions de révocation des membres du directoire Le présent article vise à modifier les conditions de révocation des membres du directoire ou du directeur général unique en supprimant l'obligation de proposition par le conseil de surveillance mais en permettant à ce dernier, si les statuts le prévoient, d'exercer lui aussi le pouvoir de révocation. L'article 121 de la loi du 24 juillet 1966, tel qu'il est actuellement en vigueur, concerne les sociétés anonymes ayant un directoire et un conseil de surveillance et dispose que « les membres du directoire peuvent être révoqués par l'assemblée générale, sur proposition du conseil de surveillance ». Dans la mesure où ils sont nommés par le conseil de surveillance, le dispositif ne respecte pas le parallélisme des formes. Cela s'explique par la volonté du législateur, en 1966, de faire jouer à l'assemblée des actionnaires un rôle d'arbitre en cas de conflit entre le conseil de surveillance et le directoire. Le présent article procède à deux modifications : la première est rédactionnelle et consiste à préciser que ces conditions de révocation s'appliquent pour les membres du directoire, mais aussi pour le directeur général unique, ce qui est implicite puisqu'il est, par définition (art.120), le « membre » unique, qui exerce les fonctions du directoire dans une société dont le capital est inférieur à un million de francs et qui en a décidé ainsi. L'autre changement est nettement plus important puisqu'il concerne la procédure de révocation elle-même. Alors que la procédure est actuellement unique, il est proposé de la transformer et de donner au statut la possibilité d'ouvrir une deuxième voie : · la procédure « normale » serait la révocation par l'assemblée générale, sans que le conseil de surveillance ait à en faire la proposition ; · les statuts pourraient, en plus, prévoir que le conseil de surveillance ait aussi la possibilité de révoquer un membre du directoire. Chacun des deux organes pourrait ainsi révoquer un membre du directoire sans avoir à obtenir l'accord de l'autre : leur autonomie en serait accrue, même si cela pourrait entraîner des désaccords entre eux, désaccords qui doivent être limités par le fait que les membres du conseil de surveillance sont renouvelés par l'assemblée générale et nommés pour une durée inférieure ou égale à six ans (art.134 de la loi du 24 juillet 1966). Les nouvelles dispositions visent à modifier une procédure lourde et jugée peu efficace, qui favorisait le maintien du statu quo. Votre Rapporteur s'inquiète néanmoins du risque qu'il y a de fragiliser le directoire par la simplification des conditions de révocation de ces membres. Il faudrait éviter de fournir ainsi un argument aux détracteurs de la formule de société avec conseil de surveillance et directoire alors que ce modèle est estimé plus démocratique et mieux à même de défendre les droits des actionnaires de la société. Ce faisant, le présent article ne modifie pas la disposition selon laquelle une révocation décidée sans juste motif peut donner lieu à dommages-intérêts, ce qui est cohérent avec l'extension de cette possibilité au directeur général et aux directeurs généraux délégués des sociétés à conseil d'administration. * * * Votre Commisison a adopté l'article 58 sans modification. * * * Article 59 (Articles 100 et 139 de la loi du 24 juillet 1966) Possibilité pour le conseil d'administration et le conseil de surveillance de prendre certaines décisions par « visioconférence » Le présent article vise à assouplir la prise de décisions en permettant aux statuts de prévoir que certaines décisions du conseil d'administration ou du conseil de surveillance puissent être prises par « visioconférence », c'est-à-dire en présence « virtuelle » de certains de leurs membres. Cette possibilité ne concerne pas les décisions les plus importantes pour la société (élection du président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, comptes annuels ou comptes consolidés). L'actuel article 100 de la loi du 24 juillet 1966 fixe en la matière des règles de quorum assez strictes : « Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Toute clause contraire est réputée non écrite. « A moins que les statuts ne prévoient une majorité plus forte, les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. » Le paragraphe I du présent article vise à ouvrir la possibilité d'autoriser, dans les statuts, pour les conseils d'administration, la pratique de la « visioconférence » qui sera prise en compte aussi bien pour le calcul du quorum que pour celui de la majorité des votes. Les statuts ne pourront pas autoriser la visioconférence pour les décisions prévues aux articles 110, 115, 340 et 357-1 de la loi du 24 juillet 1966 : il s'agit respectivement de l'élection du président du conseil d'administration, de la révocation de ce dernier, de la nomination du directeur général et, le cas échéant, des directeurs généraux délégués, de l'établissement des comptes annuels et des comptes consolidés. Ces décisions, particulièrement importantes, continueront à ne pouvoir être prises que si 50 % des membres du conseil, c'est-à-dire le quorum, sont présents et seuls les votes des membres du conseil présents ou représentés seront pris en compte. Si les statuts le prévoient, les autres décisions pourront donc être prises « par des moyens de visioconférence » : en 1966, la loi exigeait la présence des membres ; la loi n° 67-559 du 12 juillet 1967 permettait que certains membres soient représentés (15) ; le présent article réalise donc un pas supplémentaire pour améliorer la souplesse de fonctionnement du conseil d'administration. Il est à noter que les statuts peuvent n'ouvrir cette possibilité qu'à une partie des décisions - ils peuvent donc ajouter d'autres interdictions à celles qui figurent dans le présent article -. Le présent article prévoit qu'un décret détermine les moyens de visioconférence utilisés dans ce cas ; conformément à l'article 508 de la loi du 24 juillet 1966 ce décret sera pris en Conseil d'État : il conviendra néanmoins de veiller à ce qu'il soit assez rigoureux pour éviter les faux de tous ordres. Pour plus de précision, votre Rapporteur vous propose de remplacer la formule « déterminés par décret » par « dont la nature et les conditions d'application sont déterminées pas décret » : en effet, le décret ne devra pas seulement préciser quels sont les moyens de visioconférence autorisés (vidéoconférence, visioconférence par internet...), c'est-à-dire leur nature, mais aussi dans quelles conditions ils peuvent être utilisés. Votre Rapporteur estime que l'ouverture d'une telle possibilité est un élément de souplesse tout-à-fait souhaitable dans la mesure où sa mise en _uvre ne pose de problèmes ni techniques ni juridiques. Le Gouvernement doit pouvoir donner toutes les garanties nécessaires à votre Assemblée sur ce point. Toutes les garanties sur la faisabilité étant acquises, la visioconférence apparaît comme un moyen très pratique de prise de décision, qui évitera notamment que le conseil d'administration ne profite de l'absence annoncée de l'un de ses membres pour l'exclure volontairement d'une délibération. La possibilité d'avoir recours à la visioconférence doit donc être largement ouverte. Or le fait que la possibilité de prendre certaines décisions par visioconférence soit soumise à modification des statuts apparaît très contraignant : il faudra auparavant réunir une assemblée générale extraordinaire et obtenir les conditions de quorum et de majorité nécessaires. Cet assouplissement des modalités de prise de décision sera donc conditionné à une décision initiale lourde à obtenir, alors qu'il devrait plutôt être une possibilité commune. Aussi semble-t-il préférable à votre Rapporteur de prévoir que cette possibilité soit de droit commun. Néanmoins, pour les entreprises, de taille plus modeste, le coût de la mise en place des moyens techniques nécessaires peut s'avérer trop élevé au regard de l'utilisation qui pourra en être faite ; aussi votre Rapporteur propose-t-il que cette possibilité soit ouverte, sauf disposition contraire des statuts, en renversant ainsi la logique de la décision initiale : ainsi, seule la volonté d'empêcher le vote par visioconférence, ou d'en limiter la portée au-delà de ce que le présent article dispose (voir supra), aura à figurer dans les statuts. La logique de cet alinéa serait, de ce fait, inversée afin d'offrir à tous la possibilité de plus de souplesse, sans qu'elle entraîne une dépense excessive et inutile pour les petites sociétés. Les détails de la mise en _uvre de la visioconférence figureront dans le règlement intérieur. Les dispositions susmentionnées sont relatives au conseil d'administration ; le même mécanisme est mis en place, par le paragraphe II du présent article, au bénéfice du conseil de surveillance, par la modification, selon un schéma identique, de l'article 139, qui transpose pour le conseil de surveillance les dispositions de l'article 100 applicable au conseil d'administration. Dans ce cas, comme dans le précédent, le présent article fixe une liste des décisions qui ne sauraient faire l'objet de visioconférence : il s'agit de celles prévues aux articles 120 et 138 de la loi du 24 juillet 1966, c'est-à-dire respectivement la nomination des membres du directoire et de son président et l'élection du président et du vice-président du conseil de surveillance. Ce sont donc, là encore, les décisions les plus importantes. Votre Rapporteur considère que les mêmes aménagements que ceux relatifs aux sociétés à conseil d'administration doivent être effectués, afin que la loi prévoie un décret plus précis et que la visioconférence soit de droit commun, sauf décision statutaire contraire. Enfin, il faut souligner qu'il est surprenant que les révocations de directeur général, directeur général délégué, membre du directoire ou directeur général unique (dans la mesure où les statuts ont accordé ce droit de révocation au conseil de surveillance, voir commentaire de l'article 58) ne fassent pas partie de ces exceptions : ce sont des décisions tout aussi importantes que les nominations, et le parallélisme des formes justifie une telle disposition. Votre Rapporteur estime donc nécessaire d'inclure ces révocations dans les décisions ne pouvant pas être prises par visioconférence. * * * M. Philippe Auberger ayant retiré un amendement ayant le même objet, votre Commission a adopté deux amendements (n° 218 et n° 219) de votre Rapporteur visant à rendre de droit commun la prise de décision par visioconférence au sein du conseil d'administration et du conseil de surveillance, sauf dispositions statutaires contraires. Votre Commission a ensuite rejeté deux amendements identiques de MM. Philippe Auberger et François d'Aubert, visant à autoriser la consultation écrite de membres du conseil d'administration, puis deux amendements rédactionnels identiques des mêmes auteurs. Votre Commission a ensuite adopté un amendement (n° 220) rédactionnel puis deux amendements (n° 221 et n° 222) de précision du Rapporteur. Votre Commission a enfin rejeté un amendement de M. Philippe Auberger précisant l'obligation de confidentialité, qui s'impose à l'ensemble des dirigeants de sociétés. Votre Commission a adopté l'article 59 ainsi modifié. * * * Limitation du cumul des mandats (Articles 92, 111, 127, 136 et 151 de la loi du 24 juillet 1966) Limitation du cumul des mandats sociaux Cet article modifie plusieurs dispositions de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, et tend à aménager le régime des cumuls des mandats sociaux. Actuellement, la loi dispose qu'une personne physique ne peut appartenir simultanément à plus de huit conseils d'administration (article 92 de la loi), plus de huit conseils de surveillance (article 136), plus de deux directoires (article 127). Le législateur a ainsi souhaité que les administrateurs se consacrent effectivement à leurs tâches, et voulu limiter les abus. Pour les membres de conseils d'administration, le calcul doit être effectué en tenant compte des fonctions de membre de conseil de surveillance. En revanche, rien n'interdit à une administrateur déjà pourvu de huit mandats d'exercer les fonctions de gérant d'une société en nom collectif, d'une société à responsabilité limitée ou d'une société en commandite, d'être nommé directeur général d'une ou plusieurs sociétés anonymes de type classique. Le dépassement du plafond déterminé à l'article 92 de la loi du 24 juillet 1966 ne conduit pas nécessairement à la nullité de la nomination au poste d'administrateur excédentaire. En effet, l'intéressé dispose d'un délai de trois mois à compter de cette dernière pour se démettre de l'un de ses autres postes d'administrateur. A défaut de régularisation dans ce délai, il est réputé démissionnaire du mandat excédentaire, le dernier en date, et doit restituer les rémunérations perçues à ce titre, sans que la validité des délibérations auxquelles il a pris part puisse être mise en cause. Le présent article renforce ce dispositif anti-cumul. Compte tenu d'abus de cumul de mandats sociaux notoires, qui ne peuvent qu'alimenter l'absentéisme, votre rapporteur y adhère pleinement. Quelle est la situation actuelle ? En 1998, d'après une enquête du cabinet KPMG, 446 personnes rassemblaient entre leurs mains 599 mandats de sociétés cotées au CAC 40. Chaque société du CAC 40 avait en moyenne des administrateurs communs avec quatre autres sociétés du CAC 40. Le cumul est frappant s'agissant des présidents de conseils d'administration, de conseils de surveillance, du directoire et gérant. Les 53 présidents des sociétés du CAC 40, soit 12% des mandataires du CAC 40 détenaient au total 135 mandats au sein du CAC 40. Autrement dit, outre leurs 53 mandats de président, ceux-ci détenaient 82 mandats dans une autre société du CAC 40. Parmi ces 82 mandats, 23 sont des mandats réciproques. On entend par mandat réciproque le fait que le président de la société X est mandataire de la société Y alors que le président de la société Y est mandataire de la société X. Un président de conseil d'administration, celui d'une très grande banque, est même président du directoire d'une autre grande banque et du conseil d'administration d'une troisième. Il exerce par ailleurs six mandats d'administrateur et un mandat de membre de conseil de surveillance d'importantes sociétés industrielles, commerciales et financières. Le projet de loi contribue assurément à assainir cette situation que votre Rapporteur juge anormale, archaïque voire dangereuse, et qui est justement critiquée par les observateurs étrangers. Sans doute, les données disponibles concernent-elles au premier chef les sociétés cotées. Votre Rapporteur reconnaît que celles-ci doivent faire l'objet de règles plus rigoureuses. Cependant, il s'interroge sur leur faisabilité, des petites entreprises ayant trop souvent le même statut que les grandes, celui des sociétés anonymes. Le paragraphe I propose une nouvelle rédaction de l'article 92. N'est plus prohibée l'« appartenance simultanée » à plusieurs conseils d'administration mais « l'exercice simultané » de plusieurs mandats d'administrateur de sociétés anonymes. Une personne physique représentant une personne morale pourrait donc se trouver concernée. Par ailleurs, les sociétés visées sont étendues à celles dont le siège est situé « sur le territoire français » et non plus limitées à celles qui ont leur siège « en France métropolitaine ». Sont donc uniquement exclus les postes dans des sociétés dont le siège se trouve à l'étranger. Les exceptions à la règle sont réduites et simplifiées. Notons d'emblée que la plupart des dirigeants des sociétés du CAC 40 ou du SBF 250 sont favorables à la limitation des exceptions. Actuellement, le plafond des huit postes d'administrateur cumulables peut être dépassé par les représentants permanents des personnes morales administrateurs, la limitation ne concernant que les personnes physiques. En outre, celle-ci n'est pas applicable aux administrateurs dont le mandat est exclusif de toute rémunération en vertu de dispositions législatives et réglementaires (quels que soient donc les statuts), aux administrateurs des sociétés d'études et de recherches tant qu'elles ne sont pas parvenues au stade de l'exploitation, aux sociétés de développement régional, aux instituts régionaux de participation à condition que les statuts excluent toute rémunération à ce titre. Les mandats d'administrateur de diverses sociétés d'assurances ayant la même dénomination ne comptent que pour un seul mandat. Ces exceptions ne se justifiant plus - chaque société a droit à toute l'attention nécessaire - le présent article ne prévoit plus qu'une exception destinée à prendre en compte la situation des groupes : l'exclusion des mandats comptabilisés des mandats d'administrateurs des sociétés contrôlées, au sens de l'article 357-1 de la loi du 24 juillet 1966, alors qu'aujourd'hui la loi permet aux administrateurs d'une société, même s'ils sont déjà titulaires de huit mandats, d'être également administrateurs, mais dans la limite de cinq mandats supplémentaires, d'autres sociétés dont le capital est détenu à concurrence de 20 % au moins par une société dont ils sont déjà administrateurs ou membres du directoire ou du conseil de surveillance. Dans la nouvelle rédaction de l'article 92 de la loi du 24 juillet 1966, toutes les filiales sont concernées. La notion de groupe retenue est celle prévue à l'article 357-1 de la loi du 24 juillet 1966. Elle est relativement large puisque sont prises en compte les sociétés qui subissent une « influence notable » d'une société mère. Pour le reste, le paragraphe I du présent article reprend le régime actuel des « sanctions » applicables en cas de dépassement de seuil. Le paragraphe II modifie l'article 111 de la loi du 24 juillet 1966. Celui-ci limite à deux le nombre de mandats de président de conseil d'administration de sociétés anonymes ayant leur siège social en France métropolitaine qu'il est possible d'exercer simultanément. Comme au paragraphe I, il est prévu de prendre en compte l'ensemble des sociétés ayant leur siège social « sur le territoire français ». Le paragraphe III rédige l'article 127 de la loi du 24 juillet 1966, et substitue, comme au paragraphe I, l'expression « Nul ne peut exercer » à l'expression "Nul ne peut appartenir", s'agissant du cumul de mandats de membre du directoire ou de directeur général unique de sociétés anonymes. En outre, il ne permet plus que l'exercice d'un seul mandat, et prend en compte non seulement les sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire métropolitain mais aussi celles qui ont leur siège outre-mer et, comme précédemment, l'existence des groupes, pour atténuer la rigueur de la nouvelle règle. Votre Rapporteur s'interroge sur l'impact de la rigueur du nouvel article 127 sur certaines petites et moyennes entreprises, notamment en milieu rural, où le cumul est assez fréquent. Le paragraphe IV rédige à nouveau l'article 136 de la loi du 24 juillet 1966, et procède aux mêmes aménagements qu'au paragraphe I, s'agissant du cumul des mandats de membre du conseil de surveillance, sans toutefois reproduire les deux derniers alinéas de l'article 92 relatifs à la procédure de démission d'office et au dispositif dérogatoire en faveur des groupes. Le paragraphe V tire les conséquences de la modification de l'article 127 opérée au paragraphe III, et supprime l'indication de son contenu -la limitation de l'appartenance simultanée à des directoires ou de l'exercice simultané des fonctions de directeur général unique - au deuxième alinéa de l'article 151 de la loi du 24 juillet 1966, relatif aux cumuls croisés. Votre Rapporteur considère, comme cela a été indiqué sous l'article 57, que les paragraphes présentés ci-dessus devraient être complétés, pour la clarté du texte, par les dispositions du projet de loi relatives au cumul des mandats qui figurent à l'article 57. Il n'en est pas nécessairement de même de l'article 64 du présent projet qui cependant complète utilement les dispositifs décrits ci-dessus en prévoyant que le rapport annuel présenté par le conseil d'administration à l'assemblée générale devra comprendre la liste de l'ensemble des mandats exercés par les mandataires sociaux. Ces dispositions tendent à faire juges les actionnaires de l'effectivité du travail de ces derniers. La liste peut servir d'élément de réflexion pour la désignation de nouveaux mandataires sociaux déjà pourvus de plusieurs mandats. Précisons enfin que les conditions d'entrée en vigueur du présent article sont fixées par le paragraphe II de l'article 70 du projet de loi. Celui-ci accorde aux mandataires sociaux dix-huit mois à compter de la publication de la loi pour se mettre en conformité avec les dispositions commentées ci-dessus. A défaut, ils seront réputés démissionnaires de tous leurs mandats. Faut-il aller plus loin ? Assurément, s'agissant des autres mandats exercés par les présidents de conseil d'administration, cas non traités par le projet de loi, alors que l'objectif de séparation des fonctions doit naturellement leur être appliqué. Assurément aussi sur le cumul de sièges d'administrateur. L'exercice de cinq mandats, au lieu de huit, paraît un maximum raisonnable. Par ailleurs, votre Rapporteur a fourni plus haut des données sur les mandats dits réciproques. Il se demande s'il ne serait pas nécessaire de limiter au moins le cumul des mandats sociaux exercés au sein de sociétés concurrentes. Celui-ci peut aboutir dans certains cas à des situations de blocage calamiteuses voire caricaturales. L'affaire BNP-Société générale-Paribas est encore dans toutes les mémoires. Le débat doit être l'occasion pour le Gouvernement de faire part de ses réflexions sur l'incompatibilité qui peut naître de l'appartenance aux structures décisionnelles de sociétés directement et publiquement rivales. Pour le secteur public, la loi du 24 juillet 1966 s'applique, s'agissant des sociétés anonymes, mais elle est d'ores et déjà renforcée par les dispositions de la loi du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du service public. La limitation des cumuls s'applique en effet à toutes les sociétés anonymes donc à celles où l'État détient des participations, où l'État est présent dans les conseils d'administration ou de surveillance. Pour les établissements publics industriels et commerciaux de l'État, certaines sociétés figurant sur une liste, comme la Banque française du commerce extérieur, les entreprises nationales, sociétés nationales, sociétés d'économie mixte ou sociétés anonymes dans lesquelles l'État détient directement plus de la moitié du capital social ainsi que les sociétés à forme mutuelle nationalisées, les membres des conseils d'administration ou de surveillance, représentant l'État, sont soumis à des règles plus strictes. Ils ne peuvent appartenir simultanément à plus de quatre conseils. L'article 11 de la loi du 26 juillet 1983 précitée prévoit que ceux qui se trouvent en infraction avec les dispositions ci-dessus doivent, dans les trois mois de leur accession à un nouveau mandat, se démettre de l'un de leurs mandats. A défaut et à l'expiration de ce délai, ils sont réputés s'être démis de leur nouveau mandat. * * * Après avoir adopté un amendement (n° 223) rédactionnel de votre Rapporteur, votre Commission a rejeté un amendement de M. Jean-Pierre Brard, tendant à limiter le cumul de mandats d'administrateur de sociétés anonymes à deux, et adopté deux amendements identiques de votre Rapporteur (n° 224) et de la commission des Lois (n° 19), tendant à faire passer le nombre de mandats d'administrateur pouvant être exercés simultanément par une même personne de huit à cinq. MM. Philippe Auberger et Jean-Jacques Jégou ont estimé cette nouvelle limitation trop stricte, le premier évoquant le cas des groupes familiaux, le second celui des sociétés non cotées. Votre Commission a adopté un amendement de votre Rapporteur (n° 225) tendant à limiter à dix le nombre de mandats d'administrateur représentant permanent d'une personne morale dans les sociétés contrôlées. Ce faisant, l'amendement (n° 20) de la commission des Lois ayant un objet voisin, et l'amendement de M. Pierre Hériaud étendant la dérogation à la règle du cumul aux mandats exercés par des personnes physiques au sein des groupes sont devenus sans objet. M. Jean-Louis Dumont, soutenant un amendement de M. Jean-Pierre Balligand, et M. Jean-Jacques Jégou ont présenté des propositions identiques tendant à moduler le champ des dérogations à la règle de cumul en fonction du montant des participations détenues par des sociétés affiliées à des organes centraux, afin de tenir compte des particularités des banques coopératives. Après que votre Rapporteur eût estimé les amendements intéressants mais devant être étudiés plus en détail, M. Jean-Louis Dumont a retiré l'amendement qu'il défendait et la Commission a rejeté l'amendement de M. Jean-Jacques Jégou, en attendant un nouvel examen dans le cadre de l'article 88 du Règlement. Votre Commission a rejeté un amendement de M. Jean-Pierre Brard visant à n'autoriser l'exercice que d'un mandat de président de conseil d'administration de sociétés anonymes. Elle a adopté un amendement (n° 226) de votre Rapporteur tirant les conséquences de la suppression des multiples dérogations à la limitation du cumul des mandats et précisant la procédure en cas d'infractions à la règle relative au cumul de mandats de président de conseil d'administration, M. Michel Inchauspé s'interrogeant sur les règles de cumul finalement applicables aux présidents de conseil d'administration. Elle a adopté un amendement (n° 227) de votre Rapporteur tendant à réinsérer sous un article nouveau de la loi du 24 juillet 1966 la limitation du cumul de mandats de directeur général prévue par l'article 57 du projet de loi au II de l'article 115 de ladite loi. Elle a rejeté un amendement (n° 21) de la commission des Lois relatif au cumul de mandats de membre du directoire ou de directeur général unique et de mandats d'administrateur, le sujet devant être traité dans la partie de la loi du 24juillet 1966 consacrée aux cumuls croisés. Elle a rejeté l'amendement (n° 64) de M. Jean-Paul Charié prévoyant un assouplissement de la règle relative au cumul de mandats de direction en faveur des sociétés réalisant un chiffre d'affaires inférieur à un certain seuil, votre Rapporteur ayant indiqué que l'amendement faisait appel à une donnée fluctuante, celle du chiffre d'affaires, et que l'amendement (n° 22) de la commission des Lois répondait à la préoccupation exprimée par plusieurs commissaires, puisqu'il permettait l'exercice de deux mandats de direction au sein de sociétés dont les titres ne sont pas admis sur un marché réglementé, tout en laissant la limitation à un mandat prévue par le projet de loi pour les autres. Votre Commission a adopté l'amendement (n° 22) de la commission des Lois. M. Philippe Auberger a regretté que l'amendement ne concerne que les mandats de direction et non les mandats d'administrateur. Votre Commission a adopté un amendement (n° 228) de conséquence de votre Rapporteur. Elle a adopté un amendement (n° 229) de votre Rapporteur supprimant des dispositions devenues sans objet, le mandat de direction ne pouvant être exercé par des représentants permanents de personnes morales au sein des sociétés duales. L'amendement (n° 23) rectifié de la commission des Lois et l'amendement de M. Pierre Hériaud relatifs aux cumuls croisés au sein des groupes sont alors devenus sans objet. La Commission a rejeté, par cohérence, les amendements identiques de MM. Jean-Pierre Balligand et Pierre Hériaud, relatifs au cumul de mandats de direction dans les sociétés duales appartenant à des réseaux d'établissements de crédit coopératif. La Commission a adopté un amendement rédactionnel (n° 230) de votre Rapporteur. Elle a rejeté un amendement présenté par M. Jean-Pierre Brard abaissant le nombre de mandats de membre de conseil de surveillance de sociétés anonymes cumulables de huit à deux, et adopté les amendements identiques de votre Rapporteur et (n° 24) de la commission des Lois le faisant passer à cinq, M. Philippe Auberger jugeant cette nouvelle limitation excessive. Votre Commission a adopté un amendement (n° 232) de votre Rapporteur évitant un renvoi à un autre article, dans l'esprit des travaux de la commission supérieure de codification. Elle a rejeté l'amendement de conséquence (n° 25) de la commission des Lois supprimant le V de l'article, considérant qu'il n'était pas en cohérence avec un autre amendement de ladite commission maintenant le nombre maximal de mandats de direction pouvant être exercés simultanément dans les sociétés duales à un lorsque celles-ci sont cotées. Votre Commission a adopté un amendement (n° 233) de votre Rapporteur reprenant le contenu du II de l'article 115 tel que rédigé à l'article 57 du projet. Elle a adopté un amendement (n° 234) de votre Rapporteur créant un article spécifique dans la loi du 24 juillet 1966 relatif aux cumuls croisés, et limitant le nombre de mandats d'administrateur à quatre pour les personnes exerçant déjà un mandat de président de conseil d'administration, les sous-amendements de M. Philippe Auberger proposant d'assouplir la règle - six mandats au lieu de quatre -, de limiter les règles de cumul aux sociétés cotées, et de ne pas tenir compte, dans la comptabilisation des mandats, de ceux exercés au sein d'un groupe, ayant été rejetés. Votre Commission a ensuite adopté l'article 60, ainsi modifié. * * Prévention des conflits d'intérêts (Articles 101, 143, 262-11, 102, 144, 103, 145 et 262-12 Extension du régime d'autorisation des conventions Pour l'essentiel, le présent article étend la procédure d'autorisation des conventions passées entre une société et l'un de ses dirigeants, et assure une plus grande transparence des conventions dites libres. Il est à craindre que lorsqu'un dirigeant contracte avec sa société, il abuse de sa position pour obtenir des avantages exorbitants. Toutefois, d'un autre côté, le contrat peut être utile à la société, et intéressant pour les deux parties, ou tout simplement ne pas porter atteinte aux intérêts de la société. La loi du 24 juillet 1966 a donc prévu trois régimes différents qu'il convient de rappeler brièvement. Il existe des conventions interdites, des conventions libres et des conventions réglementées. Sont interdites certaines conventions liées au crédit. Il est interdit par exemple à un administrateur ou à un directeur général de contracter sous quelque forme que ce soit des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, de faire cautionner ou avaliser par elle ses engagements envers des tiers (article 106 de la loi du 24 juillet 1966). L'interdiction n'est pas applicable lorsque l'administrateur est une personne morale, lorsqu'un prêt est consenti par la société à un administrateur élu par les salariés, lorsque la société exploite un établissement bancaire ou financier, à la condition qu'il s'agisse d'opérations courantes de commerce conclues à des conditions normales. Les emprunts, découverts, avals ou garanties irrégulièrement contractés sont nuls. Sont libres, en revanche, les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales (article 102 de la loi du 24 juillet 1966), la jurisprudence ayant précisé le contenu de ces deux expressions. Le texte est d'application courante pour les ventes, fournitures et prestations de services. Il n'a pas donné lieu à trop de difficultés. Les conventions réglementées, c'est-à-dire toutes les autres, connaissent un régime de contrôle lequel est prévu à l'article 101 de la loi du 24 juillet 1966. La procédure s'applique aussi bien à une vente, à un bail qu'à une concession de locaux. Elle s'applique aux modifications d'une convention conclue antérieurement, par exemple à l'augmentation substantielle du salaire d'un administrateur régulièrement lié à la société par un contrat de travail. Les dispositions législatives concernent bien évidemment les conventions directes (les actes n'ayant pas de caractère conventionnel n'étant pas soumis à la procédure), mais aussi les conventions indirectes ou par personne interposée, et les conventions conclues par la société avec une autre société ou entreprise lorsque les cocontractants ont des dirigeants communs. Le contrôle est applicable lorsque l'administrateur, ou le directeur général, est, sans être personnellement partie au contrat, indirectement intéressé à celui-ci. Il convient de préciser que la procédure ne s'applique que là où existe une convention, écrite ou verbale, c'est-à-dire un accord de volontés créant, modifiant ou éteignant un rapport de droit. Les actes sans caractère conventionnel sont exclus. La procédure ne s'applique pas à une fusion entre sociétés ayant des administrateurs communs, car les autres garanties légales prévues pour cette opération doivent suffire. De même, elle ne joue pas pour les rémunérations du président et des directeurs généraux fixées par le conseil, ni pour les jetons de présence des administrateurs déterminés par l'assemblée générale des actionnaires dans la mesure où ces rémunérations sont moins contractuelles qu'institutionnelles. L'article 64 du présent projet prévoit des mesures de transparence particulières en la matière. La procédure relative aux conventions dites réglementées comporte cinq étapes : - information du conseil d'administration ; - autorisation donnée par le conseil ; - avis aux commissaires aux comptes des conventions autorisées, dans le délai d'un mois à compter de la conclusion desdites conventions ; - rapport spécial des commissaires aux comptes ; - et, enfin, consultation de l'assemblée générale, après audition du rapport spécial des commissaires aux comptes. Si cette procédure n'a pas été respectée, la convention n'est pas nécessairement nulle. La nullité n'est en effet prononcée que si la convention n'a pas été préalablement autorisée, et si elle a eu des conséquences dommageables pour la société (article 105 de la loi du 24 juillet 1966). Si l'autorisation préalable du conseil a été obtenue, les vices ultérieurs de la procédure n'entraînent pas la nullité de la convention. La seule sanction est alors la responsabilité personnelle de l'administrateur, qui doit réparer le préjudice subi par la société. Si l'assemblée n'approuve pas la convention, il en est de même. Le présent article comporte huit paragraphes qui modifient les régimes des conventions ci-dessus décrits. Le paragraphe I rédige l'article 101 de la loi du 24 juillet 1966. Il étend le régime de l'autorisation aux conventions entre une société, l'un de ses directeurs généraux délégués ou l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article 355-1 de la loi du 24 juillet 1966. L'objet du dernier alinéa de l'article 101 précité est également étendu dans le même esprit puisque le régime de l'autorisation des conventions passées entre une société et une entreprise devra concerner celles qui font intervenir des directeurs généraux délégués ou plus généralement un « dirigeant » de cette entreprise. Rappelons que le titre de directeur général délégué est créé à l'article 57 du présent projet ; il est porté par les personnes qui ont pour mandat d'assister le directeur général. Votre Rapporteur considère que le pourcentage, sus-mentionné, de 10 % est significatif, mais abaissé à 5% il le resterait encore dans des sociétés au capital très dilué. Il observe d'ailleurs que les sociétés du SBF 250 sont favorables à ce dernier seuil. Le paragraphe II rédige l'article 143 de la loi du 24 juillet 1966 et procède aux mêmes extensions s'agissant des sociétés dualistes, comportant directoire et conseil de surveillance. Aussi une convention intervenant entre une société et un actionnaire disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article 355-1 de la loi du 24 juillet 1966 devra-t-elle être autorisée par le conseil de surveillance. De même, devra être autorisée une convention entre la société et une entreprise « dirigée » par un membre du directoire ou du conseil de surveillance de la société. Le paragraphe III rédige le premier alinéa de l'article 262-11 de la loi du 24 juillet 1966. Il étend, s'agissant des conventions réglementées dans les sociétés par actions simplifiées, le contenu du rapport que le commissaire aux comptes doit présenter aux associés aux conventions intervenues entre la société et l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits supérieurs à 10 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article 355-1. Le paragraphe IV complète l'article 102 de la loi du 24 juillet 1966, lequel dispose que les conventions au sein des sociétés anonymes, portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales ne sont pas soumises à la procédure d'autorisation, afin que les conventions dites libres puissent être transparentes. Il est prévu, d'une part, que les conventions soient communiquées au président du conseil d'administration et, d'autre part, que la liste et l'objet en soient communiqués aux autres membres du conseil d'administration. Votre rapporteur constate que les professionnels s'inquiètent de l'ampleur qu'auront, en pratique, les listes de conventions. Mais il note que toutes les conventions sont publiées en annexe des comptes aux États-Unis et au Royaume-Uni. L'effort de transparence ne devrait pas être hors de portée en France. Ne retenir que les conventions « significatives » laisserait une marge d'incertitude source de difficultés. Cependant les modalités proposées mériteraient d'être aménagées afin de mieux distinguer le rôle des dirigeants et celui des commissaires aux comptes. Le paragraphe V procède aux mêmes avancées que le paragraphe IV s'agissant des sociétés dualistes, et modifie l'article 144 de la loi du 24 juillet 1966. Le paragraphe VI modifie l'article 103 de la loi du précitée, et prolonge le contenu du paragraphe IV en prévoyant que le commissaire aux comptes reçoit du président du conseil d'administration les conventions « libres » qui lui ont été communiquées. Le paragraphe VII complète l'article 145 de la loi précitée, dans le même esprit, et concerne les sociétés dualistes. Le paragraphe VIII abroge l'article 262-12 de la loi précitée, lequel dispose que le commissaire aux comptes n'a pas à présenter aux associés des sociétés par actions simplifiées les conventions entre la société et un président ou ses dirigeants portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales. Ces dernières feront donc partie du rapport des commissaires aux comptes sur les conventions intervenues, directement ou par personne interposée, entre la société et un président ou ses dirigeants, les associés devant statuer sur ce rapport. * * * Votre Commission a examiné deux amendements identiques de MM. Philippe Auberger et François d'Aubert tendant à restreindre le champ du régime des conventions réglementées à celles qui ont une incidence significative sur l'activité, le chiffre d'affaires ou le résultat de la société. Votre Rapporteur a fait observer que la notion d'« incidence significative » ne pourrait qu'être source de difficultés d'interprétation et, surtout, que les amendements revenaient en arrière puisque le régime actuel des conventions réglementées n'est nullement limité aux conventions qualifiées de « significatives ». M. Jean-Jacques Jégou a considéré que le caractère significatif d'une convention dépendait de son objet, puis la Commission a rejeté les amendements de MM. Philippe Auberger et François d'Aubert. Votre Commission a examiné un amendement de M. François d'Aubert tendant à restreindre le champ du régime des conventions devant être autorisées, rejeté au profit de deux amendements identiques de votre Rapporteur (n° 235) et (n° 26) de la commission des Lois l'étendant, au contraire, aux conventions intervenant entre une société et l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 5 %. Le Président Henri Emmanuelli et votre Rapporteur ont fait observer que le droit des sociétés devait en effet s'adapter au phénomène massif de diffusion du capital des sociétés. Elle a adopté deux amendements rédactionnels identiques de votre Rapporteur (n° 236 et n° 27) de la commission des Lois, rejeté un amendement de précision de M. Philippe Auberger relatif au régime des conventions intervenant entre une société et une entreprise ayant des dirigeants communs, adopté un amendement (n° 237) de votre Rapporteur indiquant que ces conventions devaient être autorisées quel que soit le statut de l'entreprise et l'intitulé des fonctions de direction exercées au sein de celle-ci. Votre Commission a adopté l'amendement (n° 28) de la commission des Lois étendant aux entreprises aux sociétés en commandite par action les dispositions modifiant le champ d'application des conventions réglementées applicables aux sociétés anonymes. Elle a rejeté deux amendements identiques de MM. Philippe Auberger et François d'Aubert supprimant les dispositions du projet de loi relatives à la transparence des conventions non réglementées. Votre Commission a adopté deux amendements (n° 239) de votre Rapporteur relatifs aux modalités de communication de ces conventions, les amendements (n° 29 et 30) de la commission des Lois limitant cette communication aux conventions ayant une importance significative devenant sans objet. Votre Commission a adopté les amendements de coordination (n° 31, 32, 33 et 34) de la commission des Lois. Elle a enfin adopté l'article 61, ainsi modifié. * * * Article additionnel après l'article 61 (Article 29 ter de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable Régime des conventions entre les personnes morales et leurs administrateurs Votre Rapporteur a présenté un amendement portant article additionnel et prévoyant des mesures de transparence des conventions intervenant entre des personnes morales et l'un de leurs administrateurs ou personnes assurant un rôle de mandataire social dans le but d'y soumettre les associations. Une telle mesure est réclamée par les associations elles-mêmes afin d'éviter des dérives du type de celles qu'a connues l'Association pour la recherche contre le cancer. M. Jean-Louis Dumont a indiqué que l'amendement correspondait à une suggestion figurant dans un rapport de M. Harlem Désir présenté au Conseil économique et social. Votre Commission a adopté l'amendement (n° 240). (Articles 225, 226-1, 227 et 226 de la loi du 24 juillet 1966) Extension des droits des actionnaires minoritaires Chacun s'accorde à reconnaître que les actionnaires ne jouent pas en France le rôle qui devrait être le leur. Les réflexions en la matière sont anciennes, mais le développement de la capitalisation de la place financière de Paris détenue par des actionnaires individuels - près du tiers au total -, et certaines affaires comme celles du Crédit Lyonnais ou d'Eurotunnel rendent certaines réformes indispensables. En effet, ces investisseurs individuels ont droit à la même considération que les investisseurs institutionnels. Sans doute existe-t-il des associations d'actionnaires. Toutefois, il faut convenir qu'elles ont quelques difficultés à se constituer, peut-être en raison des règles qui encadrent leur création, et de leurs pouvoirs qui ne sont guère supérieurs à ceux que la loi reconnaît aux actionnaires minoritaires, certainement à cause du faible goût des actionnaires français pour l'action collective. Elles regroupent des actionnaires d'une même société cotée, dès lors qu'ils peuvent justifier d'une inscription nominative depuis au moins deux ans, et détiennent ensemble au moins 5 % des droits de vote, ce pourcentage étant dégressif en fonction du capital de la société (article 172-1 de la loi du 24 juillet 1966). Elles doivent communiquer leurs statuts à la société et à la Commission des opérations de bourse. Elles peuvent convoquer l'assemblée générale, requérir l'inscription à l'ordre du jour de projets de résolution, demander la récusation pour juste motif d'un ou plusieurs commissaires aux comptes, demander en justice la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion, poser par écrit deux fois par exercice, des questions au président du conseil d'administration ou au directoire sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation, demander à ce que les commissaires aux comptes soient relevés de leurs fonctions, par décision de justice, avant l'expiration de leur mandat, et enfin intenter une action sociale en responsabilité contre les administrateurs. Le présent article ne modifie pas le régime des associations d'actionnaires, mais complète les droits des actionnaires minoritaires qui ne sont pas regroupés au sein d'associations, ne peuvent l'être, ou parce qu'elles n'existent pas et qu'il est trop long de les créer afin d'agir ou d'obtenir certaines informations rapidement, ou parce qu'il s'agit de sociétés non cotées, ou enfin parce que les critères pour la création d'associations ne sont pas satisfaits (inscription nominative depuis au moins deux ans). Il ne remet pas en cause le principe, à vrai dire incontournable, selon lequel la société fonctionne selon la loi de la majorité. La minorité sera toujours la minorité. Mais la majorité n'est pas la totalité. L'article tend donc simplement à accroître les droits des actionnaires minoritaires, notamment les droits à l'information. De la sorte, il renforce la prévention des difficultés des entreprises, une mauvaise information pouvant masquer des opérations irrégulières ou une mauvaise gestion. Plus précisément, le présent article modifie les articles 225 à 227 de la loi du 24 juillet 1966, relatifs au contrôle des sociétés anonymes. Le paragraphe I abaisse le seuil au-delà duquel un ou plusieurs actionnaires peuvent : - demander en justice la récusation, pour juste motif, d'un ou plusieurs commissaires aux comptes désignés par l'assemblée générale (article 225 de la loi précitée) ; - poser par écrit, deux fois par exercice, des questions au président du conseil d'administration ou au directoire sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation (article 226-1) ; - demander à la justice de relever de leurs fonctions les commissaires aux comptes en cas de faute ou d'empêchement, avant l'expiration normale de ces fonctions (article 227). Pour exercer ces droits, les actionnaires doivent aujourd'hui représenter au moins un dixième du capital social. Il est proposé de faire passer ce seuil à 5 %. C'est un seuil, pourtant significatif, qui permet actuellement aux actionnaires minoritaires de requérir l'inscription de projets de résolution à l'ordre du jour des assemblées générales ou d'exercer l'action sociale entre les administrateurs (articles 160 et 245 de la loi du 24 juillet 1966), pouvoirs assez limités. Le paragraphe II modifie le premier alinéa de l'article 226 de la loi du 24 juillet 1966, qui vise à prévenir les abus de majorité. Il étend les droits à l'information des actionnaires pour les opérations de gestion des sociétés anonymes, et allège la procédure. A l'heure actuelle, un ou plusieurs actionnaires représentant au moins le dixième du capital social peuvent demander en justice la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion. Le présent article propose d'abaisser le seuil permettant aux actionnaires minoritaires d'obtenir des informations sur ces opérations, dans le même esprit qu'au paragraphe I. Il suffirait qu'ils représentent au moins 5 % du capital social. Il est proposé, en outre, de substituer à la demande de rapport d'expertise une procédure plus simple et plus directe de questions écrites au président du conseil d'administration ou au directoire. La justice n'est plus le point de passage obligé ; ce faisant, le débat sur la gestion de la société est opportunément réintroduit dans celle-ci. Ce n'est qu'à défaut de réponse dans le délai d'un mois ou à défaut de communication d'éléments de réponse satisfaisants, que le juge sera amené à désigner un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion. Les questions, nécessairement écrites, pourraient être posées à n'importe quel moment de l'exercice, contrairement aux questions « sur les faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation » prévues à l'article 226-1 de la loi du 24 juillet 1966. Cependant, la rédaction proposée conduit, sans doute involontairement, compte tenu du libellé actuel du deuxième alinéa de l'article 226 de la loi du 24 juillet 1966, à permettre au ministère public et à la Commission des opérations de bourse, dans certains cas, de poser des questions sur la gestion des sociétés. Votre Rapporteur considère que, compte tenu de ce qui précède, cette faculté ne serait pas opportune, et, en conséquence, que le deuxième alinéa sus-mentionné doit être modifié pour n'ouvrir le droit au questionnement qu'aux éléments internes de la société, dont le comité d'entreprise. Il est à noter, par ailleurs, que le champ des informations susceptibles d'être obtenues est élargi par le présent paragraphe, puisque les actionnaires minoritaires pourront poser des questions non seulement sur des opérations de la société dont ils sont actionnaires, mais aussi des sociétés contrôlées au sens de l'article 355-1, sens plus restrictif qu'à l'article 357-1 de la loi du 24 juillet 1966. L'article 355-1 précité dispose qu'une société est considérée comme en contrôlant une autre : « - lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ; « - lorsqu'elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société ; « - lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société. « Elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu'elle dispose, directement ou indirectement, d'une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient, directement ou indirectement, une fraction supérieure à la sienne. » Il s'agit là d'une heureuse initiative qui prend en compte le phénomène des groupes. La mission de l'expert éventuellement désigné par le juge pourra donc s'étendre aux sociétés du groupe, ce que la jurisprudence ne permet pas pour l'instant (16). S'agit-il d'extensions de droits excessives ? A l'évidence, non. Observons tout d'abord que le présent article ne fait qu'élargir des droits ouverts par ailleurs aux comités d'entreprise, au ministère public, à la Commission des opérations de bourse et aux associations d'actionnaires s'agissant de la récusation de commissaires aux comptes ou de la demande d'informations sur la gestion, ainsi qu'aux associations d'actionnaires s'agissant des questions sur les faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation, et au conseil d'administration, au directoire et au comité d'entreprise s'agissant du renvoi de commissaires aux comptes pour faute ou empêchement. Constatons ensuite que ces droits sont encadrés par certaines dispositions législatives, existantes ou proposées, et la jurisprudence. Tout d'abord, la demande de récusation de commissaires aux comptes (article 225 de la loi du 24 juillet 1966) reste soumise à l'exigence de justes motifs, et c'est toujours la justice qui se prononce. La demande d'information sur la gestion (article 226), ensuite, doit être appréciée, si elle vise des filiales, au regard de « l'intérêt du groupe » (cf. deuxième alinéa du paragraphe II du présent article). Si les demandes, qu'elles visent la société ou ses filiales, ne sont point satisfaites, la justice est saisie. Or, la loi actuelle dispose que c'est celle-ci qui détermine l'étendue de la mission et des pouvoirs des experts. La jurisprudence exige pour sa part que les demandeurs fournissent des présomptions d'irrégularité affectant une ou plusieurs opérations de gestion déterminées, et des présomptions suffisantes de nature à établir l'utilité de l'expertise. Tel n'est pas le cas, par exemple, des opérations courantes conclues à des conditions normales. La notion d'opération de gestion a même été précisée. Il s'agit d'actes accomplis par les dirigeants, par exemple de projets d'acquisitions de locaux. Une reprise d'entreprise par ses salariés n'est pas un acte de gestion, de même qu'une cession d'actions par des actionnaires à un tiers effectuée en dehors de toute intervention des organes de gestion ou que les actes qui ressortissent de la compétence exclusive des assemblées générales. Les questions sur les faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation (article 226-1) doivent avoir un objet précis, et ne peuvent être formulées que deux fois par an. La révocation du commissaire aux comptes (article 227) ne peut quant à elle être prononcée que par décision de justice, et seulement en cas de faute ou d'empêchement, ce qui garantit les commissaires aux comptes contre les tentatives de rénovation abusives. Il convient d'ajouter enfin que les sociétés sont protégées par la jurisprudence relative aux abus des minoritaires. Les comportements susceptibles de porter atteinte aux intérêts de la société peuvent être sanctionnés sur le terrain judiciaire lorsqu'ils sont constitutifs d'abus de droit. La réparation des abus peut consister en l'octroi de dommages-intérêts. Au total, le présent article fait donc progresser les légitimes droits des actionnaires minoritaires, sans remettre en cause le principe du « gouvernement des sociétés » par la majorité. Faut-il aller plus loin ? Votre Rapporteur considère qu'il n'y a pas lieu d'exclure de l'abaissement de seuil le dispositif prévoyant le droit des actionnaires minoritaires de demander la désignation en justice d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale des actionnaires (article 158 de la loi du 24 juillet 1966) ainsi que le dispositif leur permettant de demander la liquidation légale de la société au président du tribunal de commerce (article 402 de la loi du 24 juillet 1966). * * * Votre Commission a adopté un amendement rédactionnel de votre Rapporteur (n° 241) rendant sans objet l'amendement (n° 35) de la commission des Lois, abaissant le seuil nécessaire pour ouvrir droit, pour les actionnaires minoritaires, de demander en justice la convocation d'une assemblée générale. Elle a adopté un amendement (n° 242) plus extensif de votre Rapporteur permettant non seulement aux actionnaires représentant au moins 5 % du capital social de demander la désignation en justice d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale des actionnaires mais aussi de demander la liquidation légale de la société au président du tribunal de commerce. Votre Commission a rejeté un amendement de M. Gilbert Gantier limitant le champ d'application du nouveau dispositif permettant à des actionnaires minoritaires de poser des questions écrites sur une ou plusieurs opérations de gestion des sociétés. Elle a adopté un amendement (n° 243) de votre Rapporteur étendant ce droit aux associations d'actionnaires minoritaires et aux comités d'entreprise. L'amendement (n° 36) de la commission des Lois limitant cette extension aux associations est alors devenu sans objet. Votre Commission a adopté un amendement (n° 244) de votre Rapporteur supprimant une précision inutile. L'amendement (n° 37) de la commission des Lois relatif à la nouvelle procédure applicable à l'expertise de gestion a été rejeté au profit de l'amendement de votre Rapporteur aménageant les dispositions de la loi du 24 juillet 1966 ayant trait aux droits pour le ministère public et la Commission des opérations de bourse de demander une expertise de gestion. Elle a adopté un amendement (n° 245) de votre Rapporteur tirant les conséquences de l'amendement n° 242. Votre Commission a adopté l'article 62, ainsi modifié. * * * (Articles 161-1 et 165 de la loi du 24 juillet 1966) Participation aux assemblées générales Le présent article a un double objet : - donner aux actionnaires, sous condition d'une modification préalable des statuts de la société, la possibilité de participer aux assemblées générales par des moyens de télécommunication déterminés par décret ; - supprimer la possibilité de subordonner à un nombre minimal d'actions le droit d'accès à l'assemblée générale ordinaire. A.- LA PARTICIPATION AUX ASSEMBLÉES PAR DES MOYENS DE TÉLÉCOMMUNICATION En modifiant l'article 161-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 relatif au vote par correspondance, le paragraphe I du présent article crée une seconde exception à l'obligation de présence ou de représentation imposée aux actionnaires pour pouvoir participer aux assemblées générales. En l'état actuel du droit, seul le vote par correspondance permet aux actionnaires de participer aux assemblées sans être présents ou représentés. Le présent article ajoute la possibilité d'une participation par des moyens de télécommunication. Le 1° du paragraphe I regroupe sous un même paragraphe les dispositions de l'article 161-1 de la loi du 24 juillet 1966 relatives au vote par correspondance. Pour mémoire, on rappellera que le vote par correspondance est un droit pour les actionnaires, quelle que soit la nature de l'assemblée. Toute clause statutaire contraire à ce droit est réputée non écrite. En application du décret n° 67-236 du 23 mars 1967, le formulaire de vote par correspondance est adressé à tout actionnaire qui en fait la demande ou lui est directement remis - en particulier lorsque lui est adressée une formule de procuration - accompagné notamment du texte des résolutions. Le formulaire doit offrir à l'actionnaire la possibilité, sur chaque résolution, soit de voter dans un sens favorable ou défavorable, soit de s'abstenir. L'article 161-1 de loi du 24 juillet 1966 précise les règles de calcul du quorum et de la majorité de manière à tirer les conséquences de la possibilité de voter par correspondance. Ne sont pris en compte dans le calcul du quorum que les formulaires qui ont été reçus par la société avant la réunion de l'assemblée. D'autre part, les formulaires ne donnant aucun sens de vote ou exprimant une abstention sont considérés comme des votes négatifs. Le 2° du paragraphe I du présent article complète l'article 161-1 par un nouveau paragraphe créant, sous réserve d'une modification préalable des statuts de la société, la possibilité de participer aux assemblées par des moyens de télécommunication et modifiant en conséquence les règles de calcul du quorum et de la majorité. La participation par des moyens de télécommunication est offerte à toute société anonyme ou en commandite par actions. Comme le vote par correspondance, elle est ouverte à toutes les assemblées, qu'elles soient ordinaires, extraordinaires ou spéciales. En revanche, à la différence des dispositions relatives au vote par correspondance, le présent article vise la participation aux assemblées et non les seules opérations de vote. Il ne se limite pas à une reconnaissance législative de la possibilité du vote électronique, mais ouvre l'utilisation des moyens de télécommunication pour chacune des phases des assemblées, et notamment pour les débats. De ce point de vue, contrairement au vote par correspondance qui offre la possibilité de voter sans participation aux débats, le présent article ne porte pas atteinte au principe délibératif qui fonde l'organisation des assemblées. En visant les moyens de télécommunication, le présent article revêt une portée très large. Ces moyens sont en effet susceptibles d'inclure : - le recours au téléphone ; - l'utilisation de la télécopie ; - la visioconférence, par ailleurs introduite, pour la participation aux séances des conseils d'administration et de surveillance, à l'article 59 du présent projet. Cette technique permettrait aux actionnaires, par le réseau téléphonique ou par celui d'internet, d'être présents aux assemblées en apparaissant sur un écran. Elle ne serait adaptée que pour les assemblées réunissant un nombre limité d'actionnaires ; - la télétransmission des interventions et des votes des actionnaires qui seraient ainsi complètement « dématérialisés », puisqu'ils n'apparaîtraient plus sur un écran, mais s'exprimeraient par le biais de supports électroniques. Votre Rapporteur juge inopportun de définir aussi largement les supports susceptibles d'être utilisés en assemblée générale d'actionnaires. Le vote par téléphone ou par télécopie n'offre pas les garanties de sécurité et de fiabilité suffisantes. C'est pourquoi il serait préférable de ne viser que : - la visioconférence introduite par le présent projet au sein des réunions des conseils d'administration et de surveillance ; - la notion de supports électroniques utilisée, comme on verra plus loin, par la loi n° 2000-230 du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l'information et relative à la signature électronique. Le présent article modifie les règles de calcul du quorum et de la majorité pour tenir compte des nouvelles modalités de participation aux assemblées qu'il propose de créer. Ces règles sont actuellement déterminées par les articles 153, 155 et 156 de la loi du 24 juillet 1966 qui fixent des quorums et des majorités différents selon la nature de l'assemblée, mais ont en commun de ne prendre en compte que les actionnaires présents ou représentés. Afin de lever toute difficulté d'interprétation, le présent article propose d'assimiler aux actionnaires présents ceux qui participent aux assemblées par des moyens de télécommunication. L'utilisation du dispositif proposé est soumise à une modification préalable des statuts de la société. Cette condition a indéniablement un effet restrictif. Le vote d'une clause statutaire suppose qu'une assemblée extraordinaire soit convoquée, que soit atteint un quorum du tiers des actionnaires sur première convocation, puis du quart sur deuxième convocation, et qu'enfin une majorité des deux tiers des présents ou représentés se prononce en faveur de la résolution. Contrairement au vote par correspondance, la participation aux assemblées par des moyens de télécommunication n'est donc pas un droit pour les actionnaires. Les difficultés juridiques et techniques soulevées par le présent article et l'incertitude qui pourrait peser sur les capacités financières de certaines sociétés à mettre en place le dispositif proposé justifient cependant une modification préalable des statuts. Il est en effet souhaitable que l'introduction des nouvelles technologies dans l'organisation des assemblées soit précédée d'une étude de faisabilité et de coût dont les conclusions pourraient être présentées devant l'assemblée générale extraordinaire, et soumise à l'accord d'une majorité renforcée des actionnaires. 2.- Les difficultés d'application L'introduction des nouvelles technologies dans l'organisation des assemblées générales d'actionnaires est susceptible de remédier au manque chronique de participation observé au sein des sociétés françaises. Seuls 5 % des actionnaires français assistent aux assemblées générales et plus de la moitié déclarent ne jamais voter. Cette désaffection développe l'usage des pouvoirs en blanc qui favorise les organes dirigeants en place. Faute de connaître un autre actionnaire à qui donner procuration, chaque actionnaire a tendance à renvoyer le formulaire de procuration sans indication du nom du mandataire. La collecte de ces pouvoirs en blanc permet d'atteindre le quorum, mais transfère au président de l'assemblée le vote attaché aux procurations. L'article 161 de la loi du 24 juillet 1966 précise en effet que, pour toute procuration d'un actionnaire sans indication de mandataire, le président de l'assemblée émet un vote favorable à l'adoption des projets de résolution présentés ou agréés par le conseil d'administration, et un vote défavorable à l'adoption de tous les autres projets de résolution. Actuellement, pour émettre un vote hostile, un actionnaire qui ne peut pas participer à l'assemblée doit donc soit trouver un mandataire dont il est sûr du vote, soit recourir au vote par correspondance. L'ouverture des assemblées aux technologies de l'information offre indéniablement aux actionnaires une nouvelle possibilité d'user de leurs droits. Il n'en reste pas moins que le dispositif proposé soulève des difficultés d'application à la fois juridiques et techniques. La participation aux assemblées générales par des moyens de télécommunication suppose que soit juridiquement fondée la force probante de l'écrit et de la signature électroniques. Au niveau européen, le projet de directive du Parlement et du Conseil pour les signatures électroniques et les services de certification définit la signature électronique comme étant « une signature sous forme numérique intégrée, jointe ou liée logiquement à des données ». En droit interne, la loi n° 2000-230 du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l'information et relative à la signature électronique fixe une réglementation générale qui donne un fondement juridique au dispositif proposé par le présent article. Cette loi introduit en effet un nouvel article 1316-3 dans le code civil qui reconnaît à l'écrit sur support électronique la même force probante que l'écrit sur support papier. Elle définit la signature électronique comme consistant « en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle se rattache ». L'application de la force probante de la signature électronique aux assemblées générales d'actionnaires se heurte à des difficultés techniques propres au droit des sociétés. La preuve de la qualité d'actionnaire et du nombre d'actions disposant du droit de vote n'est pas toujours aisément établie, notamment pour les actionnaires détenant des titres au porteur dont le compte est tenu par un intermédiaire financier et dont la société ignore par conséquent l'identité et le nombre d'actions. Par ailleurs, le nombre de voix attachées à un titre varie d'une action à l'autre, le droit français autorisant le vote double, les possibilités de privation du droit de vote pour certaines actions et les limitations du nombre de voix par actionnaire. En outre, la légalité des débats et des votes en assemblée générale suppose que soient respectées des règles particulièrement difficiles à transcrire dans une procédure de participation virtuelle aux délibérations : obligation d'offrir la possibilité de voter à bulletin secret, de voter par résolution, de maintenir le quorum pendant toute la durée de l'assemblée, de faire émarger les présents sur la feuille de présence ... L'Association nationale des sociétés par actions (ANSA) a confié à un groupe de travail le soin d'étudier les possibilités d'application des moyens de télétransmission aux assemblées générales d'actionnaires. Daté de janvier 2000, le rapport de ce groupe de travail conclut à la faisabilité d'une telle utilisation. Il distingue trois applications différentes des nouvelles technologies. - la simple retransmission de la réunion sur un site ouvert : Cette technique, déjà utilisée par plusieurs sociétés cotées, consiste en une simple retransmission sans intervention possible de l'actionnaire. Elle ne soulève pas de difficulté juridique particulière, si ce n'est le fait de donner à une réunion d'actionnaires un caractère public, ce que, d'après l'ANSA, aucune disposition n'interdit. - la participation aux débats de l'assemblée générale par des moyens de télétransmission : Il s'agit de donner aux actionnaires la faculté de participer aux débats en s'exprimant à distance par des supports électroniques. Cette faculté doit cependant être réservée aux seuls actionnaires et chaque participant doit être en situation de suivre l'intégralité des débats, ce qui implique la retransmission simultanée, sur le lieu même de la réunion comme sur le site électronique, de l'intégralité des interventions. En outre, le bureau de l'assemblée doit être en mesure de donner et de retirer la parole, d'ouvrir et de clore les débats et de mettre aux voix les résolutions et les amendements. Pour répondre à ces impératifs, l'ANSA préconise la mise au point de « cartes d'admission électronique », préalablement adressées aux actionnaires qui en font la demande afin de procéder, avant la réunion, aux vérifications nécessaires. Ces cartes affectent aux intéressés des numéros de code leur ouvrant l'accès aux débats. - le vote à distance par des moyens de télétransmission : Le vote électronique implique des opérations complexes. Outre la vérification du nombre de voix attachées à chaque action, il convient de s'assurer que l'actionnaire n'a pas préalablement émis un vote par le biais d'un autre système. Par ailleurs, la feuille de présence ne pourra être établie qu'au fur et à mesure de la réception des votes électroniques. L'ANSA recommande la confection de « bulletins électroniques » comportant la signature électronique de l'actionnaire et l'indication soit de ses choix de vote, résolution par résolution, soit de l'instruction donnée à un tiers. Ces bulletins sont introduits dans une « urne électronique » précédée d'un « sas protecteur », c'est-à-dire d'un ordinateur distinct chargé d'assurer la sécurité du scrutin (protection contre les virus et les opérations de piratage ou de sabotage) et d'enregistrer la signature de l'expéditeur. L'urne proprement dite effectue le comptage des voix et des votes, et édite la feuille de présence. La faisabilité de ces solutions techniques doit faire l'objet d'un examen approfondi au moment de la préparation du décret d'application du présent article. C'est pourquoi votre Rapporteur propose de renvoyer au décret non seulement la définition de la nature des moyens de télécommunication que les sociétés pourront utiliser lors de leurs assemblées, mais aussi la détermination des conditions d'utilisation de ces moyens. B.- LA SUPPRESSION DE LA POSSIBILITÉ DE SUBORDONNER À UN NOMBRE MINIMAL D'ACTIONS LE DROIT D'ACCÈS À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE Le paragraphe II du présent article abroge l'article 165 de la loi du 24 juillet 1966 qui prévoit la possibilité d'exiger, par disposition statutaire, un nombre minimal d'actions pour ouvrir le droit de participer aux assemblées générales ordinaires. L'article 165 limite cette possibilité en précisant que le nombre minimal exigé ne peut pas être supérieur à dix. En outre, il ouvre aux actionnaires propriétaires d'un nombre d'actions inférieur à celui requis la possibilité de se réunir pour atteindre le minimum statutaire. Ces actionnaires ont également la possibilité de se faire représenter par l'un d'eux ou par le conjoint de l'un d'eux. Même s'il ne vise que les assemblées générales ordinaires, l'article 165 est une entorse aux droits des actionnaires. En premier lieu, il limite leur possibilité d'accès aux assemblées et par conséquent leur droit de participer aux débats et de voter. En second lieu, il prive les petits porteurs de l'usage individuel du droit d'information dont dispose tout actionnaire. Le dernier alinéa de l'article 138 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 prévoit en effet que, si les statuts subordonnent le droit d'accès à l'assemblée à un nombre minimal d'actions, les documents et les renseignements compris dans le droit d'information des actionnaires ne sont envoyés qu'au représentant du groupe d'actionnaires réunissant le nombre d'actions requis. Compte tenu de la désaffection des assemblées générales, la restriction prévue à l'article 165 est inopportune. En outre, elle est en contradiction avec le dispositif proposé par le présent article pour ouvrir les assemblées aux technologies d'information. Il conviendrait cependant de tirer les conséquences de l'abrogation proposée en supprimant, à l'article 95 de la loi du 24 juillet 1966, la référence à la limitation jusqu'à présent ouverte par l'article 165. L'article 95 de la loi du 24 juillet 1966 prévoit que les statuts de la société fixent le nombre minimal d'actions dont un actionnaire doit être propriétaire pour pouvoir être administrateur. Pour les sociétés qui usent de la possibilité ouverte par l'article 165 de la même loi, ce nombre est déterminé selon les règles suivantes : - pour les administrateurs de « droit commun », le nombre minimal d'actions exigé ne peut pas être inférieur à celui requis pour ouvrir aux actionnaires le droit de participer à l'assemblée générale ordinaire ; - pour les administrateurs représentants les salariés en application de l'article 93-1 de loi précitée, le nombre minimal d'actions exigé est égal à celui requis pour ouvrir aux actionnaires le droit de participer à l'assemblée générale ordinaire. Ces règles doivent être modifiées afin de tenir compte de la suppression, proposée par le présent article, de la possibilité de subordonner à un nombre minimal d'actions l'accès à l'assemblée générale ordinaire. Votre Rapporteur propose le dispositif suivant : - s'agissant des actionnaires de « droit commun », le nombre minimal d'actions exigées pour devenir administrateur doit pouvoir être librement fixé par les statuts, sans obligation de respecter un seuil ; - s'agissant des actionnaires salariés visés à l'article 93-1, il convient, pour assurer une meilleure participation des salariés à l'administration de la société, de supprimer la possibilité de subordonner leur accès au conseil d'administration à un nombre minimal d'actions. * * * Votre Commission a adopté deux amendements (n° 246 et 247) de votre Rapporteur, le premier visant à restreindre la nature des techniques susceptibles d'être utilisées en assemblée générale d'actionnaires, et le second renvoyant au décret la détermination des conditions d'application de ces techniques, votre Rapporteur ayant souligné qu'il convient d'exclure la possibilité de participer aux assemblées par téléphone ou par télécopie. Elle a également adopté un amendement (n° 248) de votre Rapporteur supprimant, d'une part, le seuil imposé au nombre minimal d'actions requis par les statuts pour devenir administrateur, et, d'autre part, la possibilité de subordonner à la détention d'un nombre minimal d'actions l'accès des salariés actionnaires au conseil d'administration. M. Jean-Pierre Brard a considéré que cette mesure permet d'assurer une meilleure participation des salariés à l'administration des sociétés et qu'il s'agit donc d'une première contribution à la réforme de l'épargne salariale. En conséquence, un amendement (n° 38) de la Commission des lois modifiant les règles de calcul du nombre minimal d'actions requis par les statuts pour devenir administrateurs est devenu sans objet. Votre Commission a ensuite adopté l'article 63, ainsi modifié. * * * (Article 157-3 (nouveau) de la loi du 24 juillet 1966) Information des actionnaires Le présent article a pour objet d'inclure dans le rapport de gestion présenté à l'assemblée générale ordinaire des informations sur les rémunérations et avantages versés aux mandataires sociaux et sur les mandats et fonctions qu'ils exercent. Il insère en effet dans la loi n°66-537 du 24 juillet 1966 un article 157-3 qui prévoit que le rapport présenté par le conseil d'administration, ou le directoire, à l'assemblée générale ordinaire comprend : - un compte rendu sur la rémunération totale et sur les avantages de toute nature versés à chaque mandataire social durant l'exercice ; - l'indication du montant des rémunérations et des avantages de toute nature que chacun de ces mandataires a reçus de la part des sociétés contrôlées au sens de l'article 355-1 ; - la liste de l'ensemble des mandats et fonctions exercés par les mandataires sociaux de la société. A.- LES RÈGLES ACTUELLES La loi du 24 juillet 1966 donne aux organes dirigeants de la société une prééminence dans la nomination des mandataires sociaux et la fixation de leurs rémunérations, sans laisser aux actionnaires un réel droit à l'information. L'intervention des actionnaires en matière de désignation et de rémunération des mandataires sociaux se limite à la nomination des membres du conseil d'administration et du conseil de surveillance, ainsi qu'à la fixation du montant global des jetons de présence destinés aux membres du premier de ces deux organes. Si l'assemblée générale des actionnaires nomme les administrateurs et arrête le montant global des jetons de présence, elle ne maîtrise pas l'utilisation de cette somme, puisque les jetons sont librement répartis par le conseil d'administration entre ses membres (article 108 de la loi du 24 juillet 1966 et premier alinéa de l'article 93 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967). En outre, le conseil d'administration peut allouer aux administrateurs des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats qui leur sont confiés (article 109 de la loi du 24 juillet 1966). Il peut également autoriser le remboursement des frais de voyage et de déplacement, ainsi que des dépenses engagées par les administrateurs dans l'intérêt de la société (deuxième alinéa de l'article 93 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967). De plus, c'est le conseil d'administration lui-même qui élit parmi ses membres son président et détermine sa rémunération (article 110 de la loi du 24 juillet 1966). Quant aux directeurs généraux, ils sont nécessairement nommés par le conseil d'administration qui fixe leur rémunération (article 115 de la loi du 24 juillet 1966). L'article 57 du présent projet donne également au conseil d'administration la possibilité de désigner, sur proposition du directeur général, un ou plusieurs directeurs généraux délégués. Si les membres du conseil de surveillance sont nommés par l'assemblée générale, la rémunération de leur président et de leur vice-président est déterminée par le conseil lui-même (articles 134 et 138 de la loi du 24 juillet 1966). Pour leur part, les membres du directoire sont nommés par le conseil de surveillance, qui confère à l'un d'eux la qualité de président, l'acte de nomination fixant le mode et le montant de leur rémunération (articles 120 et 123 de la loi du 24 juillet 1966). S'agissant par ailleurs des membres des comités créés par le conseil d'administration en application de l'article 90 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967, leur nomination et leur rémunération restent une prérogative exclusive du conseil. De manière générale, la confidentialité de rémunérations décrites ci-dessus est garantie par le fait qu'elles échappent à la procédure de contrôle prévue aux articles 101 et suivants de la loi du 24 juillet 1966. A l'exception de la rétribution des mandats spéciaux confiés aux administrateurs, les rémunérations des dirigeants sont en effet assimilées à des opérations courantes et ne constituent pas des conventions réglementées soumises à l'autorisation préalable du conseil d'administration et à la présentation à l'assemblée d'un rapport spécial des commissaires aux comptes. En l'état actuel de notre droit, il n'existe aucune obligation d'information nominative des actionnaires sur les rémunérations, mandats et fonctions des mandataires sociaux. En effet, la définition du contenu des rapports présentés à l'assemblée générale ordinaire ne prévoit pas une telle information : - le rapport de gestion du conseil d'administration ou du directoire doit présenter la situation et l'activité de la société durant l'exercice écoulé. Défini par l'article 148 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967, son contenu ne comporte pas d'information sur les rémunérations et les fonctions des mandataires ; - le rapport des commissaires aux comptes relate l'accomplissement de leur mission de certification, de vérification et de contrôle. Prévue à l'article 228 de la loi du 24 juillet 1966, cette mission ne porte pas sur la rémunération et les fonctions des mandataires sociaux. Les comptes consolidés présentés par le conseil d'administration ou le directoire à l'assemblée générale comprennent, en application de l'article 248-12 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967, une annexe qui indique : - le montant des rémunérations allouées, au titre de l'exercice, aux membres des organes d'administration, de direction et de surveillance de la société consolidante, à raison de leurs fonctions dans les entreprises contrôlées au sens de l'article 357-1 de la loi du 24 juillet 1966 ; - le montant des avances et crédits accordés aux membres de ces organes par la société consolidante et par les entreprises contrôlées, avec indication des conditions consenties ; - le montant des engagements en matière de pensions et indemnités assimilées dont bénéficient les anciens membres de ces organes. Cependant, ces informations sont données de manière globale pour les membres de chacun des organes concernés et ne permettent donc pas d'avoir des indications nominatives. Par ailleurs, l'obligation de consolidation comptable comprend plusieurs exemptions et ne vise que les sociétés qui contrôlent de manière exclusive ou conjointe une ou plusieurs autres entreprises, ou qui exercent une influence notable sur celles-ci. Echappent donc à l'obligation de consolidation des rémunérations les sociétés qui ne remplissent pas ces conditions. Les actionnaires peuvent avoir accès aux rémunérations et fonctions des mandataires sociaux en usant de leurs droits de consultation. En application de l'article 168 de la loi du 24 juillet 1966, tout actionnaire a droit d'obtenir communication de la liste des administrateurs, des membres du directoire et du conseil de surveillance, ainsi que du montant global des rémunérations versées, selon l'effectif de la société, aux dix ou cinq personnes les mieux rémunérées. Ces droits de consultation n'offrent cependant qu'une information partielle. En effet, l'article 168 de la loi de 1966 vise l'identité des principaux dirigeants de la société, mais n'oblige pas à préciser les mandats et les fonctions qu'ils exercent. En outre, l'énumération des personnes listées ne recouvre pas l'ensemble des mandataires sociaux. En outre, la consultation des plus grosses rémunérations ne donne accès qu'à un montant global et ne vise pas nécessairement les mandataires sociaux, certains des salariés les mieux rémunérés pouvant ne pas être mandataires. S'agissant enfin des plans d'options sur actions, l'assemblée générale ordinaire est informée annuellement du nombre, du prix, des bénéficiaires des options consenties et des options exercées (article 174-20 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967), mais cette information est présentée globalement sans précision nominative des bénéficiaires et du montant des options attribuées. L'absence d'obligation d'information nominative sur les rémunérations et les fonctions des mandataires sociaux est considérée par certains comme une source de conflits d'intérêts. Elle entretient en effet la suspicion sur la capacité des dirigeants à fixer leurs rémunérations de manière à rendre compatibles leurs intérêts personnels avec ceux des investisseurs. La transparence et la discussion de la rémunération des dirigeants sont donc devenues, à côté de la dualité du pouvoir au sein du conseil d'administration, un des principes de base du gouvernement d'entreprise, comme en témoignent des exemples récents. Plusieurs pays ont indéniablement pris de l'avance en instituant la transparence des rémunérations des dirigeants d'entreprise. Aux États-Unis, la Security Exchange Commission a rendu obligatoire la publication, dans les rapports annuels soumis aux assemblées d'actionnaires, de la rémunération annuelle de chacun des membres du conseil d'administration, y compris les éléments variables, les avantages en nature, les cotisations de retraite et les stock-options. Après les vagues de privatisations organisées par les gouvernements conservateurs de Mme Margaret Thatcher, le Royaume-Uni a connu de très forts accroissements de salaires et une attribution d'un nombre important de stock-options. Ces pratiques ont justifié la publication du rapport de Sir Richard Greensbury dont les recommandations sont devenues des normes observées par l'ensemble des sociétés cotées. Ainsi, le rapport annuel des sociétés britanniques doit comporter, pour chaque dirigeant, la décomposition de sa rémunération globale en salaires proprement dits (partie fixe et partie variable), en bonus et plans d'attribution de stock-options dont les paramètres (volumes, calendrier, prix d'exercice) doivent être définis, quantifiés et justifiés, ainsi qu'en avantages en nature, régimes de retraite et indemnités payées en cas de départ de l'entreprise. En France, la transparence des rémunérations se heurte à la réticence de nos compatriotes à dévoiler leur niveau de fortune. Les conditions dans lesquelles a été publiée, en plein conflit social au sein de la société PSA, la feuille d'imposition de M. Jacques Calvet continuent d'influer sur l'attitude des grands patrons français. De même, ces derniers gardent à l'esprit la polémique née de la publication du montant des indemnités et des options sur actions consenties à M. Philippe Jaffré au moment de son départ de la présidence d'ELF. La spécificité des pratiques françaises a cependant récemment suscité un débat au sein des représentants du patronat et poussé certains dirigeants à plaider en faveur de la transparence. La publication au cours de l'été 1999 du second rapport de M. Marc Viénot a donné lieu, au sein du MEDEF et de l'AFEP, à des prises de position très divergentes. Les mêmes organismes ont annoncé en janvier 2000 une opération vérité, en incitant les sociétés cotées à publier à l'avenir l'ensemble des revenus de leurs dirigeants. M. Ernest-Antoine Seillière, président du MEDEF et de la CGIP, a devancé cette recommandation en publiant, le 29 mars dernier, la rémunération annuelle nette qu'il a perçue en 1999 (comprenant les salaires, les avantages en nature et les jetons de présence), ainsi que les plus-values latentes, nettes d'impôt, qu'il détenait, au 31 décembre 1999, par le biais de stock-options. D'autres patrons français ont pris, à titre individuel, des initiatives allant dans le même sens. Depuis plusieurs années, M. Claude Bébéar, président du directoire de la société AXA, communique sa rémunération. De même, M. Patrick Ponsolle a divulgué sa rémunération de président d'Eurotunnel pour se conformer aux règles en vigueur outre-Manche. Plus récemment, M. Jean Peyrelevade, président du Crédit lyonnais, a dévoilé le montant de la rémunération fixe et proportionnelle au chiffre d'affaires versée aux membres du comité exécutif de la banque, le total des options de souscription d'actions attribuées à ces membres, ainsi que la répartition individuelle de ces trois rémunérations. Plusieurs investisseurs internationaux, et notamment les fonds de pension américains, ont adopté sur la question de la transparence des rémunérations une attitude encore plus exigeante. Certains d'entre eux considèrent en effet justifié que les actionnaires puissent donner un avis sur l'adéquation des rémunérations avec les performances de l'entreprise, à partir d'un calcul confié à un organe indépendant et incluant les revenus et avantages reçus des filiales, y compris celles qui ne sont ni cotées ni contrôlées. Le débat a donc dépassé la seule question de la publication des rémunérations et porte actuellement sur le point de savoir si celles-ci doivent être votées par l'assemblée générale des actionnaires. B.- LE DISPOSITIF PROPOSÉ Le présent article propose d'instituer une obligation d'information nominative de l'assemblée générale ordinaire sur les rémunérations et avantages dont bénéficient les mandataires sociaux, ainsi que sur les mandats et fonctions qu'ils exercent. Cette obligation vise les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions. Elle ne concerne pas les sociétés à responsabilité limitée, ni les sociétés par actions simplifiées. Elle est cependant plus large que l'obligation proposée par M. Marc Viénot dans son rapport de 1999, qui ne visait que les sociétés cotées. Le présent article prévoit de rattacher cette information au rapport de gestion présenté annuellement, en application de l'article 157 de la loi du 24 juillet 1966, par le conseil d'administration ou le directoire devant l'assemblée générale ordinaire réunie, sauf exceptions, dans les six mois suivant la clôture de l'exercice. Une telle insertion assimile l'information proposée à une communication relevant de la gestion de la société, donnée sous la seule responsabilité du conseil d'administration ou du directoire. L'insertion au rapport de gestion a l'avantage de permettre une large information des actionnaires. Ce rapport est en effet non seulement présenté en assemblée générale, mais aussi, en application de l'article 168 de la loi de 1966, obligatoirement envoyé, aux frais de la société, aux actionnaires qui en font la demande. La publicité ouverte par le présent article dépasse cependant le seul cadre des actionnaires. Le rapport de gestion devant être déposé au greffe du tribunal de commerce, l'information proposée sera accessible aux tiers pour les sociétés qui se conforment à leur obligation de dépôt. En outre, en application de l'article L.432-4 du code du travail, elle sera également communiquée au comité d'entreprise. Le degré d'exhaustivité et de précision de la publicité proposée diffère selon la nature de la communication. Le présent article prévoit en effet trois informations distinctes. 1.- L'information sur les rémunérations et les avantages versés par la société (premier alinéa de l'article 157-3) Le premier alinéa de l'article 157-3 prévoit que le rapport de gestion comprend un compte rendu sur la rémunération totale et les avantages de toute nature versés à chaque mandataire social durant l'exercice. Cet alinéa ne précise pas par qui sont versés les rémunérations et les avantages en cause, et doit donc être interprété comme visant la société sur laquelle porte le rapport de gestion, c'est-à-dire, dans l'hypothèse d'un groupe, la société mère. Cet alinéa définit le champ des rémunérations et des avantages visés, le périmètre des personnes bénéficiaires concernées, ainsi que la précision de l'information proposée. - le champ des rémunérations et des avantages visés : En visant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés, le présent alinéa englobe : - les salaires, lorsque les personnes visées bénéficient d'un contrat de travail ; - les jetons de présence ; - les sommes fixes ou proportionnelles au chiffre d'affaires versées aux mandataires sociaux ; - les compléments de retraite versés en fin de mandat. En revanche, le présent alinéa peut être interprété comme excluant : - les options de souscription ou d'achat d'actions qui, en application de l'article 208-8-1 de la loi du 24 juillet 1966, sont consenties, mais non versées ; - les indemnités de départ qui font l'objet d'une convention signée en début de mandat et qui constituent une créance sur la société ; - les avantages de logement ou de voiture qui ne se matérialisent pas par un versement ; - les crédits ou les avances octroyés lorsqu'ils ne sont pas assimilables à des avantages. Ainsi, du point de la définition du périmètre des rémunérations et des avantages versés, le présent alinéa est plus contraignant que le dernier rapport Viénot. Ce dernier proposait en effet une information sur les rémunérations de toute nature perçues par les dirigeants, sans mentionner les avantages dont ceux-ci peuvent par ailleurs bénéficier. - les personnes bénéficiaires : Pour définir le type de personnes bénéficiaires des rémunérations et avantages visés, le présent alinéa a recours à la notion de mandataires sociaux que l'article 208-8-1 de la loi du 24 juillet 1966 utilise pour préciser les dirigeants susceptibles de bénéficier d'options sur actions. Cette notion inclut les administrateurs, les membres du directoire, les membres du conseil de surveillance, les directeurs généraux, les directeurs généraux délégués et les gérants des sociétés en commandite par actions. En revanche, les mandataires spéciaux désignés et les membres des comités créés par le conseil d'administration en application de l'article 90 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 ne semblent pas concernés. Sur ce point, l'obligation d'information proposée dépasse à la fois les dispositions réglementaires existantes, les propositions du patronat et les initiatives prises par les dirigeants de certaines sociétés. L'article 248-12 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 ne vise en effet que les membres des organes d'administration, de direction et de surveillance, ce qui exclut les directeurs généraux qui ne sont pas administrateurs. Le rapport Viénot de 1999 utilise la notion plus restrictive de « dirigeants formant l'équipe de direction générale ». En outre, les initiatives prises à titre individuel par certains patrons ne portaient que sur la rémunération perçue soit par le président de la société, soit par ses principaux mandataires, et notamment par les membres du comité de direction. Cependant, en ne visant que les mandataires sociaux, le présent alinéa risque d'instaurer une distorsion entre l'information relative à la rémunération des salariés qui, prévue à l'article 168 de la loi du 24 juillet 1966 non modifié par le présent projet, reste globale et limitée à une seule société, et, d'autre part, celle relative à la rémunération des dirigeants qui devient nominative et consolidée. Votre Rapporteur propose donc d'étendre le présent alinéa aux dix salariés les mieux rémunérés. - la précision de l'information proposée : Trois dispositions du présent alinéa déterminent le degré de précision de l'information proposée. En premier lieu, cette information passe par un compte rendu sur les rémunérations et avantages versés et non par une simple indication de leurs montants. Le recours à la notion de compte rendu ouvre la possibilité d'expliquer dans le rapport de gestion la politique de détermination des rémunérations, notamment en précisant les principes qui président à la répartition entre fractions fixes et fractions variables, à la détermination de l'assiette des parties variables et à la fixation des règles d'attribution des bonus et des primes. Ces explications figurent dans les propositions présentées par le dernier rapport Viénot. Par ailleurs, il est prévu que le conseil d'administration rende compte de la rémunération et des avantages versés à chaque bénéficiaire. L'information proposée est donc nominative et dépasse par conséquent le degré de précision des dispositions actuellement en vigueur. Le droit à communication des dix meilleures rémunérations (article 168 de la loi du 24 juillet 1966) et l'information sur les rémunérations figurant dans l'annexe aux comptes consolidés (article 248-12 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967) ne donnent accès, on l'a vu, qu'à des données globales sans préciser l'identité des bénéficiaires. Sur ce point, le présent alinéa s'inspire des pratiques en vigueur aux États-Unis et au Royaume-Uni, mais va au-delà des propositions du rapport Viénot de 1999 qui se prononce en faveur d'une information globale, à l'exception des jetons de présence pour lesquels une information individuelle est préconisée. Enfin, la période de versement des rémunérations et avantages visés par le présent alinéa est précisée : l'information portera sur les versements effectués durant l'exercice, c'est-à-dire pendant l'année sur laquelle porte le rapport de gestion. 2.- L'information sur les rémunérations et les avantages reçus des sociétés contrôlées (deuxième alinéa de l'article 157-3) Le deuxième alinéa de l'article 157-3 fait obligation au conseil d'administration ou au directoire d'indiquer dans le rapport de gestion le montant des rémunérations et des avantages de toute nature que chacun des mandataires sociaux a reçus de la part des sociétés contrôlées au sens de l'article 355-1 de la loi du 24 juillet 1966. En utilisant les notions de rémunérations et avantages de toute nature et de mandataires sociaux, cet alinéa donne à l'obligation qu'il crée le même périmètre d'application que l'alinéa précédent. Les rémunérations et avantages visés, ainsi que les personnes qui en sont bénéficiaires, sont donc les mêmes que ceux décrits plus haut. Pour aligner l'information relative aux salariés sur celle visant les dirigeants, il convient donc, comme votre Rapporteur l'a proposé à l'alinéa précédent, d'étendre le présent alinéa aux dix salariés les mieux rémunérés. En revanche, l'information introduite par cet alinéa se distingue de celle prévue au précédent, en ce qu'elle ne concerne que les rémunérations et les avantages reçus des sociétés contrôlées et qu'elle est définie de manière relativement moins précise. Le but du présent alinéa est de faire réaliser par le conseil d'administration ou le directoire d'une société mère une consolidation des rémunérations et avantages reçus par les mandataires sociaux de cette société mère de la part des sociétés que celle-ci contrôle. Une telle consolidation figure actuellement dans l'annexe aux comptes consolidés prévue par l'article 248-12 du décret n°67-236 du 23 mars 1967. Comme on l'a vu plus haut, cette annexe ne concerne cependant que les sociétés soumises à l'obligation de présenter des comptes consolidés et ne comporte que des informations globales, sans indication des montants perçus par chaque mandataire. Le présent alinéa va donc au-delà du droit existant en prévoyant une information nominative, et en visant toutes les sociétés placées à la tête d'un groupe sans que les exceptions prévues en matière de consolidation des comptes puissent jouer. L'information prévue est également plus complète que celle proposée par le dernier rapport Viénot, lequel ne prévoit aucune information sur le montant des rémunérations perçues de la part de sociétés contrôlées. Ce rapport se contente de préconiser la transparence sur les règles de perception des jetons de présence alloués aux dirigeants à raison des mandats sociaux détenus dans les sociétés du groupe. Par ailleurs, le présent alinéa vise les rémunérations et avantages perçus de la part des sociétés contrôlées, et non les rémunérations et avantages versés par celles-ci. Cette rédaction soulève le problème de la manière dont les informations recherchées seront collectées. A la différence des rémunérations et avantages qu'elle verse elle-même à ses mandataires, la société mère n'a pas un accès direct aux rémunérations et avantages dont ceux-ci peuvent bénéficier en siégeant dans les organes des sociétés contrôlées. Il est donc clair que la consolidation proposée ne pourra être obtenue que par un dispositif de déclaration personnelle des mandataires dont il appartiendra au conseil d'administration ou au directoire, responsables devant les actionnaires de l'exactitude des informations qu'ils leur apportent, de garantir la fiabilité. Un même dispositif s'appliquera aux dix salariés les mieux rémunérés que votre Rapporteur propose d'inclure dans l'information prévue au présent alinéa. On peut s'interroger sur la pertinence de la méthode de consolidation retenue. Le présent alinéa définit le périmètre des sociétés contrôlées en visant l'article 355-1 de la loi du 24 juillet 1966. Cet article donne une définition du contrôle qui est utilisée pour l'application des dispositions relatives soit aux notifications et informations sur les participations significatives, soit à la réglementation de l'autocontrôle. Les règles actuellement en vigueur pour la consolidation des rémunérations, et notamment l'article 248-12 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 fixant le contenu de l'annexe aux comptes consolidés, ont recours à une autre définition du contrôle, prévue à l'article 357-1 de la loi précitée. Pour assurer la cohérence entre l'information fournie par l'annexe aux comptes consolidés et celle prévue par le présent alinéa, il serait préférable que ce dernier se réfère à l'article 357-1 qui, en outre, définit plus largement le périmètre des sociétés contrôlées. En visant chacun des mandataires, le présent alinéa donne, on l'a vu, un caractère nominatif à l'obligation d'information sur les rémunérations et avantages reçus des sociétés contrôlées. Sur ce point, il a le même degré de précision que l'information, prévue à l'alinéa précédent, sur les rémunérations et avantages versés par la société mère. Il ne prévoit cependant qu'une indication des montants reçus, rédaction qui se distingue du compte rendu prévu à l'alinéa précédent, et semble exclure la possibilité, pour le conseil d'administration ou le directoire, d'expliquer dans le rapport de gestion la politique de rémunération des dirigeants menée au sein des sociétés contrôlées. Par ailleurs, à la différence de l'alinéa précédent, la période au cours de laquelle les rémunérations et avantages sont perçus n'est pas précisée. Cette différence pourrait donner lieu à des divergences d'interprétation. Par souci de clarté, il serait préférable de retenir une même rédaction en indiquant que l'information relative aux sociétés contrôlées porte sur les rémunérations et avantages perçus au cours de l'exercice, c'est-à-dire au cours de l'année sur laquelle porte le rapport de gestion. 3.- L'information sur les mandats et fonctions exercés par les mandataires sociaux (dernier alinéa de l'article 157-3) Le dernier alinéa de l'article 157-3 prévoit que le rapport de gestion doit comprendre la liste de l'ensemble des mandats et fonctions exercés par les mandataires sociaux de la société. Cette information est un complément indispensable à celle prévue aux deux alinéas précédents. Il est en effet logique de permettre aux actionnaires de connaître les mandats et fonctions effectivement exercés par les mandataires dont les rémunérations sont communiquées. En faisant la transparence sur les fonctions et les mandats des dirigeants, le but de cet alinéa est en outre de permettre une meilleure application des dispositions relatives au cumul des mandats et aux conventions réglementées, prévues aux articles 60 et 61 du présent projet. D'une manière générale, il s'agit de donner aux actionnaires la possibilité de vérifier si les éventuelles situations de cumul sont compatibles avec la disponibilité que requiert le mandat qui a été confié à chacun des dirigeants. A cet effet, l'information proposée a une portée très générale. Elle vise non seulement les mandats, mais aussi les fonctions que les mandataires peuvent exercer, notamment en application d'un contrat de travail. D'autre part, il s'agit de l'ensemble des mandats et fonctions, quelle que soit la société dans laquelle ils s'exercent. Le présent alinéa a, en effet, vocation à englober toutes les entreprises dans lesquelles les mandataires de la société concernée par le rapport de gestion exercent des mandats et fonctions, et non les seules sociétés du groupe. Sur ce point, pour éviter toute difficulté d'interprétation, il serait utile de préciser que les mandats et fonctions visés sont ceux exercés par les mandataires dans toute société. En outre, dans un souci d'homogénéité par rapport aux informations prévues en matière de rémunération, la précision du présent alinéa gagnerait à être renforcée. Il conviendrait en premier lieu de spécifier que l'information proposée est nominative en indiquant qu'elle porte sur chacun des mandataires sociaux. Il serait également utile d'indiquer que l'information porte sur les mandats et fonctions exercés durant l'année sur laquelle porte le rapport de gestion. A défaut de cette précision, le présent alinéa pourrait être interprété comme faisant obligation d'informer sur les mandats et fonctions exercées à une date donnée - à la fin de l'exercice par exemple - et non sur l'ensemble de l'année. Enfin, par cohérence avec l'extension, proposée par votre Rapporteur, des deux alinéas précédents aux dix salariés les mieux rémunérés, il convient d'inclure ces salariés dans la liste prévue au présent alinéa. * * * Votre Commission a rejeté un amendement de M. François d'Aubert visant à obliger toutes les sociétés cotées à constituer un comité des rémunérations. Votre Commission a adopté un amendement (n° 249) de votre Rapporteur visant à préciser la période de versement, par les sociétés contrôlées, des rémunérations et avantages que le projet propose de faire figurer dans le rapport de gestion. Elle a également adopté un amendement(n° 250) de votre Rapporteur alignant la méthode de consolidation de l'information prévue par le projet sur celle utilisée pour l'établissement des comptes consolidés. Elle a en outre adopté trois amendements (n° 251, 252 et 253) de votre Rapporteur, le premier précisant que la liste relative aux mandats et fonctions proposée par le projet est nominative, le second mentionnant qu'elle porte sur tous les mandats et fonctions exercés au cours de l'année, et le dernier spécifiant que les mandats et fonctions visés sont ceux exercés, quelle que soit la société d'exercice. M. Augustin Bonrepaux a ensuite présenté un amendement des membres du groupe socialiste établissant la transparence sur les options sur actions dont bénéficient, chaque année, les dirigeants et les principaux salariés des sociétés. Cet amendement prévoit en effet que le rapport de gestion comprend une information nominative portant, d'une part, sur les options consenties aux mandataires sociaux et aux dix plus importants bénéficiaires salariés, et, d'autre part, sur les options levées par ces mandataires et salariés. Cet amendement propose de réaliser une consolidation des options attribuées au niveau du groupe, en visant celles détenues non seulement sur la société sur laquelle porte le rapport de gestion, mais aussi sur les sociétés qui lui sont liées. Par ailleurs, afin d'informer les actionnaires des éventuels cumuls d'options consécutifs aux situations de cumul de mandats, l'information relative aux mandataires sociaux concernera également les options détenues sur toutes les sociétés contrôlées à raison des mandats ou fonctions que ces mandataires y exercent. M. Augustin Bonrepaux a estimé qu'il s'agit d'une mesure indispensable, appelée à être complétée par d'autres dispositions, qui seront rattachées à des projets de loi à venir. M. Philippe Auberger a déclaré qu'il n'est pas hostile à cette mesure, mais qu'elle crée une distorsion par rapport à l'information, moins contraignante, exigée en matière de revenus, traitements et salaires. Il a notamment fait observer que l'obligation de communiquer le montant global concernant les dix meilleures rémunérations reste prévue société par société, sans consolidation au niveau du groupe. Il a enfin craint que la mesure proposée n'ait qu'un effet d'affichage, faute de sanction sérieuse en cas de manquement. M. Jean-Jacques Jégou a présenté un amendement prévoyant une information sur les options attribuées aux mandataires ou salariés figurant, selon la taille de l'entreprise, parmi les dix ou cinq plus gros bénéficiaires d'options. Il a estimé que cet amendement répond à l'objectif poursuivi par l'amendement présenté par M. Augustin Bonrepaux. Mme Nicole Bricq a fait remarquer que le critère proposé par M. Jean-Jacques Jegou n'est pas pertinent, dans certains secteurs les dirigeants de PME bénéficiant d'une rémunération élevée. Elle s'est en revanche prononcée en faveur d'un élargissement de l'information prévue par le projet aux dix salariés les mieux rémunérés. Votre Rapporteur a confirmé que le projet prévoit une information relative aux mandataires sociaux, mais ne vise pas les salariés. Il a, par ailleurs, rappelé que l'information prévue est de nature à engager la responsabilité du conseil d'administration et qu'elle peut également faire l'objet de la procédure d'injonction instaurée par l'article 67 du projet. M. Philippe Auberger a fait remarquer que certaines sociétés préfèrent faire l'objet d'une contravention plutôt que de communiquer la rémunération de leurs dirigeants. La meilleure sanction serait par conséquent de réintégrer cette rémunération dans le bénéfice imposable des sociétés. Votre Rapporteur a mis en doute l'effet dissuasif de la sanction proposée par M. Philippe Auberger. Votre Commission a adopté un amendement (n° 254) de votre Rapporteur étendant, dans le texte du présent article, aux dix salariés les mieux rémunérés l'information prévue par le projet pour les mandataires sociaux, par cohérence avec l'amendement relatif aux plans d'options. Elle a également adopté cet amendement (n° 255). En conséquence, l'amendement de M. Jean-Jacques Jégou est devenu sans objet. Votre Commission a ensuite rejeté un amendement de M. Christian Cuvilliez visant à préciser que le rapport de gestion inclut une information relative aux jetons de présence et aux avantages de toute nature versés aux membres du conseil d'administration. Votre Rapporteur a en effet fait valoir que le présent article, en visant les « rémunérations et avantages de toute nature versées aux mandataires sociaux » répond déjà à l'objet de cet amendement. Votre Commission a ensuite adopté l'article 64, ainsi modifié. * * * Après l'article 64 Votre Commission a rejeté un amendement (n° 39) de la Commission des lois obligeant les organes dirigeants à délibérer sur la rémunération de leurs membres et à reproduire intégralement dans leurs procès-verbaux cette délibération. M. Philippe Auberger a fait remarquer que la disposition prévue par cet amendement relève du règlement intérieur de chaque société et n'a donc pas vocation à figurer dans la loi. Votre Commission a ensuite examiné l'amendement (n° 40) de la Commission des lois prévoyant une délibération des assemblées générales sur les comptes consolidés. M. Michel Inchauspé a estimé cette disposition totalement inapplicable, l'assemblée générale d'une société ne pouvant se prononcer sur les comptes des sociétés contrôlées et la simultanéité de l'examen des comptes annuels et des comptes consolidés étant impossible. M. Philippe Auberger a fait également remarquer que la délibération proposée par cet amendement suppose un vote des actionnaires sur les comptes de sociétés extérieures. M. Dominique Baert a cependant observé que cet amendement n'impose pas aux actionnaires de délibérer simultanément sur les comptes de la société et sur les comptes consolidés. Le Président Henri Emmanuelli a constaté que si cet amendement ne soulève pas d'objection de principe, sa rédaction pose cependant un problème. Sur la proposition de votre Rapporteur, votre Commission a rejeté cet amendement, ainsi que l'amendement (n° 50) de M. Alain Tourret visant à ce que le rapport de gestion des mutuelles porte sur les personnes morales qu'elles contrôlent. Identification des actionnaires (Articles 161-2 (nouveau), 263, 263-2, 263-3 à 263-6 (nouveau) et 356-1 de la loi du 24 juillet 1966) Représentation et identification des actionnaires non résidents Le présent article modifie la loi du 24 juillet 1966 d'une part, en instituant un nouveau cas de représentation aux assemblées générales, pour ceux des actionnaires qui ne résident pas en France ; d'autre part, en améliorant la connaissance de leur actionnariat par les sociétés émettrices cotées, grâce à un renforcement des conditions d'identification du ou des propriétaires réels des titres. A.- LA REPRÉSENTATION DES ACTIONNAIRES NON RÉSIDENTS Le présent article introduit une nouvelle règle de représentation aux assemblées d'une société, pour les actionnaires qui ne résident pas en France, dans le but d'assurer la sécurité de leur vote. 1.- L'aménagement du principe de représentation Le paragraphe I de cet article introduit un article 161-2 qui ouvre une possibilité de représentation des actionnaires, qui ne résident pas en France, aux assemblées d'une société dont ils détiennent des titres. En principe, tout actionnaire ou tout titulaire de certificat de droit de vote a le droit de participer aux décisions collectives, en vertu des articles 1844, alinéa 1er, du code civil et 283-1, alinéa 1er de la loi du 24 juillet 1966. Par ailleurs, le droit pour un actionnaire de se faire représenter aux assemblées est d'ordre public (article 161, alinéas 1er et 5ème). Le texte actuel de la loi du 24 juillet 1966 offre trois possibilités de représentation pour les actionnaires qui ne peuvent assister aux assemblées : - soit ils donnent une procuration à un autre actionnaire ou à leur conjoint (article 161) ; - soit ils votent par correspondance (article 161-1) ; - soit ils adressent une procuration à la société, sans indication de mandat (article 161, al. 6). Dans ce dernier cas, un vote favorable sera émis à l'adoption des projets de résolution présentés ou agrées par le conseil d'administration ou le directoire, et un vote défavorable à l'adoption des autres projets de résolution. 2.- Les conditions d'intervention de l'intermédiaire régulièrement inscrit L'exercice du droit de vote d'un actionnaire non résident est actuellement mal assuré dans la mesure où l'intervention d'un intermédiaire agissant pour son compte n'est prévue par aucun texte. Afin de remédier à cette situation, le présent article instaure la possibilité pour un actionnaire qui n'est pas domicilié en France de transmettre son vote à un intermédiaire, ce dernier pouvant désormais être inscrit en compte, dans des conditions strictement définies. Dans un premier temps, le présent article complète l'article 263 de la loi du 24 juillet 1966 en posant le principe de l'inscription en compte du propriétaire des titres, qui seul détient le droit de vote. Ce principe fait référence à l'article 94-II de la loi de finances pour 1982, qui a consacré la dématérialisation des valeurs mobilières. Désormais, les titres émis en territoire français doivent être obligatoirement inscrits dans des comptes tenus par la personne morale émettrice ou par un intermédiaire financier habilité, quelle que soit leur forme (au porteur ou nominatifs). La question est, ensuite, de savoir si l'inscription en compte doit nécessairement se faire au nom du propriétaire réel des titres ou si elle peut se faire au nom du propriétaire apparent, c'est-à-dire de l'intermédiaire qui agit pour son compte. La nouvelle rédaction de l'article 263, proposée dans le présent article, complète l'affirmation du principe de l'inscription en compte au nom du propriétaire par une dérogation qui autorise, pour les sociétés cotées, l'inscription par un intermédiaire, lorsque le propriétaire des titres ne réside pas en France. Cette possibilité est soumise à une double condition : d'une part, l'intermédiaire doit spontanément révéler sa qualité au moment de l'ouverture du compte ; d'autre part, il est soumis à de strictes obligations déclaratives concernant l'identité des propriétaires réels des titres. En cas de manquement à ces obligations, l'intermédiaire encourt une peine d'emprisonnement de deux ans et une amende de 60.000 francs, en application de l'article 440 de la loi du 24 juillet 1966, qui vise les personnes « qui, en se présentant faussement comme propriétaires d'actions ou de coupures d'actions, auront participé au vote dans une assemblée d'actionnaires, qu'(elles) aient agi directement ou par personne interposée ». Enfin, le présent article aborde les conditions d'exercice du droit de vote des actionnaires non résidents en France, en introduisant un nouvel article 263-4. En vertu de cet article, un intermédiaire régulièrement inscrit peut, en vertu d'un mandat général de gestion de titres, transmettre le vote d'un propriétaire pour une assemblée générale. Avant cette transmission, la société émettrice peut demander à cet intermédiaire de lui fournir la liste des propriétaires non résidents des actions auxquels ces droits de vote sont attachés. Cette disposition est quelque peu redondante avec les articles 263-1 et 263-2 qui offrent la même possibilité à l'émetteur, à tout moment, sous réserve qu'elle soit prévue dans les statuts de cette société, pour les titres au porteur. L'objectif est, sans doute, d'assurer la communication de cette liste avant les réunions des assemblées générales, pour une société qui n'aurait pas procédé à une modification de ses statuts à cette fin. Cette hypothèse ne vise, cependant, que l'identification des actionnaires au porteur, l'article 263-2 prévoyant que la liste des actionnaires nominatifs peut être demandée à tout moment par l'émetteur. En cas de manquement à cette obligation, le vote émis par l'intermédiaire n'est pas pris en compte lors de l'assemblée générale. B.- L'IDENTIFICATION DES PROPRIÉTAIRES DE TITRES NON RÉSIDENTS EN FRANCE Le paragraphe II du présent article vise également à améliorer la connaissance que peuvent avoir les sociétés émettrices cotées de leur actionnariat, en particulier lorsque les actionnaires n'ont pas leur domicile en France. A cette fin, il renforce les moyens d'identification des actionnaires par ces sociétés. 1.- Des règles d'identification différentes pour les actionnaires au porteur et les actionnaires nominatifs Rappelons que l'accès à une assemblée suppose la justification de la qualité d'actionnaire. En principe, les titulaires d'actions nominatives sont connus de la société dans la mesure où ces titres doivent être inscrits dans des comptes tenus par la société émettrice, au nom de chaque propriétaire. S'agissant des titulaires d'actions au porteur, la justification de leur qualité résulte d'un certificat établi par l'intermédiaire qui tient leur compte, constatant l'indisponibilité de ces titres jusqu'à la date de l'assemblée. Toutefois, ces règles ne permettent pas réellement d'identifier les propriétaires de titres qui ne résident pas en France, alors que cette connaissance peut s'avérer très utile pour une société émettrice. a) L'identification des actionnaires au porteur Le présent article reprend le régime des « titres au porteur identifiable » (TPI), en allégeant la rédaction de l'article 263-1 de la loi du 24 juillet 1966, qui résulte de la loi n°87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne. Les « titres au porteur identifiable » sont, comme les titres au porteur classiques, administrés par un intermédiaire financier mais, sur demande de la société émettrice, l'anonymat portant sur l'identité des actionnaires peut être levé. Ils permettent donc aux sociétés cotées ou assimilées, dont les titres circulent au porteur, de connaître leur actionnariat, à une date déterminée. Le régime du TPI doit être expressément prévu par les statuts de la société (article 263-1, 1er alinéa) et ne concerner que les valeurs mobilières conférant, immédiatement ou à terme, le droit de vote dans les assemblées d'actionnaires de la société émettrice (actions, actions à bons de souscription, etc.). En vertu du premier alinéa de l'article 263-1, ce régime permet à la société émettrice d'obtenir les renseignements suivants relatifs aux titulaires des titres : - leur nom ou leur dénomination sociale (pour les personnes morales) ; - leur nationalité ; - leur année de naissance ou, pour les personnes morales, leur année de constitution ; - leur adresse ; - la quantité de titres détenus par chacun d'eux ; - le cas échéant, les restrictions dont ces titres peuvent être frappés. Afin de garantir la confidentialité des informations recueillies, la demande de renseignements ne peut être effectuée que par la société émettrice, qui peut présenter une demande à tout moment. Les renseignements sont recueillis par la SICOVAM, organisme de compensation des titres, dans un délai de dix jours ouvrables qui suivent la demande. Si ce délai n'est pas respecté ou lorsque les renseignements fournis sont incomplets ou erronés, la SICOVAM peut demander, sous astreinte, au président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, d'enjoindre l'établissement financier défaillant à exécuter son obligation (article 263, al. 3). Les renseignements sont ensuite communiqués, dans un délai de cinq jours ouvrables, par la SICOVAM à la société qui a présenté la demande. Cette procédure est intégralement reprise, avec quelques aménagements rédactionnels, dans le paragraphe I de l'article 263-1. Votre Rapporteur suggère d'harmoniser le délai prévu dans cet article pour le recueil des informations permettant d'identifier les détenteurs de titres au porteur avec celui, prévu dans l'article 263-2 pour l'identification des propriétaires des titres nominatifs. Dans les deux cas, la fixation de ce délai est renvoyée à un décret. b) Identification des actionnaires nominatifs Pour les actions nominatives, le présent article modifie l'article 263-2 afin de permettre à la société émettrice de demander, à tout moment, à un intermédiaire régulièrement inscrit de révéler l'identité des propriétaires de ces actions. Cette procédure est plus simple à mettre en _uvre dans la mesure où elle ne doit pas être prévue dans les statuts de la société. Votre Rapporteur propose également d'alléger la rédaction du premier alinéa de cet article en supprimant la dernière phrase, la condition de délai étant reprise dans la phrase précédente. Dans un souci d'harmonisation avec la précédente procédure, cette condition de délai pourrait également être fixée par décret. La nouvelle rédaction de l'article 263-2 prévoit, en outre, que les droits spéciaux attachés aux actions nominatives, ne peuvent être exercés par l'intermédiaire régulièrement inscrit, si les renseignements qu'il fournit ne permettent pas le contrôle des conditions requises pour l'exercice de ces droits. Parmi ces conditions figure l'existence d'une inscription nominative depuis deux ans au moins pour l'attribution d'un droit de vote double (article 175) ou d'un dividende majoré (article 347-2). Il s'agit, ici, de soumettre le bénéfice de ces dispositions au contrôle des conditions requises pour leur obtention. 2.- Des possibilités d'identification renforcées La principale avancée du présent article est de permettre à la société émettrice de poursuivre les demandes d'identification jusqu'à ce qu'elle parvienne à obtenir l'identité des propriétaires réels des titres. Elle dispose, ainsi, d'une faculté de percer les « écrans » successifs d'intermédiaires dont l'intervention masque, très souvent, le bénéficiaire final des titres. Le paragraphe II de l'article 263-1 ouvre cette possibilité, à l'issue de la mise en _uvre de la procédure des TPI, telle qu'elle est définie au paragraphe I de cet article. La société émettrice peut alors demander, soit à la SICOVAM, soit directement aux personnes figurant sur la liste qui lui a été fournie, des informations relatives aux propriétaires réels des titres. Elle peut, dans ce cas, ne viser que les personnes dont elle estime « qu'elles pourraient être inscrites pour compte de tiers », ce qui lui laisse une large marge d'initiative. Une procédure identique est prévue, par l'article 263-2, pour identifier les propriétaires réels d'actions nominatives. Dans ces deux cas, la société est libre de poursuivre ses investigations jusqu'à ce qu'elle obtienne satisfaction, conformément au paragraphe I de l'article 263-3. A l'issue de ces opérations, le présent article institue un nouveau droit pour ces sociétés leur permettant de demander à toute personne morale, propriétaire de ses actions et possédant le quarantième du capital ou des droits de vote, de lui indiquer l'identité des personnes détenant directement ou indirectement plus du tiers du capital social de cette personne ou des droits de vote exercés lors de ses assemblées générales. Le respect de ces dispositions n'exonère pas cette personne morale des obligations de déclaration de participations significatives qui lui incombent, en vertu des articles 356-1 (action de concert), 356-2 (contrôle) et 356-3 de la loi du 24 juillet 1966. 3.- Les sanctions Ce dispositif est encadré par des règles sanctionnant, d'une part, la divulgation des informations recueillies par la société émettrice ; d'autre part, le manquement aux obligations imposées à l'intermédiaire inscrit. Dans le premier cas, le présent article prévoit que les renseignements recueillis sont réservés à la société qui en a fait la demande (article 263-1, III). Cette dernière ne peut les céder à un tiers, même à titre gratuit, sous peine de sanctions pénales prévues à l'article 226-13 du code pénal, à savoir une peine d'emprisonnement d'un an au plus et une amende maximale de 100.000 francs. Par ailleurs, un article 263-6 est introduit qui soumet les personnes ayant connaissance de ces informations (au sein de la société émettrice, de la SICOVAM ou dans le cadre de son activité) au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. L'article prévoit que ces dispositions ne sont opposables ni à la Commission des opérations de bourse, ni à l'autorité judiciaire. Dans le second cas, l'intermédiaire régulièrement inscrit est soumis à deux types d'obligations. D'une part, il est tenu de transmettre les informations que lui demandent la société émettrice dans le cadre du présent article, sous peine d'être privé des droits de vote pour toute assemblée d'actionnaires qui se tiendrait jusqu'à la date de régularisation de l'identification, tandis que le paiement du dividende correspondant est différé jusqu'à cette date (article 263-5). En cas de méconnaissance volontaire des obligations découlant des articles 263 à 263-3, le tribunal de commerce peut prononcer la privation totale ou partielle, pour une durée maximale de cinq ans, des droits de vote attachés aux actions ayant fait l'objet de l'interrogation, voire du droit de vote correspondant. Ces sanctions peuvent être prononcées à la demande de la société émettrice ou d'un ou plusieurs actionnaires détenant au moins 5 % du capital. Enfin, le paragraphe III du présent article soumet l'intermédiaire régulièrement inscrit aux obligations déclaratives découlant de l'article 356-1, qui les impose dans le cadre d'une action de concert entre deux ou plusieurs sociétés. La violation de ces obligations est sanctionnée conformément aux dispositions de l'article 263-5, c'est-à-dire par une privation de droit de vote. * * * Votre Commission a rejeté un amendement de M. Gilbert Gantier suggérant un certain nombre de modifications de rédaction de l'article 65, que votre Rapporteur n'a pas jugées toutes utiles. Elle a ensuite adopté un amendement (n° 256) de votre Rapporteur dont l'objet est de préciser que la possibilité de représentation aux assemblées d'actionnaires, prévue dans l'article 65, est ouverte aux propriétaires de titres qui n'ont pas leur domicile en France et qui ne peuvent, de ce fait, être représentés. Puis, elle a rejeté deux amendements identiques de MM. Philippe Auberger et Gilbert Gantier, visant à substituer une référence à la résidence fiscale à celle prévue dans le présent article. Votre Rapporteur a en effet précisé qu'il est préférable de conserver la référence à la notion de domicile en France au sens du code civil, pour des motifs de simplicité. Votre Commission a également adopté deux amendements rédactionnels (n° 257 et 258) de votre Rapporteur visant à harmoniser les conditions de délai fixées aux deuxième et troisième alinéas du premier paragraphe de l'article 65, ainsi que l'amendement (n° 41) de la commission des Lois et trois amendements (n° 259, 260 et 261) de votre Rapporteur, visant à alléger la rédaction du présent article. Elle a adopté deux amendements identiques (n° 262), présentés respectivement par MM. Philippe Auberger et Gilbert Gantier ainsi que l'amendement (n° 42) de la commission des Lois visant à harmoniser l'ensemble du dispositif proposé par cet article. Elle a ensuite adopté un amendement de précision (n° 263) de votre Rapporteur. Enfin, elle a rejeté deux amendements identiques, l'un présenté par M. Philippe Auberger et l'amendement (n° 98) de M. Jean-Paul Charié visant à instituer un rapport annuel relatif aux possibilités d'identification des actionnaires par les sociétés cotées, à l'intention du Parlement. Le Rapporteur a, en effet, jugé la procédure proposée assez lourde malgré son intérêt certain sur le fond. Votre Commission a adopté l'article 65, ainsi modifié. * * * Dispositions relatives au contrôle (Article 355-1 de la loi du 24 juillet 1966) exercé dans le cadre d'une action de concert Le présent article complète l'article 355-1 de la loi du 24 juillet 1966 afin de préciser la définition du contrôle d'une société sur une autre, par référence à la notion de « sociétés agissant de concert ». Il reconnaît ainsi la possibilité d'un contrôle exercé de manière conjointe sur une autre société. A.- LE CONTRÔLE D'UNE SOCIÉTÉ AU SENS DE L'ARTICLE 355-1 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 L'article 355-1 définit les critères permettant de déterminer une situation de contrôle. En vertu de cet article, une société en contrôle une autre, de droit, lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ou lorsqu'elle dispose, seule, de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires, conforme à l'intérêt de la société. Il peut également s'agir d'un contrôle de fait « lorsqu'elle détermine, en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ». Le contrôle peut ainsi être exercé de manière indirecte, par l'intermédiaire d'une ou plusieurs sociétés tierces. Une situation de contrôle est, par ailleurs, présumée, dans le cas où la société « dispose, directement ou indirectement, d'une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne » (article 355-1, al. 2). Il convient de noter que la loi du 24 juillet 1966 comprend plusieurs définitions du contrôle, d'une part, pour la définition du périmètre de consolidation des groupes (article 357-1) ; d'autre part, pour celle de l'étendue des groupes au regard de l'épargne salariale (article 208-4). Dès lors que la situation de contrôle est établie, conformément aux conditions posées à l'article 355-1, les sociétés concernées sont soumises aux dispositions relatives aux notifications et informations sur les participations significatives ainsi qu'aux règles relatives à l'autocontrôle qui imposent aux sociétés contrôlées directement ou indirectement par une société par actions de notifier à cette dernière et à chacune des sociétés participant au contrôle, le montant des participations qu'elle détient dans leur capital respectif ainsi que les variations de ce montant (article 356-2). Dans un arrêt « Association pour la Défense des Actionnaires Minoritaires c/Compagnie Générale des Eaux » du 20 février 1998, la Cour d'appel de Paris a considéré que le contrôle défini par l'article 355-1 de la loi du 24 juillet 1966 est exclusif de la notion d'action de concert, dans la mesure où cette action peut avoir des objectifs plus larges que le contrôle. Autrement dit, il y a contrôle uniquement dans le cas où une société dispose, seule, de la majorité des droits de vote dans une autre société, grâce à un accord conclu avec d'autres associés : il s'agit donc d'un contrôle unitaire. Cette jurisprudence écarte tout lien avec la notion de « sociétés agissant de concert » qui recouvre une situation dans laquelle des personnes ont conclu « un accord en vue d'acquérir ou de céder des droits de vote ou en vue d'exercer des droits de vote pour mettre en _uvre une politique commune vis-à-vis de la société » (art. 356-1-3). Les personnes agissant de concert « sont tenues solidairement aux obligations qui leur sont faites par la loi et les règlements » : elles sont notamment soumises aux obligations de déclaration de franchissement de seuil, définies par l'article 356-1, et, le cas échéant, de dépôt d'un projet d'offre publique. B.- LES AMÉNAGEMENTS PROPOSÉS 1.- La reconnaissance d'un contrôle exercé conjointement dans le cadre d'une action de concert Le présent article permet la prise en compte de l'existence d'une action de concert entre deux ou plusieurs sociétés pour déterminer si elles contrôlent, de fait, une autre société. Il prévoit, en effet, que deux ou plusieurs sociétés agissant de concert exercent un contrôle conjoint sur une autre « lorsqu'elles déterminent en fait les décisions prises dans les assemblées générales de cette dernière ». L'article 66 du présent projet de loi reconnaît ainsi la possibilité d'un contrôle exercé conjointement et non plus seulement par une seule société. Cette référence à l'action de concert s'avère cependant problématique, en raison de l'ambiguïté des termes qui la définissent. Comme le relève le Conseil des marchés financiers (17), cette action distingue, en réalité, un accord « capitalistique » (en vue d'acquérir ou de céder des droits de vote) et un accord en vue d'une politique commune (exercice des droits de vote pour mettre en _uvre une politique commune). L'action de concert, telle qu'elle est entendue dans le présent article, ne s'applique, en principe, pas à un accord conclu en vue d'exercer un vote limité sur un objet déterminé mais vise plutôt l'idée de « politique commune ». Or, l'hypothèse d'un accord capitalistique n'exclut pas une situation de simple convergence de votes alors même que le contrôle implique, par définition, davantage qu'une domination « accidentelle » sur une société. Cette ambiguïté invite à préciser la rédaction du présent article. Certes, le fait que les sociétés agissant de concert déterminent non pas une mais plusieurs décisions prises dans plusieurs et non pas une assemblée générale de la société, comme cela est précisé, peut suffire à garantir l'idée de continuité qu'implique le contrôle. Il n'est cependant pas à exclure que plusieurs décisions fassent l'objet d'un accord, sans qu'il y ait de véritable consensus ou qu'il existe une communauté d'intérêts sur la gestion de la société contrôlée. Compte tenu des incidences que peut avoir la notion de contrôle au sens de l'article 355-1 dans d'autres branches du droit (droit du travail, droit de l'audiovisuel, etc.) et des développements contentieux auxquels elle donnerait, inévitablement, lieu ; il importe d'écarter cette possibilité. C'est pourquoi, votre Rapporteur juge utile de préciser que les sociétés agissant de concert contrôlent conjointement une société lorsqu'elles déterminent, en fait, les décisions prises aux assemblées générales de cette société, dans le cadre d'un accord en vue d'une politique commune. Cette formulation semble préférable pour éviter tout risque de confusion sur les conditions d'application de l'article 355-1. En outre, elle permet d'unifier les interprétations en matière de contrôle, tout en garantissant la protection des actionnaires minoritaires. 2.- Les implications du lien entre action de concert et contrôle Votre Rapporteur observe que les implications de cette mesure n'ont pas fait l'objet d'un recensement exhaustif, ce qui est fort regrettable pour la cohérence du dispositif législatif. La notion de contrôle, au sens de l'article 355-1, a, en effet, une incidence sur plusieurs dispositions légales qui s'y réfèrent. C'est notamment le cas pour la constitution d'un comité de groupe, prévue par l'article 439-1 du code du travail. Cet article dispose, en effet, que ce comité est constitué « au sein du groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies aux articles 354, 355-1 et au deuxième alinéa de l'article 357-1 de la loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ». En introduisant la possibilité d'un contrôle conjoint, la modification de l'article 355-1 risque de conduire à la constitution d'un comité de groupe de la société contrôlée avec chacune de sociétés participant à l'action de concert, ce qui va à l'encontre du principe même d'un tel comité. Il apparaît donc préférable de se limiter à l'hypothèse d'un contrôle exercé de manière unitaire, comme c'est le cas actuellement, en visant exclusivement les dispositions actuelles de l'article 355-1, sans se référer à l'existence d'une action de concert. * * * Votre Rapporteur a présenté un amendement (n° 264) dont l'objet est de préciser la notion d'action de concert utilisée pour déterminer l'exercice d'un contrôle conjoint de deux ou plusieurs sociétés sur une autre. Cet amendement ayant une finalité identique avec ceux présentés par MM. Philippe Auberger, Gilbert Gantier et Marc Laffineur, il leur a suggéré de s'associer à son amendement et de retirer, en conséquence, les leurs. Votre Commission a adopté cet amendement (n° 264) ainsi que l'amendement (n° 43) de la commission des Lois, excluant l'application de la notion de contrôle conjoint pour la constitution d'un comité de groupe dans les conditions prévues par l'article L.439-1 du code du travail. * * * Dispositions relatives aux injonctions de faire (Article 493 de la loi du 24 juillet 1966) Recours aux injonctions de faire et demandes en référé Le présent article vise à renforcer l'effectivité du droit d'accès aux documents sociaux dont disposent les actionnaires, en leur permettant de recourir à la procédure des injonctions de faire. Il s'agit ainsi de mieux assurer leur droit d'information sur la gestion de la société. Le paragraphe I introduit ces dispositions dans l'article 493 de la loi du 24 juillet 1966, qui figure au titre III, relatif aux dispositions diverses et transitoires et n'a plus de portée juridique aujourd'hui. En permettant aux actionnaires d'exiger la production, la communication ou la transmission des documents sociaux, par injonction ou par désignation d'un mandataire, il donne une portée concrète au droit d'information de ces derniers, droit essentiel pour leur participation effective à la vie de la société et l'exercice d'un vote éclairé sur la gestion des dirigeants de cette société. En l'état actuel du droit, le principe est que la société doit obligatoirement de procéder à l'envoi de ces documents, en particulier avant la tenue des assemblées générales, sous peine de sanction pénale. Si ce mécanisme permet de protéger les droits des actionnaires, il reste cependant d'une portée pratique relativement limitée dans la mesure où la sanction intervient a posteriori. Le présent article renverse cette logique en autorisant les personnes intéressées à saisir le juge des référés, pour obtenir la communication des documents suivants : · l'inventaire, les comptes annuels, la liste des administrateurs ou des membres du directoire et du conseil de surveillance, les rapports qu'ils ont établis ainsi que ceux des commissaires aux comptes, le texte et l'exposé des motifs des résolutions proposées, le montant des rémunérations versées aux personnes les mieux rémunérées ainsi que celui des sommes ouvrant droit à certaines déductions fiscales et le montant des actions nominatives de parrainage et de mécénat (article 168) ; · la liste des actionnaires de la société, qui permet notamment aux actionnaires minoritaires, qui ne détiendraient pas le nombre suffisant d'actions pour avoir accès à l'assemblée, de se grouper (article 169) ; · les documents sociaux qui ont été tenus à la disposition des actionnaires avant les assemblées générales des trois derniers exercices, ainsi que les procès-verbaux et les feuilles de présence de ces assemblées, pour faciliter les comparaisons (article 170) ; La possibilité de recourir au juge statuant en référé ne concerne pas uniquement les actionnaires des sociétés anonymes mais est également offerte aux associés d'une société à responsabilité limitée, pour la production, notamment, du rapport de gestion, de l'inventaire et des comptes annuels établis par le gérant (article 56, alinéa 1er). Elle concerne aussi les obligataires, pour la transmission du texte des résolutions et des rapports qui seront présentés à l'assemblée générale ainsi que des procès-verbaux et des feuilles de présence des assemblées générales à la masse de laquelle ils appartiennent (article 318). Enfin, cette faculté est prévue en cas de liquidation d'une société, pour le dépôt de documents au registre du commerce et des sociétés (article 392) et les documents sociaux qui peuvent être habituellement consultés (article 414). Deux solutions sont offertes, dans le cadre de cette procédure : soit la société est enjointe, sous astreinte, de respecter ses obligations ; soit, un mandataire est désigné pour procéder à la communication des documents souhaités. Le paragraphe I de l'article 67 prévoit que si la procédure est mise en _uvre, les frais qu'elle occasionne sont à la charge du dirigeant ou du liquidateur défaillant. Cette disposition s'impose non seulement au regard du manquement constaté, mais aussi du fait qu'en l'absence de défaillance, les frais d'envoi des documents mentionnés sont supportés par la société. Le paragraphe II du présent article complète le dispositif en dépénalisant certaines sanctions en lien avec les obligations de communication qui viennent d'être évoquées, désormais couvertes par la possibilité de recourir à la procédure d'injonction de faire. Les dispositions des articles 426 (alinéas 2 et 3) et 445 sanctionnant l'absence de mise à disposition des documents sociaux pour les associés d'une SARL, d'une part, et les actionnaires d'une société anonyme, d'autre part, sont ainsi supprimées. Il en est de même pour l'article 465, en cas d'omission de l'appel de fonds pour la libération intégrale du capital social ou d'émission de bons ou obligations avant libération intégrale du capital social, et l'article 487 (alinéa 3) en cas de violation, par le liquidateur, de son obligation de permettre aux associés d'exercer leur droit de communication des documents sociaux. Le présent article procède, par ailleurs, à une mise à jour du dispositif pénal par rapport aux infractions de droit commun. Dans la mesure où les infractions sont déjà couvertes par le droit pénal général, les dispositions suivantes sont abrogées : articles 467 (escroquerie), 468 (émission de parts de fondateurs), 469 (émission d'obligations négociables par des gérants d'autres sociétés que les sociétés par actions ou des particuliers), 470 (émission d'obligations avant un délai de deux ans) et 433 (1°, 2° et 3° _ escroquerie et faux dans le cadre de la constitution des sociétés anonymes). Enfin, certains articles, définissant des infractions tombées en désuétude, sont supprimés, qu'il s'agisse de la négociation de promesses d'actions (article 434, 5°), de l'amortissement du capital par voie de tirage au sort des actions (article 453) ou de la réalisation d'opérations, par le gérant de société en commandite par actions, avant l'entrée en fonction du conseil de surveillance (article 461). * * * Votre Commission a adopté quatre amendements rédactionnels (n° 44, 45, 46 et 47) de la commission des Lois, votre Rapporteur ayant retiré un amendement. Votre Commission a adopté l'article 67, ainsi modifié. * * * (Articles 1843-3 du code civil et 2 bis (nouveau) Injonctions de faire Le présent article a également pour objet de permettre le recours à la procédure des injonctions de faire pour faciliter, d'une part, les appels de fonds nécessaires à la libération du capital social (paragraphe I de l'article) ; d'autre part, le dépôt de certaines pièces obligatoires au registre du commerce et des sociétés (paragraphe II). Le paragraphe I de cet article prévoit qu'au-delà du délai légal, tout intéressé peut demander au juge des référés d'enjoindre les dirigeants d'une société de procéder aux appels de fonds nécessaires à la libération du capital social d'une société. Votre Rapporteur rappelle qu'une société est constituée lorsque deux ou plusieurs personnes décident, par contrat, « d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter » (article 1832 du code civil). La création d'une société repose donc sur l'obligation faite aux associés de réaliser un apport, c'est-à-dire de transférer la propriété ou la jouissance d'un bien à la société, en contrepartie duquel il reçoit des parts ou actions. L'article 1843-3 du code civil, qu'il est ici proposé de modifier, distingue trois catégories d'apports : l'apport en numéraire, l'apport en nature et l'apport en industrie. En vertu du cinquième alinéa de cet article, lors de la souscription, une quote-part de l'apport en numéraire doit être obligatoirement versée, en application des dispositions statutaires ou légales. A titre d'exemple, une moitié au moins de la somme doit être versée pour la constitution d'une société anonyme (article 75, al. 2 de la loi du 24 juillet 1966) et la totalité de cette somme est nécessaire pour celle d'une société anonyme à responsabilité limitée (article 38). En cas d'inexécution de sa promesse d'apport, l'associé défaillant devient, de plein droit, « débiteur des intérêts de la somme due à compter du jour où elle devait être payée ». En outre, des dommages-intérêts peuvent être alloués à la société, si elle a subi un préjudice par suite du défaut de libération, c'est-à-dire de versement effectif des fonds. Le paragraphe I de l'article 68 complète ces dispositions en permettant de recourir au juge des référés pour obtenir, soit par injonction, soit par la désignation d'un mandataire, que les appels de fonds nécessaires soient réalisés. Cette procédure peut être utilisée pour la constitution de n'importe quelle forme de société, dans la mesure où elle est prévue dans le code civil et s'adresse aussi bien aux administrateurs d'une société anonyme qu'au gérant d'une société à responsabilité limitée ou, de manière plus générale, aux dirigeants de la société en création. Là encore, l'objectif est de permettre l'accomplissement effectif d'une obligation, sans préjudice toutefois, de l'application des sanctions, présentées supra. Le paragraphe II du présent article modifie, dans le même sens, l'ordonnance n°58-1352 du 27 décembre 1958 réprimant certaines infractions en matière de registre du commerce et des sociétés. L'inscription sur le registre du commerce et des sociétés participe à la publicité légale et constitue, à ce titre, un élément essentiel de sécurité pour les droits des tiers. A titre d'exemple, les sociétés ne jouissent de la personnalité morale qu'à compter de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés (articles 5 de la loi n°66-537 du 24 juillet 1966 et 1842 du code civil). Le décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales impose aux sociétés en nom collectif (article 13-1), aux sociétés à responsabilité limitée (article 44-1) et aux sociétés par actions (article 293) de déposer au registre du commerce et des sociétés, un certain nombre de documents, parmi lesquels les comptes annuels, le rapport de gestion ou encore le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels. Ces obligations résultent de la transposition de la quatrième directive européenne sur le droit de sociétés du 25 juillet 1978, intégrée dans le décret de 1967 modifié. Les informations qui figurent dans le registre sont donc importantes et leur publication contribue à une plus grande transparence sur le fonctionnement des sociétés. Les infractions en matière de registre du commerce sont prévues dans l'ordonnance du 27 décembre 1958 dont l'article 2 punit d'une amende de 30.000 francs et / ou d'un emprisonnement de six mois, « quiconque donne, de mauvaise foi, des indications inexactes ou incomplètes en vue d'une immatriculation, d'une radiation ou d'une mention complémentaire ou rectificative au registre du commerce et des sociétés ». Le présent article complète cet article en vue de permettre la désignation d'un mandataire ou le prononcé d'une injonction de faire, pour obtenir la publication des documents des sociétés qui s'y refuseraient. Dans le but de ne pas pénaliser les entreprises respectueuses de leurs obligations et de garantir les droits des tiers, il ouvre cette action à toute personne intéressée ainsi qu'au ministère public. Votre Rapporteur est favorable à ces dispositions qui permettent aux personnes concernées de faire valoir efficacement leurs droits, tout en confortant l'effort de transparence de la vie économique engagé dans le présent projet de loi. A cet égard, ce dispositif contribue à la lutte contre le blanchiment des capitaux pour laquelle le Groupe d'action sur le blanchiment des capitaux (GAFI) (18) a récemment préconisé de « mettre l'accent sur la communication de rapports annuels et sur un examen régulier des informations sur la société ou encore de prévoir des dispositions permettant la radiation des sociétés des registres lorsqu'elles ne respectent pas ces procédures ». * * * Votre Commission a adopté l'amendement rédactionnel (n° 48) de la commission des Lois et adopté l'article 68, ainsi modifié. * * Dispositions diverses et transitoires (Article 464-2 de la loi du 24 juillet 1966) Sanction des comportements fautifs des dirigeants d'une société Le présent article a pour objet de compléter le dispositif pénal applicable aux sociétés par actions simplifiées (SAS) afin de permettre de sanctionner les comportements fautifs de leurs dirigeants, susceptibles de porter atteinte au bon fonctionnement de la société. A.- ÉVOLUTION RÉCENTE DU RÉGIME DES SOCIÉTÉS PAR ACTIONS SIMPLIFIÉES La société par actions simplifiées (SAS) a été introduite en droit français par la loi n°94-1 du 3 janvier 1994 dans le but de favoriser le rapprochement des entreprises. Initialement réservé aux sociétés d'un certaine importance, le régime des SAS a récemment connu une très large ouverture, grâce à l'article 3 de la loi n°99-587 du 12 juillet 1999 sur l'innovation et la recherche. L'adoption de la loi du 12 juillet 1999 a, en effet, profondément modifié le régime de la SAS, d'une part, en élargissant les conditions requises pour être associé ; d'autre part, en instituant la possibilité d'une SAS unipersonnelle. Ce type de société peut, à présent, être constitué par n'importe quelle personne physique ou morale (article 262-1) et n'exige plus l'association de deux ou plusieurs sociétés ayant un capital social d'au moins 1,5 million de francs. En outre, la création d'une SAS nécessitait jusqu'alors que le capital soit libéré, en totalité, dès la souscription. Le nouveau régime de la SAS prévoit que les actions souscrites en numéraire peuvent désormais n'être libérées que de la moitié lors de la souscription, le surplus devant l'être en une ou plusieurs fois dans un délai de cinq ans à compter de son immatriculation au registre du commerce. Enfin, l'article 3 de la loi du 12 juillet 1999 permet à une SAS d'être instituée par une seule personne. Cette réforme devrait conduire à un développement de cette forme de société, dont le principal intérêt réside dans la souplesse juridique et la très grande liberté contractuelle qu'elle offre aux associés qui disposent de toute latitude pour aménager leurs relations d'associés ainsi que l'organisation du pouvoir dans la société. Dans ce dernier cas, en effet, les articles 89 à 177-1 relatifs à l'organisation du pouvoir dans les sociétés anonymes ne s'appliquent pas aux SAS (article 262-1, alinéa 3). Cette très grande liberté se manifeste à plusieurs niveaux. D'une part, les conditions dans lesquelles une telle société est dirigée sont fixées par les statuts, sous réserve que soit désigné un président pour représenter la société à l'égard des tiers (article 262-7). Une SAS peut ainsi être dirigée par une seule personne ou un organe collégial, ce qui explique que le présent article fasse référence au président ou au dirigeant de la société. Si le président est le seul organe obligatoire, les modalités de sa désignation sont, en revanche, totalement libres. Ses compétences sont les mêmes que celles du président directeur général de la société anonyme, à savoir qu'il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance, au nom de la société, dans la limite de l'objet social. En vertu de l'article 262-9, les responsabilités du président et des dirigeants de la SAS sont celles des administrateurs ou des membres du directoire de la société anonyme. En outre, les infractions prévues par les articles 432 à 437, 439, 449 à 459 de la loi du 24 juillet 1966 pour les sociétés anonymes s'appliquent également aux SAS, tandis que les peines prévues pour les dirigeants des sociétés anonymes sont applicables au président et aux dirigeants de la SAS (article 464-1). D'autre part, les statuts déterminent également les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés (article 262-10, alinéa 1er). Toutefois, la loi réserve expressément certaines attributions à la collectivité des associés, en particulier « les attributions dévolues aux assemblées générales extraordinaires et ordinaires des sociétés anonymes, en matière d'augmentation, d'amortissement ou de réduction de capital, de fusion, de scission, de dissolution, de nomination de commissaires aux comptes, de comptes annuels et de bénéfices » (article 262-10, alinéa 2). Les décisions prises en violation de ces dispositions peuvent être annulées, à la demande de tout intéressé (article 262-10, alinéa 4). Un aménagement a été institué pour les SAS unipersonnelles, le troisième alinéa de l'article 262-10 disposant que, dans ce cas, « le rapport de gestion, les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés sont arrêtés par le président ». B.- LA NÉCESSITÉ D'UN RENFORCEMENT DE LA PROTECTION DES ASSOCIÉS DANS UNE SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE Aucune sanction pénale n'est actuellement prévue en cas d'absence de consultation des associés pour les décisions qui viennent d'être évoquées, alors même qu'elles sont susceptibles d'engager la responsabilité de ces derniers à l'égard de tiers. A cet égard, il convient de relever qu'aux termes de l'article 262-7, « dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu de circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve ». Une difficulté du régime de la SAS réside dans le fait que la protection des associés est moins bien assurée que dans les autres formes de société, dans la mesure où une protection contractuelle est substituée à une protection légale. Il convenait donc de prévoir des dispositions destinées à assurer la protection de la collectivité des associés. Dans cette perspective, le présent article introduit une disposition d'ordre public dont l'objectif est de garantir que les associés d'une SAS seront effectivement consultés pour prendre certaines décisions importantes, susceptibles d'engager leur responsabilité à l'égard de tiers. Les décisions visées portent sur les opérations susmentionnées, telles que l'approbation des comptes annuels, dont l'article 262-10 précise qu'elles doivent être exercées collectivement. L'article 69 du présent projet de loi complète donc les dispositions pénales concernant les SAS (articles 464-1 à 464-4) en sanctionnant, à l'article 464-2 de la loi du 24 juillet 1966, l'absence de consultation des associés pour la détermination desdites décisions, par une peine de six mois d'emprisonnement et de 7.500 euros. La gravité de cette sanction correspond aux peines applicables à des manquements de même nature, tels que l'absence de consultation de l'assemblée générale ordinaire pour l'approbation des comptes annuels et du rapport de gestion dans les sociétés anonymes (article 441) ou la même infraction commise par le gérant d'une société à responsabilité limitée (article 427). * * * Votre Commission a adopté l'article 69 sans modification. Article additionnel après l'article 69 Délai d'application de la réduction du nombre maximal des membres de conseil d'administration et de conseil de surveillance Votre Commission a adopté un amendement (n° 266) portant article additionnel présenté par le Rapporteur, relatif aux dispositions transitoires pour la réduction du nombre maximal de membres des conseils d'administration et des conseils de surveillance. * * * Délais d'application des dispositions relatives aux cumuls de mandats et au mandat de directeur général délégué Le présent article fixe les délais d'application des dispositions relatives à la dissociation des fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général (paragraphe I), au cumul des mandats sociaux (paragraphe II) et à l'entrée en vigueur du titre de directeur général délégué (paragraphe III). Le paragraphe I du présent article fixe les conditions d'application des articles 56 et 57 qui dissocient, sauf dispositions statutaires contraires, les fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général. Il distingue deux types de sociétés : les sociétés dont les titres sont admis sur le marché réglementé et les sociétés anonymes dont les titres ne sont pas admis sur le marché réglementé et qui étaient immatriculées au registre du commerce et des sociétés avant la date de publication de la présente loi. Les premières disposent d'un délai de dix-huit mois pour rendre effective la dissociation des fonctions ou pour choisir le cumul. Comme cette dernière solution doit être le résultat d'une modification de statuts, l'assemblée générale des actionnaires doit l'avoir décidée. C'est la raison pour laquelle, si celle-ci ne s'est pas réunie pour en débattre dans le délai qui lui est accordé, la dissociation, qui est de principe selon les articles 56 et 57 du présent projet de loi, s'applique. Dans le souci de préserver la direction de l'entreprise, afin d'éviter que l'application de la loi ne décapite les sociétés qui n'auraient pas rempli leurs obligations, le présent article dispose que les présidents du conseil d'administration assurant la direction générale de la société cesseront de présider le conseil d'administration. Le « président-directeur général » ne sera plus que le directeur général et le conseil d'administration devra élire un nouveau président. Cette dissociation d'office n'en demeure pas moins transitoire : si l'assemblée générale extraordinaire adopte ensuite explicitement la solution du cumul, le directeur général pourra redevenir « président-directeur général ». Votre Rapporteur observe que le délai de dix-huit mois semble d'une durée suffisante, une assemblée générale des actionnaires ayant lieu au minimum une fois par an. En ce qui concerne l'obligation de réunir une assemblée générale extraordinaire afin de modifier les statuts dans le cas du choix du cumul des fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général, la rédaction proposée laisse planer un doute : en effet, la dissociation d'office s'applique à l'issu du délai « sauf si, dans ce délai, l'assemblée générale extraordinaire a modifié ou précisé les statuts » ce qui peut paraître flou pour les sociétés dont les statuts mentionnent déjà le principe du cumul et qui n'auraient pas de modification à apporter sur ce point. D'ailleurs, même si la réunion d'une assemblée générale extraordinaire n'est indispensable que dans le cas du choix du cumul, elle est très souhaitable pour les autres sociétés dans la mesure où l'entrée en vigueur de la présente loi aura pour conséquence la caducité d'une partie de leurs statuts. Il serait donc plus sain que chaque société anonyme réunisse une assemblée générale extraordinaire afin que les statuts soient mis en conformité avec la présente loi. Le second alinéa du paragraphe I traite le cas des sociétés anonymes dont les titres ne sont pas admis sur le marché réglementé, et qui étaient immatriculées au registre du commerce, avant la date de publication de la présente loi. Comme il s'agit de petites entreprises déjà constituées, l'application de la dissociation d'office serait difficile et très pénalisante dans le cas où la personne qui cumule les deux fonctions est la seule, parmi les administrateurs, à être en mesure de présider le conseil d'administration. Il est donc proposé que de telles sociétés anonymes puissent rester sous le régime actuellement en vigueur sans que leurs statuts aient à être modifiés pour prévoir le cumul, et donc sans que leur assemblée générale extraordinaire doive délibérer. En revanche, les sociétés anonymes dont les titres ne sont pas admis sur le marché réglementé, mais qui seront immatriculées au registre du commerce et des sociétés à partir de la date de publication de la présente loi devront, si elles le souhaitent, prévoir dans leurs statuts le cumul des fonctions. La loi s'appliquera ainsi aux nouvelles petites sociétés. Dans le cas où les objections de votre Rapporteur relatives aux modalités de choix de l'organisation de la direction des sociétés seraient retenues et où une solution plus souple serait adoptée, il s'avèrerait nécessaire d'ajuster ces dispositions transitoires. Le paragraphe II du présent article fixe le délai d'application des nouvelles règles en matière de cumul de mandats des administrateurs, présidents de conseil d'administration, directeurs généraux, membres du directoire et membres du conseil de surveillance définies aux articles 92, 111, 115, 127, et 136 modifiés par les articles 57 et 60 du présent projet de loi. Les différents mandataires sociaux devront se mettre en conformité avec ces nouvelles dispositions dans un délai de dix-huit mois après la publication de la présente loi. A défaut, ils sont réputés démissionnaires de tous leurs mandats. Néanmoins, les décisions auxquelles ils ont participé demeurent valides en application du présent projet. En cas de refus de prise en compte des nouvelles règles, tous les mandats sont donc perdus : la personne qui est en infraction ne peut plus participer à aucune décision dans quelque société où elle détenait un mandat, sauf à engager sa responsabilité. La sanction est bien de nature à décourager toute velléité de cumul illégal. Enfin, le paragraphe III organise la transition entre le titre de directeur général et celui de directeur général délégué : dès la publication de la loi, toute personne qui assistait le « président-directeur général » avec le titre de directeur général prend automatiquement le titre de directeur général délégué. Dans la mesure où ce changement de titre est sans aucune incidence sur les fonctions et le statut des personnes, il peut s'appliquer sans délai, et, en particulier, sans attendre que les fonctions de président du conseil d'administration et celles de directeur général soient dissociées, ou que leur cumul soit prévu par la modification des statuts. * * * Votre Commission a rejeté un amendement rédactionnel présenté par M. Gilbert Gantier puis un amendement rédactionnel (n° 49) de la commission des Lois. Votre Rapporteur ayant retiré un amendement de précision, la Commission a adopté un amendement (n° 267) de cohérence de votre Rapporteur. Votre Commission a adopté l'article 70, ainsi modifié. * * * Votre Commission a rejeté un amendement de M. Christian Cuvilliez obligeant les sociétés à inclure dans leurs statuts l'engagement de respecter la législation relative aux institutions représentatives du personnel, et prévoyant la nullité des décisions et délibérations prises en violation de cet engagement. Article additionnel après l'article 70 (Articles n° 102, 208-1, 208-3 et 208-8 de la loi du 24 juillet 1966 et article L. 443-6 du code du travail) Dispositions relatives aux options sur actions Votre Commission a ensuite adopté un amendement (n° 268) de M. Jean-Pierre Balligand augmentant le contrôle de l'assemblée générale sur l'attribution des options sur actions, interdisant l'attribution à un salarié d'options sur une filiale non cotée et renforçant le lien entre option et actionnariat salarié. Votre Commission a ensuite examiné trois amendements de M. Jean-Jacques Jégou et trois amendements de M. François d'Aubert modifiant le régime fiscal des options sur actions. Votre Rapporteur a fait valoir que la fiscalité des options sur actions doit être examinée dans son ensemble en loi de finances. M. Jean-Jacques Jégou a retiré ses trois amendements et la Commission a rejeté ceux de M. François d'Aubert. Votre Commission a ensuite examiné deux amendements de M. Jean-Jacques Jégou et deux amendements de M. François d'Aubert relatifs aux bons de souscription de parts de créateur d'entreprise. Votre Rapporteur a rappelé que cette question a déjà fait l'objet d'un débat lors de l'examen de la loi de finances pour 2000, et que votre Commission avait alors décidé de la rattacher au problème général de l'épargne salariale, lequel doit faire l'objet d'un projet de loi spécifique. M. Jean-Jacques Jégou a retiré ses deux amendements et votre Commission a rejeté ceux de M. François d'Aubert. Votre Commission a ensuite rejeté deux amendements de M. Christian Cuvilliez modifiant les règles relatives au licenciement économique, dont votre Rapporteur a estimé qu'ils trouveraient davantage votre place dans le projet, en cours de préparation, sur la modernisation sociale. Votre Commission a ensuite examiné quatre amendements de M. Jean-Jacques Jégou, le premier prolongeant les délais de versement de l'épargne salariale, les deux suivants relatifs au régime des plans d'épargne d'entreprise et le dernier modifiant les règles de l'intéressement et de la participation. Votre Rapporteur a estimé que la question de l'épargne salariale doit être étudiée dans son ensemble, à l'occasion de l'examen du projet de loi spécifique que le Gouvernement va déposer sur ce thème. M. Jean-Jacques Jégou a retiré ses quatre amendements. DISPOSITIONS RELATIVES AU SECTEUR PUBLIC Représentation des usagers au conseil d'administration ou de surveillance des entreprises assurant une mission de service public Votre Commission a adopté un amendement (n° 269) présenté par M. Yves Cochet visant à faire représenter les usagers des entreprises du secteur public au sein des conseils d'administration ou de surveillance, votre Rapporteur ayant cependant considéré que la notion d'usager mériterait d'être précisée. Élargissement de la représentation de l'État aux entreprises privées dont il est indirectement actionnaire Le présent article prévoit la possibilité, pour l'État, d'être représenté au sein des organes délibérants des entreprises privées dans lesquelles il détient indirectement 10 %, au moins, du capital, ou dans lesquelles, un ou plusieurs de ses établissements publics, détiennent directement ou indirectement, ensemble ou séparément, 10 % au moins du capital. La représentation des établissements publics dans des entreprises dont ils sont directement ou indirectement actionnaires est déjà juridiquement organisée. Le présent article ne vise donc qu'à conférer, dans certaines conditions, un droit supplémentaire à l'État. A.- LA REPRÉSENTATION ACTUELLE DE L'ÉTAT ACTIONNAIRE L'article 5 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public organise la présence, aux côtés de représentants des salariés et de personnalités choisies pour leur compétence spécifique, de représentants de l'État, nommés par décret, dans les conseils d'administration ou de surveillance des institutions suivantes : - les établissements publics industriels et commerciaux de l'État, autres que ceux dont le personnel est soumis à un régime de droit public, les autres établissements publics de l'État qui assurent une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial, lorsque la majorité de leur personnel est soumise aux règles du droit privé ; - les entreprises nationales, sociétés d'économie mixte ou sociétés anonymes dont plus de 90% du capital est détenu par des personnes morales de droit public ou par des sociétés qui entrent dans le champ d'application de la loi de 1983 ; - les sociétés centrales de groupes d'entreprises nationales d'assurances et les sociétés à forme mutuelle nationalisées ; - la banque française du commerce extérieur et la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur ; L'article 12 de la loi n° 49-985 du 25 juillet 1949, modifiant l'article 2 du décret-loi du 30 octobre 1935, impose, pour sa part, une représentation de l'État, au sein des conseils d'administration, de gérance ou de surveillance, proportionnelle à sa participation, lorsqu'il possède directement au moins 10 % du capital d'une société. Les sociétés concernées par ce texte, sont présentées dans le tableau ci-dessous qui indique, pour chacune d'elle, la participation financière de l'État.
Les articles 91 et 135 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, permettent à une personne morale d'être nommée administrateur, sous réserve de désigner un représentant permanent. Il en découle la possibilité, pour l'État, d'être représenté, dans les conditions du droit commun, dans les sociétés privées dont il détient directement moins de 10 % du capital. Les articles 95 et 135 de la même loi exigent, toutefois, de chaque administrateur qu'il détienne un nombre d'actions minimum fixé par les statuts de l'entreprise. L'article 51 de la loi n° 96-1054 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, prévoit la représentation de l'État dans des filiales d'entreprises publiques, c'est à dire dans des sociétés dont plus de la moitié du capital est détenue directement ou indirectement par une entreprise du secteur public mentionnée par la loi du 26 juillet 1983 ou conjointement par l'État, un établissement public de l'État et le cas échéant des collectivités territoriales. Le nombre de représentants de l'État, au sein des organes dirigeants de ces entreprises publiques est fixé par décret. Moins d'une trentaine d'entreprises sont concernées, dont, par exemple, Thomson Multimédia, SNCF Participations, ou la Compagnie générale des matières nucléaires (COGEMA). Ce panorama de la représentation de l'État dans les organes dirigeants des entreprises du secteur public et du secteur privé permet de constater un vide juridique, s'agissant de la possibilité de sa représentation dans une entreprise privée dont il détiendrait, indirectement, moins de 50% du capital, ou dont un ou plusieurs établissements publics se trouveraient dans cette même situation. Il ne s'agit pas d'hypothèses purement théoriques et dans deux cas concrets au moins, dont le premier est à l'origine du présent article, on se trouve confronté à ce vide juridique. - Il s'agit, en premier lieu, de la constitution, en cours, du nouveau groupe EADS qui devrait devenir la première entreprise européenne et la troisième mondiale dans les domaines de l'aéronautique, de l'espace et de la défense, par la fusion d'Aérospatiale Matra, Dasa (allemand) et Casa (espagnol). La structure de détention du capital d'EADS est la suivante :   13% 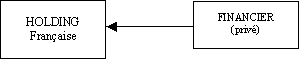 45,8%    (1) SOGEPA : Société de gestion des participations aéronautiques détenue à 99,99 % par l'État. (2) Le % en italique indique le % de détention dans EADS. L'État détient donc, par l'intermédiaire de la SOGEPA, 50% de la holding française, il est indirectement actionnaire minoritaire et, malgré un accord conclu avec l'entreprise, se trouve face à l'impossibilité juridique d'être représenté au conseil d'administration, ce qui est pourtant souhaité par tous les acteurs concernés pour des raisons évidentes de stratégie industrielle. En l'état actuel de la législation la seule solution serait, pour l'État, de satisfaire aux dispositions des articles 95 et 130 de la loi du 26 juillet 1966 susvisée, et d'acquérir le nombre d'actions minimum prévu dans les statuts pour être nommé administrateur. Le même problème pourrait se poser pour EADS, groupe dans lequel l'État détient indirectement 15 % de participations, mais aucune demande de l'État ou de l'entreprise ne semble avoir été formulée à ce jour, en vue d'une représentation au conseil d'administration. Un second exemple permet d'illustrer cette situation, même si, dans ce cas non plus, personne n'a, semble-t-il, envisagé la nécessité de la représentation de l'État. Il s'agit de Thomson CSF, dont l'État détient, par l'intermédiaire de la holding Thomson SA, environ 30 % du capital. Avec le vaste mouvement en cours de regroupements d'entreprises et les probables nouvelles cessions de parts d'entreprises publiques, il peut s'avérer utile, dans certains cas, que l'État, puisse être représenté au titre de sa participation indirecte ou de celle d'un établissement public, dans des sociétés privées. Le paragraphe I ouvre la possibilité à l'État d'être représenté au sein d'un conseil d'administration ou de surveillance d'une entreprise privée dont il détiendrait indirectement au moins 10 % du capital ou d'une entreprise privée dont un ou plusieurs établissements publics de l'État détiendraient directement ou indirectement au moins 10 % du capital. La société doit appartenir au secteur privé, elle doit approuver cette représentation puisqu'elle désignera les représentants, elle pourrait être de droit étranger si ce droit est compatible avec le dispositif juridique proposé. La faculté reconnue à l'entreprise de refuser la nomination de représentants de l'État est confortée par le parallélisme de rédaction entre le premier alinéa du présent projet « l'État peut être représenté... » et les articles 91 et 135 de la loi du 24 juillet 1996 qui précisent : « Une personne morale peut être nommée administrateur... ». A l'inverse le nombre de représentants de l'État dans les filiales d'entreprises publiques est fixé par décret. Trois dispositions du paragraphe I appellent quelques précisions. 1.- Le mode de détermination du seuil de 10 % de participation Pour calculer le niveau de participation publique dans le capital d'une entreprise, est retenue la règle du produit des pourcentages successifs de participation sur chaque chaîne reliant l'État ou un établissement public à l'entreprise concernée. Ce mode de calcul est celui retenu par l'administration fiscale pour apprécier si le minimum de 10% de parts détenues indirectement par une société mère dans une filiale est atteint, en vue de l'application d'un régime fiscal spécifique (instruction 4N-3-88 du 6 mai 1998). L'exigence d'une chaîne ininterrompue de participations majoritaires détenues ensemble ou séparément par l'État et ses établissements publics a été écartée afin de permettre à l'État de bénéficier d'une éventuelle représentation aussi loin que possible dans la chaîne. En revanche dans le système proposé, inhabituel dans le secteur public puisqu'il tolère la rupture de chaîne majoritaire, le pourcentage d'intérêts s'amenuise systématiquement avec l'allongement de la chaîne de détention. Le principe de calcul est le suivant : si la société A détient 80 % du capital de la société B qui détient 30 % du capital de la société C détenant elle même 45 % du capital de la société D, A détient indirectement 10,8 % de D. En application de ce principe, si l'État détient 100 % de la société A qui détient 50 % de la société B qui, à son tour, détient 30 % de la société C qui détient 50 % de D, la représentation de l'État serait possible dans les sociétés B et C mais pas dans la société D dans laquelle la part de l'État ne serait que de 7,5 %. Mais si un établissement public détient, directement ou indirectement, 10 % du capital de la société D, la représentation de l'État dans D devient possible puisque la participation publique totale est alors de 17,5 %. En outre, si un établissement public détient indirectement 9 % du capital d'une société X et que l'État détient directement 6 % du capital de la même société, la participation publique totale est supérieure à 10 %, mais la représentation de l'État serait dans ce cas impossible car l'État serait directement actionnaire. 2.- Le statut des représentants de l'État Le décret n° 94-582 du 12 juillet 1994 relatif aux conseils et aux dirigeants des établissements publics et entreprises du secteur public, prévoit que les représentants de l'État dans les conseils d'administration des entreprises visées doivent être choisis parmi les fonctionnaires de catégorie A et agents contractuels d'un niveau équivalent, en activité ou en retraite. S'agissant des entreprises publiques relevant de l'article 1er de la loi relative à la démocratisation du secteur public, ils peuvent également être choisis parmi les dirigeants de ces mêmes entreprises. Le paragraphe II (1° et 2°) du présent article a repris, s'agissant du choix des personnes, des règles analogues. Les représentants de l'État devront être choisis parmi les agents publics de l'État ou les dirigeants des établissements publics et des sociétés, groupements ou personnes morales, quel que soit leur statut juridique, dans lesquels plus de la moitié du capital est détenue, directement ou indirectement, ensemble ou séparément par l'État et les établissements publics. Les représentants de l'État, sont désignés par l'organe compétent de l'entreprise qui peut donc s'y refuser, sur proposition du ministre dont dépendent les agents publics ou du ministre de tutelle pour les dirigeants d'entreprises du secteur public. S'agissant de la limitation du nombre de mandats, la loi du 24 juillet 1966 (articles 92 et 136), prévoit qu'une personne physique ne peut appartenir simultanément à plus de huit conseils d'administration ou de surveillance de sociétés anonymes ayant leur siège social en France métropolitaine. En outre, l'article 11 de la loi relative à la démocratisation du secteur public interdit à un membre du conseil d'administration ou de surveillance d'appartenir simultanément à plus de quatre conseils dans les entreprises visées aux paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 1er à savoir : - les établissements publics nationaux à caractère industriel et commercial autres que ceux dont le personnel est soumis à un régime de droit public ; - les autres établissements publics nationaux qui assurent à la fois une mission de service public à caractère industriel et commercial et à caractère administratif, lorsque la majorité de leur personnel est soumise aux règles du droit privé ; - les sociétés dont l'État détient directement plus de la moitié du capital. Cette limitation à quatre mandats n'est donc pas applicable aux entreprises privées dont l'État est actionnaire indirect et il existe une incertitude quant à l'application de la limite à huit mandats de la loi sur les sociétés commerciales, cette limite visant les personnes physiques et non les personnes morales. C'est pourquoi, le présent article étant silencieux sur ce point, votre rapporteur souhaite limiter à huit le nombre de mandats exercés par les représentants de l'État, cette limite s'appliquant dans les mêmes conditions que celles posées par l'article 92 de la loi du 24 juillet 1966. L'ensemble des nouvelles dispositions conduirait donc à une limitation à huit mandats dans les entreprises publiques ou privées à l'exception des entreprises publiques de premier rang relevant de l'article 11 de la loi relative à la démocratisation du secteur public. La compatibilité avec les règles du statut de la fonction publique, est garantie par deux dispositions du présent article. Le troisième alinéa du paragraphe I reprend les dispositions qui figurent dans le dernier alinéa de l'article 11 de la loi sur la démocratisation du secteur public, afin de dispenser les représentants de l'État de l'obligation, faite aux administrateurs et membres des conseils de surveillance des entreprises du secteur privé, d'être personnellement propriétaires d'un nombre d'actions minimum de l'entreprise. Cette obligation qui résulte des articles 95 et 130 de la loi du 24 juillet 1966 sur les entreprises commerciales, est en effet contraire aux dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires qui leur interdit de prendre, par eux mêmes ou par personnes interposées, dans une entreprise soumise au contrôle de l'administration à laquelle ils appartiennent ou en relation avec celle-ci, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance. Cette interdiction de détenir des actions à titre personnel a été étendue par la jurisprudence à tous les agents publics de l'État. L'alinéa 4 du I prévoit que toute rémunération perçue par les représentants de l'État pour l'exercice de leur mandat est versée au budget général de l'État. Cette disposition complète le droit existant en matière de régime de rémunération du mandat de représentant de l'État, qui découle de la loi du 26 juillet 1983. Ce mandat est gratuit, à l'exception du remboursement des frais de mission. Il peut faire l'objet d'une rémunération versée au Trésor public pour les entreprises que l'article 4 de la même loi exclut du champ d'application de l'article 11. Ces dernières, auxquelles le présent article ajoute les entreprises dans lesquelles l'État est actionnaire indirect, sont les établissements publics et les sociétés mentionnés aux 1 et 3 de l'article 1er de la loi du 26 juillet 1983 dont le nombre de salariés est inférieur à 200, et les établissements publics et les sociétés explicitement exclues par les annexes II et III de la loi. En outre, les entreprises du secteur public dont le siège est situé à l'étranger ou dans un territoire d'outre mer, sont également exclues du champ d'application de l'article 11 de la loi du 26 juillet 1983. Les jetons de présence qui étaient auparavant versés à un compte spécial du Trésor, viennent abonder le budget général de l'État, depuis la suppression par l'article 62 de la loi de finances du 30 décembre 1987, de ce « compte d'emploi des jetons de présence aux représentants et tantièmes revenant à l'État ». On observera que les interdictions et les limites posées par le présent article, aux représentants de l'État pour l'exercice de leur mandat, s'imposent, non seulement aux fonctionnaires, mais aussi aux dirigeants d'entreprises publiques qui ne sont pas fonctionnaires et qui ne sont donc pas soumis au statut de la fonction publique. Cette rédaction apparaissant trop générale et source de difficulté, votre rapporteur propose un amendement visant à voir appliquer aux seuls agents publics de l'État les restrictions qui découlent des troisième et quatrième alinéas du paragraphe I. 3.- La détermination du nombre de représentants Le paragraphe III du présent article modifie l'article 2 du décret-loi du 30 octobre 1935 (modifié par la loi du 25 juillet 1949 précitée), qui organise le contrôle de l'État sur les sociétés, syndicats et associations ou entreprises de toute nature ayant fait appel au concours financier de l'État. Les représentants élus des salariés, au sein des conseils d'administration de gérance ou de surveillance où siègent également des représentants de l'État, ne sont pas pris en compte dans le calcul du nombre de sièges réservés à l'État. Cette précision est conforme à la pratique actuelle, même si elle n'était sous tendue par aucun texte et la nouvelle règle a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises visées par l'article 2 du décret-loi modifié, dans lesquelles des représentants des salariés siègent au conseil d'administration. Dans les sociétés anonymes qui entrent dans ce champ d'application, le nombre de représentants de l'État ne peut être inférieur à deux. En revanche, le nombre de représentants de l'État dans les entreprises visées par le présent article reste indéterminé et devra résulter, au cas par cas, d'un accord avec l'entreprise concernée. * * * Votre Commission a rejeté un amendement présenté par M. Pierre Hériaud visant à supprimer l'interdiction faite aux représentants de l'État, au sein des conseils d'administration et de surveillance, d'être personnellement propriétaires d'actions de l'entreprise. Votre Rapporteur s'est déclaré défavorable à cet amendement, en précisant que la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires leur interdit de prendre par eux-mêmes des participations dans une entreprise dans laquelle leur administration a des intérêts. Votre Commission a ensuite adopté trois amendements présentés par votre Rapporteur. Les deux premiers (n° 270 et 271)visent à restreindre aux seuls représentants de l'État soumis au statut général des fonctionnaires de l'État, l'interdiction de percevoir personnellement des jetons de présence et celle de détenir des actions de l'entreprise au sein de laquelle ils représentent l'État. Le troisième (n° 272)vise à étendre aux représentants de l'État dans les sociétés anonymes dont il est actionnaire indirect, l'application de l'article 92 de la loi du 24 juillet 1966, qui limite le nombre de mandats que peut exercer une personne physique. Votre Commission a adopté l'article 71, ainsi modifié. * * * Article 72 Objet et régime juridique du contrat d'entreprise Cet article instaure le contrat d'entreprise, contrat qui lie l'État et une entreprise publique sous tutelle de l'État ou dont il est actionnaire. L'entreprise doit être en charge d'une mission de service public, dont la mise en _uvre est l'objet du contrat d'entreprise. Son régime juridique sera celui des actuels contrats de plan. La notion de contrat d'entreprise est introduite au sein de la législation relative à la contractualisation publique. 1.- L'entreprise cocontractante est chargée d'une mission de service public Qu'elle soit un établissement public sous tutelle de l'État, une société dans laquelle l'État est actionnaire majoritaire ou minoritaire, l'entreprise qui passe avec l'État un contrat d'entreprise est chargée d'une mission de service public. Il ne fait pas de doute que les grandes entreprises de réseau, qui actuellement contractent avec l'État, sont chargées d'une telle mission. Les contrats en cours entre l'État et EDF, GDF et La Poste y font référence. Ainsi, le contrat actuellement en vigueur entre l'État et GDF définit les « missions d'intérêt général » qui incombent à l'établissement public. Elles concernent la sécurité des approvisionnements en gaz naturel de la France, l'égalité de traitement, l'aménagement du territoire, l'environnement, la sécurité des approvisionnements intérieurs, le partenariat avec les collectivités locales, et l'effort en faveur de l'emploi et de l'exclusion. Si le texte proposé permet de couvrir les contrats existants, il ouvre aussi la possibilité à toute entreprise chargée d'un service public de contracter avec l'État. La contractualisation au profit du service public est ainsi facilitée, par la définition d'un instrument explicitement mis à sa disposition. 2.- Le contrat d'entreprise porte sur la mission de service public qui incombe à l'entreprise Le contrat d'entreprise a pour seul objet la mission de service public : les « objectifs » décrits par le contrat lui sont « liés », les « moyens » sont ceux nécessaires « pour les atteindre ». Les activités strictement commerciales ou industrielles de l'entreprise sont laissées à l'appréciation de ses dirigeants. Ce resserrement de l'objet du contrat entre l'État et l'entreprise permet ainsi d'aboutir à une rationalisation des rapports entre l'État et le marché. Le champ du contrat n'en reste pas moins large, comme le prouve, par exemple, l'énumération des missions d'intérêt général figurant au contrat passé entre l'État et GDF. Le contrat d'entreprise est donc un instrument assez ouvert pour concerner un nombre substantiel d'entreprises, mais il assigne au contrat un objet précis : le service public. 3.- Le régime juridique du contrat d'entreprise Le contrat d'entreprise est négocié par les ministres chargés de l'économie et du budget, et par les ministres de tutelle de l'entreprise cocontractante. Cette disposition comble le vide juridique de la loi du 29 juillet 1982 qui ne définissait aucune règle en la matière. La disposition présente ne fait que légaliser la pratique actuelle. Ainsi, en 1997, le contrat entre l'État et GDF a été signé par le ministre chargé des Finances, le ministre délégué au budget et le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications. Le contrat ne peut être résilié par l'État avant son terme normal que dans les cas prévus par le contrat lui-même. En reprenant cette disposition déjà présente dans la loi du 29 juillet 1982, le projet garantit une certaine sécurité juridique pour l'entreprise, notamment au regard des engagements financiers de l'État puisque le contrat d'entreprise détermine « les relations financières entre l'État et l'entreprise ». Votre Rapporteur estime que la même garantie doit prévaloir en faveur de l'État, qui doit pouvoir être assuré de la prise en compte des objectifs liés au service public et des moyens y afférents, définis par le contrat. Le contrat d'entreprise est ainsi conçu comme un « vrai contrat » : il ne s'agit pas d'un acte réglementaire déguisé. Les tiers au contrat ne peuvent se prévaloir du contenu du contrat, qui n'engage que les cocontractants. Par contre, chaque partie au contrat est réellement et juridiquement responsable des engagements qu'elle prend face à l'autre partie (19). 4.- Le contrat d'entreprise dans la législation actuelle Le présent article propose de généraliser l'existence des contrats d'entreprise dans la législation actuelle, dès lors que celle-ci fait mention du contrat de plan en application de la loi du 29 juillet 1982. Ainsi, dans la loi du 4 février 1995, modifiée par celle du 25 juin 1999, le contrat d'entreprise est mis à disposition de l'État et des établissements publics ou sociétés concernés, afin de mettre en _uvre « l'égal accès de tous au service public » prévu. Cette disposition permettra aussi de donner la faculté à la SNCF et à La Poste de passer un contrat d'entreprise avec l'État, puisque ce contrat est introduit, au côté du contrat de plan, aux articles 24 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation sur les transports intérieurs et 9 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications (20). Cette disposition ne substitue cependant pas le contrat d'entreprise au contrat de plan. Une telle mesure aurait exigé soit l'abrogation de la loi portant réforme de la planification du 29 juillet 1982, soit la substitution du premier au second, dans tous les textes légaux. Or le contrat de plan doit rester en vigueur, ne serait ce que parce que les contrats de plan État-région ont encore pour base juridique la loi du 29 juillet 1982, comme l'a rappelé encore récemment un arrêt du Conseil d'État (21). * * * Votre Commission a examiné un amendement de M. Pierre Hériaud, tendant à ne permettre qu'aux seules entreprises placées sous la tutelle de l'État, de passer un contrat d'entreprise avec lui. Votre Rapporteur a estimé qu'une société par action, comme France Télécom, pouvait être chargée d'une mission de service public et donc, à ce titre, passer un contrat d'entreprise avec l'État. L'amendement a alors été rejeté. Elle a ensuite adopté un amendement (n° 273) de votre Rapporteur, tendant à préciser le régime juridique de la résiliation des contrats d'entreprise. Votre Commission a adopté l'article 72, ainsi modifié. * * * (articles 4 et 7 de la loi n°83-675 du 26 juillet 1983 Extension du champ d'application des contrats d'entreprise Cet article a pour objet de donner la faculté de passer un contrat d'entreprise avec l'État, dans les conditions et sous les réserves posées par l'article précédent, à tous les établissements et sociétés visés par la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public. L'actuel article 7 de la loi du 26 juillet 1983 sur la démocratisation du secteur public permet au conseil d'administration ou de surveillance des établissements publics ou sociétés visés aux articles 1er et 4 de cette loi (22) de délibérer des grandes orientations stratégiques, économiques, financières ou technologiques, notamment à travers le contrat de plan, avant leur mise en _uvre. Le 1° du présent article introduit le contrat d'entreprise à l'article 7 de la loi du 26 juillet 1983, au côté du contrat de plan. L'existence d'un contrat d'entreprise ou de plan est clairement appréhendée comme une simple éventualité. La liberté de contracter est ainsi clairement explicitée. Sans modifier le sens et la portée de l'article 7, la rédaction proposée inscrit le principe de la délibération par le conseil d'administration ou de surveillance, des grandes orientations stratégiques, économiques, financières et technologiques de l'entreprise, dans le dispositif législatif concernant les conseils d'administration ou de surveillance des sociétés anonymes et dans les dispositions légales ou réglementaires qui s'appliquent spécifiquement aux organes de certains établissements publics. Votre Rapporteur vous propose de modifier cette rédaction afin de clairement signifier que les contrats de plan ou d'entreprise sont des éléments, parmi d'autres, par lesquels sont délibérées les orientations stratégiques de l'entreprise. Le 2° du présent article procède à une adaptation de l'article 7 de la loi du 26 juillet 1983. Les institutions représentatives du personnel des établissements et sociétés visés aux articles 1er et 4 (23) sont informées du projet de passation d'un contrat d'entreprise, comme elles le sont aujourd'hui pour les contrats de plan. Le 3° du présent article prévoit l'extension des dispositions des articles 7, 8 et 9 de la loi du 26 juillet 1983, relatives au fonctionnement du conseil d'administration ou de surveillance et aux droits d'information des institutions représentatives du personnel, à toutes les entreprises et sociétés que l'article 4 excluait du bénéfice de ces mesures(24). L'article 7 de la loi du 26 juillet 1983 garantit, au conseil d'administration ou de surveillance, un droit à la délibération sur les grandes orientations stratégiques, économiques, financières et technologiques de l'entreprise, avant que les mesures qui en découlent soient mises en application. Cela concerne les contrats de plan ou d'entreprise en tant que supports de ces orientations. L'alinéa 2 de l'article 7 assure aux institutions représentatives du personnel de l'entreprise un droit à l'information, sur les projets préparatoires à l'élaboration d'un contrat de plan ou d'entreprise. Cette information est organisée par le conseil d'administration ou le directoire, après avis du conseil de surveillance. L'article 8 précise que le conseil d'administration ou de surveillance se réunit sur convocation du président selon un ordre du jour qu'il a fixé. Le conseil peut ajouter, par un vote à la majorité simple, des points à cet ordre du jour. Si le conseil ne s'est pas réunit depuis plus de deux mois, il peut se réunir sur décision d'au moins un tiers de ses membres, sur un ordre du jour fixé au préalable. L'article 9 garantit aux membres du conseil d'administration les moyens d'exercer leur mandat, en termes de locaux, d'équipements de ces locaux et de secrétariats. Il revient au conseil de décider de ces moyens, ainsi que des conditions d'accès de ses membres dans les établissements de l'entreprise. * * * Votre Commission a rejeté un amendement de M. Pierre Hériaud, tendant à simplifier l'introduction de la notion de contrat d'entreprise dans la loi du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public. Elle a ensuite adopté deux amendements rédactionnels (n° 274 et 275) de votre Rapporteur. Votre Commission a adopté l'article 73, ainsi modifié. Votre Commission a rejeté un amendement de M. Jean-Pierre Balligand visant à insérer un article facilitant, dans les entreprises dans lesquelles l'État détient plus de 20 % du capital, les cessions de parts et les augmentations réservées de capital en faveur des salariés de l'entreprise. Votre Rapporteur a, en effet, considéré que cette disposition trouvera sa place dans le futur projet de loi sur l'épargne salariale. * * * (Article 24 de la loi n° 93-923 du 19 juillet 1993) Information du Parlement sur la situation économique et financière Cet article tend à regrouper l'information du Parlement sur le secteur public. Le paragraphe I fusionne deux rapports du Gouvernement remis au Parlement chaque année. Il s'agit, d'une part, du rapport, institué par l'article 24 de la loi n° 93-923 du 19 juillet 1993 de privatisation, sur la mise en _uvre des opérations de transfert au secteur privé d'entreprises publiques, d'ouverture de capital d'entreprises publiques et de cession de participations minoritaires d'État et, d'autre part, du rapport, institué par l'article 20 de la loi n° 94-679 du 8 août 1994 (1), sur la situation économique des sociétés dont l'État détient directement plus de la moitié du capital et des établissements publics de l'État à caractère industriel et commercial. Le nouveau rapport doit être présenter chaque année au Parlement au plus tard le 30 septembre. La fusion des deux rapports s'accompagne d'ajustements qui en modifient le périmètre et la présentation. La partie concernant les cessions d'actifs du secteur public au secteur privé, issue de l'article 24 de la loi du 19 juillet 1993, retrace désormais de la même façon les opérations fondées sur les titres II et III de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations, alors que la rédaction actuelle ne retrace les opérations fondées sur le titre III qu'en annexe (2). Il s'agit de rendre compte de façon plus complète de ces dernières opérations, qui peuvent être significatives (3) Cette partie du nouveau rapport fera toujours état « des produits encaissés par l'État en cours d'exercice et de leur utilisation ». Le périmètre de la partie du rapport qui est issue de la loi du 8 août 1994 est modifié. Il concerne les établissements publics de l'État qui exercent une activité industrielle et commerciale, et non plus seulement ceux qui sont reconnus comme ayant un caractère industriel et commercial. Les activités industrielles et commerciales de certains établissements publics à caractère administratif entrent ainsi dans le champ du rapport. Il concerne les sociétés que l'État détient majoritairement, « directement ou indirectement ». Seules les sociétés dont l'État possède, directement, plus de la moitié du capital entrent actuellement dans le champ du rapport. La rédaction proposée par le Gouvernement limite cependant le rapport aux « principales » sociétés et « principaux » établissements publics évoqués. Votre Rapporteur propose de ne pas limiter le rapport aux sociétés et établissements « principaux ». En effet, un exemple significatif et utile à l'information des parlementaires peut être relatif à une structure de taille modeste. Votre Rapporteur propose de revenir à la rédaction initiale, issue de la loi du 8 août 1994, afin que le rapport aborde clairement la situation financière des entreprises, l'évolution globale et sectorielle de leur valeur patrimoniale et de leur résultat, ainsi que leurs engagements hors bilan. Le paragraphe II du présent article tend à compléter le rapport évoqué par des éléments relatifs à la mission de l'État, en tant qu'actionnaire de sociétés et tuteur d'établissements publics. Il s'agit, tous les deux ans, de réaliser un bilan de la gestion par l'État, notamment à travers l'action de ceux qui le représentent dans les conseils d'administration ou de surveillance, de ses participations et de ses intérêts. Le paragraphe III précise que cette partie du rapport relative aux missions d'actionnaire et de tuteur de l'État, est présenté au Parlement pour la première fois en 2000. Le paragraphe IV aménage la législation existante, afin de tenir compte de la fusion des rapports. L'article 24 de la loi du 19 juillet 1993, qui créait le rapport sur les cessions d'actif du secteur public, est abrogé. Votre Rapporteur propose d'abroger, de façon symétrique, l'alinéa 2 du a du I de l'article 164 de l'ordonnance portant loi de finances pour 1959, issu de l'article 20 de la loi du 8 août 1994, qui crée le rapport annuel relatif à la situation économique des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés que l'État détient majoritairement. Cette disposition, issue d'une loi ordinaire, peut être abrogée par la présente loi, sans attendre la prochaine loi de finances. * * * Votre Commission a d'abord adopté un amendement rédactionnel (n° 276) de votre Rapporteur, puis trois autres amendements (n° 277, 282 et 283) de votre Rapporteur précisant le contenu du rapport institué par le présent article. Elle a ensuite adopté un amendement (n° 278) de M. Dominique Baert, précisant que ce rapport est accompagné de l'avis du Haut conseil du secteur public, son auteur ayant souligné que l'exposé des motifs du projet de loi le prévoit Puis votre Commission a adopté un amendement (n° 279) de votre Rapporteur, visant à compléter le bilan de l'exercice par l'État de sa mission d'actionnaire ou de tuteur des entreprises publiques, par des éléments concernant sa politique industrielle et sa politique de l'emploi. En conséquence, un amendement du Rapporteur et un amendement de M. Christian Cuvilliez sont devenus sans objet. M. Gérard Bapt a souhaité que ce rapport puisse être examiné avant la discussion budgétaire, permettant ainsi aux parlementaires de travailler de façon plus efficace. Votre Rapporteur a rappelé que la rédaction de l'article 74 obligeait déjà le Gouvernement à présenter son rapport avant le 1er octobre, et qu'ainsi ce souhait était satisfait. Elle a ensuite examiné un amendement de M. Pierre Hériaud, tendant à ce que le bilan de l'exercice par l'État de sa mission d'actionnaire ou de tuteur des entreprises publiques soit élaboré chaque année et non tous les deux ans. Votre Rapporteur, ayant noté que la direction du Trésor estimait que la mise au point d'un tel bilan n'était possible que tous les deux ans, a néanmoins émis un avis favorable à l'adoption de l'amendement. M. Jean-Jacques Jégou a estimé qu'il était normal que l'État puisse présenter un bilan annuel. Le Président Henri Emmanuelli a exprimé son accord avec cette opinion. En conséquence, votre Commission a adopté cet amendement (n° 279). Votre Commission a adopté deux amendements de votre Rapporteur, le premier rédactionnel (n° 280) et le second (n° 281) abrogeant toutes les dispositions instituant les deux rapports que le présent article fusionne en un seul. Votre Commission a adopté l'article 74, ainsi modifié. * * * Votre Commission a rejeté un amendement de M. Yves Cochet, créant un observatoire « des droits de l'être humain et de l'environnement » ayant pour mission d'accompagner et d'encourager les progrès éthiques des entreprises, votre Rapporteur ayant estimé que cet amendement n'avait pas sa place dans le présent projet de loi. Votre Commission a examiné un amendement de M. Yves Cochet portant article additionnel, visant à rendre obligatoire la présentation annuelle au Parlement d'un rapport d'information sur les concours financiers publics ou semi-publics accordés pour des exportations civiles ou militaires. Votre Rapporteur a considéré que cette disposition ne pouvait être retenue en l'état et qu'elle méritait d'être réexaminée. Tout en insistant sur l'importance de ce type d'information pour permettre au Parlement d'exercer son contrôle, M. Jean-Pierre Brard a retiré l'amendement. En conséquence, le sous-amendement rédactionnel présenté par votre Rapporteur est devenu sans objet. * * * Votre Commission a ensuite adopté l'ensemble du projet de loi, ainsi modifié, et vous demande d'émettre un vote favorable à son adoption. () Rapport n° 563 de M. Christian Pierret, au nom de la commission des Finances, IX° législature, p. 166 (1) Circulaire de la direction des affaires criminelles du ministère de la Justice relative à la mise en _uvre de la loi n°90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux provenant du trafic de stupéfiants - 28 septembre 1990. (1) Rapport 1999-2000 sur les typologies du blanchiment des capitaux. (1) Résolution sur le deuxième rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur l'application de la directive relative au blanchiment des capitaux - 9 mars 1999 - JOCE n°C 175 du 21/06/1999. (1) Directive modifiée sur la base du texte COM (1999) 352 final. () Rapport sur les pays ou territoires non-coopératifs - 14 février 2000. (1) Rapport sur les pays ou territoires non coopératifs - 14 février 2000. () CJCE, question préjudicielle du Conseil d'État français, « Association Eglise de scientologie de Paris c/ Premier ministre », 14 mars 2000. () Dans une déclaration du 2 mars dernier, le secrétaire d'État américain au Trésor, M. Larry Summers, annonçait : « The new measures are designated to be graduated, discretionary and targetable » (les nouvelles mesures sont destinées à s'appliquer graduellement, de manière discrétionnaire et ciblée). (1) Rapport sur l'évolution de la distribution : de la coopération à la domination commerciale, n°2072, page 189. (1) Me Jean-Marie Meffre,« Les conditions de la rupture loyale des relations commerciales établies », in Lamy Droit économique, bulletin n°122, novembre 1999, page 5. () L'article 422-1 du code pénal prévoit que « toute personne qui a tenté de commettre un acte de terrorisme est exemptée de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les coupables ». (1) cf. Décision du Conseil constitutionnel n° 99-421 DC du 16 décembre 1999. (1) La définition donnée à l'article 355 de la loi du 24 juillet 1966 est en effet plus restrictive (voir commentaire de l'article 61). (1) Pour éviter les cumuls abusifs, l'article 83-1, alinéa 2 du décret n 67-236 du 23 mars 1967 dispose que chaque administrateur ne peut disposer, au cours d'une même séance, que d'une seule procuration. (1) cf. Chambre commerciale de la Cour de Cassation, 14 décembre 1993, affaire Compagnie de navigation mixte c/Allianz. () Revue CMF, n°25, février 2000. (1) Rapport sur les typologies du blanchiment des capitaux / 1999-2000. () Le régime juridique du contrat de plan, qui est repris mot pour mot dans la disposition qui vous est soumise pour définir celui du contrat d'entreprise, a été ainsi éclairé par un arrêt du Conseil d'État Ministre chargé du plan et de l'aménagement du territoire c. communauté urbaine de Strasbourg, du 8 janvier 1988. (22) Il s'agit des deux dispositions législatives qui prévoient la contractualisation entre l'État et respectivement la SNCF et La Poste. (3) CE, 25 octobre 1996, association estuaire-écologie. (1) Il s'agit des établissements publics à caractère industriel et commercial, dont le statut du personnel est de droit privé, des établissements publics qui gèrent des services publics à caractère industriel et commercial et à caractère administratif, dont le statut du personnel est de droit privé, des sociétés de tout type, et des filiales détenues en majorité, directement ou indirectement, conjointement ou pas, par l'État, ces établissements et ces sociétés, qui ont un effectif salarié supérieur à 200, en moyenne sur les 24 derniers mois. Il faut en exclure les établissements et sociétés qui figurent aux annexes II et III de la loi du 26 juillet 1983, parmi lesquels les ports autonomes et les théâtres nationaux. (2) Il s'agit des établissements publics à caractère industriel et commercial dont le statut du personnel est de droit privé, des établissements publics qui gèrent des services publics à caractère industriel et commercial et à caractère administratif, dont le statut du personnel est de droit privé, des sociétés de tout type, dont l'effectif salarié est inférieur à 200, en moyenne sur les 24 derniers mois. Il s'agit aussi des établissements et sociétés qui figurent aux annexes II et III de la loi du 26 juillet 1983, parmi lesquels on compte notamment les ports autonomes et les théâtres nationaux. © Assemblée nationale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
