
![]()
N° 3323
--
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 11 octobre 2001.
AVIS
PRÉSENTÉ
AU NOM DE LA COMMISSION DE LA DÉFENSE NATIONALE ET DES FORCES ARMÉES(1),
SUR LE PROJET DE loi de finances pour 2002 (n° 3262)
TOME XI
COMPTES SPÉCIAUX DU TRÉSOR
PAR M. Loïc BOUVARD,
Député.
--
(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.
Voir le numéro : 3320 (annexe no 43).
Lois de finances.
La Commission de la Défense nationale et des Forces armées est composée de :
M. Paul Quilès, président ; M. Robert Gaïa, M. Jean-Claude Sandrier, M. Michel Voisin, vice-présidents ; M. Pierre Lellouche, Mme Martine Lignières-Cassou, M. Jean-Claude Viollet, secrétaires ; M. Jean-Marc Ayrault, M. Jacques Baumel, M. Jean-Louis Bernard, M. André Berthol, M. Jean-Yves Besselat, M. Bernard Birsinger, M. Loïc Bouvard, M. Jean-Pierre Braine, M. Jean Briane, M. Marcel Cabiddu, M. Antoine Carré, M. Bernard Cazeneuve, M. Guy-Michel Chauveau, M. Alain Clary, M. François Cornut-Gentille, M. Charles Cova, M. Michel Dasseux, M. Jean-Louis Debré, M. François Deluga, M. Philippe Douste-Blazy, M. Jean-Pierre Dupont, M. François Fillon, M. Christian Franqueville, M. Yves Fromion, M. Yann Galut, M. René Galy-Dejean, M. Roland Garrigues, M. Henri de Gastines, M. Bernard Grasset, M. Jacques Heuclin, M. François Hollande, M. Jean-Noël Kerdraon, M. François Lamy, M. Claude Lanfranca, M. Jean-Yves Le Drian, M. Georges Lemoine, M. François Liberti, M. Jean-Pierre Marché, M. Franck Marlin, M. Jean Marsaudon, M. Christian Martin, M. Guy Menut, M. Gilbert Meyer, M. Michel Meylan, M. Jean Michel, M. Jean-Claude Mignon, M. Charles Miossec, M. Alain Moyne-Bressand, M. Arthur Paecht, M. Jean-Claude Perez, M. Robert Poujade, M. Jean-Pierre Pujol, Mme Michèle Rivasi, M. Michel Sainte-Marie, M. Bernard Seux, M. Guy Teissier, M. André Vauchez, M. Émile Vernaudon, M. Aloyse Warhouver, M. Pierre-André Wiltzer.
INTRODUCTION 7
I. - LES COMPTES SPÉCIAUX DU TRÉSOR AFFÉRENTS À LA DÉFENSE RECOUVRENT DES ENJEUX FINANCIERS ET INDUSTRIELS SANS GRAND RAPPORT ENTRE EUX 9
A. À L'EXCEPTION DES CONSTRUCTIONS NAVALES MILITAIRES, LES COMPTES DE COMMERCE DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE RETRACENT DES ACTIVITÉS DE FAIBLE IMPORTANCE 9
1. Le budget du compte 904-05 (constructions navales militaires) est élevé car il finance l'activité de DCN, industriel de premier plan en Europe 10
2. Les autres comptes de commerce de la Défense n'ont pas la même portée industrielle et financière 12
a) Les crédits des subsistances militaires (compte 904-01) restent stables car la professionnalisation des armées s'achève 12
b) Le financement des exploitations industrielles des ateliers aéronautiques de l'Etat (compte 904-03) évolue peu parce que l'activité du SMA est spécifique 13
c) Les moyens consacrés à l'approvisionnement des armées en produits pétroliers (compte 904-20) restent relativement élevés à cause du cours des carburants 14
B. LE COMPTE D'AFFECTATION SPÉCIALE PERMET À L'ETAT DE SOUTENIR ET DE FAVORISER LES RESTRUCTURATIONS DU SECTEUR PUBLIC DE L'ARMEMENT 15
1. Le compte n° 902-24 est le support des recompositions du capital public des industries de défense 16
2. Ce compte retrace aussi les apports de l'Etat actionnaire aux entreprises en difficulté 17
II. - DES RÉFORMES AMBITIEUSES RESTENT NÉCESSAIRES POUR PARTICIPER À L'EUROPE DE L'ARMEMENT, SURTOUT AU SEIN DES ANCIENS ARSENAUX 19
A. LES ENTREPRISES EUROPÉENNES DE L'AÉRONAUTIQUE ET DE L'ESPACE ONT ENGAGÉ UN PROCESSUS DE CONCENTRATION QUI DOIT SERVIR DE MODÈLE AUX AUTRES SECTEURS 19
1. Le regroupement des capacités européennes est le plus poussé dans le domaine des missiles 20
a) MBDA est le second missilier mondial derrière Raytheon 20
b) L'intégration définitive des capacités européennes achoppe sur la place des entreprises allemandes du secteur 21
2. Les restructurations de l'espace doivent se poursuivre 22
a) L'industrie spatiale européenne bénéficie d'un marché institutionnel trop restreint pour se positionner favorablement sur le marché commercial mondial 22
b) L'activité des lanceurs doit être réorganisée autour d'EADS - LV 23
c) Dans le secteur des satellites, Astrium et Alcatel Space Industries se concurrencent 24
3. La persistance de concurrences frontales dans la production d'avions et d'hélicoptères de combat est anachronique au regard du reste du secteur de l'aéronautique 25
a) La forte rivalité européenne dans le domaine des avions de combat entretient des duplications injustifiées 26
b) Eurocopter ne fédère pas encore la totalité de l'industrie européenne des hélicoptères 27
c) Le transport militaire se structure progressivement autour d'EADS 27
B. DE GRANDS GROUPES EUROPÉENS DE L'ÉLECTRONIQUE DE DÉFENSE SE DÉVELOPPENT DÉSORMAIS AU NIVEAU MONDIAL 28
1. Thales semble en passe de réussir sa stratégie de développement mondial par acquisitions 28
2. BAe Systems et EADS ont également vocation à être présents sur le marché de l'electronique militaire 30
C. LE SECTEUR DE LA CONSTRUCTION NAVALE EST EN PLEINE RESTRUCTURATION, EN FRANCE PLUS TIMIDEMENT QU'AILLEURS 30
1. Deux modèles industriels s'opposent, qui reposent l'un sur les regroupements de capacités autour de systémiers, l'autre sur le primat des chantiers navals 31
2. DCN est pénalisé par son statut d'administration pour participer au processus en cours 32
a) La France est le dernier pays d'Europe où subsiste un grand industriel naval rattaché à son ministère de tutelle 33
b) DCN a vocation à se rapprocher plus étroitement de Thales pour fédérer par la suite des chantiers navals encore indépendants 34
c) Une transformation rapide en société avec ouverture du capital est absolument impérative 35
D. L'INDUSTRIE DE L'ARMEMENT TERRESTRE EN EUROPE EST TOUJOURS TRÈS MORCELÉE 36
1. A l'inverse de leurs concurrents américains, les groupes européens ne disposent pas d'une taille critique 36
2. Les difficultés de Giat-Industries empêchent la société nationale de jouer un rôle fédérateur 37
a) Des coopérations ont certes été engagées 37
b) L'assainissement financier reste néanmoins un préalable primordial 38
E. LES ENTREPRISES D'ÉQUIPEMENT AÉRONAUTIQUE ET DE PROPULSION SONT RESTÉES À L'ÉCART DES RAPPROCHEMENTS EUROPÉENS MAIS DOIVENT S'Y PRÉPARER 40
1. Les partenariats revêtent le plus souvent la forme de coopérations ponctuelles 40
2. Le groupe Snecma est bien placé pour participer à la création d'un « EADS des motoristes » 41
CONCLUSION 45
EXAMEN EN COMMISSION 47
MESDAMES, MESSIEURS,
La présentation d'un avis budgétaire sur les comptes spéciaux du Trésor est destinée à étudier les équilibres financiers des services industriels et entreprises publiques de l'armement, tout en permettant de dresser un bilan sur leur fonctionnement, leurs résultats et sur les réformes envisagées ou conduites pour en améliorer la productivité et la compétitivité.
Le récent rapport de Cour des Comptes sur les industries d'armement de l'Etat, rendu public le 25 octobre dernier, a confirmé l'intérêt et l'actualité d'une telle démarche. Votre Rapporteur s'y référera lorsqu'il étudiera la situation de certains services ou entreprises plus particulièrement analysés par la Cour (le service de la maintenance aéronautique - SMA - , DCN et Giat-Industries).
Deux catégories de comptes spéciaux du Trésor intéressent, à des titres divers, le ministère de la Défense :
- les comptes de commerce qu'il gère directement :
_ 904-01 « Subsistances militaires » ;
_ 904-03 « Exploitations industrielles des ateliers aéronautiques de l'Etat » ;
_ 904-05 « Constructions navales de la marine militaire » ;
_ 904-20 « Approvisionnement des armées en produits pétroliers ».
- le compte d'affectation spéciale 902-24, relatif aux « produits de cessions de titres, parts et droits de sociétés », qui relève du ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, et reflète la situation du secteur public de l'armement.
Depuis trois ans, de profonds changements ont affecté les services industriels et les entreprises publiques de l'armement : Aérospatiale a fusionné avec Matra Hautes Technologies, puis DASA et CASA ; la direction des constructions navales, devenue le service à compétence nationale DCN, a modernisé son système de gestion sans néanmoins changer de statut ; Giat-Industries a mis en _uvre un nouveau plan pour assainir sa situation financière ; le SMA a entrepris une réforme interne cohérente.
D'autres réformes sont en cours : le Gouvernement a enfin décidé de transformer DCN en société ; l'Etat a accepté de céder 25 % de sa participation au capital de l'entreprise Snecma, afin de lui permettre de nouer des alliances européennes.
Votre Rapporteur tire deux enseignements de ces démarches :
- l'avènement de l'Europe de la défense doit guider les choix de réforme du secteur public de l'armement ;
- le statut de compte de commerce n'est pas adapté pour des activités industrielles confrontées à une internationalisation croissante.
La naissance d'EADS était un premier pas dans le secteur de l'aéronautique et de l'espace, qui en appelle d'autres dans les domaines de la construction navale, de la propulsion et de l'armement terrestre. Les recommandations formulées par votre Rapporteur au sujet de DCN dans ses avis budgétaires sur les projets de lois de finances pour les années 2000 et 2001 semblent avoir reçu un écho favorable, bien que partiel et tardif. Une industrie européenne de l'armement intégrée se met progressivement en place : il convient dès à présent de préparer les services industriels et les entreprises publiques du secteur à y participer.
La réforme du secteur public de l'armement est désormais urgente ; l'immobilisme statutaire n'est plus possible car l'avenir des services industriels de l'Etat et des entreprises publiques passe par des alliances européennes.
*
Après avoir présenté le cadre budgétaire des différents comptes spéciaux du Trésor relevant de la défense, ce rapport examinera les réformes du secteur public de l'armement et des services industriels du ministère de la Défense dans le contexte de recomposition des industries européennes de défense.
I. - LES COMPTES SPÉCIAUX DU TRÉSOR AFFÉRENTS À LA DÉFENSE RECOUVRENT DES ENJEUX FINANCIERS ET INDUSTRIELS SANS GRAND RAPPORT ENTRE EUX
Les deux catégories de comptes spéciaux du Trésor qui concernent le ministère de la Défense n'ont pas le même objet.
Les quatre comptes de commerce qui intéressent directement les activités de défense ont une justification commerciale et industrielle. Ceux dont relèvent les subsistances militaires et les approvisionnement des armées en produits pétroliers s'apparentent à un mode comptable de regroupement d'achats ou d'approvisionnements spécifiques des armées. Les autres, DCN et le SMA, sont de véritables services industriels de l'armement.
Le compte d'affectation spéciale 902-24 a une vocation patrimoniale. Les participations de l'Etat dans les industries d'armement y sont rattachées et gérées.
A. À L'EXCEPTION DES CONSTRUCTIONS NAVALES MILITAIRES, LES COMPTES DE COMMERCE DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE RETRACENT DES ACTIVITÉS DE FAIBLE IMPORTANCE
L'ordonnance organique du 2 janvier 1959 dispose que les comptes de commerce retracent « des opérations de caractère industriel ou commercial effectuées à titre accessoire par les services publics de l'État ». Les services non dotés d'une personnalité juridique propre peuvent ainsi exercer des activités pour lesquelles les règles habituelles du droit budgétaire et de la comptabilité publique ne sont pas adaptées.
Le régime juridique des comptes de commerce prévoit les exceptions suivantes aux principes classiques qui régissent les finances publiques :
- un découvert en fin d'exercice, sous réserve d'une autorisation préalable du Parlement, comme ce fut le cas en l'an 2001 pour les comptes 904-01 « Subsistances militaires » et 904-20 « Approvisionnement des armées en produits pétroliers », qui ont reçu respectivement une autorisation de découvert de 7,6 et 45,7 millions d'euros (50 et 300 millions de francs) ;
- un report de leur solde (qu'il soit positif ou négatif) à l'exercice suivant, en dérogation au principe de l'annualité budgétaire ;
- une unité de compte, le compte étant ainsi alimenté indistinctement par les différents chapitres budgétaires, contrairement à la règle de spécialité des crédits ;
- des résultats annuels conformes aux règles du plan comptable général (article 26 de l'ordonnance organique de 1959), cette obligation favorisant le contrôle du Parlement, de la Cour des Comptes et des ministères gestionnaires.
Ces éléments de réelle souplesse comptable ont conduit à choisir le statut de compte de commerce pour la gestion de nombreuses activités industrielles et commerciales rattachées au ministère de la Défense ; celui-ci gérait, en 2001, quatre des dix comptes de commerce encore existants.
Le projet de loi de finances pour 2002 prévoit un montant de dépenses nettes d'environ 2,46 milliards d'euros (16,1 milliards de francs) pour les comptes n° 904-01, 904-03, 904-05 et 904-20, soit 8,4 % des dépenses du ministère de la Défense hors pensions.
LES QUATRE COMPTES DE COMMERCE
DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE
N'ÉVOLUERONT PAS DE LA MÊME FAÇON ENTRE 2001 ET 2002
(en millions d'euros) | |||
Comptes de commerce |
Recettes - Dépenses |
Évolution | |
Loi de |
Projet de Loi de |
2001 / 2002 | |
904-01 Subsistances militaires |
60,98 |
60,98 |
- _ |
904-03 Exploitations industrielles |
254,59 |
269,1 |
+ 5,7 % _ |
904-05 Constructions navales |
1 655,6 |
1 661,69 |
+ 0,3 % _ |
904-20 Approvisionnements |
457,35 |
519 |
+ 13,5 % _ |
TOTAL CATEGORIE |
2 428,52 |
2 460,77 |
+ 1,3 % _ |
Mis en place par la loi de finances initiale pour 1968, le compte de commerce 904-05 « Constructions navales de la marine militaire » est crédité, en recettes, du produit des cessions de matériels et des constructions navales aux services clients et à l'exportation, du montant des réparations, prestations de services, études et recherches et du produit des ventes de biens mobiliers et immobiliers affectés à l'exploitation du service des constructions navales.
Il supporte, en dépenses, le coût des achats de matières premières, outillages et matériels consommables ou utilisables, le règlement des commandes de fabrications, de constructions et de réparations navales placées dans l'industrie, le coût de renouvellement des immobilisations, les frais de fonctionnement du service, les versements au titre des activités d'exportation (prévus par l'article 62 de la loi de finances pour 1979) et les remboursements des dépenses de personnel au budget général.
Les recettes et les dépenses ont été estimées par la loi de finances pour 2001 à 1 655,6 millions d'euros (10,85 milliards de francs) ; elles devraient connaître une très légère augmentation à 1 661,69 millions d'euros (10,9 milliards de francs), selon les prévisions du projet de loi de finances pour 2002.
La reprise d'activité dans le domaine des acquisitions d'équipements neufs par la Marine nationale se confirme (+ 21 %). Cette tendance explique à elle seule l'évolution prévue des recettes et des dépenses de DCN.
En revanche, le maintien en condition opérationnelle des navires subit toujours les conséquences de l'ajustement du format de la flotte. La baisse d'activité (- 8,5 %) devrait poser des problèmes à certains établissements, notamment Brest et Toulon.
Enfin, les prévisions de plan de charge lié aux exportations et à la diversification ne sont pas bonnes (- 25 %) car les contrats à l'export ne compensent pas totalement l'achèvement des principaux projets de diversification.
Ces évolutions, retracées dans le tableau ci-après, affectent plus particulièrement le volume des achats de matières et le niveau des prestations de services directes. La fin du financement des mesures de dégagement des cadres à 52 ans commence à se faire sentir favorablement sur le montant des charges de personnel (- 2 %).
LE PLAN DE CHARGE DE DCN
DEVRAIT DIMINUER QUELQUE PEU EN 2002
Réalisations (1) |
Prévisions (1) | ||||||||
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
Evolution |
2003 | |
Etudes et construction neuve |
10,3 |
9,5 |
7,2 |
4,4 |
3,4 |
3,8 |
4,6 |
+ 21 % |
5,2 |
Entretien |
8,8 |
8,6 |
6,0 |
6,6 |
5,2 |
5,9 |
5,4 |
- 8,5 % |
5,7 |
Exportations et |
5,2 |
4,4 |
5,4 |
6,9 |
4,0 |
4,4 |
3,3 |
- 25 % |
2,6 |
TOTAL |
24,3 |
22,5 |
18,6 |
17,9 |
12,6 |
14,1 |
13,3 |
- 5,7 % |
13,5 |
(1) En millions d'heures. | |||||||||
Les trois comptes de commerce du ministère de la Défense qui ont vocation à conserver ce statut ne sont pas comparables au compte 904-05. Leur activité est très spécifique et le niveau de leurs crédits beaucoup plus faible.
Le compte de commerce 904-01 « subsistances militaires » a été créé par la loi du 26 août 1943. Géré par le commissariat de l'armée de Terre, il retrace l'achat, le conditionnement, le stockage et la cession aux corps de troupe et autres parties prenantes relevant du ministère de la Défense et des départements approvisionnés par celui-ci, de toutes les denrées ou matières nécessaires aux services des vivres, des fourrages, du chauffage et de l'éclairage.
Le régime juridique de compte de commerce permet de constituer très rapidement des suppléments d'approvisionnement nécessaires aux opérations extérieures et en temps de crise. Ce statut est approprié pour les activités du Commissariat de l'armée de Terre relatives à la logistique de subsistance des troupes ; son remplacement d'ici 2003 par une structure d'approvisionnement commune aux armées et aux services communs du ministère de la Défense n'est pourtant pas exclu.
Au regard du total des crédits des comptes de commerce du ministère de la Défense dont il représente 2,5 %, le compte 904-01 est relativement négligeable.
Ce compte reçoit, en recettes, le produit des cessions effectuées aux divers corps de troupe ou organismes consommateurs. Il supporte, en dépenses, le prix d'achat des denrées et différentes matières relevant de son objet, le remboursement au budget général des dépenses de personnel et les frais généraux du service.
Le projet de loi de finances initiale pour l'année 2002 maintient les recettes à leur niveau de 2001, soit 38,11 millions d'euros (250 millions de francs). Les prévisions de dépenses, qui étaient évaluées à 60,98 millions d'euros (400 millions de francs) en 2001, restent inchangées en 2002.
Pour compenser l'écart de 23 millions d'euros (150 millions de francs) entre recettes et dépenses, il est prévu d'apurer partiellement le solde de trésorerie du compte qui s'élève à 35 millions d'euros (230 millions de francs), en croissance constante ces dernières années. Ce procédé comptable est exceptionnel ; il ne pourra pas être reconduit au delà de l'année 2002.
La professionnalisation des armées étant terminée, les recettes et dépenses du compte 904-01 n'évoluent pas par rapport à l'année passée : les effectifs sont stables, le coût de leur alimentation et de leur chauffage également.
Créé par la loi du 30 décembre 1952, le compte 904-03 retrace les recettes et les dépenses afférentes aux réparations, modifications, fabrications et prestations diverses effectuées sur des matériels aériens par les ateliers industriels de l'aéronautique (AIA) de l'Etat. Le produit des aliénations et des transferts d'affectation de biens immobiliers et celui des aliénations et cessions de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces ateliers y sont également reportés.
Les trois AIA de Cuers-Pierrefeu, Bordeaux et Clermont-Ferrand ont été regroupés au sein du SMA en 1997.
Deux types d'acteurs interviennent sur le marché de la maintenance aéronautique en France : des industriels privés (Snecma, Air France) et des établissements du ministère de la Défense (SMA, Ateliers de réparation de l'armée de l'Air et de l'aéronautique navale). La part du SMA dans les différentes activités militaires de la maintenance aéronautique industrielle varie de 20 %, dans le domaine des équipements, à 40 % pour les cellules d'aéronefs et 60 % pour les moteurs.
Afin d'être plus compétitif, le SMA a entrepris d'améliorer le suivi de sa gestion et la maîtrise de ses coûts de production. Au titre des mesures mises en _uvre dans le cadre de son plan d'entreprise depuis 1999, le SMA :
- renouvelle actuellement son système comptable (mise en place de SISMA), de manière à être en mesure de présenter des comptes certifiés en 2002 ;
- termine la contractualisation de l'ensemble de ses prestations, afin de réaliser de substantielles économies pour ses clients budgétaires ;
- poursuit l'amélioration de son outil de production selon la technique anglo-saxonne du benchmarking (comparaison avec ses homologues et partenaires) et la réorganisation de ses activités administratives et financières (projet RFSA) : l'objectif est d'optimiser les besoins des clients et de réduire les coûts de fonctionnement d'environ 30 millions d'euros (196,8 millions de francs) d'ici 2003-2004.
Un accord industriel pour la maintenance des moteurs de Mirage à l'exportation a été conclu avec Snecma. De même, un partenariat avec Dassault Aviation dans le domaine de l'entretien des avions de combat a fait l'objet d'une lettre d'intention. Des alliances industrielles européennes ne sont pas envisagées ; il est vrai que le secteur d'activité des services de maintenance est très spécifique et ne représente pas un enjeu fondamental pour l'Europe de l'armement à court terme.
La loi de finances initiale pour 2001 avait prévu un niveau de recettes et de dépenses de 254,6 millions d'euros (1,67 milliard de francs). Le projet de budget pour l'année 2002 établit les crédits du SMA à 269,1 millions d'euros (1,76 milliard de francs), soit une hausse qui résulte essentiellement de l'augmentation des prestations à l'armée de l'Air (+ 8,4 %) et à l'Aéronavale ( + 11 %).
La charge de travail a diminué de 0,9 % en 2001 ; une augmentation de l'ordre de 0,85 % est prévue pour 2002.
LA CHARGE DE TRAVAIL DU SMA
RESTE STABLE POUR L'INSTANT
(en millions d'heures) | |||||
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 | |
AIA Bordeaux |
0,979 |
0,972 |
0,927 |
0,907 |
0,897 |
AIA Clermont-Ferrand |
1,288 |
1,216 |
1,290 |
1,295 |
1,239 |
AIA Cuers Pierrefeu |
0,919 |
0,904 |
0,879 |
0,866 |
0,958 |
Total |
3,186 |
3,092 |
3,096 |
3,068 |
3,094 |
La Cour des Comptes s'est inquiétée d'une diminution possible du plan de charge du SMA à plus long terme. Pour faire face à cette évolution, un rapprochement structurel des AIA avec les filiales des industriels de l'aéronautique paraît inévitable : les AIA de Clermont-Ferrand (réparations et maintenance) et Bordeaux (moteurs) pourraient travailler en coopération avec EADS et Snecma. Des partenariats doivent être envisagés sans attendre.
Le compte de commerce 904-20 « approvisionnements des armées en produits pétroliers » a été créé par la loi de finances du 29 décembre 1984.
Il a pour objet de retracer, en recettes, les cessions de produits pétroliers aux armées françaises ou alliées, les revenus de l'exploitation de l'oléoduc Donges-Metz, et les recettes diverses.
En dépenses, il identifie l'achat des produits pétroliers pour le compte des armées nationales ou alliées, le remboursement des frais engagés par le budget de la Défense pour des cessions à des gouvernements étrangers, et les charges d'exploitation de l'oléoduc Donges-Metz. Il ne couvre pas les charges de fonctionnement du SEA, qui relèvent du budget général.
Le compte 904-20 permet au SEA de gérer son activité comme le ferait une entreprise de distribution de produits pétroliers : acquisition de carburants auprès de raffineurs (sur le territoire national ou à l'étranger), stockage, distribution aux armées françaises ou alliées.
Le projet de loi de finances pour l'année 2002 prévoit une hausse significative de 13,5 % des crédits affectés à ce compte, leur montant passant de 457,3 à 519 millions d'euros (de 3 à 3,4 milliards de francs) l'an prochain : les besoins des troupes déployées en opérations extérieures (Kosovo, Bosnie-Herzégovine, Macédoine) et les variations du cours du pétrole expliquent cette évolution. D'un point de vue budgétaire, le compte 904-20 est le plus important des comptes de commerce du ministère de la Défense après DCN. Le statut actuel permet de :
- constituer un stock qui n'appartient pas directement à chacune des armées ;
- retracer avec exactitude les opérations d'achat et de vente de produits pétroliers ;
- individualiser facilement les consommations de chaque armée ;
- disposer d'une trésorerie polyvalente qui favorise le paiement des fournisseurs indépendamment de la destination finale des produits.
Ce régime juridique a également facilité le rôle de leader logistique de la France lors des opérations extérieures des forces armées françaises et étrangères, comme c'est le cas pour la KFOR au Kosovo ou la SFOR en Bosnie.
Jusqu'à présent, le compte de commerce s'est révélé bien adapté pour isoler et retracer les opérations du SEA, dont le volume est directement affecté par les fluctuations imprévisibles des cours du baril et du dollar. L'année passée, votre Rapporteur s'était inquiété de la sous-évaluation des coûts des carburants dans la définition du montant des crédits en faveur du SEA. Le projet de loi de finances pour 2002 pourrait se trouver hypothéqué par les conséquences sur le marché des produits pétroliers de la riposte alliée aux attentats commis à New York et Washington le 11 septembre dernier.
Néanmoins, une transformation du compte de commerce n'apparaît pas souhaitable, même si l'internationalisation de l'activité du SEA devait s'accentuer.
B. LE COMPTE D'AFFECTATION SPÉCIALE PERMET À L'ETAT DE SOUTENIR ET DE FAVORISER LES RESTRUCTURATIONS DU SECTEUR PUBLIC DE L'ARMEMENT
Le compte d'affectation spéciale a pour unique objet de déroger au principe de non-affectation des recettes aux dépenses, à la différence des comptes de commerce, qui visent à permettre l'affectation des recettes aux dépenses et la compensation entre différents chapitres budgétaires. Il est doté de crédits limitatifs et ne dispose pas d'une autorisation de découvert, même s'il existe quelques comptes d'affectation spéciale qui retracent des opérations à caractère temporaire.
Le compte 902-24 a été créé par la loi de finances pour 1993. Son champ a été élargi par la loi de finances pour 1997 aux opérations autrefois imputées au compte 904-09 « Gestion de titres du secteur public et apports et avances aux entreprises publiques ».
Reflétant la politique industrielle de l'Etat dans le domaine du secteur public de l'armement, il retrace :
- en recettes, le produit des ventes par l'Etat de titres, parts ou droits de sociétés ;
- en dépenses, les dotations en capital, les avances d'actionnaire et autres apports aux établissements et entreprises publics, les dépenses relatives aux ventes de titres, de parts ou de droits de sociétés.
Les flux constatés sur ce compte indiquent quelles sont les priorités de l'Etat pour l'industrie de l'armement. L'objectif est à chaque fois de pérenniser les compétences nationales : les cessions de participations publiques au capital d'entreprises de défense favorisent les alliances européennes ; les recapitalisations préparent l'assainissement financier préalable à des partenariats aujourd'hui indispensables.
Le produit des cessions de participations, de titres et de droits de l'actionnaire public dans le secteur de l'armement est affecté a ce compte. Le ministère de la Défense n'est concerné que de manière indirecte puisqu'il n'en est pas le gestionnaire.
Le niveau des recettes illustre le degré d'ouverture du secteur public aux alliances ou aux recompositions.
Le secteur public de l'armement a profondément évolué ces dernières années. Le compte 902-24 permet de l'attester, puisqu'y ont été successivement inscrits le produit net de la privatisation d'Aérospatiale-Matra (673 millions d'euros/ 4 416 millions de francs en 1999) et celui des ajustements de participations dans EADS (1 095,6 millions d'euros / 7 187 millions de francs en 2000).
Il arrive que d'importantes réformes soient réalisées par échanges de participations, qui ne peuvent être retracés par le compte 902-24. Ce fut le cas de la privatisation de Thomson-CSF, devenu Thales, qui a été effectuée en contrepartie d'apports industriels par Alcatel et Dassault industries (1998), puis par échange de participations au profit d'Alcatel (1999).
Au cours de l'année 2002, l'Etat devrait probablement céder à des investisseurs institutionnels et individuels, ainsi qu'à des salariés du groupe, 25 % de sa participation au capital de la société Snecma. A l'issue de cette vente, l'Etat conservera sa position d'actionnaire majoritaire avec 72,3 % des titres. Le contexte boursier actuel a conduit à reporter cette opération, initialement prévue pour le 11 octobre dernier. Des recettes d'un montant de l'ordre de 1,5 milliard d'euros (9,8 milliards de francs) étaient attendues, sur la base d'une valorisation de l'entreprise à environ 6 milliards d'euros (39,4 milliards de francs). Votre Rapporteur espère que la vente d'une partie du capital de Snecma ne sera pas effectuée au détriment du patrimoine national ; il convient d'attendre au préalable que le marché soit stabilisé.
Le produit de cette cession d'actifs publics pourrait utilement être affecté, au moins en partie, aux besoins d'entreprises publiques de l'armement comme la société nationale des poudres et explosifs (SNPE) ou Giat-Industries.
Les dépenses du compte d'affectation spéciale 902-24 reflètent les défaillances du secteur public. Les apports financiers consentis par l'Etat en faveur de certaines industries d'armement relèvent de ses obligations d'actionnaire : aux termes de la loi du 26 juin 1966 sur les sociétés commerciales, il est tenu de reconstituer leur capital social.
Destinées à préserver des savoir-faire dont l'utilité stratégique n'est pas à démontrer, de telles dépenses doivent impérativement être accompagnées de solides contreparties, en termes de rigueur de gestion et de modernisation.
La société nationale Giat-Industries est la principale bénéficiaire de ces dotations. Le montant total des recapitalisations opérées en sa faveur depuis sa création s'élève à 2,66 milliards d'euros (17,45 milliards de francs), répartis comme suit :
- 572 millions d'euros de dotations en capital en 1996, soit 6 millions inscrits en dépense du compte 902-24 et 566 millions provenant du chapitre 54-90 du budget des charges communes ;
- 564 millions de dotations en capital, intégralement inscrits en dépense du compte 902-24 en 1997 ;
- 656 millions d'avances d'actionnaire, en 1998 ;
- 868 millions de dotations en capital, prélevés eux aussi sur le compte 902-24 en 1999, afin d'apurer les pertes et de reconstituer les capitaux propres de la société nationale ;
La loi de finances rectificative de l'année 2001 devrait prévoir un nouveau versement de 610 millions d'euros (4 milliards de francs) qui seront prélevés sur le même compte. Giat-Industries aura donc bénéficié à la fin de cette année de recapitalisations d'un montant de 3,27 milliards d'euros (21,45 milliards de francs).
Ces sommes sont généralement prélevées sur le titre V du budget du ministère de la Défense, ce qui pénalise à due concurrence les investissements des armées.
La SNPE pourrait également bénéficier des crédits du compte 902-24. Ses fonds propres s'élèvent en effet à 266,8 millions d'euros (1,75 milliard de francs) pour un endettement d'environ 343 millions d'euros (2,25 milliards de francs). Une augmentation de capital de 76,2 millions d'euros (500 millions de francs) est envisagée pour accompagner la diversification des activités de l'entreprise d'ici 2003.
Suite à l'explosion de l'usine AZF aux abords de Toulouse le 21 septembre dernier, une réflexion a été engagée sur l'avenir du pôle chimique de l'agglomération. La SNPE y dispose de trois filiales : Isochem, SNPE Chimie, Tolochimie, qui réalisent 40 % de son chiffre d'affaires. Dans l'hypothèse où la décision serait prise de délocaliser ces installations industrielles, l'Etat devrait très certainement apporter une contribution financière plus significative à la société nationale.
II. - DES RÉFORMES AMBITIEUSES RESTENT NÉCESSAIRES POUR PARTICIPER À L'EUROPE DE L'ARMEMENT, SURTOUT AU SEIN DES ANCIENS ARSENAUX
L'Europe de l'armement, qui est l'un des piliers de l'Europe de la défense, a trois composantes principales :
- les alliances industrielles transeuropéennes, dont le secteur aéronautique et spatial a été le théâtre principal au cours de ces trois dernières années ;
- les commandes conjointes d'armements identiques, préfigurées par les acquisitions d'hélicoptères Tigre et NH 90, de frégates antiaériennes Horizon, ou d'avions de transport A 400 M ;
- l'harmonisation des procédures d'achats, grâce à la mise en place de l'organisme conjoint de coopération en matière d'armement (OCCAR).
La réforme des services industriels de l'Etat et du secteur public de l'armement participe au premier volet de ce processus de construction d'une Europe de la défense. Les recompositions industrielles sont plus ou moins avancées selon les secteurs d'activité. Leurs modalités ne se résument pas à des opérations de fusion-acquisition. Des partenariats ponctuels, formalisés par des filiales communes, fédèrent aussi les compétences européennes en matière d'armement. L'aéronautique, l'espace et l'électronique de défense ont été restructurés à l'échelle européenne ; la construction navale est désormais engagée dans une évolution similaire ; les secteurs de la propulsion et des équipements aéronautiques devraient également suivre cette voie. Seul l'armement terrestre reste pour l'instant en retrait de cette tendance.
A. LES ENTREPRISES EUROPÉENNES DE L'AÉRONAUTIQUE ET DE L'ESPACE ONT ENGAGÉ UN PROCESSUS DE CONCENTRATION QUI DOIT SERVIR DE MODÈLE AUX AUTRES SECTEURS
Le 9 décembre 1997, les chefs d'Etats et de gouvernements allemand, britannique et français avaient appelé de leurs v_ux la naissance d'une industrie aéronautique européenne, civile et militaire. La création d'EADS nv ne s'inscrit que partiellement dans cette dynamique, puisque le nouveau groupe a uniquement fusionné les principaux industriels français (Aérospatiale-Matra), allemands (DaimlerChrysler Aerospace - DASA) et espagnols (Construcciones Aeronauticas SA - CASA) de son domaine d'activité. EADS a néanmoins favorisé des concentrations sectorielles, dans les domaines des missiles, de l'aéronautique et de l'espace ; ce processus a renforcé la position de l'industrie aéronautique européenne vis-à-vis des grands groupes américains de la défense. Les regroupements en Europe ne sont peut-être pas terminés ; le directeur général de BAe Systems, M. John Weston, n'a pas exclu une fusion avec EADS, déclarant à ce sujet : « Ce n'est pas impossible, mais pas dans un futur proche ».
L'industrie des missiles revêt un enjeu stratégique majeur ; des coopérations européennes ont été décidées en la matière bien avant que des regroupements européens soient souhaités dans tous les domaines de l'armement. La filialisation des activités de British Aerospace et Matra Hautes Technologies au sein de Matra BAe Dynamics a amorcé le mouvement ; Finmeccanica et GEC Marconi ont, par la suite, fusionné leurs capacités dans Alenia Marconi Systems. Les rapprochements de British Aeropace et GEC Marconi puis d'Aerospatiale-Matra avec DASA et CASA ont resserré les liens de l'industrie des missiles. La création de MBDA au cours de cette année est une étape supplémentaire de la recomposition du secteur autour d'un groupe européen capable de rivaliser avec les concurrents américains. Cette évolution ne semble pas achevée pour autant.
Le 26 avril 2001, EADS, BAe Systems et Finmeccanica ont signé l'accord créant MBDA, société commune qui regroupe les activités missiles et systèmes de missiles de leurs filiales respectives : Aérospatiale Matra Missiles, Matra BAe Dynamics et Alenia Marconi Systems. La société MBDA doit être opérationnelle cette automne. BAe Systems et EADS souhaitaient être actionnaires de référence à parité : chacun des deux groupes possède donc indirectement, via leurs participations dans leurs filiales holding, 37,5 % du capital de MBDA. Avec 25 %, Finmeccanica est également un actionnaire important.
MBDA EST LA FILIALE COMMUNE
DES TROIS PRINCIPAUX FABRICANTS EUROPÉENS DE MISSILES
(Europe) |
BAe Systems (Royaume-Uni) |
Finmeccanica (Italie) |
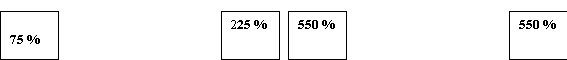
(Holding) |
AMS-NV (Holding) |

|
Cette restructuration de l'industrie des missiles est la plus importante en Europe ; à plusieurs égards, on peut parler de la naissance d'un « Airbus des missiles ».
Premier fabricant européen de missiles avec un chiffre d'affaires de 2,3 milliards d'euros (15,1 milliards de francs) si l'on additionne les résultats de chacune de ses composantes pour l'année 2000, MBDA fédère l'essentiel des compétences européennes de ce secteur.
MBDA EST LE DEUXIÈME FABRICANT
DE MISSILES DANS LE MONDE
(1) En milliards d'euros
Sociétés |
Chiffres d'affaires |
RAYTHEON |
3,3 |
MBDA |
2,3 |
LOCKHEED MARTIN |
2,0 |
BOEING |
1,1 |
THALES SHORT |
0,6 |
BGT |
0,4 |
SAAB BOFORS |
0,35 |
KONGSBERG |
0,3 |
MBDA développe une gamme de quarante missiles ou systèmes de missiles ; l'entreprise joue un rôle de premier plan dans la conduite des grands programmes européens, tels le missile air-air longue portée Meteor, le missile de croisière Scalp-EG/Storm Shadow, ou encore le système de défense navale PAAMS. Le nouveau groupe européen ambitionne également de nouer des partenariats transatlantiques à parité, à l'occasion du développement d'un système de défense antimissiles de théâtre pour le compte de l'OTAN ; des coopérations existent déjà avec Boeing (programme Meteor), Lockheed Martin (missiles antichars) et Raytheon (ASRAAM).
L'intégration des capacités de production de missiles en Europe suppose que l'industrie allemande y trouve toute sa place. Ce n'est pas encore pleinement le cas.
Deux groupes allemands fabriquent des missiles :
- Lenkflugkörpersysteme (LFK), dont EADS détient 70 % du capital et MBDA les 30 % restant ;
- BGT, dont 80 % du capital appartient à Diehl alors qu'EADS est un actionnaire minoritaire (20 %).
L'intégration des fabricants allemands de missiles au pôle européen en cours de constitution est indispensable. Le rapprochement de BGT et MBDA ne passe pas nécessairement par une fusion : un regroupement de LFK et BGT pourrait être envisagé dans un premier temps et l'entité créée serait filialisée à MBDA.
La question de la participation de BGT à MBDA a de sérieuses incidences européennes : l'achat de missiles Meteor par l'Allemagne n'a toujours pas été confirmé ; ce retard est lié aux incertitudes qui entourent encore l'avenir de BGT, puisqu'une alliance de ce dernier avec Raytheon n'est pas exclue.
L'espace est un enjeu industriel et militaire considérable. Depuis le milieu des années 1990, les Etats-Unis en ont fait une de leurs priorités, comme l'illustrent :
- le développement soutenu de lanceurs destinés à concurrencer Ariane ;
- le financement de recherches en faveur de satellites d'alerte avancée destinés à la défense antimissiles ;
- les conclusions de la Commission présidée l'année dernière par M. Donald Rumsfeld, devenu Secrétaire américain à la Défense, en faveur d'une « space dominance ».
Les acteurs européens du marché spatial ne sont pas restés sans réagir. Les restructurations doivent néanmoins aller plus loin pour préserver les acquis techniques et industriels de l'Europe.
Les dépenses spatiales civiles et militaires américaines sont cinq fois plus importantes que celles de l'ensemble des pays européens. Le contraste est plus flagrant s'agissant des dépenses en faveur de l'espace militaire : l'industrie spatiale américaine, concentrée autour de Boeing (qui a racheté les lanceurs de Mc Donnell Douglas et plus récemment l'activité satellites de Hughes) et Lockheed Martin (très présent dans les satellites militaires et les lanceurs), bénéficie de financements institutionnels quinze fois plus élevés que l'industrie spatiale européenne, elle aussi concentrée autour de deux acteurs (EADS et Alcatel Space Industries).
Le marché mondial de l'espace, évalué approximativement à 50 milliards de dollars (55,5 milliards d'euros), se répartit entre :
 - le marché institutionnel civil américain (12,5 milliards de dollars) ;
- le marché institutionnel civil américain (12,5 milliards de dollars) ;
- le marché militaire américain (12,5 milliards de dollars) ;
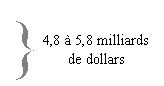 - le marché civil européen (4 à 5 milliards de dollars) ;
- le marché civil européen (4 à 5 milliards de dollars) ;
- le marché militaire européen (800 millions de dollars) ;
- le marché commercial mondial (9 milliards de dollars) ;
- les marchés russe et japonais (10 milliards de dollars).
Pour se positionner sur les seuls marchés accessibles et concurrentiels (9 milliards de dollars), les industriels européens peuvent compter sur 4,8 à 5,8 milliards de dollars de commandes des Etats européens, alors que dans le même temps les industriels américains bénéficient de dépenses institutionnelles d'un montant de 25 milliards de dollars. C'est dire que l'industrie européenne est handicapée par l'insuffisance des budgets spatiaux des pays européens.
La création d'EADS a permis de regrouper l'essentiel des compétences européennes dans la conception et la production de fusées.
Les bureaux d'études d'EADS Launch Vehicles conçoivent Ariane ; EADS produit la quasi-totalité des composants du lanceur européen à l'exception de la propulsion. L'industriel européen est aussi actionnaire d'Arianespace, à hauteur de 25 % du capital.
Avec douze à quinze des trente à trente-cinq lancements commerciaux potentiels chaque année, Arianespace conserve actuellement 50 % de parts de marché sur un créneau bien spécifique, dont sont exclus les lancements militaires institutionnels américains, russes et étrangers. Cette position forte est le résultat des décisions prises en Europe au cours des années 1980, mais aussi de l'échec du choix américain de privilégier la navette réutilisable. Or cette situation est susceptible d'évoluer au désavantage d'Ariane.
Les autorités américaines ont réorienté la stratégie spatiale des Etats-Unis autour de deux axes complémentaires :
- prise de contrôle des lanceurs russes (Proton exploité par Lockheed Martin et Zenith par Boeing), dont le coût est bien inférieur à celui d'Ariane 5 (14 millions de dollars la tonne lancée contre 30 millions pour Ariane), alors que leur capacité d'emport est identique (5,5 tonnes) ;
- développement de lanceurs d'une capacité d'emport pouvant atteindre 12 tonnes (Atlas 5 de Lockheed Martin et Delta 4 de Boeing) pour concurrencer Ariane 5 d'ici 2004-2005, avec des recherches en parallèle sur les lanceurs réutilisables évolutifs (EELV).
Les institutions européennes apportent un soutien partiel aux évolutions nécessaires d'Ariane 5, dont la stratégie de lancements de deux satellites à la fois conditionne la rentabilité. Depuis l'échec du vol n° 501, les industriels sont mis en demeure par l'Agence spatiale européenne d'autofinancer le coût des développements de la fusée à hauteur de 600 à 750 millions d'euros (de 3,9 à 4,9 milliards de francs).
D'ores et déjà, le coût des adaptations d'Ariane 5 pèse sur les résultats d'Arianespace, qui a affiché une perte nette de 242 millions d'euros (1,6 milliard de francs) en 2000. Le retour à l'équilibre n'est pas escompté avant 2005-2006.
Deux séries de mesures doivent être rapidement mises en _uvre pour sortir de cette situation :
- l'industrie est dans l'obligation de réaliser elle-même des réductions supplémentaires de coûts. Au delà de son engagement à diminuer les charges de 50 % en quatre ans, il lui faut se rationaliser davantage, notamment en rassemblant toutes les activités d'EADS liées aux lanceurs dans une seule et même société et en diminuant le nombre de sous-traitants ; EADS et Snecma doivent devenir les deux principaux contractants d'Arianespace ;
- de même, il serait souhaitable que l'Agence spatiale européenne participe davantage au financement du centre spatial guyanais, EADS supportant à ce titre une charge de 17 millions d'euros (110 millions de francs) par tir alors que les concurrents américains disposent gratuitement des installations gouvernementales de Cape Kennedy Naval Station et Vandenberg Air Force Base.
Les fabricants européens de satellites sont au nombre de deux : Astrium, entreprise issue d'un processus de regroupement avant la création d'EADS ; Alcatel Space Industries, société née du rapprochement d'Alcatel avec Thales.
La société Astrium regroupe Matra-Marconi Space et DASA depuis un an. Son capital est détenu à 75 % par EADS et à 25 % par BAe Systems. Cette entreprise a réalisé un chiffre d'affaires d'un peu plus de 2 milliards d'euros (13,1 milliards de francs) en 2000. Troisième société spatiale dans le monde derrière Boeing-Hughes et Lockheed Martin, elle occupe le premier rang européen. La société est notamment impliquée dans de nombreux programmes de satellites à vocation militaire en Europe : maîtrise d'_uvre du satellite d'observation optique français Hélios 2 ; participation aux appels d'offre pour la réalisation des satellites britannique Skynet 5 et allemand SAR-Lupe.
Issue du regroupement des activités spatiales d'Alcatel, de Thales et d'Aérospatiale (avant sa fusion avec Matra Hautes Technologies) en 1998, la société Alcatel Space Industries a quant à elle une forte identité nationale. Son chiffre d'affaires est de l'ordre de 1,37 milliard d'euros (8,9 milliards de francs). L'entreprise est impliquée dans plusieurs programmes spatiaux militaires : composantes d'Hélios 2 ; réalisation de Syracuse 3, satellite français de télécommunications militaires de nouvelle génération.
Astrium et Alcatel Space Industries, concurrents sur le marché français des satellites et de l'espace, coopèrent à l'exportation. Pour pouvoir présenter des offres concurrentes à la DGA, les deux entreprises développent les mêmes savoir-faire et ainsi « doublonnent » leurs investissements, alors que l'exportation requiert davantage leurs complémentarités.
A titre d'exemple, la démarche retenue par la DGA pour la conception de Syracuse 3 tranche avec celle du ministère de la Défense américain (Dod) pour le programme de satellites EHF advanced : après avoir constaté que le niveau de recherche-développement était trop important pour que les industriels supportent séparément les investissements, le Dod leur a suggéré de proposer un contrat négocié et commun ; la DGA, quant à elle, a mis en concurrence Astrium et Alcatel Space Industries.
Il n'est pas certain que l'Europe de l'armement gagnerait à une fusion entre Astrium et Alcatel Space Industries, à supposer qu'une telle hypothèse soit acceptable au regard des règles de la concurrence. En revanche, un approfondissement de leur coopération serait bénéfique dans les domaines où le poids des investissements est le plus important (tels les fréquences EHF pour les télécommunications militaires). Il appartient aux Etats clients de tenir compte de cette nécessité.
La création d'EADS l'année passée a permis d'amorcer la recomposition des industries européennes de l'aviation par :
- le rapprochement des entreprises du consortium Eurofighter qui sont engagées dans le programme d'avion de combat européen Typhoon ;
- la mise en place d'une société Airbus intégrée, dont EADS détient 80 % du capital et BAe Systems 20 % ;
- la création d'un pôle de transport militaire à partir des unités de production de CASA ;
- la clarification de la situation patrimoniale de certaines filiales, telles Eurocopter dont EADS est l'actionnaire majoritaire.
La réorganisation sectorielle de l'aéronautique militaire européenne est pourtant incomplète.
Actuellement, le marché des avions de combat se partage entre trois constructeurs européens : le consortium Eurofighter (BAe Systems, EADS et Alenia), Dassault Aviation (EADS et Dassault Aviation) et Gripen (Saab et BAe Systems). Deux groupes américains occupent également de solides parts de marché en Europe : Boeing avec le F 15 et accessoirement le F 18 ; Lockheed Martin, avec le F 16 et prochainement le Joint Strike Fighter (JSF) dont la société vient tout juste d'obtenir le contrat qualifié de « contrat du siècle ». Deux constructeurs russes concurrencent les industriels européens à l'exportation : VPK/MAPO et Sukhoi.
EADS et Finmeccanica ont décidé de réunir leurs activités aéronautiques militaires au sein d'une société commune : European military aircraft company (Emac). Un début de restructuration du secteur de l'aviation militaire de combat est ainsi engagé : Emac va notamment gérer 62,5 % de la charge de travail du Typhoon et 57,5 % de celle du Tornado. Le nouveau groupe prendra ainsi une position déterminante dans la conduite des principaux programmes européens d'aviation de combat. En 2000, la somme des résultats des composantes d'Emac avoisinait les 2,6 milliards d'euros (17 milliards de francs) de chiffre d'affaires.
EADS est par ailleurs le second actionnaire de Dassault Aviation (45,76 % du capital) après le Groupe Industriel Marcel Dassault, structure qui gère les avoirs de la famille Dassault (49,9 %). EADS ne peut pas favoriser un éventuel rapprochement de l'avionneur français avec Emac car le principal actionnaire de Dassault Aviation y est opposé.
Il est pourtant souhaitable qu'Emac rassemble à l'avenir les compétences de ses partenaires dans l'Eurofighter et celles de Dassault Aviation. L'Europe de la défense s'en trouverait ainsi confortée par davantage de cohérence industrielle. EADS atteindrait alors le troisième rang mondial des fabricants d'avions de combat (derrière Boeing et Lockheed Martin). Actuellement, le groupe européen occupe le quatrième rang mondial de ce secteur, juste derrière BAe Systems.
La prochaine génération d'avions de combat européens ne pourra être développée par une industrie morcelée. La nécessité de mettre les efforts de recherche-développement en commun pourrait infléchir le processus de restructuration du secteur. L'avenir de l'aéronautique européenne de combat suppose le rassemblement d'entreprises qui ont fait la preuve de leurs compétences techniques ; dans le cas contraire, la forte implantation américaine pourrait se transformer en domination commerciale, d'autant que BAe Systems coopère avec les industriels américains sur le programme JSF.
La société Eurocopter est née en 1992, à la suite de la fusion des divisions hélicoptères d'Aérospatiale et de DASA. Depuis l'année dernière, la totalité du capital est détenue par EADS.
Eurocopter est le premier fabricant d'hélicoptères civils et militaires en Europe et au monde : son chiffre d'affaire total s'est élevé, au cours de l'année 2000, à 2 milliards d'euros (13,1 milliards de francs). La défense représente 40 % de cette activité. En Europe, 55 % des ventes de l'entreprise sont dues à des commandes militaires.
Les principaux matériels militaires commercialisés par la société sont les hélicoptères Fennec, BO 105, Écureuils EC 635, Panther, Cougar, Tigre et NH 90. Ces deux derniers types d'équipements devraient imposer Eurocopter comme un des acteurs incontournable du marché militaire.
Parmi les concurrents d'Eurocopter sur ce segment du marché, trois sont américains (Bell Helicopter, Boeing et Sikorsky) et deux sont européens (Agusta, filiale de Finmeccanica et Westland).
Alors que Finmeccanica et EADS ont resserré leurs liens dans d'autres secteurs, votre Rapporteur estime le moment propice à une alliance entre Eurocopter et Agusta. Une telle coopération serait la première étape d'un partenariat européen susceptible de s'élargir à Westland.
Cette démarche est réaliste, compte tenu des prévisions de croissance du marché militaire en Europe et au niveau mondial. L'industrie aéronautique européenne s'en trouverait plus cohérente.
Si le programme A 400 M est lancé comme prévu, Airbus deviendra un industriel de référence dans le domaine du transport militaire. Il concurrencera directement le C 17 de Boeing et le C 130 J de Lockheed Martin. Le groupe européen se positionne sur un créneau très spécifique : celui des avions tactiques moyen-porteurs. Il ne produit aucun autre type d'appareil de transport mais étudie la possibilité de commercialiser des avions ravitailleurs stratégiques dérivés des Airbus A 310 et A 330.
Deux industriels européens affichent leur compétence dans le domaine des avions de moindre envergure : EADS (grâce aux activités de CASA) et Finmeccanica.
L'accord de coopération conclu le 14 avril 2000 entre EADS et Finmeccanica au sujet de l'aéronautique militaire ouvre des perspectives intéressantes : l'industriel italien apportera à l'Emac ses activités de transport
(C-27 J, ATR-72 ASW, ATR-42 MP). Il n'est pas prévu pour l'instant que les chaînes de production de CASA (C-212, CN-235, C-295) y soient également rattachées.
La division d'EADS ainsi que les activités d'Emac qui concernent les avions de transport militaire ont vocation, à terme, à se rapprocher d'Airbus. En effet, Airbus military corporation est contrôlée à 80 % par EADS. Un regroupement de l'ensemble favoriserait l'émergence d'une compétence européenne sur la totalité de la gamme des avions de transport militaire.
Partie prenante de toutes les entreprises européennes du secteur, EADS apparaît en position de fédérateur de l'industrie européenne du transport militaire.
B. DE GRANDS GROUPES EUROPÉENS DE L'ÉLECTRONIQUE DE DÉFENSE SE DÉVELOPPENT DÉSORMAIS AU NIVEAU MONDIAL
La physionomie du secteur de l'électronique de défense a été profondément modifiée depuis 1999. La création d'un pôle britannique autour de British Aerospace a encouragé les entreprises européennes à se réorganiser. Désormais, trois entités européennes existent sur le marché : Thales, BAe Systems et EADS.
La plupart des industriels européens du secteur de l'électronique militaire ont ébauché une stratégie de partenariat avec des groupes américains. L'objectif recherché est un accès au marché domestique des Etats-Unis : les crédits publics en faveur de la défense pour l'année 2002 s'y élèvent à 343,5 milliards de dollars.
L'attitude d'ouverture de l'administration américaine vis-à-vis de la possibilité de coopérations industrielles transatlantiques rend plus probables, à moyen terme, des alliances euro-américaines que des partenariats proprement européens. Il semble donc difficile de concevoir une fusion des principaux acteurs européens de l'électronique de défense.
Depuis le 6 décembre 2000, Thomson-CSF s'appelle Thales (THomson signaAL Electronic Systems). L'entreprise a été privatisée en 1998 : un échange d'actions a été réalisé au profit d'Alcatel et Dassault Industries en contrepartie d'apports industriels. En 1999, Alcatel a conforté sa position d'actionnaire privé de référence en portant sa participation à 25,3 %. En mai 2001, Alcatel a acquis 48,83 % de la participation de Thales dans Alcatel Space Industries, portant ainsi sa participation à 100%. Le montant de la transaction, fixé à 795 millions d'euros (5,2 milliards de francs), a été payé pour moitié en numéraire et pour moitié en titres, Alcatel ne conservant finalement que 20 % du capital de Thales ; la part de l'Etat sera également diluée d'ici à 2006 à un niveau de 28,8 % (contre 33,4 % actuellement).
L'Etat reste le principal actionnaire de Thales, d'autant qu'il dispose d'une action spécifique (golden share) lui permettant de s'opposer à toute évolution qu'il jugerait contraire à ses intérêts.
La direction de l'entreprise s'est assignée deux priorités :
- développer la taille de Thales par des acquisitions externes sur le plan mondial, stratégie qualifiée de « multidomestique » ;
- réorienter partiellement les activités du groupe en faveur du secteur civil, de manière à diminuer sa dépendance à l'égard des dépenses militaires des Etats.
Thales a réalisé plus de la moitié de son activité dans le secteur militaire au cours de l'année 2000 avec un chiffre d'affaires lié à la défense de 4,93 milliards d'euros sur un total de 8,58 milliards (32,3 milliards de francs sur un total de 56,3 milliards). L'aéronautique (avionique, gestion du trafic aérien et simulation-entraînement) et les technologies de l'information (composants et technologies pour communications, sécurité des transactions, GPS) sont les deux autres pôles de compétence du groupe.
Dans le domaine de la défense, Thales se positionne sur les créneaux spécifiques des télécommunications militaires, des radars aéroportés, de la guerre électronique, de l'optronique et des sonars : la part de l'électronique représente 40 à 50 % du coût total des avions ou bâtiments de surface et 30 à 60 % du coût total des systèmes de missiles.
Malgré l'échec de son rapprochement avec Marconi Electronic Systems en 1999, le groupe a procédé à de nombreuses acquisitions d'entreprises de son secteur d'activité depuis deux ans : rachats de Short Missile Systems et de Racal Electronics au Royaume-Uni, de ADI en Australie, et de 50 % de la filiale défense de Samsung en Corée. L'intégration de Short Missile Systems puis de Racal a donné une dimension fortement européenne à Thales : il conforte son second rang européen derrière BAe Systems. Grâce à son réseau commercial mondial dans plus de quarante pays, le groupe a pu obtenir d'importants contrats : le système de défense aérienne de l'OTAN, ACCS ; les missiles de très courte portée Starstreak pour le compte du Royaume-Uni ; les postes radio de quatrième génération PR4G pour la France et les Emirats-Arabes Unis ; le système de missiles sol-air courte portée
K-SAM pour la Corée du Sud ; le système de combat naval pour les corvettes de l'Afrique du Sud.
Fort de ses coopérations extra-européennes, Thales ambitionne de nouer des liens transatlantiques importants. Une filiale au capital détenu à parité avec Raytheon a été créée dans le secteur de la défense aérienne : Thales Raytheon Systems est formellement entrée en activité le 1er juin dernier. Néanmoins, la dimension européenne de Thales ne s'estompera pas : 60 % des ventes de l'entreprise sont réalisées en Europe.
_ BAe Systems est présent sur tous les secteurs de la défense : l'aéronautique, la construction navale, l'armement terrestre. Avec un chiffre d'affaires avoisinant les 19,7 milliards d'euros (129 milliards de francs), dont 5 milliards d'euros (32,8 milliards de francs) liés à l'électronique, il occupe le premier rang européen de l'industrie de défense, devant EADS.
Equipementier qui a élargi son champ de compétences de l'électronique embarquée sur les aéronefs à l'électronique navale et terrestre, le groupe a développé de nombreuses coopérations européennes ponctuelles dans les secteurs de l'espace (Astrium), des missiles (MBDA) ou de l'aéronautique (Airbus, Eurofighter). Il est aussi partenaire de Boeing et Lockheed Martin sur d'importants programmes américains.
_ Le groupe européen EADS a lui aussi une compétence d'électronicien de défense. Trois unités ont plus particulièrement réalisé un chiffre d'affaires cumulé d'environ 1 milliard d'euros (6,56 milliards de francs) dans ce secteur en 2000 :
- EADS Systems and Defence Electronics, qui regroupe de nombreuses activités initialement allemandes et françaises dans les secteurs « systèmes aéroportés », « intelligence, reconnaissance et surveillance », « systèmes navals et terrestres ». Aucune de ces entités n'a atteint la taille critique qui lui permettrait de se positionner seule sur le marché mondial. Des acquisitions et partenariats sont envisagés, à l'image de la création d'ET Marinesysteme (joint venture avec Thales) ;
- EADS Services, qui est déjà au premier rang des bancs d'essai multifonction pour les avions civils ou militaires ;
- EADS Télécommunications, au premier rang mondial des réseaux de télécommunications sécurisées, en partenariat avec le Canadien Nortel Networks.
Des collaborations avec Northrop Grumman ne sont pas exclues, dans le secteur des drones en particulier.
C. LE SECTEUR DE LA CONSTRUCTION NAVALE EST EN PLEINE RESTRUCTURATION, EN FRANCE PLUS TIMIDEMENT QU'AILLEURS
Trois chantiers navals français exercent une activité de construction de navires militaires : les Chantiers de l'Atlantique/Alstom Leroux Naval (groupe Alstom), les Constructions mécaniques de Normandie (CMN) et DCN. Seul ce dernier occupe une place significative sur le marché. Pénalisé par son statut d'administration, il a transformé son mode de gestion et noué quelques partenariats. Sa participation aux regroupements européens suppose au préalable des réformes statutaires plus ambitieuses.
Très récemment, le mouvement des restructurations dans le secteur de l'industrie navale militaire s'est accéléré. Le 27 octobre 2000, plusieurs industriels allemands de l'armement naval (Babcock, Borsig et ThyssenKrupp) et le gouvernement du Chancelier Schröder ont engagé un processus de concentration, ouvert à d'éventuels partenariats européens. Des négociations ont été entreprises avec les chantiers navals espagnols Izar et italiens Fincantieri, en vue d'une participation à leurs privatisations.
DEUX INDUSTRIELS EUROPÉENS DOMINENT LE SECTEUR DE LA CONSTRUCTION NAVALE MILITAIRE : BAE SYSTEMS ET DCN
(En millions d'euros) | |||
Pays |
Industriels |
Chiffre d'affaires |
Chiffre d'affaires total |
ROYAUME UNI |
BAe Systems |
1 829,4 |
18 794,5 |
Vosper Thornycroft |
150,2 |
415,6 | |
FRANCE |
DCN |
1 687,2 |
1 814,1 |
Thales |
762,2 |
6 860,0 | |
ALLEMAGNE |
HDW |
571,7 |
762,2 |
Thyssen Werften |
564,5 |
762,2 | |
ESPAGNE |
Izar |
465,3 |
1 349,9 |
ITALIE |
Fincantieri |
276,7 |
1 627,5 |
(Source : DCN) | |||
Jusqu'à présent, les chantiers navals militaires ont été restructurés sur des bases nationales, alors que les industriels de l'électronique et des systèmes de défense ont largement engagé un processus d'alliances européennes : rachat de Signaal par Thomson-CSF (devenu Thales), prises de participation de BAe Systems dans STN Atlas et Celsius (via Saab), joint-venture Alenia Marconi System entre BAe Systems et Finmeccanica, joint-venture Thomson Marconi Sonar.
Les restructurations des chantiers navals ont pris la forme de privatisations, d'abord en Allemagne et au Royaume-Uni, puis maintenant en Italie et en Espagne. Cette première phase a conduit à l'émergence de deux modes d'organisation industrielle en Europe :
- le regroupement de chantiers navals intégrant l'ensemble des fonctions de conception et d'intégration des systèmes d'armes aux navires, comme en atteste l'exemple du rapprochement des chantiers Blohm und Voss (spécialisé dans les navires de surface) avec Howaldtswerke Deutsche Werfte (au premier rang européen de la construction de sous-marins) en Allemagne ;
- le rachat de chantiers navals cantonnés à des fonctions de réalisation des coques par des entreprises d'électronique de défense, ce qui s'est produit au Royaume-Uni.
Les électroniciens de défense, Thales et BAe Systems, sont devenus des intervenants majeurs du fait de l'importance croissante des systèmes de combat dans les navires militaires de nouvelle génération. Charge utile des bâtiments il y a trente ans environ, les systèmes de combat sont désormais au c_ur des aspects opérationnels ; ils représentent d'ailleurs 50 % du coût des navires.
Les chantiers navals restent des acteurs clés du marché, ne serait-ce que pour assembler les différentes parties des bateaux. En Europe, leur profil technique diffère tout autant que leur actionnariat ou leur statut. Certains présentent un éventail de compétences suffisant pour se passer, dans le domaine de l'architecture et de la conception du système de combat, du concours des électroniciens de défense : c'est le cas de DCN, mais aussi des chantiers allemands Blohm und Voss et HDW. D'autres sont dépendants des concepteurs de systèmes de combat qui assument la responsabilité des programmes (prime contractors) et sous-traitent la construction des coques : les chantiers britanniques de Barrow-in-Furness, Yarrow Shipbuiders et Govan appartiennent à BAe Systems.
Deux ensembles industriels répondant à des stratégies antagonistes se sont constitués au niveau européen : BAe Systems et les chantiers allemands. Les chantiers navals européens encore indépendants se rapprocheront tôt ou tard de l'un ou l'autre : la privatisation des chantiers espagnols EN Izar, rassemblant Bazan et Aesa, est prévue pour une échéance postérieure à 2003 ; la privatisation de leur homologue italien Fincantieri a débuté en 2000 et la part de la holding publique IRI pourrait être amenée à évoluer.
Malgré des restructurations internes importantes DCN a conservé jusqu'à présent un statut de compte de commerce anachronique au regard des évolutions actuelles du marché de la construction navale militaire.
Pour l'Etat, les enjeux liés à l'avenir de DCN sont stratégiques (DCN est le concepteur des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins), économiques (DCN a réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 1,6 milliard d'euros/10,5 milliards de francs en 2000) et industriels (l'Europe de l'armement comportera inéluctablement une dimension navale).
Il est donc urgent de donner à DCN les moyens de participer aux restructurations européennes qui s'accélèrent, sous peine de le marginaliser. Il n'y a pas d'avenir pour DCN sans partenaires.
La direction des constructions navales est devenue le service à compétence nationale « DCN » par le décret n° 2000-326 du 12 avril 2000. Concrètement, DCN est resté une administration.
Malgré la clarification des responsabilités entre l'industriel étatique (DCN) et l'Etat client (le service des programmes navals de la DGA), une certaine confusion des genres persiste : l'Etat demeure tout à la fois le propriétaire, le client, le gestionnaire et le financier de DCN.
Or, pour réussir sa mutation, il est essentiel que DCN parvienne à :
- développer une véritable culture d'entreprise, en mobilisant les personnels autour d'objectifs industriels, financiers et commerciaux ;
- surmonter les nombreux freins administratifs à la gestion économique et financière : à titre d'exemple, le contrat de vente de 6 frégates à Singapour a été signé en mars 2000, mais leur réalisation n'a été notifiée à DCN qu'en septembre de la même année car le contrat de DCN International avec DCN a été bloqué pendant 6 mois pour diverses raisons administratives. Par ailleurs, et malgré les souplesses apportées par le décret n° 2001-726 du 31 juillet dernier, le cadre général des approvisionnements de DCN, de nature réglementaire, lui impose des contraintes incompatibles avec une activité industrielle ;
- gérer efficacement les ressources humaines, la structure des compétences et des emplois ne correspondant pas à la vocation industrielle de DCN. Alors que les effectifs de l'industrie aéronautique et spatiale se répartissent entre 29 % de cadres, 33 % de techniciens, 11 % de personnels administratifs et 27 % d'ouvriers, DCN emploie 12 % d'ingénieurs, 30 % de techniciens, 10 % de personnels administratifs et 48 % d'ouvriers. Il faut continuer à réduire les effectifs d'exécution, externaliser les fonctions de soutien, recruter des juristes, des acheteurs qualifiés et des contrôleurs de gestion ;
- échapper au formalisme du code des marchés publics, malgré les dérogations prévues par le décret du 31 juillet 2001 mentionné précédemment (recours plus facile à la procédure des marchés négociés en lieu et place des appels d'offre, partenariats de moyen terme avec la sous-traitance). Ce texte n'autorise ni les achats d'urgence, ni les compensations industrielles (offsets).
Pour l'instant, le statut de service à compétence nationale ne garantit pas que ces exigences soient remplies. En outre, la dispersion, la dimension excessive et l'imbrication des établissements de DCN avec les structures de la Marine nationale ou de la DGA se révèlent être pénalisantes en matière de coûts.
Thales et DCN coopèrent depuis quelques années déjà :
- développements conjoints dans le domaine des torpilles, via une coopération avec l'italien Wass, à partir de 1992 ;
- accord commercial à l'occasion de la réalisation du contrat Sawari 2, portant sur la vente de 3 frégates à l'Arabie Saoudite, en 1996.
Le 10 février 2000, les deux industriels ont annoncé un approfondissement de leur partenariat par la création d'une société commune chargée de la commercialisation des grands programmes et détenue à parts égales entre l'Etat et Thales. Les modalités de mise en place de cette filiale, SSDN, ont formellement été approuvée un an après, le 13 mars 2001, et de surcroît elle ne fonctionne toujours pas ; c'est dire la pesanteur des procédures applicables en la matière.
SSDN satisfait un intérêt mutuel entre Thales et DCN : le réseau international du groupe d'électronique de défense devrait permettre de contrebalancer l'activisme commercial des concurrents de DCN à l'exportation ; en contrepartie, Thales devrait acquérir une stature de systémier dans le domaine de l'armement naval, tout en bénéficiant des retombées commerciales des contrats obtenus. Le premier grand contrat géré par cette structure concernera la réalisation, pour la France, des deux frégates antiaériennes du programme de coopération franco-italien Horizon. Le renouvellement des flottes de surface de la plupart des pays européens d'ici 2008 pourrait inciter les gouvernements à privilégier des coopérations entres chantiers navals.
Dans le contexte actuel de restructurations au niveau européen, l'ensemble DCN-Thales est confronté à deux risques majeurs :
- une rupture de la coopération d'Izar avec DCN, au profit de partenaires allemands ou américains ;
- le rapprochement de BAe Systems avec les chantiers navals allemands.
Le choix de l'acquéreur d'Izar, dans deux ou trois ans, déterminera l'avenir du partenariat franco-espagnol dans le domaine des sous-marins conventionnels Scorpène. Une prise de contrôle d'Izar par le consortium allemand fragiliserait DCN à l'exportation, comme ce fut le cas à l'occasion du rachat de Kockums Naval Systems par HDW le 23 septembre 1999.
De même, la création d'un pôle naval regroupant BAe Systems, HDW et Blohm und Voss mettrait en difficulté la coopération de Thales, via sa filiale Signaal, avec Blohm und Voss et menacerait DCN grâce à la puissance commerciale des chantiers allemands.
Il est donc indispensable pour DCN de renforcer ses liens avec Thales afin de constituer un groupe naval de stature européenne et mondiale, et de participer avec des chances de succès au processus de privatisation des chantiers espagnols Izar.
Deux options juridiques permettent de doter des services administratifs exerçant une activité industrielle ou commerciale d'une personnalité morale distincte de l'Etat : l'établissement public industriel ou commercial (EPIC), ou la société.
A la différence de l'EPIC, la société dispose d'un capital social, est propriétaire d'un fonds de commerce et observe les voies d'exécution du droit commun (astreintes, injonctions de payer, saisies), offrant par là des garanties solides aux clients, fournisseurs et partenaires. Ce statut permet également d'augmenter facilement les capitaux propres.
Le contexte est aujourd'hui favorable à une réforme statutaire de cette envergure :
- le nouveau système de gestion de DCN, opérationnel depuis 2001, correspond à celui d'une entreprise industrielle ;
- le format des effectifs sera stabilisé d'ici fin 2002, date avant laquelle on ne peut envisager l'entrée en vigueur d'une loi transformant le compte de commerce ;
- le carnet de commande s'élève à quelque 7,6 milliards d'euros (50 milliards de francs), auxquels s'ajouteront les recettes de la conception des frégates multimissions et des sous-marins nucléaires d'attaque du futur (Barracuda).
Il est donc indispensable d'engager rapidement un processus législatif en ce sens. La direction de DCN a élaboré, en avril 2001, un plan intitulé « Azur », qui conforte cette analyse : une transformation du statut à une échéance de dix-huit mois fut proposée. Le 6 juillet dernier, les Ministres de la Défense et de l'Economie, des Finances et de l'Industrie ont annoncé, dans un communiqué commun, l'intention du Gouvernement de transformer DCN en société d'Etat à capital fermé d'ici le 1er janvier 2003. Une société chargée de préparer la transition d'un statut à l'autre sera prochainement créée ; il serait souhaitable que cette mesure entre rapidement en vigueur.
Votre Rapporteur se réjouit de ces décisions : au delà de l'habillage sémantique de la réforme, c'est bien la solution juridique d'une société anonyme qui a été retenue. Néanmoins, il est très regrettable que le Gouvernement n'accepte pas d'autres actionnaires que l'Etat.
Des participations étrangères au capital de DCN sont absolument nécessaires sous peine de maintenir l'entreprise à l'écart des restructurations européennes en cours ; de telles alliances structurelles sont urgentes et DCN peut faire valoir de sérieux atouts technologiques et industriels à cet effet.
Depuis les années 1990, le marché de l'armement terrestre se caractérise par de grandes variations de commandes de blindés et une diminution tendancielle des achats de munitions. La réduction des débouchés a fortement dégradé les équilibres comptables et financiers des industriels. Selon le groupement des industriels de l'armement terrestre (GICAT), l'activité des entreprises françaises du secteur à diminué de 50 % depuis dix ans, en passant d'un chiffre d'affaires cumulé de 5,5 milliards d'euros (36 milliards de francs) en 1991 à 2,73 milliards d'euros (17,9 milliards de francs) en 2000.
La société nationale Giat-Industries a été pénalisée par des handicaps supplémentaires : sureffectifs, sous-capitalisation initiale, absence de préparation interne à la comptabilité et au fonctionnement d'entreprise dès le changement de statut. La Cour des Comptes a critiqué certaines orientations stratégiques, telles le rachat du groupe belge Herstal. Enfin, certains contrats à l'exportation, la vente de chars Leclerc aux Emirats Arabes Unis notamment, ont été conclus à perte.
Le contexte actuel du secteur n'est pas favorable pour des alliances européennes. Des rapprochements ponctuels sont néanmoins nécessaires, de manière à éviter de donner prise aux velléités américaines de racheter les industriels les plus fragiles.
L'homogénéité du marché des Etats-Unis a permis très tôt un regroupement des acteurs américains de l'armement terrestre. Il n'en va pas de même en Europe, où ce secteur industriel reste encore morcelé.
_ Dans le domaine des blindés, deux industriels américains, General Dynamics et United Defense, réalisent un chiffre d'affaires de plus de 1,7 milliard d'euros (11,2 milliards de francs) chacun. A l'opposé, l'Europe compte une dizaine d'intervenants, dont les chiffres d'affaires varient de 549 millions d'euros (3,6 milliards de francs) pour Giat-Industries à environ 76 millions d'euros (500 millions de francs) pour l'Autrichien Steyr.
Ce morcellement explique que les industriels américains aient récemment réalisé d'importantes acquisitions en Europe : Mowag (Suisse) a été racheté par General Motors, Bofors (Suède) par United Defense, Santa Barbara (Espagne) par General Dynamics. Par ailleurs, General Dynamics a acquis une partie du capital de Steyr (Autriche).
Les industriels britanniques privilégient des regroupements nationaux : Alvis et Vickers pourraient fusionner prochainement. En revanche, il se pourrait que l'un des deux principaux constructeurs allemands, Rheinmetall, s'allie à un industriel américain, Alliant en l'occurrence. L'entreprise publique Giat-Industries s'en trouverait alors isolée.
_ Dans le secteur des munitions, les Etats-Unis disposent également de deux grands groupes : Alliant et Primex ont chacun une activité représentant environ 305 millions d'euros (2 milliards de francs). L'Europe dénombre une vingtaine d'acteurs, dont les chiffres d'affaires oscillent entre un montant identique à celui d'Alliant et Primex pour le plus important (Royal Ordnance) et quelques dizaines de millions d'euros pour ceux de plus petite dimension.
Dans ce domaine bien particulier du marché de l'armement terrestre, il n'existe pas de stratégie de regroupements industriels à l'échelle européenne, même si certaines sociétés allemandes ont entrepris des rapprochements autour de Rheinmetall.
Dix ans après le transfert des activités du compte de commerce « Groupement industriel des armements terrestres » (GIAT) à la société nationale Giat-Industries, la situation de cet industriel est toujours inquiétante. Des alliances semblent pourtant nécessaires. Dans les deux cas, il incombe à l'Etat de prendre ses responsabilités d'actionnaire exclusif.
A l'exception de l'activité des chars de combat, la plus concurrentielle et aussi la moins porteuse, la société Giat-Industries s'est engagée dans des partenariats techniques et commerciaux susceptibles de préfigurer des alliances sectorielles intéressantes.
_ Un accord a été conclu avec Renault Véhicules Industriels (groupe Volvo) pour répondre au second appel d'offres du ministère de la Défense concernant l'acquisition de 700 véhicules blindés de combat d'infanterie (VBCI). Une filiale commune détenue à parité, Satory Military Vehicles, a été créée afin de gérer la première commande de 65 véhicules qui a été notifiée au consortium pour un montant de 358 millions d'euros (2,35 milliards de francs). Dans un second temps, la maîtrise d'_uvre et la commercialisation de tous les programmes menés en commun (véhicules de l'avant blindé-VAB, char AMX 10, VBCI) devaient lui être attribuées. Les moyens industriels de Satory Military Vehicles étant actuellement insuffisants, la commission spécialisée des marchés a refusé à titre provisoire que cette filiale supervise directement la conduite du programme VBCI.
Les perspectives commerciales concernant les véhicules blindés légers sont favorables : de nombreux pays les substituent aux chars de combats jugés trop chers ; de nombreuses unités d'infanterie en Europe ont besoin de véhicules plus efficaces que ne le sont les modèles actuels. Le consortium Giat-Industries/ Renault VI pourrait s'ouvrir à d'autres partenaires.
_ Le secteur des armes et munitions se prête également à des alliances européennes. Des coopérations techniques spécifiques existent : le développement de l'obus Bonus avec le Suédois Bofors, la conception de munitions intelligentes avec le Suisse Oerlikon, des études sur le renouvellement de la gamme des systèmes anti-chars Apilas avec le Britannique HEL. Des accords plus structurels ont aussi été noués : une société commune avec Royal Ordnance, créée en 1993, développe des systèmes d'armes de moyen calibre ; une joint-venture avec Royal Ordnance et Rheinmetall étudie les possibilités de production commune d'un canon de char de 140 mm. Enfin, un accord de coopération dans les munitions de moyen calibre a été signé avec l'Allemand Diehl, le 4 juin 1998. De tels partenariats établissent des liens ponctuels. L'avenir passe par leur approfondissement.
La société nationale a présenté ses comptes pour l'exercice 2000 : un chiffre d'affaires en diminution de 36,1 % à 564,7 millions d'euros (3,7 milliards de francs) ; des pertes nettes en augmentation de 93,8 % à 279,9 millions d'euros (1,84 milliard de francs). La situation du groupe public d'armement reste donc très préoccupante.
DEPUIS SA CRÉATION, GIAT-INDUSTRIES ACCUMULE
DES PERTES QUEL QUE SOIT LE NIVEAU DE SON CHIFFRE D'AFFAIRES
(en millions d'euros) | ||
Chiffre d'affaires |
Résultat net | |
1990 (1) |
456,3 |
- 42,4 |
1991 |
1 705,6 |
- 62,5 |
1992 |
1 692,1 |
- 78,1 |
1993 |
1 404,3 |
- 176 |
1994 |
1 169,4 |
- 445 |
1995 |
1 271,3 |
- 1 568,7 |
1996 |
1 280,6 |
- 300,3 |
1997 |
1 027,2 |
- 433,7 |
1998 |
1 078,6 |
- 139 |
1999 |
883,7 |
- 144,4 |
2000 |
564,7 |
- 279,9 |
(1) sur 6 mois | ||
La dégradation des résultats de Giat-Industries pour l'année 2000 est la conséquence de difficultés conjoncturelles passées. L'entreprise a dû cesser ses livraisons de chars Leclerc aux Emirats Arabes Unis de mi-2000 à mi-2001 pour renégocier plusieurs aspects du contrat signé en 1993, dont la remise à niveau des matériels vendus. Compte tenu du report des livraisons (entraînant un important stockage et un arrêt de la chaîne de production), le chiffre d'affaires a diminué à due proportion. La reprise d'activité se répercutera sur le chiffre d'affaires de 2001 qui devrait avoisiner les 769 millions d'euros (5,04 milliards de francs), soit une augmentation prévisionnelle de 36,2 %.
La récurrence des pertes sur les dix dernières années montre que les handicaps de l'entreprise sont avant tout structurels :
- malgré les fermetures ou cessions déjà réalisées ou bien en cours, la dispersion des sites constitue encore un frein à la productivité ;
- la diminution des effectifs, de 14 412 personnes en 1990 à 6 575 en 2002, s'effectue uniformément alors qu'elle devrait concerner essentiellement les catégories les plus coûteuses pour l'entreprise et tenir compte de ses besoins qualitatifs.
L'effort d'adaptation réalisé ces dernières années est certes conséquent : une marge brute de 55 millions d'euros (360 millions de francs) devrait être dégagée, lors de l'exercice en cours, sur les activités qui constituent le c_ur du métier de Giat-Industries, après avoir isolé le coût de l'effort d'adaptation de l'entreprise (sureffectifs, surmoyens, formation, reengineering) et le coût du contrat de vente de chars aux Emirats Arabes Unis. Mais ces restructurations ne suffiront pas à assurer l'avenir : la fin des livraisons de chars Leclerc aux Emirats Arabes Unis est prévue pour mi-2003, sans que des débouchés sûrs (en Arabie Saoudite, en Grèce ou en Turquie) maintiennent un niveau convenable de plan de charge, comme prévu par le plan économique, stratégique et social (PSES) adopté en 1998.
Un nouveau plan de réduction des moyens de production, dans le prolongement du PSES, apparaît d'ores et déjà nécessaire. La Cour des Comptes suggère des fermetures de sites, l'entreprise ne conservant que les établissements de Sartory (siège social et bureaux d'études), Roanne ou Saint-Chamond (blindés), Bourges et La Chapelle (armes et munitions) ; à défaut, de nouvelles pertes d'un montant de 1,5 milliard d'euros (10 milliards de francs) pourraient être contractées entre les années 2000 et 2005.
Si Giat-Industries dispose d'atouts techniques incontestables, comme l'illustre la signature au salon du Bourget d'un contrat avec General Dynamics Armament Systems pour la fourniture de tourelles de 20 mm à l'hélicoptère RAH 66 Comanche, l'assainissement des comptes est indispensable avant une éventuelle ouverture de capital pour nouer des alliances.
E. LES ENTREPRISES D'ÉQUIPEMENT AÉRONAUTIQUE ET DE PROPULSION SONT RESTÉES À L'ÉCART DES RAPPROCHEMENTS EUROPÉENS MAIS DOIVENT S'Y PRÉPARER
A la différence de leurs homologues américains, les fabricants européens de moteurs et d'équipements aéronautiques se sont peu regroupés hors de leur marché domestique. La réorganisation de l'industrie aérospatiale et le coût de développement de nouveaux programmes à forte exigence technologique devraient les y inciter dans un proche avenir. Dans le contexte actuel, la cession par l'Etat d'une partie du capital de Snecma a été reportée mais pas remise en cause. La voie sera ouverte dès que possible à des rapprochements structurels que commandent l'intérêt de Snecma et l'Europe de l'armement.
Aux Etats-Unis la concentration des fabricants de moteurs et d'équipements est avancée, même si le rachat d'Honeywell par General Electric s'est heurté au refus de la Commission européenne ; il n'en est pas de même en Europe.
CINQ ACTEURS EUROPÉENS COEXISTENT
SUR LE MARCHÉ DE LA PROPULSION
(1) En milliards d'euros
Sociétés |
Chiffres d'affaires |
ROLLS ROYCE |
7,82 |
SNECMA |
5,65 |
MTU |
1,8 |
FIAT AVIO |
1,6 |
VOLVO AERO |
1,4 |
Au niveau européen, des rapprochements nationaux ont été entrepris : Rolls-Royce a racheté à BMW ses parts de la filiale commune BMW-RR ; le groupe Snecma a acquis Labinal (le 2 mai 2000) et Hurel-Dubois (le 13 septembre de la même année).
Des coopérations industrielles et commerciales importantes ont également été nouées ou sont sur le point de l'être :
- pour la réalisation des moteurs des lanceurs européens Ariane et les études sur la propulsion du projet de lanceur italien Vega (entre Snecma et Fiat Avio) ;
- pour le développement du moteur TP400 de l'Airbus A 400 M (entre Snecma, Fiat Avio, MTU et Rolls-Royce) ;
- dans les activités de propulsion à poudre (création d'Herakles, filiale conjointe entre Snecma et la SNPE, appelée à intégrer les activités de propulsion tactique de Royal Ordnance, Bayern Chimie et MBDA au sein de la joint-venture New Celerg).
Cependant, des alliances européennes structurelles restent à l'état de projet. Leur aboutissement est absolument nécessaire car une comparaison des chiffres d'affaires souligne l'extrême fragilité des fabricants européens par rapport à leurs homologues américains. Les grands programmes d'armement européens, l'A 400 M ou Ariane 5 évolution par exemple, supposent des investissements tels que des regroupements semblent inévitables à terme.
Snecma est un groupe de propulsion et d'équipements aéronautiques et spatiaux. Ses activités sont duales : 16 % de son chiffre d'affaires est lié à la défense.
L'entreprise occupe le second rang européen des fabricants de moteurs, derrière Rolls-Royce, et fournit une gamme très étendue de moteurs :
- M 53 pour les Mirage 2000 et M 88-2 du Rafale ;
- Tyne des avions de transport Transall, C-160, Atlantique 1 et 2 ainsi que TP400 de l'A 400 M ;
- Arrius des hélicoptères Écureuil et Fennec ainsi que RTM 322 du NH90 ;
- Vinci et Vulcain pour le lanceur spatial européen Ariane 5 ;
- propulsion des missiles stratégiques M 45 et de la nouvelle génération M 51.
Ses clients sont très diversifiés : Boeing, Airbus, Arianespace, Eurocopter, Sikorsky, Dassault Aviation, notamment.
Le groupe est également en bonne position sur le marché mondial des équipements aéronautiques : il se situe au second rang européen, derrière BAe Systems, dans un secteur où les entreprises européennes (Smiths Group, Zodiac Intertechnique, Sagem SFIM, Cobham, Liebherr Aerospace et Diehl notamment) sont de taille plus modeste.
LE GROUPE SNECMA JOUE UN RÔLE IMPORTANT
AUX NIVEAUX EUROPÉEN ET MONDIAL
Secteurs d'activité |
Rang européen |
Rang mondial |
PROPULSION |
2ème |
4ème |
· Propulsion aéronautique |
2ème |
4ème |
· Propulsion spatiale |
1er |
- (1) |
EQUIPEMENTS |
2ème |
6ème |
· Atterrisseurs |
1er |
1er |
· Systèmes de freinage |
1er |
3ème |
· Inverseurs de nacelles |
1er |
2ème |
· Transmissions de puissance |
2ème |
2ème |
· Équipements de moteurs |
2ème |
6ème |
· Câblages aéronautiques |
1er |
1er |
(1) Les restructurations sont en cours dans ce secteur.
Source : Snecma, mars 2001.
Des partenariats européens avec Fiat Avio, voire dans une moindre mesure Volvo Aero et MTU, sont clairement souhaités par la direction et le Gouvernement. Snecma peut constituer le fédérateur européen d'un secteur morcelé et dont les débouchés se sont restructurés avec l'apparition d'EADS, et la création de la société Airbus.
L'ouverture du capital décidée par le Gouvernement est de nature à favoriser la conclusion d'alliances avec ces sociétés dont l'actionnariat est privé. Le report de cette ouverture du capital ne devrait pas avoir d'incidence majeure car les autres industriels européens se trouvent eux aussi dans une position d'attentisme bien compréhensible au lendemain des événements du 11 septembre.
La direction de Snecma n'est pas favorable à un resserrement des liens avec Rolls-Royce, qui s'est pourtant prononcé en faveur d'une telle hypothèse. En fait, un tel projet se heurterait au partenariat entre Snecma et General Electric au sein de CFM International, premier concepteur de moteurs d'avions civils au monde (Boeing 737 et A 320) ; Rolls-Royce en est l'un des principaux concurrents.
Cette incompatibilité ne doit pas pour autant faire obstacle au renforcement des partenariats entre les deux entreprises :
- dans le domaine des moteurs militaires (programmes Adour, TP400 et moteur militaire futur) ;
- dans le domaine des moteurs d'hélicoptères (RTM 322, notamment).
L'Europe de la défense repose désormais sur l'émergence de pôles industriels intégrés : la création d'EADS a amorcé une nouvelle étape du processus ; les secteurs de la construction navale, de l'armement terrestre et de la propulsion devraient bientôt connaître une évolution similaire.
L'examen des crédits des comptes spéciaux du Trésor intéressant le ministère de la Défense ne peut s'abstraire de ce contexte.
L'analyse détaillée des comptes de commerce montre que ce régime juridique spécifique n'est pas adapté pour des services à vocation industrielle soumis à une contrainte budgétaire et à un besoin d'alliances internationales. L'existence des comptes relatifs aux subsistances militaires et à l'approvisionnement des armées en produits pétroliers se justifie ; le compte du service de la maintenance aéronautique devra nouer des partenariats à l'avenir ; celui du service à compétence nationale DCN pose de sérieux problèmes déjà évoqués l'an passé.
Sur ce dernier point, votre Rapporteur constate que le Gouvernement semble avoir enfin pris en considération sa proposition, formulée dès l'examen du projet de loi de finances pour l'année 2000, de transformer DCN en société. On peut s'interroger néanmoins sur la pertinence de refuser d'en ouvrir le capital.
L'avenir des principaux services industriels du ministère de la Défense et des entreprises publiques du secteur de l'armement est au c_ur du débat, de même que leur aptitude à initier les regroupements européens en cours ou qui s'esquissent.
Snecma constitue à cet égard un exemple intéressant, puisqu'une ouverture de capital a été décidée de manière à préparer des regroupements européens nécessaires à l'émergence d'un « EADS des motoristes » sans remettre en question les liens transatlantiques existants.
La société nationale Giat-Industries est également confrontée à un besoin d'alliances industrielles. Si son statut ne constitue pas un obstacle, il convient d'attendre l'achèvement de son redressement financier avant d'envisager des coopérations autres que ponctuelles.
A terme, les principaux services industriels du ministère de la Défense et les entreprises publiques de l'armement devront, pour survivre, s'intégrer dans des ensembles industriels européens. Il convient de les préparer au plus tôt à cette échéance.
La Commission de la Défense s'est réunie le 6 novembre 2001, sous la présidence de M. Robert Gaïa, Vice-Président, pour examiner les articles 35, 36 et 39 du projet de loi de finances pour 2002 relatifs aux comptes spéciaux du Trésor, sur le rapport de M. Loïc Bouvard, rapporteur pour avis.
Après une présentation générale des comptes spéciaux du Trésor intéressant la Défense, M. Loïc Bouvard a analysé les transactions du compte d'affectation spéciale 902-24 relatives aux entreprises nationales du secteur de l'armement. Il a plus particulièrement observé que Giat-Industries, déjà recapitalisée à hauteur de 2,66 milliards d'euros (17,45 milliards de francs) depuis sa création, avait à nouveau besoin de 610 millions d'euros (4 milliards de francs) qui devraient lui être versés d'ici le premier trimestre de 2002. Il a ensuite précisé que l'Etat devrait céder 25 % du capital de la société Snecma à des investisseurs institutionnels dès que les conditions du marché le permettraient, c'est-à-dire quand l'entreprise sera à nouveau valorisée aux alentours de 6 milliards d'euros (une quarantaine de milliards de francs), soit l'estimation qui prévalait avant les attentats perpétrés aux Etats-Unis le 11 septembre dernier. Il a ajouté qu'une recapitalisation de la SNPE à hauteur de 76 millions d'euros (500 millions de francs) avait été envisagée, estimant que le concours de l'Etat à cette entreprise pourrait être plus élevé, dans l'hypothèse où elle devrait délocaliser ses usines de Toulouse.
M. Loïc Bouvard a ensuite rappelé que le coup d'envoi des restructurations des industries françaises de la défense dans une perspective européenne avait été donné dans les secteurs aéronautique et électronique, avec les privatisations d'Aérospatiale-Matra, fusionnée depuis avec DASA et CASA au sein d'EADS, et de Thomson-CSF, devenu Thales.
Il a constaté que la société EADS, créée le 11 juillet 2000, se situait au troisième rang mondial de l'aéronautique et de l'espace. Il a précisé que si le groupe britannique BAe Systems n'avait pas participé à la fusion, il s'était associé à EADS par l'intermédiaire de nombreuses filiales communes, favorisant ainsi l'émergence d'un pôle européen capable de faire face à la concurrence américaine.
Le rapporteur pour avis a remarqué que la création d'EADS avait eu d'importantes conséquences sectorielles. Elle a conduit les principaux fabricants européens de missiles à s'entendre le 26 avril 2001 pour regrouper leurs compétences au sein de MBDA, premier groupe européen et second mondial, derrière Raytheon. Elle a également favorisé le renforcement de la cohérence de la filière spatiale européenne avec l'accélération de la création d'Astrium et des restructurations de la chaîne de fournisseurs d'Arianespace.
Le rapporteur a toutefois regretté que le secteur de l'industrie aéronautique militaire reste encore trop émietté. Il a observé à cet égard que Dassault Aviation, concurrencé par les consortia Eurofighter et Gripen, refusait de s'associer à d'autres partenaires européens. Il a également relevé qu'EADS, actionnaire à plus de 45 % de Dassault Aviation, souhaitait qu'il noue un partenariat avec Finmeccanica au sein de la société European Military Aircraft Company (Emac) destinée à regrouper la majorité des concepteurs de l'Eurofighter, à l'exception notable de BAe Systems. Il a estimé que cette évolution serait souhaitable au moment où le gouvernement américain venait d'attribuer le programme d'avion de combat JSF à Lockheed Martin. Il a ensuite constaté qu'Eurocopter ne rassemblait pas tous les industriels européens de son secteur puisque Agusta et Westland restaient des concurrents actifs. Il s'est néanmoins réjoui de certaines avancées dans le domaine du transport militaire, notamment avec la création d'Airbus Military Corporation.
Puis abordant le secteur de l'électronique de défense, M. Loïc Bouvard a souligné que Thales était un groupe international dont 57 % du chiffre d'affaires étaient issus d'activités aussi spécifiques que les télécommunications militaires, les radars aéroportés, la guerre électronique, l'optronique et les sonars. Il a rappelé que l'entreprise avait procédé à de nombreuses acquisitions depuis deux ans et souligné que l'intégration de Short Missile Systems puis de Racal Electronics avait conforté son second rang dans l'électronique de défense en Europe. Il s'est réjoui que Thales ambitionne également de nouer des liens transatlantiques importants, notamment dans le domaine de la défense aérienne à travers une filiale au capital détenu à parité avec Raytheon, Thales Raytheon Systems.
Le rapporteur pour avis a souligné que le mouvement de restructuration concernait également les domaines de la construction navale, de la propulsion et, dans une moindre mesure, de l'armement terrestre.
Abordant le cas de DCN, il a rappelé avoir déjà démontré devant la Commission, à l'occasion de la présentation de ses avis budgétaires pour les années 2000 et 2001, que son régime juridique actuel était inadapté.
Il a précisé, en premier lieu, que l'organisation de DCN en service à compétence nationale était loin de résoudre toutes ses difficultés de gestion des ressources humaines et que, malgré un décret du 31 juillet 2001 censé en atténuer le formalisme, les règles applicables à ses achats nuisaient à la bonne exécution des contrats à l'exportation, quand elles n'en empêchaient pas tout simplement la conclusion, en rendant notamment impossible toute compensation industrielle (offset). Il a ajouté, en second lieu, que le statut de compte de commerce ne permettait pas à DCN de disposer de la personnalité juridique indispensable pour nouer des alliances structurelles.
Se félicitant que le Gouvernement ait enfin pris ces arguments en considération, M. Loïc Bouvard a fait état de la décision, annoncée le 6 juillet dernier, de transformer DCN en société. Il a fait observer qu'elle intervenait alors que la restructuration du secteur de la construction navale militaire était bien avancée en Allemagne et achevée au Royaume-Uni.
Le rapporteur pour avis a alors considéré que, pour rompre tout risque d'isolement, DCN devait absolument participer au processus de privatisation des chantiers navals espagnols Izar en 2003 et nouer rapidement un partenariat durable avec l'Italien Fincantieri. Convenant que le statut de société d'Etat prenait en compte les préoccupations des personnels, il a toutefois douté qu'il permette enfin à DCN de s'imposer comme un partenaire incontournable en Europe. Après avoir souligné que les exemples d'Aérospatiale-Matra et de Snecma, montraient que les alliances passaient par des ouvertures de capital, il a observé que le communiqué du Gouvernement du 6 juillet 2001 semblait exclure une telle solution pour DCN, lui préférant des partenariats par filiales. Regrettant ce choix, le rapporteur a fait valoir que, dans un proche avenir, l'Etat devrait aller plus loin en ouvrant le capital de la société, ainsi qu'il l'avait préconisé depuis plusieurs années.
M. Loïc Bouvard a alors jugé plus pertinents les choix retenus en faveur de Snecma, le statut de l'entreprise facilitant beaucoup les choses. Il a observé que les alliances structurelles entre les cinq grands motoristes européens (Rolls Royce, Snecma, MTU, Fiat Avio et Volvo Aero) restaient à l'état de projet malgré leur extrême fragilité face à leurs concurrents américains. Il s'est alors prononcé en faveur de l'émergence d'un « EADS des motoristes » à partir d'une alliance entre Snecma et d'autres fabricants européens.
Le rapporteur pour avis a toutefois constaté que les discussions entamées à ce sujet avaient échoué jusqu'à présent, l'Etat ayant trop longtemps laissé planer le doute sur ses intentions. Il a rappelé à cet égard que le Premier ministre n'avait annoncé une ouverture du capital de Snecma qu'en juin dernier. Il a ajouté qu'après ce temps perdu, l'introduction en bourse initialement prévue pour cet automne avait dû être reportée en raison de l'impact sur les marchés financiers des attentats du 11 septembre.
M. Loïc Bouvard a alors exprimé sa confiance dans la conclusion prochaine d'alliances entre Snecma, qui lui paraissait en mesure de faire face à la dégradation conjoncturelle de ses marchés, et d'autres constructeurs européens.
Il a souhaité terminer sa présentation de la modernisation du secteur public de l'armement, en évoquant les perspectives d'avenir de Giat-Industries. Exprimant sa vive inquiétude devant l'isolement stratégique dans lequel semblait se trouver l'entreprise, il a observé que l'industrie de l'armement terrestre se trouvait fragilisée en Europe, notamment du fait de son morcellement. Après avoir souligné que Giat-Industries restait un des principaux industriels européens de l'armement terrestre, il s'est félicité de son association à Renault Véhicules Industriels pour conduire le programme de véhicules blindés de combat d'infanterie (VBCI). Il a alors émis le v_u que cette démarche, si elle se confirmait, préfigure une véritable restructuration de l'industrie française des blindés légers. Après avoir évoqué d'autres partenariats dans le domaine des munitions, il a considéré que des rapprochements plus étroits pourraient voir le jour, à la condition que, dans le même temps, l'Etat actionnaire appuie les efforts de l'entreprise pour mettre en valeur ses activités viables.
Après avoir jugé que le Gouvernement avait apporté jusqu'à présent des réponses différentes, et parfois insuffisantes, aux difficultés du secteur public de l'armement, le rapporteur a estimé que leur solution passait par des alliances européennes ou transatlantiques.
Il a également fait valoir que tout retard en ce domaine pouvait être préjudiciable aux entreprises concernées dans un contexte d'évolution très rapide des marchés et des acteurs.
M. Loïc Bouvard a alors invité la Commission à donner un avis défavorable à l'adoption des articles du projet de loi de finances pour 2002 relatifs aux comptes spéciaux du Trésor.
Approuvant les observations du rapporteur sur la situation de Giat-Industries, M. Yves Fromion a tenu à rappeler que cette entreprise avait déjà bénéficié de 17,5 milliards de francs de recapitalisation et que 4 milliards supplémentaires au moins restaient à venir, en s'interrogeant sur l'utilité réelle d'un tel effort budgétaire. Après avoir considéré que des plans sociaux successifs et l'absence de perspectives appelaient une tout autre attitude vis-à-vis du groupe, il a insisté sur l'inquiétude des salariés qui jugeaient la situation intenable. Il a enfin estimé que les pertes de Giat-Industries, qui représentaient le quart de celles du Crédit Lyonnais, constituaient un véritable scandale financier.
M. Loïc Bouvard a souligné qu'il partageait de longue date les préoccupations de M. Yves Fromion quant à l'avenir de Giat-Industries, tout en rappelant que des mesures d'adaptation avaient néanmoins pu être prises puisque les effectifs de l'entreprise étaient passés de 14 000 à quelque 5 800 (compte non tenu des filiales). Il a ajouté que, pour l'exercice 2001, une marge brute positive serait même probablement dégagée dans les secteurs constituant le c_ur d'activités du groupe. Puis, après avoir jugé qu'à l'issue du contrat d'exportation du char Leclerc aux Emirats Arabes Unis, les débouchés extérieurs apparaissaient très incertains, il a fait remarquer que la Cour des Comptes allait, dans son récent rapport, jusqu'à préconiser la fermeture pure et simple de certains sites.
M. Yves Fromion a alors insisté sur l'amertume des militaires qui constataient que l'effort consenti en faveur de Giat-Industries pesait sur les budgets d'équipement de la Défense.
Après avoir exprimé son accord avec le rapporteur sur la nécessité de transformer rapidement DCN en société d'Etat, M. Jean-Yves Le Drian a estimé que le maintien de l'entreprise au sein du secteur public ne l'empêcherait pas de nouer des alliances avec des partenaires étrangers. Il a considéré par ailleurs qu'eu égard à la culture d'entreprise de DCN, il n'existait pas d'alternative au statut de société d'Etat. Récusant des critiques fréquentes, il a considéré que DCN ne se trouvait pas dans une situation comparable à celle de Giat-Industries, puisqu'elle disposait de bonnes perspectives de marché et qu'elle avait su procéder à d'importantes adaptations internes. Enfin M. Jean-Yves Le Drian a souhaité que la Commission examine les perspectives de la construction aéronautique militaire européenne après le lancement du programme JSF.
M. Robert Poujade s'est interrogé sur les perspectives offertes à Giat-Industries par le contrat relatif à la réalisation du VBCI, compte tenu d'un environnement concurrentiel qui reste défavorable. Il a par ailleurs fait état du débat en cours en Italie concernant l'A 400 M.
M. Jean Michel a souligné les progrès accomplis par Giat-Industries en matière d'effectifs et de qualité. Il a, à cet égard, regretté certaines appréciations de la Cour des Comptes qu'il a jugées excessives. Puis il a mis l'accent sur les perspectives d'exportation de matériel terrestre offertes par l'Arabie saoudite, la Grèce et tout particulièrement la Turquie, précisant que le char Leclerc avait réalisé une démonstration probante dans ce dernier pays qui, par ailleurs, a d'importants besoins de véhicules de transport de troupes. Enfin, tout en souhaitant la poursuite rapide du mouvement européen de restructuration industrielle dans le secteur de l'armement, il a exprimé la crainte que le Royaume-Uni cherche à maintenir une certaine distance à l'égard des pays du continent et soit tenté par le rôle de « Cheval de Troie » des Etats-Unis au sein de l'Europe de la défense.
*
La Commission a alors émis un avis favorable à l'adoption des articles 35, 36 et 39 du projet de loi de finances pour 2002 relatifs aux comptes spéciaux du Trésor, les membres des groupes RPR, UDF et DL votant contre.
N° 3323-XI.- Avis de M. Loïc Bouvard(commission de la défense) sur le projet de loi de finances pour 2002 - Comptes spéciaux du Trésor.
- Cliquer ici pour retourner au sommaire général
- Cliquez ici pour retourner à la liste des rapports et avis budgétaires
- Cliquez ici pour retourner à la liste des discussions budgétaires
Avis n° 1864 présenté au nom de la Commission de la Défense nationale et des Forces armées sur le projet de loi de finances pour 2000, tome XI, comptes spéciaux du Trésor, par M. Loïc Bouvard, XIème législature.
Avis n° 2627 présenté au nom de la Commission de la Défense nationale et des Forces armées sur le projet de loi de finances pour 2001, tome XI, comptes spéciaux du Trésor, par M. Loïc Bouvard, XIème législature.
Les programmes du quatrième sous-marin nucléaire lanceur d'engins de nouvelle génération (SNLE-NG) et des deux nouveaux transports de chalands de débarquement (NTCD) ont des incidences directes sur les études et la construction neuve.
Il s'agit essentiellement des effets de la vente de frégates à Singapour et de l'achèvement des sous-marins Scorpène pour le Chili.
La diversification consiste à produire des matériels qui n'ont pas une utilité militaire, tels des plates-formes de forage pétrolier par exemple. Ce faisant, DCN exerce une activité hors de son domaine traditionnel de compétence.
Propos rapporté par le Quotidien La Tribune, en date du 8 juin 2001.
MBDA fait partie du consortium « Team Janus », conduit par Lockheed Martin : ce consortium a soumissionné auprès de l'OTAN pour étudier la faisabilité d'un système de défense antimissiles de théâtre.
L'unité monétaire du marché spatial est le plus souvent le dollar. C'est la raison pour laquelle votre Rapporteur n'a pas jugé opportun de détailler cette somme en euros.
Alenia Spazio, filiale du groupe italien Finmeccanica, ne s'est pas rapprochée d'Astrium : l'entreprise italienne aurait engagé des discussions avec Boeing et Alcatel Industries en vue d'un partenariat.
Alcatel a récemment récupéré les 49 % détenus par Thales.
Actuellement, EADS se trouve impliqué dans deux programmes, Typhoon et Rafale, qui se concurrencent directement.
Ces chiffres sont extraits de données du GIFAS.
Une trentaine de juriste serait nécessaire ; actuellement, ils ne sont que deux.
Une centaine de cadres fait défaut en ce domaine.
Ces deux programmes, prévus par le projet de loi de programmation militaire pour les années 2003-2008, conditionneront la réussite de la transformation en société : au 1er janvier 2003, l'entreprise DCN ne sera pas suffisamment compétitive pour affronter à son avantage la concurrence. Il semble donc indispensable de garantir un minimum d'activité pour assurer la réforme de DCN, ce qui n'empêche nullement de lui assigner des objectifs de coûts.
Satory, Roanne, Tarbes, Saint-Chamond et Toulouse pour la production de blindés ; Bourges, Tulle, Tarbes, Cusset et La Chapelle pour la production d'armes et munitions.
5 830 si l'on ne tient pas compte des filiales à 100 % de la société (Luchaire Défense et Manurhin Défense).
Le nombre annuel moyen d'heures travaillées par salarié effectivement rémunéré à temps plein est de 1372,8 heures par an, ce qui représente l'équivalent d'un régime moyen de 12,7 semaines de congés annuels, financé par l'entreprise, sur la base de 35 heures de travail par semaine. Obtenir une productivité convenable dans de telles conditions relève de la gageure.
Il convient, à cet égard, de souligner que l'organisation de la société a été revue depuis 1995 et que les procédures d'achats ainsi que les procédés de production ont été améliorés.
La Commission européenne a opposé son veto à cette fusion le 3 juillet dernier, considérant qu'une telle opération était contraire aux règles de la concurrence. Il ne serait resté que deux groupes américains de taille mondiale dans le secteur des moteurs suite au rachat d'Honeywell : General Electric (12,7 milliards d'euros/83,3 milliards de francs de chiffre d'affaires en 2000) et Pratt & Whitney (8,63 milliards d'euros/56,6 milliards de francs la même année).