

![]()
N° 67
——
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 11 juillet 2007.
RAPPORT D’INFORMATION
DÉPOSÉ
en application de l’article 145 du Règlement
PAR LA COMMISSION DES FINANCES, DE L’ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU PLAN
préalable au débat d’orientation budgétaire pour 2008,
ET PRÉSENTÉ
PAR M. Gilles CARREZ,
Rapporteur général,
Député.
——
I.– DES FINANCES PUBLIQUES DÉSORMAIS SOUS CONTRÔLE PERMETTENT D’ENGAGER LE CHOC DE CONFIANCE DONT NOTRE ÉCONOMIE A BESOIN 5
A.– DES FINANCES PUBLIQUES RÉTABLIES MAIS ENCORE VULNÉRABLES 5
B.– UN AMBITIEUX PROJET FISCAL APTE À REMETTRE LA FRANCE SUR LES RAILS DE LA COMPÉTITIVITÉ 11
II.– LE DÉSENDETTEMENT DEMEURE UN IMPÉRATIF QUI DOIT INSPIRER UNE STRATÉGIE D’ASSAINISSEMENT BUDGÉTAIRE INSCRITE DANS LA DURÉE 15
A.– TRANSFORMER L’ESSAI DE LA MAÎTRISE DE LA DÉPENSE : UN RELÂCHEMENT SERAIT MALVENU 15
1.– Amplifier la politique de maîtrise de la dépense 15
2.– Conforter et élargir la norme de dépense 17
3.– Restaurer les marges de manœuvre en dépenses 25
B.– PENSER LE DÉSENDETTEMENT À MOYEN TERME ET TRACER UN CHEMIN VERS L’ÉQUILIBRE 32
1.– À l’horizon 2008, le maintien sous contrôle du déficit 33
2.– À l’horizon de la législature, le défi exigeant du désendettement 36
AUDITION DE M. PHILIPPE SEGUIN, PREMIER PRÉSIDENT DE LA COUR DES COMPTES 41
I.– DES FINANCES PUBLIQUES DÉSORMAIS SOUS CONTRÔLE PERMETTENT D’ENGAGER LE CHOC DE CONFIANCE DONT NOTRE ÉCONOMIE A BESOIN
A.– DES FINANCES PUBLIQUES RÉTABLIES MAIS ENCORE VULNÉRABLES
Les finances publiques sont désormais clairement engagées dans la voie du redressement. L’équilibre budgétaire, indispensable à terme pour préparer efficacement le choc démographique du vieillissement de la population, est enfin une perspective crédible.
Ici se situe l’une des plus remarquables performances de la XIIème législature.
À l’image des VIIIème (1986-1988) et Xème (1993-1997) législatures, elle remet des finances de l’État en bien meilleur état qu’elle n’en a hérité. Le déficit de l’État s’est établi à 35,7 milliards d'euros en 2006. Ce sont 10,7 milliards d'euros (soit près d’un quart) de moins que les 46,4 milliards d'euros de déficit légués par la XIème législature (1).
● Cet assainissement doit moins à la conjoncture économique, satisfaisante mais loin d’être exceptionnelle durant les cinq dernières années, qu’à un très puissant effort de discipline budgétaire.
En ce sens, il est de nature structurelle.
Le Rapporteur général s’est en effet attaché à faire la part au sein des performances budgétaires annuelles du « durable » et du « provisoire » en isolant le poids de la conjoncture économique dans l’évolution du déficit.
Le système fiscal français évolue selon une tendance cyclique très affirmée qui fait surréagir le produit des impôts aux à-coups de l’économie. Ainsi, les rentrées fiscales s’accélèrent brusquement lorsque la croissance repart (les ressources fiscales ont progressé près de deux fois plus vite que l’économie entre 1999 et 2001) et se tarissent brutalement lorsqu’elle s’essouffle (les ressources fiscales ont diminué en valeur entre 2002 et 2003 alors même que le taux de progression du PIB était – très modestement – positif) (2).
Cependant, à long terme, les ressources de l’État évoluent au même rythme que la richesse nationale (c'est-à-dire selon le taux de croissance potentielle de l’économie) (3). Les excédents d’une année dus à une croissance supérieure à son potentiel et à une forte élasticité des recettes fiscales au PIB ont vocation à être compensés par des moins-values aussi importantes lorsque croissance et élasticité diminuent.
Dès lors, il est possible d’identifier un surplus annuel « durable » (c'est-à-dire qui correspond à l’augmentation spontanée des recettes pour une croissance de l’ordre de 2 ¼ %) et une élasticité des recettes fiscales au PIB unitaire.
Si un budget annuel répartit en nouvelles charges publiques ou en allégements d’impôts un montant supérieur au surplus durable, les finances de l’État sont structurellement dégradées, quelle que soit par ailleurs l’évolution apparente du déficit. Et le dérapage budgétaire, qui peut être masqué par une conjoncture exceptionnelle qui gonfle artificiellement le volume des rentrées fiscales, présente bien vite sa facture lorsque les nouvelles dépenses et les baisses d’impôts continuent à exercer leurs effets dans un contexte de raréfaction des ressources
Les surplus durables s’élèvent chaque année à environ 10/12 milliards d'euros (4). C’est la marge de manœuvre dont doit se contenter le législateur budgétaire respectueux des générations futures. La « règle des dix milliards d'euros » consiste donc à ne pas dépenser chaque année plus de ce montant sauf à dégrader de manière structurelle les finances de l’État.
Or cette règle fut très imprudemment ignorée par la XIème législature qui entre 1997 et 2002 a dépensé, en moyenne, 17 milliards d'euros (5) par an (avec 9,2 milliards d'euros de hausse des charges publiques, 0,8 milliard d'euros d’allégements supplémentaires de cotisations sociales sur les bas salaires et 7 milliards d'euros de baisses d’impôts). Ainsi, le solde de l’État s’est dégradé, structurellement, de près de 7 milliards d'euros au total.
À l’inverse, la XIIème législature a su efficacement borner ses choix budgétaires dans la voie étroite et difficile de l’assainissement budgétaire. En ne dépensant « que » 11,7 milliards d'euros par an en moyenne (avec 7,2 milliards d'euros de hausse des charges publiques, 0,6 milliard d'euros d’allégements supplémentaires de cotisations sociales sur les bas salaires et 3,9 milliards d'euros de baisses d’impôts), elle est parvenue à stabiliser le déficit structurel de l’État.
Il importe de prendre la réelle mesure de cette performance.
À l’image d’un paquebot conservant son cap un long moment après que le gouvernail a été actionné, les phénomènes budgétaires sont affectés d’une grande inertie, tant sur les stocks (les intérêts de la dette font longtemps peser sur les budgets futurs le poids des choix laxistes du passé) que sur les flux (les dépenses nouvelles, outre leur coût permanent, sont parfois des foyers de dépenses supplémentaires ; ainsi, les allégements de charges sociales sur les bas salaires mis en œuvre par la XIIème législature ont en grande partie découlé du choix des 35 heures dont il a bien fallu compenser le coût pour les entreprises). Le passé pèse ici d’un poids déterminant : si le faible niveau des taux d’intérêt a fortement allégé le coût réel du rebond de la dette publique, l’accroissement de la taille de la fonction publique au cours des années 1990, à contre-courant de tous nos voisins européens, a immanquablement imprimé aux dépenses de personnel, en particulier de pension, une dynamique qui obère largement les marges de manœuvre budgétaires.
Dans ce contexte, le mérite n’est pas mince d’être parvenu à réduire de 42 % les montants dépensés durant les années 2002-2007 par rapport à la législature 1997-2002.
● La discipline budgétaire appliquée sans relâche depuis 2002 a permis de remettre les finances publiques sous contrôle. L’État est désormais sorti de la zone rouge conjurant la menace de l’accroissement incontrôlé de la dette (« l’effet boule-de-neige »).
Il est en effet une situation des finances publiques qui, de facto, interdit l’usage effectif d’une politique économique autonome en soumettant les choix budgétaires à un impératif incontournable. C’est dans cette situation que s’est brutalement trouvée la XIIème législature.
Lorsque le déficit dépasse un certain niveau et que la dette a franchi un seuil déterminé, la contrainte budgétaire obère presque totalement la politique économique. Les critères du Pacte de stabilité annexé au Traité de Maastricht formalisent la contrainte de la discipline budgétaire que d’autres mécanismes correcteurs – qu’il s’agisse d’une brutale dégradation de la notation financière d’un État qui met en cause sa capacité à emprunter à un coût raisonnable ou des traditionnels ajustements par dévaluation qui ont jalonné notre histoire budgétaire – rappellent à l’intention des gouvernants.
Les notions de seuil stabilisant et d’effet « boule-de-neige » éclairent cette approche. L’évolution de l’endettement public (rapport entre le montant de la dette publique et le PIB) est le critère d’appréciation décisif de la soutenabilité des finances publiques, en particulier dans un contexte dans lequel les dépenses publiques sont appelées à subir une forte inflation à moyen terme comme c’est le cas avec le vieillissement de la population. À l’évidence, le ratio d’endettement public reste stable d’une année sur l’autre dès lors que la dette s’accroît au même rythme que le PIB en valeur. Or, la variation de la dette découle directement du besoin de financement des administrations publiques. La condition de stabilité du ratio d’endettement se traduit alors par le fait que le déficit public stabilisant (en % du PIB) est égal au produit du ratio d’endettement et du taux de croissance nominale de l’économie (6).
Cette règle fournit précisément une justification économique aux ratios de finances publiques fixés dans le Pacte de stabilité et de croissance : pour une croissance en volume de 3 % et une inflation de 2 %, soit une croissance nominale d’environ 5 %, un déficit public de 3 % du PIB stabilise la dette au niveau de 60 % du PIB.
Cependant, le comportement tendanciel de l’économie française se révèle moins favorable que les hypothèses retenues dans le Pacte de stabilité et de croissance. Sur la base, à court terme, d’un taux de croissance potentiel de 2 ¼ % en volume ou 4 % en valeur, le solde stabilisant que l’on peut considérer comme le montant maximum que peut atteindre le déficit tout en préservant la soutenabilité des finances publiques, est égal à 2,6 % pour une dette proche de 65 % du PIB.
Dans ce contexte, les jugements sur la qualité du solde ne peuvent être déconnectés de l’évolution de l’économie. Ce n’est pas la même chose d’atteindre le solde stabilisant lorsque la conjoncture est porteuse (ainsi, en 2000, le déficit stabilisant allait jusqu’à 4 % grâce à une croissance supérieure à 4 % en volume) que lorsqu’elle est modérée. Il n’en reste pas moins que des finances publiques placées hors de la trajectoire du solde stabilisant tendent à interdire l’usage d’une politique économique autonome, par l’effet « boule-de-neige » qui voit l’endettement progresser d’autant plus vite que la croissance est atone, dégradant un peu plus, par les intérêts qu’il génère, le niveau du déficit qui lui-même accélère la dynamique de l’endettement.
Ce raisonnement éclaire les résultats obtenus par le XIIème législature. Pour la première fois depuis 2001, l’État est parvenu en 2006 à rompre l’effet boule-de-neige en atteignant le solde stabilisant de 2,6 %. Or, ce seuil a été franchi en dépit d’une croissance modérée (2,1 %), et grâce à des outils éprouvés efficacement sur une longue période : la maîtrise intransigeante de la dépense et l’affectation de toutes les « bonnes surprises » en recettes à l’atténuation du déficit. Nos finances publiques sont ainsi désormais replacées sur une trajectoire soutenable à moyen terme, qui autorise l’exercice d’une politique économique plus ambitieuse. Et, à l’inverse de ce qui s’est passé en 2002, il n’y a pas de « vice caché » dans la situation budgétaire. Le solde stabilisant atteint est structurel.
● Les conditions sont désormais remplies pour commencer à faire usage de l’autonomie budgétaire recouvrée grâce aux efforts de la précédente législature. Cependant, pour être sous contrôle, nos finances publiques n’en sont pas moins fort vulnérables. Comme il a été vu, le solde stabilisant la dette publique, sous la nuance décisive qu’il apparaisse dans un contexte de croissance modérée, est un plafond, une limite à ne pas franchir sans dommages pour les générations futures.
Le déficit de l’État qui correspond à ce solde se situe autour de 35 à 40 milliards d’euros. Une dégradation précipiterait les finances publiques dans les affres de la dynamique auto-générée de la dette alourdie par l’augmentation des taux d’intérêt. Qu’il soit possible, à court terme, de financer un choc de confiance dont on verra que notre économie a besoin ne peut signifier pour autant qu’il soit permis de relâcher aujourd’hui l’effort de discipline budgétaire. À l’inverse, le Rapporteur général tend à penser que cet effort doit encore être approfondi pour accompagner efficacement le retour de la confiance. Deux défis prioritaires découlent de cette conviction.
Le premier concerne l’exécution 2007.
La majorité s’est attachée à construire à l’automne dernier un budget équilibré et responsable, respectueux du chemin vers l’équilibre tracé à la fin de la XIIème législature. Ainsi, la réforme fiscale d’ampleur (6,7 milliards d'euros de baisses d’impôts au premier rang desquelles la réforme du barème de l’impôt sur le revenu) adoptée essentiellement dans la loi de finances initiale pour 2006 a été partiellement financée par le franchissement d’une nouvelle étape dans la maîtrise de la dépense (– 1 % en volume) permettant de contenir les montants globalement distribués à 12 milliards d'euros, près des marges de manœuvre « durables » dont doit se contenter une gestion respectueuse des générations futures. Or, compte tenu du choix délibéré de retenir des hypothèses prudentes de croissance et d’élasticité des recettes, l’amélioration apparente du solde entre la loi de finances initiale pour 2007 et les estimations alors retenues pour 2006 s’est limitée à moins de 3 milliards d'euros, plaçant le déficit prévu à 42 milliards d'euros.
Le déficit se situe donc dans la borne haute de la zone de sécurité de nos finances publiques. Il est par conséquent exclu que l’exécution du budget de l’année conduise à revoir le déficit à la hausse. C’est la première priorité aux yeux du Rapporteur général.
Il est vrai que l’équilibre du budget 2007 a été construit à partir d’une estimation du budget 2006 moins favorable que l’exécution constatée dans le projet de loi de règlement. Entre l’automne 2006 et l’hiver 2007, un peu plus de 5 milliards d'euros de plus-values supplémentaires de recettes ont été observées, ramenant le déficit 2006 de 40,5 à 35,5 milliards d'euros. L’application mécanique des hypothèses de croissance des ressources fiscales retenues dans la loi de finances initiale pour 2007, dont on a salué la prudence (croissance de 2 ¼ % conforme au potentiel de l’économie et élasticité « de ralentissement » limitée à 1,2), conduit à rehausser de 5,3 milliards d'euros les prévisions de ressources et à minorer d’autant le déficit prévisionnel.
Cependant, il serait dangereux de tabler dès aujourd’hui sur cette plus-value pour deux raisons. La première tient à la modération des recouvrements observés durant le premier semestre 2007, en particulier s’agissant de la TVA nette sur laquelle repose le dynamisme du produit des impôts depuis 2004. La seconde raison concerne spécifiquement l’impôt sur les sociétés net. Le net rebond des résultats fiscaux des sociétés en 2006 a dopé le rendement de l’acompte exceptionnel de décembre 2006 créé dans la loi de finances rectificative pour 2005 puis renforcé et étendu par la loi de finances rectificative 2006, qui anticipe le versement de l’IS dû au titre de l’année n lorsque la croissance des bénéfices dépasse un certain seuil (au lieu d’attendre que l’IS dû au titre des résultats de l’année n soit versé, comme auparavant, l’année n+1). Ainsi, les acomptes exceptionnels versés en 2006 ont rapporté 4,3 milliards d'euros à l’État. C’est autant de moins que les sociétés concernées devront verser en 2007. Si la loi de finances initiale avait pris en compte cette mesure nouvelle, c’était pour des montants significativement inférieurs. Et rien à ce jour ne permet de penser que la progression des bénéfices en 2007 permettra de retrouver un niveau d’acomptes comparable en décembre prochain. Dès lors, un ajustement du produit de l’IS net est possible, bien qu’il soit difficile d’en cerner l’ampleur si tôt dans l’année. La bonne tenue des recouvrements des acomptes de juin invite néanmoins à l’optimisme. En tout état de cause, le surplus de recettes doit, en application de l’article d’équilibre de la loi de finances pour 2007, être affecté à la diminution du déficit.
Maintenir le déficit de l’État dans la « zone de contrôle » a deux incidences.
Les dépenses doivent être exécutées « à l’euro près ». Cette exigence serait une vraie révolution budgétaire : pour la première fois depuis bien longtemps, elle signifierait qu’une année d’élection peut être autre chose qu’une année de laxisme budgétaire. C’est bien parce que l’année 2002 (comme en son temps, et de manière plus spectaculaire encore, l’année 1993) s’est soldée par une brutale inflation des dépenses publiques, liée en particulier à un budget initial « généreux » et mal calibré, que la XIIème législature a dû mettre son point d’honneur à ramener le déficit public sous les 3 % du PIB, conformément à nos engagements européens.
Du côté des recettes, le IV de l’article 52 de la loi de finances initiale pour 2007 dispose clairement que les surplus de recettes doivent être « utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire ». Il sera vu infra que le projet de loi pour le travail, l’emploi et le pouvoir d’achat a une légère incidence fiscale en 2007. Le Rapporteur général souhaiterait limiter cette incidence au minimum, et veiller à ce qu’elle soit strictement gagée par des plus-values équivalentes. Si tel ne devait être le cas, il deviendrait nécessaire, par exemple dans le collectif de fin d’année, de dégager des recettes compensant la dégradation du déficit au-delà de 42 milliards d’euros.
Au-delà de l’exécution 2007, un deuxième défi accompagne la mise en œuvre du choc fiscal dès lors que l’on veut le concilier avec l’assainissement des finances publiques : c’est le défi du désendettement. Le Président de la République a confirmé l’objectif du retour de la dette publique sous les 60 % du PIB à l’horizon 2012 au plus tard. Cela implique de penser nos choix budgétaires à l’échelle de toute la législature, et d’en dessiner dès aujourd’hui la trajectoire. C’est l’un des aspects décisifs du présent débat d’orientation budgétaire.
B.– UN AMBITIEUX PROJET FISCAL APTE À REMETTRE LA FRANCE SUR LES RAILS DE LA COMPÉTITIVITÉ
Notre taux de chômage est supérieur d’un tiers à la moyenne de nos partenaires européens, notre croissance est inférieure d’un tiers aux performances de nos voisins. Dans de telles conditions, on ne peut renoncer à consacrer toute notre énergie pour redonner une ambition économique à nos citoyens. La discipline budgétaire, indispensable, ne doit viser qu’une fin : libérer des marges de manœuvre pour nourrir une politique économique d’envergure, susceptible, comme l’a voulu le Président de la République, de « gagner le point de croissance qui nous manque ». C’est tout l’objet du projet de loi en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat déposé le 27 juin 2007 sur le bureau de l’Assemblée nationale. Ce projet est indissociable du débat d’orientation budgétaire pour 2008 du fait de son envergure économique et financière exceptionnelle.
Ce texte, dès le début de la législature, met en pratique la philosophie économique de la majorité en utilisant tous les leviers nécessaires à la relance cohérente de notre économie.
Le moteur de l’accélération de la croissance réside dans la valorisation du travail.
Le facteur décisif du progrès est, enfin, identifié : le travail, en ce qu’il est la source de toute richesse et un élément moteur de chaque identité.
Les instruments de sa promotion sont clairs : inciter à « travailler plus pour gagner plus » grâce à l’allégement des impôts et cotisations sur les heures supplémentaires qui fait sauter le verrou des 35 heures ; interdire que le fruit du travail soit injustement saisi par l’État au risque de décourager l’initiative, grâce au renforcement du bouclier fiscal qui exclut que plus de 50 % des revenus gagnés soient prélevés et à des allégements de droits de mutation ; faire que le travail paie toujours plus que l’inactivité, grâce au revenu de solidarité active ; encourager les plus dynamiques et les plus généreux à entreprendre toujours plus en permettant aux contribuables qui le souhaitent d’affecter une part substantielle de leur ISF au financement de PME ou d’organismes d’intérêt général.
Jamais depuis 2000 tant de moyens financiers n’ont été consacrés à un plan fiscal volontariste et cohérent. En régime de croisière, le « choc fiscal » devrait en effet alléger de près de 13 milliards d'euros, soit un point de PIB, les prélèvements sur les ménages et les entreprises. Son impact sur les finances publiques sera tout aussi massif et rapide :
– dès 2007, l’État devra compenser aux organismes de sécurité sociale le coût des allégements de cotisations sociales sur les heures supplémentaires liées à l’augmentation de la majoration de la rémunération des heures supplémentaires dans les entreprises de moins de 20 salariés pour la période allant du 1er octobre ou 31 décembre ; le ministère de l'Économie, des finances et de l'industrie évalue cet effort financier à 1,1 milliard d'euros auxquels s’ajouteront 0,4 milliard d'euros au titre des premiers allégements de droits de succession, soit une moins-value totale de 1,5 milliard d'euros ;
– l’essentiel du coût du choc fiscal sera assumé en 2008 : l’État devra y consacrer 8 milliards d'euros supplémentaires, avec en particulier les premières incidences de la création d'un crédit d'impôt sur le revenu en faveur des intérêts d'emprunts supportés à raison de l'acquisition ou de la construction de l'habitation principale (1,9 milliard d'euros), l’extension en année pleine de la compensation des baisses de cotisations sur les heures supplémentaires (3,4 milliards d'euros) et les premiers effets de leur exonération de l’impôt assis sur les revenus 2007 (0,4 milliard d'euros), ainsi que l’arrivée à plein régime des allégements de droits de mutation (1,5 milliard d'euros supplémentaires) ; de même, les régimes d’exonération d’ISF au titre des PME et des organismes d’intérêt général s’appliquant aux souscriptions réalisées à compter du 20 juin 2007, l’ISF dû en 2008 sera minoré d’un montant estimé à 170 millions d'euros ;
– le projet de loi TEPA exercera enfin un impact budgétaire complémentaire de 3,5 milliards d'euros après 2008 (dont 2,8 milliards d'euros dès 2009) lié en particulier à l’application en année pleine de l’exonération en matière d’impôt sur le revenu des heures supplémentaires (après que l’allégement d’impôt sur le revenu en 2008 aura porté sur les revenus de l’année 2007 dont auront été exonérés les seuls revenus d’heures supplémentaires postérieurs au 1er octobre 2007), qui mobilise 1,1 milliard d'euros ; dans le même esprit, l’extension du crédit d’impôt aux intérêts d’emprunt supportés sur toute une année (contre les six derniers mois de l’année 2007) devrait réduire le produit de l’impôt sur le revenu de 1,3 milliard d'euros supplémentaires, et les réductions d’ISF sur les souscriptions réalisées sur l’ensemble d’une année amputeront les ressources de l’État de 0,2 milliard d'euros.
Au terme de cette montée en charge, le coût des principaux dispositifs du projet de loi sera, en année pleine :
– de 6 milliards d'euros pour les allégements d’impôt et de cotisations sociales sur les heures supplémentaires ;
– de 3,7 milliards d'euros pour le crédit d’impôt en faveur des intérêts d’emprunts supportés au titre de la résidence principale ;
– de 2,2 milliards d'euros pour l’ensemble des allégements des droits de mutation ;
– de 0,6 milliard d'euros pour l’élargissement du bouclier fiscal ;
– de 0,4 milliard d'euros pour les réductions d’ISF.
L’INCIDENCE BUDGÉTAIRE DES MESURES PROPOSÉES
DANS LE PROJET DE LOI EN FAVEUR DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DU POUVOIR D’ACHAT
(en millions d'euros)
|
Incidence dans le budget 2007 |
Incidence dans le budget 2008 |
Incidence dans le budget 2009 |
Incidence postérieure à 2009 |
Cumul |
Exonération des salaires perçus par les jeunes de moins de 25 ans |
– 40 |
|
|
– 40 | |
Création d'un crédit d'impôt sur le revenu en faveur des intérêts d'emprunts supportés à raison de l'acquisition ou de la construction de l'habitation principale |
– 1 890 |
– 1 290 |
– 550 |
– 3 730 | |
Allégements des droits de mutation |
– 351 |
– 1 472 |
– 170 |
– 170 |
– 2 163 |
Allégement des droits de succession |
– 120 |
– 1 240 |
– 170 |
– 170 |
|
Allégement des droits de donation |
– 230 |
– 230 |
|
|
|
Exonération permanente des dons en numéraire effectués par des personnes de moins de 65 ans dans la limite de 20 000 euros |
– 1 |
– 2 |
|
|
|
Passage à 50 % et extension à CSG et la CRDS du bouclier fiscal |
|
– 625 |
|
35 |
– 590 |
Réductions d’ISF nettes |
– 170 |
– 240 |
– 410 | ||
Création d’une réduction en matière d’ISF pour les investissements dans le capital de PME |
|
– 190 |
– 190 |
|
|
Exclusion de la fraction du versement ayant donné lieu à la réduction d’ISF prévue à l’article 885-0 V bis |
|
30 |
|
|
|
Création d’une réduction d’impôt en matière d’ISF au titre des dons consentis à des fondations reconnues d’utilité publique, des établissements publics de recherche, des établissements publics d’enseignement supérieur et des organismes d’insertion par l’activité économique |
|
– 110 |
– 50 |
|
|
Incidence de la création de la réduction d’impôt en matière d’ISF sur la réduction d’impôt sur le revenu au titre des dons |
|
100 |
|
|
|
Allégements d’impôt et de cotisations sociales sur les heures supplémentaires |
– 1 115 |
– 3 765 |
– 1 100 |
– 5 980 | |
Exonération en matière d’impôt sur le revenu des heures supplémentaires, des heures complémentaires et des IHTS |
|
– 400 |
– 1 100 |
|
|
Compensation des allégements de cotisations salariales nets des effets de l’augmentation de la majoration de la rémunération des heures supplémentaires dans les entreprises de moins de 20 salariés |
– 1 115 |
– 3 365 |
|||
Total incidence budgétaire du projet de loi |
– 1 466 |
– 7 962 |
– 2 800 |
– 685 |
– 12 913 (a) |
(a) 13 563 millions d’euros pour le seul État mais 12 913 euros pour les administrations publiques dans leur ensemble grâce à la plus-value de 650 millions d’euros au profit des organismes de sécurité sociale liée à l’augmentation de 10 % à 25 % de la majoration salariale des quatre premières heures supplémentaires dans les entreprises de 20 salariés au moins concernées.
Source : ministère de l’Économie, des finances et de l’emploi.
II.– LE DÉSENDETTEMENT DEMEURE UN IMPÉRATIF QUI DOIT INSPIRER UNE STRATÉGIE D’ASSAINISSEMENT BUDGÉTAIRE INSCRITE DANS LA DURÉE
Pour être rétablies, nos finances publiques n’en sont pas moins encore fragiles. Deux principes, efficacement éprouvés pendant la XIIe législature, doivent être suivis : la maîtrise absolue de la dépense publique ; l’inscription des choix budgétaires dans la durée, qui impose un « chemin de désendettement » clairement balisé.
A.– TRANSFORMER L’ESSAI DE LA MAÎTRISE DE LA DÉPENSE : UN RELÂCHEMENT SERAIT MALVENU
1.– Amplifier la politique de maîtrise de la dépense
Les allègements de prélèvements obligatoires proposés par le nouveau Gouvernement ne sont compatibles avec la situation actuelle de nos finances publiques qu’à condition que soit parallèlement amplifiée la politique de maîtrise de la dépense publique.
En effet, l’assainissement de nos finances publiques ne peut ni ne doit être mis entre parenthèses.
Il ne peut pas l’être :
– du fait de nos responsabilités vis-à-vis de nos partenaires européens. La France s’est engagée à maintenir son déficit public inférieur à 3 % du PIB, à viser un objectif d’équilibre à moyen terme et à faire revenir son endettement public sous le taux de 60 % du PIB ;
– du fait de nos responsabilités vis-à-vis de nos concitoyens. Les deux premières réunions de la Conférence nationale des finances publiques, en janvier 2006 et janvier 2007, ont débouché sur le diagnostic partagé de la nécessité du désendettement. Le premier rapport du Conseil d’orientation des finances publiques, en février dernier, a insisté sur le choc démographique à venir et sur l’impact du vieillissement sur les dépenses publiques. La maîtrise de nos comptes publics est donc un impératif moral autant que financier.
Il ne doit pas l’être :
– repousser l’assainissement à plus tard alors que la situation économique actuelle est plutôt favorable expose à de sévères déconvenues en cas de retournement de conjoncture. La XIIe législature en a fait l’expérience lorsque, après le retournement de 2001-2002, elle a dû faire face aux conséquences de la politique insuffisamment rigoureuse menée par la majorité précédente ;
– plus l’ajustement budgétaire est reporté, plus l’intensité des efforts à fournir ultérieurement est grande. Il faut, en effet, alors compenser trois éléments à la fois : la dégradation initiale du déficit, mais aussi l’augmentation des charges d’intérêt directement engendrée par l’augmentation de la dette, ainsi que l’augmentation des charges d’intérêts découlant de la hausse des taux indirectement provoquée par l’augmentation de la dette. Schématiquement, on peut considérer qu’une dégradation du solde public de 1 point de PIB entraîne dès la première année une hausse des charges d’intérêt de 0,025 point de PIB (soit environ 450 millions d’euros) et, à titre indicatif, qu’une augmentation des taux d’intérêt de 1 point de base coûte 0,001 point de PIB (soit environ 18 millions d’euros). Plus l’ajustement est tardif, plus le « surcoût » de la dégradation initiale progresse rapidement ;
– s’accommoder d’une augmentation passagère de la dette publique au nom d’une politique de renforcement de la croissance comporte des risques. Un endettement excessif est un facteur de diminution de la croissance potentielle : la charge de la dette limite les marges de manœuvre budgétaire et restreint d’autant les possibilités de politiques de soutien de la croissance ; les émissions de titres de dette publique détournent une partie importante de l’épargne au détriment de l’investissement productif. C’est pour éviter ce double effet d’éviction qu’il convient de ne pas relâcher les efforts de désendettement.
Pour toutes ces raisons, les allègements fiscaux et sociaux consentis en ce début de législature doivent être adossés à une politique résolue de baisse des dépenses.
L’actuelle majorité peut s’appuyer sur les acquis de la précédente législature, pendant laquelle les dépenses du budget général de l’État ont, sans discontinuer, été stabilisées en volume. Chaque projet de loi de finances a été construit sur un rythme de progression épousant celui de l’inflation, chaque loi de finances a été exécutée en respectant le niveau de dépense arrêté par le Parlement.
LA MAÎTRISE DE LA DÉPENSE DE L’ÉTAT EN EXÉCUTION
(en milliards d’euros)
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 | |
Dépenses nettes du budget général (exécution) (a) |
273,5 |
273,8 |
283,7 |
288,6 |
266,1 |
Changements de périmètre (b) |
+ 1,7 |
– 2,4 |
+ 5,8 |
– 0,4 |
– 27,3 |
Progression des dépenses à périmètre constant en Mds€ |
+ 10,3 |
+ 2,7 |
+ 4,1 |
+ 5,3 |
+ 4,7 |
Évolution en valeur |
+ 3,9 % |
+ 1,0 % |
+ 1,5 % |
+ 1,9 % |
+ 1,6 % |
Inflation constatée (c) |
1,7 % |
1,9 % |
1,7 % |
1,8 % |
1,7 % |
Évolution en volume |
+ 2,2 % |
– 0,9 % |
– 0,2 % |
+ 0,1 % |
– 0,1 % |
(a) Dépenses du budget général hors remboursements et dégrèvements, hors recettes en atténuation de la charge de la dette et hors fonds de concours. Les dépenses 2006 sont présentées hors effet de la régularisation comptable, effectuée en LFR 2006, des pensions versées en décembre 2005 (3,3 milliards d’euros).
(b) Changements de périmètre identifiés dans la charte de budgétisation associée à chaque PLF (un signe « + » indique une budgétisation, un signe « – » une débudgétisation). Y sont ajoutés : en 2002 la prise en compte des dépenses supplémentaires votées en LFR 2002 pour apurer des « dettes » antérieures au 31 décembre 2001 (1,8 milliard d’euros) ; en 2003 la prise en compte des dépenses supplémentaires « récurrentes » votées en LFR 2002 (2,6 milliards d’euros) ; en 2006 le traitement en moindres recettes des compensations d’allégements de charges sociales (17,1 milliards d’euros).
(c) Indice des prix à la consommation hors tabac publié par l’INSEE.
Entre 2004 et 2006 (7), la progression annuelle des dépenses du budget général a ainsi été limitée à 4,7 milliards d’euros en moyenne : la performance est d’autant plus remarquable que les dépenses de personnel, particulièrement rigides, représentent à elles seules environ 60 % de cette augmentation.
2.– Conforter et élargir la norme de dépense
La nouvelle majorité doit préserver et conforter la crédibilité acquise par la norme de dépense sous la précédente législature, qui en a fait l’un des outils essentiels de pilotage de nos finances publiques.
● La préservation de la crédibilité de la norme de dépense passe, d’abord, par son strict respect cette année.
En 2007, les dépenses nettes du budget général ne devront donc pas excéder les 266,9 milliards d’euros votés par le Parlement en loi de finances. En ce sens, le fait que, à l’ouverture de la XIIIème législature, le nouveau Gouvernement n’ait pas souhaité proposer un « collectif budgétaire » – nécessairement porteur de dépenses supplémentaires – mérite d’être salué.
Le respect de la norme de dépense en 2007 constitue un enjeu particulièrement important, pour au moins deux raisons : il s’agit du premier budget fondé non plus sur la stabilisation des dépenses en volume mais sur leur réduction en volume (– 1 %, soit + 0,8 % en valeur) ; le rythme mensuel des dépenses en 2007 s’est accéléré par rapport à celui de l’année 2006, au cours de laquelle les débuts hésitants de l’application de la LOLF en gestion ont contribué à modérer la dépense.
Il convient donc, d’ici à la fin de cette année, d’être particulièrement vigilant à la maîtrise des dépenses en gestion, compte tenu :
– des risques qui existent « traditionnellement » sur certains postes budgétaires, tels que les opérations extérieures de la Défense ou certains dispositifs sociaux ;
– des insuffisances de crédits qui, à l’instar de l’année dernière, devraient apparaître sur la mission Travail et emploi (qui avait nécessité l’ouverture d’environ 700 millions d’euros de crédits supplémentaires en gestion 2006) et sur la mission Engagements financiers de l’État (qui doit supporter le paiement des primes d’épargne logement liées aux clôtures de « vieux » PEL dont le régime fiscal et social a été modifié en 2006).
● Dans un second temps, le renforcement de la crédibilité de la norme de dépense passe par l’élargissement de son périmètre. Le Rapporteur général réaffirme son souhait, formulé en mars dernier, que « soit définie une norme d’évolution de la dépense appliquée à une assiette plus large que les seules dépenses nettes du budget général » (8). Un élargissement présenterait en effet un double avantage.
D’une part, il limiterait les possibilités de contournement de la norme par d’autres « canaux » de dépense et, partant, permettrait de répondre aux critiques selon lesquelles la norme actuelle n’a qu’une « signification limitée » (9). Conscient de cette limite, le Rapporteur général présente d’ailleurs chaque année dans son rapport sur le projet de loi de finances différents agrégats de dépenses, complémentaires à celui jusqu’alors retenu par le Gouvernement.
D’autre part, l’élargissement du périmètre de la norme accroîtrait les facultés d’arbitrage et de redéploiement en son sein. Par exemple, pour permettre d’honorer un engagement budgétaire important ou pour faire face à une dépense inéluctable substantielle, les crédits nets du budget général pourraient, une année donnée, évoluer plus vite que l’inflation à condition de diminuer à due concurrence les autres dépenses incluses dans l’assiette retenue. À niveau de dépense publique constant, les facultés de choix du Gouvernement et du Parlement s’en trouvent donc accrues.
Toutefois, le périmètre d’une norme de dépense « élargie » doit être délimité en prenant garde au risque de « dilution » de la norme, à laquelle conduirait une conception par trop extensive. Contrairement à ce qu’induisent certaines critiques sur son caractère trop restreint, la norme de dépense n’a pas vocation à embrasser la totalité des différents canaux de dépense afin de fournir la « photographie » la plus fidèle possible des charges de l’État à un moment donné. Cette finalité – au demeurant parfaitement légitime – peut être poursuivie par la constitution d’autres agrégats de dépenses (10).
Mais à cette vision descriptive et statique, sensible aux fluctuations et aux phénomènes transitoires qui ne reflètent pas la tendance à moyen terme du budget, il convient d’opposer une vision prescriptive et dynamique de la norme de dépense : « prescriptive » en ce que la norme ne peut porter que sur des éléments sur lesquels les pouvoirs publics (et, plus précisément, le Gouvernement) ont une réelle faculté de décision ; « dynamique » en ce que l’intérêt de la norme est de permettre de définir une trajectoire d’évolution à moyen terme.
Quoique élargie, la norme de dépense doit donc demeurer un outil de pilotage des finances publiques : les dépenses appelées à figurer dans la norme doivent autant que possible être réellement « sous contrôle », tant en prévision lors de l’élaboration de la loi de finances de l’année qu’en exécution lorsqu’il s’agit de se conformer à l’enveloppe votée par le Parlement.
C’est pourquoi, il ne paraîtrait pas pertinent d’inclure dans la norme élargie le prélèvement sur recettes au profit du budget de l’Union européenne. Même s’il constitue une indéniable charge pour le budget de l’État, il peut être considéré comme une donnée exogène : il n’est pas justifié d’en faire peser le poids sur les choix discrétionnaires du législateur financier national. Il en va sans doute de même des dépenses des comptes d’affectation spéciale, qui peuvent fluctuer fortement d’une année sur l’autre sans nécessairement refléter une tendance de fond, la dépense étant in fine « pilotée » par la recette affectée (11). C’est le cas également des dépenses fiscales : si certaines s’apparentent à de véritables dépenses budgétaires « déguisées », si leur meilleur encadrement est absolument nécessaire (12), elles peuvent difficilement trouver leur place dans une norme de dépense élargie compte tenu des difficultés à les évaluer en prévision et à les maîtriser en exécution.
● En revanche, les prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales devraient certainement entrer dans le périmètre d’une norme de dépense élargie. Le tableau ci-dessous rend compte de leur dynamisme ces dernières années.
ÉVOLUTION DES PRÉLÈVEMENTS SUR RECETTES
AU PROFIT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
(en milliards d’euros)
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 | |
PSR au profit des collectivités locales (exécution) |
34,8 |
36,6 |
45,7 |
46,4 |
48,2 |
– |
p.m.: prévision LFI |
34,7 |
36,4 |
45,2 |
45,7 |
47,4 |
49,4 |
Changements de périmètre (a) |
– |
– 0,8 |
+ 8,2 |
– 0,9 |
n.s. |
n.s. |
Progression à périmètre constant en Mds€ |
+ 3,1 |
+ 2,6 |
+ 0,9 |
+ 1,6 |
+ 1,8 |
– |
Évolution en valeur |
+ 9,8 % |
+ 7,3 % |
+ 2,4 % |
+ 3,5 % |
+ 3,9 % |
– |
Évolution en volume |
+ 8,2 % |
+ 5,4 % |
+ 0,7 % |
+ 1,7 % |
+ 2,2 % |
– |
(a) Changements de périmètre identifiés dans chaque PLF (un signe « + » indique un élargissement du PSR, un signe « – » une réduction de son champ). Les principaux changements sont : en 2003 la normalisation des conditions d’imposition locale de France Télécom ; en 2004 la réforme des dotations aux collectivités territoriales ; en 2005 la diminution de la DGF des départements en contrepartie d’un transfert de taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA).
La constatation d’une évolution en volume bien supérieure à celle des dépenses du budget général n’est pas surprenante : le contrat de croissance et de solidarité liant l’État aux collectivités territoriales repose précisément sur une revalorisation des dotations supérieure à la seule inflation (l’enveloppe « normée » est indexée sur la somme de l’indice des prix et du tiers de la progression du PIB). On retrouve donc ici un autre enjeu de gestion des finances publiques : rendre compatible le rythme d’évolution des dotations de l’État aux collectivités territoriales avec celui de ses propres dépenses – ou diminuer ces dernières de façon plus drastique.
● Il pourrait en outre être envisagé d’intégrer à une norme de dépense élargie les remboursements et dégrèvements d’impôts locaux. Ceux-ci ont atteint 12,7 milliards d’euros en 2006 et 14,1 milliards d’euros en loi de finances pour 2007 (admissions en non valeur comprises).
REMBOURSEMENTS ET DÉGRÈVEMENTS D’IMPÔTS LOCAUX
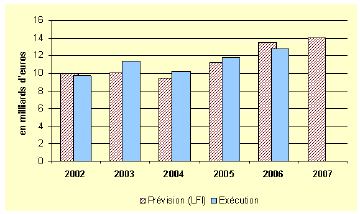
Alors que les remboursements et dégrèvements d’impôts d’État peuvent s’analyser – en général – comme des conséquences directes des mécanismes fiscaux (par exemple les remboursements de TVA), les remboursements et dégrèvements d’impôts locaux apparaissent plutôt comme des subventions implicites aux collectivités territoriales, l’État se substituant au contribuable local pour la prise en charge effective de l’impôt. Ces dernières années, ces dégrèvements ont certes évolué de façon erratique : à la baisse en 2002 et 2004 ; à la hausse en 2003, 2005 et 2006 (voir le graphique ci-dessus). Toutefois, en moyenne sur la XIIe législature, ils ont augmenté d’environ 500 millions d’euros chaque année, sous l’effet notamment des dégrèvements de taxe professionnelle.
À titre d’illustration, le tableau ci-dessous présente l’évolution à périmètre constant de l’assiette élargie ici suggérée : dépenses nettes du budget général, prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et remboursements et dégrèvements d’impôts locaux.
MESURE DE LA PROGRESSION DES DÉPENSES DE L’ÉTAT
AU TRAVERS D’UNE ASSIETTE ÉLARGIE
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 | |
1. En prévision | ||||||
Progression en Mds€ |
– |
+ 7,2 |
+ 4,0 |
+ 8,5 |
+ 8,8 |
+ 4,9 |
Progression en volume |
– |
+ 0,8 % |
– 0,3 % |
+ 0,7 % |
+ 0,7 % |
– 0,3 % |
2. En exécution | ||||||
Progression en Mds€ |
+ 13,0 |
+ 7,0 |
+ 3,7 |
+ 8,5 |
+ 7,6 |
– |
Progression en volume |
+ 2,6 % |
+ 0,3 % |
– 0,6 % |
+ 0,7 % |
+ 0,5 % |
– |
En prévision, l’élargissement du périmètre des dépenses considérées montre une augmentation annuelle de 6,6 milliards d’euros en moyenne, soit environ 2,5 milliards d’euros de plus chaque année que ce qu’autorise l’actuelle norme de dépense (voir également le graphique ci-dessous). Cet accroissement supplémentaire correspond pour environ 2 milliards d’euros au prélèvement sur recettes et pour environ 0,5 milliard d’euros aux remboursements et dégrèvements d’impôts locaux.
PROGRESSION ANNUELLE DE CERTAINES CATÉGORIES DE DÉPENSES
EN LOI DE FINANCES INITIALE
(en milliards d’euros)
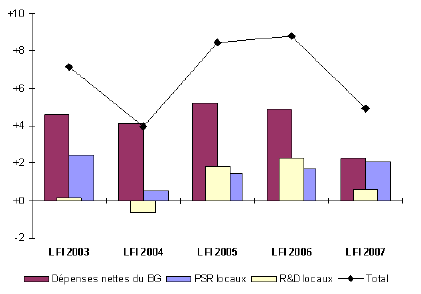
En exécution, l’assiette élargie a davantage progressé que les seules dépenses nettes du budget général : le décalage le plus significatif concerne l’exercice 2003, où le prélèvement sur recettes au profit des collectivités locales a augmenté de plus de 2,5 milliards d’euros, sous l’effet notamment de l’application de la dernière tranche de la suppression de la part salariale de la taxe professionnelle. L’année 2004 fait cependant exception : les dépenses « élargies » reculent de 0,6 % en volume, soit plus fortement que l’actuelle norme de dépense
(– 0,2 %), du fait du recul par rapport à 2003 des dégrèvements locaux de 1,3 milliard d’euros.
La prise en compte de ces derniers dans l’analyse de l’exécution peut donc être source d’une contrainte particulière, s’agissant de crédits qui ne sont qu’évaluatifs et dont la consommation peut sensiblement s’écarter des évaluations initiales en fonction des comportements des agents économiques : un dépassement de la prévision relative aux dégrèvements obligerait à réduire d’autant les autres dépenses afin de respecter le rythme de progression globale. Leur inclusion dans la norme de dépense mérite donc réflexion, d’autant qu’à la différence des prélèvements sur recettes ils n’impactent pas les dépenses de l’État en comptabilité nationale.
Pour l’avenir, reste également à déterminer quel pourrait être le rythme d’évolution à fixer à cette enveloppe élargie de dépenses. Sur le modèle de la stratégie retenue sous la XIIe législature, il paraîtrait raisonnable de décider, dans un premier temps, d’une stabilisation en volume.
À titre d’illustration, si cette norme « 0 volume » avait été appliquée depuis la loi de finances pour 2003 à un tel périmètre élargi (13), les dépenses n’auraient dû augmenter en moyenne que de 5,5 milliards d’euros par an, alors qu’elles ont en réalité progressé de 6,6 milliards d’euros chaque année en moyenne. En cumul sur 5 ans, la stabilisation en volume aurait limité l’augmentation totale à 27,7 milliards d’euros au lieu de 33,2 milliards d’euros. En conséquence, si cette norme avait été appliquée dès 2003, ce sont 5,5 milliards d’euros d’économies supplémentaires qui auraient dû être réalisées. Toutes choses égales par ailleurs, le déficit en serait réduit d’autant.
Plus précisément, le graphique ci-dessous confronte l’accroissement effectif en loi de finances initiale de l’assiette élargie à l’accroissement maximum qu’aurait autorisé une stabilisation en volume. Il permet de constater que les lois de finances pour 2004 et pour 2007 ont d’ores et déjà respecté cette norme : en 2004 du fait de la diminution des remboursements et dégrèvements locaux ; en 2007 du fait de la réduction des dépenses nettes du budget général de 1 % en volume. À l’inverse, les barres foncées représentent l’effort supplémentaire qu’il aurait fallu fournir, dans l’élaboration des projets de loi de finances pour 2003, 2005 et 2006, si la norme élargie avait été appliquée.
COMPARAISON DE LA STABILISATION EN VOLUME ET DE L’ÉVOLUTION RÉELLE
DE L’ENVELOPPE ÉLARGIE DE DÉPENSES
(en milliards d’euros)
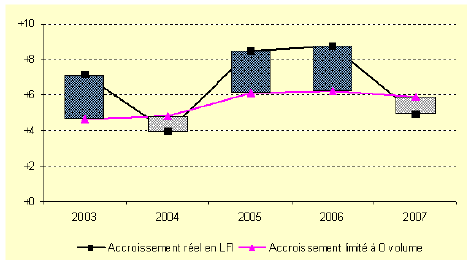
Assiette considérée (à périmètre constant, données LFI) : dépenses nettes du budget général, prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et remboursements et dégrèvements d’impôts locaux.
Pour l’avenir, si l’on appliquait la norme d’évolution « 0 volume » au périmètre élargi ici suggéré, l’augmentation des dépenses en loi de finances pour 2008 devrait être d’un peu moins de 6 milliards d’euros avec une hypothèse d’inflation de 1,8 % ou de 5,3 milliards d’euros avec une inflation de 1,6 % (14).
Pour important qu’il soit, l’effort ne serait pas insurmontable :
– il serait inférieur à celui effectué en loi de finances pour 2007 (au terme de laquelle l’assiette élargie devrait être réduite de 0,3 % en volume) ;
– il donnerait davantage de marges de manœuvre sur le budget général, pour lequel l’engagement pris dans le Pacte de stabilité 2008-2010 de procéder à une réduction de 1,25 % en volume paraît très difficile à tenir (son augmentation ne pourrait guère excéder 1,5 milliard d’euros) (15).
● Si, pour les raisons évoquées plus haut, l’on décidait d’exclure les remboursements et dégrèvements d’impôts locaux de la norme de dépense élargie et que l’on s’en tenait à un élargissement aux seuls prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales, l’application rétrospective de la norme « 0 volume » sur la période 2003-2006 aurait conduit à économiser environ 3,7 milliards d’euros supplémentaires en quatre ans. En 2007, la loi de finances est d’ores et déjà allée au-delà de l’objectif, du fait de l’effort particulier effectué sur les dépenses du budget général (réduction en volume de 1 %). Une stabilisation en volume des prélèvements sur recettes en faveur des collectivités territoriales pour 2007 aurait supposé de limiter leur accroissement à 0,9 milliard d’euros, soit une économie de 1,2 milliard d’euros.
En retenant cette même assiette pour élaborer le prochain projet de loi de finances, l’augmentation des dépenses serait limitée à 5,7 milliards d’euros en 2008, sous une hypothèse d’inflation de 1,8 % (16) : 4,8 milliards d’euros pour le budget général et 0,9 milliard d’euros pour les prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales.
● Toutefois, pour que cette nouvelle norme ne soit pas contournée et pour qu’elle demeure suffisamment ambitieuse, il conviendrait de s’efforcer de mieux contrôler les affectations de recettes à des personnes morales distinctes de l’État (sécurité sociale, opérateurs de l’État etc.). Un tel périmètre correspondrait d’ailleurs aux suggestions du Rapporteur général dans son rapport de février 2007 rédigé au nom du Conseil d’orientation des finances publiques (17).
Une partie de ces affectations est d’ores et déjà prise en compte lors de l’examen, chaque année, des changements de périmètre affectant le budget général : par exemple, pour mesurer l’évolution des dépenses entre 2005 et 2006, la loi de finances pour 2005 a été « diminuée » des 17,1 milliards d’euros de crédits destinés à compenser les allégements de cotisations sociales, cette compensation s’effectuant à partir de 2006 par affectation de recettes à la sécurité sociale. Mais les dépenses ainsi transformées en « moindres recettes » échappent ensuite à la mise sous tension de la norme de dépense.
En outre, les changements de périmètre n’incluent que les dépenses déjà clairement assurées par l’État, non les dépenses « nouvelles » : les affectations de recettes n’ayant pas pour corollaire une réduction à due concurrence de crédits budgétaires préexistants échappent à l’application de la norme de dépense. Par exemple, les différentes affectations réalisées en 2007 au profit de l’Agence nationale de la recherche (825 millions d’euros), d’OSEO (130 millions d’euros) ou du Centre national de développement du sport (20 millions d’euros) n’ont pas été considérées comme des changements de périmètre et n’ont donc pas été comptabilisées par le Gouvernement dans la mesure de la progression des dépenses. Elles atteignaient pourtant 1,2 milliard d’euros au total, après 2,2 milliards d’euros en 2006 (hors allègements de cotisations sociales compensés à la sécurité sociale).
Le Rapporteur général, dans son analyse des marges de manœuvre budgétaires présentée chaque année à l’occasion de l’examen du projet de loi de finances, prend d’ores et déjà en compte ces dépenses « débudgétisées » d’une année sur l’autre et correspondant à des charges assumées (plutôt qu’assurées) par l’État. À l’automne dernier, ces dépenses effectuées par d’autres organismes publics pouvaient être évaluées à environ 1,4 milliard d’euros chaque année en moyenne entre 2003 et 2007 (18). L’enjeu est donc loin d’être négligeable. Il le sera vraisemblablement d’autant moins à l’avenir que se multiplieront les délégations à des opérateurs de l’État ou que se développeront davantage les relations entre l’État et la sécurité sociale.
C’est pourquoi, lorsqu’elles s’apparentent à de véritables dépenses budgétaires, y compris lorsque ces dépenses n’étaient jusqu’alors pas supportées par le budget général, les recettes affectées devraient être considérées comme impactant la norme de progression l’année où cette affectation est décidée en loi de finances. Les années suivantes, on voit mal l’intérêt qu’il y aurait à intégrer l’évolution de la ressource affectée dans le périmètre de la norme, sauf à ne plus pouvoir maîtriser cette dernière. Il appartient en revanche au Parlement – exerçant sa fonction de contrôle – de s’assurer du bon usage des fonds ainsi affectés.
3.– Restaurer les marges de manœuvre en dépenses
Ces dernières années, les choix budgétaires de l’État ont essentiellement pris la forme de mesures jouant sur le volet « recettes » – au risque d’ailleurs de multiplier des dépenses fiscales s’apparentant à des subventions budgétaires déguisées. Cette situation tient à la rigidité croissante des dépenses de l’État, qui limite d’autant les marges de manœuvre du pouvoir politique, ainsi qu’en atteste le graphique ci-dessous.
LA RIGIDITÉ DES DÉPENSES DE L’ÉTAT
(en pourcentage des dépenses nettes du budget général)
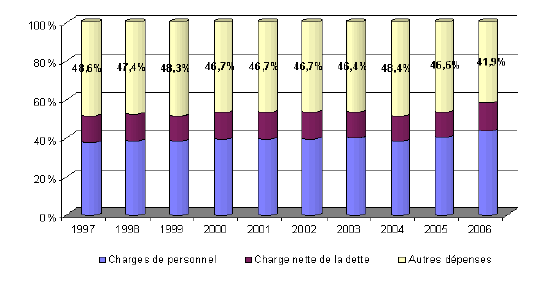
Sur les dix années considérées (1997-2006), la charge de la dette absorbe en moyenne environ 13,5 % des dépenses de l’État et constitue aujourd’hui son deuxième poste budgétaire, derrière l’enseignement scolaire. Les dépenses de personnel (pensions comprises) représentent en moyenne 40 % du budget général. Compte tenu de ces dépenses quasi « obligatoires » ou difficiles à réduire à court terme, les facultés de choix du pouvoir politique – matérialisées ici par les « autres dépenses » – sont réduites à moins de la moitié du budget général. Du fait des divers changements de périmètre intervenus l’année dernière (impact de la LOLF sur la définition de la masse salariale ; débudgétisation des compensations d’allégements généraux de cotisations sociales), elles ne représentent plus que 41,9 % des dépenses en 2006.
● Cette rigidité pèse sur les choix budgétaires pour 2008, qui apparaissent d’autant plus contraints que la charge de la dette devrait augmenter de façon non négligeable l’année prochaine.
On sait que l’État bénéficie depuis plusieurs années d’une situation relativement favorable : le faible niveau des taux d’intérêt a permis de « compenser » la hausse de l’encours de la dette, cette hausse ne se répercutant que faiblement sur la charge annuelle due par l’État. Le graphique ci-dessous permet par exemple de constater que les variations de la charge de la dette ces quatre dernières années sont inférieures à celles de la fin des années 1990 et sans commune mesure avec celles du début des années 1990.
ÉVOLUTION DE L’ENCOURS ET DE LA CHARGE DE LA DETTE DE L’ÉTAT
(avant swaps, en millions d’euros)
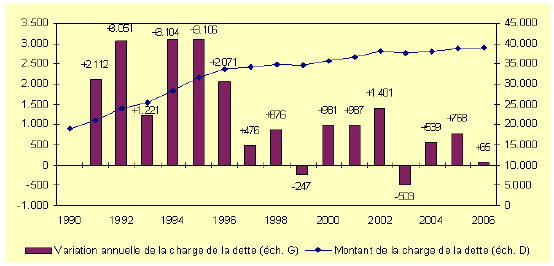
Or, cet « effet taux » – qui contrebalance l’« effet volume » – prend progressivement fin. En 2006, la hausse des taux d’intérêt a essentiellement concerné les taux à court terme, directement influencés par une politique monétaire de la Banque centrale européenne moins accommodante. Cette année, les taux à long terme connaissent eux aussi une nette augmentation : le taux de l’OAT à 10 ans s’est établi à 4,1 % au premier trimestre 2007 (au lieu de 3,8 % au premier trimestre 2006) et a fortement progressé depuis, pour atteindre environ 4,6 % à la mi-juin.
Même si cette remontée n’est pas nécessairement appelée à se poursuivre dans les prochains mois (19), on peut considérer, en se fondant sur le dernier Programme de stabilité (relatif à la période 2008-2010), que la charge de la dette augmentera d’environ 1,7 % en volume en moyenne sur les trois prochaines années. En 2008, cela représenterait environ 1,4 milliard d’euros de plus que la prévision initiale pour 2007, soit un niveau de progression qui n’a plus été connu depuis 2002. À titre de comparaison, les crédits n’avaient progressé que de 0,2 milliard d’euros entre la loi de finances pour 2006 et la loi de finances pour 2007.
● Les dépenses de personnel, qui rassemblent aujourd’hui 44,4 % des dépenses nettes du budget général, constituent un autre poste de dépense dynamique. À elles seules, les dépenses de pensions pourraient augmenter d’au moins 1,5 milliard d’euros entre 2007 et 2008.
On mesure bien, dans ces conditions, l’intérêt qu’il y a à profiter des importants départs à la retraite de fonctionnaires ces prochaines années pour revoir et adapter le format de notre fonction publique. Saisir cette occasion dès 2008 paraît d’autant plus nécessaire que c’est l’année qui, pour la fonction publique d’État, constitue le « pic » des départs à la retraite (plus de 80 000 départs). Comme l’indique le graphique ci-dessous, les années suivantes méritent également d’être mises à profit, plus de 70 000 départs étant prévus chaque année jusqu’à 2011.
PRÉVISIONS DE DÉPARTS À LA RETRAITE DANS LA FONCTION PUBLIQUE D’ÉTAT
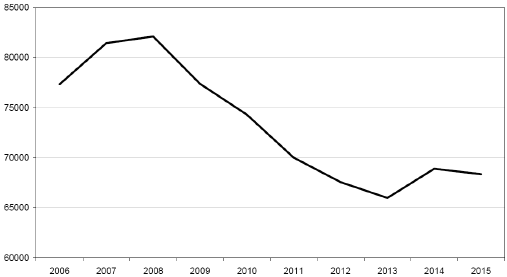
Source : Gilles Carrez, Rapport au nom du Conseil d’orientation des finances publiques (février 2007).
Le nouveau Gouvernement propose d’aller plus loin en ne remplaçant qu’un fonctionnaire partant à la retraite sur deux. Il s’agit d’un objectif global à atteindre, non d’un couperet à respecter uniformément : les décisions ne sauraient donc être prises in abstracto mais en fonction des besoins identifiés sur chaque programme, notamment grâce à la justification au premier euro présenté dans les annexes budgétaires (20).
La réduction des effectifs apparaît comme un moyen efficace et pérenne de réaliser des économies et de restaurer les marges de manœuvre de l’État. Comme le montre le graphique ci-dessous, les économies réalisées la première année du non remplacement d’un agent sur deux sont de l’ordre de 1 milliard d’euros. Si l’effort est poursuivi chaque année, les économies cumulées – c’est-à-dire les réductions de crédits à ouvrir en loi de finances – excèdent 10 milliards d’euros au bout de 10 ans (soit au total plus de 350 000 départs non remplacés). En réalité, les dépenses évitées sont encore plus substantielles, ces simulations ne prenant en compte ni l’augmentation du point fonction publique, ni l’impact des mesures catégorielles.
ÉCONOMIES GÉNÉRÉES PAR LE NON-REMPLACEMENT
D'UN DÉPART À LA RETRAITE SUR DEUX
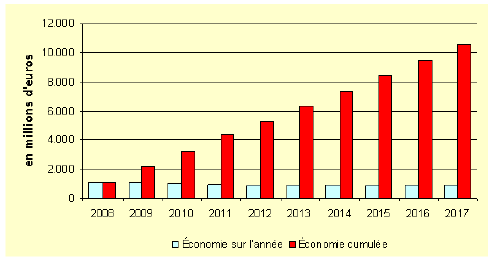
Cette évolution de la fonction publique d’État doit être conçue comme un moyen de renforcer la qualité du service public : en favorisant les réformes et les adaptations, elle est l’occasion de rénover les métiers, d’améliorer les gestions de carrière et d’accroître l’intérêt des fonctions exercées. Le Président de la République s’est d’ailleurs engagé à ce que la moitié des gains de productivité soit « recyclée » auprès des agents en place, afin de récompenser les efforts et d’inciter à la réforme.
Plus généralement, la réflexion sur les effectifs gagnerait à faire l’objet d’une approche pluriannuelle, fondée sur la définition de grandes orientations de moyen terme de la politique salariale et de recrutement de l’État. Ce cadrage global pourrait ensuite être décliné par mission (pour les crédits) et par ministère (pour les effectifs), afin de responsabiliser les gestionnaires sur leur masse salariale.
● Les efforts sur les dépenses ne sauraient cependant être limités aux seuls crédits de personnel. C’est, plus largement, l’ensemble de l’appareil productif de l’État qui doit être « mis sous tension ».
Les dépenses de fonctionnement de l’État représentent 33 milliards d’euros sur le budget général en 2007, dont 17 milliards d’euros hors subventions pour charges de service public. Or, comme le relève la Cour des comptes, « dans le champ social et pour l’État, malgré le foisonnement des statistiques et des indicateurs, la mesure de la productivité reste très fruste. Dans le cadre de la LOLF, environ 10 % des indicateurs seulement portent sur la productivité » (21).
Des gains de productivité doivent donc être plus systématiquement recherchés. À cette fin, les indicateurs d’efficience – renseignant directement sur le coût de la gestion pour le contribuable – doivent être multipliés, en particulier dans les programmes « soutien ». Ceux-ci peuvent par exemple renseigner sur la mutualisation des moyens, la professionnalisation de la politique d’achats, le développement des contrats d’externalisation, la rationalisation des dispositifs territoriaux, l’optimisation des dépenses immobilières, logistiques ou informatiques. Le Gouvernement a d’ailleurs prévu d’organiser un début de convergence des indicateurs d’efficience des fonctions support, sous forme notamment d’indicateurs relatifs à l’immobilier ou de « ratios d’efficience bureautique », permettant de mesurer et de comparer certains coûts annuels moyens supportés par les programmes (22).
● Toutefois, il y aurait quelques naïvetés à penser que la diminution des dépenses publiques pourrait s’appuyer sur la seule réduction du « train de vie de l’État ». Il convient donc de réfléchir également à l’évolution des missions de l’État régulateur économique et social.
Les dépenses d’intervention sont ainsi un secteur dans lequel il est possible d’améliorer l’efficacité de l’action publique tout en réduisant les coûts.
En loi de finances pour 2007, ces dépenses représentent (23) :
– près du quart des dépenses nettes du budget général, soit 61,7 milliards d’euros ;
– plus de 40 % des dépenses brutes du budget général (y compris remboursements et dégrèvements), soit 138,2 milliards d’euros.
RÉPARTITION DES DÉPENSES D’INTERVENTION PAR MISSION EN LFI 2007
(en pourcentage des crédits bruts du budget général)
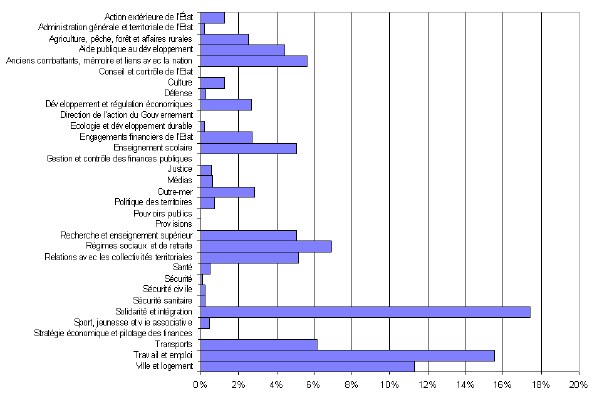
N.B. : pour des raisons de lisibilité du graphique, la mission Remboursements et dégrèvements, qui représente 55,3 % des crédits, n’est pas représentée.
Sur ce sujet, la Cour des comptes note que : « l’insuffisante lisibilité et l’efficacité douteuse de certaines interventions est d’autant plus problématique qu’une fois créés les dispositifs sont rarement supprimés, ce qui introduit de facto un fort degré de rigidité dans les dépenses de l’État. Les prestations fonctionnant selon une logique de "droits ouverts" (aides au logement, minima sociaux, etc.) font souvent l’objet, année après année, d’une reconduction tacite et de revalorisations ou révisions de barèmes qui sont autant de "coups partis" majeurs pour les finances publiques. Lorsqu’ils ne produisent pas les effets escomptés, les dispositifs ne sont pas supprimés mais souvent complétés par des mesures jugées plus efficaces sur le moment mais qui viennent à leur tour se superposer aux autres, de façon à la fois coûteuse et peu lisible, le plus souvent sans amélioration notable des résultats » (24).
C’est pourquoi le Rapporteur général considère que les dépenses d’intervention devraient être :
– mieux gérées : il est nécessaire de clarifier et de mieux délimiter les compétences des différents acteurs que sont l’État, les collectivités territoriales, les organismes de sécurité sociale et les opérateurs dans toute une série de domaines (politique familiale, politique de l’emploi et de l’insertion, politique du logement etc.). À titre d’exemple, la gestion de l’allocation de solidarité spécifique (ASS), qui représente plus de 2 milliards d’euros à la charge de l’État, fait intervenir une multitude d’intervenants. En juin 2006, un rapport d’audit a lancé plusieurs pistes d’amélioration, qui mériteraient désormais d’être mises en œuvre (25) ;
– mieux ciblées : en matière de culture, de tourisme, de « zonage » de la politique de la ville ou encore de formation professionnelle, la concentration des moyens sur des priorités précises est préférable au saupoudrage et à la dispersion ;
– mieux hiérarchisées : l’État ne pouvant « tout faire », au risque de l’empilement des dispositifs et de l’éparpillement des moyens, il lui faut arbitrer entre ses différentes missions de régulateur économique et social. Il s’agit donc d’effectuer de vrais choix, d’évaluer a priori tout nouveau dispositif, puis de s’assurer de la cohérence entre les objectifs et les moyens, afin d’assurer une « authentique révélations des préférences » de l’État (26).
● Sur tous les éléments qui précèdent, le Gouvernement et le Parlement peuvent s’appuyer sur les audits de modernisation mis en place depuis l’année dernière. Une 7e « vague » d’audits a été lancée en avril dernier : 17 nouveaux audits ont été annoncés, dont deux à vocation transversale portant respectivement sur les conséquences de la dématérialisation des procédures administratives sur les services de l’État et sur la gestion de la trésorerie et des placements des établissements publics.
Au-delà de la communication sur le « périmètre » des dépenses examinées par les audits (près de 150 milliards d’euros) et sur les gains de productivité « potentiels » identifiés à un certain horizon temporel (de 6 à 8 milliards d’euros sur 3 ans selon le Gouvernement), il importe désormais de passer résolument à la phase de mise en œuvre.
Celle-ci n’est, pour le moment, que timidement commencée et il est bien difficile de mesurer les économies qui ont d’ores et déjà pu être réalisées. Sur 131 audits au total, 38 sont en cours de réalisation et 93 sont terminés. Parmi ces derniers, 63 sont « en cours de mise en œuvre », 28 rapports sont terminés mais « en attente d’orientation » et seulement 2 audits (sur la déclaration de revenus sur Internet et sur la gestion des moyens de fonctionnement des services déconcentrés des ministères sociaux) ont été complètement mis en œuvre.
Il serait souhaitable qu’à l’automne prochain le Gouvernement fasse le point sur les suites données aux audits, en indiquant et en chiffrant clairement les mesures intégrées dans le projet de loi de finances pour 2008.
Dès à présent, le Rapporteur général se félicite du lancement d’une revue générale des politiques publiques. À l’instar de plusieurs pays qui sont parvenus à réduire sensiblement leurs dépenses publiques, il s’agit de s’interroger méthodiquement sur l’efficacité et la légitimité de l’ensemble des politiques publiques. L’objet de cette révision générale est donc plus large que celui des audits de modernisation, concentrés sur des sujets ciblés et orientés vers la recherche de gains de productivité.
De surcroît, l’impulsion est donnée au plus haut niveau de l’État : le Président de la République présidera lui-même le nouveau « Conseil de la modernisation des politiques publiques ». Le suivi du processus sera assuré par un comité présidé conjointement par le Secrétaire général de l’Élysée et le Directeur de cabinet du Premier ministre. Les ministres viendront y rapporter eux-mêmes. D’ores et déjà, le Premier ministre a lancé quatre chantiers, transversaux et prioritaires, relatifs à l’organisation de l’État au plan local, à l’allègement des contraintes juridiques et des contrôles, aux relations entre l’État et les collectivités territoriales et à l’amélioration de la gestion des ressources humaines. Les premiers résultats de la révision générale des politiques publiques sont attendus pour la fin du mois de mars 2008, de façon à pouvoir être pris en compte dès la construction du projet de loi de finances pour 2009.
B.– PENSER LE DÉSENDETTEMENT À MOYEN TERME ET TRACER UN CHEMIN VERS L’ÉQUILIBRE
Le Rapporteur général a identifié dans le I du présent rapport les contraintes et les espoirs qui dessinent le contexte de notre stratégie budgétaire. Ils ont permis d’en dresser le premier pilier : la maîtrise exigeante, ambitieuse et sans relâche de la dépense de l’État. Ils imposent cependant d’aller plus loin, en traçant un chemin crédible vers le désendettement.
Il a été démontré supra que les marges de manœuvre budgétaires « durables » ne dépassent pas 10 à 12 milliards d’euros par an. Tout surplus de recettes d’une année sur l’autre supérieur à ce montant risque fort de disparaître l’année suivante en étant compensé par une moins-value d’ampleur équivalente au creux de la conjoncture, comme l’a illustré l’expérience du cycle économique 1998-2003. Ne pas dégrader structurellement les finances de l’État entre 2007 et 2012 impose donc, au minimum, de ne pas dépenser sur l’horizon de la législature, plus de 50 milliards d’euros. Mais franchir une étape de plus dans l’assainissement exige bien plus encore.
1.– À l’horizon 2008, le maintien sous contrôle du déficit
Les implications de la règle de répartition vertueuse des marges de manœuvre budgétaires tendent à contraindre très fortement le budget pour 2008.
L’UTILISATION DES MARGES DE MANœUVRE BUDGÉTAIRES : ÉVOLUTION DU DÉFICIT DE L’ÉTAT EN 2008 SELON DEUX SCENARII DE CROISSANCE
(en milliards d’euros)
(I) Surplus induit par une croissance de 3 % (a) |
(I) Surplus induit par une croissance de 2 ¼ % (a) |
(II) Montants distribués en 2008 avant LFI (A) + (B) + 15,3 (A) Baisses d’impôt + 9,6 | |
Évolution apparente du déficit |
Évolution structurelle du déficit |
(a) Des hypothèses d’élasticité des recettes fiscales nettes au PIB sont corrélées aux scenarii de croissance selon les tendances observées dans le passé. Ainsi, les produits des impôts tendent à très fortement surréagir aux croissances élevées : l’hypothèse de croissance de 3 % est par conséquent ici associée à une élasticité de 2 (comme en 1999-2000). En revanche, à long terme, les recettes fiscales doivent évoluer au rythme de la richesse nationale : notre scénario de croissance potentielle est ainsi fondé sur une élasticité unitaire.
Le tableau ci-dessus met en évidence l’impact des mesures adoptées ou proposées à ce jour sur l’équilibre du budget pour 2008 selon deux scenarii de croissance, l’un tablant sur une nette reprise économique permettant d’atteindre rapidement le haut du cycle (3 % de croissance), l’autre s’appuyant sur une croissance conforme à son potentiel, évaluée de manière conservatrice à la lumière de l’expérience des dix dernières années (2 ¼ %). Compte tenu du phénomène de surréaction des ressources de l’État à la croissance décrit supra, il en résulterait des surplus allant de près de 11 milliards d’euros dans le scénario prudent à plus de 25 milliards d’euros dans le scénario optimiste.
Le « choc fiscal » ampute nos marges de manœuvre en 2008 de 8 milliards d’euros (27), auxquels il faut ajouter 1,6 milliard d’euros de baisses d’impôts déjà « dans les tuyaux », au premier rang desquelles la réforme de la taxe professionnelle dans laquelle l’État a accepté de prendre à sa charge l’inflation des taux depuis 1996 au-delà des 3,5 % de la valeur ajoutée des entreprises pour un coût en 2008 estimé à 1,3 milliard d’euros (28).
Parallèlement, du côté des charges de l’État, il a été vu qu’il ne sera guère possible, pour ce premier budget de la législature, d’aller au-delà du gel en volume d’une enveloppe de dépenses étendue aux prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales. Cela représente un accroissement des dépenses au sens large de 5,7 milliards d’euros en valeur.
Dès lors, les montants qui devraient être distribués en 2008 atteignent 15,3 milliards d’euros, induisant une dégradation structurelle des finances de l’État limitée à 4,6 milliards d’euros sur la base d’une hypothèse de croissance modérée et prudente.
L’impact potentiel de ces choix de politiques économiques et budgétaires sur le solde apparent devrait cependant être plus nuancé. Les scenarii de croissance envisagés déploient un large éventail qui reflète lui-même l’extrême sensibilité des finances publiques à la conjoncture économique. Une croissance forte permettrait ainsi, grâce à l’accélération des rentrées fiscales qui, si l’on en juge par l’expérience des années récentes, reste l’hypothèse la plus probable, de réduire le déficit de plus de 10 milliards d’euros. Mais une croissance modérée, conforme à sa tendance passée, induirait un accroissement du déficit de seulement 5 milliards d’euros.
En déduire des estimations de déficits pour 2008 impose au préalable d’émettre diverses hypothèses relatives aux profils des recettes de l’État en 2007. Le tableau ci-après qui se livre à cet exercice montre ainsi que le déficit en 2008 (29), apprécié dans un contexte de croissance modérée en 2008, devrait se situer dans une fourchette allant de 38 milliards d’euros, si l’activité s’accélère dès le second semestre 2007, à 43 milliards d’euros, si la conjoncture reste modérée mais ferme en 2007 comme en 2008, c’est-à-dire dans l’hypothèse prudente où la croissance est conforme à son potentiel.
L’ÉVOLUTION DU DÉFICIT STRUCTUREL DE L’ÉTAT EN 2008 SELON L’AMPLEUR DES PLUS-VALUES DE RECETTES EN 2007
(en milliards d’euros)
Nette reprise de l’activité |
Tassement conjoncturel en 2007 |
affermissement de la croissance sur sa tendance de moyen terme en 2007 | |
Solde 2007 LFI (A) |
– 42,0 | ||
Plus ou moins-values de recettes en 2007 par rapport à la LFI (B) |
+ 10 |
+ 2 |
+ 5 |
Coût en 2007 des mesures du projet de loi TEPA (C) |
1,5 | ||
Solde 2007 induit |
– 33,5 |
– 41,5 |
– 38,5 |
Évolution du solde en 2008 selon l’hypothèse médiane d’une croissance modérée de 2 ¼ % (a) (II) (b) |
– 4,5 | ||
Solde 2008 (I + II) |
– 38 |
– 46 |
– 43 |
(a) Voir le tableau supra relatif à la répartition des marges de manœuvre budgétaires en 2008.
(b) En première approximation, c’est l’évolution structurelle du solde.
Le résultat de ces simulations, certes affectées par trop d’approximation pour être plus qu’indicatives, dégage néanmoins un enseignement solide.
Grâce aux efforts de la XIIème législature qui ont solidement arrimé les finances publiques au point d’ancrage du solde stabilisant structurellement la dette, une dégradation précipitée du solde public est très improbable, et, dès lors que la loi de finances initiale pour 2008 s’inscrit dans la démarche de responsabilité suivie depuis 2002, la trajectoire d’assainissement des finances publiques est maintenue en 2008. Ainsi, même si la croissance reste modeste, les choix budgétaires proposés pour 2008 permettent de conserver le déficit à un niveau très proche du solde de la loi de finances initiale pour 2007.
2.– À l’horizon de la législature, le défi exigeant du désendettement
Les montants distribués en 2008 épuisent les marges de manœuvre « durables » disponibles, sans éloigner cependant les finances publiques du point d’ancrage que constitue le déficit stabilisant structurellement la dette. À ce titre, les arbitrages rendus contraignent les choix budgétaires de l’ensemble de la législature. Leur pertinence tient précisément à cette prise de conscience. Le Président de la République a bien dit que le choc fiscal est étroitement lié à l’engagement pris du désendettement, à la lumière duquel il prend son sens. La France ne fait aujourd’hui un usage massif de l’autonomie recouvrée de sa politique économique au prix d’une pause dans la réduction des déficits que parce qu’elle s’engage dès demain à mener de front la bataille du désendettement. D’abord libérer les forces du travail et de la croissance, pour ensuite mieux en consacrer les dividendes à l’assainissement des finances publiques, voilà le sens du projet budgétaire et fiscal de la nouvelle majorité.
Les simulations qui suivent évaluent l’effort budgétaire à accomplir entre 2009 et 2012 pour respecter l’engagement de la France auprès de ses partenaires européens de faire refluer sa dette publique en deçà des 60 % du PIB selon deux scenarii de croissance entre 2008 et 2012 (ressaut durable de la croissance à 3 % pendant cinq ans ou maintien d’un potentiel de croissance modéré de 2 ¼ %). Elles sont construites après prise en compte du « choc fiscal » et des choix de dépenses pour 2008 tels qu’évoqués dans le présent rapport.
Si la croissance faiblissait durablement, l’ajustement budgétaire nécessaire au reflux de la dette publique à l’horizon 2012 serait probablement hors de portée. Une croissance de 1,5 % par an en moyenne rendrait nécessaire de réduire le déficit de près de 13 milliards d'euros chaque année pour respecter le plafond des 60 % du PIB. Un tel effort impliquerait non seulement de renoncer à toutes dépenses ou baisses d’impôt nouvelles, mais aussi d’augmenter significativement les prélèvements au risque d’affaiblir encore la croissance. Il faut donc souligner l’extrême vulnérabilité de nos finances publiques à l’affaiblissement du potentiel de croissance du pays.
À l’opposé, l’endettement public glisserait presque aisément sous les 60 % du PIB, sans réel effort budgétaire (moins de 1 milliard d'euros de baisse du déficit chaque année), si l’économie française s’installait durablement sur un rythme de croissance proche de 3 %. Le scénario est ambitieux sans être hors de portée si l’on en juge par les performances de nos voisins européens.
LES TRAJECTOIRES DES FINANCES DE L’ÉTAT ENTRE 2008 ET 2012 POUR RAMENER LA DETTE PUBLIQUE EN DESSOUS DES 60 % DU PIB
(pourcentages rapportés au PIB
montants en milliards d’euros)
HYPOTHÈSE D’UNE CROISSANCE À 2 ¼ %
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
Croissance du PIB en volume |
hypothèse à 2 ¼ % par an | ||||
Dette publique (objectif de 60 % du PIB en 2012) |
63,7 % |
63,3 % |
62,6 % |
61,4 % |
60 % |
Déficit public cible pour atteindre l’objectif de dette (a) |
– 2,5 % |
– 2,1 % |
– 1,7 % |
– 1,3 % |
– 0,9 % |
Effort annuel de réduction du déficit pour atteindre l’objectif de dette |
pause |
6,9 par an | |||
Déficit cible de l’État pour atteindre l’objectif de la dette (b) |
43 (c) |
36 |
29 |
22 |
16 |
HYPOTHÈSE D’UNE CROISSANCE À 3 %
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
Croissance du PIB en volume |
hypothèse à 3 % par an | ||||
Dette publique (objectif de 60% du PIB en 2012) |
63,7 % |
62,9 % |
62,0 % |
61,1 % |
60 % |
Déficit public cible pour atteindre l’objectif de dette (a) |
– 2,2 % |
– 2,1 % |
– 2,0 % |
– 1,8 % |
– 1,7 % |
Effort annuel de réduction du déficit pour atteindre l’objectif de dette |
pause |
0,8 par an | |||
Déficit cible de l’État pour atteindre l’objectif de la dette (b) |
38 (c) |
37 |
36 |
35 |
35 |
(a) Sous l’hypothèse, arbitraire, que seul le déficit public concoure à la progression de l’endettement public (la variation des actifs publics, par exemple sous la forme des privatisations, exerce de fait un impact important sur l’endettement).
(b) Sous l’hypothèse que l’État assume seul l’effort de redressement, l’ensemble des comptes des autres administrations publiques restant globalement à l’équilibre chaque année (comme constaté en 2006 et prévu en 2007). Il est par ailleurs retenu une clé de passage du déficit budgétaire au déficit au sens du Traité de Maastricht de 5 milliards d’euros (moyenne 1999-2006)
(c) Pour l’évaluation du déficit 2008, voir le tableau supra.
Le scénario de croissance à 2 ¼ % permet d’apprécier la portée de l’engagement de désendettement pris par la nouvelle majorité.
Le Rapporteur général tient, à ce stade, à rappeler sa conviction que les choix budgétaires ne peuvent efficacement être pensés qu’à l’aune des réalités, si possible appréhendées avec la prudence qui caractérise le regard du « bon père de famille » avisé mais responsable. C’est pourquoi il se refuse à penser les choix budgétaires dans un autre contexte que l’économie réelle. L’expérience montre que tabler sur une croissance subitement et durablement installée, très au-delà des taux de 2 ¼ à 2 ½ % par an, peut précipiter nos finances publiques dans l’écueil dont elles ne sortent que péniblement depuis 2002.
Il est vrai que l’objet même de la politique économique est d’exercer une influence significative sur le comportement des agents économiques et par conséquent d’accroître le potentiel de croissance du pays. Et il est tout aussi évident que les marges de productivité sont considérables, qu’elles naissent du renforcement nécessaire de notre taux d’activité, de l’accroissement de l’intensité capitalistique de notre économie, d’une gestion performante de notre secteur public, d’un rétablissement de notre balance commerciale, etc. Le Gouvernement a raison d’affirmer que c’est près d’un point de croissance en plus chaque année qui pourrait être arraché à la torpeur économique du pays.
Néanmoins, la gravité de la responsabilité que l’état de nos finances publiques nous impose à l’égard des générations futures, amplifiée par les besoins de financement qu’induira inéluctablement le vieillissement de la population, nous oblige à refuser de prendre un nouveau pari sur la croissance : c’est de nos efforts, et de nos seuls efforts, que viendra le rétablissement des finances publiques. Si la croissance se relève, tant mieux. L’assainissement n’en sera que plus rapide et plus profond, au grand profit de tous les Français et, sans doute, de la croissance elle-même ainsi allégée du poids de l’endettement public. Mais nous devons ménager la possibilité que la croissance reste sur sa tendance constatée depuis 20 ans. Rappelons qu’entre 1980 et 2007, les paris sur la croissance se sont soldés par une dette qui a plus que triplé, passant de 21 à 64 % du PIB.
Un deuxième argument étaye le choix raisonné de la prudence : maintenir une croissance potentielle de 2 ¼ à 2 ½ % est, en soi, une performance. Le vieillissement de la population tend en effet, mécaniquement, à réduire le nombre des actifs occupés à produire. Il en résulte ainsi un abaissement du potentiel de croissance, qu’atténue mais ne compense pas la hausse de la productivité liée au progrès technologique et à la remobilisation du travail. Là encore, le raisonnable n’épuise pas le possible. L’économie française peut retrouver le dynamisme qui irradie les grandes périodes de son histoire. À plus court terme, elle peut signer durablement quelques performances solides. Et le cycle économique pourrait s’engager quelques années durant dans sa phase haute. C’est l’objet de la politique économique de renforcer la probabilité de ces possibles. Mais l’urgence de la politique budgétaire commande de s’appuyer sur le certain pour renverser le cercle vicieux du surendettement et préparer au mieux les chocs du futur.
Dans ce contexte, le scénario prudent mais raisonnable montre que le respect de nos engagements budgétaires nous impose de réduire le déficit de l’État de près de 7 milliards d'euros par an à partir de 2009 pour le ramener à 16 milliards d'euros en 2012. Ce n’est qu’à ce prix que la dette refluera sous les 60 % du PIB.
Compte tenu de la règle de répartition des surplus durables (qui ne dépassent pas 10/12 milliards d'euros par an), cela implique que moins de 4 à 5 milliards d'euros soient « distribués » chaque année en dépenses nouvelles ou en allégements fiscaux supplémentaires. Cette marge est réduite à 1 à 2 milliards d'euros en 2009 après imputation de l’incidence budgétaire du projet de loi en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat évaluée à 2,8 milliards d'euros (30).
L’intensité de l’effort à accomplir apparaît encore plus nettement lorsque l’on rappelle que le respect du gel en volume d’une norme des dépenses du budget général étendue aux prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales préempte, chaque année, près de 6 milliards d'euros. De toute évidence, notre objectif de désendettement rend nécessaire d’aller plus loin encore, et plus vite.
La discipline budgétaire impose de ne plus faire dépendre les équilibres annuels des lois de finances, des arbitrages budgétaires au jour le jour et des aléas de la conjoncture.
C’est pourquoi le Rapporteur général réaffirme son attachement au développement d’une vision pluriannuelle des finances publiques. Jusqu’à présent, la programmation annexée à chaque projet de loi de finances est très largement déconnectée de la procédure budgétaire et de la discussion parlementaire. Le Pacte de stabilité transmis en fin d’année à la Commission européenne échappe à tout réel débat politique. En sens inverse, la multiplication des lois de programmation « sectorielles » contraint les choix budgétaires de l’État (en 2007, les quatre principales lois de programmation couvraient 57 milliards d’euros de crédits, soit plus de 20 % des dépenses nettes du budget général (31)).
Ce début de législature doit donc être l’occasion de tracer les perspectives d’évolution des finances publiques à moyen terme, afin de traduire la volonté politique de la nouvelle majorité en un engagement de portée pluriannuelle, assorti d’un échéancier précis de réalisation. Le débat porterait sur les objectifs généraux recherchés, sur le cheminement à suivre, éventuellement sur les moyens précis à mettre en œuvre et sur les clauses de « rendez-vous » qui pourraient être fixées pour juger de son bon déroulement. L’enjeu consiste à tracer le chemin de désendettement esquissé ci-dessus.
Pour l’État, cette démarche se traduirait par exemple par un engagement à faire évoluer ses dépenses – mesurées selon un agrégat élargi et stable – à un rythme donné durant la période considérée et à systématiquement affecter l’intégralité des excédents conjoncturels de recettes à la réduction de son déficit. Ce cadrage global pourrait ensuite être décliné sous forme de plafonds de dépenses triennaux par mission, ainsi que l’ont suggéré MM. Alain Lambert et Didier Migaud (32). Les gestionnaires y gagneraient en visibilité et en responsabilité ; les pouvoirs publics en capacité de pilotage de nos finances publiques.
AUDITION DE M. PHILIPPE SEGUIN, PREMIER PRÉSIDENT
DE LA COUR DES COMPTES
Au cours de sa séance du 11 juillet 2007, la commission des Finances, de l’économie générale et du plan a auditionné M. Philippe Séguin, Premier président de la Cour des comptes, sur l’exécution du budget de 2006 et sur le rapport de la Cour préalable au débat d’orientation budgétaire.
Le Président Didier Migaud accueille M. Philippe Séguin, premier président de la Cour des comptes, accompagné de M. Christian Babusiaux, président de la première chambre, et de M. Jean-Raphaël Alventosa, conseiller maître. Sous la législature précédente, des relations très nourries se sont nouées entre l’Assemblée nationale et la Cour des comptes, dans le respect de l’indépendance de chacun. La fonction de contrôle du Parlement est tout aussi essentielle que sa fonction législative et la commission des Finances, à cet égard, est investie d’une responsabilité particulière.
Le report de l’examen du projet de loi de règlement et du débat d’orientation budgétaire permet de procéder à cette audition, qui portera sur deux sujets : le projet de loi de règlement définitif du budget 2006 et le début de l’exécution 2007 ; le rapport préalable au débat d’orientation budgétaire pour 2008.
En 2007, la Cour des comptes est amenée à certifier les comptes de l’État pour la première fois.
La Commission, tout en en comprenant les raisons, regrette les conditions d’examen du projet de loi de règlement. Elle souhaite prendre les dispositions nécessaires pour que les choses se passent différemment en 2008 et que son activité de contrôle soit effective.
M. Philippe Séguin, Premier Président de la Cour des comptes, souligne le prix attaché par la Cour des comptes à sa mission d’assistance auprès du Parlement et se réjouit de la confiance manifestée à son égard par l’Assemblée nationale et plus particulièrement par la commission des Finances.
Puis, il présente l’architecture d’ensemble des travaux occupant la Cour des comptes.
Le plus récent d’entre eux, le rapport sur la situation et les perspectives des finances publiques, préliminaire au débat d’orientation budgétaire, a été rendu public le 20 juin 2007. Ce rapport, qui a vocation à constituer un véritable audit annuel des finances publiques, s’appuie sur d’autres travaux plus ciblés : le rapport annuel sur les résultats et la gestion budgétaire de l’État ainsi que les travaux de certification des comptes de l’État et de ceux du régime général de la sécurité sociale. La Cour des comptes ne se contente pas de commenter les chiffres donnés par le Gouvernement ou par l’INSEE ; le rapport préliminaire est nourri par toute une série d’analyses et d’expertises menées par la Cour tout au long de l’année.
Le rapport sur les résultats et la gestion budgétaire de l’État, publié le 29 mai 2007, se centre sur les résultats de l’État pour l’année échue. En plus de la traditionnelle analyse de l’exécution, il audite la performance d’un certain nombre de programmes et présente une analyse financière des soldes de l’État.
Les travaux de certification, pour l’État comme pour le régime général de la sécurité sociale, visent à évaluer la conformité des états comptables à un référentiel comptable donné. Loin d’être purement formel, cet exercice fait émerger des questions importantes. Il a notamment permis d’apprécier les charges à payer et plus généralement les dettes non financières, les engagements hors bilan, l’évolution de l’actif et du passif de l’État ou des organismes de sécurité sociale. Il éclaire les données de comptabilité budgétaire et de comptabilité nationale d’une lumière probablement plus crue mais plus précise.
Quant au rapport sur la situation et les perspectives des finances publiques, il ramasse les principaux messages des différents travaux de la Cour de comptes, il éclaire la signification et les limites des chiffres essentiels, il donne une vision synthétique englobant l’ensemble des finances publiques – celles de l’État, celles du régime général de la sécurité sociale et celles des collectivités territoriales.
Pour schématiser, les travaux sur les comptes et sur les résultats constituent en quelque sorte des photos à un instant t de la situation budgétaire et comptable de l’État et du régime général de la sécurité sociale pour l’année échue alors que le rapport préliminaire reconstitue le film des finances publiques avec une analyse de leur histoire récente et de leurs perspectives. Or ce film peut susciter quelques inquiétudes.
La situation budgétaire s’était certes améliorée à la fin du dernier épisode, fin 2006, avec un déficit public ramené à 2,5 % du PIB, mais l’amélioration est restée limitée. En pourcentage du PIB, le déficit était seulement revenu au niveau permettant de stabiliser la dette et non à celui permettant de la réduire. Enfin, en termes structurels, le déficit n’a pas suffisamment baissé pour garantir son maintien sous le plafond des 3 % du PIB en cas de retournement de conjoncture.
Cette amélioration s’avère en outre fragile. La réduction du déficit, depuis 2004, s’explique avant tout par la progression des recettes fiscales, dont rien ne garantit le caractère durable. Comme l’an dernier, des mesures exceptionnelles, par définition non reconductibles – par exemple, l’anticipation du calendrier d’encaissement de l’impôt sur les sociétés ou le versement de soultes – ont également contribué à réduire le déficit. Sans ces mesures exceptionnelles, le déficit aurait atteint 2,8 % du PIB.
Quant aux dépenses, elles continuent à augmenter aussi vite que le PIB, c’est-à-dire à un rythme très supérieur aux objectifs fixés par le Gouvernement dans les programmations pluriannuelles. Ce rythme a certes été un peu moins élevé en 2006 qu’en 2005. Pour l’État, les dépenses ont progressé de 1,9 % en valeur, soit une quasi-stabilité en volume. L’objectif « zéro volume » inscrit dans la loi de finances initiale pour 2006 a donc presque été respecté. Néanmoins, on ne peut guère parler de tendance de fond au ralentissement puisque la croissance des dépenses publiques, au cours des cinq dernières années, a excédé en moyenne annuelle celle des cinq années précédentes. En outre, les limites de la norme de dépense, qui n’inclut pas encore, par exemple, les prélèvements sur recettes, doivent une nouvelle fois être soulignées. Et puis, la fin de l’année 2006 a été marquée par d’importants arriérés de paiement, dont le montant ne peut être estimé avec précision. Le problème majeur est donc l’absence de maîtrise des dépenses, qui explique le non-respect des engagements successifs de retour à l’équilibre pris dans le cadre européen.
Le ratio d’endettement s’est lui aussi amélioré en 2006 : il a été ramené à 63,7 % du PIB. Pourtant, là encore, il ne faut pas s’en tenir aux apparences car cette baisse de 2,5 points ne traduit pas un rééquilibrage des comptes publics. Elle a été obtenue grâce à des cessions d’actifs exceptionnellement élevées – plus de 16 milliards d’euros, un montant jamais atteint depuis la première vague de privatisations, en 1986 – et à des mesures de trésorerie, qui n’ont eu d’autre objet que de réduire le ratio d’endettement juste avant la clôture des comptes annuels. Ces deux voies, qui n’améliorent en rien la situation patrimoniale des administrations publiques, ne pourront être empruntées au même degré dans les prochaines années.
La dette est d’autant plus problématique qu’elle sert pour l’essentiel à financer des dépenses courantes et non un effort d’investissement. Pour ce qui concerne spécifiquement l’État, si la dette financière a diminué de 4 milliards d’euros, la dette non financière, que la certification permet désormais de connaître, a augmenté de 16 milliards. Et il ne faut pas négliger la dette sociale, dont le quasi-triplement, depuis 2002, reflète l’accumulation des déficits de la sécurité sociale et plus particulièrement de l’assurance maladie. La dette sociale dépasse 120 milliards d’euros, alors qu’il est à l’évidence anormal de financer des prestations sociales par l’emprunt.
Ce qui frappe enfin, en France, c’est que l’amélioration des comptes publics s’avère beaucoup plus limitée que dans des pays comparables, au premier rang desquels l’Allemagne. Par exemple, la réduction du déficit public français – moins 0,5 point de PIB –, a été presque deux fois moins importante que celle de la zone euro et trois fois moins que celle de l’Allemagne.
L’exercice 2007 risque de voir encore se creuser l’écart avec les partenaires principaux de la France si le déficit est seulement stabilisé à 2,5 % du PIB, comme le prévoyaient les objectifs affichés fin 2006, et si la règle prévue par le pacte de stabilité – réduction annuelle de 0,5 point de PIB en termes structurels – n’est pas respectée.
Par conséquent le bilan est mitigé pour 2006 et il serait étonnant que le début de l’exercice 2007 laisse présager un redressement.
Les éléments disponibles sur l’exécution du budget de l’État à l’issue des quatre premiers mois de 2007, par rapport à la situation constatée un an plus tôt, font apparaître un accroissement des dépenses et un recul des recettes nettes, qui entraînent une aggravation sensible du déficit. Cette comparaison par rapport à 2006 est en partie perturbée par des paramètres techniques mais le déficit budgétaire, fin avril 2007, est comparable à celui de 2005 et légèrement supérieur à ceux de 2003 et de 2004 à la même époque. Si les éléments disponibles à ce stade ne permettent pas de tirer des conclusions chiffrées sur l’ensemble de l’année, ils montrent la nécessité d’une réelle vigilance. Les premières tendances, couplées à la fin de certaines opérations qui avaient momentanément réduit la dette de l’État à la fin de l’exercice 2006, se sont dès à présent traduites par une remontée rapide de celle-ci, de plus de 43 milliards d’euros sur les cinq premiers mois de l’année.
Le risque d’aggravation du déficit de la sécurité sociale, également annoncé dans le rapport sur les finances publiques, est confirmé par les prévisions récentes de la commission des comptes de la sécurité sociale. La prévision de déficit du régime général pour 2007, fixée à 8 milliards dans la loi de financement de la sécurité sociale, sera sans doute largement dépassée, la commission des comptes de la sécurité sociale avançant un montant de 12 milliards.
Trois raisons principales expliquent cette évolution défavorable. Tout d’abord, pour la branche maladie, le comité d’alerte a diagnostiqué, au vu des quatre premiers mois de l’année, un dérapage de l’objectif national des dépenses de l’assurance maladie (ONDAM) 2007 de l’ordre de 2 milliards d’euros rien que pour les soins de ville ; la commission des comptes a quant à elle évalué le dépassement de l’ONDAM à 2,6 milliards, dont 2,3 milliards sur les seuls soins de ville. Deuxième facteur de dérapage, les dépenses de la branche retraite seront plus fortes que prévu, notamment du fait de la forte progression des départs anticipés, qui se poursuit ; la caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) a annoncé un risque de dérapage de l’ordre de 1 milliard d’euros par rapport à la prévision, ce que confirment les données de la commission des comptes de la sécurité sociale. Enfin, pour 2007, le coût des exonérations de cotisations de sécurité sociale se révèle sensiblement supérieur au « panier » des impôts et taxes affectés en compensation ; la perte serait de 850 millions d’euros.
Par ailleurs, si le projet de loi soumis aux caisses prévoit que les exonérations de cotisations sur les heures supplémentaires feront l’objet d’un remboursement par l’État, ses modalités n’ont pas à ce jour été précisées. Il peut en résulter, en 2007, un alourdissement des dettes de l’État de 1 à 2 milliards selon la date d’application de la mesure, ce qui pèsera sur la trésorerie des régimes.
De façon générale, les dettes non réglées de l’État, dont le rapport de certification des comptes de la sécurité sociale a souligné le poids – près de 9 milliards d’euros pour l’ensemble des régimes –, pèsent d’un poids croissant sur la trésorerie des caisses. L’État a bien reconnu ses dettes dans son bilan, la Cour des comptes l’a vérifié à l’occasion de l’exercice de certification des comptes de l’État, mais encore faut-il qu’il se donne les moyens de les régler dans des délais raisonnables, sans quoi les créances enregistrées par la sécurité sociale poseront un problème de sincérité comptable.
Aggravation de la situation de l’État et de la sécurité sociale, poursuite d’une vive progression des dépenses des collectivités territoriales, les finances publiques dans leur ensemble semblent se détériorer en 2007. L’INSEE confirme cette tendance : il vient d’annoncer l’augmentation de la dette publique de 33,7 milliards d’euros durant le premier trimestre de 2007, ce qui fera repasser le ratio d’endettement de 63,7 à 65 % du PIB.
L’aggravation des déficits et de la dette n’est pas dénuée de conséquences. Tout d’abord, elle rend la France vulnérable au relèvement des taux d’intérêt amorcé fin 2005 et qui semble devoir se poursuivre. Ensuite, elle limite les marges de manœuvre budgétaires et fiscales du pays, pourtant nécessaires eu égard à la rigidité de la majorité des dépenses, notamment des dépenses de personnel, et à l’augmentation à venir des dépenses publiques, liées notamment au vieillissement démographique. Enfin, elle contrevient au principe d’équité entre générations, qui exigerait de cesser de reporter sur les générations suivantes une partie de la charge des dépenses courantes.
En tout état de cause, il appartient au Gouvernement et au Parlement de définir les voies, les moyens et le rythme du redressement budgétaire. Comme toujours, plusieurs méthodes et plusieurs approches sont envisageables. Ce n’est pas à la Cour des comptes de décider de la politique à mener.
Ces derniers mois, on a noté une prise de conscience collective des risques et inconvénients d’une dette publique trop élevée, surtout lorsqu’elle ne sert pas à investir. Il ne faudrait pas que la vigilance retombe car elle est propice à un assainissement des finances publiques. La chance doit être saisie, d’autant que le contexte de croissance soutenue qui semble devoir prévaloir pour les prochains mois dans l’ensemble de la zone euro fournit l’occasion d’une amélioration structurelle des comptes publics.
Sur la base de cette analyse, la Cour des comptes examine les outils de pilotage des finances publiques et elle met d’abord l’accent sur le nécessaire renforcement de la programmation pluriannuelle des finances publiques. Cet outil, prévu à la fois par la LOLF et par les engagements européens de la France, est indispensable pour ancrer les stratégies budgétaires dans la durée. Jusqu’ici, il n’a pas fait l’objet d’une appropriation suffisante. Les programmations, qui fixaient des objectifs sans indiquer comment les atteindre, se trouvaient dépourvues de prise sur le réel.
Cette programmation doit devenir un cadre de référence réel pour tous les acteurs publics, ce qui suppose qu’elle fasse l’objet de consultations plus approfondies et qu’elle soit à la fois plus opératoire et mieux étayée.
La prochaine programmation, qui sera présentée en décembre à Bruxelles et devra, conformément au Pacte de stabilité, couvrir l’ensemble de la législature, peut être déterminante pour l’évolution de la situation financière du pays à moyen terme. Elle sera d’autant mieux respectée qu’elle s’appuiera sur des règles de pilotage renforcées. Tous les pays qui ont assaini leurs finances publiques se sont dotés de règles de pilotage claires et globales. Vu les imbrications entre finances de l’État, finances locales et finances sociales, il doit s’agir d’un pilotage d’ensemble, associant tous les acteurs de la dépense publique.
Pour l’État, la priorité est d’améliorer la définition de la norme de dépenses. Une petite moitié seulement du total des dépenses étant concernée pour l’instant, la norme n’exerce pas encore tout l’effet modérateur attendu. La recommandation de la Cour des comptes émise sur ce point a en partie été entendue puisque le Gouvernement souhaite intégrer les prélèvements sur recettes dans l’assiette de la norme. Il souhaite aussi adopter un référentiel budgétaire, sorte de pendant de celui qui existe en matière comptable, qui permettrait de préciser les règles à respecter pour une plus grande sincérité budgétaire. Les recommandations de la Cour des comptes commencent donc à porter leurs fruits.
Il faut également tirer parti de la LOLF, qui apporte plusieurs outils de maîtrise budgétaire : des règles d’affectation des surplus de recettes fiscales pour que ceux-ci contribuent effectivement à la réduction du déficit budgétaire ; une obligation de justification au premier euro des dépenses, qui devrait conduire à éviter la reconduction automatique des dotations d’année en année ; une mesure des coûts par action ; une mesure de la performance. La mise en place de ce système n’en est encore qu’à ses débuts. Il faut utiliser ces instruments et redéfinir les politiques qui n’ont pas fait leurs preuves.
La Cour des comptes, dans son rapport, formule également des propositions relatives aux nécessaires actions de fond sur les dépenses. Elle n’entend pas porter de jugement de valeur sur le niveau des dépenses publiques, ce qui n’aurait aucun sens ; seul compte l’équilibre entre recettes et dépenses. En revanche, elle se doit de souligner que le niveau actuel du déséquilibre impose de rechercher et d’examiner avec encore plus d’attention l’efficacité de la dépense. Son message est clair : aucun redressement des finances publiques ne sera possible sans une meilleure maîtrise et sans une meilleure efficacité des dépenses.
L’effort doit bien sûr porter sur les dépenses de personnel mais il n’existe pas de solution possible sans action sur les dépenses d’intervention, qui, depuis dix ans, ont au total compté pour plus de 80 % dans l’augmentation des dépenses publiques ; leur maîtrise constitue donc un enjeu majeur pour l’avenir.
Les dépenses de personnel des administrations publiques représentaient 235 milliards d’euros en 2006 et ont augmenté de 40 % depuis dix ans, en lien avec la progression des effectifs, qui a atteint 30 % dans les collectivités territoriales, 18 % dans la fonction publique hospitalière et, malgré la décentralisation, 6 % dans la fonction publique d’État. De 2005 à 2015, les employeurs publics auront été confrontés au départ à la retraite de plus d’un tiers – 36 % – des personnels titulaires. Ce contexte offre une occasion unique de meilleure maîtrise des dépenses de personnel. La Cour des comptes ne préconise certainement pas la réduction systématique des effectifs ou l’application uniforme d’une norme de non-remplacement des départs mais une analyse fine, en fonction des missions et des besoins de chaque administration, mais aussi des gains de productivité déjà réalisés ou à programmer.
Les dépenses d’intervention, dépenses de prestations, d’aides, de subventions et de transferts divers aux ménages, entreprises ou collectivités, représentent 420 milliards d’euros, soit plus de la moitié des dépenses publiques. Il faut y ajouter les dépenses fiscales et les exonérations de charges sociales, souvent qualifiées dans la presse économique de « niches fiscales et sociales », qui représentent près de 130 milliards d’euros, soit l’équivalent de 7 points de PIB. Les dépenses d’intervention sont extrêmement dynamiques – elles ont augmenté de 25 % en dix ans, hors dépenses fiscales, et même de 40 % pour l’État –, malgré une efficacité mal évaluée et un contrôle souvent défaillant. Souvent, elles sont insuffisamment ciblées, c’est-à-dire qu’elles ne bénéficient pas prioritairement à ceux qui en auraient le plus besoin. Tel est le cas de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) ou de la prime pour l’emploi. Les dispositifs d’aide s’accumulent, se superposent, sédimentent et s’enchevêtrent. La Cour des comptes a illustré ces problèmes dans les domaines des aides au logement et à l’emploi, en matière de politique de la ville ou de décentralisation. Il conviendrait à tout le moins de revoir nombre de régimes d’aide et de transfert, non pas pour remettre en cause le niveau global d’intervention et d’aide publique mais pour mieux cibler les dispositifs et remettre en cause ceux qui ne servent à rien.
La liste des recommandations pourrait évidemment être allongée, d’autres figurant dans le rapport et plus généralement dans les travaux publiés par la Cour des comptes tout au long de l’année – le rapport annuel, les rapports thématiques et le rapport sur la sécurité sociale –, puisque son fil directeur est précisément de traquer les dépenses inutiles, les gaspillages, les actions inefficientes.
À cet égard, le rapport sur les résultats et la gestion budgétaire, cette année, outre la traditionnelle analyse de l’exécution budgétaire, contient des évaluations par programme, qui constituent en quelque sorte des premiers audits de performance. La Cour des comptes a ainsi examiné les trente-quatre missions et conduit une analyse plus approfondie d’une vingtaine de programmes. L’exercice a été difficile et très contraint, pour ne pas dire plus, en termes de calendrier, du fait de l’indisponibilité de certains rapports annuels de performance et de nombreux indicateurs de performance. Des progrès ont certes été réalisés en matière de tableaux de bord, les indicateurs de performance et les cibles sont mieux définis et mieux renseignés, mais il reste beaucoup à faire.
Il reste en particulier un chantier à mener : celui de la mise en place d’une comptabilité d’analyse des coûts des actions engagées dans le cadre des programmes. On ne peut mesurer correctement la performance d’une action que par rapport à son coût. Or cette comptabilité reste très lacunaire : par exemple, on ne sait pas encore bien ventiler par action les dépenses de personnel ou certaines charges comme les amortissements ou les provisions. Tout le profit possible n’a pas encore été tiré de la nouvelle comptabilité générale, qui n’a été mise en place qu’entre 2006 et les deux premiers mois de 2007. Dans ces conditions, il est encore difficile d’évaluer l’efficience des actions.
De ce premier exercice en mode LOLF, il ressort en tout cas qu’il vaudrait mieux rechercher dans chaque ministère des solutions appropriées, avec des calendriers adaptés. C’est la raison pour laquelle la Cour des comptes recommande, dans le rapport sur les résultats et l’exécution budgétaire, l’élaboration rapide de plans d’actions ministériels, qui programmeraient précisément les efforts à consentir et les objectifs à atteindre dans ce domaine.
Quant à la question de la dégradation des comptes sociaux, le recours à la Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES) reste évidemment possible, mais à la condition, mise par le Parlement, d’un relèvement du taux de la contribution au remboursement de la dette sociale (CDRS) pour ne pas allonger la durée d’amortissement, estimée à quinze ans en valeur médiane. Pour l’instant, l’endettement de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) se creuse dans des proportions préoccupantes. Le rapport sur la sécurité sociale reviendra sur ce sujet en septembre et examinera en détail plusieurs thèmes qui sont au cœur de la problématique de l’équilibre des comptes, notamment les pertes d’assiette des prélèvements sociaux, la fiabilité des comptes des hôpitaux, les revenus des médecins, les dépenses de médicaments ou encore les aides publiques aux familles.
Le Rapporteur général insiste sur la réduction du déficit au niveau stabilisant la dette, qui ne progresse par conséquent plus par rapport au PIB et a fait l’objet des commentaires suivants dans le rapport de la Cour des comptes : « Le déficit de 2006 est inférieur de 11,3 milliards à la prévision de la loi de finances initiale pour 2006 et de 7,8 milliards par rapport à celui de 2005. La quasi-stabilité en volume des dépenses nettes du budget général a contribué à cette amélioration mais celle-ci tient surtout à la forte progression des recettes fiscales de l’État à périmètre et législation constants. Conformément à l’article 51 de la loi de finances initiales pour 2006, les importants surplus de recettes fiscales constatés en cours d’exercice ont été intégralement affectés à la réduction du déficit. » Cela signifie que ce déficit, dû à la maîtrise de l’objectif de dépenses en volume, est stabilisant et place les comptes en excédent primaire. Toutefois, d’un point de vue méthodologique, il importe effectivement d’élargir la norme de dépenses, en particulier aux prélèvements sur recettes, essentiellement à ceux concernant les collectivités locales, pour un montant total d’une cinquantaine de milliards d’euros. Ce sera l’enjeu du débat d’orientation budgétaire pour 2008.
L’exécution 2007 semble inspirer davantage d’inquiétudes à la Cour des comptes. Cependant, comme en 2006, la prévision de recettes fiscales est très prudente et, compte tenu de l’effet base, un surplus de l’ordre de 3 à 6 milliards d’euros est espéré, lequel sera intégralement consacré à la réduction du déficit. En tout cas, il faut garder le cap du respect scrupuleux de la norme de dépenses votée par le Parlement.
En revanche, des inquiétudes peuvent effectivement être nourries à propos des comptes sociaux. D’ailleurs, face aux dérapages en matière d’assurance maladie, le comité d’alerte a été immédiatement actionné et différentes mesures devraient être prises. C’est plus difficile pour le volet retraite, compte tenu des départs anticipés plus nombreux que prévu, et le rendez-vous de 2008 est attendu pour aborder cette question. Les comptes publics sont donc vulnérables à une conjoncture et un taux de croissance susceptibles de se dégrader, d’autant que la baisse du ratio de dette enregistrée en 2006 est exclusivement imputable à des cessions d’actifs et à un resserrement du fonds de roulement de l’État.
Parmi les treize réserves émises par la Cour des comptes vis-à-vis des comptes 2006, quelles sont les plus préoccupantes à court terme ? Lesquelles traduisent les plus grandes divergences avec les teneurs de compte ? Lesquelles risquent d’impacter le plus négativement le passif de l’État ?
Un point d’accord a-t-il été trouvé au sujet du niveau de provisionnement à appliquer dans le bilan d’ouverture de 2006 pour plusieurs organismes publics ou parapublics ?
La Cour des comptes est-elle en mesure de porter un jugement global sur les premiers rapports annuels de performance ?
Le Président Didier Migaud s’interroge sur la priorité à retenir pour que l’État progresse dans la mise en œuvre de la LOLF, avec un objectif de transparence et d’efficacité de la gestion publique.
La Cour des comptes voit-elle se profiler un dérapage des dépenses en 2007 ? De quels outils les parlementaires disposent-ils, en mode LOLF, pour apprécier finement le pilotage infra-annuel des dépenses ?
Que propose la Cour des comptes pour contribuer à la maîtrise des dépenses de la sécurité sociale ?
Où en est la réflexion de la Cour des comptes à propos de la définition de la dépense fiscale ?
Répondant tout d’abord au Rapporteur général, M. Philippe Séguin précise que la Cour, dans les treize réserves qu’elle a formulées, s’est gardée de tout pointillisme.
Les deux sujets de préoccupation les plus importants sont la lacune des systèmes d’information et les faiblesses du contrôle interne.
S’agissant des systèmes d’information, il convient de distinguer ce qui doit être amélioré immédiatement – le chemin de révision – et ce qui dépend du déploiement des nouveaux systèmes d’information – CHORUS, COPERNIC et l’opérateur national de la paye. La mise en place d’un dispositif opérationnel de contrôle et d’audit interne dans tous les ministères doit s’imposer rapidement.
Une autre réserve importante porte sur les actifs militaires, dont la valorisation et le recensement doivent incontestablement progresser.
Il est peu probable que les sujets ayant fait l’objet de réserves soient traités dès l’année prochaine. Les engagements que les autorités compétentes ont pris vis-à-vis de la Cour sont en général assortis d’un échéancier de trois ans. Le ministre de la défense a pour sa part confirmé à la Cour, par lettre du 29 juin, les engagements souscrits par son prédécesseur.
Les principales divergences relevées par la Cour portent sur des points très techniques : le statut du « compte État » de la COFACE, celui des fonds d’épargne de la Caisse des dépôts et consignations, la qualification exacte des contrats d’échange de taux. Le ministre des finances s’est engagé à clarifier sa position sur ces points.
Les réserves de la Cour sont à charge et à décharge : elles conduisent aussi bien à demander des réévaluations d’actifs – tel est le cas, au ministère de la défense, pour les immobilisations corporelles et incorporelles spécifiques – qu’à augmenter les passifs, en y ajoutant par exemple des obligations fiscales ou des passifs d’intervention. Le bilan de l’État certifié par la Cour comporte ces différentes modifications.
S’agissant des différences d’appréciation avec le Gouvernement au sujet des provisions, le traitement comptable des situations nettes négatives de certains organismes publics, évoqué dans le rapport sur les comptes de 2005, a été clarifié par le comité des normes de comptabilité publique. Les valeurs négatives de ces entités viennent en diminution de l’ensemble des actifs immobilisés de l’État. Elles ne sont individualisées qu’en annexe au compte général de l’État. La Cour s’est ralliée à la position de l’administration, qui a considéré que le FSV et le FFIPSA étaient des organismes de sécurité sociale et non des organismes contrôlés par l’État. Elle a en revanche immédiatement tiré les conséquences de ce fait dans la certification des comptes de la branche retraite, en demandant que l’arrêté du 27 novembre 2006 soit modifié afin de prévoir une combinaison du FSV avec les comptes de la branche. Il faut en effet que les comptes du FSV apparaissent d’un côté ou de l’autre : État ou sécurité sociale.
Sur un autre plan, la Cour a convaincu le producteur des comptes de l’État de passer les provisions correspondant aux obligations de l’État au titre de l’exercice suivant pour les « passifs ferroviaires » – RFF et SAAD, mais aussi les engagements de la SNCF en matière de retraites.
Au sujet des rapports annuels de performance – les RAP –, les difficultés tenant au calendrier doivent être soulignées : la Cour n’a disposé, avant d’adopter son rapport, que de versions provisoires, voire d’éléments très partiels. Il faudra donc veiller l’an prochain à ce que les RAP soient publiés en temps voulu, faute de quoi l’exercice perdrait de sa signification. Cependant, la lecture faite de ces rapports depuis un mois confirme ce que la Cour avait conclu au vu des éléments provisoires : il reste beaucoup à faire car de nombreux indicateurs doivent encore être renseignés. Ainsi, seulement 42 % des trente objectifs et des cent quatorze indicateurs de la mission « Enseignement scolaire » sont renseignés. Dans la plupart des programmes, l’analyse en coûts complets prévue par la LOLF n’a pas été réellement effectuée. Les données de comptabilité générale n’ont guère été utilisées. C’était au demeurant inévitable, puisque cette nouvelle comptabilité générale a surtout progressé dans les derniers mois de 2006. Il n’en reste pas moins qu’un progrès massif reste à accomplir pour les prochains RAP. Il n’y a pas de mesure possible des résultats et des conditions dans lesquelles ils sont été obtenus sans connaissance des coûts.
Répondant ensuite à l’intervention de M. le Président Didier Migaud, M. Philippe Séguin convient que certaines insuffisances doivent être relevées dans la mise en œuvre de la LOLF : inadaptation de l’architecture par missions et programmes, imprécision des plans d’action ministériels, persistance de raisonnements en termes de « services votés » et de « mesures nouvelles »… On peut y ajouter l’incertitude persistante quant au rôle des responsables de programme – il y a peu de chances que l’on avance tant que l’on n’aura pas tranché le nœud gordien –, le caractère inapproprié d’un nombre important d’objectifs et d’indicateurs, ou encore les défaillances du contrôle de gestion.
Deux progrès pourraient être rapidement accomplis : d’une part, le renforcement de la fiabilité des comptes budgétaires et de comptabilité générale et la réduction significative, par rapport à ce que l’on a constaté cette année, des délais de production des comptes ; d’autre part, le développement de la mesure du coût des actions, qui est au centre du dispositif mis en place par la LOLF. La démarche de performance qui inspire désormais la gestion publique ne deviendra une réalité et ne pourra éclairer véritablement le législateur que lorsque les administrations se seront mises en situation de produire des indications précises et chiffrées sur leurs résultats et sur les moyens mobilisés pour les atteindre. Or la comptabilité d’analyse des coûts est aujourd'hui embryonnaire, et même les données de la nouvelle comptabilité générale n’ont pas été intégrées dans les RAP pour établir un coût complet. La connaissance des coûts constitue donc un chantier ultraprioritaire.
Comme l’a relevé M. Didier Migaud, un dérapage se profile dans de nombreux sous-secteurs des administrations publiques. Fin mai, les dépenses nettes du budget général étaient en augmentation de 5,3 milliards d’euros par rapport à l’année précédente. Cette hausse s’explique en partie par le profil atypique de l’année 2006, qui a été marquée par le retard dans le démarrage de l’exécution de la LOLF, mais elle traduit aussi l’augmentation de certains postes de dépenses. Fin avril, sur les 5 milliards d’euros d’augmentation, 3,2 milliards concernaient des dépenses d’intervention. Le respect de l’objectif de la loi de finances initiale suppose, à l’évidence, que dans les prochains mois le rythme de consommation de crédits initiaux soit inférieur à celui qui a été observé durant les quatre premiers mois. Ce respect sera rendu plus difficile par le volume croissant des reports de charges intervenus en 2006 et par les sous-dotations budgétaires qui affectent certaines missions en 2007.
S’agissant du dérapage de la sécurité sociale, le dépassement de l’ONDAM à hauteur de 2,6 milliards, la forte progression des départs anticipés à la retraite et le coût des exonérations de cotisations ont déjà été évoqués. En outre, la Cour n’a pas connaissance de toutes les données chiffrées relatives aux collectivités locales pour l’année en cours. Trois éléments d’analyse doivent néanmoins être mentionnés. Premièrement, c’est à compter de 2007, et plus encore en 2008 et 2009, que l’essentiel des transferts de personnel prévus par la loi du 13 août 2004 pèsera sur les charges de fonctionnement. Deuxièmement, une décélération des dépenses d’investissement est peu probable en raison de l’effet du cycle électoral, de l’inertie des procédures des marchés publics en cours, du transfert de certaines dépenses d’investissement vers les départements et les régions, mais aussi du dynamisme des prix constaté dans le secteur du BTP. Enfin, certains départements anticipent un accroissement, en 2007 et 2008, des charges au titre de la nouvelle prestation de compensation du handicap, et l’APA a continué d’augmenter au rythme de 9 % sur les quatre premiers mois de 2007.
Concernant les mesures à court terme qui pourraient être préconisées pour maîtriser les dépenses, si la Cour n’a pas l’ambition de se substituer au Parlement, elle souligne toutefois qu’il faudra veiller à partager les efforts entre professions de santé et assurés, entre cotisants, entre retraités actuels et futurs. Les choix de principe en matière de retraites ont été faits dès la réforme de 2003. L’équilibre financier doit être obtenu par l’effet, combiné ou non, de trois leviers : l’âge de la retraite, le taux de cotisation et le taux de remplacement. Les réformes à venir, à commencer par le rendez-vous de 2008, devront aller plus loin, les travaux récents du COR montrant que l’équilibre n’est pas assuré avec une prévision de taux de chômage de 4,5 %, pour 2020. Il faudra y ajouter un objectif d’égalité de traitement entre les cotisants, ce qui implique la réforme des régimes spéciaux.
En matière d’assurance maladie, il conviendrait d’accroître la productivité du système de distribution des soins, qu’il s’agisse de la répartition géographique des équipements hospitaliers, de la réorganisation interne de l’hôpital, de la mise en place d’une médecine de ville mieux organisée, ou encore de la redistribution des compétences entre les médecins et les professions paramédicales. Il faudra également se préoccuper de la répartition du reste à charge entre les assurés : 60 % des dépenses d’assurance maladie sont générées par des patients en ALD. Cette proportion ne cesse d’augmenter, si bien que le reste à charge pour les autres assurés s’accroît lui aussi. Le parcours de soins coordonné est une des causes de cette augmentation.
Enfin, la définition d’une norme de progression des dépenses fiscales constitue une question difficile. Que ce soit dans le champ de l’État ou dans celui de la sécurité sociale, les dépenses fiscales ont augmenté ces dernières années beaucoup plus vite que les dépenses budgétaires. Cela n’a pas été sans conséquences sur les déficits. Une telle progression s’explique en partie par le fait que ces dépenses ne sont encadrées par aucune norme, à la différence des dépenses budgétaires classiques. Il est donc tout à fait légitime de réfléchir à la mise en place d’une norme spécifique, tant pour modérer les dépenses fiscales et que pour éviter les effets de substitution avec les dépenses qui sont aujourd'hui normées. Néanmoins, pour mettre en place un tel dispositif, il est indispensable de faire au préalable des progrès en matière de recensement, de chiffrage et d’évaluation des dépenses fiscales. Une fois ce cap franchi, une norme sera envisageable. Aux Pays-Bas, par exemple, les progrès accomplis dans le chiffrage et le recensement ont à eux seuls permis d’obtenir l’effet modérateur attendu, au point que la question de la norme a été reléguée au second plan.
M. Jérôme Chartier souligne qu’il ne peut, en tant que membre de la commission des finances, qu’être d’accord avec M. le Premier président dans sa volonté de traquer les dépenses inutiles, et lui demande quel pourrait être, dans l’idéal, le rôle d’un rapporteur spécial de la commission des finances dans cette traque. Au sujet des 36 % de personnels titulaires partant à la retraite entre 2005 et 2015, M. Séguin a indiqué qu’il faudrait veiller à la non-reconduction systématique des dotations et à l’analyse fine des départs poste par poste. De quels outils le rapporteur spécial doit-il disposer pour contribuer à cette analyse et pour s’assurer de l’efficacité de son travail de contrôle et de suggestion ?
Par ailleurs, dans sa réponse aux observations de la Cour, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique se déclare réservé sur la mesure de l’évolution des dépenses de l’État réalisée par la Cour, suivant des périmètres qui lui apparaissent parfois contestables. Quels sont ces périmètres contestés ?
M. Jean-Louis Idiart se déclare heureux de retrouver M. Séguin et évoque le temps où celui-ci, alors président de l’Assemblée nationale, s’employait déjà à faire jouer pleinement son rôle au Parlement. Il affirme que son groupe, lors des débats en séance publique du lundi 16 juillet, pourrait reprendre purement et simplement l’intervention du Premier président devant la commission. Il y a en effet tout lieu de s’inquiéter de la situation présente et à venir.
S’agissant des comptes sociaux, ne pourrait-on mentionner aussi les efforts à faire sur le coût des médicaments et envisager une action forte en matière de prix ?
M. Charles de Courson estime pour sa part que les gouvernements successifs devraient davantage tenir compte des remarques formulées par la Cour. La commission des finances discute depuis plusieurs années du problème de la norme de dépenses. Le rapport sur le résultat et la gestion souligne que la hausse pour 2006 atteint 6,2 % et non 1,9 %, ce dernier chiffre se rapportant à la dépense nette. L’annexe V comporte un certain nombre d’évaluations selon les périmètres et indique que la hausse atteint 5,6 % entre l’exécution 2005 et l’exécution 2006 et 6,7 % entre l’exécution 2006 et le projet de loi de finances pour 2007.
La dépense nette n’est assurément pas un indicateur pertinent de l’évolution des dépenses. Elle ne peut rendre compte de la rigueur ou de l’absence de rigueur en matière de dépense publique. Il faut y ajouter, comme le préconise la Cour, tous les prélèvements, certains remboursements – ceux qui sont effectués sur les impôts locaux – ainsi que les dépenses fiscales : en effet, on n’a cessé ces dernières années, pour faire croire que l’on était rigoureux, de transformer des dépenses budgétaires en dépenses fiscales ; pis, on a instauré des dépenses fiscales différées, comme l’atteste le financement du prêt à taux zéro – PTZ –, véritable bombe budgétaire.
Plusieurs concepts pourraient être développés : le passage de la dépense nette à la dépense brute ; l’inclusion des dépenses fiscales ; l’intégration du problème des organismes divers d’administration centrale – ODAC. Il faut aussi se demander quels sont les opérateurs au sens de la LOLF. Un travail réalisé par les services de la commission des finances sur les effectifs de ces opérateurs durant les quatre dernières années met en évidence des augmentations de l’ordre de 10 000 à 12 000 créations d’emplois chaque année, soit un chiffre bien supérieur à la réduction du nombre d’emplois sur le budget de l’État.
Par ailleurs, si la Cour relève l’aggravation continue des dettes de l’État à l’égard de la sécurité sociale, elle n’a jamais suggéré à la commission des finances de déposer un amendement pour corriger le déficit de la loi de règlement à hauteur de la dette constatée. Il est indiqué que cette dette s’élevait, à la fin de 2006, à 9,1 milliards d’euros, soit une augmentation d’un milliard par rapport à l’année précédente. Le Gouvernement conteste ce chiffre et avance celui de 6,2 milliards. Comment expliquer cette divergence ? Ne serait-il pas opportun qu’un amendement de la commission des finances vienne recadrer les comptes et leur conférer un peu plus de sincérité ? Actuellement, ces sommes sont comptabilisées comme recettes dans les comptes de la sécurité sociale, mais pas comme dépenses de l’État.
Enfin, la Cour pourrait-elle effectuer des synthèses sur les opérateurs au sens de la LOLF ? On pourrait alors déterminer dans quelle mesure la rigueur affichée au niveau de l’État est une pseudo-rigueur.
M. Jean-Pierre Brard relève que, selon M. le Premier président, la dette n’a été stabilisée que par des moyens artificiels, telles les cessions d’actifs et les mesures providentielles de trésorerie prises avant la clôture des comptes. De combien la dette aurait-elle dérapé sans ces subterfuges ?
M. Séguin a déjà exprimé son scepticisme au sujet des exonérations de charges. Ne serait-il pas pertinent, avant de prendre de nouvelles mesures, de réaliser une étude d’impact ? Le « bouclier fiscal » a par exemple été adopté il y a deux ans sur la base de 90 000 bénéficiaires et d’un « don » moyen de 4 000 euros par bénéficiaire. Or, au mois de mai, on en était à 1 100 bénéficiaires pour une ristourne moyenne de 67 000 euros.
Par ailleurs, comment la Cour envisage-t-elle l’évolution de la dette sociale – 120 milliards d’euros –, sachant que les mesures prises par le Gouvernement se traduiront par une baisse des recettes pour les régimes sociaux ?
Enfin, quelle cohérence trouver entre l’accroissement des départs anticipés en retraite, confirmé par la Cour, et le « travailler plus » dont il est beaucoup question aujourd'hui ?
En réponse à M. Jérôme Chartier, M. Philippe Séguin signale que la question du rôle du rapporteur spécial renvoie à un sujet plus vaste, celui du rapport que doivent entretenir le contrôle politique, exercé par le Parlement, et le contrôle technique, exercé par la Cour des comptes. Il serait regrettable que l’on retire au rapporteur spécial les moyens de se rendre sur place et de constater sur pièces. Même s’il n’en fait pas usage, il doit toujours conserver cette possibilité. En revanche, toute une série de tâches doivent être assumées par d’autres que les politiques. La ligne de partage est au demeurant facile à trouver.
S’agissant de la norme, la Cour a tracé plusieurs périmètres possibles. Elle a montré que ceux-ci aboutissaient à des résultats très différents, mais toujours supérieurs à la norme actuelle. Elle s’est néanmoins gardée de préconiser telle ou telle solution, si ce n’est la nécessaire intégration des prélèvements et de certains remboursements et dégrèvements.
M. Séguin précise à l’intention de M. Charles de Courson que le chiffre de 9,1 milliards correspond à la dette de la sécurité sociale au 31 décembre 2006, tandis que celui de 6,2 milliards correspond à la fin de la période complémentaire. En comptabilité générale, c’est bien la somme de 9,2 milliards qu’il faut retenir. En outre, il s’agit bien d’une dette : elle ne doit pas entrer dans le résultat budgétaire.
M. Christian Babusiaux, président de la première chambre de la Cour des comptes, apporte à l’intervention de M. Charles de Courson d’autres éléments de réponse.
Il conviendrait à tout le moins de placer dans le périmètre de la norme de dépenses les prélèvements sur recettes et une partie des remboursements et dégrèvements – la part qui correspond à des politiques publiques, ou, en d’autres termes, les dépenses fiscales qui sont le strict équivalent de dépenses budgétaires. La prime pour l’emploi et le crédit d’impôt recherche, par exemple, sont des substituts de dépenses budgétaires et ont toujours été présentés comme tels. Ils devraient donc entrer dans le périmètre de la norme de dépenses. L’objectif de la Cour en la matière était de démontrer que la définition de la norme est un enjeu majeur pour la maîtrise des dépenses publiques.
Il est par ailleurs exact que l’État a transféré des effectifs aux opérateurs ou leur a confié des actions qu’il exerçait jusqu’alors, par exemple en matière sanitaire. La Cour a donc demandé qu’un recensement des effectifs des opérateurs soit publié.
M. Georges Tron souligne que la question des opérateurs est évoquée de façon récurrente depuis de nombreuses années par la commission des finances dont les membres ont également travaillé sur ce sujet au sein de la MEC. L’intérêt s’est également porté sur le problème de la gestion du patrimoine immobilier de l’État, car il est au moins aussi important que celui des effectifs. Or il est extrêmement difficile d’avoir une vue exhaustive de cette gestion. Il voudrait donc savoir si, au-delà des ressources humaines, la Cour des comptes mène une réflexion sur tout ce qui concerne les opérateurs.
M. Christian Babusiaux répond qu’il s’agit d’une question de consolidation des comptes car il y a beaucoup à redire sur la comptabilité de l’État et des opérateurs. La solution est donc de consolider à la fois les comptes de l’État et ceux des opérateurs. Le Comité des normes a d’ailleurs inscrit ce sujet à son programme 2007-2008. Néanmoins il conviendra de faire en sorte au préalable que les comptes de l’État lui-même soient fiables. L’étape suivante sera la consolidation des comptes.
M. Philippe Séguin s’adresse d’abord à M. Brard qui voudrait savoir de combien serait augmentée la dette s’il n’y avait pas les mesures exceptionnelles. La réponse est extrêmement difficile à apporter – et cette remarque ne constitue pas une position de prudence – car il y a un mélange d’opérations de long terme et d’opérations de trésorerie : si on voulait les ignorer il s’agirait d’environ 50 milliards d’euros supplémentaires ; si on ne le voulait pas ce ne serait qu’à peu près 16 milliards. La réalité se situe donc sans doute quelque part entre ces deux chiffres.
En ce qui concerne les exonérations de charges, personne ne peut dire avoir entendu, depuis trois ans, le Premier Président émettre une opinion personnelle à ce sujet.
M. Jean-Pierre Brard veut connaître l’avis de la Cour.
M. Philippe Séguin ajoute que la Cour n’a jamais dit que les exonérations n’étaient pas une bonne chose. Elle a simplement souligné que, comme tout le monde, elle était incapable de dire si c’était bien ou pas ; ce qui, en soi, est déjà très inquiétant. (Sourires)
Il faut être conscient des difficultés de l’évaluation dans certains domaines sociaux, en particulier pour les aides à l’emploi. En effet pour distinguer entre la part qui revient à la mesure prise elle-même et ce qui est dû à l’environnement ou à d’autres raisons particulières, par exemple tenant à l’entreprise en cause, il faudrait se lever matin et étudier les cas à la petite cuillère, entreprise, par entreprise. Même sur le plan scientifique l’Université n’a pas beaucoup avancé en la matière.
Actuellement des centaines de milliards font l’objet de transferts sans que l’on soit capable d’évaluer les résultats.
Et ces propos concernant l’évaluation valent également pour les études d’impact.
Le Rapporteur général dit qu’elles sont toujours positives ! (Sourires)
M. Louis Giscard d’Estaing a bien noté que M. le Premier Président a évoqué le rôle d’assistance au Parlement que joue la Cour. Il voudrait donc savoir si elle aurait à formuler des propositions pratiques en la matière, y compris, éventuellement, sur le plan institutionnel, afin de renforcer la coordination entre la Cour et les commissions des finances des deux assemblées dans leur travail de contrôle des dépenses publiques, voire pour créer un nouveau dispositif.
En ce qui concerne l’excès d’action en début de législature au moment de la mise en place de la commission des finances, il relève que, si l’on se projette cinq ans en arrière, on constate que la situation était équivalente. Un audit comparable à celui qui avait été réalisé en 2002 serait-il aujourd’hui inutile compte tenu de la certification des comptes réalisé par la Cour sur l’exécution du budget 2006 car ses conclusions en seraient sans doute proches, notamment pour ce qui est de la sous-budgétisation dans certains secteurs ? Il pense en particulier à l’APA qui était absente du budget 2002.
S’agissant des normes relatives aux déficits, la Cour considère-t-elle que les critères fixés à Maastricht constituent toujours des indicateurs intéressants – et la comparaison avec l’Allemagne peut être faite - quant à ce qu’il convient de respecter en matière de dépenses publiques et de déficit ?
Pour ce qui est de la programmation pluriannuelle, la Cour estime-t-elle que la réalisation des contrats de plan État-région constitue un indicateur intéressant ou apporte-t-elle la démonstration que la programmation pluriannuelle connaît bien des avatars ? Un simple constat a posteriori fait ainsi apparaître que l’une des conséquences de la création de nouveaux organismes, en particulier les OPCI, est une augmentation de 30 % des effectifs de la fonction publique territoriale depuis 1999.
M. Yves Censi s’intéresse à la séparation évoquée entre contrôle technique et contrôle politique. A ses yeux l’exemple du FIPSA est intéressant car il comporte en lui-même ces deux aspects, étant un cas de démocratie sociale en soi. M. de Courson qui, comme lui, en a été le rapporteur spécial, a évoqué la fin du BAPSA à propos duquel se déroulait un vrai débat dans le cadre de la discussion budgétaire au Parlement, ce qui permettait un contrôle politique.
Puis a été créé le FIPSA qui a été alimenté par le produit d’une taxe sur le tabac. Or son rendement est bien moins dynamique que ce qui existait précédemment compte tenu de la politique anti-tabac de l’État. En conséquence il lui manque 1,9 milliard.
La Cour préconise l’alignement de sa branche maladie sur l’assurance maladie du régime général, ce qui, semble-t-il, n’obèrerait par vraiment ce dernier. Est-ce toujours d’actualité ?
En ce qui concerne le compensation démographique la Cour serait-elle favorable à une réforme des règles ?
Enfin la Cour serait-elle favorable à la création d’un conseil de surveillance aux côtés de la MSA, qui assurerait un contrôle à la fois technique et politique ?
M. Michel Bouvard a déjà compris qu’il fallait faire vite et qu’il n’aurait sans doute pas les réponses aujourd’hui. (Sourires)
Il souligne que, depuis 2001, le retour à l’équilibre est la première obligation de résultat en matière de contrôle et de maîtrise des dépenses publiques, ce qui l’amène à deux séries de questions.
En ce qui concerne l’évolution des effectifs il subsiste toujours un gros problème de dénombrement si l’on en croit le rapport sur le débat d’orientation budgétaire. En effet les chiffres fournis par les ministères ne correspondent pas à ceux obtenus par le logiciel de référence. On peut donc se demander s’il n’y aurait pas une certaine flexibilité des effectifs dans la fonction publique. Est-on allé assez loin dans la simplification des corps ? Comment pourrait-on mieux encadrer les choses, notamment chez les opérateurs ?
Pour ce qui est, ensuite, des outils de pilotage, le Premier président a souligné qu’il fallait mettre en place un système d’information de l’État. La Cour a-t-elle engagé un travail sur la gestion des systèmes informatiques de l’État ?
M. Philippe Séguin remercie d’abord M. Jean-Louis Idiart de son propos liminaire et souligne qu’il faut faire encore des efforts dans le domaine du médicament, notamment en ce qui concerne les génériques et les antibiotiques. Il est indispensable d’achever la base de données sur le médicament et de continuer à travailler sur les déremboursements en fonction du service médical rendu.
Les importantes mesures prises en 2005 et 2006 ont permis de réduire sensiblement la croissance des dépenses de médicaments. Il est souhaitable d’intervenir encore dans ce domaine.
M. Charles de Courson a demandé si la Cour avait des propositions en matière de coordination. Il connaît l’article 58 de la LOLF et nous sommes dans la même situation au regard des commissions sociales, y compris vis à vis de leurs MEC respectives. Cela étant il faut se souvenir que si la Cour est effectivement vouée à l’assistance du Parlement elle a en fait trois missions.
Elle doit d’abord assister le Gouvernement lui-même, notamment dans sa mission d’exécution du budget. Il lui appartient de l’éclairer par les critiques qu’elle formule dans les référés qu’elle adresse et dans les rapports qu’elle publie. La seule différence avec les devoirs qu’elle a envers le Parlement est que le Gouvernement ne peut pas lui demander de rapports.
Sa deuxième mission est celle d’aider le Parlement.
Enfin, elle a une troisième tâche vis à vis de l’opinion publique. En effet, dès sa création, Napoléon lui avait demandé de faire part de ce qu’elle constatait au souverain. C’était alors l’Empereur, aujourd’hui c’est le peuple.
En conséquence elle a eu une très grande liberté dès l’origine. La question de fond est de savoir si le fait d’être indépendante, ne serait-ce que parce qu’elle a des devoirs envers ses trois interlocuteurs, n’est pas une bonne garantie pour chacun d’entre eux de la qualité des informations qu’il reçoit. Il n’est pas certain que l’on pourrait trouver une meilleure solution. En tout cas celle-ci fonctionne bien depuis deux cents ans.
Quant à l’audit des finances publiques, c’est précisément ce que la Cour cherche à réaliser avec le rapport sur les situations et les perspectives. Cela constitue un pas de plus sur le chemin de l’audit annuel.
Il est évident que le succès de la LOLF devra beaucoup aux membres de la commission des finances.
Le Président Didier Migaud s’en dit convaincu !
M. Philippe Séguin évoque enfin la possibilité d’une réforme constitutionnelle concernant l’organisation de l’examen des lois de finances
Le Président Didier Migaud indique que la commission est en plein dans le sujet.
M. Philippe Séguin souligne qu’il s’agit d’un vrai sujet
M. Christian Babusiaux ajoute que, sur l’audit, on peut aller plus loin. Il a d’ailleurs été demandé qu’il porte aussi sur les résultats de l’année en cours. Cela serait bon en raison de la volatilité accrue de l’impôt sur les sociétés car il y a un système d’acomptes qui ne prend pas en considération les données économiques de l’année en cours.
Aujourd’hui l’impôt sur les sociétés représente une part de la fiscalité encore plus importante qu’en 2002 mais la combinaison des éléments rend extrêmement difficile la prévision des résultats pour 2007. C’est pourquoi il faut pousser un cri d’alarme et l’on n’a pas de chiffres sur le montant vraisemblable du surcroît de recettes, car les calculs sont trop aléatoires. Ainsi lorsque le Parlement s’est prononcé en novembre 2006, l’excès de recettes était sous-évalué.
Pour ce qui est de l’évaluation des dépenses, les chiffres figurent dans l’audit des finances publiques. Et les budgétisations sous-évaluées y sont recensées.
Pour ce qui de l’intercommunalité, les chiffres font ressortir une augmentation des dépenses des EPCI de 40 % depuis 2002 alors que celles des communes ont augmenté de 12 %. Cela a évidemment généré des surcroîts de recettes.
Dans le cadre du FIPSA a été réalisé un alignement des prestations maladies des exploitants agricoles. Le problème de la parité se pose donc en matière de retraite, mais pas pour la maladie.
En ce qui concerne la compensation subsiste un problème : il serait plus légitime d’intégrer les salariés dans les effectifs du régime général avant de procéder au calcul de la compensation, ce qui donnerait des résultats différents dans la compensation avec les autres régimes.
En revanche la Cour ne s’est pas prononcée sur un éventuel conseil de surveillance du FIPSA, mais cela pose une autre question : celle de la consolidation du FIPSA avec le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour y voir plus clair, et de son financement.
Le Président Didier Migaud remercie M. le Premier président de la Cour des comptes en indiquant qu’il répondra par écrit à M. Michel Bouvard.
*
* *
Au cours de sa séance du 11 juillet 2007, la Commission a, en application de l’article 145 du Règlement, autorisé la publication du présent rapport d’information.
*
* *
1 () Le montant du déficit 2002 légué par la précédente majorité est calculé sur l’hypothèse d’une répartition des « responsabilités budgétaires » relatives à l’exercice 2002 définies comme suit.
Les dépenses ont augmenté sur l’ensemble de l’exercice au total de 12,0 milliards d'euros (a) par rapport à 2001 (soit 7,5 milliards d'euros de plus que prévu en loi de finances initiale). De ce montant :
– 9 milliards d'euros sont imputables à la XIème législature puisque correspondant :
– pour 4,9 milliards d'euros aux crédits ouverts par la loi de finances initiale ;
– pour 4,3 milliards d'euros aux ouvertures de crédits votées dans la première loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1050 du 6 août 2002) afin, pour 1,8 milliard d'euros, d’apurer les dettes de l’État antérieures au 31 décembre 2001 (aide médicale de l’État, prime de noël accordée aux chômeurs, compensation d’exonérations de cotisations sociales, etc.) et, pour 2,5 milliards d'euros, de combler les insuffisances de la loi de finances initiale (rémunérations, opérations militaires extérieures, etc.). C’est à partir des crédits de la loi de finances initiale pour 2002 majorés de ces dépenses qu’a été calculée la norme d’évolution « zéro en volume » appliquée à la loi de finances initiale pour 2003.
– En revanche, 2,9 milliards d'euros doivent être mis à la charge de la XIIème législature, correspondant, pour 0,7 milliard d'euros, à l’accroissement des charges de la dette et, pour l’essentiel du reliquat, à un accroissement de la consommation des reports entre 2001 et 2002.
Du côté des recettes, il faut parallèlement distinguer les allégements fiscaux votés par la XIème législature (5,0 milliards d'euros) et la baisse de 5 % de l’impôt sur le revenu adoptée dans la loi de finances rectificative d’août 2002 précitée (2,6 milliards d'euros).
2 () C’est ce phénomène que décrit la notion d’élasticité des recettes fiscales nettes au PIB.
3 () Cela signifie qu’à long terme l’élasticité des recettes fiscales nettes au PIB est unitaire.
4 () 10,7 milliards d'euros en 2007 soit le produit du taux de croissance potentiel de l’économie en valeur, 4 %, ou montant des ressources fiscales nettes du budget général de l’État, 267,9 milliards d'euros en 2006.
5 () En euros 2007.
6 () Ce résultat n’est acceptable qu’en première approximation. Si l’on note g le taux de croissance nominale de l’économie et d le radio d’endettement, le déficit public stabilisant n’est pas d × g, mais d × g / (1 + g). L’approximation est valable dès lors que g est « petit devant 1 », ce qui est le cas en France (g vaut au maximum 5 % les bonnes années).
7 () L’analyse de la progression des dépenses en 2002 et 2003 est compliquée par le changement de majorité : la forte augmentation de 2002 est largement imputable à la XIème législature (pour environ 7,4 milliards d’euros sur 10,3 milliards d’euros) ; l’exécution de la loi de finances pour 2003 s’est traduite par une forte diminution en volume comparée à une exécution 2002 « alourdie » par les dépenses supplémentaires votées en août en loi de finances rectificative. Pour une analyse du partage des « responsabilités » budgétaires en 2002, voir le rapport d’information du Rapporteur général sur la loi fiscale depuis 2002, Tome 1, n° 3152, juin 2006, p. 54.
8 () Rapport d’information sur les premiers éléments disponibles concernant l’exécution du budget en 2006, n° 3782, mars 2007, p. 17.
9 () Cour des comptes, Rapport sur les résultats et la gestion budgétaire de l’État pour l’année 2006, p. 26.
10 () Par exemple, l’ « agrégat élargi des charges budgétaires » que présente chaque année le Rapporteur général lors de l’examen du projet de loi de finances comprend les dépenses nettes du budget général, les remboursements et dégrèvements d’impôts locaux, les prélèvements sur recettes au profit de l’Union européenne et des collectivités territoriales, les dépenses des comptes d’affectation spéciale et le solde des autres comptes spéciaux.
11 () Les comptes spéciaux sont structurellement équilibrés à long terme. À court terme, leurs dépenses – qui dépendent des recettes, donc de la croissance – évoluent cependant plus rapidement que celles du budget général.
12 () Sur ces points, voir Gilles Carrez, Rapport général sur le projet de loi de finances 2007, Tome 1, n° 3363, p. 35.
13 () Dépenses nettes du budget général, prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et remboursements et dégrèvements d’impôts locaux.
14 () Les trois dernières lois de finances fixaient à 1,8 % la prévision d’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac, exprimée en moyenne annuelle. Cette évolution a finalement atteint 1,7 % en 2006 et est estimée par l’INSEE dans sa dernière note de conjoncture à 1,2 % pour 2007.
15 () Le Programme de stabilité 2008-2010 prévoit une réduction des dépenses du budget général de 1,5 % pour 2009 et de 1,75 % pour 2010, c’est-à-dire une stabilisation en valeur à l’horizon de la projection.
16 () Ou à 5,1 milliards d’euros avec une inflation de 1,6 %.
17 () Le rapport proposait d’inclure les prélèvements sur recettes au profit des collectivités locales, les remboursements et dégrèvements d’impôts locaux et « les affectations de recettes à d’autres acteurs publics qui peuvent s’apparenter à de la dépense budgétaire » (p. 38).
18 () Voir le Rapport général sur le projet de loi de finances pour 2007, Tome 1, n° 3363, octobre 2006, p. 16.
19 () Dans sa note de conjoncture de juin 2007, l’INSEE indique qu’ « à l’horizon de la fin de l’année, la remontrée des taux à long terme devrait (…) rester limitée en Europe, notamment parce que les finances publiques s’améliorent, que les risques de volatilité des économies semblent avoir durablement baissé, impliquant la réduction de la prime de risque, et que les changements dans les placements des investisseurs en faveur des obligations pèsent sur les taux » (p. 71).
20 () Si un taux de remplacement global des départs à la retraite est « utile en termes de cadrage macro-économique, ce ne peut être un instrument de gestion. Au niveau microéconomique, le renouvellement des effectifs d’un service a en effet d’autres causes, qui peuvent de plus être stimulées et permettent aussi de gérer activement des formules de rémunération partiellement forfaitaire (…). L’affichage du taux de remplacement conduit au contraire à exonérer a priori d’effort les services qui ont des effectifs jeunes, même s’ils ont des gisements de productivité, et inciter les autres à chercher les bonnes justifications pour obtenir malgré tout le remplacement de leurs départs » (Conseil d’analyse économique, Performance, incitations et gestion publique, juin 2007, p. 52).
21 () Cour des comptes, Rapport sur la situation et les perspectives des finances publiques, juin 2007, p. 84.
22 () Circulaire budgétaire du 12 mars 2007 sur la préparation du volet « performance » du projet de loi de finances pour 2008 et circulaire budgétaire du 3 juillet 2007 sur la finalisation des documents budgétaires.
23 () Le propos est ici limité aux dépenses stricto sensu, mais les interventions de l’État prennent également la forme de dépenses fiscales, de prélèvements sur recettes et de ressources affectées.
24 () Rapport sur la situation et les perspectives des finances publiques, juin 2007, p. 88.
25 () Rapport d’audit de modernisation de l’IGF et de l’IGAS sur la gestion de l’ASS. Il est notamment proposé d’améliorer le service rendu, de simplifier la vérification du service fait, de réorganiser les relations entre DRTEFP, DDTEFP et Assedic et d’optimiser le recouvrement des indus. Sur les audits de modernisation, voir également infra.
26 () Selon l’expression du Conseil d’analyse économique (Économie politique de la LOLF, 2007, p. 158).
27 () Voir le B du II du présent rapport.
28 () À laquelle s’ajoute notamment la réduction d’impôt pour les souscriptions au capital des PME adoptée dans la loi de finances initiale pour 2007 qui exercerait un premier impact en 2008 évalué à 190 millions d'euros.
29 () Pour une croissance 2008 modérée conforme à son potentiel.
30 () La XIème législature a distribué chaque année 17 milliards d’euros en moyenne entre 1997 et 2002. La XIIème législature, réussissant néanmoins à réduire de 40 % les montants dépensés, a, pour sa part, distribué près de 12 milliards d’euros par an.
31 () Loi d’orientation et de programmation pour la sécurité intérieure du 29 août 2002 (2003-2007) ; loi d’orientation et de programmation pour la justice du 9 septembre 2002 (2003-2007) ; loi de programmation militaire du 27 janvier 2003 (2002-2008) ; loi d’orientation et de programmation pour la recherche du 18 avril 2006 (2006-2010).
32 () La mise en œuvre de la LOLF. À l’épreuve de la pratique, insuffler une nouvelle dynamique à la réforme, octobre 2006, p. 24. Trois années est la période la plus fréquemment retenue par les États pratiquant des budgétisations pluriannuelles. À la différence des auteurs du rapport précité, le Rapporteur général propose que la programmation porte sur les crédits de paiement, la budgétisation en autorisations d’engagement étant encore trop balbutiante.
© Assemblée nationale