

![]()
N° 1798
——
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 7 juillet 2009.
RAPPORT D’INFORMATION
déposé
en application de l’article 145 du Règlement
PAR LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE
sur les rémunérations des dirigeants mandataires sociaux
et des opérateurs de marchés,
ET PRÉSENTÉ
PAR M. Philippe HOUILLON,
Député,
en conclusion des travaux d’une mission d’information présidée par
M. Jean-Luc WARSMANN (1)
Député.
——
La mission d’information sur les nouvelles régulations de l’économie est composée de : M. Jean-Luc Warsmann, président ; M. Claude Goasguen et M. Philippe Vuilque, vice-présidents ; M. Philippe Houillon, rapporteur sur les rémunérations des dirigeants mandataires sociaux et des opérateurs financiers ; M. Sébastien Huyghe, rapporteur sur les lacunes de la réglementation bancaire ; M. Jean-Michel Clément, M. Éric Diard, M. René Dosière, M. Arnaud Montebourg, M. Éric Straumann.
INTRODUCTION 7
I. – L’EXISTENCE D’ABUS INADMISSIBLES 9
A. LE NIVEAU TRÈS ÉLEVÉ DE LA PLUPART DES RÉMUNÉRATIONS DES MANDATAIRES SOCIAUX DE TRÈS GRANDES SOCIÉTÉS 9
1. Un épiphénomène 9
a) Une exception par rapport au commun des chefs d’entreprise 10
b) Des justifications difficiles à admettre pour l’opinion 11
2. Les différentes strates des émoluments des mandataires sociaux : des mécanismes inflationnistes 12
a) La rémunération de base 14
b) Les options de souscription et d’achat d’actions 15
c) Les actions gratuites 21
d) Les indemnités de départ 22
e) La retraite chapeau 24
B. DES OPÉRATEURS FINANCIERS EN PROIE À UNE TROP GRANDE CUPIDITÉ 25
1. Un système de rémunération intrinsèquement imparfait 26
2. Des excès considérables 27
a) Des sommets sans commune mesure avec la rémunération moyenne des acteurs de l’économie réelle 27
b) Une absence totale de responsabilisation qui est choquante 29
II. – DES TENTATIVES DE MORALISATION AU SUCCÈS RELATIF 30
A. LES RÉPONSES APPORTÉES PAR LE LÉGISLATEUR 30
1. Des évolutions successives et prudentes en France 31
a) Une plus grande transparence des rémunérations octroyées 32
b) Un recours aux stock-options mieux délimité et fiscalisé 34
c) L’assujettissement des parachutes dorés à des critères de performance et à une fiscalité plus équitable 35
d) L’interdiction temporaire des rémunérations variables des dirigeants mandataires sociaux des entreprises aidées par l’État 37
2. Des aménagements législatifs plus ou moins prononcés dans les autres pays 38
B. LES DÉMARCHES D’AUTORÉGULATION PRIVILÉGIÉES PAR LES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES 40
1. Les règles élaborées par le MEDEF et l’AFEP au sujet des dirigeants mandataires sociaux 40
a) Le code de janvier 2007 41
b) Les recommandations du 6 octobre 2008 43
c ) Un premier bilan en demi-teinte 45
2. Les règles élaborées en février 2009 par le Haut comité de place sur les émoluments des professionnels des marchés financiers 47
3. La soft law en vigueur dans les autres principaux pays développés 49
a) Un corpus de règles contractuelles relatives à la gouvernance largement diffusé 49
b) Des lacunes s’agissant des marchés financiers 50
III. – COMMENT PARVENIR À UN JUSTE ÉQUILIBRE ? 51
A. UN PROBLÈME QUI NE PEUT TROUVER DE SOLUTION DURABLE QUE SUR LE FONDEMENT D’UNE HARMONISATION INTERNATIONALE 52
1. Un enjeu de dimension mondiale 52
2. La nécessité d’une réglementation européenne 53
a) Le choix d’une simple recommandation en matière de rémunérations des dirigeants mandataires sociaux 53
b) La perspective de règles plus contraignantes en matière de rémunérations dans le secteur des services financiers 54
B. QUELLE VOIE PRIVILÉGIER POUR TOUTE NOUVELLE RÉGULATION EN FRANCE ? 56
1. L’instrument fiscal, outil efficace mais à employer avec discernement 56
a) La remise en cause du bouclier fiscal, solution aux excès en matière de rémunération des dirigeants d’entreprise ? 56
b) Pour un plafonnement de la déductibilité de rémunération totale des dirigeants mandataires sociaux de l’assiette de l’impôt sur les sociétés 58
c) L’existence d’arguments en faveur d’un ajustement du régime fiscal des stock-options 59
2. La détermination d’une règle de portée générale, approche plus flexible 61
3. Le renforcement de l’autodiscipline au sein des sociétés cotées : une carte complémentaire à jouer 63
a) Les vertus d’un contrôle au cas par cas dans une économie de marché ouverte sur l’international 63
b) Crédibiliser un tel mécanisme, par l’institutionnalisation du comité des sages en observatoire des rémunérations des dirigeants mandataires sociaux 64
C. ACCOMPAGNER LE MOUVEMENT D’UNE NOUVELLE ÉTAPE DANS LA GOUVERNANCE DES ENTREPRISES 66
1. Instaurer des dispositifs permettant de lever les suspicions 66
a) Donner un statut légal aux comités des rémunérations 67
b) Accroître l’information des actionnaires et les consulter davantage 68
c) Limiter plus fortement le cumul des mandats sociaux 71
d) Instituer une véritable transparence sur les rémunérations des opérateurs financiers dans les sociétés intervenant dans la finance 73
2. Mettre un terme à l’hypocrisie entourant le statut des dirigeants de grandes entreprises 74
a) Bannir le cumul d’un contrat de travail avec un mandat social 74
b) Revoir les avantages consentis pour la retraite 76
3. Moraliser certaines pratiques devenues inacceptables 77
a) Mettre de l’ordre à la pratique des jetons de présence 77
b) Ajuster le régime juridique des stock-options 78
CONCLUSION 81
SYNTHÈSE DES PROPOSITIONS 83
CONTRIBUTION DE MM. PHILIPPE VUILQUE ET JEAN-MICHEL CLÉMENT ET DES MEMBRES DU GROUPE SOCIALISTE, RADICAL, CITOYEN ET DIVERS GAUCHE (SRC) APPARTENANT À LA MISSION D'INFORMATION 87
EXAMEN EN COMMISSION 93
LISTE DES PERSONNES ENTENDUES PAR LA MISSION D’INFORMATION 99
ANNEXE : LES DIFFÉRENTS ÉLÉMENTS CONNEXES DE LA RÉMUNÉRATION DES DIRIGEANTS DU CAC 40 EN 2008 102
La crise financière qui frappe aujourd’hui le monde entier, très certainement la plus grave depuis la grande dépression de 1929, marque un tournant dans la conception et l’organisation de l’économie de marché. Le capitalisme, s’il reste le seul système à avoir apporté la preuve de sa capacité à créer de la richesse et à dynamiser des pays en attente de développement, est victime de soubresauts montrant qu’il est également vulnérable.
Le temps de la déréglementation totale, prôné par ceux-là même qui ont précipité les difficultés actuelles de l’économie et de la finance mondiales, est révolu. La France, en raison de la place historique qu’y occupe la puissance publique, n’a jamais cédé à la tentation d’une libéralisation à outrance. Plus que jamais, elle a un rôle à jouer dans la définition d’un cadre plus équilibré, plus efficace, en un mot dans le capitalisme du XXIème siècle.
D’ores et déjà, au sein du G 20, les principaux pays développés et en voie de développement réfléchissent sur le nouveau visage à donner à l’économie de marché, à travers l’élaboration de règles tout à la fois adaptées et efficaces. La commission des Lois de l’Assemblée nationale, traditionnellement très impliquée sur les sujets relatifs aux régulations économiques, ne pouvait rester à l’écart des débats en cours. Afin d’apporter son concours par des propositions susceptibles de nourrir des initiatives sur le plan national, européen ou même international, elle a mis en place, le 16 décembre 2008, une mission d’information de dix membres, qui s’est assignée plusieurs thèmes d’investigation.
Le présent rapport d’information, portant plus spécifiquement sur le cas des rémunérations des dirigeants de grandes entreprises cotées et des opérateurs financiers, est le résultat des travaux menés sur le premier de ces thèmes. Le sujet n’est assurément pas nouveau. Il a pris néanmoins une résonance particulière avec la révélation d’émoluments aux montants exorbitants consentis dans des sociétés et des établissements financiers mis à mal par des erreurs stratégiques de leur management.
Lors de son discours prononcé à Toulon le 25 septembre 2008, le Président de la République n’hésitait pas à fustiger « trop d’abus, trop de scandales », en effectuant ces remarques de bon sens : « Ce système où celui qui est responsable d’un désastre peut partir avec un parachute doré, où un trader peut faire perdre cinq milliards d’euros à sa banque sans que personne ne s’en aperçoive, où l’on exige des entreprises des rendements trois ou quatre fois plus élevés que la croissance de l’économie réelle, ce système a creusé les inégalités, il a démoralisé les classes moyennes et alimenté la spéculation sur les marchés. (…) La crise actuelle doit nous inciter (…) à retrouver un équilibre entre la liberté et la règle, entre la responsabilité collective et la responsabilité individuelle. »
Force est de reconnaître que ce discours n’a pas toujours eu les faveurs des responsables de l’action publique, y compris au sein de la commission des Lois qui, dans un précédent rapport d’information, s’en remettait à davantage de transparence et d’autorégulation (2). Néanmoins, la persistance des faits dénoncés de même que les effets relatifs des tentatives d’améliorations initiées tant par le législateur que par les organisations professionnelles des entreprises ne peuvent qu’inviter à réviser le jugement d’alors.
Naturellement, il convient de se garder de tout amalgame hâtif entre dirigeants d’entreprises et mandataires sociaux des grandes sociétés cotées ou entre guichetiers d’agences bancaires et traders des principaux établissements des places boursières. Les abus restent le fait de minorités ; ils n’en sont pas moins choquants.
Sans aucunement chercher à jeter l’anathème sur un enjeu complexe et délicat, la mission d’information a souhaité dresser un état des lieux aussi objectif que possible de la situation. Elle s’est également penchée sur les effets des aménagements apportés dans les législations des États, ainsi que sur les résultats obtenus dans le cadre de l’autorégulation des intéressés. Ses constats, qui traduisent le caractère insatisfaisant du contexte actuel, l’ont conduite à formuler des propositions dont elle espère qu’elles trouveront une traduction, dans l’intérêt bien compris de tous.
I. – L’EXISTENCE D’ABUS INADMISSIBLES
Personne ne peut nier que la compétence et l’importance des responsabilités des dirigeants des plus grandes entreprises et des principaux établissements financiers puissent justifier des niveaux de rémunération bien supérieurs à ceux des salariés ordinaires. Pour autant, ainsi que l’observait en juillet 2007 M. Philippe Manière dans une étude de l’institut Montaigne au titre révélateur, « les inégalités de revenus doivent être tolérables pour le corps social, c’est-à-dire explicables » (3). Or, tel ne semble pas toujours être le cas.
La décennie qui s’est écoulée a vu se creuser le fossé entre la revalorisation des rémunérations des mandataires sociaux et celle des salaires. Selon l’institut français des administrateurs, la rémunération moyenne des dirigeants de grandes sociétés cotées a progressé de 15 % par an entre 1997 et 2007 alors que celle des salariés a évolué, sur la même période, de 3 % en rythme annuel. En outre, les montants perçus par les dirigeants des grandes entreprises cotées et par les opérateurs financiers ont atteint ces dernières années, en France comme dans la plupart des pays industrialisés, des sommets pouvant paraître difficilement justifiables au regard de leurs performances objectives.
A. LE NIVEAU TRÈS ÉLEVÉ DE LA PLUPART DES RÉMUNÉRATIONS DES MANDATAIRES SOCIAUX DE TRÈS GRANDES SOCIÉTÉS
Depuis le début des années 2000, il ne s’est jamais passé plus de trois ans en France sans qu’un scandale sur la rémunération ou les indemnités de départ d’un dirigeant de grande entreprise cotée éclate ; se sont en effet succédées les affaires Messier (2002), Bernard (2005), Forgeard et Zacharias (2006), Tchuruk et Russo (2008), Morin (2009). Ce contexte a considérablement nui à l’image des chefs d’entreprise en général, dont la situation personnelle est souvent à mille lieux des privilèges dont jouissent quelques happy few. Il a aussi porté atteinte, dans une certaine mesure, à la valeur travail en anéantissant toute progressivité des rémunérations en fonction des mérites et des responsabilités.
Les rémunérations des dirigeants des plus grandes sociétés faisant appel public à l’épargne en France atteignent des montants qui peuvent donner le vertige aux salariés modestes et aux classes moyennes. Alors que, selon le Conseil de l’emploi, des revenus et de la cohésion sociale (CERCS), le revenu médian annuel des Français s’établissait en 2007 à 15 780 euros pour une personne seule et 23 664 euros pour un couple, le revenu moyen des responsables des plus grosses entreprises se situait, quant à lui, aux alentours de 5 millions d’euros, soit de 208 à 312 fois plus. Le décalage est même encore plus grand aux États-Unis, où le revenu des capitaines d’industrie et des rois de la finance a augmenté de plus de 400 % sur la période 2000-2006 quand, dans le même temps, le revenu médian des ménages a diminué de 1,1 % (4).
Se pose légitimement, dès lors, la question de la justification de ces écarts. Outre qu’ils peuvent apparaître moralement contestables, il est permis de douter qu’ils correspondent à une différence aussi gigantesque de valeur ajoutée pour la richesse d’un pays.
a) Une exception par rapport au commun des chefs d’entreprise
La grande majorité des dirigeants d’entreprise se trouve à la tête de petites ou moyennes entités. L’institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) recense 3 millions d’entreprises françaises, dont 1,2 million employant un ou plusieurs salariés.
Selon la même source, les chefs d’entreprise français gagnent en moyenne 38 500 euros par an (5). Pour autant, tous ne sont pas égaux devant les revenus.
En effet, les responsables de PME employant entre 50 et 100 personnes percevraient un revenu annuel moyen d’environ 110 000 euros, tandis que ceux dirigeant des sociétés de plus de 2 000 salariés verraient leur rémunération atteindre 470 000 euros. Le contraste est toutefois le plus saisissant avec les responsables exécutifs des plus grandes sociétés cotées de la place de Paris, dont la rémunération moyenne a atteint, en 2007, 3 millions d’euros s’agissant des 120 plus importantes (SBF 120) et 4,7 millions d’euros pour les 40 premières (CAC 40), options de souscription ou d’achat d’actions – les fameuses stock-options – incluses.
Ces disparités selon la taille des entreprises se doublent également de disparités selon les secteurs d’activité. Les rémunérations varieraient du simple au double entre la construction (un peu moins de 100 000 euros en moyenne), et la finance (un peu plus de 210 000 euros). Le statut de l’entreprise influe lui aussi, puisque les émoluments des dirigeants de sociétés indépendantes sont souvent moindres (à peine plus de 90 000 euros en moyenne) que ceux de filiales de grands groupes de taille équivalente (environ 140 000 euros).
En définitive, comme le souligne le journaliste Patrick Bonazza, dans un ouvrage au titre sans équivoque : « Un gouffre sépare donc l’univers des petits patrons et celui des P-DG du CAC 40. (…) Là, on change d’échelle. On est sur une autre planète qui s’apparente un peu à celle des stars du show business. » (6).
À leur décharge, le cas des dirigeants des principales sociétés cotées françaises n’est pas atypique dans l’économie mondiale actuelle. En effet, par comparaison, la rémunération moyenne, hors stock-options, des dirigeants des sociétés du FTSE 100 britannique avoisine les 2,8 millions d’euros (montant porté à 4,2 millions d’euros avec les stock-options), celle des managers des sociétés du DAX 30 allemand près de 3 millions d’euros et celle des responsables des 500 plus grandes sociétés américaines, environ 11 millions d’euros (7). Plus récemment, une étude de l’institut RiskMetrics, rendue publique le 23 mars 2009 par la Commission européenne, constatait pour sa part que la rémunération médiane des dirigeants d’entreprise en Europe a augmenté de 74 % entre 2003 et 2007, afin de se situer aux alentours de 2,8 millions d’euros (8).
COMPARAISONS DES RÉMUNÉRATIONS GLOBALES POUR 2007 DE QUELQUES DIRIGEANTS FRANÇAIS AVEC CELLES DE LEURS HOMOLOGUES AMÉRICAINS
Secteurs |
FRANCE |
ÉTATS-UNIS |
Banques |
Baudoin Prot (BNP-Paribas) : 3,3 millions d’euros |
Lloyd Blankfein (Goldman Sachs) : 70,3 millions de dollars |
Daniel Bouton (Société générale) : 3,2 millions d’euros |
Richard Fuld (Lehman Brothers) : 40 millions de dollars | |
Georges Pauget (Crédit agricole) : 2,1 millions d’euros |
James Dimon (JP Morgan Chase) : 30,4 millions de dollars | |
Michel Lucas (Crédit mutuel) : 1,4 million d’euros |
John Thain (Merrill Lynch) : 17,3 millions de dollars | |
Charles Milhaud (Caisse d’épargne) : 1,6 million d’euros |
Kenneth Lewis (Bank of America) : 16,4 millions de dollars | |
Industrie automobile |
Carlos Gohsn (Renault) : |
Rick Wagoner (General Motors) : 15,7 millions de dollars |
Christian Streiff (PSA) : |
Alan Mulally (Ford) : |
De surcroît, les mandataires sociaux ne sont pas toujours les mieux rémunérés dans leur propre société car ils sont parfois dépassés par des responsables de filiales étrangères ou certains experts, tels que les traders dans les banques, par exemple.
b) Des justifications difficiles à admettre pour l’opinion
L’écart entre rémunérations des dirigeants de petites et de grandes sociétés n’est pas en soi condamnable, dès lors que les résultats obtenus par les intéressés sont à la hauteur de la mission qui leur a été confiée par les actionnaires, dans une logique « gagnant-gagnant ». En outre, il convient de ne pas perdre de vue que, même si les PME réalisent la moitié de la production nationale et emploient 60 % des salariés de droit privé, les grandes sociétés de dimension transnationale et exportatrices contribuent aussi à l’emploi, ne serait-ce qu’en faisant vivre de nombreux sous-traitants, et à la création de richesse, notamment fiscale.
Cependant, on est en droit de s’interroger sur l’ampleur du hiatus constaté. Certains arguments avancés pour le justifier suscitent d’ailleurs quelques interrogations. C’est notamment le cas de celui de la concurrence internationale à laquelle seraient confrontées les grandes sociétés pour recruter les meilleurs dirigeants. Les responsables ou anciens responsables exécutifs français de groupes étrangers aussi prestigieux que Glaxo SmithKline, Unilever ou Corus n’avaient auparavant jamais exercé de mandat social à la tête de l’une des sociétés du CAC 40 ; ils n’ont ainsi pas été débauchés mais ont acquis par eux-mêmes leurs fonctions à l’étranger. Cela ne signifie pas pour autant que la notion de marché international des cadres dirigeants n’a aucun sens, une véritable compétition s’exerçant dans le recrutement de certaines catégories intermédiaires très qualifiées et mobiles géographiquement. En outre, il n’est pas très surprenant que les conseils d’administration ou de surveillance tiennent compte des pratiques en vigueur à l’étranger pour déterminer la rétribution des dirigeants mandataires sociaux auxquels ils accordent ou renouvellent leur confiance.
Au-delà de sa dimension morale, le problème soulève une véritable interrogation sur la justesse de l’allocation des ressources au sein des entreprises. En effet, si les dirigeants mandataires sociaux exercent une mission importante en contribuant incontestablement à l’essor de la société dont ils ont la charge, il n’est pas pour autant certain que leur travail puisse effectivement se monétiser à hauteur de plusieurs centaines de fois celui des salariés de base. Chacun, à son niveau, participe à la réalisation des objectifs et à la recherche des profits. En outre, si l’on rapporte l’utilité sociale d’un dirigeant mandataire social à celle d’un chirurgien, d’un gardien de la paix ou d’un pompier, on peut légitimement s’interroger sur le fossé financier qui les sépare.
Même sur un plan strictement économique, il est permis de douter que les niveaux atteints par les rémunérations de la majorité des mandataires sociaux des sociétés du CAC 40 présente aujourd’hui une corrélation étroite avec les résultats de leur gestion, alors qu’il en va tout autrement du commun des chefs d’entreprise français, notamment ceux à la tête des TPE et des PME. En effet, un chef de petite ou moyenne entreprise réinvestit la plupart du temps l’argent qu’il retire de son activité, de sorte que sa rémunération réelle est différée en ce qu’elle réside dans la capitalisation de sa société. Un dirigeant mandataire social, quant à lui, se comporte plus souvent comme un administrateur d’entreprise, appointé à cet effet et financièrement prémuni à l’encontre de tout risque de licenciement intempestif. En cela, les garanties qui lui sont offertes (actions, options et indemnités) atténuent considérablement le caractère motivant de sa révocabilité.
2. Les différentes strates des émoluments des mandataires sociaux : des mécanismes inflationnistes
Les mandataires sociaux de grandes entreprises cotées n’entretiennent pas un lien patrimonial et affectif aussi fort que les dirigeants de PME familiales avec la société qu’ils administrent. Sortes de gestionnaires « mercenaires » recrutés par un actionnariat le plus souvent morcelé, ils portent attention aux conditions financières qui leur sont consenties alors que les dirigeants de PME familiales placent la pérennité de leur société au premier plan. Au fur et à mesure, les avantages liés à la rémunération des mandataires sociaux de grandes entreprises se sont étoffés et sophistiqués.
Rémunération de base agrémentée de bonus variables, actions gratuites ou obtenues dans le cadre de plans d’achat ou de souscription, indemnités de départ et retraites supplémentaires à prestations définies… : tels sont aujourd’hui les différents sous-ensembles du package négocié entre chaque grande société et ses dirigeants. Les indications rendues publiques, en vertu de la transparence désormais exigée par la loi, montrent que les situations et le profil des rémunérations varient selon chaque entreprise. Il n’en demeure pas moins que les montants frappent par leurs niveaux. Surtout, en dépit de leur supposé caractère cyclique, ils restent tendanciellement orientés à la hausse (9), ce qui traduit leur caractère foncièrement inflationniste. Le contexte actuel ne dément d’ailleurs pas véritablement ce constat puisque, malgré l’ampleur de la crise, quatorze dirigeants de sociétés du CAC 40 ont vu leurs rémunérations progresser entre 2007 et 2008 ; quant aux baisses les plus significatives, elles ont surtout affecté leurs homologues de secteurs dans lesquels l’État avait demandé des contreparties à son soutien financier (banques et automobile).
DÉTAIL DES ÉLÉMENTS DE RÉMUNÉRATION ACCORDÉS PAR LES CINQ SOCIÉTÉS FRANÇAISES COTÉES QUI ONT LE MIEUX RÉTRIBUÉ
LEURS DIRIGEANTS EXÉCUTIFS EN 2007 (en millions d’euros)
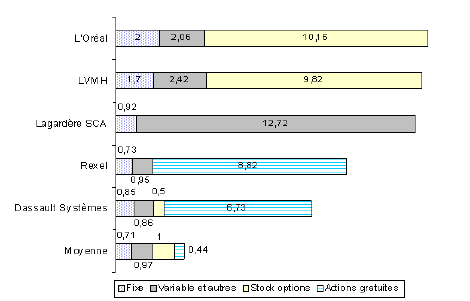
Source : Proxinvest
Les mandataires sociaux ne sont pas à proprement parler des salariés de la société qu’ils dirigent. Pour autant, ils se trouvent dans une situation contractuelle avec elle et perçoivent une rémunération fixe de base, assortie d’un complément variable (pouvant atteindre jusqu’à deux fois le montant annuel de la rémunération fixe) indexé sur les résultats de chaque intéressé.
En France, la rémunération de base annuelle des mandataires sociaux ne constitue qu’une petite partie de leurs émoluments annuels. Une étude relativement récente du cabinet de consultants Hay Group a démontré que, sans atteindre une proportion aussi faible qu’aux États-Unis (42 %), elle ne représente qu’un peu plus de la moitié de la rémunération globale annuelle des dirigeants de grandes sociétés (54 %) alors que dans le reste de l’Europe elle dépasse les deux tiers (69 %).
RÉMUNÉRATION ANNUELLE DE BASE DES DIRIGEANTS DE SOCIÉTÉS
RÉALISANT UN CHIFFRE D’AFFAIRES SUPÉRIEUR À 10 MILLIARDS D’EUROS
(en % de la rémunération totale directe)
Europe |
France |
États-Unis | |
Bonus annuel |
35 % |
27 % |
23 % |
Salaire de base annuel |
34 % |
27 % |
19 % |
Source : Étude comparative réalisée en 2006 par le cabinet Hay Group auprès de 203 sociétés européennes de 16 pays et 139 sociétés américaines, publiée dans la Tribune, le 12 juin 2007. | |||
Selon le cabinet Proxinvest, la rémunération fixe des dirigeants des sociétés du SBF 120 a augmenté de 3,92 % en 2007. La part variable, quant à elle, a connu une évolution plus marquée, avec une hausse de 20,64 %.
En fait, plus que les émoluments fixes, ce sont les bonus qui prêtent le flanc à la critique en raison de conditions d’attribution souvent peu explicites et d’une évolution parfois déconnectée de la santé économique des entreprises concernées. Le journaliste Patrick Bonazza indique ainsi, dans son ouvrage précédemment mentionné (10), que le président-directeur général du groupe Suez s’est vu attribuer, en 2003, un bonus de 1,59 million d’euros en dépit d’une perte de la société chiffrée à 2,3 milliards d’euros ; l’intéressé décida tout de même de sa propre initiative de réduire de 50 % ce bonus, compte tenu des circonstances.
De manière surprenante, il arrive également que ces éléments de rémunération variable soient accordés à des responsables non exécutifs, c’est-à-dire aux anciens dirigeants qui continuent d’exercer la présidence du conseil d’administration ou du conseil de surveillance sans pour autant s’impliquer dans la gestion au jour le jour. Il en va ainsi, notamment, dans des entreprises comme L’Oréal, Total, Vinci ou Sanofi-Aventis.
La logique sous-jacente à l’attribution des bonus, assimilables à une prime d’efficacité, apparaît donc souvent dévoyée dans les faits. Naturellement, on ne saurait s’en tenir à la seule observation des cours de bourse et des résultats comptables pour apprécier la performance d’un mandataire social : dans les circonstances de la crise actuelle, la conjoncture influe nécessairement sur les résultats des entreprises, de sorte que c’est davantage au regard des performances relatives de chaque société, vis-à-vis du reste de son secteur, que les bonifications doivent être, le cas échéant, consenties. Il n’en demeure pas moins que l’on ne peut que regretter que « le bonus résiste fortement à la baisse et s’emballe à la hausse » (11) et qu’il soit attribué, dans certains cas, à des personnes qui n’exercent plus de responsabilités opérationnelles au sein de l’entreprise.
DÉTAIL DES ÉLÉMENTS DE RÉMUNÉRATION ACCORDÉS PAR LES CINQ SOCIÉTÉS FRANÇAISES COTÉES QUI ONT LE MIEUX RÉTRIBUÉ
LEURS DIRIGEANTS NON EXÉCUTIFS EN 2007 (en millions d’euros)
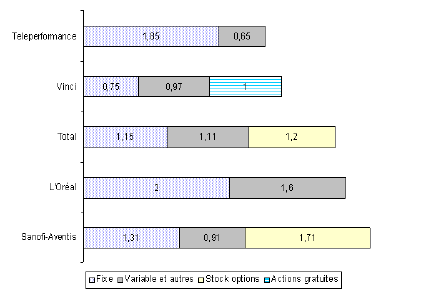
Source : Proxinvest
b) Les options de souscription et d’achat d’actions
Parce qu’elles touchent, de fait, à la rémunération de catégories sociales parmi les plus aisées, les options de souscription ou d’achat d’actions font régulièrement l’objet de remises en cause, alimentées par les abus de ce qui reste fort heureusement une petite minorité de leurs bénéficiaires. Il est vrai que la complexité technique de la question (dans ses volets juridique et fiscal, notamment) nourrit toutes sortes de fantasmes nuisibles à ce qui demeure, avant tout, un instrument de participation et de motivation des salariés, en théorie susceptible de bénéficier à leur ensemble sans distinction.
• Une combinaison entre intéressement et participation au capital
Directement inspirés des « stock-options plans » anglo-saxons, les plans d’options de souscription ou d’achat d’actions ont été introduits dans notre droit par la loi n° 70-1322 du 31 décembre 1970, relative à l’ouverture d’options de souscription ou d’achat d’actions au bénéfice du personnel des sociétés. Concrètement, il s’agit d’une forme mixte d’intéressement et de participation au capital, dans laquelle l’entreprise consent à son personnel le droit d’acquérir ses propres actions à des conditions privilégiées, lui offrant ainsi l’occasion de réaliser une plus-value.
Les plans d’options peuvent porter soit sur la souscription, soit sur l’achat d’actions. Le premier cas, prévu à l’article L. 225-177 du code de commerce, porte sur des titres virtuels et débouche sur une augmentation de capital soumise à une procédure allégée, en termes de publicité ou de paiement notamment. Le second cas, prévu à l’article L. 225-179 du code de commerce, s’applique à des titres déjà émis et préalablement rachetés à cette fin par la société. Si elles sont équivalentes pour leurs bénéficiaires, ces deux techniques s’apprécient différemment du point de vue des dirigeants et des actionnaires : les options de souscription apparaissent certes plus faciles à gérer mais elles conduisent aussi à une certaine dilution du capital. La définition des modalités arrêtées est donc affaire d’opportunité.
Dans les deux cas de figure, la procédure se déroule en trois étapes. Dans un premier temps, la société attribue au bénéficiaire le droit, pendant une période donnée, de se porter acquéreur d’un certain nombre de titres à un prix déterminé. Ce prix, qui ne peut être inférieur à 80 % de la moyenne des cours du marché des vingt séances de bourse précédentes, aux termes des articles L. 225-177 et L. 225-179 du code de commerce, reste fixe pendant toute la période durant laquelle l’option est ouverte (article L. 225-181 du même code).
Dans un second temps, le bénéficiaire peut choisir de lever l’option qui lui a été attribuée. Sa démarche se trouve dictée par le niveau du cours ou de la valeur des actions. Si ceux-ci ont progressé au-delà du prix fixé lors de l’attribution, le bénéficiaire obtient alors une plus-value. Cependant, cette étape implique pour lui un décaissement, puisqu’il doit payer au prix convenu les actions sur lesquelles portait son option.
Enfin, dans un dernier temps, le bénéficiaire qui a exercé sa levée d’options a la possibilité de revendre les actions qu’il a ainsi acquises. Ce n’est qu’à ce stade qu’il rentre dans ses fonds et jouit effectivement de sa plus-value. Il peut également décider de conserver ses titres, dans l’espoir de voir sa plus-value progresser encore.
Même s’il existe de nombreuses différences avec le système en place en France, comme l’illustre l’encadré ci-après, le régime des stock-options aux États-Unis procède initialement de la même logique incitative grâce, non pas à des minorations de prix lors de la souscription ou de l’achat des actions, mais à des avantages fiscaux.
LE RÉGIME DES STOCK-OPTIONS AUX ÉTATS UNIS
Le régime des stock-options, n'est pas le même, aux États-Unis, selon que celles-ci concernent une minorité d'employés, ou au contraire une large majorité d'entre eux.
Avant même que le développement des sociétés de l’Internet ne conduise, à la suite de l'exemple antérieur de Microsoft pour les nouvelles technologies, à une très large diffusion des stock-options dans les start up, certaines entreprises américaines ont, en effet, procédé à une large distribution des stock-options : PepsiCo, Cisco, Starbuck et Whole Foods.
1. les plans d'attribution à tous les employés
Les Incentive stock-options (ISO) bénéficient d'un régime fiscal de faveur, mais doivent respecter certaines conditions, qui sont pour l'essentiel les suivantes :
- les options sont proposées à tous les salariés et uniquement à eux (les membres non salariés du Board n'y ont pas droit) et doivent être exercées dans les trois mois au plus, en cas de départ de l'entreprise ;
- le plan fait l'objet d'un document écrit, qui doit être approuvé dans les douze mois par les actionnaires, et préciser le nombre de parts délivrées et les employés concernés ;
- un délai maximum de dix ans est prévu tant pour l'attribution de l'option qu'ensuite, pour son exercice ultérieur ;
- chaque option est attribuée dans le cadre d'un accord qui précise les conditions de son exercice, et notamment la période pendant laquelle elle peut être exercée à l'intérieur des limites générales précédentes ;
- le prix d'exercice ne peut être inférieur à la valeur de marché de l'action au jour de l'attribution de l'option ;
- les salariés ne doivent pas détenir, à la date d'attribution, un capital représentant plus de 10 % des droits de vote de l'entreprise, à moins que la valeur de l'exercice ne soit d'au moins 10 % supérieure à la valeur de marché et que l'option ne puisse être exercée dans un délai supérieur à cinq ans ;
- la valeur des actions acquises lors de l'exercice d'options ne peut excéder 100 000 dollars sur une période de douze mois. Au-delà, les ISO sont soumis au régime des non qualified options, qui sont discrétionnairement attribuées.
Sur le plan fiscal, l'avantage des ISO concerne les employés, qui ne paient que le seul impôt sur la plus-value entre le prix d'exercice et le prix de cession.
2. Les attributions discrétionnaires
Les non qualified options ne bénéficient d'aucun avantage fiscal. Elles peuvent être attribuées à tout employé, et même aux personnes qui ne sont pas salariées, selon le choix de l'entreprise. La différence entre la valeur lors de d'exercice et le prix fixé lors de l'attribution de l'option est assujettie à l'impôt sur le revenu. La somme correspondante est déduite du résultat de l'entreprise.
Pour les dirigeants d'entreprise, les stock-options ont été créées pour contourner les plafonds prévus en matière fiscale pour la déductibilité des salaires.
• Le caractère jusqu’à présent discrétionnaire du dispositif
Dispositifs souples par essence, les plans d’options de souscription ou d’achat d’actions ont prêté le flanc à certaines dérives. Au fil du temps, ils sont devenus l’apanage d’une partie trop réduite des salariés des sociétés, les dirigeants mandataires sociaux en étant jusqu’à présent les principaux bénéficiaires, comme l’illustre le tableau ci-après.
PROPORTION DES STOCK-OPTIONS RÉSERVÉES AUX DIRIGEANTS
DE CERTAINES SOCIÉTÉS DU CAC 40
Sociétés |
Proportion réservée aux dirigeants |
Nombre de dirigeants bénéficiaires |
Vallourec |
31 % |
4 (en 2007) |
Vinci |
31 % |
13 (en 2006) |
Société générale |
30 % |
11 (en 2007) |
Renault |
22 % |
7 (en 2007) |
Axa |
21 % |
6 (en 2008) |
Bouygues |
19,5 % |
12 (en 2007) |
Alstom |
18 % |
6 (en 2007) |
Air Liquide |
17 % |
11 (en 2007) |
EADS |
8 % |
2 (en 2006) |
Total |
5 % |
3 (en 2007) |
Source : AMF. | ||
En France, en 2007, à peine 300 000 salariés étaient attributaires de telles options, dont 140 000 dans certaines sociétés du CAC 40, au rang des plus vertueuses desquelles figuraient Alcatel-Lucent (39,8 % du personnel), Vivendi (19,7 %) et Essilor (18,1 %).
Les plans d’options ne peuvent être mis en œuvre que dans des sociétés par actions. La procédure à suivre implique donc tout naturellement les deux organes sociaux prévus pour ce type de sociétés : l’assemblée générale des actionnaires et le conseil d’administration ou le directoire.
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires est logiquement amenée à intervenir en raison des incidences des plans sur la composition du capital de la société. Aux termes des articles L. 225-177 et L. 225-179 du code de commerce, elle autorise le principe du plan, elle précise le délai au cours duquel les options pourront être attribuées et elle détermine les modalités de fixation du prix des options.
Le conseil d’administration ou le directoire, quant à lui, propose à l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires la mise en œuvre du plan d’options. Surtout, il assure la gestion pratique du plan, en fixant les conditions qui s’attachent aux options, en attribuant ces dernières et en arrêtant leur prix sur la base des principes fixés par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires.
La mise en œuvre concrète dépend largement du conseil d’administration ou du directoire, principaux régulateurs du système. C’est donc eux, voire même leur président, qui arrêtent de façon largement autonome des éléments aussi déterminants que le choix des bénéficiaires des options. Or, dans les faits, force est de constater que ce choix se portait initialement sur les principaux cadres, les dirigeants ou certaines catégories essentielles de salariés, alors même que le mécanisme des plans d’options est supposé s’adresser à un éventail plus large de salariés. Avant l’adoption de la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 relative aux revenus du travail, la marge d’autonomie du conseil d’administration ou de surveillance était très large et elle pouvait être utilisée en dehors de tout contrôle ou de toute justification.
• Des rémunérations différées plus que substantielles, offrant des perspectives de gain à presque tous les coups
La plus grande partie des revenus considérables perçus par certains dirigeants de grandes sociétés cotées émane des plus-values engendrées par la cession d’actions libérées après avoir été obtenues dans le cadre d’un plan d’option de souscription ou d’achat. Le tableau ci-après détaille, à titre d’illustration, la plus-value réalisée, entre le 1er janvier 2008 et le 25 mars 2009, à l’issue de la cession des options détenues par plusieurs mandataires sociaux du CAC 40 ; les chiffres se passent de commentaires.
GAINS DE CERTAINS DIRIGEANTS DU CAC 40 DÉTENTEURS DE STOCK-OPTIONS,
ENTRE LE 1ER JANVIER 2008 ET LE 25 MARS 2009
Bénéficiaires |
Plus-value réalisée (en €) |
Patrick Kron (Alstom) |
12,2 millions d’€ |
Gérard Mestrallet (GDF-Suez) |
5,4 millions d’€ |
Benoît Potier (Air Liquide) |
2,6 millions d’€ |
Patrick Ricard (Pernod Ricard) |
2 millions d’€ |
Xavier Huillard (Vinci) |
1,7 million d’€ |
Daniel Bouton (Société générale) |
1,5 million d’€ |
Christophe de Margerie (Total) |
826 000 € |
Franck Riboud (Danone) |
540 000 € |
Xavier Fontanet (Essilor) |
423 000 € |
Baudouin Prot (BNP-Paribas) |
332 800 € |
Henri de Castries (Axa) |
155 600 € |
Source : L’Express, 2 avril 2009. | |
En la matière, les dirigeants de grandes entreprises françaises ne font pas figure d’exception, leurs homologues anglo-saxons apparaissant encore mieux lotis. Selon le Wall Street Journal, le montant des attributions de stock-options dans les sociétés qui composent le Standard & Poor’s 500 aurait été multiplié par dix entre 1993 et 2006. Il en a résulté des gains individuels dépassant l’entendement. Le président-directeur général du groupe Oracle aurait ainsi encaissé plus d’un milliard de dollars de stock-options entre 1992 et 2005 ; son homologue de la banque City Group, récemment soutenue par l’État fédéral américain, aurait quant à lui perçu 960 millions de dollars.
En théorie, même agrémentées d’une décote de 20 % sur le cours des actions au moment de leur souscription, les actions octroyées dans le cadre d’un plan d’options de souscription ou d’achat ne devraient pas automatiquement déboucher sur une perspective de plus-value. En effet, en cas de retournement des cours de bourse, à l’instar du krach de 2008, le prix d’acquisition peut être supérieur à la possibilité de liquidation sur le marché. Pour autant, certaines techniques permettent d’atténuer, voire d’annihiler tout simplement, ce risque.
C’est le cas notamment du repricing, permettant au bénéficiaire de stock-options dont l’intérêt a fortement pâti d’une chute des cours, de renégocier le prix de ses options avec l’assentiment du conseil d’administration ou du directoire. Existe une autre technique qui, sans remettre en cause le prix des options, apporte une forme de compensation à travers un mécanisme de recharge automatique (reloading), c’est-à-dire l’octroi d’un nombre équivalent d’options nouvelles. Enfin, certaines institutions financières offrent à des détenteurs de stock-options une garantie sur les cours, entre le moment où l’option est levée et celui où elle s’exerce.
Au final, ainsi que le résume le prix nobel d’économie Joseph Stiglitz, les stock-options s’apparentent à un système où « face je gagne [NDLR : le mandataire social], pile tu perds [NDLR : la société] » (12). Toutes ces sophistications ont en effet contribué à dénaturer les principes inhérents aux plans d’options de souscription ou d’achat d’actions, en les transformant en instruments de rémunération différée au détriment de leur objet initial, qui était de motiver les cadres dirigeants à assurer le succès de leur entreprise.
• Un mécanisme non à l’abri de pratiques frauduleuses
Les fraudes demeurent rares mais elles causent, par leur forte médiatisation, un grand tort aux stock-options, dont l’existence même se trouve ainsi remise en cause. Il convient de distinguer en l’espèce l’abus de droit du délit d’initiés.
Dans le premier cas, la valorisation du cours boursier de l’entreprise se voit artificiellement gonflée grâce à toutes sortes de techniques : transfert d’actifs sur une filiale spécialement créée à cet effet et sur laquelle porte le plan d’options, ajustement des périmètres de filiales consécutivement à l’adoption d’un plan, attribution antidatée d’options. Ces pratiques répréhensibles ne sont pas toujours aisées à déceler, ce qui explique leur subsistance, même à un niveau relativement marginal.
Dans le deuxième cas, certains bénéficiaires jouissant d’une position importante au sein de la société se servent des informations auxquelles ils ont accès dans le cadre de leurs fonctions pour spéculer sur les options qu’ils se sont vus attribuer, maximisant ainsi leur plus-value. Selon l’article L. 465-1 du code monétaire et financier, le délit d’initié se caractérise par la réalisation d’opérations sur le marché, en s’appuyant sur des données ou des perspectives encore ignorées du public et susceptibles d’influencer le cours du titre. Si la date de réunion du conseil d’administration fixant le prix des options n’est pas neutre, surtout si elle intervient à la veille d’annonces stratégiques, c’est surtout à l’occasion de la cession de titres levés par les bénéficiaires que la question du délit d’initiés se pose.
De manière plus générale, comme l’a souligné un rapport d’information de MM. Jean Arthuis, Paul Loridant et Philippe Marini, au nom de la commission des Finances du Sénat, publié au printemps 1995 : « il faut bien admettre que la population à laquelle s’adresse généralement les options est, de par ses fonctions, détentrice d’informations sur les perspectives de la société. Or, faute de règles claires et publiques, une telle situation est de nature à entretenir, sans doute à tort, un désagréable climat de suspicion. » (13). En dépit des avancées obtenues, depuis la publication de ce constat, en termes de transparence sur les conditions d’exercice de la levée d’options, force est de reconnaître que ce climat de suspicion demeure.
L’attribution gratuite d’actions a été introduite dans notre droit des sociétés à l’initiative de M. Édouard Balladur, lors de l’examen de la loi de finances initiale pour 2004. L’ambition de l’auteur de cette innovation était de pallier les imperfections des stock-options en permettant une association la plus large possible des salariés au capital – et, partant, aux résultats – de leur entreprise.
Aux termes des articles L. 225-197-1 à L. 225-197-6 du code de commerce, l’assemblée générale extraordinaire peut autoriser le conseil d’administration ou le directoire à procéder, au profit des membres du personnel salarié de l’entreprise ou à une partie seulement, à une attribution gratuite des actions existantes ou à émettre. Le procédé est ainsi calqué sur celui des stock-options dans son déroulement.
À l'instar des options de souscription ou d’achat d’actions, les actions gratuites ne sont définitivement acquises qu’au terme d’une durée fixée par l’assemblée générale (période d’acquisition) et ne pouvant être inférieure à deux ans. Elles doivent en outre faire l’objet d’une durée minimale de conservation par leurs bénéficiaires (appelée période de cession), fixée là aussi par l’assemblée générale et ne pouvant être inférieure à deux ans.
S’ils sont éligibles au dispositif, le président du conseil d’administration, le directeur général, les membres du directoire et le gérant de société par actions sont toutefois soumis à des modalités un peu particulières, dans la mesure où le conseil d’administration ou de surveillance doit fixer la proportion d’actions gratuites ainsi attribuées qui ne peuvent être cédées avant la fin de leur mandat. Un tel mécanisme se veut résolument moralisateur.
Le problème est qu’en droit, rien ne s’oppose à ce qu’un mandataire social puisse cumuler l’attribution de stock-options avec des actions gratuites. Ce faisant, il lui est possible de bénéficier des avantages financiers des deux formules et d’accroître un peu plus sa rémunération différée, indépendamment de sa performance d’ailleurs puisque le gain issu d’une cession d’actions gratuites est systématique. Se trouvaient dans un tel cas de cumul en 2008, parmi les dirigeants du CAC 40, ceux des sociétés Alcatel-Lucent (250 000 options et 250 000 actions gratuites attribuées), Alstom (57 500 options et 1 000 actions gratuites attribuées), Axa (390 000 options et 84 000 actions gratuites attribuées), Schneider Electric (63 000 options et 6 750 actions gratuites attribuées) et Vivendi (360 000 options et 30 000 actions gratuites attribuées).
L’article 1984 du code civil définit le mandat comme l’acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le mandat devient social lorsqu’il est donné par une personne morale à une personne physique afin que celle-ci assure sa direction, sa gestion et son contrôle.
Juridiquement, les dirigeants mandataires sociaux ne sont pas liés à la société qu’ils administrent par un contrat de travail, dans la mesure où ils ne se trouvent pas subordonnés à leur mandant. Leur relation contractuelle obéit donc à des règles spécifiques, essentiellement fixées par le droit commercial. Révocables ad nutum, c’est-à-dire sans préavis ni justification, ils se trouvent ainsi en situation de relative précarité juridique par rapport aux salariés de droit commun. Cette situation est compensée par des émoluments significatifs. Elle est parfois atténuée, pour ne pas dire contournée, par l’attribution d’indemnités de départ dont le montant peut être majoré en cas d’existence d’un contrat de travail dont les intéressés bénéficiaient avant leur nomination à la tête de l’entreprise et suspendu le temps de leur mandat.
Eu égard aux montants consentis dans ce cadre, ces indemnités de départ se trouvent habituellement désignées par le vocable imagé de « parachute doré ». Depuis dix ans, elles se sont généralisées, y compris en période de reprise économique. Très peu de sociétés cotées et, à vrai dire très peu de mandataires sociaux, y ont dérogé. Selon une étude du cabinet Hewitt, rendue publique par le quotidien Le Monde début janvier 2009, pas moins de 79 % des dirigeants des sociétés du SBF 120 en bénéficiaient l’an passé, soit au titre de leur mandat social (à hauteur de 31 %), soit au titre d’un contrat de travail (48 %) (14). Devenues aujourd’hui une composante à part entière de la part variable de la rémunération des dirigeants, ces indemnités ont atteint une proportion plus que significative des salaires de base, à en juger par l’étude comparative réalisée en 2006 par le cabinet Hay Group auprès de 203 sociétés européennes de 16 pays et 139 sociétés américaines et publiée dans le quotidien La Tribune, le 12 juin 2007.
LE MONTANT DES INDEMNITÉS DE DÉPART DES DIRIGEANTS D’ENTREPRISE
AUX ÉTATS-UNIS ET DANS LES PRINCIPAUX PAYS EUROPÉENS EN 2006
(en % de la rémunération de référence)
États-Unis |
200 à 300 % de la rémunération en espèces dans la moitié des cas ; |
Allemagne |
250 % du salaire de base |
France |
200 % de la rémunération en espèces |
Pays-Bas |
100 % à 200 % du salaire de base |
Royaume-Uni |
100 % de la rémunération en espèces |
Source : Hay Group, étude publiée dans le quotidien La Tribune, le 12 juin 2007, p. 34 et 35. | |
Fondamentalement, les dirigeants d’entreprise sont des gestionnaires, recrutés pour développer une société et valoriser sa valeur boursière. L’absence de lien systématique entre le versement d’une rémunération différée substantielle, au moment du départ d’un dirigeant de société et la réalisation effective d’objectifs de performance économique par celui-ci, a donc de quoi choquer.
L’exemple le plus caricatural en la matière est sans doute fourni par l’ancien président-directeur général du groupe Worldcom qui, malgré la faillite de sa société, s’est vu accorder en 2002 le remboursement d’un prêt de 400 millions de dollars ainsi que des indemnités annuelles avoisinant 1,5 million de dollars. Plus directement en rapport avec la crise actuelle, l’ancien directeur général de la banque Fortis, M. Paul Voltron, a quant à lui bénéficié, avant la nationalisation de cette dernière puis sa cession à BNP-Paribas, du versement d’une indemnité de départ de 1,35 million d’euros.
Des cas similaires ont été observés en France. C’est ainsi que, alors qu’il était renvoyé parce qu’il n’avait pas réussi à garantir la mise au point dans les délais prévus de l’Airbus A 380, le précédent président exécutif du groupe EADS a perçu quelque 8,2 millions d’euros (soit 1,2 million d’euros de préavis, 4,9 millions d’euros d’indemnité et 2,4 millions d’euros de prime de non-concurrence). Cette indemnité est apparue d’autant plus choquante qu’elle intervenait au moment même où les difficultés industrielles et commerciales que son bénéficiaire n’avait pu ni empêcher, ni prévenir conduisaient le groupe qu’il avait dirigé à licencier près de 10 000 personnes. Plus récemment, de telles pratiques auraient pu être mises en œuvre à l’occasion du renouvellement des dirigeants de Dexia (une indemnité de 3,7 millions d’euros étant notamment prévue pour l’ancien directeur général de la banque) si les autorités françaises n’avaient pesé de tout leur poids pour empêcher cette perspective inacceptable.
QUELQUES EXEMPLES RETENTISSANTS DE PARACHUTES DORÉS
Années |
Mandataire social concerné |
Société |
Montant |
1989 |
F. Ross Johnson |
RJ Reynolds Tobacco |
58,0 millions de dollars |
2002 |
Jean-Marie Messier |
Vivendi-Universal |
20,5 millions d’euros (1) |
2003 |
Philippe Jaffré |
Elf |
10,0 millions d’euros |
2003 |
Jean-Pierre Tirouflet |
Rhodia |
2,1 millions d’euros |
2005 |
Carly Fiorina |
Hewlett Packard |
42,0 millions de dollars |
2005 |
Daniel Bernard |
Carrefour |
9,9 millions d’euros |
2006 |
Noël Forgeard |
EADS |
8,2 millions d’euros |
2006 |
Antoine Zacharias |
Vinci |
10,0 millions d’euros (1) |
2007 |
Charles Prince |
Citygroup |
40,0 millions de dollars |
2007 |
Rijkman Groenink |
ABN Amro |
4,3 millions d’euros |
2008 |
Serge Tchuruk |
Alcatel-Lucent |
5,2 millions d’euros |
2008 |
Patricia Russo |
Alcatel-Lucent |
6,0 millions d’euros |
2008 |
Martin Sullivan |
AIG |
68,0 millions de dollars |
2009 |
Thierry Morin |
Valeo |
3,2 millions d’euros |
(1) Non versés, faute d’accord définitif du conseil d’administration. | |||
Certes, il existe aussi des contre-exemples, à l’image de M. Pierre Bilger, ancien président-directeur général d’Alstom qui, en 2003, renonça à un parachute doré de 4,1 millions d’euros en raison des difficultés de son entreprise. Il convient également de citer le cas de M. Louis Gallois, président exécutif en fonction du groupe EADS, qui a refusé que soit prévu un tel avantage lors de son recrutement. Néanmoins, de tels exemples restent minoritaires. Dans les faits, la pratique des parachutes dorés s’est ainsi peu à peu transformée en véritable politique de rémunération.
Aspect peu critiqué car assez peu connu du grand public, les retraites supplémentaires à prestations définies constituent un élément différé très substantiel des rémunérations consenties aux mandataires sociaux. La loi n° 2003-775 du 21 août 2003, portant réforme des retraites, a donné un cadre juridique, fiscal et social à ce type particulier de pensions, désormais définies et régies par l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale.
Financées par les entreprises employeurs, elles garantissent à leurs bénéficiaires un niveau de pension prédéterminé, correspondant à un pourcentage du dernier salaire annuel perçu. Compensant la différence entre les montants versés par les régimes de cotisation obligatoire (AGIRC et ARRCO) et le plancher garanti, elles donnent lieu, le plus souvent à des provisions considérables au moment du départ de leur bénéficiaire. Le cas le plus emblématique de ces dernières années est celui de l’ancien président-directeur général du groupe Carrefour, M. Daniel Bernard. Afin de lui assurer une retraite annuelle de 1,2 million d’euros, l’entreprise avait dû provisionner dans ses comptes pas moins de 29 millions d’euros. Dans une décision rendue le 7 octobre 2008, la Cour d’appel de Paris a néanmoins prononcé la nullité de la convention sur laquelle reposait cette retraite supplémentaire, en raison non seulement d’un défaut d’autorisation préalable du conseil d’administration du groupe Carrefour et, de surcroît, des conséquences dommageables que cet avantage revêtait pour la société (15).
Il n’en demeure pas moins que de tels montants semblent monnaie courante dans les grandes sociétés cotées. À titre d’illustration, on mentionnera qu’Antoine Zacharias (ancien PDG de Vinci) est assuré de percevoir 2,2 millions d’euros chaque année à ce titre, que MM. Jean-René Fourtou (Vivendi) et Alain Joly (Air Liquide) bénéficient d’une retraite annuelle de 1,2 million d’euros, tandis que M. Bertrand Colomb (Lafarge) se voit verser une rente de 1 million d’euros tous les ans du fait de ses anciennes fonctions.
Il existe des variantes, qui peuvent prendre la forme d’une distribution d’actions gratuites (Eiffage) ou d’une prime exceptionnelle, équivalente à la somme des bonus perçus sur une certaine durée (Publicis). Dans le dernier de ces deux cas particuliers, le document de référence de la société concernée indique une provision cumulée de 9,7 millions d’euros. De tels dispositifs présentent toutefois l’avantage de coûter un peu moins cher à l’entreprise ou d’être mieux indexés sur les performances des intéressés.
Tous ces avantages sont nécessairement avalisés par les conseils d’administration ou de surveillance des entreprises. Cette formalité ne pose cependant pas beaucoup de problèmes, dans la mesure où les membres de ces conseils entretiennent le plus souvent des relations étroites avec les dirigeants opérationnels, quand ils ne bénéficient pas pour une part d’entre eux des mêmes acquis.
B. DES OPÉRATEURS FINANCIERS EN PROIE À UNE TROP GRANDE CUPIDITÉ
Le cas des opérateurs financiers des grandes banques et sociétés d’assurance se distingue de celui des mandataires sociaux en ce que certaines rémunérations individuelles, liés à des fonctions spécifiques il est vrai, sont parfois encore plus démesurées. Surtout, la transparence a moins court, ce qui autorise davantage d’abus. Pareil constat suscite d’autant plus d’insatisfaction que, pour paraphraser Patrick Artus et Marie-Paule Virard, « Comme la soif de l’or autrefois, la soif de rendement a entraîné la planète finance aux confins de la crise systémique » (16).
1. Un système de rémunération intrinsèquement imparfait
Primes salariales, versées en numéraire, les bonus sont apparus au sein des grands établissements bancaires anglo-saxons dans les années 1980. Ils se sont généralisés par la suite, en s’hybridant en France avec le mode traditionnel de rémunération des agents de change.
Leurs modalités de distribution sont assez peu formalisées et varient d’un établissement à l’autre. La plupart du temps, la direction générale alloue aux responsables de services une enveloppe de primes définie en fonction de l’appréciation des résultats obtenus, à charge pour les chefs de services d’en répartir ensuite le montant à leurs subordonnés.
Le taux des bonus distribués chaque mois de février se négocie au printemps de l’année précédente. Dans un récent rapport du Conseil d’analyse économique consacré à la crise des subprimes, M. Olivier Godechot, chercheur au CNRS, pointait une « forte hétérogénéité et l’adaptation de la règle à des rapports de force locaux entre les lignes de métier et la direction de la banque » (17). Et le chercheur de poursuivre : « Le taux varie très fortement entre les lignes de métier. Il peut descendre à 5 % pour la trésorerie, et monter jusqu’à plus de 30 %, voire 35 % pour les dérivés, en particulier les dérivés actions. »
De fait, cette mécanique de rémunération apparaît profondément inégalitaire. Et cela est d’autant plus contestable que les personnels qui occupent les fonctions de back-office, c’est-à-dire ceux qui vérifient la conformité des opérations engagées par les traders et les vendeurs aux normes de sécurité internes fixées par leur employeur, bénéficient généralement des primes les moins élevées. Dans l’échelle des heureux bénéficiaires, les traders et les vendeurs se situent au premier plan (376 000 euros en moyenne), devant les ingénieurs de marchés (217 000 euros), souvent plus diplômés, puis les analystes financiers (130 000 euros) et les métiers support, dont notamment ceux dévolus au contrôle des risques (80 000 euros).
Ainsi que le souligne le rapport du Conseil d’analyse économique susmentionné, le bonus moyen des traders et des vendeurs équivaut à quatre fois le montant de la rémunération fixe moyenne, le ratio retombant à 2,5 pour les ingénieurs de marchés, à 0,8 pour les analystes financiers et à 0,34 pour les contrôleurs des risques.
Conséquence de ces distorsions de rémunérations, ceux qui veillent à la régularité et à la sécurité des activités réalisées par les traders et les vendeurs avec les fonds de leur établissement sont considérablement moins bien rémunérés que ceux qui prennent des positions sur les marchés, certes potentiellement lucratives mais aussi très risquées. Les germes des dysfonctionnements récents du système financier résident dans cette situation paradoxale, où l’appât du gain est davantage récompensé que la certitude de rentabilité. Les faits (scandale Kerviel à la Société générale, prises de positions irrégulières à la Caisse d’épargne) ont malheureusement corroboré ce triste constat.
Les opérateurs financiers ont bénéficié, ces dernières années, de rémunérations dépassant l’entendement. Les dévoiements du système ont atteint un tel degré de paroxysme que la maximisation des primes de ces catégories de personnels est devenue une fin en soi, occultant au passage leur justification initiale, à savoir la réalisation d’opérations bénéficiaires pour les établissements employeurs à travers le financement de l’économie.
a) Des sommets sans commune mesure avec la rémunération moyenne des acteurs de l’économie réelle
Nonobstant le cas particulier des mandataires sociaux des grandes banques de dépôt, dont les principes de rémunération répondent aux mêmes règles que les mandataires sociaux de toutes les grandes sociétés cotées, le secteur de la finance, et tout particulièrement celui de la finance d’investissement ou de la banque d’affaires, s’illustre par des rémunérations parfois vertigineuses. Caractéristique révélatrice s’il en est, ce ne sont pas nécessairement les dirigeants des établissements de crédit qui perçoivent les émoluments les plus élevés au sein de leurs entreprises, mais certaines catégories de personnels aux compétences réputées aussi rares qu’elles paraissent opaques au grand public.
C’est notamment le cas des banquiers conseils, qui perçoivent un pourcentage des opérations de rapprochement qu’ils supervisent, et des métiers de l’industrie financière (les traders et vendeurs, les ingénieurs de marchés financiers, les analystes financiers et même les personnels en charge du contrôle des risques), rémunérés à la commission ou au bonus. Là où certains présidents-directeurs généraux de sociétés cotées bénéficient de rémunérations annuelles globales atteignant tout de même 3 millions d’euros, certaines de ces catégories spécifiques de personnels des banques (les traders et vendeurs, principalement) peuvent obtenir jusqu’à 10 millions d’euros. « À Paris, ceux qui gagnent plus de 10 millions par an se comptent sur les doigts d’une main. À plus de 1 million, ils sont de trois à quatre cents. » (18). Rien d’étonnant, dans de telles conditions, à ce que l’ancien président-directeur général du conseil d’administration de la Société générale n’appointait, en 2007, qu’à la 44ème place dans le classement des rémunérations les plus élevées de la banque qu’il dirigeait et à ce que l’actuel présidant du directoire d’Axa ne se situe qu’au 70ème rang des plus hautes rémunérations du groupe.
Aux États-Unis, les chiffres sont encore plus édifiants. En 2007, les traders de Wall Street se sont partagés quelque 7,7 milliards d’euros de commissions (19). La seule banque d’affaires Goldman Sachs a versé, la même année, 20 milliards de dollars en salaires et bonus à ses employés, soit une moyenne de près de 662 000 dollars par employé. Naturellement, les dirigeants des principaux établissements financiers de la place (Bear Stearns, Citygroup, Goldman Sachs, Lehman Brothers, Merill Lynch, Morgan Stanley) ne sont pas demeurés en reste vis-à-vis de cette manne, puisqu’ils auraient bénéficié, de 2004 à 2007, de rémunérations annuelles cumulées équivalant à un total de 3,6 milliards de dollars.
A en croire les quelques indications rendues publiques sur la question, pareilles sommes ne dénotent pas particulièrement des rétributions susceptibles d’être attribuées aux gestionnaires de fonds d’investissement. Qu’ils spéculent sur des titres, des biens ou des matières premières (hedge funds) ou investissent dans des sociétés en difficultés en vue d’un redressement rapide et d’une revente assortie de plus-value juteuse (private equity), ces instruments engendrent de puissants effets de levier financier. Pour illustration, on se bornera à souligner que le gestionnaire du fonds Paulson & Co a été rémunéré à hauteur de 3,7 milliards de dollars en 2007, George Soros se contentant quant à lui de 2,9 milliards de dollars la même année, au titre du Soros Fund Management (20). En France, seuls les fonds de private equity ont rencontré quelque succès, à l’image de PAI Partners, qui aurait procuré environ 500 millions d’euros de revenus à son principal gestionnaire.
LES DIRIGEANTS DE HEDGE FUNDS
LES MIEUX RÉMUNÉRÉS EN 2008
James Simons (Renaissance Technology Corp.) |
2,5 milliards de dollars |
John Paulson (Paulson & Co) |
2,0 milliards de dollars |
John Arnold (Centaurus) |
1,5 milliard de dollars |
Georges Soros (Soros Fund Management) |
1,1 milliard de dollars |
Raymond Dalio (Bridgewater Associates Inc.) |
7 800 000 dollars |
Bruce Kovner (Caxton Associates LLC) |
6 400 000 dollars |
David Shaw (D.E. Shaw & CO) |
2 700 000 dollars |
Stanley Druckenmiller (Duquesne Cap. Man.) |
2 600 000 dollars |
Source: Institutional Investors. | |
D’après le magazine Alpha de Institutionnal Investors, les employés de ces fonds ne semblent pas en reste : en 2008, les directeurs généraux ont touché en moyenne 2 millions de dollars, les responsables d’investissements 1,4 million de dollars, les gérants confirmés plus de 1 million de dollars et les employés de base, près de 800 000 dollars. Du fait de la crise financière, de tels montants seraient même en diminution de 16 % par rapport aux émoluments effectivement perçus en 2007.
Pareilles sommes révèlent une certaine déviance du système financier, dont la finalité s’est peu à peu muée en une accumulation de plus-values au détriment du financement du développement des entreprises.
b) Une absence totale de responsabilisation qui est choquante
Les abus des rémunérations des opérateurs financiers sont dénoncés aujourd’hui avec d’autant plus de force qu’ils sont pour partie à l’origine de la crise financière la plus grave de ce XXIème siècle. Ainsi que le résume Joseph Stiglitz : « Le système des bonus a très certainement contribué d’une manière importante à la crise. Il a été conçu pour encourager la prise de risques, mais il a encouragé la prise de risques excessifs. » (21).
En effet, comment justifier les montants astronomiques versés par les établissements de crédit – y compris les banques qui jusqu’alors étaient spécialisées dans le crédit aux particuliers et aux entreprises – à leurs traders, vendeurs, ingénieurs de marchés et analystes financiers, sinon par la recherche d’une rentabilité de 25 % à 30 % sur fonds propres ? L’invention des crédits subprimes, ces crédits immobiliers aux ménages américains insolvables, et plus encore leur adossement à des obligations sophistiquées cédées à l’ensemble des banques traditionnelles et aux épargnants attirés par des taux de rémunération supérieurs aux bons du Trésor trouvent en effet pour partie leur justification dans cette équation par essence très risquée. Si la responsabilité en revient d’abord aux banques d’affaires américaines, force est toutefois de reconnaître que la grande majorité des établissements financiers du reste du monde s’est laissée griser par la perspective de rendements exceptionnels par rapport à des crédits classiques.
Le souci des banques de conserver des spécialistes de haut niveau, courtisés par d’autres établissements et par définition très mobiles, a engendré une forme de surenchère salariale. L’enjeu, intellectuellement compréhensible en période de croissance, l’est moins en période de crise. Pourtant, il joue à plein dans de telles circonstances comme l’illustrent les agapes fortement médiatisées, dans un grand restaurant de Monaco, organisées par les banques Dexia et Fortis au plus fort de leurs difficultés de trésorerie, à l’automne 2008, pour leurs traders les plus performants.
Selon les calculs du cabinet de chasseurs de têtes Humblot Grant Alexander, s’ils devraient globalement diminuer de 50 % à 60 % par rapport à ceux de l’an passé, les bonus octroyés au titre de l’exercice 2008 aux seuls traders des banques françaises devraient bien être versés au cours de cette année. Ainsi, un trader sur les marchés d’actions recevra, en moyenne, entre 301 200 et 376 500 euros de prime, contre 753 000 euros un an plus tôt. Les banques assurent qu’elles réaliseront ces versements avec circonspection, en tenant compte des résultats des intéressés (les activités de change et certains traders ayant dégagé des bénéfices, qui se sont traduits par les profits de plusieurs milliards annoncés par les établissements de la place parisienne). Pour autant, le doute est permis à en juger par l’information selon laquelle la banque Natixis, déficitaire à hauteur de 2,8 milliards d’euros, a versé 70 millions d’euros de primes à 3 000 de ses 5 650 collaborateurs l’an passé.
À l’heure où les États sont obligés de donner leur caution à des institutions financières qui, pour certaines d’entre elles, ont pris des risques inconsidérés, une telle situation a de quoi interpeller. En effet, il n’est pas acceptable que, parce qu’ils n’ont d’autre choix pour sauver les avoirs des épargnants et le circuit du crédit dans l’économie réelle, les États assument les conséquences des erreurs de pilotage stratégique et les dérives salariales des établissements bancaires fautifs. Il serait pour le moins regrettable que les opérateurs financiers considèrent qu’ils jouissent d’une certaine impunité salariale, grâce notamment à l’assurance de la garantie étatique en cas de difficultés trop graves. Une telle absence de responsabilisation ne doit plus avoir cours dans l’économie d’aujourd’hui ; les contribuables n’entendent pas, à bon droit, subventionner les prises de risque des banques et de leurs opérateurs.
II. – DES TENTATIVES DE MORALISATION AU SUCCÈS RELATIF
Longtemps, les informations touchant aux rémunérations des dirigeants des plus grandes entreprises et des opérateurs financiers sont restées confidentielles. La révélation par les médias, notamment à l’occasion des crises financières de la décennie écoulée, de scandales retentissants a conduit le législateur à imposer des règles de transparence et à tenter de moraliser les pratiques. Les organisations représentatives des entreprises ont également cherché à encadrer les choses, à travers l’élaboration de codes de conduite applicables par la seule bonne volonté des principaux intéressés.
Le constat est malheureusement sans appel : tant la régulation par la loi que l’autorégulation par des normes informelles n’ont véritablement empêché les dérives précédemment mises en exergue dans le présent rapport.
A. LES RÉPONSES APPORTÉES PAR LE LÉGISLATEUR
Le législateur n’est pas resté inactif devant les difficultés mises à jour par différentes crises nées tantôt de l’éclatement de la bulle Internet (faillite de Worldcom, affaire Videndi Universal), tantôt de l’opacité des opérateurs des marchés financiers (faillites d’Enron et de Parmalat), tantôt de scandales de gestion isolés (soupçon de délit d’initiés dans le cadre de la révélation des problèmes de l’A 380 d’Airbus).
Il a ainsi mis en place un cadre juridique destiné à améliorer les principes de gouvernance interne des sociétés et à renforcer la transparence applicable aux rémunérations des mandataires sociaux. Plus récemment, il s’est attaché à prévoir des contreparties au soutien financier de l’État et à réajuster les prélèvements obligatoires en vigueur.
1. Des évolutions successives et prudentes en France
Plusieurs textes importants adoptés par le Parlement français ont traité de la question des rémunérations des dirigeants d’entreprises :
– la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001, sur les nouvelles régulations économiques, a notamment posé les premières bases de l’information des actionnaires sur ces émoluments, étendu le champ des conventions réglementées pour prévenir les conflits d’intérêts et dissocié les fonctions de président du conseil d’administration ou de surveillance et de directeur général afin de parvenir à une véritable répartition des tâches exécutives ;
– dans le même esprit, la loi n° 2002-1303 du 29 octobre 2002, modifiant certaines dispositions du code de commerce relatives aux mandats sociaux, a renforcé la réglementation du cumul des mandats sociaux des dirigeants. En effet, il est apparu nécessaire de limiter le nombre de ces mandats – à cinq, dans le cas des administrateurs de sociétés anonymes cotées – pour éviter aux dirigeants sociaux de mal exercer des fonctions trop nombreuses. En outre, cette législation a permis de restreindre les risques de conflits d’intérêts ;
– par la suite, la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005, en faveur de la confiance et de la modernisation de l’économie, a inclus les avantages en nature et les rémunérations différées des dirigeants sociaux dans le champ des conventions réglementées et précisé la nature des informations délivrées à ce sujet aux actionnaires ;
– de même, la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007, en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat, a prévu que les indemnités de départ des dirigeants doivent répondre à des conditions de performance fixées a priori par les conseils d’administration ou de surveillance. En outre, l’assemblée générale des actionnaires se prononce désormais sur chaque cas de dirigeant social, sur la base des éléments d’information fournis par le conseil d’administration ou de surveillance et validés par les commissaires aux comptes ;
– enfin, la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 sur les revenus du travail a conditionné l’attribution de stock-options à la distribution corrélative, à l’ensemble des salariés et à au moins 90 % de ceux des filiales, d’options de même nature, d’actions gratuites ou de dispositifs d’intéressement et de participation.
Avec l’enracinement de la crise et l’implication grandissante de l’État dans le soutien à l’économie, députés et sénateurs sont dernièrement convenus, lors de l’adoption de la loi n° 2009-431 du 20 avril 2009 de finances rectificative pour 2009, d’un encadrement plus strict, jusqu’au 31 décembre 2010, des conditions d’octroi de rémunérations variables et différées aux dirigeants d’entreprises (présidents de conseils, mais aussi membres du directoire et directeurs généraux et généraux délégués) bénéficiant d’aides publiques.
a) Une plus grande transparence des rémunérations octroyées
La loi du 26 juillet 2005 a modifié l’article L. 225-102-1 du code de commerce afin de prévoir que le rapport annuel du conseil d’administration ou du directoire à l’assemblée générale des actionnaires sur l’état de la participation des salariés au capital social décrit les éléments fixes, variables et exceptionnels composant les rémunérations et avantages de toutes natures versés aux mandataires sociaux. Ce rapport doit également indiquer les engagements de toutes natures pris par la société au bénéfice de ses mandataires sociaux, correspondant à des éléments de rémunération, des indemnités ou des avantages dus ou susceptibles d’être dus à raison de la prise, de la cessation ou du changement des fonctions de mandataire social, voire postérieurement.
Ces dispositions font clairement écho à l’une des propositions formulées en 2003 par la mission d’information de la commission des Lois sur la réforme du droit des sociétés (22).
Tous les dirigeants des sociétés anonymes cotées se conforment désormais à ces exigences. C’est d’ailleurs en partie en raison de cela que les révélations médiatiques les plus retentissantes sont possibles.
Des informations rendues publiques, il découle que la rémunération moyenne des dirigeants mandataires sociaux du CAC 40 s’est établie, en 2008, à 1,96 million d’euros, cet indice médian masquant malgré tout de fortes disparités, notamment entre les rémunérations des dirigeants de Vallourec (935 500 euros) et de Danone (4,3 millions d’euros) ou LVMH (3,9 millions d’euros). Il convient par ailleurs de souligner que, depuis l’adoption de la loi du 21 août 2007, les commissaires aux comptes certifient la sincérité des informations relatives aux rémunérations individuelles dans toutes leurs composantes, à l’occasion de la présentation des comptes annuels soumis à l’assemblée générale.
![]()
PRINCIPALES RÉMUNÉRATIONS DES DIRIGEANTS DU CAC 40 (2007 / 2008, en euros)
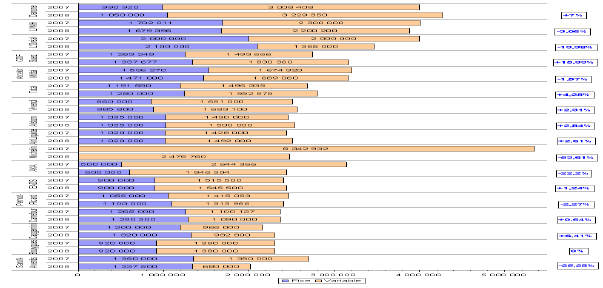
L’objectif de transparence poursuivi par le législateur semble donc avoir été atteint, mais seulement partiellement en raison du degré de généralité des informations rendues publiques. Dans leurs recommandations rendues publiques le 6 octobre 2008, le mouvement des entreprises de France (MEDEF) et l’association française des entreprises privées (AFEP) ont eux-mêmes souligné qu’« il existe encore des marges de progrès dans la lisibilité de ces informations ».
b) Un recours aux stock-options mieux délimité et fiscalisé
Dispositifs souples par essence, les plans d’options de souscription et d’achat d’actions prêtent le flanc à de sérieuses critiques. Les modifications qui y ont été successivement portées n’ont pas pour autant conduit à leur suppression, un temps envisagée ; le législateur a plutôt cherché, d’une part, à mieux corréler l’exercice des options aux performances objectives de leurs bénéficiaires et, d’autre part, à élargir le champ de leurs attributaires.
C’est ainsi que la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de l’actionnariat salarié a conditionné la souscription de leurs options par les mandataires sociaux ou les membres du directoire : désormais, le conseil d’administration ou, selon le cas, le conseil de surveillance doit décider que ces options ne peuvent être levées par les intéressés avant la fin de leur mandat ou fixer le pourcentage des actions levées qu’ils sont tenus de conserver jusqu’à la fin de leur mandat, ces éléments se trouvant publiés dans le rapport prévu à l’article L. 225-102 du code de commerce.
Plus récemment, la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail a posé le principe selon lequel les options de souscription ou d’achat d’actions ne peuvent être attribuées à des dirigeants mandataires sociaux que si la société distribue des options identiques, des actions gratuites ou des primes d’intéressement ou de participation à l’ensemble de ses salariés ou au moins à 90 % de ceux-ci (filiales incluses). Ces dispositions, prévues aux articles L. 225-186-1 et L. 225-197-6 du code de commerce ont commencé à s’appliquer à compter de l’exercice comptable en cours.
En matière de prélèvements obligatoires, les options de souscription ou d’achat d’actions ont également été assujetties à une contribution sociale fixée à 10 % pour les employeurs et à 2,5 % pour les bénéficiaires à travers la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale. Cette contribution est payée au moment de l’attribution des options octroyées à compter du 16 octobre 2007.
Au total, le cadre juridique des plans d’options de souscription ou d’achat d’actions a sensiblement évolué afin de faire davantage place aux exigences de transparence et de justice sociale. Il n’en demeure pas moins encore perfectible.
c) L’assujettissement des parachutes dorés à des critères de performance et à une fiscalité plus équitable
L’octroi d’indemnités de départ à des mandataires sociaux peut revêtir une grande variété de formes. Toutes poursuivent néanmoins un même objectif : fournir au bénéficiaire un dédommagement financier en contrepartie de la perte de ses fonctions.
Traduction littérale de l’expression anglo-saxonne de « golden handshake », le parachute doré est le plus souvent négocié et décidé dès la nomination du dirigeant. Rien n’interdit toutefois qu’il le soit également au moment de son départ (forcé ou volontaire), comme l’a illustré le cas de M. Jean-Marie Messier. À l’été 2002, ce dernier tenta de monnayer son départ de la tête du groupe Vivendi Universal en échange d’une indemnité de 20,5 millions d’euros. Cette somme fut contestée par le conseil d’administration au motif qu’il ne l’avait pas formellement approuvée (conformément aux prescriptions du code de commerce sur les conventions réglementées), mais confirmée par un tribunal arbitral siégeant à New York (23) puis par un arrêt de la Cour suprême de l’État (24).
Formellement, l’attribution d’un parachute doré peut être accordée au titre d’une convention, c’est-à-dire d’un contrat, mais aussi au titre d’une résolution sociale de l’organe compétent, généralement le conseil d’administration (25). Au-delà de la variété des techniques juridiques employées, le contenu de l’indemnité diffère sensiblement selon les cas et les sociétés. Il est néanmoins possible d’identifier quatre grandes catégories de parachutes dorés, qui peuvent d’ailleurs fort bien s’articuler les unes aux autres :
– premièrement, les conventions ou décisions prévoyant le versement pur et simple d’une indemnité forfaitaire en cas de cessation des fonctions du dirigeant (26), cette indemnité étant calculée sur la base d’un nombre d’années de salaire. Il s’agit là du cas le plus fréquent ;
– deuxièmement, les conventions dans lesquelles celui qui met fin aux fonctions du dirigeant bénéficiaire s’engage à lui racheter ses actions à un prix déterminé (27), souvent supérieur à leur valeur vénale. Cette technique combine parfois indemnité de départ et levée d’options de souscription ou d’achat d’actions ;
– troisièmement, les conventions ou résolutions prévoyant le versement au dirigeant renvoyé d’une pension complémentaire de retraite, le plus souvent par anticipation à son arrivée à l’âge normal de la retraite pour les salariés (28) ;
– enfin, les engagements conventionnels octroyant des avantages matériels ou en nature au dirigeant limogé. Cette catégorie est le plus souvent un complément des précédentes.
La loi du 21 août 2007 a modifié les articles L. 225-42-1 et L. 225-90-1 du code de commerce afin d’interdire l’attribution de ce type d’indemnités sans qu’aient été atteints par le dirigeant bénéficiaire un certain nombre d’objectifs et de critères de performance, définis par le conseil d’administration ou de surveillance et validés par l’assemblée générale des actionnaires. Un peu moins de deux ans après la promulgation de la loi, la définition des critères de performance pris en considération semble diversement mise en œuvre par les sociétés cotées.
Le dixième rapport de l’institut Proxinvest sur la rémunération des dirigeants d’entreprise souligne d’ailleurs que si 92,3 % des indemnités de départ soumises en 2007 à l’approbation des assemblées générales d’actionnaires ont été adoptées (pour un montant moyen, au sein du SBF 120, de 3,5 millions d’euros), elles étaient assorties de « conditions de performance généralement peu exigeantes ». L’AMF a partagé ce constat dans son rapport 2008 sur le gouvernement d’entreprise et le contrôle interne, tout en dressant un état des lieux plus nuancé entre les sociétés fixant des objectifs volontaristes, celles qui se contentaient d’objectifs minimalistes et enfin celles qui n’avaient pas encore assorti le paiement de telles indemnités de critères de performance (29).
Pour illustration, il suffit de mentionner que les indemnités de départ consenties à l’ancien président-directeur général du groupe Valeo, au printemps 2009, avaient été validées sur la base des nouvelles conditions exigées par la loi du 21 août 2007. Le pari de l’exemplarité par la transparence, fait par le législateur au début de la XIIIème législature, n’a donc manifestement pas produit ses effets.
Fort de ce constat, le Parlement a souhaité agir sur un autre levier. À l’occasion de l’adoption de la loi n° 2008-1330 de financement de la sécurité sociale pour 2009, il a ainsi prévu d’assujettir aux cotisations sociales, dès le premier euro, les indemnités de départ des mandataires sociaux supérieures à un montant d’un million d’euros. Il a complété à cet effet les articles L. 136-2 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que l’article L. 741-10 du code rural. Dans le même temps, les députés ont inséré dans la loi n° 2008-1425 de finances initiale pour 2009 une disposition plafonnant à 200 000 euros le montant des indemnités de départ déductibles du bénéfice imposable au titre de l’impôt sur les sociétés. Alors que les rémunérations différées pouvaient antérieurement être totalement déduites de cet impôt, elles ne sont désormais défiscalisées que pour la part inférieure à six fois le plafond de la sécurité sociale.
Ces récentes initiatives législatives traduisent une certaine exaspération des parlementaires devant la persistance d’abus que la norme n’a jusqu’alors pas réussi à endiguer. Elles devraient permettre à l’État et aux organismes de protection sociale de tirer quelques retombées financières de ces pratiques, sans pour autant empêcher leur poursuite. À tout le moins, il est vrai, elles pourraient y apporter une certaine modération.
d) L’interdiction temporaire des rémunérations variables des dirigeants mandataires sociaux des entreprises aidées par l’État
L’ampleur du soutien de l’État à certains pans essentiels de l’économie française a fait surgir un débat légitime sur l’opportunité de contreparties exigées, notamment à l’égard des dirigeants de ces entreprises en difficulté.
Initialement, le pouvoir exécutif souhaitait s’en tenir à une intervention ponctuelle et d’ordre réglementaire. Le décret n° 2009-348 du 30 mars 2009, relatif aux conditions de rémunération des dirigeants des entreprises aidées par l’État ou bénéficiant du soutien de l’État du fait de la crise économique et des responsables des entreprises publiques, interdisait ainsi l’attribution de stock-options et d’actions gratuites aux dirigeants mandataires sociaux (30) des entreprises faisant l’objet d’un soutien de la société de prises de participation de l’État (SPPE), soit les six principales banques françaises, ainsi qu’aux dirigeants mandataires sociaux des sociétés concernées par le plan automobile, soit Renault et PSA. Parallèlement, l’attribution de bonus était soumise à des critères de performance simples, préétablis pour une durée annuelle et publics.
Un volet spécifique aux entreprises publiques était également prévu, l’actionnaire étatique s’engageant à ce que les entreprises publiques dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé respectent des règles et des principes de gouvernance d’un haut niveau d’exigence éthique, consistant notamment pour leurs dirigeants au renoncement d’un cumul du mandat social avec un contrat de travail, à la subordination de leur rémunération à des critères de performance et au plafonnement à deux ans de leurs éventuelles indemnités de départ, par ailleurs non exigibles en cas d’échec personnel.
Tout en se félicitant de cette réaction de l’exécutif, le Parlement a considéré qu’elle restait trop limitée dans sa portée en ce que les entreprises bénéficiant des interventions du Fonds stratégique d’investissement y échappaient. C’est la raison pour laquelle il a saisi l’opportunité de l’examen de la loi de finances rectificative pour 2009 du 20 avril dernier, précédemment mentionnée, pour conforter sur le plan juridique et compléter le dispositif posé par la voie réglementaire. Les conséquences de cet élargissement ont été tirées par le décret n° 2009-445 du 20 avril 2009 portant modernisation du fonctionnement du Fonds de développement économique et social.
Toutes ces règles présentent un intérêt évident. Elles sont cependant réversibles et limitées à la durée prévisible de la crise, pour ce qui concerne les éléments de rémunération variable.
2. Des aménagements législatifs plus ou moins prononcés dans les autres pays
Peu de pays ont, jusqu’à présent, encadré de manière significative le processus de rémunération des dirigeants d’entreprise ou des opérateurs financiers. Aux États-Unis, bien que les affaires Enron et Worldcom ont poussé le Congrès à adopter la loi du 31 juillet 2002 sur la réforme de la comptabilité des sociétés cotées et la protection des investisseurs (dite « loi Sarbanes-Oxley », du nom de ses auteurs), le sujet n’a été abordé, jusqu’à l’arrivée au pouvoir du président Barak Obama, que sous l’angle de la transparence vis-à-vis des actionnaires.
En Allemagne aussi, une grande latitude reste accordée aux instances dirigeantes des entreprises. Le § 87 de la loi sur les actions ("Aktiengesetz") dispose que le conseil d’administration fixe la rémunération des dirigeants de société. Celle-ci doit être raisonnable et proportionnée aux devoirs des intéressés. Depuis 2007, ces derniers sont tenus de publier leur rémunération dès lors que l’entreprise qu’ils gèrent est cotée en bourse (31). En Europe continentale (Italie, Espagne notamment), cette position est largement partagée.
Il n’est qu’au Royaume-Uni qu’une réglementation spécifique sur la rémunération des dirigeants a été adoptée dès 2002 ; elle a récemment été actualisée par le Companies Act du 8 novembre 2006. En l’état du droit britannique, les Directors Remuneration Report Regulations imposent aux sociétés cotées en bourse de fournir un rapport annuel détaillé sur la rémunération des dirigeants et de le soumettre à l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires (32). Il s’agit là de prérogatives dévolues aux actionnaires sans équivalent à ce jour.
Les développements de la crise financière et économique mondiale ont conduit plusieurs pays, et non des moindres, à réviser leur appréciation de leur propre législation en matière de rémunération des principaux responsables d’entreprises et de banques.
C’est ainsi qu’à l’occasion de son adoption, le 3 octobre 2008, de la loi sur la stabilisation d’urgence, destinée notamment à permettre le rachat par l’État fédéral de créances douteuses détenues par les banques américaines pour un montant d’environ 700 milliards de dollars, le Congrès a prévu que les dirigeants des établissements bénéficiaires de cette aide publique ne puissent prétendre à des parachutes dorés en cas de faute avérées. En février 2009, le Président américain et son Secrétaire au Trésor ont complété ces mesures par un plafonnement à 500 000 dollars de la rémunération liquide – c’est-à-dire hors titres, eux-mêmes gelés jusqu’au remboursement des aides – des dirigeants d’établissements bénéficiant du concours de l’État fédéral.
D’autres pays, à l’instar de l’Allemagne, notamment, ont eux aussi transcrit dans leur réglementation une exigence similaire, lors de la finalisation de leurs plans de sauvetage de leurs banques. Ainsi, outre-Rhin, un décret du 20 octobre 2008 dispose qu’en fonction de la nature, du montant et de la durée des aides publiques obtenues, le fonds de sauvetage des établissements financiers peut imposer un plafond aux salaires, une rémunération supérieure à 500 000 euros étant qualifiée, en l’espèce, d’« inappropriée ». Plus récemment, le 18 juin 2009, le Bundestag a adopté une nouvelle loi qui responsabilise davantage les conseils d’administration et de surveillance à l’égard des rémunérations consenties, instaure une franchise obligatoire de leur police d’assurance égale à un an et demi de leur rémunération et prolonge le délai au terme duquel les stock-options peuvent être levées (celui-ci passant à quatre ans).
Certains États ont néanmoins choisi d’explorer d’autres pistes. À titre d’illustration, aux Pays-Bas, depuis le 1er janvier les présidents-directeurs généraux et directeurs des 90 sociétés cotées à la bourse d’Amsterdam subissent une majoration de la taxation de leurs primes de 30 % dès lors qu’ils gagnent plus de 500 000 euros annuels nets et que ces primes dépassent leur salaire annuel. Les sociétés cotées néerlandaises s’exposent, de leur côté, à une très lourde pénalité (15 % d’impôts supplémentaires sur leurs bénéfices) si elles augmentent un responsable à quelques mois d’un départ, de manière à gonfler sa retraite. Enfin, les avoirs en actions des présidents-directeurs généraux et des autres mandataires sociaux sont gelés dès la première rumeur de rachat concernant leur entreprise et les quelque 700 directeurs de fonds d’investissement que compte le royaume se trouvent tenus de reverser au fisc le quart des revenus tirés des actions qu’ils détiennent dans leur propre société.
En Belgique, le Gouvernement a annoncé, le 7 novembre 2008, la préparation d’un projet de loi modifiant le code des sociétés qui vise à limiter les indemnités de départ des mandataires sociaux à un an de salaire, cette période de référence étant portée à 15 mois en cas d’ancienneté comprise entre 20 et 25 ans et à 18 mois au-delà. Le Conseil d’État du royaume a toutefois invalidé l’avant-projet, le jugeant trop discriminatoire et obligeant ainsi la préparation d’un nouveau texte avant tout engagement de la discussion parlementaire. Depuis, le chef du gouvernement belge a changé et l’ordre des priorités intérieures s’en est trouvé quelque peu modifié.
De fait, les réponses législatives apportées au problème des rémunérations parfois extravagantes des dirigeants d’entreprises et des opérateurs financiers fluctuent sensiblement d’un pays à l’autre. Sans doute une harmonisation, au plan international, sera à terme nécessaire afin de donner toute sa cohérence et son efficacité au processus de moralisation entamé partout.
B. LES DÉMARCHES D’AUTORÉGULATION PRIVILÉGIÉES PAR LES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES
Les milieux d’affaires considèrent que la norme édictée par le législateur ou le pouvoir réglementaire est souvent trop rigide pour être efficace. Conscients que les débordements constatés en matière de rémunération des principaux dirigeants appelaient une réponse éthique, ils ont donc échafaudé des principes moralisateurs, au sein de codes de bonne conduite ou de recommandations. Ces soft laws n’ont pas de valeur juridiquement contraignante. Elles énoncent des lignes directrices que les sociétés restent libres de suivre ou de ne pas appliquer.
En pratique, le développement de la transparence et la publicité des décisions des organes dirigeants poussent cependant de nombreuses sociétés à appliquer volontairement de telles règles, faute de quoi elles ont à se justifier auprès des marchés financiers sur lesquels elles lèvent bien souvent les capitaux nécessaires à leur développement (principe du « comply or explain »). En Europe, cette incitation est d’ailleurs renforcée par les dispositions de la directive 2006/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 (33), transposées en droit français par la loi n° 2008-649 du 3 juillet 2008 portant diverses dispositions d’adaptation du droit des sociétés au droit communautaire.
1. Les règles élaborées par le MEDEF et l’AFEP au sujet des dirigeants mandataires sociaux
En France, les organisations représentatives des entreprises ont commencé à se pencher sur les enjeux de la gouvernance et des rémunérations des mandataires sociaux des sociétés cotées dans le milieu des années 1990. La réflexion a débouché sur plusieurs rapports, tels ceux de M. Marc Viénot sur le gouvernement d’entreprise de juillet 1995 et juillet 1999, ainsi que celui de M. Daniel Bouton sur le même sujet, datant quant à lui de septembre 2002.
Cette démarche s’est poursuivie au-delà de l’adoption de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière, avant de déboucher sur les premières recommandations officielles du MEDEF et de l’AFEP portant spécifiquement sur la rémunération des dirigeants mandataires sociaux de sociétés cotées, en janvier 2007. Le 6 octobre 2008, ces recommandations ont été complétées par un certain nombre de précisions encore inimaginables il y a cinq ans à peine.
À chaque fois, la question de la rémunération n’a été envisagée que comme l’un des aspects du problème plus général de la bonne gestion des sociétés et du fonctionnement harmonieux de leurs organes sociaux.
a) Le code de janvier 2007
Les recommandations établies en janvier 2007 par le MEDEF et l’AFEP imposent un certain nombre de principes généraux pour la détermination, par les conseils d’administration ou de surveillance des sociétés cotées ayant leur siège en France, de la rémunération des dirigeants mandataires sociaux. Leur lecture laisse penser qu’elles sont complètes ; leurs résultats inclinent à nuancer cette perception.
Ces recommandations spécifient tout d’abord que la rémunération des mandataires sociaux dirigeant des sociétés cotées doit être exhaustive. Les organes responsables se voient en théorie tenus, sur la base de suggestions formulées par les comités ad hoc des rémunérations, d’apprécier globalement mais de manière individualisée la partie fixe, les bonus, les options de souscription ou d’achat d’actions, les attributions gratuites d’actions, les jetons de présence, ainsi que les conditions de retraite, les indemnités de départ et les avantages particuliers tels que la mise à disposition d’un véhicule ou de locaux de fonction.
Sur ce premier point, les comités de rémunération sont plus particulièrement invités, pour élaborer leurs propositions destinées à guider la décision des conseils seuls juridiquement compétents, à prendre en considération un ensemble précis d’aspects relatifs à chaque strate de la rémunération :
– la partie fixe, peut ainsi être différenciée selon que le dirigeant mandataire social poursuit une carrière sans discontinuité dans la société ou qu’il est recruté à l’extérieur. Elle ne doit être revue qu’à échéances relativement longues et ne progresser que si des événements concernant l’entreprise le justifient ;
– le bonus, pour sa part, doit être lisible pour les actionnaires et fixé pour une période déterminée. En outre, son lien avec la partie fixe de la rémunération doit être clairement établi, à travers un pourcentage maximum adapté au métier de la société. De surcroît, il est suggéré de mettre en place des critères quantitatifs et qualitatifs d’attribution qui soient simples, peu nombreux mais précis, objectifs, mesurables et adaptés à la stratégie d’entreprise. Surtout, seules des circonstances très particulières peuvent justifier l’octroi d’un bonus exceptionnel ;
– les stock-options et les actions gratuites, quant à elles, sont censées être octroyées sur la base d’une politique d’attribution raisonnable et appropriée, reposant notamment sur des objectifs de performance à échéance d’une ou plusieurs années. Pour parvenir à un minimum de moralisation des pratiques, il est recommandé de tenir compte du montant total de la rémunération fixe et variable annuelle ainsi que du nombre d’options déjà attribuées et de leur valorisation. Le principe de la décote (jusqu’à 20 %, aux termes des articles L. 225-177 et L. 225-179 du code de commerce), est remis en cause pour les mandataires sociaux. De même, il est proposé de mieux tenir compte des effets de dilution de capital pour les actionnaires ainsi que de fixer le nombre des actions issues de levées d’options ou d’actions gratuites que les président du conseil, directeur général, directeurs généraux délégués et membres du directoire ou gérants de société par actions sont tenus de conserver au nominatif jusqu’à la fin de leurs fonctions ;
– enfin, pour ce qui concerne les indemnités liées à la cessation des fonctions, l’attention des organes sociaux est attirée sur l’intérêt de les prévoir contractuellement dès l’origine, en fonction de la partie fixe de la rémunération, de même que sur l’importance de tenir compte de l’existence ou non de droits à une retraite supplémentaire. Il est aussi souligné que les éventuelles clauses de non-concurrence doivent être négociées dans le respect de l’intérêt social. Toute révocation pour faute doit exclure l’attribution de tels avantages.
Sur le plan des principes, les recommandations de janvier 2007 prévoient également de manière explicite que la rémunération des dirigeants d’entreprise doit être déterminée en cohérence avec celle de leurs homologues. Elles évoquent aussi la recherche d’un juste équilibre prenant en compte l’intérêt général de l’entreprise, les pratiques du marché et les performances des dirigeants. À cet égard, les critères de performance utilisés pour établir la partie variable de la rémunération, ou le cas échéant pour l’attribution d’options ou d’actions gratuites, doivent correspondre aux objectifs de l’entreprise, être simples à expliquer et autant que possible stables dans la durée.
Plus généralement, la rémunération des dirigeants mandataires sociaux y est présentée comme devant répondre à des exigences de mesure, d’équilibre, d’équité et de renforcement de la solidarité et de la motivation à l’intérieur des entreprises. Le MEDEF et l’AFEP appellent même à prendre en compte les réactions des autres parties prenantes et de l’opinion publique. Enfin, il est prescrit d’informer les actionnaires de manière très complète sur la rémunération individuelle versée aux mandataires sociaux, sur le coût global de la direction générale de leur groupe, ainsi que sur la politique de détermination des rémunérations qui est appliquée.
Avec le recul de plus de deux ans de pratique, l’expérience montre que ces grands principes n’ont que partiellement freiné les dérives constatées et dénoncées en matière de rémunérations des principaux responsables de sociétés cotées. Le seul cas des stock-options suffit à le démontrer puisque, en dépit des recommandations de janvier 2007, bien peu nombreux sont les dirigeants mandataires sociaux de sociétés cotées françaises à avoir renoncé à l’avantage de la décote. Les organisations professionnelles à l’origine de ces préceptes sont elles-mêmes implicitement convenues du caractère relatif des effets de leurs recommandations, en adoptant depuis – sous l’insistance des pouvoirs publics, il est vrai – des exigences plus précises.
b) Les recommandations du 6 octobre 2008
Dans le prolongement de la volonté exprimée par le Président de la République, lors de son discours de Toulon du 25 septembre 2008, que « les professionnels se mettent d’accord sur des pratiques acceptables », de nouvelles recommandations ont été présentées par l’AFEP et le MEDEF le 6 octobre suivant. Si l’annonce de celles-ci a quelque peu été précipitée par les événements, il convient de préciser que le comité d’éthique du MEDEF avait entamé une réflexion à leur sujet depuis mars 2008. Bien qu’elles concernent avant tout les 688 sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, ces recommandations ont aussi vocation à s’appliquer aux sociétés non cotées ou dont les titres sont admis aux négociations sur un marché organisé, tel Alternext. Tout en rappelant les principes mis en exergue en 2007, ces nouvelles recommandations les précisent et les complètent sur cinq points.
En premier lieu, la fin de la situation actuelle d’un possible cumul entre contrat de travail et mandat social est préconisée pour les président et directeur général des sociétés anonymes monistes ainsi que les président du directoire ou directeur général unique des sociétés anonymes dualistes et les gérants de sociétés en commandite par actions. Ce non-cumul, applicable aux mandats confiés ou renouvelés après le 6 octobre 2008 mais ne concernant pas les collaborateurs de groupes de sociétés exerçant des fonctions de mandataire social dans une filiale, devrait prendre la forme d’une démission ou d’une rupture conventionnelle.
En deuxième lieu, il est spécifié que les conditions de performance fixées pour l’octroi d’indemnités de départ et les clauses de non-concurrence doivent, à présent, n’autoriser l’indemnisation d’un dirigeant qu’en cas de départ contraint et lié à un changement de contrôle ou de stratégie. Se trouve ainsi exclu tout versement dès lors que le mandataire social concerné quitte à son initiative la société qu’il dirigeait pour exercer de nouvelles fonctions ou dès lors qu’il change de fonctions à l’intérieur d’un groupe de sociétés ou encore qu’il a la possibilité de faire valoir ses droits à la retraite à brève échéance. En outre, un plafond de deux ans de rémunération, fixe et variable, se voit fixé.
En troisième lieu, il est suggéré de soumettre toute liquidation des retraites supplémentaires à prestations définies à la condition que leur bénéficiaire soit mandataire social ou salarié de l’entreprise lorsqu’il fait valoir ses droits et qu’il satisfasse un critère d’ancienneté raisonnable. Les organisations professionnelles des entreprises soulignent tout particulièrement qu’un tel avantage ne saurait être réservé aux mandataires sociaux et que sa valeur doit être prise en compte dans la fixation globale des rémunérations. Par ailleurs, la période de référence prise en compte pour le calcul des prestations doit être de plusieurs années, tout gonflement artificiel de la rémunération sur cette période étant à proscrire.
En quatrième lieu, il est demandé que l’attribution d’options de souscription ou d’achat d’actions corresponde à une politique d’association au capital et non à un complément de rémunération instantanée. Anticipant les modifications apportées depuis par le législateur, à travers la loi du 3 décembre 2008 précédemment mentionnée, les organisations représentatives des entreprises préconisent une extension du bénéfice des stock-options à l’ensemble des salariés ou, à tout le moins, sa corrélation à un dispositif d’association de ceux-ci aux performances de l’entreprise (intéressement, accord de participation dérogatoire, attribution gratuite d’actions, entre autres). Est également suggéré de conditionner l’attribution d’actions gratuites aux mandataires sociaux à la réalisation d’objectifs de performance, cette condition ne trouvant pas à s’appliquer au reste des salariés.
DÉTAIL DU VOLET DES RECOMMANDATIONS DU 6 OCTOBRE 2008 RELATIF AUX OPTIONS D’ACHAT OU DE SOUSCRIPTION D’ACTIONS ET AUX ACTIONS GRATUITES • Attribution : – les options d’achat ou de souscription d’actions et les actions gratuites ne doivent pas représenter un pourcentage disproportionné de l’ensemble des rémunérations, options et actions attribuées à chaque dirigeant mandataire social. À cette fin, les conseils d’administration ou de surveillance sont systématiquement tenus d’examiner l’attribution de nouvelles options et actions au regard de tous les éléments de la rémunération du dirigeant mandataire social concerné ; – pour éviter une trop forte concentration de l’attribution sur les dirigeants mandataires sociaux, un pourcentage maximum d’options et d’actions pouvant être attribuées ceux-ci doivent être définis par les conseils, en fonction de la situation de chaque société (taille de la société, secteur d’activité, champ d’attribution plus ou moins large, nombre de dirigeants...) ; – afin de limiter les effets d’aubaine, les attributions sont supposées intervenir aux mêmes périodes calendaires et chaque année. Le nombre d’options de souscription et d’achat d’actions ainsi que d’actions gratuites attribuées ne doit pas, notamment, s’écarter des pratiques antérieures de l’entreprise, sauf changement de périmètre significatif justifiant une évolution du dispositif ; – les actions de performance attribuées aux dirigeants mandataires sociaux doivent être conditionnées à l’achat d’une quantité définie d’actions lors de la disponibilité des actions attribuées ; – la décote se voit supprimée pour l’ensemble des attributaires et les instruments de couverture des options interdits. • Levée et acquisition : – l’exercice par les dirigeants mandataires sociaux de la totalité des options et l’acquisition des actions se trouvent liés à des conditions de performance à satisfaire sur une période de plusieurs années consécutives, ces conditions devant être sérieuses, exigeantes et combiner conditions de performance internes à l’entreprise et externes, c’est-à-dire liées à la performance d’autres entreprises, d’un secteur de référence ; – les périodes précédant la publication des comptes, pendant lesquelles l’exercice des options de souscription ou d’achat d’actions n’est pas possible, doivent être fixées par le conseil d’administration ou de surveillance à qui il incombe aussi de déterminer les garde-fous procéduraux contre tout risque de délit d’initié. • Conservation : – il est préconisé que le conseil d’administration ou de surveillance impose aux dirigeants mandataires sociaux de conserver un nombre important et croissant des titres acquis en retenant, au choix, soit une référence à la rémunération annuelle à fixer pour chaque mandataire, soit un pourcentage de la plus-value nette après cessions nécessaires à la levée et aux impôts et prélèvements sociaux et frais relatifs à la transaction, soit une combinaison des deux, soit un nombre fixe d’actions ; – la norme retenue doit être compatible avec d’éventuels critères de performance et être périodiquement révisée à la lumière de la situation des mandataires bénéficiaires, soit au moins à chaque renouvellement de mandat social. |
Enfin, en cinquième et dernier lieu, l’amélioration de la transparence des composants des rémunérations des mandataires sociaux fait elle aussi l’objet d’une attention particulière. Pour la rendre plus pertinente et effective, il est ainsi suggéré, d’une part, que chaque société cotée rende publics tous les éléments de rémunération des dirigeants, potentiels ou acquis, immédiatement après la réunion du conseil les ayant arrêtés et, d’autre part, que cette publicité procède d’une présentation standardisée dont un modèle figure en annexe des recommandations du 6 octobre 2008.
Afin de s’assurer du suivi de leurs suggestions, le MEDEF et l’AFEP se sont engagés à analyser les informations publiées par les sociétés concernées et, dans l’hypothèse où ils constateraient un défaut d’application « sans explication suffisante », à en saisir les dirigeants en cause. À cet effet, un rapport global sur l’évolution du suivi de ces recommandations devrait être rendu public chaque année. De son côté, le Gouvernement a annoncé que l’Autorité des marchés financiers établira elle aussi un suivi de la mise en œuvre de ces préconisations.
c ) Un premier bilan en demi-teinte
Le Président de la République, lors de son discours de Toulon, ainsi que le Gouvernement, lors du conseil des ministres du 7 octobre 2008, avaient clairement laissé entendre que faute d’une application, dès 2009, par les entreprises françaises des dernières recommandations de leurs organisations professionnelles, le législateur serait rapidement appelé à se saisir de la question. Afin de donner crédit à cette perspective, l’AMF avait été chargée de recenser les informations communiquées sur le sujet par les sociétés de la place de Paris et d’en dresser un état des lieux au début de cette année. Ce bilan est paru le 13 janvier.
Selon l’autorité administrative indépendante chargée de la régulation des marchés financiers, au 7 janvier 2009, 94 % des plus fortes capitalisations françaises de la bourse de Paris (à savoir 120 des 128 sociétés cotées sur le compartiment A d’Euronext) avaient adhéré aux recommandations de l’AFEP et du MEDEF du 6 octobre 2008, 90 % l’ayant fait sans aucune réserve. En outre, 7 % déclaraient attendre la tenue de leurs conseils d’administration, au mois de février, pour les adopter.
Les informations publiées laissent toutefois entrevoir une certaine disparité de situations, puisque la proportion des sociétés cotées sur les autres compartiments d’Euronext ayant elles aussi souscrit les recommandations du 6 octobre 2008 était sensiblement moins forte. En effet, seulement 101 des 180 sociétés du compartiment B (soit 56 %) et 96 des 289 sociétés du compartiment C (soit 33 %) avaient entrepris une démarche en ce sens.
Ces chiffres ont évolué depuis et un bilan véritablement exhaustif ne sera effectué par l’AMF qu’à l’occasion de la publication de son prochain rapport annuel sur le gouvernement d’entreprise et le contrôle interne. D’ores et déjà, on peut se féliciter que la détermination affichée par les pouvoirs publics ait permis d’obtenir des résultats tangibles et rapides au sein des plus grandes sociétés de droit français, où les problèmes étaient les plus patents et les excès les plus flagrants.
Ainsi, 35 des 40 sociétés du CAC 40 ont adopté sans réserve les nouvelles recommandations sur la rémunération de leurs dirigeants (soit 87,5 %), une autre émettant des réserves sur la seule interdiction du cumul d’un mandat social avec un contrat de travail tandis que trois autres, de droit étranger, n’ont pas souhaité prendre de position sur le sujet. Cette adhésion est relativement identique au niveau du SBF 120 (89 %), les réserves exprimées ne concernant qu’un nombre marginal d’entreprises (1,6 %).
Un tel élan en faveur d’une moralisation plus prononcée des pratiques de rémunération des dirigeants mandataires sociaux aurait encore paru inimaginable il y a peu. Pour autant, cette logique de l’autorégulation n’est qu’à demi convaincante.
Les faits parlent d’eux-mêmes. Bien que les dernières recommandations du MEDEF et de l’AFEP invitent les sociétés cotées à « prohiber les effets d’aubaine tendant à un marché baissier » en matière d’attribution d’options de souscription ou d’achat d’actions, moins de six mois après leur adhésion à ces règles conventionnelles, les plus hauts dirigeants de la Société générale bénéficiaient, avant d’y renoncer sous la pression de l’opinion et des pouvoirs publics, de l’octroi d’options à un cours historiquement bas (24 euros), leur garantissant d’ici 2012 de très substantielles plus-values.
Il convient également d’observer que le code de bonne conduite du 6 octobre 2008 a un champ d’application non exhaustif dans la mesure où il omet les gérants personnes physiques de sociétés à responsabilité limitée (SARL) elles-mêmes gérantes de sociétés en commandite par actions. Ces cas de figure certes rares existent tout de même en France puisqu’en relèvent des sociétés aussi renommées que Groupe Lagardère, Euro Disney SCA, Michelin ou Hermès international.
Enfin, il est permis de s’interroger sur la crédibilité et l’effectivité de règles conventionnelles définies par ceux-là mêmes qui soit se déclarent dans l’impossibilité d’imposer leur respect aux entreprises, soit autorisent l’attribution d’émoluments manifestement abusifs ou, pour le moins, inappropriés. Or, comme le soulignait Me Philippe Portier, en décembre 2008, dans un commentaire des principes actés par le MEDEF et l’AFEP : « une entreprise pourrait-elle satisfaire à l’injonction faite par le Gouvernement d’adhérer aux recommandations, de manière formelle, pour ensuite les écarter dans leur dimension la plus substantielle ? Au pied de la lettre, tel pourrait être le cas » (34).
Le Gouvernement ne s’y est d’ailleurs pas trompé, en exigeant par la voix des ministres chargés de l’économie et du travail, que le MEDEF et l’AFEP mettent en place un dispositif plus opérationnel pour le cas des entreprises recourant massivement à des licenciements ou en situation difficile. Le 30 avril 2009, les organisations professionnelles des entreprises ont annoncé la création d’un comité des sages chargé de contribuer à la bonne application des principes de mesure, d’équilibre et de cohérence des rémunérations des dirigeants mandataires sociaux en cas de recours massif au chômage partiel ou de plans sociaux d’ampleur. Présidé par M. Claude Bébéar, président d’honneur d’Axa et président de l’institut Montaigne, cette instance pourra être saisie par les conseils d’administration ou de surveillance, les comités de rémunération et les assemblées générales des entreprises qui ont adhéré aux recommandations du 6 octobre 2008 ; ses avis seront transmis aux entreprises qui l’auront saisi et il pourra communiquer sur ses avis s’il estime qu’il n’en a pas été rendu compte de manière appropriée. Il s’agit là d’une initiative assurément intéressante. Reste à voir quels seront les effets réels de l’action de ce comité des sages, ainsi que la fréquence de ses consultations.
2. Les règles élaborées en février 2009 par le Haut comité de place sur les émoluments des professionnels des marchés financiers
Lors de son allocution télévisée du 12 février 2009, le Président de la République observait à juste titre que le système de rémunération de « ceux que l’on appelle traders, ces jeunes gens qui jouaient à spéculer (…) a conduit à la catastrophe que l’on sait ». Et Nicolas Sarkozy de conclure : « C’est cela qu’il faut interdire ». Jusqu’alors, ainsi que cela a précédemment été souligné, la situation était marquée par le laisser-faire le plus absolu, aucune politique de rémunération des opérateurs financiers n’étant réellement débattue au sein des organes sociaux des banques, de sorte que personne ne se trouvait astreint à rendre des comptes.
La préoccupation des pouvoirs publics a finalement été relayée jusqu’au plus haut niveau des établissements financiers français. Un groupe de travail associant la fédération bancaire française, la fédération française des sociétés d’assurance, l’association française de la gestion financière, l’association française des investisseurs en capital, l’association française des marchés financier, l’AMF, la commission bancaire et la direction générale du Trésor et de la politique économique, a spécialement été mis sur pied afin d’élaborer un guide de bonnes pratiques sur les rémunérations des professionnels des marchés. Cette démarche, alors unique en son genre, a débouché sur l’adoption d’un code d’éthique validé par le Haut comité de place peu de temps après la prise de position du chef de l’État. Ces règles s’appliqueront aux bonus relatifs aux exercices 2009 et 2010.
D’emblée, il convient de souligner que toutes les catégories d’opérateurs, qu’ils interviennent au niveau du front office (traders et vendeurs), au niveau des fonctions support (analystes et ingénieurs de marchés) ou à celui du back office (contrôleurs), se trouvent visées. L’ensemble des activités de marché et de la banque d’investissement ou de financement est également concerné, ce qui permet d’englober les établissements de crédit mais aussi les compagnies d’assurance, les entreprises d’investissement et les sociétés de gestion.
Afin de mettre un terme aux déviances de ces dernières années, et notamment de corréler plus étroitement la part variable des émoluments des opérateurs financiers susmentionnés avec les performances réelles à long terme des établissements qui les emploient, ce code d’éthique pose un certain nombre de règles innovantes :
– en premier lieu, l’assiette des rémunérations variables s’appliquera, non plus aux revenus bruts générés par l’activité des opérateurs financiers, mais aux profits nets pour leur employeur, ce qui constitue un puissant vecteur de moralisation ;
– en deuxième lieu, la part variable ne pourra être versée qu’en fonction des gains réels dégagés, une partie se trouvant à cet effet différée dans le temps afin de prendre en compte les résultats complets des opérations. Ce point apporte une réponse au danger d’une prise de risques inconsidérés ; l’exemple le plus révélateur en la matière est celui du trader Jérôme Kerviel, dont il s’est avéré que les prises de position engageaient jusqu’à 50 milliards d’euros et mettaient en jeu le devenir même de la Société générale ;
– en troisième lieu, une partie des rétributions se verra versée en titres ou en options sur titres de l’établissement employeur. Ainsi, les opérateurs seront moins enclins à réaliser des « coups » ponctuellement lucratifs ; ils devront agir en conservant à l’esprit la pérennité des bénéfices et la rentabilité à moyen et long terme ;
– enfin, et cela n’est sans doute pas la moindre des nouveautés, les conseils d’administration ou de surveillance des établissements employeurs auront l’obligation de se prononcer sur la politique de rémunération de leurs professionnels des marchés. Pour certaines rémunérations très élevées, excédant un seuil que le code évoque sans toutefois fixer, ils bénéficieront même d’une information particulière.
Comme pour les rémunérations des dirigeants d’entreprise, un mécanisme de suivi est censé permettre de veiller à la mise en œuvre effective de ces principes de bon sens. Les autorités administratives indépendantes chargées de la supervision du secteur financier français (AMF, Commission bancaire et Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, notamment) se sont vues explicitement investies d’une mission de vérification de l’application du code tout juste élaboré et d’évaluation des risques susceptibles de persister.
Incontestablement, le code d’éthique sur la rémunération des professionnels des marchés constitue une avancée importante. Sans doute n’est-il pas parfait. Il présente néanmoins l’avantage de tracer une voie, d’autant plus que peu de pays se sont engagés jusqu’ici sur ce chemin de la moralisation de la finance. Cependant, comme l’ont fait valoir les parties prenantes à ces engagements : « La mise en œuvre de ces principes en France doit être prolongée par une approche européenne mais également mondiale dans le cadre de l’initiative conduite par le G 20, afin de maintenir la compétitivité des entreprises travaillant en France ».
3. La soft law en vigueur dans les autres principaux pays développés
Traditionnellement, dans les pays de culture anglo-saxonne, les organismes professionnels jouent un rôle prépondérant dans la détermination et la désignation des règles de gouvernement d’entreprise. Cela est sans doute un peu moins vrai dans les pays de droit germano-latin, où la loi intervient plus souvent, même s’ils se sont progressivement rangés eux aussi à cette solution du fait de la mondialisation et de l’harmonisation des usages qui en a découlé.
a) Un corpus de règles contractuelles relatives à la gouvernance largement diffusé
Les premières règles contractuelles relatives à la corporate governance ont été élaborées aux États-Unis dans les années 1980, sur la base des réflexions menées au sein d’une commission mise en place par l’American Law Institute et l’American Bar Association. Elles ont été formalisées au sein des Principles of Corporate Governance, en avril 1993, lesquels suggéraient notamment l’instauration de comités des rémunérations chargés d’éclairer les décisions des conseils d’administration ou de surveillance. Ces avancées n’ont pas pour autant empêché les scandales, à commencer par celui de l’affaire Enron, ni dissuadé le Congrès, pourtant peu interventionniste sur ces questions, de légiférer en profondeur en 2002.
De manière assez logique, le Royaume-Uni est le second pays où l’autorégulation a reçu l’écho le plus large. Sous l’impulsion de l’Institutional Shareholders Committee et de la Confederation of British Industry, des recommandations semblables à celles émises aux États-Unis ont vu le jour. Leur synthèse, réalisée sous l’égide d’une commission présidée par Sir Adrian Cadbury, a été publiée en mai 1991 et a débouché sur l’entrée en vigueur d’un code des bonnes pratiques applicables aux sociétés cotées (code of best practices), ces dernières devant se conformer aux règles de ce code ou justifier leur inobservation (comply or explain). Les recommandations de Sir Cadbury prévoyaient notamment la transparence effective des rémunérations des mandataires sociaux, la limitation de la durée des contrats de travail des executive directors et l’instauration de comités des rémunérations.
Ces règles ont fait l’objet d’ajustements contractuels, notamment à la suite du rapport Greenbury de 1995, qui dénonçait les rémunérations abusives versées à certains dirigeants désignés sous le sobriquet de fat cats, et ont été regroupées au sein du Combined Code on Corporate Governance, qui figure en annexe des règles boursières du London Stock Exchange et dont la dernière version remonte à 2006 (35). Il n’empêche que, là aussi, le législateur a fini par poser des principes plus contraignants dans la loi, en 2002.
Sur le continent européen, de manière concomitante aux rapports Viénot et Bouton, tant les dispositions italiennes émises par le comité pour le gouvernement d’entreprise des sociétés cotées de la Borsa italiana que les Corporate Governance Grundsätze allemandes de la Grundsatzkommission Corporate Governance se sont inspirées de la philosophie du rapport Cadbury.
Les institutions communautaires, qui ont elles-mêmes conduit des réflexions en 2001 et 2002, n’ont pas jugé utile d’élaborer un code européen de bonne gouvernance ; elles lui ont préféré une coordination des pratiques nationales, à travers la directive 2006/46/CE précédemment mentionnée. À la lumière des conséquences de la crise que le monde entier traverse aujourd’hui, il est permis de s’interroger sur l’opportunité de réviser cette appréciation, ne serait-ce que sur certains domaines précis, tels que la rémunération des dirigeants des sociétés cotées. En affranchissant ceux-ci des contraintes de la territorialité des droits nationaux les plus exigeants, la mondialisation impose une harmonisation juridique par le haut. Naturellement, celle-ci ne peut se limiter au seul cadre communautaire.
b) Des lacunes s’agissant des marchés financiers
À la différence des questions relatives à la gouvernance, les principes applicables aux rémunérations des opérateurs financiers n’ont jusqu’à présent pas fait l’objet d’un cadre conventionnel abouti et contraignant à l’étranger. À cet égard, la France s’est placée à la pointe du processus d’autorégulation avec l’adoption du code d’éthique dont il a été question précédemment.
Il est pour le moins paradoxal que le pays le plus affecté par les désastres induits par les comportements cupides de certains intervenants sur les marchés financiers n’ait pas œuvré à la mise en place de règles communément acceptées par les établissements de crédit, les sociétés d’assurance, les entreprises d’investissement et les sociétés de gestion implantés sur son sol. En effet, aux États-Unis, les banques se sont contentées de plafonner les rémunérations de leurs dirigeants lorsqu’elles bénéficiaient d’une aide de l’État fédéral. L’explication de cette réserve tient à la structure des rémunérations des courtiers outre-Atlantique, très majoritairement dépendantes de la part variable. En outre, des États fédérés comme celui de New York tirent également de substantielles recettes fiscales du système actuel.
Au Royaume-Uni, en revanche, en dépit de l’importance cruciale de l’ingénierie financière dans l’économie nationale, le Gouvernement semble avoir pris la mesure de l’enjeu en adoptant des positions très critiques à l’encontre de la distribution de bonus par les banques britanniques, pour la plupart nationalisées. Il faut reconnaître que la perspective d’une distribution de primes par la Royal Bank of Scotland, détenue à 68 % par l’État, à hauteur d’un milliard de Livres Sterling alors même que l’établissement accuse 28 milliards de pertes pour 2008 a suscité de légitimes indignations. De fait, l’association britannique des établissements bancaires a reconnu les préoccupations liées à l’existence de ces primes et s’est déclarée disposée à s’engager dans une remise à plat du système.
Les autres pays européens, quant à eux, n’ont pas réellement encouragé des initiatives de leurs secteurs financiers respectifs en faveur de règles conventionnelles régissant les rémunérations des opérateurs de marchés. Sans doute le caractère extrêmement concurrentiel des professions concernées les a-t-il invités à la prudence, afin de ne pas déstabiliser un peu plus un pan essentiel au rétablissement de leurs économies.
Il n’en demeure pas moins que les choses vont heureusement évoluer dans la même direction que celle esquissée en France, au plan international comme au sein de chaque pays développé, afin de moraliser des pratiques devenues condamnables et dangereuses pour l’économie mondiale dans son ensemble. Le sommet du G 20, qui s’est tenu les 1er et 2 avril 2009 à Londres, a en effet pris l’engagement d’appliquer plusieurs recommandations du forum de stabilité financière, consistant notamment en une implication plus forte des comités de direction des établissements financiers dans la détermination des rémunérations de leurs opérateurs, un alignement de ces rémunérations sur les risques pris au nom de ces établissements et un contrôle plus étroit des régulateurs nationaux sur ces questions. Il s’agit là d’avancées concrètes, que les législateurs nationaux vont devoir désormais décliner dans chaque pays.
III. – COMMENT PARVENIR À UN JUSTE ÉQUILIBRE ?
La mission d’information ne remet pas en cause le fait que l’exercice de responsabilités importantes au sein de grandes entreprises ou d’établissements bancaires d’envergure puisse justifier des émoluments sensiblement supérieurs à ceux du commun des salariés. Pour autant, elle considère que des écarts excessifs sont nuisibles au bon fonctionnement de l’économie car ils risquent de remettre en cause la légitimité sociale de l’échelle des responsabilités au sein de ses principaux acteurs.
Mieux corréler la rémunération des dirigeants et des opérateurs financiers à la performance des entreprises et des banques apparaît donc indispensable. Force est de reconnaître, à la lumière de la crise actuelle, que les dispositifs en vigueur, en France comme dans de nombreux autres pays, présentent des carences. En la matière, les solutions ne peuvent plus être rigoureusement nationales ; la mondialisation de l’économie appelle des réponses transnationales ou, à tout le moins, un minimum de coordination.
A. UN PROBLÈME QUI NE PEUT TROUVER DE SOLUTION DURABLE QUE SUR LE FONDEMENT D’UNE HARMONISATION INTERNATIONALE
La mondialisation des échanges s’est accompagnée d’un affranchissement des frontières juridiques. Ne pouvant avoir une application extraterritoriale, la loi ne peut être efficace que si elle s’inscrit dans un cadre juridique supranational poursuivant le même objectif qu’elle.
Pour ce qui concerne la question des rémunérations des dirigeants d’entreprise et, peut-être plus encore, des opérateurs financiers, le bon échelon d’intervention est le plus large possible, c’est-à-dire le G 20 ou, à tout le moins, l’organisation pour la coopération et le développement économiques (OCDE). L’harmonisation communautaire est bien entendu souhaitable, mais elle ne peut intervenir de manière isolée.
1. Un enjeu de dimension mondiale
Les grandes banques et entreprises présentent de plus en plus un caractère mondial, soit qu’elles possèdent des succursales dans divers pays, soit qu’elles optent pour une cotation sur les places financières les plus importantes (Wall Street et Londres). À leur niveau, la concurrence ne s’exerce pas sur un marché national, mais bien à l’échelon mondial. Les mandataires sociaux de ces entreprises ainsi que les opérateurs financiers de ces banques mettent en avant cet aspect pour ex²iger un alignement par le haut de leurs émoluments sur leurs concurrents directs.
Cela est plus particulièrement vrai dans le secteur de la finance, où les traders et les responsables de salles de marchés expérimentés sont relativement peu nombreux et où la perspective de débauchages ne peut être contrecarrée que par une tendance continue à la revalorisation salariale. Ce phénomène, dit du « hold-up », le chercheur du CNRS Olivier Godechot l’a illustré de manière imagée il y a quelques années déjà : « Si dans l’usine les salariés ne peuvent partir avec l’usine, dans la finance les salariés peuvent partir avec la caisse, non pas avec toute la caisse, mais avec tout ce qui dans la caisse a de la valeur » (36).
Pour ce qui concerne les mandataires sociaux, le phénomène s’est même accentué du fait de la transparence accrue qui a été exigée des sociétés cotées. Ainsi que le souligne M. Philippe Manière dans l’étude publiée par l’institut Montaigne en juillet 2007 : « chacun y ayant intérêt (les dirigeants, mais aussi les intermédiaires consultés sur ce sujet – chasseurs de tête et sociétés spécialisées –, souvent rémunérés au pourcentage des rémunérations examinées ou prescrites), s’est installée une sorte d’échelle de perroquet, les augmentations des uns justifiant celles des autres » (37).
De fait, un véritable cercle vicieux inflationniste s’est emparé des rémunérations des dirigeants d’entreprise et des opérateurs financiers quand, dans le même temps, au nom de la compétitivité internationale, les employés de leurs groupes ou établissements étaient appelés à modérer leurs exigences salariales.
Mettre un frein à cette spirale suppose une action résolue et coordonnée des pouvoirs publics de tous les pays développés et en voie de développement. Si les pays dans lesquels les excès les plus notables ont été dénoncés (notamment les États-Unis) ne mettent pas en œuvre les mêmes règles que leurs partenaires, il y a fort à parier que la régulation que nos concitoyens appellent de leurs vœux trouve rapidement ses limites. Cette éventualité concerne surtout les métiers de la finance, dont la crise actuelle a montré les dérives et les implications potentielles sur l’économie réelle.
En la matière, il n’est pas sûr que de simples accords informels suffisent à garantir l’engagement de chacun à appliquer de nouvelles règles du jeu. Pour cette raison, la mission d’information encourage les autorités françaises à demander la formalisation des nouveaux préceptes dans une convention ou un accord international à ratifier. De la sorte seulement, les engagements pris pourront être débattus par les différents Parlements nationaux et se verront assortis d’une valeur contraignante, à l’abri de l’influence de certains lobbies directement intéressés par la question.
2. La nécessité d’une réglementation européenne
De manière générale, le droit économique des États membres de l’Union européenne est fortement marqué par les prescriptions du droit communautaire. Toute régulation des rémunérations des dirigeants d’entreprise et des opérateurs financiers a vocation à s’effectuer à ce niveau avant de se trouver déclinée dans les différents droits nationaux des Vingt-sept. Ainsi, elle pourrait être la plus harmonisée et cohérente possible en Europe.
a) Le choix d’une simple recommandation en matière de rémunérations des dirigeants mandataires sociaux
En application de l’article 44 § 2 g du traité instituant la Communauté européenne – repris dans le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (38) sous la référence de l’article 50 § 2 g –, qui tend à assurer la liberté d’établissement dans les différents pays du marché commun, le droit des sociétés, qui régit la question de la rémunération des dirigeants des sociétés cotées, relève du champ de compétence des institutions communautaires. L’Union européenne se voit en effet assigner la mission de coordonner les garanties exigées des sociétés commerciales dans les États membres dans le but de protéger les intérêts des associés et des tiers. Ainsi, le Conseil de l’Union est habilité à prendre des directives, liant les États membres quant au résultat à atteindre tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens.
Pour mémoire, on précisera que si les directives n’ont pas d’effet juridique direct, les ressortissants des États membres qui auraient omis de les transposer ou l’auraient fait dans un but non conforme aux objectifs fixés par le texte communautaire en cause peuvent en exciper. De la sorte, les dispositions nationales incompatibles sont susceptibles de se voir écartées par le juge. En outre, à l’occasion d’une question préjudicielle, la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que les juridictions internes ont l’obligation d’interpréter leur droit à la lumière des principes des directives (39).
L’élaboration d’un règlement communautaire spécifique, d’effet juridique direct sur les différents droits internes, est également possible. Si elle ne représente pas la voie qui a été privilégiée jusqu’à présent en matière de droit des sociétés, elle a permis à chaque fois des avancées significatives. On rappellera à cet égard, le règlement (CE) 2137/85 du 25 juillet 1985, qui a institué le groupement d’intérêt économique européen, destiné comme son homologue français à faciliter ou à développer l’activité économique de ses membres, ainsi que le règlement (CE) 2157/01 du 8 octobre 2001 fixant le statut de la société européenne.
À ce stade, la Commission européenne s’est bornée à formuler une nouvelle recommandation sur le régime des administrateurs de sociétés cotées (40). Cette volonté de privilégier l’incitation sur la contrainte est clairement assumée, la Commission affirmant qu’elle « souhaite encourager les entreprises à mettre en œuvre les principes d’une politique de rémunération à long terme lors de l’examen des contrats du personnel pour l’année 2010 » (41). Sur le fond, les principes énoncés rejoignent ceux du code de bonne conduite édicté par l’AFEP et le MEDEF (notamment s’agissant du conditionnement aux performances et des plafonnements des indemnités à quelques années de rémunération), sous réserve de quelques petites nuances : en l’espèce, la Commission recommande d’allonger à trois ans (au lieu de deux, en droit interne), la durée légale de conservation des options d’actions ; en outre, elle suggère d’éviter l’octroi de stock-options aux dirigeants non exécutifs ; enfin, elle propose de permettre aux sociétés de réclamer des rémunérations variables dont l’octroi se serait révélé, a posteriori, inapproprié.
b) La perspective de règles plus contraignantes en matière de rémunérations dans le secteur des services financiers
Le droit des marchés financiers, appelé à encadrer davantage les rémunérations des opérateurs financiers, s’inspire lui aussi fortement des exigences portées au niveau européen. Sans qu’aucun article du traité instituant la Communauté européenne (ni même du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne appelé à lui succéder) n’y fasse explicitement référence, la compétence des institutions communautaires en la matière s’est progressivement imposée, en corollaire de l’édification de l’Union économique et monétaire, sur le fondement des principes touchant à la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux.
La création d’un marché unique des services financiers a été encouragée par la directive 93/22/CEE du 10 mai 1993 concernant les services d’investissement dans le domaine des valeurs mobilières, dite directive « DSI », qui fut transposée en droit français par la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières. Suite à la cotation des marchés financiers en euros au 1er janvier 1999, la Commission européenne a souligné la nécessité d’améliorer l’harmonisation des règles régissant ce marché unique. Cette volonté a pris la forme d’un ensemble de mesures contenues dans le « plan d’action pour les services financiers » (PASF), qui s’est traduit par l’élaboration de pas moins de quarante-deux mesures législatives, parmi lesquelles la directive 2004/39/CE du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers (MIF) et la directive 2004/109/CE du 15 décembre 2004 sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé (directive « transparence »).
Une harmonisation des modalités de rémunération des opérateurs financiers au sein des États membres apparaît relever du marché financier unique. Rien ne s’oppose donc à ce que l’Union européenne édicte des règles sur la question, ne serait-ce que par voie de directive. La Commission européenne envisage d’ailleurs très sérieusement d’intervenir de la sorte, comme elle l’a laissé entendre à l’occasion de la formulation, le 30 avril 2009, de sa dernière recommandation sur les politiques de rémunération dans le secteur des services financiers (42).
La mission d’information considère que l’élaboration d’un texte de droit européen dérivé (directive ou règlement) encadrant plus précisément les modalités de rémunération des dirigeants d’entreprise et des opérateurs financiers contribuerait à renforcer le processus de régulation en cours de définition au sein du G 20. L’Europe ne peut plus se permettre de distorsions nationales en la matière, sauf à maintenir le système de surenchère salariale dont ont bénéficié jusqu’alors des catégories d’employés très privilégiés qui, de ce fait, ont parfois perdu le sens de leurs obligations et de leurs responsabilités. Un cadre juridique commun, le plus harmonisé possible, contribuera certainement à rompre avec cette dynamique et devrait conduire, corrélativement, les intéressés à se concentrer davantage sur l’accomplissement de leurs missions que sur les gains qu’ils peuvent espérer en retirer.
B. QUELLE VOIE PRIVILÉGIER POUR TOUTE NOUVELLE RÉGULATION EN FRANCE ?
Si la régulation doit incontestablement comporter une dimension mondiale pour être réellement efficace, rien n’interdit à chaque pays de mettre en place, à son niveau, un certain nombre d’ajustements législatifs ou réglementaires destinés à accompagner – et non à contredire – le mouvement. La France n’échappe pas à ce constat de carence, ou à tout le moins d’insuffisance.
Deux instruments se trouvent plus particulièrement mobilisables par la puissance publique pour procéder à un encadrement effectif : la fiscalité, tout d’abord, qui est l’apanage de l’État et permet de lisser certains « effets revenu » par une augmentation à due concurrence des prélèvements obligatoires ; la norme générale, ensuite, qui se contente de poser des principes dont le juge est appelé à vérifier, le cas échéant, la mise en œuvre.
De manière plus générale, l’autorégulation n’est pas en soi dénuée d’intérêt. Elle est indéniablement la plus adaptée à la grande diversité des situations. Elle ne peut cependant être préférée à la loi que si elle devient plus crédible qu’elle ne l’a été jusqu’à présent. À cet égard, la formule du comité des sages appelle de substantiels changements.
1. L’instrument fiscal, outil efficace mais à employer avec discernement
La norme fiscale est incontestablement efficace car elle s’applique rapidement et présente une forte dimension dissuasive. Elle n’en comporte pas moins des handicaps dans la mesure où, maniée sans discernement, elle peut revêtir un caractère confiscatoire qu’il convient d’éviter dans un domaine aussi crucial que l’attractivité de notre territoire pour les élites managériales et, par voie de conséquence, pour les performances de nos entreprises.
a) La remise en cause du bouclier fiscal, solution aux excès en matière de rémunération des dirigeants d’entreprise ?
La révélation de certains excès en matière de rémunération des dirigeants d’entreprise a conduit plusieurs responsables politiques de tous bords à suggérer une abrogation du bouclier fiscal ou, à tout le moins, l’adoption de mesures dérogatoires pour ses bénéficiaires les plus fortunés.
Le principe du bouclier fiscal a été introduit par la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. Il a été conforté et amplifié par l’article 11 de la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat. Désormais, aux termes du premier alinéa de l’article 1er du code général des impôts, les impôts directs payés par un contribuable ne peuvent être supérieurs à 50 % de ses revenus. Les conditions d’application de ce principe sont précisées à l’article 1649-0 A du même code.
Concrètement, la limitation à 50 % du revenu fiscal de référence de l’imposition des contribuables domiciliés en France prend la forme d’un droit à restitution de la fraction des prélèvements excédant le plafond légal. Les impôts entrant dans le calcul sont principalement : l’impôt sur le revenu ; l’impôt de solidarité sur la fortune, les contributions sociales sur les revenus du patrimoine (contribution sociale généralisée et contribution au redressement de la dette sociale, prélèvement social et contribution additionnelle) ; les contributions sociales sur les revenus d’activité et de remplacement et les produits de placement ; la taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférentes à l’habitation principale ; la taxe d’habitation afférente à l’habitation principale.
Sont également prises en compte, trois catégories de revenus perçus au titre de l’année qui précède le paiement des impositions, à savoir :
– les revenus soumis à l’impôt sur le revenu nets de frais professionnels ;
– les produits soumis à un prélèvement libératoire ;
– les revenus exonérés d’impôt réalisés au cours de la même année en France ou hors de France.
L’idée d’une suppression du bouclier fiscal, en vue de ramener les rémunérations des dirigeants d’entreprises à davantage de mesure, traduit une mauvaise appréciation de l’objet de ce dispositif comme de son champ d’application. En effet, les mandataires sociaux n’en sont pas les bénéficiaires exclusifs, ni même les principaux. En outre, il convient de rappeler que le principe du plafonnement de l’imposition fiscale directe des contribuables français participe à la recherche de l’équité et de la justice fiscales, en veillant à priver les prélèvements obligatoires de tout caractère confiscatoire, par définition nuisible à l’attractivité de notre pays à l’égard de capitaux et de talents très mobiles.
Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2005-530 DC du 29 décembre 2005 relative à la loi de finances pour 2006, a d’ailleurs précisé que l’exigence définie par l’article 13 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 « ne serait pas respectée si l’impôt revêtait un caractère confiscatoire ou faisait peser sur une catégorie de contribuables une charge excessive au regard de leurs facultés contributives ». Sur la base de ce constat, le bouclier fiscal, « loin de méconnaître l’égalité devant l’impôt, tend à éviter une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques ».
Les chiffres de l’administration fiscale illustrant les remboursements intervenus au 12 février 2009 montrent également l’utilité du procédé pour deux catégories de contribuables, représentant un total de 13 998 foyers fiscaux :
– d’une part, des foyers aux revenus très modestes mais possédant leur résidence principale et pour qui le poids de la taxe foncière peut être difficilement supportable, soit environ deux tiers des bénéficiaires du dispositif ;
– d’autre part, des contribuables assujettis à l’impôt de solidarité sur la fortune subissant le plafonnement du plafonnement de cet impôt, qui devaient consacrer une très grande fraction de leurs revenus pour l’acquitter.
On est donc loin d’un système destiné à privilégier les dirigeants d’entreprise. Des améliorations et des aménagements sont certainement possibles, mais dans le cadre d’un débat plus général sur la fiscalité patrimoniale, dont la cohérence d’ensemble peut paraître perfectible. D’ailleurs, cette perspective fait déjà l’objet de réflexions de la part des commissions des Finances des assemblées, en vue de réformes appropriées une fois la crise actuelle passée et le redressement des finances publiques suffisamment réamorcé.
b) Pour un plafonnement de la déductibilité de rémunération totale des dirigeants mandataires sociaux de l’assiette de l’impôt sur les sociétés
En l’état du droit fiscal, les rémunérations des dirigeants mandataires sociaux des sociétés cotées sont déductibles des bénéfices imposables au titre de l’impôt sur les sociétés, sous deux réserves :
– en premier lieu, qu’elles ne soient « pas excessives eu égard à l’importance du service rendu » (aux termes du 1° du 1 de l’article 39 du code général des impôts) ;
– en second lieu, qu’elles n’excèdent pas six fois le plafond annuel de la sécurité sociale, soit environ 200 000 euros, pour ce qui concerne leur volet différé au sens des articles L. 225-42-1 et L. 225-90-1 du code de commerce (aux termes du 5 bis de l’article 39 du code général des impôts).
À bien des égards, cette situation ne peut être considérée comme satisfaisante, dans la mesure où elle déresponsabilise, pour ne pas dire qu’elle encourage à faire preuve de largesse, les conseils d’administration et de surveillance au moment de fixer les émoluments des dirigeants mandataires sociaux. En effet, dès lors que la grande majorité des sommes et avantages attribués s’impute sur les impôts de la société, il va sans dire que leur propension à croître devient moins sujette à caution, y compris en période de difficultés pour le groupe ou l’entreprise.
Par ailleurs, la déductibilité de certaines charges s’entend comme une forme de reconnaissance de leur utilité sociale. Or, en l’espèce, il est permis de douter de la pertinence et de l’acceptation par l’ensemble des salariés et de nos concitoyens des émoluments perçus aujourd’hui par les dirigeants mandataires sociaux des principales sociétés cotées du pays. Dans ces conditions, le législateur ne peut qu’être amené à réviser son jugement sur la déductibilité de ces rémunérations et avantages de toutes sortes des bénéfices imposables.
La suppression de la déduction fiscale des sommes et avantages de toutes natures attribués au-delà d’un certain plafond apparaît d’autant plus envisageable qu’elle n’empêcherait pas les conseils d’administration ou de surveillance à consentir des gratifications supérieures à la limite des montants déductibles. Toutefois, dans de tels cas de figure, il leur reviendrait de se justifier plus expressément devant les assemblées générales d’actionnaires, surtout si celles-ci étaient dans la foulée appelées à se prononcer par un vote, même consultatif.
Reste à déterminer la valeur de la limite en deçà de laquelle la rémunération totale, directe ou différée, ainsi que les avantages de toutes natures resteraient déductibles du bénéfice imposable. Un montant équivalent à trente fois le plafond annuel de la sécurité sociale, c’est-à-dire environ 1 million d’euros, semble constituer un compromis raisonnable, notamment en ce qu’il ne changerait rien à la situation actuelle des plus petites sociétés du SBF 250. En revanche, pour les sociétés du SBF 120, il en irait différemment.
Une telle réforme, aux implications potentiellement fortes, n’exige pas de changements législatifs de grande ampleur. Une simple modification du 5 bis de l’article 39 du code général des impôts, de manière à élargir son champ d’application et à relever un peu le plafond prévu, devrait suffire.
c) L’existence d’arguments en faveur d’un ajustement du régime fiscal des stock-options
Les stock-options sont incontestablement l’élément de rémunération des dirigeants d’entreprise et d’opérateurs financiers qui a le plus défrayé la chronique ces dernières années. Le législateur s’est essayé à en corriger les imperfections sans pour autant y parvenir totalement, de sorte que de nouveaux ajustements apparaissent souhaitables.
Leurs régimes fiscaux (issu des articles 80 bis, 163 bis C et 200 A du code général des impôts ainsi que des articles 91 bis et 91 ter de l’annexe II du même code) et social (résultant des articles L. 136-6 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale) tiennent compte des aléas s’appliquant aux avantages qu’elles sont susceptibles de procurer à leurs bénéficiaires. Pour mémoire, la fiscalité des stock-options se décompose en trois niveaux distincts et porte sur :
– le rabais, c’est-à-dire la différence entre le prix de souscription de l’action et son cours effectif sur le marché le jour où l’offre est formulée ;
– la plus-value d’acquisition, différence entre la valeur du titre à la date de la levée de l’option et le prix de souscription ;
– la plus-value de cession, différence entre le cours de vente des actions en bourse et le cours de levée des actions attribuées dans le cadre du plan.
Pour plus de clarté, le tableau ci-après synthétise les règles applicables en la matière. Il illustre, d’autre part, leur grande complexité.
LES DIFFÉRENTS RÉGIMES D’IMPOSITION DES OPTIONS SUR TITRES
Imposition du rabais excédentaire au titre de l’année de la levée de l’option | ||||||||
Options attribuées avant le 1er janvier 1990 |
Options attribuées du 1er janvier 1990 au 30 juin 1993 |
Options attribuées depuis le 1er juillet 1993 | ||||||
Sans objet : pas de notion de rabais excédentaire |
Imposition en traitements et salaires |
Imposition en traitements et salaires | ||||||
Options attribuées jusqu’au 26 avril 2000 | ||||||||
Options attribuées avant le 20 septembre 1995 |
Options attribuées du 20 septembre 1995 | |||||||
Cession après le délai d’indisponibilité de 5 ans (1) |
Cession après le délai d’indisponibilité de 5 ans (1) | |||||||
Si options levées avant le 1er janvier 1990 |
Si options levées depuis le 1er janvier 1990 | |||||||
Gain de levée d’option |
Plus value de cession |
Imposition de la totalité du gain (2) : prix de cession moins prix d’exercice |
Gain de levée d’option (2) |
Plus value de cession | ||||
Exonération |
Imposition à l’impôt sur le revenu au taux forfaitaire de 18 % (3) |
Imposition à l’impôt sur le revenu au taux forfaitaire de 18 % (3) |
Imposition à l’impôt sur le revenu au taux forfaitaire de 30 % (3) ou option pour l’imposition en traitements et salaires sans quotient (3) |
Imposition à l’impôt sur le revenu au taux de 18 % (3) | ||||
Options attribuées depuis le 27 avril 2000 | ||||||||
Cession, conversion au porteur ou location pendant le délai d’indisponibilité de 4 ans (sauf dispense du respect du délai d’indisponibilité) |
Cession après le délai d’indisponibilité de 4 ans | |||||||
Gain de levée d’option (2) |
Plus-value de cession |
Gain de levée d’option |
Plus value de cession | |||||
Pour la fraction annuelle ≤ 152 500 euros |
Pour la fraction annuelle ≥ 152 500 euros | |||||||
Imposition selon les règles des traitements et salaires avec quotient (4) |
Imposition à l’impôt sur le revenu au taux forfaitaire de 18 % (3) |
Avant le délai de conservation de 2 ans (5) |
Après le délai de conservation de 2 ans (5) |
Avant le délai de conservation de 2 ans (5) |
Après le délai de conservation de 2 ans (5) |
Imposition à l’impôt sur le revenu au taux forfaitaire de 18 % (3) | ||
Imposition au taux forfaitaire de 30 % (3) |
Imposition au taux forfaitaire de 18 % (3) |
Imposition au taux forfaitaire de 40 % (3) |
Imposition au taux forfaitaire de 30 % (3) | |||||
Ou option pour l’imposition à l’impôt sur le revenu en traitements et salaires sans quotient (3) |
||||||||
Source : instruction fiscale du 5 janvier 2009, bulletin officiel des impôts 5-F-1-09 n° 2. (1) Par hypothèse, compte tenu de l’ancienneté des options. (2) Minoré, le cas échéant, du montant du rabais excédentaire déjà imposé au titre de l’année de la levée d’option. (3) Augmenté des prélèvements sociaux dus au titre des revenus du patrimoine. S’y ajoute, pour les options attribuées à compter du 16 octobre 2007, la contribution salariale spécifique de 2,5 %. Le taux de 18 % est applicable aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2008 (il était de 16 % antérieurement). (4) Et imposition à la CSG et à la CRDS dues au titre des revenus d’activité. (5) Décompté à partir de l’expiration du délai d’indisponibilité de 4 ans (sauf en cas de dispense du délai d’indisponibilité). | ||||||||
À la différence de certains pays tels que l’Allemagne, où la fiscalité des stock-options est identique à celle des salaires, la France compte parmi les pays qui accordent à ce dispositif un traitement plus avantageux que celui des revenus directs du travail. Si la question présente indéniablement une dimension internationale, du fait de la rivalité croissante entre grandes entreprises pour recruter certaines catégories de salariés très spécialisés ou qualifiés, elle mérite quand même d’être posée à la lumière des abus constatés en matière de rémunérations de dirigeants mandataires sociaux et d’opérateurs financiers.
Sans préconiser un retour à une taxation des stock-options comme de simples revenus, l’institut Montaigne suggérait lui-même une meilleure distinction entre gains réalisés du fait des performances objectives des bénéficiaires de ces options (dont le taux d’imposition pourrait être modulé à la baisse, à un niveau de l’ordre de 26 % pour la fraction annuelle supérieure à 152 500 euros, dans un évident souci de corrélation plus étroite entre attributions d’options et résultats), et profits réalisés grâce à la cession de titres délivrés uniquement au titre d’une rémunération complémentaire (assujettis, quant à eux, à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales). Une telle modulation présenterait l’avantage de valoriser fiscalement les revenus que les mandataires sociaux tirent des conséquences bénéfiques de leur gestion et de pénaliser les options attribuées dans le seul but de gonfler des émoluments déjà conséquents, l’instrument fiscal étant par nature le plus incitatif à l’égard des entreprises.
L’association des entreprises innovantes Croissance plus, quant à elle, propose une modulation fiscale en fonction du nombre de salariés concernés par les plans d’options. En cas de plan bénéficiant à l’ensemble des salariés en poste depuis plus d’un an et dont moins de 10 % seulement seraient réservés aux dirigeants mandataires sociaux, le taux forfaitaire d’imposition pourrait se voir minoré. En cas de plan bénéficiant à au moins 10 % des salariés, le taux marginal d’imposition varierait entre 29 % et 43 %, selon le temps passé dans l’entreprise. Dans les autres cas, la fiscalité et les charges sociales resteraient identiques à celles des salaires.
De telles suggestions, avant d’être mises en œuvre, appellent une expertise quant à leur impact budgétaire. Pour autant, elles ouvrent divers champs de réflexion pour rendre le mécanisme des stock-options plus juste.
2. La détermination d’une règle de portée générale, approche plus flexible
La loi ne peut résoudre toutes les difficultés et encadrer toutes les situations au sein des entreprises. Prétendre le contraire serait contreproductif et risquerait de nuire à l’économie de notre pays. Pour autant, les révélations choquantes de ces derniers mois (bonus des traders de Chevreux et Natixis, parachute doré de l’ancien président-directeur général de Valeo, stock-options des dirigeants de la Société générale et de GDF-Suez) illustrent combien la pratique s’est éloignée de principes de bon sens. Le législateur est donc dans son rôle lorsqu’il préconise l’adoption d’une mesure législative qui, sans nécessairement entrer dans le détail, poserait un principe appelé à être vérifié selon chaque cas d’espèce, au besoin, par le juge.
En la matière, le Parlement se doit toutefois d’écrire la loi d’une main tremblante. En effet, la mondialisation des échanges et des capitaux rend plus que jamais précaire l’implantation des sièges sociaux de grands groupes de dimension internationale. Toute législation qui serait considérée comme excessivement intrusive dans le domaine contractuel risquerait de conduire à des délocalisations génératrices de pertes fiscales et de destructions d’emplois. Il convient donc d’y prendre garde, dans un souci de responsabilité.
Les recommandations de l’AFEP et du MEDEF précisent que la rémunération des dirigeants mandataires sociaux doit être fixée en tenant compte de l’intérêt général de l’entreprise. Le président de l’AMF, M. Jean-Pierre Jouyet, évoque quant à lui « l’utilité collective », ce qui recouvre peu ou prou les mêmes tenants et aboutissants, tandis que Mme Colette Neuville, présidente de l’association pour la défense des actionnaires minoritaires, se réfère à l’intérêt social, dont la dimension est plus restrictive en ce qu’elle ignore l’enjeu de cohésion des salariés, l’acceptabilité sociale et, de manière plus générale, l’intérêt de l’économie française dans son ensemble.
On peut imaginer qu’un actionnaire contestant le montant d’une rémunération excessive consentie à des dirigeants mandataires sociaux puisse obtenir du juge l’annulation de celle-ci, dès lors que la société aurait adhéré aux recommandations de l’AFEP et du MEDEF, conformément aux articles L. 225-37 et L. 225-68 du code de commerce. Dans le silence de la loi, c’est toutefois au juge qu’il appartiendra de se prononcer sur ce point. Les auditions de la mission d’information ont montré qu’il n’y semble pas particulièrement disposé. Par ailleurs, on peut raisonnablement penser que le Parlement est fondé à en débattre, ne serait-ce qu’en raison des implications d’un tel concept sur la vie interne des entreprises.
Il ne serait sans doute pas inutile que les décisions des conseils d’administration ou de surveillance s’agissant des rémunérations des dirigeants mandataires sociaux soient prises au regard de critères objectifs, adaptés à la situation individuelle de chaque société. Sans entrer dans le détail, il est permis de penser que la moyenne des rémunérations des dirigeants des entreprises du même secteur, les performances économiques réalisées, ainsi que le traitement social des salariés (préservation de l’emploi, reclassement des effectifs licenciés pour motifs économiques) pourraient constituer des éléments d’appréciation suffisamment tangibles.
Naturellement, la loi devrait s’en tenir à l’affirmation du principe du respect de l’intérêt général, afin de conserver aux conseils leur pouvoir d’appréciation, faute de quoi les organes sociaux se verraient privés d’une large part de leur responsabilité, ce dont il ne saurait être question. Cette seule intervention du législateur serait néanmoins utile, en ce qu’elle favoriserait les recours d’actionnaires contestant les choix effectués par les conseils en matière de rémunération des dirigeants mandataires sociaux.
3. Le renforcement de l’autodiscipline au sein des sociétés cotées : une carte complémentaire à jouer
On ne peut balayer d’un revers de main les avancées obtenues ces derniers mois au niveau des organisations professionnelles des entreprises et des sociétés cotées elles-mêmes. Plus que le fond des recommandations du 6 octobre 2008, c’est leur application qui soulève des doutes légitimes. Le Gouvernement a déjà obtenu des avancées sur ce plan, avec la mise en place du comité des sages présidé par M. Claude Bébéar. Il reste que, pour donner à l’autorégulation toutes ses chances de produire de réels effets, il semble nécessaire de donner au mécanisme de contrôle informel désormais en place une dimension plus solennelle et plus systématique, faute de quoi le précepte « comply or explain » continuera à sonner creux.
a) Les vertus d’un contrôle au cas par cas dans une économie de marché ouverte sur l’international
Si l’autorégulation a insuffisamment fonctionné jusqu’à présent, c’est moins en raison du fond des règles de soft law mises au point par les organisations professionnelles des entreprises, qu’à cause des défaillances rencontrées dans leur mise en œuvre. Tant le MEDEF que l’AFEP ne souhaitent pas effectuer par eux-mêmes un contrôle sur leurs adhérents, mission qui échoit davantage à un corps professionnel qu’à une organisation représentative.
Dans l’ensemble, force est d’ailleurs de reconnaître que les prescriptions informelles édictées en 2003 puis en 2007 ont rencontré un écho assez important au sein des sociétés cotées de la place de Paris. À titre d’illustration, trois quarts d’entre elles ont mis en place des comités des rémunérations et d’audit, démembrements spécialisés des conseils d’administration et de surveillance, sans que la loi ne les y oblige. En outre, la quasi-intégralité des conseils comporte plus de la moitié d’administrateurs indépendants, au sens de la définition qu’en donne le code de gouvernement d’entreprise du MEDEF et de l’AFEP.
À bien y réfléchir, la loi elle-même n’est pas épargnée par les risques de contournement. Les multiples changements apportés à notre droit des sociétés depuis 2001 n’ont pas empêché la subsistance d’abus, sans que leurs bénéficiaires ne se trouvent dans l’illégalité. Le dernier exemple en date est celui de l’indemnité de départ de l’ancien président-directeur général de Valeo, soumise à des critères de performance conformément aux prescriptions de la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat et plafonnée à deux années de rémunération.
La loi, par essence de portée générale, ne peut efficacement traiter de cas aussi disparates que ceux des quelques centaines de dirigeants mandataires sociaux des sociétés du SBF 120. Au-delà de la fixation de principes généraux, c’est aux acteurs de la gouvernance des sociétés commerciales d’assurer par eux-mêmes le respect d’un certain nombres d’impératifs éthiques, de conditions économiques et d’exigences de justice sociale.
A cet égard, même si elle a fait suite à une injonction des ministres chargés de l’économie et du travail, résultant elle-même des souhaits formulés par le Président de la République lors de son intervention radiotélévisée du 5 février 2009, l’installation par le MEDEF et l’AFEP d’un comité des sages chargé de se prononcer sur les rémunérations des dirigeants mandataires sociaux d’entreprises qui procèdent à des licenciements massifs constitue une innovation intéressante par rapport aux situations antérieures. Jusqu’alors, l’application des principes relatifs à l’éthique des dirigeants d’entreprise était laissée à la libre appréciation des principaux intéressés. Désormais, dans certains cas, elle pourra faire l’objet d’une appréciation concrète par une instance ad hoc. C’est là un premier pas en direction de l’efficacité, mais un pas insuffisant toutefois.
b) Crédibiliser un tel mécanisme, par l’institutionnalisation du comité des sages en observatoire des rémunérations des dirigeants mandataires sociaux
À bien des égards, le comité des sages du MEDEF et de l’AFEP est marqué par certains défauts dirimants. Cette structure ne repose tout d’abord sur aucune autre base que le communiqué du 30 avril dernier annonçant sa création et confiant sa présidence à M. Claude Bébéar. Le profil des six autres membres, tous dirigeants d’entreprises en fonction ou retirés des affaires, à l’exception d’un professeur de droit, montre en outre que le MEDEF et l’AFEP ont conservé la haute main sur sa composition.
De même, les interrogations sur la portée réelle de la mise en place de ce comité sont d’autant plus fondées que les modalités de sa saisine et son champ de compétences apparaissent relativement restrictifs. En effet, l’objet de ses avis se limitera essentiellement aux dirigeants des entreprises qui recourent au chômage partiel ou à des plans sociaux de forte ampleur, et non à ceux de l’intégralité des sociétés ayant adhéré aux recommandations du MEDEF et de l’AFEP. Il est vrai que les abus les plus choquants concernent les dirigeants de sociétés qui ne s’appliquent pas à eux-mêmes la modération que les salariés se voient imposer, mais on aurait pu penser qu’un champ de compétences plus large avait toute sa place, les abus pouvant aussi être le fait de pratiques isolées en périodes d’expansion des entreprises.
Par ailleurs, seuls les conseils d’administration ou de surveillance ainsi que les comités des rémunérations et les assemblées générales d’actionnaires pourront procéder à la saisine du comité des sages. Dans les faits, les conflits entre le dirigeant mandataire social et les conseils, avec qui ont été négociés les émoluments en cause, sont assez rares. Dans le cas de Valeo, par exemple, il convient de souligner que la position du conseil d’administration recommandant à l’assemblée générale de se prononcer contre les indemnités de départ de M. Thierry Morin peut paraître paradoxale dans la mesure où elle revenait à demander aux actionnaires un vote contre les stipulations contractuelles négociées antérieurement entre ce même conseil et l’intéressé. Quant à une saisine par l’assemblée générale, elle supposera un vote majoritaire à cet effet, certainement difficile à obtenir dans les sociétés au capital relativement atomisé ou principalement patrimonial.
L’aspect le plus contestable est sans doute la confidentialité des décisions du comité des sages, dont les avis ne s’adresseront qu’à l’instance qui l’a saisi et au conseil d’administration, seul décisionnaire final en matière de rémunération des dirigeants mandataires sociaux. Il est toutefois prévu que le comité se réserve la possibilité de communiquer si ses avis ne lui semblent pas suffisamment pris en compte. De fait, la discrétion sur un sujet aussi sensible demeurera la règle, seuls les excès les plus manifestes faisant l’objet d’une certaine publicité.
Il est à craindre que toutes les précautions prises pour limiter ou encadrer l’activité du comité des sages du MEDEF et de l’AFEP ne nuisent considérablement à l’efficacité du dispositif d’autorégulation souhaité par les organisations professionnelles des entreprises. In fine, c’est la légitimité même du processus qui pourrait s’en trouver entachée.
Afin de remédier à ces travers, plusieurs aménagements de bon sens semblent absolument nécessaires pour rétablir vis-à-vis de ce système de contrôle un minimum de crédibilité à l’égard des citoyens et d’autorité à l’égard des principaux intéressés :
– en premier lieu, il convient d’officialiser solennellement l’existence de ce comité des sages, à travers un acte juridique qui l’institue et le pérennise. En l’espèce, on pourrait envisager sa transformation en observatoire sur les rémunérations des dirigeants mandataires sociaux, créé par la voie réglementaire à l’instar de l’observatoire de l’épargne réglementée (article R. 221-12 du code monétaire et financier), de l’observatoire de la laïcité (décret n° 2007-425 du 25 mars 2007), de l’observatoire économique de l’achat public (article 130 du code des marchés publics) ou de l’observatoire des prix des produits agricoles et alimentaires (article R. 611-9 du code rural), notamment ;
– en deuxième lieu, il importe d’élargir la composition de cette instance tout en y maintenant une majorité de personnalités désignées par les organisations professionnelles des entreprises. On pourrait en effet envisager que les ministres chargés de l’économie et du travail y nomment une ou plusieurs personnalités qualifiées, à raison de leurs fonctions représentatives des salariés, de leur appartenance à l’administration du Trésor public ou de leur expérience personnelle en matière de ressources humaines et d’investissement socialement responsable, par exemple ;
– en troisième lieu, les modalités de saisine, à l’occasion d’un départ de dirigeant ou d’une arrivée contestée notamment, devraient être elles aussi assouplies, de manière à permettre aux pouvoirs publics et, le cas échéant, à une minorité qualifiée des assemblées générales d’actionnaires (représentant 5 % du capital social, par exemple), de solliciter un avis spécifique ;
– en quatrième lieu, dans certaines situations particulières, la saisine de l’observatoire et la publicité de ses avis devraient être systématiques. À cet égard, il serait certainement opportun de prévoir de telles modalités d’intervention en cas d’annonce de plans réduction d’effectifs d’une ampleur excédant 1 000 emplois ;
– enfin, de manière plus générale, il semblerait opportun que l’instance exerce un suivi annuel de l’application des recommandations de l’AFEP et du MEDEF par l’ensemble des sociétés du CAC 40 qui y ont souscrit, donnant lieu à la publication d’un rapport annuel remis au Gouvernement et au Parlement. Sans nécessairement détailler la situation de chaque entreprise, retracée dans les documents de référence, l’observatoire pourrait néanmoins apprécier si les rémunérations consenties correspondent effectivement à l’intérêt général, son avis étant susceptible le cas échéant de motiver une action en justice intentée par des actionnaires individuels mécontents.
Toutes ces suggestions n’ont d’autre but que de donner véritablement sa chance à la nouvelle étape de l’autorégulation engagée ces derniers mois. En l’état, même s’il accomplit sa tâche avec application, il n’est pas sûr que le comité des sages du MEDEF et de l’AFEP atteigne tous les objectifs qui lui ont été assignés. En effet, outre qu’il lui reviendra de dénoncer les situations les plus contestables, il aura également à réconcilier, par l’efficacité de son action, l’opinion avec les dirigeants des grandes sociétés françaises de dimension internationale. S’il n’y parvient pas, c’est au législateur qu’il incombera de régler ce second aspect de sa mission, implicite mais fondamental. Les suggestions formulées précédemment s’entendent donc comme d’ultimes alternatives à la loi.
C. ACCOMPAGNER LE MOUVEMENT D’UNE NOUVELLE ÉTAPE DANS LA GOUVERNANCE DES ENTREPRISES
L’amélioration de la situation des rémunérations des dirigeants d’entreprise et des opérateurs financiers ne résultera pas d’un grand soir législatif, mais plus probablement d’un ensemble de retouches portant sur des mécanismes du droit des sociétés qui ont montré leur imperfection. Ainsi, l’amélioration de la gouvernance est une nouvelle fois au cœur du débat.
1. Instaurer des dispositifs permettant de lever les suspicions
En l’état, la transparence constitue le principal support de la moralisation des pratiques de rémunération au sein des grandes entreprises. Si elle s’est révélée jusqu’alors plutôt restreinte, notamment dans le secteur financier, c’est moins en raison des limites intrinsèques de son principe que de ses modalités de mise en œuvre. Autrement dit, une partie des solutions consiste à rendre cette transparence plus substantielle et effective.
a) Donner un statut légal aux comités des rémunérations
Comme cela a été souligné précédemment, la plupart des codes de bonne conduite élaborés dans les pays développés sur la question de la gouvernance des sociétés cotées recommandent l’intervention de comités des rémunérations, chargés d’éclairer les décisions des conseils d’administration ou de surveillance lors du recrutement de nouveaux mandataires sociaux ou dirigeants. Ces structures n’ont actuellement qu’une existence informelle, puisque la loi ne leur accorde aucune reconnaissance explicite.
Les sociétés cotées sont ainsi libres de les instituer ou non. Dans son dernier rapport sur le gouvernement d’entreprise et le contrôle interne, l’AMF estimait que 73 % des sociétés françaises cotées contrôlées sur le sujet en disposaient, contre 67 % auparavant. La proportion atteignait 96 % parmi les sociétés figurant dans l’échantillon Euronext A (37 sociétés du CAC 40 et 13 autres de taille importante, à l’instar de Areva, Atos Origin, Havas ou Thales) et 50 % seulement pour les autres (43).
L’utilité, le fonctionnement et la qualité des recommandations de ces comités ne sont, globalement, pas contestés. L’expérience montre que les membres de ces instances sont assidus, leur taux de présence atteignant 95 %. Selon l’AMF, près des trois-quarts sont composés au moins pour moitié par des administrateurs indépendants – ce pourcentage étant de 81 % pour les sociétés de l’échantillon Euronext A et de 62 % pour les autres – ; en outre, dans 82 % des cas, leur président est différent de celui du conseil d’administration ou de surveillance.
Le fait est que, en la matière, la pratique des sociétés est marquée par une grande disparité. Naturellement, comme chaque individu, chacune présente des caractéristiques qui la rendent unique. Pour autant, il est permis de considérer qu’un progrès substantiel pourrait résulter d’un minimum d’harmonisation par la loi, à commencer par l’instauration d’une obligation de mettre en place de tels comités dans les sociétés cotées qui n’y ont actuellement pas recours. La généralisation de ces comités, outre qu’elle reviendrait à conforter une attitude largement adoptée sur la place financière française, permettrait également de légitimer les émoluments accordés. Elle apparaît enfin d’autant plus souhaitable que la récente ordonnance n° 2008-1278 du 9 décembre 2008 transposant la directive 2006/43/CE du 17 mai 2006 et relative aux commissaires aux comptes a conféré un statut légal aux comités d’audit, qui constituent un autre type de comité spécialisé relevant des conseils d’administration ou de surveillance (à l’article L. 823-19 du code de commerce).
L’élaboration d’un véritable statut légal pour ces instances conduirait nécessairement le législateur à se pencher sur leur composition. L’institut Montaigne, que l’on ne peut soupçonner de sous-estimer les contraintes que supportent les entreprises, suggérait à cet égard que soit interdite au sein des comités des rémunérations la présence de toute personne ne pouvant attester de sa totale indépendance à l’égard des dirigeants. Il excluait de ce fait les bénéficiaires de contrats de prestation de services avec la société en cause ou les membres placés en situation de subordination via d’autres organes dirigeants d’autres sociétés.
Prévoir au sein de ces comités la présence d’une majorité d’administrateurs indépendants constituerait certainement un progrès, sans pour autant devenir la panacée à toutes les dérives. Comme l’a souligné l’une des personnes auditionnées par la mission, connue pour sa parfaite connaissance des cercles patronaux du CAC 40, il est bien rare qu’un dirigeant mandataire social ne parvienne pas à s’assurer le soutien de tout administrateur réputé indépendant, ne serait-ce que parce qu’il est appelé à être en contacts étroits avec lui dans l’exercice de ses fonctions. Pour cette même raison, d’autres garde-fous apparaissent nécessaires.
Au nombre de ceux-ci, pourrait figurer la présence, au sein de ces comités, d’au moins deux membres représentant les salariés, choisis par le conseil sur une liste présentée par les représentants du personnel dans la société. Ces membres particuliers pourraient se prononcer sur les rémunérations envisagées mais leur vote aurait une portée uniquement consultative. Les réticences émises par certaines organisations syndicales auditionnées par la mission d’information à l’égard d’une telle perspective n’auraient pas lieu d’être dans la mesure où ces représentants des salariés auraient ainsi accès aux informations des comités, pourraient y faire valoir leur point de vue et ne se trouveraient pas engagés par les propositions formulées aux conseils d’administration ou de surveillance. Autre avantage, les conseils ne pourraient pas ignorer la position prise par les représentants des salariés lors des réunions des comités des rémunérations au moment d’arrêter une décision sur les émoluments consentis, surtout si la loi leur conférait l’obligation de se prononcer en tenant compte de l’intérêt général.
b) Accroître l’information des actionnaires et les consulter davantage
La détermination des rémunérations les plus élevées dans les sociétés cotées ou les grandes banques incombe au conseil d’administration ou de surveillance (articles L. 225-47, L. 225-53 et L. 225-63 du code de commerce). Les actionnaires, devant lesquels le conseil d’administration ou le directoire est censé rendre annuellement des comptes, ne bénéficient le plus souvent que d’une information parcellaire, encore que celle-ci s’est singulièrement étoffée depuis dix ans à l’initiative du législateur.
Les derniers développements législatifs de 2001, 2005 et 2007 ont permis de parvenir à de véritables avancées s’agissant des mandataires sociaux. Comment expliquer, autrement, que les indemnités fixées pour leur départ aient été avalisées, en 2007, par des votes oscillant entre 62 % et 80 % des suffrages des assemblées générales d’actionnaires, signe d’un réel échange entre les exécutifs et les organes délibérants ? Il n’en demeure pas moins que ces votes ne correspondent pas, à proprement parler, à une consultation expresse sur le détail des rémunérations des dirigeants, ce qui distingue notre pays de la situation qui prévaut au Royaume-Uni, aux Pays-Bas ou en Hongrie notamment.
Outre-Manche, en effet, les sociétés cotées sont tenues depuis 2002 de présenter à l’assemblée générale de leurs actionnaires un rapport annuel détaillé sur la rémunération des dirigeants, indiquant les objectifs assignés, les composantes retenues ainsi que les modalités d’appréciation des performances réalisées. Un tel dispositif, sans entraver l’exercice de leurs prérogatives par les conseils d’administration ou les directoires, associe plus étroitement les actionnaires à la mise en place de la politique de rémunération de leur société. En somme, il responsabilise les propriétaires de la société sur les orientations retenues par les conseils, ce qui pourrait être intéressant dans le cas français.
Ainsi que le révèle le tableau ci-dessous, d’autres pays ont fait un choix institutionnel plus radical. La Belgique, la Suède, le Danemark, notamment, ont prévu de conférer le pouvoir de fixer les rémunérations des dirigeants mandataires sociaux aux assemblées générales d’actionnaires.
Cette option, que le groupe Nouveau Centre a récemment promue à l’occasion du dépôt et du débat d’une proposition de loi sur le sujet (44), présente toutefois de sérieux défauts :
– tout d’abord, elle crée une certaine incohérence institutionnelle en attribuant à un organe social qui n’a pas la compétence du recrutement des mandataires sociaux la responsabilité d’en déterminer la rémunération, qui est pourtant la contrepartie essentielle de ce recrutement ;
– ensuite, elle déresponsabilise les conseils d’administration et de surveillance, en ce qu’elle les exonère de toute mise en cause devant les tribunaux en cas de contestation des justifications des montants accordés aux dirigeants ;
– enfin, dans les sociétés à actionnariat diffus, elle renforce de fait la position des fonds de placement étrangers ou institutionnels, dont les droits de vote ont un effet d’entraînement et à l’égard desquels la direction doit garder un minimum d’indépendance dans l’intérêt industriel et social national.
CONSULTATION DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES D’ACTIONNAIRES EN MATIÈRE DE RÉMUNÉRATIONS DES DIRIGEANTS MANDATAIRES SOCIAUX EN EUROPE
Pays |
Existence et portée de la consultation |
Nature des règles |
Autriche |
Pas de consultation. |
— |
Belgique |
La détermination de la rémunération des principaux dirigeants est du ressort exclusif de l’assemblée générale. Elle ne peut être déléguée. |
|
Allemagne |
L’assemblée générale des actionnaires se prononce sur la rémunération des membres du conseil d’administration ou de surveillance. |
Loi |
Danemark |
La rémunération des membres du conseil d’administration ou de surveillance est soumise à l’approbation obligatoire de l’assemblée générale des actionnaires. |
Loi |
Grèce |
L’assemblée générale des actionnaires se prononce sur la rémunération des membres de l’équipe de direction, qui décident en revanche de la rémunération de tous les autres cadres dirigeants et de la politique de rémunération de la société. |
Loi |
Finlande |
La rémunération de la direction est déterminée par l’organe qui a procédé à sa désignation. |
|
France |
Vote sur le rapport annuel et non sur la politique de rémunération. |
Loi |
Hongrie |
L’assemblée générale des actionnaires est associée à la définition des principes de rémunération de long terme pour les principaux gestionnaires, ainsi que les membres du conseil d’administration et de surveillance. |
Loi |
Espagne |
Vote sur le rapport annuel et non sur la politique de rémunération. |
Loi |
Italie |
L’assemblée générale des actionnaires approuve la rémunération des membres du conseil d’administration ou de surveillance. Le conseil en revanche décide de la rémunération de tous les autres cadres dirigeants et de la politique de rémunération de la société. Il n’existe pas de vote sur des critères de performance. |
Loi |
Lettonie |
Pas de consultation. |
— |
Lituanie |
Vote consultatif ou obligatoire. |
Recommandations |
Luxembourg |
Pas de consultation. |
— |
Malte |
Les actionnaires peuvent approuver les enveloppes globales dévolues aux rémunérations ainsi que les critères applicables aux rémunérations des dirigeants. |
Recommandations |
Pays-Bas |
Consultation. |
Loi |
Pologne |
Pas de consultation. |
— |
Suède |
L’assemblée générale des actionnaires décide de la rémunération individuelle de chaque membre de l’équipe de direction. |
Loi |
Suisse |
L’assemblée générale des actionnaires se prononce partiellement sur les montants et les méthodes de détermination des rémunérations du conseil d’administration ou de surveillance et de l’équipe de direction. Néanmoins, c’est le conseil qui a le dernier mot en matière de fixation des rémunérations des membres de l’équipe de direction. |
Loi et recommandations |
Slovaquie |
Seuls les statuts peuvent prévoir une consultation de l’assemblée générale des actionnaires sur la rémunération des membres du conseil d’administration ou de surveillance et de l’équipe de direction. Aucune recommandation ne l’impose, ni n’exige un vote sur la politique de la société en matière de rémunérations. Une évolution sur ce dernier point est néanmoins envisagée. |
Loi |
Royaume-Uni |
L’assemblée générale se prononce, par résolution, sur le rapport concernant la rémunération des membres de l’équipe de direction. |
Recommandations |
Source : Rapport de la Commission européenne sur l’application, par les États membres, des recommandations sur la rémunération des dirigeants d’entreprise, SEC(2007) 1022, 13 juillet 2007. | ||
Le mécanisme du vote consultatif apparaît donc constituer le meilleur compromis institutionnel. À cet effet, il suffirait seulement de prévoir que tous les éléments constitutifs des rémunérations des dirigeants mandataires sociaux ainsi que les engagements de toutes natures correspondant à des indemnités ou des avantages dus ou susceptibles d’être dus à raison de la prise, de la cessation ou du changement de fonctions relèvent du régime des conventions réglementées, prévu aux articles L. 225-38 à L. 225-42-1 et L. 225-86 à L. 225-90-1 du code de commerce. La loi soumet actuellement à ce régime les indemnités de départ des dirigeants exécutifs ainsi que certaines indemnités exceptionnelles des administrateurs ou membres du conseil de surveillance. Il en résulte que ces éléments de rémunération doivent faire l’objet d’une autorisation préalable des conseils, les commissaires aux comptes étant par ailleurs avisés, de même que l’assemblée générale des actionnaires qui doit formellement en approuver le principe.
La sanction de la désapprobation de l’assemblée générale des actionnaires est la mise en cause de la responsabilité personnelle des mandataires sociaux concernés, qui doivent réparer le préjudice causé à la société ; en cas de détournement de biens appartenant à la société, la responsabilité du bénéficiaire et celle de leurs éventuels complices peut être engagée sur le fondement du délit d’abus de bien social, le contrat en cause se trouvant requalifié en acte anormal de gestion. Il s’agit là de conséquences très tangibles à l’égard des conseils et des intéressés. En outre, il est quasi certain qu’aucun conseil dont les choix en matière de rémunération des dirigeants auraient été remis en cause par un vote consultatif de l’assemblée générale des actionnaires ne se risquerait à passer outre l’avis des détenteurs du capital. L’expérience récente de Bristish Petroleum, au Royaume-Uni, le montre puisque le résultat de la consultation de l’assemblée générale des actionnaires a conduit le conseil d’administration à modifier la rémunération du principal dirigeant de la société.
c) Limiter plus fortement le cumul des mandats sociaux
Les articles L. 225-21 et L. 225-77 du code de commerce limitent à cinq le nombre de mandats d’administrateur ou de membre de conseil de surveillance d’une société anonyme ayant son siège sur le territoire français pouvant être exercés simultanément par une même personne physique. Eu égard à l’importance des fonctions des membres des conseils, on peut s’interroger sur la pertinence d’un nombre aussi important de mandats sociaux cumulables.
Surtout, la pratique montre que, dans de très nombreux cas, les administrateurs ou les membres de conseils de surveillance cumulant plusieurs mandats sont par ailleurs dirigeants mandataires sociaux d’autres sociétés cotées. À titre d’illustration, on mentionnera que M. Thierry Desmarest, président du conseil d’administration de Total, est également administrateur de Sanofi-Aventis, d’Air Liquide, de Renault et membre du conseil de surveillance d’Areva. De même, Mme Anne Lauvergeon, présidente du directoire d’Areva est-elle également administrateur de GDF-Suez, membre du conseil de surveillance de Safran (45) et administrateur de Total. M. Michel Péberau, quant à lui, tout en exerçant les fonctions de président du conseil d’administration de BNP-Paribas, est administrateur de Lafarge, de Saint-Gobain, de Total et membre du conseil de surveillance d’Axa. Enfin, M. Jean-Martin Folz, ancien président du directoire de PSA et président de l’AFEP, est-il administrateur d’Alstom, de Carrefour, de Saint-Gobain et membre du conseil de surveillance d’Axa.
De telles situations sont sujettes à caution :
– d’une part, elles offrent la possibilité à des dirigeants mandataires sociaux de cumuler des jetons de présence qui, s’ils s’apparentent à de « l’argent de poche », peuvent néanmoins s’élever à des montants très substantiels (potentiellement supérieurs à 100 000 euros annuels pour cinq mandats exercés) ;
– d’autre part, elles peuvent conduire à relativiser le regard critique que ces administrateurs particuliers sont en situation de porter sur des homologues présents parfois à leur propre conseil d’administration ou de surveillance, quand ces administrateurs-PDG ne sont pas eux-mêmes trop occupés par leur propre gestion pour assister aux réunions d’autres conseils d’administration ou de surveillance.
À leur décharge, néanmoins, les intéressés ont utilement fait valoir devant la mission d’information qu’il est dans l’intérêt d’un dirigeant de société de pouvoir solliciter l’avis ou l’opinion éclairée d’un ou de plusieurs autres chefs d’entreprise qui ont démontré leur aptitude à la prise de décision, lorsqu’il se trouve confronté à des choix stratégiques qui engagent l’avenir de plusieurs milliers ou dizaines de milliers de salariés. Il est vrai que le rôle des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance ne consiste pas à contrôler les comptes ou la gestion, mais plutôt à accompagner et à influencer les orientations de l’exécutif de la société.
Il n’en demeure pas moins troublant que certains dirigeants mandataires sociaux cumulant plusieurs mandats sociaux se trouvent à exercer, au sein de plusieurs sociétés importantes, un rôle important au sein des comités des rémunérations. Ainsi, M. Jean-Cyril Spinetta, président du conseil d’administration d’Air France-KLM il y a quelques mois encore, est par ailleurs présent aux comités des rémunérations d’Alcatel-Lucent, de GDF-Suez et de Saint-Gobain. Il en va de même de M. Thierry Desmarest, président du conseil d’administration de Total et membre des comités des rémunérations de Sanofi-Aventis, Renault ou Air Liquide. M. Alain Joly, ancien président du conseil de surveillance d’Air Liquide, est quant à lui le président du comité des rémunérations de BNP-Paribas et membre de celui de la société qu’il dirigea tandis que M. Franck Riboud, président-directeur général de Danone, participe aux réunions des comités des rémunérations d’Accor et de Renault. Et de telles situations ne sont nullement marginales.
Par voie de conséquence, il ne semble pas inopportun de revoir les règles de cumul des mandats sociaux au sein des sociétés cotées le plus importantes, une exception pouvant être admises pour les administrateurs ou membres de conseils de surveillance de PME à statut de société commerciale. Une réduction à trois du plafond du nombre de mandats autorisés dès lors qu’au moins un mandat social serait exercé dans une société de plus de 250 salariés, réalisant un chiffre d’affaires net de plus de 30 millions d’euros et affichant un bilan comptable supérieur à 15 millions d’euros constituerait sans doute un point d’équilibre, d’autant qu’elle ne s’appliquerait en fait qu’aux mandats exercés au sein des conseils des grandes sociétés cotées implantées sur le territoire français.
d) Instituer une véritable transparence sur les rémunérations des opérateurs financiers dans les sociétés intervenant dans la finance
Le fait que les rémunérations des opérateurs financiers des établissements de crédit ou d’assurance français ne fassent l’objet d’aucune transparence à l’égard des actionnaires constitue indéniablement un facteur qui a contribué à l’emballement que leur part variable a connu ces dernières années. Au même titre que la politique suivie en matière de rétribution des cadres dirigeants, la connaissance de celles-ci représente pourtant un indicateur assez pertinent du bien-fondé des orientations managériales de sociétés qui occupent une place clé dans le fonctionnement de l’économie.
Les arguments plaidant en faveur d’une véritable transparence des rémunérations des dirigeants d’entreprise apparaissent tout autant valables pour les opérateurs financiers. Outre qu’elle permettrait une plus grande responsabilisation des banques et des sociétés d’assurance sur les critères retenus pour récompenser certains de leurs employés agissant pour leur compte sur les marchés financiers, la publicité des montants attribués globalement en primes de résultats et des modalités de leur octroi inciterait sans doute les établissements de crédit et les sociétés d’assurance, dans leur ensemble, à davantage de mesure. Dans la situation actuelle, seuls les intéressés disposent des informations sur la rémunération de leurs homologues, ce qui engendre des effets pervers et des pressions inflationnistes sur leur hiérarchie sans que les actionnaires ni le grand public ne puissent s’en émouvoir.
La mission d’information ne conteste pas le caractère hautement concurrentiel des métiers de la finance, ni même la nécessité pour les grands établissements de la place de Paris de conserver, au moyen d’incitations salariales, leurs meilleurs éléments. Elle considère cependant que, si l’ensemble des banques et des compagnies d’assurance des pays développés étaient astreintes à rendre publiques les rémunérations de leurs traders et vendeurs, de leurs ingénieurs de marchés et de leurs analystes financiers – pas nécessairement de manière nominative, mais au moins sous la forme de rémunérations moyennes au sein de chaque métier assorties d’indications sur les montants les plus élevés et les moins élevés –, la tendance haussière de ces dernières années n’aurait sans doute pas été aussi forte.
À la manière de ce que le législateur a prévu pour les dirigeants mandataires sociaux d’entreprise, il conviendrait donc d’inscrire dans la loi le principe d’une telle transparence. Les modalités concrètes de celle-ci pourraient prendre diverses formes : on peut en effet envisager que le rapport annuel de gestion présenté sur le fondement de l’article L. 225-102 du code de commerce par le conseil d’administration ou le directoire des banques et des compagnies d’assurance, qui ont juridiquement le statut de sociétés commerciales, contienne les indications relatives aux rémunérations des responsables de services de trading ; une alternative consisterait à créer une publicité spécifique sur le sujet, sur la base d’une disposition inscrite dans le livre V du code monétaire et financier, cette seconde éventualité offrant l’avantage de ne pas restreindre la mesure aux seules banques en visant potentiellement l’ensemble des prestataires de services financiers.
2. Mettre un terme à l’hypocrisie entourant le statut des dirigeants de grandes entreprises
Nombre des avantages qui suscitent aujourd’hui les critiques ont été obtenus par les mandataires sociaux en raison de la précarité supposée, d’un point de vue juridique, de leur situation. Petit à petit, cette précarité a été surcompensée du fait d’un certain nombre de dévoiements devant lesquels le législateur ne peut rester impassible.
a) Bannir le cumul d’un contrat de travail avec un mandat social
L’article L. 225-22 du code de commerce n’interdit pas le cumul entre mandat social et contrat de travail. Au cours de l’exercice de son mandat social, le dirigeant d’entreprise voit le plus souvent son contrat de travail suspendu de manière à pouvoir en bénéficier de nouveau – ou, à défaut, d’indemnités de licenciement substantielles – au moment de son départ. S’agissant des dirigeants de filiales exerçant par ailleurs des responsabilités fonctionnelles au sein de la société mère, le cumul entre leur mandat social au sein de la filiale et leur contrat de travail au sein de la société mère a cours sans restriction, ce qui apparaît plus logique mais peut donner lieu aussi à certains excès.
Comme le concluait Me Lydie Dauxerre dans une étude consacrée au sujet publiée en janvier 2007 : « Le cumul d’un contrat de travail et d’un mandat social est un sujet parfois déroutant. La difficulté de cette matière réside probablement moins dans l’application de deux ordres juridiques (le “social” et le “commercial”) que dans la conciliation d’intérêts quelque peu contradictoires. Il faut tout à la fois ne pas confondre les genres en superposant dans une même personne les qualités, peu compatibles a priori, de dirigeant et de subordonné et permettre aux salariés de participer à la gestion de leur entreprise sans être privés pour autant des garanties découlant d’un contrat de travail. » (46).
Selon une étude du cabinet Hewitt datant de décembre 2008 et publiée le 6 janvier 2009 dans le quotidien Les Échos, 44 % des sociétés du SBF 120 reconnaissaient l’existence d’un cumul entre mandat social et contrat de travail pour leurs dirigeants. Dans 58 % des cas, elles se trouvaient ainsi contraintes, en cas de départ des intéressés, à verser une indemnité classique de licenciement en plus de leur indemnité de départ.
S’agissant des sociétés du CAC 40, seuls quatorze dirigeants mandataires sociaux ne bénéficiaient pas de contrat de travail l’an passé (Alcatel-Lucent, Alstom, Bouygues, EADS, EDF, Lagardère, LVMH, Michelin, Pernod-Ricard, PPR, Renault, Total, Unibail-Rodamco et Veolia environnement). À l’inverse, sept autres en disposaient sans toutefois pouvoir prétendre à des indemnités de licenciement (Air France KLM, Axa, BNP-Paribas, Cap Gemini, Crédit Agricole, GDF-Suez, Vinci). Autrement dit, dans près de la moitié des cas, les dirigeants mandataires sociaux des sociétés les plus importantes disposaient d’un contrat de travail, même suspendu, assorti d’indemnités préalablement négociées pouvant atteindre jusqu’à deux ans de rémunération brute globale (Accor, Air Liquide, Carrefour, Danone, Lafarge, France Télécom, Vivendi, Sanofi-Aventis, notamment).
Cette situation, pour le moins choquante au regard des montants consentis pour les dirigeants des sociétés en cause, a été dénoncée à plusieurs reprises. Elle apparaît en outre quelque peu contradictoire avec les principes posés par le code du travail pour définir la position du titulaire d’un contrat de travail, à savoir le lien de subordination avec son employeur, lien qui n’existe pas s’agissant d’un président de conseil d’administration ou du directoire.
Le MEDEF et l’AFEP ont logiquement souhaité qu’il soit mis un terme à ce type de cas de figure, dans leurs recommandations les plus récentes, en faisant notamment valoir que : « Le niveau élevé des rémunérations des dirigeants mandataires sociaux dans les sociétés cotées se justifie notamment par la prise de risque. Il est par conséquent incompatible avec le cumul des avantages du contrat de travail. » (47).
La mission d’information approuve cette volonté, qui participe d’une nécessaire clarification des choses. Le législateur ne peut cependant en rester à cette affirmation de principe, qui permet dans les faits une pérennisation, même partielle, des abus puisque le non-cumul repose sur une démarche volontaire des intéressés (prenant la forme, soit d’une rupture conventionnelle, soit d’une démission). Il ne semble pas illégitime de prévoir, dans le code de commerce, que les président-directeur général ou président et directeur général dans les sociétés anonymes monistes, ainsi que les président du directoire et directeur général unique dans les sociétés anonymes dualistes et les gérants de sociétés en commandite par actions ne peuvent être titulaires d’un contrat de travail avec la société dans laquelle ils exercent leur mandat social, ni même dans l’une de ses filiales contrôlées au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce.
Afin de régler le cas particulier des dirigeants mandataires sociaux ayant effectué l’intégralité ou une grande partie de leur carrière dans l’entreprise à la tête de laquelle ils accèdent – et de ce fait, soumis à un contrat de travail jusqu’à leur nomination par le conseil –, le législateur pourrait spécifier que les indemnités conventionnelles et légales pour rupture du contrat de travail auxquelles les intéressés avaient préalablement droit se trouvent, dans ce cas, reconduites à l’occasion du mandat social et éventuellement réévaluées par les conseils, au regard des nouvelles responsabilités exercées, dans la limite d’un plafond de deux ans de rémunération totale.
b) Revoir les avantages consentis pour la retraite
Les retraites supplémentaires à prestations définies des dirigeants mandataires sociaux, plus connues sous le vocable de « retraites chapeaux », peuvent apparaître choquantes aux salariés relevant du régime général dans la mesure où elles reviennent à faire supporter par l’entreprise employeur, parfois même en cas de départ consécutif à un échec, le coût du différentiel de revenus entre la pension liquidée et les derniers émoluments perçus.
Actuellement, trente-quatre des quarante valeurs les plus importantes de la place de Paris font bénéficier leurs dirigeants de telles retraites additives. Dans certains cas, le régime est partagé par l’ensemble des salariés du groupe, à l’instar du mécanisme en vigueur au sein de Saint-Gobain, GDF-Suez ou Suez environnement. Dans d’autres cas, plus nombreux à vrai dire, le régime de retraite supplémentaire est réservé à un petit nombre de cadres supérieurs, quand il n’a pas pour seul bénéficiaire le président-directeur général de la société. A France Télécom, seulement 140 cadres et le président-directeur général se trouvent en situation d’obtenir une retraite supplémentaire qui peut égaler, dans le cas du plus haut dirigeant notamment, jusqu’à 20,8 % de la meilleure moyenne annuelle de ses rémunérations brutes des trente-six derniers mois d’activité. Pour mémoire et, à titre de comparaison, le régime général des salariés du privé est déterminé sur la base de la rémunération perçue lors des vingt-cinq meilleures années, ce qui induit un effet de lissage considérablement plus fort.
Le mécanisme des retraites supplémentaires à prestations définies engendre le plus souvent à la charge des sociétés concernées des provisions de plusieurs millions d’euros pour un nombre très réduit de bénéficiaires. Les organisations professionnelles des entreprises ont reconnu implicitement l’existence d’abus, à l’occasion de l’élaboration de leurs dernières recommandations sur les rémunérations des dirigeants mandataires sociaux. À cette occasion, elles ont souhaité poser des exigences de bon sens, à savoir que :
– le groupe de bénéficiaires potentiels soit sensiblement plus large que les seuls mandataires sociaux ;
– les bénéficiaires satisfassent des conditions raisonnables d’ancienneté dans l’entreprise, fixées préalablement par le conseil d’administration ou le directoire ;
– les droits potentiels ne représentent qu’un pourcentage limité de la rémunération fixe de chaque bénéficiaire ;
– la période de référence prise en compte pour le calcul des prestations soit de plusieurs années, tout gonflement artificiel de rémunération sur cette période à seule fin d’augmenter le rendement du régime de retraite se voyant proscrit.
Ces prescriptions ont représenté une réelle innovation par rapport aux recommandations publiées en janvier 2007. Il convient peut-être d’attendre un peu pour leur laisser le temps de produire leurs effets, avant d’envisager d’intervenir formellement sur la question. Néanmoins, si les aménagements proposés par le MEDEF et l’AFEP ne se révèlent pas suffisamment efficaces, il conviendra de réfléchir à un système différent. En l’espèce, la suggestion de l’institut Montaigne consistant à mettre fin à la compensation financière des entreprises en contrepartie de la mise en place pour leurs dirigeants d’un régime de retraite par capitalisation assorti le cas échéant de déductions fiscales ne manque pas d’attrait. Il s’agit d’une alternative intéressante à l’instauration d’une fiscalité confiscatoire, qui résoudrait certainement le problème en cette période de crise mais ouvrirait la voie à la réitération des excès passés une fois la reprise venue.
3. Moraliser certaines pratiques devenues inacceptables
Au cours de ses travaux, la mission d’information a relevé que certaines dispositions du code de commerce prêtent le flanc à l’abus. Sans dédouaner ceux qui s’en sont habillement prévalus pour optimiser leurs émoluments, le législateur ne peut fermer les yeux sur ces imperfections manifestes de notre droit.
a) Mettre de l’ordre à la pratique des jetons de présence
L’octroi de jetons de présence aux administrateurs ou aux membres de conseils de surveillance est une pratique très répandue dans les sociétés cotées. Les articles L. 225-45 et L. 225-83 du code de commerce restent en la matière peu diserts, en ce qu’ils se contentent de laisser aux conseils d’administration ou de surveillance le soin de répartir entre personnalités mandatées pour contrôler la gestion et veiller à la bonne marche de l’entreprise les montants globaux alloués chaque année à cet effet par l’assemblée générale des actionnaires.
Les situations varient fortement non seulement d’une société à l’autre, mais également d’un administrateur à l’autre. C’est ainsi, par exemple, que les présidents du conseil d’administration et de la direction générale du groupe Renault ont perçu, en 2007, des montants annuels de jetons de présence de 28 000 euros, les plaçant au 10ème rang des membres du conseil, alors que la même année, le président du conseil d’administration d’Alcatel-Lucent recevait une enveloppe de 96 890 euros, supérieure de près de 40 000 euros à celle des administrateurs les mieux rétribués pour leur présence.
De manière plus générale, il est permis de s’interroger sur la pertinence de l’existence de jetons de présence pour le président du conseil et le directeur général dès lors qu’ils sont également rémunérés pour leur gestion et que leur participation aux réunions du conseil d’administration procède, en quelque sorte, de leur charge de travail. Certains dirigeants mandataires sociaux ont d’ailleurs adopté une position très logique à cet égard, en refusant de percevoir des jetons de présence de la part de la société qu’ils dirigent : c’est le cas, notamment, des présidents du conseil d’administration et des directeurs généraux de Total et de Saint-Gobain.
Autre subtilité pour le moins baroque concernant les jetons de présence, leur majoration en fonction de la présence effective des intéressés aux réunions des instances auxquelles ils appartiennent. À titre d’illustration, le document de référence pour 2007 de la société Saint-Gobain souligne que les administrateurs se sont vus allouer, à titre de partie fixe, la somme annuelle de 25 600 euros et, à titre de partie variable, 3 520 euros par présence effective aux séances. Le cas de figure n’est pas isolé et illustre, finalement, que les jetons de présence sont bien mal nommés dans la mesure où ils rémunèrent une simple appartenance à une instance, l’implication réelle des intéressés donnant lieu à des rétributions complémentaires.
Forte de ces constats, la mission d’information est amenée à formuler deux suggestions : en premier lieu, interdire, au besoin dans la loi, le versement par des sociétés cotées de jetons de présence à leurs propres responsables exécutifs, leur rémunération incluant de fait cet aspect naturel de leur mission ; en second lieu, subordonner le versement de jetons de présence à la participation effective des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance aux travaux de l’organe social auquel ils appartiennent. En somme, il s’agit ni plus ni moins de revenir aux sources des justifications de ces rétributions censées dédommager, à raison du temps qu’elles y consacrent réellement, les personnes qui s’impliquent dans la surveillance de la gestion de sociétés cotées, dans un souci de bonne gouvernance.
b) Ajuster le régime juridique des stock-options
En l’état des articles L. 225-177 et L. 225-179 du code de commerce, les options de souscription ou d’achat d’actions peuvent être accordées à un prix jusqu’à 20 % inférieur à la moyenne des cours des vingt séances de bourse précédentes. Ce rabais quasi-systématiquement appliqué jusqu’à la crise actuelle, ainsi que la période de référence extrêmement courte retenue pour le calcul du prix d’achat ou de souscription, garantissaient presque automatiquement de substantielles plus-values aux bénéficiaires de stock-options, indépendamment même de l’impact de leur gestion sur la valorisation boursière de leur entreprise puisqu’une simple stabilisation des cours sur le moyen terme suffisait à leur procurer un rendement à deux chiffres.
L’importance des montants atteints par la cession de ces options ne s’explique pas, naturellement, par ces seules caractéristiques. Il n’en demeure pas moins que l’avantage procuré par la décote ainsi que par l’étroitesse de la fenêtre de calcul du prix des options peut susciter des réserves quant à leur bien-fondé, surtout que les bénéficiaires de telles options jouissent par ailleurs d’autres libéralités. De surcroît, la simple réservation, à titre préférentiel, d’actions constitue déjà en soi un privilège non négligeable pour qui, en charge de la gestion de la société au quotidien, possède la meilleure appréciation possible sur ses perspectives de développement, d’activité et de valorisation boursière potentielle. Pourquoi, dans ce cas, prévoir d’emblée un avantage significatif sur le prix d’acquisition ou de souscription, si ce n’est pour gonfler la rémunération des intéressés ?
Dans leurs ultimes recommandations sur la rémunération des dirigeants d’entreprises, le MEDEF et l’AFEP ont préconisé aux conseils d’administration et de surveillance des sociétés cotées de ne plus appliquer de décote aux stock-options accordées aux mandataires sociaux. Cette suggestion n’est pas nouvelle, car elle figurait déjà dans les recommandations publiées en janvier 2007, avec l’efficacité que l’on sait (48). La démarche patronale se heurte en outre à une limite importante dans son application, dans la mesure où elle ne concerne que les dirigeants mandataires sociaux et non les autres catégories de bénéficiaires, au premier rang desquelles figurent les opérateurs financiers dans le cas des grands établissements de crédit ou d’assurance.
Il a été précédemment indiqué que le public à qui s’adressait, jusqu’à présent, le dispositif des stock-options était majoritairement constitué de cadres supérieurs exerçant des fonctions dirigeantes ou clés dans les entreprises. La loi du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail entend infléchir cet état des choses, en favorisant une diffusion plus large de l’attribution des titres des sociétés à l’égard des salariés. Pour cette raison, même si l’on peut raisonnablement penser que les salariés de base se verront plutôt accorder des actions gratuites ou des primes d’intéressement ou de participation dès lors que les cadres dirigeants bénéficieront d’options de souscription ou d’achat d’actions, une suppression totale de la décote n’apparaît pas souhaitable.
Il semble plus pertinent d’envisager une suppression ciblée, qui concernerait les mandataires sociaux ainsi que les opérateurs financiers (catégories susceptibles d’être précisées par décret, par renvoi de la loi, de manière à permettre facilement les ajustements qui pourraient paraître nécessaires au gré de la sophistication et de l’évolution des métiers de la finance et des responsabilités au sein des entreprises). Il apparaît néanmoins souhaitable de prévoir une telle suppression de manière explicite dans les articles L. 225-177 et L. 225-179 du code de commerce. Les autres catégories de salariés, quant à elles, pourraient continuer à se voir offrir des conditions de souscription ou d’achat plus avantageuses, d’autant plus justifiées que leurs rémunérations sont moindres.
Parallèlement, un allongement du nombre de séances de cotation pris comme référence pour le calcul du prix des options apparaît lui aussi souhaitable. La durée actuelle ne permet pas de lisser certains effets d’annonces ou de privilégier une performance de moyen terme dans la valorisation de l’entreprise. Là aussi, une modification des articles L. 225-117 et L. 225-179 du code de commerce semble devoir être envisagée, afin de substituer aux vingt jours de séance prévus actuellement, une période de référence beaucoup plus longue, qui pourrait avoisiner par exemple cent trente jours de séance, soit une durée de six mois à l’échelle d’une année calendaire. Un tel allongement est notamment préconisé par les représentants des entreprises innovantes.
La rémunération des dirigeants mandataires sociaux et des opérateurs financiers a longtemps été considérée comme relevant exclusivement du domaine des rapports contractuels entre les entreprises et leur management. Soucieux d’éviter toute dérive vers un dirigisme économique aux effets dommageables, le législateur s’est contenté de les encadrer sous l’angle de la transparence. La publicité des émoluments consentis à l’égard des actionnaires était supposée garantir une certaine modération des comportements.
Las, force est de reconnaître que ce modèle de soft regulation n’a pas empêché les excès auxquels on a récemment assisté. Plus encore que les montants parfois astronomiques reçus par une poignée de privilégiés, ce sont les circonstances accommodantes dans lesquelles ces rétributions ont parfois été accordées qui peuvent choquer. En effet, s’il n’est pas anormal qu’un dirigeant mandataire social ou qu’un opérateur financier perçoive un salaire qui tienne compte de ses performances pour son entreprise ou son établissement employeur, il est beaucoup moins acceptable que des gratifications en tous genres perdurent lorsque l’intéressé n’a pas donné satisfaction, a commis des erreurs ou même lorsque son employeur se débat dans de graves difficultés de trésorerie.
Compte tenu de l’ampleur de la crise actuelle et de ses conséquences parfois dramatiques pour des centaines de milliers de salariés, le maintien du statu quo est devenu impossible. En formulant les propositions figurant dans ce rapport, la mission d’information de la commission des Lois sur les nouvelles régulations de l’économie entend prendre activement part à l’entreprise de moralisation et de refondation du capitalisme en cours.
Le législateur a conscience que la loi, par définition générale, ne peut pas trop entrer dans le détail sous peine de se révéler inadaptée à des profils d’entreprises par définition multiples. La règle doit néanmoins évoluer, afin de poser de nouveaux principes. Il en va de la crédibilité des équilibres nécessaires à la solidité de notre pacte social. Il en va aussi, dans une large mesure, de l’efficience économique grâce à la restauration d’une valeur un peu trop oubliée ces dernières décennies par les grands dirigeants et banquiers, en dépit de son rôle essentiel dans le système capitaliste, à savoir : l’éthique de responsabilité.
I. AGIR AU NIVEAU INTERNATIONAL ET EUROPÉEN
Proposition n° 1 : formaliser, au sein d’un engagement international juridiquement contraignant, les choix de réforme réalisés par les pays du G 20 s’agissant des modalités de rémunération des dirigeants de sociétés et des opérateurs financiers.
Proposition n° 2 : transcrire au sein d’une directive les recommandations de la Commission européenne sur le régime de rémunération des administrateurs des sociétés cotées.
II. POSER LES JALONS JURIDIQUES D’UNE AUTORÉGULATION VÉRITABLEMENT EFFICACE
Proposition n° 3 : réécrire le 5 bis de l’article 39 du code général des impôts, afin de plafonner à 1 million d’euros les rémunérations et avantages de toutes natures consentis annuellement aux dirigeants mandataires sociaux demeurant déductibles de l’assiette de l’impôt sur les sociétés.
Proposition n° 4 : inscrire, aux articles L. 225-47, L. 225-53, L. 225-63 et L. 225-81 du code de commerce que la rémunération des présidents du conseil d’administration ou de surveillance, du directoire ainsi que celle des directeurs général et généraux délégués doit correspondre à l’intérêt général de l’entreprise.
Proposition n° 5 : donner une base réglementaire au comité des sages du MEDEF et de l’AFEP, en le transformant en observatoire des rémunérations des dirigeants mandataires sociaux.
À cette occasion :
– élargir la composition de l’actuel comité des sages en permettant la désignation de personnalités qualifiées choisies selon leur expérience personnelle des ressources humaines, de l’investissement socialement responsable, du dialogue social, notamment.
– permettre aux pouvoirs publics et aux actionnaires minoritaires représentant au moins 5 % du capital social de saisir le futur observatoire sur les rémunérations des dirigeants d’entreprise en cas de situation appelant une vigilance particulière.
– instaurer une autosaisine systématique du futur observatoire sur les rémunérations des dirigeants d’entreprise et la publicité obligatoire de ses avis dans les cas concernant des entreprises procédant à une réduction d’effectifs de 1 000 emplois et plus.
– prévoir un rapport annuel au Gouvernement et au Parlement du futur observatoire sur les rémunérations des dirigeants d’entreprise.
III. DONNER UN NOUVEL ÉLAN À LA GOUVERNANCE DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES
A. Démocratiser les processus de fixation des rémunérations
Proposition n° 6 : à l’instar de ce qui a été fait pour les comités d’audit par l’ordonnance n° 2008-1278 du 8 décembre 2008, donner un statut légal aux comités des rémunérations pour toutes les sociétés dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé remplissant des seuils de chiffre d’affaires hors taxe, d’effectifs et de bilan comptable, définis par décret en Conseil d’État.
Dans ce cas, envisager la présence à titre consultatif d’au moins deux représentants des salariés, désignés par les conseils d’administration ou de surveillance sur proposition des représentants du personnel, de manière à permettre un droit de regard sur les débats des comités et d’éclairer plus complètement les conseils dans leur prise de décision, notamment au regard du respect de l’intérêt général.
Proposition n° 7 : modifier les articles L. 225-42-1 et L. 225-90-1 du code de commerce afin d’obliger les conseils d’administration ou de surveillance à consulter les assemblées générales ordinaires des actionnaires sur l’intégralité des éléments de rémunération et les engagements de toutes natures correspondant à des indemnités ou à des avantages dus ou susceptibles d’être dus à raison de la prise, de la cessation ou du changement de fonctions d’un dirigeant mandataire social.
Proposition n° 8 : limiter à 3, dans les articles L. 225-21 et L. 225-77 du code de commerce, le nombre de mandats sociaux pouvant être simultanément détenus par une même personne physique au sein de sociétés anonymes ayant leur siège social en France, dès lors qu’au moins l’une de ces sociétés présente un chiffre d’affaires hors taxe, un total de bilan et un nombre moyen de salariés excédant les seuils fixés par l’article R. 233-16 du code de commerce.
B. Clarifier le statut des dirigeants mandataires sociaux
Proposition n° 9 : bannir, aux articles L. 225-22 et L. 225-61 du code de commerce, le cumul entre mandat social et contrat de travail afin d’empêcher tout cumul d’indemnités de départ.
Proposition n° 10 : mettre en place un système de retraite par capitalisation, sur la base de cotisations personnelles, pendant la durée du mandat social, afin de le substituer aux régimes existants de retraite complémentaire à prestations définies.
Naturellement, dans le cas des salariés accédant au statut de mandataire social, le changement de statut ne devrait pas rendre caducs les droits jusqu’alors acquis dans un système de retraite complémentaire en entreprise, la cotisation personnelle cessant seulement pour la durée à venir du mandat social.
C. Mettre un terme aux abus les plus criants
Proposition n° 11 : interdire, aux articles L. 225-45 et L. 225-83 du code de commerce, l’attribution de jetons de présence aux présidents du conseil d’administration ou de surveillance et aux directeurs généraux et généraux délégués lorsqu’ils sont administrateurs de la société qu’ils gèrent.
Proposition n° 12 : prévoir que les jetons de présence sont attribués au prorata de la participation effective des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance aux travaux du conseil auquel ils appartiennent.
Proposition n° 13 : supprimer, aux articles L. 225-177 et L. 225-179 du code de commerce, la décote de 20 % sur le prix d’attribution des stock-options aux dirigeants mandataires sociaux.
Proposition n° 14 : lisser les prix d’attribution des stock-options, par un calcul portant sur le cours moyen observé sur une période de 130 séances de bourse (environ six mois) au lieu de vingt (moins d’un mois).
Proposition n° 15 : examiner la possibilité de moduler le traitement fiscal des options de souscription ou d’achat d’actions attribuées aux dirigeants mandataires sociaux, selon qu’elles s’inscrivent dans un plan ayant bénéficié à l’ensemble des salariés de la société, à une proportion significative de salariés ou à un nombre très réduits de dirigeants.
D. Accroître la transparence en matière de rémunération des opérateurs financiers
Proposition n° 16 : prévoir, soit dans le rapport annuel de gestion mentionné à l’article L. 225-102 du code de commerce (pour les établissements bancaires et les compagnies d’assurances cotées), soit au sein d’une disposition spécifique du code monétaire et financier, la publication annuelle des enveloppes globales dévolues par chaque prestataire de services financiers à la rémunération des opérateurs financiers et des sommes réparties entre les différentes catégories d’opérateurs.
CONTRIBUTION DE MM. PHILIPPE VUILQUE ET JEAN-MICHEL CLÉMENT ET DES MEMBRES DU GROUPE SOCIALISTE, RADICAL, CITOYEN ET DIVERS GAUCHE (SRC) APPARTENANT À LA MISSION D’INFORMATION
La commission des Lois, avec le concours de ses différentes composantes politiques, a pu utilement mener un travail approfondi sur la question de la rémunération des dirigeants de grandes sociétés dont la situation actuelle n’est plus tolérable. Les différentes auditions et réflexions conduites ont permis d’éclairer l’opinion publique sur ce sujet. Il convient à présent d’aller plus loin et de passer à la phase suivante : légiférer.
Aujourd’hui, on ne peut plus échapper à une véritable politique concernant les hauts revenus dans notre pays, sans laquelle les fondements même de la cohésion nationale sont menacés. Il est urgent de mettre fin aux rémunérations indécentes de certains dirigeants de grandes sociétés et à la protection dont ils disposent. A ce titre, la question des mécanismes de leurs rémunérations et de leurs conditions d’attribution ne peut être éludée.
Un constat accablant partagé par tous
La crise économique que nous connaissons actuellement se caractérise par une explosion des inégalités et tout particulièrement de la rémunération des dirigeants.
Actuellement, les hauts revenus captent l’essentiel de l’augmentation de la richesse nationale en France. Alors même que le salaire de 90 % des salariés les moins payés a stagné depuis 2002, celui des dirigeants de sociétés s’est envolé pour atteindre, avec les bonus et les stock-options, 4,7 millions d’euros en moyenne pour les dirigeants du CAC 40 : cela représente 300 fois le SMIC. Cette hausse est due pour beaucoup aux stock-options et aux actions gratuites.
Ce creusement des inégalités marque une rupture historique avec la situation qui a prévalu pendant près de 25 ans. L’écart des rémunérations était encore de 1 à 30 dans les années 1960-70 dans la majorité des pays. Aujourd’hui, il a explosé et il retrouve des valeurs qui n’avaient pas été observées depuis les années 30.
La croissance annuelle moyenne des très hauts revenus est même plus élevée en France qu'aux États-Unis.
Le taux de croissance des salaires des 3 500 ménages les plus aisés est de 51 % sur la dernière décennie, c'est 16 fois plus important que celui des salaires de la grande majorité de la population.
Il n’existe aucune justification économique à un tel niveau de rémunérations. Elles ne rémunèrent pas le risque car elles reposent sur des rémunérations variables (stock-options, bonus) qui ne sont exercées que lorsqu’elles sont favorables et quelles s’accompagnent en plus de parachutes dorés ou de retraites « chapeaux ».
De même, elles ne rémunèrent pas la performance. Elles reflètent essentiellement les mouvements généraux de la bourse et une situation de rente, entretenue par l’opacité et le contrôle insuffisant des rémunérations des dirigeants.
Au vu de cette situation, il n’est alors plus acceptable de faire croire que la valeur travail d’un dirigeant du CAC 40 touchant 300 fois le SMIC puisse réellement être 100 fois plus élevée que celle d’un patron d’une PME de moins de 50 salariés dont la rémunération moyenne est de 3 SMIC. Cela ne peut plus perdurer.
Des tentatives de moralisation trop succinctes et une autorégulation insuffisante et peu efficace
Depuis son discours de Toulon en septembre 2008, le Président de la République n’a pas eu de mots assez durs pour stigmatiser certains dirigeants d’entreprises partant avec des fortunes assurées, alors même qu’ils les ont menées à la faillite. On s’attendait alors à des modifications de la législation sur le sujet. En réalité, il n’en fut rien.
Depuis des semaines, le gouvernement refuse toute modification de la législation en la matière. La ministre de l’économie l’a encore rappelé le 30 juin 2009 devant la commission des Lois. Selon elle, cela ne concernerait que les dirigeants du CAC 40 et du SBF 120. Mais là est justement le problème.
De plus, la ministre estime que les dispositions réglementaires d’avril dernier afférentes à la rémunération des dirigeants des entreprises aidées par l’État seraient, en l’espèce, suffisantes.
Cela n’est pas vrai. La Cour des comptes vient de le démontrer dans son dernier rapport relatif aux concours publics aux établissements de crédit. Elle estime que : « le dispositif encadrant la rémunération des dirigeants des établissements bancaires est complexe et peu lisible ». De plus, « les conventions qui lient chaque banque à l’État sont toujours en attente de révision pour intégrer les dispositions de la loi et du décret du 20 avril ». Elle ajoute que : « les dispositions interdisant les retraites-chapeaux résultant du décret du 20 avril 2009 resteront largement sans effet. […] Les politiques de rémunération doivent être intégrées dans le contrôle des risques et le traitement fiscal et social de l’ensemble des éléments de rémunération (bonus, retraites-chapeaux, parachutes dorés) doit être réexaminé ».
Par ailleurs, il convient de rappeler que les données salariales évoquées précédemment correspondent à des revenus avant impôts. Alors que la fiscalité pourrait corriger un tant soit peu ces inégalités, il n’en est rien. La politique fiscale conduite depuis 2002 a fait tout l'inverse. Elle n'a fait qu’aggraver la situation. En effet, la fiscalité applicable aux très hauts revenus a été fortement réduite.
En appeler à l’autorégulation, à l’évolution des mentalités et des pratiques ou aux mesures de transparence comme le fait le gouvernement, relève moins d’une fausse naïveté en la matière que d’une volonté dissimulée de ne rien faire.
Ce n’est pas non plus la nouvelle charte AFEP-MEDEF qui changera réellement les choses. Les pratiques récentes en témoignent. L’incantation n’a jamais été source d’action. Aucune contrepartie n’a été demandée en retour de la souscription à cette charte.
De même, il n’est pas étonnant que le forum de stabilité financière recommande l’utilisation de la voie législative et parlementaire plutôt que l’engagement volontaire des entreprises.
Il est donc grand temps d’en finir avec le chapelet des scandales dévoilés ces derniers mois sur les avantages totalement disproportionnés de ces mêmes dirigeants.
Des propositions limitées qui répondent imparfaitement à la nécessité de mettre un terme au scandale des rémunérations indécentes
Les propositions faites par la mission d’information sont opportunes et tentent de répondre au problème posé. Certaines modifications réglementaires ou législatives vont dans le bon sens et l’on ne peut que s’en féliciter. D’autres restent trop en retrait ou demeurent dénuées de toute portée réelle. L’heure n’appelle pas à la frilosité ou à la retenue sur un tel sujet.
Ainsi, la proposition n° 3 prévoit de plafonner à 1 million d’euros les rémunérations et avantages de toutes natures consentis aux dirigeants de sociétés chaque année et déductibles de l’assiette de l’impôt sur les sociétés.
Une telle disposition signifie que le plafond de déductibilité à l’impôt sur les sociétés de la seule rémunération se situerait aux alentours de 800 000 euros par an, puisqu’un dispositif de plafond des avantages de toutes natures (« parachutes dorés »…) de 200 000 euros a été adopté dans la loi de finances pour 2009, à l’initiative du Président de la commission des finances de l’Assemblée. Limiter à 800 000 euros au maximum la simple rémunération des dirigeants n’est pas sérieux. Ce montant est bien trop élevé eu égard à l’ampleur de l’inégalité et ne corrige pas l’indécence d’un tel salaire.
Le groupe SRC propose une limitation de la déductibilité à 25 fois le montant de la plus faible rémunération à temps plein, après cotisations sociales, en vigueur dans l’entreprise lorsque la société en question est aidée par l’État (environ 300 000 euros par an).
Dans le même esprit, le groupe SRC propose également que la rémunération des mandataires sociaux des sociétés cotées ne puisse excéder un montant égal à la plus faible rémunération en équivalent temps plein versée au sein de l’entreprise multipliée par un coefficient proposé par le conseil d’administration et validé par l’assemblée générale des actionnaires, après avis du comité d’entreprise. De plus, les rémunérations dépassant ces deux plafonds pourraient rester soumises à l’impôt sur les sociétés et subir un taux d’imposition sur le revenu exceptionnel.
La proposition n° 4 n’a aucune portée juridique à ce jour et demeurera sans effets.
La proposition n° 5 est clairement en retrait. Il ne s’agit plus de mesurer l’écart ou de le constater, il faut le réduire ou l’encadrer.
La proposition n° 6 est pertinente. A ce titre, il est important d’accorder un droit de vote aux deux représentants des salariés présents au sein des comités des rémunérations.
La proposition n° 7 prend tout son sens uniquement si l’assemblée générale des actionnaires se prononce par un vote.
Les propositions n° 8 et 9 répondent favorablement au problème du cumul des mandats sociaux.
La proposition n° 10 traduit la volonté bienvenue de mettre fin aux retraites-chapeaux. Pour autant, elle ne recueille pas l’approbation du groupe SRC. Si la retraite ne doit pas devenir un élément de rémunération cachée des mandataires sociaux des grandes sociétés, elle doit s’inscrire dans le cadre d’une politique nationale pour tous les salariés. Cela ne peut pas avoir lieu par capitalisation.
Les propositions n° 11 à 15 se résument au titre de leur chapitre : « mettre un terme aux abus les plus criants ». En effet, elles limitent les abus les plus criants mais uniquement ces derniers. Il convient d’aller nettement plus loin, notamment sur le plan fiscal.
La dernière proposition est utile et recueille notre soutien.
L’ensemble de ces 16 propositions traduit la volonté sincère de modifier les comportements des dirigeants de grandes sociétés d’entreprises en termes de rémunérations. Mais elles reflètent également une certaine retenue sur le sujet. On ne peut se limiter à ce stade.
Ainsi, le 30 avril 2009, le groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche a défendu une proposition de loi relative aux hauts revenus et à la solidarité (n°1544). Cette dernière traduisait cette volonté de légiférer avec courage sur la question de la rémunération des dirigeants.
Pour être véritablement efficace, ce sujet nécessite un préalable : supprimer le bouclier fiscal. Il n’est pas possible de vouloir mettre fin aux injustices et d’encadrer la rémunération des dirigeants si parallèlement, les effets correcteurs et redistributeurs de la fiscalité ne peuvent plus jouer. En plafonnant la somme de ces impositions, on incite à l’explosion des plus hauts salaires car quelle que soit l’ampleur de cette hausse, elle ne sera à partir d’un certain niveau plus soumise à imposition. Cela n’est pas acceptable. Au moment où la crise économique exige l’effort de tous, il est intolérable que seuls les plus nantis de nos concitoyens soient exonérés de tout effort de solidarité.
Encadrer la rémunération de base des dirigeants de grandes sociétés cotées ou plafonner la rémunération des sociétés aidées par l’État nous parait nécessaire pour mettre fin aux excès de toutes natures. A ce sujet, madame le ministre de l'économie et de l'emploi a affirmé lors du débat en séance publique que plafonner la rémunération des dirigeants équivaudrait à revenir à une économie administrée. Ces propos caricaturaux ne sont pas sérieux. Ils le sont d'autant moins que le Président Obama a proposé un plafonnement à 500 000 dollars par an de la rémunération des grands dirigeants des sociétés aidées par l’État américain.
De plus, nous proposons la création d’un comité indépendant des rémunérations au sein du conseil d’administration ou de surveillance. Il remettra un rapport à l’assemblée générale des actionnaires sur les rémunérations des dirigeants et sur la politique de rémunération à venir. Les représentants du personnel pourront interroger les dirigeants sur le contenu de ce rapport qui devra être validé par l’assemblée générale des actionnaires.
En outre, nous souhaitons interdire totalement l’attribution de stock-options et d’actions gratuites, hormis pour les sociétés qui sont âgées de moins de 5 ans. Il est nécessaire d’encourager les jeunes entrepreneurs qui prennent des risques.
Les indemnités de départ comme les parachutes dorés ne doivent pas excéder deux fois la plus haute indemnité de départ en cas de licenciement d’un salarié, prévus dans les accords d’entreprise, de branche ou la loi.
De même, limiter le montant des retraites-chapeaux des dirigeants de grandes sociétés à 30 % de la rémunération de la dernière année de l’exercice de sa fonction est raisonnable.
Il est tout à fait regrettable que la majorité parlementaire ait rejeté en bloc toutes ces propositions lors de leurs examens en séance publique.
D’autres mesures sont également envisageables.
Pourquoi ne pas instaurer une responsabilité personnelle des dirigeants dont la justice reconnaît la gestion fautive par une franchise obligatoire de leurs polices d’assurance égales à un an et demi de leurs rémunérations. Les composantes de la rémunération liées à la performance ne seraient versées qu’à la fin du contrat de travail. L’obligation pour le conseil de surveillance de diminuer le salaire des membres du directoire lorsque la situation de l’entreprise se dégrade sérieusement serait aussi souhaitable.
Ces propositions viennent d’être votées par le Parlement allemand qui a su, après les Pays-Bas, légiférer sur ce sujet. Il parait opportun de nous en inspirer pour compléter le débat et pour in fine légiférer en France sur les rémunérations des dirigeants de sociétés cotées ou aidées.
Chercher à polémiquer sur un tel sujet, refuser de voir la réalité de la situation ou de légiférer en la matière, c’est reconnaître et accepter ces pratiques. Cette vision de la société n’est pas la nôtre.
La situation actuelle appelle à la justice, à l’équité et au courage. Tel est l’esprit dans lequel les députés du groupe SRC membres de la mission d’information ont travaillé pour lui donner un débouché. Ils l’appellent de leurs voeux.
Au cours de sa réunion du 7 juillet 2009, la Commission examine le rapport de la mission d’information sur les nouvelles régulations de l’économie concernant les rémunérations des dirigeants mandataires sociaux et des opérateurs de marchés, sur le rapport de M. Philippe Houillon, rapporteur.
Après l’exposé du rapporteur, plusieurs commissaires interviennent.
M. Philippe Vuilque. Le groupe SRC a participé activement aux travaux de la mission d’information et a souhaité compléter le rapport en y joignant une contribution.
C’est un travail très utile qui a été mené, ayant pour objectif de mettre fin aux rémunérations indécentes de certains dirigeants, et tout particulièrement ceux des grandes entreprises du CAC 40. À cet égard, il est important de ne pas faire d’amalgame avec la rémunération des dirigeants des PME, qui n’a rien de comparable.
Le constat accablant, partagé par tous, est celui d’une explosion des inégalités de revenus. Le taux de croissance des salaires des 3 500 ménages les plus aisés est 16 fois plus important que celui des salaires de la grande majorité de la population ; les dirigeants du CAC 40 ont une rémunération qui représente en moyenne 300 fois le SMIC, et 100 fois la rémunération des patrons de PME.
Les tentatives de moralisation sont trop succinctes et l’autorégulation est insuffisante et peu efficace.
Alors que le Président de la République, dans son discours de Toulon en septembre 2008, n’a pas eu de mots assez durs pour stigmatiser certains dirigeants d’entreprises, la position du Gouvernement, et notamment de Madame Christine Lagarde que nous avons auditionnée, est très en retrait.
Pourtant, la Cour des comptes, dans son dernier rapport relatif aux concours publics aux établissements de crédit, estime que « le dispositif encadrant la rémunération des dirigeants des établissements bancaires est peu lisible et complexe ». De plus, « les conventions qui lient chaque banque à l’État sont toujours en attente de révision pour intégrer les dispositions de la loi et du décret du 20 avril ». Elle ajoute que « les dispositions interdisant les retraites-chapeaux résultant du décret du 20 avril 2009 resteront largement sans effet. […] Les politiques de rémunération doivent être intégrées dans le contrôle des risques et le traitement fiscal et social de l’ensemble des éléments de rémunération (bonus, retraites-chapeaux, parachutes dorés) doit être réexaminé ».
Il n’y a pas de fiscalisation suffisante de ces rémunérations, cette insuffisance étant encore accrue par l’instauration du système du bouclier fiscal.
Enfin l’autorégulation prônée par le MEDEF et l’AFEP est une sorte d’incantation. Elle ne change pas grand-chose dans la mesure où elle n’a pas de contrepartie.
Les propositions de la mission sont limitées et répondent imparfaitement à la nécessité de mettre un terme au scandale des rémunérations indécentes. Au nombre de seize, elles traduisent des avancées, mais nous semblent caractérisées par une trop grande retenue.
Les propositions nos 1 et 2 sont un rappel utile de la nécessité d’agir au niveau européen et international.
La proposition n° 3, prévoyant de plafonner à 1 million d’euros la déductibilité des rémunérations et avantages de toute natures consentis aux dirigeants de sociétés de l’assiette de l’impôt sur les sociétés, signifie que le plafond de la seule rémunération se situerait aux alentours de 800 000 euros par an, puisqu’un dispositif de plafond des avantages de toutes natures de 200 000 euros a été adopté en loi de finances pour 2009. Ce montant est bien trop élevé et nous proposons d’aller nettement plus loin, en limitant la plus haute rémunération à 25 fois le montant de la plus faible rémunération à temps plein, après cotisations sociales, en vigueur dans l’entreprise lorsque la société en question est aidée par l’État, soit environ 300 000 euros par an.
M. Philippe Houillon, rapporteur. Afin d’éviter toute ambiguïté, je tiens à préciser sur ce dernier point que la proposition formulée par le rapport de la mission d’information ne consiste pas à plafonner à 1 million d’euros les rémunérations et avantages de toutes natures des dirigeants mandataires sociaux. Il s’agit de plafonner à ce même montant la déductibilité fiscale des émoluments attribués vis-à-vis de l’assiette de l’impôt sur les sociétés, ce qui n’exclut nullement que les conseils d’administration ou de surveillance puissent consentir des rémunérations au-delà de cette somme.
M. Philippe Vuilque. En ce qui concerne la proposition n° 4, liant la rémunération des dirigeants à l’intérêt général de l’entreprise, nous préférerions, sur le modèle de ce qui s’est fait en Allemagne, qu’il soit indiqué clairement que la responsabilité des organes dirigeants peut être engagée si les rémunérations se révèlent inopportunes ou contraires à l’intérêt général de l’entreprise. Même s’il appartiendra au juge d’apprécier l’intérêt général, la rédaction proposée par la mission n’est pas suffisamment forte.
La proposition n° 5 est clairement en retrait. Il doit s’agir non pas de mesurer l’écart ou de le constater, mais de le réduire ou de l’encadrer.
La proposition n° 6 est pertinente. À ce titre, il est important d’accorder un droit de vote aux deux représentants des salariés présents au sein des comités des rémunérations.
La proposition n° 7 prend tout son sens uniquement si l’assemblée générale des actionnaires se prononce par un vote.
Les propositions nos 8 et 9, relatives au problème du cumul des mandats sociaux, recueillent notre accord.
La proposition n° 10 ne recueille pas notre approbation. Le système de la retraite par capitalisation n’est pas une réponse satisfaisante. Il convient de prévoir un mécanisme qui s’inscrive dans une réforme plus générale des régimes de retraite.
Les propositions nos 11 à 15 se résument enfin au titre de leur chapitre : « mettre un terme aux abus les plus criants ». Vous ne vous attaquez en effet qu’aux abus les plus criants, alors qu’il conviendrait d’aller nettement plus loin, notamment sur le plan fiscal. Les grands dirigeants d’entreprises bénéficieront du bouclier fiscal. Or, c’est la tare essentielle de ce rapport que de ne pas aborder cette question. Si l’on conserve le mécanisme du bouclier fiscal, certaines propositions n’auront que peu d’efficacité.
Je rappellerai enfin que le groupe SRC a défendu au mois d’avril une proposition de loi relative aux hauts revenus et à la solidarité, portant sur ce sujet.
En conclusion, j’ai envie de dire : « chiche, allons-y ! ». Un certain nombre de propositions du rapport méritent de se concrétiser en proposition de loi et d’être discutées par notre assemblée.
M. Philippe Gosselin. Je suis d’accord avec cette dernière proposition de notre collègue. Je me réjouis de ce rapport, qui comporte des propositions intéressantes, poil à gratter pour certaines, plus modérées pour d’autres. Je ne suis pas pour l’économie administrée mais pour la liberté, qui ne va pas sans responsabilité. Dans certains cas, c’est à la loi de fixer le cadre de cette responsabilité. Un tel travail, dans le contexte actuel, honore notre commission.
M. Jean-Michel Clément. Je souhaite en premier lieu relever l’utilité du travail accompli par la mission d’information. Bien peu d’entre nous auraient pu préjuger au début de nos travaux de l’ampleur des conclusions auxquelles le rapport aboutit. Ce travail a permis de mettre en lumière l’ensemble des dysfonctionnements du système de rémunérations, là où le retentissement médiatique s’arrête aux plus scandaleux d’entre eux. Les multiples auditions auxquelles nous avons procédé nous ont en effet offert un éclairage sur l’ensemble du dispositif. Nous avons ainsi abouti à une prise de conscience partagée des limites des systèmes de rémunération des dirigeants d’entreprises, allant bien au-delà des failles des recommandations de l’AFEP et du MEDEF ou des imperfections du comité des sages. L’ampleur de nos conclusions va répondre bien plus efficacement aux inquiétudes de l’opinion publique.
Notre mission a mis en évidence le fait que l’absence de modification de la réglementation en la matière laisserait perdurer les pratiques antérieures. Une loi est nécessaire, j’en veux pour preuve les déclarations ici même de M. Claude Bébéar qui a estimé qu’un dirigeant d’entreprise digne de ce nom n’avait pas besoin de plus de quelques semaines pour faire des membres du comité des rémunérations de la société ses alliés.
S’agissant des propositions faites, je rejoins notre collègue Philippe Vuilque : des avancées notables sont proposées, mais des imperfections demeurent. Je ne citerai que trois exemples. J’estime tout d’abord que la responsabilité des dirigeants fautifs n’est pas assez réaffirmée. Nous estimons que son principe doit être posé dans la loi, à des fins essentiellement préventives, à l’image de ce qui a été fait en matière de PEA et qui a permis la moralisation des pratiques. Une telle inscription doit permettre de modifier les comportements, sans même qu’il soit besoin de faire intervenir un juge. Nous rejoindrions ainsi l’exemple allemand.
Deuxième manque, la place des représentants des personnels dans le dispositif de contrôle des rémunérations des dirigeants n’est pas précisée.
Enfin, nous regrettons qu’en matière de fiscalité, les sanctions proposées pénalisent davantage les actionnaires, et notamment les petits actionnaires – car la non-déductibilité des rémunérations des dirigeants s’assimile à un impôt supplémentaire frappant l’entreprise et donc minorant les dividendes –, alors qu’il conviendrait de sanctionner davantage des dirigeants eux-mêmes. Mais alors que le système de l’avoir fiscal permettait de sanctionner in fine le dirigeant, la proposition faite ne le permet pas, ce que nous regrettons.
Au total, nous pensons que légiférer est une nécessité et que le rapport constitue un excellent travail préparatoire à la future loi que nous appelons de nos vœux.
M. Dominique Raimbourg. Je rejoins ce qui a été dit par mes collègues et ne ferai donc que quelques remarques rapides. Ce rapport constitue une avancée bienvenue, que nous saluons. Toutefois, je veux insister sur la nécessité d’en tirer des conséquences en matière fiscale.
Sans doute doit-on sortir en la matière de la logique selon laquelle il ne faudrait pas augmenter les impôts, car le cas des dirigeants d’entreprises justifie une hausse ciblée de la fiscalité. Sans doute faudrait-il tout d’abord créer une tranche supplémentaire au barème de l’impôt sur le revenu. Le Royaume-Uni venant de faire de même, nous n’encourrions pas le risque d’une concurrence fiscale.
Mais ensuite, il conviendrait aussi de réfléchir à une meilleure articulation avec le bouclier fiscal. Je prends acte des déclarations faites par le ministre du budget et des comptes publics, qui a indiqué que quelque 10 000 personnes aux revenus modestes, mais au patrimoine important, bénéficient de la mesure, ce qui peut justifier son maintien dans ce cas de figure. En revanche, s’agissant des hautes rémunérations, il conviendrait de supprimer ce bouclier qui n’a pas de justification.
M. Philippe Houillon, rapporteur. Je me réjouis de l’unanimité de notre commission sur le fait que les propositions formulées dans le rapport de la mission d’information constituent une avancée. Je prends également acte de certaines réserves émises et souhaiterais y apporter quelques éléments de réponse.
Pour ce qui concerne la notion d’intérêt général de l’entreprise, j’observe qu’elle figure expressément dans les recommandations du MEDEF et de l’AFEP. Le président de l’Autorité des marchés financiers, M. Jean-Pierre Jouyet, a estimé pour sa part que les rémunérations des dirigeants mandataires sociaux doivent correspondre à l’utilité collective. Quand au Bundestag, il vient d’exiger l’octroi de rémunérations appropriées. Vous conviendrez tous avec moi que, au-delà des termes retenus, toutes ces notions relèvent de la même épure.
S’agissant des sanctions de l’irrespect de l’intérêt général de l’entreprise, je me bornerai à rappeler que l’affirmation d’un principe dans la loi ouvre nécessairement la voie à des sanctions, civiles ou pénales, lorsque ceux à qui ce principe s’impose ne s’y conforment pas. On ne peut ainsi exclure qu’une juridiction constatant qu’un conseil d’administration ou de surveillance a consenti des rémunérations manifestement excessives et contraires à l’intérêt de l’entreprise serait fondée à examiner dans quelle mesure il y a eu ou non abus de bien social.
La proposition consistant à soumettre à l’assemblée générale des actionnaires l’appréciation de l’ensemble des rémunérations et avantages de toutes natures consentis aux dirigeants mandataires sociaux implique naturellement, quant à elle, une consultation expresse et un vote.
Au fond, l’essentiel des divergences porte sur les mesures fiscales préconisées. Il s’agit de la traduction de visions différentes de notre société, la majorité considérant que les contribuables les plus fortunés ont aussi le droit à conserver une partie des revenus qu’ils tirent de leur activité, tandis que l’opposition souhaite une fiscalisation plus large de ces revenus. En tout état de cause, cette divergence transcende l’objet du rapport.
J’ajoute, pour conclure, que l’argument selon lequel les actionnaires seront les principaux pénalisés par la limitation des revenus des dirigeants mandataires sociaux déductibles de l’impôt sur les sociétés n’est que facialement exact. Une telle mesure vise surtout à responsabiliser les actionnaires, qui auront leur mot à dire dorénavant.
Conformément à l’article 145 du Règlement de l’Assemblée nationale, la Commission autorise le dépôt du rapport de la mission d’information en vue de sa publication.
LISTE DES PERSONNES ENTENDUES
PAR LA MISSION D’INFORMATION
1. Gouvernement
— Mme Christine LAGARDE, ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi
2. Organisations professionnelles des entreprises et des établissements bancaires
• Mouvement des entreprises de France (MEDEF)
— Mme Laurence PARISOT, présidente
— M. Robert LEBLANC, président du comité d’éthique
— Mme Joëlle SIMON, directrice des affaires juridiques
— M. Guillaume RESSOT, directeur adjoint des affaires publiques
• Association française des entreprises privées (AFEP)
— M. Jean-Martin FOLZ, président
— M. Alexandre TESSIER, directeur général
• Fédération bancaire française
— M. Georges PAUGET, directeur général du Crédit Agricole SA, président de la Fédération bancaire française
— Mme Valérie OHANNESSIAN, directrice générale adjointe de la Fédération bancaire française
— Mme Céline de COMPREIGNAC, directrice des relations institutionnelles
• Croissance Plus
— M. Frédéric BEDIN, président
— M. Amaury ELOY, vice-président,
— M. Christian NOUEL, secrétaire général
— Mme Alexia ROBINET, chargée de mission
• Comité des sages
— M. Claude BÉBÉAR, président
• Confédération générale des PME (CGPME)
— M. Pascal LABET, directeur des affaires économiques
— M. Lionel VIGNAUD, conseiller juridique de la direction
• Association des chambres françaises de commerce et d’industrie
— M. Jean-François BERNARDIN, président
— M. Vincent MARTIN, directeur appui aux entreprises à la direction générale adjointe entreprises et territoires
• Chambre de commerce et d’industrie de Paris
— M. Didier KLING, président du cabinet Kling et Associé, vice-président de la délégation de Paris, chargé du développement de l’entreprise
— Mme Anne OUTIN-ADAM, directeur des développements juridiques
— Mme Véronique ÉTIENNE-MARTIN, conseiller parlementaire
3. Dirigeants mandataires sociaux de sociétés françaises cotées
• BNP-PARIBAS
— M. Michel PÉBEREAU, président du conseil d’administration
• Essilor
— M. Xavier FONTANET, président directeur général
• Axa
— M. Henri de CASTRIES, président du directoire
— M. Emmanuel TOUZEAU, directeur du service de presse
• Publicis
— M. Maurice LÉVY, président du directoire
— M. Mathias EMMERICH, secrétaire général
4. Magistrats et organismes divers
• Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation
— Mme Claire FAVRE, présidente
• Autorité des marchés financiers
— M. Jean-Pierre JOUYET, président
— M. Thierry FRANCK, secrétaire général
• IFRAP
— M. Bernard ZIMMERN, président
— M. Bertrand NOUEL, avocat honoraire chargé des affaires juridiques
• Association des actionnaires minoritaires
— Mme Colette NEUVILLE, présidente
5. Organisations syndicales
• Force Ouvrière – FO
— Mme Marie Suzy PUNGIER, secrétaire confédérale
• Confédération Française Démocratique du Travail – CFDT
— Mme Patricia FERRAND, secrétaire confédérale
— M. Emmanuel MERMET, secrétaire confédéral
• Confédération générale du Travail – CGT
— M. Pierre Yves CHANU, conseiller de l’espace syndicalisme et société (activités économiques de la CGT)
• Confédération française des travailleurs chrétiens – CFTC
— M. Joseph TOUVENEL, secrétaire général adjoint
ANNEXE : LES DIFFÉRENTS ÉLÉMENTS CONNEXES DE LA RÉMUNÉRATION DES DIRIGEANTS DU CAC 40 EN 2008
Dirigeants opérationnels/sociétés |
Stock-options attribuées sur l’exercice (valorisation comptable) |
Actions gratuites attribuées sur l’exercice |
Jetons de présence |
Contrat de travail et Indemnités de départ |
Retraite complémentaire |
Gilles Pélisson |
62 500 (721 875 €) |
15 625 (725 938 €) |
17 395 € |
Contrat de travail. Suspendu ; indemnités de rupture peuvent aller jusqu’à 2 ans, plafonnées à 109 785 € par an. Indemnités de départ. 24 mois de rémunération fixe et variable du dernier exercice, soumis à conditions de performance. |
OUI. Dispositif de retraite supplémentaire à caractère additif pour les cadres dirigeants. |
Jean-Cyril Spinetta (PDG)** |
0 |
0 |
40 000 € |
Contrat de travail. Mais pas d’indemnités de départ. |
OUI. Régime collectif de retraite différentielle en faveur des cadres dirigeants, dont le PDG. |
Benoît Potier |
88 000 (1 803 000 €) |
0 |
41 000 € (inclus dans le fixe) |
Contrat de travail. Suspendu provisoirement. Assurance chômage des chefs d’entreprise + indemnité compensatrice de perte de retraite. Indemnités. Maximum de 24 mois de rémunération brute globale (fixe et variable), soumis à conditions de performance. |
OUI. Régime de retraite applicable aux cadres d’Air Liquide. |
Patrick Kron (PDG) Alstom (1) |
57 500 (1 679 000 €) |
1 000 (105 000 €) |
A renoncé à en percevoir depuis le 1er avril 2005. |
Pas de contrat de travail mais indemnités fixées à deux années de sa dernière rémunération brute globale (fixe et variable), soumis à conditions de performance sur le cours de l’action Alstom. |
OUI. Pension annuelle équivalente à 1,2 % par année d’ancienneté, sur la fraction des rémunérations supérieure à huit fois le plafond de la Sécurité sociale. Au 31 mars 2008, le montant des engagements s’élevait à 1 653 808 €, y compris les indemnités légales de départ à la retraite. |
Ben Verwaayen (directeur général depuis le 14 septembre 2008) |
250 000 (532 500 €) |
250 000 (407 500 €) |
0 |
NON. |
OUI. Dès 60 ans. Soumis à condition de performance sur l’évolution des revenus et du résultat d’exploitation + critères qualitatifs. |
Henri de Castries |
390 000 (1 257 000 €) |
84 000 (1 426.320 €) |
87 526 € |
Contrat de travail, mais pas d’indemnités. |
OUI. Régime de retraite supplémentaire des cadres de direction. Au plus tôt à partir de 60 ans, avec minimum de 10 ans d’ancienneté dont 5 comme cadre de direction. |
Baudoin Prot |
170 000 (2 843 930 €) |
0 |
118 907 € |
Contrat de travail. Indemnités de fin de carrière pouvant aller jusqu’à 11,66 mensualités, plafonnées à 14 112 euros, du salaire de base. Pas d’indemnité de départ. |
OUI. Régime collectif et conditionnel. Pensions calculées sur la base des rémunérations touchées en 1999 et 2000. |
Martin Bouygues (PDG) |
200 000 (1 058 000 €) |
0 |
76 508 € |
NON. |
OUI. Plan collectif de retraite supplémentaire à prestations définies en faveur de certains dirigeants. Ancienneté minimum de 10 ans. Limitation du montant à 40 % de la rémunération de référence. |
Paul Hermelin (directeur général) |
0 |
0 |
48 000 € |
Contrat de travail. Suspendu provisoirement. Pas d’indemnité de départ. |
OUI. |
José Luis Duran (directeur général)** |
130 000 (926 900 €) |
60 000 max (2 028 000 €) droit radié dans le cadre du départ de José Luis Duran |
0 |
Indemnités de départ. Deux ans de rémunération brute globale, soit 4 797 937 €. |
NON. |
Pierre-André Chalendar |
175 000 (1 067 500 €) |
0 |
0 |
Contrat de travail. Suspendu durant la durée du mandat. Indemnités de départ. Non précisées. |
OUI. Régime complémentaire des salariés ingénieurs du groupe (Pierre-André Chalendar est présent dans la société depuis plus de 20 ans). |
Georges Pauget (directeur général) |
0 |
0 |
52 000 € |
Contrat de travail, mais pas d’indemnités. |
OUI. Financement du départ à la retraite compris dans les avantages en nature. |
Axel Miller (administrateur et président du comité de direction)** |
200 000 (344 000 €) |
0 |
0 |
Indemnités de départ. Un an de rémunération fixe, soit 825 000 € (attribués à titre de rémunération exceptionnelle, cf. ci-avant). |
OUI. Prestation équivalente à une rente de retraite annuelle, en cas de vie au moment du départ à la retraite, dont le montant équivaut à 80 % d’une rémunération fixe plafonnée, sous certaines conditions dont une carrière de 35 ans. |
Louis Gallois |
0 (40 000 unités de performance évaluées à 481 200 € à fin 2008) |
0 |
0 |
NON. |
OUI. Retraite complémentaire du comité exécutif. Peut aller jusqu’à 50% du salaire de base, en incluant la retraite obligatoire. Provision nette au 31 décembre 2008 : 1,4 million d’€. |
Pierre Gadonneix |
0 |
0 |
0 |
NON. |
NON. |
Xavier Fontanet |
120 000 (486 000 €) |
20 (378 €) |
17 000 € |
Contrat de travail. Suspendu pendant la durée du mandat. Indemnités de départ. Deux années de salaire au titre du contrat de travail sous conditions de performance. |
OUI. Indemnité de départ à la retraite : 182 839 € / Engagement de retraite complémentaire de 2 677 274 € (valeur actuarielle). Jusqu’à 25 % de la rémunération de référence avec plus de 20 ans d’ancienneté. |
Didier Lombard |
0 |
0 |
0 |
Contrat de travail. Suspendu. Indemnités de départ. Maximum de 21 mois de rémunération, calculée sur la base de la moyenne de la rémunération mensuelle brute totale. |
OUI. Régime supplémentaire de retraite instauré pour les cadres dirigeants du Groupe « hors grille ». Jusqu’à 20,8 % de la meilleure moyenne annuelle des rémunérations brutes des 36 derniers mois. |
Gérard Mestrallet (PDG)* |
0 |
200 000 (256 140 €) |
0 |
Le contrat a été suspendu et pas d’indemnité de départ. |
OUI. Régime de retraite collective de l’ex-Groupe Suez. |
Franck Riboud |
200 000 (3 142 000 €) |
0 |
0 |
Le contrat a été suspendu mais les indemnités de départ restent fixées à deux années de rémunération brute (fixe et variable), sur la base de la dernière rémunération annuelle. Soumis à conditions de performance. |
OUI. Régime de retraite à prestations définies. Peut atteindre 65 % des derniers salaires. Total des engagements pour les mandataires sociaux au 31 décembre 2008 : 32 100 000 €. |
Jean-Paul Agon |
0 |
0 |
57 279 € (55 000 €) |
Le contrat a été suspendu mais les indemnités de départ restent fixées à 12 mois de la dernière rémunération fixe, sous condition de performance, et auxquelles s’ajouteraient les indemnités au titre de la rupture du contrat de travail. |
OUI. Régime « Garantie de Ressources des Retraités Anciens Cadres Dirigeants ». Base des trois meilleures années des sept années civiles précédant le départ en retraite. Ne peut excéder la moyenne de la partie fixe des salaires des trois années prises en compte ni 50% de la base de calcul. |
Bruno Lafont |
120 000 (2 521 200 €) |
0 |
25 000 € |
Le contrat a été suspendu mais les indemnités de départ restent fixées à deux années de rémunération brute (fixe et variable) perçue pour l’année la plus favorable sur les trois années précédant la date de notification du licenciement, soumis à conditions de performance. |
OUI. Régime de retraite à prestations définies de type additif, applicable que si l’intéressé est dans la société au moment de la retraite. En l’état, ce plan procurerait à Bruno Lafont une retraite de 26 % de sa rémunération de référence. |
Arnaud Lagardère |
0 |
0 |
16 334 € |
NON. |
OUI. Régime de retraite supplémentaire. Taux de remplacement plafonné à 35% de la rémunération de référence (moyenne des cinq dernières années de rémunération brute annuelle). Montant de l’engagement à ce régime au 31 décembre 2008 : 24,3 millions d’€. |
Michel Rollier |
0 |
0 |
0 |
NON. |
NON. |
Bernard Arnault |
600 000 (12 516 000 €) |
0 |
119 060 € |
NON. |
OUI. Montant de l’engagement pour le PDG au 31 décembre 2008 : 15 093 225 €, déterminés sur la base d’une rémunération de référence égale à la moyenne des rémunérations annuelles au cours des trois dernières années civiles précédant l’année du départ à la retraite, plafonnée à 35 fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale. |
Patrick Richard |
77 908 (1 170 000 €) |
nc |
0 |
NON. |
OUI. Régime de retraite collectif à prestations définies. Ancienneté minimum de 10 ans. Montants provisionnés pour les deux mandataires dirigeants sociaux au 30 juin 2008 : 16 millions d’€. |
Christian Streiff |
140 000 (1 335 600 €) |
0 |
19 800 € |
Contrat de travail. Indemnités conventionnelles liées à la rupture du contrat de travail (montant non connu à ce jour, préavis en cours) (société). |
OUI. Retraite complémentaire pour les membres du Directoire. Christian Streiff n’en bénéficiera pas car il ne remplit pas les conditions d’ancienneté et de départ du groupe. |
Gérard Le Fur (directeur général jusqu’au 30 novembre 2008)** |
0 |
0 |
0 |
Indemnités de départ de 24 mois de la dernière rémunération globale. Seule la moitié de l’indemnité a été versée, soit 2 705 000 € , pour prendre en compte la durée limitée du mandat de Gérard Le Fur. Ce dernier continuera à toucher 250 000 € par trimestre jusqu’au 30 septembre 2011 en échange de son engagement de n’accepter aucune mission concurrentielle. |
OUI. Régime de retraite supplémentaire additif à prestations définies. Réservé aux cadres présentant un minimum de 10 ans d’ancienneté et dont la rémunération annuelle de base excède pendant plusieurs années quatre plafonds annuels de la sécurité sociale. Intégralement financé par l’entreprise. Le complément de retraite ne peut dépasser 37,5 % du salaire final. |
François-Henri Pinault |
0 |
15 000 (915 300 €) |
163 527 € |
NON. |
NON. |
Carlos Ghosn |
0 |
nc |
28 000 € |
NON. |
OUI. Régimes de retraite supplémentaire dont le cumul ne peut excéder la moitié de la rémunération d’activité. |
Jean-Pascal Tricoire |
63 000 (1 067 220 €) |
6 750 (488 835 €) |
0 |
Contrat de travail. Avec indemnités de départ relatives à une clause de non-concurrence, fixées à deux années de rémunération brute globale. |
OUI. Régime collectif de prévoyance de l’entreprise. |
Frédéric Oudéa |
20 000 (331 400 €) |
nc |
nc |
Contrat de travail. Avec indemnités de départ relatives à une clause de non-concurrence, fixées à deux années de rémunération brute globale (fixe et variable), soumis à conditions de performance liées aux résultats du groupe. |
OUI. Régime d’allocation complémentaire de retraite des cadres de direction. |
Jean-Louis Chaussade |
0 |
0 |
234 675 € |
Contrat de travail. GDF Suez suspendu pendant la période du mandat chez Suez Environnement. Indemnités de départ. 15 mois de rémunération brute globale (fixe et variable) soumis à critères de performances : croissance moyenne du CA, croissance du cours de la Bourse, taux de rentabilité. |
OUI. Régime collectif de retraite supplémentaire applicable aux salariés de Suez Environnement + régimes collectifs et obligatoires de prévoyance + assurance garantie sociale des dirigeants. |
Christophe de Margerie |
200 000 (998 000 €) |
nc |
0 |
Pas de contrat mais indemnités fixées à deux années de rémunération brute (fixe et variable) sur la base des douze derniers mois précédant la résiliation ou le non-renouvellement du mandat. |
OUI. Régime supplémentaire de retraite. Au 31 décembre, les engagements au profit de Christophe de Margerie correspondent à une pension annuelle de 18,9 % de la rémunération qu’il a perçue en 2008. |
Gérard Poitrinal |
60 000 (510 000 €) |
0 |
28 125 € |
NON. |
OUI. Régime de retraite supplémentaire à cotisations définies |
Pierre Verluca |
14 000 (910 640 €) |
0 |
0 |
Contrat de travail. Suspendu durant la durée du mandat. Indemnités de départ. 340 615 €, calculés en application de la convention collective |
OUI. Identique à celle des cadres supérieurs du groupe. Plafonnée à 20 % du salaire mensuel de base des trois dernières années, hors part variable et limitée à 4 plafonds annuels de la Sécurité Sociale. |
Henri Proglio |
0 |
0 |
102 969 € |
NON. |
OUI. Régime collectif de retraite supplémentaire à cotisations définies des cadres dirigeants |
Xavier Huillard |
0 |
22 000 (620 400 €) |
61 413 € |
Le contrat a été suspendu. Pas d’indemnité. |
OUI. Régime de retraite complémentaire garantissant une pension complémentaire comprise entre 20 et 35% de la moyenne des trois années de rémunération. Les engagements de Vinci pour Xavier Huillard s’élevaient à 826 700 € au 31 décembre 2008. |
Jean-Bernard Lévy |
360 000 (1 281 600 €) |
30 000 (620 100 €) |
Contrat de travail. Mais le document de référence précise que le dirigeant souhaite y renoncer. Indemnités de départ. Formule progressive en fonction de l’ancienneté. Ne peut pas excéder 21 mois de rémunération brute globale. |
OUI. Régime de retraite complémentaire + régime de retraite additif. La provision 2008 pour ces régimes de retraite s’élève à 2 053 561 € pour les membres du directoire. | |
(1) Exercice 2007-2008. (2) Première mention de la société dans le tableau. (3) De droit luxembourgeois. (4) De droit néerlandais. (5) De droit belge. (*) Nommé en cours d’exercice. (**) N’occupe plus ces fonctions. Sources : documents de référence des sociétés concernées. | |||||
1 () La composition de cette mission figure au verso de la présente page.
2 () « Gouvernement d’entreprise : liberté, transparence, responsabilité », rapport d’information n° 1270, 2 décembre 2003 (XIIème législature).
3 () Institut Montaigne, Amicus Curiae : « Comment “bien” payer les dirigeants d’entreprise ? », p. 5.
4 () La Tribune, lundi 3 novembre 2008, p. 3.
5 () Étude publiée en 2006 dans le journal économique La Tribune.
6 () Patrick Bonazza : « Les patrons sont-ils trop payés ? », 2008, Larousse, p. 12.
7 () Source : étude de l’institut Montaigne précitée.
8 () « Executive remuneration in Europe : key statistics and shareholder’s scrutiny », 23 mars 2009.
9 () Selon l’institut Montaigne, seuls 6 dirigeants de sociétés du CAC 40 ont vu leur rémunération baisser entre 2003 et 2004, 7 entre 2004 et 2005 et 9 entre 2005 et 2006, le phénomène s’expliquant notamment par le renouvellement des intéressés, induisant un ajustement à la baisse par rapport aux dirigeants sur le départ, qui, eux, bénéficiaient d’un effet d’ancienneté.
10 () Op. cit., p. 25.
11 () Ibidem.
12 () Joseph Stiglitz : « Quand le capitalisme perd la tête », Fayard, 2003.
13 () Rapport d’information n° 274 (1994-1995), enregistré à la présidence du Sénat le 17 mai 1995, p. 50.
14 () Étude effectuée en décembre 2008 et publiée le 13 janvier 2009 par le quotidien Le Monde.
15 () CA Paris, 3ème chambre, 7 octobre 2008, infirmant le jugement du tribunal de commerce de Paris du 23 avril 2007.
16 () Patrick Artus et Marie-Paule Virard : « Globalisation, le pire est à venir », 2008, éditions La Découverte.
17 () « La crise des subprimes », rapport de MM. Patrick Artus, Jean-Baptiste Betbèze, Christian de Boissieu et Gunther Capelle-Blancard, 2008, p. 205 et 206.
18 () Mélanie Delattre et Emmanuel Lévy : « L’homme qui valait 5 milliards. Quand le capitalisme financier devient fou », Paris, First, 2008.
19 () Depuis 2002, le montant des bonus versés par les cinq banques d’investissement new yorkaises est estimé à 312 milliards de dollars.
20 () Patrick Bonazza : « Les banquiers ne paient pas l’addition », Hachette, 2008, p. 74 et 77.
21 () Ibidem, p. 31.
22 () Rapport d’information n° 1270 précité, (XIIème législature), p. 41 et 42.
23 () Sent. AAA 27 juin 2003, « Messier vs VU SA, VU Canada, VU holding », n° 3-T-199-00205-04.
24 () Cour suprême de l’État de New York (civil case n° 112173/03), 16 septembre 2003.
25 () CA Versailles, 24 septembre 1992 ; CA Paris, 7 juin 2000.
26 () Cass. com., 16 novembre 1983, 22 juillet 1986, 16 janvier 1990, 22 juin 1993, 12 mars 1996.
27 () Cass. com., 1er juin 1993, 12 mars 1996.
28 () CA Paris, 30 avril 1987 ; TGI de Paris, 26 octobre 1999.
29 () Rapport précité du 27 novembre 2008, p. 41.
30 () A savoir les président du conseil d'administration, directeur général, directeurs généraux délégués, membres du directoire, président du conseil de surveillance ou gérants.
31 () Gesetz über die Offenlegung von Vorstandsvergütungen vom 10/08/2005.
32 () Sections 217 à 219 du Compagnies Act.
33 () Directive modifiant les directives du Conseil 78/660/CEE concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés, 83/349/CEE concernant les comptes consolidés, 86/635/CEE concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers, et 91/674/CEE concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d'assurance.
34 () Me Philippe Portier, avocat à la Cour : « Commentaires sur les recommandations du MEDEF et de l’AFEP sur les “parachutes dorés” », parus dans « La semaine juridique social » n° 49, 2 décembre 2008.
35 () Voir à ce sujet l’étude de Me Jean-Baptiste Poulle : « La mise à l’épreuve du principe se conformer ou expliquer au Royaume-Uni », publiée dans « La semaine juridique Entreprises et Affaires » n° 5, 29 janvier 2009.
36 () Revue française de sociologie, 2006 ; article cité par M. Patrick Bonazza dans son ouvrage précité, p. 22.
37 () Étude de l’institut Montaigne précitée, p. 3.
38 () Issu du traité modifiant le traité sur l’Union européenne, le traité instituant la Communauté européenne et certains actes connexes, signé à Lisbonne le 13 décembre 2007 et ratifié par la France le 14 février 2008.
39 () CJCE, 13 novembre 1990, « Marleasing SA contre La Comercial Internacional de Alimentacion SA ».
40 () Recommandation de la Commission du 30 avril 2009 complétant les recommandations 2004/913/CE et 2005/162/CE en ce qui concerne le régime de rémunération des administrateurs des sociétés cotées.
41 () COM(2009) 211 final, 30 avril 2009.
42 () Recommandation de la Commission du 30 avril 2009 sur les politiques de rémunération dans le secteur des services financiers.
43 () Rapport précité, p. 24.
44 () Proposition de loi n° 1671 visant à démocratiser le mode de fixation des rémunérations des mandataires sociaux dans les sociétés anonymes, déposée sur le Bureau de l’Assemblée nationale le 13 mai 2009 et examinée en séance publique le 25 juin suivant.
45 () Jusqu’au 13 février 2009.
46 () Me Lydie Dauxerre, avocat à la Cour : « le cumul d’un contrat de travail et d’un mandat social : un mariage d’intérêts ? », paru dans « La semaine juridique social » n° 5, 30 janvier 2007.
47 () Recommandations AFEP-MEDEF du 6 octobre 2008, p. 2.
48 () Recommandations AFEP-MEDEF sur la rémunération des dirigeants mandataires sociaux de sociétés cotées, janvier 2007, p. 8.
© Assemblée nationale